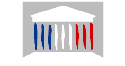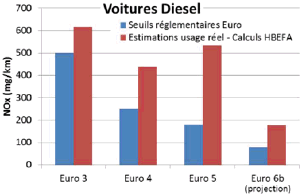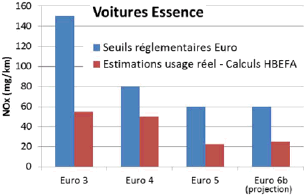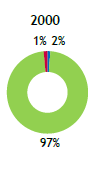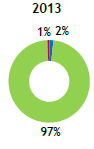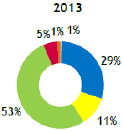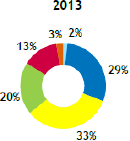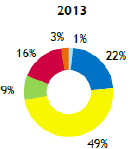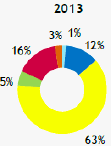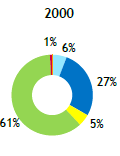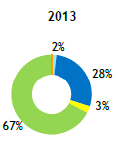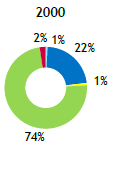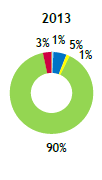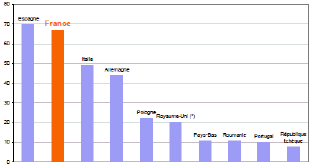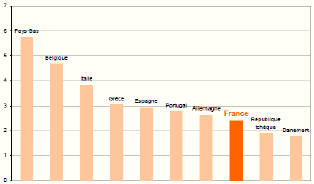______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationalele 19 mai 2016.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 146-3, alinéa 6, du Règlement
PAR LE COMITÉ D’ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET PRÉSENTÉ PAR
MM. Jean-Louis ROUMÉGAS et Martial SADDIER
Députés
——
SOMMAIRE
___
Pages
SYNTHÈSE DU RAPPORT 9
PROPOSITIONS DES RAPPORTEURS 27
INTRODUCTION 33
PREMIÈRE PARTIE : ÉVALUER LE COÛT DE LA POLLUTION DE L’AIR ET CLARIFIER LES COMPÉTENCES DES ACTEURS QUI LUTTENT CONTRE SES NUISANCES 35
I. UN COÛT IMPORTANT POUR LA SOCIÉTÉ MAIS DIFFICILE À ÉVALUER 35
A. LE COÛT DE L’INACTION : UNE DONNÉE INDISPENSABLE POUR L’INFORMATION DU GRAND PUBLIC ET L’AIDE À LA DÉCISION 35
1. Les nombreuses externalités négatives de la pollution de l’air doivent être mieux connues 35
2. Les bénéfices associés à la lutte contre la pollution de l’air doivent être davantage mis en avant 37
B. UN EXERCICE D’ÉVALUATION COMPLEXE 38
1. L’estimation du coût socio-économique est entourée de difficultés 39
a. Un travail qui repose sur trois étapes semées d’embûches 39
b. Une valorisation monétaire de la mortalité et de la morbidité liées à la pollution de l’air problématique 46
c. Un recours peu fréquent aux indicateurs de qualité de vie 50
2. Les résultats disponibles sont d’amplitude très variable et restent des approximations 51
a. Un coût probablement sous-évalué 52
b. Des chiffrages hétérogènes 53
3. Les estimations centrées sur le coût pour la sécurité sociale semblent plus robustes 55
a. Des calculs fondés sur des coûts tangibles 55
b. Une approche qui, pour l’heure, n’est pas exempte de sérieuses limites méthodologiques 58
C. DES CONNAISSANCES ÉPIDÉMIOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES QUI DOIVENT ÊTRE APPROFONDIES 59
II. LA NÉCESSITÉ DE RENFORCER LE PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L’AIR 62
A. LES ACTIONS MENÉES SONT PARTIELLES ET PEU STRUCTURÉES 62
1. La lutte contre le réchauffement climatique et l’amélioration de la qualité de l’air sont insuffisamment articulées 62
a. Des problématiques liées 62
b. Des outils cloisonnés, voire contradictoires 63
i. Au niveau national 64
ii. Au niveau local 66
2. La gouvernance des politiques anti-pollution est complexe et instable 67
a. Une action ministérielle discontinue 67
b. Une planification locale foisonnante et inaboutie 69
c. Des marges de manœuvre insuffisantes pour les acteurs de terrain 74
d. Des actions insuffisamment évaluées 75
3. La gestion des pics de pollution est inappropriée 76
a. Une procédure complexe et peu lisible pour le grand public 77
b. Des mesures à l’impact limité car insuffisamment ciblées et rapides 80
c. Un cadre juridique en cours de révision 85
B. DONNER DE LA COHÉRENCE ET DE LA STABILITÉ AUX OUTILS DE PLANIFICATION ET DE GESTION NATIONALE ET LOCALE 87
1. Une urgence absolue : avoir une vision nationale et locale intégrée « climat–air–énergie » 87
2. Faire des acteurs de terrain le pivot des politiques de qualité de l’air 88
3. Évaluer les plans nationaux et les actions locales et conforter les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) 90
4. Anticiper la gestion des épisodes de pollution et rendre la procédure plus lisible 93
C. CLARIFIER LA COMMUNICATION EN DIRECTION DU GRAND PUBLIC 95
1. S’assurer de la cohérence et de l’exhaustivité des données fournies 95
2. Utiliser un indice de qualité de l’air synthétique 96
DEUXIÈME PARTIE : AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DES MESURES RELATIVES AUX SOURCES MOBILES ET FIXES DE POLLUTION 99
I. SE DONNER LES MOYENS DE LUTTER CONTRE LA POLLUTION ÉMISE PAR LE SECTEUR ROUTIER 99
A. LES TRANSPORTS ROUTIERS : UN SCORE PLUTÔT MÉDIOCRE EN TERMES DE QUALITÉ DE L’AIR 99
1. Malgré la baisse des émissions qui lui sont liées, le trafic routier contribue fortement aux concentrations élevées de certains polluants 100
2. Les taxes et les aides concernant ce secteur favorisent les rejets de certains polluants 105
a. Des outils fiscaux et financiers non ciblés sur la lutte contre la pollution locale par les particules fines et les oxydes d’azote et qui encouragent la diéselisation du parc 106
b. Un soutien au véhicule électrique qui reste faible au regard de son impact sur la pollution locale et de son potentiel de développement 114
c. L’abandon de l’écotaxe poids-lourds : une occasion manquée 116
3. Le contrôle des émissions automobiles souffre de faiblesses structurelles 121
a. Des procédures d’essai qui ne permettent pas d’assurer le respect des normes Euro 121
b. Des propositions d’amélioration de la Commission européenne en partie contestées 125
B. TAXER ET AIDER LES VÉHICULES EN FONCTION DE LEUR DEGRÉ DE NOCIVITÉ 128
1. Faut-il résorber le différentiel de taxation essence-gazole ? 129
2. Orienter les investissements et les achats vers des motorisations moins polluantes 131
a. Accélérer le renouvellement du parc par des aides plus incitatives 132
b. Adapter le transport routier de marchandises 133
C. RÉGULER DIFFÉREMMENT LE TRAFIC ROUTIER ET PROMOUVOIR L’AUTO-PARTAGE 136
1. Promouvoir la circulation graduée 136
a. Gérer de manière dynamique le trafic routier 136
b. Mettre en place des zones de circulation restreinte sous certaines conditions 138
2. Soutenir le covoiturage domicile-travail 149
D. RÉDUIRE LES VALEURS LIMITES D’ÉMISSIONS ET RENFORCER LEUR CONTRÔLE 152
1. Utiliser le levier des normes Euro 152
2. Modifier les dispositifs d’homologation des véhicules et de mesure de leurs émissions 154
II. IMPLIQUER DAVANTAGE LES AUTRES SECTEURS DANS LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L’AIR 156
A. L’INDUSTRIE : RENDRE LA FISCALITÉ PLUS INCITATIVE ET MIEUX CONTRÔLER LES INSTALLATIONS CLASSÉES 156
1. Les résultats obtenus par ce secteur sont importants mais la politique de réduction des émissions reste perfectible 156
a. Une baisse importante des rejets encouragée par la réglementation européenne et relayée par les investissements des entreprises 156
b. Une taxe générale sur activités polluantes « air » dont le montant est inférieur aux coûts des dommages environnementaux et des meilleures technologies disponibles 158
c. Une majorité d’installations classées inspectées occasionnellement 159
2. Faut-il revoir le barème de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) « air » ? 161
3. Renforcer le contrôle des installations soumises à simple déclaration en s’appuyant sur les préfets et les maires 162
B. L’AGRICULTURE : CHANGER DE DISCOURS POUR LE RENDRE AUDIBLE 163
1. La qualité de l’air doit s’inscrire dans le contexte plus large de la compétitivité de l’agriculture hexagonale 163
a. Des émissions quasiment stables 163
b. La nécessité d’accompagner les efforts d’un secteur spécifique et fragilisé 169
2. Le verdissement des exploitations fait désormais partie intégrante de leur compétitivité 173
a. Limiter les intrants 173
b. Intégrer les exploitations dans leur écosystème 178
3. Les pouvoirs publics doivent se donner les moyens de convaincre 180
a. Les expérimentations doivent être développées : le réseau des fermes DEPHY - Démonstration Expérimentation Production de références sur les systèmes économes en pHYtosanitaires 181
b. Placer l’agriculteur au centre du dispositif en l’informant, en le formant et en le soutenant 182
C. LA POLLUTION D’ORIGINE RÉSIDENTIELLE PROGRESSE ET SA RÉDUCTION PASSE PAR UNE POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE VOLONTARISTE 185
1. La réduction de la pollution atmosphérique d’origine résidentielle, passée un peu inaperçue, est synonyme d’amélioration de la performance énergétique du parc immobilier 185
a. Une pollution passée un peu inaperçue 185
b. Une source de pollution à ne pas négliger 186
c. Un parc de logements dans lequel la maison individuelle et l’ancien dominent, ce qui se ressent sur sa performance énergétique 189
d. L’amélioration des appareils de chauffage 190
2. La mobilisation des acteurs est le gage de l’efficacité des mesures prises 194
a. Adapter les solutions au contexte local 194
b. Sensibiliser les particuliers 195
TROISIÈME PARTIE : LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L’AIR INTÉRIEUR 199
I. LA MOBILISATION DES POUVOIRS PUBLICS 199
A. DE L’OBSERVATOIRE DE LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR (OQAI) AU PLAN DE QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR (PQAI) 199
1. La première campagne de l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur 199
2. Le Plan national santé-environnement (PNSE) 200
3. Le Grenelle de l’environnement et le PNSE 2 201
4. Le Plan national santé-environnement 3 (PNSE 3) et le plan de qualité de l’air intérieur (PQAI) 201
B. UN BILAN CONSISTANT 203
1. La recherche sur les milieux et les populations 203
a. Les études sur les milieux 203
b. Les études sur les populations 205
2. La réglementation par seuil 206
3. L’information du public et des professionnels 207
a. L’étiquetage des matériaux de construction et de décoration 207
b. Les autres types d’information 207
4. L’accompagnement des malades 209
II. UN SUJET COMPLEXE ET UNE GOUVERNANCE TOUFFUE QUI LAISSENT SUBSISTER DES ZONES D’OMBRE 209
A. UN SUJET COMPLEXE 210
1. La qualité de l’air intérieur est une résultante 210
2. Une démarche scientifique et administrative exigeante dans un univers incertain 211
a. Les différentes étapes 212
b. L’exemple des matériaux de construction et de décoration 213
c. Le projet d’étiquetage des produits d’ameublement et des produits d’entretien 214
d. Les incertitudes scientifiques 215
3. Des messages contradictoires 215
B. UNE GOUVERNANCE TOUFFUE QUI, EN DÉPIT DES PRÉCAUTIONS PRISES, NE CONTRIBUE PAS À CLARIFIER LES RÔLES ET LE MESSAGE DES POUVOIRS PUBLICS 216
1. Une gouvernance touffue 216
a. L’Observatoire de la qualité de l’air intérieur 220
b. Le Centre scientifique et technique du bâtiment 221
c. Les autres acteurs 221
2. Des mesures ont été prises pour limiter les dysfonctionnements 223
a. L’ouverture à la société civile 223
b. Le travail en réseau 223
c. Les comités de déontologie 224
3. Mais la répartition des rôles et le message à transmettre ne sont pas toujours clairs 225
a. La communication et la formation 225
b. La qualité de l’air dans les enceintes ferroviaires souterraines 225
C. DES ZONES D’OMBRE 226
1. Le monde du travail 226
2. Le cas du radon 227
III. UNE POLITIQUE À CONCILIER AVEC D’AUTRES EXIGENCES 228
A. LES ALÉAS DE LA CAMPAGNE DE MESURE DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 228
B. LA NÉCESSITÉ D’UNE BONNE ARTICULATION AVEC LES NORMES EN MATIÈRE DE LOGEMENT 230
AUDITION DE M. DIDIER MIGAUD, PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR DES COMPTES 233
EXAMEN PAR LE COMITÉ 249
ANNEXE N° 1 : VALEURS GUIDES SANITAIRES ET VALEURS DE GESTION DE LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR 261
ANNEXE N° 2 : PERSONNES ENTENDUES PAR LES RAPPORTEURS 263
CONTRIBUTION DE LA COUR DES COMPTES À L’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L’AIR 269

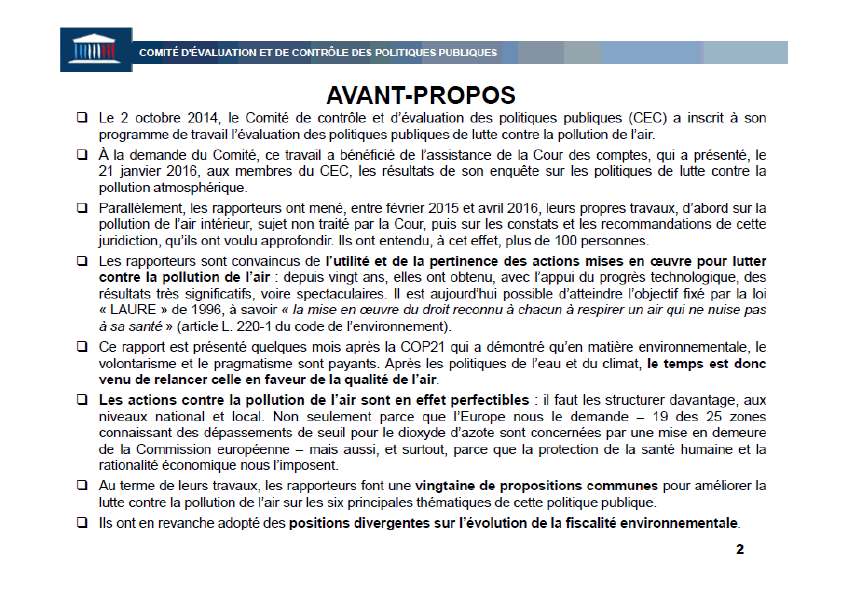
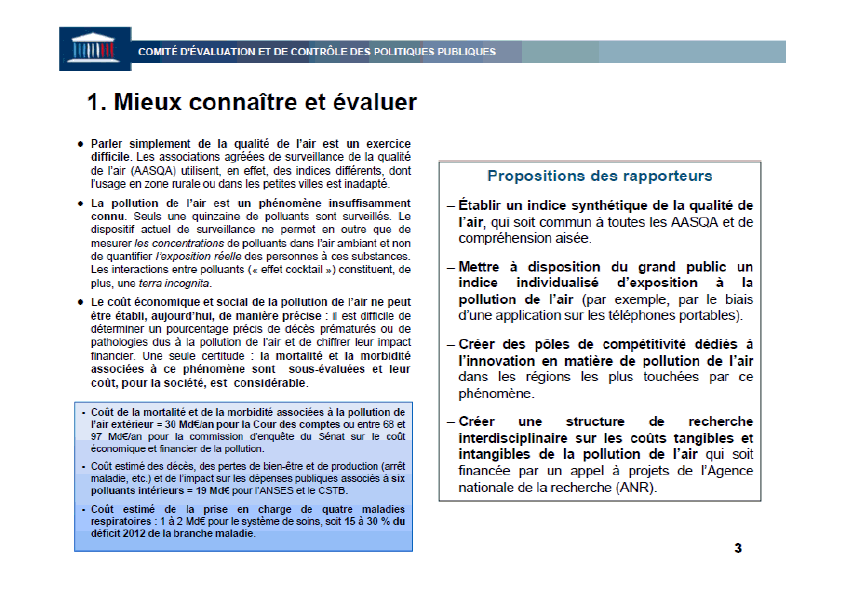
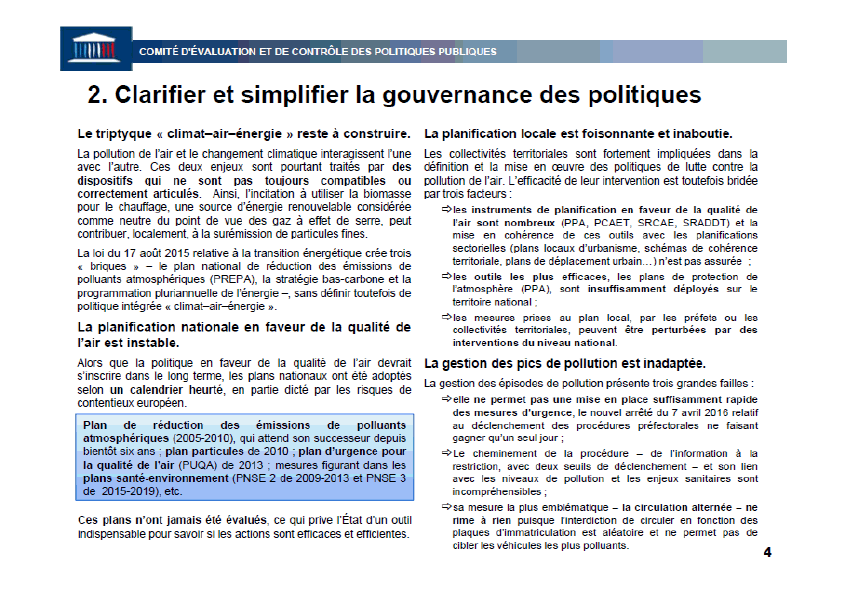
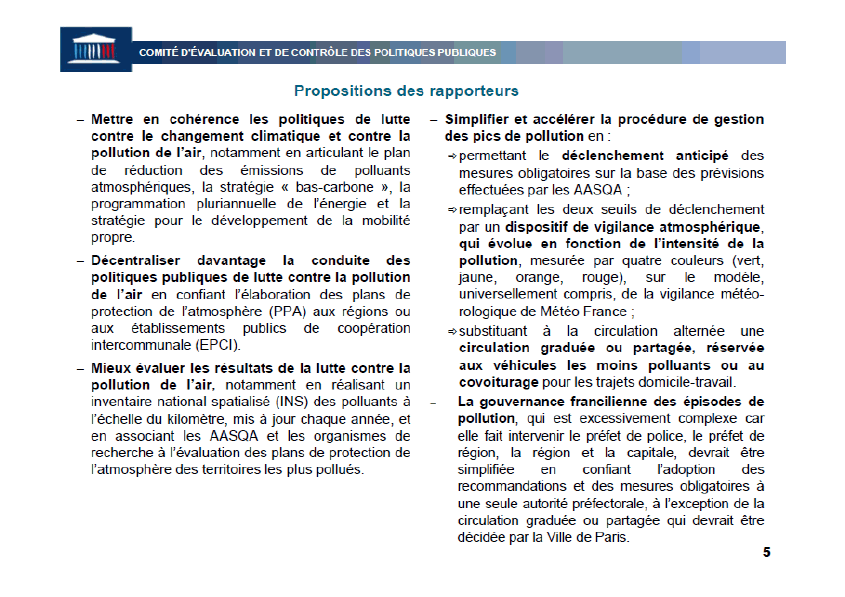
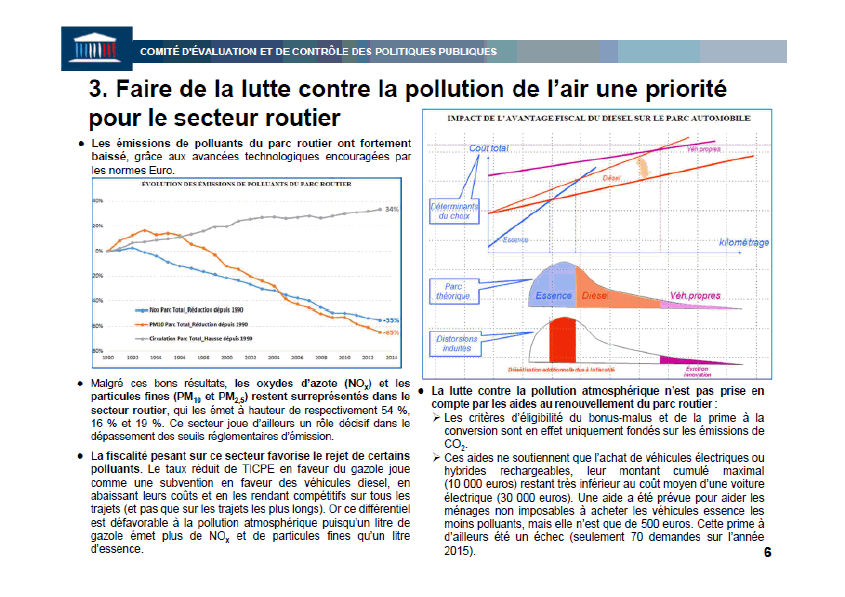
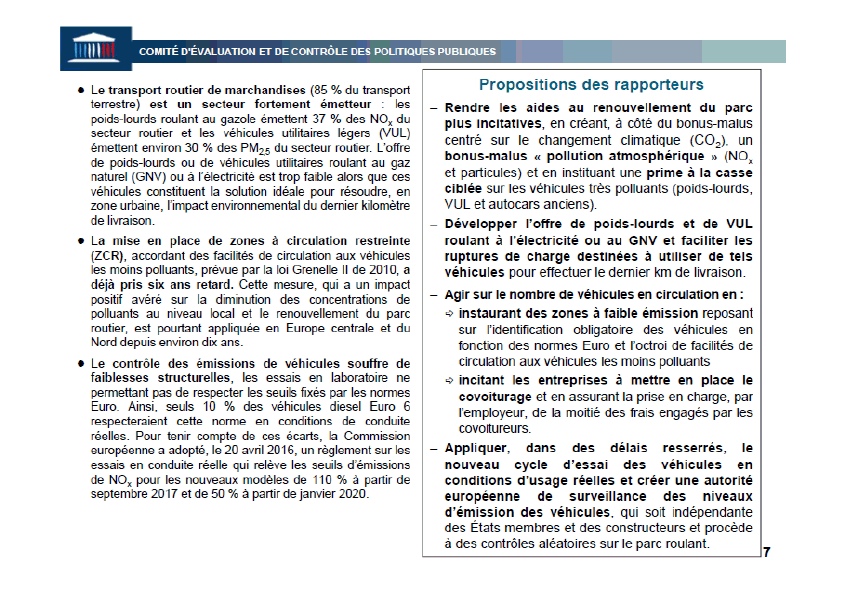
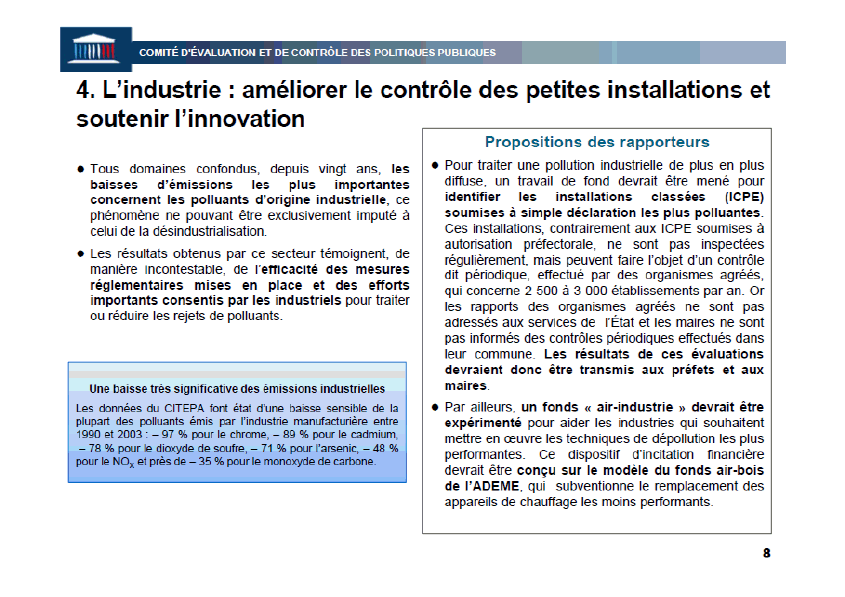
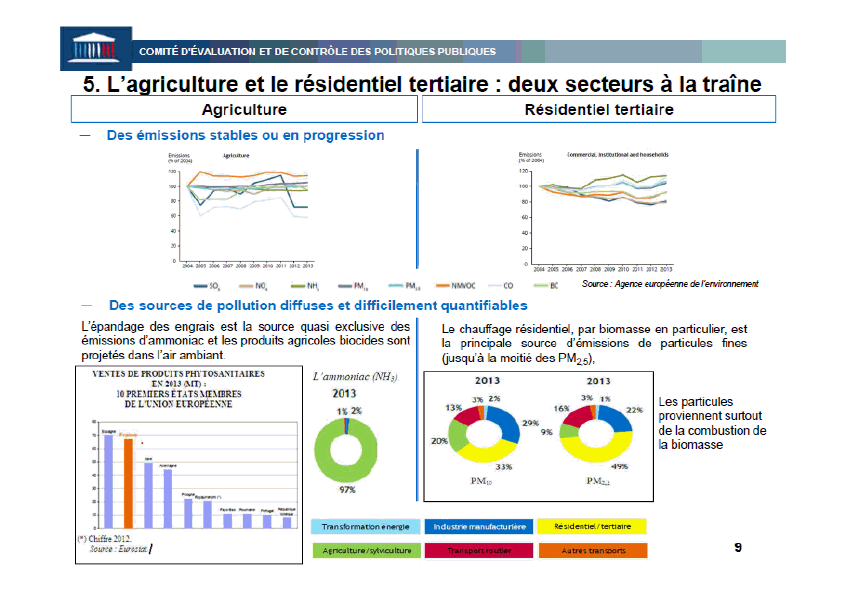
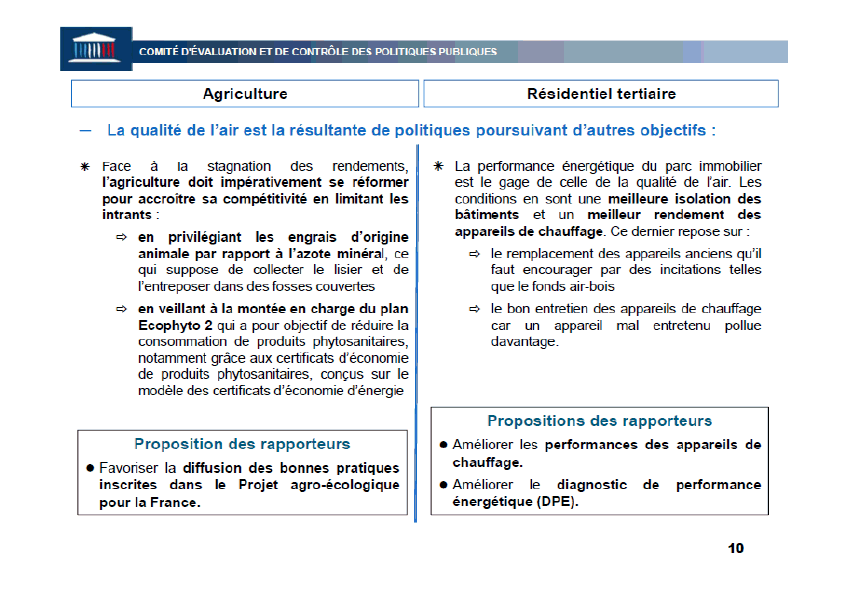
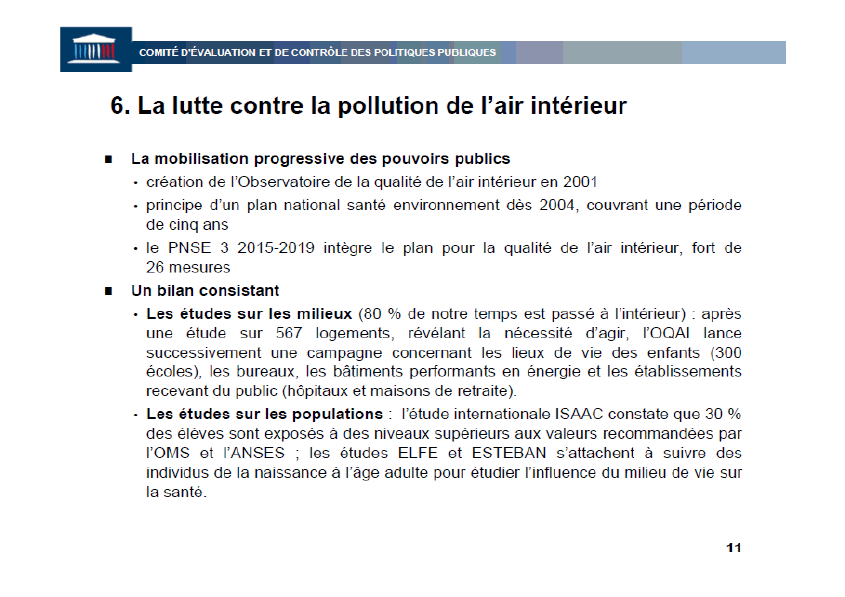
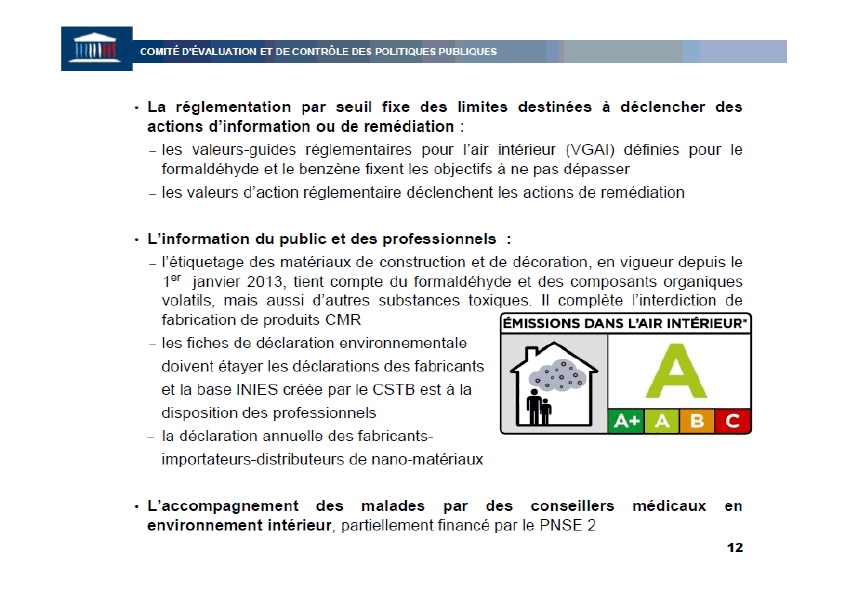
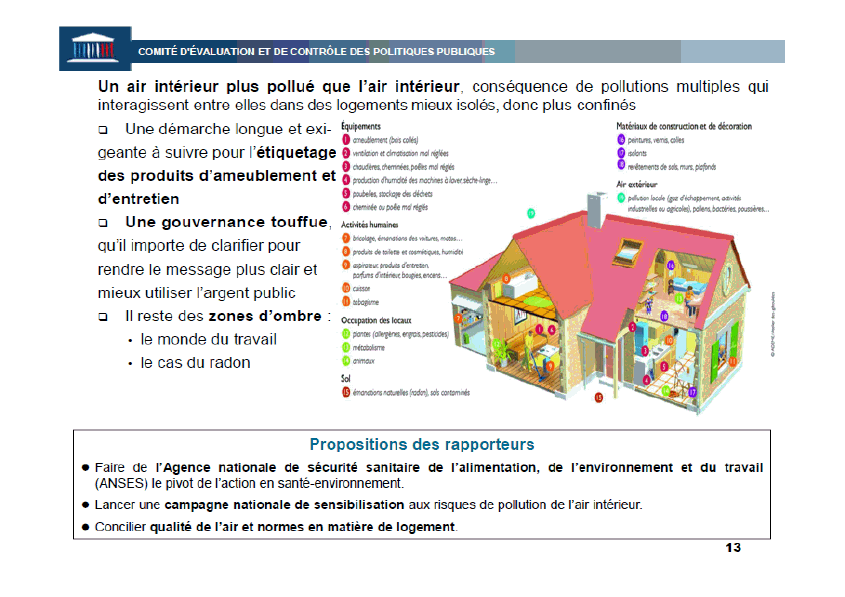
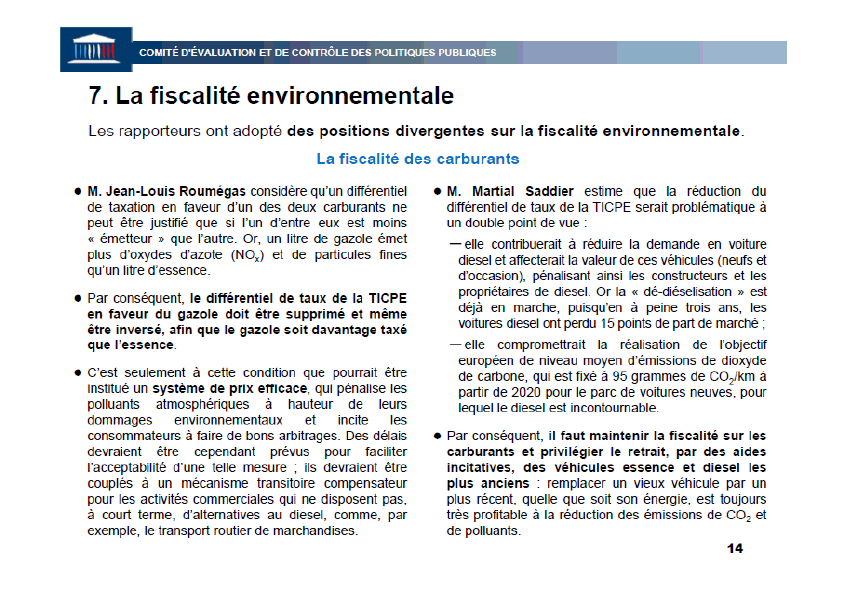
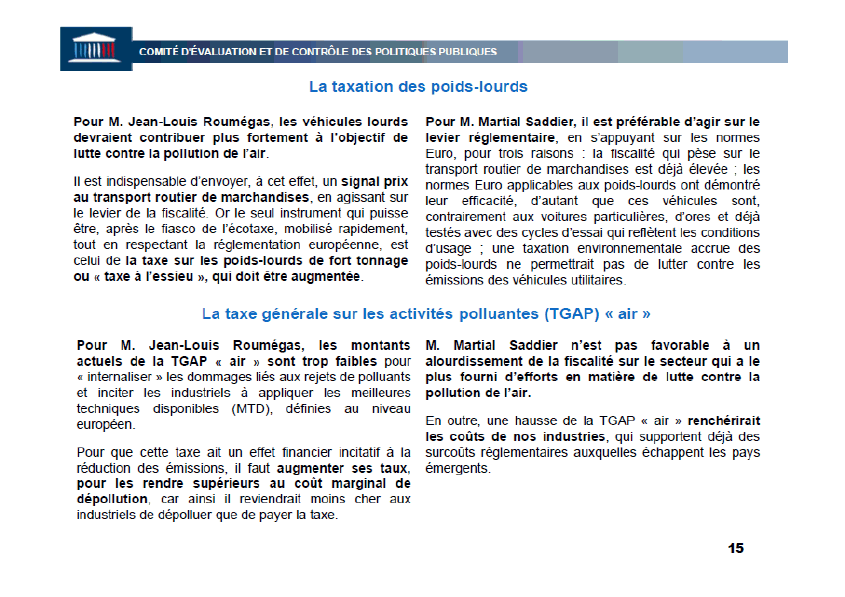
Proposition n° 1 : mieux connaître le niveau de pollution de l’air :
– mettre à disposition du grand public un indice individualisé d’exposition à la pollution de l’air ;
– encourager la création de pôles de compétitivité dédiés à l’innovation en matière de pollution de l’air dans les régions les plus touchées.
Proposition n° 2 : mieux connaître les conséquences de pollution de l’air :
– créer une structure de recherche interdisciplinaire sur les coûts tangibles et intangibles de la pollution de l’air financée par un appel à projets de l’Agence nationale pour la recherche (ANR) ;
– inclure un volet « qualité de l’air » dans le projet médical partagé des groupements hospitaliers de territoire (GHT) situés dans une zone couverte par un plan de protection de l’atmosphère (PPA).
Proposition n° 3 : mettre en cohérence les politiques de lutte contre le réchauffement climatique et contre la pollution de l’air :
– articuler la stratégie bas-carbone, le plan de réduction de la pollution atmosphérique, la programmation pluriannuelle de l’énergie et la stratégie pour le développement de la mobilité propre ;
– renforcer la cohérence des schémas territoriaux qui encadrent ces politiques (SRCAE, SRADDET, PCAET et PPA) avec les planifications sectorielles (urbanisme, transport et logement) ;
– sensibiliser les élus locaux à ces sujets.
Proposition n° 4 : confier l’élaboration des plans de protection de l’atmosphère (PPA) et des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) à la région ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Proposition de M. Martial Saddier : approfondir la recherche consacrée à l’impact de l’usage du sel de déneigement sur la pollution liée aux particules.
Proposition n° 5 : mieux évaluer les résultats de la lutte contre la pollution de l’air :
– réaliser un inventaire national spatialisé des émissions de polluants à l’échelle du kilomètre, régulièrement mis à jour, pour développer l’évaluation des actions en faveur de la qualité de l’air ;
– associer les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) et les organismes de recherche à l’évaluation des plans de protection de l’atmosphère (PPA) des zones connaissant des concentrations élevées de polluants, en incluant deux volets : l’impact sur la qualité de l’air et les externalités socio-économiques.
Proposition n° 6 : modifier la procédure de gestion des pics de pollution :
– permettre la mise en œuvre, par anticipation, d’interdictions et de restrictions, sur prévision pour tous les polluants ;
– remplacer les deux seuils de déclenchement (information/ recommandation et alerte) par un dispositif de « vigilance atmosphérique », mesurant l’intensité de la pollution en fonction de quatre couleurs (vert, jaune, orange et rouge, sur le modèle de Météo France) ;
– substituer à la circulation alternée une circulation réservée aux véhicules les moins polluants ou au covoiturage pour les trajets domicile-travail et autoriser le contrôle de la circulation par la vidéo-verbalisation.
Proposition n° 7 : établir un indice synthétique de la qualité de l’air, qui soit commun à toutes les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) et de compréhension aisée.
Proposition de M. Jean-Louis Roumégas : augmenter la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSCVR ou « taxe à l’essieu ») sur les poids-lourds de fort tonnage.
Proposition de M. Martial Saddier : agir sur le levier règlementaire et non sur la fiscalité pour réduire la pollution issue des poids lourds et des véhicules utilitaires.
Proposition de M. Jean-Louis Roumégas : modifier la fiscalité sur les carburants :
– supprimer, dans un premier temps, l’écart de TICPE qui avantage le gazole tout en prévoyant un mécanisme compensateur pour les activités commerciales ne disposant pas, à court terme, d’alternatives au gazole ;
– augmenter, dans un second temps, les taux de TICPE pour taxer plus fortement le gazole que l’essence.
Proposition de M. Martial Saddier : maintenir la fiscalité sur les carburants et privilégier le retrait des véhicules essence et diesel les plus anciens.
Proposition n° 8 : rendre les aides au renouvellement du parc des véhicules routiers plus incitatives :
– créer un bonus-malus centré sur la lutte contre la pollution atmosphérique (NOx et particules) en basant ses critères d’éligibilité sur les niveaux d’émission des polluants de véhicules ;
– instituer une prime à la casse ciblée sur les véhicules très polluants (poids-lourds, véhicules utilitaires légers et flottes d’autocars anciens roulant au diesel) ;
– étendre la prime à la conversion à l’achat de véhicules électriques d’occasion.
Proposition n° 9 : réduire la pollution induite par le transport routier de marchandises :
– inciter les constructeurs de poids-lourds et de véhicules utilitaires roulant à l’électricité ou au gaz naturel à créer des consortiums pour qu’ils disposent de plates-formes de construction de châssis permettant de réaliser des économies d’échelle ;
– augmenter le nombre de stations de gaz naturel pour véhicules (GNV) et de points de charge électrique ;
– faciliter les ruptures de charge destinées à utiliser de tels véhicules pour effectuer le dernier kilomètre de livraison ;
– adapter le statut des fleuves pour favoriser le transport fluvial des marchandises.
Proposition n° 10 : généraliser les mesures de gestion dynamique du trafic (abaissement de la vitesse pendant les périodes chargées, limitation ou contrôle de l’accès des automobilistes aux voies rapides, etc.).
Proposition n° 11 : instaurer de manière progressive des zones à circulation restreinte (ZCR) temporaires ou permanentes :
– rendre obligatoire l’identification, dans ces zones, des véhicules en fonction de leurs émissions de polluants et prévoir, à leur entrée, une automatisation du contrôle des véhicules fondée sur la consultation du système d’immatriculation des véhicules (SIV) par la collectivité territoriale compétente ;
– le cas échéant, compenser par des aides financières les inégalités générées ;
– généraliser les avantages (facilités de stationnement par exemple) accordés aux véhicules les moins polluants (pastille verte et classe 1) ;
– instaurer des dérogations pour certains types de véhicules (ambulances, etc.) ou d’usages (covoiturage, travail de nuit).
Proposition n° 12 : permettre aux agglomérations de mettre en place, après une phase d’expérimentation, des péages urbains modulables (selon le trafic, le covoiturage, le niveau de pollution, etc.).
Proposition n° 13 : encourager les modes de transports collaboratifs pour les trajets domicile-travail :
– inciter les entreprises à mettre en place un système de covoiturage dédié à leurs salariés ;
– intégrer le covoiturage domicile-travail dans les modes de transport couverts par la prise en charge par l’employeur de 50 % des frais engagés.
Proposition de M. Jean-Louis Roumégas : inciter les autorités européennes à adopter rapidement la norme Euro 7 pour supprimer les écarts de niveaux d’émission des véhicules essence et diesel.
Proposition de M. Martial Saddier : anticiper l’entrée en vigueur de la norme Euro 6, sans s’engager dans l’élaboration de norme nouvelle.
Proposition n° 14 : réformer l’homologation des véhicules et la mesure de leurs émissions :
– mettre en place, dans des délais resserrés, un nouveau cycle d’essai des véhicules fondé sur la mesure des émissions dans des conditions de conduite réelles ;
– créer, au niveau européen, une autorité de surveillance indépendante chargée d’assurer le suivi du respect des niveaux d’émissions en mettant en œuvre des contrôles a posteriori sur les véhicules en circulation.
Proposition de M. Jean-Louis Roumégas : augmenter progressivement les tarifs de la TGAP « air » pour les rapprocher des coûts des dommages causés et pour inciter les industriels à investir dans les meilleures techniques disponibles.
Proposition de M. Martial Saddier : agir sur le levier réglementaire, notamment par le biais des meilleures techniques disponibles, et non sur la fiscalité, pour réduire les émissions industrielles.
Proposition n° 15 : développer l’expérimentation d’un fonds « air-industrie » sur le modèle du fonds « air-bois » pour soutenir le développement des techniques de dépollution industrielle les plus innovantes.
Proposition n° 16 : améliorer le contrôle des installations classées soumises à simple déclaration :
– informer les maires et les préfets des résultats des contrôles périodiques ;
– permettre aux préfets de demander, lors des pics de pollution, que ces installations soient inspectées lorsque leur contrôle par un organisme agréé a mis en lumière le caractère particulièrement polluant de leur activité.
Proposition n° 17 : favoriser la diffusion des bonnes pratiques inscrites dans le Projet agro-écologique pour la France, notamment en :
– réduisant les consommations d’engrais grâce à des techniques limitant les émissions d’ammoniac (pendillard ou injection) ;
– encourageant la couverture des fosses à lisier et la valorisation des effluents d’élevage grâce à l’épandage et la méthanisation ;
– veillant à la montée en charge du plan Ecophyto 2, en particulier du dispositif des certificats d’économie d’usage des produits phytosanitaires ;
– développant la recherche sur les solutions alternatives au travail du sol.
Proposition n° 18 : améliorer les performances des appareils de chauffage :
– généraliser les aides au renouvellement des foyers de combustion non performants sur le modèle du fonds air-bois ;
– mettre à l’étude la possibilité d’interdire la commercialisation des foyers ouverts dans les zones sensibles ;
– prévoir une transmission obligatoire, lors de l’entretien des appareils, d’une notice d’information sur les risques de pollution de l’air liés au chauffage résidentiel.
Proposition n° 19 : améliorer le diagnostic de performance énergétique (DPE) :
– préciser que le descriptif de l’appareil de chauffage porte sur son état de vétusté ;
– prévoir, le cas échéant, la transmission de l’attestation d’entretien des appareils de chauffage au moment de l’établissement du DPE.
Proposition n° 20 : faire de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) le pivot de l’action en santé-environnement, en la chargeant d’organiser la collecte et la centralisation des données sur les environnements intérieurs.
Proposition n° 21 : lancer une campagne nationale de sensibilisation aux risques de pollution de l’air intérieur à destination des particuliers et des professionnels.
Proposition n° 22 : concilier qualité de l’air et normes en matière de logement :
– associer systématiquement normes d’aération et normes d’isolation thermique en cas de rénovation et de travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments ;
– élargir le diagnostic de performance énergétique (DPE) au contrôle de la qualité de l’air intérieur.
Le 2 octobre 2014, le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) a décidé d’inscrire à son programme de travail l’évaluation des politiques de lutte contre la pollution de l’air, sur proposition du groupe écologiste. Cette évaluation trouvait parfaitement sa place, à la suite de l’évaluation du paquet énergie-climat menée par le CEC en 2014, à un moment où le projet de loi sur la transition énergétique et pour la croissance verte arrivait devant le Parlement et où le Gouvernement préparait très activement la COP21, destinée à freiner le réchauffement climatique. La conférence s’est révélée un succès diplomatique pour notre pays puisqu’elle s’est achevée par un accord général, dont la phase de ratification par les États est désormais ouverte.
L’article L. 220-2 du code de l’environnement définit la pollution de l’air comme « l’introduction par l’homme, directement ou indirectement, ou la présence, dans l’atmosphère et les espaces clos, d’agents chimiques, biologiques ou physiques ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer le biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives ». Ainsi, la pollution de l’air n’est-elle plus tant un enjeu environnemental qu’un impératif de santé publique car la prise de conscience par le grand public de l’importance de la qualité de l’air pour la santé a suivi de près les progrès des connaissances épidémiologiques.
Le 20 novembre 2014, le CEC a désigné les deux rapporteurs de cette évaluation : M. Jean-Louis Roumegas, membre du groupe écologiste, et M. Martial Saddier, membre du groupe Les Républicains.
Sur le fondement de l’article L. 132-5 du code des juridictions financières, le Président de l’Assemblée nationale a, sur proposition du CEC, demandé l’assistance de la Cour des comptes afin de réaliser cette évaluation. Par lettre du 23 octobre 2014, le Premier président de la Cour des comptes a confirmé son accord pour procéder à cette évaluation et précisé que le rapport de la Cour serait remis au CEC avant la fin janvier 2016. L’évaluation relevant des compétences de deux chambres distinctes (la deuxième et la septième), elle a été confiée à une formation interchambres présidée par Mme Evelyne Ratte, présidente de la septième chambre. Grâce à des rencontres régulières, les rapporteurs du CEC ont pu être tenus informés et faire part régulièrement de leurs réactions et demandes.
M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes, a présenté le rapport de la juridiction financière le 21 janvier 2016 au cours d’une audition ouverte à la presse. Ce rapport, qui figure à la fin du présent rapport, porte principalement sur trois points : d’une part, les objectifs assignés à la lutte contre la pollution de l’air ; d’autre part, le cadre juridique dans lequel elle s’inscrit ; enfin, les moyens budgétaires, fiscaux et humains qui y sont consacrés, et les résultats mesurés sur le territoire métropolitain. Il contient des développements plus spécifiques sur trois sujets que les rapporteurs du CEC souhaitaient voir examiner : la pollution de l’air d’origine industrielle, la pollution due à la production énergétique ainsi que l’action en faveur du développement du véhicule électrique. Pour répondre à la demande de l’Assemblée nationale, l’équipe de la Cour a adopté un « grand angle », de l’échelon européen à l’échelon local. Elle a ainsi comparé les politiques menées aux niveaux national et local par nos principaux partenaires et voisins : les Pays-Bas, notamment à Amsterdam, Rotterdam et La Haye ; l’Allemagne, avec les villes de Düsseldorf, Cologne et Bonn ; la Suisse, à Berne, Zurich et Genève ; l’Italie, à Milan et Turin ; le Royaume-Uni, à Londres.
S’agissant du bilan, la Cour des comptes prend acte de la forte réduction des émissions polluantes même si les résultats obtenus sont inégaux selon les secteurs. Elle souligne l’importance de s’attaquer à la pollution de fond, qui se concentre dans des zones bien identifiées, ce qui vaut à la France plusieurs contentieux de la part de la Commission européenne. La Cour recommande une politique d’ensemble plus cohérente, s’attaquant de front à la pollution atmosphérique et au réchauffement climatique, et non plus indépendamment l’une de l’autre, grâce à une gouvernance structurée selon le principe de subsidiarité, à des moyens mieux identifiés et à des recherches sur les sources de pollution encore insuffisamment documentées telles que les pesticides et les particules ultrafines.
Les rapporteurs ont conduit leurs propres travaux. Ils ont procédé à de nombreuses auditions pour mieux comprendre les méthodes d’évaluation du coût de la pollution atmosphérique et mieux cerner le phénomène mal connu de la pollution de l’air intérieur. Après la présentation du rapport de la Cour, ils ont animé des tables rondes destinées à recueillir la position des parties prenantes sur le constat qu’elle avait établi.
La synthèse qu’ils ont réalisée s’articule autour de trois axes principaux : la nécessité d’évaluer le coût de la pollution de l’air et de clarifier les compétences des acteurs impliqués (première partie) ; l’importance d’améliorer l’efficacité des mesures encadrant les sources mobiles et fixes de pollution (deuxième partie) et de faire de la lutte contre la pollution de l’air intérieur une priorité (troisième partie).
PREMIÈRE PARTIE : ÉVALUER LE COÛT DE LA POLLUTION DE L’AIR ET CLARIFIER LES COMPÉTENCES DES ACTEURS QUI LUTTENT CONTRE SES NUISANCES
I. UN COÛT IMPORTANT POUR LA SOCIÉTÉ MAIS DIFFICILE À ÉVALUER
Le coût de la pollution de l’air – intérieur et extérieur – a fait l’objet de nombreuses évaluations, au niveau national et international. Mais le foisonnement des chiffrages disponibles conduit aussi à souligner qu’en la matière, il n’existe pas de vérité scientifiquement établie mais seulement des estimations, voire des approximations, tant les hypothèses qui encadrent les calculs peuvent être fragiles. Ce constat, qui ne doit pas être masqué, n’enlève rien à l’utilité de ces évaluations, devenues un élément incontournable de tout débat sur l’amélioration de la qualité de l’air.
A. LE COÛT DE L’INACTION : UNE DONNÉE INDISPENSABLE POUR L’INFORMATION DU GRAND PUBLIC ET L’AIDE À LA DÉCISION
Les études qui évaluent le coût de la pollution de l’air ont pour principal mérite de sensibiliser toutes les parties prenantes, en commençant par le grand public et les décideurs, aux lourds enjeux – sanitaires, économiques, financiers, etc. – associés à l’amélioration de la qualité de l’air. Elles font ainsi ressortir le coût de l’inaction contre cette nuisance, qui est considérable et qui ne pourrait que s’aggraver en l’absence de toute mesure correctrice.
1. Les nombreuses externalités négatives de la pollution de l’air doivent être mieux connues
L’évaluation du coût de la pollution de l’air répond à une nécessité démocratique et juridique. Elle permet de satisfaire le droit à l’information en matière environnementale, qui découle de la Charte de l’environnement résultant de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005. L’article 7 de cette Charte dispose, en effet, que toute personne a le droit « d’accéder aux informations relatives à l’environnement ». Or les impacts, sanitaire, économique, financier, etc., de la pollution de l’air font incontestablement partie de ces informations.
L’évaluation de ce coût a aussi des vertus pédagogiques car elle permet de caractériser les effets néfastes de cette pollution. Ses « externalités négatives », selon la terminologie employée par les économistes, peuvent ainsi être mises en évidence : les conséquences associées à cette pollution n’étant pas intégrées par les marchés, son coût pour la société est, de fait, bien supérieur au coût « privé » qu’elle représente pour les émetteurs de polluants.
Les externalités en jeu vont en effet bien au-delà de l’impact de la pollution sur la qualité de l’air, dont l’opinion publique n’est pas toujours consciente. Celles-ci ont notamment des conséquences sur :
– la santé, la pollution de l’air étant un facteur de mortalité, de morbidité – définie comme la fréquence des maladies ou des incapacités dans une population donnée – ou, plus simplement, de gêne ou d’irritation, notamment pendant les pics de pollution ;
– l’activité productive et la richesse nationale, mesurées par le PIB, au travers, d’une part, des décès prématurés, des maladies et de l’absentéisme engendrés par une mauvaise qualité de l’air et, d’autre part, des investissements consentis par les acteurs économiques pour réduire leurs activités polluantes ;
– la qualité de vie en raison des effets de cette pollution sur la souffrance associée à la mortalité ou à la morbidité, l’anxiété vis-à-vis de l’avenir, le temps passé auprès d’un malade, etc. ;
– les finances publiques au travers des dépenses de santé (soins de ville, hospitalisations, etc.) et des dépenses de prévention, de surveillance et de recherche visant à lutter contre la pollution de l’air ;
– le patrimoine bâti, la pollution de l’air extérieur étant responsable de la détérioration des façades des bâtiments.
La pollution de l’air a donc des effets sur des biens et services marchands et non marchands. Son coût est, de ce fait, ainsi que l’a souligné la commission d’enquête du Sénat consacrée à ce sujet, « protéiforme » (1), ce qui rend toute analyse exhaustive de celui-ci extrêmement difficile car elle impliquerait de chiffrer un grand nombre d’éléments impondérables.
Autrement dit, évaluer le coût de la pollution revient à évaluer les modifications apportées au bien-être de la société, ce qui constitue une gageure comme l’illustre le graphique ci-après, réalisé par l’économiste Olivier Chanel, directeur de recherche au CNRS.
EFFETS ET COÛTS À PRENDRE EN COMPTE POUR ÉVALUER L’IMPACT DE LA POLLUTION
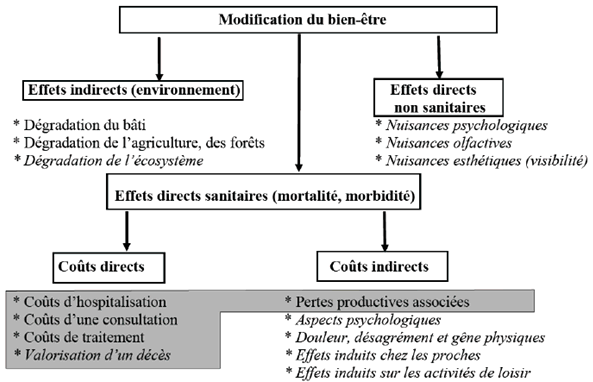
Notations : Composantes non marchandes (en italiques) et marchandes (en caractères romains).
Composantes repérées en grisé : évaluation monétaire des effets sanitaires dans l’étude européenne Aphekom de 2011.
Source : document remis par M. Olivier Chanel, directeur de recherche au CNRS, à l’issue de son audition.
2. Les bénéfices associés à la lutte contre la pollution de l’air doivent être davantage mis en avant
L’évaluation des impacts de la pollution de l’air contribue à améliorer l’efficacité des politiques publiques lesquelles, selon l’article 6 de la Charte de l’environnement, doivent « promouvoir un développement durable » en conciliant « la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès ».
Certes, pour les décideurs publics, le coût de la pollution de l’air ne saurait, à lui seul, constituer un outil d’évaluation des politiques de prévention de cette même pollution.
En effet, ainsi que l’a souligné M. Xavier Bonnet, chef du service de l’économie et de l’évaluation du Commissariat général au développement durable, l’objectif, pour les responsables publics, ne peut être de réduire ce coût à zéro, ce qui reviendrait à éliminer toute pollution atmosphérique et serait, en l’état actuel de nos modes de vie et de nos technologies, parfaitement utopique. En revanche, ce coût constitue « une alerte sur les marges de progrès possibles et sur le fait que des actions en faveur de la réduction de la pollution de l’air peuvent faire baisser ces coûts » (2).
Les politiques d’amélioration de la qualité de l’air peuvent ainsi faire l’objet d’une analyse économique via la réalisation d’études coûts-bénéfices, qui permettent de mettre en regard les bénéfices d’une amélioration de la qualité de l’air avec les coûts des mesures envisagées.
La mesure du coût de la pollution de l’air constitue donc, selon la commission d’enquête précitée du Sénat, une « indication importante pour le décideur public », plusieurs travaux ayant permis de « mettre en évidence les bénéfices associés à la mise en place d’une règlementation plus contraignante » en faveur de la baisse des émissions et des concentrations de polluants de l’air (3).
Tel est le cas, par exemple, des études d’impact qui ont accompagné la publication, le 19 décembre 2013, d’un nouveau « paquet » de propositions de la Commission européenne visant à baisser les plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques. Les conclusions de l’une de ces évaluations, réalisée par l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS), sont résumées dans l’encadré ci-dessous.
Les bénéfices associés à l’adoption du nouveau paquet « qualité de l’air »
L’INERIS a évalué le rapport coûts-bénéfices, pour la France, des politiques de lutte contre la pollution de l’air à partir des différents scénarios retenus par la Commission européenne. Il a notamment mesuré les bénéfices sanitaires, en termes de diminution des coûts associés à la mortalité et à la morbidité, qui résulteraient de la baisse des émissions de polluants, en estimant que la mise en œuvre de la réglementation en vigueur dans l’ensemble des États-membres – le scénario B – réduirait, par rapport au scénario A dans lequel les émissions des États-membres en 2030 seraient similaires à celles de 2005, les dommages sanitaires de 43 %. La mise en œuvre de nouveaux plafonds d’émission – correspondant au scénario D – réduirait ces dommages d’encore environ 13 %, ce qui induirait, au total, des bénéfices sanitaires annuels de l’ordre de 17,7 milliards d’euros, chiffre à comparer au coût des mesures de réduction envisagées, qui est estimé à 6,4 milliards d’euros par an.
Source : Pollution de l’air : le coût de l’inaction, rapport d’information n° 610, tome I, pp. 106-107 (Sénat – session extraordinaire 2014–2015).
B. UN EXERCICE D’ÉVALUATION COMPLEXE
Le caractère indispensable de l’évaluation du coût de la pollution de l’air ne confère pas pour autant à cet exercice le statut d’une science exacte. Les chiffrages réalisés reposent en effet sur des calculs fortement hypothétiques, ce qui explique la grande amplitude des estimations disponibles.
1. L’estimation du coût socio-économique est entourée de difficultés
Le plus souvent, l’évaluation du coût de la pollution de l’air est centrée sur la dimension socio-économique de celui-ci. Or cette évaluation passe par un cheminement complexe, marqué par de très nombreuses incertitudes.
a. Un travail qui repose sur trois étapes semées d’embûches
L’évaluation du coût socio-économique de la pollution de l’air nécessite de pouvoir établir un lien entre les émissions de polluants dans l’air et les dommages sanitaires que ces émissions génèrent. Cet exercice implique, par conséquent, de parcourir trois étapes, dont chacune se heurte à des difficultés méthodologiques particulières :
– déterminer l’exposition de la population à la pollution de l’air ;
– évaluer les impacts de cette exposition sur la santé ;
– estimer le coût économique – exprimé en euros ou en dollars – de ces impacts sanitaires.
• Étape 1 : mesurer l’exposition à la pollution de l’air
La première étape consiste à déterminer les niveaux de concentration de polluants auxquels est exposée la population considérée.
Cette mesure, qui porte sur la durée, la fréquence et l’intensité des expositions, impose, au niveau national, le maintien d’un parc instrumental conséquent, dont les critères de qualité sont fixés par la réglementation européenne. Le réseau de surveillance de la qualité de l’air extérieur est ainsi composé de stations (stations de trafic, stations industrielles, stations dites de « fond urbain », etc.), dont la densité et les objectifs sont encadrés par la directive « qualité de l’air » du 21 mai 2008 (4).
Cependant, cette surveillance ne prend en compte, comme l’a souligné la commission d’enquête du Sénat sur le coût de la pollution de l’air, qu’un aspect « très limité » de cette pollution : « alors que des dizaines de polluants ont été identifiés », seulement douze polluants sont suivis par l’Union européenne, ce qui dénote une « excessive sélectivité » des substances visées par le droit européen (5).
Par ailleurs, l’estimation de l’exposition ne permet pas de quantifier l’exposition proprement dite, réelle. Le dispositif actuel ne permet en effet de mesurer, grâce aux stations, que les concentrations de polluants dans l’air ambiant, lesquelles ne sont, comme l’a relevé la commission d’enquête du Sénat, « qu’un indicateur imparfait de l’exposition » (6).
L’OCDE et les difficultés de mesure des concentrations de particules
Pour mesurer ces concentrations, l’OCDE a recours à des outils de modélisation spécifiques.
Les estimations de concentrations des particules PM10 procèdent ainsi du modèle GUAM (Global Urbain Air Quality Model) mis au point par la Banque mondiale et portent sur plus de 3 200 grandes villes de la planète.
Or, compte tenu de ses spécificités, ce modèle ne tient pas compte de plusieurs éléments importants, à savoir :
– les gradients de concentration en zone urbaine (c’est-à-dire les effets de concentration extrême) ;
– les différences d’exposition selon le groupe de population ;
– la pollution intérieure ;
– les effets de la pollution de l’air ambiant sur la population des villes de moins de 100 000 habitants ou des campagnes.
En outre, les données sur les concentrations de particules fines – les PM2,5 – étant rares, l’outil utilisé par l’OCDE pour modéliser ces concentrations (le GMAPS de la Banque mondiale) est scientifiquement fragile car il présuppose qu’il est possible de les déduire en appliquant un ratio PM10 – PM2,5 « qui ne repose que sur un nombre d’observations assez réduit » (7).
Des mesures plus précises, centrées sur l’exposition individuelle à la pollution de l’air, peuvent être toutefois effectuées. À titre d’illustration, la commune de Champlan (Essonne), présentée en 2006 comme la plus polluée de France, a fait l’objet d’un programme d’études spécifique, mis en place pour recueillir, notamment par le biais de capteurs portés par les habitants, des données sur les niveaux d’exposition et établir une cartographie fine, jusqu’à l’échelle de la rue, de ces phénomènes. Ce travail exemplaire, qui a permis de relativiser l’intensité de la pollution locale, a été réalisé par plusieurs organismes, notamment l’Institut national de veille sanitaire (InVS) et Airparif, l’association agréée de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) d’Île–de–France.
Plus récemment, Airparif a souhaité développer un outil interactif qui vise à fournir à ses utilisateurs un indice individualisé d’exposition, au domicile comme au travail. De tels indicateurs, dès lors qu’ils sont robustes sur le plan scientifique, devraient être développés et diffusés très largement, via les nouvelles technologies. Ces informations, couplées à des recommandations destinées aux publics fragiles (jeunes enfants, asthmatiques, etc.) lors des pics de pollution, pourraient alors s’afficher sur les écrans des téléphones et contribuer, de cette manière, à sensibiliser l’opinion publique aux enjeux de la qualité de l’air.
Par ailleurs, on ne dispose pas, aujourd’hui, de données complètes sur l’ensemble des sources de polluants. La Cour des comptes souligne, à cet égard, la nécessité de disposer d’études plus abouties sur les particules ultrafines et la pollution liée aux pesticides (8).
Il est donc nécessaire d’encourager l’innovation dans le domaine de la mesure des polluants, en regroupant les efforts des acteurs publics et privés dans des pôles de compétitivité « qualité de l’air », qui devraient être créés dans les régions connaissant des niveaux élevés de pollution. On rappellera en effet que ce type de structure favorise le développement de projets collaboratifs de recherche et développement particulièrement innovants, en rassemblant, sur un territoire bien identifié et sur une thématique ciblée, des entreprises, des laboratoires de recherche et des établissements de formation.
Proposition n° 1 : mieux connaître le niveau de pollution de l’air :
– mettre à disposition du grand public un indice individualisé d’exposition à la pollution de l’air ;
– encourager la création de pôles de compétitivité dédiés à l’innovation en matière de pollution de l’air dans les régions les plus touchées.
• Étape 2 : mesurer les impacts de cette exposition sur la santé
Cette étape clef s’appuie les fonctions exposition-risque, qui sont issues des études épidémiologiques et qui permettent de faire le lien entre une exposition à un polluant et un risque sanitaire supplémentaire en termes de mortalité ou de morbidité.
Les données mobilisées pour évaluer les impacts sanitaires
liés à la pollution de l’air
Les impacts de court terme : Leur évaluation repose sur l’analyse de séries temporelles (chronologiques) de mesures de polluants dans l’air et de données de santé telles que la mortalité et la morbidité respiratoire ou cardiovasculaire issues de données hospitalières collectées de manière routinière. En France, cette approche a été mise en œuvre dans le cadre du Programme de surveillance air et santé (PSAS), mis en place en 1997 et animé par l’Institut national de veille sanitaire (INVS).
Les impacts de long terme : L’évaluation des effets de l’exposition chronique à la pollution repose sur des études de cohorte, qui consistent généralement à suivre, sur une période habituellement longue (plusieurs années), des sujets dont la caractéristique prépondérante est l’exposition au facteur de risque étudié. Ce type d’études implique donc de disposer, pour chaque sujet inclus dans l’enquête, des données individuelles relatives à son exposition et à son état de santé. Par conséquent, l’évaluation des expositions sur des durées longues est « complexe, et le suivi, dans le temps, des sujets participant aux études de cohorte est lourd à mettre en œuvre ».
Source : Commission des comptes et de l’économie de l’environnement, Santé et qualité de l’air extérieur, juillet 2012, p. 27 et p. 30.
Or ce lien est difficile à établir car les données mobilisées pour y parvenir ne sont pas toujours fiables ou sont incomplètes :
– les indicateurs sanitaires peuvent être entachés d’incertitudes dans la mesure où les données sur la mortalité ou la morbidité sont fortement dépendantes de la qualité du système de soins et des modes de recueil existants ;
– l’état des connaissances épidémiologiques ne permet pas toujours d’établir une relation exposition-risque pour certaines substances. Ainsi, l’étude sur le coût socio-économique de la pollution de l’air intérieur, publiée en 2014 et dirigée par l’économiste Pierre Kopp, n’a pas retenu le formaldéhyde, pourtant présent dans 100 % des bâtiments et source notoire d’irritations (9) ;
– le lien entre l’exposition à la pollution de l’air et le risque sanitaire est quantifié de manière assez imprécise par la « fraction attribuable à l’environnement » (FAE). Issue de la littérature scientifique, celle-ci correspond à la part, souvent exprimée en pourcentage, de maladies attribuables, sur l’ensemble des cas connus, à l’environnement. Or, pour la pollution de l’air, cette fraction est obtenue en déduisant la part du tabac et des expositions professionnelles et se présente, pour un grand nombre de pathologies (asthme, bronchite, cancer des voies respiratoires, etc.), sous la forme d’un intervalle de valeurs assez large, compris entre 5 % et 35 % (10). Les chercheurs de l’équipe d’épidémiologie des maladies allergiques et respiratoires (EPAR) de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ont souligné, à cet égard, que les calculs des FAE sont « entourés d’incertitudes qui sont larges ». Par conséquent, ils ont pris le soin de préciser, dans leur étude, que les estimations de FAE présentées pour les maladies respiratoires les plus répandues « doivent être considérées comme des ordres de grandeurs » (11) ;
– enfin, les pathologies liées à la pollution de l’air ayant des causes multiples, l’impact sanitaire individuel des polluants est difficile à évaluer.
L’OCDE et les difficultés de mesure de l’impact sanitaire de la pollution de l’air
Appelé Global Integrated Sustainability Model (GISMO), l’outil employé par l’OCDE pour modéliser l’impact sanitaire de la pollution de l’air extérieur détaille les décès imputables à une cause précise par sexe et par âge dans les différentes régions du monde.
Son objectif est de décrire la charge de morbidité, qui est mesurée à l’aide d’indicateurs tels que la mortalité et la morbidité et peut être quantifiée, pour les malades, en « années de vie corrigées de l’incapacité » (AVCI).
Or, comme le souligne l’OCDE elle-même, dans le domaine de la pollution de l’air, les estimations de cette donnée sont « entachées d’incertitudes » (12) :
– à titre d’illustration, dans les cas de cancers, ces estimations peuvent être fondées sur de simples hypothèses et ne pas tenir compte de tous les effets, comme ceux des substances chimiques sur le système endocrinien ;
– en outre, certaines méthodes d’estimation de la charge de morbidité – comme la pondération par l’incapacité et la prise en compte du facteur âge – font débat parmi les experts, tout comme les comparaisons entre certaines données recueillies dans plusieurs pays ;
– enfin, les données AVCI n’ont été calculées que pour certaines substances, c’est-à-dire celles pour lesquelles il existe des fonctions connues de dose-effet (13).
En conclusion, comme l’a souligné la Commission des comptes et de l’économie de l’environnement, qui est rattachée au ministère de l’écologie, « si on est certain que la pollution de l’air est source de dommages sanitaires, l’attribution de dommages sanitaires à tel ou tel polluant particulier est beaucoup plus incertaine ». Pour illustrer ce constat, la Commission prend comme exemples le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde d’azote (NO2) et les particules (PM) en indiquant qu’à l’heure actuelle, « il n’est pas possible de préciser dans quelle mesure les effets apparents des PM sont en réalité les effets du NO2 ou du SO2, ou réciproquement, ou dans quelle mesure la présence d’autres polluants affecte la toxicité des PM. Les effets sanitaires associés aux particules intègrent donc, sans qu’on puisse déterminer dans quelle proportion, les effets sanitaires du SO2 et du NO2 et réciproquement » (14).
Ces données aussi parcellaires que fragiles rendent le chiffrage de l’impact sanitaire de la pollution de l’air particulièrement délicat.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le nombre de décès imputables à la pollution de l’air ambiant par les particules a été révisé à la hausse, ces dernières années, de manière spectaculaire, comme l’illustre le graphique ci-après, sous l’effet de « l’amélioration de la collecte de données » (15). Ainsi, selon l’étude Global Burden of Disease pilotée par l’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’université de Washington, dont les résultats ont été publiés dans la revue The Lancet en décembre 2012 et repris par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le total de ces décès était, en 2010, quatre fois supérieur à celui indiqué, pour la même année, par l’OCDE.
ESTIMATIONS DU NOMBRE DE DÉCÈS DUS À LA POLLUTION DE L’AIR AMBIANT
PAR LES PARTICULES
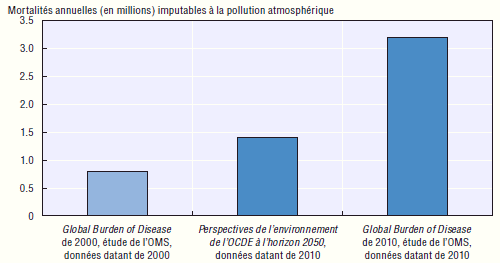
Source : OCDE, Le coût de la pollution de l’air : Impacts sanitaires du transport routier, 2014, p. 34.
Ces incertitudes expliquent aussi que le chiffre de 42 000 décès prématurés annuels attribuables à la pollution particulaire en France – issu du programme de recherche européen Clean Air for Europe (CAFE) et publié en 2005 – ait été contesté, même si celui-ci est devenu une référence dans le débat public.
Certains chercheurs estiment en effet que cette valeur est discutable car elle s’appuierait sur des comptages en partie erronés et dus à des confusions entre différentes pathologies (16). Leur estimation, qui a été communiquée aux rapporteurs par M. Christophe Rafenberg, chercheur associé à l’INSERM, est donc beaucoup plus basse : celle-ci serait ainsi comprise entre 8 000 et 22 000 décès au grand maximum.
• Étape 3 : estimer le coût économique de ces impacts sanitaires
L’estimation de ce coût passe par l’utilisation de valeurs monétaires de référence pour évaluer l’impact économique de chaque polluant sur la mortalité et la morbidité et exprimer celui-ci en euros ou en dollars.
Or, par définition, ces valeurs, dont la méthodologie sera examinée en détail plus loin, ne permettent pas de mesurer le coût total de la pollution de l’air. En effet, celui-ci englobe, comme l’a rappelé la commission d’enquête du Sénat consacrée à cette problématique, plusieurs éléments qu’il est possible de regrouper en deux grandes catégories :
– le coût socio-économique engendré par les pathologies et les décès prématurés associés à la pollution de l’air n’est qu’un sous-ensemble du coût sanitaire, qui comprend aussi un coût tangible, marchand, directement appréhendable en termes de richesse nationale et de PIB et qui inclut les dépenses de santé, l’absentéisme et la perte de productivité ;
– à ce premier type de coûts s’ajoute un second, le coût non sanitaire, qui est loin d’être négligeable bien que difficilement mesurable. Celui-ci recouvre les effets négatifs de la pollution de l’air sur la baisse des rendements agricoles, la perte de biodiversité, la dégradation des bâtiments et de très nombreux coûts cachés, comme les dépenses de prévention et de recherche d’organismes tels que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), les dépenses de surveillance de la qualité de l’air et celles induites par le respect de la réglementation en matière de qualité de l’air (17).
Les études qui tentent de proposer une approche exhaustive du coût de la pollution, comme celle de l’ANSES, du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et de l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI), sur certains polluants intérieurs, sont, de ce fait, extrêmement rares.
Une étude détaillée du coût de six polluants intérieurs
Le périmètre des coûts pris en considération pour les six polluants étudiés (le benzène, le trichloréthylène, le radon, le monoxyde de carbone, la fumée de tabac et les particules PM10 et PM2,5) en 2014 par l’OQAI, l’ANSES et le CSTB, comprend :
– le coût externe (– 18 milliards d’euros), formé de deux composantes : le coût engendré par la mortalité (– 8,5 milliards d’euros) et les pertes de bien-être liées à la pollution de l’air intérieur (– 8 milliards d’euros), d’une part, et le coût des pertes de production des entreprises et des administrations engendrées par les conséquences des arrêts de maladie d’autre part (– 1,5 milliard d’euros) ;
– l’impact sur le bien–être de la variation du solde des finances publiques liée à la pollution de l’air intérieur (– 195 millions d’euros). Ont été distingués dans ce coût :
• les dépenses de soin et de prévention (– 360 millions d’euros) ;
• le coût des recherches, des expertises et des communications institutionnelles relatives à la pollution intérieure (– 11 millions d’euros) ;
• l’impact, positif en l’espèce, sur les pensions de retraite qui seront versées, ou pas, en cas de décès prématuré (+ 209 millions d’euros) ;
• le coût de prélèvement de l’impôt nécessaire pour financer les dépenses publiques supplémentaires engendrées par la pollution de l’air intérieur (pour se procurer 1 € d’impôt, il faut prélever 1+α €, ce coefficient étant estimé à 0,2).
La rapporteure de la commission d’enquête du Sénat, Mme Leila Aïchi, a d’ailleurs indiqué qu’« il n’existe, à notre connaissance, aucune étude exhaustive ayant recensé l’ensemble des coûts de la pollution de l’air intérieur et extérieur pour l’économie » (18).
b. Une valorisation monétaire de la mortalité et de la morbidité liées à la pollution de l’air problématique
L’évaluation du coût socio-économique de la pollution de l’air repose sur des conventions, c’est-à-dire sur des règles acceptées par la plupart des experts, qui concernent deux domaines : la valeur monétaire attribuée aux décès prématurés associés à la pollution de l’air et celle de la morbidité liée à cette pollution, qui est une fraction de la première.
• Des valeurs tutélaires disparates, résultant d’enquêtes d’opinion
L’évaluation socio-économique des impacts sanitaires de la pollution de l’air repose sur l’attribution d’une valeur monétaire à la mortalité. En effet, les études qui mesurent le coût que représente, pour la société, un décès prématuré lié à cette pollution ont recours à une valeur unitaire, la valeur d’une vie statistique (VVS), appelée aussi valeur d’évitement d’un décès ou valeur de la vie humaine, qui peut être définie comme « la somme d’argent que chaque individu est prêt à payer pour une réduction donnée du risque de décès prématuré, dû par exemple aux maladies liées à la pollution atmosphérique » (19).
Cette valeur peut être déterminée par plusieurs méthodes, la plus utilisée étant celle du consentement à payer (20), lequel peut être estimé par une évaluation contingente où les individus sont interrogés sur leur consentement à payer pour des mesures qui modifient le risque de décès. Ainsi, ce consentement est « généralement estimé à partir d’une enquête où l’on explique à chaque individu le scénario envisagé (mesure proposée, conséquences, etc.). (…) Chaque personne est alors amenée à évaluer son consentement à payer face à ce scénario. Soit sous la forme d’une question ouverte (“ Combien seriez-vous prêt à payer pour le projet ?”). Soit sous la forme d’une ou de plusieurs questions fermées (“Seriez-vous prêt à payer au moins X dollars pour le projet ?”) » (21).
Or, selon une revue de la littérature scientifique effectuée en 2011 par l’OCDE, qui a recensé 1 095 valeurs de la vie statistique dans le monde, cette valeur oscillerait entre 2 660 dollars et 20 millions de dollars selon les études et le pays considéré (dollars de 2005) (22).
À partir de ce travail de synthèse, l’OCDE a proposé, en 2012, une valeur moyenne pour les adultes de l’OCDE située entre 1,5 et 4,5 millions de dollars (dollars de 2005), avec une valeur de référence de 3 millions de dollars. Pour l’Union européenne, la fourchette correspondante serait de 1,8 à 5,4 millions de dollars, avec une valeur de référence de 3,6 millions de dollars (23).
Le calcul de la valeur de la vie statistique selon l’OCDE
D’après l’OCDE, le calcul de la valeur de la vie statistique (VVS) à partir des résultats d’une enquête sur les préférences déclarées par les personnes interrogées peut s’effectuer de la manière suivante : si l’enquête montre un consentement à payer (CAP) moyen de 30 dollars pour ramener le risque annuel de décès du fait de la pollution atmosphérique de 3 pour 100 000 à 2 pour 100 000, cela signifie qu’une personne consent à payer 30 dollars pour bénéficier de cette réduction de risque de 1 pour 100 000. Ainsi, dans cet exemple, pour chaque groupe de 100 000 personnes, cette réduction du risque évite 1 décès. Si l’on fait la somme des CAP individuels de 30 dollars des 100 000 personnes considérées, on obtient la VVS de référence de 3 millions de dollars proposée par l’OCDE.
Source : OCDE, La valorisation du risque de mortalité dans les politiques de l’environnement, de la santé et des transports, 2012, p. 14.
Le groupe de travail du Commissariat général à la stratégie et à la prospective sur l’évaluation socio-économique, présidé par l’économiste Émile Quinet, a toutefois relevé que le rapport de l’OCDE « se base exclusivement sur des études de préférences déclarées, c’est-à-dire sur des données issues d’enquêtes ». Or ces données « sont fragiles en raison du caractère hypothétique de ces approches, et plus spécifiquement des multiples biais cognitifs associés aux réponses à des questionnaires qui ont été identifiés dans la littérature en psychologie et économie » (24).
Les experts de la direction de l’environnement de l’OCDE entendus par les rapporteurs ont d’ailleurs confirmé que la valeur de la vie statistique est une « approximation, pas une mesure exacte », tout en soulignant qu’il n’existait aucune autre alternative qui permettrait de donner une évaluation plus précise du coût socio-économique de la pollution de l’air (25).
La valeur de la vie statistique en France
En France, la valeur de la vie statistique est utilisée dans le calcul socio-économique des projets de transport et fait l’objet de révisions régulières. Le rapport « Boiteux » du Commissariat général du plan de 2001 a recommandé une « valeur tutélaire » de 1,5 million d’euros pour la valeur de la vie humaine sauvée sur la route et proposé, pour la pollution de l’air, une valeur d’évitement d’un décès de 504 000 euros.
Ce dernier chiffre a été obtenu en appliquant un coefficient correcteur de 35 % à la valeur tutélaire retenue pour le secteur des transports, principalement pour tenir compte de l’écart de l’impact, sur l’espérance de vie, des décès dus aux transports et des décès dus à la pollution : une personne décédant du fait d’un accident de la route voit en effet son espérance de vie amputée de quarante ans, en moyenne, alors qu’une personne décédant du fait d’une exposition prolongée à la pollution – effet de long terme – ne perdrait environ que dix ans.
Depuis lors, le Commissariat général à la stratégie et à la prospective s’est appuyé sur les recommandations de l’OCDE de 2012 pour proposer d’actualiser la valeur de référence française à 3 millions d’euros (euros de 2005, soit 3,3 millions d’euros en 2010), ce référentiel devant évoluer au même rythme que la croissance du PIB par habitant.
Il convient de préciser que le Commissariat a refusé, pour des considérations éthiques, de différencier la valeur de la vie humaine en fonction de l’âge, tout en suggérant, lorsque cette question se pose (risque de décès associé à des populations très jeunes ou très âgées), d’utiliser la valeur de l’année de vie gagnée, en complément du calcul fondée sur la valeur de la vie statistique. Dans ce cas, le Commissariat recommande de retenir 115 000 euros (euros de 2010) par année de vie gagnée, cette valeur devant croître comme le PIB par habitant (26).
Le caractère quelque peu artificiel de cette valorisation est encore plus accentué lorsqu’il s’agit d’estimer le coût de la morbidité, qualifié de « parent pauvre » de l’évaluation du coût socio-économique de la pollution par M. Xavier Bonnet, chef du service de l’économie et de l’évaluation du Commissariat général au développement durable (CGDD). En effet, c’est ce coût qui est le plus soumis à incertitude tant dans la quantification des impacts sanitaires que dans les valeurs monétaires de référence disponibles.
L’OCDE a toutefois estimé, en 2014, qu’il ressortait des derniers travaux internationaux en date que les coûts de la morbidité « ajoutent environ 10 % au coût total de la mortalité calculé d’après la VVS moyenne » (27).
L’évaluation monétaire de la morbidité associée à la pollution :
une opération complexe
Deux raisons principales complexifient l’évaluation monétaire de cette morbidité :
– alors qu’en général une seule valeur est attachée à un décès prématuré, il y a davantage de valeurs monétaires de référence à construire pour la morbidité. En effet, les impacts de la pollution de l’air en termes de maladie – hospitalisations, journées d’activités restreintes, etc. – sont, par définition, plus nombreux que ceux en matière de mortalité et diffèrent d’une pathologie à l’autre ;
– les valeurs de référence sont d’autant plus complexes à construire qu’elles intègrent plusieurs composantes : les coûts marchands (dépenses d’assurance-maladie par exemple) et les coûts non marchands, liés à la douleur ou à la gêne occasionnée par la maladie au patient ou à son entourage. Or ces coûts non marchands, qui présentent les plus fortes incertitudes, représentent la part la plus importante du coût de la morbidité.
• Un coût socio-économique qui se résume à une multiplication
D’après l’OCDE, le coût économique des impacts sanitaires de la pollution de l’air ambiant serait égal au montant de la valeur d’une vie statistique (VVS) d’une zone géographique ou d’un pays donné multipliée par le nombre de décès prématurés du territoire considéré (28). Pour la France, ce coût a donc été estimé, en 2010, à 54,86 milliards de dollars (= 17 389 décès x une VVS de 3,155 milliards de dollars). Au niveau de l’OCDE, il serait égal à 1 570 milliards de dollars (= 478 104 décès x une VVS de 3,286 milliards de dollars).
L’OCDE précise que ce coût a été majoré de 10 % pour tenir compte de la morbidité, et que dans l’Union européenne, il ressort de l’analyse des études existantes que le coût associé au transport représenterait « vraisemblablement quelque 50 % du coût économique total » (29).
L’étude de l’OMS et de l’OCDE de 2015
Fondée sur la même méthodologie, une étude conjointe du bureau régional de l’OMS pour l’Europe et de l’OCDE, a évalué à 1 430 milliards de dollars le coût économique, en 2010, de la pollution aux particules PM2,5 et de la pollution intérieure dans les 53 pays européens membres de l’OMS. Selon cette recherche, cette pollution s’est traduite par 662 769 décès prématurés, dont 164 231 sont dus à la seule pollution de l’air intérieur (30).
De son côté, la Cour des comptes a relevé les écarts importants liés à l’évaluation de ce coût : la valeur unitaire attribuée à chaque vie épargnée est en effet très différente d’une étude à l’autre (à titre d’illustration, 504 000 euros pour le Commissariat général au développement durable, entre 1 et 2 millions d’euros pour l’étude européenne CAFE et 3 millions d’euros pour celle de l’OMS/OCDE), « ce qui conditionne fortement l’équation finale » (31).
Pour conclure cette présentation de l’évaluation socio-économique du coût de la pollution de l’air, on peut citer le jugement de l’économiste Olivier Chanel, directeur de recherche au CNRS, qui a souligné les « grandes incertitudes » de cet exercice, « qui cumule les incertitudes en amont » – sur les concentrations de polluants et l’exposition à la pollution – et « ses propres incertitudes », qui résultent de ses choix méthodologiques en matière de monétarisation (32).
c. Un recours peu fréquent aux indicateurs de qualité de vie
La valorisation de la mortalité peut concerner soit le nombre de décès prématurés – ce que permet la valeur de la vie statistique – soit celui des années de vie perdues. Dans le second cas, les experts ont recours à la valeur d’une année de vie, qui fait référence à l’effort que la collectivité est prête à consentir non pas pour réduire les probabilités de décès mais pour augmenter l’espérance de vie d’une année.
L’approche « valeur d’une année de vie » peut alors être combinée à une appréciation de la qualité de vie, ce qui permet de corriger cette valeur par ce facteur. En effet, si une valeur monétaire peut être associée à la perspective d’une année de vie supplémentaire, celle-ci peut être accompagnée de peines et de souffrances, ce qu’il convient de prendre en compte.
De ce point de vue, l’approche dite QALY (Quality Adjusted Life Year) ou « année de vie ajustée par sa qualité » est de nature à améliorer l’évaluation du coût de la pollution de l’air et, par la même occasion, celle des politiques visant à lutter contre ce phénomène. La Cour des comptes a d’ailleurs souligné, dans une communication adressée au Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, l’intérêt des méthodes anglo-saxonnes qui cherchent à « donner un équivalent monétaire aux éléments qualitatifs propres à la durée et à la qualité de vie » (33).
Méthodologie du QALY
Selon le Commissariat général à la stratégie et à la prospective, un QALY « est une unité de mesure de la durée de vie pondérée par la qualité de vie liée à la santé », cette dernière étant valorisée par un score fondé sur les préférences de la population générale et mesuré sur une échelle d’intervalle qui assigne le score 1 à la parfaite santé et le score 0 au décès. Le nombre de QALYs est alors calculé en pondérant les durées passées dans ces différents états de santé par les scores de préférence associés à ces états (34).
Plusieurs échelles de qualité de vie ont été ainsi construites, dont les deux plus importantes sont, selon le Commissariat général au développement durable, le Health utilities Index Mark 3 (HUI3), qui propose huit grandeurs pour caractériser l’état de santé d’un individu, chacune d’entre elles étant évaluée sur une échelle comportant cinq à six niveaux, et l’EuroQol EQ-5D d’origine européenne qui prend en compte cinq grandeurs évaluées sur trois niveaux (35).
En effet, le critère du gain de durée de vie pondérée par la qualité de vie, mesuré en QALYs, qui est notamment utilisé par le National Institute for Clinical Excellence, un institut du National Health Service (NHS) britannique chargé de l’évaluation des technologies médicales, permet, d’ores et déjà, d’effectuer la comparaison « coût-utilité » des programmes de santé, en analysant, d’une part, le coût de la mise en œuvre du programme étudié et, d’autre part, le coût lié à l’absence de programme (36).
Cette méthode a même été appliquée dans le domaine de la pollution de l’air, puisqu’en 2014, les chercheurs de l’ANSES et du Centre scientifique et technique du bâtiment ont été en mesure d’utiliser un ratio coût-utilité inspiré des travaux de l’OMS, afin de prendre en compte la baisse de la qualité de vie durant les périodes de traitement et de rémission des personnes atteintes d’une maladie liée à un polluant intérieur (37).
Cependant, malgré ces travaux et la recommandation du Commissariat général à la stratégie et à la prospective selon laquelle le critère de l’année de vie ajustée par la qualité devrait être, en développant les recherches, introduit dans les évaluations socio-économiques (38), il n’existe pas de référentiel français établissant le nombre d’euros par QALY gagné.
2. Les résultats disponibles sont d’amplitude très variable et restent des approximations
Le caractère protéiforme du coût de la pollution de l’air et le recours à des « conventions » pour apprécier la dimension socio-économique de ce coût rendent impossible l’établissement d’un chiffrage précis des dommages qui lui sont associés. Ce domaine d’évaluation est donc celui des estimations, si ce n’est des approximations.
a. Un coût probablement sous-évalué
Les seules certitudes dont on dispose en matière d’évaluation du coût de la pollution de l’air est que celui-ci est probablement sous-évalué, en raison du caractère très incomplet des chiffrages effectués.
Les limites méthodologiques au calcul de ce coût sont en effet de quatre ordres :
– premièrement, à la différence des effets sanitaires de court terme de la pollution de l’air, qui surviennent dans les heures ou les jours suivant l’exposition et dont l’analyse s’appuie sur des études de séries temporelles, disponibles, pour certaines maladies, depuis 70 ans, les effets de long terme sont imparfaitement appréhendés, leur mesure nécessitant de recourir à des études de cohorte, plus complexes et, par conséquent, pas assez nombreuses ;
– deuxièmement, les effets sanitaires de certains polluants ne sont pas tous connus ou n’ont été découverts que récemment, par exemple en ce qui concerne les liens entre la pollution de l’air et le diabète ou l’autisme. On peut donc considérer que, si notre pays compte probablement moins de décès prématurés liés à cette pollution que le chiffre « officiel » de 42 000 morts, à l’inverse, le nombre de malades affectés par ce facteur est aussi considérable que méconnu. D’ailleurs, lorsqu’un tel chiffrage pourra être établi, il ne pourra qu’être révisé à la hausse de manière régulière, au fur et à mesure que des études épidémiologiques préciseront les effets de la dégradation de la qualité de l’air sur la survenance ou l’aggravation des différentes pathologies ;
– troisièmement, les interactions entre polluants, appelées « effet cocktail », ne sont pas encore mesurées, bien qu’aucun scientifique ne mette en doute leur réalité. Il est vrai aussi que ce phénomène est excessivement complexe à appréhender car cela revient à évaluer les effets additifs ou synergiques qui peuvent se produire lorsqu’une substance « potentialise » les effets d’un autre produit (39). Par conséquent, ainsi que l’a rappelé Mme Leila Aïcha, rapporteure de la commission d’enquête du Sénat sur le coût de la pollution, l’effet cocktail des différents polluants de l’air « n’est pas pris en compte dans les différentes études épidémiologiques menées, qui servent de base au calcul du coût économique de la pollution de l’air. Chaque polluant fait en effet l’objet d’une évaluation individuelle. Or, chaque individu est exposé tout au long de sa journée à de nombreux polluants de l’air extérieur et intérieur, dont les interactions pourraient conduire à une exacerbation de la morbidité et de la mortalité, à court terme comme à long terme » (40) ;
– enfin, les effets non sanitaires de la pollution de l’air (sur les rendements agricoles, la biodiversité, la dégradation des bâtiments, etc.) sont, selon Mme Leila Aïcha, « encore peu documentés » (2). Les quelques chiffrages réalisés, dont certains commencent à dater, indiquent toutefois que leur impact est loin d’être négligeable. Ainsi, le coût de la baisse des rendements agricoles pour les 25 pays européens a été évalué, en 2000, à 2,5 milliards d’euros par le programme de recherche Clean Air for Europe (CAFE). Par ailleurs, une étude de l’Institut für Witschaftspolitik und Wirtschaftsforschung (IWW) de l’université de Karlsruhe a retenu, pour la France, un coût lié aux dommages de la pollution sur patrimoine bâti d’environ 3,4 milliards d’euros en 2000 (41).
Pour toutes les raisons précédemment évoquées et comme le montre le tableau ci-après, les estimations du coût de la pollution de l’air sont très hétérogènes.
Au-delà des variations qui résultent des différences de périmètres dans les coûts, le nombre de pays et les polluants considérés ou des taux de change du dollar et de l’euro, force est de constater que les chiffrages de la mortalité et de la morbidité associées à cette pollution et de l’impact économique de ces dommages sanitaires peuvent être sans commune mesure d’une étude à l’autre.
Pour ne prendre qu’un exemple, le coût des décès prématurés dus à la pollution particulaire dans l’Union européenne (à 25 États-membres) serait compris entre 190 et 700 milliards d’euros selon la Commission européenne et égal à environ 1 000 milliards de dollars (dans l’Union à 27 États-membres) selon l’OCDE et l’OMS.
Cette hétérogénéité se retrouve dans le calcul du coût économique de la pollution de l’air établi par la commission d’enquête du Sénat. La conclusion des développements du rapport consacrés à « l’état des lieux » en France ne cite en effet pas moins de quatre chiffres : un coût de la mortalité et de la morbidité compris entre 68 à 97 milliards d’euros, cet intervalle étant celui de l’étude européenne, vieille de dix ans, Clean Air for Europe ; un coût non sanitaire a minima de 4,3 milliards d’euros ; un coût pour les régimes obligatoires de la sécurité sociale de 3 milliards d’euros ; enfin, un coût de la pollution de l’air intérieur de 19 milliards d’euros, qui ne peut être sommé à celui de la pollution atmosphérique car les polluants présents dans les deux environnements se recoupent pour partie (42).
EXEMPLES D’ESTIMATIONS DU COÛT DE LA POLLUTION DE L’AIR
OMS/OCDE (2015) |
Europe (2005) |
France (2013 et 2015) | |
Air extérieur |
- Coût économique (2010) de l’impact sanitaire de la pollution particulaire : . Coût des décès prématurés (243 165) avec une valeur de la vie statistique (VVS) commune dans 27 pays européens : 1 064 Md$ . Coût des décès prématurés (16 892) en France : 69,4 Md$ |
- Programme CAFE de la Commission européenne mesurant l’impact sanitaire (2000) de la pollution particulaire : . Coût de la mortalité (348 000 décès prématurés) dans 25 pays : 190,2 à 702,8 Md€ . Coût de la morbidité (100 000 hospitalisations) dans 25 pays : 78,3 Md€ . Coût de la mortalité (42 000 décès prématurés) en France : 21,3 Md€ . Coût de la morbidité (13 360 hospitalisations) en France : 6,4 Md€ |
- Étude d’octobre 2013 du Commissariat général au développement durable sur le coût (2010) des dommages sanitaires liés aux particules fines (PM2,5) en France : . Coût de la mortalité (42 000 décès prématurés) : 20 à 22 Md€ . Coût de la morbidité (13 000 hospitalisations) : 6,4 à 10 Md€ - Rapport de juillet 2015 de la commission d’enquête du Sénat : . coût total de l’impact sanitaire de l’ozone et des particules (45 000 décès prématurés) : 68 à 97 Md€ . coût non sanitaire de la pollution de l’air en France (baisse des rendements agricoles, dégradation des bâtiments, dépenses de recherche, etc.) : 4,3 Md€ a minima |
Air intérieur |
- Coût des décès prématurés dans 27 pays européens : 283 Md$ |
- Étude ANSES-CSTB-Pierre Kopp (6 polluants pris en compte) sur la France : . Coût de la mortalité (29 000 décès prématurés) : 8,8 Md€ . Coût de la morbidité (années de vie en mauvaise santé) : 8,8 Md€ . Coût total (mortalité, dégradation de la qualité de vie, perte de production, soins remboursés, etc.) : 19,5 Md€ |
De son côté, la Cour des comptes retient, dans l’enquête demandée par le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, le chiffrage du Commissariat général au développement durable (CGDD) qui a conclu, en 2012, à un coût annuel de la pollution de l’air extérieur pour la société compris entre 20 et 30 milliards d’euros (43), en combinant, pour les aspects de mortalité, un calcul sur la base de la valeur de vie statistique et, pour les aspects de morbidité, une évaluation directe sur la base du coût des traitements (44).
3. Les estimations centrées sur le coût pour la sécurité sociale semblent plus robustes
Plusieurs chercheurs estiment que l’évaluation du coût de la pollution devrait être fondée non pas sur le chiffrage, quelque peu hasardeux, d’une « valeur de la vie humaine » mais sur le calcul du coût de la prise en charge des maladies liées à la pollution de l’air. Toutefois, si cette approche ciblée sur des coûts réels, effectifs, est, sans doute, plus rigoureuse, elle n’est pas exempte de certaines limites méthodologiques.
a. Des calculs fondés sur des coûts tangibles
Le Commissariat général au développement durable (CGDD), l’équipe d’épidémiologie des maladies allergiques et respiratoires (EPAR) de l’INSERM et la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), qui a transmis ses propres estimations à la commission d’enquête du Sénat, ont cherché à calculer les dépenses du système de soins (45) relatives aux principales maladies respiratoires et maladies professionnelles associées à la pollution de l’air, ainsi que celles liées aux indemnités journalières versées aux malades en cas d’arrêt de travail.
La méthode d’évaluation choisie par les auteurs de ces études est donc volontairement « modeste » au regard de l’approche socio-économique, qui est fondée sur des coûts intangibles, en référence à la valeur de la vie humaine.
Outre son caractère fortement hypothétique, cette approche s’appuie sur la notion de « décès prématurés », qui pose plusieurs problèmes méthodologiques. On peut en évoquer deux, mentionnés par M. Christophe Rafenberg, chercheur associé à l’INSERM :
– les décès pris en compte par cette approche « économique » devraient être ceux des personnes actives, qui produisent des richesses et qui contribuent au PIB, l’âge limite de référence en la matière étant, en France, fixé à 65 ans. Or les résultats des chercheurs de l’EPAR montrent que 83 % du total des décès attribuables à la pollution concernent des personnes de plus de 65 ans. Ils ne peuvent donc être considérés comme des décès prématurés au sens économique du terme ;
– une approche purement économique impliquerait en outre de calculer une valeur spécifique de la vie pour les personnes âgées effectivement décédées. Or ce n’est pas le cas pour la valeur de la vie statistique, qui constitue une moyenne et se réfère à un individu considéré comme représentatif de la population et de ses différentes classes d’âge.
À l’inverse, le recours à des estimations centrées sur le traitement de pathologies associées à la pollution de l’air, serait, selon l’analyse développée par les chercheurs de l’EPAR, « moins sujet à débats ou à controverses, plus accessible que les valeurs issues des méthodologies fondées sur les coûts intangibles et le consentement à payer » (46).
Cette démarche alternative est en outre relativement simple à mettre en œuvre dans la mesure où elle peut être résumée par la formule suivante : « Coûts attribuables à l’environnement = Nombre total de malades x Fraction attribuable [à l’environnement] x Coût par cas » (47).
Enfin, comme le montre le tableau ci-après, dans deux cas sur trois, les fourchettes de coût établies par ces estimations sont proches, les écarts constatés entre les chiffres de l’EPAR et ceux du CGDD s’expliquant par des divergences de comptage de deux pathologies attribuables à la pollution de l’air (les bronchites chroniques et les broncho-pneumopathies obstructives chroniques), une « scorie » technique qui devrait pouvoir être éliminée à l’occasion de nouvelles recherches.
Les ordres de grandeur très larges retenus par la CNAMTS – de 500 millions à 1,4 milliard d’euros – s’expliquent, quant à eux, par le fait que celle-ci a évalué le coût de trois maladies seulement, contre cinq pour l’EPAR et le CGDD, le périmètre restreint de cette évaluation amplifiant, par là-même, la dispersion des écarts qui résultent des différentes fractions attribuables à l’environnement utilisées.
Dans la conclusion de leur étude, les chercheurs de l’EPAR soulignent l’intérêt d’une méthode qui, si elle n’est pas exempte d’imprécisions, montre, par rapport aux coûts dits « intangibles », que les 1 à 2 milliards d’euros de coût pour le système de soins représentent « avec certitude 15 à 30 % du déficit 2012 de la branche maladie de la sécurité sociale ». En outre, une telle estimation présente « l’avantage d’être facilement comprise et partagée par l’ensemble des citoyens », car elle peut être qualifiée, en raccourci, de « coût pour la sécurité sociale » (48).
ESTIMATIONS DU COÛT DE LA POLLUTION DE L’AIR POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE
Équipe d’épidémiologie des maladies allergiques et respiratoires (EPAR) de l’INSERM |
Commissariat général au développement durable (CGDD) (2015) |
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) pour la commission d’enquête du Sénat sur le coût de la pollution de l’air (2015) | ||||
- Pathologies étudiées : asthme, bronchites aigües (BA) ou chroniques (BC), cancers des voies respiratoires basses et hautes et bronco-pneumopathies obstructives chroniques (BPCO) |
- Pathologies étudiées : idem |
- Pathologies étudiées : maladies respiratoires chroniques (BPCO et asthme) et cancers (dont cancers du poumon) qui tous deux ne sont pas dénombrés par la CNAM | ||||
- Nombre annuel de nouveaux cas attribuables à l’environnement : . hospitalisations pour causes respiratoires : 13 796 . hospitalisations pour causes cardiovasculaires : 19 761 . bronchites chroniques : 134 000 . bronchites aigües : 450 218 enfants, 500 000 adultes |
- Nombre annuel de nouveaux cas attribuables à l’environnement : . hospitalisations pour causes respiratoires : idem . hospitalisations pour causes cardiovasculaires : idem . bronchites chroniques : 120 000 . bronchites aigües : idem |
- Coûts considérés : dépenses remboursées par l’assurance-maladie (AM) et maladies professionnelles liées à la pollution de l’air . Coût pour l’AM : 490 à 1 442 M€ (en 2012) . Coût des prestations versées au titre des maladies profes-sionnelles : 1 Md€/an (sur la période 2004-2013) | ||||
Valeur basse |
Valeur haute |
Valeur basse |
Valeur haute | |||
BPCO |
26 800 |
40 200 |
BPCO |
49 700 |
72 000 | |
Cancers voies basses |
1 608 |
4 020 |
Cancers voies basses |
idem |
idem | |
Cancers voies hautes |
76 |
380 |
Cancers voies hautes |
idem |
idem | |
- Coûts considérés : consultations, traitements, hospitalisations, indemnités journalières en cas d’arrêt de travail |
Coûts considérés : idem | |||||
- Coût total : 886 à 1 817 M€/an |
Coût total : 1 à 2 Md€/an | |||||
Nota : Les chiffres concernant le nombre de bronchites chroniques et de BPCO sont soulignés pour mettre en évidence les différences de comptage entre l’étude des chercheurs de l’EPAR et celle du Commissariat général au développement durable.
b. Une approche qui, pour l’heure, n’est pas exempte de sérieuses limites méthodologiques
Cette méthode d’évaluation, qui se veut plus rigoureuse car elle s’appuie sur des coûts réels, présente cependant plusieurs limites :
– les résultats obtenus sont des estimations a minima qui ne tiennent pas compte de certains coûts, faute de données disponibles. Plus précisément, les coûts unitaires par cas sont sous-estimés, et ce pour trois raisons :
• premièrement, « certains coûts annexes ne sont pas pris en compte ou mal identifiés dans la comptabilité du système de soins », comme le coût des transports sanitaires – les données de la CNAMTS relatives à ces dépenses ne sont pas identifiées par maladie –, celui des radios de contrôle ou échographies cardiaques prescrites par l’hôpital mais réalisées en cabinet de ville ou celui des aides à la fin de vie (allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie). En outre, même lorsque les données existent, celles-ci sont « très parcellaires, hétérogènes (…) et se réfèrent à des années différentes » ;
• deuxièmement, certains coûts devraient être calculés non seulement en tenant compte des nouveaux cas déclarés ou des malades admis en affection longue durée en cours d’année, mais aussi en fonction des durées et des évolutions des pathologies, une opération que les chercheurs ne sont pas en mesure d’effectuer. À titre d’illustration, il n’est pas possible d’additionner les récidives de cancers aux coûts annuels des nouveaux cas ou de connaître la dépense induite par les maladies évolutives ou chroniques, comme les bronchites ;
• troisièmement, encore aujourd’hui, certains coûts estimés dans les études, comme par exemple celui de l’asthme, prêtent à débat (49) ;
– d’autres inconnues subsistent, comme le coût réel des indemnités journalières des malades en cas d’arrêt de travail. En effet, les calculs incluant la valeur moyenne d’une journée d’arrêt retenue par le Commissariat général au développement durable et les chercheurs de l’INSERM, soit 48,43 euros, sont « surévalués pour les personnes au SMIC, moins surévalués pour les personnes gagnant moins de deux fois le SMIC (souvent affiliés à une mutuelle ou assurance complémentaire) et sous-évalués pour les personnes gagnant au moins deux fois le SMIC (dont les ressources permettent l’accès aux assurances complémentaires et mutuelles) » (50) ;
– enfin, le nombre de cas attribuables à la pollution – la fraction attribuable à la pollution ou FAE – a été évalué selon deux méthodes : à partir d’études scientifiques, comme pour l’asthme et le cancer, et de calculs effectués par les auteurs des études pour les autres maladies. Dans ce second cas de figure, les chercheurs ont procédé de manière assez empirique. À titre d’illustration, dans l’étude du CGDD, le nombre de broncho-pneumopathies obstructives chroniques attribuables à l’environnement a d’abord été estimé pour déduire ensuite le nombre de cas de bronchites chroniques.
Au total, le « manque notable de données sur les coûts ventilés par maladie, par âge ou encore par gravité de maladie » conduit les chercheurs de l’EPAR à estimer qu’une telle « “photographie” annuelle des coûts pour le système de soin français est imparfaite et globalement très sous-estimée » (51).
C. DES CONNAISSANCES ÉPIDÉMIOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES QUI DOIVENT ÊTRE APPROFONDIES
Les développements qui précèdent mettent en évidence un besoin réel de connaissances supplémentaires dans les domaines épidémiologique, économique et financier pour mieux connaître le coût de la pollution de l’air et évaluer ainsi, de manière plus fine, l’efficience des politiques de lutte contre cette pollution.
L’absence de programme de recherche consacré au coût de la pollution
Il n’existe pas de programme de recherche français spécifiquement dédié à l’évaluation du coût de la pollution de l’air. Ce thème n’est que l’une des composantes de projets de recherche plus larges. Il est donc difficile d’identifier les montants totaux spécifiquement mobilisés par les ministères concernés ou leurs opérateurs sur cette thématique.
Ainsi, dans le cadre du programme PRIMEQUAL (programme de recherche inter-organismes pour une meilleure qualité de l’air à l’échelle locale), co-piloté par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), qui le finance à hauteur de 600 000 euros, et le ministère de l’écologie et dédié à la qualité de l’air, des travaux de recherche sont en cours pour évaluer les coûts et les bénéfices sanitaires liés à la mise en place de mesures de politiques publiques (par exemple, analyse coût-bénéfice de la mise en place de zones de restriction de circulation en Île-de-France).
Un autre exemple est le projet d’évaluation des stratégies de lutte contre la pollution de l’air à longue distance dans le contexte du changement climatique financé par l’ADEME pour 250 000 euros et qui travaille sur les bénéfices associés à la réduction du coût sanitaire par la mise en œuvre des stratégies d’atténuation du changement climatique.
En outre, des projets de recherches qui ne ciblent pas l’évaluation socio-économique de la pollution de l’air – et des mesures visant à la réduire – contribuent à l’amélioration globale des connaissances. C’est le cas, par exemple, des projets du programme de recherche PRIMEQUAL qui apportent des informations ou développent des outils permettant de renseigner les différentes étapes nécessaires à cette évaluation : mesure et/ou modélisation des émissions et des concentrations de polluants, exposition des individus à la pollution de l’air, etc.
Ces projets sont beaucoup plus nombreux que ceux qui se focalisent sur l’évaluation socio-économique proprement dite.
À côté des financements réalisés dans le cadre de PRIMEQUAL, le ministère de l’écologie finance aussi des organismes qui étudient la problématique de la recherche sur la qualité de l’air. C’est dans ce cadre que l’ANSES et l’ADEME ont soutenu financièrement le projet européen ACCEPTED (Assessment of changing conditions, environmental policies, time activities, exposure and disease) à hauteur de 1,2 million d’euros. Lancé en 2012, celui-ci a pour but d’améliorer les connaissances en matière d’expositions futures à la pollution de l’air, en lien avec le changement climatique.
Source : réponse du Commissariat général au développement durable au questionnaire des rapporteurs.
Dans le domaine épidémiologique, des recherches devraient être menées pour identifier et comptabiliser l’ensemble des décès et des maladies provoqués ou aggravés par la pollution de l’air, ce qui suppose, au préalable, d’améliorer la fiabilité, la régularité et l’exhaustivité des données disponibles. Il y a là, comme l’ont laissé entendre les chercheurs entendus par les rapporteurs, tout un « nouveau monde » à cartographier, pour mettre en évidence, par exemple, les liens entre pollution de l’air et diabète ou retards de croissance intra-utérins (52).
Dans ce but, les études de séries temporelles et de cohortes devraient être développées pour quantifier, avec le plus de précision possible, les effets sanitaires de cette pollution. Certaines des enquêtes d’ores et déjà effectuées dans notre pays pourraient ainsi inclure cette dimension, comme l’ « enquête santé et protection sociale » (ESPS) menée par l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES), qui constitue une référence en matière de santé de la population générale. Conduite tous les deux ans, elle recueille, depuis 1988, des données sur l’état de santé, la situation sociale et le recours aux soins d’un échantillon de 8 000 ménages ordinaires, soit 22 000 personnes, ce qui fait qu’elle est représentative d’environ 97 % de la population de la France métropolitaine.
Dans le domaine économique et financier, le chiffrage du coût de la prise en charge de ces maladies pour le système de soins pourrait être affiné de deux manières. D’une part, afin de calculer un total plus fiable, un échantillonnage de ce coût par pathologie liée à la pollution de l’air pourrait être établi en s’appuyant sur les données recueillies par le système national d’information inter-régimes de l’assurance maladie (SNIIRAM), qui permettent de déterminer les coûts associés par type de maladie. D’autre part, les dépenses des mutuelles, relatives au remboursement des frais non pris en charge par la sécurité sociale, devraient être intégrées dans ce total.
Dans l’enquête réalisée à la demande du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, la Cour des comptes, après avoir noté la fragilité des moyens consacrés aux recherches sur le coût de la pollution de l’air, a estimé, au vu de la pluralité des intervenants, qu’il « serait utile de renforcer la coordination des études socio-économiques et d’améliorer la mutualisation des compétences et des méthodes de travail » (53).
C’est pourquoi, pour mener à bien ces travaux et, d’une manière générale, exercer une veille scientifique sur les coûts – tangibles et intangibles – de la pollution de l’air, une structure de recherche interdisciplinaire, financée par un appel à projets de l’Agence nationale pour la recherche (ANR), pourrait être créée. Elle devrait travailler en réseau avec les organismes comparables des autres pays européens, l’OCDE et l’OMS, et publier, de manière régulière, des chiffrages consolidés.
Par ailleurs, ces données épidémiologiques et économiques devraient être croisées avec celles des admissions aux urgences des hôpitaux des territoires connaissant des pics ou des épisodes saisonniers de pollution. Un lien pourrait être ainsi établi entre niveaux élevés de pollution et surcroît d’activités hospitalières impliquant, le cas échéant, la mobilisation de moyens supplémentaires pour assurer la prise en charge des personnes dont les pathologies sont provoquées ou aggravées par ces phénomènes d’exposition.
Ce volant d’activité susceptible d’être relié à la pollution de l’air pourrait alors trouver sa traduction dans le « projet médical partagé » des établissements publics de santé participant aux groupements hospitaliers de territoire (GHT). Prévues par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, ces nouvelles structures visent, en effet, à garantir une offre de proximité en permettant une mutualisation des services médico-techniques (article L. 6132-1 du code de la santé publique).
Ce travail de recoupement des données devrait être effectué, en priorité, dans les GHT des agglomérations densément peuplées (plus de 250 000 habitants) et des zones où les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées ou risquent de l’être, soit les deux types de territoires couverts par des plans de protection de l’atmosphère (PPA).
Proposition n° 2 : mieux connaître les conséquences de pollution de l’air :
– créer une structure de recherche interdisciplinaire sur les coûts tangibles et intangibles de la pollution de l’air financée par un appel à projets de l’Agence nationale pour la recherche (ANR) ;
– inclure un volet « qualité de l’air » dans le projet médical partagé des groupements hospitaliers de territoire (GHT) situés dans une zone couverte par un plan de protection de l’atmosphère (PPA).
II. LA NÉCESSITÉ DE RENFORCER LE PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L’AIR
La politique en faveur de la qualité de l’air est une politique publique inaboutie, qui pâtit de nombreuses limites, qu’il s’agisse d’incohérences avec d’autres priorités nationales – comme la lutte contre le changement climatique –, de la complexité de la gouvernance, aux niveaux national et local, et de la gestion imparfaite des pics de pollution.
A. LES ACTIONS MENÉES SONT PARTIELLES ET PEU STRUCTURÉES
Les actions en faveur de la qualité de l’air souffrent d’importants défauts de conception et d’exécution. La Cour des comptes estime, en conséquence, que cette politique publique n’est pas encore stabilisée (54).
1. La lutte contre le réchauffement climatique et l’amélioration de la qualité de l’air sont insuffisamment articulées
La confusion est trop souvent entretenue entre l’objectif de lutte contre la pollution atmosphérique et la lutte contre le changement climatique. Elle masque des contradictions entre ces deux politiques, qui ne sont pas assez harmonisées, alors qu’elles devraient être mises au service d’une stratégie de développement durable cohérente : la main gauche de la transition écologique ne devrait pas ignorer ce que fait sa main droite. En outre, ce défaut d’articulation réduit l’efficacité des actions en faveur de la qualité de l’air.
La pollution de l’air et le changement climatique interagissent l’une avec l’autre pour plusieurs raisons, que l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a récemment rappelées (55) :
– les activités humaines sont responsables des émissions de polluants de l’air, comme de gaz à effet de serre (GES). Ainsi le secteur résidentiel–tertiaire, qui était, en 2013, le premier émetteur de particules PM2,5 (49 %) représentait aussi 24 % des émissions de CO2 ; le secteur des transports routiers émettait, quant à lui, 54 % des émissions d’oxydes d’azote et 34 % des émissions de CO2 ;
– l’évolution des concentrations de polluants est liée aux conditions climatiques. Par exemple, les conditions anticycloniques favorisent la stagnation des polluants dans les basses couches de l’atmosphère, tandis que les vents les transportent sur de grandes distances, provoquant ainsi la pollution atmosphérique transfrontière. À l’inverse, le changement climatique influe sur la pollution : selon l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS), dans une grande partie de l’Europe, cette « pénalité climatique » augmenterait en moyenne, l’été, les concentrations en ozone de 2 à 3 microgrammes par mètre cube (µg/m3), une hausse qui pourrait même atteindre 10 µg/m3 en Europe centrale et du Sud (56) ;
– enfin, comme le montre la figure ci-dessous, une partie des polluants, notamment l’ozone et les particules, ont un impact climatique.
LA NÉCESSITÉ D’ABORDER CONJOINTEMENT QUALITÉ DE L’AIR
ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
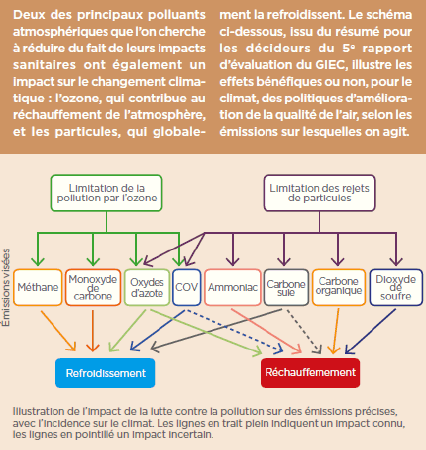
Source : ADEME.
b. Des outils cloisonnés, voire contradictoires
Alors qu’elles devraient faire l’objet d’une approche intégrée, la lutte contre la pollution de l’air, celle contre le changement climatique et la politique énergétique reposent sur des instruments qui ne sont pas toujours compatibles ou correctement articulés.
• La DGEC : une direction générale « air » dont la dénomination ne fait référence qu’à l’énergie et au climat
Sur le plan administratif, une constatation s’impose : la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), qui est en charge de la qualité de l’air au ministère de l’environnement, ne fait pas apparaître cet objectif dans son intitulé.
Cette direction a pourtant été créée en 2008, l’année de l’adoption de la directive n° 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur en Europe, qui fixe, en la matière, les grands objectifs à atteindre.
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui a consacré, comme on le verra plus loin, le triptyque climat-air-énergie, n’a pas incité, non plus, l’administration centrale à modifier le nom de la DGEC pour s’y référer. Pour certains, ce décalage n’est que symbolique – il n’emporte pas de conséquences pratiques sur la place qu’occupe, au sein du ministère, la politique en faveur de la qualité de l’air –, même s’il est malvenu.
Pour d’autres, en revanche, l’absence de mention explicite du volet « air » n’a pas que des effets purement sémantiques. Cette problématique était auparavant traitée, au sein du ministère, par la direction générale de la prévention des risques, ce qui était logique au vu des impacts environnementaux et sanitaires de la pollution – qu’il faut prévenir ou atténuer – ; elle était alors clairement identifiée. À l’inverse, le rattachement de cette thématique à la DGEC a eu pour résultat, du moins dans un premier temps, que les enjeux liés au climat l’ont emporté sur ceux de la qualité de l’air.
• La qualité de l’air : un objectif qui peut être de second rang face aux enjeux énergétiques et climatiques
Sur le plan du contenu des politiques, l’enquête de la Cour des comptes a mis en lumière les effets ambivalents des politiques de l’énergie et du climat sur la lutte contre la pollution atmosphérique.
À titre d’illustration, l’incitation à utiliser la biomasse – une source d’énergie renouvelable, considérée comme neutre du point de vue des gaz à effet de serre – et le chauffage au bois contribuent, localement, lorsque les appareils sont anciens, à la surémission de particules fines.
Les incohérences les plus manifestes concernent cependant les aides au secteur routier et la fiscalité des carburants (57), où les mesures prises pour réduire les gaz à effet de serre, dont le dioxyde de carbone (CO2), ont eu un impact négatif sur la qualité de l’air :
– ainsi, les aides au renouvellement du parc automobile ont, au départ, orienté les achats vers les véhicules diesel, considérés comme moins émetteurs de CO2, alors que ceux-ci rejettent des polluants dans l’atmosphère ;
– de même, la fiscalité favorable au gazole, qui contribue à soutenir les motorisations diesel, a des effets contreproductifs sur la qualité de l’air. Or cet arbitrage en faveur du diesel est largement partagé en Europe, en partie pour des raisons d’efficacité environnementale : l’IFP Énergies nouvelles (ex-Institut français du pétrole) relève, à cet égard, que l’augmentation de la part des moteurs diesel dans le parc automobile européen « s’est vite imposée comme une solution très séduisante pour atteindre rapidement les objectifs fixés par la réglementation sur le CO2 » (58).
• La loi de transition énergétique : un texte qui n’articule pas de façon formelle les politiques du climat, de l’énergie et de la qualité de l’air
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte permettra-t-elle de surmonter ces contradictions ?
Selon la direction générale de l’énergie et du climat, ce texte vise à donner de la cohérence aux politiques publiques qui peuvent avoir un impact sur la qualité de l’air. Mais il le fait en consacrant quatre instruments, qui constituent autant de « briques », car aucune ne s’articule avec les trois autres :
– le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA), défini à l’article L. 222-9 du code de l’environnement ;
– la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dite « stratégie bas–carbone », prévue par l’article L. 222-1 B du même code. Elle a été fixée par le décret n° 2014-1491 du 18 novembre 2015 et complète le plan national d’adaptation climatique prévu par l’article 42 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ;
– la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), définie à l’article L. 141-3 du code de l’énergie ;
– la stratégie pour le développement de la mobilité propre, prévue par l’article 40 de la loi du 17 août 2015 et dont le document d’initialisation a été présenté le 9 décembre 2015.
La loi relative à la transition énergétique reconnaît, certes, des duos, voire des trios de politiques publiques, sans associer toutefois, de manière explicite, la lutte contre le changement climatique et celle contre la pollution de l’air ni donner un contenu précis au triptyque « climat-air-énergie ».
Ainsi, la stratégie pour le développement de la mobilité propre constitue, selon la loi du 17 août 2015, un « volet annexé » de la programmation pluriannuelle de l’énergie, qui est elle-même « compatible » avec la stratégie bas-carbone. La loi précise par ailleurs que la politique énergétique préserve la santé humaine et l’environnement « en réduisant l’exposition des citoyens à la pollution de l’air » (article L. 100-1 du code de l’énergie) et contribue « à l’atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique » prévus par le PREPA (article L. 100-4 du même code).
Aussi bienvenues soient–elles, ces dispositions de principe, qui restent à traduire dans les faits, n’imposent donc pas de définir et de mettre en œuvre une politique « climat-air-énergie » intégrée.
La stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable (SNTEDD) adoptée en conseil des ministres le 4 février 2015, qui est présentée, par le Gouvernement, comme le cadre d’action le plus englobant qui soit en matière environnementale, aurait pu esquisser un rapprochement des objectifs et des outils de ces trois enjeux. Mais celle-ci se contente d’indiquer qu’il revient aux acteurs locaux d’y veiller, en précisant que le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques s’appuiera sur des outils de planification régionaux ou intercommunaux, tels que les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et les plans de protection de l’atmosphère (PPA), « pour la mise en œuvre efficace d’une politique intégrée climat-air-énergie ».
Autrement dit, ce document d’orientation renvoie aux préfets et aux collectivités territoriales, les maîtres d’œuvre des SRCAE et des PPA, le soin de définir, par leurs propres moyens, un « processus de convergence » des politiques énergétiques, climatiques et de qualité de l’air dont les règles n’ont pas été fixées par l’État.
Introduits par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle II), les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) visent à fournir un cadre cohérent pour les politiques et les actions dans les domaines climatiques, énergétiques et de la qualité de l’air.
Cependant, les SRCAE évalués par le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) en 2013 étaient encore loin du compte : en effet, l’élaboration de ces schémas a fait apparaître que « l’organisation des administrations et des structures locales n’était pas adaptée à une approche intégrée des trois enjeux, climat, air et énergie ». Ce défaut de transversalité entraîne deux conséquences. D’une part, on trouve « rarement un organigramme qui permette d’accueillir et de gérer ensemble les trois blocs “climat/air/énergie” ». D’autre part, les contenus des schémas « mettent davantage en évidence une juxtaposition des déclinaisons régionales propres à chacun des trois thèmes qu’ils ne s’attachent à montrer qu’ils sont interconnectés : par exemple, il est rarement souligné que l’étalement urbain a des conséquences sur l’énergie nécessaire pour le chauffage et pour les transports, lesquelles se traduisent par une détérioration de la qualité de l’air. Construire une approche réellement transversale qui ne soit pas un simple empilement d’orientations thématiques (climat, air, énergie, transports, bâtiments, agriculture, etc.) reste donc un exercice peu familier » (59).
Ces insuffisances locales ne font que refléter celles observées au niveau national pour définir et mettre en œuvre le triptyque « climat-air-énergie ».
2. La gouvernance des politiques anti-pollution est complexe et instable
La gouvernance des politiques de lutte contre la pollution de l’air présente quatre lacunes majeures : l’absence de cadre d’action clair et défini de manière interministérielle, la prolifération des outils de planification locaux, la remise en cause fréquente du principe de subsidiarité et l’absence d’évaluation des mesures mises en œuvre.
a. Une action ministérielle discontinue
• Un cadre interministériel inexistant
La politique en faveur de la qualité de l’air est complexe car elle est, par définition, multifactorielle : elle doit traiter l’ensemble des pollutions, y compris les plus diffuses, auxquelles contribuent tous les secteurs d’activité. Elle doit agir, en outre, à tous les niveaux, ce qui implique de très nombreux acteurs.
C’est la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) du ministère de l’environnement qui joue, en principe, le rôle de « chef de file » des politiques publiques de lutte contre la pollution de l’air. En réalité, l’association des autres ministères compétents (industrie, transports, intérieur, agriculture, santé et finances) à l’élaboration et à la mise en œuvre des différentes actions est plus ou moins étroite.
Ainsi, les principaux outils d’amélioration de la qualité de l’air au niveau local – les plans de protection de l’atmosphère (PPA) – sont préparés et arrêtés par les préfets, mais ni le ministère de l’intérieur ni la DGEC n’organisent un retour d’expérience national sur la mise en œuvre des mesures adoptées.
La Cour des comptes a observé, de son côté, que le ministère de la santé est – paradoxalement – en retrait dans l’élaboration de la politique en faveur de la qualité de l’air, alors même qu’il est chargé de la définition des plans nationaux santé-environnement (PNSE), qui comportent des actions anti-pollution, comme le troisième PNSE, qui couvre la période 2015-2019 et affiche un objectif de réduction des émissions liées aux secteurs résidentiel et agricole.
Par ailleurs, la DGEC n’est pas compétente pour traiter de la qualité de l’air intérieur – celui-ci pouvant être beaucoup plus pollué que l’air extérieur –, car cette problématique est du ressort de la direction générale de la prévention des risques (DGPR) du ministère de l’environnement, dont le métier « historique » est la surveillance et la prévention de la pollution industrielle.
Le rôle d’impulsion et de coordination de la DGEC s’inscrit donc dans une « gouvernance » particulièrement complexe.
Certes, en soi, la multiplicité des acteurs ne constitue pas, comme le souligne la Cour des comptes, un problème, mais elle le devient quand elle n’est pas corrigée par un cadre d’action défini de manière interministérielle. Il est symptomatique, à cet égard, que le comité interministériel de la qualité de l’air (CIQA), qui n’a été mis en place qu’en septembre 2012, ne se soit pas souvent réuni, puisque ses membres se sont rencontrés, pour la dernière fois, en décembre… 2013. Interrogée sur ce sujet, la DGEC a indiqué que l’extinction – rapide – de cette structure résulte du fait qu’elle était seulement chargée de l’élaboration et du suivi du plan d’urgence de la qualité de l’air (PUQA) de 2013, dont les 38 mesures ont été engagées : le CIQA n’était donc qu’un comité à durée déterminée.
• Des plans nationaux adoptés selon un calendrier heurté
La politique de lutte contre la pollution de l’air devrait s’inscrire dans le long terme. Plusieurs plans successifs ont été pourtant adoptés au niveau national, et de manière rapide, une démarche qui ne peut qu’être dommageable à l’efficacité des mesures visant à améliorer la qualité de l’air.
La transposition de la directive 2001/81/CE sur les plafonds d’émission, dite directive NEC, a conduit à mettre en place un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA) en 2003, qui couvrait une période de cinq ans (2005-2010).
La publication du nouveau plan ayant pris un retard considérable – au point que l’échéance fixée par la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable, soit une publication prévue, au plus tard, le 31 décembre 2015, n’a pas été respectée – des mesures ont été prises, entre-temps, dans le cadre des plans nationaux santé environnement (PNSE). Parallèlement, ont été adoptés, pour répondre aux injonctions européennes, le plan particules en juillet 2010 et le plan d’urgence pour la qualité de l’air (PUQA) en février 2013. Il convient d’y ajouter le plan d’actions sur la qualité de l’air intérieur de juin 2013 et, tout dernièrement, le plan d’action pour la qualité de l’air présenté le 2 juin 2015 par la ministre de l’environnement, Mme Ségolène Royal.
Une valse de plans anti–pollution à cinq temps depuis 2003
– Programme national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA 1) de juillet 2003 : 29 mesures
– Plan particules de juillet 2010 : 44 mesures
– Plan d’actions pour la qualité de l’air intérieur (PQAI) de juin 2013 : 26 actions
– Plan d’urgence pour la qualité de l’air (PUQA) de juillet 2013 : 38 mesures
– Plan d’action pour la qualité de l’air de juin 2015 : 2 mesures (certificats « qualité de l’air » pour les voitures et appel à projets « villes respirables en cinq ans »)
La Cour estime que cet enchaînement irrégulier de plans a été dicté « au moins autant par le risque de contentieux européen que par l’objectif d’établir une stratégie nationale visant à unifier les politiques de lutte contre la pollution de l’air » (60).
En outre, ce calendrier heurté a eu un impact négatif sur la transposition locale des mesures décidées au niveau national. À titre d’illustration, les plans de protection de l’atmosphère (PPA) ont été révisés pour supprimer des mesures prévues par le plan particules de 2010 puis abandonnés par le PUQA de 2013, une partie des travaux réalisés par les collectivités territoriales ayant ainsi été effectués en vain…
Il faut donc espérer que le prochain plan de réduction des polluants atmosphériques, le PREPA 2, qui constitue la stratégie du Gouvernement pour la période 2016-2020 et doit être publié au plus tard le 30 juin 2016 en vertu de l’article 64 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, mettra de l’ordre – et de la constance – dans la conduite, à tous les échelons, des actions en faveur de la qualité de l’air.
Cette loi a précisé, à cet effet, que deux outils de planification locaux – les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et les plans de protection de l’atmosphère (PPA) – doivent prendre en compte les objectifs et les actions du plan national (article L. 229-2 du code de l’environnement).
b. Une planification locale foisonnante et inaboutie
Compte tenu de la dimension essentiellement locale des problèmes à traiter, les collectivités territoriales sont fortement impliquées dans la définition et la mise en œuvre des politiques de lutte contre la pollution de l’air.
L’efficacité de leur intervention est toutefois limitée par deux facteurs : une planification encombrée et insuffisamment cohérente et la place trop faible occupée, sur l’ensemble du territoire, par les outils les plus efficaces, les plans de protection de l’atmosphère (PPA).
• Des outils nombreux, à l’articulation complexe
Outre les PPA, arrêtés par les préfets de département et qui déterminent, au niveau de certaines intercommunalités, des mesures de réduction des polluants atmosphériques (61), il convient de citer :
– les plans climat énergie territoriaux (PCET), au nombre de 488 selon le centre de ressources de l’ADEME (62). La loi dite Grenelle II de 2010 les a rendus obligatoires dans toutes les collectivités, quel que soit leur statut (communes, communautés de communes ou d’agglomérations, départements ou régions), de plus de 50 000 habitants. L’article 188 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a abrogé ces dispositions pour prévoir qu’un tel plan doit être adopté par tous les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants au plus tard le 31 décembre 2016 et par tous les EPCI de plus 20 000 habitants au plus tard le 31 décembre 2018. Ce texte a en outre transformé ces outils, qui ne traitaient que des gaz à effet de serre, en plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) ;
– les schémas régionaux climat-air-énergie (SRCAE), qui sont co-élaborés par les préfets de région et les conseils généraux. Ils contiennent des orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en contenir les effets.
Ainsi s’est mise en place, dans les territoires, une planification à plusieurs bandes, ce qui est une source de complexité : à l’échelle régionale, avec les SRCAE, et, à l’échelle intercommunale, avec deux types d’acteurs : les EPCI s’agissant des PCAET et les préfets de département s’agissant des PPA.
En outre, la mise en cohérence de ces outils – PPA, PCAET et SRCAE –, entre eux et avec les planifications sectorielles (logement, transports, etc.), n’est pas assurée : en effet, comme l’ont observé les trois corps d’inspection ayant établi un rapport sur la gestion des pics de pollution, « les conditions d’élaboration et les régimes juridiques de ces différents documents ne garantissent pas leur bonne articulation » (63).
Il convient de rappeler, à cet égard, que :
– s’agissant des PCAET, ils doivent être compatibles avec les orientations et les objectifs de SRCAE déjà adoptés. Ils doivent en outre être pris en compte par les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les plans locaux d’urbanisme (PLU), mais ceux-ci peuvent y déroger pour un motif justifié ;
– les SRCAE, quant à eux, comportent des orientations avec lesquelles les PPA et les plans de déplacements urbains (PDU) doivent être compatibles. Les documents d’urbanisme doivent, en outre, prendre en compte ces schémas. Cependant, cette notion de « prise en compte », qui est trop faible pour que l’urbanisme et les thématiques climat-air-énergie soient perçus de manière conjointe, a conduit un corps d’inspection, le Conseil général de l’environnement et du développement durable, à considérer que le « renvoi à l’urbanisme est un des rendez-vous manqués des SRCAE » (64) ;
– les PPA ne sont pas opposables aux documents d’urbanisme (SCoT et PLU).
Comme l’ont souligné les corps d’inspection, il résulte de cet ensemble de planifications un « paysage juridique touffu, constitué par strates successives » (65), qui ne peut parvenir à établir une solidarité fonctionnelle entre l’aménagement des villes et des territoires, d’une part, et les enjeux climat-air-énergie, d’autre part.
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi « NOTRe ») pourrait toutefois changer la donne. En effet, ce texte crée des schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT), qui ont un périmètre large (aménagement du territoire, mobilités, lutte contre la pollution de l’air, maîtrise et valorisation de l’énergie, logement et gestion des déchets) et qui ont vocation à absorber les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie. Surtout, ces nouveaux schémas ont une portée prescriptive, dans la mesure où les documents d’urbanisme (SCoT, PLU, PDU) et les plans climat-air-énergie territoriaux doivent les respecter (article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales).
Les SRADDT pourraient donc jouer, vis-à-vis des différents outils de planification, un rôle « intégrateur ». Leur mise en application demandera, par conséquent, beaucoup d’opiniâtreté, de pédagogie et donc de temps.
LA PLANIFICATION TERRITORIALE DES POLITIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L’AIR EN 2014
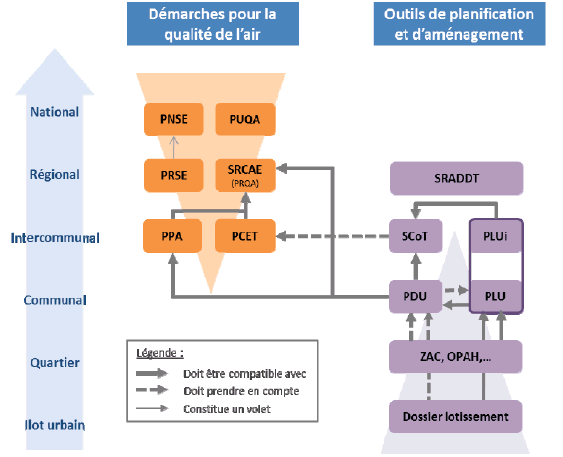
Source : ADEME, Qualité de l’air : orientations stratégiques 2015-2020, juin 2015, p. 11.
• Un déploiement limité des outils les plus efficaces, les PPA
Selon la Cour des comptes, les plans de protection de l’atmosphère (PPA), « seuls outils dédiés à la qualité de l’air », sont des « déclinaisons et compléments indispensables des dispositifs nationaux » et « permettent de prendre des mesures au plus près du terrain » (66).
Ces documents, adoptés par les préfets de département, sont obligatoires dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où les normes de qualité de l’air « ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être » (article L. 222-4 du code de l’environnement).
Ils ont pour objet de ramener, dans un délai qu’ils fixent, la concentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites fixées par la réglementation et comportent, à cet effet, des mesures concernant, notamment, le fonctionnement et l’exploitation de certaines catégories d’installations, l’usage des carburants ou des combustibles, les conditions d’utilisation des véhicules et l’augmentation de la fréquence des contrôles des émissions des installations (article L. 222-5 du code de l’environnement).
Le mode opératoire des PPA
Les PPA sont préparés par les services compétents de l’État – direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE) en Île-de-France – puis soumis, avant d’être adoptés, à une phase de consultation avec toutes les collectivités territoriales concernées, à laquelle succède une phase d’enquête publique.
Ils proposent un volet de mesures reglementaires mises en oeuvre par arrêtés préfectoraux, ainsi qu’un volet de mesures volontaires définies, concertées et portées, dans les domaines qui les concernent, par les collectivites territoriales et les acteurs locaux (professionnels) concernés.
Les préfets peuvent prendre, dans ce cadre, deux types de mesures :
– des mesures de police prises au titre des régimes de police administrative préexistants : police des installations classées (ICPE) ou police administrative générale (règles relatives à la circulation, à la santé publique, etc.) ;
– des mesures de police administrative spécifiques aux PPA, prévues par les articles R. 222-33 à R. 222-35 du code de l’environnement, qui concernent en particulier les installations fixes de combustion et le contrôle technique des véhicules.
À titre d’illustration, le PPA révisé de la région Île-de-France de mars 2013 comprend onze mesures réglementaires dont : l’obligation pour 300 établissements franciliens de mettre en place un plan de déplacement visant à optimiser les trajets de leurs salariés ; le renforcement des valeurs limites d’émissions pour les chaudières collectives ; l’interdiction des épandages par pulvérisation en cas de vent ; la limitation de l’utilisation des moteurs auxiliaires de puissance pour les plates-formes aéroportuaires, etc.
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a élargi la palette des mesures pouvant être prises, au titre des PPA, par les autorités compétentes en matière de police, en précisant qu’elles peuvent être « préventives, d’application temporaire ou permanente » et prescrire la réduction des vitesses maximales autorisées (article L. 222-6 du code de l’environnement).
Pour la Cour des comptes, l’intérêt des PPA réside dans leur capacité à édicter des mesures réglementaires ou incitatives adaptées, la prise en compte, par ces plans, de l’environnement local ayant été observée dans tous ceux qui ont été analysés pour les besoins de l’enquête.
En outre, la prise en compte de la qualité de l’air est plus précise dans les territoires couverts par un PPA que dans les autres. L’article 188 de la loi du 17 août 2015 a en effet prévu que, lorsque tout ou partie du territoire qui fait l’objet d’un plan climat-air-énergie territorial est inclus dans un PPA, le premier outil doit être compatible avec les objectifs fixés par le second.
Pourtant, en dépit de leur caractère opérationnel et de leur adaptabilité, les PPA, au nombre de 35 seulement, dont 32 signés et 3 en cours d’élaboration, ne couvraient, en avril 2016, que 47 % de la population (67).
La Cour des comptes a observé qu’il existe de véritables « zones blanches », l’absence de plan dans de nombreuses agglomérations constituant, selon elle, un indicateur de « la réticence de certains responsables à s’engager sur des mesures de lutte contre la pollution de l’air » : aucun PPA n’est en vigueur en Bretagne (en dehors de celui couvrant la zone urbaine de Rennes), en Midi-Pyrénées (hors Toulouse) ou en Picardie. De même, des agglomérations comme Annecy ou Annemasse, qui font partie des zones en contentieux européen, ne sont pas non plus couvertes (68).
Il est vrai aussi que les crédits budgétaires alloués aux PPA, qui ont souvent servi à financer des études préalables, une étape généralement décisive pour convaincre et impliquer les acteurs locaux, ont baissé significativement ces dernières années, ce qui a sans doute freiné leur diffusion. La direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) indique que les crédits ouverts en loi de finances initiale pour ces plans sont passés de 3 millions d’euros en 2013, à 2,3 millions d’euros en 2014, puis à moins d’1,6 million d’euros en 2015 pour atteindre 1 million d’euros en 2016.
c. Des marges de manœuvre insuffisantes pour les acteurs de terrain
En matière de lutte contre la pollution de l’air, le principe de subsidiarité, qui consiste à réserver à l’échelon supérieur ce que l’échelon inférieur ne pourrait effectuer que de manière moins efficace, est souvent remis en cause.
En effet, d’après la Cour des comptes, « encore trop d’interventions au niveau national perturbent les mesures prises au plan local, par les préfets ou les collectivités » (69), ces interférences pouvant retarder ou limiter la mise en œuvre de dispositifs efficaces et provoquant, de ce fait, des tensions. En particulier, les autorités préfectorales, qui sont chargées de la mise en œuvre des mesures réglementaires prévues par les PPA, en période normale comme en cas de pic de pollution, ne maîtrisent pas toujours cet aspect des politiques en faveur de la qualité de l’air, en raison de décisions prises par les autorités nationales.
Cette difficile articulation entre échelons national et local s’est manifestée à l’occasion des deux exemples étudiés par la Cour : les interdictions ou limitations ciblées de la circulation et l’interdiction des feux de cheminée « ouverts » en Île-de-France.
Dans le premier cas, en Rhône-Alpes, l’arrêté interpréfectoral du 18 juillet 2014 permet d’interdire la circulation des poids-lourds en transit de plus de 7,5 tonnes les plus polluants (Euro I, II, III) dans les vallées de l’Arve, de la Maurienne, de la Tarentaise et dans les zones urbaines des pays de Savoie lors de certains pics de pollution. Ce texte, qui s’inscrit dans le cadre du PPA de la vallée de l’Arve, limite cette interdiction à 20 jours par an, quel que soit le nombre de jours de dépassement des seuils réglementaires de concentrations de polluants atmosphériques.
Dans le second cas, l’interdiction des feux de cheminée en foyer ouvert, qui est prévue par le PPA d’Île-de-France, a été abandonnée, en janvier 2015, à la demande de la ministre de l’écologie et sur le fondement d’un arrêté du préfet de région pris le 21 janvier. Cette mesure a été annulée par le tribunal administratif de Paris le 18 juin 2015, au motif que l’autorité préfectorale ne peut prendre des mesures incompatibles avec les objectifs d’un PPA.
Il convient de citer un autre cas « d’interférence », qui a concerné, une fois encore, le PPA de la région Île-de-France. L’élaboration de ce document a demandé trois ans, après quoi, deux ans après son entrée en vigueur, l’une de ses mesures phares, la création d’une zone de circulation à faible émission, a été abandonnée, en juillet 2012, faute d’adoption, au niveau national, d’un dispositif d’identification des véhicules les plus polluants. Un PPA révisé, en partie vidé de sa substance, a alors été adopté en mars 2013, dans l’attente de la publication, qui n’interviendra que cette année, du nouveau plan.
d. Des actions insuffisamment évaluées
L’enquête de la Cour des comptes montre, de manière frappante, qu’aucun bilan des actions engagées en faveur de la qualité de l’air n’a jamais été dressé, voire sérieusement chiffré :
Au niveau national, « les plans spécifiques à la qualité de l’air ne sont jamais évalués a posteriori, ni globalement ni par action » et seul un état d’avancement des différentes mesures est effectué. Les autorités politiques et administratives « se privent ainsi d’un outil indispensable pour savoir si les actions sont efficaces et efficientes » (70).
Au niveau local, il n’y a pas de suivi réel des SRCAE – certes, des indicateurs y figurent, mais rarement des échéanciers – de même qu’aucun PPA n’a été évalué a posteriori au regard de ses objectifs, alors que les dispositions qui encadrent ce type de plan prévoient que leur mise en œuvre fera l’objet d’un bilan annuel (article R. 222-29 du code de l’environnement) et d’une évaluation « au moins tous les cinq ans » (R. 222-30 du même code).
Deux mesures récentes pourraient toutefois mettre un terme à cette culture de la non-évaluation.
• En premier lieu, le prochain plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA 2) sera accompagné d’un tableau de bord interministériel qui, selon la direction générale de l’énergie et du climat, permettra de décliner, pour chaque mesure, l’acteur responsable, les moyens (humains, techniques et financiers) mis en œuvre, les livrables attendus et les indicateurs de suivi. La loi du 17 août 2015 sur la transition énergétique précise, en outre, que ce plan est réévalué tous les cinq ans et, si nécessaire, révisé (article L. 222-9 du code l’environnement).
Il y a lieu de noter que cette approche évaluative s’appliquera aussi à la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable (SNTEDD), dont l’un des indicateurs de suivi est l’indice de pollution de l’air en milieu urbain. Celui-ci ne reflétera toutefois que l’évolution des concentrations de quatre polluants (dioxyde de soufre, dioxyde d’azote, ozone et particules PM10), ce qui n’en fera pas un outil de mesure fin. En outre, ces niveaux de pollution seront mesurés, à l’échelle nationale, à partir d’un échantillon de stations fixes d’une année sur l’autre, ce qui ne permettra pas de se renseigner sur l’évolution des concentrations à proximité d’industries ou d’axes routiers (71).
• En second lieu, grâce à l’élan donné par le débat sur la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l’évaluation des PPA devrait – enfin – devenir une réalité. Cependant, les informations fournies par la DGEC laissent plutôt penser qu’il faut s’attendre à des progrès très modestes, du moins dans un premier temps. Les services du ministère de l’environnement indiquent que les préfets devront mettre en œuvre des « indicateurs adaptés à la situation locale », en précisant qu’« il est techniquement et financièrement difficilement envisageable de mettre en place systématiquement une évaluation ex-post de chacune des mesures mises en œuvre ». En outre, la loi du 17 août 2015 ne pose pas d’obligations très étendues dans ce domaine : les autorités compétentes en matière de police, qui arrêtent les mesures préventives destinées à atteindre les objectifs des PPA, peuvent en effet se contenter de communiquer, chaque année, au préfet du département « toute information utile sur les actions engagées contribuant à l’amélioration de la qualité de l’air » (article L. 222-6 du code de l’environnement).
3. La gestion des pics de pollution est inappropriée
La gestion des pics de pollution, qui est placée au centre du traitement médiatique des politiques de lutte contre la pollution de l’air, n’est pas toujours appropriée. Ce dispositif connaît des dysfonctionnements, voire des ratés, ce qui réduit d’autant l’impact des mesures prises pour limiter les effets, sur la population, de ces épisodes de pollution.
a. Une procédure complexe et peu lisible pour le grand public
• Un dispositif à deux étages peu compréhensible
Les épisodes de pollution – la terminologie retenue par le législateur – se réfèrent aux situations dans lesquelles les normes de qualité de l’air – définies, en droit interne, par un décret en Conseil d’État qui fixe, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), les niveaux de concentration à ne pas dépasser pour l’ozone (O3), le dioxyde d’azote (NO2), le dioxyde de soufre (SO2) et les particules PM10 – « ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être » (article L. 223-1 du code de l’environnement).
L’arrêté du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant précise, quant à lui, que ces « pics » sont caractérisés :
– soit à partir d’un critère de superficie, dès lors qu’une surface totale d’au moins 100 km2 est concernée par un dépassement des seuils d’ozone, de dioxyde d’azote et/ou de particules PM10 ;
– soit à partir d’un critère de population, lorsqu’au moins 10 % de la population du département (pour les départements de plus de 500 000 habitants) ou lorsqu’au moins 50 000 habitants du département (pour les départements de moins de 500 000 habitants) sont concernés par un dépassement d’un ou plusieurs de ces seuils.
Par ailleurs, la directive n° 2008/50/CE du 21 mai 2008, qui a défini les objectifs en matière de valeurs limites d’exposition aux différents polluants, a aussi fixé des seuils d’information et d’alerte pour la protection de la santé humaine et de l’environnement.
Elle a été transposée dans le code de l’environnement aux articles R. 221-1 à R. 221-3, une mesure qui a renforcé les règles prévues par la directive en instaurant des seuils d’information pour l’ozone, le dioxyde d’azote et les particules PM10, d’une part, et un seuil d’alerte pour ces particules, d’autre part (72).
Lorsque ces seuils sont atteints, les préfets déclenchent des actions, qui sont de nature différente selon qu’elles relèvent de la procédure d’information ou de la procédure d’alerte : les premières sont des recommandations, tandis que les secondes sont obligatoires.
SEUILS D’INFORMATION ET D’ALERTE POUR LES PARTICULES PM10,
LE DIOXYDE DE SOUFRE, LE DIOXYDE D’AZOTE ET L’OZONE
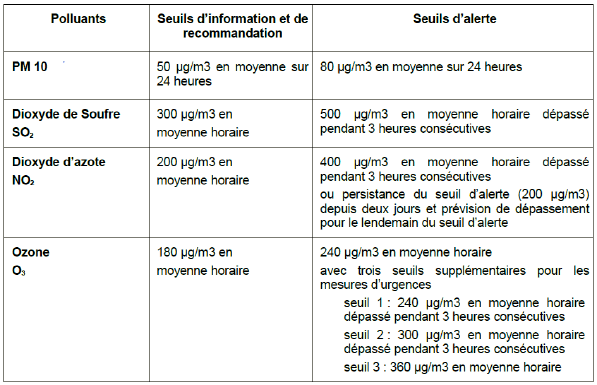
Source : Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et Inspection générale de l’administration (IGA), La gestion des pics de pollution de l’air, juillet 2015, p. 20.
Ce cadre d’action a été critiqué pour sa complexité tant par la Cour des comptes que par trois corps d’inspection, le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l’Inspection générale de l’administration (IGA) :
– selon la Cour, le maintien de deux seuils réglementaires n’est pas très clair pour le public, d’autant que les mesures recommandées au premier seuil ne deviennent pas forcément obligatoires en cas de dépassement du second. En outre, les deux seuils entraînent – en principe – des actions différentes mais « ce n’est pas toujours aussi simple » : ainsi, en cas d’alerte, des recommandations peuvent subsister alors que, dans les mêmes domaines, il est possible de mettre en place des mesures obligatoires (73) ;
– sur l’ensemble de la procédure et le « panel » des outils à disposition des préfets, les inspections générales ont estimé que « la complexité de l’empilement réglementaire et la longue liste des recommandations et des mesures possibles nuit à la lisibilité, à la compréhension et donc à l’efficacité de ces mesures » (74). À cet égard, le nouvel arrêté encadrant les procédures préfectorales, adopté le 7 avril 2016, constitue un progrès : il ne mentionne que 23 recommandations ou mesures réglementaires de réduction des émissions, sans distinguer entre celles qui relèvent de l’information ou de l’alerte, contre 27 recommandations et 23 mesures obligatoires pour l’arrêté précédent, adopté le 26 mars 2014.
Les seuils d’information et d’alerte
Pour les quatre polluants concernés, deux seuils sont définis :
– le seuil d’information-recommandation, au-delà duquel sont diffusées des informations auprès du grand public et des recommandations, notamment sanitaires ou qui visent à modifier certains comportements. Ces mesures ne sont ni obligatoires ni sanctionnables. Les recommandations sanitaires concernent principalement les populations vulnérables ou sensibles auxquelles il est conseillé d’éviter ou de réduire les activités physiques intenses. En matière de transports, les recommandations concernent le report des déplacements, le contournement de la zone pour le trafic de transit de poids-lourds, le recours aux modes actifs (marche à pied, vélo), etc. ;
– le seuil d’alerte, qui permet à l’autorité préfectorale de prendre des mesures obligatoires et prescriptives, comme la circulation alternée, les restrictions d’accès pour les poids-lourds ou le report de certaines activités émettrices de particules dans le secteur industriel. Il convient de noter que la mise en œuvre de ces mesures peut mobiliser d’importants effectifs de police : 16 937 en 2014 et 13 121 en 2015, en cumul annuel, pour les seules opérations concernant les transports en Île-de-France (circulation alternée, contournement par les poids-lourds, contrôles techniques, etc.).
Il est incontestable que le cheminement peu lisible de cette procédure – de l’information à la restriction – est une source de perplexité pour le grand public.
En outre, la nature même des enjeux en cause, en termes de protection de l’environnement et de la santé publique, et leur lien avec les seuils retenus, ne transparaissent pas vraiment dans les différentes étapes et mesures qui rythment la gestion des pics de pollution.
La mise en œuvre de ce dispositif se réduit donc, aux yeux de l’opinion publique, à un simple distinguo : les jours avec ou sans contraintes, qui n’incite guère les citoyens à se sentir, dans leur vie quotidienne, coresponsables des actions de lutte contre la pollution de l’air. Elle peut être, de surcroît, l’occasion de tensions politiques fortes : c’est notamment le cas en Île-de-France, autour de la question de la mise en œuvre de la circulation alternée, qui fait l’objet d’une couverture médiatique particulièrement soutenue et dont la Ville de Paris souhaite la mise en place automatique dès le premier jour de dépassement du seuil d’alerte.
• Des seuils contestés
Les seuils retenus sont parfois considérés comme étant trop élevés car ils laissent « passer » une pollution qui est, de ce fait, invisible. Ce reproche est surtout adressé aux seuils applicables à l’ozone et au dioxyde d’azote (NO2), lesquels sont rarement dépassés et ne déclenchent, par conséquent, qu’un petit nombre de procédures. À titre d’exemple, en 2012-2013, 85 des 93 dépassements enregistrés du seuil d’information en Île–de–France ont concerné les PM10. Dans le même temps, la procédure n’a été déclenchée pour le dioxyde d’azote que trois fois.
En outre, dans le cas du NO2, qui fait partie des oxydes d’azote (NOX), on peut même parler d’incohérence entre la valeur limite pour la protection de la santé humaine, qui est de 40 µg/m3 en moyenne annuelle civile, et le seuil d’alerte, qui est de 400 µg/m3.
Ces considérations ont conduit M. François de Rugy, dans une proposition de loi visant à l’automaticité du déclenchement des mesures d’urgence en cas de pics de pollution, examinée par l’Assemblée nationale le 14 janvier 2016, à prévoir le durcissement de certains seuils.
Cette initiative s’appuyait sur les propositions formulées par la commission d’enquête du Sénat sur le coût économique et financier de la pollution de l’air, qui a recommandé d’aligner progressivement les valeurs d’exposition européennes sur celles recommandées par l’OMS (75).
En conséquence, la proposition de loi prévoyait :
– pour l’ozone, de fixer à 120 µg/m3 – au lieu de 180 µg/m3 – le seuil d’information et à 160 µg/m3 le premier seuil d’alerte (au lieu de 240 µg/m3) ;
– pour le dioxyde d’azote, de diviser par deux le seuil d’alerte et la valeur limite pour la protection de la santé humaine (en moyenne horaire), en les faisant passer de 200 à 100 µg/m3.
Ces dispositions ont été supprimées en séance, à l’initiative du Gouvernement qui a fait adopter un amendement prévoyant la transmission au Parlement, dans un délai d’un an après la publication de la loi, d’un rapport comportant des recommandations relatives aux normes de qualité de l’air.
b. Des mesures à l’impact limité car insuffisamment ciblées et rapides
• Des mesures inadaptées
Par rapport au dispositif de gestion des pics de pollution adopté en 2010, celui prévu par l’arrêté du 26 mars 2014 puis par l’arrêté du 7 avril 2016, constitue un réel progrès car il inclut une liste de mesures visant désormais tous les secteurs d’émission de polluants atmosphériques, y compris l’agriculture. Cependant, l’enquête de la Cour des comptes montre que, dans la pratique, ces mesures touchent les secteurs sur lesquels il est relativement facile d’agir (l’industrie et la circulation routière par exemple), alors que d’autres émetteurs importants de polluants, comme l’agriculture ou le logement, en sont exclus.
Lors des pics de pollution franciliens de mars 2014 et de mars 2015, plusieurs mesures relatives aux transports et à l’industrie ont été prises : obligation de contournement de Paris pour les poids-lourds, réduction de la vitesse de circulation, circulation alternée, gratuité des transports en commun, gratuité du stationnement résidentiel, restrictions ou réduction de fonctionnement mises en œuvre par les installations classées, etc.
À l’inverse, afin de tenir compte de la période de reprise des travaux sur les cultures en sortie d’hiver, seules des recommandations ont été diffusées par la préfecture de région auprès du secteur agricole (sur le report des épandages en 2014 et l’arrêt de ces épandages par pulvérisation en 2015).
Quant à la circulation alternée, considérée par beaucoup d’acteurs comme le nec plus ultra en matière de gestion des pointes de pollution, cette mesure, telle qu’elle est appliquée actuellement – une interdiction de circulation basée sur le numéro pair ou impair de la plaque d’immatriculation –, est critiquable à un double point de vue :
– en termes de lutte contre la pollution, cette restriction « à l’aveugle » permet à des voitures très polluantes, grâce à la loterie des plaques, de continuer à circuler. Souvent perçue comme absurde et arbitraire, elle n’a qu’un impact limité sur le niveau de la pollution, la baisse des émissions venant uniquement à proportion de la diminution du nombre de voitures en circulation. En outre, le principe aléatoire de la mesure réduit les marges de manœuvre des autorités préfectorales désireuses de limiter les dérogations accordées à certains véhicules lourds ou utilitaires et ne constitue pas un levier pour la promotion des véhicules les moins polluants ;
– la circulation alternée est particulièrement lourde et coûteuse à mettre en œuvre. La constatation du non-respect de cette mesure ne peut être faite qu’après l’interception du véhicule, une obligation qui découle de l’article L. 121-1 du code de la route en vertu duquel le conducteur est pénalement responsable des infractions qu’il commet en conduisant. En effet, cette infraction ne fait pas partie de celles – comme le stationnement interdit ou les excès de vitesse – mentionnées aux articles L. 121-2 et L. 121-3 du même code, qui permettent à la police de les imputer au titulaire de la carte grise et donc de se passer, de manière dérogatoire, de l’interception du véhicule. Aussi l’application de la circulation alternée a-t-elle mobilisé, le 23 mars 2015, près de 1 000 fonctionnaires sur 378 points de contrôle. En outre, cette mesure implique la gratuité des transports en commun, ce qui représente, selon la préfecture d’Île-de-France, un coût de l’ordre de 10 millions d’euros par jour pour le syndicat des transports de cette région, le STIF.
• Une procédure insuffisamment réactive en 2015
L’arrêté du 26 mars 2014 a institué une procédure spécifique lors des pics de pollution dus aux particules fines (PM10), centrée sur la notion de persistance : dès lors que le seuil d’information était dépassé durant deux jours consécutifs (76) et qu’il était prévu un dépassement le jour même et le lendemain, la procédure d’alerte était automatiquement enclenchée. Autrement dit, les mesures obligatoires pouvaient être déclenchées pour le 4ème jour de dépassement prévu du seuil d’information et de recommandation.
Ce dispositif, qui a été abrogé par l’arrêté du 7 avril 2016 (cf. infra), était insuffisamment réactif pour deux raisons essentielles :
– d’une part, les mesures ne pouvaient être maintenues, même si la météorologie ne garantissait pas la fin du pic, dès lors que des variations temporaires des concentrations de polluants se produisaient un peu en-dessous du seuil d’information. Les inspections ministérielles ont estimé que l’application en Île-de-France du nouveau dispositif de persistance en 2015 était apparue « trop contraignante en ce que des fluctuations autour du seuil d’information empêchaient d’activer des mesures temporaires alors qu’à l’évidence le pic de pollution allait se renforcer à nouveau » (77) ;
– d’autre part, l’arrêté ne permettait pas une mise en place rapide des mesures contraignantes. Les conditions de délai pour leur déclenchement étaient de fait trop restrictives, ce qui était de nature à susciter l’incompréhension du grand public. Comme le retour à une prévision « normale » interrompait, de surcroît, le comptage, ces exigences retardaient d’autant les décisions qui pouvaient être prises si l’épisode se poursuivait.
Il est vrai aussi que la gestion des pics de pollution est soumise à des conditions particulières, qui rendent cet exercice difficile. Ainsi, en l’état des connaissances, les prévisions en matière de qualité de l’air ne sont fiables qu’à un horizon de 24 heures, des tendances pouvant être seulement données à 48, voire 72 heures. Des délais aussi restreints rendent difficile l’anticipation, suffisamment à l’avance, des épisodes de pollution.
En outre, la capacité à prévoir un dépassement de seuil ne peut être parfaite, alors que les recommandations et les mesures d’urgence doivent prendre effet le lendemain. À titre d’illustration, Airparif indique que cette capacité était, en 2015, de 83 % pour les pics de pollution de PM10 (soit 10 jours sur 12 journées) et que le taux de fausses alertes, pour ces polluants, a atteint 33 % (soit 7 jours pour 21 prévisions) (78).
• Un impact des mesures d’urgence difficile à appréhender
L’impact des mesures d’urgence ne peut être apprécié que dans un seul domaine, celui des niveaux de pollution. L’impact sanitaire de ces mêmes mesures reste en effet, pour l’essentiel, une terra incognita.
• L’impact sur les niveaux de pollution : réel mais moindre que les restrictions liées à la COP21
L’efficacité des mesures prises est, selon la Cour des comptes, « difficile à quantifier avec certitude, et ce d’autant plus si les actions menées sont de courte durée » (79).
Cet impact est en outre amoindri par :
– la faible réactivité de la procédure d’urgence, qui, comme cela a déjà été souligné, retarde l’entrée en vigueur des mesures restrictives ;
– le fait aussi que, très souvent, l’épisode de pollution s’achève avec le changement de la situation météorologique. C’est en effet l’arrivée de vents soutenus ou de pluie qui marque, par dispersion ou précipitation au sol, la fin du pic.
L’impact de la circulation alternée peut être toutefois mesuré, comme ce fut le cas lors du pic de pollution de mars 2014 en Île-de-France. Cette restriction a en effet permis de réduire, de manière significative, les concentrations de dioxyde d’azote et de particules fines sur le périphérique (de près de 30 % et de moins de 10 % respectivement) et à proximité du trafic (de 10 % et de 6 % en moyenne respectivement). De même, en 2015, l’analyse par Airparif de l’impact de la circulation alternée montre des diminutions des concentrations de l’ordre de 2 % en situation éloignée du trafic, et jusqu’à 20 % sur certains tronçons en proximité de trafic (boulevard périphérique en heure de pointe).
À titre de comparaison, l’impact de cette mesure a été moins important que celui résultant des mesures de restriction de la circulation prises pour l’ouverture de la Conférence de Paris sur le climat, la COP21. Les dimanche 29 et lundi 30 novembre 2015, les autoroutes A1 et A6, ainsi que le boulevard périphérique et la route nationale RN2, ont été partiellement fermés à la circulation pour des raisons de sécurité. Or ces fermetures, associées aux recommandations de la préfecture d’Île-de-France d’éviter de prendre les transports, ont entraîné une baisse record de trafic, qui s’est traduite par une diminution encore plus sensible des niveaux de pollution. Ainsi, sur les grands axes, comme le boulevard périphérique et l’autoroute A1, des baisses de – 20 % pour le dioxyde d’azote et de – 36 % pour les PM10 ont été observées en moyenne.
• L’impact sanitaire : insuffisamment connu mais qui semble plutôt faible
L’impact sanitaire des mesures d’urgence n’est pas connu dans la mesure où les effets des pics de pollution sur la santé humaine ne sont pas, eux-mêmes, clairement identifiés.
Certes, les agences régionales de santé (ARS), comme celle d’Île-de-France, à partir de l’analyse des passages aux urgences, des appels à « SOS médecins » et des données de mortalité, autant d’éléments collectés de manière continue, peuvent constater, pour certaines pathologies, une augmentation des diagnostics lors des épisodes de pollution, à l’instar de ce qui a été observé pour l’asthme en mars 2015. Mais ces structures ne disposent pas, pour l’heure, d’éléments suffisants pour affirmer que cette hausse est due au pic de pollution ou à l’exposition aux pollens de printemps.
Les inspections ministérielles qui ont remis un rapport sur la gestion des pics de pollution ont rappelé que la littérature scientifique considérait que l’impact des pics a un « effet très faible sur la détérioration de la santé ». Pour appuyer leur propos, elles ont notamment cité une note de l’Institut national de veille sanitaire (InVS) de 2012 d’après laquelle « l’effet des pics de dépassement des valeurs seuil a un impact négligeable pour la population générale, majorant de moins de 1 % la mortalité et de moins de 3 % les hospitalisations » (80).
D’autres recherches tendent cependant à montrer que les conséquences, sur certaines pathologies, de ces pointes de pollutions ne sont pas négligeables sur le plan local : une autre étude de l’InVS estime, par exemple, qu’à Paris, au cours de la période 2007-2010, 5 % des décès et 7 % des hospitalisations pour causes cardio-vasculaires attribuables à la pollution de l’air seraient associés aux pics de pollution dépassant le seuil d’alerte des PM10 (81).
Ces éléments plaident en faveur d’études plus poussées sur le bilan sanitaire des pics de pollution et des mesures d’urgence qui les accompagnent.
• Des mesures d’information-recommandation non évaluées
Les mesures d’information-recommandation ne font l’objet d’aucun suivi. Par conséquent, les ARS, qui sont chargées de les diffuser, notamment par le biais de communiqués de presse auprès des établissements de santé et médico-sociaux, des mairies, etc., sont « aveugles » sur les gains sanitaires apportés – ou non – par leurs recommandations.
Cette absence de retour s’observe aussi en ce qui concerne les publics ciblés par ce type de mesures : enfants, sportifs, femmes enceintes, etc. Les acteurs chargés de mettre en œuvre la procédure d’information-recommandation sont donc incapables d’apprécier la pertinence de ces actions, ce qui fragilise le « premier étage » du dispositif de gestion des pics de pollution.
c. Un cadre juridique en cours de révision
• La proposition de loi du groupe écologiste
La proposition de loi n° 3287 visant à l’automaticité du déclenchement des mesures d’urgence en cas de pics de pollution, qui a été examinée par l’Assemblée nationale le 14 janvier 2016 dans le cadre d’une journée d’initiative parlementaire réservée au groupe écologiste, réformait le dispositif de gestion des pointes de pollution sur deux points clefs :
– elle donnait une valeur législative à la notion d’épisode de pollution persistant, en visant tous les polluants atmosphériques – et non les seules particules PM10, comme le prévoit l’arrêté relatif au déclenchement des procédures préfectorales – et en indiquant que la persistance était établie dès lors que le dépassement du seuil d’information et de recommandation pour un polluant était constaté pendant deux jours consécutifs et s’accompagnait d’une prévision de dépassement du même seuil ;
– elle obligeait le préfet de département à déclencher la procédure d’alerte en cas d’épisode de pollution persistant, ainsi qu’en cas de dépassement pendant plus de vingt-quatre heures d’un seuil d’alerte.
Ce texte a été adopté par l’Assemblée nationale, après avoir été substantiellement amendé par le Gouvernement, qui a supprimé le caractère automatique de la procédure, en faisant valoir que celle-ci, en retirant aux préfets leur pouvoir d’appréciation, était de nature à rendre plus difficile l’adoption de mesures évolutives, adaptées aux réalités locales.
La version de la proposition de loi issue des travaux de l’Assemblée nationale consacre, en revanche, la notion d’épisode de pollution persistant, en précisant, à l’article L. 223-1 du code de l’environnement, que les mesures prises « sont maintenues tant que les prévisions montrent que les conditions restent propices à la poursuite de l’épisode ».
• L’arrêté du 7 avril 2016
Lors de cette même séance, le secrétaire d’État chargé des transports, M. Alain Vidalies, s’est engagé à réviser l’arrêté du 26 mars 2014 encadrant les procédures préfectorales afin d’accélérer le déclenchement des mesures d’urgence, en raccourcissant la procédure d’un jour.
Le nouvel arrêté, signé le 7 avril 2016 par six ministres, reprend, à cet effet, les délais prévus par la proposition de loi initiale, en permettant le déclenchement de ces mesures en cas de dépassement du seuil d’information et de recommandation pour les PM10 la veille et de dépassement de ce même seuil prévu pour le jour même et le lendemain.
Comme le montre la figure ci-desous, les mesures d’alerte pourront être ainsi déclenchées pour le troisième – et non plus le quatrième – jour de dépassement.
PROCÉDURE RELATIVE À LA PERSISTANCE D’UN ÉPISODE DE POLLUTION AU PM10
DÉFINIE PAR L’ARRÊTÉ DU 26 MARS 2014
ET PAR L’ARRÊTÉ DU 7 AVRIL 2016
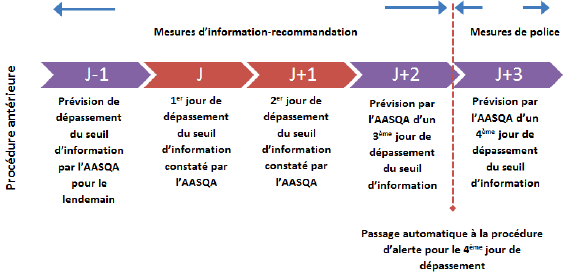
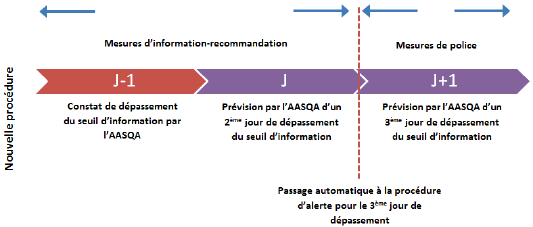
L’article 14 du nouvel arrêté prévoit par ailleurs que les mesures sont maintenues « tant que les prévisions météorologiques ou les prévisions en matière de concentrations de polluants montrent qu’il est probable que le seuil d’information et de recommandation soit dépassé le lendemain ou le surlendemain ».
Enfin, l’arrêté précise que les préfets adopteront les mesures d’urgence après consultation d’un comité d’experts regroupant les services déconcentrés de l’État, l’agence régionale de santé, les présidents d’EPCI à fiscalité propre et les présidents des autorités organisatrices de transport concernés par l’épisode de pollution.
B. DONNER DE LA COHÉRENCE ET DE LA STABILITÉ AUX OUTILS DE PLANIFICATION ET DE GESTION NATIONALE ET LOCALE
Il faut mettre un terme à la succession des plans « qualité de l’air », adoptés selon des calendriers heurtés et dont les objectifs sont – plus ou moins – remis en cause par d’autres politiques, centrées sur l’efficacité énergétique et la lutte contre le changement climatique. L’action des autorités locales doit, elle aussi, gagner en cohérence et en efficacité, ce qui impose de revoir la procédure de gestion des pics de pollution.
1. Une urgence absolue : avoir une vision nationale et locale intégrée « climat–air–énergie »
Dans la conclusion générale de son enquête, la Cour des compte estime que la mise en cohérence des politiques de lutte contre la pollution de l’air et le changement climatique constitue « une urgence : les outils mis en place pour diminuer l’émission de CO2 ne doivent plus entraîner de fait l’émission accrue d’autres polluants, comme cela peut être le cas aujourd’hui » (82).
Cette clarification doit englober la politique de l’énergie et conduire à une vision intégrée des enjeux « climat-air-énergie », ce qui permettra d’améliorer l’efficacité des différents plans d’actions.
Cette vision intégrée pourrait être développée par le Conseil national de l’air (CNA), qui est d’ores et déjà saisi, pour avis, par le ministre chargé de l’environnement, de toutes les questions relatives à la lutte contre la pollution de l’air et à l’amélioration de la qualité de l’air. En outre, ce conseil peut être également consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires et sur les politiques publiques ayant une incidence dans ce domaine (article D. 221-16 du code de l’environnement).
Le rôle consultatif du CNA devrait donc être étendu aux politiques du climat et de l’énergie, dont le contenu influe directement sur l’efficacité des mesures anti-pollution, et, plus largement, à toutes les questions relatives à la convergence des objectifs et des outils du triptyque climat-air-énergie.
Le Gouvernement devrait veiller, par ailleurs, à la bonne articulation des plans nationaux suivants :
– le plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA), qui devrait être élargi à la lutte contre la pollution de l’air intérieur et renommé, en conséquence, « plan d’amélioration de la qualité de l’air intérieur et extérieur » ;
– la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone ou « stratégie bas-carbone » ;
– la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) ;
– la stratégie pour le développement de la mobilité propre.
Au plan local, la cohérence entre les différents plans mentionnant la lutte contre la pollution de l’air et les planifications sectorielles (aménagement, transport, logement, etc.) devrait être renforcée.
Les connaissances sur les problématiques climat-air-énergie et leur lien avec l’urbanisme devraient donc être développées, ce qui implique de mettre en place des actions de sensibilisation, notamment vis-à-vis des élus. En effet, cet « apprentissage » est, ainsi que l’a souligné le Conseil général de l’environnement et du développement durable, nécessaire pour « acquérir des réflexes de regards croisés » (83).
De même, comme les actions contre la pollution de l’air se retrouvent dans diverses planifications, dont les acteurs locaux n’ont pas forcément une vision d’ensemble, des cartes de compétences « air » devraient être établies pour être mises à disposition des différents services, directions, etc., des collectivités territoriales, afin de les aider à identifier quelle politique non spécifique à la qualité de l’air pourrait accueillir des orientations ou des actions qui permettent de l’améliorer.
Proposition n° 3 : mettre en cohérence les politiques de lutte contre le réchauffement climatique et contre la pollution de l’air :
– articuler la stratégie bas-carbone, le plan de réduction de la pollution atmosphérique, la programmation pluriannuelle de l’énergie et la stratégie pour le développement de la mobilité propre ;
– renforcer la cohérence des schémas territoriaux qui encadrent ces politiques (SRCAE, SRADDET, PCAET et PPA) avec les planifications sectorielles (urbanisme, transport et logement) ;
– sensibiliser les élus locaux à ces sujets.
2. Faire des acteurs de terrain le pivot des politiques de qualité de l’air
La pollution de l’air est, sauf rares exceptions, un problème de dimension essentiellement locale, qui nécessite des réponses adaptées et concertées entre tous les responsables de terrain.
Le principe de subsidiarité doit donc être intégralement appliqué par les politiques en faveur de la qualité de l’air, ce qui implique au minimum, de la part de tous les acteurs, de respecter la répartition des compétences entre les trois niveaux de planification et de décision suivants.
Le rôle de l’État au niveau national est de fixer, dans le respect du cadre défini par l’Union européenne, des objectifs de résultats, de mettre en place les mesures – fiscales, législatives et réglementaires – qui relèvent de la puissance publique et de fournir des outils à disposition des collectivités territoriales et des préfets.
Le rôle de « rassembleur » de la région, qui est indispensable pour assurer, au bon échelon territorial, la cohérence des politiques « climat-air-énergie », a été reconnu par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Son article 3 précise en effet qu’elle est chargée « d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives au climat, à la qualité de l’air et à l’énergie » (article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales). C’est la région qui devrait donc rendre homogènes ou compatibles les politiques locales de lutte contre la pollution atmosphérique, afin d’éviter que des agglomérations proches ne conduisent des actions contradictoires en matière de qualité de l’air, qui compliquent la vie quotidienne de leurs habitants sans obtenir de résultats. La région devrait également veiller à la cohérence des calendriers des différents plans locaux concernant cette thématique (PPA, PCAET, SRCAE, etc.).
Enfin, l’échelon intercommunal est le bon niveau pour adopter des mesures efficaces de lutte contre la pollution locale. C’est à cette échelle qu’il faut déployer, plus largement qu’ils ne le sont aujourd’hui, les plans de protection de l’atmosphère (PPA), à condition, comme le préconise la Cour des comptes, de laisser aux services déconcentrés de l’État et des collectivités territoriales la « responsabilité de la mise en œuvre effective des PPA » (84).
Aux yeux des rapporteurs, cependant, il faut aller au-delà de ces équilibres pour décentraliser, de manière plus poussée, les politiques locales de lutte contre la pollution de l’air, en les articulant autour d’un duopole région-intercommunalités et en donnant toute sa portée au rôle de chef de file de la région. Cette nouvelle architecture pourrait s’organiser de manière suivante :
– les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), aujourd’hui co-construits par les préfets de région et les conseils régionaux, devraient être confiés aux régions ;
– dans les régions dont le territoire est couvert en totalité ou en grande partie par un PPA, il reviendrait à cette collectivité territoriale d’élaborer ce document de planification ;
– dans les autres territoires, le PPA serait élaboré par les EPCI et la région territorialement compétents.
Proposition n° 4 : confier l’élaboration des plans de protection de l’atmosphère (PPA) et des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) à la région ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
3. Évaluer les plans nationaux et les actions locales et conforter les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA)
• Un travail d’évaluation qui doit s’appuyer sur un inventaire spatialisé et les AASQA
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit un renforcement « à géométrie variable » de l’évaluation des plans nationaux et locaux de lutte contre la pollution de l’air. En effet, si le plan national de réduction de la pollution atmosphérique (PREPA) fera l’objet d’un suivi rigoureux, qui s’appuiera sur un tableau de bord précis, pour les PPA, la loi ne prévoit qu’une simple transmission, par les autorités compétentes en matière de police, des informations jugées utiles aux préfets.
Rien n’empêche cependant les acteurs de terrain d’aller plus loin. C’est notamment le cas en Île-de-France où l’association agréée de surveillance de la qualité de l’air compétente, Airparif, est associée à l’évaluation du PPA révisé de la région, qui a été adopté le 25 mars 2013. Le travail ainsi effectué est novateur, mais les outils dont dispose cette association ne lui permettent pas d’effectuer de véritables évaluations ex-post. En effet, ses estimations se fondent sur un bilan hypothétique de la qualité de l’air en Île-de-France, estimé en l’absence de tout PPA, après quoi Airparif compare, au fil de l’eau, ce scénario avec les relevés qu’elle établit année après année. Cette AASQA n’est donc pas en mesure d’apprécier, avec ce travail de modélisation, la réalité de l’impact du plan local de lutte contre la pollution.
L’évaluation des actions en faveur de la qualité de l’air devrait donc être affinée et développée, sans tomber pour autant dans le travers du systématisme.
Outre que certaines mesures ne sont pas toujours évaluables au regard de la qualité de l’air, comme celles qui visent à sensibiliser le public, il ne faut pas non plus chercher à tout évaluer – c’est le cas notamment des actions « sans regret », rapidement abandonnées –, d’autant plus que ce type d’exercice peut représenter un coût important. À titre d’exemple, l’évaluation multi-critères de l’opération « fonds air-bois », qui vise à renouveler dans la Vallée de l’Arve quelque 3 200 appareils domestiques de chauffage au bois les plus polluants, représente un quart du fonds d’aide, soit 848 000 euros pour un dispositif d’aide de 3,2 millions d’euros sur quatre ans (85).
Dans ces conditions, deux voies pourraient être raisonnablement empruntées pour mieux évaluer les politiques nationales et locales de lutte contre la pollution de l’air.
• La première consisterait à s’appuyer sur l’analyse des données collectées par l’inventaire national spatialisé (INS), chargé de recenser, avec une très haute résolution spatiale et temporelle, les émissions d’une cinquantaine de polluants atmosphériques. Le ministère de l’écologie s’est engagé, en 2005, dans la réalisation de cet outil, qui n’a été livré cependant que mi-2015, les données mises à disposition étant, de surcroît, celles de 2007, ce qui, comme l’observe la Cour des comptes, fait perdre de la pertinence à cet outil.
Un inventaire spatialisé « qualité de l’air », multisectoriel, mis à jour chaque année et pouvant être décliné en inventaires locaux, faciliterait le travail de collecte des données au niveau territorial le plus fin, y compris dans les zones rurales, et permettrait de faire le lien entre les niveaux de pollution constatés et les mesures prises pour les réduire. On pourrait même concevoir que cet outil puisse, à l’instar du Saneringstool utilisé aux Pays-Bas, qui effectue des mesures à l’échelle du kilomètre et a des fonctionnalités de modélisation très poussées, calculer l’impact des projets d’aménagement (urbain, routier, etc.) sur la qualité de l’air.
Cet inventaire national pourrait être le moyen de mieux identifier l’origine des pollutions locales. En particulier, M. Martial Saddier souhaite qu’on puisse sur ce point déterminer le lien entre l’utilisation du sel de déneigement et la pollution de l’air dans les zones de montagne, à partir de l’étude réalisée en 2012 et 2013 par Air Rhône-Alpes relative à l’impact du salage sur les concentrations de PM10. Les résultats obtenus en 2012 étaient en effet plus alarmants que les relevés constatés l’année suivante, sur deux sites différents, l’un en centre-ville, l’autre en bordure d’autoroute. Il faudrait donc lancer un programme de recherche pour vérifier et quantifier le rôle joué par le sel de déneigement dans la pollution liée aux particules. C’est en effet, pour les zones de montagne, un enjeu important, la disparition de cette source potentielle de pollution étant de nature à revenir en-dessous de seuils autorisés.
Proposition de M. Martial Saddier : approfondir la recherche consacrée à l’impact de l’usage du sel de déneigement sur la pollution liée aux particules.
• La seconde voie d’amélioration serait centrée sur l’évaluation des actions locales les plus fortes, innovantes ou coûteuses, en allant au-delà de l’analyse de leur impact sur la qualité de l’air – l’évolution des niveaux de pollution – pour apprécier les externalités économiques et sanitaires des politiques mises en œuvre.
Les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA), les agences régionales de santé et certains organismes de recherche (l’INSERM par exemple) pourraient être associés à ce travail, qui devrait porter, en priorité, sur les plans de protection de l’atmosphère (PPA) mis en œuvre dans les zones dans lesquelles les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées.
Proposition n° 5 : mieux évaluer les résultats de la lutte contre la pollution de l’air :
– réaliser un inventaire national spatialisé des émissions de polluants à l’échelle du kilomètre, régulièrement mis à jour, pour développer l’évaluation des actions en faveur de la qualité de l’air ;
– associer les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) et les organismes de recherche à l’évaluation des plans de protection de l’atmosphère (PPA) des zones connaissant des concentrations élevées de polluants, en incluant deux volets : l’impact sur la qualité de l’air et les externalités socio-économiques.
• Un financement des AASQA qui doit être pérennisé
Pour mener à bien leur mission de surveillance de la qualité de l’air et participer à l’évaluation des plans en faveur de la qualité de l’air, les AASQA devraient bénéficier de financements pérennes.
Leurs ressources, qui émanent de l’État, des collectivités territoriales et des industriels, sont en effet menacées :
– la dotation de l’État baisse d’année en année. Les subventions aux 27 AASQA ont ainsi diminué de 2,9 % entre 2014 et 2016. En 2016, le budget disponible pour ces associations subira, par rapport à l’année dernière, une baisse de 3,4 % ;
– les départements tendent eux aussi à se désengager du financement de ces associations. C’est, d’après Airparif, l’AASQA d’Île-de-France, le cas de trois d’entre eux dans cette région et d’une trentaine de ces collectivités au niveau national ;
– les industries émettant de moins en moins de polluants grâce à l’application des meilleures techniques disponibles, leur participation, via la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) « air », au financement des AASQA pourrait, peu à peu, se réduire.
Pour sanctuariser les moyens du dispositif de surveillance de la qualité de l’air, plusieurs pistes pourraient être explorées :
– celle proposée par la Cour des comptes consiste à élargir le financement des AASQA à d’autres secteurs économiques, comme l’agriculture et le logement, une mesure conforme au principe pollueur-payeur mais politiquement sensible et techniquement difficile à mettre en œuvre ;
– une autre piste consisterait à affecter une fraction minime de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) à la couverture des besoins du réseau des AASQA ;
– une dernière piste consisterait à s’appuyer sur des négociations financières entre l’État et les collectivités à la suite des transferts de compétences prévus par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République pour sanctuariser les financements des départements et des régions aux AASQA.
4. Anticiper la gestion des épisodes de pollution et rendre la procédure plus lisible
Les mesures de fond en faveur de la qualité de l’air sont les seules à même d’obtenir des résultats durables. Lorsqu’elles auront produit tous leurs effets, elles permettront de faire l’économie d’une procédure de gestion des pics de pollution.
À court et moyen terme, en revanche, il paraît difficile de se priver d’un tel dispositif qui est, aujourd’hui, le seul outil disponible pour agir rapidement sur des niveaux élevés de pollution et sensibiliser, de manière régulière et massive, la population à l’enjeu de la qualité de l’air.
La procédure devrait être cependant profondément réformée, pour gagner en réactivité et en lisibilité.
La gestion des pics de pollution de l’air présente en effet trois grandes failles, qui pèsent sur son efficacité :
– elle ne permet pas une mise en place suffisamment rapide des mesures d’urgence, le nouvel arrêté du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales ne faisant gagner qu’un seul jour ;
– elle est peu compréhensible en raison de l’existence d’un double seuil pour la mesure des niveaux de pollution et l’adoption de recommandations ou de mesures obligatoires ;
– sa mesure la plus emblématique – la circulation alternée – ne rime à rien puisque l’interdiction de circuler en fonction des plaques d’immatriculation est aléatoire et ne permet pas d’optimiser l’efficacité d’une telle restriction en ciblant les véhicules les plus polluants.
Ces trois aspects devraient donc être corrigés selon les modalités suivantes.
1° Les mesures d’interdiction ou de restriction devraient pouvoir être déclenchées de manière anticipée, à partir des prévisions établies par les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA). Les inspections ministérielles ont proposé, à ce sujet, de permettre le déclenchement des premières mesures de police dès le jour du franchissement prévu du seuil d’information et dès lors que l’événement semble pouvoir durer au vu du contexte météorologique (86). Cette procédure « accélérée » devrait, en outre, concerner, comme le recommande la Cour des comptes (87), tous les polluants ou, à tout le moins, ceux qui font l’objet d’un seuil réglementé : l’ozone (O3), le dioxyde d’azote (NO2), le dioxyde de soufre (SO2) et les particules PM10 – et non les seules particules fines.
2° La distinction entre seuil d’information-recommandation et seuil d’alerte devrait être abandonnée au profit d’un code de quatre couleurs – vert, jaune, orange et rouge – inspiré du dispositif de vigilance, universellement connu et compris, de Météo France (88). Ce dispositif de « vigilance atmosphérique » permettrait ainsi de mieux identifier, chaque jour, le degré d’intensité du pic, en définissant des niveaux de pollution (50, 80, 100 µ/m3, etc.) plus fins que les seuils actuellement retenus. Il faciliterait aussi la graduation des décisions à prendre.
3° La circulation alternée a vocation à disparaître avec la généralisation des zones à circulation restreinte (ZCR), qui régulent l’accès des véhicules aux centres-villes ou aux agglomérations densément peuplées en fonction de leurs émissions de polluants atmosphériques (cf. infra la proposition n° 11).
La mise en place d’un tel dispositif demandant du temps, l’interdiction de circulation fondée sur le numéro des plaques d’immatriculation devrait être remplacée, dans un premier temps, par le recours au covoiturage, sous une forme volontaire ou obligatoire, en fonction de l’intensité du pic. À titre d’illustration, cette forme de mobilité, qui pourrait rassembler, dans le même véhicule, trois à quatre personnes – le conducteur et ses passagers –, serait encouragée en période verte et jaune ; en période orange et rouge, elle pourrait même s’imposer aux propriétaires de véhicules.
En incitant ces derniers à mutualiser les trajets entre leur domicile et leur travail, cette mesure aurait pour effet de retirer un bien plus grand nombre de voitures de la circulation, ce qui aurait un double impact, en termes de réduction de la pollution, d’une part, et de solidarité entre habitants d’une même agglomération ou région, d’autre part.
Afin d’éviter la mobilisation d’importants effectifs de police, le respect de ces obligations devrait être contrôlé par le recours à la vidéo-verbalisation. Au préalable, l’article L. 121-3 du code de la route, qui permet d’imputer certaines infractions aux titulaires de la carte grise, sans avoir à intercepter le véhicule, devrait être modifié pour ajouter le non-respect de la circulation alternée ou du covoiturage.
Proposition n° 6 : modifier la procédure de gestion des pics de pollution :
– permettre la mise en œuvre, par anticipation, d’interdictions et de restrictions, sur prévision pour tous les polluants ;
– remplacer les deux seuils de déclenchement (information/recommandation et alerte) par un dispositif de « vigilance atmosphérique », mesurant l’intensité de la pollution en fonction de quatre couleurs (vert, jaune, orange et rouge, sur le modèle de Météo France) ;
– substituer à la circulation alternée une circulation réservée aux véhicules les moins polluants ou au covoiturage pour les trajets domicile-travail et autoriser le contrôle de la circulation par la vidéo-verbalisation.
Par ailleurs, la gestion des pics de pollution en Île-de-France est devenue d’une trop grande complexité en raison de la coexistence de deux autorités préfectorales – le préfet de région et le préfet de police de Paris –, d’un pouvoir municipal, celui de la capitale, dont la capacité d’initiative est bridée en raison d’un statut particulier, hérité de l’histoire, de la région la plus riche du pays et d’un nouveau venu, la métropole du Grand Paris, qui ne pourra pas se désintéresser de l’enjeu de la qualité de l’air. Le fait que la maire de Paris, Mme Anne Hidalgo, ait regretté que le nouvel arrêté de gestion des pics de pollution, pris le 7 avril dernier, ne donne aucun pouvoir de décision aux collectivités territoriales et que la présidente de la région Île-de-France ait fait part de son intention de déposer un recours gracieux contre ce texte, au motif qu’il ne mentionnait pas les régions, est symptomatique.
Ces éléments plaident en faveur d’une simplification de la gouvernance francilienne des épisodes de pollution : l’adoption des recommandations et des mesures obligatoires devrait être confiée à un seul représentant de l’État, à l’exception de la circulation alternée qui devrait être, en attendant la mise en place de la zone à circulation restreinte dans la capitale, déclenchée par la Ville de Paris.
C. CLARIFIER LA COMMUNICATION EN DIRECTION DU GRAND PUBLIC
Le citoyen peut accéder à une masse impressionnante d’informations sur la qualité de l’air. En effet, celles qui émanent d’entités publiques ou d’associations agréées sont nombreuses et l’offre privée va s’amplifier dans les années à venir. La qualité et la cohérence de ces données devrait donc devenir une priorité.
1. S’assurer de la cohérence et de l’exhaustivité des données fournies
L’information du public sur la qualité de l’air est assurée par de nombreux organismes publics :
– le ministère de l’environnement, qui communique régulièrement sur ce sujet, et les AASQA qui, outre leur mission de surveillance de la qualité de l’air, établissent des inventaires régionaux d’émissions ;
– Météo France, le laboratoire central de surveillance de la qualité de l’air et le CNRS, qui gèrent le système national de modélisation et de cartographie de la qualité de l’air ;
– le centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA), qui coordonne et réalise les inventaires d’émissions de polluants.
S’y ajoutent les sociétés privées qui ont un intérêt objectif à « noircir » le tableau de la pollution et développent, par conséquent, comme le relève la Cour des comptes, « sans toujours une grande rigueur méthodologique, des outils et des applications grand public qui utilisent les données mises à disposition gratuitement par les organismes de mesure de la qualité de l’air » (89).
Il y a fort à parier, étant donné l’intérêt croissant du grand public pour ce type de données, qu’un marché de l’information sur la qualité de l’air va se développer très rapidement, porté par de nombreux opérateurs privés. L’État, qui n’a pas encore fixé de cadre pour l’usage de ces données, devrait s’y atteler. Il devrait aussi s’assurer de la cohérence de l’ensemble des informations fournies, qu’elles émanent d’organismes publics ou privés, et de leur utilité.
2. Utiliser un indice de qualité de l’air synthétique
La Cour des comptes formule des observations extrêmement sévères sur la communication des décideurs locaux sur le pic de pollution de 2014 (90). Il est vrai aussi, comme l’ont souligné les inspections ministérielles dans leur rapport sur la gestion de ces épisodes de pollution, que « parler simplement de la qualité de l’air est un exercice difficile », pour plusieurs raisons :
– d’une part, plusieurs indices synthétiques sont publiés par les AASQA, en particulier l’indice ATMO, qui est déterminé par les niveaux de pollution mesurés par les stations de fond et donne une information journalière dans les villes de plus de 100 000 habitants, et l’indice urbain européen CITEAIR ;
– d’autre part, l’échelle de mesure de ces indices ayant été conçue pour les agglomérations, leur usage en zone rurale ou pour les petites villes est mal adapté.
À ces premiers facteurs de complexité s’ajoute un problème d’articulation entre les différents seuils d’information-recommandation et d’alerte encadrant la gestion des pics de pollution, lesquels sont peu nombreux (deux à cinq pour chacun des quatre polluants suivis), et les niveaux de pollution mesurés par l’indice ATMO, qui sont d’une grande sophistication puisqu’à chacun d’entre eux correspond un chiffre de 1 à 10, une couleur (vert, orange et rouge) et un qualificatif (de très bon à très mauvais). Dans le même temps, cet indice ne prend pas en compte les stations de mesure le long du trafic routier, ce qui amoindrit son intérêt (91).
Au vu des limites actuelles des dispositifs de mesure de la qualité de l’air, la construction d’un nouvel indice devrait devenir une priorité, quand bien même il serait certainement difficile, d’un point de vue technique, de le relier aux seuils réglementaires de pollution car ceux-ci sont exprimés par polluant, selon différentes échelles de temps (heure, jour, année, etc.) et différentes notions (objectif de qualité, valeur cible, valeur limite, etc.).
Les inspections ministérielles ont recommandé d’établir un indice synthétique, utilisé par toutes les AASQA et ayant « une amplitude de valeurs permettant d’apprécier la situation avec une réelle sensibilité » (92), une suggestion reprise par la Cour des comptes (93).
Bien entendu, cet outil devrait être cohérent avec les quatre niveaux de vigilance – vert, jaune, orange et rouge – qui devraient encadrer une procédure rénovée de suivi et de gestion des pics de pollution (cf. supra la proposition n° 6).
Proposition n° 7 : établir un indice synthétique de la qualité de l’air, qui soit commun à toutes les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) et de compréhension aisée.
DEUXIÈME PARTIE : AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DES MESURES RELATIVES AUX SOURCES MOBILES ET FIXES DE POLLUTION
La présente partie a pour objet de porter une appréciation sur les différents outils – autres que ceux liés à la planification nationale et locale – de lutte contre la pollution de l’air.
Par commodité, ils ont été regroupés en deux grands blocs, selon qu’ils visent des sources mobiles – le transport routier – ou fixes de pollution (industries, logements, exploitations agricoles, etc.).
Cette typologie, qui est courante, ne signifie pas que les deux « familles » rassemblent des dispositifs de nature identique. Au contraire : les outils juridiques et financiers sont trop divers, quel que soit le secteur considéré. Ainsi, les plus anciens et, sans doute, les plus efficaces, concernent le secteur industriel. Le secteur du transport routier se voit appliquer de multiples mesures, de nature très variée, qui peuvent contredire l’objectif de la qualité de l’air. Enfin, les outils concernant les secteurs résidentiel et agricole sont les plus récents, certains d’entre eux n’étant pas spécifiques à la lutte contre la pollution atmosphérique.
Cette hétérogénéité dans la panoplie des mesures anti-pollution ne fait qu’illustrer l’inégale contribution des différents secteurs à la réduction des émissions et la faible prise en compte des enjeux « air » par certaines politiques. Ces déséquilibres devraient être corrigés, à condition que les nouvelles actions tiennent compte des contraintes spécifiques des acteurs concernés.
I. SE DONNER LES MOYENS DE LUTTER CONTRE LA POLLUTION ÉMISE PAR LE SECTEUR ROUTIER
Pour la Cour des comptes, la participation du secteur routier à la lutte contre la pollution de l’air « n’est pas encore une priorité bien établie » (94). Cette situation résulte de certains choix fiscaux et réglementaires, motivés par des stratégies industrielles, des contraintes technologiques et des considérations environnementales – en l’espèce, la lutte contre le réchauffement climatique. L’ajustement des mesures anti-pollution, dans un contexte marqué par de telles « pesanteurs », ne peut donc pas être brutal.
A. LES TRANSPORTS ROUTIERS : UN SCORE PLUTÔT MÉDIOCRE EN TERMES DE QUALITÉ DE L’AIR
La baisse des émissions du transport routier est intermédiaire entre celles de l’industrie et de l’agriculture et tend à ralentir depuis quelques années. Ce « score » relativement médiocre s’explique, en partie, par l’adoption de certains dispositifs, fiscaux, financiers et réglementaires.
1. Malgré la baisse des émissions qui lui sont liées, le trafic routier contribue fortement aux concentrations élevées de certains polluants
En matière de pollution de l’air, le bilan du transport routier est contrasté – ses émissions baissent, mais il reste un important contributeur –, un contraste que l’on retrouve pour le dioxyde de carbone. En outre, les réductions obtenues l’ont été principalement grâce à des avancées technologiques qui rencontrent, aujourd’hui, certaines limites. Leur contournement demandera des efforts d’investissement significatifs de la part des constructeurs.
• Une baisse des émissions de polluants du parc routier
Comme le montre le graphique ci-dessous, malgré une croissance du trafic de 34 % entre 1990 et 2013, les émissions d’oxydes d’azote (NOX) et de particules fines (PM10) ont baissé de respectivement 55 % et 65 %.
ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS DU PARC ROUTIER
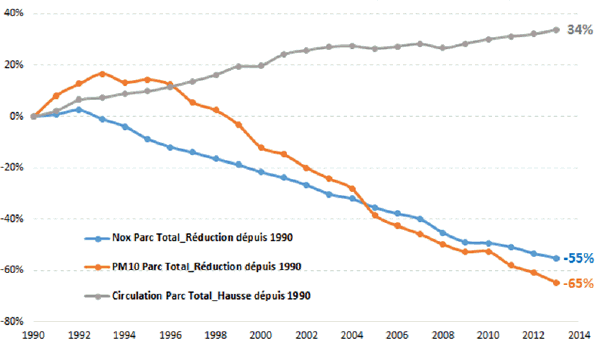
Source : CITEPA, Secten 2015.
Il convient de souligner que les poids-lourds roulant au gazole ont participé, de manière active, à ce mouvement, en réduisant de manière drastique, grâce aux normes Euro et à de nouvelles motorisations diesel, leurs émissions de polluants. À titre d’illustration, entre 1990 et 2013, les oxydes d’azote et les hydrocarbures émis par ces véhicules ont été réduits de respectivement 97,2 % et 94,6 % (95).
Certains représentants des constructeurs s’appuient sur la baisse des émissions pour tenir des discours sur la pollution automobile pour le moins surprenants, en affirmant que la concentration en particules dans l’habitacle est plus élevée que celle constatée à l’échappement ou que la taille des véhicules n’influe pas sur la quantité de polluants rejetés au niveau des rues. Ces propos, qui minimisent l’impact du secteur routier sur la qualité de l’air, ne sont pas défendables, ce secteur contribuant encore au dépassement des seuils de pollution.
• Un secteur qui contribue néanmoins au dépassement des seuils
Malgré ces bons résultats, les pollutions du transport routier demeurent, en volume, significatives. Les oxydes d’azote (NOX) et les particules fines (PM10 et PM2,5) y sont, en particulier, surreprésentés.
D’après les données du Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA), les oxydes d’azote sont émis à 54 % par le transport routier, une proportion qui n’a pas évolué entre 2010 et 2013, après avoir peu baissé depuis 2000 (58 %) (96). En conditions réelles de conduite, c’est-à-dire hors mesure effectuée en laboratoire, les émissions de ces polluants sont même, selon l’ONG Transport & Environment, pratiquement constantes depuis quinze ans, ce qui devrait faire des NOX, dans les prochaines années, l’enjeu majeur de la pollution urbaine. Le poids du secteur routier dans ces émissions est en effet accentué dans les agglomérations : ainsi, à Paris, 66 % des émissions de NOX émanent des véhicules.
Quant aux PM10 et PM2,5, ces particules fines sont émises à hauteur de respectivement 16 % et 19 % par le transport routier. La contribution de ce secteur aux émissions de particules en suspension est toutefois largement supérieure dans les zones où les valeurs limites sont dépassées ; elle atteint alors, en moyenne, 30 %, voire 40 % à 70 % localement. Sur les grands axes routiers et dans et à proximité des agglomérations, cette part peut atteindre des proportions plus importantes. Par exemple, pour les seules PM2,5, elles atteignent 30 % en Île-de-France et 58 % à Paris.
On constate d’ailleurs, à proximité des grands axes, des écarts entre la baisse des émissions de polluants et la réalité de la qualité de l’air. Les données d’Airparif, l’AASQA d’Île-de-France, montrent qu’entre 2000 et 2012, les émissions calculées de NOX issues du trafic routier ont baissé, dans la région, de 48 %. Sur la même période, la baisse des niveaux d’oxydes d’azote mesurés n’est que de 20 % le long de l’autoroute A1, au nord de Paris, où Airparif exploite une station de mesure permanente. Cette dichotomie se retrouve dans le cas des particules PM10 : les émissions régionales ont diminué, sur cette période, de 55 %, alors que la baisse le long du périphérique parisien a été limitée à 13 %.
Le transport routier joue donc un rôle décisif dans le dépassement des valeurs limites d’émission de certains polluants. Ainsi, d’après le dernier Bilan de la qualité de l’air en France, en 2014, les seuils annuels d’oxydes d’azote pour la protection de la santé humaine n’ont pas été respectés par 36 stations de mesure, principalement situées à proximité du trafic routier et dans les grandes agglomérations (97), un constat qui vaut pour d’autres polluants. À titre d’exemple, dans l’agglomération parisienne, 300 000 habitants, qui résident au voisinage des grands axes routiers, sont concernés par un dépassement de la valeur journalière pour les PM10. De même, les niveaux de dioxyde d’azote (NO2) sur les axes les plus chargés, sont, en moyenne, toujours deux fois supérieurs à la valeur limite annuelle (98).
• Un secteur qui reste un émetteur significatif de CO2
La mise au point de technologies peu émettrices en CO2 a permis au transport routier de participer à la réduction de ce gaz à effet de serre. Comme le montre le graphique ci-dessous, si, depuis 1990, la circulation des véhicules français et étrangers sur le territoire français a augmenté de 36 %, leurs émissions de CO2 associées, nettes des énergies renouvelables, n’ont crû que de 7 %.
LA CIRCULATION DES VÉHICULES EN FRANCE
ET LES ÉMISSIONS ASSOCIÉES DE CO2 NETTES DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
(Base 100 en 1990)
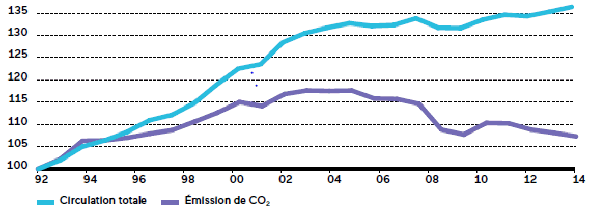
Sources : CITEPA et Bilan de la circulation routière, cités par le Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA), L’industrie automobile française. Analyse et statistiques 2015, septembre 2015.
La part du transport routier dans les émissions de dioxyde de carbone reste néanmoins très significative et tend à croître. Les données du CITEPA pour l’année 2013 indiquent en effet que celui-ci est émis à 34 % par ce secteur, une proportion qui a augmenté depuis ces vingt dernières années (28 % en 1990) (99).
• Des techniques de dépollution qui se heurtent à plusieurs limites
Le progrès technique a clairement joué en faveur de la réduction des polluants émis par le secteur du transport routier.
Dans le cas des NOX, par exemple, le renouvellement du parc et l’introduction généralisée de pots catalytiques sur les véhicules particuliers essence depuis 1993 et diesel à partir de 1997 ont beaucoup aidé. Les filtres à particules sont apparus en 2000 et ont été généralisés sur les véhicules diesel neufs avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, d’un nouveau seuil d’émissions qui les a rendus de facto obligatoires.
Or ces innovations, qui ont été stimulées par le respect des normes Euro qui règlementent les émissions de poids-lourds depuis 1990 et celles des voitures depuis 1992 (100), se heurtent, depuis peu, à des « plafonds de verre technologiques » qui tendent à s’épaissir.
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a relevé qu’il est difficile, pour les véhicules diesel, de maîtriser simultanément les niveaux d’émissions de particules et de NOX : en effet, « diminuer les émissions de particules en brûlant mieux le carburant se traduit par une augmentation des oxydes d’azote. Inversement, réduire les oxydes d’azote à la source suppose une dégradation de la qualité de la combustion, qui s’accompagnera alors de la formation de particules en plus grande quantité » (101).
L’IFP Énergies nouvelles (l’ex-Institut français du pétrole) considère même que le durcissement des normes Euro, en particulier depuis la mise en place de la norme Euro 5 en 2009 (cf. la figure ci-après), aura pour effet de rendre plus ardu le « compromis » entre les émissions de CO2 et celles de NOX (102).
ÉVOLUTION DES NORMES D’ÉMISSIONS EN EUROPE POUR LES VÉHICULES DIESEL
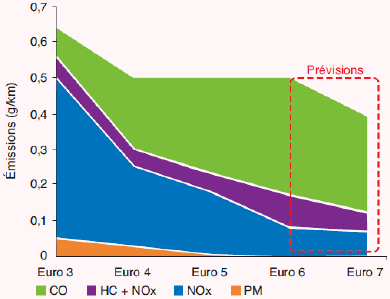
Nota : CO : monoxyde de carbone, HC et NOX : hydrocarbures et oxydes d’azote.
Source : Frost & Sullivan, Euro Emission Standards-Diesel Engines, cité par l’IFP Énergies nouvelles, Le point sur … Le Diesel, janvier 2016.
Les systèmes dits de post-traitement, qui visent à réduire les émissions de particules fines et d’oxydes d’azote, comportent, par ailleurs, des limites techniques, résumées dans l’encadré ci-dessous, qui peuvent peser sur leur contribution à la lutte contre la pollution l’air.
Les systèmes de post-traitement des particules et des NOX
En ce qui concerne les filtres à particules, fin 2013, selon l’ADEME, plus du tiers du parc des véhicules particuliers en circulation en était équipé, soit environ 7 millions de voitures.
L’ADEME indique que les filtres « fermés » permettent d’éliminer au moins 95 % en masse et 99,7 % en nombre des particules de 23 nanomètres, donc 100 fois plus petites que le seuil des PM2,5. Certains filtres fermés, dits « catalysés », seraient toutefois à l’origine de sur-émissions de dioxyde d’azote (NO2).
Les filtres à particules « ouverts » n’élimineraient, quant à eux, que 30 % à 50 % des émissions de particules. Ils ne permettraient pas, de ce fait, aux véhicules particuliers de respecter la réglementation Euro 5.
En ce qui concerne les systèmes de post-traitement des NOX, les principales solutions consistent à :
– agir sur la combustion par le recyclage des gaz à échappement (« recirculation des gaz d’échappement » ou EGR selon l’acronyme anglais). C’est, selon l’IFP Énergies nouvelles, la solution la plus répandue, car elle permet de satisfaire jusqu’aux normes Euro 5. Mais son utilisation intensive peut réduire les performances du moteur, ce qui a conduit les constructeurs à limiter son usage ;
– recourir à un piège à NOX, un système qui est appliqué sur les véhicules légers, de petite et moyenne taille. Toutefois, celui–ci ne fonctionne correctement que dans une certaine plage de température des gaz d’échappement ;
– recourir à la réduction catalytique sélective (SCR en anglais), où la réduction des NOX est assurée par une réaction avec de l’ammoniac, embarqué dans une solution aqueuse contenant 32,5 % d’urée, l’Adblue. Certaines mesures indiquent que cette technologie permettrait de réduire les émissions réelles de 60 %, sans pouvoir atteindre cependant le seuil fixé dans la norme Euro 6b. En outre, comme pour le piège à NOX, la fenêtre d’activité du catalyseur est limitée, ce qui peut affecter la performance du système. Enfin, le fonctionnement de ce dispositif implique de développer, de manière massive, un système de distribution d’urée car un plein d’Adblue tous les 20 000 kilomètres – chiffre avancé par les constructeurs, au lieu de la distance de 5 000 kilomètres conseillée par certains experts – entraînerait une augmentation très importante des émissions de NOX en conditions de conduite réelles.
Sources : Cour des comptes, ADEME, IFP Énergies nouvelles et contribution de M. François Cuenot de l’ONG Transport & Environment.
Ces apories techniques ont conduit l’ADEME à estimer que « de nouvelles réductions d’émissions à l’échappement seront de plus en plus difficiles à atteindre pour les véhicules particuliers, au-delà de la norme Euro 6. De plus, chaque nouveau dispositif de dépollution est susceptible de générer d’autres types d’émissions de polluants primaires ou secondaires » (103).
Ces remarques soulignent la nécessité, pour la branche automobile, de maintenir, si ce n’est d’accroître, ses investissements en matière de recherche et développement pour lui permettre de relever les défis technologiques, de plus en plus aigus, posés par la réduction conjointe des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques. Les rapporteurs sont confiants à ce sujet car les dépenses de cette industrie – 5,9 milliards d’euros en 2012 – constituent, depuis 1999, le plus important budget de R&D au sein des entreprises françaises, soit 15 % du total (104).
2. Les taxes et les aides concernant ce secteur favorisent les rejets de certains polluants
La fiscalité des carburants et les aides au renouvellement du parc des véhicules ne tiennent pas compte – ou alors de manière très limitée – de l’objectif de lutte contre la pollution par les oxydes d’azote et les particules fines. Ces outils ont en outre encouragé la diéselisation du parc, ce qui n’a pas été favorable à la qualité de l’air.
a. Des outils fiscaux et financiers non ciblés sur la lutte contre la pollution locale par les particules fines et les oxydes d’azote et qui encouragent la diéselisation du parc
• Les outils fiscaux
• Un déséquilibre qui est le fruit de l’histoire
Parmi tous les outils fiscaux applicables au secteur des transports routiers, un seul d’entre eux – et encore depuis 2014 seulement – est explicitement calculé sur les émissions de polluants atmosphériques, la taxe sur les véhicules de société (TVS), laquelle n’a rapporté, en 2015, que 773 millions d’euros (105).
L’outil principal – la fiscalité sur les carburants et le différentiel existant en faveur du gazole – a, selon la Cour des comptes, des effets « contreproductifs » sur ces mêmes émissions (106).
En effet, par rapport à l’essence, le gazole bénéficie d’une fiscalité préférentielle, qui se traduit par un taux réduit de taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE). Ce différentiel s’explique, historiquement, par le choix opéré par la France de privilégier, à la suite des deux chocs pétroliers, une politique fiscale favorable à la diéselisation du parc automobile, afin de soutenir les constructeurs français bien positionnés sur ce type de motorisation.
Comme le montre le tableau ci-après, depuis 2014, un rééquilibrage est cependant intervenu, afin de réduire l’écart de taxation entre le gazole et l’essence, tout particulièrement en faveur de celle qui incorpore des biocarburants, le super sans plomb 95-E 10 (SP 95-E 10).
Engagé par la loi de finances pour 2014, ce mouvement est complexe car il joue sur deux leviers :
– une augmentation tarifaire générale de la TICPE en fonction de la valeur croissante donnée à la tonne de carbone pour chaque carburant. Celle-ci est conforme à la trajectoire prévue par l’article 1er de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique, qui a fixé pour objectif au Gouvernement, pour le calcul des tarifs des taxes intérieures de consommation, de parvenir à une valeur de 56 euros par tonne de carbone en 2020 et de 100 euros par tonne en 2030 ;
– des modulations de la TICPE au profit de l’essence et aux dépens du gazole. Alors que le différentiel entre le gazole et le SP 95-E 10 était supérieur à 17 centimes en 2012, il ne sera plus que de 10 centimes en 2017.
TARIFS DE LA TICPE SUR LES PRINCIPAUX CARBURANTS DE 2012 À 2017
(en centimes d’euro par litre de carburant)
Type de carburant |
2012 |
2015 (fixé LFI 2014) |
2016 (fixé LFI 2014 mais non appliqué) |
2016 (fixé LFR 2015) |
2017 (fixé LFR 2015) |
Évolution 2014-2017 |
Essence SP 95 ordinaire |
60,69 |
62,41 |
64,12 |
64,12 |
65,07 |
+ 7,22 % |
Essence SP 95-E 10 |
60,69 |
62,41 |
64,12 |
62,12 |
63,07 |
+ 3,92 % |
Essence SP 98 |
63,96 |
65,68 |
67,39 |
67,39 |
68,34 |
+ 6,85 % |
Gazole |
42,84 |
46,82 |
48,81 |
49,81 |
53,07 |
+ 23,88 % |
Écart de tarif TICPE entre SP 95-E 10 et gazole |
17,85 |
15,59 (écart en baisse de 2,26 centimes) |
15,31 (écart en baisse de 0,28 centimes) |
12,31 (écart en baisse de 3,28 centimes) |
10,00 (écart en baisse de 2,31 centimes) |
– 43,98 % (écart en baisse de 7,85 centimes) |
Nota : L’essence SP 95 E 10 contient jusqu’à 10 % de biocarburants. Si l’essence SP 95 classique demeure plus largement distribuée dans notre pays, la proportion de SP 95-E 10 dans l’ensemble des volumes d’essences consommés en France est néanmoins passée de 13,4 % en 2010 à 30,1 % en 2014.
• Une subvention qui biaise les arbitrages entre les trois motorisations
Le différentiel de TICPE joue clairement comme une subvention en faveur des véhicules diesel. L’arbitrage entre les différentes motorisations dépend, en effet, des paramètres suivants : le kilométrage effectué chaque année par le conducteur, le prix initial du véhicule et la consommation de carburant. Or, vis-à-vis de ces facteurs, les trois types de motorisation disponibles présentent, chacun, des avantages et des inconvénients :
– les véhicules à essence, qui sont peu chers à l’achat, sont adaptés aux trajets courts. En revanche, leur coût relatif augmente vite, en raison de leur importante consommation de carburant ;
– les véhicules diesel sont adaptés aux trajets plus longs : plus chers à l’achat, leur coût relatif augmente lentement du fait de leur faible consommation de carburant. Les moteurs diesel présentent en effet l’avantage d’une consommation au kilomètre inférieure – de 10 à 15 % – à celle des moteurs à essence ;
– les véhicules électriques, très chers à l’achat, coûtent, en revanche, très peu à l’usage.
Le différentiel en faveur du gazole tend à détériorer les deux arbitrages essence/diesel et diesel/électrique, en rendant les véhicules diesel compétitifs sur tous les trajets et non pas seulement sur les trajets les plus longs.
IMPACT DE L’AVANTAGE FISCAL DU DIESEL SUR LE PARC AUTOMOBILE
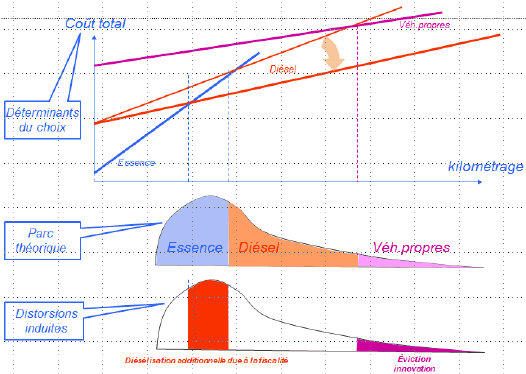
Source : Schéma communiqué par M. Dominique Bureau, président du Comité pour l’économie verte.
Lecture : Le différentiel de TICPE en faveur du gazole agit comme une subvention de la part variable du coût du véhicule (le coût du kilométrage), qui fait pivoter vers le bas la courbe de coût total du diesel. Ceci provoque une diéselisation non justifiée du parc – qui devrait comprendre davantage de véhicules essence, plus adaptés aux trajets courts –, car elle est suscitée par l’avantage fiscal et non pas par les mérites propres de ce type de motorisation. En outre, cette diéselisation excessive limite la part des véhicules propres alternatifs, en freinant les dépenses de recherche et développement sur ce type de voiture. En effet, l’avantage en faveur du gazole incite à concevoir des véhicules diesel innovants, ce qui freine l’entrée, sur le marché, des véhicules électriques ou hybrides.
En outre, deux autres mécanismes fiscaux ont pu favoriser le choix de ce type de motorisation. En premier lieu, les entreprises ont la possibilité de récupérer 80 % à 100 % de la TVA sur les dépenses de carburant des véhicules de tourisme et des véhicules utilitaires. Or cette mesure n’est applicable qu’au gazole (comme à l’essence E85 et au GPL) et exclut l’essence « ordinaire ». En second lieu, la taxe sur les véhicules de société (TVS), qui comprend un barème qui tient compte des différences de niveaux de pollution émise par les véhicules, comporte aussi un tarif en fonction de la puissance fiscale du véhicule, ce qui favorise les motorisations diesel.
• Une subvention dommageable à l’environnement
Dans un avis rendu en avril 2013, le Comité pour la fiscalité écologique, devenu depuis le Comité pour l’économie verte, a porté un jugement très critique sur le différentiel de taxation en faveur du gazole pour deux raisons :
– il avantage un carburant qui émet plus de gaz carbonique. En effet, compte tenu de l’écart de densité entre les carburants (la masse volumique du gazole est de 0,85 kg/l contre 0,74 kg/l pour l’essence), la combustion d’un litre de gazole émet 15 à 17 % de CO2 de plus que la combustion du même volume d’essence. Rappelons toutefois qu’avec les technologies actuelles, on parcourt 20 % de distance en plus avec un litre de gazole qu’avec un litre d’essence ;
– en outre, ce différentiel est « défavorable au gazole en ce qui concerne la pollution atmosphérique », puisqu’un litre de gazole émet plus d’oxydes d’azote (NOX) et de particules fines qu’un litre d’essence.
Ce comité a donc estimé que l’écart de taxation au profit du gazole est « injustifié au regard des coûts externes environnementaux des différents carburants » (107). La Cour des comptes est parvenue à la même conclusion, en considérant que « ce différentiel n’apparaît plus justifié : en prenant en compte à la fois leur contribution à la pollution de l’air et au réchauffement climatique, les externalités négatives produites par la circulation des véhicules diesel sont en effet supérieures à celles des véhicules essence » (108). Elle estime, de surcroît, que les allègements de la TICPE, qui incitent à la consommation de gazole, sont défavorables à la qualité de l’air. Or le total de ces dépenses fiscales est supérieur à 2 milliards d’euros en 2015 (109).
• La place prédominante du diesel dans le parc automobile
• Un phénomène européen
La diéselisation du parc a été rapide en France : 4 % des véhicules roulaient au gazole en 1980, contre pratiquement 64 % en 2013. Elle s’inscrit toutefois dans un mouvement européen d’ensemble, qui est la conséquence directe de politiques industrielles et fiscales favorables aux voitures diesel et qui se traduit, dans l’Union européenne, par un parc de véhicules particuliers constitué à 35 % par ce type de motorisation.
Ce contexte favorable est cependant en train de s’inverser, comme le montre le graphique ci-après, qui enregistre un fléchissement du taux de diéselisation entre 2010 et 2014.
TAUX DE DIÉSELISATION PAR PAYS
(en % du marché total)
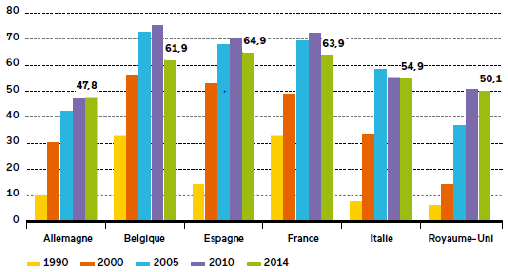
Source : Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA), L’industrie automobile française. Analyse et statistiques 2015, septembre 2015, p. 18.
• Des ventes de véhicules diesel qui baissent rapidement depuis 2014
Depuis 2002, les immatriculations de voitures particulières neuves équipées d’un moteur diesel ont été, en France, supérieures à celles des autres motorisations. Or, après le record atteint en 2012 (73 %), elles ont, en 2013, reculé pour la première fois, avant de baisser encore en 2014, pour représenter 64 % des immatriculations totales (110). En 2015, la part du diesel dans les nouvelles immatriculations est même passée sous la barre des 60 %, une évolution retracée par le graphique ci-dessous.
ÉVOLUTION, EN FRANCE, DE LA PART DU DIESEL
DANS LES NOUVELLES IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES PARTICULIERS
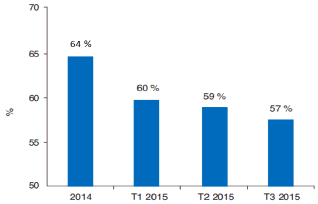
Source : Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA), cité par l’IFP Énergies nouvelles, Le point sur … Le Diesel, janvier 2016.
Ainsi, en à peine trois ans, le diesel a perdu 15 points de part de marché. Le premier trimestre 2016 a confirmé cette tendance, puisque la part des voitures diesel s’établit à 52,1 %, tandis que celle de l’essence progresse de 5,9 points à 43,4 % (111).
Ce contexte, qui marque une véritable rupture par rapport aux décennies passées, résulte de la combinaison de trois facteurs :
– le taux de ménages acheteurs de voitures neuves n’était, en 2015, que de 3,4 %, le plus faible depuis trente ans, et le peu de Français qui achètent une voiture neuve optent, le plus souvent, pour un petit modèle, moins cher. Or, avec l’accroissement de la part de marché des véhicules de gamme inférieure – les segments A et B, qui regroupent les « mini » ou petites citadines et les modèles polyvalents, de taille moyenne – « la demande en voiture diesel, une solution coûteuse pour les petits véhicules, se contracte » (112) ;
– les mesures récemment adoptées, qu’elles soient fiscales, financières ou réglementaires (réforme du bonus-malus, instauration d’une prime à la conversion limitée au véhicule électrique ou hybride, hausse de la TICPE sur le gazole, mise en place annoncée de zones à circulation restreinte dans certaines villes), sont défavorables à l’achat et à la revente des véhicules diesel ;
– ce contexte « anti–diesel » est encore aggravé par l’image dégradée (en termes d’environnement et de santé) de ce type de motorisation.
Pour certains experts, le diesel pourrait même devenir l’apanage exclusif des grosses berlines et disparaître des petits modèles urbains. En outre, comme le coût des véhicules diesel augmente avec celui des techniques de dépollution, le prix de ces voitures se rapproche de celui des véhicules essence hybrides, dont le bilan, en termes d’émissions de polluants, est meilleur. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’association Transport & Environment, considère que la hausse du taux de diéselisation est définitivement révolue.
• Les aides au renouvellement du parc
Le bonus-malus écologique et la prime à la casse, dont les conditions d’éligibilité sont uniquement fondées sur les émissions de CO2, visent à accélérer, dans le cadre de la lutte contre les gaz à effet de serre, la reconversion du parc automobile en faveur de véhicules moins émetteurs de dioxyde de carbone. Ces deux dispositifs ont permis d’atteindre cet objectif – selon le Commissariat général au développement durable (CGDD), l’émission moyenne est passée de 149 à 117 grammes de CO2 par kilomètre entre 1997 et 2013 –, mais ont eu, aussi, des effets ambivalents sur la qualité de l’air.
• La prime à la casse
Ce dispositif d’aide au remplacement de véhicules anciens, dont l’objectif premier était de soutenir le secteur automobile, a été appliqué entre 2009 et 2011. Il a été vertueux, du point de vue de la qualité de l’air, car il a permis de retirer de la circulation les véhicules les plus polluants, en les substituant par des véhicules performants. Son efficacité a été cependant limitée par le fait que le parc se renouvelle, aujourd’hui, très peu quand bien même 30 % des véhicules particuliers, soit 10 millions d’unités, ont plus de dix ans. En outre, les véhicules d’occasion, dont une forte proportion a plus de dix ans, représentent plus de 80 % des ventes de véhicules.
• Le bonus-malus
Instauré en 2008, ce dispositif vise à accélérer le renouvellement du parc automobile en faveur des véhicules plus sobres en énergie et moins émetteurs de gaz à effet de serre en agissant sur deux leviers : le bonus subventionne l’achat de voitures neuves émettant moins de CO2, tandis que le malus taxe, par une majoration du prix d’achat, les ventes de véhicules fortement émetteurs de dioxyde de carbone.
Depuis sa mise en place, les seuils d’attribution du bonus ont été resserrés au point de ne bénéficier, aujourd’hui, comme le montre le barème ci-après, qu’aux véhicules particuliers électriques ou hybrides rechargeables. La prime maximale de 6 300 euros ne concerne en effet que les véhicules particuliers qui émettent moins de 21 grammes de CO2 et qui ont, de fait, une motorisation électrique.
Taux d’émission de CO2 (en g/km) |
Montant du bonus (en euros) |
Montant du malus (en euros) |
0 à 20 |
6 300 (dans la limite de 27 % |
– |
21 à 60 |
1 000 |
– |
131 à 135 |
– |
150 |
136 à 140 |
– |
250 |
141 à 145 |
– |
500 |
146 à 150 |
– |
900 |
151 à 155 |
– |
1 600 |
156 à 175 |
– |
2 200 |
176 à 180 |
– |
3 000 |
181 à 185 |
– |
3 600 |
186 à 190 |
– |
4 000 |
191 à 200 |
– |
6 500 |
à partir de 201 |
– |
8 000 |
En outre, l’aide complémentaire à l’acquisition d’un véhicule peu polluant, dite prime à la conversion, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2015, n’atteint son maximum – 3 700 euros –, que dans le cas de l’achat d’un véhicule électrique. Elle est conditionnée, depuis le 1er janvier 2016, à la mise au rebut d’un véhicule diesel vieux de plus de dix ans, contre quinze ans auparavant. Cette dernière condition est si restrictive qu’elle explique, en partie, les mauvais résultats obtenus par le dispositif l’année dernière : à la fin de l’année 2015, en effet, seules 3 145 demandes de primes de conversion avaient été enregistrées.
Un bonus écologique également centré sur le CO2
pour les véhicules utilitaires légers (VUL)
Il est prévu, pour les véhicules utilitaires légers (VUL), un montant d’aide variable suivant le niveau d’émission de CO2 du véhicule :
– pour les véhicules dont le taux d’émission est inférieur ou égal à 20 g de CO2/km, le montant de l’aide est fixé à 27 % du coût d’acquisition, toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans toutefois être supérieur à 6 300 euros ;
– pour les véhicules dont le taux d’émission est compris entre 21 et 60 g de CO2/km, le montant de l’aide est fixé à 20 % du coût d’acquisition, toutes taxes comprises, du véhicule, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans toutefois être supérieur à 4 000 euros.
En 2014, seuls 3 562 VUL ont bénéficié de ce bonus écologique.
Ces différentes évolutions ont eu des effets ambivalents sur les rejets de polluants. Ainsi, lors de ses deux premières années d’application, comme le montre l’enquête de la Cour des comptes, le bonus a avantagé exclusivement les véhicules dont les rejets de CO2 étaient les moins élevés et orienté, de fait, les ventes vers les motorisations diesel, qui émettent des NOX et des particules (113).
À l’inverse, le dispositif actuel est extrêmement positif pour la qualité de l’air, puisqu’il soutient l’achat de véhicules électriques ou hybrides rechargeables qui n’émettent, à l’usage, aucun ou très peu de polluants. Dans le même temps, il n’aide quasiment pas les consommateurs – pour qui ces voitures, en raison de leur prix élevé, restent hors de portée – à acheter les véhicules diesel ou essence qui rejettent le moins de dioxydes d’azote et de particules fines.
La restriction du champ du bonus a été en effet compensée, mais seulement en partie, par une aide spécifique qui cible les véhicules essence les moins polluants. D’une part, une aide de 500 euros, réservée aux seuls ménages non imposables, a été accordée en 2015 pour l’acquisition d’un véhicule essence neuf ou d’occasion respectant la norme Euro 6 et émettant moins de 110 g de CO2/km. Elle est passée à 1 000 euros le 1er janvier 2016. D’autre part, les véhicules essence neufs ou d’occasion respectant la norme Euro 5 et émettant moins de 110 g de CO2/km sont éligibles à la prime à la conversion et ouvrent droit à une aide d’un montant de 500 euros pour les ménages non imposables.
Or, jusqu’à présent, cette aide, dont le montant est très inférieur au « bonus écologique » destiné à l’achat des véhicules électriques, n’a pas rencontré de succès, puisqu’elle a été demandée à 70 reprises seulement au cours de l’année 2015, dont 3 pour des véhicules d’occasion.
b. Un soutien au véhicule électrique qui reste faible au regard de son impact sur la pollution locale et de son potentiel de développement
Souvent présenté comme la meilleure solution pour assurer une mobilité propre, le véhicule électrique reste un achat très coûteux, en dépit des aides accordées. Par ailleurs, le bilan environnemental global de ce type de motorisation, de la production au recyclage, doit être nuancé.
• Un véhicule électrique (VE) non polluant à l’usage mais onéreux
Sur leur lieu d’utilisation, les véhicules électriques ont un bilan positif en termes de qualité de l’air. En effet, ils n’émettent aucun polluant à l’échappement, tandis qu’ils permettent de réduire les pollutions dues au freinage ou aux pneus, et ce pour trois raisons : l’absence d’embrayage, le recours au freinage récupératif, qui évite 80 % des freinages en récupérant, grâce à l’accélérateur, l’énergie cinétique, et l’utilisation de pneus à faible résistance.
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), dans une analyse du cycle de vie des véhicules thermiques et électriques, a d’ailleurs estimé qu’en cas de durcissement des normes européennes sur la qualité de l’air, le second type de motorisation présenterait, dans les grandes villes, un « net avantage » sur son équivalent thermique (114).
L’impact positif du développement des véhicules électriques dans les zones urbaines densément peuplées a été confirmé par une étude prospective réalisée par le cabinet de conseil Aria Technologies. Les modélisations effectuées indiquent qu’un parc roulant composé, en 2020, de 20 % de ces véhicules dans le centre-ville de Rome aurait pour effet de réduire, de manière substantielle, au niveau de la rue, les concentrations de plusieurs polluants : – 34 % pour le NOX, – 33 % pour le monoxyde de carbone, – 29 % pour les PM10 et – 22 % pour les PM2,5 (115).
Le recours à cette technologie se heurte toutefois au prix d’achat des véhicules électriques, qui est extrêmement élevé – soit 30 000 euros en moyenne, la batterie coûtant, à elle seule, environ 10 000 euros. Combiné à une autonomie faible, actuellement limitée à 150 kilomètres avec une seule charge (116), cet élément explique la part très faible occupée par le véhicule électrique dans le marché : en 2015, seuls 22 000 de ces véhicules ont été vendus, ce qui représente moins de 1 % des ventes totales.
La part des immatriculations de véhicules électriques augmente cependant de façon rapide. Sur le premier trimestre 2016, cette part a été multipliée par deux par rapport au même trimestre de 2015 et a atteint 1,2 % (117). En outre, à moyen terme, les deux éléments négatifs que constituent le prix du véhicule électrique et sa faible autonomie devraient progresser dans un sens favorable au consommateur. Les constructeurs ont en effet annoncé la réduction par deux du coût de la batterie d’ici 2020, tandis que l’autonomie des prochains modèles devrait, à l’inverse, doubler d’ici 2017.
Par ailleurs, l’infrastructure nécessaire à l’utilisation du véhicule électrique se développe, grâce au soutien apporté par les collectivités territoriales et l’État – pour ce dernier, via une enveloppe spécifique de 50 millions d’euros au titre du programme d’investissements d’avenir – à l’installation de points de charge : au nombre de 12 000 environ, ceux-ci devraient atteindre les 20 000 en 2017. Les entreprises participent aussi à cet effort, comme EDF, avec le projet de « corridor électrique » sur les autoroutes, ou le programme d’investissement du groupe Bolloré, qui porte sur 16 000 stations de recharge payantes.
De plus, les perspectives offertes par le recyclage de la batterie pourraient conforter le marché du véhicule électrique, en réduisant le coût de cette composante. Les constructeurs envisagent d’employer cet élément comme une unité de stockage d’électricité, afin de renvoyer l’énergie non utilisée dans le réseau ou d’alimenter la consommation domestique. De tels développements exigeront toutefois de mettre en place des dispositifs de charge bidirectionnelle et d’inventer un modèle économique, dans lequel, par exemple, l’électricité réutilisée serait achetée au propriétaire du véhicule.
Enfin, compte tenu de son coût, le véhicule électrique, qui reste stationné 90 % du temps, doit avoir un taux d’utilisation élevé pour devenir rentable. Les solutions d’auto-partage s’avèrent donc particulièrement adaptées pour ce mode de transport et le rendent, pour cette raison même, attractif pour les personnes désireuses d’instaurer un autre type de rapport à l’automobile.
Ces paramètres devraient favoriser la demande en véhicules électriques. Mais la pénétration de ce type de motorisation restera encore faible pendant de longues années. Les scénarios les plus optimistes des constructeurs tablent, en effet, sur une part de marché qui ne représenterait que 10 % des nouvelles immatriculations de véhicules particuliers d’ici 2030.
Les dispositifs d’aide publique sont donc essentiels pour soutenir la filière, jusqu’à ce que la production atteigne un volume critique et que les constructeurs puissent réaliser ainsi des économies d’échelle, qui fassent baisser le coût des véhicules électriques.
Or le soutien public au véhicule électrique, qui est important, n’empêche pas que celui-ci reste, pour de nombreux ménages, un produit de luxe, dont le prix moyen à l’achat est ultra-dissuasif.
Certes, depuis la réforme du bonus-malus de 2015, le cumul maximum du bonus et de la prime à la conversion s’établit à 10 000 euros au bénéfice des acquéreurs de voitures électriques. Mais, au final, ce montant reste très éloigné des 30 000 euros que représente, en moyenne, l’achat d’un véhicule électrique, les 20 000 euros restants n’étant pas à la portée de tous les budgets.
On observera, pour conclure, que les problématiques du véhicule hybride rechargeable sont proches. Il est vrai que celui-ci pollue lorsqu’il est fait usage, sur les trajets les plus longs, du moteur thermique, mais, avec une batterie apportant environ 60 kilomètres d’autonomie, ce type de véhicule permet un usage 100 % électrique, avec zéro émission, en milieu urbain. Le coût moyen d’un tel véhicule – 42 000 euros – est toutefois encore plus élevé que celui des modèles électriques purs, surtout lorsqu’il est rapporté à la prime spécifique de 2 500 euros à destination des acquéreurs de voitures émettant de 21 à 60 grammes de CO2/km, ce qui correspond aux véhicules hybrides n’utilisant pas le gazole.
• Un bilan environnemental global de la filière à nuancer
Le bilan écologique du cycle de vie (de la production au recyclage) des voitures électriques a été peu étudié. En effet, il n’y a pas d’autre évaluation que celle établie par l’ADEME en 2013, qui a déjà été citée. Or cette analyse conduit à nuancer l’impact positif de ce type de motorisation pour deux raisons :
– la contribution de la phase de fabrication au potentiel de changement climatique est significativement plus importante pour le véhicule électrique (69 %) que pour le véhicule thermique (15 %). La production de la batterie représente, à elle seule, 35 % de la contribution du véhicule électrique à l’effet de serre. Cependant, à l’usage, ce type de véhicule permet un gain environnemental certain. Sa contribution au changement climatique est alors estimée à 9 tonnes d’équivalent CO2, contre 22 tonnes pour un véhicule thermique ;
– le potentiel d’acidification atmosphérique du véhicule électrique, c’est-à-dire d’augmentation de la teneur en substances acidifiantes dans la basse atmosphère, à l’origine des pluies acides, est plus élevé que celui du véhicule thermique. Cette différence résulte notamment des émissions de dioxyde de soufre (SO2) provenant de la production du cobalt et du nickel utilisés dans la batterie (118).
c. L’abandon de l’écotaxe poids-lourds : une occasion manquée
Le secteur du transport routier de marchandises contribue de manière importante aux émissions de polluants atmosphériques. Or, depuis l’abandon de l’écotaxe poids-lourds, la fiscalité qui lui est applicable n’en tient absolument pas compte, ce qui remet en cause l’application du principe pollueur–payeur. Il convient donc de donner une dimension environnementale plus marquée aux mesures qui encadrent ce secteur.
• Un secteur fortement émetteur et qui a pris, depuis longtemps, le dessus sur les modes de transport plus propres
Les trois postes qui contribuaient de manière prépondérante aux émissions d’oxydes d’azote (NOX) du transport routier étaient en 2013 (119) :
– les véhicules particuliers (VP) diesel catalysés à hauteur de 39 % ;
– les poids-lourds roulant au gazole à hauteur de 37 %, le diesel ayant toujours été un carburant utilitaire (il n’existe pas de camion essence) ;
– les véhicules utilitaires légers (VUL de moins de 3,5 tonnes) à hauteur de 15 %. Ces véhicules ont représenté, selon le ministère de l’environnement, 12,6 % du transport réalisé par les véhicules immatriculés en France en 2014.
Ces chiffres montrent la part très majoritaire, dans ces émissions, des poids-lourds et des VUL, tout en soulignant le fait que la contribution de ces deux catégories de véhicules est notablement différente. Cette différenciation s’observe aussi pour les émissions de PM2,5 : les poids-lourds en représentent environ 15 % et les VUL environ 30 %. En outre, les émissions des poids-lourds sont réparties entre les zones urbaines et les grands axes routiers et celles des véhicules utilitaires sont plus fortement localisées en agglomération.
Par ailleurs, parce qu’il est compétitif, le transport routier occupe, de très loin, la première place dans le transport intérieur de marchandises, au détriment du transport ferroviaire et fluvial, plus propre. Selon le ministère de l’environnement, la route assure en effet 85 % du transport terrestre intérieur de marchandises, contre 9,5 % pour le transport ferroviaire et 2,3 % pour le transport fluvial – en Allemagne, ces parts étaient, en 2013, de respectivement 63,9 %, 23,5 % et 6,8 %. En outre, les distances en charge inférieures à 300 kilomètres prédominent dans notre pays, ce qui rend plus difficile le transport modal. 57 % des tonnes chargées par le pavillon français sont même livrées à moins de 50 kilomètres (120).
TRANSPORT INTÉRIEUR DE MARCHANDISES EN FRANCE
(en milliards de tonnes-kilomètres)
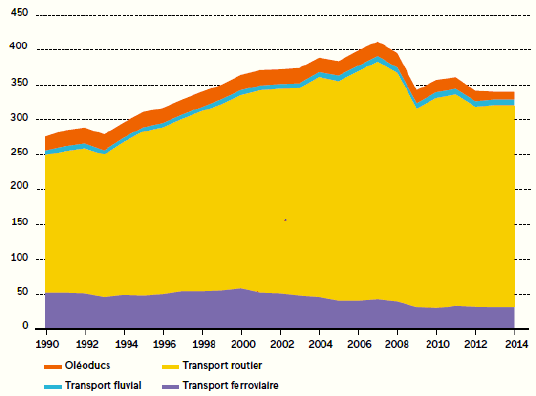
Source : Ministère de l’écologie, cité par le Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA), L’industrie automobile française. Analyse et statistiques 2015, septembre 2015, p. 45
La position géographique centrale de la France sur le continent européen génère, de surcroît, un trafic de transit intense, qui est un facteur de pollution « importée ». À titre d’illustration, en 2014, 6,1 millions de poids-lourds ont traversé les Pyrénées (soit deux fois plus que les Alpes françaises), le transit représentant près de la moitié de ces flux. Cette position entraîne aussi, toujours au détriment de la qualité de l’air car les camions concernés peuvent être âgés, une forte activité de cabotage sur le territoire national, qui fait de notre pays le second le plus caboté de l’Union européenne, après l’Allemagne (121).
Ces phénomènes sont bien connus. Ils auraient dû conduire notre pays à appliquer un dispositif qui aurait permis d’internaliser les effets négatifs des polluants émis par le secteur des transports routiers, notamment celui des poids-lourds. Or ce ne fut pas le cas, en raison du fiasco de l’écotaxe.
• Une mesure utile mais inappliquée : l’écotaxe poids-lourds
Les rapporteurs ne referont pas ici un historique détaillé de l’écotaxe, qui a fait l’objet, à l’Assemblée nationale, d’une mission d’information, présidée par le président de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, M. Jean-Paul Chanteguet (122).
On rappellera seulement que cette taxe a été instituée par la loi de finances pour 2009, à la suite des conclusions du Grenelle de l’environnement, dont l’engagement n° 45 prévoyait la création d’une éco-redevance kilométrique pour les poids-lourds sur le réseau routier non concédé. Elle devait mettre en œuvre le principe d’utilisateur-payeur du réseau routier, tout en contribuant à la réduction des émissions de polluants, de la manière suivante :
– le produit de cette taxe devait financer des projets d’infrastructures de transports, en particulier des lignes à grande vitesse et des voies navigables, par le biais d’une affectation à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) ;
– les taux kilométriques de la redevance étaient modulés en fonction de la catégorie d’émissions Euro du véhicule ;
– elle était due pour tout véhicule, immatriculé en France ou à l’étranger, dont le poids total autorisé en charge était supérieur à 3,5 tonnes.
Cette taxe, qui devait entrer en vigueur au 20 juillet 2013, a été reportée, une première fois, en raison de difficultés techniques, puis suspendue, par le Premier ministre, le 29 octobre 2013, après un mouvement de contestation. Elle devait être toutefois remplacée par un péage de transit, qui a été annoncé en juin 2014 et adopté par la loi du 8 août 2014 de finances rectificative, avant d’être, lui aussi, suspendu sine die le 9 octobre 2014.
Les rapporteurs ne peuvent que regretter cette occasion manquée, qui représente un coût – évalué à 968 millions d’euros, en comptant l’indemnisation d’Écomouv’, la société chargée de la collecte de l’écotaxe – et qui se démarque des choix effectués par trois de nos voisins, qui ont institué des taxes ou redevances kilométriques : la Suisse depuis 2001, l’Allemagne depuis 2005 et la Belgique depuis le 1er avril 2016.
• Faut-il mettre en place une fiscalité environnementale des véhicules de transport ?
La résiliation du contrat avec Ecomouv rend « irréaliste » – c’est le terme employé par la rapporteure de la commission d’enquête du Sénat sur le coût de la pollution de l’air, Mme Leila Aïchi – le rétablissement de l’écotaxe (123).
Dans le même temps, les véhicules de transport devraient contribuer plus fortement à l’objectif de lutte contre la pollution de l’air.
M. Jean-Louis Roumégas considère qu’il est indispensable d’envoyer, à cet effet, un signal prix au transport routier de marchandises, en agissant sur le levier de la fiscalité. Or le seul instrument qui puisse être mobilisé rapidement est celui de la taxe sur les poids-lourds de fort tonnage. Les véhicules porteurs et les tracteurs routiers de 12 tonnes et plus immatriculés en France, soit un parc d’environ 400 000 engins, acquittent en effet une taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSCVR), aussi appelée « taxe à l’essieu », qui est notamment assise sur le nombre d’essieux et dont le produit finance l’entretien des voiries. L’article 28 de la loi de finances pour 2009 a baissé, à compter du 1er janvier 2009, les montants de cette taxe en les alignant sur les taux minimaux fixés par la directive « Eurovignette » du 17 juin 1999, en prévision de l’entrée en vigueur de l’écotaxe. Compte tenu de l’abandon de cette dernière, il conviendrait de revenir sur cette baisse.
Proposition de M. Jean-Louis Roumégas : augmenter la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSCVR ou « taxe à l’essieu ») sur les poids-lourds de fort tonnage.
M. Martial Saddier estime, pour sa part, qu’il est préférable d’agir sur le levier réglementaire pour trois raisons.
1° La fiscalité qui pèse sur le transport routier de marchandises est d’ores et déjà élevée, ce secteur acquittant environ 3,5 milliards d’euros de TICPE. En outre, la suspension de l’écotaxe, puis du péage de transit poids-lourds, a été compensée par une augmentation de la fiscalité sur le gazole routier : l’accise « gazole professionnel » pour le transport routier de marchandises a été en effet fixée, depuis le 1er janvier 2015, à 43,19 €/hl, soit une hausse de 4 €/hl, qui doit rapporter une recette d’au moins 300 millions d’euros, presque équivalente, selon les calculs de la Fédération nationale des transporteurs routiers, aux montants prévus pour le droit de péage.
2° Les normes Euro applicables aux poids-lourds (Euro 0 à Euro VI) ont démontré leur efficacité en termes de réduction des émissions polluantes, d’autant que ces véhicules sont testés avec des cycles d’essai spécifiques, qui reproduisent assez fidèlement les conditions d’usage et qui sont plus stricts que ceux appliqués aux véhicules particuliers et aux véhicules utilitaires légers.
En 23 ans, entre les normes Euro 0 et Euro VI, les plafonds d’émissions ont été divisés par 36 pour les oxydes d’azote, par 18 pour les hydrocarbures et par 35 pour les particules. La norme Euro VI, qui s’applique depuis le 1er janvier 2014 à tous les poids-lourds neufs de plus de 3,5 tonnes, impose ainsi, par rapport à la norme Euro V, des réductions supplémentaires de 80 % pour les oxydes d’azote, de 50 % pour les particules et plus de 70 % pour les hydrocarbures.
L’abaissement des seuils a en outre conduit les constructeurs à équiper ces véhicules de filtres à particules et de systèmes de « déNOX », des dispositifs dont la durabilité est garantie sur 7 ans ou 700 000 kilomètres et qui, à la différence de ce que l’on peut observer pour les véhicules particuliers, semblent performants.
L’enjeu essentiel réside donc dans le renouvellement de la flotte des poids-lourds, qu’elle soit dédiée au transport de marchandises ou de voyageurs, puisque la part des véhicules les plus polluants, ceux inférieurs à la norme Euro IV, s’élève, selon le Commissariat général au développement durable, à 27,5 %.
3° Enfin, une taxation environnementale accrue des poids-lourds ne permettrait pas de lutter efficacement contre les émissions des véhicules utilitaires légers (VUL). Or certains d’entre eux sont très anciens et polluent beaucoup. Il suffit d’ailleurs de se promener dans n’importe quelle agglomération pour prendre la mesure des nuisances dues à ces « cheminées roulantes », qui devraient être mises hors jeu par des mesures incitatives.
Proposition de M. Martial Saddier : agir sur le levier règlementaire et non sur la fiscalité pour réduire la pollution issue des poids lourds et des véhicules utilitaires.
3. Le contrôle des émissions automobiles souffre de faiblesses structurelles
Les normes Euro fixent des valeurs limites d’émission pour quatre polluants (oxydes d’azote, monoxyde de carbone, hydrocarbures et particules fines). Elles constituent, selon la Cour des comptes, le « socle » de la stratégie de réduction de la pollution issue du secteur routier (124) et ont eu, comme cela a déjà été souligné, un impact favorable sur la qualité de l’air.
Ces normes comportent toutefois d’importantes limites intrinsèques, qui concernent majoritairement les véhicules diesel et qui résultent du caractère biaisé des procédures mises en œuvre pour contrôler les émissions. La Commission européenne a proposé d’améliorer ce dispositif en adoptant plusieurs initiatives, dont l’une est très controversée.
a. Des procédures d’essai qui ne permettent pas d’assurer le respect des normes Euro
En vertu de la directive n° 2007/46/CE du 5 septembre 2007, tous les véhicules automobiles doivent être réceptionnés ou homologués pour pouvoir être mis en circulation sur la voie publique.
Cette procédure d’homologation vise à s’assurer que le véhicule répond aux exigences réglementaires en termes de sécurité et d’impact environnemental. Elle est décentralisée, en application du principe de subsidiarité. Par conséquent, si l’Union européenne dispose de la compétence de définir les limites d’émissions et les règles encadrant les procédures d’essai avant la délivrance de l’homologation, il revient aux États membres de veiller à la mise en œuvre de ces tests. La majorité d’entre eux ont désigné, à cet effet, des services techniques, directement rémunérés par les constructeurs automobiles.
Selon la présidente de la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale, Mme Danielle Auroi, ce cadre juridique, qui permet au constructeur de choisir l’État membre dans lequel il souhaite procéder à la réception du véhicule, a eu pour conséquence, comme les avis des autorités nationales d’homologation peuvent diverger et leur réputation de rigueur varier, un « chalandage administratif », dans lequel les fabricants recherchent le système le plus souple ou le moins coûteux (125). Un récent document de travail de la Commission européenne permet d’illustrer ce phénomène, en indiquant que le Luxembourg, les Pays-Bas et Malte, qui n’ont pas de production automobile, ont délivré respectivement 1 002, 393 et 344 titres d’homologation de modèles entre 2004 et 2009 (126).
En outre, sur le plan technique, dans un avis publié en 2014, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a indiqué que le cycle d’essai utilisé pour la vérification du respect des normes Euro – le New European Driving Cycle ou NEDC, utilisé depuis plus de 40 ans et en vertu duquel les polluants sont mesurés à l’échappement en laboratoire – « n’est pas représentatif des émissions des véhicules lors de leur usage réel, ce qui conduit à sous-estimer, entre autres, les émissions de NOx des voitures diesel ». Par conséquent, le durcissement des seuils d’émissions des NOx des voitures diesel n’a pas permis de diminuer les émissions réelles de ces véhicules à l’usage (127).
Ironie du sort, cet avis a été rendu un an avant l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2015, de la norme Euro 6, qui réduit par deux les rejets maximaux autorisés de NOX (128).
COMPARAISONS DES ÉMISSIONS DE NOX ENTRE LES SEUILS EURO
ET EN CONDITIONS RÉELLES
|
|
Comparaison entre les seuils réglementaires Euro* et les émissions calculées en usage réel suivant la méthode HBEFA** de l’évolution, dans le temps, des émissions de NOx des voitures diesel et essence.
* Euro 3 : véhicules neufs en vente entre 2001 et 2005, Euro 4 entre 2006 et 2010 et Euro 5 après 2011.
** HandBook Emission Factors for Road Transport : facteurs unitaires d’émissions de polluants construits à partir de mesures, sur de nombreux véhicules, d’émissions de polluants, suivant des cycles de roulage représentatifs des usages réels mixtes ville, route et autoroute.
Source : ADEME (2014).
Le décalage entre les émissions mesurées en laboratoire et celles relevées à l’aide d’un système « mobile », car embarqué dans le véhicule et donc plus fiable, avait pourtant été relevé dès 2011 par le centre commun de recherche de la Commission européenne.
De plus, ce décalage peut être accentué par des stratégies d’optimisation aux homologations, c’est-à-dire par le fait que certains véhicules sont préparés de manière à respecter les valeurs limites à l’émission sur banc d’essai (par exemple, par le réglage de la pression des pneus ou la désactivation de la climatisation).
Il a été confirmé depuis par plusieurs études. À titre d’illustration, en 2015, les analyses effectuées par le logiciel AVL Cruise ont montré que les émissions de CO2 d’une voiture à essence, en conditions de conduite réelles, dépassaient d’environ 65 % les résultats des tests « classiques » (129). En ce qui concerne les véhicules diesel, l’ONG Transport & Environment a estimé, dans un rapport publié le 14 septembre 2015, que seuls 10 % d’entre eux respectent la norme Euro 6 en conditions normales d’utilisation.
Auprès du grand public, les limitations techniques des tests actuels ont été spectaculairement mises en lumière par la révélation, le 18 septembre dernier, par l’Environmental Protection Agency américaine, que 482 000 véhicules diesel de marques Audi et Volkswagen, construits entre 2009 et 2015 et vendus aux États-Unis, avaient été équipés d’un logiciel permettant de fausser les émissions de NOX avant l’homologation de l’administration fédérale.
Le retentissement de cette affaire a conduit le ministère de l’environnement à lancer, en janvier 2016, un programme de contrôle portant sur 100 voitures représentatives du marché français, choisies de façon aléatoire. La commission technique indépendante chargée d’évaluer leurs émissions a publié, le 7 avril dernier, les résultats, résumés dans l’encadré ci-dessous, des tests effectués sur les 52 premières voitures, sur un banc d’essais dans un laboratoire et sur route avec un appareil embarqué.
Résultats des contrôles des émissions de NOX et de CO2 effectués par la commission technique indépendante installée le 4 janvier 2016
En ce qui concerne les oxydes d’azote (NOX) :
– Les résultats du cycle d’essais « traditionnel », qui a été légèrement modifié (passage de la marche arrière par exemple), montrent que 12 véhicules, principalement des Euro 6, dépassent de plus de 10 % la norme autorisée.
– Les essais sur piste montrent que 8 véhicules Euro 6 sur les 9 testés, bien qu’équipés d’une vanne EGR recyclant les gaz d’échappement et d’un piège à NOX, présentent des anomalies, qui peuvent dépasser jusqu’à cinq fois la norme.
– Au total, une majorité (13 sur 23) des véhicules Euro 6 testés en conditions réelles dépassent de plus de 5 fois leurs limites d’émissions.
En ce qui concerne le dioxyde de carbone (CO2), en conditions réelles d’utilisation, les trois quarts des véhicules testés présentent des émissions supérieures de 20 % à 50 % à ce qui est autorisé.
Source : ministère de l’environnement.
Ce contexte d’ensemble a une double conséquence :
– politique car il remet en cause le système d’homologation des véhicules et l’effectivité des normes Euro, ce qui a des répercussions sur la confiance que le citoyen et le consommateur peuvent accorder aux institutions et aux industriels ;
– pratique car il fausse les inventaires nationaux d’émissions de polluants. Ceux réalisés par le Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) pour la pollution du secteur routier se basent sur des données européennes (de type COPERT ou HBFA), qui s’appuient sur des tests, certes plus réalistes que ceux effectués à l’homologation, mais qui restent des essais en laboratoire. Les données issues de ces mesures pourraient être, par conséquent, systématiquement sous-évaluées, ce qui aurait pour effet de réduire la fiabilité d’ensemble des statistiques sur la réduction des émissions de polluants.
b. Des propositions d’amélioration de la Commission européenne en partie contestées
• Une redéfinition des protocoles de test qui relève les seuils d’émission de NOX
En 2015, dans le cadre de la procédure dite de « comitologie », la Commission européenne a proposé, au titre de sa compétence d’exécution, de réviser le cadre réglementaire des procédures d’essai afin d’introduire des tests de mesure des émissions en conduite réelle (130).
Elle a présenté, dans ce but, deux textes qui supposent la mise au point d’un équipement de mesure mobile ou embarqué de type Portable Emissions Measurement System (PEMS) :
– le premier texte définit les procédures d’essai en conditions réelles, dites Real Driving Emissions Tests ou RDE ;
– le second définit les niveaux intermédiaires et les délais auxquels les constructeurs automobiles devront se conformer avant de respecter le plafond d’émission de polluants autorisé.
La Commission européenne a proposé par ailleurs de remplacer le cycle d’homologation utilisé depuis 1973 par le cycle d’homologation international WLTP pour mesurer, en laboratoire, les émissions de CO2 et de polluants.
Sur la base de l’avis favorable du Comité technique des véhicules à moteur (CTVM) rendu le 28 octobre 2015, la Commission européenne a transmis, le 25 novembre 2015, au Conseil de l’Union européenne et au Parlement européen une proposition de règlement visant à mettre en œuvre les tests RDE en deux étapes :
– 1ère étape : au plus tard le 1er septembre 2017 pour les nouvelles homologations de véhicules et le 1er septembre 2019 pour tous les véhicules neufs vendus, les niveaux d’émissions pour les NOX en conduite réelle ne devront pas dépasser la limite fixée par les normes Euro 6 majorée par l’application d’un coefficient multiplicateur de 2,1. Cette marge de tolérance est appelée facteur de conformité ;
– 2nde étape : au plus tard le 1er janvier 2020 pour les nouvelles homologations de véhicules et le 1er janvier 2021 pour tous les véhicules neufs vendus, le facteur de conformité sera limité à 1,5.
Ce règlement de la Commission européenne a été finalement publié le 28 avril 2016 et porte le n° 2016/646.
Le facteur de conformité moyen actuel, estimé à 400 % aujourd’hui, passera donc, pour les nouveaux modèles de voitures, à 110 % d’ici septembre 2017, puis à 50 % d’ici janvier 2020. Comme le montre le graphique ci-dessous, ces facteurs de conformité conduisent à relever, de manière significative, les seuils d’émission de NOX.
LA RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE ET LES NIVEAUX D’ÉMISSION DE NOX
MESURÉS EN CONDITIONS DE CONDUITE RÉELLES
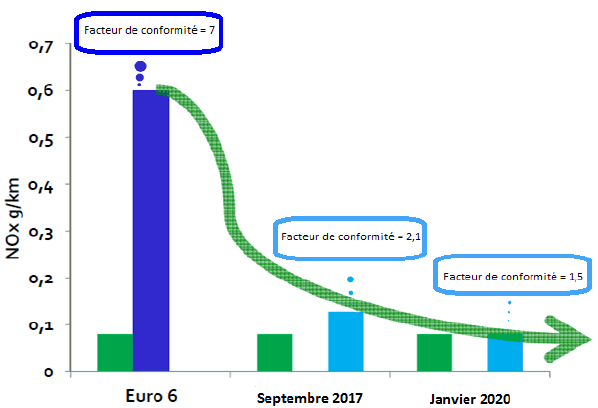
Nota : Les trois histogrammes verts indiquent les niveaux d’émission de NOx autorisés par la norme Euro 6. L’histogramme bleu foncé indique les niveaux d’émission de NOx de certains véhicules Euro 6 mesurés en conditions de conduite réelles. Les deux histogrammes bleu clair indiquent les niveaux d’émission de NOx en conditions réelles autorisés par le règlement « RDE », avec, pour les nouveaux modèles de véhicules, des marges de tolérance ou de dépassement de 110 % (facteur de conformité de 2,1) en septembre 2017 et de 50 % (facteur de conformité de 1,5) en janvier 2020.
Source : d’après l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA).
La Commission européenne a justifié ces marges de tolérance, qui entreront en indiquant qu’elles résultent des incertitudes qui entourent la fiabilité technique des appareils de mesure embarqués.
En réalité, la discussion sur le calendrier d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et leur degré de flexibilité, loin de se résumer à des échanges purement techniques, a donné lieu à d’âpres débats, résumés dans l’encadré ci-après, entre les États membres, la Commission européenne et le Parlement européen.
Les conditions d’adoption et le contenu du règlement « RDE » sont, de surcroît, soupçonnés d’avoir fait la part trop belle aux constructeurs automobiles européens pour deux raisons :
– d’une part, le comité technique ayant validé ce règlement, le CTVM, qui réunit des représentants des États membres et de l’industrie automobile, ainsi que des experts, est composé à 70 % de représentants de ce secteur économique ;
– d’autre part, la Commission européenne, en proposant d’appliquer ces marges de tolérance, a de facto amendé les seuils d’émission et leur date d’entrée en vigueur, autant d’éléments qui sont fixés par un acte communautaire de base (le règlement n° 705/2007) et a donc outrepassé sa compétence d’exécution. Telle est, en tout cas, l’analyse effectuée, le 7 novembre 2015, par le service juridique du Parlement européen. Si celle-ci était juste, le protocole RDE pourrait faire l’objet d’un recours en annulation devant la Cour de justice de l’Union européenne, à condition qu’une institution européenne ou un État membre prenne l’initiative de la saisir...
Un règlement « RDE » très contesté
La présidente de la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale, Mme Danielle Auroi, a estimé, le 14 janvier dernier, que si ce texte « constitue un progrès au regard des différences mesurées aujourd’hui (en moyenne 400 %), c’est aussi une nette révision à la baisse de la proposition initiale de la Commission européenne (phase de transition jusqu’en 2019, seuil de tolérance fixé à 60 %, puis à 20 % ensuite) ». En outre, ce règlement renvoie « l’application réelle de la norme Euro 6 à une date hypothétique » puisque la marge de tolérance de 1,5 est, à ce stade, autorisée pour une durée indéterminée pour les nouvelles immatriculations.
Ce recul en termes d’ambition normative résulte des demandes des États membres. Ainsi, selon le journal Le Monde en date du 16 décembre 2015, la France aurait demandé un facteur de conformité d’au maximum 2 jusqu’en 2019, puis d’au moins 1,4 (40 %) au-delà. D’autres États membres, comme l’Italie, l’Espagne et la République tchèque, auraient prôné des facteurs de conformité encore plus souples (2,6), tandis que l’Allemagne aurait défendu un facteur de 2,1 pour la période 2017-2019.
De nombreux députés européens se sont montrés, de leur côté, très critiques à l’égard du règlement « RDE ». La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen a ainsi adopté, le 14 décembre 2015, une « résolution d’objection » contre ce texte, au motif qu’il excédait les compétences d’exécution prévues par l’acte de base et n’était pas compatible avec le but ou le contenu de cet acte, et demandé à la Commission européenne de soumettre une nouvelle proposition. La résolution a toutefois été rejetée (par 323 voix contre 317) en séance plénière le 3 février 2016, ce qui a ouvert la voie à l’adoption du règlement « RDE » le 20 avril dernier.
Une résolution du Parlement européen du 27 octobre 2015 a par ailleurs recommandé l’adoption des « bonnes pratiques » suivantes en matière de mesure des émissions automobiles : la possibilité de procéder à une réévaluation, par la Commission européenne, des certificats d’homologation délivrés par les autorités nationales ; la création d’une autorité de surveillance européenne ; le prélèvement, chaque année, d’un échantillon représentatif de nouveaux modèles pour les tester en conditions de conduite réelle, etc. (131).
Cette assemblée s’est également prononcée, par une résolution adoptée le 17 décembre 2015, en faveur de la création d’une commission d’enquête, au mandat très large, sur le rôle et la responsabilité de la Commission européenne et des États membres dans le scandale Volkswagen. Son champ d’investigation inclut notamment le manquement allégué de la Commission européenne et des autorités des États membres à prendre des mesures appropriées et efficaces pour superviser l’application de la réglementation et le manquement allégué de la Commission à introduire des tests reflétant les conditions réelles de conduite.
• Une proposition de règlement révisant le cadre de l’homologation des véhicules
Le 27 janvier 2016, la Commission européenne a présenté une proposition de règlement relatif à la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur qui tend à abroger la directive 2007/46/CE et à durcir les règles du jeu.
Très ambitieuse, cette nouvelle initiative propose de :
– rémunérer les services techniques effectuant les tests via une taxe collectée auprès des constructeurs ;
– soumettre ces services à un système d’audit centralisé (les audits seraient effectués dans les laboratoires d’essais par la Commission européenne et des experts nationaux et contrôlés ensuite par les pairs) ;
– organiser des contrôles a posteriori, effectués sur les véhicules en circulation pour compléter les contrôles avant homologation ;
– donner à la Commission de nouveaux pouvoirs, notamment celui de suspendre l’accréditation des services techniques défaillants, de contester une homologation délivrée par une autorité nationale, de demander le rappel d’un véhicule du marché et d’imposer des amendes (jusqu’à 30 000 euros par véhicule non conforme) aux constructeurs convaincus d’infractions.
B. TAXER ET AIDER LES VÉHICULES EN FONCTION DE LEUR DEGRÉ DE NOCIVITÉ
Une politique plus volontariste de réduction des émissions du secteur routier implique de mettre en place une approche cohérente, qui traite l’ensemble des polluants – sans oublier pour autant l’objectif de réduction du CO2 – et responsabilise les acteurs, c’est-à-dire les constructeurs et les consommateurs. Cette approche intégrée devrait donc reposer sur un système d’incitation plus élaboré.
1. Faut-il résorber le différentiel de taxation essence-gazole ?
La « prime à la diéselisation » induite par le différentiel de taxation en faveur du gazole constitue l’un des plus importants défis posés à la politique en faveur de la qualité de l’air. Ainsi que cela a déjà été souligné, un rééquilibrage partiel entre les taux de la TICPE applicables au gazole et à l’essence a été voté en lois de finances, jusqu’en 2017. Celui-ci est-il opportun ou faut-il aller encore plus loin ? Les rapporteurs ont des positions divergentes à ce sujet.
• Un différentiel de taxation à corriger pour M. Jean-Louis Roumégas
M. Jean-Louis Roumégas considère qu’un différentiel de taxation en faveur d’un des deux carburants ne peut être justifié que si l’un d’entre eux est moins « émetteur » que l’autre. Or, comme cela a été déjà indiqué, un litre de gazole émet plus de CO2, d’oxydes d’azote (NOX) et de particules qu’un litre d’essence.
Par conséquent, pour M. Jean-Louis Roumégas, le différentiel de taux de la TICPE en faveur du gazole devrait être supprimé et même être inversé, afin que le gazole soit davantage taxé que l’essence. C’est seulement à cette condition, en effet, que pourrait être institué un système de prix efficace, qui pénalise le dioxyde de carbone et les polluants atmosphériques à hauteur de leurs dommages environnementaux et incite les consommateurs à faire de bons arbitrages.
En outre, une annulation du différentiel de la TICPE aurait certainement un impact important et immédiat, via ses répercussions économiques et psychologiques, sur le taux de diéselisation du parc automobile.
Enfin, le rééquilibrage du prix à la pompe entre gazole et essence pourrait s’avérer plus aisé dans le contexte actuel, en raison des prix relativement bas des produits pétroliers. Des délais devraient être cependant prévus pour faciliter l’acceptabilité d’une telle mesure ; ils devraient être couplés à un mécanisme transitoire compensateur pour les activités commerciales qui ne disposent pas, à court terme, d’alternatives au diesel, comme, par exemple, le transport routier de marchandises.
Proposition de M. Jean-Louis Roumégas : modifier la fiscalité sur les carburants :
– supprimer, dans un premier temps, l’écart de TICPE qui avantage le gazole tout en prévoyant un mécanisme compensateur pour les activités commerciales ne disposant pas, à court terme, d’alternatives au gazole ;
– augmenter, dans un second temps, les taux de TICPE pour taxer plus fortement le gazole que l’essence.
• Une voie alternative à privilégier pour M. Martial Saddier : le recours massif à des incitations financières
M. Martial Saddier estime qu’en matière de fiscalité, il convient toujours d’agir avec prudence, surtout si l’on veut tenir compte de trois grands objectifs : continuer de lutter contre le réchauffement climatique, éviter de déstabiliser l’appareil industriel et de recherche du secteur automobile, et préserver nos entreprises de transport.
La réduction du différentiel de taux de la TICPE en faveur du gazole serait, de ce point de vue, quadruplement problématique.
1° Cette mesure pourrait fragiliser les entreprises gestionnaires de flottes pour lesquelles la problématique de revente des véhicules est importante, surtout en cas de risque de chute de prix du véhicule diesel d’occasion.
2° Cette mesure affecterait aussi, pour les mêmes raisons, les ménages, comme le montrent les calculs du directeur de l’Observatoire du véhicule du CETELEM, M. Flavien Neuvy. Cet expert a estimé que « dès lors que l’on décide d’harmoniser les prix de l’essence et du diesel, on prononce la fin des ventes de véhicules particuliers diesel » : en effet, « à partir du moment où les prix des carburants sont les mêmes, pour amortir le surcoût à l’achat et à l’usage – car un véhicule diesel est plus coûteux à entretenir –, il ne faudra plus faire 20 000 kilomètres par an, mais sans doute 30 000 ou 40 000 : dès lors, plus personne n’aura intérêt à acheter une voiture diesel. Dans un tel contexte, la valeur des véhicules diesel à la revente va diminuer, et leurs propriétaires vont subir une décote d’environ 20 % – ce qui peut représenter une perte de 1 000 euros pour un véhicule de 8,5 ans et 70 000 à 80 000 kilomètres au compteur, donc une perte potentielle totale de 20 milliards d’euros si l’on considère que 20 millions de véhicules sont concernés en France » (132).
3° Ces évolutions ne manqueraient pas d’avoir des répercussions sur nos constructeurs. Les grands coups de volant en termes de politiques publiques sont en effet extrêmement difficiles à suivre pour les automobilistes comme pour les industriels : pour reprendre les propos de M. Neuvy, alors que depuis le Grenelle de l’environnement, l’accent a été mis sur la réduction des émissions de CO2 et que les industriels ont beaucoup investi pour mettre au point des voitures plus performantes, « quelques années plus tard, ils se sont entendu dire que, le diesel étant très nocif en termes de santé publique, il fallait revenir en arrière en rapprochant les prix de l’essence et du diesel, afin de rééquilibrer le parc automobile au profit des véhicules à essence » (1).
4° La dé-diéselisation induite par un tel contexte pourrait avoir des effets contreproductifs sur la politique de lutte contre le changement climatique. Comme l’a rappelé M. Gilles Le Borgne, directeur de la recherche et du développement du groupe PSA, le diesel reste, aujourd’hui, « incontournable » pour atteindre l’objectif européen, applicable à partir de 2020 au parc de voitures neuves, de 95 grammes de CO2/km de niveau moyen d’émissions, qui est fixé par le règlement CE n° 443/2009 du 23 avril 2009. À titre d’illustration, PSA, avec une moyenne d’émissions d’un peu plus de 110 g de CO2 par km, est leader en Europe, la moyenne du marché européen étant 123,7 g de CO2 par kilomètre. Or les véhicules vendus à moins de 100 g, qui représentent un tiers du portefeuille du groupe, sont à 66 % des diesels (133).
Compte tenu de ces éléments, plutôt que de « rééquilibrer » la fiscalité des carburants, il serait préférable, pour M. Martial Saddier, d’adapter les outils financiers applicables au parc pour les différencier plus fortement en fonction de l’ancienneté des véhicules, en mettant l’accent sur des aides incitant à retirer de la circulation les plus âgés et les plus polluants d’entre eux. Un objectif simple devrait en effet guider les politiques publiques dans ce domaine : remplacer un véhicule ancien par un plus récent, quelle que soit son énergie, est toujours très profitable à la réduction des émissions de polluants et de CO2.
Cette politique massive de retrait des véhicules faiblement performants ne pourrait être toutefois mise en place qu’après avoir effectué une analyse complète du bilan environnemental du « cycle de vie » des véhicules anciens et neufs, en intégrant trois paramètres : le CO2, les NOX et les particules fines. En effet, pour être efficaces, les dispositifs d’aide devraient être ciblés en fonction des résultats de l’examen approfondi des émissions d’un échantillon représentatif du parc roulant de poids-lourds, de véhicules utilitaires légers et de véhicules particuliers diesel, essence et électrique. Pour ne prendre qu’un exemple, les nouveaux moteurs à essence 3 cylindres qui se substituent, sur les petits véhicules, à la motorisation diesel ne sont pas équipés de filtres à particules, ce qui justifie que l’on procède à des analyses poussées de leurs performances en termes d’émissions de polluants et de gaz carbonique.
Proposition de M. Martial Saddier : maintenir la fiscalité sur les carburants et privilégier le retrait des véhicules essence et diesel les plus anciens.
2. Orienter les investissements et les achats vers des motorisations moins polluantes
Ainsi que le constate la Cour des comptes, les outils utilisés pour lutter contre la pollution de l’air « comportent peu d’incitations financières spécifiques » (134). Ces aides, qui sont essentielles pour modifier les choix des consommateurs et orienter les stratégies des constructeurs, devraient être plus nombreuses dans le secteur routier et intégrer, à côté de l’objectif de lutte contre le changement climatique, celui de la qualité de l’air.
a. Accélérer le renouvellement du parc par des aides plus incitatives
En aucun cas, la limitation de la diéselisation du parc, via des mesures fiscales – un sujet qui, comme on l’a vu, fait débat entre les rapporteurs – ne pourrait, à elle seule, suffire à améliorer la qualité de l’air, compte tenu du temps de renouvellement du parc.
En effet, l’âge moyen de sortie du parc est d’environ quatorze ans pour les véhicules particuliers. On estime par ailleurs que, sur environ 32 millions de véhicules particuliers, 6 millions pourraient être des diesel de plus de dix ans, soit 19 % du parc total. À Paris même, 16 % des voitures pourraient être des diesel immatriculées avant le 1er janvier 1997 (17 % en petite et grande couronnes) (135).
Au vu de ce contexte, l’enjeu premier est bien de retirer de la circulation l’ensemble des véhicules les plus émetteurs, ce qui pourrait être fait en utilisant trois outils.
• Instaurer un bonus-malus « polluants atmosphériques »
Le mécanisme du bonus-malus, qui a permis de lutter contre les émissions de dioxyde de carbone, devrait jouer aussi en faveur de la qualité de l’air, en encourageant la réduction des polluants atmosphériques.
Dans ce but, plutôt que de concevoir un outil complexe dont les conditions d’éligibilité combineraient deux paramètres, le gaz carbonique et les polluants, il serait plus simple d’instaurer, à côté du bonus-malus actuel, centré sur le CO2, un second dispositif, qui combine aide à l’achat d’un véhicule émettant peu de polluants atmosphériques et majoration du prix d’un véhicule en émettant beaucoup. Les deux objectifs – la lutte contre le changement climatique et l’amélioration de qualité de l’air – seraient ainsi traités de manière identique.
Les conditions d’éligibilité du bonus-malus « polluants atmosphériques » seraient fondées sur les critères, qui seront définis par un décret, des véhicules à très faibles et faibles émissions de polluants atmosphériques, mentionnés respectivement aux articles 36 et 37 (ce dernier étant repris à l’article L. 224-7 du code de l’environnement) de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Ces véhicules bénéficieraient donc d’un bonus, tandis que tous les autres seraient « malusés ».
• Instaurer une prime à la casse ciblée
La prime à la casse est un dispositif coûteux. À titre d’illustration, celle mise en place en 2009 a mobilisé, sur deux ans seulement, plus de 1,2 milliard d’euros. Instaurer une prime à la casse dont l’objectif serait de retirer de la circulation toutes les catégories de véhicules polluants rendrait le coût « unitaire » de la réduction des émissions extrêmement élevé.
Il serait donc plus opportun d’instaurer une prime à la casse ciblée sur les véhicules les plus polluants, à savoir les poids-lourds, les véhicules utilitaires légers (VUL) et les flottes d’autocars qui roulent au gazole et dont les seuils d’émission correspondent aux normes Euro les plus anciennes.
• Étendre la prime à la conversion aux véhicules électriques d’occasion
La stratégie pour le développement de la mobilité propre fixe un objectif de 1,9 million de véhicules électriques en 2030 (2,5 millions pour les véhicules hybrides rechargeables). Le marché du véhicule électrique reste cependant un marché émergent, donc fragile. Son développement ne peut, de surcroît, s’appuyer sur la vente de véhicules électriques d’occasion, alors que les premiers d’entre eux, correspondant aux modèles immatriculés en 2010 ou 2011, sont apparus l’année dernière.
En effet, pour plusieurs raisons, qui tiennent notamment aux craintes des acheteurs relatives à la fiabilité des véhicules et à la longévité de la batterie, les véhicules électriques semblent subir une forte décote à la revente. Or, le stockage d’un véhicule invendu étant coûteux, les professionnels hésitent à vendre des modèles dont la valeur résiduelle ne permet pas de prévoir une revente rapide.
Pour lever ce blocage et inciter, dans le même temps, les ménages aux moyens limités à passer au véhicule électrique, la prime à la conversion de 3 700 euros réservée à l’achat d’un véhicule électrique neuf devrait être étendue à l’acquisition d’un véhicule d’occasion ayant cette motorisation. Bien entendu, ce nouvel avantage devrait être conditionné à la reprise d’un vieux véhicule diesel.
Proposition n° 8 : rendre les aides au renouvellement du parc des véhicules routiers plus incitatives :
– créer un bonus-malus centré sur la lutte contre la pollution atmosphérique (NOx et particules) en basant ses critères d’éligibilité sur les niveaux d’émission des polluants de véhicules ;
– instituer une prime à la casse ciblée sur les véhicules très polluants (poids-lourds, véhicules utilitaires légers et flottes d’autocars anciens roulant au diesel) ;
– étendre la prime à la conversion à l’achat de véhicules électriques d’occasion.
b. Adapter le transport routier de marchandises
Pour réduire les émissions de polluants du secteur du transport routier de marchandises, les choix d’investissement des acteurs devraient être orientés vers les véhicules équipés des technologies les moins nocives à la qualité de l’air.
À cet effet, il faudrait privilégier :
– l’hybridation des véhicules utilitaires (VUL) et des petits poids-lourds diesel ;
– le recours à des VUL et à des petits poids-lourds essence, avec ou sans hybridation, ainsi qu’à des VUL, à des bus électriques et à des poids-lourds roulant au gaz naturel pour véhicules (GNV). Il convient d’ajouter à cette liste le bio-GNV, issu de la méthanisation des déchets.
Le développement de l’offre de poids-lourds ou de véhicules utilitaires roulant à l’électricité ou au GNV constitue une solution prometteuse. Une étude IVECO/Renault Trucks indique par exemple que les véhicules lourds roulant au gaz émettent 41 % de NOX et 86 % de particules en moins qu’un diesel Euro 6. Le recours à cette technologie se heurte toutefois à de sérieux obstacles, ce que reflète la modestie des objectifs fixés, dans ce domaine, par le Gouvernement : la stratégie pour le développement de la mobilité propre propose d’atteindre une part du parc de poids-lourds roulant au GNV de 3 % en 2023 et de 7 % en 2030.
Les premiers obstacles sont d’ordre technique. Ainsi, le gaz naturel utilisé comme carburant se présente sous deux états : le gaz naturel compressé (GNC) ou le gaz naturel liquéfié (GNL). L’autonomie de ce carburant est cependant encore limitée : entre 400 et 500 kilomètres pour le GNC, contre 800 à 900 kilomètres pour le GNL. Elle devrait cependant atteindre, dans les prochaines années, les 1 200 kilomètres.
S’y ajoutent des contraintes financières et logistiques. Le marché pour ce carburant alternatif en France est en devenir, ce qui fait que l’offre en gamme de véhicules roulant au GNV est limitée : on comptait d’ailleurs, en 2014, seulement 100 000 véhicules légers et lourds roulant au gaz dans notre pays, contre plus de 800 000 en Italie. En outre, les stations d’avitaillement sont peu nombreuses : selon l’Association française du gaz naturel pour véhicules, sur les 49 stations GNV en France, seule une vingtaine sont utilisables par des véhicules articulés (les camions les plus longs) et les projets en cours laissent envisager qu’environ 20 stations supplémentaires pourraient voir le jour d’ici le premier semestre 2017.
Ce contexte explique pourquoi les poids-lourds GNV sont encore peu attractifs pour les transporteurs, le différentiel de coût étant de l’ordre de 30 % entre les véhicules roulant au gazole et ceux roulant au gaz. Les coûts d’investissement et de maintenance des camions roulant au gaz naturel liquéfié (GNL) sont en particulier très supérieurs à ceux d’un poids-lourd diesel (environ 50 000 euros d’investissement en plus et 5 000 euros par an de coûts opérationnels supplémentaires) par véhicule poids-lourd (136).
Les problématiques des véhicules électriques ou hybrides lourds sont proches. Ces camions coûtent en effet deux à trois fois plus que leurs concurrents thermiques, en raison notamment du prix de la batterie.
L’offre de poids-lourds roulant à l’électricité ou au gaz naturel devrait donc être développée de deux manières :
– en incitant les constructeurs à créer des consortiums pour qu’ils disposent de plates-formes de production de châssis et puissent ainsi réaliser des économies d’échelle ;
– en augmentant le nombre de stations GNV et de points de charge électrique. L’État pourrait ainsi faciliter, dans le cadre de la stratégie pour le développement de la mobilité propre, le déploiement de ces stations sur le modèle, par exemple, du dispositif GNVolontaire en Rhône-Alpes, un cluster qui regroupe notamment le Grand Lyon, La Poste et des transporteurs et qui prévoit une aide à l’acquisition de véhicules permettant de rentabiliser la station d’avitaillement.
Par ailleurs, le recours au gaz naturel et à l’électricité devrait devenir la solution pour résoudre les problèmes que posent l’usage, en zone urbaine, des poids-lourds et des véhicules utilitaires et l’impact environnemental des derniers kilomètres de livraison. D’un point de vue logistique, cette solution impose d’augmenter les plages de livraison et de faciliter, à proximité des villes, les ruptures de charge pour utiliser, en fin de trajet, de plus petits véhicules roulant au GNV ou à l’électricité. Elle nécessite donc un important investissement foncier, ce qui devrait inciter les collectivités territoriales à identifier et à saisir certaines emprises foncières – comme des terrains en friches ou des immeubles en reconversion – pour dégager de tels espaces. La Ville de Paris a inscrit, à cet effet, dans son plan local d’urbanisme des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC), qui peuvent être notamment utilisées pour servir de points relais à la distribution des marchandises.
Le recours au transport fluvial de marchandises pourrait aussi devenir une solution alternative au dernier kilomètre de livraison effectué par la route. Son développement impliquerait de simplifier le statut juridique des fleuves, dont les régimes de police sont, dans les principales agglomérations, d’une grande complexité. Ce sujet pourrait faire l’objet d’une mission d’information parlementaire.
Proposition n° 9 : réduire la pollution induite par le transport routier de marchandises :
– inciter les constructeurs de poids-lourds et de véhicules utilitaires roulant à l’électricité ou au gaz naturel à créer des consortiums pour qu’ils disposent de plates-formes de construction de châssis permettant de réaliser des économies d’échelle ;
– augmenter le nombre de stations de gaz naturel pour véhicules (GNV) et de points de charge électrique ;
– faciliter les ruptures de charge destinées à utiliser de tels véhicules pour effectuer le dernier kilomètre de livraison ;
– adapter le statut des fleuves pour favoriser le transport fluvial des marchandises.
C. RÉGULER DIFFÉREMMENT LE TRAFIC ROUTIER ET PROMOUVOIR L’AUTO-PARTAGE
De nouvelles mesures, régulant de manière innovante le trafic routier, encourageant le covoiturage domicile-travail et s’appuyant sur les technologies modernes de l’information et de la communication, devraient promouvoir un autre usage du véhicule et de la voirie.
1. Promouvoir la circulation graduée
La circulation alternée doit céder la place à la circulation graduée, qui a pour but d’améliorer la qualité de l’air, en régulant l’accès aux voies rapides et aux zones densément peuplées.
Pour être efficace, elle doit reposer sur deux piliers : la gestion dynamique du trafic à des fins de réduction des émissions de polluants et la création, dans les agglomérations, de zones de circulation restreinte (ZCR) dont l’accès est réservé aux véhicules les moins émetteurs.
a. Gérer de manière dynamique le trafic routier
• Une mesure efficace : la réduction des vitesses maximales
Appliquées sur une grande partie du territoire national, la plupart des mesures – permanentes ou temporaires – de réduction de vitesse maximale a pour principal objectif l’amélioration de la sécurité routière (article R. 413-1 du code de la route), la gestion du trafic et l’aménagement urbain (article R. 110-2 du même code). Mais, comme le relève la Cour des comptes, elles sont aussi de plus en plus utilisées comme moyen de limiter les nuisances environnementales du trafic.
Les mesures permanentes peuvent d’ailleurs être prises dans le cadre des plans de protection de l’atmosphère. Elles sont prévues par l’article L. 222-6 du code de l’environnement, en vertu duquel les autorités de police peuvent prescrire des limitations à la circulation des véhicules, y compris la réduction des vitesses maximales autorisées, au titre des mesures préventives qu’elles décident pour réduire les émissions de polluants et atteindre les objectifs du plan.
Exemples de mesures permanentes de réduction de la vitesse
sur le réseau routier national
Rocade de Bordeaux (A 630) : passage de 110 à 90 km/h (arrêté préfectoral du 19 juin 2007 pris notamment pour réduire la pollution liée au développement du trafic).
Réseau autoroutier de la métropole Aix-Marseille : passage de 110 km/h à 90 km/h sur les axes A7, A51, A515, A516, A517, A7, A55, A50, A501 et A502 (arrêtés pris entre 2012 et 2015 et visant explicitement le PPA des Bouches-du-Rhône).
Réseau autoroutier de l’agglomération de Strasbourg : passage de 110 km/h à 90 km/h sur l’A3 ; passage de 110 km/h à 90 km/h pour les véhicules de transport de moins de 3,5 tonnes et à 80 km/h pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes sur l’A35 ; passage de 90 à 70 km/h sur l’A350 (depuis le 28 avril 2010, en application du PPA de Strasbourg).
Réseau des voies rapides de l’agglomération de Lyon : baisse générale sur les autoroutes et voies rapides, notamment afin de réduire les nuisances (arrêté du 10 mai 2012). Pour le réseau non concédé : passage de 110 km/h à 90 km/h sur les axes A6, A7, A42, A43, A450 et N346 ; passage de 90 km/h à 70 km/h sur l’A7 dans Lyon.
Périphérique parisien : abaissement de la vitesse de 80 km/h à 70 km/h par le décret du 3 janvier 2014, sur le fondement du PPA d’Île-de-France.
La réduction temporaire de vitesse en cas de pic de pollution est, quant à elle, encadrée par l’article L. 223-1 du code de l’environnement et par l’arrêté du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales. Ces dispositions prévoient ainsi la possibilité, pour le préfet, d’imposer un abaissement de 20 km/h des vitesses maximales autorisées, sans toutefois descendre en dessous de 70 km/h.
Ces mesures ont fait l’objet d’une évaluation globale par l’ADEME qui a souligné l’impact très positif, en matière de qualité de l’air, des réductions de vitesse lorsque celles-ci sont initialement élevées (passage de 130 à 110 km/h, de 110 à 90 km/h et de 90 à 70 km/h).
• Des mesures de gestion du trafic routier qui permettent de lutter contre les surémissions
En limitant la congestion – qui contribue à la surémission des polluants –, les mesures de gestion dynamique du trafic permettent d’optimiser l’usage des infrastructures routières existantes, en poursuivant deux objectifs : l’amélioration de la sécurité et celle de la qualité de l’air. Ces mesures ont aussi un impact positif sur les consommations de carburant – qu’elles améliorent –, sur les temps de parcours et, enfin, sur l’efficacité énergétique des déplacements.
À ce jour, environ 31 opérations de mesures de gestion de trafic ont été mises en œuvre sur le réseau routier national et 27 sont en phase d’étude ou de projet. Elles comprennent :
– la limitation dynamique des vitesses, qui consiste à les abaisser pendant les périodes très chargées afin d’optimiser l’écoulement du trafic. Elle est notamment mise en œuvre pendant les pics de trafics estivaux sur l’A7 et l’A9 en Vallée du Rhône ;
– la régulation d’accès, qui consiste à limiter ou à contrôler l’accès des automobilistes à la voie rapide afin de conserver la fluidité de la section courante. Des sites pilotes ont été expérimentés à cet effet, il y a quelques années, en Île-de-France, ce qui a permis le déploiement, depuis 2015, de tels dispositifs sur plusieurs axes des voies rapides urbaines de cette région ;
– la gestion dynamique des voies, qui consiste à utiliser la totalité de l’espace routier circulable, de manière variable dans le temps. Elle conduit, par exemple, à utiliser l’espace de la bande d’arrêt d’urgence aux heures de pointe pour tous les usagers (exemple du tronc commun A4/A86 en Île-de-France) ;
– l’interdiction de dépasser pour les poids-lourds, qui permet de réduire la congestion dans les zones de fort trafic de ces véhicules. De nombreuses expérimentations ont été menées en France (entre autres, sur l’A47 entre Lyon et Saint-Étienne, ainsi que sur l’A31 en Lorraine).
Ces mesures devraient être généralisées sur l’ensemble du réseau routier national et s’accompagner d’une mutualisation des données publiques ou privées relatives à l’état du trafic – les conducteurs devant accéder à cette banque de données via leurs ordinateurs de bord, GPS ou smartphones – afin que, comme le préconise un rapport remis à la commission des transports du Parlement européen, chaque véhicule puisse s’adapter, en temps réel, à celui-ci et éviter ainsi la congestion (137).
Proposition n° 10 : généraliser les mesures de gestion dynamique du trafic (abaissement de la vitesse pendant les périodes chargées, limitation ou contrôle de l’accès des automobilistes aux voies rapides, etc.).
b. Mettre en place des zones de circulation restreinte sous certaines conditions
Le retrait des véhicules les plus émetteurs peut se faire soit définitivement, par le recours à des aides financières – cet aspect ayant déjà été évoqué –, soit ponctuellement, dans le temps (covoiturage en cas de pic de pollution) ou dans l’espace, via des zones à circulation restreinte (ZCR) en centre urbain. Ce dernier dispositif, qui attribue, en quelque sorte, un « bonus » de circulation ou de stationnement aux véhicules faiblement émetteurs et un « malus » aux autres, devrait donc être déployé dans les grandes agglomérations.
• Un dispositif répandu en Europe et qui a fait ses preuves
L’accès aux ZCR ou zones à faible émission (Low Emission Zone ou LEZ en anglais) est interdit aux véhicules qui ne répondent pas à certains critères sur leurs émissions polluantes, généralement établis d’après les normes Euro. En pratique, comme le rappelle l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), qui a publié une étude détaillée sur les LEZ en Europe, les véhicules concernés sont les véhicules « les plus polluants, c’est-à-dire les plus encombrants ou les plus anciens » (138).
Or la mise en place, longtemps retardée, de ces zones dans notre pays contraste avec les décisions prises, au cours des années 2000, par plusieurs villes ou régions européennes.
L’étude de l’ADEME indique en effet que leur nombre n’a cessé d’augmenter en Europe pour atteindre, en mars 2014, environ 194 zones, à travers neuf pays : l’Allemagne (qui comptait alors 70 villes opérant de tels dispositifs), l’Autriche, le Danemark, l’Italie, les Pays-Bas, la République tchèque, le Royaume-Uni, le Portugal et la Suède. La Suède est le premier pays à les avoir mises en place, en 1996, dans les centres-villes de Göteborg, Malmö et Stockholm. Les régions de l’Italie du Nord ont suivi en 2007, puis Berlin et Londres, respectivement en janvier et février 2008.
La synthèse de l’ADEME permet en outre de mettre en avant les trois résultats positifs associés à la mise en place de ces zones :
– si les impacts sur la pollution de l’air ne sont pas identiques d’une zone à une autre, dans tous les cas des réductions sont observées sur les concentrations en oxydes d’azote (NOX) et les concentrations en particules PM10. La Cour des comptes confirme ce constat, en citant, à ce sujet, le ministère fédéral allemand de l’environnement qui a estimé que la mise en œuvre de ces zones outre-Rhin avait permis de réduire, depuis 2008, de 10 % les émissions de PM10 et d’oxydes d’azote et de dix le nombre de jours de dépassement des valeurs limites (139) ;
– ces zones ont eu un impact sur le renouvellement du parc des véhicules. À titre d’illustration, aux Pays-Bas, les véhicules les plus « propres » sont plus nombreux dans les villes opérant une zone à faible émission : la proportion de véhicules Euro 5 y est de 25 %, contre 13 % dans les villes sans LEZ (140) ;
– enfin, si la réduction, dans les zones étudiées, des émissions de polluants est significative, les bénéfices en termes d’amélioration globale de la qualité de l’air sont, d’après l’ADEME, plus modérés, notamment en raison de la multitude des sources de pollution en zone urbanisée et de l’influence, souvent déterminante, des conditions météorologiques.
L’ADEME conclut cette revue des zones à faible émission en indiquant que leur déploiement lui paraît être un outil « nécessaire » dans la mesure où leur mise en place « permet d’agir sur le renouvellement du parc automobile et le développement de transports multimodaux » (141).
L’étude d’impact du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte contient une estimation des effets environnementaux des zones à circulation restreinte qui fait, elle aussi, état de gains très substantiels, détaillés dans l’encadré ci-dessous.
Estimation des gains environnementaux liés aux ZCR contenue dans l’étude d’impact du projet de loi « transition énergétique »
Pour cette étude d’impact, le ministère de l’environnement a fait l’hypothèse que les restrictions de circulation mises en œuvre dans les collectivités volontaires concerneraient les véhicules diesel Euro 1 et Euro 2 et les véhicules essence Euro 1, qui représentent environ 12 % du parc et 300 000 voitures.
Il a estimé par ailleurs que 70 % des propriétaires de véhicules interdits les remplaceraient par un plus récent (Euro 5) et que 30 % changeraient de mode de transport (covoiturage, transport en commun, etc.).
Avec ces hypothèses, les gains liés à la mise en place de ZRC dans les 11 collectivités retenues s’élèveraient, sur trois ans, à 360 millions d’euros, qui correspondent à la monétarisation de l’impact sanitaire des émissions de polluants issue des travaux du Commissariat général à la stratégie et à la prospective.
En outre, sur une année, les émissions de NOX attribuées aux 300 000 véhicules seraient réduites de 67 % et les émissions de PM10 de 92 %.
Ces chiffres constituent, selon le ministère, une estimation « très basse » puisqu’ils ne prennent en compte que les véhicules particuliers. La prise en compte des poids-lourds et véhicules utilitaires légers augmenterait donc significativement les gains obtenus.
Le tableau ci-après synthétise les principaux aspects et résultats des zones à faible émission mises en œuvre à Stockholm, Londres, Berlin et Milan.
SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX ASPECTS ET RÉSULTATS DES ZONES À FAIBLE ÉMISSION DE STOCKHOLM, BERLIN, MILAN ET LONDRES
Cadre de référence |
Véhicules concernés |
Type d’identifiant |
Péage urbain |
Contrôle et sanctions |
Impact sur la qualité de l’air |
Impact sur le parc des véhicules et les modes de transport | |
Stockholm |
Loi de 1992 ouvrant aux villes la possibilité de mettre en place une LEZ. Mise en place de la LEZ de Stockholm en 1996. |
• Depuis 2014, interdiction de circuler pour : – les camions, bus et autocars diesel de plus de 3,5 tonnes de plus de 6 ans (sauf ceux entre 6 et 8 ans qui respectent la norme Euro 3) ; – les poids-lourds Euro 2. • À partir de 2017, interdiction de circuler pour les poids-lourds Euro 4. |
Document apposé sur le pare–brise |
Dispositif non prévu |
Contrôle visuel par la police. En cas d’infraction, amende d’environ 1 000 couronnes suédoises (environ 100 €) |
Entre 1996 et 2007, diminution des émissions : – de NOx de 3 à 4% ; – d’hydrocarbures de 16 à 21 % ; – de particules de 13 à 19 %. |
Entre 1996 et 2007 : – pour les camions : diesel + 12 %, unités gaz et éthanol + 70 et essence - 47 % ; – pour les bus : diesel - 49 %, essence - 98 % et éthanol + 90 %. |
Berlin |
Règlement fédéral de 2006. Mise en place de la LEZ dans le centre–ville et le périphérique intérieur de Berlin en 2008. |
• Concerne tous les véhicules (sauf les deux-roues) diesel et essence, même ceux immatriculés hors Allemagne. • Depuis le 1er janvier 2010, véhicules « verts » (Euro 4) seuls autorisés à circuler. • Dérogations nationales prévues pour certains véhicules (transport de personnes handicapées, ambulances, médecins urgentistes, police, pompiers, tracteurs etc.) • Dérogations locales ne pouvant dépasser un taux de 10 % et valables au maximum 24 mois. |
Vignette correspondant aux normes Euro, pouvant être commandée sur Internet et coûtant entre 5 et 10 € |
Dispositif non prévu |
Contrôle visuel par la police. En cas d’infraction, amende de 40 € et retrait d’un point sur le permis (qui en compte douze) |
Depuis 2007, diminution : – de la concentration moyenne annuelle de PM10 de 6,8 % et de NOx de 12 % ; – du nombre de journées de dépassement de la valeur limite journalière de 14 %. |
Véhicules diesel Euro 3 et 4 équipés d’un filtre à particule = 91 % du parc en 2010, contre 49 % selon simulation sans LEZ |
Milan |
Art. 3 du code de la route italien de 1992 qui définit les LEZ et art. 7 qui ouvre cette possibilité aux municipalités à des fins de prévention de la pollution de l’air. LEZ de Milan mise en place en 2008. |
• Interdiction de circuler pour les véhicules Euro 1 essence, les véhicules Euro 0, 1, 2 et 3 diesel et les véhicules de plus de 7,5 mètres. Zone active de 7h30 à 18h ou 19h30 • Droit d’entrée pour les autres véhicules (y compris étrangers dès lorsqu’ils sont soumis aux normes Euro) dans le centre-ville (Area C depuis 2011) • Cyclomoteurs, taxis, véhicules électriques, hybrides ou roulant aux biocarburants exemptés. |
N° immatriculation relevé par vidéo–surveillance puis comparé avec une base de données |
Tarifs de 2 € /jr pour les résidents (après 40 accès gratuits) et de 3 à 5 €/jr pour les livraisons. |
• Contrôle par 48 caméras qui permettent d’automatiser les contraventions (70 à 285 € en vertu d’une loi régionale de 2006) • Recettes issues de la et redevance et des contraventions = 25 M€ par an |
• Diminution des émissions : – de PM10 de 10 % depuis 2010 (18 % depuis 2004) ; – de NOx de 18 % depuis 2004. |
Depuis 2010 : – part des véhicules électriques, hybrides et GPL passée de 9,6 % à 16,6 % ; – usage accru des bus (+ 6,9 % aux heures de pointe) et des tramways (+ 4,1%) |
Londres |
Mise en place de la LEZ en 2008 (la plus grande d’Europe, couvrant l’ensemble de l’agglomération londonienne). |
• Depuis janvier 2012, interdiction de circuler pour les camions de plus de 3,5 tonnes et les cars < norme euro 4. • Paiement d’une redevance journalière de 100 à 200 £ pour les conducteurs d’un véhicule non conforme (après déclaration préalable). • Projet de restriction de circulation, sur le périmètre de la Congestion Charge, qui s’appliquerait à tous les véhicules < à la norme Euro 6 diesel ou Euro 4 essence à partir de 2018. |
N° immatriculation relevé par vidéo–surveillance puis comparé avec une base de données |
11,5 £ par jour de Congestion charge. 46 % des recettes de ce péage d’entrée dans le centre de l’agglomération (créé en 2003) investis dans les transports en commun. |
• Contrôle par des caméras fixes et mobiles. • Amendes de 500 (poids-lourds, autocars) à 1 000 £ (minibus), en fonction du type de véhicule. |
Depuis la création de la LEZ, diminution des émissions : – de PM10 de 7% ; – de NOx de 8 %. |
Depuis la création de la LEZ, passage de 20 % des véhicules poids-lourds en véhicules plus propres. |
Source : Cour des comptes (2015) et ADEME (2014).
• Des ZAPA aux ZCR : cinq années perdues faute de réflexion et de constance dans la conduite des actions anti-pollution
• L’échec des ZAPA
La loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010 prévoyait d’instituer, à titre expérimental, dans les communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants où une mauvaise qualité de l’air était avérée, une zone d’actions prioritaires pour l’air (ZAPA), dont l’accès était interdit aux « véhicules contribuant le plus à la pollution atmosphérique ». Cette expérimentation pouvait être engagée pendant une durée ne pouvant excéder trois ans soit à l’initiative des communes ou groupements de communes, soit sur proposition du préfet adressée à ces communes ou groupements, la loi fixant un délai de deux ans pour la présentation des projets de ZAPA.
Aucune collectivité n’ayant pu déposer de dossier complet avant la date limite – 8 seulement avaient alors signé avec l’ADEME des conventions pour étudier la faisabilité du dispositif et 7 avaient mené à terme cette évaluation –, le dispositif a été suspendu en juillet 2012. Le Plan d’urgence pour la qualité de l’air (PUQA) de février 2013 l’a repris, mais sans que cette orientation ne fasse l’objet d’une mesure et d’un calendrier spécifiques.
La synthèse des études de faisabilité des ZAPA réalisée par l’ADEME a mis en lumière les raisons qui ont conduit à cet échec, dont la principale semble avoir été le manque de temps pour répondre à l’ensemble des questions soulevées par un tel dispositif (142).
En effet, si les recherches effectuées à cette occasion ont démontré la pertinence des ZAPA d’un point de vue environnemental, elles ont aussi fait apparaître les difficultés financières, juridiques et sociales liées à leur mise en œuvre :
– la question des moyens apparaît centrale, car ces dispositifs induisent des coûts, tant pour les collectivités et l’État que pour les riverains et les usagers des transports communs (143). C’est ainsi que les communautés de communes n’ont pas, selon l’ADEME, souhaité poursuivre « notamment en raison de la question du partage des responsabilités et des moyens à mettre en œuvre qui n’a pas été totalement clarifiée » ;
– la question de l’articulation des différents pouvoirs de police dans ces zones est aussi essentielle, en raison de la multiplicité des autorités susceptibles d’intervenir sur leur territoire et du problème posé par l’étendue des prérogatives de la collectivité territoriale chargée de mettre en œuvre le dispositif. Le contrôle du respect des ZAPA soulève aussi le problème de l’accès des communes et des groupements de communes au système centralisant les normes Euro des véhicules – le service d’immatriculation des véhicules (SIV) – qui n’a pas été expressément prévu ;
– enfin, pour l’ADEME, le principal frein à la mise en place d’une ZAPA reste qu’elle « apparaît comme une mesure discriminatoire pour les habitants les plus modestes ». Comme le souligne la Cour des comptes, les ZAPA toucheraient en effet les véhicules anciens plus polluants, majoritairement détenus par des populations plus défavorisées : 34 % du parc des véhicules 1 et 2 « étoiles », les plus polluants selon la nomenclature établie par l’arrêté du 3 mai 2012, étaient alors détenus par des ménages non imposables (144).
Ce dernier élément montre l’importance des mesures d’accompagnement et des alternatives qui devraient être proposées aux résidents des ZAPA pour contrebalancer les inégalités éventuellement générées par la restriction de circulation (offre de transports en commun, aides au renouvellement du parc, dérogations ou souplesse dans l’application de la zone).
Par ailleurs, le caractère opérationnel de telles zones repose sur l’identification visuelle des véhicules en fonction de leurs émissions de polluants. Or celle-ci a été repoussée à plusieurs reprises, ce qui, selon l’ADEME, a été un « sérieux frein à la mise en œuvre des ZAPA » (145).
Ainsi, le dispositif de la « Pastille verte », introduit en 1998 pour que les véhicules qui en étaient dotés puissent circuler même en cas de circulation alternée, n’a jamais été utilisé. De même, le système d’identification prévu par le « Plan particules » de 2010 n’a pas été mené à son terme, avant d’être, de nouveau, mentionné par le Plan d’urgence pour la qualité de l’air (PUQA) de 2013.
Ce dispositif a été seulement présenté deux ans après, le 2 juin puis le 30 septembre 2015, par la ministre de l’environnement, Mme Ségolène Royal, afin d’accompagner la mise en œuvre des zones à circulation restreinte (ZCR) prévues par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui a abrogé les dispositions du code de l’environnement encadrant les ZAPA.
• Les ZCR : un dispositif plus opérationnel
La Cour des comptes estime que les ZCR, qui seront créées sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’EPCI et délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables et détermine les catégories de véhicules concernés, constituent une « modification tardive et marginale des ZAPA » (146).
En réalité, si les ZCR présentent une certaine continuité avec le dispositif abrogé, elles comportent de réelles améliorations par rapport aux ZAPA (cf. l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales) :
– la possibilité d’en créer a été ouverte, par un amendement de l’Assemblée nationale, à toutes les communes (ou les EPCI à fiscalité propre, lorsque ceux-ci disposent du pouvoir de police de la circulation), par la suppression du seuil de 100 000 habitants retenu pour les ZAPA ;
– ces nouvelles zones relèvent d’un pouvoir de police spécifique, exercé par les maires (ou les présidents d’EPCI concernés) (cf. le I de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales), ce qui, selon l’étude d’impact jointe au projet de loi, permettra « de satisfaire aux objectifs [de lutte contre la pollution atmosphérique] en clarifiant les autorités responsables » ;
– les ZCR constituent en outre un complément aux plans de protection de l’atmosphère (PPA) puisque la création d’une telle zone ne peut avoir lieu que dans le périmètre d’un tel plan. Le dispositif précédent se contentait, lui, de préciser que le projet de ZAPA devait être « compatible » avec le PPA existant ;
– enfin, contrairement aux ZAPA, il n’est pas prévu, pour le nouveau dispositif, de phase d’expérimentation limitée dans le temps, avec approbation de la liste des collectivités volontaires par décret en Conseil d’État, une condition qui, selon l’étude d’impact, « avait probablement freiné les collectivités volontaires à se manifester ». En outre, la durée de vie des ZCR sera précisée par l’arrêté qui les créera, ce qui donnera plus de liberté aux communes ou intercommunalités intéressées.
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a ajouté qu’en cas d’interdiction de circulation de certaines catégories de voitures particulières, l’accès aux réseaux de transport public en commun est assuré gratuitement ou par toute mesure tarifaire incitative décidée par les autorités organisatrices de transports (AOT).
Par ailleurs, les textes d’application de ces dispositions législatives sont en cours de finalisation : le projet de décret relatif aux zones à circulation restreinte a fait l’objet d’une consultation du public du 15 au 31 janvier 2016 et a été transmis au Conseil d’État et le projet d’arrêté relatif à la classification des véhicules en fonction de leurs émissions polluantes a également été soumis à consultation pendant cette même période.
En outre, l’implication du ministère de l’environnement dans ce dossier semble avoir enclenché une réelle dynamique puisque, par rapport aux 8 villes engagées dans la démarche des ZAPA, ce sont 20 villes, lauréates de l’appel à projets « Villes respirables en cinq ans », qui devraient mettre en œuvre une zone à circulation restreinte, en échange d’un appui financier – jusqu’à un million d’euros de dotations ou prêts bonifiés – et méthodologique de l’ADEME.
Un certificat « qualité de l’air » pour favoriser les véhicules les moins polluants
Présenté le 2 juin 2015, ce dispositif vise à faciliter l’identification des véhicules (voitures particulières, deux-trois roues, poids-lourds et autobus) les moins polluants par le biais d’une nomenclature, sous forme de pastilles de couleur apposées sur le véhicule et intitulées certificats qualité de l’air (crit’air ou CQA).
Il n’est pas obligatoire, mais permet aux communes d’accorder des avantages – facilités de stationnement ou de circulation par exemple – aux conducteurs des véhicules les moins émetteurs et incite, de ce fait, les citadins à privilégier, pour leurs déplacements, des mobilités peu polluantes.
À cet effet, la nomenclature prévue par l’arrêté, non publié à ce jour, qui doit remplacer celui du 31 mai 2012 distingue les véhicules les plus propres en les répartissant en quatre classes, en fonction du type de motorisation et de l’âge du véhicule, soit une catégorie spécifique pour les véhicules électriques et trois autres calées sur les normes Euro 1 à 6.
Le certificat CQA pourra être commandé par les conducteurs volontaires auprès d’un portail internet connecté au système d’immatriculation des véhicules, gratuitement les six premiers mois de sa mise en place puis moyennant le paiement d’une somme modique (cinq euros). Ce système de délivrance fera l’objet d’une expérimentation afin de tester l’application internet et le système d’envoi à domicile des certificats. Son coût de développement est estimé à un million d’euros, dont 912 000 euros environ pour l’Imprimerie nationale, qui éditera et délivrera les certificats.
Toutefois, compte tenu des délais d’élaboration et de concertation requis par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les ZCR ne pourront pas dans, leur grande majorité, entrer en vigueur avant 2017, ce qui a conduit la Cour des comptes à constater, au regard des objectifs fixés par la loi « Grenelle II », que la mise en place de ce dispositif aura pris, en tout, cinq ans de retard.
L’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales dispose en effet que le projet d’arrêté local établissant une ZCR doit être accompagné d’une étude « présentant l’objet des mesures de restriction, justifiant leur nécessité et exposant les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus de leur mise en œuvre, notamment en termes d’amélioration de la qualité de l’air et de diminution de l’exposition de la population à la pollution atmosphérique ». Ce texte doit être en outre soumis pour avis, par l’autorité compétente, aux autorités organisatrices de la mobilité dans les zones et dans leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux gestionnaires de voirie, ainsi qu’aux chambres consulaires concernées.
L’article 49 de la loi du 17 août 2015 permet, cependant, au maire d’une commune située dans une zone pour laquelle un plan de protection de l’atmosphère a été adopté, de mettre en place de manière transitoire – jusqu’au 1er janvier 2017 – des restrictions à certaines heures. À ce titre, Paris a déjà restreint, par un arrêté pris le 28 août 2015, l’accès à certains poids-lourds, de même que la commune de Versailles depuis le 7 septembre 2015.
La zone à faible émission de la Ville de Paris
Adopté par le Conseil de Paris le 9 février 2015, le plan de lutte contre la pollution de la capitale poursuit deux objectifs : favoriser, par des mesures d’accompagnement, les mobilités non ou peu polluantes et mettre en place une zone à faible émission, selon le calendrier suivant :
– 1er juillet 2015 : entrée en vigueur des mesures incitatives destinées aux ménages roulant en véhicule essence ou diesel mis en service avant le 1er janvier 1997 :
• prise en charge de l’abonnement annuel Navigo sur des réseaux de transport comme le métro, pour la part non remboursée par l’employeur, et d’un abonnement d’un an au service Velib’, éventuellement complétée par une réduction de 50 % sur l’abonnement annuel au service de voitures électriques Autolib’, en contrepartie de la vente ou de la destruction du véhicule polluant et de l’engagement à ne pas acheter, sur une certaine durée, de nouveau véhicule ;
• aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique égale à 33 % de son prix d’achat (plafonné à 400 euros) ;
• réduction de 50 % sur l’abonnement à Autolib’ pour les jeunes de 25 ans ayant eu leur permis depuis moins d’un an ;
– 1er septembre 2015 : interdiction de circulation, du 1er septembre 2015 au 1er janvier 2017, des camions et autocars pré-Euro et Euro 0 et 1 (antérieurs au 1er octobre 2001) de 8 heures à 20 heures. De nombreuses dérogations sont toutefois prévues (véhicules d’intérêt général, camions de déménagement, véhicules frigorifiques, véhicules d’approvisionnement des marchés parisiens, camion-citernes, etc.) ;
– 1er juillet 2016 : interdiction de circulation des véhicules particuliers et utilitaires légers diesel ou essence de catégorie ou classe 1 (pré–Euro, Euro 0 ou 1 mis en service avant le 1er janvier 1997).
Nota : voir infra le tableau des catégories ou classes retenues pour les véhicules particuliers.
• Des conditions à respecter pour assurer le succès des ZCR
Aux yeux des rapporteurs, la pertinence environnementale et la faisabilité économique et sociale des zones à circulation restreinte pourrait être renforcées par six mesures.
Premièrement, dans le langage courant, ce dispositif devrait se référer aux « zones à faible émission », une appellation usuelle en Europe et qui indique clairement l’objectif recherché. Utiliser les mots « circulation restreinte » donne une coloration trop coercitive à cette initiative.
Deuxièmement, les catégories de véhicules concernés et les avantages qui leur sont attachés doivent être définis et différenciés de façon très précise. À titre d’exemple, les véhicules à pastille verte, à « zéro émission », pourraient bénéficier de facilités de circulation dans les voies de bus. La catégorie 1 (pastille violette), voire même la catégorie 2 (pastille jaune), ne bénéficieraient, en plus du droit de circuler, que de certains avantages de stationnement. La catégorie 3 (pastille orange) n’autoriserait le véhicule qu’à circuler dans la zone. Enfin, en l’absence de pastille, un véhicule serait interdit de circulation au sein de la zone à faible émission.
LES QUATRE CERTIFICATS QUALITÉ DE L’AIR (CQA)
POUR LES VÉHICULES PARTICULIERS
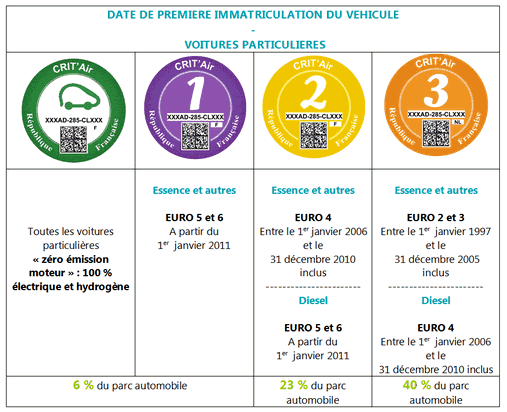
Source : ministère de l’environnement.
Le classement des véhicules en quatre catégories paraît trop restrictif, surtout au vu de la composition du parc. Selon les représentants de la Ville de Paris, les catégories 1, 2 et 3 ne concerneraient en effet que 70 % des véhicules particuliers essence et diesel, ce qui signifie, si cette estimation est exacte, que 30 % des automobilistes pourraient être, d’entrée de jeu, exclus des avantages attachés aux ZCR. Il aurait donc été beaucoup plus judicieux de prévoir un système davantage différencié, par exemple en utilisant sept catégories basées sur les normes Euro 0 à 6.
Troisièmement, la mise en œuvre du dispositif devrait être progressive, avec un phasage, dans le temps, des véhicules concernés par la restriction et, le cas échéant, une évolution du périmètre de la zone.
Quatrièmement, il faudrait prévoir – sans en abuser – des dérogations pour certains types de véhicules ou d’usages, afin d’éviter l’instauration de mesures discriminatoires – par exemple à l’égard du travail de nuit, qui limite le recours au transport en commun et les alternatives à la voiture particulière – ou d’encourager les bonnes pratiques, comme le covoiturage. Ces dérogations, qui pourraient être définies au plan local et s’ajouter aux dérogations prévues au niveau national (pour les véhicules des forces de l’ordre ou d’utilité publique), devraient être concertées entre les agglomérations qui mettront en œuvre des zones à faible émission pour qu’elles présentent une certaine homogénéité et ne compliquent pas inutilement les trajets, en particulier ceux des transporteurs.
Cinquièmement, des aides financières pourraient être prévues, de façon à accompagner la transition et à faciliter l’acceptabilité sociale du dispositif.
Enfin, le dispositif d’identification des véhicules devrait être automatisé, au lieu de reposer sur des autocollants – à la durée de vie limitée – et l’œil averti des fonctionnaires de police. En effet, les zones à faible émission les plus efficaces, comme à Londres ou à Milan, assurent la surveillance du respect des critères d’accès par des caméras, fixes ou mobiles, qui lisent à distance la plaque d’immatriculation des véhicules pour la comparer à une base de données qui centralise les normes d’émission des véhicules. En France, cette base existe : elle est gérée par le système d’immatriculation des véhicules (SIV), qui regroupe les catégories Euro. Les communes et les EPCI mettant en œuvre une ZCR devraient donc pouvoir accéder au SIV afin de s’assurer que les véhicules en circulation ou stationnement dans la zone sont autorisés à le faire.
Proposition n° 11 : instaurer de manière progressive des zones à circulation restreinte (ZCR) temporaires ou permanentes :
– rendre obligatoire l’identification, dans ces zones, des véhicules en fonction de leurs émissions de polluants et prévoir, à leur entrée, une automatisation du contrôle des véhicules fondée sur la consultation du système d’immatriculation des véhicules (SIV) par la collectivité territoriale compétente ;
– le cas échéant, compenser par des aides financières les inégalités générées ;
– généraliser les avantages (facilités de stationnement par exemple) accordés aux véhicules les moins polluants (pastille verte et classe 1) ;
– instaurer des dérogations pour certains types de véhicules (ambulances, etc.) ou d’usages (covoiturage, travail de nuit).
• Mettre en place des péages urbains réactifs
L’instauration d’une zone faible émission pourrait être couplée, comme c’est le cas à Milan et à Turin, à un dispositif de péage urbain.
La mise en place d’un tel « tarif d’entrée », qui exigerait de modifier notre droit, devrait faire, au préalable, l’objet d’une expérimentation, afin de s’assurer que la poursuite de deux objectifs – la réduction des émissions et la lutte contre la congestion du trafic –, ne conduira pas à l’inefficacité du dispositif. En effet, une zone à circulation restreinte « vertueuse » du point de vue des émissions, car parcourue par un pourcentage croissant de véhicules électriques, pourrait rapidement devenir une zone congestionnée, si les propriétaires de ces véhicules ne payaient pas de péage urbain.
C’est pourquoi il faudrait privilégier des systèmes « réactifs », dans lesquels les conducteurs ne paieraient leur passage que dans le cas où les voies seraient très chargées ou les agglomérations très polluées.
Proposition n° 12 : permettre aux agglomérations de mettre en place, après une phase d’expérimentation, des péages urbains modulables (selon le trafic, le covoiturage, le niveau de pollution, etc.).
2. Soutenir le covoiturage domicile-travail
Comme chacun peut le constater dans sa vie quotidienne, le covoiturage, c’est-à-dire l’utilisation, encadrée par l’article L. 3132-1 du code des transports, d’un véhicule par plusieurs personnes, pour en partager les frais et réduire le coût de leurs déplacements, se développe rapidement.
Le rapport de la Cour des comptes ne mentionne, pourtant, qu’une seule fois (page 74), et encore de manière incidente, ce type de mobilité, malgré le potentiel de réduction des émissions qu’elle représente. En effet, cette solution, qui s’apparente, à une échelle réduite, à un transport en commun, permet de retirer de la circulation des véhicules émetteurs de gaz à effet de serre et de polluants.
Le Commissariat général au développement durable a estimé que, lors de la mobilisation du covoiturage, le nombre total de véhicules évités pour un jour ouvré moyen pourrait être, compte tenu des pratiques de mobilité actuelles, compris entre 2,7 millions lorsque les individus qui covoiturent voyagent à 2 par véhicule, soit une baisse de 17,56 %, et 4,2 millions lorsqu’ils ont la possibilité de voyager à 4 par véhicule, soit une réduction de 26,67 %. L’impact environnemental du covoiturage se traduirait alors par une réduction des émissions de CO2 de 4,14 % à 6,60 % (147).
Au plan local, les impacts du covoiturage sont également significatifs. Ils ont été estimés dans trois territoires par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), qui a comparé les pratiques des covoitureurs l’année de l’évaluation, qui a vu la mise en place d’une centrale de réservation, par rapport aux pratiques des mêmes personnes au cours de l’année de référence. Dans l’Arc jurassien, la mise en place de ce dispositif a permis de diminuer d’environ un tiers les émissions atmosphériques (COV, NOX, PM10, PM2,5 et CO2) liées au trafic sur les trajets domicile-travail des covoitureurs historiques et récents et de générer, si l’on raisonne en coût complet (amortissement, assurance, carburant, entretien, etc.), une économie de 2,51 millions d’euros par an, soit 2 640 euros par nouveau covoitureur (148).
Pour certains observateurs, cependant, le covoiturage ne pourra pas se transformer en un outil quotidien de lutte contre la pollution automobile, car cette forme d’auto-partage concerne surtout de longs trajets, plutôt ponctuels. À titre d’exemple, la plate-forme BlaBlaCar organise le transport de 600 000 personnes par mois, pour des déplacements de 330 kilomètres en moyenne, principalement effectués le week-end.
La part du covoiturage pour motif domicile-travail et domicile-études est d’ailleurs réduite et se situerait, d’après les calculs de l’ADEME, entre 2,3 % et 4,1 % (149).
Ce type de mobilité pourrait toutefois, selon M. Denis Baupin et Mme Fabienne Keller, « s’étendre dans un futur proche à des déplacements plus courts et plus immédiats, voire aux trajets pendulaires domicile travail dans les zones périurbaines et rurales » (150).
Cette perspective très probable résulte de la conjonction d’une offre et d’une demande structurellement dynamiques :
– d’une part, chaque jour, 40 millions de sièges de voiture inoccupés circulent. Le potentiel de mobilisation de places disponibles pour organiser des trajets quotidiens entre le domicile et le travail est donc considérable. M. Olivier Binet, le fondateur de Karos, une application qui propose des « covoitureurs », considère ainsi que 15 à 20 % de la population adulte pourrait recourir de manière quotidienne à cette modalité de déplacement ;
– d’autre part, les moins de 35 ans, qui sont parmi les usagers les plus assidus du covoiturage – la moitié des répondants à une enquête de BlaBlaCar ont moins de 30 ans et près d’un quart a moins de 25 ans – n’achètent quasiment pas de voitures neuves : ils ne représentent en effet plus que 10 % des acheteurs. Les raisons de cette chute sont certes multiples, mais la première, comme l’a rappelé M. Flavien Neuvy, le directeur de l’Observatoire CETELEM de l’automobile, est que la voiture est moins « statutaire » qu’au début des années 1990 : « les Français considèrent que ce n’est plus le meilleur moyen de montrer que l’on a réussi dans la vie, et se demandent s’il est bien utile de dépenser 22 000 euros – le prix moyen actuellement – pour acheter un véhicule neuf » (151).
L’évolution de la société devrait donc être favorable à l’utilisation partagée des voitures. La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte en a d’ailleurs pris acte en :
– prévoyant que les sociétés d’autoroute s’engagent à créer des places de stationnement pour le covoiturage (article 53) ;
– donnant à ces sociétés la possibilité de créer une tarification privilégiée pour les covoitureurs (article L. 122-4 du code de la voirie routière) ;
– permettant aux autorités organisatrices des transports, seules ou avec les collectivités territoriales intéressées, de mettre à la disposition du public, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, des plateformes dématérialisées facilitant la rencontre des offres et des demandes de covoiturage (article L. 1241-1 du code des transports).
Compte tenu de ces éléments, le développement du covoiturage pour les trajets domicile-travail devrait être encouragé de deux manières :
– en incitant les entreprises à mettre en place un système de covoiturage dédié pour leurs salariés. L’article 51 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose, à cet égard, que, dans le périmètre d’un plan de déplacements urbains (PDU), toutes les entreprises regroupant plus de 100 salariés sur un même site doivent élaborer un plan de mobilité, d’ici le 1er janvier 2018, pour encourager l’utilisation des transports en commun et le recours au covoiturage. Le programme d’actions compris dans ce plan peut comporter, à cet effet, des mesures relatives « au covoiturage et à l’auto-partage » (article L. 1214-8-2 du code des transports) ;
– en faisant en sorte que les salariés qui recourent au covoiturage bénéficient du remboursement partiel, par l’employeur, des frais qu’ils ont avancés. Les salariés du secteur privé qui prennent les transports publics (métro, bus, tramway, train) pour se rendre sur leur lieu de travail bénéficient d’une prise en charge par l’employeur, qui est exonérée de charges sociales et s’effectue à hauteur de 50 % du titre de transport sur la base d’un tarif de 2e classe et du trajet le plus court. Ce n’est pas le cas pour le covoiturage, même s’il est effectué dans le cadre du plan de mobilité de l’entreprise, et s’apparente, dans les faits, à l’utilisation d’un transport en commun.
Proposition n° 13 : encourager les modes de transports collaboratifs pour les trajets domicile-travail :
– inciter les entreprises à mettre en place un système de covoiturage dédié à leurs salariés ;
– intégrer le covoiturage domicile-travail dans les modes de transport couverts par la prise en charge par l’employeur de 50 % des frais engagés.
D. RÉDUIRE LES VALEURS LIMITES D’ÉMISSIONS ET RENFORCER LEUR CONTRÔLE
La mise en cause de Volkswagen et les résultats du programme français de contrôle des émissions de véhicules ont montré les limites du système actuel d’homologation. Faute d’avoir été suffisamment strict et précis, celui-ci a connu une faillite retentissante. Cet échec ne doit pas, pour autant, remettre en cause l’outil des normes Euro, qui garde toute sa pertinence, mais inciter l’Europe à approfondir ses procédures de contrôle.
1. Utiliser le levier des normes Euro
Les niveaux d’émission de polluants imposés par les normes Euro, exprimés en mg/km parcouru pour les polluants gazeux et en nombre par km parcouru pour les particules, sont identiques, quelle que soit la catégorie – la taille – du véhicule.
En revanche, il existe encore aujourd’hui, malgré l’abaissement progressif des seuils d’émission, tout dernièrement par la norme Euro 6, un différentiel, retracé dans les deux tableaux ci-après, entre les normes appliquées aux véhicules essence et celles appliquées aux diesel, qui tient compte des spécificités de ce second type de motorisation et conduit à accepter, pour celui-ci, un niveau plus élevé en émissions d’oxydes d’azote (NOX).
Ce différentiel, qui s’inverse suivant la nature du polluant – un véhicule à motorisation essence est ainsi « autorisé » à émettre deux fois plus de monoxyde de carbone (CO) qu’un véhicule diesel –, peut être considéré comme une prime à la pollution.
VALEURS LIMITES D’ÉMISSIONS DES NORMES EURO
POUR LES VÉHICULES PARTICULIERS DIESEL ET ESSENCE
DIESEL |
Entrée en vigueur pour les véhicules homologués |
CO |
NOx |
PARTICULES |
PARTICULES |
Euro 1 |
01/1993 |
2 720 |
s.o. |
140 |
s.o. |
Euro 2 |
01/1996 |
1 000 |
s.o. |
DI : 100 IDI : 80 |
s.o. |
Euro 3 |
01/2000 |
640 |
500 |
50 |
s.o. |
Euro 4 |
01/2005 |
500 |
250 |
25 |
s.o. |
Euro 5a |
09/2009 |
500 |
180 |
5,0 |
s.o. |
Euro 5b |
09/2011 |
500 |
180 |
4,5 |
6,10 |
Euro 6b et c |
09/2014 |
500 |
80 |
4,5 |
6,10 |
DI : injection directe. IDI : injection indirecte (moteur à « préchambre »). s.o. = sans objet.
ESSENCE |
Entrée en vigueur pour les véhicules homologués |
CO |
NOx |
PARTICULES |
PARTICULES |
Euro 1 |
01/1993 |
2 720 |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Euro 2 |
01/1996 |
2 200 |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Euro 3 |
01/2000 |
2 300 |
150 |
s.o. |
s.o. |
Euro 4 |
01/2005 |
1 000 |
80 |
s.o. |
s.o. |
Euro 5a |
09/2009 |
1 000 |
60 |
5,0 |
s.o. |
Euro 5b |
09/2011 |
1 000 |
60 |
4,5 |
s.o. |
Euro 6b |
09/2014 |
1 000 |
60 |
4,5 |
6,10 |
Euro 6c |
09/2017 |
1 000 |
60 |
4,5 |
6,10 |
s.o. = sans objet.
La convergence des seuils d’émission de NOX et de CO pour les véhicules diesel et essence étant engagée depuis la norme Euro 4, M. Jean-Louis Roumégas souhaite parachever ce mouvement en adoptant, le plus rapidement possible, une norme Euro 7. Cette mesure rendrait service aux véhicules diesel en supprimant le régime d’exception qui leur est accordé pour les émissions d’oxydes d’azote et qui, au final, ne fait que conforter leur mauvaise réputation environnementale et sanitaire. Au lieu de concentrer leurs efforts sur la défense d’un « droit à polluer », les décideurs pourraient ainsi s’attaquer au fond du problème – le nombre de véhicules en circulation –, à travers la maîtrise de la demande par le développement des mobilités propres et le recours à des restrictions de circulation ciblées.
Proposition de M. Jean-Louis Roumégas : inciter les autorités européennes à adopter rapidement la norme Euro 7 pour supprimer les écarts de niveaux d’émission des véhicules essence et diesel.
M. Martial Saddier estime au contraire que l’Union européenne ne doit pas, en engageant une réflexion sur la norme Euro 7, ouvrir un nouveau « front », alors que le principal défi, pour les constructeurs et les autorités de surveillance, est d’appliquer, dès que possible, la norme Euro 6.
Proposition de M. Martial Saddier : anticiper l’entrée en vigueur de la norme Euro 6, sans s’engager dans l’élaboration de norme nouvelle.
2. Modifier les dispositifs d’homologation des véhicules et de mesure de leurs émissions
• Appliquer la norme Euro 6 dans les meilleurs délais
Le règlement n° 2016/646 de la Commission européenne du 20 avril 2016 relatif aux essais en conditions de conduite réelles (RDE) s’accompagne, via un mécanisme de « marges à ne pas dépasser », d’un report indéterminé de la mise en œuvre effective des seuils limites d’émission de NOX définis par la norme Euro 6.
En effet, au début de l’année 2016, seul un engagement de révision annuelle du « facteur final de conformité » (fixé à 1,5 en 2020, soit un dépassement autorisé de 50 % de la norme) était envisagé par la Commission européenne, en fonction du progrès technique. La marge de tolérance de 110 %, applicable à partir de 2017, n’aurait donc même pas été réexaminée.
Aussi la résolution européenne qui a été adoptée sur ce sujet par l’Assemblée nationale le 26 février 2016, en application de l’article 88-4 de la Constitution et à l’initiative de la présidente de la commission des affaires européennes, Mme Danielle Auroi, a-t-elle accepté que le nouveau cycle d’essai fondé sur la mesure des émissions en conditions de conduite réelles repose sur des facteurs de conformité, tout en regrettant ce délai ad infinitum (152).
Toutefois, il semblerait, selon les dernières informations communiquées à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, que la Commission européenne ait manifesté son intention de ramener les facteurs de conformité, entre 2017 et 2023, à 1, ce qui n’apparaît pas excessif compte tenu du temps d’adaptation technologique à prévoir pour les constructeurs (153).
• Créer une agence européenne d’homologation
Une solution a priori simple pour vérifier le respect des valeurs limites d’émission consisterait à utiliser, à cet effet, les installations dédiées au contrôle technique des véhicules. Une telle démarche paraît cependant irréaliste, car elle imposerait que les centres techniques investissent en moyens d’investigation lourds, analogues à ceux du programme national de contrôle des véhicules mis en place par la ministre de l’environnement, Mme Ségolène Royal, et disposent des compétences requises pour les opérer, ce qui, sur un plan pratique et économique, serait totalement inenvisageable. À l’heure actuelle, en effet, les procédures de contrôle technique, qui restent utiles pour identifier de très gros problèmes, ne permettent même pas, en matière de dépollution, de détecter l’absence éventuelle du filtre à particules si ce dernier a été ôté volontairement…
Une autre solution serait de faire suivre les émissions des véhicules par l’ordinateur de bord. Or celui-ci est paramétré par les constructeurs, ce qui n’en fait pas, aujourd’hui, le meilleur des outils de contrôle.
Une troisième piste, beaucoup plus ambitieuse, recommandée en octobre 2015 par le Parlement européen, consisterait à créer une agence européenne d’homologation. La proposition de règlement sur la réception et la surveillance des véhicules présentée le 27 janvier 2016 par la Commission européenne a écarté cette solution au profit d’un système d’audits pilotés par l’exécutif bruxellois, car la commissaire européenne en charge du dossier, Mme Elżbieta Bieńkowska, a considéré que l’agenda Better regulation ou « mieux légiférer », qui est porté par les institutions européennes, rendrait difficile la création d’une énième structure de ce type.
Les rapporteurs considèrent néanmoins que le coup porté à la confiance des consommateurs par l’affaire Volkswagen, tout comme la problématique au long cours de l’amélioration de la qualité de l’air, justifieraient une telle initiative.
Une agence européenne de supervision des autorités nationales chargées de l’homologation des véhicules, indépendante de la Commission européenne, des États membres et des constructeurs, devrait donc être mise en place. À l’image de la commission technique installée par la ministre de l’environnement en janvier 2016, cette agence devrait procéder, de manière aléatoire, à des prélèvements sur le parc roulant européen pour contrôler le travail des services techniques, ainsi que les émissions des voitures et des poids-lourds en circulation.
Proposition n° 14 : réformer l’homologation des véhicules et la mesure de leurs émissions :
– mettre en place, dans des délais resserrés, un nouveau cycle d’essai des véhicules fondé sur la mesure des émissions dans des conditions de conduite réelles ;
– créer, au niveau européen, une autorité de surveillance indépendante chargée d’assurer le suivi du respect des niveaux d’émissions en mettant en œuvre des contrôles a posteriori sur les véhicules en circulation.
II. IMPLIQUER DAVANTAGE LES AUTRES SECTEURS DANS LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L’AIR
La contribution des différentes sources fixes de pollution – l’industrie, l’agriculture et le secteur résidentiel-tertiaire – à l’objectif de l’amélioration de la qualité de l’air est encore très inégale. Cette situation appelle des correctifs.
A. L’INDUSTRIE : RENDRE LA FISCALITÉ PLUS INCITATIVE ET MIEUX CONTRÔLER LES INSTALLATIONS CLASSÉES
Les mesures mises en place, depuis plusieurs années, dans le secteur de l’industrie pour réduire ses émissions, qui sont surtout d’ordre réglementaire, ont été efficaces. Elles restent néanmoins perfectibles.
1. Les résultats obtenus par ce secteur sont importants mais la politique de réduction des émissions reste perfectible
Tous domaines confondus, depuis quinze ans, les baisses d’émissions les plus importantes concernent les polluants d’origine industrielle, ce phénomène ne pouvant être, selon la Cour des comptes, exclusivement imputé à celui de la désindustrialisation.
a. Une baisse importante des rejets encouragée par la réglementation européenne et relayée par les investissements des entreprises
• Un cadre de référence clair et efficace
Les mesures réglementaires applicables au secteur ont été adoptées de manière précoce, dès les années 1980. Elles résultent, pour l’essentiel, de la transposition de directives européennes sectorielles et l’objectif de qualité de l’air y est, selon la Cour des comptes, « explicite et spécifique » (154).
Les installations industrielles ayant les émissions les plus importantes sont en effet soumises à trois directives, qui concernent l’application de valeurs limites d’émission, l’interdiction d’utiliser certaines substances ou certains matériaux et l’obligation de recourir aux meilleures techniques disponibles.
La directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, dite directive IED d’après son acronyme anglais, constitue, en la matière, la réglementation structurante. Toutes les installations couvertes par cette directive sont en effet tenues de prévenir et de réduire la pollution grâce à l’application des meilleures techniques disponibles – les MTD –, qui sont définies par des documents de référence, les BREF (Best available Reference techniques document), élaborés dans le cadre du processus de Séville, qui réunit les industriels, les administrations nationales et les experts de l’Institut de prospective technologique de Séville et du centre commun de recherche de la Commission européenne. Ces BREF laissent quatre ans aux installations pour mettre à jour les technologies et réviser les permis d’exploitation. La notion de MTD est en outre dynamique puisque, pour chaque secteur industriel, ces techniques de référence sont réévaluées régulièrement. Le cadre d’action précédent, défini par la directive « IPPC » de 1996, relative à la maîtrise et à la prévention des pollutions, était, de ce point de vue, beaucoup moins satisfaisant car il ne faisait que citer une série de BREF à « prendre en compte ».
La directive de 1999 sur les solvants et la directive de 2001 sur les grandes installations de combustion ont été incorporées dans la directive « IED », respectivement en 2015 et 2016.
Enfin, la dernière venue, la directive relative à la limitation des émissions de polluants atmosphériques par les installations de combustion de taille moyenne, a été adoptée à la fin de l’année dernière.
• Une diminution notable des rejets de polluants industriels mais qui reste différenciée
Quelques exemples suffiront à montrer les résultats, en termes de baisse des émissions, obtenus par des industries emblématiques des phénomènes de pollution observés lors des années 1970. Ils témoignent, de manière incontestable, de l’efficacité des mesures réglementaires mises en place et des efforts importants consentis par les industriels pour traiter ou réduire les rejets de polluants.
Depuis 2005, les industries de la chimie ont diminué leurs émissions d’un facteur 4 pour le soufre (SO2), de 52 % pour les composés organiques volatils (COV) et de 41 % pour les particules. Aussi cette industrie ne représente-t-elle, aujourd’hui, que 5 % des émissions de COV, 1 % des émissions de particules et 3 % des émissions d’oxydes d’azote (NOX). Ces résultats sont à la hauteur des sommes consacrées aux mesures d’abattement des émissions et à l’amélioration de l’outil industriel : sur les 3,1 milliards d’euros que ce secteur investit, 8 % sont consacrés à la réduction de son empreinte environnementale, 12 % à la maîtrise des risques et 47,2 % au maintien et à la modernisation des sites.
Quant aux industries pétrolières françaises – 8 raffineries actives –, elles ont réduit, depuis 2000, leurs émissions de soufre par trois (de 138 000 tonnes à 40 000 tonnes) et celles de NOx et de COV de moitié au cours de la période 2000-2013. 500 millions d’euros ont été investis dans cet effort, principalement pour la désulfuration.
Cependant, malgré son engagement dans la lutte contre la pollution de l’air, l’industrie reste, comme le montre l’encadré ci-après, un émetteur important de polluants, comme les particules et les COV, voire très important pour les métaux lourds et les polluants organiques persistants.
Il semble, à cet égard, que les mesures de réduction « simples », avec un fort rendement, car visant de grosses installations, soient épuisées. Par conséquent, pour traiter une pollution industrielle de plus en plus disséminée, c’est un travail de fond, sur mesure, qui devrait être mené. Il pourrait reposer sur l’identification des sites qui restent fortement émetteurs, sur le modèle de l’action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans l’eau (RSDE), qui a consisté à affiner la surveillance de 4 000 installations pour les amener à adopter des actions ciblées.
Une baisse des émissions industrielles qui reste fortement différenciée
– L’industrie, avec le sous-secteur de la transformation d’énergie, représente 85 % des émissions de soufre (SO2), 31 % des émissions de particules fines (PM10 et PM2,5) et 21 % des émissions de NOx.
– C’est aussi, s’agissant de l’industrie manufacturière, la source principale d’émissions pour une majorité de métaux lourds (46 % pour l’arsenic, 64 % pour le cadmium, 68 % pour le mercure, etc.) et de polluants organiques persistants comme les dioxynes et les furanes (22 %) et le polychlorobyphénile (54 %).
– Les données du CITEPA font état d’une baisse sensible – mais variable – de la plupart des polluants émis par l’industrie manufacturière entre 1990 et 2003 : – 97 % pour le chrome, – 89 % pour le cadmium, – 78 % pour le dioxyde de soufre et – 71 % pour l’arsenic, mais seulement – 48 % pour le NOX et près de – 35 % pour le monoxyde de carbone.
Sources : Cour des comptes, CITEPA (rapport national d’inventaire 2015), CGDD (Bilan de la qualité de l’air 2014).
b. Une taxe générale sur activités polluantes « air » dont le montant est inférieur aux coûts des dommages environnementaux et des meilleures technologies disponibles
Payée à l’administration des douanes, la taxe générale sur activités polluantes (TGAP) « air », qui a représenté, en 2014, une recette de 53,1 millions d’euros, soit un peu plus de 6 % du rendement de la taxe (155), est due, au titre des installations classées pour l’environnement (ICPE) soumises à autorisation qui émettent certaines substances polluantes dans des quantités supérieures aux seuils indiqués, par les installations de combustion d’au moins 20 MW, ainsi que par les installations de traitement thermique des ordures ménagères d’une capacité supérieure à 3 tonnes par heure.
Cette taxe a été renforcée, à plusieurs reprises, au cours des dernières années. En effet, son barème a évolué, avec l’ajout, entre 2009 et 2013, de nouvelles substances, douze au total, dont des métaux lourds (comme l’arsenic, le cadmium, le chrome, le plomb, le mercure, etc.) et les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ses taux ont été en outre augmentés entre 2009 et 2016 : par exemple, de 44,49 €/t à 140,13 €/t pour les oxydes de soufre, de 53 €/t à 169,14 €/t pour les oxydes d’azote (NOX) et de 64,86 €/t à 264,80 €/t pour les poussières totales en suspension. Ces évolutions se sont traduites par un accroissement sensible des recettes – de près de 40 millions d’euros entre 2009 et 2014 – qui est relevé par la Cour des comptes (156).
Cependant, les taux de cette taxe, qui sont fixés sur le poids des substances émises dans l’atmosphère (maxima de 1 030,23 €/kg et 515,12 €/kg en 2016 pour le mercure et l’arsenic respectivement), sont, selon le Commissariat général au développement durable, très inférieurs aux coûts des dommages environnementaux et sanitaires causés par les émissions. À titre d’illustration, le coût externe d’une tonne de NOX est estimé à 4 400 euros et celui d’une tonne de poussières à 87 000 euros d’après la directive 2009/33/CE. De même, l’Agence européenne de l’environnement évalue entre 1 000 et 2 200 euros le coût externe d’une tonne de composé organique volatil non méthanique (COVNM), un chiffre à comparer avec le taux de 140,13 €/t appliqué aux hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils (157).
Les taux de la TGAP « air » sont, en outre, très inférieurs aux coûts d’investissement dans les meilleures technologies disponibles (MTD), et donc au coût marginal de réduction des émissions de polluants industriels. L’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) a estimé, il y a plus de dix ans, que ce coût était compris entre 300 et 8 900 €/t pour les NOX et entre 100 et 1 200 €/t pour le soufre (SO2). Il en a conclu que les taux de la TGAP « air » n’avaient pas d’effets financiers incitatifs à la réduction des émissions (158).
c. Une majorité d’installations classées inspectées occasionnellement
La fréquence et la rigueur des contrôles des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont différenciés selon qu’elles sont soumises ou non au régime de l’autorisation préalable.
• Les installations les plus contrôlées étaient au nombre de 44 000 fin 2015. Elles sont soumises à autorisation préfectorale (31 000 établissements en tout) – ou à enregistrement, cette procédure étant une autorisation simplifiée (13 000 établissements) – et sont divisées en trois catégories en fonction de leurs émissions, chacune relevant de la police de l’inspection des installations classées.
– Les installations prioritaires (1 900 établissements), les plus polluantes et qui relèvent de la directive Seveso, sont inspectées tous les ans (taux d’inspection effectif de 98 %).
– Les installations à enjeu régional (10 000 établissements) sont inspectées tous les 3 ans (taux d’inspection effectif de 85 à 90 %).
– Les installations restantes le sont tous les 7 ans (taux d’inspection effectif de 90 à 93 %).
Cette typologie, qui permet la visite de l’ensemble du parc tous les sept ans, n’exclut pas des inspections spécifiques : ainsi les 800 établissements qualifiés comme étant prioritaires au titre de la qualité de l’air seront tous revisités cette année, à la suite d’une communication en conseil des ministres de la ministre de l’environnement faite le 3 septembre 2015.
• Les ICPE soumises à simple déclaration, cette catégorie regroupant des établissements très divers, allant des pressings aux petites fonderies, sont à la fois les installations les plus nombreuses – 450 000 en tout – et les moins contrôlées :
– elles ne sont inspectées qu’à la suite du dépôt d’une plainte (159) ou dans le cadre d’une action spécifique, comme celle menée entre 2008 et 2012 en direction des pressings par l’inspection des installations classées ;
– certaines font l’objet d’un contrôle dit périodique – si l’arrêté préfectoral de prescription de fonctionnement pris au moment de la déclaration le prévoit –, qui est réalisé par des organismes agréés, comme le DEKRA, tous les cinq ans pour celles qui ne disposent pas de certaines certifications (ISO 14001 par exemple) et tous les dix ans pour celles qui bénéficient d’un système « qualité ». Or ce type de contrôle ne concerne, chaque année, que 2 500 à 3 000 installations ;
– les autres établissements ne sont contrôlés qu’à deux occasions : lors de visites inopinées de l’inspection des installations classées ou de contrôles effectués par des bureaux techniques, qui ne vérifient que certains points précis, comme la présence d’un extincteur par exemple.
L’immense majorité des installations classées n’est donc contrôlée que de façon très aléatoire. Le Conseil général de l’environnement et du développement durable a d’ailleurs calculé qu’une installation en déclaration n’était visitée qu’une fois tous les 90 ans (160).
En outre, l’inspection des installations classées ne dispose pas de chiffre précis sur les installations soumises à déclaration qui devraient faire l’objet d’un contrôle périodique : les déclarations « papier » des ICPE qui permettraient de les identifier sont aujourd’hui stockées dans les préfectures et ne sont pas centralisées.
Un suivi régulier de l’ensemble des installations en déclaration ne paraît toutefois pas nécessaire dès lors que leur fonctionnement régulier ne présente que des risques limités et que le contrôle de celui-ci peut reposer, d’une part, sur la responsabilité de l’exploitant et, d’autre part, sur le respect de certaines prescriptions génériques.
En outre, la tenue et l’informatisation d’un registre de ces installations, qui permettront d’effectuer des croisements entre le contenu des déclarations effectuées sur un téléservice dédié et les observations formulées par l’inspection des installations classées lors de la visite d’un établissement, ont commencé en début d’année 2016. Cette base de données centralisée, qui constitue un progrès par rapport à la situation antérieure où la déclaration papier était archivée dans une armoire de la préfecture, devrait faciliter le respect, par les établissements contrôlés, de leurs obligations.
Le contrôle périodique des installations en déclaration continuera néanmoins de présenter de sérieuses lacunes. D’abord, les entreprises concernées n’ont pas à adresser les rapports des organismes agréés aux services de l’État. Ensuite, les maires ne sont pas informés des contrôles effectués dans leur commune.
2. Faut-il revoir le barème de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) « air » ?
• M. Jean-Louis Roumégas estime que la TGAP « air » ne répond à aucune logique environnementale claire : elle est trop faible pour « internaliser » les dommages liés aux rejets de polluants et inciter les industriels à appliquer les meilleures techniques disponibles.
Pour que cette taxe ait un effet financier incitatif à la réduction des émissions, il faudrait donc augmenter ses taux, pour les rendre supérieurs au coût marginal de dépollution, car ainsi, selon l’INERIS, « il reviendrait moins cher aux industriels de dépolluer que de payer la taxe » (161).
En outre, la TGAP « air » devrait permettre de financer des projets d’amélioration de la qualité de l’air, sur le modèle de la taxe sur les émissions d’oxydes d’azote (NOX) des grandes installations de combustion mise en place par la Suède en 1992. Le taux d’emblée très élevé de cette taxe (de l’ordre de 5 500 €/t en 2013, soit plus de 30 fois le taux en vigueur en France) était compensé par le fait que les recettes de la taxe étaient redistribuées aux entreprises en fonction de leur production d’énergie. Or, selon le Commissariat général au développement durable (CGDD), cette redistribution intra-sectorielle, qui favorisait les entreprises les moins intensives en pollution, « a prouvé son efficacité environnementale » : ainsi, 62 % des entreprises ont investi, dès 1993, dans les solutions de réduction des émissions, contre 7 % en 1992, et les émissions de NOX sont restées relativement stables entre 1992 et 2007, tandis que la production d’énergie a augmenté de 77 %, ce qui représente une baisse substantielle de l’intensité polluante de la production (162).
Proposition de M. Jean-Louis Roumégas : augmenter progressivement les tarifs de la TGAP « air » pour les rapprocher des coûts des dommages causés et pour inciter les industriels à investir dans les meilleures techniques disponibles.
• M. Martial Saddier n’est pas favorable à un alourdissement de la fiscalité sur le secteur qui a le plus fourni d’efforts en matière de lutte contre la pollution de l’air. Il convient en outre de trouver un juste équilibre entre les mesures réglementaires et les dispositions fiscales applicables au secteur industriel, qui peut varier selon la nature des polluants. Or il n’est pas facile de doser ces différents éléments, d’autant que ni les dommages environnementaux, ni le coût des mesures d’abattement des émissions ne sont simples à évaluer. De plus, le recours aux meilleures techniques disponibles (MTD) peut être plus efficace que la voie fiscale. Si la réglementation oblige déjà un industriel à réduire ses émissions par le recours aux MTD, le recours à la taxation devient redondant – ce dernier subit une « double peine » : il a mis en œuvre des solutions innovantes, qui lui coûtent cher, et doit continuer à payer un certain montant de TGAP, même réduit – et n’a plus qu’un objectif de rendement.
Par ailleurs, nos industries sont exposées à la concurrence internationale. Une hausse de la TGAP conduirait donc à renchérir leurs coûts, au détriment de leur compétitivité. Or celle-ci subit d’ores et déjà le poids des surcoûts réglementaires, qui n’est pas négligeable. Pour les raffineries françaises, par exemple, ceux-ci seraient compris, par rapport à leurs concurrentes hors Union européenne, entre 7,5 et 10,5 €/tonne.
Proposition de M. Martial Saddier : agir sur le levier réglementaire, notamment par le biais des meilleures techniques disponibles, et non sur la fiscalité, pour réduire les émissions industrielles.
• Les rapporteurs s’accordent pour souligner l’opportunité d’expérimenter un fonds « air–industrie » pour aider les industries, notamment celles de petite taille, qui souhaitent mettre en œuvre les techniques de dépollution les plus performantes. Ce dispositif d’incitation financière, qui devrait être conçu sur le modèle du fonds « air–bois » subventionnant le remplacement des appareils de chauffage les moins performants, fait actuellement l’objet d’une expérimentation dans la communauté de communes de Faucigny–Glières de la vallée de l’Arve, soutenue par l’État dans le cadre de l’appel à projets « Villes respirables en 5 ans ».
Proposition n° 15 : développer l’expérimentation d’un fonds « air-industrie » sur le modèle du fonds « air-bois » pour soutenir le développement des techniques de dépollution industrielle les plus innovantes.
3. Renforcer le contrôle des installations soumises à simple déclaration en s’appuyant sur les préfets et les maires
Le contrôle périodique des installations classées soumises à simple déclaration devrait être renforcé par une meilleure information des préfets et des maires :
– d’une part, les préfets devraient être informés des contrôles périodiques effectués par les organismes agréés qui ont fait l’objet de constatation de non-conformités majeures et qui n’ont pas été réglées dans les délais. Cette obligation d’information pourrait même s’étendre à toutes les installations dont les rapports de contrôle ont montré qu’elles étaient fortement polluantes ;
– d’autre part, les préfets informeraient, sur une base annuelle, les maires de ces résultats.
Par ailleurs, les préfets devraient pouvoir demander à l’inspection des installations classées de contrôler, lors des pics de pollution, les établissements soumis à déclaration. Bien qu’ayant parfois une petite taille, ces établissements peuvent être à l’origine d’une pollution diffuse, qui peut jouer un rôle dans les dépassements des seuils réglementaires.
Proposition n° 16 : améliorer le contrôle des installations classées soumises à simple déclaration :
– informer les maires et les préfets des résultats des contrôles périodiques ;
– permettre aux préfets de demander, lors des pics de pollution, que ces installations soient inspectées lorsque leur contrôle par un organisme agréé a mis en lumière le caractère particulièrement polluant de leur activité.
B. L’AGRICULTURE : CHANGER DE DISCOURS POUR LE RENDRE AUDIBLE
1. La qualité de l’air doit s’inscrire dans le contexte plus large de la compétitivité de l’agriculture hexagonale
a. Des émissions quasiment stables
L’élevage et la culture sont considérés comme des sources de pollution atmosphérique en raison des effluents d’élevage, d’une part, et de l’utilisation à la fois d’engrais et de produits phytosanitaires par les cultivateurs, d’autre part.
Dans le cadre de leurs engagements internationaux, les membres de l’Union européenne se sont engagés à réduire les sources de pollution que sont les gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques. La convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques encadre les premiers tandis que la directive NEC, en cours de révision, vise à limiter les émissions de quatre polluants – le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, les composés organiques volatils et l’ammoniac – en fixant des plafonds nationaux. La Commission a proposé d’élargir le contrôle à la fois aux particules fines et au méthane, relevant par ailleurs de la convention des Nations unies. Cette seconde option a été repoussée.
Au sein de l’Union, la pollution du secteur agricole reste stable au fil du temps, ce qui justifie que les instances européennes s’en préoccupent.
PRINCIPALES SOURCES D’ÉMISSIONS DANS LES 28 PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE
![]()
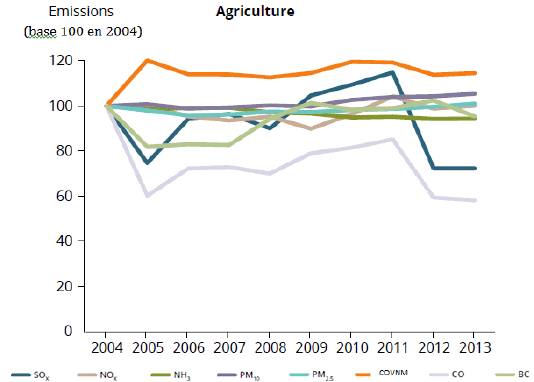
Source : Agence européenne de l’environnement.
Depuis 2004, les émissions des principaux polluants, à l’exception de l’ammoniac, stagnent ou progressent. En cela, les tendances constatées dans l’agriculture française ne se distinguent en rien de celles observées en Europe.
• L’ammoniac (NH3)
|
|
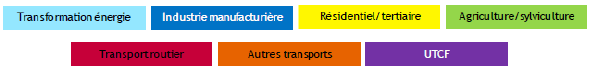
Source : CITEPA, Rapport national d’inventaire, avril 2015.
L’inventaire SECTEN du CITEPA estime à 701 kilotonnes pour l’année 2013 les émissions d’ammoniac provenant du secteur agricole, dont près des trois quarts sont dues à l’élevage, le quart restant résultant de l’épandage d’engrais minéraux pour les cultures.
L’ammoniac, sous sa forme gazeuse, est créé par dégradation des engrais azotés. Un léger mouvement de recul des émissions semble se dessiner à long terme, mais insuffisant pour garantir que les obligations internationales de la France seront respectées. Le Protocole de Göteborg amendé fixe un engagement de réduction des émissions de NH3 de 4 % en 2020 par rapport à 2005, c’est-à-dire un plafond calculé de 685 kilotonnes. Or, depuis 2006, les émissions oscillent entre 710 et 730 kilotonnes, au gré des fluctuations des prix des denrées agricoles, dans la mesure où une hausse des prix des denrées incite les agriculteurs à maximiser le rendement, donc à augmenter les engrais.
Les engrais azotés, comme les engrais potassiques et phosphatés, sont destinés à favoriser la croissance de la plante et à augmenter les rendements. La France en est un grand consommateur en Europe. On distingue la forme organique (effluents d’élevage) et la forme minérale qui provient de l’industrie chimique. Plus les quantités épandues sont élevées, plus les émissions le sont aussi. En outre, la forme des engrais influe fortement sur les émissions : l’utilisation d’urée a progressé ces dernières années, cette forme étant globalement plus émettrice que les ammonitrates. Les émissions s’en trouvent impactées à la hausse.
CONSOMMATION D’ENGRAIS MINÉRAUX CONSOMMATION D’ENGRAIS MINÉRAUX
AZOTÉS EN 2013 (MT D’AZOTE) : AZOTÉS EN 2013 PAR SAU (T D’AZOTE/HA) :
10 PREMIERS ÉTATS MEMBRES 10 PREMIERS ÉTATS MEMBRES
DE L’UNION EUROPÉENNE DE L’UNION EUROPÉENNE
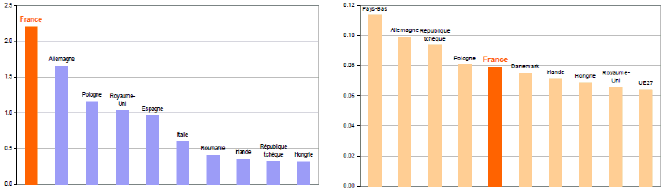
Source : Eurostat. SAU : surface agricole utile.
Source : Eurostat ; données 2013 pour la consommation,
2010 pour la SAU.
L’ammoniac, dangereux à forte concentration, est surtout mis en cause en tant que molécule précurseur de particules fines. Le secteur agricole, à l’origine de 20 % des émissions de particules fines PM10, est depuis plusieurs années, placé sous le feu des projecteurs à l’occasion des pics de pollution printaniers. L’épandage a certes lieu au printemps, mais il ne saurait en être autrement. Il est en effet interdit en hiver puisque, épandus sur des sols humides, les engrais risquent d’être emportés par le ruissellement des précipitations, contribuant à la pollution des eaux et obligeant les cultivateurs à un autre passage. Par ailleurs, le sol doit être sec pour des raisons agronomiques au risque, sinon, de se tasser sous le poids des engins agricoles et donc de perdre ses qualités. Les marges de manœuvre sont donc extrêmement limitées : les deux leviers étant la réduction, soit des surfaces traitées, soit des engrais épandus. C’est évidemment cette piste qu’il conviendra d’explorer en priorité en jouant à la fois sur les fertilisants et la rotation des cultures, qui prévient l’appauvrissement des sols.
• Les particules
|
|
|
|
TSP (total des particules |
PM10 |
PM2,5 |
PM1,0 |
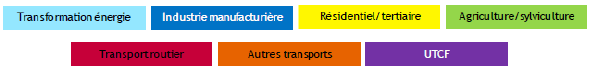
Source : CITEPA, Rapport national d’inventaire, avril 2015.
L’inventaire dressé par le CITEPA montre que la part de l’agriculture dans les émissions de particules est inversement proportionnelle à leur diamètre : plus il est faible, plus les substances pénètrent facilement dans l’organisme et l’appareil respiratoire, ce qui contribue à leur dangerosité.
Les rejets de particules totales en suspension diminuent moins vite que les autres, révélant la relative inertie du secteur agricole puisqu’il s’agit surtout, pour ce secteur, des émissions liées au labour des cultures.
• Les gaz à effet de serre
ü le méthane
ÉMISSIONS DE MÉTHANE, RÉPARTITION PAR SECTEUR
|
|
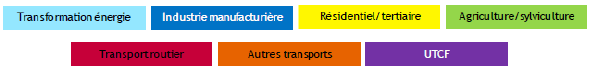
Source : CITEPA, Rapport national d’inventaire, avril 2015.
La principale source d’émission de méthane est le secteur de l’agriculture/sylviculture du fait majoritairement de la fermentation entérique et des déjections animales. Les émissions totales, passées de 2,8 millions de tonnes en 2000 à 2,3 millions en 2014, ont reculé surtout grâce à la transformation d’énergie et au résidentiel/tertiaire ; en revanche, les émissions agricoles ont peu évolué (de 1,7 million de tonnes à 1,5 million) même si la production laitière a été intensifiée.
ü le protoxyde d’azote
|
|
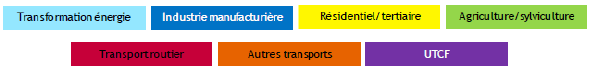
Source : CITEPA, Rapport national d’inventaire, avril 2015.
Quelle que soit l’année considérée, le principal secteur émetteur est l’agriculture/sylviculture. Les émissions de ce puissant gaz à effet de serre, de l’ordre de 250 fois plus puissant que le CO2, sont imputables aux apports azotés sur les sols cultivés avec l’épandage des fertilisants minéraux et d’origine animale. Le protoxyde d’azote, ou azote nitreux, se caractérise en outre par une longue durée de vie (environ 110 ans) et contribue à la destruction de l’ozone stratosphérique. Cependant, les émissions ont diminué de près de 16 % du fait de la réduction des quantités d’apports minéraux et du volume des déjections à épandre.
• Les pesticides
Le CGDD constate que « lors de la pulvérisation d’un produit phytosanitaire sur un feuillage, 30 à 50 % du produit n’atteint pas sa cible et est diffusé dans l’atmosphère et que des traces de plus de quatre-vingts pesticides sont notamment présentes dans l’air parisien (163) ». Une telle déperdition de produits potentiellement toxiques n’est satisfaisante ni sur le plan sanitaire ni même sur le plan économique et sa réduction constitue un objectif de politique publique.
Les pesticides sont répartis en trois grandes familles de produits : les fongicides, les herbicides et les insecticides. Ils sont épandus à grande échelle dans l’environnement pour détruire les nuisibles et protéger les récoltes. La France en est le deuxième consommateur de l’Union européenne. Elle se place toutefois au huitième rang pour la consommation de produits phytosanitaires exprimée en kilogrammes par hectare.
VENTES DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES |
VENTES DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES |
|
|
(*) Chiffre 2012. Source : Eurostat. |
SAU : surface agricole utile. Source : Eurostat ; données 2013 pour les ventes, 2010 pour la SAU. |
Quatre cultures (céréales à paille, maïs, colza et vigne) utilisent près de 80 % des quantités de pesticides pour moins de 40 % de la surface agricole utile. Dans son rapport sur les pesticides (164), le député Dominique Potier souligne que « par leur importance en surface et le haut niveau d’emploi de pesticides qui leur correspond en moyenne, le blé, le colza, et la vigne sont les trois “piliers” de la consommation des pesticides en France ». Ainsi la vigne, qui représente moins de 3 % de la SAU, consomme environ 20 % des pesticides. Le soufre et le glyphosate sont les plus utilisés.
Si, proportionnellement, la consommation de produits phytosanitaires nous place dans la moyenne européenne, force est de constater qu’elle stagne et que les mesures prises n’ont pas atteint l’objectif de réduction de 50 %. Plusieurs facteurs ont joué contre les impulsions données par les pouvoirs publics : selon une étude de l’INRA (165), les changements de culture n’ont eu que peu d’impact sur l’utilisation de ces produits entre 2008 et 2012, les substitutions s’étant opérées entre cultures d’intensité de traitement comparable, si bien que la pluviosité ou l’évolution des prix (en 2011 et 2012, ceux des céréales et des oléagineux ayant été supérieurs d’environ 20 % aux niveaux de 2010) sont sans doute responsables de cette tendance haussière qui s’est encore poursuivie entre 2013 et 2014, en raison d’un climat pluvieux préjudiciable aux céréales, à la betterave et au colza.
NOMBRE DE NODU, EN MILLIONS D’HA, EN ZONES AGRICOLES, HORS ZNA,
TRAITEMENTS DE SEMENCES, PRODUITS DE BIOCONTRÔLE VERT –
CALCUL MAAF, DONNÉES BNV-D (EXTRACTION LE 30/06/2013)
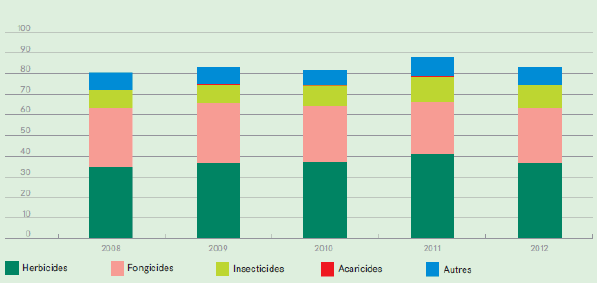
NODU : nombre de doses unités.
Source : Pesticides et agro-écologie, les champs du possible, rapport de Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle, au Premier Ministre, décembre 2014.
b. La nécessité d’accompagner les efforts d’un secteur spécifique et fragilisé
Au vu du constat, d’une part, et des engagements pris, d’autre part, sans oublier les impacts sanitaires, les pouvoirs publics ne peuvent se contenter du statu quo, mais il importe aussi de prendre la mesure du problème et de la spécificité du secteur.
• Un cycle de production rigide donc une pollution saisonnière
L’agriculture a ceci de particulier que le progrès scientifique et technique ne suffira jamais à neutraliser entièrement les caprices de la nature et du climat. Une épizootie, les mesures drastiques qu’elle implique, des précipitations trop rares ou trop abondantes peuvent anéantir plusieurs années de travail et d’investissements, rien n’y fait. L’amplitude des variations de la production – et des prix – est plus large que pour n’importe quel autre secteur alors que le cycle de production, notamment de l’élevage, peut être long. La flexibilité et l’adaptation au marché sont plus compliquées qu’ailleurs.
L’agriculture vit au rythme intangible des saisons. Dans les champs, les travaux comme la fertilisation, les semis, les moissons ou les vendanges suivent, indépendamment des techniques, un rythme immuable. Cette saisonnalité prive le plus souvent les acteurs de marges de manœuvre, pourtant souhaitables. Elle doit aussi être appréciée au regard de l’objectif ultime de la politique de lutte contre la pollution de l’air qui est la réduction de la pollution de fond. Dans l’atmosphère, les émissions, liées à l’épandage et aux moissons, sont importantes mais limitées dans le temps.
Enfin, l’ammoniac est dangereux surtout parce qu’il se recombine avec des NOx, émis surtout par le trafic routier en agglomération, pour former des particules. Régler ce problème plus récent résoudrait au moins en partie celui de l’ammoniac.
L’agriculture est néanmoins incluse dans le périmètre de l’arrêté interministériel du 26 mars 2014 encadrant la gestion des pics de pollution par les autorités préfectorales, tout comme dans l’annexe de l’arrêté du 7 avril 2016 qui le remplace. Son article 6 dénote un changement d’approche puisqu’il prévoit que « les mesures de restriction applicables aux secteurs agricole et industriel sont définies en concertation avec les parties concernées, en tenant compte des impacts économiques et sociaux, des contraintes d’organisation du travail, le cas échéant des pratiques culturales et des impératifs liés aux cycles biologiques des végétaux et des animaux, et en s’assurant que les conditions de sécurité sont respectées et que les coûts induits ne sont pas disproportionnés au regard des bénéfices sanitaires attendus ». Il précise en outre que « la baisse d’activité doit rester une possibilité alternative à l’arrêt total des activités si les conditions le permettent ».
La liste comprend d’ailleurs davantage de recommandations que d’interdictions puisqu’il est question de :
– recourir à des procédés d’épandage faiblement émetteurs d’ammoniac ;
– recourir à des enfouissements rapides des effluents ;
– suspendre la pratique de l’écobuage et les opérations de brûlage à l’air libre des sous-produits agricoles ;
– reporter les épandages de fertilisants minéraux et organiques en tenant compte des contraintes déjà prévues par les programmes d’actions pris au titre de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
– reporter les travaux du sol.
• Un sujet nouveau
Pour les habitants des villes, la pollution de l’air fait partie du quotidien. Ce n’est pas le cas chez les agriculteurs pour qui la pollution atmosphérique n’est pas un problème, même si des travaux récents ont révélé à la fois que l’agriculture y contribuait et qu’elle en était victime. Un rapport de 2011 (166) évalue à 850 millions d’euros pour la France le manque à gagner dû à la baisse des rendements des cultures du blé à cause de la pollution à l’ozone. Et le blé n’est pas un cas unique. Sont recensés comme sensibles à l’ozone le soja, le melon, les légumes à gousse (haricots, pois, fèves…), le navet, l’oignon, la laitue ou encore la tomate. À l’opposé du spectre sont classés comme résistants l’orge, le prunier, le fraisier, le seigle ou le brocoli. La présence d’incinérateurs d’ordures ménagères, d’aéroports ou d’axes à fort trafic à proximité des cultures a sur elles un impact non négligeable. Une étude allemande (167) sur des salades cultivées près d’axes routiers a, par exemple, montré des teneurs en plomb croissantes en fonction de l’intensité du trafic.
En outre, l’INSERM et l’université de Caen ont piloté une étude dénommée AgriCan, Agriculture & cancer, portant sur une cohorte (168) et s’étendant sur une période de quinze ans, à partir de 2005. Les premiers résultats publiés en novembre 2014 montrent que les cancers sont globalement moins nombreux dans la population agricole que dans la population générale, mais que la prévalence de certains types de cancer (prostate, mélanome, myélome, lymphome et lèvres) y est en revanche supérieure. Le lien de causalité n’est cependant pas encore établi. Par ailleurs, l’ANSES s’est auto-saisie de la question. La Cour des comptes souligne qu’une campagne de recensement des pesticides figure à la fois dans le PNSE 3 et dans la feuille de route rédigée par la conférence environnementale de novembre 2014. Un protocole de surveillance harmonisé doit être établi par le LCSQA en s’appuyant sur les travaux de l’ANSES à condition d’obtenir les crédits indispensables du plan Ecophyto. Les recherches méritent d’être poursuivies compte tenu de l’enjeu non seulement pour les agriculteurs et la population agricole, mais aussi pour l’ensemble de la population, afin de mesurer l’exposition et les voies de transmission des différentes substances retrouvées dans la nourriture.
De plus, la Cour des comptes a justement relevé la nécessité de coordonner les travaux que les AASQA ont déjà engagés sur les pesticides de façon à homogénéiser les méthodes et rendre ainsi les résultats comparables. Elle a rappelé aussi l’intérêt qu’il y aurait à assurer une bonne représentation de l’agriculture dans les conseils d’administration des AASQA.
• Un secteur fragilisé
La population active agricole est devenue marginale numériquement (3,5 % de la population active en 2007) et le nombre d’exploitations diminue à un rythme proche de 3 % par an.
Les statistiques sur les revenus ne sont pas encore disponibles mais il ressort des chiffres de la campagne 2014-2015 que des récoltes abondantes de céréales notamment ont coïncidé avec une baisse des cours mondiaux tandis que la fin des quotas laitiers a provoqué un effondrement des cours et la crise du porc a été tellement profonde que les pouvoirs publics ont dû intervenir.
Le tableau ci-dessous illustre l’étau qui se resserre sur l’agriculture française.
INDICES DES PRIX AGROALIMENTAIRES EN AMONT ET EN AVAL
(base 100 en 2010)
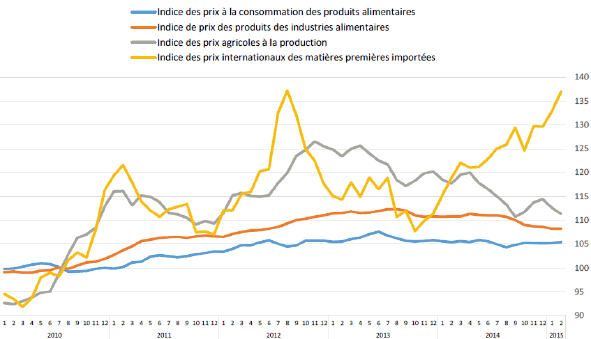
Source : INSEE, avril 2015.
Même si les indices synthétiques camouflent une réalité souvent contrastée, les prix de vente des produits agricoles, après avoir connu un pic en 2012, ont amorcé un recul qui ne s’est pas démenti depuis. Inversement, les prix des matières premières importées, et qui représentent les consommations intermédiaires du secteur agricole, s’inscrivent en forte progression depuis 2013, provoquant un écrasement des marges, si tant est qu’elles existent.
Par ailleurs, dans une note extrêmement critique (169), le Conseil d’analyse économique dénonce les résultats très médiocres de l’agriculture française : « un emploi en baisse, des revenus faibles dans certaines activités, une dégradation marquée de l’environnement, une performance commerciale qui s’érode ». Ainsi, les aides directes atteignaient en 2013 un montant moyen de 30 000 euros par exploitation et représentait 84 % du résultat courant avant impôt. Le cumul de ces aides représente un total de 10 milliards d’euros – hors exonérations fiscales et sociales – qui ne parvient pourtant pas à assurer des revenus corrects à chacun. Ils sont structurellement faibles dans l’élevage des bovins et ovins allaitants, la production de légumes de plein champ et la viticulture non AOC. Les jeunes sont pénalisés par un endettement élevé et les pensions versées aux retraités particulièrement faibles.
Pourtant, après avoir souligné le « bilan environnemental alarmant » de l’agriculture française, le Conseil souligne que « mettre en place une agriculture plus respectueuse de l’environnement devient aujourd’hui une véritable urgence » et sa première recommandation consiste à « mettre le capital naturel au centre de la politique agricole ».
2. Le verdissement des exploitations fait désormais partie intégrante de leur compétitivité
L’évolution des prix sur les marchés internationaux, qui comprime fortement les revenus des agriculteurs, les piètres performances environnementales, voire les menaces qui pèsent sur les milieux naturels, et partant sur les « immobilisations » des exploitations, tout concourt désormais à faire du « verdissement » de l’agriculture française une ardente nécessité. Le plan d’action globale pour l’agro-écologie, qui a pour objectif d’encourager les modes de production performants à la fois sur le plan économique et sur le plan environnemental, en est la traduction. Il constitue une feuille de route pour les pouvoirs publics, sur laquelle la lutte contre la pollution de l’air a toute sa place.
Indépendamment du fait qu’une agriculture plus sobre recouvrerait une plus grande autonomie vis-à-vis de ses fournisseurs, l’amélioration de la qualité de l’air ne peut être obtenue qu’au prix d’une moindre utilisation des substances à l’origine des pollutions constatées. Dans ce domaine, les deux priorités sont nettement identifiées : les nitrates, pour réduire les émissions d’ammoniac, et les pesticides.
• La réduction des émissions d’ammoniac
L’élevage est le principal responsable des émissions d’ammoniac et la volatilisation intervient à chaque stade : le bâtiment où sont parqués les animaux, le stockage des déjections et l’épandage. Et le problème est ancien puisque les déjections animales et les engrais qui y en sont issus sont à l’origine de l’eutrophisation et de l’acidification des sols contre lesquelles des mesures telles que la directive nitrates ont été prises avec un succès très relatif.
La refonte de la directive consacrée aux installations classées, dite IED, entraîne un rehaussement des exigences en matière environnementale ainsi qu’une légère augmentation du nombre d’exploitations agricoles assujetties. Les élevages visés sont ceux détenant plus de 40 000 emplacements pour les volailles ; ou de 2 000 pour les porcs de production et de 750 pour les truies. Environ 3 000 exploitations seraient concernées en France. Chacune d’entre elles serait tenue d’obtenir une autorisation, renouvelable, en contrepartie de l’application des meilleures techniques disponibles (MTD) décrites dans des documents de référence, appelés BREF (Best available Reference techniques document). La directive IED devrait rendre opposables dans un délai de quatre ans des mesures pour la protection de la qualité de l’air, tant au niveau des bâtiments d’élevage qu’en ce qui concerne l’épandage des effluents.
Le schéma ci-dessous décrit, pour chaque étape de la chaîne, les actions possibles pour réduire les émissions. Les impacts figurés en gras à droite correspondent aux étapes les plus émettrices, en lien avec la durée de séjour des effluents. Ce croquis met en évidence les risques de report des émissions d’amont en aval : en particulier, agir seulement sur le bâtiment se répercutera à un stade ultérieur (stockage ou épandage), en particulier pour les émissions d’azote gazeux. À moyens limités et efficacité comparable entre plusieurs actions, on préférera donc les mesures mises en place à l’épandage. Elles induisent un abattement des émissions sur le bilan d’ensemble de la chaîne.
LA CHAÎNE DE GESTION DES DÉJECTIONS ANIMALES ET DES IMPACTS ASSOCIÉS
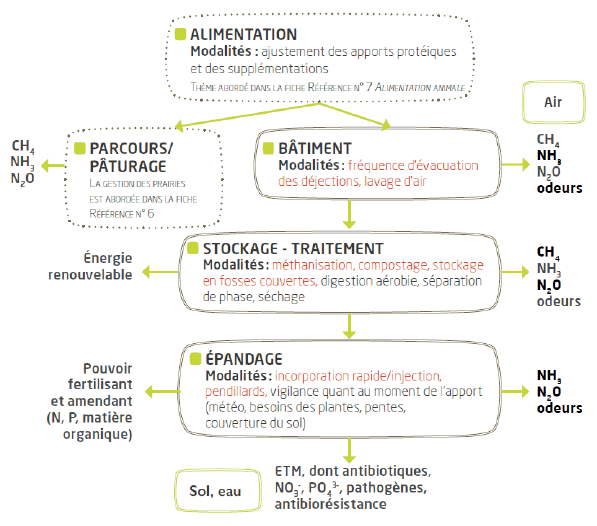
Source : ADEME, Agriculture & environnement, « Des pratiques clefs pour la préservation du climat, des sols et de l’air et les économies d’énergie », juin 2015.
L’alimentation biphasée s’est très largement répandue dans les élevages porcins si bien que les limites sont pratiquement atteintes, à moins de passer à une alimentation multi-phases, plus délicate à mettre en œuvre. Chez les ruminants, l’incorporation de lipides insaturés dans l’alimentation réduirait les rejets entériques (méthane). Néanmoins, la décision dépend largement de l’évolution des cours des denrées.
Au niveau des bâtiments, pour limiter les pertes d’azote, les déjections seront rapidement évacuées vers des ouvrages de stockage adaptés ; de même, l’ammoniac peut être piégé grâce à des dispositifs spécifiques. Les techniques sont très peu mises en œuvre, les marges de progression sont donc importantes mais butent sur l’obstacle du coût. Le plan pour la compétitivité et l’adaptation des exploitations agricoles 2014-2020 (PCAE) se donne d’ailleurs pour première priorité de moderniser les exploitations d’élevage et considère que les bâtiments doivent être conçus pour réduire leur impact environnemental sur l’air, l’eau et le paysage.
Dans la phase de stockage, l’enjeu réside dans la préservation du potentiel de fertilisation des résidus destinés à l’épandage. Parmi les différentes options possibles, on trouve, à des montants d’investissement variables, les fosses à lisier couvertes pour en limiter le volume ; le bâchage des tas de fumier, de façon à limiter les pertes gazeuses et la dilution dans les eaux de pluie ; le compostage des effluents solides pour en améliorer le pouvoir fertilisant.
Des traitements comme la méthanisation permettent de transformer les déjections en azote ammoniacal, rapidement disponible pour les cultures, tout en produisant de l’énergie. Très répandue outre-Rhin, où le prix de rachat de l’énergie produite est apparemment élevé, cette technique paraît offrir de bonnes perspectives et elle est soutenue par le plan Énergie Méthanisation Autonomie Azote. L’objectif est d’installer 1 000 méthaniseurs d’ici à 2020 pour un coût estimé à 2 milliards d’euros. Le parc se compose actuellement de 180 méthaniseurs à la ferme et d’une vingtaine de méthaniseurs territoriaux (170). Ce sont en effet des équipements délicats d’emploi, onéreux donc difficiles à amortir.
À l’épandage, le but est de limiter au strict minimum la volatilisation, ce qui revient à maximiser l’efficacité de l’intrant. Le coup est donc double : une moindre dose, une moindre pollution tant de l’air que du sol. Les techniques résident dans l’application par pendillard ou par injection directe dans le sol. Cet avantage ne doit pas dissimuler, d’une part, que les équipements sont très coûteux et, d’autre part, que cette technique consomme davantage d’énergie.
• La réduction des émissions de pesticides
Les produits phytosanitaires participent de la pollution de fond, leur présence découlant de leur volatilisation à partir du sol ou des plantes, de l’érosion éolienne des sols ainsi que de leur dérive après épandage. Réduire leur présence est une préoccupation déjà ancienne, même si leur utilisation globale n’est pas limitée. La réglementation, conformément à la directive REACH sur les substances chimiques dangereuses, définit uniquement les produits autorisés, la dose maximale correspondante et les conditions d’application (en particulier force du vent et distance par rapport à un point d’eau, formation des utilisateurs…). Il est à noter que l’épandage aérien de produits phytosanitaires est définitivement proscrit depuis le 1er janvier 2016.
Au plan national, le plan Ecophyto, lancé en 2008, était destiné à réduire progressivement l’utilisation de produits phytosanitaires mais la consommation n’a pas été réduite de moitié de 1998 à 2008, comme la France s’y était engagée. Aussi une deuxième version du plan, élaborée à la suite de la mission du député Dominique Potier, a-t-elle vu le jour en octobre 2015. Dans un premier temps, à l’horizon 2020, une réduction de 25 % est visée, grâce à la généralisation et l’optimisation des techniques actuellement disponibles. Ensuite, une réduction de 50 % est programmée pour 2025, qui reposera sur des mutations profondes des systèmes de production et des filières. L’enveloppe financière annuelle, prélevée sur le produit de la redevance pour pollution diffuse encadrée par l’article L. 213-8-10 du code de l’environnement, s’élève à 41 millions d’euros et viendra abonder les budgets des agences de l’eau.
Une des mesures phares du plan Ecophyto 2 est la mise en place de certificats d’économie de produits phytosanitaires (CEPP), dispositif conçu à l’image de celui en vigueur pour les économies d’énergie, et prévu dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014. L’expérimentation, qui couvrira la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2022, se déroulera selon les principes fixés par l’ordonnance n° 2015-1244 du 7 octobre 2015. Le décret portant application du dispositif sera travaillé en concertation étroite avec les parties prenantes et les acteurs concernés par sa mise en œuvre (distributeurs, exploitants).
Les distributeurs (coopératives et négociants), dénommés les « obligés », devront favoriser la mise en place, dans les exploitations agricoles, d’« actions reconnues » afin de faire diminuer l’usage, les risques et les impacts des produits phytopharmaceutiques.
Les certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP) acquis par la mise en œuvre de ces actions au titre de la dernière année de l’expérimentation, devront être équivalents à une diminution de recours aux produits cohérente avec les objectifs de diminution définis par le plan. L’objectif, pour chaque distributeur, sera déterminé à partir des ventes déclarées à la banque nationale de vente de produits phytopharmaceutiques par les distributeurs agréés (BNV-D), constituées par les données disponibles des cinq années les plus récentes. L’unité de compte sera l’indicateur de suivi du plan qui aura été retenu.
Un distributeur acquerra des CEPP par la mise en œuvre des actions reconnues ou par acquisition auprès d’éligibles, c’est-à-dire d’autres personnes morales que les obligés, ayant également mis en œuvre des actions visant à la réalisation d’économies de produits phytopharmaceutiques. Par ailleurs, en fin de période d’expérimentation, un distributeur pourra obtenir des CEPP auprès d’autres obligés.
Les actions reconnues comme permettant de générer des économies de produits phytopharmaceutiques devront concerner autant de filières que possible et être largement diffusées sous une forme pédagogique. Elles pourront par exemple concerner les produits de biocontrôle (171), les variétés résistantes ou tolérantes aux bio-agresseurs ainsi que les outils d’aide à la décision, le conseil ou l’investissement dans du matériel permettant de limiter sensiblement ou d’éviter le recours aux produits phytopharmaceutiques et la mise en place de systèmes de cultures économes.
Des bilans in itinere et des évaluations ex post du dispositif permettront de s’assurer que ces obligations de moyens auront abouti à une diminution effective du recours aux produits phytosanitaires dès les premières années de fonctionnement du dispositif, d’évaluer la performance du dispositif et d’ajuster les fiches actions si nécessaire. Un premier bilan du dispositif sera conduit au bout de deux ans.
• La réduction des émissions de particules
Le brûlage des résidus serait responsable des plus de 60 % des émissions de PM2,5 provenant des cultures hors engins agricoles. Aussi la règle, rappelée dans la circulaire interministérielle du 18 novembre 2011 (172) publiée en application du plan particules, est-elle l’interdiction du brûlage des résidus de culture et des feux pastoraux, et l’exception la dérogation, accordée par les préfets, pour des raisons agronomiques ou sanitaires.
Par ailleurs, la directive nitrates, dont l’objectif premier est d’éviter le lessivage du nitrate, impose désormais la couverture des sols dans les zones vulnérables à ce type de pollution aquatique. En interculture, une autre solution consiste à planter une culture intermédiaire piège à nitrate (CIPAN). De telles mesures préviennent également l’érosion éolienne des sols (selon l’INRA, la présence d’une végétation permettrait de réduire jusqu’à 90 % les émissions de particules primaires par érosion éolienne), prouvant tout l’intérêt qu’il y a à une approche globale de la pollution.
Les émissions de particules sont limitées par les techniques culturales simplifiées, dont l’introduction sert surtout à restaurer la qualité des sols, en particulier leur teneur en matière organique. Elles exigent toutefois une grande maîtrise car leur introduction peut favoriser l’apparition de plantes adventices, et l’utilisation accrue d’herbicides. Ces techniques consistent à réduire le nombre de passages de préparation du sol, de fertilisation ou de traitement, et à mieux tenir compte des conditions climatiques dans les décisions d’intervention, un vent faible et un sol humide réduisant les quantités émises.
b. Intégrer les exploitations dans leur écosystème
• Faire le bilan de la spécialisation des régions et des exploitations induite par le marché et les politiques publiques
Dans une intéressante étude (173) de 2012, consacrée au flux d’azote, l’INRA met en évidence, sous l’angle environnemental, le rôle joué par le marché et les dispositifs publics de soutien aux exploitations sur les spécialisations régionales et la taille des exploitations. Comme « les économies d’échelle en agriculture excèdent les économies de gamme », réalisées grâce à une intégration amont-aval du processus de production, « les exploitations se spécialisent et s’agrandissent. Les effectifs des cheptels bovins-viande et de vaches par exploitation ont plus que doublé sur les vingt dernières années en France, ceux des élevages porcins ont été multipliés par 6 ». De plus, la spécialisation permet une plus grande proximité avec les fournisseurs (négociants d’aliments pour bétail) et les clients (industrie agro-alimentaire avec laquelle les producteurs contractualisent) incités à s’installer près des exploitations, si bien que les exploitations se concentrent géographiquement.
L’INRA constate que les réglementations environnementales n’ont pas contrecarré le mouvement ni allégé la pression environnementale, au contraire. « Des études consacrées à l’adaptation des élevages aux contraintes de la directive nitrates dans les Côtes-d’Armor montrent que les subventions publiques versées aux élevages localisés dans les zones d’excédents structurels pour mettre en place des stations de traitement favorisent les grandes exploitations qui sont en mesure de supporter les charges fixes liées au traitement, au détriment des plus petites exploitations. Le traitement peut même induire un accroissement de la taille des élevages (économie d’échelle sur le volume traité). »
Ces constats méritent d’être médités au regard de l’impact de la fin des quotas laitiers et de la prochaine entrée en vigueur de la directive IED qui entraînera des sujétions supplémentaires pour les élevages intensifs. Les fonds de la PAC, qu’il s’agisse des paiements directs au titre du premier pilier ou des aides au titre du développement rural (deuxième pilier), doivent être pleinement utilisés et redéployés pour permettre un développement écologiquement harmonieux des territoires et rémunérer les « aménités », selon le terme utilisé par le Conseil d’analyse économique.
• Favoriser les engrais d’origine animale, plutôt que d’origine minérale
L’engrais organique est à privilégier puisqu’il est un produit fatal de l’élevage tandis que l’engrais minéral est fabriqué. Le bilan carbone de l’engrais minéral est donc moins favorable mais il a le double avantage d’être bon marché et plus facile à utiliser puisque, issu d’un processus de chimie industrielle, sa composition est plus stable. L’enjeu est donc de corriger cette appréciation en cherchant à rendre concomitamment l’engrais chimique moins attractif – cela dépend essentiellement des prix de l’énergie – et l’engrais organique plus attractif.
En outre, les émissions seront d’autant plus limitées que l’enfouissement sera rapide. Dès lors les plans d’épandage doivent s’ajuster en conséquence, ce qui suppose une bonne coordination des acteurs, les régions d’élevage ne se juxtaposant pas avec celles de grande culture.
• Favoriser la diversification des cultures
Le mouvement continu de spécialisation de l’agriculture française, observé depuis une cinquantaine d’années, a conduit à une spécialisation des exploitations en production animale ou végétale, qui est allée de pair avec une séparation géographique des zones de culture et d’élevage. Dans de nombreuses fermes, la variété des cultures recule, et les rotations sont de plus en plus courtes. Or les conséquences sont préjudiciables pour l’environnement : les régions productrices de maïs manquent d’eau, la consommation d’énergie fossile et les émissions de gaz à effet de serre augmentent, tout comme l’usage des pesticides car il devient de plus en plus difficile de maîtriser les adventices et les parasites avec des rotations courtes et des assolements peu variés.
Devant un bilan aussi négatif sur le plan environnemental et économique – les rendements stagnent malgré l’intensification culturale –, le ministère de l’agriculture a lancé le plan « Protéines végétales pour la France » sur la période 2014-2020. Il souligne l’intérêt de ces cultures en remplacement des tourteaux de soja largement importés, les conséquences bénéfiques qu’elles ont sur la consommation d’engrais azotés quand elles sont introduites dans les assolements. En somme, elles renforcent l’autonomie fourragère de notre élevage.
Ainsi, des exploitants en polyculture-élevage ont même réussi à accroître leur revenu en misant sur cette complémentarité. Le développement des cultures de légumineuses offre aussi des perspectives. Toutefois, une étude commandée par le ministère de l’agriculture et réalisée par des ingénieurs de l’INRA (174) met en évidence les verrous technologiques qui bloquent le développement de cultures alternatives et montre que la réussite passe par une organisation de la filière de l’aval vers l’amont, c’est-à-dire que les agriculteurs ne se lanceront pas dans l’aventure sans être assurés de trouver un débouché stabilisé (de préférence par le biais de la contractualisation). La réussite repose alors sur une indispensable coordination des acteurs.
• Favoriser les prairies
Les sols et le carbone qu’ils séquestrent sont liés à de nombreux enjeux environnementaux. Ils jouent un rôle majeur dans la régulation du climat mais aussi dans la préservation de la qualité des eaux et de l’air, la préservation de la fertilité des sols et le maintien de la biodiversité, tout particulièrement via la préservation, voire l’accroissement, des stocks de matières organiques.
Les analyses axées sur les émissions de gaz à effet de serre, qui envisagent le sol comme puits de carbone, ou sur la pollution par les nitrates dans les sols, les eaux ou l’air, convergent pour vanter les avantages de la prairie et de l’élevage en plein champ. Une mise à l’herbe prolongée favorise le stockage de carbone dans le sol tout en ayant un effet positif sur les autres gaz à effet de serre, puisque la part des déjections émises en bâtiment, et donc les émissions de N2O et CH4 associées, seront réduites. Les prairies contribuent en outre au maintien de la biodiversité. Le CITEPA qui, pour le compte de l’ADEME, a évalué dix actions au regard de leur potentiel de réduction des émissions d’ammoniac conclut que « comme les émissions sont environ 10 fois plus faibles à la pâture que dans le continuum bâtiment-stockage-épandage, la préservation des pratiques actuelles de pâturage reste un enjeu important » (175), même si la conjoncture économique dégradée et les contraintes climatiques poussent en sens inverse. Il y a cependant lieu de se réjouir que la recherche appliquée confirme l’intuition du lien qui unit écologie et bien-être animal.
Proposition n° 17 : favoriser la diffusion des bonnes pratiques inscrites dans le Projet agro-écologique pour la France, notamment en :
– réduisant les consommations d’engrais grâce à des techniques limitant les émissions d’ammoniac (pendillard ou injection) ;
– encourageant la couverture des fosses à lisier et la valorisation des effluents d’élevage grâce à l’épandage et la méthanisation ;
– veillant à la montée en charge du plan Ecophyto 2, en particulier du dispositif des certificats d’économie d’usage des produits phytosanitaires ;
– développant la recherche sur les solutions alternatives au travail du sol.
3. Les pouvoirs publics doivent se donner les moyens de convaincre
D’accord sur la ligne à suivre, les ministères de l’agriculture et de l’écologie entendent privilégier les mesures incitatives. La conjoncture dégradée plaide aussi pour une approche consensuelle. Il n’empêche que les résultats ne sont pas au rendez-vous en ce qui concerne tant les nitrates, puisque la France a été condamnée par la Commission européenne en septembre 2014, que les pesticides. Aussi est-il impératif de passer à la vitesse supérieure.
Hormis l’aspect sanitaire dont la connaissance mérite d’être approfondie, la lutte contre la pollution de l’air doit se fondre dans les dispositifs existants qui vont dans le bon sens dans la mesure où la réduction des intrants concourt à l’amélioration de la qualité de l’air. Cette démarche, dont d’aucuns pourraient être tentés de critiquer le minimalisme, se préoccupe avant tout d’efficacité. Elle cherche à ne pas brouiller le discours et à ne pas contrecarrer les efforts engagés par le ministère de l’agriculture pour donner de la cohérence aux initiatives de façon à avoir plus de chances de convaincre un monde agricole désorienté par des injonctions nombreuses et parfois paradoxales en provenance du marché, des autorités et des consommateurs. Les outils sont là et l’objectif est de généraliser leur utilisation pour leur donner leur pleine efficacité, pour réussir une révolution d’ampleur comparable à celle de l’après Seconde Guerre mondiale.
a. Les expérimentations doivent être développées : le réseau des fermes DEPHY - Démonstration Expérimentation Production de références sur les systèmes économes en pHYtosanitaires
Action majeure du plan Ecophyto 2, le dispositif DEPHY a pour finalité d’éprouver, valoriser et déployer les techniques et systèmes agricoles réduisant l’usage des produits phytosanitaires tout en promouvant des techniques économiquement, environnementalement et socialement performantes. Le dispositif repose sur un réseau national couvrant l’ensemble des filières de production et mobilisant les partenaires de la recherche, du développement et du transfert.
Le réseau FERME DEPHY, initié en 2009 au stade expérimental, rassemble plus de 1 900 exploitations agricoles engagées dans une démarche volontaire de réduction de l’usage de pesticides ainsi que 250 organisations professionnelles agricoles partenaires (chambres d’agriculture, coopératives, CIVAM (176), instituts techniques, INRA, etc.), 182 ingénieurs réseau animant des groupes d’agriculteurs et 200 sites expérimentaux. Le projet vise désormais 3 000 exploitations. Le réseau DEPHY EXPE réunit 41 porteurs de projets répartis sur environ 170 sites expérimentaux, et permet de concevoir, tester et évaluer des systèmes de culture visant une forte réduction de l’usage de produits phytosanitaires. DEPHY EXPE permet ainsi d’évaluer la faisabilité et les performances techniques, économiques et environnementales d’environ 500 systèmes de culture en rupture forte avec l’usage des produits phytosanitaires, et d’en favoriser progressivement le transfert auprès des agriculteurs en lien avec le réseau DEPHY FERME. En s’appuyant sur les réussites ou les échecs constatés en expérimentation, le réseau participera à la production de références de systèmes économes en phytosanitaires, à la compréhension des processus en jeu, et contribuera à identifier des besoins de recherches complémentaires. Le plan Ecophyto 2 prévoit un élargissement progressif du réseau à 3 000 exploitations, avec une ouverture vers d’autres collectifs impliqués dans l’agro-écologie.
Alors qu’au niveau national, le recours aux produits phytosanitaires – en particulier herbicides et fongicides – a augmenté ces dernières années (+ 5,8 % entre la période 2011-2012-2013 et la période 2012-2013-2014 et + 9,4 % entre 2013 et 2014), le réseau des fermes DEPHY a diminué, entre 2012 et 2014, le nombre de traitements moyen (IFT) de 10 % en grandes cultures et polyculture-élevage, de 12 % en arboriculture et en viticulture, de 15 % en cultures légumières, de 38 % en horticulture et de 22 % en canne à sucre.
C’est dans un cadre de ce type que la prise de conscience des enjeux de la qualité de l’air peut avoir lieu.
b. Placer l’agriculteur au centre du dispositif en l’informant, en le formant et en le soutenant
Placer l’agriculteur au centre du dispositif figure parmi les sept piliers du plan Ecophyto 2, dont la gouvernance a été simplifiée remodelée pour y associer le ministère de l’écologie, et qui s’inscrit au cœur du projet agro-écologique qui englobe la qualité de l’air. Dès lors, il convient d’actionner les leviers prévus dans ce cadre.
Outre le réseau des fermes DEPHY, le plan consolide les outils de diffusion d’information, comme les bulletins de santé du végétal (BSV) et le portail de la protection intégrée.
• S’appuyer sur l’abondante information disponible
Ø Les bulletins de santé du végétal
Les BSV, déclinés par région, ont vu le jour en 2009, dans le sillage du plan Ecophyto 1. Selon la filière de spécialisation, le BSV est publié de façon hebdomadaire ou bimensuelle (en dehors des périodes de trêves hivernale et estivale). Il présente notamment :
• un état sanitaire des cultures : stades de développement, observations des ravageurs et maladies, présence de symptômes ;
• une évaluation du risque phytosanitaire, en fonction des périodes de sensibilité des cultures et des seuils de nuisibilité des ravageurs et maladies ;
• des messages réglementaires, qui pourraient occasionnellement porter sur la qualité de l’air, comme l’a suggéré le représentant des chambres d’agriculture qui a participé à la table ronde organisée par les rapporteurs.
Il est placé sous la responsabilité d’un animateur filière, qui synthétise trois sources d’information :
• des données d’observations : elles sont obtenues à partir du suivi périodique d’un réseau de parcelles fixes ou flottantes judicieusement positionnées sur le territoire. Ce travail implique l’ensemble des agents de terrain locaux (chambres d’agriculture, coopératives, négoces), mais aussi des agriculteurs ;
• des données de modélisation : pour prévoir l’arrivée ou l’intensité d’attaques de certains bioagresseurs, les Instituts techniques, l’INRA, les services régionaux de la protection des végétaux ont construit des modèles épidémiologiques. Ils sont largement utilisés dans le cadre de l’élaboration des BSV ;
• des données de suivis biologiques en laboratoire.
L’objectif du BSV est de présenter un état général de la santé des végétaux, mais aussi de faire ressortir les particularités locales. Sur un même territoire, certains départements peuvent être uniquement concernés par tel ou tel type de ravageur. Le BSV est ensuite publié sur différents sites internet, dont ceux des chambres d’agriculture et des directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF), et, pour certaines régions, envoyé par courriel aux personnes en ayant fait la demande.
Ø Le portail EcophytoPIC
Le portail EcophytoPIC, qui date de 2010, a pour objet de sensibiliser les professionnels du secteur agricole au sujet de la Protection intégrée des cultures (PIC) et ainsi de faire évoluer les pratiques vers une réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Le site s’est enrichi en 2015 d’un outil interactif de sensibilisation nommé Concept. En libre accès, il propose aux agriculteurs une simulation d’évolution du système de culture, de façon soit rapide, soit approfondie. Dans le premier cas, il s’agit d’une première sensibilisation ; dans le second, la consultation dure une à deux heures mais peut être fractionnée avec des sauvegardes partielles ou totales. L’outil peut s’utiliser seul, accompagné d’un conseiller ou au cours d’une formation.
On a décompté 5 400 connexions par mois en 2015. Ce vecteur d’information et de bonnes pratiques mérite d’être connu et relayé.
Ø Les Certophyto
L’utilisation, la distribution, le conseil, la vente de produits phytopharmaceutiques (ou phytosanitaires) sont soumis à la détention d’un certificat individuel professionnel qui atteste de la connaissance suffisante pour utiliser les pesticides en sécurité et en réduire leur usage. Le certificat doit également être présenté pour l’achat de pesticides à usage professionnel.
La validité du certificat est de dix ans pour les agriculteurs et les employés agricoles et de cinq ans pour les activités de service (vente, conseil). Depuis le 26 novembre 2015, le certificat est obligatoire dans le secteur agricole : agriculteurs et salariés agricoles, forestiers et agents des collectivités territoriales.
Les formations et tests sont dispensés par des organismes de formation habilités par le ministère chargé de l’agriculture. La prévention des risques sur la santé et sur l’environnement fait partie des thèmes abordés dans la formation.
• Adapter l’enseignement agricole et l’ouvrir sur l’extérieur
En mars 2014, a été lancé le plan « Enseigner à produire autrement » pour « revisiter les référentiels et les pratiques pédagogiques afin de les mettre en conformité avec les enjeux de la transition écologique ; de redéfinir le rôle de l’exploitation agricole de l’établissement, dans son volet pédagogique, mais également comme outil de démonstration et d’expérimentation ; de renforcer la gouvernance régionale pour dynamiser les réseaux d’établissements […] ; de repenser la formation des personnels concernés par le plan d’action ». Le plan a vocation à être décliné dans les projets régionaux de l’enseignement agricole.
En dehors de la révision des programmes et du contenu des diplômes, chaque exploitation d’établissement se verra fixer des objectifs en lien avec chacun des plans d’action du projet agro-écologique, notamment les plans Ecophyto, Ecoantibio, azote/méthanisation, protéines végétales. Pour que la transition agro-écologique soit partagée et portée par les acteurs institutionnels, associatifs et économiques, les conseils régionaux doivent être étroitement associés à ce plan.
• Soutenir les agriculteurs
Des initiatives sont prises pour établir des passerelles entre les institutionnels et les exploitants.
Régionalisé car couplé aux programmes de développement rural des régions, le plan pour la compétitivité et l’adaptation des exploitations agricoles (PCAE) recueillera les financements du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), du ministère de l’agriculture et des régions, évalués à 200 millions d’euros pour la période 2014-2020 auxquels s’ajouteront les aides des autres financeurs qui souhaiteront soutenir les actions retenues.
L’État et les régions partagent une stratégie commune qui se décline autour des priorités suivantes :
– la modernisation des exploitations d’élevage, qui est la première priorité du plan, au vu des besoins particuliers dans ce secteur soumis à des coûts d’investissement élevés avec l’enjeu particulier que constituent les bâtiments, l’amélioration des conditions de travail et l’autonomie alimentaire du cheptel ;
– la recherche de la double performance dans le secteur végétal, par la maîtrise des intrants et la protection des ressources naturelles (érosion des sols, eau, biodiversité...). Il s’agit également de répondre aux problématiques particulières de certaines de ces filières : rénovation du verger, investissement dans les serres, investissement dans les secteurs du chanvre, du lin, de la fécule de pomme de terre et du riz pour éviter leur disparition au profit des céréales... ;
– l’amélioration de la performance énergétique des exploitations agricoles, pour réduire les charges de production et promouvoir les investissements d’économie d’énergie et de production d’énergie renouvelable dans les exploitations, notamment par la méthanisation ;
– de façon transversale, l’encouragement des projets s’inscrivant dans une démarche agro-écologique, en particulier ceux conduits dans le cadre d’un groupement d’intérêt économique et environnemental.
Le cadre existe donc pour intégrer la problématique de la qualité de l’air et de l’ancrer dans les territoires, en priorité ceux où la pollution atmosphérique de fond est élevée.
C. LA POLLUTION D’ORIGINE RÉSIDENTIELLE PROGRESSE ET SA RÉDUCTION PASSE PAR UNE POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE VOLONTARISTE
1. La réduction de la pollution atmosphérique d’origine résidentielle, passée un peu inaperçue, est synonyme d’amélioration de la performance énergétique du parc immobilier
a. Une pollution passée un peu inaperçue
Le 16 février 2016, la Commission européenne a exposé la stratégie européenne pour la production de chaleur (chauffage) et de froid (climatisation et réfrigération). Elle souligne tout particulièrement que l’Union y consacre 50 % de sa consommation d’énergie finale et que les principaux utilisateurs sont, tout d’abord, le secteur résidentiel qui absorbe 45 % de la production totale de chaleur et de froid, le secteur industriel qui représente 37 %, le reste correspondant à la part des services (18 %). Ces chiffres révèlent l’importance du secteur résidentiel dans la consommation d’énergie. D’ailleurs, la loi de transition énergétique (LTE), qui se fixe, entre autres objectifs, de réduire de 50 % (177) la consommation énergétique finale d’ici à 2050, implique une action forte dans ce domaine.
Un tel volontarisme politique à tous les niveaux (178) s’explique également par l’enjeu que représente le secteur résidentiel dans la politique énergétique. C’est surtout la dépendance énergétique et la vulnérabilité qu’elle entraîne vis-à-vis des pays producteurs de combustibles qui ont focalisé l’attention des décideurs publics, plutôt que les conséquences en termes de pollution atmosphérique. Néanmoins, il s’agit d’un simple décalage dans le temps puisque, en définitive, les deux objectifs convergent : l’amélioration globale de la performance énergétique des bâtiments et des appareils de chauffage est le prix à payer pour une meilleure qualité de l’air.
Un autre facteur explique la discrétion du phénomène de la pollution d’origine résidentielle : son caractère diffus. Les sources sont extrêmement nombreuses, faibles considérées individuellement et difficilement repérables, à l’inverse d’une usine par exemple.
b. Une source de pollution à ne pas négliger
L’inventaire du CITEPA juge encourageants les résultats obtenus. Pour la quasi-totalité des substances suivies, les niveaux d’émission les plus bas enregistrés depuis le début des observations (1960 ou 1990 selon les substances) correspondent à la période 2009-2013. Toutefois, mesurées par leur pouvoir de réchauffement global (PRG), les émissions dues au résidentiel-tertiaire continuent d’augmenter.
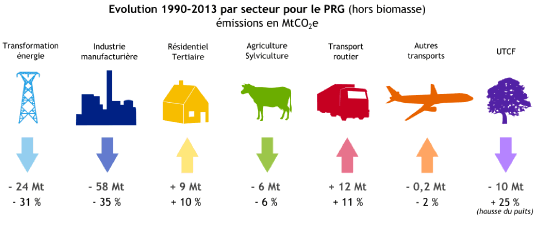
Source : CITEPA, Rapport national d’inventaire, avril 2015.
• Le dioxyde de carbone (CO2)
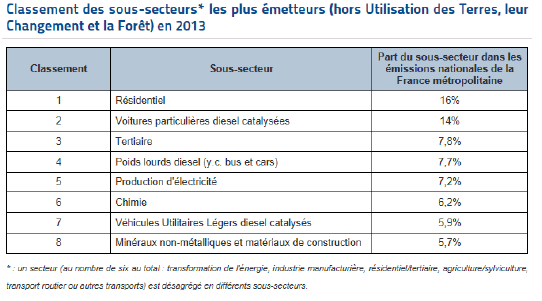
Source : CITEPA, Rapport national d’inventaire, avril 2015.
La consolidation du résidentiel et du tertiaire donne le pourcentage de 23,8 %, ce qui le place au deuxième rang des émetteurs derrière le transport (27,6 %). Le CITEPA relève que, depuis les années 1960, les émissions liées à la biomasse ont fortement augmenté pour trois raisons : premièrement, la prise en compte des agrocarburants depuis le début des années 1990 ; deuxièmement, l’augmentation des déchets incinérés ; et, troisièmement, l’accroissement de la consommation de bois par le secteur résidentiel. Ce sont ces deux phénomènes qui ont contribué à accroître la part relative du secteur résidentiel-tertiaire dans les émissions de CO2, qui est un gaz à effet de serre et non, au sens strict, un polluant atmosphérique.
• Les particules
C’est surtout à cause de ses émissions de particules que le secteur contribue à la pollution atmosphérique. Le phénomène d’urbanisation implique également une concentration des émissions qui, prises isolément, sont faibles mais qui, regroupées et combinées avec d’autres sources de pollution telles que le trafic routier, peuvent provoquer un dépassement des seuils d’alerte.
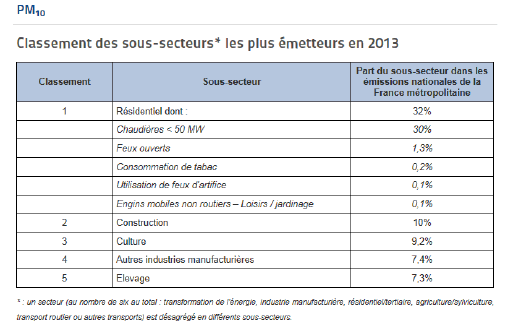
Source : CITEPA, Rapport national d’inventaire, avril 2015.
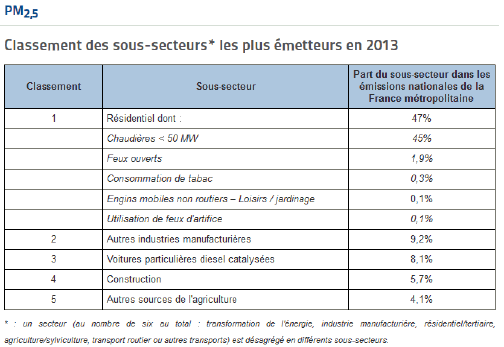
Source : CITEPA, Rapport national d’inventaire, avril 2015.
Bien que la part relative du tertiaire dans les rejets de particules recule quelque peu, elle reste néanmoins prépondérante. Cette surreprésentation du secteur s’explique notamment par la combustion du bois (33 % des émissions totales pour les PM10) et dans une moindre mesure, par celle du charbon et du fioul.
• Les autres polluants
La Cour des comptes l’a signalé, le secteur résidentiel est le principal émetteur de COV (179), provenant quasi exclusivement du chauffage au bois et de HAP (180). Le développement de la climatisation provoque aussi une très forte augmentation des émissions d’hydrofluorocarbure, un très puissant gaz à effet de serre.
c. Un parc de logements dans lequel la maison individuelle et l’ancien dominent, ce qui se ressent sur sa performance énergétique
En 2012, la France comptait 33,4 millions de logements, dont 27,8 millions de résidences principales, soit 83,2 %. Le parc se décompose en 18,8 millions de maisons individuelles et 14,6 millions de logements collectifs, représentant une proportion de 56,1 % et de 43,9 %, pratiquement la même que celle entre les logements construits avant 1975 et après. Ainsi, la préférence des Français pour la maison individuelle se traduit dans les chiffres et le parc immobilier est relativement ancien.
Les énergies les plus utilisées pour le chauffage sont le gaz (44 %), utilisé surtout dans les immeubles collectifs (à 54,5 %), l’électricité (33,5 %) et le fioul (14 %). La part du bois (3,8 %) n’est pas négligeable et il sert surtout dans les maisons individuelles.
RÉPARTITION DES RÉSIDENCES PRINCIPALES
SELON L’ÉNERGIE DE CHAUFFAGE DE BASE
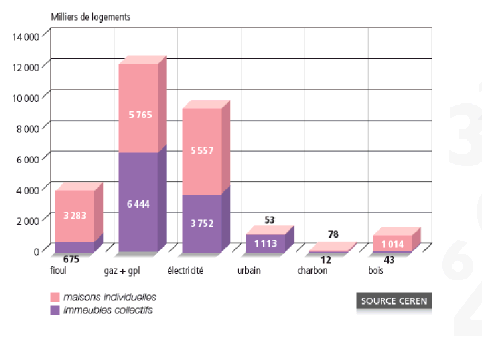
L’analyse de la consommation énergétique en fonction de l’âge du bâtiment met en évidence une performance médiocre des bâtiments antérieurs au premier choc pétrolier. Par ailleurs, plus ils sont récents, plus ils sont performants.
PART DE LA CONSOMMATION DE CHAUFFAGE À CLIMAT NORMAL
DANS LES RÉSIDENCES PRINCIPALES PAR PÉRIODE DE CONSTRUCTION
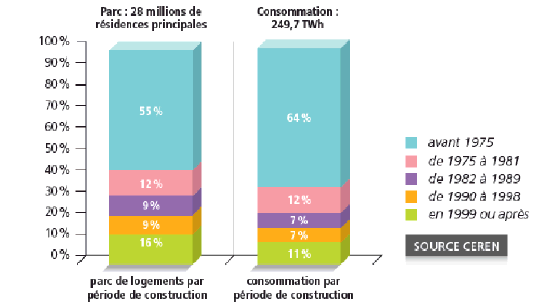
d. L’amélioration des appareils de chauffage
Le principal levier de lutte contre la pollution de l’air d’origine résidentielle consiste à améliorer la performance énergétique des appareils de chauffage et des bâtiments (une meilleure isolation limite le chauffage et la climatisation). Si la France se distingue peu des autres pays de l’Union, elle présente néanmoins la spécificité d’avoir misé sur l’énergie nucléaire, et partant sur l’électricité. Elle est d’ailleurs la principale source d’énergie (37 %) utilisée pour le chauffage et la climatisation du secteur résidentiel. Viennent ensuite le gaz (32 %), le pétrole (16 %) et les énergies renouvelables (15 %).
CONSOMMATION FINALE DU RÉSIDENTIEL-TERTIAIRE
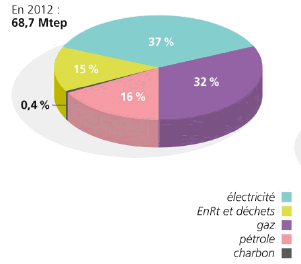
Source : ADEME, chiffres clés du bâtiment 2013.
Ce bilan n’est qu’une photographie et ne retrace pas l’évolution des choix dans les modes de chauffage au fil du temps. Le croisement du mode de chauffage et de la date de construction met en évidence des tendances de fond : le gaz a perdu du terrain au profit de l’électricité qui voit sa part se tasser depuis 1990, et le fioul s’effondre.
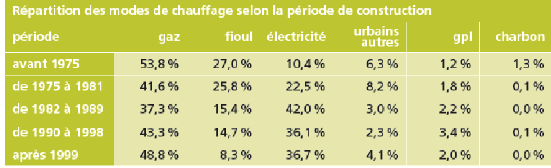
Source : ADEME, chiffres clés du bâtiment 2013.
• Aider au renouvellement des appareils anciens
Près d’un ménage sur deux en résidence principale individuelle utilise un appareil de chauffage au bois, pratiquement toujours associé à une autre source d’énergie, principalement l’électricité. Ce mode de chauffage séduit de plus en plus de ménages : en 2012, 7,4 millions d’entre eux utilisaient le bois comme mode de chauffage principal ou secondaire, dans leur résidence principale, contre 5,9 millions en 1999. La France est le premier marché européen pour les appareils de chauffage au bois. Il faut dire que le chauffage au bois présente un triple avantage : il fait partie des énergies renouvelables, contribue à réduire la dépendance énergétique et il est peu onéreux à l’usage. Cependant, quand la combustion n’est pas complète et le matériau de bonne qualité, il se révèle extrêmement polluant (NOx et particules). L’ADEME a établi que « le parc des appareils de chauffage au bois se caractérise par 50 % d’équipements non performants (appareils datant d’avant 2002 et foyers ouverts) qui sont très polluants : ils émettent 80 % des particules fines issues du chauffage au bois individuel. » (181) Aussi est-il indispensable de promouvoir des appareils à foyer fermé et à bon rendement énergétique. Or le renouvellement des appareils individuels de chauffage au bois est de l’ordre de 4 % par an, ce qui signifie que la durée de vie moyenne des équipements est de vingt-cinq ans, chiffre à mettre en regard des progrès techniques réalisés sur la période : les nouveaux poêles et chaudières émettent dix à trente fois moins que les anciens.
Les pouvoirs publics peuvent agir, et ils l’ont fait, dans deux directions.
Tout d’abord, ils peuvent aider le consommateur en éclairant ses choix, grâce à l’étiquetage et à la labellisation menée conjointement avec les professionnels. Et le label « Flamme verte » en offre une excellente illustration. Ce label a été créé en 2000 par les fabricants d’appareils domestiques et l’ADEME. L’étiquette est apparue sur les appareils en 2010. Le classement s’étale de 1 à 5 étoiles en fonction de deux critères : le rendement énergétique de l’appareil et le monoxyde de carbone (CO) émis dans l’atmosphère. Un critère relatif aux émissions de poussières a été intégré le 1er janvier 2011. Depuis le 1er janvier 2015, le label n’est plus accordé qu’aux appareils affichant 5 étoiles minimum, et l’étiquetage s’est élargi en introduisant les 6 et 7 étoiles reflétant l’amélioration énergétique et écologique des nouveaux équipements. À compter de 2018 et avec une nouvelle étape en 2020, les critères d’attribution du label deviendront plus rigoureux et ils s’étofferont avec la prise en compte des émissions de composés organiques volatils et des oxydes d’azote en même temps que cesseront d’être commercialisés les modèles les moins performants. Il s’agit là d’une anticipation progressive de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2022, du règlement 2015/1185 concernant les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide pris en application de la directive 2009/125/CE dite « éco-conception ». Ce règlement n’interdira pas pour autant la vente d’appareils à foyer ouvert, à condition qu’ils respectent les performances et les normes de qualité les concernant.
Ensuite, la puissance publique peut subventionner le remplacement des appareils anciens comme cela a été fait dans la vallée de l’Arve, à hauteur de 1 000 euros. Le succès a été au rendez-vous puisque, sur une cible de 11 000 appareils, un peu plus de 3 000 ont été changés ou sont en cours de changement. Le représentant de l’ADEME auditionné par les rapporteurs considère qu’il s’agissait d’une gageure dans la mesure où le reste-à-charge pour les particuliers reste élevé, de l’ordre de 5 000 euros, le changement d’appareil entraînant souvent le tubage des conduits d’évacuation, tandis que les économies de chauffage sont très faibles, voire nulles, pour les habitants d’une vallée alpine. L’aide reste néanmoins appréciable surtout qu’elle peut se cumuler avec le CITE et l’éco-PTZ. Depuis, l’ADEME s’est vu confier la gestion d’un Fonds Air, dans le cadre du projet « ville respirable » et, le 19 janvier 2016, les trois premières conventions françaises ont été signées en Isère, par Grenoble Alpes Métropole, la communauté de communes du Pays du Grésivaudan et la communauté d’agglomération du pays Voironnais. Le conseil régional d’Ile-de-France a depuis décidé d’en faire autant et prévu, pour ce faire, un budget d’un million d’euros. Ce dispositif a été déployé pour les collectivités volontaires en priorité dotées d’un plan de protection de l’atmosphère (PPA) pour cause de dépassement des valeurs réglementaires, et pour lesquelles le chauffage résidentiel individuel est identifié comme source de pollution. Tel est bien le cas puisque, en Rhône-Alpes, 90 % des émissions de particules proviendraient du chauffage au bois. Comme dans la vallée de l’Arve, sont visés les appareils datant d’avant 2002 et les foyers ouverts, mais ne sont éligibles que les poêles « Flamme verte 7 étoiles ». Le montant de la prime disponible est fixé par chaque collectivité. Les rapporteurs considèrent que ce dispositif a fait la preuve de son efficacité et mérite d’être progressivement généralisé. Relevant le paradoxe qu’il y a à subventionner le remplacement des foyers ouverts tout en autorisant leur commercialisation, les rapporteurs souhaitent que soit étudiée la possibilité d’une interdiction de ces foyers dans les zones sensibles, où les seuils de pollution sont régulièrement dépassés, notamment en se fondant sur le considérant n° 11 de la directive 2009/125/CE, dite écoconception qui autorise un État membre à « introduire de nouvelles dispositions fondées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement en raison d’un problème spécifique à cet État membre ».
La voie réglementaire offre aussi la possibilité de faire évoluer la qualité des combustibles qui alimentent les appareils de chauffage. La DGEC a ainsi rappelé que la quasi-disparition du dioxyde de soufre dans l’atmosphère devait beaucoup à la diminution de la teneur en soufre des combustibles commercialisés. Enfin, si l’information et l’incitation ne suffisent pas, il reste la voie de l’obligation, toujours délicate à manier. Ainsi, la Cour des comptes rapporte que, en Allemagne, la réglementation impose purement et simplement le démontage des appareils de chauffage de plus de quarante ans, c’est-à-dire antérieurs à 1974.
• Veiller à l’entretien des appareils
Chauffer un logement bien isolé avec un appareil performant est la condition sine qua non pour qu’un particulier réduise ses émissions polluantes. Encore faut-il qu’il entretienne convenablement son matériel sans quoi il verra une bonne partie des bénéfices de ses efforts anéantis. En effet, faute d’entretien, le rendement d’un appareil, quel que soit le combustible utilisé, se dégrade et sa durée de vie se réduit quand l’habitant ne met pas sa vie en jeu : on songe à l’intoxication au monoxyde de carbone qui fait une centaine de morts par an ou aux risques d’incendie. La Fédération française du bâtiment estime à 3 millions le nombre de chaudières pas ou mal entretenues ; quant à l’ADEME, elle préconise, pour les appareils à bois fonctionnant par tirage naturel, un ramonage semestriel des conduits en plus du nettoyage régulier de l’appareil lui-même.
Pourtant, la réglementation existe. Chacun songe à l’attestation que l’occupant devrait fournir à la compagnie qui assure son habitation. Mais il y a plus. Le décret n° 2009-649 du 9 juin 2009 relatif à l’entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kilowatts, et qui modifie l’article R. 224-20 du code de l’environnement, précise les modalités de l’entretien annuel obligatoire. L’initiative incombe à l’occupant, sauf stipulation contraire du bail. L’entretien, qui doit être effectué par un professionnel reconnu, comporte la vérification de la chaudière, le cas échéant son nettoyage et son réglage, ainsi que la fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière en place, les améliorations possibles de l’ensemble de l’installation de chauffage et l’intérêt éventuel du remplacement de celle-ci. Au terme de l’opération, une attestation doit être délivrée et conservée deux ans par le client. Ce décret est complété par un arrêté du 15 septembre 2009 du ministre de l’écologie qui détaille les étapes de l’entretien annuel, qui comprend notamment le rendement et les émissions de polluants atmosphériques de la chaudière, selon la méthode décrite. Si la teneur en monoxyde de carbone dépasse 50 ppm (182), le professionnel délivre une injonction d’arrêt de l’appareil jusqu’à sa remise en état. Le contrôle des émissions porte sur les COV et les poussières pour les appareils utilisant les combustibles solides (bois, charbon), et les NOx pour les appareils à combustible gazeux ou liquide (gaz, fioul). Les émissions observées sont comparées à des valeurs de référence. À l’occasion de la nouvelle réglementation, un guide à l’intention des particuliers a été rédigé.
Les rapporteurs souhaitent que cette réglementation soit complétée par une obligation de transmission, lors de l’entretien des appareils, d’une notice d’information sur les risques de pollution de l’air liés au chauffage résidentiel.
En Allemagne, la Cour des comptes le souligne, il existe des valeurs limites pour les appareils de chauffage et les professionnels chargés de l’entretien biennal des appareils vérifient que les normes sont respectées. Quand elles ne le sont pas, les anomalies sont signalées aux autorités locales qui peuvent imposer des travaux, voire le remplacement de la chaudière. Le contrôle peut s’étendre jusqu’au combustible utilisé.
Proposition n° 18 : améliorer les performances des appareils de chauffage :
– généraliser les aides au renouvellement des foyers de combustion non performants sur le modèle du fonds air-bois ;
– mettre à l’étude la possibilité d’interdire la commercialisation des foyers ouverts dans les zones sensibles ;
– prévoir une transmission obligatoire, lors de l’entretien des appareils, d’une notice d’information sur les risques de pollution de l’air liés au chauffage résidentiel.
2. La mobilisation des acteurs est le gage de l’efficacité des mesures prises
Une fois le diagnostic porté et les moyens d’action identifiés, il faut passer à l’étape suivante qui est leur appropriation par la totalité des acteurs.
a. Adapter les solutions au contexte local
Quels que soient les avantages et les inconvénients propres à chaque mode de chauffage, aucun ne constitue la panacée et ne peut remplacer tous les autres. Aussi sera-ce aux régions, chargées d’élaborer les nouveaux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, plus intégrés que les précédents, de prendre la main pour préserver la qualité de l’air ou faire reculer la pollution de fond dans les zones particulièrement touchées, en veillant à un certain équilibre entre les différentes énergies utilisées.
Ainsi, l’habitat diffus peut difficilement se passer du chauffage au bois, une énergie renouvelable, bon marché et produite localement. Mais, à défaut d’avoir choisi la voie de la contrainte, le parc actuel est à l’origine d’importants rejets de particules fines, par exemple en Rhône-Alpes. Aussi peut-il être judicieux de faire coexister, selon les caractéristiques géographiques et démographiques, d’autres sources d’énergie dont on a vu plus haut qu’elles évoluent au fil du temps.
Parmi les moyens de chauffage traditionnel se trouve le gaz naturel dont l’infrastructure de distribution (200 000 kilomètres de tuyaux environ) existe déjà, et qui n’est pas soumis aux aléas de production des énergies solaire et éolienne. Le chauffage au gaz naturel présente l’avantage de rejeter très peu ou pas de particules et peu de NOx, ce qui permettrait de contrebalancer le chauffage au bois.
VALEURS LIMITES D’ÉMISSIONS EN MG/M3 FIXÉES PAR LA DIRECTIVE ÉCOCONCEPTION
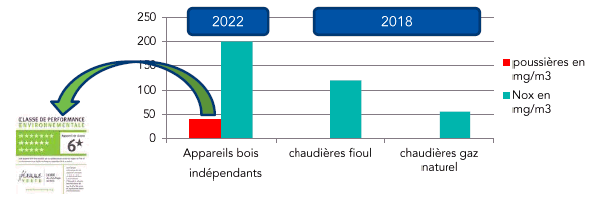
Source : GRDF.
b. Sensibiliser les particuliers
S’agissant de pollution de l’air, les particuliers se voient plus souvent en victimes qu’en fauteurs de troubles. Ils se plaignent, non sans raison, de la qualité de l’air dans les villes, mais oublient un peu vite qu’ils circulent en voiture ; recherchent des fruits et légumes colorés, aux formes parfaites, qui se conservent des semaines dans le bas du réfrigérateur ; laissent aux collectivités le soin de se débarrasser de déchets toujours plus volumineux ; et se chauffent. Il serait temps de les faire entrer dans la boucle de l’écologie responsable : ils sont le maillon d’une chaîne et il est vain de chercher un bouc émissaire responsable d’un phénomène auquel chacun a sa part.
• Les gestes du quotidien
Au crépuscule des années 1970, le Gouvernement avait lancé la chasse au gaspi, et l’envolée des prix du pétrole après le second choc pétrolier avait aiguillonné l’ardeur des chasseurs. En ce début de XXIe siècle, l’urgence écologique, les média le serinent, va révolutionner notre modèle de développement, qui n’est pas tenable. Les institutions politiques ont amorcé le tournant en se fixant des objectifs et des échéances, par exemple avec la loi de transition énergétique en France, la stratégie européenne « Vers un secteur du chauffage et du refroidissement intelligent, efficace et durable », la COP21. Les habitants des pays développés ne doivent plus se contenter de regarder le ballet incessant des puissants de ce monde, car c’est leur propre sort et celui de leurs enfants qu’ils ont entre leurs mains.
En matière de pollution de l’air, les gestes les plus simples ont un effet immédiat, même si leurs effets ne sont pas visibles à l’œil nu : baisser le chauffage la nuit – en outre, c’est plus sain –, surtout en cas de pic de pollution ; brûler un combustible de bonne qualité ; entretenir convenablement son appareil de chauffage, pour moins consommer d’énergie, voire le remplacer s’il est vieux…
En outre, l’interdiction du brûlage des déchets verts mériterait d’être une nouvelle fois rappelée, la circulaire interministérielle du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts, destinées aux préfets de département, n’étant pas très connue des administrés. À cause notamment des émissions incontrôlées de particules, de dioxines et autres substances cancérigènes, l’interdiction fondée sur l’article 84 du règlement sanitaire départemental est la règle et l’autorisation l’exception. Les entreprises qui entretiennent les jardins sont soumises aux mêmes contraintes. Le préfet peut toutefois accorder des dérogations, mais sur proposition de l’autorité sanitaire et après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Le règlement sanitaire départemental est opposable, et sa violation passible d’amende. Les dérogations sont suspendues en cas de pics de pollution et, en tout état de cause, le brûlage est interdit dans les périmètres des plans de protection de l’atmosphère (PPA) et dans les zones dites « sensibles » à la dégradation de la qualité de l’air, identifiées par l’AASQA compétente, dans les zones urbaines, en zone péri-urbaine et rurale lorsqu’il existe un système de collecte et/ou des déchèteries.
• Le diagnostic de performance énergétique
Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un document, valable dix ans, qui, sur la base de l’article L. 134-3 du code de la construction et de l’habitation, est à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire d’un bien immobilier. Il est même joint à des fins d’information au contrat de location. L’article L. 134-4-1 prévoit qu’un DPE soit établi pour les bâtiments équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement avant 2017. Il s’agit donc d’une formalité qui fait partie des actes de la vie courante des Français.
Le contenu du DPE est précisé par l’article R. 134-2 du même code. Il contient :
• les caractéristiques du bâtiment ou de la partie de bâtiment et un descriptif de ses équipements (chauffage, eau, air...) ;
• l’indication, pour chaque catégorie d’équipements, de la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée ainsi qu’une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations ;
• l’évaluation de la quantité d’émissions de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée ;
• l’évaluation de la quantité d’énergie d’origine renouvelable utilisée ;
• le classement du bâtiment ou partie de bâtiment en application de l’échelle de référence selon le principe de l’étiquette énergie et de l’étiquette climat ;
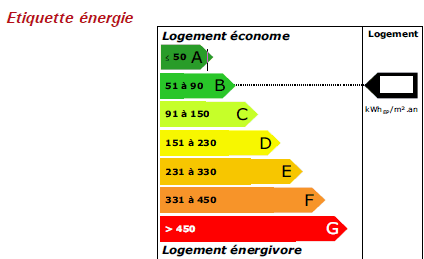
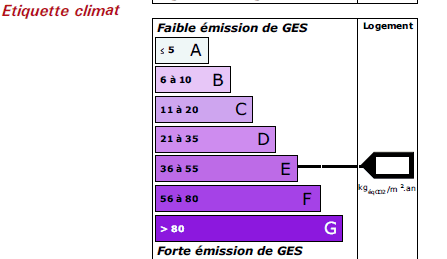
• des recommandations pour maîtriser les consommations d’énergie, en particulier les travaux qui pourraient être réalisés pour améliorer la performance énergétique du bâtiment, accompagnées d’une évaluation de leur coût et de leur efficacité.
Dans la rédaction actuelle de l’article précité, il n’est question que de descriptif des équipements et de recommandations. Les rapporteurs jugent utile de préciser que la description doit porter aussi sur l’état de vétusté de l’appareil de chauffage examiné et, pour mieux faire mieux appliquer la réglementation sur l’entretien des chaudières, que les deux dernières attestations soient fournies à l’occasion du DPE.
Proposition n° 19 : améliorer le diagnostic de performance énergétique (DPE) :
– préciser que le descriptif de l’appareil de chauffage porte sur son état de vétusté ;
– prévoir, le cas échéant, la transmission de l’attestation d’entretien des appareils de chauffage au moment de l’établissement du DPE.
TROISIÈME PARTIE : LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L’AIR INTÉRIEUR
La pollution atmosphérique a longtemps accaparé l’attention, et des pouvoirs publics, et des médias. Pourtant, la qualité de l’air intérieur s’est progressivement invitée dans le débat public, bien que sur un mode mineur. D’une part, les données épidémiologiques ont révélé une véritable explosion des pathologies respiratoires et des allergies. Comme le souligne régulièrement le professeur de Blay, 30 % des individus nés après 1980 sont allergiques. Il s’agit d’un constat paradoxal puisque la désindustrialisation et l’adoption de normes plus contraignantes laissaient augurer une amélioration sur le terrain des pathologies respiratoires. D’autre part, le scandale de l’amiante a tétanisé les esprits et poussé l’État et les collectivités territoriales à prendre des initiatives dans le cadre de la loi de 1996 qui institue, dans l’article L. 220-1 du code de l’environnement, une politique destinée à mettre en œuvre « le droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé », et dont la définition de la pollution atmosphérique, donnée par l’article L. 220-2 du même code, englobe les espaces clos.
Les pouvoirs publics se sont mobilisés dès le début des années 2000, affichant un bilan consistant (I). La complexité du sujet et une gouvernance touffue, en dépit des mesures prises, laissent des zones d’ombre (II). En outre, inscrite dans une action gouvernementale qui poursuit d’autres missions importantes, la lutte contre la pollution de l’air intérieur doit être conciliée avec d’autres objectifs de politique publique (III).
I. LA MOBILISATION DES POUVOIRS PUBLICS
A. DE L’OBSERVATOIRE DE LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR (OQAI) AU PLAN DE QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR (PQAI)
L’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI) et le Plan national santé-environnement (PNSE) constituent le socle d’une politique jouant sur tous les leviers à la disposition des pouvoirs publics.
1. La première campagne de l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur
C’est le souci d’éviter de nouveaux scandales sanitaires qui a présidé à la création, par une convention entre les trois ministères, chargés du logement, de l’environnement et de la santé, l’ADEME, l’ANAH et le CSTB, de l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur en juin 2001, à la suite d’une initiative de Louis Besson, alors ministre du logement.
À l’origine, l’OQAI apparaît comme une structure originale et innovante. Il a été conçu pour fournir des données permettant la caractérisation de l’exposition des populations (enfants, personnes âgées…) aux contaminants présents dans les environnements intérieurs. En effet, la méconnaissance en ce domaine limite l’évaluation des risques sanitaires qui y sont associés et explique en partie les difficultés rencontrées à mettre en œuvre des solutions efficaces et proportionnées aux problèmes rencontrés.
Sa première tâche consistait à mener une vaste campagne de mesure de 2003 à 2005 pour dresser un état des lieux des logements en France. Ont ainsi été recueillies des données dans 567 résidences principales, réparties entre cinquante départements et soixante-quatorze communes, sur une durée d’une semaine. Les mesures ont été faites à l’intérieur, y compris dans les garages, comme à l’extérieur, pour établir des comparaisons. Les auteurs en concluent qu’« il en ressort une spécificité de la qualité de l’air intérieur qui tient en particulier à la présence de substances non observées à l’extérieur ou bien à des concentrations nettement plus importantes. » Autrement dit, l’OQAI a fait le constat inattendu que l’air intérieur est, en règle générale, plus pollué que l’air extérieur. Si seulement 9 % des logements présentent des concentrations très élevées de plusieurs polluants, en considérant chaque polluant isolément, 5 à 30 % des logements présentent des concentrations nettement plus élevées que la moyenne. En revanche, 45 % des logements présentent des niveaux de concentration très faibles pour l’ensemble des polluants considérés, ce qui signifie a contrario que, dans la moitié des logements, la qualité de l’air intérieur doit être améliorée. Il est apparu également que 37 % des logements sont contaminés par des moisissures qui ont un pouvoir allergisant certain et qui, au moins pour certaines d’entre elles, dégagent des mycotoxines. La proportion de logements français ayant des teneurs en composés organiques volatils (COV) plus élevées qu’à l’extérieur varie entre 68,4 % pour le trichloréthylène et 100 % pour le formaldéhyde. Ce sont les aldéhydes qui sont les molécules les plus fréquentes et les plus concentrées. Le xylène et le toluène sont les hydrocarbures présents dans tous les logements.
2. Le Plan national santé-environnement (PNSE)
Parallèlement, l’importance de l’environnement pour la santé sera consacrée au plus haut niveau du droit national par le biais de la Charte de l’environnement et qui dispose dans son article premier : « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Un an avant avait été votée la loi relative à la politique de santé publique de 2004 qui instaure un plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement, couramment appelé plan national santé environnement, PNSE, qui couvre une période de cinq ans. C’est à la suite de la conférence interministérielle de Londres en 1999, puis celle de Budapest en 2004, organisées par l’OMS, et en cohérence avec la stratégie en santé environnement élaborée par la Commission européenne (SCALE), que le premier PNSE 1 2004-2008 a été adopté. Il s’appuyait sur le rapport d’une commission d’orientation et était construit sur une approche intégrée et globale de l’ensemble des polluants et milieux de vie pour répondre aux enjeux de prévention des principaux risques sanitaires environnementaux. L’ampleur et la complexité de la thématique relative aux liens entre la santé et l’environnement, ainsi que les attentes et interrogations qu’elle suscite chez nos concitoyens, sont telles que l’élaboration d’un PNSE, sa déclinaison en régions et sa mise à jour tous les cinq ans ont été inscrites dans le code de la santé publique (article L. 1311-6). Les deux premiers couvrent respectivement les périodes 2004-2008 et 2009-2013.
3. Le Grenelle de l’environnement et le PNSE 2
Les dix années en question ont été marquées par le Grenelle de l’environnement, en particulier la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010. Le texte crée une section consacrée à la qualité de l’air intérieur au sein du chapitre intitulé « Surveillance de la qualité de l’air et information du public ». Le texte fixe également les responsabilités de l’État à qui sont confiés « les travaux d’identification des facteurs de pollution, l’évaluation des expositions et des risques sanitaires relatifs à la qualité de l’air dans les environnements clos » (article L. 221-7 du code de l’environnement). C’est pourquoi l’article L. 221-8 rend obligatoire une surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public (183), renvoyant ses modalités à des décrets.
Dans le sillage d’un texte ambitieux, le PNSE 2 (2009-2013) se proposait de consolider les résultats du PNSE 1, et de commencer à exploiter les données réunies dans ce cadre de façon à réduire les pollutions observées. Parmi les cinquante-huit actions prévues, les plus importantes, concernant la qualité de l’air intérieur, étaient, d’une part, la campagne de mesures dans les écoles comme prélude à la surveillance de la qualité de l’air dans les établissements recevant du public. D’autre part, un étiquetage relatif aux émissions (COV et formaldéhyde) des produits de construction et de décoration devait être progressivement mis en place, lequel serait un préalable à celui des autres sources intérieures de pollution les plus significatives (meubles, produits d’entretien, etc.). Des actions de sensibilisation des professionnels du bâtiment devaient également être développées.
4. Le Plan national santé-environnement 3 (PNSE 3) et le plan de qualité de l’air intérieur (PQAI)
Le PNSE 3, qui correspond à la période 2015-2019, s’assigne pour but de consolider les progrès accomplis et propose une nouvelle approche de la santé environnementale intégrant la notion d’exposome. Ce terme, qui correspond à une approche globale de la santé environnementale, désigne « l’ensemble des expositions pour la vie entière » pour reprendre la définition qu’en donne le projet de loi relatif à la santé déposé par le Gouvernement le 15 octobre 2014, par opposition au génome, la santé des individus résultant de la combinaison de ces deux facteurs. Il s’agit d’un changement de paradigme qui impose de prendre en considération toutes les sources de pollution ou d’exposition susceptibles de concourir à l’altération de la santé des individus, à la fois en considérant la totalité des voies d’exposition à un polluant ou une nuisance et, quand c’est possible, les interactions entre polluants. L’exposome fait le lien entre une approche par milieu et une approche par pathologie.
Le premier axe du Plan consiste toujours à prévenir les cancers liés à l’environnement, et le second à mieux connaître les expositions, leurs effets et les leviers d’action. Les pathologies résultent souvent de causes multifactorielles, ce qui suppose d’étudier l’exposition cumulée qui doit être appréhendée à travers des indicateurs d’exposition globale et de programmes de biosurveillance. Concrètement, la collecte de données doit être étendue, les résultats exploités et aisément disponibles. Selon les termes mêmes du PNSE 3, « l’air intérieur constitue un axe fort de progrès en santé environnementale » grâce à la mise en œuvre du plan de qualité de l’air intérieur (action n° 49) qu’il intègre.
Le plan de la qualité de l’air intérieur a été présenté au Conseil national pour la transition écologique et au Conseil national de l’air en juin 2013, avant d’être adopté en septembre. Il pourra être décliné en région. Les vingt-six actions qu’il recense, et auxquelles correspondent les lettres de l’alphabet, sont regroupées en cinq grands chapitres : informer le grand public et les acteurs relais ; développer l’étiquetage pour les produits susceptibles d’émettre des polluants dans l’air intérieur ; dans la filière du bâtiment, développer les actions incitatives et préparer les évolutions réglementaires ; progresser vis-à-vis des pollutions spécifiques et améliorer les connaissances.
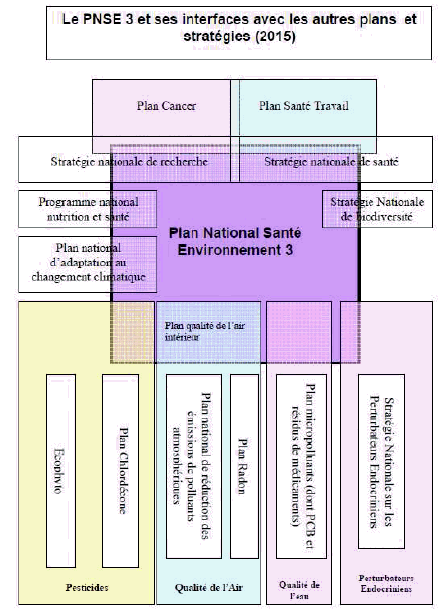
La loi ainsi que les différents plans qui se sont succédé se sont traduits en mesures concrètes, qui se sont déployées dans trois directions : la recherche pour mieux appréhender l’impact de la qualité de l’air intérieur sur la santé des occupants des milieux clos, la réglementation pour réduire les sources de pollutions, et l’information du public. Sur ces trois registres, le bilan des quinze dernières années est substantiel.
1. La recherche sur les milieux et les populations
• Lieux de vie fréquentés par les enfants : L’OQAI poursuit la campagne nationale dans 300 écoles (600 salles de classe), qui a pour objectif d’améliorer la connaissance de l’exposition des enfants aux polluants (chimiques, physiques et biologiques) présents dans les écoles maternelles et élémentaires et pour lesquels les connaissances sont encore limitées. Il s’agit de mieux connaître la pollution dans le parc d’établissements afin d’apporter des données utiles à l’évaluation des risques sanitaires pour ces populations sensibles et de hiérarchiser les situations à risque. De plus, le confort d’ambiance est également évalué afin de connaître les niveaux d’exposition au bruit et à l’éclairage ainsi que le confort thermique des enfants dans les écoles. En 2017 démarrera l’exploitation des données.
• Les bureaux : De nombreux contaminants peuvent être présents dans les bâtiments à usage de bureaux, qu’ils soient chimiques, physiques ou biologiques. Les pathologies associées sont multiples, souvent aspécifiques et plurifactorielles. Cependant, la qualité de l’air dans les bâtiments de bureaux est actuellement très mal connue en France et la connaissance du parc de bâtiments (nombre, répartition géographique et typologie) est très limitée. Par ailleurs peu de données sont aujourd’hui disponibles sur les interactions entre qualité de l’air intérieur et performance énergétique des bâtiments à usage de bureaux. Ainsi, une campagne nationale a démarré en 2013, dont les objectifs sont les suivants :
– élaborer un état du parc des immeubles de bureaux en termes de qualité de l’air intérieur (QAI), de confort perçu et de performance énergétique ;
– classer les immeubles de bureaux au regard de ces critères ;
– élaborer des recommandations d’amélioration de la QAI dans les bureaux.
• Les bâtiments performants en énergie : L’OQAI a mis en place un dispositif de remontée de données et de partage d’information – dénommé OQAI-Bâtiments performants en énergie (BPE) – ouvert à l’ensemble des acteurs publics et privés intéressés par les questions de qualité d’air et de confort dans les nouveaux bâtiments. Un protocole harmonisé a été élaboré et est mis à disposition des acteurs souhaitant mieux connaître leur parc de bâtiments. Une base de données a été développée. Elle rassemble au fil de l’eau l’ensemble des données sur la qualité de l’air, le confort et les consommations d’énergie dans les bâtiments performants en énergie. In fine son objectif est d’accompagner, en temps réel, le déploiement des nouvelles constructions, et d’identifier les éléments d’ajustement à mettre en œuvre pour optimiser le parc de bâtiments en cours de métamorphose.
• Les nouveaux lieux de vie : Il s’agit de préparer une prochaine campagne nationale de l’OQAI, en lien avec le PQAI et la poursuite du déploiement de la surveillance obligatoire de l’air intérieur dans les établissements recevant du public. L’étude consiste à collecter et analyser les données bibliographiques disponibles sur les nouveaux lieux pressentis que sont les hôpitaux (établissements de soins au sens large) et maisons de retraites. Au terme du programme, une proposition de paramètres à mesurer dans ces lieux et de dimensionnement d’une campagne nationale de mesure sera faite.
b. Les études sur les populations
L’INSERM a publié le volet français des études internationales International Study on Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC), mené dans 401 classes d’écoles élémentaires de six villes françaises (Bordeaux, Clermont-Ferrand, Créteil, Marseille, Reims et Strasbourg) par l’équipe d’Isabelle Annesi-Maesano. Il en ressort que 30 % des élèves sont exposés à des niveaux des principaux polluants atmosphériques supérieurs aux valeurs guides recommandées par l’OMS et l’ANSES (cf. infra). La même équipe a participé à l’étude SINPHONIE, financée par le Parlement européen. Elle couvrait les établissements scolaires de vingt-trois pays européens, et fait des recommandations relatives notamment à l’emplacement des écoles, à leur conception, à leur ventilation et à l’importance de mesurer périodiquement la qualité de l’air.
En mai 2015, les résultats de l’étude GERIE, financée elle aussi sur fonds européens et menée dans les maisons de retraite de sept pays européens (184), révèle la vulnérabilité des personnes âgées aux polluants de l’air intérieur.
Les populations à risque méritent d’être suivies en priorité par les chercheurs en épidémiologie et en étiologie.
Par ailleurs, des études générales en santé publique ambitieuses sont en cours :
– en 2014 a été lancée l’enquête Esteban qui vise notamment à mesurer notre exposition à certaines substances de l’environnement, à mieux connaître notre alimentation et notre activité physique et à mesurer l’importance de certaines maladies chroniques dans la population, dont l’asthme et les allergies. Construite pour être répétée tous les sept ans environ, Esteban permettra de recueillir, sur le long terme, des données précieuses pour développer une vision plus globale de la santé, qui associe environnement, alimentation, nutrition, activité physique et maladies chroniques ;
– Esteban a été précédée par ELFE, première étude longitudinale française consacrée au suivi des enfants, de la naissance à l’âge adulte, qui aborde les multiples aspects de la vie de l’enfant sous l’angle des sciences sociales, de la santé et de la santé-environnement. Lancée auprès de 500 familles pilotes en 2007, elle est généralisée en France métropolitaine depuis avril 2011 et concerne plus de 18 000 enfants. Soutenue par les ministères en charge de la recherche, de la santé, et de l’écologie, ainsi que par un ensemble d’organismes de recherche et d’autres institutions, l’étude ELFE mobilise plus de quatre-vingts équipes de recherche.
De telles études focalisant à la fois sur les individus et leur milieu de vie sont indispensables pour établir d’abord des corrélations entre pathologies et certaines substances, puis des liens de causalité.
2. La réglementation par seuil
La panoplie à la disposition des pouvoirs publics s’étend de l’interdiction pure et simple comme celle de la fabrication, transformation et commercialisation de l’amiante depuis le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, à la publication de normes à respecter assorties d’échéances plus ou moins lointaines.
Il existe plusieurs types de valeurs (185), qui, bien que dotées de la même terminologie, recouvrent des notions et des applications différentes. Il faut dans un premier temps distinguer l’origine de ces valeurs selon qu’elles sont définies par l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et par le Haut Conseil de la santé publique (HCSP), ou par décret (valeurs guides réglementaires et valeurs d’action rapide).
Les valeurs guides de qualité de l’air intérieur proposées par l’ANSES constituent le socle initial du procédé institutionnel visant à fixer des valeurs réglementaires de surveillance de la qualité de l’air intérieur. Elles sont fondées uniquement sur des critères sanitaires et sont de nature indicative.
Afin d’appuyer les pouvoirs publics dans l’élaboration de valeurs réglementaires permettant de mettre en place des actions d’amélioration de la qualité de l’air intérieur, le ministère chargé de la santé a demandé au HCSP de proposer, à partir des valeurs guides de qualité de l’air intérieur définies par l’ANSES, des valeurs repères d’aide à la gestion dans l’air des espaces clos, ainsi qu’un calendrier pour leur déploiement. Ces valeurs se décomposent en valeurs d’action immédiate, d’information pour le formaldéhyde, ainsi qu’en valeurs cibles à atteindre à une échéance déterminée par le HCSP. Ces différents seuils permettent de donner un cadre d’intervention aux gestionnaires. Pour les définir, le HCSP tient compte de considérations pratiques, réglementaires, juridiques, économiques et sociologiques.
La loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale a posé le principe de la définition de valeurs-guides pour l’air intérieur, afin de réduire l’exposition à long terme de la population à des polluants dans les espaces clos. Les valeurs-guides réglementaires pour l’air intérieur (VGAI), définies par décret du 2 décembre 2011 et mentionnées à l’article R. 221-29 du code de l’environnement, ont été définies pour le formaldéhyde et le benzène sur la base des valeurs repères proposées par le HCSP. Elles correspondent à des niveaux provisoirement acceptables en deçà desquels aucune action à court terme n’est nécessaire. Ces valeurs évoluent dans le temps de façon à atteindre les « valeurs guides de qualité de l’air intérieur » établies par l’ANSES. Le décret distingue deux échéances : 2015 pour la valeur intermédiaire définie par le HCSP et 2023 pour la valeur cible définie par l’ANSES.
Enfin, les valeurs d’action (VA) réglementaires, définies par le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 modifié, correspondent aux valeurs d’action immédiate proposée par le HCSP. Lorsqu’un résultat de mesure est supérieur à la valeur d’action, a fortiori quand il y en a plusieurs, le propriétaire ou exploitant de l’établissement fait réaliser une expertise dans un délai maximal de deux mois après la réception des résultats pour identifier les causes de ce dépassement et les mesures correctrices à mettre en œuvre.
3. L’information du public et des professionnels
a. L’étiquetage des matériaux de construction et de décoration
Depuis le 1er janvier 2013, tous les produits de construction doivent être étiquetés pour guider les consommateurs et les professionnels dans leur choix.
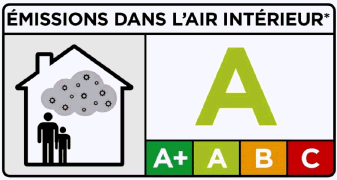
Conformément aux orientations du PNSE 2, l’étiquetage intègre l’émission de formaldéhyde et l’émission totale de COV. Mais d’autres polluants sont également pris en compte, car les enquêtes de l’OQAI ont montré leur forte présence dans les logements : l’acétaldéhyde, le toluène, le tetrachloroéthylène, le xylène, le triméthylbenzène, le dichlorobenzène, l’éthylbenzène, le butoxyéthanol, et le styrène.
L’étiquetage complète une autre mesure, qui interdit dans la fabrication des produits de construction et décoration les composés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 (trichloréthylène, benzène, phtalate de bis et phtalate de dibutyle).
b. Les autres types d’information
• Les produits dont la commercialisation s’accompagne d’allégations environnementales
Depuis le 1er janvier 2014, et dans le sillage de la loi dite « Grenelle 2 », les produits de construction et de décoration dont la publicité s’appuie sur des arguments de nature environnementale, en particulier leur impact sur la pollution de l’air, doivent impérativement faire l’objet d’une déclaration environnementale aux termes du décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale de certains produits de construction et de l’arrêté du même jour sur le même sujet, qui ont été partiellement annulés par le Conseil d’État en juin 2015, au motif que les délais fixés (six mois pour les déclarations simplifiées et un an pour les déclarations exhaustives) n’étaient pas suffisants pour que les fabricants procèdent aux tests préalables nécessaires. L’entrée en vigueur du dispositif en a été décalée de six mois (le 30 juin 2014 pour les déclarations simplifiées et le 1er janvier 2015 pour les déclarations exhaustives). Les fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) sont consultables gratuitement sur un site accessible à la fois aux professionnels et aux autres publics.
• Les fiches de déclaration environnementale et la base INIES
La fiche de déclaration environnementale et sanitaire, ou FDES, est un outil regroupant des informations multicritères objectives, quantitatives et qualitatives pour déclarer les performances des produits de construction. Elle se compose de deux volets :
– un volet environnemental qui constitue la déclaration environnementale (analyse du cycle de vie du produit ou ACV) ;
– un volet sanitaire, résultant d’études ou d’essais en laboratoire, qui présente des informations sur la contribution du produit de construction à l’évaluation des risques sanitaires, au confort d’usage, au confort hygrothermique, acoustique, etc.
La caractérisation de l’impact environnemental et sanitaire des constructions nécessite de disposer d’informations regroupées les plus objectives possibles, pertinentes et consensuelles sur les caractéristiques environnementales et sanitaires des produits de construction. Avec le soutien financier du ministère de l’écologie et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), la base de données INIES a été créée par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) début 2005 pour mettre à disposition de l’ensemble des acteurs du bâtiment ces caractéristiques. La base INIES recense les fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES), fournies par les fabricants ou syndicats professionnels, établies en respectant une méthodologie d’évaluation de dix indicateurs principaux caractérisant la qualité environnementale des produits de construction (consommation énergétique, lutte contre le changement climatique, consommation de ressources, production de déchets ultimes, pollution de l’eau, de l’air, etc.).
Ces fiches FDES permettent d’évaluer, à l’échelle d’un bâtiment, la contribution des produits aux impacts environnementaux et sanitaires d’un bâtiment. À ce jour, deux logiciels d’intégration existent ; l’un d’eux, le logiciel Elodie, est développé depuis 2007 par le CSTB avec l’appui financier du ministère de l’écologie.
Les instances de gouvernance de la base INIES se composent du conseil de surveillance et du comité technique. Le conseil de surveillance présidé par le ministère de l’écologie veille à l’éthique et à la déontologie de fonctionnement de la base INIES ; il rassemble l’ensemble des signataires du protocole 2008-2012 encadrant la gestion de la base ainsi que des représentants des associations de protection de l’environnement.
La base INIES, qui contient plus de 1 000 fiches FDES couvrant environ 10 400 références commerciales, a vocation à devenir à terme un outil d’aide à la décision des prescripteurs dans leurs choix de produits de construction, qu’ils soient issus du monde professionnel ou du grand public.
• Le recensement des nano-matériaux
Depuis le 1er janvier 2013, en application du décret n° 2012-232 du 17 février 2012 relatif à la déclaration annuelle des substances à l’état nanoparticulaire pris en application de l’article L. 523-4 du code de l’environnement, les producteurs, distributeurs et importateurs de substances à l’état nanoparticulaire sont tenus à une déclaration annuelle, à partir de 100 grammes par an, sur le site r-nano.fr, géré par l’ANSES.
4. L’accompagnement des malades
L’action 23 du PNSE 2 consistait à développer le métier de conseiller (médical) en environnement intérieur (CMEI), qui correspond à une formation sanctionnée par un diplôme universitaire, créé en 2001 à Strasbourg par l’Université Louis Pasteur sous l’initiative du Professeur de Blay, pneumo-allergologue, puis par un diplôme inter-universitaire de santé respiratoire et habitat qui a vu le jour en 2005 (Universités de Brest, Montpellier, Paris, Toulouse et Strasbourg). Pour ce faire, un appel à projets avait été lancé, le ministère chargé de la santé prenant en charge 50 % des frais occasionnés pendant trois ans, à hauteur de 10 000 euros par an. Les CMEI posent un diagnostic éducatif auprès du patient en se rendant à son domicile et en lui posant des questions sur ses habitudes de vie (habitat, environnement intérieur, lieu de travail, école). Ce diagnostic permet d’identifier les polluants responsables des asthmes (parfums d’intérieur, désodorisants, produits ménagers, huiles essentielles) et les situations qui conduisent à des allergies et à des problèmes respiratoires. À Paris, par exemple, la visite est remboursée sur prescription médicale d’un spécialiste, mais la ville n’a pas communiqué autour de ce service ; cela étant, il reste toujours aux particuliers la possibilité de consulter le CMEI à titre privé. Ailleurs, comme à Tours, les associations sont invitées à conseiller les patients admis aux urgences pour une crise d’asthme sévère. Le PNSE 3 (action Y) projette de dresser le bilan des CMEI.
II. UN SUJET COMPLEXE ET UNE GOUVERNANCE TOUFFUE QUI LAISSENT SUBSISTER DES ZONES D’OMBRE
La santé environnementale reste encore largement à explorer ; les études révèlent un impact incontestable de l’environnement mais l’envergure du sujet et les exigences de l’action publique qui ne peut se fonder que sur des réalités avérées, expliquent que les avancées soient lentes et progressives. Cette complexité se ressent forcément sur la gouvernance car la qualité de l’air intérieur mobilise quantité d’acteurs publics et privés.
1. La qualité de l’air intérieur est une résultante
L’air intérieur résulte de très nombreux facteurs. D’abord et avant tout de l’air extérieur, bien sûr, mais d’autres éléments contribuent à l’améliorer ou le dégrader.
L’habitation joue aussi. Les produits de construction et de décoration tels que les revêtements et les peintures émettent des substances dont certaines sont toxiques. Il en va de même pour l’ameublement : les produits en aggloméré de bois, les peintures, les colles et les vernis par exemple sont particulièrement émetteurs.
Les échanges entre air intérieur et air extérieur sont assurés grâce à la ventilation. Or elle devient essentielle dans des bâtiments conçus pour être plus performants sur le plan énergétique, donc mieux isolés. La présidente d’une des associations auditionnées par les rapporteurs fait d’ailleurs remonter la première vague d’allergies à la « chasse au gaspi », slogan vedette de la campagne pour les économies d’énergie qui a suivi le premier choc pétrolier. Des phénomènes de condensation et des moisissures persistantes témoignent d’un mauvais équilibre entre isolation, aération et chauffage.
L’intoxication au monoxyde de carbone, imputable à des appareils de chauffage défectueux, est encore à l’origine d’une centaine de décès en moyenne par an, et constitue donc la première cause de mortalité accidentelle par toxique en France. Entre le 1er septembre 2013 et le 31 mars 2014, 1 028 épisodes d’intoxication domestique au CO survenus par accident et impliquant 3 050 personnes, ont été signalés au système de surveillance de l’Institut de veille sanitaire (InVS). Le chauffage au bois en foyer ouvert est aussi nocif pour la santé des habitants même s’ils n’en ressentent pas les effets immédiatement.
Le comportement des habitants influe également sur la qualité de l’air intérieur. Leur seule présence produit du dioxyde de carbone et favorise l’humidité, elle-même propice aux acariens et aux moisissures, dont certains sont très allergisants. Par ailleurs, l’occupant choisit la température de son logement et nombreux sont ceux qui dorment dans une pièce chauffée fenêtres closes, surtout quand elle donne sur une rue bruyante. De même, les activités ont une incidence sur l’air intérieur : la cuisson des aliments, la toilette et le ménage qui est fait avec des produits émissifs, de même que les animaux familiers. Ainsi, le poil de chat est un allergène puissant, à l’origine de pathologies respiratoires sérieuses chez des sujets qui ont pris l’habitude de dormir avec leur animal de compagnie. Enfin, nul n’ignore plus les méfaits du tabac non seulement pour le fumeur, mais aussi pour son entourage, à l’inverse de ceux causés par les bougies parfumées, les encens et autres huiles essentielles qui, pour être naturels, n’en émettent pas moins des substances irritantes.
En outre, les différentes substances n’auront pas non plus le même effet selon l’état de santé des occupants. Outre les allergiques, les enfants, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées, comme les malades traités par chimiothérapie, sont plus vulnérables que les autres.
LES SOURCES POTENTIELLES DE CONTAMINATION ET LES POLLUANTS ASSOCIÉS
Sources potentielles |
Exemples de pollutions associées |
Occupation du bâtiment |
|
Présence humaine et d’animaux |
Bio-effluents (dont dioxyde de carbone (CO2), éthanol, acétone, isoprène), virus, bactéries, moisissures, allergènes, biocides |
Activités quotidiennes (cuisine, hygiène, etc.) Comportements ponctuels (tabagisme, utilisation de bougies, d’encens, etc.) |
Polluants de la fumée de tabac (particules, benzène, monoxyde de carbone, acroléine, etc.), composés organiques volatils (COV), composés organiques semi-volatils (hydrocarbures aromatiques polycycliques), dioxyde d’azote (NO2), monoxyde de carbone (CO), particules remises en suspension |
Bâtiments |
|
Produits de construction, de décoration, d’entretien et de bricolage (revêtements de sol et de mur, matériaux d’isolation, peinture, vernis, colles, joints, nettoyants, bois agglomérés, moquette, tissus neufs, etc.) |
COV (aldéhydes, alcanes, alcools, cétones, paraffines, oléfines, hydrocarbures aromatiques monocycliques), composés organiques semi-volatils (polychlorobiphényles, retardateurs de flamme bromés, phtalates, biocides, etc.), fibres |
Pathologies du bâtiment liées à la présence de ponts thermiques, dégâts des eaux, etc. |
Moisissures, acariens |
Systèmes et équipements en lien avec des défauts de conception, de mise en œuvre, de maintenance ou d’usage (appareils de chauffage, de production d’eau chaude, systèmes de ventilation ou d’air conditionné, épurateurs d’air, etc.) |
CO, NO2, COV, particules, ozone, biocontaminants (moisissures, bactéries, etc.) |
Ameublement (bois agglomérés, mousses et tissus d’ameublement) Équipements bureautiques (matériels informatiques, photocopieurs, etc.) |
COV (aldéhydes, alcanes, alcools, cétones, paraffines, oléfines, hydrocarbures aromatiques monocycliques), retardateurs de flamme, particules ultrafines, ozone |
Environnement du bâtiment, en particulier le sol et l’air extérieur |
Radon, polluants issus des sols contaminés, NO2, ozone, CO, COV, dioxyde de soufre (SO2), moisissures, particules, métaux |
Pollution secondaire (issue par exemple de l’interaction entre l’ozone et des composés comme les terpènes émis par des sources intérieures de pollution telles que les produits de construction et de décoration, d’ameublement, les textiles, les désodorisants, les produits d’entretien, etc.) |
COV (formaldéhyde, hexaldéhyde, benzaldéhyde), particules ultrafines, radicaux libres |
Source : « Qualité d’air intérieur, qualité de vie. 10 ans de recherche pour mieux respirer », OQAI.
2. Une démarche scientifique et administrative exigeante dans un univers incertain
Les associations de consommateurs et les citoyens déplorent souvent le manque de réactivité des pouvoirs publics face aux enjeux environnementaux. Mais l’analyse détaillée des étapes successives qui doivent être respectées avant de parvenir à une réglementation telle que l’étiquetage explique largement les délais retenus avant son entrée en vigueur et le choix quasi systématique d’informer plutôt que d’interdire ou de réglementer.
Faute de connaître la fraction attribuable aux polluants de l’air intérieur des pathologies qu’ils provoquent, la démarche comporte quatre étapes :
– l’identification du danger, autrement dit le recensement des agents susceptibles d’entrer en contact avec les populations, et de leurs effets indésirables ;
– l’estimation de la relation dose-effet, qui vise à quantifier la relation entre la dose d’exposition et la réponse de l’organisme ou sa probabilité de réponse ; elle sert à établir une valeur toxicologique de référence (VTR) ; encore faut-il, pour ce faire, disposer d’instruments de mesure suffisamment précis. La métrologie est une compétence essentielle pour mener ce type d’étude. En outre, il est très compliqué de déclasser une substance d’intérêt et de la considérer comme un cancérogène avéré. Aussi est-il quasiment indispensable de se caler sur les organismes internationaux tels que le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), qui dépend de l’Organisation mondiale de la santé ;
– l’évaluation des expositions pour identifier les populations en contact avec l’agent dangereux et, si possible, quantifier l’exposition ; les effets des expositions chroniques sont particulièrement difficiles à mettre en évidence. Mettre en regard un pic de pollution et ses effets sanitaires prête moins à discussion que de le faire pour une pollution de fond. Une fois le protocole au point, la collecte effectuée et les données exploitées, les résultats doivent être comparés aux études portant sur les populations ;
– la caractérisation du risque qui opère une synthèse de la démarche en estimant la probabilité et la gravité des effets indésirables susceptibles de se produire.
À l’évaluation du risque succède la phase de gestion du risque pendant laquelle sont arrêtées des mesures de protection et de prévention en fonction du coût externe qui est une pièce maîtresse du dispositif puisqu’il sert de critère de décision à l’action publique.
CONTRIBUTION DE LA CONNAISSANCE DE L’EXPOSITION À L’ÉVALUATION
ET À LA GESTION DU RISQUE
Méthode d’évaluation des risques sanitaires de l’US-EPA (NAS/NRC 1983)
et de l’Union européenne (Directive 93/67 EEC)
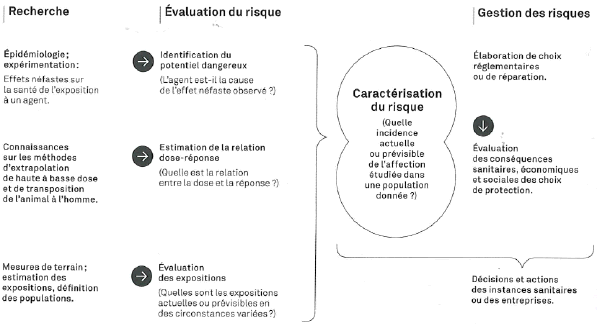
Source : « Qualité d’air intérieur, qualité de vie. 10 ans de recherche pour mieux respirer », OQAI.
b. L’exemple des matériaux de construction et de décoration
Les instances qui ont participé aux travaux d’étiquetage ont souligné devant les rapporteurs qu’il leur fallait, dans un premier temps, définir un protocole de mesurage qui s’applique à tous les matériaux concernés et qui ne puisse pas être contesté par les producteurs/distributeurs.
Il faut ensuite établir une grille de classement adaptée, c’est-à-dire qui soit à la fois synthétique, juste (les pondérations des différents polluants comportent inévitablement une part d’arbitraire), claire et acceptée par les industriels. En effet, les intervalles qui correspondent aux catégories A+, A, B et C doivent être suffisamment discriminants pour éviter que l’immense majorité des produits ne se voient attribuer la même note, ce qui reviendrait à priver l’étiquetage de tout intérêt. Les industriels ont aussi leur mot à dire dans la mesure où il est préférable qu’ils accompagnent la démarche. Dans ce cas précis, l’INERIS a constaté que l’accord avait été relativement facile à obtenir car les substituts au formaldéhyde étaient disponibles et connus. Les coûts doivent être supportables pour toutes les catégories d’entreprises, pour ne pas trop pénaliser les plus petites. Enfin, le processus de certification auprès d’organismes agréés ne doit pas constituer un goulet d’étranglement qui compromettrait la commercialisation des produits étiquetés, et partant la santé financière des entreprises.
Expliquant le choix de l’étiquetage des produits de construction et de décoration plutôt que l’autorisation/interdiction de certaines substances, le ministère de l’écologie le justifie par la facilité d’appliquer une telle réglementation. Une information obligatoire claire est opérationnelle plus rapidement qu’une validation officielle des produits, du type autorisation de mise sur le marché, qui demande des études scientifiques et juridiques conséquentes pour une application très lointaine. Au contraire, grâce à l’étiquetage, les produits les plus performants seront très vite mis en valeur avec des effets bénéfiques attendus en matière d’innovation et une amélioration à terme de la qualité des produits disponibles sur le marché.
Enfin, l’étiquetage doit être connu des acheteurs. L’information du grand public et des acteurs relais constitue un axe majeur du PQAI. Sous ce titre, il est prévu de lancer une campagne d’information à destination du grand public, portant notamment sur l’étiquetage. Parallèlement, l’appropriation par les acteurs de l’étiquetage des produits de construction et de décoration doit être mesurée (action F). Or les résultats provisoires des sondages effectués tendent à montrer que les consommateurs tiennent compte de cette information pour leurs achats, à condition de savoir qu’elle existe, mais qu’elle reste largement ignorée du grand public.
c. Le projet d’étiquetage des produits d’ameublement et des produits d’entretien
Un accord volontaire doit être recherché avec les professionnels dans le cadre du PQAI, concernant les produits d’ameublement, en donnant la priorité aux meubles pour enfants. Le recensement préalable est long dans la mesure où les matériaux qui entrent dans la composition des meubles sont plus nombreux que ceux utilisés pour les produits de construction et de décoration. Le remplacement des produits émissifs n’est pas évident non plus, ce qui constitue un obstacle supplémentaire. L’ANSES, travaillant sur des critères purement scientifiques, vient de publier un avis (186) sur l’opportunité de l’étiquetage des produits d’ameublement, qu’elle juge souhaitable en distinguant trente et une substances d’intérêt.
De même, qu’il s’agisse des produits d’ameublement ou d’entretien, il est extrêmement difficile de caractériser correctement le niveau d’exposition. Les meubles n’émettent pas de façon continue dans le temps : un produit neuf et tout juste déballé émettra beaucoup plus qu’un meuble plus ancien, et la concentration ne sera pas la même selon la taille et la ventilation de la pièce dans laquelle il est installé.
L’INERIS signale aussi que les émissions ne sont pas les mêmes pendant l’utilisation des produits ménagers et après, et qu’elles varient en fonction des supports sur lesquels ils sont utilisés (carrelage, mur, revêtement de sol,…). Dans ces conditions, l’étiquetage ne peut être transposé tel quel pour les produits d’entretien et l’INERIS considère préférable de communiquer sur les conditions d’utilisation. Il signale incidemment que les éco-produits ne convainquent pas vraiment sur le plan sanitaire : s’ils sont sans doute produits de façon plus respectueuse de l’environnement, ils n’émettent pas moins de substances volatiles que les autres.
d. Les incertitudes scientifiques
La plus connue réside dans l’effet « cocktail », qui recouvre la notion d’aérosols secondaires, et l’effet potentialisateur de certaines substances sur d’autres. Le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur le coût de la pollution insiste sur l’inconnue que constituent les combinaisons des différents types de pollution entre elles (extérieure et intérieure, chimique et biologique, etc..), que l’on ne peut mesurer. On sait ainsi que l’ozone, issu des gaz de combustion des véhicules sous l’effet de la chaleur, rend toxiques des produits d’entretien en principe inoffensifs. Les effets sanitaires de certains polluants de l’air sont encore mal connus ou n’ont été découverts que récemment, à l’instar du lien mis en avant entre l’exposition aux particules fines et les maladies neurodégénératives, ou du rôle de perturbateur endocrinien joué par certains polluants.
Par ailleurs, les effets sanitaires des nanomatériaux restent largement inconnus. À l’échelle nanoparticulaire, les matériaux présentent de multiples différences en termes de composition, de caractéristiques dimensionnelles et de propriétés physico-chimiques. Or, de l’industrie pharmaceutique aux télécommunications, de l’aéronautique à la chimie, les champs d’application des nanotechnologies apparaissent chaque jour plus nombreux. L’appareil respiratoire constitue la voie principale de pénétration des nano-objets dans l’organisme humain. Compte tenu de leur taille, les nano-objets inhalés ou ingérés seraient capables de franchir les barrières biologiques (nasale, bronchique, alvéolaire…) et de migrer vers différents sites de l’organisme via le sang et la lymphe (processus de translocation).
3. Des messages contradictoires
Les autorités sanitaires ne sont pas les seules à chercher à capter l’attention des populations, s’agissant de qualité de l’air intérieur, et elles doivent compter avec d’autres intervenants. L’argument « nature » fait mouche auprès des consommateurs et il faut alors aller à contre-courant du message publicitaire, ou du moins l’atténuer. C’est ainsi que l’INERIS et le CSTB en sont venus à s’intéresser aux parfums d’ambiance, aux bougies parfumées et aux encens qui se sont révélés nocifs pour les publics fragiles. L’ANSES s’est également saisie du problème de l’efficacité des épurateurs d’air dont certains modèles sont utilisés dans les pressings pour réduire la concentration du perchloroéthylène. Tel était bien le cas, mais les dispositifs produisaient du phosgène, une substance tout aussi toxique. Les appareils vendus aux particuliers pour mesurer la qualité de l’air à l’intérieur des logements ne semblent guère utilisables dans la mesure où aucune procédure d’homologation n’existe. De même, les études menées sur les plantes dépolluantes par l’ADEME n’étaient guère concluantes : les plantes n’absorbent pas suffisamment les polluants pour réduire la concentration dans les habitations. Les fabricants de dispositifs d’épuration de l’air ou de mesure de la qualité de l’air s’efforcent de répondre aux inquiétudes et aux aspirations de consommateurs et, dans ce contexte, le message des pouvoirs publics et des autorités sanitaires peine parfois à se faire entendre.
B. UNE GOUVERNANCE TOUFFUE QUI, EN DÉPIT DES PRÉCAUTIONS PRISES, NE CONTRIBUE PAS À CLARIFIER LES RÔLES ET LE MESSAGE DES POUVOIRS PUBLICS
Compte tenu de l’importance des forces à mobiliser, nombreux sont les acteurs à intervenir dans l’élaboration de la réglementation, sans oublier que l’approche par milieu, qui élargit le périmètre des facteurs à considérer, complique encore la donne. Malgré des mesures destinées à pallier une gouvernance technocratique, la répartition des rôles et le message à transmettre ne sont pas toujours très clairs.
L’ensemble des intervenants, à l’exception des équipes de l’INSERM, est recensé dans le tableau ci-après. Seuls l’OQAI et le CSTB sont concernés exclusivement par la qualité de l’air intérieur. Aussi feront-ils l’objet d’un coup de projecteur particulier.
LISTE DES INSTANCES COMPÉTENTES EN MATIÈRE D’AIR INTÉRIEUR
(Les noms en gras sont des opérateurs de l’État)
Nom |
Statut |
Gouvernance |
Missions |
Travaux récents |
AASQA (associations agréées de surveillance de la qualité de l’air) Atmo France |
Association loi 1901 |
Quadripartite entre AASQA, représentants des collectivités, des industriels et des associations de défense de l’environnement |
Surveillance de la qualité de l’air (art. L. 221-3 du code de l’environnement) |
- participation aux campagnes de l’OQAI - appui aux collectivités (conseil, formation) |
ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) |
EPIC (art. L. 131-3 à 7 du code de l’environnement) |
Conseil d’administration (10 représentants des ministères de tutelle, 2 parlementaires, 3 représentants des collectivités, 5 personnalités qualifiées et 6 représentants du personnel) Conseil scientifique, dont les membres sont nommés par les ministres de la recherche, de l’écologie et de l’énergie. |
- Prévention et la lutte contre la pollution de l’air (développer des connaissances et des outils nécessaires à la mise en œuvre d’actions efficaces de prévention et d’amélioration de la qualité de l’air ; contribuer à mettre en œuvre des actions innovantes d’amélioration et de prévention de la qualité de l’air sur les territoires et diffuser les bonnes pratiques ; mieux prendre en compte la qualité de l’air dans toutes les actions de l’Agence) ; - limitation de la production de déchets - économies d’énergie - développement des technologies propres - lutte contre les nuisances sonores |
- études sur les plantes dépolluantes et les chaudières à bois - financement de projets (programme PRIMEQUAL) - formations |
ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) |
EPA (art. L. 1313-1 et suivants du code de santé publique) |
Conseil d’administration, aux droits de vote également répartis entre ministères de tutelle, et les autres membres (partenaires sociaux, organisations professionnelles, ONG et mouvement associatif, élus et personnel) 5 comités d’orientation thématiques (dont santé-environnement) ouverts à des personnalités extérieures très impliquées et/ou emblématiques Conseil scientifique, garant de la qualité et de l’indépendance de son expertise. |
- 1 Évaluer les risques et éclairer l’action publique - 2 Conduire une expertise scientifique collective et indépendante - 3 Faire progresser la connaissance au service de la santé humaine |
1 - VGAI et appui à l’étiquetage des produits d’ameublement 2 – Évaluation coût de la pollution intérieure 3 – Animation R31 et RN3P |
CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment) |
EPIC |
Conseil d’administration et comité consultatif où sont représentés l’ANAH, l’ADEME Commission de déontologie |
- recherche et expertise - accompagner l’innovation - certification - diffusion des connaissances |
évaluation sanitaire des matériaux de construction et de décoration ; des aérosols (métrologie) |
INERIS (Institut national de l’environnement industriel et des risques) |
EPIC |
Conseil d’administration comprenant 7 représentants de l’État, 5 représentants des activités économiques concernées, 3 personnalités qualifiées, 8 représentants des personnels Conseil scientifique et Commission d’orientation de la recherche et de l’expertise |
- réaliser ou faire réaliser des études et des recherches permettant de prévenir les risques que les activités économiques font peser sur la santé, la sécurité des personnes et des biens, ainsi que sur l’environnement, et de fournir toute prestation destinée à faciliter l’adaptation des entreprises à cet objectif. (art. R. 131-36 du code de l’environnement) |
- évaluation des bougies et encens - évaluation des chaudières à bois - rapport Activités domestiques et qualité de l’air intérieur : émissions, réactivité et produits secondaires - rapport sur l’opportunité d’étiquetage des produits d’entretien - travaux sur les nanoparticules |
INPES (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé) |
EPA |
Conseil d’administration avec 9 représentants de l’État, 6 des organismes de protection sociale, 3 personnalités qualifiées, 6 représentants des usagers et 2 du personnel Conseil scientifique |
- lutte contre le cancer, - lutte pour limiter l’impact sur la santé de la violence, des comportements à risque et des conduites addictives, - lutte pour limiter l’impact sur la santé des facteurs d’environnement, - amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques, - prise en charge des maladies rares (loi de santé publique du 9 août 2004) |
Brochure guide de la pollution de l’air intérieur |
INRS (Institut national de recherche et de sécurité) |
Association loi 1901 à but non lucratif |
Conseil d’administration paritaire entre syndicats d’employeurs et de salariés |
Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles |
Brochures d’information et sessions de formation |
IRSN (Institut national de radioprotection et de sûreté nucléaire) |
EPIC |
Conseil d’administration de 10 représentants de l’État, 6 personnalités qualifiées et 8 représentants du personnel Conseil scientifique consultatif Commission de déontologie |
Expertise et recherche sur la sûreté nucléaire et protection contre les radiations ionisantes |
Cartographie des zones de radioactivité et Atlas du radon Brochures d’information |
InVS (Institut de veille sanitaire [en cours de fusion avec l’INPES]) |
||||
OQAI (Observatoire de la qualité de l’air intérieur) |
Convention de 4 ans renouvelable entre ministères écologie, santé, ADEME, CSTB, ANSES renouvelable depuis 2001) |
Conseil de surveillance et d’orientation (représentants ministères logement, santé, écologie, CNA (187), ADEME, ANSES, ANAH), conseil scientifique et comité consultatif désigné par les ministères logement, santé, écologie |
- identification des risques à l’intérieur des bâtiments - évaluation des expositions - recommandations aux professionnels et aide méthodologique aux pouvoirs publics |
- Campagnes de mesure dans les lieux de vie (logements, écoles, bureaux, bâtiments HQE) - Formations |
a. L’Observatoire de la qualité de l’air intérieur
L’OQAI est historiquement l’acteur le plus ancien dans le domaine de l’air intérieur puisqu’il est né d’une convention conclue initialement en 2001 entre les ministres de l’écologie, du logement et de la santé, le Centre scientifique et technique du bâtiment, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, et renouvelée depuis. La dernière en date couvre la période 2011-2015.
DOTATIONS DE L’OQAI EN € TTC (2007 – 2015)
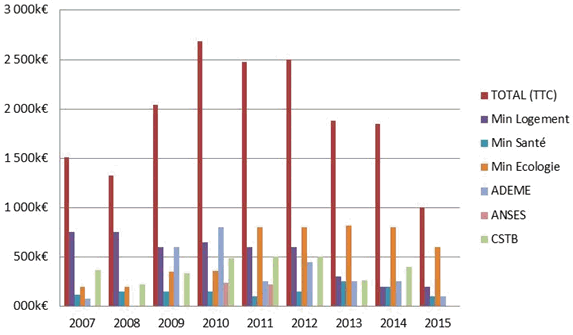
Source : OQAI.
Le budget de l’OQAI provient d’une dotation du ministère de l’écologie et il varie en fonction des programmes de recherche auxquels il est associé. Chaque année, le conseil de surveillance fixe le budget sur la base duquel des conventions bipartites sont passées entre les différents financeurs et le CSTB, opérateur de l’OQAI. Le niveau des financements fluctue selon les années en fonction du programme de travail entre 1,5 et 2,7 millions d’euros. Le total des dotations de l’OQAI a baissé en 2015 avec des budgets alloués fixés à 1 million d’euros. Dans la pratique, l’OQAI est très dépendant, d’une part, des programmes de recherche financés par les autres instances de recherche, et d’autre part, du CSTB qui est son opérateur et qui dispose des équipements nécessaires pour élaborer les protocoles de mesure et les tests.
En outre, l’extension progressive des compétences de l’ANSES à la santé du vivant dans son ensemble déséquilibre à son profit les relations avec l’OQAI, cantonné dans la surveillance des milieux, et qui fait appel à des techniques et des équipements qu’il n’a pas.
b. Le Centre scientifique et technique du bâtiment
Pièce essentielle du dispositif de connaissance de l’environnement intérieur, le Centre scientifique et technique du bâtiment est un EPIC dont les missions principales s’articulent autour de la recherche des déterminants de la sécurité et du confort des bâtiments, de l’évaluation de l’innovation dans le bâtiment, de la certification et de la diffusion des connaissances auprès des professionnels. Il a porté l’OQAI sur les fonts baptismaux et continue d’assurer son activité puisqu’il y consacre une équipe. Une autre s’occupe exclusivement de l’évaluation sanitaire des matériaux de construction et de décoration, y compris l’ameublement. Une troisième équipe est spécialisée dans les aérosols et les bio-contaminants.
Le CSTB a des liens assez étroits avec l’ANSES notamment, puisque la directrice scientifique de l’OQAI est vice-présidente de la commission spécialisée sur l’air ; et d’autres experts participent aussi à des commissions spécialisées ou des groupes de travail. En soumissionnant ensemble à des appels d’offres de l’ANSES ou de PRIMEQUAL, programme de recherche inter-organismes pour une meilleure qualité de l’air à l’échelle locale, ou encore à l’appel à projets « Connaissances, réduction à la source et traitement des émissions de polluants dans l’air », CORTEA, de l’ADEME, le CSTB et l’INERIS ont remporté des contrats pour étudier le chauffage au bois ou les produits d’entretien. Le CSTB dirige également le conseil scientifique du programme PRIMEQUAL. Il est équipé pour étudier la pollution à l’intérieur des bâtiments. Le grand équipement de recherche ARIA réunit des laboratoires et moyens expérimentaux pour étudier la qualité sanitaire des produits, équipements et ouvrages de bâtiment.
Jouent aussi un rôle actif s’agissant d’air intérieur l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’Institut national de l’environnement industriel et des risques et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail
Les missions de l’ANSES, fixées par l’ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 qui fusionne l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) et l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET), portent essentiellement sur l’évaluation des risques dans le domaine de l’alimentation, de l’environnement et du travail, en vue d’éclairer les pouvoirs publics dans leur politique sanitaire. La répartition des rôles repose sur le principe fondamental de séparation de l’évaluation des risques qui incombe à l’Agence et de sa gestion, qui est du ressort des pouvoirs publics. Par ses travaux, l’ANSES offre une lecture transversale et pluridisciplinaire des questions sanitaires puisqu’elle étudie l’ensemble des expositions (particules, ondes, inhalation, ingestion...) auxquelles est soumis l’ensemble de la population française, ce qui en fait le pivot de la politique en santé-environnement.
Sa gouvernance est organisée de façon à assurer à la fois l’indépendance et le pluralisme de la recherche ainsi que la représentation, en particulier au sein de son conseil d’administration, de l’ensemble des parties prenantes à la santé environnementale. L’ANSES est dirigée par un conseil d’administration assisté d’un conseil scientifique. Le conseil d’administration est épaulé par cinq comités d’orientation thématiques ouverts à des personnalités extérieures très impliquées ou emblématiques de tendances de la société civile : santé-environnement, santé-travail, alimentation, santé et bien-être animal, santé végétale. L’Agence comprend également un conseil scientifique indépendant, composé exclusivement de scientifiques, et garant de la qualité et de l’indépendance des expertises menées. L’équilibre entre les grands domaines de compétence de l’Agence y est assuré. Peuvent saisir l’ANSES l’État, les parties représentées à son conseil d’administration, les organisations syndicales et l’Agence peut décider de se saisir d’un thème particulier.
L’Institut national de l’environnement industriel et des risques
L’INERIS est un EPIC, placé sous la tutelle du ministère de l’écologie et créé en 1990, qui a repris le centre de recherche de Charbonnages de France pour en préserver les compétences et l’expertise dans le domaine de la maîtrise des risques et les mettre au service des pouvoirs publics et de l’industrie. Les trois domaines de compétences traditionnelles continuent de structurer les activités de l’INERIS : la géotechnique des mines, les risques accidentels liés aux explosions, d’abord aux coups de grisou et de poussière, et aujourd’hui, aux risques liés à la présence de nanomatériaux, qui sont des poussières très fines, et aux autres risques chimiques, du type SEVESO ; enfin les risques chroniques dans lesquels entrent les risques que font peser les activités économiques sur la santé des personnes et l’environnement. Historiquement, l’INERIS s’intéressait surtout aux risques industriels, d’abord ceux associés aux charbonnages puis à ceux liés à la présence de toutes sortes de polluant.
L’INERIS a développé une expertise dans les méthodes de mesure, notamment de la qualité de l’air, priorité ayant été donnée dans un premier temps à l’air extérieur. Pour l’INERIS, l’air intérieur est un sujet connexe à ses activités de métrologie et de recherche sur les expositions des populations. Il travaille bien sûr avec le CSTB, chacun ayant ses domaines de prédilection, souvent hérités du passé. Le CSTB a particulièrement étudié le volet biologique, en particulier l’impact des moisissures ; l’INERIS étant spécialisé dans la partie chimique. La subvention pour charges de service public ne finance pas de recherche sur l’air intérieur, qui est prise en charge dans le cadre de programmes de recherche, faisant suite à appel à projets, tels que PRIMEQUAL, de l’ordre de 200 000 euros par an. L’INERIS travaille aussi étroitement avec la direction générale de la prévention des risques du ministère de l’écologie, pour tout ce qui concerne la réglementation et qui est financé par la subvention pour charges de service public (réglementation applicable aux écoles par exemple, ou pollutions constatées dans le voisinage d’installations polluantes).
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) est également concernée par la qualité de l’air intérieur. En tant qu’opérateur de l’État pour la transition énergétique, elle a un rôle à jouer dans la qualité de l’air intérieur qui a partie liée avec la performance énergétique des bâtiments. Cet EPIC met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public ses capacités d’expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre, et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit. Au titre de ce dernier volet, elle lance des appels à projet qu’elle finance dans le cadre des programmes PRIMEQUAL (programme de recherche inter-organismes pour une meilleure qualité de l’air à l’échelle locale), AACT-Air destiné à soutenir les actions des collectivités locales en faveur de l’air, ou PNR-E EST qui le programme national de recherche consacré à l’environnement, à la santé et au travail.
2. Des mesures ont été prises pour limiter les dysfonctionnements
a. L’ouverture à la société civile
Alors que, d’emblée, la gouvernance de l’OQAI, des AASQA et de l’ANSES a été conçue pour prendre en compte les préoccupations de la société civile, grâce à la présence des associations dans les instances de direction, les organes de direction d’instances plus anciennes ont été ouverts aux associations. Ainsi, à l’INERIS, il a été institué une commission d’orientation de la recherche et de l’expertise (CORE) qui concrétise la démarche d’ouverture de l’institut. Officialisée par l’arrêté du 26 avril 2011, elle marque le passage d’une gouvernance scientifique à une gouvernance scientifique, technique et sociétale.
Pour assurer une bonne coordination, des réseaux ont été institués dont la plupart sont pilotés par l’ANSES, acteur-clé de la santé environnement.
Dans le cadre de l’évaluation des risques sanitaires liés aux pollutions des milieux de vie (air, eau, sol), l’ANSES anime et coordonne un réseau de trente et un organismes scientifiques (agences sanitaires, instituts et laboratoires de recherche dont l’ADEME, le CSTB, l’INERIS, l’INRS et l’IRSN, mais pas l’OQAI).
L’ANSES étudie par ailleurs les mécanismes d’exposition en milieu de travail et les risques sanitaires propres à différentes professions, à l’aide de méthodes d’évaluation et d’outils innovants, comme le réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles (RNV3P), qui permettent également la définition de stratégies de vigilance. Ce réseau repose sur les centres de consultation des pathologies professionnelles (CCPP) – il y en a une trentaine en France – qui reçoivent les cas critiques qui leur sont adressés par la médecine du travail. Un salarié qui s’estime exposé à une qualité critique de l’air intérieur sollicite son médecin du travail, qui peut l’envoyer au CCPP dont il dépend et c’est l’Agence qui recense ces cas pour déceler d’éventuelles pathologies émergentes, lesquelles sont signalées au ministère du travail et servent à l’évaluation des risques.
Que les travaux de l’ANSES résultent d’une saisine des administrations ou d’une initiative propre, ils sont publiés de façon à contribuer à l’information du grand public. Outre les VGAI qui ont servi de base aux travaux ultérieurs du Haut Conseil en santé publique (HCSP), les études les plus récentes portent sur la pollution dans les enceintes ferroviaires et l’étiquetage des produits d’ameublement.
Les rapporteurs préconisent de parachever l’évolution consistant à faire de l’ANSES le pivot de l’action en santé-environnement, en la chargeant d’organiser la collecte et la centralisation des données sur les environnements intérieurs.
De son côté, l’INERIS anime le réseau RSEIN (Réseau recherche santé environnement intérieur), réseau qui effectue la veille documentaire sur l’air intérieur.
Proposition n° 20 : faire de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) le pivot de l’action en santé-environnement, en la chargeant d’organiser la collecte et la centralisation des données sur les environnements intérieurs.
Alors que les contrats d’objectifs et de moyens prévoient une diversification des ressources des instances de surveillance et de recherche, des comités de déontologie ont été créés pour prévenir les conflits d’intérêts. C’est le cas notamment à l’ANSES et au CSTB.
Née en 2010 de la fusion de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) et de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET), l’ANSES s’est dotée dès 2011 d’un comité de déontologie et de prévention des conflits d’intérêts composé de huit membres. Il peut intervenir dans toutes les situations et à chacune des étapes de l’expertise collective, depuis la saisine jusqu’à l’avis de l’Agence. Le comité de déontologie et de prévention des conflits d’intérêts peut être saisi par un membre du conseil d’administration, du conseil scientifique, des comités d’experts spécialisés, ou encore par le directeur général ou un des agents de l’ANSES.
Quant au CSTB, la création du comité de déontologie externe a été validée par le conseil d’administration en décembre 2014, et il est désormais opérationnel. Composé de six personnalités extérieures, il a pour objet de guider et soutenir le CSTB dans le respect de son dispositif visant à garantir déontologie et prévention des conflits d’intérêts. Il établit un rapport annuel de ses missions à l’attention du conseil d’administration du CSTB. Le comité externe de déontologie peut être saisi par toute personne physique ou morale directement intéressée.
3. Mais la répartition des rôles et le message à transmettre ne sont pas toujours clairs
a. La communication et la formation
Beaucoup d’acteurs compétents en santé-environnement ont conçu et lancé des modules de formation ou de communication.
Le site de l’OQAI renvoie aux formations dispensées par le CSTB qui a pour mission de participer à la diffusion de la connaissance, en priorité auprès des professionnels. En outre, en partenariat avec lui, il organise des ateliers. Les deux derniers ont été consacrés aux COV et à la qualité de l’air dans les bureaux.
Le contrat d’objectifs et de performance de l’ANSES comporte, dans le volet « Information et ouverture à la société », l’objectif n° 27 intitulé « Sensibiliser aux enjeux sanitaires et de l’expertise » pour répondre aux besoins en formation des fonctionnaires des administrations nationales et territoriales.
L’ADEME, de son côté, s’était engagée dans le dernier contrat d’objectifs conclu avec l’État, à organiser des actions d’information et des campagnes de communication de grande ampleur pour faire évoluer les mentalités, les comportements et les actes d’achat et d’investissement des agents économiques.
Les AASQA, sollicitées par les collectivités locales, se sont elles aussi lancées dans la formation. D’ailleurs, le PQAI prévoit de faire appel à elles pour former et sensibiliser les personnels des collectivités dans la mise en place de la surveillance de la qualité de l’air dans les établissements recevant du public.
Si le besoin de formation n’est pas contestable, un tel foisonnement de l’offre soulève notamment deux questions. D’une part, la multiplication des initiatives contribue-t-elle réellement à mieux faire connaître l’offre et à une meilleure diffusion de l’information dans la mesure où, pour y accéder, il faut au préalable savoir à qui s’adresser ? D’autre part, et sans qu’il y ait nécessairement contradiction, les structures ne finissent-elles pas par se faire concurrence entre elles au détriment d’une utilisation optimale des deniers publics ? Par exemple, chacune de ces organisations développe un site internet sur lequel elle expose ses compétences et le catalogue des formations qu’elle propose.
Les rapporteurs jugent nécessaire de coordonner les différentes initiatives prises pour informer le grand public, en lançant une campagne nationale de sensibilisation aux risques de pollution de l’air intérieur.
Proposition n° 21 : lancer une campagne nationale de sensibilisation aux risques de pollution de l’air intérieur à destination des particuliers et des professionnels.
b. La qualité de l’air dans les enceintes ferroviaires souterraines
L’ANSES a publié le 7 septembre dernier un rapport sur la pollution chimique de l’air dans les enceintes de transports ferroviaires souterrains et les risques sanitaires associés chez les travailleurs. Parallèlement, l’ADEME indique dans un document consacré à ses orientations stratégiques en matière de qualité de l’air pour la période 2015-2020 que, s’agissant d’air intérieur dont les déterminants sont moins bien connus et les milieux particulièrement hétérogènes, « le défi est donc double : besoin d’agir, de la conception du bâtiment à son usage, afin d’améliorer ou de préserver la qualité de l’air intérieur ; et besoin de hiérarchiser les situations, les problématiques, pour agir de la façon la plus efficace possible. À cette fin, mais également dans l’objectif de développer la prise de conscience et l’action citoyenne, l’analyse des différentes situations de vie pourra être développée. Ceci pourrait d’ailleurs faire apparaître des thèmes peu considérés jusqu’ici, comme la pollution intérieure dans les moyens de transport (automobile, gares souterraines...) (188). »
Ces deux exemples illustrent les difficultés rencontrées à coordonner l’action des instances compétentes pour la qualité de l’air intérieur, alors même que les enjeux paraissent encore mal connus du grand public. Ainsi, il serait bon que l’ADEME, qui a vocation à traduire dans la réalité la transition énergétique, alerte aussi ses interlocuteurs sur l’impact de l’isolation thermique sur la qualité de l’air intérieur.
Les établissements professionnels sont soumis à une réglementation propre, engageant la responsabilité de l’employeur et imposant des mesures plus rigoureuses, en particulier des règles de ventilation (articles R. 4222-10 à R. 4222-17 du code du travail), puisque les travailleurs sont soumis à des expositions chroniques. Les installations de captage et de ventilation doivent permettre de réduire les concentrations de ces polluants dans l’atmosphère au niveau le plus bas possible, ces concentrations devant rester inférieures aux valeurs limites d’exposition réglementaires contraignantes. Les contrôles atmosphériques relèvent du code du travail (articles R. 4412-27 à R. 4412-31 pour les agents chimiques dangereux, R. 4412-76 à R. 4412-80 pour les agents chimiques classés CMR). Ces dispositions sont complétées par un arrêté du 15 décembre 2009.
Néanmoins, on constate une absence de documentation à propos de certains milieux. L’ANSES a bien été saisie par la direction générale du travail, la direction générale de la santé et la direction générale de la prévention des risques de la pollution dans les enceintes ferroviaires souterraines ; par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Ville de Paris sur le problème de la pollution atmosphérique dans le réseau des égouts. Mais elle n’est pas chargée de collecter des données directement. À moins d’être alertée par les membres de ses comités d’orientation thématiques, elle intervient en aval, en particulier grâce au RNV3P. De plus, une fois les recherches menées, il faut ensuite faire redescendre l’information auprès du public concerné, qui n’est pas toujours au fait des précautions à prendre, comme cela semble être le cas dans les entreprises artisanales comme les salons de coiffure, les manucures ou les prothésistes dentaires, par exemple.
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle, issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents dans la croûte terrestre. Il provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction. Reconnu comme cancérigène pulmonaire pour l’homme au même titre que le tabac, il est la deuxième cause de décès par cancer du poumon en France, environ 2 000 par an, très loin toutefois derrière ce dernier. Un plan de lutte est d’ailleurs mis en œuvre. L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire a dressé une cartographie du potentiel radon, distinguant trente et un départements. Dans ces zones, la législation du travail (article R. 4457-6 du code du travail) soumet à des obligations de surveillance renforcée les employeurs dont les travailleurs passent plus d’une heure par jour en sous-sol (189). En outre, les autorités locales doivent, dans les établissements recevant du public, faire procéder à un dépistage par des professionnels agréés et, si, dans une pièce occupée plus d’une heure par jour, la concentration en gaz excède 400 Bq/m3 en valeur moyenne annuelle, des travaux doivent être entrepris pour réduire l’exposition au radon. La direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature signale ainsi que, après plusieurs années de discussion, la Commission internationale de protection radiologique (190) (CIPR, avril 2015) vient de réévaluer le coefficient de dose pour le radon et que le risque est bien plus important qu’estimé jusqu’à présent. En conséquence, il devient urgent d’améliorer sa gestion, en particulier dans l’habitat car il représente un véritable enjeu de santé publique.
Il importe donc de réévaluer la réglementation en fonction de la progression des connaissances. Le bilan du plan national d’actions 2011-2015 pour la gestion du risque lié au radon est en cours mais il peut déjà être considéré comme mitigé : seule la moitié des actions a pu être menée à son terme, en partie faute de moyens. La transposition de la directive 2013/59/Euratom relative aux normes de base en matière de radioprotection rend nécessaire une amélioration de la réglementation actuelle en particulier, avec la mise en place d’un niveau de référence ne pouvant pas excéder 300 Bq/m3 (au lieu de 400 Bq/m3) pour tout type de bâtiment et un renforcement de l’information de la population sur ce risque. Pour cela, il est nécessaire d’intégrer le radon aux politiques d’amélioration de la qualité de l’air intérieur.
III. UNE POLITIQUE À CONCILIER AVEC D’AUTRES EXIGENCES
A. LES ALÉAS DE LA CAMPAGNE DE MESURE DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
La loi dite Grenelle 2 créait une obligation de surveillance de la qualité de l’air pour les établissements recevant du public et en renvoyait les modalités à un décret. Le décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011 instaurait une montée en charge progressive : avant le 1er janvier 2015 pour les établissements d’accueil collectif des enfants de moins de six ans ; avant le 1er janvier 2018 pour les écoles élémentaires ; avant le 1er janvier 2020 pour les accueils de loisir et les établissements scolaires du second degré, et avant le 1er janvier 2023 pour les autres établissements.
En outre, la périodicité des contrôles portant sur le benzène, le dioxyde de carbone et le formaldéhyde, était fixée à sept ans et ces contrôles devaient être confiés à des organismes accrédités.
Le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 détaillait la marche à suivre. La totalité des pièces devait être vérifiée dans les établissements de moins de dix salles : « L’évaluation des moyens d’aération comporte pour chaque pièce examinée : 1° Un constat de la présence ou non d’ouvrants donnant sur l’extérieur ; 2° Une vérification de la facilité d’accès aux ouvrants donnant sur l’extérieur et de leur manœuvrabilité ; 3° Un examen visuel des bouches ou grilles d’aération existantes. » En début d’année, il a été modifié et complété par le décret n° 2015-1926 du 30 décembre dernier. Celui-ci abaisse à six pièces au lieu de dix, le seuil en-deçà duquel les contrôles doivent être faits dans toutes les pièces en précisant qu’il ne s’agit que des locaux destinés à l’enseignement (hors salles de travaux pratiques) et aux activités collectives. En tout état de cause, le nombre maximum de salles contrôlées reste fixé à vingt, l’échantillon choisi devant être représentatif de l’établissement. Au cas où il serait situé à proximité immédiate d’une installation de nettoyage à sec, le tétrachloroéthylène sera ajouté à la liste des substances mesurées. En outre, les modalités de contrôle sont détaillées.
Les premières réactions d’hostilité vinrent des mairies, responsables des locaux des crèches et des écoles maternelles, qui redoutaient le coût de la dépense (estimé à tort ou à raison à environ 1 500 euros par salle), surtout que les délais étaient d’autant plus difficiles à tenir que seuls des organismes agréés étaient habilités à procéder à ces contrôles. En outre, la trivialité de certains d’entre eux due à un souci de précision a donné prise à un scepticisme amusé. C’est ainsi que ce décret s’est vu attribuer le deuxième prix des normes absurdes par la mission de lutte contre l’inflation normative. Les rapporteurs Alain Lambert et Jean-Claude Boulard ont suggéré de le remplacer par un autre qui enjoindrait les personnes morales responsables de veiller à ce que les agents d’entretien aèrent les locaux régulièrement. La ministre de l’écologie a indiqué, dans un communiqué du 24 septembre 2014, que là où des mesures auraient été prises pour améliorer la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments, notamment grâce à des guides de bonne pratique, l’application du décret serait suspendue. Dans l’attente de la parution d’un autre texte, le ministère a publié un guide pratique, assorti de quatre grilles d’autodiagnostic dédiées aux catégories d’intervenants : l’équipe de gestion de l’établissement (direction, mairie…), les responsables des activités de la pièce occupée (enseignant, puéricultrice…), le personnel d’entretien et les services techniques en charge de la maintenance du site. En clair, l’évaluation pourra être réalisée par les services techniques municipaux en mettant à disposition des personnels des crèches et écoles maternelles, et plus largement des collectivités, des kits de prélèvements.
Le décret n° 2015-1000, paru le 17 août 2015, a repoussé au 1er janvier 2018 l’échéance au terme de laquelle les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans et les écoles maternelles devraient avoir mis en œuvre pour la première fois le dispositif de surveillance de l’air intérieur. Ils seront suivis par les centres de loisirs, les collèges et lycées au 1er janvier 2020, avant toute une série d’autres établissements (piscines, hôpitaux...) au 1er janvier 2023. Le texte supprime en outre l’obligation d’accréditation des organismes chargés de procéder à l’évaluation des systèmes d’aération des bâtiments.
Les rapporteurs ont auditionné le Laboratoire d’hygiène de la Ville de Paris ainsi que la direction chargée des affaires immobilières en première ligne sur ce dossier. Les résultats provisoires font ressortir que, sur 157 crèches contrôlées, vingt et un incidents, soit 13,4 %, ont été relevés, dont douze concernent le dioxyde de carbone. Dans ces cas, il suffit d’aérer la pièce pour ramener la concentration en dessous du plafond. Les neuf autres dépassements sont dus au benzène pour un tiers, et au formaldéhyde pour les deux tiers restants. S’agissant des écoles maternelles et élémentaires, trente et une d’entre elles ont été contrôlées entièrement (campagne d’été et d’hiver), et quatre dépassements de la valeur guide ont été enregistrés pour le formaldéhyde.
Selon les estimations, la dépense engagée serait de l’ordre de 2 millions d’euros pour les établissements scolaires, et de 7 millions pour l’ensemble des bâtiments. La Ville considère que les sommes en jeu sont très élevées au regard des dysfonctionnements car les remèdes sont souvent simples, à commencer par l’aération des locaux, même si tous ne sont pas forcément faciles à mettre en pratique. Premièrement, il est préférable de recourir à des matériaux faiblement émissifs et de s’assurer qu’ils ne sont pas posés trop tôt, c’est-à-dire que les parois sur lesquels ils sont appliqués sont suffisamment sèches, car ils risquent, sinon, de se dégrader et de polluer. Deuxièmement, les émissions des produits diminuent avec le temps, selon une courbe logarithmique. La direction des affaires immobilières s’efforce donc de respecter un délai d’un mois entre l’achèvement des travaux et l’entrée des enfants dans les lieux. Troisièmement, le benzène étant un polluant secondaire de la circulation automobile, il est préférable de ne pas implanter les établissements le long ou auprès d’axes à fort trafic routier ou de stations-service. Quatrièmement, la Ville, qui dispose de son propre personnel d’entretien, a lancé un programme de formation professionnelle périodique pour sensibiliser à l’utilisation des produits d’entretien et à l’aération.
Les services de la Ville de Paris suggèrent également de faire des contrôles systématiques au terme de travaux importants, pour s’assurer que les locaux sont sains avant l’accueil des enfants, et de faire passer la périodicité des contrôles de sept à dix ans pourvu, bien sûr, qu’ils aient été satisfaisants. Les communes ou les communautés de communes pourraient aussi s’équiper d’instruments de mesure plus rudimentaires, mais fiables, qui permettraient de détecter d’éventuelles anomalies entre deux contrôles approfondis et d’y remédier sans délai.
B. LA NÉCESSITÉ D’UNE BONNE ARTICULATION AVEC LES NORMES EN MATIÈRE DE LOGEMENT
Dans un contexte marqué, d’une part, par un impératif d’économies budgétaires et, d’autre part, par la nécessité de s’engager dans la transition énergétique, la tentation est forte pour la puissance publique soucieuse d’améliorer la qualité de l’air des bâtiments à l’intérieur desquels elle ne peut intervenir directement d’agir par le truchement de normes. Si des initiatives sont prises dans ce domaine, elles devront s’inscrire dans la politique du logement pour produire pleinement leurs effets.
Parallèlement au plan de relance de la construction annoncé par le Gouvernement le 29 août 2014, la ministre du logement a élaboré une série de cinquante mesures destinées à simplifier la construction, parmi lesquelles figure l’amélioration de la lisibilité des exigences liées à la réglementation sur la ventilation.
Dans le domaine de la construction, force est de relever les difficultés à diffuser les bonnes pratiques. La représentante du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), Mme Kirchner, a expliqué au cours de son audition y voir une des principales difficultés rencontrées. De son côté, la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN) répond que, pour concilier la performance énergétique des bâtiments et la qualité de l’air intérieur, le PQAI mise sur la sensibilisation et la formation des professionnels. L’objectif est de prévenir la non-conformité des installations des systèmes d’aération et de s’assurer de leur performance, performance qui ne saurait se confondre avec la complexité technique. Au contraire, doivent être privilégiés des équipements solides, simples d’utilisation et d’entretien, pour durer sans compromettre la qualité de l’air intérieur. Dans sa réponse au questionnaire des rapporteurs, la DGALN constate que « de nombreuses idées fausses circulent sur la qualité de l’air intérieur dans le milieu professionnel, qui découlent d’une mauvaise lecture des réglementations. En effet, certains professionnels pensent que, pour respecter la réglementation technique 2012 (RT 2012), il faut supprimer les fenêtres qui s’ouvrent dans les bâtiments. Or, c’est tout le contraire que dit la réglementation : l’obligation d’avoir des ouvrants est toujours d’actualité. Par définition, des ouvrants doivent pouvoir s’ouvrir ! ».
Ainsi, dans le cadre du programme d’action pour la qualité de la construction et la transition énergétique (PACTE), une action est prévue pour développer la connaissance des risques pathologiques rencontrés lors des projets de construction et de rénovation. Il s’agit de bâtir un cadre méthodologique destiné aux professionnels afin de leur permettre d’effectuer un diagnostic du couple bâti/ventilation pour proposer des solutions adaptées à un changement de vitrage ou à une isolation des parois.
Dans cet esprit, les rapporteurs jugent nécessaire d’associer systématiquement normes d’aération et normes d’isolation thermique, qu’il s’agisse de constructions neuves ou de rénovations. Ils souhaitent également, afin de sensibiliser davantage les particuliers, que le diagnostic de performance énergétique (DPE) soit élargi au contrôle de la qualité de l’air intérieur.
Proposition n° 22 : concilier qualité de l’air et normes en matière de logement :
– associer systématiquement normes d’aération et normes d’isolation thermique en cas de rénovation et de travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments ;
– élargir le diagnostic de performance énergétique (DPE) au contrôle de la qualité de l’air intérieur.
*
* *
La qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments dépend avant tout de celle de l’air extérieur, mais l’absence de pollution externe ne garantit pas aux occupants un environnement sain. Le développement des connaissances a fait prendre conscience de l’importance du milieu sur la santé humaine et favorisé une nouvelle approche mettant l’accent sur « l’exposome », qui a déplacé l’attention des experts du produit au milieu. Une telle démarche a trois conséquences majeures :
– premièrement, elle implique de fédérer la communauté scientifique en mutualisant les connaissances pour permettre des avancées dans un domaine qui reste largement inexploré ;
– deuxièmement, dans le cadre de la transition énergétique, l’amélioration de l’isolation doit aller de pair avec celle de la ventilation, pour ne pas être synonyme de dégradation de la qualité de l’air intérieur ;
– troisièmement, l’occupant devient un acteur essentiel de son environnement.
Dès lors, recherche, formation des professionnels et information des consommateurs doivent guider en priorité l’action publique. Le Gouvernement devra veiller à ce que soient menés les travaux sur la nocivité potentielle de l’environnement intérieur, que le cadre institutionnel soit optimisé et qu’une information suffisante et lisible parvienne aux professionnels comme aux ménages. Les premiers devront bénéficier d’un effort d’accompagnement dans la transformation de leur métier, et les seconds prendre conscience de l’impact de leur comportement sur leur environnement intérieur, et leur propre santé. L’information, actuellement disponible à condition de savoir où la chercher, reste à étoffer, notamment par le biais de l’étiquetage des produits d’ameublement et des consignes d’utilisation, mais, pour le moment, elle demeure très éparse.
AUDITION DE M. DIDIER MIGAUD,
PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR DES COMPTES
Lors de sa séance du 21 janvier 2016, le Comité entend M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes, sur l’évaluation des politiques publiques de lutte contre la pollution de l’air, réalisée par la Cour des comptes à la demande du Comité.
M. Claude Goasguen, président. Mes chers collègues, je vous prie tout d’abord d’excuser le président Bartolone qui m’a demandé de le suppléer.
Nous allons entendre M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes, qui va nous présenter la contribution de la Cour des comptes à l’évaluation des politiques publiques de lutte contre la pollution de l’air.
Je vous rappelle que nous avons décidé de réaliser cette évaluation à la demande du groupe écologiste, et que nous avons demandé l’assistance préalable de la Cour des comptes.
M. Didier Migaud est accompagné de Mme Évelyne Ratte, présidente de la septième chambre, et de M. Henri Paul, président de chambre, rapporteur général.
Nos deux rapporteurs sont Jean-Louis Roumégas et Martial Saddier.
M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes. Je suis heureux de venir une nouvelle fois devant vous afin de présenter l’enquête réalisée à la demande du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques.
Votre comité a souhaité que la Cour lui remette un rapport sur le bilan et les perspectives des politiques de lutte contre la pollution de l’air extérieur menées par la France. Je veux saluer l’implication forte des rapporteurs Martial Saddier et Jean-Louis Roumégas. Les rapporteurs de la Cour ont bénéficié de réunions de travail fructueuses et ont également entendu M. Saddier, au titre de ses fonctions de maire de Bonneville, en Haute-Savoie, et en sa qualité de président du Conseil national de l’air.
Le rapport de la Cour porte principalement sur trois points : d’une part, les objectifs assignés à la lutte contre la pollution de l’air ; d’autre part, le cadre juridique dans lequel elle s’inscrit ; enfin, les moyens budgétaires, fiscaux et humains qui y sont consacrés, et les résultats mesurés sur le territoire métropolitain.
Il contient des développements plus spécifiques sur trois sujets que votre Comité voulait voir examiner : la pollution de l’air d’origine industrielle, la pollution due à la production énergétique ainsi que l’action en faveur du développement du véhicule électrique.
Comme cela a été convenu avec les rapporteurs de votre Comité, ce travail ne traite en revanche pas de la pollution de l’air intérieur, que le CEC a examiné par lui-même. Le sujet des gaz à effet de serre, qui a fait l’objet d’un rapport de la Cour fin 2013 dans le cadre de l’évaluation de la mise en œuvre du « paquet énergie-climat », n’est abordé ici que de manière incidente.
Pour répondre à la demande de l’Assemblée nationale, l’équipe de la Cour a adopté un « grand angle », de l’échelon européen à l’échelon local. Elle a ainsi comparé les politiques menées aux niveaux national et local par nos principaux partenaires et voisins : les Pays-Bas, notamment à Amsterdam, Rotterdam et La Haye ; l’Allemagne, avec les villes de Düsseldorf, Cologne et Bonn ; la Suisse, à Berne, Zurich et Genève ; l’Italie, à Milan et Turin ; le Royaume-Uni, à Londres. L’annexe 3 du rapport montre ainsi que des solutions efficaces ont d’ores et déjà été mises en œuvre dans plusieurs secteurs économiques, dans des pays proches de la France.
La Cour a entendu près de deux cents personnes, tant au niveau national qu’au niveau déconcentré et décentralisé. Elle a analysé la mise en œuvre des plans de protection de l’atmosphère (PPA) au niveau local, notamment en Île-de-France, dans la vallée de l’Arve en Haute-Savoie, dans les Bouches-du-Rhône, en Haute-Normandie et dans la région grenobloise. Elle a examiné la gestion des pics de pollution de mars 2014 et de mars 2015.
La Cour a également souhaité approcher au plus près le coût de cette politique et appréhender au mieux la dimension financière des actions locales, qu’elles soient menées par les collectivités territoriales, les associations ou les entreprises. Elle a, pour ce faire, réalisé une enquête auprès des collectivités territoriales et des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA).
Pour vous présenter le travail de la Cour, je suis entouré d’Évelyne Ratte, présidente de la septième chambre de la Cour, qui a présidé la formation inter-chambres chargée d’examinée le rapport ; d’Henri Paul, président de chambre et rapporteur général du Comité du rapport public et des programmes ; de Christian Descheemaeker, président de chambre, contre-rapporteur ; de Marie-Ange Mattei, conseillère maître, Julien Marchal, auditeur, et Virginie Duhamel, rapporteure extérieure, qui ont travaillé sur cette enquête.
Le rapport de la Cour dresse deux constats principaux. Premièrement, la politique publique de lutte contre la pollution atmosphérique a permis une réelle amélioration de la situation pour certains polluants, même si des « points noirs » persistent localement, ce qui est problématique. Deuxièmement, la politique de lutte contre la pollution de l’air pâtit de nombreuses limites : incohérences avec d’autres politiques publiques, complexité de la gouvernance, gestion imparfaite des crises, inégale contribution des secteurs émetteurs à la baisse des émissions.
J’en viens au premier message de la Cour. La politique publique de lutte contre la pollution atmosphérique est une politique ancienne, qui a mis du temps à se structurer en France. Si elle a permis une réelle amélioration de la situation pour certains polluants, des « points noirs » persistent localement, contre lesquels il convient d’agir.
Les pics de pollution récents, l’affaire « Volkswagen » et les soupçons qui pèsent entre autres sur Renault montrent la grande actualité du sujet, ainsi que la forte sensibilité de l’opinion publique à cette question. Cela ne doit pas faire oublier que la politique de lutte contre la pollution de l’air est déjà ancienne, cette pollution faisant l’objet de l’attention des pouvoirs publics depuis les années soixante, c’est-à-dire bien avant que la question du changement climatique ne soit mise au premier plan, au cours des années quatre-vingt-dix.
L’action des pouvoirs publics en France a néanmoins tardé à se structurer. La plupart des mesures mises en œuvre depuis une vingtaine d’années l’ont été sous la pression de l’Union européenne. Cette faible appropriation est paradoxale, puisque les exemples internationaux montrent que respirer un air sain, droit inscrit dans le code de l’environnement français, est un objectif atteignable. Les actions menées en France montrent que l’action publique en la matière peut être efficace – je pense notamment aux émissions du secteur industriel et de la production d’énergie, qui ont fortement baissé au cours des vingt dernières années.
Le rapport comporte un bilan synthétique de la qualité de l’air en France métropolitaine, analysée par rapport au respect des normes fixées par la loi. Sur le fondement de ce bilan, la Cour constate une réelle amélioration de la situation depuis vingt ans pour certains polluants. Les émissions de polluants, c’est-à-dire leurs rejets dans l’air, diminuent globalement depuis 1990. Cette amélioration concerne davantage le secteur de l’industrie, avec de très fortes baisses des rejets, que celui de l’agriculture, où la tendance est à la stagnation des émissions ; la baisse des émissions des transports ou du secteur résidentiel-tertiaire est intermédiaire, mais ralentit depuis quelques années.
Toutefois, des points noirs locaux persistent, où les concentrations, c’est-à-dire la teneur dans l’air des polluants, restent élevées. Les zones où l’amélioration se poursuit sont à distinguer de celles où les teneurs restent supérieures aux normes en vigueur. Les enjeux sont en effet très spatialisés, et la relation entre émissions et concentrations dépend de nombreux facteurs locaux, comme la topographie, le climat, la densité de l’habitat ou du trafic.
Les études mettent ainsi en évidence quatre types de « points noirs » persistant sur le territoire métropolitain : certaines zones très urbanisées ou densément peuplées ; les zones se trouvant à proximité d’axes de transport denses ; certaines zones industrielles dites « multi-émettrices » ; enfin, des zones aux conditions géographiques et topographiques particulières, comme les vallées.
Au sein de ces « points noirs », les concentrations de polluants dépassent les seuils réglementaires fixés au niveau européen de manière récurrente. Depuis 2010, vingt-cinq zones connaissent des dépassements pour le dioxyde d’azote, et dix-neuf sont aujourd’hui concernées par une mise en demeure de la Commission européenne. Depuis 2005, une quinzaine de zones ne respectent pas les valeurs limites pour les particules fines ; dix font également l’objet d’une procédure contentieuse au niveau européen.
Au regard de l’impact sanitaire, mais également économique, de l’exposition à la pollution atmosphérique, la persistance de ces « points noirs » n’est pas satisfaisante. Les travaux menés depuis une vingtaine d’années ont permis d’établir de manière certaine la nocivité de la pollution de l’air et les coûts élevés qu’elle entraîne pour la collectivité. Les experts s’accordent sur le fait qu’il n’y a pas de seuil en dessous duquel la santé serait épargnée. En somme, c’est bien l’exposition quotidienne et prolongée à la pollution, davantage que celle qui découlerait de pics ponctuels, qui est à l’origine du développement de maladies cardio-vasculaires ou respiratoires.
Les dépenses correspondant à la prise en charge par le système de soins des pathologies liées à cette pollution sont élevées : 1 milliard d’euros au moins. Cette pollution serait à l’origine de dix-sept à quarante-deux mille décès prématurés par an en France et représenterait un coût socio-économique de 20 à 30 milliards d’euros. Ce coût est un montant minimum, puisqu’il ne concerne que l’impact des particules fines et de l’ozone.
Cette situation fait par ailleurs peser un risque contentieux sur la France, lié au non-respect des valeurs limites fixées par la réglementation européenne. Les procédures engagées par la Commission européenne ces dernières années ont d’ailleurs prospéré au cours de l’année 2015. Pour le seul contentieux « particules », qui concerne dix zones, le montant de l’amende infligée à la France en cas de condamnation par la Cour de justice de l’Union européenne pourrait s’élever à 100 millions d’euros la première année, puis à 90 millions d’euros par an. Deux autres procédures sont actuellement ouvertes, qui concernent respectivement le dépassement de concentrations maximales pour le dioxyde d’azote dans dix-neuf zones et le dépassement du plafond d’émission d’oxydes d’azote (NOx).
Au-delà de ce constat factuel qui, sans être ni catastrophique ni alarmiste, n’est certainement pas satisfaisant, la Cour dresse, dans son rapport, un second constat : la politique de lutte contre la pollution de l’air pâtit de nombreuses limites, qu’il s’agisse d’incohérences avec d’autres politiques publiques, de la complexité de la gouvernance, de la gestion imparfaite des crises ou de l’inégale contribution des secteurs émetteurs à la baisse des émissions.
La Cour a relevé des incohérences entre l’objectif de lutte contre la pollution de l’air et les objectifs d’autres politiques publiques nationales. La confusion est notamment trop souvent entretenue avec la politique de lutte contre le changement climatique. Ces deux politiques reposent parfois sur des instruments communs mais ne sont pas toujours compatibles ou pas toujours correctement articulés. Ainsi, les gaz à effet de serre – dont le CO2 – ne constituent qu’une partie des polluants nocifs de l’atmosphère, et les mesures prises pour leur réduction, naturellement souhaitables, produisent parfois un effet négatif sur la qualité de l’air. Le rapport met par exemple en évidence les effets ambivalents du chauffage au bois : instrument efficace dans la lutte contre les émissions de CO2, il contribue localement de manière importante à la surémission de particules fines.
En ce qui concerne les transports automobiles, la Cour examine aussi le soutien au diesel par rapport à l’essence. Dans un objectif de réduction des émissions de CO2, un taux réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) devait contribuer à la promotion du gazole. Cette vocation initiale apparaît aujourd’hui en contradiction avec l’objectif d’amélioration de la qualité de l’air : la combustion de ce carburant s’accompagne en effet d’importantes émissions de dioxyde d’azote et de particules fines, polluants aujourd’hui jugés nocifs.
La Cour recommande donc de veiller à la cohérence des politiques énergétique et de lutte contre la pollution de l’air. Cette adéquation passe par la poursuite du mouvement de rééquilibrage entre la fiscalité de l’essence et celle du gazole. La taxation du gazole et de l’essence pourrait dépendre de l’impact de leurs émissions respectives – polluants atmosphériques et gaz à effet de serre.
Le cas du véhicule électrique soulève les mêmes observations. Sur le lieu de son utilisation, l’impact est positif sur la qualité de l’air. Toutefois, des interrogations demeurent sur ses performances globales, sa fabrication – notamment celle de la batterie – ou la production d’énergie avec laquelle il fonctionne, devant également être prises en compte.
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, promulguée en août 2015, prévoit une plus grande cohérence des politiques énergétiques et de lutte contre la pollution de l’air. Ainsi, l’objectif de réduction de l’exposition des citoyens à la pollution de l’air est intégré dans les objectifs de la politique énergétique. Ces dispositions de principe restent toutefois à traduire dans les faits.
Le rapport s’attache ensuite à l’examen de la gouvernance de la politique de lutte contre la pollution de l’air, qui présente encore des lacunes. Le vote, en 1996, de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie – dite loi « LAURE » – n’a en effet pas empêché des difficultés persistantes. Ces difficultés concernent notamment le pilotage des outils, la répartition des compétences entre responsables publics et, enfin, la gestion des pics de pollution.
Au niveau national, la Cour a constaté une dispersion des responsabilités, malgré le rôle de « chef de file » de la direction générale de l’énergie et du climat du ministère de l’écologie. Le nombre important de départements ministériels concernés par la question de la qualité de l’air – écologie mais également santé, industrie, agriculture ou logement – n’est pas un obstacle en soi, mais, en l’état, l’absence de cadre d’action clair et défini de manière interministérielle nuit à l’atteinte des objectifs.
Par ailleurs, la politique publique de lutte contre la pollution de l’air devrait davantage s’inscrire dans le long terme. Or plusieurs plans successifs – la Cour évoque en particulier le « plan particules » et le « plan d’urgence pour la qualité de l’air » – ont été rapidement adoptés, selon un calendrier qui est apparu heurté. Une telle démarche a été dommageable à l’efficacité de cette politique. En effet, l’élaboration de ces plans a surtout été motivée par la nécessité de répondre rapidement à une situation de crise. Leur efficacité n’a pas été évaluée ex post, ce que la Cour recommande de faire à l’avenir.
Au plan budgétaire, les dépenses relatives aux politiques de lutte contre la pollution de l’air sont difficiles à retracer. Cela s’explique par la diversité des instruments financiers disponibles – fiscalité, crédits budgétaires, moyens des opérateurs –, mais aussi par la difficulté à identifier, au sein des crédits budgétaires, ceux consacrés à ces politiques. Les crédits affectés à la surveillance mais aussi à la recherche en matière de qualité de l’air pourraient être recensés de manière plus systématique. L’information du Parlement pourrait être améliorée, en complétant le jaune « Protection de la nature et de l’environnement » avec des indicateurs de la qualité de l’air.
L’articulation et la répartition des compétences entre le niveau national et les responsables locaux sont également perfectibles. Les plans de protection de l’atmosphère sont partout reconnus comme des instruments utiles, et les responsables locaux se les sont généralement bien appropriés. Ces plans ont parfois permis la mise en place d’actions innovantes, comme le fonds « Air Bois » dans la vallée de l’Arve.
Néanmoins, le principe de subsidiarité est encore trop souvent remis en cause, les préfets ou collectivités territoriales ne disposant pas toujours des marges de manœuvre qui leur sont nécessaires. De même, les autorités préfectorales sont chargées de la mise en œuvre des mesures réglementaires prévues dans les PPA, or elles ne maîtrisent pas toujours leur application en raison d’interventions des autorités nationales. La difficile articulation entre échelons national et local s’est par exemple manifestée au sujet de l’interdiction des feux de cheminée « ouverts » en Île-de-France et des interdictions ou limitations ciblées de la circulation. L’évolution rapide des dispositifs réglementaires ou financiers au niveau national complique aussi leur prise en considération dans les PPA.
La Cour formule plusieurs recommandations qui devraient permettre de remédier à ces difficultés d’articulation entre niveaux national et local. Ainsi, les calendriers des plans nationaux et des plans locaux de lutte contre la pollution de l’air pourraient gagner en cohérence, afin que le cadre de l’action locale soit mieux défini et plus prévisible.
La gestion des situations de crise, également qualifiées de « pics de pollution », ne paraît pas toujours appropriée. Ces pics focalisent souvent l’attention des pouvoirs publics et de l’opinion, ce qui peut paraître paradoxal pour plusieurs raisons. D’une part, les experts n’ont pas relevé d’effets sanitaires particulièrement aggravés lors de ces pics : la nocivité de la pollution atmosphérique semble plutôt provenir d’une exposition prolongée à un air pollué. D’autre part, les mesures pouvant être mises en œuvre lors de ces pics apparaissent inadaptées. Elles touchent surtout les secteurs sur lesquels il est le plus facile d’agir, en particulier l’industrie, tandis que d’autres émetteurs importants de polluants en sont majoritairement exclus, comme l’agriculture.
La circulation alternée est emblématique des problématiques rencontrées : cette mesure sensible est particulièrement lourde à mettre en œuvre ; or son impact sur la pollution s’avère faible. Des restrictions ciblées, limitant la circulation aux véhicules les plus polluants, pourraient opportunément remplacer les restrictions de circulation « à l’aveugle », c’est-à-dire selon la plaque d’immatriculation. L’identification des véhicules a été repoussée à plusieurs reprises, alors qu’elle permettrait de réguler la circulation ponctuellement, en cas de pics, ou de manière pérenne, dans les centres-villes très pollués. La mise en œuvre rapide de cette mesure contenue dans la loi relative à la transition énergétique nous apparaît donc souhaitable.
Avant de conclure, je veux revenir sur le caractère encore très inégal de la contribution des secteurs émetteurs à la baisse de la pollution de l’air.
Les mesures mises en place depuis plusieurs années dans le secteur de l’industrie ont été efficaces. Elles sont pour la plupart réglementaires. Elles ont contribué à une baisse très importante des rejets, qui ne peut être exclusivement imputée au phénomène de désindustrialisation. Des progrès sont également sensibles dans le secteur des transports, du fait principalement de l’évolution des techniques ou des limitations de vitesse à proximité des zones les plus polluées.
Toutefois, des mesures qui auraient eu des effets importants sur la pollution ont été suspendues. Ce choix a été préjudiciable à l’amélioration de la qualité de l’air. Le rapport cite notamment la suspension de l’écotaxe poids lourds ou de l’identification des véhicules les plus polluants, indispensable à la création de zones de restrictions de circulation. Je ne reviendrai pas sur la problématique du différentiel de taxation entre l’essence et le gazole, que j’ai déjà évoquée.
Le secteur résidentiel-tertiaire et le secteur agricole restent, en revanche, peu concernés par les mesures de réduction des émissions. Ils représentent pourtant une part croissante des rejets de certaines substances polluantes. La Cour recommande à ce titre deux choses : d’une part, la mise en œuvre de mesures qui permettront au secteur agricole de contribuer à l’atteinte des objectifs de réduction des émissions ; d’autre part, la surveillance obligatoire de la présence dans l’air des pesticides les plus nocifs.
Plus largement, la Cour regrette l’application insuffisante du principe pollueur-payeur en matière de pollution de l’air. À ce jour, celui-ci s’applique pleinement à l’industrie à travers la taxe générale sur les activités polluante (TGAP) « air », mais uniquement de manière partielle au secteur des transports. L’industrie est, à travers la TGAP-air, la seule qui finance la surveillance de la qualité de l’air.
En conclusion, ce que le travail de la Cour montre, à partir d’une analyse des politiques menées depuis vingt ans, c’est qu’il est possible d’agir contre la pollution de l’air. La France dispose d’un outil efficace de surveillance de la qualité de l’air. Les émissions de nombreux polluants ont diminué du fait de l’application de normes et de techniques de production plus respectueuses de l’environnement. Les exemples étudiés dans d’autres pays développés montrent également que l’action publique peut influer positivement sur la qualité de l’air, et donc sur l’état de santé des habitants.
La Cour nuance cependant ce bilan positif à deux égards. D’une part, une partie des coûts économiques liés à la pollution peut être diminuée, à condition de donner aux autorités locales la responsabilité de mettre en œuvre les mesures les mieux adaptées, dans un cadre stable fixé au niveau national. D’autre part, les résultats de la politique de lutte contre la pollution de l’air extérieur sont longs à obtenir. L’échéance de la future directive européenne sur la réduction des plafonds nationaux d’émissions de polluants étant fixée à 2030, il appartient donc dès aujourd’hui aux représentants du suffrage universel, quelques mois après le vote de la loi relative à la transition énergétique, de définir et d’engager les actions concrètes de long terme permettant de respecter les objectifs définis.
M. Jean-Louis Roumégas, rapporteur. Je tiens d’abord à remercier le Premier président Didier Migaud ainsi que l’ensemble des membres de la Cour des comptes, qui témoignent d’une forte mobilisation de la Cour sur ce sujet. Je salue également l’étendue et la cohérence du travail accompli, qui prouve que l’on peut agir pour améliorer la qualité de l’air, et mieux qu’on ne le fait.
En ce qui concerne les plans de protection de l’atmosphère, la Cour souligne à juste titre qu’ils constituent les outils de planification les plus efficaces. Ne faudrait-il pas aller jusqu’à les rendre contraignants et donc opposables aux documents d’urbanisme, pour accroître encore leur efficacité ?
La Cour estime également que les pics de pollution ne constituent qu’un aspect de la problématique, en marge de l’exposition quotidienne de la population à la pollution chronique, qui constitue le cœur du problème. Néanmoins, ces pics de pollution méritent qu’on s’y intéresse, compte tenu de leurs incidences sanitaires, constatées par les professionnels de santé. Or vous soulignez la faiblesse des dispositifs destinés à gérer ces pics. Dans ces conditions, ne faut-il rendre obligatoire le dispositif d’identification des véhicules selon leurs émissions de façon à adopter des mesures de restriction de la circulation plus cohérentes et plus efficaces que celles qui se fondent sur le seul critère de la plaque d’immatriculation ? Doit-on imaginer pour cela un dispositif qui s’apparente à celui de la « pastille verte » ?
En ce qui concerne l’automaticité du déclenchement des mesures de police en cas de dépassement des seuils de pollution, une proposition de loi du groupe écologiste vient d’être adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, et un arrêté ministériel devrait être publié pour organiser une application plus systématique et plus rapide de ces mesures de police.
En matière de politique fiscale, la Cour souligne que le principe pollueur-payeur est plus ou moins bien respecté selon les secteurs : correctement appliqué dans l’industrie, il n’en va pas de même dans le secteur résidentiel, les transports ou l’agriculture. Faut-il envisager un relèvement des barèmes et un élargissement de l’assiette et de la TGAP-air ? Qu’en est-il par ailleurs de l’affectation de la TGAP ? Faudrait-il, selon vous, affecter plus précisément le produit de la taxe aux politiques de lutte contre la pollution de l’air ?
Vous faites également observer que le bonus-malus sanctionne moins les impacts sanitaires que l’impact climatique de la pollution, puisque ce sont les émissions de CO2 qui sont prises en compte. Ne faudrait-il donc pas le modifier pour tenir compte du taux d’émission des particules fines ? Par ailleurs, ne devrait-on pas accroître la part du produit de la taxe sur le diesel – voué à augmenter dans les années à venir du fait de l’alignement de cette taxe sur la taxe appliquée à l’essence – affectée à la lutte contre la pollution de l’air, sachant que, malgré un rendement beaucoup plus important, il est prévu de n’en affecter qu’une petite partie (2 milliards d’euros en 2016 et 2,5 milliards en 2017) ?
Par ailleurs, la réduction des émissions polluantes dues aux véhicules ne nécessite-t-elle pas de revoir le système de contrôle des émissions ? C’est en tout cas ce qu’incitent à penser l’affaire Volkswagen et, plus récemment et dans une moindre mesure, l’affaire Renault, qui ont montré les failles des dispositifs de contrôle. Abstraction faite des phénomènes de tricherie, ne devrait-on pas confier les contrôles à une instance indépendante et revoir également les critères auxquels ils obéissent, afin que les résultats correspondent autant que faire se peut à ceux qui sont obtenus dans des conditions réelles de circulation.
Vous avez enfin évoqué le coût sanitaire et social de la pollution de l’air – en d’autres termes, le coût de l’inaction. Vous paraît-il possible et souhaitable d’élaborer un instrument et des indicateurs précis permettant d’évaluer ce coût, dont un rapport du Sénat indique qu’il se situerait entre 60 et 90 milliards d’euros ?
Je rappelle enfin qu’au-delà du rapport de la Cour des comptes, notre Comité a décidé d’inclure dans ses travaux la qualité de l’air intérieur, avec l’idée de produire un rapport global sur l’air extérieur et l’air intérieur.
M. Martial Saddier, rapporteur. Je m’associe aux remerciements que Jean-Louis Roumégas a adressés à l’ensemble des magistrats avec lesquels nous avons travaillé depuis plusieurs mois.
Le rapport rendu par la Cour des comptes établit un diagnostic clair de ce qui marche et de ce qui ne marche pas, et propose des pistes d’amélioration de nos politiques de lutte contre la pollution de l’air. Vous soulignez notamment la qualité du réseau de surveillance, organisé autour de quelque six cents stations de mesure et d’AASQA, dont l’ingénierie performante garantit la fiabilité du diagnostic.
Vous affirmez cependant qu’il nous reste des marges de manœuvre. Des progrès ont déjà été accomplis dans certains domaines, notamment celui des pluies acides. La qualité de l’air s’est améliorée ses dernières années, même s’il reste des « points noirs », qui ne font pas à eux seuls un bilan apocalyptique. Le rapport précise d’ailleurs que la France, si elle n’est pas le meilleur élève de l’Union européenne, n’est pas non plus le plus mauvais, puisqu’elle se situe exactement sur la médiane – constat dont on ne doit pas néanmoins se contenter.
Je suis heureux que votre rapport pose clairement les enjeux des politiques d’arbitrage entre le diesel et l’essence. Vous soulignez ainsi que la prime à la casse a favorisé les moteurs diesel dans un double objectif : un objectif économique de soutien à la production industrielle et un objectif environnemental de lutte contre le réchauffement climatique par la baisse des émissions de CO2. La France est ainsi passée entre 2007 et 2013 d’un taux d’émission moyenne par kilomètre de 149 à 117 grammes de CO2, ce qui en fait le pays le plus performant de l’Union européenne. Le corollaire de cette politique a été de faire passer en une trentaine d’années la part des véhicules roulant au gazole de 4 % à 63 % du parc automobile, avec les conséquences que l’on sait en matière d’émissions d’oxydes d’azote (NOx) et de particules fines.
Par ailleurs, si à la motorisation diesel se substituent désormais, sur les petits véhicules, de nouveaux moteurs essence 3 cylindres, il est à noter que ces moteurs ne sont pas équipés de filtres à particules, ce qui justifierait, selon la Cour, que l’on procède à des analyses poussées de leurs performances en termes d’émission de NOx, de PM10 et de CO2.
Compte tenu de ces constats, au lieu de mettre en œuvre des politiques distinctes, visant, pour l’une, à améliorer la qualité de l’air et, pour l’autre, à lutter contre le réchauffement climatique, ne faudrait-il pas, comme je le défends depuis longtemps, opter, dans le champ du progrès technologique comme dans celui de la fiscalité, pour des mesures qui combinent ces deux objectifs ?
Si certains secteurs économiques ont progressé en matière de lutte contre la pollution, ce n’est le cas ni du secteur agricole – le ministère de l’agriculture étant assez peu sensibilisé à cette problématique – ni du secteur du résidentiel-tertiaire. Comment inverser la tendance ?
En matière de communication, il est difficile de définir une stratégie globale à l’échelle nationale, dans la mesure où, d’un territoire à l’autre, la pollution de l’air peut être liée à des sources de polluants diverses. Il n’est ainsi pas toujours aisé de faire entendre aux acteurs locaux qu’au sein d’un même bassin de vie, certaines zones sont essentiellement touchées par les émissions liées aux transports, d’autres par celles liées aux cheminées ou au chauffage domestique.
Je me réjouis que la Cour se soit penchée sur le cas de la vallée de l’Arve, soulignant dans son rapport l’implication des services de l’État et notamment de la direction départementale du territoire (DDT) de Haute-Savoie. J’ajoute que, si le PPA de la vallée de l’Arve fonctionne bien, c’est grâce à la structure intercommunale que j’ai l’honneur de présider et aux cent six maires qui ont collaboré à l’écriture de ce PPA et animent le fameux fonds « Air Bois ». Ce fonds, le Président de la République, le Premier ministre et Ségolène Royal ont estimé nécessaire qu’il soit généralisé, et vous serez sans doute heureux d’apprendre, monsieur le Premier président, que l’agglomération grenobloise vient de décider la mise en place d’un outil similaire.
Vous soulignez le caractère instable et discontinu de la planification au niveau national et la multiplication des outils. Serait-il souhaitable d’opter pour un seul outil qui pourrait être inclus dans la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable ?
En vous appuyant sur l’exemple des zones d’actions prioritaires pour l’air (ZAPA), supprimées puis rétablies sous une autre forme, ainsi que sur l’interdiction des feux de cheminée, vous mettez en lumière le non-respect du principe de subsidiarité. Pensez-vous qu’il faille décentraliser la politique de lutte contre la pollution, en y associant les représentants de l’État ? Quel serait selon vous le bon échelon coordinateur, sachant que se poserait alors la question du financement de ces politiques par les collectivités territoriales responsables.
En Allemagne, les ramoneurs ont l’obligation de signaler tout appareil de chauffage défectueux ou trop ancien sur lequel ils interviennent, le propriétaire devant alors obligatoirement le remplacer. Compte tenu du poids du chauffage au bois dans les émissions de particules fines, pensez-vous qu’il faille aller jusqu’à ce type de mesure contraignante, dès lors que les dispositifs incitatifs comme le fonds « Air Bois » auront montré leurs limites ?
M. Jacques Myard. Les effets de la lutte contre la pollution de l’air se mesurent sur le long terme mais, au vu de la manière dont ont diminué les émissions des principaux polluants entre 1990 et 2013, nous avons déjà de quoi être satisfaits, même si des progrès restent à faire.
Si les PPA peuvent être efficaces, comme en témoigne l’exemple de la vallée de l’Arve, il n’en demeure pas moins que les collectivités locales doivent souvent, pour agir, s’en remettre à des mesures nationales.
Pour ce qui concerne le diesel, j’ai cru comprendre que les moteurs avaient fait d’immenses progrès et qu’ils étaient beaucoup moins polluants qu’on veut bien le dire.
En matière de gouvernance, la dispersion des responsabilités que vous dénoncez me laisse sans voix. Il serait sage de confier à un seul ministre la coordination de la lutte contre la pollution de l’air : nous y gagnerions en efficacité, et cela permettrait sans doute de faire quelques économies.
Je suis quoi qu’il en soit heureux de voir que la politique de lutte contre la pollution porte ses fruits et que les gens y sont de plus en plus sensibilisés. Reste à poursuivre les efforts.
M. Jean-Yves Caullet. Je tiens à m’associer au concert de remerciements entamés par mes collègues et veux saluer en particulier l’approche globale de la question qui est celle du rapport.
Il en ressort d’emblée que la multiplicité des pollueurs et des sources de pollution peut contribuer à déresponsabiliser chacun, phénomène qu’aggrave encore une gouvernance par trop dispersée. Cela ne doit pas nous empêcher d’agir dans tous les domaines où cela est possible et nécessaire.
Je voudrais m’arrêter sur les incohérences et les informations contradictoires auxquelles sont confrontés nos concitoyens qui cherchent à adopter des comportements vertueux en matière de pollution de l’air. Que comprendre en effet lorsque, convaincu par l’idée que la biomasse est renouvelable, on fait l’acquisition d’un chauffage à bois, mais que l’on apprend quelques mois plus tard que ses émissions sont néfastes pour la santé ? Que penser lorsque, ayant lu que les moteurs à essence et les petites cylindrées étant moins polluants qu’un gros diesel, on troque celui-ci contre un petit véhicule, pour s’entendre dire ensuite que le gros diesel moderne polluait moins qu’un petit 3 cylindres non équipé de filtre à particules ? Ces revirements sont catastrophiques, car ils concernent des arbitrages budgétairement conséquents pour les ménages et ne peuvent que saper leur confiance dans les préconisations publiques. Je défends à cet égard les actions locales, qui permettent de mieux faire le lien entre les efforts demandés et les résultats obtenus.
Le rapport souligne enfin le rôle de la biomasse dans la transition énergétique puisqu’elle est censée représenter en 2020 60 % du mix énergétique. Il est donc nécessaire de définir avec précision les conditions d’utilisation vertueuse de cette biomasse, en labellisant éventuellement les procédés industriels recommandables, pour l’information de nos concitoyens.
M. Martial Saddier, rapporteur. La Cour a également souligné une autre question importante, celle de l’importation et de l’exportation des sources d’émissions, notamment de particules fines, sans qu’il soit possible d’analyser très clairement ces mouvements. On a coutume de dire que l’agglomération lilloise est surtout polluée par les particules fines en provenance du nord de l’Europe, de même que l’on dit que le long de notre frontière continentale, 30 % des particules fines proviennent des autres pays européens. Il serait bienvenu que l’Union européenne, qui n’hésite pas à lancer – légitimement – des procédures contentieuses contre nous, soit dans son rôle en éclairant l’origine de ces particules.
M. Claude Goasguen, président. Je m’étonne que le rapport ne dise rien des lobbies, car s’il est un domaine où ils prospèrent, c’est bien celui qui nous occupe. A-t-on les moyens de vérifier leurs allégations et d’assurer une information correcte des consommateurs ?
M. Didier Migaud. Lutter contre la pollution est efficace et produit des résultats, ce qui est encourageant. Mais cela nécessite que les citoyens, consommateurs et usagers, soient correctement informés. C’est pour cela que nous insistons sur la nécessité de développer une politique de communication forte et cohérente dans le temps, ce qui est, en creux, un moyen de dire qu’il faut se donner les moyens de lutter contre les lobbies. Il faut savoir par exemple qu’il existe des appareils de chauffage au bois plus ou moins performants, car plus la combustion du bois est complète, moins les émissions de particules fines sont importantes.
M. Claude Goasguen, président. Pourquoi ne pas imaginer un système de contrôle comme celui qu’utilise le ministère de la santé pour les médicaments ou les soins sanitaires ?
M. Didier Migaud. On peut en effet envisager un système de normes ou de labels. Quoi qu’il en soit, la Cour estime qu’il existe des marges de progrès.
Martial Saddier a raison de pointer les contradictions qui peuvent se faire jour entre la lutte contre la pollution de l’air et la lutte contre le réchauffement climatique, et il paraît souhaitable en effet de mettre en place un dispositif unique permettant de combiner les deux objectifs.
Les PPA, s’ils ne sont pas contraignants par eux-mêmes – les rendre tels poserait un certain nombre de difficultés – contiennent en revanche des mesures réglementaires qui peuvent l’être. Appliquer ces dernières et vérifier qu’elles le sont est déjà un préalable indispensable.
En ce qui concerne le partage des responsabilités entre l’échelon national et l’échelon local, le rapport montre, à partir de quelques exemples, que les décisions prises au niveau national ne sont pas toujours les mieux adaptées aux réalités du terrain. Il préconise donc de confier aux autorités déconcentrées et aux collectivités territoriales la mise en œuvre effective des mesures contenues dans les PPA ; cela relève de leurs compétences et ce sont elles qui sont le mieux à même d’organiser les dispositifs, même si elles agissent dans un cadre défini à l’échelle nationale. Reste ensuite à régler la question des moyens.
M. Jacques Myard. Certaines responsabilités peuvent être déléguées au niveau local, mais la classification des polluants et les normes doivent être établies au niveau national.
M. Didier Migaud. La pollution atmosphérique est avant tout un phénomène localisé, c’est pourquoi c’est aux autorités locales, même si elles opèrent dans le cadre fixé au niveau national, de prendre les décisions qui s’imposent et de décider, le cas échéant, de déclencher un plan d’action.
En ce qui concerne les pics de pollution, l’impact des mesures prises pour les neutraliser est souvent limité, et le rapport souligne bien que ce qui est le plus nocif en termes de santé publique, c’est l’exposition prolongée aux polluants et non les pics de pollution. L’action publique devrait donc porter en priorité sur la mise en œuvre de mesures de fond pérennes, en particulier dans les secteurs qui, comme le secteur agricole, sont aujourd’hui exemptés d’une grande partie des efforts nécessaires à la lutte contre la pollution de l’air.
En cas de pic de pollution néanmoins, nous pensons qu’il serait préférable de n’avoir qu’un seul seuil de déclenchement des mesures. Il est également souhaitable que le dispositif d’identification des véhicules en fonction de leurs émissions, prévu dans la loi relative à la transition énergétique, soit rapidement instauré, non seulement pour les pics de pollution mais également pour la mise en place de zones de restriction de circulation. Ces actions ont fait la preuve de leur efficacité dans plusieurs pays, et nous sommes pratiquement le dernier pays à pratiquer la circulation alternée, que les autres pays ont abandonnée au profit de dispositifs plus ciblés. De même, il est souhaitable qu’en cas de persistance de la pollution, le déclenchement de la procédure d’alerte par les préfets soit automatique.
M. Claude Goasguen, président. S’il y a persistance, on ne peut plus parler de pic. L’expression est sans doute plus médiatique, mais la confusion peut être à l’origine de polémiques dommageables, comme on l’a vu entre la maire de Paris et la ministre de l’écologie.
M. Didier Migaud. Pour ce qui concerne la fiscalité, la Cour ne recommande pas de l’alourdir. En revanche, elle constate que les efforts devraient être mieux répartis entre les secteurs émetteurs, afin qu’ils ne pèsent pas uniquement sur l’industrie. Dans le secteur des transports, par exemple, l’abandon de l’écotaxe impose a minima de revoir les taux de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers. De plus, la Cour préconise de poursuivre le rééquilibrage entre la fiscalité sur le diesel et la fiscalité sur l’essence. Enfin, le secteur agricole pourrait contribuer au financement du dispositif de surveillance de la qualité de l’air, par exemple grâce à l’instauration d’une taxe sur les pesticides.
Dans les secteurs agricoles et résidentiels, on peut également agir par le biais d’un durcissement de la réglementation, éventuellement accompagné d’un dispositif d’aides financières. À ce titre, le fonds « Air Bois » mis en place dans la vallée de l’Arve est une formule intéressante.
Nous insistons également sur le fait qu’il ne faut pas uniquement prendre en compte les émissions de CO2 mais également les autres polluants, particules fines et dioxydes d’azote. D’où l’intérêt d’imaginer des aides ou des taxes modulées en fonction de la norme Euro à laquelle sont soumis les véhicules.
Enfin, plusieurs rapports de la Cour ont établi que le principe pollueur-payeur n’était pas appliqué partout. Cela peut sans doute expliquer que les émissions d’ammoniac, essentiellement liées à l’agriculture, sont celles qui ont le moins diminué – moins 2,9 % – depuis vingt ans. Or ce n’est pas une fatalité puisqu’aux Pays-Bas, elles ont au contraire très fortement baissé sur la même période, grâce à une politique extrêmement volontariste.
Mme Évelyne Ratte, présidente de la septième chambre de la Cour des comptes. M. Roumégas nous a interrogés sur l’affectation de la TGAP. Il nous semble que le produit de la TGAP est suffisamment affecté, dans la mesure où l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) bénéficie directement de la majeure partie des recettes qu’elle génère et en consacre une part non négligeable à des actions visant à réduire la pollution de l’air.
S’agissant plus spécifiquement de la TGAP-air, une disposition de la loi de finances pour 2016 permet aux industriels de flécher une part importante de la taxe qu’ils acquittent au bénéfice des AASQA. Ils peuvent leur verser directement au maximum 171 000 euros ou 25 % des cotisations dues au titre de l’année. Ce plafond s’applique désormais par installation et non plus par établissement.
Par ailleurs, vous n’ignorez pas que la Cour des comptes n’est jamais très favorable au principe de l’affectation des taxes…
M. Claude Goasguen, président. Monsieur le Premier président, madame la présidente, il me reste à vous remercier pour cet excellent rapport, qui fera date à n’en pas douter et dont nous sommes heureux d’autoriser la publication.
Le Comité autorise la publication du rapport de la Cour des comptes.
Lors de sa séance du 19 mai 2016, le Comité examine le présent rapport.
M. le président Claude Bartolone. Le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) a décidé de réaliser l’évaluation des politiques publiques de lutte contre la pollution de l’air à la demande du groupe Écologiste. Il a été fait appel à l’assistance de la Cour des comptes, dont l’étude a été présentée par son Premier Président le 21 janvier dernier ; nos deux rapporteurs sont Jean-Louis Roumégas et Martial Saddier, à qui je donne la parole.
M. Jean-Louis Roumégas, rapporteur. Avec Martial Saddier, nous présentons ce rapport à deux voix ; je tiens d’ailleurs à dire que ce travail a été réalisé dans une parfaite entente, dans un état d’esprit pragmatique et optimiste. Sur ce sujet très technique, nous avons trouvé beaucoup de points d’accord, nos divergences ne transparaissant que dans quelques-unes des propositions.
Nous tenons à saluer une nouvelle fois le travail remarquable de la Cour des comptes. Pour notre part, nous avons entendu plus de cent personnes : chercheurs, représentants d’association et responsables du monde de l’entreprise et d’administration.
Nos travaux nous ont conduits à un constat à la fois optimiste et volontariste. La lutte contre la pollution de l’air est efficace, le rapport de la Cour en atteste. Elle constitue avant tout une nécessité sanitaire, et c’est pourquoi nous avons voulu traiter ensemble ses deux dimensions inséparables : la pollution de l’air extérieur – qui a fait l’objet des travaux de la Cour des comptes – et la pollution de l’air intérieur.
Les outils de lutte contre la pollution de l’air existent, ils restent à perfectionner afin de les rendre encore plus efficaces, ce à quoi visent plusieurs de nos propositions. En premier lieu, nous avons constaté que la pollution de l’air est un sujet mal connu : seuls une quinzaine de polluants sont surveillés, et encore sont-ce les concentrations de polluants qui sont étudiées, et non l’exposition des individus à ces substances. Les interactions entre polluants – le fameux « effet cocktail » – sont elles aussi largement inconnues. Le coût de la pollution de l’air est tout aussi méconnu et sous-évalué : son coût sanitaire et social, mais aussi ce que l’on appelle le coût de l’inaction – le nombre des décès prématurés qui lui sont imputables –, ne cessent d’être réévalués.
Dans le même temps, paradoxalement, le citoyen commence à être inondé d’informations plutôt brouillonnes sur la qualité de l’air, des opérateurs privés développant une offre dans ce domaine, qui consiste surtout à recycler les données publiques disponibles. Pour toutes ces raisons, il faut approfondir nos connaissances métrologiques, épidémiologiques et économiques sur ce phénomène. À cette fin, nous proposons d’établir un indice synthétique de la qualité de l’air qui soit à la fois commun à toutes les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) et de compréhension aisée, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Nous proposons aussi de mettre à la disposition du grand public un indice individualisé d’exposition à la pollution de l’air, par exemple par le biais d’une application sur les téléphones portables.
Nous proposons également de créer des pôles de compétitivité dédiés à l’innovation en matière de pollution de l’air dans les régions les plus touchées par ce phénomène.
Enfin, nous proposons de constituer une structure de recherche interdisciplinaire sur les coûts tangibles et intangibles de la pollution de l’air, financée par un appel à projets de l’Agence nationale de la recherche (ANR).
M. Martial Saddier, rapporteur. Comme mon collègue Jean-Louis Roumégas, je tiens à souligner que nous avons travaillé pour l’intérêt général et pour l’amélioration de la santé publique. Nous avons tenté de réaliser un travail de fond qui englobe l’ensemble des composantes de la pollution de l’air. En tant que président du Conseil national de l’air (CNA) depuis huit ans, sous cinq ministres successifs, de sensibilités politiques diverses, j’ai vu plusieurs rapport sur le sujet et, je crois pouvoir dire que celui que nous vous présentons aujourd’hui fera date.
Ce rapport se veut en effet transversal, simple et lisible ; il dresse un véritable état des lieux et trace un certain nombre de perspectives. Je remercie le président du groupe Les Républicains, Christian Jacob, qui m’a demandé de représenter ma famille politique pour être co-rapporteur. Je m’associe par ailleurs aux remerciements adressés aux magistrats de la Cour des comptes.
Jean-Louis Roumégas a retracé la première phase de nos travaux, qui concerne le diagnostic, préalable indispensable à toute perspective, quel que soit le sujet étudié. Le deuxième aspect sur lequel nous avons souhaité insister est celui de la gouvernance, qui reste à construire. Il nous faut en effet aborder ensemble l’enjeu de la qualité de l’air et celui du climat – je rappelle que l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité, mardi dernier, la ratification de l’accord de Paris. Comme le démontre le rapport, agir sur un levier a une incidence sur tous les autres, qu’il s’agisse des transports, du chauffage, de l’industrie ou de la biomasse. Une action influant de façon positive sur les émissions de gaz à effet de serre peut avoir des effets négatifs sur d’autres éléments, déterminants pour la qualité de l’air, et inversement.
À dire vrai, depuis une dizaine d’années, c’est-à-dire depuis le départ du contentieux européen, les gouvernements successifs n’ont pris de mesures en faveur de la qualité de l’air qu’en urgence, lorsque la Commission européenne leur écrivait. Il convient de sortir de cette gestion conjoncturelle pour mener une politique durable et permanente. Cela suppose que soit réduit le nombre des outils : chaque fois que la Commission européenne se manifeste, nous avons le réflexe, typiquement français, d’inventer un nouveau dispositif. Aux plans de protection de l’atmosphère (PPA) s’ajoutent les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), les schémas régionaux climat-air-énergie (SRCAE) et les schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT), si bien que personne n’y comprend plus rien.
À nos yeux, les trente-cinq PPA, qui couvrent 46 % de la population, sont de loin les outils les plus efficaces, mais ils sont insuffisamment déployés ; il faut réaliser une nouvelle expertise du territoire, élargir le champ des PPA et en élaborer de nouveaux là où c’est nécessaire car, en dix ans, la qualité de l’air a évolué.
La gestion des pics de pollution n’est plus adaptée. On se focalise trop sur eux, alors que chacun s’accorde aujourd’hui à dire qu’il faut agir sur la pollution de fond, ce qui n’allait pas de soi il y a dix ans. Il convient de revoir les procédures de déclenchement des alertes et abandonner la circulation alternée dans les grandes villes, qui n’est pas une solution.
Nos propositions, communes, sont les suivantes. Il nous faut mettre en cohérence les politiques de lutte contre le changement climatique et contre la pollution de l’air. Il nous faut également décentraliser davantage les politiques publiques : s’il revient à l’État de déterminer les grandes orientations, c’est aux régions et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’élaborer et de mettre en œuvre les PPA. Il convient aussi de mieux évaluer les résultats de la lutte contre la pollution de l’air : toute politique publique et tout argent engagé doivent faire l’objet d’une évaluation.
Nous devons encore simplifier le déclenchement des procédures de gestion des pics de pollution. Nous avons conscience que la procédure d’information du public a connu deux modifications, dont la dernière, très lourde, est récente. Reste que le dispositif n’est pas assez visible : nous proposons de nous appuyer sur les alertes météo, dont chaque Français a l’habitude, à 20 heures 30, de voir les images expliquant que l’on se trouve en zone jaune, verte, orange ou rouge ; elles sont très visibles et facilement compréhensibles.
Enfin, dans les grandes villes, il faut recourir à la circulation graduée ou partagée. Dans beaucoup de villes du monde, des caméras permettent d’identifier les véhicules les moins polluants afin de les favoriser ; pour ce faire, la loi doit être modifiée afin créer un statut juridique pour la vidéo-verbalisation.
Aujourd’hui, à Paris, les autorités sont multiples : préfet de police, préfet d’Île-de-France, Ville de Paris, Métropole du Grand Paris, Gouvernement. Il y a trop d’acteurs pour une seule politique, et nous considérons qu’il faut clarifier le rôle de chacun.
M. Jean-Louis Roumégas, rapporteur. Nous abordons maintenant les politiques sectorielles, en commençant par le secteur routier.
Ce secteur a progressé dans le domaine de l’émission de polluants, principalement du fait de l’évolution des motorisations, mais il demeure l’un des principaux contributeurs à la pollution de l’air, particulièrement en ce qui concerne les oxydes d’azote (NOx) et, dans une moindre mesure, les particules fines.
Cinq facteurs contribuent à cette situation.
Premièrement, la fiscalité des carburants, notamment le taux réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) en faveur du gazole, subventionne l’achat des voitures diesel, qui émettent plus de NOx et de particules fines que les voitures à essence. Notre système est ainsi plutôt vertueux en ce qui concerne le climat, mais pas dans le domaine de la pollution de l’air.
Deuxièmement, la dernière version du bonus-malus et la prime de conversion créée en 2015 sont axées sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais n’aident quasiment pas les consommateurs à acheter les voitures à essence les moins polluantes.
Troisièmement, le transport routier de marchandises a réduit fortement ses émissions, mais continue de polluer, surtout au cours du dernier kilomètre de livraison. Les solutions alternatives, telles que camions et véhicules utilitaires légers (VUL) roulant au gaz ou à l’électricité, existent, mais elles sont encore trop coûteuses, et les plateformes de transfert permettant de passer d’un véhicule à l’autre ne sont pas assez nombreuses.
Quatrièmement, l’un des outils les plus efficaces, permettant d’agir sur le nombre et la qualité des véhicules en circulation – les zones à basses émissions –, n’a toujours pas été mis en œuvre en France. Vingt villes se sont engagées à le faire, mais les premières zones ne pourront pas voir le jour avant 2017, alors que Londres, Milan et Berlin se sont dotées de cet outil il y a environ dix ans.
Cinquièmement, le scandale Volkswagen a mis en lumière les failles des tests d’émission des véhicules en laboratoire. En conditions réelles d’utilisation, la plupart des véhicules aux normes Euro 4, 5 et 6 ne respectent pas leurs valeurs limites d’émission, les valeurs réelles étant parfois quatre à cinq fois supérieures.
Nous proposons de rendre plus incitatives les aides au renouvellement du parc en créant, à côté du bonus-malus centré sur le changement climatique, un bonus-malus « pollution atmosphérique » basé sur les émissions de NOx et de particules, et en instituant une prime à la casse ciblant les véhicules très polluants : poids lourds, VUL et autocars anciens.
Nous recommandons aussi de développer l’offre de poids lourds et de VUL roulant à l’électricité ou au gaz naturel pour véhicules (GNV) et de faciliter les ruptures de charge permettant l’utilisation de tels véhicules pour effectuer le dernier kilomètre de livraison, celui-ci étant souvent situé en centre-ville.
Nous préconisons également d’agir sur le nombre de véhicules en circulation, en instaurant des zones à faibles émissions grâce à l’identification obligatoire des véhicules en fonction des normes Euro, en octroyant des facilités de circulation aux véhicules les moins polluants, en incitant les entreprises à mettre en place le covoiturage et en assurant la prise en charge par l’employeur de la moitié des frais engagés par les intéressés, comme il est pratiqué pour les abonnements aux transports en commun.
Nous proposons enfin d’appliquer, dans des délais resserrés, le nouveau cycle d’essai des véhicules en conditions d’usage réelles et de créer une autorité européenne de surveillance des niveaux d’émission des véhicules, qui soit indépendante des États membres et des constructeurs et procède à des contrôles aléatoires sur le parc roulant.
M. Martial Saddier, rapporteur. Un autre secteur contribuant largement à la pollution de l’air est celui de l’industrie, mais il est satisfaisant de constater que, lorsque la France et l’Europe prennent des décisions, les résultats concrets sont au rendez-vous. C’est très encourageant, à la fois pour nos concitoyens et pour les partenaires, publics et privés, avec lesquels nous travaillons pour relever ce défi.
Depuis vingt ans, les baisses d’émissions les plus importantes concernent les polluants d’origine industrielle. Elles ne sont moins liées à la désindustrialisation qu’aux efforts importants réalisés par les industriels. Les résultats sont probants : – 97 % pour le chrome, – 89 % pour le cadmium, – 78 % pour le dioxyde de soufre, – 71 % pour l’arsenic, – 48 % pour le NOx.
Cet élan doit être poursuivi, sans pour autant pénaliser ce secteur soumis à une forte compétition internationale. Nous proposons en premier lieu d’améliorer l’information sur les installations classées, car les données obtenues ne sont pas systématiquement transmises, singulièrement dans les zones ou des PPA sont en place. Il faut faire circuler l’information entre ces établissements, les maires et les préfets.
Par ailleurs, sur la base du volontariat, et en se fondant sur le modèle du fonds « Air Bois », qui est en voie de généralisation, nous proposons d’expérimenter, dans les règles communautaires, un fonds « Air Industrie » qui accompagnerait les industries concernées, sur la base du volontariat, pour qu’elles modifient leurs techniques de filtration afin d’aller au-delà de la norme.
Une des novations de notre rapport réside dans une approche transversale liant l’agriculture, l’industrie, le trafic routier et le résidentiel tertiaire.
Nous avons abordé la question de l’agriculture avec réalisme, car les agriculteurs ignorent largement qu’ils sont susceptibles d’être à l’origine de la détérioration de la qualité de l’air. Il s’agit de réactions physico-chimiques assez complexes, puisque les émissions d’origine agricole, notamment lors de l’épandage des engrais, deviennent dangereuses lorsqu’elles viennent se combiner à l’air des zones urbaines proches. Le phénomène est notable à Paris et en région parisienne, celle-ci étant en partie constituée de grandes zones agricoles. Nous proposons donc d’informer les agriculteurs, de les inciter à renouveler le matériel d’épandage et à utiliser des engrais non nocifs et d’approfondir la recherche sur l’épuisement des sols.
S’agissant du secteur résidentiel, les mentalités ont beaucoup évolué. La biomasse constitue une énergie renouvelable présentant de grandes qualités environnementales, à condition d’être correctement utilisée. Beaucoup de travail reste à faire en matière de performance énergétique des logements et des appareils de chauffage, ainsi que de diagnostic de performance énergétique. Nous soutenons activement la généralisation du fonds « Air Bois », né dans la vallée de l’Arve en Haute-Savoie, et qui s’est étendu à Grenoble et à la région parisienne, une quatrième expérimentation étant en cours.
Il s’agit de remplacer les appareils de chauffage au bois les plus anciens, qui ne sont plus performants, et de favoriser le brûlage de bois sec et le bon entretien des appareils. Nous n’avons pas souhaité aller jusqu’au contrôle intrusif de ces appareils dans les propriétés privées, mais nous proposons que les responsables du ramonage puissent délivrer, lors de leur passage, des fiches d’information relatives à la bonne utilisation de ces appareils. C’est particulièrement important en milieu urbain – il ne faut pas oublier que 7,5 millions de Français utilisent une cheminée.
M. Jean-Louis Roumégas, rapporteur. Sur ce dernier point, nous considérons que, dans les zones sensibles, il ne devrait plus être permis, à terme, de vendre des foyers ouverts.
Nous avons également étudié la pollution de l’air intérieur, qui résulte de la combinaison de polluants extérieurs et de polluants propres à l’air intérieur. Rappelons qu’un individu passe, en moyenne, plus de 80 % de son temps à l’intérieur !
La France a été pionnière dans ce domaine en créant l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (AQAI), qui est probablement une conséquence du scandale de l’amiante. La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a ensuite inscrit dans le code de la santé publique le plan national santé environnement (PNSE), d’une durée de cinq ans, et dont une partie est consacrée à l’air intérieur. La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle 2 », a alors créé une section consacrée à la qualité de l’air intérieur dans le code de l’environnement, confiant à l’État la responsabilité de l’identification des facteurs de pollution et de l’évaluation des risques sanitaires issus de l’exposition des populations. Enfin, le PNSE 3, qui couvre la période 2015-2019, intègre le plan pour la qualité de l’air intérieur (PQAI).
Les études portant sur la pollution de l’ait intérieur sont nombreuses. Après une étude portant sur 567 logements, réalisée entre 2003 et 2005, et qui a révélé la nécessité d’agir, l’OQAI a lancé des campagnes concernant successivement les lieux de vie des enfants, dont 300 écoles, puis les bureaux, les hôpitaux et maisons de retraite, les bâtiments performants en énergie et les établissements recevant du public. L’étude internationale ISAAC – acronyme de International Study of Asthma and Allergies in Childhood in France – constate, au vu d’un échantillon national réparti entre six villes de France, que 30 % des élèves sont exposés à des niveaux supérieurs aux valeurs recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). L’étude longitudinale française depuis l’enfance (ELFE) et l’étude de santé sur l’environnement, la biosurveillance, l’activité physique et la nutrition (ESTEBAN), qui porte sur 18 000 enfants de 500 familles, s’attachent à suivre des individus de la naissance à l’âge adulte pour étudier l’influence du mode et du milieu de vie sur la santé.
Dans le domaine de la réglementation par seuil, des valeurs guides réglementaires pour l’air intérieur (VGAI) sont définies pour le formaldéhyde et le benzène 2. À partir des valeurs établies par l’ANSES, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) propose des valeurs d’action rapide pour le formaldéhyde, le benzène, le naphtalène, le trichloréthylène et le tétrachloréthylène, ainsi que pour les particules fines ; des valeurs d’information et de recommandation pour le formaldéhyde ; enfin, des valeurs repères et des valeurs cibles qui constituent respectivement un objectif intermédiaire et un objectif final. Les valeurs repères proposées par le HCSP pour le formaldéhyde et le benzène sont amenées à évoluer pour atteindre les valeurs guides définies par l’ANSES tandis que le dépassement des valeurs d’action rapide doit déclencher une expertise immédiate, préalable à des mesures correctrices.
S’agissant de l’information du public et des professionnels, l’étiquetage des matériaux de construction et de décoration, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, tient compte du formaldéhyde et des composants organiques volatils, mais aussi d’autres substances toxiques. Il complète l’interdiction de fabrication de produits cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR). De plus, des fiches de déclaration environnementale doivent étayer les déclarations des fabricants et la base qui les recense : la base INIES, créée par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), est à la disposition des professionnels. Une déclaration annuelle des fabricants, importateurs et distributeurs de nanomatériaux est également prévue si les quantités traitées dépassent 100 grammes.
Enfin, l’accompagnement des malades par des conseillers médicaux en environnement intérieur est partiellement financé par le PNSE 2. À Paris, la visite est remboursée si elle est prescrite par un spécialiste. À Tours, les associations visitent les patients admis aux urgences pour une crise d’asthme sévère. De cette façon, les bonnes pratiques peuvent se diffuser.
Contrairement à l’idée reçue, l’air intérieur est plus pollué que l’air extérieur, du fait de la conjonction de divers facteurs : meubles en bois collé ou en aggloméré, matériaux de construction ou de décoration, appareils de chauffage mal réglés – l’intoxication à l’oxyde de carbone fait encore une centaine de victimes par an –, cheminées à foyer ouvert, stockage de déchets, particules dégagées par les activités domestiques comme la cuisson, le bricolage ou le ménage – en raison des produits d’entretien –, présence d’animaux au poil allergisant, fumées de tabac, d’encens ou de bougies parfumées.
Les sources de pollution de l’air intérieur sont multiples : des produits, inoffensifs lorsqu’on les prend séparément, cessent de l’être lorsqu’ils se combinent, notamment dans les habitations les mieux isolées, où l’air est le plus confiné.
La démarche scientifique doit dès lors comprendre quatre étapes. La première consiste en l’identification du danger, c’est-à-dire des sources polluantes intérieures. La seconde est l’estimation de la relation dose-effet, qui vise à quantifier les effets sur l’organisme. La troisième est l’évaluation et la quantification de l’exposition. La quatrième consiste à estimer la probabilité et la gravité du risque sanitaire ainsi que des effets indésirables susceptibles de se produire. Pour étiqueter les matériaux de construction et de décoration, il a fallu établir une grille de classement adaptée, comportant une pondération des différentes substances identifiées, acceptable par les fabricants, et suffisamment discriminante pour que tous les produits ne figurent pas dans la même classe. Le défi est tel que l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) préconise même un étiquetage des produits d’entretien, rappelant les bonnes conditions d’utilisation.
La gouvernance de la pollution de l’air intérieure est touffue, car de nombreux acteurs interviennent : l’ANSES, l’INERIS, le CSTB, l’OQAI, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et les AASQA, et il convient d’éviter les doublons. En outre, des zones d’ombre subsistent, notamment à propos du radon dont le risque a été réévalué par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR).
Enfin, la lutte contre la pollution de l’air intérieur doit être conciliée avec d’autres exigences. Ainsi, la campagne de mesures menée dans les établissements scolaires montre que les contrôles risquent de coûter très cher là où des mesures simples à concevoir, sinon à mettre en œuvre, suffiraient : ouverture des fenêtres avant et après la classe, choix des matériaux et respect des conditions d’utilisation, respect d’un délai entre la fin d’un chantier et l’entrée des enfants dans les lieux, formation du personnel d’entretien. En outre, le souci de la qualité de l’air intérieur va à l’encontre des mesures de simplification des normes en matière de construction et de logement. En tout état de cause, il importe de sensibiliser les particuliers comme les professionnels à l’importance de l’aération et de la ventilation dans le cadre des travaux de rénovation énergétique, par exemple en étendant le diagnostic de performance énergétique (DPE) au contrôle de la qualité de l’air intérieur.
J’en viens à nos propositions relatives à la fiscalité environnementale sur laquelle nous avons des divergences de vues.
En ce qui concerne la fiscalité des carburants, je considère que la moindre taxation du gazole constitue une subvention indirecte dommageable à l’environnement. Elle doit être supprimée, en annulant le différentiel de taux de TICPE en faveur du gazole, voire en taxant davantage le gazole que l’essence, le premier émettant plus de polluants que la seconde. Le rééquilibrage du prix à la pompe pourrait être facilité par le caractère relativement faible du prix actuel des produits pétroliers. Il devrait être étalé dans le temps et s’appuyer sur un mécanisme compensateur pour des activités comme le transport routier de marchandises, qui recourt exclusivement au gazole.
S’agissant de ce dernier secteur, il convient d’internaliser davantage les coûts environnementaux, et je déplore l’abandon de l’écotaxe qui pénalise les investissements des infrastructures de transport et favorise l’abandon du « tout routier ». Je suis donc favorable au rétablissement des taux de la taxe à l’essieu qui avaient été diminués dans la perspective de l’entrée en vigueur de l’écotaxe.
Les montants actuels de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) « air » appliquée aux émissions atmosphériques, sont trop faibles, inférieurs à ceux pratiqués par certains pays voisins. Pour que cette taxe ait un effet incitatif à la réduction des émissions, il faut augmenter ses taux afin de les rendre supérieurs au coût marginal de dépollution.
M. Martial Saddier, rapporteur. Sur ce sujet, M. Roumégas et moi-même avons des approches différentes.
Je suis défavorable à un alourdissement de la fiscalité. S’agissant de la réduction du nombre de moteurs diesel au sein du parc automobile, j’observe que ce mouvement est amorcé, puisque la part des véhicules diesel a diminué de quinze points en quelques années, et qu’il se vend aujourd’hui plus de voitures roulant à l’essence qu’au gazole.
La Cour des comptes a appelé notre attention sur le fait que, lorsque l’on actionne un levier, par exemple celui du CO2,afin de contenir le réchauffement climatique, on risque de le faire au détriment d’autres actions, celles portant par exemple sur les NOx ou les particules fines. Il faut faire l’analyse d’ensemble de la chaîne des conséquences. Ainsi, chacun s’accorde à considérer que les véhicules électriques sont « propres », mais, en l’absence d’analyse complète de la filière, incluant notamment le recyclage de la batterie, l’innocuité environnementale de ces automobiles n’est pas prouvée. Par ailleurs, nous remplaçons, dans les villes, les petits véhicules diesel par des véhicules équipés de moteurs essence à trois cylindres qui ne sont pas nécessairement équipés de filtres à particules. La question est donc posée : le fait de privilégier un aspect ne risque-t-il pas d’en détériorer d’autres ?
Il faut encore rappeler que nos constructeurs se sont donné pour objectif de ramener d’ici à 2020 leur taux d’émission à 95 grammes de CO2 par kilomètre. Or, de telles transitions industrielles ne se font pas d’un claquement de doigts, et la disparition accélérée du diesel pourrait remettre en cause cet objectif et, partant, la politique de lutte contre le réchauffement climatique. J’ajoute qu’environ dix millions de véhicules très anciens sont encore en circulation en France et que leurs propriétaires, qui les utilisent tous les jours pour aller travailler, ne disposent pas forcément des moyens financiers de les remplacer du jour au lendemain.
Je souhaite donc que, comme avec les fonds « Air Bois » et « Air Industrie », nous privilégiions l’incitation, et que toute hausse de la fiscalité des carburants soit restituée aux particuliers pour les aider à changer les véhicules les plus anciens.
S’agissant des poids lourds, je rappelle qu’ils font l’objet de tests en conditions réelles, qu’ils sont à la norme Euro 6 depuis plus de deux ans, et que les véhicules utilitaires en centre-ville posent des problèmes de pollution bien plus importants. Je suis donc défavorable, compte tenu des efforts d’ores et déjà réalisés, à une hausse de la fiscalité appliquée aux poids lourds.
Enfin, l’industrie est le secteur qui a fourni le plus d’efforts au cours des vingt dernières années. Augmenter la fiscalité qui pèse sur elle serait injuste et méconnaîtrait le contexte de compétition internationale auquel elle est confrontée. Une approche incitative est donc préférable, à l’instar de ce que nous proposons avec l’expérimentation d’un fonds « Air Industrie » qui aiderait financièrement, sur une base volontaire, les industries ayant encore des marges de progrès, dans les zones où des PPA sont en cours, c’est-à-dire dans celles où un enjeu important existe.
Au-delà de ces divergences de vues portant sur la fiscalité, je tiens encore à remercier M. Roumégas, avec qui nous avons pu dégager des perspectives communes, et je ne désespère pas que les pouvoirs publics se saisissent de notre rapport afin de relever le double défi de la qualité de l’air dans notre pays et de la lutte contre le réchauffement climatique.
Mme Monique Rabin. Merci pour cet excellent rapport. Je déplore que les travaux du CEC ne connaissent pas une meilleure publicité, car ils sont d’une grande qualité. Nous serons à vos côtés pour que certaines de vos propositions soient traduites dans les lois à venir, notamment la loi de finances.
Lors de l’examen de la loi de finances pour 2016, les AASQA avaient fait part de leurs inquiétudes quant à leur financement. Comment envisagez-vous l’attribution des moyens nécessaires au fonctionnement de ces associations dont vous avez démontré l’utilité ?
La préoccupation de la qualité de l’air intérieur s’impose désormais au grand public. Or nos concitoyens sont assez perplexes sur les actions à entreprendre. Quels outils pourraient être mis à leur disposition pour les éclairer ? Les normes ne sont pas toujours aisées à comprendre, que ce soit lorsque l’on achète un meuble ou des produits d’entretien. Comment, d’autre part, mesurer soi-même la qualité de l’air dans son logement ou son entreprise ?
M. Jean-Louis Roumégas, rapporteur. La qualité de l’air intérieur constitue un sujet « émergent ». C’est l’une des causes majeures d’affections telles que les allergies, l’asthme et les maladies respiratoires. Nous manquons de données sanitaires en longue période pour les maladies plus graves, comme les cancers, mais de fortes suspicions existent.
C’est pourquoi nous demandons des recherches supplémentaires sur la qualité de l’air intérieur ainsi qu’une meilleure information du public, car les sources de pollution sont assez bien identifiées. Les mesures de concentration globale de polluants sont aisées à réaliser et peu onéreuses ; il est donc tout à fait opportun de les généraliser.
S’agissant du financement des AASQA, notre rapport formule des propositions. Il pourrait être justifié d’étendre les contributions à tous ceux qui participent à la pollution de l’air, y compris les secteurs de l’agriculture et du logement, car les AASQA ne sont actuellement financées que par l’industrie. Par ailleurs, une fraction de la TICPE pourrait être affectée à la couverture des besoins du réseau. Enfin, on pourrait s’appuyer sur les négociations entre l’État et les collectivités, dans le cadre des transferts de compétences organisés par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), afin de sanctuariser le financement des AASQA par les régions et départements. Nous proposons par ailleurs que le couple région-métropole ou région-agglomération soit chef de file de la lutte contre la pollution de l’air.
M. Martial Saddier, rapporteur. M. Roumégas a souligné qu’il existait un foisonnement d’informations et que l’ensemble était peu lisible. La qualité des mesures de la pollution de l’air ne doit pas être susceptible de contestations sur le plan scientifique. Je rappelle que nous proposons un dispositif s’appuyant sur la présentation des bulletins météo pour informer les Français.
Nous considérons que les AASQA sont les mieux placées pour ce faire, car elles disposent des compétences nécessaires, mais je suis bien placé, en tant que président du Comité national de l’air (CNA), pour savoir qu’elles doivent courir chaque année après les financements, ce qui, d’une part, mobilise leur énergie au détriment de l’activité qui constitue leur raison d’être, et, d’autre part, risque de les rendre quelque peu « frileuses » au moment de mettre sur la place publique le résultat de leurs travaux.
Or la qualité de l’air, demain plus que jamais, a besoin de transparence, de mesures de qualité diffusées quotidiennement à nos concitoyens. La vérité sur l’air qu’ils respirent leur est due. À cette fin les AASQA doivent être autonomes et jouir d’un financement pérenne, pluriannuel.
M. le président Claude Bartolone. C’est un sujet important. Nous voyons bien, en Île-de-France, la course aux subventions à laquelle Airparif est contrainte de se livrer auprès de la région ou des départements. Cette situation nuit au crédit des instruments de mesure de la qualité de l’air qu’utilisent ces associations.
Le rapport qui vient de nous être présenté est à la fois bien conçu est enrichissant, et certains de ses éléments gagneraient à être popularisés. Un certain nombre des thèmes abordés étaient latents, comme l’impact de la qualité de l’air sur le développement économique ; on sait par exemple qu’un certain nombre d’entreprises ne peuvent plus envoyer de cadres supérieurs à Shanghai, car ceux-ci mesurent le risque que représente la pollution pour la santé de leurs enfants.
L’enjeu industriel est réel, quelles que soient les différences susceptibles d’exister entre les rapporteurs au sujet de la fiscalité. La perspective d’une destruction massive de véhicules l’illustre à l’envi : nous devons réinventer la destruction massive aidée en période de paix – nous savons trop ce qu’elle représente en temps de guerre ! – et ce sans aggraver les inégalités.
J’ai été très intéressé par les développements relatifs aux réflexes quotidiens à acquérir, comme celui d’aérer les locaux d’habitation ou de travail, ainsi qu’à l’apparition de certains risques, souvent mal connus, comme celui résultant des bougies parfumées : qui, parmi ceux qui en achètent pour les offrir, sait qu’elles sont susceptibles de dégrader l’air ?
Je souhaite remercier une nouvelle fois nos rapporteurs pour la qualité de leurs travaux. Leur divergence de points de vue en matière fiscale ne fera qu’enrichir le débat, et je propose au Comité d’autoriser la publication du rapport.
Le Comité autorise la publication du présent rapport.
ANNEXE N° 1 :
VALEURS GUIDES SANITAIRES ET VALEURS DE GESTION
DE LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
France |
International | ||||
ANSES |
HCSP |
Europe/Index |
OMS | ||
Formaldéhyde |
Court terme |
50 μg/m3 (2 heures) |
30 μg/m3 (30 minutes) |
100 μg/m3 (30 minutes) | |
Long terme |
10 μg/m3 (2019) |
Valeur d’action rapide : 100 μg/m3 Valeur d’information et de recommandation : 50 μg/m3 Valeur repère : 30 μg/m3 Valeur cible : 10 μg/m3 |
- |
100 μg/m3 | |
Monoxyde de carbone (CO) |
24 heures |
- |
- |
- |
7 mg/m3 |
8 heures |
10 mg/m3 |
- |
10 mg/m3 |
10 mg/m3 | |
1 heure |
30 mg/m3 |
- |
30 mg/m3 |
35 mg/m3 | |
30 minutes |
60 mg/m3 |
- |
- |
- | |
15 minutes |
100 mg/m3 |
- |
- |
100 mg/m3 | |
Benzène |
Court terme |
30 μg/m3 (1-14 jours) |
Concentration aussi faible que possible |
- | |
Long terme – effets à seuil |
10 μg/m3 |
Valeur d’action rapide : 10 μg/m3 Valeur repère : 5 μg/m3 Valeur cible : 2 μg/m3 |
- | ||
Long terme – effets sans seuil |
2 μg/m3 pour une exposition la vie entière correspondant à un niveau de risque de 10-5 (a) |
1,7 μg/m3 pour une exposition la vie entière correspondant à un niveau de risque de 10-5 (a) | |||
Naphtalène |
Court terme |
- |
- |
- |
- |
Long terme |
10 μg/m3 |
Valeur d’action rapide : 50 μg/m3 Valeur repère : 10 μg/m3 |
10 μg/m3 |
10 μg/m3 | |
Trichloroéthylène |
Court terme |
- |
- |
- |
- |
Long terme – effets sans seuil |
20 μg/m3 pour une exposition la vie entière correspondant à un niveau de risque de 10-5 (b) |
Valeur d’action rapide : 10 μg/m3 Valeur repère : 2 μg/m3 |
- |
23 μg/m3 pour une exposition la vie entière correspondant à un niveau de risque de 10-5 (b) | |
Tétrachloroéthylène |
Court terme |
1 380 μg/m3 (1-14 jours) |
- |
- | |
Long terme |
250 μg/m3 |
Valeur d’action rapide : 1 250 μg/m3 Valeur repère : 250 μg/m3 |
- |
250 μg/m3 | |
Dioxyde d’azote |
Court terme |
- |
- |
200 μg/m3 (1 heure) |
200 μg/m3 (1 heure) |
Long terme |
- |
- |
40 μg/m3 |
40 μg/m3 | |
Benzo(a)pyrène (marqueur du mélange d’hydrocarbures aromatiques polycycliques [HAP]) |
Court terme |
- |
- |
- |
- |
Long terme |
- |
- |
- |
0,12 ng/m3 pour une exposition la vie entière correspondant à un niveau de risque de 10-5 (c) | |
Acétaldéhyde |
Court terme |
- |
- |
200 μg/m3 (d) |
- |
Long terme |
- |
- |
200 μg/m3 |
- | |
Xylènes |
Court terme |
- |
- |
20 mg/m3 (d) |
- |
Long terme |
- |
- |
200 μg/m3 |
- | |
Toluène |
Court terme |
- |
- |
15 mg/m3 (d) |
- |
Long terme |
- |
- |
300 μg/m3 |
- | |
Styrène |
Court terme |
- |
- |
2 000 μg/m3 (d) |
- |
Long terme |
- |
- |
250 μg/m3 |
- | |
Ammoniac |
Court terme |
- |
- |
100 μg/m3 (d) |
- |
Long terme |
- |
- |
70 μg/m3 |
- | |
Particules PM2,5 |
24 heures |
(e) |
- |
25 μg/m3 | |
Long terme |
(e) |
Valeur d’action rapide : 50 μg/m3 Valeur repère : 20 μg/m3 (f) Valeur cible : |
- |
10 μg/m3 | |
Particules PM10 |
24 heures |
(e) |
- |
50 μg/m3 | |
Long terme |
(e) |
Valeur d’action rapide : 75 μg/m3 Valeur repère : 30 μg/m3 (f) Valeur cible : |
20 μg/m3 | ||
ANSES : Agence nationale de la sécurité sanitaire en charge de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
HCSP : Haut Conseil de la santé publique.
OMS : Organisation mondiale de la santé.
(a) L’ANSES et l’OMS proposent également des valeurs respectivement égales à 0,2 et 0,17 μg/m3 pour une exposition la vie entière correspondant à un niveau de risque de 10-6.
(b) L’ANSES et l’OMS proposent également des valeurs respectivement égales à 2 et 2,3 μg/m3 pour une exposition la vie entière correspondant à un niveau de risque de 10-6.
(c) L’OMS propose également une valeur égale à 0,012 ng/m3 pour une exposition la vie entière à un niveau de risque de 10-6.
(d) Durée associée à la VGAI non précisée.
(e) L’ANSES recommande l’utilisation des valeurs proposées par l’OMS.
(f) Valeur guide long terme proposée par l’OMS.
ANNEXE N° 2 :
PERSONNES ENTENDUES PAR LES RAPPORTEURS
1. Auditions :
– Audition de Mme Elisa Lanzi, économiste, analyste des politiques à la direction de l’environnement de l’OCDE, et de M. Nils Axel Braathen, administrateur principal à la direction de l’environnement de l’OCDE (17 février 2015).
– Audition de M. Olivier Chanel, économiste, directeur de recherche au CNRS (17 février 2015).
– Audition de Mme Andrée Buchmann, présidente de l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI), accompagnée de M. Francis Allard, président du Conseil scientifique de l’OQAI (16 avril 2015).
– Audition de M. Étienne Crépon, président du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), accompagné de Mme Séverine Kirchner, directrice adjointe Recherche à la direction « Santé, confort » du CSTB, et coordinatrice scientifique de l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI) (21 mai 2015).
– Audition de M. Raymond Cointe, directeur général de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS), accompagné de Mme Martine Ramel, responsable du pôle Risques et technologies durables à la direction des risques chroniques de l’INERIS (21 mai 2015).
– Audition de Mme Guislaine Lobry, sous-directrice des écoles à la direction des affaires scolaires (DASCO) de la Ville de Paris, et de M. Georges Salines, chef du bureau de la santé environnementale et de l’hygiène de la Ville de Paris, accompagné de M. Claude Beaubestre, ingénieur responsable du département des pollutions physico-chimiques de l’environnement du laboratoire d’hygiène de la Ville de Paris (LHVP) (21 mai 2015).
– Audition de Mme Patricia Blanc, directrice générale de la prévention des risques, accompagnée de M. Xavier Strebelle, chef du bureau de la prospective, de l’évaluation et des données, et de M. Laurent Girometti, directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages à la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature, accompagné de Mme Marie-Christine Roger, cheffe du bureau de la qualité technique et de la réglementation technique de la construction, ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (17 juin 2015).
– Audition de M. Bernard Garnier, président d’ATMO France, accompagné de Mme Anne Laborie, secrétaire générale d’ATMO France, et de Mme Nathalie Leclerc, responsable qualité air intérieur d’ATMO Alsace (17 juin 2015).
– Audition de M. Olivier Toma, président du Comité développement durable santé (c2ds) (17 juin 2015).
– Audition de M. Xavier Bonnet, chef du service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable, et de Mme Doris Nicklaus, cheffe du bureau de l’évaluation des politiques des risques, de l’eau et des déchets, au Commissariat général au développement durable (1er juillet 2015).
– Audition de M. Dominique Gombert, directeur de l’évaluation des risques, de Mme Valérie Pernelet-Joly, chef de l’unité d’évaluation des risques liés à l’air à la direction de l’évaluation des risques, et de M. Guillaume Boulanger, adjoint au chef de l’unité d’évaluation des risques liés à l’air, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) (1er juillet 2015).
– Audition de Mme Isabella Annesi-Maesano, directeur de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), de M. Christophe Rafenberg, chercheur associé à l’unité « Épidémiologie des maladies Allergiques et Respiratoires » (EPAR) (Inserm-Paris 6), et de M. Gilles Dixsaut, médecin, centre de pneumologie Cochin-Hôtel-Dieu (1er juillet 2015).
– Audition de Mme Karima Delli, députée européenne (3 mars 2016).
– Audition de M. Nicolas Le Bigot, directeur technique du Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA), accompagné de M. Pierre-Louis Debar, directeur Économie, statistiques et transports (17 mars 2016).
– Audition de M. Jean-Félix Bernard, président d’AIRPARIF, et de M. Frédéric Bouvier, directeur (6 avril 2016).
2. Tables rondes :
– Table ronde sur les enjeux de santé publique liés à la pollution de l’air intérieur, (19 mars 2015), en présence de :
. M. Frédéric de Blay, professeur à la faculté de médecine de Strasbourg ;
. M. Pierre Souvet, président de l’Association Santé Environnement France (ASEF) ;
. Mme Marie-Pierre Rinn, présidente de l’antenne de Tours de l’association Asthme & Allergies ;
. M. Olivier Andrault, chargé de mission Agriculture et alimentation de l’UFC Que Choisir ;
. Mme Ghislaine Palix-Cantone, chef du bureau de l’environnement intérieur, milieux de travail et accidents de la vie courante, Mme Caroline Paul, chef du bureau de l’environnement extérieur et produits chimiques, et Mme Corinne Drougard, adjointe au chef du bureau de l’environnement intérieur, milieux de travail et accidents de la vie courante, à la direction générale de la santé ;
. Mme Isabelle Momas, professeur des universités, directeur de l’unité de recherche « Épidémiologie environnementale : impact sanitaire des pollutions » de l’université Paris Descartes.
– Table ronde sur l’étude exploratoire du coût socio-économique des polluants de l’air intérieur de juin 2014 (16 avril 2015), réunissant des auteurs de cette étude :
. Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) : M. Guillaume Boulanger, adjoint au chef de l’unité d’évaluation des risques liés à l’air, direction de l’évaluation des risques, et M. Thomas Bayeux, économiste à l’unité « risques et société », direction de l’information, de la communication et du dialogue avec la société ;
. Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) : Mme Séverine Kirchner, directrice adjointe Recherche à la direction « Santé, confort », coordinatrice scientifique de l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI).
– Table ronde sur la gouvernance des politiques publiques de lutte contre la pollution de l’air : Comment la planification et le pilotage des mesures de lutte contre la pollution de l’air pourraient-ils gagner en efficacité ? (3 février 2016), en présence de :
. M. Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat (DGEC) au ministère de l’écologie, accompagné de M. Loïc Buffard, sous-directeur de l’efficacité énergétique et de la qualité de l’air, et de Mme Edwige Duclay, cheffe du bureau de la qualité de l’air ;
. M. José Caire, directeur Villes et territoires durables, Mme Joëlle Colosio, directrice régionale Île-de-France, et Mme Marie Pouponneau, ingénieur au service Évaluation de la qualité de l’air, à l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie (ADEME) ;
. M. Benoît Bulliot, manager Environnement et Stratégie, référent Air et Santé pour la société I Care & Consult ;
. Mme Isabelle Roussel, présidente de l’Association pour la prévention de la pollution atmosphérique (APPA).
– Table ronde sur la pollution de l’air d’origine industrielle : Comment l’industrie et le secteur de l’énergie s’adaptent-ils à la lutte contre la pollution de l’air ? (11 février 2016), en présence de :
. M. Jean-Luc Perrin, sous-directeur des risques chroniques et du pilotage à la direction générale de la prévention des risques (DGPR) du ministère de l’environnement, accompagné de M. Serge Artico, chef du bureau de la réglementation, du pilotage de l’inspection et des contrôles et de la qualité ;
. M. Raymond Cointe, directeur général de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS), et Mme Laurence Rouil, responsable du pôle modélisation et aide à la décision ;
. M. Philippe Prudhon, directeur des affaires techniques, et M. Thomas Senac, président du comité environnement, de l’Union des industries chimiques (UIC) ;
. Mme Isabelle Muller, déléguée générale de l’Union française des industries pétrolières (UFIP) *, accompagnée de M. Jean-Yves Touboulic, directeur raffinage, et de M. Bruno Ageorges, directeur des relations institutionnelles et des affaires juridiques.
– Table ronde sur la pollution de l’air d’origine agricole : Comment l’agriculture s’adapte–t–elle à la lutte contre la pollution de l’air ? (18 février 2016), en présence de :
. M. Rik Vandererven, adjoint au sous-directeur de la performance environnementale à la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) du ministère de l’agriculture, accompagné de Mme Nathalie Guesdon, cheffe du bureau Changement climatique et biodiversité ;
. M. Louis Cayeux, sous-directeur au développement durable à la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) ;
. M. Jacques Pasquier, membre du pôle Agriculture et environnement à la Confédération paysanne ;
. M. Antoine Henrion, élu « référent air » à l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) *, membre du Conseil national de l’air, accompagné de Mme Sophie Agasse, responsable des dossiers impacts environnementaux à l’APCA * ;
. M. Jérôme Mousset, chef du service Agriculture et forêts à l’ADEME, accompagné de M. Thomas Eglin, en charge des questions sur l’air ;
. Mme Charlotte Lepitre, coordinatrice du réseau santé-environnement, et M. Camille Dorioz, chargé de mission agriculture, chez France nature environnement (FNE) *.
– Table ronde sur le renouvellement du parc des véhicules routiers : Comment améliorer la qualité des véhicules routiers pour réduire la pollution de l’air ? (3 mars 2016), en présence de :
. M. Dominique Bureau, président du Comité pour l’économie verte ;
. M. François Cuenot, chargé de mission « émissions de véhicules » à l’ONG Transport & Environment ;
. Mme Marie Castelli, secrétaire générale d’AVERE-France, association pour le développement de la mobilité électrique ;
. M. Dominique Herrier, directeur adjoint du Centre de résultats Transports de l’IFP Énergies nouvelles (IFPEN) ;
. M. Gilles Lacan, président d’Écologie sans frontière, accompagné de Mme Marion Bes, assistante juridique.
– Table ronde sur la régulation du trafic routier : Comment mieux réguler le trafic routier pour réduire la pollution de l’air ? (10 mars 2016), en présence de :
. Mme Christine Bouchet, adjointe au directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministère de l’environnement ;
. M. Pascal Dupuis, chef du service du climat et de l’efficacité énergétique à la direction générale de l’énergie et du climat du ministère de l’environnement, accompagné de M. Thomas Bouyer, adjoint au chef du bureau de la qualité de l’air ;
. Mme Florence Berthelot, déléguée générale adjointe, et Mme Elisabeth Charrier, secrétaire générale Île-de-France et Centre, de la Fédération nationale des transporteurs routiers (FNTR) ;
. M. Sébastien Vray, porte-parole de RESPIRE (Association nationale pour la préservation et l’amélioration de la qualité de l’air) ;
. M. Olivier Binet, président de Karos.
– Table ronde sur la pollution d’origine résidentielle : Comment réduire la pollution de l’air émise par le secteur résidentiel ? (17 mars 2016), en présence de :
. M. Loïc Buffard, sous-directeur de l’efficacité énergétique et de la qualité de l’air à la direction générale de l’énergie et du climat du ministère de l’environnement ;
. M. Gilles Aymoz, chef du service Bâtiment de l’ADEME ;
. M. Pascal Housset, représentant de la Fédération française du bâtiment (FFB) i, accompagné de Mme Stéphanie Brouzes, ingénieur environnement ;
. M. Didier Chapuis, directeur territorial d’Air Rhône-Alpes ;
. M. Thierry Rocque, délégué Relations institutionnelles à la direction Développement de GrDF.
3. Déplacement à Paris sur la gestion des pics de pollution (24 mars 2016) :
• Agence régionale de santé (ARS) Île-de-France : Mme Nadine Weissleib, directrice du pôle Veille et sécurité sanitaires, Mme Cécile Somarriba, coordinatrice de la cellule Veille et alerte, et Mme Céline Legout, ingénieure à l’Institut national de veille sanitaire (InVS) ;
• Préfecture de Paris et d’Île-de-France : M. Jean-François Carenco, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, Mme Isabelle Derville, directrice adjointe à la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement (DRIEA), Mme Aurélie Vieillefosse, directrice adjointe à la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE), Mme Clara Herer, chef du service Énergie, climat, véhicules à la DRIEE, et M. Sébastien Maes, chargé de mission au secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) ;
• Préfecture de police de Paris : M. Michel Cadot, préfet de police de Paris, M. Jean-Paul Kihl, préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris, M. Philippe Dalbavie, conseiller technique en charge des affaires juridiques au cabinet du préfet, M. Jean Benet, directeur des transports et de la protection du public, et M. Muriel Rault, commissaire divisionnaire, adjoint au sous-directeur régional de la circulation et de la sécurité routières ;
• Mairie de Paris : M. Christophe Najdovski, adjoint à la Maire de Paris chargé des transports, et M. Hervé Levifve, conseiller technique.
CONTRIBUTION DE LA COUR DES COMPTES À L’ÉVALUATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES DE LUTTE
CONTRE LA POLLUTION DE L’AIR
Cette contribution peut être consultée à l’adresse suivante :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i3772.pdf
1 () Pollution de l’air : le coût de l’inaction, rapport n° 610 de Mme Leila Aïchi remis le 8 juillet 2015 au Président du Sénat, tome I, p. 93 (Sénat – session extraordinaire de 2014-2015).
2 () Contribution écrite remise à l’issue de l’audition du 1er juillet 2015.
3 () Pollution de l’air : le coût de l’inaction, rapport précité, p. 104.
4 () Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe.
5 () Pollution de l’air : le coût de l’inaction, rapport précité, pp. 276-277.
6 () Pollution de l’air : le coût de l’inaction, rapport précité, p. 88.
7 () OCDE, Perspectives de l’environnement de l’OCDE à l’horizon 2050. Les conséquences de l’inaction, 2012, p. 370.
8 () Les politiques publiques de lutte contre la pollution de l’air, enquête demandée par le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, décembre 2015, p. 38.
9 () Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI), Étude exploratoire du coût socio-économique des polluants de l’air intérieur, avril 2014, p. 21.
10 () À titre d’illustration, l’intervalle retenu pour l’asthme va de 10 à 35 %.
11 () Christophe Rafenberg, Gilles Dixsaut et Isabella Annesi-Maesano, « Évaluation a minima du coût de la pollution atmosphérique pour le système de soins français », Environnement Risques & Santé volume 14 n° 2, avril-mai 2015.
12 () Perspectives de l’environnement de l’OCDE à l’horizon 2050. Les conséquences de l’inaction, rapport précité, p. 315.
13 () L’estimation de la dose-effet vise à quantifier la relation entre la dose d’exposition et la réponse de l’organisme ou sa probabilité de réponse.
14 () Commission des comptes et de l’économie de l’environnement, Santé et qualité de l’air extérieur, rapport préparé par le Commissariat général au développement durable, juillet 2012, p. 30.
15 () OCDE, Le coût de la pollution de l’air : Impacts sanitaires du transport routier, 2014, p. 32.
16 () « Évaluation a minima du coût de la pollution atmosphérique pour le système de soins français », article précité. Les broncho-pneumopathies obstructives chroniques (PBCO) auraient été ainsi confondues avec les bronchites chroniques.
17 () Pollution de l’air : le coût de l’inaction, rapport précité, pp. 93 et 94.
18 () Ibid., p. 98.
19 () OCDE, La valorisation du risque de mortalité dans les politiques de l’environnement, de la santé et des transports, 2012, p. 13.
20 () Les deux autres principales méthodes sont, d’une part, les indemnités versées par les compagnies d’assurance aux victimes d’accidents (mais ces indemnités ne couvrent que les préjudices assurés) et, d’autre part, l’estimation de la perte que va subir la société du fait de la mort ou des blessures d’un individu (méthode dite du capital humain).
21 () Vincent Biausque, « Valeur statistique de la vie humaine : une méta-analyse », Note de travail ENV/EPOC/WPNEP(2010)9/FINAL, OCDE, 20 janvier 2011, p. 8.
22 () Ibid, p. 4. Il y a lieu de noter que, par la suite, plusieurs centaines d’estimations de la valeur de la vie statistique, qui ne répondaient pas aux critères qualitatifs définis par l’OCDE, ont été retirées en 2012 de cet échantillon initial, l’échantillon final ne comportant que 366 évaluations de cette valeur.
23 () La valorisation du risque de mortalité dans les politiques de l’environnement, de la santé et des transports, rapport précité, p. 15.
24 () Commissariat général à la stratégie et à la prospective, Éléments pour une révision de la valeur de la vie humaine, avril 2013, p. 14.
25 () Document remis le 2 février 2015 par Mme Elisa Lanzi et M. Nils Axel Braathen à l’issue de leur audition.
26 () Commissariat général à la stratégie et à la prospective, L’évaluation socio-économique des investissements publics, septembre 2013, p. 108.
27 () Le coût de la pollution de l’air : Impacts sanitaires du transport routier, rapport précité, pp. 59-60.
28 () La formule mathématique employée par l’OCDE est plus complexe car elle intègre des éléments liés à la croissance du PIB réel, à la hausse des prix à la consommation et au taux de change corrigé des parités de pouvoir d’achat de la zone ou du pays considéré, mais elle peut être synthétisée de cette manière.
29 () Le coût de la pollution de l’air : Impacts sanitaires du transport routier, rapport précité, p. 58.
30 () Economic cost of the health impact of air pollution in Europe, avril 2015, pp. 9 et 25.
31 () Les politiques publiques de lutte contre la pollution de l’air, enquête annexée, p. 28.
32 () Intervention écrite remise par M. Chanel à l’issue de son audition du 17 février 2015.
33 () Communication de la Cour des comptes sur l’évaluation des politiques de lutte contre le tabagisme de décembre 2012 annexée au rapport d’information n° 764 La lutte contre le tabagisme : quinze propositions pour répondre à un enjeu majeur de santé publique présenté par MM. Denis Jacquat et Jean-Louis Touraine le 28 février 2013 (Assemblée nationale – XIVe législature), p. 40.
34 () Éléments pour une révision de la valeur de la vie humaine, rapport précité, p. 17.
35 () Santé et qualité de l’air extérieur, rapport précité, p. 36.
36 () Cour des comptes, La prévention sanitaire, communication à la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale, octobre 2011, p. 50. Cette méthode est aujourd’hui privilégiée par la Haute autorité de santé (HAS) dans ses analyses médico-économiques (Cf. les Choix méthodologiques pour l’évaluation économique à la HAS publiés en octobre 2011, p. 9).
37 () Étude exploratoire du coût socio-économique des polluants de l’air intérieur, rapport précité, p. 25.
38 () L’évaluation socio-économique des investissements publics, rapport précité, p. 110.
39 () En outre, pour démontrer ces effets « mélange », il faut recourir à un protocole expérimental complexe : on expose un groupe d’animaux à un polluant, un autre groupe à un autre polluant et un troisième groupe aux deux polluants.
40 () Pollution de l’air : le coût de l’inaction, rapport précité, p. 101.
41 () Ibid., pp. 140-141.
42 () Pollution de l’air : le coût de l’inaction, rapport précité, p. 146.
43 () Cf. le rapport précité Santé et qualité de l’air extérieur de la Commission des comptes et de l’économie de l’environnement, p. 45.
44 () Les politiques publiques de lutte contre la pollution de l’air, enquête précitée, p. 28.
45 () Entendu ici comme l’ensemble des intervenants publics ou privés, des opérateurs de soins et des prestataires de services qui contribuent à la prise en charge du patient, de ses séquelles ou de son accompagnement.
46 () « Évaluation a minima du coût de la pollution atmosphérique pour le système de soins français », article précité.
47 () Commissariat général au développement durable (CGDD), « Pollution de l’air et santé : les maladies respiratoires et le coût pour le système de soin », Le point sur n° 176, octobre 2013, p. 4.
48 () « Évaluation a minima du coût de la pollution atmosphérique pour le système de soins français », article précité.
49 () Commissariat général du développement durable (CGDD), « Estimation des coûts pour le système de soins français de cinq maladies respiratoires et des hospitalisations attribuables à la pollution de l’air », Études & documents n° 122, avril 2015, pp. 29-30. À titre d’illustration, faute de données, il n’est pas possible de déterminer le nombre de nouveaux malades d’asthme durant une année pleine.
50 () « Évaluation a minima du coût de la pollution atmosphérique pour le système de soins français », article précité.
51 () « Évaluation a minima du coût de la pollution atmosphérique pour le système de soin français », article précité.
52 () Des travaux de l’EPAR sont en cours sur ces deux sujets. Les retards de croissance peuvent être dus aux perturbateurs endocriniens mais aussi à une mauvaise vascularisation du fœtus due à la pollution de l’air.
53 () Les politiques publiques de lutte contre la pollution de l’air, enquête précitée, p. 28.
54 () Les politiques publiques de lutte contre la pollution de l’air, enquête annexée, p. 8.
55 () Qualité de l’air et changement climatique : des problématiques liées, La Lettre Recherche ADEME & vous n° 13, décembre 2015, p. 2.
56 () L’INERIS quantifie l’effet du changement climatique sur la pollution à l’ozone, 3 septembre 2015.
57 () Ces outils sont analysés de manière détaillée dans la deuxième partie du présent rapport (dans le 2 du I.A.).
58 () IFP Énergies nouvelles, Panorama 2016. Le point sur… Le Diesel, janvier 2016, p. 3.
59 () Conseil général de l’environnement et du développement durable, Premier bilan de la mise en place des schémas régionaux Climat-Air-Énergie (SRCAE), mars 2013, p. 28.
60 () Enquête annexée, p. 54.
61 () Compte tenu de leur rôle clef, les PPA feront l’objet d’un commentaire distinct.
62 () Ce chiffre est indicatif, l’ADEME ne disposant pas d’un outil de recensement spécifique de ces plans.
63 () Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), Inspection générale de l’administration (IGA) et Inspection générale des affaires sociales (IGAS), La gestion des pics de pollution de l’air, juillet 2015, p. 48.
64 () Premier bilan de la mise en place des schémas régionaux Climat-Air-Énergie (SRCAE), rapport précité p. 36.
65 () La gestion des pics de pollution de l’air, rapport précité, p. 48.
66 () Enquête annexée, p. 57.
67 () On peut y ajouter quatre plans locaux pour la qualité de l’air ou PLQA (à Niort, Poitiers, Limoges et Chambéry), un dispositif alternatif aux PPA prévu par l’article R. 222-13-1 du code de l’environnement.
68 () Enquête annexée, p. 57.
69 () Enquête annexée, p. 8.
70 () Enquête annexée, p. 54.
71 () Commissariat général au développement durable (CGDD), Proposition d’indicateurs de suivi de la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable, Études & documents n° 127, juin 2015, p. 71.
72 () La directive fixe un seuil d’alerte pour trois substances seulement : le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde d’azote (NO2) et l’ozone (O3). Pour les seuils d’information, seul l’ozone est concerné.
73 () Enquête annexée, pp. 83 et 110.
74 () Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), Inspection générale de l’administration (IGA) et Inspection générale des affaires sociales (IGAS), La gestion des pics de pollution de l’air, juillet 2015, p. 22.
75 () Rapport n° 601 précité, p. 53 (tome I, proposition n° 8).
76 () Ce constat s’appuie sur une modélisation qui intègre les données des stations de fond mesurant les caractéristiques chimiques d’une masse d’air moyenne. Ces stations de type urbain, périurbain et rural permettent le suivi de l’exposition moyenne de la population aux polluants atmosphériques.
77 () La gestion des pics de pollution de l’air, rapport précité, p. 51.
78 () Épisodes de pollution en Île-de-France, bilan synthétique de l’année 2015.
79 () Enquête annexée, p. 79.
80 () La gestion des pics de pollution de l’air, rapport précité, p. 16.
81 () Sylvia Medina, Des polluants atmosphériques qui altèrent notre santé, journée scientifique « Météo et climat », Institut national de veille sanitaire, 24 novembre 2014, p. 43.
82 () Enquête annexée, p. 113.
83 () Premier bilan de la mise en place des schémas régionaux Climat-Air-Énergie (SRCAE), rapport précité, p. 28.
84 () Enquête annexée, p. 113.
85 () Ce budget élevé s’explique aussi par le soin apporté à l’évaluation d’une opération ayant vocation à être démultipliée à l’échelle nationale.
86 () La gestion des pics de pollution de l’air, rapport précité, p. 55.
87 () Enquête annexée, p. 113.
88 () Vert : pas de vigilance particulière ; jaune : attention particulière en cas d’activités sensibles aux risques météorologiques ; orange : grande vigilance requise face aux phénomènes dangereux prévus ; rouge : vigilance absolue face à des phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle.
89 () Enquête annexée, p. 108.
90 () Enquête annexée, p. 109.
91 () Le réexamen de l’indice Atmo est prévu, en particulier son lien avec les seuils réglementaires, la représentativité des stations de mesure et la prise en compte des différents polluants.
92 () La gestion des pics de pollution de l’air, rapport précité, p. 27.
93 () Enquête annexée, p. 113.
94 () Enquête annexée, p. 100.
95 () Fédération nationale des transporteurs routiers (FNTR), Le livre vert du transport routier de marchandises, septembre 2015, p. 11.
96 () CITEPA, Rapport national d’inventaire – inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre en France, format SECTEN, avril 2015, p. 173.
97 () Commissariat général au développement durable (CGDD), Bilan de la qualité de l’air en France en 2014 et principales tendances observées sur la période 2000-2014, septembre 2015, p. 22.
98 () Airparif, Surveillance & information sur la qualité de l’air en Île–de–France. Bilan année 2015, avril 2016, p. 3.
99 () Rapport national d’inventaire précité, p. 26.
100 () Les problèmes que soulève le contrôle de ces normes seront abordés plus loin (Cf. le 3 du I.A. de cette partie).
101 () Émissions de particules et de NOX par les véhicules routiers, avis de l’ADEME, juin 2014, p. 4.
102 () Le point sur… Le Diesel, article précité, p. 3.
103 () Avis précité de l’ADEME, p. 6.
104 () Comité des constructeurs français d’automobiles, L’industrie automobile française, Analyse et statistiques 2015, juillet 2015, p. 34.
105 () Le barème de cette taxe créée en 1979 était appliqué jusqu’au 30 septembre 2013 sur la quantité de CO2 émise par les véhicules. Depuis lors, la TVS comprend aussi un barème qui tient compte des différences de niveaux de pollution émise par les véhicules selon leur type de motorisation et selon leur année de mise en service.
106 () Enquête annexée, p. 49.
107 () L’écart de taxation entre le gazole et l’essence, avis n° 3 du Comité pour la fiscalité écologique, 18 avril 2013. Sur le second point, une étude de la Commission européenne de 2012, citée par le comité, montre que les émissions de NOX sont supérieures de 72 % pour le gazole par rapport à l’essence.
108 () Enquête annexée, p. 50.
109 () Taux réduit sur le gazole sous condition d’emploi – le fioul domestique ou le gazole non routier utilisé pour les tracteurs agricoles (1,8 milliard d’euros) – et remboursement d’une fraction de la TICPE sur le gazole utilisé par certains véhicules lourds (375 millions d’euros).
110 () L’industrie automobile française, rapport précité, p. 38.
111 () Commissariat général au développement durable (CGDD), Chiffres et statistiques n° 747, avril 2016, p. 1.
112 () Le point sur … Le Diesel, article précité, p 2.
113 () Enquête annexée, p. 44.
114 () Élaboration selon les principes des ACV des bilans énergétiques, des émissions de gaz à effet de serre et des autres impacts environnementaux induits par l’ensemble des filières de véhicules électriques et de véhicules thermiques, VP de segment B (citadine polyvalente) et VUL à l’horizon 2012 et 2020, étude réalisée pour le compte de l’ADEME par Gingko21 et PE International, novembre 2013, p. 28.
115 () Fanny Velay-Lasry, Pourquoi les véhicules électriques sont une solution de mobilité durable ?, décembre 2015.
116 () On estime en outre, les véhicules électriques étant trop récents pour qu’on dispose de certitudes en la matière, que la batterie pourrait perdre jusqu’à 25 % de son autonomie après dix ans d’utilisation.
117 () Chiffres et statistiques n° 747, étude précitée du CGDD, p. 2.
118 () Bilan précité des filières de véhicules thermiques et électriques, p. 12 et p. 18.
119 () Rapport national d’inventaire du CITEPA précité, p. 172.
120 () L’industrie automobile française, rapport précité, p. 45.
121 () Le cabotage est une prestation concernant le fret, dont le chargement et le déchargement sont réalisés au sein d’un même pays par un transporteur appartenant à un autre pays de l’Union européenne.
122 () Pour une politique durable du transport de marchandises : l’éco-redevance poids-lourds, rapport d’information n° 1937 présenté par M. Jean-Paul Chanteguet et déposé le 14 mai 2014. Le contrat conclu avec la société Ecomouv’ pour collecter cette taxe a fait l’objet, au Sénat, d’un rapport d’enquête présenté par Mme Virginie Klès (rapport n° 543 déposé le 21 mai 2014).
123 () Pollution de l’air : le coût de l’inaction, rapport précité, p. 155.
124 () Enquête annexée, p. 100.
125 () Communication à la Commission des affaires européennes sur les mesures des émissions de polluants atmosphériques dans le secteur automobile, compte rendu n° 250 du 13 janvier 2016.
126 () Document de travail des services de la Commission européenne, Additional analysis to complement the impact assessment supporting the Review of the type-approval framework for motor vehicles, SWD (2016) 9 final, 27 janvier 2016.
127 () Émissions de particules et de NOX par les véhicules routiers, avis précité, p. 3.
128 () Soit un plafond d’émission de 80 milligrammes de NOX par kilomètre (contre 45 mg/km aux États-Unis et même 35 dans l’État de Californie).
129 () Agence européenne de l’environnement, Explaining road transport emissions, rapport publié le 27 janvier 2016, p. 37.
130 () La Commission européenne dispose du pouvoir de modifier les éléments purement techniques des actes de portée générale adoptés par les institutions européennes. Ses propositions sont alors examinées, au titre de la « comitologie », par un comité technique, qui doit les adopter à la majorité qualifiée, le Parlement européen et le Conseil disposant ensuite de trois mois pour s’opposer à la mesure.
131 () Résolution du 27 octobre 2015 sur la mesure des émissions dans le secteur automobile [2015/2865(RSP)].
132 () Compte rendu n° 28 de la mission d’information sur l’offre automobile française dans une approche industrielle, fiscale et énergétique, mercredi 10 février 2016.
133 () Audition de M. Carlos Tavares, président du directoire de PSA Peugeot Citroën, accompagné de M. Gilles Le Borgne, par la Commission des affaires économiques, compte rendu n° 44, mercredi 15 avril 2015.
134 () Les politiques publiques de lutte contre la pollution de l’air, enquête annexée, p. 8.
135 () Chiffres communiqués respectivement par le Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA), l’IFP Énergies nouvelles et la Ville de Paris.
136 () IFP Énergies nouvelles, Le point sur… Le GNL dans le transport : quel potentiel pour la filière ?, décembre 2015.
137 () The World Is Changing. Transport, Too, direction générale des politiques internes du Parlement européen, étude pour la Commission TRAN, janvier 2016, p. 102.
138 () ADEME, Les zones à faible émission (Low Emissions Zones) à travers l’Europe : déploiement, retours d’expérience, évaluations d’impact, efficacité du système, mise à jour de juin 2014, p. 8.
139 () Annexes de l’enquête, p. 13.
140 () Les zones à faible émission (Low Emissions Zones) à travers l’Europe, étude précitée de l’ADEME, p. 60.
141 () Idem, p. 4.
142 () ADEME, Zones d’actions prioritaires pour l’air (ZAPA). Synthèse des études de faisabilité réalisées par sept collectivités françaises, rapport final, février 2015.
143 () À titre d’illustration, les coûts des dispositifs de contrôle des véhicules ayant le droit de circuler dans ces zones était estimé, pour la ville de Grenoble, à 1,3 million d’euros pour les investissements et 900 000 euros annuels pour le fonctionnement.
144 () Annexes de l’enquête de la Cour des comptes, p. 56.
145 () Zones d’actions prioritaires pour l’air (ZAPA). Synthèse des études de faisabilité précitée, p. 7.
146 () Annexes de l’enquête de la Cour des comptes, p. 57.
147 () CGDD, Le covoiturage pour les déplacements domicile-travail : quel potentiel ?, Études & documents n° 107, juin 2014, pp. 20 et 28. Le Commissariat n’a pas évalué cet impact en termes de réduction des émissions de polluants atmosphériques, ce qu’on peut regretter.
148 () ADEME, Leviers d’actions pour favoriser le covoiturage de courte distance, évaluation de l’impact sur les polluants atmosphériques et le CO2, septembre 2015, pp. 48-49.
149 () Enquête auprès des utilisateurs du covoiturage longue distance, septembre 2015, p. 15.
150 () Les nouvelles mobilités sereines et durables : concevoir et utiliser des véhicules écologiques, rapport n° 1713 (Assemblée nationale) fait au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques (OPECST) et déposé le 16 janvier 2014, p. 73.
151 () Compte rendu n° 28 de la mission d’information sur l’offre automobile dans une approche industrielle, fiscale et énergétique, mercredi 10 février 2016.
152 () Résolution sur la révision des procédures de mesure des émissions de polluants atmosphériques, considérée comme définitive le 26 février 2016 (texte adopté n° 684).
153 () Rapport n° 3484 fait au nom de la commission du développement durable sur la proposition de résolution et préparé par M. Michel Lesage, 9 février 2016, p. 19.
154 () Enquête annexée, p. 66.
155 () À titre de comparaison, la TGAP sur les déchets a rapporté 423,4 millions d’euros.
156 () Enquête annexée, p. 89.
157 () Commissariat général au développement durable, La fiscalité environnementale en France : un état des lieux, avril 2013, p. 23.
158 () INERIS, Étude de mesures économiques et structurelles pour réduire les émissions de NOX, de SO2, de COV et de NH3, septembre 2002, p. 13.
159 () 617 contrôles d’ICPE en autorisation ou en déclaration ont fait suite à une plainte en 2015, 535 en 2014.
160 () CGEDD, Audit du programme n° 181 « Prévention des risques », mai 2012, p. 166.
161 () Étude de mesures économiques et structurelles pour réduire les émissions de NOX, de SO2, de COV et de NH3, rapport précité, p. 14.
162 () La fiscalité environnementale en France : un état des lieux, rapport précité, p. 22.
163 () CGDD, Études & documents n° 136 « Les pollutions par les engrais azotés et les produits phytosanitaires : coûts et solutions », décembre 2015.
164 () Pesticides et agro-écologie, les champs du possible, novembre 2014.
165 () Usage des pesticides en agriculture : effets des changements d’usage des sols sur les variations de l’indicateur NODU, Nicolas Urruty, Jean Boiffin, Hervé Guyomard, Tanguy Deveaud.
166 () Sénat, rapport n° 610 « Pollution de l’air : le coût de l’inaction » de M. Jean-François Husson et Mme Leïla Aïchi, p. 140.
167 () Von Hoffen L.P., Säumel I., 2014, « Orchards for edible cities : Cadmium and lead content in nuts, berries, pome and stone fruits harvested within the inner city neighbourhoods in Berlin, Germany », Ecotoxicology and Environmental Safety.
168 () 180 000 personnes ont accepté de répondre au premier questionnaire.
169 () Les notes du Conseil d’analyse économique n° 27, « L’agriculture française à l’heure des choix », décembre 2015.
170 () Un méthaniseur territorial traite des effluents agricoles, mais majoritairement d’autres types de déchets provenant du territoire.
171 () Le biocontrôle est défini comme un ensemble de méthodes de protection des cultures basées sur le recours à des organismes vivants ou des substances naturelles (source : INRA).
172 () S’appuyant sur la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe.
173 () INRA, « Les flux d’azote liés aux élevages, Réduire les pertes, rétablir les équilibres », janvier 2012.
174 () Meynard J.M., Charlier A. et alii, « La diversification des cultures : comment la promouvoir ? », mai 2015.
175 () ADEME-CITEPA, « Analyse du potentiel de 10 actions de réduction des émissions d’ammoniac des élevages français aux horizons 2020 et 2030 », Étude prospective – Synthèse, décembre 2013 p. 9.
176 () Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural.
177 () Par rapport à 2012.
178 () La Commission entend augmenter les possibilités de contribution au titre du budget de l’UE pour la période 2014-2020 : « Les fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) permettront d’affecter environ 19 milliards d’euros à l’efficacité énergétique et 6 milliards d’euros aux énergies renouvelables, notamment dans le secteur des bâtiments et dans celui du chauffage et du refroidissement urbains, et environ 1 milliard d’euros aux réseaux de distribution intelligents. » in Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-51-FR-F1-1.PDF
179 () Composants organiques volatils.
180 () Hydrocarbures aromatiques polycycliques.
181 () Les Avis de l’ADEME Bois énergie et qualité de l’air, décembre 2015.
182 () Partie pour million, unité de mesure conventionnelle.
183 () Sont exclus les bâtiments à pollution spécifique, c’est-à-dire, selon l’article R. 4222-3 du code du travail, « les locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine ainsi que les locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et les locaux sanitaires. »
184 () France, Suède, Grèce, Danemark, Belgique, Pologne, Italie.
185 () L’ensemble des valeurs est récapitulé en annexe n° 1.
186 () Expertise en appui à l’étiquetage des produits d’ameublement, avis de l’ANSES, juin 2015.
187 () Conseil national de l’air.
188 () Qualité de l’air : orientations stratégiques de l’ADEME, Période 2015-2020, p. 5
189 () Arrêté du 7 août 2008 relatif à la gestion du risque lié au radon dans les lieux de travail.
190 () Créée en 1928, la CIPR est une organisation non-gouvernementale dont l’objectif est d’apprécier l’état des connaissances sur les effets des rayonnements afin d’identifier leurs implications du point de vue des règles de protection à adopter. La CIPR analyse les résultats des recherches effectuées dans le monde et examine les travaux d’autres organisations internationales, émet des recommandations générales, destinées, en particulier, aux organismes réglementaires, sur les règles de protection et les niveaux d’exposition à ne pas dépasser (Source : ASN).
i Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
© Assemblée nationale