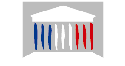______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 juin 2016.
RAPPORT D’ACTIVITÉ
FAIT
AU NOM DE LA DÉLÉGATION AUX OUTRE-MER (1),
sur l’activité de la délégation (avril 2015 – juin 2016),
PAR
M. Jean-Claude FRUTEAU
Député
——
(1) La composition de la délégation figure au verso de la présente page.
La Délégation aux Outre-mer est composée de : M. Jean-Claude Fruteau, président ; Mme Huguette Bello, Mme Chantal Berthelot, Mme Sonia Lagarde, M. Serge Letchimy, M. Didier Quentin vice-présidents ; Mme Brigitte Allain, M. Dominique Bussereau, M. Bernard Lesterlin, secrétaires ; M. Ibrahim Aboubacar, M. Bruno Nestor Azerot, M. Jean-Jacques Bridey, M. Ary Chalus, M. Alain Chrétien, M. Stéphane Claireaux, M. Édouard Courtial, M. René Dosière, Mme Sophie Errante, M. Georges Fenech, M. Hervé Gaymard, M. Daniel Gibbes, M. Philippe Gomes, M. Philippe Gosselin, Mme Geneviève Gosselin, M. Mathieu Hanotin, M. Philippe Houillon, M. Guénhaël Huet, Mme Monique Iborra, M. Éric Jalton, M. Serge Janquin, M. François-Michel Lambert, M. Guillaume Larrivé, M. Patrick Lebreton, M. Gilbert Le Bris, M. Patrick Lemasle, M. Bruno Le Roux, M. Michel Lesage, Mme Gabrielle Louis-Carabin, M. Victorin Lurel, M. Thierry Mariani, M. Alfred Marie-Jeanne, M. Hervé Mariton, M. Olivier Marleix, M. Philippe Naillet, M. Jean-Philippe Nilor, M. Patrick Ollier, Mme Monique Orphé, M. Napole Polutélé, M. Thierry Robert, M. Camille de Rocca Serra, Mme Maina Sage, M. Boinali Said, M. Paul Salen, M. François Scellier, M. Gabriel Serville, M. Jonas Tahuaitu, M. Jean-Charles Taugourdeau, M. Jean-Paul Tuaiva, M. Jean Jacques Vlody
SOMMAIRE
___
Pages
A. LES OUTRE-MER ET LA COP 21 13
1. Les modalités de préparation du rapport 13
2. Les principales orientations du rapport 15
3. L’examen par la Délégation – La proposition de résolution 16
4. Les suites publiques des travaux de la Délégation sur le changement climatique 19
B. LE RAPPORT D’INFORMATION SUR LA RÉFORME DU DROIT DU TRAVAIL 20
1. Les principaux constats du rapport et leurs conséquences 21
2. Les travaux de la Délégation et ses propositions finales 22
3. L’impact des travaux de la Délégation sur la discussion du projet de loi en séance publique 24
a. La modification des règles applicables à la négociation collective 24
b. Les dispositions relatives à la formation professionnelle 25
II. LA DÉLÉGATION, LIEU DE VEILLE ET D’INFORMATION SUR LES PROBLEMATIQUES ULTRAMARINES 26
A. LA SITUATION DE MAYOTTE : PERSPECTIVES D’AVENIR ET DIFFICULTÉS DU PRÉSENT 26
1. Les perspectives ouvertes par le document stratégique Mayotte 2025 26
2. Le constat des difficultés du présent : le rapport de la Cour des comptes 27
B. LES ÉCHANGES AVEC LES PARLEMENTAIRES CHARGÉS D’ÉTUDES SUR DES SUJETS A IMPLICATIONS ULTRAMARINES 29
1. Le recyclage et la valorisation des déchets outre-mer (mission de M. Serge Letchimy) 29
2. Le suicide des jeunes Amérindiens de Guyane (mission de Mme Marie-Anne Chapdelaine et de Mme Aline Archimbaud, sénatrice) 30
3. L’insertion des DOM dans leur environnement régional (mission de M. Jean-Jacques Vlody) 32
4. La réforme des minima sociaux (consultation de la Délégation par M. Christophe Sirugue, parlementaire en mission) 33
C. LES AUDITIONS D’INSTITUTIONS INVESTIES DE COMPÉTENCES INTERESSANT LES OUTRE-MER 34
1. L’état des actions de l’Agence française de développement (audition de M. Fabrice Richy, directeur du département outre-mer) 34
2. La transformation du statut de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer – IEDOM (audition de MM. Hervé Gonsard, directeur général, et Philippe La Cognata, directeur) 35
3. L’état du paysage audiovisuel dans les outre-mer français (audition de M. Patrice Gélinet, membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel) 36
4. L’aide aux activités culturelles des outre-mer (audition de M. Daniel Carcel, directeur de l’Agence de promotion et de diffusion des cultures de l’outre-mer) 37
D. LES AUDITIONS D’EXPERTS 38
1. La commémoration du 70e anniversaire de la départementalisation (audition de MM. Marcel Dorigny, historien, et Nicolas Roinsard, sociologue) 38
2. Le service public de l’eau – distribution d’eau potable et assainissement – dans les départements d’outre-mer (audition de M. Pierre-Alain Roche, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts) 40
TRAVAUX DE LA DÉLÉGATION 43
AUDITIONS DE LA DÉLÉGATION 47
I. LES AUDITIONS SUR LA SITUATION DE MAYOTTE 47
A. PRÉSENTATION PAR M. IBRAHIM ABOUBACAR DU DOCUMENT STRATEGIQUE MAYOTTE 2025 – UNE AMBITION POUR LA REPUBLIQUE 47
B. PRESENTATION PAR M. DIDIER MIGAUD, PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES, DU RAPPORT « LA DEPARTEMENTALISATION DE MAYOTTE : UNE REFORME MAL PREPAREE, DES ACTIONS PRIORITAIRES A CONDUIRE » 55
II. LES AUDITIONS DE PARLEMENTAIRES CHARGÉS DE RAPPORTS SUR DES SUJETS IMPLIQUANT LES OUTRE-MER 75
A. PRÉSENTATION PAR M. SERGE LETCHIMY DES PRÉCONISATIONS DE SON RAPPORT SUR LE RECYCLAGE ET LA VALORISATION DES DÉCHETS OUTRE-MER 75
B. PRESENTATION PAR MME MARIE-ANNE CHAPDELAINE DES CONCLUSIONS DU RAPPORT SUR LE SUICIDE DES JEUNES AMERINDIENS DE GUYANE 86
C. PRESENTATION PAR M. JEAN-JACQUES VLODY DES PREMIERES ORIENTATIONS DE SON RAPPORT SUR L’INSERTION DES DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER DANS LEUR ENVIRONNEMENT REGIONAL 97
D. ECHANGE AVEC M. CHRISTOPHE SIRUGUE, CHARGE D’UN RAPPORT SUR LA REFORME DES MINIMA SOCIAUX 112
III. LES AUDITIONS DE RESPONSABLES D’INSTITUTIONS ET D’ORGANISMES INTERVENANT DANS LES OUTRE-MER 123
A. AUDITION DE M. FABRICE RICHY, DIRECTEUR DU DEPARTEMENT OUTRE-MER DE L’AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT, SUR L’ACTION DE L’AGENCE DANS LES OUTRE-MER 123
B. AUDITION DES DIRIGEANTS DE L’INSTITUT D’EMISSION DES DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER 138
C. AUDITION DE M. PATRICE GELINET, MEMBRE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’AUDIOVISUEL 145
D. AUDITION DE M. DANIEL CARCEL, DIRECTEUR DE L’AGENCE DE PROMOTION ET DE DIFFUSION DES CULTURES DE L’OUTRE-MER 156
IV. LES AUDITIONS D’EXPERTS 165
A. AUDITION DE M. MARCEL DORIGNY, HISTORIEN, ET DE M. NICOLAS ROINSARD, SOCIOLOGUE, À L’OCCASION DU 70ÈME ANNIVERSAIRE DE LA DÉPARTEMENTALISATION 165
B. AUDITION DE M. PIERRE-ALAIN ROCHE, INGENIEUR GENERAL DES PONTS, DES EAUX ET DES FORÊTS, SUR LE PROBLÈME DE L’EAU DANS LES OUTRE-MER 177
LISTE DES PERSONNALITÉS AUDITIONNÉES (par ordre chronologique) 188
Constituée en juillet 2012, à l’initiative du Président de l’Assemblée nationale, pour offrir un lieu spécifique de débats et d’échanges sur les outre-mer, la Délégation a poursuivi et diversifié cet effort au cours de la période couverte par le présent rapport d’activité, soit avril 2015-juin 2016.
L’ordre du jour du Parlement n’a pas fourni à la Délégation d’amples occasions de contribuer, comme elle a pu le faire au cours des années précédentes, à l’enrichissement du dispositif de projets de loi dont l’objectif et le contenu seraient susceptibles, en tout ou en partie, d’impliquer les outre-mer. En revanche, l’évènement international majeur que constitua la réunion de la COP 21, autrement dit la vingt-et-unième conférence des parties à la convention des Nations Unies sur le changement climatique, fut l’objet d’un investissement particulièrement important de la part de la Délégation, notamment des trois rapporteurs qu’elle chargea d’étudier ce thème.
Les éléments statistiques
Avant d’entrer plus avant dans le détail des activités de la Délégation, il convient de laisser toute leur place aux chiffres. Pendant la période couverte par ce rapport, seize réunions ont été tenues, pour une durée totale de débats de 19 h 45. La Délégation a procédé à l’audition de 16 personnalités ; elle a en particulier reçu à deux reprises, dans le cadre de ses travaux sur les conséquences du changement climatique sur les outre-mer, puis à l’occasion du projet de loi relatif à la réforme du droit du travail, Mme George Pau-Langevin, ministre des outre-mer.
Outre le présent rapport d’activité, la Délégation a publié deux rapports d’information1 :
- le rapport n°3172, « Les outre-mer aux avant-postes du changement climatique »¸ déposé le 27 octobre 2015 ;
- le rapport n°3617, « Améliorer le dialogue social et renforcer la formation professionnelle ; les enjeux de la réforme du droit du travail dans les outre-mer », déposé le 29 mars 2016.
Une modification a été apportée à la composition du bureau : la Délégation a nommé, le 27 octobre 2015, Mme Marie-Anne Chapdelaine, députée d’Ille-et-Vilaine, vice-présidente en remplacement de Mme Catherine Beaubatie.
Une constante : un fonctionnement souple et ouvert
Comme les années précédentes, j’ai eu le souci d’organiser les travaux de la Délégation sur la base d’une expression équilibrée des différents groupes politiques, de la majorité comme de l’opposition parlementaires. Je continue de souhaiter, en outre, que les rapports thématiques de la Délégation puissent être confiés conjointement à un député ultramarin et à un député de l’hexagone.
La première de ces intentions a été parfaitement concrétisée par les conditions d’élaboration du rapport sur le changement climatique, conjointement confié à Mme Maina Sage, députée UDI, et à MM. Ibrahim Aboubacar et Serge Letchimy, députés SRC. Avec l’accord explicite de ses collègues, Mme Sage a assuré la coordination générale de la préparation et de la rédaction de ce document.
J’ai également veillé à ce que la Délégation puisse avoir connaissance des travaux, intéressant les outre-mer, dans lesquels certains de ses membres ont été impliqués à un titre ou un autre. C’est ainsi que M. Serge Letchimy est venu présenter les propositions du rapport qui lui a été confié sur le lourd problème de la collecte et du recyclage des déchets, que M. Ibrahim Aboubacar a exposé les lignes principales du document Mayotte 2025, et que M. Jean-Jacques Vlody a fait part des orientations possibles du rapport qui lui a été demandé, au titre d’une mission spécifique, sur l’insertion des DOM dans leur environnement régional.
La Délégation : un interlocuteur de référence
La mission conférée à la Délégation aux outre-mer par la Conférence des Présidents conduit à en faire l’interlocuteur de référence des institutions que leurs compétences propres amènent à prendre en considération les différents domaines de la vie collective des outre-mer.
C’est pourquoi je me réjouis particulièrement d’avoir accueilli le Premier président de la Cour des comptes, M. Didier Migaud, qui a bien voulu accorder à la Délégation la primeur de la présentation publique du rapport consacré par cette juridiction à la départementalisation de Mayotte. Une telle démarche, conforme à l’esprit des relations voulues par la Constitution entre le Parlement et la Cour des comptes, conforte le rôle de la Délégation dans l’organisation générale des travaux parlementaires.
Dans une perspective un peu plus informelle, la Délégation a souhaité entendre des représentants d’autorités administratives indépendantes qui sont amenés à se préoccuper des outre-mer dans les domaines qui leur sont propres : c’est ainsi qu’elle a reçu M. Patrice Gélinet, membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Nous avons également souhaité nous informer des projets et des évolutions d’institutions dont les outre-mer sont le domaine d’intervention exclusif – l’Institut d’émission d’outre-mer (IEDOM) ou l’Agence de promotion et de diffusion des cultures de l’outre-mer – ou fournissent une grande part de l’activité – l’Agence française de développement.
En outre, il m’a semblé utile de donner un prolongement propre à notre Délégation à certains travaux de réflexion commandés par le Gouvernement sur des thématiques ultramarines. La Délégation a entendu, à ce titre, M. Pierre-Alain Roche, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, coordonnateur d’un rapport interministériel sur le problème crucial de l’eau intitulé « Propositions pour un plan d’action pour l’eau dans les départements et régions d’outre-mer et à Saint-Martin ».
Je voudrais faire une mention spécifique de la démarche de notre collègue M. Christophe Sirugue, chargé par le Gouvernement de faire des propositions pour la réforme des minima sociaux qui, souhaitant accorder une attention particulière aux impacts possibles d’une telle réforme dans les outre-mer, a spontanément choisi d’interroger, à ce sujet, les membres de la Délégation : une réunion spécifique a été consacrée à cet échange.
Cette dernière initiative confirme que le rôle de la Délégation comme lieu de représentation active, d’études et d’information sur les questions relatives aux outre-mer bénéficie d’une reconnaissance institutionnelle croissante.
Les commentaires détaillés qui suivent permettent de le vérifier.
I. LES RAPPORTS D’INFORMATION DE LA DÉLÉGATION AUX OUTRE-MER
Du début d’avril 2015 au début de juillet 2016, la Délégation a produit, sous la forme règlementaire du rapport d’information, une étude thématique sur les effets du changement climatique dans les outre-mer et une contribution à l’examen parlementaire du projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs.
A l’approche de la réunion, accueillie par la France, de la vingt-et-unième conférence des parties à la convention des Nations Unies sur le changement climatique, communément dénommée COP 21, l’attention de la Délégation a été appelée de plusieurs parts sur la situation spécifique des outre-mer au regard du changement climatique et de ses conséquences. La Délégation a en conséquence décidé de consacrer une étude particulière à cette question, et d’en charger trois de ses membres, Mme Maina Sage, députée de la Polynésie française, M. Ibrahim Aboubacar, député de Mayotte et M. Serge Letchimy, député de la Martinique. C’est délibérément qu’ont été ainsi désignés des parlementaires représentant chacun un bassin océanique.
Les trois rapporteurs ont considéré, d’un commun accord, que Mme Maina Sage serait en quelque sorte leur « chef de file », assurant la coordination des activités préalables à l’élaboration du rapport et en proposant les principales orientations.
1. Les modalités de préparation du rapport
Comme l’a exposé Mme Maina Sage devant la Délégation, l’esprit général du rapport était d’assurer l’expression propre des analyses et des intentions des outre-mer, qui sont certes parmi les victimes les plus exposées aux phénomènes associés au changement climatique, mais qui entendent aussi prendre pleinement leur part des actions d’atténuation ou d’adaptation qu’appellent ces phénomènes.
Afin de permettre une telle expression, des questionnaires ont été adressés par les soins de chacun des trois rapporteurs aux personnalités – élus, scientifiques, responsables associatifs – engagées à des titres divers dans l’affaire du changement climatique et de ses conséquences. Les membres de la Délégation ont été spécialement sollicités.
Quatorze auditions ont été conduites par les rapporteurs à l’Assemblée nationale, au mois de septembre 2015. Elles ont permis d’entendre les personnalités suivantes :
M. Nicolas Bériot, secrétaire général de l’Observatoire national sur les effets du changement climatique (ONERC)
M. Gilles Bœuf, directeur du Museum national d’histoire naturelle, conseiller scientifique pour l’environnement, la biodiversité et le climat auprès du cabinet de Mme la ministre de l’Écologie
M. Antoine Bonduelle, fondateur de Réseau Action Climat France, membre du Conseil économique, social et environnemental
M. Alain Brondeau, délégué de rivages Outre-Mer au Conservatoire national du Littoral et des espaces lacustres
Mme Elisabeth Dupont-Kerlan, directrice générale de l’Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), et M. Alexis Delaunay, directeur du contrôle des usages et de l’action territoriale
Mme Virginie Duvat, professeur à l’Université de La Rochelle
M. Guy Fabre, directeur de l’Action régionale à l’ADEME
Mme Françoise Gaill, directrice du département Environnement et développement durable du CNRS
M. Nicolas Imbert, directeur exécutif de Green Cross France
M. Jean Jouzel, directeur de recherches au Commissariat de l’énergie atomique, membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE)
M. Bernard Larrouturou, directeur général, et M. Jean-Marc Chastel, directeur délégué pour les risques, santé, énergie et climat du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA)
M. Sébastien Moncorps, directeur du comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature, et Mme Aurélie Bocquet, chargée de mission
M. Serge Planes, directeur du Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement (CRIOBE) et de l'Institut des récifs coralliens du Pacifique
M. Fabrice Richy, directeur, M. François Parmantier, directeur adjoint du département Outre-mer et M. Pierre Forestier, responsable de la division Changement climatique, Agence française de développement
M. Jean-François Soussana, directeur scientifique Environnement à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA).
Plusieurs de ces personnalités ont bien voulu communiquer aux rapporteurs, au moment ou à la suite de leur audition, des documents ou des notes complémentaires.
D’autres entretiens ont été conduits par chacun des rapporteurs dans sa région d’origine. En outre, un grand nombre d’élus, de scientifiques, d’institutions ou d’associations ont adressé aux rapporteurs des réponses et des contributions dont il a été tenu le plus grand compte dans la rédaction du rapport final. Inévitablement, les réponses adressées varient en la forme et par l’orientation, malgré l’envoi d’un questionnaire uniforme. Elles n’en témoignent pas moins éloquemment de l’intérêt, voire de l’inquiétude, suscités par la thématique du changement climatique dans les outre-mer.
Enfin, Mme George Pau-Langevin, ministre des outre-mer, est venue devant la Délégation le 29 septembre 2015, pour présenter la position du Gouvernement à la veille de l’ouverture de la négociation. À cette occasion, un échange de vues sur la position spécifique des outre-mer dans la COP a eu lieu, mettant notamment l’accent sur la nécessité d’un accompagnement financier d’actions d’atténuation et d’adaptation parallèle au dispositif du « fonds vert » dont bénéficient entre autres les petits États insulaires en développement (P.E.I.D.).
2. Les principales orientations du rapport
Sur le fondement du riche matériau documentaire recueilli au cours de la phase préalable et de divers rapports d’expertise technique produits par des organismes français de recherches tels que le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), le rapport a développé une analyse en trois étapes.
Il a tout d’abord cherché à tracer le cadre général de la situation à laquelle les outre-mer étaient confrontés.
Pour une exacte compréhension du débat, il convenait, en commençant, de planter le décor d’ensemble de la discussion ; il était donc nécessaire de rappeler succinctement comment s’était développé le cadre de négociations dont la conférence de Paris devait être la vingt-et-unième occurrence, à partir de la résolution de l’Assemblée générale du 6 décembre 1988 qui entérine la constitution du Groupe international d’experts sur le climat (GIEC) et, partant, le principe de la création d’une instance d’expertise spécialement dédiée à l’accompagnement scientifique des futures négociations sur le changement climatique. Dans la deuxième partie de ce tableau d’ensemble, est proposée ensuite une description des données objectives du phénomène dans les outre-mer, comportant d’une part le rappel de chiffres-clés et mettant l’accent, d’autre part, sur ses principales manifestations et sur l’étendue de son impact social et économique.
Appuyé sur les informations recueillies pendant la phase préparatoire, le rapport fait état des réactions des outre-mer à ce qui paraît pour ses auteurs une menace multiforme et immédiate. Il souligne notamment la richesse des recherches actuellement en cours dans les outre-mer, aussi bien que les alertes émises sur les lacunes des connaissances. Il met aussi en valeur la prise de conscience, contrastée mais réelle, de la situation chez les élus comme dans la population.
Dans une deuxième étape, le rapport en vient aux stratégies de réponse qui ont pu être élaborées, en suivant la distinction désormais consacrée entre atténuation et adaptation.
Au titre de l’atténuation, c’est-à-dire des mesures propres à supprimer, ou du moins à réduire fortement, les causes actuellement reconnues du changement climatique, l’accent est mis avant tout sur la nécessité de renouveler les modalités d’approvisionnement des outre-mer en énergie, qui dépendent actuellement, dans une très large proportion, d’énergies fossiles non renouvelables et polluantes. Sont également mentionnées au même titre la politique des transports et la politique de l’eau.
Au titre de l’adaptation, c’est-à-dire des dispositions permettant de limiter dans l’avenir les conséquences prévisibles du changement climatique sur les milieux naturels, la vie quotidienne et les activités économiques, le rapport, sans viser à l’exhaustivité, s’est attaché à décrire quatre politiques prioritaires : la gestion du « trait de côte », la protection de la biodiversité, notamment à travers les aires marines protégées, la gestion des risques liés aux possibilités de submersion des terres et l’évolution des activités agricoles.
Dans une troisième et dernière étape, la Délégation a souhaité définir quatre points d’attention qui pourraient caractériser un message spécifique des outre-mer à destination de la COP 21 : la clarification du cadre financier des actions d’atténuation et d’adaptation engagées dans les outre-mer, la promotion de la coopération régionale avec les États indépendants, le renforcement et la pérennisation de la recherche, la promotion de solutions innovantes fondées sur la nature et la réutilisation des solutions traditionnelles.
3. L’examen par la Délégation – La proposition de résolution
Le projet de rapport a été examiné par la Délégation au cours de sa réunion du 27 octobre 2015.
Ouvrant la séance, le président de la Délégation s’est félicité de la qualité de la coopération entre les trois rapporteurs, qui leur a permis de conduire à terme un travail complexe autour d’enjeux politiques de première importance, et a opportunément associé une parlementaire de l’opposition, reconnue comme chef de file, et deux parlementaires de la majorité.
Il a indiqué qu’il lui avait paru opportun de donner un prolongement procédural aux réflexions de la Délégation en proposant à la signature de chacun de ses membres un projet de proposition de résolution déposé au titre de l’article 34-1 de la Constitution, tendant, comme le dit son titre, à promouvoir la prise en compte des outre-mer dans les négociations de la COP 21.
Cette proposition de résolution, par ailleurs soutenue et co-signée par les trois rapporteurs, a recueilli l’adhésion expresse de membres de la Délégation appartenant à tous les groupes parlementaires, ultramarins comme métropolitains, et, pour les ultramarins, représentant les trois bassins océaniques.
Le Règlement de l’Assemblée nationale ne permet pas au président de la Délégation aux outre-mer, de déposer une proposition de résolution au nom de celle-ci (les présidents de commissions permanentes n’ont pas davantage ce droit). Mais rien ne s’oppose à ce qu’un tel texte, par ailleurs déposé en séance publique dans les formes règlementaires, soit soumis à l’approbation de la Délégation, dont le vote favorable renforce évidemment sa portée symbolique et politique.
Au cas d’espèce, la proposition de résolution a été mise aux voix au cours de la réunion de la Délégation, et a recueilli l’unanimité des suffrages des présents. Elle a été déposée, immédiatement après cette réunion, au nom du président de la Délégation, agissant formellement à titre individuel, et des députés qui avaient préalablement manifesté leur soutien exprès à cette initiative.
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
La vingt-et-unième conférence des parties aux négociations sur le climat (COP 21) qui se tient prochainement à Paris, est généralement considérée comme devant marquer une étape décisive dans la concertation internationale pour lutter contre les conséquences du changement climatique qui menace notre planète.
Le consensus scientifique désormais atteint sur la réalité de ce phénomène et sur l’ampleur des conséquences qui risquent d’en découler à court et à moyen terme sur les conditions communes de la vie sur la Terre ne laisse plus de place au doute sur la nécessité de prendre des mesures énergiques et rapidement applicables pour lutter contre ses causes.
Les outre-mer sont en première ligne pour attester de l’urgence d’agir.
En effet, de toutes les parties du territoire français, les outre-mer sont de loin les plus immédiatement exposés aux conséquences visibles du changement climatique. Leurs territoires se situent, en grande majorité, dans des climats équatoriaux ou tropicaux, et sont fortement marqués par leur caractère maritime. Cette vulnérabilité, liée au positionnement géographique de ces territoires, est exacerbée pour la plupart d’entre eux par leur insularité. Ainsi, le quotidien de nos populations sera nécessairement affecté par une pression accrue sur le foncier, des conflits d’usage exacerbés, des destructions d’équipements ou de productions répétées et une dégradation générale de notre cadre de vie. C’est dire que les enjeux climatiques, notamment océaniques, y sont majeurs partout. On s’attend à une plus grande occurrence de valeurs extrêmes, que ce soit pour les températures ou précipitations. Les risques de tempêtes et de cyclones y ont toujours été élevés, mais le dérèglement climatique va très probablement contribuer, disent les spécialistes, à en amplifier les effets.
A la vulnérabilité physique, s’ajoute pour les outre-mer la fragilité économique. En effet, les économies de ces territoires sont modestes, isolées et souvent très dépendantes de leurs ressources naturelles, aujourd’hui menacées. Les concentrations urbaines importantes et le mitage de l’habitat donnent au dérèglement climatique des effets spécifiques, auxquels il convient d’ajouter des risques épidémiologiques accrus, qui sont rarement évoqués.
En outre, les territoires d’outre-mer se caractérisent notoirement par une biodiversité exceptionnelle représentant 80 % de la biodiversité française, dont 13 000 espèces endémiques. Dès aujourd’hui le changement climatique porte des atteintes souvent irréversibles à cette biodiversité.
Aussi bien les outre-mer sont-ils intéressés au premier chef par le bon déroulement des travaux de la COP 21.
Nous pensons, inversement, qu’une prise en compte explicite et clairement assumée de leur situation spécifique par rapport à l’objet de cette négociation peut apporter une efficace contribution au succès de celle-ci.
Tout d’abord, en raison de leur importance géopolitique. La France possède le deuxième domaine maritime mondial, couvrant 11 millions de km², dont 97 % se trouvent en outre-mer. De plus, les outre-mer sont présents dans tous les bassins océaniques ; ils ont les moyens de pratiquer avec les États-îles, leurs voisins, des coopérations efficaces, attestées par les déclarations régionales déjà signées dans l’Océan Indien (la Déclaration des Iles du 25 juin 2014), dans le Pacifique (la Déclaration de Lifou du 30 avril 2015 et la Déclaration de Taputapuâtea du 16 juillet 2015) ou dans la Caraïbe (l’Appel de Fort-de-France du 9 mai 2015).
Ensuite, parce qu’il existe dans les outre-mer de nombreuses initiatives qui montrent une disposition collective à affronter les difficultés vitales liées au changement climatique, à en prendre toute la mesure et à définir les stratégies d’atténuation et d’adaptation propres à en limiter les effets, y compris sur la longue durée. A une opinion publique encore insuffisamment sensible à la réalité du changement climatique et de ses conséquences, les outre-mer peuvent présenter la preuve de son existence et proposer des moyens propres à en contenir les conséquences.
C’est pourquoi il apparaît hautement souhaitable que, dans la préparation comme dans le déroulement de la COP 21, les outre-mer soient pleinement intégrés aux stratégies, nationales et internationales, de lutte et d’adaptation au changement climatique, comme dans la recherche des solutions les plus appropriées pour répondre à ces manifestations.
Proposition de résolution
Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34-1 de la Constitution,
Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,
– Réaffirme l'importance des outre-mer au sein de la nation, de par leur apport à la richesse française en termes de biodiversité et leur contribution géostratégique au territoire national.
- Souhaite que dans la définition de la stratégie de la France dans la conduite des négociations de la vingt-et-unième Conférence des Parties sur le climat (COP 21), toutes dispositions soient prises pour assurer la prise en compte de la situation spécifique des outre-mer et de leur exposition particulière aux conséquences du changement climatique, notamment dans la composition de la délégation française à la conférence.
- Souhaite que les outre-mer soient pleinement associés à la mise en œuvre ultérieure des décisions prises lors de la COP 21.
- Souhaite que des mesures adéquates soient prises pour faciliter la pérennité des efforts accomplis dans les outre-mer pour le développement des connaissances liées à l’étude du changement climatique et de ses conséquences et pour la mise en œuvre des actions d’atténuation et d’adaptation appelées par ce phénomène.
- Souhaite que soient résolument appuyées les initiatives de coopération régionale prises avec la participation des outre-mer dans les différentes régions océaniques où ceux-ci sont présents.
4. Les suites publiques des travaux de la Délégation sur le changement climatique
La proposition de résolution de la Délégation a été examinée par l’Assemblée nationale le 25 novembre 2015, dans une discussion commune avec la proposition de résolution n°3219 de M. Bruno Le Roux pour accéder, au-delà de la COP 21, à une société à bas carbone.
Deux membres de la Délégation sont intervenus dans le débat : Mme Maina Sage, s’exprimant au nom du groupe UDI, et M. Ibrahim Aboubacar, ce dernier suppléant le président de la Délégation.
Après avoir exprimé l’opinion de son groupe sur la proposition de résolution de M. Le Roux, Mme Sage a exposé l’essentiel des constatations, conclusions et propositions du rapport d’information dont elle était responsable pour la Délégation. En terminant son discours, elle a appelé l’attention de l’Assemblée sur l’enjeu pour la France tout entière d’un traitement adéquat des conséquences du changement climatique dans les outre-mer. Elle a souhaité que soit promue « cette idée que la France n’est pas seulement européenne et continentale, mais maritime et mondiale », avant de conclure : « Nous devrions en être fiers et comprendre l’opportunité que représente pour la France ce réseau de territoires de par le monde. La France est le seul pays au monde où le soleil ne se couche jamais, et cela grâce à ses outre-mer. »
M. Aboubacar s’est fait l’interprète de la démarche globale du rapport, de ses constats, de ses propositions et de ses appels, en concluant par ces mots : « Ce débat sur le changement climatique reprend, en définitive, l’interrogation profonde que chacun de nous doit avoir sur sa relation avec la Nature. C’est sans doute sous cet aspect que l’apport des outre-mer est fondamental pour notre Nation. La prise en compte des relations que ces populations entretiennent encore avec leur environnement, de leur vision du monde, exprimée ou non, que chacun pourrait appréhender en étant attentif à l’autre : c’est en cela que nous considérons légitime que les outre-mer soient pleinement associés à la mise en œuvre ultérieure des décisions prises lors de la COP21. Il convient ainsi de mettre en place, au niveau national, des mécanismes qui permettront leur consultation automatique dans le cadre des discussions internationales sur le climat. »
Dès le début de son intervention, qui concluait les débats, Mme Ségolène Royal, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, a reconnu que les outre-mer « étaient en effet les territoires les plus gravement touchés par le réchauffement climatique. » Après avoir développé ses réponses aux différents intervenants qui s’étaient exprimés sur la proposition de résolution « globale » de M. Le Roux, Mme Royal a déclaré, en écho aux interventions de Mme Sage et de M. Aboubacar : « Je veux dire un dernier mot sur la place que vous souhaitez réserver aux outre-mer. Dès ce soir s’ouvre le sommet France-Océanie : comme l’ont souligné Maina Sage et Ibrahim Aboubacar, l’enjeu est majeur car nous disposons de potentiels exceptionnels. Les régions ultramarines, souvent qualifiées de périphériques, peuvent être au centre de la transition énergétique en démontrant leur capacité à s’orienter vers l’autonomie énergétique ; à cet égard la COP21 offre la possibilité d’une nouvelle étape – et j’y veillerai – quant à l’implication des outre-mer dans les négociations sur le climat. La France a pris l’engagement, en assumant la présidence de la COP21, de permettre à chaque voix d’être entendue, notamment celle des plus fragiles et des plus vulnérables. Les instances de la représentation politique constituent des relais indispensables de ces voix locales, qui pourront ainsi s’exprimer, comme ce fut le cas cet après-midi. »
La résolution tendant à promouvoir la prise en compte des outre-mer dans les négociations de la COP 21 a été, ensuite, adoptée.
B. LE RAPPORT D’INFORMATION SUR LA RÉFORME DU DROIT DU TRAVAIL
La saisine de la Délégation sur le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (ci-après désigné sous l’appellation de réforme du code du travail) a été motivée par le constat que, ni dans l’exposé des motifs de ce texte, ni dans le dispositif proposé, ne figurait de disposition relative aux règles de droit du travail applicables dans les départements et régions d’outre-mer.
Or, dans la perspective même de la réforme, caractérisée par le souci d’améliorer les conditions du dialogue social, un aménagement des conditions d’application du droit du travail dans ces territoires apparaissait opportun. Il entrait pleinement dans les compétences de la Délégation d’y réfléchir et de les proposer : c’est la tâche accomplie par Mme Monique Orphé, rapporteure de la Délégation.
1. Les principaux constats du rapport et leurs conséquences
Le rapport d’information préparé par Mme Orphé commence par tracer un tableau d’ensemble des difficultés spécifiques qui conditionnent l’emploi dans les outre-mer. A un chômage, structurel et de longue durée, bien plus présent que dans l’Hexagone, s’ajoutent un niveau de formation initiale insuffisant et une offre de formation professionnelle qui correspond très imparfaitement aux besoins des économies locales.
Pour remédier à des difficultés qui sont autant de facteurs de blocage, le dialogue social est une condition nécessaire, si elle n’est pas suffisante. Dans le passé, on a cherché à accorder, en quelque sorte, une « priorité forcée » à la conduite de négociations collectives dans le cadre de chaque territoire : c’est le sens de l’article 16 de la loi du 25 juin 1994, dite « loi Perben », qui subordonne à l’insertion d’une clause expresse en ce sens l’application des conventions collectives nationales dans les départements d’outre-mer. L’expérience montre que ce pari de méthode n’a pas été gagné, faute en particulier qu’aient été créées les conditions du déploiement effectif de procédures de négociation collective dans les outre-mer – faute de volonté d’y parvenir. Les auditions conduites par la Rapporteure, tant des représentants du patronat que des représentants des organisations syndicales, n’ont pu que confirmer ce constat.
Il faut impérativement en finir avec une telle situation, c’est la conviction de la Délégation. C’est pourquoi celle-ci a préconisé, en premier lieu, un aménagement des critères de représentativité syndicale permettant d’associer les organisations syndicales proprement ultramarines aux négociations collectives menées dans leur territoire d’implantation. Elle a, en outre, souhaité que soit permis un recours accru aux salariés mandatés, afin de tenir compte de la part écrasante, dans les économies des différents territoires, des petites et très petites entreprises.
A cette double condition, la Délégation a jugé possible d’envisager avec plus de réalisme l’inversion de la règle posée par la loi de 1994, et de prévoir que, dans l’avenir, les conventions collectives nationales seraient applicables de plein droit dans les départements d’outre-mer sauf clause expressément contraire. Quant aux conventions collectives nationales en vigueur, et qui n’ont pas été rendues applicables outre-mer, les organisations syndicales représentatives, comme il a été dit, dans chaque territoire seront invitées à engager des négociations sur le principe et les modalités de leur éventuelle mise en application future.
Il est clair que la pratique du dialogue social trouvera plus aisément à s’appliquer si la situation globale de l’emploi s’améliore significativement dans les outre-mer. Le rapport de la Délégation passe en revue les différents outils de la politique de l’emploi stricto sensu – spécifiques ou non aux outre-mer – en appelant à en améliorer la mobilisation.
Dans la même perspective, la Délégation s’est intéressée à l’amélioration de la formation, qu’il s’agisse de la formation initiale ou de la formation tout au long de la vie professionnelle. Il lui est apparu que des améliorations pouvaient être recherchées dans trois directions : faciliter la transmission des informations sur les demandeurs de formation entre les prescripteurs de formation, à partir de la reconnaissance du rôle pivot de Pôle Emploi ; consacrer la fonction primordiale de l’Agence de l’Outre-Mer pour la mobilité (LADOM) ; encourager les structures d’insertion confirmées et en premier lieu le Service militaire adapté (SMA). Elle a également estimé nécessaire une plus grande attention aux parcours individuels de formation, passant concrètement par la mise en place d’un guichet unique de la formation professionnelle et la confirmation de services de formation professionnelle de proximité.
2. Les travaux de la Délégation et ses propositions finales
L’évolution du calendrier général de préparation et de présentation du projet de loi portant réforme du code du travail a conduit à un aménagement des travaux spécifiques de la Délégation à son sujet. Le report jusqu’au 23 mars 2016 de l’adoption définitive du projet en Conseil des ministres ne laissait que quelques jours pour prendre connaissance d’un texte dont la version définitive a été stabilisée tardivement. C’est pourquoi l’examen du projet par la Délégation a été scindé en deux étapes : le 29 mars, Mme Orphé, rapporteure, a soumis à l’appréciation de nos collègues les grandes orientations de son rapport ; le 5 avril, elle a présenté le rapport définitif et les dix-sept propositions qui découlaient de ses analyses. Lors de cette seconde réunion, ce rapport et ces propositions ont été adoptés à l’unanimité des députés présents.
Les propositions de la Délégation
1. Assurer dans la commission d’experts et de praticiens des relations sociales chargée de réfléchir à la refondation du droit du travail la présence d’experts et de praticiens formés aux spécificités des relations du travail outre-mer.
2. Prévoir expressément d’associer aux travaux de la commission des représentants des organisations ultramarines d’employeurs et de salariés.
3. Créer des critères de représentativité propres aux organisations patronales et syndicales exerçant leur activité dans un département d’outre-mer particulier.
4. Rendre applicables de plein droit aux outre-mer les conventions collectives à champ d’application national, sauf stipulation contraire.
5. Prévoir, à l’occasion de la négociation d’une convention ou d’un accord collectif à champ d’application national, la consultation préalable des organisations reconnues représentatives au niveau local dans les outre-mer.
6. Pour les conventions collectives nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi, prévoir, dans un délai de deux ans, l’ouverture obligatoire de négociations entre les organisations locales sur le principe et les conditions éventuelles de leur application dans chaque département. À défaut, les dire applicables de plein droit.
7. Assurer l’information systématique, exhaustive et à jour, des organisations syndicales et des salariés sur l’état des conventions collectives applicables dans chaque département d’outre-mer.
8. Prévoir les modalités d’information préalable des partenaires sociaux locaux sur les négociations collectives nationales et les modalités de transmission aux organisations nationales de l’avis sur ces négociations des partenaires sociaux locaux.
9. Créer, sur une base paritaire, des comités servant de cadre à la négociation collective pour l’adaptation, dans chaque département, des conventions nationales ou la conclusion d’accords collectifs locaux.
10. Organiser la formation des représentants des salariés au dialogue social et à la négociation des conventions et accords collectifs de travail.
11. Permettre la nomination d’élus mandatés par les organisations représentatives de salariés dans les outre-mer aux fins d’animer la négociation collective dans les entreprises à faible effectif salarié, en leur accordant les mêmes protections juridiques qu’aux délégués syndicaux.
12. Définir la place des accords collectifs conclus dans chaque territoire, entre les conventions collectives nationales, qu’ils priment, et les accords de groupe ou d’entreprise, qui l’emportent sur eux.
13. Développer et simplifier, par la mise en place d’un « guichet unique » en ligne, l’accès des demandeurs de formation en outre-mer aux offres de formation disponibles.
14. Adapter aux besoins spécifiques des jeunes ultramarins le dispositif pérennisé de la garantie jeunes, compte tenu des difficultés particulières de leur parcours de formation.
15. Créer un droit opposable à la formation professionnelle au bénéfice des demandeurs d’emploi inscrits depuis plus de deux ans.
16. Favoriser l’ouverture, dans le cadre des négociations collectives entre partenaires sociaux locaux, de discussions sur la définition spécifique du travail saisonnier dans les outre-mer.
17. Prévoir l’entrée en vigueur de la partie législative du code du travail national dans le département de Mayotte.
Certaines de ces propositions n’appelaient pas de prolongement dans une modification législative. Certaines, et notamment la mise en place d’un guichet unique de la formation, se sont heurtées aux exigences de recevabilité financière découlant de l’article 40 de la Constitution. D’autres définissaient plus une orientation qu’elles n’impliquaient une traduction directe en amendements. Toutes ces considérations doivent être prises en compte au moment d’apprécier l’impact des travaux de la Délégation sur l’examen du projet de loi en séance publique.
3. L’impact des travaux de la Délégation sur la discussion du projet de loi en séance publique
Le calendrier très resserré de l’examen du projet de loi n’a pas permis la prise en considération des propositions de la Délégation par la commission des Affaires sociales, saisie au fond.
En séance publique, le Premier ministre a engagé la responsabilité du Gouvernement en vertu de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, avant que n’aient pu être appelés en séance la plupart des amendements inspirés des propositions de la Délégation. Cependant, le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité contient un certain nombre de dispositions plus ou moins directement liées à ces propositions.
a. La modification des règles applicables à la négociation collective
L’article 14 bis du projet considéré comme adopté par l’Assemblée nationale dispose :
- que les conventions et accords collectifs dont le champ d’application est national s’appliquent, sauf stipulations contraires dans les départements et collectivités d’outre-mer dans un délai de six mois à compter de leur entrée en vigueur (modification de l’article L. 2222-1 du code du travail) ;
- que lorsqu’une convention ou un accord collectif de travail dont le champ d’application est national s’applique dans les territoires d’outre-mer précités, les modalités d’adaptation aux spécificités de ces collectivités peuvent être prévues par d’autres accords collectifs (modification de l’article L. 2622-2 du code du travail). Si, par exception, une convention ou un accord collectif de travail national venait à exclure un des territoires d’outre-mer, des accords collectifs régionaux pourraient être conclus, le cas échéant en reprenant les stipulations de cette convention ou de cet accord.
En outre, il est prévu que l’application dans les outre-mer des conventions et accords conclus avant le 1er avril 2017 fera l’objet d’un réexamen à l’occasion de la négociation de leurs avenants. Ces avenants peuvent décider de leur application totale ou partielle aux collectivités d’outre-mer.
Ces dispositions nouvelles s’inspirent largement des propositions 4, 5 et 6 de la Délégation, ci-dessus reproduites.
La reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales locales, préconisée par la proposition 3, n’est pas explicitement affirmée par le texte voté ; cependant, elle résulte implicitement mais nécessairement des références faites aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d’employeurs habilitées à négocier en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
b. Les dispositions relatives à la formation professionnelle
L’article 36 ter du projet de loi met en place, à titre expérimental, pendant toute l’année 2017, pour le département de la Réunion, « un dispositif de contractualisation avec des personnes, en emploi ou non, sans qualification professionnelle, leur permettant d’exercer pleinement leurs droits et d’accéder à un premier niveau de qualification professionnelle ». Ce texte résulte de l’amendement n° 4761 déposé par Mme Monique Orphé et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen. Il procède du même esprit que la proposition 15 de la Délégation, qui crée un droit opposable à la formation. Issu d’une initiative parlementaire, il a dû revêtir un caractère expérimental pour satisfaire aux exigences de la recevabilité financière.
Par ailleurs, le texte considéré comme adopté comprend un article 33 quater, résultant d’un amendement n°1313 du Gouvernement déposé en séance publique, qui permet, dans les régions volontaires, de porter de 25 à 30 ans la limite d’âge supérieure fixée pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage par l’article L. 6222-1 du code du travail. Cette disposition est applicable en 2017, 2018 et 2019. Elle satisfait une préoccupation exprimée par la proposition 14 de la Délégation mais circonscrite par celle-ci à la seule garantie jeunes.2
* *
*
Au printemps 2015, la Délégation a été informée des réflexions conduites par le Gouvernement en vue de la réforme de la contribution au service public de l’électricité (CSPE). La CSPE concourant entre autres au financement de la compensation tarifaire au bénéfice des outre-mer, le président de la Délégation s’est préoccupé des répercussions possibles de la réforme sur la ressource ainsi procurée, qu’il a cherché à évaluer, notamment, à travers plusieurs entretiens avec des personnalités compétentes. Il a rendu compte de ses investigations au cours de deux réunions de la Délégation, les 29 juin et 16 juillet 2015. Initialement annoncés pour le début de l’été 2015, les arbitrages gouvernementaux sur la CSPE ont été rendus de telle manière que la réforme a été insérée dans la loi de finances rectificative pour 2015 (n°2015-1786 du 29 décembre 2015), dont elle constitue l’article 14. La réforme a consisté à intégrer la CSPE dans le champ d’application de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE).
II. LA DÉLÉGATION, LIEU DE VEILLE ET D’INFORMATION SUR LES PROBLEMATIQUES ULTRAMARINES
A mesure que l’histoire et la pratique de la Délégation prennent consistance, il apparaît de plus en plus qu’en dehors de son intervention dans de grands débats politiques comme la préparation de la COP 21 ou des travaux législatifs tels que la réforme du droit du travail, elle est appelée à jouer un rôle spécifique de veille et d’information, soit sur des problématiques ultramarines d’actualité, soit sur les activités d’institutions publiques intéressant les outre-mer.
L’examen par la Délégation de la situation de Mayotte donne une illustration privilégiée de ce rôle, justifiant ainsi qu’un développement particulier lui soit consacré. On évoquera ensuite les autres interventions de parlementaires sur des sujets qui intéressent les outre-mer, les auditions « institutionnelles » et enfin les auditions de personnalités qualifiées.
A. LA SITUATION DE MAYOTTE : PERSPECTIVES D’AVENIR ET DIFFICULTÉS DU PRÉSENT
La Délégation a abordé la situation difficile de Mayotte au cours de ses réunions du 16 juillet 2015 et du 13 janvier 2016, où elle a, respectivement, entendu M. Ibrahim Aboubacar, député de Mayotte, lui décrire les principales orientations du document stratégique « Mayotte 2025, une ambition pour la République » et M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes, présenter les conclusions du rapport spécialement consacré par la Cour à la départementalisation de Mayotte.
1. Les perspectives ouvertes par le document stratégique Mayotte 2025
La part active prise par notre collègue M. Aboubacar à la préparation du document stratégique Mayotte 2025 lui donnait une autorité certaine pour en exposer, le 16 juillet 2015, les axes essentiels devant la Délégation.
Il a tout d’abord souligné qu’à la différence du « pacte » précédent, le document en cause procédait d’un vaste travail de consultation impliquant élus et responsables, à un titre ou un autre, de la société mahoraise, et qu’il a été signé par des élus de plusieurs sensibilités politiques, avant que le Premier ministre ne vienne lui apporter sur place, par sa signature, son appui.
La première priorité des travaux préparatoires de Mayotte 2025 a été « le calendrier d’alignement sur le droit commun des dispositions liées au droit du travail et à la sécurité sociale ». Le mérite de ce calendrier, a expliqué M. Aboubacar, est de permettre aux partenaires sociaux, aux acteurs économiques et aux élus de « voir clair » dans l’échéancier des responsabilités qui leur incombent pour la réalisation de l’alignement.
Les auteurs du document stratégique ont également consacré beaucoup d’attention aux questions d’éducation et de formation professionnelle, ainsi qu’aux actions spécifiques de formation permettant d’améliorer l’efficacité de la fonction publique locale. D’autres engagements de Mayotte 2025 portent sur l’aménagement et le logement, « domaines où tout reste à faire », selon M. Aboubacar, ainsi que sur l’environnement. En revanche, les questions de sécurité et d’immigration, si elles ont été évoquées au cours des discussions, n’ont pas été intégrées parmi les recommandations du document stratégique, car elles ont été considérées comme relevant des fonctions régaliennes de l’État.
Dans le débat qui a suivi l’exposé de M. Aboubacar, l’unanimité s’est faite parmi les députés présents pour saluer la qualité de la démarche qui a conduit à l’élaboration du document stratégique, qui peut valoir précédent instructif pour d’autres territoires. Les interrogations exprimées ont surtout porté sur l’horizon effectif des perspectives de réforme à Mayotte, au-delà même de 2025, et sur le degré de précision atteint, dès à présent, dans la définition des phases de réalisation des réformes envisagées par le document.
2. Le constat des difficultés du présent : le rapport de la Cour des comptes
Le Premier président de la Cour des comptes, M. Didier Migaud, s’est félicité de pouvoir donner à la Délégation aux outre-mer la primeur des conclusions que la Cour avait décidé de consacrer au processus de départementalisation de Mayotte, sous un titre en soi explicite : « La départementalisation de Mayotte : une réforme mal préparée, des actions prioritaires à conduire ».
Avant d’exposer les constats auxquels la Cour était parvenue à l’occasion de son contrôle et les propositions qu’elle en déduisait, le Premier président a souhaité insister sur les contraintes que fait peser sur l’ensemble des politiques publiques menées à Mayotte la croissance très forte de la population de l’île, renforcée par une immigration illégale qu’il est possible de contenir, mais non point d’arrêter tout à fait. Les perspectives de développement économique sont incertaines, en dépit des investissements consentis. C’est dans ce contexte difficile, a indiqué M. Migaud, qu’il convient d’apprécier la départementalisation de Mayotte, « aboutissement d’un long processus voulu par les Mahorais ».
Or, précisément, l’insuffisante préparation du processus de départementalisation fait la matière du premier constat développé dans le rapport de la Cour des comptes. « Le passage de la spécialité à l’identité législative » est à ce jour inachevé ; le passage à la fiscalité de droit commun a pris du temps ; l’absence de solution à l’imbroglio juridique autour de la propriété foncière compromet la mise en place de la fiscalité locale. Quant au transfert, dans les conditions juridiques de droit commun, des compétences conférées au département à la nouvelle collectivité mahoraise, il n’a pas été accompagné des efforts adéquats d’adaptation des structures de l’administration départementale. Enfin, « le pilotage financier des actions du département demeure insuffisant. »
Cette dernière observation a conduit M. Didier Migaud à la formulation du second constat de la Cour : les conséquences financières de la décentralisation « sont mal maîtrisées ». L’État porte une part de la responsabilité de cette situation, car il ne suit pas avec toute l’attention souhaitable l’évolution de sa contribution financière propre, et ne fait pas ressortir l’effort de rattrapage financier qu’il accomplit de fait. La même imprévisibilité, pour partie liée à l’alignement des règles fiscales locales sur le droit commun, affecte les ressources des collectivités locales, de sorte que la situation budgétaire du département et de plusieurs communes est menacée.
Dans ces conditions, la Cour des comptes a été amenée, au titre d’un troisième constat, à souligner les difficultés particulières que rencontrent trois politiques pourtant indispensables : l’environnement (accès à l’eau, assainissement, habitat insalubre) ; le développement du système éducatif, la gestion des politiques sociales et plus spécialement du revenu de solidarité active – dont la charge financière est appelée à s’alourdir – et de la protection de l’enfance en danger, dans une île où l’on dénombre quelque trois mille mineurs isolés.
En concluant son propos, le Premier président appelle à une mobilisation accrue des « pouvoirs publics nationaux et locaux » pour éviter, entre autres, que « les financements dégagés pour 2015-2020 ne permettent pas de retour à la hauteur des moyens consacrés ».
Le débat qui a suivi la présentation de M. Migaud a donné à M. Aboubacar, premier intervenant, la possibilité d’exprimer, avec toute l’ampleur souhaitable, son évaluation personnelle des analyses et des conclusions de la Cour. Il a reconnu et déploré les obstacles qui, dans le passé, se sont dressés devant le processus de départementalisation, retardant notamment de manière dommageable la réforme de l’état-civil, la réforme foncière et la réforme fiscale. Cependant il a tenu à affirmer que les contraintes liées à la démographie, à la question foncière et à la question de l’immigration sont les sources premières de la responsabilité des politiques, la question du statut ne venant qu’en second. Passant en revue les recommandations détaillées de la Cour, il s’est tout particulièrement inquiété de la difficulté de sortir convenablement de la question foncière et également des perspectives d’évolution du RSA.
Les réflexions des députés qui sont intervenus après M. Aboubacar ont convergé pour souligner la nécessité, mais aussi la difficulté, de l’action qui apparaît immédiatement indispensable pour assurer la réussite de la départementalisation de Mayotte et éviter ainsi le choc de la déconvenue.
B. LES ÉCHANGES AVEC LES PARLEMENTAIRES CHARGÉS D’ÉTUDES SUR DES SUJETS A IMPLICATIONS ULTRAMARINES
Poursuivant une pratique déjà observée par le passé, la Délégation a tenu à entendre, outre M. Aboubacar précédemment cité, les parlementaires qui, à un titre ou un autre, ont conduit des travaux en lien avec les outre-mer : M. Serge Letchimy, Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Jean-Jacques Vlody. Une mention particulière doit être faite de la démarche consultative, en quelque sorte inverse, voulue et entreprise par M. Christophe Sirugue, parlementaire en mission sur la réforme des minima sociaux. Nous présenterons ces diverses missions successivement.
1. Le recyclage et la valorisation des déchets outre-mer (mission de M. Serge Letchimy)
Le 30 juin 2015, M. Serge Letchimy, député de la Martinique, est venu exposer à la Délégation les principales conclusions de sa mission préliminaire sur les modalités de traitement des véhicules hors d’usage. Cette mission est une suite de l’adoption de la loi sur la transition énergétique. Elle avait pour objet d’études un comportement polluant dont les outre-mer n’ont pas l’exclusivité, mais que les caractéristiques géographiques de ces territoires peuvent rendre très gênant : l’abandon de véhicules à l’état d’épaves sur la voie publique.
M. Letchimy a ouvert son intervention en apportant quelques statistiques illustrant l’ampleur matérielle du problème, qui se chiffre par milliers de véhicules abandonnés. Les conséquences esthétiques, chimiques et sanitaires de cette pollution sont considérables. Dès lors il est impératif d’assurer réellement la collecte et le traitement des épaves. L’état des installations où sont concrètement effectuées ces tâches n’est pas satisfaisant. Il serait souhaitable que l’activité de traitement des véhicules hors d’usage (élimination des déchets et récupération des pièces) soit davantage encadrée à travers un système d’installations agréées : mais, sur ce point, M. Letchimy a noté que de grands progrès restaient encore à accomplir.
Premier obstacle à ces progrès : la règlementation européenne, qui interdit d’exporter ailleurs qu’en Europe ceux des produits de la récupération considérés comme déchets dangereux, est tout à fait inadaptée à la situation géographique des territoires et conduit à des aberrations tant économiques qu’environnementales. La recherche de solutions régionales, et notamment la mutualisation des installations de traitement là où elle est matériellement possible, a les préférences de M. Letchimy.
Autre difficulté majeure : s’il existe des filières de récupération pour certains composants, tels que les huiles, les pneus et les batteries, la récupération des carcasses de véhicules n’est pas convenablement organisée ; « les concessionnaires ne sont pas impliqués dans la récupération », observe M. Letchimy et la charge de cette tâche repose sur les communes, selon des procédures dont on peut contester l’efficacité. Les compagnies d’assurances, en outre, s’impliquent inégalement, selon les territoires, dans la collecte des véhicules.
Au terme de son exposé, M. Letchimy a donné connaissance à la Délégation, en avant-première, des vingt-six propositions de son rapport, articulées autour de trois axes : l’encouragement déterminé au traitement par les centres agréés des véhicules hors d’usage ; le développement de la valorisation outre-mer des pièces réutilisées dans une perspective d’économie circulaire ; le recyclage des véhicules hors d’usage selon une règle de proximité.
2. Le suicide des jeunes Amérindiens de Guyane (mission de Mme Marie-Anne Chapdelaine et de Mme Aline Archimbaud, sénatrice)
Le 16 février 2016, Mme Marie-Anne Chapdelaine a fait part à la Délégation des conclusions du rapport qu’elle a établi conjointement avec Mme Aline Archimbaud, sénatrice de Seine-Saint-Denis, sur le suicide des jeunes Amérindiens de Guyane, rapport remis au Premier ministre le 30 novembre 2015.
Mme Chapdelaine a commencé son intervention par le rappel d’un fait dramatique : le taux de suicide est, chez trois peuples amérindiens de l’intérieur guyanais, dix fois supérieur au taux métropolitain. Ce constat est directement à l’origine de la mission qu’elle a accomplie.
Se fondant sur ses entretiens, mais surtout sur les observations qu’elle a pu faire en se rendant en Guyane et en rencontrant les personnes directement intéressées, Mme Chapdelaine a mis en avant une cause primordiale : l’isolement et l’incapacité des jeunes, même et surtout après qu’ils ont entrepris des études, à trouver leur vraie place, notamment mais pas seulement faute de débouchés économiques. Plus largement, « ces peuples aux traditions séculaires ont voulu se tourner vers la modernité, sans toutefois être accompagnés dans cette double culture ».
Ce défaut d’accompagnement se traduit notamment dans les lacunes de l’organisation de l’éducation nationale, qui prend imparfaitement en charge le problème posé par « l’accès à l’éducation d’enfants qui ne maîtrisent pas encore totalement le français ».
Evoquant les propositions du rapport, Mme Chapdelaine a d’abord souligné la nécessité de lutter contre le déracinement et ses traductions dans la vie quotidienne des jeunes, à travers, notamment, les difficultés de logement sur le lieu des études et la coupure liée à l’éloignement entre ce lieu et le domicile des parents. Elle est ensuite revenue sur la nécessité d’améliorer le « dispositif des intervenants en langue maternelle en zone amérindienne ». L’aménagement du système de santé en fonction de la configuration des lieux est une nécessité. Plus largement, elle a insisté sur la revendication d’égalité de traitement exprimée par beaucoup des personnes qu’elle a rencontrées en Guyane.
Elle a enfin préconisé une clarification du statut du Comité consultatif des populations amérindiennes et bushinenge (CCPAB), instance d’expression collective des populations guyanaises de l’intérieur.
Dans la discussion qui a suivi, révélant une sensibilité unanimement partagée à la gravité du problème évoqué par Mme Chapdelaine, Mme Chantal Berthelot, députée de la Guyane, est intervenue pour indiquer que le rapport Chapdelaine-Archimbaud avait reçu localement un accueil très positif. Elle a manifesté, en particulier, son accord avec la transformation, préconisée par le rapport, du CCPAB en grand conseil coutumier. D’une manière générale, elle a salué l’intérêt des propositions formulées, tout en déplorant la frilosité des pouvoirs publics à reconnaître officiellement, conformément aux règles posées par l’Organisation internationale du travail, les peuples autochtones, leurs spécificités culturelles et, aussi, leurs conseils coutumiers.
À l’issue de cette réunion, j’ai adressé, en ma qualité de président de la Délégation, une lettre au Président de la République pour lui faire part de notre inquiétude unanime à propos de la situation décrite par Mme Chapdelaine. J’ai reçu, en date du 10 mars 2016, la réponse suivante :
Monsieur le Président,
Vous m’avez fait part des préoccupations des membres de la délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale au sujet de la situation des peuples amérindiens de Guyane.
Particulièrement sensible aux motifs de votre intervention, je tiens à vous en remercier sincèrement. Soyez assuré de toute l’attention avec laquelle j’ai pris connaissance de vos observations et des recommandations contenues dans le rapport remis au Premier ministre par Mesdames Aline Archimbaud et Marie-Anne Chapdelaine.
Je partage vos inquiétudes. Je connais les difficultés que rencontrent les Amérindiens de Guyane, et notamment les jeunes chez qui le nombre de suicides est alarmant.
Aussi, j’ai signalé votre démarche à Madame George Pau-Langevin, ministre des outre-mer, ainsi qu’à Madame Ericka Bareigts, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité réelle, pour une analyse et une mise en œuvre au plan interministériel des préconisations du rapport.
En vous renouvelant mes remerciements, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
François HOLLANDE
3. L’insertion des DOM dans leur environnement régional (mission de M. Jean-Jacques Vlody)
Le 10 mai 2016, M. Jean-Jacques Vlody a partagé avec les membres de la Délégation l’état de ses réflexions sur la mission dont il a été chargé par le Gouvernement afin, a-t-il précisé, de déterminer les conditions optimales de l’insertion des départements et régions d’outre-mer dans leurs espaces géographiques respectifs ; son champ de compétence ne s’étend pas à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis et Futuna, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon. La qualité de l’insertion recherchée doit être appréciée selon de multiples critères, économiques, sociaux et culturels. Le paradoxe est qu’il s’agit de déterminer ainsi comment des régions considérées comme ultrapériphériques au regard des normes européennes peuvent acquérir en même temps un rôle central dans les zones où elles se trouvent. Or, constate M. Vlody, les régions ultramarines ont souvent l’impression que la France mène dans ces zones une politique contraire à leurs intérêts. La consécration législative en cours de la coopération régionale doit se traduire concrètement par la possibilité pour les collectivités d’outre-mer de passer des accords avec les pays de la zone, de sorte que le rayonnement international de la France puisse passer par les départements et régions de l’outre-mer, que ce soit pour la sécurité collective, la coordination des politiques de santé ou les échanges d’informations météorologiques.
La circulation transfrontalière des personnes pourrait offrir un terrain de choix pour cette coopération régionale dont le développement paraît très opportun à M. Vlody, qui s’est dit encouragé dans cette opinion par les observations qu’il a pu faire sur la gestion des frontières de la Guyane par les administrations responsables sur place.
Dans la discussion qui a suivi l’exposé de M. Vlody, M. Ibrahim Aboubacar est intervenu pour fournir quelques exemples concrets des obstacles auxquels se heurte la pratique de la coopération régionale dans l’Océan Indien : l’installation de câbles de communication sous-marins, le rôle des normes dans le ralentissement constaté des échanges économiques, les restrictions au développement des réseaux de communication, etc.
En réponse, M. Vlody a notamment insisté sur la difficulté éprouvée par les administrations d’Etat à prendre la juste mesure de l’importance que peut représenter dans un territoire donné un problème qui peut paraître non prioritaire si on le rapproche des grands enjeux nationaux. Il a rejoint M. Aboubacar sur la question des normes.
4. La réforme des minima sociaux (consultation de la Délégation par M. Christophe Sirugue, parlementaire en mission)
La réunion tenue par la Délégation, le 8 mars 2016, a été l’occasion d’une innovation dont il faut d’ailleurs se féliciter, puisqu’elle a été provoquée par une demande de consultation et d’échange qui m’a été adressée par notre collègue M. Christophe Sirugue, chargé par le Premier ministre d’une mission de réflexion sur les minima sociaux. M. Sirugue, conscient de la sensibilité des outre-mer à un tel sujet, a souhaité recueillir l’avis des membres de la Délégation avant de donner un tour définitif aux conclusions qu’il devait présenter.
M. Sirugue a commencé par retracer le cadre d’ensemble de la réflexion qui lui était demandée, en rappelant qu’elle faisait suite à l’évaluation du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale récemment conduite sur instruction du Premier ministre. Il a résumé l’état de ses constatations critiques en soulignant la complexité des neuf dispositifs juxtaposés de minima sociaux et « leur iniquité selon le minimum social dont on bénéficie ». Les bénéficiaires potentiels de ces allocations éprouvent de réelles difficultés à faire valoir leurs droits.
Ensuite M. Sirugue a exposé les trois scénarios de réforme possibles entre lesquels il lui revenait de faire un choix : maintien des minima sociaux existants avec une évolution des paramètres d’octroi dans le sens d’une plus grande équité et d’une plus grande accessibilité ; fusion de ces minima actuels en trois nouveaux : l’allocation de solidarité aux personnes âgées qui serait globalement maintenue, fusion des deux allocations versées aux personnes handicapées ; création d’une « couverture socle » universelle.
Parallèlement, il a suggéré, d’une part, le retour de la charge financière du revenu de solidarité active dans le budget de l’Etat et, d’autre part, l’incitation à la conduite de véritables politiques d’insertion par les départements, qui semblent s’en être fortement désintéressés ces derniers temps.
Il y a lieu, pour M. Sirugue, d’accorder une attention spéciale à l’impact potentiel de l’effort de réforme sur les outre-mer, en raison, d’une part, de l’ampleur matérielle du revenu de solidarité active dans ces territoires, et, d’autre part, de l’existence d’un dispositif spécifique, le RSO. La fonction de « régulateur social » jouée dans les outre-mer par les minima sociaux, beaucoup plus marquée qu’en métropole, la question de la capacité des collectivités locales des outre-mer à conduire des politiques d’insertion plus ambitieuses, peuvent amener à s’interroger sur l’opportunité, voire même la possibilité de mettre en œuvre telles quelles dans les outre-mer les réformes qu’il serait décidé d’appliquer en métropole : telle est la question que M. Sirugue a souhaité soumettre à la Délégation.
En réponse à cette interrogation, j’ai rappelé la sensibilité extrême des populations ultramarines à l’encontre de toute idée de différence de traitement entre les outre-mer et la métropole, la notion de « traitement spécifique » leur apparaissant, à l’expérience, comme équivalente à celle de « traitement minimum ». La prise en compte de spécificités qui sont réelles ne peut être envisagée qu’au prix de la proclamation préalable du principe d’ensemble de l’égalité de traitement. M. Boinali Said et Mme Brigitte Allain, puis M. Ibrahim Aboubacar ont ensuite confirmé globalement le sens de cette réponse, en insistant plus particulièrement sur son applicabilité à la situation de Mayotte.
C. LES AUDITIONS D’INSTITUTIONS INVESTIES DE COMPÉTENCES INTERESSANT LES OUTRE-MER
Parmi les missions habituelles de la Délégation, figurent les relations avec les institutions publiques et parapubliques dont l’action intéresse, en tout ou en partie, les outre-mer. A ce titre, la Délégation a entendu des représentants de l’Agence française de développement (AFD) et de l’Institut d’émission d’outre-mer (IEDOM).
1. L’état des actions de l’Agence française de développement (audition de M. Fabrice Richy, directeur du département outre-mer)
Comme on le sait, l’Agence française de développement poursuit en parallèle des actions de soutien aux pays en voie de développement et des actions d’accompagnement au développement dans les outre-mer français. Pour faire le point sur l’état de ces dernières actions, la Délégation a reçu à sa demande, le 5 mai 2015, M. Fabrice Richy, directeur du département outre-mer de l’AFD.
M. Richy a longuement décrit les programmes de l’AFD dans les outre-mer, dont il a rappelé d’emblée qu’ils s’articulaient selon quatre priorités : « soutenir les politiques publiques, notamment en faveur de la cohésion sociale et de l’environnement ; renforcer le secteur privé pour créer localement de l’emploi et de la valeur ajoutée ; améliorer l’habitat et l’aménagement urbain ; encourager l’intégration régionale ».
Le soutien financier aux politiques publiques, principal poste des financements accordés par l’AFD, bénéficie pour un tiers aux collectivités locales et pour deux tiers à leurs établissements publics et aux sociétés d’économie mixte. M. Richy a mis clairement en évidence le rôle d’accompagnement et de coopération que joue l’Agence pour la définition de la politique financière des collectivités locales, ajoutant que le bon accomplissement de cette mission impliquait une adaptation constante des produits financiers mis à la disposition des collectivités et un effort continu de formation des responsables administratifs chargés de la gestion financière.
La deuxième priorité, renforcer le secteur privé, s’impose au regard de la situation de l’emploi dans les outre-mer. Elle prend quatre formes, successivement détaillées par M. Richy : l’octroi de crédits à court et moyen terme, pour le compte de Bpifrance Financement, les garanties d’emprunt, le soutien au micro-crédit, et l’intervention directe auprès des entreprises privées dans le cadre de co-financements.
Troisième priorité : l’aménagement et l’habitat, sous la forme de soutien à de grandes opérations d’aménagement, de systèmes combinés de prêts à échéances diverses, et enfin d’audit et d’appui technique aux sociétés de logement social.
En abordant la quatrième et dernière priorité stratégique, l’encouragement à l’intégration régionale des outre-mer français, M. Richy a reconnu que l’AFD n’avait pas encore pleinement su tirer profit de l’atout que lui donnait, pour la réussite de cet objectif, sa présence simultanée en appui aux outre-mer et en accompagnement du développement des États voisins de ceux-ci.
En conclusion, il a exprimé l’intention de maintenir à un haut niveau les concours financiers apportés aux outre-mer et d’accompagner au plus près les politiques locales qui s’inscrivent dans les priorités stratégiques de l’Agence.
Dans le débat qui a suivi la présentation de M. Richy, M. Patrick Lebreton, revenant sur la fin de l’exposé, s’est interrogé sur la cohérence des choix de l’AFD, qui en arrive à soutenir simultanément, dans la même zone géographique, deux projets de même nature conduits, l’un dans un État indépendant, l’autre dans une région d’outre-mer, alors qu’ils sont manifestement en situation de concurrence. M. Jean-Jacques Vlody a demandé des précisions sur les modalités de l’engagement de l’AFD dans le soutien au logement. M. Fabrice Richy a confirmé que les responsables de l’Agence avaient bien conscience du problème posé par la situation décrite par M. Lebreton et que des dispositions de gestion étaient prises pour en éviter autant que possible le renouvellement ; il a rappelé que désormais l’Agence française de développement n’intervenait plus directement dans l’activité logement.
2. La transformation du statut de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer – IEDOM (audition de MM. Hervé Gonsard, directeur général, et Philippe La Cognata, directeur)
Le 26 avril 2016, M. Hervé Gonsard et M. Philippe La Cognata, respectivement directeur général et directeur de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, sont venus expliquer aux membres de la Délégation les motifs de la récente transformation de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) en société anonyme simplifiée (SAS) au capital entièrement détenu par la Banque de France.
M. Gonsard a exposé que le statut antérieur de l’IEDOM – établissement public – ne correspondait ni à la réalité de la situation de l’Institut, placé depuis longtemps sous la tutelle effective de la Banque de France, ni aux normes d’indépendance par rapport aux autorités gouvernementales que la Banque est tenue de respecter en raison de son appartenance au Système bancaire européen.
La solution d’une intégration pure et simple de l’IEDOM dans les structures de la Banque de France, avec disparition de sa personnalité juridique, a été écartée. Elle eût en effet entraîné l’alignement des conditions de recrutement des cadres des services implantés dans les outre-mer sur les règles de droit commun applicables au personnel de la Banque, et donc empêché la poursuite de la pratique du recrutement local. De plus, elle aurait amené à appliquer aux personnels de l’IEDOM les règles de rémunération en vigueur à la Banque, qui leur auraient été moins favorables.
La transformation de l’IEDOM en société par actions simplifiée réalise donc, aux yeux de M. Gonsard, le meilleur compromis possible entre les exigences des normes européennes et les garanties statutaires attendues par les personnels.
En réponse à une question de M. Philippe Naillet, M. Gonsard a précisé que le changement de statut ne porterait aucune atteinte aux activités de l’IEDOM pour la cotation des entreprises, essentielle pour la détermination des capacités d’emprunt de celles-ci.
3. L’état du paysage audiovisuel dans les outre-mer français (audition de M. Patrice Gélinet, membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel)
L’audiovisuel dans les outre-mer fait partie des attributions plus spécialement dévolues à M. Patrice Gélinet, membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui est venu exposer devant la Délégation les constats et les suggestions que lui inspirent cinq ans d’exercice de ces fonctions.
M. Gélinet a donné une présentation détaillée, territoire par territoire, du paysage audiovisuel des outre-mer. À propos de l’offre de télévision, il a noté que l’arrivée de la télévision numérique terrestre dans les outre-mer, en 2010, avait permis un net accroissement d’une offre de télévisions gratuite incomparablement inférieure, cependant, à ce qu’elle est dans l’Hexagone. En revanche, l’offre de programmes radiophoniques est globalement du même niveau, voire, à La Réunion, supérieure. Les radios associatives sont très nombreuses et les caractéristiques géographiques des territoires font jouer à ces radios un rôle essentiel dans la communication de proximité. La situation de la Nouvelle Calédonie est particulière, car il n’y existe que quatre radios privées et deux radios publiques, dont France Inter, « seule chaîne de radio du service public accessible à l’ensemble des ultramarins. »
Entre l’hexagone et les outre-mer, ce tableau fait apparaître une situation d’inégalité manifeste, d’abord, pour l’offre de télévision. D’une part, et en violation de l’objectif fixé par la loi de septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’offre de télévision gratuite outre-mer reste très inférieure à ce qu’elle est en métropole. La réalisation de l’égalité, a expliqué M. Gélinet, se heurte essentiellement au coût de transport outre-mer du signal des chaînes nationales gratuites, qui paraît aux opérateurs privés irrémédiablement inférieur au montant des recettes publicitaires qu’ils peuvent escompter sur un marché local limité. D’autre part, le passage à la haute définition dans les outre-mer représente un surcoût de 40 % rédhibitoire pour les opérateurs.
Pour la radio, M. Gélinet exprime un constat différent : « le nombre de chaînes de radio est à peu près satisfaisant », sous réserve de quelques lacunes. Il n’est, d’ailleurs, globalement pas possible, dans les outre-mer comme dans l’Hexagone, d’augmenter le nombre des chaînes privées sans perturber le marché publicitaire local. Seule la Nouvelle Calédonie pose un problème spécifique de rareté de l’offre.
Des inégalités peuvent également être constatées entre les outre-mer. La concurrence écrasante de France Télévisions contribue à fragiliser la situation des chaînes de télévision privées présentes dans ces territoires, jusqu’à leur faire perdre l’accès aux droits de diffusion des programmes de TF1 que la société publique de programme a seule les moyens financiers d’acquérir. Pour M. Gélinet, la mutualisation des programmes se révèle dès lors la seule solution pour la pérennisation des chaînes privées.
A la suite de l’exposé de M. Gélinet, Mme Maina Sage, s’appuyant sur son expérience personnelle, rappelle que les chaînes privées dont il est ici question sont souvent, en réalité, des « chaînes pays » soutenues et financées par les territoires. Les problèmes, bien réels, de coût et de taille des marchés publicitaires mentionnés par M. Gélinet incitent à la prudence dans la conduite d’un élargissement de l’offre passant par la TNT. Du moins faudrait-il accompagner les radios locales dans leur recherche de ressources financières, notamment auprès du Fonds de soutien à l’expression radiophonique.
4. L’aide aux activités culturelles des outre-mer (audition de M. Daniel Carcel, directeur de l’Agence de promotion et de diffusion des cultures de l’outre-mer)
Le 29 juin 2016, M. Daniel Carcel est venu présenter aux membres de la Délégation les activités de l’Agence de promotion et de diffusion des cultures de l’outre-mer, dont il est le directeur depuis 2013. Il a rappelé les objectifs principaux de l’action de l’Agence : aide aux productions littéraires, théâtrales et artistiques des outre-mer, aide à la diffusion des œuvres, notamment dans les manifestations culturelles internationales, constitution d’une base de références commune facilitant les contacts en réseaux, etc. L’ action de l’Agence, dans ce cadre, vise non seulement à faire connaître dans l’Hexagone les activités culturelles des outre-mer, mais encore à favoriser les relations culturelles entre les outre-mer, auxquelles la distance et le coût des transports font immédiatement obstacle.
S’appuyant sur les délibérations de l’assemblée générale de l’Agence, tenue la veille de l’audition, M. Carcel a indiqué qu’elles avaient conduit à stabiliser la structure associative de celle-ci en fonction de l’adhésion manifestée par les collectivités ultramarines à sa démarche. La restriction des dépenses de fonctionnement décidée à la suite de cette clarification juridique permet, a-t-il ajouté, de doter l’Agence de crédits d’intervention dont elle ne disposait pas jusqu’à présent.
Au cours du débat qui a suivi, l’accent a été mis par Mme Chantal Berthelot, Mme Gabrielle Louis-Carabin et moi-même sur les dispositions que pourrait prendre l’Agence, dans le nouveau cadre qui a été fixé à ses missions, pour se faire mieux connaître des bénéficiaires potentiels de son action et en accroître ainsi l’efficacité.
La Délégation a tenu deux réunions en compagnie d’experts aux compétences très différentes, puisque la première, s’inscrivant dans la commémoration du 70ème anniversaire de la départementalisation, s’intéressait à l’histoire et à la sociologie des DOM, tandis que la seconde était consacrée au problème crucial de la ressource en eau dans nos territoires.
1. La commémoration du 70e anniversaire de la départementalisation (audition de MM. Marcel Dorigny, historien, et Nicolas Roinsard, sociologue)
Le 19 mars 1946, Félix Gouin, président du Gouvernement provisoire, promulguait la loi érigeant les anciennes colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane en départements français. L’évènement a été commémoré en divers lieux, notamment au ministère des outre-mer. La Délégation s’est associée, le 30 mars 2016, à cette œuvre de mémoire en conviant des universitaires à lui présenter un double regard scientifique sur ce changement de statut et ses suites. Regard historique, avec M. Marcel Dorigny, maître de conférences à l’université Paris VIII et membre de la Société d’histoire de l’outre-mer, connu pour ses travaux sur l’esclavage dans les Antilles françaises ; regard sociologique, avec M. Nicolas Roinsard, maître de conférences à l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, dont les recherches ont principalement porté sur Mayotte et La Réunion.
L’essentiel de la contribution de M. Marcel Dorigny a consisté à rappeler - fait apparemment peu mentionné lors des récentes commémorations – que la loi de 1946 ne fut pas le premier texte juridique érigeant en départements des territoires d’outre-mer. La départementalisation fut d’abord, historiquement, une œuvre de la Révolution française, inscrite dans la Constitution de l’an III. Pour les Conventionnels, la départementalisation des colonies françaises, symbole de l’application universelle et égale de la loi, était la garantie institutionnelle de l’abolition de l’esclavage, qu’ils venaient de décréter par la loi du 16 pluviôse, an II. La Constitution de l’an VIII établie par le Premier consul Bonaparte, en appliquant aux colonies le principe du statut spécifique, a en réalité favorisé le retour des pratiques esclavagistes, dont il faudra attendre 1848 pour voir la disparition. La départementalisation de 1946, soutenue par Raymond Vergès et Aimé Césaire, renouvelle la démarche des révolutionnaires, dans un contexte historique évidemment différent et avec un champ géographique plus restreint. Selon M. Dorigny, elle a certainement été un facteur d’amélioration de la situation des populations des outre-mer, notamment par la voie de l’éducation, même si on ne peut pas affirmer qu’elle se soit traduite partout et dans tous les domaines par un progrès effectif de l’égalité des droits.
Rebondissant sur cette dernière affirmation, M. Nicolas Roinsard a rappelé tout d’abord que la départementalisation correspond à l’objectif « de rattrapage, d’assimilation législative et de remise à niveau par rapport à la métropole » que se fixent alors les pouvoirs publics. De fait, la départementalisation a permis de réels progrès, notamment pour la santé, l’habitat, les infrastructures et l’éducation. Elle s’est en outre accompagnée du « passage d’une société traditionnelle et rurale à une société moderne dominée par une économie tertiaire ». Le changement majeur représenté par « l’avènement d’une classe moyenne salariée alimentée par la multiplication des emplois publics » n’a pas remis en cause la répartition fondamentale entre les groupes sociaux dominants et dominés, la division sociale correspondant souvent, en outre, à une division raciale.
Au-delà de la question immédiate de la vie chère, la persistance de cette structuration fortement inégalitaire explique, selon M. Roinsard, la violence des contestations sociales que l’on a pu constater dans les outre-mer de 2008 à 2011, contestations qui remettent en question « les promesses égalitaires et républicaines de la départementalisation ». En bref, la formule d’Aimé Césaire se vérifie toujours, soixante-dix ans après la loi du 19 mars 1946 : « les sociétés d’outre-mer demeurent des départements à part davantage que des départements à part entière. »
M. Roinsard a illustré cette analyse générale en se rapportant à l’exemple de La Réunion. Il a fait apparaître que la politique de l’Etat dans ce département, après s’être concentrée sur la modernisation des infrastructures, n’avait engagé qu’à partir des années 60 des actions qui, portant sur la réforme foncière, la scolarisation, la protection sociale, et le développement des emplois publics, étaient susceptibles d’exercer une influence sur la structuration de la société.
Les effets de cette politique sont patents, à commencer par la marginalisation, en trente ans, de la population agricole dans la population active totale, s’accompagnant d’un accroissement très rapide, et sans doute incomplètement mesuré par les statistiques, du chômage, chômage de longue durée et qui touche massivement les jeunes. La pression démographique ne peut qu’amplifier le phénomène, au moins jusque dans les années 2030.
L’essor de l’économie tertiaire, facteur de développement d’une société de consommation, n’est pas favorable à l’emploi de chômeurs dont le niveau de qualification ne correspond pas à ses besoins. L’emploi public, dont la croissance accompagne la tertiarisation de la société, a profité bien davantage, dans les quarante premières années de la départementalisation, aux métropolitains qu’aux Réunionnais, d’autant plus que le système éducatif a manifesté une certaine inertie par rapport à la formation des jeunes en âge d’accéder au marché du travail.
M. Roinsard a dégagé les constats qui permettent de voir dans la société réunionnaise « une structure de classe marquée par l’inégalité et la pauvreté ». Il a relevé en particulier que le salaire réunionnais moyen est inférieur de 12 % à la moyenne métropolitaine, et que près d’un Réunionnais sur deux appartient à la catégorie des inactifs, où prédominent les retraités disposant de faibles ressources. Le nombre de ménages réunionnais vivant sous le seuil de pauvreté nationale est 3,8 fois supérieur à la proportion métropolitaine. Il a fallu du temps pour mettre en place à La Réunion une véritable économie de transfert, avec le revenu minimum d’insertion, apparu en 2009 et qui est devenu rapidement « une composante importante de l’économie des pauvres », permettant cependant « une amélioration sensible des conditions de vie ».
Le poids de la mécanique du RMI à La Réunion n’est pas compréhensible, d’après M. Roinsard, si l’on ne prend pas en compte la prégnance des « mécanismes de reproduction sociale » hérités de la société de plantations coloniale, qui engendrent une certaine acceptation collective des inégalités. Dès lors, « la départementalisation a davantage déplacé que supprimé les conditions originelles de production des inégalités », à La Réunion comme dans les autres départements d’outre-mer. Il reste à savoir, a-t-il conclu, si la jeunesse actuelle, dont les conditions sociales dominantes entravent les aspirations à une meilleure intégration économique, en viendra ou non à voir dans ces inégalités bien réelles des iniquités, « terreau fertile pour la contestation et la violence sociales ».
2. Le service public de l’eau – distribution d’eau potable et assainissement – dans les départements d’outre-mer (audition de M. Pierre-Alain Roche, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts)
Le 24 mai 2016, la Délégation a reçu M. Pierre-Alain Roche, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, coordonnateur d’un rapport intitulé « Propositions pour un plan d’action pour l’eau dans les départements et régions d’outre-mer et à Saint-Martin », élaboré à la demande conjointe de la ministre de l’écologie et de la ministre des outre-mer.
M. Roche a souhaité replacer, en préalable, son étude dans la perspective des difficultés générales auxquelles sont confrontés les outre-mer : pression démographique, faiblesse des revenus, haut niveau de chômage et taux de mortalité infantile, important à considérer dans l’évaluation d’une politique de l’eau. Il a relevé ensuite des spécificités institutionnelles : le rôle d’amortisseur social de l’emploi public, qui se répercute, entre autres, sur la productivité du service public de l’eau, les difficultés chroniques des finances locales, et par contraste l’adéquation positive des limites physiques des bassins hydrographiques avec les découpages administratifs des territoires communaux. Enfin, il a mentionné l’impact des incertitudes foncières.
Abordant ensuite le fond de l’étude, M. Roche a affirmé d’emblée que la qualité des services essentiels de distribution d’eau potable à Mayotte et en Guyane lui paraissait poser gravement question au regard des normes internationales généralement reconnues. Il a noté, de manière générale, l’extrême variété des situations financières que l’on peut observer dans les outre-mer. En outre, selon lui, si des efforts significatifs sont consentis pour l’investissement, on constate « la grande faiblesse des efforts de gestion et de service des usagers », et les communes n’exercent pas toujours avec toute la rigueur souhaitable leur responsabilité à l’égard de leurs concessionnaires ou de leurs régies, selon le cas.
La régulation du service public de l’eau se heurte à des difficultés que l’on rencontre aussi dans l’Hexagone, mais qui sont particulièrement aiguës dans les outre-mer. Il est malaisé d’interpréter ces difficultés à la seule lumière du niveau des prix facturés, dans la mesure où, « dans la facturation des ménages, prix et niveau de consommation se compensent ». Récurrente à Mayotte et en Guyane, l’insuffisante qualité du service de traitement des eaux se manifeste aussi à La Réunion, mais de manière extrêmement localisée. En Guadeloupe, le niveau des pertes dans le système de distribution d’eau est tel, pour M. Roche, qu’il est permis de parler d’un véritable délabrement des installations, qui ne peut que s’aggraver faute de recours à des solutions de gestion technique pourtant bien connues. Cette situation peut se reproduire à plus ou moins long terme dans tous les outre-mer.
M. Roche a ensuite mis en cause les défauts de comptage ou de recouvrement qui obèrent directement les recettes du service public. Pour lui, « la question du consentement à payer se pose réellement », moins de la part des consommateurs individuels que de certaines collectivités ou de grands ensembles immobiliers. La conjonction d’un fort taux d’impayés et de la mauvaise qualité du service rendu ne peut que compromettre fortement la réalisation de l’équilibre financier. La solution à ces difficultés tient moins à l’accroissement des investissements en infrastructures de captage et de transfert qu’à la poursuite d’un effort quotidien pour l’amélioration concrète du service.
Abordant la situation du service public de l’assainissement, M. Roche a estimé qu’elle était globalement identique à celle du service public de l’eau potable. Des investissements très importants ont été consentis, mais ils sont souvent en complète disproportion par rapport aux besoins réels. Les controverses sur l’adaptation aux conditions climatiques locales des installations dissimulent aisément des imperfections dans l’entretien courant.
Le remède aux insuffisances ainsi constatées passe, selon le rapport, par la mise au point de systèmes de financement allant directement, non pas aux investissements, mais au renforcement des capacités de gestion financière courante et de maintenance des installations. Il convient en effet de surmonter le manque d’attractivité, pour les banques, de collectivités locales dont les capacités d’autofinancement sont inégalement préservées. La séparation des comptes généraux de la collectivité et des comptes annexes du service public de l’eau peut apporter un premier remède, en permettant de dégager des critères de productivité spécifiques pour ce service.
L’instrument opérationnel du financement souhaité pourrait être, de l’avis de M. Roche, une « conférence régionale des bailleurs » rassemblant l’ensemble des institutions et établissements susceptibles d’accorder un concours financier et concluant avec chaque collectivité un contrat à cinq ans, définissant les enjeux d’amélioration du service que l’on veut atteindre, avec des indicateurs de résultat et une programmation adaptée des financements. Bien entendu, cette formule ne peut être efficace que si les parties partagent au préalable un diagnostic exactement établi sur la performance du service, sa gouvernance et le rapport qualité/prix des prestations : or, à ce jour, il est impossible d’obtenir des statistiques sur la disponibilité effective du service.
Le rapport préconise en outre la création de formations techniques, notamment pour accompagner la montée en puissance des travaux sur les réseaux. Il faut en effet avoir conscience du fait que l’exécution de travaux sur la voie publique tels que l’installation de canalisations est une opération complexe, qui prend du temps et ne peut se traiter sur le mode industriel.
En écho à l’exposé de M. Roche, M. Jean-Jacques Vlody a tout d’abord rappelé, se référant à la situation de La Réunion, que le préfet était allé jusqu’à engager des poursuites pénales contre les communes pour infraction à la loi sur l’eau. S’interrogeant sur la disponibilité des fonds structurels européens pour le financement des coûteux investissements nécessaires, il a estimé que le principal problème rencontré par les collectivités tenait à la consolidation des ressources affectées à ces travaux et à la difficulté de mobiliser les concours financiers nécessaires.
En réponse, M. Roche a notamment fait valoir qu’en se focalisant sur des chiffres globaux d’investissements nécessaires, on risquait de créer chez les responsables des collectivités un sentiment d’impuissance, dans la mesure où nombre d’entre elles n’ont pas, à l’évidence, la capacité d’entretenir le rythme d’investissement correspondant. Il a rappelé que la priorité devait être donnée à la reconstitution, via la conférence des bailleurs, de capacités de financement, moyennant des progrès vers l’équilibre des comptes, pour des collectivités dont l’absence ou l’insuffisance de l’autofinancement empêche, à défaut, la définition de projets à long terme. Quant aux difficultés d’accès aux fonds européens, elles sont vraisemblablement liées à la récente redéfinition, plus restrictive, des conditions d’éligibilité.
*
* *
La Délégation a examiné le présent rapport au cours de sa réunion du mercredi 29 juin 2016.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Mes chers collègues, la présentation d’un rapport d’activité est toujours un exercice un peu convenu, et mon intervention de ce jour risque de ne pas échapper totalement à la règle.
Certes, je n’y reprendrai pas les éléments statistiques qui figurent dans le projet de rapport qui vous a été distribué. En effet, pour nous éviter le commun désagrément de leur sèche énumération, ces éléments, extraits du rapport, vous ont été adressés il y a quelques jours. Bien entendu, sauf si vous y voyez un inconvénient majeur, les indications figurant dans le projet seront complétées pour tenir compte de la présente réunion. Mais globalement les chiffres qui vous ont été transmis vous donnent une idée précise de la réalité de l’activité de la Délégation.
Il est naturellement d’usage, dans le cadre d’un rapport d’activité, de mettre en lumière les aspects positifs des réalisations de l’année passée, en recourant tant aux chiffres – vous les connaissez – qu’au commentaire. C’est bien l’exercice convenu dont je vous parlais en commençant tout à l’heure.
Mais, aujourd’hui, il me semble que l’exercice n’est pas si habituel que cela pour notre Délégation et que nous pouvons avoir de légitimes motifs de satisfaction si nous apprécions le bilan de ses activités en fonction des considérations qui ont poussé le président de l’Assemblée nationale – il le rappelait encore il y a quelques jours en recevant les élus ultramarins – à en proposer la création, selon une procédure rapide, sans attendre les aléas de la consécration législative.
Dans la pensée de son créateur et de tous ceux qui ont appuyé son initiative, la Délégation est en effet, pour les outre-mer, à la fois un lieu d’expression, d’information et de représentation – ce dernier terme devant être pris en son sens le plus dense.
Lieu d’expression dans le débat politique, que ce soit à l’occasion de procédures législatives ou d’autres initiatives. L’existence de la Délégation donne aux élus ultramarins et, au-delà, aux élus métropolitains sensibles aux problèmes des outre-mer, le moyen de faire entendre la voix de nos territoires, de proposer, voire d’imposer la prise en compte des problèmes qui leur sont propres dans des projets politiques ou des procédures législatives où ces problèmes sont présents mais ne sont pas ou pas suffisamment reconnus. Nous y sommes bien parvenus cette année, que ce soit avec le rapport sur les conséquences du changement climatique sur les outre-mer ou avec le rapport sur la réforme du code du travail. A chaque fois, notre action – l’action de nos rapporteurs, l’intervention collective de la Délégation – a rappelé à ceux que la pression d’autres priorités avait conduits à les oublier la réalité et l’importance des aspects ultramarins de nos débats nationaux.
Lieu d’information ensuite. Nous avons eu à cœur d’organiser tout au long de cette année une série d’auditions dont vous avez pu apprécier la diversité. Nous avons entendu plusieurs de nos collègues qui, à des titres variés, ont contribué à la réflexion du pouvoir exécutif. Nous avons entendu des représentants d’institutions dont les compétences concernent, en totalité ou en partie, les outre-mer. Nous avons reçu des experts, un historien, un sociologue, un ingénieur des ponts et chaussées. La lecture des comptes rendus, d’ores et déjà en ligne et qui seront, comme à l’accoutumée, reproduits dans la version définitive du rapport écrit, vous permettra de prendre conscience de la masse d’informations contenue dans ces différentes contributions.
Lieu de représentation enfin. J’ai dit qu’il fallait prendre ce terme au sens le plus fort. La Délégation aux outre-mer est apparue, cette année, comme l’interlocuteur valable, la porte d’entrée de notre Assemblée pour les questions ultramarines. C’est clairement parce qu’il a bien voulu lui reconnaître cette qualité que le Premier président de la Cour des comptes a délibérément choisi la Délégation comme lieu de la première présentation publique de son rapport sur la décentralisation de Mayotte. Et quand notre collègue Christophe Sirugue a voulu connaître l’opinion des outre-mer dans le cadre de sa réflexion sur la réforme des minima sociaux, c’est tout naturellement à notre Délégation qu’il a songé.
Alors, oui, nous avons de nombreux motifs de satisfaction. La pratique vérifie la fécondité objective de l’idée du président Bartolone. La Délégation aux outre-mer est bien un lieu adapté à l’expression plurielle de la sensibilité ultramarine.
Lieu d’autant plus adapté que, sans renier les différences politiques qui nous distinguent et parfois nous opposent, nous avons su travailler en bonne intelligence dans l’intérêt de nos territoires : le soutien apporté à ma proposition de résolution sur les effets du changement climatique dans les outre-mer en est la preuve, et il a assis la représentativité de notre Délégation.
Je tiens également à remercier les collègues qui, en acceptant de prendre en charge un rapport ou en participant à nos réunions, assurent du même coup l’effectivité et la consistance de nos travaux.
Mais je ne peux pas cacher l’insatisfaction que j’éprouve en constatant la fréquentation parfois bien mesurée de nos réunions.
Certes, je suis aussi bien placé que quiconque pour comprendre les contraintes de distance et de temps qui empêchent, en particulier, nos collègues ultramarins d’envisager leur présence à l’ensemble de nos réunions. Mais, entre cette situation « idéale » et le désintérêt qu’il me faut bien constater chez beaucoup, n’est-il pas possible d’envisager une attitude médiane, j’allais dire une place un peu plus grande à notre Délégation dans nos emplois du temps ?
Il y va de la substance de nos travaux, de la crédibilité de notre démarche collective et individuelle, tant à l’égard de nos interlocuteurs politiques et institutionnels que des populations de nos territoires. Je ne m’acquitterais pas convenablement de la charge que j’ai l’honneur d’exercer si je ne vous faisais pas part, sereinement mais clairement, de ce sentiment.
Au moment où l’on va entrer dans la période pré-électorale pour l’élection présidentielle, puis les élections législatives, il me semble indispensable que nous poursuivions collectivement nos efforts pour continuer à faire vivre cette délégation, et plus encore pour la développer, dans l’intérêt de nos territoires et des citoyens qui les habitent, comme dans l’intérêt national.
Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix le rapport d’activité de la Délégation.
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.
AUDITIONS DE LA DÉLÉGATION3
I. LES AUDITIONS SUR LA SITUATION DE MAYOTTE
A. PRÉSENTATION PAR M. IBRAHIM ABOUBACAR DU DOCUMENT STRATEGIQUE MAYOTTE 2025 – UNE AMBITION POUR LA REPUBLIQUE
(Séance du 16 juillet 2015)
M. le Président Jean-Claude Fruteau. Je vous rappelle qu’en juin dernier, à Mamoudzou, le Premier ministre, en visite officielle dans l’Océan indien, a signé, avec les élus de l’île, un document intitulé Mayotte 2025 – Une ambition pour la République. Ce document, selon les propres termes de Mme Pau-Langevin, ministre des outre-mer, doit beaucoup à la ténacité et à la force de conviction de notre collègue Aboubacar.
J’ai donc demandé à celui-ci de bien vouloir présenter à la délégation ce document fondamental pour l’avenir de son département. En effet, comme le souligne le préambule, il trace, pour les dix années à venir, le cheminement de Mayotte vers le droit commun de la République.
M. Ibrahim Aboubacar. Puisque j’ai pris soin de communiquer le document à l’ensemble de nos collègues, je serai très synthétique. Depuis le début de la législature, j’ai été amené à intervenir au moins à trois reprises en séance pour en réclamer l’élaboration. Je me suis dans le même temps beaucoup battu avec les différents ministères concernés pour leur faire admettre la nécessité d’un document stratégique pour piloter la mise en œuvre de la départementalisation de Mayotte dont chacun constatait qu’elle commençait à partir en roue libre.
En effet, le processus statutaire de Mayotte a été lancé avec l’élaboration d’un premier document stratégique, dit « Accord sur l’avenir de Mayotte », que nous avons signé le 27 janvier 2000 avec par Jean-Jacques Queyranne, secrétaire d’État à l’outre-mer, Lionel Jospin étant Premier ministre. À défaut de savoir exactement la direction à prendre, ce document s’inspirait largement des dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie et prévoyait une période transitoire d’une dizaine d’années et le lancement de réformes afin que, parvenus en 2010, nous soyons en mesure de choisir entre la collectivité départementale créée en 2001 et le département. Le conseil général devait éventuellement déclencher cette dernière phase et l’assemblée élue en 2008 a souhaité à l’unanimité le lancement du processus de départementalisation. Nous nous sommes dès lors mis d’accord avec l’État pour élaborer un document en précisant les conditions. Nommé rapporteur du comité pour la départementalisation de Mayotte, j’ai remis mon rapport au Premier ministre François Fillon fin 2008 ; malheureusement, en l’absence d’accord, l’État a souhaité publier sa propre feuille de route, intitulé « Pacte pour la départementalisation de Mayotte ».
Contrairement à ce que son nom laissait entendre, ce « pacte » n’engageait que le Gouvernement puisqu’il n’était pas le fruit des travaux des uns et des autres ; du reste, il n’a pas été soumis à signature. Quant à nous, élus, nous avons refusé qu’il constitue la question posée à la population. Ainsi, contrairement à la consultation de l’an 2000 qui nous demandait si nous acceptions ou non l’Accord sur l’avenir de Mayotte, celle de 2009 se bornait à nous demander si nous acceptions la transformation de Mayotte en département d’outre-mer.
À l’unanimité, la classe politique de Mayotte a alors décidé de faire campagne sur la départementalisation, signalant que le Pacte contenait les orientations du Gouvernement. Chose exceptionnelle dans l’histoire de la République, c’est le préfet de Mayotte qui a été mandaté pour sillonner les dix-sept communes de l’île afin d’informer pleinement la population des orientations gouvernementales.
Certains pourraient être amenés à penser que le présent document stratégique serait un reniement dudit Pacte ou un changement de position de la part des élus de Mayotte ; il n’en est rien. La preuve en est que le nouveau document a été signé par les quatre parlementaires de l’île, par le président du conseil général, le président du conseil économique, social et environnemental, le président de l’association des maires… personnalités qui ne sont pas du même bord politique. Le véritable pacte pour la départementalisation est donc ce document stratégique, le précédent n’ayant de pacte que le nom.
En outre, le Pacte de 2008 avait de nombreux défauts : très vague, il n’abordait pas les multiples préoccupations de la population et des acteurs économiques et présentait le désavantage d’être considéré par l’État comme le document directeur de la mise en œuvre de la départementalisation. Aussi, dans les premiers moments de la départementalisation, entre 2011 et 2013, on enjoignait d’appliquer le pacte, rien que le pacte, tout le pacte ; mais comme le pacte était vide, cela revenait à ne rien mettre en œuvre du tout… Nous nous sommes par conséquent battus pour qu’il y ait un document beaucoup plus précis permettant aux acteurs économiques et aux partenaires sociaux de savoir où aller, tous convaincus de la nécessité d’un processus progressif et adapté.
Le document stratégique dont je viens de vous retracer la genèse a été adopté en conseil des ministres le 8 janvier 2014, le chef de l’État le mentionnant au cours de sa conférence de presse du 14 janvier et venant à Mayotte même pour le lancer. Tenant à ce qu’il soit le résultat, cette fois, d’une co-construction entre les élus locaux et l’État, nous avons dialogué pendant six mois pour son élaboration, les services de l’État, par leur expertise, ayant largement contribué à l’enrichir. Le préfet animait les réunions. Nous étions organisés en sept ateliers, correspondant aux sept têtes de chapitre du document, chacun dirigé par une personnalité : parlementaire, président du conseil économique, social et environnemental, président de l’association des maires ou président du conseil général. En décembre 2014 nous avons abouti à une synthèse réalisée par le préfet et un stagiaire de l’École nationale d’administration (ENA). Une semaine encore avant la venue du Président de la République dans l’Océan indien, les derniers arbitrages n’étaient pas encore rendus. Au bout de six mois, donc, nous sommes parvenus à des arbitrages très solides car très approfondis et qui, de ce fait, aux yeux de la partie mahoraise, engagent le Gouvernement.
Le document précise le calendrier d’alignement sur le droit commun des dispositions liées au droit du travail et à la sécurité sociale, le code des impôts et certains textes marginaux liés au droit de l’urbanisme et de la domanialité étant déjà pour leur part applicables. Il faut savoir qu’à l’exception des dispositions concernant les emplois d’avenir, aucun des textes votés depuis 2012 relatifs à l’emploi et au travail n’est applicable à Mayotte : leur mise en œuvre a été renvoyée à des ordonnances qui n’ont jamais été prises. Nous avons beaucoup discuté avec les acteurs économiques et syndicaux pour nous mettre d’accord sur cet alignement sur le droit commun. Nous ne pouvons nous permettre le luxe de voir le département de Mayotte vivre au rythme permanent de tensions syndicales et de manifestations de la population, l’adaptation des lois ne pouvant être fonction de la pression de la rue. Le calendrier que nous avons défini ensemble permet donc aux acteurs sociaux de régler leur agenda social, aux acteurs économiques d’y voir clair dans leur stratégie d’investissement et de développement dans le territoire et aux élus d’être tenus par un cheminement commun évitant une surenchère qui déstabiliserait l’île.
Outre ce volet institutionnel, une très longue discussion a eu lieu sur le volet social. Tous les sujets ont été abordés : enfance, jeunesse, vieillesse… Un atelier a été consacré aux aspects économiques. Nous avons tenu à examiner à fond plusieurs thématiques jamais encore abordées : les services à la personne, le travail dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. Négliger d’en parler, c’est favoriser l’économie informelle.
Un autre atelier s’est penché sur les questions d’éducation et de formation sur lesquelles les indicateurs restent très préoccupants. J’ai dit à Mme Vallaud-Belkacem que nous n’en étions pas à la refondation de l’école mais bien à sa fondation. Quant à la formation, elle est à développer à tous les niveaux, qu’il s’agisse de la formation initiale ou de la formation continue dans les secteurs privé et public. Nous avons en effet une fonction publique à structurer : les syndicats ne l’envisagent le plus souvent que sous l’angle du statut et de la lutte contre la précarité mais, au regard de l’efficacité de l’action publique, la formation des fonctionnaires est un énorme chantier sur lequel nous devons nous entendre. C’est particulièrement le cas dans le domaine de l’éducation : la formation continue d’au moins un tiers de nos 3 000 instituteurs est un vrai débat.
Un atelier a été consacré à l’aménagement et au logement, domaines où tout reste à faire. Quand j’ai présenté, en commission des lois, un amendement prévoyant un taux de 25 % de logements sociaux, il s’agissait, de manière un peu provocante, de faire prendre conscience que certains objectifs sont dépourvus du moindre rapport avec la réalité chez nous : si nous avions 2 ou 3 % de logements sociaux dans certaines communes, à Mayotte, ce serait déjà bien.
Un chapitre du document porte par ailleurs sur les questions environnementales, de développement durable, sur lesquelles, là encore, malheureusement, Mayotte reste très en retard si on en juge par les progrès réalisés à la Réunion, en Guadeloupe, à la Martinique ou en Guyane.
Le dernier chantier abordé concerne l’intégration du département dans son environnement et touche plus précisément aux questions de sécurité et d’immigration. La teneur des débats de cet atelier n’a pas été restituée dans le document stratégique, l’État considérant que ces sujets relevaient de son action régalienne. Il a par conséquent été souhaité que la démarche de concertation entre les services de l’État et les élus locaux soit, en la matière, conduite différemment. Si le document n’évoque pas ces questions, elles ont été toutefois abordées ici et là, de façon transversale, par les autres ateliers.
Voilà l’esprit du document, la place et le rôle que nous lui donnons. Nous l’avons intitulé « Mayotte 2025 » car, compte tenu des thématiques retenues, nous étions unanimement opposés à l’idée de travailler à échéance de vingt ou vingt-cinq ans. Il fallait offrir une visibilité pour les dix prochaines années, soit l’équivalent de deux contrats de plan État-région (CPER), la durée du CPER étant elle-même peu ou prou égale celle du programme opérationnel européen : 2014-2020. Nous avons ainsi voulu que le document stratégique couvre la durée de deux documents programmatiques, de façon à garantir une certaine visibilité sans risquer de se perdre dans de trop lointains méandres. De surcroît, l’appareil statistique étant encore plus déficient à Mayotte qu’ailleurs, faire des projections au-delà de dix ans reviendrait à spéculer outre mesure.
Tel est, rapidement résumé, ce document stratégique que le Premier ministre a eu l’amabilité de bien vouloir venir signer à Mayotte pour conférer au geste une certaine solennité. Le préfet a immédiatement après engagé le processus de sa mise en œuvre par le comité de pilotage. Les parlementaires devront, de leur côté, dans leur travail législatif, se sentir aiguillonnés par ce texte qui présente le mérite, je le répète, de mettre sur la table des arbitrages, des réflexions partagées sur les problématiques essentielles concernant Mayotte. Certes, il ne les balaie pas toutes mais il offre d’ores et déjà une grande visibilité à la construction progressive et adaptée de ce département.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Vous avez pu constater, chers collègues, avec quelle passion Ibrahim Aboubacar parle de ce document d’avenir – un avenir de plus en plus commun. Si la page n’est pas blanche, continuer de la remplir ne sera pas simple. Je connais M. Aboubacar de longue date : la passion que je viens d’évoquer est sa marque de fabrique, une passion qui peut aller jusqu’à l’intransigeance. Il a en tout cas la force de conviction nécessaire pour faire avancer les choses, comme il l’a montré avec ce document stratégique. Le fait que ce dernier ait été signé par le Premier ministre marque l’engagement solennel de l’État à accompagner Mayotte et ses élus dans la voie de la départementalisation tout en consacrant la volonté de nos compatriotes mahorais.
Mme Éricka Bareigts. Le travail d’Ibrahim Aboubacar me laisse tout à fait admirative, tant sur le fond que sur la forme.
Sur la forme, pour trouver une traduction concrète, un document d’une telle ambition doit fédérer. Or cela a été d’emblée le cas puisque la méthode choisie a consisté à animer la réflexion avec l’ensemble des acteurs locaux. L’une des premières réussites de cette démarche est donc d’avoir élaboré un document correspondant à une volonté partagée.
Sur le fond, il me paraît fondamental de parler de « contrat de société » puisque c’est donner du sens au choix d’un statut, au choix d’outils juridiques et économiques divers et variés. Donner du sens à la construction du territoire, c’est jeter les fondements d’une belle réussite – réussite que je vous souhaite du fond du cœur.
Je reste persuadée de l’existence d’un destin commun entre Mayotte et La Réunion : nous avons une identité géographique commune, nous sommes voisins, cousins et des Européens, des Français de l’Océan indien. En tant que Réunionnaise, je prends par conséquent ma part de votre aventure et vous pourrez compter, cher collègue, sur notre soutien dans l’hémicycle au cours de débats que j’espère prochains.
Vous êtes allé jusqu’à prévoir des dispositifs réglementaires ou particuliers dans l’application de lois existantes. Ainsi, puisque vous estimez qu’il s’agit, en matière d’éducation, moins de refonder l’école mais de la fonder, allez-vous échanger avec le ministère de l’éducation nationale pour mettre en place des mesures spécifiques en ce sens ?
Mme Maïna Sage. Je m’associe aux félicitations et aux encouragements pour la réussite de ce plan qui donne une vision très complète et à moyen et long terme.
Êtes-vous allé jusqu’au « phasage » des mesures que vous préconisez ? Quelles sont les priorités immédiates pour Mayotte ?
Enfin, quelle est la méthodologie de mise en œuvre ? Vous avez prévu des bilans réguliers, mais créerez-vous une structure particulière, un comité de suivi ? Les équipes juridiques de Mayotte vont-elles assurer une permanence pour faire en sorte que les mesures adoptées soient rapidement appliquées ?
Mme Monique Orphé. Je vous félicite également, cher Ibrahim, pour ce document complet. L’ambition est grande, le chantier est vaste. J’ai bien compris le choix de 2025 – c’est demain – mais si une certaine lisibilité, un plan d’action concret financé, la prise en compte des CPER sont nécessaires, ce choix ne risque-t-il pas d’entraver la réalisation de l’ambition affichée, surtout par rapport aux contraintes auxquelles se heurte la population mahoraise ? Vous rappelez vous-même qu’en matière d’éducation tout reste à faire, que dans le domaine de la santé les améliorations à apporter sont nombreuses, de même que pour les équipements, notamment publics ? Comment se projeter après 2025 ?
« Nous voulons rester Français pour être libres ». C’est un peu le vœu de tous les ultramarins qui ont choisi la France. Dans votre esprit, s’agit-il d’assimilation, d’intégration ou d’adaptation ? Autant de questions qu’il faudra bien se poser demain. Vous pourrez en tout cas également compter sur notre soutien auprès du Gouvernement.
Je terminerai, en tant que vice-présidente de la délégation aux droits des femmes, sur la question de l’égalité hommes-femmes qui est un vrai défi pour demain. Sachez que si la présidente de notre délégation devait se rendre à Mayotte, je serais prête moi aussi à effectuer le déplacement pour échanger sur ce sujet qui n’est pas encore une réalité en France métropolitaine et encore moins dans les départements ultramarins. Là aussi, en dépit de quelques avancées, tout reste à faire ; quoi qu’il en soit, je demeure à votre disposition pour en discuter avec les forces vives de votre territoire.
M. Napole Polutélé. Je joins mes félicitations et mes encouragements à ceux de nos collègues. Je me réjouis d’être parmi vous aujourd’hui car nous aussi sommes en pleine élaboration, à Wallis-et-Futuna, d’un document de stratégie et de développement à l’horizon 2025-2030. Aussi le document présenté par M. Aboubacar est-il susceptible de me donner certaines pistes de réflexion. En effet, le document que nous sommes, pour notre part, en train de rédiger servira de fondement à tout notre développement économique et social et au contrat de développement dans les prochaines années. Il prévoira également tout ce qui concerne les investissements et les engagements de l’État et de l’Europe. La méthode que vous avez choisie est la même que celle nous appliquons à Wallis : nous formons des groupes de travail, de réflexion en y associant le plus possible les forces vives mais aussi la chefferie – élément parfois essentiel pour avancer dans les réformes. Il n’est pas toujours facile de parvenir au consensus.
Merci, en tout cas, pour ce compte rendu. Si cela était possible, je souhaite que vous nous donniez quelques pistes, quelques conseils pour notre propre travail, ce qui nous serait très bénéfique.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Votre intervention résume bien, monsieur Polutélé, l’intérêt de la délégation aux outre-mer : faire en sorte que les problèmes, les initiatives, les sujets se « rencontrent » et que nous puissions en discuter.
Je reviendrai en effet sur l’appellation générique « les outre-mer ». Nous sommes passés du singulier au pluriel, ce qui présentait l’avantage de mettre l’accent sur les différences – nous ne sommes pas tous exactement semblables et nous n’avons pas tous la même histoire. Reste que nous avons vraiment beaucoup en commun et je crains qu’en passant du singulier au pluriel on ne l’oublie un peu trop. Après tout, l’expression « outre-mer » ne signifie rien d’autre que « de l’autre côté la mer », comme on dit en créole. Et si l’on ne met pas de « s », c’est tout simplement parce que c’est un adverbe ; qui plus est, l’utilisation de ce pluriel était une manière d’insister sur la séparation ou la spécialisation au lieu d’inviter à la communion.
La délégation aux outre-mer de l’Assemblée peut donc être le lieu où l’on se montre tout à la fois pluriel et singulier.
M. Ibrahim Aboubacar. Je tiens à partager les compliments entendus avec tous les collègues qui se sont investis dans ce travail. Les questions qui m’ont été posées, nous les avions en fait abordées dès le début du processus.
Comment appliquer les mesures préconisées par le document : par la voie législative ou par la voie réglementaire ? Le chef de l’État, quand il est venu à Mayotte en août 2014, a déclaré que la formalisation emprunterait l’une ou l’autre voie. La question n’est donc pas tranchée. Seulement, il faut tenir compte d’un élément nouveau : le chantier de l’égalité réelle. Notre souci est que la démarche visant à l’égalité réelle soit un prolongement de ce premier travail, voire une démarche complémentaire. Nous ne pouvons de toute façon pas le présenter d’une autre manière aux acteurs locaux. Il s’agit donc de trouver la bonne articulation. Nous attendons un peu de voir quelle direction le Gouvernement va prendre pour reprendre la discussion sur la manière de formaliser le document stratégique.
Un comité de suivi a effectivement été mis en place ; dispositif local, il est composé du représentant de l’État et des présidents des ateliers. Une première réunion s’est tenue le 9 juillet dernier à Mamoudzou. Un pilote est nommé pour chaque thématique, avec des sous-pilotes poue prolonger la discussion. C’est au sein de ce dispositif de suivi que la question du « phasage » va se poser. Il convient néanmoins de déterminer des priorités. D’emblée, en effet, nous nous sommes mis d’accord pour que ce document ne soit pas un inventaire à la Prévert et donc qu’il définisse des priorités : l’éducation, la reprise en main de la jeunesse – qui tend à s’égarer –, la cohésion sociale, l’égalité hommes-femmes et la mise sur pied de services publics performants. La construction des collectivités locales est quant à elle une priorité, y compris pour ce qui relève du B-A, BA : la fiscalité locale de droit commun n’a été mise en place qu’en janvier 2014 ! Je pense aussi à l’intercommunalité, pratiquement inexistante à Mayotte.
Il nous est également apparu évident que les partenaires sociaux devront se mettre d’accord sur un agenda social. Même si personne n’a théorisé la question de l’égalité sociale, il n’échappe à personne qu’elle est à l’origine des mouvements sociaux qui se répètent à Mayotte depuis 2012. Chaque atelier et le comité de suivi vont séquencer les priorités tout en formalisant des outils. Outre les documents financiers, il faudra rédiger des conventions portant sur des thématiques culturelles – c’est pourquoi je tiens à faire venir la présidente de la délégation aux droits des femmes car il faut bâtir un plan transversal sur l’égalité hommes-femmes. Pour sa part, la ministre de l’éducation nationale, qui accompagnait le Premier ministre lors de sa visite à Mayotte, doit commencer à voir clair sur l’action à mener avec les collectivités locales, depuis la construction d’internats jusqu’à la restauration scolaire, en passant par la scolarisation de tous les enfants de trois ans - seulement 60 % d’entre eux vont à l’école. Sur les questions éducatives, nous avons, là encore, une stratégie précise dont les principaux points ont été dégagés avec la ministre lors de sa venue.
Pour le reste, la nature des outils partenariaux dépendra de la capacité des élus locaux, notamment les élus communaux, à aller plus ou moins vite ou plus ou moins loin. Nous nous sommes aperçus que notre construction départementale péchait en un point : elle s’est toujours faite avec le conseil général – organe de négociation avec l’État, c’est lui qui, statutairement, est consulté sur tous les textes –, alors que les communes ont toujours un peu été laissées pour compte. On ne peut pas continuer à ne pas mettre la commune au cœur de la construction départementale – si l’on veut, en particulier, impliquer la population.
Mme Orphé me demande si le processus engagé relève de l’assimilation ou de l’intégration. Il s’agit d’intégration. Au sein de mon atelier, nous avons beaucoup travaillé sur la manière de solder la question, qui revenait sans cesse, de l’identité – tension entre droit commun et identité, rythme de la départementalisation, les uns trouvant que sur tel sujet il est trop rapide mais trop lent sur tel autre.
Pour ce qui concerne Wallis-et-Futuna, nous avons beaucoup observé ce qui s’était fait ailleurs, et nous nous sommes beaucoup inspirés du processus prévu par les accords de Matignon sur la Nouvelle-Calédonie, même si nous ne poursuivions pas le même objectif. Nous avons également observé de près ce que Victorin Lurel a réalisé au sein du conseil régional de Guadeloupe qui a publié un très bon document stratégique, que je vous recommande. Nous avons en outre suivi avec une grande attention les débats relatifs à la création des collectivités territoriales uniques de Guyane et de Martinique. Nous nous enrichissons par conséquent de ce que font les uns et les autres, d’autant qu’on nous enjoint de construire la départementalisation de Mayotte en évitant les erreurs des autres – ce qui ne signifie pas grand-chose car personne ne définit les erreurs en question…
M. le président Jean-Claude Fruteau. Ne vous faites pas d’illusion : les seules erreurs que l’on évite de commettre sont celles qu’on a déjà faites – et encore, pas toujours… Et se pénétrer de l’expérience des autres ne signifie pas nécessairement qu’on sera dans le bon chemin.
Je suis moi aussi, monsieur Aboubacar, plein d’admiration pour le document stratégique que vous présentez, une admiration toutefois tempérée par le fait que je connais depuis longtemps votre force de travail, votre force de conviction, votre volonté de faire avancer les choses. Je suis par conséquent très heureux de vous retrouver ici, toujours prêt à aller de l’avant sans jamais écarter les problèmes importants.
Je vous remercie donc de nous avoir fait partager la réflexion d’ensemble menée pour l’avenir de Mayotte.
B. PRESENTATION PAR M. DIDIER MIGAUD, PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES, DU RAPPORT « LA DEPARTEMENTALISATION DE MAYOTTE : UNE REFORME MAL PREPAREE, DES ACTIONS PRIORITAIRES A CONDUIRE »
(Séance du 13 janvier 2016)
M. le président Jean-Claude Fruteau. Monsieur le Premier président de la Cour des comptes, je suis particulièrement heureux de vous accueillir au nom de la délégation aux outre-mer, ainsi que la délégation qui vous accompagne.
Vous avez bien voulu nous donner la primeur des conclusions du rapport public consacré par la Cour au processus de départementalisation de Mayotte et je vous en remercie.
Notre délégation a déjà eu l’occasion de bénéficier des lumières de la Cour des comptes : elle a en effet entendu, le 27 novembre 2014, M. Antoine Durrleman, président de chambre, dans le cadre de ses travaux sur le projet de loi relatif à la santé.
Aujourd’hui, votre venue, monsieur le Premier président, me paraît se situer au-delà d’une collaboration ponctuelle, qui fut d’ailleurs très fructueuse. Il me plaît d’y voir, en effet, la déclinaison, dans le cadre spécifique des compétences de notre délégation, des relations institutionnelles entre le Parlement et la Cour des comptes, dont nul n’ignore que le principe est inscrit dans la Constitution.
Notre délégation n’est certes pas un organe de contrôle au sens étroitement juridique du terme, mais plutôt une instance de rencontre où peut s’instaurer un débat contradictoire, ouvert et serein, sur des sujets intéressant les outre-mer dans toute leur diversité. La question que nous allons aborder ce matin fait à l’évidence partie de ces sujets.
Je vous remercie, monsieur le Premier président, d’avoir accepté de vous prêter à un exercice qui contribue à renforcer la vocation de notre délégation au service des outre-mer, et je vous donne maintenant la parole.
M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes. Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, je réponds très volontiers à l’invitation de votre délégation, afin de vous présenter le rapport de la Cour sur la départementalisation de Mayotte.
Ce rapport s’inscrit dans la continuité de nombreux travaux de la Cour sur des problématiques de gestion publique intéressant l’outre-mer, mais il s’agit de son premier travail spécifiquement consacré à Mayotte. Cela ne veut pas dire pour autant que serait la première fois que la Cour s’intéresse à ce territoire : dans un chapitre du rapport public annuel 2011 sur les flux migratoires irréguliers outre-mer, elle formulait plusieurs recommandations le concernant. Dans son rapport thématique 2014 sur la santé dans les outre-mer, elle abordait la situation difficile de Mayotte sur le plan sanitaire.
Dans le chapitre de son rapport public annuel 2015 consacré aux compléments de rémunération des fonctionnaires d’État outre-mer, la Cour reconnaissait que si l’extension à Mayotte du dispositif en 2013 était cohérente avec son nouveau statut de département, elle regrettait néanmoins, dans le même temps, que cette extension n’ait pas été l’occasion de réexaminer la pertinence des surrémunérations dans l’ensemble des départements d’outre-mer.
Outre ces contrôles et enquêtes de la Cour, vous savez que les juridictions financières sont présentes outre-mer, avec plusieurs chambres régionales et territoriales des comptes : celle de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, celle de Nouvelle-Calédonie, celle de Polynésie française, celle de Saint-Pierre-et-Miquelon et celle de La Réunion et de Mayotte.
Entre 2011 et 2014, la chambre régionale de Mayotte a été particulièrement active puisqu’elle a rendu plus de 100 avis de contrôle budgétaire. Elle a établi, pendant la même période, des rapports d’observation définitifs sur le département, ainsi que sur la plupart des communes et des syndicats intercommunaux. Cette chambre a contribué à l’élaboration du rapport qui nous intéresse ce matin dans le cadre d’une formation commune avec la Cour.
Pour vous présenter ce travail, j’ai à mes côtés Jean-Philippe Vachia, président de la quatrième chambre de la Cour et de la formation commune, Henri Paul, président de chambre et rapporteur général de la Cour, ainsi que Pierre Souchet, l’un des rapporteurs de l’enquête.
Près de cinq ans après les lois de 2009 et 2010, trois ans et demi après le rapport d’information du Sénat sur le nouveau département, et alors que l’État vient de présenter un nouveau plan stratégique, « Mayotte 2025 », la Cour a souhaité dresser un premier bilan de la période 2010-2014. Son rapport met en avant deux constats principaux et s’intéresse aux défis auxquels l’île va être confrontée dans les années qui viennent.
Premièrement, le processus de départementalisation a été insuffisamment préparé et piloté. Il est loin d’être achevé. Cette situation met en évidence les résultats insuffisants des chantiers conduits par le département comme par l’État dans le cadre du pacte pour la départementalisation de Mayotte.
Deuxièmement, les conséquences financières de la départementalisation sont mal maîtrisées et soulèvent de fortes interrogations pour l’avenir. Cet état de fait est d’autant plus problématique que les collectivités mahoraises sont dans des situations financières elles-mêmes très difficiles.
Enfin, Mayotte va devoir relever plusieurs défis essentiels et structurants, notamment en ce qui concerne l’équipement du territoire, l’enseignement du premier degré et l’action sociale.
Avant de vous présenter ces constats, je souhaite revenir en quelques mots sur le contexte sociodémographique et économique de Mayotte et sur le cadre juridique de sa départementalisation.
Le contexte sociodémographique et économique de Mayotte constitue bien évidemment une donnée majeure. Il pèse d’ores et déjà sur toutes les politiques publiques menées dans ce territoire. Selon l’INSEE, la population mahoraise s’élèverait à 212 000 habitants. Une incertitude pèse sur ce chiffre, notamment du fait d’un important flux d’immigration économique, en provenance principalement des Comores, concrètement de l’île d’Anjouan. L’immigration légale, relativement modérée, se double d’une immigration clandestine plus difficile à chiffrer. Les près de 20 000 étrangers en situation irrégulière interpellés et éloignés en 2014 ne constituent sans doute qu’une partie des flux réels.
Les pouvoirs publics se sont engagés à limiter ces flux. Cela s’est traduit par une réorganisation des services préfectoraux, un renforcement des moyens des forces de sécurité et l’augmentation des interceptions des barques à moteur, les kwassa-kwassa. Malgré cet effort, l’immigration clandestine reste toujours très mal maîtrisée. La réponse à la question migratoire réside dans la coopération avec l’environnement immédiat de Mayotte, notamment avec l’Union des Comores. En effet, l’écart de développement avec le reste de l’archipel rend Mayotte particulièrement attractive.
La population de Mayotte a triplé depuis 1985. Faute de modélisation fiable, l’INSEE refuse de diffuser ses estimations d’évolution pour les années à venir. Mais selon les projections de l’ONU, elle pourrait atteindre près de 500 000 habitants dès 2050 – autrement dit encore doubler – et plus de 700 000 en 2100. Cette population est très jeune : la moitié des habitants a moins de dix-sept ans et demi. Elle est composée à 40 % d’étrangers, dont 95 % de Comoriens.
Malgré d’incontestables progrès dans le domaine socio-économique, le chômage, avec un taux de 36,6 %, demeure le plus élevé de l’ensemble des départements d’outre-mer. Le revenu par habitant de Mayotte, soit 7 900 euros, dépasse à peine le quart du revenu national – il est de 31 500 euros au niveau national et de 18 900 euros pour La Réunion –, malgré une augmentation sensible de 65 % entre 2005 et 2011.
La situation économique de Mayotte reste fragile malgré une croissance moyenne de 8,7 % par an entre 2005 et 2011. Au regard des contraintes d’une économie insulaire, les opportunités de développement sont rares. L’inauguration du nouveau terminal de l’aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi pourrait ouvrir des perspectives en matière touristique, sous plusieurs conditions : l’une d’entre elles, non remplie à ce jour, est le développement d’infrastructures hôtelières adaptées.
Des investissements massifs ont été engagés pour augmenter et diversifier les capacités du port de commerce de Longoni dans le cadre d’une délégation de service public accordée par le département à un partenaire privé. Ces investissements constituent toutefois un risque pour le département en raison de la courte durée de la délégation. La réussite suppose que le modèle économique mis en place par le partenaire privé fonctionne réellement et que les difficultés sociales actuelles auxquelles est confronté le port soient résolues.
C’est dans ce contexte que la départementalisation de Mayotte a eu lieu. Ce changement de statut, l’aboutissement d’un long processus voulu par les Mahorais, désigne la transformation de Mayotte de collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution en une collectivité unique régie par le dernier alinéa de l’article 73. La collectivité exerce à la fois les compétences d’un département d’outre-mer et d’une région d’outre-mer. La départementalisation a été approuvée par 95,2 % des électeurs lors de la consultation organisée le 29 mars 2009.
Le département de Mayotte a été officiellement créé le 31 mars 2011 et la départementalisation s’est traduite par le passage à l’identité législative pleine et entière, par l’adoption de la fiscalité de droit commun, par de nouveaux transferts de compétences pour le département et par l’acquisition du statut de région ultrapériphérique de l’Union européenne, statut qui rend Mayotte davantage éligible aux fonds européens.
Ces rappels étant faits, j’en viens au premier constat de la Cour.
La départementalisation aurait nécessité d’être mieux préparée et pilotée, ce qui n’a été le cas ni au niveau de l’État ni au niveau du département lui-même. Le pacte pour la départementalisation de Mayotte de 2008 avait identifié les principales conditions préalables à la départementalisation. Malgré cela, le pilotage de la réforme par l’État s’est avéré défaillant. Dans d’autres territoires, l’évolution statutaire a été accompagnée par des comités de suivi périodiques. Tel n’a pas été le cas pour Mayotte, que ce soit au niveau central ou déconcentré. En conséquence, d’importants retards ont été pris sur les trois chantiers prioritaires pour l’État.
En premier lieu, le passage de la spécialité à l’identité législative n’est pas encore mené à son terme. Le Gouvernement a été habilité fin 2010 à légiférer par ordonnances, mais le travail législatif et réglementaire nécessaire, s’il est déjà imposant avec l’adoption d’une trentaine d’ordonnances, est loin d’être achevé.
En deuxième lieu, le passage à la fiscalité de droit commun, pourtant décidé en 2001, n’a finalement été réalisé qu’au 1er janvier 2014. Pendant ces treize années, le Gouvernement a plusieurs fois été conduit à préparer dans l’urgence des textes prolongeant les délais, avant de faire adopter dans l’urgence la réforme en 2013.
En troisième lieu, des incertitudes continuent de peser sur la question foncière. Son règlement nécessitait de régulariser le partage entre domaine public de l’État et du département. Il supposait de traiter la question des occupations sans titre et surtout de déterminer les redevables de la taxe d’habitation pour assurer le succès du passage à la fiscalité directe locale.
Pour la population, c’est la découverte de la taxe foncière et de la taxe d’habitation. Dans les faits, un risque de contentieux fiscal de masse continue de peser sur les collectivités territoriales, notamment du fait de l’interrogation persistante sur l’évaluation des valeurs locatives.
La départementalisation s’est accompagnée du transfert de nouvelles compétences au département en matière d’action sociale et de formation. Le département de Mayotte exerce désormais l’ensemble des compétences d’un département d’outre-mer et d’une région d’outre-mer, à l’exception de la construction et de l’entretien des collèges, des lycées et des routes nationales.
Le département n’a pas su adapter en temps opportun ses structures pour assurer pleinement ces nouvelles compétences. Des effectifs très importants sont affectés aux missions de soutien au détriment des missions d’intervention, comme l’action sociale, ou des missions stratégiques telles que l’aménagement, le développement économique, la gestion des crédits européens ou le suivi du contrat de plan État-région.
Par ailleurs, le pilotage financier des actions du département demeure insuffisant. L’expertise financière doit être consolidée et l’évaluation du coût des politiques conduites améliorée. La présentation du budget du département par fonction met l’accent sur le fonctionnement des services généraux et non sur les politiques qu’il est chargé de mener.
Le deuxième constat de la Cour concerne les conséquences financières de la départementalisation. Elles sont mal maîtrisées. Le risque de dérapage est réel pour le budget de l’État et pis encore pour celui du département. La situation financière du département et des communes reste particulièrement préoccupante.
Tout d’abord, je veux souligner que la contribution financière de l’État à la départementalisation n’est pas suivie en tant que telle par l’administration centrale. Ce suivi a dû être réalisé par la Cour dans le cadre de son contrôle. Dans son périmètre le plus réduit, le coût stricto sensu de la départementalisation a été de 67,6 millions d’euros cumulés depuis 2010. Ce chiffre est un solde de dépenses nettes supplémentaires. Il se décompose en trois volets : d’une part, une dotation de compensation de 83 millions d’euros versée au département pour la perte de ses anciennes recettes fiscales ; d’autre part, une dotation de compensation des différents transferts de charges passée de 2,9 millions d’euros en 2012 à 18,9 millions d’euros en 2014 ; enfin, l’État perçoit désormais l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés.
Cependant, au sens large, le processus de départementalisation a eu un coût cumulé de 161,6 millions d’euros entre 2010 et 2014, lié à une augmentation conséquente des dotations dont bénéficient les collectivités mahoraises, essentiellement sous forme de prélèvements sur recettes pour l’État.
Si l’on prend en compte l’ensemble des flux financiers afférents à des politiques publiques menées par l’État, l’effort budgétaire de l’État au profit de Mayotte est passé de près de 680 millions d’euros en 2010 à près de 890 millions d’euros en 2014.
Au total, l’État est engagé dans une logique de rattrapage de son effort budgétaire en faveur de Mayotte et de ses habitants. Ce rattrapage par rapport aux autres DOM n’en est pas moins partiel, dans la mesure où l’effort budgétaire global par habitant à Mayotte demeure inférieur à celui consenti dans ces départements. En loi de finances initiale (LFI) pour 2014, il s’élevait à 5 688 euros en Guadeloupe, 5 716 à la Martinique, 6 420 en Guyane, 5 331 à La Réunion et 3 964 à Mayotte.
Ce rattrapage implicite, que l’État n’assume pas clairement, fait peser un risque financier. L’effort budgétaire annuel s’est déjà accru de 210 millions d’euros ; un alignement du niveau de dépenses par habitant sur celui de La Réunion nécessiterait un effort supplémentaire de 307 millions d’euros par an. Dans ces conditions, la Cour appelle l’État à mieux anticiper et programmer la trajectoire de dépenses en faveur de Mayotte.
Dans le même temps, le passage à la fiscalité de droit commun a profondément modifié le modèle financier des collectivités mahoraises. L’autonomie financière des communes, qui ont désormais prise sur leurs produits fiscaux, est en théorie renforcée ; en 2015, les assiettes des impôts locaux ont été réajustées, souvent fortement à la baisse, ce qui a conduit les communes à augmenter sensiblement leurs taux d’imposition pour maintenir leurs ressources.
Les collectivités se posent deux questions essentielles quant au caractère prévisible et stable de leur structure financière.
D’une part, la répartition entre les communes et le département des recettes tirées de l’octroi de mer fait débat. Cette recette fiscale est particulièrement dynamique. L’État en a déjà changé les règles deux fois en moins de seize mois. L’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2015 a finalement tranché pour 2016 et a priori pour l’avenir en opérant un partage entre le département et les communes. Cette situation doit être stabilisée.
D’autre part, la garantie des ressources des collectivités mahoraises à leur niveau de 2012, au demeurant moins élevé que celui de 2013, notamment pour le département, a d’abord été accordée par l’État, puis retirée fin 2014. L’instabilité des règles a été préjudiciable aux collectivités mahoraises qui ne disposent pas de recettes prévisibles.
La Cour observe que la situation financière du département et des communes est fragile. Avec le passage à la fiscalité de droit commun, la structure des produits de gestion courante du département a été bouleversée. Les recettes fiscales et douanières représentaient 76 % des produits de gestion en 2013 ; les dotations, subventions et participations s’élevaient à 20 % de ce même montant. Les proportions sont désormais respectivement de 37 % et 55 %.
Ayant perdu des ressources dynamiques, le département a vu sa situation financière se dégrader à partir de 2014. Cela ne doit pas masquer le poids excessif pour le département des charges de structure, qui s’explique par un effectif très important et un régime indemnitaire favorable.
Le même constat peut être fait pour les communes. Malgré la progression des ressources en 2014, liée notamment à l’affectation de l’octroi de mer, leur niveau reste insuffisant au regard des compétences à exercer et compte tenu du poids excessif des dépenses de personnel.
De nombreuses communes font l’objet d’un plan de redressement arrêté par le préfet, sur proposition de la chambre régionale. Pour le département comme pour les communes, les dépenses d’investissement servent par conséquent de variable d’ajustement, alors même que les besoins en équipement demeurent considérables.
Je veux terminer mon propos en rappelant les défis, identifiés par la Cour, que le département de Mayotte va devoir relever dans les années qui viennent et dans le contexte que je viens d’évoquer. Ils concernent au moins trois domaines : le développement, la scolarisation et l’action sociale.
Premièrement, Mayotte souffre encore d’un retard important en matière d’accès à l’eau, d’assainissement et de résorption de l’habitat insalubre. Des actions dans ces domaines ont été prévues dans le plan Mayotte 2025. Elles font partie d’un recensement assez exhaustif des besoins identifiés.
La Cour recommande que ces actions soient conduites de manière prioritaire. Mayotte a désormais accès, pour un montant maximal d’environ 300 millions d’euros sur la période 2014-2020, à des crédits structurels européens. Seul un calendrier réaliste et suivi impliquant l’État et les collectivités mahoraises permettra la mobilisation totale et utile de ces fonds européens, qui suppose évidemment des contreparties nationales.
Deuxièmement, le système éducatif à Mayotte doit s’adapter à la perspective d’une scolarisation de masse, alors que les résultats sont encore insuffisants. Bien qu’en progression constante, le taux de scolarisation des enfants de trois ans ne s’élève qu’à 63,3 %, contre 100 % en métropole ; 67 % des élèves de CE1 et 75 % des élèves de CM2 ne présentent que des acquis insuffisants ou fragiles en français, contre 21 % et 26 % respectivement en métropole – même si comparaison dans ce domaine n’est pas toujours raison.
Il apparaît donc nécessaire d’augmenter les capacités d’accueil de la population en âge d’être scolarisée. Cela passe par la formation et le recrutement d’enseignants qualifiés, ainsi que par le règlement de la question des constructions scolaires. En effet, aucune alternative crédible n’a été définie pour le moment depuis l’échec et la dissolution du syndicat mixte d’investissement pour l’aménagement de Mayotte, dont c’était la responsabilité. Un soutien technique de l’État aux communes semble, sur ce point, tout à fait indispensable.
Troisièmement, la Cour s’est intéressée aux politiques sociales. Deux d’entre elles ont retenu plus particulièrement son attention : la gestion du revenu de solidarité active (RSA) et la protection de l’enfance en danger.
Limité initialement en 2012 à 25 % du niveau métropolitain, le RSA versé à Mayotte a ensuite été revalorisé à 37,5 % au 1er janvier 2013, puis à 50 % du niveau national au 1er janvier 2014. Ces revalorisations ont augmenté les montants versés à chaque allocataire, mais ont aussi accru le nombre des bénéficiaires de l’allocation. Encore loin d’être achevée, la montée en charge du RSA comporte un risque significatif de dérapage financier. Dans ces conditions, la cristallisation de la compensation financière accordée par l’État au département à son niveau de 2014 fait peser une incertitude sur la capacité de ce dernier à supporter cette charge qui continuera à augmenter.
La protection de l’enfance en danger à Mayotte reste par ailleurs un sujet d’autant plus sensible que l’île compte environ 3 000 mineurs isolés – situation unique en France. L’État reste fortement engagé en raison des imbrications de cette problématique avec de nombreuses autres politiques publiques : droit d’entrée et de séjour des étrangers, protection médicale, éducation, formation professionnelle. Pour autant, le département ne s’est pas encore réellement saisi de cette compétence qui est obligatoire en matière d’aide sociale à l’enfance. Il doit rapidement faire en sorte de l’exercer de manière complète et adaptée.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, vous l’avez compris, la départementalisation n’est pas l’avenir radieux que certains espéraient. Loin d’être achevé, ce processus doit s’appuyer sur une mobilisation plus résolue de l’État dans ses différentes composantes et des élus locaux. Dans le cas contraire, Mayotte et les Mahorais seront confrontés au risque que les financements dégagés pour 2015-2020 ne permettent pas de retours à la hauteur des moyens consacrés.
La Cour formule plusieurs recommandations en vue de remplir enfin les conditions préalables à la réussite de la départementalisation. Il appartient aux pouvoirs publics nationaux et locaux de s’en saisir en fonction des priorités qu’ils auront définies. Je souhaite insister particulièrement sur la nécessité qui s’attache à remettre en chantier les bases de la fiscalité directe locale : la situation actuelle est en effet difficilement tenable et suppose un effort tant des services de l’État que des communes. À défaut, on aura le plus grand mal à éviter que le malaise social constaté aujourd’hui dans l’île ne s’aggrave dans les mois qui viennent.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Je vous remercie, monsieur le Premier président, de cette présentation. La délégation aux outre-mer a eu l’occasion de s’intéresser à la situation de Mayotte à travers la présentation par notre collègue Ibrahim Aboubacar du document stratégique Mayotte 2025.
Le rapport de la Cour apporte un éclairage réaliste sur les conditions préalables à la mise en œuvre de cette stratégie qui semble avoir été bien accueillie dans son principe par les responsables politiques intéressés.
L’évolution statutaire de Mayotte a été largement débattue et adoptée démocratiquement. L’État est responsable dans une très large mesure, comme le dit d’ailleurs le rapport de la Cour, des conditions de son accomplissement. Ce qui ne veut pas dire, naturellement, que la collectivité de Mayotte et les communes qui la composent n’aient pas à prendre leurs responsabilités.
C’est dans cette perspective que se placent les questions que je voudrais, au nom de la délégation, vous poser avant que mes collègues ne s’expriment à leur tour.
L’insistance singulière mise par le rapport sur le facteur démographique montre que, faute d’une maîtrise convenable de l’évolution de la population, les actions politiques semblent vouées à l’échec. Certes, ce n’est pas là une question prioritairement financière. Cependant, la Cour a-t-elle pu apprécier, dans le cours de ses travaux, les conditions dans lesquelles l’État, par exemple, pourrait accompagner ou favoriser une telle maîtrise et les obstacles administratifs, économiques ou autres à surmonter ?
La Cour constate qu’en dégageant les moyens en personnel et en matériel adéquats, l’État est parvenu à améliorer la lutte contre l’immigration clandestine, qui présente à Mayotte des formes spécifiques. Il semble que, dans d’autres domaines, ces moyens administratifs de l’État ne soient pas encore à la hauteur des objectifs poursuivis dans le cadre de la départementalisation. Une évaluation de ces moyens, quantitative, mais surtout qualitative, paraît-elle nécessaire à la Cour et à quelles conditions lui paraît-elle possible ?
Comment rendre aux communes entravées par le poids de leurs dépenses de fonctionnement une certaine liberté de manœuvre, notamment pour le développement d’investissements nécessaires, tout en tenant compte de la situation de l’emploi, qui peut expliquer pour partie l’importance desdites dépenses ?
Enfin, d’une manière générale, le rapport évoque le risque de « dérapage » des coûts liés directement ou indirectement à la départementalisation de Mayotte. S’agit-il seulement d’une évolution consécutive aux imperfections de la gestion administrative ? Auquel cas, il est possible de trouver des solutions. Ou bien s’agit-il de la répercussion comptable et financière de la politique de modernisation et de développement voulue par les pouvoirs publics ? Dans ce dernier cas, le terme de « dérapage » ne risque-t-il pas d’être perçu comme impliquant une appréciation d’opportunité de la part de la Cour ?
M. Ibrahim Aboubacar. Dans votre conclusion générale, monsieur le Premier président, aux pages 123 et 125 de votre rapport, vous constatez que le processus de départementalisation a commencé en 2001 et que, dix ans après, en 2011, les principaux acteurs n’étaient pas prêts au basculement. Vous indiquez également à la fin que c’est par une définition claire des étapes à franchir et par un effort énergique pour combler les retards qu’il faut commencer, dans un esprit de responsabilité partagée.
Que la départementalisation fût mal préparée, nous le savons, particulièrement ceux d’entre nous qui ont suivi ce processus depuis quinze ans. Les causes en sont multiples. Qu’il nous faille avoir une vision partagée, État et responsables locaux, pour réussir la suite, nous sommes les premiers à l’appeler de nos vœux.
L’accord de 2000 sur l’avenir de Mayotte, bien qu’approuvé par 73 % de la population, n’était pas unanime. Des doutes et des suspicions demeuraient dans les esprits de certains dirigeants et la volonté de mettre en œuvre le contenu de l’accord n’était pas au rendez-vous, certains considérant même que toutes ces réformes préalables étaient prétexte à retarder ou refuser la départementalisation.
C’est ainsi que la réforme de l’état civil, la réforme foncière et la réforme fiscale ne furent pas menées à terme avec la force nécessaire sans que cela n’émeuve personne. Bien que le pacte pour la départementalisation de 2008 ait rappelé ces exigences, aucune accélération n’a été observée entre son octroi par le Président de la République et la départementalisation effective en 2011. On venait de repousser la réforme fiscale de 2007 à 2014, mais le foncier et l’état civil restaient toujours à la traîne.
La réaction est venue des élus locaux, inquiets de voir le processus s’embarquer sur de mauvais rails. Je remercie mon collègue Victorin Lurel d’avoir accepté, lorsqu’il était ministre des outre-mer, l’idée que je lui avais soumise dès septembre 2012, d’une vision partagée, devenue le document stratégique « Mayotte 2025 », signé cette fois par l’État et l’ensemble des élus locaux. Il faut maintenant le faire vivre et aller plus loin dans les défis à relever. C’est pourquoi j’approuve totalement votre recommandation n° 2.
Vous faites observer, à juste titre, dans votre introduction que l’expression « départementalisation » ne rend compte qu’imparfaitement du processus de transformation juridique du territoire. On ajoutera que l’appellation de « département de Mayotte » ne rend compte que partiellement de la réalité de ce statut. Les dénominations actuelles des collectivités de Guyane et de la Martinique sont plus pertinentes, mais cela tient à notre histoire.
Ce point est particulièrement important. Il suffit de lire dans les lois que nous avons votées depuis 2012 la quantité d’appellations désignant Mayotte : parfois, on lit « les départements d’outre-mer et Mayotte », parfois « les départements d’outre-mer », ou encore « les quatre départements d’outre-mer », voire « les cinq départements d’outre-mer ». À tel point que moi-même, en tant que législateur, je ne sais jamais s’il faut parler de département ou de région d’outre-mer dans un texte de loi ni si, a priori, Mayotte est ou non concernée.
Enfin, je voudrais rappeler avec force qu’à l’heure où nous faisons un bilan de cette départementalisation, quatre ans après son lancement, il importe d’avoir à l’esprit que la totalité des phénomènes en œuvre dans l’île ne sont pas tous dictés ou liés par cette départementalisation ; et l’on a tendance à lui mettre sur le dos des choses qui n’ont rien à voir… La départementalisation fixe, bien entendu, un cadre juridique à notre développement et l’oriente, l’impulse ou l’impacte. Mais enfin, refuser la pauvreté, vouloir l’éducation de la population, vouloir la santé des gens, un mieux-vivre et un mieux-être, nous continuerons à le vouloir, quel que soit le statut du territoire ! C’est d’ailleurs ce que les îles indépendantes voisines viennent chercher à Mayotte… tout en nous donnant des leçons d’indépendance !
Les contraintes qui s’imposent au territoire, explosion démographique, rareté du foncier, spécificités culturelles, relations avec nos voisins comoriens, département ou pas, elles seront là. C’est le cadre qui régit notre développement.
À partir de cela et compte tenu de mon temps de parole limité, je me cantonnerai à quelques questions et observations parmi toutes celles que m’inspire ce rapport dont je salue la tonalité et l’impartialité. Je n’ajouterai pas l’exhaustivité, car ce ne fut sans doute pas votre objectif.
Ma première question a trait à l’immigration et à ses impacts sur les politiques publiques à Mayotte. Selon vous, quelle est la conjugaison possible entre l’attractivité de Mayotte par rapport aux îles voisines et la juste aspiration au développement de sa population ? C’est une question de fond, qu’il ne faut pas continuer de sous-entendre, et qui est sous-tendue par des oppositions entre nous, élus locaux, et l’État. Pourra-t-on continuer à bénéficier des différentes dérogations contenues dans le régime législatif applicable à Mayotte pour endiguer ce phénomène migratoire ? Quelle mesure supplémentaire, selon vous, pourrait être prise utilement pour améliorer l’efficacité de la lutte contre l’immigration clandestine ?
Dans le cadre de votre recommandation n° 2 sur le pilotage, dont le contenu est pertinent, faut-il clairement suggérer à l’État la nomination à nouveau d’un chargé de mission rattaché à Matignon pour piloter, entre autres, ce processus, et à la préfecture de Mayotte celle d’un alter ego ? La pratique que nous avons, depuis plusieurs années, localement, de confier cette tâche à un stagiaire de l’École nationale d’administration (ENA) n’est manifestement pas satisfaisante.
Toujours dans la recommandation n° 2, un point crucial doit être abordé, c’est la connaissance par les usagers de la norme applicable à Mayotte : vos observations, pages 41 à 44, et notamment à la page 42, décrivent de réelles difficultés. Comment remédier à cela, nul n’étant censé ignorer la loi ?
S’agissant du développement économique, je m’en tiendrai à votre recommandation n° 1 sur le port. Je m’inquiète doublement, à la lecture de toutes les irrégularités et imprécisions qui ont entouré la passation de cette délégation de service public (DSP), objet des remarques de la chambre régionale des comptes, et du dispositif exposant le risque pesant sur le département, tel que décrit à la page 36 du rapport. Cela me donne l’occasion de rappeler que le port de commerce de Mayotte est le seul à avoir un statut différent des autres ports de commerce des départements d’outre-mer.
J’en viens à la recommandation n° 3 et à la question foncière, qui est, comme vous l’avez dit, centrale. Au-delà de ce qui est écrit, il faut souligner une incompréhension très profonde entre l’État et les élus locaux. La création de l’Établissement public foncier (EPF), objet de votre recommandation, en gestation depuis six ans, est la manifestation de cette incompréhension que symbolise l’initiative de la Direction générale des outre-mer (DGOM), citée page 48 et consistant à interroger la validité des textes malgaches qui régissaient auparavant notre foncier. Je voudrais souligner la dangerosité de cette démarche, car un certain nombre d’actes de propriété aujourd’hui en œuvre sont attachés à ces textes de 1926 et 1929.
Je ne comprends pas cette démarche consistant à s’interroger à ce propos, car il y a d’autres questions infiniment plus graves à se poser, s’agissant de ces textes malgaches et de la rupture de nos relations avec les Comores. Comment des centaines d’hectares sont-ils passés du statut de concession au statut de propriété privée, alors que, dans les ordonnances royales, ils étaient censés revenir au domaine public ?
Comment demander aujourd’hui à la population qui habite dans la zone des cinquante pas géométriques (ZPG) de payer une contribution, alors qu’on dit vouloir régulariser la situation en référence au droit des indigènes ? Lorsque Mayotte a été vendue à la France en 1841-1843, le roi avait reconnu explicitement, dans l’article 6 du traité, la propriété des indigènes qui y habitaient. J’appelle donc à faire preuve de prudence et à se garder de remuer par trop des dispositifs d’une autre époque qui ne feront que compliquer les choses.
Cette incompréhension nous a conduits à sortir le décret sur la zone des cinquante pas géométriques en 2009, alors que la régularisation foncière a été entamée en 2001. Le Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) avait fini son relevé physique plusieurs années après, et le département a été incapable de poursuivre le travail.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Monsieur Aboubacar, puis-je vous demander d’abréger un peu votre intervention ?
M. Ibrahim Aboubacar. Je vais conclure, monsieur le président.
Concernant le pilotage de la réforme fiscale, vos recommandations 4 et 6 sont pertinentes.
En revanche, je souhaite savoir dans quelle mesure la modification des bases fiscales excluant de l’impôt une grande proportion de contribuables a pu être décidée entre 2014 et 2015, posant ainsi la question de l’égalité entre les contribuables devant l’impôt. Est-ce légal ? Qui contrôle ? Cette situation est-elle tenable ?
S’agissant de ce qu’on appelle le coût de la départementalisation, les recommandations 5 et 6, et 7 à 11 sont, elles aussi, tout à fait pertinentes. La stratégie de rattrapage de l’effort de l’État par habitant et les efforts des collectivités locales doivent être conduits en concomitance pour aller dans le sens d’un renforcement des capacités, de la bonne gouvernance, de la transparence et de la maîtrise des dépenses.
La question du RSA enfin concentre à elle seule nombre d’approximations. J’ai été frappé par le fait que vous ayez dû recourir à des chiffres de l’ONU pour articuler vos réflexions dans ce document, l’INSEE ayant refusé de donner les projections officielles. Comment accepter le plafonnement du montant de la contribution à son niveau de 2014, à un moment où le RSA était égal à 50 % de la valeur nationale, sachant que nous étions dans une phase ascendante du dispositif ?
Pour conclure, je remercie la Cour des comptes pour le travail extrêmement important et utile qu’elle a mené et qui permettra aux acteurs locaux de s’approprier de manière partagée les enjeux qui sont devant eux.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Je tiens à prévenir mes collègues que je ne pourrai pas leur accorder le même temps de parole qu’à Ibrahim Aboubacar ! Cela étant, en tant que député de Mayotte, il est concerné au premier chef. Il était donc normal qu’il bénéficie d’une exception pour lui.
M. René Dosière. Quand on lit attentivement votre rapport, monsieur le Premier président, on s’aperçoit qu’il est parfaitement conforme à la vocation de la Cour d’être en quelque sorte une briseuse de rêve… Ce rêve, je l’ai vécu avec les Mahorais en 2009 quand, dans l’enthousiasme général, ils ont souhaité la départementalisation. Votre rapport démontre, en s’appuyant sur de multiples exemples, que ni l’État, au niveau national ou local, ni les collectivités, qu’il s’agisse du conseil général ou des communes, ni la société mahoraise n’étaient préparés au choc que représentait l’application du statut départemental.
Votre constat est réaliste et vous formulez un certain nombre de propositions. Il me semble que les défis que vous évoquez nécessitent de resserrer ces propositions autour de deux ou trois points importants et d’un pilotage beaucoup plus étroit entre l’État et les collectivités – et quand on parle de pilotage, on parle d’engagements réciproques. Or vous avez noté à plusieurs reprises que les collectivités n’avaient pas respecté les engagements qu’elles avaient pris à l’égard de l’État dans tel ou tel domaine.
Dans votre rapport, vous n’abordez pas les questions d’état civil, sur lesquelles j’ai beaucoup travaillé avec Didier Quentin et dont je ne suis pas sûr qu’elles soient réglées. Il serait peut-être utile que la délégation puisse faire une vérification sur ce sujet précis, car tout le monde devrait disposer d’un état civil. Où en est-on aujourd’hui ?
À plus long terme, l’Assemblée n’échappera pas à une réflexion sur l’avenir de Mayotte. Quel développement, quel type de société souhaitons-nous offrir aux jeunes Mahorais, qui sont particulièrement nombreux ? À lire votre rapport, et compte tenu de ce que nous pouvons connaître sur la réalité de Mayotte, on a le sentiment qu’au fond, dans cette société, il y aura deux catégories de personnes : ceux qui disposeront d’emplois publics, et les autres, qui bénéficieront de prestations publiques. Plus un certain nombre de clandestins, avec ou sans papiers… Mais les emplois privés, ceux qui créent de la richesse, je ne les vois pas. Est-ce ce type de société, cette sorte d’assistanat général, au sens propre du terme, c’est-à-dire un système où les gens vivront avec des revenus provenant de l’extérieur, alors qu’eux-mêmes ne produiront rien, est-ce cela que nous voulons offrir à la population mahoraise ? C’est un vrai problème, car ce type d’évolution est humainement inacceptable pour les Mahorais et financièrement insupportable pour la France.
Vers quel type de société voulons-nous faire évoluer Mayotte, compte tenu du fait qu’il faudra bien régler, de manière plus prioritaire que nous ne l’avons fait jusqu’à présent, l’expansion démographique ? L’île est par nature un territoire limité. La population ne peut pas augmenter indéfiniment, ou alors il faudra qu’elle le quitte. Pour aller où, et pour faire quoi ?
J’en viens aux relations entre Mayotte et le reste des Comores, en particulier Anjouan. Le niveau de vie à Mayotte va augmenter, artificiellement dans la mesure où cette augmentation ne sera pas générée par la richesse locale, mais par des transferts financiers en provenance de France. Cette augmentation de richesse représente un attrait considérable pour des gens qui, à côté, sont dans la misère. Vingt mille personnes sont reconduites par an, et sans doute autant arrivent – parfois les mêmes ! Une somme considérable, de l’ordre de 50 millions d’euros, est dépensée en mesures policières. On ne peut pas continuer ainsi. Il faudra bien que le Gouvernement se donne les moyens de régler ce problème, qu’on ne pourra régler que dans le cadre d’une discussion avec les Comores. Les modalités de la discussion ne sont sans doute pas simples, mais je le répète, nous ne pouvons pas continuer dans ce sens, car continuer ainsi, c’est n’offrir aucun avenir, sinon un avenir d’enfer et policier aux Mahorais, qui méritent beaucoup mieux que cela.
Mme Sophie Errante. Je suis députée de Loire-Atlantique, mais je travaille depuis quinze ans avec l’île de Mayotte en tant que chef d’entreprise.
Je n’ai pas encore parcouru entièrement le document « Mayotte 2025 », mais je me demande, si l’on veut mettre à profit les richesses de l’île, qui sont nombreuses, comment favoriser le développement économique et touristique. L’état de Mayotte s’est considérablement dégradé ces quinze dernières années, en termes notamment d’insécurité et de manque d’hygiène. Certes, lors d’un déplacement ministériel, je suppose que tout est fait pour que ce soit bien calé, mais si vous y allez sans prévenir personne, vous constaterez entre autres que l’île est envahie de déchets. Tout cela ne donne pas envie d’y venir. Si l’on veut donner du potentiel à Mayotte, il faudra régler d’abord les problèmes d’insécurité, de qualité du milieu, et faire ce qu’il faut pour rendre possible l’investissement.
Je connais beaucoup de chefs d’entreprise qui disent ne plus pouvoir vivre à Mayotte et qui veulent quitter l’île parce qu’ils ne peuvent plus scolariser leurs gamins, qu’ils vivent sans perspective d’avenir et dans l’appréhension de perdre leur bien. Si l’on ne fait rien en matière de sécurité, d’éducation et d’hygiène, on aura beau faire dans l’incantation, rien ne changera. Mayotte mérite qu’on lui donne sa chance parce qu’il y a beaucoup de belles choses à y faire. Je partage à cet égard les craintes de René Dosière.
M. François Scellier. Je me limiterai aux questions financières et budgétaires.
Les dispositifs d’aide fiscale qui existent en métropole sont également appliqués à Mayotte. Avez-vous, monsieur le Premier président, étudié les conséquences que ces avantages fiscaux peuvent avoir en termes d’investissement, tant au niveau qualitatif que quantitatif, sur le développement de l’île ?
M. Victorin Lurel. Je tiens à saluer la Cour des comptes et son Premier président, pour la tonalité et la qualité de son rapport. Et je partage totalement les appréciations d’Ibrahim Aboubacar.
Il faut tenir compte de l’impatience sociale. On a mis à peu près cinquante ans pour parvenir à l’égalité sociale dans les quatre autres DOM. Mayotte n’attendra pas cinquante ans : ce qui a été arrêté en 2008, s’agissant notamment du RSA, a dû être accéléré face à la demande sociale, et c’est insuffisant. Je suis convaincu qu’il faudra accroître le rythme du rattrapage, car la conflictualité sociale s’est fortement développée à Mayotte. Les gens sont parfaitement informés de ce qui se fait à Paris, l’information arrivant très rapidement à Mayotte.
J’en viens au deuxième risque et à ce qui est arrivé aux quatre départements d’outre-mer. Certains ont parlé de façon excessive de génocide culturel, de disparition des valeurs traditionnelles de la société. Parallèlement à la croissance, on verra se développer une sorte de « satisfaction querelleuse », comme disait Raymond Aron. Il y aura peut-être une sorte de revival culturel, qu’il faut appréhender dès maintenant, pour éviter qu’il vienne à se développer sur une base confessionnelle. Pour l’heure, Mayotte est une société apaisée en termes de pratiques cultuelles et culturelles, et c’est une chance. Mais si nous nous contentons d’agir en termes de dépense publique sans tenir compte de cette dimension culturelle, nous risquons de faire naître les querelles que nous connaissons dans nos propres régions.
J’aimerais savoir si la Cour a entendu les élus sur la question des mineurs en « déshérence ». L’État ne jouant pas son rôle en termes de contrôle des flux migratoires, beaucoup d’enfants sont laissés sur place. Le budget du département en la matière s’élevant à 1 % des dépenses – peut-être un peu plus aujourd’hui en dépenses d’intervention –, comment voulez-vous qu’il consacre beaucoup plus pour contrôler des flux qu’il ne maîtrise pas et qui relèvent de la compétence de l’État, notamment aux frontières ? Il faut, en l’occurrence, une politique plus que partagée avec l’État.
Certains de mes collègues, qui avaient mené des missions sur place, avaient émis le vœu de créer – vous l’avez évoqué à propos de l’investissement – une sorte d’agence technique qui serait à la disposition des communes, et qu’il y ait, pour un temps limité, une reprise de la compétence de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Je ne sais pas si cette question est toujours d’actualité, mais j’aimerais savoir si l’on peut imputer la responsabilité de cette situation au seul département, en laissant entendre que les élus sont irresponsables et se contentent d’ignorer la présence de ces enfants dans les rues…
M. Didier Migaud. Je vous remercie pour les appréciations que vous avez portées sur le travail de la Cour, sur sa tonalité et son impartialité.
Vous avez été plusieurs à avoir mis en avant le facteur démographique. Si la Cour a souhaité y insister, c’est qu’il s’agit bien d’une spécificité de Mayotte. Le sujet est très sensible, comme le montrent les réserves de l’INSEE pour communiquer les conclusions d’études qu’il a sans menées, d’où notre recours à l’ONU pour obtenir quelques projections. C’est un facteur extrêmement important, que nous ne connaissons dans aucun autre département français.
Ce phénomène pèse lourdement sur l’ensemble des politiques publiques et l’État ne semble pas en avoir pris la pleine mesure. Il n’appartient pas à la Cour de prescrire une politique démographique : cela relève de la responsabilité des élus nationaux et des élus locaux. Nous restons dans le rôle qui est le nôtre, qui consiste à évaluer les conséquences de ce facteur démographique qui tient à tout à la fois à la croissance naturelle et à l’insuffisante maîtrise de l’immigration clandestine en dépit des efforts que l’État a consentis pour mieux endiguer ce phénomène, et qu’il faut reconnaître : depuis que la Cour a fait un certain nombre d’observations sur cette immigration clandestine, des mesures ont été prises pour renforcer les moyens administratifs, et qui ont en partie porté leurs fruits.
Si l’État a contribué à l’impréparation que vous avez tous déplorée et que nous avons identifiée, il a néanmoins pris un certain nombre de mesures. Il s’est doté d’un véritable secrétariat général pour les affaires régionales qui devrait lui permettre d’assurer son rôle d’autorité de gestion des fonds européens structurels et d’investissement. Compte tenu de l’importance de l’enjeu du développement, cette réforme est particulièrement bienvenue.
Pour ce qui est de l’absence de pilotage, nous avons pu noter que tout n’avait pas été fait pour assurer le suivi aussi bien sur le plan national que sur le plan des représentants de l’État sur le territoire de Mayotte. Les dispositions visant à organiser une nouvelle gouvernance prévues dans le cadre du plan Mayotte 2025 devraient offrir une perspective de pilotage plus resserrée. Reste encore à mettre en place ce dispositif, et il faudra que cela suive si l’on veut que les problèmes soient pris à bras-le-corps.
Pour ce qui est des communes, sans modification du volume de leurs ressources, la plupart d’entre elles seront incapables de dégager de l’autofinancement pour réaliser les équipements nécessaires, même si tout ne relève pas de leur responsabilité. La chambre régionale a fait un certain nombre de préconisations, notamment sur le gel provisoire du taux de la surrémunération pour les fonctionnaires locaux. Cette mesure devrait leur permettre, nous semble-t-il, de dégager de réelles marges de manœuvre en l’absence d’autres gisements d’économies. Manifestement, les collectivités sont réticentes ; nous n’avons pu que renouveler notre recommandation en la matière.
Si les communes obtiennent de nouvelles ressources, le risque est que seule une part marginale bénéficiera aux dépenses d’investissement, compte tenu de la propension des collectivités à privilégier les dépenses de fonctionnement. L’affectation directe d’une fraction de ces nouvelles ressources à la section d’investissement est une solution à écarter : elle pourrait avoir pour effet pervers de réduire la nécessité pour les communes de dégager un autofinancement à partir de la section de fonctionnement. C’est une véritable difficulté, d’autant que si la perspective de bénéficier de davantage de fonds structurels européens est effectivement un élément positif, la question reste posée des contreparties à assurer, du côté de l’État, mais également des collectivités territoriales qui doivent impérativement contraindre leurs dépenses de fonctionnement.
Le problème du chômage, que vous avez également évoqué, ne se réglera pas par de l’emploi public. Les élus locaux doivent être conscients de la nécessité de mieux maîtriser l’augmentation de la masse salariale des collectivités : du fait de la surrémunération, chaque emploi public créé entraîne des dépenses supplémentaires.
Le risque de « dérapage » que j’ai évoqué ne doit pas être interprété comme étant de la part de la Cour un jugement d’opportunité sur le nécessaire effort de rattrapage. Nous voulons simplement dire qu’il peut y avoir dérapage par rapport à ce que l’État a prévu pour faire face à tel ou tel besoin : ces actions étant insuffisamment encadrées, précisées, programmées, les conséquences financières et budgétaires n’en sont pas tirées. D’où des situations subies. On peut faire le même raisonnement sur les conséquences de la départementalisation ou sur le RSA : les incidences d’une augmentation des sommes nécessaires pour le paiement du RSA sont insuffisamment prises en considération, y compris au niveau de l’État.
Le président Vachia aura peut-être l’occasion de revenir sur la question de la cristallisation au niveau de 2014, soulevée par Ibrahim Aboubacar. La loi peut s’interpréter et, bien entendu, il y a une marge de négociation entre l’État et les collectivités territoriales pour s’entendre sur la répartition de la dépense en la matière. Il est souhaitable qu’il y ait sur ce sujet des discussions sérieuses entre l’État et les collectivités territoriales.
Le président Vachia répondra plus précisément aux questions relatives à l’état civil et aux avantages fiscaux qui peuvent être reconnus sur l’île. La Direction générale des finances publiques (DGFIP) connaît quelques difficultés pour identifier les opérations. Elle avance d’ailleurs des arguments qui ne sont pas toujours très convaincants ; il faudra y revenir. Je ne comprends pas pourquoi la DGFIP ne parviendrait pas à mieux identifier les conséquences de tel ou tel dispositif fiscal. On ne peut ignorer les avantages accordés sans agrément qui peuvent se fondre dans la masse, mais il doit tout de même être possible de mener des investigations complémentaires. Quoi qu’il en soit, pour le moment, nous manquons d’éléments pour apprécier les conséquences de la mise en place d’un certain nombre de dispositifs fiscaux sur l’île de Mayotte.
Mme Errante a évoqué de vrais sujets. J’ai moi-même pu me rendre compte, en me rendant sur l’île, des problèmes d’insécurité et d’éducation, sans compter des problèmes plus basiques, comme l’accès à l’eau ou l’assainissement. Ce qui explique le manque d’attractivité de Mayotte pour les fonctionnaires d’État, qui n’y restent pas toujours aussi longtemps qu’ils l’avaient prévu en raison de ce contexte : j’ai même rencontré des fonctionnaires véritablement en souffrance. Il faut donc être très attentif à ces questions.
Pour ce qui est des mineurs isolés, c’est pour l’heure l’État qui assume cette responsabilité, alors que la compétence revient normalement au département. Dans les faits, ce sont les associations, subventionnées par l’État, qui font le plus gros du travail – je veux parler des mineurs isolés étrangers, qui sont les plus nombreux. Le département doit être en mesure d’exercer les compétences qui lui ont été transférées et s’en donner les moyens.
Je ne sais, monsieur Dosière, si la Cour est une briseuse de rêve, ce n’est pas obligatoirement sa vocation ! Reste que nous sommes obligés de raisonner à partir de la réalité et non des engagements pris et des objectifs affichés ; et lorsque nous les prenons en considération, nous mesurons le décalage entre les uns et les autres. Nos observations en tout cas nous ont conduits à la conclusion que la préparation a été insuffisante et l’ensemble du processus insuffisamment piloté, tant au niveau de l’État qu’au niveau du département et des collectivités.
M. Jean-Philippe Vachia, président de la quatrième chambre de la Cour des comptes. En ce qui concerne le port de Longoni, monsieur Aboubacar, la chambre régionale des comptes avait rendu un avis qui soulignait certains risques et certaines limites de l’opération, mais c’est à l’évidence un facteur possible de développement économique. Aujourd’hui, le département est indirectement engagé dans de gros investissements d’outillage portuaire engagés par le délégataire et il porte en quelque sorte ces risques. Il faut donc que le modèle de développement puisse se mettre en place ; cela suppose que les questions qui donnent lieu à des conflits quasiment journaliers entre le délégataire et la vieille société d’outillage portuaire soient définitivement réglées.
Il n’appartient pas à la Cour de dire comment cette question sociale doit être réglée, mais il est vivement souhaitable qu’elle le soit. Il est plus important de régler la question sociale pour permettre le développement économique que d’envisager un autre statut pour le port. Cette délégation de service public pourra fonctionner si le délégant, autrement dit le département, le délégataire et les partenaires sociaux parviennent à se mettre d’accord sur un modèle de développement.
Vous avez souligné à juste titre l’importance de la question foncière. Le rapport recense un certain nombre de sujets. La mise en place d’une agence foncière doit s’accompagner d’une clarification définitive de la propriété juridique du domaine public comme du sort à donner aux « occupants sans titre » – j’ai bien entendu vos rappels historiques. En tout état de cause, la stabilisation de la propriété foncière ou de l’occupation foncière est assurément une des clés du développement. Les dossiers étant sur la table, il faut dès à présent arrêter des solutions.
La question des bases fiscales est sans doute le tout premier des chantiers prioritaires. Si, en 2015, les services fiscaux ont rétréci les bases de la fiscalité directe locale, c’est tout simplement parce qu’on n’arrivait pas à trouver un certain nombre de redevables. La mission prioritaire, à travers des travaux sur l’adressage, l’état civil et l’inventaire des occupants – je ne parle pas des propriétaires – des parcelles, consiste à définir les bases de la fiscalité directe locale, s’agissant notamment ceux qui vont payer la taxe d’habitation. La situation actuelle est totalement intenable et appelle une solution d’urgence – une « opération commando », en quelque sorte – pour régler la question des occupants des parcelles.
En ce qui concerne le RSA, le texte de loi parle de cristallisation à son niveau de 2014. Il faut en faire l’interprétation, dans la mesure où, en 2014, nous en étions encore à un pourcentage du tarif du RSA national. Il y aura sans doute une réévaluation. Notre inquiétude porte plutôt sur l’aspect démographique : plus le tarif du RSA augmentera, plus les ayants droit seront nombreux. Nous souhaitons, là comme ailleurs, une programmation de la dépense et de l’effort à consentir, sachant que, derrière cela, se pose aujourd’hui la question plus générale du financement du coût net du RSA par les départements.
Pour ce qui est du suivi, nous avons noté que des structures de pilotage ont été mises en place par le plan Mayotte 2025. La structure de suivi doit être sur le point de se réunir sous la houlette du préfet. Il faut aussi identifier au niveau national quelqu’un qui soit capable d’assurer le suivi et surtout fixer une programmation financière à moyen terme de l’effort de l’État. Nous avons constaté l’effort à faire ; reste à le programmer pour savoir où nous voulons aller.
Le rapport évoque bien la question de l’état civil, à la page 50 ; mais vous avez raison, monsieur Dosière, le travail n’est pas terminé. Cela fait partie des prérequis qui n’ont pas été totalement remplis.
M. René Dosière. L’objectif est de connaître le nombre de ressortissants à la taxe d’habitation.
M. Jean-Philippe Vachia. Les connaître et les retrouver, avec un adressage et une dénomination des rues qui est loin d’être définitivement arrêtée.
Le Premier président a répondu à la question sur les avantages fiscaux ; nous n’avons pas eu davantage d’éléments. Ce sera l’objet d’une enquête ultérieure.
Concernant le développement économique, le PIB est essentiellement constitué de transferts financiers. Il s’agit donc de trouver des modèles de développement. Cela passe par de l’investissement public local grâce à la solvabilisation permise par les fonds européens. Même si l’État a annoncé qu’il apporterait lui-même les contreparties, ce qui est exceptionnel, encore faut-il mettre sur la table des projets viables ; or vous connaissez l’immensité des exigences de l’Union européenne quant à la qualité des réalisations… C’est maintenant qu’il faut engager ces projets et, fût-ce à titre symbolique, il faut que les collectivités puissent, dans leur section d’investissement, accompagner cet effort d’investissement public.
La différence de modèle de développement entre Mayotte et les Comores est un puissant facteur d’attraction pour les migrants. Nous avons eu quelques échanges avec le ministère des affaires étrangères pour faire le point sur la politique diplomatique de la France dans cette région. Des pourparlers sont en cours pour trouver des accords afin de mieux contrôler les bateaux comoriens. Il faudrait arriver – mais nous sommes là aux limites des compétences de la Cour et nous entrons dans le domaine de la diplomatie – à une sorte de donnant-donnant entre les concours, qui ne sont pas totalement négligeables, de l’Union européenne pour le développement des Comores, et de leur part un meilleur contrôle des flux d’immigration. Nous avons pu constater sur place que les sept vedettes des moyens maritimes de Mayotte – gendarmerie, douanes, etc. – sont utilisées à plein quasiment tous les jours pour l’interception des kwassa-kwassa. Beaucoup sont interceptés, mais d’autres pas ; cela ne peut pas durer éternellement. Nos moyens maritimes sont employés à la limite de leurs capacités. S’il y a une solution, elle passe sans doute par des accords avec l’Union des Comores.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Monsieur le Premier président, je vous remercie, ainsi que les membres de la délégation qui vous accompagne, d’avoir consacré tout ce temps à la délégation aux outre-mer et de lui avoir réservé la primeur de votre rapport public sur le processus de départementalisation de Mayotte.
II. LES AUDITIONS DE PARLEMENTAIRES CHARGÉS DE RAPPORTS SUR DES SUJETS IMPLIQUANT LES OUTRE-MER
A. PRÉSENTATION PAR M. SERGE LETCHIMY DES PRÉCONISATIONS DE SON RAPPORT SUR LE RECYCLAGE ET LA VALORISATION DES DÉCHETS OUTRE-MER
(Séance du 30 juin 2015)
M. le Président Jean-Claude Fruteau. Vous vous souvenez que le point de vue de notre délégation sur le projet de loi relatif à la transition énergétique avait été présenté en séance par notre collègue Serge Letchimy.
Depuis lors, M. Letchimy a été chargé par Mme la ministre de l'écologie, le 4 décembre 2014, d'une mission d'expertise et de proposition portant sur un des aspects de cette transition : l'amélioration de la prévention et de la valorisation des déchets dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler l'économie circulaire et en prenant comme point de départ le secteur automobile.
Dans sa lettre de mission, Mme Royal explique que la désignation d'un parlementaire représentant les outre-mer traduit à la fois l'importance particulière du sujet pour ceux-ci et un message de confiance en leur capacité à développer des solutions innovantes. Je laisse à M. Letchimy le soin de nous en dire plus sur le contenu et les perspectives de son travail.
M. Serge Letchimy. Mes chers collègues, la mission que Mme la ministre de l’écologie m’a confiée à la suite de la loi relative à la transition énergétique concerne l’ensemble des départements et régions d’outre-mer (DROM) : Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Guyane et Mayotte. Elle comprend deux temps : un pré-rapport, que je m’apprête à lui remettre dans les prochains jours, ayant pour objet, bien circonscrit, d’analyser les conditions de la mise en place d’une filière de traitement des véhicules hors d’usage (VHU) ; un rapport définitif, à remettre à la fin du mois de juillet, visant à étudier l’extension des propositions formulées pour la filière des VHU à d’autres filières (plastique, verre, métaux, etc).
Pour me permettre de mener à bien cette mission, Mme la ministre a mis à ma disposition une équipe de quatre personnes. Composée de membres du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGIET), elle a fourni un très gros travail, que je tiens à saluer. Une mission de ce genre appelait, bien entendu, de nombreuses réunions. Elle exigeait, surtout, de se déplacer pour prendre connaissance des situations locales ; je me suis donc rendu à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, et bien sûr en Martinique – malheureusement, je n’ai pas pu me rendre à Mayotte – et j’ai pu être accompagné, lors de mes visites, par deux experts.
Nous avons pu prendre la mesure de la complexité de la situation : si les perspectives de développement de la filière de traitement des VHU sont grandes, elles sont entravées par de multiples blocages, liés à la législation nationale mais surtout européenne ou encore à la discontinuité des processus de recyclage.
Je citerai quelques chiffres pour dresser un rapide état des lieux.
Le nombre de VHU traités dans les centres agréés en vue d’un démantèlement, d’une dépollution et d’une récupération des pièces pour le marché local ou l’export se monte à La Réunion à 4 000 véhicules sur un total de 15 000 véhicules mis hors d’usage chaque année, en Martinique à 7 500 sur 12 000, en Guyane à 1 000 sur 5 000, en Guadeloupe à 10 000 sur 12 000, à Mayotte à 1 100 sur 2 000.
S’il y a moins de véhicules directement abandonnés le long des routes qu’il y a dix ans où la situation était catastrophique, leur nombre reste important, voire très important : beaucoup sont laissés sur des terrains privés, dans les bois ou les ravines. On estime, par exemple, que ces stocks se situent entre 7 000 et 10 000 en Guadeloupe, entre 15 000 et 20 000 véhicules en Martinique, et, plus grave encore, entre 15 000 et 30 000 en Guyane. Non seulement cette situation est dangereuse d’un point de vue sanitaire car ces VHU sont des nids à moustiques vecteurs de la dengue ou du chikungunya, mais elle accroît la pollution visuelle des paysages et la pollution physique de la nature en raison de la présence de certains matériaux et produits.
Elle révèle un grave problème d’organisation des filières. Il n’existe pas de labellisation d’éco-organismes chargés des VHU, donc pas de prise en charge financière du véhicule tant dans sa première vie que dans sa seconde vie, quand il est hors d’usage. Les filières ne sont pas suffisamment structurées pour qu’un maximum de véhicules fasse l’objet d’un traitement en centre agréé.
Cependant les centres agréés émergent peu à peu à côté des casses traditionnelles. Un effort considérable a permis la création de cinq centres en Martinique et de sept centres à La Réunion. Toutefois, des centres sauvages continuent d’exister, comme celui, gigantesque, qui jouxte l’aéroport de Cayenne, que je me disposais à visiter quand on m’a prévenu qu’il n’était pas agréé. Certains sont bien connus de la police et des autorités administratives, d’autres leur échappent, tels ceux qui se situent sur des terrains de particuliers et qui abritent des trafics de pièces détachées.
La situation est tout à la fois difficile et riche de perspectives car nous commençons à assister à la mise en place progressive d’une filière.
Il faut préciser que le traitement des VHU dans les centres agréés qui en assurent la dépollution, obligatoire, et la décomposition porte sur environ trois cents matériaux et que ceux qui sont considérés comme des déchets dangereux au sens de la réglementation européenne ne sont exportables qu’en Europe. Seule La Réunion a obtenu une dérogation administrative qui lui permet d’exporter vers les pays tiers, l’Inde en particulier. Dans les faits, tout le monde fait ce qu’il veut et exporte vers les pays tiers. Vous l’aurez compris, monsieur le président, c’est un désordre complet !
M. le président Jean-Claude Fruteau. Je l’avais bien compris !
M. Serge Letchimy. Absurdité du siècle : des subventions sont octroyées pour réexporter vers l’Europe. Si pour la Martinique et la Guadeloupe, la route maritime est directe, les bateaux partis de La Réunion sont contraints de passer par une multitude de ports.
Je le dis tout net, j’ai beaucoup de problèmes avec le concept d’« égalité réelle ».
M. le président Jean-Claude Fruteau. Vous n’êtes pas le seul, mon cher collègue.
M. Serge Letchimy. Je suis plutôt partisan de l’émancipation réelle.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Il faudra que vous m’expliquiez ce que recouvre cet adjectif de « réelle », qu’il soit appliqué à l’égalité ou à l’émancipation. Mais refermons vite cette parenthèse.
M. Serge Letchimy. Absurdité, disais-je, que ce concept d’égalité réelle qui contraint d’exporter vers l’Europe. Inutile de vous dire quelles sont les conséquences de cette obligation en termes de coûts de transport et d’empreinte environnementale.
Dans ces conditions, la filiérisation au niveau local constitue un immense enjeu. On pourrait envisager, par exemple, que la Martinique mutualise le traitement des pneus avec la Guadeloupe, laquelle dispose d’une unité de production de frites de pneus destinées aux sous-couches de voirie ou aux plateaux sportifs. Or une telle solution est impossible aujourd’hui : les financements mis en place au titre du fonds RUP – régions ultrapériphériques – ne peuvent être utilisés à de telles fins. On pourrait alors envisager des actions coordonnées entre la Martinique et Sainte-Lucie ou bien encore La Réunion et le Mozambique ou l’Afrique du Sud. J’insiste sur cette dimension transfrontalière car elle permettrait de créer une synergie pour la deuxième vie du véhicule en organisant les filières de récupération à partir d’un effet de masse critique de nature à amortir les investissements parfois lourds que nécessite le traitement des batteries, du plastique, du verre, des métaux. Je pense entre autres aux broyeurs à tri – il n’y en a pas partout – qui traitent les véhicules dépollués en triant la ferraille, le plastique, les vitres.
Par des appels à projets État ou région, il faut structurer l’offre de grands équipements de traitement à travers les différents départements et régions d’outre-mer afin d’accompagner la filiérisation du traitement sur place.
Mais avant d’en venir à la dépollution, au traitement et à la valorisation, il y a une première étape incontournable : la récupération des véhicules. La législation actuelle est très complexe. Il existe des éco-organismes pour la récupération des huiles usagées, des pneus et des batteries, rachetées à prix élevés en métropole, et des efforts notables sont à souligner en ce domaine. Toutefois, pour les véhicules en tant que tels, il n’existe pas d’éco-organisme : les concessionnaires ne sont pas impliqués dans la récupération. Le règlement issu de la dernière réforme relative aux VHU n’a pas permis de mettre en place un processus de responsabilisation. La prise en charge de la récupération des véhicules sur voirie relève donc principalement des collectivités dans la majorité des DROM, la Guadeloupe se situant à part avec un système performant de ramassage au sol qu’elle a organisé grâce à un appel d’offres qui s’apparente à une délégation de service public.
Les élus sont ainsi soumis à une très forte pression pour débarrasser les routes des véhicules abandonnés. Cela nécessite de mandater une entreprise et de prendre le risque de l’enlèvement. Je dis risque car la récupération peut toujours donner lieu à des « cancans », comme on dit en créole : certains propriétaires, dès lors qu’il y a enlèvement, trouvent un intérêt soudain à leur voiture abandonnée et n’hésitent pas à prétendre qu’elle contenait de l’or
M. Daniel Gibbes. Ou qu’elle était neuve…
M. Serge Letchimy. Ou bien qu’elle était flambant neuve et vous reprochent de l’avoir détériorée. En tant que maire, j’ai été l’objet de multiples procès de cette sorte. Cela ne m’a pas empêché de faire enlever près de 12 000 VHU : malheureusement – je n’y suis pour rien, croyez-moi –, ils ont pris feu à l’endroit où ils étaient stockés et nous avons vendu les carcasses aplaties à l’Inde !
À l’abandon sur voirie s’ajoutent les problèmes liés aux assurances pour les véhicules accidentés. Dans certaines régions, comme la Martinique ou la Guadeloupe, les compagnies jouent le jeu : 90 % des voitures accidentées déclarées économiquement non récupérables par les assureurs sont transférées aux centres de traitement de VHU. En Guyane, en revanche, on dirait qu’il n’y a pas d’accidents : en fait, les centres ne reçoivent quasiment aucun véhicule par le canal des assurances et le secteur informel prospère. Nous proposons toute une série de mesures pour renforcer la réglementation, notamment pour obliger les compagnies d’assurances à diriger les véhicules accidentés vers les centres agréés.
En outre, il importe d’accroître les prérogatives des municipalités afin de réduire le délai des procédures qui peuvent aujourd’hui durer entre trois et six mois : il faut constater la présence du véhicule, identifier le propriétaire, prendre contact avec lui, cela prend du temps. Toutes les communes ne sont pas comme la ville de Saint-Denis, très performante en ce domaine : en quarante-huit heures, m’a indiqué le maire, les véhicules sont enlevés.
J’en viens aux propositions que nous avons formulées : vingt-six au total, ordonnées autour de trois axes principaux.
Premier axe : faire progresser le nombre de véhicules hors d’usage traités par les centres agréés, enjeu tout à la fois sanitaire, environnemental et économique. Si nous ne confortons pas les centres agréés, notamment en les sécurisant, les centres informels vont prospérer en leur faisant une concurrence illégale.
Proposition n° 1 : réorganiser la gouvernance de la politique de prise en charge et de traitement des VHU.
Proposition n° 2 : permettre une meilleure estimation du nombre de VHU en tenant compte des exportations. Les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) affirment ne pas avoir de moyens pour mener à bien cette action. Il faut donc les renforcer et mettre tout en œuvre pour disposer d’une évaluation annuelle du nombre de véhicules.
Proposition n° 3 : poursuivre les campagnes de communication. Dans la loi de transition énergétique, j’ai déposé un amendement visant à instaurer la pénalité la plus forte possible pour réprimer le stockage de VHU sur les parcelles privées. Cela suppose, bien évidemment, un effort d’information en direction des populations, effort déjà bien entamé : saluons ici le remarquable travail effectué par certains maires, notamment à Cayenne et à Kourou. Toutefois, pour que les maires continuent dans cette voie, il faut les aider par des financements spécifiques, sinon on verra augmenter les dépôts illégaux de VHU.
Proposition n° 4 : sensibiliser les propriétaires de VHU potentiels en leur adressant une information personnalisée à partir du système d’immatriculation des véhicules (SIV).
Proposition n° 5 : rendre plus facile le traitement d’un véhicule en l’absence de carte grise. On sait que l’une des techniques qui permet d’alimenter le secteur informel est de faire disparaître ce document. Par ailleurs, lorsqu’un véhicule est déclaré économiquement non viable, la carte grise devient la propriété de l’assurance et comme il y a un délai avant qu’il puisse être revendu, il se retrouve pendant un certain temps sans propriétaire identifié.
Proposition n° 6 : instaurer une éco-contribution dans le cadre de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP).
Et si cette solution ne peut être retenue, notre proposition n° 7 vise à mettre en place une alternative à travers un système de consigne pour les VHU et les batteries. Autrement dit, il s’agirait d’ajouter au prix d’achat une somme au titre de la consigne, qui pourrait être récupérée lors de la remise au centre agréé du véhicule en fin de vie. Ce dispositif a très bien fonctionné pour les bouteilles, pourquoi pas pour les VHU ?
Proposition n° 8 : verser une prime pour tout VHU déposé dans un centre agréé afin de résorber le stock de VHU. Les nouveaux véhicules pourraient bénéficier du système de la consigne tandis que ceux du stock existant seraient l’objet de cet autre mécanisme d’incitation. Nous estimons que les collectivités locales et l’État ont tout intérêt à consacrer des fonds à l’élimination des stocks au sol.
Proposition n° 9 : effectuer dans chaque DROM un inventaire des VHU en les localisant dans une base de données géographiques. Cela nécessiterait notamment d’utiliser des moyens modernes comme les drones, car certains sont déposés sur des terrains forestiers.
Proposition n° 10 : encourager la création de fourrières pour y transférer les véhicules stationnant trop longtemps sur la voie publique en prenant soin d’établir un maillage plus resserré composé de fourrières de petites tailles. Précisons que tous ces équipements structurants relèveraient d’appels à projets, État ou région.
Proposition n° 11 : mettre en œuvre pour les véhicules déposés sur des terrains privés les possibilités introduites dans le projet de loi relatif à la transition énergétique que j’évoquais à l’instant.
Le deuxième axe de nos propositions consiste à optimiser la valorisation des pièces de réutilisation pour développer l’économie circulaire dans les DOM.
Proposition n° 12 : rediriger les véhicules déclarés irréparables et détenus par les assureurs vers les centres VHU agréés. J’ai déjà cité le cas de la Guyane où les centres agréés, qui ne traitent que 1 000 VHU sur les 15 000 à 20 000 stockés dans la nature, ne reçoivent pratiquement aucun véhicule en provenance des assurances. Pour mettre fin à ce phénomène, il faut faire obligation aux assureurs d’orienter les VHU vers les centres agréés. Cela suppose bien sûr de tarir la source à laquelle s’alimente l’économie informelle, avec les conséquences que cela peut avoir en termes d’emploi, mais il me semble possible de transformer certaines casses en centres agréés, à l’instar de la casse du Lamentin en Martinique.
Proposition n° 13 : faciliter la fermeture des casses illégales en se concentrant sur les plus dommageables pour l’environnement.
Proposition n° 14 : faciliter l’utilisation d’installations mobiles de dépollution et de compactage de VHU, comme cela s’est fait en Guyane entre Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni.
Proposition n° 15 : créer un label « garage propre » ou « garage pour l’environnement », au-delà même des centres agréés proprement dits.
Proposition n° 16 : développer l’entretien et la réparation des véhicules avec des pièces de réutilisation certifiées. Aujourd’hui, les compagnies d’assurances ne peuvent déclarer un véhicule économiquement réutilisable que si un devis est établi. Or ce devis porte le plus souvent sur des pièces neuves. Il s’agirait d’intégrer les pièces récupérées par les centres agréés dans les devis de réparation afin de développer les filières en pleine émergence. Lors de notre visite à La Réunion, nous avons pu constater que les centres agréés commençaient d’alimenter des transferts de pièces vers Madagascar et l’Île Maurice, comme, dans l’hexagone, des centres agréés exportent vers l’Afrique.
Proposition n° 17 : créer des filières VHU pour les autres véhicules que les automobiles, tels les engins agricoles ou industriels ou encore les véhicules de transport.
Le troisième axe de nos propositions vise à recycler les VHU en adoptant un principe de proximité. Il faut éviter la réexportation systématique vers l’Europe des matériaux issus du traitement des VHU : cela n’a pas de sens !
Proposition n° 18 : intégrer les coûts de transport et les aides à l’investissement dans l’analyse économique de la rentabilité des investissements. L’Europe et la France accepteront-elles de financer le transport inter-DROM ? Accepteront-elles de financer le transport entre la Martinique et Sainte-Lucie, entre La Réunion et l’Afrique du Sud ?
Proposition n° 19 : encourager le recyclage local en lançant des appels à projets reposant sur des procédés innovants.
Proposition n° 20 : aider les transports locaux au même titre que les transports vers l’hexagone.
Proposition n° 21 : obliger les importateurs d’équipements à adhérer aux associations locales en cas d’absence de collecte et de traitement de leur part. Cet encouragement à développer les structurations locales pour répondre aux besoins des territoires vient renforcer l’égalité réelle.
Proposition n° 22 : prévoir l’intervention des éco-organismes nationaux pour les pneus.
Proposition n° 23 : développer une coopération régionale avec les pays voisins, aspect que nous avons déjà évoqué.
Proposition n° 24 : favoriser la sortie du statut de déchet, question très technique et complexe. S’il était possible de ne pas appliquer à certains matériaux le statut de déchet, qui relève de la réglementation européenne, cela permettrait une valorisation sous forme énergétique.
Proposition n° 25 : laisser la possibilité de traiter en dehors de l’Union européenne les déchets non dangereux issus des VHU.
Enfin, proposition n° 26, nous préconisons d’habiliter les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution à fixer en matière de déchets les règles appropriées à la situation singulière de leur territoire, qu’elles relèvent du domaine de la loi ou du règlement. Cela permettrait, au-delà des textes européens renvoyant à la convention de Bâle, dont on ne peut s’affranchir, de s’adapter aux réalités locales pour tout ce qui relève de l’économie circulaire et de la valorisation des déchets. La Martinique a ainsi déjà obtenu trois habilitations qui lui donnent la possibilité de fixer des règles spécifiques dans le domaine des transports, de l’énergie et de la formation professionnelle. A La Réunion, par la volonté de la population, que je respecte, l’habilitation ne s’applique pas.
Voici, monsieur le président, mes chers collègues, les grandes lignes du pré-rapport que je m’apprête à remettre à Mme la ministre de l’écologie.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Je vous remercie, mon cher collègue, pour cette présentation très complète. Nous nous ferons tous un plaisir de prendre connaissance de votre rapport dans son entier, une fois que vous l’aurez remis à Mme la ministre.
Avant d’en venir aux questions, je voudrais saluer la nomination de trois nouveaux membres de notre délégation : Mme Marie-Anne Chapdelaine, ici présente, à qui je souhaite la bienvenue, Mme Florence Delaunay et M. Jean-Marc Fournel, tous trois désignés par le groupe SRC en remplacement de collègues appelés à d’autres fonctions.
M. Daniel Gibbes. Je tiens à adresser toutes mes félicitations à Serge Letchimy pour le travail qu’il a effectué, en un temps restreint sur des territoires très éloignés les uns des autres. Le sort des VHU est une vraie problématique pour nos territoires, pour lesquels il représente un enjeu sanitaire et environnemental mais aussi économique du fait des nuisances visuelles qu’ils induisent pour le tourisme.
Dans votre présentation, vous n’avez pas évoqué Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Pouvez-vous nous en dire plus ? Je précise que contrairement à Saint-Barthélemy, Saint-Martin n’a pas la compétence en matière d’environnement ; elle reste donc rattachée pour ces questions au territoire national.
M. Serge Letchimy. Peut-être serait-il bon, dans ce cas, que vous écriviez une lettre à Mme la ministre pour demander que nos préconisations s’y appliquent aussi.
M. Daniel Gibbes. J’aimerais avoir des précisions sur le coût des enlèvements de VHU et la solution de la consigne.
Comme Saint-Martin a la compétence en matière fiscale, nous avions pensé mettre en place une taxe à l’acquisition de la voiture, couvrant les frais d’enlèvement en cas d’abandon. Elle ne nous a toutefois pas paru très juste car ce n’est pas toujours celui qui achète le véhicule qui pollue. La consigne paraît être une bonne formule.
Par ailleurs, j’ai remarqué que les campagnes d’enlèvement se soldaient toujours par une recrudescence de stockages sur les terrains privés : il y en a toujours plus !
M. Serge Letchimy. Quel champ couvrent les pouvoirs de police à Saint-Martin ?
M. Daniel Gibbes. Nous les avons dans certains domaines. Pour l’environnement, nous sommes rattachés au territoire national.
M. Serge Letchimy. La problématique des VHU met en jeu plusieurs compétences car elle touche aussi bien l’environnement que la santé, le droit des assurances, la police, le pouvoir d’exporter ou le statut des déchets.
M. Daniel Gibbes. Nous avons la compétence en matière fiscale, ce qui pourrait nous permettre des adaptations pour les assurances, mais pour le reste, nous relevons du territoire national.
Quand nous revendons nos VHU, des entreprises étrangères se rendent sur place pour retirer batteries, huiles usagées, déchets toxiques, avant d’aplatir la carcasse et de l’envoyer en Amérique du sud.
Mme Maïna Sage. À mon tour d’adresser des félicitations à M. Letchimy pour ce rapport qui intéressera également les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74.
J’aimerais vous faire part des actions que nous avons entreprises en Polynésie.
Nous avons mis en place une taxe d’environnement pour le recyclage des véhicules (TERV), acquittée lors de l’achat du véhicule neuf. Nous nous sommes équipés d’unités mobiles de compactage que nous déplaçons à travers les îles lors de campagnes de ramassage, en collaboration avec les communes. Enfin, nous avons veillé à encourager le remplacement des véhicules mis à la casse grâce à une prime versée à toute personne qui achète un nouveau véhicule après avoir déposé l’ancien dans un centre de traitement, sous conditions d’une certaine ancienneté, de l’ordre de dix ans.
M. Daniel Gibbes. Comment est versée la prime ?
Mme Maïna Sage. Elle est versée sous forme d’abattement sur le prix du véhicule neuf et modulée en fonction de la nature des véhicules, les véhicules propres, hybrides et électriques, faisant l’objet d’un bonus écologique.
J’en viens à deux questions précises, monsieur Letchimy. Votre rapport comprendra-t-il des éléments chiffrés sur les coûts ? Qu’en est-il de la transposition des mesures préconisées pour les VHU à d’autres filières ? Je pense, par exemple, aux médicaments non utilisés : certes il s’agit d’une toute petite filière, mais la réexportation vers l’Europe paraît être un non-sens.
M. Serge Letchimy. Nous présenterons des estimations chiffrées dans le rapport final. Nous devons analyser le coût du ramassage pour les collectivités ainsi que présenter des simulations pour le coût de la consigne, solution alternative à l’éco-contribution. Nous aurons également à faire la démonstration de la viabilité économique des centres agréés et à évaluer les conséquences financières et sociales de la fermeture des centres informels. Enfin, nous présenterons des estimations chiffrées concernant la filiérisation : quel est le coût des exportations vers l’Europe ? quelles unités de production pourront être financées au cas où les transferts de proximité seraient privilégiés ? quels sont les moyens financiers d’accompagnement ?
Quant à la transposition à d’autres filières, elle renvoie à trois enjeux principaux.
Premier enjeu : comment associer le traitement des VHU au traitement des déchets issus des industries, des véhicules à grand gabarit, aux matériels électriques ? Les équipements devront permettre d’exploiter ces déchets d’une autre nature.
Deuxième enjeu : comment l’associer au traitement des déchets de l’électro-ménager ? Une entreprise guyanaise peut nous servir d’exemple pour lancer des projets de ce type.
Troisième enjeu : comment filiériser les trois cents matériaux issus des VHU avec des produits de même type ? Je pense, par exemple, au plastique. Des unités industrielles spécialisées dans le traitement de certains matériaux commencent d’émerger.
Compte tenu de ces enjeux, il importe de mettre en place une gouvernance au niveau régional afin d’élaborer une stratégie globale d’élimination et de valorisation des déchets liés au VHU. Tout dépend de notre capacité à composer avec la convention de Bâle grâce à une redéfinition du statut du déchet dangereux afin d’échapper à l’obligation d’exporter en Europe. Cela nous permettra de travailler à des filiérisations avec des pays à proximité et de mutualiser les équipements : imaginons qu’une unité de retraitement du plastique soit installée à Sainte-Lucie plutôt qu’en Martinique. Nous devons travailler à des solutions reposant sur des investissements dans les pays tiers et des transferts réciproques de produits avec ces pays.
Cette gouvernance ne serait pas seulement politique, elle serait aussi une gouvernance d’ingénierie. Des plans permettraient de définir des axes directeurs pour la filiérisation, les réglementations, les investissements. L’échéance est à dix ans, mais si la réussite est là, de nombreux emplois peuvent être créés.
M. Jean-Paul Tuaiva. Ce rapport concerne-t-il uniquement le traitement des VHU ou englobe-t-il le traitement des ordures ménagères ou encore des métaux spéciaux contenus dans les déchets hospitaliers ?
M. Serge Letchimy. Avec Mme la ministre, nous avons voulu coupler analyse de situation et préfiguration d’un business model permettant de mettre en place une filiérisation-valorisation globale. Parmi les divers types de déchets, nous avons choisi de nous focaliser sur les VHU, du fait de la multitude des matériaux qui les composent – plastique, verre, métaux, etc. (le problème se pose aussi dans l’hexagone, je l’ai constaté, même si ce n’est pas avec la même ampleur). De la récupération des VHU jusqu’à leur valorisation, nous avons identifié les possibilités de filiérisation, en association avec des déchets complémentaires – matières plastiques, appareils électro-ménagers. Dans cette perspective, nous avons convenu de procéder en deux étapes.
Il faut saluer la détermination des professionnels qui se mobilisent dans tous les DROM. Lors des visites que j’ai faites sur les divers territoires, j’ai pu mesurer le chemin parcouru par ces petites casses familiales devenues de grandes entreprises. Les enjeux économiques sont très importants. Nous avons tout intérêt à développer le marché des pièces détachées, tant au niveau interne qu’à l’exportation. Les concessionnaires ne sont pas encore suffisamment impliqués.
Reste à construire des synergies régionales car les marchés locaux sont encore trop petits. La Martinique, avec ses 392 000 habitants, pourrait s’associer à Trinidad ou Sainte-Lucie pour financer conjointement des équipements, tels des navires de transport, tout comme La Réunion pourrait s’associer à Madagascar.
J’ai ressenti sur le terrain un vrai désir d’avancer, en dépit des contraintes existantes. Des initiatives ont déjà été prises en matière de transferts transfrontaliers. Les stratégies d’import et de transformation se développent de plus en plus dans d’autres domaines. Je prendrai l’exemple de la Martinique, qui forte de son savoir-faire en joaillerie, importe des pierres précieuses du Brésil pour les sertir avant d’exporter des bijoux en Europe.
Pour les déchets, nous pourrions procéder de la même manière. Cela implique, d’une part, de ne pas avoir peur du déchet venu de l’étranger, d’autre part, de trouver le moyen de composer avec la législation européenne pour encourager une valorisation régionale des déchets.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Je remercie les membres de la Délégation pour leur participation, et M. Letchimy pour sa très intéressante intervention.
B. PRESENTATION PAR MME MARIE-ANNE CHAPDELAINE DES CONCLUSIONS DU RAPPORT SUR LE SUICIDE DES JEUNES AMERINDIENS DE GUYANE
(Séance du 16 février 2016)
M. le Président Jean-Claude Fruteau. Nous allons maintenant, conformément à ce qui devient une bonne tradition, entendre la présentation d'un travail réalisé par un membre de la Délégation sur un sujet intéressant les outre-mer.
Nous avons déjà entendu, en 2015, l'exposé de M. Serge Letchimy sur sa mission auprès de la ministre de l'écologie, relative à la récupération des déchets automobiles, et celui de M. Ibrahim Aboubacar sur le document Mayotte 2025 dans la préparation duquel il s'est beaucoup impliqué.
Aujourd'hui, Mme Marie-Anne Chapdelaine nous parlera du rapport qu'elle a élaboré avec notre collègue du Sénat Aline Archimbaud sur le suicide des jeunes Amérindiens de Guyane. Afin de préparer nos échanges, une synthèse vous a été adressée par voie électronique jeudi dernier.
Mme Marie-Anne Chapdelaine. Monsieur le président, mes chers collègues, je commencerai par vous exposer les raisons qui ont motivé ce rapport.
Les autorités sanitaires ont mis en évidence un taux de suicide chez les Amérindiens huit à dix fois supérieur à la moyenne pour la Guyane et la métropole. Ce phénomène concerne avant tout trois peuples amérindiens de l’intérieur – les Wayampis, les Wayanas et les Tékos – et commence à s’étendre aux Bushinenge, autre peuple de Guyane. Certains de nos collègues parlementaires guyanais ont fortement alerté Mme la ministre des outre-mer sur cette situation puis le Président de la République lors de sa visite en Guyane. Des associations se sont également manifestées.
Le Premier ministre a par la suite décidé de nommer deux parlementaires en mission, deux parlementaires de métropole, Mme Aline Archimbaud, sénatrice, et moi-même, pour rédiger un rapport sur le suicide des jeunes Amérindiens en Guyane. Dans notre travail, nous avons dès le départ pu compter sur l’appui de nos collègues guyanais, notamment de Mme Chantal Berthelot, et je tiens à les remercier ici.
Compte tenu de l’ampleur de la tâche et de l’enjeu de la mission, la modestie s’imposait à nous : ce nombre élevé de suicides met en jeu la survie même d’un peuple premier. (Mme Chantal Berthelot entre dans la salle de réunion).
J’étais en train de dire, madame Berthelot, que nous nous étions beaucoup appuyés sur les parlementaires guyanais et que vous aviez été pour nous une personne-ressource.
Pour remplir nos objectifs, nous avons d’abord cerné les ressources à notre disposition en métropole. Nous avons rencontré des ethnologues, des psychologues, des associations. Puis nous sommes parties sur le terrain, où nous avons eu la chance de bénéficier de l’appui du préfet, du recteur d’académie, ainsi que du sous-préfet aux communes de l’intérieur. Nous avons rencontré des responsables de diverses institutions, des élus locaux et nationaux, des syndicats, des professionnels du milieu sanitaire.
Nous avons également tenu à entendre les habitants. L’une de nos grandes interrogations était d’ailleurs de savoir si les gens viendraient à nous. Ils l’ont fait : le bouche-à-oreille a fonctionné et nous avons pu recueillir des témoignages, quelquefois véhéments.
Les causes de l’augmentation du nombre de suicides sont multiples. Le premier facteur est l’isolement : la forêt constitue une barrière plus forte encore que l’eau. À cela s’ajoute le désœuvrement : ces territoires sont marqués par l’absence de perspectives. Nous avons rencontré des jeunes qui avaient fait avec leurs parents le pari de l’éducation et allaient se former sur le littoral : certains avaient étudié dans des conditions tellement dégradées qu’ils n’avaient pu construire aucun projet de vie ; d’autres, en retournant chez eux, étaient confrontés à l’absence de débouchés économiques. Des très nombreux jeunes ne parviennent pas à trouver leur place. Il faut prendre en compte aussi des facteurs identitaires et culturels : ce peuple aux traditions séculaires a voulu se tourner vers la modernité, sans toutefois être pleinement accompagné dans cette double culture. Le problème de la reconnaissance des cultures se pose ; on nous a tout le temps demandé pourquoi la France n’a pas signé la fameuse convention 169 de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux. Nous avons pris note de ce propos, mais, bien entendu, il appartient au seul Gouvernement de prendre position dans ce débat.
Causes sanitaires, intrafamiliales, identitaires et culturelles se mêlent pour expliquer cette recrudescence de suicides.
La France est fière d’avoir le premier domaine maritime du monde mais elle oublie que c’est grâce aux outre-mer, dont certains territoires subissent une rupture d’égalité. Nous nous sommes félicités de la nomination de Mme Bareigts comme secrétaire d’Etat à l’égalité réelle : les gens que nous avons rencontrés sont fondés à nous parler du problème. Dans les communes de l’intérieur en Guyane, des équipements et services considérés comme courants chez nous ne sont même pas assurés aux habitants. Je pense à l’eau, au gaz, à l’électricité. Cette réalité matérielle accentue un certain désœuvrement, qui peut être source de mal-être.
Nous avons rencontré des populations qui ont envie de se prendre en charge, des élus qui se battent pour leur territoire. Et nous avons constaté que la République n’était pas toujours rendez-vous.
Certes, le préfet a mis en place une cellule régionale pour le mieux-être des personnes de l’intérieur qui réunit tous les acteurs concernés. Certes, le recteur a envoyé des intervenants en langue maternelle pour faciliter l’accès à l’éducation des enfants qui ne maîtrisent pas encore totalement le français. Mais le manque de moyens est source de multiples obstacles pratiques. Par exemple, les communes n’ont pas assez de ressources pour mettre en place des cantines à midi dans les écoles. Ne faudrait-il pas que l’État se substitue à elles pour assurer l’égalité sur le territoire de la République ?
À cela s’ajoutent les problèmes liés au foncier, à l’orpaillage, à l’empoisonnement au mercure, dont quelques études tendent à prouver – cela n’est pas avéré pour l’instant – qu’il serait à l’origine de malformations neurologiques.
Dans nos préconisations, Aline Archimbaud et moi avons essayé d’être les plus pragmatiques possible. Nous nous sommes demandé comment lutter concrètement contre le mal-être chez les jeunes et nous avons formulé une liste de propositions.
Personne ne s’étonnera que je commence par l’éducation ! Il nous semble important de régler la question du logement des lycéens amérindiens. Pour faire leurs études, ils se rendent sur le littoral, principalement à Cayenne, or les internats des établissements où ils sont scolarisés ne sont pas ouverts le week-end. Ils sont donc contraints de trouver des familles pour les héberger en fin de semaine, des familles qui ne sont pas ou sont peu contrôlées et dont le logement ne se situe pas forcément près des établissements. Ces jeunes, déracinés, se trouvent ainsi livrés à eux-mêmes. Et je vous laisse imaginer les conséquences pour les jeunes filles. Certaines, parties faire des études afin d’améliorer leur situation, reviennent dans leur village avec un bébé : ce n’est pas tout à fait le modèle de réussite sociale dont elles rêvaient.
Une autre forme de déracinement est vécue par les femmes enceintes qui sont contraintes de se rendre sur le littoral deux mois avant leur accouchement, et qui se demandent ce que va devenir leur famille. Tout cela parce qu’on n’a pas encore tiré tous les profits de la télémédecine.
Lors de notre visite à Maripasoula, nous avons pu prendre la mesure des souffrances vécues par les collégiens – donc des enfants de seulement douze ans parfois – qui ne peuvent retourner dans leur famille pendant deux mois faute de moyens de transport adéquats : s’il y a une pirogue le samedi pour les emmener chez eux, à deux heures de trajet, il n’y en a pas le dimanche pour les ramener au collège.
Nous avons encore été confrontées dans certains établissements au mauvais entretien des locaux.
En métropole, les parents d’élèves seraient déjà intervenus auprès de l’inspection d’académie. Il va falloir faire preuve d’inventivité et trouver des solutions pour que ces situations changent.
Je dois souligner que nous avons trouvé le personnel éducatif très en pointe alors que l’on nous avait dit que les enseignants n’étaient pas volontaires. En réalité, ils étaient bien volontaires ; ils aimeraient seulement pouvoir retourner à Cayenne plus souvent et bénéficier d’une meilleure adaptation des vacances scolaires, ce qui a été fait en partie par le recteur pour les vacances de Noël.
Il manque le petit déclic qui permettrait d’opérer des changements. Les populations se prennent en charge. Mais, élue de Bretagne, donc d’esprit décentralisateur, j’ai été surprise par la demande de reconnaissance qu’elles ont explicitement adressée à l’État.
Une autre de nos propositions vise à consolider le dispositif des intervenants en langue maternelle en zone amérindienne. C’est une demande récurrente des populations. Les enfants en âge scolaire n’ont pas toujours le niveau exigé en langue française et il serait bon de faciliter leur transition vers le milieu scolaire.
En matière de santé, il existe des dispositifs mais ils sont coûteux et inadaptés. Pour descendre l’Oyapock en pirogue, un psychiatre mettra une semaine pour rester seulement vingt-quatre heures sur place. Pour le même prix, ne pourrait-on préférer une journée de voyage en avion pour quatre jours de consultation ? Le dispositif de prise en charge psychiatrique, notamment après une tentative de suicide, reste un grand problème car tout suivi de long terme est impossible. De la même façon, le recteur nous a expliqué que les difficultés de transport l’empêchaient d’envoyer du personnel, du fait notamment de l’absence de lignes de transports fluviaux.
Nous proposons de mettre en place des mutualisations entre la préfecture, les services médicaux et l’éducation nationale. Il faut garantir une sécurisation des transports fluviaux.
Il importe de résoudre ces problèmes matériels : il est possible de le faire car cela ne nécessite pas des sommes astronomiques. Les gens arrivent déjà à se débrouiller avec des bouts de ficelle ; il s’agit de parvenir à mettre un peu de liant.
Je continuerai avec les infrastructures et le développement.
La République n’a pas donné l’accès au téléphone à ces territoires alors que le Suriname voisin, qui est l’un des pays les pauvres du monde, et le Brésil assurent partout une couverture téléphonique en 4G et 3G. Lors d’une réunion d’une cinquantaine de personnes à Talhuen, les habitants nous ont dit vouloir bénéficier des mêmes services qu’en métropole. Certains jeunes nous ont demandé pourquoi la mission locale avait fermé et si, en métropole, elles étaient aussi fermées. Des mères de famille, révoltées par les dégâts causés par l’orpaillage clandestin sur l’écosystème, nous ont demandé si dans les villes de métropole, nous supporterions qu’il y ait de telles zones de non-droit.
Nous avons entendu des jeunes, diplômés ou non du baccalauréat, nous faire part de leur souhait de démarrer dans la vie et de ne plus être des assistés. C’est une dimension très importante à prendre en compte : les populations veulent se prendre en main et demandent simplement un peu d’aide. Elles veulent être reconnues pour ce qu’elles sont, y compris au plan culturel.
Le parc de Guyane, qui fait un travail formidable, pourrait offrir à ces jeunes une autre issue que la désespérance, l’alcool, le mal-vivre d’une double culture : un emploi qui leur donnerait une place dans la société.
La lettre de mission insistait sur les transformations envisageables. Le Conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge (CCPAB) a un statut un peu bâtard : il dépend de l’État mais doit être rattaché à la nouvelle collectivité territoriale et s’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants, il ne pourra être autonome. Cette instance n’a pas de budget propre et les membres du CCPAB ne sont même pas défrayés de leurs frais de déplacement, même s’ils doivent venir du fin fond de la Guyane pour pouvoir siéger à Cayenne. Nous avons formulé quelques préconisations pour que le CCPAB soit considéré comme un équivalent des comités consultatifs, voire d’un conseil économique et social.
Nous avons pris acte de très fortes demandes concernant le foncier, en précisant que notre mission ne couvrait pas ce domaine. Cela fait partie du problème de la reconnaissance de la culture puisque l’État possède 80 % du foncier. Dans certaines zones de droit coutumier, les habitants peuvent certes se livrer à des cultures traditionnelles, mais cela ne suffit plus. La question qui se pose est celle des possibilités de développement des communes amérindiennes.
Nous avons remis notre rapport le 30 novembre dernier à Mme la ministre des outre-mer, en présence du cabinet de Mme la ministre des affaires sociales. Nous avons eu des contacts avec les membres du cabinet de Mme la ministre de l’éducation nationale et nous devrions bientôt rencontrer le Premier ministre – notre rendez-vous avait été reporté car il devait avoir lieu juste au moment des attentats.
La ministre des outre-mer nous a promis d’intégrer quelques-unes des mesures que nous préconisons dans le pacte d’avenir pour la Guyane. J’aimerais ici insister sur le fait que les changements que nous appelons de nos vœux ne réclament pas tous des moyens financiers supplémentaires.
J’ai découvert des gens qui se prenaient en main, qui avaient conscience des problèmes. Il faut les aider. La République ne doit abandonner personne. Nous avons apporté notre petite pierre à un édifice qui a déjà commencé à se construire. Sachez qu’Aline Archimbaud et moi-même nous resterons mobilisées aux côtés de nos collègues guyanais pour soutenir leurs revendications et pour faire avancer les choses.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Nous pouvons remercier Marie-Anne Chapdelaine pour ce rapport.
Ce bref aperçu de vos constats et préconisations montre que vous avez découvert des réalités qui vous ont surprise, réalités que nous ne connaissons pas dans les autres départements et territoires d’outre-mer. Donner un coup de projecteur sur cet aspect particulier était d’autant plus important.
Le pacte d’avenir pour la Guyane, que présentera Mme Pau-Langevin, tentera de répondre en partie à vos préconisations
Il appartiendra à la Délégation et à nos collègues guyanais de faire suivre d’effets vos propositions.
Mme Monique Orphé. Je remercie Marie-Anne Chapdelaine pour son intéressant travail.
Le plan santé pour les outre-mer élaboré par Chantal de Singly sera décliné par territoire et tiendra compte des spécificités locales. Il serait bon que le problème particulier des suicides des jeunes Amérindiens ainsi que de l’addictologie soit pris en compte dans ce cadre.
Mme Gabrielle Louis-Carabin. La situation des jeunes Amérindiens a été une découverte pour moi.
Une de mes collègues, employée communale, s’est rendue à Camopi où l’une de ses filles occupe un poste à mi-temps de psychologue. Elle m’a jointe avant le carnaval pour me dire que les enfants qu’elle avait rencontrés éprouvaient un grand mal-être et m’a demandé s’il serait possible de les inviter à Petit-Canal. J’ai accepté et ils sont venus. Ils ont défilé pour le carnaval, et ils sont aussi allés à la messe, non pas avec leurs habits traditionnels parce qu’ils respectent leurs coutumes mais avec des costumes comme les nôtres – j’ai pris des photos que j’ai montrées au sénateur Georges Patient lors d’une rencontre avec la ministre des outre-mer. J’ai pu constater comme ils étaient sclérosés : il y a quelque chose de bloqué en eux, ils n’arrivent pas à participer au carnaval, bien plus, à entrer pleinement dans la vie.
Il est difficile d’admettre que sur un territoire de la République française, il y ait des jeunes aussi isolés, touchés par le fléau de la drogue et de l’alcool, qui ont des difficultés à être scolarisés et qui, lorsqu’ils le sont, ne peuvent revenir dans leur famille le week-end. Il est difficile d’admettre qu’il y ait des jeunes qui manquent d’un suivi psychologique alors que dans les autres départements et territoires d’outre-mer il existe des centres médico-psychologiques. Il y a vraiment quelque chose à faire.
Il a été question du foncier. On a fait venir des gens d’ailleurs pour planter. Mais on aurait pu aussi aider les Amérindiens à planter sur leur territoire, ce qui les aurait aidés à mieux se nourrir. Car là aussi, il y a un problème.
Mme Chantal Berthelot. Je tiens à remercier Marie-Anne Chapdelaine et Aline Archimbaud pour le travail qu’elles ont fourni. Leur rapport a été lu, et est beaucoup travaillé, actuellement, en Guyane. Leur tâche n’a pas été simple : elles ont eu un programme très chargé et se sont heurtées à des difficultés logistiques. La Guyane est un beau pays mais il n’est pas toujours très aisé de s’y déplacer. En outre, le monde des Amérindiens est un monde en soi, avec des codes très particuliers. Il n’était sans doute pas évident d’y pénétrer.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, je tiens à saluer l’initiative du Gouvernement. Mme la ministre des outre-mer, lors de sa visite à Maripasoula au début de l’année 2015, a été sensibilisée à la problématique des suicides des jeunes Amérindiens, que l’on peut considérer comme un échec pour notre société. Que le Premier ministre ait diligenté des parlementaires en mission montre l’intérêt du Gouvernement pour cette question.
Nous souhaitons, bien sûr, que cet intérêt se traduise par des mesures concrètes. Gabriel Serville et moi avons besoin de tous nos collègues pour mener ce combat : il faut que les propositions formulées dans le rapport soient prises en compte. L’attente est très grande.
Le rapport constitue une précieuse source d’informations et permet une appropriation facile grâce à la liste des propositions argumentées.
Je commencerai par le CCPAB, institué dans la loi de 2007 pour prendre en compte les problématiques propres aux populations amérindiennes et bushinenge. Ses membres, qui se sont saisis à la fin du mois de janvier du rapport, approuvent votre proposition de transformation en grand conseil coutumier.
C’est une transformation importante, à mes yeux, car elle permettrait de légitimer ce que l’on attend d’une instance consultative dotée d’une dimension culturelle spécifique. Pour l’heure, l’État français se refuse à signer la convention 169 de l’OIT, en vertu du principe posé par l’article 1er de la Constitution : « La France est une République une et indivisible ». Il ne reconnaît pas les peuples autochtones et donc les conseils coutumiers, à l’exception de la Nouvelle-Calédonie.
Pour assurer sa cohésion sociale, la Guyane aurait pourtant besoin que la France accepte de prendre en compte les particularités de ces deux peuples, qu’il s’agisse de leurs codes socio-culturels ou de leurs façons de fonctionner.
Je tiens à souligner que les quinze propositions prioritaires n’appellent pas toutes des financements supplémentaires mais de la volonté, de la coordination, une mutualisation de moyens.
J’insisterai sur une proposition en particulier, la proposition n° 8 relative au logement des lycéens, sur laquelle s’accordent les proviseurs de lycée, les principaux de collège et le recteur. Nous attendons la mise en place concrète de la collectivité territoriale de Guyane pour disposer de moyens supplémentaires afin d’assurer la présence de surveillants et d’animateurs le week-end. Nous espérons tous que cette mesure sera mise en œuvre rapidement.
La proposition relative à la mise en place de centres médicopsychologiques à Camopi et Maripasoula, en liaison avec l’hôpital de Cayenne et l’hôpital de Saint-Laurent, recueille elle aussi un large accord.
Une réunion annuelle de suivi peut paraître parfois lourde. En l’occurrence, elle apparaît nécessaire pour faire un point d’étape sur la mise en œuvre des différentes propositions.
J’exprimerai ici le souhait, monsieur le président, que la Délégation nous accompagne dans nos démarches, même si je sais que Mme la ministre des outre-mer est très sensible à ces questions. Il faut que le Gouvernement puisse trancher.
La proposition n°7 sur la collation servie aux élèves me tient aussi particulièrement à cœur. Vous avez compris, chers collègues, combien les distances posent de problèmes pour les transports. En tant que parents ou futurs parents, nous ne pouvons admettre que des enfants, après s’être réveillés très tôt pour pouvoir se rendre dans leur établissement scolaire, restent toute une journée sans rien manger ou bien se nourrissent de choses à bannir au plan diététique alors que les plans santé ont montré le poids du diabète et de l’hypertension en outre-mer. Le rôle de la société est d’accompagner. Généraliser l’accès à une collation me semble indispensable. J’espère que Mme la ministre, que je sais sensible à ces questions, va se battre pour que ce service soit mis en place. Il faut que nous montrions que nous l’appuyons afin qu’elle puisse gagner ses arbitrages interministériels.
Cette semaine, l’Assemblée nationale aborde des sujets très sensibles pour la Guyane. Aujourd’hui, la Délégation aux outre-mer entend Mme Marie-Anne Chapdelaine sur son rapport et demain, la commission du développement durable organise une table ronde sur l’orpaillage illégal. Cette pratique est un vrai fléau pour notre territoire et elle nourrit le mal-être des populations amérindiennes et bushinenge. Les garimpeiros, orpailleurs illégaux sans foi ni loi, pillent les abatis des populations, exercent des violences sur les habitants, les femmes en particulier, et se livrent à la surchasse et à la surpêche. Ils sont à l’origine d’une pollution de l’eau au mercure, avec les conséquences que l’on sait en termes d’atteintes à la chaîne alimentaire et de malformations neurologiques.
Dans une dizaine de jours, nous allons aborder la deuxième lecture du projet de loi relatif à la biodiversité. Si la Guyane représente une part importante du domaine maritime de la France, elle a une place particulière dans la préservation de la biodiversité à travers la forêt amazonienne. En ce domaine, les Amérindiens, forts d’un savoir-faire millénaire, jouent un rôle décisif. Les députés de Guyane ont besoin du soutien de leurs collègues pour que ce rôle trouve une reconnaissance dans la loi : reconnaissance de leur apport pour l’humanité et reconnaissance de leur culture propre.
Je terminerai par les langues pour regretter, monsieur Gosselin, que la droite ne nous ait pas suivis dans la reconnaissance des langues minoritaires. Il importerait de reconnaître et valoriser les langues amérindiennes, qui sont en train de se perdre. Je sais que M. Gosselin partage mes regrets.
M. Philippe Gosselin. Attention à l’interprétation des pensées, ma chère collègue ! (Sourires)
Mme Chantal Berthelot. Enfin, il ne nous a pas échappé que le plan santé pour l’outre-mer, évoqué par Mme Orphé, pourrait intégrer ces problématiques. Mme Chantal de Singly s’est rendue en Guyane et j’ai eu l’occasion de lui écrire pour appeler son attention sur ces sujets. Il importerait de créer un Observatoire du suicide en Guyane, à l’instar des instances existant sur le territoire hexagonal. Il pourrait intégrer la cellule régionale pour le mieux-être des personnes de l’intérieur qui permet une approche spécifique du suicide dans les populations amérindiennes et bushinenge.
Nous comptons sur l’appui de la Délégation pour que la ministre des outre-mer et le Premier ministre rendent des arbitrages favorables à la mise en œuvre des propositions formulées dans le rapport de Mme Chapdelaine.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Ces réalités, madame Berthelot, vous les connaissez mieux que personne. Vous avez bien raison d’insister sur la nécessaire implication du Gouvernement. Mais il ne s’agit pas seulement d’une question de politique. Mme Chapdelaine a dit que la République n’était pas au rendez-vous. Et à vous entendre les uns et les autres, on ne peut que trouver invraisemblable que dans un département français, la République une et indivisible ait oublié une grande partie de ses habitants.
Nous avons prévu d’auditionner Mme la ministre des outre-mer sur la question particulière du pacte d’avenir pour la Guyane. Il faut espérer que les choses pourront avancer, d’autant que les propositions du rapport n’exigent pas des sommes considérables.
La Délégation plaidera auprès de Mme Pau-Langevin pour que ces questions soient prises en compte le plus rapidement possible et que les propositions qui peuvent être dès maintenant mises en œuvre le soient.
C’est une question de suivi. La Délégation se doit d’insister sur ces situations intenables. Comment, par exemple, peut-on laisser des enfants sans collation ? Nous sommes tous responsables, notamment par méconnaissance – ce qui est mon cas comme d’autres.
Vous pouvez compter sur moi, si c’est nécessaire, pour vous apporter toute l’aide qui soit en mon pouvoir.
M. Philippe Gosselin. Je tenais à être présent à cette réunion de la Délégation car j’estime qu’il s’agit d’un sujet grave. De façon générale, notre pays n’a pas l’ambition qu’il devrait avoir en matière de prévention des suicides. Et en disant cela, je n’intente aucun procès au Gouvernement, ces questions dépassant les clivages politiques. En France, rappelons-le, le suicide est la première cause de mortalité chez les jeunes.
En lisant le rapport de Mme Chapdelaine, j’ai découvert des chiffres qui m’ont alarmé, ébahi. Je savais que le taux de suicide était important chez les Amérindiens mais je n’avais pas imaginé qu’il atteignait de telles proportions. C’est un premier intérêt du rapport que de mettre en avant ces éléments quantitatifs bruts, avant même d’aborder concrètement le problème humain.
J’emboîte le pas au président de la Délégation. Nous pouvons partager non seulement le diagnostic mais aussi – sous réserve d’un inventaire plus précis – l’essentiel des préconisations. Je n’ai pas le sentiment qu’elles impliquent de consacrer des sommes astronomiques, même si les distances et les difficultés d’accès, l’absence de raccordement à un réseau d’eau et d’électricité, sans même évoquer la couverture en 3 G ou 4 G, compliquent forcément les choses. Je ne néglige pas non plus l’importance du phénomène identitaire chez les quelque 10 000 Amérindiens de Guyane : la perte de repères entraîne des difficultés à savoir qui on est. Je prends aussi en compte les efforts entrepris dans le cadre du pacte d’avenir pour la Guyane.
La transformation du Conseil consultatif en conseil coutumier est une piste à creuser. En Nouvelle-Calédonie, il existe un Sénat coutumier. Autrement dit, la République a reconnu la place d’une civilisation, d’une culture, d’une langue particulières. Ce qui a été fait dans une collectivité d’outre-mer, certes dotée d’un statut spécifique, pourrait trouver sans difficultés majeures à s’appliquer en Guyane.
La fierté est un sentiment à ne pas négliger. Moi qui suis normand, je revendique d’être normand. Cela fait partie de ma culture, de mes racines. On peut être normand et français comme on peut être guyanais, amérindien et français.
Sur les langues autochtones, madame Berthelot, la révision de la Constitution en vue de l’intégration de la Charte des langues régionales n’est pas d’actualité. Toutefois, le cadre législatif actuel permet déjà de prendre en compte les langues régionales. Et je ne vois pas ce qui empêcherait très concrètement de mettre en valeur les langues amérindiennes.
Cet ensemble de propositions m’apparaît cohérent et mérite une attention partagée. Je tiens à remercier Marie-Anne Chapdelaine et Aline Archimbaud pour leur rapport, qui pourrait recevoir l’assentiment unanime de la Délégation, et qui est la preuve qu’un travail conjoint entre notre assemblée et le Sénat peut être productif.
Je terminerai pour exprimer à nouveau le regret que la prévention du suicide dans notre pays ne constitue pas une plus grande cause d’engagement collectif.
Mme Marie-Anne Chapdelaine. Je tiens à remercier encore nos collègues guyanais, en présence de Chantal Berthelot, de la confiance qu’ils nous ont faite et de l’aide qu’ils nous ont apportée. Devant l’ampleur de la tâche, il fallait rester modeste : nous aurions pu nous y perdre.
La République est une et indivisible. L’égalité réelle doit s’appliquer partout. Il importe de la rendre telle, aussi, dans le territoire intérieur de la Guyane : ses habitants ont droit aux mêmes choses que les autres Français.
Les habitants amérindiens vivent des situations qui mettraient nos concitoyens de métropole dans les rues et provoqueraient un déferlement de parents d’élèves aux portes de nos permanences. Ils attendent beaucoup de la République. Nous devons être au rendez-vous.
Très modestement, je serai aux côtés de mes collègues guyanais pour que les choses avancent. La République, c’est la diversité, que le Mont-Saint-Michel soit en Bretagne ou en Normandie !
Je terminerai par deux remarques.
En Bretagne, les enseignants du collège public des îles du Ponant se déplacent pour dispenser leurs cours dans divers sites. Pourquoi ce qui est possible en Bretagne ne le serait pas en Guyane, si c’était bien la solution ?
Lorsque nous avons visité un village, une superbe boîte aux lettres d’un mètre sur un mètre a attiré mon attention mais bien vite, quelqu’un m’a fait remarquer que les lettres s’y entassaient parce que le courrier n’était jamais relevé.
Mme Chantal Berthelot. Il est relevé une fois par mois.
Mme Marie-Anne Chapdelaine. Une telle chose ne devrait pas être possible sur le territoire de la République. Les services publics doivent être accessibles à tous.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Je vous remercie, madame Chapdelaine, pour cette présentation et pour votre travail.
Quelqu’un demande-t-il encore la parole ?
M. Philippe Gosselin. Monsieur le président, pourrait-on envisager d’adresser une lettre au Premier ministre dans laquelle nous exprimerions le vœu unanime de la Délégation de voir mises en œuvre les propositions du rapport de Marie-Anne Chapdelaine et Aline Archimbaud ?
M. le président Jean-Claude Fruteau. Oui, la Délégation est toujours libre d’émettre un vœu en ce sens. Je me charge, mes chers collègues, si vous le voulez bien, de l’exprimer en votre nom (Assentiment).
C. PRESENTATION PAR M. JEAN-JACQUES VLODY DES PREMIERES ORIENTATIONS DE SON RAPPORT SUR L’INSERTION DES DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER DANS LEUR ENVIRONNEMENT REGIONAL
(Séance du 10 mai 2016)
M. le président Jean-Claude Fruteau. Notre délégation est aujourd’hui réunie pour entendre notre collègue Jean Jacques Vlody, parlementaire missionné par le Premier ministre afin de formuler des propositions de solutions pour favoriser le développement économique, social et éducatif des outre-mer.
Vous savez par ailleurs, mes chers collègues, que nous sommes le 10 mai, jour qui revêt une signification particulière pour les outre-mer puisque, depuis dix ans, il est consacré à la mémoire de la traite des esclaves et de son abolition. C’est ainsi que, chaque année, la Nation tout entière est amenée à se souvenir, à comprendre et à réagir devant un long cortège d’oppression, d’aliénation et de servitude.
Je ne pense pas me tromper en disant qu’ici nous sommes tous conscients que la mémoire de tant de vies perdues et écrasées en violation de la dignité qui, de manière inaliénable, est celle de tout homme, doit être conservée. Toutefois, ce devoir de mémoire ne saurait se borner à regarder le passé : il permet, par le débat qu’il suscite, de maintenir les consciences éveillées devant le risque de voir revenir le mépris de l’homme, hélas susceptible de prendre bien d’autres formes que la traite et l’esclavage.
Il incite aussi à se souvenir de l’élan qui, sur le fondement des principes de liberté, d’égalité et de fraternité, a conduit à l’abolition de l’esclavage en 1848, et à se demander comment donner aujourd’hui à ces principes une consistance effective dans les outre-mer.
Dans le cadre des travaux du Parlement, la réflexion sur la mise en œuvre concrète de ces valeurs dans les outre-mer constitue l’une des missions primordiales de notre délégation, qui, réunion après réunion, en décline toutes les conséquences. Elle doit encore être au cœur de la mission confiée par le Premier ministre à Jean-Jacques Vlody afin de réfléchir aux moyens de favoriser le développement des outre-mer, dans les dimensions que j’ai évoquées, via leur meilleure inclusion dans leur environnement régional. Aussi m’a-t-il semblé important que les membres de la délégation puissent entendre notre collègue faire le point sur l’état d’avancement de ses travaux, qu’ils puissent l’interroger et lui faire part de leurs réflexions.
M. Jean-Jacques Vlody. Je vous remercie, monsieur le président, pour ces propos célébrant la date commémorative de l’abolition de l’esclavage dans notre pays. J’ai une pensée particulière pour le premier Vlody identifié : il s’agit d’un esclave affranchi à Sainte-Suzanne en 1848 et qui se trouve être mon arrière-arrière-grand-père. Je compte parmi mes ancêtres des Malgaches et des esclaves indiens ; par ailleurs, tous les Payet de La Réunion proviennent de la commune de Saint-Priest-la-Roche, située dans la région de Lyon. Cela constitue un bel exemple de la mixité de nos territoires.
Les champs d’intervention de ma mission sont très vastes et revêtent une dimension multipolaire. À l’origine de bien des problèmes rencontrés se trouve la réalité de nos territoires français de l’océan Indien – La Réunion et Mayotte –, et des Caraïbes – la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Nous ne parlons donc pas des territoires d’outre-mer (TOM), ni de l’ensemble de l’outre-mer français, mais des régions et départements français d’outre-mer.
La question posée est la suivante : comment réussir une meilleure insertion de ces territoires dans leur espace géographique ? Comment mieux insérer La Réunion et Mayotte dans l’océan Indien, et comment mieux insérer la Guadeloupe et la Martinique dans l’espace caraïbe et sud-américain ? Les divers thèmes portent sur l’économie, l’exportation, la problématique de la connectivité, aérienne, maritime et numérique, sur la circulation des personnes, particulièrement dans le domaine des visas pour la Guyane et Mayotte, ainsi que sur les échanges, qu’ils soient sanitaires, culturels ou universitaires.
Une des données de la problématique est que ces régions sont ultrapériphériques de l’Europe ; ce sont les territoires les plus éloignés d’un centre. À ce titre, nous bénéficions de dispositions particulières, que ce soit le document unique de programmation (DOCUP) pour l’Europe ou les dispositifs nationaux : tous ont pour objet d’organiser de meilleures conditions de développement économique et social. Toutefois, nous demeurons des espaces périphériques de la France et de l’Europe : comment faire pour que ces régions deviennent des centres dans l’espace qui est le leur ?
Comment la France doit-elle s’appuyer sur ces territoires pour s’insérer dans ces espaces géographiques ? C’est là le cœur de ma mission ; pour l’heure, je laisse en friche la question du vocabulaire qui, toutefois, est importante, car il ne s’agit pas d’intégrer ni de rayonner, mais d’insérer nos territoires pour que la politique de notre pays puisse être conduite à partir d’eux. Cela doit être réalisé en cohérence et en complémentarité ; cependant, nous avons parfois l’impression que les politiques nationales sont menées à l’envers, voire contre nos régions. Lorsque l’on est réunionnais, mahorais, guadeloupéen, martiniquais ou guyanais, on a souvent le sentiment que la France mène une politique de relations avec les États allant à l’encontre de nos intérêts.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Et l’Europe !
M. Jean-Jacques Vlody. Et l’Europe. Comment inverser cette situation et faire comprendre que nous sommes dans une autre dimension ?
De récentes évolutions législatives redonnent un cadre à ce que l’on appelle de façon quelque peu simpliste la coopération régionale, consistant à travailler avec les pays de la zone, mais je ne souhaite pas limiter mes travaux à la simple question de la coopération régionale. C’est tout un état d’esprit, une mentalité de l’organisation administrative qu’il convient de faire évoluer, et cela ne s’arrête pas à la question d’une coopération entre une collectivité et un État ou entre deux États.
À l’occasion de l’examen de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite NOTRe, j’ai fait adopter un amendement modifiant les relations entre l’État et les collectivités locales dans leurs politiques de coopération régionale. Jusque-là, selon son bon vouloir, l’État pouvait associer les régions et départements à des politiques ou à des concertations avec les pays de la zone en matière de relations bilatérales : désormais, cette simple faculté est devenue une obligation.
Une autre évolution résultera des propositions faites par Serge Letchimy dans son rapport déposé le 16 mars dernier sur la proposition de loi relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération de l’outre-mer dans son environnement régional, dont l’examen est en cours. Il s’agit de conférer aux collectivités la possibilité, par délégation de l’État, de passer des accords-cadres avec les pays voisins indépendants : c’est une révolution. Cela montre une évolution de la position de l’État au sujet de ses relations avec les pays voisins des territoires d’outre-mer. L’ancien ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius, avait été pionnier en introduisant une nouveauté sémantique avec la notion de « diplomatie territoriale ». Cette notion, qu’il faut désormais faire vivre, consisterait à ce que la France organise ses relations diplomatiques à partir des territoires situés dans la zone, et non plus uniquement à partir d’un État centralisé décidant de son seul point de vue.
Afin d’illustrer mon propos, je souhaiterais narrer une anecdote trouvée sous la plume de Wilfrid Bertile : la France, dans ses relations avec les pays de la zone au cours des années 2000, s’interrogeait sur l’inquiétude de La Réunion concernant la production d’ananas Victoria. Le représentant de l’État s’insurgeait de constater que l’on n’autorisait pas l’île Maurice à développer ces ananas, alors qu’il s’agit d’une production concurrente des ananas français cultivés à 200 kilomètres à peine. À l’époque, la mentalité de l’État français le conduisait à considérer qu’accompagner un pays en développement l’emportait sur le développement de son propre territoire situé dans la même zone.
Cet état d’esprit, frustrant pour les intéressés, n’est plus de mise aujourd’hui. Beaucoup de chemin n’en reste pas moins à parcourir, pour passer de ce statut d’espace périphérique à celui de centre sur lequel viendrait s’appuyer l’État en matière de diplomatie territoriale, que ce soit dans le fonctionnement même de l’État ou l’organisation administrative, telle qu’elle résulte de la loi ou du règlement. Cette coopération entre nos territoires – c’est-à-dire la France – et divers pays de la zone se révèle positive lorsque le bon sens s’impose ; cela est flagrant dans le domaine de la santé et de la sécurité sanitaire, dans celui de la sécurité maritime ainsi que dans celui de l’aide aux populations vulnérables en cas de catastrophe naturelle.
Ainsi, lorsqu’un problème de sécurité se présente dans l’océan Indien, particulièrement dans le domaine de la piraterie, la France est capable, grâce à la Commission de l’océan Indien (COI), de mobiliser ses moyens maritimes et militaires et d’organiser avec les autres pays de la zone la surveillance du territoire. Un partenariat a été établi et des accords ont été passés. Madagascar et les Seychelles sont d’ailleurs les bases maritimes de ce dispositif de lutte contre la piraterie.
Dans le domaine sanitaire, à l’occasion des épisodes d’émergence des maladies tropicales, tels le Zika, le chikungunya et autres fièvres épidémiques, a été constitué le réseau de surveillance des épidémies et gestion des alertes (SEGA), fruit d’une coopération entre La Réunion, Maurice, Madagascar, Mayotte et les Seychelles. Des partenariats portant notamment sur la formation entre médecins ont été établis, car chacun a compris qu’un manquement à la sécurité sanitaire à un endroit donné pouvait rapidement concerner l’ensemble de la zone.
La coopération porte aussi sur la météo, et les échanges d’informations en cas de cyclone se font naturellement entre La Réunion, Maurice, Madagascar et les Seychelles, chacun surveillant la trajectoire des cyclones.
Dans le cadre des catastrophes naturelles, le dispositif PIROI, qui relève de la Croix-Rouge, est basé dans les divers pays concernés, et, grâce à l’aide militaire et à la mobilisation de nos moyens logistiques, permet des interventions rapides pour la potabilisation de l’eau ou la construction de camps, par exemple.
Ainsi, lorsque les problématiques de diplomatie territoriale, susceptibles d’opposer La Réunion à Madagascar ou La Réunion à Maurice pour des questions de territoires, ou la France au Suriname au sujet de la légitimité du pouvoir en place, ne la limitent pas – ce qui est rarement le cas –, la coopération fonctionne bien, car elle commande l’intérêt supérieur des nations.
Cette coopération reste toutefois à construire dans le domaine de l’économie, et, à travers elle, de la circulation des personnes. La question est celle des visas exigés pour circuler au sein de la zone : la vision parisienne de cette problématique est en complet décalage avec la réalité de certains territoires. Ma mission m’a conduit à réaliser une cinquantaine d’auditions et de nombreuses visites de terrain. J’ai ainsi eu l’occasion d’aller au Suriname en passant par Saint-Laurent-du-Maroni : vu d’ici, on nous explique que la France va être envahie par l’ensemble des pays sud-américains à cause de problèmes de visas ; la circulation des personnes est conçue comme un danger majeur pour la sécurité du territoire, que cela soit en matière d’immigration économique ou de surveillance sanitaire.
Ainsi ai-je entendu, à Cayenne, le directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) qui m’a mis en garde contre le risque sanitaire majeur que représenterait la libre circulation des personnes entre Saint-Laurent-du-Maroni et le Suriname, susceptible de déclencher une pandémie mondiale. J’ai alors considéré que la France, à elle seule, ne pourrait pas faire face à une telle crise et qu’il fallait faire appel à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et à l’Organisation des Nations Unies (ONU).
Je me suis ensuite rendu à l’hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni, et j’ai rapporté les propos qui m’avaient été tenus : ils ont déclenché l’hilarité de mes interlocuteurs ; l’adjoint du directeur de l’ARS qui était présent m’a indiqué que la circulation des personnes constituait d’ores et déjà une donnée de fait, et qu’elle n’avait pas vocation à diminuer. Il a considéré qu’il s’agissait d’une vision parfaitement erronée de la réalité constatée sur le terrain ; le regard porté par la Métropole sur ces territoires est déformé.
Le sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni m’a conduit au petit poste-frontière, qui est réputé surveiller les 500 kilomètres de longueur du fleuve Maroni : cela prête à rire ! Ce poste est évidemment contourné par les personnes désireuses de se rendre au Suriname.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Ou alors, c’est qu’elles n’ont pas bien compris !
M. Jean-Jacques Vlody. Mille bateaux passent ainsi chaque jour. Le sous-préfet m’a indiqué que, son administration de tutelle lui demandant de « faire du chiffre », il faisait procéder chaque jour à une dizaine de raccompagnements à la frontière, et que les intéressés revenaient le lendemain. On constate à quel point notre conception de ce territoire est inadaptée.
Le sous-préfet m’a ensuite fait visiter un village peuplé par des Amérindiens, qui, curieusement, ne sont français que depuis 1967, alors qu’ils existent depuis 3 000 ans et n’ont rien demandé. Le ministère de la culture met en place des programmes d’art et d’histoire afin de mettre en valeur la richesse patrimoniale des peuples amérindiens. Or les familles sont réparties sur les deux rives opposées du fleuve, et le maire de la commune d’Awala Yalimapo, représentant l’autorité française, m’a expliqué qu’il souhaitait organiser un partenariat avec la partie de sa famille située sur l’autre rive du fleuve afin de célébrer l’intronisation du nouveau chef. Il m’a indiqué que, à cette fin, il devait se procurer un visa à Saint-Laurent-du-Maroni, situé à 100 kilomètres de son village, qu’il lui fallait une autorisation administrative, des pirogues homologuées aux normes françaises ainsi qu’un permis de naviguer, et que le fleuve devait être navigable. Le sous-préfet m’a confirmé ces faits. Or il se trouve que les intéressés ne sont pas titulaires du permis, que les pirogues ne sont pas homologuées et que le fleuve n’est pas navigable. Il est heureux que nous puissions faire confiance à l’intelligence des hommes, car il serait ridicule de vouloir empêcher ces gens, qui sont des ressortissants français, de perpétuer leurs traditions. Une fois encore, la vision de la Métropole est sans commune mesure avec cette réalité observée sur le terrain.
Les accords de sécurité conclus entre les États posent, eux aussi, de sérieux problèmes dans le domaine de la circulation des personnes, singulièrement à Mayotte où je dois me rendre prochainement. Pour que les territoires s’ouvrent les uns aux autres et communiquent, il faut d’abord que les hommes et les femmes qui y vivent puissent se rencontrer ; or il est plus facile pour un Brésilien, un Malgache ou un Mauricien de se rendre à Paris que, pour un Brésilien, de gagner Cayenne ou, pour un Malgache, de gagner La Réunion. De fait, aucun visa n’est exigé pour se rendre à Paris, alors que ce document est exigé pour aller à La Réunion.
Les craintes de notre administration au regard de la sécurité sanitaire conduisent à des incohérences ; le risque existe, en effet, mais il est largement surévalué.
Quelques préconisations du rapport, dont je pense achever la rédaction à la fin du mois de juin prochain, prennent déjà forme, et il reste quelques auditions et déplacements à effectuer ; je tenais beaucoup à échanger avec les membres de la délégation afin de m’enrichir de leurs interrogations comme de leurs propositions.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Avant de donner la parole à nos collègues, je souhaite saluer la présence de Mme Julie Bouaziz, conseillère chargée de l’intérieur et des outre-mer au sein du cabinet du président de l’Assemblée nationale, M. Claude Bartolone, qui a demandé à assister à nos travaux. En notre nom à tous, je lui ai dit que sa présence ès qualités était bienvenue : madame, vous êtes ici chez vous.
Vous avez, monsieur Vlody, abondamment évoqué les questions de sécurité sanitaire, liées à celle de la circulation des personnes, mais qu’en est-il des coopérations susceptibles de favoriser le développement économique et social de ce que vous avez défini comme les départements d’outre-mer, auxquels, il y a cinq ans, Mayotte s’est ajoutée, avant d’acquérir, il y a deux ans, le statut de région ultrapériphérique de l’Union européenne ?
Les sujets de la santé, de la circulation des personnes, de la culture et de l’éducation font l’objet de débats depuis des années, sans que l’on puisse constater de réelles évolutions. Selon vous, que faudrait-il faire pour que nos départements franchissent une étape supplémentaire vers un meilleur développement économique ?
M. Ibrahim Aboubacar. Il est vrai que le champ de la mission est large. Il reprend une partie des thèmes abordés par la proposition de loi de Serge Letchimy. Les questions évoquées sont surtout d’ordre institutionnel et concernent les progrès souhaités par l’ancien ministre des affaires étrangères dans le domaine de la fusion des outils d’intervention économique, tel l’adossement de l’Agence française de développement (AFD) à la Caisse des dépôts, et en tout état de cause, l’augmentation des taux d’intervention dans ces régions.
Je connais peu l’Atlantique, mais souhaiterais évoquer la situation dans l’océan Indien : monsieur Vlody, avez-vous entendu les opérateurs économiques des zones concernées ? Je ne songe pas à la COI, mais aux organisations économiques qui font de l’économie, pas à celles qui font de la politique sur le dos de l’économie…
M. Jean-Jacques Vlody. J’ai bien compris !
M. Ibrahim Aboubacar. Un plan de connectivité de l’océan Indien a été lancé à partir de projets de réseaux de câbles circulant dans la zone : j’ai constaté que, en définitive, la connexion s’établissait de façon extrêmement désordonnée et n’était toujours pas achevée. De fait, les schémas que les opérateurs percevaient comme les plus pertinents sur le plan économique n’ont pas été retenus. Des raccordements partiels ont été effectués avec les câbles LION 1 et 2 – acronyme de Lower Indian Ocean –, il m’est même revenu que les Comores ont été câblées par un opérateur chinois. À l’époque, c’était l’opérateur national France Télécom qui était censé servir les intérêts de la France dans la zone et être membre des consortiums qui se sont constitués ; or cela n’a pas été possible. M. Daniel Golberg, président du groupe d’amitié France-Comores, s’est rendu à Mayotte il y a quelques années : il avait été scandalisé par l’échec de ce qui aurait dû constituer une avancée économique significative.
Autre exemple concret, car le monde économique veut des choses concrètes : le projet des îles Vanille, destiné à développer le tourisme. Dans un passé récent, j’ai été directeur de la chambre de commerce de Mayotte ; à ce titre je connaissais bien ce projet : le plus gros obstacle qu’il a rencontré a été celui des visas de circulation des touristes, ainsi que la desserte aérienne. On peut concevoir que les liaisons aériennes soient coûteuses ; mais les Mauriciens et les Chinois ne sont pas limités par la question des visas, ce qui est loin d’être le cas à La Réunion, par exemple, pour laquelle il a fallu délivrer une dérogation afin de pouvoir accueillir des touristes, avec une procédure simplifiée de délivrance de visas.
Dans le domaine de la connectivité maritime, aucun progrès n’est constaté, alors qu’il existait des projets ; il est toutefois vrai que la COI intervient parfois avec des logiques politiques. Je n’en constate pas moins que, même en l’absence de ces obstacles, les projets échouent.
Dans le domaine du développement des échanges et de l’insertion intervient souvent ce qui est pudiquement dénommé la « question des normes » portant sur les produits agricoles ; à Mayotte, on parle ainsi couramment de la viande malgache. Il ne s’agit pas de contourner les normes déterminées par les autorités de l’Union européenne, mais de rechercher comment s’y adapter dans les filières au sein desquelles nous avons des intérêts, afin de ne pas faire obstacle à la circulation des marchandises.
Ces questions très concrètes reviennent sans cesse dans les forums, et il conviendrait de les régler avant de multiplier les nouveaux sujets de réflexion. Lorsque les acteurs identifient un problème à résoudre, certains pays agissent avec célérité, ce que la France ne sait pas faire. Ainsi, la question des réseaux a été résolue en trois mois à Maurice, en neuf mois aux Seychelles, alors que, cinq ans plus tard, la France n’a toujours pas trouvé de solution satisfaisante. Je n’évoque pas les États déliquescents comme Madagascar ou les Comores qui ne disposent pas des structures administratives nécessaires, mais de nos partenaires économiques qui sont souvent exaspérés par notre façon d’aborder les choses dans ces zones. Dans bien des domaines, nos approches administratives leur paraissent pour le moins curieuses.
Sur ces sujets, il conviendrait de lancer quelques grands chantiers avec la vision qui est celle du monde de l’économie, et de nous interroger sur la manière dont nous pouvons faire évoluer nos pratiques et, parfois, nos réglementations. Cela favoriserait notre insertion ; car nous sommes souvent perçus comme des donneurs de leçons dans le domaine de l’efficacité administrative.
M. le président Jean-Claude Fruteau. C’est ce que l’on sait faire !
M. Jean Jacques Vlody. C’est ce que nous faisons le mieux…
M. Ibrahim Aboubacar. Nous avons parfois raison en ce qui concerne le domaine sanitaire, par exemple, mais nos concurrents ou partenaires économiques savent mettre à profit nos infrastructures.
Dans le cadre des derniers travaux de la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer (CNEPEOM), présidée par Mme Chantal Berthelot, et dont je suis membre, M. Michel Magras, sénateur de Saint-Barthélemy, était rapporteur sur la desserte aérienne outre-mer. Nous avions alors entendu l’ensemble des acteurs du secteur, y compris la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), qui ont considéré que certaines situations étaient encore incompréhensibles, et que le système paraissait totalement bloqué. Il ne semble pas exister de perspectives d’amélioration en termes de volume de trafic, et encore moins dans celui de la baisse des prix. Peut-être pourriez-vous, monsieur Vlody, dans le cadre de votre mission, dialoguer de façon directe avec les acteurs du transport aérien afin d’améliorer la situation.
Pouvez-vous, par ailleurs, nous informer sur l’état d’avancement des accords de partenariat économique (APE) passés entre l’Union européenne et les pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP) ? Seront-ils de nature à résoudre des problèmes ? Il m’est revenu qu’ils ne sont pas encore conclus dans l’océan Indien, les Mauriciens sont très inquiets et souhaitent voir le dossier avancer ; ils avaient même proposé des sous-accords entre Maurice, Madagascar, les Seychelles et la France, afin d’échapper à la lenteur des discussions au sein de l’Union européenne.
Dès lors que nos difficultés d’insertion sont, pour partie, liées à l’héritage des réglementations européennes, il faudrait savoir à quel moment les négociations relatives à l’outil commercial que constituent ces APE prendront fin.
M. Philippe Houillon. C’est une mission extrêmement importante que la vôtre. Le délai paraît presque trop court pour faire le tour de la question. Les régions ultrapériphériques françaises sont un vecteur de développement multidirectionnel, que ce soit sur le plan économique ou linguistique. Grâce à elles, notre pays est la seconde puissance maritime au monde. Or nous n’en sommes qu’aux balbutiements de la découverte des richesses de la mer, que ce soit dans l’océan Indien, dans les Caraïbes ou au large de l’Amérique. La perspective de conquérir de nouvelles ressources porte en elle des espoirs de développement économique.
Si vous avez posé le diagnostic avec talent, je reste cependant sur ma faim s’agissant des solutions. Dans le domaine du transport aérien, il est évident qu’il faut pouvoir se déplacer et communiquer avec l’Hexagone ! Sur place, les populations nous le disent. Il s’agit au demeurant moins d’un problème de temps de trajet que de coût ; quant à la question des visas, nous l’avons déjà abordée.
Mais il nous faut aborder aussi celle des normes. J’espère que vous saurez non seulement produire des exemples, mais aussi dégager un système, une organisation générale ou des principes adaptés à chaque territoire. En France, on a tendance à appliquer la norme européenne au maximum de sa portée, ce qui pénalise tant l’Hexagone que l’outremer. Il faudrait pouvoir adopter d’autres normes qui soient plus compatibles avec l’environnement immédiat où elles s’appliquent. Le raisonnement pourrait être modélisé sur la question de savoir sous quelles conditions des normes différentes peuvent s’appliquer et avec quelle rapidité. Au fond, quelle autre démarche imaginer tout en restant en cohérence avec les normes de l’État ? Il conviendrait de préserver l’unité nationale, mais en permettant aux échanges d’aller plus vite.
M. Jean Jacques Vlody. Cher collègue Ibrahim Aboubacar, il faut que vous sachiez que nous avons entendu tous les acteurs économiques : chambres consulaires – agriculture, métiers et artisanat, commerce et industrie –, entreprises, clubs d’exports, représentants de Business France ou secrétariat d’État au commerce extérieur. L’audition d’une représentante de la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte, devenue présidente de l’Union des chambres de commerce et d’industrie de l’océan Indien, a particulièrement retenu notre attention.
Monsieur le président, vous vous demandez à quoi servent les outre-mer et quel intérêt ils présentent pour la France.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Je l’ai fait simplement parce que j’entends parler du sujet depuis plus de vingt ans, notamment lorsque je siégeais au Parlement européen, sans que cela ait beaucoup avancé.
M. Jean Jacques Vlody. Si nous ne savons pas les mettre à profit comme têtes de pont avancées, ils n’ont en effet aucun intérêt. L’outre-mer et l’Hexagone ne peuvent être gagnants qu’en jouant ensemble.
La situation des régions ultrapériphériques présente trois inconvénients : l’éloignement, l’insularité et l’étroitesse du marché. Sur les deux premiers facteurs, il n’est guère facile d’agir ; mais il n’en va pas de même du troisième. En elles-mêmes, La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane constituent des marchés trop contraints et trop restreints. Mais, si nous tournons le regard vers l’ensemble des petits États des Caraïbes, c’est un marché de 60 millions d’habitants qui s’ouvre à nous. Pour La Réunion et Madagascar, la Communauté de développement d’Afrique australe ou Southern African Development Community (SADC) et le territoire de la COI totalisent 400 millions d’habitants.
Ces marchés sont en construction, j’en suis conscient, mais la France devrait s’appuyer sur eux. La Martinique siège en tant que collectivité au sein de l’Association des États de la Caraïbe (AEC), le conseil général et la région de La Réunion demandent à être membres observateurs du Marché commun de l’Afrique orientale et australe, encore appelé Market for Eastern and Southern Africa (COMESA). Notons, au passage, que la Chine a obtenu le statut de membre observateur de la COI.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Elle l’a obtenu ; elle a été assez gentille pour ne pas l’exiger.
M. Jean-Jacques Vlody. La France pourrait ainsi, à travers la présence de ses territoires dans ces organismes, s’ouvrir à ces espaces économiques.
Cette démarche ne doit pas se faire au détriment de nos territoires. À La Réunion, le président de la chambre d’agriculture s’est montré très prudent, et même, par certains aspects, fermé à une ouverture accrue vers Madagascar, où le travail est beaucoup moins cher, ce qui risque d’inonder le marché réunionnais de denrées produites ailleurs et de casser le système de production sur place. Il faut donc raisonner par sujet et par secteur, en travaillant à une plus grande complémentarité avec les voisins.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Ce n’est pas simple.
M. Jean-Jacques Vlody. Il y a des territoires où l’ouverture ne pose pas de problème. Alors qu’il était difficile de s’approvisionner aux Seychelles en produits frais à destination des touristes qui s’ajoutent à la population locale de 90 000 habitants, notre ambassadeur a compris qu’il pouvait être possible d’en faire venir de La Réunion. La complémentarité doit donc être notre première préoccupation. Sinon, nous risquons de nous faire damer le pion.
Encore faut-il savoir quantifier certains services. Lorsque le Centre hospitalier universitaire de La Réunion envoie un chirurgien opérer pendant un mois à Maurice, il ne sait pas comment facturer cette prestation. L’université de La Réunion, qui détient des pépites, distribue gratuitement son savoir-faire au lieu de le vendre. Nous sommes incapables de faire fructifier ce que nous avons semé. Sans doute conviendrait-il de recenser l’ensemble de ces actions. Les pays de la zone peuvent s’appuyer sur notre ingénierie, nous pouvons les accompagner dans leur développement, pour le plus grand bien de tous.
La connectivité et le lien numérique constituent un autre aspect fondamental, car ils sont un vrai moyen de réduire les distances. C’est pourquoi nous nous battons en faveur d’une 4G qui soit abordable, car elle est un enjeu de développement économique.
Dans le cadre du conseil des ministres de la COI, la France et l’île Maurice ont adopté un programme de soutien aux agriculteurs, organisé par l’université de La Réunion : il s’agit là d’un bon moyen de vendre de la compétence et de la formation.
Quant à la question du câble marin, elle n’est pas réglée. Tout le monde s’accorde à dire qu’il faut en tirer un troisième, mais sans qu’il y ait consensus sur le consortium économique pour le porter. Avec le secrétariat d’État au numérique, nous avons vu que des projets sont déjà sur la table. L’un pourrait partir du Brésil pour la Guyane, l’autre de l’Espagne. Si nous ne voulons pas être dépassés, il nous faudrait régler la question dans les trois ans.
Le groupe CMA CGM, leader mondial du transport maritime, a fait de l’île de La Réunion un centre de correspondances (hub) en complémentarité avec Maurice…
M. le président Jean-Claude Fruteau. En complémentarité avec Maurice !
M. Jean-Jacques Vlody. …comme pôle d’éclatement. Mais, une fois organisés les différents pôles, il faudra aussi une compagnie maritime régionale : les collectivités ou l’État devront, avec des acteurs privés, s’engager dans la desserte de ce territoire. Pour l’heure, le marché n’est pas suffisamment attractif pour qu’un acteur privé vienne s’y installer. Il est donc nécessaire de créer une infrastructure pour créer un flux.
La situation est différente en ce qui concerne le domaine aérien. Il s’agit là moins d’économie que de réglementation. Tous nos territoires sont soumis aux règles de la DGAC, qui veulent que tout État qui obtient l’autorisation de se poser sur le sol français doit garantir la réciprocité. Ils sont donc confrontés à un problème dont la solution ne dépend pas d’eux. Etihad Airways, compagnie aérienne nationale des Émirats arabes unis, a ainsi exigé l’accès aux aéroports français en contrepartie des facilités offertes à Air France. Une compagnie norvégienne qui relie l’Amérique du Nord et le Brésil serait prête à aller jusqu’à la Guadeloupe et jusqu’à la Martinique, mais l’autorisation ne lui est pas donnée. Il serait nécessaire d’adapter la réglementation sur ce point : nos territoires ne doivent pas être soumis à ces règles de réciprocité.
M. le président Jean-Claude Fruteau. C’est cela, oui !
M. Jean-Jacques Vlody. Nous ne pouvons pas être systématiquement désavantagés par des enjeux qui sont liés aux relations entre compagnies ou États européens. Les volumes de nos dessertes ne sont pas décisifs pour ces compagnies : ce ne sont que quelques milliers de passagers en plus, mais, pour nous, ils sont importants. Je vais rencontrer les représentants de la DGAC pour parler avec eux de la possibilité d’une telle dérogation.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Cet exemple montre les limites de l’exercice qui consiste à laisser se nouer des relations directes entre les régions de la République française et des États indépendants. Peut-on vraiment concéder que, dans tel ou tel domaine, La Réunion puisse être exemptée de règles internationales dont je rappelle qu’elles n’ont pas connu d’exception jusqu’à présent ?
La DGAC assure que la solidarité nationale joue en matière de transport aérien et de taxes d’aéroport. Celles-ci seraient deux fois plus élevées outre-mer si la DGAC ne se préoccupait pas de leur prise en charge.
M. Jean Jacques Vlody. Il y a en effet deux points de vue à confronter, celui de la compensation de la solidarité nationale et celui du développement du nombre de passagers. La vraie limite réside en ce que nos territoires n’ont d’intérêt pour ces compagnies que dans la mesure où, grâce au mécanisme de la réciprocité, ils leur offrent un point d’entrée en Europe et, plus particulièrement, en France.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Certaines compagnies développent en effet depuis quelques années une stratégie d’accès à l’Union européenne, et particulièrement à la France, qui n’a rien à voir avec les outre-mer.
M. Jean Jacques Vlody. Les régions ultrapériphériques et les DOM souffrent par ailleurs d’un manque de rapidité décisionnelle sur les sujets qui les concernent. Ce n’est pas que l’État ne s’intéresse pas à leur sort, mais une question qui est importante pour elle peut l’être moins au regard d’autres enjeux nationaux. J’en veux pour preuve notre récente participation à la relance de l’association des parlementaires des pays membres de la Commission de l’océan Indien. Il a fallu que les élus locaux s’en saisissent pour que notre Assemblée suive.
Il est nécessaire de coordonner les actions de l’État et des collectivités présentes sur nos territoires. Les États voisins sont souvent perdus. Maires, chefs d’établissements publics intercommunaux (EPCI), présidents d’EPCI, agence régionale de santé, préfet, président de région : telle est la diversité des interlocuteurs qu’ils ont en face d’eux selon les sujets.
M. le président Jean-Claude Fruteau. On constate une dilution…
M. Jean-Jacques Vlody. Une dilution des responsabilités. Le comité national de suivi et de gestion des fonds européens, qui fédère ces diverses autorités au service d’un but spécial, pourrait cependant servir de modèle si nous voulions créer, par analogie, un comité pour la coopération avec les États voisins.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Il fonctionne.
M. Jean-Jacques Vlody. Il fonctionne même bien !
J’en viens à la question des normes et à celle des accords ACP, qui nous renvoie à la problématique des limites de l’exercice de relations directes avec les États voisins dans certains cadres. Nous ne sommes pas prêts à avancer sur certains modèles : il ne s’agit pourtant pas de nous défaire de notre appartenance nationale ou de perdre notre statut de région ultrapériphérique. Nous nous demandons au contraire comment l’État et l’Europe peuvent s’appuyer sur nos territoires pour travailler avec les pays de la zone.
Les crédits du Fonds européen de développement (FED) alloués à la Guadeloupe y sont, à titre expérimental, gérés sur place par la région, et non directement par Bruxelles, comme auparavant. Il en va de même pour les crédits d’INTERREG, qui correspondent à un dispositif complémentaire. Nous travaillons d’ailleurs à leur meilleure coordination. Cet exemple montre que l’Union européenne est prête, elle aussi, à s’appuyer sur les régions ultrapériphériques pour rayonner dans la zone de l’océan Indien ou des Caraïbes.
Quant aux accords ACP ou APE, ou accords de Cotonou, ils devraient être révisés à l’échéance de 2020. La France doit être présente à cette révision des accords, alors qu’elle a peiné jusqu’à présent à se sentir directement concernée par eux. Pourtant, la production des pays ACP est en concurrence directe avec celle de nos territoires ultramarins. Il me semble donc que l’État doit se saisir de ces sujets et questions. Nous pouvons essayer d’avancer à travers la COI.
En ce qui concerne une desserte aérienne qui irait au-delà des possibilités de la réglementation actuelle, on note un projet de compagnie régionale, avec Air Austral, qui, avec sa filiale Ewa Air, opère sur Mayotte et l’Afrique. Nous en sommes aux balbutiements. Le marché des Antilles ne constitue pas quant à lui un enjeu commercial en soi. Il conviendrait de revoir la réglementation pour y permettre l’opération simplifiée de petites sociétés privées capables de transporter, par exemple, des hommes d’affaires.
J’en viens à la question des visas dans les îles Vanille. C’est la sécurité qu’il faut envisager d’abord. Cela fait, je formulerai deux séries de propositions. Premièrement, je crois que, sans aller jusqu’à supprimer l’obligation de visa, il faudra simplifier les conditions de circulation. Les visas de transit ont déjà été supprimés dans certains cas, ce qui permet de passer d’un pays à l’autre de la zone sans autre formalité. Un arrêté du 11 mars 2016 les a par exemple supprimés pour les Brésiliens qui passaient en Guyane pour aller en Martinique. On peut également imaginer de supprimer les visas pour de très courts séjours d’un ou deux jours.
Mais on peut également concevoir des visas de long séjour pour certains acteurs accrédités et identifiés : élus, diplomates, présidents d’assemblée locale, acteurs culturels se rendant à un festival, universitaires allant à un colloque, chefs d’entreprise allant à une réunion… Tous pourraient, sur une base régulière, se déplacer de manière impromptue. Je proposerai donc que les ministères des affaires étrangères des pays concernés établissent une liste de personnalités pour lesquelles la France s’engagerait à délivrer des visas d’une durée de deux ou trois ans.
Deuxièmement, il n’y a plus besoin de visa pour passer de l’île Maurice à La Réunion. Mais les Mauriciens qui se rendent à La Réunion doivent montrer qu’ils détiennent une certaine quantité d’espèces ou un moyen de paiement, tel qu’une carte de crédit. La problématique des « certificats d’hébergement » persiste également. Je connais ainsi l’exemple de deux sœurs habitant à l’île Maurice qui ont perdu une troisième sœur habitant à La Réunion. Pour assister à son enterrement, elles ont eu besoin de certificats d’hébergement à La Réunion, alors qu’il faut deux jours pour les établir et que la cérémonie ne peut être différée… Les conditions actuelles sont prohibitives et constituent en tout état de cause un frein à la circulation. Il ne me semble pas qu’elles méritent d’être conservées en l’état lorsqu’aucune menace particulière ne pèse sur la sécurité – trafic de drogue ou terrorisme – ou qu’un risque migratoire n’apparaît pas, sans aller jusqu’à permettre la circulation libre et totale de tout le monde. Cette révision pourrait porter sur la liaison entre les Seychelles et La Réunion, comme entre La Réunion et l’île Maurice. Pour ce qui est des Comores, c’est différent.
En Amérique du Sud, la révision faciliterait les échanges dans la zone du fleuve Maroni, qui délimite la frontière entre la Guyane française et le Suriname. Je proposerai la délivrance de visas transfrontaliers, car les habitants qui vivent le long du fleuve passent indifféremment de l’une à l’autre rive, pour bénéficier par exemple de l’offre de soins au gré de leurs besoins. Ces visas transfrontaliers permettraient aux habitants de circuler de chaque côté du fleuve.
Nous pourrions de même envisager des hôpitaux transfrontaliers au Suriname. Nous travaillons de même à Mayotte sur la question d’infrastructures transfrontalières. L’idée intéresse aussi l’ARS de la Guadeloupe, qui gère aussi Saint-Martin et Saint-Barthélemy, dans la zone caraïbe, où il s’agirait de regrouper en un seul deux projets de construction d’un hôpital.
Les entreprises qui disposent de la logistique, des ressources organisationnelles, juridiques ou humaines, n’ont pas besoin de nous pour s’internationaliser. Elles le faisaient avant nous et continueront après nous : elles savent s’adapter aux réglementations des divers pays pour y conquérir des parts de marché. Notre rôle est plutôt d’accompagner dans leur conquête de marchés extérieurs celles qui disposent d’un savoir-faire et de compétences, mais qui n’ont pas la pratique de l’export et ont des problèmes de débouchés ou de logistique. Une piste de réflexion s’ouvre à nous, avec l’harmonisation du cadre juridique : ne pourrait-on imaginer, sur le modèle de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) et de l’Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires dans la Caraïbe (OHADAC), une Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires dans l’océan Indien ? Cette harmonisation offrirait aux entreprises un cadre juridique autre que le cadre juridique international. En matière d’export et de compétitivité économique, il faut parfois qu’interviennent une autorité de régulation et des instances de jugement en cas de litige.
La question de l’harmonisation de la fiscalité des entreprises se pose également. Pour que nos entreprises soient compétitives, je proposerai la réciprocité de l’imposition sur les sociétés et une fiscalité adaptée pour les entreprises exportatrices. Il s’agit d’une demande des acteurs économiques.
Dans tous ces domaines – aérien, réglementation, normes, fiscalité –, il nous faut définir un modèle français et européen qui tienne compte de toutes ces problématiques et soit adapté à nos territoires. Nos collectivités vont désormais pouvoir signer des accords-cadres. Nous devons, de notre côté, commencer à réfléchir à des modèles qui leur permettraient de relever tous leurs défis : leur meilleure insertion et celle de la France dans leur espace géographique.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Merci, cher collègue, de nous avoir livré en primeur quelques-unes des propositions qui figureront dans votre rapport. Le moment est venu, en effet, d’avancer sur ces questions, qu’il est bon de remettre à l’ordre du jour. Certaines sont anciennes : je les ai abordées déjà lorsque je siégeais au Parlement européen. Il y a quelques années, ici même, j’ai rédigé, en collaboration avec M. Hervé Gaymard, un rapport d’information sur les accords de partenariat économique entre l’Union européenne et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.
Je ne suis pas étonné de la profondeur et de la justesse de vos analyses. Votre rapport pèsera lourd et ne laissera pas le Gouvernement indifférent.
M. Jean Jacques Vlody. La tâche est immense, en effet. J’ai parfois l’impression de m’être aventuré dans la forêt amazonienne : plus j’avance, plus la végétation s’épaissit. Mais nous ferons en sorte de ne pas nous enliser.
Je voudrais rappeler, pour finir, que l’Assemblée nationale est désormais membre de l’association des parlementaires des pays membres de la Commission de l’océan Indien, qui a été relancée les 4 et 5 mai derniers à l’île Maurice. Le bureau exécutif a été mis en place, présidé par Madagascar. La France, à travers ma personne, et les Comores en sont vice-présidents, l’île Maurice et les Seychelles rapporteurs.
D. ECHANGE AVEC M. CHRISTOPHE SIRUGUE, CHARGE D’UN RAPPORT SUR LA REFORME DES MINIMA SOCIAUX
(Séance du 8 mars 2016)
M. le président Jean-Claude Fruteau. L’essentiel de notre réunion consiste à auditionner notre collègue Christophe Sirugue, dans le cadre de sa mission sur la simplification des minima sociaux.
Auparavant, je voudrais dire un mot à propos de la Journée internationale de la femme.
Cette journée trouve son origine dans le combat de celles que l’on a appelées les « Suffragettes », au début du XXe siècle, pour obtenir de meilleures conditions de vie et de travail, et le droit de vote.
Depuis, il y a eu des progrès incontestables, notamment l’obtention du droit de vote, mais il reste beaucoup à faire pour que les femmes soient pleinement amenées à participer, sur un pied d’égalité avec les hommes, à toutes les composantes de notre société. Trop d’inégalités persistent, en particulier dans le monde du travail : précarité des contrats, sous-rémunération, ségrégation professionnelle, difficulté d’accès à des postes à responsabilités, pour ne citer que cela.
Mais surtout, il ne faut jamais oublier cette terrible statistique : une femme sur trois dans le monde est encore victime de violences physiques ou sexuelles. C’est notre devoir de refuser cette situation, que ce soit dans le monde ou sur nos territoires, et de continuer à nous mobiliser pour que tous ces comportements discriminatoires à l’égard des femmes disparaissent au plus tôt et que l’égalité hommes femmes soit réelle.
Cela étant dit, nous sommes heureux d’accueillir M. Christophe Sirugue, député de Saône-et-Loire, secrétaire de la Commission des affaires sociales, vice-président de la délégation de l’Assemblée nationale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, qui a été chargé par le Premier ministre d’une mission sur la simplification des minima sociaux.
Nous vous accueillons, cher collègue, de manière tout à fait informelle, dans le cadre de la délégation aux outre-mer, où nous essayons de réfléchir aux problèmes qui se posent aux collectivités des outre-mer. Ce n’est pas pour rien si l’on parle aujourd’hui « des » outre-mer. Si nous avons des points communs sur le plan économique et social, nous avons aussi des différences, qui ne rendent pas facile la réflexion globale sur l’ensemble des outre-mer français.
La mission de M. Christophe Sirugue porte sur l’ensemble du territoire national. Ses objectifs doivent obéir à plusieurs impératifs : assurer l’équité du régime des minima sociaux, le rendre moins complexe, et donc, plus accessible concrètement à ceux qui ont vocation à en bénéficier, et aussi en simplifier la gestion… on ne se trompe jamais quand on dit, en France, simplifier la gestion, c’est une nécessité permanente !
Comme il est de règle en pareil cas, j’imagine que la conduite de cette mission a amené notre collègue à procéder à un certain nombre d’auditions d’élus et de responsables administratifs. J’ai cru comprendre, également, qu’il avait tenu à rencontrer des personnes bénéficiant de minima sociaux. Mais, comme tout le monde le sait, la question des minima sociaux a des répercussions particulières dans les outre-mer, compte tenu de la situation économique et sociale de nos territoires. C’est pourquoi, à côté des entretiens et des consultations qu’il a menés par ailleurs avec des interlocuteurs hexagonaux ou ultramarins, M. Christophe Sirugue a souhaité ouvrir le dialogue avec les collègues de la délégation aux outre-mer, qui est l’expression institutionnelle de la représentation des outre-mer dans notre assemblée.
Je le remercie de sa disponibilité et je l’invite maintenant à nous présenter les grandes orientations de sa mission, les questions que celle-ci l’amène à se poser ou à nous poser, en relation avec la situation des outre-mer.
M. Christophe Sirugue. Monsieur le président, chers collègues, je suis accompagné de M. Sébastien Grobon, membre de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), qui travaille avec moi sur cette mission.
Le Premier ministre m’a confié une mission qui fait suite au dernier rapport d’évaluation du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, dont les conclusions indiquaient qu’il restait des progrès importants à faire, concernant les différents minima sociaux existant aujourd’hui dans notre pays.
À ce jour, nous avons neuf minima sociaux, qui sont le fruit de l’histoire. Certains datent de l’après-guerre, comme l’allocation veuvage, d’autres sont venus avec la crise, comme l’allocation de solidarité spécifique (ASS) pour les chômeurs de longue durée. Quant au revenu minimum d’insertion (RMI), remplacé depuis par le revenu de solidarité active (RSA), il a été instauré pour faire face à la crise sociale.
Les porteurs du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté ont constaté la complexité de ces dispositifs juxtaposés et leur iniquité selon le minima social dont on bénéficie. À situation de ressources comparable, les droits peuvent différer d’un minima social à l’autre. En outre, la complexité de l’accès aux droits est grande pour nombre de ces minima sociaux. C’est une difficulté, non seulement pour les allocataires, mais aussi pour celles et ceux qui en assurent la gestion ou le suivi – je pense, notamment, aux travailleurs sociaux.
Je dois rendre mes conclusions à la fin du mois de mars. Dans cette perspective, je m’interroge sur la particularité des outre-mer. J’ai souhaité être auditionné par votre Délégation pour vous demander ce que vous pensez des évolutions que je propose, dans la mesure où elles peuvent avoir des incidences extrêmement lourdes, notamment au regard du pourcentage d’allocataires sur vos territoires.
Pour atteindre les objectifs fixés par le Premier ministre, nous avons envisagé trois scénarios.
Le premier scénario est paramétrique. Il maintient les minima sociaux existants, mais il joue sur les différents paramètres pour essayer de contribuer à l’équité, à la simplicité et à l’accès aux droits.
Le premier paramètre que nous pourrions modifier est celui de l’âge. Certains dispositifs, en effet, sont ouverts à partir de dix-huit ans, d’autres à partir de vingt-cinq ans. D’autres encore, comme le minimum vieillesse, concernent les personnes âgées. Aujourd’hui, le RSA n’est accessible qu’à partir de vingt-cinq ans. La question se pose d’une harmonisation en termes d’âge.
Le deuxième paramètre pourrait être lié au niveau de ressources, qui diffère selon les minima sociaux. Dans certains cas, on prend en compte, ou non, les ressources des conjoints. Dans d’autres cas, on a, ou non, des forfaits indexés, comme le forfait logement. Ce paramètre pourrait également faire l’objet d’une harmonisation.
Le troisième paramètre pourrait être celui de la périodicité. Pour certains minima sociaux, qui donnent droit à des allocations, comme l’allocation logement, on se réfère aux ressources de l’année n–2, c’est-à-dire à une période très éloignée de celle où l’on fait la demande. Pour d’autres, on remonte aux trois derniers mois, s’agissant, notamment, du RSA et du principe de déclaration trimestrielle, laquelle peut être ensuite actualisée tous les mois.
Le deuxième scénario propose de créer trois minima sociaux en fusionnant les dispositifs existants.
Le premier serait l’actuelle allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), ex-minimum vieillesse, dont nous modifierions peu le périmètre.
Un deuxième bloc de minima sociaux regrouperait l’allocation adulte handicapé (AAH) et l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI).
Le troisième bloc regrouperait tous les autres minima sociaux, le RSA, l’ASS, le revenu de solidarité (RSO) etc. L’une des difficultés porte sur le regroupement du RSA et de l’ASS : faut-il le faire ? Si la mesure semble intellectuellement satisfaisante, puisque les situations des bénéficiaires – des personnes éloignées de l’emploi depuis longtemps, sont comparables, la difficulté vient de ce que l’ASS donne des droits à la retraite, et pas le RSA. En outre, les personnes qui perçoivent l’ASS considèrent qu’il ne s’agit pas d’un minima social comme les autres, mais qu’elles ont acquis des droits parce qu’elles ont travaillé et qu’elles ont perçu, dans un premier temps, des indemnités journalières, avant de bénéficier de l’ASS.
De notre côté, nous pensons qu’une personne qui a bénéficié de l’ASS pendant douze ans n’est plus dans une mécanique de retour à l’emploi, en tout cas pas davantage que quelqu’un qui perçoit le RSA. Il conviendrait donc de ne pas fusionner les deux dispositifs, mais de limiter l’ASS dans le temps, en prévoyant un accompagnement renforcé. Au bout de deux ans, par exemple, le bénéficiaire de l’ASS rebasculerait dans le cadre du RSA.
Le troisième scénario consiste à supprimer tous les minima sociaux existants pour n’en créer qu’un seul, soit une couverture socle universelle, ouverte à toutes les personnes en situation de précarité.
Ce socle serait assorti de deux compléments. Un complément de soutien serait dédié à ceux qui ne peuvent pas avoir une activité : les personnes de plus de soixante-cinq ans et les personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler. Un deuxième complément, d’insertion, viendrait accompagner les bénéficiaires de ce minima social. Il nous faudrait alors revoir nos politiques d’insertion. Je ferai d’ailleurs, dans le rapport, un développement assez long sur les politiques d’insertion.
Aujourd’hui, les départements ont fortement réduit les crédits alloués aux politiques d’insertion, à cause de la charge que constitue le RSA, mais aussi parce qu’ils ont perdu un peu de leur dynamique pour mettre en place ces politiques d’insertion.
Jusqu’en 2004, les départements consacraient environ 20 % de l’ensemble de l’allocation du RSA à des politiques d’insertion, contre 8,1 % aujourd’hui, selon les chiffres de l’Observatoire national de l’action sociale (ODAS). Ces politiques se limitent désormais à financer les dispositifs existants, quand ils ne sont pas revus à la baisse. L’ingénierie sociale, qui faisait la richesse des politiques d’insertion adaptées aux territoires, a en grande partie disparu.
Le Premier ministre m’a demandé de lui faire rapidement une proposition sur ce point, parce qu’il devait rencontrer les représentants de l’Assemblée des départements de France (ADF).
Nous allons proposer, dans le rapport, la recentralisation du RSA, c’est-à-dire le paiement de l’allocation à 100 % par l’État. Cette mesure nous semble indispensable, compte tenu des difficultés des départements à prendre en charge le versement du RSA. Si nous ne faisons rien, nous risquons de voir s’installer des disparités dans les politiques développées par les départements en direction du RSA, alors qu’il s’agit d’un dispositif universel, et donc, destiné à l’ensemble des bénéficiaires, quel que soit l’endroit où ils se trouvent.
Parallèlement à la recentralisation du RSA, nous préconisons l’obligation pour les départements de mener des politiques d’insertion à hauteur de 20 %, ce chiffre nous semblant constituer une base crédible. Il nous semble nécessaire de rappeler que les bénéficiaires des minima sociaux, notamment ceux qui sont en recherche d’activité, ont besoin de politiques d’insertion, quelles qu’elles soient, sociales ou professionnelles, et que ces politiques d’insertion nécessitent des moyens. Nous proposons donc que 100 % de ces politiques d’insertion soient prises en charge par les départements.
Le financement du RSA étant assuré à 100% par l’État et le financement des politiques d’insertion à 100 % par les départements, on arrive, en termes de montants, à une répartition 80/20, qui correspond à la répartition du RMI lorsqu’il a été mis en place, et qui nous semble être à la fois crédible et porteuse. L’Association des départements de France est plutôt en accord avec cette proposition, même si elle continue à négocier avec l’État l’année de référence pour la prise en charge à 100 %, l’État souhaitant que ce soit 2016, les départements 2014.
J’en viens à la spécificité des outre-mer.
Il y a d’abord l’ampleur que prennent certains minima sociaux sur vos territoires - je pense en particulier au RSA.
Autre particularité, le RSO, dispositif spécifique aux outre-mer.
Enfin, les territoires et les collectivités d’outre-mer ont-ils la capacité de consacrer aujourd’hui 20 % du RSA aux politiques d’insertion ? Y a-t-il des supports, en termes d’entreprises, d’ateliers, de chantiers d’insertion ? Compte tenu du nombre très élevé de bénéficiaires sur vos territoires, est-il possible de porter une telle ambition ?
Cela m’amène à vous faire part de ma réflexion de fond.
Les minima sociaux jouant sur vos territoires un rôle de régulateur social beaucoup plus important qu’en métropole, considérez-vous que la réforme qui m’a été demandée par le Premier ministre doit être universelle, et donc, concerner les territoires et départements d’outre-mer ? Ou bien, compte tenu de vos particularités, estimez-vous qu’elle ne peut ou ne doit pas être déclinée sur vos territoires ?
C’est une vraie question, car elle met en jeu une modification substantielle. Je serais enclin à considérer qu’il ne peut pas y avoir de distinction entre les outre-mer et la métropole. En même temps, j’ai rencontré certains de vos collègues qui ont appelé mon attention sur l’impact d’une telle réforme dans les outre-mer. J’attends donc, chers collègues, que vous m’éclairiez sur ce sujet.
Du RSO, on m’avait dit que c’était un dispositif qui allait en diminuant. Les chiffres montrent, au contraire, qu’il est reparti à la hausse.
Le RSO est, en gros, un dispositif qui ne dit pas son nom. C’est en réalité un dispositif d’accompagnement à la retraite pour des gens dont on sait qu’ils ne pourront pas retrouver une activité. Peut-il être regroupé avec d’autres dispositifs ou doit-il être maintenu tel quel, du fait de la particularité de l’enjeu ?
Il y a une vraie spécificité des outre-mer. Je voudrais l’aborder avec toute la rigueur nécessaire, d’où cette rencontre qui est extrêmement importante pour m’éclairer sur cette question.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Comme je l’ai dit dans mon propos liminaire, les situations sont différentes d’un département à l’autre ou d’un territoire d’outre-mer à l’autre. On ne peut pas, par exemple, préconiser pour Mayotte les mêmes solutions que pour La Réunion ; la distance n’est pas que géographique. Notre collègue Boinali Said en parlera sans doute.
Nous nous sommes toujours battus, avec nombre de mes collègues, pour que les outre-mer ne fassent pas l’objet d’un traitement particulier. Cela ne veut pas dire que nous sommes tout à fait semblables. Chacun a sa personnalité, et les histoires, les cultures, les coutumes, les climats sont différents. C’est pour cette raison que l’on parle aujourd’hui « des » outre-mer. Pour autant, il faut rappeler que le traitement spécifique des règles applicables dans le domaine social a souvent été interprété comme un traitement minimum par rapport à ce qui se faisait ailleurs. Je le dis sans acrimonie, mais cela s’est souvent passé ainsi. Il faut absolument éviter cela.
La refonte complète du système est un projet ambitieux et très séduisant, mais assurément, une telle réforme ne produirait pas les mêmes effets à Mayotte et à La Réunion.
J’ai toujours la même crainte, qui me vient des combats que j’ai menés dans le passé. Le RMI, instauré par un gouvernement socialiste, donc plus enclin à la préoccupation sociale, n’était pas en métropole le même que dans les départements d’outre-mer. C’était, au départ, une bonne idée, qui a donné lieu à une injustice. L’injustice sociale ne doit pas être acceptée. Il existe des moyens pour pallier les inconvénients engendrés par les différences qui existent entre les territoires. Les populations d’outre-mer ne supportent plus que l’on parte de ces différences pour faire moins que ce qui existe en métropole.
Pour ces raisons, je serais tenté de dire qu’il faut intégrer les outre-mer dans la réforme « normale », faite pour l’ensemble de la nation, tout en veillant à la prise en compte de leurs spécificités.
M. Boinali Said. À Mayotte, 60 à 65 % de la population a moins de vingt-cinq ans. Le taux de chômage y est très élevé par rapport aux autres outre-mer. La question de l’insertion par l’activité économique se pose donc d’emblée.
Par ailleurs, les collectivités locales, à Mayotte, ont de grandes difficultés en termes de ressources. Elles sont quasiment dans l’incapacité d’assumer l’ensemble des prestations qui relèvent de leurs compétences. La prise en charge par l’État d’un certain nombre de prestations qui étaient offertes par le département est, à mes yeux, une question importante.
Mais, le président Fruteau l’a dit, il y a une disparité en termes de niveau de prestations telles qu’elles sont distribuées. Il est donc nécessaire d’envisager une convergence des niveaux de prestations, le coût de la vie à Mayotte étant très élevé, du fait de l’éloignement et de l’« économie » de l’importation.
En ce qui concerne le niveau de ressources des familles, le calcul est biaisé. Ce sont les hommes qui, le plus souvent, disposent de ressources, les femmes s’occupant, selon la coutume, du foyer et des enfants.
Telle est la situation pour des territoires éloignés, qui connaissent de grandes difficultés et qui nécessitent, peut-être plus que d’autres, une plus grande prise en charge.
En ce qui concerne la vieillesse, les gens n’ont souvent pas assez travaillé pour bénéficier d’une pension de retraite. Les pensions ayant été calculées à partir de modèles locaux avant de rentrer dans le droit commun, beaucoup de personnes âgées ont une pension de 150, voire 70 euros, alors que le coût de la vie est extrêmement élevé. L’harmonisation est donc nécessaire en la matière.
Vous avez parlé d’un troisième scénario et d’une couverture socle, avec des déclinaisons pour la vieillesse, le handicap et l’insertion. Il conviendrait peut-être de se diriger vers ce type de réforme pour embrasser l’ensemble des difficultés.
Mme Brigitte Allain. Je suis membre de la Délégation aux outre-mer, mais je n’habite pas dans ces départements. C’est donc un regard extérieur que j’apporterai.
J’ai eu un aperçu de la vie dans les départements d’outre-mer à travers la mission d’information que j’ai conduite sur les circuits courts et la relocalisation des filières agricoles et alimentaires. À cette occasion, j’ai passé quelques jours à Mayotte et à La Réunion.
J’ajouterai aux spécificités de Mayotte qui ont été évoquées le fait que cette île accueille un grand nombre de personnes en provenance des autres îles des Comores. C’est une réalité qui pèse fortement sur le département, dont la population est essentiellement composée de jeunes. En ce qui concerne l’insertion par l’activité économique, les filières alimentaires peuvent être un support. Mais cela suppose, au-delà des moyens financiers, un accompagnement de la part de l’État.
J’ai eu la satisfaction de constater, tant à Mayotte qu’à La Réunion, que les services de l’État, notamment ceux compétents pour l’agriculture et de l’alimentation, sont très présents et font encore le travail qui se faisait il y a vingt ans en métropole. L’administration a un vrai rôle d’accompagnement en matière de développement, en lien avec des associations et la chambre de commerce.
Cela étant, j’ai eu l’impression que Mayotte était abandonnée par les pouvoirs publics. Il conviendrait d’interpeller le Gouvernement sur ce sujet. On parle des migrants à Calais. Je ne sais pas si les Mahorais considèrent comme des migrants les Comoriens qui arrivent à Mayotte, Mayotte étant elle-même une île des Comores, mais cela crée une situation très difficile.
J’ai eu l’occasion d’aller, à titre privé, en Guadeloupe, où j’ai pu constater que beaucoup de personnes étaient dans une situation difficile, du fait du manque d’emploi et du manque d’accompagnement du développement. Trop de produits sont importés, au détriment d’un développement endogène, qui est possible en Guadeloupe, à La Réunion et partout dans les outre-mer. Si certains départements ne peuvent pas consacrer 20 % du montant du RSA aux politiques d’insertion, il faudra leur accorder une aide supplémentaire.
S’agissant de Mayotte, je le répète, j’ai vraiment eu l’impression qu’on l’abandonnait. Outre le problème des personnes qui arrivent des îles voisines, j’ai constaté qu’il était également difficile de développer l’agriculture, car on ne sait pas toujours à qui appartiennent les terres.
M. le président Jean-Claude Fruteau. La Délégation aux outre-mer est composée de députés qui représentent les départements et territoires d’outre-mer et de députés qui représentent des circonscriptions métropolitaines. Vous avez donc, madame Allain, toute légitimité à vous exprimer ici. La présence de députés métropolitains garantit que les membres ultramarins ne passent pas leur temps à se regarder entre eux. N’hésitez pas à nous faire part de vos impressions, que vous soyez allée sur place à titre privé ou en tant que membre d’une mission d’information.
M. Christophe Sirugue. Une des particularités des outre-mer, qui est forte à Mayotte, sans lui être spécifique, est la jeunesse de la population. Si nous devions étendre à tous, aujourd’hui, le bénéfice du RSA ou de la couverture socle, il faudrait faire fi de la barrière d’âge. J’ai, en effet, du mal à expliquer pourquoi on aide quelqu’un qui a vingt-cinq ans, mais pas quelqu’un qui en a vingt-quatre. Sauf que le nombre de jeunes sur vos territoires a un impact financier qui n’est pas neutre, et que, par ailleurs, nous souhaiterions introduire dans le troisième scénario, et probablement dans le premier scénario, l’idée du droit opposable à l’insertion.
On veut, aujourd’hui, porter la notion des droits et des devoirs, qui me paraît importante en termes de reconnaissance des personnes. En échange d’un devoir, comme celui d’avoir un contrat, par exemple, il y aurait un droit opposable à l’insertion, c’est-à-dire que toute personne pourrait exiger de son conseil départemental la mise en place d’une politique d’insertion.
Compte tenu du nombre de jeunes qui vivent dans les territoires et départements d’outre-mer, si nous ouvrons à tous, à partir de dix-huit ans, sans faire de distinction entre la métropole et les outre-mer, un droit opposable à l’insertion, dois-je m’attendre à ce qu’il y ait, dans les outre-mer, des difficultés pour proposer des politiques d’insertion, passant notamment par l’activité économique ? Ou bien peut-on, comme ailleurs, en y mettant les moyens, développer de telles politiques ?
Je ne connais pas suffisamment le support économique et commercial de vos territoires pour avoir la réponse. J’ai déjà interrogé la FEDOM, mais je serais heureux d’obtenir de la délégation des informations complémentaires.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Quelle a été la réponse de la FEDOM ?
M. Christophe Sirugue. En gros, la couverture par les entreprises est différente selon les territoires, avec une partie qui peut s’apparenter à une forme d’industrie, et une partie qui s’apparente davantage à de l’artisanat. Il est donc plus difficile d’offrir des structures d’insertion dans certains territoires d’outre-mer qu’en métropole, par exemple. Par ailleurs, la difficulté des déplacements fait qu’un jeune vivant dans les outre-mer a peut-être plus de difficultés à être mobile qu’un jeune vivant en métropole, qui peut facilement aller de Nantes à Montpellier si ce parcours d’insertion lui est suggéré.
Du coup, je suis perplexe. Je suis partisan d’un droit qui s’applique à l’ensemble des territoires de notre nation, mais en même temps, je me demande si je dois distinguer les particularismes.
Il ne faudrait pas qu’un nombre important de jeunes se tournent ensuite vers les collectivités d’outre-mer en arguant de leur droit opposable pour exiger un parcours d’insertion et ces collectivités n’aient pas les structures pour répondre à leur demande. Ce qui vient d’être dit sur Mayotte qui m’interpelle.
M. Boinali Said. Nos modèles de développement se sont immédiatement centrés sur les zones urbaines, au détriment du monde rural où il n’existe pratiquement pas d’entreprises. Notre seule chance serait de jouer sur la mobilité et que les jeunes disposent d’un espace plus large, l’espace national, qui servirait d’appui aux dispositifs d’insertion. Car si l’on s’en tient à notre modèle de développement, 60 % des territoires n’ont pas de tissu économique, qu’il s’agisse d’entreprises ou d’artisanat. Les collectivités peineraient donc à établir des liens entre les entreprises et les jeunes pour accompagner leur insertion.
Cela étant, dès lors qu’il s’agit d’un droit, qui plus est, opposable, il faut l’étendre. L’extension permettra au moins de mobiliser les collectivités locales dans cette dynamique. Un pan entier de la population vit dans l’économie informelle, ce qui absorbe tous nos efforts en matière de développement. Il faut extraire une bonne partie de la jeunesse de ce monde de l’informel pour construire une économie. À Mayotte, tout est à construire ; c’est la différence par rapport aux autres départements d’outre-mer.
Je pense qu’il faut jouer sur la mobilité et les coopérations avec les autres territoires, et prévoir des modèles de développement.
M. le président Jean-Claude Fruteau. La question que vous posez, monsieur Sirugue, sur le droit opposable, est globale. Elle ne peut être divisée. Peut-on proposer un droit opposable à l’insertion en métropole, qui ne soit pas opposable dans les outre-mer ? Je serais le premier à le dénoncer. Ce serait bafouer un principe essentiel, à savoir le droit de tout citoyen à accéder à ce que propose son pays. Soit on propose le droit opposable à l’insertion pour tout le monde, soit on ne le propose pas.
M. Christophe Sirugue. C’est toute la question.
M. le président Jean-Claude Fruteau. C’est aussi très difficile pour nous d’y répondre. C’est une question à laquelle il nous faudra réfléchir. Des questions essentielles ont été posées, dont les conséquences ne concernent pas seulement les outre-mer, et nous sommes loin d’avoir toutes les réponses.
Nous avons reçu récemment le Premier président de la Cour des comptes et ses collaborateurs, qui avaient mené une réflexion sur Mayotte. Leur constat, au premier abord, pouvait paraître extrêmement sévère, mais M. Ibrahim Aboubacar lui-même, dans un écrit que j’ai lu il y a peu, a évoqué un constat certes sévère, mais lucide. Un certain nombre de questions, parfois brutales, ont été posées par la Cour des comptes. L’État ne peut pas fuir ses responsabilités.
Aujourd’hui, pour en avoir discuté plusieurs fois avec Mme la ministre des outre-mer – c’était vrai également du temps de M. Victorin Lurel –, je peux dire que cette question importante soulève bien des interrogations au niveau du Gouvernement. Mais les solutions ne sont pas simples.
Un processus a été mis en œuvre, dont on peut dire qu’il a été trop rapide ou qu’il n’a pas été engagé assez tôt, mais la situation est aujourd’hui extrêmement difficile et elle ne s’améliore pas. Boinali Said sera sans doute de mon avis sur ce point. On attend tout de cette départementalisation que les élus de Mayotte ont voulu. Pourtant, les effets ne sont pas là.
M. Boinali Said. Nous sommes confrontés à l’incapacité du territoire à contrôler ses frontières et à l’arrivée d’une jeunesse qui n’a pas forcément grandi à Mayotte, ce qui accroît les difficultés d’insertion et d’intégration de la jeunesse et de l’ensemble de la population dans le processus de départementalisation, c’est-à-dire le droit commun.
M. Ibrahim Aboubacar. Je commencerai par évoquer les autres collectivités d’outre-mer, notamment celles qui ne sont pas représentées ici, avant de revenir au cas de Mayotte.
Je suis rapporteur pour avis de la Commission des lois, pour la mission budgétaire concernant les collectivités d’outre-mer. Même si la notion de minima sociaux concerne, à proprement parler, les collectivités de l’article 73, il faudrait, à l’heure où nous parlons d’égalité réelle dans toutes les collectivités d’outre-mer, évoquer ce qui se passe dans les autres collectivités. Saint-Martin, qui a repris un certain nombre de compétences en la matière, s’est engagée dans un processus d’adaptation des minima sociaux et du droit social, compte tenu de sa situation, son territoire étant composé d’une partie hollandaise et d’une partie française.
En Polynésie française, les dispositifs de solidarité sont extrêmement limités. Le seul dispositif qui existe fait l’objet, en ce moment, d’un accompagnement de l’État pour pallier des difficultés financières.
Nombre de minima sociaux n’existent pas à Mayotte. Lors de la départementalisation, un dispositif d’extension, prévu dans le Pacte pour la départementalisation, a été mis en place, visant à créer de nouveaux minima sociaux sur une période de vingt à vingt-cinq ans. Le président Hollande, arrivé au pouvoir, a indiqué sa volonté de diviser cette période de moitié, c’est-à-dire de la porter à dix ou quinze ans.
Le plan « Mayotte 2025 » a évoqué le sujet. Un certain nombre de dispositions sont en attente. Il y a, d’une part, cette simplification, d’autre part, l’institution de minima qui n’existaient pas. Il faudra donc réfléchir à la façon d’aborder concrètement la question de ces minima dans une logique de simplification. Le meilleur exemple que je puisse donner est celui de la prime d’activité, qui remplace la prime pour l’emploi et le RSA, la prime pour l’emploi existant depuis plusieurs années à Mayotte, alors que le RSA n’existe que depuis peu.
Je voulais simplement souligner que, pour notre département, l’exercice est double lorsqu’il s’agit de modifier, simplifier ou adapter des dispositifs qui, soit n’existent pas encore, soit sont mis en œuvre progressivement.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Monsieur Sirugue, je vous remercie d’avoir souhaité rencontrer la Délégation aux outre-mer pour avoir son avis sur ces questions. Je remercie également nos collègues pour leur participation à cette audition.
III. LES AUDITIONS DE RESPONSABLES D’INSTITUTIONS ET D’ORGANISMES INTERVENANT DANS LES OUTRE-MER
A. AUDITION DE M. FABRICE RICHY, DIRECTEUR DU DEPARTEMENT OUTRE-MER DE L’AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT, SUR L’ACTION DE L’AGENCE DANS LES OUTRE-MER
(Séance du 5 mai 2015)
M. le président Jean-Claude Fruteau. Mes chers collègues, nous avons le plaisir d’accueillir aujourd’hui M. Fabrice Richy, directeur du département Outre-mer de l’Agence française de développement (AFD).
C’est très volontiers que j’ai donné une suite favorable à la demande de l’Agence, qui souhaitait présenter à la Délégation son action spécifique en outre-mer, à la suite de la récente publication de ses principaux chiffres d’activité pour 2014. Cette démarche est une nouvelle preuve du rôle que remplit désormais notre Délégation dans les relations d’information et d’échange entre les parlementaires et les institutions.
L’AFD d’aujourd’hui revendique l’héritage de la Caisse centrale de la France d’outre-mer créée par Pierre Mendès-France en 1944. Si ses missions et dénominations ont évolué au rythme des évènements qui ont marqué l’histoire nationale depuis soixante-dix ans, l’AFD conserve et développe une action significative en faveur de l’outre-mer. C’est cette action que j’ai convié M. Richy à exposer aujourd’hui à la Délégation.
Je ne doute pas que son exposé ne l’amène à nous présenter un certain nombre de chiffres. Pour ma part, j’évoquerai d’abord une donnée globale : les financements de l’AFD à destination de l’outre-mer ont représenté en 2014 un peu plus de 1,5 milliard d’euros, soit à peu près un cinquième de l’ensemble des concours financiers accordés par l’Agence.
En consultant le rapport consacré par l’Agence à son activité outre-mer pour 2014, j’ai noté aussi que son principal domaine d’intervention avait été ce qu’elle appelle « aménagement urbain et équipement ». Quant aux bénéficiaires, ils se répartissent dans une proportion de 60 %/40% à peu près, entre le secteur public largement entendu et le secteur privé.
On souligne, dans ce contexte, la forte augmentation des concours financiers de l’Agence aux « acteurs publics locaux » entre 2013 et 2014, conséquence – selon le rapport – du désengagement du secteur bancaire privé.
Si l’on ne peut que se féliciter de voir ainsi assurée la pérennité des efforts de développement engagés par les différentes collectivités publiques de l’outre-mer, on doit dès lors se poser la question de l’évolution à plus long terme de leur financement.
Aussi bien, monsieur Richy serions-nous heureux, non seulement d’entendre vos commentaires sur le bilan de l’action passée de l’Agence outre-mer, mais aussi de connaître votre stratégie pour l’avenir.
M. Fabrice Richy, directeur du département Outre-mer de l’Agence française de développement (AFD). Monsieur le président, mesdames et messieurs, je tiens tout d’abord à vous remercier de nous avoir invités à cette séance de travail, qui nous donne l’occasion de vous présenter l’activité de l’AFD en outre-mer.
Comme vous l’avez dit, monsieur le président, une grande part de l’activité de l’Agence est orientée vers les politiques publiques. Pour nous, il est très précieux d’entretenir une relation de dialogue, de contact et d’entretien régulier avec les représentants de la Nation, avec le Parlement. En effet, c’est là que se définissent en grande partie les politiques publiques que nous accompagnons par nos financements.
Comme vous l’avez rappelé, l’AFD est un acteur ancien dans les outre-mer. Créée en 1941, devenue en 1944 la Caisse centrale de la France d’outre-mer, elle a connu des évolutions importantes au cours de son histoire. Elle fut un acteur majeur du développement des outre-mer, notamment dans les années cinquante : création de Sociétés d'aménagement et de banques de place – les outre-mer n’ayant pas de banques de place, nous avons joué ce rôle pendant trente ans environ, jusqu’à la cession des participations bancaires en 2005 ; création, à partir des années soixante, de sociétés de logement social. Par ces créations, et bien sûr par ses financements, l’AFD a fortement contribué à l’aménagement et à l’habitat dans les outre-mer. De fait, c’est pour nous une activité extrêmement importante.
En outre, l’AFD intervient à la fois dans les outre-mer et dans les États étrangers. Or les actions engagées, les projets lancés et les politiques menées dans les outre-mer ont souvent inspiré l’AFD dans ses politiques, ses projets et ses investissements dans les États étrangers. Les outre-mer sont ainsi une source précieuse de renouvellement pour l’Agence.
Je vous présenterai d’abord notre cadre stratégique et nos orientations pour les années à venir, pour revenir ensuite sur le bilan de notre activité.
En 2014, l’AFD s’est dotée d’un cadre d’intervention régional pour les outre-mer, qui a été présenté au Conseil d’administration de l’AFD et au Comité outre-mer en mai 2014. Ce cadre d’intervention régional, qui est notre cadre stratégique pour les quatre années à venir, a défini quatre priorités : soutenir les politiques publiques, notamment en faveur de la cohésion sociale et de l’environnement ; renforcer le secteur privé pour créer localement de l’emploi et de la valeur ajoutée ; améliorer l’habitat et l’aménagement urbain ; encourager l’intégration régionale. Vous y retrouverez des thématiques qui vous préoccupent fortement en tant qu’élus et représentants des différents territoires.
Première priorité : soutenir les politiques publiques, notamment en faveur de la cohésion sociale et de l’environnement.
Comme vous l’avez dit, monsieur le président, le secteur public constitue l’essentiel de notre activité en outre-mer. Sur le milliard et demi d’euros de financement accordé par l’AFD en 2014, près de 900 millions concernent le secteur public dans sa globalité.
Le secteur public dans sa globalité constitue donc un point d’appui extrêmement fort de l’action de l’AFD dans les outre-mer. Ces 900 millions se décomposent ainsi : 300 millions environ pour les collectivités locales ; 600 millions pour le « parapublic » – établissements publics, locaux, régionaux et nationaux, sociétés d’économie mixte et établissements hospitaliers.
Les 300 millions pour les collectivités locales sont principalement destinés aux communes, aux départements et aux régions ; les trois quarts des communes des outre-mer empruntent auprès de l’AFD. Nous sommes donc un acteur extrêmement important. A titre d’exemple, à La Réunion, toutes les communes ont souscrit un emprunt auprès de l’AFD.
Dans les outre-mer, l’AFD est la spécialiste des collectivités locales. Nous menons des travaux d’évaluation des finances communales, des actions de formation et d’appui des collectivités locales. Dans certains territoires, nous menons une action très spécifique de restructuration des finances locales, notamment communales. Un accent particulier est mis sur les communes de moins de 10 000 habitants : en 2014, 31 de ces communes ont reçu l’appui financier de l’AFD.
Je dois dire – mais vous pourrez me le confirmer – que nous sommes souvent considérés par les mairies comme un appui très important pour la conduite de leur politique financière. Mais il ne s’agit pas de leur « donner des leçons ». Nous travaillons vraiment en collaboration, en analysant leur documentation avec eux et en les conseillant sur des orientations stratégiques financières vertueuses.
Cela nous amène à travailler constamment à l’adaptation de nos produits.
Classiquement, nous prêtions aux collectivités locales et aux établissements publics pour financer des projets. Depuis pratiquement sept ou huit ans, nous avons fait évoluer nos interventions –anciennement basées sur des financements de projets- vers des prêts budgétaires, en basant notre approche sur la solidité, la fiabilité et la soutenabilité des finances de chaque collectivité. Dès que nous sommes assurés de cette soutenabilité, nous pouvons intervenir pour financer globalement un programme d'investissement, et non plus projet par projet. Ces prêts sont des instruments relativement souples, appréciés des collectivités locales. A partir de là, l’AFD a commencé à s’intéresser aux communes dans les États étrangers.
Il est un autre domaine sur lequel nous faisons des efforts constants d’adaptation : l’amélioration de nos produits financiers.
Depuis dix ans, nous assurions le préfinancement des projets bénéficiaires de subventions européennes – car beaucoup d’investissements réalisés par les collectivités locales le sont sur fonds FEDER. Depuis un an, la possibilité de préfinancement a été, en outre, étendue aux subventions de l’État aux collectivités locales et établissements publics. Les concours ainsi apportés ont maintenant atteint un volume financier relativement important.
Ce sont, là encore, des outils particulièrement appréciés. En effet, les communes ne touchent les fonds européens ou les subventions d’Etat qu’une fois le projet réalisé ou en tout cas bien engagé, ce qui leur pose un problème évident de trésorerie. Le préfinancement par l’AFD permet d’engager le projet, et d’attendre que celui-ci soit achevé pour nous rembourser. En 2014, cette activité a représenté pratiquement 80 millions, contre 25 ou 30 millions en 2013 ; nous avons accordé au cours de la seule année 2014 autant de préfinancements que pendant toute la décennie précédente. La demande est croissante : en 2015, nous ferons encore davantage, surtout après l’extension du préfinancement aux subventions de l’État français.
Nous sommes très à l’écoute des problématiques formulées par les collectivités locales et faisons évoluer nos produits en fonction de celles-ci : c’est pour répondre aux demandes des collectivités que nous sommes passés du financement projet au financement budgétaire, et que nous avons mis en place le préfinancement des subventions européennes, puis des subventions d’État.
Nous menons aussi une action transversale sur les politiques publiques dans un certain nombre de territoires, départements ou régions d’outre-mer, notamment sur les politiques environnementales régionales. A titre d’exemple, nous appuyons le financement du schéma de transport de la Polynésie française.
Par ailleurs, nous avons lancé, avec un certain nombre de partenaires, une étude sur les politiques en faveur des personnes âgées. En effet, depuis deux ans, nous avions reçu de nombreuses demandes de financement pour des EHPAD et nous voulions un peu mieux connaître ce secteur.
Nous sommes en train de mettre au point avec deux régions, la Réunion et la Guadeloupe, un système de prêts bonifiés au travers du FEDER. Pour la région Réunion, ces prêts seraient destinés à la réhabilitation du logement social, et devraient permettre aux organismes de logement social d’accéder à des lignes de refinancement intéressantes : ce type de prêts n’est pas facile à mettre en place et nous n’en sommes qu’au stade expérimental, mais il y a un partenariat. De la même façon, nous travaillons avec la région Guadeloupe sur la mise en place d’un financement bonifié d’actions environnementales et climatiques. Ces chantiers, que nous avons lancés cette année, avancent et nous espérons obtenir des résultats en 2016 ou en 2017.
Nous menons également, en direction des collectivités, une activité de formation relativement importante, au travers du Centre d’études financières, économiques et bancaires (CEFEB), l’université d’entreprise de l’AFD, dont le siège est à Marseille. Nos interventions prennent la forme de stages, de séminaires à l’intention des directeurs financiers et des directeurs généraux des communes, notamment sur les sujets financiers. Et nous sommes en passe de signer un accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), pour créer des synergies dans les accompagnements des collectivités locales. Très souvent, l’une des faiblesses des actions de ces collectivités tient au niveau insuffisant de formation des cadres administratifs, qui obère la capacité des élus à agir pour structurer les finances locales.
J’en viens à notre deuxième priorité : renforcer le secteur privé pour créer de l’emploi et de la valeur ajoutée. Dans les outre-mer, les enjeux en termes d’emploi sont majeurs : le taux de chômage y est élevé, et particulièrement le chômage des jeunes (60 % à La Réunion). Cette situation a de lourdes conséquences – aggravation de la précarité, menace pour la cohésion sociale – que vous avez à gérer tous les jours.
En premier lieu, nous intervenons en tant que prestataire pour le compte de Bpifrance Financement. En 2014, nous sommes intervenus pour un peu plus de 500 millions d’euros en faveur de quelque 2 000 entreprises, généralement de taille moyenne, à travers des crédits de trésorerie à court terme et de crédits à plus long terme, tels que les crédits de développement.
En deuxième lieu, nous menons une action sur les garanties. Dans les départements d’outre-mer, nous avons transféré en 2014 à Bpifrance l’activité de fonds de garantie, couverte désormais par les fonds nationaux de garantie. Dans le Pacifique, nous avons conservé un instrument de garantie, la SOGEFOM (Société de gestion de fonds de garantie de l’Outre-mer). Depuis sept ans, la SOGEFOM a accordé en moyenne chaque année environ 20 millions d’euros de garanties, en général à de petites, voire de très petites entreprises. En 2014, rien qu’en Nouvelle-Calédonie, une centaine d’emplois ont été ainsi créés – sans compter ceux qui ont été préservés. La garantie SOGEFOM est une garantie bancaire, que nous accordons sur demande de la banque, et en second rang derrière celle-ci. La quotité garantie varie entre 50 et 60 %, la banque assurant le reste : c’est un risque partagé entre la banque et nous.
En troisième lieu, nous menons une action en faveur du micro-crédit.
Nous sommes un financeur ancien et fidèle de l’Adie (Association pour le droit à l’initiative économique), que ce soit dans les outre-mer ou dans les États étrangers. Nous avons financé plusieurs prêts – dont le dernier en 2014, de 4 millions d’euros. En outre, sur sa proposition, nous avons mis au point un nouveau produit, un prêt d’un montant plus important que les prêts traditionnels qu’elle propose et qui devrait permettre à des entreprises de grandir, une fois passé le cap d’un ou deux salariés : le prêt Propulse. Nous entretenons des relations avec d’autres institutions de microfinance, comme France Active et Initiative France.
Nous avons suivi avec beaucoup d’intérêt l’audit sur la microfinance du Conseil économique, social et environnemental, dont nous avons reçu la rapporteure, Mme Crozemarie. Nous sommes en train de monter un séminaire sur la microfinance, qui pourrait se tenir cette année à Mayotte et permettrait un partage d’expérience entre les différents acteurs : l’Adie, France Initiative, mais aussi les acteurs publics. Nous espérons aboutir prochainement.
Il reste que le modèle économique de la plupart des institutions de micro-finance repose sur des subventions d’équilibre, besoin auquel nous ne pouvons répondre, dans la mesure où il n’existe pas de subventions destinées à de tels besoins dans les outre-mer. Dans les États étrangers en revanche, de nombreux organismes de microfinance, montés parfois à l’initiative de l’AFD, l’ont été sur subventions grâce au programme 209 du ministère des affaires étrangères – programme de subventions et d’aide au développement.
Concrètement, l’absence de système de subventions limite notre possibilité de soutenir, à moyen ou long terme, les acteurs de terrain du microcrédit en outre-mer. Traditionnellement, en effet, pour monter une organisation de microfinance, on travaille dans un premier temps selon le régime des subventions ; une fois que l’organisation est arrivée à un premier niveau de maturité, elle peut emprunter. C’est ainsi que nous avons soutenu financièrement pendant des années, par des subventions, l’action de l’Adie dans les États étrangers, pour qu’elle se constitue, jusqu’à ce qu’elle puisse nous emprunter.
En dernier lieu, nous intervenons directement auprès des entreprises privées.
Environ 100 millions de financements ont été accordés en 2014 à ce titre. Nous instruisons une dizaine de dossiers par an, systématiquement en cofinancement avec les banques, que nous contribuons ainsi à accompagner dans leur soutien à l’économie locale. En dépit d’un nombre de dossiers qui peut paraître peu élevé (mais qui dépend en définitive du dynamisme des économies et de ce que les banques commerciales souhaitent partager avec nous), ces financements représentent des montants unitaires élevés (10 à 20 millions d’euros), et généralement sur des tailles de projets plus conséquentes que les dossiers traités par Bpifrance Financements. Bpifrance, jusqu’à 3 millions d’euros, suit une procédure déconcentrée dans laquelle les directeurs régionaux ont le pouvoir de décision.
Notre rôle est double. Nous pouvons sécuriser un tour de table financier auprès d’une ou plusieurs banques de la place qui n’ont sur les projets qu’un regard financier et ont besoin de la capacité d’analyse de ces projets d’un partenaire comme l’AFD. Mais nous pouvons aussi prendre l’initiative en nous adressant au secteur bancaire de place pour accompagner un projet sur le moyen terme.
Notre avantage comparatif est double : nos équipes d’ingénieurs nous donnent une capacité d’analyse technique bien plus forte que celle des banques classiques. En outre, nos financements sont à plus long terme que ceux des banques puisque nous pouvons aller facilement jusqu’à quinze ans alors que les banques sont hésitantes et vont rarement au-delà de dix ans. Cela nous permet d’entraîner les banques privées de la place sur des projets où elles ne seraient sans doute pas allées, ou sur lesquels nous allons les chercher.
Nous avons un secteur de prédilection, sur lequel nous avons beaucoup travaillé ces dernières années et dont l’outre-mer peut être fier : les énergies renouvelables, secteur extrêmement dynamique et innovant, avec de belles sociétés dont les capacités de recherche méritent d’être valorisées. Ainsi avons-nous accompagné une dizaine de projets dans ce secteur, que ce soit en photovoltaïque, en biomasse, en éolien, et sans doute prochainement en énergie des mers, etc.
Au total, depuis quatre ans, les dix projets que nous avons contribué à financer dans ce domaine représentent pour nous seuls pratiquement 100 millions d’euros d’investissement – le total de l’investissement étant de plus de 200 millions d’euros. Ils portent sur la construction de serres agricole avec couverture photovoltaïque et stockage de l’énergie, d’ombrières photovoltaïques pour le maraîchage, d’une génératrice alimentée par la bagasse etc. Bref, une pluralité de projets avec une pluralité de sources énergétiques. Il y a là une opportunité, pour les outre-mer, de se mettre en avant, en cette année où se tient la COP 21.
En ce domaine, le savoir-faire des territoires insulaires des outre-mer français est tout à fait intéressant. Vous connaissez par ailleurs la problématique des États insulaires dans le monde. Les outre-mer pourraient sans doute envisager une collaboration avec les États insulaires en général : dans la zone caraïbe, dans l’Océan indien, dans les îles du Pacifique, des partages d’expériences pourraient être très profitables.
J’en viens au troisième point de mon exposé : l’aménagement et l’habitat.
C’est un domaine extrêmement important. Nous intervenons à la fois dans le secteur public, notamment avec les SEM d’aménagement et d’habitat, et dans le secteur privé, sur des opérations de promotion privée.
Il s’agit pour nous d’accompagner les mutations démographiques très complexes de certains territoires – notamment en Guyane et à Mayotte. Par exemple, nous sommes intervenus en 2014 au soutien de la Société immobilière de Mayotte, la SIM. Nous sommes également intervenus sur plusieurs opérations d’aménagement, privées ou publiques. Nous finançons la ZAC de Pierrefonds Aérodrome à la Réunion, que j’ai visitée il y a une quinzaine de jours ; c’est un très beau projet, avec une belle maîtrise d’ouvrage.
Toujours à La Réunion, pour nous adapter à la demande, nous avons mis au point un prêt « sculpté », comprenant à la fois un prêt de trésorerie, un prêt de portage sur l’aménagement, et un prêt à long terme sur le financement des équipements structurés.
Nous continuons par ailleurs à jouer un rôle d’animateur au sein d’un pôle technique du logement social. Nous réunissons régulièrement les directeurs de sociétés de logement social et nous assurons des missions d’audit et d’appui technique. Je précise toutefois que l’AFD n’a plus du tout de personnel dans les sociétés de logement social comme ce fut le cas pendant longtemps. Notre rôle au sein de ces sociétés est donc plus en retrait que par le passé.
J’en viens à la quatrième priorité définie par le cadre d’intervention régional : encourager l’intégration régionale.
Vous le savez mieux que moi, c’est un thème difficile à aborder, qui a fait l’objet de nombreux rapports parlementaires et aussi de nombreuses études internes à l’AFD. Il a changé de nom selon les époques : on parlait naguère de coopération régionale, on parle maintenant d’intégration régionale.
Nous tentons de soutenir les actions d’intégration régionale menées par les différentes collectivités, notamment les régions. Nous le faisons en participant à un certain nombre de missions et, surtout, en mettant en réseau nos agences. En effet, l’AFD est sans doute le seul outil de l’État français qui travaille à la fois dans les outre-mer et dans les États étrangers voisins de ces territoires. À ma connaissance, l’AFD est la seule institution qui ait, ainsi, deux « jambes », ce qui lui a permis de diffuser dans les États étrangers des politiques menées dans les outre-mer.
Cela dit, je pense que l’on devrait pouvoir un peu mieux exploiter ces « deux jambes » qu’on ne l’a fait ces dernières années, en mettant systématiquement en relation les régions, les collectivités locales avec nos agences locales, et en faisant de celles-ci un passage obligé. Nous n’utilisons pas suffisamment notre capacité – non pas à monter des projets, parce que je ne crois pas que nous en ayons les moyens financiers – mais à participer aux réseaux de manière plus importante. Or le travail en réseau est devenu une composante des dynamiques territoriales.
Nous pouvons aussi intervenir au bénéfice d’entreprises privées travaillant dans les outre-mer, telle que la société Akuo qui travaille beaucoup dans les Caraïbes, à La Réunion, mais aussi en Amérique Latine et prochainement en Indonésie. Nous donnons l’occasion à ces sociétés de créer des réseaux autres que les réseaux proprement « républicains ». Je crois que c’est l’un des enjeux que nous pouvons nous donner.
2014 a été pour nous une année de transition. En effet, les années précédentes, le secteur bancaire, du fait de la crise, s’était mis en retrait. Nous avons donc joué un rôle contracyclique, en intervenant très fortement dans le refinancement de ce secteur. Ensuite, nous nous sommes retirés : les banques locales étant refinancées par leurs maisons-mères, nous n’avions plus de raison d’intervenir. 2014 a donc très clairement fait rebasculer l’AFD du côté du secteur public et du secteur parapublic.
Pour cette année et les années à venir, notre objectif est double : tout d’abord, maintenir le cap de financement d’1,5 milliard d’euros, conformément au contrat d’objectifs et de moyens signé par la directrice générale de l’AFD, le ministre des finances, le ministre des affaires étrangères et la ministre des outre-mer, avec un volet BPI qui restera aux alentours de 500 millions d’euros et qui devrait même augmenter en raison d’une dynamique assez forte ; ensuite, continuer notre travail sur les collectivités locales et les entreprises.
Le PIB des outre-mer atteint à peu près 52 milliards d’euros. Cela veut dire que le 1,5 milliard d’euros mis en œuvre par l’AFD représente globalement 3 % du PIB des outre-mer, ce qui est loin d’être négligeable. Notre objectif est donc de maintenir au moins ces 3 %, d’être encore plus présents et de rester au plus près des politiques locales sur les problématiques que je viens d’évoquer.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Merci pour cette intervention très intéressante et très éclairante sur les activités de l’AFD.
M. Patrick Lebreton. Je suis moi-même député de La Réunion, mais aussi maire de Saint-Joseph, la commune la plus australe d’Europe, qui compte 38 000 habitants. De fait, nous sommes tout à fait satisfaits du soutien que nous a accordé l’AFD, surtout au cours de ces dernières années, pour réaliser un certain nombre d’investissements importants – assainissement, équipements structurants.
Votre directrice générale soulignait avec justesse dans le rapport que dans les outre-mer persistent des inégalités et un taux de chômage élevé, qui rendent nécessaires la poursuite de politiques volontaristes en faveur de la cohésion sociale, de la création d’emplois, et l’émergence d’un nouveau modèle de croissance.
Toujours selon votre rapport, l’AFD consacre 574 millions d’euros à l’île de la Réunion. Dans le même temps, le niveau d’intervention de l’AFD à destination de l’île Maurice, distante d’à peine 250 km de chez nous, est d’environ 500 millions d’euros. Loin de moi l’idée de critiquer l’aide apportée par l’AFD à l’île Maurice, qui est pour moi « l’île sœur » de la Réunion ; je suis d’ailleurs président du groupe d’amitié parlementaire entre la France et l’île Maurice. Mais j’ai tout de même remarqué que 47,5 millions d’euros étaient consacrés à l’extension du port à conteneurs de la Réunion, et qu’une somme à peu près comparable, c’est-à-dire 43 millions de dollars, était consacrée à l’extension du port à conteneurs de Mer Rouge à l’île Maurice, qui a vocation à devenir le hub du commerce maritime dans la zone de l’Océan Indien.
Pour reprendre les termes du directeur de la Mauritius Port Authority, j’en conclus que l’on peut s’interroger sur la cohérence des stratégies régionales de l’AFD. En clair, est-ce que le hub maritime de l’océan Indien sera à l’île Maurice ou à La Réunion ? L’île Maurice est une partenaire, une amie, mais elle est aussi une concurrente avec des règles sociales et des contraintes fiscales différentes. Cela dit, je reconnais que l’île Maurice ne bénéficie pas du soutien d’une métropole.
Ma question n’est ni tendancieuse, ni provocante. Mais comme vous êtes appelé à travailler à la fois dans l’océan Indien et dans les Caraïbes et que d’autres cas que celui-ci risquent de se présenter, je voudrais savoir s’il existe aujourd’hui à l’AFD une stratégie concertée sur les politiques menées entre la direction des outre-mer, d’une part, et les services chargés des pays de la même aire géographique, d’autre part.
Vous avez parlé tout à l’heure de coopération régionale. Or vous savez très bien qu’il n’est plus concevable de parler de développement sans prendre en compte la dimension régionale. Pour les insulaires que nous sommes, c’est particulièrement important.
M. Jean-Jacques Vlody. Je vais faire écho à l’intervention de Patrick Lebreton. J’avais reçu M. Marc Dubernet lorsqu’il était en poste à La Réunion, pour évoquer avec lui la nécessité d’une coordination de la politique de l’AFD dans les États membres des régions outre-mer et dans les territoires. Il semble que cette démarche n’ait pas été entreprise jusqu’à présent.
C’est un peu une attitude naturelle pour l’État français que de mener une politique de coopération et de développement, d’accompagnement des pays en voie de développement sans se préoccuper de manière régulière de la réalité des territoires français qui sont dans ces régions. On pourrait sortir de cette conception centralisée et parisienne, et imaginer l’inverse, c’est-à-dire accompagner le développement des pays qui se trouvent à l’entour des territoires ultramarins à partir de ces territoires. D’où ma question : comment mener, à travers l’AFD, une politique de développement des pays de la zone à partir des têtes de pont de notre République et de l’Europe que constituent les territoires d’outre-mer ?
Cela dit, j’ai entendu avec satisfaction ce que vous avez dit sur les financements FEDER en partenariat avec la région, et sur l’impérieuse nécessité de trouver des financements pour la réhabilitation des logements sociaux.
L’AFD est l’actionnaire majoritaire de la SIDR, la Société immobilière du département de la Réunion, qui est elle-même le premier opérateur de logements sociaux. La réhabilitation est un des enjeux majeurs de la SIDR qui, en tant qu’opérateur public, ne bénéficie ni de la défiscalisation, ni d’un accompagnement financier. Les premiers locataires de la SIDR vivent aujourd’hui dans des logements insalubres dont certains ne seraient même plus éligibles à l’aide de la Caisse d’allocations familiales en raison de leur état. Une telle situation est socialement insupportable. Il est donc urgent d’accompagner financièrement la SIDR pour permettre la réhabilitation de ces logements.
Je profite de l’occasion pour vous interroger, en tant que représentant de l’actionnaire majoritaire, sur la question de l’accession à la propriété des locataires de logements sociaux. Pendant des années, les opérateurs ont construit des logements qu’ils ont rétrocédés aux occupants dès le début, sous certaines conditions – par exemple, location-vente ou loyers d’accès différé ; nous en avons des exemples dans toutes nos communes. Mais aujourd’hui, une certaine frilosité et certaines difficultés de nature financière – difficultés supposées – semblent bloquer l’accession à la propriété. Or c’est une aspiration très forte des populations, en particulier à La Réunion. Certains logements, tels qu’ils sont conçus – notamment les maisons de villes, petites structures urbaines autonomes les unes des autres – s’y prêteraient pourtant parfaitement... à condition que la volonté politique soit vraiment là.
Enfin, ne croyez-vous pas que ce serait un juste retour des choses que de permettre à un locataire qui a déjà payé plusieurs fois son logement, d’en devenir propriétaire en le repayant une dernière fois ?
M. le président Jean-Claude Fruteau. Monsieur Richy, vous avez signalé qu’un tiers des financements accordés par l’Agence sont en fait des prestations réalisées par l’AFD pour BPI. Pourriez-vous nous parler de l’état actuel de la collaboration entre les deux institutions ?
M. Fabrice Richy. Commençons par l’intégration, ou la coopération, régionale.
J’ai entendu parler de l’histoire des deux ports, - je ne travaillais pas encore sur l’Outre-Mer à l’époque - et je peux témoigner des réactions qu’elle a provoquées en interne. Si j’ai dit que l’AFD avait deux jambes et qu’elle ne savait sans doute pas encore les utiliser de la meilleure manière possible, c’est aussi parce que la discussion qu’a provoquée cette histoire nous a fait prendre conscience de la nécessité d’assurer la cohérence de nos politiques et de nos financements –nous avons sans doute à notre disposition des moyens pour y parvenir.
Mais cette nécessité, à l’heure actuelle, ne concerne pas seulement l’AFD. Elle concerne plus globalement le dispositif public dont l’Agence n’est qu’une des représentations. Une meilleure coordination est sans doute possible entre les différents acteurs (partenaires locaux, ambassades, services des préfectures etc) qui agissent chacun avec leurs propres outils et selon leurs agendas et priorités.
Parce que nous en sommes conscients, nous avons adopté depuis quatre ans une stratégie interne à l’AFD sur la coopération régionale. En même temps, l’Agence est une vieille dame… Nous travaillons chaque jour pour mieux inscrire nos politiques d’intervention dans leur contexte régional.
Je sais que dernièrement, des amendements ont été adoptés pour obliger la puissance publique à se coordonner. C’est un premier pas, même si je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. Sans doute vous-mêmes, en tant que députés, aurez-vous à remettre le chantier sur la table de l’Assemblée. Je ne doute pas que vous le fassiez au moment opportun. Mais c’est l’ensemble du dispositif qu’il faudrait réformer petit à petit.
Je ne peux pas vous dire plus que cela : le dossier des deux ports a provoqué une prise de conscience chez tous les acteurs ; le dispositif public doit mieux se coordonner ; enfin, nous ne sommes qu’une représentation de ce dispositif public.
Je préfère rester modeste sur le sujet, tout en sachant que cette problématique est prise en compte. Le principal sujet est de savoir comment arriver, dans une perspective pas trop lointaine, à mieux coordonner les acteurs (et ce faisant les actions de l’AFD). Je suis sûr que l’on y arrivera, mais c’est un travail de longue haleine et de tous les jours.
M. Jean-Jacques Vlody. Il ne s’agissait pas de faire le procès de l’AFD, mais d’alerter le directeur de son département Outre-mer sur cette réalité.
M. Fabrice Richy. J’ai parlé tout à l’heure de l’organisation, projetée par l’AFD, d’un séminaire à Mayotte sur le microcrédit. Nous avons l’intention d’y inviter des représentants du microcrédit de la sous-région Océan Indien, justement en relation avec les agences de l’AFD. Ce sera l’occasion d’un partage d’expériences. Tout cela est un peu novateur. Certes, ce n’est pas ainsi que l’on va réinventer le monde.
M. Philippe Houillon. C’est dommage !
M. Fabrice Richy. Mais au moins, à notre niveau, avec nos moyens d’action, on agit ! De même, il y a quinze jours, quand je suis allé à la Réunion, j’ai rencontré longuement le secrétaire général qui est très intéressé par l’intégration régionale.
J’ai travaillé longtemps dans les Caraïbes et en Nouvelle-Calédonie ; il se trouve que, pour des raisons de carrière, je suis parti à l’étranger pendant sept ans. Pendant cette période, à mes yeux, la situation a un peu évolué : des réseaux commencent à se nouer, des entreprises commencent à travailler dans d’autres zones géographiques. A titre d’exemple, une société de téléphonie mobile réunionnaise (que nous avons récemment accompagnée) travaille dans la sous-région. Sans doute trouvez-vous que cela n’avance pas assez vite. Pourtant, petit à petit, « la mayonnaise commence à prendre ».
À propos du logement, je voudrais d’abord préciser que nous ne sommes pas seuls actionnaires de la SIDR : nous portons également les parts de l’État, qui a la parole la plus forte dans les conseils d’administration de la SIDR, comme dans ceux d’autres sociétés immobilières d’outre-mer. Voilà pourquoi j’avais tenu à préciser dans mon intervention que pendant longtemps, soit pratiquement dix ans – cela n’a jamais été le cas à la SIDR – l’AFD avait eu des agents dans les sociétés immobilières mais que maintenant il n’y en avait pratiquement plus. Depuis quatre ou cinq ans, l’État a très fortement repris la main sur la gestion des sociétés immobilières. Je ne dis pas que c’est un bien ou un mal ; c’est une donnée.
Dans ce contexte l’AFD est toujours consciente des enjeux de l’habitat, secteur qu’elle continue d’accompagner activement et c’est bien pour cela qu’elle travaille à la mise en place du prêt bonifié dont j’ai parlé tout à l’heure. Nous nous y intéressons de très près ; nous sommes en train de faire une étude sur le sujet en partenariat avec la région Réunion. J’espère que l’on pourra aboutir sur ces questions de financement de la réhabilitation, qui sont très lourdes pour la SIDR, mais aussi dans d’autres régions.
J’espère également que le projet de bonifier des prêts par le fonds FEDER aboutira, car il permettra d’ouvrir des perspectives. Entre des fonds FEDER et nous, l’effet de levier devrait jouer à plein : pour un euro mis, l’objectif recherché serait d’arriver à 3, 4, 5 euros investis. C’est l’objectif recherché. On y travaille avec la région Réunion et, sur un autre secteur, avec la Guadeloupe. Si ces projets se réalisaient, cela pourrait faire école.
J’ai été interrogé sur l’accession à la propriété. C’est un sujet que je connais bien. Il est exact qu’en général, les sociétés immobilières sont réticentes à faire de l’accession à la propriété. J’ai été moi-même directeur général d’une société immobilière et, en cette qualité, j’éprouvais cette réticence. En effet, ce n’est pas la construction qui fait vivre une société immobilière, ce sont les loyers. À long terme, c’est un enjeu énorme de soutenabilité de la société qui est posé par la pratique de l’accession. Si on aborde le sujet d’une manière très politique en disant qu’il faut vendre parce qu’il faut vendre, on risque un blocage de la société. C’est donc davantage dans le cadre des plans stratégiques de patrimoine qu’il faudrait identifier les secteurs qui seraient ouverts à la vente, selon des modalités bien précises. Si des décisions en ce sens sont prises par le conseil d’administration et assumées par l’ensemble de la classe politique, on pourra sans doute construire des politiques d’accession à la propriété beaucoup plus solides.
Si l’on peut citer de beaux exemples de ventes du patrimoine, on peut aussi citer des exemples catastrophiques, qui aboutissent à une propriété dégradée. C’est pour cela qu’il faut lancer la vente sur certaines parties de patrimoine. Il faudrait donc que les conseils d’administration décident quelle partie du patrimoine peut être concernée. Il faut une politique construite, et se garder d’une logique du « tout ou rien ». Souvent, les directeurs généraux et les équipes de direction craignent d’être embarqués dans un système qu’ils ne contrôlent plus, alors même que la pérennité de toute société est liée aux loyers.
M. Jean-Jacques Vlody. Voilà qui est clair !
M. le président Jean-Claude Fruteau. En effet, il faut se garder du tout ou rien : tout pour garder la propriété des logements, et rien pour la réhabilitation des mêmes logements. Il faut par ailleurs tenir compte de la règle générale que vous édictez, à savoir que ce n’est pas sur la construction des logements, mais sur leur location et sur le fait de les garder le plus longtemps possible que s’assoit la solidité financière des sociétés immobilières. Reste que cela ne justifie pas le fait que des logements vieux de plus de quarante ans soient devenus insalubres – voire soient, comme certains logements de la SIDR, de véritables bidonvilles.
C’est une lourde charge pour les municipalités, car elle leur retombe dessus périodiquement, lorsque certaines personnes, parce qu’elles vivent dans des taudis, bloquent les routes. Par ailleurs, le fait que des familles entières vivent dans des conditions insupportables nuit à l’image de la société immobilière propriétaire. Pourtant, au départ, les logements ainsi contestés ont été un élément essentiel de l’amélioration de l’habitat.
Il faudrait en effet que les conseils d’administration se penchent sur la question, qui est, malheureusement, trop souvent occultée. Il y a une vraie prise de conscience à provoquer. J’observe que l’AFD fait partie de la gouvernance des sociétés immobilières. Certes, elle n’en est pas l’actionnaire majoritaire. Mais enfin, elle est une société publique, et elle porte les parts de l’État. Je pense donc qu’elle a un pouvoir d’influence considérable. La remarque vaut aussi pour les élus qui, ici ou là, participent au conseil d’administration.
M. Fabrice Richy. Ce ne peut être que de l’ordre du projet collectif.
Je voudrais préciser qu’à la SIDR, par exemple, nous avons deux sièges et que l’État en a quatre. Quoi qu’il en soit, dans les sociétés immobilières, le sujet de la gouvernance est très compliqué, et la situation mériterait d’être clarifiée.
Les relations avec la BPI sont bonnes. De nombreux collaborateurs de l’AFD travaillent pour elle : au moins 6 à La Réunion, 4 ou 5 en Martinique, autant en Guadeloupe, etc. Au total, un peu plus de 25 personnes assurent au quotidien l’ensemble du traitement des dossiers BPI, recevant les clients et les entreprises, dans un rapport de prestation de services axé sur les problèmes de trésorerie. Les crédits à court terme représentent en effet une bonne partie de notre activité BPI.
Nous sommes satisfaits parce que la représentation BPI constituait pour nous un enjeu. La mise en place de ce grand projet public a été réalisée très rapidement, début 2014, dans des conditions qui n’étaient pas évidentes. Comme dans toute relation entre des établissements partenaires, il convient de s’ajuster, mais je crois qu’en définitive, passées les étapes liées à l’organisation du travail et à la bonne coordination, nous pouvons être satisfaits du travail que nous faisons pour le compte de cette banque.
M. François Parmantier. En fait, les trois cinquièmes de l’activité correspondent au financement à court terme. C’est un pourcentage très significatif, qui répond à l’essentiel du besoin des petites entreprises ultramarines.
Petit rappel sur le contexte ayant conduit à ce dispositif AFD/BPI dans les DOM : le Premier ministre de l’époque, Jean-Marc Ayrault, avait en effet annoncé en juillet en Martinique que l’AFD interviendrait pour le compte de BPI. Vous imaginez bien que pendant les quatre derniers mois de l’année 2013, tous nos efforts ont tendu à rendre opérationnels l’ensemble des dispositifs.
Ce chantier très conséquent a mobilisé l’ensemble de nos deux maisons. Pendant les quatre derniers mois de 2013, des groupes de travail techniques– ont permis de travailler avec BPI, main dans la main, sur les produits, les systèmes d’information, la formation des personnels. Au 1er janvier 2014, l’ensemble des équipes était sur le pont pour commercialiser l’ensemble des produits BPI, de sorte que, depuis maintenant un an et demi, une demande insistante des socioprofessionnels ultramarins se trouve satisfaite.
M. Jean-Jacques Vlody. J’aimerais que vous nous donniez votre appréciation sur la pertinence des produits BPI par rapport à la structure des entreprises. A la Réunion, il y a 80 ou 90 % de TPE ou PME. Est-ce que les produits BPI sont bien adaptés à ce type d’entreprises, ou sont-ils plus adaptés aux 10 % de grosses entreprises que nous avons sur notre territoire ? Ces outils sont-ils suffisamment pertinents ? Doivent-ils être améliorés par rapport à la structure des entreprises de notre territoire ?
M. François Parmantier. La BPI a nommé –c’est une différence substantielle avec l’ancien système – deux directeurs interrégionaux, qui sont arrivés à la fin de décembre 2013 : Christian Quéré à Saint-Denis (pour Mayotte et la Réunion), et Michèle Papalia à Pointe-à-Pitre (pour les Antilles et la Guyane). Ils sont également vos interlocuteurs, et sont à l’écoute des entreprises.
Avec le recul de quinze mois, nous nous rendons compte que l’essentiel des produits répond effectivement aux besoins. Je rappelle qu’aujourd’hui la gamme de produits va du financement court terme jusqu’au cofinancement, et dans certains cas, jusqu’au cofinancement AFD, BPI plus une banque, en passant par des systèmes de garantie – cela correspond à l’activité de l’ancien Fonds DOM que vous connaissiez, qui a bénéficié à plusieurs centaines d’entreprises, y compris les petites entreprises ultramarines.
Je pense, sans vouloir répondre à la place de M. Quéré ou de Mme Papalia, que la BPI est elle aussi soucieuse d’adapter son système et sera à l’écoute de demandes émanant des socioprofessionnels en vue de l’évolution de certains produits.
C’est ainsi que la BPI a décidé fin 2014, avec début de mise en œuvre début 2015, de pratiquer la subdélégation pour les garanties. Afin de raccourcir les délais de décision et de faciliter la fluidité des décisions d’octroi de garanties, les seuils de subdélégation en banque ont été portés à 200 000 euros. Concrètement, cela signifie qu'aujourd’hui, lorsqu’une entreprise va voir sa banque, dès lors que l’on est sur un montant inférieur à 200 000 euros, la banque décide elle-même d’imputer la garantie. Il s’agit bien là d’une adaptation aux des besoins des entreprises.
Bien évidemment, dès lors que de nouveaux besoins seront exprimés dans des proportions qui permettent à un organisme comme BPI de mettre en place une nouvelle ligne de produits ou d’adapter des produits existants, nous aurons tous à cœur – la BPI comme nous-mêmes qui sommes, d’une certaine façon, les revendeurs de ses produits – de satisfaire ces besoins.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Monsieur Richy, il ne me reste plus qu’à vous remercier, ainsi que vos collaborateurs.
M. Fabrice Richy. Nous restons à votre disposition.
B. AUDITION DES DIRIGEANTS DE L’INSTITUT D’EMISSION DES DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER
(Séance du 16 avril 2016)
M. le président Jean-Claude Fruteau. Mes chers collègues, je suis heureux d’accueillir M. Hervé Gonsard, directeur général, et M. Philippe La Cognata, directeur de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) et de l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM). Et je salue la présence de Mme Véronique Bensaïd-Cohen, qui est conseillère parlementaire auprès du Gouverneur de la Banque de France.
Comme vous le savez sans doute, depuis 1959, l’IEDOM et depuis 1996, l’IEOM ont la responsabilité de la gestion, de la circulation monétaire et des systèmes de paiement, respectivement dans les départements et collectivités de l’article 73 de la Constitution, et en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna.
Le rapprochement entre la Banque de France et ces deux instituts n’est pas nouveau. La création de la zone euro, la constitution du système européen de banques centrales l’ont rendu inévitable. Sous l’impulsion des instances européennes, ce processus devrait connaître prochainement une étape supplémentaire, décisive en tout cas pour l’IEDOM. Le sujet suscite naturellement dans les outre-mer un certain nombre d’interrogations.
Parmi les attributions de notre Délégation aux outre-mer, figure précisément l’obligation d’informer l’Assemblée nationale sur tous les projets qui sont susceptibles d’affecter la vie économique et sociale des outre-mer, y compris à travers les évolutions institutionnelles. Voilà pourquoi j’ai souhaité que les responsables des deux instituts d’émission ultramarins viennent nous éclairer sur l’avenir de leurs institutions.
Je vous remercie, messieurs Gonsard et La Cognata, d’avoir été sensibles au souci que nous avions exprimé. Et sans plus tarder, je vous passe la parole.
M. Hervé Gonsard, directeur général de l’IEDOM et de l’IEOM. Monsieur le président, mesdames et messieurs, c’est un honneur d’être parmi vous aujourd’hui, et nous vous remercions de nous avons conviés à cette audition sur la réforme de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, envisagée par l’article 52 du projet de loi relatif à la transparence et à la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, qui a été adopté par le conseil des ministres le 30 mars dernier.
L’IEDOM est la banque centrale déléguée à des départements et collectivités d’outre-mer dont la monnaie est l’euro. La réforme proposée par le Gouvernement est de transformer cet institut, aujourd’hui établissement public, en filiale à 100 % de la Banque de France. C’est une réforme importante qui permettrait, de façon claire et définitive, d’ancrer l’IEDOM dans l’Eurosystème, tout en préservant son identité ultramarine.
Comme vous l’avez rappelé, monsieur le président, cette réforme s’inscrit dans un mouvement entamé lors du passage à l’euro. À cette occasion en effet, l’IEDOM a connu une première étape importante de rapprochement avec la Banque de France. À suite d’un compromis qui fut à l’époque longuement débattu avec la Banque centrale européenne (BCE), l’IEDOM a conservé son statut d’établissement public, mais il est devenu un agent de la Banque de France. Il a été placé sous la gouvernance de la Banque de France, et sous la responsabilité financière de celle-ci.
L’IEDOM exerce depuis lors ses missions fondamentales « au nom, pour le compte et sous l’autorité de » la Banque de France. Mais alors que ses activités, que sa gouvernance l’ont clairement rapproché de la Banque de France, l’IEDOM est, pour des raisons historiques, demeuré, pour ce qui reste de sa vie sociale, que ce soient les instances représentatives du personnel (IRP), les accords collectifs ou la gestion des ressources humaines, dans l’orbite du groupe AFD (Agence française de développement) avec lequel il forme une union économique et sociale (UES). Or cette UES avec l’AFD, avec laquelle l’IEDOM, précisément à la suite de l’évolution de 1999, n’a plus ni management commun ni activité commune, est de plus en plus fragilisée, et cette fragilité ira en s’aggravant avec les évolutions récentes de l’AFD, notamment avec la croissance rapide de son activité.
Alors qu’il avait envisagé à un moment la dissolution de l’IEDOM dans la Banque de France, l’État retient aujourd’hui une sorte de rapprochement sans dissolution. C’est une solution qui permet l’intégration pleine et entière de l’IEDOM au sein de l’Eurosystème, mais dans le respect de son identité ultramarine.
Ce rapprochement, qui va un peu « dans le sens de l’histoire », garantirait la pérennité de l’Institut et de toutes ses missions.
D’abord, la transformation de l’établissement public IEDOM en société publique détenue par la Banque de France 100% publique – ce n’est absolument pas une privatisation, car l’IEDOM resterait dans le secteur public – traduirait d’une façon beaucoup plus claire aujourd’hui, dans le droit positif comme dans les faits, l’appartenance de l’IEDOM au groupe Banque de France, et donc l’accomplissement des missions de l’Eurosystème en totale indépendance vis-à-vis de l’État, sur l’ensemble du territoire national où circule l’euro.
En outre, ce rapprochement permettrait d’amplifier ce qui existe d’ailleurs déjà : une logique de métiers entre la Banque de France et l’IDEOM. L’institut d’émission remplit en effet, dès à présent, quasiment les mêmes missions que la Banque de France dans les départements d’outre-mer. Ces dernières années ont vu d’ailleurs de plus en plus le déploiement et l’utilisation par l’IEDOM des outils et des applicatifs développés par la Banque de France, principalement dans les métiers fiduciaires, dans les métiers de la cotation des entreprises, ou dans les métiers du surendettement des particuliers.
Cette réforme permettrait donc de renforcer la cohérence, la collaboration avec la Banque de France dans l’exercice de ces métiers. Elle permettrait de renforcer également la synergie et, au final, la qualité des missions exercées par l’IEDOM au service des territoires ultramarins et de nos concitoyens d’outre-mer.
Autre point important : la transformation de l’IEDOM en société détenue par la Banque de France permettrait de concilier l’appartenance de l’institut à la Banque, et le nécessaire maintien de l’identité ultramarine de l’IEDOM – et ce, notamment, dans la gestion à terme, plus particulièrement dans la gestion des ressources humaines, qui est un point que regardent attentivement nos salariés.
Elle permettrait donc à l’IEDOM d’assurer une continuité dans la gestion des personnels, qui pourraient, comme c’est le cas aujourd’hui, continuer à être recrutés sur une base principalement locale, et non pas sur une base nationale comme la Banque de France, tout en conservant des règles de mobilité qui lui sont propres et qui sont très différentes de la Banque de France.
Enfin, cette autonomie lui permettrait de conserver des modalités de rémunération qui, aujourd’hui, sont différentes de celles de la Banque de France.
En dehors de ces problèmes importants de prise en compte de la gestion interne, cette autonomie, qui n’est pas une intégration, nous permettrait de maintenir une autonomie de fonctionnement pour prendre en compte les réalités économiques et sociales des outre-mer et adapter, lorsque c’est nécessaire, certains dispositifs ou procédures aux contraintes liées à l’insularité, à l’éloignement ou au décalage horaire.
De par la forme qu’elle prendrait, cette réforme présente un autre intérêt : le siège de l’IEDOM étant maintenu, elle permettrait le partage de ses services avec l’IEOM, comme c’est le cas aujourd’hui. Nous continuerions de disposer de services de siège communs aux deux instituts d’outre-mer, ce qui autorise, entre autres, le fonctionnement de synergies qui, là encore, ne pourraient exister si l’IEDOM était intégré à la Banque de France.
Cette réforme, et on y veille, sera assortie de garanties sociales importantes pour le personnel. La modification de la nature juridique de l’Institut par la loi n’emporterait pas, par elle-même, de conséquences sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels embauchées par l’IEDOM ni, en particulier, sur leur statut ni sur leur contrat.
Elle n’emporterait pas non plus, en tant que telle, de remise en cause immédiate et directe de l’unité économique et sociale dont je vous ai parlé. Cette modification relèverait ensuite de la voie conventionnelle ou juridictionnelle.
Par la suite, les incidences sociales de la réforme seraient évidemment réglées par voie conventionnelle entre toutes les parties prenantes, à savoir : l’IEDOM, l’AFD, la Banque de France et évidemment, les représentants du personnel des instituts.
Ce processus, et le Gouverneur de la Banque de France l’a dit devant la commission des finances de cette assemblée lorsqu’il est venu s’exprimer début mars, n’affectera ni les missions, ni les statuts des agents de l’IEDOM ni les droits qui y sont attachés. La Banque de France a fait savoir qu’elle s’attacherait à préserver l’ensemble des droits individuels et collectifs des salariés de l’IEDOM.
J’ajouterai à cela que le dialogue social qui s’inscrit résolument dans la transparence, et qui a été engagé dès le 19 février, bien avant que ne soit rendu public le projet de loi du Gouvernement, avec les représentants de l’IEDOM, de l’AFD mais aussi de la Banque de France, est largement engagé. Des démarches d’information-consultation sont en cours, et les directions des établissements que j’ai cités s’attacheront à informer les personnels en tant que de besoin. J’ajouterai qu’avec le directeur des instituts, Philippe La Cognata, nous sommes allés déjà dans quatre des territoires concernés. Nous allons boucler notre tour par Saint-Pierre et Miquelon et la Guyane, le mois prochain.
Avec ce projet de transformation de l’IEDOM, monsieur le président, mesdames et messieurs, en société détenue par la Banque de France, c’est potentiellement une nouvelle étape importante pour les instituts qui se dessine, mais celle-ci s’inscrit dans la continuité et donc dans la permanence.
C’est un changement qui, nous en sommes convaincus, devrait renforcer l’IEDOM, à la fois dans son appartenance à l’Eurosystème, mais aussi dans les services qu’il doit rendre – encore meilleurs et au meilleur coût – à nos concitoyens d’outre-mer.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Merci, monsieur le directeur général. Je voudrais vous poser une question simple, qui reflète sinon l’inquiétude, du moins l’interrogation d’un certain nombre de personnes ou de groupes dans les outre-mer.
En somme, un établissement public national, qui était chargé jusqu’à présent de la gestion de la circulation monétaire, des systèmes de paiement, etc. devient une société par actions simplifiée, propriété à 100 % de la Banque de France.
Ce schéma était-il le seul possible ? Je ne le pense pas. En tout cas, quels sont les avantages et les inconvénients qui ont fait que la préférence lui a été accordée ?
M. Philippe Naillet. Selon les propos que vous avez tenus, le personnel garderait son statut et ne perdrait aucun avantage. Reste que l’on s’interroge sur l’offre de crédit qui sera offerte demain, notamment au tissu économique, via la cotation des entreprises. Pouvez prendre l’engagement que l’offre de crédit ne sera pas plus restreinte ? Voilà les questions que l’on se pose aujourd’hui à propos de cette transformation de l’IEDOM en SAS.
M. Hervé Gonsard. Monsieur le président, pourquoi avoir choisi ce statut ?
Aujourd’hui, l’établissement public national ne peut demeurer en l’état parce que la Banque de France étant elle-même une personne publique sui generis – comme le dit la jurisprudence du Conseil d’État – sans équivalent ailleurs, ne peut pas détenir un établissement public. Ce point a été vérifié avec les services de Bercy, d’autres services juridiques, et a été également débattu devant le Conseil d’État.
Pour que la Banque de France puisse être propriétaire de l’Institut, on a dû choisir un statut qui relève du droit commercial. Comme l’idée est de faire de l’IEDOM la propriété exclusive, à 100 %, de la Banque de France, la société par actions simplifiée (SAS) se trouve être le statut le plus adapté. C’est pour cela qu’il nous est apparu comme la meilleure solution possible quand nous avons étudié la question à la demande du Gouvernement.
Monsieur le député, vous m’avez interrogé sur les changements que pourrait provoquer la réforme de l’IEDOM, en termes d’offre de crédit via la cotation des entreprises. En effet, l’IEDOM lui-même, en tant que banque centrale, n’offre pas de crédit à l’économie. En revanche, il cote les entreprises et cette cotation constitue un élément important, pour les banques, dans leurs décisions d’attribution de crédit.
De ce point de vue, la méthode de cotation, telle qu’elle existe aujourd’hui, ne sera pas modifiée. C’est déjà la cotation de la Banque de France qui est utilisée. Il n’y aura donc aucun risque qu’une nouvelle méthode de cotation puisse porter atteinte à l’offre de crédit et vienne restreindre l'offre de crédit par rapport à ce qui existe aujourd’hui.
Par ailleurs, nous avons bien conscience, même si les statistiques nous disent que, dans les outre-mer, le crédit a été en hausse de 5 % sur l’année 2015, que certaines PME et notamment des TPE ont parfois du mal à avoir accès au crédit bancaire. De ce point de vue, le rapprochement – si le Parlement le souhaite – entre l’IEDOM et la Banque de France permettra d’aller plus loin. En effet, la Banque de France a créé un référent, un correspondant TPE dans chacun des succursales de la Banque de France. Si l’IEDOM devient une des filiales de la Banque de France, nous appliquerons exactement le même processus, à savoir que dans chacune des agences de l’IEDOM il y aura un référent, un correspondant TPE qui travaillera en toute indépendance par rapport aux banques –on sait, dans la maison Banque de France et dans la maison IEDOM, garantir le secret – et pourra donner tous les conseils possibles aux chefs d’entreprise, notamment à ceux qui sont à la tête de TPE. Donc, de ce point de vue, le rapprochement avec la Banque de France permettrait d’aller un petit peu plus loin et de fournir ce service complémentaire aux chefs de PME et de TPE.
Mme Monique Orphé. Vous insistez beaucoup sur l’identité ultramarine. Pour ma part, je m’interroge sur l’intérêt de cette « absorption », dans la mesure où vous gardez les mêmes compétences, les mêmes missions. Pourquoi le faire ?
D’autre part, vous dites que les agents, les salariés garderont les mêmes droits individuels et collectifs. Cela signifie donc qu’il y aura deux types de salariés au sein de la Banque de France. Est-ce possible ?
Enfin, comment allez-vous garantir ce recrutement local ?
M. Hervé Gonsard. Madame Orphé, pourquoi procéder à un tel rapprochement si l’on garde les mêmes missions ?
La raison fondamentale de cette réforme est de nous mettre parfaitement en adéquation avec l’Eurosystème actuel, pour que nous soyons effectivement dans les mains de la Banque de France, comme on avait commencé à le faire en 1999, et que nous ne soyons plus dans les mains de l’État. D’où la décision rendue le 16 mars dernier par la BCE. De fait, la BCE se félicite de cette évolution qui mène à son terme l’indépendance de l’IEDOM comme de la Banque de France vis-à-vis de l’État.
Maintenant, est-il possible, en étant intégré au groupe Banque de France, de conserver deux statuts ? C’est une question très importante. Nous avons plutôt opté pour la solution filiale que pour l’intégration pure et simple dans la Banque de France. Cela permet d’avoir des statuts du personnel différents. Si demain, nous demandions à l’IEDOM d’être totalement intégré, si nous transformions les agences de l’IEDOM en agences de la Banque de France, nous aurions le même statut, les mêmes modes de recrutement, et les mêmes modes de mobilité et de rémunérations que la Banque de France.
De ce point de vue, la Banque de France est très égalitaire, très unitaire : que l’on soit en Corse ou à Paris, malgré la cherté de la vie, on y est payé de la même façon qu’à Limoges où l’on sait que l’immobilier n’est pas au même prix. Cette différence de statut permettrait précisément de maintenir les surrémunérations qui existent aujourd’hui pour les agents de l’IEDOM par rapport aux agents de la Banque de France.
Vous parliez également du recrutement. En effet, la Banque de France recrute sur un concours national. Cela signifie que si l’on intégrait purement et simplement l’IEDOM à la Banque de France, et que cette dernière était partout présente, on recruterait sur concours national, et on affecterait ensuite les gens qui ont réussi ce concours dans chacune des succursales de la Banque de France, qui pourrait être celle de Limoges, de Marseille, de Brest, ou demain, de Saint-Denis de la Réunion, par exemple.
On n’aurait plus ce que l’on a aujourd’hui : aujourd’hui, l’IEDOM recrute son personnel sur place, localement. Cette possibilité, qui permet de répondre à certaines problématiques locales, par exemple à la situation de l’emploi, n’existe pas dans le statut de la Banque de France.
Voilà pourquoi il nous a paru important de garder ces spécificités aux collectivités d’outre-mer qui ont l’euro pour monnaie.
J’ajoute qu’à la Banque de France, les cadres sont tenus à la mobilité. Au bout de trois ou quatre ans, ils doivent quitter la succursale dans laquelle ils travaillent, pour prendre des fonctions dans une autre succursale. Chez nous, à l’inverse, les agents d’encadrement, les chefs de service des différents services – à l’exception de deux ou trois cadres qui sont mutables par définition, à savoir le directeur, l’adjoint et un autre chef de service – ne sont pas forcés à la mobilité. Et il est souvent bien plus difficile de faire une mobilité entre deux départements ou régions d’outre-mer qu’entre deux régions ou départements métropolitains.
Donc, pour des raisons liées à la fois aux recrutements, à la mobilité et à la rémunération, nous avons pensé qu’il fallait plutôt conserver un statut différent à notre personnel et ne pas l’intégrer purement et simplement dans le statut des agents de la Banque de France.
Mme Véronique Bensaïd-Cohen. Madame la députée, le Gouverneur a été particulièrement attentif au statut du personnel de l’IEDOM. L’alternative était la suivante : soit la SAS, qui permettait de conserver la réalité des salariés d’outre-mer ; soit l’intégration pure et dure, qui amenait à appliquer les règles liées au personnel de la Banque de France. Le choix du Gouvernement, que nous avons partagé, était justement celui d’un statut à part.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Je vous remercie pour votre disponibilité et pour les éclaircissements apportés par vos réponses.
Mme Véronique Bensaïd-Cohen. Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, sachez que nous restons à votre entière disposition.
C. AUDITION DE M. PATRICE GELINET, MEMBRE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’AUDIOVISUEL
(Séance du 8 juin 2016)
M. le président Jean-Claude Fruteau. Mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd’hui pour entendre M. Patrice Gélinet, qui est membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) depuis 2011, nommé par le président de l’Assemblée nationale, et dont le mandat s’achèvera en 2017.
M. Gélinet a fait carrière dans l’audiovisuel ; il a été directeur de France Culture et a animé pendant plus de dix ans, avant d’entrer au CSA, la fameuse émission 2 000 ans d’histoire.
Au sein du Conseil, M. Gélinet est spécialement chargé de suivre les questions relevant de la compétence de cette haute autorité en tant qu’elles s’appliquent aux outre-mer. C’est à ce titre qu’il m’a paru intéressant de le prier de venir rencontrer les membres de notre délégation.
Ces fonctions le conduisent à effectuer des déplacements dans les différentes régions du globe où la France est présente. Il bénéficie par ailleurs d’une connaissance globale de l’audiovisuel dans les outre-mer. Or, nous savons ici par expérience, à la délégation, combien elle est à la fois précieuse et difficile à acquérir, ne serait-ce que pour d’évidentes raisons tenant au temps et à l’espace.
Attribution des fréquences, évolution de l’offre de services audiovisuels, structuration économique du secteur, relations culturelles régionales, autant de questions, parmi d’autres, sur lesquelles M. Gélinet a certainement une vision globale dont je le remercie par avance de nous faire profiter ; je lui passe maintenant la parole.
M. Patrice Gélinet, membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Le problème de l’audiovisuel dans les outre-mer me préoccupe beaucoup ; ma nomination au CSA m’a permis de la découvrir, ainsi que les territoires ultramarins que je ne connaissais guère. De ce fait, j’ai une vision décalée et nouvelle de la situation de l’audiovisuel dans les outre-mer où j’ai eu l’occasion de me rendre à plusieurs reprises. Je suis ainsi allé deux fois aux Antilles, une fois en Guyane, une fois à La Réunion, deux fois en Polynésie et deux fois en Nouvelle-Calédonie.
Nous consultons l’État – dont les prérogatives varient en fonction des territoires considérés, particulièrement la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie – pour avis sur toutes les questions concernant l’outre-mer. Par ailleurs, sur toutes les décisions du Conseil concernant l’audiovisuel, nous consultons pour avis le conseil régional, qu’il s’agisse de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane ou de La Réunion.
Je présenterai en premier lieu le paysage télévisuel et radiophonique des outre-mer.
Avant la venue de la télévision numérique terrestre (TNT), l’offre télévisuelle y était très limitée et essentiellement réduite à deux chaînes publiques - Radio France Outre-mer (RFO), aujourd’hui Outre-mer 1ère, et Tempo - auxquelles venaient s’ajouter quelques chaînes locales privées appelées « télés pays », puisant une partie de leurs programmes dans les grilles de France Télévisions. Cette situation contraignait les ultramarins à se tourner vers l’offre de télévision payante en s’abonnant notamment à Canal Satellite, appelé Canal Overseas, très prisé localement.
L’arrivée de la TNT en 2010, avec un multiplex accueillant dix chaînes de télévision au maximum, a permis aux ultramarins d’accéder à un plus grand nombre de chaînes gratuites qu’auparavant : entre huit et onze en fonction des territoires. Tous les outre-mer reçoivent six chaînes de France Télévisions : France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô, la chaîne locale publique du réseau Outre-mer 1ère, plus Arte et France 24.
La Martinique et la Guadeloupe reçoivent ainsi onze chaînes, ce qui a nécessité l’installation d’un deuxième multiplex à la Martinique ; La Réunion et Mayotte, dix ; Saint-Martin, la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, neuf ; Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Wallis-et-Futuna, huit. Dans ces trois derniers territoires n’existent que les six chaînes publiques de France Télévisions ainsi qu’Arte et France 24. Certains territoires reçoivent par ailleurs entre une et trois chaînes privées.
On constate que le nombre de chaînes de la TNT reçues, qui est de vingt-six en métropole, est considérablement moindre outre-mer, et varie selon les territoires considérés : entre huit et onze chaînes, soit à peu près trois fois moins que dans l’Hexagone.
Pour la radio, à l’exception de la Nouvelle-Calédonie, le nombre des stations par habitant est comparable entre la métropole et les outre-mer. Parfois, l’offre est supérieure : ainsi, La Réunion compte cinquante-quatre chaînes de radio pour 800 000 habitants, alors qu’en Île-de-France elles sont une cinquantaine pour 12 millions d’habitants.
Il n’existe que deux catégories de radios dans les outre-mer : des « A » et des « B ». Les radios « A » sont associatives, souvent animées par des bénévoles et la part des ressources qu’elles tirent de la publicité ne peut dépasser 20 % du chiffre d’affaires. Il s’agit de radios de proximité, très nombreuses : en métropole, sur neuf cents stations, les deux tiers relèvent de ce statut.
À l’occasion de mes déplacements outre-mer, j’ai pu constater qu’elles y jouent un rôle considérable, particulièrement dans les régions très éloignées des grands centres urbains ; ainsi j’ai récemment constaté qu’en Polynésie certaines îles ne reçoivent que le service public et la petite chaîne diffusant des informations locales. Cette situation prévaut aux Marquises, à Bora-Bora, aux îles Gambier ainsi qu’aux îles Australes – où je n’ai pu me rendre, faute d’aéroport, et où existe la station « Radio Kotokoto », à laquelle je suis très attaché, et qui, comme toutes ces chaînes associatives, est financée par la commune. Au regard de l’isolement géographique des îles concernées, on conçoit l’importance que revêtent ces petites radios locales, et le CSA fait preuve de tolérance à leur égard en faisant mine d’ignorer que certaines d’entre elles ne sont pas véritablement en mesure de lui adresser leur bilan annuel obligatoire.
Les radios « B » sont commerciales, locales ou régionales ; les « C » empruntent une partie de leurs programmes à une chaîne nationale et sont des stations commerciales locales ; les « D » sont des chaînes thématiques nationales comme Radio Classique ou Jazz Radio, etc. ; les « E » sont les grandes radios généralistes privées comme Europe 1, RTL ou RMC. Je mets à part le service public, placé sous la tutelle de l’État qui peut préempter des fréquences lorsque celles-ci sont mises en appel.
La Nouvelle-Calédonie connaît une situation particulière, car il n’y existe que quatre radios privées et deux radios publiques, par ailleurs diffusées dans tous les outre-mer. La première radio publique est Nouvelle-Calédonie 1ère, comme il existe Polynésie 1ère, Martinique 1ère, etc., ces diffuseurs émettant à la fois des programmes de télévision et de radio ; la seconde est France Inter, seule chaîne de radio du service public accessible à l’ensemble des ultramarins. Par ailleurs, France Culture n’est diffusée qu’à Saint-Denis de La Réunion, ce qui constitue une anomalie au regard des obligations du service public en matière de couverture, mais aussi au regard de la continuité territoriale.
La Guadeloupe compte 34 radios privées pour 400 000 habitants ; la Martinique, 34 radios privées pour 380 000 habitants ; la Guyane, 41 radios privées pour 240 000 habitants ; la Polynésie, 26 radios privées pour un nombre équivalent d’habitants ; la Nouvelle-Calédonie, quatre radios privées pour 266 000 habitants, ce qui est une anomalie ; La Réunion, 50 radios privées pour 830 000 habitants ; Wallis-et-Futuna, deux radios publiques et aucune radio privée pour 15 000 habitants ; Saint-Pierre-et-Miquelon, deux radios privées pour 6 000 habitants ; Saint-Barthélemy et Saint-Martin, douze radios privées ; Mayotte, enfin, reçoit quelques radios privées.
Pour la radio comme pour la télévision, ce tableau du paysage audiovisuel outre-mer présente une double inégalité entre la métropole et les outre-mer, d’une part, et entre les outre-mer eux-mêmes d’autre part.
Dans le domaine de la télévision, cette inégalité est flagrante dans l’offre de chaînes gratuites ainsi que dans le passage à la haute définition (HD), qui a été réalisé en métropole au mois d’avril dernier.
L’offre outre-mer de la TNT gratuite est inférieure à celle de métropole, avec huit à onze chaînes d’un côté contre vingt-six de l’autre, peut-être bientôt vingt-sept si la chaîne d’information continue de France Télévisions voit le jour. J’ai d’ailleurs demandé à Delphine Ernotte qui, le cas échéant, devrait diriger cette chaîne, si ses programmes seraient diffusés outre-mer.
Cet écart n’est pas conforme à ce que l’on était en droit d’attendre de la télévision numérique terrestre puisque l’article 105 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que : « Avant le 1er juillet 2007, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les modalités de développement de la télévision numérique dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie formulant des propositions relatives à la mise en place d’une offre de services nationaux gratuits de télévision identique à la métropole… » Nous constatons que cette offre identique n’est pas réalisée.
Ce rapport au Parlement, réclamé à l’époque par la ministre de la culture, Mme Christine Albanel, et le secrétaire d’État à l’outre-mer, M. Christian Estrosi, a été confié à mon prédécesseur au CSA, Alain Méar. Il préconisait le déploiement de la TNT en trois étapes.
La première étape, franchie dès 2010, consistait à mettre en place un premier multiplex comportant dix chaînes opérées par France Télévisions, dont sept à huit devaient être publiques, elles sont aujourd’hui au nombre de huit : celles de France Télévisions, d’Arte et de France 24 ; auxquelles se sont ajoutées quelques chaînes privées.
La deuxième étape devait être celle du lancement d’un deuxième multiplex, lui aussi opéré par France Télévisions, incluant les autres chaînes locales, de nouveaux projets locaux ainsi qu’une ou deux chaînes publiques en haute définition.
La troisième étape devait consister en un appel à candidatures pour un troisième multiplex comprenant des chaînes nationales.
Aucune des deux dernières étapes n’a été franchie ; il existe donc aujourd’hui deux multiplex à la Martinique et en Guadeloupe, partout composés d’au moins huit chaînes publiques et d’une à trois chaînes privées – Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna ne recevant aucune chaîne privée.
Toutes les chaînes de la TNT diffusées à partir du multiplex installé en 2010, appelé Réseau outre-mer (ROM 1), le sont en SD – acronyme de standard definition – ; l’offre de chaînes outre-mer n’est pas identique à celle de la métropole, et la diffusion en haute définition n’y est pas disponible. Cela signifie que les ultramarins n’ont pas accès à TF 1, Canal Plus en clair, D 8, W 9, TMC, NT 1, Énergie 12, BFMTV, I-Télé, D 17, LCI, Gulli, HD 1, l’Équipe 21, 6 ter, Numéro 23, ni même à La Chaîne Parlementaire.
Pour pouvoir regarder ces chaînes, les ultramarins doivent s’abonner aux bouquets des offres payantes comme Canalsat, Numericable, Vini en Polynésie ; ce qui revient à dire qu’ils doivent payer pour des programmes que les métropolitains peuvent voir gratuitement alors que leur pouvoir d’achat est supérieur à celui des habitants des outre-mer. À mes yeux, cette situation constitue une inégalité choquante.
L’idéal serait que l’offre de télévision gratuite soit la même en métropole et en outre-mer, mais sa réalisation se heurte à plusieurs difficultés. La première réside dans les réserves exprimées par les chaînes locales qui achètent et diffusent gratuitement sur la TNT une partie des programmes de TF1 et M6, ces deux chaînes n’étant pas disponibles en accès gratuit. La seconde procède du coût que représenterait le transport du signal de ces chaînes nationales gratuites outre-mer : il fait reculer les opérateurs relevant du secteur privé qui redoutent de ne pas trouver localement la manne publicitaire suffisante pour amortir leurs investissements.
Par définition, il n’est pas possible de contraindre ces chaînes à diffuser leur programme dans l’offre TNT ; certaines, toutefois, envisagent cette possibilité, particulièrement celles qui ne sont pas susceptibles de concurrencer les chaînes locales. Ainsi, lorsque M. Nonce Paolini, alors président du groupe TF1, est venu défendre le passage de LCI en diffusion gratuite sur la TNT en métropole, je lui ai demandé – c’était un peu un piège - s’il envisageait cette distribution pour toute la France. Sa réponse a été positive. Je lui ai donc indiqué que je serais en mesure d’annoncer aux ultramarins qu’ils pourraient voir LCI gratuitement ! La question a été mise à l’étude par le groupe, et M. Gilles Pélisson, qui en est l’actuel président, m’a indiqué que la réflexion se poursuivait.
Une autre inégalité réside dans la différence de qualité de l’offre : alors que toutes les chaînes de la TNT sont diffusées en haute définition en métropole, seules deux chaînes le sont en Guadeloupe à partir d’un duplex. Il n’y a pas de place dans les multiplex existants pour le passage de la haute définition, qui nécessite une bande passante supplémentaire : il faudrait ouvrir un nouveau multiplex, et le surcoût de l’opération est évalué à 40 % du coût actuel.
Par ailleurs, Mme Delphine Ernotte a indiqué au CSA que la diffusion outre-mer de la chaîne d’information continue actuellement envisagée, qui pourrait s’appeler France Info, n’était pas prévue – cette chaîne serait alors la seule du groupe France Télévisions dans ce cas – mais qu’en revanche elle serait prête à passer à la haute définition.
Je l’ai déjà souligné : le rôle de la radio est probablement plus prégnant outre-mer que celui de la télévision puisque la durée d’écoute en métropole est d’environ un peu moins de trois heures par jour, contre trois heures vingt à La Réunion, et de quatre heures à quatre heures et demie aux Antilles.
La Nouvelle-Calédonie mise à part, le nombre de chaînes de radio est à peu près satisfaisant, bien que des radios nationales privées et publiques manquent encore, comme RTL et Europe 1 ; une partie de leur programme est toutefois reprise par des chaînes locales privées. Par ailleurs, France Inter mis à part, France Culture, France Musique, FIP, Le Mouv’ et France Info ne sont pas diffusées outre-mer ; le cas de France Bleu est particulier puisqu’il s’agit d’une chaîne d’échelon régional de la métropole, qui est en quelque sorte remplacée par les chaînes du réseau Outre-mer 1ère.
Il n’est, en outre, pas possible d’augmenter indéfiniment le nombre des chaînes privées sans perturber le marché publicitaire local, qui connaît les mêmes difficultés que le marché publicitaire métropolitain ; il faut, par ailleurs préserver les radios existantes dont la publicité constitue l’unique source de revenus.
Reste le cas de la Nouvelle-Calédonie où le nombre de stations de radio demeure beaucoup plus faible que dans le reste de l’outre-mer, puisqu’en dehors du service public, avec Nouvelle-Calédonie Radio et France Inter, il n’existe que quatre radios privées autorisées. Quelque huit radios y sont aujourd’hui autorisées, dont quatre émettent des programmes distincts, les quatre restantes étant des radios dites « petites sœurs » des deux plus importantes radios néo-calédoniennes. Radio Rythme Bleu (RRB) – considérée comme anti-indépendantiste – a ainsi deux « petites sœurs » émettant exactement les mêmes programmes, Radio Baie des Tortues et Fréquence Nord ; réputées indépendantistes, les deux autres stations n’émettent pas. Seules quatre radios sont donc réellement présentes, dont trois sont généralistes, la dernière, filiale du groupe NRJ, étant une chaîne musicale.
Le problème de la ressource de fréquences ne se pose pas outre-mer comme en métropole où il n’y a pratiquement plus de place disponible en bande modulation de fréquence. Conformément à la loi, le CSA a lancé une consultation publique en vue d’un appel à candidatures en Nouvelle-Calédonie le 7 juin dernier ; une étude d’impact devra en outre être réalisée. Nous souhaitons diversifier l’offre de radio dans l’archipel, avec des stations d’un format autre que généraliste : la seule chaîne musicale étant NRJ, il pourrait y avoir une chaîne diffusant du jazz ou de la musique classique, ce que font des radios associatives à La Réunion et en Guyane. Il est assez saisissant d’entendre une station diffuser de la musique classique au fond de la jungle, je me souviens, après avoir fait cette suggestion, de m’être pris pour Fitzcarraldo construisant un opéra à Manaus…
La Nouvelle-Calédonie ne dispose pas de radios associatives, et il serait bon que de telles stations soient implantées dans les territoires les plus reculés comme les îles Loyauté. Je rappelle que les radios associatives peuvent être financées par les communes, mais aussi par l’État, par l’intermédiaire du fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER), qui dépend de la direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC), donc du ministère de la culture et dispose de 29 millions d’euros pour ces radios. À l’occasion de mes déplacements, je constate régulièrement que l’existence de ce fonds est méconnue ; de son côté, le fonds de soutien lui-même ne s’empresse pas de rappeler qu’il peut aider à l’installation ainsi qu’à l’exploitation de radios associatives…
L’ensemble de ces inégalités est susceptible de donner aux ultramarins le sentiment de « ne pas être des Français à part entière, mais des Français entièrement à part », selon la formule d’Aimé Césaire ; en tout état de cause, le fait est manifeste dans le domaine de l’audiovisuel.
Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna mis à part, une à trois chaînes de télévision privées sont toujours présentes dans les territoires d’outre-mer ; elles rencontrent des difficultés, car elles sont tributaires de la manne publicitaire. Par ailleurs, elles trouvent devant elles le géant France Télévisions, le réseau Outre-mer 1ère ayant pour sa part largement les moyens de financer des programmes. Cette concurrence est parfois jugée déloyale par les télévisions privées locales, nous l’avons constaté à l’occasion de la Coupe du monde de football : jusqu’en 2014, cet événement très populaire était retransmis par les chaînes privées qui achetaient les droits de diffusion à TF. En 2014, le groupe TF1 a mis ses droits aux enchères, et ce sont les chaînes du réseau Outre-mer 1ère quiles ont acquis, alors qu’auparavant, ces droits revenaient automatiquement aux chaînes privées.
La situation peut sembler singulière puisque c’est avec l’argent de ce que l’on appelait la redevance que le service public rachète des droits de diffusion à TF1.
Les chaînes de télévision privées ont ainsi été fragilisées. Le même problème s’est posé en 2014 avec l’élection des Miss, jusque-là diffusée par des chaînes privées ultramarines ; le réseau Outre-mer 1ère a racheté les droits de ce programme. La situation est délicate car, avec sa force de frappe, le groupe France Télévisions pousse ces chaînes privées à la disparition : la plupart d’entre elles connaissent aujourd’hui les plus grandes difficultés, quand elles n’ont pas déjà mis un terme à leur activité. À terme, le paysage audiovisuel ultramarin risquerait de revenir à ce qu’il était à l’époque de l’Office de radiodiffusion-télévision française (ORTF) ; c’est pourquoi il me semble important de maintenir une saine concurrence entre les télévisions publiques et privées outre-mer.
Il faut donc avoir conscience que ces chaînes locales ont du mal à vivre dans un contexte de marchés publicitaires restreint d’où provient pourtant le plus clair de leurs ressources, et que, pour demeurer, elles devront mutualiser leurs programmes. Antenne Réunion donne l’exemple d’une chaîne ultramarine privée prospère, dont l’audience dépasse celle de Réunion 1ère. De son côté, la chaîne ATV, présente en Guyane, à la Martinique, et, par le satellite, en Guadeloupe, dispose d’un bassin publicitaire et de population regroupant les 400 000 habitants de la Martinique, les 400 000 habitants de la Guadeloupe, ainsi que les 250 000 habitants de la Guyane, soit l’équivalent de la population de La Réunion.
La rédaction du rapport du CSA au Parlement sur les télévisions ultramarines est en cours, et Mme Monique Orphé, députée de La Réunion, l’a déjà réclamé. J’attends la communication de données concernant divers sujets comme l’évolution de l’audience des chaînes de la TNT ; les parts d’audience des distributeurs payants, qu’il s’agisse du câble, du satellite ou de l’ADSL, en comparaison avec la TNT gratuite ; les marchés publicitaires locaux ; la production locale. La question du coût réel du transport et de la diffusion de la TNT pour chaque territoire selon les particularités de chacun d’entre eux n’est, par ailleurs, pas à négliger. Je pense à la Polynésie, dont l’étendue est équivalente à celle de l’Europe, ou aux difficultés posées par le relief de La Réunion, qui exige un nombre important de réémetteurs.
Le rapport alimentera la réflexion avant que ne soient envisagés les moyens propres à faire disparaître les inégalités que j’ai évoquées, ainsi qu’à garantir une concurrence saine entre les secteurs public et privé.
Je me tiens à votre disposition si vous avez besoin de précisions supplémentaires.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Merci pour cet exposé très complet qui a permis aux membres de la délégation d’avoir une vision d’ensemble du paysage audiovisuel des territoires ultramarins, car chacun d’entre nous n’en possède bien souvent qu’une perception partielle.
C’est d’ailleurs l’un des objets de nos travaux que de faire progresser la connaissance de l’ensemble des départements, collectivités et territoires, certes chez les députés ultramarins, mais surtout, chez les élus de la métropole. C’est la raison d’être de notre délégation aux outre-mer.
C’est avec beaucoup d’intérêt que j’ai entendu vos réflexions, un mot me frappe toutefois : celui d’« inégalité ». Ces différences de traitement sont incontestables dans les domaines de la qualité et de l’importance de l’offre audiovisuelle ; cela sonne faux à l’heure où nous aspirons à la réalisation de l’égalité réelle.
À cet égard, nous sommes fiers que ce soit l’une des nôtres, Mme Éricka Bareigts, élue de Saint-Denis de La Réunion, qui occupe les fonctions de secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité réelle.
Mme Maina Sage. Merci pour ce panorama détaillé du paysage audiovisuel dans nos territoires ultramarins.
Je prends acte de votre préoccupation d’améliorer l’accès à l’offre nationale et à la TNT, ainsi que, sur le plan de la qualité, le passage à la haute définition. Il faudra cependant prendre en compte les difficultés que cela représente en termes de coûts et d’investissements. Je suis ces questions de près, car je siège au conseil d’administration de la chaîne Tahiti Nui TV (TNTV) depuis 2008, à ce titre je connais bien la problématique des chaînes dites « privées ».
Comme vous l’avez indiqué, il s’agit de « télés pays », dont certaines sont privées et d’autres non, ce qui, à mes yeux, est le cas pour TNTV, société d’économie mixte (SEM) financée pour la plus grande part par le territoire. Il s’agit donc de fonds publics accompagnant une politique publique, et dépendant d’un ministère local. J’ai souvent été témoin des difficultés résultant de l’hybridité du statut de ces chaînes de télévision, qui sont soit réputées publiques, comme celle du bouquet proposé par le groupe Outre-mer 1ère, ou « parapubliques », comme TNTV, car ces chaînes doivent trouver elles-mêmes une part de leurs ressources ; or la manne publicitaire se raréfie.
Si aujourd’hui ces différentes chaînes entretiennent des relations conflictuelles, c’est en partie parce que le groupe Outre-mer 1ère doit, lui aussi, se procurer des recettes, situation qui pousse les protagonistes à améliorer la qualité de la réception, grâce à la haute définition, mais aussi celle des grilles de programmes. La question est donc posée, y compris sur le plan national, de l’opportunité même de la présence de chaînes publiques ainsi que de leur objet.
Les bouquets proposés par le secteur public multiplient les chaînes spécialisées dans des domaines particuliers : nous arrivons aujourd’hui à quasiment vingt-six chaînes en Métropole. Avec huit à onze chaînes outre-mer, le mouvement naturel est de vouloir réduire les inégalités et fournir l’ensemble du bouquet : mais à quel prix pour le marché local de l’audiovisuel cela se fera-t-il ?
Le contexte n’est plus le même, les relations locales étaient saines autrefois, mais l’augmentation des demandes nationales a créé des situations très conflictuelles. Je comprends cependant le groupe Outre-mer 1ère, qui a besoin de se positionner, de faire du chiffre et d’obtenir des résultats afin de justifier son existence. Des menaces existent à l’échelon national, qui ont entraîné ces situations ; par ailleurs, une logique de groupe est à l’œuvre, et ce qui s’est passé à La Réunion a eu des conséquences dans nos territoires, dans nos relations avec des chaînes qui sont dites locales et privées alors que, dans les faits, elles ne relèvent pas du secteur privé.
Il m’est revenu que le service public – Outre-mer 1ère – souhaite sortir de cette relation de compétition entre chaînes publiques pour construire des partenariats et trouver une entente au profit des usagers, qui, sinon, risquent d’être lésés.
Dans ce contexte, je demeure prudente : le passage à la HD n’est pas sans péril, et le mieux peut être l’ennemi du bien ; nous avons estimé le coût de l’opération pour TNTV, que j’ai alertée en début d’année. Il y aura aussi un impact sur les territoires autonomes en matière de télécommunications, dont la Polynésie française, qui préserve l’équilibre du groupe Office des postes et télécommunications (OPT) avec ses filiales exerçant des activités payantes en revendant un bouquet de droit privé.
L’un des objectifs recherchés est que l’usager puisse bénéficier de chaînes gratuites, mais vous l’avez dit vous-même : ces opérateurs que l’on ne peut pas contraindre viendront-ils en Polynésie ? Seront-ils disposés à payer pour être présents dans le nouveau bouquet TNT étoffé outre-mer ?
Si je comprends la démarche, il n’en faut pas moins mesurer les enjeux et les conséquences pour les territoires concernés. D’autres solutions existent et d’autres situations pourraient être débloquées : c’est le cas de Télédiffusion de France (TDF), du signal que nous devons toujours payer, des obligations auxquelles les chaînes locales sont statutairement astreintes et des plages horaires…
Ces évolutions lourdes risquent donc de se révéler contreproductives.
Je souhaiterais par ailleurs que soit posée la question de fond : qu’attendons-nous des chaînes publiques dans nos territoires ? Je sais qu’une réorganisation est en cours sur le plan national, et cela est une bonne chose. Sur le plan local, il serait bon de faire évoluer notre chaîne publique nationale rediffusée par le réseau Outre-mer 1ère, car se borner à faire de l’audience serait manquer le but.
Enfin, le paysage radiophonique est émaillé de profondes disparités en fonction des territoires considérés. J’ai participé à la relance d’une radio associative en Polynésie et à la création d’une autre, ce qui m’a conduit à soutenir le dossier devant le comité technique radiophonique (CTR).
Si les aides du FSER sont effectivement mal connues, il me semble qu’un accompagnement au montage des dossiers devrait être organisé, car, vous l’avez relevé, il s’agit parfois d’associations très éloignées du cœur de l’archipel qu’est Papeete, et il me semble que cette situation se retrouve dans d’autres territoires. Les dossiers sont très lourds à constituer, ce à quoi s’ajoute la pression ressentie lors du passage devant le jury ; il faut aider les associations concernées à accéder à ces fonds publics. Certaines contraintes devraient être levées, telles les obligations de remplir des quotas. Car le contexte est différent outre-mer : si l’on veut qu’une chaîne ait du succès, il faut pouvoir diffuser de la musique locale, et les quotas de chansons d’expression françaises peuvent constituer un handicap.
De même la classification des radios en A, B et C doit être établie avec prudence, ainsi, si la catégorie A présente des avantages, la catégorie C peut être préférable, car la grille de programme imposée peut ne pas correspondre à un équilibre économique. La tentation est alors de renoncer à la catégorie A, en dépit des aides auxquelles elle ouvre droit, au profit de la catégorie C, dont la grille de programmes est plus souple ; car les perspectives de commercialisation et de levée de recettes sont meilleures.
Je souhaite encore signaler que le prochain rapport bisannuel de la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer (CNEPEOM) sera consacré à la culture outre-mer. Je travaille sur ce sujet avec notre collègue Olivier Marleix ; nous entendons de nombreux acteurs de la culture entendue au sens large, et, dans ce cadre, je vous recevrais avec plaisir.
M. Patrice Gélinet. Le rapport devrait être prêt au début de l’automne prochain ; j’ai d’autant plus hâte que, comme vous l’avez rappelé, monsieur le Président, mon mandat au CSA échoit au mois de janvier 2017.
Par ailleurs, je vous ai fait part des précautions à observer avant d’étendre l’offre gratuite outre-mer : encore une fois, je suis très choqué de voir les ultramarins payer pour voir des programmes diffusés gratuitement en métropole, particulièrement au regard des différences de pouvoir d’achat.
S’agissant des radios, c’est avec raison que vous avez souligné que le FSER est méconnu, je l’ai constaté aux îles Marquises, à La Réunion et en Nouvelle-Calédonie, où d’ailleurs, la question ne se pose même pas puisqu’il n’y a pas de radio associative dans l’archipel. Si ce fonds de soutien était mieux connu des associations, il y aurait peut-être plus de créations de stations de radio.
À Paris, nous sommes loin des outre-mer ; il faut se déplacer afin de prendre conscience de la réalité des choses. Au demeurant, des représentants du CSA sont présents dans tous les départements de France sans exception, à travers les comités territoriaux de l’audiovisuel (CTA). Leur rôle n’est pas négligeable : ils ont une mission d’accompagnement, et je leur ai demandé à tous, notamment à celui de Polynésie - qui, comme c’est souvent le cas, est présidé par le président du tribunal administratif, et dont le secrétaire général est un membre du Haut-Commissariat de la République - de prendre contact avec les associations afin de les aider dans des démarches qui sont d’une complexité rare.
Il est vrai qu’il y a de quoi être découragé, mais, si elles sont aidées par les CTA, il n’y a aucune raison pour que les associations ne bénéficient pas des subsides versés par le FSER. Je ne suis pas assuré que l’État sera ravi de satisfaire plus de demandes, car le fonds fonctionne avec une enveloppe fermée de 29 millions d’euros, qui n’a pas évolué depuis trois ans.
Quant aux quotas de chansons d’expression française, je rappelle qu’ils incluent les langues régionales, et cela est aussi vrai en métropole qu’outre-mer ; et je n’ignore pas le succès que rencontre en Polynésie la chanson tahitienne ou marquisienne. Mais de quelle radio vous êtes-vous occupée, madame Sage ?
Mme Maina Sage. De Taui FM, qui diffuse une partie des programmes de RTL.
M. Patrice Gélinet. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, existe une commission qui se réunit une fois par an, tantôt à Paris, tantôt à Nouméa ou Papeete ; c’est l’occasion d’échanger avec le Gouvernement sur tous les problèmes, et je mets ces déplacements à profit pour visiter le plus possible de radios. J’ai ainsi été le premier membre du CSA à visiter Radio Bora-Bora, qui couvre l’ensemble des îles Sous-le-Vent ; j’y ai été reçu par le maire de Bora-Bora, qui a souligné que j’étais le seul membre du Conseil à m’y être déplacé.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Merci encore pour cette présentation très complète. Nous prendrons connaissance de votre rapport avec beaucoup d’attention, et j’espère qu’il saura trouver sa traduction dans le projet de loi sur l’égalité réelle…
M. Patrice Gélinet. Je dois rencontrer bientôt M. Victorin Lurel, ancien ministre chargé des outre-mer ; j’ai été surpris à la lecture de son rapport sur l’égalité réelle outre-mer, qu’il a récemment remis au Premier ministre, de constater que l’audiovisuel est absent de la problématique.
Mme Maina Sage. J’ai appris récemment que des travaux étaient en cours au sujet de la grille des radios nationales afin de favoriser la promotion de la diversité…
M. Patrice Gélinet. Cela fait partie des missions du CSA ; la chaîne France Ô, qui est diffusée sur la TNT gratuite en métropole et outre-mer, et constitue en principe la chaîne représentant les territoires ultramarins, et les chaînes du réseau Outre-mer 1ère vont être placées sous l’autorité de la même personne. Jusqu’à présent les deux chaînes s’ignoraient, on aurait pu attendre d’elles que chacune reprennent des programmes de l’autre, or elles ne le font que très peu. À l’avenir, une harmonisation va se faire jour sous la direction de Walles Kotra, qui a été mis à la tête de ce nouveau groupe.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Merci pour vos propos, monsieur Gélinet.
D. AUDITION DE M. DANIEL CARCEL, DIRECTEUR DE L’AGENCE DE PROMOTION ET DE DIFFUSION DES CULTURES DE L’OUTRE-MER
(Séance du 29 juin 2016)
M. le président Jean-Claude Fruteau. Mes chers collègues, l'ordre du jour de notre réunion comporte en premier point l'audition du directeur de l'Agence de promotion et de diffusion des cultures de l’outre-mer. Créée il y a déjà trois ans, cette agence s'est mise progressivement au travail sous la présidence de M. Greg Germain que j'avais convié à venir nous en exposer l’histoire, le parcours et les projets.
L'Agence a été créée à la fois pour faciliter la création culturelle ultramarine, pour en accompagner la diffusion et pour aider au développement des projets de coopération culturelle entre les outre-mer, entre les outre-mer et la métropole, entre les outre-mer et l'international. Elle est compétente pour l'ensemble des outre-mer français, quel que soit leur statut constitutionnel. Mais l'adhésion à l'Agence se fait en vertu de décisions autonomes des assemblées délibérantes des différentes collectivités.
Un empêchement de dernière minute ne permettant pas à M. Germain de venir devant notre délégation, c'est le directeur de l'Agence, M. Daniel Carcel – un Réunionnais – qui va, s'il le veut bien, développer devant nous ces trois points. Il peut, bien entendu, en aborder d'autres s'il le juge opportun.
Je ne doute pas qu'il le fasse avec toute la compétence nécessaire, car il accompagne le développement de l'Agence et l'action de son président depuis 2013, c'est-à-dire quasiment depuis les débuts de l'aventure. De surcroît, l’Agence a tenu son assemblée générale hier. M. Carcel a donc une vision claire, en tout cas récente, de son bilan et de ses projets. Je lui suis par avance reconnaissant de nous en faire profiter. C’est pourquoi je lui laisse maintenant la parole.
M. Daniel Carcel, directeur de l’Agence de promotion et de diffusion des cultures de l’outre-mer. Au nom du président Gerg Germain, je vous remercie de cette audition sur l'Agence de promotion et de diffusion des cultures de l’outre-mer. Nous accordons une grande importance à l’attention que portent les parlementaires, spécialement ceux de l’outre-mer, à ce nouvel outil construit au service de nos identités, de nos patrimoines et de nos cultures.
À l’intérieur de ce périmètre de mission que l’on nous a confié, nous avons à intervenir dans les domaines du patrimoine, du cinéma et de l’audiovisuel, de la littérature et de l’édition, du spectacle vivant et de la musique, des arts plastiques. Nous avons donc la tâche d’aider les acteurs de tous les secteurs culturels, dans tous les territoires d’outre-mer, quelle que soit leur forme institutionnelle. Nous travaillons pour les douze territoires d’outre-mer, y compris les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) qui accueillent des résidences d’artistes, qui produisent des ouvrages dont l’un a été présenté cette année au salon du livre de Paris, et qui organisent régulièrement des expositions. La vie culturelle va jusque dans ces territoires très lointains.
Cinq collectivités sur douze ont déjà adhéré à l’Agence et siègent à son conseil d’administration pour nous aider à la construire et à la faire avancer : le conseil général de La Réunion, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le conseil régional de Guadeloupe, le gouvernement de la Polynésie française et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Comme vous le voyez, toutes les formes de territoires sont déjà présentes.
Mme Chantal Berthelot. La Guyane n’a pas adhéré ?
M. Daniel Carcel. Non. À l’époque où nous avons proposé à la Guyane d’adhérer, la fusion de la région et du département était imminente. Ils ont préféré attendre que cette nouvelle collectivité soit opérationnelle et qu’elle devienne notre interlocutrice par la suite, ce qui peut se comprendre.
Mme Chantal Berthelot. On va dire que c’est une adhésion en attente.
M. Daniel Carcel. C’est cela ; ils nous ont demandé d’attendre un peu.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Il faut un aiguillon pour stimuler !
M. Daniel Carcel. Notre mission est d’apporter plus de visibilité aux productions ultramarines, à nos créations qui peuvent être des spectacles, des œuvres, des documentaires, des livres. Il s’agit de promouvoir ces créations dans les médias mais aussi par le biais de notre très beau site internet, Cultures outre-mer, qui est alimenté quotidiennement par toutes les informations culturelles qui arrivent des territoires. Outre ce site, une page Facebook et un compte Twitter nous permettent de relayer les informations sur les réseaux sociaux. Nous avons souhaité cette visibilité sur le monde numérique qui revêt une grande importance à notre époque.
Une fonction importante du site internet est de servir de centre de ressources pour les acteurs culturels ultramarins, qui y sont tous présentés, avec la description de leurs créations avec photos et petite vidéo s’il y a lieu. Nous renvoyons évidemment vers leur propre site internet quand ils en ont un. Ce centre de ressources a pour objectif de collecter en permanence des informations sur tous ceux qui s’investissent dans le secteur culturel, en les rendant faciles à identifier, même s’ils se trouvent en Nouvelle-Calédonie ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour qu’il soit très facile d’obtenir leurs coordonnées. Jusqu’à présent, il était très difficile d’identifier les troupes de théâtre de Nouvelle-Calédonie ou les groupes de musique de Polynésie française.
La vitrine, c’est l’actualité de nos territoires et aussi celle de la diaspora ultramarine de l’Hexagone, qui est très active et dont nous relayons les informations ultramarines. Outre ces fonctions de centre de ressources et de vitrine, le portail internet comporte aussi un outil à l’usage des professionnels : un annuaire avec les coordonnées de tous ceux qui s’intéressent à l’outre-mer – sans être forcément ultramarins. Cet espace est une plateforme de travail qui permet aux professionnels d’échanger des informations, de poster une annonce, de rechercher un coproducteur, un musicien pour tourner avec un groupe, etc. Nous avons passé du temps à construire cet outil destiné à la promotion.
Nous faisons aussi un travail de communication sur les grands marchés et événements internationaux comme le festival Babel Med Music de Marseille, ou le World Music Expo (WOMEX), un festival européen qui change de pays tous les ans. Nous sommes présents sur les grands marchés internationaux où nous accompagnons des artistes et des producteurs pour les aider à rencontrer des acheteurs et à diffuser leurs œuvres. Dans la plaquette que je vous ai remise, vous pourrez voir ce que nous avons fait au Sunny Side of the Doc à La Rochelle, où nous étions très récemment, et vous y trouverez les coordonnées de tous les producteurs et réalisateurs présents sous cette ombrelle outre-mer, c'est-à-dire dans le stand commun où nous avons réuni tout le monde. La présence sur les marchés internationaux est évidemment très importante pour la promotion de nos producteurs.
Nous faisons aussi un gros travail d’accompagnement des compagnies, des artistes et des équipes qui ont du mal à entrer dans les réseaux, en les recevant ou en communiquant avec eux par le biais d’internet. Ils sont souvent à la recherche de financements, notamment pour les transports, de partenaires pour coproduire un spectacle, un documentaire ou une exposition, de diffuseurs qui achètent ensuite leur création.
Telle est, rapidement résumée, l’action de l’agence.
Mme Chantal Berthelot. Merci, monsieur Carcel, pour la présentation de cette agence dont j’avais oublié la création, je l’avoue humblement. Peut-être l’oubli est-il lié au fait qu’il n’y a pas eu un bon contact au départ avec la représentation nationale. À présent, je me souviens de l’implication de Greg Germain dans les états généraux de l'outre-mer et de sa volonté de créer un outil de diffusion et de promotion des cultures ultramarines. Au moins, nous avons réduit la distance grâce à cette rencontre qui nous rafraîchit la mémoire.
Puisque l’assemblée générale s’est tenue hier, peut-être pourrez-vous nous tracer les perspectives de l’Agence ?
En voyant la brochure que vous nous avez donnée, je ne peux que me réjouir de la promotion d’un très bon documentaire sur la Guyane. La promotion de l’Agence s’effectue-t-elle dans les deux sens ? Autrement dit, aidez-vous les artistes ultramarins qui vivent et produisent dans l’Hexagone à venir présenter leurs créations dans nos territoires ? J’ai très souvent des demandes de cette nature, compte tenu du prix des billets d’avion et de leur poids dans les budgets.
M. Daniel Carcel. S’agissant de ces difficultés de circulation, la priorité a été donnée à ceux qui sont là-bas et qui veulent venir montrer leur travail ici, car ils ont vraiment du mal à accéder aux réseaux nationaux.
Cela étant, nous travaillons avec les artistes qui ont décidé de s’installer dans l’Hexagone, dont certains ont envie de retourner outre-mer pour y montrer leur production ou pour y monter des projets coopératifs avec des partenaires. Pour ces projets, que nous soutenons, nous avons des interlocuteurs dans les territoires d’outre-mer : les directions des affaires culturelles, services déconcentrés de l’État ; les services culturels des collectivités territoriales ; et des partenaires de diffusion. Ces interlocuteurs directs peuvent recevoir l’information sur les projets et éventuellement décider de les accueillir.
Pour le financement du déplacement d’un artiste ou d’une compagnie de l’Hexagone vers un territoire d’outre-mer, il existe un dispositif : le Fonds d'aide aux échanges artistiques et culturels de l'outre-mer (FEAC), cofinancé par le ministère de la culture et le ministère des outre-mer. Il y a donc des possibilités d’aller de l’Hexagone vers les outre-mer. De notre côté, nous soutenons avec beaucoup d’attention les projets coopératifs, qui se construisent avec une équipe ici et une autre là-bas, et qui permettent de profiter des deux réseaux. En nous efforçant de promouvoir ce mode de construction des projets, nous sommes dans notre rôle d’intermédiaire : nous voulons permettre aux artistes de se rencontrer.
Nos moyens ne nous permettent pas encore de développer des projets à l’international de façon très importante. Nous allons sur des marchés internationaux où les acheteurs viennent s’intéresser aux artistes qui font l’actualité dans les territoires d’outre-mer. Mais nos créateurs pourraient facilement avoir l’idée d’organiser des tournées, notamment dans leur zone régionale. Ceux de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française pourraient solliciter des aides pour aller en Nouvelle-Zélande, aux Îles Fidji, en Australie ou en Asie du Sud-Est. Nous n’avons pas les moyens, que ce soit en ressources humaines ou en financements, pour les accompagner.
De toute façon, il existe des fonds de coopération régionale, comme le Fonds Pacifique par exemple, pour faire avancer ce genre de projets de circulation à l’intérieur d’une zone. Il est vrai que peu d’opérateurs portent des projets culturels dans ce type de zones de coopération. C’est là où nous avons besoin de votre aide pour essayer de donner confiance et de faire avancer des opérateurs qui ont envie de construire des projets à une échelle comme la Caraïbe ou l'océan Indien. Comme il faut être un peu structuré pour construire ce type de démarche, l’accompagnement préalable consiste souvent en une structuration. Ces tournées sont compliquées à monter quand on n’a pas un minimum de fonctionnement administratif solide, une compétence interne. Dans nombre de projets que nous accompagnons avec nos interlocuteurs dans les territoires, nous avons souvent à faire face à un manque de compétences dans les domaines de l’administration ou de la production.
Des jeunes viennent se former ici et décident d’y rester. Il faudrait leur donner les moyens de repartir outre-mer pour mettre les compétences acquises ici au service des artistes de leurs territoires. Ce n’est pas facile actuellement compte tenu de la taille trop réduite du marché local.
Mme Gabrielle Louis-Carabin. En regardant votre document, je vois que divers festivals guadeloupéens sont mentionnés, notamment Terre de blues ou le Festival régional et international du cinéma de Guadeloupe (FEMI) qui n’est pas centré sur la région puisqu’il présente des films indiens ou canadiens.
M. Daniel Carcel. C’est un festival international.
Mme Gabrielle Louis-Carabin. Quand ces gens-là viennent chez nous, les collectivités participent à leur accueil. Pour Terre de blues, on fait venir des gens d’Afrique. Les acteurs culturels sont déjà ouverts sur l’international avec l’aide de la région, du département, des collectivités.
M. Daniel Carcel. Les collectivités jouent un rôle fondamental dans la structuration culturelle de leur territoire. Dans chacun des territoires, nous avons des interlocuteurs, plus ou moins importants. Les producteurs ou éditeurs dont l’activité est basée en outre-mer bénéficient d’un soutien important de la part de leur collectivité.
Mme Gabrielle Louis-Carabin. Bien souvent ce sont les services culturels. Nous recevons les responsables de la FEMI, du centre culturel Sonis, de la salle Robert Loyson, tous ces gens qui font un travail très important pour la culture.
M. Daniel Carcel. C’est vrai. Pour rebondir sur la remarque de Mme Berthelot, je dirais qu’en outre-mer, il est difficile de faire passer des artistes d’un territoire à l’autre. Étant de La Réunion, je remarque que peu d’artistes antillais y sont accueillis et réciproquement. Danyèl Waro a dû jouer une fois en Guyane pendant toute sa carrière. Il reste beaucoup à faire pour développer nos échanges internes car il y a des talents en Nouvelle-Calédonie qui ne demandent qu’à se produire dans les festivals de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion. Mais les distances représentent un obstacle.
Mme Gabrielle Louis-Carabin. Les transports coûtent cher.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Cinq collectivités sur douze ont adhéré à l’Agence, avez-vous dit, ce qui implique que sept d’entre elles ne l’ont pas fait. Je me souviens que le conseil régional de la Martinique avait invoqué l’existence d’instances qui lui étaient propres pour ne pas s’associer – en tout cas dans l’immédiat – aux premières activités de l’Agence. Quel est votre point de vue sur le sujet ? Qu’est-ce que l’Agence apporte de plus que les collectivités d’outre-mer ?
M. Daniel Carcel. Quand nous sommes allés en Martinique, une agence culturelle régionale était en cours de création et elle devait notamment avoir pour mission d’aider les artistes martiniquais à s’exporter. Les responsables nous ont dit qu’ils n’avaient pas besoin d’une agence nationale. Cependant, le directeur des services culturels nous a expliqué que l’agence régionale était dédiée en priorité au développement culturel local et que nos services pourraient être utiles pour aider à la diffusion des artistes martiniquais dans l’Hexagone ou à l’international. Il envisageait donc un partenariat entre les deux agences. Les élus de la nouvelle collectivité territoriale ont désormais une autre approche et les choses vont certainement évoluer.
Suite à l’assemblée générale d’hier soir, il a été décidé que notre agence conserverait son statut d’association puisqu’il n’y a pas assez de collectivités adhérentes pour porter le projet un peu lourd de création d’un établissement public de coopération culturelle (EPCC). Nos deux ministères de tutelle – celui de la culture et celui des outre-mer – nous ont annoncé hier soir leur volonté de poursuivre l’aventure de l’Agence sous une forme associative, et d’utiliser ses moyens pour travailler de façon plus étroite avec les acteurs de terrain, en leur apportant des aides plus directes. Nous devons notamment les aider à être présents sur les marchés internationaux car l’aide – significative – des collectivités reste insuffisante en la matière. Il faut des moyens pour se rendre, par exemple, au grand marché à Budapest ou au Marché des musiques de l'océan Indien (IOMMA - Indian Ocean Music Market) à La Réunion. Nous devons apporter une aide complémentaire aux équipes artistiques qui veulent vraiment aller vers leur zone de coopération et à l’international. Les collectivités d’outre-mer étant très bien situées dans leur zone régionale, nous devons déjà les aider à bien y circuler. Quant aux marchés internationaux, ils représentent des occasions de rencontres et d’achats.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Votre rapport d’activité de 2014 mentionnait divers partenariats avec des institutions et des réseaux professionnels, en vue de la diffusion des cultures ultramarines. Quel point d’étape pouvez-vous faire ? Combien d’accords ont-ils été formalisés d’une manière ou d’une autre ? Quelles sont leurs traductions concrètes ?
M. Daniel Carcel. Nous avons rencontré les grandes institutions : l’Institut français, le Bureau export de la musique française (Bureauexport), l’Office national de diffusion artistique (ONDA), la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (SPEDIDAM), la Société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes (ADAMI). Nous avons engagé des actions avec certaines d’entre elles, notamment les organisations professionnelles. Nous avons offert aux artistes des occasions de rencontre avec des institutions susceptibles de les aider, de leur apporter des subventions.
Les grands organismes étaient plutôt en attente de notre nouvelle structure puisque nous devions devenir un EPCC. Ils étaient désireux de nous rencontrer pour comprendre nos démarches et notre façon de travailler, mais ils attendaient la création de la structure définitive pour concrétiser. Nous allons certainement passer une convention avec l’ONDA et des accords avec le Bureauexport, le Bureau international de l'édition française (BIEF) et l’Institut français pour que des artistes des outre-mer entrent dans leurs programmes d’actions. Comme nous étions en train de construire une structure, ces interlocuteurs attendaient que nous ayons fini de poser nos fondations avant de s’engager.
Mme Gabrielle Louis-Carabin. Est-ce que vous accordez des subventions ?
M. Daniel Carcel. L’association de préfiguration n’a pas de compétence pour accorder des subventions ou des aides directes. À la demande des ministères, cette interdiction figure dans le procès-verbal établi lors de la première assemblée générale constitutive. Cette disposition va évoluer car elle nous bloque énormément : il est difficile de construire un partenariat sans apporter une contribution. Quand on construit un projet avec une équipe artistique et qu’on recherche des partenaires, on doit apporter quelque chose pour être crédible.
Mme Gabrielle Louis-Carabin. Si vous n’apportez pas de moyens financiers, vous pouvez être le relais au niveau des ministères de l’outre-mer et de la culture.
M. Daniel Carcel. C’est ce que nous avons fait jusqu’à présent : flécher des dossiers, insister sur la nécessité d’accorder une aide à tel ou tel groupe afin qu’il puisse, par exemple, participer au salon mondial du jazz de Brême. Nous avons fait un travail de lobbying et de réseau, mais pour construire des partenariats, nous devons avoir les moyens d’une politique incitative. C’est difficile si on n’a pas quelque chose à mettre dans la corbeille de la mariée.
Mme Chantal Berthelot. Quel est le montant de votre budget ?
M. Daniel Carcel. Chaque ministère nous apporte une subvention de 250 000 euros, ce qui veut dire que notre budget s’élève à 500 000 euros.
Mme Chantal Berthelot. J’ai vu que vous avez une équipe de trois personnes.
M. Daniel Carcel. Notre équipe, conçue dans la perspective d’un EPCC comptant douze territoires partenaires, va se réduire. Les ministères souhaitent que nous dégagions un budget d’intervention à partir des 500 000 euros dont nous disposons.
Mme Gabrielle Louis-Carabin. C’est une bonne chose que vous puissiez inciter des partenaires, même des collectivités, à se joindre à vous. Il faut que vous puissiez participer, ne serait-ce qu’à hauteur de 5 000 euros.
M. Daniel Carcel. En effet. Il faut être présent, même si la participation n’est pas très importante.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Au détour d’une phrase, vous avez parlé de la formation. L’Agence est-elle en mesure d’intervenir concrètement dans ce domaine ? Les groupes et les troupes peuvent avoir du talent mais néanmoins avoir besoin de formations qui leur permettront de s’exprimer davantage.
M. Daniel Carcel. D’être au niveau de leurs concurrents, tout simplement.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Avez-vous les moyens d’intervenir dans ce domaine ?
M. Daniel Carcel. Certains de nos interlocuteurs ont cette compétence : les directions des affaires culturelles en outre-mer et les services culturels des collectivités. De notre côté, nous avons mission d’identifier les manques, notamment en matière de diffusion. Comme je vous le disais, nombre d’artistes manquent de compétence en administration, qu’ils soient plasticiens ou qu’ils travaillent dans le spectacle ou la réalisation audiovisuelle. Ils ont souvent le talent et quelque chose à dire. Ils savent faire mais ils ne savent pas vendre. Il faut faire en sorte qu’ils aient cette compétence à leurs côtés. Cette compétence structurelle doit être présente sur le territoire, près d’eux, au quotidien. C’est ainsi que se construit une petite entreprise culturelle : un petit noyau administratif fait vivre des talents qui se réunissent. Si plusieurs équipes ont besoin d’un chargé de production, pourquoi ne pas mutualiser les moyens pour qu’ils puissent se partager un poste ? Un collectif de plasticiens, trois groupes de musique, plusieurs compagnies de théâtre peuvent entrer dans ce genre de logique. Notre rôle est de les y aider. Nous devons identifier les besoins et construire un projet avec le service culturel de la région, la direction des affaires culturelles (DAC) du territoire et l’Agence.
Quel type de formation faut-il apporter ? Tout dépend du projet. J’aimerais insister à nouveau sur le fait que des jeunes ultramarins, formés dans l’Hexagone à l’administration de compagnie ou d’autres métiers du même genre, ne rentrent pas outre-mer parce qu’il n’y a pas assez de travail pour qu’ils puissent en vivre. Nous pouvons apporter des réponses à ce problème, en faisant un travail de structuration. Par la mutualisation et la diversification, il est possible d’assurer un travail à mi-temps à une personne. Pouvant compter sur cette base pérenne, la personne peut ainsi décider de retourner en outre-mer où elle préfère vivre plutôt qu’à Paris.
Mme Gabrielle Louis-Carabin. Nous espérons que votre nouvelle orientation portera ses fruits.
M. Daniel Carcel. Quoi qu’il en soit, le fait que les ministères nous aient autorisés à organiser notre budget de manière à dégager des crédits d’intervention va beaucoup changer la donne.
Mme Chantal Berthelot. Pourrions-nous être destinataires des informations sur les manifestations que vous organisez ?
M. Daniel Carcel. J’ai demandé l’autorisation de pouvoir vous diffuser nos informations par courriel, afin que vous soyez au courant de l’avancée de nos travaux.
Mme Gabrielle Louis-Carabin. En voyant le nom de votre structure – Agence de promotion et de diffusion des cultures de l’outre-mer –, j’ai pensé qu’elle ne concernait que les Ultramarins qui sont ici. Ce n’est qu’en lisant votre documentation que j’ai compris qu’elle s’adressait aussi à ceux qui sont dans les territoires, et qu’elle permet des échanges.
M. Daniel Carcel. C’est exactement cela.
Mme Gabrielle Louis-Carabin. En plus, j’associais le nom de Greg Germain au cinéma.
M. Daniel Carcel. C’est aussi un homme de théâtre.
Mme Gabrielle Louis-Carabin. C’est un homme de culture.
M. Daniel Carcel. En effet. Ce projet lui tient vraiment à cœur et je suis très heureux de pouvoir l’accompagner comme, du reste, tous les membres du conseil d’administration. Au sein de ce conseil, siègent des personnalités qualifiées comme la journaliste Marie-Josée Alie-Monthieux, l’écrivain Daniel Picouly ou Michel Colardelle qui a été directeur des affaires culturelles de Guyane. Je travaille avec ces personnalités qui nous accompagnent pour faire avancer ce projet. Nous prenons une nouvelle orientation, après avoir tiré les leçons de l’expérience passée, et nous continuons à avancer avec le soutien de nos deux ministères de tutelle.
M. le président Jean-Claude Fruteau. C’est un nouveau défi qui s’offre à vous.
M. Daniel Carcel. Absolument !
M. le président Jean-Claude Fruteau. Vous en parlez avec tellement de passion et de conviction, que je suis persuadé que vous allez réussir.
M. Daniel Carcel. Je vous remercie vraiment pour ce bon augure.
M. le président Jean-Claude Fruteau. C’est moi qui vous remercie au nom de la Délégation. J’ai trouvé cette rencontre enrichissante car je n’étais guère plus informé que mes deux collègues des activités de l’Agence. Les autres membres de la Délégation – vingt-sept députés ultramarins et une quarantaine de députés des circonscriptions métropolitaines – pourront prendre connaissance du compte rendu de l’audition. Je rappelle que la mission de cette délégation, voulue par le président Bartolone, est d’éclairer les autres députés sur les problématiques de l’outre-mer.
M. Daniel Carcel. Je suis totalement en phase avec vous puisque l’Agence vise à défendre nos patrimoines et nos expressions culturelles, et de renforcer leur voix au sein du concert de la nation.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Merci encore, monsieur le directeur.
A. AUDITION DE M. MARCEL DORIGNY, HISTORIEN, ET DE M. NICOLAS ROINSARD, SOCIOLOGUE, À L’OCCASION DU 70ÈME ANNIVERSAIRE DE LA DÉPARTEMENTALISATION
(Séance du 30 mars 2016)
M. le président Jean-Claude Fruteau. Il y a soixante-dix ans et onze jours, la loi du 19 mars 1946 érigeait en départements la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion. Le rôle de la Délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale étant d’attirer l’attention de la représentation nationale sur les particularités de nos territoires, j’ai souhaité qu’elle participe, dans l’exercice de ses compétences, à l’évocation de cet anniversaire.
Soixante-dix ans donc après la disparition du statut colonial dans ces quatre départements, il est important que l’on se pose les questions suivantes : Le passage de la colonie au département a-t-il été l’instrument d’une réelle émancipation ? S’est-il agi au contraire d’une simple substitution de vocabulaire, laissant subsister les anciens rapports de domination ? Ou la vérité se situe-t-elle entre ces deux positions extrêmes et, le cas échéant, où placer le curseur ?
Pour nous aider à répondre à ces questions, nous avons fait appel au concours d’un historien et d’un sociologue. Monsieur Marcel Dorigny, vous êtes maître de conférences en histoire à l’Université de Paris VIII, et vous représentez la Société française d’histoire des outre-mer – anciennement société d’histoire des colonies françaises, fondée en 1912. Vous avez axé vos recherches sur l’histoire de l’esclavage et des Antilles depuis le XVIIIe siècle, et vous ne manquerez pas de nous aider à resituer les enjeux de la départementalisation dans une perspective historique de long terme.
Monsieur Nicolas Roinsard, vous êtes maître de conférences en sociologie à l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand et travaillez sur la transformation de la société à La Réunion et à Mayotte, entre permanences et évolutions.
M. Marcel Dorigny, maître de conférences en histoire à l’Université Paris VIII. La départementalisation de 1946 n’est en réalité pas la première mais la seconde, la première transformation des colonies en départements remontant à 1795 et à la Constitution de l’an III, première constitution républicaine appliquée en France, jusqu’au coup d’État de Bonaparte.
La Constitution de l’an III est extrêmement claire : il n’y a plus de colonies, mais des départements d’outre-mer. La départementalisation est radicale. Saint Domingue – aujourd’hui Haïti – est transformée en cinq départements ; les autres territoires, la Martinique, la Guadeloupe et ses dépendances, la Guyane, Saint-Louis du Sénégal, La Réunion, l’Île de France – l’actuelle île Maurice –, les Seychelles et les comptoirs de l’Inde également. Le mot colonie est proscrit et, à l’issue de la transformation de ces territoires en départements, la loi devient la même partout, de Paris au Calvados, jusqu’outre-mer : c’est l’isonomie républicaine.
Cette évolution, qui pourrait surprendre aujourd’hui, est la conséquence de l’abolition de l’esclavage quelques mois plus tôt, par la loi du 4 février 1794 - 16 pluviôse, an II, dans le calendrier républicain. Les révolutionnaires, en effet, pensaient – sans doute un peu naïvement – qu’en transformant les colonies en départements, ils rendraient impossible le retour de l’esclavage puisque, la loi étant la même partout, rétablir l’esclavage dans les îles aurait signifié pouvoir le rétablir dans les départements métropolitains. C’est la première tentative de constitutionnalisation du principe de la liberté générale. Reste que la loi n’a pas été appliquée partout, notamment à La Réunion, où les colons n’ont pas accepté, pas plus qu’à la Martinique, alors sous occupation anglaise.
Lorsque Bonaparte prend le pouvoir en 1799, après son coup d’État, il va rédiger une nouvelle constitution, la Constitution de l’an VIII, dont l’article 91 précise : « Le régime des colonies françaises est déterminé par des lois spéciales. » Ce dernier terme, s’il autorise, sans le nommer explicitement, le retour de l’esclavage, a aussi permis à Toussaint Louverture – ce que n’avait pas anticipé Bonaparte – de rédiger pour Saint-Domingue sa propre constitution, prélude à l’indépendance de l’île.
Le grand projet des révolutionnaires de 1795 qui avaient transformé les colonies en départements par souci d’égalité et d’uniformisation législative n’aura donc duré qu’un peu plus de cinq ans, Bonaparte choisissant d’imposer le retour à l’ancien système. Ce qui va caractériser, partant, notre longue histoire coloniale jusqu’en 1962, c’est la division législative entre la métropole et les colonies. Si l’Algérie est divisée en départements, leur contenu n’a rien à voir avec les départements métropolitains, et l’assemblée algérienne qui sera mise en place après la Seconde Guerre mondiale octroiera au million de Français d’Algérie et aux neuf millions d’indigènes le même nombre de députés, ce qui évidemment n’aboutit pas à la même représentativité.
L’idée d’isonomie républicaine étant morte, la loi n’est plus la même selon les lieux et selon les personnes. Il existe en Algérie un statut de l’indigénat qui va durer fort longtemps et, dans les colonies, alors même que le code civil est entré en vigueur en 1804, s’applique également le code noir, qui restera en application jusqu’au décret d’abolition de l’esclavage du 27 avril 1848, malgré son incompatibilité juridique avec le code civil.
Le statut colonial va perdurer, au moins juridiquement, jusqu’en 1946, date à laquelle, pour la seconde fois, les colonies seront transformées en départements. Il ne saurait être question en effet pour les constituants de 1946, empreints de l’esprit de la Résistance, pas davantage que pour les grandes figures de l’anticolonialisme que sont Raymond Vergès et Aimé Césaire, qui jouèrent un grand rôle dans le projet de départementalisation, de maintenir le statut colonial. À cette réserve près que la loi de départementalisation du 19 mars 1946 ne va s’appliquer qu’aux « anciennes colonies », c’est-à-dire aux territoires colonisés avant 1830 : ni l’AOF, ni l’AEF ni l’Indochine ne sont concernées.
Aux termes de la loi, la législation applicable en métropole le sera également dans les nouveaux départements d’outre-mer, c’est-à-dire à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane et à La Réunion – ainsi qu’à Mayotte depuis très récemment, mais Mayotte, du fait d’un droit coutumier très vivace, constitue un cas particulier.
Toute la question, soixante-dix ans après, est de savoir si cette départementalisation a porté ses fruits et contribué à l’intégration républicaine des anciennes colonies. La réponse est certes inégale selon les territoires et les populations concernées, mais il me semble que, dans deux domaines au moins, elle a constitué une avancée positive, je veux parler de l’aménagement du territoire mais surtout de l’éducation.
On peut certes spéculer sur le fait de savoir si cela aurait été le cas sans la départementalisation, mais il est indéniable qu’avec l’application des lois de la République, le niveau scolaire moyen s’est élevé dans les départements d’outre-mer. Il faut rappeler en effet que, jusque dans les années cinquante, malgré les lois Ferry, une très forte proportion de la population ultramarine n’était jamais allée à l’école, ainsi que le montre le documentaire Les 16 de Basse-Pointe, qui met en scène seize coupeurs de canne noirs inculpés d’un meurtre à la fin des années quarante, et dont aucun ne sait ni lire ni écrire.
Néanmoins, la départementalisation a posé un problème majeur à l’échelle macroéconomique. En effet, les départements d’outre-mer n’en appartiennent pas moins à l’Europe, dont ils appliquent la législation sociale et dont ils partagent la monnaie, l’euro, une monnaie forte, ce qui engendre des inégalités économiques considérables avec les territoires voisins, lesquels appartiennent au tiers-monde. L’exemple le plus flagrant en est l’économie du tourisme : ainsi, la première destination touristique des Caraïbes est-elle la République dominicaine, où les Français de métropole peuvent s’offrir deux semaines de vacances pour le prix d’un aller simple vers la Martinique.
Il faut donc être bien conscient que, si l’égalité juridique induite par la départementalisation peut incontestablement être considérée comme un progrès, elle a créé au plan local des difficultés qu’on ne doit pas sous-estimer.
M Nicolas Roinsard, maître de conférences en sociologie à l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. J’interviens donc ici en tant que sociologue, qui travaille depuis près de dix-huit ans sur la société réunionnaise et depuis trois ou quatre ans sur Mayotte, à partir d’enquêtes de terrain, qui permettent de mieux comprendre le mode de vie des populations. J’ai surtout travaillé sur les questions de pauvreté, de chômage et sur la mise en œuvre des politiques publiques.
Avec la départementalisation, le 19 mars 1946, des quatre « vieilles colonies », l’objectif de l’État français est de mener dans ces territoires d’outre-mer une politique de rattrapage, d’assimilation législative et de remise à niveau par rapport à la métropole. Il s’agit, pour reprendre les termes de l’époque, de rompre avec l’ère coloniale en s’assurant notamment que les indices économiques et sociaux de ces nouveaux départements d’outre-mer se rapprochent progressivement de la moyenne nationale.
La littérature spécialisée a tendance à beaucoup mettre en exergue les changements spectaculaires survenus dès lors, soulignant que La Réunion aurait, en cinquante ans, accompli ce qui avait demandé un siècle et demi à l’Europe, en termes de transition sanitaire, démographique et de développement.
Si l’on s’attache à tous les progrès réalisés au plan de la santé, du droit, de la couverture sociale, de la démographie, de l’instruction, de l’habitat et, plus largement, des infrastructures, on ne peut nier en effet que des changements spectaculaires se sont produits. De même, si l’on observe les transformations du paysage sociologique sous l’angle du passage d’une société traditionnelle et rurale à une société moderne dominée par une économie tertiaire, le constat d’une transformation radicale de l’organisation socio-économique est sans appel.
Cette transformation ne doit néanmoins pas masquer ce qui subsiste derrière le changement, et il convient de mettre en lumière, dans la lignée des travaux de Pierre Bourdieu, l’existence d’inerties qui participent d’une certaine forme de reproduction sociale. Ces inerties, on les retrouve en effet dans l’étude de la structure sociale, c’est-à-dire de la distribution des classes dans l’espace social des anciennes sociétés de plantations coloniales.
Si ces sociétés ont connu, à partir de la départementalisation, un changement majeur avec l’avènement d’une classe moyenne salariée alimentée par la multiplication des emplois publics – lesquels ont d’ailleurs d’abord profité aux métropolitains –, l’observation des strates supérieures et inférieures de la pyramide sociale montre que les groupes historiquement dominés et dominants sont demeurés les mêmes.
Cette réalité est objectivée par certains travaux réalisés à partir de sources statistiques et des indicateurs de l’INSEE, lesquels ont malheureusement leur limite puisque les statistiques ethniques sont interdites, alors que la division sociale dans les colonies correspond souvent à une division raciale.
Il suffit alors pour pallier la défaillance de ces indicateurs d’observer ce qui se passe dans la rue. Je pense ici aux durs conflits sociaux qu’ont connus les cinq DOM au cours de ces dernières années. Largement couverts par les médias nationaux, ces conflits dénoncent invariablement la vie chère dans les outre-mer, où les prix à la consommation sont en moyenne de 20 à 30 % supérieurs à ceux de la métropole.
Pour autant, cette contestation sociale outre-mer ne saurait être appréciée à sa juste valeur en ne considérant que la question de la vie chère. Cela apparaît clairement avec le mouvement contre la profitation qui a secoué les Antilles début 2009, en aval d’un mouvement démarré en Guyane en 2008, et qui s’est ensuite propagé à la Réunion en mars 2009, sans parler des quarante-quatre jours de grève qu’a connus Mayotte en 2011. Aux Antilles, le débat social s’est ainsi rapidement focalisé sur la question des inégalités et notamment sur la reconduction des positions de dominants et de dominés dans l’espace social. Cette conflictualité interroge en pointillé les promesses égalitaires et républicaines de la départementalisation, et il n’est pas anodin qu’il ait fallu rebattre les cartes lors des états généraux de l’outre-mer.
Soixante-dix ans après la départementalisation, et pour reprendre les mots, visionnaires et désormais célèbres, d’Aimé Césaire, les sociétés d’outre-mer demeurent des départements à part davantage que des départements à part entière.
Cette singularité des outre-mer dans l’espace national se mesure, d’une part, par le poids des inégalités internes à ces sociétés, inégalités aggravées par un chômage de masse, et, d’autre part, par le poids des inégalités externes, dans la mesure où tous les indicateurs de vulnérabilité – seuil de pauvreté, taux de chômage, recours aux minima sociaux ou à la CMU – montrent un écart important entre les DOM et la métropole. Je vous propose donc de discuter ici des limites de la promesse égalitaire de la départementalisation à La Réunion, à travers le prisme d’une analyse de la pauvreté, des inégalités et des mécanismes de reproduction sociale qui y président.
Après la loi de 1946, les premières politiques publiques se déploient principalement dans le domaine de la santé, des infrastructures – habitat, hôpitaux, écoles, route, électrification, réseaux d’eau potable. Ce n’est que dans un deuxième temps, dans les années soixante et soixante-dix, que l’État va engager une seconde série de mesures susceptibles de modifier la structure sociale. Je pense en particulier à la réforme foncière, à la scolarisation, à la mise en œuvre de la protection sociale et au développement des emplois publics.
La Réunion va dès lors être marquée par une triple évolution : le déclin de sa société rurale, la montée du chômage, la tertiarisation de l’économie avec l’accroissement de l’emploi public. En l’espace d’une seule génération, l’agriculture est passée d’une position dominante dans l’emploi local – 43 % de la population active en 1961 – à une position marginale – 7 % en 1990. Le déclin des emplois agricoles a pour corollaire l’envol du chômage : mesuré pour la première fois en 1967, son taux est déjà de 11 % – taux qui doit être ramené à 23 % si l’on inclut les seize mille personnes considérées en sous-emploi –, il atteindra le taux record de 36,5 % en 2000, au sens du BIT, et de 42 % au sens du recensement, avant d’être redescendu aujourd’hui à 26,4 %, sachant, là encore, que les indicateurs de l’INSEE ne sont pas nécessairement appropriés pour décrire le marché du travail réunionnais, marqué par un sous-emploi et un travail informel importants et dans lequel de nombreux chômeurs découragés ne sont pas inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi.
Cela étant, le chômage à La Réunion est marqué par deux caractéristiques importantes : c’est un chômage de longue durée – la durée moyenne de chômage est de trente-six mois – et qui touche massivement les jeunes, puisque le taux de chômage des 15-24 ans avoisine les 60 % depuis une dizaine d’années.
Une des premières causes de ce chômage endémique est la pression démographique que connaît l’île depuis un demi-siècle. À titre d’exemple, dans les années soixante-dix et quatre-vingt, la population active croît deux fois plus vite que le niveau de l’emploi. L’écart s’est aujourd’hui resserré, mais pas suffisamment pour inverser la tendance : entre 2006 et 2011, l’emploi a augmenté de 8 %, ce qui est plutôt une bonne performance puisqu’il n’augmente que de 2 % en métropole sur la période, mais la population active augmente, elle, de 10 %.
Cette pression démographique risque de peser quelques années encore sur La Réunion. Les projections réalisées par l’INSEE estiment en effet à plus d’un million le nombre d’habitants en 2030, ce qui signifie que la population active devrait croître de moitié en l’espace de vingt-cinq ans.
Deux autres facteurs expliquent le chômage endémique à La Réunion. En premier lieu, la forte croissance de l’activité féminine, qui a doublé en l’espace de trente ans ; en second lieu, le niveau de qualification exigé au sein du secteur tertiaire, qui a longtemps pénalisé et pénalise encore les chômeurs réunionnais, en majorité peu ou pas qualifiés. L’économie de l’île s’est en effet fortement tertiarisée avec la mise en place des nombreux équipements publics et des services administratifs, lesquels ont généré de nombreux emplois, contribuant ainsi à faire émerger une société de consommation et le développement d’activités commerciales axées autour de l’import et de la distribution.
Ce passage d’une économie dominée par le secteur primaire à une économie dominée par le secteur tertiaire est relativement atypique. Jean Benoist, anthropologue qui a beaucoup travaillé sur La Réunion et les Antilles, qualifiait ainsi La Réunion de société pseudo-industrielle, n’ayant pas connu de phase intermédiaire entre une économie primaire et une économie tertiaire. C’est en ce sens que le chômage a également une origine historique, les mutations de l’appareil productif ayant laissé en marge une masse de travailleurs ruraux, que les emplois publics n’ont pu absorber, ayant été, jusque dans les années quatre-vingt, majoritairement dévolus à des métropolitains –, ces derniers qui n’étaient que 3 200 dans l’île en 1961, étaient 37 400 en 1990 et 80 000 en 2006. Or la surreprésentation des métropolitains dans le corps des fonctionnaires d’État au cours des quarante premières années de la départementalisation est flagrante et plus encore dans les catégories socio-professionnelles supérieures : au recensement de 1982, les métropolitains ne représentaient que 4 % de la population réunionnaise mais 53 % des cadres de la fonction publique.
Comment aurait-il pu en être autrement au vu des politiques éducatives alors mises en œuvre à La Réunion ? Jusqu’aux années soixante-dix, époque où la majeure partie de la population créole est encore analphabète, les conditions sont loin d’être réunies pour que l’institution scolaire se développe à hauteur des besoins observés, l’essentiel de l’effort ayant été concentré sur le primaire, pour accueillir les enfants dans une société qui n’a pas encore achevé sa transition démographique. La population âgée de quinze ans et plus compte 9 % de diplômés en 1954, 11 % en 1961 et 13 % en 1974, soit une augmentation de quatre points en l’espace de vingt ans. En 1990, 70 % de la population de quinze ans et plus est encore dépourvue de diplômes, et 20 % possède un niveau de diplôme inférieur au baccalauréat.
Cette inertie du système scolaire a participé jusqu’aux années quatre-vingt-dix à la stabilité du système social. Si le rattrapage progressif du taux de scolarisation et l’allongement de la durée des études ont permis depuis une amélioration sensible, sinon remarquable, du niveau de formation de la population réunionnaise, celle-ci reste en deçà des indicateurs observés à l’échelle nationale, la proportion de bacheliers restant par exemple inférieure de dix points à la moyenne nationale. En 2012, on recense un Réunionnais sur quatre, âgé de quinze à trente-quatre ans, et un sur deux, âgé de quinze à vingt-quatre ans, qui ont terminé leur scolarité sans avoir obtenu de diplôme, soit deux fois plus qu’en France métropolitaine.
Cette sous-qualification de la population contribue à maintenir le chômage à un niveau élevé sur un marché du travail de plus en plus qualifié et qui, encore aujourd’hui, continue d’avantager les métropolitains, toujours surreprésentés dans les catégories professionnelles supérieures.
Dans l’ensemble, la structure des catégories socio-professionnelles (CSP) reste dominée à La Réunion par des positions appartenant aux catégories populaires et à la petite classe moyenne : un emploi sur cinq relève des métiers de service aux particuliers et le second type d’emploi dominant est celui d’ouvrier. Le salaire moyen est ainsi de 12 % inférieur à celui de la France métropolitaine.
Si les emplois occupés se situent en bas de l’échelle sociale, il ne faut pas perdre de vue en outre que près d’un Réunionnais sur deux appartient à la catégorie des inactifs, globalement constituée de personnes disposant de faibles ressources, notamment les personnes âgées, une grande partie des retraités ayant été faiblement insérés dans l’économie salariale et étant contraints d’avoir recours aux minima sociaux : en 2008, 45 % des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans percevaient l’allocation vieillesse, contre 5, 4 % en métropole.
Cette structure de classe marquée par l’inégalité et la pauvreté se lit parfaitement dans les statistiques de l’INSEE. En 2008, 49 % des ménages réunionnais vivaient sous le seuil de pauvreté nationale, contre 13 % en métropole ; 36 % bénéficiaient de la couverture médicale universelle complémentaire, contre 6 % en métropole ; 20 % bénéficiaient du RMI, contre 3,4 % à l’échelle nationale, et, selon les données les plus récentes, un quart des ménages bénéficient des minima sociaux.
La sociohistoire de la départementalisation montre ensuite qu’il a fallu du temps pour que l’économie de transfert se mette en place et que les inégalités reculent. Jusque dans les années soixante-dix et quatre-vingt, les quelques prestations sociales et familiales versées dans les DOM étaient assez peu appropriées au contexte local.
Comme le précise l’article 73 de la Constitution de 1946 : « Le régime législatif des départements d’Outre-Mer est le même que celui des départements métropolitains, sauf exception déterminée par la loi ». Or des exceptions, il y en aura et, suivant le principe de la parité sociale, on mettra en place des critères d’éligibilité singuliers, des montants minorés, notamment en matière de politique familiale afin de contrer les tendances natalistes des DOM – je vous renvoie ici aux travaux d’Arlette Gautier.
Il faudra en fait attendre l’arrivée du RMI en janvier 2009 pour qu’une véritable protection sociale apparaisse dans les DOM. À La Réunion, un ménage sur deux demande le RMI, et un sur quatre en sera bénéficiaire à la fin de l’année.
Le revenu minimum d’insertion va donc devenir rapidement une composante importante de l’économie des pauvres, une économie de survie, qui va malgré tout permettre une amélioration sensible des conditions de vie. Vingt ans plus tard, le constat perdure et, en 2008, à la veille du remplacement du RMI par le RSA, 12 % des allocataires du RMI résident dans les DOM, alors que ces départements ne représentent que 3 % de la population française, soit un rapport de un à quatre.
On peut en conclure qu’avec, d’un côté, un sur-salariat porté par la fonction publique – lequel s’accompagne en outre d’une sur-rémunération qui, sur des territoires où les minima sociaux sont minorés ne fait que durcir les inégalités – et, de l’autre, un sous-salariat adossé à une situation de chômage de masse, la société réunionnaise demeure une société duale, comme l’était la société de plantations, divisée entre les grands propriétaires terriens et les « sans terre ».
Si ce statu quo social s’explique par les contraintes objectives déjà évoquées – chômage de masse, structure de l’emploi, pressions démographiques, faiblesse des qualifications – il s’explique aussi par des mécanismes de reproduction sociale particulièrement prégnants dans le cadre des anciennes sociétés de plantations coloniales, inégalitaires par essence et où les inégalités ont été érigées en habitus, pour reprendre la terminologie bourdieusienne, c’est-à-dire durablement intériorisées : avoir été gouverné pendant plus de trois siècles par un régime politique, juridique et économique aussi violent que l’était le régime colonial laisse des traces. Il est ainsi impossible de comprendre le poids et la mécanique du RMI à La Réunion sans faire le détour par l’histoire, qui donne les clefs de lecture permettant d’expliquer la manière dont est envisagée la fonction sociale du travail dans une ancienne société de plantations où le salariat est loin d’avoir été pourvoyeur de droits pour tous.
Globalement, l’économie mise en place dans le cadre de la départementalisation a donc davantage déplacé que supprimée les conditions originelles de production des inégalités. Aujourd’hui, ces fortes inégalités qui caractérisent la société réunionnaise, comme celles des autres DOM, posent évidemment un certain nombre de questions politiques économiques et sociales, avec, en ligne de mire, l’enjeu de maintenir une certaine cohésion sociale dans une société socialement fracturée.
Se posent en particulier un certain nombre de questions quant à l’avenir et aux conditions d’intégration de la jeunesse domienne, particulièrement touchée par le chômage et la précarisation de l’emploi.
Si les générations précédentes, encore marquées par la structure fondamentalement inégalitaire de la société de plantations, ont intégré dans leur mode de vie les situations de pauvreté et d’inégalité qui étaient les leurs, qu’en est-il des nouvelles générations ? Sont-elles prêtes à accepter une reproduction des inégalités ? La jeunesse actuelle est une génération charnière, coincée entre des aspirations de rupture avec les positions sociales inférieures des générations précédentes et des conditions contemporaines d’intégration économiques qui, dans bien des cas, les renvoient à ces mêmes positions sociales. Dans ces conditions les inégalités peuvent être perçues comme des iniquités, lesquelles constituent un terreau fertile pour la contestation et la violence sociales
M. le président Jean-Claude Fruteau. Personne ne peut contester le constat que vous avez dressé. La Réunion a évolué, même si cette évolution n’est pas exactement celle que nous aurions souhaitée, mais nous n’avions pas la main. Ce qui importe le plus cependant à notre délégation parlementaire, ce sont les difficultés que vous envisagez pour l’avenir, car notre rôle est précisément de faire en sorte d’aplanir ces difficultés. Or ce que je retire de vos propos c’est que, si la départementalisation a eu, dans certains domaines, des effets bénéfiques, elle semble s’être essoufflée. Pour dire les choses plus brutalement, à part quelques améliorations en matière d’infrastructures ou de protection sociale, elle n’a pas changé grand-chose, et nous devons aujourd’hui ouvrir de nouvelles perspectives pour l’avenir.
M. Nicolas Roinsard. Il faut en effet s’inscrire dans une perspective progressiste et poursuivre les progrès accomplis depuis 1946.
M. Marcel Dorigny. Quel a été le rôle des politiques d’émigration dans ces sociétés ? Je sais qu’il a été massif aux Antilles, et il n’y a qu’à voir le nombre d’Antillais qui travaillent en métropole à La Poste, dans la gendarmerie ou la police, et dans les hôpitaux – ils représentent près d’un tiers des effectifs de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris – pour s’en convaincre. Ce sont souvent les enfants, voire les petits enfants, de personnes ayant émigré dans les années soixante et soixante-dix, dans le cadre des politiques soutenues par le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d’outre-mer (BUMIDOM), pour alléger la pression démographique outre-mer et combler en même temps les besoins de main d’œuvre de la métropole.
M. Nicolas Roinsard. Des Réunionnais ont également émigré, mais beaucoup moins que les Antillais. Aujourd’hui d’ailleurs, le mouvement s’inverse, et de nombreux Réunionnais adhèrent au slogan « Vivre et travailler au pays ».
M. Marcel Dorigny. D’autre part, y a-t-il une immigration à La Réunion, comme aux Antilles où les Haïtiens immigrent en masse, et en Guyane, où un tiers de la population est haïtienne ?
M. le président Jean-Claude Fruteau. Nous avons un problème du même ordre avec la migration des Mahorais et des Comoriens, qui se font passer pour des Mahorais.
M. Marcel Dorigny. Les flux migratoires de l’île Maurice vers La Réunion sont-ils importants ?
M. le président Jean-Claude Fruteau. C’est un phénomène extrêmement marginal.
M. Marcel Dorigny. La situation est différente dans les Caraïbes où, avec dix millions d’habitants à Haïti pour 400 000 habitants à la Martinique – soit l’équivalent d’un faubourg de Port-au-Prince –, on a affaire à des transferts de population massifs, qui n’ont pas d’équivalent dans l’océan Indien.
M. Philippe Naillet. On estime aujourd’hui qu’il y a 17 000 Mauriciens à la Réunion.
M. Marcel Dorigny. Et y a-t-il une émigration de La Réunion vers Maurice ?
M. Philippe Naillet. Il n’y a pas d’émigration économique, mais nous sommes les premiers clients de Maurice pour le tourisme. 150 000 Réunionnais vont en vacances à Maurice chaque année, ce qui est bien supérieur au nombre de métropolitains. On y trouve des séjours moins chers et plus luxueux.
M. Marcel Dorigny. Cela rejoint ce que je disais tout à l’heure sur les différences considérables qui existent entre le niveau de vie à La Réunion – qui appartient à l’Europe – et dans les territoires voisins, où, parfois, on se contente de survivre, comme à Rodrigues.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Ce sont deux systèmes qui ne s’interpénètrent pas.
M. Marcel Dorigny. Il fut un temps où Maurice était le premier producteur de pulls, parce que les Européens y implantaient des usines, jusqu’à ce qu’ils délocalisent leur production vers la Chine, où la main d’œuvre était moins chère. Les départements d’outre-mer sont de ce point de vue dans une situation très défavorisée, parce qu’ils appliquent la législation européenne.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Notre appartenance à l’Europe ne peut pas avoir que des avantages ; nous devons également en assumer les inconvénients. Mais peut-on aller jusqu’à dire que nous n’avons pas tiré les effets bénéfiques de la départementalisation et que nous en supportons au contraire les conséquences négatives ?
M. Nicolas Roinsard. Il ne fait aucun doute pour moi que La Réunion a tiré de la départementalisation des effets bénéfiques en termes de développement. Il est difficile d’élaborer des scénarios prédictifs sur ce que serait devenue l’île sans la départementalisation, mais il est clair que le transfert de droits et les efforts de rattrapage par rapport à la métropole ont eu des incidences positives. Cela a néanmoins pris du temps, et l’on paie sans doute aujourd’hui le fait que certaines politiques aient été différées dans le temps.
J’observe malheureusement qu’à Mayotte, on est en train de reproduire les mêmes erreurs. On a commencé à mettre de l’argent dans l’école dans les années quatre-vingt-dix, faisant passer entre 2002 et 2012 la proportion de bacheliers dans une génération de 12 % à 49 %, mais avec un diplôme dont le niveau est inférieur à celui de la métropole, ce qui fait que les Mahorais qui s’inscrivent dans une université métropolitaine y rencontrent de grandes difficultés.
Pour les autres DOM, la vie s’y est globalement améliorée avec le temps, sans qu’on sache comment ils auraient évolué en devenant indépendants.
M. le président Jean-Claude Fruteau. Vous faites un parallèle entre la départementalisation et l’indépendance ?
M. Nicolas Roinsard. S’interroger sur les effets de la départementalisation implique de se poser en creux la question des autres solutions possibles.
M. le président Jean-Claude Fruteau. À La Réunion, les progrès accomplis sont-ils liés à la départementalisation ou à l’afflux de crédits dus à l’action de certains hommes politiques comme Michel Debré, qui, quel que soit le jugement que l’on porte sur son action, a joué un rôle moteur dans le développement de l’île ? En d’autres termes, est-ce le système institutionnel ou est-ce la volonté politique qui prime ? C’est une question primordiale à mes yeux car, selon moi, c’est la volonté politique qui prime. Si elle est bridée par des systèmes politiques, il faut donc changer ces derniers ; dans le cas contraire, cela ne sert à rien.
Mme Brigitte Allain. Je suis députée de Dordogne, autre département d’outre-mer, pourrais-je dire avec humour… Or je me demande savoir si on a laissé à ces départements la possibilité de valoriser tout leur potentiel et toutes leurs richesses. Dans le domaine énergétique par exemple, un grand nombre de ces DOM auraient eu la possibilité d’assurer leur autosuffisance mais en ont été empêchés, parfois par une législation trop restrictive.
La départementalisation a certes permis une hausse du niveau de scolarisation et la création d’infrastructures du niveau de celles de la métropole mais, dans le même temps, elle a placé ces territoires dans une forme de dépendance en matière d’énergie mais aussi en matière de denrées alimentaires, malgré d’importantes ressources locales, au rang desquelles il faut compter la population, car une population dynamique peut être un atout. Notamment en matière de tourisme, et c’est ici que le sort de la Dordogne rejoint en un certain sens celui des DOM : département métropolitain le plus visité, après Paris et les départements du littoral, la Dordogne est aussi l’un des plus pauvres ! Comment peut-on l’expliquer et comment faire en sorte de mieux valoriser le patrimoine touristique de ces territoires ?
M. Philippe Naillet. Messieurs, j’ai beaucoup appris en vous écoutant. Je partage votre idée selon laquelle notre priorité doit être la jeunesse. La Réunion ne tiendra pas avec un niveau de chômage aussi élevé chez les jeunes, d’autant qu’il y a parmi ses jeunes chômeurs une part importante de diplômés.
À l’autre bout du spectre, j’ai été dimanche célébrer une centenaire, témoignage vivant des progrès fulgurants fait dans l’île en matière de santé : en 1946, au moment de la départementalisation, l’espérance de vie à La Réunion était de cinquante ans à peine ; aujourd’hui, elle est de soixante-dix-sept ans chez les hommes et de quatre-vingt-trois ans et demi chez les femmes, soit presque aussi élevée qu’en métropole. Il y a eu l’an dernier soixante centenaires à La Réunion, et l’on estime à près de deux mille le nombre de nonagénaires ou plus, chiffre qui devrait être multiplié par six en 2040. Il y a donc eu d’indéniables progrès.
Reste que la logique de rattrapage par rapport à la métropole a pu, par certains aspects, être handicapante et qu’à cet égard la départementalisation a montré ses limites. Notre réflexion doit donc porter sur la construction d’un modèle à dimension régionale, porté par les Réunionnais. Cela ne remet évidemment nullement en cause le fait que nous sommes français. Nul sur l’île ne songerait à le contester, et nous savons ce que nous devons à la France.
B. AUDITION DE M. PIERRE-ALAIN ROCHE, INGENIEUR GENERAL DES PONTS, DES EAUX ET DES FORÊTS, SUR LE PROBLÈME DE L’EAU DANS LES OUTRE-MER
(Séance du 24 mai 2016)
M. le président Jean-Claude Fruteau. J’ai le plaisir d’accueillir en votre nom M. Pierre-Alain Roche, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts. M. Roche a été le coordonnateur d’un rapport intitulé « Propositions pour un plan d’action pour l’eau dans les départements et régions d’outre-mer et à Saint-Martin » qui a été commandé par la ministre de l’écologie et la ministre des outre-mer.
Nos responsabilités dans les territoires que nous représentons nous ont rendus personnellement très sensibles, quelle que soit notre région géographique d’origine, aux problèmes posés par l’alimentation en eau potable puis, à l’autre bout de la chaîne de consommation, par le traitement des eaux usées. De plus, les récents travaux de la délégation aux outre-mer sur le changement climatique et ses effets dans les outre-mer ont été l’occasion de prendre une nouvelle conscience des conséquences potentielles de l’élévation des températures sur les ressources en eau actuellement disponibles. C’est pourquoi le rapport établi sous la direction de M. Roche présente pour nous un grand intérêt.
Tous les outre-mer, quel que soit leur statut juridique, sont confrontés aux difficultés évoquées par ce rapport. Il est important de le rappeler en ouverture de notre réunion, même si la mission de M. Roche et de son équipe ne s’étendait pas à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie et à Wallis et Futuna, territoire dans lequel la disponibilité de l’eau potable semble spécialement problématique.
Je remercie, en tout cas, M. Roche d’avoir bien voulu se rendre disponible pour notre Délégation, et je lui passe la parole.
M. Pierre-Alain Roche. Monsieur le président, monsieur le député, le travail que je vais vous présenter portait sur un périmètre relativement ambitieux, puisqu’il couvrait l’ensemble des Antilles, la Guyane, Mayotte et La Réunion, mais ne couvrait pas l’ensemble des outre-mer. Je ne serais vraiment pas en mesure de vous parler de territoires où je ne suis pas allé à l’occasion de cette mission.
Ce travail fait suite aux recommandations d’un rapport interministériel sur la politique de l’eau. Il a été commandé en vue de la préparation d’un plan d’action en faveur de l’eau dans les départements et régions d’outre-mer. Le souci d’efficacité de l’action était fortement marqué dans la commande.
Je commencerai par quelques constats sur des faits connus mais qui servent, au moment de parler d’un sujet spécialisé, à rappeler les enjeux globaux, socio-économiques, dans lesquels il s’inscrit.
La pression de la croissance démographique est très forte à Mayotte, en Guyane et également à La Réunion, contrastant avec les Antilles. Les densités de population sont très importantes dans certains territoires. Le niveau des revenus est faible, voire très faible. Le taux de chômage est très important. Les indicateurs sociaux sont à un niveau critique. Le taux de mortalité infantile, indicateur très lié à la problématique de l’eau, est extrêmement contrasté par rapport à l’Hexagone, tout particulièrement à Mayotte. Sur un sujet qui nourrit les débats actuels, beaucoup plus qu’à l’époque de l’établissement de notre rapport, le retard à combler avec l’Hexagone, une étude de l’OCDE fait ressortir, là encore, des situations contrastées.
Quand on analyse ensuite la situation institutionnelle, on constate que les outre-mer se distinguent de l’Hexagone par la présence de collectivités communales d’une taille significative, atteignant la masse critique, sous réserve de certaines situations particulières en Guyane. Les disparités constatées entre les DOM et à l’intérieur d’un même DOM résultent de spécificités locales liées à l’histoire.
Nous avons estimé que notre mission devait nous conduire à aborder certaines réalités de manière assez crue : l’emploi public joue de façon spécifique, plus fortement que dans l’Hexagone, un rôle d’amortisseur social, avec des répercussions sur la productivité d’un service public qui est à caractère industriel et commercial et sur les conditions d’accomplissement de l’action sociale dans le cadre de ce service. Le service public de l’eau et de l’assainissement n’échappe pas totalement au contexte général des finances publiques, et notamment à la faiblesse des finances communales, comme des difficultés du secteur industriel et commercial, avec des répercussions sur les programmes d’investissement. Je dois, en revanche, relever l’atout que constituent des échelles géographiques assez miraculeuses lorsqu’il est question de gestion de l’eau. Les notions de bassin hydrographique, avec des réseaux cohérents de rivières ou de ravines, et de région administrative se recoupent le plus souvent. La question se pose bien sûr de manière assez différente en Guyane.
La question du foncier est particulièrement prégnante pour la détermination des solutions, avec la complexité du droit de propriété, les problèmes cadastraux, et les difficultés liées, dans certains territoires, aux occupations illégales.
J’en viens maintenant plus précisément aux services publics d’eau et d’assainissement, pour dire qu’en Guyane et surtout à Mayotte, le niveau du respect de la qualité des services essentiels pose question au regard des exigences du droit international, dans la mesure où des dizaines de milliers de personnes n’y ont pas un accès convenable à l’eau potable. Selon les statistiques officielles, la part des logements dépourvus d’eau potable est de 22% à Mayotte et de 10% en Guyane, sans aucun rapport avec ce qui est observé ailleurs ; encore ces chiffres sont-ils très vraisemblablement sous-estimés.
Lorsque nous avons examiné la situation financière des différents services publics, nous avons constaté l’existence d’une gamme extrêmement variée : certaines sont satisfaisantes, proches de ce qu’on trouve dans une grande partie du monde et dans l’Hexagone, d’autres très dégradées, parfois au point de poser question au regard des normes internationales.
Quant à la responsabilité politique, elle est marquée plus qu’ailleurs, et un peu comme aux Etats-Unis, par le caractère significatif des efforts consentis pour créer l’outil, et la grande faiblesse des efforts de gestion et de service des usagers. Des difficultés doivent, d’autre part, être relevées dans la manière dont l’autorité organisatrice – commune ou établissement public - exerce ses responsabilités, soit parce que la commune laisse une liberté d’action trop grande à sa régie, soit parce que les conditions d’accomplissement de la délégation de service public sont insuffisamment contrôlées.
La régulation du service public (indicateurs, observations, communications) se heurte à des difficultés que l’on rencontre aussi dans l’Hexagone, comme le montre le rapport que j’ai rendu il y a quelque temps – M. Michel Lesage, ici présent, le sait – sur la situation du service public de l’eau et de l’assainissement dans la France entière. Mais ces difficultés sont particulièrement aiguës dans les outre-mer.
Les prix de l’eau – eau potable et assainissement collectif - sont assez variés, assez difficiles à interpréter. Contrairement à ce qu’on pense souvent, les prix de la Martinique ne sont pas les plus élevés, ce sont les prix guyanais. Les prix bas, particularité réunionnaise, sont contrebalancés par une consommation très élevée, supérieure à l’Italie, qui connaît une situation analogue. Au final, lorsqu’on regarde la facturation des ménages, prix et niveau de consommation se compensent : on connaît bien, à La Réunion, les pratiques de maraîchage ! Il n’est pas seulement question de remplissage de piscines ou de lavage de voitures, mais bien d’activités para-économiques exercées par des ménages qui ont bien besoin de compléments de revenus.
Les configurations géographiques des outre-mer sont spécifiques. Sur des territoires d’assez petite extension, on observe des contrastes marqués entre zones arrosées et zones sèches, y compris à Mayotte. La question du transfert de l’eau et de la réalisation des infrastructures a été structurante dans les années passées. Elle continue à polariser l’histoire des territoires, alors qu’elle n’est plus vraiment d’actualité aujourd’hui.
A La Réunion, on constate des anomalies sanitaires, c’est-à-dire l’existence de poches où la question de la qualité du système de traitement des eaux ne s’est pas mise au niveau des standards pratiqués dans la plupart des outre-mer. Les problèmes sont beaucoup plus récurrents en Guyane et à Mayotte, mais les situations locales exceptionnelles constatées à La Réunion méritent d’être signalées.
Nous avons été amenés à poser, en Guadeloupe, le constat, extrêmement grave, d’une situation en voie de délabrement. Le niveau des fuites dans les réseaux est tel qu’il n’est pas possible d’assurer la continuité de la desserte en eau. On recourt à des tours d’eau, à des stockages, on remet en eau, avec des pressions élevées qui entraînent à nouveau la destruction des réseaux. La méthode de gestion accélère la dégradation des réseaux. Nous avons été surpris de constater, et nous l’avons relevé, que la gestion n’est pas très tournée vers ce qu’on pourrait appeler le ménagement du patrimoine, qui consiste à réétager les pressions, à mettre en place des mécanismes régulateurs, pour lesquels on dispose aujourd’hui de technologies élaborées. Ces mécanismes permettent d’éviter les tours d’eau, et surtout de faire vivre les canalisations dans les meilleures conditions. On a tendance à ignorer cette ingénierie technique qui est pourtant au cœur des solutions de court terme permettant d’améliorer la situation dans un état général fortement dégradé. Tout le monde s’inquiète des mécontentements qui se manifestent sporadiquement. J’ai plutôt tendance à m’étonner, avec le regard extérieur qui est le mien, de la patience extrême des populations. On a eu longtemps tendance à évoquer le carême, en disant qu’il n’y avait pas d’eau ; la vérité, ce n’est pas qu’il n’y a pas d’eau, c’est que les réseaux fuient. Il est vraiment urgent, je crois, de remédier à cette situation.
Certes, il y a des besoins de primo-équipement. Si l’on regarde les rendements des réseaux dans chacun des territoires, l’apparence des chiffres est que les situations les plus satisfaisantes s’observent d’abord à Mayotte (82 %) et ensuite en Guyane (77 %), la dégradation la plus forte étant observée en Guadeloupe où le taux de rendement du réseau est de 52 % ; à la Réunion (59 %) et en Martinique (66 %), la situation n’est pas tellement éloignée. Finalement, ces chiffres traduisent l’âge des réseaux. La Guyane et Mayotte ne sont pas plus vertueuses que les autres territoires au regard de la gestion ; simplement, les installations sont plus récentes. Ce qui arrive aujourd’hui en Guadeloupe est destiné à se produire plus tard ailleurs.
On constate aujourd’hui beaucoup de prélèvements sauvages, de défauts de comptage ou de recouvrement. Dans une commune, aucune facture n’a été émise depuis onze ans ; c’est beaucoup ! Dans ces conditions, il ne faut pas s’étonner de ce qu’il n’y ait pas d’argent dans les caisses : si on n’émet pas de facture, les gens ne vont pas venir faire la queue pour payer des factures qu’ils n’ont pas reçues. Il faut bien s’organiser pour émettre les factures. En Guadeloupe, pour une question de gestion de logiciel, a-t-on dit, Veolia n’a pas émis de facture pendant dix-huit mois pour le centre de l’île.
La question du consentement à payer se pose réellement. Les premiers à ne pas payer leurs factures sont certaines collectivités locales et les grands ensembles d’immeubles, donc les principaux débiteurs. Il ne faut pas croire que faire payer l’eau, c’est faire payer les pauvres ! Les mauvais payeurs ne sont pas vraiment des « riches », mais ils sont en situation de pouvoir considérer qu’ils ont la possibilité de s’exonérer de leurs responsabilités. La généralisation des impayés jusqu’à 30 % ou 50 % – indépendamment d’éventuels mots d’ordre politiques – témoigne d’une incompréhension collective. Quand vous superposez ces pratiques, ces habitudes souvent anciennes, et la mauvaise qualité du service rendu, avec beaucoup d’eau produite mais qui n’arrive pas chez le consommateur, vous avez la clé des difficultés que rencontre le service pour parvenir à l’équilibre.
La clé de la réponse ne consiste pas tant à ajouter de grandes infrastructures de captage et de transfert qu’à reconstituer une ingénierie financière, regagner la confiance des consommateurs, faciliter l’amélioration de la qualité du service, débloquer les compteurs qui ont été bloqués, etc. Il s’agit d’efforts à consentir au quotidien. Restaurer la confiance, c’est revenir aux fondamentaux du service public, et lui restituer sa noblesse en revisitant chacune des composantes des activités de production.
La situation de l’assainissement est analogue. Ses caractéristiques ne sont pas très originales : grosso modo, c’est une politique plus imposée, plus extérieure que la politique de l’eau potable. Autour de l’eau potable, les enjeux sont délicats, et tout le monde s’y intéresse. Quand on commence à parler d’assainissement, l’enthousiasme est moins grand, et on évoque tout de suite les normes européennes. L’assainissement est dispendieux et un peu subi.
Face à des risques de contentieux majeurs, beaucoup d’investissements ont été faits. Certains ont été efficaces, mais pas tous. Beaucoup de stations d’épuration flambant neuves qui commençaient à se dégrader alors que leur rendement était extrêmement faibles : par exemple, des stations conçues pour dix mille équivalents habitant avec six cents équivalents habitant effectifs et une collecte d’eaux usées à traiter très faible. Si, à la place de ces stations très coûteuses, on avait réalisé un filtre planté de roseaux, on aurait fait des économies. Il est nécessaire d’améliorer la cohérence de la programmation des investissements.
Il existe des services d’eau potable qui sont à l’équilibre financier et ont du répondant en termes économiques. L’observation vaut un peu moins pour l’assainissement, mais les situations sont, là encore, extrêmement contrastées.
Pour l’assainissement non collectif, pour lequel des travaux importants ont été réalisés en Martinique, les déversements peuvent constituer des enjeux réels. Mais il ne faut pas se tromper d’objectif. L’adaptation des stations aux conditions locales entretient tout un débat. La plupart, selon ce que j’en ai vu, sont semblables aux stations en service en Inde, qui sont soumises également au climat tropical. Les difficultés relevées sont davantage liées aux conditions d’entretien et à la disponibilité de techniciens. Sans doute les investissements actuellement réalisés permettent-ils de disposer d’installations mieux adaptées, mais le patrimoine existant est mal utilisé.
Nous insistons sur la nécessité de restituer la cohérence entre la logique de raccordement et d’équipement en réseaux et en stations et la logique de paiement. Jusqu’à présent on s’est focalisé sur les investissements en équipements nouveaux sans se préoccuper des pompes qui lâchent. Quand les équipements sont de bonne qualité, il ne faut pas grand-chose pour revenir aux véritables priorités.
D’une manière générale, nous avons conseillé d’établir des programmations comportant des objectifs qui puissent être atteints.
J’ai beaucoup parlé d’eau potable et d’assainissement, parce que le rapport a fait le choix de présenter ces deux domaines comme absolument prioritaires. Nous avons parlé en outre des enjeux sur le milieu naturel et sur le littoral, mais la tonalité générale du rapport est de dire que ces questions ne peuvent pas être bien traitées tant qu’on ne traite pas les fondamentaux : en termes d’assainissement, le déversement des eaux non traitées est la première des nuisances, et il n’est pas possible d’imaginer aujourd’hui de ne pas disposer d’eau potable.
Les outils dont nous disposons – la remarque vaut aussi pour l’Hexagone, car il s’agit là d’un mal français – sont affectés par un certain décalage. Il s’agit de documents produits depuis Paris, dont la lecture est très intéressante, mais qui ne sont pas nécessairement en prise sur la réalité quotidienne des collectivités. Par exemple, vus de l’Hexagone, les comités de bassin donnent l’impression d’avoir une activité plutôt satisfaisante ; mais on s’aperçoit qu’il y a un consensus pour dire que – avec des exceptions intéressantes – leur activité n’est pas si substantielle qu’elle puisse susciter la confrontation.
Les offices de l’eau n’ont pas beaucoup de ressources, et de plus, structurellement, la taille des populations ne permet pas de les prendre en considération. Naturellement, on relève de grandes différences de situation, que nous avons pu apprécier en conduisant dans chaque office une mission d’une semaine ; mais globalement, s’ils peuvent en effet percevoir des recettes de redevance les offices n’atteignent pas une dimension suffisante, à nos yeux, pour permettre la redistribution, ce qui fonde leur utilité – je dois dire que ce n’est pas l’opinion du conseil départemental.
Nos constats nous conduisent à préconiser un changement de méthode, en nouant des relations entre les financeurs qui privilégient le renforcement des capacités avant toute autre considération : les capacités qu’il s’agit ici de renforcer, ce ne sont pas les grands équipements, mais les logiciels de facturation et de maintenance, les programmations, etc. Il faut faire en sorte que l’Agence française du développement et la Caisse des dépôts se réinvestissent dans ces services pour accompagner ces efforts avec des outils assez puissants.
Pourquoi parler de réinvestissement ? Parce qu’on a des contrastes de solvabilité et d’ingénierie. Dans certaines collectivités de La Réunion, par exemple, les procédures sont simples et sont facilitées ; d’autres collectivités éprouvent des difficultés dans la gestion de leur patrimoine et ne répondent pas aux critères de bancabilité. Il faut pouvoir poser un acte de foi collectif dans la possibilité de surmonter ces difficultés.
Quand il s’agit de porter un effort d’investissement à long terme, plus votre autofinancement est dégradé, et moins vous êtes attractif pour les banques. Il faut donc trouver un mécanisme qui renforce cette attractivité, en séparant bien les comptes de la collectivité des comptes du service d’eau potable : ainsi, même si les finances de la collectivité proprement dites sont dans le rouge, ce service public, doté d’un budget annexe autonome, répondant à des critères de productivité spécifique, doit pouvoir bénéficier d’efforts particuliers permettant d’améliorer sa situation sans que l’on prétende régler le problème général des finances de la collectivité en cause.
Certaines opérations de sauvetage de collectivités ont été des réussites, d’autres ont été plus difficiles et il en est parfois résulté la non-réélection du maire. Là, il faut isoler la gestion du service public de l’eau, en pratiquant des tarifications sociales adaptées. Parfois on évoque des prix bas, alors que les tarifications sociales sont très peu pratiquées, parce qu’on n’a pas nécessairement envie d’entrer dans l’ingénierie correspondante.
L’idée est de rassembler l’ensemble des bailleurs – la région, gestionnaire des fonds européens, l’ONEMA, la Caisse des dépôts et l’AFD – pour constituer une sorte de conférence, dont le secrétariat est assuré par la DEAL, et qui devient une espèce de bailleur financier négociant avec la collectivité un contrat de moyen terme. Certains nous ont opposé que cette proposition entraînait une ingérence et une atteinte à la légitimité des collectivités locales. Mais dans une situation où sont en cause les fondamentaux, il faut bien se mettre d’accord sur les critères et les indicateurs permettant d’assurer que l’argent a été bien investi. Cela suppose que l’on accepte d’établir un diagnostic sérieux et partagé sur des sujets « sous le tapis », la performance, la gouvernance, le rapport qualité/prix, etc. La statistique que j’ai eu le plus de mal à trouver dans les DOM, alors qu’elle est disponible dans le monde entier, c’est celle de la disponibilité effective de l’eau pour les usagers. En effet, il est gênant d’afficher que l’eau n’est disponible qu’une partie de la semaine. J’ai été obligé de dépouiller dans la presse la liste des tours d’eau pour avoir une idée des populations concernées. Si on veut traiter la question des tours d’eau, si l’on veut que les gens aient plus d’eau, si on veut améliorer la gestion, il faut accepter de faire la lumière sur ces sujets « sous le tapis ».
Il y a un enjeu de réorientation des priorités. Un certain nombre des choix qui ont été faits dans la durée n’ont pas procédé d’une vision globale des enjeux de l’amélioration du service, mais pour répondre ponctuellement à une demande spécifique de mise aux normes. Il faut en outre lever des tabous spécifiques, notamment sur l’éligibilité à certains financements de l’indispensable renouvellement des réseaux. Il faut défragmenter et élargir les interventions financières, qui portent par définition sur des dépenses pluriannuelles ; les résultats se constatant dans la durée, nous avons proposé d’inscrire ces interventions dans une logique de contrats quinquennaux, négociés par la conférence régionale des bailleurs avec des indicateurs de performance et de résultats et comportant de la subvention, du prêt, de l’aide à l’ingénierie. La mise en œuvre de ce schéma suppose un exercice de réagencement qui n’est pas très facile dans certains territoires, mais qui est beaucoup plus simple dans les outre-mer : il convient de s’entendre sur un échéancier pluriannuel, des indicateurs de résultat, une montée en puissance et des clauses de revoyure.
Les excellentes dispositions de l’Agence française de développement à l’égard de cette démarche permettent d’espérer qu’on trouvera une solution pour les collectivités qui sont le plus en difficulté, quelle que soit l’hétérogénéité constatée des situations.
Les propositions sur la croissance verte que le rapport avait formulées pour les DOM ont été étendues à l’ensemble de la France par la Caisse des dépôts, parce que celle-ci les trouvait intéressantes mais ne pouvait pas établir de différence entre l’Hexagone et les outre-mer.
Les crédits de l’ONEMA, dont la Corse est actuellement la seule bénéficiaire, pourraient opportunément être aussi affectés aux outre-mer, si l’on parvenait à créer la confiance. Bien sûr, compte tenu du niveau actuel des taux d’intérêt, la question de la bonification d’intérêts n’est pas pressante ; mais si les taux venaient à remonter, l’ingénierie financière sur les bonifications pourrait être utile.
J’ai déjà parlé de la conférence régionale des bailleurs. Il nous paraît en outre indispensable de prévoir un ensemble de formations et d’accompagnements, notamment en cas de montée en puissance du travail sur les réseaux. Elle ne pourra pas se faire du jour au lendemain : intervenir dans la rue, installer des canalisations, cela prend du temps, et il est très difficile de traiter ces travaux sur le mode industriel. Il faut aussi prendre en considération les effets de marché sur les travaux publics.
Si la logique contractuelle que nous préconisons prend, elle pourra être élargie à d’autres domaines. Dans la perspective de la mise en place des comités régionaux de la biodiversité, nous avons envisagé de proposer, ce qui déplaît un peu aux administrations, la fusion des schémas existants. Les SAR et les SDAGE, dès lors qu’ils possèdent la même base territoriale, ne gagnent sans doute pas en force en restant séparés ; nous avons proposé des expérimentations sur ce thème.
Voici l’essentiel des préconisations que nous avons présentées ; je vous remercie de votre compréhension des limites de notre rôle.
M. le Président Jean-Claude Fruteau. Je vous remercie, monsieur Roche, en mon nom et en celui de mes collègues présents, de cette présentation extrêmement nourrie.
Vous avez évoqué la difficulté qu’il y a à s’exprimer en partant d’un point de vue extérieur. Un tel regard permet parfois une vue d’ensemble qu’il peut être difficile d’acquérir de l’intérieur. Il permet en outre de mettre en évidence ce qui est original jusqu’au scandale, si je puis dire, comme vous l’avez fait à plusieurs reprises. C’est la vertu de ce genre d’exercice.
M. Jean-Jacques Vlody. Il était intéressant, voire indispensable, de dresser l’état des lieux, même si nous connaissons tous les grandes données du problème. Mais il convient maintenant de savoir comment on va le régler, ce problème. Comme vous l’avez dit dans votre conclusion, la question centrale est celle du financement des investissements. A La Réunion, nous avons connu une situation particulière, où le préfet a fini par recourir à une forme extrême de coercition, engageant des poursuites contre des maires pour des problèmes d’assainissement.
M. le Président Jean-Claude Fruteau. Contre des communes !
M. Jean-Jacques Vlody. Oui, des communes.
M. le Président Jean-Claude Fruteau. J’ai été moi-même convoqué en tant que maire de Saint-Benoît. On m’avait indiqué que je pouvais me faire représenter par un adjoint. Je ne l’ai pas fait, je me suis rendu en personne à la convocation. C’était un peu après ma réélection comme maire.
M. Jean-Jacques Vlody. La raison invoquée était le non-respect de la loi sur l’eau. Mais les investissements nécessaires pour la construction des réseaux d’assainissement étaient évalués, il y a trois ou quatre ans, à 800 millions d’euros pour l’ensemble du territoire de La Réunion. Je souhaiterais d’ailleurs savoir si ce type d’investissement est toujours éligible aux fonds européens ou si vous préconisez le rétablissement de cette éligibilité qui aurait été supprimée. On a soutenu, à La Réunion, que ni l’Etat, ni l’Europe n’acceptaient plus de financer les réseaux primaires d’assainissement. Or ni le département, ni, a fortiori, les collectivités, ne disposent des ressources financières correspondantes. Les ressources procurées par les recettes affectées à l’Office de l’eau ont seulement permis le financement de travaux partiels dans quelques communes.
Se pose aussi la question de la sécurisation des approvisionnements, des captages. Nous rencontrons aujourd’hui un problème de consolidation des ressources affectées à ces travaux et de mobilisation des financements nécessaires.
M. Pierre-Alain Roche. Je vais essayer de vous apporter une réponse spécifique, même si le rapport n’a pas été décliné territoire par territoire, car notre souci était de présenter des solutions globales. Ceci étant nous avons quelquefois mis le projecteur sur telle ou telle situation particulière.
A La Réunion, si l’on calcule les investissements nécessaires au dimensionnement des réseaux en fonction des consommations habituelles des habitants, on arrive effectivement à un montant élevé d’investissement. Mais le niveau de consommation est une anomalie : on alimente à travers le réseau de distribution d’eau potable des usages qui ne sont pas économes. Une étude réalisée sur le secteur de Saint-Pierre a montré à quel point la maîtrise des consommations permettait de diminuer les besoins en investissements. Quand on manipule des chiffres globaux d’investissements nécessaires, on mélange très souvent l’accessoire et l’essentiel, et on aboutit à un constat d’impossibilité collective. Nous avons adopté la logique inverse : si on arrive, en cinq ans, à doubler le montant actuel des investissements, cela représente déjà un effort considérable au regard des capacités des maîtrises d’ouvrage. Quand il s’agit de restructurer un réseau en milieu urbain, d’ouvrir les chaussées, cela prend du temps, c’est compliqué. Donner des chiffrages en centaines de millions d’euros, cela n’a pas de sens, car il y a une totale incapacité collective à entretenir un rythme d’investissement correspondant. Il faut plutôt définir des priorités, se demander comment intensifier les efforts, et au fur et à mesure les volumes d’investissement accompagnent.
Aujourd’hui, dans le cadre des règles actuellement en vigueur, les crédits n’arrivent pas à suivre. Des dossiers sont présentés, mais ils ne s’exécutent pas, ou pas assez. La Réunion fait un peu exception historique à cet égard, ce qui lui permet de bénéficier des crédits laissés disponibles par les autres bénéficiaires potentiels en fin de programme.
M. Jean-Jacques Vlody. Ce n’est pas suffisant !
M. Pierre-Alain Roche. Vous ne pouvez pas mettre sur la table, du jour au lendemain, trois cents millions d’euros. C’est une affirmation que l’on peut soutenir dans un discours, mais, dans la réalité, le progrès est nécessairement incrémental, dans des domaines qui sont des domaines de proximité, de détail. On n’est pas du tout dans le domaine des grandes infrastructures.
Par ailleurs, le rapport affirme qu’il faut financer les systèmes d’assainissement dans leur intégralité. Tout à l’heure, j’ai beaucoup insisté sur le fait que la question du financement est d’abord une question d’équilibre des comptes, de restructuration, dans un certain nombre de cas où les leviers de l’autofinancement n’arrivent pas à se reconstituer. La création de la conférence des bailleurs permet de ne pas attendre que l’autofinancement se reconstitue pour que des prêts à long terme soient accordés. Certaines collectivités disposent de puissants effets de levier, et sont exposées à buter sur le plafond des ressources disponibles. Beaucoup ont un problème de mobilisation de la ressource d’ingénierie financière et technique, qui les gêne pour porter des projets et les mener à terme.
Notre plan d’action est plus tourné vers l’accompagnement de ceux qui ont besoin de faire ces progrès. Du coup les principaux bénéficiaires potentiels de nos propositions ne sont pas nécessairement les Réunionnais, puisqu’ils disposent déjà de capacités de mobilisation. En revanche, l’ouverture progressive des financements à mesure que les besoins se révèlent vaut pour tout le monde.
Sur les financements européens, la difficulté qui a pu être relevée ne tient pas à la modification des taux mais à la redéfinition de l’assiette, qui exclut désormais les investissements « productifs », la Commission ayant demandé qu’on enlève les recettes futures escomptées de l’investissement de la base subventionnable. Cette modification a eu des répercussions très importantes à La Réunion, tant pour l’eau potable que pour l’assainissement. L’assiette a diminué, mais un effet correctif a été renégocié sur les taux, de sorte que ceux qui avaient déjà engagé des opérations ne perdent pas trop par rapport à ce qu’ils attendaient.
L’issue du dialogue entre la région et la Commission dépend énormément des priorités définies par la région. S’il y a une conférence des bailleurs, une association chargée de gérer les fonds du FEDER, et si cette association choisit de se battre sur l’eau potable et sur l’assainissement, la négociation aura des résultats. C’est vraiment une question de définition collective des priorités.
M. le Président Jean-Claude Fruteau. Merci encore, monsieur Roche, pour votre présentation dont nous aurons à tirer les enseignements.
LISTE DES PERSONNALITÉS AUDITIONNÉES
(par ordre chronologique)
- MM. Fabrice Richy, directeur, et François Parmantier, directeur adjoint du département outre-mer de l’Agence française de développement, sur l’action de l’Agence dans les outre-mer – 5 mai 2015
- M. Serge Letchimy, député de la Martinique, sur son rapport relatif au recyclage et à la valorisation des déchets outre-mer – 30 juin 2015
- M. Ibrahim Aboubacar, député de Mayotte, sur le document stratégique « Mayotte 2025 – Une ambition pour la République » – 16 juillet 2015
- MM. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes, et Jean-Philippe Vachia, président de la quatrième chambre, sur le rapport « La départementalisation de Mayotte : une réforme mal préparée, des actions prioritaires à conduire » – 13 janvier 2016
- Mme Marie-Anne Chapdelaine, députée d’Ille-et-Vilaine, sur le rapport relatif au suicide des jeunes Amérindiens de Guyane – 16 février 2016
- M. Christophe Sirugue, député de Saône-et-Loire, sur la réforme des minima sociaux – 8 mars 2016
- MM. Marcel Dorigny, historien, et Nicolas Roinsard, sociologue, sur la commémoration du 70ème anniversaire de la départementalisation – 30 mars 2016
- MM. Hervé Gonsard, directeur général, et Philippe La Cognata, directeur, de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer – 16 avril 2016
- M. Jean-Jacques Vlody, député de La Réunion, sur son rapport relatif à l’insertion des départements d’outre-mer dans leur environnement régional - 10 mai 2016
- M. Pierre-Alain Roche, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, coordonnateur d’un rapport sur l’eau dans les outre-mer – 24 mai 2016
- M. Patrice Gélinet, membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel – 8 juin 2016
- M. Daniel Carcel, directeur de l’Agence de promotion et de diffusion des cultures de l’outre-mer – 29 juin 2016
1 Ces deux rapports représentent au total 223 pages imprimées.
2 Le Sénat a adopté, avec modifications, le projet de loi portant réforme du code du travail dans sa séance du 28 juin, la veille de l’examen du présent rapport d’activité. Il a notamment maintenu le principe de l’abrogation de la loi Perben inscrit à l’article 14 bis du projet, tout en l’aménageant.
3 Les auditions sont publiées dans l’ordre de leur présentation dans la seconde partie du rapport d’activité, et non dans leur ordre chronologique.
© Assemblée nationale