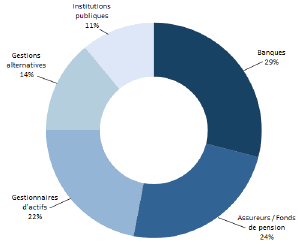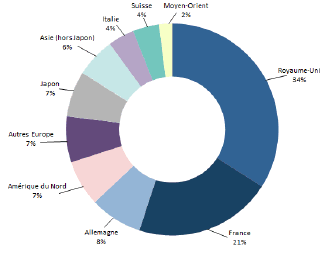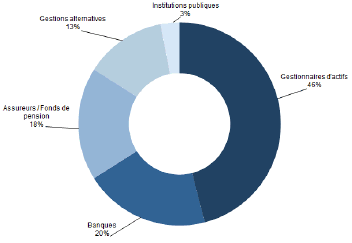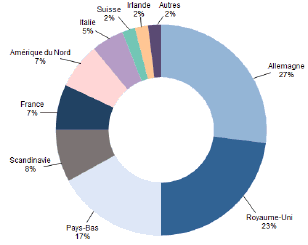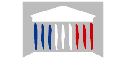
N° 3936
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 juillet 2016.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES FINANCES
en conclusion des travaux de la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) (1)
sur la gestion et la transparence de la dette publique
ET PRÉSENTÉ PAR
MM. Jean-Claude BUISINE, Jean-Pierre GORGES et Nicolas SANSU
Députés
——
MM. Olivier CARRÉ et Alain CLAEYS
Présidents.
(1) La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
La mission d’évaluation et de contrôle est composée de : MM. Olivier Carré, Alain Claeys, présidents, M. Gilles Carrez, président de la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, Mme Valérie Rabault, rapporteure générale, MM. Jean-Claude Buisine, Christophe Castaner, Charles de Courson, Marc Francina, Jean-Pierre Gorges, Laurent Grandguillaume, Jérôme Lambert, Hervé Mariton, Nicolas Sansu, Mme Eva Sas, MM. Pascal Terrasse, Philippe Vigier, Éric Woerth.
SOMMAIRE
___
Pages
CONTRIBUTIONS 7
INTRODUCTION 13
I. LA PROGRESSION DE LA DETTE PUBLIQUE : UN PHÉNOMÈNE GÉNÉRAL AUX CAUSES MULTIPLES 15
A. UNE DETTE PUBLIQUE EN PROGRESSION CONSTANTE DEPUIS 1974 15
1. L’ensemble des pays industrialisés et les secteurs public comme privé connaissent un fort niveau d’endettement 15
a. La structure de la dette française 15
b. Une progression forte de l’endettement depuis quarante ans 17
2. Les dynamiques en œuvre dans l’augmentation de la dette 20
a. L’installation d’un déficit public permanent depuis 1974 20
b. Une transformation radicale du mode de financement des États et l’existence d’un effet « boule de neige » 27
c. Les effets du ralentissement de la croissance et de l’inflation 31
3. La dette publique de la France est-elle soutenable ? 35
a. La soutenabilité de la dette dépend avant tout du différentiel entre taux de croissance et taux d’intérêt réel 35
b. Les soldes budgétaires stabilisant : une indication fragile 37
c. Le déficit structurel ne permet pas d’appréhender la soutenabilité de la dette 39
d. Une notation toujours positive de la dette française 40
e. Les risques du recours aux cessions d’actifs et les contributions au désendettement 41
f. Faut-il une règle plus contraignante pour piloter les finances publiques au niveau national ? 43
B. LE COÛT DE LA DETTE PUBLIQUE : LE TROISIÈME POSTE DE DÉPENSES DE L’ÉTAT 44
1. Le coût global de la dette pour les finances publiques 44
2. Le paradoxe de la situation actuelle : une dette publique en hausse, une charge de la dette en baisse 47
3. Jusqu’à quand les créanciers de l’État accepteront-ils des rendements faibles, voire négatifs ? 48
a. Pourquoi les investisseurs continuent-ils à acheter les titres émis par l’État ? 48
b. Un environnement de taux négatifs n’est pas tenable à terme 51
II. LE FINANCEMENT DE LA DETTE DE L’ÉTAT : UNE GESTION EFFICACE DANS UN CADRE CONTRAINT 53
A. UNE GESTION DE LA DETTE CONTRAINTE PAR LES RÈGLES EUROPÉENNES ET NATIONALES 53
1. La disparition des possibilités de monétisation de la dette au profit d’un financement passant exclusivement par les marchés financiers 53
a. Une évolution de la gestion sous l’égide de la construction européenne 53
b. Une gestion de la dette sous la surveillance des marchés 55
2. La création de l’AFT et son rôle dans la gestion de la dette publique 57
3. Des émissions de dette encadrées par les lois de finances 61
B. UNE GESTION À L’ÉCOUTE DES ATTENTES DES INVESTISSEURS 62
1. La stratégie mise en œuvre par l’AFT 62
a. Le rôle du comité stratégique 62
b. Les principes directeurs de la stratégie de l’AFT 64
c. Un professionnalisme et une efficacité reconnus 66
2. Les outils de la politique d’émission 67
a. Les produits 67
b. Le rôle déterminant des spécialistes en valeurs du Trésor 73
c. Les émissions sur le marché primaire 77
d. Des titres échangés sur le marché secondaire, le marché de « l’occasion » 82
3. La politique d’émission en période de taux bas : les questions de l’allongement de la durée de la dette et du réabondement des souches anciennes 85
a. Peut-on allonger la durée moyenne de la dette pour sécuriser une plus grande partie de la dette aux taux actuels ? 85
b. Pourquoi émettre des titres portant un coupon supérieur aux taux du marché ? 89
III. QUI POSSÈDE LA DETTE ? UNE QUESTION SANS RÉPONSE 94
A. LA CONNAISSANCE DES DÉTENTEURS DE LA DETTE DE L’ÉTAT EST INSUFFISANTE 94
1. Une connaissance fragmentaire reconstituée à partir de différentes sources 94
2. Une dette majoritairement détenue à l’étranger 96
3. Faut-il « réinternaliser » la dette ? 100
B. LES ENJEUX D’UNE PLUS GRANDE TRANSPARENCE 102
C. LES OBSTACLES À L’IDENTIFICATION DES CRÉANCIERS DE L’ÉTAT 104
1. Des échanges permanents sur le marché secondaire, des intermédiaires nombreux et internationaux 104
2. La traçabilité des titres se heurte à un obstacle juridique… 106
3. … et à la volonté de préserver l’anonymat des investisseurs 108
IV. LES DÉFIS ÉCONOMIQUES POSÉS PAR LA DETTE INCITENT À DÉPASSER LES SOLUTIONS TRADITIONNELLES 111
A. LES PROBLÈMES ÉCONOMIQUES POSÉS PAR LA DETTE 111
1. Les critères de Maastricht, bien qu’assouplis à de nombreuses reprises, conduisent à des politiques déflationnistes qui aggravent la dette 111
a. Des règles contraignantes pour la gestion de la dette publique 111
b. Une obsolescence de fait du PSC renforcée par sa contestation récurrente 114
c. Le risque de trappe déflationniste alimenté par la déconnexion entre politique monétaire et politique budgétaire 116
2. Une exposition de plus en plus problématique au risque de taux 117
3. Le risque d’émergence de nouvelles bulles spéculatives via l’assouplissement quantitatif 120
a. Les effets positifs du quantitative easing sur l’activité et la dette 120
b. Les limites du quantitative easing : hausse des inégalités, risque de bulle financière, efficacité limitée de la transmission de la politique monétaire 126
B. LES POSSIBILITÉS DE RÉDUIRE L’ENDETTEMENT PAR UNE RÉFORME DU CADRE EN VIGUEUR 127
1. Faire évoluer le rôle de la BCE : monétiser les dettes publiques ou permettre un financement monétaire ciblé ? 127
a. La transmission de la politique monétaire pourrait être facilitée par le recours à des instruments directs de financement 128
b. Cette approche suppose cependant des évolutions importantes des mentalités et de la législation 131
2. La possibilité et les problèmes posés par une restructuration concertée de la dette 132
3. Transformer le FESF en banque ? 135
4. Recourir plus largement aux garanties publiques ? 135
LISTE DES PROPOSITIONS 137
EXAMEN EN COMMISSION 139
COMPTES RENDUS DES AUDITIONS 153
ANNEXE 300
Contribution de Jean-Pierre Gorges
De la dérive à l’addiction
Que retenir des travaux de la Mission parlementaire d’évaluation et de contrôle sur la dette française, dont j’ai été l’un des rapporteurs ?
D’abord, que l’histoire de sa constitution est révélatrice. Nous avons pu en retracer l’évolution étape par étape depuis environ quarante ans, c’est-à-dire depuis que les gouvernements successifs ont pris la mauvaise habitude de faire voter des budgets en déficit.
Leur succession régulière a nourri la dette de la France. On peut même affirmer sans crainte d’être démenti que toutes les politiques publiques se sont construites sur le postulat suivant : pour être élu et gouverner tranquille, il n’est pas gênant de vivre à crédit. Pour régler la note, on verra plus tard.
À cet égard, nous avons pu constater le coût durable de propositions électorales et de décisions gouvernementales jugées encore aujourd’hui comme emblématiques par la société française. Ainsi de la retraite à 60 ans ou des 35 heures, liste non limitative…
Parallèlement, et c’est probablement le plus grave, l’État a progressivement cessé d’investir. Le PIB de la France s’élève aujourd’hui à 2 100 milliards d’euros, la dépense publique à 1 250 milliards, et l’investissement de l’État à 16 milliards seulement… Vous avez bien lu.
La dette française se présente aussi comme une trinité inégale.
200 milliards sont le fait des collectivités locales et territoriales. Mais les emprunts correspondants sont destinés exclusivement à l’investissement. Ils sont effectivement remboursés ainsi que leurs frais financiers, puisque les collectivités sont dans l’obligation de présenter des comptes en équilibre. Mais l’État fait valoir que les moyens qui permettent aux collectivités d’investir viennent d’abord de la DGF, dont les montants leur sont transférés par l’État…
C’est ce qui justifie probablement les décisions gouvernementales récentes de baisser la DGF, en arguant de la lutte nécessaire contre les déficits… Mais cela laisse pendant le problème de l’investissement public.
Cependant, cette décision a eu pour première conséquence de freiner brutalement les investissements des collectivités, avec les retombées économiques négatives que chacun peut observer aujourd’hui.
Ensuite, il y a la dette sociale, qui est intégralement une dette de fonctionnement. Certes la CRDS a été créée pour garantir son remboursement. Mais chacun peut observer que le rythme de celui-ci est très lent, et que cet outil réputé provisoire voit ses échéances reculées année après année. La France finance son système social à crédit.
Enfin, la dette de l’État, très majoritairement due aux dépenses de son fonctionnement, n’est aujourd’hui pas remboursée. Nous empruntons chaque année de quoi financer le renouvellement d’une partie de son montant, aggravé des intérêts financiers, et du financement du nouveau déficit de l’exercice qui s’achève.
Il n’en reste pas moins que l’annuité correspond à 130 milliards d’euros, et le nouveau déficit budgétaire à plus ou moins 70 milliards (dont les intérêts financiers de 42 milliards cette année), malgré le contexte extrêmement favorable des taux de l’argent.
Je passe sur les gymnastiques financières récentes destinées à permettre au gouvernement de ne pas afficher avant les échéances électorales de 2017 une dette dont le montant serait supérieur à celui du PIB. Ces artifices ont un coût qui sera payé plus tard. Par d’autres ?
Nous avons également analysé la gestion de la dette française. Je crois pouvoir affirmer qu’il y a unanimité à cet égard : les spécialistes de France Trésor méritent toutes nos félicitations.
En effet, ce n’est pas de leur fait s’il n’existe aujourd’hui aucun projet qui affiche clairement une volonté politique d’inverser le processus apparemment sans fin de l’alourdissement de la dette française.
C’est inquiétant, ne serait-ce que parce que cela nous oblige à nous interroger sur la durabilité des politiques publiques en cours, et aussi de celles qui font l’objet des promesses électorales de 2017.
De plus, nous vivons une sorte de débat public hors sol, qui compromet l’avenir du pays, où sévit une sorte de guerre de religion entre deux camps également illusionnistes : les uns affirment que l’alourdissement de la dette n’est pas grave, puisque nous ne la rembourserons jamais ; et les autres, plutôt adeptes du bonneteau, nous affirment qu’une sortie de l’euro suffira à régler le problème.
Pourtant, les risques sont réels. Il n’est nulle part écrit que les taux de l’argent resteront indéfiniment négatifs ou même bas. Il arrive parfois aussi que les marchés financiers ne suivent plus. On l’a vécu durement en 2008-2009. On l’a ressenti aussi brutalement mais fugitivement lors de l’annonce du Brexit, dont les conséquences réelles à terme restent inconnues.
Enfin, la France a aujourd’hui développé une sorte de dépendance à la dette. Ainsi la BCE en détient 18 %, tendance en hausse. L’indépendance de notre pays en est de fait altérée, et c’est d’autant plus vrai que l’on connaît mal les autres détenteurs de la dette française.
Et puis la politique de la BCE de rachat des dettes souveraines à taux négatifs est-elle durable ?
Elle me fait penser à la naissance d’une addiction, à ces premières doses de drogue que des gens bien intentionnés vous offrent. « Essaye ! » C’est comme cela que l’addiction commence, et il est rare que ce genre d’histoire finisse bien…
Contribution de Nicolas Sansu
La dette publique de la France a atteint 2 096 milliards d’euros fin 2015. Cette dette n’a cessé de progresser depuis 1974.
Voici donc plus de quarante ans que cette dette pèse de plus en plus sur le débat public et sur les politiques publiques, alimentant tous les phantasmes et les catastrophismes.
Dans une perspective historique, force est de constater que l’explosion de cette dette, qui concerne tous les pays développés, a coïncidé avec le triomphe de l’idéologie néolibérale (le fameux There Is No Alternative de Madame Thatcher).
C’est dans le cadre du changement de doctrine de financement de l’État - par le recours exclusif aux marchés financiers – de l’affaiblissement du pacte social issu de l’après-guerre (programme du Conseil National de la Résistance) et de la dérégulation mondialisée des échanges, que se sont constituées toutes les dettes souveraines.
Elles ont d’ailleurs progressé partout, quel que soit le modèle socio-économique, en France comme aux États-Unis, au Royaume-Uni comme au Danemark.
Il n’y a donc pas de lien entre dette et niveau de dépenses publiques, ou en tout cas pas sur le trend de long terme, car là où les dettes privées sont trop importantes, elles finissent par être reprises par la sphère publique (crise de 2008 aux États-Unis et en Espagne).
Donc, la dette est consubstantielle au modèle de développement qui, peu ou prou, est le même dans tous les pays du monde occidental.
C’est pourquoi, il faut se poser les seules questions qui vaillent : à qui profite la dette, quel est son rôle, et comment sortir de cette spirale ?
Les travaux de la MEC que nous avons conduits ont permis de montrer que l’effet "boule de neige" est toujours à l’œuvre (taux d’intérêt réels supérieurs au taux de croissance de l’économie), et donc qu’on ne peut attribuer aux seuls déficits successifs le gonflement de la dette.
L’absence de transparence et de réelle connaissance des détenteurs de la dette ne provient pas d’une difficulté technique, il s’agit bien – comme l’ont souligné plusieurs personnes auditionnées – d’un choix politique. Ce choix politique est contestable car il ne permet pas d’assurer une véritable souveraineté sur notre dette !
Il y a pourtant nécessité de pouvoir remonter jusqu’au détenteur final, ne serait-ce que pour éviter que les titres de dette publique française n’alimentent la "chaudière" des paradis fiscaux. Ce serait la moindre des précautions à un moment où la fraude et l’évasion fiscales amputent nos ressources communes de 60 à 80 milliards d’euros par an.
Alors, au nom de la dette, on impose des politiques restrictives partout en Europe. La dette est donc un puissant vecteur de domination des tenants de la pensée unique. Il n’est qu’à voir le sort fait à la Grèce et la pression des créanciers pour imposer des restrictions très dures pour le peuple.
C’est pourquoi, il est urgent de sortir de cette spirale infernale. La pression exercée par la dette publique, et donc par les marchés financiers, doit être combattue.
Dans le cadre de cette mission, plusieurs propositions sont évoquées comme le changement des règles de financement des investissements via la BEI mais d’autres chemins devraient être explorés.
D’ailleurs, au nom du groupe GDR, j’avais déposé une proposition de résolution européenne sur l’évolution des dettes souveraines dans la zone euro (n° 2723) et commis un rapport (n° 2738) avec des propositions qui restent d’actualité, en premier lieu desquelles la convocation d’une conférence européenne sur la dette.
C’est avec une telle conférence européenne qui pourra déboucher sur une négociation des dettes souveraines (avec étalement et annulation de la dette illégitime) que l’on désensibilisera notre dépendance à la dette.
Nietzsche, dans la Généalogie de la morale, décrivait le coup de génie du christianisme par l’effacement de la dette symbolique des hommes : « Dieu lui-même, Dieu parvenant seul à libérer l’homme de ce qui pour l’homme même est devenu irrémissible, le créancier s’offrant pour son débiteur, par « amour » (qui le croirait ?), par amour pour son débiteur ! ».
Sans intervention divine, la France doit pourtant se sauver elle-même d’une situation d’endettement que la plupart des acteurs s’accordent à reconnaître comme pesant lourdement sur son indépendance financière et donc sur sa capacité à maîtriser son destin.
Cependant, la dette publique ne se résume pas uniquement à un fardeau : elle est d’abord liée à la constitution du bien public, à ce qui fait la cohésion des sociétés dans le temps. La dette publique s’avère nécessaire, dans le cadre du financement actuel des États, pour assurer la cohérence intergénérationnelle de la société. Il n’est pas anormal en effet que le coût des équipements publics qui seront utilisés par plusieurs générations ne soit pas totalement supporté par la génération actuelle.
Ce n’est donc pas tant le niveau de la dette publique qui importe que sa soutenabilité et son impact sur les politiques publiques. Se poser la question de la gestion et de la transparence de la dette publique, c’est donc se demander dans quel cadre, pour quelles raisons, et éventuellement au profit de qui, la dette publique a-t-elle pu tant se développer. C’est aussi tenter de proposer des solutions pour regagner des marges de manœuvre, assurer notre indépendance et faire en sorte que la dette de tous ne constitue pas une rente pour quelques-uns.
Les réponses ne sont pas simples et elles doivent chercher à dépasser les clivages partisans. C’est l’objet de la mission d’évaluation et de contrôle (MEC). On peut en effet estimer, de part et d’autre, que tel allégement fiscal ou telle politique publique ont contribué à aggraver la dette, en diminuant les recettes ou en augmentant les dépenses. Le déficit budgétaire n’explique cependant pas à lui seul l’accumulation de dette publique, car la question de la progression de la dette renvoie à des mécanismes plus profonds.
En effet, la dette est aussi fonction de la croissance, du mode de financement des États, du niveau de l’inflation et de celui des taux d’intérêt. Si bien que deux États placés dans une situation de déficit budgétaire comparable, mais dont l’environnement économique et monétaire diffère complètement, peuvent connaître une évolution radicalement différente de leur dette publique.
Ainsi, après des périodes de fort endettement comme au sortir de la seconde guerre mondiale, la part de la dette dans le PIB a été rapidement réduite, principalement en raison d’une forte hausse de l’inflation (qui réduit la valeur réelle de la dette) et d’une croissance forte. Un tel niveau de dettes pouvait par ailleurs être amorti par le jeu de dévaluations successives, que l’euro interdit désormais. Il y a donc eu un changement d’environnement macroéconomique.
Dans le même temps, on a assisté à une transformation profonde du mécanisme de financement général de l’État. Auparavant, celui-ci pouvait compter sur tout un mécanisme qualifié de « circuit du Trésor » qui lui permettait de drainer une épargne suffisante, tant auprès des banques que des particuliers, à des conditions qu’il définissait lui-même. Il pouvait en outre compter sur la banque centrale pour lui fournir des avances, voire même pour monétiser sa dette (c’est-à-dire l’effacer par le biais de son pouvoir de création monétaire). Sous l’effet d’un changement des paradigmes dominants de la théorie économique, qualifié de « tournant monétariste » au milieu des années 1970, ce système qui permettait à l’État de financer sa dette sans trop de difficultés s’est effondré.
Au nom de la transparence et de la discipline, l’État s’est volontairement livré à la contrainte d’emprunter sur les marchés financiers, à des conditions qu’il ne maîtrisait plus. Quarante années plus tard, il doit payer environ 45 milliards d’euros par an pour rembourser les seuls intérêts des emprunts qu’il a contractés. À qui paye-t-il ces sommes considérables ? La réponse est loin d’être évidente. Banques centrales, banques commerciales, fonds d’investissement, compagnies d’assurances, en France ou à l’étranger, l’Agence France Trésor elle-même, en charge de la gestion de la dette, ne possède pas de renseignements précis.
On se retrouve ainsi face à un paradoxe : alors que l’ambition initiale visant à pousser l’État à se financer sur les marchés visait à atteindre davantage de transparence et moins d’intervention de l’État dans l’économie, on se retrouve désormais face à des mécanismes obscurs, complexes et opaques qui vont jusqu’à permettre à des sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux d’acquérir sans limite des titres de dette souveraine qu’elles contribuent elles-mêmes à alimenter par l’évasion fiscale. Dans le même temps, la question de la dette publique occupe plus que jamais le devant de la scène des problèmes économiques, comme on l’a récemment observé avec la crise de la zone euro provoquée par l’insoutenabilité de la dette grecque. Cette double désillusion exige un questionnement sur l’ensemble des mécanismes de gestion de la dette publique. Si ceux-ci apparaissent efficaces, c’est alors sur le cadre économique et juridique d’ensemble que doivent porter les interrogations.
I. LA PROGRESSION DE LA DETTE PUBLIQUE : UN PHÉNOMÈNE GÉNÉRAL AUX CAUSES MULTIPLES
La dette publique française s’élève aujourd’hui à près de 2 096 milliards d’euros et sa croissance a été continue depuis 1974 – date du dernier budget en équilibre – et particulièrement depuis 2008 du fait de la crise financière et de ses conséquences.
Si le contexte économique actuel permet à la France de bénéficier de taux d’intérêt sur les emprunts d’État, qui ont rarement été aussi faibles, ce qui contribue à alléger la charge de la dette, il fait cependant peser de nombreux risques sur la dette française.
A. UNE DETTE PUBLIQUE EN PROGRESSION CONSTANTE DEPUIS 1974
1. L’ensemble des pays industrialisés et les secteurs public comme privé connaissent un fort niveau d’endettement
Fin 2015, les dettes publiques de la quasi-totalité des grands pays développés ont atteint des niveaux extrêmement élevés : 248 % du PIB au Japon, 105 % aux États-Unis, 89 % en Grande-Bretagne, 91 % dans la zone euro (133 % pour l’Italie, 96,1 % pour la France, 71 % pour l’Allemagne).
a. La structure de la dette française
La dette publique brute de la France s’élève, à la fin 2015, à 2 096 milliards d’euros. En son sein, la dette de l’État, en hausse de 49,8 milliards d’euros par rapport à 2014, représente à elle seule 1 661,2 milliards d’euros, soit presque 80 % du total.
La dette des organismes divers d’administration centrale (ODAC) s’élève à 18,9 milliards d’euros, celle des administrations publiques locales (APUL) à 196,5 milliards d’euros et celle des administrations de sécurité sociale (ASSO) à 220,3 milliards d’euros.
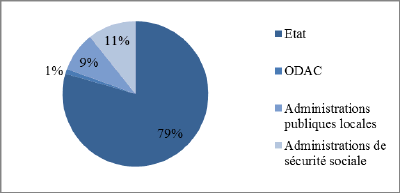
Source : Insee.
La dette nette des administrations publiques s’élève, pour 2015, à 1 904,1 milliards d’euros (soit 87,3 % du PIB), en hausse de 53,5 milliards par rapport à 2014.
DETTE PUBLIQUE BRUTE ET DETTE PUBLIQUE NETTE
(en milliards d’euros)
Au 31 décembre 2015 | ||
Dette publique brute |
Dette publique nette | |
État |
1 661,2 |
1 556,7 |
Organismes divers d’administration centrale |
18,9 |
2,9 |
Administrations locales |
196,5 |
184,0 |
Administrations de sécurité sociale |
220,3 |
160,5 |
Ensemble des administrations publiques |
2 096,9 |
1 904,1 |
En % du PIB |
96,1 |
87,3 |
Source : Insee, comptes nationaux, base 2010.
Dette publique brute et nette
Il existe un débat récurrent sur la distinction entre dette brute et dette nette. La seconde se calcule en soustrayant à la dette brute les actifs que possèdent les administrations publiques (dépôts, crédits et titres de créance négociables détenus par les administrations publiques sur les autres secteurs). Si l’on en soustrait les actifs financiers pour obtenir la dette nette, l’endettement public de la France n’est plus que de 87,3 % du PIB. Et si on prend en compte le patrimoine public, en intégrant l’ensemble des actifs physiques, y compris les bâtiments publics, le solde devient même positif (31 % du PIB en 2012).
Se référer à la dette brute, conduit à présenter comme importantes des opérations qui sont en fait neutres pour le patrimoine public : par exemple un remboursement de dette par une vente d’actifs publics (tels que des terrains ou des participations dans des entreprises), ou inversement une nationalisation payée par une émission de dette.
En tout état de cause, la dette publique a pris des proportions importantes à partir des années 1970, sans interruption ni renversement de tendance, et quelles que soient les majorités au pouvoir.
Ce phénomène ne concerne pas uniquement la France et touche presque tous les pays développés. Les États-Unis, par exemple, qui avaient ainsi un endettement public très peu important jusqu’à la fin des Trente Glorieuses, ont vu celui-ci fortement progresser au tournant des années 1970 et 1980, tout en suivant des politiques fiscales et sociales très différentes de la France.
On peut donc considérer que la dette n’est que partiellement dépendante de la nature des politiques publiques mises en œuvre ou, plus précisément, qu’elle trouve aussi son origine dans une situation économique d’ensemble qui est commune à l’ensemble des grands pays industrialisés.
b. Une progression forte de l’endettement depuis quarante ans
En 1974, la dette publique française était proche de 20 % du PIB, soit un niveau suffisamment faible pour la placer hors du débat politique. Sept ans plus tard, malgré deux chocs pétroliers et une montée significative du chômage, la dette publique n’a finalement que peu progressé puisqu’elle n’atteint, en 1981, que 21 % du PIB.
Entre 1981 et 1991, l’endettement public va progresser de 15 points (de 21 à 36 % du PIB) avec des déficits budgétaires annuels compris entre 2 et 3 points de PIB. Parallèlement, la richesse du pays continue de progresser : entre 1974 et 1991, le PIB, en euros courants (non corrigé de l’inflation), passe ainsi de 210 milliards d’euros à 1 097 milliards d’euros (1).
De 1992 à 1998, à la suite d’une récession en 1992-1993, la dette publique va connaître une première phase d’accélération exponentielle. En six ans, la part de la dette par rapport au PIB progresse de 24 points (36 % à 60 %), soit en moyenne de 4 points par an, avec des déficits budgétaires parfois proches de 6 % du PIB avant un retour à 3 % du PIB en 1998.
De 1999 à 2001, le taux de la dette par rapport au PIB diminue et repasse sous la barre des 60 % fixée par le Traité de Maastricht, parallèlement à l’entrée en vigueur de l’euro. La France respecte les critères de Maastricht (60 % de dette publique, un taux de déficit annuel du budget de 3 % avec une croissance de 2 % du PIB).
La dette publique reprend ensuite sa progression entre 2001 et 2007, sur un rythme plus lent, puisque la dette n’atteint que 64 % du PIB en 2007.
C’est alors qu’interviennent la crise financière et la deuxième phase d’accélération de la dette publique. Entre 2007 et 2015, la dette passe de 64 à 96,1 % du PIB, soit un montant en valeur de 2 096 milliards d’euros. Sur les quatre premières années de cette période, de 2007 à 2011, le taux de la dette publique passe de 64 % à 87 % du PIB (+ 10,9 points pour la seule année 2009), soit une progression de 5 points par an, qui diminue à 2 points par an en moyenne, entre 2011 et 2015.
ÉVOLUTION DE LA DETTE PUBLIQUE DEPUIS 1978
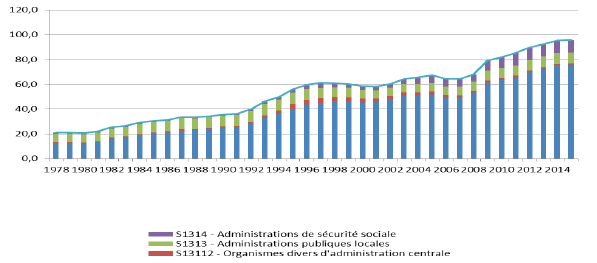
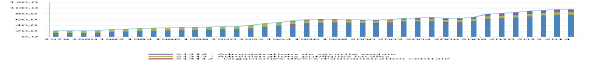 Source : AFT.
Source : AFT.
On constate une progression continue du rythme de progression de la dette publique depuis vingt ans et une accélération dans la période récente.
VARIATION ANNUELLE DE LA DETTE PUBLIQUE
(en points de PIB)
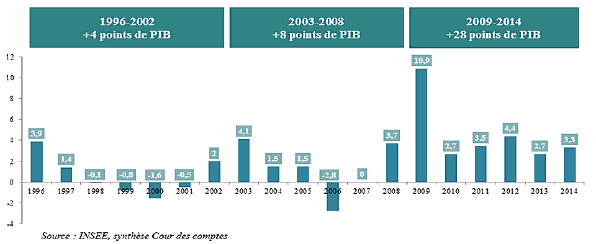
Il faut préciser qu’au cours de la période récente, la dette de l’État a crû plus rapidement que celles des collectivités locales et de la sécurité sociale : elle a augmenté de 20 % entre 2010 et 2014, quand celle des administrations publiques locales croissait de 7 % et celle des administrations de sécurité sociale de 16 %. Quant à la dette des opérateurs de l’État (organismes divers d’administration centrale, ODAC), elle a diminué de 31 % au cours de la même période.
LA DETTE SOCIALE La dette sociale est constituée de quatre sous-ensembles. ● La Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) amortit chaque année 14 milliards d’euros grâce aux ressources qui lui sont affectées. L’encours de dette votée devant être repris par la CADES est de 269,8 milliards d’euros à la fin 2015. Son terme est estimé à 2024. ● Il s’est constitué, dans la période récente, une dette à court terme portée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), qui assure la trésorerie du régime général : son déficit était de 27,5 milliards d’euros à la fin de l’année 2014. L’ACOSS est donc un émetteur important de dette à court terme sur les marchés financiers. ● Quant à la dette des hôpitaux publics, elle représente 1,5 point de PIB (29,4 milliards d’euros) après avoir triplé entre 2002 et 2015, en raison des plans successifs de relance de l’investissement hospitalier qui ont été mis en place au début des années 2000. ● Enfin, il est plus particulièrement question en ce moment de la dette de l’UNEDIC, qui représente environ 1,4 point de PIB (25,9 milliards d’euros fin 2015) et dont le déficit s’amplifie (3,9 milliards d’euros en 2014, 4,4 milliards d’euros en 2015). * La dette des administrations de sécurité sociale est exposée à un risque de remontée des taux, pour la dette à court terme, naturellement, mais aussi pour la dette à long terme, car il s’agit d’une dette partiellement à taux révisable. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a accéléré le calendrier de reprise de cette dette par la CADES. Il restera cependant un découvert de trésorerie d’environ 20 milliards d’euros à la fin de l’année 2016. Ces découverts sont financés par des émissions à court terme. |
Si ce niveau de dette publique est inédit sous la Ve République, dans le temps long, la situation actuelle n’est pas exceptionnelle : l’État français a eu recours à la dette pour faire face à de fortes dépenses, comme pendant les périodes de conflit. La dette est passée, par exemple, d’une valeur presque nulle par rapport au PIB en 1820, à environ 290 % du PIB en 1944. La dette publique (comme privée) est devenue partie intégrante du fonctionnement économique, social et financier de la société.
Il est important de souligner que ce phénomène de progression de la dette touche également l’endettement privé qui a également augmenté significativement au cours de la même période. En France, le taux d’endettement des agents non financiers atteint ainsi 124,8 % du PIB (55,8 % pour les ménages, 69 % pour les sociétés non financières). En témoigne également le taux d’endettement très élevé des secteurs privé non financier en zone euro (de 122,7 % du PIB des États de la zone euro à la fin 2015) et financier (150 % du PIB de la zone euro), lequel progresse constamment depuis une quinzaine d’années.
Ce phénomène d’endettement public et privé concomitant pose avec d’autant plus d’importance la question d’une stratégie de désendettement : en effet, lorsque tous les acteurs cherchent à se désendetter en même temps, entraînant ainsi une destruction monétaire à travers les remboursements cumulés, le risque de déflation est extrêmement fort. Or, la déflation est le pire scénario en matière de remboursement de dette puisque la différence entre la valeur réelle et la valeur nominale de la dette accroît mécaniquement la valeur réelle de celle-ci (en effet, si les prix baissent, la dette exprimée de manière nominale apparaît relativement plus importante en termes réels, c’est-à-dire en termes de pouvoir d’achat, du fait de l’augmentation de la valeur de la monnaie induite par la déflation).
2. Les dynamiques en œuvre dans l’augmentation de la dette
Les facteurs d’augmentation de la dette résultent d’une conjonction d’éléments, tant structurels que conjoncturels et tant politiques qu’économiques. De manière générale, la dette a évolué en même temps que changeaient le mécanisme général de financement de l’État et le contexte économique général, en particulier la politique monétaire.
Trois mécanismes principaux se sont conjugués :
– le niveau des dépenses publiques, et la baisse des recettes en proportion du PIB alimentée, notamment, par la concurrence fiscale et l’évasion fiscale, qui ont conduit à une progression du déficit public ;
– la disparition du circuit du Trésor et le financement de l’État par les marchés financiers, conjugué au durcissement de la politique monétaire ;
– le ralentissement général de la croissance et de l’inflation.
a. L’installation d’un déficit public permanent depuis 1974
La dette publique résulte d’une accumulation de déficits. Les mécanismes qui déterminent le déficit public dépendent à la fois des dépenses publiques (qui intègrent la charge de la dette et dépendent donc en partie du différentiel entre taux d’intérêt et taux de croissance) et de l’évolution des recettes, qui est elle-même conditionnée par le niveau de croissance et les choix effectués en matière de politique fiscale.
Depuis 1974, aucun budget n’a été voté en équilibre en France, que ce soit pour faire face à une situation de l’emploi dégradée ou pour limiter les effets des crises économiques et du ralentissement général de la croissance. Par conséquent, les déficits ont eu tendance à s’accentuer pour atteindre leur paroxysme en 2009, sous l’effet de la crise financière, année pendant laquelle la différence entre recettes et dépenses a atteint 138,9 milliards d’euros (soit 7,2 points de PIB).
DÉFICIT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES EN COMPTABILITÉ NATIONALE
(en milliards d’euros)
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 | |
S13 - Ensemble des administrations publiques |
– 138,9 |
– 135,8 |
– 105,0 |
– 100,4 |
– 85,4 |
– 84,8 |
– 77,5 |
Source : Insee.
Cette situation n’est pas propre à la France : comme le rappelle Henri Sterdyniak, « de 1974 à 2013, la France et l’Italie n’ont jamais eu d’excédents budgétaires ; les États-Unis n’en ont connu que trois années, l’Allemagne et la Grande-Bretagne quatre, le Japon cinq. L’équilibre budgétaire n’est donc pas une norme » (2). Dans la période actuelle, la quasi-totalité des pays développés connaissent ainsi de forts déficits publics, soit, en 2014, 7,8 % du PIB au Japon, 5,7 % au Royaume-Uni, 4,9 % aux États-Unis – mais 2,4 % seulement dans la zone Euro.
De manière générale, les dépenses de l’État ont eu tendance à augmenter plus rapidement que ses recettes, alors que ces mêmes recettes connaissaient parfois d’importantes évolutions à la baisse, pour des raisons conjoncturelles ou sous l’effet de choix politiques.
• La hausse globale des dépenses publiques
La part des dépenses publiques dans le PIB est passée de 35 points de PIB en 1960 à 56,8 points en 2015. À mi-chemin de cette période, en 1993, le niveau des dépenses publiques était déjà proche de 55 points de PIB. Ainsi, que ce soit à travers les dépenses sociales, territoriales ou celles de l’État, la dépense publique a alimenté le déficit. Dans la mesure où la hausse concomitante des prélèvements obligatoires n’a pas suffi à couvrir la dépense publique, la différence a été nécessairement financée par l’endettement. Pour rappel, en 1978, le niveau des recettes publiques était de 42,98 % du PIB, puis de 50,83 % en 2011 et de 53,2 % en 2015. Le niveau de recettes est donc constamment resté inférieur à celui des dépenses.
Concernant les collectivités territoriales, il convient néanmoins de souligner que la hausse de leurs dépenses est nécessairement compensée par celle de leurs recettes, en raison de l’obligation qui leur est faite de voter un budget de fonctionnement en équilibre. La question de la dette des collectivités locales ne se pose donc pas dans les mêmes termes puisque seules les dépenses d’investissement peuvent être financées par le recours à l’emprunt.
RATIOS DE FINANCES PUBLIQUES DEPUIS 2012
(en % du PIB)
2012 |
2013 |
2014 |
2015 | |
Déficit public |
– 4,8 |
– 4,0 |
– 4,0 |
– 3,6 |
Dette publique (brute) |
89,6 |
92,4 |
95,3 |
96,1 |
Dette publique nette* |
80,6 |
83,6 |
86,5 |
87,3 |
Recettes publiques |
52,0 |
52,9 |
53,4 |
53,5 |
Dépenses publiques |
56,8 |
57,0 |
57,3 |
57 |
Prélèvements obligatoires |
43,8 |
44,8 |
44,8 |
44,7 |
(*) La dette publique nette est égale à la dette publique brute moins les dépôts, les crédits et les titres de créance négociables détenus par les administrations publiques sur les autres secteurs.
Source : Insee, mars 2016.
Une analyse de la structure des dépenses montre par ailleurs que les dépenses de l’État ont régressé en proportion du PIB depuis les années 1980 alors que celles liées à la sécurité sociale et aux collectivités territoriales ont progressé du fait de la décentralisation et des transferts de charges qui en ont résulté. En valeur, les dépenses de l’État sont certes passées de 101 milliards d’euros en 1980 à 463 en 2014 mais, en part du PIB, elles sont restées stables, avec même une tendance à la baisse ces dernières années : en 1985, les dépenses de l’État représentaient ainsi 24,8 % du PIB, 22,5 % en 2000 et seulement 21,6 % du PIB en 2014. La part des dépenses de l’État dans le PIB français a donc baissé de trois points en trente ans (3).
À l’inverse, la part des dépenses sociales et des dépenses des collectivités territoriales a augmenté en pourcentage du PIB sur la même période. Dans la dépense publique prise dans son ensemble (56,8 % du PIB en 2015), l’État ne représente aujourd’hui que 26 % des dépenses publiques, les ODAC en portent 6,7 %, les collectivités territoriales 20,5 % et les administrations de sécurité sociale près de 46,5 %.
Néanmoins, le déficit public (– 77,5 milliards d’euros) est essentiellement celui de l’État (– 72,4 milliards d’euros fin 2015) et des administrations de sécurité sociale dans une moindre mesure (– 5,8 milliards d’euros), le solde des administrations territoriales étant quant à lui légèrement positif en 2015 (0,7 milliard d’euros).
Pour lutter contre l’endettement, comme l’a rappelé le ministre des finances Michel Sapin à la mission, le Gouvernement a pour stratégie de maîtriser les dépenses publiques (qui s’établissent en 2015 à 56,8 % du PIB, soit le même niveau qu’en 2012, après une légère augmentation en 2013 et 2014) tout en baissant le ratio de prélèvements obligatoires, en particulier pour les entreprises, afin de favoriser la croissance et d’obtenir une stabilisation de l’endettement. En valeur, le ralentissement de la progression des dépenses publiques a été constaté entre 2012 et 2015. (4)
Les membres de la mission considèrent sur ce point que l’investissement productif devrait être privilégié au sein de la dépense publique. À titre d’exemple, l’instauration d’une TVA réduite dans la restauration a réduit de près de 2,1 milliards d’euros les recettes fiscales, pour un résultat largement reconnu comme insuffisant, notamment en matière d’emploi ou d’investissement.
La Cour des Comptes (5) a dressé le constat selon lequel la croissance de la dette ne finance que pour une faible part des investissements. Ainsi, en 2015, les investissements ont représenté 11,3 milliards d’euros pour des émissions de dette à moyen et long terme qui se sont élevées à 93 milliards d’euros. L’augmentation de la dette n’a donc financé des investissements qu’à hauteur de 12 %, des charges d’activité de l’État à hauteur de 64 % (personnel, fonctionnement, intervention et intérêts de la dette) et le solde (24 %) a servi à rembourser ou à acheter de la dette à court terme.
IMMOBILISATIONS RAPPORTÉES AUX DETTES À MOYEN ET LONG TERME
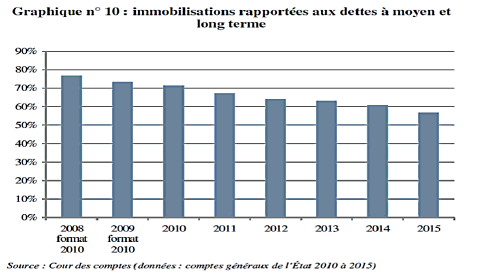
Centrer la dépense publique sur des investissements créateurs de richesse devrait donc être une priorité. Il faut d’ailleurs remarquer qu’en comptabilité nationale sont exclues du champ de la dépense publique des opérations qui affectent le déficit budgétaire telles que les opérations d’acquisition de titres financiers, puisqu’elles n’impliquent aucune diminution de l’actif financier net des administrations, mais seulement une réallocation d’actifs au sein du patrimoine des administrations entre trésorerie et titres. Il en va de même des dotations en capital si elles conduisent à une augmentation de la valeur de la participation de l’État détenue dans l’entreprise, et donc in fine du patrimoine de l’État.
C’est le cas de la dotation de l’État au Fonds stratégique d’investissement (FSI) en 2009, qui n’est pas considérée comme une dépense en comptabilité nationale et n’augmente donc pas le besoin de financement de l’État puisque celui-ci a reçu en contrepartie un actif financier de même valeur (6). Par conséquent, il pourrait être utile, sans que cela n’alourdisse la dépense publique et donc la dette, de recourir plus massivement à des fonds d’investissement ayant pour objectif de relancer l’investissement productif.
Proposition : Injecter davantage de ressources dans des fonds d’investissement publics, dans la mesure où leur impact est neutre au sens de la comptabilité nationale.
Les rapporteurs souhaitent rappeler que le niveau de la dépense publique n’est pas en soi un problème s’il conduit à favoriser l’expansion économique. En revanche, toute réduction mal ciblée de la dépense publique peut aggraver le problème de l’endettement. Ce sont notamment les conclusions d’une étude du FMI publiée en janvier 2013 (7) selon laquelle un euro de baisse des dépenses publiques en situation de forte dépression et de taux d’intérêt à leur plancher, diminue l’activité de plus d’un euro, avec un effet négatif sur les rentrées fiscales.
À titre d’exemple, pour un multiplicateur budgétaire (c’est-à-dire l’effet de la dépense publique sur la croissance) de 1,6 point, une baisse des dépenses publiques de 1 % du PIB diminue celui-ci de 1,6 % et n’entraîne une amélioration du solde public que de 0,2 %, mais conduit en revanche à augmenter le ratio dette/PIB de 0,4 %. En l’absence de politiques de soutien à la croissance, ce manque à gagner fiscal peut potentiellement être plus élevé que le gain escompté des réductions de dépenses publiques.
• La contraction des recettes fiscales
Le déficit de l’État dépend de ses dépenses, mais également de la croissance et des rentrées fiscales.
Pour stimuler la croissance, les différents Gouvernements ont donc souvent recouru à des baisses d’impôts, comme le souligne le rapport de Gilles Carrez (8) publié en 2010, alors qu’il était Rapporteur général : « entre 2000 et 2009, le budget général de l’État aurait perdu entre 101,2 – 5,3 % de PIB – et 119,3 milliards d’euros – 6,2 % de PIB – de recettes fiscales, environ les deux tiers étant dus au coût net des mesures nouvelles – les « baisses d’impôts » – et le tiers restant à des transferts de recettes aux autres administrations publiques
– sécurité sociale et collectivités territoriales principalement ».
De son côté, le collectif pour l’audit citoyen de la dette estime qu’en trente ans, la part des recettes de l’État dans le produit intérieur brut (PIB) a chuté de 5,5 points (9). Si cette part était restée constante, la dette publique serait inférieure à son niveau actuel de 24 points de PIB, soit 488 milliards d’euros.
La récapitulation de dix ans de baisse d’impôt est présentée dans le tableau ci-dessous.
DIX ANS DE BAISSE DES RECETTES FISCALES NETTES
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | |
Recettes fiscales nettes |
243,5 |
248,3 |
243,8 |
243,6 |
269,9 |
276,9 |
272,9 |
272,3 |
265,1 |
230,7 |
Évolution annuelle en % |
2,0 % |
– 1,8% |
– 0,1% |
10,8% |
2,6% |
– 1,5% |
– 0,2% |
– 2,6% |
– 13% | |
Évolution spontanée en % |
7,5 % |
– 0,2% |
0,1% |
6,7% |
4,4% |
8,8% |
6,0% |
2,8% |
– 9,6% | |
Coût cumulé des mesures nouvelles depuis 2000 en milliards d’euros | ||||||||||
Fourchette haute |
– 7,9 |
– 20,4 |
– 25,9 |
– 31,8 |
– 36,2 |
– 40,0 |
– 50,5 |
– 65,6 |
– 77,8 |
– 77,7 |
Fourchette basse |
– 7,9 |
– 19,8 |
– 25,2 |
– 30,2 |
– 32,5 |
– 33,9 |
– 41,6 |
– 53,5 |
– 61,7 |
– 68,3 |
Coût cumulé des mesures de périmètre depuis 2000 en milliards d’euros | ||||||||||
Fourchette haute |
– 1,7 |
– 7,8 |
– 12,7 |
– 15,8 |
– 17,9 |
– 22,0 |
– 25,6 |
– 34,6 |
– 38,2 |
– 41,6 |
Fourchette basse |
– 1,7 |
– 7,6 |
– 12,4 |
– 14,1 |
– 15,9 |
– 18,2 |
– 20,4 |
– 27,8 |
– 29,3 |
– 32,9 |
Source : ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État.
Trois facteurs ont joué dans la baisse générale du niveau des recettes publiques.
Premièrement, la concurrence fiscale s’est traduite par une diminution des taux d’imposition. On peut considérer que la concurrence fiscale a remplacé l’outil de la dévaluation : ne pouvant plus recourir à la dévaluation de leur monnaie pour relancer leur compétitivité ni adopter des mesures protectionnistes, les pays ayant intégré l’Union monétaire jouent sur leur fiscalité, seul outil encore à leur main, pour développer leur attractivité. De la même façon que les guerres de change conduisaient à des stratégies non coopératives, les pays européens se heurtent désormais aux inconvénients de la concurrence fiscale et sociale.
Le taux de l’impôt sur les sociétés (IS) est passé de 45 à 33 %, de même qu’ont été réduites le nombre de tranches de l’impôt sur le revenu (IR), avec la suppression notamment des deux plus hautes tranches en 2007 (celles à 42 et 48 %, remplacées par une tranche à 41 %) pour un manque à gagner de 3,9 milliards d’euros pour l’État, avant le rétablissement d’une sixième tranche à 45 % en 2012.
Cette évolution a été accentuée par la multiplication des dépenses fiscales. Le projet de loi de finances pour 2016 recensait 449 dépenses fiscales, dont 430 ayant un impact budgétaire en 2016. Le coût total de ces dépenses fiscales est estimé à plus de 83 milliards d’euros en 2016, soit plus que le déficit budgétaire à financer et près du double de la charge de la dette. Le crédit impôt recherche (CIR) représentait la dépense fiscale la plus élevée (environ 5 milliards d’euros par an) jusqu’à la création du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) qui coûtera en 2019, 20 milliards d’euros par an au budget de l’État (12 milliards d’euros en 2015).
Les rapporteurs souhaitent ici rappeler que la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (10) comporte plusieurs dispositions qu’il conviendrait d’appliquer dans leur intégralité : affectation d’éventuel surplus de recettes fiscales et sociales à la réduction du déficit public ; plafonnement en valeur des dépenses fiscales et crédits d’impôt et stabilisation des niches sociales ; révision des nouvelles dépenses fiscales et les niches sociales dans un délai de trois ans après leur entrée en vigueur.
Il convient en revanche de souligner qu’il est très difficile, voire impossible, de connaître l’impact réel sur la croissance des différentes mesures fiscales adoptées. En leur absence, il est possible que l’activité économique eût été différente, entraînant une évolution à la baisse (ou à la hausse suivant le point de vue adopté quant à leur efficacité) des recettes fiscales.
Proposition : Renforcer l’évaluation des politiques publiques, évaluer régulièrement l’efficacité des dépenses fiscales et tirer les conséquences de ces évaluations.
Enfin, l’évasion fiscale représente, d’après les évaluations de la Cour des comptes, 60 milliards d’euros par an de recettes nettes non perçues. Même s’il est par définition difficile de chiffrer le coût de manœuvres visant précisément à échapper à la taxation, le rapport de la commission d’enquête du Sénat de juillet 2012 sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales rappelait que le Conseil des prélèvements obligatoires évaluait le manque à gagner dans une fourchette de 29 à 40 milliards d’euros pour l’année 2007 (11).
Les enjeux budgétaires sont donc majeurs, et les enjeux moraux le sont aussi. Alors que l’impôt sur le revenu est concentré sur une minorité de foyers fiscaux, il n’est pas supportable de voir que des sociétés ou des foyers aisés parviennent à échapper à l’impôt. Il existe, en outre, un enjeu propre à la dette de l’État, la proportion de ces titres détenue dans des paradis fiscaux n’étant pas connue.
Les Rapporteurs considèrent que l’on ne peut pas se satisfaire d’une situation dans laquelle les impôts des Français servent à enrichir des investisseurs installés dans les paradis fiscaux par le versement des intérêts sur la dette (cf. Troisième partie du rapport).
Proposition : Renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, en veillant particulièrement à ce que la dette française ne puisse servir à enrichir des investisseurs installés dans des paradis fiscaux.
Cette contraction des recettes fiscales peut également être due à la conjoncture. À titre d’exemple, entre 2008 et 2009, les recettes fiscales nettes de l’État ont chuté de 40 milliards d’euros, alors que les dépenses n’ont augmenté que de 12 milliards d’euros. Dans certaines situations, c’est bien l’absence de recettes qui creuse le déficit, plus que l’augmentation des dépenses.
b. Une transformation radicale du mode de financement des États et l’existence d’un effet « boule de neige »
Un autre élément important qui a joué dans la progression de la dette publique est le fait que l’État a progressivement déconstruit le « circuit du Trésor » qui lui permettait, jusqu’au début des années 1970, de se financer en recourant largement aux acteurs nationaux, y compris aux particuliers, à un taux qu’il déterminait lui-même.
Ce mécanisme qui a été jugé inflationniste, notamment sous l’influence des théories monétaristes et, malgré des divergences au sein même de l’État (12), a progressivement été remplacé par un financement passant exclusivement par les marchés. Ce faisant, une partie significative de l’émission de dette publique auparavant financée par des organismes publics ou privés nationaux, à des conditions et à des taux déterminés par l’État, a été transférée aux marchés financiers sans possibilité d’en déterminer les conditions financières.
La part de la dette non négociable, c’est-à-dire régie par des règlements administratifs et politiques, était très largement dominante en Allemagne, en Italie et en France jusqu’à la fin des années 1960. Au Royaume-Uni, elle était émise à parts égales avec la dette négociable jusqu’à ce qu’un basculement d’ensemble se produise : entre 1970 et 1990, la dette négociable s’est imposée jusqu’à devenir quasiment la seule en circulation. Elle est passée, au Royaume-Uni, de 51 % de la totalité de la dette émise en 1945 à 82 % en 1993. En Allemagne, elle est passée de 8 % en 1953 à 81 % en 1993. En France, en 1987, plus de 90 % des instruments émis étaient négociables.
Pourtant, en France, de 1944 à la fin des années 1960, le Trésor se finançait de façon administrée en dehors des procédures de marché, selon des mécanismes qui faisaient du Trésor le premier collecteur de fonds de l’économie, Banque de France mise à part. À lui seul, il recueillait plus de capitaux que le secteur bancaire : 695 milliards de francs contre 617 milliards pour le secteur bancaire. Il en redistribuait également davantage : 783 milliards. « L’argent était donc marqué du sceau de l’administration publique » selon la formule de Benjamin Lemoine.
La politique du « circuit du Trésor » s’inscrivait dans la continuité des mesures prises par les États – pas seulement la France – pendant la guerre pour drainer des ressources financières, sachant que la France a eu pour spécificité de maintenir, voire de renforcer, un système contraignant envers les banques et les marchés après 1945 : « Alors que les banques et le gouvernement en Grande-Bretagne et aux États-Unis redonnent la priorité au financement des entreprises, à partir de 1946, l’État en France instaure une réglementation stricte envers les banques tendant à capter leurs ressources financières. » (13) Le principe consistait à faire revenir dans les caisses de l’État – par des moyens contraignants – les capitaux qui en étaient sortis pour financer les dépenses publiques. La direction du Trésor collectait, à travers son réseau d’institutions bancaires et financières, l’épargne disponible qu’elle avait elle-même contribué à injecter par le canal de l’investissement et de la dépense publique.
Le « circuit du Trésor » et le placement de la dette auprès du public, avec un taux fixé administrativement, procuraient, jusqu’au début des années 1970, les trois quarts des ressources nécessaires au financement des déficits de l’État (66 % en 1975) (14). En 1991, la proportion est inversée : les ressources négociables constituent 78,5 % de la dette publique, et 93 % en 1993. Aujourd’hui, comme l’illustre le projet annuel de performances de la mission Engagements financiers de l’État pour 2016, la dette non négociable est en voie d’extinction, aucune émission nouvelle n’a été réalisée depuis 1999.
LES COMPOSANTES DU « CIRCUIT DU TRÉSOR » Le « circuit du Trésor », qui a alimenté les caisses de l’État pendant les Trente Glorieuses », se composait : – d’un réseau d’institutions financières et bancaires sous la tutelle du Trésor : la Caisse des dépôts et consignations et les caisses d’épargne, le Crédit Agricole et les grands organismes spécialisés (Crédit national, Crédit foncier de France) ; – de l’ensemble des institutions dont la trésorerie était obligatoirement gérée par l’État (budgets annexes, établissements publics et semi-publics, collectivités locales, particuliers et entreprises – par exemple les comptes chèques postaux ainsi que les fonds particuliers déposés au Trésor). Le dépôt des trésoreries par les correspondants était complété par la souscription forcée de bons du Trésor par le système bancaire. Le système dit des « planchers de bons du Trésor en compte courant » a contraint les banques, de 1948 à 1967, à détenir dans leurs portefeuilles une proportion conséquente de bons du Trésor en comptes courants, en rapports avec leurs dépôts. La gestion administrée de la dette à court terme permettait au Trésor de bénéficier de ressources peu onéreuses, dont il fixait lui-même le prix, sans se confronter au libre jeu de l’offre et de la demande. Au surplus, ces outils lui offrent un levier de contrôle sur la masse monétaire, via l’orientation des dépôts bancaires. Source : Benjamin Lemoine, Les finances publiques à l’épreuve de la dette, in Jean-Marie Monnier (dir.), Finances publiques, La Documentation française, 2015, pages 30 et 31. |
La disparition des bons-plancher en 1967 a constitué le premier élément significatif du basculement entre un État collecteur et un État emprunteur qui a recours au marché obligataire plus qu’à des circuits administrés. Il a dès lors été nécessaire d’attirer des épargnants, y compris internationaux, créant une dépendance de fait à l’égard des marchés.
La loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit opéra ensuite le « décloisonnement du marché financier » en créant, entre le marché interbancaire et le marché boursier du moyen et long terme, un marché de court terme sur lequel tous les opérateurs (Trésor, entreprises, banques) purent émettre des « titres de créances négociables ». Pour assurer une meilleure diffusion de ses propres titres de dette, le Trésor public favorisa la création et le développement des marchés de produits dérivés.
Depuis la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, ce sont des « entreprises de marché », qui sont chargées de fixer les règles des marchés dits « réglementés » dont elles assurent le fonctionnement. Enfin, en application du traité de Maastricht (1992), les avances de la Banque de France à l’État furent prohibées, mais celui-ci put s’endetter bien au-delà des limites prévues par les traités européens en recourant aux marchés financiers.
C’est par le recours au marché que l’État chercha donc à augmenter ses facultés d’emprunt car les ressources qu’il obtenait par le « circuit du Trésor » traditionnel s’avéraient insuffisantes à couvrir des déficits devenus considérables. Le rôle des théories monétaristes dans la conduite de ces politiques a été décisif. On en espérait un meilleur contrôle de la masse monétaire pour lutter contre l’inflation et plus généralement un recul du poids de l’État dans l’économie.
La réalité actuelle contredit cet espoir. La masse monétaire évolue désormais de manière anarchique, se plaçant au gré des opportunités sur les dettes publiques, les matières premières, les actions ou les obligations, alimentant des bulles spéculatives, mettant les États sous pression et favorisant les inégalités.
Il faut, par ailleurs, y ajouter le coût direct de la disparition de ce mode de financement. Alors que les intérêts sur la dette publique étaient quasiment nuls dans ce mécanisme administré de financement, les intérêts payés sur la dette oscillent entre 40 et 50 milliards d’euros par an pendant la décennie 2000. Le collectif pour un audit citoyen de la dette estime ainsi que si l’État avait emprunté au taux d’intérêt réel au lieu de recourir aux marchés financiers, sur la période 1985-2014, le niveau de la dette serait inférieur de 29 points de PIB, soit de 589 milliards d’euros.
Cette modification substantielle du mode de financement des États a en outre précédé un changement radical de politique monétaire, initié aux États-Unis au début des années 80 et qui s’est étendu rapidement en Europe. La Réserve fédérale américaine (Fed) et son président, M. Paul Volcker, ont conduit une politique monétaire conduisant à une montée rapide des taux d’intérêt qui a eu des conséquences considérables. Avant 1980, le poids des dettes, privées comme publiques, était minoré en permanence par des taux d’inflation et de croissance supérieurs aux taux d’intérêt. Depuis lors, le poids des dettes n’a cessé de croître, en France comme dans les pays voisins, du fait de taux d’intérêt plus élevés que les taux de croissance.
Cette tendance de fond montre que le problème de la dette dépasse la question des orientations et des choix politiques effectués, ou la couleur politique des Gouvernements. Une partie significative des facteurs qui conduisent à l’accroissement ou non de la dette publique ne relèvent plus directement de la sphère de décision politique.
De surcroît, dans une situation de taux d’intérêt bien supérieur au taux de croissance – que le recours aux marchés financiers a contribuer à créer – s’est développé un effet de « boule de neige » suivant lequel la dette s’autoalimente.
De 1980 à 2007, on a constaté presque sans interruption ce phénomène que le rapport de M. Gilles Carrez, alors rapporteur général de la commission des finances, avait décrit dès 2010. Même dans une hypothèse basse et strictement comptable (c’est-à-dire sans prendre en compte les effets sur les décisions de politique économique), l’effet « boule de neige » a ainsi contribué à augmenter le poids de la dette par rapport au PIB d’au moins 6 points de PIB sur un total de 30 points.
Même la faiblesse actuelle des taux d’intérêt et le fait que la France s’endette à des taux négatifs jusqu’à cinq ans, qui ont permis d’abaisser significativement le taux d’intérêt apparent sur la dette à 2,2 %, ne suffisent pas à stopper cet effet, car la croissance du PIB reste largement inférieure à 2,2 % (0,2 % en 2014, 1,1 % en 2015). En effet, les bons du Trésor émis à des taux nuls, voire négatifs aujourd’hui, ne portent que sur les nouveaux emprunts. Le stock de la dette recouvre des prêts consentis à des taux d’intérêt bien plus élevés, pouvant atteindre 4 ou 5 %.
ÉCART ENTRE TAUX D’INTÉRÊT APPARENT ET TAUX DE CROISSANCE NOMINALE
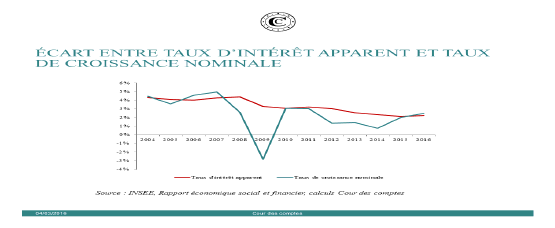
L’effet « boule de neige » pourrait en outre devenir considérable, en cas de remontée des taux. Au taux de 2007, c’est-à-dire avec un taux apparent de la dette de l’État de 4,5 % au lieu de 2,2 % actuellement, la charge de la dette en 2015 aurait été de 27 milliards d’euros supérieure à ce qu’elle a été : un retour au taux moyen d’avant la crise aurait représenté près de 1,5 point de PIB de dépenses supplémentaires, et donc, toutes choses égales par ailleurs, de déficit.
c. Les effets du ralentissement de la croissance et de l’inflation
Enfin, le dernier élément qui a largement contribué à l’augmentation de la dette publique réside dans la faiblesse de la croissance et de l’inflation.
• L’inflation ne permet plus la diminution de la dette en valeur
Comme l’a souligné M. Jean Pisany-Ferry devant la commission des finances (15), « dans un régime d’inflation normal, la dévalorisation de la dette par l’inflation éloigne l’avenir du passé. Aujourd’hui, le passé continue à peser extrêmement lourd du fait de la faiblesse de l’inflation et de celle de la croissance réelle. » Lors de son audition par la mission, l’économiste Natacha Valla a estimé que « dans le contexte actuel, l’inflation est bien l’instrument le plus efficace pour gérer, à moyen et long terme, notre stock de dette publique : un taux de 3 %, voire 4 % nous aiderait vraiment beaucoup », tout en relevant que « dans les phases où l’on doute du potentiel de croissance à long terme, il est difficile de sortir de la dette par la dynamique macroéconomique classique, croissance et inflation ».
En effet, l’inflation exerce un effet positif sur le ratio de dette par rapport au PIB en améliorant le solde primaire et en réduisant la valeur réelle de la dette. À volume constant, la consommation augmente en valeur avec la hausse des prix, ce qui augmente les recettes de TVA. Si les salaires suivent également l’inflation, les recettes de l’impôt sur le revenu et les cotisations sociales augmentent. Ces effets positifs peuvent être minorés par la hausse des prix des achats effectués par l’État mais il est généralement admis que le premier effet l’emporte largement sur le second (16). La charge d’intérêts comparée aux recettes s’allège, puisque les intérêts restent stables alors que les revenus augmentent. Enfin, le PIB lui-même augmente en valeur alors que la dette demeure la même en valeur : son poids relatif diminue donc par rapport au PIB.
Le taux d’inflation en baisse continue depuis 2011 pèse sur notre capacité à alléger le poids de la dette : 0 % en 2015, 0,5 % en 2014 et 0,9 % en 2013, bien loin de l’objectif de 2 % fixé par la Banque centrale européenne (BCE).
ÉVOLUTION DU TAUX D’INFLATION EN FRANCE
(en %)
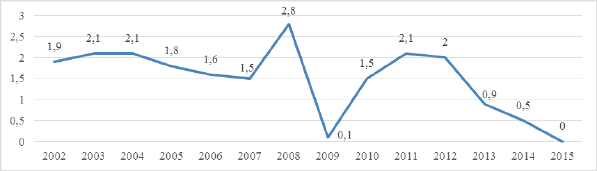
Source : INSEE.
Dans ces conditions, il semble difficile de réitérer le tour de force de l’après-guerre qui avait permis aux pays européens de se débarrasser en quelques années seulement d’une dette publique encore plus importante que celle que nous connaissons aujourd’hui, en proportion de la richesse produite. M. Thomas Piketty, auteur du Capital au XXIe siècle, écrit ainsi dans Libération du 29 décembre 2014 (17) : « La palme de l’amnésie revient quant à elle à l’Allemagne, avec la France en fidèle second. En 1945, ces deux pays avaient une dette publique dépassant 200 % du PIB. En 1950, elle était tombée à moins de 30 %. Que s’est-il passé, aurait-on soudainement dégagé les excédents budgétaires permettant de rembourser une telle dette ? Évidemment non : c’est par l’inflation et la répudiation pure et simple que l’Allemagne et la France se sont débarrassés de leur dette au siècle dernier. S’ils avaient tenté de dégager patiemment des excédents de 1 % ou 2 % du PIB par an, alors on y serait encore, et il aurait été beaucoup plus difficile pour les gouvernements de l’après-guerre d’investir dans la croissance ».
Il faut toutefois préciser les limites des effets positifs de l’inflation sur la charge de la dette.
D’une part, l’inflation se répercute directement sur les taux d’intérêt de la part de la dette de l’État qui est indexée (environ 10 %).
D’autre part, la complexité des effets de l’inflation sur le ratio dette publique/PIB peut conduire à en relativiser les avantages. Une étude publiée par l’OCDE (18) en 2012 estimait que, pour un pays qui aurait une dette de 100 % du PIB, un renouvellement de sa dette de 20 % par an et des caractéristiques moyennes en termes de croissance et de taux d’intérêt, une augmentation permanente de l’inflation d’un point de pourcentage, si elle était entièrement répercutée sur les taux d’intérêt, conduirait à une réduction du ratio dette/PIB d’environ 6 points au bout de 10 ans. L’effet serait accentué si le taux de renouvellement de la dette était plus réduit et si le recours à la « répression financière » (19) permettait de contenir la hausse des taux d’intérêt.
Selon la même étude, les inconvénients d’une inflation élevée l’emporteraient cependant sur ses bénéfices en matière de maîtrise du ratio dette/PIB : baisse du pouvoir d’achat des consommateurs, volatilité des taux de change, incertitude sur la capacité à instaurer une nouvelle cible d’inflation crédible, dérapage dans une spirale inflationniste, coût de la désinflation dans le futur, forte hausse des taux à long terme qui pénaliserait les investissements, et pénalisation des épargnants ayant effectué des placements à taux fixe (non indexés sur l’inflation) comme des emprunteurs ayant souscrit des prêts à taux variable.
Les perspectives de réduction du poids de la dette par l’inflation paraissent de toute manière réduites dans le contexte actuel, tant des taux de 3 ou 4 % paraissent durablement difficiles à atteindre, malgré la politique de la BCE pour relancer l’inflation et atteindre l’objectif d’un taux de 2 %. L’exemple du Japon montre qu’augmenter l’inflation de manière significative n’est pas chose facile. La situation est compliquée en zone euro par le fait que la banque centrale unique est responsable de la politique monétaire pour l’ensemble des pays de la zone euro alors que leurs spécificités exigeraient bien souvent des politiques monétaires radicalement différentes : ainsi, la compétitivité de la Grèce ou, dans une moindre mesure, de la France, nécessiteraient un euro plus faible alors que l’Allemagne profite, pour l’instant, de la force de celui-ci.
• Croissance : une faiblesse de la croissance qui pèse sur la stratégie de désendettement
Autre moyen privilégié de réduire l’endettement, les perspectives de croissance sont également limitées. En volume, le PIB a évolué de 0,2 % en 2012, de 0,6 % en 2013 et en 2014 et de 1,3 % en 2015.
Dans cette situation, le budget de l’État se retrouve pris en étau : d’un côté, des baisses d’impôts sont jugées nécessaires pour stimuler la croissance et engendrer des recettes fiscales supplémentaires ; de l’autre côté, ces baisses de recettes entraînent un accroissement du déficit si elles ne sont pas suivies d’une hausse significative de l’activité ou d’une réduction des dépenses publiques, sachant que la réduction des dépenses publiques peut également déprimer la croissance. Un cercle vicieux se met en place : tantôt les Gouvernements appuient sur le levier des recettes, tantôt sur celui des baisses de dépenses pour combler le déficit, mais cela se fait toujours simultanément à la mise en œuvre de nouvelles dépenses et de nouvelles réductions d’impôts. S’installe dès lors un conflit d’objectifs permanent sur la question de la dette, que l’on peut qualifier de « boucle de rétroaction ».
La stratégie de l’État se complexifie donc dès lors qu’il doit également prendre en compte la situation du secteur privé. On constate en effet une forte corrélation positive entre le ralentissement de l’endettement du secteur privé non financier et la baisse de la croissance. En d’autres termes, si le secteur privé est trop endetté et cherche à se désendetter, ou bien s’il ne recourt pas assez au crédit pour investir, l’activité économique sera réduite. Le surendettement du secteur privé conduit ainsi les entreprises à réduire leur investissement et les ménages à consommer moins, ce qui a pour conséquence une baisse de la demande privée qui pèse sur la rentabilité des entreprises et le revenu fiscal.
À ce moment-là, si le Gouvernement, lui-même soucieux de réduire la dette publique, augmente les recettes fiscales par une hausse d’impôts et réduit les dépenses publiques, il risque de peser sur le revenu disponible des ménages (donc sur leur endettement net et leur capacité à rembourser) et sur la capacité d’investissement des entreprises privées. La croissance économique s’en trouvera dès lors à nouveau affaiblie.
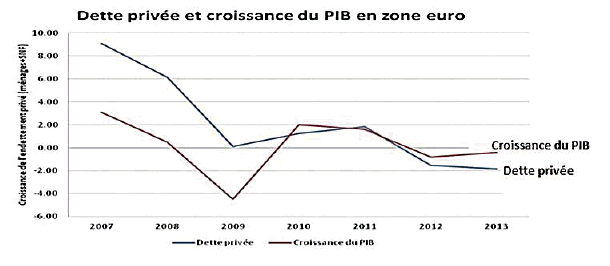
Source : OCDE.
L’État a donc en permanence un rôle contracyclique à jouer pour équilibrer le cycle interne d’une économie de marché. Ne pas investir quand le secteur privé ne le fait pas et ne pas relâcher la pression fiscale lorsque l’économie repart empêcherait l’activité économique de suivre une trajectoire équilibrée. En effet, la dette agit souvent comme palliatif à l’insuffisance de création monétaire, elle-même nécessaire pour développer la croissance et l’activité.
Son niveau peut devenir un problème dès lors que tous les acteurs s’engagent dans une stratégie de désendettement ou de rationnement du crédit : la destruction monétaire engendrée par le remboursement des crédits étouffe l’activité et pèse sur les recettes fiscales. Ce conflit structurel concernant la question des déficits nécessite donc certainement d’innover dans les moyens de gestion de la dette en sortant des schémas de pensée traditionnels.
3. La dette publique de la France est-elle soutenable ?
Le niveau de l’endettement public est un problème dès lors qu’il réduit les marges de manœuvre du politique, étouffe l’économie et constitue un handicap dans la mise en œuvre de mesures favorables à la croissance. Il pose alors la question de la soutenabilité de la dette c’est-à-dire de la capacité d’un pays à rembourser ses créanciers, sans s’appauvrir. La dette doit, en effet, être évaluée au regard de la richesse produite par le pays et de ses perspectives d’évolution.
LE CALCUL DE LA DETTE PUBLIQUE A-T-IL DU SENS ? La manière de calculer la dette est-elle fiable et est-elle pertinente ? En particulier, est-il pertinent de comparer un flux à un stock ? * La même dette en valeur absolue n’aura pas le même impact pour un pays très pauvre ou un pays très riche. La comparaison au PIB permet d’en tenir compte en première approche. Reste la question de la comparaison entre un stock pluriannuel (la dette publique) à un flux annuel (le PIB). Dans ces conditions, il pourrait être pertinent de comparer l’échéance moyenne de la dette publique (environ sept ans) à l’accumulation de PIB durant cette durée moyenne. Dans ce cas, c’est à l’accumulation de PIB pendant sept années, soit une valeur de près de 14 000 milliards d’euros, qu’il convient de comparer le stock de 2 100 milliards d’euros de dette publique. Toutefois, le PIB est celui d’un pays et la dette publique celle de l’État et des institutions publiques. Or c’est bien les revenus de l’État qui constituent le flux annuel de revenus auquel revient la charge de financer la dette publique. Dans le cas de la France, l’ensemble des prélèvements obligatoires représente ainsi 976 milliards d’euros en 2015 (44,6 % du PIB), mais le coût de la dette n’est lui que de 44,3 milliards d’euros. Par ailleurs, le ratio dette/PIB n’enregistre au numérateur que la valeur nominale de la dette, et non sa valeur de remboursement, qui peut varier fortement lorsque cette dette est constituée d’obligations indexées sur l’inflation, ce qui est le cas de 25 % de la dette publique britannique. Enfin, s’il est impossible de mesurer, dans cette approche, la dimension temporelle et le bienfait pour les générations futures de l’endettement présent, on peut rapporter l’ensemble du stock de dette publique au patrimoine global de l’État : estimé à près de 2 500 milliards d’euros, il est bien supérieur à l’encours de dette publique. |
a. La soutenabilité de la dette dépend avant tout du différentiel entre taux de croissance et taux d’intérêt réel
Dans le contexte de faible croissance que l’on connaît depuis près de quarante ans, le taux d’intérêt applicable sur la dette publique a pratiquement toujours été supérieur au taux de croissance. Depuis 1999, le différentiel entre le taux de croissance et le taux d’intérêt apparent applicable à l’ensemble du stock de dette publique a été négatif de manière continue, avec un paroxysme en 2009 où ce différentiel atteint 6,3 points. Or, à chaque fois que le taux de croissance est inférieur au taux d’intérêt apparent, le poids de la dette par rapport au PIB s’accroît.
DIFFÉRENCE ENTRE TAUX D’INTÉRÊT APPARENT ET TAUX DE CROISSANCE
DEPUIS 1999
Taux d’intérêt apparent sur la dette (en %) |
Taux de croissance |
Écart entre le taux de croissance et le taux d’intérêt apparent sur l’ensemble de la dette publique | |
1999 |
5 |
3,4 |
– 1,6 |
2000 |
4,9 |
3,9 |
– 1 |
2001 |
5,1 |
2 |
– 3,1 |
2002 |
5,1 |
1,1 |
– 4 |
2003 |
4,7 |
0,8 |
– 3,9 |
2004 |
4,4 |
2,8 |
– 1,6 |
2005 |
4,1 |
1,6 |
– 2,5 |
2006 |
3,9 |
2,4 |
– 1,5 |
2007 |
4,3 |
2,4 |
– 1,9 |
2008 |
4,5 |
0,2 |
– 4,3 |
2009 |
3,4 |
– 2,9 |
– 6,3 |
2010 |
3,1 |
2 |
– 1,1 |
2011 |
3,3 |
2,1 |
– 1,2 |
2012 |
3,1 |
0,2 |
– 2,9 |
2013 |
2,6 |
0,6 |
– 2 |
2014 |
2,4 |
0,6 |
– 1,8 |
2015 |
nd |
1,3 |
Source : AFT et Insee, calcul de l’écart pour le rapport.
L’évaluation de la soutenabilité et la dynamique de la dette publique dépendent donc à la fois du taux d’intérêt applicable et du niveau de croissance mais aussi du niveau d’inflation (si l’inflation est supérieure au taux d’intérêt nominal, et donc que le taux d’intérêt réel applicable à la dette est négatif, alors le poids relatif de la dette décroît même en cas de déficit).
Les taux d’intérêt très bas pratiqués actuellement et les vastes liquidités donneraient donc une opportunité historique de pouvoir se financer à long terme sans accroître le fardeau financier. Il pourrait s’agir d’une opération de bonne gestion : par exemple, un intérêt de 1 % sur un déficit de 5 % du PIB coûte 0,05 % du PIB soit 2,4 fois moins qu’un intérêt de 4 % sur un déficit de 3 % du PIB, cette dernière situation ayant été le standard communément admis et pratiqué dans les années passées. La question se pose donc de se défaire de la contrainte budgétaire pour relancer l’investissement en profitant dès aujourd’hui du coût très faible de l’endettement.
En outre, il est nécessaire de rappeler qu’un État ne rembourse jamais entièrement sa dette : comme le rappelle M. Paul Krugman, dans le cas de la dette publique des États-Unis au sortir de la Seconde guerre mondiale, celle-ci représentait 241 milliards de dollars de l’époque (120 % du PIB) mais en 1962, le ratio dette publique/PIB était tombé à 60 % alors que le montant nominal de la dette était à peu près équivalent à celui de 1946. Ce ratio a continué de baisser durant les décennies 1960 et 1970 alors que le budget de l’État était (faiblement) déficitaire. Ce n’est qu’avec l’explosion du déficit budgétaire que le ratio dette/PIB a recommencé à augmenter aux États-Unis.
Autre exemple souvent cité, en 1995, la dette publique du Canada s’élevait à 101 % du PIB mais, en 2007, elle n’était plus que de 66 %. Pourtant, la dette en valeur (en dollar canadien) a augmenté de 23 % sur cette même période, parallèlement à une croissance supérieure du PIB en valeur.
La question pertinente, en termes de politique publique, est donc de savoir à quelle vitesse et à quel moment il est possible et nécessaire de rembourser sa dette publique. L’effet « boule de neige », dont il a déjà été question, en fournit un critère simple : tant que la dette nominale n’augmente pas plus vite que la croissance du PIB (g), augmentée de l’inflation (i), le ratio dette/PIB n’augmente pas. Dès que la dette nominale augmente plus vite que g + i, le ratio augmente inéluctablement quels que soient les efforts budgétaires consentis (sauf à imaginer des restrictions budgétaires considérables comme le montrent l’exemple de la Grèce et la plongée de son économie dans la récession).
En réalité, tout remboursement au-delà du rythme permis par la croissance et l’inflation prises ensemble induit une croissance de la dette que l’économie réelle ne peut pas financer à terme. Dit autrement, on peut penser qu’aucun investisseur ne serait lésé si un pays débiteur explicitait un tel critère de remboursement dans la mesure où, à terme, il sait qu’il ne peut pas être remboursé plus rapidement. Au moment de prêter, les investisseurs seraient donc conscients à l’avance des limites de remboursement auxquels le pays emprunteur se soumet pour ne pas compromettre son futur.
Proposition : Se poser la question de prévoir une limite au remboursement annuel de la dette publique en fonction du niveau d’évolution de la croissance et de l’inflation afin de stopper l’effet « boule de neige ».
La prise en compte du taux de croissance réel de l’économie pourrait donc permettre de plafonner la vitesse de remboursement de la dette en fonction de la capacité de remboursement d’un pays. Cela suppose cependant un renversement de logique : il conviendrait alors d’aligner le droit des créanciers sur la réalité économique et l’intérêt général, plutôt que l’inverse.
b. Les soldes budgétaires stabilisant : une indication fragile
La soutenabilité de la dette peut également s’appréhender à travers une analyse des soldes stabilisants (solde stabilisant et solde primaire stabilisant).
Le solde stabilisant le poids de la dette publique dans le PIB est le solde qui fait varier la dette publique à un rythme strictement identique à celui de la croissance. Plus la croissance est forte, moins les niveaux de solde à atteindre pour stabiliser ou réduire la dette publique sont élevés. Ce critère ne permet cependant pas de rendre compte de la soutenabilité de la croissance.
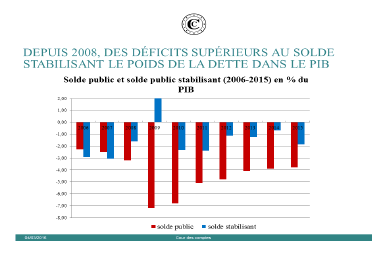
Source : Cour des comptes – Mars 2016
Il faut également considérer le solde budgétaire primaire, c’est-à-dire le niveau de déficit public auquel on soustrait la charge de la dette. La dette se stabilise lorsque le solde primaire (en % du PIB) est égal à l’écart entre le taux d’intérêt réel et le taux de croissance de l’économie multiplié par le ratio de la dette publique dans le PIB. À titre d’exemple, pour la France en 2013, le solde primaire stabilisant pour 2013 était de 2 %.
Selon la Cour des comptes, le déficit public en 2016 devrait être de 3,3 % du PIB. Or, pour que la dette se stabilise en 2017 par rapport à 2016, il faudrait donc que le solde public ne soit que de 2,7 % du PIB. Il faudrait que l’objectif de 3 % pour 2016 soit atteint, mais aussi que celui de 2017, qui prévoit une baisse du déficit public de 0,6 point de PIB, soit respecté : à ces deux conditions, l’endettement public se stabiliserait.
Par conséquent, plus la charge de la dette est élevée, plus la contrainte en matière de déficit primaire stabilisant est forte. Toutefois, lorsque le taux d’intérêt apparent de la dette est égal au taux de croissance du PIB, le solde primaire stabilisant est nul. Dans les cas, historiquement plus fréquents, où le taux d’intérêt est supérieur au taux de croissance du PIB, la dette augmente indéfiniment si le solde primaire reste inférieur au solde primaire stabilisant. La prise en compte du taux d’intérêt et du taux de croissance est donc essentielle à l’analyse de la soutenabilité de la dette.
Il convient de souligner que la France a régulièrement, depuis 2009, réduit son déficit – et ce quelles que soient l’inflation et la croissance. Cela a pourtant eu un prix : les contraintes de la maîtrise du déficit, dans un environnement de faible croissance, peuvent avoir un caractère non-soutenable. En effet, comme l’a formulé l’économiste Gaël Giraud, « on peut dire d’une dette publique qu’elle devient insoutenable à partir du moment où il n’est plus possible de la rembourser sans s’appauvrir, appauvrissement qui réduit encore les capacités futures du pays à rembourser sa dette ». La France, avec un haut niveau de prélèvements obligatoires et un faible taux d’investissement, semble en passe de franchir cette limite.
c. Le déficit structurel ne permet pas d’appréhender la soutenabilité de la dette
Le solde structurel sépare au sein du déficit public la partie attribuable directement à la conjoncture (le déficit dit « conjoncturel ») et celle qui en est indépendante (le déficit dit « structurel »), sur laquelle les décisions publiques peuvent avoir un impact direct.
Le calcul du solde structurel repose de manière intrinsèque sur la définition du cycle économique et donc de l’écart du PIB au PIB potentiel (l’écart de production). On observe ainsi de moindres recettes et un surcroît de dépenses (notamment celles liées à l’indemnisation du chômage) lorsque le PIB est inférieur à son niveau potentiel et à l’inverse un surplus de recettes et une diminution des dépenses lorsqu’il lui est supérieur.
À partir du niveau de déficit public et en s’appuyant sur des semi-élasticités à l’écart de production conventionnelles pour chacune des recettes (impôt sur le revenu et CSG, impôt sur les sociétés, cotisations sociales et autres recettes fiscales) ainsi que pour les prestations chômage, il est ainsi possible de calculer le déficit structurel puis, par solde et en excluant les mesures ponctuelles et temporaires, le déficit conjoncturel (voir l’annexe 9.2 du programme de stabilité d’avril 2016 et l’annexe 4 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 du décembre 2014, qui détaille le calcul du solde structurel).
DETTE PUBLIQUE ET DÉFICIT PUBLIC EN % DU PIB
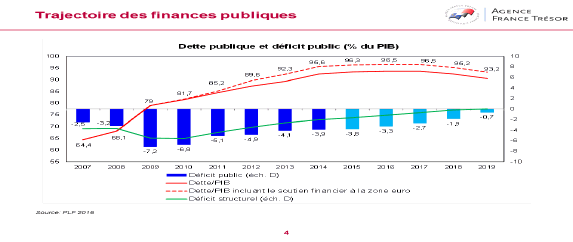
Le pilotage des finances publiques par le déficit structurel permet d’éviter le principal écueil d’une stratégie basée uniquement sur le solde nominal, à savoir tenter de compenser par des mesures de consolidation supplémentaires les moindres recettes en phase de ralentissement de l’économie. Une telle approche nominale est, en effet, de nature pro-cyclique.
À long terme, la progression de l’endettement est essentiellement le reflet de la somme des déficits structurels passés, puisqu’en moyenne sur un cycle économique, l’écart de production est nul, tout comme par conséquent la somme des déficits conjoncturels. Toutefois, à la suite d’une crise comme celle enregistrée en 2008-2009, la résorption des déficits conjoncturels via la réduction de l’écart de production prend plusieurs années, si bien que le niveau de l’endettement reflète en partie les déficits conjoncturels accumulés depuis cette crise.
C’est là le principal défaut de l’approche par le solde structurel : tout comme le PIB potentiel, il conduit à séparer sur des critères discutables ce qui relève du permanent et de la conjoncture. Il conduit en outre à « neutraliser » toute décision politique, dont l’efficacité potentielle sur la croissance se voit subordonnée à des effets de structure indépendants. C’est d’ailleurs également un biais que l’on peut reprocher aux agences de notation, lorsqu’elles analysent la dette de la France.
d. Une notation toujours positive de la dette française
La note AA de la France demeure sur le troisième cran le plus élevé de l’échelle de notation par les agences de notation.
Cette notation repose sur cinq piliers : d’une part, le cadre institutionnel et le cadre économique, regroupés en un profil économique et institutionnel, d’autre part, le facteur extérieur, le facteur budgétaire et le facteur monétaire, regroupés en un profil de flexibilité et de performance qui, avec le profil économique et institutionnel, permet d’aboutir à un niveau indicatif de la note de l’État, pouvant faire l’objet d’ajustements en fonction de facteurs exceptionnels typiques pour certains emprunteurs. En ce qui concerne la France, aucun des cinq facteurs n’est considéré comme une faiblesse à proprement parler : soit ils sont neutres, soit ils constituent des forces.
Il convient cependant de souligner que les critères de notation des agences se situent souvent dans un couloir idéologique étroit : ainsi, le degré de « flexibilité monétaire » apprécié par les agences suppose l’indépendance totale de la politique monétaire, ce qui est en soi un sujet de discussion.
En effet, la France doit prendre en considération son intégration dans la zone euro comme autre critère de soutenabilité de sa dette. Les critères de Maastricht, fondés sur un déficit public limité à 3 % du PIB et une dette publique à 60 % du PIB, n’ont pour seul objectif, au-delà de leur valeur nominative qui ne repose pas sur des critères objectifs (20), que d’éviter un accroissement trop important de la masse monétaire perçu comme préjudiciable à la valeur de l’euro.
Néanmoins, la France a une épargne privée importante et possède de nombreuses infrastructures qui constituent un patrimoine financier et non-financier de première importance. Cela signifie éventuellement que des ménages sont prêts à acheter régulièrement de la dette publique ou que cette épargne peut, le cas échéant, être mise à contribution pour rembourser la dette publique ou assurer le sauvetage des banques.
e. Les risques du recours aux cessions d’actifs et les contributions au désendettement
Les Gouvernements successifs ont souvent procédé à d’importantes cessions d’actifs, dont certaines ont pour but d’améliorer l’efficacité des entreprises privatisées, et qui ont permis de réduire temporairement le montant de la dette, tout en appauvrissant le patrimoine de l’État. Les actifs financiers de l’État ont ainsi diminué en moyenne entre 2000 et 2016, même si, au niveau global de l’ensemble des administrations publiques, leur valeur a augmenté. Fin 2015, l’État possède ainsi 324,8 milliards d’euros d’actifs financiers et a perçu 4,1 milliards d’euros de dividendes. En 2012, il en percevait 4,6 milliards d’euros.
La loi de finances pour 2015 prévoyait que l’Agence des participations de l’État (APE) devait réaliser 5 milliards d’euros de cessions, pour en affecter 4 milliards au désendettement de l’État. Une mission que l’APE a remplie pour 1,5 milliard en 2014, pour la première fois depuis 2007.
Toutefois, il convient de prendre garde à ce que la vente des participations de l’État amène à une réduction des recettes de l’État (dividendes versés et plus-values) que ne compense pas la réduction des intérêts payés sur la dette, puisque les taux d’intérêt d’emprunt de l’État sont très faibles.
Le même raisonnement peut s’appliquer aux contributions au désendettement dans le cadre des comptes d’affectations spéciaux (CAS), qui n’ont jamais rempli leur objectif.
DÉSENDETTEMENT DE L’ÉTAT - EXÉCUTION
(en CP, format courant)
2012 |
2013 |
2014 |
2015 | |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
458 634 614 |
446 569 348 |
414 752 521 |
411 101 205 |
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
61 395 975 |
76 106 405 |
76 553 449 |
86 243 222 |
Participations financières de l’État |
0 |
0 |
1 500 000 000 |
800 000 000 |
Source : Projet de loi de finances pour 2016
Des programmes Désendettement figurent en effet dans trois comptes d’affectation spéciale (CAS) : Contrôle de la circulation et du stationnement routiers, Gestion du patrimoine immobilier de l’État et Participations financières de l’État. Le CAS Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien qui en comportait également un, n’a jamais contribué au désendettement de l’État ; il a été supprimé par la loi de finances pour 2016.
Ces comptes d’affectation peuvent participer au désendettement de l’État de deux manières. D’une part, leur solde, lorsqu’il est positif, vient réduire le déficit et donc le besoin de financement de l’État. D’autre part, ils peuvent être utilisés pour rembourser ou racheter des emprunts antérieurs par l’intermédiaire de la Caisse de la dette publique.
Créée par la loi de finances pour 2003, la Caisse de la dette publique a repris les missions du Fonds de soutien des rentes et de la Caisse d’amortissement de la dette publique. La Caisse de la dette publique peut notamment acheter, conserver, annuler ou céder les titres émis par l’État. Elle peut, en outre, recourir aux opérations d’achat, de vente, de pension livrée, de contrats à terme et d’échange de taux d’intérêt.
Comme le relève la Cour des comptes dans son rapport sur le budget de l’État en 2015, la contribution des programmes de désendettement plafonne à des niveaux peu élevés.
En 2015, 1,3 milliard d’euros ont été affectés aux programmes de désendettement des CAS, dont 800 millions d’euros de crédits du CAS Participations financières de l’État affectés à la Caisse de la dette publique.
L’activité de la Caisse de la dette publique depuis sa création a également été réduite. Il faut toutefois souligner qu’elle a été utilisée en 2014 et en 2015, ce qui n’avait plus été le cas depuis 2007.
Depuis sa création, la caisse a été dotée de 100 millions d’euros en 2003, 12,96 milliards d’euros en 2006, 100 millions d’euros en 2007, 1,5 milliard d’euros en 2014 et 800 millions d’euros en 2015. Elle a mené quatre opérations de désendettement :
– en 2006, rachats de titres d’État pour 7,98 milliards d’euros ;
– en 2014, achat et annulation d’obligations assimilables du Trésor (OAT) à hauteur de 106,5 millions d’euros et amortissement d’OAT pour 1,4 milliard d’euros ;
– en 2015, amortissement de bons du Trésor à taux fixe (BTF) pour un montant de 800 millions d’euros.
Cela a conduit à la suppression de la participation du « CAS immobilier » au désendettement de l’État, dans le cadre d’une refonte des outils de financement de la politique immobilière de l’État, comme l’a confirmé le secrétaire d’État au budget Christian Eckert devant la commission des finances de l’Assemblée nationale (21), en pointant le manque d’efficacité économique de ce type de dispositif.
f. Faut-il une règle plus contraignante pour piloter les finances publiques au niveau national ?
Pour trancher ce débat de la soutenabilité, le thème de la « règle d’or » ressort fréquemment dans le débat public. Elle vise à ce que tout alourdissement de la dette publique soit réservé au financement d’investissements qui viendront accroître le patrimoine collectif de la nation.
Cette « bonne » dette s’opposerait dès lors à la « mauvaise dette », qui ne sert qu’à financer des dépenses publiques courantes (frais de fonctionnement et dépenses de consommation trop importantes). Ce thème de la règle d’or a été mis en avant dans le rapport de Michel Pébereau sur la dette publique, en 2005, dans lequel on peut lire que « Depuis 25 ans, la plupart du temps (19 années sur 25), le déficit public (et donc la dette correspondante) n’a pas servi à financer de nouveaux éléments d’actifs mais d’autres dépenses : le renouvellement des équipements existants et des dépenses de fonctionnement courant ». Ferait ainsi figure de modèle la dette des collectivités locales, qui ne représente a priori qu’une dette liée aux investissements, puisque celles-ci ont l’obligation de voter en équilibre leurs budgets de fonctionnement et ne peuvent recourir à l’emprunt que pour investir.
Compte tenu de l’ampleur des missions de l’État, de leur caractère obligatoire et de l’intervention de l’État en dernier ressort, une telle règle semble difficilement transposable. Elle pose en outre certains problèmes pratiques, notamment s’agissant de la notion d’investissement : faut-il prendre en compte uniquement des investissements physiques ou productifs, ou bien faut-il considérer que des dépenses de fonctionnement comme l’éducation ou le financement de la recherche comme des investissements ? Par ailleurs, qu’en est-il des investissements spécifiquement régaliens tels que la défense ? L’acquisition d’armes fait-il partie de l’investissement pour lequel il est légitime de s’endetter, alors que le financement des professeurs ou des militaires ne le serait pas ?
Il existe par ailleurs souvent un lien étroit entre investissement et fonctionnement. À titre d’exemple, acquérir un porte-avions relève d’un investissement majeur mais cela nécessite de disposer du personnel nécessaire pour son fonctionnement.
En raison de la fragilité de ce type de notion, il semble préférable de s’abstenir de recourir à de telles règles qui réduisent le champ de la décision politique et l’enferment dans des débats interminables pour distinguer le « bon » investissement du « mauvais » investissement ou du fonctionnement, là où ces notions répondent essentiellement à des orientations politiques qui doivent pouvoir être assumées sans contrainte. Les problèmes économiques posés par un alourdissement de la dette reposent bien plus sur sa dynamique et sur le contexte économique d’ensemble que sur sa nature propre.
B. LE COÛT DE LA DETTE PUBLIQUE : LE TROISIÈME POSTE DE DÉPENSES DE L’ÉTAT
1. Le coût global de la dette pour les finances publiques
Le problème de la soutenabilité de la dette est aggravé par celui du coût de son financement, ce que l’on désigne habituellement comme la « charge » de la dette.
En coût cumulé, selon les données fournies à la mission par l’Agence France Trésor, la France a versé 1 254 milliards d’euros d’intérêts entre 1978 et 2014 pour la dette de toutes les administrations publiques confondues.
Ce chiffre doit être mis en perspective avec les recettes et les dépenses publiques cumulées sur cette même période : les intérêts versés représentent 5,5 % des recettes annuelles moyennes sur cette période (sur l’année 2014 ce ratio n’était que de 4,3 % de l’ensemble des recettes) et 5,1 % des dépenses cumulées (4 % en 2014).
Dans le même temps, sur la période 1978-2014 (22), l’accroissement total de la dette publique a été de 1 945 milliards d’euros.
Concernant les émissions et les amortissements de dette sur une base annuelle, c’est-à-dire le flux annuel d’émission de titres de dette et de remboursement, il n’existe pas de données en comptabilité nationale concernant l’ensemble des administrations publiques. Elles ne sont disponibles que pour la dette de l’État, et seulement à partir de l’introduction de l’euro, en 1999.
Sur la seule dette de l’État, depuis 1999, la France a remboursé près de 1 617,45 milliards d’euros, soit presque une année de production de richesse au niveau de la Nation tout entière. Ces remboursements ne sont toutefois pas définitifs puisqu’ils consistent largement à faire « rouler » la dette, c’est-à-dire à rembourser pour réemprunter.
DETTE NÉGOCIABLE D’ÉTAT DEPUIS 1999
(en millions d’euros)
Émissions |
Amortissements |
Charge budgétaire | ||||
BTF |
MLT |
BTF |
MLT |
BTF |
MLT | |
1999 |
94 133 |
81 985 |
107 639 |
45 654 |
1 102 |
32 464 |
2000 |
95 387 |
90 472 |
86 061 |
66 853 |
1 882 |
32 893 |
2001 |
120 204 |
91 100 |
110 778 |
63 689 |
2 135 |
33 891 |
2002 |
185 421 |
95 995 |
149 684 |
68 423 |
2 542 |
34 690 |
2003 |
237 851 |
118 888 |
217 331 |
69 926 |
2 439 |
35 169 |
2004 |
220 697 |
131 502 |
232 322 |
76 389 |
2 113 |
36 140 |
2005 |
202 196 |
126 367 |
203 945 |
82 241 |
2 047 |
36 897 |
2006 |
164 425 |
121 132 |
193 501 |
94 707 |
2 220 |
36 964 |
2007 |
183 556 |
107 622 |
171 347 |
79 109 |
3 405 |
36 191 |
2008 |
314 440 |
130 589 |
254 615 |
99 627 |
4 396 |
39 400 |
2009 |
501 636 |
178 564 |
425 797 |
121 243 |
1 682 |
35 212 |
2010 |
428 905 |
210 687 |
455 887 |
104 857 |
1 029 |
38 772 |
2011 |
407 259 |
207 764 |
416 601 |
116 811 |
1 611 |
43 891 |
2012 |
392 979 |
201 500 |
404 175 |
118 793 |
206 |
44 977 |
2013 |
389 714 |
191 946 |
382 471 |
127 016 |
157 |
43 621 |
2014 |
408 141 |
203 077 |
406 699 |
134 949 |
142 |
42 050 |
2015 |
341 894 |
220 014 |
364 506 |
147 150 |
– 302 |
41 396 |
Nota : les BTF sont les titres de maturité inférieure à un an ; les colonnes MLT concernent les titres à plus d’un an (BTAN et OAT).
Source : ministère de l’économie et des finances.
REFINANCEMENT À PLUS D’UN AN ET VARIATION
DE LA DETTE DE COURT TERME DEPUIS 1999
Amortissements totaux de titres de maturité supérieure à un an |
Variation de l’encours de dette à moins d’un an (BTF) (en millions d’euros) | ||
(en millions d’euros) |
(en % PIB) | ||
1999 |
45 654 |
3,2 % |
– 13 506 |
2000 |
66 853 |
4,5 % |
9 326 |
2001 |
63 689 |
4,1 % |
9 426 |
2002 |
68 423 |
4,3 % |
35 737 |
2003 |
69 926 |
4,3 % |
20 520 |
2004 |
76 389 |
4,5 % |
– 11 625 |
2005 |
82 241 |
4,6 % |
– 1 749 |
2006 |
94 707 |
5,1 % |
– 29 076 |
2007 |
79 109 |
4,1 % |
12 209 |
2008 |
99 627 |
5,0 % |
59 825 |
2009 |
121 243 |
6,3 % |
75 839 |
2010 |
104 857 |
5,3 % |
– 26 982 |
2011 |
116 811 |
5,7 % |
– 9 342 |
2012 |
118 793 |
5,7 % |
– 11 196 |
2013 |
127 016 |
6,0 % |
7 243 |
2014 |
134 949 |
6,3 % |
1 442 |
2015 |
147 150 |
6,7 % |
– 22 612 |
Source : AFT.
À travers le paiement des intérêts comme le remboursement du principal, les opérations sur la dette constituent de loin le premier poste d’opérations financières de l’État en termes de flux.
Il convient de rappeler que des hauts fonctionnaires du Trésor, tels Maurice Pérouse (ancien directeur du Trésor), s’étaient opposés pour cette raison même au recours au marché pour financer la dette publique, considérant que le système d’adjudication provoquerait un renchérissement considérable pour le Trésor du coût de ses opérations et se traduirait du même coup par un « enrichissement sans cause » des banques, via les intérêts versés. Les services du Trésor s’inquiétaient des taux obtenus sur les marchés, dont ils n’avaient plus la maîtrise (cf. voir supra).
De fait, la charge de la dette a fortement progressé, en particulier depuis les années 1980, pendant lesquelles se sont combinés taux d’intérêt élevés et faible croissance, provoquant un accroissement considérable de la rentabilité des obligations d’État pour leurs détenteurs et entraînant une hausse du coût même de l’endettement pour l’État et les organismes publics.
TAUX MOYEN PONDÉRÉ À L’ÉMISSION DES TITRES D’ÉTAT, DEPUIS 1999
(en %)
BTF |
OAT et BTAN |
Ensemble | |
1999 |
2,74 |
4,08 |
3,65 |
2000 |
4,29 |
5,27 |
4,98 |
2001 |
4,10 |
4,73 |
4,47 |
2002 |
3,22 |
4,58 |
3,94 |
2003 |
2,21 |
3,62 |
2,88 |
2004 |
2,04 |
3,71 |
2,91 |
2005 |
2,11 |
3,18 |
2,68 |
2006 |
2,96 |
3,65 |
3,40 |
2007 |
3,94 |
4,24 |
4,12 |
2008 |
3,61 |
4,13 |
3,88 |
2009 |
0,70 |
2,95 |
1,70 |
2010 |
0,45 |
2,53 |
1,49 |
2011 |
0,81 |
2,80 |
1,85 |
2012 |
0,08 |
1,86 |
0,98 |
2013 |
0,06 |
1,54 |
0,79 |
2014 |
0,07 |
1,31 |
0,68 |
2015 |
– 0,19 |
0,63 |
0,26 |
Source : AFT.
(en %)
Taux moyens pondérés |
Moyenne 1998 - 2008 |
Moyenne |
Année 2014 |
Année 2015 |
Année* | |
COURT TERME |
Ensemble des BTF |
3,15 % |
0,42 % |
0,07 % |
– 0,19 % |
– 0,39 % |
dont BTF à 3 mois |
3,10 % |
0,35 % |
0,07 % |
– 0,19 % |
– 0,39 % | |
MOYEN ET LONG TERME |
Émissions à plus d’un an |
4,15 % |
2,34 % |
1,31 % |
0,63 % |
0,45 % |
dont émission à 10 ans |
4,44 % |
3,03 % |
1,87 % |
0,93 % |
0,70 % | |
Données à jour au 3 mars 2016. *résultats partiels / seuls des titres à long terme ont été émis en mars 2016.
Source : AFT.
Au lendemain de la crise financière de 2008, le rythme d’endettement de l’État s’est accéléré mais le taux d’intérêt à l’émission s’est réduit de 3,8 % en 2008 à 0,26 % en 2015. Si le taux moyen pondéré à l’émission est aujourd’hui très faible, il convient cependant de prendre garde au risque de remontée des taux qui ont pu atteindre près de 5 % en 2000, alors que la croissance est aujourd’hui nettement inférieure à celle d’alors. L’analyse de ce risque est détaillée dans la quatrième partie de ce rapport.
Signalons toutefois d’ores et déjà qu’une augmentation de seulement 1 % des taux d’intérêt pourrait alourdir considérablement la charge annuelle de la dette, et ceci de manière exponentielle, et la renchérir de près de 16,8 milliards d’euros par an à l’horizon 2025.
2. Le paradoxe de la situation actuelle : une dette publique en hausse, une charge de la dette en baisse
Depuis la crise financière et l’adoption d’une politique monétaire non-conventionnelle par la BCE, la situation est devenue paradoxale : alors que l’endettement public a augmenté de plus de 30 points de PIB depuis 2008, la charge de la dette des administrations publiques est restée stable, voire a connu une légère décrue pour représenter 46,4 milliards d’euros en 2014 et 43,8 milliards en 2015.
En effet, depuis 2012, la charge de la dette de l’État (42,1 milliards d’euros en 2015) est en baisse régulière. Elle diminue sur cette période en moyenne de 1,4 milliard d’euros par an.
CHARGE DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE DE L’ÉTAT – COMPTABILITÉ BUDGÉTAIRE
(en millions d’euros)
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 | |
Dette négociable – charge nette (1) |
38 253 |
38 944 |
39 184 |
39 596 |
43 796 |
36 895 |
39 801 |
45 502 |
45 182 |
43 778 |
42 193 |
OAT et BTAN-charge nette d’intérêts |
35 068 |
35 545 |
34 856 |
34 435 |
34 785 |
35 128 |
36 505 |
39 924 |
41 339 |
41 849 |
41 118 |
Intérêts versés |
37 037 |
37 428 |
36 706 |
36 504 |
36 855 |
37 923 |
39 330 |
42 897 |
43 958 |
43 735 |
43 339 |
Recette de coupons courus à l’émission |
1 969 |
1 883 |
1 849 |
2 069 |
2 070 |
2 795 |
2 825 |
2 973 |
2 620 |
1 887 |
2 221 |
OAT et BTAN – charge d’indexation |
1 072 |
1 352 |
2 107 |
1 756 |
4 615 |
84 |
2 267 |
3 967 |
3 638 |
1 772 |
932 |
BTF – intérêts versés |
2 113 |
2 047 |
2 220 |
3 405 |
4 396 |
1 682 |
1 029 |
1 611 |
206 |
158 |
142 |
Autres charges et produits |
|||||||||||
Dettes reprises – charge nette |
2 |
2 |
20 |
16 |
626 |
504 |
412 |
265 |
231 |
180 |
83 |
Dette non négociable |
21 |
6 |
5 |
4 |
14 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
Investissements d’avenir – rémunération des fonds |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
165 |
408 |
645 |
667 |
688 |
Trésorerie – charge nette |
- 206 |
- 116 |
- 275 |
- 80 |
14 |
204 |
104 |
66 |
234 |
242 |
181 |
Charges |
318 |
398 |
404 |
586 |
751 |
540 |
248 |
365 |
309 |
253 |
205 |
Produits |
525 |
514 |
679 |
666 |
736 |
336 |
144 |
300 |
75 |
11 |
24 |
Autres |
43 |
45 |
7 |
16 |
13 |
20 |
20 |
14 |
9 |
17 |
14 |
Charge totale de la dette et de la trésorerie |
38 113 |
38 881 |
38 941 |
39 550 |
44 464 |
37 625 |
40 503 |
46 256 |
46 303 |
44 886 |
43 159 |
Contrats d’échange de taux d’intérêts - gains |
294 |
479 |
519 |
273 |
156 |
140 |
386 |
322 |
307 |
208 |
134 |
Produits |
2 137 |
2 154 |
2 091 |
1 939 |
1 912 |
1 210 |
800 |
619 |
488 |
290 |
185 |
Charges |
1 843 |
1 675 |
1 572 |
1 666 |
1 757 |
1 070 |
414 |
297 |
181 |
82 |
51 |
(1) Hors frais et commissions ; hors gains/pertes sur rachats.
Source : Agence France Trésor ; DGFiP.
Ainsi, le taux d’intérêt moyen payé sur l’ensemble de la dette publique (2,2 %) – ou taux apparent – est en baisse sous le double effet de conditions de financement exceptionnellement favorables et d’un très faible taux d’inflation qui allège la charge des emprunts indexés. Il demeure néanmoins largement au-delà du taux de croissance et d’inflation, ce qui fait que l’effet « boule de neige » continue à alimenter la dette publique (cf. supra).
En outre, ce taux est sensible à des facteurs qui pourraient rapidement l’influencer à la hausse : impact de la hausse de l’inflation sur les obligations indexées, remontée des taux à court terme comme à moyen long terme. Cette situation exceptionnelle ne sera donc vraisemblablement pas durable à long terme.
3. Jusqu’à quand les créanciers de l’État accepteront-ils des rendements faibles, voire négatifs ?
À la suite de la crise financière et de la crise des dettes souveraines dans la zone euro, les banques centrales ont mobilisé une palette très large d’outils pour favoriser la reprise de l’activité économique et encourager l’investissement, notamment via le crédit bancaire, et pour lutter contre les risques de déflation. La BCE a ainsi abaissé à plusieurs reprises ses taux directeurs – dont le taux de dépôt, devenu négatif en juin 2014 –, et mis en œuvre une politique de rachats de titres de dettes souveraines.
Cette politique, qui s’est traduite par une injection massive de liquidités sur les marchés et une hausse mécanique de la demande de titres de dette souveraine, a eu pour conséquence de faire baisser les taux sur ces titres, dont une partie importante présente désormais des rendements négatifs.
a. Pourquoi les investisseurs continuent-ils à acheter les titres émis par l’État ?
Dans ce contexte, les Rapporteurs ont cherché à comprendre, au cours des auditions, pourquoi les investisseurs acceptaient de prêter à la France avec des rendements très faibles – voire négatifs –, alors que la dette publique continue à augmenter, et que toutes les agences de notation sont revenues sur la note maximale de la France.
Les investisseurs achètent des titres de dette souveraine pour différentes raisons. Les banques centrales achètent des valeurs du Trésor pour diversifier leurs réserves de change entre différents types d’actifs financiers. Les investisseurs tels que les assureurs ou les fonds de pensions cherchent à adosser leurs engagements vis-à-vis de leurs clients, en termes de rendement et de maturité, à des investissements en valeurs du Trésor. Les banques commerciales, quant-à-elles, détiennent des valeurs du Trésor pour des raisons réglementaires : elles doivent disposer d’un montant suffisant de titres liquides et de très bonne qualité afin de faire face aux besoins de liquidités à court terme.
Plusieurs explications se dégagent des auditions menées par la mission et des indications fournies par l’AFT pour expliquer que ces investisseurs prêtent à la France avec les taux de rendement actuels.
Le passage en territoire négatif du taux de facilité de dépôt au jour le jour appliqué aux banques lorsqu’elles effectuent des dépôts auprès des banques centrales constitue une première explication. Ce taux est devenu négatif en juin 2014 (– 0,1 %) et a été abaissé à plusieurs reprises, pour s’établir à – 0,4 % depuis mars 2016.
Comme l’a expliqué M. Raoul Salomon, responsable des activités de marché pour Barclays en France, « aujourd’hui, si l’on place son argent auprès de la BCE, le taux est très négatif, cela va donc coûter beaucoup. Si l’on peut placer cet argent de façon moins coûteuse, c’est quand même intéressant. » Les achats de titres souverains peuvent donc rester intéressants pour les investisseurs s’ils offrent des rendements moins négatifs que le taux de dépôt.
Les anticipations de taux jouent également un rôle important. Même si les rendements sont faibles aujourd’hui, les investisseurs peuvent anticiper une baisse encore plus importante des taux de la banque centrale en raison d’anticipations de croissance et d’inflation faibles. Acheter un titre à un taux inférieur au taux de la facilité de dépôt aujourd’hui peut ainsi se révéler rentable si les taux diminuent au cours de la vie du titre.
Le rôle des anticipations de taux a été souligné au cours des auditions par l’économiste Natacha Valla, qui a également insisté sur le risque d’un retournement de ces anticipations : « un investisseur obligataire pense à son coupon, mais aussi à l’évolution de la valorisation du titre, de son prix de marché. Or les investisseurs qui anticipent une baisse des taux – indépendamment du fait qu’ils soient positifs, nuls ou déjà négatifs – considèrent qu’en achetant aujourd’hui, ils auront fait un gain en capital. Dans la gestion d’actifs, ce sont les anticipations qui comptent : tant que les investisseurs s’attendent à voir les taux diminuer, ils accepteront des obligations à des taux négatifs, en raison de ces gains hypothétiques en capital.
« Combien de temps dureront ces anticipations négatives ? […] Le jour où un retournement se produira, les investisseurs auront la perspective non seulement d’un taux négatif, mais aussi d’une perte en capital. Nous nous en rapprochons inévitablement : les investisseurs feront alors un raisonnement différent de celui qu’ils font aujourd’hui et arbitreront différemment entre les possibilités qui s’offrent à eux. » (23)
Les contraintes prudentielles sont, en outre, fortes et accordent un traitement préférentiel à la dette publique. Elles ont été renforcées depuis la crise financière à travers la refonte des ratios de solvabilité et de liquidité, dans le cadre de Bâle III pour les banques et de Solvabilité II pour les compagnies d’assurance. Les établissements sont désormais tenus de détenir des actifs liquides et de haute qualité. Pour cette raison, disposer de titres d’État bien notés constitue une sécurité indispensable au respect de ces exigences réglementaires.
Pour certains, les contraintes macroprudentielles, associées aux achats de titres publics par les banques centrales, constituent une forme de « répression financière » visant à maintenir les taux d’intérêt à un niveau plus bas qu’ils ne le seraient autrement. Ainsi, M. Denis Kessler, président-directeur général de SCOR SE, estime qu’« afin de préserver un flux suffisant d’investissement en dette souveraine, en toutes circonstances, aux dépens d’allocations alternatives, le régulateur européen a décidé de ne pas imposer de chargement en capital sur la détention de titres souverains par les assurances… Ceci a incité bon nombre d’assureurs à étoffer leur portefeuille d’obligations souveraines, aux dépens des intérêts des assurés et des épargnants. » (24)
Deux autres explications d’ordre plus technique ont été avancées par l’AFT pour expliquer la forte demande de titres de la dette française sur les marchés. D’une part, certains investisseurs non bancaires n’ont pas de comptes à la Banque de France et doivent donc placer leurs liquidités auprès d’intermédiaires bancaires ou dans des titres. Selon les conditions que leur offrent les intermédiaires bancaires ou selon les limites de risques qu’ils peuvent avoir sur ces intermédiaires, ils peuvent préférer un investissement en valeurs du Trésor, plus sûr même s’il est moins rentable. D’autre part, certains investisseurs internationaux peuvent investir dans des valeurs du Trésor mais acheter en parallèle un contrat dérivé permettant d’échanger les flux en euros contre des flux dans une autre devise. Selon les niveaux de taux et de change entre les différentes zones monétaires, ces investissements peuvent alors procurer une rentabilité positive à l’investisseur, ou alors moins négative que si ces disponibilités étaient placées sur le marché domestique sur un support équivalent.
Enfin, une recherche de sécurité de la part des investisseurs a été évoquée à plusieurs reprises. La dette française est pour les investisseurs un placement sûr et la liquidité des titres français, c’est-à-dire la facilité à les vendre ou les acheter sur le marché secondaire, est valorisée. Ainsi, selon l’économiste Gaël Giraud, les investisseurs « prêtent à la France à des taux ridiculement bas car ils doivent diversifier leurs portefeuilles, acquérir des titres de la dette publique et en acheter une partie en euros. Dans la zone euro, la totalité du sud de l’Europe est proscrite – certains pays n’ayant d’ailleurs plus accès au marché – et les autres États de la zone euro émettent peu de dettes ; les investisseurs anglo-saxons prêtent donc à des taux presque nuls à la France, non parce qu’ils croient à la vertu de sa politique en matière de finances publiques, mais parce qu’ils souhaitent détenir de la dette publique en euros émise par une économie solide. » (25)
Une explication du même ordre a été avancée par M. Dominique Plihon, professeur d’économie financière et porte-parole d’Attac : « Les marchés financiers, notamment obligataires, évoluent dans un climat de grande incertitude dans lequel les dettes publiques des grands pays, et notamment celle de la France, représentent une sécurité recherchée. Les investisseurs acceptent donc de payer une prime de risque négative. En outre, l’État français est solide ; malgré l’importance de l’évasion fiscale, le système de recouvrement des impôts fonctionne efficacement, contrairement à celui de la Grèce. » (26)
Plusieurs économistes ont toutefois alerté la mission sur le caractère potentiellement provisoire d’une telle situation. M. Gaël Giraud a ainsi prévenu que « nos finances publiques [n’étaient] pas assez vertueuses pour séduire les marchés dans un contexte autre que celui, très spécifique, d’aujourd’hui ». Selon Mme Natacha Valla, « sur la qualité de la signature française et sa résilience, il ne faut pas pécher par orgueil même si aujourd’hui, tout se passe très bien ».
b. Un environnement de taux négatifs n’est pas tenable à terme
Sous l’influence de la faiblesse de l’inflation et de la croissance, des politiques monétaires non conventionnelles des banques centrales, de l’excès d’épargne et des incertitudes pesant sur les marchés financiers, les taux négatifs trouvent à s’appliquer dans un nombre croissant de pays, pour des emprunts de maturités de plus en plus longues.
Selon l’agence de notation Fitch, en mai 2016, plus de 10 000 milliards de dollars de dette souveraine affichaient des taux négatifs. Cette situation concernait quatorze pays. Le Japon, mais également la Suisse et, plus récemment, l’Allemagne, empruntent avec des rendements négatifs sur une maturité de dix ans.
Si les taux négatifs constituent une aubaine à court terme pour les emprunteurs permettant d’alléger la charge de la dette de manière indolore, ils constituent une anomalie au regard de la valeur donnée au temps et des repères de nos sociétés. Ils ne paraissent pas tenables à long terme, tant leurs effets négatifs sont nombreux.
Ils ont tout d’abord conduit à un écrasement des primes de risque et poussé les investisseurs vers des placements de plus en plus risqués. La mauvaise évaluation du coût du risque qui en découle constitue une menace pour la stabilité financière.
Ils menacent également, à terme, la solidité financière des banques et des sociétés d’assurances. Le gouverneur de la Banque de France considère que la politique monétaire de l’Eurosystème a eu globalement, en 2015, un effet positif sur la rentabilité des banques, l’accroissement des volumes de crédit et l’amélioration de la solvabilité des emprunteurs ayant compensé les conséquences de la baisse des taux. Il n’en reconnaît pas moins que s’ils se prolongeaient, les taux bas affecteraient la rentabilité des secteurs bancaire et assurantiel. Lors de la présentation du rapport d’activité de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour 2015, son vice-président, M. Bernard Delas, a pour sa part qualifié les taux négatifs de « poison dont les effets sont inéluctables même s’ils n’apparaissent que lentement » et estimé qu’ils feront peser sur les assureurs, à terme, des risques qu’ils auront de plus en plus de difficultés à assumer.
Les épargnants, en particulier ceux des classes moyennes, en recherche de sécurité, sont également pénalisés par la faiblesse des taux, même si les taux négatifs ne leur sont pas appliqués. Comme l’avait relevé M. de Larosière lors de son audition, « dire aux gens qui font l’effort de mettre de l’argent de côté en prévision des aléas de la vie, pour leur vieillesse, pour leurs enfants… qu’ils vont y perdre, c’est renverser les lois sociales ».
Même du point de vue des emprunteurs, on peut s’interroger sur les effets des taux négatifs sur la demande de titres, s’ils devaient se maintenir. Cette interrogation, dont M. de Larosière avait fait part à la mission, est renforcée aujourd’hui par l’évolution de la situation au Japon, où l’une des principales banques du pays, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, menace de se retirer du groupe des vingt-deux établissements japonais qui achètent la dette lors des adjudications.
II. LE FINANCEMENT DE LA DETTE DE L’ÉTAT : UNE GESTION EFFICACE DANS UN CADRE CONTRAINT
Compte tenu des enjeux financiers de la dette de l’État, qui représente environ 80 % de la dette publique de la France au sens des critères de Maastricht, et des particularités de la dette des collectivités locales et des administrations de sécurité sociale, la mission a concentré ses travaux sur la gestion de la dette de l’État, assurée depuis 2001 par l’Agence France Trésor.
A. UNE GESTION DE LA DETTE CONTRAINTE PAR LES RÈGLES EUROPÉENNES ET NATIONALES
1. La disparition des possibilités de monétisation de la dette au profit d’un financement passant exclusivement par les marchés financiers
Les transformations des modes de financement de l’État, qui ont abouti à un financement quasi exclusif par émission d’obligations sur les marchés financiers (cf. partie I sur la disparition du « circuit du Trésor »), résultent d’une série de décisions successives prises à partir du milieu des années 1960.
a. Une évolution de la gestion sous l’égide de la construction européenne
La loi de 1973 sur la Banque de France (27) a constitué une étape mais n’a pas joué le rôle décisif que certains lui ont attribué en faveur du basculement d’une dette non négociable vers un financement sur les marchés financiers.
Si l’article 25 de la loi de 1973 disposait que « le Trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l’escompte de la Banque de France », son article 24 permettait à la Banque de France d’« escompter, acquérir, vendre ou prendre en gage des créances sur l’État, les entreprises et les particuliers dans les conditions qu’elle juge nécessaires pour atteindre les objectifs de la politique monétaire, et en tenant compte de la situation particulière des demandeurs et des présentateurs ». De même que la Banque centrale européenne achète aujourd’hui des titres de dette sur le marché secondaire, la loi de 1973 permettait à la Banque de France d’acheter des titres d’État sur le marché ou d’escompter ceux qui étaient présentés par des opérateurs privés, ce qui permettait à l’État de vendre plus facilement ses bons du Trésor.
Surtout, l’article 19 de la loi disposait que « les conditions dans lesquelles l’État peut obtenir de la Banque des avances et des prêts sont fixées par des conventions passées entre le ministre de l’économie et des finances et le gouverneur ». Ces conventions devaient être approuvées par le Parlement, ce qui a été fait dès 1973 (28). La loi de 1973 n’a donc pas interdit les avances de la Banque de France à l’État.
Ce n’est finalement qu’avec la loi du 4 août 1993 (29), adoptée dans le cadre de la mise en place de l’Union économique et monétaire, qu’il a été « interdit à la Banque de France d’autoriser des découverts ou d’accorder tout autre type de crédit au Trésor public ou à tout autre organisme ou entreprise publics. L’acquisition directe par la Banque de France de titres de leur dette est également interdite. » (30)
Ce sont aujourd’hui les règles européennes qui restreignent le champ des possibilités en matière de gestion de la dette publique. En effet, l’article 123 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales, « d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l’Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres ; l’acquisition directe, auprès d’eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite. »
Cet article se combine avec l’article 124 du même traité, qui interdit « toute mesure, ne reposant pas sur des considérations d’ordre prudentiel, qui établit un accès privilégié des institutions, organes ou organismes de l’Union, des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d’autres organismes ou entreprises publics des États membres aux institutions financières ».
Ces deux dispositions, qui interdisent d’une part les prêts par la banque centrale et d’autre part l’accès privilégié aux institutions financières qui caractérisait le « circuit du Trésor », contraignent les États européens à se financer sur les marchés financiers. Cette soumission aux conditions fixées par les marchés financiers était vue comme une incitation supplémentaire à la discipline budgétaire, la dégradation des finances publiques d’un État étant supposée entraîner une augmentation de la prime de risque exigée par les prêteurs.
À ces deux articles s’ajoute la clause de non-renflouement – ou no-bail out – prévue à l’article 125 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui interdit à l’Union européenne et à ses États membres de répondre des engagements des autorités publiques d’un autre État membre. Cette interdiction doit permettre aux marchés financiers d’apprécier la situation financière de chacun des États membres individuellement. Pour M. Dominique Plihon, porte-parole d’Attac, « les économistes libéraux justifient cette clause pour éviter l’aléa moral, qui, en garantissant leur sauvetage, inciterait les États à ne pas bien gérer leurs finances publiques. L’expérience de la crise a montré l’inanité de cette clause, la situation étant telle que les Européens durent aider la Grèce, l’Irlande, l’Espagne et le Portugal. » (31)
Comme le souligne M. Rémi Pellet (32), « si l’article 125 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne interdit des mécanismes qui imposeraient que des États fussent solidaires de ceux qui sont défaillants, en revanche, le traité n’a pas pour effet d’interdire toute forme de solidarité volontaire entre États. » (33)
En effet, le paragraphe 2 de l’article 122 du traité permet que « lorsqu’un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison de catastrophes naturelles ou d’événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance financière de l’Union à l’État membre concerné. » C’est sur le fondement de cet article qu’ont notamment pu être mises en place les mesures d’aides à la Grèce.
Il existe par ailleurs des possibilités de prêts et emprunts bilatéraux entre les Trésors européens, qui permettent de couvrir des besoins de trésorerie ou de placer des excédents. De telles opérations sont peu fréquentes, mais, depuis 2013, la France a déjà recouru six fois à cette possibilité en tant qu’emprunteur et cinq en tant que prêteur.
b. Une gestion de la dette sous la surveillance des marchés
L’interdiction du financement monétaire et la clause de non-renflouement sont de nature à inciter les investisseurs à examiner attentivement la soutenabilité de la dette des États membres avant de leur prêter de l’argent.
La dette publique est par conséquent désormais gérée sous la surveillance étroite des agences de notation et des investisseurs, alors que, jusque dans les années 1970, en France, l’administration des finances dominait les acteurs des marchés financiers, en les mettant au service du financement de l’État et de ses priorités économiques.
Le recours aux marchés financiers pour le financement de l’État présente un certain nombre d’avantages. Il a d’abord permis de faire face à la forte augmentation des besoins entraînée par la succession de déficits budgétaires depuis 1974. Les ressources procurées par le « circuit du Trésor » n’auraient pas suffi, à elles seules, à y faire face. De plus, même si cela n’a pas toujours été le cas par le passé, il permet aujourd’hui de s’endetter à des taux très faibles qu’un recours, par exemple, à l’épargne des ménages ne permettrait pas.
Mais, ainsi que le sociologue Benjamin Lemoine l’a mis en lumière lors de son audition, « cette configuration de marché, avec tous ses avantages, emporte aussi une série de contraintes à respecter pour entretenir la qualité de la signature de la République française. Cette gestion de la dette implique une manière de présenter ses comptes et aussi une façon d’organiser et de penser les politiques économiques et financières. […] Une différence politique cruciale se niche dans ces modalités concrètes par lesquelles l’État se finance et émet sa dette. »
L’État est vu aujourd’hui sur les marchés financiers – et se comporte – comme un acteur comme un autre, sans « privilèges ».
Lors de son audition, M. Jacques de Larosière, président du conseil stratégique de l’AFT, a donné une illustration de cet état de fait, en soulevant la question du taux d’intérêt négatif payé par l’État pour la trésorerie laissée sur le compte du Trésor à la Banque de France. La BCE a en effet décidé que les taux d’intérêt négatifs sur la facilité de dépôt étaient applicables aux dépôts effectués par les administrations publiques (34). La rémunération des opérations de dépôt à la Banque de France a ainsi conduit en 2015 au paiement d’intérêts par l’État à la Banque de France, pour un montant de 32,9 millions d’euros. Il peut paraître anormal que l’État soit taxé pour la trésorerie qu’il laisse sur le compte du Trésor à la Banque de France. Cependant, selon les explications données par M. de Larosière, l’État est contraint de s’y résigner : « pour corriger ce que nos amis du Trésor perçoivent également comme une anomalie, il faudrait lancer une procédure contre la Banque centrale européenne (BCE) afin d’obtenir une exception pour les trésors nationaux par rapport aux banques ; cela donnerait sans nul doute l’impression que le Trésor demande un privilège. Dans la situation actuelle des marchés, il semble qu’il vaille mieux se soumettre à la loi commune. »
Les rapporteurs ne partagent pas cette résignation et estiment que les États doivent bénéficier d’une exception à l’application de taux négatifs sur leurs dépôts auprès de la banque centrale.
Proposition : Obtenir de la Banque centrale européenne que les taux d’intérêt négatifs ne s’appliquent pas aux dépôts des administrations publiques auprès de la banque centrale.
Surveillée par les acteurs des marchés financiers, la dette publique est devenue un enjeu politique majeur, une contrainte qui pèse en permanence sur la définition des politiques publiques.
Cette contrainte est particulièrement forte en zone euro. Elle ne s’exerce pas de la même manière dans d’autres pays qui ont une dette publique plus importante ou comparable, comme les États-Unis (105 % du PIB), le Japon (248 % du PIB) ou le Royaume-Uni (89 % du PIB), mais ne sont pas soumis aux mêmes contraintes : le Japon est principalement endetté auprès de ses résidents et, contrairement à la BCE, la Bank of England (BoE) et la Federal reserve (Fed) sont autorisées à acheter des titres de dette publique sur le marché primaire, finançant ainsi une partie du déficit public par la création monétaire. D’une manière plus générale, l’euro a la particularité d’être la « monnaie d’une banque centrale sans État (35) », monnaie unique de dix-neuf États différents, avec des politiques budgétaires et des économies différentes, ce qui rend le pilotage de la politique monétaire plus rigide pour atténuer les effets de chocs économiques et financiers.
Cette situation est prise en compte de manière négative par les agences de notation financière. Ainsi, parmi les cinq piliers sur lesquels repose le système de notation de Standard & Poors, figure la flexibilité monétaire. L’agence examine la flexibilité dont disposent les autorités monétaires pour limiter la détérioration de la qualité de crédit d’un État en période de crise. Or, l’agence précise que l’analyse de la flexibilité monétaire est différente pour un pays appartenant à une union monétaire comme la zone euro. Elle évalue, en premier lieu, l’efficacité de la politique monétaire de la BCE pour la zone euro et en second lieu, « le score initial du pays appartenant à une union monétaire est ajusté à la baisse afin de refléter une flexibilité monétaire moindre par rapport à des pays bénéficiant d’une autorité monétaire propre (comme la Réserve Fédérale aux États-Unis ou la Banque d’Angleterre). En effet, dans le cas d’une zone monétaire, la politique monétaire est définie par rapport aux besoins de la zone dans son ensemble mais n’est pas mobilisable pour répondre aux besoins spécifiques d’un État en particulier si sa situation diffère significativement de celle des autres pays de la zone. » (36)
2. La création de l’AFT et son rôle dans la gestion de la dette publique
La gestion de la dette de l’État incombe depuis 2001 (37) à l’Agence France Trésor, qui n’est pas une agence dotée de la personnalité morale, mais un service à compétence nationale, placé sous l’autorité du directeur général du Trésor, qui en est le président, et dirigé par un directeur général.
Outre la gestion de la dette, l’AFT est chargée de la gestion de la trésorerie de l’État et des relations avec les correspondants du Trésor, les investisseurs, les intermédiaires financiers et les autres émetteurs, ainsi que du contrôle interne et du contrôle des risques.
Elle a pour mission de gérer la dette et la trésorerie de l’État au mieux des intérêts du contribuable et dans les meilleures conditions de sécurité, ainsi que de s’assurer que l’État puisse faire face en permanence à ses obligations financières, son compte à la Banque de France ne pouvant pas être débiteur.
Sa création a obéi à plusieurs motivations, plus ou moins explicitement exprimées. La technicité beaucoup plus grande des opérations de gestion de la dette depuis la fin des années 1980, la généralisation des appels au marché par adjudications et la mise en place d’un réseau de banques spécialistes en valeurs du Trésor (SVT) ont, en premier lieu, été mises en avant.
Il s’agissait également de tirer parti des transformations induites par la création de l’euro et la mise en place d’un marché européen unifié, qui permettaient d’envisager des opérations nouvelles sur un marché plus large que celui du franc. Ces motivations étaient ainsi synthétisées par M. Benoît Cœuré, alors directeur général adjoint de l’AFT : « La complexité croissante des opérations, l’exposition accrue au risque de contrepartie et au risque de marché, la nécessité d’un contact étroit avec les acteurs financiers plaidaient pour un renforcement et une spécialisation des moyens techniques et humains affectés à la gestion de la dette. Et il apparaissait de plus en plus nécessaire de mettre en place un contrôle des risques comparable à celui qui se développait, dans la même période, dans les organisations privées. » (38)
Il y avait également une motivation plus politique, qui consistait à dégager le gestionnaire de la dette de ce que Benoît Cœuré désignait comme de potentiels « conflits d’intérêt » : entre la gestion de la dette et la politique monétaire, entre les différentes missions du Trésor (l’État émetteur encourage les achats de titres publics alors que l’État « industriel » veut orienter les capitaux vers la bourse), enfin avec les ministères dits « dépensiers », « à l’affût des techniques nouvelles de déconsolidation et de crédit différé, dont le responsable de la dette redoute, au contraire, le coût plus élevé et l’impact potentiellement négatif pour la signature de l’État ».
Enfin, la décision de créer une agence de la dette avait également une dimension « marketing », visant à créer une « marque » reconnue par les investisseurs et à envoyer un message de sérieux et de crédibilité aux investisseurs potentiels.
À la fin des années 1990, des réformes allant dans le même sens ont été menées dans de nombreux pays de l’OCDE.
Les agences de la dette des autres grands émetteurs souverains
Les agences créées bénéficient de statuts différents, mais l’organisation institutionnelle de la gestion de la dette est comparable pour ce qui concerne les grands émetteurs souverains que sont les États-Unis, le Japon, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie et l’Espagne. La forme de l’entité varie entre celle d’un bureau au sein du Trésor et celle d’une agence – sans que cela se traduise toujours par une distinction juridique avec un service administratif – et avec des degrés variables d’autonomie.
Ainsi, pour ce qui est des principaux pays de l’Union européenne, la gestion de la dette est confiée en Espagne et en Italie à des services relevant du ministère chargé des finances. Aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, les agences bénéficient d’une autonomie de gestion, mais n’ont pas la personnalité juridique. L’agence allemande, la Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmgH , est une société anonyme détenue à 100 % par l’État. Elle est placée sous l’autorité du ministre des finances, mais, symboliquement, son siège est à Francfort, place financière et siège de la BCE, loin du ministère des finances qui est à Berlin.
Lors de la création de l’AFT, son positionnement par rapport au ministère des finances a été âprement débattu au sein de celui-ci (39), une agence extérieure au ministère des finances, détachée du pouvoir politique, ayant initialement été envisagée. Il a finalement été décidé de créer formellement cette agence, tout en conservant celle-ci au sein du ministère des finances. Pour reprendre l’analyse de M. Benoît Cœuré, « l’AFT n’est pas une agence… et ce n’est pas sa structure administrative mais son mode de fonctionnement qui fait sa nouveauté ».
L’AFT ne dispose pas de budget propre, ses moyens de fonctionnement sont ceux du ministère des finances. Ils n’apparaissent pas isolément dans les documents budgétaires, mais sont regroupés avec ceux de l’administration centrale de la direction générale du Trésor dans le programme 305 Stratégie économique et fiscale de la mission Économie et le programme 218 Conduite et pilotage des politiques économiques et financières de la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines. L’AFT gère les budgets liés directement à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, comme l’informatique et la communication. Son activité est retracée dans le programme 117 Charge de la dette et trésorerie de l’État et dans le compte de commerce Gestion de la dette et trésorerie de l’État, ainsi que dans le compte de commerce Couverture des risques financiers de l’État. En 2015, la mission Engagements financiers de l’État a bénéficié d’un déversement de 4 millions d’euros en provenance de la mission Économie, correspondant à la quote-part des personnels de l’Agence France Trésor au sein de la direction générale du Trésor, ainsi qu’un déversement de 1,9 million d’euros de la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines.
Selon les analyses de M. Benjamin Lemoine, « l’un des intérêts pour les « Trésoriens » de maintenir l’Agence au cœur de l’administration est de répercuter en interne la contrainte financière, incarnée par les taux d’intérêt sur la dette et les exigences des investisseurs, dans les enjeux de négociation budgétaire avec les ministères « dépensiers ». Le Trésor se comporte comme le « directeur financier » de la « grande entreprise État », et tente de baliser auprès des représentants politiques les « bons » choix, ceux qui emportent avec eux le moins de perturbations sur la signature financière de l’État. » (40) Les liens de l’AFT avec la direction du budget et la direction générale des finances publiques lui donnent en outre accès à de nombreuses informations macro-économiques et budgétaires qu’elle peut utiliser pour apporter des réponses aux investisseurs. D’une manière générale, à la différence des agents de l’agence allemande, qui ne sont pas habilités à évoquer l’état de l’économie allemande en général, les agents de l’AFT « vendent » la politique économique et financière de la France aux investisseurs. Ainsi, M. Ambroise Fayolle, alors directeur général de l’AFT, vantait dans L’année des professions financières 2013 des réformes structurantes comme le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et l’accord sur la « sécurisation de l’emploi » signé par les partenaires sociaux comme autant de facteurs de nature à attirer les investisseurs.
La position originale de l’AFT au sein du ministère des finances est enfin, selon Benoît Cœuré, source d’une plus grande réactivité : « Les opérations de financement et les choix budgétaires sont étroitement imbriqués. […] L’efficacité plaide pour une chaîne de décision resserrée lorsqu’un mouvement rapide des marchés financiers ou des opérations financières imprévues de l’État appellent des décisions urgentes. »
L’AGENCE FRANCE TRÉSOR AU SEIN DES MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
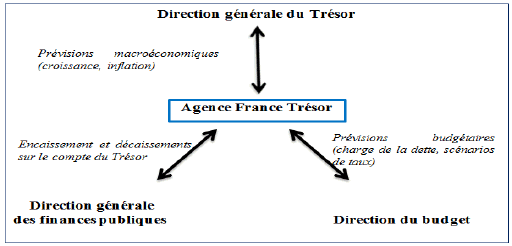
Source : Agence France Trésor.
Contrairement à la plupart des agences de la dette des autres grands pays développés – comme son homologue allemand qui compte 250 personnes – l’AFT fonctionne avec des effectifs réduits. Cela s’explique par sa position au sein du ministère des finances, qui lui permet de s’appuyer sur l’ensemble des services du ministère.
Les effectifs de l’AFT comptent aujourd’hui trente-neuf personnes, dont vingt-neuf fonctionnaires et dix contractuels. Cette répartition a pour but d’allier les compétences de fonctionnaires connaissant parfaitement les processus financiers de l’État et de professionnels des marchés sous contrat. Lors de son audition, le directeur général de l’AFT a considéré que les moyens attribués à l’agence étaient suffisants : « comme n’importe quel responsable d’administration publique on pourrait souhaiter naturellement en avoir davantage… Mais nous sommes très conscients des contraintes du secteur public, et j’estime que la qualité de notre personnel nous permet d’exercer notre mission correctement. » (41)
3. Des émissions de dette encadrées par les lois de finances
Outre les règles européennes déjà évoquées, la gestion de la dette de l’État est encadrée par les décisions prises par le Parlement, dont la LOLF (42) a renforcé les prérogatives, et par le Gouvernement.
La capacité du Parlement à maîtriser l’évolution de la dette publique reste limitée, tant elle dépend de facteurs qu’il peut difficilement maîtriser, comme la conjoncture économique, l’inflation et l’évolution des taux d’intérêt, mais il se prononce, lors de la loi de finances, sur plusieurs éléments ayant des incidences directes sur la dette publique.
À travers les choix exprimés en matière de recettes et de dépenses, tout d’abord, la loi de finances fixe le solde budgétaire primaire de l’État (c’est-à-dire hors intérêts de la dette), qui constitue le principal flux alimentant l’encours de la dette publique.
À l’occasion du vote de l’article d’équilibre, le Parlement se prononce sur un tableau de financement évaluant les ressources et les charges de trésorerie de l’État qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier. Il vote de ce fait sur le besoin de financement annuel de l’État, qui déterminera le montant des émissions de dette à réaliser sur les marchés financiers.
Ces émissions sont elles-mêmes encadrées par l’autorisation que doit donner le Parlement d’émettre des emprunts et de procéder aux autres opérations relatives à la trésorerie de l’État et à des reprises de dettes. Cette autorisation s’accompagne d’un plafonnement par le Parlement de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an.
Ce plafond ne porte que sur la dette négociable dont la durée de vie est supérieure à une année et concerne la variation nette de la dette appréciée en fin d’année. Le Gouvernement dispose donc de la possibilité d’émettre plus de dette à court terme sans autorisation du Parlement, ce qu’il a fait, par exemple, en réaction à la crise financière de 2008 en faisant passer la part des BTF dans la dette négociable de 13,6 % à 18,7 % entre 2008 et 2009. La LOLF évite ainsi que le Gouvernement soit placé devant les difficultés que le président des États-Unis peut connaître quand le Congrès refuse d’augmenter le plafond de la dette.
La LOLF prévoit également que la loi de finances arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l’année, du produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État. L’octroi des garanties de l’État, qui sont susceptibles d’avoir, ultérieurement, des conséquences sur le solde budgétaire, doit lui aussi être autorisé en loi de finances.
Enfin, l’article 26 de la LOLF réserve aux lois de finances pour 2016 la possibilité de déroger aux obligations faites, d’une part, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’État et, d’autre part, à l’État, d’émettre ses emprunts en euros. Il interdit aux emprunts émis par l’État de comporter des exonérations fiscales.
La gestion de la dette publique est ainsi encadrée au niveau organique, au niveau législatif et au niveau réglementaire.
Pour l’année 2016, l’article 57 de la loi de finances (43) autorise notamment le ministre des finances et des comptes publics à procéder à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises (autorisation législative requise par la LOLF), ainsi qu’à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme.
Le même article fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an à 62,5 milliards d’euros et prévoit que les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l’année, du produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État, sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Le décret n° 2015-1799 du 29 décembre 2015 relatif à l’émission des valeurs du Trésor, pris pour son application, précise que les caractéristiques des titres d’une maturité initiale supérieure à un an sont définies par arrêté du ministre chargé des finances et que le ministre est autorisé à échanger ou à racheter, sur le marché, tout titre de la dette publique négociable, les intérêts dus par l’État sur les titres échangés ou rachetés étant payés pour le montant couru à la date de l’échange ou du rachat.
Enfin, selon les informations recueillies auprès de l’AFT, les opérations de syndication sont soumises à la validation expresse du ministre, à la fois en termes d’opportunité et de modalités de réalisation (choix du syndicat de SVT notamment), et le ministre est consulté sur toute mise en place d’opérations spécifiques de gestion de la dette, comme la mise en place d’un programme de contrats d’échange de taux d’intérêt (swaps) en 2001.
B. UNE GESTION À L’ÉCOUTE DES ATTENTES DES INVESTISSEURS
1. La stratégie mise en œuvre par l’AFT
a. Le rôle du comité stratégique
L’Agence France Trésor est assistée dans la gestion de la dette de l’État par un comité stratégique, qui se réunit deux fois par an. Le rôle de ce comité, qui ne fait pas partie de l’AFT, est de donner sa lecture propre des principes qui gouvernent la politique d’émission de l’État et la gestion de sa trésorerie, ainsi que de se prononcer sur les pratiques en cours et les éventuelles évolutions à venir.
Il est présidé par M. Jacques de Larosière, ancien directeur du Trésor, ancien gouverneur de la Banque de France, ancien directeur général du Fonds monétaire international et président d’Eurofi. Outre son président, le comité stratégique comprend actuellement neuf membres, qui ne sont pas rémunérés et exercent tous des fonctions financières internationales :
– des émetteurs de dette : M. Günther Braünig, membre du conseil d’administration de KfW, et M. Bertrand de Mazières, ancien directeur général de l’AFT, directeur général des finances à la Banque européenne d’investissement (BEI) ;
– des acheteurs de dette : M. Lim Chow Kiat, directeur des investissements du Government of Singapore Investment Corporation (GIC), fonds souverain de Singapour ; Mme Satu Huber, directrice générale du fonds de pension finlandais Elo Mutual Pension Insurance Company ; M. Assaad J. Jabre, membre du conseil d’administration de la banque africaine Ecobank Transnational Incorporated, membre du conseil consultatif de la Société islamique pour le développement du secteur privé (SID), filiale de la Banque islamique de développement ; M. Dino Kos, directeur des Global regulatory affairs de la société financière américaine CLS ; M. Yong Yin, directeur général du Centre de gestion des réserves de la State administration of foreign exchange (SAFE) de la République populaire de Chine ;
– des gens de marché : M. Marc-Antoine Autheman, président du conseil d’administration d’Euroclear, et M. René Karsenti, président de l’International Capital Market Association (ICMA).
Le rôle de ce comité, tel qu’explicité par son président devant la mission, reste assez limité : « Son rôle est de tester les initiatives et plus généralement l’activité de l’AFT, en soulevant des questions : venant de personnes très informées et très compétentes, elles amènent l’AFT à réagir. […] Nous nous coulons dans le moule de l’AFT : nous ne réinventons pas une stratégie d’émission de la dette publique française. Concrètement, nous posons des questions, nous soulevons des problèmes : dans un monde où les conditions du marché changent de jour en jour, la stratégie suivie est-elle la bonne ou doit-elle être modifiée ? »
Le comité stratégique a par exemple interrogé l’AFT sur l’opportunité d’émettre dans des devises autres que l’euro, en renminbi chinois par exemple, pour s’implanter sur des marchés financiers nouveaux. L’AFT a écarté cette hypothèse, considérant que le marché de l’euro était suffisant et que des émissions en devises risquaient d’être perçues par les marchés comme la manifestation d’une difficulté à se financer uniquement par des émissions en euros.
La CADES emprunte pour sa part dans d’autres devises que l’euro, en transformant immédiatement l’émission en euros et en concluant en même temps que l’émission de l’emprunt un contrat d’échange pour retrouver ultérieurement les devises nécessaires pour le remboursement des investisseurs. Lors de son audition, M. Patrice Ract Madoux, le président de son conseil d’administration, a précisé que « à la création de la CADES en 1996, il lui avait été demandé de ne pas gêner les émissions du Trésor en empruntant dans d’autres monnaies que le franc. La Caisse d’amortissement a donc emprunté dans d’autres devises. Lors de la mise en place de l’euro, les emprunts antérieurs ont été convertis en euros mais, avec l’accord de son conseil d’administration, elle a continué à émettre dans d’autres devises pour dégager ce marché. » Les émissions en devises de la CADES permettent de répondre à la demande des banques centrales asiatiques dont le portefeuille est constitué d’emprunts en dollars, euros et livres avec des règles de répartition des risques. Leurs achats étant limités par les émissions publiques françaises exclusivement libellées en euros par le Trésor, celles de la CADES leur permettent d’acheter des titres français, notamment, en dollars. Outre les inconvénients évoqués par l’AFT, des émissions d’obligations de l’État en devises porteraient donc en germe un risque de « cannibalisation » des émissions de la CADES.
b. Les principes directeurs de la stratégie de l’AFT
La stratégie d’émission mise en œuvre par l’AFT repose sur des principes de transparence, de prévisibilité et de flexibilité, pour répondre à la demande des investisseurs.
Le premier élément de transparence et de prévisibilité est la communication en fin d’année, à la suite du vote de la loi de finances, du programme des émissions à moyen et long terme. Sur la base du programme de financement de l’État adopté en loi de finances, établi sur la base de la prévision de déficit budgétaire et des remboursements de dette arrivant à échéance, l’AFT propose au ministre un découpage entre le montant à emprunter à court terme (maturités inférieures à un an) et à long terme (maturités supérieures à deux ans), puis communique son programme indicatif d’émission de dette à moyen et long terme pour l’exercice suivant.
Outre le montant total des émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats, l’AFT annonce aux investisseurs, à titre indicatif, les créations de nouveaux titres envisagées, ainsi que les méthodes et le calendrier des adjudications.
PROGRAMME DE FINANCEMENT DE L’ÉTAT EN 2015 ET 2016
(en milliards d’euros)
LR 2015 |
LFI 2016 | |
Besoin de financement | ||
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
116,4 |
125 |
Dont amortissement de la dette à moyen et long termes (nominal) |
114,2 |
124,5 |
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) |
2,3 |
0,5 |
Amortissement des autres dettes |
0,1 |
- |
Déficit à financer |
70,5 |
72,3 |
Autres besoins de trésorerie |
2 |
1,2 |
Total |
189,1 |
198,5 |
Ressources de financement | ||
Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats |
187 |
187 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
0,8 |
2 |
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
– 22,6 |
- |
Variation des dépôts des correspondants |
6,7 |
- |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
– 5,2 |
9 |
Autres ressources de trésorerie |
22,4 |
0,5 |
Total |
189,1 |
198,5 |
Le calendrier des adjudications est un autre élément de prévisibilité. Les émissions ont en effet lieu selon un calendrier précis, en fonction de la maturité des titres, et connu à l’avance. L’AFT peut adapter ce calendrier en fonction des besoins, mais elle informe préalablement le marché de tout ajustement.
Ainsi, les adjudications de bons du Trésor à taux fixe et à intérêt précompté (BTF), titres de maturité inférieure à un an, ont lieu tous les lundis à 14 h 50, celles des obligations assimilables du Trésor (OAT) de maturité de deux à sept ans, le troisième jeudi du mois et celles des OAT de maturité supérieure à sept ans, le premier jeudi du mois. Pour les OAT, les adjudications ont lieu à 10 h 50 pour les titres nominaux et à 11 h 50 pour les titres indexés sur l’inflation. En 2015, l’AFT a procédé à 50 adjudications de BTF et 32 adjudications d’OAT.
Pour les OAT, les titres concernés par l’adjudication, ainsi que les montants à émettre, sont communiqués quatre jours ouvrés avant l’adjudication.
Selon M. Anthony Requin, directeur général de l’AFT, la régularité et la prévisibilité de l’AFT sont deux caractéristiques très appréciées des investisseurs. M. Jacques de Larosière, président du comité stratégique de l’AFT a confirmé que « s’ils réussissent à instiller l’idée qu’ils ont une stratégie stable alors les investisseurs continueront de leur faire confiance. Pour le moment, cela fonctionne bien. La stabilité de la stratégie d’émission de l’AFT contribue à la stabilité des marchés : les deux vont de pair. »
La troisième caractéristique de la stratégie d’émission de l’AFT est sa flexibilité, entendue comme l’adaptation à la demande des investisseurs. L’écoute des marchés et la prise en compte de la demande sont vues comme des moyens d’assurer la meilleure liquidité (cf. infra) possible sur l’ensemble de la courbe des taux, et donc d’émettre à moindre coût.
Ce dialogue avec les investisseurs constitue une priorité pour l’AFT, qui indique avoir rencontré plus de 300 investisseurs, en France ou à l’étranger, en 2015. Il a deux objectifs. D’une part, il permet de « prendre le pouls » du marché, de recueillir le point de vue des investisseurs sur la France et sur le marché de la dette. Ces contacts directs avec les investisseurs sont importants pour limiter la dépendance aux spécialistes en valeurs du Trésor que la Cour des comptes regrettait dans son référé de 2012 sur la gestion de la dette de l’État par l’AFT.
D’autre part, ils permettent à l’agence de présenter sa stratégie d’émission et les qualités techniques de la dette française, ainsi que de communiquer des éléments d’information sur la situation des économies française et européenne, la politique économique et budgétaire de la France et les réformes structurelles engagées.
L’écoute des investisseurs se combine avec une tradition d’innovation, soulignée au cours des auditions de la mission. Ainsi, pour M. Raoul Salomon, responsable des activités de marché pour Barclays en France, « la France a une tradition de modernité. Elle a été la première à émettre une obligation d’État à trente ans dans ce qui allait devenir la zone euro ; la première à émettre une obligation démembrée, ou STRIPS (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities) ; la première à proposer des obligations indexées sur l’inflation. Chaque fois, la France a été moteur de l’innovation financière. » Elle a également été la première, en 2005, à émettre des obligations à cinquante ans pour répondre aux besoins des fonds de pension étrangers, en particulier américains.
c. Un professionnalisme et une efficacité reconnus
Si l’on peut discuter le cadre choisi pour le financement de l’État, c’est-à-dire un financement sur les marchés financiers, la mission n’a entendu, au cours de ses auditions, aucune critique sur la manière dont l’AFT exerçait sa mission dans ce cadre. Lors de son audition, M. Benjamin Lemoine a ainsi estimé que « l’Agence France Trésor regroupe une concentration d’expertise assez forte. Dans la configuration de marché, l’État continue de fonctionner avec le souci de l’intérêt général, de se placer au service du citoyen en finançant la dette au meilleur coût tout en gardant le souci de la stabilité de cette émission à long terme. »
Les spécialistes en valeurs du Trésor auditionnés ont eux aussi souligné la qualité du travail de l’AFT, « l’une des équipes les mieux organisées de toutes celles qu’il nous est donné de côtoyer, toujours très innovante et proche des besoins des clients » pour M. Franck Motte, responsable Eurorates HSBC.
Les résultats obtenus en matière de maîtrise de la charge de la dette – alors que l’encours de la dette continue à augmenter –, et le taux de couverture moyen lors des adjudications, sont autant d’indices de ces qualités, même si ces performances ne doivent évidemment pas tout au travail de l’AFT ; le contexte de marché, la politique monétaire accommodante de la BCE, le contexte économique général (croissance et inflation faibles) et les qualités intrinsèques de la France y contribuent largement.
Mme Amélie Roux, de l’agence de notation FitchRatings, a estimé qu’un des atouts de la France, qui justifie que sa notation se maintienne à un niveau élevé, résidait dans sa capacité à financer son déficit et à refinancer sa dette : « En tant qu’émetteur de référence en Europe, elle a accès à des marchés liquides et profonds, et la structure de sa dette est très favorable car, essentiellement libellée en euros et présentant des maturités très longues, elle a un coût globalement modéré. »
Selon les informations transmises à la mission par l’AFT, depuis 2014, les taux moyens pondérés à l’émission sont historiquement bas par rapport à ces vingt dernières années. Ils sont négatifs à court terme depuis 2015 et s’établissaient à 0,63 % en 2015 pour les titres à moyen et long terme, contre 4,15 % en moyenne sur la période 1998-2008.
Le taux de couverture lors des adjudications, qui permet de mesurer la sécurité des adjudications, est également satisfaisant. Ce taux rend compte du rapport entre le volume demandé et le volume servi pour chaque adjudication.
La cible fixée dans le projet annuel de performances est fixée à 200 % pour les titres à court terme (BTF) et 150 % pour les titres à moyen et long terme. En 2014, la réalisation s’est élevée à 300 % pour les titres à court terme et à 229 % pour les titres à moyen et long terme. Bien qu’en léger repli, les résultats pour 2015 sont très satisfaisants, avec un taux de 294 % pour les adjudications de BTF et de 200 % pour les adjudications de titres à moyen et long terme. Le taux n’est descendu en dessous de la cible pour aucun titre, ni à court terme – le moins bon résultat est de 225 % –, ni à long terme – le moins bon résultat est de 167 %.
Ils restent, depuis le début de l’année 2016, sensiblement supérieurs à la cible.
2. Les outils de la politique d’émission
Une série de réformes a été mise en œuvre depuis 1985 pour développer un marché des titres d’État susceptible de lui permettre d’emprunter dans les meilleures conditions possibles, et d’offrir aux acteurs du marché des titres standardisés et un accès simple et sécurisé.
Les instruments mis en place s’inspirent du modèle américain, qui se décompose en trois instruments, bills, notes et bonds, en fonction de leur maturité. En France, les instruments mis en place sont :
– les bons du Trésor à taux fixe et à intérêt précompté (BTF), pour le court terme ;
– les bons du Trésor à intérêt annuel (BTAN), pour le moyen terme,
– et les obligations assimilables (44) du Trésor (OAT) pour le long terme.
ENCOURS DE LA DETTE NÉGOCIABLE DE L’ÉTAT AU 23 MAI 2016
(en milliards d’euros)
Encours total de la dette négociable |
1 602 |
Moyen et long terme |
1 447 |
dont titres indexés |
179 |
Court terme |
155 |
Source : Agence France Trésor.
Au 23 mai 2016, la dette de l’État était constituée de 53 obligations nominales (à taux fixe) et de 16 obligations indexées sur l’inflation, dont 7 sur l’inflation française et 9 sur l’inflation européenne.
L’encours de la dette à taux fixe s’élevait à 1 268 milliards d’euros et celui de la dette indexée à 179 milliards d’euros.
L’encours des BTF (155 milliards d’euros) peut s’assimiler à un endettement à taux variable, dans la mesure où leur maturité est inférieure à un an et, en moyenne sur l’encours, de quatre mois environ. Ainsi, les titres à taux fixe représentent 79,2 % de l’encours total de 1 602 milliards d’euros et les titres à taux variable 20,8 %, dont 11,2 % indexés sur l’inflation et 9,7 % de BTF.
DETTE NÉGOCIABLE À MOYEN ET LONG TERME DE L’ÉTAT AU 31 MARS 2016
(en milliards d’euros)
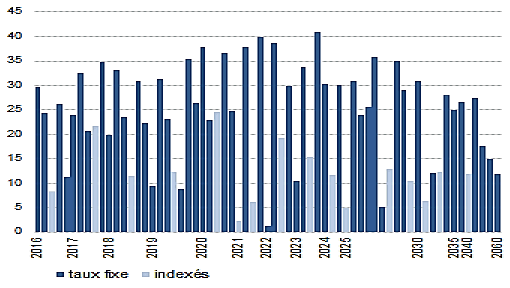
Source : Agence France Trésor.
Hormis le cas particulier des titres indexés sur l’inflation, il faut rappeler que tous les BTAN et OAT sont à taux (ou coupon) fixe : le montant du coupon versé annuellement ne varie pas pendant toute la durée de vie du titre. D’autres pays européens, comme l’Italie, recourent plus régulièrement aux obligations à taux variable.
Par le passé, des OAT à taux variable ont été émises, comme l’OAT TEC 10, lancée en 1996, dont le taux d’intérêt était indexé sur le taux de l’échéance constante à dix ans (TEC 10) (45). Ces titres étaient potentiellement plus risqués que les titres indexés sur l’inflation, puisque leur taux variait en fonction des taux d’intérêt sur le marché secondaire et non en fonction des prix à la consommation. Aucun de ces titres n’est actuellement en circulation.
Ceci a pour conséquence qu’une éventuelle hausse des taux d’intérêt ne se répercute pas immédiatement sur l’intégralité du stock de dette, mais uniquement sur les nouvelles émissions destinées à financer le déficit budgétaire ou l’amortissement des titres arrivés à échéance.
Les différents titres utilisés ont des caractéristiques et répondent à des objectifs différents :
i. Les bons du Trésor à taux fixe et à intérêt précompté (BTF)
Les BTF sont des titres à court terme de maturité inférieure ou égale à un an (trois, six et douze mois) qui constituent l’instrument de gestion de trésorerie de l’État. Tous les émetteurs souverains disposent de tels instruments. Certains émetteurs, comme l’Allemagne, n’émettent qu’à six et douze mois.
Les BTF ne portent pas de coupon : le rendement du titre est inclus dans le prix d’achat du titre, l’autre flux étant le remboursement par l’État à maturité. Lorsque le taux d’intérêt est positif, l’État reçoit en numéraire, à l’émission du titre, un montant inférieur au capital à rembourser à l’échéance. Inversement, en cas de taux négatif, l’État reçoit à l’émission les intérêts payés par le créancier plus le capital à rembourser à échéance. Ainsi, un BTF émis à un taux de – 0,10 % pour une maturité d’un an serait acheté par l’investisseur à 100,10 euros pour un remboursement de 100,00 euros un an plus tard.
Au 31 mai 2016, le taux du BTF à trois mois était de – 0,49 %.
Selon les informations fournies à la mission par l’AFT, les BTF sont utilisés par les banques centrales hors zone euro pour la gestion de leurs réserves de changes – essentiellement en Europe de l’est, au Moyen-Orient et en Asie du sud-est – et par les fonds monétaires en euros.
ii. Les bons du Trésor à intérêt annuel (BTAN)
Les BTAN (bons du Trésor à intérêts annuels) sont des valeurs assimilables du Trésor, émises pour des durées de deux ou cinq ans. Depuis le 1er janvier 2013, les nouveaux titres de maturité deux ans et cinq ans sont émis sous la forme d’OAT, comme pour les titres de long terme (sept ans et plus). Les souches de BTAN existantes ont continué à être abondées pour assurer leur liquidité. Il subsiste quatre BTAN, dont le dernier arrivera à maturité le 25 juillet 2017.
iii. Les obligations assimilables du Trésor (OAT)
Les OAT sont des obligations à moyen et long terme, c’est-à-dire de maturité à l’émission comprise entre deux et cinquante ans.
Une obligation se caractérise par :
– son nominal ou principal, c’est-à-dire le montant unitaire des obligations composant un emprunt, qui sert de base au calcul des intérêts. Le montant nominal d’une OAT est de 1 euro ;
– son coupon ou taux d’intérêt nominal, c’est-à-dire la rémunération due par l’émetteur au porteur de l’obligation. Le coupon des OAT est annuel et est un pourcentage fixe du nominal ;
– sa maturité ou date de remboursement ;
– ses modalités de remboursement. Les OAT sont remboursées par l’État in fine.
Tous les émetteurs souverains disposent de tels instruments, mais les maturités supérieures à trente ans ne sont pas fréquentes. L’Allemagne, par exemple, ne s’endette actuellement pas au-delà de trente ans ; l’Espagne a émis en mai 2016 son premier titre à cinquante ans.
Au 31 mai 2016, le taux à dix ans s’élevait à 0,49 %.
Comme les BTF, les OAT sont utilisées par les banques centrales hors zone euro pour leurs réserves de change. Les banques, notamment pour la gestion de leur portefeuille de liquidité, privilégient les maturités inférieures à dix ans. Les assureurs et fonds de pensions ont pour leur part besoin de titres plus long, jusqu’à trente ans, voire cinquante ans.
iv. Les obligations assimilables du Trésor indexées sur l’inflation
Les OATi (créées en 1998) et OAT€i (créées en 2001) sont des OAT indexées respectivement sur l’inflation française et sur l’inflation européenne. Alors que des produits de ce genre existaient depuis 1981 en Angleterre, la France a été le premier pays de la zone euro à en émettre. En échange de la protection contre l’inflation, c’est-à-dire contre le risque d’érosion monétaire de son titre, le prêteur accepte un taux plus bas. Pour sa part, l’État mise sur la stabilité des prix pour diminuer sa charge d’intérêt.
En moyenne, l’AFT émet environ 10 % de son programme d’émissions annuel via ces titres.
L’État verse annuellement un flux égal au produit d’un coupon dit « réel » (calculé en pourcentage fixe du principal indexé, déterminé lors de l’émission et fixé pour la durée de vie du titre) et du principal de l’obligation multiplié par le coefficient d’indexation calculé en référence à l’indice des prix à la consommation hors tabac. À maturité, l’État rembourse le principal indexé sur l’ensemble de la période. Au cas où la référence quotidienne d’inflation à maturité serait inférieure à la référence de base, le remboursement est garanti égal au nominal.
Au 3 février 2016, le taux de rendement de l’OAT€i la plus longue, de maturité 25 juillet 2040, s’élevait à 0,10 %, tous les autres titres ayant un rendement négatif.
En zone euro, outre la France, l’Italie est un émetteur important de titres indexés, avec des titres indexés sur l’inflation italienne et des titres indexés sur l’inflation européenne. L’Allemagne n’a commencé à émettre des titres indexés qu’en 2006 et a émis pour la première fois en 2015 un titre indexé de maturité trente ans. L’Espagne est la dernière arrivée sur le marché, avec trois titres émis depuis 2014.
Les OATi et OAT€i sont traditionnellement achetées par des investisseurs qui doivent couvrir un passif exposé à l’inflation, notamment les assureurs-vie et les fonds de pensions, mais aussi les banques qui gèrent des livrets indexés sur l’inflation comme le livret A et les livrets bancaires indexés sur le taux du livret A. En raison de la couverture des expositions liées au taux du livret A, la proportion d’OATi détenue par des résidents (65 %) est beaucoup plus forte que pour les autres titres.
Elles sont également achetées par d’autres catégories d’investisseurs, intéressés par des opportunités de prix par rapport à d’autres actifs, et qui ne conservent pas nécessairement la composante inflation de l’investissement.
v. Les obligations démembrées (STRIPS)
Le démembrement d’une obligation consiste à transformer chaque flux de paiement en un titre indépendant, ce qui permet de répondre à certaines demandes d’investissement spécifiques, en créant des obligations zéro-coupons (aucun intérêt n’est versé durant toute la durée de vie de l’obligation, la rémunération des investisseurs étant assurée par la différence entre la valeur d’émission et la valeur de remboursement). Les obligations démembrées ne sont pas créées directement par l’AFT mais par les SVT à partir de titres à moyen et long terme.
vi. Les clauses d’action collective
Tous les titres d’une maturité supérieure à un an émis depuis le 1er janvier 2013 comportent une « clause d’action collective » (46) autorisant l’État, s’il dispose de l’accord de la majorité des détenteurs de titres, à modifier les termes du contrat d’émission.
À la suite d’une décision de l’Eurogroupe du 28 novembre 2010 prise à l’initiative de l’Allemagne, l’article 12 du traité instituant le Mécanisme européen de stabilité (MES) a prévu de telles clauses, standardisées pour leur assurer un effet juridique identique, pour les émissions de tous les pays de la zone euro. Le contenu de ces clauses a été précisé par les « termes de référence », adoptés le 18 novembre 2011 par le comité économique et financier de l’Union européenne (47), afin d’assurer une mise en œuvre identique dans l’ensemble des État membres de la zone euro. Ces clauses types comprennent notamment :
– une clause permettant, avec l’accord d’une majorité d’obligataires, de modifier les conditions du contrat d’émission. Les modifications les plus importantes (date d’échéance, diminution du montant de la créance, modification de la devise…) ne peuvent être adoptées qu’à la majorité qualifiée de 75 % du montant global de l’émission. Les dispositions les moins importantes du contrat d’émission peuvent être modifiées à la majorité simple de 50 % du montant global de l’émission ;
– une clause d’exclusion des droits de vote attachés aux obligations détenues par l’État émetteur ou les organismes publics qu’il contrôle ;
– des clauses organisant la procédure de vote et les conditions de représentation des obligataires par un agent désigné par l’émetteur.
Lors de son audition, M. Dominique Plihon, porte-parole d’Attac, a souligné l’importance de telles clauses dans la perspective d’une restructuration de dette souveraine : « Tous les emprunts publics européens relèvent d’une clause d’action collective ; si un pays se trouve en difficulté et souhaite restructurer sa dette, et que la majorité de ses créanciers acceptent la négociation, alors la minorité ne peut pas la bloquer. Des fonds vautours, ne détenant que 1 % de la dette argentine, ont obligé ce pays à passer sous leurs fourches caudines à cause de l’absence de clause d’action collective pour la dette passée, alors que la majorité des créanciers aimeraient renégocier la dette. »
b. Le rôle déterminant des spécialistes en valeurs du Trésor
Les spécialistes en valeurs du Trésor (SVT) sont des banques sélectionnées par l’État pour devenir les partenaires de l’AFT pour ses activités sur les marchés. Ils ont un rôle de « grossistes » des titres de dette : ils sont les seuls à les acheter à l’émission, sur le marché primaire, lors des adjudications, et les revendent aux investisseurs finaux ou à d’autres intermédiaires sur le marché secondaire. Ils en conservent également une partie, ce qui les place dans la situation singulière d’être à la fois « grossistes » et investisseurs.
Ce partenariat a été mis en place en France en 1987, sur le modèle des primary dealers américains, peu après le lancement de la première OAT et la généralisation des adjudications (1985).
Le système des primary dealers est très répandu dans le monde. Les SVT ont d’ailleurs précisé lors de leur audition qu’ils exerçaient cette mission auprès de nombreux États. BNP Paribas, par exemple, a le statut de SVT auprès de vingt-quatre Trésors dans le monde, principalement ceux de la zone euro, mais également les États-Unis, le Japon, la Chine et l’Australie.
Aux États-Unis, où les primary dealers existent depuis 1960, il y en a aujourd’hui 22 (48). Dans l’Union européenne, d’après le recensement du sous-comité des emprunts d’État du Comité économique et financier, 22 des 28 États membres recourent à un système de primary dealers (49). Il faut préciser que, si l’Allemagne n’est pas incluse dans cette liste, son système d’émission est proche : les adjudications sur le marché primaire y sont réservées à un groupe d’établissements (« Bietergruppe Bundesemissionen »), dont la liste est actualisée chaque année. Ce groupe était composé de 36 établissements au 1er janvier 2016. Les conditions pour participer à ce groupe sont moins contraignantes que pour les SVT, mais ces établissements doivent remplir certaines conditions, notamment souscrire au moins 0,05 % des adjudications sur une année. Des classements des membres du groupe sont publiés deux fois par an.
Les SVT sont désignés tous les trois ans par le ministre des finances sur recommandation d’un comité composé de personnalités parmi lesquelles les rapporteurs spéciaux des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat chargés de la mission Engagements financiers de l’État.
Depuis le 1er janvier 2016, le groupe des SVT est composé de dix-huit établissements parmi lesquels cinq établissements français, six européens, six nord-américains et un japonais : Bank of America - Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole - CIB, Citigroup, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Natixis, Nomura, Royal Bank of Scotland, Santander, Scotiabank Europe, Société Générale et UBS.
La composition du groupe reflète la diversité des établissements actifs sur le marché des emprunts d’État français : grandes banques de réseau, établissements spécialisés, institutions d’origine française et étrangère. La diversité géographique des SVT représente un atout pour la diversification de la base d’investisseurs de la dette, même si, par ailleurs, tous ces établissements sont présents dans le monde entier.
Les missions des SVT consistent à :
– assurer le bon déroulement des émissions primaires en participant aux adjudications et en préparant les émissions avec l’AFT pour les adapter au mieux à la demande du marché. M. Thomas Spitz, responsable du trading au Crédit Agricole, a ainsi précisé lors de son audition que les SVT avaient pour rôle « de conseiller l’AFT sur le type d’émissions ou de produits qui, à un moment déterminé, seront plus intéressants pour les investisseurs et lui permettront donc d’émettre de façon moins onéreuse : obligations à trente ans, dette indexée sur l’inflation, etc. » (50) ;
– placer les valeurs du Trésor et assurer la liquidité du marché secondaire ;
– promouvoir le marché des valeurs du Trésor ;
– fournir un conseil continu à l’AFT en matière de politique d’émissions, de gestion de la dette, de promotion de la signature de l’État, de couverture des risques financiers de l’État, de régulation des marchés de taux et de gestion des finances publiques.
Les engagements des SVT
Les SVT signent une charte avec l’État, qui matérialise leurs engagements. Cette charte prévoit notamment que, sauf cas de force majeure, chaque SVT participe à toutes les adjudications. Elle fixe un volume minimum à obtenir lors des adjudications sur les douze derniers mois glissants.
Des obligations sont également prévues en matière d’animation et de maintien de la liquidité du marché secondaire. Chaque SVT doit assurer la couverture de l’ensemble de la gamme des produits émis par l’AFT, en cotant ferme et en continu, à l’achat et à la vente, aux clients et aux autres SVT. La charte prévoit une part de marché minimale de 2 % sur le marché secondaire.
En matière de conseil, les SVT doivent contribuer quotidiennement à l’information de l’AFT sur les évolutions du marché, le volume des opérations qu’ils ont traitées voire, lorsqu’ils l’estiment pertinent, sur la nature de leurs clients et leurs propres positions. En outre, ils doivent transmettre systématiquement à l’AFT la production de leurs services d’analyse et de recherche sur les questions relatives au marché obligataire souverain ou affectant la signature de la France, et donner à l’AFT libre accès à l’ensemble de leurs recherches et analyses sur le fonctionnement des marchés financiers. Des rencontres régulières avec les économistes des SVT sont prévues.
Les SVT s’engagent à développer le placement des valeurs du Trésor dans le cadre de leur stratégie commerciale, font bénéficier l’AFT de leur connaissance des investisseurs, analystes et journalistes et assistent l’AFT lors de ses déplacements à la rencontre des investisseurs.
Enfin, chaque SVT s’engage à mettre en œuvre les moyens et l’organisation pertinents (expression en français, présence effective en France, etc.) pour remplir ses missions auprès de l’AFT. Un responsable SVT est désigné dans chaque établissement, qui coordonne les contacts entre l’AFT et les services du SVT et s’assure du respect de la charte au sein de son établissement.
Les SVT font l’objet d’une évaluation par l’AFT, qui publie chaque année un palmarès prenant en compte la participation aux adjudications, la présence sur le marché secondaire et les aspects qualitatifs de la relation avec l’AFT (qualités opérationnelle et du conseil, proximité et stabilité de la relation). BNP Paribas est en tête de ce classement depuis dix ans.
Comme le montre l’étendue des missions des SVT auprès de l’AFT – qui ne compte, rappelons-le, que trente-neuf agents –, des liens étroits existent entre les SVT et l’AFT, la charte évoquant « l’établissement d’un haut degré de confiance réciproque, c’est-à-dire d’une relation proche et continue dans le temps ». (51)
Aussi les rapporteurs ont-ils interrogé le directeur général de l’AFT sur une forme de « connivence » qui pouvait s’établir avec le monde de la banque. La nomination de la directrice générale adjointe de l’AFT comme directrice générale adjointe, chargée des affaires financières, bancaires et européennes à la Fédération nationale du Crédit Agricole, intervenue peu après le début des travaux de la mission, pouvait en effet légitimement prêter à interrogations. Selon les explications fournies par le directeur général de l’AFT, ce départ aurait été permis car il ne se faisait pas vers une banque faisant partie des SVT, mais vers une structure actionnariale de cette banque. La jurisprudence de la commission de déontologie des fonctionnaires (52) aurait déjà autorisé à deux reprises des fonctionnaires du Trésor à occuper des fonctions dans cette structure. Il n’y aurait, selon lui, pas de cas de départ d’un fonctionnaire de l’AFT qui ait rejoint un SVT.
Compte tenu de la faiblesse des taux consentis à l’État lors des émissions, avec une partie de la courbe à taux négatifs, et des contraintes qui pèsent sur les SVT, les rapporteurs ont cherché à comprendre l’intérêt pour les banques de faire partie de ce « club ». En effet, comme l’a précisé M. Benjamin Lemoine lors de son audition, « les banquiers se plaignent de perdre de l’argent sur ces adjudications, car les taux d’intérêt sont très faibles. Pour eux, ces opérations représentent un coût humain, puisqu’il faut payer un trader obligataire pour s’en occuper. Le trading sur les obligations d’État est une perte. »
L’hypothèse du patriotisme des SVT paraissant insuffisante, a fortiori pour des banques étrangères, plusieurs explications peuvent être avancées.
La première est la demande des investisseurs. Comme l’a précisé M. Amaury D’Orsay, responsable mondial du trading de taux au sein de la Société Générale : « le marché des dettes d’État est important pour nos investisseurs et représente une forte activité de conseil ». Une grande banque doit être en mesure de proposer à ses clients des obligations souveraines, véritables « produits de base » des marchés financiers. Les profits des banques interviennent donc dans un second temps, lors de la vente des titres aux investisseurs, y compris lorsqu’elles vendent des titres à la banque centrale dans le cadre du quantitative easing (cf. partie IV).
Les SVT conservent une partie des titres pour leur usage propre et pour satisfaire à leurs obligations prudentielles.
Il y aurait également un enjeu d’image. Pour M. Raoul Salomon, de Barclays, « le fait d’être SVT est un signal très fort : cela nous aide à investir d’autres marchés ». Pour M. Christophe Jobert, de BNP Paribas, « être premier SVT nous positionne comme le meilleur spécialiste en valeurs du Trésor, et donc comme une contrepartie de choix auprès de tous les investisseurs internationaux ».
La proximité avec le Trésor serait en outre une « porte d’entrée » pour le reste de la sphère publique, comme l’a précisé M. Raoul Salomon : « Le secteur public est également un important émetteur de dette. Le fait d’être proche du Trésor nous aide dans nos relations avec ces agences émettrices de dette. » Au-delà de l’émission de dettes, selon les propos d’un SVT recueillis par M. Benjamin Lemoine dans le cadre de sa thèse, la relation avec le Trésor serait également vue comme une porte d’entrée au sein du « client État » (53) pour obtenir d’autres mandats de la part de la puissance publique, par exemple lors d’opérations de fusions-acquisitions ou de privatisations.
La qualité de SVT permet de plus de compléter les achats lors des adjudications par des « offres non compétitives » et d’obtenir des mandats rémunérés de syndication, pour les titres qui ne sont pas émis par adjudication. Les syndications étant rares, les commissions touchées par les SVT restent toutefois relativement modestes (cf. infra).
Enfin, comme l’a montré la description du rôle des SVT, l’État est dans une situation de dépendance à leur égard pour son financement, ce qui peut leur donner un levier d’influence. M. Benjamin Lemoine donne l’exemple de la loi bancaire du 26 juillet 2013 (54). Selon lui, « lors de la préparation de la loi bancaire du 26 juillet 2013, la tenue du marché de la dette a fonctionné comme un moyen de pression des banques, réunies en fédération, face aux velléités réglementaires du gouvernement ou de certains parlementaires […]. Les banques arguaient que la « filialisation » – c’est-à-dire la soumission de certains pans de l’activité bancaire à des contraintes prudentielles importantes – pourrait rendre encore plus coûteuse qu’elle ne l’est déjà la charge de spécialiste en valeurs du Trésor, voire la rendrait définitivement impossible. En somme, trop réglementées, les banques ne pourraient plus assurer leur « précieux » travail de tenue de marché qui serait aux fondements de la « liquidité » tant recherchée de la dette française par l’État, et donc un garant de son faible prix pour la République. » Il en conclut, d’une formule provocatrice, que « tenir le marché des dettes d’État c’est donc aussi, pour les banques, "tenir l’État" » (55).
c. Les émissions sur le marché primaire
i. La mise en concurrence des investisseurs par le recours privilégié aux adjudications
L’AFT émet l’ensemble des titres selon un calendrier stable et connu à l’avance (cf. supra). C’est également le mode d’émission retenu par les autres grands émetteurs occidentaux, comme les États-Unis, le Japon, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni. Il permet de lisser dans le temps le programme de financement de l’État et est apprécié par le marché pour les conditions de transparence (dates régulières, annonce en amont) dans lesquelles il intervient.
Depuis 1985, les titres d’État sont principalement émis par la technique de l’adjudication « au prix demandé » ou « à la hollandaise », en référence à la méthode utilisée par la bourse aux fleurs des Pays-Bas. Cette technique vise à mettre en concurrence les souscripteurs (les SVT) pour obtenir le prix le plus bas pour l’État.
Avant chaque adjudication, l’Agence France Trésor consulte les SVT sur les titres et le volume à adjuger, puis annonce, le vendredi matin, les titres et la taille qu’elle adjugera lors des adjudications de la semaine suivante.
Ensuite, chaque SVT exprime ses offres d’achat au travers du système d’adjudication Telsat, géré par la Banque de France, en indiquant le montant qu’il souhaite acheter et le prix auquel il est prêt à le faire. Il peut exprimer plusieurs offres à des prix différents, et s’engage à acquérir les titres si l’AFT les lui alloue.
La Banque de France communique à l’AFT une grille d’adjudication représentant de manière anonyme l’ensemble des offres des SVT. L’AFT choisit alors la taille qu’elle souhaite allouer pour chaque titre. Les offres sont servies en commençant par celles dont les prix sont les plus élevés (donc les taux d’intérêt les plus faibles) jusqu’à concurrence du montant souhaité par l’Agence France Trésor. Les participants payent donc des prix différents, correspondant exactement aux prix qu’ils ont demandés.
Le taux moyen pondéré est calculé à partir du coupon de l’obligation, fixe et connu avant l’adjudication, et des prix payés par chacun des souscripteurs, pondérés par les quantités achetées.
Il faut distinguer le coupon (ou taux d’intérêt nominal), de l’obligation, du taux d’intérêt effectif du titre, qui représente son coût réel pour l’État. Les OAT prévoient le paiement d’un coupon chaque année, connu avant l’émission du titre et constant pendant toute la durée de vie du titre (56). Il existe généralement une différence entre le taux de coupon et le taux d’intérêt effectif du titre, qui reflète le taux de marché à l’émission, dans la mesure où te taux de coupon est arrondi au quart de point. Cette différence génère, selon le cas, des primes ou des décotes à l’émission. C’est nécessairement le cas lorsque les taux d’intérêt sont négatifs, puisque les coupons sont fixés à un taux positif ou nul.
Lorsque le taux effectif est inférieur au taux de coupon, l’investisseur verse en compensation à l’État, à l’émission, une somme supérieure au capital qui sera remboursé à échéance (la somme payée par l’investisseur correspond à la valeur actuelle des flux de paiement futurs, actualisés avec le taux d’intérêt à l’émission). L’État émetteur encaisse dans ce cas une « prime à l’émission » (57), actuariellement neutre au cours de la vie du titre, résultant de la différence entre le taux de coupon des titres émis et le taux d’intérêt demandé par les investisseurs au moment de l’émission.
Ainsi, si l’État émet une OAT de maturité cinq ans portant un coupon nul (0 %), à un taux réel de – 0,1 %, pour un remboursement de 100 euros de capital à maturité l’État encaisserait 100,50 € à l’émission. Ce montant de 100,50 euros se décompose en 100 euros de capital et 0,50 € de prime à l’émission.
ii. Les offres non compétitives
À l’issue des adjudications, les SVT ont la possibilité de présenter des « offres non compétitives », servies au taux ou prix moyen pondéré de l’adjudication et qui s’élèvent au maximum à 25 % du montant total émis. Avant chaque séance d’adjudication un coefficient d’attribution des offres non compétitives est calculé pour chaque SVT en fonction de sa participation, par ligne, aux trois dernières séances d’adjudication compétitives portant sur des titres de même catégorie (la séance en cours n’étant pas incluse). Ce coefficient permet de déterminer le montant maximum que chacun d’entre eux est autorisé à demander au titre des offres non compétitives.
Ces offres non compétitives sont utilisées comme un moyen de récompense et de motivation des SVT, puisque la charte SVT prévoit que l’AFT peut retirer le droit de présenter des offres non compétitives à un SVT ayant omis de participer à une adjudication sans raison valable ou n’ayant pas respecté certains engagements prévus par la charte.
Selon l’AFT, elles permettent en outre à l’État d’émettre un montant supplémentaire de titres (25 %) dans un environnement de marché propice, sans peser en amont sur les conditions de l’adjudication. Ainsi, lorsque l’AFT émet 8 milliards d’euros d’OAT, les offres compétitives peuvent permettre d’émettre 2 milliards d’euros supplémentaires. Cette offre de titres est par définition bien absorbée par le marché, alors que l’annonce d’une émission de 10 milliards d’euros aurait eu un impact en termes de valorisation, en amont de l’adjudication, l’AFT n’ayant jamais annoncé une adjudication de taille aussi élevée.
En 2015, les offres non compétitives ont représenté 27,3 milliards d’euros, soit 12,4 % du montant total émis.
iii. Des émissions exceptionnelles par syndication
L’adjudication est le principal mode d’émission des valeurs du Trésor. Il reste cependant une part très marginale des émissions qui a lieu par syndication. Depuis la création de l’AFT, il y a quinze ans, douze émissions au total ont été réalisées par syndication. Sur les cinq dernières années, les émissions par syndication ont représenté 1,4 % du programme de financement en 2011, 2,3 % en 2013 et 1,7 % en 2014. Il n’y a eu d’émission par syndication ni en 2012, ni en 2015. En avril 2016, deux nouveaux emprunts d’État français de maturité vingt ans et cinquante ans ont été émis par syndication, à hauteur respectivement de 6 et 3 milliards d’euros.
La syndication est utilisée exceptionnellement pour l’émission d’un nouveau titre à long terme. La complexité des titres, notamment les OAT indexées à l’inflation, est un autre facteur pris en considération pour émettre par syndication.
Pour l’AFT, la syndication présente un certain nombre d’avantages :
– l’opération est réalisée très rapidement, au maximum 48 heures après l’annonce de l’opération, ce qui permet de profiter au mieux des conditions de marché ;
– les titres émis sont directement alloués aux investisseurs ce qui permet d’éviter les contraintes de taille de bilan et de risque qui peuvent peser sur les SVT ;
– le montant émis est supérieur à celui émis lors d’une adjudication ;
– les acheteurs sont identifiés et l’AFT détermine l’allocation entre les différents investisseurs. La demande pouvant être supérieure à la taille que l’AFT souhaite émettre, elle définit quel montant allouer à chaque investisseur, en prenant notamment en compte la qualité de l’investisseur, sa volonté de conserver le titre à long terme et son souhait de l’acheter contre un autre titre ou en numéraire.
Ainsi, pour les deux émissions réalisées par syndication le 12 avril 2016, l’AFT a été en mesure de publier des informations plus précises sur les investisseurs finaux qu’elle ne peut le faire lorsqu’elle recourt à une adjudication. Ces informations permettent de vérifier que le profil des investisseurs n’est pas le même selon la maturité du titre :
PROFIL DES INVESTISSEURS LORS DE L’ÉMISSION PAR SYNDICATION DU 12 AVRIL 2016
OAT 1,25 % 25 MAI 2036
|
|
OAT 1,75 % 25 MAI 2066
|
|
Source : Agence France Trésor.
L’exécution d’une émission par syndication diffère sensiblement d’une émission par adjudication. Après consultation des SVT sur l’opération, l’AFT choisit un syndicat bancaire. Si la charte SVT prévoit que tous les SVT font partie du syndicat, des chefs de file (généralement entre 4 et 6) sont désignés pour accompagner l’État dans le placement des titres auprès des investisseurs. Les chefs de file sont désignés en fonction de leur classement SVT, de leur part de marché sur les marchés primaire et secondaire et de leur qualité d’analyse sur la mise en œuvre optimale de l’opération. Un indicateur de rotation permet en outre d’éviter que les mandats soient attribués trop souvent aux mêmes banques.
Les émissions par syndication prennent la forme d’un contrat de prise ferme entre l’AFT et les banques du syndicat. Elles donnent lieu au versement de commissions aux banques du syndicat, dont les chefs de file se répartissent l’essentiel. Ces commissions rémunèrent à la fois l’appui commercial des banques pour vendre les titres aux investisseurs finaux et la prise ferme à laquelle les banques s’engagent en cas d’impossibilité de placer les titres auprès des investisseurs finaux.
À titre d’exemple, lors de l’opération du 12 avril, le mandat proposé aux banques était le suivant :
ÉMISSION DU 12 AVRIL 2016
OAT 20 ans |
OAT 50 ans | ||
Caractéristiques |
Maturité |
25 mai 2036 |
25 mai 2066 |
Coupon indicatif |
1 % |
1,75 % | |
Dénomination |
euros |
euros | |
Taille minimale |
3 milliards d’euros |
2 milliards d’euros | |
Syndicat |
Membres |
Tous les SVT | |
Chefs de file |
Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole, HSBC, Morgan Stanley et Société générale | ||
Commissions |
Niveau |
entre 0,15 % et 0,25 % |
entre 0,2 % et 0,3 % |
Répartition |
95 % chefs de file, 5 % autres membres | ||
Exécution |
Fenêtre |
Début de semaine du 11 avril 2016 | |
Source : Agence France Trésor.
Dans les documents budgétaires, les commissions de syndication sont incluses dans la ligne « Frais et commissions de gestion de la dette », qui comprend également d’autres dépenses, comme la rémunération d’Euroclear, le dépositaire central des titres émis par l’État. Elles n’apparaissent pas de manière distincte. Comme le montre le tableau suivant, ces frais fluctuent dans des proportions importantes d’une année sur l’autre, tout en restant modérés, en comparaison de la charge de la dette :
ÉVOLUTION DES FRAIS ET COMMISSIONS DE GESTION DE LA DETTE
(en millions d’euros)
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 (58) |
2013 |
2014 |
2015 (1) |
13 |
20 |
20 |
14 |
9 |
17 |
14 |
6 |
Source : Rapports annuels de performances de la mission Engagements financiers de l’État.
Proposition : Préciser dans les documents budgétaires de la mission Engagements financiers de l’État le montant des commissions de syndication.
d. Des titres échangés sur le marché secondaire, le marché de « l’occasion »
On distingue généralement, s’agissant du marché obligataire, le marché primaire, sur lequel de nouvelles obligations sont émises, et le marché secondaire sur lequel s’effectuent les transactions sur les obligations déjà émises. Après avoir été émis sur le marché primaire et achetés par les SVT, les titres de l’État sont revendus sur le marché secondaire, où il s’en échange pour plus de 10 milliards d’euros par jour (cf. infra). Un investisseur peut en effet conserver ses titres jusqu’à leur remboursement in fine, mais aussi les revendre avant le terme. La durée de détention des titres par les investisseurs qui ne les conservent pas jusqu’à leur terme peut varier de quelques jours à plusieurs mois.
Les marchés primaire et secondaire sont complémentaires. Comme les acheteurs d’obligations ne peuvent pas demander à l’émetteur la conversion du titre en monnaie avant l’échéance, le marché secondaire leur assure la possibilité de revendre leurs titres pour récupérer leur investissement quand ils le souhaitent. Le marché financier secondaire permet ainsi, notamment, de faire correspondre le besoin des émetteurs de se financer à long terme avec les préférences des investisseurs, qui peuvent avoir des besoins de placement à plus court terme.
Le bon fonctionnement du marché primaire repose donc sur une liquidité satisfaisante du marché secondaire.
Le jeu quotidien d’offre et de demande autour de la dette négociable sur le marché secondaire établit les taux de marché des différentes obligations, qui permettent d’évaluer les tensions sur le marché de la dette d’État et se répercutent sur les prix des titres à émettre.
L’évolution des taux sur les valeurs du Trésor sur le marché secondaire montre à la fois que ces titres offrent des rendements négatifs sur des maturités de plus en plus longues (jusqu’à six ans en mars 2016) et que la courbe des taux s’est aplatie, c’est-à-dire que l’écart de rendement entre les titres à court terme et les titres à long terme est moins élevé qu’auparavant.
ÉVOLUTION DE LA COURBE DES TAUX SUR LES TITRES D’ÉTAT FRANÇAIS
(valeur en fin de mois, en %)
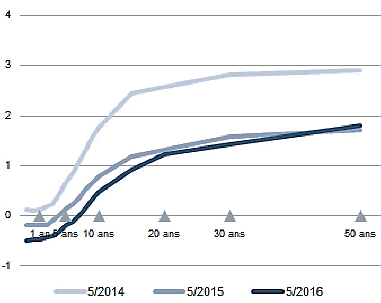
Source : Bloomberg.
Le marché secondaire est animé par les SVT, comme le prévoit la charte qu’ils ont signée avec l’AFT. Ils s’engagent à fournir des prix en permanence, sur l’ensemble des valeurs du Trésor, à l’achat et à la vente :
– aux investisseurs finaux qui souhaitent acheter ou vendre ces titres. Ces cotations peuvent se faire au travers de plateformes électroniques (Bloomberg, Tradeweb, Eurex Bonds) ou en réponse à une requête d’un client, en direct ou via un courtier ;
– aux autres SVT sur des plateformes dédiées.
Cette obligation permet d’assurer la liquidité des valeurs du Trésor. Un client qui souhaite acheter des titres ou solder une position est en mesure de trouver des prix compétitifs à tout moment.
Anticipant qu’ils vont peut-être devoir revendre leurs actifs dans le futur, les acheteurs sont plus intéressés par des actifs liquides (59). Une plus grande liquidité des titres permet donc aux États de pouvoir se financer à des taux plus faibles.
Dans une étude sur la liquidité des marchés obligataires français, l’Autorité des marchés financiers estime que « deux caractéristiques essentielles d’un actif liquide sont sa capacité à pouvoir être effectivement échangé et dans le même temps, le coût lié à cette exécution. La liquidité constitue un élément essentiel dans le fonctionnement des marchés en affectant les coûts de négociation supportés par les investisseurs qui se transmettent indirectement aux coûts de financement des émetteurs sur le marché primaire. » (60)
Pour l’économiste Natacha Valla, la liquidité de la dette française est un de ses atouts : « La dette française est très liquide, et le marché très profond. C’est un point essentiel, et l’une des responsabilités de l’État dans sa gestion de la dette publique est de préserver ces caractéristiques : elles sont très appréciées des investisseurs, ce qui nous apporte une stabilité financière essentielle qui est même, de mon point de vue, de l’ordre du bien public. » (61)
Si, au quotidien, la liquidité du marché secondaire est assurée par les SVT, l’AFT s’efforce d’y contribuer par sa politique d’émission, en particulier en veillant à ce que les titres de référence atteignent rapidement un encours critique (62), en abondant régulièrement les titres créés et en étant attentive aux besoins du marché afin d’émettre les titres demandés par les investisseurs.
L’AFT a ainsi dû agir pour pallier les conséquences du programme d’achats de titres publics de l’Eurosystème sur la liquidité du marché. Les achats réguliers de titres entre les maturités deux à trente ans ont rendu nécessaire le réabondement régulier des souches anciennement émises (off-the-run) afin de maintenir la meilleure liquidité possible sur l’ensemble des OAT. La proportion des émissions off-the-run par rapport aux émissions totales (33,3 %) a connu son plus haut niveau depuis 2011 (63).
Certains s’interrogent sur les conséquences des achats de l’Eurosystème sur la liquidité du marché secondaire. Pour Mme Natacha Valla, « des pays comme l’Autriche ou l’Allemagne dont les émissions nettes sont moins importantes que les nôtres, peuvent voir se produire un phénomène de raréfaction de leurs titres de dette sur le marché : la demande est forte, mais l’offre très limitée – d’autant qu’il y a une forte rétention de titres. Il y a donc un assèchement de la liquidité, provoqué en partie par les achats massifs de la BCE. Ce n’est pas le cas de la France, en tout cas pas encore. »
M. Raphaël Gallardo, stratégiste du pôle Investissement et solutions clients de Natixis Asset Management, pointe un risque de contradiction dans l’action des banques centrales : « en Allemagne comme au Japon, les achats massifs de l’institut monétaire ont fortement dégradé la liquidité du marché secondaire. En cas de rehaussement des programmes de quantitative easing, la liquidité se réduirait encore plus, au point ultime de faire apparaître des primes de liquidité substantielles sur les souches les moins échangées. Là aussi, on aboutit à une contradiction : plus la banque centrale achète des titres pour faire baisser leur rendement, plus elle détériore la liquidité du marché, plus elle fait monter les rendements de ces titres par apparition d’une prime de liquidité. » (64)
Les instruments de couverture des risques
Les deux principaux instruments de couverture des risques sur titres d’État sont les contrats à terme (futures contract) et les swaps de risque de crédit (credit default swap).
Ø Un contrat à terme est un engagement ferme de livraison d’un titre, à une date future et à un prix déterminé à l’avance, échangé selon des modalités standardisées sur un marché organisé. Il existe un contrat à terme sur la dette d’État française, portant engagement de livrer une OAT de maturité dix ans.
Les contrats à terme peuvent permettre d’investir avec un effet de levier. Selon l’AFT, il s’agit néanmoins, au premier chef, d’un instrument de couverture liquide qui permet aux spécialistes en valeurs du Trésor, notamment, de couvrir leur position sur les OAT qu’ils distribuent sur le marché secondaire, sans recherche d’effet de levier.
Environ 70 000 lots de contrats futurs sur OAT sont échangés chaque jour sur Eurex, chaque lot représentant une valeur nominale de 100 000 euros, soit un équivalent de 7 milliards d’euros d’obligations. Le volume quotidien échangé sur le Bund, l’obligation allemande de référence, est environ dix fois plus important.
Ø Un swap de risque de crédit (CDS) est une couverture contre le défaut d’un émetteur. La contrepartie qui achète une protection sur une période donnée paie périodiquement une prime d’assurance. La contrepartie qui vend la protection indemnise l’assuré en cas de défaut de l’émetteur à hauteur d’une valeur de recouvrement, qui est un pourcentage du nominal du swap déterminé dès la conclusion du contrat. Comme les contrats futurs, les CDS permettent de prendre des positions à la hausse ou à la baisse sur la valeur d’un titre d’État, en générant de l’effet de levier. La réglementation européenne a encadré la possibilité de vendre des CDS à découvert : la vente à nue de CDS souverains, c’est-à-dire la vente de CDS sans détenir d’obligations de l’émetteur sous-jacent en contrepartie, est interdite dans l’Union européenne depuis le 1er novembre 2012.
Source : Agence France Trésor.
3. La politique d’émission en période de taux bas : les questions de l’allongement de la durée de la dette et du réabondement des souches anciennes
Le caractère exceptionnel de la période actuelle, caractérisée par la politique monétaire non conventionnelle de la BCE et par des taux d’intérêt très faibles, a conduit la mission à s’interroger sur d’éventuelles adaptations de la politique d’émission de l’AFT à ce contexte. Deux questions en particulier peuvent se poser : faut-il allonger la durée moyenne de la dette pour sécuriser une plus grande partie de la dette aux taux actuels ? Pourquoi émettre des titres à partir de souches anciennes, porteuses d’un coupon beaucoup plus élevé que les taux de marché ?
a. Peut-on allonger la durée moyenne de la dette pour sécuriser une plus grande partie de la dette aux taux actuels ?
Dans le contexte actuel de taux très bas, il peut paraître opportun, dans l’intérêt du contribuable, de s’endetter à plus long terme pour profiter des taux bas et se prémunir contre une hausse des taux ultérieure.
Ce débat, alimenté par certains économistes, a eu lieu devant le comité stratégique de l’AFT. C’est une question que se posent tous les émetteurs. Ainsi, certains pays européens – l’Irlande en mars et la Belgique en avril – ont récemment émis des obligations, pour des montants certes très limités, à cent ans, alors que la maturité maximale des titres émis par la France est de cinquante ans.
Pour MM. Jean-Hervé Lorenzi et Pierre-Xavier Prietto (65), du Cercle des économistes, l’allongement de la durée de la dette restreindrait « de manière très sensible l’angoisse liée aux émissions répétitives d’emprunts importants, à l’incertitude sur les taux d’intérêt auxquels elles auront lieu, et au risque de subir une brutale hausse du coût de la dette en cas de hausse des taux d’intérêt. Il s’agit de modifier totalement l’approche actuelle de la gestion de la dette, sans pour autant remettre en cause la réduction des déficits publics. »
L’AFT considère quant-à-elle qu’elle ne peut pas se permettre d’être trop « opportuniste », mot employé à la fois par M. Antony Requin et par M. Jacques de Larosière lors de leurs auditions, et qui correspond à une ligne de conduite ancienne de l’AFT, déjà explicitée par M. Benoît Cœuré, alors directeur général adjoint de l’AFT, en 2005 (66). Pour M. Requin, « la taille de la dette nous impose de revenir régulièrement sur le marché. Nous ne pouvons donc pas nous permettre d’être excessivement opportunistes, c’est-à-dire de surprendre le marché par de brusques à-coups dans notre politique d’émission : cela ne ferait que rendre les taux volatils. » (67)
Elle ne renégocie pas de larges stocks de dette (33 milliards d’euros de rachats ont été effectués en 2015), mais refinance les tombées de dette en profitant des conditions actuelles. 116,4 milliards d’euros ont ainsi été refinancés en 2015 et 125 milliards le seront en 2016.
Outre la volonté de ne pas « brusquer » le marché, M. Requin a justifié la stratégie, que l’on peut qualifier de prudente, de l’AFT en matière de rachats par le problème de la « profondeur de marché », c’est-à-dire la capacité du marché à absorber des volumes importants.
Tous les investisseurs ne sont pas intéressés par tous les points de la courbe, c’est-à-dire pour prêter à toutes les maturités : « très peu d’investisseurs sont intéressés par des titres à trente ou cinquante ans, hormis quelques entités de gestion alternative – les hedge funds – et des fonds de pensions. Ces derniers sont les seuls vrais investisseurs de long terme : les fonds de gestion alternative achètent et vendent souvent, pour essayer de faire des profits. […] Nous ne pouvons pas forcer le marché à absorber des titres dont il ne voudrait pas. » Par exemple, au cours de la première partie de l’année 2015, pendant laquelle les taux étaient très bas, les investisseurs ne voulaient pas acheter les titres français à moyen et long terme à taux très faible ou négatif. La demande ne s’est reformée qu’après le double mouvement de hausse des taux intervenu en avril et en mai. En cas de surcroît d’émission de dette à long terme, l’absence de demande aurait provoqué un envol des taux.
Cette analyse a été confortée par M. Raoul Salomon, responsable des activités de marché pour Barclays en France : « Un ex-ministre a eu l’idée de faire passer la maturité de la dette française de sept à quinze ans, comme au Royaume-Uni. Tous les SVT se sont tournés vers l’AFT en lui faisant savoir que c’était certainement une bonne idée, mais qu’il n’y avait pas de demande, et que la dette serait vendue à un prix insensé. Le rôle de l’AFT est de veiller à tout cela. »
SEGMENTATION DE LA DEMANDE DE TITRES DE L’ÉTAT
Taux d’intérêt (en %)
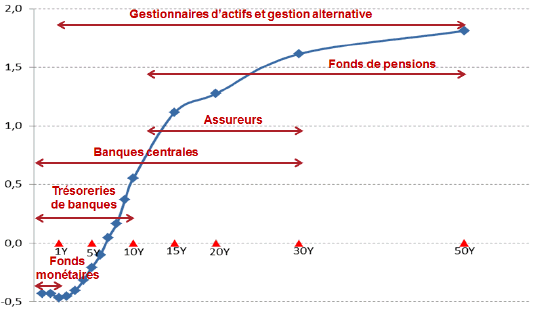
Maturité (en années)
Source : Agence France Trésor.
C’est pour cette raison que l’AFT estime qu’elle ne peut pas émettre des quantités trop importantes au-delà de trente ans. De manière progressive, la durée de la dette a toutefois été allongée en 2015.
DURÉE DE VIE MOYENNE DE LA DETTE NÉGOCIABLE DE L’ÉTAT DEPUIS FIN 2012
Fin 2012 |
Fin 2013 |
Fin 2014 |
Fin 2015 |
Fin avril 2016 |
7 ans 34 jours |
7 ans 2 jours |
6 ans 362 jours |
7 ans 47 jours |
7 ans et 108 jours |
Source : Agence France Trésor.
Si l’effet sur la durée de vie moyenne est modeste, l’augmentation de la maturité moyenne à l’émission est continue depuis 2011, passant de huit ans en 2011 à 9,4 années en 2015. Cette tendance devrait se poursuivre en 2016. La France a par exemple émis le 11 avril dernier deux nouvelles obligations à vingt ans (6 milliards d’euros à un taux de 1,3 %) et cinquante ans (3 milliards d’euros à un taux de 1,9 %). Le dernier emprunt à 50 ans avait été émis en 2010 à un taux de 4,18 %.
MATURITÉ MOYENNE À L’ÉMISSION
(en années)
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
8 |
8,1 |
8,6 |
8,9 |
9,4 |
Source : Agence France Trésor.
Par rapport aux principaux émetteurs comparables, la durée de vie de la dette française se situait, au 31 décembre 2014, plutôt dans le haut de la fourchette.
DURÉE DE VIE MOYENNE DE LA DETTE AU 31 DÉCEMBRE 2014
(en années)
Royaume-Uni |
Belgique |
France |
Allemagne |
Italie |
Espagne |
États-Unis |
14,9 |
7,6 |
7 |
6,4 |
6,4 |
6,3 |
5,7 |
Source : Agence France Trésor.
Pour mettre en œuvre une stratégie plus « offensive », se pose en outre le problème du coût de rachat des dettes anciennes.
Les arrêtés de création des valeurs du Trésor précisent en effet explicitement que « l’État s’interdit de procéder pendant toute la durée de l’emprunt à l’amortissement par remboursement anticipé des obligations, mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges » (68). Selon les explications fournies par l’AFT, de telles clauses sont prévues par la plupart des États émetteurs. Les investisseurs exigeraient des rendements plus élevés à l’émission si les remboursements anticipés étaient autorisés. Dans le contexte actuel, les avantages d’une possibilité de remboursement anticipé seraient cependant réels en termes de réactivité et d’adaptation aux conditions du marché. Les coûts et avantages de l’introduction de clauses de remboursement anticipé mériteraient par conséquent d’être réévalués.
Proposition : Étudier les coûts et avantages de l’introduction de clauses de remboursement anticipé dans les obligations émises par l’État.
Avec les règles en vigueur, l’AFT ne pourrait refinancer la dette ancienne aux conditions actuelles, plus avantageuses, qu’en procédant à des rachats au prix du marché. Pour M. Anthony Requin, « si nous devions racheter d’énormes quantités de dette émise précédemment, nous le ferions au cours de ces dettes au jour du rachat. Il n’y aurait donc pas de gain important : certes, nous pourrions racheter de la dette pour ré-émettre à taux bas, mais nous rachèterions cette dette à un prix beaucoup plus élevé. En taux actuariel, ce serait neutre. » L’AFT devrait en effet trouver des vendeurs qui acceptent de se séparer de titres de dettes anciens, porteurs de coupons élevés, alors même que ceux-ci gagnent en rentabilité dans le contexte actuel.
De fait, l’AFT ne procède à des rachats qu’en quantités limitées, pour préfinancer les programmes d’émission des deux années à venir, et ainsi lisser les montants à émettre au cours du temps. À titre d’exemple, en 2015, l’AFT a reçu l’autorisation d’émettre 187 milliards d’euros de dette, nette des rachats, et a effectué des émissions brutes pour 220 milliards d’euros. Les rachats se sont limités à 33 milliards d’euros, et ce sera également le cas en 2016 d’après les projections. Ces lissages contribuent à l’allongement de la durée moyenne de la dette en remplaçant des titres de maturité résiduelle d’un ou deux ans par des titres longs.
Dans son rapport spécial sur le projet de loi de finances pour 2016, notre collègue Victorin Lurel a récapitulé le montant des rachats réalisés depuis 2007. Ils ont fortement augmenté en 2014 et 2015 du fait de l’arrivée à échéance d’une partie des émissions, importantes, réalisées pendant la crise financière de 2008 et la crise des dettes souveraines de 2009.
MONTANT DES RACHATS DE TITRES DE MATURITÉS N, N+1 ET N+2 RÉALISÉS DEPUIS 2007
(en milliards d’euros)
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
10 |
23 |
14 |
26 |
25 |
26 |
24 |
31 |
33 |
Source : Agence France Trésor.
Cette situation, où la France s’interdit de profiter des opportunités que le contexte permettrait pour diminuer la charge de la dette, illustre la dépendance aux marchés qu’entraînent le niveau de notre dette et le choix d’un mode de financement par l’émission d’obligations sur les marchés.
Sans remettre en cause le bien-fondé des arguments invoqués par l’AFT, les rapporteurs s’interrogent sur la possibilité de profiter davantage des taux actuels. La demande lors des adjudications étant toujours très supérieure au montant adjugé, n’y aurait-il pas des possibilités de se montrer un peu plus opportuniste vis-à-vis des marchés financiers pour diminuer la charge d’intérêt payée par le contribuable ?
Proposition : Profiter davantage des opportunités de marché pour réduire la charge de la dette sur le long terme.
b. Pourquoi émettre des titres portant un coupon supérieur aux taux du marché ?
Le 4 mai 2016, l’AFT a procédé à l’adjudication de 1,85 milliard d’euros d’OAT 6,00 % 25 octobre 2025, pour un taux moyen pondéré de 0,39 %.
Les rapporteurs ont interrogé l’AFT sur les raisons qui la conduisaient à émettre des OAT portant des coupons si élevés (6 %), tout en sachant que le taux obtenu par l’État serait beaucoup plus faible (0,39 %). Il paraîtrait de prime abord plus logique d’émettre des titres portant des coupons plus proches des prix du marché.
C’est ainsi que l’État procède lorsqu’il émet une nouvelle obligation. Mais pour assurer la liquidité du marché secondaire – dont l’importance a déjà été soulignée – l’AFT émet, selon le principe de l’assimilation, des obligations dont les caractéristiques sont identiques à des obligations plus anciennes, c’est-à-dire, dans le contexte actuel, portant un coupon plus élevé. Ce principe permet d’éviter la multiplication des lignes d’obligations et d’augmenter le montant de chacune d’entre elles. Leur promotion en est facilitée et il est plus aisé pour les acteurs du marché secondaire de trouver un vendeur ou un acheteur dès qu’ils le souhaitent.
Comme M. Raoul Briet, président de la première chambre de la Cour des comptes, l’a souligné devant la commission des finances le 25 mai dernier, cette stratégie d’émissions à partir de souches anciennes n’est ni propre à la France (l’Espagne et le Royaume-Uni, par exemple, suivent la même politique), ni nouvelle. Les émissions à partir de souches anciennes sont pratiquées depuis septembre 2007 et ont été systématisées en 2008.
Selon les explications de l’AFT, la nécessité de réabonder les souches anciennes a été renforcée par le volume important des achats réalisés par l’Eurosystème dans le cadre du programme d’assouplissement quantitatif de la BCE. Ces achats ont réduit la liquidité du marché sur certains titres, ce qui a entraîné une forte demande des investisseurs, répercutée auprès de l’AFT par les SVT. Elle estime que, si elle n’avait pas répondu à cette demande, le déséquilibre entre l’offre et la demande aurait conduit à des taux à l’émission plus élevés.
Le tableau suivant montre que si la proportion de titres émis à partir de souches anciennes a été plus élevée en 2015 (33,9 %) que les deux années précédentes, elle n’est pas atypique au regard des proportions observées depuis 2008. Elle est inférieure à celles de 2009 et 2011, et très proche de celles de 2010 et 2012.
PROPORTION DES ÉMISSIONS DE TITRES À PARTIR DE SOUCHES ANCIENNES
Années |
Volume émis (en milliards d’euros) |
Proportion des émissions de l’année | ||
Titres de référence |
Titres anciens |
Titres de référence |
Titres anciens | |
2008 |
88,3 |
30,8 |
74,1 % |
25,9 % |
2009 |
102,3 |
64 |
61,5 % |
38,5 % |
2010 |
127,8 |
62,5 |
67,2 % |
32,8 % |
2011 |
111,6 |
76,1 |
59,5 % |
40,5 % |
2012 |
124,2 |
60,2 |
67,3 % |
32,7 % |
2013 |
127 |
48,2 |
72,5 % |
27,5 % |
2014 |
137,2 |
48,1 |
74 % |
26 % |
2015 |
133,6 |
68,6 |
66,1 % |
33,9 % |
Source : AFT.
En conséquence de la baisse des taux d’intérêts, l’écart entre les coupons portés par les anciennes souches et les taux de marché est en revanche beaucoup plus important que par le passé, ce qui a eu pour conséquence de permettre à l’État de recevoir en trésorerie, en 2015, un montant record de primes à l’émission (22,7 milliards d’euros) lors des réémissions de titres créés avant la baisse des taux. En particulier, les taux négatifs conduisent nécessairement à l’encaissement de primes d’émission, puisqu’aucune OAT n’a de coupon négatif.
PRIMES À L’ÉMISSION NETTES DES DÉCOTES
(en milliards d’euros)
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
– 2,3 |
4,4 |
8,2 |
2,5 |
9,2 |
6 |
7,4 |
22,7 |
Source : Cour des comptes, d’après les rapports d’activité de l’AFT.
Les primes à l’émission encaissées en 2015 ont représenté environ un point de PIB pour la France, un niveau comparable à ce qui a été observé au Royaume-Uni (0,9 %), en Espagne (1,2 %) ou en Belgique (1 %).
Ces ressources de trésorerie expliquent la déconnexion partielle, constatée par la Cour des comptes, entre l’évolution du déficit de l’État et celle de sa dette. Elles ont notamment été utilisées pour racheter des BTF, contribuant ainsi à réduire l’encours de la dette à court terme, plus sensible au risque de taux que la dette à moyen et long terme.
Il faut souligner que l’émission de souches anciennes avec des coupons élevés n’entraîne pas de surcoût pour l’État par rapport à une nouvelle obligation avec un coupon plus proche des taux de marché, mais que les flux de trésorerie sont différents.
Le 5 février 2015, l’État a procédé à une émission à 10 ans en recourant le même jour à deux souches différentes :
– une nouvelle émission de référence à 10 ans dont il a fixé le coupon à 0,5 % ;
– une souche ancienne à 31 ans émise pour la première fois en 1994 avec un coupon de 6 %.
Les taux d’intérêt obtenus sur les deux souches ont été voisins, respectivement de 0,61 % et 0,62 %.
Les flux de trésorerie correspondant à la charge de la dette sont cependant très différents. Pour un milliard d’euros émis :
– dans le premier cas, l’État paie une décote de 11 millions d’euros tout de suite et versera chaque année un coupon de 5 millions d’euros pendant 10 ans (coût de 61 millions d’euros pour un taux de 0,61 %) ;
– dans le second cas, l’État reçoit une prime de 538 millions d’euros tout de suite et versera chaque année un coupon de 60 millions d’euros pendant 10 ans (coût de 62 millions d’euros pour un taux de 0,62 %).
Source : Cour des comptes, Le budget de l’État en 2015, mai 2016.
Dans un cas, l’État paie une décote puis des coupons faibles, dans l’autre, il reçoit une prime puis paie des coupons plus élevés. In fine, le coût pour l’État est comparable, mais dans le deuxième cas l’obtention de ressources de trésorerie au moment de l’émission s’accompagne d’une charge de la dette plus élevée les années suivantes en comptabilité budgétaire (69).
Le traitement comptable des primes à l’émission et des décotes
En comptabilité budgétaire, les primes et les décotes sont considérées lors de l’émission des titres comme des ressources ou des charges de trésorerie. Elles ont pour effet d’accroître les ressources ou le besoin de financement de l’État l’année de l’émission.
Les intérêts servis pendant la durée de vie des titres sont comptabilisés comme charges budgétaires. Celles-ci seront intégrées à la charge de la dette de l’État pour les exercices considérés.
Ainsi, les émissions de titres à partir de souches anciennes ont deux effets du point de vue budgétaire :
– un effet positif l’année d’émission, avec une ressource de trésorerie (prime à l’émission) ;
– un effet négatif les années suivantes, avec des charges accrues dues à un taux d’intérêt servi plus élevé que les niveaux de marché.
En comptabilité générale, les primes ou décotes font l’objet d’un étalement sur la durée de vie des titres venant, selon le cas, alléger ou alourdir les charges faciales. Ainsi, un titre portant un taux d’intérêt facial de 3 % et émis au taux actuariel de 1 % sera valorisé à 1 % en comptabilité générale. En d’autres termes, l’effet des primes à l’émission et des décotes est neutre sur la charge de la dette en comptabilité générale et en comptabilité nationale (dette « maastrichtienne »).
Source : Rapport de la rapporteure générale sur le projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2015.
Selon la Cour des comptes, la déconnexion partielle entre l’évolution du déficit et celle de la dette permise par le niveau élevé des primes d’émission n’est que temporaire. Elle souligne que, dans les années à venir, le versement de coupons plus élevés créera un besoin de financement accru et que la dette retrouvera progressivement le niveau qu’elle aurait atteint dans l’hypothèse théorique où seules des souches nouvelles auraient été utilisées.
Dans leur réponse à la Cour, le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d’État au budget estiment cette comparaison peu opportune. Selon eux, « une situation dans laquelle les primes à l’émission nettes seraient nulles est peu réaliste dans l’absolu. S’agissant spécifiquement de 2015, elle aurait été impossible à atteindre, sauf à s’interdire d’émettre tout titre à taux négatif. Ceci aurait été préjudiciable à l’État, qui aurait payé des taux d’intérêt plus élevés. »
Pour les rapporteurs, au premier abord surpris par l’émission de titres portant des coupons très supérieurs aux taux de marché, le recours par l’AFT à l’émission de titres issus de souches anciennes – dont la Cour des comptes ne conteste d’ailleurs pas le bien-fondé – reste opportun en ce qu’il permet, en préservant la liquidité du marché secondaire, de maintenir une demande élevée et des taux réduits lors des adjudications.
Les flux de trésorerie qui en découlent pourraient en outre s’avérer intéressants pour l’État, dans certaines circonstances, dans la mesure où les intérêts sont fixes sur toute la durée de vie du titre, alors que la richesse du pays augmente. Leur poids en proportion du PIB est donc de moins en moins élevé.
Cette politique doit cependant être mise en œuvre avec le seul souci d’obtenir des financements au meilleur coût pour l’État, et non d’afficher une baisse – ou une moindre augmentation – artificielle et à court terme de l’encours de la dette de l’État.
III. QUI POSSÈDE LA DETTE ? UNE QUESTION SANS RÉPONSE
A. LA CONNAISSANCE DES DÉTENTEURS DE LA DETTE DE L’ÉTAT EST INSUFFISANTE
1. Une connaissance fragmentaire reconstituée à partir de différentes sources
L’Agence France Trésor met de nombreuses informations à la disposition des investisseurs et du public, à travers les documents budgétaires (mission Engagements financiers de l’État, compte de commerce Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État), son site internet, ses bulletins mensuels et son rapport d’activité : publication du programme indicatif de financement de l’État pour l’année à venir, calendrier et résultat des adjudications, encours détaillé de la dette négociable, durée de vie moyenne de la dette, récapitulatif mensuel des opérations réalisées par elle, etc. Le projet annuel de performances de la mission Engagements financiers de l’État fournit en outre une simulation des conséquences sur la charge de la dette d’un choc de taux et de l’évolution de l’inflation. La richesse et le détail de ces informations contrastent avec les éléments disponibles sur la détention de la dette de l’État, qui ne sont présentés que sous la forme de grandes masses : distinction entre résidents et non-résidents et, pour les premiers seulement, par grands types de détenteurs (banques, assurances, OPCVM, autres). Les rapporteurs ne peuvent que condamner ce manque de transparence : s’il peut exister des difficultés pour identifier certains investisseurs (cf. infra), il est difficile de croire que l’AFT n’est pas en mesure de savoir précisément quelle proportion de la dette est détenue, par exemple, par la banque centrale.
L’AFT indique ne pas disposer d’une connaissance précise et exhaustive de sa base d’investisseurs et les quelques éléments d’information qu’elle fournit ne sont que des estimations. Elles proviennent de quelques données qualifiées de « dures » par son directeur général – essentiellement les statistiques de la balance des paiements produites par la Banque de France –, et d’autres plus « molles » – les remontées des spécialistes en valeurs du Trésor. Encore les données qualifiées de « dures » comportent-elles des biais : par exemple, parmi les non-résidents figurent des résidents français qui détiennent des comptes à l’étranger (70).
Les statistiques produites par la Banque de France proviennent d’une collecte auprès des établissements teneurs de compte-titres, qui déclarent d’une part leurs détentions pour compte propre de titres financiers, et d’autre part les détentions de leur clientèle, agrégées par secteur statistique. Ces informations sont complétées par les échanges d’informations au sein de l’Eurosystème prévues par le règlement de la BCE sur les statistiques de détention de titre (71).
Ces statistiques fournissent une répartition de la détention de la dette négociable de l’État entre, d’une part, non-résidents et résidents et, d’autre part, pour les résidents seulement, entre quatre grands secteurs statistiques (assurances, établissements de crédit, OPCVM et autres). Pour les non-résidents, elles ne fournissent aucune information sur la répartition par secteur statistique ni par zone géographique. Les statistiques de la Banque de France sont les seules à être officiellement communiquées. Elles sont publiées chaque mois dans le bulletin mensuel de l’Agence France Trésor et mises à disposition sur son site internet.
Pour affiner sa connaissance du marché et comprendre les grands mouvements qui peuvent se produire, l’AFT croise ces informations avec d’autres sources, comme le Coordinated Portfolio Investment Survey, un sondage effectué régulièrement par le Fonds monétaire international (FMI) auprès des investisseurs afin de déterminer la nationalité de ceux qui détiennent des titres financiers. Cette enquête porte sur un périmètre qui est plus large que celui de la seule dette de l’État, puisqu’elle inclut à la fois les dettes publiques et privées. Il faut faire l’hypothèse qu’il n’y a pas de forte différence de proportions entre la détention de dette publique et de dette privée pour extrapoler les résultats de cette enquête à la structure de la détention de la dette de l’État. Il ne s’agit en outre que d’un sondage, dont il faut relativiser la précision.
Enfin, l’AFT dispose de données qualifiées de plus « molles » par son directeur général lors de son audition. Ces informations proviennent des spécialistes en valeurs du Trésor ; elles donnent des informations utiles sur les tendances du marché. En vertu d’une règle de reporting commune aux États membre de la zone euro, les SVT ont en effet l’obligation de communiquer leurs opérations d’achat et de vente, par type de maturité et par groupe de pays, que ces opérations aient lieu entre SVT ou avec des investisseurs finaux. Les gestionnaires de la dette des pays européens ont mis en place avec l’Association for Financial Markets in Europe (AFME) un reporting harmonisé pour faciliter le travail des banques et améliorer l’information des gestionnaires de dette sur les achats et ventes de titres de dette de l’État. Ce rapport est établi sur la base d’un document harmonisé d’activité sur les marchés secondaires de dette européens établi par le sous-comité des emprunts d’État du Comité économique et financier de l’Union européenne. Les informations y figurant sont couvertes par un accord de confidentialité.
Pour les pays de l’OCDE à l’exception du Japon, ce reporting permet de connaître chaque mois les types d’acheteurs (assureurs, trésoreries de banques, asset managers, gestion alternative…) et leur localisation géographique, parmi quinze grandes zones.
Les rapports des SVT ont trois grandes limites.
Premièrement, il ne s’agit que de données de flux portant sur les achats et les ventes réalisés par les SVT et non de données de stock.
Deuxièmement, ils ne couvrent que les achats ou ventes dont les SVT sont une des contreparties (80 à 90 % du volume total échangé selon l’AFT). De ce fait, l’AFT n’a pas non plus d’informations sur le désinvestissement que constitue l’arrivée à échéance de titres détenus par les investisseurs : attendre le remboursement d’une obligation sans réinvestir le montant remboursé est équivalent à un flux vendeur, mais ne fait pas l’objet d’une transaction avec un SVT.
Troisièmement, ainsi que M. Raoul Salomon l’a exposé à la mission (72), ces données sont présentées de manière agrégée pour préserver la discrétion des investisseurs : « tous les SVT fournissent tous les mois au Trésor des statistiques harmonisées de flux, indiquant par pays et par type d’investisseur ceux avec qui nous avons traité. Une des entrées est « banque centrale », et comme il n’y en a qu’une par pays, on peut évidemment voir ce que fait l’investisseur. Un certain nombre de banques centrales nous ont fait savoir qu’elles n’appréciaient pas que nous fournissions autant de détails, elles n’avaient pas envie que tous leurs investissements soient rendus publics de la sorte. Elles nous ont donc demandé de présenter les données en additionnant plusieurs pays, de façon à ce que les flux ne soient pas visibles par tout le monde.
« Il ne faut pas sous-estimer le fait que certains n’ont pas envie de faire savoir quand ils achètent ou vendent. Ceci ajouté au fait que les investisseurs sont obligés d’avoir des dépositaires hors de leurs frontières, cela rend la collecte de ces données extrêmement compliquée. »
2. Une dette majoritairement détenue à l’étranger
D’après les statistiques fournies par la Banque de France, à la fin de l’année 2015, la dette négociable de l’État était détenue à 61,9 % par des non-résidents. Parmi les résidents, les principaux investisseurs étaient les assurances (18,9 %) et les établissements de crédit (9,1 %).
DÉTENTION DES TITRES DE LA DETTE NÉGOCIABLE DE L’ÉTAT AU 4E TRIMESTRE 2015
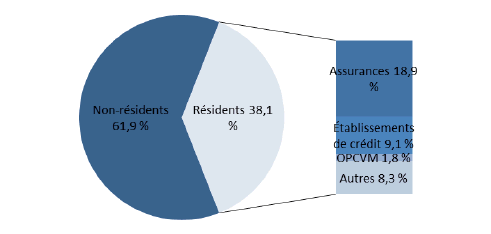
Source : Banque de France.
Selon les informations fournies par M. Denis Beau, directeur général des opérations de la Banque de France lors de son audition (73), au 3e trimestre 2015, la part de la dette détenue directement par les ménages français était marginale (moins de 0,01 % du total). C’est sous forme intermédiée, via l’assurance-vie ou les OPCVM, que les ménages français détiennent une partie de la dette de l’État. La simplicité et la fiscalité de l’assurance-vie les conduisent, en effet, à préférer l’intermédiation à la détention directe (74).
Il existe certes un marché des OAT aux particuliers. Ceux-ci peuvent acquérir des titres d’État via Euronext, les SVT étant obligés de leur proposer des cotations. Mais en raison de la faiblesse des taux, ce placement n’est plus intéressant, même dans un contexte de baisse généralisée de la rémunération des autres placements « liquides » comme le livret A ou le plan épargne logement (PEL). Le volume annuel des échanges sur le marché des OAT aux particuliers est passé de 2,8 milliards d’euros en 2006 à 51 millions d’euros en 2015.
Ce phénomène n’est pas propre à la France, puisque, en Allemagne, la vente directe aux investisseurs privés a été suspendue à la fin de l’année 2012.
Comme le montrent les chiffres publiés par Eurostat en juin 2015 (75), du point de vue de la détention de la dette publique par les non-résidents, la situation de la France n’est pas atypique au sein de l’Union européenne. Si des différences importantes peuvent être observées, la position de la France est médiane et très proche de celle de l’Allemagne.
PART DE LA DÉTENTION DE LA DETTE PUBLIQUE PAR DES NON-RÉSIDENTS
EN 2014 DANS L’UNION EUROPÉENNE (76)
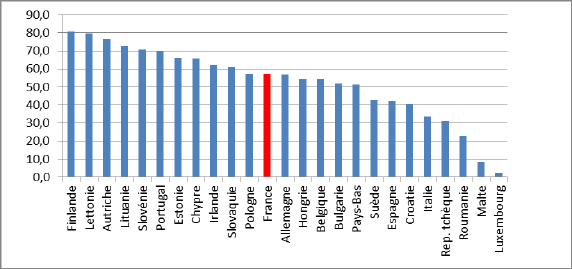
Source : Eurostat.
Il convient de préciser que les chiffres d’Eurostat portent sur la dette publique dans son ensemble. La dette de l’État, plus liquide et bénéficiant d’un crédit plus élevé, attire plus les grands investisseurs internationaux. La proportion détenue par les non-résidents est donc plus élevée que pour la dette publique prise dans son ensemble.
L’augmentation de la part des non-résidents dans la détention de la dette de l’État est très sensible depuis la fin des années 1990. Elle est à la fois le produit d’une politique de diversification de la base d’investisseurs suivie avec constance par la direction du Trésor puis par l’AFT, et une conséquence directe de la création de l’euro, qui a donné naissance à un marché européen unifié. Comme le montre le graphique suivant, présenté par le directeur général de l’AFT lors de son audition, la détention de la dette de l’État par les non-résidents a fortement augmenté dans un premier temps du fait d’une diversification au sein de la zone euro, puis d’une internationalisation hors zone euro, avant de se stabiliser autour de 63 %.
DÉTENTION DE LA DETTE DE L’ÉTAT PAR LES NON-RÉSIDENTS
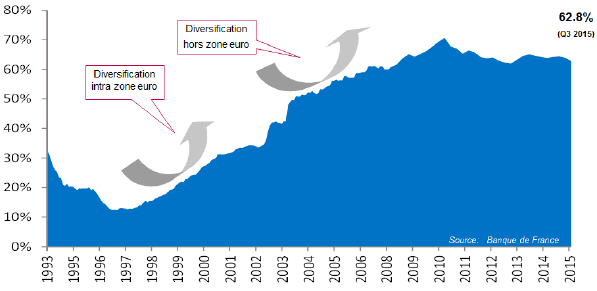
La mise en place par la BCE d’un programme d’achats de titres publics dans le cadre de ses mesures non conventionnelles de politique monétaire a eu pour conséquence de faire baisser la part des non-résidents dans la détention de la dette de l’État (de 64,4 % en mars 2015 à 61,9 % à la fin décembre 2015), les achats de titres français étant principalement réalisés par la Banque de France pour le compte de l’Eurosystème. En outre, parmi les non-résidents, figure la BCE, qui achète également des titres d’État français.
À l’issue de ses auditions, la mission n’a pas pu établir une photographie précise de la détention de la dette de l’État, mais a pu obtenir quelques informations supplémentaires tirées par l’AFT du sondage Coordinated Portfolio Investment Survey conduit par le FMI et des données de flux fournies par les SVT.
Si l’on fait l’hypothèse que la structure de la détention de la dette de l’État ne diffère pas significativement de la structure de la détention de l’ensemble de la dette extérieure de la France, on peut déduire du sondage du FMI que la moitié des investisseurs non-résidents se situent en zone euro. La dette de l’État serait ainsi répartie entre environ un tiers d’investisseurs résidents, un tiers d’investisseurs en zone euro et un tiers d’investisseurs hors zone euro. Pour M. Antony Requin, directeur général de l’AFT, « l’euro étant notre monnaie, on peut considérer que nous avons deux tiers d’investisseurs résidents dans notre propre zone ».
Pour ce qui concerne les investisseurs hors zone euro, l’AFT estime qu’ils se situeraient principalement en Europe hors zone euro (Royaume-Uni, Russie, Suisse et pays scandinaves), au Moyen-Orient et en Asie, et sans doute plus marginalement en Amérique. L’AFT estime que l’Asie et le Moyen-Orient représentent 10 à 20 % des achats annuels de dette française, dont une bonne part est réalisée par des banques centrales et des fonds souverains. Les investisseurs japonais sont plus divers : outre la banque centrale, on retrouverait les banques commerciales, les fonds de pension et les assureurs.
Des données de flux fournies par les SVT, l’AFT déduit que par le passé, environ la moitié des flux de dette française étaient absorbés par les banques centrales et les entités du secteur public, c’est-à-dire les fonds souverains. Les banques centrales sont des investisseurs caractérisés par une relative insensibilité au prix et par une grande stabilité ; elles conservent le plus souvent les titres jusqu’à maturité.
Pour M. Franck Motte, responsable Eurorates HSBC, en 2015, « près de 70 % des achats nets de dette française ont été réalisés par des entités publiques : banques centrales ou entités gérant de l’argent pour le compte d’États. » M. Christophe Jobert, responsable des activités global market en France pour BNP Paribas, a pour sa part estimée que les banques centrales autres que la BCE – en premier lieu les banques centrales asiatiques – représentaient environ 25 % de la part détenue par les non-résidents. Parmi les autres investisseurs non-résidents figurent ensuite « des banques du monde entier, beaucoup de fonds de pension, et des grands gestionnaires de fonds » dont il est difficile d’identifier la répartition géographique.
Pour ce qui concerne les résidents, la base d’investisseurs est relativement stable, dominée par les assurances (19 %), les OAT étant incontournables dans les fonds en euros de l’assurance-vie, et les établissements de crédit (9 %), notamment pour constituer les réserves de liquidité qui leur permettent de couvrir les décaissements à court terme. Les règles prudentielles de solvabilité et de liquidité imposent aux banques (Bâle III) et aux assurances (Solvabilité II) la détention de titres d’État, considérés comme liquides et peu risqués. Pour les banques, ces titres entrent également dans une stratégie de diversification des portefeuilles, en y mêlant actifs risqués et sans risques, et sont utilisés sur le marché du financement interbancaire et les opérations de pension avec les banques centrales.
Pour ce qui concerne le secteur domestique, la seule évolution notable récente est une montée en puissance du secteur public, sous l’effet des achats effectués par la Banque de France dans le cadre du quantitative easing.
DÉTENTION DE LA DETTE DE L’ÉTAT PAR LES RÉSIDENTS
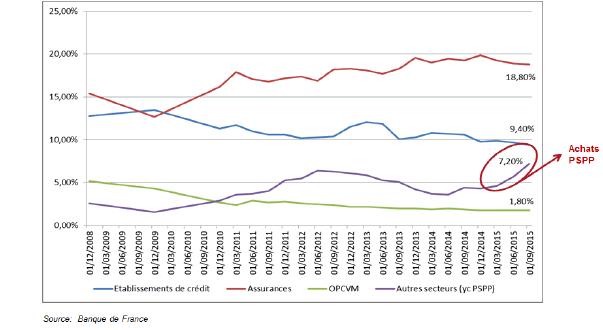
3. Faut-il « réinternaliser » la dette ?
De manière récurrente, et singulièrement depuis la crise des dettes souveraines, de nombreuses voix se font entendre pour réclamer une « réinternalisation » de la dette française.
Pour l’AFT, cette option présenterait plus de risques que d’avantages, en particulier en ce qu’elle rendrait l’État dépendant d’une base d’investisseurs trop étroite. C’est au contraire son objectif que d’avoir une base d’investisseurs aussi large et diversifiée que possible.
Elle prend pour exemple l’émission de 9 milliards d’euros à vingt et cinquante ans réalisée en avril par syndication (la syndication permet de connaître les acheteurs). Les investisseurs français n’ont participé qu’à hauteur de 21 % sur la tranche à vingt ans et 7 % sur la tranche à cinquante ans. En se reposant uniquement sur les investisseurs domestiques, l’AFT estime qu’elle n’aurait pas pu émettre plus de 1,5 milliard d’euros au taux finalement adjugé ou aurait dû servir un taux d’intérêt plus élevé pour émettre un montant supérieur.
Un autre risque est celui d’une trop forte dépendance du secteur financier (banques, assurances, gestionnaires d’actifs, fonds de pension) à l’émetteur souverain. Les limites de risques, internes ou réglementaires, des établissements peuvent d’ailleurs les conduire à limiter leurs niveaux d’exposition.
L’internationalisation, si elle n’est pas concentrée sur une zone géographique étroite, permet de sécuriser la souscription des émissions de dette à travers les cycles économiques traversés par les différentes régions du monde. Elle doit se doubler d’une diversification des catégories d’investisseurs, qui ont des besoins différents, en termes de produits et de maturité. C’est un facteur de résilience et de stabilité.
La diversification géographique des investisseurs permet en outre d’élargir la demande et d’augmenter la concurrence potentielle pour l’achat des titres de dette française, et donc de diminuer le coût de la charge de la dette.
L’idée sous-jacente à la proposition de « réinternalisation » ne serait, en fait, pas tant de déplacer le curseur entre résidents et non-résidents pour ce qui concerne la détention de titres de dette de l’État sur les marchés financiers – le comportement des investisseurs français sur les marchés financiers ne se distingue pas très significativement de celui des investisseurs non-résidents –, mais de construire un mode de financement de la dette de l’État moins dépendant des marchés financiers en faisant d’avantage appel à l’épargne domestique.
Il s’agirait en effet de se mettre à l’abri de la volatilité des flux de capitaux, et des taux d’intérêt, de se soustraire à l’influence des agences de notation et de desserrer la contrainte des marchés financiers sur la définition des politiques publiques.
L’épargne des Français est abondante : le taux d’épargne s’élève à 14,5 %, l’encours des placements financiers des ménages dépasse 4 300 milliards d’euros et, de manière symbolique, le montant des encours d’assurance-vie (1 650 milliards d’euros) équivaut au montant de la dette négociable de l’État.
L’importance des besoins de financement de l’État (192 milliards d’euros en 2015, à rapprocher des 212 milliards d’euros d’épargne brute des ménages) ne permettrait pas de se passer des marchés financiers, mais certains économistes proposent, à l’instar de M. Gaël Giraud (77), de mobiliser cette épargne de manière volontariste pour financer de grands projets d’avenir.
Les critiques à l’encontre de cette proposition sont connues : elle porte en germe le risque d’un effet d’éviction au détriment de l’investissement privé, voire de la consommation, et, surtout, entraînerait un surcoût pour l’État compte tenu des conditions qui lui sont actuellement consenties sur les marchés financiers. Lors de son audition, M. Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics a d’ailleurs précisé que l’objectif du Gouvernement était que l’épargne soit investie dans l’économie, pas dans la dette publique, ou qu’elle diminue au profit de la consommation.
Pour les rapporteurs, cette proposition ne doit cependant pas être rejetée d’un revers de main, dès lors qu’il s’agirait de financer des investissements contribuant à la richesse nationale et non le simple fonctionnement de l’État. La tentation peut exister de se contenter de profiter des taux faibles actuellement obtenus sur les marchés financiers, mais ce contexte exceptionnel ne doit pas nous conduire à renoncer à chercher des solutions pour rendre le financement de l’État moins dépendant des marchés financiers et plus stable. Le recours à l’épargne des Français améliorerait en outre la transparence sur la détention de la dette et offrirait une nouvelle possibilité de placement sans risque à nos concitoyens. Pour reprendre l’expression utilisée par M. Benjamin Lemoine lors de son audition, « il s’agit d’un arbitrage entre les taux d’intérêt et la liberté accordée aux politiques économiques » (78).
Proposition : Étudier les possibilités d’une mobilisation de l’épargne des ménages pour financer des grands projets d’avenir.
B. LES ENJEUX D’UNE PLUS GRANDE TRANSPARENCE
Il ressort des auditions menées par la mission que l’AFT semble se satisfaire du niveau d’information dont elle bénéficie sur la détention de la dette de l’État. Pour M. Anthony Requin, « ce qui nous intéresse comme émetteurs, ce n’est pas de savoir si tel ou tel investisseur précis détient des titres de dette française mais de comprendre les grands mouvements de marché qui peuvent se produire. Pourquoi, par exemple, un grand investisseur décide-t-il de vendre ? Faut-il voir là le signe d’une défiance, la conséquence d’une évolution de la réglementation… ? C’est ce type d’information qui a de la valeur pour nous en tant qu’émetteur. »
Les enjeux d’une plus grande transparence sont pourtant importants.
Il s’agit tout d’abord d’une question de souveraineté et de principe démocratique : la charge de la dette est payée par les impôts, il est légitime que les Français et leurs représentants sachent à qui sont versés chaque année plus de 40 milliards d’euros.
Une meilleure connaissance des créanciers permettrait en outre de mieux appréhender les risques de mouvements de capitaux et les risques liés à une grande concentration de titres de dette entre les mains d’un investisseur. Pour M. Gaël Giraud, « nous devons connaître l’identité des détenteurs de notre dette pour nous assurer qu’ils ne joueront pas contre nous le jour où le spread français remonterait, ce qui se produira quand les taux d’intérêts mondiaux cesseront d’être négatifs » (79).
Enfin, il y a un enjeu éthique : doit-on considérer que l’argent prêté à l’État n’a pas d’odeur ? Alors que la France affiche sa volonté de lutter contre les paradis fiscaux, comment accepter que des investisseurs puissent acheter des titres de dette française depuis un paradis fiscal et de ne pas savoir à quelle hauteur ? Interrogé à ce sujet lors de son audition, le directeur général de l’AFT a reconnu que « certains fonds situés dans des paradis fiscaux achètent certainement des titres obligataires, mais ce sont des cheminements très difficiles à repérer : il peut y avoir des chaînes d’actions successives pour acquérir des titres de dette française – chaînes qu’il est extrêmement difficile de remonter. » Cette difficulté a été confirmée par M. Frédéric Germain, directeur des opérations d’Euroclear : « si la banque agit pour le compte d’un établissement situé dans l’Ohio qui travaille lui-même pour le compte de quelqu’un situé dans les îles Caïman ou dans le Delaware, il sera très compliqué de s’assurer du respect des règles standard et de ne pas se trouver dans un paradis fiscal. En l’état actuel, je ne peux pas vous dire si c’est le cas ou non. »
En 2009, le Parlement avait introduit à l’article 125 A du code général des impôts (80), à l’initiative du Gouvernement, une disposition prévoyant un prélèvement à la source, dont le taux avait été fixé à l’époque à 50 %, sur les intérêts des valeurs du Trésor lorsque ceux-ci « sont payés hors de France, dans un État ou territoire non coopératif (81) ». Ce taux a depuis été porté à 75 %.
En application de cet article, dès lors qu’un établissement payeur effectue un versement dans un État ou territoire non coopératif, il a l’obligation de procéder à ce prélèvement, sauf à ce que le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces revenus ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un ETNC.
Cette disposition est en réalité de portée très limitée, puisqu’elle ne vise que les flux directs entre la France et les territoires concernés, quel que soit le bénéficiaire final des intérêts. Gilles Carrez, alors rapporteur général, relevait dans son rapport que « pour éviter l’interposition de bénéficiaires établis dans des États ou territoires qui ne sont pas des ETNC, il aurait pu paraître souhaitable qu’il soit tenu compte des sommes payées indirectement à des bénéficiaires établis ou domiciliés dans un ETNC. Une telle modalité est inopérante. Le débiteur ou payeur établi en France ne connaît pas la destination finale des dividendes, revenus ou rémunérations qu’il verse si elle n’est pas dans le pays où il les verse. Il n’est donc pas possible de mettre à sa charge le paiement de l’application d’un taux majoré pour des flux qui transiteraient par des États ou territoires coopératifs pour en réalité parvenir dans des États ou territoires qui ne le sont pas. » (82)
D’après les chiffres fournis à la mission, le montant total des prélèvements réalisés en application de cet article se sont élevés à 883 000 euros en 2014 et 188 000 euros en 2015. Le ministère estime que le caractère modeste de ces montants démontre l’efficacité du dispositif et le caractère prohibitif du taux de 75 %. Une autre interprétation, moins optimiste, pourrait être que, du fait que seuls les transferts directs vers un ETNC sont visés, il est facile d’y échapper en passant par un intermédiaire situé dans un pays ne figurant pas dans la liste des ETNC.
C. LES OBSTACLES À L’IDENTIFICATION DES CRÉANCIERS DE L’ÉTAT
Plusieurs éléments expliquent que la connaissance des créanciers de l’État ne soit que fragmentaire. Un premier obstacle à l’identification des créanciers de l’État est d’ordre pratique : la rapidité avec laquelle les titres sont échangés et l’internationalisation des marchés financiers, avec de nombreux intermédiaires, compliquent la recherche. Un deuxième obstacle est juridique : il existe une procédure d’identification des porteurs d’actions, mais elle ne s’applique pas aux détenteurs de titres d’État. Surtout, il ressort des auditions qu’il y a une volonté de protéger l’anonymat des investisseurs de crainte de les voir fuir le marché de la dette française, ce qui explique que l’obstacle juridique n’ait pas été levé.
1. Des échanges permanents sur le marché secondaire, des intermédiaires nombreux et internationaux
Ce flou sur la détention de la dette n’est pas une spécificité française.
Il faut noter cependant que le Trésor américain cherche à savoir qui sont les détenteurs finaux de sa dette et publie ces informations. Cependant, il reste que les informations publiées, les « TIC data » (Treasury International Capital) (83), font apparaître, selon M. Raoul Salomon, responsable des activités de marché pour Barclays en France des « situations extrêmement étranges ». Cette analyse a été confirmée par M. Anthony Requin : « je confirme qu’il existe des incongruités : les analyses qu’essaye de mener le Trésor américain sur sa base d’investisseurs montrent que la Belgique détient des quantités de dette américaine étonnantes. Cela s’explique par le fait que la Belgique est le siège d’Euroclear, organisme de dépôt et de règlement-livraison par lequel transitent un certain nombre de comptes. Mais derrière Euroclear il y a probablement des comptes-titres qui sont mouvementés depuis d’autres pays. » Pour M. Salomon, « si l’on étudie les statistiques américaines, on retrouve les pays où se trouvent ces dépositaires. On trouve ainsi de nombreux dépositaires dans les îles des Caraïbes, mais on se doute bien que l’argent ne vient pas de là. Le biais statistique peut donc être gigantesque. »
La difficulté d’obtenir une photographie précise de la détention de la dette de l’État a été confirmée par tous les interlocuteurs de la mission.
La dette de l’État étant très liquide, ces difficultés sont d’abord liées au volume échangé chaque jour sur le marché secondaire, comme l’a rappelé M. Anthony Requin lors de son audition : « la dette française s’échange sur le marché secondaire et change donc de mains de jour en jour. Ces transactions sont importantes : 10 milliards (84) d’euros par jour, 3 600 milliards par an – chiffres à comparer à celui du stock, qui est de 1 600 milliards. » Selon M. Frédéric Germain, directeur des opérations d’Euroclear France, « il transite entre 80 et 100 milliards d’euros par jour sur la dette d’État. Mais il faut faire attention avec ces chiffres : dans la même journée, une banque peut s’échanger dix ou cent fois les mêmes titres. »
VOLUME QUOTIDIEN MOYEN TRAITÉ PAR LES SVT DEPUIS 2011 (EN MILLIARDS D’EUROS)
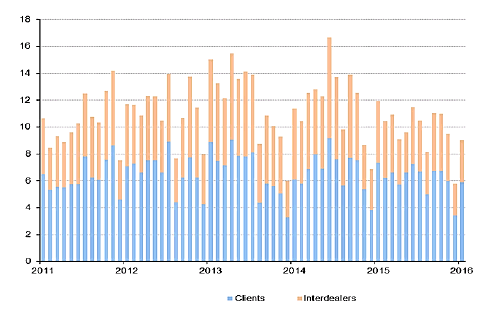
Les intermédiaires entre le détenteur final et l’émetteur peuvent en outre être nombreux et situés dans différents pays. L’identification du détenteur final supposerait par conséquent d’identifier les porteurs en cascade afin de remonter la chaîne. Selon les explications fournies à la mission par l’AFT, l’existence d’intermédiaires financiers rendrait la recherche des propriétaires finaux complexe et leur bonne identification incertaine. Dans la plupart des cas, les références qui seraient rapportées par Euroclear (cf. infra) renverraient à des conservateurs de titres pour le compte de tiers. De plus, les titres souverains sont souvent acquis par l’intermédiaire de fonds d’investissement dédiés. Il faudrait donc prolonger l’interrogation auprès de ces divers et multiples intermédiaires financiers, alors que l’identité des détenteurs peut varier rapidement.
La complexité de l’identification des détenteurs des titres est donc un premier argument avancé pour justifier le statu quo.
Euroclear France est le dépositaire central de titres financiers français. Créée en 1949 sous le nom de Sicovam SA, l’infrastructure a été rachetée en 2001 par le groupe Euroclear qui rassemble les dépositaires centraux belges, finlandais, hollandais et suédois, Euroclear UK ainsi qu’un dépositaire central international.
Euroclear a une double fonction de dépositaire central et de gestionnaire du système de règlement-livraison.
En tant que dépositaire central, il fait le lien entre les émetteurs qui y déposent leurs titres et les intermédiaires financiers qui conservent ces titres pour le compte des investisseurs ou leur propre compte. Il s’assure à tout moment que le nombre de titres en circulation est égal au nombre de titres émis.
En tant que gestionnaire du système de règlement-livraison, il assure l’échange en temps réel entre les titres et le paiement lorsqu’une opération a lieu. Pour reprendre l’expression utilisée par M. Frédéric Germain, directeur des opérations d’Euroclear, lors de son audition, Euroclear a un « rôle notarial » pour les titres d’État, sous la supervision de l’Autorité des marchés financiers et de la Banque de France.
Il a aussi un rôle de gestion des comptes titres de ses clients : tous les instruments financiers inscrits en compte font l’objet d’un suivi de leur naissance à leur mort. Chacun des clients d’Euroclear (la majeure partie des établissements de crédit) dispose d’un compte qui reflète les positions de ses propres clients ; les comptes de ces établissements doivent correspondre à la somme des avoirs de leurs clients et de leurs avoirs propres.
Compte tenu de sa position de « notaire », la mission espérait pouvoir obtenir d’Euroclear des précisions sur les détenteurs finaux de la dette de l’État. Il n’en a rien été. M. Frédéric Germain, directeur des opérations d’Euroclear a en effet expliqué : « Nous connaissons les établissements de crédit qui s’adressent à nous. Leur position est le reflet de la somme des avoirs de leurs propres clients. Nous n’avons pas de visibilité sur les investisseurs finaux. » Si le versement des intérêts transite par Euroclear, celui-ci ne les verse pas directement à leur bénéficiaire : « L’émetteur met à notre disposition l’ensemble des intérêts à verser, et sur la base des positions respectives de nos clients, nous versons à due concurrence les montants qui reviennent à chacun des établissements. Ces derniers ont ensuite l’obligation de reverser ces intérêts à leurs propres clients. »
2. La traçabilité des titres se heurte à un obstacle juridique…
Comme l’a relevé M. Frédéric Germain, « d’un point de vue technique et théorique, dans un monde dématérialisé, tout peut s’identifier. Mais la réglementation en vigueur en matière de titres d’État ne nous permet pas d’identifier les détenteurs de titres finaux. C’est aujourd’hui juridiquement impossible. »
Il existe en effet un dispositif permettant d’identifier les porteurs de titres, en particulier les actionnaires des sociétés émettrices, prévu à l’article L. 228-2 du code de commerce. Lorsque ses statuts le prévoient, la société émettrice peut demander à tout moment au dépositaire central de fournir l’identité des porteurs de titres de capital ou donnant accès au capital. Lorsque ses titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la société émettrice peut également s’enquérir des noms des propriétaires de titres nominatifs domiciliés à l’étranger auprès de l’intermédiaire teneur de comptes-titres.
Ce dispositif, initialement prévu pour les émetteurs de titres de capital ou donnant accès au capital, a été étendu à certains émetteurs d’obligations par l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise en application de l’article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.
Le rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance précisait : « Certains émetteurs d’obligations, actuellement non concernés par ces dispositions, souhaitent également mieux connaître les détenteurs de ces titres de créance, principalement pour les raisons suivantes :
« 1° Cette connaissance permettra d’améliorer la communication financière et d’adapter au mieux les campagnes de présentation aux investisseurs ;
« 2° Une meilleure connaissance facilitera une gestion plus dynamique de leur dette, par un meilleur rapprochement entre le besoin de l’émetteur et les intérêts des investisseurs. »
L’ordonnance a explicitement exclu les personnes morales de droit public du bénéfice de ce dispositif d’identification des porteurs de titres.
Il fonctionne pourtant de façon simple, comme l’ont exposé les représentants d’Euroclear (85) :
« Ce dispositif est très simple : nous avons une position titre dans nos livres, et si l’émetteur nous déclare, conformément à la loi et à ses statuts, que nous pouvons identifier ses actionnaires à une date donnée, nous lançons une requête auprès de l’ensemble des établissements de crédit parmi nos clients. Ils nous informent, sur la base de données strictement encadrées par la loi, et nous compilons ces informations pour remettre à l’émetteur la liste de ses actionnaires.
« Ce dispositif est bien évidemment transposable à tout titre, de quelque nature que ce soit, notamment aux titres d’État. Mais juridiquement, ce dispositif ne leur est pas applicable. Il n’a pas été décidé par le législateur de permettre l’identification des investisseurs détenant des titres d’État. Il peut y avoir de bonnes ou de mauvaises raisons à cela. »
S’il est simple sur le principe, il faut cependant préciser que l’efficacité de ce dispositif est limitée par l’internationalisation des marchés. En fait, les émetteurs reçoivent rarement une liste exhaustive de leurs détenteurs.
Comme l’a exposé M. Frédéric Germain : « La loi a été rédigée en 1987, lorsque les marchés étaient très peu internationalisés. Il n’a pas été anticipé que de plus en plus d’investisseurs étrangers s’intéresseraient aux sociétés françaises. Évidemment, ces investisseurs étrangers n’ont pas tous un compte dans une banque française. Ils peuvent avoir un compte à la Chase Manhattan Bank, qui a elle-même un compte chez BNP Paribas, par exemple.
« BNP Paribas ne connaît pas nécessairement l’investisseur qui est client de la Chase Manhattan. Dans le processus de titre au porteur identifiable, BNP Paribas nous communiquera le nom de la Chase Manhattan, et pas plus que cela. Ce sont les limites du système. Évidemment, plus le marché s’internationalise, plus nous avons tendance à perdre l’identité des détenteurs finaux.
« […] En 2002 (86), le législateur a décidé de mettre en place un autre dispositif pour casser l’opacité créée par une structure de comptes en cascade. Il a donc donné la possibilité à l’émetteur d’interroger la Chase Manhattan – soit par lui-même, soit par l’intermédiaire du dépositaire central – et d’identifier les porteurs en cascade, afin de remonter la chaîne.
« Cette procédure est toutefois assez inefficace, pour une raison simple. Les informations récupérées auprès de la banque interrogée sont globalisées, elles donnent pour adresse une tour où se trouvent 5 000 à 6 000 personnes, et il est très difficile d’atteindre l’interlocuteur capable de donner la bonne information. »
3. … et à la volonté de préserver l’anonymat des investisseurs
Le Gouvernement n’a pas souhaité étendre aux titres d’État le dispositif d’identification des porteurs de titre en vigueur pour les actions, avec toutes ses imperfections, lorsqu’il l’a étendu aux obligations d’entreprise en 2014.
Il est parfois avancé que la détention d’actions confère des droits, comme les droits de vote en assemblée générale, alors qu’un investisseur dans des obligations d’État n’a aucun levier juridique pour influer sur la politique suivie par l’émetteur et que cela justifierait cette différence de traitement entre actions et obligations. Trois objections peuvent toutefois être soulevées à l’encontre de cet argument :
– le dispositif a déjà été ouvert à certaines obligations par l’ordonnance du 31 juillet 2014 ;
– si les investisseurs n’ont pas de levier juridique pour influer sur la politique de l’émetteur, ils en ont un autre peut-être plus puissant, un levier économique, en « votant avec leurs pieds » ou en laissant simplement planer la menace de le faire ;
– les clauses d’action collective mises en place depuis le 1er janvier 2013 prévoient un vote des détenteurs de titres si l’État souhaite modifier les termes du contrat d’émission d’un titre.
Au demeurant, l’exclusion des obligations émises par les personnes morales de droit public du dispositif de l’article L. 228-2 du code de commerce paraît peu cohérente avec les dispositions, législatives et réglementaires, introduites en 2012 pour permettre la mise en place des clauses d’action collective dans les obligations.
Comme cela a déjà été mentionné, l’article 59 de la loi de finances pour 2013 prévoit un vote des détenteurs de titre sur toute proposition de modification du contrat d’émission, ce qui rend leur identification nécessaire. Pour ce faire, l’article 3 du décret n° 2012-1517 du 29 décembre 2012 relatif aux clauses d’action collective applicables aux titres d’État dispose que « le droit de vote est apprécié par l’enregistrement comptable des titres concernés soit dans les comptes de titres tenus par l’État, soit dans les comptes de titres tenus par un intermédiaire mentionné aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier (…). Chaque intermédiaire transmet la liste des détenteurs à l’État. »
Il y a donc un texte réglementaire qui prévoit, dans le cas précis d’une restructuration de la dette, que chaque intermédiaire transmet la liste des détenteurs à l’État, et un texte législatif plus général qui interdit à l’État d’interroger Euroclear sur l’identité des détenteurs de ses titres.
L’existence d’une procédure pour connaître les détenteurs de la dette française dans le cas d’une demande de restructuration de la dette montre que l’argument de la complexité du processus d’identification ne paraît pas insurmontable.
L’interdiction faite à l’État d’interroger le dépositaire central pour connaître les détenteurs des titres qu’il a émis résulte plutôt d’une volonté de protéger l’anonymat des investisseurs, de crainte de les voir fuir le marché de la dette française. Cette crainte a été très clairement exprimée lors des auditions de la mission par le directeur général de l’AFT :
« Une obligation de déclaration qui s’imposerait aux détenteurs de dette française, et uniquement à eux, nous ferait prendre un risque car ce serait un désavantage compétitif par rapport aux autres États si une telle obligation ne s’appliquait pas à eux. Les investisseurs, en effet, n’aiment pas dévoiler leurs positions sur le marché, pour des raisons dont certaines me semblent légitimes.
« Ainsi, beaucoup de nos investisseurs sont des banques centrales, qui doivent placer des réserves de change et souhaitent disposer d’actifs sûrs et liquides. Mais les banques centrales peuvent aussi, parfois, être amenées à réaliser des transactions dans le cadre de leur politique de change, donc à vendre des quantités de titres importantes. Elles font partie du secteur public d’un État étranger : de telles transactions massives pourraient les placer en position inconfortable vis-à-vis des pays émetteurs, car cela pourrait être interprété comme un signal négatif, un geste de défiance.
« Quant aux investisseurs privés – assureurs, fonds de pension… – ils ne souhaitent pas dévoiler au marché, à tout moment, leurs positions. Ce serait pour eux un risque, car les marchés connaissent les règles de diversification et de prise de risque : ils pourraient donc savoir, dans certaines configurations de marché, quand ces investisseurs vont être obligés de vendre certains titres. La publication de leurs positions pourrait donc se retourner contre eux. »
Les spécialistes en valeurs du Trésor ont abondé dans le même sens.
Pour M. Raoul Salomon, responsable des activités de marché pour Barclays, « en fait, il faudrait demander aux investisseurs d’où vient l’argent qu’ils placent, et ils n’ont pas nécessairement envie de le dire. Il est évident que certains ont quelque chose à cacher, mais lors de la crise des dettes souveraines, nous avons aussi connu des investisseurs qui n’étaient pas très fiers d’avoir investi dans la dette grecque ou espagnole, et qui ne préféraient pas trop en parler. De façon générale, on préfère parler des investissements gagnants que perdants, et ce n’est pas propre aux investisseurs institutionnels. […] Il ne faut pas sous-estimer le fait que certains n’ont pas envie de faire savoir quand ils achètent ou vendent. »
M. Franck Motte, responsable Eurorates HSBC, en est arrivé à la même conclusion que M. Requin : « si la France annonce demain qu’elle veut savoir qui détient quoi, les investisseurs se tourneront vers les obligations d’autres États ».
Ce risque a également été pointé par l’économiste Henri Sterdyniak : « il n’est pas possible de demander l’identité des acheteurs des titres de notre dette ; on peut le regretter, mais cela ne se fait pas sur les marchés mondiaux ».
Faut-il pour autant renoncer à se donner la possibilité d’en savoir plus ? On peut observer que les États-Unis publient régulièrement une liste des détenteurs étrangers de leurs titres, avec les biais qui ont déjà été évoqués, sans que cela semble nuire à leur capacité de se financer sur les marchés. Ensuite, comme l’a évoqué M. Gaël Giraud, il ne s’agirait pas de rendre publique l’identité des acheteurs, mais de permettre à l’État d’avoir accès à cette information. Il lui serait ainsi possible, occasionnellement, de remonter la chaîne des investisseurs pour mieux apprécier les risques de marché. Ce pourrait en outre être un moyen de renforcer la lutte contre les paradis fiscaux.
Proposition : Lever les verrous interdisant à l’État de connaître ses créanciers en permettant l’identification des détenteurs des obligations émises par les personnes morales de droit public (article L. 228-2 du code de commerce).
I. LES DÉFIS ÉCONOMIQUES POSÉS PAR LA DETTE INCITENT À DÉPASSER LES SOLUTIONS TRADITIONNELLES
La progression de la dette publique s’accompagne de nombreux risques économiques, auquel la France, comme d’autres pays européens, n’arrive pas à répondre efficacement.
Intégrée dans une union monétaire, la France ne dispose plus des outils de politique monétaire qui permettent à un État de réduire sa dette, tels que la dévaluation ou la stimulation de l’inflation.
En outre, à travers le risque de taux sur la dette publique, comme à travers celui d’alimenter de nouvelles bulles financières par une politique monétaire expansionniste (visant principalement à soulager les États et à relancer l’activité mais qui n’atteint que très partiellement ses objectifs), les problèmes économiques liés directement au niveau de l’endettement public sont aujourd’hui d’une importance capitale.
A. LES PROBLÈMES ÉCONOMIQUES POSÉS PAR LA DETTE
1. Les critères de Maastricht, bien qu’assouplis à de nombreuses reprises, conduisent à des politiques déflationnistes qui aggravent la dette
Malgré l’absence de règle d’or, la dette publique française n’est pas libre de contraintes : la France s’est engagée à respecter les critères de Maastricht dans le cadre de la mise en place de la zone euro (articles 121 à 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – TFUE - et protocole n° 12 sur les déficits excessifs). Si la mise en place de ces critères correspondait à une volonté de garantir une cohérence macroéconomique entre les pays membres de la zone euro, ils conduisent également à l’adoption de politiques à tendance déflationnistes, indépendamment du contexte économique, ce qui s’avère potentiellement dommageable sur le niveau de la dette publique, en particulier en période de crise et de faible croissance.
a. Des règles contraignantes pour la gestion de la dette publique
Le TFUE encadre la gestion des finances publiques, évaluées à travers deux critères : le déficit public et la dette publique. Le déficit public est excessif lorsqu’il dépasse 3 % du PIB. La dette publique est excessive lorsqu’elle dépasse 60 % du PIB, sauf si elle diminue suffisamment, c’est-à-dire si la part de la dette qui excède 60 % du PIB diminue d’au moins un vingtième par an en moyenne sur les trois dernières années.
Avec l’adoption du Six-Pack (2011), de nouvelles contraintes ont émergé telles qu’un rythme de réduction du déficit structurel supérieur à 0,5 % du PIB par an pour les États membres dont la dette publique est supérieure à 60 % du PIB ou le fait que l’augmentation des dépenses publiques doit être moindre que celle de la croissance potentielle. Par ailleurs, les États doivent avoir un objectif à moyen terme (OMT) qui permet de garantir la viabilité des finances publiques. Celui-ci, qui consiste à prévoir un retour à l’équilibre structurel des comptes publics (déficit structurel limité à 0,5 % ou 1 % du PIB en fonction de leur ratification ou non du pacte budgétaire européen) est défini par la Commission européenne pour chaque État. Il ne s’agit pas a priori de limiter les dépenses, mais de s’assurer qu’il y ait des recettes équivalentes en face.
Le pacte de stabilité et de croissance (PSC) comporte donc, désormais, deux types de dispositions :
– la surveillance multilatérale (disposition préventive) : les États de la zone euro présentent leurs objectifs budgétaires à moyen terme dans un programme de stabilité actualisé chaque année. Un système d’alerte rapide permet au Conseil ECOFIN, réunissant les ministres de l’Économie et des finances de l’Union, de leur adresser une recommandation à un État en cas de dérapage budgétaire ;
– la procédure de déficit excessif (disposition dissuasive). Elle est enclenchée dès qu’un État membre dépasse le critère de déficit public fixé à 3 % du PIB, sauf circonstances exceptionnelles. Le Conseil Ecofin adresse alors des recommandations pour que l’État mette fin à cette situation. Si tel n’est pas le cas, le Conseil peut prendre des sanctions : dépôt auprès de la BCE qui peut devenir une amende (de 0,2 à 0,5 % PIB de l’État en question) si le déficit excessif n’est pas comblé.
Depuis 2012, le principe d’une surveillance multilatérale des politiques économiques des États membres est également acté par l’article 121 TFUE. À l’origine, la surveillance – régie par différents textes formant le PSC – portait uniquement sur les finances publiques. Depuis 2012, elle porte également sur la prévention des déséquilibres macroéconomiques (PDM). Il existe ainsi deux cadres de surveillance multilatérale des politiques économiques, l’un portant sur les finances publiques, l’autre sur la macroéconomie.
LES DEUX CADRES DE SURVEILLANCE DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES NATIONALES
Cadre de surveillance |
Surveillance des finances publiques |
Surveillance macroéconomique |
Instrument juridique |
Pacte de stabilité et de croissance (PSC) |
Prévention et correction des déséquilibres macroéconomiques (PDM) |
Volet correctif |
Procédure pour déficit excessif |
Procédure pour déséquilibre excessif |
Source : Rapport de Mme Valérie Rabault sur le pacte de stabilité pour 2016-2019.
Actuellement, et depuis février 2009, la France relève du volet correctif du PSC. En revanche, bien qu’en situation de déséquilibre macroéconomique excessif depuis février 2015, la France ne relève pas du volet correctif de la prévention des déséquilibres macroéconomiques dans la mesure où la Commission n’a pas initié à son encontre l’ouverture d’une procédure.
La Commission européenne et le Conseil peuvent en effet estimer que l’effort d’ajustement peut être plus limité en période de conjoncture économique défavorable. Pour autant, les États n’ayant pas encore atteint leur OMT doivent compenser les réductions de recettes discrétionnaires par des réductions de dépenses équivalentes.
LA SURVEILLANCE DES FINANCES PUBLIQUES
Volet Préventif |
Orientations du Conseil |
Le Conseil adopte ses orientations généralement en février sur la base de l’examen annuel de la croissance élaboré par la Commission |
Programme de stabilité ou programme de convergence |
Ces programmes sont transmis par les États membres à la Commission avant le 30 avril | |
Évaluation et suivi |
− Les programmes sont évalués dans les trois mois de leur transmission − Un avertissement et des recommandations peuvent être adoptés en cas d’écart important avec la trajectoire d’ajustement | |
Volet correctif |
Ouverture de la procédure pour déficit excessif |
Sur décision du Conseil, agissant sur recommandation de la Commission, le Conseil adopte des recommandations en vue de la correction du déficit excessif |
Actions suivies d’effet |
− L’État membre remet un rapport sur les actions suivies d’effet qu’il a entreprises en vue de remédier au déficit excessif − La Commission évalue les actions suivies d’effet | |
Mise en demeure |
En l’absence d’actions suivies d’effet, le Conseil peut, sur recommandation de la Commission, adresser une mise en demeure | |
Sanctions |
Sanction du volet préventif |
Dépôt portant intérêts de 0,2 % du PIB |
Sanctions du volet correctif |
Dépôt ne portant pas intérêts de 0,2 % du PIB, voire amendes de 0,2 % du PIB à 0,5 % du PIB si l’État membre enfreint à plusieurs reprises les règles du volet correctif |
Source : commission des finances.
L’ensemble de ces dispositions conduit à l’adoption de politiques de réduction forcées des déficits publics, sous le contrôle de la Commission européenne. Pour autant, les résultats ne sont pas probants : en 2014, sept pays de la zone euro dont la France sont encore soumis à la procédure de déficit excessif (87). Surtout, malgré une tendance d’ensemble à la réduction des déficits publics sur les cinq dernières années, le niveau des dettes publiques s’est lui constamment renforcé depuis la mise en place du PSC originel.
b. Une obsolescence de fait du PSC renforcée par sa contestation récurrente
Là réside le principal paradoxe et, pour certains, l’inefficacité du PSC : s’il arrive globalement à jouer son rôle incitatif de réduction des déficits par une pression constante sur les Gouvernements (88), il s’est en revanche révélé parfaitement inopérant du point de vue du niveau des dettes publiques qui n’ont cessé de croître dans la quasi-totalité des pays de la zone euro.
Entre 1999 et 2007, l’endettement public dans la zone euro a certes diminué : il est passé de 72 % du PIB en moyenne à 68 %. Les « PIGS » (Portugal, Italie, Grèce, Espagne), aujourd’hui montrés du doigt, étaient même plus « vertueux » que la moyenne européenne : leur dette était passée de 90 % à 75 % en moyenne.
Mais le poids des dettes publiques en Europe n’a globalement fait que croître, montrant ainsi que la réduction du déficit n’est pas le seul critère à prendre en compte en matière de dynamique d’accumulation des dettes. Au dernier trimestre de 2014, la dette des 28 États membres de l’Union européenne attaignait ainsi 86,6 % du PIB. Celle des pays de la zone euro représentait 92,1 % du PIB. À nouveau, la dette publique des pays de la zone euro diminue légèrement en 2015 pour atteindre 90,7 % du PIB. La tendance de fond demeure cependant à un alourdissement du poids de la dette dans la zone euro depuis 1999.
Dès 2003, un débat concernant l’assouplissement du pacte de stabilité et de croissance est donc lancé à l’initiative du président Jacques Chirac, soutenu à l’époque par le chancelier allemand Gerhard Schröder. Le pacte de stabilité et de croissance a été par conséquent modifié en 2005 afin d’introduire la définition d’un objectif de moyen terme, la fixation d’une trajectoire d’ajustement vers cet objectif et la prise en compte des réformes structurelles.
La crise économique de 2008 puis celle des dettes souveraines au sein de la zone euro auront pour conséquence un allongement de la liste des pays en situation de procédure de déficit excessif. Au titre de l’année 2009, quatorze pays de la zone euro sur seize sont en situation de déficit excessif et beaucoup obtiennent alors des délais supplémentaires pour revenir à la situation d’équilibre.
Toutefois, aucune de ces étapes de la contestation n’a abouti à une remise en cause des critères de Maastricht. La mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance se conclut aujourd’hui par un constat d’échec que l’ancien président de la Commission européenne Romano Prodi avait résumé, dès 2002, en le qualifiant de « pacte de stupidité ».
La France aurait pourtant particulièrement intérêt à la réforme du PSC. En effet, outre son caractère procyclique (qui aggrave l’austérité lorsque le cycle de croissance est faible ou négatif), celui-ci ne fait aucune différence concernant la nature des dépenses. Or, si une stratégie de passager clandestin, qui consiste à faire porter aux autres le poids des efforts, est possible en matière économique, elle l’est aussi en matière stratégique et de défense. Ainsi, dès lors que la France assure la conduite d’un certain nombre d’opérations hors du territoire européen mais qui intéressent directement la sécurité de l’ensemble de celui-ci (tels que l’opération menée au Mali depuis 2013), il serait souhaitable que les dépenses liées à ces opérations exceptionnelles puissent être totalement sorties du calcul du déficit.
Proposition : Soustraire du calcul du déficit public les dépenses liées directement à des opérations militaires intéressant la sécurité de l’Europe et approuvées par le Conseil européen.
La Commission européenne a en outre accepté, en janvier 2015, un allégement de l’interprétation du pacte de stabilité. Elle l’a d’abord fait en assurant que tout argent public mis directement dans le fonds européen chargé de porter le plan d’investissement de 315 milliards d’euros (aussi appelé plan Juncker) ne sera pas pris en compte dans le calcul du déficit du pays contributeur. Par ailleurs, elle a assoupli les critères permettant d’activer la « clause d’investissement », qui était restée peu utilisée jusqu’à présent. Celle-ci permet à la Commission d’autoriser des écarts temporaires par rapport à la trajectoire devant ramener le déficit structurel vers l’objectif à moyen terme défini dans les recommandations par pays, ou par rapport à l’objectif à moyen terme pour les États membres qui l’ont atteint, pour autant que la croissance de leur PIB est négative ou le PIB reste nettement inférieur à son potentiel (se traduisant par un différentiel supérieur à – 1,5 % du PIB). Les investissements doivent correspondre à des projets cofinancés par l’Union au titre des politiques structurelles et de cohésion (y compris les projets cofinancés au titre de l’initiative pour l’emploi des jeunes), des réseaux transeuropéens et du mécanisme pour l’interconnexion en Europe.
Cet assouplissement reste cependant limité. En premier lieu, les États soumis à une procédure pour déficit excessif ne peuvent s’en prévaloir : l’écart permis par la Commission ne doit pas entraîner le non-respect de la valeur de référence de 3 % et une marge de sécurité appropriée doit être préservée. Par ailleurs, cet écart doit être compensé dans les délais fixés aux fins du programme de stabilité ou de convergence de l’État membre (plans budgétaires à moyen terme des États membres), donc avoir une valeur nulle à moyen terme.
Il est donc nécessaire d’aller plus loin en permettant aux États soumis à une procédure pour déficit excessif de relancer également leur investissement sans craindre de sanctions et de ne pas limiter la définition des investissements aux seuls projets cofinancés par l’Union européenne, ce qui en limite excessivement le champ.
Proposition : Permettre aux États soumis à une procédure pour déficit excessif de recourir à la clause d’investissement afin de sortir de l’effet procyclique du pacte de stabilité.
Proposition : Ne pas limiter la liste des investissements pris en compte dans la clause d’investissement aux seuls projets cofinancés par l’Union européenne.
c. Le risque de trappe déflationniste alimenté par la déconnexion entre politique monétaire et politique budgétaire
Il serait donc temps de réformer le cadre juridique européen. En effet, pour réduire le poids de la dette, il est nécessaire de maintenir un niveau de croissance et d’inflation supérieur au taux d’intérêt réel (cf. chapitre I. A. 3). La pression constante sur la réduction du déficit public conduit au contraire à des mécanismes déflationnistes.
Au-delà des règles contraignantes présentées ci-dessus, et dont l’interprétation peut être améliorée, le mécanisme européen se heurte à un autre obstacle important qui réside dans la déconnexion entre la politique monétaire et la politique budgétaire. D’un côté, la BCE peut mener une politique monétaire non-conventionnelle (bien que sérieusement limitée par l’impossibilité pour elle de racheter des titres d’État sur le marché primaire, ce qui suppose de recourir à l’intermédiaire du marché financier pour financer la relance), mais de l’autre côté les États n’ont pas la capacité, en raison des contraintes du PSC, d’appuyer cette politique monétaire par des mesures budgétaires suffisantes. Dans la période récente, ce constat a été fait au plus haut niveau : M. Mario Draghi, le président de la BCE, déclarait ainsi le 7 avril 2016 que « d’autres sphères de décision doivent contribuer de façon beaucoup plus appuyée, au niveau national et au niveau européen ». Il avait également déclaré auparavant que la BCE était « la seule institution à soutenir la croissance en Europe ».
Encore faut-il souligner que les orientations nouvelles de la BCE sont qualifiées par l’ensemble des intéressés de « non-conventionnelles », c’est-à-dire hors des fonctions classiques prévues par les traités, lesquels mettent l’accent sur la maîtrise de l’inflation à un taux inférieur mais proche de 2 %.
Il existe donc un biais déflationniste de la politique monétaire. Dans le cas de la France, quand l’État était le grand banquier de l’économie, il fonctionnait comme une banque de dépôt, contrôlant la politique monétaire tout en se finançant. Progressivement, ces fonctions ont été dissociées, pour attribuer la politique monétaire exclusivement à la Banque de France – bien avant Maastricht et la construction européenne –, tandis que le Trésor se contentera d’émettre de la dette de marché sans se préoccuper de la question monétaire.
L’État délègue désormais totalement à la Banque centrale européenne la question de la monnaie et, par incidence, la question de l’inflation. Les investisseurs étant désormais théoriquement protégés de l’inflation sur la valeur de leurs titres, par les règles institutionnelles européennes et par l’indépendance et le mandat de la BCE, ils devaient en théorie, dans l’esprit des monétaristes, accepter de prêter à l’État à un taux d’intérêt moins élevé.
Toutefois, non seulement cette pratique institutionnelle conduit mécaniquement à une politique anti-inflationniste mais elle n’est pas non plus conforme aux résultats espérés puisque les taux auxquels l’État emprunte sont la plupart du temps supérieurs aux taux de croissance.
Or, dans une situation de déflation, la majorité des acteurs privés souffrent d’un surendettement qui les empêche d’investir, ce qui paralyse la machine économique ; l’ensemble des acteurs privés tentent donc de se désendetter en vendant leurs actifs. Si tous vendent simultanément leurs actifs, le prix de ceux-ci s’effondre, ce qui entraîne une baisse généralisée des prix. Si cette baisse se produit plus vite que la réduction de la dette nominale des agents, alors la dette réelle augmente. Dans une trappe déflationniste, la dette des acteurs s’accroît donc si chacun cherche à se désendetter au même moment.
C’est pour lutter contre ce risque que les banques centrales pratiquent désormais une politique monétaire hyperaccommodante, qui s’éloigne des traités, sans parvenir pour autant, du moins dans la zone euro, à relancer l’économie. Il faudrait donc aller plus loin dans la réflexion sur l’articulation entre politique monétaire et budgétaire, ainsi que sur l’essence même de la politique monétaire (voir IV.B ci-après) qui ne peut se réduire à la question du taux d’intérêt.
2. Une exposition de plus en plus problématique au risque de taux
Un des avantages, mais aussi un des risques, de la politique monétaire actuelle tient à la faiblesse des taux d’intérêt. Celle-ci est due tant à la politique monétaire de la BCE qu’au contexte économique d’ensemble, qui permet le financement à bas coût des États. Cet « état de grâce » pourrait cependant ne pas durer. À l’heure actuelle, les investisseurs estiment que placer leur argent dans des titres de dette publique s’apparente à déposer de l’argent dans un coffre-fort : s’il convient de payer la location du coffre, ils ont également la certitude d’y retrouver leur argent. De la même façon, ces investisseurs estiment qu’en achetant des titres émis par la France, ils pourront retrouver leur capital, moyennant des frais de garde.
Par ailleurs, les marchés financiers anticipent le maintien des taux d’intérêt à des niveaux bas car ils ne perçoivent aucun risque d’inflation ni de retour d’une croissance forte. Ils sont à la recherche de placements sans risque et liquides et ce placement leur semble avantageux.
TAUX D’INTÉRÊT SUR LA DETTE PUBLIQUE
ET TAUX COURTS ANTICIPÉS
Taux actuels |
Anticipations des taux courts par les investisseurs | |
1 a |
– 0,4 |
– 0,4 |
2 a |
– 0,4 |
– 0,4 |
3 a |
– 0,35 |
– 0,25 |
4 a |
– 0,25 |
0,05 |
5 a |
– 0,14 |
0,3 |
6 a |
– 0,03 |
0,6 |
7 a |
0,12 |
1,0 |
8 a |
0,25 |
1,12 |
9 a |
0,45 |
2 |
10a |
0,64 |
2,35 |
15 a |
1,19 |
2,3 |
20a |
1,34 |
1,8 |
30 a |
1,66 |
2,3 |
50 a |
1,85 |
2,14 |
Source : OFCE
Le risque de remontée des taux, qui peut tenir soit à des phénomènes purement financiers soit au retour de la croissance, ne doit cependant pas être écarté.
Le fonctionnement des marchés financiers est en effet marqué par de forts mouvements mimétiques qui peuvent provoquer des hausses ou des chutes brutales des taux selon des phénomènes plus ou moins rationnels, parfois complètement irrationnels comme dans le « phénomène des taches solaires ». Selon l’économiste Gaël Giraud « il est ainsi tout à fait envisageable que les marchés puissent faire brutalement hausser les taux si un phénomène collectif faisait vendre des euros massivement par réflexe de protection. C’est exactement ce qu’il s’est passé en Grèce en janvier 2010 : alors que les difficultés sur les finances publiques grecques étaient connues depuis plus de six mois et n’avaient pas eu d’effet significatif sur les taux, ce n’est qu’en janvier 2010 que les marchés pensent que la probabilité que la Grèce s’effondre est élevée, ce qui provoque une hausse brutale des taux. Il y a un risque direct qui tient à l’instabilité et aux phénomènes amplificateurs des marchés financiers ».
Il existe aussi un risque de remontée des taux en raison d’une croissance plus forte que prévue ou d’un renversement de politique monétaire. À cet égard, les perspectives de redémarrage de l’investissement, de l’emploi et de l’économie étant meilleures aux États-Unis qu’en Europe, la Fed pourrait s’engager dans une politique de remontée des taux en 2016. Elle se montre néanmoins extrêmement prudente à cause du risque de krach obligataire : si les marchés anticipaient une remontée rapide des taux, ils s’attendraient à une baisse des cours obligataires qui pourrait précipiter une panique contagieuse. Si le choc de taux reflète un redémarrage de la croissance et une anticipation d’inflation également à la hausse, il serait cependant certainement positif sur la dette en raison de l’effet sur les recettes fiscales.
À l’inverse, dans le cas d’un choc de crédit, la dette publique française pourrait subir de plein fouet les conséquences d’une remontée des taux. Les conséquences sur la charge de la dette seraient d’abord modérées, puis augmenteraient progressivement. Le graphique ci-dessous montre ce qui se produirait en cas de hausse brutale des taux de 100 points de base (1 %) avec, dans le second cas, un choc simultané d’inflation de 0,5 %. Les conséquences sur la charge de la dette sont potentiellement importantes. Dans le premier cas, l’on voit que la hausse de la charge de la dette serait de 2,1 milliards d’euros dès 2016 et augmenterait chaque année pour atteindre un surcoût de 16,5 milliards d’euros dans dix ans (2025). En plus de l’impact sur la charge de la dette et donc sur le déficit de l’État, le niveau de la dette s’en trouverait également renforcé.
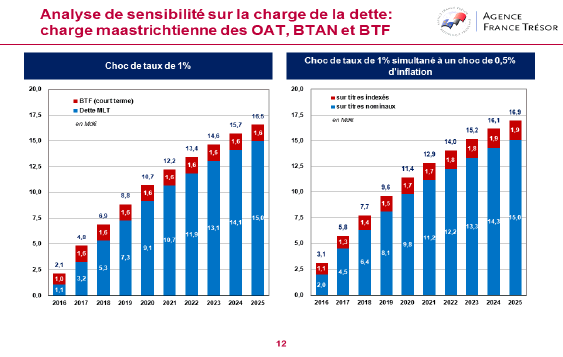
Il en résulte un équilibre précaire et paradoxal : le retour de la croissance, dans cette situation d’endettement, est à la fois souhaitable pour les recettes publiques et non-souhaitable en raison de son effet potentiellement haussier sur les taux (l’effet d’un point de croissance supplémentaire serait cependant supérieur sur le montant des recettes fiscales que l’augmentation de la charge de la dette issu d’un point de taux d’intérêt supplémentaire). Plus l’endettement est élevé, plus ce risque est fort ; mais sans endettement, le retour de la croissance est plus difficile à obtenir.
Il existe enfin un dernier risque tenant à l’utilisation du quantitative leasing (QE) dans ses formes actuelles : celui-ci se heurte non seulement à un effet limité sur l’activité économique – le marché financier ne répercutant pas forcément l’expansion monétaire sur le financement de l’économie réelle ce qui est par ailleurs source d’inégalité dans la redistribution de cette manne financière – mais il peut également contribuer à l’émergence d’une bulle financière obligataire qui représenterait une menace grave pour la stabilité, financière comme sociale, de l’ensemble des pays concernés.
3. Le risque d’émergence de nouvelles bulles spéculatives via l’assouplissement quantitatif
a. Les effets positifs du quantitative easing sur l’activité et la dette
La mise en place d’une politique monétaire non-conventionnelle par la BCE a un double objectif de stimulation de l’activité pour éviter le risque déflationniste et d’adoucissement des contraintes qui pèsent sur les finances publiques. Elle s’inscrit à la suite des politiques menées par les banques centrales américaines, britannique et japonaise :
– la Federal reserve américaine (Fed) a lancé trois programmes non-conventionnels en 2008, 2010 et 2012. Le premier, étalé sur deux ans, visait le rachat des créances toxiques : 1 700 milliards de dollars ont ainsi été investis. Le deuxième, lancé en novembre 2010 et stoppé en juin 2011, a permis l’acquisition de 1 000 milliards de dollars de bons du Trésor américain, permettant ainsi d’autofinancer la dette américaine. La politique d’assouplissement quantitatif a contribué à l’augmentation du bilan de la Fed qui atteint aujourd’hui 4 500 milliards de dollars (3 882 milliards d’euros) contre 800 milliards de dollars (708 milliards d’euros) en 2007 ;
– la Banque d’Angleterre a également pratiqué le quantitative easing entre 2009 et 2013 en rachetant plus de 375 milliards de livres sterling de dette souveraine sur la période (489 milliards d’euros) ;
– la Banque du Japon a relancé ce dispositif en 2013, le montant annuel des rachats atteignant 70 000 milliards de yens (460 milliards d’euros).
Dans le cas de l’Europe, ce programme de rachat de titres devrait in fine atteindre près de 1 660 milliards d’euros, soit environ 12 % du PIB européen, d’ici mars 2017. Le bilan de la Banque centrale européenne devrait donc dépasser 4 000 milliards d’euros, soit au-delà de l’objectif affiché en juin 2014 lorsqu’elle avait annoncé le lancement des T-LTRO (89) et un programme de rachats de crédits titrisés (ABS) et d’obligations sécurisées. L’assouplissement quantitatif pourrait être prolongé au-delà de mars 2017, si l’inflation n’atteignait pas la valeur cible espérée : près de 2 % à moyen terme. Les rachats de dette publique (PSPP - Public sector purchase programme) atteignent déjà 806 milliards d’euros en mai 2016 et ne sont pas stérilisés pour favoriser l’inflation.
Les achats de dette française par la BCE se sont élevés à 136,5 milliards d’euros entre mars 2015 et avril 2016, soit environ 10 milliards d’euros par mois en moyenne. Pour le mois d’avril 2016, avec la montée en puissance du quantitative easing (de 60 à 80 milliards d’euros par mois), ce montant a été de 14,9 milliards d’euros. Les titres français achetés par l’Eurosystème ont une maturité moyenne de 7,7 années (90).
Il est pour l’instant prévu que les achats de titres durent jusqu’en mars 2017 « ou au-delà si nécessaire et, en tout cas, jusqu’à ce que le Conseil des gouverneurs observe un ajustement durable de l’évolution de l’inflation conforme à son objectif de taux inférieurs à, mais proches de 2 % à moyen terme », pour reprendre la formule utilisée par M. Mario Draghi lors de sa conférence de presse du 10 mars 2016. Un programme supplémentaire d’achats de titres d’entreprises a commencé en juin 2016.
Dans sa mise en œuvre, le quantitative easing s’efforce de limiter tout effet d’éviction sur le secteur privé. Comme l’a précisé M. Denis Beau, directeur général des opérations de la Banque de France, lors de son audition, la Banque de France « s’efforce de peser le moins possible sur le fonctionnement des marchés […]. Un principe de neutralité est appliqué dans tout l’Eurosystème. […] On achète l’ensemble des titres en respectant la maturité moyenne des dettes sur lesquelles on intervient. En outre, les interventions ont lieu tous les jours, tout au long de la journée. C’est aussi ce souhait de limiter leurs conséquences sur la liquidité des marchés qui explique la création de dispositifs permettant de prêter à nouveau les titres achetés dès lors qu’un phénomène de rareté se ferait jour sur le marché. » (91)
Indirectement, en soutenant l’activité, en permettant le rachat de titres sur le marché secondaire et en maintenant des taux d’intérêt faibles, la politique monétaire peut permettre de contenir l’évolution de la dette.
Il convient cependant de souligner que la politique monétaire de la BCE n’a aucun effet direct sur le volume de la dette publique française puisque la BCE n’utilise pas sa capacité de création monétaire pour racheter de la dette publique sur le marché primaire, au moment de l’émission. Son mandat la limite à des rachats sur le marché secondaire, auprès d’investisseurs ou d’acteurs financiers, au cours du marché. La Cour de justice de l’Union européenne a même précisé que « l’acquisition des obligations souveraines sur les marchés secondaires ne doit pas avoir un effet équivalent à celui de l’acquisition directe de telles obligations sur les marchés primaires, ce qui pourrait être le cas si les opérateurs susceptibles d’acquérir de telles obligations sur le marché primaire avaient la certitude que l’Eurosystème va procéder au rachat de ces obligations dans un délai et dans des conditions permettant à ces opérateurs d’agir, de facto, comme des intermédiaires de l’Eurosystème pour l’acquisition directe de ces obligations » (92).
L’Eurosystème achète donc les titres sur le marché secondaire, au prix du marché. La décision de la BCE précisait que l’Eurosystème acceptait « d’être traité de la même façon (pari passu) que les investisseurs privés pour les titres de créance négociables qu’il peut acheter selon le PSPP (93), conformément aux conditions de ces instruments »
Conformément aux traités européens, les achats de titres publics réalisés par l’Eurosystème ne réduisent donc pas les dettes des États : les titres ne sont pas annulés et les banques centrales perçoivent, comme n’importe quel créancier, les coupons attachés aux obligations. On peut toutefois estimer, comme M. Patrick Artus, qu’il s’agit d’une forme de monétisation, dans la mesure où « les banques centrales reversent leurs profits ou leurs pertes aux gouvernements. Si une Banque Centrale achète de la dette publique, elle reçoit les intérêts correspondants de la part du gouvernement, puis elle lui reverse : la situation est exactement similaire à l’annulation de la dette, puisque le gouvernement, en termes nets, n’assure plus le service de la dette. » (94)
Cette politique semble avoir été efficace aux États-Unis, où la politique de quantitative easing a été mise en place dès 2008 : l’inflation de base y est maintenant proche de 2 %, voire légèrement supérieure. En Europe, elle a contribué à baisser le spread entre États, les taux d’intérêt et à relancer le crédit : les effets sont toutefois limités à l’heure actuelle.
LES EFFETS DU QE SUR L’ENVIRONNEMENT MACRO-FINANCIER
Tableau 1 : Évolution des spreads intra-ZE depuis le 1er janvier 2013 (maturité 10 ans, en pb)
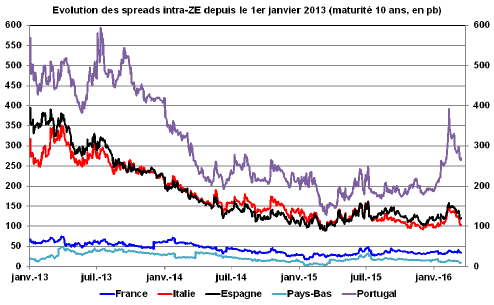
Tableau 2 : Croissance du PIB et chômage en zone euro
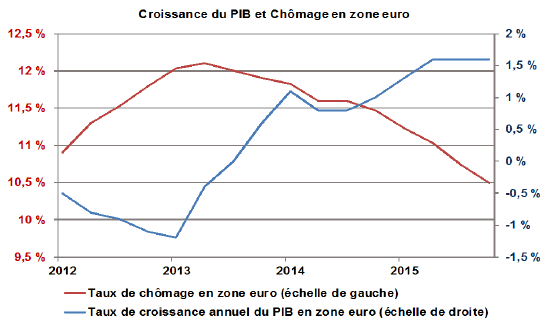
Tableau 3 : Taux des nouveaux prêts au secteur privé
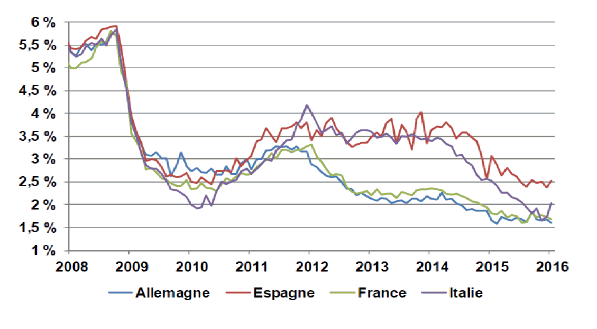
Source : AFT
Lors de son audition, Mme Natacha Valla avait cependant estimé que « la politique monétaire actuelle de la zone euro est immensément plus puissante que toutes les petites recettes que nous pourrions inventer. (…) Nous disposons là d’un outil bien plus puissant que n’étaient les avances au Trésor. »
Le discours du gouverneur de la banque de France, prononcé le lundi 23 mai 2016, va dans le même sens « je tiens à souligner que la politique monétaire de l’Eurosystème a eu globalement, en 2015, un impact positif sur la rentabilité et à la solvabilité des banques de la zone euro. La baisse des taux courts et l’aplatissement de la courbe des taux ont réduit la marge nette d’intérêt des banques, mais l’accroissement des volumes de crédit vient partiellement compenser le premier effet ; la baisse des taux améliore la solvabilité et la qualité de crédit des emprunteurs, ce qui se traduit par une baisse du coût du risque. Les banques bénéficient enfin d’une réduction du coût de leurs émissions de dette, via notamment le TLTRO ». Il alerte toutefois sur la rentabilité de certains secteurs : « il est vrai aussi que les taux bas prolongés peuvent affecter la rentabilité des secteurs bancaire et assurantiel. Dans le secteur de l’assurance, le contexte de taux bas conduit à une situation où les rendements des titres entrant en portefeuille sont inférieurs aux taux servis sur leurs polices d’assurance vie. J’appelle donc de nouveau les organismes à la prudence dans la fixation des taux de revalorisation de leurs contrats d’assurance vie. »
Mais comme l’a relevé M. Denis Beau lors de son audition, l’évaluation précise des conséquences sur les taux d’intérêt des rachats de dette publique par les banques centrales « est un exercice délicat, car de multiples facteurs jouent sur le prix de ces titres sur le marché secondaire ». Une étude de l’INSEE publiée en décembre 2015 (95) a estimé que « la hausse initialement envisagée de 1 100 milliards d’euros du bilan se traduit par une baisse d’environ 80 points de base des taux souverains de long terme ».
Pour l’AFT, le PSPP a permis d’abaisser les primes de risque sur l’ensemble de la courbe des taux, allégeant le coût d’émission des titres de la dette, qui s’établit à 0,4 % fin mars 2016 pour les émissions à moyen et long terme, contre 0,63 % en 2015. Cette baisse de taux s’est traduite par une hausse de la demande des investisseurs pour les titres de plus longue maturité, qui offrent des rendements plus élevés.
Il faut cependant préciser que la courbe des taux moyens pondérés des émissions à moyen et long terme, fournie à la mission par l’AFT montre que la baisse des taux d’intérêt sur les titres émis par l’État français est bien antérieure à la mise en place du quantitative easing. L’AFT avait déjà ponctuellement connu des taux négatifs sur des emprunts à court-terme, dès la mi-juillet 2012, soit bien avant la décision de la BCE de faire passer son taux de dépôt sous la barre du zéro et la mise en place du programme d’achats de titres publics. Le graphique ci-dessous ne concerne cependant que les émissions à moyen et long terme.
TAUX MOYEN PONDÉRÉ DES ÉMISSIONS À MOYEN ET LONG TERME
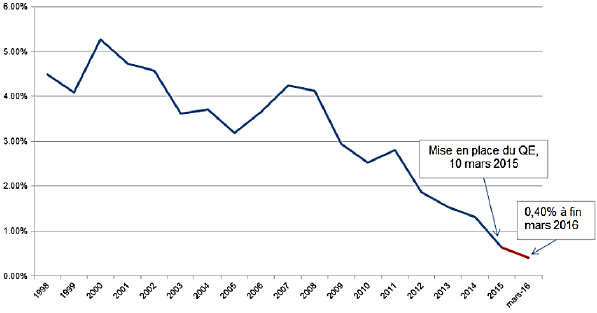
Source : Agence France Trésor.
Pour M. Philipp Hildebrand, vice-président de la société de gestion d’actifs BlackRock et ancien président de la banque centrale suisse, « ce n’est pas la politique de la BCE qui engendre les taux négatifs. Les taux bas constituent un phénomène global lié au fait qu’il y a trop d’épargne et pas assez d’investissements. Et il n’y a pas assez d’investissements parce que les agents économiques (consommateurs et entreprises) n’ont pas confiance dans l’avenir. C’est précisément cette confiance que la BCE essaye de rétablir. Cette politique expansionniste n’est donc pas la cause mais la conséquence. » (96)
Rappelons que l’objectif premier de la mise en place de ce programme par la BCE n’était pas de faire baisser les rendements des obligations souveraines, mais de ramener l’inflation à un niveau inférieur mais proche de 2 %. De ce point de vue, l’objectif est loin d’être atteint, puisque l’inflation en France s’est élevée à -0,1 % en glissement annuel en avril 2016 (et - 0,2 % dans la zone euro). Certains économistes soulignent toutefois que les résultats auraient été pires sans l’intervention de la BCE.
Dans ce contexte, la plus grande incertitude règne sur la durée du quantitative easing. Si des économistes comme Patrick Artus évoquent un « piège de l’irréversibilité » quand les taux d’intérêt ont été durablement bas (97), des contestations de plus en plus vives de la politique de la BCE se font entendre, notamment en Allemagne. Les effets bénéfiques sur les taux d’intérêt des dettes souveraines sont contrebalancés par les risques de fragilisation des banques et des compagnies d’assurances, la pénalisation des épargnants et la création d’une bulle obligataire dont l’éclatement aurait de lourdes conséquences.
En toute hypothèse, il importe de se préparer dès aujourd’hui à la fin programmée du quantitative easing et à une remontée des taux d’intérêt découlant, dans le meilleur des cas, de la consolidation de la croissance et de la reprise de l’inflation, mais qui peut aussi résulter d’une simple normalisation d’une situation exceptionnelle ou, dans le pire des cas, du déclenchement d’une nouvelle crise financière.
Proposition : Se préparer à la remontée des taux d’intérêt en sécurisant une plus grande partie de la dette aux taux exceptionnellement bas consentis actuellement et en élaborant des modes de financement moins dépendants des marchés financiers.
b. Les limites du quantitative easing : hausse des inégalités, risque de bulle financière, efficacité limitée de la transmission de la politique monétaire
Cette politique comporte en outre quelques risques. En premier lieu, un risque de bulle obligataire auquel la BCE se montre très attentive. On constate en effet une augmentation de la valorisation des actifs financiers : l’augmentation de la valeur des titres obligataires est une conséquence directe de la baisse des taux d’intérêt.
Celle-ci a théoriquement enrichi les détenteurs d’obligations à taux élevé, mais elle met maintenant en difficulté les assureurs et fonds de pension qui ne peuvent plus servir des rentabilités élevées. Par conséquent, les liquidités des banques centrales contribuent à nourrir la bulle obligataire, qui pourrait éclater si elles décidaient d’augmenter les taux d’intérêt. Or, si le marché obligataire décrochait, les conséquences sur l’économie réelle seraient considérables, car les entreprises et les États se trouveraient contraints de diminuer leurs dépenses. L’effondrement obligataire n’est pas certain, mais on ne peut pas l’exclure.
Cette situation résulte notamment de l’absence de ciblage de la mise à disposition des liquidités qui passe uniquement par l’intermédiaire du marché. Cela conduit non seulement à enrichir les banques, via un effet d’aubaine, puisque ce mécanisme leur permet d’acquérir sur le marché primaire une dette publique garantie par la BCE quelle que soit la qualité de la dette tout en réalisant des marges considérables, mais cela contribue également au développement des inégalités.
En effet, le double mouvement de réduction des recettes fiscales (en pourcentage du PIB) et la substitution d’un mode de financement par les marchés financiers au financement de l’État par des avances à taux nul reviennent à accorder une "double remise" à la partie fortunée de la population en mesure d’accumuler de l’épargne. En effet, l’épargne des ménages est d’autant plus abondante que la pression fiscale qui s’exerce sur leurs revenus est faible, et le financement de l’État par les marchés permet de donner une rentabilité significative à ces revenus qui auraient pu, sans cela, être taxés. Dit autrement, l’augmentation de la dette publique française permet un transfert de richesse au profit des ménages les plus aisés.
C’est notamment le constat de la Banque des règlements internationaux (BRI) dans son dernier rapport trimestriel. Depuis la mise en place du quantitative easing, la richesse des ménages les plus favorisés a progressé deux fois plus vite que celle des plus pauvres en Allemagne et en Italie, quatre fois plus vite aux États-Unis et cinq fois plus vite en France. Le rapport indique ainsi que « en poussant le cours des actifs à la hausse, la politique monétaire a exercé sur les inégalités deux pressions en sens contraire : une réduction, par la hausse des prix de l’immobilier, et un accroissement par l’augmentation du cours des actions », selon la BRI. Mais, « alors que les taux d’intérêt bas et la hausse du prix des obligations n’ont eu qu’un impact négligeable sur les inégalités de richesse, la forte hausse des actions (+ 195 % pour le S&P 500 depuis 2009), plus cyclique et moins persistante, a été le principal moteur de l’inégalité. Le redressement du prix des maisons dans la plupart des pays ne l’a que partiellement compensé ». Les plans de rachats d’actifs et les taux bas, voire négatifs, sur une longue durée, ont en effet eu comme conséquence de pousser les investisseurs privés vers les actifs les plus rentables et les plus risqués, d’en augmenter le prix, créant ainsi plus d’inégalité.
Dans ce contexte, les membres de la mission plaident pour une politique monétaire mieux ciblée, qui permettrait de dégager des marges de manœuvre pour les États et de financer des investissements socialement utiles, sans passer forcément par l’intermédiaire des marchés financiers.
Dès lors, on doit se poser de façon prospective de la question des leviers d’action, que ce soit par des ruptures radicales à travers la réforme des traités (en permettant à la BCE de financer les États sur le marché primaire) ou par l’utilisation des marges de manœuvre existantes dans les traités (financement des organismes publics de crédits, comme la BEI, par la BCE).
B. LES POSSIBILITÉS DE RÉDUIRE L’ENDETTEMENT PAR UNE RÉFORME DU CADRE EN VIGUEUR
L’endettement public, comme l’endettement privé, pourraient être limités par des mesures techniques et politiques compatibles avec le cadre juridique en vigueur. Mener une action plus ambitieuse, suppose cependant de se poser la question de sa modification.
1. Faire évoluer le rôle de la BCE : monétiser les dettes publiques ou permettre un financement monétaire ciblé ?
La transmission insuffisante de la politique monétaire à l’économie réelle empêche le redémarrage de l’inflation et de la croissance. En effet, l’assouplissement monétaire, non dénué d’efficacité, se heurte cependant à des limites conséquentes comme indiqué ci-dessus. Non seulement il ne permet pas d’agir directement sur le niveau d’endettement des États mais il n’est pas non plus suffisant, à l’heure actuelle, pour permettre un redémarrage de la croissance et de l’inflation, dont le rôle en matière de réduction des déficits et de la dette publique sont au moins aussi importants que l’équilibre budgétaire.
En particulier, la transmission de la politique monétaire à l’économie réelle, qui s’opère via les banques et le marché financier, n’atteint pas les résultats espérés. L’impact supposé du multiplicateur monétaire, selon laquelle les banques commerciales créeront x euros qui alimenteront l’économie réelle pour chaque euro émis par la banque centrale, ne correspond en effet pas à la réalité. Les banques privées ne prêtent, en effet, que si une demande leur est adressée et que l’opération est potentiellement rentable.
Ces deux conditions n’ont pas été remplies depuis 2008, car la demande de crédit s’est effondrée à cause du surendettement du secteur privé et les investissements actuellement nécessaires, notamment en matière de transition énergétique, n’offrent pas un caractère de rentabilité suffisant par rapport aux rendements offerts par les marchés financiers, quand bien même leur utilité sociale serait nettement supérieure. Les banques mixtes qui exercent à la fois des activités de marché et de réseau préfèrent prendre part à des opérations à fort effet de levier spéculatif sur les marchés financiers, puisqu’elles disposent de l’assurance publique liée à la garantie des dépôts qui agit comme une garantie de la part de la collectivité et qui les incite à prendre des risques.
Enfin, les règles de fonctionnement de la zone euro ont amplifié la crise des dettes souveraines, puisqu’elles ont imposé un ajustement budgétaire bien plus contraignant qu’ailleurs, notamment aux États-Unis. La Banque d’Angleterre (BoE), la Fed et la banque centrale du Japon ont conduit des politiques monétaires différentes de celle de la BCE. Ainsi la BoE n’a pas hésité à racheter massivement de la dette publique sur le marché primaire, ce qui a réduit le coût de la dette en exerçant une pression à la baisse sur les taux d’intérêt et a également contribué à stabiliser les marchés en limitant la spéculation ; la BCE, fort contrainte par ses statuts, a choisi une autre orientation. Elle n’est pas intervenue dans un premier temps, puis n’a agi que sur le marché secondaire.
a. La transmission de la politique monétaire pourrait être facilitée par le recours à des instruments directs de financement
• Un financement des établissements publics de crédits par la BCE ?
De nouvelles solutions méritent d’être étudiées. À titre d’exemple, l’Australie, a pratiqué le QE for people en 2009 juste après la crise financière. Cet instrument permet de distribuer directement aux citoyens de l’argent issu de la création monétaire de la banque centrale, ex nihilo, c’est-à-dire à partir de rien et sans remboursement. Ceci a vraisemblablement permis à l’Australie d’éviter une récession importante. Au contraire, elle a permis aux ménages surendettés d’être à nouveau solvables. Ce succès ne signifie pas que n’importe quel QE for people fonctionnerait dans n’importe quelle situation, mais on peut se poser la question de savoir s’il serait opportun de l’importer en Europe.
Une autre option serait que la BCE s’accorde avec les États et les institutions européennes sur la politique industrielle nécessaire à la relance de la croissance, une croissance qui pourrait d’ailleurs être ciblée sur des actions d’intérêt général comme la transition énergétique.
Cela suppose en premier lieu de réfléchir au mode de financement. À l’heure actuelle, les banques centrales de l’Union européenne (UE) ne peuvent pas procéder à des opérations de « financement monétaire » qui leur sont interdites par l’article 123 du TFUE et les statuts du Système européen des banques centrales. Il est donc impossible pour la BCE ou toute autre banque centrale de l’Eurosystème de ne pas exiger le remboursement d’un titre de dette souveraine arrivé à maturité. De même, elles ne peuvent pas non plus convertir ces titres en perpétuités, c’est-à-dire les garder indéfiniment sans exiger de remboursement. Cependant, aucune limite technique ou juridique ne pèse sur la taille du bilan de la BCE, ce qui signifie que son pouvoir de création monétaire est potentiellement illimité et ne repose in fine que sur la confiance des citoyens dans leur monnaie.
Surtout, les traités permettent de financer directement les organismes publics de crédits de la zone euro, à commencer par la Banque européenne d’investissement (BEI). L’article 123-2 du traité de Lisbonne traite des opérations de refinancement (c’est-à-dire de la fourniture de liquidités) aux établissements publics de crédit par la BCE. Ceux-ci bénéficient, ainsi, des mêmes possibilités de financement que les établissements privés de crédit. En France cela pourrait être, par exemple, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque publique d’investissement (Bpifrance) ou encore la Banque postale, lesquels pourraient s’en servir pour financer des actions de développement industriel concertées avec le Gouvernement et les institutions européennes.
Au niveau communautaire, rien ne s’oppose également à ce que la BCE finance massivement la BEI par le biais d’une création monétaire pure (en retour de laquelle on n’exige aucun remboursement), laquelle financerait à son tour les organismes publics nationaux de crédits tels que, dans le cas de la France, la BPI. Cette opération conduirait à une augmentation significative de la masse monétaire qui atteindrait directement l’économie réelle et pourrait permettre de relancer l’activité et, par conséquent, l’inflation, avec l’ensemble des effets bénéfiques qui en sont attendus sur le niveau des dettes publiques comme privés. La transition énergétique pourrait être financée par ce biais, d’autant plus que le coût de l’inaction dans ce domaine représente un risque potentiellement beaucoup plus important à terme sur la dette des États ainsi que le montrent les rapports du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). En cas de surcroît d’inflation, perspective aujourd’hui très lointaine, il serait aisé de stopper cette politique.
Au sein des banques publiques, des départements spécifiquement outillés pour piloter les opérations de transition pourraient être identifiés afin d’assurer une traçabilité maximale des projets bénéficiant de la création monétaire de la BCE. Au niveau comptable, ces investissements de transition devraient être exclus du calcul du déficit « au sens de Maastricht », par exemple, en les traitant comme des immobilisations à l’instar de la comptabilité d’entreprise et en les amortissant sur des durées économiques à préciser (98). Il faudrait, également, isoler le plan d’investissement du calcul de l’endettement public car les intérêts nuls n’alourdiront pas le service de la dette qui serait de plus émise à très long terme (vint ou trente ans, voire plus dans certains cas). Ces investissements généreraient, de plus, des recettes pour les États (via la réduction du chômage et les prélèvements sur les nouvelles activités) participant ainsi au rééquilibrage des budgets nationaux.
Proposition : Permettre un financement de la BEI et des autres organismes publics de crédits par création monétaire directe de la BCE afin de relancer l’investissement et de favoriser la transmission de la politique monétaire à l’économie réelle.
• Un financement monétaire direct des États ?
Si ce type d’opérations peut se mener dans le cadre des traités actuels (99), sous l’impulsion d’une volonté politique, on peut aussi se poser la question de l’opportunité d’un financement monétaire direct des États, qui lui ne peut se faire qu’en renégociant les traités actuels. En effet, cela reviendrait à une monétisation de la dette publique, opération par laquelle la dette publique est remplacée par la monnaie : l’État (ou la banque centrale liée à l’État) crée de la monnaie, rachète la dette publique détenue par les agents économiques et la détruit tout en la conservant dans le bilan consolidé de l’agent économique (État et banque Centrale, qui n’est qu’un seul agent économique, l’État « souverain »). La solvabilité de l’État est alors améliorée puisque le niveau de dette publique est directement réduit.
Ceci est très différent de la politique de la BCE d’achats de dette publique : la dette publique est rachetée aux investisseurs contre création monétaire, mais est conservée dans le bilan de la BCE qui est un agent économique distinct des États. Ceux-ci doivent continuer à assurer le service de leur dette publique, y compris celle détenue par la BCE : leur solvabilité n’en est donc pas améliorée, même si les achats de la BCE peuvent éviter une crise de liquidité (la dette publique émise est achetée par la BCE).
Le risque de défaut pour la dette publique détenue par les investisseurs autres que la BCE est même accru, puisque la BCE ne veut pas participer aux programmes de réduction de la dette publique qui peut s’appliquer aux autres investisseurs (haircut (100), PSI), ce qui concentre le risque de perte sur ces autres investisseurs.
S’il y avait une « vraie monétisation » dans la zone euro, la quantité de monnaie augmenterait et la dette publique baisserait, ce qui n’est pas le cas. Cette monétisation améliorerait la solvabilité de l’État et réduirait le risque de défaut sur la dette publique.
Cela nécessiterait une réforme de l’article 123 du TFUE qui précise, à l’heure actuelle, que « l’acquisition directe, auprès d’eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite ».
Or, cette disposition des traités n’a rien d’évident en soi. En effet, la création monétaire publique n’a été combattue qu’à partir du moment où s’est imposée progressivement l’idée que la puissance publique serait par nature incapable d’utiliser efficacement l’outil de la création monétaire. Celui-ci, logiquement, a alors été réservé aux banques privées et à la BCE (laquelle est, par son statut, prêteur en dernier ressort des banques mais non des États). Or, si l’on oblige les États à s’endetter auprès d’investisseurs privés, on crée en effet des gagnants, en l’occurrence les institutions financières qui se chargent de financer les États et qui ne le font pas gratuitement.
b. Cette approche suppose cependant des évolutions importantes des mentalités et de la législation
La défiance à l’égard des autorités publiques n’a aucun fondement analytique, ni même empirique : on ne voit guère pourquoi les représentants légitimes des citoyens en charge de la gestion de l’intérêt général seraient nécessairement moins vertueux dans l’usage de la création monétaire que des acteurs privés qui maximisent leur intérêt privé à court terme.
Empiriquement, si des épisodes d’excès de dépenses publiques permis par une création monétaire publique ont bel et bien existé, il convient de rappeler que d’autres épisodes de gestion efficace de la « planche à billets » existent tout autant : la politique monétaire ouest-européenne des Trente Glorieuses qui, sur un sentier de croissance inflationniste, a permis la reconstruction de l’Europe en est l’illustration.
L’obstacle de la révision des traités ne doit cependant pas empêcher de réfléchir à des solutions innovantes, notamment lorsqu’elles sont appuyées par des économistes tels que Lord Adair Turner, président de l’autorité de régulation des services financiers en Grande-Bretagne. Selon son analyse (101), les injections de « monnaie hélicoptère (102) » auraient ainsi été la meilleure solution pour relancer la croissance dans les économies avancées après la crise financière de 2008. Il considère d’ailleurs que cette solution demeure valide pour le Japon et la zone euro. La création monétaire publique, par le biais d’obligations à long terme détenues de manière permanente par la BCE (idée déjà avancée par les économistes Giavazzi et Tabellini), pourrait permettre aux pays de la zone euro de financer une baisse d’impôt simultanée pour une durée de trois ans afin de relancer l’activité tout en réduisant la concurrence fiscale, et cela sans alourdir le déficit public puisque l’argent nécessaire à cette opération serait fourni de la même manière que pour le quantitative easing.
Il serait aussi possible d’annuler une partie des dettes gouvernementales détenues par les banques centrales, au Japon par exemple, ou au Royaume-Uni, pays dans lequel la Banque d’Angleterre détient des obligations gouvernementales pour une valeur d’environ 23 % du PIB.
2. La possibilité et les problèmes posés par une restructuration concertée de la dette
Face à un fardeau qui s’alourdit constamment, il n’est plus impensable qu’une partie de la dette publique doive in fine faire l’objet d’un « haircut » ou d’une restructuration concertée. Celle-ci peut prendre essentiellement deux formes : une restructuration dans le temps (sous forme d’étalement) ou une restructuration de sa valeur (un abaissement).
Le prix Nobel d’économie Paul Krugman avait ainsi proposé un plafond acceptable de remboursement de dette publique visant à contrebalancer « l’effet boule de neige ». Cette idée pourrait se résumer de la manière suivante : si l’on fait le constat que le poids de la dette s’autoalimente dès lors que le taux de croissance de la charge de la dette est supérieur au taux de croissance de l’économie (sur lequel se fonde, à fiscalité constante, l’évolution des recettes fiscales) alors le remboursement ne devrait pas excéder la proportion d’intérêts rapportée au taux de croissance. Autrement dit, il convient de limiter le poids des remboursements en fonction du rythme d’accroissement de la richesse du pays. S’en tenir à cette idée supposerait vraisemblablement une restructuration de la dette dans la plupart des pays européens.
Autre hypothèse, l’annulation de tout ou partie de la dette publique afin de regagner les marges de manœuvre nécessaires pour redonner du souffle à l’économie et à l’État. À cet égard, il convient de souligner que tous les emprunts publics européens relèvent d’une clause d’action collective ; si un pays se trouve en difficulté et souhaite restructurer sa dette, et que la majorité de ses créanciers acceptent la négociation, alors la minorité ne peut pas la bloquer.
La restructuration ou l’annulation d’une dette publique n’est pas quelque chose d’impossible ou d’irréel. L’histoire est émaillée d’exemples de défauts sur les dettes souveraines. L’effacement des dettes a existé dès l’Antiquité pour des raisons politiques et sociales. Il compense des processus d’appauvrissement et d’aliénation récurrents : il suffisait de malchance, de maladies, de mauvaises récoltes, pour que facilement un petit propriétaire rural doive se transformer en fermier, pour qu’il aliène un champ pour payer ses dettes, pour qu’il en vienne même à aliéner dans l’esclavage ses enfants ou sa propre personne, pour éteindre ses dettes. Dans la Mésopotamie antique, les rois babyloniens effaçaient l’ardoise des créditeurs. Des siècles plus tard, la loi biblique du Jubilé disposait que toutes les dettes seraient automatiquement annulées tous les sept ans.
La France a également recouru à ce type de mesures. La banqueroute de 1797, dite des « deux tiers » puisqu’elle ne portait que sur les deux tiers de la dette, en est l’exemple le mieux connu qui a permis de solder la dette considérable accumulée sous l’Ancien régime (4 milliards de livres – plus de 80 % du PIB d’après des estimations « alors que les recettes de l’État n’excédaient guère 500 millions et que les dépenses atteignaient 630 millions ») (103). Pour faire face à cette situation, les assemblées révolutionnaires décidèrent l’égalité de tous devant l’impôt et la vente au profit du pays des biens du clergé grâce notamment à l’émission d’assignats. Toutefois, la période révolutionnaire ne se prêtant pas à la collecte des impôts, quand la situation politique s’est stabilisée, le Directoire décida d’effacer autoritairement les deux tiers de la dette.
De manière plus générale, on constate qu’entre 1946 et aujourd’hui il y eu 169 cas de suspension de paiement ou d’annulation de dettes à travers le monde. Les exemples de l’Argentine, de l’Équateur et de l’Islande, souvent cités, ne sont que les cas d’annulation de dettes les plus récents.
Des annulations de dette souvent provoquées par des crises
L’Argentine, a suspendu le paiement de sa dette pour un montant de 90 milliards de dollars fin 2001. Les grandes banques nord-américaines, italiennes et allemandes détenaient la partie la plus importante des titres de la dette argentine. L’année qui suivit fut une année de troubles politiques et sociaux et de fermeture des débouchés vers l’étranger. Mais l’Argentine réussit, dès 2003, à relancer la croissance qui a oscillé de 7 à 9 % entre 2003 et 2009. Dans les faits, ce que l’Argentine a négocié avec ses créanciers internationaux plus qu’elle n’a annulé sa dette. Le pays avait proposé une décote (exonération) de 65 dollars sur chaque titre de sa dette publique décote qui fut acceptée par la plupart des créanciers qui ne pouvaient plus vendre ces titres à un prix suffisant sur le marché secondaire. 76 % des titres ont alors été ainsi modifiés, ce qui a permis une réduction des deux tiers de la dette. Il convient en outre de souligner que le pays, dès 2003, pouvait réemprunter comme auparavant sur les marchés financiers.
Dans le cas de l’Islande, le déclencheur a été la faillite des banques privées en 2008. Leurs dettes cumulées constituaient environ dix fois le PIB du pays et l’État n’avait pas les moyens de les refinancer. Les Gouvernements britanniques et néerlandais ont alors exigé du Gouvernement islandais qu’il leur verse des compensations car eux-mêmes avaient garanti les dépôts de leurs citoyens. L’Islande a refusé de rembourser une dette engendrée par une crise bancaire privée dont le Gouvernement n’était pas jugé responsable. En fin de compte, le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont poursuivi l’Islande devant un tribunal d’arbitrage qui, trois ans plus tard, a donné raison à cette dernière. Par l’annulation de cette dette, l’Islande n’a pas connu non plus de chaos social ni d’effondrement de son activité économique.
À chaque fois l’on constate que l’effacement des dettes revient fondamentalement à un accroissement, validé ex-post, de la masse monétaire puisqu’il ne s’agit ni plus ni moins que d’une entorse à la loi du reflux (qui consiste à détruire l’argent créé par les banques au moment du prêt dès lors qu’on procède à son remboursement).
L’effacement de dettes est finalement un autre moyen de création monétaire sans contrepartie. Il permet d’aligner la masse monétaire à la réalité économique d’un pays à un moment donné. Certes, il ne dit rien sur la légitimité de la manière dont ce surcroît de monnaie validé a posteriori a été dépensé mais il acte le fait que sans cet alignement, c’est-à-dire sans convergence de la masse monétaire réelle avec la masse monétaire issue de la dette, le système se retrouve face à un déséquilibre global dont les effets sont potentiellement très destructeurs.
Dans cette configuration, tout acharnement à rembourser la dette publique, c’est-à-dire à rompre cet équilibre, renvoie le pays à son état économique antérieur, annihilant ainsi en partie la création de valeur qui en a résulté.
3. Transformer le FESF en banque ?
La transformation du Fonds européen de stabilité financière (FESF) en banque, c’est-à-dire lui accorder une licence bancaire, afin qu’il puisse prêter aux États de l’argent au même taux qu’il emprunte à la banque centrale a souvent été évoquée.
Cela permettrait d’éviter le recours aux marchés financiers pour une partie de la dette, et donc d’aider à prémunir les États contre le risque de hausse des taux d’intérêt. Et cela ne reviendrait pas à monétiser la dette des États puisqu’il ne s’agit pas d’un scénario de création monétaire pure, mais bien d’un schéma de type loi du reflux (prêt et remboursement de prêts) : seul changerait le loyer de l’argent prêté.
Pour rappel, à la suite du sommet de l’Eurogroupe du 11 mars 2011, le FESF a d’ores et déjà la capacité d’acheter de la dette publique primaire, c’est-à-dire nouvellement émise, des États. Il peut également intervenir sur le marché secondaire ou prêter à des États en situation difficile. Toutefois, son action est conditionnée à l’avis unanime des pays participants et de la Banque centrale européenne, notamment dans le cadre du Mécanisme européen de stabilité (MES) instauré en 2012.
Or, le MES, institué par l’article 136 du TFUE, prévoit que les États bénéficiaires doivent s’engager à prendre des mesures précises qui conditionneront l’octroi du prêt ou l’intervention sur le marché primaire de la dette (c’est-à-dire sur les titres de dette nouvellement émis). Or, ce système de conditionnalité des aides, qui se résume souvent à des mesures d’austérité, participe de la limitation du pouvoir budgétaire des États au lieu de leur apporter les marges de manœuvre nécessaires pour investir et relancer la croissance, conformément aux enseignements de la théorie dynamique de la dette.
Proposition : Accorder une licence bancaire au FESF
4. Recourir plus largement aux garanties publiques ?
S’interroger sur les moyens innovants de stimuler la croissance sans alourdir le déficit conduit à poser la question d’un recours accru aux garanties publiques que pratique déjà l’État dans les plans industriels à travers l’action de la BPI notamment.
Une garantie de l’État est un engagement par lequel celui-ci accorde sa caution à un organisme dont il veut faciliter les opérations d’emprunt en en garantissant au prêteur le remboursement en cas de défaillance du débiteur. En application de l’article 34 de la LOLF, une garantie doit être autorisée par la loi de finances et fait l’objet d’un plafond. En comptabilité nationale comme en comptabilité budgétaire, les garanties, tant qu’elles ne sont pas appelées, ne sont pas intégrées à la dette publique. La dette garantie reste celle de l’émetteur aussi longtemps que celui-ci n’appelle pas la garantie. Ces engagements hors bilan correspondent à des engagements dont la valorisation s’avère incertaine et dépend du futur. En cas de réalisation d’un événement donné, la responsabilité de l’État peut être appelée. Ils sont ainsi susceptibles de peser à terme sur les finances publiques, et font donc l’objet d’un suivi très attentif.
Les garanties de l’État recouvrent une large gamme d’interventions ayant vocation à soutenir l’activité économique ou à assurer un financement à certains agents économiques dans les cas où l’intervention du marché apparaît insuffisante. Il s’agit de garanties octroyées dans le cadre d’accords bien définis, parmi lesquelles on trouve notamment les dettes garanties par l’État, les garanties liées à des missions d’intérêt général (mécanismes d’assurance via la Caisse centrale de réassurance, garanties accordées à la Coface pour le soutien à l’exportation, garanties de protection des épargnants, etc.), les garanties de passif (engagement au titre de la quote-part française au capital appelable du MES) ainsi que les engagements financiers de l’État (projets de cofinancement, aide au développement).
En réalité, le risque ne se matérialise que rarement, et il est largement inférieur aux bénéfices retirés par ce type de méthode qui constitue un palliatif à l’absence de prise de risque du secteur bancaire privé. L’État devrait porter ce risque au regard même des bénéfices qu’il en retirera ultérieurement.
Proposition : Recourir plus largement aux garanties publiques pour financer l’investissement.
Maîtriser l’évolution de la dette en favorisant l’investissement
● Renforcer l’évaluation des politiques publiques, évaluer régulièrement l’efficacité des dépenses fiscales et tirer les conséquences de ces évaluations.
● Renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, en veillant particulièrement à ce que la dette française ne puisse servir à enrichir des investisseurs installés dans des paradis fiscaux.
● Recourir plus largement aux garanties publiques pour financer l’investissement.
● Injecter davantage de ressources dans des fonds d’investissement publics, dans la mesure où leur impact est neutre au sens de la comptabilité nationale.
Limiter la charge de la dette
● Étudier les coûts et avantages de l’introduction de clauses de remboursement anticipé dans les obligations émises par l’État.
● Profiter davantage des opportunités de marché pour réduire la charge de la dette sur le long terme.
● Se préparer à la remontée des taux d’intérêt en sécurisant une plus grande partie de la dette aux taux exceptionnellement bas consentis actuellement.
● Se poser la question de prévoir une limite au remboursement annuel de la dette publique en fonction du niveau d’évolution de la croissance et de l’inflation afin de stopper l’effet boule de neige.
Renforcer la transparence
● Préciser dans les documents budgétaires de la mission Engagements financiers de l’État le montant des commissions de syndication.
● Lever les verrous interdisant à l’État de connaître ses créanciers en permettant l’identification des détenteurs des obligations émises par les personnes morales de droit public (article L. 228-2 du code de commerce).
Favoriser des modes de financement moins dépendants des marchés financiers
● Étudier les possibilités d’une mobilisation de l’épargne des ménages pour financer des grands projets d’avenir.
Des pistes pour redonner des marges de manœuvre aux États
par une évolution des règles européennes
● Accorder une licence bancaire au Fonds européen de stabilité financière (FESF).
● Permettre un financement de la Banque européenne d’investissement (BEI) et des autres organismes publics de crédits par création monétaire directe de la Banque centrale européenne (BCE) afin de relancer l’investissement et de favoriser la transmission de la politique monétaire à l’économie réelle.
● Obtenir de la Banque centrale européenne que les taux d’intérêt négatifs ne s’appliquent pas aux dépôts des administrations publiques auprès de la banque centrale.
● Ne pas limiter la liste des investissements pris en compte dans la clause d’investissement aux seuls projets cofinancés par l’Union européenne et permettre aux États soumis à une procédure pour déficit excessif de recourir à la clause d’investissement afin de sortir de l’effet procyclique du pacte de stabilité.
● Soustraire du calcul du déficit public les dépenses liées directement à des opérations militaires intéressant la sécurité de l’Europe et approuvées par le Conseil européen.
Lors de sa réunion du 6 juillet 2016, la commission a examiné le rapport d’information de la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur la gestion et la transparence de la dette publique (MM. Jean-Claude Buisine, Jean-Pierre Gorges et Nicolas Sansu, rapporteurs).
M. le président Gilles Carrez. Nous examinons aujourd’hui le troisième et dernier rapport de la Mission d’évaluation et de contrôle au titre de 2016. Je laisse la parole aux rapporteurs.
M. Jean-Claude Buisine, rapporteur. Je souhaiterais d’abord rappeler quelques chiffres : depuis 1974, aucun budget n’a été voté en équilibre, et la dette publique n’a cessé de progresser, passant de 20 % du PIB à la fin des années 1970 à près de 96 % du PIB aujourd’hui, soit 2 096 milliards d’euros à la fin de l’année 2015. Cette situation de fort endettement est inédite sous la Ve République, mais elle ne l’est pas dans l’histoire : en 1944, par exemple, l’endettement a atteint près de 280 % du PIB, avant d’être réduit drastiquement sous l’effet de l’inflation et de retomber à moins de 30 % du PIB en 1950.
Pour ce qui est de la période actuelle, je voudrais souligner trois points.
Le premier est qu’un fort niveau d’endettement public n’est pas propre à la France : la plupart des pays industrialisés ont suivi ce même chemin, alors même que les orientations politiques et idéologiques étaient sensiblement différentes. Dans ce phénomène généralisé d’endettement, une partie importante relève donc des mécanismes de fonctionnement du système économique et financier tel qu’il s’est développé depuis une quarantaine d’années.
Le deuxième point est que la dette touche également le secteur privé, dans des proportions plus importantes encore que le secteur public. Le secteur privé non financier en France est ainsi endetté à hauteur de 124,8 % du PIB en 2015, et l’endettement du secteur financier, à l’échelle de la zone euro, atteint près de 150 % du PIB.
Enfin, la dette publique ne se résume pas uniquement à un fardeau : elle est d’abord liée à la constitution du bien public. Ce n’est donc pas tant le niveau de la dette publique qui importe que sa soutenabilité, c’est-à-dire notre capacité à l’honorer sans nous appauvrir et sans réduire excessivement nos marges de manœuvre.
Or, malgré la réduction des taux d’intérêt sous l’effet de politiques monétaires ambitieuses, le taux apparent sur l’ensemble de notre dette publique – 2,2 % – demeure largement supérieur au taux de croissance, ce qui alimente un « effet boule de neige », que le président Gilles Carrez avait mis en évidence dès 2010 dans ses précédentes fonctions de rapporteur général.
Face à ce constat, il nous a semblé nécessaire d’analyser les causes multiples de notre endettement, avant de traiter du sujet de la gestion de la dette et de la question de sa transparence, dont parlera Nicolas Sansu. Enfin, nous nous sommes interrogés sur les solutions qui pourraient réduire notre endettement tout en maintenant la capacité à investir et à appuyer le développement de l’activité, point que présentera Jean-Pierre Gorges.
Je profite de ma position de premier orateur pour saluer les équipes de l’Agence France Trésor (AFT), dont le professionnalisme a été reconnu par tous les interlocuteurs que nous avons auditionnés. Leur travail a, certes, une limite : celle d’un financement fortement contraint et qui a profondément évolué en quelques décennies. C’est pourquoi nous avons aussi souhaité analyser les phénomènes à l’œuvre dans la progression de l’endettement, lesquels relèvent, selon notre analyse, de trois causes principales.
La première est, bien entendu, le déficit permanent de l’État. La part des dépenses publiques en proportion du PIB est ainsi passée de 35 points de PIB en 1960 à 56,8 points en 2015. Dans la mesure où la hausse concomitante des prélèvements obligatoires n’a pas suffi à couvrir la dépense publique, la différence a été nécessairement financée par l’endettement. Je tiens néanmoins à rappeler l’effort poursuivi depuis 2012, qui a permis de diviser par deux le niveau du déficit public par rapport aux points hauts atteints en 2009 et 2010.
La Cour des comptes cependant a constaté un net recul de la part de l’investissement dans les dépenses : en 2015, sur un accroissement de l’endettement de 93 milliards d’euros, seuls 11,7 milliards ont été consacrés à l’investissement, soit 12 %. La progression de l’endettement répond donc essentiellement à celle des charges d’activité de l’État : personnel, fonctionnement, mais aussi dépenses d’intervention.
Parallèlement, les recettes en pourcentage du PIB ont baissé de façon permanente. Un vrai travail d’évaluation dynamique des recettes et des dépenses fiscales mérite donc d’être mené et suivi.
La croissance de l’endettement tient à un second facteur majeur : l’évolution du mécanisme de financement de l’État, laquelle est intervenue en même temps qu’un durcissement de la politique monétaire : je veux parler de la disparition du « circuit du Trésor », qui permettait à l’État de drainer l’épargne des banques et des particuliers, à des conditions qu’il définissait lui-même. Il pouvait, en outre, compter sur la banque centrale pour lui fournir des avances, voire pour monétiser sa dette. Ce système, qui permettait à l’État de se financer sans trop de difficultés, a progressivement été remplacé par un financement passant exclusivement par les marchés.
Cela devait permettre à l’État d’accroître sa capacité de financement – ce qui a été le cas –, mais aussi de rendre la dette plus transparente et de mieux maîtriser la masse monétaire. Force est de constater que ces derniers objectifs n’ont pas été atteints. Si l’État peut en effet faire appel aux liquidités à l’échelle internationale, cet appel au marché a un coût considérable : entre 1978 et 2014, la France a versé 1 254 milliards d’euros d’intérêts pour la dette de toutes les administrations publiques confondues.
La transparence n’existe pas plus, et même plutôt moins, sur les détenteurs de la dette publique. Quant à la volonté de mieux maîtriser la masse monétaire, la disparition du circuit du Trésor n’a pas empêché l’émergence de bulles financières ou immobilières.
La question de la dépendance de l’État à l’égard des marchés doit donc être posée sérieusement.
Enfin, dernier facteur, il ne faut pas oublier le poids du ralentissement général de la croissance et de l’inflation sur le niveau actuel de notre endettement en terme de ratio par rapport au PIB ; d’autant que la croissance joue non seulement sur le ratio de dette, mais aussi sur les recettes fiscales. Entre 2008 et 2009, au moment de la crise financière, les recettes fiscales nettes de l’État ont chuté de 40 milliards d’euros – cette chute a été due en partie aux dépenses fiscales, en particulier au bouclier fiscal –, alors que les dépenses n’ont augmenté que de 12 milliards d’euros. Dans certaines situations, c’est bien l’absence de recettes qui creuse le déficit, plus que l’augmentation des dépenses.
Quelles leçons peut-on retenir de ces mécanismes de progression de l’endettement ?
D’une part, que le budget de l’État se retrouve constamment pris en étau : d’un côté, des baisses d’impôts sont nécessaires pour stimuler la croissance et engendrer des recettes fiscales supplémentaires ; de l’autre, ces baisses de recettes entraînent un accroissement du déficit si elles ne sont pas suivies d’une hausse significative de l’activité ou d’une réduction des dépenses publiques. C’est pourquoi une politique raisonnée consiste à trouver des solutions pour favoriser l’investissement et l’activité sans nécessairement alourdir le déficit. C’est ce que fait le Gouvernement depuis 2012 en stabilisant le niveau des prélèvements obligatoires, tout en dégageant des marges de manœuvre pour les entreprises.
D’autre part, cela doit nous conduire à nous poser des questions sur le rythme de remboursement soutenable pour notre pays. La soutenabilité de la dette dépend, en effet, de l’écart entre le taux de croissance et le taux d’intérêt apparent applicable au stock de dette publique. Chaque fois que le taux de croissance est inférieur au taux d’intérêt apparent, le poids de la dette par rapport au PIB s’accroît, sauf coupe drastique dans les dépenses publiques.
Enfin, la gestion de la dette présente des paradoxes qui ne sont pas sans risque : alors que l’endettement public a augmenté de plus de 30 points de PIB depuis 2008, la charge de la dette est restée stable, voire a légèrement diminué, pour représenter 43,8 milliards d’euros en 2015.
Cela est dû à la faiblesse actuelle des taux d’intérêt, situation inédite qui peut se retourner à moyen terme. Le risque sur la dette publique serait alors important : pour une augmentation de taux d’intérêt de 1 point, la charge de la dette serait supérieure de 2 milliards d’euros dès la première année. L’impact étant cumulatif au fur et à mesure des réémissions de dette, la charge de la dette serait, en 2025, supérieure de 16,8 milliards d’euros à celle de 2016.
C’est pourquoi il est nécessaire de s’intéresser plus en détail aux modalités de gestion de la dette, point que traitera mon collègue Nicolas Sansu.
Avant de lui céder la parole, je tiens à rappeler que la situation n’est pas catastrophique, contrairement à ce que j’entends parfois : le déficit tend à être maîtrisé, le Gouvernement s’y employant depuis le début du quinquennat. Il reste encore des efforts à faire, mais les résultats montrent que la France est sur la bonne voie.
Pour le reste, je souhaite vous faire partager un point de vue plus personnel : au cours des auditions, nous avons pu apprécier le rôle joué par la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES). Je trouverais particulièrement intéressant de mettre en place un mécanisme similaire à la CADES pour la dette de l’État, avec l’objectif d’éteindre celle-ci à long terme, en établissant un échéancier mettant en œuvre la stratégie de désendettement de l’État.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Je rappelle que ce travail de la Mission d’évaluation et de contrôle était une demande de ma part, à la suite d’une proposition de résolution européenne que j’avais défendue devant notre commission l’année dernière. Dans la mesure où il est d’usage de nommer un rapporteur de la majorité et un rapporteur de l’opposition, et où ma position est incertaine, j’ai été « encadré » par deux collègues corapporteurs. Je tiens à les saluer ; nous avons travaillé ensemble de manière conviviale et, je l’espère, efficace.
Comme l’a rappelé Jean-Claude Buisine, la gestion de la dette s’opère dans un cadre contraint par les règles européennes et par un niveau élevé de dette, qui nous oblige à un refinancement régulier sur les marchés. La dette de l’État nous est apparue, dans ce cadre, très convenablement gérée : la charge de la dette est maîtrisée, et l’État met en œuvre son programme de financement sans anicroche, avec un taux moyen à l’émission de titres à moyen et long terme de 0,63 % en 2015, contre 4,15 % en moyenne sur la période de 1998 à 2008.
Ce satisfecit ne nous empêche pas de nous interroger sur la stratégie d’émission.
L’AFT – qui n’a d’agence que le nom, puisqu’il s’agit non pas d’une structure autonome, ainsi qu’il en existe dans certains pays, mais d’un démembrement de la direction générale du Trésor – résume sa stratégie en quelques mots : transparence, prévisibilité et adaptation à la demande des investisseurs. Elle travaille en relation étroite avec les dix-huit banques spécialistes en valeurs du Trésor (SVT), qui ont pour rôle d’acheter les titres sur le marché primaire et d’assurer la liquidité du marché secondaire, ainsi que de conseiller l’État en matière de politique d’émission et de gestion de la dette. Les SVT nous ont indiqué que l’AFT était l’une des administrations les plus performantes en matière de gestion de la dette. Les liens entre les SVT et l’AFT sont d’ailleurs très resserrés, ce qui peut parfois poser des problèmes de conflits d’intérêts.
L’AFT explique qu’elle ne peut pas se montrer opportuniste en modifiant sa politique d’émission pour profiter du contexte, de taux d’intérêt très bas. Il nous semblerait pourtant possible de profiter davantage des opportunités de marché pour sécuriser une plus grande partie de la dette aux taux exceptionnellement bas que nous connaissons actuellement.
En outre, je voudrais être très clair sur un sujet dont nous avons déjà beaucoup parlé au sein de notre commission : la réémission de souches anciennes, porteuses de coupons plus élevés que les taux du marché, ainsi que les primes d’émission qui en découlent.
D’une part, ces émissions ne coûtent globalement pas plus cher à l’État que celles qui portent des coupons proches des taux du marché. Ce qui est opéré, c’est un décalage dans le temps, c’est-à-dire l’encaissement immédiat d’une prime par l’État compensé par le versement, les années suivantes, de coupons plus élevés. D’autre part, cette stratégie d’émission n’est ni propre à la France, ni nouvelle : l’AFT y recourt régulièrement pour entretenir la liquidité du marché secondaire et répondre à la demande des investisseurs. Selon les explications de l’AFT, sans ces émissions, la moindre liquidité du marché entraînerait des taux d’intérêt plus élevés, notamment sur ces souches anciennes, qui sont recherchées.
À la différence des années précédentes, le montant des primes d’émission encaissées en 2015 a été extrêmement élevé : 22,7 milliards d’euros. Pourtant, la proportion de titres émis à partir de souches anciennes a été de 33,9 % en 2015, donc proche des niveaux enregistrés en 2010 et en 2012 – 32,7 % –, et moindre qu’en 2009 – 38,5 % – ou en 2011 – 40,5 %.
L’importance des primes encaissées – de mémoire, la prime la plus élevée a été de 8,9 milliards d’euros – et le montant total de 22,7 milliards proviennent de l’écart de taux entre les coupons sur les souches anciennes – de 4 à 6 % – et les taux d’intérêt actuels du marché.
Si cela soulever des questions quant à son résultat immédiat en comptabilité budgétaire, point dont nous avons débattu lors de l’examen du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2015, en comptabilité nationale, sur longue période, il n’en va pas de même.
J’en viens au problème de la connaissance des détenteurs de la dette. L’un des buts de cette mission était de renforcer la transparence sur cette question. Force est de reconnaître que nous avons peu progressé : l’AFT nous a expliqué qu’elle n’avait pas une connaissance exhaustive de ses investisseurs et que celle-ci se heurtait à des obstacles qui sont détaillés dans le rapport et sur lesquels je reviendrai brièvement. Nous ne sommes pas convaincus que l’AFT nous ait fourni toutes les informations dont elle pouvait disposer. Cela reste donc un sujet d’interrogation.
Je rappelle ce que l’on sait : la dette de l’État est détenue à 62 % par des non-résidents, mais aucune répartition par pays ou par secteur d’activité n’est fournie ; les 38 % détenus par les résidents se répartissent entre les compagnies d’assurances pour 19 %, les établissements de crédit pour 9 %, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) pour 2 % et une catégorie « autres », dans laquelle figurent notamment les acteurs publics tels que la Banque de France.
La part de cette dernière catégorie augmente nécessairement avec la politique de rachat de titres, dite d’assouplissement quantitatif – quantitative easing –, menée par la Banque centrale européenne (BCE) et par son bras armé en France, la Banque de France. Ainsi, une part grandissante de la dette est détenue par la BCE, principalement via la Banque de France. La BCE a en effet acheté 152 milliards d’euros de titres français depuis que l’assouplissement quantitatif, décidé en mars 2015, est mis en œuvre. Et cela va continuer jusqu’en mars 2017.
Les autres informations dont dispose l’AFT proviennent des SVT, sur les transactions qu’ils opèrent. Il ressort de ce reporting qu’environ les deux tiers des investisseurs résident dans la zone euro et que les investisseurs hors zone euro se situent principalement sur le continent européen, au Moyen-Orient et en Asie.
Pour justifier l’absence de données précises sur la détention de la dette, l’AFT invoque le volume de titres échangé chaque jour sur le marché secondaire, qui s’élève à plus de 10 milliards d’euros. Chaque année, s’échange sur ce marché plus de 1,5 fois le montant total de la dette publique française. S’y ajoute le problème des intermédiaires entre l’émetteur et le détenteur final, qui peuvent être nombreux et internationaux. Je rappelle à cet égard qu’il n’y a aucune transaction directe entre l’État et les investisseurs finaux : l’État vend aux SVT sur le marché primaire, et ce sont eux qui revendent sur le marché secondaire.
Ces obstacles ne sont pourtant pas insurmontables. Il existe, pour les actions, un dispositif permettant d’identifier les porteurs de titres en interrogeant le dépositaire central et en remontant la chaîne. Techniquement, ce dispositif, même s’il n’est pas parfait, pourrait être transposé aux titres d’État, ce que l’article L. 228-2 du code de commerce exclut explicitement. Si ce verrou juridique n’a pas été levé, c’est parce qu’il y a, en fait, une volonté, très clairement exprimée par le directeur général de l’AFT, mais aussi par le ministre des finances Michel Sapin – lors des auditions –, de protéger l’anonymat des investisseurs, de crainte de les voir fuir le marché de la dette française. Comme s’ils avaient quelque chose à cacher !
L’une de nos propositions est donc de lever le verrou qui empêche l’État d’interroger le dépositaire central, à savoir Euroclear. Il ne s’agit pas de publier la liste des détenteurs de la dette de l’État, mais de permettre à celui-ci d’avoir accès à cette information, afin notamment d’éviter que les titres de dette de l’État ne viennent alimenter les paradis fiscaux.
En 2009, à l’initiative du rapporteur général Gilles Carrez, nous avions instauré, à l’article 125 A du code général des impôts, un prélèvement à la source sur les intérêts des valeurs du Trésor payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif. Cette mesure rapporte moins de 1 million d’euros. On sait très bien qu’il suffit à celles et ceux qui détiennent de tels titres et localisent leurs revenus dans des États ou territoires non coopératifs de passer par un intermédiaire pour éviter ce prélèvement à la source.
Le manque de progrès sur la question de la transparence de la dette a été, je l’ai dit, la source de notre plus grande frustration dans le cadre de ce travail car la transparence est une condition de notre souveraineté. Ajoutons que, d’après ce que les dirigeants d’Euroclear nous ont indiqué lorsque nous les avons auditionnés le 29 mars dernier, le Trésor pourrait organiser lui-même les compensations, ce qui permettrait beaucoup plus de transparence.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Ainsi que mes collègues corapporteurs viennent de vous l’exposer, la dette publique pose de nombreux problèmes, celui de la transparence n’étant pas le moindre. Si la gestion de la dette par l’AFT nous a semblé professionnelle et efficace, voire assez remarquable, la question de l’endettement pose la question du soutien à l’activité sans aggraver son niveau.
J’ai joint une contribution au rapport, que j’ai intitulée « De la dérive à l’addiction ». Ce qui manque, c’est de faire le lien entre le recours à l’endettement et l’évolution du chômage car utiliser la dette pour soutenir l’activité n’a guère de sens si cela ne réduit pas le chômage.
Il nous a semblé nécessaire de proposer quelques pistes de réflexion.
Il s’agit notamment de se poser la question de l’évolution de certaines règles de l’Union européenne nous contraignant passablement sur un certain nombre de points.
D’un point de vue comptable, d’abord, il faudrait soustraire du calcul du déficit public les dépenses liées aux opérations militaires intéressant la sécurité de l’Europe et approuvées par le Conseil européen telles que l’intervention au Mali. Des propositions ont déjà été faites en ce sens, mais elles sont restées sans aucune suite. D’une manière générale, je me suis toujours interrogé sur le fait d’intégrer les dépenses de la défense dans les pactes de stabilité, car très peu de pays en Europe ont un budget d’investissement et de fonctionnement important dans le domaine de la défense, ce qui fausse les règles.
D’un point de vue économique, ensuite, les règles du pacte de stabilité et de croissance ne sont pas toujours favorables à l’investissement, même si la Commission européenne a accepté, en janvier 2015, une évolution de son interprétation : l’argent public placé dans le fonds européen finançant le plan d’investissement de 315 milliards d’euros, dit « plan Juncker », ne sera pas pris en compte dans le calcul du déficit du pays contributeur. C’est une avancée.
Par ailleurs, la Commission a assoupli les critères permettant d’activer la « clause d’investissement », qui permet de dépasser le niveau de déficit autorisé pour financer des dépenses d’investissement – le problème de la dette française, on l’a dit, en particulier de la dette de l’État, c’est qu’elle est essentiellement constituée de dépenses de fonctionnement.
Cette clause d’investissement fait écho aux règles applicables aux collectivités territoriales qui ne peuvent recourir à l’emprunt que pour financer de l’investissement – même si il y a un débat sur ce point : selon certains, l’investissement des collectivités territoriales est aussi permis par la dotation globale de fonctionnement (DGF), c’est-à-dire, in fine, par le budget de l’État.
Cependant, seuls sont pris en compte les investissements cofinancés par l’Union européenne, et les États soumis à une procédure pour déficit excessif, tels la France, ne peuvent s’en prévaloir. Ces restrictions limitent donc sérieusement notre capacité à investir. Il faudrait aller plus loin en permettant aux États soumis à une procédure pour déficit excessif de relancer leur investissement sans craindre des sanctions et en ne limitant pas la définition des investissements aux seuls projets cofinancés par l’Union européenne, ce qui en restreint excessivement le champ. Ce sont deux des propositions que nous formulons.
Dans la mesure où l’argent ne coûte pas cher, ce serait l’occasion d’investir fortement – j’avais d’ailleurs interrogé le ministre des finances à ce sujet. Mais, pour cela, il faut être crédible. Il serait vertueux de réaliser des investissements productifs qui relanceraient l’activité et, partant, amélioreraient les rentrées fiscales, mais l’Europe nous contraint. Nous sommes pris, en quelque sorte, dans un étau.
Plus généralement se pose la question des solutions pour que la dette ne soit pas un frein à l’investissement.
L’assouplissement quantitatif pratiqué par la BCE ne permet pas suffisamment de relancer l’investissement et le crédit aux entreprises : en transitant par le marché, la quantité de monnaie impressionnante créée par la banque centrale n’atteint que très peu l’économie réelle et alimente plus vraisemblablement de nouvelles bulles financières ou immobilières, ce qui est un autre risque majeur de l’excès d’endettement que nous connaissons. L’idée est donc de créer un lien direct entre la création monétaire et les entreprises.
La question pourrait se poser, dès lors, d’en passer par la monétisation des dettes publiques, mais celle-ci est interdite par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il s’agit, là encore, d’une contrainte : il n’est pas possible pour la BCE, ou pour les banques centrales nationales, d’acquérir des instruments de dette des États. Certains parmi nous le regrettent. À titre personnel, je considère qu’il n’y a aucune garantie pour que l’argent qui serait ainsi accordé à l’État soit utilisé à bon escient et ciblé sur l’investissement. Dans le cadre de ce travail, j’ai défendu l’idée que la dette devait être réservée à l’investissement. On ne devrait pas pouvoir s’endetter pour financer le fonctionnement quotidien : c’est un mécanisme très dangereux à terme.
Il reste que les établissements publics de crédits de la zone euro, à commencer par la Banque européenne d’investissement (BEI), peuvent accéder aux financements de la BCE dans les mêmes conditions que les établissements privés. Dès lors, rien n’interdirait à la BCE d’utiliser son pouvoir de création monétaire pour financer les organismes publics de crédit sur la base d’investissements concertés et programmés avec les États de la zone euro. En France, tel pourrait être le cas, par exemple, de la Caisse des dépôts et consignations ou de la Banque publique d’investissement (Bpifrance). L’intérêt d’un tel circuit direct serait de favoriser immédiatement l’investissement.
Cette opération permettrait une augmentation de la masse monétaire au bénéfice direct de l’économie réelle, une relance de l’activité et, par conséquent, de l’inflation, avec l’ensemble des effets bénéfiques qui en sont attendus sur le niveau des dettes publiques comme privées. En cas de surcroît d’inflation, perspective aujourd’hui très lointaine, il serait aisé de stopper cette politique.
On peut remarquer que tout converge : les taux d’intérêt sont bas, l’énergie ne coûte par cher et il n’y a pas d’inflation. Toutefois, l’absence d’inflation est aussi due, à mon avis, à la faiblesse de l’investissement. D’autre part, si les taux d’intérêt, actuellement très bas, reviennent à un niveau supérieur à l’inflation, notre dette risque de nous coûter de plus en plus cher.
Ces investissements produiraient, de plus, des recettes pour les États, notamment via la réduction du chômage, et contribueraient ainsi au rééquilibrage des budgets nationaux. Ainsi que je l’ai indiqué précédemment, c’est bien l’évolution de la courbe du chômage qui agrège l’économique et le social : si l’économie fonctionne, mais qu’elle est réservée à quelques-uns, nous avons raté notre pari social.
Une autre solution qui permettrait de réduire le coût de l’endettement serait d’accorder une licence bancaire au Fonds européen de stabilité financière (FESF), afin qu’il puisse prêter de l’argent aux États au même taux qu’il emprunte à la banque centrale, sans la prise d’intérêt opérée par le marché financier. Transformer le FESF en banque permettrait d’aider les États à se prémunir contre le risque de remontée des taux d’intérêt. Je souligne que même si le rapport entre l’augmentation des taux et l’accroissement de la charge de la dette est n’est pas exponentiel, et que ce mécanisme est généralement plus lent qu’on ne le pense, il n’en reste pas moins très dangereux.
Précisons que ce schéma impliquant le FESF est bien un schéma avec prêt et remboursement de prêts. Car il faut savoir que nous ne remboursons jamais le capital de la dette : nous réempruntons chaque année pour payer les annuités et les frais financiers.
Enfin, une dernière solution à explorer consisterait à recourir de manière accrue aux garanties publiques que pratique déjà l’État dans le cadre des plans industriels, notamment à travers l’action de Bpifrance.
En application de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), une garantie doit être autorisée par la loi de finances et fait l’objet d’un plafond, mais ces plafonds pourraient être augmentés sans alourdir le déficit. En effet, en comptabilité nationale comme en comptabilité budgétaire, les garanties ne sont pas intégrées à la dette publique tant qu’elles ne sont pas appelées. Cela permettrait d’encourager le secteur privé à développer l’investissement sans recourir au déficit de l’État.
Certes, il existe un risque potentiel, mais, en réalité, il ne se matérialise que rarement, et il est largement inférieur aux bénéfices de ce type de méthode, qui constitue un palliatif de l’absence de prise de risque du secteur bancaire privé. L’État pourrait supporter ce risque au regard des bénéfices qu’il en retirerait en termes de soutien à l’activité économique. Selon moi, nous n’arriverons pas à nous sortir de la situation actuelle sans prendre de risques.
D’une manière générale, je pense que seul l’investissement nous permettra de reprendre la bonne voie.
M. le président Gilles Carrez. Merci, messieurs les rapporteurs, pour cette présentation.
Je reviens sur le montant particulièrement élevé des primes d’émissions en 2015. Vous avez avancé un élément très important, M. Sansu : en 2015, la proportion des émissions sur souches anciennes a été dans la moyenne haute, mais elle n’a pas été anormalement élevée c’est bien l’écart de taux qui a fait la différence. Il y a cependant un aspect que vous n’avez pas évoqué : ces primes d’émission servent à rembourser de la dette. Et on ne m’enlèvera pas de l’idée que, en remboursant de la dette, notamment de la dette à court terme, on ralentit sa progression par rapport au PIB, ce qui est l’un des critères de Maastricht. Je suppose donc que le Gouvernement – chacun le ferait à sa place – va communiquer sur le fait que la dette n’a pas été un problème au cours de la présente législature, en soulignant la différence avec la précédente. Or c’est une vision sinon inexacte, à tout le moins très partielle.
Par ailleurs, qu’est-ce qui interdirait d’utiliser les primes d’émission à autre chose qu’au remboursement de la dette ? Il semble qu’elles soient traitées uniquement comme un phénomène de trésorerie, interne à la dette. N’aurait-on pas pu inscrire le montant de 22,7 milliards d’euros en recettes budgétaires, quitte à l’amortir, ainsi que le suggère Charles de Courson ?
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Il y a sur ce point effectivement un effet d’aubaine. Dans le même temps, si cela change la donne pour 2015, cela ne la change pas sur la durée, quels que soient la maturité de ces souches anciennes et les coupons qu’elles portent.
Si l’on inscrivait ce montant en recettes budgétaires, il faudrait alors se poser la question d’inscrire aussi la provision correspondante, ce qui neutraliserait l’opération. Quoi qu’il en soit, la LOLF dispose que les primes d’émission sont des ressources de trésorerie, qui viennent donc immédiatement en déduction de la dette.
M. le président Gilles Carrez. Il s’agit donc, en quelque sorte, d’une affectation obligatoire.
M. Dominique Lefebvre. Il ne faut pas tout analyser à travers un prisme politicien : le montant très élevé des primes d’émission en 2015 correspond simplement à une réalité du marché. La question, c’est de le placer.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Il est placé. Ce sont en effet les souches anciennes qui sont recherchées.
M. le président Gilles Carrez. Ainsi que l’a relevé la rapporteure générale la semaine dernière, la politique de rachat sur le marché secondaire pratiquée par la BCE assèche l’offre de ce type d’obligations.
M. Charles de Courson. Je reviens sur ce sempiternel problème : qui détient la dette française ? Vous expliquez pourquoi on ne veut pas savoir, mais, en réalité, l’AFT sait qui détient, in fine, la dette française. Si l’on connaît les flux, on peut calculer les stocks ou, à tout le moins, trouver des ordres de grandeur. Dans votre rapport, vous indiquez que les banques centrales elles-mêmes ne tiennent pas à ce que l’on sache pourquoi elles achètent ou vendent de la dette. Quelles sont leurs raisons ? Je suppose que c’est pour éviter la spéculation.
D’après ce que vous avez indiqué, la BCE, qui a décidé d’intervenir sur le marché secondaire, détient environ 150 milliards d’euros de titres français, soit un peu de moins de 10 % de notre dette. Or, avec l’extension de l’assouplissement quantitatif à 80 milliards par mois, on nous dit que ce montant augmenterait de 15 milliards par mois. Disposez-vous d’informations à ce sujet ? Quelle est la projection pour la fin de l’année 2016 ? Ce montant pourrait atteindre 250 à 280 milliards.
D’après le tableau que vous avez reproduit à la page 91 de votre rapport, le montant des primes d’émission encaissées entre 2012 et 2015, qui dépasse 45 milliards d’euros. Vous expliquez que l’une des raisons est l’intervention de la BCE sur le marché secondaire, qui a asséché le marché pour les institutions qui souhaitent acheter des titres plus chers afin de bénéficier de taux d’intérêt plus élevés. Pourriez-vous nous en dire plus sur l’intervention de la BCE ? Pourquoi s’intéresse-t-elle particulièrement aux souches anciennes, et non à des émissions plus récentes ? Rien ne l’empêcherait d’acheter des titres sur le marché secondaire quelques jours après leur émission.
J’en termine par la traduction comptable de ce phénomène, qui devient massif. Vous indiquez qu’« en comptabilité générale, les primes ou décotes font l’objet d’un étalement sur la durée de vie des titres ». Dès lors, on trouve désormais, dans la comptabilité générale de l’État, des charges financières qui ne sont pas les mêmes qu’en comptabilité budgétaire. La LOLF assimile l’ensemble des opérations relatives aux emprunts à des opérations de trésorerie, alors que, dans toutes les autres institutions publiques, y compris les collectivités territoriales, il s’agit d’opérations budgétaires. J’avais tenté de faire supprimer cette disposition proprement monstrueuse de la LOLF, hélas sans succès. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce point ? Quel est l’écart entre les charges financières en comptabilité budgétaire et les charges financières en comptabilité générale ?
M. Alain Chrétien. La principale information que je retiens de ce rapport, c’est que près des deux tiers de la dette de notre pays appartiennent à des non-résidents, États ou entités, que l’on ne connaît pas. En termes de souveraineté financière et de souveraineté nationale, cela ne peut pas laisser indifférent ! Vous êtes-vous interrogés l’évolution de la part de la dette détenue par les non-résidents ?
Au Japon, la dette publique atteint 200 % du PIB, ce qui pourrait être une catastrophe nationale – en France, elle approche 100 % du PIB et nous sommes en difficulté – mais cette dette appartient en grande majorité aux Japonais. Ils savent à qui appartient leur dette, puisqu’ils la possèdent !
Il serait donc important que l’on réfléchisse à la manière de réorienter notre endettement afin que notre dette appartienne principalement au peuple français. C’est une question de souveraineté nationale. D’autant que, au regard de l’évolution des taux d’intérêt, que vous avez évoquée, se pose la question de la dépendance vis-à-vis de ces institutions étrangères, dont on ne connaît pas les intentions. Aujourd’hui, la Chine est la première créancière des États-Unis : elle peut changer la structure de la dette américaine quand et comme elle le veut. Peut-être sommes-nous, nous aussi, tributaires de circonstances analogues.
Je m’interroge : cette ignorance est-elle voulue ou non ? Charles de Courson indique qu’on ne veut pas savoir, ce qui est pire encore que de ne pas savoir.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. On peut savoir.
M. Alain Chrétien. Alors, il faut que l’Assemblée nationale sache ! Et qu’on ne nous dise pas qu’on peut savoir, mais qu’on ne fait rien pour ! Vous avez proposé de lever les verrous juridiques ; cela me semble absolument indispensable. Si l’on veut être souverains, il faut dire clairement que l’on veut que la dette française soit en majorité détenue par des résidents.
M. Dominique Lefebvre, président. Je félicite à mon tour les rapporteurs. Ce sujet n’est pas simple à traiter, car il y a de multiples aspects, notamment la question de la sincérité de la dette dans un environnement macroéconomique donné et dans le contexte mondialisé que nous connaissons. Le rapport est très riche en informations. J’ai lu avec intérêt les contributions de Jean-Pierre Gorges et de Nicolas Sansu, qui montrent bien que la question de la dette donne lieu à des approches différentes et à de nombreux débats politiques.
Depuis 2012, la question de savoir qui sont les non-résidents qui détiennent plus de 60 % de notre dette revient assez régulièrement sur tous les bancs. Certains estiment que ce niveau de détention est une atteinte intolérable à la souveraineté et à l’indépendance nationales, et exigent la transparence en la matière. Cela dit, une fois que l’on saura qui détient la dette, que fera-t-on de plus ou de moins ? Si l’on veut être indépendant en matière de dette, il faut dépendre de soi-même, c’est-à-dire être fort économiquement.
Dès lors que les dépenses sont supérieures aux recettes, il y a deux possibilités : soit on emprunte à ceux qui ont de l’argent, soit on émet de la monnaie, ce qui ne peut se faire désormais que dans le cadre de la zone euro. L’assouplissement quantitatif, c’est-à-dire le rachat par la BCE de titres d’État à des intermédiaires financiers, se traduit, in fine, par de la création monétaire.
La question fondamentale reste celle de la stabilisation de la dette et, à long terme, de sa réduction. À cette fin, il faut connaître les origines de la dette et ses effets, dont certains sont d’ailleurs positifs. Nous disons tous assez spontanément que le financement à moyen terme, par la dette, des dépenses de fonctionnement ou de la protection sociale est absurde. Dans une période de croissance faible ou lorsqu’il y a des chocs de court terme, il est assez normal que l’Unédic ait une dette, mais il y a un problème si les comptes évoluent toujours dans le même sens et que cette dette devient perpétuelle.
Tous les gouvernements depuis 1974, quelle que soit leur couleur politique, ont leur part de responsabilité dans la progression de la dette. Néanmoins, il y a eu deux périodes de forte augmentation : d’une part entre 1993 et 1998, d’autre part entre 2002 et aujourd’hui, avec 400 milliards d’euros supplémentaires entre 2002 et 2007, puis 600 milliards au cours de la période suivante. Aujourd’hui la dette tangente les 100 % du PIB. Pendant très longtemps, mes collègues de la Cour des comptes ont écrit dans leurs rapports que dépasser les 100 % serait une catastrophe, compte tenu de l’« effet boule de neige ». Mais pourquoi 100 % plutôt que 90 % ou 60 %, taux qui constitue l’un des critères de Maastricht ? On ne le sait pas. Le vrai problème, c’est lorsque la dette progresse de manière continue et que l’on n’arrive pas à la maîtriser, ce qui renvoie aux politiques qui sont menées.
Il faut d’ailleurs raisonner en prenant en considération la dette publique globale plutôt que sa répartition par catégories d’administrations, dès lors notamment que l’État transfère 105 milliards de crédits budgétaires et d’outils fiscaux aux collectivités territoriales. On dit souvent que les collectivités territoriales sont, par définition, mieux gérées que l’État et que leur dette est vertueuse, car elles ne s’endettent que pour investir, mais, en réalité, les dépenses de fonctionnement des collectivités progressent deux à trois fois plus vite que celles de l’État.
D’autre part, il y a la question, posée notamment par Nicolas Sansu, de savoir s’il existe des mécanismes qui permettraient, à dette équivalente, de réduire le coût de son financement, ce qui renvoie à la question du rôle des banques centrales et des intermédiaires financiers. En l’espèce, j’appelle l’attention sur un paradoxe : ainsi que le montre le rapport, le coût de la dette n’a cessé de baisser. Certes, la question de la détention de la dette par les non-résidents et celle du fonctionnement des marchés financiers méritent d’être posées, mais il faut se garder des raccourcis populistes en la matière. Cela étant, tout le monde sait qu’une partie de notre dette est détenue par les banques centrales de pays asiatiques, ce qui renvoie à d’autres déséquilibres macroéconomiques mondiaux.
Le rapport est très intéressant et va alimenter le débat. Néanmoins, la seule réponse simple que l’on peut apporter est la suivante : il vaut toujours mieux avoir un endettement maîtrisé qu’un endettement dont on n’arrive pas à freiner la progression, tant en termes de souveraineté et d’indépendance qu’en termes de coût.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Pourquoi ne veut-on pas dire quelles banques centrales achètent ou vendent nos titres ? Le directeur général de l’AFT nous a expliqué très clairement qu’il s’agissait d’éviter la spéculation sur certains États – je vous renvoie à son audition. Pour ma part, je ne pense pas que cet argument soit opérant.
Les titres de dette publique français constituent 18 % des actifs rachetés par la BCE. Il est en effet probable que la part de dette française détenue par la BCE atteindra 260 ou 270 milliards d’euros à la fin du processus, si l’assouplissement quantitatif s’arrête en mars 2017 – mais bien malin qui peut dire si cette politique de liquidité va continuer ou non.
Monsieur le président, l’assouplissement quantitatif n’est pas de la création monétaire ex nihilo, puisqu’il y a un remboursement ; ce n’est donc pas tout à fait l’équivalent de la création monétaire que l’on pratiquait auparavant avec le circuit du Trésor.
Nous n’avons pas abordé la question de l’écart entre comptabilité budgétaire et comptabilité générale dans le rapport. Les chiffres figurent dans le projet annuel de performances de la mission Engagements financiers de l’État.
Bien évidemment, monsieur le président, il vaut mieux un endettement maîtrisé qu’un endettement non maîtrisé, mais il y a plusieurs manières de maîtriser son endettement. Certains vous expliqueront qu’on dépense trop, d’autres que tout dépend de la manière de financer la dette. Les uns et les autres ont d’ailleurs raison en partie. Selon moi, l’un des enjeux est la transparence. On nous dit qu’on ne peut pas faire la transparence si tout le monde ne la fait pas. Mais, si l’on en reste là, on ne la fera jamais, ce qui pose un problème, notamment pour traiter la question des États et des territoires non coopératifs. On sait que les banques centrales du Moyen-Orient et d’Asie détiennent une part non négligeable de la dette française, mais on connaît les flux, non les stocks. L’AFT et Euroclear peuvent calculer les stocks à partir des flux.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Je comprends la question de notre collègue Alain Chrétien. Techniquement, on peut savoir qui sont les détenteurs non-résidents. Mais le système actuel nous permet d’émettre de la dette à des taux très bas, voire négatifs. Le risque, c’est que le marché se bloque, et que l’on ne puisse plus y avoir accès pour refinancer la dette, sachant que l’on ne rembourse pas le capital.
Le véritable piège est que, plus la dette augmente, plus les frais financiers diminuent. En d’autres termes, plus on emprunte, moins cela coûte cher d’emprunter. Dans la mesure où l’on ne rembourse pas le capital et que les frais financiers diminuent avec l’augmentation de la dette, l’endettement est devenu un mode de fonctionnement, l’outil des responsables politiques, dans la limite du plafond symbolique des 100 % du PIB. On nous habitue à vivre avec la dette, mais, le jour où le retournement des taux d’intérêt se produira, cela nous coûtera très cher, peut-être un ou deux points de croissance.
En résumé, l’anonymat nous permet d’avoir des frais financiers faibles, mais risque de nous coûter cher à moyen terme.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Il est aussi nécessaire de connaître les détenteurs de la dette afin de savoir qui est susceptible de jouer avec nous ou contre nous en cas de retournement des taux d’intérêt. Cela réduirait les risques.
Ainsi que nous l’avons précisé dans le rapport, « connaître » ne signifie pas « publier ». Il s’agit non pas d’établir un cadastre public, mais de disposer d’un certain nombre d’informations, comme en matière d’impôt sur le revenu.
M. Dominique Lefebvre, président. Donc, il ne s’agit pas d’instaurer un reporting public sur la dette.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Non. En revanche, il est important de pouvoir remonter jusqu’au détenteur final.
En application de l’article 145 du règlement, la commission autorise la publication du rapport d’information de la Mission d’évaluation et de contrôle sur la gestion et la transparence de la dette publique.
– M. Renaud Duplay, sous-directeur, première sous-direction de la direction du budget, et de Mme Cécile Maysonnave, adjointe au chef de bureau, bureau des lois de finances 155
– M. Denis Beau, directeur général des opérations de la Banque de France* 162
Audition du 10 février 2016
– M. Benjamin Lemoine, chargé de recherches en sciences sociales au Centre national de la recherche scientifique, auteur d’une thèse sur la mise en marché de la dette publique française intitulée Les valeurs de la dette. L’État à l’épreuve de la dette publique 167
Auditions du 1er mars 2016
– M. Raoul Briet, président de la première chambre de la Cour des comptes, M. Éric Dubois, conseiller maître et Mme Raphaëlle Eloy, rapporteure extérieure 179
– Les représentants d’agences de notation : M. Patrice Cochelin, directeur senior, finances publiques, et M. Jean-Michel Six, responsable des études économiques pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, de Standard & Poor’s, et M. Tony Stringer , directeur général et Mmes Maria Malas-Mroueh et Amélie Roux de FitchRatings 194
Auditions du 9 mars 2016
– M. Patrice Ract Madoux, président de la CADES et de Mme Geneviève Gauthey, inspecteur des finances publiques. 206
– M. Jacques de LAROSIERE, président du comité stratégique de l’Agence France Trésor, président de EUROFI. 220
– Table ronde, réunissant M. Franck Motte, responsable Eurorates HSBC ; M. Raoul Salomon, responsable des activités de marché pour Barclays en France ; M. Philippe Le Perchec, directeur d’exploitation Barclays CIB ; M. Christophe Jobert, responsable des activités global market en France pour BNP Paribas* ; M. Amaury D’Orsay, responsable mondial du trading de taux au sein de la Société Générale*, et M. Thomas Spitz, responsable du trading au Crédit Agricole* 225
Auditions du 15 mars 2016
– M. Anthony Requin, directeur général de l’Agence France Trésor (AFT), accompagné de M. Tân Le Quang, responsable de la communication. 238
– M. Gaël Giraud, directeur de la chaire « Énergie et prospérité » de l’École Polytechnique (X), de l’École normale supérieure (ENS) et de l’École nationale de la statistique et de l’administration économique (ENSAE), et de M. Henri Sterdyniak, conseiller scientifique de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) 254
Audition du 22 mars 2016
– M. Dominique Plihon, professeur d’économie à l’université Paris-Nord, porte-parole de l’Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne (Attac) 266
Audition du 29 mars 2016
– Mme Natacha VALLA, économiste 274
– Mme Brigitte DAURELLE, directeur général d’Euroclear, et M. Frédéric GERMAIN, directeur des opérations 283
Audition du 14 juin 2016
– M. Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics 290
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
Audition du 9 février 2016
M. Renaud Duplay, sous-directeur, première sous-direction de la direction du budget, et de Mme Cécile Maysonnave, adjointe au chef de bureau, bureau des lois de finances.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Le 20 janvier 2016, la commission des Finances a décidé la création d’une mission d’évaluation et de contrôle sur la transparence et la gestion de la dette publique – dont je rappelle qu’elle s’élevait à la fin du troisième trimestre 2015 à 2 103 milliards d’euros. Comme il est d’usage, la MEC associe majorité et opposition afin de rechercher des propositions consensuelles. Pour vous entendre, nous sommes donc trois rapporteurs : Jean-Claude Buisine, du Groupe Socialiste, républicain et citoyen, Jean-Pierre Gorges, du groupe Les Républicains, et moi-même, qui appartiens au Front de gauche.
Cette mission d’évaluation et de contrôle fait suite à un travail que j’avais mené l’année dernière en tant que rapporteur d’une proposition de résolution européenne relative aux dettes souveraines des États de la zone euro.
M. Renaud Duplay, sous-directeur de la première sous-direction de la Direction du budget. Je voudrais d’abord replacer notre intervention dans son contexte institutionnel. Le directeur général de l’Agence France Trésor (AFT), Anthony Requin, devait initialement participer à cette audition, mais les agendas des uns et des autres ont rendu impossible sa présence aujourd’hui. Le sujet de la dette intéresse évidemment la direction du budget, et nous sommes impliqués dans un certain nombre de processus. Mais nous nous sommes peut-être ceux qui, au sein du ministère des finances, sont les moins savants sur les questions de dette. Nous ne nous occupons pas, en effet, de la politique d’émission, de la gestion et du contrôle de la charge de la dette.
Nous serons donc sans doute amenés à renvoyer certaines questions vers le directeur général de l’AFT, ce dont je vous prie par avance de m’excuser.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Aujourd’hui, notre pays est en déficit structurel depuis quarante ans, et nous ne pouvons plus rembourser la dette accumulée. Ce que nous voulons comprendre, c’est comment cette dette s’est constituée, année après année, et ce qui l’alimente. Je compare souvent la dette au cholestérol : il y a le bon et le mauvais cholestérol ; de la même façon, une dette née d’investissements que l’on peut rembourser, ce n’est pas grave.
Cette somme globale de 2 103 milliards comprend la dette de l’État, la dette des collectivités territoriales, la dette de la Sécurité sociale. Mais les collectivités territoriales remboursent, elles, leurs dettes. Il faut donc éviter les amalgames.
Nous voulons aussi comprendre comment la dette est gérée, ce qu’elle nous coûte et surtout qui la détient : les événements grecs nous ont bien montré que c’est celui qui détient la dette qui fait la loi dans un pays.
Nous souhaitons faire des recommandations et alerter les responsables – ce n’est pas une histoire de gauche ou de droite : les alternances ont été nombreuses en quarante ans, mais la dette a continué de croître. C’est un sujet qui ne devra pas échapper au débat politique de 2017 car à ce rythme, en 2020, nous aurons atteint un point de non-retour.
M. Jean-Claude Buisine, rapporteur. Y a-t-il, à votre sens, des raisons de maintenir à l’article L. 228-2 du code du commerce qui opère une distinction entre les émetteurs d’action et les émetteurs d’obligation, en ce qui concerne les informations qu’ils peuvent obtenir du dépositaire central ?
M. Renaud Duplay. Sur ces points, je vais malheureusement vous décevoir car ces questions relèvent de l’AFT. C’est elle, en effet, qui gère les actifs, et pourra donc notamment vous apporter des éléments sur les détenteurs de la dette.
Au sein du ministère des finances, la direction du budget est chargée de coordonner la préparation du budget de l’État. C’est un processus par essence interministériel, puisque chaque ministère – à différents niveaux, avec l’arbitrage in fine du Premier ministre – discute des moyens nécessaires à la mise en œuvre des politiques publiques. Nous sommes donc les principaux artisans de ce document et de ses quelques milliers de pages d’annexes.
La charge de l’intérêt de la dette est l’une des lignes de dépenses les plus importantes de l’État : elle représente un peu moins de 50 milliards d’euros chaque année, en diminution d’ailleurs grâce aux bas niveau des taux d’intérêt.
La direction du budget s’attache donc à assurer une bonne budgétisation de cette ligne. L’AFT, gestionnaire de la dette, est en quelque sorte l’équivalent d’un ministère – la relation de négociation n’est évidemment pas la même qu’avec d’autres ministères, puisque la charge de la dette s’impose à nous. L’AFT cherche à en optimiser le coût et les travaux menés au cours des dernières années ont largement contribué à la maîtrise du coût de la dette que l’on peut constater aujourd’hui.
Inversement, la direction du budget apporte à l’AFT le montant du déficit budgétaire, qui constitue un élément essentiel de la définition du programme de financement de l’État. Ce programme est en effet construit en fonction principalement des dettes à refinancer et des nouvelles dettes malheureusement nécessaires pour financer le déficit budgétaire. Il y a donc une sorte de boucle de rétroaction : nos travaux de budgétisation produisent un déficit budgétaire, et l’AFT nous communique le montant prévisible de la charge de la dette.
L’AFT est donc le gestionnaire de la dette. Ses responsables décident de la stratégie de financement et d’émission. Ils sont les mieux à même d’évaluer l’évolution probable de la charge de la dette, car ils sont bons connaisseurs des conditions envisageables de financement.
Nous interagissons également sur la question de la mutualisation des trésoreries : la direction du budget, en tant que tête de réseau d’un ensemble d’organismes, assure le dépôt de l’ensemble des liquidités des établissements publics auprès du Trésor, afin de faciliter le financement de l’État par l’AFT.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Quel est aujourd’hui le risque d’une dérive des coûts de la dette ? J’imagine que la direction du budget établit des prévisions, et même des simulations : il serait intéressant que nous disposions de ces documents.
Combien coûte le fonctionnement de ce « ministère de la dette » qu’est l’AFT ? Dans certains pays, la gestion de la dette est complètement externalisée, dans d’autres elle est complètement internalisée ; nous sommes dans une sorte d’entre-deux, si je comprends bien : quel est le budget de l’Agence, et comment évolue-t-il ? La gestion de la dette coûte-t-elle de plus en plus cher ?
Nous vous transmettrons sans doute des questions très précises par écrit, sur le coût des salaires de l’AFT, et par exemple d’éventuels allers-retours avec le secteur bancaire, par exemple. Nous aimerions en effet comprendre aussi comment la direction du budget travaille sur le budget de l’AFT.
M. Renaud Duplay. L’Agence France Trésor est un service du ministère des finances, inclus dans la direction générale du Trésor. Je ne dispose pas ici du niveau précis des effectifs, mais c’est une petite structure : c’est plutôt une structure d’état-major, qui pilote la stratégie de la dette, en lien avec des conseils. J’essaierai d’obtenir ces données et de vous les communiquer, mai le coût humain de la gestion de la dette par l’AFT est très faible.
Il ne faut pas oublier le réseau du Trésor, réseau d’une grande efficacité qui dépend de la direction générale des finances publiques (DGFiP). L’ensemble des comptables publics déposent en effet leurs liquidités auprès du Trésor – c’est une obligation légale. Ce réseau a un coût, bien sûr, mais il a bien d’autres fonctions : en particulier, il recouvre l’impôt et tient la comptabilité des collectivités territoriales. J’insiste ici sur son importance comme réseau centralisateur d’une trésorerie qui permet à l’AFT d’effectuer son métier d’optimisation de l’actif : nous n’avons pas de trésoreries dormantes, qui augmenteraient notre endettement brut et donc le coût du financement de la dette. Nous ne sommes pas dans la situation des pays, nombreux, où les trésoreries, souvent déposées dans le réseau des banques primaires – ce qui peut être une méthode pour soutenir le commerce –, sont très fragmentées. Cette concentration est facteur d’efficacité, et la gestion de la trésorerie par l’AFT se veut active. Ayant moi-même exercé le métier de conseiller des pays étrangers sur leur gestion financière, je peux vous assurer que le monde nous envie ce dispositif associant le réseau du Trésor et l’AFT.
L’AFT est donc un service du ministère, avec lequel nous construisons le projet de loi de finances. Notre relation n’est pas la même qu’avec d’autres ministères – si vous me permettez l’expression – dépensiers.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. La dette globale de 2 103 milliards d’euros que nous citions tout à l’heure est répartie entre dette de l’État, dette des collectivités territoriales et dette de la Sécurité sociale. La trésorerie est effectivement centralisée, mais chacun gère son endettement comme il l’entend. Cela pose d’ailleurs un problème aux collectivités territoriales dans leurs relations avec les banquiers : ceux-ci ne comprennent pas que l’on leur demande des prêts sans déposer d’argent auprès d’eux – c’est pourtant ainsi qu’ils gagnent de l’argent… Vous bénéficiez donc de la trésorerie, mais ce n’est pas le cas des collectivités territoriales, dont pourtant les comptes sont en équilibre – et qui payent leurs dettes.
Les frais financiers sont d’environ 46 milliards pour cette année. Mais quelle est, dans ces intérêts, la part imputable à la dette de l’État ? Pouvez-vous d’ailleurs nous confirmer, pour cette dette proprement dite, le chiffre de 1 600 milliards ?
Il est important pour nous d’évaluer précisément le coût de l’argent. Quand la charge de la dette diminue, on a l’impression que la dette diminue, et que ce n’est pas grave d’être en déficit, mais c’est faux ! L’encours de capital continue d’augmenter. C’est le piège de la dette : un retournement pourrait nous coûter 15 ou 20 milliards.
Quelle est la fragilité de cette dette ? Qui détient aujourd’hui la dette de la France ? La dette des collectivités territoriales est très bien connue, chaque collectivité a ses interlocuteurs ; il me semble que ce n’est pas le cas de la dette de l’État.
M. Renaud Duplay. Je suis à nouveau désolé de vous renvoyer à l’AFT qui saura notamment vous exposer qui détient notre dette. Ce sont d’ailleurs des données en partie publiques. La dette de l’État s’élève en effet à 1 600 milliards d’euros environ. L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) fournit de nombreuses données, en comptabilité nationale : dette des administrations publiques confondues, ce qui comprend la dette de l’État, mais aussi d’autres, celle de l’UNEDIC, par exemple. On y trouve un niveau de charge d’intérêt qui sera l’intérêt consolidé des administrations publiques. Je souligne la distinction entre comptabilité budgétaire et comptabilité nationale. Celle-ci ne tient pas compte exactement des mêmes faits générateurs ; elle ne comptabilise pas non plus tous les flux de cash, certains sont lissés dans le temps. Les normes variant, les données varient également.
S’agissant des dépôts des collectivités territoriales auprès du Trésor, c’est une sorte de contrepartie de l’avance de trésorerie consentie par l’État sur la fiscalité locale : celle-ci est recouvrée, je le rappelle, par les services de l’État, en fin d’année mais les sommes sont mises à disposition des collectivités territoriales, sur la base de prévisions, dès le mois de janvier, par douzièmes provisoires. Il y a donc une obligation de dépôt par les collectivités territoriales, mais celle-ci trouve sa contrepartie dans l’obligation de moyens de l’État. Vous vous interrogerez peut-être sur l’équilibre de cette relation, mais en tout cas elle n’est pas à sens unique.
M. Jean-Claude Buisine, rapporteur. Comment évoluent les dépenses et les recettes de l’État depuis 2002 ? Pouvez-vous distinguer, au sein des recettes, ce qui relève notamment de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les sociétés, de la TVA… ?
M. Renaud Duplay. Nous pourrons vous faire parvenir ces données, qui sont évidemment publiques, puisqu’elles figurent dans les lois de règlement.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Il faudrait à mon sens aller plus loin. Notre système est à la dérive depuis quarante ans, remontons jusqu’à 1974, dernière année où notre budget a été à l’équilibre ! L’année 2002, c’est une date électorale.
M. Jean-Claude Buisine, rapporteur. C’est aussi une date qui a un sens d’un point de vue économique.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. La date de 1974 me paraît également préférable. En 2002, il n’y a déjà plus de rémunération excessive des détenteurs de la dette. Il y a eu des années, en revanche, où certains ont gagné énormément d’argent – un rapport sénatorial de 1998 avait bien souligné ce phénomène, relevé aussi par Gilles Carrez dans son rapport de 2010. Nous touchons là à ce que l’on appelle la « dette illégitime ». Il est donc important de connaître, année par année, le montant de la dette, mais aussi la rémunération des détenteurs de cette dette.
Certaines études estiment à 600 milliards d’euros la dette que l’on aurait pu éviter si les taux d’intérêt n’avaient pas été excessifs. C’est une question cruciale.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. C’est à partir d’une loi votée sous Georges Pompidou que la France a financé son endettement par le recours aux marchés, plutôt que grâce à sa banque centrale. Aujourd’hui, les banques privées vendent de l’argent à l’État… Or ce sont des intermédiaires qui coûtent très cher. Il faut le mettre en évidence ! Ne pourrions-nous acheter l’argent un peu moins cher à la banque centrale ?
M. Nicolas Sansu, rapporteur. En effet, en 1973, on change de modèle. Quelles sont les conséquences de cette dérégulation sur la rémunération des détenteurs de la dette ? Nous voulons comprendre comme cette « boule de neige » des déficits excessifs s’est construite : pour cela, il nous faut une analyse sur le temps long. Il y a certes des déficits excessifs, mais ils ont, j’en suis persuadé, été amplifiés par des mécanismes financiers.
Tout cela est d’autant plus compliqué qu’aujourd’hui, la France place parfois sa dette à des taux d’intérêt négatifs – qui ne peuvent pas durer.
J’avais abordé ces questions dans mon rapport sur la proposition de résolution européenne que j’ai cité, mais ce n’était pas facile, puisque l’Agence France Trésor n’avait pas voulu venir devant nous… Cette fois, elle viendra.
M. Renaud Duplay. Je vous propose de formuler vos demandes par écrit, afin que leur champ et leur portée soient parfaitement précisés.
S’agissant de la politique monétaire, elle relève de la direction du Trésor, voire de la Banque de France.
S’agissant des données budgétaires, je me permets d’insister sur l’importance d’utiliser des données statistiques, c’est-à-dire conçues pour être comparables sur la longue durée, et qui englobent le périmètre le plus large. Nous pouvons également fournir des données budgétaires, mais celles-ci seront méthodologiquement plus hétérogènes : en particulier, ce qui relève de l’État, des collectivités territoriales, des comptes sociaux évolue au cours du temps. Des décisions politiques – la décentralisation, mais aussi les allégements de charges sociales compensées par l’État, par exemple – font évoluer les périmètres. La seule lecture des budgets successifs peut donc être difficile, et poser des problèmes d’interprétation. J’insiste enfin sur la rupture représentée, en termes de présentation du budget, par l’entrée en vigueur de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Les changements de périmètre peuvent avoir des conséquences importantes pour les politiques publiques. Ainsi, les collectivités territoriales payent leur dette, et si les dépenses étaient plus fortement régionales, elles seraient naturellement couvertes, puisque les régions ont l’obligation de présenter des comptes équilibrés – contrairement à l’État, qui vit en déficit depuis quarante ans. La dette de l’État est devenue pour tous les politiques une variable d’ajustement : tous les programmes politiques présentés lors d’une élection présidentielle sont financés par de la dette !
Il serait bon de pouvoir relier, sur quarante ans, des événements politiques comme la décentralisation à l’évolution de la dette. Les rôles respectifs de l’État et des collectivités territoriales varient en effet de façon importante, et cela peut avoir des conséquences sur la dette.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Il nous faudra en effet être attentifs aux variations des périmètres. Je note, mon cher collègue, que la décentralisation n’a pas fait diminuer la dette de l’État, bien au contraire.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Par ailleurs, les critères de Maastricht sont importants, mais ne pourrait-on pas les assouplir ? Ainsi, la France a des dépenses de défense plus élevées que la plupart de ses partenaires : ne pourrait-on pas faire sortir ces sommes du total pris en compte pour calculer si elle rentre dans les clous des fameux critères ?
M. Renaud Duplay. Les questions que vous abordez sont politiques, et je ne me permettrai pas de me prononcer sur le fond.
La dette existe. Il est bien difficile de l’attribuer à telle politique publique, à telle décision précise, de dire ce qui précisément est à l’origine de tel montant de dette, même si c’est une question bien compréhensible.
S’agissant des dépenses de défense, je souligne que le coût des opérations extérieures (OPEX) est finalement assez marginal, autour d’un milliard d’euros, c’est-à-dire 0,05 point de PIB. Il faut donc mettre ces dépenses en regard d’autres que nos partenaires pourraient à leur tour vouloir faire sortir de la comptabilité au sens de Maastricht – le coût de l’accueil des migrants, par exemple. Chaque pays a ses propres politiques publiques : subies ou choisies, il revient à la représentation nationale d’en décider.
M. Jean-Claude Buisine, rapporteur. Quel est le regard de la direction du budget sur la gestion de la dette ? Y a-t-il en la matière un point de non-retour ?
M. Renaud Duplay. Je vais à nouveau vous décevoir.
La question du point de non-retour a été abordée par de très nombreux économistes. Je n’ai pas d’expertise précise sur ce sujet. C’est de toute façon quelque chose de difficile à définir, et à évaluer : si un tel point de non-retour existe, il résulte à coup sûr de facteurs multiples, et non du seul niveau d’endettement. Ainsi, l’endettement du Japon est très élevé, mais ce pays se finance sans problème. Les États-Unis disposent bien d’un plafond légal de dette, mais ils le relèvent très régulièrement…
Quant au jugement sur la gestion, il ne m’appartient pas de me prononcer sur la qualité de la gestion de l’AFT. Il me semble, encore une fois, que c’est un système plutôt envié par nos principaux partenaires.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Vous défendez vos collègues, c’est la moindre des choses.
Nous aimerions également que vous récapituliez, année par année, les recettes fiscales. En effet, si l’on vote une loi que l’on appellerait par exemple « travail, emploi, pouvoir d’achat » (TEPA), et que l’on diminue les impôts des plus riches, cela gonfle-t-il la dette ? Si l’on se prive de recettes fiscales, la dette augmente… Il y a des déficits excessifs, mais il y a des déficits qui sont parfois organisés, de manière volontaire ou involontaire. C’est aussi un phénomène que j’avais constaté en travaillant sur les dettes souveraines. Nous aimerions ainsi faire apparaître les différents mécanismes de construction de la dette.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Ce que nous voulons, c’est mettre en évidence les événements importants : la progression de la dette depuis quarante ans n’est pas linéaire. Il faut aussi faire la part du structurel et du conjoncturel, ce qui n’est pas simple.
Bien sûr, un pays comme la France – dont les ménages détiennent quelque 4 500 milliards d’actifs financiers – pourrait sans problème supporter une dette de 1 600 milliards. Le problème, c’est que l’on ne rembourse plus : jusqu’où cela peut-il durer ? Il faut que les politiques prennent de vraies décisions. Or tous les programmes politiques promettent des baisses d’impôt… Ici même, dans cette salle, les mêmes proposent d’un côté de diminuer la TVA et de l’autre de faire baisser la dépense publique de 100 milliards !
Peut-on marquer les moments forts où la dérive s’amplifie ? Notre situation ne tombe pas du ciel. Les seuls responsables, ce sont les politiques.
M. Jean-Claude Buisine, rapporteur. Combien la France a-t-elle payé d’intérêts, et combien a-t-elle remboursé de principal depuis 1974 ? Quelle est la part des intérêts dans la composition de la dette publique actuelle ? Pourriez-vous mettre ces chiffres en parallèle avec la croissance de la dette publique depuis 1974 ?
M. Renaud Duplay. Ce sont là des questions de politique budgétaire : il faudrait les poser à M. le ministre, car elles vont bien au-delà de ma mission.
Je peux néanmoins apporter quelques éléments méthodologiques pour votre projet d’associer la progression de la dette à des actions politiques, c’est-à-dire faire le départ entre ce qui relève de décisions et ce qui relève de la conjoncture. Quand, en 2009, la récession survient, on s’attend naturellement à ce que les recettes plongent tandis que certaines dépenses, notamment des dépenses sociales, qui sont des stabilisateurs automatiques, augmentent. Dès lors, le déficit augmente et la dette également. Mais la dette peut également augmenter sous l’effet d’autres facteurs : reprises de dettes, par exemple. Certains pays confrontés à une crise de la dette – le Portugal ou la Grèce – n’avaient pas seulement des déficits excessifs : ils avaient aussi des dettes qui sont réapparues et ont dû être reconsolidées dans leur dette publique. Ce qui était soutenable a alors cessé de l’être.
L’analyse que vous appelez de vos vœux se heurtera à tous les problèmes de périmètre que j’évoquais : il est extrêmement délicat de distinguer, ne serait-ce que d’une exécution à l’autre, les effets de données économiques – croissance, chômage, prix du pétrole… –, de décisions politiques – telle ou telle variation de la législation fiscale, évolution des effectifs et des rémunérations de la fonction publique, investissements de transport ou programmes d’armement… – et d’événements exogènes ponctuels – catastrophes naturelles…
Des travaux européens sont menés pour essayer de mesurer un déficit structurel, qui serait isolé de l’effet d’événements ponctuels. Cette construction d’une donnée statistique permettrait d’évaluer l’effort structurel de chaque pays : les politiques contribuent-elles à diminuer, ou au contraire à renforcer, le déficit structurel ?
J’invite surtout à une grande prudence sur l’interprétation des données brutes d’exécution budgétaire. Il est bien difficile de faire le départ entre ce qui relève de la politique d’un gouvernement et de ce qui relève de facteurs exogènes. Il y a de plus des problèmes classiques d’effets retours : ainsi, un stimulus provoque de la croissance et améliore les recettes. Il s’agit donc d’un débat général sur la politique budgétaire.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Nous allons vous poser des questions par écrit. Mais nous vous avions fait parvenir un questionnaire, et la question des intérêts versés depuis 1974 y figurait ; or ce n’est pas une question de politique budgétaire ! C’est le résultat d’un calcul. Nous aimerions ne pas ressortir de cette audition sans aucune donnée chiffrée.
M. Renaud Duplay. Je peux vous donner un chiffre, mais sous toutes réserves.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Nous aurons au moins un ordre d’idées…
M. Renaud Duplay. La France aurait versé un peu plus de 1 200 milliards d’euros en intérêts entre 1975 et 2014, toutes administrations publiques confondues. Je pense qu’il s’agit de données courantes.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Il nous faudra reprendre les calculs pour avoir des euros constants.
J’aimerais aussi revenir sur les rémunérations, dans le passé. Nous sommes aujourd’hui encore, globalement, bien au-delà de l’inflation, ou du livret A. Mais certaines années, la rémunération a été trois, voire quatre points supérieure à l’inflation.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Des gens se sont enrichis, cela ne fait aucun doute. Et certaines décisions, prises avant 1974, doivent peut-être être remises en cause. Ce sont des décisions politiques…
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Madame, monsieur, merci. Nous vous transmettrons des questions écrites, et nous souhaitons recevoir des réponses précises.
M. Denis Beau, directeur général des opérations de la Banque de France.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Cette mission d’évaluation et de contrôle a pour objet principal l’examen des questions que posent la détention et la gestion de la dette. J’ai demandé la création de cette mission à la suite d’une proposition de résolution européenne relative à la dette souveraine des États de la zone euro, qui n’a pas prospéré, mais qui a suscité la rédaction d’un premier rapport.
L’action de la Banque de France intéresse notre mission à plusieurs égards. La Banque organise, avec l’Agence France Trésor (AFT), les adjudications de titres de dette de l’État ; produit des statistiques relatives à la dette publique, en particulier à sa détention ; met enfin en œuvre le programme d’achats de titres de dette publique décidé par la Banque centrale européenne.
Je vous laisse la parole pour un propos liminaire.
M. Denis Beau, directeur général des opérations de la Banque de France. Merci pour votre invitation. Je commencerai par apporter des éléments de réponse aux questions que vous m’avez posées par écrit.
S’agissant tout d’abord du rôle que joue la Banque de France dans l’organisation des adjudications de valeurs du Trésor, il est celui d’un prestataire pour le compte du Trésor. On peut le qualifier de technique : nous fournissons un système permettant de gérer ces adjudications et nous les animons afin qu’elles se déroulent bien du point de vue technique. C’est important, certes, mais ce qu’il convient de retenir, c’est que nous n’intervenons pas dans la politique d’émission ni dans les critères de choix. Dès lors que le principe d’une adjudication a été validé, nous apportons l’outillage technique requis. Et, dans ce cadre, nous sommes soumis à certaines diligences.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Vous êtes le service des marchés publics de l’AFT ?
M. Denis Beau. Disons que, pour mener des adjudications sur une dette aussi importante que celle de la France, il faut un outil technique performant, et que notre contribution consiste à fournir cet outil à l’AFT.
Vous nous avez interrogés en deuxième lieu sur les statistiques relatives à la détention de la dette de l’État. Ces statistiques sont établies par la Banque de France à partir d’une collecte réalisée auprès d’établissements teneurs de comptes-titres, dans le cadre de l’élaboration de la balance des paiements, pour des besoins qui nous sont propres, pour la stabilité financière et la politique monétaire.
C’est dans ce cadre que nous publions dans la balance des paiements des données concernant la part de la dette française qui est détenue par des non-résidents. Selon le dernier chiffre dont je dispose, qui concerne le troisième trimestre 2015, cette part est estimée à 63 %.
Quant à la part de la dette qui est détenue directement par les ménages, elle était, toujours au troisième trimestre 2015, très faible puisqu’elle dépassait pas 0,01 %, soit 260 millions d’euros, sur 1 900 milliards d’euros de dette totale : c’est marginal.
J’en viens au programme d’achat de titres de dette publique mené par l’eurosystème – la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales. Un élément de contexte, d’abord. Trois programmes sont en cours d’exécution : les deux premiers, lancés en octobre et novembre 2014, permettent d’acheter des actifs privés tandis que le troisième, le plus important, vise les titres publics ; il a débuté en mars 2015. Au total, l’eurosystème achète environ 60 milliards d’euros de titres par mois, en valeur de marché. Selon la communication qui a été faite, il est pour l’instant prévu que ces achats durent jusqu’en mars 2017.
C’est le Conseil des gouverneurs de la BCE qui a décidé de ce programme et qui en a arrêté les principes. Les titres éligibles au programme d’achat de titres publics ont une maturité comprise entre deux et trente ans et proviennent de quatre catégories d’émetteurs : les États souverains de la zone euro, les agences reconnues par l’eurosystème, les collectivités territoriales et les émetteurs supranationaux localisés dans la zone euro. Pour sélectionner ces titres, on applique en outre des critères de qualité de crédit.
Un principe fondamental de fonctionnement de l’eurosystème est la décentralisation. En vertu de ce principe, ce sont les banques centrales nationales qui procèdent à l’exécution des décisions – en l’espèce, des achats de titres. Cette logique très prégnante est guidée par des considérations d’efficacité : les marchés sont complexes et chaque banque centrale dispose d’équipes spécialistes du marché national. Plusieurs règles permettent de coordonner et d’assurer l’exécution de ces achats comme s’ils étaient l’œuvre d’une seule banque centrale dotée de multiples bras.
S’agissant de l’allocation des achats entre les différentes banques centrales nationales, les montants sont déterminés selon une clé qui correspond à la répartition du capital de la BCE. De ce fait, la Banque de France achète environ 20 % des 60 milliards mensuels. La BCE elle-même procède à des achats, mais pour des montants limités, qui représentent 8 % de l’ensemble des titres à acheter.
Selon les classes d’actifs, ce principe de décentralisation peut être aménagé. En ce qui concerne les titres supranationaux, compte tenu des caractéristiques de ce marché et des compétences des banques centrales nationales, deux banques centrales, dont la Banque de France, procèdent aux achats pour toutes les banques centrales de l’eurosystème.
En outre, un principe de spécialisation s’applique, en vertu duquel chaque banque nationale, en raison de sa connaissance du marché national, est appelée à intervenir sur le marché dont elle est le plus proche. De ce fait, la Banque de France achète au premier chef des titres français, même si nous en achetons aussi d’autres – je viens de mentionner les titres supranationaux.
J’en viens aux modalités d’achat. Lorsqu’il s’agit de déterminer le montant à acheter au cours d’une période donnée, la coordination est un peu plus poussée. Dans ce cas, en effet, l’on s’efforce de peser le moins possible sur le fonctionnement des marchés sur lesquels on intervient. À cette fin, un principe de neutralité est appliqué dans tout l’eurosystème. Ainsi, s’agissant de titres dont la maturité s’échelonne de deux à trente ans, on achète l’ensemble des titres en respectant la maturité moyenne des dettes sur lesquelles on intervient. En outre, les interventions ont lieu tous les jours, tout au long de la journée. C’est aussi ce souhait de limiter leurs conséquences sur la liquidité des marchés qui explique la création de dispositifs permettant de prêter à nouveau les titres achetés dès lors qu’un phénomène de rareté se ferait jour sur le marché.
Au 31 janvier 2016, la Banque de France avait acquis 84,4 milliards d’euros de titres souverains. Sachant que les 8 % achetés par la BCE sont attribués aux différentes dettes de la zone euro en fonction de la répartition de son capital, la dette française achetée dans le cadre du programme depuis son lancement en mars 2015 représente au total 92 milliards d’euros environ, sur 553 milliards de titres publics achetés.
Vous m’avez interrogé sur les conséquences sur les taux d’intérêt des rachats de dette publique par les banques centrales. Leur évaluation précise est un exercice délicat, car de multiples facteurs jouent sur le prix de ces titres sur le marché secondaire ; mais des estimations sont possibles. Je vous renvoie à la récente analyse de l’INSEE à ce sujet, publiée en décembre 2015, et qui tend à montrer qu’à elle seule, l’anticipation du programme par les opérateurs de marché a fait baisser les taux de 80 points de base, ce qui est assez significatif compte tenu du niveau absolu des taux d’intérêt. Il existe évidemment une marge d’erreur. Mais l’on peut considérer que l’effet global des programmes d’achat sur les niveaux généraux des taux sur le marché équivaut à une baisse d’environ 100 points de base des taux directeurs.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Vous donnez l’impression d’être plutôt un sous-traitant, un opérateur extérieur : vous facilitez la gestion de la dette, sans intervenir dans la politique qui la gouverne. Mais quel est votre point de vue sur cette gestion ? Est-ce une routine faite pour durer des années, ou pourrait-elle être compliquée par l’augmentation continue de la dette ?
M. Denis Beau. Je l’ai dit, notre rôle en la matière est technique et c’est de ce point de vue que je vous répondrai. Nous nous efforçons d’apporter les outils les plus performants compte tenu du type de technique d’adjudication retenu par l’AFT. Le fonctionnement de ces adjudications et la qualité technique de la gestion de la dette me paraissent très satisfaisants.
M. Jean-Claude Buisine, rapporteur. Comment analysez-vous la dette publique ? Sa gestion actuelle ne comporte-t-elle pas des risques ?
M. Denis Beau. À chaque adjudication, concrètement, les spécialistes en valeur du trésor (SVT) soumettent des offres qu’il faut collecter dans un temps donné. Les risques opérationnels que présente l’exécution de cette opération sont très étroitement surveillés. En effet, des procédures de secours renforcées sont prévues, afin que l’adjudication puisse être exécutée dans un très grand nombre de cas, même si le dispositif principal devait être entravé par des difficultés de communication. Ces procédures garantissent un niveau très élevé de sécurité à l’AFT qui peut ainsi conduire ces opérations comme elle l’entend, au moment où elle l’a décidé.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Vous êtes passé rapidement sur la détention de la dette. Or on sait que les statistiques concernant sa répartition entre résidents et non-résidents sont très fortement biaisées. Si j’achète de la dette française à Londres, suis-je considéré comme résident ou comme non-résident ? Et qu’en est-il si un étranger achète un titre de dette française sur la place de Paris ? Comment avoir davantage d’informations à ce sujet, comment mieux catégoriser les détenteurs ? Si ce n’est pas possible, pourquoi ?
Savez-vous à quel rythme les titres de dette publique française s’échangent sur le marché secondaire ?
J’en viens au programme de quantitative easing (assouplissement quantitatif), qui porte sur 1 140 milliards d’euros au total. Vous avez parlé d’un gain de 100 points de base sur les taux, ce qui, rapporté aux quelque 10 000 milliards de dette des États de la zone euro, n’est pas négligeable !
Je suis gêné par le principe de neutralité dont vous avez fait état. Le but du rachat de titres n’est-il pas que nos dettes souveraines ne représentent plus un risque pour les États et pour les peuples ? J’entends bien que c’est une façon de réguler le marché. Mais quel est le rôle des banques centrales, et d’abord de la Banque de France, depuis 1974 ? Comment a-t-il évolué eu égard à la gestion de la dette, à l’émission des titres et à leur gestion ? Depuis cette époque, le circuit du Trésor a disparu et aucun véritable circuit européen ne s’y est substitué. Est-il, à vos yeux, possible d’en créer un afin de mieux contrôler notre dette ? Au Japon, la dette est phénoménale mais elle est détenue par les ménages, ce qui n’est pas le cas en France. N’est-il pas envisageable de relancer des emprunts d’État pour reprendre la main sur la dette car si celle-ci était directement détenue par les résidents, les enjeux ne seraient pas tout à fait les mêmes ?
M. Denis Beau. Permettez-moi d’abord de clarifier un point concernant l’objectif des programmes d’achat.
Ces programmes relèvent des mesures de politique monétaire dites non conventionnelles : ils ont été engagés alors que l’on avait déjà fait très fortement baisser les taux d’intérêt et mené des politiques dites de credit easing (assouplissement qualitatif), c’est-à-dire de prêt à des maturités de plus en plus longues aux établissements de crédit. Nous avons conduit cette politique monétaire en nous appuyant sur les établissements de crédit et sur leur capacité de transmission, pour une raison essentielle : le rôle majeur que jouent ces établissements dans le financement de l’économie de la zone euro. À un certain stade, nous avons souhaité, compte tenu de l’évolution de l’inflation et des anticipations d’inflation – car c’est là notre objectif fondamental –, continuer de peser sur les conditions monétaires en utilisant des moyens complémentaires. Tel est le sens des programmes d’achat.
Leur but est bien d’intervenir sur les courbes de taux d’intérêt sur le marché secondaire des titres d’État pour les infléchir à la baisse, mais dans le cadre de la politique monétaire, afin, par l’intermédiaire de différents mécanismes de transmission, de soutenir la demande et de faire évoluer l’inflation vers l’objectif de la BCE. La baisse qu’ont subie les taux est le signe que ces mesures fonctionnent. On a fait diminuer les taux souverains et cette baisse des conditions de rémunération s’est transmise à l’économie réelle à travers les conditions auxquelles les différents acteurs empruntent.
La question des échanges de titres de dette sur le marché secondaire excède notre mission de soutien technique à l’AFT. D’une manière générale, il est difficile d’obtenir des statistiques concernant les échanges de dettes obligataires sur le marché secondaire, dont des pans entiers correspondent à des opérations de gré à gré. Avec ce que l’on appelle l’électronification des marchés, c’est-à-dire le développement des plateformes électroniques sur lesquelles les acteurs se connectent pour échanger, ces échanges sont devenus un peu plus faciles à mesurer. Mais la Banque ne dispose pas de statistiques à ce sujet.
En ce qui concerne la détention par les non-résidents, les données que nous connaissons sont publiées : je ne peux que vous y renvoyer. S’agissant plus précisément de la classification d’un achat de titres selon que celui-ci se déroule à Londres ou à Paris, nous pourrons interroger nos spécialistes. Il me semble, mais c’est à confirmer, que le critère est l’origine du détenteur et non le lieu de la négociation, puisque, je l’ai dit, les statistiques sont issues d’une enquête menée auprès des établissements qui tiennent les comptes-titres. Il peut dès lors y avoir des subtilités qui nécessitent un travail particulier et peuvent expliquer qu’il soit difficile d’obtenir des statistiques fines.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Pourriez-vous nous expliquer le mécanisme des taux d’intérêt négatifs ?
M. Denis Beau. Il faut partir des conditions auxquelles les établissements de crédit se refinancent auprès de la banque centrale – BCE et banques centrales nationales, sachant que, je l’ai dit, ce sont ces dernières qui interviennent du point de vue opérationnel auprès des établissements bancaires. Il existe des taux directeurs, ceux auxquels la banque centrale prête aux établissements de crédit, et un taux de dépôt, qui est aujourd’hui négatif, de 30 points de base. Cela signifie qu’une banque privée qui dispose d’un excédent de liquidité peut déposer cet argent à la banque centrale et que cela lui coûtera 30 points de base. C’est une incitation à placer cette liquidité ailleurs pour obtenir un meilleur rendement. C’est l’un des objectifs que poursuit une banque centrale en proposant des taux négatifs : il s’agit d’une incitation de politique monétaire à acheter des actifs, par exemple des titres d’État, ce qui, si de nombreuses banques font de même, crée une demande de ces titres, laquelle entraîne une baisse des taux qui va s’étendre à d’autres classes d’actifs à travers des mécanismes dits de portfolio rebalancing (rééquilibrage du portefeuille). Ainsi, l’ensemble des conditions monétaires dans l’économie s’oriente à la baisse, ce qui soutient la demande et crée un supplément d’activité qui contribue à relancer l’inflation vers l’objectif de la banque centrale.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Ce n’est peut-être pas à vous de répondre à cette question, mais un pays dont la dette est détenue à plus de 50 % par des non-résidents est-il dans une situation à risque ? Dans le cadre des opérations que vous conduisez, avez-vous eu la consigne de faire en sorte que la proportion de résidents augmente ? À quels critères vous conformez-vous, au fond ? Ne s’agit-il que d’acheter l’argent le moins cher possible, sans considération du porteur ? Avez-vous seulement des consignes ?
M. Denis Beau. Comme vous le suggérez vous-même, ce n’est pas à moi de répondre à votre question.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Dans les opérations que vous menez, savez-vous avec qui vous traitez ?
M. Denis Beau. Du point de vue de la banque centrale qui achète des titres dans le cadre des programmes dont je vous ai parlé, les achats permettent de poursuivre les objectifs de politique monétaire que je vous ai décrits. Comme prestataires de service pour le compte de l’AFT, nous ne nous posons pas cette question. Nous fournissons un service technique afin que l’adjudication se déroule conformément au souhait de l’AFT.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Vous n’êtes que techniciens ? Vous ne prenez aucune initiative ?
M. Denis Beau. Nous ne sommes que des opérateurs. J’ai défini la prestation que nous fournissons à l’AFT : nous lui apportons un outil pour gérer des soumissions et nous organisons la séance d’adjudication de sorte que tous les ordres soient bien transmis en temps et en heure et que l’AFT dispose des informations nécessaires pour décider du prix d’émission de la dette qu’elle a soumise à adjudication à tel moment. Voilà notre rôle ; il ne va pas plus loin.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Merci.
M. Benjamin Lemoine, chargé de recherches en sciences sociales au Centre national de la recherche scientifique, auteur d’une thèse sur la mise en marché de la dette publique française intitulée Les valeurs de la dette. l’État à l’épreuve de la dette publique.
M. Jean-Claude Buisine, rapporteur. La mission d’évaluation et de contrôle poursuit ses travaux avec l’audition de M. Benjamin Lemoine. Cette audition permettra de mettre en perspective le sujet de notre mission, puisque vous avez étudié le passage d’une dette administrée dans le cadre du circuit du Trésor à une dette de marché, ainsi que la transformation de la dette en une contrainte avec laquelle la décision politique doit composer.
Vos travaux pourront utilement nous éclairer sur les questions suivantes : comment la solution du recours au marché s’est-elle imposée, et quelles ont été les conséquences de cette décision ? Comment apprécier le rôle des grandes banques spécialistes en valeurs du Trésor (SVT) ? Le fait que la dette de l’État soit désormais majoritairement détenue par des non-résidents constitue-t-il un atout ou un handicap ?
M. Benjamin Lemoine, chargé de recherches au Centre national de la recherche scientifique. Les recherches que je vais vous présenter font suite à une enquête historique, sociologique et économique, que j’ai conduite pour ma thèse de doctorat. Il s’agit de comprendre comment la dette de marché, avec laquelle nous vivons aujourd’hui, est progressivement devenue normale et s’est substituée à l’ancien système. Cette plongée dans les expériences du passé permet d’éclairer sur les possibilités et les marges de manœuvre qui ont été progressivement écartées.
Aujourd’hui, la technique dominante est celle de l’endettement de l’État sur les marchés financiers, assuré par l’Agence France Trésor (AFT) qui émet une dette reconnue pour sa liquidité. Cette gestion fait ses preuves vis-à-vis de la communauté financière internationale.
Cette technique offre un certain nombre d’avantages, notamment celui de pouvoir emprunter à un taux d’intérêt très faible. Mais beaucoup de commentateurs rappellent que ce phénomène est réversible et soumis à de nombreux aléas. Cette configuration de marché, avec tous ses avantages, emporte aussi une série de contraintes à respecter pour entretenir la qualité de la signature de la République française. Cette gestion de la dette implique une manière de présenter ses comptes — ainsi, des techniques de comptabilité financière privée ont progressivement été introduites, notamment avec la loi organique relative aux lois de finances — et aussi une façon d’organiser et de penser les politiques économiques et financières.
Dans ma thèse, je défends l’idée qu’une différence politique cruciale se niche dans ces modalités concrètes par lesquelles l’État se finance et émet sa dette ; en somme, dans la nature des techniques de souscription elles-mêmes.
Il ne s’agit pas d’une histoire propre à la France. Ce qui importe au niveau mondial, c’est de comprendre les rapports entre sphère publique et sphère privée qui sont induits par cette technique de financement, c’est-à-dire les rapports entre, d’une part, une sphère d’administration des activités bancaires et financières par la loi et le règlement, et, d’autre part, une sphère d’accumulation individuelle de ces actifs financiers libérés de ces contraintes réglementaires et administratives.
On trouve quelques données chiffrées dans une étude du Fonds monétaire international publiée en septembre 2014 par le département « Fiscal Affairs » et intitulée : « La composition de la dette souveraine dans les économies avancées : une perspective historique. » Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, deux types de dette publique coexistent : la dette dite « non négociable », régie par des règlements administratifs et politiques et la dette dite « négociable » — on pourrait dire marchande — c’est-à-dire émise, vendue et distribuée conformément à des procédures de marché. La part de la dette non négociable, non marchande, était très largement dominante en Allemagne, en Italie et en France. Au Royaume-Uni, elle était émise à parts égales avec la dette négociable.
La dette marchande est passée, au Royaume-Uni, de 51 % de la totalité de la dette émise en 1945 à 82 % en 1993. En Allemagne, le grand bond vers le marché est considérable, la dette marchande passe de 8 % en 1953 à 81 % en 1993.
Les Trente glorieuses ont été des années d’expérimentation de financement de l’État en dehors des procédures de marché. Pendant une courte parenthèse historique, de 1944 à la fin des années soixante en France, le Trésor pouvait se financer de façon administrée en dehors des procédures de marché. Ces modes de financement ont été un instrument, parmi d’autres, qui a favorisé cette période de forte croissance, en permettant l’investissement public dans l’économie et un certain nombre de retours sur investissement pour les finances publiques. Jusqu’aux années soixante-dix, ces instruments administrés ont constitué une part dominante de la dette, mais, dès 1987, cette proportion s’est inversée, puisque les instruments négociables sont devenus omniprésents : plus de 90 % des instruments émis étaient alors négociables.
On associe la naissance de la dette publique au déséquilibre budgétaire, qui apparaît en 1974. La chronologie que je propose est un peu différente : en s’intéressant aux évolutions des instruments de financement, on voit apparaître les premiers changements dès le milieu des années soixante, avec des réformes successives du système administré. Les premières expérimentations commencent en 1963, et un coup d’arrêt important sera porté aux mécanismes administrés entre 1966 et 1968, lors du passage au ministère des finances de Michel Debré, accompagné de son conseiller Jean-Yves Haberer. Ces éléments sont très bien documentés, notamment par le comité d’histoire économique et financière du ministère des finances.
Il est intéressant de constater que ces changements ont toujours été analysés comme des développements naturels, comme s’il fallait se plier à la loi d’évolution de la contrainte internationale. À la lecture de ces études et des archives, on note cependant que, dès les années soixante, une critique des mécanismes administrés se développe, et qu’un débat s’installe au sein de la direction du Trésor pour rompre petit à petit avec ces mécanismes de financement de la dette en dehors des marchés.
Si la chronologie budgétaire commence en 1974 avec le premier budget exécuté en déficit, la chronologie des changements concernant les instruments de financement lui est antérieure d’une dizaine d’années. En 1968, la phase d’expérimentation initiale est achevée, comme le démontre l’étude du plancher des bons du Trésor. Cet outil de financement paraîtrait aujourd’hui totalement hétérodoxe vis-à-vis du système bancaire et financier, car il s’agissait d’un système réglementaire contraignant les banques à souscrire des titres d’État dans une certaine proportion de leurs actifs en portefeuille. Or, dans les années soixante, cette part réglementaire a été progressivement réduite, puis définitivement fermée.
Cette technique offrait une sécurité de financement pour l’État, puisqu’elle lui assurait des liquidités en toutes circonstances en fonction de l’évolution de la masse monétaire — des actifs que détenaient les banques en portefeuille —, mais elle se voulait aussi une expérience vertueuse sur le plan de la monnaie. On pourrait penser que ces mécanismes administrés étaient inflationnistes, mais, à l’époque, ils ont précisément été constitués comme une manière de contrôler la masse monétaire, permettant au Trésor de garder un œil sur ce que faisaient les banques de leurs liquidités et de geler certains actifs des banques, les empêchant de prêter plus encore à l’économie réelle.
De manière anachronique, on pourrait comparer cela à un système de réserves obligatoires, à cette différence près que ces réserves étaient placées en bons du Trésor. Ce système jouait donc un double rôle de contrôle de la politique monétaire et de financement de l’État. Ce dispositif était très original : le taux d’intérêt était fixé autoritairement par l’État, il n’y avait donc pas de prix de marché pour ces bons ; et il se voulait une expérience de contrôle centralisé de la politique monétaire.
Non seulement ces bons du Trésor ont disparu, mais un découpage institutionnel de toutes ces fonctions s’est peu à peu mis en place. Quand l’État était le grand banquier de l’économie, il fonctionnait comme une banque de dépôt, contrôlant la politique monétaire tout en se finançant. Progressivement, ces fonctions ont été dissociées, pour attribuer la politique monétaire exclusivement à la Banque de France — bien avant Maastricht et la construction européenne —, tandis que le Trésor se contentera d’émettre de la dette de marché sans se préoccuper de la question monétaire.
Un des résultats de ce découpage est que, aujourd’hui, l’État émet des obligations dont le taux d’intérêt est indexé sur l’inflation, ce qui protège les investisseurs. Si l’État s’autorise à émettre des titres de ce type, c’est qu’il parie sur le fait que la Banque centrale européenne appliquera une politique d’inflation contenue ; vous imaginez bien que, si l’inflation venait à déraper, le taux d’intérêt de ces titres exploserait.
Cet exemple démontre que le contrôle de la monnaie et le financement de l’État sont cloisonnés institutionnellement. L’inflation est presque devenue une donnée objective, sur laquelle le Trésor n’a plus aucun levier et que l’État délègue totalement à la Banque centrale européenne. Les investisseurs étant protégés de l’inflation sur la valeur de leurs titres, ils acceptent de prêter à l’État à un taux d’intérêt moins élevé. C’est donc bénéfique pour l’État, qui peut se financer à moindre coût ; néanmoins, il conforte cette politique anti-inflationniste. De nombreux économistes se demandent s’il faut préférer une inflation aussi faible ou une inflation légèrement plus élevée. Dans une certaine mesure, ces outils tranchent le débat : l’État émet des instruments qui induisent qu’une inflation basse est bonne ad vitam aeternam, que c’est la meilleure pour la politique économique.
Vous avez eu, à l’occasion de l’audition qui s’est tenue hier, une illustration du fonctionnement de l’État banquier, lorsque votre interlocuteur de la direction du budget a souligné que les collectivités locales déposaient leur trésorerie au Trésor de façon contrainte. D’une certaine manière, ce dépôt obligatoire des collectivités locales est le dernier résidu de ce que j’appelle le circuit du Trésor, qui était beaucoup plus étendu auparavant. Le nombre d’institutions contraintes de déposer leur trésorerie auprès de la direction du Trésor était alors bien plus élevé : étaient concernées la Caisse des dépôts et consignations, une série de banques publiques telles que le Crédit foncier, le Crédit national, le Crédit agricole, ainsi que le compte chèque postal, qui recueillait l’épargne des particuliers. Plutôt que de déposer leurs liquidités dans une banque, certains particuliers préféraient ainsi recourir à l’État et les déposer aux guichets du Trésor. Ces fonctions ont été définitivement démantelées dans les années 2000. La Banque de France a elle aussi géré pendant longtemps des comptes pour de la clientèle particulière.
Il est intéressant de garder cet élément présent à l’esprit dans le débat actuel : ces dépôts étaient en partie utilisés pour financer les écarts entre dépenses et recettes à court terme.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. C’est de la cavalerie !
M. Benjamin Lemoine. À l’époque, c’était considéré comme de l’orthodoxie budgétaire. Ce n’était pas le seul mode de financement, mais c’était l’un des moyens de financer la trésorerie de l’État. L’emprunt n’a pas disparu pendant cette période, mais il n’était qu’une technique parmi d’autres. Ce qui a disparu aujourd’hui, c’est la pluralité des moyens de financement, il ne reste aujourd’hui qu’un instrument exclusif.
En 1955, ces mécanismes faisaient du Trésor le premier collecteur de fonds de l’économie, Banque de France mise à part. À lui seul, il recueillait plus de capitaux que le secteur bancaire : le Trésor recueillait 695 milliards de francs contre 617 milliards pour le secteur bancaire. Il en redistribuait également davantage : 783 milliards. L’argent était donc marqué du sceau de l’administration publique. Cela allait de pair, à l’époque, avec la nationalisation des banques et du crédit.
Aujourd’hui, on peut tenter d’imaginer ce que serait un Trésor européen. Pourrait-on imaginer des dispositifs analogues permettant de coordonner le contrôle de la politique monétaire et le financement d’un Trésor européen, tout en réglementant le système bancaire à l’échelle européenne ?
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Dans les années quatre-vingt, les collectivités locales se sont surtout financées avec des prêts structurés, ce qui a permis de faire baisser le coût de l’argent. Ce système a été très efficace jusqu’à ce que la complexité de ces produits soit telle qu’ils en deviennent toxiques. Mais les taux sont passés de 15 % à des niveaux très bas, proches de 2 %. Les collectivités sont donc sorties des emprunts à taux fixes sur des périodes bien tenues pour adopter une gestion plus dynamique de la dette. Après les Trente glorieuses, l’État est entré dans ce dispositif et se fournit sur le marché. Pour vous, une telle gestion de la dette a-t-elle permis de gagner de l’argent ? Le coût a-t-il diminué par rapport à la période précédente, lorsque les mécanismes n’étaient pas négociables ? Peut-on craindre qu’une forme de toxicité ne se soit aussi installée dans la gestion de la dette ?
Par ailleurs, pensez-vous que ce sont nos politiques publiques qui influencent la dette ou que, à l’inverse, la dette influence nos politiques ? Nous entendons lors de chaque campagne électorale les engagements des uns à baisser les impôts, des autres à baisser la TVA : tout le monde finance ses rêves électoraux avec de la dette. On s’en rend compte en permanence au sein de la commission des finances : ceux qui proposent des mesures de réduction des déficits sont capables de proposer en même temps des baisses de recettes, ce qui entretient la dérive du système : le déficit structurel est de plus de 70 milliards et la dette ne fait que grandir.
Enfin, quel est le lien entre le coût de l’argent et le montant de la dette ?
M. Benjamin Lemoine. Il ne faut pas pousser trop loin l’analogie entre les différents émetteurs de dette. L’Agence France Trésor regroupe une concentration d’expertise assez forte. Dans la configuration de marché, l’État continue de fonctionner avec le souci de l’intérêt général, de se placer au service du citoyen en finançant la dette au meilleur coût tout en gardant le souci de la stabilité de cette émission à long terme.
Cela veut dire que l’État refuse de prendre des risques inconsidérés. Les produits structurés auxquels certaines collectivités locales ont souscrit étaient connus du Trésor, et, s’il avait pu conseiller les collectivités locales, il leur aurait fortement conseillé de ne pas y souscrire. Le Trésor se refuse à ce genre de pratiques risquées.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Dans les emprunts toxiques, on recherche le degré de responsabilité respectif des communes, des banques et de l’État. L’État s’est toujours désengagé en s’abritant derrière le principe de libre administration des collectivités locales, et il lui a été reproché de ne pas offrir ce niveau de conseil.
M. Benjamin Lemoine. Pour ce qui concerne la gestion de la dette de l’État, il est évident que le Trésor ne rentrera pas dans ce modèle de gestion risquée.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Si nous sommes passés des emprunts structurés aux emprunts toxiques, c’est pour faire face à un besoin d’argent. Les 4 000 collectivités qui ont souscrit le même type d’emprunt au même moment avaient deux types de préoccupations : alléger le poids de leur dette et financer leurs projets. Si le marché pour financer la dette française vient à s’assécher, on inventera peut-être des mécanismes pour continuer de vivre à crédit, et c’est alors que le risque de toxicité peut survenir.
M. Benjamin Lemoine. Il y a une histoire de la mise en marché de la dette des collectivités locales, à laquelle ont participé Dexia et un certain nombre d’institutions qui étaient publiques, et qui ont progressivement adopté des modèles de gestion calés sur la finance de marché. L’administration publique a été liée à la promotion du modèle de la finance de marché pour les collectivités locales. En ce sens, on peut y trouver une forme de responsabilité des pouvoirs publics.
S’agissant de la toxicité, mon hypothèse est différente. Si nous reprenons l’exemple des obligations indexées sur l’inflation, il s’agit d’un produit considéré comme sécurisé, mais il emporte une série de contraintes radicales sur la façon de penser les politiques économiques. Par exemple, il incite à privilégier la lutte contre l’inflation plutôt que le plein-emploi.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. C’est une forme de toxicité.
M. Benjamin Lemoine. Libre à vous de le qualifier ainsi. En tout cas, c’est une contrainte, un verrou sur la manière d’envisager les politiques économiques. Il n’est pas seulement dans la pensée des acteurs, mais il se concrétise dans des instruments de financement : des choix sont faits sur les politiques économiques à venir.
Vous m’interrogiez sur l’influence des politiques publiques sur la dette, et inversement. Il faut rappeler que cette politique de mise en marché de la dette a été un projet d’État. Il y a même consacré des moyens considérables : en 1987, pour faire la promotion de ses nouveaux titres, l’État a recruté une société de communication et loué des plages à la Régie française de publicité. Un clip a été diffusé sur FR3, dans lequel Paul-Loup Sulitzer vantait les mérites de la nouvelle dette d’État mise sur le marché. Il y a donc eu une stratégie d’État de commercialisation de la dette, ce sont les pouvoirs publics qui ont décidé, au nom de l’intérêt général, parce que le recours au marché coûterait moins cher, d’adopter et de faire leurs un certain nombre de contraintes. Il a décidé de jouer de ces contraintes, et de faire les politiques qui feraient de nous le bon élève aux yeux des investisseurs financiers.
C’est une stratégie : l’Agence France Trésor se pense aujourd’hui comme éminemment technique, mais l’histoire longue nous montre que cette technique est le produit de choix de politiques publiques de financiarisation des techniques d’alimentation de la trésorerie.
Vous m’avez interrogé sur la différence de coût d’une période à l’autre ; au début des années soixante, l’équivalent de l’Agence France Trésor, alors appelé « Bureau A1 de la trésorerie et du financement de l’État », s’opposait par la voix de son directeur de l’époque, Maurice Pérouse, au retour du mécanisme de marché pour l’émission de bons du Trésor. Selon lui, l’adjudication provoquerait un renchérissement considérable pour le Trésor du coût de ses opérations et se traduirait du même coup par un « enrichissement sans cause » pour les banques. Il pointait également les risques de réaction de la presse et de l’opinion difficilement contrôlables, et le fait que cette procédure ferait échapper au contrôle du ministère des finances une des vannes qui contribuaient alors à l’alimentation de la trésorerie. Les services du Trésor s’inquiétaient même des taux obtenus sur les marchés, qu’ils ne maîtrisaient plus. Selon une note du Trésor de l’époque : « Par l’incidence de mesures délibérées prises dans le cadre de notre politique monétaire générale, les baisses successives du “plancher” de bons du Trésor des banques depuis deux ans (ramené en un an de 25 % à 15 % des dépôts) ont non seulement tari, mais transformé en charge un mécanisme qui assurait jusqu’alors à la trésorerie des ressources pratiquement indexées sur l’évolution des dépôts bancaires. » En résumé, on a créé une contrainte et un coût là où de l’argent arrivait quasiment sans coût.
Pour être objectif, il faut expliquer la philosophie qui sous-tendait ces réformes. En s’attaquant à ces mécanismes administrés, on escomptait réduire l’inflation, car on pensait que cela réduirait la part de création monétaire imputable à l’État. À l’époque où l’on va réformer ces instruments, l’inflation avait été contenue à 6 % en moyenne de 1950 à 1960. On a donc accusé le système de bons du Trésor d’être responsable de l’inflation, mais elle était à peu près contenue au cours de ces années. Ce n’est que dans les années soixante-dix que l’inflation a fortement augmenté pour passer à des taux à deux chiffres, et cela s’explique par des facteurs internationaux.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Vous nous expliquez que, afin de rendre la dette un peu plus efficiente, nous en avons perdu le contrôle. La mission d’évaluation et de contrôle s’intéresse à la gestion et à la transparence de la dette. En ce qui concerne sa gestion, nous avons compris qu’un type de structure de dette induira un certain type de contraintes sur les politiques publiques. Vous nous avez dit que l’État continuait à faire de la maîtrise de l’inflation la priorité absolue, comme en témoigne l’émission de titres indexés sur l’inflation. L’Agence France Trésor propose ce type de titres, mais je crois qu’ils sont largement minoritaires.
M. Benjamin Lemoine. Je les citais pour illustrer mon propos, mais, en effet, ils ne constituent pas le cœur de la stratégie de financement de l’État.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. D’autres pays n’ont pas du tout la même structure de la dette. On parle toujours de la dette publique phénoménale du Japon, détenue en grande partie par les Japonais eux-mêmes. Aujourd’hui, comment explique-t-on que la part de la dette française détenue par les ménages soit si faible, puisqu’elle s’élève à seulement 260 millions ?
En ce qui concerne la transparence, il a été envisagé de constituer un cadastre de la dette. Pensez-vous qu’il serait utile de mettre en œuvre quelque chose de ce type pour mieux connaître la dette et nous permettre d’agir plus facilement ?
Les propos de Maurice Pérouse contre l’adjudication m’inspire d’autres questions. Quelles sont actuellement les parts respectives de l’adjudication et de la syndication ? Il me semble que l’adjudication est devenue quasi systématique dans les procédures. Pourriez-vous aussi décrire les relations qui existent entre les SVT, c’est-à-dire les établissements désignés par l’AFT comme ayant le droit d’émettre des titres, et l’AFT ? Maurice Pérouse n’a-t-il pas eu raison : certains établissements bancaires gagnent en fait beaucoup d’argent sur les émissions de titres de dette grâce aux mécanismes d’adjudication ?
M. Benjamin Lemoine. Les titres indexés sur l’inflation représentent effectivement une faible part des émissions. L’exemple visait à montrer que l’arbitrage entre inflation, conjoncture économique et financement de l’État n’est plus coordonné par les pouvoirs publics. Il a persisté dans les années 1970, malgré la réforme du circuit du Trésor, qui dosait en quelque sorte son financement monétaire en fonction de la conjoncture, considérant qu’une petite part de financement monétaire était nécessaire, notamment en période de relance de l’économie. Cette fonction de coordination entre la politique monétaire et le financement de l’État a totalement disparu avec l’indépendance de la banque centrale : on délègue désormais à des experts et on se refuse à toute forme d’intervention du politique. C’est un gage de qualité des politiques économiques.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Les titres de dette sont différents selon les objectifs recherchés. Qui donne le feu vert à l’émission de tel ou tel type de titres ? Le ministre ou le directeur de l’AFT ? Le politique doit-il donner son aval ou la décision est-elle du seul ressort de l’administration ?
M. Benjamin Lemoine. Les OAT indexées, que j’ai déjà évoquées, ont été émises avec l’aval de Dominique Strauss-Kahn et portaient même son nom : sur la place financière, on parlait des « DSK bonds » — des obligations DSK. C’est un exemple parmi d’autres.
J’en profite pour répondre à une autre de vos questions sur la détention de titres par les ménages. Edmond Alphandéry, ministre de l’économie d’Édouard Balladur de 1993 à 1995, avait tenté de renouer avec la souscription en direct par les ménages d’obligations appelées OAT particuliers. Pourquoi cette souscription a-t-elle été un échec ? Il faudrait poser la question au Trésor. Le système bancaire a-t-il mal joué son rôle de relais dans la diffusion de ces produits ? L’année de son lancement, cette nouvelle formule à l’usage exclusif des ménages portait sur un volume de 10 milliards de francs pour un programme global d’émissions du Trésor de 500 milliards de francs. La même année, la part réservée aux particuliers se limitait à 2 % de la dette publique, tous titres confondus, et à environ 4 % des obligations émises ; il faut en effet distinguer les obligations des bons du Trésor qui sont des titres à court terme.
Pour expliquer cet échec, on rappelle souvent que ces OAT particuliers impliquaient un taux d’intérêt plus élevé que celui du marché — c’est sans doute la réponse que fournira l’AFT. Néanmoins, parlementaires et gouvernants peuvent considérer qu’il est légitime d’avoir une politique qui développe cette souscription en direct, notamment pour une raison simple : la politique économique sera moins sous pression. Si l’on propose un produit assorti d’un bon taux d’intérêt, l’épargne des Français s’y placera bien volontiers a priori et l’on ne sera pas obligé de changer le logiciel des politiques économiques. Encore une fois, il s’agit d’un arbitrage entre les taux d’intérêt et la liberté accordée aux politiques économiques.
Venons-en au cadastre de la dette. Il faudrait l’envisager comme un cadastre de l’épargne et de sa circulation. Comment l’épargne est-elle répartie socialement ? Quelles catégories sociales peuvent épargner ? Comment cette épargne est-elle intermédiée ? Le changement fondamental est que l’épargne est désormais gérée par des investisseurs institutionnels qui sont les clients finaux de la dette publique. L’un des enjeux du débat est d’identifier les canaux par lesquels circule cette épargne. Ce sont des questions politiques fondamentales. À partir de la répartition sociale de l’épargne, on peut faire des hypothèses sur la détention indirecte de la dette publique par les épargnants.
Tout d’abord, on peut se demander pourquoi la détention directe n’est pas davantage valorisée. Ensuite, on peut chercher à identifier les détenteurs indirects de la dette publique via les investisseurs institutionnels. Le Parlement pourrait prendre l’initiative d’une enquête sur la répartition de l’épargne par catégorie sociale et par ménage.
Qui a la capacité d’épargner et donc de bénéficier éventuellement de ces placements en titres d’État ? La question s’est posée en Grèce : on a constaté une mise en concurrence entre deux types d’acteurs : d’un côté, les épargnants – internationaux en l’occurrence – qui détiennent des titres de dette, et, de l’autre, les victimes des politiques d’austérité. Ces derniers n’ont pas la capacité d’épargner, vivent grâce aux minima sociaux ou aux pensions de retraite, et ne sont bénéficiaires, si l’on peut dire, que d’une dette sociale ou de la dépense sociale. Pour que les épargnants puissent être rémunérés par le biais des taux d’intérêt sur les obligations du Trésor, les pouvoirs publics doivent revoir à la baisse les promesses qu’ils ont faites – sous forme de dépenses sociales, de sécurité sociale, de régimes de retraite – à ceux qui ne peuvent épargner.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. J’en reviens à la discussion que nous avons eue sur les taux. Pour vous, y a-t-il des risques de taux ? Sommes-nous actuellement dans le piège des taux bas ? Je suis membre de la commission des finances depuis 2002, à une époque où la dette était d’environ 1 500 milliards d’euros. Nous avons bien travaillé, en quelques années… On s’accorde à dire que, si les taux augmentent d’un point, la dette s’accroît de 20 milliards d’euros. D’où peut venir le risque de taux ? Vous dites qu’une faible partie de la dette est indexée sur l’inflation, ce qui est une forme de maîtrise. Mais il y a aussi le piège des taux bas : nous sommes dopés à la dette.
Peut-on imaginer de revenir à un système où une banque centrale nous financerait à des taux très bas ? Depuis l’époque de Pompidou, les banques font le marché et vont chercher l’argent moins cher auprès de la banque centrale. Il faut diminuer la masse de la dette régalienne en améliorant la gestion du pays. Mais on peut aussi agir sur la gestion financière. En tant que maire, j’ai un fournisseur régalien pour construire des logements sociaux, puisque j’emprunte à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à des taux très bas – 1,25 % – sur des durées très longues. C’est l’argent placé par les Français, que je récupère à des taux faibles pour faire des investissements productifs : des immeubles qui permettront aux gens de se loger moyennant le paiement d’un loyer, des équipements structurants. Sur le plan local, nous arrivons donc à emprunter de cette manière des sommes qui représentent tout de même quelques dizaines de millions d’euros. Au niveau national, ne serait-il pas possible d’avoir un mécanisme permettant de financer les opérations du pays à des taux bas, les banques restant sur le marché privé ? Dans ce cadre-là, l’épargne des Français pourrait être dirigée vers un système d’emprunts obligataires.
M. Benjamin Lemoine. Dans les années 1990, nous avons connu des épisodes de taux d’intérêt très élevés. Un comité d’audit, dont faisait partie l’économiste Henri Sterdyniak, entre autres, en a évalué les conséquences sur la charge des intérêts de la dette dans le budget de l’État, et a mis en évidence un effet boule de neige. Il y a effectivement une vulnérabilité aux taux d’intérêt.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Quel élément extérieur peut faire bouger ces taux ? Il existe une toxicité liée aux montages de produits financiers mais n’y a-t-il pas aussi une toxicité politique, un coût intermédiaire qui était apparu lors de la crise pétrolière de 1976 ? Il n’y a pas de coïncidence : quand le prix des matières premières varie, on commence à vivre en déséquilibre. Si un point d’inflation coûte 20 milliards d’euros en intérêts, deux points représentent 40 milliards d’euros et on arrive ainsi à plus de 100 milliards d’euros de déficit structurel. À ce rythme, nous pouvons très vite rattraper la Grèce.
Il faut que les Français soient informés de ce risque, il faut leur dire qu’il va falloir arrêter de vivre à crédit parce que l’argent coûte cher et qu’il faudra bien rembourser la dette. Après avoir été rapporteur de la commission d’enquête sur les emprunts toxiques, j’en suis venu à penser que cet épisode a été salutaire pour les collectivités locales : elles ont pris conscience des risques et vont se montrer plus prudentes au moment d’investir. On emprunte pour investir, mais, comme les charges de fonctionnement amputent les capacités d’autofinancement, on se retrouve à financer du fonctionnement par de l’emprunt. Il est nécessaire d’envoyer un message aux Français : ces 2 100 milliards d’euros de dette nous font courir un risque, alors arrêtons ! C’est pourquoi il me semble important de travailler sur les risques de taux et la toxicité politique.
M. Benjamin Lemoine. Libre à vous de rattacher ce risque de toxicité au fait que l’État vivrait à crédit pour des objectifs que vous jugez mauvais ou illégitimes. Votre parole de parlementaire est tout à fait cohérente. Je suis d’accord avec vous : il y a un risque politique sur les taux d’intérêt, mais on peut considérer qu’il empêche une autre politique de relance budgétaire encore plus importante.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Politiquement, il y a diverses façons de réagir face à la dette. Il y a deux extrêmes : d’un côté, Jean-Luc Mélenchon dit qu’il ne faut pas rembourser la dette ; de l’autre, le Front national dit qu’elle ne coûtera plus rien si nous sortons de l’euro parce que nous pourrons alors jouer avec la monnaie et faire des réévaluations ou des dévaluations. Ces propositions ne sont pas cohérentes, mais elles visent à faire croire aux Français que la dette n’est pas un problème, qu’on peut s’en sortir en ne la payant pas ou en la faisant disparaître grâce à la maîtrise de sa monnaie.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Il ne faut pas caricaturer. La question de la légitimité ou de l’illégitimité de la dette se pose toujours dans les pays qui sont très endettés. Cela a été le cas en Équateur, en Argentine, et même en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale ; c’est actuellement le cas en Grèce. Ne nions pas non plus les conditions historiques de la création de la dette qui conduisent à discuter de sa prise en compte partielle ou totale. Le problème des dettes souveraines se pose d’ailleurs dans tous les pays occidentaux, et pas seulement dans la zone euro.
On peut débattre du remboursement total ou partiel de la dette, mais aussi de sa sécurisation. Comme le relevait Jean-Pierre Gorges : les collectivités locales ont un prêteur public, pourquoi l’épargne des Français ne servirait-elle pas au financement de l’État ? Cela nous ramène au plancher des bons du Trésor tel qu’il se pratiquait jusqu’aux années 1970 et à l’idée de création d’un circuit du Trésor européen. Au lieu de distribuer des milliards d’euros aux banques privées, la BCE ne ferait-elle pas mieux de sécuriser des dettes publiques par le biais d’un plancher du Trésor européen, rémunéré à un taux administré et donc géré ?
Quelles pourraient être, selon vous, les conditions de création de ce circuit du Trésor européen ? D’aucuns voient dans l’instauration d’un tel système une manière de consolider les critères maastrichtiens au niveau européen — ce qui ne correspond pas à ma façon de voir les choses. Cela suppose un vrai débat entre tous les pays. Faut-il que les excédents allemands servent à diminuer les déficits français ou grecs ? Je caricature à l’envi pour expliquer que le déficit des uns permet à d’autres d’être en excédent. Quand on considère la zone euro dans son ensemble, on constate que le déficit total est bien moins élevé que la seule somme des déficits car se faisant on ne prend pas en compte les excédents.
À votre avis, ce circuit du Trésor européen devrait-il être adossé à un emprunt européen, à des dépôts bancaires obligatoires, ou reposer sur la création monétaire comme on le fait aujourd’hui avec la BCE ?
M. Benjamin Lemoine. On peut considérer qu’il y a deux définitions concurrentes de la toxicité politique des taux d’intérêt.
D’un côté, il y a celle que j’ai appelée budgétaire et qui correspond à ce que vous évoquez, monsieur Gorges. On la retrouve aussi dans l’expertise du rapport de la commission Pébereau qui va jusqu’à faire une analogie avec la drogue, comme vous l’avez fait vous-même. Pour résumer : les taux d’intérêt sont faibles, on s’endette facilement et cela se traduit par une forme de laxisme budgétaire.
De l’autre côté, on peut considérer qu’il y a une toxicité du financement par les marchés parce que ce mode de financement crée des verrous. Prenons un exemple : le rôle des agences de notation pendant le passage de la crise de la finance privée à la crise des dettes publiques. Le débat est souvent balayé d’un revers de main sur la base de l’argument suivant : les agences de notation ne déterminent pas les taux d’intérêt puisque ceux-ci restent stables même après la dégradation d’une note.
Il est intéressant de voir comment ces agences illustrent le consensus de la communauté financière. Pour mesurer les dettes publiques, elles cherchent à déterminer la capacité des États à rembourser leur dette et leur engagement dans ce processus. Elles se fondent sur des facteurs économiques et budgétaires, mais elles retiennent aussi des critères politiques. Leur grille de notation comporte en effet un facteur sociopolitique : la stabilité institutionnelle du pays. L’agence surveille par exemple le débat public sur des questions telles que l’indépendance de la banque centrale, la création monétaire ou l’inflation. Tout dérapage de ce critère institutionnel — selon l’appréciation de l’agence de notation — va être considéré comme le signe d’une mauvaise gestion de la dette publique. Il y a donc bien là un verrou sur l’organisation des institutions financières d’un État.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Vos propos me rappellent ce qui s’est passé à Chypre et me poussent à vous poser une question : les agences tiennent-elles compte de l’actif financier de la population du pays ? En 2004 ou 2005, j’avais rédigé une proposition de loi visant à ce que l’État présente des comptes en équilibre. Certains m’ont représenté que cela ne servait à rien puisque l’État est le dernier payeur. Mais peut-on rappeler aux Français que le dernier payeur, c’est eux ? Si, un jour, le pays ne peut plus payer la dette, elle sera couverte par l’actif financier des Français. Est-ce que ce critère intervient dans la notation ? Les Français, qui représentent l’État, possèdent un actif financier estimé à 4 500 milliards d’euros, c’est-à-dire deux fois supérieur à la dette. Il n’y a donc pas de risque de défaut de paiement dans ce pays et ce n’est pas la peine d’enlever des « A » : de toute façon, il y aura des gens pour payer. En fait, on peut dire aux Français : un jour, vous serez les payeurs directs de la dette par le biais de vos actifs ; on ne la fera pas payer par les générations futures.
M. Benjamin Lemoine. Pour la communauté financière, la référence aux générations futures ne veut rien dire. Les agences se posent une question : est-ce que l’État tient ses engagements sur ses contrats financiers ? Plus précisément, elles tracent une courbe d’évolution démographique pour détecter un vieillissement de la population et sa conséquence : les personnes vieillissantes vont exiger leur pension de retraite et venir concurrencer directement les possesseurs d’actifs financiers, donc les détenteurs de bons du Trésor.
D’une certaine manière, le monde financier est dans la lutte des classes. Vous parlez des Français qui possèdent des actifs, mais, en fait, il ne s’agit que d’une partie de la population : la catégorie sociale qui a pu épargner et placer en bons du Trésor, ce qui nous ramène à l’audit de l’épargne.
« Pour moi, le futur n’existe pas », a dit un jour le responsable d’une agence de notation. Tout est dans le présent, tout est question d’arbitrages entre différentes politiques publiques. Choisit-on de réformer l’État social pour aménager et payer la dette financière, tenir ses engagements, améliorer sa signature financière, être un bon élève des marchés financiers ?
En Grèce, Syriza a voulu procéder à un autre arbitrage en annonçant que le pays ne ferait pas défaut sur sa dette sociale. Puis est venue la vague de la contrainte, le verrou politique. La toxicité politique l’a emporté dans l’autre sens, et des sanctions progressives ont fini par étouffer cette tentative. Un éditorialiste politique peut analyser la situation en ces termes : on a réussi à ensevelir cette option de réarbitrage en faveur de la dépense publique. Cet épisode vient nuancer vos propos : le laxisme budgétaire n’est pas l’option qui triomphe perpétuellement. En fait, certains arbitrages tendent au contraire à défendre une politique favorable au maintien dans le temps du remboursement, du paiement des coupons d’intérêt, à la classe des personnes qui ont des revenus leur permettant d’épargner.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Le problème est le différentiel de vitesse entre la prise de conscience politique et l’accroissement de la dette. Nous voyons bien que la dette progresse plus vite que les réformes qu’on met en place.
M. Benjamin Lemoine. Il serait intéressant d’aborder la question de la syndication et de l’adjudication avec l’AFT. Il y a toujours des syndications. Vous avez dit, monsieur Sansu, que les banques gagnent à l’adjudication. En fait, ce n’est pas le cas.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Ce n’est pas ce que j’ai dit, j’ai cité Maurice Pérouse.
M. Benjamin Lemoine. À l’époque, c’était vrai. Dans le système actuel, l’État met les banques en concurrence, si bien qu’elles ont plutôt tendance à perdre de l’argent sur ce segment d’activité sur le marché primaire, c’est-à-dire lors des adjudications mensuelles d’obligations du Trésor. Elles sont en concurrence les unes avec les autres et veulent apparaître comme de bonnes élèves aux yeux du Trésor. C’est aussi une question : pourquoi les banques cherchent-elles à être bien classées ? Le Trésor établit un classement des banques en fonction du volontarisme dont elles font preuve lors des adjudications et en fonction de critères qualitatifs.
Les banquiers se plaignent de perdre de l’argent sur ces adjudications, car les taux d’intérêt sont très faibles. Pour eux, ces opérations représentent un coût humain, puisqu’il faut payer un trader obligataire pour s’en occuper. Le trading sur les obligations d’État est une perte, disent-il mais certains d’entre eux expliquent que cette perte à court terme s’inscrit dans une stratégie à long terme : le fait de participer activement à ces adjudications permet d’obtenir des mandats sur les syndications où il n’y a pas de mise en concurrence des établissements bancaires. Lors d’une syndication, une même banque achète l’intégralité d’un certain montant sur un titre et se charge ensuite de le redistribuer aux investisseurs. D’une certaine manière, l’État paie la banque pour ce mandat particulier. Le Trésor recourt généralement à des syndications en cas d’innovation, comme ce fut le cas lors de la vente d’obligations indexées sur l’inflation. Il faudrait savoir s’il y a un débat sur les parts respectives de la syndication et de l’adjudication, si l’on pourrait se passer des syndications, si elles sont inscrites dans le service de la dette et, si c’est le cas, quel est leur coût estimé.
Monsieur Sansu, vous m’avez interrogé sur le système que l’on pourrait imaginer à l’échelle européenne. Effectivement, cela implique de repenser le système bancaire et financier à l’échelle européenne. Dans le cas des eurobonds dont il était question à un moment donné, il s’agissait en quelque sorte d’utiliser la qualité de la signature de l’Allemagne. Ces obligations européennes auraient pu financer certains États, mais avec des contreparties très fortes. D’une certaine façon, ils auraient pu servir d’outils de discipline budgétaire : puisque le modèle allemand permet d’obtenir des taux faibles, les États qui profiteront de ces obligations devront se plier à certaines contraintes. Ce système reproduisait la contrainte. Le circuit du Trésor n’est pas calé sur ce modèle des euro-obligations, ou alors sur un modèle impliquant un Trésor européen collecteur d’épargne, un pôle public bancaire. En fait, l’essentiel de l’arbitrage se joue sur le statut de cet argent, sur le rapport de force entre les circuits de l’argent géré publiquement et les circuits de l’argent privatisé.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Avez-vous travaillé sur la relation entre la dette et la sortie de l’euro ? Imaginons que, demain, nous revenions au franc, avec une parité de 1 franc pour 1 euro. Que se passe-t-il si, après-demain, le franc est à 0,80 euro ou à 1,20 euro ?
M. Benjamin Lemoine. Il ne faut pas oublier qu’il existait autrefois une autre contrainte, celle du franc, au nom de laquelle on opérait aussi des ajustements. Nous avons basculé de la contrainte de la valeur du franc à la contrainte des taux d’intérêt, mais il est intéressant de noter que, pendant les Trente glorieuses, les dévaluations étaient diplomatiquement négociées. Le pouvoir politique réfléchissait à ces questions monétaires qui sont à présent gérées par des instances techniques en relation avec des banques privées. D’une certaine manière, la parole démocratique n’est plus présente sur ces questions. Elles sont désormais réglées techniquement plutôt que politiquement. Vous devriez interroger des économistes qui réfléchissent à des modèles de sortie de l’euro et qui élaborent des scénarios.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Ce sera le débat en 2017 : certains expliqueront que tout se réglerait avec une sortie de l’euro, d’autres diront qu’il suffirait de ne pas rembourser la dette. À bas l’austérité, continuons de dépenser ! Ces positions sont partagées par près de la moitié de la population.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Le débat existe aussi aux États-Unis.
M. Benjamin Lemoine. C’est tout l’intérêt de votre mission. Aucune technique n’est neutre. Chaque choix sur les techniques de financement, sur la manière dont on réalise le crédit emporte des conséquences politiques. Le choix des techniques induit des conséquences lourdes, avec des avantages et des inconvénients. Vous allez apporter une contribution importante au débat démocratique pour 2017. Avant de mener des débats macroéconomiques sur la sortie de l’euro, il faut examiner tous les instruments intermédiaires pour voir que chaque choix, aussi modeste soit-il, sur des techniques de financement ou de réglementation bancaire et financière permet certaines choses et en empêche d’autres, crée des verrous, mais aussi des ressources. Il importe que ces arbitrages soient explicités dans l’espace public, ce qui n’est pas fait actuellement.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Aujourd’hui, on fait comme s’il n’y avait qu’une solution.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Il faut regarder aux limites, des deux côtés, et voir quel positionnement correspond à un pays comme la France.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Monsieur Lemoine, nous vous remercions.
M. Raoul Briet, président de la première chambre de la Cour des comptes, M. Éric Dubois, conseiller maître et Mme Raphaëlle Eloy, rapporteure extérieure.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Madame, messieurs, merci d’avoir répondu à notre invitation. Je souligne que les échanges de la Cour des comptes avec la mission d’évaluation et de contrôle ont toujours été très fructueux. Nous souhaitions vous poser certaines questions, notamment sur les risques pesant sur les différentes dettes – de l’État, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale. Je souligne d’ailleurs que la dette des collectivités territoriales est garantie, elle, par les habitants, même si l’État joue son rôle car tous les ans, les collectivités présentent des comptes en équilibre.
M. Raoul Briet, président de la première chambre de la Cour des comptes. La dette publique a augmenté de façon presque continue depuis le début des années 1970 comme l’illustre le graphique ci-dessous.
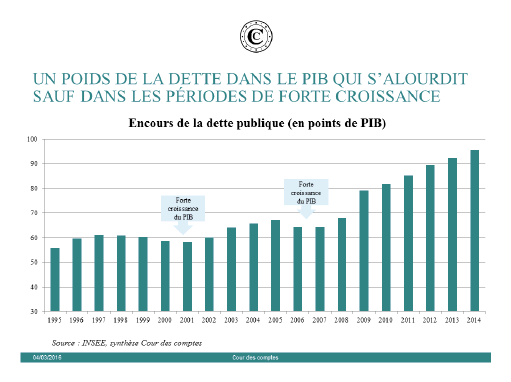
C’est le résultat d’une accumulation des déficits : depuis 2008, ceux-ci sont, en effet, systématiquement supérieurs au solde qui permettrait de stabiliser le poids de la dette dans le PIB. À l’exception des années 2006 et 2007, le solde public est même très nettement inférieur au solde stabilisant.
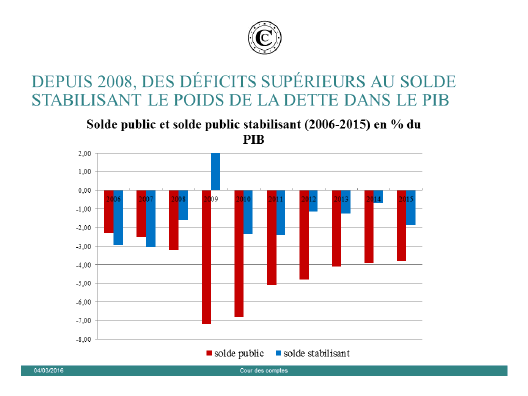
La dette représente près de 100 % du PIB : pour qu’elle soit stabilisée, le solde public ne devrait donc pas être supérieur à l’évolution du PIB nominal de l’année considérée. En 2015, il aurait ainsi fallu que le déficit public soit de l’ordre de 2 points de PIB : ce ne sera finalement pas loin du double de ce chiffre, puisque les dernières prévisions du Gouvernement comme de la Commission européenne situent le déficit aux alentours de 3,8 % du PIB.
Il n’y a eu que deux exceptions au cours des vingt dernières années : de 1998 à 2001, et 2006-2007. Il s’agissait, et ce n’est pas un hasard, de périodes de forte croissance économique. Rétrospectivement, on ne peut que constater que les périodes de croissance accrue ne sont guère mises à profit pour réduire suffisamment les déficits publics, et donc pour préparer les années de croissance plus faible qui suivent.
Je voudrais souligner ici que les autorités publiques ont trop souvent tendance à considérer comme durables les phases de croissance plus forte, c’est-à-dire le haut des cycles économiques. Cela a été le cas entre 1998 et 2001, comme en 2006 et 2007 pendant lesquelles des allégements fiscaux importants ont été consentis. Il serait donc à mon sens judicieux de piloter les finances publiques en utilisant la notion de « solde structurel », qui figure maintenant dans les textes, notamment dans la loi organique de décembre 2012, même si sa mesure et son utilisation en sont délicates. Le solde structurel a néanmoins le grand mérite de permettre une évaluation du solde effectif constaté par rapport à l’évaluation de la conjoncture, et donc d’éviter de commettre des erreurs.
Je souligne également que les autorités publiques sous-estiment aussi fréquemment l’effet de rémanence des crises sur le taux de croissance : les crises, et en particulier celle qui s’est enclenchée en 2007-2008, conduisent à un affaiblissement progressif de la croissance potentielle de l’économie française, et par conséquent à une surestimation de la croissance et à une sous-estimation des efforts nécessaires pour résorber les déficits.
En outre, depuis une vingtaine d’années, la croissance de l’endettement public s’est accélérée, croissance au sein de laquelle on peut distinguer trois périodes :
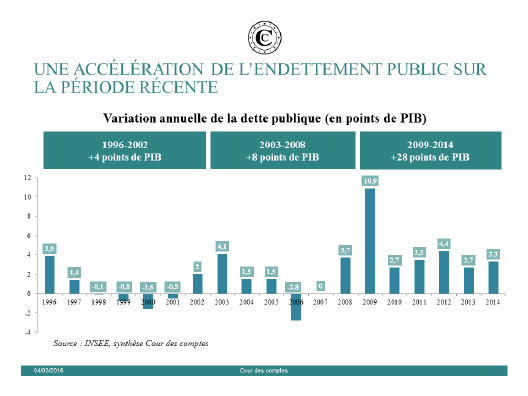
La France a abordé la crise de 2008-2009 avec un solde et une dette publique dégradés. Elle a laissé jouer les stabilisateurs automatiques et mené un plan de relance ; mais celui-ci a été d’une ampleur sensiblement moindre que chez nos voisins allemands, nos marges de manœuvre étant elles-mêmes sensiblement inférieures.
Le Premier Président de la Cour des comptes le dit régulièrement : la question de la maîtrise de la dette, est celle de la capacité de la France à opérer librement des choix, à décider en toute souveraineté de ses politiques publiques ; c’est une question politique, au sens noble du terme afin de pouvoir rester maîtres de notre destin.
Autre point, la dette de l’État représente l’essentiel de la dette publique française – près de 80 % en 2014.
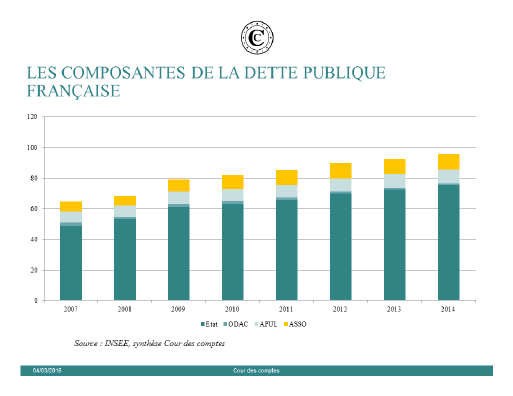
Au cours de la période récente, la dette de l’État a crû plus rapidement que celles des collectivités locales et de la sécurité sociale : elle a augmenté de 20 % entre 2010 et 2014, quand celle des administrations publiques locales (APUL) croissait de 7 % et celle des administrations de sécurité sociale (ASSO) de 16 %. Quant à la dette des opérateurs de l’État (organismes divers d’administration centrale, ODAC), elle a diminué de 31 % au cours de la même période.
Le fait que la dette de l’État progresse beaucoup plus vite que celle des administrations de sécurité sociale ou des collectivités locales ne signifie pas que l’État est beaucoup moins bien géré que celles-ci : l’augmentation de la dette n’est pas fonction du sérieux de la gestion des uns ou des autres. Dans notre système, en effet, l’État est le réassureur en dernier ressort : c’est la centrale du déficit… D’une certaine manière, la plupart des déficits publics et donc des dettes se reportent in fine, sur l’État. Ainsi, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a provoqué, pour le budget de l’État, une perte de recettes : le déficit, et donc la dette, se sont accrus. Je ne voudrais pas entamer ici une discussion des conséquences du CICE sur l’emploi et la masse salariale, mais ses effets sont bénéfiques à l’ensemble de la communauté nationale, et donc aussi aux administrations de sécurité sociale et aux collectivités locales.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Vous dites que c’est l’État qui a financé le CICE. Mais le pacte de responsabilité – quoi que l’on en pense par ailleurs – a imposé des efforts à tous : 20 milliards ont été demandés au budget de l’État, mais aussi 11 milliards aux collectivités locales et 20 milliards à la sécurité sociale. La perte de recettes a été partagée.
M. Raoul Briet. La perte a été supportée par l’État seul, mais à cette occasion il a essayé d’enclencher un mouvement de maîtrise des dépenses de l’ensemble des administrations publiques.
Pour juger des efforts consentis en matière de gestion, un seul paramètre compte à mon sens : le rythme de l’évolution des dépenses. C’est l’instrument de mesure le moins conventionnel et le moins discutable.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. La Cour des comptes a montré, je crois, que les efforts de dépense nets demandés dans le cadre du CICE avaient porté à plus de 60 % sur les collectivités territoriales.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Pour financer le CICE, l’État met tout le monde à contribution. En baissant la dotation globale de fonctionnement (DGF), il oblige les collectivités à s’endetter – mais celles-ci sont dans l’obligation d’équilibrer leurs comptes. Cette dette-là sera donc remboursée ! C’est un transfert, en quelque sorte, mais dont l’État est toujours garant.
Le cas de la dette sociale est un peu différent, puisqu’il peut y avoir des résultats, les recettes peuvent augmenter.
M. Raoul Briet. Le juge de paix, je le redis, c’est l’évolution des dépenses des différentes catégories d’administrations publiques – l’évolution de chaque catégorie au cours d’une période donnée, ainsi que l’évolution comparée des différentes catégories. Cette analyse permet de mieux mesurer les efforts des uns et des autres – les efforts devant en effet être consentis par tous. La dette de l’État augmente davantage, mais cela ne veut pas dire qu’il est plus mal géré.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Je ne dis pas que l’État ne fait pas d’efforts !
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. J’avais un jour naïvement proposé que l’État présente des comptes équilibrés… Je suis maire, je présente des comptes en équilibre, pourquoi pas l’État ? Mais l’on m’a répondu que l’État étant le dernier payeur, on ne pouvait pas lui imposer une telle règle.
M. Raoul Briet. De facto, l’État est le payeur en dernier ressort.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Mais l’État n’existe pas : le dernier payeur, c’est le citoyen !
M. Raoul Briet. De toute façon, le payeur, c’est bien le contribuable, national, local ou social : nous voyons la différence, mais je pense que les Français, souvent, ne la voient pas ! Pour eux, tout prélèvement est un revenu disponible en moins.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Que la dette de l’État joue un rôle particulier, pour des raisons liées aux fonctions régaliennes, je veux bien le comprendre. Le problème, au demeurant, ce n’est pas tant le montant de la dette que la capacité à la rembourser. Or l’État ne peut plus rembourser sa dette, puisque ses comptes sont systématiquement en déficit.
M. Raoul Briet. C’est en effet la dynamique de la dette qui est forte. Mon propos était, modestement, de souligner que l’augmentation plus forte de la dette de l’État par rapport à celle des administrations locales et des administrations de sécurité sociale ne signifiait en rien qu’il se serait montré particulièrement dispendieux.
La dette des collectivités locales représente aujourd’hui un peu moins de 10 % du volume total de la dette publique. Depuis une dizaine d’années, l’encours de cette dette a tendance à progresser, mais lentement.
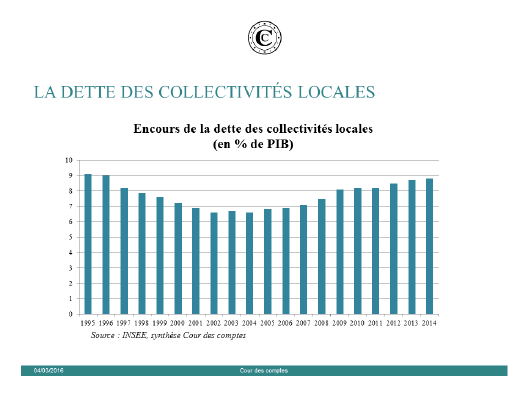
La dette sociale est du même ordre de grandeur : elle représente maintenant un peu plus de 10 points de PIB, avec une progression très sensible entre 2008 et 2014 : pour le seul régime général et le Fonds de solidarité vieillesse (FSV), cela représente 8 points de PIB. Elle devrait atteindre son plus haut point en 2015 alimentée par les déficits de la branche maladie et de la branche vieillesse.
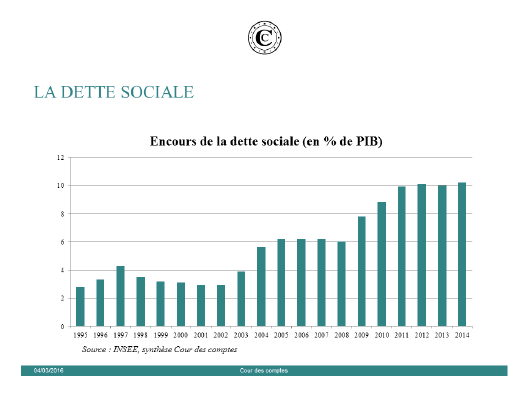
Cette dette se compose, vous le savez, de quatre sous-ensembles. La Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) amortit chaque année 16 milliards grâce aux ressources qui lui sont affectées. Son terme est estimé à 2024. Il faut souligner que s’est constituée, dans la période récente, une dette à court terme portée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), qui assure la trésorerie du régime général : cette dette atteignait près de 28 milliards d’euros à la fin de l’année 2014. L’ACOSS est donc un émetteur important de dette à court terme sur les marchés financiers. Quant à la dette des hôpitaux publics, elle représente 1,5 point de PIB mais il faut surtout souligner qu’elle a triplé entre 2002 et 2012, en raison des plans successifs de relance de l’investissement hospitalier qui se sont mis en place au début des années 2000. Enfin, il est plus particulièrement question en ce moment de la dette de l’UNEDIC. Elle représente environ 1 point de PIB.
La dette des administrations de sécurité sociale est exposée à un risque de remontée des taux, notamment pour sa part à court terme, naturellement, mais aussi pour la dette à long terme, qui est une dette à taux révisable.
Je rappellerai ici les recommandations classiques de la Cour des comptes : autant la Cour considère que le déficit de l’État peut être justifié, au regard de l’effort d’investissement qu’il consent, autant elle considère que les déficits de régimes de protection sociale – qui assurent des transferts instantanés entre actifs, ou entre actifs et retraités – n’ont pas de justification économique, en tout cas sur le moyen terme. Bien sûr, des lissages de cycles économiques peuvent expliquer une dette momentanée des organismes de sécurité sociale ; À moyen et long terme, il n’y a aucune justification de fond à financer des transferts par de la dette.
Nous nous sommes plus particulièrement inquiétés de la dette de l’ACOSS, très exposée à un risque de relèvement des taux. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a accéléré le calendrier de reprise de cette dette par la CADES, mais il restera un découvert de trésorerie d’environ 20 milliards d’euros à la fin de l’année 2016. Ces découverts seront financés par des émissions de court terme.
J’en viens maintenant aux principaux risques pesant sur la dette publique.
La trajectoire prévue dans le projet de loi de finances pour 2016 prévoit une stabilisation du niveau de la dette publique aux alentours de 96,5 milliards à l’horizon 2016-2017.
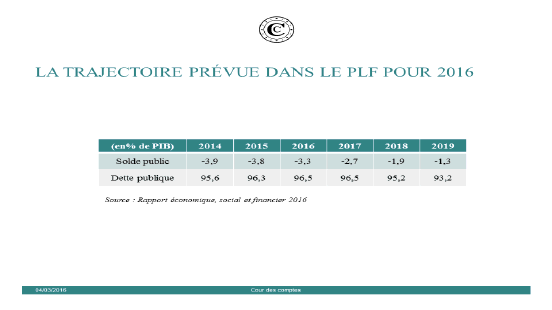
Le premier risque si cette trajectoire n’est pas suivie, c’est bien sûr de ne pas mener la réduction des déficits telle qu’elle est prévue. La Cour s’est exprimée sur ce point dans son rapport public annuel, en début d’année, et elle le refera au mois de juin. Je le disais : les phases de regain économique comme celui que nous connaissons actuellement, même s’il est modéré et fragile, ont historiquement correspondu à des phases de relâchement de l’effort budgétaire. Dans des pays comme l’Italie ou l’Espagne, on constate d’ailleurs qu’après des phases d’ajustement sévère et rapide des finances publiques, la réduction des déficits et l’effort sont moindres. Il y a donc un risque lié à la période.
Le déficit public devrait être de 3,3 % du PIB en 2016. Nous avons mis en évidence les risques qui s’attachent aux hypothèses macroéconomiques retenues – inflation, croissance, masse salariale – qui nous paraissaient un peu optimistes. Les informations qui nous sont parvenues depuis 2016 confirment plutôt nos inquiétudes : cela fait peser un risque sur les recettes de l’exercice 2016.
Du côté des dépenses, nous referons le point précisément, en juin 2016, à l’occasion du rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques. Le pari de la loi de finances pour 2016, c’est que les économies attendues sur la charge de la dette et les annulations de crédits de la réserve de précaution suffiront à compenser totalement les dépenses nouvelles décidées en fin d’année 2015 ou en début d’année 2016.
Voilà pour les risques à court terme.
Pour que le déficit se stabilise en 2017 par rapport à 2016, il faudrait que le solde public soit de 2,7 points de PIB. Il faudrait donc que l’objectif pour 2016 soit atteint, mais aussi que l’objectif pour 2017, qui prévoit une baisse du déficit public de 0,6 point de PIB, soit respecté. C’est à ces deux conditions que la dette se stabiliserait.
À moyen terme, il existe un risque de remontée des taux. Nous vivons une période particulière, exceptionnelle même, et dont personne ne sait combien de temps elle va durer : nos conditions de financement sont extraordinairement favorables. Les taux sont si bas, à court comme à moyen terme, que si l’encours de la dette de l’État a progressé de 70 % entre 2007 et 2015, la charge de la dette n’a progressé que de 7 %. Depuis 2012, la charge de la dette a même diminué.
Vous nous avez notamment interrogés sur la proportion d’encours de dette due à l’effet boule de neige. La France a peu pâti de ce phénomène, qui traduit le fait qu’à politiques données, toutes choses égales par ailleurs, lorsque le taux apparent de la dette, c’est-à-dire le taux moyen qui s’attache au stock de dette à un instant donné, est supérieur au taux de croissance de l’économie, alors le ratio entre la dette et le PIB se dégrade spontanément sous le seul effet du paiement des intérêts de la dette.
Nous avons calculé à partir des données de l’INSEE qu’au cours de la dernière décennie, l’effet boule de neige n’avait contribué à augmenter le poids de la dette par rapport au PIB que de 6 points de PIB sur un total de 30 points. Cet effet boule de neige devrait être quasiment nul en 2015 et en 2016, puisque le taux de croissance du PIB en valeur sera sans doute très proche du taux d’intérêt moyen sur la dette publique.
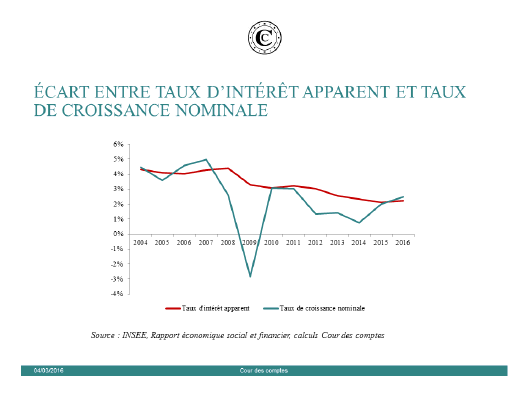
L’effet boule de neige n’explique donc l’augmentation de la dette depuis dix ans que pour un cinquième environ. En revanche, il pourrait devenir important en cas de remontée des taux. Au taux de 2007, c’est-à-dire avec un taux apparent de la dette de l’État de 4,5 % au lieu de 2,8 % actuellement, la charge de la dette en 2015 aurait été de 27 milliards supérieure à ce qu’elle a été : un retour au taux moyen d’avant la crise aurait représenté près de 1,5 point de PIB de dépenses supplémentaires, et donc, toutes choses égales par ailleurs, de déficit.
C’est une épée de Damoclès qui pèse sur nous à moyen terme.
Il faut aussi souligner que la trajectoire de notre dette publique diverge fortement par rapport à celle de la zone euro, de l’Union européenne, et plus nettement encore par rapport à celle de l’Allemagne : notre dette progresse de façon continue, même si cette augmentation s’est légèrement atténuée récemment, quand dans la zone euro, et dans l’Union européenne, ce poids de la dette commence à diminuer.
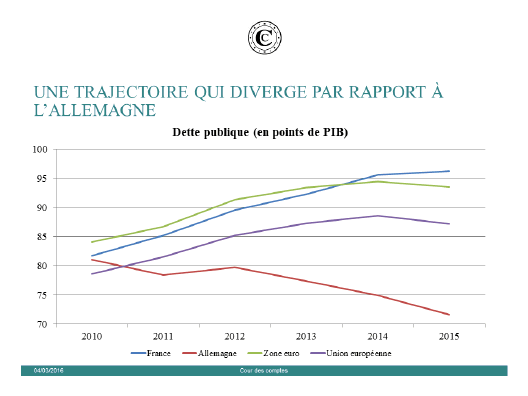
Il faut aussi avoir conscience que la perception des marchés peut devenir moins favorable pour nous qu’elle ne l’est aujourd’hui : la dette française reste considérée comme un actif sûr, ainsi qu’en attestent nos taux très bas. Mais elle représente aussi une part croissante de celle des États de la zone euro. La France est devenue le premier émetteur de dette : alors que nous représentions 19 % des émissions de moyen et long terme en zone euro en 2014, nous en représenterons selon l’Agence France Trésor 23 % en 2016. C’est la conséquence de l’inversion des courbes de la dette qui ne se constate pas pour la France.
Si cette tendance devait se poursuivre, l’Agence France Trésor serait sans doute amenée à devoir offrir des taux supérieurs pour placer la dette publique française.
Enfin, nos coûts de financement à dix ans demeurent très favorables.
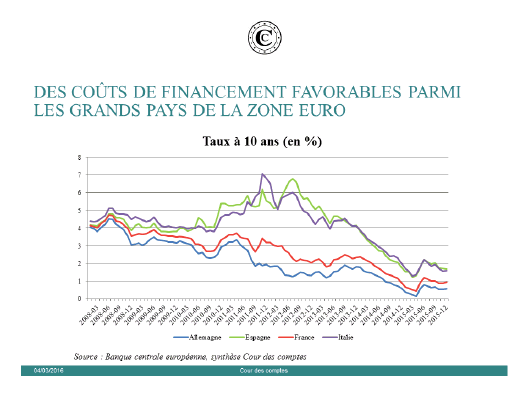
Toutefois, notre position relative est moins favorable qu’elle ne l’a été : elle demeure meilleure que celle de l’Espagne et de l’Italie, mais elle est moins favorable que celle de l’Allemagne. Si l’on laisse de côté ce dernier pays, on constate que la France se situe plutôt défavorablement par rapport au cœur de la zone euro – Autriche, Belgique, Finlande, Pays-Bas. Seule la Belgique a un niveau de taux légèrement plus élevé.
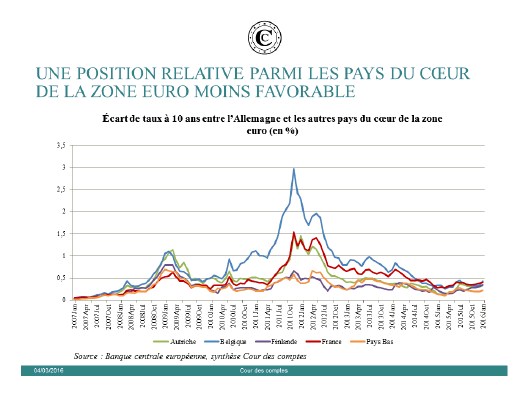
Notre situation est donc relativement fragile au regard de la perspective globale de remontée des taux.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Beaucoup de vos graphiques portent sur la période 2004-2015. C’est très court, notamment pour travailler sur l’effet boule de neige. Nous travaillons pour notre part sur la dette et sa construction depuis 1974 : l’effet boule de neige a eu, depuis quarante ans, des effets importants. La boule a beaucoup grossi à force de rouler…
Vous avez aussi dit que les périodes de croissance sont propices à un relâchement de l’effort, et notamment de l’effort fiscal. Nous en avons eu un exemple très clair avec la loi Travail, emploi, pouvoir d’achat (TEPA), ce que le président Gilles Carrez avait très bien expliqué dans son rapport de 2010. Pourriez-vous développer ce point ?
On connaît bien le discours ambiant sur les déficits et la dette : on dépense trop. Vous nous dites aussi qu’il y a un risque de taux. Mais, avec cette dette, il y a bien des gens qui gagnent de l’argent ! Même s’ils en gagnent peu parce que les taux sont bas, l’assiette est large, et au total cela fait des sommes élevées.
Enfin, l’Allemagne, d’un point de vue économique, pèse très lourd au sein de la zone euro : cela crée un biais méthodologique dans votre analyse, me semble-t-il.
M. Raoul Briet. S’agissant de la période, on pourrait évidemment remonter plus loin. Il faut néanmoins prendre en considération que la progression de la dette au cours de la période récente a été d’une intensité toute particulière. Il y a une véritable rupture, et une très forte accélération depuis 2008.
S’agissant de la comparaison avec différents pays, vous avez raison de signaler que le poids de l’Allemagne est important. Toutefois, il existe aujourd’hui un risque bien réel de divergence entre les dynamiques des dettes de la France et de ses voisins, même si on laisse de côté l’Allemagne. Et puis je continue à penser qu’il faut de temps en temps se comparer à l’Allemagne : si nous voulons peser au sein de l’Union européenne, il faut se comparer au plus fort !
S’agissant des baisses de recettes, j’ai cité les dernières périodes de forte croissance qui se sont accompagnées de baisses de recettes : les années 1998-2001, puis 2007-2008. Vous retrouverez toutes les données dans notre rapport annuel. Nous avons pris la mauvaise habitude de nous faire des illusions sur l’apport de la croissance au rééquilibrage des comptes : nous ne nous servons pas des périodes favorables pour améliorer nos comptes, et lorsque l’économie revient à son étiage précédent, nous retrouvons une situation dégradée. La Cour lance donc une mise en garde pour le futur.
Enfin, qui gagne ? C’est une question qu’il paraît aujourd’hui difficile de poser en ces termes : la dette est partagée par de très nombreux acteurs économiques, des épargnants français mais aussi du monde entier.
M. Éric Dubois, conseiller maître. Souvent, aujourd’hui, les taux offerts sont même négatifs, en France comme en Allemagne, en Suisse ou au Japon : les épargnants n’y gagnent plus, ils y perdent au contraire. Cette situation où des investisseurs acceptent de perdre de l’argent pour prêter aux États est tout à fait unique, en tout cas dans l’histoire des cinquante dernières années…
Mme Raphaëlle Eloy, rapporteure extérieure. Cette année, les taux courts de la France ont été négatifs toute l’année : cela a représenté des recettes de plusieurs centaines de millions d’euros.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Pourquoi des investisseurs acceptent-ils de perdre de l’argent ?
M. Raoul Briet. Si vous déposez de l’argent dans un coffre-fort, vous paierez la location du coffre, mais vous aurez la certitude d’y retrouver votre argent. De la même façon, ces investisseurs estiment qu’en achetant des titres émis par la France, ils pourront retrouver leur capital, moyennant des frais de garde. C’est pour eux une garantie. C’est une situation à tout le moins atypique, et guère rassurante sur le fond.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Le problème, c’est surtout que cela conduit beaucoup de nos concitoyens à penser que la dette ne coûte pas cher… Mais s’endetter pour payer du fonctionnement, c’est dangereux !
Avez-vous par ailleurs pu mesurer les conséquences des emprunts toxiques sur la dette des collectivités locales ? On doit commencer à voir des effets de ces contrats.
M. Raoul Briet. Sur ce point, il faut souligner que ces contrats structurés ont aussi, artificiellement et temporairement, réduit les charges financières de certaines collectivités. C’était un pari – certes, lorsque la conjoncture s’est retournée, c’est devenu très compliqué…
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Ils ont été bénéfiques pendant deux ans, ils seront nocifs pendant dix-huit !
M. Raoul Briet. Pour répondre précisément à votre question, nous n’avons pas mené d’étude particulière sur ce sujet. La première chambre de la Cour est en train d’achever un contrôle de la SFIL (Société de financement local), entité publique mise en place pour gérer la désensibilisation des prêts aux collectivités locales et pour intervenir dans le financement du secteur public local. Un rapport particulier sera donc rendu public prochainement, sans doute à la fin de ce semestre. Il se penchera sur la place qu’occupe aujourd’hui la SFIL : celle-ci a en effet été créée pour prendre la suite de Dexia, afin que les collectivités locales puissent continuer d’obtenir des crédits ; on craignait que les banques commerciales ne se retirent purement et simplement de ce secteur. Or ce n’est pas ce qui est arrivé, bien au contraire : les banques commerciales sont revenues, et la Caisse des dépôts est devenue un prêteur significatif aux collectivités locales, qui par ailleurs empruntent un peu moins. La place que la SFIL cherche à occuper, ou devrait occuper à moyen terme, doit donc être précisée.
M. Jean-Claude Buisine. Quels sont aujourd’hui les leviers possibles d’économies dans les dépenses publiques ?
M. Raoul Briet. On peut faire des économies partout, vous dirait le Premier Président de la Cour ! Nous essayons dans nos rapports, de repérer les pistes d’économies possibles. À mon sens, il faut faire porter les efforts partout, c’est-à-dire tant sur les transferts sociaux que sur les dépenses de l’État et des collectivités territoriales. Ce n’est pas un problème de gestion de chaque entité, mais bien un problème d’économie générale de notre système, de cohérence des différents acteurs publics intervenant sur de mêmes enjeux de politiques publiques.
Les leviers sont nombreux ; il faut prendre le risque de les actionner. C’est toute la question du choix politique.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. La Cour s’est-elle penchée sur la question du solde primaire ? Autrement dit, quel serait notre solde si nous ne versions plus d’intérêts ? L’inflation est bien inférieure au taux moyen de 2,8 % que vous citiez : une différence de 1,8 point de PIB, ce n’est pas négligeable.
M. Éric Dubois. De mémoire, nous sommes depuis trente ans presque systématiquement en déficit primaire.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Non, nous étions en excédent entre 1997 et 2001, puis en 2006 et 2007 !
M. Raoul Briet. Absolument, mais ce sont les deux périodes qui ont été citées tout à l’heure.
M. Éric Dubois. Pour 2015, nous n’avons pas encore les résultats définitifs, mais nous serons en déficit primaire de 1,5 point de PIB environ.
Mme Raphaëlle Eloy, rapporteure extérieure. Pour ce qui est de l’État, nous disposons des chiffres définitifs : le déficit est de l’ordre de 70 milliards, et la charge de la dette de l’ordre de 42 milliards.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. La France doit sortir de sa situation de déficit. Bien sûr, il faudrait d’abord que la dette cesse de grossir – au moins par rapport au PIB.
Imaginons que nous voulions en revenir au niveau maximal de dette prévu par Maastricht, c’est-à-dire 60 % du PIB. On peut estimer – en mettant à part la dette sociale et la dette des collectivités, qui me paraissent relever d’un traitement différent – que nous avons une surcharge pondérale de l’ordre de 400 milliards. Il n’est pas nécessaire de penser réduire la dette à zéro : nous vivons tous avec des dettes, et notre pays peut être endetté, du moment qu’il peut rembourser… mais il y a un risque politique, et aussi un simple risque financier de retournement des taux, vous l’avez dit.
Est-ce que vous ne pensez pas que nous pourrions mettre ces 400 milliards de côté, dans une sorte de caisse d’amortissement de la dette de l’État ?
M. Raoul Briet. Une sorte d’équivalent de la CADES.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Absolument, avec une hausse de TVA de 2 points sur quinze ans qui permettrait de financer cet amortissement. Ne faisons pas payer nos erreurs à vos enfants ! Et nous respecterions ainsi nos engagements maastrichtiens, en essayant d’avoir des comptes à l’équilibre. C’est un mécanisme qui me paraît envisageable.
M. Raoul Briet. C’est le même raisonnement qui a été tenu pour la CADES, qui était conçue comme un dispositif provisoire, destiné à faire disparaître une dette qui n’avait pas lieu d’être. Malheureusement, le provisoire…
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. …est devenu définitif.
M. Raoul Briet. Disons durable. La CADES était destinée à rembourser une dette sociale considérée comme illégitime. Faudrait-il rassembler la dette de l’État et la dette sociale ? C’est une question qui est quelquefois posée. Mais la CADES permet, à mon sens, de rendre sensibles, visibles les déficits sociaux. Sans elle, les déficits sociaux apparaîtraient comme négligeables par rapport à l’ensemble des déficits publics et donc comme « normaux ».
Dès lors que la Cour est convaincue qu’il n’est pas normal, pas responsable, d’endetter les plus jeunes générations pour payer les soins de santé ou les retraites actuelles, il est préférable de maintenir la dette sociale à part, avec une affectation particulière.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Avec le mécanisme que je propose, on créerait une autre caisse pour les 400 milliards, et on augmenterait la TVA, sur le modèle de la CRDS. Il faut sortir de cette situation !
M. Nicolas Sansu, rapporteur. On peut se souvenir que l’impôt sur les grandes fortunes était censé payer le revenu minimum d’insertion… C’était aussi un fléchage d’un prélèvement pour financer une politique publique.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Encore avant, il y a eu la vignette automobile… Chacun peut avoir ses propositions. J’en avance une ici : on met la dette superflue dans une boîte, et on rembourse peu à peu en mettant un peu plus de côté. Ce n’est pas très différent du contrat que nous faisons tous les jours avec les locataires d’un logement social qui ne payent pas régulièrement leur loyer !
Il faudra bien inventer des mécanismes pour nous remettre en état.
M. Raoul Briet. Augmenter la TVA est un choix politique… À vrai dire, intégrer le produit de cette hausse au budget général, ou le flécher vers une caisse, serait une question de présentation plus que de contenu.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Ma proposition est de flécher clairement cette somme, justement pour éviter de refaire les mêmes erreurs.
M. Éric Dubois. On pourrait aussi craindre que le reste de la dette ne soit plus maîtrisé.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Écoutez, un jour, il faudra revenir à l’équilibre ! Tout le monde le dit. Il y a des groupes politiques qui proposent que l’État présente des comptes à l’équilibre – j’avais fait cette proposition en 2005, mais je n’ai pas eu beaucoup de succès…
Il y en a d’autres qui disent qu’il ne faut pas rembourser la dette ; d’autres encore qui disent qu’il faut sortir de l’euro pour retrouver l’inflation et la dévaluation… Voilà ce que proposent les extrêmes. Il y a peut-être des solutions plus modérées.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. La TVA, qui est l’impôt le moins progressif, serait-elle vraiment le meilleur outil pour rembourser la dette ?
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Cette remarque est tout à fait idéologique.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. La vôtre aussi, mon cher collègue. La TVA est le prélèvement le plus injuste qui soit, vous le savez comme moi.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Merci de vos interventions et de ces échanges.
Les représentants d’agences de notation : M. Patrice Cochelin, directeur senior, finances publiques, et M. Jean-Michel Six, responsable des études économiques pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, de Standard & Poor’s, et M. Tony Stringer, directeur général et Mmes Maria Malas-Mroueh et Amélie Roux de FitchRatings.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, poursuivant les auditions de la Mission d’évaluation et de contrôle sur la transparence et la gestion de la dette publique, nous allons maintenant entendre les représentants de deux agences de notation des dettes souveraines.
M. Patrice Cochelin. Je suis l’un des responsables analytiques de l’agence Standard & Poor’s, chargé de la notation du secteur public, qui comprend les États souverains, les collectivités locales, les émetteurs du secteur parapublic et certains émetteurs à but non-lucratif, notamment le secteur du logement social. Je suis responsable d’une équipe qui couvre une zone géographique comprenant la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Espagne et l’Italie. Dans cette zone, nous notons environ 160 émetteurs, dont quinze États souverains, ainsi que des collectivités locales et d’autres émetteurs du secteur public et institutions multilatérales. Je travaille chez Standard & Poor’s depuis 2001, j’y suis entré en tant qu’analyste de crédit dans le secteur de la notation des entreprises ; auparavant, j’avais passé six ans au sein de la Société Générale, également comme analyste de crédit. Quant à Jean-Michel Six, il est notre chef économiste pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique.
Standard & Poor’s est présente en Europe depuis 1984 et en France depuis 1990, date à laquelle elle a succédé à l’Agence d’évaluation financière française (ADEF) – nous sommes donc présents en France depuis un peu plus de vingt-cinq ans. Notre bureau parisien est un établissement important, comprenant environ 80 analystes sur un effectif mondial de l’ordre de 1 400 analystes. Notre société a été fondée en 1860 par Henry Varnum Poor, qui a commencé son activité en émettant des opinions sur les chemins de fer américains, qui cherchaient à lever de la dette auprès d’investisseurs européens, notamment britanniques, afin de fournir à ces derniers des informations financières de nature à les aider à évaluer la solvabilité des compagnies désireuses d’emprunter. Notre activité est réglementée au niveau européen depuis 2009 et notre superviseur est l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF, également connue sous son acronyme anglais ESMA).
La note est l’expression synthétique d’une analyse de crédit. Elle s’adresse aux créanciers de l’émetteur, qui sont des investisseurs et des épargnants. De nature très technique, elle est cantonnée à un risque très spécifique, à savoir le risque de non-paiement en temps et en heure du principal et des intérêts de la dette. Il s’agit d’un avis indépendant sur la qualité future d’une signature, donc une opinion prospective, portant sur la capacité, mais aussi la volonté d’un émetteur à honorer ses engagements en temps et en heure. Il faut dissocier le risque de crédit – le seul qui nous intéresse – de l’opinion que l’on peut avoir sur d’autres types de risques souvent attachés aux mêmes obligations financières, par exemple le risque de liquidité – c’est-à-dire le degré de difficulté auquel sera confronté l’investisseur souhaitant revendre son titre.
Enfin, la notation est relative, c’est-à-dire que nous cherchons en permanence à comparer les différents émetteurs de dette, le plus souvent entre pairs – ainsi la France sera-t-elle fréquemment comparée à d’autres grands États souverains, au sein de l’Union européenne et en dehors –, mais aussi entre différentes classes d’actifs, en prenant pour critère l’identité ou la proximité des notes des émetteurs. La notation est un outil parmi d’autres pour les investisseurs et, en ce qui nous concerne, nous nous efforçons d’offrir le maximum de comparabilité entre les notes et de transparence dans leur utilisation. J’insiste sur le fait que la notation n’est pas un audit des comptes de l’émetteur, ni un exercice de vérification comptable – pour effectuer notre travail, nous nous fondons sur des informations publiques –, ni une garantie de remboursement : à terme, même les obligations notées AAA peuvent, dans des cas exceptionnels, faire défaut.
Nous avons attribué une note à l’État français à partir de 1975. Il s’agissait à l’époque de noter une émission faite par la Caisse nationale des télécommunications, garantie par l’État français. Dans notre travail, la note des États souverains ne sert pas seulement à évaluer la qualité de crédit des gouvernements, mais joue également le rôle de référence pour les emprunteurs du pays, soit parce qu’ils sont considérés comme très proches de l’État, soit parce qu’ils ont une qualité de crédit qui pourrait éventuellement paraître supérieure à celle de l’État – ce qui justifie alors que nous procédions à un exercice de comparaison permettant de déterminer si un emprunteur doit voir sa note rapprochée de celle de l’État concerné.
Standard & Poor’s attribue actuellement à la France une note à long terme de AA, sur une échelle de vingt-deux crans ne comportant que des lettres assorties de plus et de moins – les deux crans les plus bas étant les crans de défaut de paiement ; défaut sur la totalité des obligations (CD) ou défaut sélectif (SD) –, tandis que les vingt autres crans correspondent à des émetteurs à jour sur le paiement de leurs obligations. La note AA de la France est le troisième cran le plus élevé de l’échelle de notation : elle reste donc très élevée. Depuis octobre 2014, cette note est assortie d’une perspective négative indiquant qu’il existe selon nous une probabilité de l’ordre d’au moins une chance sur trois pour que la note soit abaissée à horizon de dix-huit à vingt-quatre mois. En décembre 2015, nous avons maintenu à la fois la note AA et la perspective négative.
Conformément à la réglementation, nous publions chaque année un calendrier indiquant les dates de réactualisation des notes des États souverains, qui couvre également tous les émetteurs du type collectivités locales ; ce calendrier précise que les prochaines dates de prévision pour la France seront le 22 avril 2016 et le 21 octobre 2016.
Nous avons publié aujourd’hui une mise à jour de nos actualisations en termes de prévision d’émission de dette pour 2016 pour les 132 États souverains que nous notons. Notre méthodologie, qui est très claire et peut être consultée par tout un chacun, comprend cinq grands piliers : d’une part, le cadre institutionnel et le cadre économique, regroupés en un profil économique et institutionnel, d’autre part, le facteur extérieur, le facteur budgétaire et le facteur monétaire, regroupés en un profil de flexibilité et de performance. Les deux permettent d’aboutir à un niveau indicatif de la note de l’État, pouvant faire l’objet d’ajustements en fonction de facteurs exceptionnels typiques pour certains emprunteurs.
J’en viens à la note AA actuellement attribuée à la France. Lorsque nous communiquons publiquement sur les éléments entrant dans l’explication d’une note, nous indiquons quels facteurs sont considérés comme des forces et quels facteurs sont considérés comme neutres ou comme constituant des faiblesses. En ce qui concerne la France, aucun des cinq facteurs n’est considéré comme une faiblesse à proprement parler : soit ils sont neutres, soit ils constituent des forces.
Le facteur institutionnel est le reflet des institutions et de leur fonctionnement, en particulier de leur stabilité en matière de mise en œuvre de la politique économique. En pratique, nous nous efforçons de déterminer si les institutions sont susceptibles de provoquer des blocages ou des difficultés à exercer le pouvoir, en particulier en matière économique. À ce facteur, nous ajoutons dans certains cas des risques particuliers, par exemple de type sécuritaire ; ces risques ne s’appliquent généralement pas aux États européens. Pour la France, ce facteur est positif. C’est une force.
Le facteur constitué par la structure économique et les perspectives de croissance se fonde en premier lieu sur l’analyse du PIB – son niveau absolu, mais aussi son niveau relatif par rapport à d’autres États –, puis sur l’analyse de la croissance : il s’agit de déterminer des anticipations de croissance pour les deux ou trois prochaines années – c’est le travail des analystes, effectué en étroite collaboration avec les équipes de Jean-Michel Six, qui s’occupe de la prospective macroéconomique à court et moyen terme.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Le facteur économique constitue-t-il un point fort pour la France ?
M. Patrice Cochelin. Aujourd’hui, la structure économique et les perspectives de croissance sont des facteurs positifs pour la France. Nos dernières analyses mettent en évidence une reprise de l’activité qui, si elle ne fait aucun doute, se met en route à un rythme plus lent que chez la plupart de nos voisins européens, y compris ceux qui n’étaient pas parmi les plus affectés par la crise financière.
Le facteur constitué par les comptes extérieurs est neutre. Il résulte de l’analyse de la balance des paiements et de sa construction, notamment en termes de transactions courantes. Il s’agit notamment de la capacité de l’économie à exporter, un ressort qui nous paraît s’être amélioré récemment pour la France, étant précisé qu’il dépend de plusieurs facteurs et a bénéficié d’une part de la conjoncture favorable constituée par le niveau de l’euro par rapport au dollar et par le prix du pétrole, d’autre part de facteurs plus structurels, à savoir l’amélioration de la compétitivité des entreprises françaises. On a noté un léger relèvement du taux de marge des entreprises françaises, en deux étapes : d’abord une stabilisation en 2014, puis un léger relèvement en 2015. Par ailleurs, il est important de noter que la part de la France dans le commerce mondial, qui a fait l’objet d’un déclin structurel pendant plusieurs décennies, s’est stabilisée au cours des douze à dix-huit derniers mois.
Le facteur constitué par le cadre budgétaire, la dette et le risque hors bilan est sans doute celui donnant lieu à l’analyse la plus connue. Il est également neutre. Il s’agit d’examiner les déficits publics et le niveau d’endettement, ainsi que les possibles appels sur le budget de l’État – les risques hors bilan –, en considérant par exemple l’éventuelle fragilité du secteur financier dans certains pays. On utilise pour évaluer les systèmes bancaires une échelle graduée de un à dix, le Banking Industry Country Risk Assessment (BICRA), où 1 est le risque le moins élevé et 10 le plus élevé. Sur cette échelle, les banques françaises sont au niveau de trois, ce qui signifie qu’elles présentent un niveau de risque relativement faible.
Le dernier facteur, celui de la flexibilité monétaire est positif, et prend en compte la capacité de la Banque centrale à gérer la devise et à atteindre ses objectifs, notamment en termes d’inflation et de transmission des flux financiers dans l’économie. Dans ce cadre, nous examinons aujourd’hui les actions de la Banque centrale européenne visant à défendre la croissance et à atteindre ses objectifs d’inflation, ainsi que les différentes actions menées à l’intérieur de la zone euro pour améliorer les processus de transmission de la monnaie via les banques et les différents acteurs de la zone, mais aussi entre les différents pays de la zone euro. Ainsi, la crise des dettes souveraines avait mis à mal la transmission monétaire, qui a aujourd’hui retrouvé un fonctionnement normal, en grande partie grâce à l’action de la Banque centrale.
M. Tony Stringer. (intervention en anglais interprétée par Mme Amélie Roux.) Dans la hiérarchie de FitchRatings, j’occupe le poste de managing director et je suis l’un des adjoints directs du responsable des Etats souverains. En tant que chief operating officer, je supervise toutes les problématiques transversales liées à la réglementation et à son respect.
Mme Amélie Roux. Pour ma part, je travaille depuis cinq ans chez Fitch, où je suis actuellement director, ce qui correspond au grade d’analyste senior, et je m’occupe de la notation des États dans les régions Afrique et Moyen-Orient. Quant à Maria Malas-Mroueh, elle est également director ; basée à Londres, elle est spécialisée dans la notation des pays d’Europe de l’ouest, et analyste principale pour la notation de la France.
M. Tony Stringer. Les notations sont des évaluations prospectives ne portant que sur la qualité de crédit des souverains, qui apprécient la capacité et la volonté des souverains à rembourser leurs dettes en intégralité et en temps et en heure, auprès du secteur privé. Au-delà des souverains, nous notons également des instruments de dette qui, étant généralement non subordonnés, ont la même notation que le souverain – c’est généralement le cas pour la France.
Notre méthodologie de notation est très stable depuis plus de vingt ans, c’est-à-dire depuis que nous notons des souverains. Nos méthodologies sont détaillées, robustes et appliquées de façon uniforme sur tous les souverains que nous notons. Il est important de noter que nos méthodologies définissent des notations qui ne sont pas des probabilités de défaut, mais des classements relatifs entre États – ainsi la note AAA doit-elle s’apprécier essentiellement comme la marque d’une qualité de crédit meilleure que celle d’un autre État moins bien noté : il n’y a pas de probabilité de défaut prédéfinie associée à nos notations.
Nos notations, qui intègrent des éléments quantitatifs et qualitatifs, s’établissent sur la base de quatre grands piliers. Le premier pilier est celui de la performance et des politiques et perspectives macroéconomiques, qui recouvre les perspectives de croissance, la stabilité de l’économie, ainsi que la cohérence et la crédibilité des politiques économiques.
Le deuxième pilier est constitué par les caractéristiques structurelles de l’économie. Nous cherchons à apprécier les risques d’exposition à des chocs d’origine financière, politique ou institutionnelle.
Le troisième pilier est celui des finances publiques : c’est le cœur de notre analyse, puisque la notation a pour objet d’évaluer la capacité d’un souverain à rembourser ses dettes. Dans le cadre de ce critère, nous sommes amenés à analyser le solde budgétaire, la soutenabilité de la dette – donc les projections de dette – et les différentes options de financement qui se présentent aux États.
Enfin, le quatrième pilier est celui des finances externes, qui nous conduit à analyser leur soutenabilité, à la fois du point de vue des flux – la balance courante – et du point de vue des stocks : notre analyse de la dette externe est à la fois publique et privée.
Dans le cadre de ces quatre critères, nous effectuons des peer comparisons, c’est-à-dire des comparaisons avec des pays ressemblant à la France. Pour cela, nous nous référons à un certain nombre d’indicateurs quantitatifs et les comparons à ceux d’autres pays également situés dans la zone euro ou dans l’Union européenne, ce qui nous permet de classer les pays les uns par rapport aux autres.
Mme Amélie Roux. En ce qui nous concerne, nous notons la France AA, avec une perspective stable. Notre dernière notation remonte à décembre 2015. Très schématiquement, nous estimons que la notation de la France reflète avant tout des forces liées aux structures de son économie, une économie riche et diversifiée, marquée par une grande stabilité macroéconomique et des institutions efficaces et présentant un bon niveau de gouvernance. La notation intègre également des facteurs de faiblesse correspondant essentiellement aux soldes budgétaires persistants et au niveau de l’endettement public.
En entrant un peu plus dans le détail, nous avons identifié deux forces principales expliquant que la notation de la France se situe à un niveau élevé. La première réside dans le fait que l’économie française est stable, peu volatile, diversifiée, et présente un bon niveau de productivité ; par ailleurs, elle est dotée d’un capital humain de bonne qualité. Cette richesse de l’économie se traduit pour l’État français par des revenus budgétaires très élevés et très peu volatils. La deuxième force est la flexibilité financière exceptionnelle de la France, c’est-à-dire sa capacité à financer son déficit et à refinancer sa dette. En tant qu’émetteur de référence en Europe, elle a accès à des marchés liquides et profonds, et la structure de sa dette est très favorable car, essentiellement libellée en euros et présentant des maturités très longues, elle a un coût globalement modéré.
La faiblesse principale de la France provient essentiellement de ses finances publiques. Les déficits budgétaires nous semblent persistants et liés à un niveau de dépense élevé qui a graduellement augmenté le montant de la dette publique, jusqu’à ce que celui-ci atteigne 95 % du PIB en 2014. Nous n’analysons pas ce niveau de dette publique dans l’absolu : c’est par comparaison avec les autres pays qu’il nous semble élevé, mais aussi par le fait qu’il est susceptible de limiter la capacité de la France à faire face à des chocs d’origine financière ou économique. Enfin, nous avons quelques incertitudes au sujet des trajectoires d’endettement public, qui vont dépendre de la vigueur de la reprise économique.
La deuxième faiblesse principale que nous soulignons est le chômage, qui se situe à un niveau élevé par rapport aux autres pays de la zone euro et aux pays semblables à la France. Nous estimons également que la dette externe de la France, évaluée sur une base nette, est significativement plus élevée que celle des pays appartenant au même groupe de notation.
Pour nous, la perspective de notation de la France est stable, ce qui signifie que nous n’anticipons pas de changement à court terme.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. En cela, votre appréciation diffère de celle de Standard & Poor’s.
Mme Amélie Roux. Effectivement, nous n’anticipons pas d’éléments pouvant nous amener à améliorer ou abaisser la note de la France à court terme.
En revanche, nous identifions dans notre méthodologie des facteurs pour chacun des souverains qui seraient susceptibles de nous amener à une réévaluation de la note à la hausse ou à la baisse à moyen terme. En ce qui concerne la France, ces facteurs sont au nombre de deux. Le premier est celui de la consolidation budgétaire. Nous estimons qu’une dégradation des finances publiques qui entraînerait une augmentation de la dette publique au-delà de 2017 pourrait avoir un impact négatif sur la notation et qu’à l’inverse, une consolidation budgétaire associée à une réduction de l’endettement public pourrait avoir un effet favorable sur la dette, donc sur la notation.
Le deuxième facteur est celui de la compétitivité et de la croissance. Nous estimons qu’une détérioration de la compétitivité, qui pourrait peser sur les perspectives de croissance à moyen terme, serait pénalisante pour la notation de la France ; à l’inverse, si la reprise que l’on constate actuellement se renforce et si les perspectives de croissance à moyen terme augmentent, cela pourrait constituer un facteur de révision à la hausse de la notation. Notre notation étant revue tous les six mois, la prochaine sera effectuée en juin 2016.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. On entend souvent dire que la notation de la France reste relativement stable grâce à la prise en compte des actifs publics et privés, qui constituerait une sorte de garantie dans l’hypothèse où le niveau de la dette atteindrait un niveau tel qu’il faudrait rendre des comptes, comme cela a été le cas à Chypre. Tenez-vous effectivement compte des actifs des Français, s’élevant à 4 500 milliards d’euros, pour établir votre notation ?
M. Nicolas Sansu, rapporteur. C’est à 12 000 milliards d’euros que s’élèvent ces actifs.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Ce montant correspond au patrimoine financier. Les actifs, eux, s’élèvent bien à 4 500 milliards d’euros.
M. Charles de Courson. Le bilan de l’État français est composé de 1 300 milliards d’euros de dettes, 500 millions d’euros d’actifs et 700 millions d’euros d’actifs nets négatifs. Avec ces chiffres, une entreprise serait en cessation de paiement depuis longtemps. Comment tenez-vous compte de ce bilan pour établir votre notation ?
Par ailleurs, vous nous avez dit tenir compte du niveau d’endettement s’élevant à 96 % du PIB – pour l’État, les collectivités locales et la sécurité sociale. Mais tenez-vous également compte du fait que les ménages français détiennent environ 12 000 milliards d’euros de patrimoine, notamment sous forme d’assurance-vie ? En d’autres termes, faites-vous la différence entre endettement brut et endettement net ?
M. Patrice Cochelin. Le patrimoine de l’État et la richesse du pays correspondent à deux notions distinctes. Quand on observe le niveau d’endettement de l’État, à savoir le ratio dette sur PIB, on prend pour base la dette brute moins les actifs financiers à court terme – il s’agit d’actifs liquides, c’est-à-dire disponibles en vue d’un remboursement. Pour 2015 cela fait une différence de 7,5 points de PIB. Sur le long terme, ces montants ont représenté 5 % à 6 % du PIB.
M. Charles de Courson. Tenez-vous compte de l’ensemble des participations de l’État, que ce soit dans EDF, Gaz de France ou ENGIE ?
M. Patrice Cochelin. Les actifs pris en compte pour le calcul de la dette nette sont uniquement les plus liquides. Les titres de participation détenus par l’État ne sont pas pris en compte dans le calcul de la dette nette mais le revenu produit (les dividendes) vient augmenter les recettes budgétaires non-fiscales.
M. Charles de Courson. En revanche, vous ne tenez pas compte du patrimoine immobilier – le château de Versailles, par exemple – et des collections publiques de l’État ?
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Cela n’est pas monnayable, cher collègue.
M. Patrice Cochelin. Ce qui nous intéresse, c’est d’observer les flux financiers engendrés par le patrimoine d’un côté, la dette de l’autre. Cela nous conduit à examiner la capacité de l’État à lever des impôts, ainsi que les actifs détenus par l’État et les acteurs des secteurs public et privé par rapport à d’autres pays. Du point de vue de l’activité financière, nous observons que les acteurs français rapatrient un volume élevé de fonds de l’étranger grâce à une position favorable par rapport aux autres pays.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Pour être très clair, tenez-vous compte du fait que, dans l’hypothèse où la dette monterait trop haut, on pourrait confisquer une partie des actifs financiers des Français – je pense essentiellement aux 1 600 milliards actuellement investis dans l’assurance-vie, qui constituent une richesse dormante alors qu’ils pourraient éventuellement financer la dette ?
M. Patrice Cochelin. La réponse est non : la note AA actuellement attribuée à la France ne tient pas compte de cette éventualité.
M. Charles de Courson. Il s’agit pourtant d’une hypothèse fréquemment évoquée. Au demeurant, il ne s’agirait pas d’une confiscation totale : l’idée serait de prélever les fonds excédant un certain montant par titulaire – par exemple un million d’euros.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. De mon point de vue, une telle hypothèse est loin d’être farfelue : ce pourrait être un moyen de régler le problème de la dette.
Mme Maria Malas-Mroueh. (intervention en anglais interprétée par Mme Amélie Roux.) Chez FitchRatings, nous prenons en compte les actifs de quatre façons différentes. Premièrement, nous prenons en compte la richesse des ménages français de façon indirecte, c’est-à-dire par le biais de leur effet sur la stabilité de l’économie. Nous estimons en effet que l’une des caractéristiques principales de la France réside dans le fait que les ménages sont peu endettés et ont un niveau d’épargne élevé, ce qui contribue à la stabilité macroéconomique – qui, elle, est directement prise en compte dans nos ratings. Ainsi, durant la crise financière de 2008-2009, la récession française a été beaucoup moins forte que dans d’autres pays, ce que l’on explique par le fait que la consommation privée est restée positive grâce au montant élevé de l’épargne et au faible endettement des ménages français par rapport à leurs voisins européens.
Deuxièmement, nous prenons en compte des actifs liquides dans le calcul de deux types de ratios. Pour le calcul des ratios de dette externe de la France, nous prenons pour base la dette brute externe d’une part, les actifs financiers et liquides d’autre part. Pour ce qui est de la dette publique, nous nous référons à une mesure de la dette nette, obtenue en soustrayant de la dette brute, les actifs liquides : les participations dans les entreprises stratégiques ne seront donc pas prises en compte.
Troisièmement, dans le cadre des discussions que nous avons régulièrement avec les autorités françaises, nous évoquons les plans de privatisation des différents actifs publics, mais nous n’incorporons ces éléments que si les plans de privatisation en question sont détaillés et imminents ; à défaut, nous évitons de prendre ces éléments en compte, dans un souci de cohérence.
Quatrièmement, la richesse des ménages et leur taux d’épargne élevé jouent un autre rôle indirect dans notre notation, dans la mesure où ils ont un impact sur le secteur bancaire : nous estimons que grâce aux dépôts bancaires des épargnants, l’État français n’aura pas besoin de recapitaliser les banques françaises, ce qui constitue une force en matière de notation.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. La Commission européenne n’a pas tout à fait la même analyse que vous au sujet des banques françaises.
M. Charles de Courson. Je vais me permettre de faire preuve d’une certaine insolence en vous demandant à quoi servent vos notations. Vous êtes payés par les entreprises privées, mais vous ne l’êtes pas systématiquement par les États. En l’occurrence, puisque l’État français ne vous paye pas, pourquoi le notez-vous ? Par ailleurs, quelle est votre responsabilité dans la notation ?
M. Patrice Cochelin. Pour ce qui est de notre rémunération, je ne peux malheureusement pas vous répondre, dans la mesure où nous opérons au sein de notre société une séparation très stricte entre ce qui relève du domaine analytique et ce qui relève du domaine commercial – sur lequel je ne peux m’exprimer. Je peux transmettre votre question aux services compétents, mais je ne serai même pas autorisé à connaître le contenu de la réponse qui vous sera apportée.
M. Jean-Michel Six. Tout ce que nous pouvons vous dire, c’est que si l’État français ne nous paye pas, c’est parce qu’il ne sollicite pas la note que nous lui attribuons. Et s’il devait nous payer, les analystes que nous sommes ne sauraient absolument rien des modalités pratiques du contrat qui serait conclu.
M. Charles de Courson. Nous pourrions toujours interroger le ministre compétent.
M. Jean-Michel Six. Plutôt l’Agence France Trésor.
M. Charles de Courson. Vous n’êtes cependant pas un organisme à but philanthropique. De quelle manière couvrez-vous les frais résultant de la notation des États qui ne vous sollicitent pas, donc ne vous payent pas ?
M. Jean-Michel Six. Nous sommes rémunérés par l’ensemble des entreprises et des banques que nous notons, qui constituent l’essentiel de notre chiffre d’affaires, mais aussi par un certain nombre d’États. Si nous notons aussi les États qui ne nous payent pas, ce n’est pas par plaisir ou par patriotisme, mais parce que nous y sommes contraints, dans la mesure où ces États sont garants d’entreprises que nous notons. C’est ce qui explique que nous notions la France depuis 1975 : à l’époque, l’État français était garant d’une caisse importante qui nous avait demandé de la noter.
M. Charles de Courson. Peut-on considérer que vous êtes rémunérés indirectement par les participations que détient l’État dans un certain nombre d’entreprises publiques que vous notez – je pense notamment à EDF ou ENGIE ?
M. Patrice Cochelin. Comme je vous l’ai dit, nous ne pouvons pas entrer dans le détail de nos rémunérations.
Dans tous les pays où nous notons des banques, des compagnies d’assurances et d’autres entreprises, la note de l’État est une référence qui, pour nous, constitue souvent un point de départ : elle constitue la base pour déterminer la note d’une entreprise qui serait l’une des meilleures du pays – par exemple, une banque extrêmement solide. Il est très rare qu’une entreprise se voit attribuer une note supérieure à celle de l’État où elle se trouve : cela n’arrive que dans certaines conditions strictement définies. Aujourd’hui, la note AA de la France constitue, de facto, un plafond pour ses entreprises.
M. Charles de Courson. Aucune institution française ne peut donc obtenir la note AAA ? Qu’en est-il, par exemple, de la Caisse des dépôts et consignations ?
M. Patrice Cochelin. La Caisse des dépôts et consignations est effectivement notée AA, comme l’État français.
M. Tony Stringer. Les analystes de chez Fitch sont agnostiques sur le fait que les souverains payent ou non pour leur notation. La relation commerciale relève des attributions d’un département totalement séparé des responsabilités analytiques, à savoir le business and relationship management. Les analystes n’ont jamais à connaître des discussions portant sur les frais que Fitch facture à ses émetteurs. Au sein de notre société, c’est une véritable muraille de Chine qui sépare l’activité d’analyse de l’activité commerciale.
M. Charles de Courson. Vous n’avez jamais rencontré les personnes travaillant de l’autre côté de ce que vous appelez la Muraille de Chine – qui n’est pour moi qu’un mur de papier, comme on a pu le constater à l’occasion de la crise financière de 2008 ? Et il n’est jamais arrivé qu’une personne travaille successivement d’un côté du mur, puis de l’autre ?
M. Tony Stringer. Il arrive que les analystes rencontrent des personnes travaillant du côté commercial, mais s’il arrive, au cours d’une discussion avec des émetteurs, que la discussion porte sur les contrats commerciaux, les analystes quittent immédiatement la pièce. C’est une politique qui est mise en œuvre de manière extrêmement rigoureuse. Il arrive également que certains analystes prennent un poste du côté commercial, mais l’inverse est très rare.
Pour ce qui est de savoir pourquoi nous notons la France alors qu’elle ne nous paye pas, nous estimons que la notation est un service que nous fournissons non seulement à la France mais, d’une manière plus générale, à l’ensemble des investisseurs. En tant qu’agence de notation de référence, il nous est impossible de ne pas noter la France, qui est un émetteur de très grande qualité et émettant des dettes d’un volume important.
Les analyses ne se préoccupent pas de savoir si la notation est sollicitée ou non, donc si les émetteurs payent ou pas. La méthodologie appliquée est la même dans les deux cas, et la charge de travail pour l’analyste est identique.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Quand vous attribuez une note à une entreprise ou à un souverain, vous êtes forcément conscients du fait que la publication de cette note va avoir des conséquences sur le comportement des acteurs économiques, donc sur l’économie elle-même. Intégrez-vous cette incidence dans vos modèles, et assumez-vous le fait que certaines de vos annonces – je pense évidemment aux abaissements de notes – peuvent avoir pour conséquence de mettre un pays à terre ? Par ailleurs, quand vous évaluez la dette française, en discutez-vous préalablement avec le ministre des finances ? Enfin, comment se fait-il que vous n’ayez pas vu venir ce qui s’est produit avec la dette grecque ?
M. Nicolas Sansu, rapporteur. On pourrait citer d’autres ratés survenus au cours des dernières années.
M. Patrice Cochelin. Notre méthodologie est publique et transparente, ce qui permet toujours d’expliquer pourquoi une note a changé, et sur la base de quels critères.
Pour ce qui est de l’incidence que la notation peut avoir sur le comportement de l’émetteur concerné, je rappelle que nous n’exprimons qu’un avis parmi de nombreux autres, et que cet avis est très technique et très ciblé : il se rapporte uniquement au risque de crédit, c’est-à-dire à la volonté et la capacité de l’émetteur de payer en temps et en heure le principal et les intérêts de sa dette. De nombreux autres facteurs entrent en jeu lorsque l’État s’interroge sur sa capacité à se financer et sur ce que cela va lui coûter. Il est clair que la notation n’est pas l’alpha et l’oméga en matière de coût du financement, et qu’elle n’entend pas l’être. On entend parfois dire que le fait d’avoir abaissé la note de la France n’a eu aucun effet sur les modalités de financement de la dette, ce qui est censé démontrer que la notation ne sert à rien. De notre point de vue, ces deux arguments contraires se neutralisent.
Pour ce qui est de la crise grecque, je rappelle que nous avons commencé à abaisser la note de la Grèce en 2004, c’est-à-dire bien avant que n’éclate la crise des dettes souveraines. Ayant mis en évidence des anomalies affectant la présentation des comptes, nous avions attribué la note A à la Grèce, alors que tous les autres émetteurs de la zone euro étaient notés AA ou AAA. Si l’on se réfère aux pays de la périphérie de l’Europe – ceux dont les notes ont le plus évolué, focalisant l’attention des marchés –, on observe que la notation a plutôt joué pour eux un rôle stabilisateur. Certes, ces pays ont subi un affaiblissement de leur crédit, dont nous avons rendu compte, mais leurs notes ont évolué de façon relativement modérée par rapport au coût de financement de leur dette, résultant essentiellement de l’appréciation des marchés, qui affirmaient que la grande majorité de ces pays étaient au bord du défaut de paiement : pour Standard & Poor’s, la plupart se situaient aux environs de BBB-, la dernière note de la catégorie « investissement » – alors que la note BB+, située juste en dessous, fait partie de la catégorie spéculative.
M. Charles de Courson. Vous n’avez pas répondu à ma question portant sur votre responsabilité, une question que nous avions déjà posée lors de la grande crise de 2008. Une agence de notation nous avait alors répondu n’avoir aucune responsabilité, mais une simple obligation de moyens, consistant à émettre une opinion en fonction des éléments existants. Pourtant, sur les marchés, ce n’est pas ainsi que votre notation est perçue : elle est bel et bien utilisée pour sécuriser les investisseurs, surtout les particuliers. De ce point de vue, votre responsabilité sociale et économique est nulle, contrairement à celle d’un expert-comptable qui, s’il a certifié des comptes qui se sont révélés faux, doit en répondre et en subit les conséquences : de grands cabinets d’audit en sont morts !
M. Jean-Michel Six. Précisément, nous ne sommes pas commissaires aux comptes, donc pas responsables de la véracité des comptes publics sur la base desquels nous établissons nos notations. Ainsi, Eurostat a révélé que les comptes soumis par la Grèce pour entrer dans la zone euro en 2000, qui avaient été examinés par cet organisme ainsi que par la Banque centrale européenne, contenaient un certain nombre d’inexactitudes. J’insiste sur le fait que notre travail ne consiste pas à vérifier les comptes qui nous sont soumis.
Par ailleurs, comme l’a dit Patrice Cochelin, nous ne sommes pas le seul indicateur de marché auquel les investisseurs puissent se référer pour obtenir un avis sur la qualité de crédit de tel ou tel émetteur, qu’il s’agisse d’un souverain ou d’une entreprise. Il nous arrive d’ailleurs fréquemment d’être en désaccord avec d’autres indicateurs de marché au sujet de la note attribuée à un émetteur. Vous nous avez demandé quel était notre rôle : il est modeste, et consiste essentiellement à essayer de fournir aux investisseurs – qu’il s’agisse d’institutionnels ou de fonds de gestion – des indications sur ce que nous estimons être la qualité de crédit de certains émetteurs.
Vous avez évoqué les particuliers, or nous ne nous adressons qu’aux marchés obligataires : le marché des actions ne nous concerne absolument pas.
M. Charles de Courson. Les particuliers peuvent acheter des obligations.
M. Jean-Michel Six. Certes, mais essentiellement en passant par des intermédiaires financiers.
M. Charles de Courson. Pas forcément.
M. Jean-Michel Six. Si c’est théoriquement possible, c’est compliqué en pratique, donc rare : la très grande majorité des particuliers passent par des fonds obligataires, qui se basent sur les évaluations de risques disponibles pour acheter ou non tel ou tel titre. Il existe des fonds intéressés par l’achat de titres présentant un haut niveau de risque, et certains sont même spécialisés dans ce type d’achats spéculatifs. Quand un particulier souscrit une assurance-vie – ce qui est le moyen le plus courant d’acheter des obligations –, il lui est demandé de préciser quel niveau de risque il est prêt à accepter. Un fonds risqué, c’est un fonds dont la note est relativement basse. La notation n’est pas un processus binaire, aux termes duquel on décrète que telle dette est bonne et telle autre mauvaise : échelonnée sur vingt crans, elle est le reflet d’une évaluation précise – granulaire, comme disent les analystes – et s’adressant à différents investisseurs, correspondant chacun à un niveau de risque spécifique. Certains investisseurs ont pour spécialité d’acheter « au fond du panier », c’est-à-dire qu’ils achètent de préférence des produits très risqués, donc très spéculatifs, qui pourront constituer d’excellentes affaires s’ils ne font pas défaut. La question de notre responsabilité doit donc s’apprécier sans perdre de vue que nous nous adressons à des investisseurs avertis : nous ne conseillons pas les particuliers, qui ont généralement une connaissance de la notation assez limitée.
M. Charles de Courson. Savez-vous si une agence de notation a déjà été condamnée pour défaillance dans la notation ? Je me suis laissé dire que cela n’était jamais arrivé. Confirmez-vous n’avoir qu’une obligation de moyens ?
M. Tony Stringer. FitchRatings n’a jamais eu d’amende à payer en raison de ce qu’elle aurait pu faire ou ne pas faire durant la crise. D’une manière générale, on assiste actuellement à une augmentation des poursuites judiciaires envers les agences de notation, mais cette tendance concerne les États-Unis plutôt que l’Europe.
M. Jean-Michel Six. Des agences, dont Standard & Poor’s, ont fait l’objet de procédures judiciaires concernant des notations de dette publique, mais leur responsabilité n’a pas été retenue.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Au moment de procéder à la notation d’un souverain, prenez-vous contact avec les ministres concernés et, plus généralement, avec les personnes ayant un haut niveau de responsabilité ?
M. Patrice Cochelin. Compte tenu de sa complexité, la notation souveraine est l’exercice au cours duquel nous prenons le plus d’opinions différentes. L’AFT est un interlocuteur permanent pour nous et, au besoin, il arrive que nous entrions en contact avec le ministre des finances, le ministre de l’économie, les responsables de la Banque de France, voire les partenaires sociaux.
M. Charles de Courson. Les propriétaires de Standard & Poor’s et de FitchRatings exercent-ils une influence sur le comportement de vos agences respectives ?
M. Patrice Cochelin. Je suis formel : la famille McGraw, qui est notre actionnaire historique, mais très minoritaire aujourd’hui, n’exerce aucune pression sur le fonctionnement de notre agence.
M. Charles de Courson. Qui sont vos actionnaires ?
M. Patrice Cochelin. Standard & Poor’s est une filiale de la société McGraw-Hill, qui est cotée en bourse – sans actionnaire dominant.
M. Tony Stringer. Pour Fitch, c’est un peu différent. Historiquement, nous étions détenus par la société FIMALAC, dirigée par Marc Ladreit De Lacharrière, mais FIMALAC s’est partiellement retirée de Fitch, dont elle ne détient plus que 20 % aujourd’hui. Les 80 % restants sont détenus par Hearst Corporation, un conglomérat de médias américains. Nous n’avons jamais subi la moindre interférence de nos actionnaires : ni FIMALAC, ni Hearst ne sont autorisés à participer à nos comités de notation, dont ils ne connaissent d’ailleurs pas à l’avance le lieu et la date.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. En ce qui concerne la méthodologie, vous vous référez aux facteurs objectifs que sont le niveau de dette ou la croissance du PIB, mais aussi à d’autres facteurs beaucoup plus subjectifs, notamment ce que vous désignez par l’expression la crédibilité des politiques économiques. J’aimerais savoir de quelle manière vous abordez ces facteurs subjectifs, en prenant un exemple volontairement caricatural. Si, par un heureux hasard, le Gouvernement décidait d’augmenter le SMIC de 5 % du jour au lendemain, quel effet cela aurait-il sur la notation : y verriez-vous un facteur positif ou négatif ?
De même, quand vous évoquez la flexibilité monétaire – il s’agit en fait de l’indépendance totale de la politique monétaire –, est-ce pour vous la seule politique susceptible d’avoir un effet positif, ou admettez-vous que d’autres politiques puissent avoir un effet bénéfique ? J’ai l’impression que vous effectuez vos notations en restant dans un couloir idéologique très étroit, ce qui s’est vérifié quand des alternances politiques se sont produites dans certains pays : on a alors pu constater que les agences de notation étaient très peu enclines à considérer favorablement d’autres propositions que celles constituant la doxa actuelle en Europe et dans le monde.
M. Patrice Cochelin. La crédibilité des politiques économiques ne fait pas partie des critères que nous prenons en compte.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Effectivement, c’est M. Stringer qui a utilisé cette expression.
M. Patrice Cochelin. Pour notre part, nous nous intéressons à la crédibilité de la politique monétaire, essentiellement afin d’évaluer l’efficacité de la politique de la Banque centrale européenne, qui fait partie des critères auxquels nous nous référons pour effectuer la notation des pays de la zone euro, notamment la France.
Pour ce qui est des évolutions politiques, elles ne sont pas de notre ressort : nous n’avons pas vocation à prendre part au débat public. Le politique est le principal moteur des changements survenant dans le pays, puisque les décisions prises par le Gouvernement ont un impact sur l’économie, et c’est seulement en ce sens que nous sommes amenés à nous y intéresser.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Quand vous dites dans la presse qu’il faudrait dérigidifier le marché du travail en France, n’est-ce pas la marque d’un choix politique ?
M. Patrice Cochelin. En disant cela, nous sortirions de notre rôle, c’est pourquoi nous ne l’avons jamais fait. Nous nous bornons à faire des constatations objectives, par exemple le fait que le chômage ne diminue pas en France.
M. Jean-Michel Six. Selon les chiffres publiés par Eurostat, au quatrième trimestre 2015, sur les vingt-huit pays de l’Union européenne, quatre pays – parmi lesquels la France est le plus important – n’ont pas connu de baisse du chômage. C’est ce type de constatation que nous pouvons être amenés à faire publiquement.
M. Tony Stringer. Un certain nombre de facteurs qualitatifs sont pris en compte dans les analyses auxquelles nous procédons. Aucun modèle de notation purement quantitatif ne pourrait apprécier l’ensemble des éléments utiles à la détermination de la note, c’est pourquoi il est inévitable que notre évaluation comporte un élément de jugement. Quand on évalue les politiques publiques, qu’elles soient monétaires, fiscales, ou économiques au sens large, ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les politiques en elles-mêmes, mais leurs résultats. Cela dit, nous disposons d’un historique d’analyses des souverains dans le temps et l’espace, qui nous permet parfois d’illustrer le fait que certaines politiques sont plus susceptibles que d’autres d’apporter certains effets. En tout état de cause, nos analyses auront toujours pour focus le résultat des politiques mises en œuvre. De ce point de vue, nous n’avons pas de vision idéologique sur la relance ou la consolidation budgétaire, sur le laxisme monétaire ou la contraction de la politique monétaire.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Nous vous remercions pour vos interventions qui vont utilement éclairer les travaux de notre Commission.
Audition du 9 mars 2016
M. Patrice Ract Madoux, président de la CADES et de Mme Geneviève Gauthey, inspecteur des finances publiques.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. La mission d’évaluation et de contrôle poursuit ses travaux avec l’audition du président de la CADES (Caisse d’amortissement de la dette sociale), M. Patrice Ract Madoux, qui est accompagné de Mme Geneviève Gauthey, inspecteur des finances publiques.
M. Patrice Ract Madoux, président de la CADES. Nous vous présentons de nombreux chiffres dans notre Powerpoint auxquels je me contenterai d’apporter quelques commentaires supplémentaires.
Il faut tout d’abord préciser qu’avec environ 339 milliards d’euros en recettes et 348 milliards en dépenses pour 2015, le budget de la Sécurité sociale est plus conséquent que le budget de l’État qui s’élevait pour la même année à 302 milliards d’euros en dépenses et à près de 229 milliards en recettes. Pour autant, en fin d’année 2016, le déficit de l’État devrait atteindre plus de 72 milliards d’euros, alors que le déficit social, que l’on qualifie toujours d’abyssal, serait d’une dizaine de milliards d’euros seulement. Il n’est donc pas incurable, à mon sens - comme je vais tenter de vous le démontrer.
Tous ces financements sont encadrés par les lois de finances, pour l’un, et les lois de financement de la sécurité sociale, pour l’autre. Les premières ne définissent que le niveau d’endettement possible pour la dette négociable de l’État à moyen et long terme – soit de 60,5 milliards d’euros en 2016. En revanche, le Parlement vote chaque année trois références pour la Sécurité sociale : l’objectif d’amortissement de la CADES, de l’ordre de 14,2 milliards d’euros en 2016, les reprises de dette auxquelles elle doit procéder dans l’année, à savoir 23,6 milliards d’euros – marquant une accélération en 2016 par rapport aux exercices précédents – et, enfin, la valeur qui préfigure les futures charges de la CADES, soit le plafond de découvert de l’ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale). Ce plafond est fixé pour 2016 à 40 milliards d’euros en début d’année et 30 milliards en fin d’année. Cela signifie que la CADES aura une reprise de dette à venir de l’ordre d’une trentaine de milliards d’euros.
Le schéma ci-dessous montre la part de la dette sociale dans la totalité de la dette publique française, dont elle constitue un des éléments au même titre que la dette des collectivités locales.
Total de la dette publique (au sens de Maastricht) : 2 103,2 milliards d’euros (104)
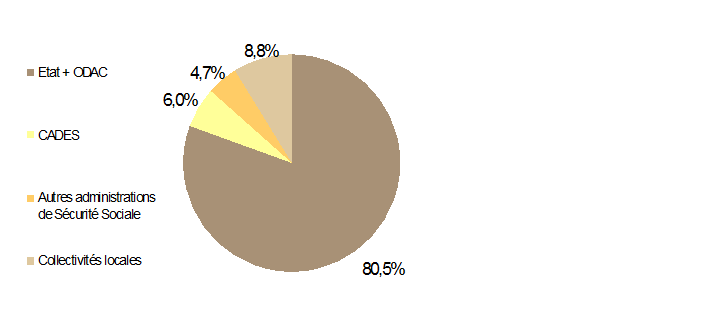
Dans un sens restreint, la dette sociale additionne la dette déjà reprise par la CADES et la dette à court terme que l’ACOSS continue de gérer. Il faudrait y ajouter quelques autres dettes sociales, mais que la CADES n’a pas pour mission d’amortir. Ce dispositif d’amortissement est très important car il permet de minimiser le poids de la dette publique nationale. Rapportés à un produit intérieur brut (PIB) de plus de 2 100 milliards d’euros, les 110,3 milliards d’euros de dette sociale amortis par la CADES représentent donc environ 5 points de PIB, et les 20 milliards d’euros d’intérêts économisés grâce à l’amortissement opéré par la CADES depuis sa mise en place équivalent à près de 1 point de PIB. Grâce au mécanisme d’amortissement, la dette publique française a ainsi été allégée de l’équivalent de 6 points de PIB, pour s’établir à 96 % de notre produit intérieur brut.
Le schéma suivant répond à votre question sur le processus de reprise de dette.
Processus de reprise de dette par la CADES
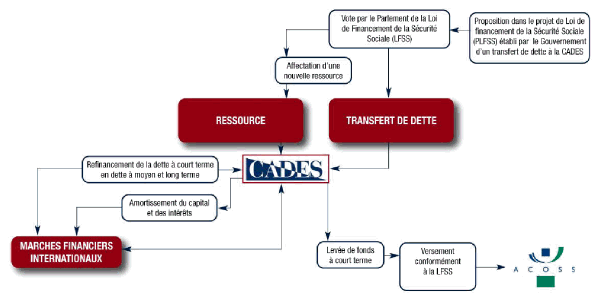
Il montre que la CADES travaille à partir des décisions votées par le Parlement s’agissant des montants des éventuels transferts de dette et de l’objectif d’amortissement de l’année. Depuis la loi organique de 2005, le Parlement vote aussi l’ajustement des ressources de la Caisse d’amortissement aux dettes qu’elle doit reprendre, afin de ne plus allonger sa durée de vie. La caisse emprunte ensuite sur les marchés à court terme les montants nécessaires à l’ACOSS. Sur les 23,6 milliards d’euros de reprise de dette attendus cette année, nous avons déjà versé 10 milliards ; nous aurons couvert ces besoins au milieu de l’année. Ne pouvant conserver une dette à court terme, nous devons ensuite la refinancer en émettant des emprunts qui en rallongent les délais jusqu’à la perception de nos ressources.
Le schéma suivant retrace la dette votée, reprise et amortie depuis la création de la CADES.
La dette votée, reprise et amortie après la reprise de dette à la fin de 2015
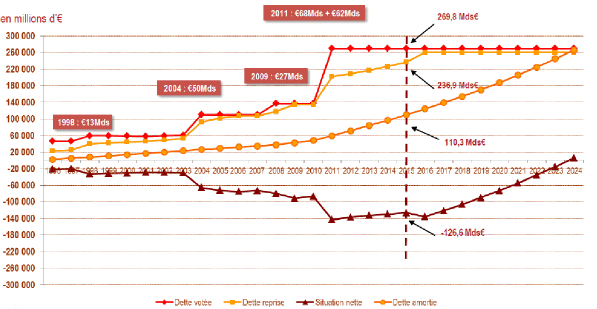
La ligne supérieure traduit le total de la dette que le Parlement a confiée à la Caisse. Depuis 2011, son montant plafonne à environ 270 milliards d’euros. Il a crû à chaque reprise votée, en 1998, 2004, 2009 et 2011. Les deux premières reprises se sont traduites par un simple rallongement de la durée de vie de la CADES, initialement fixée à 2009 et prolongée à 2014, puis à 2021. Une année, un Gouvernement avait même fait voter le principe que la CADES serait maintenue jusqu’à ce qu’elle achève sa mission… Mais dès 2005, le Parlement a voté une loi organique imposant au gouvernement d’apporter les ressources supplémentaires nécessaires à toute nouvelle reprise de dette afin de bloquer la durée de vie du dispositif. Le terme en est normalement fixé à 2025. Le schéma présenté s’arrête à 2024, anticipant une accélération de l’amortissement grâce à la baisse des taux et à la diminution des intérêts qui en découlent. Dans les conditions actuelles, la CADES a, en effet, une chance sur deux de terminer sa mission en 2024.
La ligne juste en dessous correspond aux reprises effectives de dettes. En 2011, le Parlement avait voté une reprise d’un montant de 68 milliards d’euros pour la dette de l’assurance maladie, auxquels s’ajoutaient 62 milliards d’euros pour contribuer à l’équilibre de la réforme des retraites – en principe attendu en 2018 – à raison d’un versement de 10 milliards d’euros chaque année. La CADES a assuré ces versements chaque année jusqu’en 2015 ; les 23,6 milliards votés par le Parlement pour 2016 doivent solder cette enveloppe.
Les autres lignes du schéma retracent l’évolution de la dette amortie (qui a dépassé les 110,3 milliards d’euros en 2015) et le solde à la charge de la CADES. De 126,6 milliards d’euros fin 2015, il montera à 136 milliards fin 2017. Mais il devrait, normalement, s’annuler en 2024. Ces chiffres sont résumés dans le tableau suivant.
Situations nettes comparées
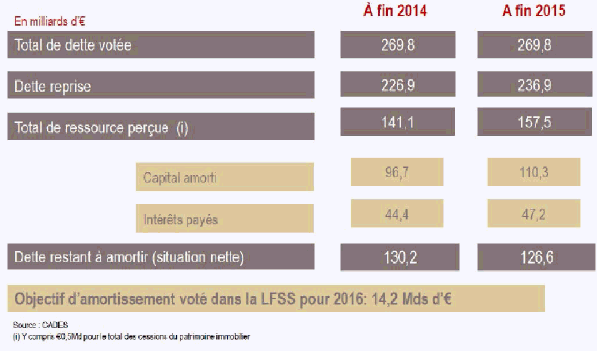
La CADES est en train d’arrêter les comptes pour 2015 : le total de la dette reprise s’établira en fin d’année à 260 milliards d’euros ; le total de la ressource perçue atteindra 174 milliards ; 124,5 milliards auront été amortis ; 49,7 milliards d’euros d’intérêts auront été payés ; il restera donc 136 milliards d’euros à amortir.
S’agissant des ressources de la CADES, la plus grande partie de ses ressources lui parvient par l’intermédiaire de l’ACOSS. Quelques ressources passent par le Trésor public. Et depuis 2005, la CADES reçoit également 2,1 milliards d’euros par an du Fonds de réserve pour les retraites (FRR). Comme on peut le voir sur le schéma suivant, la plupart de ces ressources sont très solides et elles ont crû à chaque reprise de dette.
Évolution des ressources entre 1996 et 2016
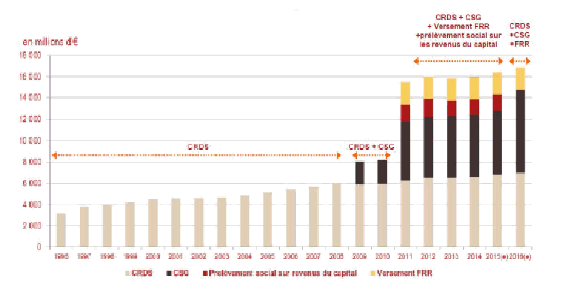
Sa ressource dédiée est la CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale). Elle est très stable et augmente avec la masse salariale. J’ai toujours raisonné en hausse de la CRDS quand il s’agissait de projeter les ressources nécessaires aux transferts de dettes, mais les gouvernements ont fait d’autres choix. La difficulté est que ces autres ressources – telles la CSG (contribution sociale généralisée) – n’ont pas été créées spécifiquement pour couvrir la dette sociale, mais ont été prises sur les ressources d’autres établissements de la Sécurité sociale, comme la CNAV (Caisse nationale d’assurance vieillesse), le FSV (Fonds de solidarité vieillesse) puis la CNAF (Caisse nationale des allocations familiales). Enfin, en 2011, pour stopper la prolongation de la durée de vie de la CADES, le Gouvernement a fait modifier l’échéancier des versements du FRR en le ramenant de 2020 et 2040, à 2011 et 2024, ce qui permet le versement de 2,1 milliards d’euros par an. Entre 2011 et 2015, la CADES a également perçu une partie du prélèvement instauré sur les revenus du capital mais en 2016, celui-ci a été attribué à un autre organisme en contrepartie de quoi la Caisse reçoit une fraction plus importante de CSG. Le « panier des ressources » en a ainsi été simplifié : CRDS et CSG ont des assiettes sensiblement similaires, revenus d’activité et de remplacement constituant l’essentiel de leurs bases. Cette situation montre aussi que les ressources de la Caisse d’amortissement sont largement indexées sur l’inflation – ce qui explique pourquoi la CADES, comme le Trésor, a pu émettre un certain nombre d’emprunts indexés sur l’inflation.
S’agissant des emprunts, les émissions de la CADES en euros sont très similaires à celles du Trésor. Toutefois, à la création de la CADES en 1996, il lui avait été demandé de ne pas gêner les émissions du Trésor en empruntant dans d’autres monnaies que le franc. La Caisse d’amortissement a donc emprunté dans d’autres devises. Lors de la mise en place de l’euro, les emprunts antérieurs ont été convertis en euros mais, avec l’accord de son conseil d’administration, elle a continué à émettre dans d’autres devises pour dégager ce marché. Pour annuler le risque de change, ces devises sont immédiatement converties en euros et un contrat d’échange est conclu en même temps que l’émission de l’emprunt afin de retrouver ultérieurement les devises nécessaires pour le remboursement des investisseurs.
Nous émettons aussi dans d’autres devises que l’euro pour répondre à la demande de nos investisseurs, notamment des banques centrales asiatiques dont le portefeuille est en bonne partie constitué d’emprunts en dollars, en euros et en livres avec des règles de répartition des risques. Elles considèrent que la France est un emprunteur très sûr mais leurs achats sont limités par les émissions publiques françaises exclusivement libellées en euros par le Trésor. Elles souhaitent donc acheter des titres français, en dollars, ce que nous proposons. Ces emprunts émis en dollars peuvent parfois représenter une part substantielle de notre portefeuille (69 % des montants levés en 2015, soit 10,3 milliards d’euros) mais nous émettons aussi dans d’autres devises.
Programme de financement 2015

En période de reprise de dette, nous émettons fortement à court terme pour alimenter l’ACOSS. Pour ce faire, nous mettons en œuvre un programme de 60 milliards d’euros
Programmes à court terme
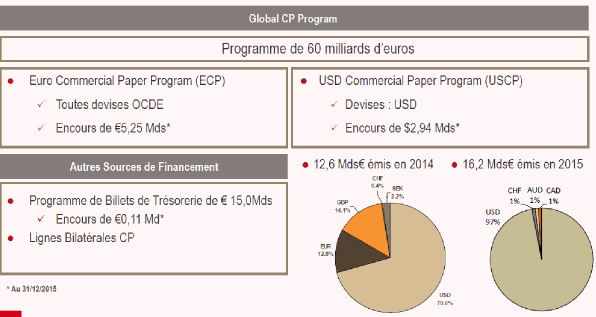
Lors des étapes les plus lourdes, entre 2000 et 2011, près de 50 milliards d’euros du portefeuille de la CADES étaient à court terme. Actuellement, seuls 6 milliards d’euros sont à court terme, répartis en trois programmes d’émission. Nos emprunts sont souvent substantiels et donc notre programme se réalise assez rapidement, comme le montre l’exécution de 2015 par ailleurs marquée par la prépondérance des émissions en dollars pour répondre à la demande.
Montant levé en 2015 (incluant les placements privés) : 14,9 milliards d’euros
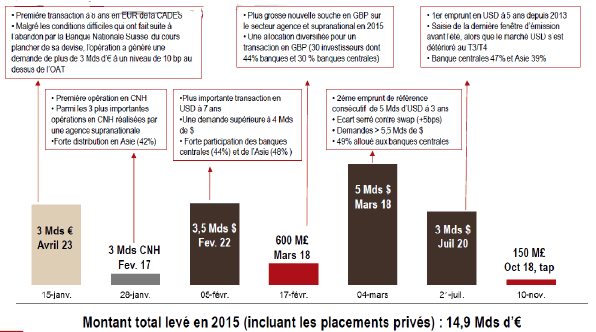
Nos principaux investisseurs sont les banques centrales du monde entier, à hauteur de 41 % de notre portefeuille en 2015. Elles sont contraintes par le FMI (Fonds monétaire international) d’acheter les emprunts des grands États pour constituer leurs réserves. Cette obligation posée en 1945, assoit la force financière des pays comme les États-Unis, l’Allemagne ou la France et facilite le placement de leurs émissions. Pour le reste, on trouve tous types d’investisseurs. Quant à leur répartition géographique, l’Asie, et plus particulièrement quatre ou cinq de ces pays, représentent aujourd’hui les plus importants de nos acheteurs (48 % en 2014, 36 % en 2015). Je précise enfin que les deux-tiers de nos emprunts sont émis en euros. En tout état de cause, les autres devises étant immédiatement changées, tous nos engagements sont libellés en euros.
Répartition de l’encours de la dette au 31.12.2015 (126,6 milliards d’euros)
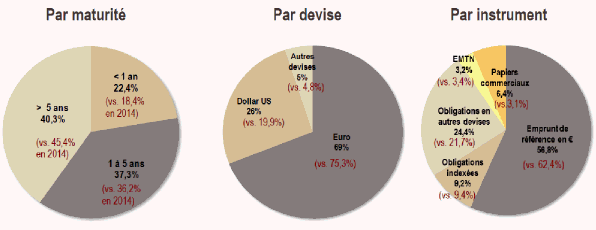
Quel est le coût comparé, pour l’État français, de la CADES face à l’Agence France Trésor. Le premier avantage de la CADES est d’émettre dans d’autres devises que l’euro et d’ouvrir ainsi d’autres marchés à la France. Certes, en étant moins importants, ses emprunts sont moins liquides que ceux de l’État, obligeant la CADES à verser quelques centimes de plus aux investisseurs. L’écart sur les emprunts en euros est de l’ordre de 0,4 à 0,6 point de base. Cela signifie que lorsque l’État émet un emprunt à 10 ans à un taux de 1 %, la CADES doit émettre à 1,07 ou 1,08 %. Il s’agit d’un coût supplémentaire supportable pour l’État et la CADES. Pour les emprunts en devises, une fois qu’ils sont transformés en euros, les cours sont généralement équivalents à ceux des emprunts de l’État.
Le schéma suivant retrace l’échéancier des emprunts à moyen et long terme.
Échéancier des emprunts à moyen et long terme 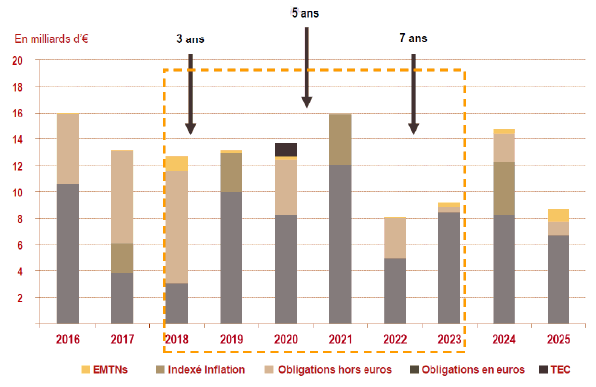
La CADES n’émet pas d’emprunts au-delà de 2025, puisqu’elle doit mourir à cette date. Les emprunts les plus longs sont émis pour 2025, car nous ne chargeons plus cette année-là et, pas trop, l’échéance 2024. Les emprunts sont émis principalement à échéance de 3 et 7 ans, qui correspondent à des maturités classiques.
Le taux moyen de refinancement de la CADES qui était de 5 % dans les années 2000 est descendu à 2,08 % à la fin de l’année 2015 et à 1,94 % à la fin février 2016. C’est pourquoi en 2016, la CADES ne devra verser que 2,6 milliards d’euros de taux d’intérêt. Ceux-ci auraient été de 5 ou 6 milliards d’euros, si les taux étaient restés les mêmes. L’économie réalisée sur les intérêts permet d’amortir la dette plus rapidement, à l’horizon de 2024.
Les horizons d’extinction de la dette sont, en effet, les suivants : nous avons une chance sur deux de finir notre activité en 2024, cinq chances sur cent d’y parvenir dès 2023, et au contraire, cinq chances sur cent de n’avoir pas encore terminé fin 2025. Nous nous livrons actuellement à des calculs et à des simulations de hausses et de baisses des taux d’intérêt et de l’inflation : l’hypothèse la plus probable est que nous aurons terminé en 2024 ; si la situation se dégrade fortement, ce sera en 2025 ; si elle s’améliore, en 2023.
En 2016, la CADES va reprendre 23,6 milliards d’euros de dette et nous avons l’intention d’émettre de 15 à 20 milliards d’euros d’emprunts à moyen et long terme.
Estimation des besoins de financement pour 2016
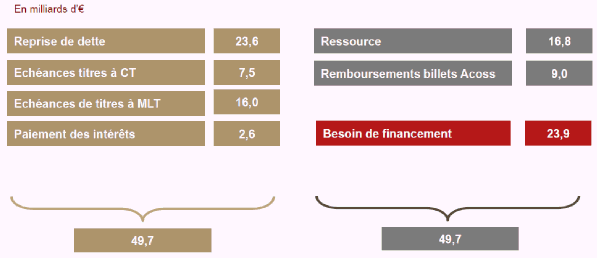
Nous avons émis pour la première fois en 2015, un emprunt en devise chinoise de 3 milliards de renmimbi sur trois ans – ce qui correspond à environ 400 millions d’euros –, le marché de cette devise apparaissant désormais suffisamment développé.
Le programme de financement pour 2016 est le suivant :
Programme de financement 2016

Le programme est réalisé actuellement à hauteur de 8,9 milliards d’euros sur les emprunts à moyen et long terme et de 6 milliards d’euros pour les emprunts à court terme.
Le texte le plus important qui régit la CADES est la loi organique de 2005, qui a solidifié son mécanisme de financement. Le graphique suivant qui retrace l’évolution des ressources de la Caisse depuis l’origine, en montre les effets.
Répartition entre amortissement et intérêts
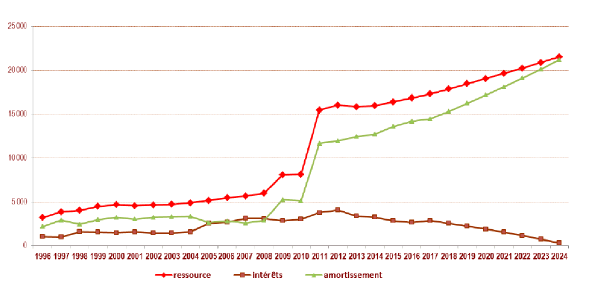
Jusqu’en 2008, la seule ressource était la CRDS. Puis, en raison des règles posées par la loi organique, nous avons bénéficié de deux ressources supplémentaires, en 2009 (une fraction de la CSG), en 2011 (une partie du prélèvement social sur les revenus du capital et les versements annuels du FRR). Étant donné que, dans le même temps, les taux d’intérêt dans le monde étaient en baisse, il est possible désormais d’envisager un amortissement de la dette en 2024.
En ce qui concerne la question des relations de la CADES avec l’Agence française du Trésor (AFT), il faut remarquer que les activités de la Caisse sont très contrôlées par un Conseil d’administration comprenant des représentants des six ministres de tutelle et par un Comité de surveillance comportant également des représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le directeur général et le directeur général adjoint de l’AFT qui sont les principaux émetteurs de dettes de l’État siègent également au Conseil d’administration. Nous arrêtons avec eux notre programme de financement annuel ; leur calendrier d’émission est public et ils sont prévenus, lorsque nous faisons nous-mêmes une émission.
Au cours des dernières années, le comité de surveillance de la CADES a été d’une grande aide, en particulier, en raison de l’action des parlementaires qui y siègent.
En 2024, l’ensemble de la dette dont le transfert a été voté par le Parlement devrait donc être amorti. Dans l’hypothèse où la CADES devrait supporter la charge de nouvelles dettes, la loi organique dispose que des ressources supplémentaires devront lui être attribuées, afin de ne pas prolonger la durée vie de la Caisse. Dans les années qui viennent, il faut donc éviter la création de nouvelles dettes, éponger la dette actuelle de 30 milliards d’euros à l’Acoss et comprendre qu’un déficit persistant de la Sécurité Sociale engendrera une nouvelle dette sociale dont le traitement sera de plus en plus compliqué.
M. Jean-Claude Buisine, rapporteur. Je tiens à vous féliciter pour votre exposé et pour les documents que vous nous avez transmis. Avez-vous réfléchi à l’hypothèse d’une situation inversée par rapport au contexte actuel, celle d’une remontée des taux d’intérêt dans les mois ou les années qui viennent ?
M. Patrice Ract-Madoux. La CADES a la chance d’être presque morte. Le risque que vous évoquez n’existe donc en fait que pour les neuf années qui viennent, d’ici 2024. À court terme, nous « pouvons tenir » encore une année. Il ne restera que 8 ans et la CADES qui sera en période d’amortissement accéléré émettra alors des emprunts de plus en plus courts. Si la courbe des taux courts reste plus basse que celle des taux longs, la situation ne devrait pas être problématique, à la différence de celle de l’État qui est endetté à 50 ans et doit assurer des financements sur des montants beaucoup plus considérables.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. La CADES est une structure de cantonnement ayant pour objet d’amortir la dette sociale et qui est rattachée à plusieurs ministères. Elle ne fonctionne pas, pour l’émission de titres comme l’Agence France Trésor : pour quelles raisons ? Par ailleurs, 40 % des titres émis sont détenus par les banques centrales des différents États. Mais qui détient vraiment la dette ? Analyser ce point est une des missions du Parlement.
Enfin, faudrait-il, selon vous, renationaliser la dette sociale, pour la rendre plus sûre ?
M. Patrice Ract-Madoux. Seuls 6 % de la dette que nous émettons sont vendus à des investisseurs français. La raison en est que la durée de maturité de cette dette, de 8 ans au plus, est incompatible avec la politique des compagnies d’assurances qui sont nos principaux acheteurs nationaux. Celles-ci ont en effet développé des politiques de garantie de taux à long terme envers leurs assurés. Pour respecter ces taux, dans la situation actuelle du marché, elles sont contraintes d’acheter des produits à très long terme, qui sont seuls à offrir des taux d’intérêt positifs.
Dans ces conditions, la CADES place sa dette soit auprès des banques centrales, soit auprès d’investisseurs de pays où les taux d’intérêt sont encore plus bas qu’en France, comme l’Allemagne. Depuis 4 à 5 ans, nous plaçons entre 15 et 20 % de notre dette auprès d’investisseurs allemands.
Techniquement, la CADES vend sa dette par syndication. Ce sont les syndicats de banques choisis par la CADES qui placent sa dette auprès des investisseurs finaux, moyennant une commission. Celle-ci varie selon le type de devise, la durée de l’emprunt et son montant. En 2015, la CADES a versé 26 millions d'euros de commissions pour 14,9 milliards d'euros d’émissions, soit un taux de commission de 0,18 %. En 2014, la CADES a versé 27 millions d'euros de commissions pour 18 milliards d'euros émis. En 2011, avec 60 millions d'euros de commission pour 31 milliards d'euros émis, le taux de commissionnement a été de 0,19 %. Depuis sa création, la CADES a versé 570 millions d'euros de commissions.
L’AFT, au contraire, travaille pour l’essentiel par adjudication. Le taux réel de l’emprunt est alors très proche de celui affiché sur le marché.
Le taux de commission versé par la CADES est équivalent à celui que versent les plus importants emprunteurs européens travaillant par syndication.
M. Jean-Claude Buisine, rapporteur. La dette de la CADES, nous avez-vous dit, est détenue pour plus de la moitié par des résidents non européens. Pouvez-vous être plus précis ?
M. Patrice Ract-Madoux. La dette de la CADES se compose d’emprunts de très fort volume proposés à des taux relativement bas. Les investisseurs qui s’y intéressent sont donc des banques centrales, des compagnies d’assurances et des fonds de pension étrangers, britanniques ou néerlandais, par exemple. Nous n’avons pas affaire à des investisseurs individuels.
Les chiffres de la répartition entre les investisseurs sont calculés au moment des émissions. En général, ceux-ci les gardent jusqu’à maturité. Nous connaissons précisément la répartition entre les investisseurs au moment où la CADES rembourse l’emprunt. Entre-temps, si les titres sont revendus, nous n’avons pas les moyens de connaître les acheteurs. Il reste que le marché secondaire se tenant essentiellement entre banques centrales, que nous ne connaissions pas les acheteurs sur le marché secondaire n’est pas inquiétant.
M. Nicolas Sansu, rapporteur, président. Comment appréciez-vous la politique de rachat de titres publics par la Banque centrale européenne ?
Par ailleurs, lorsque la CADES emprunte en devises autres que l’euro, qui paye le swap ?
M. Patrice Ract-Madoux. Lorsque nous émettons en devises, nous transformons immédiatement l’émission en euros, et nous construisons le swap inverse. Le coût du swap est intégré dans l’émission. Aujourd’hui, nous arrivons à emprunter au taux de l’eonia (Euro OverNight Index Average – taux d'intérêt interbancaire pour la zone euro à échéance de 1 jour) moins 10. Le taux de l’eonia étant à moins 30 centimes, nous empruntons ainsi à moins 40. Il faut bien admettre que la situation aujourd’hui est un peu particulière…
La politique de liquidité telle que l’ont conduite les banques centrales des États-Unis et de Grande-Bretagne avait un sens pendant la crise. Une telle politique n’est désormais plus efficiente car l’argent reste dans le système bancaire.
Par ailleurs, le fait que la dette de la CADES soit éligible au programme de rachat de la BCE fait encore baisser les taux auxquels elle émet, et rend sa dette encore moins intéressante pour les investisseurs français.
M. Jean-Claude Buisine, rapporteur. Pourrions-nous conclure de cette audition que la situation est favorable et que l’apurement de la dette sociale est en bonne voie ?
M. Patrice Ract-Madoux. Pour moi, la CADES a rempli ses objectifs. Cependant, si l’on veut mettre fin à son action, il faut cesser de créer de la dette sociale nouvelle et donc restaurer rapidement l’équilibre de la sécurité sociale.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. La tendance politique ne va-t-elle pas dans l’autre sens ?
M. Patrice Ract-Madoux. Certes. Mais c’est bien ainsi qu’il faudrait agir, avant de rééquilibrer, ensuite, le budget de la Nation.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Une amélioration des contrôles ne permettrait-elle pas, en réduisant les fraudes, le rééquilibrage des comptes sociaux ?
M. Patrice Ract-Madoux. En 2001 et 2002, du fait de la forte croissance de l’économie, les comptes de la sécurité sociale étaient revenus à l’équilibre. Il se trouve qu’on a alors laissé les dépenses sociales croître de 6 % par an. Avec l’arrêt de la croissance, les déséquilibres sont revenus. Au regard de cette évolution, les fraudes, même si elles doivent être combattues, ne sont pas l’élément essentiel du déséquilibre.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Validez-vous les estimations du montant des fraudes ?
M. Patrice Ract-Madoux. Ce point n’entre pas dans mes compétences. La CADES n’a pas le pouvoir de conduire des contrôles sur pièces et sur place. Je considère donc comme valables les chiffres publiés par l’ACOSS.
M. Charles de Courson. La dette de l’ACOSS est comprise entre 30 et 40 milliards d'euros. Aujourd’hui, la gestion de la trésorerie de l’ACOSS ne coûte-t-elle pas plus cher que si elle était transférée à la CADES ?
M. Patrice Ract-Madoux. Il faut qu’une part la plus importante possible de la dette de l’ACOSS soit transférée à la CADES. Aujourd’hui, la dette, qu’elle soit émise par la CADES ou l’ACOSS, est financée à taux négatif mais si les taux devaient remonter, nous devrions rapidement nous organiser pour emprunter à des échéances beaucoup plus longues avant la remontée des taux. La CADES est mieux à même de réagir à une telle évolution que l’ACOSS.
Par ailleurs, je souhaiterais purger l’enveloppe de 62 milliards d'euros accordés par le Parlement à la demande de l’un des gouvernements précédents dans le cadre de l’équilibre du financement du régime des retraites, de façon à ce qu’ensuite, la loi organique puisse être respectée, et que, à cette fin, le Gouvernement donne à la CADES les ressources suffisantes pour financer les éventuelles dettes nouvelles.
Enfin, nous préfinançons les reprises de dette de l’ACOSS en achetant ses billets de trésorerie.
M. Charles de Courson. Quelle partie du déficit courant de l’ACOSS financez-vous ?
M. Patrice Ract-Madoux. Nous ne finançons pas le déficit courant de l’ACOSS. Aujourd’hui, la CADES est dans un processus de refinancement d’une dette de l’ACOSS de 23,6 milliards d'euros. Cela signifie qu’au cours de l’année, elle va verser 23,6 milliards d'euros à l’ACOSS ; mais elle a déjà préfinancé ces versements par l’achat de billets de l’ACOSS, cela permettant à l’ACOSS de financer ses déficits ponctuels de trésorerie à des taux très inférieurs à ceux qu’elle obtiendrait d’autres soumissionnaires, tels que la Caisse des dépôts et consignations.
M. Charles de Courson. Selon vous, quelles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement se refuse à transférer à la CADES le solde de la dette de l’ACOSS, alors que ce transfert amènerait à augmenter les ressources de la CADES ?
M. Patrice Ract-Madoux. À mon avis la raison est unique : ne pas avoir à demander au Parlement d’appliquer la loi organique ; votée en 2005, celle-ci n’a connu sa première application qu’en 2008. Les gouvernements ont laissé s’accroître pendant trois ans le découvert de l’ACOSS avant de transférer la dette.
M. Charles de Courson. Les recettes qui vous sont affectées permettent aujourd’hui de couvrir le remboursement de la totalité des intérêts de la dette, mais pas celle de la totalité du capital ?
M. Patrice Ract-Madoux. À condition qu’il ne soit pas créé de nouvelle dette, nos ressources nous permettent d’amortir la totalité de la dette sociale, intérêts et capital, d’ici 2024.
M. Charles de Courson. Selon vous, la création de la CADES a-t-elle été une bonne initiative ?
M. Patrice Ract-Madoux. Lorsque la CADES a été créée, j’exerçais le métier d’assureur. J’avais alors interdit l’achat de titres de la CADES, considérant que la sécurité sociale ne devait pas être financée ainsi. Maintenant que la CADES existe, je trouve sensé de la gérer au mieux, en la traitant comme une caisse d’amortissement, et non pas comme une caisse de refinancement perpétuel. Cette démarche est encore fonctionnelle aujourd’hui.
M. Charles de Courson. Mais la CADES est devenue un outil de gestion perpétuelle ! On lui a transféré plusieurs fois de la dette à gérer. Il faut donc dissoudre la CADES. Sans la CADES, la dette sociale, sauf accord du Parlement, serait limitée au plafond admis pour l’ACOSS, soit 40 milliards d'euros. La CADES est devenue un mécanisme qui permet de différer les échéances inéluctables. Une obligation d’équilibre des finances de la sécurité sociale, au besoin grâce à des subventions de l’État, serait plus responsabilisant.
M. Patrice Ract-Madoux. Je crois qu’il serait plus responsabilisant d’amortir la dette existante, d’équilibrer les comptes de la Sécurité sociale et ainsi de ne plus créer de nouvelles dettes
M. Nicolas Sansu, rapporteur, président. Monsieur le président, nous vous remercions.
Audition du 9 mars 2016
M. Jacques de LAROSIERE, président du comité stratégique de l’Agence France Trésor, président de EUROFI.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Cette mission d’évaluation et de contrôle se penche sur la question de la transparence et de la gestion de notre dette publique. Nous avons souhaité vous entendre en raison de vos responsabilités en tant que président du comité stratégique de l’Agence France Trésor (AFT).
M. Jacques de Larosière, président du comité stratégique de l’Agence France Trésor, président d’EUROFI. Le comité stratégique est une instance qui siège auprès de l’Agence France Trésor, sans en faire partie. Il comprend dix personnalités très diverses, mais qui exercent toutes des fonctions financières internationales. Il se réunit deux fois par an.
Parmi ces dix personnes, il y a, outre votre serviteur, des émetteurs de dette : M. Günther Braünig, membre du conseil d’administration de KfW, et M. Bertrand de Mazières, directeur général des finances à la Banque européenne d’investissement (BEI). Il y a aussi des gens de marché : M. Marc-Antoine Autheman, président du conseil d’administration d’Euroclear, et M. René Karsenti, président de l’International Capital Market Association (ICMA). Il y a enfin une majorité d’acheteurs de dette : M. Lim Chow Kiat, directeur des investissements du Government of Singapore Investment Corporation (GIC), le fonds souverain de Singapour, Mme Satu Huber, directrice générale de Elo Mutual Pension Insurance Company, fonds de pension finlandais, M. Assaad J. Jabre, membre du conseil d’administration d’Ecobank Transnational Incorporated, banque africaine, M. Dino Kos, directeur des Global Regulatory Affairs de la société financière américaine CLS, et M. Yong Yin, directeur général du centre de gestion des réserves de la State Administration of Foreign Exchange (SAFE), c’est-à-dire la banque centrale chinoise.
Nous comptions parmi nous un économiste de grande valeur et de grand avenir, Thomas Philippon, mais il a dû renoncer et nous cherchons à le remplacer.
Le comité compte donc six Européens – quatre Français, un Allemand, une Finlandaise –, un Américain, deux Asiatiques et un Africain. Ce caractère international est pertinent : la dette publique française est en effet détenue aujourd’hui par des non-résidents à plus de 60 %.
Ce comité n’exerce pas de micro-management de l’Agence au quotidien. Son rôle est de tester les initiatives et plus généralement l’activité de l’AFT, en soulevant des questions : venant de personnes très informées et très compétentes, elles amènent l’AFT à réagir. Le comité stratégique est en quelque sorte comparable à un conseil de surveillance.
J’ai repris les procès-verbaux de nos dernières séances pour récapituler les questions posées.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. J’aurais quelques questions préalables sur les orientations préconisées par le comité stratégique. Je souhaiterais également savoir si ses membres sont-ils rémunérés. Y a-t-il des jetons de présence ? Et quels sont concrètement vos liens avec l’AFT ?
M. Jacques de Larosière. Il n’y a ni rémunération, ni jetons de présence. Il est possible de demander un défraiement pour les frais de transport, mais – renseignement pris –nous n’avons depuis cinq années remboursé que 10 000 euros : cette somme très faible montre que les membres du comité stratégique profitent de nos réunions pour mener d’autres activités … et font prendre en charge leur déplacement par d’autres organisations.
Quant aux orientations préconisées, il est très difficile de les décrire. Nous nous coulons dans le moule de l’AFT : nous ne réinventons pas une stratégie d’émission de la dette publique française. Concrètement, nous posons des questions, nous soulevons des problèmes : dans un monde où les conditions du marché changent de jour en jour, la stratégie suivie est-elle la bonne ou doit-elle être modifiée ?
C’est ainsi que nous avons interrogé l’AFT sur la possibilité d’émettre dans des devises autres que l’euro – en renmibi, par exemple. Le risque de change avec l’euro pourrait être facilement couvert, et il n’y a aucun obstacle juridique – les Italiens, par exemple, le font – mais l’AFT n’y est pas favorable.
M. Charles de Courson. Pourquoi ?
M. Jacques de Larosière. Des émissions en devise pourraient être perçues par les marchés comme la marque d’une difficulté de l’AFT à se financer uniquement par des émissions en euros. Or ce n’est pas du tout le cas ; le marché de l’euro est tout à fait suffisant. Ces émissions répondraient plutôt à une volonté stratégique de s’implanter sur des marchés financiers nouveaux, actifs. L’AFT estime aujourd’hui que ce n’est pas une raison suffisante pour se lancer dans cette entreprise.
Le comité a posé d’autres questions. Ainsi, vous savez que le compte du Trésor auprès de la Banque de France n’est pas rémunéré, ce qui est naturel et conforme aux règles de Maastricht ; mais, actuellement, il est même « dérémunéré » puisque taxé par un taux d’intérêt négatif. Est-il normal, avons-nous demandé, de payer pour un surcroît de trésorerie ? Mais, pour corriger ce que nos amis du Trésor perçoivent également comme une anomalie, il faudrait lancer une procédure contre la Banque centrale européenne (BCE) afin d’obtenir une exception pour les trésors nationaux par rapport aux banques ; cela donnerait sans nul doute l’impression que le Trésor demande un privilège. Dans la situation actuelle des marchés, il semble qu’il vaille mieux se soumettre à la loi commune. Cela oblige l’AFT à être extrêmement méticuleuse et active pour n’être ni débiteur, ni créditeur !
Nous nous interrogeons également très régulièrement sur la durée moyenne de la dette de l’État. Avec des taux très faibles, il paraît naturel de vouloir allonger cette durée moyenne, afin de profiter des taux d’intérêt bas et de se prémunir contre une éventuelle hausse des taux. Certains, dont je fais partie, ont développé ce raisonnement – qui n’est pas loin d’être partagé par nos amis du Trésor. La durée de la dette a d’ailleurs augmenté en 2015.
Mais il apparaît qu’on ne peut aller beaucoup plus loin ; personne ne suggère de racheter toute la dette. La France est en effet un très gros emprunteur, ce qui lui impose de ne pas pénaliser les gens qui lui font confiance, ni même de donner cette impression. Nous sommes dans une situation où il ne faut pas être trop opportuniste – au sens de ce mot dans le jargon des banquiers – car cela serait mal vu par ceux qui détiennent de la dette française depuis longtemps, à des taux relativement élevés.
L’AFT estime donc, de façon raisonnable, qu’elle doit agir de façon flexible, mais pas radicale : elle doit être prévisible. C’est, au sein du comité stratégique, un débat récurrent, mais nous soutenons l’action de l’AFT, qui ne doit pas scier la branche sur laquelle elle est assise.
Nous nous interrogeons aussi sur la liquidité des marchés. C’est un point essentiel : la dette doit pouvoir être vendue par ses acheteurs. Il est donc très important que le marché secondaire soit actif. Or, depuis un ou deux ans, la liquidité du marché se restreint : les acteurs principaux sont beaucoup moins présents, car la régulation financière des marchés désincite les banques, les fonds de pensions et les compagnies d’assurances à intervenir sur ces marchés secondaires. Les spécialistes en valeurs du Trésor (SVT) sont des banques, et sont moins à l’aise pour intervenir. Ces marchés sont donc moins profonds, et de plus en plus volatiles en cas de forte demande ou d’offre de titres.
Nous posons aussi des questions sur la soutenabilité de la dette de certains pays européens – vous savez qu’elle dépasse parfois 100 % du PIB – ou sur les problèmes qui naissent de la concentration des actifs souverains dans les portefeuilles bancaires. Certaines banques de certains pays détiennent en particulier d’importantes quantités de dette de leurs propres pays. C’est une facilité pour les gouvernements, qui savent pouvoir compter sur leurs banques, mais c’est une vulnérabilité pour celles-ci : il y a un risque de cercle vicieux, dans lequel les marchés pourraient commencer à se méfier de ces banques trop engagées vis-à-vis de leur propre pays, les gouvernements étant à leur tour obligés de les refinancer. C’est un phénomène que l’on observe dans certains pays du sud de l’Europe, mais aussi en Allemagne – mais ce dernier pays pose peu de problèmes de stabilité financière.
Quant aux questions que vous m’avez posées par écrit, l’une d’elles portait sur les risques d’instabilité des marchés si les taux demeurent très bas. C’est une excellente question. Comme les langues d’Ésope, les taux bas sont à la fois la meilleure et la pire des choses. Bien sûr, c’est d’abord une bonne chose : c’est une lapalissade de dire qu’ils rendent beaucoup moins coûteux le financement de notre dette. Celle-ci dépasse maintenant les 2 000 milliards, et constituerait une charge considérable si nous ne la financions pas comme nous le faisons aujourd’hui à des taux de 0,5 % ou 0,6 % sur dix ans, ce qui est tout à fait inouï. Mais des taux trop bas, pendant trop longtemps, peuvent dissuader les investisseurs d’acheter la dette publique et les inciter à aller chercher ailleurs des rendements plus élevés. Les hommes sont des hommes, et recherchent de meilleures opportunités, qui rapportent davantage, quitte à être plus risquées. Plus les taux baissent, plus le risque de désaffection augmente. Nul ne sait si cette période sera longue.
Dans cette mer agitée, l’AFT tient la barre de façon très ferme. L’agence veut maintenir la liquidité de la dette publique française et préserver le contact avec les acheteurs : ils entretiennent donc des relations très proches avec les SVT et avec l’ensemble des investisseurs. S’ils réussissent à instiller l’idée qu’ils ont une stratégie stable alors les investisseurs continueront de leur faire confiance. Pour le moment, cela fonctionne bien. La stabilité de la stratégie d’émission de l’AFT contribue à la stabilité des marchés : les deux vont de pair.
Si les taux montent – c’est une autre lapalissade – la dette coûtera plus cher. La pression qui s’exercera pour que notre pays mène une réforme budgétaire et inverse la courbe de sa dette sera en conséquence plus forte. C’est un risque réel, mais qui ne touchera pas le stock de dette, puisque notre pays a la chance d’émettre à taux fixe.
M. Charles de Courson. … Ou du moins en grande partie à taux fixe.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Cette question des taux fixes est importante : on dit souvent qu’une hausse des taux de 1 point coûterait de l’ordre de 20 milliards d’euros.
M. Charles de Courson. Vous avez trop vécu, monsieur le président, pour ignorer combien tout cela est précaire. Combien de temps les taux peuvent-ils rester si faibles ?
M. Jacques de Larosière. Si vieux que je sois, je n’ai jamais vu une politique monétaire comme celle que mène aujourd’hui la BCE !
Il peut être difficile de sortir d’une politique de très bas taux et de création massive de liquidités. C’est un phénomène que l’on observe aujourd’hui aux États-Unis, où a été lancée il y a quelques années cette politique de création monétaire presque sans limite dans le but de financer l’économie : avant de faire remonter leurs taux, ils ont prévenu, averti, préparé les marchés … Vont-ils poursuivre la normalisation ? Cela reste à voir.
La plus grande prudence doit être de mise. En effet, si les taux remontent, les portefeuilles qui sont principalement en valeurs de marché – ce qui est souvent le cas – y perdent beaucoup, puisqu’il devient alors possible d’obtenir des taux trois ou quatre fois supérieurs avec d’autres instruments.
Je n’emploierai pas, pour décrire la période que nous vivons, les termes de « bulle obligataire ». Mais nous vivons une situation tout à fait exceptionnelle, dans laquelle il faut éviter les à-coups.
M. Jean-Claude Buisine, rapporteur. Pouvez-vous préciser comment fonctionnent les taux négatifs ?
M. Jacques de Larosière. Les taux négatifs, je le souligne à nouveau, constituent pour nous un phénomène entièrement nouveau – encore plus nouveau qu’une BCE qui achète pour 60 milliards de titres publics et privés chaque mois pour assurer la liquidité des marchés.
Offrir des taux négatifs, cela revient à réprimer l’épargne au point de la taxer ! Voilà encore quelque chose que je n’avais pas vécu jusqu’ici. À mon sens, les taux d’intérêt positifs constituent un repère fondamental pour nos sociétés, et conserver pendant longtemps des taux négatifs serait une erreur majeure. Dire aux gens qui font l’effort de mettre de l’argent de côté en prévision des aléas de la vie, pour leur vieillesse, pour leurs enfants… qu’ils vont y perdre, c’est renverser les lois sociales, un peu comme si nous vivions en apesanteur !
M. Jean-Pierre Gorges. Pour ceux qui courent un risque sur les devises, c’est aussi une façon de garantir un capital en euros – quasiment 100 % du capital déposé !
M. Jacques de Larosière. On peut dire les choses comme cela…
M. Charles de Courson. Vous avez pourtant connu une période pendant laquelle, en raison d’une inflation élevée, les taux d’intérêt – non pas nominaux, mais réels – étaient négatifs. C’était une grande période de spoliation de l’épargne populaire !
M. Jacques de Larosière. C’est exact, et je vous assure que je m’en suis rendu compte – et plus encore, nos parents et nos grands-parents. Mais les taux nominaux étaient positifs, même si les taux réels ne l’étaient pas. La vision monétaire de l’épargnant, c’est que s’il dépose 100 sur un compte, et qu’on lui rend 95 ou 96, il se sent spolié – quelque soit par ailleurs le niveau de l’inflation. C’est un repère important pour la société. A-t-on raison de mener cette politique ? Certains le pensent, en faisant le même raisonnement que vous : l’inflation étant très basse, les gens ne sont pas volés, le taux est juste proche de zéro. On peut le dire, c’est grammaticalement correct, mais est-ce correct en termes d’équilibre social ? Je n’en suis pas sûr.
M. Charles de Courson. Pourtant, lorsque les taux d’intérêt réels étaient négatifs, on payait de surcroît des impôts sur ces revenus négatifs : il y avait une double spoliation ! C’est heureusement un problème auquel nous avons remédié, même si il reste la question de la taxation des moins-values.
M. Jacques de Larosière. Il faut, je crois, raisonner de façon plus globale. Dans la période que vous citez, les salariés ont énormément bénéficié de l’inflation, parce que les salaires ont également augmenté. Or ils représentent une part importante de la population. L’inflation forte a certes pénalisé les revenus de l’épargne mais a favorisé les revenus du travail.
Aujourd’hui, à l’inverse, les salariés sont victimes de la déflation, ou de la très faible inflation. Voilà une vérité économique très problématique : les salaires n’augmentent plus, et ce depuis des années. C’est l’une des explications majeures de la morosité de la croissance des économies occidentales.
Certains s’accommoderaient très bien de taux négatifs sur une longue période. À mon sens, cela revient à briser un repère fondamental de la société, et à rompre l’équilibre entre l’épargne et l’investissement : n’oublions pas que l’épargne des ménages finance 80 % de notre économie.
Je me demande d’ailleurs quelle serait l’attitude des acheteurs des titres émis par l’AFT si les taux demeuraient négatifs.
M. Nicolas Sansu. Il y a quand même beaucoup de demandeurs, malgré les taux très bas. Comment l’expliquer ?
Une dernière question avant de clore notre entretien. Peut-on imaginer une renationalisation de la dette ? Aujourd’hui, la dette n’est quasiment plus détenue par les particuliers.
M. Jacques de Larosière. Ce sont d’excellentes questions, qu’il faut poser, mais sur lesquelles je préférerais ne pas m’exprimer publiquement.
Audition du 9 mars 2016
Table ronde, réunissant M. Franck Motte, responsable Eurorates HSBC ; M. Raoul Salomon, responsable des activités de marché pour Barclays en France ; M. Philippe Le Perchec, directeur d’exploitation Barclays CIB, M. Christophe Jobert, responsable des activités global market en France pour BNPP ; M. Amaury D’Orsay, responsable mondial du trading de taux au sein de la Société Générale ; M. Thomas Spitz, responsable du trading au Crédit Agricole.
M. Nicolas Sansu, président. Messieurs, merci d’avoir répondu à notre invitation. En tant que spécialistes en valeur du Trésor (SVT), vos établissements un rôle très important auprès de l’Agence France Trésor (AFT) en matière de conseil et d’assistance. Vous avez en particulier la responsabilité de participer aux adjudications, de placer les valeurs du trésor et d’assurer la liquidité du marché secondaire. Nous avons donc souhaité vous entendre pour aborder avec vous toutes ces questions.
M. Franck Motte, responsable Eurorates HSBC. Merci de votre invitation. Pour ma part, je travaille depuis trente ans dans les activités de taux, je suis presque né avec la dette et je connais bien les SVT.
Je représente aujourd’hui la banque HSBC France, issue du rachat par
HSBC du Crédit commercial de France (CCF). En 2000, il a été décidé de conserver les activités de taux en euro à Paris, et l’ensemble du dispositif de la plateforme euro rates pour HSBC, soit vingt-cinq traders, y est installé.
Nous sommes primary dealers – ou SVT – pour l’ensemble des marchés de dette de la zone euro. Nous faisons partie des rares établissements ayant ce rôle auprès de tous les pays de la zone euro, et notre force de distribution est constituée de commerciaux répartis partout dans le monde : en Asie – notre établissement principal est à Hong Kong – à Londres et en Europe.
C‘est pour nous une activité importante, tout comme l’est notre relation avec l’AFT. Nous avons toujours considéré le Trésor français comme un précurseur. C’est probablement l’une des équipes les mieux organisées de toutes celles qu’il nous est donné de côtoyer, toujours très innovante et proche des besoins des clients.
Il s’agit d’un marché de gros : l’essentiel de nos clients gère de l’argent pour le compte d’autrui, notamment des fonds de pension ou des caisses de retraite. Mon expérience au sein de différents établissements m’a enseigné qu’il est essentiel de placer cette dette auprès d’une clientèle qui, dans sa grande majorité, est non-résidente. Rappelons que 63 % de la dette est aujourd’hui détenue à l’étranger, même si les choses sont en train de changer. En 2015, la dette se place beaucoup en zone euro, notamment auprès de la Banque centrale européenne (BCE). Près de 70 % des achats nets de dette française ont été réalisés par des entités publiques : banques centrales ou entités gérant de l’argent pour le compte d’États.
M. Raoul Salomon, responsable des activités de marché pour Barclays en France. Je participe au club des SVT dans de grands établissements depuis vingt-cinq ans, tout d’abord au sein de la Caisse des dépôts, et aujourd’hui au sein de la Barclays, banque anglaise qui fait partie des SVT depuis 1998. L’essentiel de nos activités de trading se situe à Londres et à New York, et notre force de vente est répartie dans presque toutes les grandes places financières, dont Paris.
Il est absolument essentiel d’être SVT de l’État français car la France a une tradition de modernité. Elle a été la première à émettre une obligation d’État à trente ans dans ce qui allait devenir la zone euro ; la première à émettre une obligation démembrée, ou STRIPS (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities) ; la première à proposer des obligations indexées sur l’inflation. Chaque fois, la France a été moteur de l’innovation financière, c’est pourquoi le fait d’être SVT est un signal très fort : cela nous aide à investir d’autres marchés. Cela montre aussi à nos clients que nous sommes une maison très forte sur le fixed income, c’est-à-dire les investissements permettant d’obtenir des revenus fixes, comme les obligations. Il est donc pour nous extrêmement important d’avoir des relations très proches avec l’Agence France Trésor.
M. Motte notait que les deux tiers de la dette française sont détenus à l’étranger. Cela ne doit pas nous étonner : un pays qui connaît un déficit courant doit importer de l’épargne, il faut aller la chercher à l’étranger car si nous demandions à des investisseurs français d’acheter cette dette, cela produirait un effet d’éviction non négligeable sur d’autres placements.
Par conséquent, il est essentiel de couvrir tout type d’investisseur. M. Motte expliquait que nous étions des grossistes : il faut à tout moment pouvoir couvrir des banques japonaises, des assureurs japonais, des banques centrales, des hedge funds ou des gestionnaires d’actifs anglais, car ces investisseurs peuvent à tout moment avoir des intérêts divergents. C’est ainsi que nous pouvons placer la dette française de la meilleure façon.
L’État français a une dette importante, et le secteur public est également un important émetteur de dette. Le fait d’être proche du Trésor nous aide dans nos relations avec ces agences émettrices de dette.
M. Philippe Le Perchec, directeur d’exploitation Barclays CIB. Je suis directeur administratif et financier chez Barclays, je ne travaille donc pas directement sur les marchés, mais je suis responsable de l’établissement. À ce titre, j’ai la charge du back office et du contrôle de nos opérations. Si vous avez des questions sur ces sujets, je suis prêt à vous répondre.
M. Christophe Jobert, responsable des activités global market en France pour BNP Paribas. Je suis en charge des activités de marché à BNP Paribas pour trois pays : la France, l’Allemagne et l’Italie. Comme mes collègues, je travaille sur ces marchés depuis trente ans.
La banque BNP Paribas estime que sa responsabilité première est de financer l’économie. Elle a donc organisé ses activités de marché de façon à assurer le financement des grands acteurs économiques qui ont la capacité d’intervenir sur les marchés de capitaux. Autrement dit, BNP Paribas finance l’économie sous la forme intermédiée des prêts bancaires et sous la forme désintermédiée des émissions obligataires.
De ce point de vue, le statut de SVT, qui consiste principalement à organiser les émissions obligataires de l’État, correspond au rôle que BNP Paribas entend jouer dans les circuits de financement de l’économie, et en particulier sur les marchés de capitaux. Comme HSBC, BNP Paribas a le statut de SVT auprès de vingt-quatre trésors dans le monde : principalement ceux de la zone euro, mais également les États-Unis, le Japon, la Chine et l’Australie. En tant que première banque commerciale française, nous estimons avoir une responsabilité particulière à l’égard du Trésor français, et c’est la raison pour laquelle nous sommes le premier SVT depuis 2005.
BNP Paribas s’est hissé au rang de premier arrangeur d’émissions obligataires en euros au niveau mondial, en incluant les obligations émises par les entreprises. Nous jouons donc également auprès des entreprises le rôle de premier plan que nous avons auprès de l’État. C’est une chance que les grandes entreprises et le Trésor puissent s’appuyer sur une banque française pour les accompagner sur les marchés obligataires, en leur assurant les meilleures conditions d’accès.
Être premier SVT nous positionne comme le meilleur spécialiste en valeurs du trésor, et donc comme une contrepartie de premier choix auprès de tous les investisseurs internationaux.
M. Amaury D’Orsay, responsable mondial du trading de taux au sein de la Société Générale. Je travaille sur les activités de taux au sein de la Société Générale depuis vingt ans. Nos activités sont réparties dans le monde entier, notre présence est très forte sur la place parisienne, où deux cents personnes travaillent sur les activités de dette et de dérivés de taux.
Il est également très important pour nous d’être très bien classé parmi les SVT. Comme le disait M. Jobert, le marché de la dette et des taux en euros est essentiel, l’État français est un grand émetteur et nous avons une activité très importante de placement et de conseil sur les dettes des États européens, mais aussi des entreprises européennes et des institutions financières. Il est aussi crucial d’être SVT car le marché des dettes d’État est important pour nos investisseurs et représente une forte activité de conseil.
M. Thomas Spitz, responsable du trading au Crédit Agricole. Au sein de Crédit Agricole CIB, nous avons une forte activité de taux d’intérêt, notamment la négociation des dettes d’État. L’une des spécificités du Crédit Agricole étant de travailler principalement sur le fixed income, nous avons très peu d’activité sur les actions ou les dérivés d'action. Depuis cinq ou six ans, le groupe se concentre sur le financement de la dette par de la dette privée ou de la dette publique, de la dette intermédiée ou désintermédiée.
Notre organisation est assez similaire à celle de nos homologues : nos principales zones d’activité sont la France et l’Angleterre pour la zone européenne, et nous sommes également présents aux États-Unis et en Asie, par des établissements plus tournées vers la distribution. Nous sommes également SVT historiques de nombreux États, dont la France.
Les SVT jouent trois grands rôles vis-à-vis des dettes d’État.
Il s’agit tout d’abord de la souscription lors des adjudications, au cours desquelles les SVT ont la responsabilité d’acheter la dette pour la redistribuer ensuite.
Ensuite, nous devons être capables de garantir à tout moment la liquidité de cette dette. Nous nous engageons donc à acheter à tout moment de la dette aux investisseurs qui voudraient en vendre, et à en fournir à ceux qui voudraient en acheter. C’est un rôle très important, car la capacité du marché secondaire à fonctionner de manière liquide joue un grand rôle dans la confiance que les investisseurs vont avoir dans une dette. Cela permet de réduire la prime de liquidité liée à cette dette, puisqu’un investisseur sait qu’il pourra en sortir en cas de besoin. Dans ce contexte, la capacité à distribuer cette dette partout dans le monde permet de savoir quel type d’investisseur souhaite acheter ou vendre, et à quel moment.
Notre troisième rôle est de conseiller l’AFT sur le type d’émissions ou de produits qui, à un moment déterminé, seront plus intéressants pour les investisseurs et lui permettront donc d’émettre de façon moins onéreuse : obligations à trente ans, dette indexée sur l’inflation, etc. Nous permettons également à l’AFT de se faire connaître dans le monde, avec des présentations au cours desquelles nous allons expliquer à des investisseurs les stratégies du Gouvernement et de l’AFT sur la dette et les types d’émissions qui sont envisagées. Cela permet également de mesurer l’appétit des différents investisseurs à l’égard de la dette française.
M. Charles de Courson. D’après votre connaissance de ce marché, qui détient la dette de l’État, et quelle part en est détenue par la Banque centrale européenne ?
Par ailleurs, quelle appréciation portez-vous de la situation actuelle ? L’apparition de taux négatifs vous semble-t-elle normale, et quels sont vos pronostics sur l’évolution de ces taux ?
Enfin, quelle appréciation portez-vous sur la gestion par l’AFT de la dette publique française ?
M. Jean-Pierre Gorges. Vous êtes dans le monde de la banque, face à un pays qui accumule de la dette depuis quarante ans et qui se trouve en fait dans l’incapacité de la rembourser. Quelle est votre position à cet égard ? Considérez-vous cette situation comme une aubaine, puisque vous allez continuer à aider un pays en déficit structurel dont la dette augmente ? Comment arrivez-vous à convaincre le marché que cette dette est un bon placement, alors que du point de vue politique, personne n’a encore proposé de solution pour sortir de cet endettement durable ?
M. Charles de Courson. Peut-on finir comme la Grèce ?
M. Nicolas Sansu, président. Sommes-nous en mesure de connaître les véritables détenteurs de la dette ?
C’est pour nous une question importante, nous avons l’impression d’être confrontés à une boîte noire. C’est pour cela que la question de la renationalisation de la dette française se pose avec insistance. En quelque sorte, la BCE a emprunté ce chemin en instaurant une sorte de plancher du trésor européen, puisque vos banques sont obligées de détenir une part de dette des États européens.
Comment pensez-vous que l’on puisse assurer qu’il n’y aura pas de défaut ?
M. Jean-Claude Buisine. Dans cette période de déflation, les banques ont tendance à se montrer très prudentes. Quelle incidence cette prudence peut-elle avoir sur la dette publique ?
M. Raoul Salomon. Sur la question des détenteurs de la dette, il faut savoir qu’il est extrêmement compliqué de faire des statistiques de patrimoine. L’INSEE fait maintenant ces statistiques, mais connaître les stocks est très complexe. Ce que nous pouvons connaître, ce sont les données de flux, car la balance des paiements nous y aide.
Un seul pays fait vraiment un effort pour chercher à savoir qui sont les détenteurs finaux de sa dette, ce sont les États-Unis, qui publient les « TIC data » (Treasury International Capital). Mais en y regardant de près, nous constatons des situations extrêmement étranges. Ainsi, le quatrième ou cinquième pays détenteur de dette des États-Unis serait la Belgique, ce qui est difficile à croire. Cela s’explique par le fait que la banque Euroclear a son siège en Belgique. Lorsque l’on détient de la dette, il est nécessaire d’avoir un dépositaire. Ainsi, la Banque de France est dépositaire d’un certain nombre d’autres banques centrales. Mais certains investisseurs ont besoin d’un dépositaire qui ne se trouvera pas dans leur pays, et préfèrent alors s’adresser à des établissements dont c’est la spécialité. Il y a ainsi quelques grands dépositaires, Euroclear est l’un d’eux.
Si l’on étudie les statistiques américaines, on retrouve les pays où se trouvent ces dépositaires. On trouve ainsi de nombreux dépositaires dans les îles des Caraïbes, mais on se doute bien que l’argent ne vient pas de là. Le biais statistique peut dont être gigantesque.
En fait, il faudrait demander aux investisseurs d’où vient l’argent qu’ils placent, et ils n’ont pas nécessairement envie de le dire. Il est évident que certains ont quelque chose à cacher, mais lors de la crise des dettes souveraines, nous avons aussi connu des investisseurs qui n’étaient pas très fiers d’avoir investi dans la dette grecque ou espagnole, et qui ne préféraient pas trop en parler. De façon générale, on préfère parler des investissements gagnants que perdants, et ce n’est pas propre aux investisseurs institutionnels.
Ainsi, tous les SVT fournissent tous les mois au Trésor des statistiques harmonisées de flux, indiquant par pays et par type d’investisseur ceux avec qui nous avons traité. Une des entrées est « banque centrale », et comme il n’y en a qu’une par pays, on peut évidemment voir ce que fait l’investisseur. Un certain nombre de banques centrales nous ont fait savoir qu’elles n’appréciaient pas que nous fournissions autant de détails, elles n’avaient pas envie que tous leurs investissements soient rendus publics de la sorte. Elles nous ont donc demandé de présenter les données en additionnant plusieurs pays, de façon à ce que les flux ne soient pas visibles par tout le monde.
Il ne faut pas sous-estimer le fait que certains n’ont pas envie de faire savoir quand ils achètent ou vendent. Ceci ajouté au fait que les investisseurs sont obligés d’avoir des dépositaires hors de leurs frontières, cela rend la collecte de ces données extrêmement compliquée.
C’est ainsi qu’en lisant les statistiques des États-Unis, on trouve des données extrêmement surprenantes sur les Suisses, les Belges ou les îles des Caraïbes, mais tout le monde sait bien que ce ne sont pas dans ces États que se trouvent les vrais détenteurs de la dette américaine. Il est extrêmement compliqué de disposer de statistiques sur les données de stock.
M. Christophe Jobert. La BCE achète près de 9 milliards d’euros d’emprunts d’État français chaque mois. Nous en sommes à près de 100 milliards depuis le début du programme, et nous atteindrons 185 milliards en fin d’année prochaine, ce qui représentera 12 % de l’encours de 1 500 milliards d’euros. On peut donc dire que 12 % du stock sera détenu par la BCE.
Par ailleurs, sur les 30 % de la dette détenus en France, on peut considérer sans risque d’erreur que 20 % sont placés dans l’assurance-vie, et les 10 % restants sont détenus par des banques françaises, notamment pour constituer des réserves de liquidités qui leur permettent de couvrir les décaissements à court terme.
Parmi les détenteurs de la dette, nous allons ensuite trouver les banques centrales autres que la BCE. On peut estimer le stock auprès de ces banques centrales à 25 % de la part détenue par les non-résidents, l’Asie en représentant une part importante. Il s’agit de banques centrales qui investissent leurs réserves de change dans des emprunts d’État. Ce sont des investisseurs stables, qui représentent une part importante des détenteurs de la dette française.
On trouve ensuite des banques du monde entier, beaucoup de fonds de pension, et des grands gestionnaires de fonds. Il est très difficile d’identifier précisément leur répartition géographique pour les raisons données par M. Salomon. Il faut garder en tête que cette dette est négociable à tout moment, l’une de nos obligations en tant que SVT est justement d’assurer la liquidité de cette dette à tout moment : 15 milliards d’euros de dette française s’échangent tous les jours, 10 milliards d’obligations à moyen ou long terme, et 5 milliards d’emprunts à court terme.
M. Charles de Courson. Il nous est toujours dit qu’il n’est pas possible de savoir dans le détail ce qui se passe sur le marché secondaire.
M. Franck Motte. Les SVT produisent tous les mois, ligne à ligne, les opérations réalisées avec les investisseurs. Nous donnons donc à l’AFT des données d’achat net. Mais on ne sait pas si les acheteurs réinvestissent, on ne connaît pas le stock détenu, et on ne peut pas imaginer créer une base de données des détenteurs si ce n’est pas fait au niveau mondial. Si la France annonce demain qu’elle veut savoir qui détient quoi, les investisseurs se tourneront vers les obligations d’autres États.
M. Nicolas Sansu, président. Pourquoi ? Il n’y a rien de mal à détenir de la dette.
M. Franck Motte. Non, mais à certains moments, nous avons constaté des flux très importants. Récemment, il y a eu des réapatriations massives de devises, c’est-à-dire que les banques centrales ont eu besoin des réserves de change qu’elles avaient investies pour réagir et insuffler de la liquidité dans leur propre marché. Nous les avons alors vues vendre des titres qui étaient en taux négatifs pour racheter un peu plus loin dans la courbe. Elles ont récupéré de l’argent frais pour le réinvestir dans leurs économies.
Il est de notoriété publique, par exemple, que nos amis chinois qui avaient 4 500 milliards de réserve n’en ont plus que 3 200 milliards. Ils ont donc réalisé ce type d’opérations sur le dollar comme sur l’euro, vis-à-vis de la France comme de l’Allemagne.
M. Charles de Courson. Sait-on combien détiennent les Chinois en bons du Trésor ? Beaucoup de bruits ont circulé.
M. Franck Motte. Absolument pas. Ils ont réduit leurs réserves de change au prorata de ce qu’ils détenaient. Cela signifie qu’ils ont vendu des dollars, de la livre sterling, du yen et de l’euro. Et parmi ce qu’ils ont vendu en euro, ils ont vendu des obligations allemandes et françaises, probablement aussi des obligations italiennes, au prorata de ce qu’ils détenaient.
M. Charles de Courson. Quelle analyse faites-vous de l’augmentation de la part de la dette détenue par la Banque centrale européenne ? Que signifie la politique de quantitative easing, par laquelle on inonde de liquidités pour racheter sur le marché secondaire le lendemain de l’émission ?
M. Thomas Spitz. Tout d’abord, les systèmes de quantitative easing ne sont plus très nouveaux, puisque les États-Unis et le Japon l’ont déjà fait. Contrairement à ce qui se passe au Japon, en Europe, et notamment en France, les interventions des banques centrales nationales sur les titres ne se font pas au lendemain de l’émission. L’intervention de la Banque de France sur les OAT se fait quotidiennement, sur de petits montants. On ne voit pas l’AFT émettre un jour pour que les banques centrales rachètent le lendemain. C’est une intervention régulière sur l’ensemble de la courbe de taux d’intérêt, de manière homogène. On n’assiste pas à ce mécanisme par lequel on rachète d’une main ce que l’on émet de l’autre.
La volonté annoncée de la politique de quantitative easing est de racheter la dette sur le marché secondaire, à un certain nombre d’investisseurs qui vont voir un intérêt à la vendre, et libérer du même coup leur capacité à investir dans d’autres actifs, que la BCE considère plus productifs pour l’économie. L’intention de la BCE est donc de relancer l’économie en rachetant de la dette d’État qui n’alimente pas directement l’économie privée, afin d’inciter les investisseurs à acheter de la dette obligataire privée ou à investir dans des actions. C’est le principe de base de l’action de la BCE.
La politique de quantitative easing permet aussi de ramener les taux d’intérêt des différents pays européens à des niveaux que la BCE estime plus appropriés à leurs taux de croissance respectifs, pour faire converger les différents taux d’intérêt, en réaction à la situation que nous avons connue pendant la crise européenne. Ce sont les deux grands mécanismes que la BCE a définis, et qu’elle met en œuvre par l’intermédiaire des banques centrales nationales.
M. Amaury D’Orsay. Il est vrai que les rachats sur le marché secondaire des titres émis sur le marché primaire par la BCE sont réguliers. Et ils ne se concentrent pas du tout sur les dernières émissions, mais portent sur l’ensemble de la courbe des taux et concernent aussi des émissions qui ont été réalisées il y a plus de cinq ou dix ans, par exemple sur les anciens bons à trente ans.
Ces rachats peuvent éventuellement poser des problèmes de liquidité sur ces anciennes émissions, mais ils permettent de ne pas casser le lien entre les États et les investisseurs en maintenant un certain dynamisme sur la dette primaire.
S’agissant ensuite de la politique dont l’objet est d’orienter les opérateurs vers des actifs plus risqués, un effet de change est aussi recherché. Dans les différentes politiques monétaires mises en place, cet effet de change a permis de faire baisser l’euro.
M. Jean-Pierre Gorges. Êtes-vous en contact avec les agences de notation ? Que penser d’un pays, comme la France, qui émet de la dette sans discontinuer ?
M. Nicolas Sansu, président. Une chose semble étrange : comment est-il possible d’accepter des taux d’intérêt négatifs ?
M. Raoul Salomon. Il est vrai qu’en première approche, l’idée de taux d’intérêt négatifs est extrêmement perturbante. Lorsque j’ai commencé à travailler sur les marchés financiers, le taux des bons du trésor à intérêts annuels (BTAN) à deux ans se situait autour de 7,5 %. Évidemment, je n’imaginais pas des taux d’intérêt négatifs. Mais il faut prendre en compte un élément de comparaison : à l’époque, le taux au jour le jour de la Banque de France était beaucoup plus élevé. Aujourd’hui, si l’on place son argent auprès de la BCE, le taux est très négatif, cela va donc coûter beaucoup. Si l’on peut placer cet argent de façon moins coûteuse, c’est quand même intéressant, même si c’est à taux négatif. Si demain la BCE baisse encore ses taux, il y a de fortes chances qu’ils y aient encore des investissements à des taux négatifs, bien que cela semble un non-sens, car ce sera toujours mieux que de placer son argent à la BCE.
Toutefois, beaucoup d’investisseurs n’achètent pas de taux d’intérêt négatifs. Par exemple, au cours des quatre dernières années, les assureurs français ont acheté très peu d’OAT, ils ont surtout acheté des obligations d’entreprises. Cela peut évidemment tenir au fait qu’ils anticipent un redémarrage de l’économie, mais surtout, au fait que les taux offerts sont nettement supérieurs.
Il y a un effet d’optique très fort. Nous avons tous connu des écarts de taux importants entre la France et l’Allemagne. Mais aujourd’hui, si le taux de l’Allemagne est de 0,3 et celui de la France de 0,6, nous passons du simple au double. Chaque fin d’année, les performances des différents investisseurs sont comparées. Si dans l’absolu, un taux de 0,6 n’est pas très élevé, il reste qu’il est le double de 0,3. En termes de performance, cela signifie que vous faites deux fois mieux. Ces taux négatifs vont donc créer une illusion d’optique qui compresse tous les écarts de taux.
Nous observons aussi que beaucoup de gens ont commencé à investir dans des obligations émergentes ou des obligations à haut rendement, ce qui pourra d’ailleurs provoquer un problème un jour.
M. Christophe Jobert. Sans entrer dans la technique financière, il est important de distinguer un emprunt qui porte un coupon négatif d'un emprunt qui offre un rendement obligataire négatif. Prenons un exemple simple : si vous achetez une obligation à 101, dont le coupon est à zéro, et qu’elle est remboursée à 100, son rendement obligataire sera négatif sans que son coupon soit négatif. Or la demande est telle pour certaines obligations que leur prix monte considérablement, à tel point que leur rendement obligataire devient négatif. C’est une nuance importante.
Pourquoi existe-t-il une telle demande ? Les opérations de quantitative easing y contribuent de manière importante : le Gouvernement français émet 180 milliards ; si la BCE en achète 100 milliards, auxquels s’ajoutent la demande des banques commerciales et celle des investisseurs qui préfèrent acheter un actif réputé, de qualité et liquide, comme l’est la dette française, nous aboutissons à une situation dans laquelle la demande excède l’offre.
M. Spitz a soulevé un point très important : l’effet quantitative easing fait baisser le coût de l’emprunt pour tous les émetteurs : pour l’État, mais également pour toutes les entreprises. De ce point de vue, c’est une bonne chose. En second lieu, il favorise un transfert de l’épargne depuis les obligations d’État qui ne rapportent plus rien, vers les obligations d’entreprises. Gardons à l’esprit qu’en 2015, les entreprises françaises dans leur ensemble ont émis pour 60 milliards d’euros d’obligations. Les institutions financières – banques et assurances — 60 milliards également. S’y ajoutent les émissions des agences d’État telles que la CADES (Caisse d’amortissement de la dette sociale), l’Unedic, l’AFD (Agence française de développement), pour 40 milliards. Au total, ce sont donc 160 milliards qui sont émis, à rapporter aux 185 milliards de l’État. Les 100 milliards pris par la BCE orientent autant d’épargne vers d’autres émetteurs, notamment les entreprises françaises. C’est un effet très important qui est recherché par les banques centrales.
Enfin, comme l’a mentionné M. D’Orsay, un effet change est également recherché : cette politique a eu pour effet de faire baisser l’euro, ce qui est favorable à l’économie européenne.
M. Franck Motte. Toutefois, nous pouvons rejoindre vos inquiétudes car nous sommes en train de créer un précédent. Aujourd’hui, pour acheter un actif sans risque, les investisseurs sont prêts à dépenser pour être sûrs d’être remboursés. Cela veut dire que tous ceux qui achètent d’autres types d’actifs, en pensant que c’est sans risque, sont orientés vers des placements plus risqués. Ce n’est pas une situation propre à l’Europe, mais nous sommes probablement en train de pousser l’épargne vers des placements plus risqués, et sans doute de mettre un peu en danger nos systèmes d’assurance-vie.
M. Jean-Pierre Gorges. Vous qualifiez de placement sans risque la dette d’un État qui n’arrive pas à rembourser ? Depuis quinze ans que je siège à la commission des finances, on voit la dette progresser sans interruption.
M. Franck Motte. Il y a trente ans, l’État français émettait 500 millions de francs par mois. Aujourd’hui, nous ne sommes pas loin de 18 milliards d’euros.
M. Raoul Salomon. Il faut prendre en compte que le PIB a beaucoup augmenté pendant cette période. Ce qui est important, c’est l’évolution du ratio dette/PIB. Il y a deux façons de régler ce problème : la première est de faire des surplus budgétaires, la seconde est d’avoir un taux de croissance supérieur au taux d’intérêt apparent sur la dette. La Belgique a très bien réussi de cette façon dans les années quatre-vingt-dix. La France également a connu des périodes où sa croissance était supérieure au taux d’intérêt apparent sur sa dette.
Évidemment, nous ne vivons pas les meilleures conditions économiques en ce moment, mais les gens ont confiance dans la croissance potentielle de la France, ne serait-ce qu’en raison de sa démographie. Il faut faire des efforts de maîtrise budgétaire, mais dès lors que le taux de croissance repasse au-dessus du taux apparent sur la dette, l’évolution est très rapide. Cela peut paraître abscons, mais la Belgique et beaucoup d’autres pays ont réussi à le faire. Il faut réussir à s’endetter à des taux très bas, et trouver la croissance potentielle.
M. Jean-Claude Buisine. Le fait d’avoir des taux négatifs ne constitue-t-il pas une autre forme de risque ? Comment envisagez-vous l’évolution de la situation dans les années à venir ?
M. Christophe Jobert. Pour en revenir à la question précédente, il faut avoir une approche relative. Tous les États, aujourd’hui, sont endettés, voire surendettés, ce n’est pas un cas particulier à la France. Ce que le comportement des marchés nous enseigne, c’est qu’aujourd’hui, la France émet une dette considérée comme un actif de qualité, le plus recherché après la dette de l’Allemagne. On estime qu’il est préférable d’avoir de la dette française que de la dette espagnole, de la dette italienne, ou tous les autres emprunts d’État qui circulent sur le marché.
M. Charles de Courson. Ça, c’est la théorie du pire : nous sommes moins pires que nos voisins. Les épargnants préfèrent choisir le moindre des maux, mais combien de temps cela peut-il durer ? Vous qui travaillez sur les marchés, vous ne pensez jamais qu’une crise peut survenir.
M. Raoul Salomon. Nous y pensons tout le temps au contraire !
M. Charles de Courson. Vous y pensez tout le temps, mais vous estimez qu’elle ne se réalisera jamais. Aucun d’entre vous n’avait prévu la crise de 2008. Le problème est que bien souvent, il arrive ce que personne n’a prévu. À quel moment se situe le point de rupture ?
Vous parlez de la croissance potentielle, partagez-vous l’avis exprimé dans l’ouvrage de Patrick Artus selon lequel la croissance potentielle française se situe entre 0,8 % et 1 % ?
M. Jean-Pierre Gorges. Vous parlez de la relation entre le PIB et le déficit. Mais la caractéristique essentielle d’une dette, c’est la capacité du débiteur à la rembourser. Si l’on s’endette pour construire des aéroports, des autoroutes, ce sont des investissements productifs qui auront un effet sur la croissance. Mais une dette de fonctionnement ne pourra jamais être remboursée.
Dans le calcul du PIB, on additionne ce que font les pompiers ou les gens qui passent leur temps dans le train sans rien produire : on additionne des choux et des carottes. Quelqu’un travaillant derrière un ordinateur à la puissance de calcul énorme produit beaucoup pour un petit salaire, tandis que des personnes qui font des choses inutiles vont compter autant. L’un augmente le déficit, l’autre crée une croissance réelle.
Il n’y a pas d’effet d’ordre : on ne peut pas comparer le PIB de 1980 avec le PIB actuel.
M. Charles de Courson. Au sein du déficit, il faut distinguer ce qui relève des investissements et ce qui relève du fonctionnement. Nous avons près de 52 ou 53 milliards d’euros de déficit de fonctionnement. Le déficit de la France est donc massivement un déficit de fonctionnement, ce n’est pas pour investir que nous accumulons les déficits.
Si la France était une entreprise, vous vous seriez tous sauvés depuis longtemps. Il y a 1 500 milliards de dettes pour 500 milliards d’actifs. L’actif net de l’État est donc de l’ordre de – 1 000 milliards. S’il s’agissait d’une entreprise privée, vous n’achèteriez pas une seule obligation ! Pourquoi, alors que l’État français accumule de la dette et que son déficit est essentiellement un déficit de fonctionnement, continuez-vous à considérer qu’il s’agit d’un bon placement ?
M. Jean-Pierre Gorges. Nous avons auditionné deux agences de notation, et elles ont répondu différemment lorsque nous leur avons demandé si, pour donner une note à la France, elles intégraient les actifs financiers des Français. L’une a répondu qu’elle n’en tenait pas compte, mais l’autre a répondu qu’elle intégrait évidemment cette donnée.
À un moment donné, si les choses ne fonctionnent plus, on ira chercher dans les actifs financiers des Français, comme cela s’est passé à Chypre. Une partie des actifs financiers des Français peut être saisie assez simplement, par la réquisition ou par l’impôt.
M. Nicolas Sansu, président. Il suffit de revenir à un droit sur les successions normal, et les choses se feront naturellement !
M. Christophe Jobert. Nous ne sommes pas en train de dire qu’il est bon que la dette de l’État représente 100 % du PIB. Notre rôle est de distribuer cette dette, et nous constatons aujourd’hui qu’elle se distribue bien, car elle est considérée comme liquide et que la France reste un pays riche. Aucun investisseur n’a d’inquiétude aujourd’hui sur la capacité de la République française à honorer ses dettes. Cela ne veut pas dire que c’est une bonne chose : en tant que contribuable, je m’inquiète beaucoup.
M. Charles de Courson. Vous nous décrivez la situation du marché. Mais si nous essayons de réfléchir au fond, vous faites l’hypothèse que les contribuables français continueront à payer leurs impôts. Que se passerait-il si les Français, médaillés d’argent des prélèvements obligatoires, se révoltaient et refusaient de payer l’impôt ? L’histoire est pleine de révoltes fiscales. Les banquiers font toujours l’hypothèse que les choses vont suivre leur cours, qu’il n’y aura jamais de rupture.
M. Amaury D’Orsay. C’est un peu vrai, mais ce n’est pas propre aux banquiers, tout le monde fait cette hypothèse : l’État, les banquiers, les marchés. Dans les situations de crise extrêmement tendues, comme nous avons pu en connaître en Grèce et dans certains autres pays européens, l’inquiétude principale portait sur la capacité des peuples européens à accepter les réformes et les difficultés qu’elles entraînaient.
Si l’on étudie la façon dont les marchés ont raisonné face aux problèmes de l’Espagne, il apparaît qu’ils ont commencé à anticiper des problèmes lorsque les partis extrêmes se sont trouvés en position de devenir majoritaires. C’est donc la crise politique qui peut constituer un problème, mais aujourd’hui les investisseurs considèrent que la France n’est pas dans cette situation de rupture.
M. Charles de Courson. Ils sont optimistes !
M. Amaury D’Orsay. Cet optimisme tient au niveau d’épargne et à la capacité d’épargne. Il s’y ajoute un effet banque centrale.
M. Thomas Spitz. Cet effet banque centrale ne doit pas être négligé. Si nous revenons sur l’exemple des États-Unis, nous avons longtemps entendu, suite à la crise des subprimes, les avertissements lancés par les bonds vigilantes qui craignaient que les investisseurs cessent d’acheter la dette américaine.
Cet effet ne s’est pas produit, car un flux de liquidité tel a été mis à la disposition d’investissements – auquel s’ajoute le fait que les banques centrales elles-mêmes achètent énormément de papier – que l’effet offre et demande prend le dessus sur des inquiétudes légitimes de capacité de remboursement. Plusieurs effets s’affrontent. L’un est causé par les achats massifs de la banque centrale et le montant très important de liquidités qui alimentent le marché. On peut légitimement penser que cette action de la banque centrale gomme un certain nombre de facteurs qui apparaîtraient sinon de manière bien plus saillante. D’ailleurs, l’annonce du quantitative easing de la Banque centrale européenne a eu pour effet une baisse automatique des taux d’intérêt, pas parce que les investisseurs ont pensé que l’économie allait mieux, mais parce qu’ils ont pensé que si la Banque centrale européenne achetait ces papiers, ils allaient faire la même chose.
La Banque centrale européenne a néanmoins été la première à dire que son quantitative easing était une opportunité pour les États de mener un certain nombre de réformes, et qu’il n’était pas une solution aux problèmes, mais simplement une façon de gérer une époque transitoire.
M. Amaury D’Orsay. C’est d’ailleurs une cause de frustration pour les économistes, car ils considèrent que c’est le moment pour les États de réformer en profitant de la situation de quantitative easing, pour rééquilibrer leurs finances publiques. Ce qui n’est pas le cas.
M. Thomas Spitz. Les taux d’intérêt bas ne veulent pas forcément dire que les gens considèrent que la qualité d’un État s’est améliorée. Aujourd’hui, tous les taux d’intérêt des dettes d’États européens se situent à des niveaux historiquement faibles, alors que la dette française est nettement moins bien notée qu’il y a dix ans : nous sommes trois crans en deçà de la note maximale.
Le fait que le taux d’intérêt soit bas ne signifie donc pas que la qualité de la signature est meilleure. Par contre, l’inflation est au niveau que nous connaissons, et il existe des effets mécaniques entre les taux réels et l’inflation qui jouent à plein aujourd’hui.
M. Charles de Courson. N’êtes-vous pas inquiets de constater que la politique de quantitative easing de la BCE, dont l’objectif est de faire remonter le taux d’inflation à 2 %, échoue ? Même en intégrant l’effet considérable de la baisse du prix du baril de pétrole, nous n’arrivons pas à faire remonter le taux d’inflation.
Ne pensez-vous pas que cette politique monétaire, qui aboutit à des absurdités économiques telles que des taux d’intérêt négatifs, va changer le comportement des acteurs économiques ?
M. Franck Motte. La réponse est contrastée. La Réserve fédérale américaine a mené ces opérations il y a maintenant cinq ou six ans, avec aujourd’hui un niveau de hausse de prix à la consommation de 2,2 %. On peut considérer que le quantitative easing a aidé. Il existe donc un consensus pour estimer que cette politique fonctionne, mais il faut du temps. La difficulté est d’obtenir ce temps, alors qu’il est beaucoup reproché à la BCE de ne pas en faire assez pour faire remonter l’inflation.
Nous voyons bien qu’il est délicat d’avoir donné pour mandat à une banque centrale de contrôler un taux d’inflation dont on ne contrôle pas énormément de composantes.
M. Raoul Salomon. Si mes souvenirs sont bons, le mandat de la BCE était à l’origine de maintenir le taux d’inflation entre 1 % et 2 %. Depuis, la valeur de 2 % a été gravée dans le marbre, mais je pense que pour la BCE, la situation est satisfaisante si nous restons entre 1 % et 2 %.
M. Christophe Jobert. Certes, l’action de la BCE n’a pas relancé l’inflation, mais elle a évité un choc déflationniste majeur, qui aurait été renforcé par le contre-choc pétrolier. S’il n’y avait pas eu le quantitative easing, le taux d’inflation serait bien plus faible qu’il ne l’est aujourd’hui.
M. Charles de Courson. Qui se souvient que nous avons connu la stabilité des prix en Europe de 1815 à 1914 ? Les modèles postulant qu’il est nécessaire d’avoir de l’inflation pour créer de la croissance ne rendent pas compte de la situation qui prévalait au XIXe siècle.
M. Nicolas Sansu, président. Le président De Larosière, que nous avons auditionné, nous a expliqué qu’il serait possible pour les États de racheter beaucoup plus de dette à taux bas, mais cela risquerait de déstabiliser le marché. Qu’en pensez-vous ? Cela contribuerait à réinternaliser la dette. Et dans ce cas, faut-il un Trésor européen, ou tout du moins réfléchir à un circuit du Trésor européen ?
M. Franck Motte. Nous avons l’exemple du Japon : s’ils vont au terme du projet qu’ils ont annoncé, ils auront racheté environ 100 % de leur dette en 2017 ou 2018. On peut dès lors s’interroger sur l’intérêt à garder l’actif et le passif. On entre dans un domaine où la monnaie ne veut plus dire grand-chose.
M. Jean-Pierre Gorges. Aujourd’hui, de nombreux sujets tels que le numérique ou le nucléaire justifieraient des investissements de l’État, dans des ordres de grandeur bien supérieurs aux 30 milliards du grand emprunt. Si nous souhaitions lancer un programme d’investissement de l’ordre de 200 milliards sur dix ans, pourrions-nous nous fournir facilement sur le marché ? Malgré une dette de 1 700 milliards, serait-il facile de se lancer dans ce type d’opération ?
M. Amaury D’Orsay. Il y a plusieurs éléments de réponse.
Techniquement, c’est faisable, mais comment le marché réagirait-il ? Tout dépend du discours qui sera tenu. S’il n’y a pas d’annonce de véritable réforme permettant de réduire les coûts, ce sera difficile. Si c’est associé à une réforme du coût de fonctionnement de l’État, et que ces emprunts ont pour objet de financer des investissements, je pense que cela pourrait être vu positivement par les marchés. L’effet serait positif sur la perception qu’ont les marchés de la dette française et de l’économie du pays en général.
C’est ce que le marché attendait il y a un an : un peu plus de volontarisme économique. C’est ce qui frustre actuellement les opérateurs économiques : cette situation de quantitative easing peut être une aubaine si l’on réforme et l’on investit.
M. Raoul Salomon. Il serait utile que des recettes soient affectées directement à des projets de croissance. Nous arrivons bien à faire des green bonds afin d’assurer la transition énergétique. Et je pense que le fond du problème, est effectivement le déficit de fonctionnement. Si vous annoncez de grands emprunts, beaucoup vont penser qu’ils serviront à combler ce trou, sans autre effet. Mais d’autres pays ont fait des emprunts de croissance. Je pense en tout cas que nous devrions nous y intéresser.
M. Franck Motte. Ce débat a eu lieu au niveau européen.
M. Nicolas Sansu, président. Il existe une autre mission d’évaluation et de contrôle consacrée aux programmes d’investissement d’avenir. Il est assez difficile de leur trouver des effets concrets, et il est presque certain que l’effet de levier n’est pas celui qui avait été espéré.
M. Christophe Jobert. Avant de conclure, je souhaite saisir cette occasion pour dire à votre mission que nous pouvons nous féliciter d’avoir une agence de la dette qui figure parmi les meilleures au monde. Nous couvrons vingt-quatre trésors, et l’AFT est, selon nous, l’une des meilleures au monde. Elle le doit à la qualité de ses équipes, qui ne comptent que des professionnels sachant très bien comment fonctionnent les marchés.
Elle le doit aussi au classement des SVT, qui nous encourage tous, à chaque adjudication, à acheter les emprunts d’État à un prix très élevé.
Enfin, elle est en permanence à l’écoute du marché. Vous savez sans doute qu’elle prépare chaque adjudication une semaine à l’avance avec l’ensemble des SVT pour prendre en compte la demande des investisseurs. L’AFT va donc émettre les obligations qui sont demandées par les investisseurs. Ce faisant, elle obtient le meilleur coût d’emprunt pour notre pays.
Voilà ce que je tenais à vous dire : la dette, même si elle est trop importante, est remarquablement bien gérée.
M. Amaury D’Orsay. Objectivement, notre expérience va dans le même sens. La qualité et la technicité de l’AFT sont impressionnantes.
M. Raoul Salomon. Un ex-ministre a eu l’idée de faire passer la maturité de la dette française de sept à quinze ans, comme au Royaume-Uni. Tous les SVT se sont tournés vers l’AFT en lui faisant savoir que c’était certainement une bonne idée, mais qu’il n’y avait pas de demande, et que la dette serait vendue à un prix insensé. Le rôle de l’AFT est de veiller à tout cela.
M. Jean-Pierre Gorges. Mais le fait que les frais financiers associés soient faibles n’incite pas à la vertu. Nous avons un déficit structurel de plus de 70 milliards.
M. Franck Motte. La dette représente trois points de PIB. Nous disons souvent que notre croissance est de 1 %, mais il faut prendre en compte les trois points de PIB de la dette.
M. Nicolas Sansu, président. Je vous remercie d’avoir répondu à notre invitation.
Audition du 15 mars 2016
M. Anthony Requin, directeur général de l’Agence France Trésor (AFT), accompagné de M. Tân Le Quang, responsable de la communication.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Monsieur le directeur général, merci d’avoir répondu à notre sollicitation.
M. Anthony Requin, directeur général de l’Agence France Trésor (AFT). Merci de nous recevoir. Je commencerai par rappeler le panorama de la dette de l’État. La dette de l’État est incluse dans la dette publique, qui a atteint, d’après les données de l’INSEE, 96,9 % du PIB à la fin du troisième trimestre 2015, pour un montant total de 2 105 milliards d’euros. La dette de l’État s’élève à 1 671,6 milliards d’euros, soit presque 80 % de la dette publique. Pour le reste, les organismes divers d’administration centrale (ODAC) ont une dette de 22 milliards d’euros, les administrations publiques locales (APUL) de 184,6 milliards d’euros, et les administrations de sécurité sociale (ASSO) de 225 milliards d’euros.
Dans d’autres pays, la dette de l’État représente une part moindre de la dette publique. Ainsi, l’État fédéral allemand ne porte qu’environ 50 % de la dette totale.
Seule la dette négociable de l’État est gérée par l’Agence France Trésor.
Elle se répartit de la façon suivante : la dette à moyen terme nominale (obligations assimilables du Trésor, OAT, et bons du Trésor à intérêts annuels, BTAN) en représente 80,6 % ; la dette à court terme (bons du Trésor à taux fixe et à intérêts précomptés, BTF), c’est-à-dire à trois, six ou douze mois en représente 9 % ; enfin, le reste de la dette est indexée sur l’inflation, soit française – 4,4 % – soit européenne – 5,9 %.
Lors d’auditions précédentes, vous vous êtes demandés pourquoi les investisseurs, notamment les investisseurs étrangers, étaient intéressés par l’acquisition de titres de la dette française, malgré ce qui peut apparaître – c’est affaire de jugement – comme une dette publique élevée. Adoptons un instant le point de vue d’un investisseur qui doit placer plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliards d’euros : il se trouve confronté à un univers d’investissement où l’on trouve, notamment, les titres d’État des pays de l’OCDE, caractérisés par une certaine valeur de crédit et une certaine liquidité.
Ce graphique montre l’évolution, depuis le début des années 2000, de la dette publique de plusieurs pays en fonction de leur PIB.
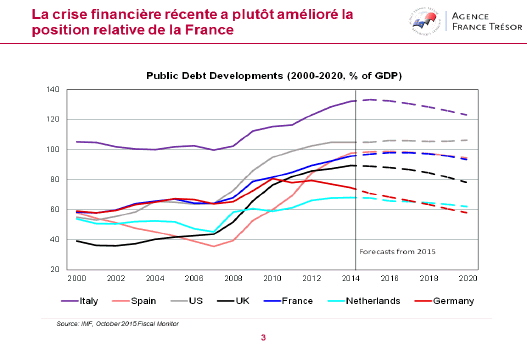
Il n’est pas évident que la situation relative de la France se soit détériorée au regard de ces indicateurs de finances publiques par rapport à certains de ses compétiteurs. Si on regarde la situation qui prévalait au début des années 2000, voire juste avant la crise aux États-Unis, au Royaume-Uni ou même en Espagne, on se rend compte que la situation de la France s’est relativement améliorée. Entre 2007 et 2015, la dette de la France a augmenté de 32 points de PIB ; elle a augmenté de 44 points de PIB au Royaume-Uni, de 43 points de PIB aux États-Unis, de 57 points de PIB au Japon. Il faut donc adopter une perspective plus large pour mieux juger de la situation française.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Nous ne sommes donc pas les plus mauvais…mais la dette devient une façon de vivre !
M. Anthony Requin. Les États ont subi en 2007-2008 un choc dont ils essayent de se remettre. La position relative de la France s’est améliorée par rapport à certains États, mais pas par rapport à l’Allemagne, par exemple. Ce graphique montre d’ailleurs la singularité de l’Allemagne, dont le ratio de dette par rapport au PIB a décru, et dont la position relative s’est beaucoup améliorée.
Les investisseurs regardent également le passé récent et l’avenir.
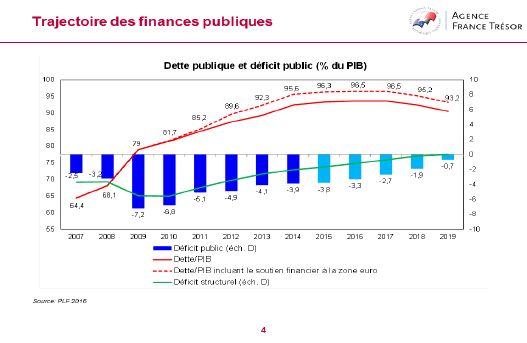
Il est frappant de constater que nous avons régulièrement, depuis 2009, réduit chaque année notre déficit rapporté au PIB – et ce quel que soit l’environnement d’inflation et de croissance. Le graphique montre également l’évolution de notre ratio entre dette et PIB, la ligne pointillée incorporant les engagements hors bilan pris par la France en garantissant les émissions obligataires effectuées par le Fonds européen de stabilité financière (FESF), c’est-à-dire le mécanisme financier mis en place par la zone euro pour aider les pays en difficulté – Irlande, Grèce, Portugal. Nous progressons chaque année de manière graduelle et nous devrions, en 2016, stabiliser ce ratio avant – nous l’espérons tous – d’entamer une décrue.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Pourquoi ce ratio devrait-il s’améliorer en 2017 ? Les années électorales sont-elles propices ?
M. Anthony Requin. Nous devrions voir en 2017 la poursuite de la réduction du déficit budgétaire, ainsi qu’un redémarrage de la croissance, qui devrait être de 1,5 % cette année. Les investisseurs valorisent cette évolution, la constance de ce chemin, la clarté de cette stratégie.
Je ne voudrais toutefois pas peindre devant vous une image trop rose. Nous entrons dans un moment crucial : L’histoire de la dette de la France sur les trente dernières années est celle d’une succession de chocs qui ont provoqué une augmentation de la dette ; à chaque fois, nous avons consenti des efforts pour la stabiliser, mais nous avons eu du mal à entamer un mouvement de réduction durable du ratio de dette par rapport au PIB.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. De quels chocs parlez-vous ?
M. Anthony Requin. Ce sont des chocs de croissance.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Ou plutôt de mécroissance !
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. En 1998, nous passons aux trente-cinq heures : la compensation des baisses de charge a représenté 300 milliards – qui ont alimenté le déficit, donc la dette ! Est-ce cela, un choc de croissance ?
M. Anthony Requin. Les moments où la France a quitté une situation de stabilisation du ratio de dette par rapport au PIB sont des moments où il y a eu des chocs de croissance, où il y a eu récession, où la croissance a dramatiquement diminué. S’ensuit une augmentation qui a un impact sur le déficit public qu’on essaie ensuite de réduire. Ces efforts permettent une stabilisation du ratio de dette par rapport au PIB, mais n’ont à ce jour pas été suffisants pour entamer une décrue avant que le prochain choc conjoncturel de cycle n’intervienne.
C’est ce que nous reprochent les agences de notation : par une maîtrise progressive de nos finances publiques nous arrivons à stabiliser une dérive, mais nous n’arrivons pas à l’infléchir. Ce qui est important pour leur analyse de crédit, c’est d’arriver à démontrer que l’on entame un mouvement durable de diminution du ratio de dette par rapport au PIB. Nous entrons aujourd’hui dans une phase très importante, puisque l’on devrait s’approcher en 2016-2017 du moment où le ratio dette sur PIB se stabilise ; il va falloir démontrer dans les années qui viennent notre capacité à diminuer ce ratio de manière durable.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Tout cela repose sur une hypothèse de déficit de – 0,7 % en 2019 : au vu des quarante dernières années, cela paraît impossible.
M. Anthony Requin. Ce qui importe, c’est la continuité dans l’effort.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. J’essaye de distinguer, dans votre graphique, la part de la projection, de celle du but recherché.
M. Anthony Requin. Les éléments de l’histogramme « déficit public » représentent le programme de stabilité déposé à Bruxelles par les autorités françaises en avril 2015.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Donc c’est un objectif. Pour analyser les risques sur la dette, nous allons vérifier si cet objectif tient ou pas.
M. Anthony Requin. Les investisseurs peuvent certes, comme vous, être dubitatifs sur l’avenir : mais nous pouvons montrer le chemin qui a été parcouru depuis 2009. Ce ne sont pas des projections, mais du réalisé.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Nous ne sommes toujours pas revenus à la situation de 2008. Or cette situation n’était déjà pas formidable. Je ne vois pas quels éléments structurels pourraient permettre, aujourd’hui, une diminution de la dette.
M. Anthony Requin. Les éléments structurels qui permettent à une dette de se stabiliser ou de diminuer sont doubles. Pour diminuer le ratio de la dette par rapport au PIB, il faut que le dénominateur – le PIB – augmente plus vite que le numérateur – la dette.
La première question que vous nous avez posée portait sur la justification de l’existence d’une agence autonome, ainsi que sur l’adéquation entre nos moyens et nos missions.
L’Agence France Trésor n’est pas une agence dotée de la personnalité morale ; c’est un service à compétence nationale, placée sous l’autorité du directeur général du Trésor et du ministre. Elle n’a donc pas ses comptes propres, elle fait partie intégrante de l’État. Elle a été créée pour donner de la visibilité, pour créer une marque reconnue par les investisseurs – ce qui est le cas. Il s’agissait aussi de lui donner une certaine autonomie dans les processus de marketing et de vente de la dette publique, dans un souci d’efficacité opérationnelle. Mais nous n’avons pas voulu couper les liens avec l’État et son insertion au sein du ministère des finances et de la Direction générale du Trésor, ainsi que nos liens avec la direction du Budget, avec la direction générale des Finances publiques, nous donnent accès à de nombreuses informations macro-économiques et budgétaires qui nous permettent d’apporter des réponses aux questions posées par les investisseurs.
L’AFT compte aujourd’hui 40 personnes, 18 femmes et 22 hommes, aux compétences et aux parcours très variés. Parmi ces personnes, il y a aujourd’hui 28 fonctionnaires, qui connaissent les processus financiers de l’État, et 12 contractuels, qui sont des professionnels des marchés. Nous avons une organisation sous forme de 8 cellules qui nous permettent de travailler opérationnellement avec efficacité.
Nous sommes assistés par un comité stratégique, dont vous avez reçu le président. Ce comité consultatif nous aide à tester des idées ; il nous permet d’avoir des échanges avec des professionnels de marché aux profils internationaux.
Quant aux moyens techniques, juridiques, matériels dont nous disposons, comme n’importe quel responsable d’administration publique on pourrait souhaiter naturellement en avoir davantage… Mais nous sommes très conscients des contraintes du secteur public, et j’estime que la qualité de notre personnel nous permet d’exercer notre mission correctement.
Votre deuxième question portait le processus d’adjudication. Vous vous demandiez si nous gagnions de l’argent sur le prix de vente aux enchères des titres de dette publique, et comment cet argent était employé.
Nous sommes, je l’ai dit, un service à compétence nationale : notre activité est retracée dans le programme 117 Charge de la dette et trésorerie de l’État et dans le compte de commerce Gestion de la dette et trésorerie de l’État, ainsi qu’à titre subsidiaire dans le compte de commerce Couverture des risques financiers de l’État. Nous ne disposons pas de budget propre, ni de compte de résultat : nous ne pouvons donc pas gagner de l’argent pour nous-mêmes ; tous nos gains reviennent au contribuable en moindre charge d’intérêt de la dette.
Une troisième question portait sur l’intérêt de connaître avec précision la base des investisseurs de la dette publique française. Vous nous demandiez également des précisions sur les territoires à partir desquels il était possible d’opérer pour acquérir de la dette française.
La connaissance précise de l’ensemble des détenteurs de la dette française serait une information intéressante bien sûr. Il serait cependant très difficile d’en avoir une photographie exacte à un moment donné : la dette française s’échange sur le marché secondaire, et change donc de mains de jour en jour. Ces transactions sont importantes : 10 milliards d’euros par jour, 3 600 milliards par an – chiffres à comparer à celui du stock, qui est de 1 600 milliards.
De plus, une obligation de déclaration qui s’imposerait aux détenteurs de dette française, et uniquement à eux, nous ferait prendre un risque car ce serait un désavantage compétitif par rapport aux autres États si une telle obligation ne s’appliquait pas à eux. Les investisseurs, en effet, n’aiment pas dévoiler leurs positions sur le marché, pour des raisons dont certaines me semblent légitimes.
Ainsi, beaucoup de nos investisseurs sont des banques centrales, qui doivent placer des réserves de change et souhaitent disposer d’actifs sûrs et liquides. Mais les banques centrales peuvent aussi, parfois, être amenées à réaliser des transactions dans le cadre de leur politique de change, donc à vendre des quantités de titres importantes. Elles font partie du secteur public d’un État étranger : de telles transactions massives pourraient les placer en position inconfortable vis-à-vis des pays émetteurs, car cela pourrait être interprété comme un signal négatif, un geste de défiance.
Quant aux investisseurs privés – assureurs, fonds de pension… – ils ne souhaitent pas dévoiler au marché, à tout moment, leurs positions. Ce serait pour eux un risque, car les marchés connaissent les règles de diversification et de prise de risque : ils pourraient donc savoir, dans certaines configurations de marché, quand ces investisseurs vont être obligés de vendre certains titres. La publication de leurs positions pourrait donc se retourner contre eux.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Je peux entendre ce que vous dites sur la transparence, même si je ne peux pas être entièrement d’accord. Mais notre question portait principalement sur les paradis fiscaux. N’est-il pas surréaliste de prétendre lutter contre ceux-ci tout en acceptant qu’ils achètent des titres de dette souveraine – qui alimentent ainsi « une grande lessiveuse » ? Il y a là, je crois, un vrai problème.
D’autre part, des études, en particulier celle de Sandy Brian Hager sur les États-Unis, montrent que la dette est de plus en plus massivement détenue par le fameux « 1 % ». Une telle concentration se vérifie-t-elle en France ?
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Une telle concentration – aux mains d’une seule banque étrangère, ou d’un seul État – n’est-elle d’ailleurs pas risquée ?
M. Anthony Requin. Ce sont là d’excellentes questions. S’agissant des paradis fiscaux, des politiques sont en effet engagées pour lutter contre les territoires non coopératifs, mais chaque État demeure souverain dans la définition de sa fiscalité. Pour pouvoir acquérir de la dette française, il faut avoir un compte titre auprès d’un dépositaire, d’un conservateur de titres. Concrètement, certains fonds situés dans des paradis fiscaux achètent certainement des titres obligataires, mais ce sont des cheminements très difficiles à repérer : il peut y avoir des chaînes d’actions successives pour acquérir des titres de dette française – chaînes qu’il est extrêmement difficile de remonter. Il faut être conscient de cette limite.
Pour autant, nous disposons de sources d’information sur notre base d’investisseurs : nous avons quelques données « dures », et d’autres plus « molles ». Tout d’abord, nous disposons des statistiques de la balance des paiements, transmises par la Banque de France. Nous savons ainsi que 38 % environ de la base des investisseurs est située en France, ce qui nous place à peu près au même niveau que l’Allemagne.
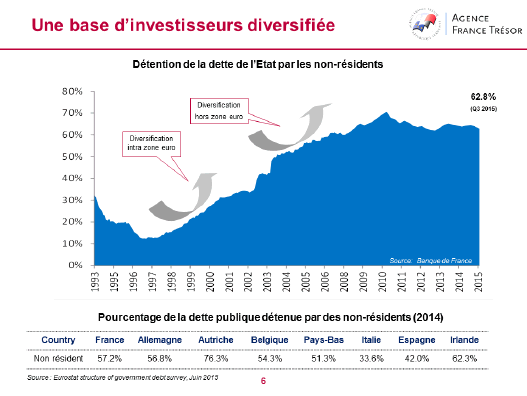
Un rapport parlementaire a déjà pointé que, parmi ces 63 % de non-résidents, certains sont sans doute des Français qui détiennent des comptes à l’étranger. Mais l’image globale est certainement bonne.
Je souligne que le taux de détention de la dette publique par des non-résidents est légèrement inférieur au taux de détention de la dette de l’État : la dette de l’État est la plus liquide, et son crédit est plus élevé. C’est donc celle vers laquelle se portent prioritairement les grands investisseurs.
Par ailleurs, le FMI effectue régulièrement un sondage auprès des investisseurs, le Coordinated Portfolio Investment Survey, afin de déterminer notamment la nationalité de ceux qui détiennent des titres financiers. De cette enquête, on peut tirer qu’environ 50 % des non-résidents qui détiennent de la dette – toutes dettes confondues, car ce sondage ne concerne pas la seule dette publique – sont situés en zone euro. Si l’on fait l’hypothèse qu’il n’y a pas de forte différence de proportions entre la détention de dette publique et de dette privée – bancaire ou d’entreprise –, on peut déduire que parmi ces 63 % d’investisseurs non-résidents, la moitié réside en zone euro.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Il y a parfois des incongruités : en 2011, Patrick Artus expliquait que le deuxième pays détenteur de dette française était les Îles Caïmans…
M. Anthony Requin. Je ne sais pas d’où viennent ces données et je n’ai pas cet article en tête. En revanche, je confirme qu’il existe des incongruités : les analyses qu’essaye de mener le Trésor américain sur sa base d’investisseurs montrent que la Belgique détient des quantités de dette américaine étonnantes. Cela s’explique par le fait que la Belgique est le siège d’Euroclear, organisme de dépôt et de règlement-livraison par lequel transitent un certain nombre de comptes. Mais derrière Euroclear il y a probablement des comptes-titres qui sont mouvementés depuis d’autres pays.
De l’analyse du FMI, on peut déduire que la dette est répartie entre un tiers d’investisseurs résidents, un tiers en zone euro et un tiers hors zone euro. L’euro étant notre monnaie : on peut considérer que nous avons deux tiers d’investisseurs résidents dans notre propre zone.
Ce graphique montre l’évolution des catégories d’investisseurs.
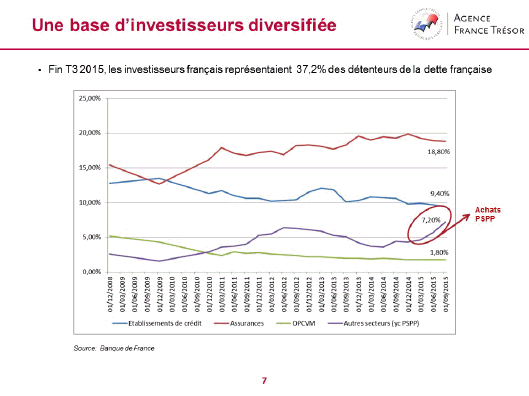
Tout instrument de mesure a ses limites, mais notre dette étant importante, on peut se fier à la loi des grands nombres… Ce qui nous intéresse comme émetteurs, ce n’est en effet pas de savoir si tel ou tel investisseur précis détient des titres de dette française mais de comprendre les grands mouvements de marché qui peuvent se produire. Pourquoi, par exemple, un grand investisseur décide-t-il de vendre ? Faut-il voir là le signe d’une défiance, la conséquence d’une évolution de la réglementation… ? C’est ce type d’information qui a de la valeur pour nous en tant qu’émetteur.
Cette base est relativement stable, même si l’on voit monter en puissance sur le schéma les « autres secteurs », c’est-à-dire le secteur public, qui comprend la Caisse des dépôts et consignations et la Banque de France. Cette montée en puissance est une conséquence de la politique d’assouplissement quantitatif de la Banque centrale européenne (BCE), qui s’opère par l’intermédiaire de la Banque de France (Public Sector Purchase Programme, PSPP).
Nous disposons également de données plus « molles », au sens où elles ne sont pas auditées. Nous ne les présentons donc pas publiquement. Elles proviennent de nos spécialistes en valeur du Trésor (SVT), ceux qui achètent lors de nos adjudications, pour revendre ensuite ces titres aux investisseurs sur le marché secondaire. Ils ont obligation de nous communiquer – c’est une règle de reporting commune aux États de la zone euro – leurs opérations d’achat et de vente, soit entre SVT, soit avec des investisseurs finaux, par type de maturité et par pays ou groupe de pays… Pour les pays de l’OCDE à l’exception du Japon, nous pouvons connaître les types d’acheteurs par pays – assureurs, trésoreries de banques, asset managers, gestion alternative… Parfois, nous avons ces données par groupe de pays. Il faut donc mixer ces données pour avoir de l’information.
De ces statistiques, nous pouvons déduire que par le passé, environ la moitié des flux de dette française étaient absorbés par les banques centrales et les entités du secteur public, c’est-à-dire les fonds souverains. C’est plutôt quelque chose dont il faut se réjouir.
Les banques centrales, qui ont au cours de la dernière décennie augmenté leurs réserves de change, souhaitent se diversifier en achetant des titres de dette française – elles ne veulent pas investir toutes leurs réserves de change dans une seule monnaie, par exemple le dollar. Cette volonté constitue, je le souligne, une bonne nouvelle : les banques centrales sont des investisseurs caractérisés par une relative insensibilité aux prix, mais aussi par une grande stabilité. Malgré les taux bas, elles continuent donc d’acheter de la dette française, comme des titres des autres grands pays bien notés de la zone euro.
Vous nous demandiez également si la faiblesse des taux d’intérêt actuels ne devait pas nous amener à renégocier de larges stocks de dette déjà existants à des conditions plus favorables. Vous souhaitiez savoir si nous pouvions profiter des taux bas pour allonger la maturité moyenne de la dette.
M. Jean-Pierre Gorges. C’est après tout ce que font les ménages : ils renégocient leurs emprunts.
M. Anthony Requin. Nous sommes un émetteur régulier et prévisible, deux caractéristiques très appréciées des investisseurs. Nous publions en fin d’année, à la suite du vote de la loi de finances, le programme de financement de l’État à moyen et long terme. Ce programme repose sur l’autorisation accordée par le Parlement. Pour les années 2015 et 2016, nous nous engageons à émettre jusqu’à 187 milliards d’euros nets des rachats sur les marchés.

La taille de la dette nous impose de revenir régulièrement sur le marché. Nous ne pouvons donc pas nous permettre d’être excessivement opportunistes, c’est-à-dire de surprendre le marché par de brusques à-coups dans notre politique d’émission : cela ne ferait que rendre les taux volatils. Nous communiquons donc un programme en amont, autant que nous le pouvons, et nous essayons de nous y tenir.
Nous ne renégocions pas de larges stocks de dette. En revanche, nous refinançons les tombées de dette en profitant des conditions d’emprunt actuelles : 116 milliards en 2015, et 125 milliards en 2016. C’est cette partie de la dette que nous allons refinancer en profitant de la baisse des taux qui est intervenue sur les titres qui viennent à maturité. Évidemment nous bénéficions de gains de refinancement.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Autrement dit, nous ne décidons plus rien… Si nous étions un État souverain, nous pourrions remettre toute notre dette en jeu pour essayer de gagner le plus possible. Cela pose un vrai problème de soumission au marché ! On est aujourd’hui à 2,6-2,7 de taux moyen. Je ne comprends pas qu’on n’ait pas décidé d’aller encore plus bas et de renégocier davantage dans l’intérêt du pays.
M. Anthony Requin. Nous essayons d’agir au mieux, en tenant compte de nos marges de manœuvre. Lorsque l’on regarde une courbe des taux, on raisonne en deux dimensions : la maturité, et le taux. Mais il y a une troisième dimension, qui nous échappe habituellement : c’est la profondeur de marché. Or celle-ci n’est pas infinie sur tous les points de la courbe : tous les investisseurs ne sont pas intéressés par tous les points de la courbe.

Ce graphique montre les différences entre les groupes d’investisseurs. Il permet de constater que très peu d’investisseurs sont intéressés par des titres à trente ou cinquante ans, hormis quelques entités de gestion alternative – les hedge funds – et des fonds de pensions. Ces derniers sont les seuls vrais investisseurs de long terme : les fonds de gestion alternative achètent et vendent souvent, pour essayer de faire des profits…
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Je complète ma question : cette renégociation de la dette pourrait aller de pair avec une renationalisation, ou une européanisation de la dette.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. En quoi le fait que sa dette soit détenue de façon importante par des non-résidents peut-il être gênant pour un pays, notamment pour sa sécurité ? Est-ce différent pour des résidents de la zone euro – qui ont donc la même monnaie que nous – et pour des résidents hors zone euro ?
M. Anthony Requin. Pour des raisons de profondeur de marché, nous ne pouvons pas – même pour profiter d’un moment où les taux sont particulièrement bas – émettre des quantités illimitées de titres à 30, 40 ou 50 ans. De plus, si nous devions racheter d’énormes quantités de dette émise précédemment, nous le ferions au cours de ces dettes au jour du rachat. Il n’y aurait donc pas de gain important : certes, nous pourrions racheter de la dette pour ré-émettre à taux bas, mais nous rachèterions cette dette à un prix beaucoup plus élevé. En taux actuariel, ce serait neutre, nous ne serions donc pas gagnants.
Notre objectif est de demeurer un émetteur régulier et transparent. Nous évitons de créer des embardées qui provoqueraient de brusques variations de notre courbe de taux – ce que les investisseurs n’aiment pas. Nous nous efforçons donc de lisser le profil d’amortissement. Nous effectuons parfois, pour cette raison, des rachats par anticipation de titres que nous n’émettons plus. On les voit sur ce graphique.
Pour l’année 2015, nous avions obtenu du Parlement l’autorisation d’émettre pour 187 milliards d’euros de dette, nette des rachats, et nous avons effectué des émissions brutes pour 220 milliards d’euros. Nous avons effectué 33 milliards de rachats, afin que notre programme en 2016 soit comparable à celui de l’année 2015.
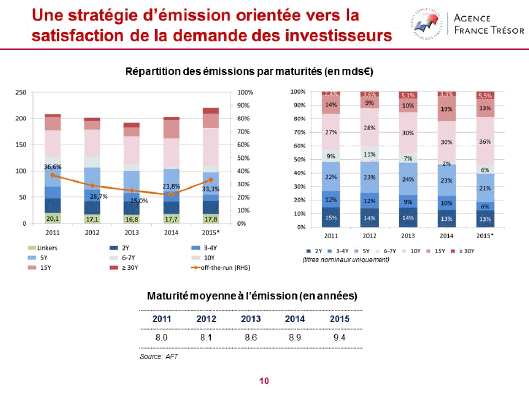
Nous avons donc tiré avantage des taux très bas, puisque nous avons sécurisé, pour une durée moyenne de 9,4 années, 220 milliards de dette à un taux historiquement bas de 0,63 % en moyenne.
Si nous avons pu le faire, c’est d’abord parce qu’il existe une demande du marché pour les titres de la dette française. Notre programme d’exécution régulier mois par mois se déroulait de façon satisfaisante : nous étions un peu en avance, et nous avons pu en profiter pour racheter un peu plus de titres et donc allonger la maturité moyenne à l’émission, parce que la demande était là. Inversement, au cours de la première partie de l’année 2015, les taux étaient très bas : les investisseurs finaux – assureurs, gestionnaires de fonds… – ne voulaient pas acheter nos titres à moyen et long terme à taux faible ou négatif. Ils ne sont revenus sur le marché qu’après le double mouvement de hausse des taux intervenu en avril et en mai. Ils étaient alors prêts à revenir acheter de la dette française pour des maturités un peu plus longues, à 10 ans, 15 ans. Si nous avions émis un surcroît de dette à maturité longue au premier trimestre 2015, l’absence de demande aurait provoqué un envol des taux ; c’est à partir du mois de juin, lorsque la demande telle qu’elle nous était rapportée par nos SVT est revenue, que nous avons pu émettre des titres longs. Et, à la fin de l’année 2015, la maturité moyenne d’émission était supérieure à celle de l’année 2014. Voilà comment nous nous efforçons de tirer avantage des taux bas ; mais nous ne pouvons pas forcer le marché à absorber des titres dont il ne voudrait pas.
En quoi le fait que la dette soit concentrée entre les mains de quelques investisseurs, voire d’un seul, est-il un problème ? Tout d’abord, les informations dont nous disposons nous laissent penser que cette situation n’est pas la nôtre : je ne pense pas qu’on puisse imaginer qu’un seul investisseur puisse détenir plus de 20 % de la dette française.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Cela ferait beaucoup.
M. Anthony Requin. Les banques centrales peuvent devoir placer des montants vraiment importants… Il faut surtout souligner qu’à la différence d’un actionnaire, un détenteur de titres obligataires est dépourvu du moindre moyen d’action sur la conduite de la politique de l’émetteur. Un actionnaire vote lors des assemblées générales ; il peut influer sur la vie de l’entreprise. Un détenteur obligataire ne peut que voter avec ses pieds – cesser d’acheter.
Nous sommes très désireux de disposer d’une base d’investisseurs aussi large et aussi diversifiée que possible. C’est une manière de nous protéger contre des chocs idiosyncratiques, des chocs qui affecteraient une catégorie particulière d’émetteurs ou un type particulier de pays. Ainsi, cette année, la chute des prix du pétrole entraîne une diminution des achats en provenance du Moyen-Orient : il est probable que les intérêts que nous payons et les amortissements que nous versons ne sont pas réinvestis en dette française, mais plutôt transférés vers les budgets nationaux. Fort heureusement, nous ne dépendons pas de cette seule catégorie d’investisseurs : si cela avait été le cas, nous aurions été à court d’acheteurs et les taux auraient fortement augmenté.
La diversité, à la fois géographique et catégorielle, est ce qui nous protège le plus efficacement contre ce type de chocs. C’est une chose importante, recherchée – par les autres pays comme par le nôtre : ainsi, l’Allemagne bénéficie d’un niveau semblable de diversification.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. La question des échecs du passé se pose : comment réinternaliser la dette ? Est-il imaginable de recréer un circuit du Trésor à l’échelle européenne qui permettrait qu’une part de la dette soit détenue en direct par des particuliers ?
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Inversement, une renationalisation de la dette ne nous conduirait-elle pas à payer notre argent plus cher que ce que permet aujourd’hui le marché ?
M. Anthony Requin. Il existe un marché structuré des OAT aux particuliers : ceux-ci peuvent, via Euronext, acquérir des titres d’État. Les SVT ont l’obligation de leur proposer des cotations. Mais en raison de la faiblesse des taux d’intérêt, les particuliers ne sont plus intéressés par ces titres. Ce n’est pas propre à la France : notre homologue, la Deutsche Finanzagentur, a pendant des années géré des comptes-titres de particuliers ; mais elle a fermé ce service en 2012, car il n’y avait plus de demande.
Les Français détiennent, il faut le souligner, beaucoup de dette française, mais pas en direct – via l’assurance-vie, les comptes bancaires, le livret A… qui apportent aussi une diversification des risques.
Les dernières opérations d’émissions directes vers les particuliers que j’ai en tête remontent aux années 2012 : elles ont été effectuées par le Trésor belge, EDF, le Crédit foncier de France sur des titres à 5 ans. Ils offraient en général des taux supérieurs de 150 à 200 points de base supérieurs à ceux proposés par l’État au même moment. Pour attirer les particuliers, il faut un certain niveau de rendement : aujourd’hui, cela se traduirait effectivement pour nous par une augmentation de la charge de la dette.
Vous nous avez également interrogés sur les risques pesant sur la dette publique française en cas de remontée des taux d’intérêt.
Nous publions, au titre de la justification au premier euro du programme 117, une analyse de sensibilité.
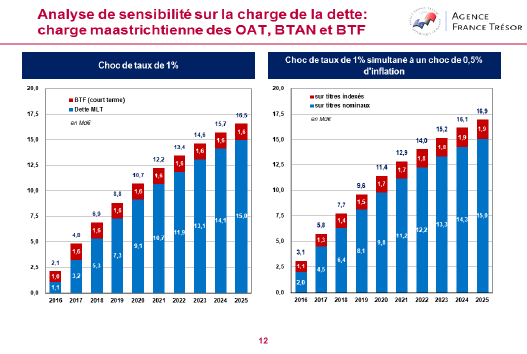
Ce graphique montre ce qui se produirait en cas de hausse brutale des taux de 100 points de base – dans le second cas, avec un choc simultané d’inflation de 0,5 %. Les conséquences sur la charge de la dette seraient d’abord modérées, puis augmenteraient progressivement.
Ce type de graphique a souvent un effet anxiogène : les conditions de taux actuelles sont très satisfaisantes, puisqu’elles nous permettent de stabiliser, voire de commencer à diminuer la charge de la dette, mais combien de temps cela durera-t-il ? Quand les taux se normaliseront, n’allons-nous pas faire face à une charge de la dette qui ne sera plus tenable ?
Ces inquiétudes sont parfois quelque peu excessives. Certes, un choc de taux peut être un choc de crédit : le marché, les agences de notation, les investisseurs cessent tout à coup de vous faire confiance, et ce qui se traduit par une hausse des taux de 100 points de base représentative d’une appréciation à la hausse du risque de crédit. Cela, effectivement, c’est dangereux. Mais un choc de taux peut aussi refléter un redémarrage de la croissance, et une anticipation d’inflation à la hausse : ce serait alors un choc positif, qui produirait sur les recettes fiscales un effet bien plus favorable que l’augmentation de la charge de la dette qui en résulterait. Nous serions, cette fois, gagnants.
Se focaliser seulement sur la charge de la dette est donc une erreur de raisonnement, une forme de myopie : il faut s’intéresser aussi aux recettes fiscales qui dépendent de la croissance et de l’inflation, nous avons plus à y gagner qu’à perdre. Au total, le choc est positif.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Vous supposez une relation entre croissance et inflation.
M. Anthony Requin. Historiquement, elle se vérifie plutôt, en tout cas sur plusieurs années. Cette année, nous avons eu une croissance plus forte mais sans redémarrage de l’inflation. Mais plusieurs années de croissance arriveraient sans doute à tendre les capacités de production, voire le marché du travail – ce que nous souhaitons tous : il y aurait alors probablement une augmentation des salaires et donc de l’inflation. Il faut aussi compter avec l’état du marché des matières premières.
M. Nicolas Sansu, rapporteur : Nous pourrons faire figurer dans le rapport ce graphique très clair. Il y a en effet beaucoup de fantasmes et d’idées fausses autour du choc de taux. Il y a une erreur grossière. Beaucoup de gens pensent que l’ensemble de la dette verrait ses taux augmenter d’un point, et que l’on paierait 16 milliards de plus dès la première année. C’est une aberration, mais c’est mieux qu’on puisse le dire clairement.
M. Anthony Requin. Il faut surtout souligner la nécessité de regarder, parallèlement, l’évolution des recettes fiscales de l’État. Le résultat peut être positif pour notre économie. Je ne veux pas être lénifiant : certains chocs de taux sont néfastes. Un choc de crédit ferait ainsi augmenter la charge de la dette, sans avoir le moindre effet positif sur les recettes fiscales.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Pouvez-vous nous dire quelques mots du programme de rachat d’actifs de la BCE ? N’y a-t-il pas un risque de bulle obligataire ?
M. Anthony Requin. Il est encore un peu tôt pour dresser le bilan du programme d’assouplissement quantitatif de la BCE : la politique monétaire accommodante remonte à plusieurs années, mais le programme d’achats de titres à grande échelle n’a encore qu’un an – il y a eu un décalage avec d’autres banques centrales qui ont entamé ce mouvement depuis plusieurs années. Cette politique semble avoir été efficace aux États-Unis, où la politique de quantitative easing a été mise en place dès 2008 : l’inflation de base y est maintenant proche de 2 %, voire légèrement supérieure. Tous les espoirs sont donc permis.
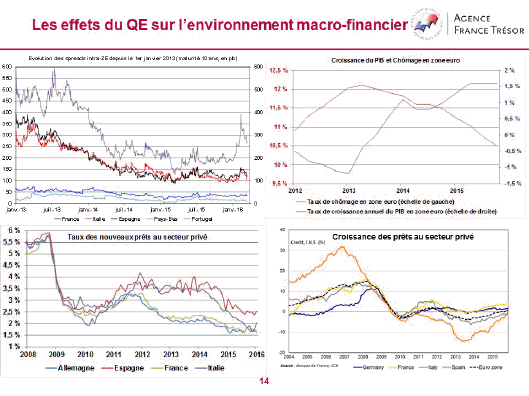
J’ajoute que l’on constate déjà des effets positifs de cette politique. Tout d’abord, la fragmentation financière au sein de la zone euro s’est réduite : on observe les conséquences de ce phénomène sur les dettes gouvernementales. Les taux, mais aussi les écarts de taux, se sont réduits.
On constate également une reconvergence des taux auxquels empruntent les entreprises quel que soit leur lieu d’établissement. C’est un phénomène sain pour la zone euro. On observe encore un redémarrage de la croissance, ainsi qu’une diminution du taux de chômage agrégé au sein de la zone euro. Le programme d’assouplissement quantitatif semble donc bien soutenir la croissance. Celle-ci se traduit enfin par une augmentation des prêts au secteur privé, alors que l’encours de prêts avait diminué dans certains pays.
Quant au risque de bulle obligataire, la BCE y est très attentive. Il y a bien une augmentation de la valorisation des actifs financiers, mais elle ne semble pas déconnectée de l’évolution de l’économie générale. L’augmentation de la valeur des titres obligataires est une conséquence directe de la baisse des taux d’intérêt. En ce qui concerne les actions, la hausse de la croissance et la dépréciation de l’euro peuvent avoir des effets sur les bénéfices des entreprises : la hausse du cours des actions peut donc tout à fait traduire une anticipation d’amélioration des résultats des entreprises. Il n’est donc à mon sens pas nécessaire à ce stade de s’inquiéter du risque de bulle financière.
M. Nicolas Sansu. Merci de ces explications. Je vais vous poser une dernière question : l’AFT est unanimement considérée comme l’une des meilleures agences de gestion de la dette au monde mais j’ai aussi l’impression que vous entretenez une certaine connivence avec le monde de la banque et des marchés financiers.
Les hauts fonctionnaires ne peuvent normalement pas être embauchés par une entreprise privée sans passer par un « sas de décontamination ». Qu’en est-il pour l’AFT, dont la directrice adjointe vient de rejoindre une grande banque française ?
M. Anthony Requin. Les fonctionnaires de l’AFT sont soumis, comme tous les autres fonctionnaires de l’État, à l’obligation de passer devant la Commission de déontologie de la fonction publique, qui émet un avis favorable ou défavorable – avis qui peut s’accompagner de restrictions des contacts que l’agent qui s’en va peut, ou pas, continuer d’avoir avec l’AFT.
Dans le cas que vous citez, ce départ s’est fait non pas vers une banque qui ferait partie des SVT mais vers une structure actionnariale de cette banque. La jurisprudence de la Commission de déontologie avait déjà autorisé par le passé à deux reprises des fonctionnaires du Trésor à occuper des fonctions dans cette association, la Fédération nationale du Crédit Agricole. Cette entité joue un rôle d’actionnaire représentant les banques régionales auprès de la société Crédit Agricole SA.
Je ne connais évidemment pas la nature des débats de la commission, et il s’agit d’affaires privées, comme vous le savez. Il me semble que ce cas particulier est conforme à la jurisprudence de la Commission de déontologie. En revanche, vous ne trouverez pas, je crois, de fonctionnaire de l’AFT qui ait rejoint un SVT.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Il fallait bien que je vous pose la question.
M. Anthony Requin. C’est une question parfaitement légitime, et que je vous remercie d’avoir posée – si vous ne l’aviez pas fait, d’autres auraient continué de se la poser.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Merci de cet échange très intéressant.
Audition du 15 mars 2016
M. Gaël Giraud, directeur de la chaire « Énergie et prospérité » de l’École Polytechnique (X), de l’École normale supérieure (ENS) et de l’École nationale de la statistique et de l’administration économique (ENSAE), et de M. Henri Sterdyniak, conseiller scientifique de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Messieurs Gaël Giraud et Henri Sterdyniak, nous vous remercions d’avoir accepté l’invitation de la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC).
M. Gaël Giraud, directeur de la chaire « Énergie et prospérité » de l’École Polytechnique (X), de l’École normale supérieure (ENS) et de l’École nationale de la statistique et de l’administration économique (ENSAE). Pour répondre aux questions que vous nous avez adressées, je voudrais déjà préciser que la dette publique française a pris des proportions importantes à partir des années 1970, date à laquelle notre pays s’est inscrit dans un mouvement plus large qui a touché presque tous les pays anciennement développés et industrialisés. Ces pays, dont les États-Unis, avaient ainsi très peu de dette publique jusqu’à la fin des trente glorieuses, puis ont vu leur endettement fortement progresser au tournant des années 1970 et 1980. Cette évolution, indépendante de la nature des politiques publiques mises en œuvre, n’a pas uniquement concerné les dettes publiques, car l’endettement privé a également augmenté significativement au cours de la même période.
Que s’est-il passé dans les années 1970 pour que les secteurs public et privé se soient endettés ? La difficulté de l’approvisionnement en énergie constitue le seul facteur exogène qui apparaît à cette époque. En 1970, les États-Unis ont atteint le point culminant de leurs réserves pétrolières (le peak oil). À partir de cette date, la productivité des puits de pétrole découverts dans les années 1930, qui avaient assuré la prospérité américaine au cours des trente glorieuses, s’est mise à décliner à cause de problèmes géologiques bien connus. La productivité des puits exploités selon les techniques conventionnelles d’extraction a décliné d’année en année à partir de 2000 pour la Mer du Nord, et en 2005 pour l’ensemble de la planète. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a reconnu ce fait en 2010 même si des débats subsistent sur la réalité du peak oil si l’on prend en compte les techniques non conventionnelles d’extraction de pétrole.
À partir du deuxième choc pétrolier du début des années 1980, le monde industrialisé n’arrive plus – et n’arrivera plus – à retrouver son niveau de croissance de consommation d’énergie des trente glorieuses. Les investissements réalisés ne parvenant plus à produire suffisamment de richesses – puisque les deux tiers de la croissance du produit intérieur brut (PIB) s’expliquent par la croissance de la consommation d’énergie –, l’endettement, pour la puissance publique comme pour le secteur privé, devient nécessaire pour pallier la faiblesse du rendement des investissements.
Le Japon possède un taux d’endettement bien supérieur au nôtre – 250 % du PIB – la dette des États-Unis représentant 125 % de leur PIB. La France se situe dans la moyenne des pays de la zone euro. Cette situation résulte plus probablement de problèmes planétaires profonds que de décisions de politique publique de tel ou tel gouvernement.
La réponse politique essentielle à la question des endettements public et privé réside dans la transition énergétique, qui devra nous permettre de nous libérer du carcan des énergies fossiles, dont nous n’arrivons plus à accroître la production pour des raisons géologiques. La question de la transition énergétique semble a priori éloignée du traitement de la dette publique, mais elle en constitue en fait la condition. Le paradoxe tient au fait que pour mener la transition vers une économie décarbonée, il faut commencer par s’endetter davantage. Pourtant, telle est la direction dans laquelle nous devons avancer si nous voulons réduire le niveau d’endettement de la puissance publique et celui de la sphère privée, ce dernier s’avérant bien plus dangereux que le premier. Le problème principal de la zone euro réside dans la dette privée et non dans celle du secteur public.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Malgré le transfert de dettes privées dans l’endettement public opéré ces dernières années?
M. Gaël Giraud. Il s’agit en effet d’un problème majeur. L’Irlande était le meilleur élève de la classe en 2007 avec une dette publique qui ne dépassait pas 25 % de son PIB et la dette espagnole n’était que de 40 % du PIB. Un an plus tard, la dette irlandaise atteignait 100 % et celle de l’Espagne ne cesse de croître, à cause du transfert que vous venez d’évoquer, monsieur Sansu. Le secteur bancaire n’a pas voulu assumer ses responsabilités et a fait peser sur le contribuable le coût de ses errements lors de la constitution de la bulle des subprimes. Il ne s’agit néanmoins que d’un facteur aggravant de la raison structurelle de l’augmentation des dettes publiques et privées qu’est l’insuffisance de la production énergétique.
M. Henri Sterdyniak, conseiller scientifique de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE). Nous nous trouvons dans une situation très particulière due à la conjonction de dettes publiques élevées dans les pays développés avec une faiblesse des taux d’intérêt et d’inflation. Les dettes et les déficits publics contribuent à stabiliser la situation macroéconomique et ne constituent donc pas des facteurs de déséquilibre.
Comme l’a dit M. Gaël Giraud, la France ne présente aucune spécificité en la matière, et il ne sert à rien de chercher une propension française à la dépense publique ou au déficit. Les pays développés sont simplement victimes d’un déséquilibre macroéconomique important, dû au triomphe à la Pyrrhus du capitalisme financier. En effet, le capital l’a emporté sur le travail ; les marchés financiers réclament des taux de rentabilité élevés que les entreprises ne peuvent atteindre par des investissements physiques. La finance se développe dans des proportions prodigieuses et, dans le même temps, le marché des biens se trouve déséquilibré et la demande s’avère insuffisante. En outre, les inégalités de revenus croissent fortement – davantage dans les pays anglo-saxons qu’en France –, si bien que les plus pauvres ne peuvent pas consommer. Les fonds de pension, puissants dans certains pays, agissent également au détriment de la demande. Enfin, des pays connaissent des excédents en pétrole quand d’autres, comme l’Allemagne et les Pays-Bas, accumulent des réserves pour financer leurs retraites futures. Au total, la demande doit être soutenue : des bulles financières et immobilières, c’est-à-dire de l’endettement privé, ont joué ce rôle, mais elles ont fini par éclater. Il ne reste donc plus que l’endettement public pour soutenir l’activité.
Le Japon et les pays anglo-saxons acceptent l’endettement public, mais ce n’est pas le cas de la zone euro ; les contraintes issues du traité de Maastricht obligent à y mener des politiques d’austérité. La zone euro souffre d’un double déséquilibre : à celui, structurel, induit par le capitalisme financier, s’ajoute en effet l’écart entre les pays du Nord qui accumulent des excédents et les pays du Sud qui ont dû conduire des politiques d’ajustement de leurs finances publiques. Le résultat est une zone en dépression dans laquelle la France se trouve, entre les deux groupes de pays : en effet, la France n’a pas accumulé d’excédents extérieurs comme l’Allemagne et n’a pas réalisé d’efforts importants de compétitivité, mais a résisté, en partie, aux politiques d’austérité du fait de sa taille. Dans la zone euro, la France est le seul pays à souffrir d’un déficit extérieur et d’un déficit public important. Réduire ce déficit obligerait à mener des politiques d’austérité qui maintiennent la zone euro dans la crise.
La situation est difficile, car il faudrait convaincre certains pays de la zone euro d’accroître leur déficit pour soulager les autres, ce qu’ils se refusent à faire, alors que sans croissance, les déficits ne se résorberont pas.
Les profits des entreprises devraient servir à investir dans la transition écologique, et les ménages disposés à consommer davantage devraient bénéficier de politiques salariales et sociales plus avantageuses. Or aucun pays n’est prêt seul à prendre de telles décisions par peur de perdre en compétitivité. Les politiques de compétitivité nuisent à l’équilibre global de l’économie mondiale. Le défi essentiel consiste à repenser l’équilibre macroéconomique de la zone euro et non à résorber la dette publique.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Peut-on expliquer l’envolée de la dette depuis les années 1970 ? Certains acteurs ont-ils gagné à cette augmentation de l’endettement ? La dette joue-t-elle un rôle dans les politiques publiques menées ? En effet, au nom de la dette, on nous demande d’accepter des mesures qui passeraient plus difficilement sans le prétexte de cette contrainte.
Quelle influence a le quantitave easing (QE) mis en œuvre aujourd’hui ? Monsieur Giraud, pourriez-vous nous présenter plus précisément vos études sur la dette ainsi que vos propositions sur les changements de maturité et d’émission de titres, et sur la renationalisation et la réinternalisation de la dette ?
M. Gaël Giraud. L’un des rôles de la dette publique consiste à stabiliser le système économique, aujourd’hui fragile. Croire que l’économie de marché s’équilibre spontanément relève d’une vision dogmatique, que de nombreux éléments théoriques et empiriques contredisent. L’État a, en réalité, en permanence un rôle contracyclique à jouer pour équilibrer le cycle interne d’une économie de marché. Si l’État refusait d’investir quand le secteur privé ne le fait pas et de relâcher la pression fiscale lorsque l’économie repart, il empêcherait l’activité économique de suivre une trajectoire équilibrée. Il n’y a pas d’économie de marché équilibrée sans intervention permanente de l’État. Cela va à l’encontre de l’idéologie selon laquelle la réduction de l’activité de l’État s’avère toujours positive, cette religion de l’économie de marché n’ayant aucun fondement théorique ou empirique.
Dans le contexte actuel de déflation, le rôle de l’État est encore plus important ; l’austérité budgétaire se révèle catastrophique, et la politique volontariste de réduction de la dette publique une très mauvaise idée. Dans une situation de déflation, la majorité des acteurs privés souffrent d’un surendettement qui les empêche d’investir, ce qui paralyse la machine économique ; l’ensemble des acteurs privés tentent donc de se désendetter en vendant leurs actifs. Or si tout le monde vend simultanément ses actifs, le prix de ceux-ci s’effondre, ce qui entraîne une baisse généralisée des prix. Si les prix baissent plus vite que la réduction de la dette nominale des agents, alors la dette réelle augmente ; par exemple, si j’ai 100 de dette et que je vends pour 10 de mes actifs, mais que le niveau général des prix baisse de 15 %, alors le poids réel de ma dette a progressé. Dans une trappe déflationniste, la dette des acteurs s’accroît si chacun cherche à se désendetter au même moment. Voilà pourquoi les politiques d’austérité imposées à la Grèce sont contre-productives ; le ratio grec de la dette publique sur le PIB ne cesse de s’élever et continuera d’augmenter tant que l’on contraindra ce pays à suivre ce chemin qui conduit à ce que la croissance du PIB restant inférieur à celle de la dette publique.
S’il est indispensable que le secteur privé se désendette pour pouvoir investir et relancer la machine économique, l’État n’a pas à mener cette politique au même moment sous peine d’aggraver la déflation et doit au contraire dépenser et investir. Lorsque l’activité économique sera repartie, l’État pourra à son tour se désendetter.
Le traité de Maastricht interdit les avances de la Banque centrale européenne (BCE) aux États, si bien que la BCE ne rachète de la dette que sur le marché secondaire, c’est-à-dire aux banques et non à l’Agence France Trésor (AFT). Il serait opportun de réviser cette disposition du traité, mais il est impossible d’obtenir un accord politique sur cette mesure aujourd’hui. Si l’on oblige les États à s’endetter auprès d’investisseurs privés, on crée en effet des gagnants, en l’occurrence les investisseurs privés. Ces derniers prêtent à la France à des taux ridiculement bas car ils doivent diversifier leurs portefeuilles, acquérir des titres de la dette publique et en acheter une partie en euros. Dans la zone euro, la totalité du sud de l’Europe est proscrite – certains pays n’ayant d’ailleurs plus accès au marché – et les autres États de la zone euro émettent peu de dettes ; les investisseurs anglo-saxons prêtent donc à des taux presque nuls à la France, non parce qu’ils croient à la vertu de sa politique en matière de finances publiques, mais parce qu’ils souhaitent détenir de la dette publique en euro émise par une économie solide.
L’assouplissement monétaire quantitatif (le QE) mené par les banques centrales américaine, européenne et japonaise – cette dernière prêtant à taux négatif –, a créé un malentendu important, celui de faire croire que les banques allaient prêter à l’économie réelle. La doctrine néoclassique standard défend l’illusion du multiplicateur monétaire, selon laquelle les banques commerciales créeront x euros qui alimenteront l’économie réelle pour chaque euro émis par la banque centrale. Cette théorie s’avère totalement fausse. Quand la banque centrale inonde le marché interbancaire de liquidités, les banques privées ne sont pas obligées de prêter aux acteurs de l’économie réelle et elles ne le feront que si une demande de crédit leur est adressée et si elles y trouvent leur intérêt. Ces deux conditions ne sont pas remplies depuis 2008, car la demande de crédit s’est effondrée à cause du surendettement du secteur privé et les bilans des banques, notamment françaises, se sont beaucoup dégradés. Il ne faut pas croire les dirigeants des banques françaises qui proclament la grande santé de leur établissement : elles sont tellement fragiles qu’elles ont peur de prêter à l’économie réelle où il existe un taux de défaut, naturel pour une économie industrialisée comme la France. Les banques mixtes qui exercent à la fois des activités de marché et de réseau préfèrent prendre part à des opérations à fort effet de levier spéculatif sur les marchés financiers, puisqu’elles disposent de l’assurance publique liée à la garantie des dépôts qui leur permet de gagner beaucoup d’argent lorsque l’opération fonctionne ou d’être sauvées par le contribuable en cas d’échec. Toutes les décisions de QE ont échoué à relancer la machine du crédit bancaire.
La BCE pourrait racheter des créances titrisées émises par les banques privées pour relancer le crédit bancaire, car elle a compris la dangerosité de la trappe déflationniste dans laquelle nous sommes enlisés et est prête à tout expédient pour encourager les banques privées à prêter à l’économie réelle. Cet instrument ne réussira pas davantage que le QE, le secteur privé n’étant plus en mesure de demander du crédit aux banques du fait de la trappe déflationniste et de l’absence totale de perspectives. Les entreprises ont besoin de carnets de commandes remplis et ce n’est pas cet outil monétaire qui stimulera l’activité.
Un pays, l’Australie, a pratiqué le QE for people en 2009 juste après la crise financière. Elle n’a pas connu de grande récession à la suite de l’utilisation de cet instrument, au contraire, cela a permis aux ménages surendettés d’être à nouveau solvables. Ce succès ne signifie pas que n’importe quel QE for people fonctionnerait dans n’importe quelle situation, mais l’on peut étudier cet exemple pour savoir s’il serait opportun de l’importer en Europe.
Le souhait de la BCE de racheter des créances titrisées des banques privées présente le danger de rééditer les erreurs commises sur la titrisation entre 2001 et 2007 et qui ont conduits à la crise des subprimes, les banques ayant prêté pour des projets qui n'avaient aucun sens – que l’on songe aux réalisations immobilières en Irlande ou en Andalousie. Si la BCE envoie le signal aux banques privées de les couvrir pour tous les prêts qu’elles émettront, elle encourage le retour de ce phénomène. La BCE devrait plutôt raisonner avec les États sur la politique industrielle – elle n’en a pas le mandat, mais nous sommes déjà entrés dans une phase non conventionnelle – et effectuer du QE en direction de secteurs fléchés, notamment, celui de la transition énergétique.
M. Henri Sterdyniak. Avant 1980, nous réussissions à spolier les rentiers car les taux d’inflation étaient supérieurs aux taux d’intérêt ; les dividendes étaient relativement faibles et les taux d’intérêt étaient inférieurs à ceux de la croissance. La révolution néolibérale a mis un terme à cette situation, et les taux d’intérêt ont atteint des niveaux très élevés entre 1980 et 2000, période au cours de laquelle les taux de croissance étaient bien plus faibles. La dette publique a augmenté et les rentiers gagnaient beaucoup d’argent grâce aux forts taux d’intérêt ; un effet de boule de neige s’est développé puisque cette situation a déprécié encore davantage la croissance, qui alimentait encore plus l’endettement.
Aujourd’hui, les taux d’intérêt sont très bas, la France s’endettant à des taux négatifs jusqu’à cinq ans. Le taux d’intérêt apparent sur la dette est très bas, à 2,2 %. La rentabilité des investissements se trouve dépréciée et la dette continue à alimenter l’effet de boule de neige, car la croissance du PIB reste inférieure à 2,2 %. La croissance nominale dépassera peut-être le taux d’intérêt de la dette l’année prochaine, et les détenteurs de dette publique y perdront. Cela constituera une bonne nouvelle : par exemple, la retraite par capitalisation ne pourra pas concurrencer la retraite par répartition.
Les marchés anticipent un maintien des taux courts autour de 2 % à horizon de 20 ou 30 ans, car ils ne perçoivent aucun risque d’inflation ni de retour d’une croissance forte. À leurs yeux, la dette de la France ne présente aucun danger. Le problème ne réside donc pas dans une pénurie d’acheteurs de titres de la dette française à taux bas, mais dans le manque d’investissements physiques productifs. Il convient donc d’agir dans le domaine industriel et non financier.
Je ne crois pas au QE for people car c’est à la politique budgétaire de transférer de l’argent au peuple et non à la politique monétaire. La BCE ne peut pas distribuer l’argent qu’elle n’a pas, car elle ne peut pas présenter de bilan déséquilibré sans que la charge de ce déficit ne soit imputée aux États de la zone euro. Les Allemands n’accepteraient pas que l’on contourne ainsi les critères de Maastricht, dont il convient d’affirmer qu’ils ne correspondent pas aux besoins actuels de l’économie européenne.
Il faut relancer un modèle productif français, mais les entreprises n’investissent pas suffisamment par rapport à leurs profits. La BCE n’a pas pour fonction de pallier l’absence des entreprises, surtout qu’elle doit décider de la politique monétaire de l’ensemble de la zone euro. Elle devrait davantage garantir les dettes publiques, mais le reste de la politique économique incombe aux États. Que peut faire la France pour relancer l’investissement dans les secteurs d’avenir comme celui de la transition énergétique ? Il est nécessaire d’approfondir les réseaux entre les entreprises et les acteurs du secteur bancaire et financier comme la banque publique d’investissement, Bpifrance, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et La banque postale, mais également les banques privées. Il y aurait lieu de conclure un pacte productif permettant de soutenir des filières d’avenir – rénovation urbaine, rénovation des logements, énergies renouvelables, transports collectifs – en aidant l’industrie française, en finançant la demande, en organisant l’offre. Il existe des circuits privilégiés pour les habitations à loyer modéré (HLM) et il convient d’en créer de nouveaux pour la transition écologique. Il y a suffisamment d’épargne en France pour financer ces actions, encore faut-il l’orienter différemment.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Le montant des dépôts d’assurance vie correspond environ à celui de la dette de l’État. Ne pourrait-on pas flécher cette épargne pour stimuler le renouveau productif. Ne serait-ce pas assimilable à la réactivation d’un circuit du Trésor ?
M. Gaël Giraud. Il y a deux options pour financer l’investissement : puiser dans des liquidités déjà existantes comme l’épargne – qui s’avère surabondante dans les pays anciennement industrialisés – ou créer de la monnaie. Ces deux actions diffèrent, puisque l’on n’augmente pas la quantité de monnaie en circulation dans le premier cas, contrairement au second.
Les banques commerciales créent de la monnaie tous les jours, ce droit leur étant délégué par l’État qui leur accorde une licence bancaire. La grande quantité d’épargne disponible pourrait nous inciter à puiser dans ces fonds plutôt que d’accroître la quantité de monnaie en circulation. J’approuve cette orientation, mais il n’est pas si simple de mobiliser l’épargne ; en effet, si les compagnies d’assurances la gèrent, le carcan prudentiel de Solvabilité II – ou Solvency II – les dissuadera de procéder à des investissements verts de long terme. Je réfléchis actuellement avec des assureurs pour assouplir le cadre de Solvabilité II et leur permettre ainsi de mobiliser l’épargne qu’ils gèrent dans les secteurs verts. En outre, l’épargne gérée par les banques migre vers les marchés financiers où la rentabilité est élevée tant que les opérations à fort effet de levier réussissent. Tant que les marchés financiers soutiendront la promesse illusoire d’investissements rapportant 5, 10 ou 15 % par an, il s’avérera difficile d’orienter l’épargne vers des investissements dans l’économie réelle qui ne rapportent pas à court terme.
Le mandat de la BCE ne l’autorise pas à intervenir dans ces domaines, mais nous avons abordé une terra incognita depuis la crise financière, et M. Mario Draghi n’hésite plus à mener une politique non conventionnelle, ce qui nous autorise à réfléchir à des actions de la BCE qui n’autorisent pas aujourd’hui les traités.
L’organisation de la zone euro repose sur l’idée d’une séparation étanche entre les politiques monétaire et budgétaire. Comme M. Henri Sterdyniak l’a dit, l’élaboration d’une politique industrielle intelligente concerne la politique budgétaire, mais on ne peut plus penser ces deux piliers de la politique économique indépendamment l’un de l’autre. La politique monétaire n’est pas neutre pour l’emploi, la croissance et les déficits publics car la quantité de monnaie injectée a un impact sur l’économie réelle. Il faudrait donc revenir sur l’indépendance de la banque centrale européenne par rapport au pouvoir politique ; la BCE n’a pas d’interlocuteur politique européen avec lequel discuter, contrairement à son homologue américaine, le manque d’un pilier politique dans la construction européenne se faisant cruellement sentir – et je suis de moins persuadé qu’il émergera un jour. Si le climat politique était différent, je plaiderais vivement pour l’instauration d’un fédéralisme européen qui permettrait la constitution d’un pouvoir politique, qui serait un interlocuteur puissant pour la BCE. Se retrouvant seule, cette dernière se tourne vers le secteur bancaire privé ; ainsi, depuis 2008, aucune décision de la BCE n’a été défavorable au secteur bancaire, y compris le rachat sur le marché secondaire de la dette publique, puisque cela a permis aux banques d’acquérir sur le marché primaire une dette publique garantie par la BCE quelle que soit la qualité de la dette. Les banques ont profité d’un immense effet d’aubaine pour réaliser des marges considérables, de l’ordre de 4 à 5 %, en achetant de la dette grecque, portugaise ou espagnole et en la revendant à un prix plus élevé à la BCE.
Les investisseurs devant diversifier leurs portefeuilles, ils ne sont pas incités à prendre en compte le risque souverain pour la France ; en revanche, ils se montrent très attentifs au risque de faillite des banques commerciales. Cela explique la tempête boursière que celles-ci ont connue pour leurs propres titres en début d’année. Les investisseurs privés internationaux ne sont pas dupes des effets d’annonce commerciaux des banques françaises et savent qu’elles ne sont pas si éloignées de la faillite ; un choc sur les actifs bancaires de l’ampleur de celui de 2008 aurait probablement raison de nos quatre champions nationaux – qui auraient fait faillite en décembre 2008 sans l’intervention massive de l’État. À la demande de M. Klaus Welle, j’ai rédigé l’année dernière un rapport pour le Parlement européen sur le coût d’un prochain krach bancaire dans la zone euro dans le contexte de la construction de l’Union bancaire européenne. J’y concluais que l’Union bancaire européenne, même en 2023, date à laquelle elle doit atteindre son régime de croisière, ne pourrait pas nous protéger d’un krach bancaire de même amplitude que celui de 2008. Dans tous les cas, les contribuables européens seraient à nouveau mis à contribution pour sauver les banques si celles-ci devaient connaître des pertes d’actifs comparables à celles enregistrées en 2008. Un krach de l’ampleur de celui de 2008 avec une Union bancaire fonctionnant à plein régime coûterait environ 1 000 milliards d’euros de PIB à la zone euro en deux ans. Le secteur privé est conscient de cette menace, ce qui explique une partie du désamour des investisseurs pour les banques françaises.
Il convient de reconstruire un mode de financement de la puissance publique en Europe qui ne passe pas par les marchés financiers.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Vous avez davantage traité la question du déficit que celle de la constitution et des risques de la dette. Vos positions s’avèrent en outre très personnelles. Monsieur Giraud, quand vous dites que la transition énergétique sauvera la France, j’ai l’impression que les choses sont un peu plus complexes que cela. Vous affirmez que tous les pays connaissent la même situation en matière d’endettement depuis l’apparition de problèmes dans le secteur des énergies carbonées, mais le cas français m’apparaît spécifique. En outre, 85 % de l’énergie consommée en France est d’origine nucléaire et, par ailleurs, les dépenses fiscales soutenant la transition énergétique sont élevées. Il faudra bien compenser la facture de 60 milliards d’euros que cette transition génère par rapport au nucléaire. D’ailleurs, Mme Ségolène Royal, ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, a annoncé vouloir prolonger la durée de vie des centrales de dix ans – décision aberrante car il faut soit les arrêter soit prolonger leur activité pendant vingt ans du fait de la nécessité d’investir 55 milliards d’euros, charge qui ne pourra pas acquitter en dix ans. Les États-Unis utilisent beaucoup d’énergies carbonées et l’Allemagne, dont la situation est meilleure que la nôtre, a décidé de revenir vers ces énergies.
La dette n’est pas uniquement liée à l’énergie, et les gouvernements français ont pris de nombreuses décisions qui ont eu un impact sur l’endettement. Un quart des dépenses sociales dans le monde sont françaises ! Le passage de l’âge de la retraite de 65 à 60 ans a représenté une forte charge financière. L’abaissement de la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaires a induit un coût annuel de 22 milliards d’euros – 12 milliards d’euros aujourd’hui – pour compenser les charges sociales. Ainsi, dans la dette française, 300 milliards d’euros découlent des 35 heures. Les réformes des retraites et des 35 heures ont généré 600 milliards de dette sur les 2 000 milliards d’euros de la dette française. La baisse de la TVA pour les restaurateurs ou la défiscalisation d’heures supplémentaires ont également contribué à notre endettement. Il est donc aisé de reconstituer la composition de la dette française.
Face à cette situation, vous nous dites qu’il suffit de mettre en œuvre la transition énergétique ! Les pays qui se portent mieux que nous, comme la Chine empruntent le chemin inverse, même si je ne dis pas qu’ils ont raison d’un point de vue environnemental.
La question qui vous est posée concerne les risques pesant sur la dette française, qu’ils aient trait à ses détenteurs ou à son taux d’intérêt. La France court-elle un danger dans ce domaine ? La constitution de la dette découle de choix politiques qui nous incombent. Vous êtes là pour éclairer la Mission d’évaluation et de contrôle sur la gestion de la dette.
M. Henri Sterdyniak. La dette française n’est pas supérieure à celle du Japon, des États-Unis et du Royaume-Uni où la protection sociale est moins développée. L’âge du départ à la retraite des Américains n’a pas été fixé à 60 ans, et pourtant le problème de l’endettement s’est posé ! L’endettement ne dépend pas de telle ou telle mesure de politique économique.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Cela résulte de choix politiques qui ne sont pas l’objet de cette mission.
M. Henri Sterdyniak. Les taux d’intérêt mondiaux sont faibles du fait de déséquilibres macroéconomiques. Si la France était le seul pays à connaître un problème d’endettement, les taux d’intérêt de sa dette seraient plus élevés, ce qui n’est pas le cas, car les marchés n’imposent aucune prime de risque à notre pays. Le problème pour les pays développés est d’ordre macroéconomique.
Le scénario d’une remontée des taux implique que la BCE donne l’impulsion, ce qu’elle ne ferait que si l’inflation et la croissance revenaient. La plupart des économistes et des acteurs du marché ne prévoient pas dans les prochaines années d’augmentation de l’inflation et de la croissance qui justifierait une forte hausse des taux d’intérêt. Si cela devait advenir, ce serait une bonne nouvelle !
M. Nicolas Sansu, rapporteur. En 2016, le déficit devrait s’élever à 72 milliards d’euros ; le CICE coûtera cette année 20 milliards d’euros, mais peut-on dire que le déficit résulte de cette mesure ?
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Les choix de politiques publiques alimentent le déficit. La question de cette mission a trait à la détention de la dette et aux risques qui pèsent sur elle. Nous devons expliquer aux Français comment sont gérés les 2 000 milliards d’euros de dette.
Vous nous dites qu’il faut investir dans le logement social et les transports écologiques, mais je fais cela depuis quinze ans en tant que maire !
M. Gaël Giraud. Sans les intérêts de la dette, le ratio de l’endettement de la France par rapport à son PIB ne dépasserait pas 30 %.
Personne ne connaît l’identité des détenteurs de la dette. L’AFT ne réalise que des estimations sur ceux qui possèdent les titres de dette française. J’ai soulevé ce point auprès du ministère des finances et des comptes publics en 2013 car il n’est pas normal que l’administration puisse se retrancher derrière son ignorance des détenteurs de la dette. Cela fait peser un risque considérable sur l’économie française, car certains de ces investisseurs pourraient vendre leurs titres de dette sans que l’on ne puisse l’anticiper. L’AFT doit exiger des banques commerciales, notamment de BNP Paribas et de la Société générale auxquelles l’Agence a délégué la diffusion de la dette publique française, la transmission de l’identité des acheteurs des titres de la dette.
L’AFT estime que deux tiers de la dette française sont détenus par des non-résidents, alors que cette proportion n’est que d’un tiers en Italie. Au Japon, les résidents détiennent 95 % de la dette publique, si bien que le pays n’est pas menacé par les marchés alors que sa dette culmine à 250 % du PIB.
Il s’agit là d’un enjeu fondamental de souveraineté politique : pourquoi avons-nous laissé au fil des années les banques commerciales gérer la dette publique française et la vendre massivement à des non-résidents ? Cela expose notre pays aux comportements erratiques et non contrôlables de ces investisseurs.
Il faut donc imposer aux banques commerciales un quota de vente des titres de la dette à des résidents, afin de nationaliser la dette publique future.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. L’AFT nous a dit aujourd’hui que si l’on mettait en œuvre une telle mesure, plus personne n’achèterait de dette française.
M. Gaël Giraud. Sur quel fait se fonde-t-elle pour étayer une telle affirmation ?
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Selon l’AFT, si l’on exigeait de connaître l’identité des acheteurs des titres de la dette, plus personne ne voudrait en acquérir.
M. Gaël Giraud. Je ne dis pas qu’il faut rendre publique l’identité des acheteurs, mais l’État doit avoir accès à cette information.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Tout fichier détenu par l’État devient public en France !
M. Gaël Giraud. Vous ne connaissez pas le montant de l’impôt acquitté par les personnes que vous rencontrez ? Il ne s’agit pas d’une information publique.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Cela finit toujours par l’être.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. L’AFT et vous êtes en désaccord, et nous nous posons des questions sur ce sujet.
M. Gaël Giraud. Il n’est pas acceptable que l’on continue à émettre de la dette publique en ignorant l’identité de ses acheteurs ; c’est un problème de souveraineté nationale.
Les banques centrales étrangères des pays de la zone euro constituent une bonne partie des acheteurs non-résidents des titres de dette publique française depuis quinze ans. On aimerait en connaître l’exacte proportion, et il n’est pas normal que l’on ne sache pas le montant de dette détenu par les banques centrales allemande ou autrichienne.
Nous devons connaître l’identité des détenteurs de notre dette pour nous assurer qu’ils ne joueront pas contre nous le jour où le spread français remonterait ce qui se produira quand les taux d’intérêt mondiaux cesseront d’être négatifs. Nos finances publiques ne sont pas assez vertueuses pour séduire les marchés financiers dans un contexte autre que celui, très spécifique, d’aujourd’hui.
M. Henri Sterdyniak. Le spread ne remonterait que si les marchés pensaient que la France allait quitter la zone euro. Les gestionnaires de portefeuille arbitrent entre les rentabilités et les risques, et estiment négligeable le risque que la France quitte la zone euro. Il est donc légitime que la France ait, à une petite prime de liquidités près, le même taux d’intérêt que l’Allemagne. Le risque d’élargissement du spread s’avère faible tant qu’aucun responsable politique ne menace de quitter unilatéralement la zone l’euro.
Il n’est pas possible de demander l’identité des acheteurs des titres de notre dette ; on peut le regretter, mais cela ne se fait pas sur les marchés mondiaux. On peut inciter les Français à détenir des titres de dette publique, mais il n’est pas opportun de dissuader les investisseurs étrangers d’en détenir.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Comment éviter que les titres de notre dette contribuent à alimenter la grande lessiveuse des paradis fiscaux ?
M. Gaël Giraud. Il ne s’agit pas de révéler publiquement l’identité des détenteurs des titres de la dette publique française. Toutes les transactions commerciales internationales, à l’exception de celles de gré à gré, peuvent être connues, des chambres de compensation enregistrant l’ensemble de ces opérations. Cette publicité n’a jamais fait fuir le moindre investisseur. Je ne crois donc pas que l’établissement d’une liste faisant apparaître l’identité des acheteurs de la dette française les dissuade d’en acquérir les titres.
Il serait utile de lancer un grand emprunt national, dont il faudrait expliquer les objectifs aux Français, notamment le financement de grands projets d’avenir.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. J’approuve cette idée. Le problème de la dette française réside dans le fait qu’elle est constituée de charges de fonctionnement et non d’investissement, car notre pays n’investit plus.
M. Henri Sterdyniak. La richesse nette des administrations est supérieure à la dette. On ne sait pas si on s’est endetté pour payer des frais de fonctionnement.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Cela n’a rien à voir !
M. Henri Sterdyniak. Mais si, cela a à voir ! En France, l’État s’endette et les collectivités locales investissent. Ces dernières sont donc riches en patrimoine – piscines et crèches – et le bilan total des administrations publiques s’avère positif, même si celui de l’État est négatif. Les infrastructures physiques représentent un montant financier parmi les plus élevés au monde et se trouvent relativement en bon état. Nos routes sont en meilleur état que les autoroutes allemandes.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Elles sont payées par l’usager.
M. Henri Sterdyniak. Oui. L’État s’endette plus facilement que les collectivités locales en France.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Parce que l’État peut le faire, mais pas les collectivités.
M. Gaël Giraud. Depuis la crise financière asiatique de 1997 et 1998, la plupart des banques centrales des pays du sud sont tétanisées par le risque de fuite très rapide des capitaux dès que les taux d’intérêt remontent, surtout aux États-Unis. Si la Fed relevait ses taux comme elle l’annonce régulièrement, elle pourrait déséquilibrer profondément le Brésil. On ne peut pas reprocher aux banques centrales du sud de tenter de se protéger de la flexibilité des taux de change et de la mobilité des capitaux en accumulant de colossales réserves de change. La responsabilité de cette situation réside dans l’instabilité des marchés financiers qui a provoqué des dégâts énormes en Asie du Sud-Est. L’Europe n’a pas souffert de ces troubles et ne mesure pas la gravité du choc de 1997 pour ces économies.
On n’a peu agi sur la question des paradis fiscaux depuis 2009. La liste noire, puis grise, de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) a été contournée par des accords bilatéraux entre paradis fiscaux. Ces pays ont signé douze accords de transparence comme l’Organisation l’exigeait pour quitter la liste, mais ils les ont en partie conclus entre eux. La véritable question derrière celle des paradis fiscaux a trait aux prix de transfert, cet instrument étant utilisé par des entreprises pour effectuer de l’optimisation fiscale en faisant apparaître dans leurs comptes des profits dans les paradis fiscaux qui ont, en fait, été réalisés dans les pays ayant un fort tissu industriel.
Il convient de mettre en œuvre les promesses formulées par le G20 en 2009 et d’obliger les paradis fiscaux à aligner leur régime fiscal sur celui de pays comme ceux de l’Union européenne (UE). En outre, il faut déployer le même système que celui conçu aux États-Unis, pour empêcher la concurrence fiscale entre les États de la fédération dont profitaient les entreprises pour optimiser leurs impôts. Cette règle, qui a fait disparaître le problème aux États-Unis, oblige les entreprises à déclarer le montant de leurs investissements, la valeur de leurs actifs, le nombre de leurs salariés et le niveau de leur profit. L’OCDE incite à juste titre les États à adopter cette norme de reporting. L’UE devrait se mobiliser sur ce sujet au sein du G20 où son influence pourrait porter.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Monsieur Giraud, vous avez écrit un article dans lequel vous recommandez de faire évoluer la maturité de la dette. Aujourd’hui, on emprunte majoritairement à huit ans, et vous vous prononcez pour une durée de trente ans. Pourriez-vous nous présenter vos idées dans ce domaine ?
M. Gaël Giraud. À cause du poids du service de la dette, la France est soumise à la tentation de « rouler la dette » en empruntant dans huit ans pour rembourser la dette d’aujourd’hui. La loi interdit pourtant un tel schéma de Ponzi, qui consiste à emprunter de l’argent à quelqu’un pour rembourser la dette contractée auprès d’une autre personne. Ce comportement s’avère assez inévitable lorsque l’on n’a pas les moyens de rembourser sa dette. Il faudrait analyser finement le cycle d’endettement de la France depuis une trentaine d’années ; cela montrerait très probablement que l'endettement contracté dans les années 1990 – qui nous coûte très cher aujourd’hui – nous oblige à rembourser une partie des intérêts de la dette en contractant de nouveaux emprunts. Il faut rallonger la maturité de l’endettement pour éviter cet enchaînement malsain pour les finances publiques. Cela n’atténuerait pas l’appétit des investisseurs privés pour la dette française compte tenu de leur besoin de diversifier leur portefeuille.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Il n’y aura pas d’acheteur, car les gens ne se situent pas dans le long terme.
M. Gaël Giraud. Sauf si l’on asséchait les maturités courtes.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Il faut que tout le monde le fasse alors.
M. Gaël Giraud. Il n’y a pas beaucoup d’émetteurs fiables de dette publique aujourd’hui dans la zone euro, ce qui donne une marge de manœuvre à la France.
M. Henri Sterdyniak. M. Giraud, je ne vous suis pas sur le schéma de Ponzi ; la dette française ne sera jamais remboursée parce que les dettes publiques ne sont, fort heureusement, jamais remboursées. L’objectif est de maîtriser le taux rapportant la dette publique au PIB. On rembourse chaque année la partie de la dette venant à échéance et l’on s’endette pour couvrir le nouveau déficit. L’AFT arbitre entre des taux courts négatifs – qui sont appelés à augmenter – et des taux longs qui restent faibles ; elle privilégie l’émission de titres à long terme puisque le taux n’est que de 1,65 % à trente ans.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. L’AFT nous a expliqué que cela devenait plus difficile de trouver des acheteurs pour ces titres. La France vit dans une anomalie où elle emprunte pour payer les intérêts de la dette.
M. Henri Sterdyniak. C’est normal, comment voulez-vous faire autrement ? Le déficit primaire – hors solde de la dette – s’élève à 2 % du PIB, peut-être moins actuellement. On ne peut pas dire que l’on va rembourser intégralement les 30 à 40 milliards d’euros que représentent 1,5 ou 2 % du PIB ! Pour rembourser la dette, il faut un solde primaire positif, ce que ne permet pas l’équilibre macroéconomique. Le solde primaire se trouvait à l’équilibre en 2006, mais la récession a évidemment généré un profond déséquilibre. M. Nicolas Sarkozy a essayé d’alimenter la machine économique en prenant des mesures expansionnistes, mais la crise financière a créé un déficit énorme. Le taux de prélèvements obligatoires a progressé de six points pendant les quinquennats de M. Sarkozy et de M. François Hollande pour réduire le déficit et la dette, mais le résultat économique de ces décisions s’est avéré catastrophique. La dette ne résulte pas de la politique de M. Sarkozy ou de celle de M. Hollande ; il s’agit d’une contrainte macroéconomique qui s’est imposée à l’économie française.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Non, c’est un mode de vie depuis 40 ans, mais cela relève d’un débat politique.
M. Henri Sterdyniak. Si tel était le cas, les taux d’inflation et d’intérêt seraient élevés. Or la situation est inverse aujourd’hui, et on ne connaît pas d’excès de demande.
On ne peut pas demander aux détenteurs de la dette publique de se faire connaître, car l’État saurait quand ils vendent leurs titres de dette, ce qu’ils n’accepteront jamais. On peut en revanche tenter de convaincre les résidents d’acheter les titres de notre dette, comme cela se passe au Japon. On pourrait par exemple leur exposer les risques des placements en Bourse et leur proposer des obligations à cinq ou à dix ans investies dans les collectivités locales ou la transition écologique et rapportant 3 %. Cela constituerait un placement sûr et permettrait de développer l’emploi en France.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Que pensez-vous de la prise en compte par certaines agences de notation du patrimoine des Français pour évaluer la dette publique ?
M. Gaël Giraud. Votre question renvoie au débat de fond sur la façon de rembourser une dette. M. Sterdyniak affirme que l’État ne rembourse jamais sa dette : dans ce cas, on ne regarde même pas le capital du pays puisque l’on part du présupposé selon lequel la dette ne sera pas remboursée. D’autres personnes évaluent le collatéral de la dette – c’est-à-dire le patrimoine du pays – et se rassurent lorsqu’ils constatent, comme pour la France, que le collatéral est bien supérieur à l’endettement. Entre ces deux extrêmes, il existe plusieurs conceptions du remboursement de la dette publique, ce qui explique l’hétérogénéité des points de vue des agences de notation.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Nous vous remercions d’être venus devant la MEC.
Audition du 22 mars 2016
M. Dominique Plihon, professeur d’économie à l’université Paris-Nord, porte-parole de l’Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne (Attac).
M. Jean-Claude Buisine, président. Nous poursuivons les travaux de la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur la transparence et la gestion de la dette publique, et avons le plaisir de recevoir M. Dominique Plihon, porte-parole de l’Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne (Attac).
M. Dominique Plihon, professeur d’économie à l’université Paris-Nord, porte-parole d’Attac. Je vous remercie de m’avoir convié à m’exprimer devant vous. J’enseigne à l’université Paris-Nord, je suis porte-parole d’Attac et membre du groupe des Économistes atterrés, dont vous avez reçu l’un des membres, M. Henri Sterdyniak.
La question de la dette s’avère, plus que jamais, essentielle. La dette publique, même en dehors des périodes de crise, représente un élément majeur du fonctionnement de l’État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale, et plus largement de l’ensemble de l’économie.
À partir de 2007 et de 2008, s’est développée une crise qui est devenue celle des dettes souveraines, la France n’étant pas le seul pays concerné. Les pays de la zone euro ont été très touchés et davantage que les États-Unis ou le Royaume-Uni – le Japon se trouvant dans un cas particulier puisqu’il connaît une déflation et une situation particulière depuis plus de dix ans ; il y a d’ailleurs probablement des enseignements à tirer pour la France et l’Europe de l’expérience japonaise.
Pour gérer au mieux la question de la dette publique, il faut d’abord établir le bon diagnostic. Les Économistes atterrés et Attac sont en désaccord avec le discours habituel sur les causes de l’endettement et les mesures à mettre en œuvre. Une vingtaine d’organisations - partis politiques, syndicats, associations et organisations non gouvernementales (ONG) – se sont regroupées dans un collectif pour réaliser un audit citoyen de la dette publique de la France (CAC), qui a été publié en 2015. Les conclusions du CAC diffèrent grandement du diagnostic et des solutions présentés habituellement.
Un changement radical de politique économique s’est opéré au tournant des années 1980 dans tous les pays avancés, à commencer par les États-Unis. La Réserve fédérale américaine (Fed) et son président, M. Paul Volcker, ont impulsé une politique monétaire conduisant à la montée violente des taux d’intérêt dans le monde. Cette décision a eu des conséquences considérables. Avant les années 1980, le rapport de la dette publique sur le produit intérieur brut (PIB) demeurait relativement stable ; depuis trente-cinq ans, ce ratio n’a cessé de croître, en France comme dans les pays voisins. La dette publique représentait un peu plus de 20 % du PIB en 1980 et 63,4 % en 2007, à la veille de la crise ; depuis 2007, le poids de la dette a explosé puisqu’il représente aujourd’hui près de 100 % du PIB français.
Le discours dominant voit dans la dérive des dépenses publiques la cause principale de la hausse de l’endettement, alors que le CAC a constaté que le ratio des dépenses publiques sur le PIB était resté constant, voire en léger repli. Le CAC estime que c’est l’évolution des recettes qui explique principalement celui de l’endettement. Les recettes de l’État ont baissé sur la période de deux points de PIB. De 1980 à 2007, la moitié de la hausse de l’endettement public s’explique par la baisse des recettes publiques, notamment fiscales.
On peut distinguer trois types d’explications à cette baisse. Il y a d’abord la croissance des dépenses fiscales. La Cour des comptes ne cesse de dénoncer la multiplication des niches fiscales ; on en recense près de 400 dans notre pays. Le crédit impôt recherche (CIR) représentait la dépense fiscale la plus élevée avec 5 milliards d’euros par an, jusqu’à la création du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), qui coûte 20 milliards d’euros par an au budget de l’État. Deuxièmement, la concurrence fiscale – voulue par les entreprises et par ceux qui souhaitent que s’exerce une pression à la baisse sur les impôts – s’est traduite par une diminution du taux d’imposition. Le taux de l’impôt sur les sociétés (IS) est ainsi passé de 45 à 33 % en France, de même que l’on a supprimé les tranches supérieures de l’impôt sur le revenu (IR), ce qui a réduit la progressivité de cet impôt et le niveau des recettes. Enfin, l’évasion fiscale représente, d’après les évaluations de la Cour des comptes, 60 milliards d’euros par an de manque pour le Trésor public.
L’effet « boule de neige » a également nourri la croissance de la dette : lorsque le taux de croissance devient inférieur au taux d’intérêt du remboursement de la dette, celle-ci augmente même en l’absence d’un déficit budgétaire primaire – hors intérêts. De 1980 à 2007, on a constaté presque sans interruption cet effet « boule de neige », que le rapport de M. Gilles Carrez avait décrit dès 2010. Le choc de 1979 sur les taux d’intérêt, découlant d’une politique monétaire très restrictive conduite par la Fed, a donné un coup d’arrêt à la croissance économique. Depuis le début des années 1980, le taux de croissance est passé de 4 à presque 0 %, même si cette contraction ne fut pas linéaire. Les taux d’intérêt ont donc été supérieurs aux taux de croissance en moyenne, cette situation nourrissant la progression de l’endettement. Cet effet explique l’autre moitié de l’augmentation de la dette publique rapportée au PIB entre 1980 et 2007.
Entre 2007 et 2012, la dette française est passée de 63,4 % du PIB à plus de 90 %, ce ratio atteignant près de 100 % aujourd’hui. La violence de l’accélération de l’augmentation de la dette est largement due à la crise, et non à une mauvaise gestion ayant conduit à une progression irraisonnée des dépenses publiques. Des rapports de la Cour des comptes, de l’Assemblée nationale et de divers organismes ont étudié les effets de la crise sur la dette ; tout d’abord, le sauvetage des banques a représenté un coût important – et non nul comme le proclament certains banquiers. Le sauvetage de la banque Dexia a coûté 6 milliards d’euros et l’achat d’actions préférentielles par l’État entre 2008 et 2010 a entraîné, d’après la Cour des comptes, une perte financière pour le Trésor public car ces actions ont été revendues à un cours déprécié. Le renflouement des banques a, au minimum, coûté 12 milliards d’euros. Ce montant fut bien supérieur au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Dans les premières années de la crise, la France a, comme de nombreux autres pays, déployé des plans de relance visant à soutenir l’activité, cette politique ayant entraîné une charge pour les finances publiques, alors même que les recettes se contractaient du fait du ralentissement économique. Il s’agit d’un effet indirect de la crise financière sur le déficit et la dette publics, même si ces mesures ont permis d’amortir la récession. La majorité des pays de la zone euro ont connu une trajectoire similaire à celle de la France au cours de ces années.
Notre constat diffère donc de celui des gouvernements successifs et se trouve partagé par un certain nombre d’élus, qui m’apparaissent néanmoins minoritaires.
Les règles de fonctionnement de la zone euro ont amplifié la crise des dettes souveraines, puisqu’elles ont imposé un ajustement budgétaire bien plus contraignant qu’ailleurs, notamment aux États-Unis. La Banque d’Angleterre (BoE), la Fed et la banque centrale du Japon ont conduit des politiques monétaires différentes de celle de la BCE. Ainsi la BoE n’a pas hésité à racheter massivement de la dette publique sur le marché primaire, ce qui a réduit le coût de la dette en exerçant une pression à la baisse sur les taux d’intérêt et a également contribué à stabiliser les marchés en limitant la spéculation. La BCE, fort contrainte par ses statuts, a choisi une autre orientation. Elle n’est pas intervenue dans un premier temps, puis n’a agi que sur le marché secondaire. La zone euro avance donc dans ce domaine avec un boulet aux pieds que n’ont pas d’autres pays.
En tant qu’Européen convaincu, la clause de non-renflouement – no bail-out – me choque profondément car elle empêche la solidarité entre les États-membres de la zone euro dans le domaine de la dette. Les économistes libéraux justifient cette clause pour éviter l’aléa moral, qui, en garantissant leur sauvetage, inciterait les États à ne pas bien gérer leurs finances publiques. L’expérience de la crise a montré l’inanité de cette clause, la situation étant telle que les Européens durent aider la Grèce, l’Irlande, l’Espagne et le Portugal. Cette liberté par rapport à la clause de non-renflouement s’est accompagnée de mesures violemment restrictives – regroupées dans des plans d’ajustement dits structurels – qui se sont avérées contreproductives, la dette ayant progressé dans ces pays, notamment en Grèce. Le corset des règles de la zone euro a empêché d’innover et de mettre en place rapidement des dispositions exceptionnelles de solidarité.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Notre mission cherche à déterminer le poids de la dette sur les décisions publiques, le problème étant d’ordre politique, et non financier comme on voudrait nous le faire croire.
Jugez-vous illégitime une partie de la dette ?
Dans les années 1980 et 1990, l’effet boule de neige s’est puissamment développé et la détention de titres de la dette est devenue une source importante de prospérité. En revanche, depuis quelques années, les taux d’intérêt sont très faibles et même proches de zéro : comment expliquez-vous cette situation ? Existe-t-il un risque de retournement des taux ? Le quantitative easing (QE) permet-il de juguler ce risque ? La BCE n'intervenant que sur le marché secondaire, certains acteurs profitent mécaniquement de la différence des prix entre les marchés primaire et secondaire.
Rembourserons-nous la totalité de la dette publique ? Est-ce légitime de la rembourser ? Est-ce faisable ? Est-ce souhaitable ?
M. Jean-Claude Buisine, président. Comment jugez-vous les décisions de baisse des recettes fiscales ? Quelle est leur part dans la situation de dette publique élevée ? Convient-il de diminuer les dépenses publiques ? Comment devons-nous procéder en la matière ? La réduction des dépenses publiques mise en œuvre par le Gouvernement actuel vous paraît-elle suffisante ? Si la dette profite à quelqu’un, à qui ?
M. Dominique Plihon. Le CAC qualifie d’illégitime la dette qui résulte de dépenses qui n’ont pas été effectuées dans l’intérêt général. Parmi les 400 niches fiscales, on trouve des exonérations d’impôt pour les plus-values réalisées par les éleveurs de chevaux de course ou pour les fabricants de pipes à Saint-Claude ; la liste de ces dépenses fiscales contient des mesures qui, même si elles n’entraînent pas les préjudices les plus importants pour les finances publiques, sont prises dans un unique but de clientélisme électoral.
Je fais partie des économistes qui dénoncent depuis trente-cinq ans le tournant monétaire opéré au début des années 1980 qui a renversé le rapport de force entre les créanciers et les débiteurs ; avant 1980, les emprunteurs parvenaient à imposer des taux d’intérêt relativement bas et des taux d’inflation plus élevés qui érodaient le poids de la dette. Des dirigeants comme Ronald Reagan, Margaret Thatcher ou Jacques Delors ont cherché à redonner au capital financier le pouvoir qu’il avait perdu ; ils ont ainsi libéralisé la circulation du capital, la mobilité de celui-ci conférant un pouvoir énorme à ses détenteurs, qui ont pu délocaliser et relocaliser les activités économiques à leur guise.
Cette politique a entraîné une montée des taux d’intérêt dans le monde, et d’abord aux États-Unis où ils ont doublé, passant de 10 à 20 %. Les pays latino-américains, fortement endettés en dollars, se sont retrouvés au bord de la faillite dans les années 1990. L’augmentation des taux a entraîné une croissance du poids de la dette, cette hausse possédant un caractère illégitime puisqu’elle était contraire aux intérêts de la majorité des acteurs et ne bénéficiait qu’aux détenteurs de titres de la dette.
Le concept de soutenabilité de la dette s’avère au moins aussi intéressant que celui de sa légitimité. On considère qu’une dette est insoutenable lorsque son évolution et son niveau sont tels que son remboursement induit l’appauvrissement du pays. La Grèce fournit l’exemple d’une dette insoutenable : à la veille de la crise, l’endettement public atteignait 100 % du PIB alors qu’il dépasse 200 % aujourd’hui. L’effet boule de neige et l’évasion fiscale ont joué un rôle prépondérant ; les Grecs paient des taux d’intérêt très élevés et ont connu six à sept années de récession. On impose un remède de cheval à un pays dont on sait pertinemment qu’il ne pourra pas le guérir. Il existe des raisons politiques à cet acharnement qui, sur le plan du raisonnement économique, s’avère absurde.
La dette de la France n’est pas insoutenable, et notre pays pourrait retrouver une situation satisfaisante s’il appliquait certaines mesures et si la crise économique ne durait pas trop longtemps. Le remboursement de la dette apparaît tout à fait possible sans que la population française ne s’appauvrisse. La dette est constituée d’un flux et d’un stock, ce dernier correspondant à l’endettement contracté dans le passé. Certains bons du Trésor sont émis à des taux nuls voire négatifs aujourd’hui, mais ils ne concernent que les nouveaux emprunts. Le stock de la dette recouvre des prêts consentis à des taux d’intérêt bien plus élevés, pouvant atteindre 4 ou 5 %, ce niveau se révélant bien supérieur au taux de croissance de l’économie, compris entre 0 et 1 %. Le taux d’intérêt sur l’encours de la dette étant supérieur à celui de la croissance, l’effet boule de neige existe. Sans être critique, la situation des finances publiques françaises est moins bonne que celle de certains de ses voisins dont l’Allemagne, mais notre pays emprunte à des taux négatifs. Pourquoi ? Les marchés financiers, notamment obligataires, évoluent dans un climat de grande incertitude dans lequel les dettes publiques des grands pays, et notamment celle de la France, représentent une sécurité recherchée. Les investisseurs acceptent donc de payer une prime de risque négative. En outre, l’État français est solide ; malgré l’importance de l’évasion fiscale, le système de recouvrement des impôts fonctionne efficacement, contrairement à celui de la Grèce.
L’Agence France Trésor (AFT) emprunte pour restructurer la dette, c’est-à-dire qu’elle utilise les taux bas pour rembourser plus rapidement, dans la mesure du possible, une dette qui lui coûte cher ; elle cherche à faire tourner la dette – phénomène du roll over – pour diminuer le taux moyen pesant sur la dette. Cette politique rencontre néanmoins des limites, et le coût moyen du stock de dette reste élevé.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. On ne rembourse pas plus que 7 à 8 % du stock de dette actuellement, ce qui n’est pas très important.
M. Dominique Plihon. En effet, et on ne peut que marginalement réaménager la structure de la dette.
Il existe un risque de retournement des taux d’intérêt. Les banques centrales ont baissé les taux jusqu’à 0 %, certains taux étant même négatifs ; elles ont massivement injecté des liquidités pour aider les banques et soutenir l’activité. Les perspectives de redémarrage de l’investissement, de l’emploi et de l’économie étant meilleures aux États-Unis qu’en Europe, la Fed s’engagera dans une politique de remontée des taux en 2016. Elle se montre néanmoins extrêmement prudente à cause du risque de krach obligataire ; en effet, si les marchés anticipaient une montée rapide des taux, ils s’attendraient à une baisse des cours obligataires qui pourrait précipiter une panique contagieuse. La dette obligataire s’avère très élevée dans le monde, elle concerne aussi bien les entreprises privées que les États et représente le plus gros compartiment des marchés financiers. Si le marché obligataire décrochait, les conséquences sur l’économie réelle seraient considérables, car les entreprises et les États se trouveraient contraints de diminuer leurs dépenses. Même si M. Mario Draghi a récemment annoncé la poursuite de la baisse des taux, il faut néanmoins prévoir leur hausse à terme. L’effondrement obligataire n’est pas certain, mais on ne peut pas l’exclure. Mon collègue M. Patrick Artus estime très probable la survenue d’un krach obligataire, alors que je suis moins affirmatif car les banques centrales me semblent disposer des moyens de l’éviter.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Les banques centrales ont injecté beaucoup de liquidités – sans grand effet sur l’économie réelle, d’ailleurs : convient-il d’approfondir cette politique en utilisant la « monnaie hélicoptère » ? Le QE n’empêche pas la dette d’augmenter, et on ne souhaite pas revenir à un circuit du Trésor européen, qui assurerait la solidarité dans la zone euro, le ratio de la dette publique par rapport au PIB pouvant être calculé à son échelle. Que pensez-vous de cette doctrine, qui ne se trouve pas dans les traités européens ?
M. Dominique Plihon. Je comprends les raisons de l’utilisation de l’instrument du QE, mais nous sommes allés trop loin dans cette voie. Les banques centrales ont injecté trop de liquidités, si bien qu’une trappe à liquidité s’est formée, empêchant l’argent de financer l’économie réelle et alimentant des bulles spéculatives sur les marchés financiers. Les liquidités des banques centrales contribuent à nourrir la bulle obligataire, qui pourrait éclater si elles décidaient d’augmenter les taux d’intérêt.
La monnaie hélicoptère consiste à jeter de la monnaie dans l’économie de manière aveugle et ne constitue pas l’instrument le plus efficace pour stimuler l’activité économique, puisque des agents ne manquant pas d’argent et n’ayant donc pas une forte propension à consommer du revenu supplémentaire bénéficieraient comme les autres d’une telle mesure. Il serait plus opportun que la BCE accepte de financer davantage la dette publique sur le marché primaire et que l’État s’engage à utiliser cette marge de manœuvre pour financer des projets prioritaires, comme des actions sociales pour les populations les plus défavorisées et des investissements de long terme pour financer la transition écologique.
La Grèce ne remboursera pas sa dette car elle est insoutenable. La plupart des pays européens seront amenés à restructurer leur dette. Nous sommes plusieurs économistes à souhaiter l’organisation d’une conférence européenne sur les dettes publiques pour discuter de l’état, contrasté, de l’endettement des pays de la zone euro. L’objectif est d’alléger le fardeau de la dette pour permettre à certaines économies de redémarrer grâce, notamment, à des investissements publics de long terme. Il faut envisager une restructuration des dettes, celle-ci pouvant prendre un contour différent selon les pays. Les mesures de restructuration vont de l’annulation – qui concernera la Grèce, une partie de sa dette ayant d’ailleurs déjà été annulée –, au rééchelonnement pour allonger les échéances et à la négociation des taux d’intérêt. Les pays de la zone euro pourraient obtenir une restructuration, mais nous n’en sommes pas là aujourd’hui.
Tous les emprunts publics européens relèvent d’une clause d’action collective ; si un pays se trouve en difficulté et souhaite restructurer sa dette, et que la majorité de ses créanciers acceptent la négociation, alors la minorité ne peut pas la bloquer. Des fonds vautours, ne détenant que 1 % de la dette argentine, ont obligé ce pays à passer sous leurs fourches caudines à cause de l’absence de clause d’action collective pour la dette passée, alors que la majorité des créanciers aimeraient renégocier la dette.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. J’approuve votre proposition, mais elle nécessite de connaître l’identité des créanciers. Comment fait-on pour savoir qui détient la dette sur le marché secondaire ?
M. Dominique Plihon. Si vous demandez une renégociation de la dette, les créanciers vont se déclarer, surtout s’ils craignent de perdre de l’argent. L’opacité sur la détention de la dette constitue en effet un vrai problème, mais il n’est pas impossible pour le Trésor de connaître une partie des créanciers. On sait déjà que deux tiers de la dette sont détenus par des investisseurs non-résidents.
Je ne suis pas opposé à l’utilisation de la fiscalité comme instrument d’incitation. Il est utile de prévoir des exonérations fiscales pour favoriser tel investissement ou telle opération. En revanche, les dépenses fiscales servant les intérêts particuliers m’apparaissent illégitimes.
L’évaluation des dépenses publiques, y compris fiscales, se révèle insuffisante en France. Le CIR, dont l’idée est bonne car il faut cibler la recherche, coûte entre 5 et 8 milliards d’euros par an au budget de l’État, et des rapports, rédigés par l’Assemblée nationale et par la Cour des comptes, ont montré qu’une partie du CIR était utilisée à des fins d’évasion fiscale par les entreprises transnationales. L’absence de réforme de ce dispositif apparaît donc incompréhensible ; on mesure le poids des lobbys, mais les élus et le Gouvernement doivent étudier régulièrement l’efficacité des dépenses fiscales, notamment les plus importantes. Or la France est l’un des pays avancés où les dépenses de recherche privée rapportées à la valeur ajoutée sont les plus basses ; le Royaume-Uni, l’Allemagne et le Japon bénéficient d’investissements privés dans la recherche bien plus dynamiques. Notre dispositif, coûteux, vise à stimuler les dépenses de recherche des entreprises, mais, au bout de plusieurs années, notre pays ne comble pas son retard sur ses concurrents européens en matière d’innovation technologique. La France n’a donc peut-être pas l’instrument approprié de stimulation de la recherche, et nous avons besoin d’un débat public régulier sur les dépenses fiscales.
Une dépense d’investissement de l’État ou d’une entreprise représente une dépense pour l’avenir. Il faut sanctuariser les dépenses d’investissement que l’on considère porteuses d’avenir. La recherche entre dans cette catégorie, de même que l’éducation, les infrastructures ou la transition énergétique. Assainir les dépenses implique de les différencier, de protéger certaines d’entre elles et de régulièrement les passer au crible.
Une personne possédant de hauts revenus et détenant des titres de la dette française bénéficie à la fois de la rémunération de sa créance et d’exonérations fiscales très avantageuses. On doit débattre de ce sujet crucial sur la place publique.
La dette publique s’avère nécessaire et inévitable dans un grand pays moderne comme la France. L’une des missions de l’État consiste à assurer la cohérence intergénérationnelle de la société. Il est normal et sain que le coût de la construction d’un hôpital, d’une route ou d’une école que trois générations utiliseront pendant soixante ans ne soit pas totalement supporté dans le présent ; toutes les générations profitant de l’infrastructure doivent participer à son financement, et l’endettement permet ce transfert intergénérationnel. Cela est fondamental pour la pérennité d’une société, si bien que le discours psalmodiant l’inopportunité de transmettre de la dette à nos enfants ne prend pas en compte l’utilisation de la dépense publique. Le poids des actifs de la France est bien supérieur à celui de sa dette, et notre pays fait partie de ceux ayant les actifs nets publics les plus élevés.
En outre, là où il y a des marchés financiers, on a besoin de la dette publique comme instrument de référence, car il s’agit du placement le moins risqué. Les agents opérant sur les marchés financiers ont besoin de ces taux de référence pour décider d’investir, de prêter ou d’emprunter. Au pied de la courbe des taux d’intérêt, on trouve les taux sans risque, généralement ceux des titres publics. J’ai effectué plusieurs missions dans des pays en voie de développement souhaitant développer leur système financier, notamment obligataire ; je leur conseillais de prendre leur temps, d’attendre d’avoir suffisamment d’émissions pour rendre leur marché liquide et de gérer leur dette publique de façon à ce que ses titres jouent l’indispensable rôle de référence pour l’ensemble du système financier.
Si une crise obligataire profonde atteignait demain les dettes privées et publiques, le système financier entrerait dans une situation très grave car les acteurs risqueraient de perdre le point de référence du taux d’intérêt appliqué à la dette publique. Je ne suis pas un fanatique du développement à outrance des marchés financiers – nous empruntons d’ailleurs trop sur le marché obligataire et pas assez auprès des banques, ces dernières devant être réformées –, mais il faut disposer d’un marché obligataire, celui-ci ayant besoin de la dette publique pour bien fonctionner.
M. Jean-Claude Buisine, président. Une harmonisation fiscale dans l’Union européenne (UE) ne permettrait-elle pas de régler en partie la dette française ? La suppression des nombreuses niches fiscales ne contribuerait-elle pas à réduire la dette ?
M. Nicolas Sansu, rapporteur. La part de dette publique détenue par des non-résidents est-elle trop élevée ? Doit-on réinternaliser une partie de la dette ? Doit-on recréer un circuit du Trésor européen afin de diluer le risque – même si le taux restait identique ? Il y a beaucoup d’épargne en France, et l’on pourrait mobiliser cette ressource pour la dette publique.
M. Dominique Plihon. Il est anormal qu’existent des écarts de fiscalité sur les titres obligataires entre les pays européens ; M. Jean-Claude Juncker et M. Jonathan Hill tentent de nous vendre leur projet d’union des marchés de capitaux (UMC), auquel je suis très opposé. Ils mentionnent à peine la question de l’harmonisation fiscale, alors qu’il s’agit de la première mesure à adopter. Les distorsions pèsent sur les pays ayant une fiscalité élevée comme la France.
Au Japon, l’essentiel de la dette publique est détenu par les résidents, et nous devrions nous inspirer de ce modèle en renationalisant notre dette. Des mesures réglementaires pourraient contraindre les banques et les investisseurs à détenir davantage de dette publique – bien que les banques en aient déjà beaucoup puisque ces titres étant réputés sans risque, leur détention améliore les ratios prudentiels. Sans aller jusqu’au plancher de possession de bons du Trésor imposé aux banques dans les années 1950, on pourrait imaginer une réglementation plus coercitive – ou plus incitative – visant à ce que les banques aient davantage de dette publique. Le système japonais se révèle assez autoritaire : les investisseurs comme les caisses d’épargne et de retraite doivent détenir une partie importante de la dette publique. On pourrait s’inspirer de cet exemple.
Les Français épargnent, en moyenne, une part importante – 16 % – de leur revenu, quand les Américains affichent un taux d’épargne presque nul. On pourrait dire aux Français d’épargner pour financer des projets français. La caisse des dépôts et consignations (CDC) a financé le logement social et les collectivités territoriales grâce au livret A. Il serait opportun de réhabiliter – en la modernisant – cette procédure, afin que l’argent des Français soit utilisé à des fins auxquelles ils adhèrent. Lorsque l’on laisse son argent à la banque ou le place dans un contrat d’assurance-vie, on ignore son utilisation. Attac défend l’idée, encore minoritaire, de création de coopératives et d’institutions publiques ou privées chargées d’utiliser l’épargne pour des actions recueillant l’assentiment de ses détenteurs, comme la création de crèches, d’écoles ou l’aide à la réinsertion. Il faut développer cette épargne solidaire – qui permettrait de renationaliser une partie de l’épargne –, la France accusant un retard en la matière par rapport à l’Italie ou à l’Espagne. L’État devrait s’engager dans cette voie qui correspond à l’intérêt général et l’Assemblée nationale devrait impulser une dynamique en ce sens. Il ne s’agit pas d’instituer une économie dirigiste, mais de favoriser des investissements éthiques qui correspondent à ce que les citoyens souhaitent pour eux, pour leurs enfants et pour leurs collectivités territoriales.
Toutes les banques locales françaises ont disparu ou été rachetées par de grands groupes. L’utilisation des fonds par les banques françaises est totalement opaque. Le législateur pourrait contraindre les banques à rendre des comptes sur l’usage des fonds déposés dans leurs caisses. Dans le cadre de cet assainissement, on pourrait mieux défendre l’utilité du financement de l’État, qui permet à la France de bénéficier d’un système de santé et d’une école publics.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Peut-on connaître la part des titres de dette publique placés dans les paradis fiscaux ?
M. Dominique Plihon. La loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a opportunément obligé les banques à publier les activités, les effectifs et les résultats de leurs filiales étrangères, y compris celles opérant dans les paradis fiscaux. La plateforme des paradis fiscaux et judiciaires, à laquelle participe Attac, vient de publier un rapport pointant les comportements des banques dans ces endroits.
Il conviendrait d’amender la loi de 2013 pour que l’information sur l’activité des banques, et notamment celle de leurs filières étrangères, soit davantage détaillée, cette mesure devant être étendue à l’ensemble des entreprises multinationales. Enfin, l’Assemblée nationale a refusé, lors d’une séance de nuit au cours de laquelle peu de députés étaient présents, de rendre publique la communication de données – ou reporting – portant sur l’activité des banques. Cela est regrettable, car on aurait créé là un fort moyen de pression sur les acteurs financiers.
M. Jean-Claude Buisine, président. Je suis d’accord avec vous, mais c’est à l’UE de mettre en œuvre le reporting, car mettre seuls en œuvre cette mesure exposerait nos banques et nos entreprises.
M. Dominique Plihon. Oui, mais le Gouvernement se bat-il au sein de l’UE pour faire avancer ce projet ?
M. Jean-Claude Buisine, président. Je l’espère et je pense qu’il agit. Je suis optimiste quant au fait que les choses vont avancer sur ce front.
Nous vous remercions, monsieur Plihon, d’être venu devant notre mission et de nous avoir fourni toutes ces explications.
Audition du 29 mars 2016
Audition de Mme Natacha VALLA, économiste.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Merci, madame, d’avoir répondu à notre sollicitation.
Mme Natacha Valla, économiste. Merci de donner de la valeur à mes analyses en me recevant. Je commencerai, avant d’insister sur quelques faits saillants, par deux remarques liminaires.
Votre mission s’intéresse à la transparence de la dette publique : celle-ci indispensable, ne peut être complète sans la transparence des finances publiques elles-mêmes, des déficits, des flux de trésorerie… – et cela à tous les niveaux, c’est-à-dire jusqu’au niveau des collectivités territoriales. Ceci est indispensable tant pour l’analyse économique que pour la perception que peuvent en avoir les citoyens et les marchés. Ces données devraient idéalement être disponibles de façon plus fréquente qu’aujourd’hui, et moins décalée dans le temps : cela nous permettrait de mieux comprendre la dynamique de la dette publique. Elles devraient, de plus, couvrir aussi ce que l’on appelle le « passif contingent » de la sphère publique, notamment les garanties. Celles-ci, peu coûteuses en termes maastrichtiens, peuvent en effet devenir des charges très lourdes à long terme. Il ne faut pas non plus oublier les créances et les prêts non performants envers le secteur du Gouvernement, ainsi que les participations et la dette des entreprises publiques – et sur ce dernier point, la France n’est pas mal placée. On parle peu aujourd’hui de cette « para-dette », mais elle pourrait devenir un sujet brûlant, notamment dans le cadre de discussions sur une éventuelle mutualisation des dettes publiques et des engagements des entités publiques au sein de la zone euro.
D’autre part, la transparence de la dette publique implique l’indépendance de plusieurs institutions. Je pense d’abord aux hauts conseils des finances publiques, dont la composition diffère beaucoup selon les pays de la zone euro. Pour que nos partenaires acceptent d’aller plus loin dans la construction de la zone euro, il est indispensable que le Haut Conseil des finances publiques français comprenne des experts vraiment indépendants du ministère de l’économie et des finances comme du monde politique. Je pense à certaines des propositions du rapport des cinq présidents ou à d’autres initiatives institutionnelles majeures qui pourraient concrétiser une véritable Europe budgétaire. Le Haut Conseil doit également disposer d’un accès illimité aux données.
Sont également concernées les institutions nationaux de statistiques comme, en France, l’INSEE, qui devrait être indépendant du ministère de l’économie et des finances, de jure comme de facto. Il faudrait également prévoir une obligation de publication des données concernant notamment les finances des collectivités territoriales, sous un format exploitable – cela peut apparaître comme un détail, mais ce n’en est pas un.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Nous reviendrons sans doute sur la question de l’indépendance, réelle ou supposée – personne n’est jamais vraiment indépendant… Mais je ne comprends pas bien vos remarques sur la transparence des finances des collectivités locales : les données existent, elles sont publiées par la direction générale des collectivités locales (DGCL). Je sais aussi que Jean-Pierre Gorges ne manquera pas d’insister sur le fait que les comptes des collectivités territoriales sont par construction à l’équilibre, et qu’elles remboursent leurs dettes.
Mme Natacha Valla. Je pensais plutôt, en l’occurrence, à l’harmonisation et à la centralisation de ces données à l’échelle européenne. Certains exemples – celui de l’Autriche, notamment, avec les déboires financiers de la Carinthie – ont montré que les données agrégées au niveau national ne suffisaient pas toujours à analyser la situation de la dette publique dans un pays donné. L’harmonisation et la disponibilité effective de données aussi fines que possible sont indispensables.
Nous reviendrons certainement sur le rôle des collectivités territoriales et l’effort budgétaire de plusieurs milliards par an qui leur est demandé : elles sont dans une situation difficile qui implique une réflexion d’ensemble sur les dépenses publiques mais c’est un autre sujet.
J’en viens aux faits qui me paraissent importants.
La durée de vie moyenne de la dette française est aujourd’hui de 7 ans et 35 jours. Cela me paraît une bonne chose ; la stratégie d’allongement de cette durée a bien fonctionné. Le taux moyen pondéré est historiquement bas, la courbe des taux comportant même une large section de taux négatifs.
Une part non négligeable de la dette est détenue par des non-résidents, ce qui a des inconvénients mais aussi, il faut le souligner, des avantages.
Le marché de la dette d’État française – avec un stock d’environ 1 600 milliards – est l’un des plus gros du monde. La dette française est très liquide, et le marché très profond. C’est un point essentiel, et l’une des responsabilités de l’État dans sa gestion de la dette publique est de préserver ces caractéristiques : elles sont très appréciées des investisseurs, ce qui nous apporte une stabilité financière essentielle qui est même, de mon point de vue, de l’ordre du bien public.
S’agissant de la situation budgétaire de la France, le déficit se réduit mais il demeure important depuis 2009 – année certes exceptionnelle. Nous avons du mal à revenir à des niveaux de déficit qui permettraient de ne pas faire exploser la dette. La crise de 2009 est arrivée après une période plutôt heureuse de consolidation de la dette publique : de 2006 à 2008. L’inertie de la dépense publique est forte – je le dis de façon non normative : c’est inévitable. Il y a dès lors aussi beaucoup d’inertie dans les déséquilibres des comptes publics.
En ce qui concerne la politique fiscale, elle a été marquée par des allégements ciblés sur les entreprises – crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), deuxième étape du pacte de responsabilité, plan d’investissement pour les TPE et PME… Cela a permis de stabiliser – on pourrait dire diminuer, mais on reste dans l’épaisseur du trait – le taux de prélèvements obligatoires. Il demeure élevé, mais il était important de ne pas aller encore au-delà notamment en raison des classements qui nous comparent à nos partenaires de l’OCDE.
Il est un peu plus difficile de parler des dépenses publiques : bien que leur hausse ralentisse depuis 2012, elles continuent de croître. Nous souffrons d’un effet de niveau assez défavorable, puisque le taux de croissance des dépenses publiques entre 2007 et 2009 était élevé ; cela rend la consolidation plus compliquée.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. La dette française est très liquide et le marché très profond, c’est entendu, mais n’est-ce pas là seulement l’effet de la politique d’assouplissement monétaire quantitatif (Quantitative Easing, QE) de la Banque centrale européenne ? L’Autriche a récemment rencontré des difficultés pour placer sa dette ; elle n’est pourtant pas dans une situation plus délicate que nous. La BCE nous aveugle-t-elle ?
Mme Natacha Valla. La BCE aveugle, oui, et le réveil sera extrêmement difficile – même s’il ne se produira pas tout de suite, mais peut-être dans quelques années. La formation des prix sur le marché obligataire, et en particulier le marché des dettes souveraines de la zone euro, est aujourd’hui une anomalie.
La liquidité de la dette française, préexistait à la mise en place du QE. Des pays comme l’Autriche ou l’Allemagne dont les émissions nettes sont moins importantes que les nôtres, peuvent voir se produire un phénomène de raréfaction de leurs titres de dette sur le marché : la demande est forte, mais l’offre très limitée – d’autant qu’il y a une forte rétention de titres. Il y a donc un assèchement de la liquidité, provoqué en partie par les achats massifs de la BCE. Ce n’est pas le cas de la France, en tout cas pas encore : le système européen des banques centrales trouve encore suffisamment de papier français pour mettre en œuvre le QE tel qu’il a été conçu.
La BCE réfléchit, sans que je puisse dire si elle s’approche d’une décision, à un rééquilibrage des proportions de ses achats de dettes, souveraines et non souveraines – elle achète en effet 88 % de papier souverain mais aussi 12 % de papier para-souverain, c’est-à-dire émis par des agences, par la Caisse des dépôts, par des banques multilatérales… Il s’agit de répondre à ce problème de liquidité dû à l’intervention de la BCE, que vous soulevez très justement : la BCE achèterait alors moins de dette allemande et autrichienne. Il serait néanmoins difficile d’acheter moins de dette à l’Allemagne sans en acheter moins à la France : les quantités sont importantes, et la répartition du capital de la BCE dépend grosso modo du PIB des États membres.
À mon sens, il serait logique d’en arriver à une telle solution : la BCE pourrait se retirer un peu du marché des dettes du monde germanique, l’offre étant moins importante, et elle se retirerait alors aussi quelque peu du marché français. Placer notre dette serait sans doute plus compliqué, mais je ne pense pas que cela provoquerait une forte augmentation des spreads français. C’est un élément à garder à l’esprit, car la situation n’ira pas en s’améliorant au fur et à mesure que la BCE continue sa politique d’achat de titres.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Pourquoi les emprunteurs achètent-ils des obligations dont les taux sont négatifs ? C’est un phénomène aussi nouveau que mystérieux, même pour nos interlocuteurs venus du monde de la finance. Une telle situation peut-elle être durable ?
Pouvez-vous revenir sur le lien entre l’inflation et la dette publique ? Les Américains réussissent à faire repartir l’inflation, mais ce n’est pas notre cas. Ce que l’on aimerait, c’est plutôt la combinaison de taux faibles et d’un petit fond d’inflation…
Mme Natacha Valla. La question des taux négatifs est en effet complexe, y compris juridiquement. Je ne crois pas qu’il y ait aujourd’hui chez les investisseurs de stratégie d’allocations d’actifs spécifiquement liée aux taux négatifs. Il faut souligner l’importance des anticipations de taux : un investisseur obligataire pense à son coupon, mais aussi à l’évolution de la valorisation du titre, de son prix de marché. Or les investisseurs qui anticipent une baisse des taux – indépendamment du fait qu’ils soient positifs, nuls ou déjà négatifs – considèrent qu’en achetant aujourd’hui, ils auront fait un gain en capital. Dans la gestion d’actifs, ce sont les anticipations qui comptent : tant que les investisseurs s’attendent à voir les taux diminuer, ils accepteront des obligations à des taux négatifs, en raison de ces gains hypothétiques en capital.
Combien de temps dureront ces anticipations négatives ? Nous sommes déjà en territoire très fortement négatif : allons-nous atteindre un plancher ? Le jour où un retournement se produit, les investisseurs auront la perspective non seulement d’un taux négatif, mais aussi d’une perte en capital. Nous nous en rapprochons inévitablement : les investisseurs feront alors un raisonnement différent de celui qu’ils font aujourd’hui et arbitreront différemment entre les possibilités qui s’offrent à eux.
Il faut aussi noter qu’il n’y a plus aujourd’hui – du fait du QE – d’arbitrage entre les différentes dettes souveraines, voire entre les dettes souveraines et celles des entreprises. Toutes les primes de risque ont été écrasées. On pensait que les taux négatifs seraient l’euthanasie du rentier : cela ne s’est pas produit ; le rentier s’en sort très bien, grâce aux anticipations de taux. Mais cela pourrait changer.
Enfin, les contraintes prudentielles sont extrêmement fortes : les gestionnaires d’actifs raisonnent dans une sphère très contrainte.
S’agissant des relations que l’on peut établir entre l’inflation et la dette publique : l’inflation réduit la dette publique et la dette publique peut créer de l’inflation. On aurait alors un cercle que je n’ose pas appeler vertueux – les macro-économistes n’aiment pas l’hyperinflation. Dans le contexte actuel, l’inflation est bien l’instrument le plus efficace pour gérer, à moyen et long terme, notre stock de dette publique : un taux de 3 %, voire 4 % nous aiderait vraiment beaucoup.
Les dynamiques d’inflation et de dette publique ont fait l’objet de nombreux travaux académiques. Aux États-Unis, le ratio de dette publique par rapport au PIB, qui dépassait largement les 100 % du PIB en 1946, a chuté de 40 % en une décennie. Grâce à la croissance, et donc aux recettes qu’elle engendre, les déséquilibres des comptes publics s’ajustent bien plus facilement : il y a bien un rôle favorable de l’inflation. A contrario, dans les phases où l’on doute du potentiel de croissance à long terme, il est difficile de sortir de la dette par la dynamique macroéconomique classique, croissance et inflation. Sommes-nous dans une stagnation séculaire ? Le débat est en cours.
Le chiffre important, c’est bien celui du ratio entre la dette et le PIB nominal : si le second croît plus vite que la première – grâce à l’inflation ou grâce à la croissance réelle –, tout va bien ; la dette se réduit.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. La dette se réduit alors en proportion du PIB, mais pas en valeur ! Si les dépenses publiques continuent d’augmenter, le déficit est toujours là, et la dette galope… La clé, c’est le retour à l’équilibre des comptes publics.
Mme Natacha Valla. Absolument. Depuis que nous avons supprimé les avances au Trésor, seul le marché nous permet d’assurer que les recettes couvrent les dépenses… Le raisonnement que je tenais est valable ceteris paribus, pour un scénario de dépenses publiques donné. Si les dépenses publiques dérapent, on revient à la case départ.
M. Jean-Claude Buisine, rapporteur. Vous avez, ai-je cru comprendre, mis en cause tout à l’heure l’indépendance de l’INSEE. Comment comprenez-vous son rôle aujourd’hui ?
Mme Natacha Valla. Il ne faut voir dans mes propos aucun sous-entendu sur les influences possibles de Bercy sur les chiffres données par l’INSEE.
Formellement, il y a un rattachement organique. Or, dans un souci d’objectivité, dans une vision d’audit, c’est une situation qui n’est pas idéale. J’aime faire le parallèle avec les banques centrales, dont l’indépendance a été essentielle pour lancer la zone euro, et aussi avec le Royaume-Uni. Cette indépendance doit être comprise de façon large, non seulement juridique, mais aussi financière.
De façon générale, il serait essentiel pour leur crédibilité vis-à-vis des investisseurs de tous ordres du monde entier que les États émetteurs d’instruments souverains sur les marchés – et pas seulement la France – disposent d’organismes statistiques parfaitement indépendants.
Il existe des moyens simples et efficaces – notamment en termes de séparation organique – de prévoir une indépendance totale.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. L’indépendance de la BCE est toute relative, en tout cas en termes de positionnement idéologique… Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que veut dire, en l’occurrence, l’indépendance. De la même façon, le Haut Conseil des finances publiques n’a rien d’indépendant. Pourquoi les universitaires seraient-ils plus indépendants que les politiques ? Le savoir n’est pas détaché des engagements de chacun – qui peuvent différer, même chez les économistes, et c’est bien normal. Cette question de l’indépendance me paraît donc un peu vaporeuse.
On parle, en France, de la dette comme d’une catastrophe ; on nous impose beaucoup de choses au nom de la dette. Or celle-ci est élevée, certes, mais elle est peu ou prou au même niveau que celle des pays comparables, même ceux dont les politiques publiques n’ont rien à voir. Les États-Unis n’ont pas de sécurité sociale, et pourtant ils ont une dette publique bien plus élevée que nous ; la dette du Japon est extrêmement importante. Pourquoi alors une telle pression en France, et plus généralement dans la zone euro ? La BCE – qui n’est ni la Fed, ni la Banque d’Angleterre – est-elle en cause, ou bien sommes-nous effectivement fragiles ?
Je ne suis pas sûr pour ma part que la dette soit uniquement une accumulation de déficits passés. Jean-Pierre Gorges reparlera sûrement des 35 heures, et votre serviteur des niches fiscales diverses et variées… Mais la principale question n’est-elle pas celle d’un déséquilibre macroéconomique ?
Mme Natacha Valla. La question de la dette publique revêt aujourd’hui une double dimension. D’une part, il y a la question de l’héritage des politiques passées, qu’il faut gérer aujourd’hui : c’est une proportion du PIB, donc finalement une capacité à rembourser. D’autre part, il y a la façon dont cette dette peut, ou pas, se traduire en croissance et plus généralement en bien-être dans le futur.
L’analyse par les uns et les autres – je parle ici de façon très générale – de la situation de chaque pays se fonde, de façon plus ou moins objective et plus ou moins intuitive, sur la perception du respect, ou non, de la contrainte budgétaire intertemporelle. Un État, en fonction des trajectoires de ses dépenses et de ses recettes, des politiques publiques, de la structure de l’économie, peut-il rembourser sa dette aujourd’hui, mais aussi dans dix, trente, voire cinquante ans s’il émet des obligations pour de telles maturités ? Si tout le monde pense que oui, alors il n’y a pas de raisons de s’inquiéter. La dette en soi, vous avez raison, n’est pas un problème ; ce qui peut le devenir, c’est la dette non soutenable.
Il ne faut pas faire table rase du passé, mais il faut partir de la situation actuelle : comment ces conditions initiales nous permettront-elles d’avoir une croissance soutenable et de stabiliser la trajectoire de notre dette, donc de respecter notre contrainte budgétaire intertemporelle ?
Les dynamiques de dette des dix ou vingt dernières années ont été explosives, en France, en zone euro ou aux États-Unis – il y a quinze ans, notre ratio de dette sur PIB était de 40 % inférieur à ce qu’il est aujourd’hui ! Il y a eu une accélération – explicable, notamment par la crise mais le fait est qu’aujourd’hui, les ratios de dette sur PIB sont bien plus élevés qu’hier.
Ne faudrait-il pas lever le tabou qui pèse sur le traitement de la dette héritée du passé, ce que les Anglais appellent la legacy debt ? Ne pourrions-nous pas calculer les ratios de dette qui nous permettraient de respirer, de mener des politiques publiques, d’avoir une croissance soutenable et, en fonction du résultat – 60, 70, 80 % – trouver un mécanisme qui permette de réajuster les compteurs et de repartir avec une dynamique de croissance ? C’est un premier ensemble de questions. Je ne comprends pas que l’on puisse faire semblant de faire l’économie d’une réflexion sur la BCE de ce point de vue. Certains pays de la zone euro ont des ratios de dette sur PIB qui empêchent, on le sait, tout remboursement de la dette, quel que soit le scénario macroéconomique. C’est la question de la dette héritée du passé.
Sur la façon dont la dette s’est composée, et de la dépense excessive qui en est à l’origine, je suis entièrement d’accord avec vous. Quant à la stabilité et au respect de la contrainte budgétaire intertemporelle, les observateurs estiment qu’ils dépendent de nombreux facteurs – priorités des gouvernements mais aussi pressions de marché que la France a eu la chance de ne pas connaître, au contraire de l’Italie par exemple.
Plus de 60 % de la dette est détenue par des non-résidents : c’est un avantage si l’on utilise l’inflation pour réduire sa valeur réelle, puisque ce sont les détenteurs étrangers qui en souffriront le plus ; mais c’est un inconvénient parce que cela nous expose à une certaine volatilité des flux de capitaux.
Les investisseurs considèrent qu’ils pourront continuer à prêter à la France si les dépenses publiques sont faites à bon escient, si elles servent à la construction des institutions – et celles de la France ne sont pas si mauvaises – et à mener de bonnes politiques publiques, notamment en matière de services publics, d’éducation et de santé. Tous ces facteurs, qui définissent un pays comme avancé, non seulement économiquement mais aussi socialement, sont pris en considération par les investisseurs : ce sont ces éléments, à la fois structurels et économiques, qui peuvent rendre soutenable une trajectoire de dette donnée.
Certains pays de la zone euro rencontrent des problèmes de gouvernance, des problèmes institutionnels qui feront que pour un même niveau de dette et une même perspective de croissance, une trajectoire de dette donnée ne sera pas soutenable alors qu’elle le serait dans un autre pays mieux géré. La France, je crois, n’est pas si mal placée que cela. Ce doit être une priorité de préserver ces qualités et cet environnement construit par les générations et les gouvernements successifs.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. C’est une discussion sans fin : quelle partie de la dette est due à des dépenses de fonctionnement ? Nous ne sommes pas un pays qui investit beaucoup, 80 % de notre déficit est dû à du fonctionnement.
Vous dites que nos services publics sont bons : cet avis n’est pas partagé par tous, notamment quant aux fonctions régaliennes – la justice ou la police. Mais on est là dans des domaines en partie subjectifs.
Mais qu’est-ce que les Français sont prêts à accepter pour payer cet équilibre ? On parlait des collectivités territoriales, mais elles ont une fiscalité propre : l’eau, les transports, le traitement des ordures sont payés par l’usager… Il y a quelqu’un qui paye ; leurs comptes sont équilibrés car la loi nous y oblige.
Nicolas Sansu et moi avons tous les deux raison : une commission d’enquête a chiffré le coût des 35 heures à 300 milliards, et la retraite à 60 ans a coûté cher, mais les niches fiscales de l’impôt sur le revenu nous coûtent 86 milliards, et il y a aussi les exonérations de TVA, par exemple… Nos dépenses fiscales sont donc très importantes et personne n’ose assurer la cohérence de notre système. Le problème est essentiellement politique, puisque l’on pourrait calculer facilement le montant de TVA qui nous mettrait à l’équilibre – une étude soulignait récemment que l’une des particularités de la France est de ne pas utiliser la TVA comme un instrument d’équilibre budgétaire.
En 1981, le passage de 40 à 39 heures a coûté cher, mais on jouait avec l’inflation et la dévaluation… L’avènement de l’euro a cassé ces outils traditionnels ; à partir de 2002, l’Allemagne amène de la flexibilité et nous apportons de la rigidité.
Aujourd’hui, il y a plusieurs scénarios : certains pensent que la croissance va revenir, mais personne ne sait comment, puisque l’on ne veut ni rogner sur des avantages, ni augmenter l’impôt ; aux extrêmes, certains disent qu’il ne sert à rien de rembourser la dette, que notre argent est bien dépensé et que rechercher l’équilibre budgétaire, c’est inutile ! Ma question porte sur un scénario plus brutal, sur lequel je n’ai pas entendu les journalistes interroger le Front national : sortir de l’euro nous permettrait à nouveau de jouer avec la monnaie ; mécaniquement, cela créera de l’inflation et la dette s’amenuisera.
Quelles seraient selon vous les conséquences pour notre dette d’une sortie de l’euro en 2017 ?
Mme Natacha Valla. En matière de comptes publics, les arbitrages, en l’absence de la possibilité de dévaluer la monnaie, sont bien sûr plus douloureux. Je suis assez d’accord avec ce que vous disiez sur la composition de notre déficit. Je veux surtout insister sur le fait qu’on aurait tort de croire que malgré le désinvestissement, ou le ralentissement de l’investissement public, nous continuerons d’avoir un stock de capital public performant. C’est une erreur majeure que nous avons faite, que nous faisons encore et qu’il faudrait cesser de faire.
Faut-il alors réduire d’autres dépenses ? Je suis portée à le penser. Mais une vraie stratégie d’investissement public est quoi qu’il en soit nécessaire, au niveau national comme au niveau européen. Nous disposons pour ce faire d’outils budgétaires, mais aussi de la Caisse des dépôts, par exemple.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Vous avez déclaré récemment que le plan Juncker était une réussite, ce qui nous paraît étrange. Un rapport sur les PIA vient d’en souligner les limites et une mission d’évaluation et de contrôle de notre Commission sur les PIA relatifs à la transition énergétique va, sans doute, dans le même sens.
Le Gouvernement se targue d’avoir réduit le déficit de 6 milliards de plus que les prévisions, mais les investissements des collectivités locales ont diminué de 4,7 milliards. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose…
Mme Natacha Valla. Nous sommes entièrement d’accord. Le diagnostic est unanime : c’est une erreur séculaire, surtout quand les taux d’intérêt sont si bas ; nous aurions les moyens de faire autrement.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. On a coupé au mauvais endroit ! Et maintenant, dans les négociations des contrats de plan entre l’État et les régions : on nous demande de lancer tous les projets engagés… Mais c’est trop tard.
Mme Natacha Valla. Quant au plan Juncker, il est très jeune : les institutions sont en place depuis quelques mois à peine. Plus de 50 milliards ont été engagés depuis mai 2015, et la montée en puissance se fait.
Ce plan comporte des éléments très concrets : il ne faut pas prêter attention seulement au volume des investissements, mais aussi à leur composition. Il y a des prises de risque nouvelles de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de ses co-investisseurs, et cela devrait donner des résultats intéressants. Certes, 315 milliards à l’échelle européenne, ce n’est pas très important, mais c’est mieux que rien. La BEI finance ainsi une laiterie coopérative dans le Cotentin qui pourra exporter du lait en Chine, une usine de retraitement du titanium en Auvergne… Ce sont des choses concrètes. Il faut être inventif et réussir à faire financer de tels projets. La machine du plan Juncker semble lourde de l’extérieur mais les résultats, j’en suis persuadée, seront intéressants.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Revenons à l’euro, car je crois que le débat sur une éventuelle sortie de l’euro sera essentiel pour les élections de 2017.
Mme Natacha Valla. La dette publique est détenue à 60 % par des non-résidents, mais le reste de l’économie se finance aussi hors de notre territoire. Sur la qualité de la signature française et sa résilience, il ne faut pas pécher par orgueil même si aujourd’hui, tout se passe très bien.
Que se passerait-il si la zone euro disparaissait ? La réponse à l’échelle de la zone euro est sans doute moins clémente que la réponse pour la France, ce qui apporte de l’eau au moulin des positions des extrêmes sur ce sujet. Les pays de la zone euro bénéficient aujourd’hui d’une compression de leurs coûts de financement et de l’externalité positive de la stabilité de l’Allemagne sur les marchés internationaux : la disparition de ces facteurs provoquerait des ajustements de change et d’inflation, mais aussi des modifications dans l’accès des uns et des autres au marché.
Si un État ne peut plus se financer sur les marchés extérieurs, il est asphyxié – on l’a vu en Grèce, mais la Grèce est finalement demeurée dans la zone euro. La France serait peut-être moins asphyxiée que d’autres pays, notamment de la zone euro, mais elle en ressentirait les effets ; il faudrait alors aller chercher l’épargne des Français pour financer l’économie. En vase clos, avec une monnaie qui se déprécie et une inflation qui déprécie la valeur des dettes, la question de l’allocation de l’épargne des Français, donc de la planification des flux de dépenses et de revenus sur le cycle d’une vie, en particulier du financement de leurs retraites, deviendrait vite très compliquée. Cette instabilité pourrait être très déstructurante pour la société française, qui souffre déjà de clivages intergénérationnels très forts comme le montrent les discussions sur les réformes des retraites ou en ce moment celles sur la loi travail, mais aussi la simple observation de la répartition intergénérationnelle des richesses.
Dans un environnement où la monnaie cesserait d’être stable, où nous cesserions d’appartenir à une zone monétaire stable, nous aurions peut-être quelques mois d’euphorie mais les lendemains seraient très douloureux.
La France n’est pas le pays dont le déséquilibre de la balance commerciale est le plus grand ; nous sommes dans la moyenne, donc nous ne subirions sans doute pas l’ajustement le plus fort, l’inflation la plus importante, mais le raisonnement demeure le même.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Une réinternalisation de la dette pourrait-elle être utile ? La BCE le fait à l’échelle européenne. Serait-il intéressant de recréer un circuit du Trésor européen ?
Mme Natacha Valla. Tout dépend de notre ambition. Dans le cadre d’une ambition européenne, il est très difficile de réinstaurer une gestion de la trésorerie de l’État par un équivalent des avances au Trésor. L’une des pierres d’angle du traité de Maastricht est justement la prohibition du financement monétaire des États.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Les traités sont restés les mêmes, mais tout le reste a changé !
Mme Natacha Valla. Absolument. Aujourd’hui, le miracle, c’est que nous faisons du financement monétaire à grande échelle ! La BCE a déjà racheté plus de 110 milliards de dette française, et en rachète tous les mois 10 milliards supplémentaires. La dette va être ainsi transférée vers le bilan de la Banque centrale européenne ce qui laisse toutes les options sur la table. Nous disposons là d’un outil bien plus puissant que n’étaient les avances au Trésor.
Les Allemands sont d’accord pour transférer sur le bilan du système européen des banques centrales, de l’émetteur monétaire, des points entiers de PIB… Nous sommes dans la situation où les dettes souveraines excessives de la zone euro, mutualisation ou pas, pourraient être absorbées par la banque centrale de la zone euro – doucement, par l’inflation, ou plus brutalement par un ajustement de la valeur nominale de ces dettes. Ceci est beaucoup plus efficace que le circuit du Trésor.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Autrement dit, même avec un ratio de dette par rapport au PIB de 95 %, on désensibilise la dette de manière considérable.
Mme Natacha Valla. Je ne plaidais pas pour une monétisation de la dette. J’insistais seulement sur la nécessité du pragmatisme et de la clairvoyance sur ce qui est en train d’être fait. Je suis pour ma part plutôt réticente à la monétisation et à un effacement de la dette sans réflexion. Agissant ainsi, la BCE n’incite pas des pays comme le nôtre à changer leurs habitudes et à cesser de laisser filer leur dette.
Mais les faits sont là : la politique monétaire actuelle de la zone euro est immensément plus puissante que toutes les petites recettes que nous pourrions inventer. Si l’on se retire de la logique de marché, on retire la logique budgétaire de la gestion des dépenses publiques et on en revient malgré tout à des contraintes beaucoup moins intertemporelles. Si nous avons l’intelligence de traiter la situation avec raison en France et avec pragmatisme en Allemagne, nous pourrons peut-être améliorer la situation – même si je ne peux qu’être d’accord sur le fait que les débats seront difficiles en 2017.
M. Jean-Claude Buisine, rapporteur. Pensez-vous qu’il y ait aujourd’hui une bulle obligataire ?
Mme Natacha Valla. La réponse pourrait être très longue, mais nous sommes en plein dedans, je crois. Les stocks de dette, publique ou privée, sont extrêmement élevés. Les niveaux d’endettement, dans la sphère publique dans les pays avancés et dans la sphère privée dans les pays émergents, sont sans précédent. C’est une situation nouvelle.
Parce que nous sommes dans un environnement monétaire où la liquidité est très marquée dans les principales zones monétaires du monde – États-Unis, Japon, zone euro, Royaume-Uni –, les rendements obligataires n’ont plus beaucoup de sens ; le lien avec la croissance, notamment, est perdu. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons tant de mal à estimer la croissance potentielle.
Il y a aussi une bulle obligataire au sens où les primes de risque sont totalement écrasées. Cela rend l’allocation d’actifs très délicate. Les bilans en train d’être construits sont extrêmement vulnérables au moindre retournement des niveaux de taux et des valorisations de ces stocks monumentaux.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Merci de cet échange.
Audition du 29 mars 2016
Mme Brigitte DAURELLE, directeur général d’Euroclear, et M. Frédéric GERMAIN, directeur des opérations
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Madame, monsieur, merci d’avoir répondu à notre invitation.
Mme Brigitte Daurelle, directeur général d’Euroclear. Permettez-moi d’abord de donner quelques informations sur le groupe Euroclear. Ce groupe est composé de plusieurs entités, dont Euroclear France, le dépositaire central de titres en France. C’est une entité unique qui joue un rôle central dans la gestion et l’administration des titres.
Cela nous confère un rôle très particulier dans la chaîne de valeur, notamment en raison de la gestion de ce que nous appelons le compte émission. Notre premier rôle est, en effet, d’assurer à tout moment l’étanchéité du compte émission, c’est-à-dire de garantir que le nombre de titres en circulation est égal au nombre de titres émis par les différents émetteurs, y compris pour les titres d’État. Nous sommes donc un important système de comptabilité.
Nous jouons également un rôle de gestionnaire du système de règlement-livraison, par lequel nous assurons l’échange en temps réel entre les titres et le cash lorsqu’une opération a lieu.
Le groupe Euroclear comprend d’autres dépositaires centraux nationaux. Je suis directeur général pour les dépositaires centraux français, belges et néerlandais mais le groupe Euroclear compte également les dépositaires centraux suédois et finlandais, Euroclear UK & Ireland et un international central securities depository, ou dépositaire central international, qui constitue une entité d’une nature un peu différente. Créé à l’origine pour traiter les Eurobonds, cette entité a plutôt vocation à servir une clientèle internationale tandis qu’un dépositaire central national traitera plutôt des titres domestiques.
Ma présentation est un peu schématique car dans la réalité, l’attribution des rôles est parfois un peu plus complexe, mais s’agissant des fonctions d’un dépositaire central, voilà ce qu’il faut savoir pour comprendre comment nous intervenons dans la chaîne de valeur.
M. Frédéric Germain, directeur des opérations d’Euroclear. Notre rôle est parfois qualifié de rôle notarial : il consiste à vérifier en permanence que le niveau des émissions correspond au nombre de titres en circulation.
Nous avons aussi un rôle complémentaire de gestion des comptes titres de nos clients, qui implique l’administration des valeurs mobilières. Tous les instruments financiers inscrits en compte chez nous font l’objet d’un suivi de leur naissance jusqu’à leur mort, grâce au traitement des opérations sur titres. Cela signifie que les paiements de dividende, les versements d’intérêts et les éventuelles opérations de fusion-acquisition transitent et sont gérées par nos systèmes.
Il y a toutefois une limite : nous avons une vocation nationale, et les titres cotés sur Euronext Paris peuvent être étrangers. Ils sont alors admissibles à nos opérations, mais nous ne jouerons pas pour eux le rôle notarial que nous jouons pour les valeurs françaises et les titres d’État. Nous sommes nous-mêmes en lien avec un dépositaire à l’étranger qui assure ce rôle notarial, et pour lequel nous agissons en tant qu’intermédiaire pour le compte des banquiers qui sont nos clients.
Cela m’amène à votre question concernant l’identité de nos clients. Il s’agit de la majeure partie des établissements de crédit, les grandes banques de la place. Toutes ne le sont pas, certaines ont fait le choix de confier cette activité à un autre banquier, pour des raisons pratiques et parfois de coût. Certains grands banquiers de la place ont une compétence plus avérée que d’autres et disposent donc de structures qui leur permettent d’accueillir un certain nombre de banques qui ne veulent pas être en relation directe avec nous.
Nous gérons un peu moins de trois cents comptes, ce qui ne représente pas le nombre exact de nos clients puisque certains clients peuvent avoir plusieurs comptes, par exemple s’ils choisissent de différencier leur activité chez nous selon qu’ils agissent pour le compte de certains clients, pour leurs propres avoirs ou pour des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Nous avons également des liens avec les centrales de compensation, la plus connue étant LCH.Clearnet, qui déverse ses opérations issues des transactions en bourse directement dans nos livres.
Chacun de ces clients dispose d’un compte chez nous qui reflète les positions de ses propres clients.
Il faut garder en mémoire que le rôle notarial du dépositaire central repose sur une équation qui fonde le système : quel qu’en soit l’émetteur, les titres sont représentés par leur correspondance dans le livre aux comptes de chacun des établissements de crédit ayant un compte chez nous. Et les comptes de ces établissements de crédit doivent correspondre à la somme des avoirs de leurs propres clients et de leurs avoirs propres. Cette équation est à la base du système français dématérialisé depuis 1984. Tous les systèmes tendent vers ce genre d’organisation, même s’ils ne sont pas tous passés par les mêmes voies. Ce modèle permet à tout moment de s’assurer qu’il n’y a pas inflation de titres et que, quelles que soient les circonstances, les ventes ou les achats sur les marchés, cette équation est respectée en permanence. C’est le rôle central du dépositaire.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Lorsque l’État français émet un titre, pouvez-vous nous préciser le déroulement des opérations après qu’un spécialiste en valeurs du Trésor (SVT) ait été choisi ?
M. Frédéric Germain. L’État français va demander au dépositaire central de créer les titres. Ensuite, il va lancer une adjudication pour vendre ces titres aux SVT qui sont clients du dépositaire central. Ces SVT vont souscrire à l’émission, et donc recevoir les titres sur la base d’une livraison assurée par le Trésor. Pour être extrêmement précis, cette livraison se fait par l’intermédiaire de la Banque de France, qui a aussi un compte chez nous et va gérer le processus d’adjudication.
Concrètement, le Trésor nous envoie l’équivalent d’un document notarial par lequel il nous informe, par exemple, qu’il a émis 100 millions de titres et qui nous demande de créer ces titres dans nos systèmes. Nous allons les créer, avec le Trésor en contrepartie. Ensuite, le Trésor va livrer ces titres aux différents SVT qui souscrivent à l’émission, en utilisant notre système de règlement-livraison, et contre livraison du cash. Le cash n’est pas livré dans nos propres systèmes, mais nous le gérons nous-mêmes sur un compte à la Banque de France. Nous ne sommes pas un établissement de crédit, nous ne gérons pas de compte cash, mais nous avons des positions miroirs qui se reflètent en monnaie centrale dans les comptes de la Banque de France.
Il y a donc un mouvement de titres qui passent du Trésor chez nous, pour créer les titres, puis par le jeu des opérations déclenchées grâce à la Banque de France, un mouvement de livraison de titres contre du cash entre le Trésor et les SVT.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Permettez-moi une question : que se passerait-il si le Trésor faisait cela directement, c’est-à-dire si les systèmes du dépositaire central étaient abrités par le Trésor ? Quelle est votre valeur ajoutée ?
M. Frédéric Germain. On peut imaginer un système indépendant du nôtre pour gérer les titres du Trésor. Mais il faut savoir que le rôle du dépositaire central ne s’arrête pas à la gestion de ces titres. Beaucoup d’émetteurs ont aussi intérêt à avoir une structure indépendante, une infrastructure de marché régulée. Nous n’avons pas encore abordé ce point, mais nous sommes sous le contrôle très strict de régulateurs : l’Autorité des marchés financiers d’un côté, et la Banque de France de l’autre. Le système est sécurisé par cette infrastructure dans laquelle nous ne sommes ni juge ni partie. Nous n’avons aucun intérêt dans cette affaire.
Le Trésor pourrait effectivement gérer un système, mais la logique de fonctionnement des marchés et la dématérialisation repose sur une fonction centralisée – celle du dépositaire central – indépendante de toute structure et qui n’a pas de rôle particulier par rapport au marché. Par exemple, nous recevons des transactions d’Euronext, nous n’avons aucunement vocation à nous intégrer dans le processus de trading. Nous sommes simplement là pour échanger les titres. Donc, en réponse à votre question il est, en effet, possible que le Trésor se passe de nos services, mais cela ne serait pas forcément dans son intérêt, ni dans celui des acteurs.
Enfin, au-delà des fonctions notariales, la fonction de règlement-livraison c’est à dire l’échange de titres contre du cash s’appuie également sur d’autres services. C’est la mécanique du collatéral : nos clients peuvent utiliser les titres mis en garantie auprès de la Banque de France pour régler de manière intra-journalière un certain nombre d’opérations. Or les titres de l’État français sont les premiers titres utilisés en garantie. Donc l’État français a aussi intérêt à utiliser nos systèmes, car ils donnent de l’attractivité à ses titres en permettant de les utiliser pour livrer-régler d’autres opérations qui n’ont rien à voir avec les titres d’État.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Comment êtes-vous rémunérés ?
M. Frédéric Germain. Le système de rémunération peut s’expliquer par analogie avec celui des droits de garde que vous acquittez lorsque vous avez des titres chez votre banquier. De la même manière que vous payez des droits de garde à votre banquier, les banquiers nous paient des droits de garde. S’y ajoute une rémunération forfaitaire en fonction des mouvements qui passent par nos systèmes.
La majeure partie de nos revenus est donc liée aux droits de garde, et une partie complémentaire provient des mouvements qui transitent dans nos systèmes. Pour vous donner un ordre d’idée, nos systèmes enregistrent en moyenne 110 000 à 120 000 mouvements par jour.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. J’ai bien compris l’intérêt que trouvent les grandes banques à ce que vous soyez dépositaire central des titres du Trésor : cela leur permet de les utiliser en garantie pour d’autres mouvements sans lien avec la dette publique.
Mais ce système ne joue-t-il pas également une fonction de dissimulation ? On voit ce qui entre et ce qui sort, mais on ne sait pas bien ce qui se passe entre temps.
Mme Brigitte Daurelle. Nous savons absolument ce qui se passe.
M. Jean-Pierre Gorges. Jouez-vous un rôle équivalent à celui d’une centrale titres au sein d’un grand groupe bancaire ?
Mme Brigitte Daurelle. Pas du tout. Nous ne sommes pas un établissement de crédit, nous sommes une infrastructure de marché, hautement régulée. Nous assumons une fonction centrale dans la gestion des échanges : notre rôle est d’assurer la jonction entre l’émetteur et les investisseurs. En tant qu’infrastructure de marché, notre rôle principal est de s’assurer qu’à tout moment, le nombre de titres émis est équivalent au nombre de titres en circulation.
Cela peut paraître trivial, mais cela impose de gérer des systèmes informatiques extrêmement puissants, qui requièrent des investissements très lourds. Nous sommes donc une infrastructure de marché jugée systémique, c’est-à-dire que si demain, par malheur, une disruption se produisait dans nos systèmes, les conséquences seraient très ennuyeuses.
Nous sommes, en conséquence, très régulés ; la façon dont nous gérons les flux est très sécurisée afin d’assurer la stabilité du monde financier et empêcher qu’un quelconque comportement déviant ou une rupture de continuité ne provoque des évènements difficilement gérables.
Nous ne sommes donc pas l’équivalent d’une centrale titres dans un établissement de crédit, nous avons un autre rôle dans la chaîne de valeur.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. En ce qui concerne France Trésor, quelle connaissance avez-vous des détenteurs finaux ?
M. Frédéric Germain. Aucune. Nous connaissons les établissements de crédit qui s’adressent à nous. Leur position est le reflet de la somme des avoirs de leurs propres clients. Nous n’avons pas de visibilité sur les investisseurs finaux.
Il est clair que d’un point de vue technique et théorique, dans un monde dématérialisé, tout peut s’identifier. Mais la réglementation en vigueur en matière de titres d’État ne nous permet pas d’identifier les détenteurs de titres finaux. C’est aujourd’hui juridiquement impossible.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Il règne un grand mystère sur les détenteurs. On dit que 60 % sont non-résidents, ce qui veut bien dire que quelqu’un l’a vu quelque part. Nous nous demandons comment identifier les détenteurs. La réglementation peut interdire de le communiquer, mais il y a bien un endroit où l’information existe.
M. Frédéric Germain. Pour parler de toute autre chose que des titres d’État, il existe un dispositif permettant d’identifier les porteurs de titres, en particulier les actionnaires des sociétés émettrices. Ce dispositif s’appelle le titre au porteur identifiable. Comme son nom l’indique, il est destiné à collecter les informations sur les titulaires de titres déposés dans nos livres. Et nous sommes l’organisme central habilité de par la loi à collecter les informations auprès des établissements de crédit qui sont nos clients.
Ce dispositif est très simple : nous avons une position titre dans nos livres, et si l’émetteur nous déclare, conformément à la loi et à ses statuts, que nous pouvons identifier ses actionnaires à une date donnée, nous lançons une requête auprès de l’ensemble des établissements de crédit parmi nos clients. Ils nous informent, sur la base de données strictement encadrées par la loi, et nous compilons ces informations pour remettre à l’émetteur la liste de ses actionnaires.
Ce dispositif est bien évidemment transposable à tout titre, de quelque nature que ce soit, notamment aux titres d’État. Mais juridiquement, ce dispositif ne leur est pas applicable. Il n’a pas été décidé par le législateur de permettre l’identification des investisseurs détenant des titres d’État. Il peut y avoir de bonnes ou de mauvaises raisons à cela.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. C’est un débat : Est-il important que ceux qui détiennent la dette émise par l’État sachent qu’ils ne peuvent pas être identifiés ? Certains y voient des avantages, d’autres des inconvénients, aujourd’hui nous envisageons plutôt les inconvénients.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Donc vous consolidez toutes les positions de vos trois cents comptes ? Vous ne savez pas si un client peut avoir des coupons à remettre à des clients à une date donnée, mais vous savez qu’il faut consolider telle position ?
M. Frédéric Germain. De par la construction technique du dispositif, nous savons que ce client a 100 000 titres inscrits dans nos livres à une date donnée. Évidemment, les mouvements en temps réel font évoluer cette valeur en permanence. Ces 100 000 titres peuvent être détenus par 100 000 clients titulaires chacun d’un titre, comme par un seul client détenant les 100 000.
Lorsque nous lançons le processus de titre au porteur identifiable, la banque va devoir nous donner l’équivalent de sa position comptable dans nos livres. Donc nous allons agréger l’ensemble des actionnaires qu’elle va nous transmettre, et vérifier que la somme de leurs positions correspond à la position dans nos livres.
Mme Brigitte Daurelle. L’émetteur va donc recevoir une liste de l’ensemble des actionnaires que nous aurons pu identifier, mais il existe des limites sur lesquelles nous allons revenir. Il y a donc une chaîne qui fait remonter l’information vers nous, nous la centralisons et nous la transmettons à l’émetteur. Et alors, il est possible d’identifier les détenteurs finaux.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Donc la banque connaît ces détenteurs ?
Mme Brigitte Daurelle. La banque connaît ses clients et sait qui détient quoi dans ses livres, bien entendu. Mais même sur ce dispositif, qui existe pour certains actifs mais pas pour les titres d’État, le processus n’est pas parfait, et l’émetteur ne reçoit pas une liste exhaustive de ses détenteurs.
M. Frédéric Germain. La loi a été rédigée en 1987, lorsque les marchés étaient très peu internationalisés. Il n’a pas été anticipé que de plus en plus d’investisseurs étrangers s’intéresseraient aux sociétés françaises. Évidemment, ces investisseurs étrangers n’ont pas tous un compte dans une banque française. Ils peuvent avoir un compte à la Chase Manhattan Bank, qui a elle-même un compte chez BNP Paribas, par exemple.
BNP Paribas ne connaît pas nécessairement l’investisseur qui est client de la Chase Manhattan. Dans le processus de titre au porteur identifiable, BNP Paribas nous communiquera le nom de la Chase Manhattan, et pas plus que cela. Ce sont les limites du système. Évidemment, plus le marché s’internationalise, plus nous avons tendance à perdre l’identité des détenteurs finaux.
Ceci étant dit, certains investisseurs font le choix d’avoir un compte directement au sein d’un établissement de crédit français. Et en 2002, le législateur a décidé de mettre en place un autre dispositif pour casser l’opacité créée par une structure de comptes en cascade. Il a donc donné la possibilité à l’émetteur d’interroger la Chase Manhattan – soit par lui-même, soit par l’intermédiaire du dépositaire central – et d’identifier les porteurs en cascade, afin de remonter la chaîne.
Cette procédure est toutefois assez inefficace, pour une raison simple. Les informations récupérées auprès de la banque interrogée sont globalisées, elles donnent pour adresse une tour où se trouvent 5 000 à 6 000 personnes, et il est très difficile d’atteindre l’interlocuteur capable de donner la bonne information.
Ce dispositif est assorti de sanctions : suspensions des droits de vote et des dividendes ; mais avant qu’une assemblée générale extraordinaire décide de telles sanctions, les titres auront probablement fait trois fois le tour du monde. Ce sont des limites très difficiles à dépasser, mais il ne faut pas être trop négatif : depuis l’introduction de cette loi, certains établissements, notamment aux États-Unis, ont estimé que puisqu’il existait une loi assortie de sanctions, ils répondraient aux sollicitations de l’émetteur ou du dépositaire central. Ce dispositif reste toutefois moins efficace que le premier niveau de titre au porteur identifiable, qui relève de la loi française.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Je comprends les difficultés, qui sont réelles, mais n’existe-t-il pas un risque qu’un certain nombre de titres se retrouve dans des paradis fiscaux ?
M. Frédéric Germain. Je ne peux pas vous répondre, car je suis incapable de vous donner des garanties dans un sens ou un autre. Évidemment, l’effet produit par ce système est que si la banque agit pour le compte d’un établissement situé dans l’Ohio qui travaille lui-même pour le compte de quelqu’un situé dans les îles Caïman ou dans le Delaware, il sera très compliqué de s’assurer du respect des règles standard et de ne pas se trouver dans un paradis fiscal. En l’état actuel, je ne peux pas vous dire si c’est le cas ou non, c’est techniquement possible, mais nous n’avons pas les moyens de le vérifier.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Connaissez-vous le volume de titres de dette d’Etat échangés ?
M. Frédéric Germain. Nous pouvons connaître le volume de titres échangés. Il transite entre 80 et 100 milliards d’euros par jour sur la dette d’État. Mais il faut faire attention avec ces chiffres : dans la même journée, une banque peut s’échanger dix ou cent fois les mêmes titres. Il y a une rotation sur les titres qui produit ces 80 à 100 milliards d’échanges. Ils sont échangés par les tables de trading dans un objectif de profitabilité ; ils peuvent être échangés à plusieurs reprises au cours de la même journée.
Nous arrêtons les positions à la fin de la journée comptable. Les banques, de gré à gré, peuvent continuer à faire du trading, mais cela apparaîtra le lendemain chez nous, ce qui signifie en fait à partir de vingt heures le soir. Le trading ne s’arrête jamais, mais les mouvements qui sont traités dans nos livres sont ceux que les banques nous transmettent à l’issue de leurs transactions de gré à gré, ou que le marché nous transmet par l’intermédiaire de la centrale de compensation LCH.Clearnet.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. En 2011, Reuters a publié un classement des cinquante plus gros détenteurs de dette française. Avez-vous une information du même type ?
M. Frédéric Germain. Non, nous ne pouvons ni infirmer ni confirmer cette information. Il est très probable qu’elle soit basée sur des analyses faites auprès d’investisseurs institutionnels par des sondages de portefeuille.
Dans ce genre de domaine, nous avons affaire à des investisseurs importants, et il est probable que leurs chiffres soient relativement justes s’ils approchent les bons conservateurs. Nous ne sommes pas en mesure de faire ce type d’analyses car nous n’avons pas de relations directes avec les investisseurs.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Que vous inspire le fait qu’il y ait des émissions de titres à des taux négatifs ?
M. Frédéric Germain. Cela ne m’inspire rien de bon d’un point de vue économique, mais du point de vue de nos systèmes, cela n’implique rien de spécifique, si ce n’est une gestion différente du cash, puisque nous allons inverser les règlements. En réalité, cela se passe de manière beaucoup plus simple que cela : au moment de l’émission, les titres sont payés moins cher. Cela n’a rien de techniquement complexe pour nous, cela ne pose pas de problèmes particuliers. Ce serait plus ennuyeux sur des titres corporate, qui sont plus complexes, mais pour des titres d’État, la gestion est extrêmement simple.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Toutes les personnes avec lesquelles nous en discutons se demandent pourquoi entrer dans ce type de système. D’habitude, on ne trouve des taux négatifs que pour des opérations de blanchiment !
Mme Brigitte Daurelle. Sur ce genre de questions, nous n’avons qu’un point de vue de citoyens, mais je ne pense pas qu’il soit utile de le partager ici. Dans le cadre de nos fonctions respectives au sein d’Euroclear France, c’est techniquement transparent, il ne s’agit que de la gestion d’un paramètre différent.
M. Frédéric Germain. Tout ce que nous pouvons vous dire, c’est qu’en matière de lutte anti-blanchiment, nous disposons d’un dispositif de vérification qui permet de nous assurer qu’il n’y a pas de blanchiment avéré qui transite par nos livres. Nous vérifions toutes les transactions pour nous assurer qu’elles se situent dans des fourchettes acceptables. Nous sommes soumis à une régulation, et ces dispositifs sont vérifiés par l’Autorité des marchés financiers, qui a par ailleurs la possibilité d’étudier tous les mouvements chez nous lorsqu’elle le veut et à tout moment ; et elle le fait.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Vous versez des intérêts ?
M. Frédéric Germain. L’émetteur verse des intérêts.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Vous ne faites qu’une consolidation de position.
M. Frédéric Germain. C’est exact. L’émetteur met à notre disposition l’ensemble des intérêts à verser, et sur la base des positions respectives de nos clients, nous versons à due concurrence les montants qui reviennent à chacun des établissements. Ces derniers ont ensuite l’obligation de reverser ces intérêts à leurs propres clients, en proportion des positions chez eux.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Et ils prennent une dîme au passage ?
M. Frédéric Germain. Ils prennent une dîme en fonction du service rendu. Nous ne nous rémunérons pas sur les montants versés par l’émetteur.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Pourrions-nous venir visiter vos locaux ?
Mme Brigitte Daurelle. Avec plaisir, je pense que nos équipes seront honorées de vous recevoir.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. C’est un sujet sur lequel nous avons été plusieurs à travailler et sur lequel il existe beaucoup de fantasmes et des inquiétudes. Le nom d’Euroclear évoque d’autres chambres de compensation, et comme dans la comptine « marabout – bout de ficelle », le nom d’Euroclear évoque rapidement Clearstream. C’est pourquoi nous aimerions bien vous rencontrer, nous rendre chez Euroclear France et voir comment les choses se passent.
Mme Brigitte Daurelle. Oui, organisons cela. Nous pourrons faire une session d’information, rencontrer les équipes et vous montrer les plateaux.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Il me reste à vous remercier pour votre intervention.
Audition du 14 juin 2016
M. Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Monsieur le ministre, nous vous remercions d'avoir accepté de venir devant cette mission. Nous avons souhaité faire le point avec vous sur les différentes questions qui se sont posées tout au long de nos travaux.
M. Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics. Vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet, et auditionné des personnes extrêmement compétentes sur la dette publique, son analyse et sa gestion, et certains de mes collaborateurs ici présents vous ont donné tous les éléments d'information nécessaires.
Je ne reviendrai pas après eux sur les grands enjeux de la dette publique française. La dette est le résultat des déficits, et il vaut mieux qu'il y ait moins de déficit si l'on veut moins de dette. C'est un des enjeux de la gestion actuelle de la France.
Aujourd'hui, notre ligne de conduite est nette et précise : elle consiste à réduire les déficits pour stabiliser notre endettement, tout en diminuant les impôts – en particulier ceux des entreprises – tandis que nous devons faire face à des dépenses exceptionnelles. Les derniers événements montrent la nécessité d'augmenter les moyens de la défense et de la police. Vous connaissez aussi la priorité donnée à l'éducation nationale.
Voilà ce qui guide l'action globale en termes budgétaires. Depuis 2012, la dette a augmenté de 6,5 points. En 2015, elle atteint 96,1 % du produit intérieur brut. Toute comparaison n'est pas forcément raison, mais il faut tout de même savoir les faire : rappelons donc que cette dette avait augmenté de 25 points entre 2007 et 2012, en particulier du fait de la mise en œuvre de plans de relance et de soutien de l'activité qui ont été financés à 100 % par une augmentation de la dette.
Notre dette est donc lourde, mais nous la maîtrisons. En 2015, elle augmentera de 0,8 point, alors qu'elle augmentait auparavant à un rythme bien plus élevé, qui se comptait en unités. Nous sommes en train de stabiliser les choses, je pense que nous verrons une légère augmentation ou une stabilisation en 2016, et si les conditions dans lesquelles nous préparons le budget pour 2017 se maintiennent, la dette sera alors stabilisée ou à la baisse. Ce résultat dépendra d'un certain nombre d'éléments, en particulier de la croissance économique, puisque le pourcentage d'endettement est un rapport entre la dette et le niveau du PIB. La croissance de ce dernier modifie donc mécaniquement ce pourcentage.
La dette publique est composée à 80 % de dette de l'État. Les 20 % restants sont du domaine de la Sécurité sociale et des collectivités locales. La question de la dette se pose donc principalement et avant tout à l'État. Nous avons une masse considérable à gérer.
Il y a plusieurs années, il a été décidé que la politique budgétaire, donc le choix du niveau des déficits et de l'appel à la dette, faisait partie des grandes décisions politiques. Mais ensuite, une certaine autonomie est donnée à l'Agence France Trésor pour la gestion quotidienne de cette dette, de manière à ce qu'elle soit faite de la manière la plus professionnelle possible, en lien avec un certain nombre d'acteurs comme les spécialistes en valeurs du Trésor (SVT).
La gestion de la dette recouvre deux aspects. Tout d’abord, le déficit crée de la dette supplémentaire. Mais le deuxième aspect, presque le plus important, est de gérer le renouvellement de la dette, la dette qui vient à échéance. Sur cet aspect que nous faisons en ce moment des économies importantes. Aujourd'hui, les taux sont extrêmement bas : ils devaient être à 0,41 % hier soir pour les emprunts à 10 ans, et sont même descendus à 0,30 % au cours de l'année dernière. Les taux sont donc historiquement bas, et les dettes contractées à un peu plus de 3 % il y a sept ou huit ans, qui arrivent aujourd'hui à échéance, sont renouvelées pour un intérêt à peine supérieur à zéro. La différence constitue une économie qui apparaît très bien dans les budgets, et qui va perdurer pendant toute la durée du prêt. Pour des prêts d'une durée de sept ans, l'économie ainsi réalisée est absolument considérable.
Ces taux très bas ne sont pas le fruit du hasard. La Banque centrale européenne maintient délibérément des taux bas parce que l'inflation est extrêmement faible, loin de l'objectif qu’elle se fixe. Nous avons toujours tendance à penser qu'une banque centrale a pour mission de ne pas dépasser un certain niveau d'inflation, mais elle doit aussi atteindre un niveau minimum d'inflation. Si l'économie est toujours dans l'attente d'un prix plus bas, les initiatives seront bridées, il faut donc une légère inflation. L’objectif est que l'inflation atteigne 2 %, mais elle est aujourd’hui à zéro, voire parfois négative.
Il convient aussi de se comparer aux autres, et d'observer si notre pays a une particularité en ce domaine. Il existe des différences très fortes au sein même de la zone euro entre les pays du cœur – l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et la France, également la Finlande – et les pays que l'on appelle à tort la périphérie : Italie, Espagne et Portugal. Sans parler de la Grèce, qui n'a pas de taux d'intérêt puisqu'elle n'a pas accès au marché et ne se finance qu'avec les plans d'aide que l'Europe lui apporte.
Cette différence montre si la dette est bien gérée. C’est la confiance qui nous est accordée qui nous permet d'avoir des taux aussi bas, c'est un élément très important de notre stratégie. Pourquoi nous prête-t-on de l'argent pour si peu ? Parce que les investisseurs nous font confiance et qu’ils ont le sentiment que notre politique va leur permettre de retrouver leur argent. La prime de risque est donc très faible pour nous, alors qu'elle est très forte pour d'autres.
La liquidité de la dette est l’autre élément : il faut que cette dette puisse être échangée très facilement. Plus l'acheteur de dette se sent en capacité de la vendre dans de bonnes conditions et quand il veut, parce qu'il a un besoin ou qu'il veut investir, et moins cette dette sera chère. C'est tout l'objet de la politique actuellement menée par l'Agence France Trésor : que sur tous les aspects de la dette, la liquidité soit la plus grande possible. C'est ce qui nous permet, lorsque nous faisons de nouveaux emprunts, de vanter cette liquidité et d'emprunter plus facilement et à moindre coût.
Voici les grands traits de la politique que nous menons. Nous pouvons ensuite débattre des principes ; ainsi, compte tenu du fait que l'on nous prête aujourd'hui pour très peu, peut-on emprunter plus ? Emprunter plus, c'est aussi rembourser plus. Aujourd'hui, notre objectif est de stabiliser la dette. Il n'y a pas de chiffre magique, mais des seuils symboliques. Lorsque l'on approche d'un ratio d’endettement de 100 % du PIB, il vaut mieux éviter de le dépasser. Pour des gens rationnels, il n'y a pas de différence entre 99,99 % et 100,01 %, mais dans l'imaginaire collectif, passer ce seuil créerait un choc. Je suis d'ailleurs persuadé que la presse autant que l'opposition dénonceraient une situation inadmissible et une mauvaise gestion. Mais ce n'est pas cela qui nous motive ; nous voulons nous assurer que les générations suivantes pourront faire face au remboursement de la dette dans des conditions supportables, sans être obligées, comme c'est le cas dans certains pays, de mettre en œuvre des politiques d'austérité traumatisantes pour les peuples concernés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France.
Il y a aussi des débats sur le bien-fondé du seuil de 3 % de déficit. J'ai entendu dire que cette valeur était tombée du ciel, ce n'est pas vrai. On considère qu'en France, la croissance potentielle normale est d'environ 1,5 %, et que l'inflation normale est de 1,5 %. Dans ces conditions, si le déficit est de 3 %, il est stabilisé. Si vous descendez en dessous de 3 %, l'endettement se réduit. La réduction de la dette n'est donc possible que si l'on reste en deçà de ce seuil de 3 %. Dès qu'on le dépasse, la dette augmente, en dessous, elle diminue.
Bien entendu, la croissance potentielle peut être plus ou moins élevée selon les époques, et l’inflation peut être plus faible ou plus haute, il s’agit d’une moyenne sur une longue durée. Ce sont les éléments qui ont été retenus au moment du Traité de Maastricht, j’en sais quelque chose puisque j’occupais le même poste lors de son adoption.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Je ne discuterai pas des causes de création de la dette. Elles s’étalent sur quarante ans, sous tous les gouvernements. C’est une façon de conduire la politique aujourd’hui, car nous sommes en déficit structurel depuis quarante ans. La dette est un facteur d’ajustement pour accompagner les différentes politiques, plus ou moins marqué selon les périodes. Il est clair que les années 2007 à 2012 nous ont coûté cher, mais vous les comparez seulement avec les trois dernières années. Trois ans et cinq ans, ce n’est pas tout à fait la même chose.
J’ai une explication un peu différente du seuil de 3 % : les frais financiers sont de 3 %, donc si les soldes primaires sont déficitaires de ce montant, les frais financiers sont couverts avec l’inflation et la croissance normale. Mais dans un contexte où les frais financiers sont presque nuls, ce seuil n’a plus de sens.
Nous sommes surpris de ne pas mieux connaître les détenteurs de la dette. Près de 60 % de la dette est détenue par des non-résidents. Nous aurions les moyens de les connaître, mais aujourd’hui, la règle du jeu fait que c’est impossible. Que pensez-vous de cette situation, et croyez-vous qu’elle puisse être gênante pour le pays ?
Ces dernières années, nous ne remboursons pas le capital de la dette, nous ne faisons que payer les frais financiers. Pour un ménage, cela revient à un différé d’amortissement. Pour cette raison, certaines des personnes que nous avons reçues nous ont déclaré qu’il ne sert à rien de rembourser la dette. Donc, si les frais financiers sont de zéro, nous pouvons continuer à emprunter.
La grande surprise est l’apparition des taux négatifs. Comment l’expliquez-vous ? Il est possible de supputer : est-ce un système de blanchiment ? Prêter son argent pour en perdre, c’est tout de même étonnant, il n’y a pas d’explication rationnelle.
Puisque l’argent ne coûte rien, et qu’on ne le rembourse pas, est-ce que le moment n'est pas propice pour lancer un grand emprunt ? Pas les 32 milliards de 2007-2012, que j’avais contestés, parce que c’était microscopique au vu des besoins du pays, mais un effort important : 200 milliards sur dix ans pour les investir dans le développement du pays, le numérique, les routes, les avions. Ne pensez-vous pas qu’il s’agit d’une occasion manquée ? À la fin de ce mandat, ne pensez-vous pas que vous auriez dû profiter de cette situation ?
M. le ministre. Au contraire !
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Les marchés sont assez opaques, et il y a en France des liquidités importantes. Faudrait-il que cette dette soit reprise en partie par les Français ?
M. le ministre. S’agissant des détenteurs de la dette, il est difficile de répondre car la dette est liquide, elle peut être échangée très fréquemment. Sa liquidité est une des raisons pour lesquelles on fait confiance à la France et on lui accorde des taux plus faibles qu’à d’autres pays comparables. Ce n’est pas techniquement totalement impossible, mais le suivi de la propriété du titre serait très complexe dans le contexte actuel d’échanges très rapides à l’échelle planétaire. Nous avons tout de même quelques idées : la Banque de France a réalisé une étude qui fait apparaître que la dette est détenue à près de 40 % par des Français, ce qui veut dire que 60 % des détenteurs sont des étrangers qui nous font confiance. Quand nous allons en Chine ou au Japon, beaucoup de questions nous sont posées sur la politique de la France le niveau de la dette, car les investisseurs locaux se demandent s’ils vont continuer à prêter à la France, en fonction des opportunités qui se présentent. Des études nous donnent quelques éléments sur les grands émetteurs. Mais si nous ne savons pas exactement combien d’obligations la Banque centrale de Chine, celle du Japon ou l’Arabie Saoudite détiennent, nous avons une petite idée dans tous les cas.
S’agissant de la réinternalisation, si nous avons une dette aussi peu chère, c’est en partie parce qu’elle n’est pas réservée aux Français. L’ouverture du champ permet à des liquidités disponibles hors de France de venir s’investir dans la dette française. Serait-il plus intéressant que l’épargne française soit investie dans des obligations d’État ? Je ne le pense pas, et notre politique est d’orienter l’épargne française vers l’économie française plutôt que le financement de la dette française.
Dans la loi Sapin II, une disposition réduit les exigences prudentielles pour permettre aux sociétés d’assurance qui possèdent beaucoup d’obligations françaises de réorienter leurs investissements vers les entreprises, tout en restant prudents. Nous préférons que l’épargne française s’oriente autant que possible vers l’économie réelle. Par ailleurs, nous préférons que l’épargne des Français diminue au profit de la consommation, s’agissant des ménages et de l’investissement, s’agissant des entreprises. La consommation peut consister en l’achat d’un appartement ou d’une maison.
La baisse du niveau d’épargne que nous constatons aujourd’hui est plutôt un élément rassurant, c’est le signe que l’épargne de précaution diminue. Du côté des entreprises, c’est l’inverse : la politique que nous menons leur a permis d’augmenter leurs marges, et l’épargne disponible est donc plus importante. Entre le moment où les marges s’améliorent et celui où l’investissement se fait, il faut cependant parfois du temps.
Pour toutes ces raisons, la réinternalisation de la dette ne serait pas une bonne politique : la dette serait plus chère et il y aurait moins d’épargne française pour soutenir l’économie.
Pour expliquer l’existence de taux négatifs, il faut se rappeler que nous n’avons pas connu d’inflation aussi faible depuis longtemps. Quand l’inflation est négative, les taux sont automatiquement beaucoup plus faibles, et éventuellement négatifs. De plus, la politique de la Banque centrale européenne pour relancer l’économie et l’inflation créée des liquidités, et le coût de l’argent diminue d’autant plus que les liquidités sont abondantes. C’est ce qui se passe aujourd’hui. D’autant plus que ceux qui prêtent leur argent à l’État dans les conditions actuelles étant sûrs de retrouver leur argent, la prime de risque est pratiquement égale à zéro. Ce ne serait pas le cas en prêtant à un particulier pour acheter un appartement, ou à une entreprise pour acheter une machine.
Les taux d’intérêt négatifs sont donc voulus par la Banque centrale européenne. Ils ne concernent pas toutes les échéances de dette. En Allemagne le taux d’intérêt des obligations à 10 ans est passé dans le négatif. Les investisseurs prêtent à l’État allemand, parce qu’ils savent qu’ils vont récupérer leur investissement, et il n’y a pas d’autres opportunités offrant autant de sécurité que la dette de l’État allemand, ou même de l’État français, car le taux de 0,40 % auquel la France emprunte est extrêmement faible.
Il faut en profiter le plus possible, car ça ne va pas durer éternellement. D’ailleurs, il ne serait pas bon que cela dure trop longtemps. Une rémunération de l’épargne aussi faible peut poser des problèmes pour l’épargne-retraite en particulier. C’est pourquoi les Allemands y sont particulièrement sensibles : le montant de leur retraite résultant de leur propre épargne est beaucoup plus élevé que chez nous, où le système de Sécurité sociale est plus important.
Vous me demandez pourquoi, puisque la dette n’est pas chère, nous n’en profitons pas pour faire un grand emprunt. Un grand emprunt, c’est un grand déficit. Dire qu’il faut faire un grand emprunt parce que la dette n’est pas chère revient clairement à dire qu’il faut un déficit beaucoup plus important. Plutôt que d’avoir un déficit à 3,4 % ou 3 % du PIB, ce qui est l’objectif cette année, il faudrait ajouter 2 ou 3 points de déficit. C’est une politique de relance par le creusement des déficits qui à moments, peut se justifier. Par exemple, lorsque nous étions confrontés à la crise financière, je n’ai jamais critiqué le principe d’une politique de relance alors que j’étais dans l’opposition. On peut penser que c’est plus ou moins bien fait, ou qu’il aurait fallu le faire dans un secteur plutôt que dans un autre, mais en soi, c’était une bonne chose.
Mais ça ne peut pas être sans fin. Le raisonnement de certains selon lequel la dette n’est pas grave car elle ne coûte pas cher connaît des limites. Dans cinq ans, lorsqu’il faudra rembourser, nous ne pourrons peut-être pas réemprunter aux mêmes taux.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Mais si dans l’intervalle, nous faisons des investissements productifs ?
M. le ministre. Les mécanismes ne sont pas de même nature que dans une entreprise. Et une entreprise ne va pas investir uniquement parce que les taux sont bas, il lui faut un marché. Je comprends le débat, mais je ne suis pas favorable à cette solution. La politique du Gouvernement n’est pas de creuser les déficits, c’est même l’inverse : nous les diminuons. Et heureusement que nous le faisons : ceux qui acceptent de nous prêter à bon marché, alors que d’autres connaissent des taux très élevés, pensent que nous sommes capables de faire face aux échéances dans de bonnes conditions, sans devoir, le jour venu, mener une politique d’austérité contradictoire avec le nécessaire développement de l’activité et de la richesse.
Dans la période actuelle, la bonne politique pour la France, comme pour beaucoup d’autres pays, est la maîtrise et la réduction des déficits, pour maîtriser sa dette. Et toute la subtilité lors des dernières années a consisté à le faire dans des conditions qui ne soient pas trop strictes, et donc contraires à la reprise de la croissance.
C’est ce que nous avons fait depuis 2014, et qui est parfois critiqué : c’est normal, nous avons sciemment repoussé d’un ou deux ans l’échéance de l’objectif de réduction des déficits sous le seuil de 3 % du PIB, en concertation avec les autorités européennes, car ce rythme de réduction nous paraissait compatible avec la reprise de l’activité. Ce n’est pas la seule raison, mais depuis que ce rythme de réduction des déficits est un peu moins fort, nous avons vu la croissance reprendre ; à 1,2 % ou 1,3 % en 2015, à 1,5 % cette année, et nous verrons ce qu’il en sera l’année prochaine, mais nous connaissons des niveaux de croissance plus élevés. C’est un équilibre subtil, nous pouvons à chaque fois contester, penser qu’il faut freiner plus ou au contraire accélérer. C’est la complexité de cet équilibre macroéconomique et de l’utilisation des finances publiques et de la dette qui nous permet aujourd’hui de retrouver un certain équilibre.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Mais en ce moment, nous ne remboursons pas le capital.
M. le ministre. Non, mais nous le ferons un jour. Avec le même niveau de capital emprunté, si notre richesse augmente de 2 % par an, ce ne sera pas la même chose. Si le revenu double, la situation est plus aisée, et le prêteur vous fera plus confiance. Tout tient à cette confiance de l’ensemble des marchés à l’égard du pays. Pourquoi, aujourd’hui, la Grèce ne peut accéder aux marchés ? On avance que le taux d’intérêt qu’elle devrait payer est de 25 %, mais ce n’est même pas le cas, car personne ne prêterait à la Grèce.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. J’ai posé la même question aux spécialistes en valeurs du Trésor, et ils pensaient qu’il serait intéressant, du point de vue du marché, que la France ait cette attitude.
M. le ministre. C’est normal, c’est leur source de revenus ! Les spécialistes en valeur du Trésor achètent d’un côté pour revendre de l’autre.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Monsieur le ministre, vous avez dit que la dette était le résultat des déficits. Personne ne le conteste, puisqu’il y a des déficits structurels et conjoncturels depuis 1974. Mais il serait bon que vous nous disiez ce que vous pensez de la constitution de la dette. Une partie de la dette nous paraît relever de ce que l’on appelle la dette illégitime. J’ai eu l’occasion de travailler l’an dernier sur ce sujet, et à certains moments, il y a eu un effet boule de neige. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, car les taux sont extrêmement bas. Mais de la dette a ainsi été créée sans que cela n’apporte rien au budget ou se traduise par de l’investissement.
Au cours de cette mission, nous avons eu de nombreuses informations sur la gestion de la dette, et je pense que nous allons conclure que la dette est extrêmement bien gérée, notamment par l’Agence France Trésor. En revanche, nous avons de grandes difficultés pour connaître les détenteurs de la dette. Il ne s'agit pas seulement de l'identité des personnes, mais de savoir ce que les titres deviennent, si ces obligations sont possédées par des sociétés impliquées dans les scandales Luxleaks ou Panama papers. L'État français devrait savoir ce que deviennent ses titres de dette, et s'ils n’alimentent pas des paradis fiscaux.
Au sein de la commission des finances, l'hypothèse d'une remontée des taux est souvent évoquée de manière catastrophiste. Or si les taux remontaient, cela n'affecterait que la nouvelle dette et le renouvellement de l'ancienne, donc 8 % du stock de dette : les 78 milliards du déficit, plus les 100 ou 110 milliards de renouvellement de la dette. Il serait bon de connaître précisément le coût d'une remontée d'un point des taux d'intérêt. Il faut dédramatiser ce sujet.
Nous nous interrogeons aussi sur le rythme du renouvellement. Nous avons assisté à une adjudication de bons à court terme. L'offre était quatre fois supérieure aux besoins. Ne pourrait-on renouveler une part plus importante de notre dette ? L'AFT nous a expliqué qu'il ne fallait pas mettre en péril le marché et la crédibilité de la France, mais ne serait-il pas opportun d'accélérer le renouvellement du stock de dette pour profiter des taux bas ? Nous ferions baisser plus encore le taux moyen de la dette.
Nous connaissons les taux servis sur le marché primaire, que ce soit à court, moyen ou long terme ; ils sont très bas. Mais dans le cadre du quantitative easing, la BCE rachète sur le marché secondaire. À quels taux rachète-t-elle ? Ceux qui achètent sur le marché primaire ne gagnent-ils pas, même à des taux négatifs, en revendant à la BCE ? La BCE rachète à peu près 50 % des titres de dette chaque mois, nous voudrions donc avoir cette information.
Enfin, il y a un an, j'avais proposé une résolution européenne sur les dettes souveraines, notamment au vu du problème de la dette grecque. La nécessité d'une conférence européenne sur les dettes souveraines était apparue. Pourra-t-on rembourser toutes les dettes, et ne faut-il pas prévoir un mécanisme européen ? Ne faut-il pas créer une dette européenne, un circuit du Trésor européen ?
La question des dettes souveraines est aujourd'hui lancinante, car elles pèsent sur les États, sur les politiques publiques menées, et au cours de l'histoire, nous avons connu des moments où certaines dettes publiques ont été effacées.
M. le ministre. Ce ne sont pas les meilleurs moments dans l'histoire !
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Après-guerre, la conférence de Londres a permis d'effacer une part très importante de la dette allemande pour lui permettre de repartir. En règle générale, l'effacement des dettes a des effets intéressants sur les politiques publiques menées.
Que pensez-vous de l'intérêt d'organiser une conférence européenne de la dette ?
M. le ministre. Il y a beaucoup d'idéologie autour de la dette, personnellement, je suis assez pragmatique.
Chacun peut faire le travail pour identifier d'où vient la dette française, mais du fait des mécanismes de refinancement, la dette a moins de dix ans ou moins de vingt ans. Parfois, aujourd'hui, nous émettons de la dette à cinquante ans, mais la dette est en elle-même relativement récente, même si elle a permis de refinancer des dettes plus anciennes.
Y a-t-il des dettes illégitimes ? Nous pouvons discuter des politiques suivies, d'un choix d'investissement, ou de la décision de diminuer un impôt en le finançant uniquement par la dette, ce qui a pu arriver à beaucoup de gouvernements, et continue à exister puisque nous diminuons le déficit tout en diminuant les impôts ; si nous n'avions pas diminué les impôts, le déficit serait moindre.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Tout est financé par la dette !
M. le ministre. Pas tout, heureusement ! La dette ne finance pas 350 milliards !
On peut penser qu'il était inutile d'emprunter pour mener une certaine politique, et qu'il aurait été préférable d'emprunter pour en mener une autre, ou de ne pas emprunter du tout. C'est le débat citoyen et démocratique, sur la politique menée par un gouvernement et une majorité. Tout cela ne permet pas de qualifier la dette de légitime ou illégitime, mais uniquement de juger la politique menée par un gouvernement ou une majorité en se finançant, au moins en partie, par de la dette.
C'est pour cela que je ne vois pas bien comment nous pourrions dire que nous allons annuler la dette illégitime pour ne payer que la dette légitime. Et entre nous soit dit, vous ne pouvez annuler la dette que lorsque vous n'avez plus besoin d'emprunter. Si d'une main vous annulez la dette, et que de l'autre, vous demandez toujours à ce que l'on vous prête de l'argent parce que vous êtes en déficit, vous allez voir ce qui va se passer !
L'autre situation dans laquelle la dette peut être annulée, c'est lorsqu'une catastrophe est survenue. Je conçois qu'il ait été extrêmement utile pour l'Allemagne d'avoir bénéficié de l’annulation de sa dette en 1945. Mais il faut se souvenir de l'état de destruction absolue dans lequel était l'Allemagne ! Certains pays ont connu des crises tellement terribles, des situations de misère absolue tellement épouvantables pour le peuple que la seule solution pour s'en sortir était d'annuler la dette. Dans ces cas, le FMI est même le premier à la proposer. La dette privée est alors annulée, et le Club de Paris va effacer une partie de la dette publique de manière à ce que l'excédent primaire soit suffisant pour permettre à l'économie de repartir.
Dans le cas de la Grèce, une grande partie de la dette privée a été réduite, et nous discutons pour réduire une partie de la dette publique. Il ne s'agit pas d'annuler la dette, mais nous pouvons rediscuter des conditions en termes de calendrier et de taux, parce que la situation est invivable pour le peuple grec lui-même. Je n'imagine donc pas que l'on puisse considérer souhaitable que notre pays subisse une catastrophe qui permette d'annuler sa dette.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Je parlais d'une conférence européenne !
M. le ministre. Et que dirait-on au sein d’une telle conférence européenne ? Ce que nous disons entre nous au sein de l'Eurogroupe ou de l'Union européenne ! Nous devons avoir une gestion concertée de l'ensemble des dettes et faire en sorte que les choses se passent en moyenne dans des conditions proches sur l'ensemble de l'Europe. Quand des différences trop fortes apparaissent entre les pays, il faut que les choses s'améliorent pour celui qui est trop endetté, mais que celui qui a des capacités – l'Allemagne aujourd'hui – soit incité à plus consommer, car cela peut être bon pour la croissance européenne. La conférence européenne, elle se tient presque tous les jours, deux fois par mois pour ce qui me concerne. Nous discutons de l'harmonisation des politiques en Europe, ce n'est pas toujours simple parce qu'il existe encore des disparités bien trop fortes entre les pays.
C'est le cœur de la politique d'approfondissement de l'Union économique et monétaire : comment mener des politiques qui rapprochent les pays au lieu de créer une distance entre les compétitivités des différents pays telle que nous avons connu la crise de la zone Euro. Si les compétitivités divergent alors que nous avons une même monnaie, cela conduit à de grandes difficultés.
C'est d'ailleurs pour cela que si nous avons fait des efforts de sérieux budgétaire, nous n'avons jamais mené de politique d'austérité. Je sais qu'il existe un débat sur l'utilisation du terme d'austérité, mais d'un point de vue strict, nous n'avons jamais mené de politique d'austérité comme d'autres pays, qui ont diminué les salaires, les retraites, les allocations sociales. Nous avons connu de moindres augmentations, des maîtrises des hausses, mais ce n'est pas du tout de même nature.
Je ne souhaite donc pas à mon pays qu'il y ait une grande conférence sur la dette, parce que cela voudrait dire que le pays est en grande difficulté. Je préfère essayer de mener une politique qui permette d'éviter ces difficultés. Il y a toute une littérature de gens très sérieux sur ce sujet, vous savez que les économistes sont avec les juristes la race la plus répandue, puisqu'il suffit de faire du droit pour être juriste et de faire de l'économie pour être économiste. On ne devient pas archéologue comme cela, il faut des diplômes. Nous pouvons débattre de tous ces éléments politiques, mais sur cette question de la dette, je suis agnostique. Je cherche ce qu'il y a de plus efficace et de plus utile pour mon pays.
Je comprends la préoccupation d'identifier les détenteurs de la dette. Cela permettrait de surcroît de mener une politique qui nous oriente plus vers telle ou telle partie du monde, car nos équipes font une forme de prospection pour expliquer en quoi notre dette est sûre, liquide.
Mais les paradis fiscaux se sont créés pour des raisons très différentes. Ce n'est pas pour cacher l'origine des obligations dont on est propriétaire, mais pour cacher le fait que l'on a de l'argent ou domicilier ses fonds dans des endroits où ils seront peu imposés. Il n'y a pas de lien. Il y a sûrement des gens dont la fortune cachée au Panama derrière des sociétés écrans est en partie composée d'obligations d'État français, mais ce n'est pas la liquidité dans ce domaine qui alimente ce type de comportements, qu'il faut combattre par ailleurs. C'est la raison d'être de certaines dispositions prévues par la loi que je propose : plus de transparence, permettre de repérer les fraudeurs, supprimer les sociétés écran et toujours connaître leurs bénéficiaires effectifs pour identifier la personne qui est responsable fiscalement. Nous sommes en train de mener tout ce travail, qui n'est possible qu'au niveau international.
Pourquoi, lors des adjudications, ne vendons-nous pas plus, puisque la demande est quatre fois plus élevée que l'offre ? S'il y a effectivement quatre fois plus de demande, ce n'est pas au prix le plus bas. Nous faisons en sorte d'avoir la part nécessaire, au prix le plus faible ; si l'on prend plus, le prix sera plus cher. La gestion de la dette consiste à essayer de payer le moins cher possible pour ce dont nous avons besoin, pas en profiter parce que c'est moins cher.
Pour vous donner quelques chiffres, nous avons aujourd'hui 72 milliards de déficit et 125 milliards de dette renouvelée chaque année. Nous sommes donc presque à 200 milliards par an. La gestion de la dette, aujourd'hui, c'est la gestion de la dette du passé, ce ne sont pas les 70 milliards nouveaux qui sont nécessaires.
M. Éric Alauzet. Pouvez-vous confirmer qu'une augmentation d'un point des taux d'intérêt représente un coût d'environ 2 milliards par an ?
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Le coût à 10 ans serait de 16 milliards.
M. le ministre. Parce qu'en dix ans, toute la dette a été renouvelée. On ne doit pas appliquer à la totalité de la dette une remontée de taux ; en sens inverse, on ne peut pas appliquer à la totalité de la dette des taux en baisse, nous n'en bénéficions qu'au fur et à mesure des renouvellements.
Ceci étant dit, l'État dépense moins en intérêts de dette cette année que l'année précédente, alors que sa dette est plus importante. Les taux d'intérêt comptent pour beaucoup dans la diminution des dépenses publiques, et je préfère payer des professeurs que des intérêts de dette. Emprunter, même avec des taux d’intérêt très faible, reste une dépense au budget de l'État à laquelle il faut bien faire face.
M. Jean-Claude Buisine, rapporteur. Quelle est la stratégie du Gouvernement pour stabiliser ou réduire le ratio dette sur PIB ?
M. le ministre. Comme pour tous les ratios, il faut agir sur le numérateur et le dénominateur. La priorité, c'est la croissance. Une croissance supérieure réduit mécaniquement le ratio et le niveau de déficit devait être rééquilibré pour pousser vers plus de croissance.
L'autre élément consiste à stabiliser la dette. Si son montant reste inchangé, le ratio baisse. Nous ne sommes pas du tout dans cette situation, mais à un moment donné, nous pouvons envisager de réduire le montant de la dette ; certains pays le font.
M. Éric Alauzet. Est-ce que la loi du marché joue sur la faiblesse des taux d'intérêt ? Tous les pays sont dans une logique de réduction de l'endettement, y a-t-il une réduction de l'offre qui influe à la baisse sur les taux d'intérêt ?
Le taux de 3 % a été fixé dans le contexte d’une croissance de 3 % et d’un stock de dette qui s'élevait à 60 % du PIB. Aujourd'hui, alors que la croissance n'est plus que de 1 % et que la dette s'élève à 96 % du PIB, l'objectif de déficit qui permet de stabiliser la dette ne doit plus être le même.
La dette illégitime, pour moi, est celle qui est liée aux intérêts plus qu'au capital. Le capital de la dette est plus une question de redistribution des richesses. Si demain nous annulons la dette, plus personne ne prêtera d'argent.
Depuis l'époque de Raymond Barre, nous avons connu cinq épisodes de relance qui se sont traduits par une augmentation des dépenses plus rapide que celle des recettes, et à chaque fois, il en est résulté de l'endettement. L'enjeu est donc de choisir les investissements qui produisent le plus d'économies. Savons-nous être sélectifs ? Je donne toujours l'exemple des ampoules que l'on remplace et qui sont amorties en deux ans.
S'agissant enfin du report des échéances de réduction du déficit à 3 %, quelles contreparties ont été exigées et admises par la France ? On cite la réforme territoriale et la réforme du code du travail.
M. le ministre. La discussion avec l'Europe ne s'est pas passée ainsi. Nous n’avons pas échangé un délai supplémentaire contre des réformes. Au même moment, nous présentions un programme de réduction des déficits et un programme de réformes. Tous les pays, même l'Allemagne, ont un programme de réformes. L'Allemagne est considérée en situation de déséquilibre car elle est en excédent excessif. Et il est vrai que ce déséquilibre présente un certain danger vis-à-vis des autres pays. Des mesures sont donc préconisées en fonction des situations budgétaires, mais aussi du fonctionnement du marché du travail.
S'il nous avait été demandé sous la contrainte de réduire nos déficits trop vite, nous aurions totalement tué la croissance, et l'ensemble européen – pas seulement la France – en subirait les conséquences. La politique européenne a consisté à passer d'une politique restrictive au niveau global à une politique neutre : pendant que certains pays continuent à diminuer leur déficit, d'autres ont un peu plus de possibilités. Aujourd'hui, sur l'ensemble européen, la politique est légèrement expansive, pour accompagner la reprise de l'activité et de la croissance.
La remarque de M. Alauzet sur les 3 % est exacte, c'est pourquoi l'année prochaine, nous allons stabiliser l'endettement avec un objectif de déficit à 2,7 %. Avec une très faible inflation et une croissance potentielle plus faible que celle que nous avons connue autrefois, le point d’équilibre est plus bas.
M. Éric Alauzet. Avec un déficit à 2,7 %, l'endettement est stabilisé ?
M. le ministre. Absolument. Les 3 % sont une moyenne de longue période, nous n'allons pas changer le chiffre tous les ans en fonction du niveau de l'inflation ou de la croissance potentielle.
Il est évident que le taux d'intérêt est plus faible car plus d’investisseurs veulent acheter des obligations. Mais cette demande tient à deux choses : la confiance, qui explique pourquoi l'on prête plus facilement aux uns plutôt qu'aux autres et l'abondance de liquidités. Quand la Banque centrale européenne déverse des liquidités, il y a plus d'argent à placer, ce qui fait baisser les taux d'intérêt. Aujourd'hui, la BCE ne peut plus baisser ses taux directeurs car ils sont déjà au plus bas. Pour continuer à soutenir l'activité et éventuellement la reprise de l'inflation, elle a recours au quantitative easing et à des politiques non-conventionnelles.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Ils font la même chose aux États-Unis, mais cela fonctionne.
M. le ministre. Nous ne sommes pas dans les mêmes cycles économiques. Cela fait trois ans que la croissance est de 3 % aux États-Unis. J'aimerais connaître cette croissance, et j'aimerais que les taux d'intérêt remontent. Le jour où les taux d'intérêt remonteront, c'est que l'activité économique sera plus forte.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Merci, Monsieur le ministre.
DETTE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (S13) AU SENS DE MAASTRICHT (*) ET SA RÉPARTITION PAR SOUS-SECTEUR
(en milliards d’euros)
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 | |
S13 - Ensemble des administrations publiques |
74,0 |
84,4 |
94,1 |
112,4 |
148,6 |
173,6 |
205,7 |
232,6 |
255,0 |
288,3 |
311,2 |
343,4 |
374,9 |
398,2 |
454,9 |
531,7 |
588,6 |
683,6 |
751,4 |
794,1 |
S1311 - Administration publique centrale |
46,6 |
52,3 |
58,0 |
70,8 |
99,5 |
116,9 |
139,8 |
158,6 |
179,6 |
202,8 |
220,9 |
249,2 |
275,6 |
291,3 |
336,2 |
399,8 |
457,7 |
537,5 |
595,9 |
631,2 |
S13111 - État |
44,3 |
49,8 |
55,1 |
67,5 |
95,0 |
111,5 |
133,7 |
151,9 |
170,8 |
192,4 |
212,7 |
239,6 |
264,6 |
279,0 |
322,5 |
382,2 |
438,6 |
488,6 |
548,0 |
584,9 |
S13112 - Organismes divers d’administration centrale |
2,3 |
2,5 |
2,9 |
3,3 |
4,5 |
5,4 |
6,1 |
6,7 |
8,8 |
10,4 |
8,2 |
9,6 |
11,0 |
12,3 |
13,7 |
17,6 |
19,1 |
48,9 |
47,9 |
46,3 |
S1313 - Administrations publiques locales |
23,9 |
27,7 |
31,1 |
36,0 |
42,8 |
49,5 |
56,3 |
64,3 |
69,3 |
78,9 |
82,4 |
85,9 |
90,9 |
96,0 |
100,6 |
105,4 |
109,5 |
112,1 |
113,9 |
106,8 |
S1314 - Administrations de sécurité sociale |
3,5 |
4,4 |
5,0 |
5,6 |
6,3 |
7,2 |
9,6 |
9,7 |
6,1 |
6,6 |
7,9 |
8,3 |
8,4 |
10,9 |
18,1 |
26,5 |
21,4 |
34,0 |
41,6 |
56,1 |
(en % du PIB) |
||||||||||||||||||||
S13 - Ensemble des administrations publiques |
21,2 |
21,1 |
20,8 |
22,0 |
25,3 |
26,6 |
29,0 |
30,6 |
31,2 |
33,5 |
33,5 |
34,3 |
35,4 |
36,3 |
40,0 |
46,3 |
49,6 |
55,8 |
59,7 |
61,1 |
S1311 - Administration publique centrale |
13,3 |
13,1 |
12,8 |
13,8 |
16,9 |
17,9 |
19,7 |
20,9 |
22,0 |
23,6 |
23,8 |
24,9 |
26,0 |
26,6 |
29,6 |
34,8 |
38,6 |
43,9 |
47,3 |
48,6 |
S13111 - État |
12,7 |
12,5 |
12,2 |
13,2 |
16,2 |
17,1 |
18,8 |
20,0 |
20,9 |
22,4 |
22,9 |
23,9 |
25,0 |
25,4 |
28,4 |
33,3 |
37,0 |
39,9 |
43,5 |
45,0 |
S13112 - Organismes divers d’administration centrale |
0,7 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
0,9 |
1,1 |
1,2 |
0,9 |
1,0 |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,5 |
1,6 |
4,0 |
3,8 |
3,6 |
S1313 - Administrations publiques locales |
6,8 |
6,9 |
6,9 |
7,0 |
7,3 |
7,6 |
7,9 |
8,5 |
8,5 |
9,2 |
8,9 |
8,6 |
8,6 |
8,8 |
8,8 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
9,0 |
8,2 |
S1314 - Administrations de sécurité sociale |
1,0 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,4 |
1,3 |
0,7 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
1,0 |
1,6 |
2,3 |
1,8 |
2,8 |
3,3 |
4,3 |
Série de PIB utilisée pour le calcul du ratio (**) |
349,6 |
399,4 |
453,2 |
511,7 |
588,0 |
652,8 |
709,6 |
760,5 |
817,9 |
859,8 |
929,4 |
1 001,9 |
1 058,6 |
1 097,1 |
1 1 368 |
1 148,4 |
1 186,3 |
1 225,0 |
1 259,0 |
1 299,7 |
(en milliards d’euros) |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
S13 - Ensemble des administrations publiques |
829,4 |
848,0 |
871,2 |
898,3 |
957,8 |
1 051,4 |
1 124,6 |
1 190,9 |
1 194,4 |
1 253,1 |
1 358,4 |
1 531,8 |
1 632,7 |
1 754,7 |
1 869,5 |
1 954,4 |
2 040,3 |
2 096,9 |
S1311 - Administration publique centrale |
675,0 |
696,6 |
718,9 |
746,4 |
804,6 |
877,7 |
915,5 |
960,0 |
950,7 |
994,0 |
1 088,8 |
1 222,1 |
1 293,5 |
1 380,1 |
1 481,4 |
1 558,9 |
1 634,0 |
1 680,1 |
S13111 - État |
630,6 |
654,5 |
676,3 |
704,2 |
764,4 |
829,4 |
869,5 |
915,6 |
912,7 |
949,5 |
1 056,9 |
1 184,7 |
1 262,4 |
1 354,5 |
1 457,3 |
1 536,1 |
1 611,3 |
1 661,2 |
S13112 - Organismes divers d’administration centrale |
44,4 |
42,1 |
42,6 |
42,1 |
40,3 |
48,3 |
46,0 |
44,4 |
38,0 |
44,5 |
31,9 |
37,4 |
31,0 |
25,6 |
24,1 |
22,7 |
22,7 |
18,9 |
S1313 - Administrations publiques locales |
107,2 |
106,7 |
106,8 |
107,1 |
106,1 |
110,0 |
113,7 |
120,2 |
128,0 |
138,2 |
149,1 |
158,1 |
164,1 |
169,8 |
177,0 |
183,8 |
189,5 |
196,5 |
S1314 - Administrations de sécurité sociale |
47,1 |
44,7 |
45,5 |
44,9 |
47,0 |
63,7 |
95,4 |
110,7 |
115,6 |
121,0 |
120,5 |
151,6 |
175,2 |
204,7 |
211,0 |
211,7 |
216,7 |
220,3 |
(en % du PIB) |
||||||||||||||||||
S13 - Ensemble des administrations publiques |
61,0 |
60,2 |
58,7 |
58,2 |
60,1 |
64,2 |
65,7 |
67,2 |
64,4 |
64,4 |
68,1 |
79,0 |
81,7 |
85,2 |
89,6 |
92,4 |
95,3 |
95,7 |
S1311 - Administration publique centrale |
49,7 |
49,5 |
48,4 |
48,3 |
50,5 |
53,6 |
53,5 |
54,2 |
51,3 |
51,1 |
54,6 |
63,0 |
64,7 |
67,0 |
71,0 |
73,7 |
76,4 |
76,7 |
S13111 - État |
46,4 |
46,5 |
45,5 |
45,6 |
47,9 |
50,7 |
50,8 |
51,7 |
49,2 |
48,8 |
53,0 |
61,1 |
63,2 |
65,8 |
69,8 |
72,6 |
75,3 |
75,8 |
S13112 - Organismes divers d’administration centrale |
3,3 |
3,0 |
2,9 |
2,7 |
2,5 |
2,9 |
2,7 |
2,5 |
2,1 |
2,3 |
1,6 |
1,9 |
1,6 |
1,2 |
1,2 |
1,1 |
1,1 |
0,9 |
S1313 - Administrations publiques locales |
7,9 |
7,6 |
7,2 |
6,9 |
6,7 |
6,7 |
6,6 |
6,8 |
6,9 |
7,1 |
7,5 |
8,2 |
8,2 |
8,2 |
8,5 |
8,7 |
8,9 |
9,0 |
S1314 - Administrations de sécurité sociale |
3,5 |
3,2 |
3,1 |
2,9 |
2,9 |
3,9 |
5,6 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
6,0 |
7,8 |
8,8 |
9,9 |
10,1 |
10,0 |
10,1 |
10,1 |
Série de PIB utilisée pour le calcul du ratio (**) |
1 358,8 |
1 408,2 |
1 485,3 |
1 544,6 |
1 594,3 |
1 637,4 |
1 772,0 |
1 853,3 |
1 945,7 |
1 995,8 |
1 939,0 |
1 998,5 |
2 059,3 |
2 086,9 |
2 115,3 |
2 140,0 |
2 190,1 |
1 772,0 |
(*) Dette au 31/12 de chaque année au sens du règlement n° 3605 de la Commission Européenne.
(**) Par rapport aux séries de PIB figurant dans les autres tableaux du thème « Comptes nationaux-Finances publiques », les PIB des années 2013 et 2014 ont été mis à jour, par anticipation de la publication des comptes qui interviendra le 30 mai 2016.
Source Insee.fr : http://www.insee.fr/fr/themes/comptes-nationaux/tableau.asp?sous_theme=3.1&xml=t_3101prov
DÉPENSES ET RECETTES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (S13)
|
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
(en milliards d’euros) |
||||||||||||||||||
Intérêts (D41) |
3,4 |
4,3 |
5,3 |
8,3 |
9,8 |
13,7 |
15,8 |
18,3 |
19,9 |
20,2 |
20,9 |
23,3 |
26,7 |
29,1 |
32,1 |
35,4 |
37,4 |
40,1 |
Taux apparent () = charge d’intérêt de l’année n sur le niveau de dette de l’année n-1 |
|
5,8 |
6,2 |
8,8 |
8,7 |
9,2 |
9,1 |
8,9 |
8,6 |
7,9 |
7,3 |
7,5 |
7,8 |
7,8 |
8,1 |
7,8 |
7,0 |
6,8 |
|
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
(en milliards d’euros) |
|||||||||||||||||||
Intérêts (D41) |
42,8 |
43,8 |
43,9 |
41,1 |
41,7 |
44,6 |
45,6 |
44,8 |
45,8 |
46,5 |
46,8 |
51,0 |
56,2 |
46,5 |
47,7 |
53,6 |
53,9 |
47,9 |
46,1 |
Taux apparent ( %) = charge d’intérêt de l’année n sur le niveau de dette de l’année n-1 |
6,3 |
5,8 |
5,5 |
5,0 |
4,9 |
5,1 |
5,1 |
4,7 |
4,4 |
4,1 |
3,9 |
4,3 |
4,5 |
3,4 |
3,1 |
3,3 |
3,1 |
2,6 |
2,4 |
1 () Selon l’INSEE, en euros constants de 2005, le PIB a progressé de 889 à 1 317 milliards d’euros.
2 () Henri Sterdyniak, La dette publique comme produit du capitalisme financier, Cairn, 2015.
3 () De la même manière, les recettes de l’État représentaient en 1978 21,41 % du PIB contre 16,37 % en 2011. L’augmentation générale des recettes est donc essentiellement due à l’augmentation des recettes des administrations de sécurité sociale (7 points entre 1978 et 2015) et des administrations publiques locales (6 points entre 1978 et 2015) qui ont vu leurs dépenses augmenter également.
4 () Rapport n° 3110, Valérie Rabault, rapporteure générale, sur le projet de loi de finances pour 2016.
5 () Rapport sur le budget de l’État en 2015.
6 () Dans le cas contraire (par exemple, lorsque l’apport en capital a pour but de combler une perte d’une entreprise publique), une telle opération conduira à augmenter la dépense de l’État en comptabilité nationale.
7 () Olivier Blanchard and Daniel Leigh, Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers, Janvier 2013.
8 () Rapport d’information n° 2689 de M. Gilles Carrez préalable au débat d’orientation des finances publiques.
9 () http://www.audit-citoyen.org/wp-content/uploads/2014/05/note-dette.pdf
10 () Loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019.
11 () Rapport de M. Éric BOCQUET, n° 673 tome I (2011-2012) - 17 juillet 2012.
12 () Benjamin Lemoine, Les valeurs de la dette. L’État à l’épreuve de la dette publique française, thèse de Sociologie soutenue le 21 décembre 2011, à l’École des Mines de Paris.
13 () Laure Quennouelle-Corre, Dette publique et marché de capitaux au XXe siècle, in J. Andreau, G. Béaur et J.-Y. Grenier (dir.), La dette publique dans l’histoire, CRH-CHEFF, 2006, pages 445 à 471.
14 () Jacques Percebois, cité par Benjamin Lemoine, Les finances publiques à l’épreuve de la dette, in Jean-Marie Monnier (dir.), Finances publiques, La Documentation française, 2015, pages 34.
15 () Audition du 30 mars 2016 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cfiab/15-16/c1516068.asp
16 () Concernant les dépenses de l’État, l’inflation rend également les mesures d’économie liées à la désindexation ou à la non-revalorisation de certaines prestations plus efficace en termes de réduction du déficit budgétaire : l’inflation est forte, plus les économies dégagées par ces mesures sont importantes.
17 () 2015 : Quels chocs pour faire bouger l’Europe ? Thomas Piketty, Libération du 29 décembre 2014.
18 () OECD 2012, Managing government debt and assets after the crisis, OECD Economics Department Policy Notes, n° 10 February 2012.
19 () L’expression de « répression financière » est due à Ronald McKinnon, professeur d’économie à Stanford, qui l’a employée en 1973 pour désigner les politiques publiques consistant à réglementer et contrôler strictement les activités bancaires, afin de maîtriser la création monétaire et d’orienter les ressources financières vers les secteurs que les États considéraient comme essentiels. Selon l’économiste Carmen M. Reinhart, la répression financière est réapparue à la suite de la crise des dettes souveraines sous la forme des réglementations macroprudentielles, qui accordent un traitement préférentiel à la dette publique, et des achats massifs de dette publique par les banques centrales, qui maintiennent les taux d’intérêt à des niveaux faibles.
20 () En effet, la théorie de la dynamique de la dette indique que le déficit budgétaire stabilisant l’endettement varie suivant le taux de croissance nominal et l’endettement et n’est pas un seuil fixe. Ainsi on peut diminuer l’endettement avec un déficit budgétaire supérieur à 3 % (Italie en 2003) ou l’augmenter s’il est inférieur à 3 % (Italie en 2008).
21 () Audition du 21 juin 2016.
22 () 1978 est la première année disponible pour les données Insee sur la dette de l’ensemble des administrations publiques.
23 () Audition du 29 mars 2016.
24 () Institut Messine, Taux d’intérêt négatifs, douze regards, janvier 2016, page 96.
25 () Audition du 15 mars 2016.
26 () Audition du 22 mars 2016.
27 () Loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France.
28 () Voir l’article de M. Vincent Duchaussoy, L’État livré aux financiers ?. La loi du 3 janvier 1973 sur la Banque de France, La Vie des idées, 1er juillet 2014.
29 () Loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l’activité et au contrôle des établissements de crédit
30 () Cette disposition a été codifiée à l’article L. 141-3 du code monétaire et financier.
31 () Audition du 22 mars 2016.
32 () Rémi Pellet, Droit financier public, Presses universitaires de France, 2014, page 821.
33 () Arrêt CJUE, Ass. Plen., 25 novembre 2012, Pringle ; aff. C-370/12.
34 () Article 4 de la décision de la Banque centrale européenne du 5 juin 2014 concernant la rémunération des dépôts, soldes et avoirs d’excédents de réserves (BCE/2014/23).
35 () Remi Pellet, op. cit., page 739.
36 () Standard & Poor’s ratings services, Méthodologie de la notation souveraine, 23 décembre 2014.
37 () Arrêté du 8 février 2001 portant création d’une agence de la dette.
38 () M. Benoit Cœuré, L’Agence France Trésor, quatre ans après, Revue française de finances publiques, janvier 2005.
39 () Benjamin Lemoine, Les valeurs de la dette. L’État à l’épreuve de la dette publique française, thèse de Sociologie soutenue le 21 décembre 2011, à l’École des Mines de Paris.
40 () Benjamin Lemoine, « Dette publique, débat confisqué. Pourquoi la France emprunte-t-elle sur les marchés ? », La Vie des idées, 12 février 2013.
41 () Audition du 15 mars 2016.
42 () Loi organique n° 2001-692 relative aux lois de finances.
43 () Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
44 () La méthode de l’assimilation permet d’éviter la multiplication des lignes d’obligations en rattachant une nouvelle émission à une tranche émise antérieurement. La nouvelle émission épouse l’ensemble des caractéristiques de l’emprunt antérieur : maturité, montant du coupon d’intérêts et clauses particulières. De ce fait, le nombre de lignes de cotation est réduit tandis que le montant de chacune d’elle est plus élevé, ce qui augmente la visibilité commerciale des titres et facilite leur promotion. C’est un moyen d’assurer leur liquidité, car il est plus facile de trouver un acheteur ou un vendeur dès qu’on le souhaite sur le marché secondaire.
45 () Taux de rendement actuariel d’une valeur du Trésor fictive dont la durée de vie serait à chaque instant égale à 10 ans. Ce taux est obtenu par interpolation linéaire entre les taux de rendement actuariels annuels des deux valeurs du Trésor qui encadrent au plus proche la maturité 10 ans.
46 () Article 59 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, décret n° 2012-1517 du 29 décembre 2012 relatif aux clauses d’action collective applicables aux titres d’État et arrêté du 29 décembre 2012 relatif aux clauses d’action collective applicables aux titres d’État.
47 () Créé par le traité de Maastricht, le comité économique et financier prépare les travaux du Conseil de l’Union européenne notamment en ce qui concerne la situation économique et financière, le taux de change de l’euro et les relations avec les pays tiers et les institutions internationales. Ce comité consultatif forme également le cadre pour la préparation et la poursuite du dialogue entre le Conseil de l’Union européenne et la Banque centrale européenne.
48 () La liste peut être consultée sur le site internet de la Federal reserve bank of New-York : https://www.newyorkfed.org/markets/pridealers_current.html
49 () http://europa.eu/efc/sub_committee/primary_dealer/pd_composition/index_en.htm
50 () Audition du 9 mars 2016.
51 () Audition du 9 mars 2016.
52 () En application de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions ou, le cas échéant, l’autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine saisit à titre préalable la commission afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ».
53 () M. Benjamin Lemoine, Les valeurs de la dette. L’État à l’épreuve de la dette publique française, thèse de Sociologie soutenue le 21 décembre 2011, à l’École des Mines de Paris, page 177.
54 () Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.
55 () Benjamin Lemoine, Les finances publiques à l’épreuve de la dette, in Jean-Marie Monnier (dir.), Finances publiques, La Documentation française, 2015, page 40.
56 () À l’exception des titres indexés sur l’inflation, dont la valeur du coupon est actualisée chaque année d’après une formule de calcul prenant en compte l’inflation.
57 () Conformément à l’article 25 de la LOLF, les primes à l’émission sont considérées comme des ressources de trésorerie.
58 () Année sans syndication.
59 () Yakov Amihud et Haim Mendelson, Asset pricing and the bid-ask spread, Journal of financial economics n° 17 avril 1986.
60 () Autorité des marchés financiers, Étude sur la liquidité des marchés obligataires français, Étude conjointe de la Division de la surveillance des marchés et de la Division études, stratégies et risques, 16 novembre 2015, page 4.
61 () Audition du 29 mars 2016.
62 () L’encours moyen des OAT est de 25 milliards d’euros.
63 () Bulletin mensuel de l’AFT de mars 2016.
64 () Raphaël Gallardo, Banques centrales, le zéro et l’infini, 10 mars 2016 :
http://communautes.agefi.fr/status/8912
65 () Jean-Hervé Lorenzi et Pierre-Xavier Prietto, S’affranchir du piège de la dette, Le Monde Économie, jeudi 18 juin 2015, page 6.
66 () M. Benoit Cœuré, L’Agence France Trésor, quatre ans après, Revue française de finances publiques, janvier 2005 : « Le gestionnaire de la dette doit résister à la tentation d’opérations opportunistes, qui viseraient un gain immédiat en tirant profit de telle ou telle configuration de marché mais lui aliéneraient la confiance des investisseurs et conduirait le marché à prendre position contre lui. »
67 () Audition du 15 mars 2016.
68 () Voir par exemple l’arrêté du 15 avril 2016 relatif à la création d’obligations assimilables du Trésor 0,00 % 25 mai 2021 en euros.
69 () En comptabilité nationale et en comptabilité générale de l’État, l’étalement des primes et décotes à l’émission permet d’assurer la correspondance entre la charge d’intérêt annuelle et le taux demandé par le marché au moment de l’émission, de sorte que la quantité de titres émis sur des souches anciennes est neutre sur le calcul du déficit « maastrichtien ».
70 () Audition du 15 mars 2016.
71 () Règlement (UE) n° 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24).
72 () Audition du 9 mars 2016.
73 () Audition du 9 février 2016.
74 () Pour les résidents français, les intérêts des OAT sont soumis, sauf exception, au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
75 () Eurostat, Structure of government debt, juin 2015 : http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Structure_of_government_debt
76 () Données indisponibles pour le Royaume-Uni, le Danemark et la Grèce.
77 () Gaël Giraud, Renationaliser la dette publique française – pourquoi et comment, CNRS, École d’économie de Paris, décembre 2012 : http://www.gaelgiraud.net/wp-content/uploads/2012/12/renationaliser-la-dette-policy-paper-REFI.pdf
78 () Audition du 10 février 2016.
79 () Audition du 15 mars 2016.
80 () III de l’article 125 A du code général des impôts, introduit par l’article 22 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009.
81 () III de l’article 125 A du code général des impôts, introduit par l’article 22 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009.
82 () M. Gilles Carrez, Rapport fait par la commission des finances sur le projet de loi de finances rectificative pour 2009, Assemblée nationale, XIIIe législature, n° 2132, 2 décembre 2009, page 329.
83 () http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
84 () M. Christophe Jobert, de BNP Paribas, a évoqué un montant de 15 milliards d’euros par jour : 10 milliards d’obligations à moyen et long terme, et 5 milliards d’emprunts à court terme.
85 () Audition du 29 mars 2016.
86 () Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
87 () Dans une recommandation adoptée le 10 mars 2015, le Conseil a accordé à la France un délai de deux ans afin de ramener son déficit public sous la limite des 3 % du PIB, c’est-à-dire à compter de 2017.
88 () Le déficit du budget de l’État a ainsi été divisé par deux en 5 ans, passant de 148,8 milliards d’euros en 2010 à 70,5 milliards d’euros en 2015.
89 () Targeted longer-term refinancing operations
90 () Le bilan des achats de l’Eurosystème dans le cadre du PSPP est mis à jour chaque mois sur le site internet de la BCE : https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html .
91 () Audition du 9 février 2016
92 () Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (grande chambre) du 16 juin 2015 – Peter Gauweiler et autres contre Deutscher Bundestag – Affaire C-62/14.
93 () Programme d’achats de titres du secteur public (public sector purchase programme).
94 () Patrick Artus, Monétisation des dettes publiques : qui sont les gagnants et les perdants ?, Flash Problèmes structurels n° 60, Natixis recherche économique, 28 janvier 2015.
95 () Jean-Cyprien Heam, Bertrand Marc, Raphaël Lee, Mathilde Pak, L’assouplissement quantitatif de la BCE a fait baisser les taux d’intérêt et contribue à la reprise de la zone euro, Note de conjoncture, INSEE, décembre 2015.
96 () Entretien au journal Le Monde, samedi 30 avril 2016, supplément Économie et entreprises, page 3.
97 () Hypothèse que semblent accréditer les situations au Japon et aux États-Unis, où la pause dans la hausse des taux amorcée par la réserve fédérale se prolonge.
98 () Cette proposition a par exemple été émise par MM. Olivier Blanchard et Francesco Giavazzi dans le Rapport du CAE - Réformer le Pacte de stabilité et de croissance - 2004.
99 () L’article 123 du TFUE précise ainsi que : « Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne, du même traitement que les établissements privés de crédit ».
100 () Un haircut est une réduction de la valeur de la dette d’un emprunteur dans le cadre d’une restructuration de dette. Lors d’une procédure de banqueroute, le haircut est une annulation totale ou partielle de la dette due au(x) créancier(s), basée sur une évaluation de la dette et des biens totaux de l’endetté.
101 () Between Debt and the Devil : Money, Credit, and Fixing Global Finance, Princeton University Press, 2015.
102 () Le concept de monnaie hélicoptère a été défini pour la première fois par l’économiste américain Milton Friedmann en 1969 dans son livre "The optimum quantity of money". Il y développait une métaphore : en situation de déflation, lorsque la demande est insuffisante et que les prix baissent, les autorités peuvent créer de la monnaie et la jeter d’un hélicoptère dans les rues afin de redonner du pouvoir d’achat aux gens. Cet argent supplémentaire disponible relance la consommation et permet de combler l’écart entre la production et la demande, suscitant une relance de l’inflation. Il est important de souligner que la création monétaire serait opérée sans contrepartie, c’est-à-dire sans endettement correspondant. Si cette idée est régulièrement évoquée dans l’actualité, certains économistes estiment qu’une création monétaire ciblée au profit d’investissements créateurs de richesse serait plus efficace pour soutenir l’activité.
103 () Gérard Béaur, « Le long passé de la dette publique », Le Monde, 14 et 15 août 2001.
104 () Données INSEE, septembre 2015
© Assemblée nationale