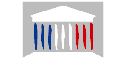
N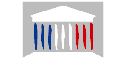
° 4082
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 octobre 2016
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET LA COMMISSION DES FINANCES
en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 3 février 2016 (1)
sur l'extraterritorialité de la législation américaine
Président
M. Pierre LELLOUCHE
Rapporteure
Mme Karine BERGER
Députés
(1) La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
La mission d’information est composée de : M. Pierre LELLOUCHE, président ; Mme Karine BERGER, rapporteure ; MM. Eric ALAUZET, Christophe CARESCHE, Charles de COURSON, Jean-louis DESTANS, Jacques MYARD et Mme Marie-line REYNAUD
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 9
I. L’EXTRATERRITORIALITÉ : LA PERCEPTION EXTERNE D’UN « NON-PROBLÈME » DU POINT DE VUE AMÉRICAIN 13
A. L’EXTRATERRITORIALITÉ, QUESTION DE POINT DE VUE 14
1. Vues d’Europe, de nombreuses lois ou réglementations américaines « extraterritoriales » 14
2. Mais du point de vue américain, la plupart ne sont pas extraterritoriales 15
B. UNE CERTAINE CONCEPTION DU RÔLE DU DROIT 16
1. Le droit comme instrument de puissance économique et de politique étrangère 16
a. Le droit mis au service des objectifs de la politique étrangère et des intérêts économiques des États-Unis 16
b. … et aussi au service direct des intérêts des firmes américaines ? 18
c. La mobilisation des moyens policiers et de renseignement américains au service de la politique juridique extérieure 20
2. Mais un droit américain qui ne saurait être l’objet d’une négociation internationale 22
C. DES CONTRADICTIONS AGGRAVÉES PAR LE BLOCAGE ACTUEL DU SYSTÈME POLITIQUE 23
II. LES ENJEUX DE L’EXTRATERRITORIALITÉ DE CERTAINES LOIS AMÉRICAINES 27
A. LES ENJEUX ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 27
1. Des pénalités considérables et en forte croissance, qui, de fait, frappent très souvent les entreprises européennes 27
a. Les pénalités pour corruption internationale d’agents publics 27
b. Les pénalités pour non-respect des sanctions économiques américaines 29
2. Le doute sur l’équité : des entreprises européennes particulièrement ciblées ? 31
a. Les pénalités pour corruption internationale 32
b. Les pénalités pour non-respect des embargos et/ou de la législation anti-blanchiment 34
3. Un prélèvement sur les économies européennes 35
4. Une donne nouvelle : le poids croissant des économies émergentes et de leurs entreprises 36
B. LES ENJEUX POLITICO-DIPLOMATIQUES : LE RISQUE D’EFFETS CONTRE-PRODUCTIFS, Y COMPRIS DU POINT DE VUE AMÉRICAIN 37
1. Le mécontentement des pays tiers et même des alliés des États-Unis 37
2. Une fragilisation potentielle du rôle international du dollar et du système financier international 38
3. La difficulté à régler finement les politiques de sanctions : le cas de l’Iran 38
III. L’ANALYSE JURIDIQUE DE L’EXTRATERRITORIALITÉ DES LOIS AMÉRICAINES 41
A. LES FONDEMENTS GÉNÉRAUX DES LÉGISLATIONS À PORTÉE EXTRATERRITORIALE 41
1. Le droit américain 41
2. Le droit français et européen 42
a. En matière pénale 42
b. En matière civile et commerciale 43
B. LA PRATIQUE : LES PRINCIPALES « ENTRÉES » DES LOIS AMÉRICAINES EXTRATERRITORIALES 45
1. Les lois qui s’appliquent à toutes les sociétés présentes sur les marchés financiers réglementés américains 46
a. La lutte contre la corruption internationale 46
b. Un autre exemple, la loi Sarbanes-Oxley 48
2. La lutte contre le blanchiment d’argent d’origine criminelle : une législation qui impose aux banques américaines de contrôler leurs correspondants étrangers 48
3. Les autres cas de figure (violations de sanctions économiques, lutte contre les organisations mafieuses, fiscalité personnelle) : plutôt une conception « extensive » des principes généraux de compétence territoriale et/ou personnelle ? 49
a. Les sanctions économiques et embargos 49
i. Des sanctions qui peuvent être ouvertement extraterritoriales 49
ii. Une dimension de « sécurité nationale » susceptible de « justifier » une extraterritorialité débridée 50
iii. Mais des pénalités contre les banques européennes plutôt fondées sur une interprétation très extensive du critère de rattachement territorial via l’usage du dollar 50
b. La lutte contre le crime organisé (loi RICO) : une volonté de sanctionner globalement les organisations mafieuses qui permet une territorialité « large » 53
c. La fiscalité : l’emploi large du critère de compétence personnelle à côté du critère territorial 53
4. La question particulière de la remise en cause des immunités souveraines 54
C. LES PRATIQUES AMÉRICAINES DE POURSUITE S’APPUIENT SUR DES CRITÈRES INCERTAINS, DES MÉTHODES INTRUSIVES, VOIRE ABUSIVES 56
1. Des critères de compétence territoriale ou personnelle pour le moins incertains 57
a. Le problème de l’implication des « US Persons » 57
b. Des définitions législatives ou plus vraisemblablement jurisprudentielles ? 58
c. Quelle accessibilité du droit ? 58
2. Le problème de l’incidence des méthodes de l’administration et de la justice américaines : de l’extraterritorialité d’édiction à celle d’exécution 59
a. Des méthodes très intrusives 59
b. La loi FATCA, exemple d’option pour une méthode de recueil d’informations intrusive et sans limite de territorialité 60
c. De multiples administrations et agences américaines impliquées : le partage du butin 61
d. La menace de sanctions très lourdes et imprévisibles qui contraint à transiger et à renoncer à la voie judiciaire 62
e. Pourtant, en cas de procès, une justice américaine assez prudente sur l’extraterritorialité 64
i. La jurisprudence récente de la Cour suprême 64
ii. Les jugements sanctionnant certains abus de l’application de la loi FCPA 66
f. Les autres conséquences du recours aux transactions 67
i. Les engagements de conformité et de contrôle 67
ii. Les engagements de non-recours et de silence 70
D. L’APPLICATION EXTRATERRITORIALE DES LOIS AMÉRICAINES EN CAUSE EST-ELLE CONTRAIRE AU DROIT INTERNATIONAL ? 71
1. L’extraterritorialité d’édiction n’est pas en soi contraire au droit international 71
2. D’autres pays ou entités adoptent des législations ou des jurisprudences extraterritoriales 72
a. L’Union européenne 72
i. Les règlements européens de sanctions économiques : un champ bien délimité mais potentiellement extraterritorial 72
ii. Des jurisprudences parfois peu exigeantes quant au lien nécessaire pour imposer une règle européenne hors du territoire communautaire 73
b. La multiplication des législations anti-corruption à portée plus ou moins extraterritoriale 74
3. Le débat sur la conformité au droit international des législations américaines en cause 77
a. Le passé : l’exemple topique de la loi Helms-Burton 77
b. Les lois FCPA et FATCA : des textes confortés par leur inscription dans une démarche internationale partagée 77
c. Des mesures de sanctions et d’embargo en contrariété avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce ? 79
IV. UNE SITUATION POLITIQUE ET JURIDIQUE EN FRANCE ET EN EUROPE NE POSANT PAS DE LIMITES À L’EXTRATERRITORIALITE DES LOIS AMERICAINES 81
A. L’ABSENCE DE POLITIQUE « CONVAINCANTE » DE RÉPRESSION DE LA CORRUPTION INTERNATIONALE POUVANT LIMITER L’INTRUSION EXTRATERRITORIALE AMÉRICAINE 81
1. Une possible limitation de l’intrusion américaine par le « partage » coopératif et l’application du principe non bis in idem 81
a. La convention OCDE de 1997 : un appel explicite au « partage » coopératif des procédures entre juridictions 81
b. La jurisprudence française : vers une reconnaissance élargie du principe non bis in idem dans le cas de procédures étrangères 82
c. La position américaine : aucune garantie que des poursuites parallèles ne soient engagées 84
2. Un droit français incapable d’engendrer une coopération et des poursuites coordonnées 87
a. Le constat : jusqu’à présent, des condamnations peu nombreuses, tardives et d’une sévérité modérée 87
b. Un renforcement du dispositif engagé en 2013 88
B. UNE RECONNAISSANCE FRANÇAISE DE L’APPLICATION DU FATCA AUX EFFETS SECONDAIRES NÉFASTES : LE PROBLÈME DES « AMÉRICAINS ACCIDENTELS » 89
1. Le choix ancien d’une politique coopérative 89
a. La convention fiscale bilatérale 89
b. L’accord « FATCA » 90
2. L’application très insatisfaisante de la convention fiscale bilatérale : les « Américains accidentels », des français victimes de son application 91
C. DES EMBARGOS ET SANCTIONS INTERNATIONALES PRINCIPALEMENT EUROPÉENS MAIS APPLIQUÉS ET SANCTIONNÉS AU NIVEAU NATIONAL 93
1. Des sanctions adoptées majoritairement au niveau européen 93
2. L’état du droit : la violation d’embargo est généralement une infraction douanière 94
3. Les sanctions concernant l’Iran : une politique de coordination coopérative décevante 96
a. Les enjeux de l’accord sur le nucléaire iranien 97
b. Une bonne volonté de principe de l’exécutif américain 98
c. Cependant, un dispositif qui reste entaché d’interrogations paralysantes pour les entreprises européennes 98
d. Le maintien de l’essentiel des sanctions « primaires » américaines, y compris sur la compensation des opérations en dollars via le système financier américain 99
e. Le problème des « lettres de confort » 102
f. La « guerre psychologique » 103
g. Les contre-arguments américains 103
4. L’inefficacité des « lois de blocage » 104
a. Un dispositif français utile mais mal adapté pour se protéger contre le caractère invasif de la justice américaine 104
b. Le règlement européen de 1996 à rénover 107
V. LES RECOMMANDATIONS DE LA MISSION : JOUER À ARMES ÉGALES 109
A. EXIGER LA RÉCIPROCITÉ ET SE DOTER D’ARMES ÉGALES POUR IMPOSER DES POLITIQUES COOPÉRATIVES 110
1. Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : être à armes égales dans la lutte contre la corruption internationale 110
2. Les solutions envisagées au problème des « Américains accidentels » 112
B. LES EMBARGOS ET SANCTIONS ÉCONOMIQUES : UN RENFORCEMENT DES MOYENS EUROPÉENS ET UNE CLARIFICATION DIPLOMATIQUE INDISPENSABLE AVEC LES ÉTATS-UNIS 114
1. La possibilité de rendre les dispositifs plus efficaces et transparents en s’inspirant des pratiques américaines 114
a. Le projet de loi relatif à la violation des embargos et autres mesures restrictives 114
b. Vers un « OFAC européen » ? 115
2. Une demande de clarification du régime des sanctions concernant l’Iran 117
3. Les options de confrontation 119
a. Les précédents 119
i. L’affaire du gazoduc sibérien 119
ii. Les lois Helms-Burton et d’Amato-Kennedy 119
b. Saisir l’Organisation mondiale du commerce ? 120
c. Le renforcement des « lois de blocage » 121
4. Les stratégies de contournement : promouvoir l’euro, privilégier les cotations boursières en Europe, … 122
C. LES OUTILS NECESSAIRES : SE DOTER DES MOYENS POUR ÊTRE « À ARMES ÉGALES » 124
1. En matière de renseignement économique 124
2. En matière d’organisation judiciaire et d’outils juridiques 127
D. UNE AUTRE PISTE DE COOPÉRATION : LES NÉGOCIATIONS INTERNATIONALES, NOTAMMENT CELLE DU PARTENARIAT TRANSATLANTIQUE, OFFRENT-ELLES DES OPPORTUNITÉS D’AVANCER ? 127
CONCLUSION 131
SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS 135
CONTRIBUTION DE M. JACQUES MYARD 141
TRAVAUX DE LA COMMISSION 143
ANNEXE N°1: LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA MISSION 163
ANNEXE N° 2 : LETTRE UNAI 167
Mesdames, Messieurs,
Depuis quelques années (depuis 2008 pour être précis), la chronique est régulièrement défrayée par les amendes colossales infligées aux États-Unis à des entreprises européennes. Les entreprises françaises ont particulièrement été frappées en 2014, année qui a vu la banque BNP-Paribas accepter de payer un montant record de près de 9 milliards de dollars pour avoir violé les embargos financiers des États-Unis contre plusieurs pays et Alstom trouver un arrangement à près de 800 millions de dollars avec les autorités judiciaires américaines (1) suite à des faits de corruption internationale au moment même – coïncidence ou non… – où la branche énergie de l’entreprise était rachetée par General Electric. Depuis lors, d’autres entreprises françaises et plus généralement européennes ont été confrontées à la rigueur du système judiciaire américain, la dernière étant Volkswagen. Cet état de fait ne peut que peser, à terme, sur la qualité des relations franco-américaines (et euro-américaines), pourtant fondées sur une alliance bicentenaire, la fraternité du sang versé durant deux guerres mondiales et, aujourd’hui encore, une très grande proximité sur de nombreux grands dossiers internationaux.
Le système judiciaire américain est certes connu pour sa sévérité : la délinquance économique est très lourdement sanctionnée, par des peines de prison qui peuvent atteindre une quinzaine d’années pour les faits de corruption et des amendes considérables pour les entreprises. Les entreprises américaines sont donc, elles aussi, mises à contribution. Le fait est pourtant que l’on constate une surreprésentation évidente des entreprises européennes dans les dossiers relatifs à l’application de certaines lois américaines, qu’il s’agisse de celles punissant la violation des embargos financiers internationaux des États-Unis (les banques européennes ont payé pratiquement toutes les plus grosses amendes américaines à ce titre) ou encore de la corruption internationale (les entreprises européennes ont versé les deux tiers des plus grosses amendes à ce titre).
Cette situation a des conséquences macro-économiques perceptibles : le versement de plusieurs dizaines de milliards de dollars, en quelques années, par les entreprises européennes représente un prélèvement significatif sur les économies européennes au bénéfice des finances publiques américaines. Elle entraîne aussi, inévitablement, des interrogations sur un possible « ciblage » des entreprises européennes et sur la loyauté de certaines pratiques des administrations américaines. Enfin, il ne faut pas négliger les enjeux diplomatiques : le récent accord avec l’Iran sur son programme nucléaire a pour contrepartie, en principe, la réintégration de ce pays dans les circuits économiques et financiers mondiaux grâce à la levée d’une grande partie des restrictions économiques et financières le concernant. Mais si l’absence de levée de la plupart des sanctions décidées aux États-Unis, la complexité de celles qui sont maintenues et leur application potentiellement extraterritoriale découragent même les entreprises européennes de retourner en Iran, cet engagement ne sera pas tenu et l’accord sera un échec, bien qu’il ait été porté à bout de bras par le président Barack Obama.
Le trouble est accentué par la nature des manquements qui justifient, selon les autorités américaines, les sanctions financières qu’elles infligent. Dans certains cas, celles-ci sont évidemment légitimes : il est normal que les consommateurs américains puissent obtenir réparation dans leur propre pays des fraudes aux règles anti-pollution imputées à Volkswagen, si elles sont avérées ; il est normal aussi que la complicité active des filiales américaines de certaines banques suisses dans la fraude fiscale de citoyens américains soit sanctionnée par le fisc américain. Mais certaines dispositions répressives appliquées par les États-Unis suscitent plus de débats en raison de leur caractère extraterritorial : il en est ainsi pour celles sanctionnant des versements de corruption effectués par des entreprises non-américaines au bénéfice d’officiels non-américains pour obtenir des contrats sur un sol non-américain, ou encore celles prétendant interdire à des banques non-américaines d’opérer certaines transactions financières avec des entités ou des pays également étrangers…
C’est la question de l’extraterritorialité qui est là posée : un État peut-il imposer ses lois hors de son territoire, lequel constitue la limite « naturelle » de sa souveraineté ? Cette question complexe appelle une analyse juridique, que le présent rapport développe : il faut distinguer l’extraterritorialité d’édiction, qui ne semble pas en elle-même contraire aux principes de base du droit international, de celle d’exécution, qui l’est ; il faut aussi être conscient que l’application de fait extraterritoriale de certaines législations américaines n’est pas fondée sur une revendication délibérée d’extraterritorialité, mais sur des interprétations larges, voire « tirées par les cheveux », du critère de compétence territoriale – ainsi du raisonnement selon lequel toute opération bancaire libellée en dollars dans le monde finit par donner lieu à une compensation effectuée sur le sol américain.
Mais l’analyse juridique ne suffit pas, il faut aussi une analyse et des réponses politiques. Le président et la rapporteure de la mission se sont rendus aux États-Unis pour s’efforcer de comprendre pourquoi ce pays a une telle tendance à prétendre imposer ses règles de droit au monde entier, et à l’Europe en particulier. La situation actuelle résulte sans doute de la conjonction de plusieurs facteurs : une volonté politique parfaitement « pensée » de valoriser la puissance économique américaine (aucune grande entreprise ne peut renoncer au marché américain) en faisant du droit, plus précisément de certaines législations dans le champ économique, un instrument de politique étrangère et de promotion des intérêts économiques américains ; mais aussi une situation actuelle de relatif blocage du système politique, compte tenu de l’incapacité de l’exécutif et du Congrès à trouver des compromis, qui permet aux différents acteurs institutionnels (administrations compétentes, organismes de régulation, procureurs, Congrès…) de développer leur activisme répressif extraterritorial sans qu’aucune autorité n’y mette des limites ; le tout sur fond d’assez large indifférence (dans une large part des milieux décisionnaires) à la politique internationale, donc aux conséquences diplomatiques dommageables de cet activisme…
S’agissant du contexte politique et géopolitique, il faut également souligner un autre point : les États-Unis ne sont pas les seuls à édicter un droit économique à portée extraterritoriale et à l’appliquer. D’autres États ou entités le font, à commencer par l’Union européenne ; mais aussi, déjà et sans doute de plus en plus à l’avenir, les grands pays émergents. En effet, l’édiction croissante de règles à portée extraterritoriale est probablement inéluctable dans une situation d’intensification constante des échanges et de globalisation. Et toute puissance économique significative peut être tentée, pour des raisons légitimes (lutter contre le crime international, la corruption, le blanchiment, le financement du terrorisme…) ou moins honorables, de jouer la carte d’une application « activiste » de législations extraterritoriales. Il faut enfin être conscient que les normes juridiques qui se diffusent mondialement ne sont pas seulement le fait des États et entités politiques, mais aussi d’acteurs privés, notamment des entreprises (par exemple les entreprises transnationales qui uniformisent les clauses de leurs contrats avec leurs fournisseurs, celles de l’internet qui imposent à tous les utilisateurs de leurs services leur conception de la protection des données personnelles ou de la liberté des contenus…). De ce point de vue, la mondialisation économique est le vrai moteur de la remise en cause de la souveraineté juridique nationale des États.
Comment réagir – au moins au problème du moment, qui est celui de l’extraterritorialité américaine ? Trois types de postures, qui peuvent d’ailleurs être complémentaires, sont envisageables. Dans la mesure où certaines législations extraterritoriales américaines visent des objectifs qui sont aussi les nôtres – lutter plus efficacement contre la corruption internationale, le financement du terrorisme ou encore la fraude fiscale internationale –, la coopération, impliquant parfois que nous nous rapprochions des mécanismes juridiques américains, compte tenu de leur efficacité, est légitime dans certains domaines, sous réserve qu’elle se fasse « à armes légales », avec des moyens juridiques mais aussi matériels (de recueil et de traitement du renseignement économique) qui permettent aux pays européens et à la France en particulier d’être crédibles. Deuxième option, l’évitement, avec par exemple la promotion de l’usage de l’euro dans les transactions internationales en réponse aux risques qui s’attachent à l’usage du dollar. Dernière option, la confrontation juridique et politique, qui a d’ailleurs donné des résultats dans un passé récent (dans les années 1980 et 1990).
En tout état de cause, la capacité de l’Union européenne, véritable superpuissance économique et juridique quand elle le veut, à se mobiliser sera déterminante. Le récent remboursement fiscal de plus de 13 milliards d’euros demandé par la Commission européenne à Apple donne à cet égard des espoirs, après une bonne décennie de renoncement face aux pratiques agressives des administrations et entreprises américaines (étant toutefois souligné que cette décision elle-même, politiquement très importante, ne comporte aucune dimension extraterritoriale, puisqu’il s’agit justement de faire payer à l’entreprise en cause le montant de l’impôt indûment évité pour ses activités sur le sol européen).
Les relations transatlantiques et plus spécifiquement la relation bilatérale franco-américaine sont extrêmement riches et denses, fondées sur l’histoire, la circulation des hommes et des idées, le partage des valeurs démocratiques et aussi les intérêts économiques. Elles doivent être préservées. Cela implique que leur équilibre ne soit pas remis en cause par l’exercice abusif de ce que certains perçoivent comme une forme d’imperium dans le domaine du droit. Cela nécessite donc, et c’est la principale recommandation de ce rapport, que la France et l’Union européenne se dotent d’armes juridiques et d’intelligence économique égales à celles construites par les États-Unis.
I. L’EXTRATERRITORIALITÉ : LA PERCEPTION EXTERNE D’UN « NON-PROBLÈME » DU POINT DE VUE AMÉRICAIN
L’extraterritorialité des lois, en première analyse, pourrait sembler être une réalité « objective » renvoyant essentiellement, d’une part à des raisonnements et des catégories juridiques, d’autre part à des considérations d’ordre diplomatique : il serait un fait que certaines lois sont ou non extraterritoriales ; et, dans le cas de lois extraterritoriales, il ne devrait échapper à personne qu’elles peuvent être perçues comme des atteintes à des souverainetés étrangères et donc entraîner des difficultés diplomatiques.
Cependant, s’étant rendus aux États-Unis dans le cadre de leurs travaux, le président et la rapporteure de la mission ont pu constater que l’extraterritorialité n’est pas une évidence objective, car le point de vue compte beaucoup : des lois ou des pratiques américaines qui nous paraissent évidemment extraterritoriales ne sont pas perçues comme telles outre-Atlantique. Quant au fait qu’elles puissent « faire problème », on constate en fait deux grands types de perceptions aux États-Unis :
– un cercle assez étroit de diplomates, hauts-fonctionnaires, universitaires et think-tankers est parfaitement conscient (beaucoup plus qu’en Europe et en France en particulier) que le droit a une portée internationale, qu’il peut être un instrument de la diplomatie et de la politique économique internationale, qu’il concourt au soft power (2). Les intéressés assument l’utilisation du droit extraterritorial comme élément de la puissance américaine : ils savent qu’inévitablement cela peut susciter des mécontentements, mais c’est un prix à payer pour tout exercice de puissance et l’efficacité doit primer.
Comme, par ailleurs, la majorité des citoyens des États-Unis, pays-continent, sont globalement moins préoccupés par les enjeux internationaux que nous ne le sommes en Europe, il apparaît aussi qu’en-dehors du cercle précité, le plus grand nombre des officiels américains, même occupant des fonctions ou des mandats importants – par exemple des hauts-fonctionnaires des administrations financières ou des autorités de régulation, ou bien des membres du Congrès –, sont en fait assez indifférents à ce type de questionnements. De leur point de vue, la loi américaine ne peut que rarement être qualifiée d’extraterritoriale, même si elle conduit à sanctionner des entreprises ou des personnes qui n’ont guère de liens avec les États-Unis, et doit de toute façon être appliquée ; de même les intérêts légitimes des citoyens américains doivent être privilégiés sur toute considération diplomatique.
A. L’EXTRATERRITORIALITÉ, QUESTION DE POINT DE VUE
1. Vues d’Europe, de nombreuses lois ou réglementations américaines « extraterritoriales »
De nombreuses législations ou réglementations américaines peuvent, à des degrés divers, être considérées comme plus ou moins « extraterritoriales » (le rapport reviendra infra sur la définition de l’extraterritorialité).
Trois domaines particulièrement problématiques ont clairement été identifiés par la mission :
– les régimes américains de sanctions internationales, avec les pénalités financières considérables payées notamment par les banques européennes accusées de les avoir violés ;
– la législation américaine réprimant la corruption d’agents publics à l’étranger, dont le non-respect a également entraîné de lourdes pénalités pour des entreprises européennes ;
– l’application de la fiscalité personnelle américaine aux citoyens américains non-résidents, même « accidentellement » américains, application rendue plus systématique par la loi et les traités dits « FATCA ».
Mais, au cours des auditions, d’autres domaines ou cas de figure d’application plus ou moins extraterritoriale de règles américaines ont été signalés. D’autres sont documentés par diverses sources. On peut citer :
– le droit américain de la concurrence qui (de même que le droit européen) prétend contrôler les fusions entre des entreprises non-américaines en raison de leurs effets éventuels sur le marché américain et sanctionner, pour les mêmes raisons, leurs ententes illicites ;
– les dispositions anti-blanchiment américaines, qui imposent aux banques américaines de contrôler les pratiques de leurs correspondants étrangers, et peuvent être spécifiquement tournées contre des organisations ciblées par les États-Unis, comme le Hezbollah libanais (voir infra) ;
– connexe des questions d’embargos et de sanctions, mais pouvant avoir un champ plus large, les réglementations américaines des exportations (notamment de produits « duaux »), qui peuvent s’étendre à l’exportation de biens depuis des pays tiers dès lors que ces biens intègrent 10 % de contenu américain ;
– certaines législations concernant la comptabilité et l’organisation des entreprises qui peuvent s’imposer à de très nombreuses entreprises du monde, notamment la loi « Sarbanes-Oxley » de 2002 ;
– constituant plutôt une pratique extraterritoriale qu’un domaine d’application extraterritoriale de la loi américaine, l’habitude de la justice américaine de chercher à recueillir des preuves en sollicitant directement des entreprises à l’étranger, sans passer par les canaux de la coopération judiciaire interétatique « classique » ;
– dans le même ordre d’idée, la pratique consistant à imposer des contrôleurs à des entreprises étrangères prises en faute.
Le représentant d’une grande entreprise française très internationalisée, notant lors de son audition que l’extraterritorialité américaine impactait celle-ci dans cinq domaines (le droit comptable/financier ; la législation anti-corruption ; les embargos internationaux ; le droit de la concurrence ; la fiscalité), a estimé qu’elle représentait en conséquence une « contrainte forte ».
Au-delà des lois et des pratiques des autorités américaines, plusieurs interlocuteurs de la mission ont mis en avant la diffusion extraterritoriale de « normes » sans base légale étatique, classiquement qualifiées de soft law, qui s’imposent de fait mondialement et finissent d’ailleurs fréquemment par être reprises dans des législations nationales ou des instruments internationaux. Or, cette soft law est très souvent d’origine américaine. On cite communément l’exemple des normes comptables. Un autre exemple flagrant, plus contemporain, est celui des règles de publicité/confidentialité/protection et d’encadrement des contenus et données personnelles mis en ligne sur internet, qui sont de facto édictées par les entreprises dominantes du secteur, lesquelles sont américaines, et imposées à leur clients, formellement sommés de les accepter contractuellement s’ils veulent accéder aux services de ces entreprises.
2. Mais du point de vue américain, la plupart ne sont pas extraterritoriales
Du point de vue défendu à Washington, la plupart des lois et pratiques que nous qualifions d’« extraterritoriales » – et critiquons en tant que telles – ne le sont pas.
Les États-Unis adoptent parfois des dispositifs délibérément extraterritoriaux destinés à sanctionner des entités étrangères, généralement des entreprises, qui se refuseraient à appliquer certaines de leurs règles, par exemple l’arrêt des « transactions » de toutes natures avec des personnes, entités ou États ciblés comme terroristes ou pratiquant la prolifération nucléaire.
Mais il est notable qu’ils ne considèrent pas comme extraterritoriales les dispositions qui justifient, selon eux, la plupart des sanctions financières infligées ces dernières années à nos entreprises ou nos banques pour des faits de corruption ou de non-respect d’un embargo économique américain : certes ces entreprises étrangères effectuaient à l’étranger les transactions ou les versements de pots-de-vin qui leur ont valu des amendes, mais comme elles ont utilisé les facilités de New-York pour compenser des opérations en dollars, ou bien y sont cotées à la bourse, cela suffisait, du point de vue qui est mis en avant, à les soumettre de plein droit à la loi américaine au même titre que des entreprises américaines. Les juristes américains soutiennent qu’il ne s’agit pas d’une application extraterritoriale de leurs lois, puisque « quelque chose » rattachait toujours les faits en cause au territoire américain. Pourtant, on le verra dans la partie du présent rapport consacrée à l’analyse juridique, ce « quelque chose » est parfois bien ténu et discutable.
B. UNE CERTAINE CONCEPTION DU RÔLE DU DROIT
L’application juste mais stricte du droit, ce qui est la mission de la justice, est inhérente à l’État de droit et est donc l’un des constituants de toutes les démocraties, mais en pratique ce constituant joue un rôle plus ou moins essentiel. Les États-Unis sont probablement l’une des démocraties qui attache le plus d’importance au « règne de la loi » (« rule of law » littéralement, que nous traduisons communément par « État de droit »). Dans ce pays où l’on inflige des sanctions pénales et civiles qui peuvent souvent paraître disproportionnées à des Européens (voire injustifiables si l’on pense à la peine de mort), l’on est bien conscient de ce que peut être la force du droit.
Cet état de fait semble entraîner une attitude parfois contradictoire dans la perception des rapports entre droit et diplomatie :
– d’un côté, il existe chez certains experts et « décideurs » une conscience bien plus grande qu’en France du fait que le droit a une empreinte internationale et peut être un instrument de la diplomatie, une arme de la puissance ;
– de l’autre, la sacralisation du droit et le principe de séparation des pouvoirs interdisent de reconnaître que ce droit peut entraîner des problèmes d’ordre diplomatique et donc pourrait devenir un sujet de négociations internationales.
1. Le droit comme instrument de puissance économique et de politique étrangère
a. Le droit mis au service des objectifs de la politique étrangère et des intérêts économiques des États-Unis
Selon une formule entendue plusieurs fois, les États-Unis ont une « politique juridique extérieure », ce qui n’est sans doute pas le cas de la plupart des autres États.
Dans les domaines « sensibles » en matière d’extraterritorialité du droit américain que la mission a identifiés, il est clair que cette empreinte extraterritoriale n’est en général pas un « hasard ». Elle est au contraire parfaitement argumentée.
● S’agissant de la corruption internationale, les États-Unis justifient leur volonté d’« exporter » et d’imposer leur modèle de lutte, incarné par le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de 1977, par la recherche d’une concurrence non faussée, sur les marchés tiers, entre leurs entreprises et les autres et en établissant des liens avec la stabilité internationale et donc leur sécurité nationale. Les États-Unis ont à ce titre été parmi les principaux promoteurs de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales adoptée dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) le 21 novembre 1997.
Dans le travail d’investigation qu’ils ont réalisé pour le compte du Centre français de recherche sur le renseignement sur le rachat de la branche énergie d’Alstom par General Electric (3), Mme Leslie Varenne et M. Éric Denécé reviennent sur les enjeux qu’attachent en particulier les autorités américaines à la lutte contre la corruption transnationale : « en 1996, le Trade Promotion Coordination Committee (TPCC) américain évalua que 11 milliards de dollars de contrats avaient été perdus par les exportateurs américains en deux ans à cause de la corruption pratiquée par les firmes étrangères. Il était sous-entendu que c’était à cause des pratiques illégitimes et douteuses de leurs concurrents que les Américains perdaient des contrats. C’est pourquoi Washington proposa d’énergiques mesures anti-corruption (…) ».
Par ailleurs, la question de la sécurité nationale était le thème central de l’« Agenda global anti-corruption » publié par la présidence américaine en 2014. Ce texte souligne l’importance de la mise en œuvre de la loi FCPA précitée, désignant la corruption comme un facteur perturbateur sur le plan géopolitique. Tout récemment encore, lors d’un voyage au Nigéria, le secrétaire d’État John Kerry a qualifié la corruption de cause profonde (root cause) du terrorisme. Plusieurs des interlocuteurs de la délégation de la mission qui s’est rendue à Washington, membres de la haute administration fédérale, ont également insisté sur le lien entre corruption internationale et terrorisme.
● S’agissant des sanctions économiques, les États-Unis assument le fait qu’elles constituent un instrument de coercition et les présentent comme un élément majeur de leur politique de sécurité.
● Plus généralement, les États-Unis sont enclins à considérer que leur conception du droit a une sorte de valeur supérieure qui doit lui permettre de s’imposer face aux règles du droit international.
Ainsi, peu soucieux de respecter l’axiome de base de ce dernier selon lequel la souveraineté des États implique leur égalité en droit et la non-ingérence dans leurs affaires, ne se gênent-ils pas pour accoler à ceux qu’ils considèrent comme leurs ennemis des qualificatifs infamants qui n’ont pas seulement une portée politique, mais aussi juridique : par exemple, le Foreign Sovereign Immunities Act lève l’immunité souveraine des États étrangers désignés comme « sponsors du terrorisme ».
b. … et aussi au service direct des intérêts des firmes américaines ?
Le rachat de la branche énergie d’Alstom par General Electric a également suscité des interrogations sur une éventuelle instrumentalisation des procédures pour corruption engagées contre Alstom en vue de convaincre ses dirigeants de choisir l’offre américaine plutôt que celle de Siemens et de Mitsubishi. Les auteurs précités mettent ainsi en lumière certaines proximités de dates qui sont troublantes : « le 16 décembre 2014, trois jours avant l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’Alstom qui approuvera la cession des activités énergies à General Electric, une nouvelle dépêche de l’agence Bloomberg confirmait la fin des poursuites contre les dirigeants d’Alstom : "Accusé de corruption, le groupe serait prêt à transiger avec le ministère de la Justice américain, mais c’est GE qui paierait" ! Selon Le Figaro du 17 décembre : "les avocats de GE auraient joué un rôle clé : leur intervention aurait permis de faire baisser le montant en échange d’une promesse d’appliquer le code de bonne conduite du groupe américain chez le français. L’accord ne devait toutefois être révélé qu'après la finalisation de l’opération pour que l’amende n’apparaisse pas comme un élément qui aurait fait pencher la balance du côté américain plutôt qu’en faveur de Siemens-Mitsubishi" ».
À propos de cette amende, qui s’est tout de même élevée à 772 millions de dollars, il faut ajouter qu’au nom de la continuité juridique de la société Alstom, c’est ce qui reste de celle-ci, c’est-à-dire essentiellement l’ex-branche transport, laquelle ne représentait qu’un tiers du chiffre d’affaires du groupe avant son démantèlement, qui l’a réglée, alors même que les manquements à l’origine de cette sanction concernaient les activités énergie reprises par General Electric ! Cette amende a représenté environ 11 % du chiffre d’affaires de l’entreprise réduite à ses activités transport (6,9 milliards d’euros pour l’exercice mars 2015-mars 2016). Il n’est pas interdit de s’interroger sur la responsabilité d’un prélèvement aussi lourd sur une entreprise fragile dans ses difficultés actuelles.
Auditionnée par la mission, Mme Claude Revel, qui était déléguée interministérielle à l’intelligence économique au moment du rachat d’Alstom, a indiqué que son service avait identifié cette entreprise comme l’une des grandes sociétés françaises les plus susceptibles d’être l’objet d’une prise de contrôle étranger, mais sans que cela ne suscite des mesures préventives : les pouvoirs publics, de son point de vue, se sont contentés de réagir quand les intentions de General Electric ont été rendues publiques, et il était dès lors bien tard pour s’y opposer efficacement, même si des membres du Gouvernement d’alors ont essayé.
Mme Varenne et M. Denécé rappellent également le cas plus ancien d’Alcatel : « l’histoire se répéterait-elle? En 2005, Alcatel est inquiété par la justice américaine pour une affaire de corruption au Costa Rica, puis d’autres affaires en Amérique latine impliquent la maison mère de cette société française. En 2006, Alcatel fusionne avec l’américain Lucent. Résultat, le PDG d’Alcatel, Serge Tchuruk, qui avait accepté la fusion, ne sera jamais inquiété et, en 2010, Alcatel Lucent paiera seulement 137 millions de dollars d’amendes, une somme extrêmement faible comparée aux 800 millions de dollars d’amendes infligées à l’Allemand Siemens pour les mêmes faits ».
Tout cela conduit ces auteurs à dénoncer « une stratégie américaine de domination économique » et même « une stratégie hégémonique permettant un véritable racket ». Concernant Alstom, plusieurs personnalités françaises auditionnées par la mission (dont au moins une occupant une position officielle) ont fait état l’implication des services de renseignement américains : ceux-ci ont clairement été associés à la procédure, voire selon certaines déclarations ont été à sa source.
Néanmoins, les représentants du Department of Justice rencontrés par la délégation de la mission à Washington n’ont pas confirmé de lien entre les procédures pour corruption engagées aux États-Unis contre Alstom et son rachat partiel par General Electric.
Ils ont en outre relevé qu’Alstom avait été l’objet, bien avant les procédures américaines et l’opération avec General Electric, de poursuites pour corruption dans divers pays, conduisant à des condamnations au Mexique (en 2004), en Italie (en 2008) et en Suisse (en 2011), ainsi qu’à une exclusion de certains marchés financés par la Banque mondiale (en 2012). Une enquête avait également été annoncée en Grande-Bretagne et le ministère des finances norvégien avait placé le groupe sous surveillance pour quatre années (en 2011). Tous ces faits sont relatés dans un rapport de l’OCDE (4) qui relevait qu’en France, toutefois, seules deux informations judiciaires pour corruption internationale avaient été ouvertes à l’encontre d’Alstom, suite à des transmissions d’informations par la Suisse concernant des faits survenus en Afrique australe, au Venezuela et en Indonésie, procédures toutes les deux conclues par des non-lieux. Cette situation conduisait les rédacteurs du rapport à un constat peu amène : « sans pouvoir aller au-delà de la formulation d’hypothèses, le fait que seules deux informations judiciaires aient été ouvertes à ce jour, laisse interrogateur sur le degré d’investissement des autorités de poursuite françaises en la matière. Les réponses obtenues au moment de la visite sur place ainsi qu’après celle-ci n’ont pas permis d’apporter de réponse satisfaisante à ces interrogations (…). De l’avis des examinateurs, cette situation pourrait être l’illustration du caractère limitatif de la responsabilité des personnes morales en France dans la mesure où cette dernière ne semble pas permettre la mise en œuvre de la responsabilité pénale des sociétés mères pour les actes de corruption de leurs filiales, malgré l’affirmation du principe des autorités françaises sur ce point ».
Si Alstom a donc été ciblé par les autorités américaines chargées de la lutte contre la corruption internationale ainsi que par General Electric, c’est bien aussi parce qu’il y avait eu, selon les américains, un certain nombre d’alertes et de procédures engagées dans d’autres pays (mais en France, une procédure judiciaire peu qui d’ailleurs n’est pas close). Ajoutons que, dans son entretien avec la mission, M. Denécé a confirmé que des entreprises américaines étaient régulièrement présentes sur les marchés pour lesquels des entreprises européennes étaient poursuivies par le système américain.
c. La mobilisation des moyens policiers et de renseignement américains au service de la politique juridique extérieure
Quoi qu’il en soit, l’utilisation délibérée de certains pans extraterritoriaux du droit américain à des fins assumées de politique générale, sinon nécessairement au profit d’intérêts particuliers américains, justifie depuis longtemps une forte mobilisation des administrations américaines, y compris des services de renseignement, sur ces questions.
La lutte contre la corruption est clairement assumée comme la seconde priorité du Federal Bureau of Investigation (FBI), juste après le contre-terrorisme. Le FBI y consacre environ 800 agents. La plupart travaillent sur le territoire américain, où ils obtiennent d’ailleurs de réels résultats (5), mais il existe aussi une unité chargée de la corruption internationale, constituée d’une trentaine d’agents, dont la délégation de la mission qui s’est rendue à Washington a rencontré les responsables. Ceux-ci ont confirmé qu’ils s’appuyaient sur des sources très diverses : les informations remontent des différents services américains de renseignement (y compris la National Security Agency-NSA), des autorités de régulation, du réseau de « legal attachés » qui représentent le FBI dans les ambassades américaines – le FBI revendique une présence de ses agents dans plus de 80 postes diplomatiques américains…
Le FBI a aussi l’avantage de pouvoir mener des enquêtes sans avoir à demander l’autorisation d’un juge ou d’un attorney. Les conditions dans lesquelles il peut enquêter sont déterminées par des directives de l’Attorney General.
S’agissant des embargos et sanctions internationales, un « think-tanker » rencontré à Washington par la délégation de la mission a souligné qu’il y avait eu dans les années 2000 un choix délibéré de centrer l’action sur le contrôle du « global financing », la surveillance des transactions financières étant un bon moyen de détecter les mouvements suspects : toutes les transactions faites par les circuits officiels sont enregistrées et donc contrôlables dès lors que l’on dispose de moyens de traitement de masse ; de plus, l’administration américaine a pu imposer l’obligation d’assurer ce « screening » des transactions aux banques elles-mêmes, les grandes banques internationales ne pouvant se permettre de refuser les règles américaines compte tenu du caractère vital de leurs activités à New-York. Mais cette situation, ayant conduit certaines de ces banques à négliger leurs engagements de screening, voire à les contourner en dissimulant la nature d’une partie de leurs transactions, a ensuite nourri les procédures répressives engagées contre nombre d’entre elles par les administrations américaines.
L’accusation portée, dans les documents américains, contre des banques telles que BNP-Paribas d’avoir omis ou falsifié le nom de leurs clients sous sanctions dans les ordres de paiement dits « reflets » qui étaient émis pour compenser à New-York des opérations en dollars les concernant montre que les États-Unis se sont organisés juridiquement (en termes d’exploitation de fichiers nominatifs par différents services) et matériellement pour traiter efficacement d’énormes masses de données, puisque ces ordres de paiement se comptent par centaines de millions.
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC), service du Trésor qui veille à l’application des sanctions internationales américaines dans le domaine financier, emploie environ 200 personnes et a un budget de plus de 30 millions de dollars. À titre de comparaison, les sanctions sont suivies par cinq personnes dans le bureau compétent de notre direction générale du Trésor.
Toujours selon Mme Varenne et M. Denécé, « l’orientation des services de renseignement américains vers le soutien à l’économie nationale n’est pas nouvelle. En 1970, le Conseil consultatif des renseignements extérieurs recommandait que "dorénavant l’espionnage commercial sera considéré comme une fonction de la sécurité nationale jouissant d'une priorité équivalente à l'espionnage diplomatique, militaire et technologique". En 1977, une réunion entre la NSA, la CIA et le département du commerce permit la création d'un bureau de liaison secret appelé Office of Intelligence Liaison dont le but était de traiter les informations permettant de défendre les intérêts économiques et commerciaux américains. Son nom sera changé quelques années plus tard en Office of Executive Support (…). Selon James Woolsey [directeur de la CIA de 1993 à 1995], la CIA aurait identifié en 1993 51 cas de pratiques déloyales de concurrents étrangers lesquelles auraient fait perdre 28 milliards de dollars à des entreprises américaines. Les actions de rétorsion prises permirent d’en récupérer 6,5. Pourtant, des officiels confirmèrent que les services américains avaient aidé Boeing pour la vente de 747 à l’Arabie Saoudite, Raytheon sur le dossier S1VAM au Brésil et Hughes pour l’exportation d’un système de télécommunications en Indonésie. Dans une conférence de 1995 à Détroit, James Woolsey déclara lui-même qu’en 1994 c’étaient 10 milliards de dollars de contrats qui avaient ainsi pu être gagnés par les entreprises américaines grâce aux renseignements fournis par l’administration (…) ». Des experts auditionnés par la mission ont confirmé la très forte orientation de la CIA, en particulier, vers le renseignement économique.
De toute évidence, la mobilisation n’est pas la même dans les pays européens. Le récent document élaboré par M. Simond de Galbert (6) met en exergue un « intelligence gap » entre les deux rives de l’Atlantique : tandis que le Trésor américain appartient depuis 2004 à la communauté du renseignement de son pays, les moyens de ses homologues européens restent faibles.
D’après les données publiées par le gouvernement américain, les agences de renseignement ont dépensé près de 68 milliards de dollars (dont une trentaine de milliards pour les seules interceptions) au cours de l’année fiscale 2014, quand le « budget » français du renseignement, si on le reconstitue en additionnant les lignes budgétaires dispersées, pourrait être d’environ 1,2 milliard d’euros (7), soit un rapport de l’ordre de 1 à 50. Comme le rapport des PIB globaux est de un à 7,5, cela signifie que, rapporté au PIB, l’effort américain de renseignement est environ sept fois plus élevé que l’effort français…
2. Mais un droit américain qui ne saurait être l’objet d’une négociation internationale
Les pays européens, dans le cadre des transferts de souveraineté inhérents à l’Union européenne, mais aussi un grand nombre de pays dans le monde sont habitués à ce que leurs lois soient contraintes par des engagements internationaux qu’ils souscrivent : les droits nationaux peuvent être, par ce biais, des objets de négociation internationale.
On sait que traditionnellement les États-Unis sont très réticents aux engagements internationaux juridiquement contraignants. Il serait trop facile de voir seulement dans cette situation une marque d’« impérialisme ».
Elle est aussi le fruit de la convergence de plusieurs facteurs :
– la valorisation du droit en tant que vecteur de valeurs morales, ce qui exclut sur le principe qu’on le négocie ;
– en dehors des cercles diplomatiques évoqués supra, une assez large indifférence aux enjeux internationaux, notamment au Congrès, dont les membres sont prêts à porter des initiatives répondant aux intérêts légitimes de leurs concitoyens victimes du terrorisme sans tenir compte de leurs conséquences diplomatiques « lourdes » (par exemple le Justice Against Sponsors of Terrorism Act-JASTA, qui vise directement l’un des alliés majeurs des États-Unis, l’Arabie saoudite – voir infra – ; le Hizballah International Financing Prevention Act du 18 décembre 2015, qui concourt à déstabiliser un peu plus le Liban en interdisant aux banques étrangères, notamment libanaises, de faire des transactions avec le Hezbollah et les entités qui en dépendent si elles veulent continuer à accéder au système financier américain via des comptes de correspondance ; ou encore l’affectation en 2012, dans le cadre du Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act, d’avoirs iraniens gelés à un fonds d’indemnisation de victimes américaines) ;
– la sacralisation de la stricte séparation des pouvoirs, qui a plusieurs effets. Elle rend plus difficile pour l’exécutif d’interférer dans les initiatives parlementaires pour décourager celles qui sont susceptibles de provoquer des dommages diplomatiques. Dans un contexte de magistrature décentralisée et largement élective, elle ne facilite pas la mise en œuvre d’une « politique pénale ». Elle conduit enfin, même au sein de la branche exécutive, à la multiplication des offices et agences de régulation plus ou moins indépendants qui ont tendance à appliquer les réglementations dont ils ont la charge en ignorant, eux-aussi, les éventuelles considérations diplomatiques.
Le constat global qui résulte de tout cela est simple : la majorité des personnes et institutions américaines qui sont en position de « décideurs » ne semblent pas prêtes à admettre que le droit qu’elles élaborent et appliquent puisse provoquer des problèmes diplomatiques, a fortiori puisse éventuellement être contraint par des engagements internationaux.
C. DES CONTRADICTIONS AGGRAVÉES PAR LE BLOCAGE ACTUEL DU SYSTÈME POLITIQUE
Ces jugements quelque peu sévères doivent sans doute être nuancés, car certaines personnalités américaines éminentes sont manifestement conscientes des risques qui s’attachent à un droit « agressivement » extraterritorial.
● Récemment (le 30 mars 2016), le secrétaire au Trésor Jack Lew a tenu, dans le cadre d’une réunion à la fondation Carnegie, des propos qui manifestent une large conscience des difficultés qu’entraîne parfois la politique américaine de sanctions internationales. Ces propos, tels qu’ils ont été rapportés (8), méritent d’être cités :
– « Even some of our closest allies [view secondary sanctions] as extraterritorial attempts to apply US foreign policy to the rest of the world » ;
– « Sanctions should not be used lightly (…). They can strain diplomatic relationships, introduce instability into the global economy, and impose real costs on companies here and abroad » ;
– « If foreign jurisdictions and companies feel that we will deploy sanctions without sufficient justification or for inappropriate reasons, we should not be surprised if they look for ways to avoid doing business in the United States or in US dollars (…). The more we condition use of the dollar and our financial system on adherence to US foreign policy, the more the risk of migration to other currencies and other financial systems in the medium-term grows ».
Toutes les critiques habituelles en Europe sont présentes dans la bouche du ministre américain : les risques diplomatiques et économiques, l’agacement qui touche même les proches alliés, le risque de remise en cause du rôle du dollar… Et le ministre concluait son propos par un engagement ferme pour l’application pleine de l’accord du 14 juillet 2015 avec l’Iran dans sa lettre comme dans son esprit (« We are doing what we have to do to comply with both the letter and the spirit of the nuclear agreement »).
● Plusieurs décisions rendues par la Cour suprême depuis 2010 montrent une réticence croissante de la plus haute juridiction américaine quant aux conceptions trop extraterritoriales de la compétence des juridictions des États-Unis. Sans détailler ces décisions (développées dans la partie d’analyse juridique du présent rapport infra), qui ne concernent pas directement les domaines les plus sensibles d’extraterritorialité américaine, on relève qu’elles réaffirment le principe selon lequel l’extraterritorialité ne se présume pas (les lois américaines n’ont une portée extraterritoriale que si le Congrès l’a explicitement prévu) et censurent certaines conceptions trop extensives du lien de rattachement au territoire américain censé justifier dans les affaires en cause la compétence du juge américain.
*
Pourquoi alors les voix raisonnables des hautes personnalités américaines qui sont conscientes des dérives de l’extraterritorialité juridique ne parviennent-elles pas – du moins pour le moment – à imposer un changement de cap ?
Cela tient sans doute en grande partie au blocage actuel du système politique américain, marqué par la cohabitation conflictuelle entre une administration démocrate et un Congrès à majorité républicaine. Ce type de cohabitation n’est pas neuf aux États-Unis, mais la nouveauté depuis quelques années, relevée par la plupart des observateurs, réside dans l’incapacité à mettre en place des mécanismes de coopération bipartisane pour trouver des compromis.
Cette situation a des conséquences dans de nombreux domaines de la politique des États-Unis, parmi lesquelles la « judiciarisation » croissante de la politique étrangère : l’un des meilleurs moyens pour le Congrès de bloquer la politique étrangère de l’exécutif, quand elle lui déplaît, est d’adopter des lois qui, par leur portée extraterritoriale, sont de nature à empêcher cette politique d’atteindre ses objectifs.
L’exemple le plus caractéristique de ce type de situation est fourni par l’accord du 14 juillet 2015 sur le nucléaire iranien (dit Joint Comprehensive Plan of Action-JCPOA) : l’équilibre de cet accord repose sur l’échange d’une limitation et d’un contrôle international du programme nucléaire de l’Iran contre un allégement des sanctions internationales, lequel doit permettre au pays de bénéficier à nouveau pleinement des avantages d’une insertion dans le commerce international ainsi que de récupérer ses avoirs gelés à l’étranger. Le succès de l’accord implique que l’Iran en tire les bénéfices attendus, donc que son commerce international et son accès aux financements et investissements internationaux ne soient plus entravés.
Cependant, dans le cadre de l’accord, ce sont surtout les sanctions européennes qui sont fortement allégées, car les États-Unis ont dû maintenir la plus grande part de leurs sanctions, en particulier « primaires » (voir infra pour la définition de celles-ci), du fait de l’hostilité de la majorité du Congrès au JCPOA.
Il est donc essentiel, pour la réussite du JCPOA et le respect de ses engagements par l’Iran, que les entreprises européennes puissent effectivement réinvestir le marché iranien. Or, il apparaît que ce retour est rendu très compliqué par les craintes suscitées par l’extraterritorialité des sanctions américaines qui sont maintenues, notamment, comme on y reviendra, concernant la compensation aux États-Unis des transactions bancaires en dollars, et plus généralement par la complexité extrême du dispositif américain.
S’ajoutent à cela divers initiatives ou décisions d’instances américaines qui alourdissent encore le climat :
– depuis le 21 janvier 2016, suite à l’adoption d’une loi du 18 décembre 2015, le programme d’exemption de visa de court séjour pour l’entrée aux États-Unis, dont bénéficient notamment les citoyens français, est remis en cause pour les personnes qui se sont rendues en Iran, Irak, Syrie ou au Soudan depuis le 1er mars 2011 ou ont la nationalité de l’un de ces pays (outre la nationalité d’un pays concerné par l’exemption) : ces personnes doivent désormais demander un visa. Cette disposition est susceptible de freiner le développement des flux d’affaires avec l’Iran dans la mesure où des représentants d’entreprises européennes, notamment, peuvent être découragés de se rendre dans le pays si cela a pour conséquence de compliquer ensuite leurs déplacements aux États-Unis ;
– la Cour suprême a validé, en avril 2016 (9), une loi permettant d’affecter des avoirs iraniens gelés à l’indemnisation de victimes américaines d’attentats dans lesquels ce pays est impliqué, alors même que le JCPOA doit permettre à l’Iran de récupérer ses avoirs gelés…
Cet exemple montre les conséquences des blocages du système politique américain : les divergences entre l’administration présidentielle, qui voulait absolument un accord, et la majorité du Congrès, hostile à celui-ci, ont conduit à une situation où l’on a une sorte d’accord en trompe l’œil, qui ne lève qu’une faible part des sanctions américaines et que, par ailleurs, le Congrès n’est pas mécontent de remettre en cause indirectement par des mesures telles que la réforme du programme de dispense de visa… Cette situation laisse aussi le champ libre à la justice et aux administrations américaines, qui appliquent les règles (c’est leur mission) sans se préoccuper des enjeux diplomatiques.
II. LES ENJEUX DE L’EXTRATERRITORIALITÉ DE CERTAINES LOIS AMÉRICAINES
Avant d’aborder l’analyse technique et juridique de la notion, complexe, d’extraterritorialité, et de ce que l’on peut en dire s’agissant des lois américaines, votre rapporteure et votre président ont souhaité rappeler quels en sont les grands enjeux.
A. LES ENJEUX ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
1. Des pénalités considérables et en forte croissance, qui, de fait, frappent très souvent les entreprises européennes
Deux types de dispositions américaines surtout ont entraîné jusqu’à présent, du fait de leur application extraterritoriale, le versement de pénalités considérables par des entreprises françaises aux autorités américaines pour des faits n’étant pas survenus sur le territoire américain (ou seulement très indirectement sur ce territoire, comme on y reviendra) :
– le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de 1977 réprimant la corruption des agents publics à l’international ;
– les différents régimes d’embargos et de sanctions internationales mis en place dans le cadre de la politique étrangère des États-Unis.
Des entreprises d’autres pays européens ont également été lourdement sanctionnées aux États-Unis pour d’autres motifs, par exemple des banques suisses pour leur responsabilité dans l’évasion fiscale des citoyens américains, ou bien plus récemment Volkswagen pour sa fraude aux règles environnementales.
a. Les pénalités pour corruption internationale d’agents publics
Les pénalités infligées au titre de la loi FCPA, longtemps d’un montant modéré, ont « explosé » à partir de 2008, comme le montre le graphique ci-après, atteignant un total de 1,8 milliard de dollars en 2010, année record, sachant que 2016 pourrait être une nouvelle année record si certaines procédures en cours aboutissent.
Les montants totaux annuels de pénalités infligées à des entreprises au titre de la loi FCPA
(en millions de dollars)
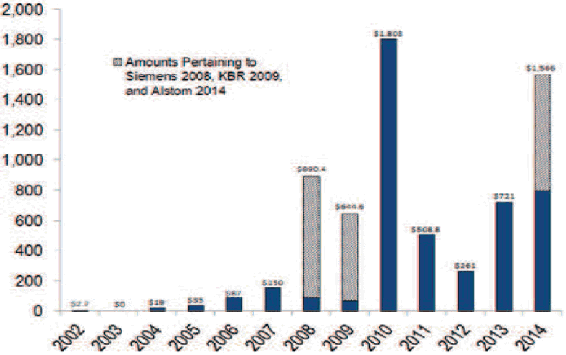
Source : Shearman & Sterling LLP, FCPA Digest, janvier 2015.
S’agissant des entreprises visées, le fait est que les entreprises européennes ne sont pas les plus nombreuses à être sanctionnées, mais versent des pénalités souvent très lourdes, de sorte qu’elles sont en revanche clairement majoritaires parmi les entreprises payant les plus gros montants.
Entre 1977 et 2014, 30 % des enquêtes ouvertes dans le cadre de la loi FCPA ont visé des entreprises étrangères, mais celles-ci ont réglé 67 % du total des amendes collectées.
Sur les 17 pénalités supérieures à 100 millions de dollars recensées en application de la loi FCPA, 10 concernaient des sociétés européennes (la « nationalité » des entreprises étant déterminée par la localisation de leur siège social, critère juridique généralement admis, notamment en droit français) contre 5 ou 6 (selon la manière dont on compte) des entreprises américaines.
Depuis 2008, année où les autorités américaines se sont mises à « taper fort » en matière de corruption internationale, comme on le voit sur le graphique ci-avant, les entreprises européennes ont versé près de 6 milliards de dollars de pénalités aux États-Unis pour violation de la loi FCPA. Ce montant pourrait être prochainement rehaussé par la pénalité que l’opérateur téléphonique finno-suédois Telia est en train de négocier dans le cadre d’une action conjointe des autorités américaines et néerlandaises, qui lui réclament environ 1,4 milliard de dollars.
Les plus gros montants de pénalités au titre de la loi FCPA
Entreprise |
Pays (du siège social de la société de tête au moment des faits incriminés) |
Montant global (DoJ et/ou SEC) des pénalités versées aux États-Unis (millions de dollars) |
Pénalités versées à des juridictions non-américaines pour les mêmes faits (millions de dollars) |
Année de la transaction |
Siemens |
Allemagne |
800 |
856 |
2008 |
Alstom |
France |
772 |
2014 | |
Olympus (America) |
Japon/États-Unis (1) |
646 |
2016 | |
KBR/Halliburton |
États-Unis |
579 |
2009 | |
Och-Ziff Capital Management Group |
États-Unis |
412 |
2016 | |
BAE Systems |
Royaume-Uni |
400 |
2010 | |
Total |
France |
398 |
2013 | |
Vimpelcom |
Pays-Bas |
398 |
398 environ |
2016 |
Alcoa |
États-Unis |
384 |
2014 | |
Snamprogetti/ENI |
Italie/Pays-Bas |
365 |
2010 | |
Technip |
France |
338 |
2010 | |
Weatherford International |
États-Unis |
252 |
2013 | |
Panalpina |
Italie |
237 |
2010 | |
JGC |
Japon |
219 |
2011 | |
Daimler |
Allemagne |
185 |
2010 | |
Alcatel-Lucent |
France |
137 |
2010 | |
Avon |
États-Unis |
135 |
2014 | |
Hewlett-Packard |
États-Unis |
108 |
2014 |
(1) Olympus est japonais, mais il semble que seule sa filiale Olympus Corporation of the Americas, dont le siège est sur le sol américain, ait été poursuivie.
Le fait est aussi que, d’après les statistiques de l’OCDE (10) sur la répression de la corruption transnationale, la justice américaine est indéniablement beaucoup plus « activiste » que celles de la plupart des pays européens : de 1999 à 2014, selon cette source, les États-Unis auraient infligé des sanctions dans 128 affaires (formellement des « schémas de corruption ») différentes de cette nature, contre 26 pour l’Allemagne, 11 pour la Corée du Sud et entre 3 et 6 pour chacun des autres grands pays développés (autres grands pays européens, dont la France, et Japon). Cela donne une certaine force à l’argument américain selon lequel, pour assurer des conditions de concurrence équitables entre les entreprises et compte tenu de la mobilisation inégale des différents pays, il serait normal que la justice américaine applique des sanctions ayant une portée extraterritoriale.
b. Les pénalités pour non-respect des sanctions économiques américaines
Les pénalités fondées sur le non-respect des sanctions économiques internationales décidées par les États-Unis ont essentiellement frappé des banques européennes : outre BNP Paribas et le Crédit agricole, HSBC, Standard Chartered, ING, Crédit suisse, ABN Amro (racheté par Royal Bank of Scotland entre-temps), Lloyds, Barclays, Commerzbank tout récemment, etc… Certaines (Commerzbank et HSBC notamment) ont également été pénalisées pour défaillance dans l’application de la législation anti-blanchiment.
La seule banque américaine sanctionnée – modérément – pour violation des embargos semble être JP Morgan Chase. La seule entreprise non financière à l’avoir été à un niveau significatif semble être Schlumberger.
Ces sanctions sont considérables et ont donc frappé presqu’exclusivement des banques européennes. Depuis 2009, celles-ci ont versé environ 16 milliards de dollars de pénalités diverses aux administrations américaines.
Les plus gros montants de pénalités infligées pour violations des sanctions internationales américaines et/ou de la législation anti-blanchiment
Entreprise |
Pays (du siège social de la société de tête au moment des faits incriminés) |
Montant global (OFAC, DoJ et/ou Fed et/ou État et comté de New York) des pénalités versées aux États-Unis (millions de dollars) |
Année de la transaction |
BNP Paribas |
France |
8 974 |
2014 |
HSBC |
Royaume-Uni |
1 931 |
2012 |
Commerzbank |
Allemagne |
1 452 |
2015 |
Crédit agricole |
France |
787 |
2015 |
Standard Chartered |
Royaume-Uni |
667 |
2012 |
ING |
Pays-Bas |
619 |
2012 |
Crédit suisse |
Suisse |
536 |
2009 |
ABN Amro/Royal Bank of Scotland |
Pays-Bas |
500 |
2010 |
Lloyds |
Royaume-Uni |
350 |
2009 |
Barclays |
Royaume-Uni |
298 |
2010 |
Deutsche Bank |
Allemagne |
258 |
2015 |
Schlumberger |
France/États-Unis/Pays-Bas |
233 |
2015 |
Clearstream |
Luxembourg |
152 |
2014 |
UBS |
Suisse |
100 |
2004 |
JP Morgan Chase |
États-Unis |
88 |
2011 |
Le seul élément de relativisation que l’on peut invoquer est le fait que, si l’on prend en compte non pas les seules amendes liées aux violations d’embargos, mais toutes celles infligées à des banques aux États-Unis, on voit que les montants peuvent être encore plus considérables pour d’autres motifs et que les banques américaines sont alors lourdement concernées.
À titre d’exemple, Bank of America a accepté en 2014 de verser 16,65 milliards de dollars (9,65 milliards en amendes et 7 milliards en allégements de prêts, nouveaux crédits et autres aides aux clients victimes des agissements de la banque) suite à son rôle dans la crise des subprimes. Au total, les sanctions financières infligées aux banques américaines en lien avec cette crise représentent de l’ordre de 65 milliards de dollars. Plus de 160 milliards de dollars d’amendes ou pénalités auraient été infligées aux États-Unis, tous motifs confondus, à des institutions financières (américaines ou non) ces dernières années.
D’ailleurs, des banques européennes aussi sont parfois lourdement sanctionnées pour des motifs autres que les violations d’embargos et de règles anti-blanchiment : par exemple le Crédit suisse pour son aide à la fraude fiscale des citoyens américains (2,6 milliards de dollars de pénalités en 2014), ou Deutsche Bank et l’UBS pour leur participation aux manipulations frauduleuses des taux interbancaires LIBOR et EURIBOR (respectivement 2,2 milliards de dollars et 1,5 milliard de pénalités aux diverses autorités américaines en 2015, auxquelles s’ajoutaient des amendes plus modestes en Europe).
Il est à noter que les poursuites américaines contre des banques européennes dans l’affaire des taux LIBOR et EURIBOR présentent également un large caractère extraterritorial, ces taux moyens de refinancement interbancaire étant quotidiennement calculés et publiés respectivement à Londres et à Bruxelles sous la responsabilité d’entités locales (pour le LIBOR, l’agence Thomson Reuters et la British Bankers Association). La compétence américaine dans les poursuites semble avoir été fondée sur la législation antitrust (il y avait entente entre les banques) et trouve effectivement une certaine légitimité dans la théorie des effets (voir infra) : les taux LIBOR, pour les différentes devises, et EURIBOR, pour l’euro, servent de référence mondiale pour la fixation des taux d’intérêt, de sorte que la manipulation de leur niveau a indéniablement des répercussions considérables dans le monde entier, États-Unis compris.
Il faut enfin signaler que Deutsche Bank négocie actuellement une pénalité qui pourrait atteindre 14 milliards de dollars, selon les demandes américaines, pour son rôle dans la crise des subprimes.
2. Le doute sur l’équité : des entreprises européennes particulièrement ciblées ?
La question du « ciblage » des entreprises européennes par les pénalités américaines doit être posée puisque, de fait, ces entreprises européennes sont fréquemment et lourdement punies.
Certains diplomates voient dans l’utilisation croissante des sanctions par les États-Unis et leur application pratique aux dépens, principalement, d’entreprises européennes, sinon peut-être un choix délibéré de l’administration américaine, du moins le signe du déséquilibre qui caractérise la relation transatlantique : la politique des sanctions serait un moyen de contraindre de fait les Européens, peu désireux de partager le fardeau militaire, d’assumer bon gré mal gré une part des coûts d’une diplomatie qui se refuse à faire passer systématiquement les considérations politiques et sécuritaires derrière les intérêts commerciaux.
De plus, la prise de distance des États-Unis vis-à-vis des interventions militaires sous la présidence de M. Barack Obama (après les déboires d’Irak et d’Afghanistan) renforcerait aujourd’hui l’importance qu’ils attachent à l’outil alternatif que sont les sanctions. D’où la nécessité d’« embarquer de force » leurs partenaires dans l’application de celles-ci… Le fait que le système se soit emballé justement à partir de 2008-2009 vient à l’appui de cette thèse, même si l’on peut aussi interpréter cet emballement comme une suite de la crise financière de 2008.
S’il est difficile de démontrer que les entreprises américaines échapperaient plus facilement aux foudres de leur administration que les entreprises européennes – par construction, on ne connaît pas les entreprises qui n’ont pas été poursuivies malgré des comportements litigieux –, il est en revanche possible d’essayer de répondre à la question suivante : lorsqu’elles sont sanctionnées, les entreprises des deux bords de l’Atlantique sont-elles traitées équitablement ?
Le rapport reviendra plus longuement, dans la partie suivante, sur les procédures transactionnelles qui conduisent à l’imposition de lourdes pénalités financières aux entreprises, pénalités accompagnées en outre d’autres obligations. Mais il est nécessaire d’évoquer d’ores et déjà les montants de ces pénalités, car leur analyse permet d’éclairer le débat sur l’« équité de traitement » des entreprises européennes.
a. Les pénalités pour corruption internationale
Les montants des pénalités infligées en application de la loi anti-corruption FCPA sont déterminés à partir de l’application de sortes de directives pénales, les United States Federal Sentencing Guidelines, issues de l’United States Sentencing Commission. Il y est prévu un processus « objectif » pour fixer les niveaux globaux (11) d’amendes :
– on calcule d’abord une « base d’amende » qui est égale au plus élevé des trois montants suivants : le gain pécuniaire ou bénéfice résultant de l’infraction en cause ; les pertes qu’elle a causées ; un montant forfaitaire fixé en fonction de divers facteurs comme le nombre de victimes ;
– on calcule ensuite un « score de culpabilité » à partir de facteurs aggravants, tels que la taille de l’entreprise ou sa situation éventuelle de récidive, ou atténuants, tels que l’auto-dénonciation des faits en cause, la coopération avec les autorités ou du moins la reconnaissance de responsabilité dans ces faits ;
– ce score débouche sur la fixation d’un coefficient multiplicateur applicable à la base d’amende. On constate qu’en règle générale, la grande taille des entreprises en cause (plus de 5 000 salariés) est susceptible d’entraîner un doublement du coefficient multiplicateur (donc potentiellement de l’amende finale toutes choses égales par ailleurs), tandis que, dans l’autre sens, l’auto-dénonciation, par une grande entreprise, peut réduire ce multiplicateur de 50 %, la pleine coopération avec les autorités de 20 % et la simple reconnaissance des faits illicites (intrinsèque à la transaction) de 10 % ;
– l’application du coefficient multiplicateur à la base d’amende conduit non pas à un montant unique, mais à la fixation d’une fourchette d’amende allant au simple au double. Dans le cas d’une grande entreprise, cette fourchette peut représenter de 2 à 4 fois la base d’amende, c’est-à-dire en général le montant du gain pécuniaire tiré des actes de corruption ; dans le cas d’une grande entreprise qui coopère pleinement avec les autorités, cette fourchette sera réduite à 1,6–3,2.
On a donc un processus « objectif », sinon nécessairement équitable, de calcul d’un intervalle dans lequel l’amende devra en principe être fixée par le juge, ou plutôt négociée dans le cadre des transactions qui constituent le mode le plus commun de résolution des dossiers FCPA.
La fourchette d’amende ainsi fixée apparaît dans les différents dossiers et il est donc possible de la comparer avec la pénalité finalement actée dans les différents cas. Or, s’il est vrai que la moyenne des pénalités effectives semble proche du milieu des fourchettes d’amende, l’on constate une large volatilité des montants de pénalités effectives par rapport à celles-ci ; dans un certain nombre de cas, ces pénalités effectives sont même inférieures au plancher de la fourchette.
Un document américain (12) fait une comparaison très significative entre deux cas où les fourchettes d’amende étaient proches, mais pas les pénalités effectives, ceux de l’entreprise américaine Alcoa et de l’entreprise française Alstom, qui ont toutes les deux signé des transactions la même année (2014) :
– pour une fourchette d’amende comprise entre 446 et 892 millions de dollars, Alcoa a négocié une pénalité inférieure au plancher, puisqu’elle a été de 384 millions ;
– pour une fourchette d’amende comprise entre 533 et 1 066 millions de dollars – soit plus élevée de 19,5 % seulement que celle applicable à Alcoa –, Alstom a dû régler 772 millions de dollars, soit une pénalité effective double de celle d’Alcoa.
Diverses explications sont avancées pour expliquer ce type d’écarts, telles que le degré de coopération des entreprises (mis en avant par les représentants du Department of Justice rencontrés par la délégation de la mission à Washington) et la prise en compte de leur santé financière. Dans le cas d’espèce, cette seconde explication est peut-être valable, Alcoa ayant fait des pertes importantes en 2013, année précédant sa transaction avec la justice américaine, ce qui n’était pas le cas d’Alstom, bien que son bénéfice 2013-2014 fût en forte baisse par rapport à l’année précédente. En revanche, l’invocation du degré plus ou moins grand de coopération des entreprises est moins convaincante pour la fixation de l’amende finale, puisque ce degré de coopération est déjà pris en compte dans la détermination de la fourchette d’amende « objective ».
b. Les pénalités pour non-respect des embargos et/ou de la législation anti-blanchiment
Les mesures d’embargo et de sanctions économiques sont fondées sur des textes généraux tels que l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) de 1977 qui prévoient des pénalités potentielles considérables : jusqu’au double du montant des transactions illicites selon l’IEEPA (13).
En pratique, la base de calcul des pénalités transactionnelles globales (14) imposées aux banques européennes pour violation des sanctions américaines ou défaillance dans l’application de la législation anti-blanchiment des États-Unis est généralement, pour les cas les plus récents (antérieurement, c’était moins), le montant des transactions financières qui sont comptabilisées, dans la partie descriptive des transactions, comme illicites (transactions découvertes par les autorités américaines ou auto-dénoncées par les banques dans le cadre de leur coopération forcée à leur propre incrimination). Ce montant de transactions « illicites » fait l’objet dans les accords de plaider-coupable d’une « confiscation » (forfeiture), confiscation « volontaire » puisque c’est dans un cadre conventionnel qu’elle s’inscrit. S’y ajoutent diverses amendes civiles et pénales au bénéfice des différentes autorités américaines associées aux poursuites.
C’est ainsi, si l’on regarde les pénalités payées en 2015 par le Crédit agricole, qu’aux 312 millions de dollars de transactions « illicites » conduisant à une « confiscation » du même montant se sont ajoutées diverses amendes qui ont porté la facture globale à 787,3 millions de dollars. De la même manière, en 2015 également, Commerzbank a payé au total 1,45 milliard de dollars dont seulement 563 millions de « confiscation », ce montant étant celui des transactions « illicites ». En 2012, HSBC avait de même versé au total 1,931 milliard de dollars, dont seulement 1,256 milliard correspondant à la « confiscation » du montant des transactions « illicites ».
En se plaçant dans l’optique de ce mode de calcul, on peut considérer que BNP Paribas a obtenu finalement un arrangement logique avec une pénalité globale correspondant au montant des transactions « illicites » –8,834 milliards de dollars – seulement majoré d’une amende de 140 millions de dollars. C’est probablement l’énormité de la somme due au titre de la « confiscation » qui a permis de limiter les paiements complémentaires. Toutefois, cette approche ne tient pas compte de l’impact systémique que cette amende peut avoir dans le cadre des marchés financiers. Le dossier rendu public contre la Deutsche Bank a fait bouger toutes les bourses européennes du fait même du caractère systémique de la banque en question.
3. Un prélèvement sur les économies européennes
En l’espace de quelques années, les entreprises européennes ont versé plus de 20 milliards de dollars de pénalités diverses aux administrations américaines pour les seuls motifs de corruption internationale et de violation des sanctions économiques des États-Unis. En ajoutant celles fondées sur d’autres motifs, on serait même probablement facilement au double. Tout cela représente un véritable prélèvement, sans contrepartie, sur les économies européennes et le niveau de vie de leurs citoyens.
Ce prélèvement est suffisamment massif pour être perceptible dans certaines grandeurs macro-économiques. Il en est ainsi en particulier, de l’amende record payée par BNP Paribas en 2014. Celle-ci a lourdement impacté la balance des transactions courantes de la France – à hauteur de 4,3 milliards d’euros pour être précis (c’est moins que le total de l’amende, car celle-ci a été partagée entre la maison-mère et sa filiale suisse, responsable des transactions litigieuses, de sorte que l’impact sur les balances courantes a aussi été partagé entre la France et la Suisse).
Le tableau et le graphique ci-après montrent l’évolution récente des soldes des transactions courantes de la France et de sa principale composante, le commerce extérieur des biens. On voit que, globalement, le solde des transactions courantes s’est amélioré, mais avec une « encoche » (une dégradation provisoire) en 2014 : celle-ci traduit principalement l’impact de la pénalité de BNP Paribas (imputée sur les flux de « revenus secondaires »), car l’amélioration de la composante « commerce extérieur » a, quant à elle, été régulière.
Évolution des soldes extérieurs de la France
(en milliards d’euros)
2012 |
2013 |
2014 |
2015 | |
Solde des transactions courantes |
– 24,9 |
– 17,1 |
– 19,7 |
– 4,3 |
Dont solde des biens |
– 54,1 |
– 43 |
– 34,6 |
– 24,3 |
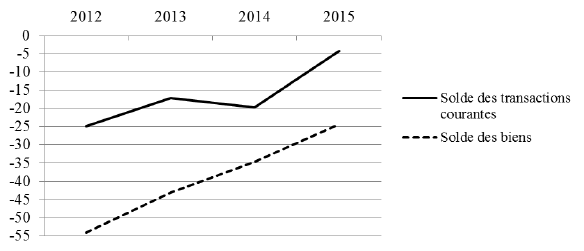
Source : statistiques de la Banque de France.
4. Une donne nouvelle : le poids croissant des économies émergentes et de leurs entreprises
Dans ce qui peut être vu, d’un certain point de vue, comme une « guerre économique » entre les firmes américaines et leurs homologues des autres pays développés (Europe, Japon…), frappées de pénalités pour non-respect de lois américaines, l’émergence d’une nouvelle catégorie de protagonistes doit être signalée : les entreprises des pays émergents.
En 1997, c’est dans le cadre de l’OCDE que la question de la corruption internationale a été traitée, car la quasi-totalité des exportations et grands marchés à l’étranger était alors le fait des acteurs économiques des pays de l’organisation. Mais depuis lors, de nouvelles puissances économiques ont émergé, dont les entreprises se positionnent de plus en plus sur des marchés dans les secteurs « sensibles » à la corruption internationale. Or, certains pays majeurs dans ce domaine ne disposent même pas, semble-t-il, de législation réprimant la corruption internationale d’agents publics – ce serait le cas de l’Inde et de l’Indonésie –, bien que l’article 16 de la convention des Nations-Unies contre la corruption de 2003 le leur impose en principe ; quant à l’application effective de ladite législation pour ceux qui en disposent, elle n’est guère vérifiable en l’absence d’un dispositif sérieux de monitorat/contrôle (comme il en existe dans le cadre de la convention OCDE de 1997 pour les membres de l’organisation).
Jusqu’à présent, les pénalités financières infligées aux États-Unis pour corruption ou violation de sanctions internationales à des entreprises non-américaines ont principalement – exclusivement pour les plus lourdes – frappé des entreprises européennes et parfois japonaises. Les entreprises des économies émergentes telles que la Chine sont, en revanche, davantage préservées. On peut interpréter cette situation de différentes façons : moindre internationalisation des entreprises, même grandes, des pays émergents ; moindre transparence aussi, ce qui rend la détection des pratiques problématiques plus difficile ; plus grande difficulté à obtenir une coopération des autorités locales pour contribuer à l’incrimination de leurs entreprises ; prudence américaine vis-à-vis de nouvelles puissances comme la Chine ? Toujours est-il que le fait est là.
Dans une telle situation, le risque existe que les entreprises européennes ne soient écartées, au bénéfice de celles des pays émergents, d’une certain de nombre de marchés où, qu’on le veuille ou non, les affaires continuent à se faire dans une certaine opacité et avec des pratiques condamnables…
Pour l’avenir, il y a donc un questionnement important sur la capacité qu’auront – ou non – les États-Unis et les autres « vieux » pays industrialisés, européens notamment, à imposer (que ce soit par les méthodes brutales des administrations américaines ou par des voies plus diplomatiques) aux nouveaux acteurs le respect de règles communes. Par ailleurs, ces nouveaux acteurs, de plus en puissants économiquement et insérés dans la mondialisation, ne manqueront pas, à leur tour, d’« exporter » leur droit national en édictant des législations à portée plus ou moins extraterritoriale.
B. LES ENJEUX POLITICO-DIPLOMATIQUES : LE RISQUE D’EFFETS CONTRE-PRODUCTIFS, Y COMPRIS DU POINT DE VUE AMÉRICAIN
Un autre enjeu de l’application extraterritoriale « agressive » de certaines lois américaines est le risque qu’elle ne conduise à des effets contre-productifs par rapport aux objectifs poursuivis, notamment s’agissant des embargos et sanctions économiques.
Il ne s’agit pas là d’ouvrir le débat sur l’efficacité des sanctions économiques, mais de constater que leur « sur-application » peut être particulièrement néfaste y compris pour les États-Unis. Notons d’ailleurs qu’au moins une entreprise auditionnée par la mission a choisi de quitter le sol américain suite à une procédure lancée contre elle.
1. Le mécontentement des pays tiers et même des alliés des États-Unis
D’abord, cette « sur-application » suscite un mécontentement légitime dans les pays tiers, non visés par les sanctions internationales des États-Unis mais dont les entreprises vont, de fait, être éventuellement soumises à de fortes amendes ou vont devoir renoncer à des marchés de crainte de celles-ci. Cet agacement dans les pays tiers concerne aussi les alliés les plus anciens des États-Unis, notamment les pays européens et plus généralement « occidentaux ». Même du point de vue américain, une telle situation n’est pas nécessairement satisfaisante : certes l’extraterritorialité des sanctions telle qu’ils la pratiquent permet en général d’imposer aux pays tiers l’application de leurs sanctions, mais elle provoque aussi des tensions diplomatiques et parfois la corde casse (cf. les différents transatlantiques sur le gazoduc sibérien dans les années 1980, puis les lois Kennedy-d’Amato et Helms-Burton en 1996-1998, développés infra dans le présent rapport).
Ce genre de situations, à long terme, ne peut que nuire à l’efficacité de l’instrument politique que sont les sanctions : les sanctions susceptibles d’être les plus efficaces sont bien sûr celles qui sont décidées en coordination et appliquées par le plus grand nombre de pays (de sorte que les possibilités de contournement soient réduites pour les pays ciblés et que, pour les pays qui sanctionnent, l’inévitable coût économique soit partagé, donc diminué pour chacun d’entre eux). C’est pourquoi, par exemple, les sanctions contre la Russie suite aux événements d’Ukraine ont été coordonnées entre les États-Unis et l’Union européenne, qui ont adopté des dispositions similaires et ont, de plus, veillé à associer à leurs sanctions, à des degrés divers, les autres pays développés. Or, la « sur-application » des sanctions américaines pourrait rendre plus difficile la constitution de ce type de coalitions.
2. Une fragilisation potentielle du rôle international du dollar et du système financier international
L’utilisation d’arguments tels que l’utilisation du dollar pour justifier l’assujettissement aux règles américaines pourrait aussi, à terme, fragiliser le statut international dominant de cette monnaie, qui reste bien utile aux États-Unis (il faut cependant reconnaître que cela ne s’est pas produit jusqu’à présent). Plus généralement, l’application brutale des lois américaines pour pénaliser très lourdement de grandes banques internationales en raison des transactions courantes qu’elles ont pu opérer pour le compte de clients sous sanctions présente certains risques à terme : risque systémique si les pénalités menaçaient la pérennité de grandes banques ; risque de perte de fluidité et de sécurité des systèmes internationaux de paiements et de correspondance bancaire…
3. La difficulté à régler finement les politiques de sanctions : le cas de l’Iran
La « sur-application » des sanctions peut enfin être contre-productive en ce sens qu’elle interdit un « réglage fin » de celles-ci, en particulier lorsque l’on souhaite les atténuer.
Les concepteurs des politiques de sanctions internationales revendiquent depuis quelques années une capacité à régler finement celles-ci pour cibler les seuls complices du terrorisme ou autres criminels et, dans le cas de sanctions visant un pays, entraver l’action des dirigeants sans réduire à la misère la population.
La réflexion sur les politiques de sanction est en effet marquée par des précédents douloureux comme celui de l’embargo commercial quasi-total imposé à l’Irak dans les années 1990, après la première « guerre du Golfe ».
On peut craindre que la complexité des dispositifs américains de sanctions internationales, la lourdeur des punitions auxquelles s’exposent leurs contrevenants et l’application extraterritoriale de ces punitions, le tout répandant partout la « sur-conformité » ou « over-compliance », n’aillent à l’encontre de cette prétention au « réglage fin ».
L’exemple de l’accord du 14 juillet 2015 sur le nucléaire iranien, déjà évoqué et sur les aspects techniques duquel le rapport reviendra, est à cet égard particulièrement caractéristique : les divisions et le blocage actuel de l’appareil politique américain, les actions contradictoires de ses différentes branches (diplomatie, Congrès, agences diverses, justice…), l’absence en conséquence de levée de la plus grande part des sanctions économiques américaines contre l’Iran, la terreur que suscite chez les entreprises ce dispositif de sanctions très complexe et qui leur fait courir des risques juridico-financiers énormes, tout cela contribue à paralyser la reprise des échanges, alors même que le succès de l’accord implique que l’Iran en tire rapidement les bénéfices attendus, donc que son commerce international et son accès aux financements et investissements internationaux ne soient plus entravés.
III. L’ANALYSE JURIDIQUE DE L’EXTRATERRITORIALITÉ DES LOIS AMÉRICAINES
A. LES FONDEMENTS GÉNÉRAUX DES LÉGISLATIONS À PORTÉE EXTRATERRITORIALE
Avant d’analyser en pratique comment les juristes américains justifient l’application extraterritoriale de certaines de leurs lois, les grands principes qui fondent la compétence territoriale des différents droits nationaux doivent être rappelés.
La règle générale est que le droit d’un État s’applique sur son territoire. Cependant, plusieurs types de justifications peuvent être avancés pour fonder une compétence juridictionnelle extraterritoriale.
S’agissant du droit américain, la compétence d’édicter des réglementations des États serait fondée, en droit coutumier et d’après une recension de jurisprudence qui a une certaine autorité aux États-Unis, les Restatements of the Law de l’American Law Institute, sur une triple base :
– la compétence territoriale, pouvant inclure des faits survenus à l’étranger compte tenu de leurs effets sur le sol national – c’est la « théorie des effets » ;
– la compétence personnelle pour tout ce qui concerne les nationaux (y compris pour des faits survenant à l’étranger) ;
– la compétence dite « réelle », pour les atteintes à la sécurité nationale.
Selon la troisième (et dernière) version du Restatement of Foreign Relations Law of the United States, § 402 et 403, le champ de compétence des États pour édicter des lois peut être fondé sur trois critères :
– un critère territorial (faits survenant pleinement ou pour une part substantielle sur le territoire national ; état des personnes s’y trouvant ; faits survenant hors du territoire, mais y ayant des effets substantiels) ;
– un critère personnel, couvrant les activités, intérêts, statuts, relations des nationaux ;
– un critère « réel », couvrant les faits dirigés directement contre la sécurité de l’État ou éventuellement certains autres intérêts publics.
Il est également précisé par cette source que la compétence juridictionnelle concernant des personnes ou activités ayant des connexions avec une autre juridiction étatique ne doit pas être exercée lorsque ce serait « déraisonnable » (unreasonable).
Le caractère raisonnable ou non doit être apprécié en fonction d’un faisceau d’indices comprenant, entre autres : le lien des activités concernées par la législation avec le territoire de l’État qui l’édicte ; si l’on invoque les effets des activités concernées sur le territoire national, le caractère substantiel, direct et prévisible de ces effets ; l’importance des réglementations en cause pour le système international ; leur compatibilité avec les traditions du système international ; la possibilité d’un conflit de normes avec un autre État, etc.
2. Le droit français et européen
De manière générale, la doctrine juridique française semble admettre sensiblement les mêmes fondements de compétence qu’aux États-Unis : la compétence est d’abord territoriale, mais peut aussi être justifiée par la nationalité, des considérations de sécurité nationale (par exemple dans le cadre de la répression d’actes particulièrement graves comme ceux de terrorisme), ou encore les nécessités de fonctionnement du service public y compris à l’étranger (droit diplomatique : les immunités de juridiction des diplomates doivent avoir pour contrepartie leur assujettissement aux juridictions de leur pays d’origine), voire peut être dans certains cas « universelle ».
En matière pénale, les règles de base de compétence juridictionnelle du droit français sont exposées aux articles 113-1 à 113-8 du code pénal :
– « la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République » (article 113-2), les navires battant pavillon français et aéronefs immatriculés en France y étant assimilés indépendamment de leur localisation (articles 113-3 et 113-4) ;
– les crimes et délits réalisés « au moyen d’un réseau de communication électronique » sont réputés commis sur le territoire de la République lorsque la victime réside en France ou y a son siège dans le cas d’une personne morale (article 113-2-1) ;
– pour des faits survenus hors du territoire national, la loi pénale française est également applicable pour les crimes et délits punis d’emprisonnement dont sont victimes des personnes de nationalité française au moment des faits (article 113-7) ;
– toujours pour des faits survenus hors du territoire national, les coupables présumés relèvent de la justice française quand ils sont de nationalité française, mais seulement, lorsqu’il s’agit de délits, sous condition de double incrimination – il doit s’agir aussi de faits délictueux dans le pays en cause (article 113-6) ;
– de plus, pour les faits survenus hors du territoire national impliquant des victimes ou des prévenus de nationalité française, le monopole des poursuites appartient au parquet et leur déclenchement doit être précédé d’une plainte ou bien d’une dénonciation par les autorités du pays en cause (article 113-8) ;
– enfin, les complices en France de faits commis à l’étranger ne sont poursuivables que sous condition de double incrimination et de condamnation préalable définitive par la juridiction étrangère (article 113-5).
Il est à noter que, pour certains actes, soit très graves, soit susceptibles d’être commis par des Français principalement, voire exclusivement, à l’étranger, tels que le terrorisme, le mercenariat ou les activités pédophiles, les conditions restrictives susmentionnées (double incrimination, plainte préalable, etc.) sont écartées par le code pénal.
Par ailleurs, dans certains cas, la loi française donne à notre justice une forme de compétence universelle : en application des articles 689 à 689-13 du code de procédure pénale, « les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque [la loi le prévoit], soit lorsqu’une convention internationale ou un acte [européen] donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’infraction ». Les engagements internationaux visés sont ensuite listés : il s’agit d’un ensemble de conventions concernant la répression du terrorisme et de son financement, de la piraterie, du détournement d’avions, du trafic de matériaux nucléaires, de la torture, des disparitions forcées, des crimes relevant de la Cour pénale internationale, etc., ainsi que de certains engagements européens (par exemple le non-respect de la réglementation du temps de conduite et de repos dans les transports routiers).
La possibilité de ces poursuites est toutefois conditionnée au fait que les personnes poursuivies se trouvent en France : il faut donc une forme de lien de rattachement au territoire national. De plus, ces cas de « compétence universelle » sont systématiquement couverts par des engagements internationaux : le droit français prend donc soin d’inscrire ses dispositions les plus extraterritoriales dans le cadre du droit international, évitant l’unilatéralisme. On ne peut donc pas parler de compétence universelle inconditionnelle
b. En matière civile et commerciale
En matière civile, le code de procédure civile comporte des règles qui attribuent une compétence aux juridictions françaises au détriment des juridictions étrangères.
Tout d’abord, son article 42, alinéa 2, prévoit une compétence générale des tribunaux français lorsque le défendeur est domicilié en France.
Il prévoit ensuite des règles de compétences spécifiques à certaines matières. Ainsi, l’article 44 donne compétence aux tribunaux français en matière d’actions réelles immobilières pour les immeubles situés en France. De même, l’article 46 donne compétence aux tribunaux français en matière contractuelle si la chose a été livrée en France ou si la prestation de services est exécutée en France. En matière délictuelle, ce même article octroie compétence aux juridictions françaises si le fait générateur du dommage a eu lieu en France ou si le dommage lui-même a été subi en France.
Si ces règles ordinaires de compétences ne peuvent être appliquées, les juridictions françaises peuvent aussi justifier leur compétence, en vertu des articles 14 et 15 du code civil, sur le fondement de la nationalité française d’une des parties.
L’article 14 du code civil dispose en effet que « l’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ». Cet article donne donc compétence aux juridictions françaises lorsqu’un français est demandeur.
L’article 15 du même code dispose, quant à lui, qu’« un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger ». Cet article donne donc compétence aux juridictions françaises lorsqu’un français est défendeur.
Ainsi, l’article 14 permet au Français, sans l’y obliger, de saisir une juridiction française. Quant à l’article 15, il offre une faveur au demandeur, français ou étranger, en lui accordant la possibilité, et non l’obligation, de traduire un défendeur français en France.
Il est par ailleurs à noter que, dans le cadre de l’Union européenne, les questions de la compétence juridictionnelle et de l’exécution des décisions de justice sont très vite apparues centrales, en matière civile et commerciale, pour la construction du « marché commun », puis du « marché unique ». Dès 1968, les six États fondateurs de la Communauté économique européenne ont conclu à Bruxelles un accord en la matière, la convention « concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale », puis cette question a fait l’objet de règlements européens, le dernier de portée générale, qui vient d’entrer en vigueur, étant le règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 « concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale » (15).
Le préambule de ce texte justifie clairement les raisons pour lesquelles l’Union européenne prétend intervenir pour clarifier les règles de compétence juridictionnelle en matière civile entre ses États membres : « certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de garantir la reconnaissance et l’exécution rapides et simples des décisions rendues dans un État membre sont indispensables ».
Le règlement européen met surtout en avant le principe de territorialité, en trouvant ensuite un équilibre entre deux de ses applications possibles : faut-il privilégier le lieu de résidence des personnes parties aux procédures, ou le lieu des « faits » en cause ? Le règlement pose donc, à son article 4, un principe général : « sous réserve [des autres dispositions] du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ». Viennent ensuite les tempéraments : des personnes peuvent être attraites indépendamment de leur lieu de résidence, notamment, selon l’article 7, devant la juridiction du lieu d’exécution d’une obligation contractuelle, celle du lieu où s’est produit un fait dommageable dans le cadre de la responsabilité délictuelle, devant la juridiction pénale compétente quand l’action civile est fondée sur une infraction, devant la juridiction où se situe un établissement (entreprise, succursale…) en cas de contestation relative à son exploitation, etc. Par ailleurs, pour le cas particulier des contrats considérés comme intrinsèquement déséquilibrés comme ceux de travail, de prêt à la consommation ou d’assurance, le règlement entend protéger la partie « faible » – le salarié, l’emprunteur, l’assuré – en lui garantissant qu’un litige le concernant pourra en tout état de cause être jugé devant la juridiction de son lieu de résidence.
Enfin, il est à noter que le règlement de 2012 fait une brèche dans le principe de stricte territorialité des compétences d’exécution en ce sens qu’il supprime l’exequatur à l’intérieur de l’Union européenne : selon ses articles 36 et 39, les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres et doivent y jouir de la force exécutoire sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure (il reste cependant la possibilité pour les parties d’engager des procédures d’opposition à cette reconnaissance et à cette exécution de plein droit).
B. LA PRATIQUE : LES PRINCIPALES « ENTRÉES » DES LOIS AMÉRICAINES EXTRATERRITORIALES
Comme l’ont observé des personnalités entendues par la mission, les diverses autorités américaines qui appliquent leur droit de manière extraterritoriale se donnent rarement la peine, dans les documents qu’elles produisent, de justifier formellement la compétence qu’elles revendiquent implicitement. Sans viser l’exhaustivité (même si la mission reste vigilante sur l’extraterritorialité des lois américaines dans d’autres domaines comme celui de la protection des consommateurs), l’analyse des textes permet toutefois de distinguer plusieurs entrées communément utilisées pour fonder cette compétence.
1. Les lois qui s’appliquent à toutes les sociétés présentes sur les marchés financiers réglementés américains
Plusieurs législations américaines ont en commun de s’attaquer aux malversations des entreprises en mettant en avant les conséquences de celles-ci sur la sincérité (au sens général plus que précisément juridique) de leurs comptes. Comme les problèmes de fiabilité des documents comptables et informations financières sont bien sûr particulièrement graves quand ils concernent des entreprises cotées sur un marché réglementé (une « bourse ») ou qui y font des émissions (le principe du marché réglementé veut que le public des investisseurs y accède à une information fiable et contrôlée), ces législations se donnent souvent comme champ d’assujettissement l’ensemble des sociétés présentes sur les marchés réglementés américains à un titre ou un autre, donc un champ allant bien au-delà des seules entreprises américaines, puisque le plus grand nombre des grandes entreprises internationalisées sont cotées à New-York.
Ce choix d’assujettir à la loi américaine toutes les entreprises, quelle que soit leur nationalité, faisant ce que l’on appellerait un appel public à l’épargne américaine semble bien relever d’une application de la « théorie des effets » : les éventuels comportements illicites d’une entreprise étrangère à l’étranger ont des effets sur la sincérité des comptes et des rapports qu’elle publie sur le territoire des États-Unis à destination des investisseurs américains dès lors qu’elle y est cotée en bourse ou y procède à des émissions (car, bien évidemment, les malversations ou flux financiers illicites sont dissimulés dans les documents comptables rendus publics).
a. La lutte contre la corruption internationale
Le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) réprimant la corruption des agents publics à l’international est ainsi explicitement extraterritorial, en ce sens qu’il vise des faits impliquant par définition des non-Américains, puisque les receleurs des versements de corruption visés sont les agents publics ou officiels étrangers, tandis que les corrupteurs « actifs » considérés sont notamment (16) tous les émetteurs de titres qui doivent être enregistrés en application de la loi américaine ou doivent publier des informations réglementées, donc toute entreprise, quelle que soit sa nationalité, qui prétend être cotée ou procéder à des émissions sur un marché financier réglementé américain (17).
Les documents intitulés « Information » (qui correspondent mutatis mutandis à des actes d’accusation) publiés sur le site du ministère américain de la justice concernant les quatre entreprises françaises qui ont été sanctionnées au titre de la loi FCPA, à savoir Alcatel-Lucent, Alstom, Technip et Total, comportent tous le constat que lesdites entreprises tombaient sous le coup de la loi FCPA (car elles sont ou étaient au moment des faits des « émetteurs de titres » au sens susmentionné).
Les documents américains relèvent également (mais sans en tirer explicitement une justification d’assujettissement à la loi américaine, qui n’est plus nécessaire) d’autres éléments d’américanité : Alcatel avait en outre un bureau à Miami, dont le chef a directement été impliqué dans des paiements de corruption en Amérique centrale ; un compte bancaire domicilié aux États-Unis a été débité pour certains de ces paiements ; s’agissant d’Alstom, sa filiale Alstom Power enregistrée aux États-Unis était impliquée dans certaines des opérations de corruption en cause…
En effet, le statut d’« émetteur » sur les marchés financiers américains n’est pas le seul lien avec les États-Unis susceptible d’être invoqué pour fonder des poursuites sur la base de la loi FCPA. Dans une affaire concernant MM. Straub et consorts (dirigeants d’une entreprise hongroise poursuivie au nom de la loi FCPA pour des faits de corruption en Macédoine et au Monténégro), alors que le critère de compétence précité ne pouvait pas être utilisé contre des personnes physiques, le lien de territorialité invoqué pour justifier la compétence juridictionnelle américaine a été l’usage de mails (qui évoquaient les actes de corruption), ces mails ayant transité par des serveurs localisés aux États-Unis. Un tribunal américain a validé cette interprétation discutable du lien de territorialité en arguant que, vu la dimension mondiale du réseau internet, les intéressés auraient dû se douter que leurs mails pouvaient transiter dans le monde entier et notamment par le sol américain (18) !
L’approche de type « fraude comptable », qui est donc la plus fréquemment invoquée à l’encontre des grandes entreprises, présente, si l’on se place du point de vue américain, plusieurs avantages.
D’abord, elle justifie d’emblée de prendre en considération l’ensemble des faits de corruption internationale qui peuvent être imputés à un groupe multinational, puisque les comptes sont présentés de manière consolidée et que les émissions d’actions ou d’obligations ont lieu en général au niveau de la société de tête. À cet égard, il semble que les autorités américaines aient parfois une interprétation extensive du critère – déjà extensif – de la qualité d’« émetteur » sur les marchés américains pour justifier leur compétence juridictionnelle : dans le cas d’Alstom, elles ont retenu des charges contre la filiale suisse Alstom Network Schweiz AG, bien que celle-ci ne remplisse aucun des critères d’assujettissement légaux du FCPA, du fait de ses liens avec les autre entités d’Alstom, lesquelles sont effectivement des « émetteurs » ; le même type de raisonnement a également été appliqué à l’entreprise italienne Snamprogetti (19).
Cette approche permet aussi de retenir chaque fois plusieurs incriminations contre les entreprises mises en cause : infraction à la législation anticorruption du FCPA ; mais aussi infraction aux dispositions prévues en matière de Books and records, c’est-à-dire d’information réglementée, du FCPA ; infraction en matière de contrôles internes prévus par le FCPA.
b. Un autre exemple, la loi Sarbanes-Oxley
Adoptée en juillet 2002 après les scandales Enron et Worldcom, la loi Sarbanes-Oxley (Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act), visant à lutter contre les fraudes comptables, s’applique comme la loi FCPA à toutes les sociétés cotées aux États-Unis, donc à nombre d’entreprises françaises, ainsi qu’aux filiales étrangères des sociétés américaines.
Elle renforce considérablement les obligations des sociétés et de leurs dirigeants en matière comptable et les sanctions éventuelles de leurs défaillances : les comptes doivent être certifiés et signés personnellement par les dirigeants ; des obligations précises d’archivage des données comptables sont prévues ; un système interne de contrôle comptable et financier doit être mis en place sous la responsabilité de la direction générale, évalué annuellement par elle et faire l’objet de rapports annuels ; une procédure interne d’alerte (ou « whistleblowing ») doit permettre aux salariés de signaler les malversations comptables et financières tout en les protégeant, etc.
2. La lutte contre le blanchiment d’argent d’origine criminelle : une législation qui impose aux banques américaines de contrôler leurs correspondants étrangers
Le Bank Secrecy Act (BSA) de 1970 comporte des dispositions anti-blanchiment, qui ont été renforcées par le Patriot Act en 2001. Le dispositif prévoit, entre autres dispositions, l’obligation pour les institutions financières américaines de mettre en place des programmes internes de détection et de prévention du blanchiment (dits Anti-Money Laundering – AML – compliance programs), comprenant une obligation de « due diligence » notamment pour les comptes des banques correspondantes impliquant des étrangers (20). Les banques américaines sont tenues de procéder à certaines vérifications « raisonnables » (« due diligence policies, procedures, and controls that are reasonably designed to detect and report instances of money laundering through those accounts ») quant à leurs correspondants étrangers, dans le cadre d’une législation moins ouvertement extraterritoriale que la loi FCPA (il s’agit d’obligations imposées aux seules banques américaines), mais qui a une portée extraterritoriale en ce sens qu’elle rend en quelque sorte ces banques américaines responsables d’errements survenus à l’étranger dans le cadre de banques étrangères, si elles n’ont pas pris de mesures pour prévenir ou détecter ces errements.
Une banque européenne, HSBC, a dû payer en 2012 une pénalité transactionnelle de plus de 1,9 milliard de dollars à la justice et aux administrations américaines, d’une part en raison de transactions violant des sanctions économiques américaines (cas comparable à celui de BNP Paribas, voir infra), d’autre part en raison de défaillances dans la prévention/détection des faits de blanchiment chez des correspondants étrangers. Formellement, c’est la filiale américaine, banque de droit américain, d’HSBC, qui a été visée par la procédure, pour ne pas avoir contrôlé suffisamment les pratiques d’une autre filiale du groupe, celle du Mexique, avec laquelle elle avait des relations de correspondance et qui était apparemment peu regardante quant à l’argent de cartels de la drogue. Les documents américains insistent sur le fait que l’appartenance de ces deux entreprises au même groupe bancaire ne changeait rien aux obligations qu’avait la filiale de droit américain d’HSBC par rapport aux filiales non-américaines du même groupe.
3. Les autres cas de figure (violations de sanctions économiques, lutte contre les organisations mafieuses, fiscalité personnelle) : plutôt une conception « extensive » des principes généraux de compétence territoriale et/ou personnelle ?
a. Les sanctions économiques et embargos
i. Des sanctions qui peuvent être ouvertement extraterritoriales
Les États-Unis mettent en œuvre de nombreux régimes de sanctions économiques et embargos dans le cadre de l’application de plusieurs législations de portée générale, qui en posent les principes depuis maintenant plusieurs décennies (Trading with the Enemy Act de 1917, Foreign Assistance Act de 1961, Arms Export Control Act de 1976, International Traffic in Arms Regulations de 1976, International Emergency Economic Powers Act de 1977, Export Administration Act de 1979…) et donnent lieu, au cas par cas, à des mesures d’application de l’exécutif. S’y ajoutent des législations spécifiques visant différents pays (notamment, de manière répétitive, Cuba et l’Iran).
Ces législations comprennent en général à la fois des prohibitions générales (embargos) qui ont directement une base légale et des délégations données à l’exécutif pour décider de sanctions individuelles, de nature administrative (interdiction d’entrée sur le sol américain, gel d’avoirs, exclusion des marchés publics américains, voire du marché américain globalement, etc.), à l’encontre de personnes physiques ou d’entreprises généralement étrangères.
Une autre distinction très importante en droit américain semble être celle entre les sanctions « primaires », applicables aux « US Persons » relevant du droit pénal américain, et les sanctions « secondaires », qui sont explicitement applicables à des personnes ou entités étrangères qui feraient des transactions avec les pays ou entités visés par les sanctions. Les sanctions secondaires peuvent donc être explicitement extraterritoriales. Cette extraterritorialité explicite est justifiée, du point de vue américain, par l’invocation d’intérêts majeurs de sécurité nationale.
En pratique, le degré d’extraterritorialité explicite des régimes de sanctions américains semble très variable. Le professeur Régis Bismuth (21) relève que certains ne visent que les personnes définies comme « subject to the jurisdiction of the United States », ce qui permet certes d’inclure les entités possédées ou contrôlées par des sociétés américaines et donc leurs filiales à l’étranger, mais comporte encore une limitation, tandis que d’autres ne comprennent aucune limitation de compétence.
ii. Une dimension de « sécurité nationale » susceptible de « justifier » une extraterritorialité débridée
Les régimes d’embargos et de sanctions ont d’abord été fondés sur des considérations de sécurité nationale (aux États-Unis comme ailleurs), ainsi que le rappellent les intitulés des lois de portée générale susmentionnées : il s’agit d’interdire le commerce avec l’ennemi, de prendre des mesures d’urgence…
Ce type de considérations peut fonder une extraterritorialité sans limite, comme le montre la rédaction de certaines dispositions du Patriot Act de 2001, adopté dans le climat particulier créé par les horreurs du « 11 septembre » : il est ainsi exposé que le blanchiment d’argent (servant notamment au financement du terrorisme) menace non seulement la sécurité des États-Unis, mais même tout le système économique et financier mondial dont dépend la prospérité (22), ce dont on peut déduire une sorte de droit (voire de devoir) pour la principale puissance mondiale de prétendre prémunir l’ensemble de ce système financier mondial contre les pratiques de blanchiment…
iii. Mais des pénalités contre les banques européennes plutôt fondées sur une interprétation très extensive du critère de rattachement territorial via l’usage du dollar
Malgré l’existence des sanctions « secondaires » et la prétention extraterritoriale très forte de certains textes américains, il apparaît, s’agissant des pénalités payées par un certain nombre de grandes banques européennes depuis plusieurs années pour non-respect des sanctions américaines, que ce sont plutôt les sanctions « primaires » qui ont généralement été invoquées, en développant une conception extensive des principes généraux traditionnels de compétence territoriale (ou parfois personnelle).
Les documents produits par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), à savoir les « Settlement Agreements » passés avec les banques sanctionnées, se réfèrent systématiquement et succinctement à la notion de transactions faites à destination ou « au travers » d’institutions financières américaines (« to or through U.S. financial institutions »). D’autres documents relatifs aux mêmes faits parlent plutôt de transactions faites au travers d’institutions financières aux États-Unis (le « Statement of Facts » signé par BNP Paribas avec la justice américaine emploie ainsi la formule de transactions « processed through (…) financial institutions in the United States »).
L’analyse des faits reprochés montre qu’il s’agit essentiellement d’opérations qui ont « transité » par les États-Unis parce que c’étaient des opérations en dollars impliquant des ordres de paiement (par le système international SWIFT) à destination d’institutions bancaires situées aux États-Unis, les banques internationales ayant l’habitude d’y centraliser leurs opérations en dollars afin de permettre ensuite leur compensation dans des chambres de compensation américaines (23). Donc, les opérations en cause n’impliquaient pas directement le territoire américain (il s’agissait de transferts entre des comptes non domiciliés aux États-Unis), mais l’impliquaient indirectement du fait de l’opération-reflet qu’elles entraînaient avec une banque correspondante aux États-Unis chargée de les prendre en compte pour la compensation globale entre banques des opérations en dollars.
Il est à noter que l’administration américaine soutient depuis longtemps que des opérations de compensation effectuées sur son territoire suffisent à assujettir aux lois américaines les transactions qui, in fine, ont donné lieu à cette compensation. S’agissant de l’Iran, l’OFAC avait ainsi, dans un premier temps des sanctions américaines contre ce pays, autorisé les transactions dites « U-turn », à savoir des transactions ne faisant pas directement apparaître des entités iraniennes, mais faites entre deux banques étrangères par le biais de leurs comptes détenus dans une banque américaine : en pratique, il s’agissait ainsi de faire une dérogation pour la compensation aux États-Unis d’opérations impliquant de créditer ou débiter les comptes en dollars de personnes ou d’entités iraniennes auprès de banques étrangères. En autorisant cette exemption, l’OFAC affirmait aussi, par prétérition, son droit de regard sur lesdites transactions ; puis cette exemption a été révoquée (le 10 novembre 2008) et il est à noter qu’elle n’est pas rétablie dans le cadre de la levée partielle des sanctions contre l’Iran après l’accord sur le nucléaire du 14 juillet 2015.
Les documents américains ne se donnent pas la peine de justifier plus amplement la compétence juridictionnelle de leur pays : implicitement, ce sont sans doute les règles générales de compétence territoriale ou personnelle qui sont invoquées, des transactions illicites étant « passées » par des institutions financières qualifiées d’américaines ou situées aux États-Unis.
Le fait que les deux banques françaises sanctionnées aux États-Unis, BNP Paribas et le Crédit agricole, y aient eu des filiales ou bureaux n’est pas déterminant : les documents américains prennent clairement en compte l’ensemble des transactions illicites (de leur point de vue) compensées aux États-Unis, que ce soit par le biais de ces établissements locaux ou d’autres correspondants. D’ailleurs, le fait que la filiale suisse de BNP Paribas, responsable des transactions incriminées, ait décidé dès 2004 de renoncer à utiliser la branche américaine de la banque pour ses opérations de compensation n’a pas empêché qu’elle soit sanctionnée pour des transactions postérieures.
Politiquement, d’autres justifications que le fait que les transactions incriminées ont transité via des « US financial institutions » peuvent être invoquées. S’agissant du cas BNP Paribas, les déclarations faites par des officiels américains au moment de la conclusion de la transaction, rapportées par le communique de presse du Department of Justice, mettent en avant la dimension « sécurité nationale », qui est une autre justification traditionnelle de l’extraterritorialité. L’Attorney General Eric H. Holder aurait ainsi déclaré : « Sanctions are a key tool in protecting U.S. national security interests ».
Mais, juridiquement, la base des poursuites américaines semble rester le « transit » de transactions incriminées par le système financier américain.
Cela dit, il est possible que l’existence de dispositions législatives américaines ouvertement extraterritoriales au nom de la sécurité nationale, comme le Patriot Act, ait pu d’une certaine façon pousser les banques européennes à la « faute » consistant à utiliser systématiquement les chambres de compensation américaines pour leurs opérations en dollars, se plaçant ainsi dans le champ de la juridiction américaine : en effet, il existe des possibilités de compensation de telles opérations hors des États-Unis, certaines plus ou moins informelles, notamment à Beyrouth, d’autres plus organisées, comme la plateforme HSBC’s Clearing House Automated Transfer Systembasée à Hong-Kong, mais il semble que la crainte de la législation américaine anti-blanchiment renforcée par le Patriot Act susmentionnée, ouvertement extraterritoriale, ait pu conduire les banques en cause à éviter soigneusement de recourir à des mécanismes où elles ne pouvaient pas vraiment contrôler la conformité de leurs correspondants.
b. La lutte contre le crime organisé (loi RICO) : une volonté de sanctionner globalement les organisations mafieuses qui permet une territorialité « large »
Le rôle moteur joué par le Federal Bureau of Investigation (FBI) dans l’enquête dite du FifaGate et les demandes d’extradition signifiées en conséquence par la justice américaine à l’encontre des personnes arrêtées en 2015 en Suisse dans cette affaire peuvent surprendre : le siège de la FIFA est en Suisse ; certains des mis en cause sont citoyens des États-Unis, mais pas la majorité (notamment pas, à une exception près, les personnalités arrêtées en Suisse) ; les différents scandales de corruption allégués concernent principalement l’attribution de l’organisation de différentes coupes du monde à des pays qui ne sont (justement) pas les États-Unis…
Il semble que la compétence revendiquée par la justice américaine pour traiter globalement, donc de manière fortement extraterritoriale, de cette affaire soit la loi dite RICO, pour Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, votée en 1970 par le Congrès pour combattre les organisations mafieuses.
La loi RICO ne comprend apparemment pas de dispositions explicitement extraterritoriales. Mais elle s’inscrit dans une volonté de pénaliser, au-delà des seuls faits directement criminels commis par des organisations mafieuses, toutes les activités et personnes qui y sont liées ou en dérivent. Elle pénalise donc de manière très large toute « entreprise » (qui peut être une entité légalement constituée, mais aussi un groupement de fait – ce que l’on appellerait une « association de malfaiteurs ») visant à tirer profit d’activités criminelles et établit une responsabilité civile solidaire de chacun des membres des entreprises criminelles en cause. Ce dispositif permet donc – du moins dans l’analyse du parquet américain – de poursuivre devant la justice américaine l’ensemble des membres d’une « entreprise » criminelle ainsi définie dès lors que l’un au moins, ou l’un des faits en cause, tombent sous la juridiction américaine en application des critères habituels (nationalité américaine ou résidence aux États-Unis de mis en cause ; pactes de corruption qui auraient été conclus sur le sol américain ; paiements illicites effectués via des comptes américains, ou simplement en dollars et donc compensés via les États-Unis…). Il constitue donc un outil puissant d’extraterritorialité.
c. La fiscalité : l’emploi large du critère de compétence personnelle à côté du critère territorial
En matière fiscale, enfin, où la mise en œuvre du Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) entraîne de sérieuses difficultés, le problème d’application extraterritoriale de la législation américaine tient surtout à l’emploi, propre aux États-Unis, du critère de nationalité à côté de celui de résidence (territorialité) pour taxer les personnes physiques.
● Le système fiscal français (comme ceux du plus grand nombre des pays) est, s’agissant des impôts directs, centré sur le critère de territorialité, qu’il s’agisse de la fiscalité personnelle, qui vise les résidents indépendamment de leur nationalité, ou de celle des sociétés, qui prend en compte la localisation des activités beaucoup plus que la « nationalité » des sociétés (localisation de leur siège social) : de manière générale (24), les bénéfices provenant d’opérations effectuées par les entreprises françaises dans les « établissements » qu’elles possèdent à l’étranger ne sont pas imposables en France (a fortiori dans le cas des filiales à l’étranger), tandis que les bénéfices réalisés par une entreprise ayant son siège hors de France sont imposables dans notre pays lorsqu’ils résultent d’opérations constituant l’exercice habituel en France d’une activité ou proviennent du revenu d’actifs situés en France.
● Le système fiscal américain donne beaucoup plus d’importance au critère de compétence personnelle, à savoir à la nationalité des entreprises et des personnes. Du point de vue américain, l’impôt direct est largement lié à la citoyenneté, tout autant qu’à la territorialité, et, dans ce cas de figure, ne porte pas sur la seule assiette localisée sur le territoire national, mais sur une assiette mondiale.
S’agissant des entreprises américaines, toutefois, le principe de la taxation au « bénéfice mondial » connaît un sérieux bémol : la non-imposition des profits à l’étranger tant qu’ils ne sont pas rapatriés, d’où un « trésor de guerre » stocké dans des pays à fiscalité douce évalué fin 2014 à 2 100 milliards de dollars pour les 500 premières entreprises américaines.
Les citoyens américains, même expatriés, restent imposables aux États-Unis sur la base de leurs revenus mondiaux, sous réserve de mécanismes spécifiques atténuant ce principe, notamment en évitant les situations de double imposition.
4. La question particulière de la remise en cause des immunités souveraines
L’immunité de juridiction des États étrangers a pour effet de soustraire ceux-ci à la compétence des tribunaux nationaux. C’est un principe coutumier du droit international (à la différence de l’immunité de juridiction des diplomates, garantie par des conventions internationales).
Cette immunité est admise par les juridictions françaises, qui toutefois distinguent traditionnellement les « actes d’autorité » des États étrangers, dont elles refusent de connaître, des « actes de gestion » comparables à ceux que pourrait faire un particulier (signer un contrat commercial par exemple), qui ne bénéficient pas de l’immunité.
Le droit américain admet lui-aussi, de manière générale, l’immunité souveraine, mais avec des exceptions notoires et problématiques.
L’une d’entre elles concerne le terrorisme : dans le cadre du Foreign Sovereign Immunities Act de 1976, la loi dispose qu’un État étranger ne bénéficie pas de l’immunité souveraine, en matière de poursuites civiles (indemnitaires) exercées par les victimes (ou leurs ayants-droits) d’actes de torture, d’exécutions extra-judiciaires, de piraterie aérienne et de prise d’otages, si cet État est désigné comme un « sponsor du terrorisme » et si les crimes en question ont été commis ou matériellement soutenus par des agents de cet État dans le cadre de leurs fonctions (25).
Le Congrès n’hésite pas à décider lui-même de l’application de cette suspension générale d’immunité souveraine à des cas spécifiques : il a par exemple voté en 2012 une disposition, dans le cadre du Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act, qui affectait spécifiquement des avoirs iraniens gelés aux États-Unis (du fait des sanctions) à l’indemnisation des victimes d’un acte de terrorisme réputé avoir été « sponsorisé » par l’Iran, à savoir l’attentat contre les soldats américains à Beyrouth en 1983. La Cour suprême a validé cette loi (dans une décision qui n’est pas centrée sur les questions de territorialité, mais sur la compétence qu’avait ou non la branche législative d’intervenir ainsi dans une affaire judiciaire en cours (26)).
Autre exemple, l’immunité juridictionnelle de la France a été mise en cause face à des risques de poursuites judiciaires aux États-Unis contre la SNCF, assimilée à l’État, pour sa participation à la déportation de certaines victimes de la Shoah durant la Seconde Guerre mondiale. Malgré le principe bien établi en droit international public de l’immunité juridictionnelle des États, la France a signé un accord avec les États-Unis (27) pour, selon les termes du préambule, « garantir l'immunité d'État souverain étranger de la France s'agissant des demandes relatives à la déportation liée à la Shoah ». Avec cet accord, la France s’assure que les États-Unis prendront toute mesure nécessaire contre des initiatives juridiques ou législatives au niveau fédéral, des États ou des autorités locales, qui mettraient en cause l’immunité de juridiction de la France. En contrepartie de cette « paix juridique durable», pour reprendre également les termes du préambule, la France s’est engagée à mettre en place un fonds doté de 60 millions de dollars.
Enfin et surtout, le Sénat, le 17 mai 2016, puis la Chambre des représentants, le 9 septembre, ont voté successivement (et à l’unanimité) la proposition de loi dite Justice Against Sponsors of Terrorism Act (JASTA), laquelle prévoit une suspension de l’immunité souveraine en matière de poursuites civiles dans le cas particulier d’actes de terrorisme dans lesquels on pourrait mettre en cause un « acte délictueux » (tortious act) d’un État étranger ou de ses agents, où que cet acte ait été commis. Il s’agit clairement de viser non seulement le soutien direct à des activités terroristes par des États, mais aussi le soutien indirect, voire tout comportement fautif excédant la simple négligence, ce qui conduirait à une extension considérable du dispositif législatif actuel, d’autant que disparaîtrait aussi la limitation actuelle de la suspension de l’immunité souveraine aux seuls États « sponsors du terrorisme » désignés par l’administration. Seule limite, cette extension serait réservée au cas d’actes de terrorisme commis sur le territoire américain. En fait, c’est l’éventuelle responsabilité indirecte de l’Arabie Saoudite dans les attaques du 11 septembre 2001 qui est principalement visée, mais des juristes (commissionnés par le gouvernement saoudien pour mener une campagne de sensibilisation contre ce texte) font valoir que, par exemple, l’Allemagne pourrait aussi être mise en cause dans la mesure où plusieurs des terroristes du « 11 septembre » avaient préparé leur opération dans la cadre de la « cellule de Hambourg » sans que les services allemands compétents ne détectent et répriment leurs projets.
Le 23 septembre 2016, le président américain a opposé son veto à ce texte. La Maison blanche redoute que des pays tiers l’exploitent pour porter plainte contre des diplomates, des militaires ou encore des entreprises américaines. Le président américain semble avoir, de plus, pris en compte les inquiétudes émises par les pays alliés (28).
Cependant, le 28 septembre 2016, ce projet de loi a été définitivement adopté suite au vote à la majorité des deux tiers du Congrès américain outrepassant le véto du président Obama.
En réaction et face aux limites de l’action diplomatique, le président a porté un amendement, co-signé par la rapporteure, lors de l’examen, en seconde lecture à l’Assemblée nationale, du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Cet amendement, écarté par le gouvernement à ce stade de la procédure législative, visait à ce que la France se dote d’une législation similaire afin qu’une victime française de terrorisme puisse poursuivre n’importe quel État dans le monde, États-Unis compris.
C. LES PRATIQUES AMÉRICAINES DE POURSUITE S’APPUIENT SUR DES CRITÈRES INCERTAINS, DES MÉTHODES INTRUSIVES, VOIRE ABUSIVES
Tout autant, voire plus, que l’affirmation, dans certains cas, de législations ouvertement extraterritoriales, ce sont en fait un certain nombre de caractéristiques du fonctionnement du système judiciaire américain qui font que l’extraterritorialité américaine pose problème.
1. Des critères de compétence territoriale ou personnelle pour le moins incertains
C’est ainsi que ce n’est sans doute pas tant le recours par la justice américaine à des principes généraux de compétence territoriale et/ou personnelle, lesquels sont appliqués par tous les pays, dont la France comme on l’a dit, mais l’usage extensif et incertain qu’elle en fait qui crée des difficultés.
a. Le problème de l’implication des « US Persons »
La notion d’« US Person », qui rend compte du critère classique de compétence fondée sur la nationalité, apparaît centrale dans l’analyse du champ d’application de certaines dispositions américaines, en particulier pour distinguer les entreprises tenues par les sanctions économiques « primaires » ou « secondaires ».
Elle est en particulier déterminante dans le contexte de la levée des sanctions internationales contre l’Iran suite à l’accord du 14 juillet 2015 sur le nucléaire iranien (Joint Comprehensive Plan of Action-JCPOA) car, pour l’essentiel, les États-Unis n’ont pas levé leurs sanctions primaires dans le cadre de cet accord, alors que leurs sanctions secondaires sont plus largement suspendues, ce qui est aussi le cas, par ailleurs, de la plupart des sanctions européennes. En conséquence, comme on le voit bien à la lecture du document FAQs (« Frequently Asked Questions ») publié par l’OFAC sur la levée des sanctions américaines, le distinguo principal est entre ce que peuvent désormais faire avec l’Iran les US Persons (toujours pas grand-chose) et les Non-US Persons (dont les droits sont beaucoup plus larges). Il est donc essentiel de savoir ce qu’est une « US Person ».
Le document « FAQs » précité a certes le mérite de donner, dans une note de bas de page, une définition de l’« US Person », du moins du point de vue de l’OFAC (est-il nécessairement celui d’autres institutions ?) : « for the purpose of primary U.S. sanctions administered by OFAC and these FAQs, the term “U.S. person” means any United States citizen, permanent resident alien, entity organized under the laws of the United States or any jurisdiction within the United States (including foreign branches), or any person in the United States ».
L’OFAC ajoute une précision intéressante : « while a U.S. branch of a foreign financial institution would be considered a U.S. person for the purposes of the ITSR [Iranian Transactions and Sanctions Regulations], the foreign financial institution located outside the United States would not ». Les banques étrangères semblent donc explicitement exonérées des sanctions américaines restant en place, à la condition qu’elles ne recourent pas aux services de leurs « branches » américaines pour des transactions avec l’Iran.
Cependant, on peut se demander si cette formulation apporte réellement quelque chose : les banques françaises et européennes sanctionnées pour des transactions en dollars avec des pays sous embargo américain l’ont été non en raison d’une prétention formelle à imposer ces embargos aux banques étrangères, mais du fait du transit d’ordres de paiement par des « U.S. financial institutions » dans le cadre de la compensation des opérations en dollars. Et, de ce point de vue, on l’a dit, le même document de l’OFAC indique clairement que les opérations dites « U Turn » transitant par le système financier américain à des fins de compensation restent prohibées.
Par ailleurs, la définition susmentionnée de l’US Person reste pour le moins vague et potentiellement extensive, puisqu’elle vise non seulement les citoyens américains, les étrangers qui sont résidents permanents aux États-Unis et les « entités » (notamment les sociétés) de droit américain, mais aussi « any jurisdiction within the United States (including foreign branches), or any person in the United States », ce qui couvre potentiellement un champ à l’extension incertaine.
b. Des définitions législatives ou plus vraisemblablement jurisprudentielles ?
Ce qui semble résulter des documents disponibles, mais demande à être vérifié, c’est que les définitions de concepts comme celui de l’US Person et plus généralement la délimitation du champ de compétence juridictionnelle des réglementations américaines qui en découle n’ont guère de base législative (hors le principe très général de compétence territoriale ou personnelle), mais sont tout au plus jurisprudentielles.
Encore, dans le cas susmentionné de l’US Person, ne trouve-t-on cette définition que dans un document administratif, dont la portée juridique est de plus incertaine et ne paraît pas dépasser celle d’une sorte de circulaire.
Du fait du fonctionnement du système américain, qui conduit, comme on y reviendra, les entreprises poursuivies à accepter à peu près systématiquement une transaction sans procès public, on est aussi en droit de se demander si ce type de définitions extensives et contestables de la compétence juridictionnelle américaine est communément confirmé par un juge américain, ou bien est surtout ne création des fonctionnaires de l’OFAC et des attorneys du Department of Justice.
Cette question est importante car il apparaît que les juges américains, notamment ceux de la Cour suprême, lorsqu’ils sont effectivement sollicités sur des questions de principe concernant le champ territorial de la juridiction américaine, sont loin de donner systématiquement raison aux interprétations les plus extensives de celui-ci (voir infra).
c. Quelle accessibilité du droit ?
Problème connexe : compte tenu de la difficulté à identifier les règles de compétence juridictionnelle américaine, à en trouver des définitions dans des textes ayant une portée juridique certaine, il y a là un véritable problème de publicité et d’accessibilité de la règle de droit.
2. Le problème de l’incidence des méthodes de l’administration et de la justice américaines : de l’extraterritorialité d’édiction à celle d’exécution
Les points évoqués supra, notamment le caractère largement jurisprudentiel de certains critères de compétence juridictionnelle invoqués aux États-Unis et le fait qu’ils ne sont que rarement (voire jamais) confirmés par de véritables jugements, renvoient aux problèmes posés par les méthodes du système judiciaire américain.
Cette question est longuement développée dans l’opuscule récent de Me Laurent Cohen-Tanugi (29), lequel considère que « les entreprises ou personnes physiques étrangères légitimement soumises à la compétence législative et juridictionnelle des États-Unis ont souvent tendance à englober dans leur procès de l’"extraterritorialité du droit américain" les mauvaises surprises que leur réservent les spécificités ou la rigueur du droit et du système juridique et judiciaire d’outre-Atlantique ».
a. Des méthodes très intrusives
M. Cohen-Tanugi cite notamment les pratiques très intrusives dans la vie des entreprises qui résultent de la procédure de « discovery » (qui oblige à fournir de très nombreux documents), de l’obligation de coopération immédiate et sans réserve avec la justice, de celle de mettre en place des programmes de conformité (compliance) et de traitement des alertes (whistleblowing), ou encore du « monitoring » obligatoire après des manquements aux lois américaines…
S’agissant de l’obligation de coopérer et de la procédure de discovery, un interlocuteur de la mission a observé qu’elles avaient pour effet de démultiplier les capacités d’enquête des autorités américaines – le travail est fait par les entreprises elles-mêmes ! – et bien sûr de contourner le problème des preuves – les entreprises s’auto-incriminent !
Pour ce qui est des lanceurs d’alerte, la Securities and Exchange Commssion (SEC), homologue de notre Autorité des marchés financiers, a mis en place depuis 2011 un programme de rémunération qui a déjà conduit au versement de plus de 111 millions de dollars au bénéfice de 34 d’entre eux, les intéressés pouvant recevoir 10 % à 30 % des amendes collectées. D’après les indications recueillies par la mission aux États-Unis en juin 2016, ce programme n’avait pas encore été mobilisé dans le cas d’affaires extraterritoriales, notamment de corruption internationale (dans lesquelles la SEC intervient). Cependant, selon des articles de presse, la SEC aurait depuis lors attribué 3,75 millions de dollars à un informateur dans une affaire de violation de la loi FCPA, affaire dans laquelle l’entreprise minière anglo-australienne BHP Billiton a accepté de verser 25 millions de dollars d’amende à la SEC suite aux séjours fastueux qu’elle avait offerts à de nombreux officiels de divers pays lors des Jeux olympiques de Pékin en 2008.
Il n’est pas exclu, par ailleurs, que des informateurs soient rémunérés par d’autres biais, par exemple par les services de renseignement ou de police américains, dans ces affaires internationales. Des personnes auditionnées par la mission se sont déclarées convaincues que cela a été le cas dans certaines affaires récentes, ces informateurs pouvant être les intermédiaires qui, localement, ont mis en œuvre les opérations de corruption. Il faut toutefois noter que, comme en France, le principe de la rémunération des lanceurs d’alerte et plus généralement des informateurs suscite aux États-Unis des interrogations et certaines réticences.
Au cours des auditions de la mission, d’autres éléments d’extraterritorialité américaine « abusive » ont été évoqués qui renvoient moins à un champ extraterritorial des réglementations qu’à des pratiques administratives et judiciaires intrusives développées du fait de la crainte suscitée par la justice américaine : il en est ainsi de la tendance (ancienne puisque le législateur français a voulu s’y opposer dès 1968 – voir la « loi de blocage » présentée infra) à solliciter directement des entreprises étrangères dans des pays étrangers dans le cadre de procédures judiciaires, plutôt que de recourir aux voies interétatiques classiques de coopération judiciaire pour recueillir informations et preuves.
On l’a dit, l’ensemble des services de renseignement américains sont depuis longtemps et très officiellement mobilisés pour l’application des lois extraterritoriales telles que la loi FCPA ou les sanctions économiques.
b. La loi FATCA, exemple d’option pour une méthode de recueil d’informations intrusive et sans limite de territorialité
D’une certaine façon, le Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) de 2010 correspond à une reprise par le législateur américain de cette pratique administrative et judiciaire très unilatérale, cette fois transposée à la lutte contre l’évasion fiscale : pour taxer effectivement les Américains de l’étranger et lutter contre l’évasion fiscale, le Congrès, plutôt que de promouvoir (comme le font l’OCDE et les grands pays européens) la constitution d’un réseau dense d’accords intergouvernementaux d’échange automatique d’informations à objet fiscal, a préféré viser de manière unilatérale et extraterritoriale des acteurs privés étrangers, les banques du monde entier, en les contraignant à livrer les informations nominatives de leurs clients américains, sauf à se voir infliger un prélèvement forfaitaire de 30 % sur tous les flux provenant des États-Unis. Ces derniers se considèrent ainsi en droit d’infliger directement à des acteurs privés, potentiellement dans le monde entier, des sanctions de nature à les priver de fait de tout accès à leur marché.
Cette logique vient, à son tour, d’être adoptée par l’Union européenne.
Après la loi FATCA, les « accords FATCA » passés avec les États-Unis notamment par les pays européens, dont la France en 2013, ont cherché à réintroduire un peu de coopération interétatique, de respect des souverainetés et de réciprocité dans ce dispositif. Mais, l’on y reviendra, s’agissant au moins de la France, ces objectifs n’ont été que partiellement atteints.
c. De multiples administrations et agences américaines impliquées : le partage du butin
Le traitement des dossiers de pénalités financières, soit pour violation de sanctions internationales, soit pour corruption internationale, contre des entreprises implique souvent plusieurs administrations ou autorités américaines. Les règlements transactionnels sont globaux, mais ces différentes autorités se partagent en général les pénalités infligées.
Cette situation contribue probablement à la multiplication des procédures et à l’inflation des montants de pénalités.
● Formellement, plusieurs administrations ou autorités fédérales ont la compétence d’infliger des amendes dites « civiles » (que nous dirions plutôt « administratives ») dans ces dossiers :
– l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) rattaché au Department of the Treasury, en matière de violations des sanctions internationales ;
– certaines autorités de régulation.
La compétence de la Réserve fédérale (la « Fed ») s’exerce ainsi en matière de lutte anti-blanchiment et de violation des sanctions financières internationales sur le fondement des obligations réglementaires de surveillance (screening) des transactions qui sont imposées aux banques.
Celle de la Securities and Exchange Commission (SEC) s’exerce en matière de corruption internationale au motif que les paiements de corruption sont évidemment dissimulés dans les documents comptables : il y a donc une dimension de fraude comptable. Les cadres de la SEC rencontrés par la délégation de la mission à Washington ont mis en avant cette spécificité : la SEC est dans le monde l’une des rares autorités de régulation boursière à avoir une compétence disciplinaire quant à la corruption.
● Les dossiers peuvent aussi être traités au pénal. C’est alors qu’intervient au niveau fédéral le Department of Justice.
● Au niveau fédéral peut s’ajouter le niveau local, notamment l’État de New-York, voir le comté de New-York (New-York a le plus souvent la compétence territoriale sur ces affaires compte tenu des chefs de compétence utilisés, que l’on a vus supra, tels que le recours aux chambres de compensation des opérations en dollars qui y sont localisées).
*
En pratique, dans la plupart des dossiers de corruption internationale, le règlement global implique à la fois le Department of Justice (DoJ) et la SEC : la seconde reçoit une amende civile dite de disgorgement, c’est-à-dire de restitution du montant du profit indu, à laquelle s’ajoute donc l’amende du DoJ, en général plus élevée. Deux autorités américaines se partagent, donc, souvent la somme de l’amende. Il y a toutefois des exceptions et, dans certains dossiers, seul le DoJ est présent : cela a été le cas pour Alstom.
S’agissant des banques punies en raison des embargos financiers internationaux, les cas de figure sont plus divers.
Dans certaines affaires, seul l’OFAC, qui est souvent, en tout état de cause, à l’origine des procédures, est présent dans le règlement final (cas par exemple de Clearstream, qui a versé 152 millions de dollars à l’OFAC en 2014).
Dans d’autres, l’État fédéral est absent. Par exemple, en 2015, Deutsche Bank a accepté de payer 258 millions de dollars qui ont été partagés entre le département des services financiers de l’État de New-York (200 millions) et la Fed (58 millions).
Souvent, un plus grand nombre d’acteurs se partagent la pénalité globale, sachant toutefois que l’OFAC, service de l’État fédéral, renonce à la sienne dès lors que la justice fédérale est partie au règlement. C’est ainsi que :
– les près de 9 milliards de dollars payés en 2014 par BNP-Paribas ont été partagés entre l’État fédéral, la Fed (508 millions), le département des services financiers de l’État de New-York (2,243 milliards) et le bureau du procureur du district de New-York (également 2,243 milliards) ;
– HSBC, en 2012, a versé plus de 1,9 milliard de dollars, répartis entre le DoJ (1,256 milliard), l’Office of the Comptroller of the Currency (500 millions) et la Fed (165 millions) ;
– Commerzbank, en 2015, a versé 1,45 milliard de dollars, répartis entre le DoJ (642 millions), la Fed (200 millions) et le département des services financiers de l’État de New-York (610 millions) ;
– le Crédit agricole, en 2015, a versé 787 millions de dollars répartis entre le bureau du procureur fédéral du district de Columbia (156 millions), le bureau du procureur du district de New-York (156 millions), la Fed (90 millions) et le département des services financiers de l’État de New-York (385 millions).
d. La menace de sanctions très lourdes et imprévisibles qui contraint à transiger et à renoncer à la voie judiciaire
Il existe aux États-Unis plusieurs formules de transactions pénales applicables aux entreprises dans les cas de délinquance économique. Le Non Prosecution Agreement met fin aux poursuites et correspond aux cas les plus bénins. La formule la plus communément utilisée est le Deferred Prosecution Agreement (DPA), ou accord de report des poursuites : celles-ci sont suspendues le temps que l’entreprise exécute les obligations prévues par l’accord, avec donc la menace d’une reprise des procédures en cas de non-respect des engagements ; ce dispositif oblige les entreprises à reconnaître les faits qui leur sont reprochés mais pas leur culpabilité. Enfin, il existe aussi des plaider-coupable à proprement parler (Guilty Plea).
La menace de sanctions administratives (par exemple un retrait de licence bancaire, ou l’exclusion des marchés publics américains qui résulterait d’une condamnation pénale pour corruption), financières, voire pénales et personnelles (peines de prison pour les cadres (30)), extrêmement lourdes et pas toujours prévisibles conduit presque systématiquement les entreprises à accepter ces transactions, bien qu’elles les privent en quelque sorte de l’occasion de faire valoir les éventuels « abus » d’extraterritorialité américaine devant un juge (les transactions comprennent bien sûr des engagements de renoncer à toute autre procédure).
S’agissant des risques pénaux personnels, Mme Leslie Varenne et M. Éric Denécé, dans leur travail précité sur le rachat d’Alstom par General Electric (31), citent notamment l’arrestation en 2013 aux États-Unis et l’emprisonnement préventif, durant un an et demi, de M. Frédéric Pierucci, l’un des dirigeants d’Alstom, qui ont sans doute pesé dans la décision des autres dirigeants de l’entreprise d’accepter un arrangement avec la justice américaine sur l’affaire de corruption concernant l’entreprise, et peut-être aussi joué un rôle dans le choix final d’un rachat par General Electric plutôt que par Siemens…
Dans le secteur bancaire, outre le risque de perte de licence pour les activités aux États-Unis, les coûts d’une éventuelle interdiction de recourir aux chambres de compensation des opérations en dollars situées à New-York sont totalement dissuasifs. Il n’est, en effet, pas possible pour une banque internationale de ne pas accéder aux chambres de compensation américaines.
D’autres représentants d’entreprises auditionnés par la mission ont plus généralement mis en avant le degré d’aléa du système judiciaire américain, la conclusion d’un éventuel procès en cas de refus de transiger étant imprévisible, ce que le dirigeant d’une grande entreprise ne peut pas envisager. Selon les dires de l’un d’entre eux, la formule transactionnelle a été préférée pour cette raison alors même que l’enquête américaine menée contre son entreprise n’avait pas démontré les faits qui lui étaient imputés.
On peut ajouter que la forme de transaction la plus souvent retenue, le DPA (voir supra) présente également l’intérêt de comprendre une reconnaissance des faits, mais pas une reconnaissance formelle de culpabilité (en général, un Statement of Facts annexé à la transaction liste tous les faits répréhensibles et l’entreprise admet simplement sa « responsabilité » pour ceux-ci – le qualificatif utilisé dans les documents étant « responsible », terme de portée générale, plutôt que « liable », qui renvoie à la responsabilité juridique). De la sorte, les entreprises échappent aux sanctions générales frappant les condamnés pour certains faits, par exemple l’exclusion des marchés publics, et sont moins directement exposées à des procédures connexes, notamment civiles.
Il faut enfin noter que le recours aux transactions présente par ailleurs d’évidents avantages pour les autorités de poursuite américaines, en les exonérant de toutes sortes de règles de droit contraignantes (prescription, justification de la compétence territoriale, recours éventuel à la coopération interétatique pour recueillir des éléments à l’international, etc.). Un bon observateur du système a en conséquence estimé devant la mission que les autorités américaines elles-mêmes, conscientes de ces avantages, veillaient à ne pas trop en « abuser » et à toujours proposer des compromis acceptables aux entreprises, sauf dans quelques cas particuliers.
On a donc un système qui ne peut que perdurer tant que les entreprises le considéreront comme répondant à leur « intérêt bien compris », dès lors que de toute évidence il correspond aussi à l’intérêt des autorités américaines.
e. Pourtant, en cas de procès, une justice américaine assez prudente sur l’extraterritorialité
Pourtant, selon Me Cohen-Tanugi dans son essai précité, lorsqu’ils sont (rarement) amenés à se prononcer en l’absence de transaction préalable, les juges américains remettent parfois en cause les conceptions trop extraterritoriales. Citant des décisions récentes, il croit même déceler un « reflux de l’extraterritorialité aux États-Unis ». Un autre juriste auditionné par la mission, tout en relevant cette évolution, a porté un jugement moins affirmatif sur le sens à lui donner, estimant qu’il s’agissait avant tout de faire face à un risque d’engorgement des juridictions américaines.
i. La jurisprudence récente de la Cour suprême
Effectivement, des décisions récentes de la Cour suprême sont très intéressantes à cet égard, même si elles concernent des affaires de responsabilité civile et non pénale et sont sans rapport avec les principaux domaines d’extraterritorialité américaine « agressive » identifiés par la mission.
● En 2010, dans l’affaire Morrison (32), la Cour a été saisie de la question de savoir si la justice américaine était compétente pour examiner les plaintes de ressortissants australiens, actionnaires d’une banque australienne, qui s’estimaient floués suite à la dévalorisation de leurs actions, laquelle était, selon eux, consécutive au rachat par ladite banque d’un établissement américain de prêts hypothécaires dont les comptes auraient été trafiqués : les plaintes visaient aussi bien la banque australienne et ses dirigeants que l’établissement américain et les requérants fondaient leur saisine de la justice américaine en arguant que les faits à l’origine de la dévalorisation de leurs actions (fausses déclarations, dissimulation comptable) étaient survenus aux États-Unis. Cette affaire, où les plaignants australiens ont été déboutés, a été l’occasion pour la Cour suprême de réaffirmer de manière générale un principe de droit américain, la présomption contre l’extraterritorialité (presumption against extraterritoriality), d’où il ressort que, lorsque le Congrès n’a pas donné explicitement une portée extraterritoriale à une loi, celle-ci n’en a pas : l’extraterritorialité ne se présume pas. Cette jurisprudence a mis fin à des jurisprudences antérieures plus fluctuantes dans lesquelles les juridictions américaines s’efforçaient d’évaluer si le Congrès avait ou non eu l’intention de donner une portée extraterritoriale à des législations peu explicites sur ce point… Elle marque donc un recul de l’application extraterritoriale du droit américain.
● Cette position a été ensuite confirmée dans une affaire concernant les droits humains fondamentaux, domaine où la tentation de la « compétence universelle » existe souvent.
En 2013, dans l’affaire Kiobel (33), la Cour suprême a été sollicitée pour savoir si la justice américaine était compétente pour trancher de poursuites civiles engagées en vertu d’une très ancienne (remontant à 1789…) loi américaine oubliée, mais toujours applicable, l’Alien Tort Statute, bien qu’en l’espèce les plaignants ne soient pas américains, non plus que les entreprises poursuivies, les faits en cause étant également survenus hors du territoire américain. Il s’agissait en effet de Nigérians attaquant des compagnies pétrolières de leur pays, mais aussi européennes, pour leur complicité alléguée dans des violations des droits fondamentaux dont ils avaient été victimes de la part de leur gouvernement. Or, l’Alien Tort Statute susmentionné donne juridiction aux tribunaux américains pour « any civil action by an alien for a tort only committed in violation of the law of nations or a treaty of the United States », la formule « law of nations » renvoyant à un concept du XVIIIème siècle, le « droit des gens », donc aux droits de l’homme dans leur généralité. Dans une conception extensive, on pouvait donc en tirer une compétence universelle des tribunaux américains pour réparer les violations des droits de l’homme, au moins celles impliquant des grandes entreprises mondiales forcément présentes sur le sol américain (donc y détenant des actifs saisissables). Mais la Cour suprême a écarté la compétence de la justice américaine en observant que l’Alien Tort Statute invoqué n’avait pas une vocation explicitement extraterritoriale et que devait alors primer la présomption selon laquelle les lois ne sont pas extraterritoriales.
● Dans d’autres affaires récentes, la Cour suprême a, de même, écarté certaines formes d’extraterritorialité en rejetant des interprétations extensives du rattachement territorial des affaires.
En 2015, dans l’affaire Sachs (34), la Cour était confrontée à la question suivante : une Californienne qui avait été victime d’un grave accident corporel ferroviaire à Innsbruck pouvait-elle poursuivre au civil devant un tribunal américain les chemins de fer autrichiens, en arguant seulement, comme critère de rattachement au territoire américain, du fait qu’elle avait acheté le passe ferroviaire utilisé par le biais d’une agence de voyage basée aux États-Unis ? Cassant une décision en appel favorable à la plaignante, la Cour suprême a rejeté la compétence juridictionnelle américaine en rappelant que la compétence territoriale devait être fondée sur le fait principal à l’origine des poursuites, en l’espèce le lieu de l’accident, et non sur un fait secondaire tel que le lieu d’achat du titre de transport.
● En 2014, la Cour avait en quelque sorte combiné les deux jurisprudences susmentionnées en tranchant dans le même sens que la jurisprudence Kiobel une autre requête concernant la compétence des tribunaux américains en matière de violations à l’international des droits fondamentaux – en l’espèce, il s’agissait de la complicité qui aurait été celle de l’entreprise Daimler dans la répression de syndicalistes en Argentine au temps de la dictature militaire. Mais le point de droit litigieux était plutôt celui mis en avant dans l’affaire Sachs, à savoir le degré de rattachement au territoire américain : les requérants pouvaient-ils poursuivre l’entreprise allemande Daimler, pour des faits mettant en cause sa filiale argentine, au motif que Daimler a aussi une filiale sur le territoire américain ? La Cour suprême a considéré que non (35).
ii. Les jugements sanctionnant certains abus de l’application de la loi FCPA
Plus directement dans le champ d’investigation de la mission, on constate que, lorsque des juges américains de première instance sont saisis par des personnes mises en cause au titre de la loi FCPA – si les grandes entreprises acceptent généralement, voire toujours, les transactions proposées, certaines des personnes physiques incriminées préfèrent parfois tenter leur chance devant un tribunal –, ils rejettent parfois les interprétations « extensives » du lien de territorialité mises en avant par le parquet américain et plus généralement les méthodes « activistes » de l’administration américaine pour poursuivre la corruption.
Un exemple en est fourni avec le cas dit Africa Sting : le FBI avait monté une opération de provocation pour piéger des dirigeants de diverses entreprises d’armement en flagrant délit de corruption d’officiels d’un pays africain ; en conséquence, 22 personnes avaient été arrêtées, suscitant en janvier 2010 un communiqué triomphal du Department of Justice. Mais ensuite, seules trois d’entre elles ayant accepté un plaider-coupable, les procès engagés contre les autres ont conduit à des décisions répétitives de relaxe (ou équivalentes) qui ont finalement conduit à un abandon général des poursuites en février 2012 !
Il semble que, dans la plupart des cas, ce soient les méthodes du FBI (emploi d’agents sous couverture, incitation au délit…) qui aient suscité les décisions de justice en faveur des prévenus. Mais, dans un cas au moins, c’est l’insuffisance du lien de territorialité invoqué qui a été mise en avant. L’un des mis en cause était en effet britannique et ne pouvait donc pas être poursuivi en raison de sa nationalité. Dans ces conditions, le lien de territorialité invoqué par le parquet pour justifier la compétence judiciaire américaine tenait au fait que l’intéressé aurait envoyé un courrier, dans lequel il signifiait son accord au pacte de corruption, depuis le Royaume-Uni vers les États-Unis. Mais le tribunal (36) a estimé que cette interprétation du critère de territorialité était injustifiée, car l’acte matériel en cause – avoir posté un document – avait été effectué sur le sol britannique, pas sur le sol américain. La prétention selon laquelle le seul fait de faire transiter un message délictueux par le système postal (matériel ou électronique) des États-Unis (un envoi vers les États-Unis transite évidemment par les États-Unis) suffirait à fonder la compétence juridictionnelle américaine a donc été invalidée en l’espèce.
f. Les autres conséquences du recours aux transactions
i. Les engagements de conformité et de contrôle
L’acceptation plus ou moins systématique de transactions par les entreprises a un autre effet : outre le paiement d’une forte pénalité, ces transactions comprennent systématiquement des engagements de mettre en place (ou de renforcer) des politiques internes de conformité (compliance) et d’accepter un monitoring (ou monitorship - qui peut être traduit par le terme « contrôle »), en accord avec les autorités américaines. Ces engagement sont complétés par des engagements plus généraux de coopération avec les autorités américaines allant jusqu’à l’auto-dénonciation des faits illicites qui seraient ensuite détectés.
Les clauses relatives au contrôle sont relativement standard dans les transactions passées avec les autorités américaines, avec quelques différences concernant notamment sa durée, la possibilité ou non d’avoir un système interne d’auto-surveillance dispensant de nommer un contrôleur externe, ou encore, s’agissant des entreprises françaises, les possibilités de contrôle laissées aux autorités françaises sur ce dispositif.
Quelques exemples de clauses de contrôle
Dans le cadre du DPA signé en 2013 au titre de violations de la loi FCPA, Total a accepté la désignation d’un contrôleur externe pour une durée de trois ans. Ce contrôleur, de nationalité française, devait être nommé par l’administration américaine sur une liste de trois noms proposés par l’entreprise (article 10 du DPA). Ses missions, et notamment les rapports qu’il doit produire périodiquement, étaient précisément décrits (annexe D du DPA). Il était expressément prévu que la transmission de ces documents se fasse par le canal de l’administration française, afin de respecter la loi de blocage de 1968 (voir infra pour le contenu de cette loi). Le contrôleur pouvait accéder à toutes les informations qu’il souhaitait dans la limite de son mandat et sous réserve des restrictions légales (comme le secret professionnel des avocats ou la loi de blocage de 1968, expressément mentionnée), devait dénoncer les éventuels faits ou présomptions de corruption qu’il détecterait et l’entreprise était tenue de mettre en œuvre ses recommandations (en cas de différend, c’est le Department of Justice qui devait trancher).
Le DPA signé en 2010 par Technip comprenait sensiblement les mêmes dispositions, notamment quant à la nomination du contrôleur, également de nationalité française, sa mission étant toutefois plus brève (deux ans). Il n’était également pas prévu de transmission systématique des rapports du contrôleur via l’administration française, le contrôleur étant chargé d’apprécier lui-même quels éléments pouvaient relever de la loi de blocage de 1968 : dans ce cas de figure seulement, leur transmission devait se faire par le biais des autorités françaises suite à une demande d’entraide judiciaire de la part des autorités américaines (annexe D du DPA, paragraphe 7). Technip s’engageait également à mettre en œuvre les recommandations du contrôleur, l’administration française (le Service central de prévention de la corruption) devant être consultée en cas de désaccord entre l’entreprise et le contrôleur.
Le DPA signé par Alstom en 2014 prévoit en son annexe D un dispositif de conformité et de surveillance pour trois ans. Son originalité principale tient au fait qu’il ne prévoit la nomination d’un contrôleur externe qu’à titre supplétif : il établit d’abord un dispositif de self reporting par l’entreprise des éventuels problèmes de corruption qu’elle détecterait, ce reporting se faisant aux autorités américaines, éventuellement par le canal des autorités françaises si l’entreprise estime que les informations en cause pourraient rentrer dans le champ de la loi de blocage de 1968. Le programme de compliance mis en place dans l’entreprise doit être évalué, selon le DPA, par la Banque mondiale et ce n’est qu’en cas de non-conformité aux standards de celle-ci qu’un contrôleur externe devrait être nommé ; or, en février 2015, la Banque mondiale a validé ce programme de compliance, de sorte que la nomination d’un contrôleur externe n’a pas été imposée. Le cas échéant, les modalités de nomination de cet éventuel contrôleur et ses prérogatives seraient similaires à celles figurant dans le DPA signé par Total. Mais donc, pour le moment, Alstom applique une obligation plus légère de self reporting ; un responsable de la conformité a été nommé à cette fin, entouré d’une équipe d’une quinzaine de personnes.
Le DPA signé en 2015 par le Crédit agricole est d’un modèle différent, car il s’agit d’une affaire de violation des sanctions financières américaines et non de la loi FCPA. Il comprend (articles 10 à 12) des engagements d’appliquer un programme de conformité, de dénoncer aux autorités américaines toute entité qui solliciterait la banque pour contrevenir aux sanctions américaines et de produire des rapports trimestriels sur ses actions de compliance.
En général, les représentants des entreprises françaises soumises à un contrôle suite à une transaction avec les autorités américaines, auditionnés par la mission, ont présenté de manière rassurante l’impact de celui-ci sur le secret de leurs affaires et quant à la protection légale des données personnelles (des clients, des salariés…) : les rapports transmis outre-Atlantique ne portent, selon leurs déclarations, que sur la mise en œuvre des programmes de conformité auxquels elles se sont engagées (recrutement de personnels ad hoc, actions de formation et de sensibilisation, mise en place ou réforme des systèmes internes d’alerte, réformes organisationnelles…), mais en aucun cas sur leurs activités opérationnelles et ne comprennent pas non plus de données nominatives ; les éventuels contrôleurs américains n’accèdent pas directement aux dossiers, mais doivent demander à l’entreprise telles ou telles informations.
Il semble exister des différences assez importantes entre les formes de contrôle imposées dans les transactions consécutives à des violations de la loi FCPA, qui comprennent en général une intermédiation de l’administration française pour la transmission des éléments recueillis par le contrôleur, en raison de la loi de blocage de 1968 (voir infra sur le détail de celle-ci), et celles imposées à des banques suite au non-respect des embargos financiers américains, qui ne comportent pas cette garantie et imposent, en outre, des contrôleurs externes en plus grand nombre (car des engagements sont pris envers plusieurs autorités américaines : État fédéral, mais aussi État de New-York, Fed…).
Quoi qu’il en soit, le fait d’imposer le contrôle d’un contrôleur à une entreprise durant plusieurs années pour vérifier qu’elle prend des mesures de remédiation constitue une forme de mesure d’exécution – dans le cadre du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dit « Sapin 2 »), l’équivalent en droit pénal français « classique » est la peine complémentaire de « mise en conformité » qui pourra être infligée aux entreprises condamnées pour des faits de corruption. De fait, le système transactionnel permet d’imposer, en l’incluant dans un accord, une mesure d’exécution extraterritoriale qui, si l’on restait dans le cadre d’une décision unilatérale de la justice américaine, serait contraire au droit international (c’est de l’extraterritorialité d’exécution) et de toute façon inopérante (dépourvue de force exécutoire hors du sol américain).
Par ailleurs, les obligations de contrôle et plus généralement de développement de programmes de conformité représentent des coûts importants pour les entreprises. S’agissant par exemple de BNP-Paribas, de fin 2014 (année de la transaction avec les autorités américaines) à fin 2016, les effectifs affectés aux missions de « conformité » devraient avoir doublé, passant dans le groupe de 1 700 à 3 500 personnes, pour un coût annuel porté de 300 millions d’euros à 600 millions. Certes, cette évolution, selon les responsables de l’entreprise, n’est due qu’en partie à l’accord passé aux États-Unis et répond également au renforcement constant des obligations de gestion des risques et de la conformité que posent les différentes normes nationales et européennes ; elle ne ferait en outre qu’aligner la banque sur les « standards » de ses concurrentes anglo-saxonnes en termes d’effectifs affectés à ce type de missions.
Mais BNP-Paribas doit aussi, plus directement, financer des équipes de plusieurs dizaines des contrôleurs délégués par les différentes institutions américaines suite à la transaction passée, ce pendant cinq ans.
Le représentant d’une entreprise industrielle au périmètre plus modeste, mise en cause pour une affaire de corruption internationale, a indiqué que le contrôle qui lui avait été imposé avait pu représenter un coût d’une dizaine de millions d’euros.
Enfin, plus généralement, la montée en puissance des fonctions juridique, de conformité et de gestion du risque dans les entreprises, fonctions qui ont généralement été (re)centralisées afin que les responsables locaux ne puissent pas s’en affranchir, a nécessairement un impact sur leur fonctionnement global, que ce soit pour le mieux (évitement de risques financiers et de réputation très lourds) ou le pire (renonciation à des affaires parfaitement légitimes, retrait de marchés prometteurs…).
D’autres, au contraire, profitent du développement de la pratique de la conformité dans les entreprises, à l’instar des cabinets d’avocat qui sont fortement sollicités par ces entreprises.
ii. Les engagements de non-recours et de silence
Enfin, dans le cadre de ces transactions, les entreprises prennent non seulement des engagements de renoncer à contester juridiquement celles-ci – ce qui est normal, ce type de clauses étant inhérent à toute transaction –, mais aussi à s’interdire toute expression publique contestant la procédure qui leur a été infligée. À cette fin, les accords de plaider-coupable comportent des clauses type qui mettent sous tutelle du Department of Justice toute expression publique concernant les affaires en cause ! C’est ainsi que les Plea Agreements ou Deferred Prosecution Agreements signés par des entreprises telles que le Crédit agricole, Alcatel, Alstom, Technip ou Total comprennent tous :
– une reconnaissance par les entreprises qu’elles ne sont pas autorisées à faire de déclarations publiques venant en contradiction avec leur acceptation de responsabilité dans les faits qui leur ont été reprochés ;
– un dispositif imposant une « consultation » avec le Department of Justice avant tout communiqué de presse ou conférence de presse qui aurait un rapport (serait « in connection ») avec la transaction passée, obligation valant aussi pour les filiales et entités dépendantes, bref un système de censure préalable.
Par ailleurs, la passation de ce type de transactions n’empêche pas d’autres poursuites, soit pour d’autres faits à l’initiative des administrations américaines, soit civiles. Par exemple, BNP Paribas est désormais poursuivie en justice par des victimes des attentats de 1998 contre les ambassades américaines à Nairobi et Dar es Salaam, qui réclament 2,4 milliards de dollars de dommages et intérêts, en raison de son implication supposée dans le soutien au gouvernement soudanais (la plus grande part des transactions financières qui ont motivé l’amende américaine contre la banque ayant été faites avec le Soudan).
D. L’APPLICATION EXTRATERRITORIALE DES LOIS AMÉRICAINES EN CAUSE EST-ELLE CONTRAIRE AU DROIT INTERNATIONAL ?
Il y a un débat sur la conformité au droit international de tout ou partie des législations extraterritoriales américaines. Il doit être abordé avec prudence, d’une part car la jurisprudence des juridictions internationales n’interdit pas, par principe, toute extraterritorialité, d’autre part compte tenu du développement de législations extraterritoriales par bien d’autres pays ou entités que les États-Unis.
1. L’extraterritorialité d’édiction n’est pas en soi contraire au droit international
Il ne faut pas confondre la compétence d’exécution des États (consistant à faire appliquer le droit, par la contrainte s’il faut), qui est strictement territoriale, et leur compétence d’édiction de normes.
Cette dernière ne peut pas être considérée comme en elle-même contraire au droit international, depuis une décision fondatrice de la Cour permanente de justice internationale (CPJI) dans l’affaire dite du Lotus, jugée le 7 septembre 1927.
Le Lotus était un navire français qui avait accidentellement abordé un navire turc en haute mer, provoquant son naufrage et le décès de plusieurs marins de nationalité turque. Le Lotus ayant ensuite fait relâche en Turquie, l’un de ses officiers (français) avait été poursuivi pénalement par la justice turque pour homicide involontaire. La justice turque fondait sa compétence sur la nationalité des victimes. Le gouvernement français, s’inscrivant dans une conception stricte de la compétence territoriale, a dénoncé ces poursuites en soutenant que la Turquie ne pouvait pas poursuivre pénalement des faits survenus hors de son territoire (en haute mer) et alors que le prévenu ne se trouvait pas sur un navire battant pavillon turc.
Dans sa décision, la CPJI a donné raison à la Turquie en tranchant en sa faveur une question de droit centrale : pour revendiquer une compétence judiciaire extraterritoriale, un État doit-il se fonder sur un titre de compétence que le droit international lui reconnaîtrait ? Ou bien suffit-il que cette revendication ne soit pas contraire au droit international ? La CPJI a choisi la seconde option, en invoquant le principe de souveraineté étatique : « le droit international régit les rapports entre des États indépendants. Les règles de droit liant les États procèdent donc de la volonté de ceux-ci (…). Les limitations de l’indépendance des États ne se présument donc pas (…). Dans ces conditions, tout ce qu’on peut demander à un État, c’est de ne pas dépasser les limites que le droit international trace à sa compétence ; en deçà de ces limites, le titre à la juridiction qu’il exerce se trouve dans sa souveraineté ».
Dans l’affaire du Lotus, il a donc été jugé :
– d’une part que le principe de souveraineté permet aux États d’édicter des normes éventuellement extraterritoriales, sous réserve de ne pas entrer en contradiction avec une règle positive du droit international (c’est l’application aux États, au nom de la souveraineté, du principe, fondé sur la liberté s’agissant des individus, selon lequel tout ce qui n’est pas interdit est permis) ;
– d’autre part, qu’en l’espèce, aucune règle du droit international n’interdit une compétence juridictionnelle pénale extraterritoriale fondée sur la nationalité (des victimes). Le principe de compétence dite « personnelle » était ainsi validé.
La doctrine dominante en France considère en outre que, si les États ont donc une faculté d’édiction de normes éventuellement extraterritoriales, ils doivent pourtant être en mesure de fonder leurs prétentions extraterritoriales sur un facteur de rattachement suffisant.
La contrariété au droit international de législations extraterritoriales ne va donc pas de soi ; elle ne peut être appréciée qu’au cas par cas et il faut pouvoir invoquer des règles positives contraires (principes du droit international ou, mieux, engagements conventionnels) ou l’absence de facteur de rattachement suffisant.
2. D’autres pays ou entités adoptent des législations ou des jurisprudences extraterritoriales
Par ailleurs, de nombreux pays, voire des organisations régionales comme l’Union européenne, disposent de législations à portée potentiellement extraterritoriale, qu’ils s’efforcent inégalement d’appliquer. La tendance est clairement à la « banalisation » de l’extraterritorialité, ce qui conduit à nuancer le jugement porté sur les pratiques américaines.
i. Les règlements européens de sanctions économiques : un champ bien délimité mais potentiellement extraterritorial
L’Union européenne est à l’origine de l’essentiel des régimes d’embargos et sanctions économiques appliqués par la France et les autres États membres.
De manière générale, ces mesures restrictives de l’Union européenne s’appliquent :
« – sur le territoire de l’UE, y compris son espace aérien ;
« – aux ressortissants de l’UE, qu’ils se trouvent ou non dans l’UE ;
« – aux entreprises et organisations établies selon la législation d’un État membre, qu’elles soient installées ou non dans l’UE. Les filiales d’entreprises de l’UE dans les pays tiers sont aussi concernées ;
« – aux transactions commerciales réalisées en tout ou en partie au sein de l’Union européenne ;
« – à bord des aéronefs ou navires relevant de la juridiction d’un État membre » (37).
On voit qu’en matière de sanctions internationales, comme les États-Unis, l’Union européenne mêle des critères de nationalité des personnes et des entreprises à des critères strictement territoriaux de compétence.
ii. Des jurisprudences parfois peu exigeantes quant au lien nécessaire pour imposer une règle européenne hors du territoire communautaire
Par ailleurs, la conception du lien de rattachement au territoire européen développée par les juridictions européennes est parfois assez extensive.
On cite le plus souvent le cas du droit de la concurrence, où les autorités de l’Union (comme celles des autres pays, d’ailleurs) se sont octroyé le droit de contrôler des fusions entre des entreprises non-européennes en raison de leurs effets sur le marché européen, donc les consommateurs européens.
Mais un autre exemple manifeste d’application extraterritoriale du droit européen est donné par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne de 2014 qui impose le « droit à l’oubli » numérique au moteur de recherche américain Google (38). Dans cette affaire, un citoyen espagnol se plaignait de ce que les recherches internet effectuées sur son nom mettent en lumière une affaire passée qui donnait une mauvaise image de lui. Or, la directive européenne sur la protection des données comprend un droit d’obtenir l’effacement de données personnelles (péjoratives) sur les moteurs de recherche. Le problème était que l’entreprise Google n’est présente directement en Espagne qu’à travers un établissement, Google Spain, chargé d’y commercialiser des espaces publicitaires, tandis que le moteur de recherche lui-même, en cause dans l’apparition des données contestées, est géré par Google Inc., implantée en Californie, hors du territoire européen. Mais la Cour a jugé que la directive était applicable à Google Inc., au motif que les activités du moteur de recherche sont indissociables de celles de vente d’espaces publicitaires, assurées notamment par Google Spain, car elles en assurent la rentabilisation : « les activités de l’exploitant du moteur de recherche et celles de son établissement situé dans l’État membre concerné sont indissociablement liées dès lors que les activités relatives aux espaces publicitaires constituent le moyen pour rendre le moteur de recherche en cause économiquement rentable ».
On peut voir dans cet arrêt une application de la « théorie des effets » dans le contexte déterritorialisé créé par internet : le moteur de recherche Google est installé aux États-Unis, mais les données qu’il met en lumière sont accessibles sur le territoire européen et y ont donc des effets de réputation sur les personnes concernées. La CJUE n’a pas explicitement invoqué cette théorie, préférant argumenter sur un lien de rattachement « indissociable ».
La tendance à l’application extraterritoriale du droit européen est d’ailleurs contestée par certains États membres. Le Royaume-Uni a plusieurs fois soutenu que certains éléments des réglementations financières de l’Union constituaient une forme illicite d’extraterritorialité. Il a ainsi demandé l’annulation de l’article 92 de la directive 2013/36, en ce qu’elle rendait la politique de rémunération (sur les bonus) de l’Union applicable aux filiales de sociétés européennes dans des centres extraterritoriaux. L’avocat général avait conclu qu’aucun principe de droit coutumier ne s’opposait à ce que l’Union adopte une telle réglementation et le Royaume-Uni a retiré ce recours avant que la Cour ne rende son arrêt. Ce pays a de même demandé l’annulation de la décision du Conseil autorisant le lancement d’une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières, au motif que cette taxe s’appliquerait à des personnes n’ayant pas de lien suffisant avec les États l’appliquant : ce recours a été rejeté sans que la CJUE ne réponde à l’argument sur le fond, car elle l’a jugée inopérant (39) (les principes d’imposition contestés par le Royaume-Uni n’étaient pas des éléments constitutifs de la décision attaquée).
b. La multiplication des législations anti-corruption à portée plus ou moins extraterritoriale
Du fait notamment des conventions internationales en la matière (de l’OCDE en 1997 et de l’ONU en 2003), qui demandent aux États signataires d’adopter des législations contre la corruption internationale, un certain nombre de pays disposent désormais de législations à portée plus ou moins extraterritoriale en la matière et les appliquent.
● L’UK Bribery Act (UKBA) britannique de 2010 est l’une des plus connues. Elle a une portée ouvertement extraterritoriale en visant non seulement les faits de corruption commis à l’étranger, mais aussi en ayant une définition large du champ des corrupteurs qui peuvent être poursuivis par la justice britannique : ce champ couvre toute entité qui « fait des affaires », même si ce n’est qu’une partie de celles-ci, au Royaume-Uni (« carries on a business, or part of a business, in any part of the United Kingdom »).
Le 30 novembre 2015, la justice britannique a réalisé deux « premières » en concluant son premier Deferred Prosecution Agreement (reprenant l’appellation américaine) pour des faits de corruption et en prononçant à cette occasion la première sanction pour défaut de prévention de la corruption (défaillance de la compliance). La banque ICBC Standard Bank, sud-africaine mais très présente en Grande-Bretagne, a accepté de verser 32,6 millions de dollars pour une affaire de corruption survenue en Tanzanie et impliquant sa « banque sœur » Stanbic Bank Tanzania. Il s’agit donc d’une application fortement extraterritoriale de la loi britannique.
● En France, le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, tel que voté par l’Assemblée nationale en juin 2016, a une portée extraterritoriale certaine, bien que délimitée.
S’agissant des dispositifs de « conformité », son article 8 institue une obligation de mettre en place dans les entreprises un dispositif de prévention de la corruption. Cette obligation vise les sociétés et groupes de plus de 500 salariés et 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. Le texte spécifie qu’il s’agit de « prévenir et détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence ». Il dispose également que, lorsque la société établit des comptes consolidés, les nouvelles obligations concerneront aussi l’ensemble de ses filiales (contrôlées majoritairement), donc semble-t-il tout le périmètre mondial des groupes français.
Le texte vise les sociétés sans préciser leur nationalité. Il faut donc sans doute, pour identifier celles auxquelles il s’applique, se référer à la règle générale posée par l’article L. 210-3 du code du commerce : « les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française ». Les filiales de groupes étrangers seraient donc concernées dès lors que le siège de ces filiales est en France.
Le volet pénal du projet a une ambition « extraterritoriale » plus marquée : tandis que l’article 9 met en place une peine dite de mise en conformité à titre de peine complémentaire pour les sociétés condamnées pour corruption ou trafic d’influence (variante française du monitoring), l’article 11 étend l’infraction de trafic d’influence au cas où les faits impliqueraient un agent public étranger.
Surtout, l’article 12 vise à lever les entraves à la compétence des autorités de poursuite françaises en matière de corruption et de trafic d’influence pour les faits commis à l’étranger (voir infra). À cet effet, lorsque ces infractions sont « commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français », il supprime les conditions restrictives de droit commun (pour l’exercice de poursuites concernant des délits commis à l’étranger par des Français) de :
– double incrimination ;
– monopole du parquet sur plainte préalable de la victime ou sur dénonciation officielle des autorités étrangères ;
– constatation préalable de l’infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère en cas de poursuite des complices en France.
Toutefois, suite à des amendements de la présente mission parlementaire, la loi française pourrait permettre l’éventuelle poursuite, devant la justice française, d’entreprises étrangères pour des faits de corruption commis à l’étranger dès lors que l’entreprise corruptrice a une quelconque activité économique en France.
● Il est par ailleurs à noter que l’adoption de législations anti-corruption à portée extraterritoriale concerne maintenant aussi des pays émergents :
– en Chine, la compétence des juridictions chinoises pour les faits de corruption d’agents publics étrangers commis à l’étranger a été étendue en 2011 : elle couvre désormais non seulement les entreprises chinoises, mais également les opérateurs économiques organisés en co-entreprise (joint-venture) avec des entreprises chinoises, ainsi que les entreprises étrangères ayant une représentation sur le territoire chinois ;
– en Russie, le gouvernement a soumis en 2015 à la Douma un projet de loi sur la reconnaissance de la responsabilité des personnes morales pour corruption qui prévoit que la responsabilité des personnes morales étrangères pourra être engagée pour faits de corruption commis hors de Russie à partir du moment où les faits portent atteinte aux « intérêts de la Russie ».
Comme l’a observé l’un des experts auditionnés par la mission, on doit probablement s’attendre, dans le contexte de la montée en puissance des pays émergents, à une multiplication des législations nationales à portée éventuellement extraterritoriales (pas seulement d’ailleurs dans le domaine de l’anti-corruption). Jusqu’à présent, la principale puissance émergente, la Chine, a surtout une posture défensive très efficace contre les intrusions extraterritoriales venant notamment des États-Unis (concrètement le pays s’oppose à toutes transmissions de documents aux autorités américaines et, dans un cas concret au moins, les autorités américaines ont dû en conséquence abandonner une procédure) ; mais, à terme, selon cet expert, il est vraisemblable que l’on sera confronté à une extraterritorialité chinoise plus « offensive ». Cette évolution pourrait aussi concerner d’autres grands pays émergents comme l’Inde ou le Brésil. La perspective suscite quelques inquiétudes dans la mesure où, aujourd’hui du moins, le fonctionnement des juridictions dans certains pays émergents n’offre pas toutes les garanties d’impartialité.
3. Le débat sur la conformité au droit international des législations américaines en cause
a. Le passé : l’exemple topique de la loi Helms-Burton
Dans le passé, des lois américaines extraterritoriales ont certainement posé de réels « problèmes » par rapport au droit international.
Il en est ainsi de la loi Helms-Burton concernant Cuba en 1996 (Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act), qui allait très loin dans l’ingérence dans les affaires intérieures de l’île (il était par exemple indiqué que le futur gouvernement cubain voulu par le législateur américain devrait exclure les frères Fidel et Raul Castro…) et prétendait sanctionner (par des poursuites civiles aux États-Unis et l’interdiction d’entrer sur leur territoire) les personnes et entreprises de toute nationalité « trafiquant » (achetant, louant, prenant en gestion…) des biens confisqués par le gouvernement cubain à des citoyens américains (y compris les exilés cubains devenus ensuite américains).
Une ingérence aussi expresse dans le gouvernement d’un pays étranger et l’imposition de sanctions à des personnes dont le seul « rattachement » aux États-Unis consistait dans l’acquisition d’un bien ayant appartenu à un Américain, personnes qui en outre n’étaient en rien responsables des faits en cause (les nationalisations du gouvernement cubain), allaient vraisemblablement – c’est du moins ce qui a été communément soutenu alors – à l’encontre de principes du droit international. Par ailleurs, des engagements conventionnels des États-Unis étaient sans doute violés, notamment ceux du GATT-OMC, qui obligent à justifier les mesures commerciales restrictives (comme un embargo) soit par des raisons légitimes de défense commerciale (lutte contre le dumping par exemple, ou clause de sauvegarde économique générale), soit par des intérêts essentiels de sécurité : si les États-Unis pouvaient invoquer de tels intérêts à l’encontre de Cuba au moment de la « crise des fusées », ils ne paraissaient plus guère crédibles à le faire trente ans plus tard, après la chute de l’URSS…
Mais, à partir du moment où l’extraterritorialité n’est pas en soi contraire au droit international, peut-on contester dans les mêmes termes les législations américaines « extraterritoriales » qui posent aujourd’hui problème ? C’est moins évident, du moins en ce qui concerne la corruption et les questions fiscales.
b. Les lois FCPA et FATCA : des textes confortés par leur inscription dans une démarche internationale partagée
S’agissant de la loi FCPA, les États-Unis peuvent en effet s’appuyer sur un texte international, la convention de l’OCDE « sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales » du 17 décembre 1997. Ce texte postérieur à la loi susmentionnée a au demeurant été suscité par l’administration américaine, laquelle souhaitait, sous la pression de ses entreprises, « égaliser » les conditions de concurrence entre les acteurs économiques des différents pays ; sa rédaction s’inspire largement de cette loi. Il inspire à son tour, on l’a dit, diverses législations nationales plus ou moins extraterritoriales.
En effet, la convention de 1997 engage l’ensemble des pays développés, dont la France. Son article 4 dispose que « chaque partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de la corruption d’un agent public étranger lorsque l’infraction est commise en tout ou partie sur son territoire ». La formule « tout ou partie sur son territoire » semble justifier, voire imposer, une conception extensive de la compétence territoriale des États, d’autant qu’elle est complétée par un « commentaire » (40) selon lequel « la compétence territoriale devrait être interprétée largement, de façon qu’un large rattachement matériel à l’acte de corruption ne soit pas exigé ».
Il faut toutefois observer, dans le cas de la loi FCPA, que cette loi, en sanctionnant des entreprises étrangères sur la seule base de leur qualité d’« émettrices » sur les marchés financiers américains, conduit potentiellement à des cas de figure où aucun élément de l’infraction (l’acte de corruption) n’est rattaché au territoire américain ou à des personnes ou entreprises américaines. La loi FCPA dépasse donc les termes de la convention OCDE et, même si elle n’est pas contraire au droit international pour cette raison, elle ne peut « justifier » son extraterritorialité par cette convention. Il semble d’ailleurs qu’aucune autre législation d’application de la convention OCDE ne prévoie le même critère extraterritorial de compétence.
Il est également à noter que le même article 4 de la convention de 1997 dispose que « lorsque plusieurs parties ont compétence à l’égard d’une infraction présumée visée dans la présente convention, les parties concernées se concertent, à la demande de l’une d’entre elles, afin de décider quelle est celle qui est la mieux à même d’exercer les poursuites ». Le texte de l’OCDE appelle donc explicitement à une coopération interétatique dans la répression de la corruption plutôt qu’aux approches unilatérales et peu respectueuses des souverainetés.
De manière plus générale et plus politique que strictement juridique, l’existence de cet engagement conventionnel international rend plus difficile de contester des législations nationales à application large que dans le cas, par exemple, des embargos américains, qui ont une base strictement nationale.
Le même type d’arguments peuvent être avancés s’agissant de la loi FATCA et des accords passés pour son application, qui s’inscrivent également dans une démarche commune portée par l’OCDE de lutte contre la fraude fiscale internationale – même si la loi FATCA, en prétendant dépasser les cadres habituels de coopération interétatique, va bien au-delà de cette démarche commune.
c. Des mesures de sanctions et d’embargo en contrariété avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce ?
Le professeur Régis Bismuth (41) relève que, dans le cas des mesures restrictives unilatérales des États-Unis et de leur prétention à pénaliser des banques européennes sur la base de compensation d’opérations en dollars, « à l’inverse de la convention OCDE en matière de corruption, le droit international conventionnel n’offre aucun support sérieux à l’existence d’une règle permissive permettant de justifier une extension de la compétence de l’État émetteur de la devise ».
Il observe a contrario que ces dispositifs de sanctions américains, au moins dans leur prétention à bloquer tout ou l’essentiel des transactions en dollars avec les pays et entités visées, contreviennent probablement à plusieurs engagements américains pris dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et des accords qui l’ont précédé, comme le GATT.
En effet, selon l’article XI de l’Accord général sur le commerce des services de 1994 (AGCS ou GATS selon l’acronyme anglophone), « sauf dans les cas envisagés à l’article XII [de l’accord, sans rapport avec les sanctions, car consacré aux restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements], un membre n’appliquera pas de restrictions aux transferts et paiements internationaux concernant les transactions courantes ayant un rapport avec ses engagements spécifiques » : les restrictions aux paiements internationaux sont donc interdites par l’AGCS, sauf si elles sont justifiées par des mesures de sauvegarde en cas de crise financière, ce qui n’est pas l’objet des sanctions américaines.
S’agissant par ailleurs des sanctions secondaires prenant la forme d’une exclusion des marchés publics américains pour les entreprises qui feraient des transactions avec des pays ou entités sous sanctions, l’auteur relève de même leur contrariété avec l’article VIII de l’Accord sur les marchés publics (AMP) de 1994, selon lequel « une entité contractante limitera les conditions de participation à un marché à celles qui sont indispensables pour s’assurer qu'un fournisseur a les capacités juridiques et financières et les compétences commerciales et techniques pour se charger du marché en question » (ce qui exclut des restrictions d’accès autres, telles que celles prévues par les sanctions).
Enfin, s’agissant de l’exception de sécurité nationale – admise dans la doctrine comme justifiant des législations extraterritoriales et prévue dans les différents accords de l’OMC – l’auteur considère qu’« il serait difficilement envisageable pour les États-Unis de justifier [leurs sanctions] sur les exceptions de sécurité qui existent dans les accords de l’OMC (…) car les sanctions adoptées ne l’ont pas été sur le fondement de la Charte de l’ONU de même qu’il est plus qu’improbable d’établir un lien entre les activités prohibées (commercer avec Cuba, l’Iran, etc.) et une menace directe sur la sécurité nationale américaine ». Cela dit, dans le cas de l’Iran, cette analyse pourrait être discutée, car il existe des sanctions onusiennes et l’implication d’institutions de ce pays dans le soutien à certains groupes communément considérés comme terroristes et son programme nucléaire sont une réalité…
Toujours est-il que le professeur Bismuth conclut, en conséquence de ces observations, que « le mécanisme de règlement des différends de l’OMC constitue donc une option offrant des chances raisonnables de succès afin de contester les mesures extraterritoriales américaines dans le domaine des sanctions économiques unilatérales ».
Par ailleurs, au moment de la pénalité imposée à BNP Paribas, certains articles de presse ont invoqué les obligations de « traitement équitable » et de « traitement national » prévues réciproquement pour les entreprises de l’autre pays par la convention d’établissement franco-américaine du 25 novembre 1959. Les litiges quant à l’application de cette convention peuvent être portés devant la Cour internationale de justice. Mais l’ampleur exceptionnelle de la pénalité payée par BNP Paribas ne suffit pas à démontrer que la banque aurait été l’objet d’un traitement inéquitable. Il faudrait soit pouvoir sérieusement alléguer qu’une banque américaine (au moins) dans la même situation s’en est tirée à meilleur compte, soit développer une argumentation solide sur le caractère intrinsèquement disproportionné, donc inéquitable, d’une telle pénalité.
Une autre voie de contestation juridique de l’application de certaines réglementations américaines, en particulier celles relatives aux sanctions économiques, pourrait être la mise en cause, du fait de leur excessive complexité et de leur caractère en partie jurisprudentiel, de leur défaut de publicité, clarté et prévisibilité. S’agissant par exemple de l’Iran, 27 ordres exécutifs ont été signés par les présidents des États-Unis depuis 1979.
Mais on doit aussi remarquer, si l’on prend par exemple le Statement of Facts signé par BNP Paribas avec le Department of Justice, le soin mis par l’administration américaine à établir que la banque était parfaitement consciente du caractère illicite (par rapport au droit américain) de ce qu’elle faisait (en citant diverses réunions internes où la question avait été évoquée et des consultations demandées à des juristes). Dans la situation présente, la volonté nouvelle des administrations américaines de diffuser des documents clairs et pédagogiques sur les conditions de la levée partielle des sanctions contre l’Iran après l’accord sur le nucléaire doit certes être saluée, mais elle aura aussi pour effet de limiter les possibilités de contestation sur le fondement du manque de publicité et de clarté des règles américaines.
IV. UNE SITUATION POLITIQUE ET JURIDIQUE EN FRANCE ET EN EUROPE NE POSANT PAS DE LIMITES À L’EXTRATERRITORIALITE DES LOIS AMERICAINES
Les politiques et les instruments juridiques existants ne sont pas suffisants pour faire obstacle à l’extraterritorialité du droit américain.
A. L’ABSENCE DE POLITIQUE « CONVAINCANTE » DE RÉPRESSION DE LA CORRUPTION INTERNATIONALE POUVANT LIMITER L’INTRUSION EXTRATERRITORIALE AMÉRICAINE
L’introduction en droit français d’une transaction pénale, sur le modèle de la Deferred Prosecution Agreement pourrait être un moyen de répondre aux critiques des administrations américaines sur les questions de corruption, en s’inspirant de leur « modèle » afin d’arriver à une sorte de modus vivendi où chacun se réserverait le droit de poursuivre « ses » entreprises indélicates et où une sorte de principe « non bis in idem » (selon lequel nul ne devrait être jugé deux fois pour les mêmes faits) serait appliqué : les entreprises françaises poursuivies en France échapperaient pour cette raison à des poursuites américaines sur la base de la loi FCPA.
Ce rééquilibrage juridique rendrait inopérant l’argument américain selon lequel les États-Unis doivent être « le shérif mondial » puisque les autres n’assument pas leurs rôles.
1. Une possible limitation de l’intrusion américaine par le « partage » coopératif et l’application du principe non bis in idem
Cet espoir de parvenir à un modus vivendi acceptable est fondé sur quelques expériences récentes concernant des pays étrangers, qu’il convient toutefois d’aborder avec prudence : les autorités américaines sont prêtes à la coopération internationale si leurs interlocuteurs répriment efficacement et sévèrement la corruption. Mais il s’agit plutôt d’une coopération au cas par cas, pas d’une renonciation par principe à poursuivre quand une autre juridiction l’a fait.
a. La convention OCDE de 1997 : un appel explicite au « partage » coopératif des procédures entre juridictions
Il convient d’abord de rappeler que l’article 4 précité de la convention OCDE anti-corruption de 1997 invite à la coopération interétatique et à la mise en œuvre pragmatique et concertée de la règle non bis in idem, en disposant que « lorsque plusieurs parties ont compétence à l’égard d’une infraction présumée visée dans la présente convention, les parties concernées se concertent, à la demande de l’une d’entre elles, afin de décider quelle est celle qui est la mieux à même d’exercer les poursuites ». Ce droit reconnu par la convention OCDE, à ses parties, de demander une concertation en cas de concurrence de juridiction est en fait un argument que pourraient utiliser les gouvernements européens pour combattre l’unilatéralisme de l’application de la loi FCPA en exigeant, au cas par cas, une concertation avec les autorités américaines en cas de poursuites contre leurs entreprises.
b. La jurisprudence française : vers une reconnaissance élargie du principe non bis in idem dans le cas de procédures étrangères
Avant de présenter les pratiques américaines, un point doit également être fait sur le droit national et le droit européen, qui tendent à une reconnaissance croissante du principe non bis in idem en cas de concurrence de procédures dans différents pays.
• Le droit européen
Le droit européen est assez clair quant à l’application du principe non bis in idem entre juridictions des États membres :
– l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 dispose qu’« une personne qui a été définitivement jugée par une partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre partie contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la partie contractante de condamnation » ;
– l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a généralisé ce principe au-delà des pays « Schengen » : « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi ».
Dans un arrêt de 2003 (42), la Cour de justice des communautés européennes a considéré que le principe non bis in idem entre des procédures de plusieurs États membres, tel que prévu par l’article 54 précité de la convention d’application de l’accord de Schengen, valait aussi si l’une des procédures en cause prenait la forme d’une transaction pénale (43).
• Le droit français : un droit positif assez restrictif, mais une jurisprudence évolutive
Le droit pénal positif français n’admet l’application du principe non bis in idem dans le cas de procédures étrangères que de manière assez restrictive : les articles 113-9 du code pénal et 692 du code de procédure pénale disposent dans les mêmes termes que, pour les infractions commises hors du territoire français (mais pour lesquelles la nationalité française de l’auteur ou de la victime pourrait justifier une compétence de la justice française), « aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite ». On a donc la double exigence d’un jugement définitif et d’une peine exécutée pour que les juridictions françaises mettent en œuvre le principe non bis in idem. En outre, celui-ci est en tout état de cause écarté lorsque les faits illicites ont été commis en tout ou partie sur le territoire national, en vertu de l’article 113-2 du code pénal (« la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République »), dont la jurisprudence a confirmé la portée (44).
Au regard de ces éléments et en se plaçant dans le cas de figure qui nous intéresse, la prise en compte d’éventuelles procédures transactionnelles (américaines ou non…) préalables par le juge français ne va pas de soi : une transaction ne constitue pas formellement une condamnation, d’autant qu’elle a souvent pour objet d’éteindre l’action publique en proposant une option alternative ne comportant par exemple pas de reconnaissance de culpabilité.
Cependant, des décisions de justice récentes, se fondant sur des engagements internationaux de la France et non sur la législation précitée, sont venues élargir le champ d’application du principe non bis in idem en accordant l’autorité de la chose jugée à des transactions pénales américaines, lesquelles se trouvaient justement avoir été passées pour des faits de corruption réprimés par la loi FCPA.
● L’une de ces décisions concerne des personnes morales (entreprises). Le 18 juin 2015, le tribunal correctionnel de Paris a rendu un jugement (45) qui s’inscrit dans les rebondissements judiciaires de l’affaire « pétrole contre nourriture » en Irak. Il concerne plusieurs sociétés (46) françaises ou américaines mises en cause dans cette affaire et qui avaient antérieurement (en 2007 ou 2008) passé au même titre des transactions avec la justice américaine, versant dans ce cadre des pénalités allant selon les cas de 3,5 millions de dollars à près de 13 millions.
Outre qu’il assimile les transactions américaines en cause à des condamnations pénales, ce jugement applique le principe non bis in idem nonobstant la compétence territoriale de la justice française (certains paiements indus ayant eu lieu sur le territoire national), laquelle aurait permis de l’écarter par principe.
Le tribunal, pour justifier cette position innovante par rapport au droit positif national, s’appuie sur des textes internationaux (ayant une valeur supra-législative en vertu de l’article 55 de la Constitution), en particulier l’article 14-7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, selon lequel « nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays ». Il mentionne également d’autres instruments internationaux, notamment l’article 4 précité de la convention OCDE anti-corruption de 1997 qui appelle à une concertation interétatique pour éviter les procédures concurrentes en la matière.
Le tribunal subordonne cependant l’application ou non du principe non bis in idem à plusieurs conditions cumulatives (réunies selon lui dans le cas d’espèce) :
– les faits objets de la transaction pénale prise en compte doivent être identiques ou intrinsèquement similaires à ceux poursuivis devant la juridiction française ;
– la procédure prise en compte à l’étranger doit être « impartiale, indépendante, diligente » et n’avoir pas eu pour objet de soustraire la société en cause à sa responsabilité pénale ;
– les peines doivent avoir été exécutées ;
– les faits en cause ne doivent pas constituer des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.
● En juin 2014, le même tribunal correctionnel avait rendu un jugement similaire concernant une personne physique, un avocat londonien impliqué dans une lourde affaire de corruption au Nigéria, celle-là même qui a par ailleurs valu à Technip de devoir passer une coûteuse transaction avec la justice américaine. Alors que des cadres de Technip avaient été condamnés, à titre personnel, pour ces faits par le même tribunal, ce dernier a constaté l’extinction des poursuites à l’encontre du justiciable précité, car il avait auparavant purgé 21 mois de prison et versé plus de 148 millions de dollars (!) dans le cadre d’une transaction pénale au Texas. La cour d’appel de Paris a confirmé le 21 septembre 2016 cette extinction des poursuites en raison du principe non bis in idem.
Il reste à savoir si la jurisprudence confirmera ces jugements encore peu nombreux.
c. La position américaine : aucune garantie que des poursuites parallèles ne soient engagées
La position des autorités américaines semble nettement plus réticente quant à une acceptation générale, au nom du principe non bis in idem, de l’autorité de la chose jugée de procédures menées à l’étranger. Elles l’admettent parfois, mais privilégient apparemment la solution intermédiaire des poursuites coordonnées avec des autorités étrangères.
Quelques affaires traitées dans le cadre de la loi FCPA montrent à cet égard l’intérêt et les limites de pratiques « coopératives » entre des justices ou administrations européennes, en l’espèce celle des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de l’Allemagne, et leurs homologues américaines.
● En 2008, Siemens a plaidé coupable pour un ensemble d’opérations de corruption, notamment en Argentine, au Bangladesh, en Irak et au Venezuela, dont le niveau très élevé et la généralisation ont motivé un montant exceptionnel de pénalités : plus de 1,6 milliard de dollars au total. Ces pénalités ont été infligées, d’une part par plusieurs autorités américaines, pour un total de 800 millions de dollars, d’autre part par la justice allemande. En effet, les poursuites ont été coordonnées entre les deux pays. Le communiqué de presse alors publié par le Department of Justice salue notamment le haut niveau de coopération atteint, incluant le partage d’informations et de preuves, et même « l’aide exceptionnelle » provenant des autorités allemandes, en particulier du parquet de Munich.
● En décembre 2011, le Department of Justice a négocié une pénalité limitée (1,76 million de dollars) avec l’entreprise américaine Aon pour des faits de corruption au Costa-Rica en relevant (dans son communiqué de presse), parmi les facteurs qui auraient contribué à « réduire substantiellement » le montant de cette amende, outre le degré de coopération de l’entreprise avec les autorités et ses efforts de remédiation, le fait qu’une pénalité de 5,25 millions de livres avait préalablement été versée à la Financial Services Authority (FSA) du Royaume-Uni et qu’en outre cette agence britannique exerçait sur l’entreprise une supervision « proche et continue ».
● En 2014, le paiement transactionnel de 240 millions de dollars par l’entreprise SBM Offshore, pour des faits de corruption dans divers pays africains, aux autorités des Pays-Bas a apparemment amené le Department of Justice américain à abandonner ses poursuites contre cette entreprise basées sur les mêmes faits.
● Enfin, l’entreprise de téléphonie Vimpelcom, dont le siège social est aux Pays-Bas (bien qu’elle soit immatriculée aux Bermudes, possédée par des intérêts russes et active principalement dans l’ex-URSS…), a accepté en février 2016 de verser une pénalité globale de 795 millions de dollars, pour des faits de corruption concernant l’Ouzbékistan, qui a été partagée entre les autorités américaines (DoJ et SEC) et néerlandaises (plus ou moins pour moitiés). Il y a eu un « deal » global où la justice américaine a accepté de « créditer » le versement fait à la justice néerlandaise sur la transaction globale.
Dans la majorité des cas cités, il ne s’agit donc pas d’une application véritable du principe « non bis in idem », dans laquelle l’une des deux justices nationales aurait renoncé à poursuivre en raison des poursuites de l’autre : il s’agit plutôt d’une sorte de « confusion des peines » dans laquelle l’entreprise n’est pas condamnée à payer double, car l’une des deux amendes est imputée sur l’autre, ou du moins les autorités américaines tiennent compte de la pénalité payée dans l’autre juridiction.
La visite à Washington de la délégation de la mission, qui y a notamment rencontré des représentants du Department of Justice et de la Securities and Exchange Commission (SEC), a permis d’obtenir confirmation de plusieurs réalités :
– en aucun cas, les autorités américaines ne sont prêtes à prendre un engagement général de non-poursuite en cas de poursuites par une juridiction étrangère. Le principe non bis in idem, de leur point de vue, n’est pas valable entre juridictions de pays différents. Les administrations américaines constatent elles-mêmes que des juridictions étrangères « opportunistes » engagent parfois des poursuites contre les entreprises après leurs propres procédures pour les faits de corruption que ces administrations américaines ont mis au jour et sanctionnés. Mais elles semblent accepter cette situation ;
– les décisions américaines quant à l’opportunité de poursuivre ou non en fonction de l’existence de procédures étrangères ne peuvent donc être prises qu’au cas par cas. Et il est probable qu’elles aboutissent plus souvent à des poursuites parallèles et si possible coordonnées – conclues par une sorte de partage des amendes – qu’à des renonciations à poursuivre ;
– ce d’autant que les cadres de la SEC, en particulier, revendiquent les compétences acquises dans la poursuite des affaires de corruption. De manière générale, la priorité semble donc à l’exercice effectif des poursuites du côté américain, avec en revanche une appétence pour les coordonner éventuellement avec d’autres poursuites nationales. Cette coordination entre juridictions américaines et étrangères n’est pas prévue par le droit américain, mais n’est pas interdite : il s’agit de proposer un « deal » global aux entreprises, mais en gardant juridiquement des procédures nationales séparées.
Certains éléments, parfois anecdotiques, entendus lors des auditions de la mission en France tendent à confirmer l’impression que l’on peut avoir d’un assez grand pragmatisme des autorités américaines et d’une préférence pour les poursuites coordonnées. Il semble d’ailleurs que la création récente (en 2014) en France d’une autorité de poursuite centralisée pour les affaires financières complexes, le parquet national financier, ait déjà un impact dans ce domaine, car elle a donné aux autorités judiciaires américaines, pour la France, un interlocuteur unique bien identifié : des échanges d’informations, accompagnés d’un partage de fait des investigations, sont déjà en cours sur des dossiers de corruption internationale. La mise en place d’un parquet national financier a donc enclenché des démarches systématiques de coopération de la justice américaine. L’audition de Madame Houlette a ainsi souligné que chaque fois qu’il y a demande de la justice américaine, le premier interlocuteur est le parquet national financier.
Il semble ainsi que dans une affaire récente d’extradition demandée par la France d’une personne qui s’était enfuie aux États-Unis, l’existence de dispositions conventionnelles permettant à l’État sollicité d’empocher la moitié du produit des confiscations de biens acquis illicitement opérées sur son territoire ait facilité le processus.
De fait, le système de poursuites coordonnées a au moins le mérite, du point de vue des finances publiques du pays européen concerné, de récupérer une partie de l’amende.
La mise en œuvre d’une solution de ce type sera facilitée si le droit de l’État européen concerné permette, comme aux États-Unis, une transaction pénale (ne serait-ce que pour permettre un parallélisme des formes qui est matériellement nécessaire pour conclure un arrangement global avec les entreprises en cause, lequel implique en fait des arrangements comparables au même moment avec les différentes juridictions nationales concernées). C’est ce que propose le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (voir infra).
2. Un droit français incapable d’engendrer une coopération et des poursuites coordonnées
L’arsenal juridique français ne dispose pas, à l’heure actuelle, d’un mécanisme de transaction pénale. Plus largement, les condamnations pour des faits de corruption internationale ont été peu nombreuses. L’action de la justice est donc trop peu convaincante pour inciter les autorités américaines à engager des poursuites coordonnées avec la France contre ses entreprises pour les mêmes faits de corruption internationale. Notons, toutefois, que les autres pays non membres de l’OCDE ne sont soumis à aucune répression de faits de corruption et que, par conséquent, la concurrence internationale reste et restera faussée.
a. Le constat : jusqu’à présent, des condamnations peu nombreuses, tardives et d’une sévérité modérée
Alors que la convention OCDE de 1997 a été rapidement transposée en droit national (par la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000), son application par le système judiciaire français apparaît lente et limitée.
Fin 2014, l’OCDE (47) ne relevait encore, s’agissant des affaires de corruption à l’international définitivement jugées, que quatre condamnations définitives, concernant exclusivement des personnes physiques (cinq au total).
Pour ce qui est des personnes morales, l’OCDE indiquait que des poursuites étaient en cours sur le même fondement à l’encontre de 21 sociétés, sans qu’aucune condamnation définitive n’ait été prononcée (4 sociétés ayant été l’objet de réquisitions du parquet aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel, 14 ayant été renvoyées en correctionnelle, 3 ayant fait appel de condamnations).
Il est intéressant de se pencher sur le cas des sociétés françaises qui ont passé des transactions pénales aux États-Unis au titre de la loi FCPA, car elles ont fait l’objet en France de procédures pour les mêmes faits (ou une partie au moins) :
– Total est poursuivi pour les faits de corruption concernant en Iran le gisement de Pars sud qui lui par ailleurs ont valu de verser 398 millions de dollars en 2013 aux autorités américaines. L’information judiciaire a été ouverte en 2006, mais le renvoi en correctionnelle n’a été effectué que fin 2014. Comme l’entreprise a donc déjà été sanctionnée aux États-Unis, il est tout à fait possible qu’elle bénéficie de la jurisprudence « non bis in idem » développée depuis deux ans au tribunal correctionnel de Paris ;
– Alstom a bénéficié de non-lieux pour des faits recoupant en partie ceux qui lui ont valu de verser 772 millions de dollars aux États-Unis ;
– Technip, également pénalisé aux États-Unis (à hauteur de 338 millions de dollars) pour les faits de corruption liés au complexe de liquéfaction de gaz de Bonny Island au Nigeria, ne semble pas avoir été poursuivi en France en tant que personne morale. En revanche, deux de ses anciens cadres ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Paris respectivement à 10 000 euros et 5 000 euros d’amende pour ces faits en janvier 2013.
Une personnalité bien placée pour parler de ces dossiers, auditionnée par la mission, a estimé que ces résultats limités du système judiciaire français s’expliquaient de plusieurs manières : l’insuffisance manifeste des moyens de la justice (et plus particulièrement du pôle financier) pour traiter de dossiers très lourds ; mais aussi, l’inadaptation totale des dispositifs de coopération judiciaire classique, qui donnent des résultats aléatoires, et ce à des délais imprévisibles ; et surtout l’obligation de la justice de trouver des preuves, qui dans le cadre de la procédure américaine sont fournies par les entreprises elles-mêmes (plaider coupable)…
b. Un renforcement du dispositif engagé en 2013
La répression de la corruption (internationale ou non) a une première fois été renforcée considérablement, en France, par l’article 6 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, lequel a porté l’amende maximale à un million d’euros, montant qui « peut être porté au double du produit tiré de l’infraction ». Auparavant, l’amende maximale s’élevait à 150 000 euros, montant susceptible d’être quintuplé compte tenu des règles générales applicables aux personnes morales (article 131-38 du code pénal), donc porté à 750 000 euros : les faits étant antérieurs à décembre 2013, c’est à ce montant maximal d’amende que Total a été condamné, en février 2016, dans l’affaire « Pétrole contre nourriture ». Indépendamment de toute considération sur le fond du dossier, il est clair qu’un tel montant d’amende présentait un caractère punitif et dissuasif très limité pour une entreprise de cette taille, même s’il faut saluer cette première condamnation française d’entreprise pour corruption internationale d’agents publics.
Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, tel que voté à l’Assemblée nationale, s’inscrit clairement dans une optique de recherche de solutions plus efficaces dans la lutte contre la corruption internationale capable d’inciter les autorités américaines à privilégier des poursuites coordonnées (voir infra).
B. UNE RECONNAISSANCE FRANÇAISE DE L’APPLICATION DU FATCA AUX EFFETS SECONDAIRES NÉFASTES : LE PROBLÈME DES « AMÉRICAINS ACCIDENTELS »
1. Le choix ancien d’une politique coopérative
En matière de fiscalité des personnes, la France a adopté une politique coopérative avec les États-Unis.
a. La convention fiscale bilatérale
C’est ainsi que la convention fiscale franco-américaine en vigueur (convention du 31 août 1994 en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune) entérine le principe de l’imposition américaine des citoyens américains même ne résidant pas aux États-Unis (et en l’espèce résidant en France), conformément au droit interne des États-Unis.
L’article 29, paragraphe 2, de ce texte comprend ainsi une disposition pour le moins particulière : « nonobstant les dispositions de la convention autres que celles du paragraphe 3 [qui vise certains articles de la convention], les États-Unis peuvent imposer leurs résidents (…) et leurs citoyens comme si la convention n’existait pas. À cette fin, le terme "citoyen" comprend tout ancien citoyen dont la renonciation à la citoyenneté des États-Unis a eu comme un de ses objets principaux celui d’échapper à l'impôt sur le revenu, mais seulement pendant une période de dix ans suivant une telle renonciation » ! Cette imposition des citoyens américains « comme si la convention n’existait pas » comporte tout de même quelques exceptions, concernant notamment les rémunérations publiques (qui ne sont imposables, indépendamment de la nationalité, que dans l’État où elles sont payées, à de rares exceptions près).
Il est par ailleurs prévu, à l’article 24, paragraphe 2, de la convention un régime spécifique pour les citoyens américains, lui-même subdivisé en sous-régimes applicables respectivement à ceux d’entre eux qui sont résidents des États-Unis (mais concernés par la convention en raison de revenus de source française) et ceux qui sont résidents de France (cas de la personne « qui est à la fois un résident de France et un citoyen des États-Unis »). Le principe alors retenu est celui de l’imposition différentielle : « les États-Unis accordent, comme crédit déductible de l’impôt américain sur le revenu, l’impôt français sur le revenu ».
Cette imposition différentielle est déterminée par catégorie de revenus, de sorte que même si l’impôt sur le revenu français est globalement au moins aussi élevé que l’impôt américain (d’autant que celui-ci est tout de même réduit pour les non-résidents), le fisc américain est en droit de demander son dû sur certaines catégories de revenus exonérées ou faiblement fiscalisées en France, notamment les plus-values immobilières sur les résidences principales, les produits d’assurance-vie, ceux d’épargne salariale.
D’après une étude de législation fiscale du Sénat de 2009, il y aurait trois mécanismes possibles, alternatifs et non cumulables : la réduction de l’assiette imposable au seul titre des revenus du travail perçus hors des États-Unis, dans la limite d’une somme de l’ordre d’une centaine de milliers de dollars par an ; un crédit sur l’impôt américain équivalent à l’impôt payé en France ; une déduction de l’impôt payé en France du revenu soumis à l’impôt américain).
Après la loi FATCA de 2010, présentée supra, notre pays a accepté de reconnaître la portée extraterritoriale de celle-ci en signant en 2013 un accord bilatéral, dans l’espoir de revenir à un dispositif plus « classique » et équilibré de coopération intergouvernementale fondée sur la réciprocité.
Le résultat est mitigé dans la forme même de l’accord :
– Comme annoncée par le président de la mission (48), la réciprocité n’est toujours pas totale sur le fond, malgré les engagements pris par l’exécutif américain d’y parvenir, les renseignements à fournir réciproquement n’étant pas les mêmes (les autorités américaines transmettent les éléments d’identification des comptes français aux États-Unis et les montants de revenus versés sur ces comptes, mais toujours pas leurs soldes) ;
– l’intitulé de l’article 4 de l’accord, « Application de la loi FATCA aux institutions financières françaises », entérine l’assujettissement des banques françaises à la loi américaine, en contrepartie de quelques aménagements dans cette application. Dans l’autre sens, la France n’a pas demandé de « mise en conformité » à sa propre législation des renseignements américains qui lui sont transmis…
2. L’application très insatisfaisante de la convention fiscale bilatérale : les « Américains accidentels », des français victimes de son application
Il résulte de la loi fiscale américaine, de la convention fiscale bilatérale et de l’accord FATCA que :
– les citoyens américains qui résident en France doivent cependant payer un impôt différentiel aux États-Unis quand l’impôt français serait inférieur à l’impôt américain, ainsi que pour les impôts non couverts par la convention fiscale ;
– aux fins de permettre à l’administration fiscale de recouvrer cet impôt, les banques françaises, par le biais de notre administration fiscale, doivent transmettre aux États-Unis toutes les données des comptes « américains » qu’elles gèrent.
La mise en œuvre de ces dispositions a mis en lumière une catégorie inconnue jusque-là de binationaux, les « Américains accidentels ».
Il existe en effet plusieurs catégories d’Américains résidant en France :
– il y a bien sûr des expatriés américains ainsi que des binationaux ayant des attaches aux États-Unis, les uns et les autres conscients (en principe) des obligations qui s’attachent à la citoyenneté américaine, y compris en matière fiscale même en cas d’expatriation.
– mais, comme la nationalité américaine s’acquiert automatiquement par la naissance sur le territoire américain (droit du sol « absolu »), sont aussi « américains » des compatriotes nés aux États-Unis mais n’ayant aucun autre lien avec ce pays (leurs parents n’étaient souvent pas américains ; ils ont quitté très jeunes les États-Unis, n’y ont ni attaches familiales ni intérêts économiques, n’y sont jamais retournés ou seulement épisodiquement en tant que touristes…). Ces « Américains accidentels » n’avaient jusqu’à présent qu’une conscience limitée de leur « américanité » et de ses conséquences : tout au plus ont-ils parfois demandé et renouvelé un passeport américain, notamment pour voyager aux États-Unis, où c’est apparemment une obligation pour les citoyens américains.
Si les Américains expatriés et binationaux « classiques » possèdent un numéro d’identification fiscale américain (tax identification number-TIN), ce n’est pas le cas des Américains accidentels, qui ne sont pas répertoriés par l’administration fiscale américaine.
Dans le cadre de l’application de l’accord FATCA, les institutions financières françaises, tenues de transmettre les données de leurs comptes « américains », ont commencé à l’automne 2014 à adresser à leurs clients de nationalité américaine, ou ayant seulement des « indices d’américanité », des courriers leur demandant de bien vouloir communiquer leur numéro d’identification fiscale américain ou de prouver qu’ils avaient renoncé à leur nationalité américaine (49) .
Les intéressés n’ont que deux options en réponse :
– soit ne rien faire, en sachant qu’alors ils seront signalés comme « américains » dans le cadre de l’accord FATCA, s’exposant donc à des enquêtes et d’éventuelles poursuites de l’administration fiscale américaine (ceci leur interdisant de voyager aux États-Unis et leur faisant courir le risque de procédures engagées contre eux par le fisc français à la demande de son homologue américain, en vertu du Mutual Assistance Collection Program), sans compter les difficultés avec leurs banques. Des refus d’ouverture de compte, ou de souscription de certains produits (par exemple d’assurance-vie ou des fonds communs de placement d’entreprise), voire des fermetures de comptes, sont en effet répertoriés ;
– soit chercher à se « mettre en règle » avec le fisc américain et renoncer à leur nationalité américaine. Il est effet possible de renoncer à celle-ci, ce que font annuellement plusieurs milliers de personnes, pour des raisons fiscales (3 415 en 2014 selon des articles de presse). Mais cette démarche est longue, chronophage et extrêmement coûteuse – potentiellement 15 000, voire 20 000 euros selon des personnes auditionnées –, car il faut préalablement régulariser sa situation avec le fisc américain en faisant des déclarations rétroactives sur plusieurs années et en payant des pénalités fiscales de retard. En outre, pour ce faire, le recours à des cabinets spécialisés apparaît inévitable : une « Américaine accidentelle » qui a essayé de remplir elle-même ses « obligations » fiscales américaines se voit depuis lors, suite à des erreurs, réclamer plus de 2 000 euros de pénalités par le fisc américain, alors même qu’au regard de la nature et du niveau modeste de ses revenus, elle ne devrait être tenue dans le cadre de la convention fiscale bilatérale à aucun impôt américain effectif. Aux frais punitifs infligés par l’administration américaine aux « mauvais citoyens » qui cherchent à lui échapper, s’ajoutent donc ceux des fiscalistes et juristes auxquels il faut recourir.
C’est pourquoi même la mise en place récente d’une procédure allégée sans pénalités par l’administration fiscale américaine ne répond pas vraiment au problème, car certains frais très importants restent.
C. DES EMBARGOS ET SANCTIONS INTERNATIONALES PRINCIPALEMENT EUROPÉENS MAIS APPLIQUÉS ET SANCTIONNÉS AU NIVEAU NATIONAL
1. Des sanctions adoptées majoritairement au niveau européen
La France, comme les États-Unis, applique un certain nombre de mesures d’embargo et de sanctions diverses établis à des fins de politique étrangère.
Ces dispositifs, en pratique, sont généralement décidés au niveau européen. Mais il existe aussi quelques mesures purement nationales, notamment des gels d’avoirs de personnes ou d’entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.
Certains des dispositifs européens traduisent des décisions onusiennes. En effet, l’article 41 de la Charte des Nations-Unies prévoit explicitement que le Conseil de sécurité peut adopter des sanctions économiques, qui « peuvent comprendre l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication (…) ».
Pour le reste, la compétence non exclusive de l’Union européenne résulte des traités européens :
– l’article 28 du traité sur l’Union européenne dispose que « lorsqu’une situation internationale exige une action opérationnelle de l’Union, le Conseil adopte les décisions nécessaires », tout en réservant un droit des États membres à prendre des mesures d’urgence « en cas de nécessité impérieuse ». Ces mesures, étant décidées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), le sont à l’unanimité (article 31 du traité) ;
– l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne traite explicitement des décisions prévoyant « l’interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers » prises dans le cadre de la PESC : leur mise en œuvre relève de décisions du Conseil, prises à la majorité qualifiée et avec une simple information du Parlement européen. Il est précisé que peuvent aussi être adoptées « des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d’entités non étatiques » ;
– par ailleurs, l’article 75 du même traité prévoit, « en ce qui concerne la prévention du terrorisme et des activités connexes », la possibilité de « mesures administratives concernant les mouvements de capitaux et les paiements, telles que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des bénéfices économiques qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, à des groupes ou à des entités non étatiques, sont en leur possession ou sont détenus par eux ». Comme on ne se trouve pas, dans ce cas particulier, dans le cadre de la PESC, ces mesures doivent être prises dans le cadre de la procédure législative normale de coproduction associant Conseil et Parlement ;
– enfin, l’article 346 du traité réserve la compétence des États membres en matière de commerce des armes : « tout État membre peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre ».
La France est actuellement tenue par des mesures restrictives européennes concernant environ 25 pays. Toutefois, la majorité de ces mesures ne visent pas globalement les échanges avec ces pays, mais seulement certaines personnes (ou entités) qui en ont la nationalité, tels que des dirigeants ou anciens dirigeants ciblés en raison de leurs atteintes aux droits de l’homme, ou encore des personnes liées au financement du terrorisme. La plupart des mesures sont en effet, soit des embargos sur la vente de matériels militaires ou pouvant servir à la répression interne (complétés d’un régime de contrôle pour les biens « à double usage »), soit des interdictions d’entrée sur le territoire et gels des avoirs appartenant à des personnes ou des entreprises. Seuls un petit nombre d’États sont ou ont été récemment frappés globalement par des mesures de restriction aux échanges économiques et financiers dans des secteurs non militaires : outre bien sûr l’Iran et la Russie, il s’agit de la Corée du Nord, de la Somalie et de la Syrie.
Le dispositif actuel présente, c’est un fait, un caractère quelque peu bicéphale puisque, bien que les règlements des sanctions soient européens, ensuite leur application reste purement nationale : ce sont les États membres qui délivrent les licences d’exportations quand elles sont requises et auxquels il revient de réprimer les infractions à ces règlements. En France, c’est la direction générale du Trésor qui délivre les autorisations dans les cas prévus par les règlements européens et qui émet des avis sur la conformité des transactions envisagées quand des entreprises la consultent.
2. L’état du droit : la violation d’embargo est généralement une infraction douanière
Si, de fait, les mesures d’embargo et de sanctions sont toujours décidées au niveau européen, leur mise en œuvre – notamment la délivrance des licences d’exportation quand un contrôle a priori de celles-ci est prévu –, ainsi que le contrôle de leur respect et la répression de leurs violations relèvent des États membres.
Dans le droit positif français en vigueur, la répression des violations d’embargos et sanctions économiques est principalement réprimée par le code des douanes et, s’agissant des embargos militaires, par celui de la défense.
● Le code des douanes sanctionne, à son article 414, la contrebande, l’importation et l’exportation sans déclaration de marchandises dites « prohibées ». Ces faits sont passibles de trois ans de prison, de confiscation et d’une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet du délit. Ces peines peuvent être portées à cinq ans de prison et une amende de trois fois la valeur des biens en cause lorsque ceux-ci sont à double usage civil et militaire. Comme, par ailleurs, l’article 38 du même code définit « comme prohibées toutes marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions », on peut considérer que la violation d’embargos commerciaux peut tomber sous les peines susmentionnées.
● De manière plus précise, l’article 459 du même code sanctionne les contrevenants « à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger », ainsi qu’aux « mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire (…) ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France ». Ceux-ci s’exposent à cinq ans de prison, une amende égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l’infraction et une peine de confiscation.
● Le code de la défense dispose quant à lui, à son article L. 2335-2, que « l’exportation sans autorisation préalable de matériels de guerre et matériels assimilés vers des États non membres de l’Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l’Union européenne est prohibée », tandis que les articles L. 2335-9 et L. 2335-10 du même code prévoient de même l’obligation d’une « licence de transfert » pour les ventes de ces matériels dans l’Union. Le non-respect de cette obligation de demander une licence d’exportation ou de transfert (et de diverses obligations procédurales complémentaires) est sanctionné, en application de l’article L. 2339-11-1 du même code, de cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende. Comme, en principe, une licence d’exportation ne sera pas accordée en direction d’un pays soumis à un embargo sur les ventes d’armes, on peut également considérer que la vente d’armes au mépris d’un tel embargo est ainsi dûment réprimée.
Ces dispositions sont souvent critiquées pour plusieurs raisons :
– elles concernent principalement les marchandises (régies par le code des douanes), les matériels militaires et certaines opérations financières, mais pas explicitement les services de toutes natures (par exemple formation, « après-vente » et assistance technique), qui peuvent aussi faire l’objet d’interdictions ou de restrictions dans le cadre de régimes de sanctions ;
– elles ne visent pas explicitement les violations indirectes, dans lesquelles une entreprise recourt délibérément à un tiers étranger pour contourner un régime d’embargo ou de sanctions ;
– elles valent pour l’importation ou l’exportation illicites des biens en cause vers ou depuis le territoire national, ou les mouvements financiers de même nature, mais ne sanctionnent pas explicitement l’éventuelle participation de personnes (physiques ou morales) de droit français, à ce titre passibles du droit pénal français, à des opérations illicites depuis des pays tiers (par exemple, le transport de matériel de guerre entre un pays tiers et un pays soumis à un embargo ou encore toute prestation dite d’« intermédiation »). Dans l’affaire dite de l’Angolagate, qui mettait en cause des personnalités françaises dans la vente d’armes d’origine soviétique au gouvernement angolais dans les années 1990, l’application de l’incrimination de « commerce illicite d’armes » a été contestée pour cette raison, y compris dans le cadre d’un courrier ministériel (50), car les armes en question n’avaient pas transité par le territoire français (les mis en cause avaient agi en tant qu’« intermédiaires »). De même, Amnesty International, se référant à des travaux d’enquêteurs des Nations unies, a mis en lumière l’implication de citoyens français dans des livraisons d’armes aux forces de sécurité de l’ex-président Laurent Gbagbo au mépris de l’embargo en vigueur concernant alors la Côte d’Ivoire et sans que cela ait pu déboucher sur des sanctions pénales (51) ;
– l’insertion de la répression des violations de sanctions (autres que les embargos militaires) dans le code des douanes la soumet aux règles de procédures applicables aux délits douaniers. Cela signifie que les litiges peuvent être réglés par voie de transaction administrative, sans publicité (article 350 du code précité), et que l’éventuel engagement de poursuites pénales est réservé au ministre de l’économie et des finances (article 458).
La solution de la transaction semble effectivement préférée en général. Les dossiers contentieux concernant des violations d’embargos et de mesures restrictives sont peu nombreux et réglés le plus souvent à l’amiable, d’après les données transmises par l’administration à la mission :
– pour 2013, deux dossiers contentieux recensés, qui se sont conclus par des transactions ;
– pour 2014, trois dossiers contentieux recensés, qui se sont également conclus par des transactions ;
– pour 2015, un dossier contentieux, en cours d’instruction
– pour 2016, un dossier contentieux en cours de traitement.
3. Les sanctions concernant l’Iran : une politique de coordination coopérative décevante
L’atténuation des problèmes posés par l’extraterritorialité de certaines lois américaines pourrait passer par la coordination des politiques de sanctions des États-Unis et de l’Union européenne. Cette coordination a clairement été recherchée s’agissant des sanctions prises à partir de 2014 à l’encontre de la Russie, qui sont très voisines de part et d’autre de l’Atlantique.
Mais la situation est-elle aussi satisfaisante concernant un autre dossier commun, celui des suites de l’accord sur le nucléaire iranien du 14 juillet 2015 (JCPOA) ?
a. Les enjeux de l’accord sur le nucléaire iranien
Le succès du JCPOA se mesurera aux flux économiques et financiers dont il permettra le rétablissement au bénéfice de l’Iran, de sa puissance économique, du niveau de vie de sa population et in fine de la popularité de ses dirigeants actuels « modérés ». Pour que les autorités iraniennes soient convaincues de l’intérêt de l’accord, il faut donc que les mesures de levée de sanctions économiques qu’il prévoit soient suivies d’effet, ce qui suppose que le « business légitime », notamment des entreprises européennes, ne soit pas découragé par des craintes dues au maintien de la plus grande part des sanctions américaines et à la complexité de celles-ci.
L’exécutif américain a voulu le JCPOA et les administrations rencontrées à Washington par la délégation de la mission qui s’y est rendue ont fait état de leur engagement pour la réussite de l’accord.
Par ailleurs, il y a naturellement des enjeux significatifs pour nos entreprises : l’Iran n’a certes jamais été un partenaire économique essentiel pour la France et ne le deviendra sans doute pas à court terme pour diverses raisons objectives (éloignement géographique relatif, faiblesse relative des liens historiques…). Mais il a représenté dans le passé, pour certaines entreprises françaises, un marché très important et offre d’évidentes opportunités.
Les échanges commerciaux franco-iraniens
En raison du durcissement progressif des sanctions internationales, les échanges commerciaux franco-iraniens (de biens) s’étaient effondrés de 3,7 milliards d’euros en 2004 à 516 millions en 2014.
En 2015, ils ont toutefois connu un léger redressement, dans le climat propice créé par les négociations et la signature du JCPOA et bien que celui-ci ne soit pas encore entré en application : ils ont atteint 629 millions d’euros (+ 22 % par rapport à 2014, mais en partant d’un niveau très faible). Les importations depuis l’Iran sont restées insignifiantes (67 millions d’euros), du fait de l’embargo pétrolier, tandis que les exportations françaises vers ce pays (562 millions) restaient dominées par des produits non concernés par les sanctions, y compris celles des États-Unis (médicaments, équipements médicaux et parfums et cosmétiques).
Les perspectives de reprise « post-JCPOA » concernent notamment l’aéronautique, les pièces détachées automobiles (compte tenu de l’implantation historique des industriels français) et, dans l’autre sens, naturellement, les hydrocarbures.
Cela dit, les enjeux ne doivent pas non plus être exagérés : même s’ils revenaient au niveau d’il y a une décennie, de l’ordre de 4 milliards d’euros, les échanges avec l’Iran ne représenteraient encore que 0,5 % à peine du commerce extérieur français total.
Le cadre plus général : les échanges irano-européens
Les constats sont sensiblement les mêmes si l’on prend plus globalement les échanges commerciaux entre l’Union européenne et l’Iran :
– un effondrement du fait du durcissement progressif des sanctions et en particulier de l’entrée en vigueur de l’embargo pétrolier européen contre les importations depuis l’Iran le 1er juillet 2012. Le volume global des échanges bilatéraux est ainsi tombé de 27,8 milliards d’euros en 2011 à 7,6 milliards en 2014 ;
– une faible reprise en 2015, avec des échanges s’élevant à 7,7 milliards d’euros (+ 1,8 % par rapport à 2014) ;
– le maintien d’un fort excédent bilatéral au bénéfice de l’Union en l’absence d’importations de produits pétroliers iraniens (en 2015, 6,5 milliards d’exportations européennes pour 1,2 milliard d’importations depuis l’Iran) ;
– une certaine marginalisation de l’Union dans le commerce extérieur iranien, dont elle n’a représenté en 2015 que 6 %, loin derrière les Émirats-Arabes-Unis (23,5 %) et la Chine (22,3 %), suivis de l’Inde, de la Turquie et enfin de l’Union.
b. Une bonne volonté de principe de l’exécutif américain
Les administrations françaises mettent en avant l’esprit coopératif que montrerait l’administration américaine pour faciliter une bonne application, dans le domaine des sanctions, de cet accord. Cet esprit coopératif répond à l’objectif diplomatique susmentionné de réussite de l’accord. Il s’est traduit par la publication de « guidances », « foires aux questions » ou textes équivalents le 16 janvier 2016, dont le contenu a fait l’objet de discussions entre les administrations française, britannique, allemande et américaine du Trésor.
c. Cependant, un dispositif qui reste entaché d’interrogations paralysantes pour les entreprises européennes
Mais les auditions ont aussi montré que, malgré cette publication de textes interprétatifs, tout reste loin d’être clair. Plusieurs problèmes restent signalés :
– autour de la notion d’« US Person » (malgré la définition qui en est enfin donnée) et sur le degré d’implication (nexus) des US Persons qui fait tomber sous la juridiction américaine directe au titre des sanctions « primaires » (suffit-il de la présence d’un citoyen américain dans une chaîne décisionnelle d’une entreprise française ?) ;
– quant à la question du risque pour une institution financière américaine d’être sanctionnée en cas d’ouverture ou de maintien d’un compte de correspondance avec une institution étrangère qui a elle-même un compte de correspondance avec une institution iranienne qui n’est plus visée par les sanctions « secondaires » (les non US Persons peuvent faire des transactions avec elle), mais reste visée par les sanctions « primaires » (les US Persons ne sont pas autorisées à faire des transactions avec elle) ;
– quant au caractère exclusif de la liste des personnes et entités qui restent nommément sous sanctions américaines (dite liste « SDN ») – peut-elle être complétée ? Que se passe-t-il si une entreprise fait des transactions avec une entité contrôlée par une entité sanctionnée (par ex. les Gardiens de la révolution) sans le savoir ?
– quant à la capacité des États fédérés à adopter leurs propres sanctions contre l’Iran ;
– concernant l’éventualité d’un rétablissement des sanctions si l’Iran ne tient pas ses engagements (« snapback »). De fait, s’agissant d’un éventuel snapback, les éclaircissements apportés par l’OFAC dans son document de « foire aux questions » (FAQs, paragraphes M-4 et M-5) sont limités : ils se bornent à un engagement générique de ne pas donner un effet rétroactif aux sanctions qui seraient réintroduites et à une formule vague sur la volonté de minimiser l’impact de ces sanctions (« The U.S. government has a past practice of working with U.S. or third-country companies to minimize the impact of sanctions on the legitimate activities of those parties undertaken prior to the imposition of sanctions, and we anticipate doing the same in the event of a JCPOA sanctions snapback »).
Les États européens doivent exiger de l’administration américaine des éclaircissements supplémentaires qui se traduiront par une mise à jour des guides. Une déclaration en ce sens a été faite le 19 mai 2016 par la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
d. Le maintien de l’essentiel des sanctions « primaires » américaines, y compris sur la compensation des opérations en dollars via le système financier américain
Le système de sanctions américaines contre l’Iran est extrêmement complexe et stratifié.
Les sanctions américaines contre l’Iran (52)
Les dispositifs américains de sanctions contre l’Iran sont multiples. À leur apogée, juste avant le JCPOA, ils comprenaient :
● des mesures de gels d’avoirs :
– consécutives à la crise des otages de l’ambassade américaine à Téhéran en 1979 ;
– concernant les entités et personnes soutenant le terrorisme (dans le cadre d’un executive order 13324 pris juste après le 11 septembre 2001) ;
– concernant les personnes et entités menaçant la stabilité de l’Irak post-Saddam Hussein (executive order 13438 de 2007) ;
– concernant les personnes et entités impliquées dans la répression en Syrie (par leur soutien au régime de M. Bachar al-Assad : executive order 13572 de 2011) ;
– concernant les entités possédées ou contrôlées par le gouvernement iranien (executive order 13599 de 2012) ;
● des mesures d’embargo commercial et sur les investissements, avec notamment un executive order de portée générale pris en 1995 qui interdit quasiment tous les échanges irano-américains, avec des exceptions évolutives ;
● diverses mesures plus spécifiques d’embargo sur les armes et les équipements à usage dual ;
● une accumulation progressive de sanctions « secondaires », c’est-à-dire de dispositions explicitement extraterritoriales, car prévoyant une palette de sanctions non pénales applicables, à la discrétion de l’administration, aux entités (entreprises mais aussi parfois États) quelle que soit leur nationalité (exclusion des marchés publics américains et des programmes financés sur des fonds fédéraux ; interdiction d’emprunter à des banques américaines, voire interdiction de toute transaction financière avec elles ; interdiction d’acquérir des actifs aux États-Unis ou d’y vendre des biens et services, etc.) :
– fournissant à l’Iran des technologies de destruction massive et certains armements (FY1993 National Defense Authorization Act de 1992, complété par plusieurs autres dispositions) ;
– réalisant des investissements significatifs dans le secteur énergétique iranien (Iran and Libya Sanctions Act-ILSA de 1996, dit loi d’Amato-Kennedy) ;
– vendant en Iran diverses technologies militaires ou investissaient dans l’extraction et la transformation de l’uranium ;
– y vendant des produits pétroliers raffinés (extension de la loi ILSA par le Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act-CISADA de 2010) ;
– s’agissant de banques, procédant à des transactions avec des banques iraniennes spécifiquement sanctionnées (loi CISADA de 2010) ;
– procédant à des transactions avec la Banque centrale iranienne (section 1245 du FY2012 National Defense Authorization Act de 2011) ;
– fournissant des matériels et services pour l’exploitation des hydrocarbures et la pétrochimie en Iran (Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act-ITRSHA de 2012) ;
– prenant part au transport des hydrocarbures iraniens (loi ITRSHA de 2012) ;
– fournissant certains services d’assurance ou liés à la dette publique iranienne (loi ITRSHA de 2012) ;
– fournissant des biens et services aux secteurs de l’énergie, de la construction navale et des transports maritimes en Iran, y vendant des métaux précieux ou des billets de banque américains ou y fournissant divers services d’assurance (Iran Freedom and Counter-Proliferation Act-IFCA de 2013) ;
– achetant des hydrocarbures iraniens (executive order 13622 de 2012) ;
– fournissant à l’Iran des biens et services dans le secteur automobile, des pierres précieuses ou contribuant au trading du rial iranien (executive order 13645 de 2013), etc., etc., etc.,…
Dans le cadre du JCPOA, et c’est peut-être la principale difficulté, les États-Unis n’ont pas levé l’essentiel de leurs sanctions « primaires », à quelques exceptions près.
L’atténuation limitée des sanctions « primaires » américaines dans le JCPOA
L’embargo « primaire » américain n’est levé (avec des régimes de licences) que pour certains produits, de sorte que peuvent désormais être autorisées :
– les exportations américaines vers l’Iran de matériels aéronautiques civils (pour Iran Air, mais pas pour des compagnies restant spécifiquement sanctionnées), de produits de santé, de produits alimentaires, de biens et services humanitaires, de certains matériels et services de communication et supports de médias (Apple exporte ses téléphones au nom de la liberté d’informer) ;
– les importations aux États-Unis de tapis et certains produits alimentaires iraniens ;
– les transactions financières, éventuellement en dollars, afférentes à ces opérations commerciales.
Par ailleurs, les filiales étrangères des entreprises américaines sont sorties du champ des sanctions « primaires » et assimilées aux entreprises étrangères tenues par les seules sanctions « secondaires ».
En particulier, les États-Unis ont maintenu la prohibition générale de la compensation via le système financier américain (les chambres de compensation de New-York) des transactions en dollars avec l’Iran (53). Du point de vue des administrations américaines, on l’a dit, cette compensation fait « passer » ces opérations par les États-Unis et donc son contrôle n’a rien d’extraterritorial selon elles. La prohibition de cette compensation relève donc des sanctions « primaires » et il ne peut y être dérogé que pour le financement des quelques transactions commerciales désormais autorisées depuis les États-Unis avec l’Iran, par exemple les ventes d’avions civils.
Par ailleurs, les entreprises non-américaines restent soumises au régime américain de contrôle des exportations et potentiellement aux sanctions « primaires » dès lors que leurs produits incorporent 10 % de technologie américaine.
Il y a également des difficultés concernant les sanctions « secondaires ».
Certes, de même que la plupart des sanctions européennes (54) et à la différence des sanctions « primaires », les sanctions « secondaires » américaines sont en partie levées, mais pas complétement : plus de 400 personnes ou entités sont retirées de la liste des personnes et entités iraniennes spécifiquement sanctionnées, dite « SDN List », mais celle-ci n’est pas complétement purgée, car les sanctions motivées par la lutte contre le terrorisme, les questions de droits de l’homme, la non-prolifération, etc., restent en place. Les personnes et entités visées à ce titre restent donc sous sanctions, notamment les Gardiens de la Révolution.
Il est en particulier à noter que les personnes ou entités non-américaines qui feraient des transactions avec des personnes ou entités iraniennes restant sous sanctions continueront à s’exposer à certaines sanctions « secondaires » américaines. C’est ainsi que restent applicables les dispositions de la loi CISADA sanctionnant indirectement les banques étrangères qui effectuent des opérations avec des entités iraniennes sous sanctions : les institutions financières américaines n’ont pas le droit d’ouvrir à ces banques des comptes de correspondance ou de règlement indirect.
e. Le problème des « lettres de confort »
Un autre problème rapporté par certaines sources est celui des « lettres de confort » : les entreprises américaines qui consulteraient l’OFAC sur la conformité d’une transaction envisagée pourraient obtenir une « lettre de confort » (document sans valeur juridique, mais engageant de fait l’administration, faisant état de l’absence d’objection de l’OFAC), tandis que l’OFAC ne répondrait pas aux sollicitations des entreprises européennes (ou répondrait quand l’opération ne paraît pas conforme, mais pas quand elle l’est).
Effectivement, il semble que l’administration américaine ne s’estime pas tenue de répondre lorsque que la transaction n’est pas concernée par les régimes de sanctions américains.
f. La « guerre psychologique »
Il faut aussi prendre en compte, au-delà de la réalité des faits, l’état d’esprit des acteurs.
Il y a d’abord ce constat fait par tous les observateurs : après « l’affaire » BNP-Paribas, la plupart des banques françaises sont en quelque sorte « tétanisées ». Quelles que soient les assurances qui leur seraient données, elles n’ont aucune envie de courir le moindre risque avec les autorités américaines pour développer des courants d’affaires qui, de toute façon, ne seront jamais majeurs pour elles, compte tenu de la taille démographique et économique de l’Iran.
Par ailleurs, certaines officines américaines s’efforcent d’entretenir le climat de crainte quant aux risques de faire des affaires en Iran. C’est ainsi que United Against Nuclear Iran (UANI), qui se présente comme une organisation à but non lucratif et non partisane, se donne pour objectif de mettre fin au soutien au régime iranien par les entreprises internationales. Ce groupe de pression a été créé par des personnalités américaines éminentes, comme l’ex-sénateur Joseph I. Lieberman, d’anciens diplomates de haut rang ou encore l’ancien directeur de la CIA Jim Woolsey. Son site internet met en avant les risques encourus par les entreprises qui font des affaires en Iran et propose également un recensement de celles-ci. UANI s’adresse directement aux entreprises : en mars dernier, des courriers très étayés ont été envoyés à plusieurs dizaines d’entreprises, notamment françaises, pour les mettre en garde quant à ces risques. L’un de ces courriers remis à la mission se termine par cette menace doucereuse : « there should be no basis for [nom de l’entreprise] to claim that it did not know of these risks if and when shareholders suffer from its decision to engage in business with Iran » (55) .
g. Les contre-arguments américains
Les représentants des administrations américaines rencontrés à Washington par la délégation de la mission, notamment à l’OFAC, ont opposé à ces observations critiques plusieurs contre-arguments :
– la suppression en 2008 de l’exemption qui existait précédemment pour la compensation à New-York des transactions en dollars impliquant l’Iran n’aurait pas empêché la poursuite du commerce avec ce pays pour les pays n’appliquant pas les sanctions américaines, du fait du recours à des financements sans dollars ;
– il ne faut pas oublier que l’Union européenne maintient aussi des sanctions significatives concernant l’Iran, en particulier les mesures de gel des avoirs et de prohibition des transactions concernant certaines personnes ou entités. Les listes américaines et européennes de ces personnes et entités iraniennes sous sanctions seraient assez proches. Les entreprises européennes réticentes à retourner faire des affaires en Iran seraient donc également découragées par le régime européen de sanctions ;
– ce d’autant que l’économie iranienne étant assez opaque, les entreprises ont du mal à identifier précisément qui est derrière leurs partenaires iraniens et s’exposent donc au risque de faire en fait des affaires avec des entités sous sanctions. Sur ce dernier point, un interlocuteur de la mission a suggéré que les moyens de renseignement pourraient être mis au service des entreprises pour les aider dans cette identification de leurs « vrais » partenaires. Certaines entreprises ont également acquis ou envisagent d’acquérir des bases de données spécialisées auprès d’agences d’informations.
4. L’inefficacité des « lois de blocage »
a. Un dispositif français utile mais mal adapté pour se protéger contre le caractère invasif de la justice américaine
Les « lois de blocage » (visant à s’opposer juridiquement aux prétentions extraterritoriales d’autres juridictions) ont été fréquemment abordées au cours des auditions de la mission : nombre de ses interlocuteurs ont évoqué notamment l’opportunité de renforcer, pour la rendre plus crédible, la loi française de 1968.
La loi de blocage française de 1968
La loi du 26 juillet 1968 (56), renforcée en 1980, interdit, « sous réserve des traités ou accords internationaux », aux Français et résidents en France, ainsi qu’aux dirigeants et agents d’entreprises (ou autres personnes morales) ayant leur siège ou un établissement en France, de communiquer « à des autorités publiques étrangères, les documents ou les renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l’ordre public ».
Elle interdit dans les mêmes conditions « à toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci ».
La violation de ces dispositions est punie (au plus) de six mois de prison et/ou 18 000 euros d’amende.
Des dispositions de cette nature présentent certes un caractère symbolique et politique. À ce titre ce sont des outils de confrontation. Mais elles peuvent aussi, d’une certaine manière, s’inscrire dans une stratégie coopérative, car elles donnent potentiellement aux entreprises une « excuse légale », admise aux États-Unis, pour ne pas se soumettre à certaines prétentions de leurs administrations et services judiciaires. Encore faut-il que ces lois de blocage soient crédibles, donc assorties de sanctions dissuasives et appliquées effectivement.
D’après la plupart des personnes auditionnées par la mission, c’est l’existence de ce dispositif législatif qui a permis aux entreprises françaises sanctionnées pour violation de la législation FCPA de négocier les conditions du contrôle qui leur était imposé : recours à des contrôleurs» en général français ; transmission de leurs rapports aux autorités américaines par le biais du Service central de prévention de la corruption (SCPC), de sorte que puisse être vérifié le respect des prescriptions de la loi de 1968 et des autres dispositions du droit national (en matière de protection des données personnelles notamment). Le SCPC a été désigné (par le Premier ministre ou celui de la justice selon les cas) « autorité gouvernementale française » (57) chargée de servir de canal de transmission entre les contrôleurs et les autorités américaines. Le fait est que les accords transactionnels imposés par les autorités américaines aux entreprises françaises sanctionnées comprennent en général (mais pas toujours) une référence à la loi de blocage et, en conséquence, admettent une sorte de filtre de l’administration française dans la transmission des rapports des contrôleurs.
Cela dit, d’après l’étude d’impact du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, c’est à deux occasions seulement que le SCPC a été désigné pour assurer cette mission de surveillance des contrôleurs, alors que plus d’entreprises françaises ont accepté des transactions américaines comprenant un contrôle : il semble donc que ce recours au SCPC ne soit pas systématique. Il semble qu’il n’ait lieu que si les entreprises en cause invoquent la loi de blocage… Il n’est pas certain que le texte du projet de loi en cours de débat, tel que rédigé, impose le recours à la nouvelle Agence anticorruption dans tous les cas de contrôle étranger (cela se fera « à la demande du Premier ministre »).
Le choix de confier à la nouvelle agence, dans la continuité du SCPC, la mise en œuvre de la loi de blocage est discuté : d’un côté, les entreprises qui ont été sous contrôle suite à des transactions avec les autorités américaines semblent en général satisfaites de l’intervention du SCPC ; de l’autre, un interlocuteur de la mission a observé que, la loi de blocage ayant pour objet la protection des intérêts souverains, en confier l’application à une autorité chargée de lutter contre la corruption peut placer celle-ci dans une situation de conflit d’intérêts (la priorité institutionnelle d’une agence anti-corruption étant le dévoilement et la sanction des faits répréhensibles, pas la protection des intérêts de souveraineté).
Par ailleurs, en ce qui concerne les transactions passées par des banques pour non-respect des embargos financiers américains, la situation est différente : d’après des témoignages recueillis, il n’y a pas de filtre administratif national qui s’interpose, au nom de la loi de blocage, entre les banques concernées et les autorités américaines. Apparemment, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (APCR), lorsqu’elle est sollicitée, se refuserait à intervenir.
Enfin, l’effectivité du texte actuel de la loi de blocage fait débat.
La Cour de cassation en a certes fait application en 2007 (58), en confirmant l’amende de 10 000 euros infligée à un avocat français qui avait cherché à recueillir des renseignements à la demande d’une autorité administrative américaine (le commissaire aux assurances de Californie) dans le cadre du litige sur le rachat d’Executive Life par le Crédit lyonnais et la MAAF, rachat suspecté d’être frauduleux par cette autorité.
En revanche, la reconnaissance de ce texte par les juridictions américaines est beaucoup plus incertaine.
La Cour suprême américaine a ainsi jugé, en 1987 (59), que l’existence de la loi de blocage ne privait pas une juridiction américaine du pouvoir d’ordonner à une partie soumise à sa juridiction de produire des preuves, même si cette production pouvait contrevenir à ladite loi (60). Dans la même affaire, elle a jugé que la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale ne définissait pas de manière exclusive ou impérative les procédures à suivre pour obtenir des documents et des renseignements sur le territoire d’un État contractant étranger. Elle affirmait ainsi l’applicabilité des règles procédurales américaines pour ordonner la communication de preuves matérielles localisées à l’étranger.
Le principal reproche opposé par les juridictions américaines à la loi française est son manque de caractère contraignant en raison d’une jurisprudence trop peu abondante. Les cours américaines ont toujours écarté la loi de blocage, estimant qu’elle n’impliquait pas de risque réel de poursuites pour les personnes en infraction avec ses dispositions. Il est vrai que des personnalités françaises auditionnées par la mission ont reconnu que, jusqu’à présent, la volonté d’appliquer cette loi avait le plus souvent été faible, que ce soit dans les sphères politiques ou dans les sphères administratives. D’autres ont relevé les imperfections de sa rédaction, très générale, alors qu’une rédaction plus « serrée » pourrait être plus efficace en évitant que le texte ne soit invoqué en quelque sorte pour le principe, comme argument de discussion, plus que pour justifier réellement la non-transmission d’informations réellement sensibles.
b. Le règlement européen de 1996 à rénover
Au niveau européen, comme on l’a rappelé, l’adoption en 1996 d’un règlement communautaire ayant le même objet – accompagnée d’une plainte à l’OMC et de discussions « franches » avec les États-Unis – avait été particulièrement efficace.
Le règlement européen de blocage de 1996
Le règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 « portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant » cité nommément en annexe la « législation adoptée par un pays tiers » en cause : il s’agit des lois Helms-Burton (Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act) et d’Amato-Kennedy (Iran and Libya Sanctions Act) adoptées la même année aux États-Unis.
S’ajoutant à des mesures classiques d’embargo commercial et financier plus anciennes, ces législations américaines avaient notamment pour effet, respectivement :
– de sanctionner toute opération de « trafic » (vente, location, gestion…), y compris par des ressortissants de pays tiers, portant sur des biens expropriés à Cuba aux dépens de citoyens américains, sous peine de poursuites civiles devant la justice américaine et d’interdiction d’entrée sur le territoire américain ;
– d’interdire tous les investissements pétroliers nouveaux significatifs (plus de 40 millions de dollars par an) en Libye et en Iran, sous peine, pour les sociétés de pays tiers, de sanctions administratives aux États-Unis, à la discrétion de l’exécutif (les sanctions possibles étant l’interdiction de recevoir des aides de l’Eximbank américaine, de bénéficier de licences d’exportation de technologie, de bénéficier de crédits aux États-Unis, de participer à leur système bancaire, de bénéficier de marchés publics fédéraux, voire d’exporter leur produits aux États-Unis) .
Le préambule du règlement de 1996 justifie ainsi la réaction communautaire : la liberté des flux commerciaux et d’investissement fait partie des objectifs communautaires ; les lois précitées, « par leur application extraterritoriale (…), violent le droit international et empêchent la réalisation des objectifs précités (…), affectent ou sont susceptibles d’affecter l’ordre juridique établi et lèsent les intérêts de la Communauté et ceux [de ses citoyens et entreprises] ».
Le règlement de 1996 prévoit des mesures de blocage très fortes :
– l’obligation pour les entreprises européennes dont les intérêts économiques et/ou financiers sont affectés, directement ou indirectement, par les lois américaines susmentionnées d’en aviser la Commission ;
– l’interdiction de reconnaître et rendre exécutoires dans ce qui était encore la Communauté européenne les décisions donnant effet à ces lois ;
– l’interdiction pour les citoyens et entreprises communautaires de se « conformer (…) aux prescriptions ou interdictions, y compris les sommations de juridictions étrangères, fondées directement ou indirectement sur les lois » en question (avec cependant des dérogations possibles sur autorisation des instances communautaires) ;
– un droit à indemnisation des citoyens et entreprises communautaires lésés en application des lois américaines susmentionnées, cette indemnisation étant à recouvrer « sur la personne physique ou morale ou toute autre entité qui a causé le dommage ou toute personne agissant en son nom ou en qualité d'intermédiaire », éventuellement suite à une saisie de leurs actifs en Europe...
Il est à noter que ce règlement a été adopté explicitement en 1996 pour contrer les lois Helms-Burton et d’Amato-Kennedy, mais pourrait être utilisé contre d’autres législations abusives si l’Union européenne en décidait ainsi : selon son article 1er, le Conseil pourrait décider de l’appliquer à d’autres lois étrangères extraterritoriales.
La question aujourd’hui posée est celle de son éventuelle relance et actualisation (une proposition de refonte du texte a été déposée par la Commission européenne en février 2015 mais ne semble pas prioritaire dans les travaux des instances européennes…).
V. LES RECOMMANDATIONS DE LA MISSION : JOUER À ARMES ÉGALES
La mission considère comme nécessaire de faire valoir auprès des États-Unis que certaines pratiques sont devenues abusives et que la France ne les acceptera plus.
On peut identifier trois grands types de réactions aux abus d’extraterritorialité juridique américaine :
– jouer la confrontation ;
– essayer de contourner les difficultés ;
– chercher à limiter cette extraterritorialité par une coopération renforcée.
Les administrations françaises entendues par la mission sont clairement dans une optique de coopération avec les États-Unis, ce sans doute pour plusieurs raisons :
– le partage d’objectifs diplomatiques convergents avec les États-Unis, notamment concernant les principaux pays sous sanctions (Russie et Iran) – ce qui n’était pas le cas s’agissant de Cuba au moment de la loi Helms-Burton –, renforcé sans doute par la priorité à la lutte contre le terrorisme, laquelle implique des échanges de renseignements « sans nuages » avec les États-Unis. On ne peut guère tout à la fois affirmer la priorité à la lutte contre les circuits de financement du terrorisme et à la promotion de la transparence financière, ce qui est le cas de la France dans le contexte présent (61), et critiquer trop vivement l’efficacité de l’administration américaine dans la détection et la répression de mouvements financiers avec des pays très « douteux » ou des entités et personnes suspectées d’activités terroristes ;
– la difficulté à attaquer des dispositions américaines comme le FCPA et le FATCA qui s’inscrivent dans un cadre international également promu par la France et poursuivent des objectifs éminemment louables (lutter contre la corruption et la fraude fiscale) ;
– l’improbabilité d’une unité de l’Union européenne pour se confronter aux États-Unis comme cela a pu être le cas dans le passé (voir infra).
La mission considère que la seule coopération ne permettra pas de résoudre les problèmes apparus depuis quelques années. Un rapport de force doit être instauré.
En conséquence, la mission préconise l’adoption de mesures et la mise en œuvre d’actions diplomatiques visant parallèlement :
– à se doter d’instruments juridiques comparables à ceux des États-Unis, à l’instar d’une transaction pénale à la française, ayant une portée extraterritoriale, afin d’être à « armes égales » dans la lutte contre la corruption ;
– à faire cesser certaines conséquences préjudiciables de cette extraterritorialité, comme par exemple en ce qui concerne les « Américains accidentels ».
A. EXIGER LA RÉCIPROCITÉ ET SE DOTER D’ARMES ÉGALES POUR IMPOSER DES POLITIQUES COOPÉRATIVES
La lutte contre la corruption internationale et celle contre l’évasion fiscale des particuliers, laquelle constitue l’objet des dispositions « FATCA », sont, au-delà des engagements conventionnels pris dans le cadre de l’OCDE ou bilatéralement, deux « causes » que la France soutient pleinement. Cet état de fait conduit inéluctablement à privilégier l’option des politiques coopératives : outre que notre pays est lié par des instruments de droit international, il ne peut qu’adhérer au principe d’une action efficace et en coopération sur ces dossiers.
1. Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : être à armes égales dans la lutte contre la corruption internationale
Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, tel que voté à l’Assemblée nationale, s’inscrit clairement dans une optique de recherche de solutions plus efficaces dans la lutte contre la corruption internationale.
Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique comprend des mesures fortes.
Outre qu’il institue une Agence française anticorruption, il renforce les moyens de prévention et de répression de la corruption de plusieurs manières, dans une optique qui n’est pas celle d’une compétence universelle, mais clairement d’un élargissement de l’emprise extraterritoriale du système de lutte français contre la corruption. Il institue notamment une obligation de mettre en place des dispositifs de prévention et détection de la corruption (« conformité ») dans les grandes entreprises (article 8), ainsi qu’une peine complémentaire de « mise en conformité » pour les entreprises condamnées pour corruption (article 9), laquelle peut être vue comme une transposition du système américain du monitoring.
Le projet tel que voté à l’Assemblée nationale comprend aussi une définition des « lanceurs d’alerte » et des mesures de protection de ceux-ci contre le licenciement et les autres sanctions professionnelles (articles 6A et suivants). Il confie au Défenseur des droits la mission d’accorder aux lanceurs d’alerte des aides financières à titre de réparation (de la perte de leur emploi).
Mais le débat s’est surtout centré sur l’opportunité d’inclure dans le texte une forme de « transaction pénale » comme il en existe dans d’autres pays, en particulier aux États-Unis, susceptible de répondre aux intérêts bien compris des entreprises comme des autorités judiciaires : du point de vue des premières, il s’agirait d’accélérer les procédures pour solder les dossiers préjudiciables à leur réputation, avec l’avantage que le paiement d’une grosse amende transactionnelle aurait pour contrepartie l’absence de condamnation pénale formelle ; pour les secondes, un tel dispositif permettrait de dépasser certaines difficultés juridiques, notamment quant à l’administration de la preuve dans des dossiers internationaux, aujourd’hui trop dépendante d’une coopération judiciaire trop chaotique et inégale selon les partenaires.
L’article 12 bis adopté par l’Assemblée nationale, sur recommandations du président et de la rapporteure de la présente mission, institue une « convention judiciaire d’intérêt public » qui pourrait être proposée par le parquet (éventuellement suite à une transmission du dossier par un juge d’instruction) aux entreprises poursuivies pour des faits de corruption ou de trafic d’influence. Cette « convention », si l’entreprise l’acceptait, pourrait prévoir plusieurs mesures : versement d’une amende au Trésor Public d’une somme proportionnée aux avantages tirés des manquements dans la limite de 30% du chiffre d’affaires moyens annuel des trois dernières années ; programme de « mise en conformité » de trois ans au plus ; mesures de réparation pour les victimes. Elle devrait être validée par un magistrat du siège en audience publique. L’ordonnance de validation n’emporterait pas « déclaration de culpabilité » et ne serait pas inscrite au casier judiciaire ; mais elle serait publiée.
L’option « coopérative » de rapprochement, de fait, avec les dispositions en vigueur aux États-Unis n’enlève rien, par ailleurs, à la nécessité de se doter d’instruments juridiques plus forts pour bloquer certaines pratiques extraterritoriales. Comme ces instruments sont les mêmes face aux différents cas de figure d’extraterritorialité, ils sont globalement présentés infra dans le développement consacré aux « lois de blocage ».
Recommandation : Instaurer une convention judiciaire d’intérêt public. Cette recommandation de la mission a donné lieu à l’article 12 bis du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Au-delà cette transaction pénale à la française, il est également préconisé la mise en place de lois extraterritoriales en matière de corruption internationale. Sur proposition de Pierre Lellouche en première lecture et de Karine Berger en seconde lecture, l’article 12 du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique s’inscrit résolument dans cette démarche. Il vise, en effet, à lever les entraves à la compétence des autorités de poursuite françaises en matière de corruption et de trafic d’influence pour les faits commis à l’étranger (voir supra). Cet article pourrait donc permettre l’éventuelle poursuite, devant la justice française, d’entreprises étrangères pour des faits de corruption commis à l’étranger dès lors que l’entreprise corruptrice a une quelconque activité économique en France. Il pourrait, également, ouvrir la voie à des procédures concertées avec les autorités américaines pouvant limiter, par la même occasion, l’intrusion des législations des États-Unis.
Recommandation : Instaurer une disposition extraterritoriale permettant l’éventuelle poursuite, devant la justice française, d’entreprises étrangères pour des faits de corruption commis à l’étranger dès lors que l’entreprise corruptrice a une quelconque activité économique en France. Cette recommandation a été intégrée à l’article 12 du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
2. Les solutions envisagées au problème des « Américains accidentels »
Face aux problèmes liés aux « Américains accidentels », il semble que l’administration fiscale américaine elle-même reconnaisse qu’il existe un problème à vouloir appliquer à ces personnes le statut de contribuable. Selon une note rédigée par M. Fabien Lehagre, animateur du Collectif pour la défense des intérêts des Américains accidentels, le département du Trésor américain formulerait, dans son document d’explication générale sur ses propositions fiscales pour 2016, la proposition d’exclure du statut de contribuable les individus qui :
– sont, à la naissance, devenus citoyens des États-Unis et citoyens d’un autre pays ;
– à tout moment, jusqu’à et au moment de la date d’expatriation, ont été citoyens d’un autre État que les États-Unis ;
– n’ont pas été résidents des États-Unis depuis qu’ils ont atteint l’âge de 18 ans ½ ;
– n’ont jamais détenu un passeport américain ou ont détenu un passeport américain dans le seul but de partir des États-Unis ;
– renoncent à leur nationalité dans les deux ans suivant le 1er janvier 2016 ou dans les deux ans suivant la date à laquelle ils apprennent qu’ils sont citoyens américains ;
– et certifient sur l’honneur être en conformité avec toute les obligations fiscales qui ont pu leur incomber dans la période de cinq ans précédant leur sortie du territoire américain.
L’adoption d’une telle législation réglerait nombre de problèmes si effectivement elle permettait une procédure rapide et gratuite ou peu coûteuse de renonciation à la citoyenneté. Il faudrait toutefois sans doute amender la proposition sur l’obligation de ne jamais avoir détenu de passeport américain, car beaucoup d’Américains accidentels ont en demandé pour voyager outre-Atlantique (sans pour autant que cela ait resserré leur liens avec les États-Unis : il s’agissait généralement de tourisme, parfois de brèves visites familiales).
On pourrait aussi imaginer, le cas échéant par le biais d’un amendement à la convention fiscale bilatérale, une implication du fisc français dans une procédure qui permettrait aux Américains accidentels (voire aux autres résidents américains) de satisfaire de manière simplifiée (et sans frais) à leurs obligations déclaratives américaines, notamment quand en pratique ils ne sont redevables d’aucun impôt américain : par exemple, l’administration fiscale française certifierait qu’à sa connaissance une personne ne dispose pas de revenus dépassant les seuils d’assujettissement américains (assez élevés pour les non-résidents) et celle-ci serait réputée avoir rempli ses obligations américaines…
Recommandation : soit par la négociation d’un amendement à l’accord fiscal bilatéral, soit par une action diplomatique forte favorisant le vote d’une disposition législative américaine ad hoc, obtenir un traitement dérogatoire pour les « Américains accidentels » leur permettant, soit de renoncer à la citoyenneté américaine par une procédure simple et gratuite, soit d’être exonérés d’obligations fiscales américaines.
En ce qui concerne la réciprocité, le gouvernement américain s’est engagé par l’accord FATCA de 2013 à agir en sorte qu’une réciprocité complète soit possible quant aux renseignements échangés. Selon l’article 6 de l’accord, « le Gouvernement des États-Unis convient de la nécessité de parvenir à des niveaux équivalents d’échanges automatiques de renseignements avec la France (…) en continuant à adopter des mesures de nature réglementaire et en défendant et en soutenant l’adoption de lois appropriées afin d’atteindre ces niveaux équivalents d’échanges automatiques réciproques de renseignements ». De plus, « les États-Unis s’engagent à adopter, d’ici au 1er janvier 2017, pour les déclarations qui concernent 2017 et les années suivantes, des règles qui imposent aux institutions financières déclarantes américaines d’obtenir et de déclarer, s’agissant des entités françaises, le NIF [numéro d’identification fiscale] français et, s’agissant des personnes physiques, la date de naissance (…) ». Il ressort des auditions qu’une initiative législative allant dans le sens serait envisagée, mais toujours pas votée…
Recommandation : exercer l’action diplomatique nécessaire pour que les engagements de réciprocité complète pris par l’administration américaine dans le cadre de l’accord dit FATCA soient tenus.
B. LES EMBARGOS ET SANCTIONS ÉCONOMIQUES : UN RENFORCEMENT DES MOYENS EUROPÉENS ET UNE CLARIFICATION DIPLOMATIQUE INDISPENSABLE AVEC LES ÉTATS-UNIS
1. La possibilité de rendre les dispositifs plus efficaces et transparents en s’inspirant des pratiques américaines
a. Le projet de loi relatif à la violation des embargos et autres mesures restrictives
Le recours aux infractions douanières pour des faits de violation d’embargos décidés par la France a fait l’objet de critiques (voir supra). Afin d’y répondre, un projet de loi « relatif à la violation des embargos et autres mesures restrictives » destiné à donner plus de visibilité à la répression de ces violations, à la renforcer et à répondre à certaines des insuffisances susmentionnées a été déposé.
Ce texte a, cependant, connu un processus législatif chaotique : déposé en 2006 et adopté par le Sénat en première lecture en octobre 2007, il n’a ensuite été examiné et voté par l’Assemblée nationale qu’en janvier 2016, après que son inscription à l’ordre du jour eut été deux fois envisagée, puis abandonnée (en 2008 puis 2013)… Le texte attend maintenant sa deuxième lecture au Sénat.
L’objet principal du projet de loi en navette est d’insérer dans le code pénal un délit de violation des embargos et des mesures restrictives.
Il donne donc une définition de ce qu’est un « embargo » ou une « mesure restrictive » en étendant à cette occasion le champ visé dans le droit répressif en vigueur, jugé insuffisant (voir supra) : les activités de « formation, de conseil ou d’assistance technique » sont formellement visées comme pouvant faire partie des sanctions économiques, de sorte que leur prestation illicite pourrait désormais être réprimée ; de plus la définition, large, vise potentiellement toutes activités « en relation avec une puissance étrangère, une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents ou toute autre personne », ce qui devrait permettre de réprimer les violations indirectes des embargos et sanctions et couvre aussi les entités non étatiques (comme Daesh).
Par ailleurs, il est prévu, dans le texte tel que voté par l’Assemblée nationale, un durcissement des peines, qui pourraient atteindre sept ans de prison et/ou 750 000 euros d’amende, montant pouvant être porté « au double de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou de la valeur des biens et services ayant été l’objet de transactions illicites ». Les peines complémentaires applicables aux sociétés, comprenant notamment un quintuplement de l’amende maximale, et la confiscation sont également prévues. Enfin, en cas de violation d’embargo sur les armements, l’application extraterritoriale de la loi à des Français, en cas de délit commis à l’étranger, serait facilitée par la levée des conditions restrictives de double incrimination et de plainte préalable de la victime ou de ses ayant-droit ou dénonciation par l’autorité du pays étranger.
Si l’on devait s’inscrire dans la même logique que le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, c’est une troisième solution qu’il faudrait privilégier, celle d’une forme de transaction pénale, bénéficiant d’une large publicité, pour toutes violations de sanctions françaises et européennes de la part d’entreprises étrangères qui auraient des activités en France , afin de concilier efficacité et transparence nécessaire des sanctions – et dans l’espoir éventuel, en prononçant quelques peines exemplaires, de parvenir au même non bis in idem « pragmatique » avec les États-Unis que celui recherché en matière de corruption internationale.
Recommandation :
– conduire à son terme le processus législatif en cours depuis 2006 visant à clarifier, élargir et renforcer la répression des violations des sanctions internationales et embargos appliqués par la France ;
– au regard des résultats de l’expérience engagée en matière de répression de la corruption (suite à la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique), envisager d’introduire un dispositif de transaction pénale de même inspiration (homologuée par la justice et rendue publique) en matière de violations des embargos par toutes entreprises ayant une activité en France.
b. Vers un « OFAC européen » ?
Le présent rapport a identifié les difficultés relatives à l’articulation entre l’Union européenne et les États membres en ce qui concerne l’édiction et l’application des sanctions internationales (voir supra). Dès lors, la question de l’action au niveau européen doit être posée, puisque les sanctions économiques que doit appliquer la France sont en pratique toujours décidées à ce niveau.
La réponse logique à la situation présente semble être d’instituer une sorte d’équivalent européen de l’OFAC : une agence européenne qui serait chargée d’appliquer les sanctions européennes du point de vue administratif (délivrance des licences et contrôle de l’application des mesures, avec ensuite transmission éventuelle des dossiers litigieux aux administrations et juridictions des États membres). Pourquoi l’Union européenne ne se doterait-elle pas, comme en matière de droit de la concurrence, des moyens administratifs d’appliquer un droit qu’elle édicte ?
M. Simond de Galbert ne croit pourtant guère en cette option dans le contexte présent de l’Union européenne et propose donc des pas intermédiaires : mise en place de transmissions directes d’informations sensibles aux juridictions amenées à se prononcer sur le bien-fondé de sanctions individuelles ; harmonisation des procédures nationales de licences ; adoption de dispositions répressives « crédibles » ; meilleur partage des informations entre agences nationales et recours à des panels d’experts au niveau européen…
Faut-il pour autant renoncer à l’idée d’un équivalent européen de l’OFAC ? On peut en fait se demander si l’« OFAC européen » n’existe pas déjà, en puissance, dans le cadre de l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF). L’OLAF a été institué en 1999 et son champ de compétence s’étend à tous les comportements illégaux portant préjudice aux intérêts financiers de l’Union européenne. Or, les droits de douane représentent l’une des ressources propres de l’Union et, pour cette raison, l’OLAF est habilité à mener des enquêtes sur les fraudes douanières et le fait effectivement. Les rapports relatifs à son activité (62) mentionnent par exemple :
– la détection d’importations frauduleuses de biodiesel « indien », lequel provenait en réalité des États-Unis et ne transitait par l’Inde (où l’on y rajoutait un peu de carburant local ou bien procédait à un vague « traitement ») que pour bénéficier d’une exemption de droits de douane à l’entrée dans l’Union ;
– le contournement des droits anti-dumping européens sur les panneaux solaires chinois en falsifiant leur origine et en faisant transiter ceux-ci via le Japon ou la Malaisie.
En menant ce genre d’enquêtes, l’OLAF a montré qu’il était capable de conduire des investigations internationales, impliquant des entreprises dans plusieurs pays, sur des flux commerciaux illicites. Il pourrait donc sans doute faire de même s’agissant de la violation d’embargos commerciaux (et probablement d’embargos financiers), étant rappelé qu’en tout état de cause l’office n’a pas de pouvoir de sanction (les dossiers établissant des infractions sont transmis aux autorités nationales compétentes).
Il faut toutefois signaler une difficulté institutionnelle susceptible de rendre difficile, dans le système européen, un élargissement des missions de l’OLAF aux questions de sanctions économiques ou l’établissement d’un équivalent de l’OFAC par un autre biais : les sanctions relèvent de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), laquelle, issue du « deuxième pilier » de l’Union, reste selon le traité sur l’Union européenne une politique strictement intergouvernementale (compétence exclusive du Conseil européen et du Conseil des ministres ; exigence d’unanimité ; absence d’actes législatifs ; rôles réduits du Parlement européen, qui doit seulement être consulté, et de la Commission ; compétence très restreinte de la Cour de justice) ; cela rend a priori plus complexe la mise en place de ce qui serait une nouvelle agence administrative opérationnelle, car celle-ci ne pourrait pas être rattachée à la hiérarchie administrative classique dépendant de la Commission et son action devrait s’exercer dans un cadre intergouvernemental régi à l’unanimité.
M. Simond de Galbert recommande enfin de chercher à négocier avec les États-Unis un système de reconnaissance mutuelle des licences d’exportations délivrées dans le cadre des dispositifs de sanctions des uns et des autres.
Recommandation : chercher à surmonter les difficultés résultant de l’articulation actuelle des dispositifs de sanctions internationales dans l’Union européenne (édiction au niveau communautaire de dispositifs appliqués nationalement) par des mesures telles que :
– la facilitation des échanges d’informations entre les services chargés de l’application de ces sanctions dans les différents États membres ;
– la poursuite de l’harmonisation des pratiques nationales, notamment en matière de délivrance de licences ;
– un effort d’harmonisation de la répression des violations, qui devrait atteindre un minimum de crédibilité et de publicité dans tous les États membres ;
– un meilleur accès des juridictions européennes aux informations qui justifient les mesures individuelles de gels d’avoirs, afin de limiter les cas où ces juridictions censurent ces mesures ;
– le lancement d’une initiative en vue de créer un office européen chargé d’appliquer les mesures édictées par l’Union (gestion des licences, information des entreprises et le cas échéant investigation et sanction administrative des infractions), éventuellement par élargissement des missions de l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF).
2. Une demande de clarification du régime des sanctions concernant l’Iran
Le régime de sanctions américains à l’encontre de l’Iran, tel qu’il résulte du JCPOA, emporte des conséquences préjudiciables pour les entreprises françaises via les réticences des banques de financer des projets en Iran (voir supra).
Certes les banques internationales sont désormais habilitées, sur le plan juridique, à effectuer des transactions avec l’Iran, sous la triple condition de ne pas utiliser un seul dollar dans celles-ci, de n’y impliquer en aucun cas leurs filiales aux États-Unis (soumises au droit américain conformément au principe de territorialité) et enfin de s’assurer qu’elles ne font aucune opération avec des entités iraniennes restant sous un régime de sanctions spécifiques. Mais, en pratique, elles sont légitimement découragées vu la complexité des opérations de financement, donc la difficulté de remplir de manière certaine ces conditions, et les risques juridiques et financiers encourus.
Tous ces facteurs cumulés, dont l’incidence respective peut être débattue, conduisent en tout état de cause à un résultat simple à ce jour : des entreprises françaises ont engagé des démarches commerciales en Iran et parfois signé des protocoles précontractuels. Mais cela s’arrête là : les engagements contractuels et financiers réels sont bloqués jusqu’à nouvel ordre.
Une option pour sortir de cette difficulté pourrait être l’obtention, de la part des autorités américaines, d’une sorte de licence générale qui validerait les opérations n’impliquant pas le dépassement de certains seuils en matière d’usage du dollar et d’implication d’US Persons telles que les filiales américaines. Des opérateurs « de bonne foi » seraient peut-être ainsi délivrés de la crainte d’avoir à assumer des erreurs qui peuvent avoir des conséquences dramatiques pour les entreprises.
Plus fondamentalement, les interrogations sur la gestion des suites de l’accord sur le nucléaire iranien posent une question de stratégie : faut-il vraiment rechercher des solutions « coopératives » et donc se réjouir de l’obtention de certaines clarifications, même si celles-ci ont pour effet de « graver dans le marbre » un certain nombre d’interprétations extraterritoriales extensives des administrations américaines ? A fortiori si cette situation conduit en pratique à bloquer largement la relance des affaires avec l’Iran, ce non seulement aux dépens des intérêts légitimes des entreprises européennes, mais surtout des objectifs diplomatiques officiellement poursuivis, qui impliquent que l’Iran tire réellement un bénéfice économique et financier rapide de l’accord ?
Recommandation : poursuivre les démarches engagées auprès de l’administration américaine afin de rendre effective l’application de l’accord sur le nucléaire iranien du 14 juillet 2015 :
– en obtenant des clarifications complémentaires sur la portée exacte des sanctions américaines restant en place (degré d’implication indirecte dans une opération d’un US Person ayant pour effet de faire tomber cette opérations sous les sanctions « primaires » ; caractère exclusif de la liste présente des entités sanctionnées dites SDN ; modalités d’une éventuelle remise en cause de l’accord ou snapback…) ;
– inviter l’administration américaine à lever les sanctions, notamment « secondaires », dont la mise en œuvre relève de l’exécutif, ou à prévoir des exemptions (waivers) de portée générale ;
– mettre en particulier l’accent sur les dispositifs les plus handicapants tels que le maintien de la prohibition des transactions dites U-Turn pour assurer la compensation à New-York d’opérations en dollars restant soumises aux sanctions « primaires » (mais pas « secondaires »), ou encore l’interdiction d’ouvrir aux États-Unis des comptes de correspondance pour les banques étrangères impliquées dans certaines transactions en Iran.
*
Recommandation : mettre nos moyens de renseignement économique au service de nos entreprises, notamment pour les aider à s’assurer que leurs co-contractants iraniens ne sont pas, directement ou indirectement, des personnes et entités restant sous sanctions.
3. Les options de confrontation
De manière plus générale, il est nécessaire d’établir un rapport de force concernant les sanctions internationales des États-Unis, si possible dans le cadre des organes internationaux de commerce.
L’Union européenne a, dans un passé qui n’est pas si lointain, accepté des confrontations avec les États-Unis concernant des lois extraterritoriales, confrontations qui ont conduit les administrations américaines à reculer.
i. L’affaire du gazoduc sibérien
Au début des années 1980, la France et l’Allemagne étaient entrées en négociation avec l’URSS pour accroître la fourniture de gaz soviétique à l’Europe occidentale, ce qui passait par la construction d’un gazoduc depuis le gisement d’Ourengoï en Sibérie. Un consortium fut alors constitué, comprenant plusieurs filiales européennes d’entreprises américaines.
Cependant, l’administration américaine était décidée à bloquer un projet qui renforçait la dépendance européenne aux hydrocarbures soviétiques et devait amener des devises à l’URSS. Suite à l’instauration de la loi martiale en Pologne en décembre 1981, le président Ronald Reagan décréta des sanctions économiques contre l’URSS, notamment dans le secteur énergétique, qui s’imposaient également aux filiales américaines à l’étranger. Cela n’empêcha pas la signature du contrat avec les Soviétiques et la Communauté européenne réagit aux pressions américaines par des mesures radicales, comme la réquisition des entreprises qui prétendaient appliquer les sanctions américaines ou la menace de poursuites pénales contre elles.
Après une phase de grande tension, où les États-Unis révoquèrent les licences d’exportation de certaines entreprises européennes, l’évolution de la situation politique (avec la libération de M. Lech Walesa en Pologne) permit un apaisement : les États-Unis levèrent leurs sanctions et rétablirent les licences européennes suspendues.
ii. Les lois Helms-Burton et d’Amato-Kennedy
En 1996, le Congrès avait adopté les lois dites Helms-Burton et d’Amato-Kennedy qui sanctionnaient délibérément les entreprises non-américaines qui auraient certaines activités économiques à Cuba, en Libye et en Iran. Ce qui était encore la Communauté européenne avait là-aussi réagi vivement (de même que d’autres pays pourtant très liés aux États-Unis, comme le Canada). La réaction européenne avait comporté :
– l’adoption d’un règlement interdisant aux citoyens et entreprises communautaires de se conformer à ces lois (voir encadré infra pour plus de détail) ;
– une saisine de l’OMC (procédure non aboutie car abandonnée) ;
– la recherche d’une solution politique négociée.
De fait, la réaction européenne avait été efficace : lors du sommet Communauté/États-Unis du 18 mai 1998, les deux parties étaient parvenues à un accord sur la levée des procédures contre les entreprises européennes qui étaient dans le viseur de l’administration américaine (notamment Total pour ses investissements en Iran) et des dispositifs durables de dérogation au profit de ces entreprises, en échange d’engagements européens de principe (tels que tenter de dissuader l’Iran d’acquérir des armes de destruction massive).
b. Saisir l’Organisation mondiale du commerce ?
L’organe de règlement des différends de l’OMC avait donc été saisi de la conformité des lois Helms-Burton et d’Amato-Kennedy, avant que la Communauté européenne ne se désiste de son action compte tenu de l’arrangement politique trouvé.
Effectivement, ainsi que le développe l’article précité du professeur Bismuth, le recours à l’OMC pourrait offrir « des chances raisonnables de succès afin de contester les mesures extraterritoriales américaines dans le domaine des sanctions économiques unilatérales ».
Mais l’auteur ajoute aussitôt : « s’il s’agit certainement du forum le plus adéquat pour que soient débattues de telles questions dans un contexte multilatéral, il faut néanmoins une volonté politique de l’Union européenne à s’engager dans cette voie » : en effet, la saisine de l’organe de règlement des différends de l’OMC appartient aux seuls États ou entités liées par l’OMC et exerçant les compétences commerciales internationales, donc, pour l’Union européenne et ses membres, à la seule Commission européenne.
La Commission aurait-elle cette volonté d’accepter la confrontation avec les États-Unis aujourd’hui ? On peut en douter vu les préoccupations présentes de l’Union européenne et le poids relatif qui y est celui des pays les plus « atlantistes ».
Par ailleurs et surtout, il faut être conscient qu’une éventuelle invocation aux règles de l’OMC risquerait de fragiliser tout autant les régimes européens de sanctions internationales que les régimes américains… En effet, il y a une différence fondamentale entre la situation de 1996 et celle de 2016 : il y a vingt ans, l’Union européenne ignorait largement les politiques de sanctions économiques internationales, qu’elle ne pratiquait pas ou seulement en suivant le Conseil de sécurité des Nations-Unies ; mais aujourd’hui, l’Union a fait des sanctions l’un des outils essentiels de son action diplomatique propre (de fait le principal concernant par exemple la Russie) ; de plus elle s’efforce d’adopter lesdites sanctions en coordination avec celles des États-Unis.
Recommandation : expertiser la conformité des régimes de sanctions internationales des États-Unis aux engagements pris dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, ainsi que l’opportunité d’une saisine de l’organe de règlement des différends de celle-ci dans un contexte où l’Union européenne utilise également de plus en plus l’instrument des sanctions économiques.
Si une telle saisine se révèle opportune, introduire un recours devant l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce
c. Le renforcement des « lois de blocage »
Les « lois de blocage » françaises et européennes, si elles ont le mérite d’exister, présentent, néanmoins, des défauts et lacunes importants (voir supra).
Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dispose (à l’article 3) que la future Agence anticorruption aura notamment pour mission de veiller, « à la demande du Premier ministre, au respect de la loi [de blocage de 1968] dans le cadre de l’exécution des décisions d’autorités étrangères imposant à une société française une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ».
Si cette disposition semble aller dans le bon sens pour une meilleure effectivité de la « loi de blocage » de 1968, le caractère contraignant limité de cette loi doit amener d’autres modifications.
Recommandation : amender la « loi de blocage » de 1968 :
– en revoyant sa rédaction pour bien identifier les informations réellement sensibles dont la transmission à des autorités étrangères doit être exclue ou restreinte ;
– en y prévoyant un encadrement strict du contrôle/monitorat accepté par les entreprises françaises dans le cadre de transactions pénales avec des autorités étrangères (contrôle de l’administration sur le choix des contrôleurs/moniteurs et les informations transmises à ces autorités étrangères) ;
– en renforçant les sanctions pénales en cas de non-respect de la loi, de sorte qu’elle soit plus crédible pour les autorités et juridictions étrangères, notamment américaines, et puisse donc être admise comme « excuse légale ».
Recommandation : lancer ou relancer le processus d’actualisation du règlement européen de blocage de 1996, afin de l’étendre, le cas échéant, à d’autres législations américaines que les lois d’Amato-Kennedy et Helms-Burton.
4. Les stratégies de contournement : promouvoir l’euro, privilégier les cotations boursières en Europe, …
Au moins s’agissant du problème posé par l’usage du dollar comme fondement des pénalités contre des banques européennes, des stratégies de contournement sont envisageables :
– il y a d’abord l’option des financements privés et paiements non bancaires, qui a été grandement explorée par certains pays (il semble ainsi que la Turquie réglait en or une part importante de son commerce avec l’Iran ces dernières années – c’est du moins l’explication la plus convaincante que l’on peut trouver au niveau élevé des « exportations » d’or depuis la première vers la seconde, alors même que la Turquie n’est pas productrice du métal précieux) ;
– il y a aussi celle du recours à des banques « petites » ou « moyennes » qui ne sont pas exposées aux États-Unis. Le système bancaire allemand, beaucoup moins concentré que le nôtre, semble offrir à cet égard des opportunités.
– il y a enfin et surtout, puisque le cœur du problème est l’usage du dollar, la question du rôle de l’euro.
Il semble que l’euro se soit peu imposé comme monnaie de substitution au dollar pour ce qui est de la facturation et du paiement des flux commerciaux internationaux. Les grands marchés internationaux de matières premières, en particulier, restent libellés en dollars. Certes, d’après les statistiques de la Banque centrale européenne (63), l’euro serait la monnaie de facturation de 58 % des échanges de la zone euro (avec des pays hors zone euro) en 2015. Mais ce taux est tendanciellement en recul : il était proche de 70 % en 2011. S’agissant de la globalité des paiements internationaux, l’euro a également perdu du terrain depuis quelques années. Sa part dans les paiements globaux serait même passée depuis 2012 de 44 % à 29 % !
Évolution de la part des différentes monnaies dans les paiements internationaux globaux sur la plateforme SWIFT
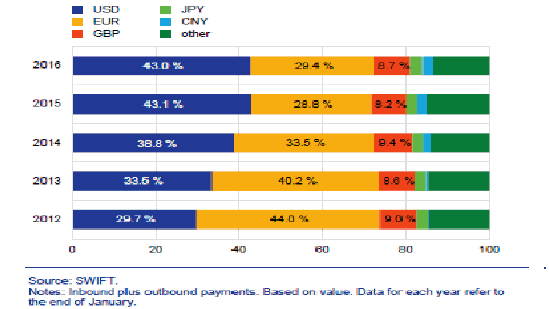
Source : rapport de la BCE sur le rôle international de l’euro, juin 2016.
De récentes statistiques (64) de la plate-forme de paiements interbancaires internationaux SWIFT portant sur la monnaie de libellé des « crédits documentaires », qui constituent l’un des modes classiques de règlement des transactions commerciales courantes, sont encore plus accablantes : le dollar y reste prédominant, avec près de 80 % de « part de marché » ; depuis 2013, la seconde devise y est désormais le yuan, du fait d’une politique volontariste de la Chine, avec, début 2015, une part de marché de 9,4 % ; l’euro n’arrive plus qu’en troisième position, à 6,4 %. Ces chiffres ne rendent sans doute compte que d’une fraction du commerce international, mais doivent cependant faire réfléchir.
Malgré ces constats d’un déclin du rôle international de l’euro depuis quelques années (sans doute lié à la crise de confiance dans la zone euro), la Commission européenne a produit un rapport sur le sujet (présenté et discuté à l’Eurogroupe du 11 février 2016) sur la base duquel elle déduit qu’il n’est pas nécessaire de prendre d’actions supplémentaires pour remédier aux obstacles microéconomiques à l’utilisation de l’euro.
Recommandation : inviter les instances européennes à enrayer le déclin de l’usage international de l’euro dans les paiements depuis quelques années et à promouvoir la monnaie européenne comme monnaie internationale.
Une autre stratégie d’évitement relève des choix des entreprises : compte tenu notamment des risques inhérents au fait d’être cotées à la bourse de New-York – assujettissement aux lois comptables américaines et à la loi FCPA –, certaines ont décidé de s’en retirer (par exemple Technip en 2007). Mais cette option a bien sûr ses inconvénients : perte d’accès aux sources de financement considérables des marchés financiers américains ; perte de confiance possible des actionnaires américains déjà présents, qui représentent souvent une part très conséquente de l’actionnariat des grandes entreprises… C’est pourquoi elle n’est exercée que par un nombre limité d’entreprises.
C. LES OUTILS NECESSAIRES : SE DOTER DES MOYENS POUR ÊTRE « À ARMES ÉGALES »
1. En matière de renseignement économique
La mise en place des différentes politiques proposées face aux débordements de l’extraterritorialité juridique américaine implique un préalable: il est nécessaire que notre pays dispose en matière de renseignement économique d’outils permettant, sinon d’être « à armes égales » avec les services américains – compte tenu de l’énormité de leurs moyens et, de fait, de la qualité des dossiers qu’ils « montent » contre les entreprises –, du moins d’être plus crédible. Cela vaut d’ailleurs aussi bien dans une optique coopérative – pour démontrer notre capacité à conduire nous-mêmes des procédures efficaces – que bien sûr dans une optique de confrontation…
Comme il a été indiqué supra, les administrations américaines chargées de débusquer la corruption internationale et les violations de sanctions internationales s’appuient massivement sur leurs services de renseignement, ainsi que sur le traitement de masse des données disponibles, et ne s’en cachent pas. Et les moyens de ces services sont considérables : cinquante fois ceux des nôtres, soit, rapporté aux PIB, un effort américain de renseignement environ sept fois plus élevé que l’effort français…
S’agissant du renseignement dans les domaines économiques et financiers, il est spécifiquement assuré en France par deux services, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et TRACFIN (pour « Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins »). Ces deux services emploieraient environ 800 agents pour un budget d’un peu plus de soixante millions d’euros (65), lequel ne représente donc qu’environ 5 % du budget global (déjà limité) du renseignement français.
Le renseignement économique est également une mission des services à vocation « généraliste », qui y consacrent des moyens significatifs, mais n’y est pas toujours distingué du contre-espionnage et n’y est clairement pas une priorité dans la période actuelle. Pourtant, selon la formule d’un interlocuteur de la mission, le renseignement de sécurité, naturellement privilégié dans une période de risque terroriste majeur, ne devrait jamais occulter le renseignement de souveraineté.
Par ailleurs, un service à vocation moins directement opérationnelle et plus prospective et politique a été mis en place.
La mission a auditionné Mme Claude Revel, qui a été de 2013 à 2015 déléguée interministérielle à l’intelligence économique. Sa mission comprenait quatre piliers : information et anticipation ; sécurité économique ; influence ; formation et sensibilisation (notamment des universités et des grandes écoles).
La délégation interministérielle a ensuite été supprimée au bénéfice d’un nouveau service de l’information stratégique et de la sécurité économiques qui n’est plus rattaché au Premier ministre, mais au ministère de l’économie et des finances (plus précisément à la direction générale des entreprises). La mission du commissaire chargé du service est définie par le décret n° 2016-66 du 29 janvier 2016 : il « élabore et propose, en lien avec le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et les autres ministères concernés, la politique publique en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation. Il en anime la mise en œuvre et en évalue l’efficacité (…) ». Son action doit se déployer notamment dans quatre domaines qui recoupent largement les enjeux évoqués dans le présent rapport : « la protection et la promotion du patrimoine matériel et immatériel de l’économie française, notamment dans le cadre des opérations internationales menées par les acteurs économiques [rachats d’entreprises…] » ; « les standards de conformité s’appliquant aux entreprises en matière de relations financières avec l’étranger, de lutte contre les fraudes aux entreprises et contre la corruption et de responsabilité sociale et environnementale » ; « la défense de la souveraineté numérique » ; « les stratégies conduites en matière de normalisation ». La mission a également auditionné le commissaire à l’information stratégique et à la sécurité économiques nouvellement nommé, M. Jean-Baptiste Carpentier.
Il y a donc, incontestablement, une volonté de développer le renseignement économique aussi bien que l’action de veille et de réflexion sur les questions d’intelligence économique. Cependant, au-delà même de la question de la très grande disparité des moyens dédiés sur l’une et l’autre rive de l’Atlantique (et de la priorité évidemment et légitimement donnée, aujourd’hui, au contre-terrorisme), les travaux de la mission ont mis en lumière une différence de culture considérable, pour le moment, entre les États-Unis et notre pays. Selon l’une des personnalités auditionnées, il pourrait falloir dix ou quinze ans pour parvenir en France au même degré de collaboration et de partage de l’information économique entre services (notamment de renseignement et des grandes administrations économiques et financières) qu’aux États-Unis, donc à la même cohérence globale. L’un des interlocuteurs de la mission a même déclaré qu’en pratique il jouait un rôle de « traducteur » entre les administrations du ministère de l’économie et des finances et les services de renseignement afin que les unes et les autres puissent mutuellement comprendre leurs priorités et donc apprendre à partager rapidement les informations réellement utiles aux autres partenaires. Il apparaît aussi que certaines administrations conservent dans notre pays une très grande réticence à prendre en compte la dimension « sale » de l’économie, à accepter l’idée que tous les pays s’efforcent d’aider leurs entreprises dans certaines situations, nonobstant les principes de la « concurrence non faussée ».
Même s’ils sont peut-être moins prégnants que ces questions de « culture administrative », quelques obstacles juridico-administratifs ont aussi été signalés : en France, le parquet ne sollicite pas ou très rarement les services de renseignement et n’est pas le destinataire officiel des informations qui en proviennent (de même que d’autres sources) – ces informations doivent être « blanchies », selon l’expression entendue, en transitant (parfois formellement) par un service administratif ou policier d’enquête.
Plus spécifiquement, le parquet national financier n’est pas directement destinataire des informations recueillies par TRACFIN et pouvant déclencher une procédure, compte tenu de la rédaction actuelle du code monétaire et financier et d’une circulaire d’application : ces informations sont transmises au seul parquet territorialement compétent. Cependant, ce problème devrait être réglé dans le cadre de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique : l’article 26 ter du texte soumis en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale prévoit une transmission directe des notes d’informations de TRACFIN au parquet financier quand elles relèvent de sa compétence.
Au-delà de la question de l’« acculturation » de nos différents services et administrations et de la levée de quelques obstacles juridiques, celle de la fluidité des relations qu’ils entretiennent avec le secteur privé est également posée : la culture de la sécurité économique et de l’échange sur ces questions avec les administrations est manifestement plus avancée outre-Atlantique que chez nous. Les États-Unis ont également l’avantage de disposer de la plupart des grands cabinets de consultants internationaux capables de dispenser des prestations globales incluant les questions de sécurité, ainsi que des grandes entreprises de stockage et traitement de masse des données informatiques (big data), outil nouveau du renseignement économique.
Il faudrait enfin une plus grande affirmation au niveau politique de l’importance du renseignement économique : ses résultats étant moins « voyants », moins évidemment bénéficiaires pour l’ensemble de la population que ceux d’une action efficace de prévention des actes terroristes, il est d’autant plus nécessaire que les gouvernants affichent la priorité qu’ils donnent – aussi – à cette dimension du renseignement.
Recommandation : renforcer les moyens affectés en France au renseignement économique ; mieux coordonner les différents services qui en sont chargés et faciliter la circulation des informations entre ces services, le parquet national financier et la future Agence anticorruption ; lever les obstacles juridiques injustifiés à celle-ci ; donner une véritable priorité politique à l’intelligence économique, ce qui implique une dimension interministérielle.
2. En matière d’organisation judiciaire et d’outils juridiques
Le même type de constats vaut pour l’organisation de notre appareil judiciaire, ses moyens et ses outils.
S’agissant de la lutte contre la corruption internationale ou de l’application de leurs embargos internationaux, les États-Unis se sont dotés des outils administratifs et techniques idoines, comme on l’a vu : unité dédiée dans le cadre du FBI s’agissant de la corruption ; service dédié dans le cadre du Trésor s’agissant des embargos (l’OFAC) ; moyens humains conséquents ; centralisation des procédures de corruption au niveau du Department of Justice ; utilisation des transactions pénales, avec l’efficacité que l’on sait…
En France, aussi, les choses se structurent progressivement, avec la mise en place successive des pôles financiers, puis des juridictions interrégionales spécialisées (2004), enfin du parquet national financier (2013). Cependant, les moyens restent limités et les compétences juridiques parfois insuffisantes. À titre d’exemple, le Service central de prévention de la corruption n’emploie qu’une dizaine de personnes et reste essentiellement cantonné à des tâches d’études et de formation/sensibilisation, même s’il a quelques missions plus opérationnelles, comme l’application de la « loi de blocage ». Cependant, nous avons vu que la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique en cours d’examen devrait assez largement changer la donne (voir supra).
D. UNE AUTRE PISTE DE COOPÉRATION : LES NÉGOCIATIONS INTERNATIONALES, NOTAMMENT CELLE DU PARTENARIAT TRANSATLANTIQUE, OFFRENT-ELLES DES OPPORTUNITÉS D’AVANCER ?
La négociation en cours du Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI ou TTIP sous l’acronyme anglophone) n’a, semble-t-il, pas de lien direct avec les problèmes d’extraterritorialité, qui ne sont notamment pas évoqués dans le mandat de négociation donné aux négociateurs européens. Mais ils pourraient y rentrer plus ou moins directement et délibérément – pour autant que cette négociation débouche, hypothèse à ce jour de plus en plus aléatoire, mais c’est une autre question...
Les accords de libre-échange ne comprenaient pas, en général, de clauses concernant la corruption, mais le récent TPP y déroge en prévoyant des dispositions de « lutte contre la corruption » et les États-Unis ont proposé un texte de même nature pour le PTCI.
Le texte du TPP comprend des engagements précis pour les États signataires, non seulement de réprimer pénalement la corruption, mais aussi d’interdire la déduction fiscale des versements de corruption, d’adopter des règles contre la falsification comptable, de mettre en place des systèmes de dénonciation anonyme, voire un engagement moins contraignant d’« encourager » les entreprises à mettre en place des systèmes internes de prévention et de détection de la corruption.
Bref, il semble s’agir d’« exporter » le modèle américain de lutte contre la corruption.
Le dispositif comprend toutefois une précaution de taille : les contestations relatives à l’application par les différents signataires de leurs législations anti-corruption respectives ne peuvent pas être soumises au système d’arbitrage interétatique (contraignant et pouvant déboucher sur des mesures de compensation ou de rétorsion) prévu par le traité. Bref, un pays (les États-Unis par exemple...) ne pourra pas prétexter qu’un autre signataire n’applique pas vraiment ses loi anti-corruption pour déclencher contre lui une procédure conduisant éventuellement à la suspension des préférences commerciales accordées dans l’accord.
L’inscription de telles clauses dans le PTCI, sans changer en soi la problématique de l’application extraterritoriale des lois américaines en la matière, donnerait encore plus de force aux arguments américains selon laquelle cette application extraterritoriale serait « normale », puisqu’un accord international qui engagerait en l’espèce l’Union européenne aurait acté la validité internationale de ce « modèle ».
En contrepartie, l’Union européenne, si elle acceptait ce type de clauses anti-corruption dans le PTCI, pourrait au moins demander une clause « non bis in idem », inscrite dans le traité, de renonciation américaine à poursuivre les entreprises européennes pour corruption dès lors que l’Union ou ses États membres mettraient eux-mêmes en place un système anti-corruption efficace répondant aux prescriptions du traité et équivalent à celui des États-Unis. Par ailleurs, l’insertion, comme dans le TPP, d’une clause excluant les questions d’application des lois anti-corruption des dispositions d’arbitrage interétatique est nécessaire pour préserver les souverainetés nationales.
Recommandation : si tant est que la négociation globale ne soit pas suspendue, insérer dans le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI) :
– des clauses de publicité et de transparence obligatoires du champ d’application extraterritoriale éventuelle des législations des parties ;
– une obligation de réponse par les parties aux demandes d’information des entreprises des autres parties quant à la conformité des opérations qu’elles envisagent à ces législations ;
– des engagements anti-corruption comprenant une clause de « non bis in idem » en cas de poursuites par l’une des parties et une exclusion des questions d’application des lois anti-corruption des dispositions d’arbitrage interétatique.
Dans un monde « globalisé » et de plus en plus « dématérialisé », il est inévitable et sans doute aussi opportun, pour lutter contre certains défis transnationaux – le financement du terrorisme, le blanchiment de l’argent de la drogue, la grande corruption, l’évasion fiscale… –, que certaines législations économiques des grands États (ou entités supranationales comme l’Union européenne) aient une emprise dépassant leur frontières, donc extraterritoriale.
Cependant, dans ce contexte général, il existe de toute évidence un « problème » spécifique avec l’extraterritorialité pratiquée par les États-Unis, et ce problème concerne au premier chef l’Europe.
Les raisons de la dérive observée sont sans doute multiples : le fonctionnement intrinsèque de la justice américaine, avec ses procédures très intrusives et ses sanctions aussi sévères que difficiles à prévoir ; le choix réitéré, au fil des années, des autorités américaines d’instrumentaliser le droit au service des intérêts sécuritaires et économiques du pays ; l’emballement plus récent du système dans une situation de relatif blocage politique aux États-Unis, laquelle empêche l’exécutif de faire valoir les intérêts diplomatiques nationaux pour mettre le holà à l’activisme des agences et aux initiatives du Congrès – cela conduisant même à menacer des priorités diplomatiques telles que la réconciliation avec l’Iran ou le maintien de l’alliance avec l’Arabie Saoudite ; la popularité, dans les opinions publiques, de la thématique de la punition des méfaits d’une part des entreprises, d’autre part des États complices du terrorisme, boostées par la crise financière, puis la flambée de terrorisme que nous vivons.
En tout état de cause, le fait est là : depuis quelques années (principalement à partir de 2008), on observe une multiplication des pénalités financières infligées aux États-Unis à des entreprises étrangères, qui se trouvent être en très grande majorité européennes (les autres étant parfois japonaises, mais rarement issues des pays émergents). Ces pénalités peuvent sanctionner, légitimement, des infractions commises par ces entreprises sur le sol américain, mais aussi, trop souvent, des faits commis hors du territoire américain et n’impliquant pas directement des personnes (physiques ou morales) américaines (ou de droit américain s’agissant de sociétés) : dans ce cas, elles sont clairement extraterritoriales, même si les autorités américaines prétendent éventuellement justifier leur compétence par des interprétations très extensives du critère de territorialité. C’est ainsi que les entreprises européennes ont en quelques années versé aux différentes institutions et administrations américaines quelques 16 milliards de dollars au titre d’infractions aux embargos décidés par les seuls États-Unis contre certains pays et de quelques 6 milliards pour des faits de corruption à l’international (commis hors du sol américain). Ces entreprises ont également accepté, dans le cadre des transactions passées avec les autorités américaines, de se soumettre à des programmes de contrôle de leurs activités qui peuvent impliquer la transmission d’informations relevant du secret des affaires.
Il faut donc réagir. Il n’y a évidemment pas de réponse unique, ni même de stratégie unique, car le mécontentement que nous ressentons face à certaines pratiques américaines ne peut pas occulter d’autres réalités : la France et les autres pays de l’Union européenne, à des degrés divers, sont non seulement liés aux États-Unis par une vieille alliance et des valeurs communes, mais partagent aujourd’hui même de nombreux combats, contre le terrorisme d’abord, mais aussi contre le crime organisé, l’argent sale, la corruption, l’évasion fiscale…
Il y a donc des domaines, tels que la fiscalité et la lutte contre la corruption, où il n’y a pas d’autre voie que la coopération, quel que soit l’énervement que les pratiques unilatérales et brutales des administrations américaines peut susciter.
La mission considère comme nécessaire de faire valoir auprès des États-Unis que certaines pratiques sont devenues abusives et que la France ne les acceptera plus. Elle estime donc que la seule coopération ne permettra pas de résoudre les problèmes apparus depuis quelques années. Un rapport de force doit être instauré.
S’agissant des sanctions économiques et embargos, l’utilisation croissante de cet instrument diplomatique par l’Union européenne, ce de plus en plus en coordination avec les États-Unis (par exemple à l’encontre de la Russie suite aux événements d’Ukraine), ne permet probablement plus d’adopter des positions aussi tranchées que dans les années 1980 et 1990, où l’Europe s’était ouvertement et efficacement opposée à l’unilatéralisme américain dans l’affaire dite du gazoduc sibérien, puis au moment des lois Helms-Burton et D’Amato-Kennedy qui visaient notamment Cuba et l’Iran.
Mais, que l’on choisisse des stratégies coopératives ou que l’on privilégie la confrontation, option dont il faut de toute façon garder la possibilité, il faut pouvoir agir « à armes égales ». À cet égard, la « machine de guerre » juridico-administrative des États-Unis ne doit certes pas constituer un modèle, mais peut tout de même inspirer certaines réformes, vu son efficacité. C’est pourquoi le présent rapport prend clairement parti pour :
– l’adoption d’instruments tels que les transactions pénales avec les entreprises (en matière de corruption mais peut-être aussi pour d’autres formes de délinquance économique), car elles permettent d’accélérer les procédures et de dépasser certains obstacles juridiques ;
– l’adoption de législations économiques à portée extraterritoriale, notamment à des fins dissuasives ;
– l’adoption ou le renforcement des dispositifs dits de blocage qui ont aussi, dans une optique coopérative, un rôle dissuasif ;
– la promotion, quand c’est possible, de stratégies de contournement, telles que l’usage de l’euro quand celui du dollar présente des risques ;
– parallèlement aux outils juridiques, le renforcement de l’« intelligence économique », défensive et offensive, que ce soit dans les services de renseignement, les administrations ou les entreprises, là-aussi en s’inspirant, à notre échelle, du très puissant dispositif américain.
Par ailleurs, il faut parvenir à régler, probablement par la voie diplomatique, un dossier particulier, celui des « Américains accidentels », également et avant tout citoyens français, qui sont confrontés du fait de la loi américaine FATCA et de l’accord bilatéral du même nom à une situation purement kafkaïenne (des procédures bureaucratiques américaines aussi incompréhensibles qu’onéreuses, des banques qui souhaitent fermer leur compte…) qui n’était manifestement pas l’objectif de cette législation et de cet accord. Ce dossier n’a pas avancé à Washington dans le contexte de blocage entre le Congrès et l’exécutif, puis la période pré-électorale. Il faut qu’il soit une priorité de notre diplomatie pour l’année prochaine.
Il reste enfin la dimension européenne, qui est particulièrement nécessaire. L’implication de l’Union est d’abord nécessaire pour des raisons politiques, car l’on s’inscrit dans un rapport de forces – de ce point de vue, la décision récente concernant Apple est très importante. L’implication accrue de l’Union est également nécessaire pour des raisons plus techniques, au moins dans le domaine des sanctions économiques et embargos, car l’on est actuellement dans une situation contradictoire dans laquelle ces sanctions et embargos sont essentiellement décidés au niveau communautaire, mais exclusivement mis en œuvre (délivrance des licences et contrôle de l’application) au niveau national.
La mission considère comme nécessaire de faire valoir auprès des États-Unis que certaines pratiques sont devenues abusives et que la France ne les acceptera plus.
À ce titre, la France doit exiger la réciprocité dans l’application de certains accords internationaux. Elle doit également se doter d’armes juridiques similaires aux États-Unis pour pouvoir lui imposer des politiques coopératives.
La mission estime, néanmoins, que la seule coopération ne permettra pas de résoudre les problèmes apparus depuis quelques années. Un rapport de force doit donc être instauré et doit se matérialiser, notamment, par une demande de clarification de la part des États-Unis en ce qui concerne les sanctions américaines internationales.
Ces objectifs ne pourront, toutefois, être atteints que par le renforcement des moyens affectés au renseignement économique français et par l’amélioration de notre appareil judiciaire.
En conséquence, la mission préconise l’adoption des mesures et la mise en œuvre des actions diplomatiques suivantes:
• Sur le plan national
Recommandation n° 1 : Instaurer une convention judiciaire d’intérêt public. Cette recommandation de la mission a donné lieu à l’article 12 bis du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Recommandation n° 2 : Instaurer une disposition extraterritoriale permettant l’éventuelle poursuite, devant la justice française, d’entreprises étrangères pour des faits de corruption commis à l’étranger dès lors que l’entreprise corruptrice a une quelconque activité économique en France. Cette recommandation a été intégrée à l’article 12 du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Recommandation n° 3 :
– conduire à son terme le processus législatif en cours depuis 2006 visant à clarifier, élargir et renforcer la répression des violations des sanctions internationales et embargos appliqués par la France ;
– au regard des résultats de l’expérience engagée en matière de répression de la corruption (suite à la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique), envisager d’introduire un dispositif de transaction pénale de même inspiration (homologuée par la justice et rendue publique) en matière de violations des embargos par toutes entreprises ayant une activité en France.
Recommandation n° 4 : amender la « loi de blocage » de 1968 :
– en revoyant sa rédaction pour bien identifier les informations réellement sensibles dont la transmission à des autorités étrangères doit être exclue ou restreinte ;
– en y prévoyant un encadrement strict du contrôle/monitorat accepté par les entreprises françaises dans le cadre de transactions pénales avec des autorités étrangères (contrôle de l’administration sur le choix des contrôleurs/moniteurs et les informations transmises à ces autorités étrangères) ;
– en renforçant les sanctions pénales en cas de non-respect de la loi, de sorte qu’elle soit plus crédible pour les autorités et juridictions étrangères, notamment américaines, et puisse donc être admise comme « excuse légale ».
Recommandation n° 5 : renforcer les moyens affectés en France au renseignement économique ; mieux coordonner les différents services qui en sont chargés et faciliter la circulation des informations entre ces services, le parquet national financier et la future Agence anticorruption ; lever les obstacles juridiques injustifiés à celle-ci ; donner une véritable priorité politique à l’intelligence économique, ce qui implique une dimension interministérielle.
Recommandation n° 6 : mettre nos moyens de renseignement économique au service de nos entreprises, notamment pour les aider à s’assurer que leurs co-contractants iraniens ne sont pas, directement ou indirectement, des personnes et entités restant sous sanctions.
• Sur le plan européen
Recommandation n° 7 : chercher à surmonter les difficultés résultant de l’articulation actuelle des dispositifs de sanctions internationales dans l’Union européenne (édiction au niveau communautaire de dispositifs appliqués nationalement) par des mesures telles que :
– la facilitation des échanges d’informations entre les services chargés de l’application de ces sanctions dans les différents États membres ;
– la poursuite de l’harmonisation des pratiques nationales, notamment en matière de délivrance de licences ;
– un effort d’harmonisation de la répression des violations, qui devrait atteindre un minimum de crédibilité et de publicité dans tous les États membres ;
– un meilleur accès des juridictions européennes aux informations qui justifient les mesures individuelles de gels d’avoirs, afin de limiter les cas où ces juridictions censurent ces mesures ;
– le lancement d’une initiative en vue de créer un office européen chargé d’appliquer les mesures édictées par l’Union (gestion des licences, information des entreprises et le cas échéant investigation et sanction administrative des infractions), éventuellement par élargissement des missions de l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF).
Recommandation n° 8 : lancer ou relancer le processus d’actualisation du règlement européen de blocage de 1996, afin de l’étendre, le cas échéant, à d’autres législations américaines que les lois d’Amato-Kennedy et Helms-Burton.
Recommandation n° 9 : inviter les instances européennes à enrayer le déclin de l’usage international de l’euro dans les paiements depuis quelques années et à promouvoir la monnaie européenne comme monnaie internationale.
• Sur le plan bilatéral
Recommandation n° 10 : soit par la négociation d’un amendement à l’accord fiscal bilatéral, soit par une action diplomatique forte favorisant le vote d’une disposition législative américaine ad hoc, obtenir un traitement dérogatoire pour les « Américains accidentels » leur permettant, soit de renoncer à la citoyenneté américaine par une procédure simple et gratuite, soit d’être exonérés d’obligations fiscales américaines.
Recommandation n° 11 : exercer l’action diplomatique nécessaire pour que les engagements de réciprocité complète pris par l’administration américaine dans le cadre de l’accord dit FATCA soient tenus.
Recommandation n° 12 : poursuivre les démarches engagées auprès de l’administration américaine afin de rendre effective l’application de l’accord sur le nucléaire iranien du 14 juillet 2015 :
– en obtenant des clarifications complémentaires sur la portée exacte des sanctions américaines restant en place (degré d’implication indirecte dans une opération d’un US Person ayant pour effet de faire tomber cette opérations sous les sanctions « primaires » ; caractère exclusif de la liste présente des entités sanctionnées dites SDN ; modalités d’une éventuelle remise en cause de l’accord ou snapback…) ;
– inviter l’administration américaine à lever les sanctions, notamment « secondaires », dont la mise en œuvre relève de l’exécutif, ou à prévoir des exemptions (waivers) de portée générale ;
– mettre en particulier l’accent sur les dispositifs les plus handicapants tels que le maintien de la prohibition des transactions dites U-Turn pour assurer la compensation à New-York d’opérations en dollars restant soumises aux sanctions « primaires » (mais pas « secondaires »), ou encore l’interdiction d’ouvrir aux États-Unis des comptes de correspondance pour les banques étrangères impliquées dans certaines transactions en Iran.
Recommandation n° 13 : si tant est que la négociation globale ne soit pas suspendue, insérer dans le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI) :
– des clauses de publicité et de transparence obligatoires du champ d’application extraterritoriale éventuelle des législations des parties ;
– une obligation de réponse par les parties aux demandes d’information des entreprises des autres parties quant à la conformité des opérations qu’elles envisagent à ces législations ;
– des engagements anti-corruption comprenant une clause de « non bis in idem » en cas de poursuites par l’une des parties et une exclusion des questions d’application des lois anti-corruption des dispositions d’arbitrage interétatique.
• Sur le plan international
Recommandation n° 14 : expertiser la conformité des régimes de sanctions internationales des États-Unis aux engagements pris dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, ainsi que l’opportunité d’une saisine de l’organe de règlement des différends de celle-ci dans un contexte où l’Union européenne utilise également de plus en plus l’instrument des sanctions économiques.
Si une telle saisine se révèle opportune, introduire un recours devant l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce
CONTRIBUTION DE M. JACQUES MYARD
à la mission d’information sur l’extraterritorialité de la législation américaine
L’excellent travail de la mission d’information sur l’extraterritorialité de la législation américaine permet de révéler au grand jour un aspect des actions judiciaires et administratives américaines trop souvent ignoré, y compris par nombre de spécialistes du droit international.
L’ampleur de ces actions crée d’ailleurs un réel malaise, tant elles affectent nombre des intérêts d’entreprises françaises et européennes et apparaissent très intrusives.
On a tous en mémoire le jugement de Raymond Aron sur les Etats-Unis - « La République impériale » - concept qu’il opposait à « impérialiste ».
La lecture de ce rapport est de nature à remettre en cause l’analyse de Raymond Aron. On est même en droit de se poser la question sur le degré de confiance que l’on peut avoir dans cet allié ! Il est vrai que nous savons depuis Phèdre, cité par Jules César dans La Guerre des Gaules, que l’on ne doit « jamais avoir de confiance dans l’alliance avec un puissant ».
Mais il y a un autre trait qui doit être souligné, c’est notre propre faiblesse et surtout l’absence de réactions de notre Gouvernement face aux agissements d’un Etat étranger en France qui sont autant de violations de notre souveraineté. Tel est le cas de l’installation de « moniteurs » dans des entreprises pour vérifier qu’elles respectent les décisions de justice américaines qui sont surtout des mesures de contrainte, sans décision d’un juge français, en violation de notre souveraineté.
Ayant eu l’honneur d’être juriste à la Direction des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères sous l’autorité de très grands serviteurs de l’Etat comme Gilbert Guillaume, futur président de la CIJ, et Noël Museux dans les années 1980, nous avions su mettre un terme aux prétentions abusives de nos chers amis américains (affaire Ourengoï, code OCDE sur les transferts de données, enquêtes de la SEC- Securities and Exchange Commission-).
Le Gouvernement français d’alors avait fermement appliqué la loi de blocage de 1968, modifiée en 1980, face aux prétentions extraterritoriales américaines.
Il est sans doute nécessaire aujourd’hui de renforcer les sanctions pénales et pécuniaires de cette loi.
Or, qu’on le veuille ou non, les lois extraterritoriales américaines conduisent tôt ou tard à des conflits de souveraineté purs et durs qui ne pourront se régler que par l’arbitrage interétatique. Nous avons cette possibilité d’attraire les Etats-Unis à cet arbitrage en application de la Convention d’établissement franco-américaine du 25 novembre 1959. J’en ai demandé l’application à plusieurs reprises au Ministre des Affaires étrangères, en vain, ce qui est un signe de faiblesse inadmissible de la part de notre diplomatie et un mauvais signal adressé à l’Administration américaine.
De deux choses l’une, ou les Etats-Unis prennent conscience qu’ils vont trop loin et on trouve des solutions qui respectent nos intérêts, ou nous serons amenés à prendre des mesures de rétorsion sur le plan français et européen.
A l’ère des puissances relatives, le Congrès des Etats-Unis et l’Administration américaine risquent d’apprendre que le monde n’est pas fait à leur image.
Lors de leur réunion commune du mercredi 5 octobre 2016, les commissions des affaires étrangères et des finances ont examiné le présent rapport d’information.
Mme la présidente Élisabeth Guigou. Mes chers collègues, nous consacrons notre séance cet après-midi à la présentation du rapport de la mission d’information qui est commune à la commission des finances et à la commission des affaires étrangères sur l’extraterritorialité de la législation américaine. Pour cette mission d’information, Pierre Lellouche en est le président et Karine Berger, la rapporteure. Je vais donc leur donner la parole immédiatement et puis ensuite nous aurons notre débat habituel et la mise aux voix. Je rappelle que cette séance est ouverte à la presse.
M. Pierre Lellouche, président de la mission d’information. Vous me permettrez de commencer par un mot de congratulations du travail parlementaire. Ce n’est pas tous les jours qu’on a l’impression d’être utile au pays. Je crois que nous avons fait honneur, avec Karine Berger et les membres de la mission, aux fonctions de parlementaire puisque, tout d’abord, cette initiative émane du Parlement et d’autre part, puisqu’elle a été menée dans un esprit bipartisan. Je me félicite d’ailleurs du travail accompli avec Madame Berger.
Pour ceux qui siègent à la commission des affaires étrangères, vous avez peut-être noté qu’au fil des années, je m’étais opposé à des textes qui posaient la question de l’extraterritorialité des lois américaines. Je pense en particulier à la loi FATCA qui prévoit un échange d’informations pour lutter contre la fraude fiscale mais qui n’est rien d’autre que la traduction en droit français d’un texte de loi américain, à la virgule près. Cette loi m’avait choqué à l’époque. Elle ne prévoit pas, d’ailleurs, de vraie réciprocité et pose, nous allons y revenir, un certain nombre de problèmes dont notamment celui des « Américains accidentels ». De même, la question de l’extraterritorialité s’était posée devant cette commission lorsqu’est venue une convention franco-américaine qui visait à acheter une paix juridique durable avec les Etats-Unis dans le cas du harcèlement permanent devant les juridictions américaines des ayant-droits des victimes de la Shoah. Ces derniers poursuivaient, en effet, la SNCF aux Etats-Unis puisqu’elle avait transporté les victimes de la Shoah pendant la Seconde guerre mondiale alors que la France était sous domination de l’occupant allemand. Il n’en demeure pas moins, malgré l’immunité souveraine, que la France avait jugé bon de signer une convention et de donner 60 millions de dollars pour éteindre les poursuites aux Etats-Unis. Ceci commençait à ouvrir la voie à ce que nous avons aujourd’hui avec la loi JASTA sur laquelle on va revenir et sur la mise à bas définitive de l’immunité souveraine des Etats, un principe pourtant fondamental du droit international.
L’affaire qui nous concerne aujourd’hui est, malgré sa technicité, extrêmement actuelle et politique. Plusieurs exemples le démontrent. Dans l’affaire Alstom qui a mobilisé tout le monde hier avec la mise sur la table de 500 millions d’euros et l’achat de trains, nous vivons les conséquences de la prise de contrôle d’une grande entreprise française par General Electrics à l’issue, ou en même temps, que se déroulait une procédure judiciaire contre Alstom sur la base d’une enquête de corruption menée devant les juridictions américaines. Cette enquête avait entrainé, non seulement l’incarcération de deux cadres d’Alstom, mais également une amende de 772 millions de dollars. Cette dernière devait être payée par le repreneur américain General Electrics. Mais en réalité, elle a été laissée à Alstom ferroviaire ; si bien que cette amende de 772 millions de dollars est supérieure aux 500 millions d’euros mis sur la table, que le contribuable hier a empruntés pour essayer de sauver l’usine d’Alstom. Il y a donc une corrélation directe entre cette affaire qui s’est produite il y a deux ou trois ans, le choix du repreneur, américain plutôt qu’allemand ou japonais, et les conséquences industrielles. Nous n’avons pas la preuve d’un lien direct. Néanmoins, cette affaire a été évoquée à plusieurs reprises durant la mission mais également l’implication des services de renseignement américain qui travaillent très directement avec les poursuites engagées par les différents organismes américains dont l’OFAC et le ministère de la justice.
Deuxième affaire, tout à fait immédiate, la loi qui s’appelle Justice for Sponsors of Terrorism qui a été adoptée la semaine dernière aux Etats-Unis malgré le veto du président Obama. Cette loi va permettre à toutes les victimes de terrorisme aux Etats-Unis de poursuivre n’importe quel Etat lié directement ou indirectement à des actes terroristes aux Etats-Unis. Cette loi visait, en pleine campagne électorale, le 11 septembre et l’Arabie Saoudite. Elle va s’appliquer partout et va poser d’énormes problèmes aux Etats-Unis également puisqu’ils vont être poursuivis dans le monde entier. Cette loi est en train de créer une situation de véritable état de jungle en droit international puisque, pour la première fois dans l’histoire des relations internationales, un grand Etat dit qu’il va attaquer tout le monde. Le résultat est que tout le monde va attaquer tout le monde y compris les alliés des Etats-Unis qui eux-mêmes sont victimes du terrorisme.
Troisième cas extrêmement actuel, la Deutsche Bank qui fait l’objet de poursuites par les Etats-Unis pour avoir participé aux spéculations sur les subprimes aux Etats-Unis. Un certain nombre de banques américaines ont déjà fait l’objet de poursuites dont Goldman Sachs et quelques autres. Ici les poursuites sont élargies sauf que la Deutsche Bank va être redressée pour un montant de 14 milliards de dollars alors qu’elle en vaut 5 et demi. Surtout, elle est exposée à hauteur de l’équivalent de treize fois le PIB de l’Allemagne. Autrement dit, si cette affaire va à son terme, on risque par un effet de dominos, une crise financière majeure en Europe. Une décision judiciaire aux Etats-Unis, fondée ou pas, en l’occurrence il s’agit de la défense des emprunteurs américains en visant les banques qui ont participé aux opérations de titrisation et aux bad loans, peut entraîner une crise financière majeure en Europe.
Dernier sujet, également dans l’actualité, ce sont les relations économiques avec l’Iran. Comme vous le savez, au terme d’un accord qui s’appelle JCPOA, le fameux dispositif 5 + 1, c’est-à-dire les membres du Conseil de sécurité plus l’Allemagne, et la communauté internationale ont décidé, il y a un an et demi, de lever les sanctions contre l’Iran en échange du gel du programme nucléaire iranien. Sauf que, dans la pratique, les sanctions américaines dites primaires sont maintenues, c’est-à-dire que les relations économiques avec l’Iran sont gelées sauf à aller demander l’autorisation des autorités américaines. De facto, nous sommes dans une situation où les entreprises françaises demandent à Washington l’autorisation de faire telle ou telle chose en fonction de la législation américaine.
Les faits sont très simples. Nous sommes devant un mur de législations américaines extrêmement touffues avec une intention précise qui est d’utiliser le droit à des fins d’imperium économique et politique dans l’idée d’obtenir des avantages économiques et stratégiques. Comme toujours aux Etats-Unis, cet imperium, ce rouleau compresseur normatif se déroule au nom des meilleures intentions du monde puisque les Etats-Unis se définissent comme un benevolent power, c’est-à-dire un pays qui ne peut faire que le bien. Et donc personne ne peut être contre la lutte contre la fraude fiscale, la corruption, les terroristes. On déroule comme ça une législation qui s’applique instantanément au reste du monde dès lors qu’il y a un rattachement quelconque avec les Etats-Unis. Cela peut être le fait d’avoir une filiale aux Etats-Unis, le fait d’utiliser une messagerie américaine, le fait d’être coté en bourse aux Etats-Unis. Tout lien de rattachement, tout ce qui fait de vous un US person, même quand vous êtes une société étrangère, même quand l’action se passe à l’autre bout du monde et ne concerne en aucun cas le territoire américain, vous placent sous le coup de la loi américaine. A partir de là, se déroule une machine redoutable dans laquelle vous avez en face de vous la totalité du système, les services de renseignement américain (il y a en 17 dont la CIA, la NSA, etc…) qui participent à l’interception des données et à la constitution du dossier, et les différents services qui peuvent vous poursuivre. Il peut y avoir le Department of Justice, l’OFAC, la SEC, le FED. Puis, on va constituer un dossier autour de vous. On va vous convoquer. On va vous dire que vous avez fait quelque chose de mal. On va vous demander si vous admettez ou pas la responsabilité. Si vous n’admettez pas, vous allez au procès et dans ce cas, c’est le cataclysme. Si vous admettez quelque chose de mal, vous êtes obligé d’apporter les preuves. Donc vous allez vous confesser et aider à la constitution du dossier. Une fois le dossier constitué, on vous demande une repentance. On vous punit, on vous met une amende, généralement équivalente à tout ce que vous avez volé. Cela peut être très cher. Ensuite, on vous demande de vous amender avec la mise en place d’un système de conformité contrôlé par ce que l’on appelle un monitor, c’est-à-dire un contrôleur, rémunéré à vos frais, installé dans votre entreprise et vous allez devenir un bon citoyen. Voilà le fonctionnement qui est d’une efficacité redoutable parce que toutes les sociétés qui s’y plient ont, en général, besoin d’avoir accès au marché américain et, d’ores et déjà, on s’est aperçu, au fil de nos travaux, depuis cinq mois, que bien des entreprises, poursuivies ou pas d’ailleurs, ont décidé de se mettre en conformité avec la loi américaine de peur d’être inquiétées. Elles reçoivent d’ailleurs des courriers d’intimidation et je pense que Karine Berger va y revenir tout à l’heure sur différentes affaires. On leur conseille de faire ou de ne pas faire telle ou telle chose.
Cet imperium juridique américain se décline dans trois domaines qui sont couverts en détail dans le rapport et deux autres qui ne le sont pas. Notre rapport n’est donc pas, en fait, totalement exhaustif. Il mériterait d’être approfondi.
Premièrement, la fiscalité. La lutte contre la fraude fiscale va permettre à l’administration américaine d’utiliser le Trésor français comme une sorte d’annexe et d’avoir instantanément toutes les informations sur les citoyens américains non-résidents et notamment en France sans réciprocité. Les banques françaises sont, en effet, obligées de donner tous les comptes de tous les résidents américains au Trésor qui les transmet ensuite à l’administration américaine. En revanche, si nous avons besoin d’une information sur un résident français, nous devons faire une demande au cas par cas. Cela pose un problème que détaillera tout à l’heure Karine Berger, celui des « Américains accidentels », c’est-à-dire ceux qui sont nés aux Etats-Unis mais qui n’ont plus de lien avec ce pays. Problème non résolu à ce jour.
Deuxième point d’entrée, la corruption internationale. C’est le cas d’Alstom. Un acte de corruption d’agents publics est commis quelque part dans le monde, en général par un concurrent d’une entreprise américaine. Les données sont réunies, les communications sont interceptées. On peut aller jusqu’à mettre en prison les cadres de cette entreprise, les faire avouer et cela peut avoir comme conséquence, comme dans le cas d’Alstom, de casser complétement la société et de la faire passer sous contrôle américain. Les actes de corruption sont notamment prévus dans une convention de l’OCDE. Les Américains ont réussi à internationaliser une loi américaine par cette convention. Je ne suis pas sûr qu’elle ait mis fin à la corruption. En tout cas, cela a permis aux Etats-Unis d’engranger beaucoup d’argent. J’y reviendrai dans un instant.
Le troisième domaine d’action de ce rouleau compresseur concerne les embargos et les sanctions. Il existe deux types de sanctions : d’une part, celles où il existe un accord comme les sanctions contre la Russie. La France, l’Union européenne, les Etats-Unis ont, en effet, décidé ensemble de punir la Russie suite à l’annexion de la Crimée, d’autre part, il y a des cas où nous ne partageons pas les mêmes sanctions comme par exemple en ce qui concerne Cuba ou le Soudan. Ces sanctions ont donné lieu à une punition extrêmement lourde pour la BNP, près de 10 milliards de dollars. Cette punition portait sur des financements de contrats avec des pays sous embargo américain mais pas sous embargo français. Les Etats-Unis reprochaient à la BNP de violer la loi américaine de façon systématique et ce même après avoir été prévenue. La sanction a donc été d’autant plus lourde. Dans le cas de l’Iran, nous avons une situation complexe où la communauté internationale décide de lever les sanctions donc théoriquement le commerce devrait reprendre avec ce pays. Néanmoins, ce pays reste soumis à de nombreuses sanctions bilatérales que les Américains appellent sanctions primaires. Ces dernières rendent, de facto, impossible à toutes personnes américaines d’opérer des activités économiques mais également toutes opérations économiques en dollars. Résultat concret, pour vendre quoi que ce soit, il faut une autorisation expresse. Dans le cas d’Airbus, il fallait que Boeing puisse vendre au préalable des avions. Dans les autres cas, c’est très compliqué et à chaque fois, il faudra un accord de l’autorité américaine.
Il y a deux autres cas qui posent problème : le terrorisme, j’ai mentionné la loi JASTA qui entrainera la fin de l’immunité souveraine. Enfin, il y a ce dernier cas qui concerne Volkswagen et la Deutsche Bank. Il y en aura d’autres cependant. Prenons la Fifa par exemple où on voit que le consommateur américain est protégé par la justice américaine, quel que soit l’endroit dans le monde, dès lors qu’il achète une voiture qui n’est pas absolument sûre ou pure ou lorsqu’une banque a mis en péril un emprunteur américain. A ce moment-là, la loi s’applique quelle que soit la nationalité de la banque ou de l’entreprise avec à chaque fois des pénalités extrêmement fortes.
Tout cela commence à faire beaucoup d’argent puisqu’au regard des tableaux inclus dans le rapport, le montant total est d’environ 20 milliards d’euros payés au Trésor américain. Si on regarde les tableaux, qu’il s’agisse des pénalités concernant la corruption internationale ou le blanchiment, l’essentiel des cibles sont européennes (allemandes, françaises, britanniques, etc…). Il y a assez peu de sociétés américaines qui sont sanctionnées.
Nous sommes donc dans une situation où la souveraineté de la France, et accessoirement des autres pays européens, les intérêts politiques, économiques et stratégiques de ces pays, sont directement mis en cause par ces législations.
Voilà pour le constat. La question est de savoir comment on peut répondre à ce rouleau compresseur. Quels sont les moyens sachant qu’il y a un très grand déséquilibre, c’est un peu le pot de terre contre le pot de fer et que le droit n’est rien d’autre que l’expression de cette différence de rapport de force économique ?
L’Histoire montre que lorsque les Européens, ensemble, ont décidé de dire stop aux Etats-Unis, cela fonctionne. Ils l’ont fait une fois entre 1996 et 1998, contre la loi Helms-Burton qui portait sur Cuba, et les Américains se sont arrêtés. Plus récemment, il y a l’affaire Apple avec l’Irlande, 13 milliards de dollars qui n’étaient pas dus à l’extraterritorialité mais en raison de la faute de l’Irlande qui autorisait Apple à ne pas payer d’impôt en Europe. Mais quand l’Union européenne a décidé de taper sur Apple, tout de suite le président Obama et le patronat américain se sont mobilisés. Quand l’Europe réagit, il se passe quelque chose. Quand il ne se passe rien et que les Américains ont le sentiment que les dispositifs législatifs européens sont inopérants, alors ils vont faire la police à votre place. Puisque vous ne réprimandez pas la corruption et la fraude, on va le faire à votre place et vos entreprises vont payer.
La mission a eu un vrai impact sur la rédaction de la loi Sapin II, non sans mal car, avec Karine Berger, nous avons dû effectuer un travail de pédagogie auprès du Gouvernement et des parlementaires de droite et de gauche pour introduire des dispositions qui ne sont pas dans la culture juridique française. La première d’entre elles est cette procédure de « plaider coupable » qui permet à l’entreprise de venir devant le juge français plutôt que d’aller se confesser à Washington et, en cas de pénalités, de les payer au Trésor français. Cela n’a pas été simple puisque le Gouvernement et le Conseil d’Etat n’en voulaient pas forcément. Nous avons introduit également une disposition extraterritoriale. Dans la mesure où une société américaine, ayant des activités en France, se livre à des actions de corruption à l’autre bout de monde, alors le juge français pourra se saisir de cette affaire. Nous avons introduit cela dans la loi Sapin II.
Nous avons développé également un certain nombre de moyens de dissuasion. Nous avons beaucoup insisté pour que le principe de non bis in idem, qui interdit de poursuivre deux fois pour la même cause dans deux pays différents, devienne une condition majeure dans les relations entre la France et les Etats-Unis.
Nous avons proposé de renforcer fortement la coopération entre la future agence anticorruption, le pôle financier et nos services de renseignement. Aux États-Unis, le n°2 du Trésor est devenu le n°2 de la CIA. Au FBI, presque autant d’agents s’occupent de renseignement économique que de lutte antiterroriste. Nous avons besoin de renforcer nos moyens de renseignement et de les mettre au service de notre économie et de la justice.
Il y a aussi des éléments de réponse à imaginer au niveau européen, que Karine va détailler, ainsi qu’au niveau international via la négociation du traité transatlantique.
L’analyse que nous avons produite n’est pas simple. Nous avions, en face de nous, un maquis de législation américaine à débroussailler, après quoi nous avons essayé de mettre en place une analyse technique juridiquement précise. Enfin, nous avons produit une série de recommandations sur ce qu’il convient de faire aux niveaux national, européen et international.
Le message le plus important est cependant politique : il faut, de façon nette, signaler à nos amis américains que cette situation ne peut plus durer, car elle peut entraîner des conséquences non gérables. L’affaire de la Deutsche Bank risque de mettre par terre le système financier européen ; l’affaire Jasta est en train de créer une jungle dans les relations internationales ; l’affaire Alstom montre que des punitions lourdes peuvent avoir des conséquences directes sur la vie de milliers de travailleurs en Europe. Il est inconcevable de continuer à se battre aux côtés des Américains dans le Sahel, en Irak ou contre le terrorisme tout en subissant ce type d’actions contre nos intérêts fondamentaux.
Il faut lancer ce signal et le décliner de façon technique et précise, aussi bien au niveau de nos législations internes qu’il faut renforcer, ce que nous avons fait en matière de corruption et que nous devrons faire en matière d’embargo et de lois de blocage, qu’aux niveaux européen et international.
Ce travail a été utile et sérieux. J’ai été heureux de travailler aux côtés de Mme Berger et des autres collègues pour un travail qui sert les intérêts de notre pays.
Mme Karine Berger, rapporteure. Je m’associe aux remerciements de Pierre Lellouche. Le travail a été fait en excellente collaboration, ce qui n’est pas simple dans notre contexte politique. Il a été fait avec l’ensemble des membres de la mission, notamment Jacques Myard.
Je veux répondre à quelques questions que vous devez vous poser.
Première question, beaucoup sont sans doute gênés par le terme « extraterritorialité ». Il y a dans le rapport une analyse juridique approfondie sur l’emploi de ce terme. Nous avons utilisé ce terme dans un contexte très large. Il ne s’agit pas stricto sensu de l’extraterritorialité du droit américain. Du point de vue américain, peu de lois sont extraterritoriales.
Cependant, Pierre Lellouche a donné de trop nombreux exemples d’entreprises, notamment européennes, qui sont soumises de fait à la loi américaine parce qu’elles ont des filiales ou sont cotées aux États-Unis ou du fait de liens beaucoup plus ténus, mais c’est bien en raison de ce lien que les affaires les concernant ont été déclenchées. Or, la plupart des entreprises auditionnées ne pouvaient pas quitter le sol américain pour des raisons économiques évidentes. Ces entreprises sont obligées d’être aux États-Unis, tout comme les banques qui doivent compenser en dollars certaines de leurs opérations. Par conséquent, se pose le problème d’un droit américain qui est réellement extraterritorial, mais aussi de l’impact extraterritorial de ce droit. Le rapport porte donc bien sur l’impact extraterritorial du droit américain.
Deuxième question, est-ce un problème ? Oui, d’après la mission. On parle d’un transfert de vingt milliards de dollars. La situation crée par ailleurs une incertitude juridique pour le monde économique et financier. Le cas le plus parfait est l’affaire iranienne puisque nous sommes revenus de Washington avec la conviction que nous ne pouvons pas à ce stade recommander aux entreprises françaises, et surtout aux banques, de renouer des liens avec l’Iran dans le contexte actuel d’incertitude juridique et diplomatique concernant la levée des sanctions contre l’Iran. Un membre de la commission des Finances, qui est encore membre du conseil de surveillance d’une entreprise liée à l’entreprise américaine Xerox, m’a montré ce matin un courrier reçu le 30 septembre de Xerox et demandant à toute personne avec laquelle cette dernière entretient des liens économiques et financiers de ne pas faire d’affaires avec l’Iran. Ainsi, une entreprise américaine s’arroge le droit de demander à ses partenaires français de ne pas faire d’affaires en Iran, sans quoi les liens seront coupés. On nous a également fait état de lettres de menaces de lobbyistes américains demandant à des entreprises françaises de ne pas se rendre en Iran, mais l’aspect amusant de cette anecdote est que le courrier en question a été reçu par un membre de la commission des Finances.
Troisième question, est-ce que les différents sujets sont de même niveau ? Non, nous n’avons évoqué que trois cas, mais qui sont très larges.
Le premier est la façon dont la lutte anticorruption a été utilisée comme un ordre juridique mondial qui exerce une influence sur les équilibres économiques mondiaux. Il y a une volonté de modification des règles de la concurrence dans le cadre de la mondialisation.
De même, les autorités américaines estiment dans l’attribution des marchés publics dans les pays émergents, qu’il n’est pas question que les entreprises non américaines n’obéissent pas aux mêmes règles que les entreprises américaines.
La question des sanctions et des embargos a été évoquée par le président.
La question de la fiscalité est un point important. Les États-Unis sont un des rares pays où la fiscalité des personnes physiques est extraterritoriale puisqu’elle dépend de leur citoyenneté, et cette dernière s’acquiert automatiquement lorsqu’une personne naît sur le sol américain. Une personne née par hasard dans un taxi à Washington est bel et bien américaine.
Ainsi, du fait de la convention fiscale bilatérale dont l’application a été facilitée par l’adoption de la loi FACTA, des personnes sans lien avec les États-Unis, certains ne parlant pas anglais, ne sachant pas faire une déclaration fiscale aux États-Unis et n’en ayant pas les moyens, sont sans recours, car on ne peut pas renoncer à la citoyenneté américaine sans être en règle avec les services fiscaux américains. Nous faisons face à une difficulté très pratique pour ces personnes et nous souhaitons aller vers une solution pratique avec l’aide de l’État français.
Quatrième question, est-ce que l’administration américaine est dans une logique d’utilisation du droit pour défendre les intérêts économiques américains ? Oui, nous le pensons. Les agences de renseignement américaines sont au service des trois piliers que j’ai évoqués pour transmettre systématiquement des informations au FBI, nos interlocuteurs nous l’ont confirmé.
Comment répondre à tout cela ? Il faut acter le fait que certaines pratiques, ces dernières années sont devenues abusives, avec un recours de plus en plus important à des sanctions colossales qui sont parfois de nature systémiques, comme dans le cas de la Deutsche Bank. Certains recours américains peuvent être qualifiés de comportements abusifs. Nous devons faire valoir que la seule coopération judiciaire ne suffira pas à rééquilibrer le rapport de force tel qu’il s’est instauré au cours de ces dernières années.
Les pistes de la mission sont d’ordre national, européen et international.
Sur le plan national, à l’occasion de l’examen du projet de loi « Sapin II », l’Assemblée nationale a adopté un mécanisme de « plaider coupable » pour les entreprises afin d’améliorer l’efficacité de la lutte contre la corruption. Aux États-Unis, où il est largement recouru à un tel dispositif, ce sont les entreprises qui apportent elles-mêmes les preuves, et qui, ainsi, d’une certaine façon, financent leurs procès. En France, c’est le parquet qui doit effectuer la recherche des preuves, et c’est principalement pour cette raison que la plupart des enquêtes qui ont conduit à infliger des amendes aux États-Unis, et qui avaient également été ouvertes en France, n’ont jamais donné lieu à condamnation dans notre pays : les preuves n’avaient jamais été trouvées. La mise en place du mécanisme de « plaider coupable » dans la loi « Sapin II » rendra donc la lutte contre la corruption plus efficace et rapide tout en renforçant le parquet.
De plus, cette mesure sera extraterritoriale dans le sens où des entreprises non françaises, mais qui réalisent des opérations sur le sol français, et qui commettent des faits de corruption à l’étranger, seront passibles d’amendes. Cette extension a été proposée par Pierre Lellouche, avant d’être reprise par le groupe socialiste et par moi-même, puis a été acceptée par le ministre de l’Economie et des finances. En matière de lutte contre la corruption, la France pourra ainsi se battre à armes égales contre les États-Unis. C’est à nos yeux la seule manière d’obliger la justice américaine à coopérer.
Sur le plan national, notre recommandation est de renforcer l’application de la « loi de blocage » de 1968, qui dispose que certaines informations relevant de la souveraineté nationale, notamment en matière de secret industriel et de secret économique, puissent ne pas être transmises à l’étranger. Nous avons constaté que, souvent, du fait de la puissance américaine, les entreprises transmettaient des informations aux autorités américaines sans passer par la procédure instituée par la loi de blocage. Cette attitude peut se comprendre, mais si nous ne faisons rien, cela risque de poser problème. Nous ne sommes pas encore parvenus à définir une solution législative.
L’intelligence économique fait en effet partie des priorités des agences de renseignement américaines, et constitue un objectif aussi important que la lutte contre le terrorisme. Cela apparaît de manière particulièrement claire lorsqu’on s’intéresse à la façon dont les agences de renseignement sont structurées. Les interlocuteurs que nous avons rencontrés dans le cadre de la mission maîtrisaient parfaitement leur sujet. En France, les choses évoluent, certes, mais nous sommes bien loin de penser que l’intelligence économique est aussi importante que la lutte contre le terrorisme. Les agences de renseignement américaines ont la capacité de traiter les informations économiques, et de les poser dans une logique de souveraineté économique. Elles les transmettent au FBI, ou à la justice, dès que cela peut être utile. Notre recommandation est que l’intelligence économique devienne, a minima, une priorité des autorités françaises, et que ces dernières puissent collaborer avec le parquet national financier dans le cadre de ses enquêtes.
La mise en place d’un organisme de lutte contre la corruption à l’échelon européen s’avère nécessaire. En effet, il sera difficile de parvenir à un équilibre des puissances et de faire face aux États-Unis si ce que nous mettons en place en France s’arrête à la France, et ne concerne pas l’Allemagne ou le Royaume-Uni. Il faut également instaurer un mécanisme de blocage à l’échelle européenne : un tel mécanisme a déjà été adopté en Europe en 1996, mais il n’est pas suffisamment performant. Enfin, la question de l’usage international de l’euro se pose. Nous avons été frappés de voir que l’euro est une monnaie de moins en moins utilisée dans les échanges internationaux, à l’opposé de ce que l’on pouvait espérer il y a encore quelques années.
Sur le plan bilatéral, nous recommandons une révision de la convention fiscale bilatérale relative aux citoyens américains « accidentels ». Ceux-ci doivent pouvoir se libérer de leur citoyenneté sans passer par des considérations financières et diplomatiques extrêmement difficiles. Nous demandons également à ce qu’il y a ait une réflexion bilatérale sur la problématique de la lecture de l’accord iranien. On nous a expliqué que l’extraterritorialité de la loi américaine ne pouvait être invoquée lorsqu’aucune personne de nationalité américaine n’était impliquée, et qu’aucun dollar américain n’était en jeu. Cependant, il est difficile pour une entreprise, et notamment pour une banque, de prétendre qu’elle ne détient aucun dollar américain dans son bilan comptable, et de s’assurer qu’aucune personne concernée par les interdictions américaines n’est impliquée dans telle ou telle opération. Notre recommandation est claire : il faut une clarification rapide avec les États-Unis sur ce point. La position du président Obama n’est d’ailleurs pas la même que celle du Congrès, et si la France ne demande pas une clarification il n’y aura pas moyen de rendre crédible la levée des sanctions iraniennes.
Dans l’hypothèse où les négociations sur le traité transatlantique se poursuivraient – ce qui n’est pourtant pas le souhait du Président de la République – il paraît indispensable d’aborder la question de l’extraterritorialité de certains droits économiques. Si ces problématiques ne sont pas abordées dans le traité, on comprend mal où elles pourraient l’être ailleurs.
Enfin, si l’ensemble de ces mesures de rééquilibrage des forces ne suffisaient pas, il y aurait toujours la possibilité de recourir aux instances internationales et notamment à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), c’est-à-dire de demander des arbitrages internationaux sur un certain nombre de lois américaines. Cela serait cependant pour nous un constat d’échec, car cela voudrait dire que les recommandations de la mission, qui visent à permettre à la France de se battre à armes égales avec les États-Unis, n’auraient pas abouti.
M. Pierre Lellouche. J’ajouterai que suite à l’adoption la loi « JASTA », M. Erdogan, dont nous parlions ce matin lors de la réunion de notre commission, a déjà indiqué qu’il allait attaquer des soldats et officines américains présents sur le sol turc. Le processus est donc lancé.
Il est également important de voir que si nos entreprises se voient infliger d’importantes amendes en matière de corruption, il n’en est pas de même pour la Chine ou l’Inde. Les pays qui ne sont pas membres de la convention OCDE ne sont pas attaqués : il y a deux poids, deux mesures, et c’est l’Europe qui sert de « champ de bataille ».
Concernant les origines de cette politique, il faut prendre conscience qu’il n’y a plus, aux États-Unis, de consensus bipartisan sur la politique étrangère à mener, de telle sorte que celle-ci est devenue assez difficile à comprendre. Si vous prenez le cas de l’Iran, le président Obama voulait lever les sanctions pour des raisons politiques, car il pense que la solution est l’ouverture de la société iranienne ; le Congrès a une autre approche.
Mme la présidente Élisabeth Guigou. Je partage entièrement le diagnostic que vous établissez, qui est irréfutable. Cette situation est choquante. Je transmettrai votre rapport à M. le Ministre des affaires étrangères, par lettre personnelle. Nous avons eu, à plusieurs reprises, des échanges avec des responsables américains, et notamment avec l’ambassadrice américaine en France : nous leur avons indiqué que cette situation était insupportable.
M. le président Gilles Carrez. Ce rapport est d’autant plus intéressant qu’il est opérationnel : des amendements ont été adoptés dans le cadre du projet de loi « Sapin II ». Compte tenu de l’affaire Deutsche Bank, qui préoccupe sans doute nos collègues allemands, ne pourrions-nous pas communiquer les conclusions de ce rapport aux commissions des finances et des affaires étrangères du Bundestag, et inscrire ce thème à l’ordre du jour lors de nos rencontres, afin d’adopter une position commune ?
Mme la présidente Élisabeth Guigou. Je trouve cette idée excellente ; j’ai d’ailleurs abordé cette question avec mon homologue allemand la semaine dernière.
M. Jacques Myard. J’ai eu grand plaisir à travailler avec Karine Berger et Pierre Lellouche sur un sujet qui me rappelle mes amours de jeunesse. J’ai d’ailleurs été amené à appliquer aux Américains la loi de 1980, qui a amendé la « loi de blocage » de 1968. Lorsque nous avons un gouvernement qui décide d’agir politiquement, les Américains sont capables de reculer, car ils savent ne pas aller trop loin.
Actuellement, nous assistons à une volonté manifeste des États-Unis d’utiliser leur droit à des fins politiques, de sécurité et d’influence, mais également à des fins commerciales : c’est une volonté impérialiste. Le droit américain est utilisé pour obtenir des marchés et éliminer des concurrents. Nous devons ne pas être naïfs et prendre conscience de ce qui se passe. Les derniers gouvernements français n’ont pas réagi, mais ils ne sont pas les seuls coupables : les entreprises françaises qui étaient mises en cause dans des affaires de corruption aux États-Unis n’ont rien dit au Gouvernement. En effet, les grands groupes sont dans les mains des cabinets d’avocats américains, qui leur conseillent de ne surtout pas avertir les autorités françaises, et de régler leurs procès discrètement, grâce au mécanisme du plaider coupable ; ces cabinets facturent pour cela des honoraires substantiels. Il est important de prendre en compte l’existence de tels intérêts privés dans notre réflexion. Les États sont éliminés, sauf l’État américain qui, dans la jungle transnationale, a su utiliser son droit de manière extraterritoriale.
On en arrive à des situations d’auto-accusation et à une violation totale et directe de la souveraineté française. Il est scandaleux que des moniteurs soient placés en France, enquêtent en France et transmettent des informations aux États-Unis sans que cela passe par la justice française. Nous ne sommes pas là dans une situation théorique. Il s’agit de mesures d’exécution et je m’étonne qu’il n’y ait pas de magistrats pour réagir à la Chancellerie. Il faut qu’il y ait une prise de conscience face à ce scandale : je suis persuadé qu’elle va arriver, parce que le rapport de Karine Berger et de Pierre Lellouche est très décapant sur de nombreux points.
Je ne partage pas tout à fait l’avis de la Rapporteure s’agissant du recours à l’arbitrage. L’arbitrage ne sera pas nécessairement un échec. Si l’on entame une procédure d’arbitrage, la Maison blanche et le département d’État américain seront très vigilants. La Cour suprême américaine elle-même a attiré l’attention sur le problème de l’extraterritorialité du droit. L’arrêt Morrison montre clairement qu’à partir du moment où la loi extraterritoriale n’a pas été « sanctifiée » comme telle par le Congrès, elle ne peut autoriser des poursuites. Les Américains se livrent véritablement à une sorte de manipulation planétaire, qui instrumentalisant leur droit, à des fins commerciales, de stratégie d’influence, etc.
La réciprocité dans les relations internationales, c’est le début de la sagesse. Il y a un moment où trop c’est trop !
M. Christophe Premat. Je vous remercie pour ce rapport qui fait froid dans le dos en montrant la réalité de la guerre économique. Je souhaiterais revenir sur la question de la fiscalité. Une des recommandations, sur le plan bilatéral, consiste à proposer la négociation d’un amendement à l’accord fiscal bilatéral pour obtenir un traitement dérogatoire pour les « Américains accidentels », leur permettant soit de renoncer à la citoyenneté américaine par une procédure simple et gratuite, soit d’être exonérés d’obligations fiscales américaines. L’affaire va être compliquée ! Il va falloir, lors de la négociation, avoir quelque chose à offrir en retour.
La perte de la nationalité américaine est très chère, plus de 2 000 dollars.
M. Pierre Lellouche. 20 000 dollars !
M. Christophe Premat. Il y a ensuite les conséquences de cette demande et on n’en finit pas. C’est un enfer fiscal. La proposition est intéressante, mais il sera compliqué de la mettre en œuvre. Je ne sais pas si la renégociation de cet accord suffira, puisque les États-Unis appliquent le principe de taxation without representation, ce qui pourrait soulever un problème de conformité à leurs principes constitutionnels. Il faudra donc identifier les leviers juridiques et fiscaux pertinents.
Je rappelle que le traitement du problème des prélèvements sociaux sur les revenus du capital en France, question certes de nature différente, a été compliqué. Après l’arrêt de Ruyter, les Français qui avaient un bien immobilier en France et qui résidaient aux États-Unis se sont retrouvés dans une situation délicate.
Ces dernières années, de nombreux accords bilatéraux ont été compliqués à négocier. Je pense notamment à la convention bilatérale avec Andorre, pour laquelle il a fallu s’y reprendre à trois ou quatre fois.
Je trouve donc la proposition séduisante, mais quelle contrepartie offrir ? Ou de quel pouvoir disposons-nous ? Car sur la question des prélèvements sociaux, nous ne pouvons nous affranchir du traité sur l’Union européenne. Il y a une véritable guerre fiscale, qu’il faut prendre en compte. Certaines de vos recommandations sont très pertinentes, mais il faudrait peut-être penser celle-ci de manière plus opérationnelle.
Mme Valérie Rabault, Rapporteure générale de la commission des finances. Je n’ai pas encore pu lire le rapport, mais au vu de ce que vous en avez dit, monsieur le président et madame la Rapporteure, je pense qu’il est absolument passionnant.
La probité de la Deutsche Bank a été mise en doute par les États-Unis dans l’affaire des subprimes. Disposons-nous des outils juridiques pour attaquer les banques américaines qui nous ont apporté les subprimes ? Il y en a beaucoup !
M. Jacques Myard. Goldman Sachs ! Et le bidonnage des comptes de la Grèce !
Mme Valérie Rabault. Je suis étonnée que depuis 2008, nous n’ayons jamais adressé la « facture » aux États-Unis. Avons-nous, en droit français ou en droit européen, la possibilité – je ne dis pas qu’elle sera utilisée – d’attaquer ces banques ?
Ma deuxième question concerne votre préconisation de développer les échanges en euro. Je suis toujours fascinée de voir que l’on vend les Airbus en dollars. Nous sommes bien pieds et poings liés au dollar aujourd’hui. Il suffit qu’une transaction intègre un contrat de couverture pour que le dollar intervienne. Comment se défaire de ce carcan ?
J’en viens à ma troisième question : la France est-elle plus visée que d’autres pays, notamment européens ? Vous avez indiqué, monsieur le président, que la Chine arrive à s’en sortir. La France est-elle donc plus visée que d’autres ou est-ce que l’Europe dans son ensemble fait office de « terrain de jeu » ?
M. Jean-Louis Destans. Je souhaiterais d’abord faire une remarque sur les conclusions du rapport. Nous avons bien vu qu’au fur et à mesure des auditions, nous partions de cas précis pour ensuite dérouler une matière qui, d’abord fiscale, touche à d’autres domaines.
L’adoption de la loi JASTA change considérablement la nature de l’extraterritorialité du droit américain, puisqu’il est désormais possible que des class actions visent des États. En l’espèce, il s’agissait de l’Iran. Nous n’avons pas beaucoup étudié cette loi même si j’étais avec Pierre Lellouche lorsque des avocats américains sont venus nous en parler. Le champ ouvert par la loi JASTA doit permettre de mobiliser un nombre de pays importants autour d’actions politiques et diplomatiques.
Nous avons eu le cas de la SNCF dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, mais il s’agit ici des attentats de septembre 2001 aux États-Unis. On voit bien les conséquences financières qui peuvent résulter de cette affaire. Je me demande s’il ne conviendrait pas d’élargir la réflexion en termes opérationnels en tenant compte de ces nouvelles dispositions du droit américain. Je ne sais pas si elles seront maintenues, mais, en attendant, le Congrès a passé outre le veto du président américain et aujourd’hui, des actions sont possibles sur le fondement de cette loi.
Mme la présidente Elisabeth Guigou. Je vais faire quelques observations et vous poser quelques questions.
D’abord, je trouve que les membres de la mission d’information, en particulier le Président et la Rapporteure, ont fait un excellent travail sur ce sujet absolument crucial, non seulement de technique financière et juridique mais aussi de politique étrangère.
Vis-à-vis des États-Unis, je crois qu’il faut être extrêmement ferme. Je n’ai aucune espèce de réticence à cet égard. En même temps, il faut être sûr que les propositions que nous faisons ne soient pas contre-productives et éviter les polémiques inutiles. Nous avons intérêt à essayer de bâtir avec ce grand allié une stratégie constructive et des politiques coopératives, notamment pour lutter contre la corruption et la fraude. C’est pourquoi je trouve que beaucoup de vos propositions sont excellentes et je crois qu’elles ont été formulées avec cet état d’esprit-là : la loi dite de blocage, la saisine de l’organe de règlement des différends de l’OMC, la question des « Américains accidentels », l’OFAC européen.
S’agissant de l’euro, je partage les observations de Valérie Rabault. Vous ne l’avez pas mentionné parce que j’imagine que cela va de soi, mais plus on renforcera l’euro, qui est d’ores et déjà la deuxième monnaie de réserve mondiale…
M. Jacques Myard. Non !
Mme la présidente Elisabeth Guigou. Mais si ! Jacques Myard n’est pas d’accord avec moi. Mais vous allez voir, monsieur Myard, que je suis d’accord avec vous sur quelque chose que vous avez dit tout à l’heure – une fois n’est pas coutume ! Il est évident que la promotion de l’euro est une façon de lutter contre le monopole de l’utilisation du dollar dans les transactions internationales.
Sur le plan national, vous avez beaucoup insisté sur les dispositions du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Il y a dans ce projet de loi des dispositions novatrices : la création d’une convention judiciaire d’intérêt public, que vous proposez et qui a été adoptée par l’Assemblée et le Sénat, et l’instauration d’une disposition extraterritoriale. Lorsque vous avez présenté vos premières réflexions devant nos commissions, je vous avais demandé d’expliquer dans votre rapport les raisons pour lesquelles la convention OCDE de 1997 – que je connais un peu, car j’ai défendu le projet de loi visant à la ratifier et j’y ai travaillé avec Dominique Strauss-Kahn – est si peu efficace. Vous répondez dans votre rapport qu’il y a une insuffisance manifeste des moyens de la justice, particulièrement du pôle financier. Je suis entièrement d’accord avec vous sur ce diagnostic, pour avoir considérablement augmenté les moyens de la justice lorsque j’étais garde des Sceaux. Je mesure toutefois à quel point, compte tenu de la complexité de ce type d’affaires, nous sommes encore loin du compte.
Vous soulignez ensuite « l’inadaptation totale des dispositifs juridiques de coopération judiciaire classique, qui donnent des résultats aléatoires et avec des délais imprévisibles ». Rien n’empêche que l’on tâche d’améliorer davantage ces mécanismes de coopération judiciaire classique et je souhaiterais que cela soit souligné. Évidemment, cela suppose des moyens, mais je ne vois pas pourquoi l’on écarte d’un revers de la main la possibilité d’améliorer les mécanismes de coopération judiciaire classiques.
Surtout, vous soulignez « l’obligation de la justice de trouver des preuves qui, dans le cadre de la procédure américaine sont fournies par les entreprises elles-mêmes ». J’avais déjà exprimé mes réserves à l’introduction de cette procédure, dite du « plaider coupable ». Vous avez dit les raisons qui vous amènent à soutenir ce dispositif, mais je veux aller encore plus loin que Jacques Myard : le système anglo-saxon – et pas seulement américain – consiste en réalité à confier à des acteurs privés le soin d’apporter des preuves et de rendre la justice, pour un coût énorme pour le contribuable, avec naturellement des risques d’inégalités – vous y avez d’ailleurs fait allusion tout à l’heure. Je me demande quel impact cette disposition pourrait avoir sur la compétitivité de nos entreprises. Il faut en effet payer des intermédiaires ; il faut payer des avocats dont les honoraires sont élevés. Nous avons toujours refusé ce système. J’espère que nous n’allons pas créer de brèche dans notre système juridique, lequel consiste à confier à des magistrats indépendants du pouvoir politique – et j’espère qu’on ira encore plus loin en modifiant un jour la Constitution –, à des juges d’instruction, à des procureurs, le soin d’apporter ces preuves. Naturellement, il faut qu’ils en aient les moyens financiers, humains et intellectuels.
En Angleterre, quand vous avez un problème, même pénal, le procureur fait son rapport et c’est à l’avocat de la défense d’apporter les preuves. Ce n’est pas un service public de la justice. Cela a été adopté et je n’en ai pas fait un combat, mais je dis : « alerte » et je demande qu’on soit extrêmement vigilant sur les résultats. Il nous faudra avoir une évaluation sérieuse de l’application de cette concession, notamment quant à ses effets pour les entreprises qui paient des amendes et paieront demain des avocats. Comment feront les PME ? Je comprends à cet égard la réticence du ministre des finances, lui-même ancien garde des Sceaux. Je tenais à le dire pour que ce soit annexé au rapport. Après, qu’il y ait une autorité centralisée des poursuites, cela est très bien.
Dernière remarque : il faut que l’Iran respecte ses obligations et que la levée des sanctions soit effective. On y a intérêt parce que c’est dans notre intérêt que l’économie iranienne s’ouvre et aussi que le président actuel, M. Rohani, remporte un succès, sinon d’autres tendances que nous connaissons bien prendront le dessus. Malheureusement, il est vrai que nous sommes dans une période critique car l’Iran joue avec les lignes rouges, et le processus de levée des sanctions est complexe – vous l’avez abondamment souligné. Il y a apparemment une bonne coopération avec l’administration américaine mais il faut là aussi être vigilant ; on m’a dit que, dans le secteur de l’aviation civile, l’instruction des licences par l’administration américaine est beaucoup plus lente pour Airbus que pour Boeing.
Mme Karine Berger. Je vous le confirme Madame la Présidente.
Mme la présidente Élisabeth Guigou. Enfin, il y a la question centrale des banques. Il paraît que 450 comptes bancaires ont été ouverts hors d’Iran par des banques iraniennes auprès de 200 banques étrangères de taille moyenne. Le problème est que les plus grandes banques internationales ne figurent pas dans cette liste. Pensez-vous que cet exemple des banques moyennes, avec les dispositions que vous préconisez, peut arriver à convaincre les banques internationales, puisque vous avez dit – et je le comprends – que vous ne prendriez pas la responsabilité de leur assurer qu’elles peuvent aller sur ce marché.
Mme Karine Berger. Merci beaucoup pour toutes ces réflexions et questions et cet apport à notre rapport. Je vais répondre aux questions notamment posées par vous Madame la Présidente. Concernant l’Iran, je suis persuadée que Pierre Lellouche voudra en dire plus mais il n’est pas possible de régler la problématique iranienne en laissant les entreprises ou les banques européennes se débrouiller avec l’administration américaine avec des licences au cas par cas. On ne peut pas le faire car elles n’ont aucun intérêt à le faire et que les réponses données par l’administration américaine sont beaucoup trop floues. C’est donc une démarche diplomatique qui doit être assumée : il faut que les Etats-Unis règlent leur problème interne concernant l’Iran. Pour ceux qui auraient été en Iran, au cas où cela vous aurait échappé, depuis le début de l’année vous ne pouvez plus bénéficier de la procédure ESTA et il faut demander un visa américain. C’est une nouveauté. Nous pensons qu’on ne pourra résoudre le problème qu’à un niveau diplomatique c’est-à-dire en demandant aux Etats-Unis de clarifier leur position et pas en renvoyant chaque entreprise se débrouiller bilatéralement.
Concernant la nouvelle procédure de « plaider-coupable », j’entends toutes vos remarques – et je les comprends – et tous les risques. Nous avons auditionné la personne la plus intéressante à mes yeux, à savoir la responsable du pôle financier en charge de tous les dossiers de lutte contre la corruption qui ont donné lieu aux fameuses sanctions aux Etats-Unis. Il faut savoir que pour toutes les entreprises sanctionnées aux Etats-Unis pour corruption, des procédures avaient été ouvertes en France. Il y avait une seule personne qui gérait ça : une seule juge qui avait 40 dossiers, qui sont chacun de la taille de celui d’Alstom, et face à elle arrivaient des avocats avec 20 dossiers ! Elle n’a jamais pu apporter la moindre preuve. Elle nous l’a dit comme ça !
C’est pour cela que j’entends parfaitement votre remarque selon laquelle on ne peut changer la logique des droits sans risque considérable de remise en cause générale. Mais la conviction que nous nous sommes forgée au fur et à mesure c’est que sur la partie économique de ce droit qui met en jeu des multinationales extraordinairement puissantes, si nous ne faisons pas jouer les mêmes mécaniques que les Américains, nous n’y arriverons pas. Pire, nous laisserons les Etats-Unis être les seuls à « racketter » ces entreprises.
Vous avez raison, il y a aura des conséquences pour un certain nombre de PME, et c’est la raison pour laquelle la procédure mise en place dans le cadre du projet de loi « Sapin II » prévoit une possible intervention d’un juge d’instruction et homologation par un juge. On est donc vraiment dans une situation où à ce stade la première tentative que nous faisons s’inscrit au maximum dans un cadre de droit français et pas anglo-saxon. Vous avez néanmoins parfaitement raison sur le fait qu’il faudra évaluer les conséquences du dispositif.
Je rebondis sur une réflexion de Valérie Rabault. Pourrait-on attaquer les banques américaines, en l’occurrence notamment Lehman Brothers ? On aurait tout de même un sujet de base juridique puisque les class actions, nouvellement mises en place, ne sont pas possibles sur tous les sujets, mais le sujet n’est pas là : le sujet est de savoir comment on arrive à développer des preuves sur la manière dont tout ceci a été réalisé. Nous ne sommes pas allés jusqu’à l’écrire dans le rapport, mais nous nous sommes forgés la conviction que pour l’optimisation fiscale agressive voire l’évasion fiscale il faudra probablement réfléchir à un « plaider coupable » pour les multinationales. Si l’on prend l’exemple des recours faits par le parquet national financier contre Google France, si le parquet n’a pas les moyens d’obtenir les informations de Google lui-même, il aura beaucoup de difficulté à démontrer que c’est un établissement stable qui est placé à Paris.
Ce n’est pas une recommandation du rapport ; nous n’avons pas été jusque-là. Mais de manière générale, chaque fois qu’il faudra poursuivre des multinationales qui ont violé des droits, qu’il s’agisse de droits du consommateur ou contre la corruption, la question de la construction du dossier à charges sera posée. En tous cas les Etats-Unis l’ont posée comme ça et les résultats sont simples : 20 milliards transmis à la justice américaine de la part des sociétés françaises.
M. Pierre Lellouche. Monsieur Premat, je partage votre analyse sur les « Américains accidentels ». Cela va être très difficile. D’abord je n’ai pas senti de grand enthousiasme au Quai d’Orsay pour s’occuper de ces malheureux Français, une démarche qui risque de compromettre l’excellence de nos relations avec Washington. Ensuite c’est très difficile car il faudrait obtenir un amendement à une convention déjà signée, c’est-à-dire un protocole, qui permette aux Américains concernés de renoncer à leur nationalité américaine sans passer par le fisc, les procédures diverses etc. Je n’ai pas senti une appétence particulière pour une telle solution à Washington, raison de plus pour la pousser sur le plan diplomatique et en faire un cas d’école. J’ai demandé au Quai d’Orsay de recenser les Français concernés, ce qui nous aiderait dans la négociation, et je ne sais pas où cela en est. Si vous avez l’occasion Madame la Présidente de relancer la direction des Amériques ce serait utile. En tous les cas il faut une action politique claire.
Madame Rabault, j’ai exactement la même réaction que vous. Le cas de la Deutsche Bank peut être un problème systémique : vu le niveau d’exposition de la banque, il y a de quoi faire tomber tout le système financier européen. J’étais au gouvernement au moment de la crise financière et je me souviens : à quelques millimètres près tout le système s’effondrait, européen et mondial. Les Etats-Unis ont fait tomber Lehman Brothers et on a vu ce que cela avait donné. Si, en raison de décisions de justice, prises comme ça aux Etats-Unis, on fait tomber la Deutsche Bank et tout le système européen, on rentre dans des choses cataclysmiques. Vous avez raison, à l’origine de la crise financière de 2008, ce n’est pas le système européen mais la spéculation sur les subprimes, les obligations pourries et les prêts un peu faciles par la finance américaine. Cela a ensuite été exporté en Europe et quand ils ont eu fini de massacrer les banques européennes – certaines ont dû être rachetées rappelez-vous -, sans parler de l’industrie américaine et tout ce qui a dû être remis à flot à coup de milliards, ils s’en sont pris aux dettes souveraines et ont commencé à attaquer la Grèce. La crise grecque a coûté, avec les plans de financement successifs, des centaines de milliards aux contribuables français et allemands. On est face à une administration américaine qui fait la sourde oreille. M. Obama a dit à François Hollande au sujet de la BNP, d’un ton offusqué qu’ici on était dans un Etat de droit comme si ce n’était pas le cas en France. Si le président Obama prétend que la justice américaine est indépendante et qu’on peut mettre tout le système financier par terre, alors il faut une réponse forte. Il faut leur dire qu’après tout cela a commencé aux Etats-Unis, que nous allons nous aussi jouer aux chasseurs de primes et engager une action, au niveau européen, international ou même français puisqu’il y a des bureaux de banques américaines en France. Nous verrons ce que cela donne. Si nous ne réagissons pas ainsi, en prétendant qu’il y a une séparation des pouvoirs, le système financier européen pourrait s’effondrer.
Sur l’euro je suis pessimiste car malheureusement, comme vous le verrez dans le rapport la place de l’euro se réduit dans le commerce international et je ne sais pas comment on pourrait inverser la tendance sauf avec beaucoup de volonté politique ce que je souhaite. C’est lié à la question de l’Iran : les banques moyennes peuvent-elles modifier le comportement des grandes banques ? Non. Les banques moyennes qui sont sollicitées par les Iraniens sont précisément celles qui ne sont pas exposées aux Etats-Unis. Mais les grandes et très grandes banques, y compris françaises, pourraient prêter des euros mais ne vont pas le faire car elles sont sur le territoire américain ou sont cotées aux Etats-Unis. Elles ne vont pas prendre le risque de se mettre en défaut avec la loi américaine.
Car le point essentiel sur lequel je veux revenir est le fait que l’accélération de ces procédures, de cette machine, est liée au vide politique à Washington. Il n’y a plus de cap. Il y a une administration d’un côté et un Congrès de l’autre et il n’y a plus de consensus bipartisan. Se sont engouffrés dans ce vide la bureaucratie et tous les chasseurs de primes, la SEC, le FED etc., qui se battent entre eux et se partagent les primes entre eux. Le système du « plaider coupable » permettra de dire aux Etats-Unis qu’on a un système efficace et de leur demander de nous laisser juger les entreprises. Mais les Américains nous répondent qu’ils les jugeront aussi et que s’il y a les deux procédures, on partagera les dépouilles à l’arrivée, ce qui est d’ailleurs contraire à la convention OCDE.
Pour toutes ces raisons, le message à adresser au ministre est de prendre une initiative politique forte mais aussi d’engager une action juridique car il n’est pas du tout sûr que ce comportement soit conforme aux règles de l’OMC. Je pense qu’on peut gagner cette action, il faut menacer de l’utiliser en tout cas et être beaucoup plus agressif, car nous avons ué jusqu’à présent en défense et en l’absence de pilote à Washington les choses se sont emballées au point de menacer le système financier européen et la stabilité de toute la politique au Moyen-Orient. Quand Erdogan dit aux Saoudiens qu’il va attaquer en responsabilité les Américains pour les attentats qu’il subit en Turquie, il n’a pas tort : un bombardement américain ou un soutien aux peshmergas kurdes produit des attentats. On peut arriver à des absurdités majeures. C’est pourquoi tous ceux qui s’occupent de sécurité nationale sont catastrophés à Washington.
J’en termine sur le JASTA. J’ai écrit au président de la République pour qu’il rappelle que la France est attachée au droit international et affirme que si les Américains persistent dans cette voie nous ferons la même chose. Il faut donner aux Américains seulement quelques semaines, avant les élections américaines, pour obtenir au minimum une clause d’exclusion de tous les alliés des Etats-Unis qui se battent avec eux contre le terrorisme. Nous allons vers un désastre juridique avec cette loi et nous risquons un désastre financier avec la Deutsche Bank. Ce système est devenu fou et un grand pays comme la France doit dire aux Etats-Unis que ça suffit. A partir de là, on s’assoit et on trouve des solutions.
Mme la présidente Élisabeth Guigou. Merci beaucoup. C’est un très beau sujet, traité avec beaucoup de précision et de manière très concrète.
Les commissions autorisent la publication du rapport d’information à l’unanimité.
ANNEXE N°1:
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA MISSION
À Paris, par ordre chronologique :
Ø MM. Édouard Marcus, sous-directeur de la prospective et des relations internationales à la direction de la législation fiscale (ministère des finances), et Florent Tesson, adjoint au chef du bureau des relations fiscales bilatérales, et Mme Anne-Marie Bassano, rédactrice au bureau des relations fiscales bilatérales
Ø Mme Agnès Romatet, directrice des entreprises, de l’économie internationale et de la promotion du tourisme (ministère des affaires étrangères et du développement international), ses collaborateurs, Mmes Sarah Chérion et Wassan Al Wahab et M. Sokrarith Henry, ainsi que M. Diego Colas, sous-directeur du droit de l’Union européenne et du droit international économique à la direction des affaires juridiques
Ø M. Thomas Courbe, directeur général adjoint du Trésor, chargé des affaires internationales, et Mme Magali Césana, chef du bureau chargé de la lutte contre la criminalité financière et des sanctions
Ø MM. Nicola Bonucci, directeur des affaires juridiques de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et Rémi Cébé, conseiller juridique principal, Mme Sandrine Hannedouche-Leric, analyste juridique principale, et M. Apostolos Zampounidis, juriste consultant
Ø Me Paul-Albert Iweins
Ø Me Laurent Cohen-Tanugi, accompagné de Mme Jodie Cohen-Tanugi et de Mlle Alexandra Lutz,
Ø MM. Fabien Lehagre, Philip Boëffard, Bernard Lozac'h et Philippe Vikar et Mme Aline Dominica Coscarat, membres du Collectif pour la défense des intérêts des Américains accidentels
Ø Mme Claude Revel, ancienne déléguée interministérielle à l’intelligence économique
Ø M. Jean-Baptiste Carpentier, commissaire à l’information stratégique et à la sécurité économiques
Ø MM. Jeroen Jansen, George Salem, Tim Eestermans, Rik Servais, juristes pour le cabinet DLA PIPER (commissionné par le gouvernement saoudien pour mener une campagne de sensibilisation sur le projet de législation américaine Justice Against Sponsors of Terrorism), et Geert van Calster, professeur de droit international public à l’université de Louvain
Ø MM. Pierrick Le Goff, directeur juridique d’Alstom, Michael Julian, responsable de la conformité, et Damien Cabarrus, responsable des affaires publiques France
Ø MM. Thierry Reveau de Cyrières, directeur des grands contentieux du groupe Total, et François Nahan, chargé des relations institutionnelles avec le Parlement
Ø Me Anne Vaucher, membre de la commission des affaires européennes et internationales du Conseil national des barreaux, et Mme Géraldine Cavaillé, directrice du service juridique
Ø MM. Georges Dirani, directeur juridique de BNP-Paribas, et Éric Martin, directeur de la conformité
Ø MM. Philippe Brassac, directeur général du Crédit agricole, et Pierre Minor, directeur juridique
Ø Me Kami Haeri, avocat associé au sein du cabinet August & Debouzy
Ø M. Alain Viallix, directeur des affaires publiques et des initiatives stratégiques de Nokia (ex-Alcatel-Lucent)
Ø MM. Patrick Calvar, directeur général de la sécurité intérieure, et Jean-Philippe Couture, sous-directeur
Ø M. Éric Denécé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement
Ø Me Daniel Soulez-Larivière
Ø Me Pierre Servan-Schreiber
Ø M. Patrick Richard, directeur juridique du groupe Vinci
Ø Mme Éliane Houlette, procureur national financier, et M. Éric Russo, 1er vice-procureur
Ø Mme Xavière Siméoni, cheffe du Service central de prévention de la corruption
À Washington, les 23 et 24 juin 2016 :
Ø S. Exc. Gérard Araud, ambassadeur de France à Washington, et ses collaborateurs, notamment MM. Jean-François Pactet, conseiller chargé des affaires stratégiques, Pierre-Édouard Colliex, attaché de sécurité intérieure, Renaud Lassus, chef du service économique régional, ses collèges Bernhard Hechenberger et Olivier Jonglez, et Cameron Griffith, chargé des relations avec le Congrès
Ø M. Richard Craig Shelby, sénateur, président de la commission des affaires bancaires du Sénat, et Mme Jelena Mc Williams, conseiller en chef de la commission
Ø M. Darryl Wegner, chef de l’unité de la corruption internationale du Federal Bureau of Investigation, et ses collègues
Ø MM. Bruce C. Swartz, adjoint de l’Attorney General, chargé des affaires internationales, Peter B. Axelrod, magistrat de liaison à Paris, et leurs collègues du Département de la justice
Ø Mme Barbara Bouchard, directrice associée senior de la division de la supervision bancaire et de la réglementation à la Réserve fédérale, M. Michael D. Solomon, directeur associé, et leurs collègues
Ø M. John E. Smith, directeur exécutif de l’Office of Foreign Assets Control du Trésor, et ses collaborateurs
Ø M. Alberto Arevalo, directeur associé de la coopération et de l’assistance technique de la Securities and Exchange Commission, et Mme Katherine Martin, directrice associée de la politique réglementaire
Ø MM. Juan Zarate, conseiller senior au Center for Strategic and International Studies, et Eric Lorber, associé senior au Financial Integrity Network
Ø M. Daniel Fried, coordinateur « sanctions » au Département d’État, et ses collaborateurs
Le Président et la Rapporteure de la mission remercient chaleureusement l’ambassadeur de France et ses collaborateurs pour leur aide irremplaçable dans l’organisation de leur déplacement et pour leur accueil, ainsi que les personnalités américaines qui ont bien voulu les recevoir.
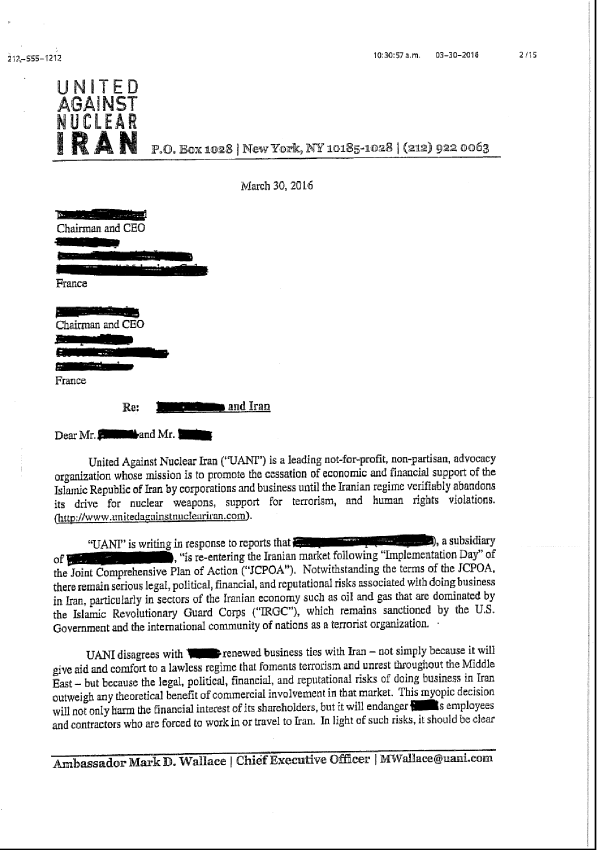
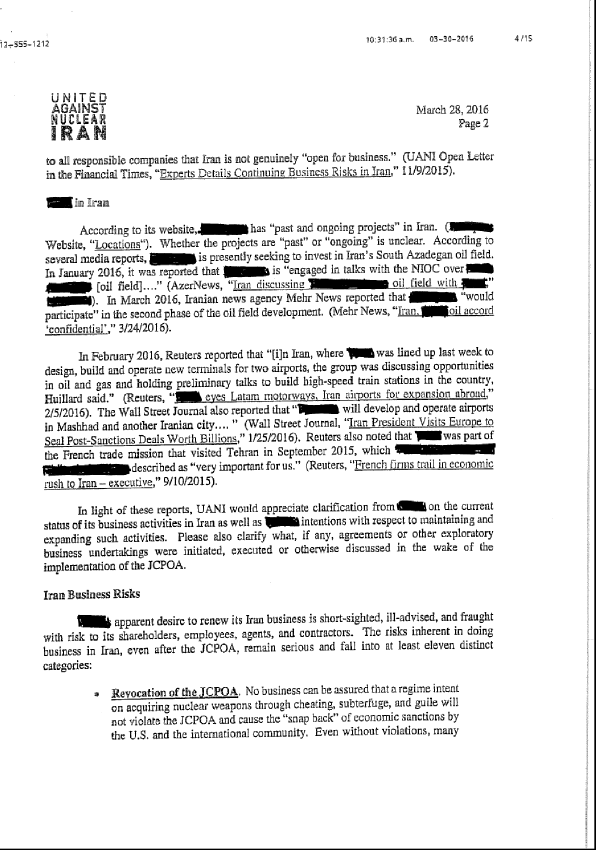
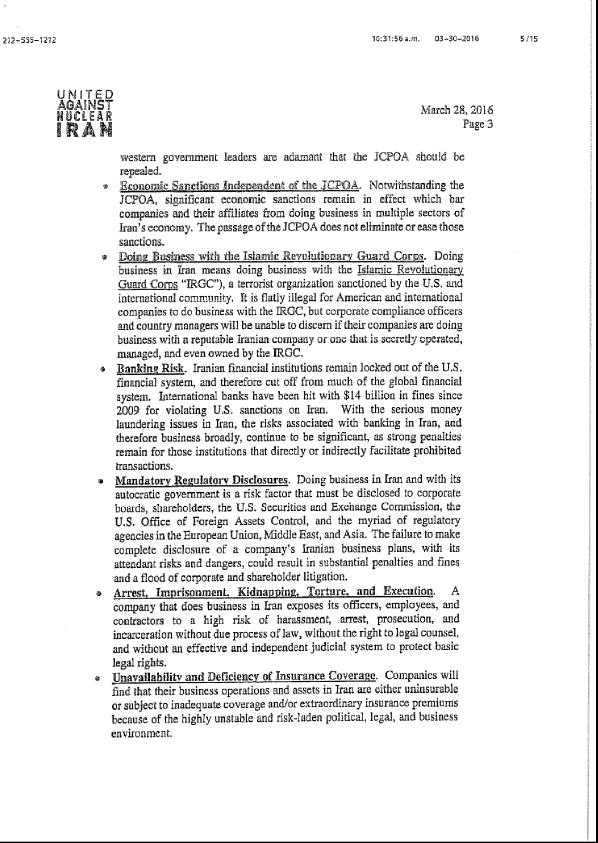
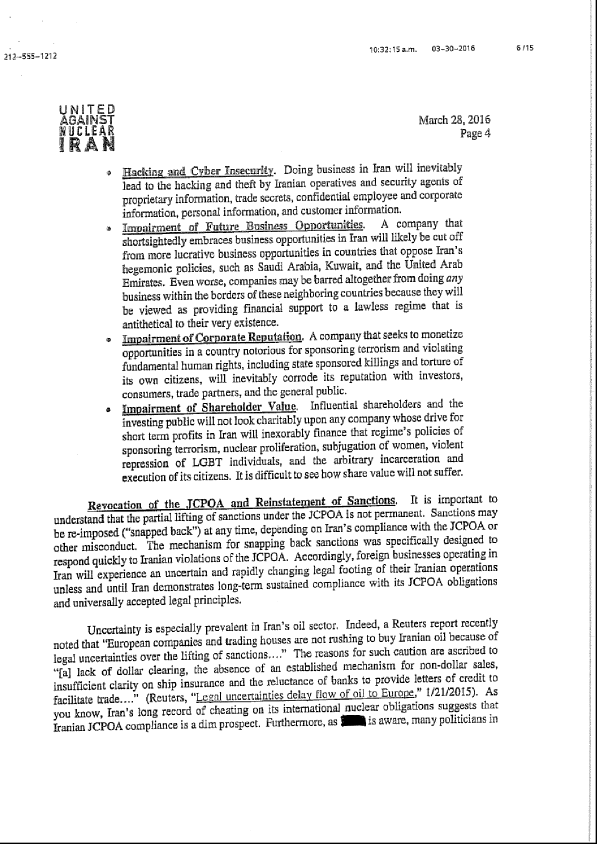
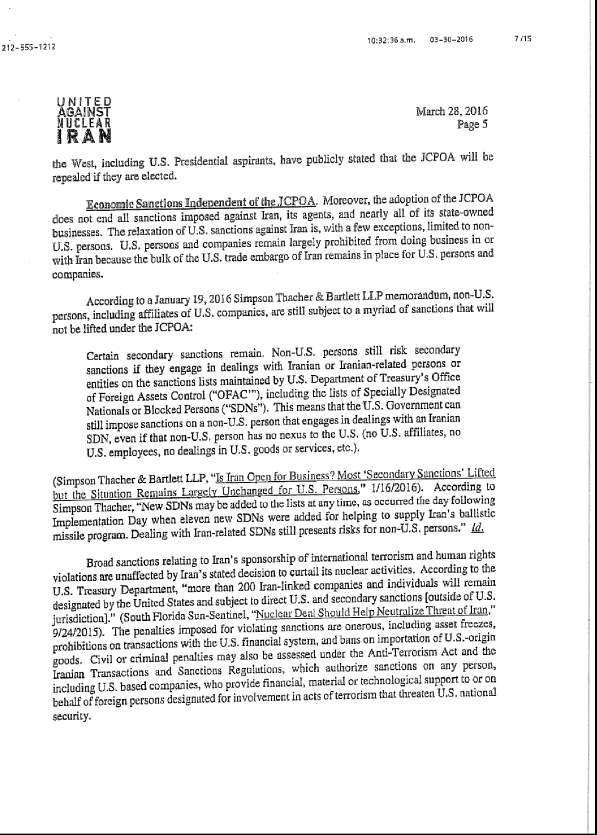
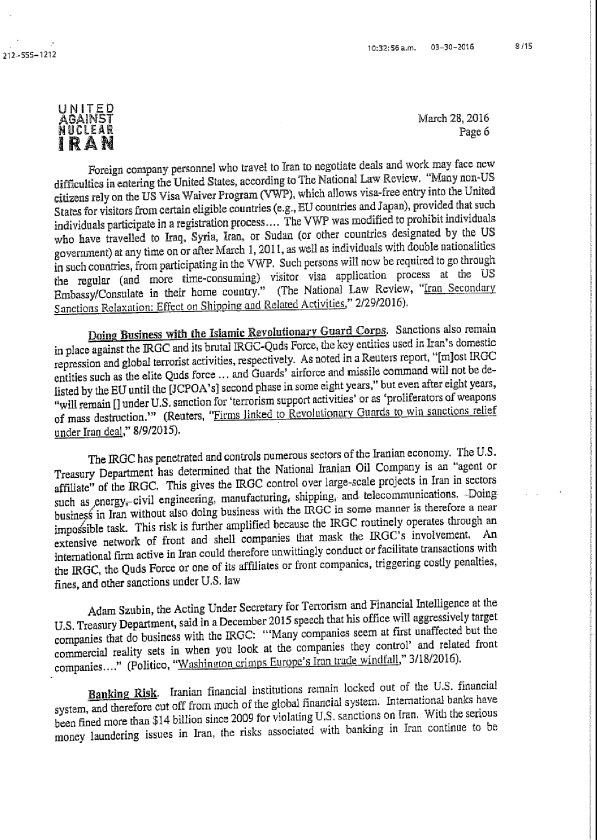
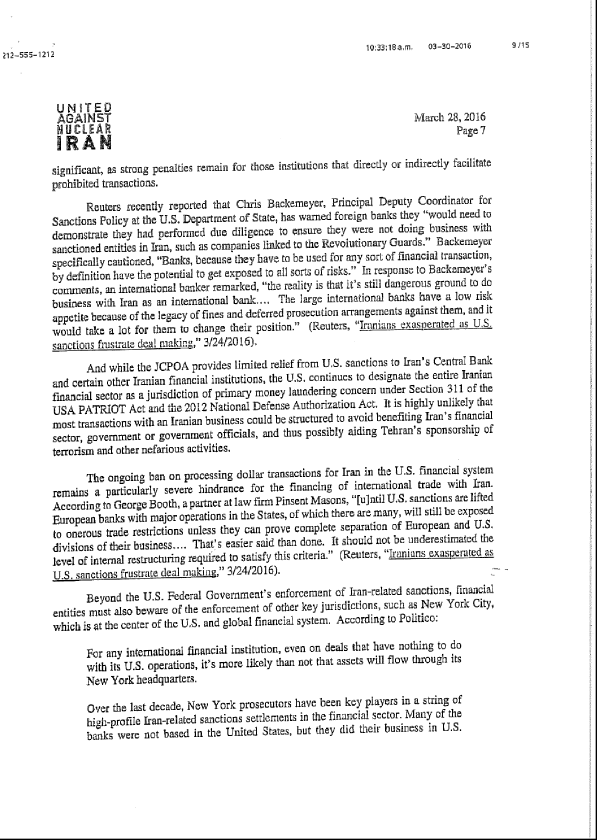
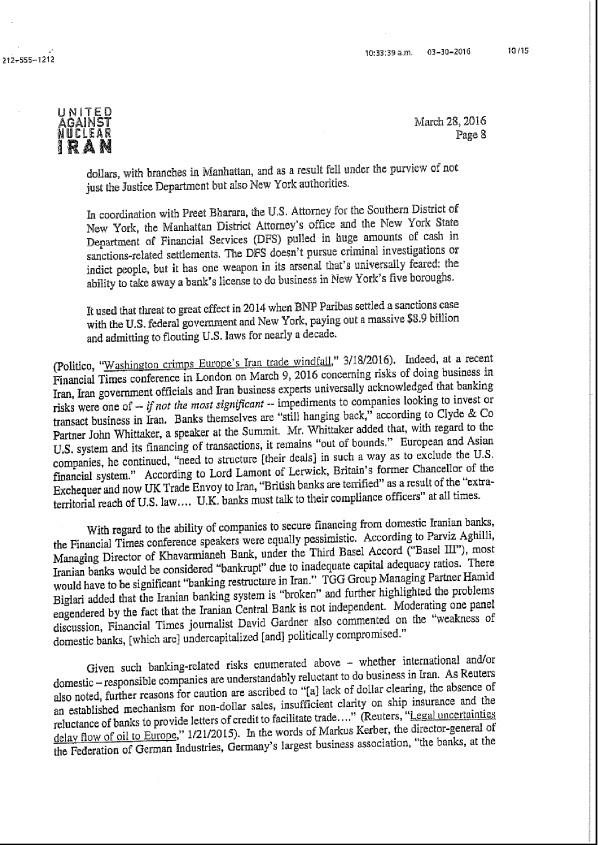
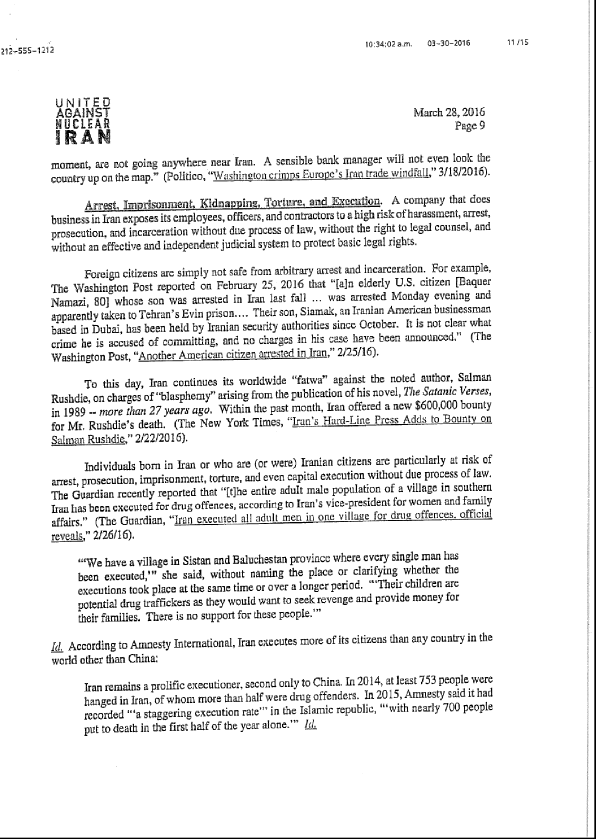
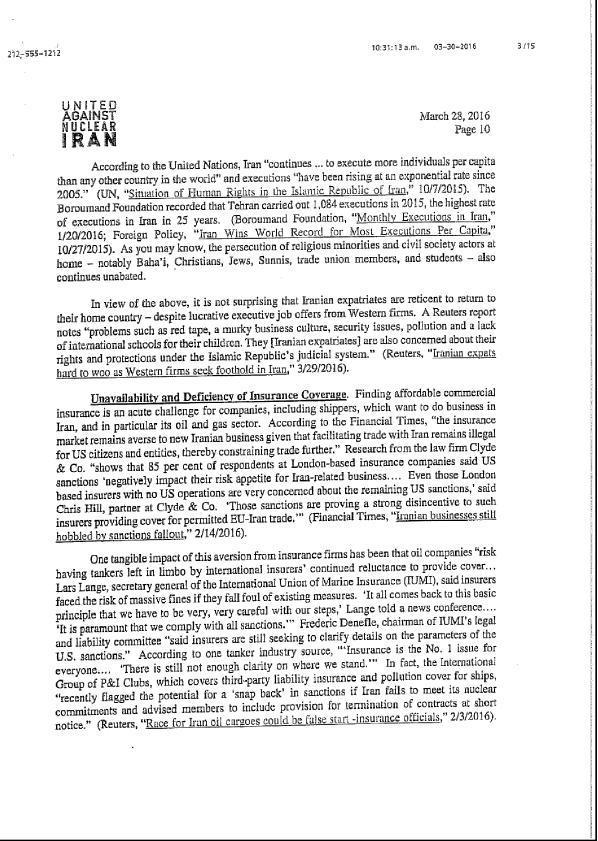
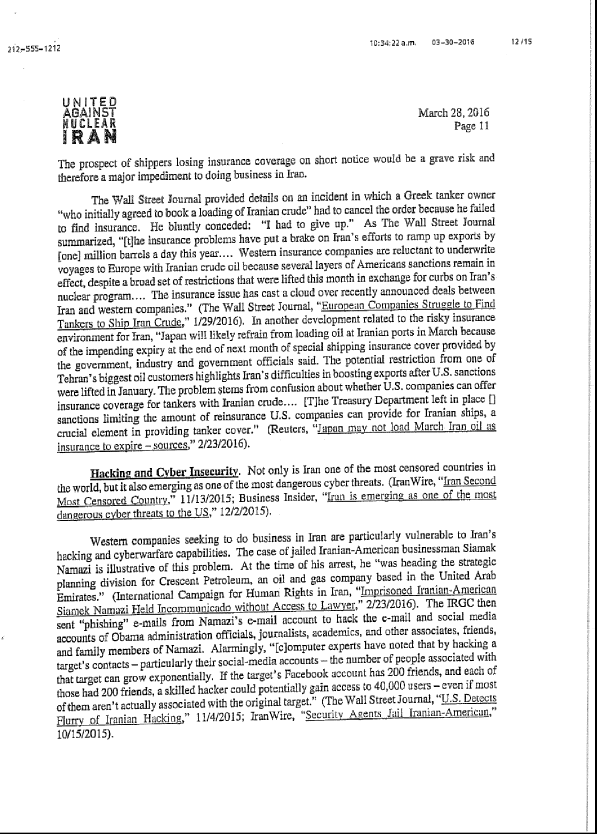
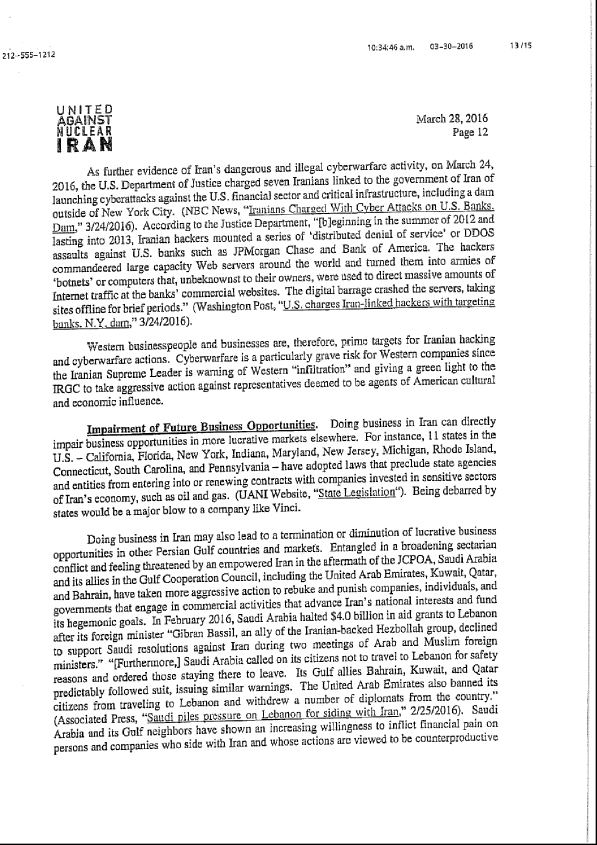
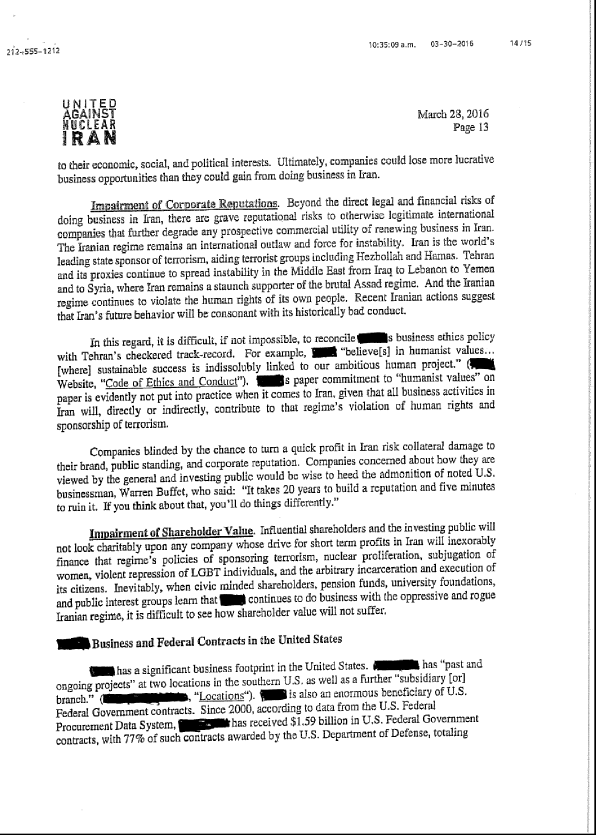
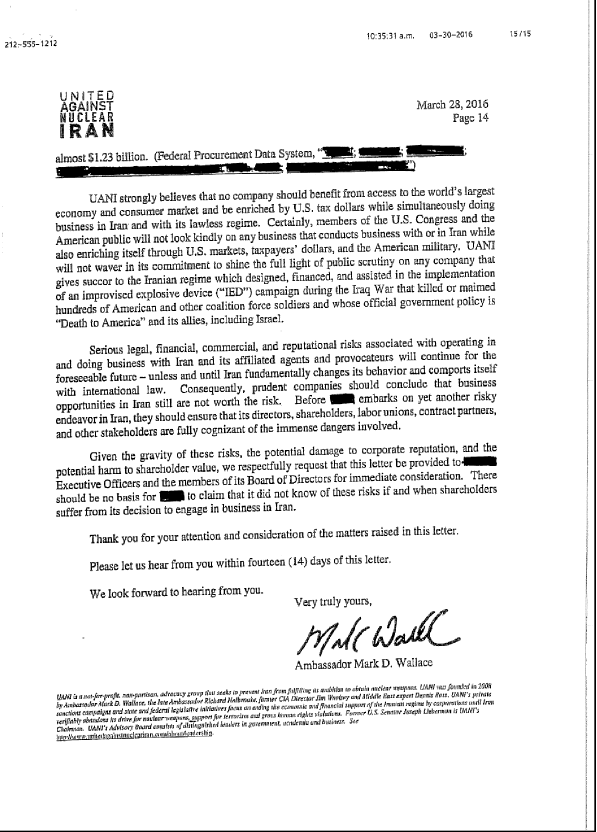
1 () Dans le présent rapport, conformément à une facilité qui rend d’ailleurs compte de la prépondérance de fait des États-Unis d’Amérique, le qualificatif « américain » renvoie par simplicité à ces derniers, bien qu’ils ne couvrent qu’une partie du continent américain, et le substantif « États-Unis » s’entend des États-Unis d’Amérique, bien que d’autres nations du monde soient également des « États-Unis », par exemple les « États-Unis mexicains ».
2 () Concept au demeurant développé par un universitaire américain, Joseph Nye.
3 () Centre français de recherche sur le renseignement-Cf2R, « Racket américain et démission d’État – Le dessous des cartes du rachat d’Alstom par General Electric », rapport de recherche n° 13, décembre 2014.
4 () Rapport de phase 3 sur la mise en œuvre par la France de la convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, octobre 2012.
5 () La liste des officiels américains de haut rang lourdement condamnés pour corruption ces dernières années est impressionnante : en 2009, l’ancien représentant de la Louisiane, M. William J. Jefferson (treize ans de prison) ; en 2011, l’ancien gouverneur de l’Illinois, M. Milorad R. Blagojevich (quatorze ans de prison) ; en 2014, l’ancien maire de La Nouvelle-Orléans, M. Ray Nagin (dix ans de prison) ; en 2016, l’ancien sénateur de Californie, M. Leland Yee (cinq ans de prison)…
6 () CNAS Economic Statecraft Series, « The challenge to building à balanced transatlantic sanctions policy between the United States and the European Union ».
7 () Estimation de Philippe Rousselot, ENA hors les murs, juin 2014, n°442.
8 () Rapportés sur le site du Financial Times.
9 () Bank Markazi v. Peterson, 20 avril 2016.
10 () Rapport de l’OCDE sur la corruption transnationale, 2014.
11 () Ces pénalités étant de fait partagées entre diverses administrations américaines : voir infra.
12 () Shearman & Sterling LLP, FCPA Digest, janvier 2015.
13 () 50 U.S. Code § 1705.
14 () Ces pénalités étant de fait partagées entre diverses administrations américaines : voir infra.
15 () Ce règlement a remplacé le règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000. De portée générale, il est complété par des textes de porte particulière, comme le règlement n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.
16 () Sont aussi visés, conformément au principe habituel de territorialité, les « domestic concerns », c’est-à-dire les personnes et entités installées aux États-Unis, ainsi que le cas de figure où les paiements litigieux ont été réalisés sur le territoire américain.
17 () Voir l’article 15 U.S. Code § 78dd–1, « Prohibited foreign trade practices by issuers », lequel vise « any issuer which has a class of securities registered (…) or which is required to file reports (…) ».
18 () Régis Bismuth, « Les nouvelles pulsions extraterritoriales américaines (affaires Alstom et BNP Paribas) : de l’importance de nuancer et de séparer le bon grain de l’ivraie », article à paraître dans l’Annuaire français de droit international d’octobre 2016.
19 () Shearman & Sterling LLP, FCPA Digest, janvier 2015.
20 () Voir l’article 31 U.S. Code § 5318, « Compliance, exemptions, and summons authority », paragraphes h et i.
21 () Article à paraître dans l’Annuaire français de droit international d’octobre 2016, « Les nouvelles pulsions extraterritoriales américaines (affaires Alstom et BNP Paribas) : de l’importance de nuancer et de séparer le bon grain de l’ivraie ».
22 () Patriot Act, titre III, section 302-a-3 : « money launderers (…) can threaten the safety of United States citizens and undermine the integrity of United States financial institutions and of the global financial and trading systems upon which prosperity and growth depend ».
23 () Les grandes banques réalisent quotidiennement pour leurs clients des millions d’opérations de crédit, de débit, de paiement, conduisant à des transferts financiers entre elles. La compensation leur permet de simplifier le règlement de ces multiples positions (dettes) croisées, en procédant par différence entre les montants consolidés par monnaie de paiement (seul le solde devra être transféré). Les opérations financières qui concernent des montants élevés transitent principalement par deux systèmes de paiement aux États-Unis : Fedwire, qui est géré par la FED, et le Clearing House Interbank Payments System (CHIPS), qui est détenu par des agents privés.
24 () Sous réserve notamment de la réintégration éventuelle au bénéfice imposable des profits faits par les filiales localisées dans les pays à « régime fiscal privilégié » (paradis fiscaux) prévue à l’article 209B du code général des impôts.
25 () 28 U.S. Code § 1605A - Terrorism exception to the jurisdictional immunity of a foreign state.
26 () Bank Markazi v. Peterson, 20 avril 2016.
27 () Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique sur l'indemnisation de certaines victimes de la Shoah déportées depuis la France signé à Washington le 8 décembre 2014
28 () Délégation de l’Union européenne, lettre à l’attention du bureau des affaires européennes et eurasiennes du département d’État américain du 19 septembre 2016
29 () En temps réel, les cahiers, « L’application extraterritoriale du droit américain, fer de lance de la régulation économique internationale ? », décembre 2014.
30 () Des peines de prison pouvant aller jusqu’à 15 ans ont été prononcées ces dernières années aux États-Unis pour violation de la loi FCPA (étant toutefois à noter que les peines en cause couvraient généralement aussi la violation d’autres législations, car il s’agit de cas de délinquance économique complexe).
31 () Centre français de recherche sur le renseignement-Cf2R, « Racket américain et démission d’État – Le dessous des cartes du rachat d’Alstom par General Electric », rapport de recherche n° 13, décembre 2014.
32 () Morrison v. National Australia Bank, 24 juin 2010.
33 () Kiobel v. Royal Dutch Petroleum, 17 avril 2013.
34 () OBB Personenverkehr AG v. Sachs, 1er décembre 2015.
35 () Daimler AG v. Bauman, 14 janvier 2014.
36 () Affaire Patel, U.S. District Court for the District of Columbia, juge Richard J. Leon, 7 juillet 2011.
37 () Source : Fiche d’information « Les mesures restrictives de l'UE », Bruxelles, le 29 avril 2014.
38 () Google/AEPD et Gonzalez (C-131/12), 13 mai 2014.
39 () Royaume-Uni/Conseil (C-209/13), 30 avril 2014.
40 () Ces « commentaires » ont été adoptés par les négociateurs à l’unanimité et s’incorporent donc en quelque sorte au dispositif de la convention.
41 () Article à paraître dans l’Annuaire français de droit international d’octobre 2016, « Les nouvelles pulsions extraterritoriales américaines (affaires Alstom et BNP Paribas) : de l’importance de nuancer et de séparer le bon grain de l’ivraie ».
42 () 11 février 2003, affaires jointes C-187/01 et C-385/01.
43 () Pour être précis, « des procédures d’extinction de l’action publique (…) par lesquelles le ministère public d’un État membre met fin, sans l’intervention d’une juridiction, à la procédure pénale engagée dans cet État, après que le prévenu a satisfait à certaines obligations et, notamment, a acquitté une certaine somme d’argent ».
44 () Cassation criminelle, 26 septembre 2007, n° 07-83829 : « l’exception de chose jugée prévue aux articles 113-9 du code pénal et 692 du code de procédure pénale ne saurait faire obstacle à l’exercice des poursuites exercées sur le fondement de la compétence territoriale française ».
45 () Tribunal correctionnel de Paris, n° 06-026092035.
46 () Clyde Union, DBTF, Flowserve Pompes et Renault Trucks.
47 () OCDE, « France: rapport de suivi écrit de phase 3 et recommandations », décembre 2014.
48 () Commission des affaires étrangères, Compte-rendu n°89 du 10 septembre 2014 relatif accord en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA »), (n° 2179)
49 () Les premiers échanges de fichiers de données ont eu lieu. Celles reçues des États-Unis sur des comptes français dans les institutions financières de ce pays concernent 39 000 personnes physiques et 15 000 personnes morales. L’administration fiscale n’a pas encore dénombré combien de comptes « américains » dans les banques françaises ont été transmis dans l’autre sens.
50 () Cf. lettre de M. Hervé Morin, alors ministre de la défense, en date du 11 juillet 2008, qui est citée dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 avril 2011.
51 () Voir : Amnesty International, « Côte d’Ivoire. Les effets destructeurs de la prolifération des armes et de leur usage incontrôlé ».
52 () Source : rapport du Congressional Research Service, « Iran Sanctions », par Kenneth Katzman, 17 juin 2016.
53 () Voir les points C-6 et C-7 du document FAQs (« Frequently Asked Questions ») publié par l’OFAC sur la levée des sanctions concernant l’Iran : « U.S. financial institutions continue to be prohibited from clearing transactions involving Iran » et « foreign financial institutions need to continue to ensure they do not clear U.S. dollar-denominated transactions involving Iran through U.S. financial institutions, given that U.S. persons continue to be prohibited from exporting goods, services, or technology directly or indirectly to Iran, including financial services ». La prestation de compensation est ainsi assimilée à une « exportation » de services financiers.
54 () Les sanctions économiques générales de l’Union européenne liées au programme nucléaire iranien, telles que l’embargo sur les hydrocarbures iraniens et la vente de technologies pétrolières à l’Iran, ou le gel des transactions financières, sont ainsi levées. Un régime de licences est prévu pour certaines technologies sensibles et les embargos sur les armes, les équipements de répression interne et la technologie des missiles restent en place, de même qu’une partie des sanctions individuelles.
55 () Pour un exemple, voir la lettre envoyée par l’UANI à une entreprise française en annexe
56 () Loi n° 68-678 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères.
57 () Mais il s’appuie naturellement pour l’exercice de cette mission sur d’autres administrations, notamment la direction des affaires criminelles, le ministère des affaires étrangères et la direction générale du Trésor. Les documents des contrôleurs destinés à être transmis aux États-Unis sont examinés lors de réunions interministérielles.
58 () Chambre criminelle, 12 décembre 2007, n° 07-83.228.
59 () Société nationale industrielle aérospatiale v. United States District Court for the southern District of Iowa, 15 juin 1987.
60 () Note de bas de page n° 29 : « It is well settled that such statutes do not deprive an American court of the power to order a party subject to its jurisdiction to produce evidence, even though the act of production may violate that statute ».
61 () Cf. le Plan national d’action contre le financement du terrorisme lancé le 18 mars 2015, le vote de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale publié, la mise en place prochaine du « registre public des trusts » (décret n° 2016-567 du 10 mai 2016)…
62 () Voir les rapports annuels d’activité de l’OLAF, ou bien le document de la Commission : « La lutte de l’UE contre la fraude et la corruption – Dans les coulisses de l’OFAC, l’Office européen de lutte antifraude ».
63 () Voir les rapports annuels de la BCE : « The international role of the euro ».
64 () http://www.swift.com/about_swift/shownews?param_dcr=news.data/en/swift_com/2015/PR_RMB_second_most_used_currency.xml.
65 () Estimation de Philippe Rousselot, ENA hors les murs, juin 2014, n°442.
© Assemblée nationale