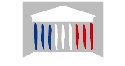______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 octobre 2016.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA MISSION D’INFORMATION (1)
sur l’offre automobile française
dans une approche industrielle, énergétique et fiscale,
ET PRÉSENTÉ
PAR Mme Sophie ROHFRITSCH, Présidente,
et
Mme Delphine BATHO, Rapporteure,
Députées.
——
TOME II
COMPTES RENDUS DES AUDITIONS
La mission d’information sur l’offre automobile française dans une approche industrielle, énergétique et fiscale est composée de : Mme Sophie Rohfritsch, présidente ; M. Frédéric Barbier, M. Christophe Bouillon, Mme Marie-Jo Zimmermann, vice-présidents ; Mme Delphine Batho, rapporteure ; M. Xavier Breton, M. Jean-Pierre Maggi, M. Jean Grellier, secrétaires ; M. Yves Albarello, M. François André, M. Jean-Marie Beffara, M. Marcel Bonnot, Mme Marie-George Buffet, M. Jean-Yves Caullet, Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Charles de Courson, Mme Françoise Descamps-Crosnier, M. Philippe Duron, Mme Arlette Grosskost, M. Michel Heinrich, M. Denis Jacquat, M. Philippe Kemel, M. Gérard Menuel, M. Bertrand Pancher, M. Rémi Pauvros, M. Patrice Prat, M. Éric Straumann, M. Jean-Michel Villaumé, membres.
__________________________________________________________________
SOMMAIRE
___
Pages
COMPTES RENDUS DES AUDITIONS 7
1. Audition, ouverte à la presse, de M. Bruno Léchevin, président de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). 9
2. Audition, ouverte à la presse, de M. Cédric Musso, directeur de l’action politique de l’UFC-Que Choisir, et de M. Nicolas Mouchnino, chargé de mission énergie et environnement. 20
3. Audition, ouverte à la presse, de M. Éric Poyeton, directeur général de la Plateforme automobile et mobilités (PFA). 29
4. Audition, ouverte à la presse, de M. Michel Costes, président du Cabinet d’analyse de données économiques INOVEV, et de M. Jamel Taganza, vice-président. 46
5. Audition, ouverte à la presse, de M. le professeur Élie Cohen, économiste (Sciences Po/CNRS). 58
6. Audition, ouverte à la presse, de M. Christophe Lerouge, chef du service de l’Industrie à la Direction générale des entreprises. 73
7. Audition, ouverte à la presse, de M. Louis Schweitzer, Commissaire général à l’investissement. 88
8. Audition, ouverte à la presse, de M. Frédéric Dionnet, directeur général du Centre d’étude et de recherche en aérothermique et moteurs (CERTAM), de M. David Preterre, toxicologue et chef de département qualité de l'air, métrologie des nanoparticules aérosolisées et évaluation et de M. Frantz Gouriou, physicien spécialiste de la métrologie des particules fines. 102
9. Audition, ouverte à la presse, de M. Laurent Benoit, président-directeur général de l’UTAC-CERAM et de Mme Béatrice Lopez de Rodas, directrice de la marque « UTAC ». 112
10. Audition, ouverte à la presse, de Mme Aliette Quint, du groupe Air Liquide, secrétaire générale de l’Association française pour l’hydrogène et les piles à combustible (AFHYPAC) et de M. Fabio Ferrari, de la société SymbioFcell. 122
11. Audition, ouverte à la presse, de M. Philippe Maler, inspecteur général de l’administration du développement durable et de M. Jean-Bernard Erhardt, administrateur en chef des affaires maritimes du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD). 135
12. Audition, ouverte à la presse, de M. Francis Duseux, président de l’Union française des industries pétrolières (UFIP), de Mme Isabelle Muller, déléguée générale et de M. Bruno Ageorges, directeur des relations institutionnelles et des affaires juridiques. 142
13. Audition, ouverte à la presse, de M. Jacques Mauge, président de la Fédération des industries des équipements pour véhicules (FIEV) et conseiller du président de Faurecia, de M. Guy Maugis, président de Bosch France et de M. Olivier Rabiller, vice-président, directeur général, en charge de l’innovation, des fusions–acquisitions, de l’après-vente et des régions en forte croissance de la société Honeywell Transportation System. 156
14. Audition, ouverte à la presse, de M. Xavier Timbeau, économiste, directeur principal de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE). 171
15. Audition, ouverte à la presse, de M. Ariel Cabanes, directeur de la prospective et de Mme Clémence Artur, chargée des relations publiques du Conseil national des professions de l’automobile (CNPA). 179
16. Rencontre, non ouverte à la presse, entre Mme la rapporteure et M. Michel Rollier, président de la Plateforme de la filière « Automobile et mobilités » (PFA) et président du conseil de surveillance de Michelin 191
17. Audition, ouverte à la presse, de M. Bernard Fourniou, président de l’Observatoire du véhicule d’entreprise (OVE) et de M. Philippe Noubel, directeur général délégué d’Arval. 203
18. Audition, ouverte à la presse, de Mme Catherine Foulonneau, directeur stratégie et territoires de GRDF, de Mme Catherine Brun, directrice commercial de GRTgaz, de M. Vincent Rousseau, directeur de projet mobilité de GRTgaz, de M. Jean-Claude Girot, président de l'Association française du gaz naturel pour véhicules (AFGNV) et de M. Gilles Durand, secrétaire général de l'AFGNV. 214
19. Audition, ouverte à la presse, de M. Christian de Perthuis, professeur à l’Université de Paris Dauphine, titulaire de la Chaire d’économie du climat. 224
20. Audition, ouverte à la presse, de M. Joseph Beretta, président du conseil d’administration de l’Association nationale pour le développement de la mobilité électrique (AVERE France). 233
21. Audition, ouverte à la presse, de MM. Jean-Marc Jancovici et de Alain Grandjean, associés fondateurs de Carbone 4, cabinet de conseil spécialisé dans la stratégie carbone. 242
22. Audition, ouverte à la presse, de M. Jacques Rivoal, président du directoire de Volkswagen France. 255
23. Non-audition, ouverte à la presse, de M. Jacques Rivoal, président du directoire de Volkswagen France 256
24. Audition, ouverte à la presse, de M. Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat au Ministère du développement durable. 257
25. Table ronde avec des représentants de la presse automobile et des associations d’automobilistes. Elle a entendu : Mme Alexandrine Breton des Loÿs, présidente du groupe Argus M. Grégory Pelletier, chef du service rédactionnel de l’édition grand public de L’Argus ; M. Arnaud Murati, chef de rubrique à L’Argus ; M. Laurent Chiapello, directeur des rédactions d’Auto Plus, de L’Auto Journal et de Sport Auto ; M. Daniel Quéro, président de l’association 40 millions d’automobilistes ; M. Didier Bollecker, président de l’Automobile Club Association ; M. Stéphane Meunier, rédacteur en chef d’Automobile Magazine ; M. Brice Perrin, chef de rubrique à L’Auto Journal ; M. Alexandre Guillet, rédacteur en chef du Journal de l’automobile ; M. Lionel Robert, directeur de la rédaction d’Auto-Moto. 271
26. Audition, ouverte à la presse, de M. Fabrice Godefroy, président de l’association Diésélistes de France et directeur général du groupe IDLP et de M. Yann Le Moal, porte-parole de l’association Diésélistes de France et directeur de la société NED. 289
27. Audition, ouverte à la presse, de M. Jacques Rivoal, président du directoire de Volkswagen France. 304
28. Audition, ouverte à la presse, de M. Flavien Neuvy, directeur de l’Observatoire CETELEM de l’automobile. 318
29. Audition, ouverte à la presse, de M. Éric Le Corre, directeur des affaires publiques du Groupe Michelin et de M. Éric Vinesse, directeur pré-développement. 332
30. Audition, ouverte à la presse, de M. Martin Vial, commissaire aux participations de l’État (APE), de M. Aymeric Ducrocq, directeur de participations industrie et de M. Jérôme Baron, secrétaire général. 349
31. Audition, ouverte à la presse, de M. Christian Peugeot, président du Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA), et de M. Nicolas Le Bigot, directeur des affaires environnementales et techniques, accompagnés de M. François Roudier, directeur de la communication. 360
32. Audition, ouverte à la presse, de M. Nicolas Paulissen, délégué général de la Fédération nationale des transporteurs routiers (FNTR), accompagné de M. Benoit Daly, secrétaire général, et de Mme Élisabeth Charrier, déléguée régionale. 375
33. Audition, ouverte à la presse, de M. Yann Delabrière, président-directeur général de FAURECIA, et M. Hervé Guyot, vice-président chargé de la stratégie. 383
34. Audition, ouverte à la presse, de M. Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, de M. Alexandre Rochatte, délégué adjoint à la sécurité et à la circulation routières, de Mme Marie Boursier, chargée d’études au bureau de la signalisation et de la circulation de la sous-direction de l'action interministérielle à la délégation à la sécurité et à la circulation routières, de M. Rodolphe Chassande-Mottin, chef du bureau de la signalisation et de la circulation de la sous-direction de l'action interministérielle à la délégation à la sécurité et à la circulation routières, et de M. Joël Valmain, conseiller technique "Europe-International" auprès du délégué interministériel à la sécurité routière 395
35. Audition, ouverte à la presse, de M. Gilles Le Borgne, directeur de la recherche et du développement, membre du comité exécutif de PSA Peugeot Citroën. 405
36. Audition, ouverte à la presse, de M. Raymond Lang, membre du directoire "transports et mobilités durables" de France nature environnement (FNE), de M. Jean Thévenon, pilote du réseau "transports et mobilités durables" de France nature environnement (FNE), de Mme Lorelei Limousin, responsable des politiques climat–transports du Réseau action climat France (RAC France) et de M. François Cuenot, responsable de l’ONG Transport & Environnement. 422
37. Audition, ouverte à la presse, de M. Thierry Pflimlin, secrétaire général de la branche marketing et services du Groupe Total et de M. Philippe Montantème, directeur stratégie de la branche marketing et services. 439
38. Audition, ouverte à la presse, de Mme Nathalie Homobono, directrice générale de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). 449
39. Audition, ouverte à la presse, avec les représentants du secteur de l’automobile au sein des grandes centrales syndicales, avec la participation de : pour Force ouvrière-Métaux (FO-Métaux) : M. Christian Lafaye, M. Laurent Smolnik, M. Jean-Yves Sabot et M. Jean-Philippe Nivon ; pour la Fédération générale des mines et de la métallurgie-CFDT (FGMM-CFDT) : M Philippe Portier, M. Franck Daout, M. Jean-François Nanda et M. Sébastien Sidoli ; pour la CFTC : M. Albert Fiyoh Ngnato, M. Eric Heitz, M. Emmanuel Chamouton et M. Franck Don ; pour la Fédération de la Métallurgie–CGC (CFE-CGC) : M. Éric Vidal, M. Jacques Mazzolini et M. Frédéric Vion 459
40. Audition, ouverte à la presse, de M. Gaspar Gascon Abellan, membre du comité exécutif et directeur de l’ingénierie du Groupe Renault, accompagné de Mme Véronique Dosdat, directrice des affaires publiques, de M. Jean-Christophe Beziat, directeur des relations institutionnelles environnement et innovation et de Mme Louise d’Harcourt, directrice des affaires parlementaires et politiques. 476
41. Audition, ouverte à la presse, de Mme Bénédicte Barbry, directrice des relations extérieures et affaires publiques et de M. Christophe Delannoy, responsable services atelier Norauto, du Groupe Mobivia sur les protocoles d’écoentretien des véhicules. 489
42. Audition, ouverte à la presse, de M. Carlos Tavarès, président du directoire du Groupe PSA. 497
43. Audition, ouverte à la presse, de M. Christian Eckert, secrétaire d’État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics. 516
44. Audition, ouverte à la presse, de M. Alain Vidalies, secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche, et de M. Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat. 527
1. Audition, ouverte à la presse, de M. Bruno Léchevin, président de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).
(Séance du mercredi 28 octobre 2015)
La séance est ouverte à midi.
La mission d’information a entendu M. Bruno Léchevin, président de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).
Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente. Notre présidente Sophie Rohfritsch m’a demandé de la remplacer pour cette audition. Elle est, en effet, retenue par un rendez-vous pris de longue date au ministère de l’agriculture. Nous recevons, en cette fin de matinée, le président de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).
Notre mission entend, dans un premier temps, faire des auditions tant sur la filière industrielle automobile que sur les impacts environnementaux de l’usage de l’automobile. Je souhaiterais que vous nous apportiez sur ce point des explications claires.
En novembre 2013, votre agence a publié une étude sur l’élaboration selon les principes des analyses de cycle de vie (ACV) des bilans énergétiques, des émissions de gaz à effet de serre et des autres impacts environnementaux induits par l’ensemble des filières de véhicules électriques et de véhicules thermiques, véhicules particuliers de segment B (citadine polyvalente) et véhicules utilitaires légers (VUL) à l’horizon 2012 et 2020. Peu souvent cité, ce rapport met en évidence que la voiture électrique peut représenter une impasse s’agissant des émissions de CO2.
N’hésitons pas à le dire, une telle étude ne peut être que pain bénit pour une députée qui, comme moi, est élue dans la circonscription où les usines Peugeot PSA produisent des moteurs diesels. Votre rapport est particulièrement édifiant, car il montre que de fausses idées circulent sur les voitures électriques. Pourrez-vous d’ailleurs nous le remettre officiellement ?
M. Bruno Léchevin, président de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). Oui, naturellement. Ce document est en ligne sur le site de notre agence, mais il reste possible d’organiser une remise officielle. Le véhicule électrique émet peu de pollution et coûte peu cher à l’usage, mais sa construction revient cher et induit quant à elle des émissions polluantes plus significatives.
En fait, il n’y a pas de solution idéale, mais un optimum à rechercher selon les différents usages. Tel pourrait être d’ailleurs le fil conducteur du court exposé liminaire que je voudrais vous présenter. Il se divisera en trois parties. Je vous livrerai d’abord des éléments de contexte, puis je plaiderai pour la nécessité de développer un mix énergétique diversifié, avant d’ouvrir la perspective sur l’avenir et sur les programmes d’investissement d’avenir relatifs à la manière de nous déplacer demain.
Le secteur des transports est à la fois très consommateur d’énergie et très émetteur de gaz à effet de serre. Il représente en effet 35 % des émissions de CO2 et 32 % de la consommation d’énergie finale en France. La part des voitures particulières dans la consommation d’énergie du secteur est de près de 61 %.
Il est par ailleurs fortement responsable de la dégradation de la qualité de l’air en France et contribue, en 2012, à 54 % des émissions d’oxyde d’azote (NOx), 14 % des émissions de particules fines en suspension (ou particulate matters) PM10 et 17 % de celles de PM2,5.
C’est également un secteur ayant des impacts économiques forts, avec un poids important sur la facture énergétique française, plus de 90 % des carburants utilisés étant issus du pétrole. Pour finir, c’est aussi un secteur à fort enjeu social, concernant notamment le problème de la dépendance vis-à-vis de l’automobile en zones rurales ou péri-urbaines, non desservies par les transports en commun.
En résumé, les transports sont un secteur clé pour la lutte contre le dérèglement climatique et la pollution de l’air, mais leurs impacts vont bien au-delà. Ils sont au cœur de nombreuses problématiques de développement durable de notre pays.
J’en viens à la nécessité de développer un mix énergétique diversifié. Le progrès technique et la diversification énergétique constituent un volet d’actions essentiel pour réduire l’impact énergétique et environnemental de l’automobile. Cependant, l’ADEME insiste sur la nécessité d’adopter une approche de neutralité technologique. Nous ne sommes pas dans une logique consistant à dire que telle ou telle énergie est à bannir. Nous regardons les choses de façon factuelle et pragmatique, et constatons qu’aujourd’hui et pour encore longtemps, il y a de la place pour tout le monde.
Certes, certaines technologies présentent des avantages car elles ne nécessitent pas de systèmes de dépollution susceptibles de dysfonctionner et donc présentent moins de risque de dérives en situation réelles. C’est le cas par exemple de I électromobilité et des carburants gazeux. Le gaz naturel pour véhicules (GNV) en particulier présente également l’intérêt fondamental de pouvoir évoluer vers du BioGNV. C’est aussi potentiellement le cas du GPL, avec le Biopropane. Ces carburants ouvrent donc la voie à plus d’énergies renouvelables, et à une meilleure collaboration entre les réseaux énergétiques.
En Rhône-Alpes, l’ADEME soutient actuellement le projet Équilibre, qui aide des transporteurs à couvrir le surcoût d’acquisition de camions GNV jusqu’à en regrouper une quinzaine, seuil d’amortissement d’une station GNV sans aide publique. Les transporteurs sont très demandeurs d’un déploiement large du GNV. Cela peut représenter environ 200 000 euros d’aides pour un ensemble quinze camions et une station, avec un effet de levier égal à 10. Ce soutien pourrait être financé sur le fonds de financement de la transition énergétique (FFTE).
À l’ADEME, nous croyons qu’il faut développer un mix énergétique diversifié parce que c’est cela qui permettra de tirer le meilleur parti des énergies renouvelables. Toutes les énergies et technologies auront leur place, Diesel, hydrogène, etc., et il faudra surtout veiller à les utiliser dans leur sphère de meilleure performance environnementale, et là où elles sont le plus adaptées d’un point de vue pratique. Par exemple, dans l’état actuel de la technique, le véhicule électrique n’est pas adapté pour un Paris-Marseille mais un Diesel l’est. La meilleure solution reste cependant un train bien rempli !
Pour certaines énergies, il faudra commencer par développer les usages captifs, sur des flottes de véhicules. L’hydrogène a de son côté un statut particulier, car c’est plus qu’une énergie de mobilité. C’est un vecteur énergétique global qu’on peut stocker, produire à partir d’autres sources, etc.. Il y a donc toute une infrastructure à développer, avec des liens dans le déploiement des réseaux intelligents (smart grids) et des logiques véhicule/bâtiment et véhicule/réseau. De ce fait, dans nos visions énergies, son déploiement est vu à un horizon plus lointain que le GNV ou les véhicules électriques à batteries.
Ouvrons enfin des perspectives sur la manière dont nous déplacerons demain. La réponse à la réduction des impacts énergétiques et environnementaux de l’automobile ne pourra pas être que technologique.
L’amélioration de la performance des véhicules aura évidemment un impact positif, mais cela ne suffira pas. Il faut aussi une évolution des comportements pour optimiser les flux de déplacement, réduire le nombre de trajets, augmenter les taux de remplissage des véhicules, etc.
Pour faire simple, l’objectif est de pouvoir utiliser chaque moyen de transport au meilleur de ses capacités, sur l’usage pour lequel ses impacts environnementaux sont les plus faibles. Ceci passe par une évolution des comportements qui visera à combiner les moyens de transport pour aller d’un point A à un point B, plutôt que de recourir à un mode unique, en particulier la voiture personnelle, pas toujours pertinente. Elle n’est qu’une solution parmi d’autres, que l’on peut partager avec d’autres utilisateurs, comme pour le covoiturage ou l’autopartage. Nous devons passer d’une logique de possession à une logique d’usage et de partage. C’est la fameuse notion de véhicule « serviciel ».
Par ailleurs, il faut également que nous reconsidérions les modes « actifs », comme le vélo ou la marche. Trop souvent, le déplacement motorisé est devenu un réflexe, alors que beaucoup de déplacements peuvent se faire à pied, voire ne pas se faire du tout.
Pour les déplacements des personnes, nous irons vers plus d’intermodalité, pour combiner différents moyens de transport entre eux, les transports en commun et les modes actifs en tête. La situation sera évidemment très différente entre les zones urbaines et rurales, suivant la disponibilité de l’offre. Les technologies de l’information et de la communication joueront un rôle clé car elles permettront de proposer des itinéraires multimodaux avec une information mise à jour en temps réel.
L’ADEME suscite, expérimente et accompagne évidemment ce mouvement dans ses différentes actions. Elle apporte notamment un soutien fort au développement de technologies performantes et adaptées aux évolutions des usages, ainsi qu’aux solutions organisationnelles innovantes : programme de Recherche et Développement ; programme de caractérisations des technologies ; enveloppe Investissements d’avenir au titre des programmes « Véhicule du futur » (PIA1) et « Véhicules et transports du futur » (PIA2).
Les investissements d’avenir représentent début 2015 pour l’ADEME plus de 180 projets soutenus, et un montant d’aide de 1,33 milliard d’euros pour un coût total des projets de 4,14 milliards d’euros. Les transports et la mobilité en représentent une part importante, et mobilisent actuellement huit appels à projets, dans le ferroviaire, la logistique et l’intermodalité, le véhicule dans son environnement, la route du futur, la mobilité du futur, les navires du futur, les ferries propres, le déploiement des bornes de recharge électriques, plus une initiative réservée aux PME.
Plus spécifiquement, l’action « Véhicules et transports du futur » du PIA, dotée de 1,12 milliard d’euros, accompagne et renforce la capacité d’innovation des entreprises (grands groupes, établissements de taille intermédiaire (ETI), petites et moyennes entreprises (PME)) et des organismes de recherche notamment dans le secteur du transport routier, contribuant à accélérer le développement et le déploiement de technologies et d’usages de mobilité terrestre innovants moins consommateurs en énergies fossiles.
Ce sont, en quelques chiffres, dix appels à projets destinés au secteur du transport routier ouverts depuis 2010 ; 42 projets décidés pour financement ; 1,1 milliard d’euros d’investissements par les bénéficiaires des projets décidés ; 262 conventions de financement signées ; 350 millions d’euros d’aides au titre des investissements d’avenir engagés (38 % de l’aide sous forme de subvention, 62 % en avance remboursable)
L’appel à projets en cours « Véhicule et mobilité du futur Édition 2015 » est ouvert jusqu’au 1er octobre 2016. Les axes soutenus sont les technologies et innovations permettant l’amélioration des performances des véhicules, les technologies et innovations sur le véhicule connecté ou le véhicule autonome/automatique ; l’expérimentation d’usages et services innovants de mobilité des personnes comme des biens.
En 2015, a également été ouverte une action intitulée Initiative PME pour accompagner et renforcer la capacité d’innovation des PME dans le secteur du transport routier notamment. Répondant aux besoins des PME, les prochaines initiatives sont programmées jusqu’en 2017. Elles seront fondées sur la simplicité, la réactivité et l’attractivité, grâce à des dossiers de candidature simplifiés, à des décisions de financement six semaines après dépôt d’un dossier et à une subvention forfaitaire de 200 000 euros pour tous les lauréats. Pour la première édition, 40 projets d’entreprise ont été financés sur 89 dossiers reçus.
Voici trois exemples de projets soutenus. Le projet OPTI’MOD LYON permet d’améliorer la mobilité des particuliers, des professionnels et du fret en milieu urbain en fournissant en continu des informations : prévisions de trafic à une heure, navigateur multimodal sur téléphone mobile, guidage sur mobile pour les conducteurs de fret... Le projet EOLAB est un concentré d’innovations pour les voitures de demain –aérodynamique, allégement, motorisation hybride, connexion– pour atteindre une consommation très basse, jusqu’à un litre aux cent... Ce projet doit être connu du grand public, qui doit pouvoir se l’approprier.
Enfin, le projet Hybrid’air de récupération et restitution d’énergie via la compression d’un gaz permet globalement une baisse de consommation d’un tiers pour des voitures essence. Ce projet abouti n’est pas encore commercialisé, faute de partenaire industriel s’engageant aux côtés de PSA.
Parmi les questions stratégiques auxquelles doivent répondre les constructeurs : faut-il changer de métier, et passer de la vente de véhicules à la vente de mobilité ? Est-ce qu’à l’avenir c’est Google qui rédigera le cahier des charges des véhicules, qui deviendront simplement des supports de services de mobilité sophistiqués ? Comment aider les constructeurs français dans ces évolutions ? De ce point de vue, le bel outil que nous gérons pour le compte de l’État, le PIA, peut être une belle opportunité même si nous commençons à réfléchir pour qu’il soit encore plus adapté afin d’aider nos constructeurs à mieux répondre au défi de l’arrivée du numérique. On n’est plus seulement à vendre des objets avec des modèles d’affaires qui vont bien, mais on doit permettre, au travers d’un soutien avec des subventions appropriées, de pouvoir tester des services de mobilité innovants, d’avoir les territoires pour le faire. On est donc davantage dans du test organisationnel, avant d’engager le développement d’éventuels futurs objets de mobilité.
Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente. Vous avez posé le problème des batteries électriques en soulignant que les véhicules qui en sont équipés peuvent être utiles pour de petits trajets, alors qu’elles ne peuvent être amorties, sur le plan de l’émission de CO2, qu’au bout de 50 000, voire 100 000 kilomètres. C’est pourquoi ce type de véhicule me dérange beaucoup.
Notre mission a été lancée à la suite des révélations récentes sur le logiciel employé par le groupe Volkswagen. Pourtant, le commissaire européen avait alerté dès 2013 sur des inexactitudes. Il me semble donc qu’il y a un problème de communication, si tout le monde était au courant depuis deux ans. Étiez-vous quant à vous informé ?
M. Bruno Léchevin. L’usage du véhicule électrique n’est pas réservé aux petits déplacements. Il importe surtout qu’il roule. Si un ménage possède deux véhicules, le véhicule électrique doit être utilisé comme premier véhicule, et non comme le véhicule d’appoint. Idéalement, son usage doit être partagé. En Île-de-France, Autolib’ permet justement à des véhicules électriques partagés de rouler beaucoup. La question de l’usage est donc primordiale. Mais je reconnais que ce type de véhicule n’est pas tout à fait approprié aujourd’hui aux longues distances, quoiqu’il ne faille pas exclure d’évolution technologique dans les prochaines décennies.
Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente. Mais avez-vous évoqué dans votre rapport les particules fines ?
M. José Caire, directeur Villes et territoires durables de l’ADEME. Notre étude reposait sur une analyse comparative des cycles de vie de la voiture électrique et de la voiture traditionnelle à propulsion thermique. Publié en novembre 2013 sur notre site, il ne fait pas moins de 300 pages, car il est bardé de toute la rigueur scientifique. Comme le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’ADEME s’entoure de nombreuses précautions pour éviter de tomber sous le reproche qu’elle ferait preuve de légèreté dans son approche.
La livraison du rapport n’est que le premier pas. La communication doit suivre et nous réfléchissons à une meilleure diffusion de ses résultats. Je souligne que nous n’avons d’ailleurs étudié qu’un seul type de batterie électrique.
Dans la presse, la dominante des réactions était que l’ADEME n’aime pas les véhicules électriques. Nous sommes en fait plus nuancés et nous avons seulement pesé le pour et le contre. Mais il est vrai qu’il ne s’agissait pas du plaidoyer sans réserve auquel certains s’étaient attendus.
Les études d’analyse du cycle de vie s’appuient sur des indicateurs normés qui permettent de mesurer les rejets de gaz à effet de serre, l’eutrophisation de l’eau, les émissions d’ozone, l’acidification de l’air ou les consommations de ressources…
Sur cette base, nous avons analysé les avantages comparés en matière d’environnement, mais aussi de coût financier. À la construction, le véhicule électrique est cher et polluant. Au stade de l’usage, en revanche, il est peu polluant et peu cher. Un véhicule électrique doit rouler beaucoup. Acheté pour ne plus rouler ensuite, il est particulièrement polluant.
Un véhicule électrique est en revanche parfaitement adapté comme premier véhicule d’un ménage. L’amortissement en termes écologiques et financiers est à ce prix. Nous insistons donc beaucoup sur cette priorité d’usage et sur la solution « servicielle ». Car, s’il est partagé, le véhicule électrique roule beaucoup.
Il a un intérêt environnemental indéniable. En matière de gaz à effet de serre, le véhicule électrique se compare au véhicule diesel. S’agissant de la qualité de l’air à proximité du véhicule, il est tout simplement imbattable.
Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente. Pardon, mais qu’en est-il de l’abrasion des plaquettes de frein et de l’usure des pneus !
M. José Caire. Il y a certainement un travail scientifique à mener sur les pièces d’usure et sur la remise en suspension des particules produites par les freins. Des compléments d’analyse sont en cours, tandis que la communication sur ces sujets est elle-même à approfondir.
En particulier, les résultats dépendent surtout du contenu carbone du mix électrique de la voiture. Si l’électricité employée est produite par du charbon, elle n’est bien sûr plus guère écologique...
S’agissant de l’affaire Volkswagen, un amalgame a eu lieu dès le départ entre deux questions qui sont différentes, même si elles sont liées.
D’une part, il y a eu fraude. Le groupe Volkswagen a introduit à dessein un logiciel clandestin dans son logiciel de commande de moteurs, de telle sorte que le véhicule reconnaisse le cycle d’homologation du banc d’essai et modifie en conséquence ses réglages, de telle sorte que les valeurs produites soient différentes des valeurs réalisées au cours d’un usage normal.
D’autre part, il y a un écart entre la valeur d’homologation des véhicules et leur vie réelle. Ce sujet était connu de l’ADEME, qui n’était en revanche absolument pas au courant de la fraude chez Volkswagen. Le sujet des valeurs d’homologation est à vrai dire un marronnier, qui est reparu dans ce climat délétère. Un consommateur qui achète un véhicule censé rouler à quatre litres/cent km sait bien que ce sera en réalité davantage.
Le cycle d’homologation est, si vous me passez l’expression, un cycle pépère au cours duquel ni la vitesse ni les accélérations ne sont poussées trop loin. Cela pose un problème. En tout état de cause, les conditions d’utilisation d’un véhicule sont extrêmement variables d’un conducteur à l’autre.
Du moins, les cycles d’homologation NEDC (new European driving cycles ou nouveaux cycles européens de conduite) seront prochainement remplacés par la procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures, WLTP). Plus significatifs, ces derniers cycles ne suscitent pas toujours l’enthousiasme des constructeurs, car ils produisent des valeurs moins flatteuses. Avant-hier, le groupe PSA a décidé quant à lui d’instaurer la transparence sur les valeurs de ce véhicule. Car les constructeurs se rendent tout de même compte qu’un climat délétère risque de s’installer si rien ne change.
En résumé, il faut se rendre compte que tout le monde ne fraude pas. La question de normes d’homologation inadaptées doit être bien séparée de la fraude.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Quelles sont les missions précises de l’ADEME en matière de qualité de l’air, de mobilité durable et quelles sont ses modalités d’intervention dans ses domaines, ses compétences, ses budgets, ainsi que la composition de ses équipes ?
S’agissant de la qualité de l’air, vous avez fait un rappel sur le calcul de la valeur moyenne des émissions dans le secteur automobile. Disposez-vous d’une typologie territoriale mettant en parallèle la situation dans les zones urbaines denses, dans les zones périurbaines et dans les zones rurales ? Elle permettrait de voir quelle est la part de l’automobile dans les émissions de CO2, de NOx, de PM10 et de PM2,5 ainsi que leur évolution dans le temps sur une période de dix ou vingt ans. Disposez-vous d’ailleurs de données sur l’émission par type de motorisation et sur les évolutions récentes tant de la motorisation au diesel que de la motorisation sur les injections essence ?
S’agissant des PIA, vous nous avez livré des données sur les projets soutenus, en soulignant que les PME sont plus particulièrement ciblées. Mais quelle est la part des grands emprunts qui est consacrée au secteur automobile ? Une évaluation et un bilan sont-ils déjà possibles ou est-il trop tôt pour mesurer l’impact et l’utilité des projets soutenus depuis 2010 ?
Dans le cadre des PIA, commet les décisions sont-elles prises ? Quelles sont les relations avec les grands constructeurs français ?
S’agissant de l’homologation des véhicules automobiles et des tests, le Gouvernement a mis en place un dispositif conçu pour vérifier qu’il n’y a pas fraude. Êtes-vous associés à ce dispositif ?
L’ADEME est-elle consultée sur la position française relative aux normes européennes en cours de négociation ? Quel est son point de vue précis sur les procédures d’homologation et sur la nature des structures qui procèdent aux tests, et sur leur indépendance ?
Enfin, vous avez déclaré que les écarts entre les valeurs affichées à l’achat du véhicule et les valeurs réelles sont de notoriété publique. Je serais intéressé de connaître l’historique de cette notoriété.
M. Denis Baupin. Je me félicite que nous commencions notre cycle d’auditions par l’audition de l’ADEME, puisque l’Agence est à la fois compétente en matière de pollution de l’air et en matière de consommation d’énergie.
Vous avez parlé de diesel propre, expression étrange qui me semble être comme un oxymore. Envisagez-vous vraiment que cela soit possible ? Quelle est votre analyse ? Comment estimez-vous le volume des particules émises par les véhicules diesel respectant la norme Euro 6, non seulement ce qui sort du pot d’échappement, mais aussi les particules secondaires qui peuvent se recomposer au cours d’étapes ultérieures ? Je vous poserais la même question sur les oxydes d’azote, tels qu’ils sont rejetés en mode de fonctionnement normal du véhicule.
Car, même si vous déclarez que tout le monde sait qu’un écart existe entre les valeurs affichées à l’achat du véhicule et les valeurs réelles, je ne suis pas certain que le consommateur moyen ait réellement conscience de ce que les émissions réelles seront en réalité trois à quatre fois supérieures à ce qui lui est annoncé. Cela induit pourtant une consommation plus élevée, partant un impact négatif sur son pouvoir d’achat.
S’agissant de l’affaire Volkswagen, si la Commission européenne était vraiment au courant du trucage, de cette fraude, comment les concurrents de la marque allemande auraient-ils pu ne pas l’être eux aussi ?
Vous avez mis l’accent sur le mix énergétique à rechercher en matière de véhicules, en soulignant à juste titre qu’il doit être le plus diversifié possible et inclure du gaz. À ce propos, quels sont les efforts nécessaires pour construire un réseau de distribution viable ou du moins en établir un schéma ? Au cours du débat sur la transition énergétique, nous étions parvenus à obtenir, sans étude d’impact, qu’elle prévoie sept à huit millions de points de recharge pour les véhicules électriques, mais sans pouvoir arriver au même s’agissant du gaz. Je rappelle qu’une directive prévoit que ces schémas doivent être établis pour les carburants alternatifs.
Quant aux perspectives d’avenir, vous avez évoqué l’usage partagé des véhicules et les technologies numériques, mais peu la forme du véhicule. Un véhicule à quatre places est-il toujours nécessaire ? Faut-il qu’il puisse toujours monter à 180 kilomètres à l’heure ? Serait-il utile de proposer un véhicule à deux places dont la vitesse maximale soit 90 kilomètres à l’heure pour contribuer à atteindre le facteur 4, c’est-à-dire l’objectif qui consiste à diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre sur une période de quarante ans ? La fin du véhicule à tout faire, susceptible d’assurer le transport de la famille pour les vacances mais utilisé en règle ordinaire pour le déplacement du seul conducteur, donnerait plus de pouvoir d’achat aux consommateurs, en lui permettant d’acquérir un véhicule qui est moins gourmand en énergie.
M. Bruno Léchevin. Pour les PIA, je n’ai pas de chiffres en tête, mais nous vous fournirons des éléments sur le pourcentage des fonds du PIA géré par l’ADEME et sur le pourcentage qui est consacré aux transports et à la mobilité. Dans ce domaine, l’Initiative PME s’appuie sur la myriade de PME innovantes qui gravitent autour des grands industriels et peuvent avoir un impact sur leur stratégie numérique, structurelle et organisationnelle. Les décisions relatives aux PIA reposent sur une comitologie où tous les acteurs sont associés, avant que le Premier ministre tranche. Je rappelle que l’ADEME est l’opérateur du Commissariat général à l’investissement (CGI) pour les PIA.
Quant aux véhicules diesel, je dirais qu’ils sont devenus plutôt plus performants que plus propres. L’avenir appartient à la mise en œuvre de la norme Euro 6, mais rien n’assure qu’elle permettra d’assurer un diesel propre. L’impact des particules secondaires est en particulier loin d’être réglé. C’est la question la plus délicate et la plus fondamentale, celle qui concerne l’impact sur la qualité de l’air. Bien que la loi prévoie des dispositifs de maîtrise de la pollution, des professionnels parmi lesquels certains taxis se livrent en Île-de-France au « défapage », c’est-à-dire qu’ils les bricolent, en dégradant la performance ou en masquant leur éventuel dysfonctionnement.
M. Denis Baupin. Les taxis ne sont pas les seuls à le faire, nous n’allons pas les stigmatiser !
M. Bruno Léchevin. Ils ne sont pas les seuls, mais ils roulent beaucoup. Or ils n’étaient pas sanctionnés. On voit ici les limites du contrôle technique, qui ne permet même pas de s’apercevoir de l’existence de telles pratiques. Des progrès sont vraiment à faire. En tout état de cause, elles seront dorénavant totalement répréhensibles.
En matière de mobilité durable, les solutions sont multiples. Elles ne résident pas seulement dans de nouvelles technologies ou dans le type de véhicule, plus léger ou moins volumineux. J’en veux pour preuve l’usage « serviciel » des véhicules. Il est vrai qu’il est dommage de concevoir des véhicules pour des départs en vacances qui n’auront lieu que deux fois par an, alors que des modèles mériteraient d’être développés qui répondraient mieux aux besoins quotidiens de celui qui doit se rendre au travail sans pouvoir emprunter les transports en commun. Nous réfléchissons donc à un usage approprié et performant du point de vue de l’impact économique et environnemental, en évaluant dans cette perspective les différents choix technologiques.
M. Laurent Gagnepain, ingénieur expert au service Transports et mobilité. S’agissant des écarts entre les valeurs d’homologation et le cycle réel, l’ADEME a pour mission de mener elle-même des tests et elle le fait sur la base des cycles d’usage réels des véhicules, pour comparer les grandes filières.
Conçus avec l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTARR), les cycles Artémis sont utilisés depuis les années 2000. Ils ont permis de constater, entre 2005 et 2010, quand la norme Euro 4 est entrée en vigueur, alors que l’émission d’oxyde d’azote est devenue plus réglementée pour les véhicules diesel, que les valeurs réelles d’émission n’ont pourtant pas baissé.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Peut-on dire qu’à mesure que les normes se durcissaient, l’écart se creusait entre les tests homologués et l’évaluation des véhicules en usage réel ?
M. Laurent Gagnepain. Oui, pour les oxydes d’azote, mais non pour les particules fines, le dioxyde de carbone étant à considérer à part. Avec un filtre à particules polluantes, la baisse peut être significative. L’homologation produit alors un effet réel. Parallèlement, les cycles ont fait l’objet d’une réflexion pour être rapprochés de l’usage réel des véhicules, tout en étant conscients de ce que chacun construit de manière différente, pour un même modèle de véhicule.
En revanche, les nouveaux cycles prennent en compte une plage plus large d’utilisation des moteurs, un maximum de points de fonctionnement, alors que le cycle NEDC ne prenait pour ainsi dire pas en compte les accélérations. Les nouveaux cycles d’homologation devraient donc fournir des valeurs moins éloignées des valeurs d’usage réel.
M. José Caire. La notoriété publique de ces écarts ne concerne d’ailleurs que le dioxyde de carbone, car chacun constate la consommation réelle de son véhicule en passant à la pompe. Mais il n’en va pas de même pour l’évaluation des rejets de particules polluantes.
M. Laurent Gagnepain. Les écarts de consommation ont tendance à augmenter. À cause du changement des chaînes de traction, les différences sont en effet de plus en plus marquées.
Les cycles ne sont pas prévus pour intégrer l’hybridation. Les véhicules qui en sont équipés présentent un écart encore plus important. L’usage qui en est fait est primordial sous ce rapport : s’ils sont employés seulement sur autoroutes, l’hybridation joue à peine ; mais il en va bien différemment s’il s’agit d’un usage urbain mettant à profit le potentiel de l’hybridation.
S’agissant du diesel, ou de l’essence, je n’emploierais jamais l’adjectif « propre » qu’entre guillemets. Il n’y a pas de moteur 100 % propre. La combustion parfaite d’un hydrocarbure ne rejetterait que du dioxyde de carbone et de l’eau, mais cette combustion parfaite n’existe pas. Les rejets d’oxyde d’azote sont également inévitables.
Il faut donc surtout distinguer entre les véhicules pourvus d’un filtre à particules (FAP), conformément à la norme Euro 6, et ceux qui n’en sont pas équipés.
M. Bruno Léchevin. Il est donc impropre de dire « propre » (Sourires).
M. Laurent Gagnepain. Les nouvelles motorisations à l’essence ne sont au reste pas forcément beaucoup plus propres que les motorisations au diesel, notamment quand elles utilisent l’injection directe. Elles rejettent en effet davantage de particules fines que les véhicules diesel équipés d’un filtre à particules. Pour respecter la norme Euro 6 C, qui entrera en vigueur en 2017-2018, les véhicules à essence auront eux-mêmes certainement besoin d’un filtre à particules.
S’agissant en outre de la formation des aérosols secondaires, les particules émises par les véhicules diesel sont plus stables que celles qui sont émises par les véhicules essence. À la sortie du pot d’échappement, il peut y en avoir plus pour un véhicule diesel, mais leur nombre n’évolue pas, tandis que celles qui sont émises par un véhicule à l’essence, plus faibles au départ, entrent ensuite dans une série continue de réactions chimiques.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Disposez-vous d’éléments de comparaison entre le diesel et l’injection directe à l’essence ? Qu’en est-il en particulier des PM2,5 ?
M. Laurent Gagnepain. Trois projets sont en cours pour caractériser les particules fines émises hors échappement, soit les particules issues des pneus, des freins et de l’embrayage. Deux programmes portent sur la caractérisation proprement dite, sur piste et sur route. Ils visent à identifier la nature, la taille et la composition de ces particules.
D’autres projets existent qui visent à limiter la production de particules. L’un est conduit à l’échelle européenne et se donne pour objectif de limiter l’émission de particules liées à l’abrasion des plaquettes de frein. Quant à nous, nous évaluons une solution tendant aux mêmes fins mais recourant à un filtre.
M. Jean-Michel Villaumé. Nous avons parlé de la pollution des véhicules particuliers, mais qu’en est-il du trafic routier de marchandises ? Disposez-vous de chiffres le concernant ses rejets qui sont, je crois, considérables ?
Dans votre propos liminaire, vous avez par ailleurs invoqué le principe de la neutralité technologique. Je serais néanmoins heureux que vous nous précisiez comment vous envisagez le véhicule de demain.
M. Bruno Léchevin. La neutralité technologique s’entend par rapport aux normes en vigueur et au regard des techniques existantes. C’est sur cette base que sont calculées les émissions. Le projet EOLAB dont je vous ai parlé met notamment l’accent sur l’hydrogène et sur le gaz naturel liquéfié (GNL). Car l’ADEME aime le gaz propre.
Monsieur Baupin, nous sommes très ambitieux sur le réseau de bornes rechargeables de gaz, mais moins sur les bornes électriques. Or nous nous enfermons ainsi dans le dilemme de la poule et l’œuf, puisqu’il y a une corrélation nécessaire entre l’extension du réseau et l’usage de véhicules rechargeables.
Comme moyen de financement, les programmes d’investissement d’avenir ne sont pas le meilleur outil, au contraire du fonds de financement de la transition énergétique. C’est lui qui finance ainsi le fonds Équilibre dans la région Rhône-Alpes.
M. Laurent Gagnepain. Monsieur Vuillaumé, des informations existent sur le trafic routier de marchandises. Les véhicules lourds sont soumis à des homologations et sont généralement en avance sur les véhicules individuels, notamment en matière d’oxyde d’azote. Les véhicules qui accusent le retard le plus sévère sont les deux roues.
La Commission européenne s’est intéressée aux poids lourds, aux véhicules utilitaires légers et aux autocars, en laissant de côté les deux roues. Mais il est vrai qu’il faut prendre en compte non seulement les émissions unitaires par véhicule, mais aussi le nombre total de kilomètres parcourus par ces véhicules ; les poids lourds roulent beaucoup.
M. José Caire. Un camion est plus facile à rendre performant, car l’investissement dans la dépollution est plus vite amorti. Les constructeurs ont d’ailleurs renoncé au diesel sur les petits modèles, comme la Twingo ou la C1.
D’ailleurs, nous n’aimons pas non plus l’expression « diesel propre », ni « essence propre ». Le vélo et la marche, voilà les seuls moyens de déplacement vraiment propres.
Quant au véhicule du futur, nous n’en avons pas de vision péremptoire. Nous menons des analyses et des études. L’idée d’un véhicule « serviciel » s’impose elle-même à contre-courant de l’image de départ. Le véhicule autonome nous semble également prometteur : dépourvu de chauffeur, il consomme moins. Il coûte peu cher et permet de développer l’offre à la demande en milieu rural.
S’agissant du gaz, nous aimons cette énergie, car elle permet de passer progressivement à une consommation décarbonée, sans rupture technologique. Le GNV fossile peut en effet être progressivement remplacé par du gaz bio. Les choix sont plus délicats concernant le véhicule électrique.
Avec la fédération nationale des transports routiers (FNTR) et le groupe GRDF, nous avons eu des échanges au sujet des camions GNV. Une station de GNV est amortie pour quinze camions. Comme je vous l’ai exposé, une subvention de 200 000 euros peut ainsi contribuer à l’achat d’une telle flotte et d’une station. La FNTR est très motivée sur ce sujet. Nous devrions recevoir entre 100 et 200 propositions si un appel à projets est lancé. Pour quelques dizaines de millions d’euros d’aides, un réseau pourrait être ainsi déployé sur l’ensemble du territoire.
M. Denis Baupin. Voilà une excellente nouvelle. Elle pourrait compenser la mauvaise nouvelle sur le véhicule « hybride Air ». Au moment où le constructeur chinois Dongfeng était entré dans le capital de PSA, j’avais compris que ce rapprochement capitalistique ouvrait aussi de nouvelles perspectives technologiques, mais il semble qu’il n’en soit finalement rien.
M. Laurent Gagnepain. Sur le projet du véhicule hybride, PSA est associé avec l’équipementier Bosch. C’est lui qui détient la clef du problème, car il faut encore trouver d’autres constructeurs industriels pour que la rentabilité économique du projet soit assurée. Un autre deuxième constructeur serait donc nécessaire, le groupe Dongfeng ne représentant qu’une possibilité parmi d’autres.
M. José Caire. Le règlement chinois sur les véhicules hybrides implique qu’ils soient électriques, alors que le véhicule « hybride Air » récupère, à la décélération du véhicule, l’énergie émise, sous forme d’air comprimé. C’est une technologie très efficace, sans batterie. Mais la rentabilité ne serait atteinte que pour une production de 600 000 véhicules, soit le double de ce que vise PSA. Ce n’est donc pas un choix simple pour un constructeur. Quant aux autres, ils ne peuvent aisément changer de stratégie en matière de véhicule hybride. C’est un verrou indéniable.
M. Bruno Léchevin. Cela ne veut pas dire que cela ne sera pas un jour.
M. Laurent Gagnepain. Quant au cahier des charges du véhicule qui ne polluerait pas, je citerais seulement un élément qui nous semble essentiel pour le définir : ce sont désormais moins de la moitié des véhicules neufs qui sont achetés par des particuliers, en 2015 ; les véhicules professionnels sont désormais en majorité. Cela change la relation entre l’acheteur et le producteur.
Un autre élément d’évolution du cahier des charges est la notion de partage, telle qu’elle est mise en œuvre avec le véhicule électrique Autolib’ produit par Bolloré. L’usage même du véhicule a conduit à la modification de son cahier des charges, par exemple s’agissant de la peinture.
Pour le véhicule autonome ou semi-autonome, il ouvre certainement la voie à une réflexion sur le format du véhicule. Il serait sans doute intéressant pour vous d’entendre sur ce sujet des représentants du groupe Valeo, qui n’a pas forcément la même vision que les constructeurs.
M. Denis Baupin. L’évolution vers les véhicules professionnels peut être un argument en faveur de véhicules plus petits.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Mais ces véhicules couvrent aussi des distances plus grandes…
M. José Caire. Nous menons des études sur les véhicules à une place ou deux places. Le véhicule classique est loin d’être la seule solution.
Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente. Messieurs, je vous remercie.
La séance est levée à treize heures trente.
◊
◊ ◊
2. Audition, ouverte à la presse, de M. Cédric Musso, directeur de l’action politique de l’UFC-Que Choisir, et de M. Nicolas Mouchnino, chargé de mission énergie et environnement.
(Séance du mercredi 28 octobre 2015)
La séance est ouverte à seize heures trente-cinq.
La mission d’information a entendu M. Cédric Musso, directeur de l’action politique de l’UFC-Que Choisir, et M. Nicolas Mouchnino, chargé de mission énergie et environnement.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Nous poursuivons nos auditions de la journée en recevant MM. Cédric Musso et Nicolas Mouchnino, deux responsables de l’organisation de consommateurs UFC-Que Choisir.
L’automobile est un bien d’usage courant. Elle est pour les particuliers comme pour de nombreux professionnels un investissement important. Elle représente aussi une lourde dépense d’usage et des charges d’entretien.
Le récent scandale Volkswagen aux États-Unis concerne aussi les véhicules vendus en Europe, dont près de 950 000 en France. Cet événement a certainement érodé la confiance des consommateurs vis-à-vis des constructeurs, et la problématique qu’il fait émerger se décline à la fois en termes d’enjeux économiques et de santé publique.
Les tests de mesure des émissions de polluants sont-ils décrédibilisés ?
Quelle réforme faudrait-il conduire rapidement, à l’échelon européen, pour rétablir la confiance ?
À ces deux questions, vous pourrez, sans doute, messieurs, nous apporter quelques pistes de réponse. Nous avons souhaité vous entendre parce votre organisation s’est, à plusieurs reprises, penchée sur le coût d’usage de l’automobile. En septembre 2012, une enquête de l’UFC-Que Choisir montrait ainsi que le choix d’une voiture diesel n’était pas toujours justifié car plus coûteux qu’une motorisation essence, sans même prendre en compte les impacts environnementaux.
M. Cédric Musso, directeur de l’action politique de l’UFC-Que Choisir. Nous vous remercions de nous auditionner et de reconnaître ainsi le rôle de l’UFC-Que Choisir dans un domaine qui intéresse au premier chef les consommateurs puisque le budget automobile occupe une part prépondérante dans le budget des ménages, notamment pour ce qui concerne les postes liés à l’entretien et à la réparation automobiles. Je rappelle à ce propos que notre association, qui promeut une fiscalité dite « sociétale », c’est-à-dire qui obéisse à une logique consumériste et, plus largement, à une logique environnementale, a également, par le passé, pris position en faveur d’une harmonisation de la fiscalité sur les carburants.
Vous évoquiez à l’instant le scandale Volkswagen, qui a renforcé la méfiance des consommateurs vis-à-vis de l’industrie automobile. C’est un fait, même si l’UFC-Que Choisir s’est gardé de crier au loup, rappelant que l’affaire concernait avant tout les consommateurs américains. En effet, même si des véhicules équipés du logiciel incriminé ont été mis en circulation en Europe, jusqu’au 1er septembre dernier, la situation des consommateurs américains était assez différente de celle des consommateurs européens qui n’ont, à proprement parler, subi aucun préjudice. J’entends par là que, dans la mesure où les consommateurs américains étaient clairement informés des émissions de leur véhicule par rapport à la réglementation NOx (oxydes d’azote), ils ont effectivement été lésés par la tricherie et une information mensongère. En Europe, en revanche, avant le 1er septembre 2015, les fiches techniques des véhicules ne mentionnaient pas la norme NOx, et les consommateurs ne peuvent donc invoquer un quelconque préjudice du fait d’une information délibérément mensongère. Dès lors, et contrairement à ce que revendiquent certains collectifs, une action de groupe n’est pas possible en France, puisque la loi Hamon sur la consommation n’a autorisé les actions de groupe qu’en réponse à un préjudice économique mais en aucun cas à préjudice moral ou environnemental.
Cela étant, l’affaire Volkswagen a mis en lumière la manière dont les fabricants d’automobile optimisaient leurs tests d’émissions, pratique qui vaut également pour les tests de consommation, réalisés en général concomitamment. Or, concernant ces derniers, les tests conduits par l’UFC-Que Choisir ont souvent fait apparaître un écart très important entre les résultats affichés par l’industrie automobile et la consommation effectivement constatée dans des conditions réelles d’utilisation du véhicule.
Nous en appelons donc à un renforcement de la réglementation européenne en matière de tests, réclamant que ceux-ci soient effectués en conditions réelles d’utilisation et assortis de contrôles a posteriori, afin que les consommateurs puissent disposer d’une information crédible. En tout état de cause, si une action de groupe était envisageable, c’est davantage sur la question de la consommation que sur celle des émissions.
Mais le vrai scandale à mes yeux réside dans les coûts de réparation sur un véhicule compte tenu du monopole que sont parvenus à préserver les constructeurs sur les pièces détachées de carrosserie, alors que leur libéralisation permettrait au consommateur de faire des économies non seulement sur sa réparation mais aussi sur son assurance. L’argument opposé à la libéralisation est celui de la sécurité, mais dois-je rappeler que le marché des pièces détachées mécaniques a, lui, été libéralisé ? Qu’on m’explique en quoi la sécurité des consommateurs serait davantage menacée par la libéralisation des pièces de carrosserie que par celle des pièces détachées mécaniques… D’ailleurs, s’il existe encore un monopole légal en Allemagne, le marché a de facto été libéralisé.
J’en viens enfin à la publicité, bien souvent trompeuse pour le consommateur. C’est notamment le cas pour les offres de location avec option d’achat, pour lesquelles les mensualités affichées camouflent bien souvent le montant minimal à verser au départ, qu’il faut de très bons yeux pour arriver à dénicher ; de même, lorsque le prix affiché est un prix global, il est assorti de conditions de reprises qui peuvent substantiellement modifier le coût du véhicule pour le consommateur. Il conviendrait donc de mieux réglementer la publicité sur les automobiles, comme cela a été fait pour le crédit à la consommation, domaine dans lequel la loi encadre désormais la publicité, notamment en imposant des normes de taille de caractères pour l’affichage des taux promotionnels.
M. Nicolas Mouchnino, chargé de mission Énergie et Environnement à l’UFC-Que Choisir. L’automobile est non seulement un poste de consommation très important pour les ménages mais c’est aussi le premier instrument de mobilité des ménages, en particulier en zone rurale. Cela donne un poids tout particulier à la question de la fiscalité applicable aux carburants car, ainsi que nous l’avons montré dans une étude, le choix du type de motorisation que fait le consommateur est principalement déterminé par le prix du carburant.
C’est d’autant plus problématique que, le diesel étant moins cher que l’essence, les consommateurs ont été incités à se tourner vers la motorisation diesel, effectuant ainsi un choix technologique inadapté à l’usage qu’ils faisaient en général de leur véhicule. C’est l’une des raisons essentielles pour lesquelles nous militons en faveur d’une harmonisation de la fiscalité et d’une convergence entre le prix de l’essence et celui du diesel, afin d’assurer la neutralité des prix sur les choix des consommateurs.
Les annonces récentes vont certes dans le bon sens, mais nous attirons votre attention sur le fait que le parc de véhicules diesel étant beaucoup plus important que celui des véhicules essence, l’augmentation du prix du diesel va mathématiquement alourdir la pression fiscale globale sur les ménages. Selon nous, une solution plus équilibrée, qui préserve l’équilibre et maintienne les prélèvements fiscaux sur le carburant à leur niveau actuel aurait été préférable. Par ailleurs, une hausse de la fiscalité doit être programmée dans le temps, afin de permettre aux ménages de l’anticiper et de décider de leur achat de véhicule en conséquence.
En ce qui concerne à présent l’information des consommateurs, l’essentiel de l’information est fourni par l’étiquette environnementale, qui renseigne sur les émissions de CO2 et la consommation du véhicule, telle qu’elle a été mesurée lors des tests.
C’est donc sur ces critères que va se déterminer l’acheteur, sans prendre en compte les coûts « cachés » qui pourtant diffèrent grandement d’un carburant à l’autre : ni le coût de l’entretien ni le coût de l’assurance ne sont en effet identiques pour un véhicule diesel et un véhicule essence. Il est donc essentiel de réintégrer ses dépenses dans le calcul du coût du véhicule, de manière à pouvoir afficher un coût d’usage kilométrique de ce dernier. En fonction du nombre de kilomètres qu’il parcourt en moyenne, le consommateur aurait ainsi la possibilité de comparer différents produits technologiques et de choisir celui qui lui convient le mieux, en pouvant anticiper le coût d’usage global du véhicule.
En ce qui concerne enfin les tests et leur protocole, il faut tout faire pour limiter les possibilités d’optimisation. On n’a pas attendu le scandale Volkswagen en effet pour savoir qu’il s’agissait d’une pratique courante et que certains tests sont réalisés climatisation et veilleuses éteintes, certains équipements ayant été déconnectés, ce qui ne correspond pas aux conditions normales d’utilisation du véhicule
Un nouveau protocole est en cours d’élaboration et de validation. Soit il doit être très clairement encadré, soit les tests devront être réalisés sur des véhicules prélevés au hasard chez les concessionnaires afin de s’assurer que leurs performances correspondent bien à ce qui est vendu au consommateur.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Pour ce qui concerne vos propres tests, dans quelles conditions sont-ils réalisés et comment vos protocoles sont-ils conçus ? Quels moyens avez-vous de garantir leur fiabilité ?
L’UFC-Que Choisir a-t-elle pris position sur la réforme de la procédure d’homologation qui est en cours au niveau européen ?
En matière de fiscalité, la convergence entre le diesel et l’essence va, selon vous et contrairement aux idées reçues, dans le sens de l’intérêt du consommateur. Vous recommandez qu’elle soit programmée dans le temps : sur combien d’années ?
Que pensez-vous de la récupération de TVA sur l’achat d’un véhicule diesel par les entreprises ?
Que pensez-vous enfin du bonus-malus mis en place par le Grenelle de l’environnement ?
Mme Marie-Jo Zimmermann. Il est normal que vous ayez un avis sur les protocoles de test mais quels échanges avez-vous sur le sujet avec les fabricants de moteurs diesel ?
Vous n’avez guère évoqué les véhicules électriques. Qu’avez-vous à en dire, notamment par comparaison aux véhicules diesel ? Avez-vous eu connaissance du rapport produit par l’Agence de l’environnement et la maîtrise de l’énergie ?
Faites-vous une différence entre les anciens moteurs diesel, réellement problématiques, et les nouveaux, dont la technologie s’est très nettement améliorée et qui émettent, selon les études, beaucoup moins de particules fines ? Avez-vous effectué des tests comparatifs qui nous assurent que vos propos en la matière sont parfaitement objectifs ?
M. Denis Baupin. Il faudra sans doute que notre commission auditionne également des médecins, car je pense qu’en matière de santé publique, ils ont des choses plus intéressantes à nous apprendre que les constructeurs automobiles ou les associations de consommateurs. Cela étant dit, je suis heureux que nous puissions entendre les porte-parole des consommateurs, dans la mesure où il apparaît que ces derniers peuvent être trompés, tant sur la question des émissions que sur celle de la consommation des véhicules. Il est donc crucial de trouver le moyen de leur garantir une information fiable.
L’UFC-Que Choisir a publié il y a quelques années une étude selon laquelle les trois quarts des acheteurs de véhicules diesel faisaient un mauvais calcul, car, à moins de vingt-cinq mille kilomètres effectués annuellement, la substitution du diesel à l’essence ne compense pas le prix plus élevé du véhicule à l’achat. Confirmez-vous ses données ?
L’âge moyen d’un acheteur de véhicule neuf en France est de cinquante-quatre ans et ne cesse même de croître ! Cela constitue un sérieux problème pour les constructeurs qui, en touchant une partie de plus en réduite de la population, risquent de voir baisser leurs ventes. Pouvez-vous nous confirmer ces chiffres et qu’en pensez-vous ?
Cette tendance ne doit-elle pas nous conduire à nous interroger sur le type de véhicules vers lesquels devraient se tourner en priorité les constructeurs de voiture, non seulement d’un point de vue environnemental mais également pour que l’offre corresponde aux besoins réels des consommateurs. Car, si le marché des voitures neuves se réduit, la mobilité est une réalité pour bon nombre de Français, qui ont donc besoin d’un véhicule. Dans cette optique, j’ai produit, avec Fabienne Keller, un rapport pour l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sur la mobilité écologique, dans lequel nous suggérions que la généralisation de véhicules moins puissants, plus petits et moins consommateurs de carburants diminuerait non seulement la pollution mais préserverait également le pouvoir d’achat des ménages. Interrogés sur cette perspective, les constructeurs nous avaient confirmé qu’ils étaient techniquement capables de concevoir ce type de véhicules mais qu’ils ne le faisaient pas, ignorant s’ils trouveraient une clientèle. Existe-t-il des enquêtes qui nous permettent de déterminer si les consommateurs préfèrent payer plus cher pour en avoir plus sous la pédale ou s’ils sont prêts à renoncer à une partie de la puissance de leur véhicule – puissance qui, par ailleurs et pour leur plus grande frustration, ne leur est bien souvent d’aucun usage –pour gagner en pouvoir d’achat ?
M. Yves Albarello. Je possède pour ma part une voiture diesel et, parcourant plus de vingt-cinq mille kilomètres par an, j’ai donc atteint mon retour sur investissement. Cela étant, il me paraît compliqué d’intégrer, comme vous le préconisez, le coût d’entretien du véhicule dans son coût d’achat, ce coût dépendant du mode de conduite de son propriétaire qui peut, le cas échéant, entraîner une usure anormale du véhicule.
Par ailleurs, depuis le 1er septembre 2015, la nouvelle norme européenne d’émissions Euro 6 a succédé à la norme Euro 5, limitant les émissions d’oxydes d’azote à quatre-vingts milligrammes par kilomètres.
Sans vouloir à tout prix défendre le diesel, je rappelle néanmoins que notre pays est leader dans la construction de moteurs diesel et souhaiterais savoir si ces progrès en termes d’émission de particules fines sont de nature à modifier votre opinion sur l’usage de ce carburant ?
M. Jean-Yves Caullet. Je suis sensible à la notion de véhicule pertinent développée par Denis Baupin et je pense que les concessionnaires devraient informer leurs clients sur le fait que, pour de petits déplacements, un moteur à essence est préférable, tant d’un point de vue financier que parce que, sous-utilisé, un moteur diesel ne remplit pas son office. Il faut se souvenir qu’historiquement le moteur diesel – solide mais bruyant – était réservé aux véhicules à usage professionnel et qu’ils n’ont été améliorés, notamment rendu moins bruyant, que pour faire bénéficier les particuliers de l’avantage financier que présentait à l’origine le diesel moins taxé que l’essence, pour aider les gros utilisateurs professionnels.
Aujourd’hui sont proposées aux pompes différentes sortes de diesel. La qualité de ces carburants a-t-elle une incidence sur la performance des moteurs, notamment en termes de pollution, ou n’est-ce que de la poudre aux yeux ?
Les véhicules diesel semblent consommer moins au kilomètre que les véhicules essence : dans quelle mesure cela joue-t-il dans le choix du carburant ?
Que ce soit pour passer à des véhicules essence ou à des véhicules diesel d’une autre génération, il va falloir renouveler le parc automobile. Quelles seraient, selon vous, les incitations les plus pertinentes pour accompagner les consommateurs ?
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. L’étude de l’ADEME à laquelle faisait référence Marie-Jo Zimmermann indique que, pour rentabiliser l’utilisation d’un véhicule électrique, il faut parcourir entre cinquante mille et cent mille kilomètres par an. Ce type d’argument ne doit donc pas être limité au seul diesel.
Par ailleurs, ne pensez-vous pas que les nouveaux protocoles de test doivent impérativement être élaborés au niveau européen pour ne pas exposer les constructeurs nationaux à une concurrence déloyale ?
M. Cédric Musso. J’indique d’emblée que nous ne serons pas en mesure de répondre à toutes vos questions et que, n’étant pas le CREDOC mais une association de consommateurs, nous ne pourrons pas non plus vous renseigner sur tel ou tel point concernant l’opinion ou les pratiques des Français.
Je puis en revanche vous indiquer que nos protocoles de test sont les mêmes que ceux des autres associations de consommateurs partout dans le monde, leurs résultats étant ensuite mutualisés. Ils sont effectués sur des véhicules que nous achetons. Nous dévions cependant du protocole officiel afin de nous rapprocher le plus possible des conditions réelles de circulation ; plus précisément, nous simulons un parcours autoroutier d’une vingtaine de kilomètres, avec plusieurs phases de changement de vitesse. Le véhicule est mis en conditions réelles d’utilisation avec ses accessoires et équipements allumés – feux de jour ou feux de croisement, air conditionné, ventilation et autoradio. Je précise que ces tests sont effectués sur des véhicules d’occasion, notre budget ne nous permettant pas de les effectuer sur des véhicules neufs.
Nous sommes conscients néanmoins que les conditions réelles d’utilisation sont différentes d’un consommateur à l’autre et qu’en fonction du type de conduite, la consommation d’un véhicule peut varier jusqu’à 30 %. Il n’en reste pas moins qu’entre un test réalisé en laboratoire, dans des conditions d’optimisation, et un test réalisé sur route, les résultats obtenus n’ont pas la même crédibilité.
Il est indéniable que notre discours sur le diesel va à l’encontre d’un certain nombre d’idées reçues partagées par la majorité des consommateurs. C’est ce qu’il ressortait du sondage que nous avions réalisé en octobre 2012 avec l’institut CSA, qui révélait que 84 % des Français estimaient que le diesel offrait un avantage tarifaire et que 71 % d’entre eux parcouraient moins de vingt mille kilomètres chaque année, seuil qui permet un retour sur investissement.
En ce qui concerne le bonus-malus, l’UFC-Que Choisir y a toujours été favorable, au point de réclamer son instauration sur les équipements électroménagers.
M. Denis Baupin. Très bien !
M. Cédric Musso. Madame Zimmermann, nous ne refusons pas le dialogue avec les fabricants de moteurs diesel, mais je ne vous cache pas que nos positions sur la libéralisation des pièces détachées ont quelque peu terni les relations que nous avions avec les constructeurs automobiles. Nous n’avons actuellement pas d’échanges sur la question spécifique du diesel mais ce n’est pas exclu pour l’avenir car en aucun cas l’UFC-Que Choisir ne crie haro sur le diesel. Nous ne lui sommes pas hostiles par principe mais réclamons, d’une part, que les informations données au consommateur reposent sur des données objectives et, d’autre part, que les différentes mesures politiques qui peuvent être prises respectent le principe de neutralité technologique.
Je ne saurais vous répondre précisément sur ce que devrait être le véhicule de demain mais ce qui est sûr, c’est que nous sommes en train d’évoluer d’une économie de la possession à une économie de l’usage, ce qui se traduit, dans le domaine de l’automobile, par un fort développement de l’auto-partage.
Nous n’avons pas encore testé la qualité des différents types de carburant, mais pourquoi, en effet, ne pas le suggérer à nos ingénieurs ?
En matière de tests, il faut indéniablement une harmonisation européenne et une réglementation qui mette fin aux pratiques d’optimisations. Celles-ci existaient bien avant le scandale Volkswagen, et cela fait des années que l’UFC-Que Choisir – membre du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), lequel rassemble quarante organisations européennes – s’est aperçu en procédant à ses propres tests qu’il existait un décalage entre la consommation et les émissions alléguées par les constructeurs d’une part et ses propres résultats d’autre part. Nous avons donc demandé un renforcement des normes, mais la Commission ne nous a que partiellement entendus. C’est la raison pour laquelle, à la suite de l’affaire Volkswagen, nous venons de la saisir à nouveau.
M. Nicolas Mouchnino. Nous n’avons pas étudié avec précision le temps nécessaire à la convergence de la fiscalité et au renouvellement du parc. En tout état de cause, il faudrait en aligner les délais sur la durée moyenne de conservation d’un véhicule par ses différents propriétaires.
La question des véhicules électriques m’amène également à évoquer celle du gaz naturel pour véhicules (GNV), largement promu à une époque, ce qui a entraîné un certain nombre de consommateurs à se lancer dans l’aventure… avant de se retrouver abandonnés en rase campagne. En effet, alors qu’on leur avait promis des centaines de stations, il n’y en a à ce jour qu’une trentaine en France, ce qui complique les déplacements pour des véhicules ayant une autonomie d’une centaine de kilomètres, sachant que les propriétaires ne sont plus autorisés à avoir de compresseurs chez eux pour pouvoir les recharger. Il est donc important, lorsque l’on fait la promotion de nouvelles technologies – que ce soit l’électricité ou, dans un avenir plus lointain, l’hydrogène – de veiller à assurer leur accessibilité.
Nous ne prônons pas un type de véhicule plutôt qu’un autre mais voulons que soit garantie la neutralité technologique. En d’autres termes, nous considérons qu’aucun élément extérieur, comme la fiscalité, ne doit venir parasiter le choix des ménages entre deux technologies, dont ils doivent pouvoir retenir la plus conforme à leur usage et aux objectifs environnementaux fixés par les pouvoirs publics.
C’est la raison pour laquelle la fiscalité sur les carburants ne nous paraît pas adaptée, car elle ne sert aucun objectif ni environnemental ni énergétique. La réglementation européenne en revanche peut aider à la convergence, car la norme Euro 6 contraint les conducteurs à concevoir des citadines à motorisation à essence dans la mesure où il devient trop coûteux d’équiper ces véhicules de filtres à particules. On observe ainsi ces derniers temps une légère augmentation de l’achat de véhicules essence.
Monsieur Albarello, vous m’avez objecté que le coût d’entretien d’un véhicule était difficile à déterminer a priori. Il faut en fait différencier l’entretien – normé par les constructeurs – de la réparation. Les coûts de révision d’un véhicule sont donc prévisibles et peuvent être intégrés dans le coût kilométrique, ce qui permet d’obtenir un coût d’usage moyen.
Mme la rapporteure. On ne peut mettre sur le même plan les pratiques d’optimisation courantes chez les constructeurs qui n’effectuent pas leurs tests dans les conditions réelles d’utilisation et le trucage délibéré dont s’est rendue coupable la firme Volkswagen. Je m’étonne d’ailleurs que vous considériez qu’il n’y a pas eu, en l’occurrence, de préjudice économique pour les consommateurs français. Vous fondez-vous pour affirmer cela sur les bases légales que la loi Hamon a définies pour l’action de groupe ? Par ailleurs, avez-vous, suite à ce scandale, été sollicités par des propriétaires français de véhicules Volkswagen ?
Pourriez-vous également nous en dire davantage sur les différences qui existent entre les normes en vigueur en Europe et aux États-Unis ?
En ce qui concerne la convergence de la fiscalité sur le diesel et l’essence, certains s’y opposent au motif que cela conduirait à une dépréciation de la valeur des véhicules diesel sur le marché de l’occasion. Qu’en pensez-vous ?
Quelle est enfin votre opinion sur la prime à la conversion instaurée pour inciter les consommateurs à remplacer leurs vieux véhicules diesel par des véhicules propres ?
M. Cédric Musso. Nous avons en effet été massivement sollicités par les consommateurs suite à l’affaire Volkswagen, parce que les médias ont assimilé la situation européenne à la situation américaine et que de nombreux collectifs se sont formés pour inciter nos concitoyens à engager une action de groupe, via notamment le site internet Class Action VW. Si nous avons émis une voix dissonante, c’est que, je le répète, telle qu’elle a été définie par la loi relative à la consommation, l’action de groupe est limitée au seul préjudice matériel et économique et ne peut en aucun cas concerner un préjudice moral ou environnemental.
Or le consommateur européen n’a pas été exposé à la même information que le consommateur américain, puisque la norme NOx ne figure pas sur les fiches techniques des véhicules commercialisés en Europe. Il ne s’agit pas pour autant de rester les bras croisés ; des plaintes ont été déposées et nous nous constituerons le cas échéant partie civile le moment venu.
Quant à la question du préjudice économique subi en cas de dépréciation du véhicule sur le marché de l’occasion, tout le problème est, d’une part, de démontrer le lien de causalité entre la tricherie et la dépréciation, et, d’autre part de quantifier très précisément le préjudice individuel. La forfaitisation d’un tel préjudice faciliterait évidemment le lancement d’une action de groupe, mais ce n’est pas dans notre tradition juridictionnelle. D’où la difficulté, voire l’impossibilité, de mettre en place ce type d’action.
Nous n’avons pas de position arrêtée sur la prime à la conversion mais restons méfiants sur les effets d’aubaine qu’elle pourrait entraîner, ce type d’aides incitant le plus souvent les professionnels à renchérir leur prix.
Mme la rapporteure. Avez-vous constaté ce type de phénomène lors de la mise en place des « jupette », « balladurette » ou autres primes à la casse ?
M. Cédric Musso. Ce n’est qu’un sentiment a priori, mais je pourrai vous répondre plus précisément après plus ample vérification.
M. Nicolas Mouchnino. Globalement, il est difficile d’évaluer la dépréciation d’un véhicule diesel du fait d’une baisse de la fiscalité sur le carburant Cela dépendra essentiellement du temps sur lequel s’effectuera la convergence. Plus il sera court, plus le risque de dépréciation est en effet élevé, ce qui est d’autant plus préjudiciable pour le consommateur que la perspective de mieux revendre un véhicule diesel qu’un véhicule essence pèse également dans la décision d’achat.
M. Denis Baupin. Vous ne vous êtes pas prononcé sur la déductibilité de la TVA dont bénéficient les entreprises pour leurs véhicules diesel, mais que pensez-vous d’étendre cette même déductibilité aux véhicules essence, ce qui améliorerait la convergence entre les deux types de motorisation ? J’ai déposé des amendements en ce sens sur le projet de loi de finances pour 2016, sachant que, le parc professionnel étant composé à 96 % de véhicules diesel, il s’agit d’une mesure qui ne coûterait pas grand-chose à l’État et inciterait en particulier de nombreux chauffeurs de taxi à opter pour les technologies hybrides.
D’autre part, que pensez-vous des futures pastilles écologiques ? Ces pastilles doivent-elles être accordées pour toute la durée de vie du véhicule ou faudrait-il reconsidérer leur attribution à chaque contrôle technique ?
Enfin, la prime à la conversion instaurée par la loi sur la transition énergétique doit-elle s’appliquer au rachat d’un véhicule d’occasion ? Cela aurait deux avantages : d’une part, cela éviterait que cette prime soit réservée à ceux qui ont les moyens d’acheter un véhicule neuf, ce qui la rendrait socialement plus juste ; d’autre part, cela contribuerait à développer un marché de l’occasion pour les véhicules propres.
M. Nicolas Mouchnino. L’UFC-Que Choisir n’a pas vocation à se positionner sur les questions concernant les entreprises – en l’occurrence, la déductibilité de la TVA, qui nous ramène, cela étant, à la manière dont se construit la fiscalité. La réforme de la fiscalité sur les carburants est un serpent de mer et fait l’objet de discussions à Bruxelles depuis plusieurs années dans le but d’envoyer un signal-prix correct aux consommateurs et d’intégrer dans son calcul les données énergétiques et environnementales.
Nous défendons la même logique en ce qui concerne la pastille écologique, qui doit garantir la neutralité technologique. Quant à la durée de son attribution, elle peut certes dépendre de l’évolution des technologies mais il nous semble que le plus important est que le dispositif de régulation de la circulation attaché à ces pastilles prenne également en compte des facteurs économiques et sociaux, comme le fait que la voiture reste indispensable à nombre de nos concitoyens pour se rendre sur leur lieu de travail ou faire leurs courses.
M. Cédric Musso. Nous n’avons pas de position officielle le fait d’étendre la prime de conversion à l’achat d’un véhicule d’occasion. Il faut toutefois faire attention, derrière un objectif louable, aux effets pervers : des véhicules qui, à défaut d’avoir été bien entretenus, auraient perdu de leurs performances énergétiques et environnementales ne doivent en aucun cas pouvoir en bénéficier. Cela implique que des contrôles soient mis en place.
Mme la rapporteure. Nous touchons là à la différence entre le prototype et ses déclinaisons. Ce qui nous ramène à la question des pastilles : doivent-elles être attribuées en fonction des caractéristiques techniques du modèle original ou après évaluation des performances de chaque exemplaire du véhicule ?
En définitive, pensez-vous que c’est grâce à une réforme des procédures de test, à une meilleure prise en compte du coût d’usage des véhicules et à une réglementation plus stricte de la publicité que l’on parviendra, en garantissant une meilleure transparence, à restaurer la confiance des consommateurs dans l’industrie automobile et, plus globalement, dans l’industrie manufacturière en général ?
M. Cédric Musso. Chaque scandale débouche invariablement sur l’idée qu’il faut fiabiliser l’information donnée aux consommateurs et renforcer les contrôles. En ce qui concerne la fiabilisation de l’information, cela commence par l’information précontractuelle, en particulier la publicité, domaine dans lequel il y a beaucoup à faire. Quant aux contrôles, nous estimons qu’ils doivent être récurrents. Mais, pour restaurer la confiance, il faudra aussi en finir avec certaines idées reçues, ce qui, dans le domaine automobile, concerne au premier chef la question de l’entretien des véhicules, qui ne doit plus être l’apanage du constructeur, au prétexte qu’il est le mieux placé pour le faire. Nos études soulignent au contraire que l’entretien est systématiquement plus cher lorsqu’il est réalisé par un opérateur du réseau plutôt que par la concurrence. La loi Hamon a renforcé les obligations d’information à ce sujet, ce qui n’empêche pas la publicité de se focaliser très largement sur les offres du constructeur en la matière, en le désignant comme le seul capable d’entretenir le véhicule. Nous demandons donc que l’information délivrée au consommateur dans le cadre des contrats d’entretien soit plus strictement contrôlée.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Messieurs, nous vous remercions pour vos interventions et les réponses que vous nous avez fournies.
La séance est levée à dix-sept heures cinquante-cinq.
◊
◊ ◊
3. Audition, ouverte à la presse, de M. Éric Poyeton, directeur général de la Plateforme automobile et mobilités (PFA).
(Séance du mardi 3 novembre 2015)
La séance est ouverte à dix-sept heures cinq.
La mission d’information a entendu M. Éric Poyeton, directeur général de la Plateforme automobile et mobilités (PFA).
Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente. Nous recevons M. Éric Poyeton, en sa qualité de directeur général de la Plateforme de la filière automobile et mobilités, la PFA. Ingénieur ayant fait l’essentiel de sa carrière dans le secteur des poids lourds – qui intéresse également notre mission –, M. Poyeton occupe ce poste depuis janvier 2015.
La PFA a été créée en 2009 au plus fort de la crise. Elle vise à établir un cadre permanent d’échanges et de concertation entre donneurs d’ordres et fournisseurs de la filière industrielle. Ainsi, la Plateforme a pour objectif principal de travailler au renforcement de la compétitivité de la filière.
Monsieur le directeur général, dans le cadre de la présentation actualisée des travaux et des missions de la PFA que vous allez nous proposer, je crois devoir préciser que deux points retiennent plus particulièrement l’attention de la mission.
Le premier concerne le Comité technique automobile ou CTA, l’une des structures chapeautées par la plateforme. Ce comité est présenté comme le représentant scientifique et technique de la filière pour défendre des propositions concertées et unifiées. A-t-il joué un rôle d’inspirateur voire de prénégociateur sur la question des tolérances concernant les émissions à l’échappement – un sujet pleinement dans l’actualité avec le scandale Volkswagen et les décisions prises, la semaine passée, à Bruxelles et d’ailleurs immédiatement contestées ?
Second point : qu’en est-il du programme de recherche-développement concernant le véhicule à deux litres pour cent kilomètres, confié à des acteurs réunis au sein de la PFA par Arnaud Montebourg quand il était ministre ? La question du diesel est-elle effectivement comprise dans ce cadre de recherche ?
Monsieur le directeur général, nous allons vous écouter pour un bref exposé liminaire, puis Mme Delphine Batho, rapporteure, et les membres de la mission d’information vous poseront différentes questions.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Avant que M. Poyeton ne s’exprime, je souhaite indiquer aux membres de la mission qu’à la suite de la décision des 28 États membres de l’Union européenne, le 28 octobre dernier, portant sur les tests d’émissions polluantes des véhicules et prévoyant des tests dits en conditions réelles de conduite mais autorisant des dépassements de 110 % pour les oxydes d’azote (NOx), entre 2017 et 2019, et 50 % après 2020, j’ai demandé à la Commission européenne, en tant que rapporteure de la mission, quelle était la composition exhaustive du Technical Committee on Motor Vehicles (TCMV), et de me fournir les comptes rendus de ses réunions ainsi que le relevé des conclusions. Il nous a été répondu tout à l’heure que le compte rendu serait disponible dans quinze jours ; surtout, notre interlocuteur nous a fait savoir qu’il n’était pas autorisé à diffuser la liste des participants à ce comité – ce qui pose un problème de transparence.
J’ai d’autre part demandé aux autorités françaises, par le biais du secrétariat général aux affaires européennes (SGAE), la composition de la délégation française, tous les éléments sur les positions françaises défendues au sein de ce comité ainsi que l’analyse du SGAE sur la portée juridique des travaux de cet organisme.
M. Éric Poyeton, directeur général de la plateforme automobile et mobilités. (PFA). La PFA a pour mission de consolider et de développer les acteurs de l’industrie automobile et du transport – ne sont concernés ici ni les opérateurs de transport ni l’aval de la filière, à savoir la distribution et le recyclage –, soit quelque 5 000 entités et 600 000 emplois. La PFA représente le premier budget de recherche-développement de France : 6,5 milliards d’euros. Parmi ces entités, à travers les fédérations adhérentes et les associations régionales de l’industrie automobile (ARIA), 2 000 adhèrent à la PFA. Très nombreuses sont celles qui livrent d’autres constructeurs et d’autres équipementiers que ceux qui sont implantés sur le sol français – nous ne sommes donc pas focalisés sur les seuls constructeurs français.
La PFA est issue des Etats-généraux de l’automobile au terme desquels a été signé le Pacte automobile. La fiche 8 de ce Pacte prévoyait un code de performance et de bonne pratique créant, notamment, une plateforme d’échanges. La PFA réunit aujourd’hui les deux constructeurs français Renault et PSA, les quatre grands équipementiers, français également, Valeo, Michelin, Plastic Omnium et Faurecia. D’autres constructeurs sont également représentés par l’intermédiaire du Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA) et d’autres équipementiers par l’intermédiaire de la Fédération des industries des équipements pour véhicules (FIEV), ainsi que les fédérations de métiers comme la plasturgie, le caoutchouc et les polymères, la mécanique et enfin la carrosserie.
Nous avons depuis peu engagé une démarche d’élargissement de la PFA – il s’agit par-là d’associer les acteurs non seulement à nos réflexions mais également à nos décisions. Ainsi, dans ce deuxième cercle, sont présents le groupement pour l’amélioration des liaisons dans l’industrie automobile (GALIA), qui travaille sur les aspects logistiques, et les pôles automobiles comme ID for Car, Lyon Urban Trucks and Bus (LUTB Transport & Mobility Systems), MOV’EO et le pôle « Véhicules du futur ». Quatorze ARIA relaient nos actions dans les régions.
Nos leviers de performance n’ont pas changé depuis le début de la mission de la PFA : nous avons vocation à construire des relations de confiance durables entre acteurs de la filière et avec son environnement ; à élargir les points de convergence entre les acteurs de la filière ; à développer une vision claire des grands enjeux de la filière, de plus en plus complexes et qui exigent une réponse de plus en plus collaborative, qu’il s’agisse de l’innovation, de la capacité à parler d’une seule voix pour le secteur automobile français – il nous revient donc de définir les actions permettant d’y répondre. Nous devons en outre servir de catalyseur des compétences dont la filière a besoin – or, aujourd’hui, nous en manquons même dans des métiers traditionnels ; enfin, nous devons inscrire la filière dans son environnement et dans son futur.
Quels sont les rapports entre la PFA, le Comité stratégique de la filière automobile (CSF) et le Conseil national de l’industrie (CNI) ? Le CSF automobile est composé de la PFA – le vice-président du premier, M. Michel Rollier, est également président de la seconde –, d’un groupe de travail, en aval, piloté par le Conseil national des professions de l’automobile, (CNPA), mais également du Comité d’orientation de la filière industrielle du transport routier (COFIT), cela afin d’avoir un contact non seulement avec les constructeurs de véhicules industriels mais aussi avec les représentants du secteur des infrastructures et les représentants des sociétés qui exploitent les matériels, comme la RATP, représentées directement par leurs syndicats. La PFA pilote par conséquent à peu près 80 % des plans d’action du CSF automobile.
Les actions de la PFA sont réparties en cinq axes.
Le premier est intitulé : « Une filière forte et influente », forte car capable de parler d’une seule voix et influente vis-à-vis de son environnement. Nous travaillons sur les réglementations, les normes et les standards ; il s’agit d’établir, grâce à nos experts, des positions techniques en prévision du futur de l’industrie automobile. Ainsi en a-t-il été récemment pour l’hydrogène comme carburant – mais les sujets peuvent être bien plus techniques encore et concerner tel ou tel fluide, les distances de freinage etc. Nous définissons également des positions d’intérêt collectif en des matières qui, pour le coup, ne sont pas techniques.
La filière en tant qu’acteur de la mobilité constitue un deuxième aspect de ce premier axe. Nous avons décidé d’être partie prenante de la démarche de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) intitulée « Fabrique des mobilités ». Nous avons structuré nos actions collectives autour de la mobilité en réfléchissant au futur et aux usages. Nous allons par ailleurs mettre en place un partenariat équilibré avec des institutions comme les nôtres en Allemagne, au Royaume-Uni ou en Espagne, certains enjeux ayant une dimension européenne plus que nationale. Enfin, un groupe de travail sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) mène cinq ou six actions qui, en la matière, relèvent du domaine collaboratif.
Le deuxième axe concerne le développement des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et des petites et moyennes entreprises (PME) de la filière. Nous menons ici trois actions principales. La première touche au développement international des ETI et des PME : nous nous organisons pour constituer une seule équipe de pilotage permettant à ces entreprises de trouver toutes les réponses qu’elles attendent. Nous mettons en outre l’accent, à court terme, dans le cadre du CSF, sur la croissance externe de nos entreprises en Allemagne. Deuxième action : nous entendons accompagner et améliorer la qualité de la relation clients-fournisseurs. Nous travaillons, comme nous aimons bien le faire dans l’automobile, avec un indicateur de mesure et, en fonction des données obtenues, nous mettons en place des actions correctives si nécessaire. Enfin, dernier point, nous soutenons les acteurs qui doivent se situer au cœur de la filière qui, en France, souffre d’un déficit d’ETI – déficit à la remédiation auquel nous réfléchissons. La task force automobile mise en place par le ministre M. Emmanuel Macron et configurée par M. Michel Rollier a d’ailleurs présenté des conclusions en ce sens le 30 septembre dernier. Nous mettons de nombreux éléments à la disposition des chefs d’entreprise en matière de veille technologique, de prévisions volumes, de médiation ; nous leur proposons également des outils pour les aider à comprendre la norme Registration Evaluation Autorisation of Chemicals (REACH), ainsi qu’un site dédié aux compétences et emplois.
Le troisième axe concerne l’efficacité industrielle. Il mobilise cinq actions principales parmi lesquelles la réalisation, depuis vingt ans, d’une enquête sur la performance industrielle des entreprises avec seize indicateurs, afin qu’elles puissent définir des actions stratégiques prioritaires. Une autre action vise au déploiement du lean soit au sein d’entreprises, soit à travers des grappes d’entreprises. Bien entendu, nous avons lancé un programme – le cinquième de la PFA – sur l’usine du futur. Nous sommes en outre devenus membres actifs de l’alliance pour l’industrie du futur pour être en cohérence nationale sur le sujet.
La question des compétences forme le quatrième axe. Nous cherchons à mettre en place un processus et une organisation permettant de créer et de faire évoluer les programmes pédagogiques locaux en fonction des priorités nationales futures et des priorités locales des industriels. Nous allons par conséquent instituer une animation nationale et une animation régionale. Au niveau régional, nous nous appuyons sur le dispositif des campus des métiers et des qualifications et nous sommes heureux de constater que nous avons fait le nécessaire pour qu’il y en ait cinq qui se créent dans les principales régions automobiles françaises. Nous tâchons de lancer des chantiers afin de former les futurs talents dont nous avons besoin. Pour les attirer, nous travaillons autour de défis pédagogiques. Notons que le renforcement de la cohérence de la filière jouera en faveur de l’attractivité de nos compétences.
Le cinquième et dernier axe est l’innovation, subdivisé en quatre actions principales. La première consiste à animer l’écosystème d’innovation, notamment à travers un travail prospectif. Il s’agit également de faire en sorte que l’ensemble des entreprises de la filière disposent de l’information nécessaire sur les priorités d’innovation des grands acteurs. Il convient d’autre part de mettre les PME innovantes en contact avec les grands acteurs de la filière, soit une démarche top down (approche descendante) et bottom up (approche ascendante). Le pilotage de quatre programmes prioritaires constitue la deuxième action : l’opération « Deux litres aux cent kilomètres », le programme fibre optimisée réaliste de carbone économique (FORCE), le programme « Véhicule autonome » – en particulier sous deux aspects : écosystème et réglementation –, enfin le programme Value Driven Product Lifecycle Management (VALDRIV-PLM), fondé sur le management de la valeur ajoutée par les outils numériques sur tout le cycle de vie des produits et services automobiles. La troisième action concerne les expertises d’innovation de la filière que nous souhaitons mettre en valeur : nous disposons de centres de compétence régionaux qui ne demandent qu’à être mis en valeur au niveau européen et international. Enfin, quatrième action, nous travaillons beaucoup en collaboration avec le Commissariat général à l’investissement (CGI), l’ADEME et la Banque publique d’investissement (Bpifrance) pour tout ce qui touche au soutien à l’innovation.
Je reviens un instant sur les Road-Maps R & D, censés donner des indications sur les priorités de la filière. Nous avons identifié huit domaines d’activité sur lesquels il faut innover en priorité, à savoir tout ce qui concerne : l’hybridation et l’électrification, le rendement des groupes motopropulseurs (GMP), le rendement du véhicule, le confort du véhicule, la connectivité et la mobilité intuitive, la réduction de l’empreinte environnementale, la sécurité, l’aide à la conduite et la valorisation des procédés. Ce mois-ci, nous avons transmis à l’ensemble de la filière 80 fiches de besoins d’innovation des grands acteurs.
Le programme « Deux litres aux cent kilomètres », pour sa part, a démarré il y a plus de trois ans. Les objectifs fixés sont deux fois plus ambitieux que ceux de la réglementation 2021. Technologiquement, nous devrions y parvenir ; reste à faire en sorte que le coût de nos véhicules ne s’en ressente pas excessivement. Le programme d’investissements d’Avenir (PIA) contribue au financement de l’opération. Nous avons déposé plus de 40 dossiers-projets pour un montant total de recherche-développement de 420 millions d’euros. Si trois démonstrateurs technologiques ont été présentés au Mondial de Paris 2014, nous sommes soucieux de renforcer cette dynamique continue d’amélioration et cette volonté d’obtenir des innovations grâce auxquelles constituer les briques technologiques répondant aux évolutions réglementaires.
En ce qui concerne le programme FORCE, nous venons d’achever la première phase. La suivante prévoit l’existence d’un atelier pilote qui devrait produire un certain nombre de tonnes de fibre de carbone optimisée.
Pour ce qui est du véhicule autonome, nous veillons à rendre possible les expérimentations en conditions réelles mais aussi en site fermé. Nous travaillons sur les compétences et l’intelligence embarquée mais aussi sur la sécurité puisque l’apparition du véhicule autonome provoquera une vraie rupture pour l’écosystème automobile.
Je n’entrerai pas dans le détail du programme VALDRIV-PLM, beaucoup plus technique et éloigné des préoccupations de la filière puisqu’il est de nature, je dirai : multifilières.
Dans votre propos liminaire, madame la présidente, vous avez évoqué le CTA. Il a un rôle d’inspirateur quant aux priorités en matière de recherche-développement mais il ne se substitue pas aux entreprises de la filière. Il tâche de fixer une ligne à partir de laquelle chacun puisse se repérer et définir sa propre stratégie d’entreprise. Cela d’autant que nous conseillons à la majorité de nos membres, qui ne sont pas des constructeurs automobiles, d’avoir de multiples clients en France, en Europe et même au-delà. Nous devons donc balayer large dans notre approche stratégique. Le CTA est par ailleurs l’organisme au sein duquel nous décidons l’affectation des moyens pour conduire des travaux prospectifs sur des sujets techniques ou en les confiant à des instituts de recherche technologique (IRT) ou des instituts pour la transition énergétique (ITE).
Dans le programme « Deux litres aux cent kilomètres », les grands acteurs de la filière automobile française sont impliqués. De la fin de l’année 2013 jusqu’à l’été 2014 nous avons pu déplorer un déficit d’implication des PME sur le sujet. Nous l’avons comblé : l’envoi, dont je viens de vous parler, de 80 fiches aux ETI et aux PME, la mise en contact des PME avec les experts managers des grands acteurs y ont contribué. Nous menons ce programme en bonne intelligence avec l’ADEME puisqu’il a bénéficié, notamment, du soutien d’Initiative PME – si bien qu’une vingtaine de projets automobiles sont nés.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Afin que nous puissions nous faire une idée plus précise de votre activité, de votre rôle d’animation et de coordination de la filière, pouvez-vous nous indiquer de quelle manière la PFA est financée, combien de personnes y travaillent ? Vous avez abordé également les rôles respectifs du CNI, du CSF
– l’organisation que vous avez décrite vous paraît-elle perfectible, vous satisfait-elle ?
Vous avez mentionné 600 000 emplois alors que l’INSEE retient plutôt le chiffre de 200 000 emplois. Pourriez-vous nous communiquer davantage de données sur le nombre d’entreprises par activité ?
En ce qui concerne le manque de compétences pour les métiers traditionnels, lesquels sont concernés ; existe-t-il des situations critiques ?
Il serait en outre intéressant de comparer la situation en 2009, contexte de crise où la Plateforme a été mise en place à l’issue des Etats-généraux de l’automobile, avec la situation actuelle. Quels sont les domaines, selon vous, qui ont bien avancé et lesquels doivent être améliorés ?
Le rôle de votre comité technique vise, si j’ai bien compris, à faire en sorte que la filière française parle d’une seule voix et, à l’occasion de l’élaboration de normes, dans ses relations avec les institutions françaises et européennes, fasse remonter certaines informations. Comment fonctionne ce comité ?
Quelles sont les positions de la PFA sur le Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures (WLTP) (procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers) – qui remplace le New European Driving Cycle (NEDC ou Nouveau cycle européen de conduite) ? Quelle est la différence entre le WLTP et ce que certains appellent Real Driving Emissions (RDE) ?
En 2014, la PFA a pris une position très intéressante sur les normes européennes d’émissions de dioxyde de carbone, position selon laquelle les dispositions envisagées sous-estimaient la consommation de carburant – autrement dit avantageaient les véhicules lourds équipés d’un moteur puissant, et pénalisaient dans le même temps tous les leviers technologiques de gains d’émission comme stop and start, allégement, hybridation… J’ai, pour ce qui me concerne, une approche très exigeante des normes antipollution mais une approche qui n’est pas naïve donc consciente qu’une norme peut masquer certains enjeux industriels pouvant favoriser la production de tel ou tel type de véhicule…
Selon vous, les normes en cours de discussion ne prennent pas suffisamment en compte la surconsommation à froid, trop de tests étant réalisés dans des conditions de conduite très rapide. La filière automobile française aurait besoin, à vous lire, d’une masse de tests plus représentatifs d’un véhicule vendu et de son usage moyen. En revanche, la filière automobile française demande que, dans le cadre du WLTP, les essais soient réalisés à la température de 23 degrés centigrades et non pas à 14 degrés. Vous demandiez également que les tests soient effectués avec des pneus à basse résistance de roulement. Ces positions ont-elles été entendues ?
M. Éric Poyeton. La PFA a été créée, nous l’avons dit, en 2009, après quoi l’État a accompagné le processus par un contrat avec Oséo, devenu Bpifrance, qui, d’un commun accord, vient à échéance cette année. Aussi, à partir de l’année prochaine, la Plateforme s’autofinancera via une mise à disposition de ressources par ses membres. Pour ce qui est des effectifs, la PFA compte, conformément aux engagements pris en 2009, dix personnes détachées par les têtes de filière, constructeurs et équipementiers – sans oublier le secteur des poids lourds. Les travaux de la PFA impliquent, au niveau national, 400 managers ou experts de l’ensemble des entreprises françaises, dans le secteur industriel aussi bien que dans celui de la recherche-développement ou des ressources humaines.
Le CSF est-il perfectible ou satisfaisant ? Il est perfectible, certes – nous avons l’habitude de considérer, dans le secteur automobile, que l’amélioration est infinie. Le fonctionnement est globalement satisfaisant dans le sens où le niveau d’échanges est très intéressant entre les différents bureaux du comité. Nous devons néanmoins veiller à éviter de doublonner les groupes de travail. Le CSF est productif lorsque nous avons des réunions en petit comité. En outre, il nous permet de travailler au niveau inter-filières ; nos collègues du rail et du nucléaire sont ainsi venus observer nos méthodes de travail afin de s’en inspirer, le cas échéant.
Vous m’avez interrogé sur le chiffre de 600 000 emplois que j’ai mentionné au début de mon intervention : il correspond à l’ensemble de l’industrie automobile. Nous prenons en compte une entité dès qu’elle réalise plus de 20 % de son chiffre d’affaires dans l’automobile.
J’en viens au manque de compétences. On peut malheureusement le constater dans tous les domaines. En arrivant à la PFA, j’ai eu à me pencher sur l’industrie de l’emboutissage, secteur qui peut à la fois être surcapacitaire pour certaines pièces, et souffrir, dans certains bassins d’emploi, d’un manque de régleurs, d’ajusteurs… si bien que des entreprises qui souhaitent se développer ne le peuvent pas. Or cette situation n’implique pas nécessairement la mobilité des acteurs, ce que l’on peut fort bien comprendre. Ce manque de compétences affecte des secteurs traditionnels mais également ceux qui nous permettent de préparer l’avenir : je pense aux domaines des multimédias, des logiciels embarqués, de l’électronique embarqué. Hélas, on relève que l’attractivité de l’industrie automobile est en forte baisse comparée à celle, par exemple, du secteur de l’aéronautique. Du coup, nous avons effectivement du mal à attirer les compétences et à les faire monter en puissance. C’est pourquoi il s’agit de l’un de nos axes prioritaires.
Par rapport à 2009, nous avons bien avancé en matière de R&D, notamment depuis que les entreprises ont adopté un mode de travail collaboratif. Nous avons totalement intégré les pôles de compétitivité dans nos travaux – nous organisons désormais des réunions mensuelles où l’esprit collaboratif est tout à fait comparable à celui des meilleures entreprises. Nous avons par ailleurs amélioré notre capacité à parler d’une seule voix et il y a tout lieu de penser que le malheureux exemple du standard des prises pour les véhicules électriques ne pourrait plus se reproduire.
Pour ce qui est de l’efficacité industrielle, plus de 350 entreprises ont adopté une démarche lean – y compris en ce qui concerne les conditions de travail pour lesquelles nous avons établi un référentiel : c’est qu’il existe, si j’ose m’exprimer ainsi, le bon et le mauvais lean comme il y a le bon et le mauvais cholestérol ! Nous travaillons sur ce point, bien sûr, avec les organisations syndicales. Nous sommes engagés en la matière dans une bonne dynamique puisque plus de mille entreprises sont déjà impliquées.
Il reste en revanche beaucoup à faire pour ce qui touche aux compétences, comme je l’ai évoqué. Nous avons mis du temps à nous structurer, à obtenir des moyens et il nous faut désormais donner un coup d’accélérateur.
La PFA a été créée en pleine crise économique – on parlait alors de retournement de conjoncture, les gens ne parvenaient pas à travailler ensemble. Nous sommes désormais plus sereins même s’il reste des problèmes à résoudre. Nombre de nos travaux bénéficient néanmoins déjà à l’ensemble clients-fournisseurs, je songe au code de bonne pratique que nous avons élaboré sur la norme REACH : il permet d’éviter à des entreprises françaises de manquer de matières polymères au fur et à mesure de l’entrée en vigueur de cette norme ; or il est important d’éviter une rupture-matière dans une chaîne de production industrielle.
J’en viens au fonctionnement du CTA. Le Comité s’appuie sur deux conseils. Le premier est celui de la recherche automobile (CRA) où se réunissent les experts en innovation de l’industrie automobile française. Ils définissent les priorités stratégiques puisqu’ils sont à même de savoir dans quels secteurs particuliers il convient de mobiliser le plus d’énergie. Au sein de la PFA, nous sommes convaincus que le futur de l’automobile sera fait d’un ensemble de solutions comprenant du diesel, de l’essence, de l’hybride, de l’hydrogène, de l’électrique, sans oublier les particularités du monde du véhicule utilitaire, du camion et des autocars. Grâce à l’expertise du CRA, nous sommes capables d’orienter les directeurs qui pilotent les programmes tels que « Deux litres aux cent kilomètres » ou « Véhicule autonome ». J’ajoute que les managers sont très impliqués dans les travaux du CRA, ce qui permet d’améliorer la fluidité et l’efficacité des relations avec notre institut pour la transition énergétique, l’institut du véhicule décarboné et communicant et de sa mobilité (VEDECOM). Le second organisme sur lequel s’appuie le CTA est le Conseil de la standardisation technique automobile (CSTA), composé lui aussi de groupes de travail qui mettent en place les actions, les tests, les prototypages qu’il faut mener pour apporter des réponses techniques à des projets, à des idées d’évolution, souvent liés à des normes. Ces deux conseils procèdent donc à des revues de projets donnant lieu, au niveau du CTA, à une discussion stratégique. Cela revient au même qu’une animation en recherche-développement au sein d’une entreprise.
Vous m’avez ensuite interrogé sur le WLTP, le NEDC et le RDE. Le NEDC est une norme instaurée dans les années 1990 pour faire progresser l’automobile sur la question des émissions polluantes. Il s’agissait de créer un référentiel commun. Il y a quelques années, les industriels comme les autorités politiques ont souhaité passer, suivant une logique d’amélioration continue, à une nouvelle norme, en l’occurrence le WLTP qui prévoit des cycles différents – en particulier avec un nombre de kilomètres et une vitesse plus élevés. Il s’agit de durcir les règles pour faire progresser la réponse de l’automobile au besoin de développement durable.
En outre, le fait que mesurer sur bancs ne permet pas de prendre en compte les milliers d’usages différents d’une voiture mais aussi d’un poids lourd ou d’un bus. Il fallait définir une mesure approchant les conditions réelles. Aussi le pourra-t-on grâce à la norme RDE qui entrera en vigueur en septembre 2017, permettant de progresser dans la voie d’une automobile écologique et qui doit être, ajoutons-nous, abordable pour le plus grand nombre et exportable – car nous avons également vocation à défendre l’industrie française.
Ces normes ne s’appliquent pas de la même manière dans les secteurs de l’automobile et du poids lourd, ce dernier étant en avance – la norme antipollution Euro 6 est appliquée depuis le 1er janvier 2014. Il s’agit, en somme, par le biais de ces normes, d’aboutir à un équilibre entre la réduction des émissions de dioxyde de carbone et celle des émissions de particules nocives pour la santé – en effet : la diminution des unes conduit rarement à la diminution des autres.
En forçant quelque peu le trait, je dirai qu’il est plus facile de dépolluer une Twingo qui serait équipée d’un gros moteur V6 diesel qu’une Twingo dotée d’un petit moteur diesel ou d’un petit moteur à essence optimisé et chargé comme il faut. Le leadership de la France sur les émissions polluantes part du principe qu'on optimise l’ensemble du véhicule, optimisation qui nous place dans le champ de contraintes le plus fort. Il est ainsi bien plus facile d’optimiser un camion qui a, certes, un problème de charge utile, mais qui n’aura pas de problème d’implantation des solutions techniques. De la même manière, on aura moins de contraintes avec une grande routière qu’avec de plus petits véhicules urbains et interurbains.
La nouvelle norme est plus représentative de la réalité, et comme rien ne vaut la réalité, la combinaison WLTP-RDE me paraît très bonne. Ainsi le monde de l’automobile s’interroge-t-il face au problème de tricherie aux homologations dont il est en ce moment question car, globalement, la dynamique est en place. La PFA souhaitait d’ailleurs que les dispositions de la norme édictée par Bruxelles la semaine dernière soient effectives dès le mois de mars dernier – et même avant. Le processus européen de définition des normes pose problème car il ne laisse pas toujours aux industriels le temps de réaliser leurs innovations. Il faut en effet prendre en compte le temps qu’il faut pour passer de la validation d’une innovation sur un démonstrateur, un prototype, à la mise en place de toute une gamme : ce n’est pas parce que vous aurez produit une pièce répondant au besoin d’un constructeur pour un gros véhicule, que la pièce en question sera la même pour un petit véhicule ; la réponse technique sera la même mais la pièce, le sous-ensemble, sera totalement différent, y compris d’un point de vue technologique. Pour bénéficier de ce temps de développement, pour réaliser des produits de qualité – il ne faut pas oublier ce que l’automobile exige en matière de sécurité – tous les industriels ont travaillé et défini des hypothèses avant même qu’il y ait un début de rédaction de la norme de 2017, ce qui démontre leur volontarisme : ils prennent le risque de s’engager à améliorer la qualité de leurs véhicules avant même de connaître les conditions détaillées des normes.
Nous construisons notre position commune en fonction de l’évolution des technologies et de notre environnement.
M. Denis Baupin. J’aimerais connaître votre point de vue sur trois questions d’actualité.
Vous affirmez que la crise actuelle ne relève que d’une tricherie. On lit dans la presse que certains commissaires européens étaient pourtant au courant depuis 2013. Pensez-vous qu’il soit crédible que les autres constructeurs automobiles n’aient pas été eux-mêmes au courant du fait que leur collègue trichait – ne serait-ce qu’à travers les comparaisons de leurs véhicules respectifs réalisées par les uns et les autres ?
Ensuite, que pensez-vous des résultats de l’enquête réalisée par le magazine Auto Plus, parue il y a quelques jours ? Cette enquête met en évidence que les véhicules consomment environ 40 % de plus, en moyenne, que ce que révèlent les tests d’homologation ? Les consommateurs paieraient ainsi 40 % de plus leur carburant que ce qu’ils pouvaient imaginer au moment de l’achat de leur véhicule. En outre, l’enquête très détaillée, puisque plus d’un millier de tests ont été effectués, révèle que les véhicules diesel Euro 6, donc les plus récents, consommeraient pour leur part plutôt 70 % de plus qu’annoncé ! Ces données attestent-elles de l’inefficacité des véhicules, de la capacité à tromper les tests de plus en plus importante – qui illustrerait elle-même la difficulté pour les constructeurs de produire des véhicules respectant les normes environnementales en vigueur ?
Ce qui m’amène à ma troisième question sur le programme « Deux litres aux cent kilomètres ». J’ai rédigé un rapport avec la sénatrice Mme Fabienne Keller portant sur les véhicules plus écologiques et donc plus sobres. Vous expliquez que la lutte contre le dioxyde de carbone se fait au détriment de la lutte contre les émissions de particules nocives et inversement – certes, si l’on ne change pas de modèle, mais si l’on décide de fabriquer des véhicules plus petits, qui ne sont pas forcément conçus pour rouler à 180 kilomètres par heure, mais à 130 kilomètres par heure, qui ne comptent pas quatre sièges mais un ou deux, bref, si l’on rompt avec le modèle dominant depuis des décennies, nous pourrons, en même temps que nous luttons contre le dioxyde de carbone, faire baisser les émissions de particules et ainsi être gagnants sur tous les tableaux. Toutes les briques technologiques sur lesquelles travaillent les constructeurs pour diminuer les consommations, j’y suis favorable, mais si l’on y ajoutait la volonté d’en finir avec le système du véhicule à tout faire, quel gain nous obtiendrions ! Dans quelles dispositions vous trouvez-vous à propos de ce changement de modèle ?
M. Éric Poyeton. Pour répondre à votre première question, il me paraît logique que les autres constructeurs n’aient pas été au courant de la tricherie. D’abord, elle est apparue aux États-Unis qui ne sont pas le territoire vers lequel nos constructeurs – à l’exception de grands équipementiers – sont le plus tournés. Ensuite, il ne faut pas oublier que dans l’industrie automobile la succession des normes s’est accélérée – ce n’est pas une critique mais un fait –, si bien que ces mêmes industriels ont le nez dans le guidon. Nous sortons d’une crise plus qu’importante. J’ai travaillé dans le secteur des poids lourds qui a tout de même subi une baisse de 63 % de son activité en volume – et même de 80 % dans le secteur du chantier. Il faut donc gérer l’après-crise. Il nous faut répondre à un besoin d’innovation fort – on évoque beaucoup les normes antipollution mais il ne faut pas oublier la multiplication des normes relatives à la sécurité des véhicules ainsi qu’au bruit qu’ils émettent. En outre, mon expérience personnelle, en tant que patron chez un constructeur, de la stratégie de la marque et des gammes, et aussi du plan relatif aux services et à la garantie, me permet de vous assurer qu’on n’ira pas chercher les informations de ce type sur les autres constructeurs et qu’on ne les écoutera pas non plus.
Je n’ai pas lu dans le détail l’enquête d’Auto Plus puisque je suis chargé de l’ensemble de l’écosystème industriel automobile français et que l’on ne compte, parmi les 5 000 entités dont je m’occupe, que deux constructeurs principaux mais les trois ou quatre autres constructeurs implantés sur le territoire national ne devant évidemment pas être négligés. Je ne suis donc pas forcément focalisé sur ces questions. On sait qu’il existe un écart entre le niveau d’émissions constaté par l’usager et celui qui est enregistré dans le cadre du cycle d’homologation. Quant à savoir si cet écart a augmenté, plus on adopte de normes Euro 4, Euro 5 et Euro 6, plus les conditions dans lesquelles sont testés les véhicules sont sévères de sorte que cet écart ne tend pas à diminuer. En revanche, le niveau global d’émissions, lui, baisse : un usager qui effectuait le trajet de Paris à Nantes avec un véhicule des années 1990 et qui refait ce même trajet aujourd’hui, qu’il roule à l’essence ou au diesel, notera une forte baisse de la consommation de son véhicule alors même que ce dernier est beaucoup plus confortable, plus sûr et bien mieux équipé qu’à l’époque. Quant aux émissions de particules PM10 et PM2.5, elles sont 50 % moindres, alors même que le parc roulant a augmenté de 40 %. C’est en raison de ces écarts que WLTP et RDE sont des normes importantes et que les industriels français soulignent depuis le début de l’année la nécessité de les adopter le plus tôt possible – même si d’autres pays automobiles auraient préféré se donner encore un peu de temps pour réfléchir. Nous n’avons jamais été opposés à l’évolution des normes. Simplement, nous souhaitons avoir le temps de faire les travaux de recherche-développement nécessaires pour y répondre dans l’ensemble des gammes. Car tout comme les villes et les États, les constructeurs ont des obligations à respecter en termes d’émissions de leur flotte – telles que la norme Corporate Average Fuel Economy (CAFE) en 2021. Si un fournisseur a dix clients différents – équipementiers ou constructeurs –, cela représente une charge importante de R&D.
Quant à faire évoluer l’architecture des véhicules, les projets foisonnent mais sans succès pour le moment car encore faut-il trouver des solutions qui soient économiquement viables. Cela reste malheureusement difficile pour les véhicules adaptés à un seul usage. Il faut en effet veiller au business model de l’engineering en vérifiant si l’on produira des véhicules en quantité suffisante pour que cette production soit économiquement réaliste. Il convient aussi de s’assurer que la vie du véhicule sera performante : il se peut très bien qu’un véhicule très spécialisé trouve peu d’acheteurs. Si les changements sont certains, ils porteront principalement, selon nous, sur le véhicule autonome qui représente une rupture tant du point de vue de l’architecture, de l’habitacle et de la responsabilité que sur le plan sociétal. Il existe déjà dans nos gammes, européennes ou ailleurs dans le monde, de nombreux véhicules deux places. Mais on ne peut reproduire l’expérience de la Nano de Tata qui s’est soldée par un véritable échec.
M. Christophe Bouillon. Si je comprends bien, la voiture du futur, qui tend à devenir un concentré de technologies, sera propre, connectée, autonome et abordable. Comment tenir compte de ces enjeux tout en limitant le poids des véhicules, qui ne nous paraît pas aller en diminuant, sachant que plus les véhicules sont lourds, plus ils consomment ?
M. Éric Poyeton. Le pic de leur montée en poids est derrière nous. Depuis plus de cinq ans, les véhicules produits sont plus légers que leurs prédécesseurs. Dans la gamme routière, l’allègement peut être supérieur à cent kilos d’un modèle au suivant : il constitue l’une des priorités de l’industrie automobile et fait l’objet de constants travaux d’innovation. Ayant eu l’occasion de visiter de nombreuses entreprises, je puis vous dire que les progrès réalisés en ce domaine sont remarquables. L’allègement est un enjeu qui réunit l’ensemble de la filière : le constructeur en parlera de la même manière que son équipementier.
Mme la rapporteure. Vous estimez que la nouvelle norme a été adoptée tardivement. Il est vrai qu’elle était en discussion depuis très longtemps. J’ai bien saisi votre propos quant au délai de décision et la capacité d’adaptation des industriels. Le Comité technique automobile a-t-il pris position sur la norme RDE ? Avez-vous assuré une veille et actualisé vos positions publiques sur le sujet, qui datent de 2014, pour tenir compte de la négociation européenne de ces normes ? Le résultat annoncé le 28 octobre dernier est-il satisfaisant pour la Plateforme de la filière automobile ? Ne pourrait-on faire mieux qu’un écart de 110 % en 2017 entre la norme Euro 6 et les nouveaux tests d’homologation ?
Vous avez affirmé que l’avenir résidait dans une diversité de solutions, tant en termes de carburant que de motorisation. Dans le même temps, vous avez indiqué en réponse à M. Denis Baupin que les véhicules adaptés à un seul usage n’étaient pas viables économiquement. Or, lors de nos précédentes auditions, nous avons observé une logique de spécialisation dans les différents types de motorisation et de carburant.
S’agissant du programme « Véhicules deux litres aux cent kilomètres », on sait que deux litres équivalent à cinquante grammes de CO2 : les nouveaux tests vont-ils faire évoluer l’objectif visé dans ce programme ? Les financements alloués à ce projet dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA) vous paraissent-ils suffisants ? Vous nous avez indiqué tout à l’heure avoir joué un rôle de mobilisation des PME : le soutien de la puissance publique à ce programme est-il suffisamment puissant ?
Pourriez-vous évoquer le programme VALDRIV-PLM ? L’économie circulaire et l’analyse du cycle de vie nous intéressent en effet aussi.
Enfin, j’ai cru comprendre en lisant vos travaux que la filière française à l’exportation avait une marge de progression : qu’en est-il ?
M. Éric Poyeton. S’agissant de la nouvelle norme, nous avons bien sûr actualisé notre position au fur et à mesure de l’avancement des discussions. Au début de l’année, par exemple, la filière automobile a exprimé d’une seule voix, très tôt, qu’elle n’était pas d’accord pour que la vitesse maximale des essais soit supérieure à 130 kilomètres par heure. Mais bien que nous suivions l’actualité, ce sujet concerne davantage les constructeurs que l’ensemble de la filière. Nous avons donc décidé de confier son traitement aux acteurs compétents.
Je n’ai pas à me prononcer sur les décisions qui ont été prises – dont je ne connais d’ailleurs pas le détail. Mais le peu d’informations dont je dispose me porte à croire que les normes à atteindre seront pour nous un défi mais qu’elles apporteront aussi une amélioration. Les commentaires que l’on peut lire dans la presse ne s’appuient pas sur les faits. Ils font fi de la nécessité de partir de la référence des véhicules d’aujourd’hui et non de la position des instances européennes et de celle du groupe qui a décidé de ces normes – les industriels français au sens large souhaitant passer à la première étape dès septembre 2017.
Selon le CTA, plusieurs points doivent être impérativement traités pour préparer l’automobile du futur. Il convient tout d’abord de raisonner en termes d’usage et de renouvellement du parc. Si, aujourd’hui, tous les véhicules étaient conformes à la norme Euro 5 ou Euro 6, peu importeraient les écarts entre les résultats d’un cycle sur bancs et la réalité constatée par chaque usager. Le secteur automobile a su démontrer par ses efforts de R&D ce dont il était capable. Mais l’âge moyen des véhicules, qui est de 8,7 ans, est malheureusement en augmentation. Et 37,5 % du parc de véhicules européens a plus de dix ans. Ensuite, nous estimons qu’il est indispensable de réfléchir aux problèmes de congestion et de massification des flux : par exemple, 53 % des émissions issues du transport de marchandises résultent de la congestion. Les industriels étant là pour travailler avec l’ensemble de leurs clients dans tous les pays qui utilisent l’automobile, il importe aussi de raisonner en termes de système de transports et de prévoir un business model équilibré qui n’inclue pas les subventions à l’achat et au remplacement des véhicules – l’existence de ces subventions ayant tendance à fluctuer avec le temps.
Nous nous efforcerons également de faire en sorte que quatre aspects plus « soft » soient pris en compte. Nous avons tout d’abord besoin de stabilité sans quoi nous épuisons nos budgets ainsi que les efforts de R&D de nos entreprises. Ainsi, par exemple, le va-et-vient des décideurs politiques et économiques mais aussi des usagers au sujet de l’écotaxe poids lourds nous a-t-il été dommageable. La capacité à anticiper l’adoption de normes nous importe beaucoup de même que la neutralité technologique des produits qui s’y conforment. Je ne pense pas que le déchaînement aurait été tel si Volkswagen avait triché sur un moteur à essence – qui n’émet ni oxygène ni fleurs mais des particules plus fines qu’un moteur au diesel ! Il convient en outre de raisonner en termes de cycle de vie : au cours de ses vies multiples, un véhicule peut se heurter à des problèmes techniques qu’il n’avait pas auparavant. Aujourd’hui, pour amoindrir les émissions des véhicules, il est nécessaire d’utiliser des carburants ayant un taux de soufre de plus en plus faible. Dans certains pays comme la Russie, ce taux est catastrophique. Il est donc problématique de ne plus avoir accès au marché des véhicules neufs et d’occasion de ces pays. On sait aussi que les écarts d’émissions peuvent varier de plus de 10 % suivant l’entretien que l’on fait d’un véhicule. Le manque d’entretien peut évidemment expliquer certains écarts constatés par l’usager. Enfin, il conviendrait que les industriels de la filière soient porteurs de solutions en matière d’éco-conduite – et c’est le cas : une célèbre entreprise, dont l’un des membres éminents préside la PFA, s’est lancée dans cette direction, en aidant ses clients à développer l’éco-conduite sur des véhicules lourds.
Je ne suis pas en opposition avec vous s’agissant de la diversité des solutions existantes. C’est de la diversité d’usages des véhicules que j’ai parlé, indiquant qu’elle pouvait être servie par une moindre diversité des motorisations.
Notre objectif étant de tirer vers le haut l’innovation de la filière, le programme « Véhicule deux litres aux cent kilomètres » correspond à cinquante grammes de CO2, peu importe que l’on fasse référence à la norme RDE ou à la WLTP. Si nous voulions être encore plus provocateurs et envoyer un signal encore plus fort aux industriels quant à nos attentes en matière d’innovation, c’est une norme d’un litre aux cent kilomètres que nous imposerions. Les industriels des PME et ETI étant tout le temps le nez dans le guidon, nous leur fixons ces objectifs pour les inciter à innover mais l’intitulé de ce programme est plutôt un terme de marketing.
Si le soutien au financement dudit programme est fort, il manque d‘homogénéité. Nous sommes très satisfaits de l’Initiative PME 2015 que nous avons élaborée en commun avec le CGI, l’ADEME et la direction générale des entreprises du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique (DGEMEIN). L’appel à projet « Véhicules et transports du futur » est très intéressant. Mais parallèlement, l’accès des projets « automobile » au Fonds unique interministériel (FUI) diminue. Or, c’est un dispositif complémentaire du précédent. Nos adhérents nous ont déjà fait savoir que neuf projets collaboratifs d’innovation automobile avaient été mis de côté au motif qu’il n’était plus possible de les inscrire dans le FUI, complémentaire des autres dispositifs. Par cohérence, nous nous appuyons sur l’ITE de VEDECOM et sur les IRT « System X » et « Jules Verne ». Mais si les IRT donnent droit au doublement du crédit impôt recherche (CIR), ce n’est pas le cas des ITE. Il est donc possible d’améliorer le financement de projets conduisant à rendre les véhicules plus économes, plus abordables et plus facilement exportables.
S’agissant de VALDRIV-PLM, la gestion de la valeur ajoutée par les outils numériques passe par les têtes de filière. Celles-ci ont choisi un système français – sachant qu’il existe également sur le marché un système allemand. Derrière ce système, nous essayons de faciliter la vie aux fournisseurs tant en matière de standards que de compétences. Nous essayons notamment d’être aussi performants, en termes de standards, que le sont nos collègues de l’aéronautique, dans le cadre du programme « Boost-Industrie » de l’Association française du numérique dans les filières industrielles (AFNET), et nos collègues allemands. Il faut faire naître des standards qui soient favorables à l’industrie française pour que la continuité et le collaboratif de l’innovation ainsi que la facilité de gestion de l’information de la pièce ou du produit tout au long de sa vie soient les meilleurs possible pour nos industriels français. Nous travaillons beaucoup à l’élaboration de standards, souhaitant des standards français et pas forcément des standards allemands. Nous aspirons bien sûr à la création de standards européens mais sans doute une étape préalable est-elle nécessaire. D’autre part, nous souhaitons dans le cadre du PLM faire entrer les plus petites entreprises dans le numérique. C’est pourquoi nous concentrons nos actions sur le soutien à la création en région Bretagne d’un centre de formation et d’acculturation des entreprises au PLM et à ses outils. De cette manière, nous favorisons l’économie circulaire en encourageant le partage de l’information produit dès l’idée de sa naissance jusqu’à son après-vente. C’est un travail de longue haleine pour lequel je crois que nous aurons la chance de bénéficier du soutien de l’appel à projet « Partenariats pour la formation professionnelle et l’emploi » (PFPE) dans le cadre du PIA.
Enfin, en ce qui concerne la filière française à l’exportation, nos constructeurs et nos équipementiers accomplissent un travail remarquable. Il faut accompagner les plus petites entreprises aussi bien en amont – tant qu’elles n’ont pas pris la décision de se lancer – qu’en aval. En amont, il fallait que la filière se prenne en main. Nous avons donc passé les douze derniers mois à définir la manière de nous organiser. Nos compétences sont regroupées à la Fédération des industries des équipements pour véhicules (FIEV). Il nous faut rapprocher de cette fédération les ARIA, les pôles de compétitivité, des experts et des constructeurs. Nous avons obtenu de premiers résultats. Avec le soutien de Business France, nous avons organisé des Tech days chez BMW il y a plus de douze mois : aujourd’hui, quatre des vingt entreprises présentes à ces rencontres ont décroché de potentielles commandes auprès de cette entreprise allemande. Plus de 150 fournisseurs potentiels ont participé à une réunion que nous avons organisée pour le projet de développement de PSA au Maroc. Nous allons poursuivre dans cette voie : nous savons que faire et comment le faire, il reste à passer à l’action. Nous franchirons une étape importante en 2016. L’accompagnement s’appuie souvent sur des compétences précises que nous n’avons aucun problème à trouver ou à faire naître dans nos entreprises.
M. Denis Baupin. Vous affirmez que les tentatives de création de certains types de véhicules plus écologiques n’ayant pas trouvé leur business model, elles se sont soldées par un échec. Mais les véhicules concernés se trouvent dans un milieu concurrentiel face à d’autres qui, pour respecter les normes écologiques, trichent soit à l’aide de logiciels soit en construisant des véhicules qui émettent beaucoup plus en fonctionnement que ne le prévoient ces normes. Si on en est arrivé là, c’est que les constructeurs n’arrivent pas à trouver un business model qui respecte les normes tout en leur permettant de vendre leurs véhicules. La question des normes écologiques et du business model doit donc être posée dans les deux sens. Dès lors qu’on permet légalement à certains de déroger aux normes – comme il vient d’en être décidé au niveau européen –, il est évident que ceux qui, pour les respecter, font des choix plus ambitieux, risquent forcément de ne pas trouver de business model. En d’autres termes, le serpent se mord la queue. En revanche, si on imposait vraiment aux constructeurs l’obligation de respecter les normes qui ont été fixées – et si elles l’ont été, c’est non par hasard ou pour faire plaisir à tel ou tel mais en raison du dérèglement climatique et de la pollution de l’air, enjeux prioritaires du point de vue de l’intérêt collectif –, les constructeurs développant ces nouveaux types de véhicules ne trouveraient-ils pas un business model ?
D’autre part, je crois vous avoir entendu dire qu’en cas de congestion, il était évident que le niveau d’émissions était très supérieur à celui enregistré dans le cadre des homologations. Le problème, c’est que c’est en ville, là où se trouve la population et que se posent les problèmes de santé publique, que congestion il y a. Un véhicule émettant des pollutions importantes au fin fond de la campagne est certes nocif mais c’est autre chose lorsque des dizaines de milliers d’entre eux en même temps en émettent autant dans un endroit où de nombreuses personnes respirent. Il est intéressant de tester des véhicules sur l’autoroute à 130 kilomètres par heure pour mesurer le niveau de pollution mais cela ne suffit pas. Certes, le mécanisme RDE comprendra des tests en milieu urbain mais pour des véhicules circulant à vingt ou trente kilomètres par heure. Or, la vitesse moyenne de circulation à Paris n’est que de seize kilomètres par heure, et ce depuis trente ans. La congestion automobile est d’ailleurs liée à la taille des voitures. Comme j’ai eu l’occasion de le souligner dans mes anciennes fonctions, on ne peut pousser les murs des immeubles mais l’on peut réduire la taille des véhicules pour permettre aux conducteurs de rouler et stationner plus facilement. Et indépendamment de cet aspect, si l’on considère comme normal que les résultats des tests d’homologation soient très différents de ce que l’on constate dans les lieux de congestion, à quoi servent les normes de pollution ? Car c’est à l’intérieur des villes que se posent les problèmes de santé publique ayant conduit à l’adoption de ces normes.
M. Éric Poyeton. Un business model n’est opérant qu’en cas de volume suffisant. Et la taille critique de nos constructeurs et de nos entreprises n’est pas un problème en la matière. Pour évaluer ce volume, les constructeurs, les équipementiers et les fournisseurs prennent en compte de la multiplicité des clients et des pays sur l’ensemble des marchés mondiaux. En termes technologiques, il faudra attendre un certain temps avant d’atteindre un volume suffisant de véhicules à l’hydrogène pour obtenir un business model efficace. En outre, comment produire de l’hydrogène de façon écologique ? Autre exemple : le financement du projet « Équilibre », qui tend à développer le recours à l’énergie gaz sur les véhicules utilitaires et industriels, part d’un bon principe puisqu’il vise à établir un business model rentable, c’est-à-dire à déterminer à partir de quel nombre de véhicules une station est rentable. L’innovation n’est donc pas que technique : elle concerne aussi les business models. L’ADEME apporte une aide à l’amorçage du projet « Équilibre » mais une fois que les volumes auront atteint la taille critique, le business model sera effectif sans subventions et donc exportable. Il importe de développer des modèles qui fassent du volume plutôt que de retenir des solutions condamnées à demeurer des solutions de niche.
Vous avez raison en ce qui concerne la congestion. Mais la vitesse moyenne du cycle est très faible, d’environ vingt-trois kilomètres par heure. Il est facile de se retourner aujourd’hui contre le cycle NEDC mais il a été créé à une époque où il n’en existait aucun et où l’on ne disposait pas des données désormais collectées par l’ADEME et l’Association interdépartementale pour la gestion du réseau automatique de surveillance de la pollution atmosphérique et d’alerte en région d’Île-de-France (AIRPARIF). Le cycle WLTP est amélioré. Il prend en compte beaucoup plus de phases. Et surtout, c’est parce que nous souhaitons agir dans le sens que vous avez indiqué qu’un accord a été conclu en faveur de l’adoption de la norme RDE. Il manquait jusqu’à aujourd’hui à la mesure des émissions réelles un protocole et une norme de mesure. Et aujourd’hui, je vous confirme que les industriels français respectent ces normes – qui sont ce qu’elles sont. Celles-ci évoluent rapidement mais nous n’avons jamais remis en cause ce rythme. Les industriels ont exprimé la volonté que les nouvelles normes soient en vigueur en septembre 2017 et jusqu’en 2021. Il y aura quasiment une nouvelle étape normative par an. Peu d’industries sont soumises à un tel rythme et doivent de la sorte conduire une R&D en cohérence avec ces normes. Car qui développe un modèle pour 2017 a aussi intérêt à ce qu’il reste conforme en 2021 sans quoi il aura un problème de business model.
Mme la rapporteure. Vous avez indiqué qu’il était prioritaire d’accélérer le renouvellement du parc automobile mais, selon vous, sans prime à la casse. Quelle politique publique permettrait-elle d’y parvenir ? Que pensez-vous de l’actuelle prime à la conversion ?
En 2012, votre Plateforme a pris position contre l’investissement dans les moteurs à l’hydrogène. Certains constructeurs dans d’autres pays développant des programmes en ce sens, pensez-vous que la filière automobile française doive en faire autant ?
M. Éric Poyeton. Je me suis sans doute mal exprimé concernant la prime à la casse. C’est un sujet sur lequel la PFA n’a pas à se prononcer car il concerne uniquement les constructeurs. La PFA considère qu’il faut prioritairement agir en faveur du renouvellement du parc tout en ayant conscience de tous les paramètres à prendre en compte – y compris le fait que l’âge moyen d’achat d’un premier véhicule neuf en France est de cinquante-trois ans.
Nous venons de faire évoluer notre position concernant l’hydrogène, en considérant qu’il fera partie de la batterie des solutions. Nous ne voyons aucune raison de dire qu’il constituera la solution principale pour la motorisation des voitures mais nous sommes conscients qu’il est une solution en tant que prolongateur d’autonomie, notamment pour les véhicules lourds et utilitaires. Nous sommes d’ailleurs très satisfaits de l’expérimentation du projet conduit sur les véhicules utilitaires Kangoo de La Poste. En outre, l’automobile pourra entrer comme consommateur dans un écosystème fonctionnant à l’hydrogène et tenant compte de la notion de smart grid (réseau intelligent) mais ce n’est pas notre secteur industriel qui favorisera le déploiement de l’hydrogène en tant que carburant. Nous le démontrons dans le document exposant notre prise de position actualisée que nous nous apprêtons à publier. Ainsi que je l’ai souligné lorsque j’ai été auditionné sur le sujet, l’hydrogène peut être un excellent substitut au diesel pour les groupes électrogènes tournant de façon stationnaire dans de nombreux endroits du monde et en particulier dans un nombre incalculable de pays d’Afrique, d’Asie et d’Europe. Il serait alors facile de le faire remplacer du diesel Euro 2, non taxé, alimentant des installations fixes. Il est des secteurs dans lesquels l’hydrogène peut être un substitut et dans lesquels, en tant que fournisseurs de motorisation, nous accepterions de voir nos moteurs remplacés par d’autres.
M. Jean Grellier. Dans le cadre du plan industriel « Usine du futur », on réfléchit actuellement au retrofitting (réaménagement) des bus urbains en lien avec la RATP. L’objectif est de déterminer comment les rééquiper de moteurs à énergie plus propre. On n’en est aujourd’hui qu’aux balbutiements puisqu’il est question d’élaborer un premier prototype susceptible d’utiliser différentes formes d’énergie dont le gaz et l’hydrogène. Si l’on parvient à réaménager les bus, on peut supposer qu’il soit possible d’en faire autant pour les poids lourds. Peut-on envisager la même solution pour des véhicules légers de tourisme à l’avenir ? Si le renouvellement du parc prend dix à quinze ans, on n’obtiendra pas les retombées souhaitées en termes environnementaux avant cette période. Ne pourrait-on par conséquent suivre des démarches permettant d’accélérer ce renouvellement ?
M. Éric Poyeton. Il ne peut être que bénéfique de porter plus d’attention à ce sujet. Mais je ne vois pas du tout comment transposer cette démarche à la voiture : personne n’acceptera de supporter le coût de ce retrofit. En revanche, dans le business to business, c’est-à-dire pour les véhicules industriels, utilitaires, les autocars et les bus, les possibilités et les innovations existent. Le pôle LUTB a notamment mené des études et établi des comparaisons européennes sur le sujet. Reste à savoir si ces projets sont conformes aux normes qui viennent d’être durcies. C’est un point à ne pas négliger : de nombreux travaux sont effectués pour convertir de gros moteurs diesel en moteurs à gaz mais ils n’ont pas abouti alors que l’on a investi de l’énergie dans des projets franco-italo-espagnols dans des volumes conséquents. Cela étant, on ne perdrait rien à envoyer un signal à l’écosystème afin qu’il s’intéresse davantage à cet enjeu, y compris en termes de business model, et qu’il soit plus créatif en la matière.
M. Philippe Kemel. Vous nous avez indiqué que le crédit impôt recherche était différent suivant le procédé de recherche utilisé, ce qui signifie qu’une forme de régulation s’exerce déjà par le biais de ce dispositif fiscal. Quelles normes en vigueur vous incitent-elles à produire des véhicules plus propres ou à calculer les cycles du produit ? Que conviendrait-il de faire en termes de régulation pour favoriser les démarches vertueuses ?
M. Éric Poyeton. Je crains de ne pas être suffisamment expert pour vous répondre. Dans un écosystème tel que la filière automobile, il nous faut une animation nationale des animateurs d’écosystème régionaux et locaux, des IRT et des ITE. Or, nous en avons. Il est vrai que le régime fiscal des IRT donne droit au doublement du CIR, ce qui n’est pas le cas du régime de l’ITE automobile. Mais je n’ai pas l’expertise nécessaire pour vous en dire davantage.
M. Philippe Kemel. Quels partenariats avez-vous conclus avec l’Agence nationale pour la formation automobile (ANFA), où l’on retrouve l’ensemble du système visant à réparer les moteurs automobiles et à maintenir le respect des normes en vigueur ?
M. Éric Poyeton. Nous nous sommes lancés dans une démarche de partenariat figurant dans notre contrat stratégique de filière. Un groupe de travail co-piloté par un représentant syndical et le directeur des compétences de la PFA mène une action tendant à assurer la synergie entre l’amont et l’aval de la filière. Il y a beaucoup d’opportunités à créer en ce domaine. Le président du Conseil national des professionnels de l’automobile (CNPA) et le président de la PFA l’ont rappelé récemment lors de rencontres ainsi que dans un échange de courriers et les premières séances de travail commun ont eu lieu très récemment. Cette idée est en plein devenir et vous prêchez un convaincu. Je peux vous en parler sous le contrôle de votre collègue M. Xavier Breton : lorsque j’étais patron de l’usine de Bourg-en-Bresse, je souhaitais créer des passerelles entre le monde de l’usine d’assemblage et celui de la distribution. On a en effet besoin, en projet, de compétences de retouches en usine à la suite de quoi le niveau de retouches diminue. Or, les distributeurs sont d’excellents réparateurs de véhicules, ce qui illustre concrètement l’utilité de créer des passerelles entre l’amont et l’aval. L’amont de la filière est bien conscient de la force de frappe de l’ANFA et ne dispose d’aucun équivalent, ayant fait le choix de développer des écoles des métiers proches des besoins des industriels ainsi que des universités. Et de plus en plus d’industriels ont développé leurs propres universités et écoles des métiers. Il faut donc rapprocher un amont, dans lequel l’implantation est proche des besoins industriels et qu’il faut fédérer en réseau, et, en aval, une puissance de frappe qui est implantée dans toutes les régions. Nous y travaillons effectivement.
Mme la rapporteure. Pourriez-vous nous fournir des informations plus détaillées s’agissant du crédit impôt recherche comme des projets affectés par la diminution du FUI, ainsi que vos positions sur la norme RDE ? Comment améliorer l’attractivité de la filière pour favoriser le recrutement des compétences ?
M. Éric Poyeton. Il nous faut mener des actions de terrain auprès des familles, des jeunes et des enseignants. Cela demande beaucoup de sueur et quelques moyens – que l’on pense trouver dans les campus des métiers et des qualifications – mais ce n’est pas le plus difficile à faire. Ensuite, il est nécessaire d’assurer un management de l’attractivité. L’ensemble des employés de l’industrie automobile sont fiers de leur industrie même si certains ont traversé des périodes difficiles. Nos salariés sont donc porteurs de cette attractivité. Encore faut-il qu’ils ne soient pas perturbés par des messages négatifs véhiculant l’idée que l’automobile serait sale et polluante, que les constructeurs et équipementiers seraient des lobbyistes indifférents à la cause environnementale et qu’ils refuseraient d’évoluer. Nous n’avons pas la chance, comme dans l’aéronautique, de défendre une cause européenne, le constructeur européen étant seul face au constructeur américain. Il nous faut aussi savoir traverser ces périodes et travailler dans la durée en adoptant une démarche de fond. Cet enjeu pourrait faire l’objet d’un Comité stratégique de filière automobile d’autant que de nombreux sujets restent uniquement abordés non pas en son sein mais en dehors de ce comité. Pour parler de la stratégie de la filière, il faut que l’ensemble des ministères soient présents. Il nous faut être persévérants et nous dire que dans l’automobile, ce que l’on fait vaut mieux que ce que l’on dit. Ensuite, les résultats seront là. Comme nous le voyons depuis plus de vingt ans.
Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente. Je vous remercie, monsieur le directeur général, de cette audition pleine d’espoir.
La séance est levée à dix-huit heures cinquante-cinq.
◊
◊ ◊
4. Audition, ouverte à la presse, de M. Michel Costes, président du Cabinet d’analyse de données économiques INOVEV, et de M. Jamel Taganza, vice-président.
(Séance du mercredi 4 novembre 2015)
La séance est ouverte à douze heures.
La mission d’information a entendu M. Michel Costes, président du Cabinet d’analyse de données économiques INOVEV, et M. Jamel Taganza, vice-président.
Mme Sophie Rohfritsch, présidente. Nous recevons, en cette fin de matinée, M. Michel Costes et M. Jamel Taganza, respectivement président et vice-président du cabinet d’analyse de données économiques INOVEV, dont le site internet, site de référence de l’industrie et du marché de l’automobile, n’est accessible qu’aux seuls professionnels.
M. Michel Costes, président et fondateur du cabinet, a commencé sa carrière dans l’industrie. Le cabinet INOVEV est fréquemment cité par la presse dans ses commentaires des séries statistiques d’activité du secteur. Il travaille à la fois pour des clients privés et des institutions publiques, y compris des ministères.
Messieurs, vous allez nous faire part d’informations précieuses et actualisées qui pourront servir de base objective à nos réflexions. Au-delà de données purement quantitatives, nous sommes vivement intéressés par certaines appréciations plus qualitatives résultant de vos analyses.
Partagez-vous l’opinion émise dans les années 2010 par certains experts selon laquelle les constructeurs français auraient raté le défi de la mondialisation ?
La diésélisation du parc français et la spécialisation sur ce type de motorisation constituent-elles un handicap ou présentent-elles encore certains atouts industriels ?
Plus généralement, le défi d’adaptation de l’outil industriel de nos constructeurs peut-il être relevé sans difficultés majeures, et à quelle échéance ?
Enfin, est-il exact que les résultats commerciaux plutôt positifs enregistrés récemment par Renault, et surtout par PSA, cacheraient une descente en gamme accompagnée d’un fort déficit commercial ? Je vous pose directement cette question car certains experts insistent sur ce double phénomène.
M. Michel Costes, président du cabinet Inovev. Avant de répondre à vos questions, Madame la présidente, je me propose de dresser un état des lieux du marché automobile français, autrement dit les véhicules vendus en France et roulant en France, et de la production automobile des constructeurs français.
Permettez-moi, en guise d’introduction de dire quelques mots d’Inovev, société indépendante à base de capitaux privés indépendants, dont les actionnaires sont des individus. Ses clients sont principalement européens et asiatiques. Inovev a été fondée récemment, en 2010, mais son équipe dirigeante est composée d’experts de l’industrie automobile, le plus âgé et le plus jeune d’entre eux ayant respectivement une expérience de quarante et de dix ans dans ce secteur – il s’agit de moi-même et de M. Jamel Taganza qui m’accompagne.
Les membres de l’équipe d’Inovev ont observé et analysé le marché automobile mondial et réalisé des prévisions. Ils ont analysé la conception d’une centaine de véhicules en procédant à leur démontage complet en coopération avec les constructeurs automobiles et leurs fournisseurs.
Les analyses et les prévisions d’Inovev s’appuient sur des données fiables et une méthodologie rigoureuse. Inovev achète ou se procure des données relatives aux immatriculations et aux ventes de tous les véhicules pour le passé et le présent. Nous les traitons après les avoir homogénéisés et les avoir mises en place dans un référentiel commun. À partir des ventes, nous estimons les productions par un calcul complexe mais très fiable lorsque celles-ci ne sont pas fournies par les constructeurs, ce qui est le cas le plus fréquent.
Nous prévoyons ensuite le futur à partir de l’analyse des facteurs clés de changement en nous fondant sur l’examen des éléments qui expliquent les plus récentes évolutions : réglementation, normes et essais, politique des constructeurs, influence des orientations générale à caractère politique et des médias. Nous réalisons des prévisions, modèle par modèle, motorisation par motorisation, usine par usine. Nous bouclons finalement la boucle en comparant nos prévisions à ce qu’il est réellement advenu, afin de toujours améliorer nos méthodes et modélisations.
Je veux d’abord évoquer le marché français, c’est-à-dire les véhicules roulant en France.
Le parc français se classe, au 1er janvier 2015, au troisième rang de l’Union européenne avec 31,5 millions de véhicules – on en compte 42,3 millions en Allemagne, 36,6 millions en Italie, et 29 millions en Grande-Bretagne. Le taux de motorisation de la France, défini comme le nombre de véhicules particuliers par habitant, se situe dans la moyenne de l’Union européenne – le pays européen le plus largement motorisé étant l’Italie, et la Pologne se situant au niveau de la France et de l’Allemagne.
Si l’on passe du stock au flux et que l’on considère les immatriculations annuelles, la France se place également au troisième rang de l’Union Européenne, mais cette fois derrière l’Allemagne et la Grande-Bretagne. Les immatriculations françaises de véhicules particuliers et de véhicules utilitaires légers ont varié de manière assez stable au cours de la dernière décennie contrairement à ce qui s’est produit en Allemagne où elles ont connu quelques soubresauts. En revanche, la production en France, tous constructeurs confondus, s’est écroulée durant la même période, passant de 3,5 à 2 millions de véhicules par an.
La crise automobile de 2008 n’a pas été vécue de la même manière en France et en Allemagne. Les deux pays ont mis en place des primes à la casse, mais de façon différente : en Allemagne, il a été annoncé que la mesure serait ponctuelle et limitée dans le temps, alors qu’en France, la mesure a duré plus longtemps et elle est donc devenue, dirons-nous, plus « habituelle ». Cela dit, nous constatons que ces dispositifs n’ont généralement qu’une incidence faible sur le niveau moyen du marché sur cinq ans. Ils créent un effet d’aubaine qui permet d’anticiper des ventes mais non de les additionner : l’augmentation des ventes est généralement suivie de leur baisse, ce dernier mouvement annulant l’effet du précédent sur le moyen terme. Le procédé présente néanmoins l’avantage de soutenir le marché à court terme.
Je dois dire un mot du mix énergétique des marchés européen et français.
La forte proportion de véhicules particuliers à motorisation diesel, soit 53 % en 2014, constitue une spécificité marquante de l’Europe par rapport au reste du monde où seules la Corée et l’Inde ont un marché de véhicules particuliers comportant une part élevée de diesel, soit respectivement 43 % et 47 %.
La motorisation diesel a véritablement commencé en France à la fin des années 1980. Le diesel représentait 10 % du marché en 1980, 15 % en 1985, et 33 % en 1990. Une telle progression, qui a eu lieu dans le cadre d’une politique énergétique visant à l’utilisation des coupes lourdes du pétrole, est restée une spécificité française jusqu’à la fin des années 1990. À partir de cette période et du début des années 2000, le diesel a en revanche décollé dans tous les pays européens, principalement du fait des progrès techniques accomplis par les constructeurs. La France a augmenté la diésélisation de son parc de manière continue de 1998 à 2008 pour atteindre un taux de près de 80 % en 2008, juste avant la crise. L’Espagne a pour sa part accru sa proportion de diesel jusqu’à 70 %. Même le Royaume Uni, qui a pour spécificité en Europe de proposer un prix de carburant diesel plus élevé que l’essence, a atteint et conservé depuis 2008 un taux de diésélisation proche de 50 %.
Les motorisations électrifiées, les véhicules hybrides et les véhicules électriques à batterie, n’occupent pas, à ce jour, de place significative sur le marché. Le développement des véhicules hybrides, qui représentent aujourd’hui environ 3 % du marché français, a rencontré deux obstacles. D’une part, leur compétitivité est difficile à mettre en évidence auprès des utilisateurs au regard des avantages de la motorisation diesel. Dans les pays où le diesel est peu répandu, les véhicules hybrides se font une place beaucoup plus facilement que lorsque le diesel est très présent. D’autre part, l’offre des constructeurs européens reste faible. La société Toyota a toutefois développé une forte politique de vente de ses véhicules hybrides en Europe, et plus particulièrement en France, voyant là un moyen d’affirmer sa différence par rapport aux constructeurs européens : 43 % des véhicules Toyota vendus en France sont des hybrides. Les véhicules électriques à batterie ne représentent aujourd’hui que 1 % du marché français. Ils n’ont pas encore trouvé leur place malgré le leadership mondial et incontesté du groupe Renault Nissan qui fabrique la Leaf, véhicule mondial, et la Zoé, véhicule européen.
J’en viens à la production automobile française. Il est nécessaire de distinguer la production des constructeurs français dans le monde, de la production sur le sol français et d’éviter ainsi tout amalgame entre deux notions qui peuvent porter le même nom.
On peut considérer que les constructeurs européens occupent la première place mondiale en termes de production de véhicules légers dans le monde. Cette première place n’est toutefois acquise que si l’on fait deux hypothèses : l’une selon laquelle la société Nissan est contrôlée par l’Europe, l’autre qui permet de comptabiliser les véhicules chinois produits dans le cadre de joint-ventures avec les constructeurs européens, notamment allemands, comme des véhicules sous contrôle européen. Le groupe Renault Nissan a connu une forte croissance : il atteint le quatrième rang mondial, derrière Toyota, Volkswagen, et General Motors, devant Hyundai et Kia qui le talonnent. Le groupe PSA se place au neuvième rang mondial.
Si la France est un pays majeur pour la production automobile dans le monde, ce n’est pas le cas pour ce qui est de la production sur son propre territoire : elle ne fait plus partie du top ten des pays du monde producteurs d’automobiles.
La question du mix énergétique mérite aussi d’être examinée pour ce qui concerne les constructeurs européens. Les groupes Ford, PSA et Renault Nissan sont les plus diésélisés : le diesel compte pour 60 % de leur production automobile. Renault Nissan et PSA produisant beaucoup de petits véhicules, et ces derniers étant peu diésélisés, la proportion de véhicules diesel produit par ces deux groupes est, en fait, supérieure à 60 % pour les moteurs de cylindrée supérieure. Ces groupes se voient d’autant plus impactés par une baisse de la motorisation diesel qu’une partie de leur production plus importante que celle de leurs concurrents est destinée à la France, pays dans lequel le diesel baisse le plus rapidement après avoir progressé rapidement.
Dans nos prévisions, nous prenons en compte les politiques probables et très certainement efficientes des groupes de constructeurs diésélisés qui auront pour objectif de freiner la décroissance du diesel, puis de stabiliser son ratio. Selon nous, en Europe, il se situerait probablement autour de 50 % en 2018. Ces stratégies lutteraient par exemple contre la désinformation actuelle assimilant souvent les motorisations diesel à des motorisations sales, alors même que les normes Euro 6 et Euro 6c les contraignent à être aussi propres que les motorisations essence, voire davantage. Un amalgame est en effet entretenu entre les anciens véhicules diesel plus polluants que les véhicules à essence, et les nouveaux véhicules diesel qui ont quasiment les mêmes résultats en termes de pollution que ces derniers, quand ces résultats ne sont pas meilleurs.
Le diesel a en effet aujourd’hui beaucoup d’avantages client à faire valoir par rapport à la motorisation essence, notamment en termes d’émission de CO2, de consommation, mais aussi de prestations. Les clients aiment le diesel. Certains pays nous l’envient même : dorénavant, le Japon considère par exemple le diesel comme un objectif de développement alternatif.
Nos prévisions prennent également en compte le fait que les groupes de constructeurs confirmeront le développement de nouvelles générations de véhicules diesel répondant aux normes les plus contraignantes. Ce processus est déjà très largement engagé chez Renault Nissan ainsi que chez PSA. Les groupes renforceront aussi très certainement le développement de véhicules électrifiés.
Quels sont les facteurs clés de changement qui auront un impact sur l’industrie automobile dans les prochaines années ?
Dans notre scénario moyen, le marché automobile français devrait rester quasiment stable d’ici à 2020, passant entre 2015 et cette date de 2,2 à 2,3 millions de véhicules vendus en France. Le marché automobile européen devrait en revanche connaître une croissance d’environ 2 % par an en moyenne, et atteindre 16,5 millions d’unités vendues en Europe en 2020, alors qu’il se situe, en 2015, à 15 millions d’unités. La croissance européenne sera donc basée sur celle de marchés « hors France », notamment sur les marchés italien, espagnol, portugais et grec, qui se trouveront en phase de rattrapage après une très forte chute des ventes, et sur une croissance des ex-pays de l’Est où le taux de motorisation reste encore assez faible.
Dans ce marché mature, des facteurs clés de changement peuvent impacter le paysage automobile de façon plus ou moins importante. Je pense notamment à des mesures de modification fiscale, comme la baisse du différentiel des taxes sur le diesel et l’essence ou l’évolution de la TVA, au renforcement des normes, au retrait de la circulation de véhicules anciens, à la limitation de la vitesse en Europe pour un redimensionnement des véhicules, au soutien au développement des transports et aux motorisations alternatifs. Ces mesures joueront en particulier sur cinq thématiques : le niveau du marché français, le niveau du marché européen, la production des constructeurs français, la baisse des émissions de CO2, la baisse des émissions de polluants hors CO2, et la réduction du bruit. Nous analysons, dans le document qui vous a été distribué, l’impact de chaque changement sur chaque thématique.
Je profite de ces éléments de prospective pour évoquer l’impact prévisible de l’affaire Volkswagen. Selon nous, elle aura très peu d’incidence sur le marché français.
Un petit fléchissement se produirait à court terme par rapport à nos prévisions, mais il serait suivi d’un rattrapage en 2016. Les fondamentaux n’ayant pas été touchés, nous considérons que cette crise n’aura pas davantage d’incidence à plus long terme. L’affaire Volkswagen pourrait provoquer une légère accélération de la baisse des immatriculations de véhicules diesel en France, mais une forte baisse avait déjà été anticipée avant cette crise et, à nouveau, les fondamentaux n’ont pas évolué. Un nouvel équilibre de mix d’énergies devrait apparaître en 2018, le diesel restant une composante forte compte tenu de ses grands avantages en termes de bilan prix, prestations et environnement.
L’affaire Volkswagen aurait par ailleurs très peu d’incidence sur la production des constructeurs français en raison de la stabilité des fondamentaux que j’ai déjà évoquée. Assez paradoxalement, le groupe Volkswagen pourrait à moyen et long terme tirer le plus parti de la crise : il dispose en effet d’une offre très diversifiée. Il pourrait donc être tenté de se donner une image « verte » en développant plus rapidement que prévu des véhicules électrifiés. Les dépenses relatives à l’affaire pourraient toutefois contraindre le constructeur à ralentir certains investissements comme certains développements. Cette crise pourrait également peut-être donner un avantage à moyen et long terme au groupe Renault Nissan qui tirerait bénéfice de son avance en matière de véhicule électrique.
Pour revenir aux évolutions prévisibles des marchés en Europe et en France, les graphiques que nous vous avons distribués montrent bien une croissance du marché mais essentiellement en dehors de la France. Le marché français est en phase de stabilisation. Globalement, en Europe, le diesel décroît jusqu’à atteindre 50 % du marché d’ici à cinq ans. Ce point d’arrivée est également celui de à la France qui part pourtant d’une situation de « surdiésélisation ».
Si nous nous intéressons à la production sur les sols nationaux, qui tient compte des exportations, qui sont par exemple très importantes en Allemagne, nous prévoyons pour les vingt-neuf États membres plus la Turquie, qui produit les mêmes véhicules que les pays européens, une poursuite de la croissance avec un retour aux chiffres de 2005. La production sur le sol français devrait également croître, en particulier en raison de la localisation de nouveaux véhicules par les constructeurs français.
Pour conclure, nous anticipons une stabilité du marché français entre 2015 et 2020, fondée sur celle des modes de mobilité alternatifs. Sur ce marché, un assainissement de l’air aura « mathématiquement » lieu entre 2015 et 2020 en raison du retrait des anciens véhicules polluants remplacés par des véhicules récents plus propres. Ce phénomène pourrait être accéléré par des mesures visant à augmenter la vitesse de ces retraits. À plus long terme, le développement des véhicules à batteries électriques devrait permettre de diminuer encore la pollution locale tout en réduisant le bruit. Par ailleurs, le moteur diesel restera très vraisemblablement en Europe une motorisation importante dans les années qui viennent, du fait de sa contribution aux objectifs draconiens de diminution de CO2, de sa moindre consommation et de prestations-clients appréciés d’une grande partie de la population.
Nous anticipons à court terme une croissance de la production des constructeurs français. Cette croissance sera d’autant plus forte qu’ils pourront continuer à vendre en Europe des diesels appréciés des consommateurs, ce qui leur donne un avantage certain par rapport à des constructeurs ne possédant pas cette technologie. À moyen et long termes, nous prévoyons une croissance encore plus forte en cas de développement des véhicules électriques, soutenu par des évolutions technologiques et une politique volontariste des pouvoirs publics.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Monsieur Costes, les conclusions que vous tirez de l’affaire Volkswagen m’étonnent. Alors qu’elle connaît de nouveaux épisodes tous les jours, doit-on être aussi rassurant que vous l’avez été concernant l’avenir de ce constructeur ? Comment analysez-vous cette tricherie ?
Pourriez-vous nous dire quelques mots du paysage mondial de l’industrie automobile et de la place qu’y occupent l’Europe et la France ?
L’outil industriel français est-il encore en surcapacité selon vous ? L’une de vos études montre qu’il n’existe plus de grand site industriel en France alors que Volkswagen, BMW et Daimler ont conservé leur plus gros site dans leur pays d’origine. Qu’en est-il de la stratégie des constructeurs français en termes d’implantation industrielle ?
Je reviendrai sur les questions de motorisation mais, à ma connaissance, au Japon, le diesel avait été interdit en ville.
M. Michel Costes. L’affaire Volkswagen fait l’objet d’une médiatisation intense et légitime puisque l’entreprise a véritablement triché. Une observation du marché de l’automobile depuis vingt ans nous montre cependant que l’attention portée un temps sur un événement donné s’évapore assez rapidement sans qu’un certain nombre de fondamentaux soient modifiés sur les moyen et long termes. Aujourd’hui, l’image du groupe est indéniablement très altérée, mais d’autres éléments sont stables dans la durée : le coût du véhicule, les prestations demandées par les clients, les dépenses de carburants etc. Par ailleurs, une entreprise qui se retrouve au cœur d’une tempête médiatique, même passagère, met aussi en place des stratégies et des actions spécifiques pour l’affronter. Nous pouvons nous tromper, mais nous pensons que cette affaire ne va pas faire chuter Volkswagen.
Cet industriel a commencé à tricher aux États-Unis où les normes applicables aux véhicules diesel sont particulièrement sévères puisqu’elles sont identiques à celles en vigueur pour les véhicules à essence. Cela l’a sans doute poussé à manipuler les chiffres. Il faut toutefois savoir que les nouvelles normes européennes Euro 6 et Euro 6c permettront vraisemblablement aux véhicules diesel européens d’être pratiquement conformes aux normes américaines.
M. Frédéric Barbier. Comment les technologies diesel et essence évoluent-elles en termes de consommation, de pollution, et de longévité ?
Je roule aujourd’hui avec une Peugeot diesel de nouvelle génération qui consomme peu malgré un moteur relativement puissant, alors que je roulais à l’essence il n’y a pas si longtemps pour des consommations nettement supérieures. Le moteur à essence de nouvelle génération sera-t-il moins gourmand et moins polluant ? Sa longévité sera-t-elle toujours inférieure à celle du moteur diesel ?
M. Michel Costes. Le rapport entre le diesel et l’essence connaît de très fortes évolutions, en particulier avec le moteur essence à injection directe qui consomme moins et permet le downsizing – obtenir plus de puissance pour une même cylindrée. Le moteur essence se rapproche finalement du moteur diesel …
Mme la rapporteure. Y compris pour l’émission de particules fines !
M. Michel Costes. En effet, c’est la conséquence de l’injection directe. Une dérogation temporaire permet d’ailleurs au moteur à essence d’émettre jusqu’en 2017 plus de particules fines que le diesel.
Les deux moteurs se rapprochent même si le diesel conserve une certaine avance en termes de consommation. Il émet aussi moins de CO2. Nous n’avons en revanche pas effectué d’études sur la longévité respective des deux technologies.
Mme Sophie Rohfritsch, présidente. Monsieur Costes, si nous prolongeons votre raisonnement sur l’évolution des véhicules diesel, nous pouvons considérer que vous préconisez une quasi-disparition du marché de l’occasion, ce qui permettrait de faire disparaître les véhicules anciens polluants.
M. Michel Costes. Je confirme que le retrait de véhicules anciens se traduit par une moindre pollution dans des proportions extrêmement plus fortes que celles que peut avoir un renforcement des normes. Il y a un facteur cent ou mille entre une action menée sur les vieux diesels et l’édiction de normes plus sévères dont l’effet est moindre ! Cela dit, on ne peut pas raisonnablement demander à tous les propriétaires de véhicules anciens d’acheter un véhicule neuf : ils n’en auraient tout simplement pas les moyens, et ce ne serait pas réaliste, même s’il s’agit bien de la solution la plus simple pour disposer d’un parc propre. On peut en revanche les persuader d’échanger leur véhicule contre un autre plus récent donc moins polluant que le précédent, mais moins coûteux qu’un véhicule neuf. Il faut travailler sur toute la chaîne.
M. Jamel Taganza, vice-président du cabinet Inovev. Il y a une sorte de décalage dans l’affaire Volkswagen : on tient le « procès » du diesel de nouvelle génération alors que des progrès technologiques considérables ont été accomplis et, dans le même temps, les régulateurs ne s’intéressent pas vraiment au marché de l’occasion.
Il est regrettable qu’il n’existe pas de mesures transitoires permettant de rajeunir progressivement le parc des véhicules roulant au diesel. La prime à la casse ou à la conversion ne concerne que l’achat des véhicules neufs alors qu’il faudrait également inciter à l’achat de véhicules d’occasion moins polluants.
M. Michel Costes. Madame la rapporteure, vous m’interrogiez sur le marché mondial de l’automobile. Il est notamment caractérisé par la récente et très forte croissance du marché chinois. En l’an 2000, la Chine produisait deux millions de véhicules ; elle en produit aujourd’hui vingt millions. Une telle progression est inédite dans l’histoire d’une industrie. La production chinoise, qui équivaut à peu de chose près au marché chinois, est pour 70 % le fait de joint-ventures entre des sociétés chinoises et des constructeurs occidentaux parmi lesquels je range les Japonais et les Coréens. Les groupes Volkswagen, General Motors et Renault sont particulièrement présents en Chine, à travers Nissan pour ce qui concerne ce dernier.
Renault commence seulement à fabriquer en Chine alors que Nissan y est installé depuis longtemps – ce qui explique d’ailleurs qu’au sein du groupe la croissance du second soit beaucoup plus forte que celle du premier. La décision de mettre en avant Nissan plutôt que Renault en Chine, la marque japonaise étant plus proche du marché chinois que la marque européenne, a été prise à une époque où personne ne s’attendait à une telle croissance du marché de l’automobile chinois. Je rappelle qu’aujourd’hui, le groupe Renault Nissan est sans doute le plus équilibré des constructeurs mondiaux : il est le seul à produire partout dans le monde.
Nous sommes dans l’incapacité de prédire ce que deviendra le marché chinois ou de savoir si la croissance économique chinoise se poursuivra, même si le gouvernement chinois a fixé un objectif de croissance de 7 %. Je rappelle aussi que le taux de croissance chinois est calculé par les Chinois eux-mêmes. Nous avons malgré tout quelques certitudes : nous savons que les Chinois auront besoin de davantage de véhicules, et qu’ils veulent lutter contre la pollution qui fait des ravages dans leur pays. Ils pourraient donc être tentés par la production de véhicules à faible taux de pollution locale comme les automobiles à batterie électrique.
Les États-Unis constituent un marché mature en période de rattrapage après une forte baisse.
Le marché russe reprend de la vigueur après avoir fortement chuté, mais nous ne savons pas à quoi nous attendre. Je rappelle que le groupe Renault est le premier producteur russe avec sa branche Avtovaz dont l’usine de Togliatti est la troisième usine européenne derrière l’usine Volkswagen de Wolfsburg et celle de Nissan à Sunderland, dans le nord-est de l’Angleterre. Le marché sud-américain vit les soubresauts que nous connaissons.
M. Jamel Taganza. Madame la rapporteure, pour répondre à votre question relative aux surcapacités en Europe, il faut en particulier distinguer les politiques des constructeurs allemands et français. Les constructeurs allemands exportent des véhicules vers des marchés divers alors que les constructeurs français ont plutôt choisi de localiser leur production et de se rapprocher des marchés. Ces deux politiques différentes expliquent que les Allemands exportent davantage que les Français, et qu’ils produisent davantage en Allemagne. Les constructeurs français produisent davantage de véhicules sur leurs marchés cibles comme la Chine ou l’Amérique du sud, et moins en Europe.
Mme la rapporteure. Quelle est la stratégie gagnante ?
M. Jamel Taganza. Dans une vision à court terme, la stratégie allemande peut sembler gagnante puisque l’industrie automobile allemande produit beaucoup plus que l’industrie française, mais à terme la stratégie de localisation des constructeurs français pourrait se révéler pertinente, l’avenir nous le dira. Elle a toutefois déjà fait ses preuves puisqu’elle a permis à Renault Nissan de surmonter la crise de 2008-2009. Renault Nissan et Volkswagen, qui ont connu une croissance assez forte depuis 2005, sont globalement en meilleure position que les constructeurs américains ou purement japonais.
Concernant la taille des usines européennes, il faut distinguer les usines historiques de grosse capacité, comme celle de Wolfsburg pour Volkswagen, des usines récentes de plus petite dimension mais dont la productivité est plus élevée. Alors que la production pouvait dépasser annuellement 800 000 unités dans les anciennes usines, les nouvelles sont souvent calibrées pour 300 000 ou 350 000 unités. Les usines qui ouvrent encore en Europe se trouvent en Europe de l’Est et sont construites sur ce dernier modèle.
Mme Sophie Rohfritsch, présidente. Pour traiter de la question des surcapacités, européennes n’est-il pas utile de s’interroger sur la production ? Renault Nissan produit dans toutes les gammes, en particulier dans ce que nous appelons le « moyen de gamme », Volkswagen produit des grosses cylindrés pour l’exportation…
M. Michel Costes. Vous avez parfaitement raison : il faut tenir compte des véhicules produits. Renault Nissan, c’est aussi Avtovaz, implanté en Russie, ou Dacia, présent dans tous les pays émergents. Le groupe mène une politique spécifique pour les véhicules à bas prix. PSA et Renault Nissan sont des groupes généralistes qui ont adopté par ailleurs, en France et à l’étranger – PSA cherche à se développer en Chine –, une politique de produits de gamme moyenne.
M. Jamel Taganza. La production de Renault Nissan et de PSA en Europe est concentrée sur des véhicules de petite dimension – le segment A, type Renault Twingo, et le segment B, type Renault Clio ou Peugeot 208. La production des constructeurs allemands est davantage répartie sur les divers segments, les grands véhicules étant destinés au marché européen et à l’exportation, mais une production de véhicules plus petits est également localisée à l’étranger. Le mix produits-marchés joue évidemment.
Mme la rapporteure. Monsieur Costes, vous avez parlé d’une baisse rapide du diesel en France. Quand ce mouvement a-t-il commencé ? Cette baisse pourrait-elle s’accélérer par rapport à vos prévisions ?
Vous suggérez d’augmenter la vitesse de retrait du marché des véhicules diesel anciens et polluants en nous recommandant de mettre en place des mécanismes qui ne favorisent pas uniquement l’achat de véhicules neufs. N’est-ce pas contradictoire avec votre analyse selon laquelle les dispositifs de type « prime à la casse » n’ont, au final, qu’un effet conjoncturel ?
Par ailleurs, la stratégie que vous nous proposez ne reviendrait-elle pas à délocaliser la pollution, ce qui n’est pas notre objectif ? Un véhicule polluant qui n’irait pas à la casse a toutes les chances d’être revendu même si ce n’est pas sur le marché français – ce circuit valorise d’ailleurs l’automobile destinée à la casse.
Vous nous indiquez que les « normes européennes Euro 6 et Euro 6c permettront à nos véhicules diesel d’être pratiquement conformes aux normes américaines ». Pouvez-vous nous indiquer si, dans les faits, les normes européennes satisfont ou non les exigences américaines ?
Un débat a lieu sur la nature des tests d’homologation des véhicules. À mesure que les normes s’élèvent, l’écart augmente avec les conditions réelles de conduite. Dans quels délais les constructeurs peuvent-ils être en mesure de respecter effectivement la norme Euro 6 ?
M. Michel Costes. Les véhicules diesel représentaient 40 % des immatriculations françaises en 1997. Ce pourcentage a augmenté de manière continue jusqu’en 2008 pour atteindre 80 %, puis il a chuté à partir de cette date. À l’époque, cette baisse s’expliquait par un facteur mécanique : la crise provoquait une augmentation proportionnelle de l’achat de petits véhicules parmi lesquels on comptait moins de diesels. Le plus étonnant, c’est que le mouvement se soit poursuivi, après une stabilisation au niveau d’un mix normal entre 2010 et 2012. Il est vrai que, depuis 2012, le diesel bashing bat son plein…
Mme la rapporteure. Les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont sérieuses !
M. Michel Costes. L’OMS prend position sur les anciens véhicules diesel !
Mme la rapporteure. Pas seulement !
M. Michel Costes. Disons que les anciens véhicules diesel sont les plus polluants au regard de l’analyse de l’OMS. Nous insistons très fortement sur la différence entre diesels anciens et nouveaux.
Aujourd’hui, le diesel respecte quasiment les mêmes normes que l’essence. Au cours des dix dernières années, les constructeurs ont diminué la pollution des véhicules. Je dispose de courbes qui montrent l’évolution de l’émission d’oxyde d’azote (NOx) entre les normes Euro 3, Euro 4, Euro 5, et Euro 6…
Mme la rapporteure. Vous parlez des normes, mais qu’en est-il de la réalité ?
M. Michel Costes. J’y reviendrai mais, sur le plan des normes, les constructeurs ont consenti de gros efforts dont ils ont finalement bénéficié puisqu’ils ont réalisé des progrès sur les marchés. Notons que tant que les efforts sont supportables, ils ne jouent en défaveur des constructeurs.
Madame la rapporteure, j’en viens au rapport entre les tests et la réalité. Les mesures effectuées aujourd’hui utilisent les procédures de test du Nouveau cycle européen de conduite automobile ou NEDC, conçu en 1973, autrement dit à une époque où le diesel était quantité négligeable. Les normes, qui visaient à fixer des seuils qui pourraient être abaissés afin de réduire progressivement la pollution, ont permis de fabriquer des véhicules de moins en moins polluants. La procédure choisie à l’époque se rapprochait le plus possible d’une réalité qui a évolué depuis, cependant, pour que les tests permettent des comparaisons dans le temps, il fallait conserver un point de référence, ce qui éloignait inéluctablement les normes de la réalité à mesure que celle-ci se transformait.
Les pouvoirs publics et l’industrie automobile ont pris conscience de cette différence bien avant l’affaire Volkswagen. Il est ainsi prévu d’introduire à partir de 2017 une procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers (WLTP) avec de nouveaux cycles de conduite automobile (WLTC) afin de résoudre ce problème. Un nouveau test a été mis en place afin de se rapprocher des conditions de roulage européennes. Il constituera un nouveau point de référence, mais on ne peut pas tout changer en permanence sans quoi l’on ne pourrait plus rien comparer.
Par ailleurs, afin d’effectuer des mesures sur route en conditions de conduite réelles, des tests dits RDE, pour Real driving emission, sont en cours de finalisation, avec des normes drastiques visant à réduire l’écart avec les essais en laboratoire. Ces données permettront aux consommateurs de mieux s’y retrouver.
Je rappelle que les normes ne constituent qu’un compromis entre l’état de la technologie et ce que l’on souhaite obtenir en termes de performance ou de pollution. Si vous demandez aux constructeurs de ne produire que des véhicules électriques, vous feriez reculer considérablement la pollution locale, mais le prix moyen du véhicule augmenterait très fortement.
Mme la rapporteure. L’élévation du niveau des normes s’est traduite par un écart de plus en plus grand au respect de la norme. C’est sur ce point que je vous interrogeais, Monsieur Costes. Aujourd’hui, dans la réalité, neuf véhicules diesel sur dix sont loin de respecter la norme Euro 6 : je me demande dans quel délai elle pourra l’être dans des conditions économiques acceptables par le consommateur.
De façon plus prospective, comment voyez-vous l’évolution technologique et économique du marché de l’automobile d’ici à 2030 ou 2040 ? Certains de nos interlocuteurs ont par exemple évoqué l’émergence d’une logique d’usage.
M. Michel Costes. Certes, l’écart entre la norme et la réalité a progressé, mais si vous mesurez l’évolution de la réalité dans le temps, vous constaterez que les résultats s’améliorent de façon extrêmement forte. L’existence de normes standardisées et la contrainte exercée ont un effet puissant sur le réel. Les progrès sont considérables même s’ils sont moindres que ce que laisse penser l’évolution des normes. Au final, ce qui importe pour la santé de nos concitoyens, c’est bien la baisse de la pollution. Elle a baissé ; il faut qu’elle baisse encore.
Des discussions sont en cours sur de nouveaux seuils, et l’on s’achemine vers des compromis. Si nous voulons aller plus loin, nous nous heurterons à des barrières technologiques, mais d’autres facteurs pourront aussi être pris en compte : on s’interroge par exemple maintenant sur les particules émises par les freins. Plus la pollution diminuera, plus notre exigence grandira. Le véhicule électrique est le seul qui permette d’éliminer la pollution locale et la pollution sonore.
Concernant l’évolution des usages, on constate un véritable succès du partage. Autolib’ à Paris en est un parfait exemple : des véhicules électriques non polluants et silencieux sont utilisés dix heures par jour. Les usages sont différents d’un lieu à l’autre : il faut adapter les véhicules en conséquence. Dans les grandes villes, le développement du véhicule électrique est souhaitable ; dans des régions boisées à faible circulation automobile, la lutte contre l’émission de particules fines n’a pas beaucoup de sens.
La France dispose d’une électricité bon marché et du plus grand constructeur mondial de véhicules électriques. Le groupe Renault Nissan vend la Leaf dans le monde entier et la Zoé progresse – elle a d’abord eu du mal, mais ses ventes ont doublé en 2015 par rapport à 2014. Si nous parvenons à franchir les barrières technologiques en développant des batteries assurant plus d’autonomie, et en diminuant les coûts, nous disposerons d’un véhicule urbain très attractif. Les Chinois travaillent certainement sur ce type de véhicule, même s’il reste cher pour leur pays – Dongfeng a entamé un partenariat sur le sujet à la fois avec Renault et PSA.
Mme la rapporteure. L’électricité chinoise provient du charbon !
M. Michel Costes. Le bilan global du véhicule tient effectivement compte du mix énergétique servant à produire l’électricité utilisée. Si elle est d’origine nucléaire, ce bilan est très favorable en termes d’émission de CO2, ce n’est évidemment pas le cas si elle est produite à partir du charbon.
M. Jamel Taganza. Nous avons du mal à prévoir ce qui se passera dans cinq ans ; nos prévisions pour 2040 ne seraient donc au mieux que des visions voire des sortes de songes. Nous pouvons en revanche nous prononcer sur les marchés intéressants aujourd’hui, et vous dire dans quelles zones du monde se développent des innovations, tant en termes de technologie que d’usage.
L’Europe a clairement une carte à jouer : sa forte urbanisation constitue un élément positif ainsi que le rapport au véhicule du consommateur qui est moins attaché à une image qu’à un usage, particulièrement en France. Ces facteurs contribuent à former un terreau favorable à l’innovation dans les technologies comme dans les usages. Le Japon bénéficie de caractéristiques identiques – la circulation à Tokyo, ville de trente millions d’habitants, est même beaucoup plus fluide qu’à Paris. Les États-Unis ou la Chine connaissent un contexte moins favorable, même si les contraintes qui s’imposent à la Chine peuvent la pousser à mettre en place des mesures bénéfiques à certaines innovations technologiques. On trouve par exemple déjà en Chine de petits véhicules et des deux-roues électriques.
M. Michel Costes. Le scooter électrique est très répandu en Chine où il est relativement peu onéreux. Lors du dernier de nos fréquents déplacements sur place, notre interprète nous expliquait qu’il hésitait entre l’achat d’un scooter électrique et d’un téléphone portable pour environ 500 euros. La vitesse de ces deux-roues est limitée.
Sans impulsion du gouvernement central, on voit se développer dans diverses provinces des Low speed electric vehicles (LSEV). Il s’agit de scooters électriques évolués, avec une batterie au plomb mais un habitacle et quatre places. Leur vitesse reste limitée à cinquante kilomètres par heure, et leur prix se situe entre 2 000 à 4 000 euros. Ces véhicules sans immatriculation sont difficiles à comptabiliser, mais nous estimons qu’au moins 400 000 unités auraient été produites. Peut-être s’agit-il d’une piste à explorer !
Mme Delphine Batho, rapporteure. Messieurs, nous vous remercions pour l’ensemble de vos interventions.
La séance est levée à treize heures trente.
◊
◊ ◊
5. Audition, ouverte à la presse, de M. le professeur Élie Cohen, économiste (Sciences Po/CNRS).
(Séance du mardi 10 novembre 2015)
La séance est ouverte à seize heures trente.
La mission d’information a entendu M. le professeur Élie Cohen, économiste (Sciences Po/CNRS).
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Nous avons le plaisir de recevoir M. Élie Cohen dont les travaux sont particulièrement reconnus en matière d’économie industrielle. Ses fonctions de professeur à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po), de directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et de membre du Conseil d’analyse économique auprès du Premier ministre, de 1997 à 2012, l’ont amené à écrire de nombreux articles ou livres dont l’un était précisément intitulé : Le décrochage industriel. Lorsque l’on considère le poids économique du secteur automobile, tout décrochage de nos capacités d’innovation et de notre appareil de production aurait, vous le savez, de lourdes conséquences.
Nous vous demanderons donc, monsieur le professeur, si les constructeurs français ont su répondre au défi de la mondialisation, notamment après la crise de 2008-2009, et, dans la même optique, si nos industriels sont en bonne position pour faire face à l’évolution des motorisations – problématique particulièrement sensible depuis la révélation, à partir des États-Unis, de pratiques frauduleuses de la part du groupe Volkswagen. Enfin, considérez-vous que les pouvoirs publics ont su anticiper ?
Vos éclairages ne manqueront pas de nous intéresser, je pense entre autres à la mise en place du Comité stratégique de la filière, mais aussi à d’autres structures, aux aides ciblées sur l’activité automobile, sans oublier les Programmes d’investissements d’avenir (PIA) dont certains axes sont directement dédiés au véhicule du futur.
M. Élie Cohen, économiste. J’ai décidé de concentrer mon exposé liminaire autour de trois sujets principaux. Je commencerai par l’effondrement de l’industrie automobile au cours des quinze dernières années. Il se trouve que j’ai publié, il y a quelques mois, vous l’avez mentionné, un livre intitulé Le décrochage industriel dont un chapitre porte précisément sur « l’effondrement de l’industrie automobile ». Je ne vous accablerai pas de données mais, dans ce livre, vous trouverez des comparaisons détaillées sur les performances, les structures de coûts, les structures de gamme, l’évolution de l’outil de production, les indicateurs de compétitivité, sur la productivité etc. dans les différents pays producteurs d’automobiles, notamment en Europe. Ma deuxième série de remarques portera sur l’affaire Volkswagen : s’agit-il d’un accident industriel du groupe ? S’agit-il d’un problème lié au diesel ? D’un problème de régulation européenne ? Vous devinez bien que c’est un peu des trois, d’où la difficulté, cette affaire révélant, au fond, un triple échec : de marché, de la régulation et un échec technologique. Enfin, je donnerai tout de même quelques perspectives.
J’en viens donc à l’effondrement de l’industrie automobile française : la violence du décrochage en matière de compétitivité, de parts de marché, de productivité, de rentabilité a été telle que cet événement macro-économique majeur peut être considéré comme l’un des facteurs de l’affaiblissement global de l’économie française au cours des quinze dernières années. L’industrie automobile représente en effet un cinquième de l’industrie manufacturière et un dixième de l’ensemble de l’économie en France. Quelques chiffres illustreront mon propos : la production automobile a baissé de 42 % en douze ans ; Renault ne produit plus que 20 % de ses véhicules en France ; 40 % de l’activité de Renault, stricto sensu, vient de Dacia et je ne parle pas de Renault en tant qu’entreprise dont les deux tiers de la valorisation viennent de Nissan – plus de la moitié du tiers restant provenant de Dacia. Il y a quelques mois, Renault – dans sa composante française – ne valait rien en termes de capitalisation boursière.
Pour mieux mesurer la violence de la dégradation de la situation, il suffit de comparer la situation de la France avec celle du Royaume-Uni. Il y a quinze ans, on considérait que l’industrie automobile était morte, Outre-Manche. Aujourd’hui on y produit plus de véhicules, avec une meilleure productivité, une meilleure rentabilité qu’en France et le solde commercial pour ce secteur est positif. À l’inverse, et pour ne prendre que cette donnée, le solde extérieur du secteur automobile, en France, était positif de 13 milliards d’euros en 2004 alors qu’il est devenu négatif : en 2012, le déficit était de 3,3 milliards d’euros. Notre déficit avec la seule Allemagne est de 7,3 milliards d’euros. Ces chiffres sont ahurissants. Même moi, en travaillant sur le sujet, je ne m’attendais pas à découvrir un tel effondrement
– un effondrement silencieux de presque la moitié de notre capacité de production.
Ce n’est pas tout : différentes études montrent que nous sommes globalement en surcapacité de production à l’échelle européenne – surcapacité évaluée à l’équivalent de dix usines de type « Sochaux » ! Sur 100 sites de production automobile, 58 perdent de l’argent. En outre, quand vous accumulez des années de mauvaises performances, vous rognez sur vos investissements, sur votre effort de recherche. Une donnée va vous faire rire : entre 2003 et 2012, la croissance de l’effort de recherche de Volkswagen a été de 229 %, alors qu’il n’a été que de 8,8 % pour Renault.
Cela a abouti, dans le cas français, à ce que j’appelle l’« évidement » du cœur manufacturier, à savoir une perte de substance progressive du métier d’ensemblier mais également de la première sous-traitance, c’est-à-dire du premier rang des équipementiers mais également du deuxième rang, du troisième… Cet ensemble s’est affaissé malgré le formidable effort réalisé à partir de 2008-2009 pour éviter une débâcle complète. Valeo, qui était au bord de la faillite, a opéré un rétablissement formidable. Donc cet évidement n’est pas du tout une fatalité : la France a abandonné des pans entiers d’activité quand d’autres pays, l’Allemagne par exemple, sont parvenus à procéder à un découpage plus fin dans la chaîne de valeur pour garder une part significative de valeur sur le territoire allemand.
L’histoire de l’industrie automobile française met en évidence, au cours des quinze dernières années, un triple échec.
Le premier est celui de la stratégie marketing, de la stratégie de montée en gamme. Nos industriels se sont révélés incapables, malgré différentes tentatives, notamment chez Renault, de monter en gamme. Toutes les expériences en la matière se sont conclues par des échecs commerciaux. Quand vous avez une spécialisation plutôt « moyen » et « bas » de gamme, comme en France, mais avec des coûts intérieurs haut de gamme, il se produit, en période de crise, un étranglement de l’entreprise qui s’est en l’occurrence matérialisé par l’effondrement de Renault et de Peugeot.
Cet échec s’est trouvé aggravé par un deuxième : celui de l’internationalisation puisque nos deux groupes ont beaucoup misé sur l’Europe et notamment l’Europe du Sud. Or, à la faveur de la crise, cette région est celle qui a connu les ajustements les plus brutaux avec, pour vous donner un exemple spectaculaire, le véritable effondrement de l’Espagne qui a alors coûté très cher à nos deux producteurs. Quant au groupe Peugeot Citroën, qui s’était montré très précurseur en s’implantant en Chine – et cela bien avant de nombreux producteurs qui ont réalisé, depuis, des performances éblouissantes –, il s’est révélé incapable, par faiblesse de moyens et à cause d’erreurs stratégiques, de financer sa croissance et son développement sur place. Aussi l’Asie n’a-t-elle pas constitué le relais de croissance qu’on pouvait espérer pour les industriels de l’automobile basés en France.
Le troisième échec est technologique : le grand pari, en matière de motorisation, a été celui du diesel. On a non seulement complètement raté le passage à l’hybride, mais même quand on a compris qu’avant de passer à la motorisation électrique il faudrait passer par une motorisation hybride, les entreprises n’ont pas été capables de la développer suffisamment rapidement ni de nouer les partenariats nécessaires. Ainsi chez Peugeot, la culture du diesel était si enracinée qu’on a investi beaucoup d’argent dans un hybride diesel qu’on a eu grand mal à mettre au point. Quant à Renault, son grand pari est de passer immédiatement à la motorisation électrique – vous avez tous en mémoire les projections de Carlos Ghosn sur la place de l’électrique en 2015-2020 –, or rien de tout cela ne va se réaliser.
Au cumul de ces trois échecs s’ajoute une fragilité financière permanente, compte tenu de la stratégie de coûts par rapport à la stratégie de spécialisation – j’y insiste, je ne parle pas de coûts unitaires de manière abstraite mais de coûts unitaires par rapport au type de spécialisation : on peut parfaitement avoir des coûts unitaires très élevés à condition d’avoir la spécialisation adéquate –, c’est le fameux mismatch constaté dans le cas français et qui s’est révélé dévastateur. Il suffit que je rappelle que la voiture connectée, autonome, que le véhicule à faibles émissions constituent les nouveaux fronts technologiques pour que vous constatiez immédiatement que nos deux entreprises, malgré leurs efforts, sur lesquels je reviendrai, ne sont pas du tout des leaders dans le secteur.
J’en viens à mon second point : l’affaire Volkswagen, fascinante tant elle soulève de problèmes. À mes yeux, elle révèle un triple échec : du marché, de la régulation, de la technologie.
Nous constatons un exemple considérable de fraude d’entreprise répétée sous couvert d’excellence. Certes, nous connaissons de multiples fraudes d’entreprise. Lorsque j’ai publié Penser la crise, j’ai énuméré toutes celles qui avaient été réalisées dans le domaine de la banque et de la finance. Reste que, d’une certaine manière, dans ce secteur, nous étions préparés à ce genre de phénomène, en particulier du fait du développement de toute une série de comportements limite en matière, notamment, de finance cachée. En revanche, dans le domaine de l’industrie et dans celui de l’automobile notamment, une fraude aussi longue, aussi répétée et dans autant de domaines est assez sidérante – et l’on en apprend tous les jours.
Dans ce « Volkswagengate », on note qu’à rebours de tout ce que l’on avait cru sur les vertus de la cogestion à l’allemande, sur les vertus du débat stratégique à l’allemande, sur la recherche du consensus à l’allemande… rien de tout cela n’a fonctionné. On découvre au contraire un système tyrannique, guidé par une ambition démesurée : devenir le numéro un mondial par tous les moyens ; on découvre une stratégie appliquée à marche forcée avec les différents niveaux hiérarchiques qui s’éteignent les uns après les autres, faisant disparaître toute éventuelle contestation ; on voit que le fait que des organes centraux soient en cogestion avec les syndicats ne change rien voire conduit à une omerta généralisée ; pire encore, on relève que la participation directe de l’État au conseil d’administration de l’entreprise aggrave le problème. Tout cela aboutit à une éblouissante faillite du marché.
La bonne nouvelle, néanmoins, est que si tous les systèmes de contrôle interne et externe n’ont pas fonctionné, c’est une petite organisation non gouvernementale (ONG) inconnue au bataillon qui, en mobilisant les ressources de l’expertise technique, en ayant recours à un laboratoire universitaire peu connu, a soulevé le problème. C’est assez rassurant : même dans un système qui paraissait hermétiquement contrôlé, une ouverture reste possible.
Deuxième point, cette affaire révèle une immense faillite de la régulation européenne. L’automobile est un domaine particulièrement suivi ; or on découvre que la régulation européenne a été totalement défaillante à cause d’une complicité générale pour fermer les yeux sur le fait que les normes adoptées ne pouvaient pas être respectées.
Ce qui m’amène à aborder la faillite technologique. Il est frappant de constater qu’il a fallu en permanence arbitrer entre émissions de dioxyde de carbone (CO2) et émissions d’oxydes d’azote (NOx) : à chaque fois que vous voulez réduire de manière drastique les émissions de NOx, vous alourdissez le véhicule, accroissez de ce fait la consommation de carburant et donc les émissions de CO2. Le patron Martin Winterkorn, grosso modo, a dit à ses troupes qu’il ne voulait rien savoir et les a sommées de régler le problème ; or les ingénieurs, malgré ce que je vous ai rappelé sur les considérables efforts de recherche de Volkswagen, n’y sont pas parvenus et il a donc été décidé de tricher pour masquer le phénomène.
Cette incapacité d’atteindre les objectifs fixés par la régulation américaine en matière de réduction de NOx a conduit la petite ONG à laquelle j’ai fait allusion à enquêter sur le fait de savoir pourquoi Volkswagen était capable d’afficher telles performances sur le marché américain alors qu’avec les mêmes moteurs le groupe déclarait, en Europe, des émissions plus élevées.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Ce n’était pas malin !
M. Élie Cohen. C’est pourtant la réalité… Cette enquête a donc révélé non seulement que Volkswagen trichait mais que les autorités de régulation européennes étaient complices. Cette affaire remet en cause le choix européen du diesel alors que les Américains ont fait celui de l’essence et les Japonais celui de l’hybride. Et nous avions, nous Français, cru que nous pourrions sauter une marche en passant directement à l’électrique – je reviendrai sur l’échec complet de la Norvège en la matière.
J’en viens à ma troisième et dernière partie et vais tâcher de dégager quelques perspectives technologiques et économiques dans le secteur automobile. Si nous voulons que les choses changent vraiment, notamment en ce qui concerne les moteurs à basses émissions, il faudra bel et bien faire le pari d’une évolution technologique disruptive, notamment en matière énergétique et dans le domaine numérique, et non en rester à une évolution incrémentale. L’Allemagne est le champion toutes catégories de la recherche incrémentale et a poussé le plus loin possible les raffinements pour améliorer le rendement des moteurs, réduire les émissions – mais sans parvenir à respecter les nouvelles normes.
Soit, dès lors, on constate que c’est un immense échec et l’on revient sur l’arbitrage NOx-CO2 qui est à la base de la régulation européenne et l’on révise ces normes en réduisant davantage les NOx parce qu’on les considérerait comme particulièrement attentatoires à la santé humaine, quitte à ce que les émissions de CO2 augmentent – c’est d’ailleurs une solution pratiquée par certains producteurs de véhicules de haut de gamme pour lesquels l’argument du poids est moins important ; soit, au cours des dix prochaines années, il faudra, j’y insiste, faire le pari d’une technologie disruptive, auquel cas il conviendra de savoir si les autorités politiques sont disposées à prolonger les délais – ce que la Commission européenne a accepté – jusqu’en 2020.
Toutefois, même avec des innovations disruptives, il faut savoir que l’automobile présente la particularité d’être une industrie de masse. Le design d’un nouveau produit et celui de son outil de production sont tels qu’il faut viser des quantités très importantes et une qualité très élevée puisqu’il s’agit d’un secteur formidablement concurrentiel où les économies d’échelle sont fantastiques. Au début de ma carrière d’économiste, un producteur fabriquant de 500 000 à 1 million de véhicules passait pour tout à fait sérieux ; le seuil critique pour pouvoir optimiser les investissements est passé aujourd’hui à environ 8 millions de véhicules. Or jusqu’à l’affaire dont il est le protagoniste, le groupe Volkswagen est celui qui a le mieux maîtrisé cette technologie de la montée en puissance avec l’optimisation de chaque maillon et une production très importante en volume et en qualité.
Aussi le pire qui puisse arriver pour Renault serait l’éclatement de son alliance avec Nissan. L’établissement de plateformes communes, la réutilisation sur plusieurs modèles des moteurs et des composants de haute qualité à faible coût et qui permettent d’accroître la fiabilité des véhicules resteront vraiment une donnée fondamentale du secteur.
Si l’on se projette à l’horizon 2025, l’idée de la spécialisation dans le haut de gamme, l’idée d’une séparation entre généralistes et spécialistes ne marche plus. Même les spécialistes du haut de gamme « descendent » vers les secteurs moyens et l’entrée de gamme. Tous les producteurs organisent leurs gammes en quatre niveaux avec une différentiation en termes de marques, de prix et d’image. Là encore, c’est Volkswagen qui l’avait le mieux réalisé avec une marque très grand luxe avec Porsche et Bentley, une marque premium avec Audi, une marque généraliste avec Volkswagen et des marques agressives d’entrée de gamme avec Seat et Skoda. Vous remarquerez d’ailleurs que tout le monde essaie d’imiter cette structure.
Je ne reviens pas sur les échecs successifs des stratégies françaises de Renault et Peugeot. Il faut distinguer le territoire français et l’avenir des producteurs à base française. Sur le territoire français, il se trouve que nous avons deux implantations industrielles qui marchent bien mais qui ne sont pas françaises : Toyota et Smart, qui ont réussi à atteindre des niveaux de productivité éblouissants, notamment Toyota, grâce au caractère récent de l’investissement, à l’optimisation des chaînes de production, à la capacité d’exporter, alors que plus de la moitié des usines françaises fonctionnent très en deçà de leurs capacités nominales. Il y a même de plus en plus d’usines Potemkine en France, qui ont l’apparence extérieure d’usines qui fonctionnent mais dont une chaîne sur deux est à l’arrêt.
Les deux grands enjeux technologiques sont l’économie d’énergie et la voiture numérique.
Lorsque vous voulez accroître de 100 kilomètres l’autonomie d’un véhicule à moteur thermique, vous devrez augmenter la capacité du réservoir de 10 litres, soit quelques euros et quelques kilogrammes supplémentaires ; si le moteur est électrique, il vous faudra alourdir le véhicule de 250 kilogrammes et le surcoût sera de 6 000 euros. Malgré l’optimisation du moteur électrique, dont il est beaucoup question, le fossé entre ces deux améliorations reste considérable.
Le véritable enjeu me paraît ce qu’on appelait celui des véhicules connectés, nommés désormais véhicules autonomes, qui implique le développement de quatre types de technologies : la connectivité, l’intelligence artificielle, les capteurs et, surtout, les interfaces homme-machine – optimisés grâce aux algorithmes installés dans le moteur lui-même – pour, si ce n’est assurer son autonomie, du moins donner un minimum d’assistance à la conduite, un minimum de sécurité, de programmation et d’optimisation.
Il faut en outre tenir compte du fait que la géographie de la production et de la consommation automobile a radicalement changé – ainsi, il y a à peine dix ans, la Chine produisait 500 000 véhicules alors qu’elle en fabrique aujourd’hui 10 millions –, phénomène qui accroît le différentiel entre les parcs de production installés et les nécessités de la consommation.
Je reviens sur l’expérience norvégienne – une fabuleuse réussite en matière d’équipement automobile en véhicules électriques qui représentaient l’année dernière 18 % des immatriculations. La Tesla Model S est le modèle le plus vendu en Norvège avec un avantage fiscal de près de 40 000 euros, ce qui, j’en conviens, laisse rêveur. Les Norvégiens s’étaient fixés pour objectif de produire 50 000 véhicules électriques pour 2017 ; or ils l’ont atteint dès avril 2015 – un succès éblouissant. On compte en outre 50 000 bornes de recharge électrique publiques dont 200 gratuites. Enfin, les véhicules électriques représentent 85 % du trafic des couloirs de bus mis à leur disposition – ce qui a provoqué une vive polémique.
On peut par conséquent admettre que les Norvégiens ont, permettez-moi l’expression, « mis le paquet », si bien que le coût de l’opération a très rapidement été jugé prohibitif – 600 millions d’euros par an en 2014 –, coût qui a même complètement dérapé par rapport aux prévisions. Surtout, certains ont découvert qu’il s’agissait d’une formidable subvention apportée à la Californie puisque, pour Tesla, la Norvège est devenue un fabuleux marché. Et, mauvaise nouvelle, les émissions de CO2 n’ont été réduites que de 0,3 % entre 2012 et 2013.
Ce modèle est-il exportable ? En Norvège même, on estime que la distorsion de concurrence est devenue trop importante par rapport aux autres véhicules. On doit en outre prendre en considération le fait que ce pays a tout de même une caractéristique : les ressources hydrauliques y sont considérables qui permettent la production d’une électricité très bon marché. La question ne se pose donc pas du tout de la même manière dans des pays qui produisent une électricité à base de charbon, comme en Allemagne, à base de gaz, comme en Italie, ou bien à base d’énergie nucléaire, comme en France.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Quelle est votre appréciation de l’efficacité des interventions des pouvoirs publics ?
M. Élie Cohen. Il me semble avoir été particulièrement clair : j’ai parlé d’échec de la régulation.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. En effet, mais ma question porte sur les interventions nationales en matière de fiscalité.
M. Élie Cohen. Je me suis en effet montré allusif sur ce point et vous avez raison de me demander des précisions. Le choix européen a été celui du diesel afin de réduire la consommation et les émissions de CO2. On a par conséquent favorisé fiscalement le diesel mais au point de complètement déformer notre système de raffinage. Cette politique a en effet conduit à des excédents considérables d’essence, que nous avons dû exporter dans des conditions de plus en plus difficiles, et, à l’inverse, à importer du diesel. Non seulement ce choix a eu un coût fiscal considérable mais un effet de distorsion non moins considérable sur notre système d’approvisionnement en produits pétroliers et sur notre appareil de raffinage dont certains outils ont été déclassés plus tôt que prévu.
La France était le principal actionnaire du principal producteur ; or c’est pendant la période où l’État s’est progressivement désengagé qu’on a assisté à ce véritable effondrement productif sur le territoire national – cela sans qu’on n’ait jamais mené un quelconque débat : je ne sache pas que l’actionnaire public ait soulevé cette question ni n’en ait fait un problème. C’est en travaillant sur le sujet que j’ai constaté la rapidité, à partir de 2003-2004, de cet effondrement.
Tout le monde a alors célébré la performance de Renault, qui reste certes remarquable puisque l’opération « Renault-Nissan puis Dacia » a été, du point de vue des intérêts de Renault et de la capacité du groupe à se projeter dans le monde, une très grande réussite. Mais si l’on raisonne en termes de base productive nationale, on constate une érosion de cette dernière, une érosion de l’effort de recherche, une panne de la politique de gamme et une perte progressive de parts de marché à l’intérieur du territoire, si bien que notre solde extérieur s’est très rapidement et très profondément dégradé. Encore une fois, je n’ai pas le souvenir qu’il y ait eu de grands débats sur l’automobile en 2005, 2006, 2007 et, en 2008, on a pensé que la grande crise touchait tous les secteurs. Seulement, ensuite, la France n’a pas bénéficié de la reprise. Et, j’y insiste, outre la perte de parts de marché à l’intérieur – et à l’extérieur –, cette crise s’est traduite par une descente en gamme. Je dirais presque que nous sommes en train de devenir, si nous raisonnons en termes d’offre productive des champions nationaux, les champions du low cost.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Je vous remercie pour la clarté de votre exposé. Vos dernières considérations me font penser que les origines de l’effondrement que vous évoquez se trouvent peut-être dans ce qui s’est passé dans les années 1990…
Vous avez déclaré que l’évidement du cœur manufacturier n’était pas une fatalité, citant l’exemple de l’Allemagne qui a su transformer sa chaîne de valeur. Pouvez-vous développer ce point ?
Quel regard porter sur les mesures prises après les Etats généraux de l’automobile – en 2009-2010, c’est-à-dire tard – : ont-elles permis d’amortir quelque peu le choc de la crise ?
Enfin, vous avez rappelé que la production automobile s’était effondrée de 42 % en douze ans. Pendant ce laps de temps, la part de l’automobile dans la production industrielle totale a-t-elle diminué ? Dans le même ordre d’idées, j’ai lu un article où vous évoquiez les secteurs à vos yeux stratégiques pour l’industrie française : la défense, l’énergie… le secteur automobile en fait-il partie ?
M. Élie Cohen. Pour ce qui est de l’effondrement, pourquoi ai-je privilégié les quinze dernières années ? On peut certes toujours remonter plus loin, mais il se trouve qu’en 2002 j’avais réalisé une étude comparée entre Volkswagen et Peugeot. J’expliquais à l’époque que PSA était le champion d’Europe de la rentabilité et, en particulier, que c’était une entreprise plus rentable que Volkswagen dont on évoquait les difficultés. Je me suis demandé ce qui s’était passé entre le début des années 2000 et aujourd’hui.
Le groupe Volkswagen a d’abord fait un effort considérable pour optimiser ses chaînes de production ; il a été le premier à concevoir la modularisation de l’outil de production et l’optimisation de chaque maillon de la chaîne de valeur ; c’est lui qui a inventé la politique de plateforme, qui a optimisé les gammes sur quelques plateformes ; c’est lui qui a été le grand innovateur en matière de technologie de production – si bien qu’il a été imité par la suite.
Ensuite, Volkswagen, l’emportant sur Renault, a racheté Skoda. Le groupe a ensuite commencé sa déclinaison de gammes, ce que les producteurs français n’ont pas su faire puisque, lorsque Renault a acquis Dacia, je me souviens d’avoir bavardé avec le patron de Renault, m’assurant qu’il n’était pas question d’importer des Dacia en France – véhicule rustique selon lui destiné aux pays émergents, première expérience automobile… Or, quelque temps après, on a vu des gens importer, je dirais presque : clandestinement, des Dacia. Quand les dirigeants de Renault s’en sont rendu compte, ils ont commencé à faire venir ces véhicules en France mais en les proposant dans les mêmes concessions que les Renault, provoquant un effet de comparaison, de « cannibalisation » terrible – erreur qui n’a pas été commise par Volkswagen qui a lancé la stratégie de quatre marques déjà mentionnée.
Enfin, les conditions financières n’ont pas été les mêmes : Renault a toujours été très limité alors que Volkswagen a pu, je le répète, beaucoup investir dans la recherche. Le contenu en recherche est trois fois supérieur dans véhicule allemand que dans un véhicule français, une différence qui finit par produire des effets. Or, pour mémoire, parmi les généralistes, en 2000, PSA était considérée comme l’une des plus belles si ce n’est la plus belle entreprise européenne.
J’ai participé aux états généraux de l’automobile qui ont eu des résultats incontestablement positifs. Les mesures prises ont permis que ne disparaissent pas un équipementier comme Valeo, alors en train de s’effondrer, mais également les décolleteurs de la Vallée de l’Arve ou les sous-traitants de premier, deuxième et troisième rangs. Ces mesures ont même permis une certaine consolidation et, dans le cas des décolleteurs de la Vallée de l’Arve, l’activité a redémarré. Malheureusement, de bonnes habitudes prises au cœur de la crise, comme la mutualisation des moyens, l’effort commun de prospection pour définir de nouvelles activités, la conquête de nouveaux marchés, ont été quelque peu abandonnées dès que la situation a commencé de s’améliorer. Notons en outre que les banques ont joué le jeu, à l’époque, accompagnant les initiatives publiques. Aussi avons-nous un certain génie pour le sauvetage des entreprises en difficulté mais sommes-nous moins géniaux dans la prospective.
Je ne sais de quelle manière répondre à votre question sur la part de l’automobile dans l’industrie française. Reste que l’effondrement de l’industrie française est incontestable. Quand on compare, sur les quinze dernières années, la performance industrielle de la France avec celle de tous les pays européens, seuls deux – et qui ne possèdent pas d’industrie automobile – font pire que nous : Chypre et Malte ! C’est l’un des sujets sur lesquels je ne parviens toujours pas à trouver de réponse satisfaisante ; je n’arrive pas à comprendre pourquoi – et je vous retourne la question – pourquoi la classe politique française s’est si peu intéressée à l’industrie française au cours des quinze dernières années ? Je suis un vieil industrialiste, j’ai écrit sur le colbertisme ; quand j’étais jeune, j’adorais aller visiter les usines… Je ne comprends pas, je le répète, cette espèce d’indifférence de la classe politique française vis-à-vis de l’industrie alors qu’on pouvait en voir l’effondrement.
M. Jean-Michel Villaumé. On ne parlait que des services.
M. Élie Cohen. Je ne crois même pas que nous ayons fait le choix des services car si cela avait été le cas, nous aurions considéré le tourisme, par exemple, comme un formidable atout et nous aurions considérablement investi dans le secteur – ce que nous n’avons pas fait non plus.
Ma question est beaucoup plus vaste : pourquoi cette indifférence à l’égard de toute la sphère productive ? Bien sûr, au cœur de l’économie productive, il y a l’industrie mais pas seulement ; on aurait ainsi pu s’intéresser aux services exportables. Je m’explique d’autant moins cette attitude qu’on relève un sentiment de fierté nationale à chaque fois qu’un grand projet aboutit : je ne connais pas de politique qui ne soit très sensible aux performances d’Airbus, d’Ariane… Pourquoi donc ce qui vaut pour ces derniers vaudrait-il si peu pour l’automobile, la machine-outil, l’électronique grand public – qui a totalement disparu –, pour les nouveaux biens électroniques… ? Je fais partie de ceux qui considèrent qu’on ne peut pas se passer d’une activité industrielle au sens manufacturier du terme.
La nouvelle industrie, c’est du manufacturier, des technologies, de l’intelligence et des services incorporés. Or il reste très important de maîtriser la brique manufacturière. Le plus bel exemple qui me vient à l’esprit est celui du véhicule électrique aux États-Unis. Le gouvernement américain a largement subventionné le développement de toutes les technologies de stockage – comme les batteries – et, lorsqu’il a fallu industrialiser, plus personne n’en était capable, alors que le véhicule électrique est un dispositif d’optimisation énergétique et d’optimisation numérique. Aussi, si vous n’êtes plus en mesure de fabriquer les composants, vous n’êtes plus capables de les comprendre.
Cela me conduit à un second exemple, celui des produits d’électronique grand public comme le téléphone portable. Le coût de fabrication de ces petits engins, produits essentiellement en Chine, est très faible. J’ai découvert avec surprise que, comme Apple ne produisait plus rien aux États-Unis, le groupe avait inventé un dispositif pour maintenir le contact entre ses laboratoires, ses technologues et les fabricants, si bien que des équipes de chercheurs, de techniciens et de méthodologues d’Apple sont en permanence dans des avions entre la Californie et la Chine pour être sur la chaîne de production. Jonathan Ive, le grand designer de ces produits, considère en effet que c’est en étant sur les chaînes de production qu’il est capable de voir où l’on peut gagner le demi-millimètre qui permettra au produit d’être encore plus fin, plus « smart » que ceux qu’il avait déjà conçus. Il n’est sans doute pas possible de réaliser l’intégralité de la production de masse dans les pays développés, mais cette articulation du manufacturing et de la conception me semble irremplaçable.
Mme la rapporteure. À propos de la stratégie de Volkswagen, vous avez évoqué la modularisation des chaînes de production. Face aux incertitudes sur l’avenir, sur les types de motorisation futurs, sur les éventuelles ruptures technologiques, le fait de disposer d’un outil de production susceptible de s’adapter beaucoup plus facilement qu’une chaîne destinée à produire pendant vingt ans le même type de modèle, est-il une question-clef dans l’organisation de l’outil industriel ?
M. Élie Cohen. La politique de plateforme et de modularisation a bouleversé pour longtemps l’économie du secteur. Elle forme un trait structurant. La percée allemande tend donc à se généraliser.
M. Denis Baupin. Je vous remercie à mon tour pour votre diagnostic lucide. Je tiens à rappeler que je suis un écologiste qui aime l’industrie, qui est convaincu qu’il n’y aura pas de transition écologique, de transition énergétique sans industrie. C’est pourquoi je ne me réjouis pas quand vous évoquez l’effondrement industriel de la France. Je me réjouis également de la clarté de votre exposé sur l’échec de la politique du diesel alors qu’on en parle assez peu. Il faut rappeler que l’Union française des industries pétrolières (UFIP) s’est déclarée favorable au rattrapage de la fiscalité entre le diesel et l’essence du fait de la déformation de notre système de raffinage, que vous avez évoquée. J’ai relevé par ailleurs votre constat d’échec du tout-électrique sur lequel nous ne pouvons que nous interroger après le vote d’une loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui consacre une bonne part à la mobilité de nature électrique. Vous avez ainsi indiqué que la Norvège comptait 50 000 bornes quand la loi en prévoit quelque 8 millions en France, un chiffre effectivement faramineux. Nous nous interrogeons sur la pertinence de ce choix à la suite de votre intervention.
Selon vous, il n’est pas possible de respecter les normes en vigueur : on doit choisir entre la réduction d’émission de CO2 et celle de NOx. Si cela est vrai, ce que je ne pense pas et je vais dire pourquoi dans un instant, nous devons choisir entre le dérèglement climatique, avec toutes ses catastrophes, et respirer un air malsain avec toutes les conséquences sanitaires que cela engendrerait. Autrement dit, nous aurions le choix, cornélien, entre la peste et le choléra … Or il existe une autre issue : celle consistant à construire des voitures plus petites. Je pose cette question, audition après audition, parce que je vois dans la fin de la « voiture à tout faire » l’une des clefs du changement de paradigme en matière automobile, autrement dit la fin de la voiture conçue pour emmener toute la famille en vacances et qui est utilisée à 99 % du temps par une personne seule.
Dès lors la question de l’autonomie des véhicules électriques se pose différemment : un véhicule à une place consommant beaucoup moins, son autonomie pourra être significativement augmentée. De votre point de vue, ne s’agit-il pas de l’une des pistes envisageables – pas la seule, certes : il faudra bien continuer de construire des voitures familiales, l’objectif n’étant pas de passer d’un modèle unique à un autre mais bien à une pluralité de modèles ?
En ce qui concerne le contrôle, vous avez tenu des propos forts en évoquant des autorités européennes complices, ce qui, d’après ce qu’on peut lire – je pense notamment aux considérations d’un commissaire européen, il y a déjà deux ans, sur ce type de trucages – semble assez juste. Si l’on veut que soient respectées des normes à la fois protectrices de la santé et efficaces contre le dérèglement climatique, ne doit-on pas rendre le contrôle indépendant, comme c’est le cas dans le secteur nucléaire avec l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ? En effet, dans le domaine qui nous occupe ici, nous constatons que tel ou tel comité a des intérêts convergents avec l’industrie – et pas forcément des intérêts d’argent d’ailleurs.
Enfin, j’ai beaucoup apprécié votre analyse du rôle de l’État actionnaire – de PSA et de Renault en l’occurrence. Or n’est-il pas de sa responsabilité, précisément, d’intervenir, dans le cadre du dialogue, bien sûr ? Quand le Président Barak Obama a engagé des fonds de l’État dans l’industrie automobile, dans un pays qui n’est pas franchement dirigiste ni anti-automobile, il a donné des consignes en matière de réduction des émissions. Que l’État actionnaire qui aide ses constructeurs exprime des souhaits ne paraît pas complètement stupide, ne serait-ce que pour veiller au bon emploi des deniers publics, ou au respect des objectifs de la politique de santé publique. Il est difficile d’obtenir un débat public sur ces questions alors qu’elles sont tout de même très structurantes.
M. Jean-Michel Villaumé. Comme mes collègues, je vous remercie, monsieur Cohen, pour vos propos particulièrement intéressants et brillants. Je suis d’accord avec vous en ce qui concerne l’effondrement industriel français mais dans le même temps vous évoquez le succès en France de Toyota et de Smart, n’y a-t-il pas contradiction ?
En outre, vous êtes revenu sur la mobilité, la voiture numérique ; si je vous comprends bien, vous prônez l’abandon du moteur thermique – qu’il soit à essence ou au diesel – tout en vous montrant réservé sur la solution électrique… Aussi, pour vous, quelle doivent être les caractéristiques de la voiture écologique ?
M. Yves Albarello. J’approuve à 1 000 %, monsieur le professeur, vos considérations sur le désintérêt total, au cours des vingt dernières années, des politiques au sujet de la désindustrialisation de la France. Je prendrai un seul exemple, que vous devez connaître : l’entreprise WABCO-Westinghouse, dont une filiale, située dans ma ville et spécialisée dans la fabrication de freins pour les poids lourds, va externaliser sa production en Pologne, provoquant donc le licenciement de 250 personnes.
Le groupe Volkswagen, après le scandale international dont il est à l’origine, sera-t-il capable de s’en relever compte tenu de ses capacités financières ?
La voiture à hydrogène a-t-elle, selon vous, un avenir technologique ?
Vous avez rappelé que PSA, dans les années 2000, était probablement plus rentable que Volkswagen. Or l’entreprise française n’a pas consacré les profits réalisés à la recherche fondamentale en vue d’innover. Nos deux grands groupes, PSA, donc, et Renault, sont-ils voués à mourir ?
M. Élie Cohen. Ma réponse à vos questions, Monsieur Baupin, sera assez simple : dans l’état actuel de la technologie du moteur diesel, on est conduit à arbitrer entre le NOx et le CO2. La raison toute simple pour laquelle Volkswagen a fraudé, c’est que le groupe n’était pas capable de présenter un véhicule avec un moteur satisfaisant les nouvelles conditions environnementales définies par les États-Unis, cela malgré ses efforts, malgré la mobilisation de ses équipes et malgré l’existence d’une technologie intermédiaire qui permettait de régler le problème du NOx mais qui aggravait les émissions de CO2. Il n’était donc pas possible de présenter sur le marché américain des véhicules intermédiaires avec le niveau de réglementation exigé, d’où la nécessité soit de renoncer purement et simplement au diesel, soit d’admettre qu’on ne sait pas fabriquer de véhicule moyen et haut de gamme répondant aux normes et qu’il faut donc de se replier sur des véhicules d’entrée de gamme à capacité beaucoup plus limitée.
Je me situe ici dans le cadre d’une économie dans laquelle les opérateurs industriels cherchent à répondre à une demande en fonction des contraintes réglementaires et des contraintes technologiques. On peut penser que l’urgence climatique est telle qu’il ne s’agit pas de la bonne méthode et qu’une rupture paradigmatique s’impose. Seulement, jamais un industriel n’en prendra le chemin par lui-même ; il faudra donc que l’autorité politique prenne des décisions et encadre cette évolution.
En ce qui concerne le régulateur européen, encore une fois, nous savons dans le détail – car la Commission européenne est transparente – quels sont les pays qui ont milité pour un relâchement des conditions et quels sont ceux qui ont au contraire exigé qu’on applique strictement les règlements. La France, l’Allemagne et l’Espagne ont été les trois pays qui ont le plus défendu la tolérance du viol des normes et l’allongement de la période probatoire tandis que les Pays-Bas y étaient très hostiles. Et, comme par hasard, les pays les plus favorables à la tolérance du non-respect des règles sont des pays fortement producteurs ou qui aspirent à le devenir. Ainsi, un grand projet d’usine est prévu en Espagne qui va massivement fabriquer, pour Volkswagen, des véhicules diesel ; or ce projet est subventionné par le gouvernement qui, logiquement, ne souhaitait pas qu’on applique les normes dans leur intégralité.
Faut-il donc instaurer un régulateur indépendant, monsieur Baupin ? J’y suis très favorable. J’ai beaucoup écrit sur la capture des régulateurs et je me suis fait agonir d’injures, notamment par des responsables politiques qui m’ont reproché ce qu’ils considéraient comme ma défiance vis-à-vis des autorités politiques au point de vouloir multiplier les autorités indépendantes. Ferais-je donc si peu confiance au sens du bien public des responsables politiques ? J’ai plaidé il y a très longtemps pour l’existence d’autorités indépendantes dans des secteurs comme les télécommunications, l’électricité et même en matière de cadrage macroéconomique et budgétaire. On est d’ailleurs quelque peu allé dans ce sens depuis lors, avec la création du Haut conseil des finances publiques notamment.
En ce qui concerne ce dont il est ici question, il s’agit de savoir si nous décidons de bloquer dès à présent le développement du diesel ou le développement même de véhicules diesel parce que les fabricants automobiles ne sont pas capables de satisfaire les normes, ou bien, comme l’a décidé la Commission européenne, de savoir si nous relâchons la vigilance sur le respect des normes pour une durée déterminée. C’est un choix et vous voyez bien qu’une autorité indépendante aurait sans doute décidé que, puisque les normes n’étaient pas respectées, il convenait d’arrêter – ce qui n’en laisserait pas moins entier le problème automobile tel qu’on l’a évoqué.
J’en viens au dialogue actionnarial entre l’État et les entreprises PSA et Renault. Ma réponse sera simple et brutale. L’État a perdu la compétence nécessaire pour dialoguer avec les entreprises. Savez-vous comment on procède quand Bercy veut discuter avec Renault ? On fait appel à un banquier d’affaires. L’État n’a plus d’expertise et y a renoncé depuis longtemps. Même Arnaud Montebourg, qui s’est beaucoup agité, quand il a eu besoin d’une contre-expertise sur Florange, a eu recours à un banquier d’affaires. Quand j’étais jeune chercheur, je m’intéressais à la « fabrication » de la politique industrielle et j’allais visiter la direction des industries électroniques et de l’informatique (DIELI), la direction des industries métallurgiques, mécaniques et électriques (DIMME)… où je rencontrais des experts sectoriels qui avaient acquis leur compétence sur une longue période ; or aujourd’hui il n’y en a plus du tout. L’une des raisons pour lesquelles l’État n’a pas ce dialogue éclairé avec les industries et même avec celles dont il est actionnaire est donc, je le répète, l’abandon de sa compétence. Et comme les services de Bercy n’ont pas perdu leur arrogance initiale, l’arrogance s’ajoute à l’incompétence. Mais c’est un choix et je ne peux que l’observer.
La réponse à la question de M. Villaumé de savoir s’il n’y a pas contradiction entre l’effondrement de PSA et Renault d’un côté, et la performance de Toyota et Smart de l’autre, est élémentaire. Dans le cas de ces deux dernières, il s’agit d’usines nouvelles, greenfield, d’emblée pensées avec les meilleures technologies, avec la meilleure connaissance des progrès réalisés en matière de gestion de production, d’où un niveau de productivité infiniment supérieur à celui des vieilles usines non optimisées, sous-utilisées… Si bien que même avec des niveaux de salaires et des niveaux de prélèvements sociaux identiques, les coûts unitaires ne sont pas les mêmes et si les usines nouvelles peuvent être très compétitives, ce n’est pas le cas des autres.
En ce qui concerne la voiture à hydrogène, depuis que je donne des conférences sur l’automobile, il se trouve toujours quelqu’un pour me dire c’est que la solution.
M. Yves Albarello. Je n’ai pas dit cela.
M. Élie Cohen. En effet, je suis bien d’accord, mais laissez-moi poursuivre. Comme je suis féru de technologie, je tâche de me tenir au courant des évolutions en la matière – l’un de mes premiers travaux d’élève-chercheur à l’École des mines portait sur les développements de la pile à combustible à Marcoussis. Pour en revenir à la voiture à hydrogène, et donc pour répondre à votre question, il existe bien sûr des prototypes mais on est encore loin de pouvoir lancer des séries industrielles avec des perspectives de production et de rentabilisation autour de cette technologie qui fait partie de ce que j’appelle les innovations disruptives indispensables dans la décennie qui vient si nous voulons faire face à l’impératif écologique, climatique.
Vous m’avez également interrogé sur l’avenir de PSA et Renault. Je serai à nouveau simple et direct : Renault et PSA comme entreprises françaises n’existeront plus dans les dix années qui viennent. Au mieux seront-elles des éléments de nouveaux groupes à vocation mondiale. Dans le cas de Renault, le nouveau groupe s’organisera autour de l’alliance actuelle qui forme déjà le troisième ou quatrième producteur mondial et qui se consolidera – et peut-être la crise provoquée par les maladresses de Bercy va-t-elle accélérer cette évolution. Renault comme entreprise nationale essentiellement basée en France et qui peut entretenir un dialogue intime avec les autorités politiques françaises, j’y insiste, c’est fini. Naîtra donc, éventuellement, un acteur global qui aura probablement son siège social hors de France et qui poursuivra une stratégie globale dont l’axe essentiel sera bien entendu Nissan. Il en ira de même pour PSA qui deviendra, si tout va bien, dans les dix années qui viennent, le fondement d’un groupe sino-européen dont la base productive sera essentiellement en Asie. Dès cette année, d’ailleurs, l’apport chinois sera supérieur à l’apport français en matière de production et de consommation. Nous assistons donc à la fin d’un grand cycle historique. Dans le meilleur des cas, deux groupes anciennement français, Renault et PSA, auront donné naissance à deux grands groupes globaux, ce qui est remarquable comme performance, mais il va falloir que Bercy, en particulier, cesse de considérer qu’il doit gronder les dirigeants de ces groupes : quand j’ai lu dans la presse que M. Macron recadrait le Président Carlos Ghosn, je n’en croyais pas mes yeux !
M. Yves Albarello. À vous entendre, l’heure est grave… Les deux principaux constructeurs français sont voués à disparaître au cours des dix prochaines années…
M. Élie Cohen. Je n’ai pas dit cela : ils sont appelés à constituer la base de deux grands groupes globaux.
M. Yves Albarello. J’avais bien compris. La même question se pose-t-elle pour d’autres constructeurs européens ? Je pense aux constructeurs italiens.
M. Élie Cohen. C’est déjà fait, pour l’Italie. FIAT, formellement, a pris le contrôle de Chrysler ; or, en fait, à l’occasion de cette opération, c’est Chrysler qui a pris le contrôle de FIAT avec la délocalisation totale de l’état-major et des structures de gouvernance du groupe italien, désormais implantés aux États-Unis et qui sont sortis de l’orbite italienne. Vous donnez donc là un bon exemple.
Pour que la comparaison soit parfaite, il faudrait que Renault installe son siège social au Japon, ce qui me paraît peu vraisemblable – il l’installera plutôt, par exemple, aux Pays-Bas.
Mme la rapporteure. La présence de l’État au capital de PSA et de Renault n’est-elle plus fondée ? Qu’est-ce qu’une politique industrielle de l’État efficace ? Ne pensez-vous pas que l’État, ou l’Europe, n’a pas à intervenir dans les choix technologiques ? Ne doit-il pas se contenter de fixer la norme et de laisser le constructeur se débrouiller pour la respecter ? Vous avez évoqué le pari du diesel. Un ministre, que vous avez cité, avait déclaré qu’attaquer le diesel revenait à attaquer le made in France. Or les entreprises concernées ont du mal à revenir sur leur culture du « tout diesel ». Comment accompagner le changement, inciter à la révision des stratégies, sachant que ce n’est pas seulement une question culturelle : la marge réalisée sur un véhicule diesel est plus importante que sur un véhicule essence ?
M. Élie Cohen. À quoi sert l’État actionnaire dans l’automobile depuis quinze ans ? L’État était très présent chez Renault et il n’est intervenu dans à peu près aucune des grandes orientations stratégiques du groupe. À l’inverse, l’État intervient beaucoup dès qu’il est question d’emplois, de délocalisation d’activité… c’est-à-dire qu’il est dans un rôle tout à fait classique d’État, rôle qui ne rend nullement nécessaire sa présence comme actionnaire de l’entreprise. Prenez l’exemple très intéressant du Royaume-Uni : lorsque BAE Systems a décidé de se retirer d’Airbus, le gouvernement britannique a exigé du groupe Airbus qu’il maintienne sa production sur le sol britannique dans telle proportion, qu’il garde un centre de recherches dans la fabrication des ailes. C’est donc l’État en tant que garant de l’intérêt général, de la prospérité du pays, qui a posé ses conditions pour autoriser une opération alors qu’il n’en avait peut-être pas la possibilité. L’État s’est par conséquent battu pour les emplois et la localisation des activités de recherche sans être actionnaire.
Si l’État français, comme il l’exprime de plus en plus, est essentiellement préoccupé par l’emploi et la localisation de l’activité, il n’a nul besoin d’être actionnaire – surtout d’une entreprise comme Renault. Observez comment General Electric a négocié avec l’État français dans le cas d’Alstom. Quand vous êtes General Electric, vous ne pouvez pas vouloir prendre le contrôle d’Alstom sans qu’au moins l’État n’y acquiesce – et en l’occurrence l’État a plus qu’acquiescé…
Si l’État veut avoir une stratégie industrielle, ce qui n’a pas été son cas au cours des quinze dernières années, on peut envisager une participation au capital et imaginer les formes de cette participation dans le temps. En tout cas, la pire des solutions est celle que l’on voit à l’œuvre dans le contexte de l’alliance Renault Nissan avec un État intrusif qui a voulu subrepticement doubler les droits de vote en créant un conflit ouvert avec les autres actionnaires et avec la totalité des administrateurs indépendants sans prévoir de plan B en cas d’échec de cette initiative.
Vous m’interrogez ensuite sur le fait de savoir si, dans le contexte d’une économie ouverte, mondialisée, il y a encore un sens à ce que l’État promeuve une stratégie industrielle nationale. La réponse est pour moi bien évidemment oui. On fait valoir que, de plus en plus, nous évoluons dans une économie de l’immatériel, du numérique ; certes, mais cette économie a besoin d’infrastructures ! Je dirai plus encore : elle a besoin d’infrastructures matérielles et immatérielles – je pense, pour ces dernières, aux infrastructures intellectuelles, qu’il s’agisse de l’enseignement supérieur ou de la recherche.
Vous avez évoqué le PIA. Il se trouve que j’ai fait partie de ses concepteurs et ce fut pour moi un rare bonheur que de travailler avec Michel Rocard et Alain Juppé tant, au quotidien, ce n’est pas ce qu’on attendrait de l’un et de l’autre qui se révèle. Nous avons commencé par considérer que les deux priorités centrales étaient transversales : l’investissement dans l’enseignement supérieur et la recherche, à savoir dans la connaissance, et la facilitation du transfert des résultats de la connaissance dans la sphère productive et industrielle. D’où les deux grands axes que nous avons d’emblée promus : à la fois le premier avec les initiatives d’excellence (Idex) et les laboratoires d’excellence (Labex) et le second avec les instituts de recherche technologique (IRT) et les sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT). Nous avions défini deux axes horizontaux et quatre axes verticaux qui correspondaient à des priorités sectorielles : les technologies du numérique, les technologies de la conversion énergétique, les nouvelles technologies des transports et de la mobilité et tout ce qui a trait à la santé, axes qui sont à la base d’une stratégie décisive si l’on veut se rapprocher le plus possible de la frontière technologique et être capables de construire une croissance fondée sur l’innovation soutenable et durable. Nous avons ensuite décliné ces axes en toute une série de programmes.
Une politique industrielle moderne consiste par conséquent à faire en sorte que, par exemple, l’écosystème de l’aéronautique puisse se développer avec des entreprises spécialisées de petite et de moyenne taille, qu’elles aient par conséquent un accès direct aux résultats de la recherche – d’où leur connexion avec les Instituts Carnot –, qu’elles aient un accès direct aux financements – d’où les programmes de financements innovants. Toute cette architecture, que nous avons essayé de concevoir et de mettre en œuvre, c’était – permettez cette immodestie – une belle opération intellectuelle. C’est le bon génie français.
Vous me demandez si l’État doit peser sur les choix technologiques. Précisément, dans le cas que je viens d’évoquer, nous avons voulu donner ses chances à toute une filière technologique : nous n’avons pas fait qu’un choix mais financé plusieurs projets concurrents sur des technologies concurrentes aussi bien en matière d’énergie solaire que de stockage d’énergie. Nous avons exploré les différentes frontières – que je ne connaissais d’ailleurs pas – entre ce qu’on appelle la chimie verte, la chimie bleue, la chimie rouge, la chimie grise… La bonne méthode consiste à créer des possibilités, des capacités et à veiller en particulier à la qualité, à la dynamique des écosystèmes, à essayer de prévenir autant que possible les phénomènes de bureaucratisation progressive, de paralysie et de redondance des organismes, de saupoudrage, etc.
Dernier élément, vous m’interrogez sur le pari du diesel. Là encore, je vous répondrai de manière simple et brutale. Compte tenu du degré d’engagement de la France dans cette filière, si l’on décide d’en sortir demain, il faudra vraiment accompagner le processus sur la moyenne et longue durée. Et comme, jusqu’à présent, et je crois que vous en êtes parfaitement conscients, PSA refusait même d’envisager cette possibilité, plaidant l’excellence absolue de sa solution diesel et faisant valoir l’amélioration continue de son système après avoir résolu l’essentiel du problème, il va falloir vraiment, j’y insiste, pour éviter une catastrophe, accompagner PSA dans ce dialogue stratégique, encore une fois si vous décidez de revenir sur le choix initial de spécialisation.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Merci, monsieur le professeur : cette audition a été particulièrement riche.
Notre prochaine réunion se tiendra mardi prochain 17 novembre.
La séance est levée à dix-huit heures.
◊
◊ ◊
6. Audition, ouverte à la presse, de M. Christophe Lerouge, chef du service de l’Industrie à la Direction générale des entreprises.
(Séance du mercredi 18 novembre 2015)
La séance est ouverte à seize heures trente.
La mission d’information a entendu M. Christophe Lerouge, chef du service de l’Industrie à la Direction générale des entreprises.
Madame la présidente Sophie Rohfritsch. Nous recevons aujourd’hui M. Christophe Lerouge, chef du service de l’industrie à la direction générale des entreprises (DGE). Il est accompagné par M. Alban Galland, chef du bureau chargé du secteur automobile. La DGE est une administration technique, à vocation stratégique, placée sous l’autorité du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique. Elle a succédé, l’an dernier, à la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services, alors plus connue sous le nom de DGCIS.
Certains des interlocuteurs de la mission ont regretté devant nous qu’il n’existe plus une grande direction générale ayant pleinement compétence sur l’industrie dans son ensemble. La semaine passée, le professeur Élie Cohen soulignait ce point. Il a même parlé devant nous d’« un effondrement silencieux » du secteur automobile en France, principalement du point de vue de la production sur notre sol.
Néanmoins, les pouvoirs publics conçoivent et mettent en œuvre divers dispositifs d’accompagnement et des aides au secteur automobile, notamment depuis la crise de 2008-2009. Un Pacte automobile a été défini en 2009, relayé aujourd’hui par le Conseil national de l’industrie (CNI) et un comité stratégique de filière.
En outre, un autre interlocuteur de la mission nous a fait part de certaines difficultés dans l’attribution des aides au développement d’innovations majeures dans le cadre du Fonds unique interministériel (FUI), qui ne relèverait apparemment plus de la compétence de votre direction mais de la Banque publique d’investissements ou Bpifrance.
Messieurs, il conviendrait que cette audition soit l’occasion de nous éclairer sur l’articulation de ces différentes structures avec une mise en perspective dans l’actualité des actions ainsi soutenues.
Nous attendons aussi des précisions sur les orientations stratégiques de la « filière du diesel ».
Il vous faudra enfin évoquer la question des normes d’homologation des véhicules en matière de polluants à l’échappement. Quelle administration est-elle compétente en la matière ? Qui négocie à Bruxelles au nom de la France et avec quel mandat technique ?
M. Christophe Lerouge, chef du service de l’industrie à la direction générale des entreprises (DGE). Je tiens tout d’abord à indiquer que je représente mon directeur général, Monsieur Pascal Faure, qui n’a pu se rendre à cette audition. Je suis, au sein de la DGE, le chef du service de l’industrie qui emploie une centaine de personnes et qui est organisé en trois grandes sous-directions, chacune composée de bureaux sectoriels. Notre administration assure un suivi des grands secteurs industriels et l’un de nos bureaux, représenté cet après-midi par son chef, Monsieur Alban Galland, est spécialisé dans le secteur automobile.
Je reviendrai sur la manière dont nous travaillons avec les grands acteurs du monde de l’automobile ainsi qu’avec le CNI et le comité stratégique de filière– que vous avez cités. J’aborderai aussi les questions de financement des projets de recherche-développement par le FUI.
Il existe quatorze comités stratégiques de filière (CSF), correspondant chacun à une grande filière industrielle. Les CSF résultent des travaux menés en 2009-2010, à la suite des Etats généraux de l’industrie, ayant institué le CNI. Douze CSF ont été créés au départ, puis d’autres sont venus les compléter. Nous disposons d’un comité stratégique dans la filière automobile pour la raison évidente que cette industrie est structurante pour notre tissu économique et d’ailleurs pour l’ensemble de l’industrie française. Ces comités stratégiques ont pour vocation première d’œuvrer à l’organisation des échanges entre les entreprises d’une filière, essentiellement entre les grands donneurs d’ordres et les sous-traitants. Et la filière automobile est effectivement organisée avec deux grands constructeurs en France – Renault et PSA – et toute une chaîne de sous-traitants de rang 1 – tels que Valeo et Faurecia – à la suite de quoi on descend dans la chaîne de sous-traitance. Les comités stratégiques sont organisés de façon à permettre un « trilogue » entre les organisations patronales, les organisations syndicales représentatives des salariés et les pouvoirs publics – c’est-à-dire l’administration chargée du domaine. Selon les CSF, plusieurs administrations peuvent être concernées. En l’occurrence, c’est le ministre chargé de l’industrie qui suit le CSF automobile. Les CSF se réunissent en session plénière une fois par an, voire plus si nécessaire, et sont organisés en un bureau et avec des groupes de travail fonctionnant régulièrement selon les différents plans d’actions définis et conduits au fur et à mesure. On compte parmi les membres du CSF automobile un vice-président, Monsieur Michel Rollier
– par ailleurs président de la Plateforme de la filière automobile (PFA) et ancien grand dirigeant de Michelin – ; pour les organisations patronales, l’ensemble des grands acteurs du secteur – Renault, PSA, Valeo, ou encore Plastic Omnium … – ; les organisations professionnelles c’est-à-dire les grandes fédérations – la Fédération de l’industrie mécanique, l’Union des industries et des métiers de la métallurgie, les fédérations représentant les équipementiers et les réparateurs automobiles – et enfin, les grandes organisations syndicales impliquées dans le secteur automobile.
Dans chaque CSF, un contrat stratégique de filière, négocié entre ses partenaires, prévoit plusieurs actions. En matière automobile, un nouveau contrat a été défini et validé il y a peu ; le comité stratégique s’étant réuni pour la dernière fois en session plénière au mois de septembre. Ce contrat prévoit une nouvelle feuille de route pour la période 2015-2017 et des actions à mener. La première action – « Se projeter » - vise à la définition d’une stratégie pour la filière à moyen-long terme et à permettre d’anticiper les besoins de compétences et de mieux accompagner l’employabilité des salariés. La deuxième action – « Innover » – concerne les grands programmes prioritaires de recherche et développement. On y retrouve les questions technologiques de réduction de la consommation, avec le véhicule « deux litres aux cent kilomètres », d’amélioration de la production grâce au développement d’usines du futur et le traitement de tout ce qui peut avoir un fort impact sur la filière automobile, comme l’utilisation de nouveaux matériaux. La troisième grande action – « Se développer » – vise à travailler sur les questions d’organisation et de consolidation de la filière. Il y a toute une gamme de sous-traitants dans le secteur automobile dont la masse critique est insuffisante. C’est pourquoi un travail est effectué afin d’essayer de restructurer la filière et ainsi de faire monter en gamme les petites et moyennes entreprises (PME), de constituer des entreprises de taille intermédiaire (ETI), de les rendre plus fortes et de leur permettre d’aller à l’international. Le dernier grand axe de ce contrat stratégique de filière s’intitule « Collaborer » : il vise les relations entre les entreprises de la filière et en particulier les relations entre les grands donneurs d’ordres et les sous-traitants. Vous le savez, un des points problématiques pour les entreprises réside dans la pression que font peser les grands donneurs d’ordres sur leurs sous-traitants et dans le fait que les sous-traitants aient connu des difficultés ces dernières années, liées peut-être à une pression trop importante d’entreprises comme Renault et Peugeot. Cela peut aussi expliquer des différences entre ce qu’il se passe dans les filières automobiles française et à l’étranger.
Schématiquement, le CSF automobile est une organisation que l’on retrouve dans d’autres filières industrielles. Mais l’automobile est un des secteurs industriels dans lesquels on peut vraiment parler de filière au sens de répartition d’une chaîne de valeur existant entre les entreprises. Lorsqu’un nouveau programme tel que le véhicule « deux litres aux cent kilomètres » est développé, il faut aborder des questions de motorisation, de matériaux et de performance automobile au sujet desquelles toute la chaîne est-elle affectée : lorsqu’on allège la structure d’un véhicule, il faut que tous les sous-traitants puissent contribuer à cet objectif.
Le CSF automobile dépend d’une superstructure qu’on appelle le Conseil national de l’industrie (CNI). Ce dernier réunit les représentants des organisations patronales – le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) –, les grandes organisations syndicales et l’administration. Je suis à titre personnel membre du bureau du CNI qui couvre l’ensemble des secteurs industriels – c’est-à-dire les 14 CSF. Le CNI travaille aussi sur des sujets transversaux : son objectif est de faire en sorte que l’industrie manufacturière et l’intérêt de la production en France, des entreprises et des usines françaises soient bien prises en compte par l’ensemble des politiques publiques, non seulement par le ministère de l’industrie mais aussi par les autres ministères. Le CNI rend pour ce faire chaque année quatre ou cinq avis sur de grands thèmes transversaux. Ainsi par exemple, en amont de l’élaboration de la loi pour la transition énergétique et la croissance verte, le CNI a émis un avis qui a été remis à Mme Ségolène Royal pour que soient pris en compte les intérêts de l’industrie. Le CNI a notamment voulu peser sur la définition des électro-intensifs, sur la question de l’économie circulaire et, plus globalement, sur tous les sujets traités par la loi ayant un impact sur l’industrie. Le CNI travaille aussi sur les questions de formation et sur l’attractivité des métiers du secteur. Les Etats généraux de l’industrie, qui datent de 2009-2010, ont en effet montré une certaine désaffection des jeunes à l’égard de l’industrie. Grâce à des manifestations telles que la Semaine de l’industrie, le CNI essaie de redonner envie aux jeunes de travailler dans le secteur industriel par le biais de formations initiales et de la formation professionnelle continue. Les organisations syndicales s’impliquent beaucoup dans ce travail. D’autres sujets sont suivis par le CNI tels que la transformation numérique de l’industrie, l’économie circulaire – qui vise à rendre l’industrie plus performante et plus propre grâce au recyclage des matériaux – et l’articulation entre la politique industrielle nationale et les politiques régionales, compte tenu du renforcement des compétences des conseils régionaux. Car au-delà des grands groupes implantés au niveau international, il importe de déterminer comment les PME implantées sur les territoires peuvent dans leur diversité s’intégrer à ces politiques nationales. Le CNI traite également des questions relatives à la commande publique et à l’achat public innovant. Tous ces travaux donnent lieu à des recommandations et à des échanges entre les différentes organisations membres du CNI. Ce Conseil est présidé par le Premier ministre qui le réunit en session plénière au moins une fois par an. Telle est l’articulation entre le CNI et les CSF : le CNI est une superstructure qui pilote les comités stratégiques de filière.
Le CNI est aussi impliqué dans le déploiement d’autres dispositifs mis en œuvre par l’administration et lancés par le précédent ministre en charge de l’industrie, Monsieur Arnaud Montebourg, et repris par Monsieur Emmanuel Macron : les trente-quatre Plans de la « Nouvelle France industrielle » qui sont devenus les neuf plus une « Solutions de la nouvelle France industrielle ». Les trente-quatre plans ont été définis comme visant des objets et produits pour lesquels on estime qu’un marché va se développer d’ici à quatre ou cinq ans, pour la fabrication desquels l’industrie française a déjà des compétences et des savoir-faire. Les plans ont été élaborés à partir de cette base de compétences et cet objectif de marché et ont donné lieu à la définition d’une feuille de route qui permettra à ces entreprises d’atteindre ces marchés. Chaque feuille de route identifie les verrous – qu’ils soient technologiques, réglementaires ou organisationnels – qui empêchent de travailler sur ces produits.
Si je cite ces trente-quatre Plans de la Nouvelle France industrielle, c’est que certains d’entre eux concernaient directement le secteur automobile. Ces plans ont été regroupés en des Solutions pour la nouvelle France industrielle voulues par Monsieur Emmanuel Macron de façon à mieux appréhender et à faciliter la gestion de cette dynamique. Les plans qui concernaient l’automobile ont été regroupés au sein de la « Solution pour la mobilité écologique ». On y retrouve les grands thèmes du véhicule autonome, du véhicule à consommation « deux litres aux cent kilomètres », du stockage de l’énergie et de l’installation des bornes de recharge électrique sur l’ensemble du territoire français. Pour chacun de ces plans a été nommé et désigné un chef de projet : Monsieur Carlos Ghosn pour le véhicule autonome et un binôme PSA/Renault relayé ensuite par la PFA pour le véhicule « deux litres aux cent kilomètres ». C’est d’ailleurs aussi pour cette raison que l’on retrouve parmi les grands axes de recherche et développement du contrat stratégique précité une articulation entre la « Solution pour la mobilité écologique » et ce qui est prévu par la filière industrielle. C’est le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) qui pilote le plan relatif au stockage de l’énergie et le préfet Francis Vuibert, s’agissant des bornes de recharge. Chacun de ces plans donne lieu à une feuille de route et un programme d’action. Certains plans sont déjà bien avancés : une loi et un décret ont notamment été publiés en 2014 s’agissant du déploiement des bornes de recharge ; deux entreprises, Bolloré et CNR, ont candidaté et ont commencé à déployer des bornes de recharge électrique sur l’ensemble du territoire.
La « Solution de mobilité écologique » fait appel à des dispositifs de financement. Vous avez cité le Fonds unique d’investissement (FUI). Certes, ce fonds finance les projets issus des soixante-douze pôles de compétitivité sur le territoire, dont certains concernent le secteur de l’automobile. Mais le FUI n’est pas le mode de financement le plus important des projets de recherche et développement poursuivis dans le cadre de la « Solution de mobilité écologique » ou du comité stratégique de filière. En fait, le dispositif auquel nous recourons est le Programme des investissements d’avenir (PIA), plusieurs appels à projet ayant été décidés en faveur du véhicule écologique, des travaux sur les batteries et du véhicule « deux litres aux cents kilomètres ». Nous mobilisons le PIA soit sous forme de subventions, soit sous forme d’avances remboursables. Le déploiement des bornes de recharge sera financé par le PIA. Le Commissariat général à l’investissement (CGI), qui pilote les PIA, a confié à l’opérateur qu’est l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) le soin de lancer des appels d’offre pour financer les différents projets. Quant au montant exact prévu dans le cadre des PIA I et II …
M. Alban Galland. … il s’élève à 750 millions d’euros pour l’ensemble des véhicules du futur – aéronautique et autres filières comprises.
M. Christophe Lerouge. Et les montants qui ont été engagés jusqu’à présent au titre des programmes du véhicule « deux litres aux cent kilomètres » et du véhicule autonome sont de 170 millions d’euros de subventions, de 126 millions d’avances remboursables et de 40 millions de prises de participations dans des projets de véhicules hybrides.
Le FUI consacre une centaine de millions d’euros d’aides aux projets remontant des pôles de compétitivité chaque année. Ce montant varie en fonction du nombre de projets et de ce que vous votez en loi de finances. Certaines aides concernent le numérique, d’autres, l’automobile et d’autres projets. Par conséquent, si les pôles de compétitivité et le FUI sont des dispositifs de soutien importants – en particulier pour les PME et les petites et moyennes industries (PMI) qui travaillent avec des laboratoires –, ce ne sont pas les plus importants pour le financement de la recherche-développement liée à l’automobile.
J’en viens à la question du diesel. Il s’agit d’un sujet que nous suivons de façon très attentive. Nous avons effectivement été surpris et déçus de découvrir ce qu’avait fait une grande entreprise mondiale qui nous semblait digne de confiance. Nous ne savons pas encore quel sera le véritable impact de cette affaire sur les normes de véhicules ainsi que sur les constructeurs, la production et l’emploi en France – points qui m’intéressent avant tout autre en tant que représentant du ministère de l’industrie. La filière du diesel pèse de l’ordre de 10 000 emplois.
M. Alban Galland. … 10 000 emplois directs.
M. Christophe Lerouge. Nous observons avec attention ce qu’il se passe à ce sujet, notamment l’impact de l’affaire Volkswagen.
S’agissant des normes et des cycles, les différents comités existant à Bruxelles sont plutôt suivis par la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE). Cette direction représente la France lorsqu’il est question de normes et de cycles de contrôle des émissions.
Voilà ce que je souhaitais vous dire de façon succincte avant de répondre à vos questions.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Je précise que nous auditionnerons bien évidemment le ministre Emmanuel Macron lorsque nos travaux en seront à un stade plus avancé. Ce qui nous intéresse aujourd’hui, c’est d’avoir un échange avec vous au niveau de compétence d’une direction administrative sur les questions de politique industrielle. Je vous remercie d’avoir décrit le schéma d’organisation et de l’impulsion de l’État en ce domaine. Nous sommes aussi préoccupés par les emplois, les usines, la question de la diminution de la production automobile en France de 42 % en douze ans et à partir de là, par la stratégie adoptée par l’État et les pouvoirs publics pour assurer l’avenir de cette filière industrielle.
Je reviendrai tout d’abord sur le bureau du secteur automobile au sein de votre service. Combien de personnes y travaillent ? Vous avez évoqué son rôle de vigilance sur les questions de normes et de réglementations. Or, j’ai, dans d’autres fonctions, suivi la manière dont les choses se passent : ce bureau du secteur automobile émet-il un avis dans le processus d’élaboration des décisions interministérielles sur les questions de normes et de positions défendues par la France à l’échelle européenne ?
Plusieurs articles de presse ont fait état du fait que la Commission européenne avait eu connaissance, dès 2011, de la fraude de Volkswagen : votre bureau en a-t-il été informé ou en a-t-il eu connaissance à un moment donné ? Il est normal que je vous pose la question.
Vous avez évoqué un point très important pour toute l’organisation de la filière : la structuration des relations entre donneurs d’ordres et sous-traitants. Dans le contexte récent, avez-vous évalué le nombre d’emplois concernés chez les sous-traitants français dépendant directement de la production de Volkswagen ? Auriez-vous des chiffres à nous communiquer à ce sujet ?
L’État est au capital de deux entreprises très importantes. Dans le cadre de la mise en œuvre par l’État de ses orientations de politique industrielle pour le secteur industriel, y a-t-il des échanges entre vous et l’Agence des participations de l’État (APE) ?
Trouvez-vous que le niveau d’engagement des programmes concernant les investissements d’avenir est satisfaisant ? Il s’agit peut-être d’une question politique auquel cas, renvoyez-nous au ministre que nous recevrons. Pourriez-vous cependant nous confirmer que 210 millions d’euros du programme « Véhicule du futur » ont été réalloués à d’autres budgets que celui du soutien à la filière automobile ?
M. Christophe Lerouge. Nous n’avions aucune idée que la moindre fraude ait pu être commise par un constructeur comme Volkswagen. Nous l’avons découvert en même temps que tout le monde dans la presse.
S’agissant de la participation de l’État au capital des deux grands constructeurs français, nous avons effectivement un partenariat et des échanges avec l’Agence des participations de l’État (APE). Notre directeur général, Pascal Faure, est membre du conseil d’administration de Renault de la même façon que de celui de l’APE. Ils se concertent donc sans arrêt. L’APE siège aussi au conseil d’administration de PSA et là encore, des échanges ont lieu régulièrement entre les deux administrations sous l’égide de Monsieur Emmanuel Macron et de son directeur de cabinet. Il n’y a donc aucune ambiguïté. Cela étant, ces échanges ne sont peut-être pas suffisamment fluides faute de temps. Mais sur les grands sujets tels que les questions de gouvernance chez Renault dans le cadre de son alliance avec Nissan, le ministre nous avait donné des consignes claires, de sorte qu’il n’y a pas eu l’épaisseur d’une feuille à cigarette entre les positions des deux représentants de l’État.
Il y a effectivement eu un redéploiement des crédits du PIA dont je n’ai pas le montant en tête. Il faut bien comprendre que si 750 millions d’euros étaient prévus dans les PIA I et II, la consommation des crédits, dont je vous ai cité les montants, n’est pas au même niveau. Ce sont donc les marges de manœuvre existantes qui ont permis ce redéploiement. En dépit de notre volonté de développer ces grands axes stratégiques, ce sont in fine les grands constructeurs et les entreprises qui déposent des dossiers. Je suis le premier à le déplorer, c’est pourquoi nous les encourageons à s’engager, à poursuivre ces objectifs dans le cadre du comité stratégique de filière. C’est d’autant plus important qu’au-delà des objectifs qui ont été fixés, on sait que l’on se dirige vers une réduction des normes d’émissions, vers davantage de contraintes de protection de l’air donc de réduction de la pollution atmosphérique et que nos constructeurs automobiles ont tout intérêt à les anticiper au maximum.
Quant à savoir si le CGI va assez loin, sans doute la réponse est-elle politique mais je vous donnerai quand même un avis qui n’engage que moi : je pense qu’il pourrait prendre davantage de risques en matière de soutien aux industriels, surtout que cela concerne vraiment des programmes de R & D et d’innovation.
S’agissant de l’organisation de notre bureau, je laisse Alban Galland répondre.
M. Alban Galland, chef de bureau. En temps normal, notre bureau compte huit chargés de mission. Notre avis est quasi systématiquement sollicité sur les questions de normes. Les comités techniques s’intéressent en général à des questions très techniques qui ne relèvent pas forcément de notre compétence – notre niveau d’expertise n’étant pas celui de la DGEC. C’est donc le plus souvent cette dernière qui propose des positions, auxquelles nous ne répondons pas systématiquement. Néanmoins, lorsqu’il s’agit d’un sujet important – notamment d’un sujet nous ayant été signalé par les constructeurs mais aussi d’autres acteurs – nous pouvons être amenés à prendre position.
Concernant le nombre d’emplois en France dépendant de Volkswagen, ce grand constructeur ne produisant malheureusement pas dans notre pays, nous avons interrogé sans succès ses fournisseurs car ils agrègent leurs ventes, soit au niveau de tous les constructeurs allemands soit au niveau mondial. Nous avons beaucoup de mal à obtenir des informations précises quant à l’impact de cette affaire chez nous.
Mme la rapporteure. Cela signifie-t-il qu’au sein de la Plateforme et du comité stratégique de filière c’est-à-dire dans le dialogue direct avec les différents niveaux de production de la filière, vous ne disposiez d’aucune remontée d’informations à ce jour ?
Vous indiquez que vous êtes amenés à donner un avis sur la question des normes : ce qui est intéressant de savoir c’est comment cet avis est-il élaboré concrètement ?
M. Christophe Lerouge. Nous avons dans le cadre du CSF des échanges avec le Comité des constructeurs automobiles français (CCFA). Nous avons donc davantage d’informations sur Renault et Peugeot. Les constructeurs étrangers sont représentés au sein du CSF mais nous n’avons pas avec eux le même degré d’interactions qu’avec le CCFA. Il nous est donc beaucoup plus difficile d’obtenir des informations sur le groupe Volkswagen.
Mme la rapporteure. Ma question ne portait pas sur le groupe Volkswagen mais sur les équipementiers des rangs 1 et 2 qui produisent en France des pièces s’insérant dans la construction des voitures Volkswagen.
M. Alban Galland. On sait que Valeo vend près de 30 % de ses pièces à l’Allemagne mais sans plus de détails. Les équipementiers considèrent que leurs parts de marché par constructeur constituent des informations confidentielles. C’est pourquoi, même interrogés indépendamment de la FIEV, leur fédération professionnelle, et de la PFA, ils ne nous répondent pas à ce stade. Nous avons en revanche demandé aux directions régionales des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de mener une veille très active dans la mesure où elles ont un accès privilégié à certains sites, y compris de rangs 2 et 3.
M. Christophe Lerouge. Pour être très franc, nous sommes même allés au-delà puisque nous avons demandé à Arcelor-Mittal quel serait l’impact de l’affaire sur leur production d’acier destiné à l’automobile. Nous n’avons pas non plus obtenu de réponse. Nous avons essayé de nous renseigner tous azimuts mais nous n’avons malheureusement guère obtenu d’informations.
M. Alban Galland. À ce stade néanmoins, comme nous l’anticipions, les impacts sur les chiffres de vente sont relativement faibles en volume. Mais il a été annoncé qu’une partie de l’effort financier accompli par Volkswagen serait reporté sur ses sous-traitants. Cela répond en partie à votre question.
S’agissant des modalités d’élaboration de nos avis sur les questions de normes, nous prenons évidemment en compte les positions des constructeurs. Mais cela ne suffit pas en réunion interministérielle. Nous essayons donc d’obtenir les informations techniques permettant de justifier ces positions. Nous vérifions qu’elles correspondent bien aux objectifs indiqués par les constructeurs – ce qui n’est pas toujours le cas et nous n’avons d’ailleurs pas exactement repris leurs positions concernant les Real Driving Emissions (RDE). Puis nous essayons de construire un argumentaire s’appuyant sur des éléments techniques afin de justifier les objectifs que nous proposons.
M. Philippe Duron. Les exigences de lutte contre le changement climatique appellent des évolutions voire peut-être une rupture en matière de mobilité. L’industrie automobile contribuant fortement à l’émission de gaz à effet de serre et de particules, elle devra dans les années à venir poursuivre ses efforts pour aller vers un véhicule plus propre.
Vous avez bien très décrit l’organisation et la modernisation des filières par le biais des dispositifs institués par le Gouvernement. Mais vous êtes passés beaucoup plus rapidement sur les cinq pôles de compétitivité qui existent depuis 2005, dont Mov’eo et « Véhicule du futur », et qui concernent tout à la fois l’automobile, les poids lourds et la mobilité. Quelle est la relation entre le CSF automobile et les pôles de compétitivité ? La politique du CNI est-elle susceptible d’influer sur les objectifs et le fonctionnement de ces pôles ?
M. Denis Baupin. Je prolongerai les questions de Mme la rapporteure concernant la fixation des normes. Vous nous avez indiqué très honnêtement que vous recueilliez l’avis des constructeurs en la matière – ce qui ne surprendra guère. Mais vous ne nous avez pas précisé en quel sens ils influaient : est-ce dans le sens de normes plus exigeantes ou au contraire moins exigeantes, d’un point de vue environnemental ? Car ceux-ci affirment généralement qu’ils sont favorables à l’accélération de la mise en application de ces normes.
S’agissant de savoir qui était au courant de l’existence de logiciels de trucage, j’ai commis une tribune la semaine dernière dans laquelle je cite cet extrait d’un article d’Auto Moto datant de 2005 : « La multitude de capteurs calculateurs installés aujourd’hui dans les voitures constituent autant d’espions électroniques facilitant les petits ajustements avec la réglementation. Capables de déterminer si le véhicule est en train de passer un cycle de dépollution, ils permettent le plus simplement du monde de basculer l’électronique moteur sur le programme spécial homologation ». Ce propos a été publié il y a dix ans dans un journal qui est loin d’être confidentiel et qui ne doit pas être inconnu de vos services ! Peut-on raisonnablement penser que depuis dix ans, personne, à part les journalistes auteurs de cette citation, ne s’est posé ce type de question et n’a imaginé qu’il pouvait y avoir des logiciels de trucage dans les véhicules ? Toutes les personnes que nous interrogeons nous répondent qu’elles ne savaient rien. Je peux comprendre que l’on n’ait pu savoir s’il allait s’agir de Volkswagen ou d’un autre constructeur. Mais comment se fait-il que ce type de constat ait été effectué il y a dix ans et que depuis lors, personne ne se soit préoccupé de savoir si les tests effectués étaient non pas représentatifs – car on savait qu’ils ne l’étaient pas – mais aussi truqués ?
Vous nous avez parlé du rôle de l’État actionnaire des deux entreprises que sont les constructeurs nationaux. Quelles orientations ont-elles été données de la part de l’État au sein du conseil d’administration de chacune de ces entreprises pour mettre en œuvre la transition énergétique ? Nous avons la chance d’être actionnaires de ces entreprises. Et nous sommes face à des enjeux écologiques majeurs dans une industrie en difficulté, qui cherche à trouver un nouveau souffle et doit cependant répondre à des besoins de mobilité essentiels dans notre pays. Or, on sait que l’acheteur d’un véhicule neuf a cinquante-quatre ans en moyenne en France. Il existe donc un décalage très important entre les véhicules que l’on vend aujourd’hui et les enjeux à la fois écologiques et sociaux auxquels nous sommes confrontés. Lorsque vous nous indiquez que les enjeux du véhicule « deux litres aux cent kilomètres » concernent en priorité le poids, les matériaux et les performances des véhicules, je suis toujours surpris – même si les constructeurs nous ont tenu le même langage lorsque je les ai auditionnés en tant que rapporteur pour l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST). Est-il toujours nécessaire qu’un véhicule puisse rouler à 180 kilomètres par heure ? Un véhicule automobile doit-il forcément être conçu pour transporter une famille en vacances alors que 99 % du temps, il transporte une personne seule ? Ces questions sont-elles abordées dans le cadre de la définition, par le comité stratégique de filière, de perspectives de long terme ? Comment l’État actionnaire apporte-t-il sa part en la matière ? Transmet-il de tels messages aux constructeurs ? Nous avons adopté une loi de transition énergétique et nous savons que nous ne pourrons respecter les engagements climatiques de la France, parmi lesquels le facteur quatre, si nous ne parvenons pas à faire évoluer la mobilité et notamment les véhicules.
M. Jean Grellier. Je vous remercie d’avoir rappelé le rôle du CNI et des comités stratégiques de filière. J’ajouterai, pour information, que depuis l’année dernière, un représentant parlementaire membre de la Commission des affaires économiques est désormais rattaché à chaque comité stratégique. À plusieurs reprises en tant que représentant du Parlement, j’ai insisté sur la nécessité de coordonner le CNI, les plans industriels, les pôles de compétitivité dans une dimension territoriale. Il reste encore beaucoup d’efforts à accomplir en ce sens. Car beaucoup sur nos territoires ignorent tout du travail important mené au sein du CNI. Comment envisagez-vous cette nécessaire coordination ainsi que sa déclinaison territoriale pour que tout le travail effectué dans le cadre des comités stratégiques de filière puisse mieux irriguer nos territoires ?
Par ailleurs, il y a en France deux grands constructeurs auxquels on peut ajouter Toyota qui construit beaucoup en France. Par ailleurs, au cours de ces dernières années, les constructeurs intermédiaires de véhicules de niche ou innovants ont eu beaucoup de difficultés à mettre sur pied un modèle économique pérenne. Y a-t-il des actions à mener en ce domaine pour aider les constructeurs à surmonter ces difficultés ? Ces derniers doivent-ils établir des relations plus étroites avec les grands constructeurs ? Je rappelle que les véhicules qui équipent Paris aujourd’hui ont été construits en Italie parce que nos industries n’avaient pas la capacité de le faire en France. Des réflexions ont-elles été menées pour nous permettre d’adopter une stratégie nationale pour ces ETI ?
Notre mission concerne l’automobile mais aussi la mobilité. Quel regard portez-vous sur le secteur des camions, des bus, des autocars et aussi des matériels agricoles ou encore de travaux publics ? Nous avons eu une grande histoire en ce domaine. Or, il n’y a plus beaucoup de constructeurs aujourd’hui en France. Avons-nous une chance de conserver encore un savoir-faire sur ces segments ? Existe-t-il des perspectives de développement, notamment en termes de mobilité durable ? Car là encore, nous allons être obligés d’innover puisque ces véhicules émettent des gaz à effet de serre.
Enfin, s’agissant des informations relatives au « problème Volkswagen », quelles sont vos relations avec les services d’intelligence économique ? De quelle manière travaillez-vous ensemble dans ces secteurs ?
M. Gérard Menuel. Vous avez parlé des cahiers des charges qui vous lient aux constructeurs automobiles ainsi que des objectifs de consommation et des rejets assignés au véhicule du futur. Avez-vous fixé des objectifs précis en termes de calendrier ? Car j’ai l’impression que cela fait longtemps que l’on parle de véhicules consommant un ou deux litres aux cent kilomètres.
D’autre part, j’ai également l’impression qu’au niveau national, les deux grands constructeurs français prennent du retard concernant les matériaux composites servant à la fabrication des automobiles. Dans le secteur des matériaux pouvant alléger le poids des voitures, et donc en faire baisser la consommation, les constructeurs allemands recourent à des produits français comme le chanvre. La réaction ne me semble pas du tout la même chez les constructeurs français.
Mme la présidente. Je compléterai ce qui a déjà été dit au sujet de l’efficacité de la politique publique d’accompagnement au développement économique et, en l’espèce, au développement industriel et au secteur automobile qui nous occupent aujourd’hui. Les pôles de compétitivité ont plus de dix ans. Nous attendons en France une grande rupture technologique dans le secteur automobile. Car nous sommes allés loin dans la recherche sur les bases de motorisation que nous connaissons. La motorisation a évolué et est beaucoup plus efficace mais nous en attendons davantage, raison pour laquelle avait été conçue la politique des pôles de compétitivité dédiés aux véhicules du futur et aux solutions de mobilité. Je sais que ces pôles sont évalués et en cours de réorganisation – mais on peut aller plus loin dans ces démarches. Quelle part de l’argent public est-elle aujourd’hui encore destinée au fonctionnement des pôles ? Quelle est celle qui est destinée au financement des projets et donc aux entreprises ? Quel est l’effet de levier de ces pôles ? Pour un euro public investi – à l’heure où l’argent public est rare et donc cher – combien investissent les grands constructeurs privés ? Ainsi que l’a souligné Monsieur Duron, cela fait des années que nous cherchons à mieux articuler les politiques nationales, régionales et locales. Nous additionnons quantité de portes d’entrée : il conviendrait d’arriver à arrêter les subventions et à n’accorder d’avances remboursables qu’aux seuls vrais projets tout en essayant de regrouper les ressources humaines affectées au développement économique et aux pôles. Car nous n’avons plus d’argent à consacrer à d’innombrables animateurs de territoire qui se retrouvent tous sur le même champ, dans les mêmes entreprises à animer le même territoire. Votre direction a une vocation stratégique mais pas toujours d’examinateur sur le moment : comment anticiper ? Le professeur Élie Cohen nous indiquait la semaine dernière que malgré tout ce que l’on savait aujourd’hui, l’effort de recherche et développement de Volkswagen s’était accru de 220 % quand, dans le même temps, elle avait augmenté de 8 % chez nous ! Cela fait onze ans que des pôles de compétitivité piétinent. Nous nous languissons qu’ils deviennent efficaces. Où en sommes-nous vraiment et comment comptez-vous mettre un terme à des budgets de fonctionnement qui n’ont plus lieu d’être aujourd’hui ?
M. Christophe Lerouge. Les pôles de compétitivité Mov’eo, ID4car et « Véhicule du futur » sont membres du CSF. Se posent effectivement des questions de gouvernance et d’articulation entre les différents niveaux. Je n’ai pas cité jusqu’ici les associations régionales de l’industrie automobile (ARIA) qui sont présentes sur les territoires. Notre ministre souhaite simplifier l’organisation existante : il l’a fait pour les plans et souhaite le faire pour les pôles et la gouvernance de la filière automobile. Le dernier CSF ayant eu lieu au mois de septembre a spécifiquement traité de ce sujet. L’un des objectifs avancés par le ministre lors de ce CSF consiste à réorganiser et à recentrer les pôles et les ARIA, voire à les fusionner.
Il existe effectivement soixante-douze pôles. Il est vrai que certains d’entre eux ne sont guère efficaces et que nous voudrions qu’ils soient réorganisés. Mais cela relève aussi de votre responsabilité politique. Car lorsque l’État souhaite supprimer un pôle de compétitivité, vous pouvez être sûr que dans les semaines qui suivent, un élu de la République vient nous dire qu’il est bien de réorganiser les choses mais qu’il ne faut surtout pas toucher au pôle implanté sur son territoire ! Je vous renvoie donc la balle, madame la présidente. Le ministre nous a demandé comment faire évoluer l’organisation de la filière automobile.
Vous avez raison de souligner que nous allons célébrer les dix ans de ces pôles : certains sont des succès. Nous voyons forcément les projets émanant des pôles puisque c’est nous qui en instruisons les dossiers. Et il est vrai qu’il est des pôles que nous ne voyons quasiment jamais. Nous évaluons régulièrement leur intérêt. L’effet de levier dépend des taux d’aides et de subvention, de la zone dans laquelle se trouvent les pôles de compétitivité et de la taille des entreprises concernées – PME, ETI ou grands groupes.
M. Alban Galland. Le taux d’aide est de 25 % pour un grand groupe et de 45 % pour une PME.
M. Christophe Lerouge. L’effet de levier des pôles de compétitivité est donc double ou triple. Quant au FUI, il est de l’ordre de cent millions d’euros par an sur le budget de l’État, complétés par les budgets des collectivités territoriales. Il y a donc certes un effet de levier mais le système doit être revu.
Concernant la fixation des normes, les constructeurs français, notamment Renault et PSA, ont un discours allant plutôt dans le bon sens, c’es-à-dire dans celui d’un durcissement – notamment des normes de cycle sur bancs ou sur route. Mais ils souhaitent que nous leur laissions le temps de les appliquer. Par ailleurs, nos outils de comparaison des véhicules français et allemands montrent que les premiers sont plutôt bien placés dans les études comparatives.
Je prends acte de l’article d’Auto Moto. Il est vrai qu’il y a des capteurs partout, mais comme dans toutes les machines. Si vous réfléchissez avec un œil d’ingénieur, vous trouverez logique d’utiliser ces capteurs pour faire de l’optimisation. Vous ne vous direz pas pour autant que les tests vont être truqués et qu’une pratique délibérée permettra de contourner les normes en vigueur. Je vous confirme donc que l’affaire Volkswagen fut une surprise et que nous n’étions pas au courant. Il n’est pas surprenant que les véhicules soient optimisés lors des tests. Mais quant à créer un logiciel permettant de détourner délibérément les tests d’homologation, c’est quelque chose que nous ignorions.
S’agissant de savoir si l’État promeut la transition énergétique en tant qu’actionnaire, je ne sais pas quel discours a été tenu par mon chef dans le cadre des conseils d’administration de Renault. Je tiens à préciser que si c’est effectivement mon chef, le directeur général, qui participe à ces conseils d’administration, moi qui suis son premier collaborateur sur les questions industrielles, n’ai pas forcément accès à toutes ces informations – et je n’ai pas à y avoir accès car il s’agit d’informations privilégiées.
La prospective relative aux évolutions des modes de transport et de la mobilité est effectivement abordée dans le cadre du CSF. Un des axes que j’ai cités a trait aux stratégies d’avenir. Certains acteurs que je n’ai pas mentionnés jusqu’ici – des centres de recherche comme l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFFSTAR), l’Institut français du pétrole et des énergies nouvelles (IFPEN) et l’ADEME – financent ce type de réflexions. Le ministère de l’industrie pèse aussi sur ces acteurs : je suis notamment membre du conseil d’administration de l’ADEME et le sous-directeur chargé du secteur des transports est membre du conseil d’administration de l’IFPEN. Nous avons donc aussi la possibilité de tenir certains discours par le biais de ces instances de gouvernance.
L’articulation entre les CSF et le CNI et la coordination avec les régions sont un des grands axes de travail sur lesquels nous voulons mettre l’accent cette année et dans l’année qui vient. Il s’agit de la déclinaison de la politique de filière dans les régions. Pour ce faire, nous utilisons d’abord les réseaux de l’État, c’est-à-dire les DIRECCTE, pour essayer de travailler avec les entreprises. Ayant été en poste en DIRECCTE avant de passer à la DGE, j’ai une vision claire de ce que peuvent faire et de ce que demandent ces directions régionales. Il y a effectivement une multiplicité d’acteurs, que ce soient les chambres de commerce et d’industrie (CCI), les agences de développement, les conseils régionaux ou les métropoles, qui souhaitent se préoccuper de ces sujets – ce qui ne facilite pas la vie des entreprises. Il nous faut donc trouver entre eux une articulation.
Je vous indiquais tout à l’heure qu’au niveau national, les comités stratégiques de filière permettent un trilogue entre les organisations patronales, les organisations syndicales représentatives des salariés et l’État. Au niveau régional, on parlera de « quadrilogue » puisque nous allons rendre les comités stratégiques de filière régionaux accessibles aux conseils régionaux – les questions de financement des entreprises étant plutôt du ressort de ces derniers et le rôle des DIRECCTE étant d’établir un lien entre les niveaux national et régional.
Cela fait vingt ans que nous disons qu’il faut davantage intervenir en fonds propres. Mais cela est difficile à faire. D’ailleurs, les entreprises ne le souhaitent pas forcément. Nous essayons de renforcer le haut de bilan des entreprises et de les regrouper. Se posent des questions de développement économique liées à la taille critique, à la montée en gamme et à la possibilité pour les entreprises d’aller sur les marchés internationaux – questions auxquelles travaille un service de la DGE dédié à la compétitivité de l’industrie. Ce sont là des points qu’il nous faut effectivement traiter, dans le cadre de l’organisation territoriale de ce service, avec les conseils régionaux et sous l’égide des préfets.
De nombreux projets de véhicules de « niche » ont été lancés en France. Il faut savoir que nous les avons beaucoup aidés. En règle générale, lorsque des entreprises souhaitent s’installer et se développer, nous les considérons avec bienveillance pour peu que leur projet soit crédible. On touche là à des questions d’attractivité du territoire dès lors qu’il s’agit d’accueillir des investissements étrangers. Il se trouve que ces projets ont échoué car leur modèle économique n’est pas encore au point. Nous nous trouvons en effet dans une industrie très capitalistique et dont les acteurs sont très figés. Les constructeurs à travers le monde ont plutôt tendance à se regrouper. S’il importe de prendre des risques, les projets de niche sont extrêmement risqués.
S’agissant de la mobilité au sens large, incluant les bus, les camions et les autocars, je ne peux pas ne pas citer ici la loi Macron : compte tenu de la libéralisation des transports et de l’installation de nouvelles lignes d’autocars prévues par cette loi, le ministre, s’il ne peut forcer à l’achat de matériel français étant donné les contraintes européennes, a adressé aux constructeurs d’autocars et d’autobus un message très net en faveur de la production de véhicules propres en France. À tel point que nous réunirons demain les opérateurs de transports routiers et les constructeurs d’autobus et d’autocars afin de déterminer en quoi le développement de l’activité de services de transports pourra aussi favoriser le développement de l’activité de production.
Travailler avec les services d’intelligence économique n’est pas simple car nous n’en avons pas l’habitude. Nous sommes alertés dès lors que ces services sont au courant que certaines entreprises étrangères observent de près des entreprises françaises. Un décret relatif aux investissements étrangers en France a été publié il y a quelques mois dans le cadre de la fusion entre General Electric et Alstom. Depuis lors, nous recevons beaucoup d’informations de la part des services d’intelligence et traitons un nombre conséquent de dossiers touchant aux questions d’investissements étrangers en France et de rachat de savoir-faire et d’entreprises françaises. Une commission de l’Inspection générale des finances et du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies s’est réunie en 2014 et a formulé des propositions sur les questions d’intelligence économique. Et nous nous sommes organisés au niveau interne afin d’adopter une vision plus anticipatrice et pour prendre davantage en compte ces questions d’intelligence économique et de protection de nos savoir-faire et de nos données.
Le calendrier d’application des normes change régulièrement. La norme Euro 6 est en application depuis septembre 2015 et nous travaillons avec les services de la Commission européenne à l’instauration des nouvelles normes de cycles – Worldwide harmonized light vehicles test procedures (WLTP), prévue en 2017, et RDE. S’agissant en revanche des projets de recherche-développement, tels que le programme du véhicule « deux litres aux cent kilomètres », nous nous sommes certes fixé une échéance ambitieuse de cinq ans, à l’horizon de 2020 mais il est difficile de faire des prévisions en la matière. C’est l’objectif que nous affichons mais nous savons qu’il sera extrêmement difficile à tenir. Ce sont les normes d’émissions de CO2 qui comptent puisqu’une échéance de 95 grammes par kilomètre a été fixée à 2020 : il convient dès lors que les constructeurs automobiles réalisent les investissements et les innovations technologiques permettant d’atteindre cet objectif.
La production de matériaux composites, comme tout ce qui contribue à l’allègement des structures, a effectivement de l’importance. Mais pour l’instant, le modèle économique ne tient pas car les matériaux restent trop chers pour les véhicules. C’est là une différence entre les filières automobile et aéronautique. La question de l’allègement des structures se pose en effet aussi pour les aéronefs. Mais les coûts de matériaux permis pour la construction d’un avion le sont moins pour celle d’une automobile. Il reste donc encore des efforts à accomplir en la matière.
Vous avez raison concernant l’anticipation de l’innovation : la DGE se considère comme une direction générale stratégique souhaitant se projeter et se livre régulièrement à des analyses stratégiques au-delà de celles que nous fournissent les constructeurs automobiles. Cela est difficile mais nous travaillons avec les organismes de recherche précités et certains dispositifs nous permettent de financer des études alimentant nos réflexions. C’est là un véritable défi pour notre administration. Mais c’est selon nous le rôle de l’État que d’être en mesure de savoir quels sont les grands axes et grandes orientations des différentes filières industrielles.
M. Denis Baupin. J’ai bien entendu que vous n’étiez pas au courant de ce que votre chef avait pu dire au conseil d’administration de Renault. Mais s’il avait prévu d’en faire un sujet majeur, on peut supposer qu’il vous aurait demandé votre avis et de lui faire des propositions. On peut donc émettre l’hypothèse que pour l’instant, la possibilité pour l’État de se servir de son statut d’actionnaire dans les entreprises publiques comme levier pour promouvoir la transition énergétique n’est pas prioritaire. Je m’exprime de façon provocatrice mais cela me préoccupe. Car vous nous dites que si l’on se fixe des objectifs concernant le véhicule consommant « deux litres aux cent kilomètres », vous savez qu’ils ne seront pas tenus. Mais ce n’est pas pour se faire plaisir que l’on s’est fixé cet objectif : c’est parce que le dérèglement climatique n’attendra pas que l’on sache si les constructeurs automobiles, sans jamais rien changer à leur modèle puisqu’ils ne le veulent pas, vont réussir malgré tout à tenir cet objectif. Lorsque nous avons auditionné le professeur Élie Cohen la semaine dernière, il nous a indiqué que nous ne parviendrions pas à respecter à la fois les normes d’émissions de CO2 et de polluants atmosphériques sans rien changer à l’automobile car nous aboutissons aux limites de l’exercice. Cela est particulièrement vrai pour le diesel. L’État étant actionnaire des deux groupes constructeurs, il engage sa responsabilité vis-à-vis des consommateurs dès lors que les ambitions en matière de dérèglement climatique ne sont pas respectées. Il y a une dizaine de jours, Auto Plus a publié une enquête portant sur mille véhicules, démontrant que la consommation réelle des véhicules est 40 % plus élevée que celle annoncée au moment de leur vente, et 60 % plus élevée pour les véhicules Euro 6 de PSA et de Renault. Par conséquent, quand le consommateur achète français parce qu’on lui a dit qu’il est bénéfique d’acheter du made in France qui représente de l’emploi local – et je n’ai évidemment rien contre –, il se trouve client de constructeurs français, dont l’État est actionnaire et qui mentent en vendant leurs véhicules. À la fin de l’année, le consommateur aura dépensé des centaines d’euros de plus que ce qu’il imaginait pour faire les déplacements qu’il avait prévu de faire : telle est la réalité de ce mensonge.
En outre, vous nous avez confirmé lors de la table ronde que nous avons organisée à l’OPECST que la France avait bien soutenu la position issue du comité de fixation des normes d’homologation à l’échelon européen qui autorise l’application d’un facteur de dérogation de 2,1 aux nouvelles normes de pollution, notamment en matière d’oxyde d’azote. Cette fois, il ne s’agit pas de l’État en tant qu’actionnaire mais en tant que régulateur. On peut entendre que les constructeurs automobiles ne souhaitent pas que l’on impose de normes trop rapidement car il faut leur laisser le temps de s’adapter. Mais alors que la Commission européenne avait formulé des propositions plus ambitieuses – et l’on ne peut pas considérer qu’elle soit un organisme anti-automobiles –, les États ont finalement proposé un report dans le temps du niveau d’ambition face à des enjeux de santé publique actuels. Il est vrai que cela relève davantage de la responsabilité du politique mais nous vous interrogeons afin que vous puissiez nous expliquer pourquoi les choses fonctionnent ainsi. Dans quelle mesure les ambitions en matière de dérèglement climatique, de consommation d’énergie, de qualité de l’air et de pouvoir d’achat des Français sont-elles prises en compte dans les lignes politiques de votre direction ?
Mme la rapporteure. Vous nous avez indiqué que vous étiez en train de travailler avec la Commission européenne sur la norme WLTD : avez-vous des échanges directs avec elle ou bien seulement par l’entremise de la DGEC ? Avez-vous été associés aux travaux du comité d’experts qui a pris récemment plusieurs décisions ?
Concernant ce que j’appelle la face cachée du débat sur le diesel, c’est-à-dire les implications en termes d’emplois et en termes industriels des décisions relatives à la fiscalité des carburants, vous avez cité le chiffre de 10 000 emplois directs dans le secteur automobile diesel. Il nous serait utile que ces éléments soient développés – pas forcément aujourd’hui – et que nous soient fournies des informations relatives aux emplois indirects, à la part que représente le diesel dans la valeur ajoutée du secteur automobile en France et à la différence de marges réalisées par les constructeurs sur un véhicule diesel et sur un véhicule essence. Tous ces éléments sont utiles à nos travaux.
Le Premier ministre a affirmé que la diésélisation massive du parc automobile était une erreur et le Gouvernement a engagé un rapprochement des fiscalités. Des études de scénario ont-elles été établies par votre direction quant aux implications industrielles de cette évolution et aux besoins d’accompagnement éventuels ? Nous nous sommes rendus à l’usine de Trémery près de Metz où nous a paru évident le problème de la modularisation des chaînes de production. Au-delà des questions de normes et de tests, si l’on va vers un avenir où l’outil industriel doit être beaucoup plus souple et beaucoup plus adaptable, quels doivent être les dispositifs d’accompagnement de l’État en ce sens ?
M. Christophe Lerouge. S’agissant du rôle de l’État dans les conseils d’administration, je vous confirme que je ne sais pas ce qui s’y est dit. Il n’empêche qu’il est quand même question dans les conseils d’administration de Renault des nouveaux modèles et des nouvelles motorisations. Le constructeur a notamment mené des travaux sur le modèle électrique Zoé. J’ignore si les termes de « transition énergétique » ont été prononcés en tant que tels mais il reste qu’une réflexion est menée et que les représentants de l’État défendent sa position sur ces sujets. De même, dans toutes les discussions que nous avons en ce moment avec les grands acteurs de l’industrie au sens large, nous traitons de la Conférence de Paris sur les changements climatiques (COP21), du coût de l’énergie, de la transition énergétique et des quotas de carbone. J’ignore si ces sujets sont soulevés en conseil d’administration mais nous les abordons en tant qu’administration avec nos interlocuteurs entreprises. Il a été question ces derniers temps dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances du coût de transport de l’électricité et des différents dispositifs d’abattement pour l’interruptibilité et des dispositifs applicables aux électro-intensifs : or nous en discutons régulièrement avec tous les grands acteurs industriels – même s’il ne s’agit pas forcément de ceux du secteur automobile, mais aussi de ceux des secteurs de la chimie et de la sidérurgie. Notre mission consiste aussi à être en contact avec les entreprises : celles-ci nous fournissent des informations que nous essayons d’examiner pour ensuite tenter de prendre en compte les intérêts de leur activité et de l’emploi.
S’agissant du rôle de l’État vis-à-vis des institutions européennes, la DGE ne participe pas au comité précité : ce sont les services du MEDDE qui représentent l’État dans ce dispositif. Et je vous confirme ce qui a été dit – à savoir qu’à partir du moment où il y a eu un vote, la France a voté sur une position. Mais que les réunions aient lieu à Bruxelles ou qu’elles soient interministérielles, je n’y prends aucune décision en tant qu’individu mais en tant que chef d’un service dépendant d’un ministre. Et des positions de cette nature sont évidemment soutenues par le cabinet du ministre, son directeur de cabinet ou le ministre lui-même. Nous prenons donc en compte les grands objectifs politiques français en matière de réduction des pollutions, de diminution des émissions de CO2 et de gaz à effet de serre.
Nous nous sommes livrés à des exercices complexes au doigt mouillé, à partir d’éléments obtenus auprès des constructeurs, pour essayer de déterminer l’impact du rapprochement de la fiscalité du gazole et de l’essence. Mais vous savez bien, madame la ministre, comment cela se passe : le Premier ministre prend un arbitrage au cours d’une réunion interministérielle où les différents services arrivent chacun avec leur propre évaluation. En l’occurrence, sur les questions de fiscalité du diesel, le cabinet de M. Macron avait demandé à la DGE et à la Direction générale du trésor de réaliser des simulations de l’impact de la mesure. Nous avons donc essayé de le faire tant bien que mal et à partir de là, d’établir une position que nous avons défendue en réunion interministérielle. Je vous confirme donc que nous avons travaillé sur ces sujets.
La modularisation des chaînes de production est également une question à laquelle nous réfléchissons beaucoup. Qui plus est, la filière automobile travaille depuis toujours sur les questions d’amélioration de la production, d’économies d’échelle et de productivité. Les entreprises de l’automobile ont mis en place depuis des années des processus de qualité et travaillent désormais sur le lean. On rejoint là une révolution chère au ministre, Monsieur Emmanuel Macron : la transformation numérique de l’industrie. La dixième des solutions de la nouvelle France industrielle s’intitule « industrie du futur » et traite précisément de l’évolution des méthodes de production vers des séries plus petites et plus adaptées, avec des temps de réactivité plus courts de la part des entreprises. C’est là un des objectifs auxquels s’intéresse le CSF car c’est l’un des axes de travail du contrat stratégique de filière que j’ai cité au début.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Je vous remercie pour vos réponses.
La séance est levée à dix-huit heures.
◊
◊ ◊
7. Audition, ouverte à la presse, de M. Louis Schweitzer, Commissaire général à l’investissement.
(Séance du mardi 24 novembre 2015)
La séance est ouverte à dix-sept heures.
La mission d’information a entendu M. Louis Schweitzer, Commissaire général à l’investissement.
Mme Sophie Rohfritsch. Nous sommes heureux de vous recevoir ce soir, monsieur Schweitzer, en votre qualité de commissaire général à l'investissement, fonction que vous occupez depuis avril 2014. Vous êtes également président d'honneur du groupe Renault Nissan, que vous avez intégré en 1986 et dont vous avez assuré la présidence de 1992 à 2005. Les membres de la mission comprendront toutefois aisément qu'il ne vous sera pas possible de porter une appréciation publique sur la stratégie et la situation actuelles du groupe. Tel n'est d'ailleurs pas l'objet principal de cette audition.
L'automobile joue un grand rôle au sein du Commissariat général à l'investissement (CGI) dans sa mission de mise en œuvre du programme des investissements d'avenir, le PIA. À la tête du CGI vous avez d'ailleurs succédé à M. Louis Gallois, lequel a quitté cette responsabilité pour présider le conseil de surveillance de PSA Peugeot Citroën !
Depuis le début de ses auditions, la mission a perçu un certain enchevêtrement dans les instances ou les structures mises en place par les pouvoirs publics, à partir de 2009-2010, pour soutenir l'emploi, la recherche & développement et l'innovation dans ce secteur essentiel.
Votre audition devrait nous permettre de discerner plus clairement qui est en charge de quoi, quels sont les effets de leviers attendus et constatés, sans omettre le rôle spécifique ou complémentaire au vôtre que joue Bpifrance, la banque publique d'investissement.
Certaines questions se posent.
Au mois de juin dernier, vous avez appelé à une meilleure mobilisation des acteurs de l'automobile en affirmant qu'à défaut, un redéploiement des crédits du PIA leur étant destinés pourrait légitimement intervenir. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Autre question : un bilan des activités d'un pôle de compétitivité aussi connu que Mov'eo a-t-il été établi ?
Des concepts comme celui de véhicule du futur ou encore de véhicule consommant deux litres aux 100 kilomètres s'inscrivent au cœur du PIA, de même que l'usine du futur, le numérique et la voiture autonome. En un mot, le rééquilibrage désormais engagé entre les motorisations essence et diesel n'a-t-il pas un impact direct sur les actions en cours ?
Par ailleurs, le PIA dispose-t-il de suffisamment de souplesse pour réorienter dans les meilleurs délais les champs de certaines recherches actuelles ?
Monsieur le commissaire général, la mission d'information va d'abord vous écouter pour un exposé de présentation. Puis, Mme Delphine Batho, notre rapporteure, vous posera un premier groupe de questions. Elle sera suivie par les membres de la mission qui, à leur tour, vous interrogeront.
M. Louis Schweitzer, commissaire général à l’investissement. Mesdames et messieurs les députés, je commencerai mon exposé liminaire en soulignant trois caractéristiques de l’industrie automobile française, qui expliquent peut-être le désordre apparent que vous avez noté.
Premièrement, l’industrie automobile intègre les progrès issus de beaucoup d’autres industries. Les voitures actuelles ne sont pas différentes dans leur base de la première voiture mise au point par Benz en 1886, il y a cent vingt-neuf ans : quatre roues, un châssis, un moteur, des sièges, un mécanisme de direction, un mécanisme de freinage. En revanche, je ne connais pas un progrès dans le domaine des process industriels ou des technologies qui ne se soit pas appliqué à l’automobile. L’automobile met en œuvre un process de fabrication, issu du fordisme, qui est à la pointe des systèmes d’automatisation, d’intégration et de réduction des coûts. De ce fait, s’il y a quelques activités spécifiques à l’industrie automobile au sein du PIA, elle est d’abord prise en compte en tant que bénéficiaire directe ou indirecte de technologies d’autres industries.
Deuxièmement, le facteur essentiel dans l’industrie automobile est la réduction des coûts, alors que dans d’autres secteurs technologiques – l’aviation ou l’industrie militaire, par exemple –, cette contrainte est beaucoup moins pesante. Si toutes les nouvelles technologies sont intégrées par l’industrie automobile, elles ne le sont bien souvent qu’après que d’autres secteurs ont géré les coûts liés à leur développement. Les matériaux composites comme la fibre de carbone commencent à y être employés mais en décalage par rapport à l’aéronautique car ils sont beaucoup plus chers que les matériaux qu’elle emploie traditionnellement. Il en va de même pour l’aluminium : il constitue un facteur de progrès puisqu’il contribue à alléger le poids des véhicules, mais comme il reste plus cher que l’acier, il est utilisé avec un décalage temporel. Comme les actions du CGI concernent le développement de nouvelles techniques ou de nouveaux matériaux, elles interviennent en amont, avant que l’industrie de l’automobile ne commence à les intégrer quand leur coût est devenu acceptable.
Troisièmement, en France, la coopération dans l’industrie automobile n’est pas facile à établir et à développer. Il existe deux grands constructeurs. Quand j’étais responsable de l’un d’eux, j’avais coutume de dire que l’autre était le plus proche de nos concurrents, autrement dit le concurrent que l’on avait envie de battre en premier. Dès lors qu’on approche d’une technique commerciale, chacun garde sa copie. Dans l’aéronautique, il existe dans notre pays un constructeur d’avions civils, un constructeur d’hélicoptères et les coopérations avec l’État sont plus faciles. En outre, derrière ces deux constructeurs automobiles, il y a les grands équipementiers, qui ont remarquablement réussi – beaucoup mieux qu’on ne l’imaginait, il y a quelques années : Valeo, Faurecia, Plastic Omnium, Michelin – mais il n’y a pas, comme en Allemagne, de coopération structurée tout au long de la filière. Je pense que c’est l’une des faiblesses de l’industrie automobile française. Les constructeurs français mettent beaucoup plus en concurrence leurs fournisseurs que ne le faisaient traditionnellement les constructeurs allemands – qui sont en train de changer d’orientation. La coopération entre les très grandes entreprises, les grandes entreprises, les entreprises moyennes et les petites entreprises de la filière est donc beaucoup plus faible.
Ces trois caractéristiques expliquent que l’intervention du programme des investissements d’avenir dans le domaine de l’industrie automobile est moins importante qu’on pourrait le croire ou qu’on aimerait à l’imaginer, eu égard au poids de celle-ci dans l’économie de notre pays.
Ce cadre général posé, j’en viens aux chiffres. Le premier programme des investissements d’avenir a été doté de 35 milliards d’euros, le deuxième programme, de 12 milliards d’euros et le Président de la République a annoncé que le Gouvernement présenterait au Parlement un troisième programme des investissements d’avenir doté de 10 milliards en 2016. Sur les deux premiers programmes, totalisant 47 milliards de crédits, 36 milliards ont été engagés, c’est-à-dire ont donné lieu à une décision d’affectation de principe du Premier ministre ; 31 milliards ont été contractualisés, c’est-à-dire ont donné lieu à un accord avec le bénéficiaire de l’aide sur un projet donné ; et 12,6 milliards ont été effectivement décaissés, le rythme de décaissement étant, à vrai dire, plus lent qu’on ne l’avait imaginé à l’origine.
Je ne suis pas capable de vous préciser quelles sommes sur ces montants sont destinées à l’industrie automobile, notamment en raison de la première caractéristique que j’ai rappelée, à savoir que cette industrie intégrant de nombreuses technologies d’autres industries, elle bénéficie en aval du fruit de recherches menées dans d’autres domaines.
Dans le cadre de ces programmes, nous avons créé des institutions qui ont pour objet de faire coopérer recherche publique et recherche privée : les instituts pour la transition énergétique (ITE), les instituts de recherche technologique (IRT). Certains concernent directement ou indirectement l’industrie automobile.
L’ITE qui la concerne le plus directement est VeDeCOM, Institut du véhicule décarboné et communicant et de sa mobilité, qui a pour objet de développer les innovations dans le domaine des véhicules électrifiés, des véhicules autonomes et connectés et des infrastructures de service et de mobilité qui y sont liés. Sont membres fondateurs de cet institut, qui associe partenaires privés et publics, les deux constructeurs français et de grands équipementiers. Le PIA lui a attribué une dotation de 119 millions d’euros et le secteur privé a apporté la même somme.
Autre institut lié à l’industrie automobile, l’IRT Jules Verne. Situé à Nantes, il se consacre aux technologies avancées de production de composites métalliques et de structures hybrides et se situe donc dans une logique de progrès des technologies de fabrication des véhicules et de matériaux. Grands constructeurs et équipementiers participent à son financement et nous lui avons apporté un équivalent-subvention de 115 millions d’euros.
Citons encore l’IRT SystemX, en région parisienne, qui travaille sur l’ingénierie numérique des systèmes, les infrastructures numériques, les territoires intelligents et le transport autonome. PSA, Renault et Valeo en sont partenaires et le PIA lui a apporté 130 millions d’euros. L’industrie automobile ne représente qu’une petite part de ses activités.
J’en viens, enfin, à l’IRT M2P, en Lorraine, dont les recherches concernent les matériaux. Nous lui avons apporté une aide totale qui représente l’équivalent de 50 millions d’euros. Là encore, je ne saurais dire la part propre à l’automobile.
Il existe un second domaine où le PIA intervient pour l’industrie automobile : l’accompagnement de projets de recherche et de développement collaboratif qui lui permettent de progresser. Sur une enveloppe de 1,1 milliard d’euros consacrée à la thématique générale du transport, il existe une sous-enveloppe de 750 millions gérée par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) consacrée aux véhicules du futur. Sur ce total, nous n’avons dépensé que 350 millions en net, en raison non d’une volonté de ne pas dépenser d’argent, mais d’un nombre insuffisant de projets de qualité. L’exigence à laquelle s’astreint le PIA ne lui fait retenir, vous le savez, que les projets réunissant les trois critères que sont l’excellence, l’innovation et la coopération, les décisions étant prises à la suite d’avis d’experts indépendants et d’une instruction ministérielle. À ces 350 millions, il faut ajouter 100 millions correspondant à des projets abandonnés en cours de route pour différentes raisons.
Nous avons retenu quarante-trois projets, dotés d’une aide du PIA se situant en moyenne aux alentours de 8 millions. Tous comportent une dimension d’efficience énergétique. Ils visent, par exemple, à améliorer les rendements des moteurs en développant des techniques plus pointues d’hybridation ou en allégeant le poids des véhicules. Ces projets sont assortis d’un cahier des charges et d’un échéancier précis, que nous suivons de près.
Toutes ces recherches s’intègrent dans l’objectif global de la mise au point d’un véhicule consommant deux litres aux 100 kilomètres à un prix abordable. La précision est importante car tout l’enjeu pour les constructeurs est de pouvoir produire des véhicules achetables, alliant prestations satisfaisantes et prix accessibles. Tous sont en mesure de mettre au point des véhicules consommant un litre par 100 kilomètres – il y a même des compétitions de sobriété énergétique en Chine où l’on descend à 0,20 litre aux 100. Il s’agit toutefois avant tout de démonstrateurs technologiques qui ont pour vocation de rassembler une série de techniques et non d’être disponibles chez les concessionnaires car leurs prix seraient hors de portée des consommateurs.
Par ailleurs, le PIA touche l’industrie automobile à travers les aides aux PME distribuées par Bpifrance et les aides relatives à la formation professionnelle.
Enfin, nous avons une coopération avec les pôles de compétitivité, dont certains concernent l’industrie automobile, mais qui ne donne pas lieu à une aide spécifique s’ajoutant à d’autres aides.
Vous avez fait référence, madame la présidente, aux propos que j’ai tenus devant les représentants de l’industrie automobile. Ma responsabilité de commissaire général est d’assurer un bon emploi des fonds que je dois allouer et j’ai effectivement déclaré que si l’industrie automobile ne nous soumettait pas de bons projets, nous affecterions nos aides à des projets autres que les siens. Cela me paraît être une règle de bon sens.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Monsieur Schweitzer, je vais faire appel à votre très grande expérience de l’industrie automobile afin que la commission bénéficie de votre éclairage sur l’affaire Volkswagen, qui a motivé la création de cette mission d’information. Vous avez déclaré qu’elle renvoyait à une culture d’entreprise spécifique, ce qui me semble être une analyse particulièrement intéressante, de nature à nous aider dans notre compréhension. À cette même occasion, vous avez souligné les problèmes soulevés par les tests en Europe et la nécessité de revoir les procédures d’homologation et de mener une réflexion plus globale sur les normes. Pourriez-vous développer votre point de vue ?
Vous venez à l’instant d’évoquer la structuration de la filière de l’industrie automobile en France, en insistant sur le fait qu’il n’y avait pas suffisamment de coopération. Nous nous sommes intéressés aux structures qui ont été mises en place à la suite des états généraux de l’automobile en 2008-2009, notamment la Plateforme de la filière automobile. Ses responsables, que nous avons auditionnés, semblaient dire que de grands progrès avaient été accomplis en la matière. Quelles sont selon vous les améliorations à apporter pour renforcer la coopération entre les différents acteurs et les différents niveaux de la filière ? Que pensez-vous de la structuration entre la Plateforme, le Comité national de l’industrie (CNI), le Comité stratégique de la filière automobile ? N’existe-t-il pas des redondances dans les instruments de pilotage et de coordination ?
Avant de poser cinq questions précises sur le programme des investissements d’avenir, je voudrais vous dire comme les membres de la commission des affaires économiques se réjouissent des grands progrès enregistrés depuis 2014 : nous disposons d’informations régulières sur la mise en œuvre du PIA, avec un état précis des redéploiements de crédits ; nous nous félicitons de la même façon des améliorations en matière de procédures de traitement des projets et de prise de décision, désormais plus rapides, ainsi que des simplifications opérées dans les comités de pilotage et de décision.
S’agissant du PIA 3, vous avez souligné qu’il était impératif que les décisions soient prises en 2016 pour 2017 et non pas en 2017 pour 2017. Pourriez-vous nous en dire plus ?
Vous avez indiqué dans votre propos liminaire que le rôle du PIA n’était pas aussi important dans le domaine de l’industrie automobile que nous pouvions l’imaginer. Comme il s’agit d’un outil stratégique en matière d’adaptations industrielles et de soutien de l’État à certaines orientations technologiques, j’aimerais que vous développiez votre point de vue.
À quoi correspondent les projets abandonnés ? S’agissait-il de projets déjà engagés ? Avez-vous procédé à des redéploiements ?
Par ailleurs, vous avez eu l’occasion de souligner que dans l’enveloppe globale, 5 milliards d’euros avaient été affectés à des domaines ne correspondant pas à l’esprit du PIA et relevant de crédits budgétaires classiques. Cela comprend-il des politiques liées à l’industrie automobile ? Je pense en particulier au programme relatif aux bornes de recharge.
Enfin, vous avez affirmé qu’il n’y avait pas un nombre suffisant de bons projets portés par l’industrie automobile. Certains acteurs, notamment la direction générale des entreprises, considèrent que le CGI ne prend pas assez de risques. Qu’en pensez-vous ?
M. Louis Schweitzer. Sur quelques points, je demanderai à Jean-Luc Moullet, directeur du programme « Compétitivité, filières industrielles et transports » au Commissariat général à l'investissement, de vous donner des réponses, qui seront plus précises que les miennes. Deuxième remarque préalable : je ne suis plus actif dans l’industrie automobile depuis 2005, ce qui fait tout de même dix ans.
Parlons d’abord de l’affaire Volkswagen, qui appelle quelques développements techniques.
Tous les cinq ans en Europe comme aux États-Unis, il y a un durcissement des normes de dépollution et, depuis une période plus récente, la Commission européenne nous demande de réduire la consommation moyenne des véhicules, qui est mesurée par le nombre de grammes de CO2 émis au kilomètre. Ces deux objectifs sont partiellement en conflit. Je veux dire par là que la dépollution d’un véhicule est plus facile et moins chère à opérer pour un véhicule à essence : une fois un pot catalytique installé, les coûts ne sont pas très élevés. En revanche, la dépollution d’un véhicule diesel est beaucoup plus coûteuse. Les constructeurs sont ainsi conduits à un arbitrage délicat dans leurs efforts entre réduction du CO2, que permettent les moteurs diesel, et réduction des polluants – oxydes d’azote, particules fines, hydrocarbures à brûler.
À mesure que les normes de dépollution deviennent plus sévères, l’écart de prix entre un véhicule diesel et un véhicule à essence augmente et engendre un surcoût pour le diesel. Ma vision, à l’époque où j’étais dans l’industrie automobile, était qu’à terme, les normes de dépollution du diesel et de l’essence devaient converger, autrement dit qu’on devait arriver à un moment où le diesel, sans doute irremplaçable pour les transports lourds, ne polluerait pas plus que l’essence, tout en continuant à consommer moins.
Il est difficile de dépolluer les véhicules diesel, qu’il s’agisse de camions ou des automobiles. Et cette contrainte a abouti à une affaire analogue à l’affaire Volkswagen, aux États-Unis en 1998, pour ce qui concerne les camions. Afin de réduire des émissions d’oxydes d’azote, plusieurs technologies peuvent être utilisées. Il y a d’abord la recirculation des gaz d’échappement, système de dépollution efficace jusqu’à un certain point. Il apparaît suffisant au regard des normes européennes actuelles mais atteignait déjà ses limites compte tenu du seuil applicable en 1996 aux États-Unis. Il y a une autre technologie : l’addition d’urée, plus chère et plus contraignante pour l’usager car elle nécessite l’installation d’un deuxième réservoir à remplir régulièrement. Les constructeurs de camions aux États-Unis s’étaient, dans les années quatre-vingt-dix, interrogés sur la meilleure technologie à employer : devait-on tirer jusqu’à son terme la technologie de la recirculation des gaz d’échappement ou bien sauter le pas et passer à l’injection d’urée ? Presque tous les constructeurs ont choisi de faire ce saut. Un seul constructeur de moteurs – il faut préciser qu’aux États-Unis, les constructeurs de moteurs se distinguent des constructeurs de véhicules – a fait le pari de continuer à utiliser la recirculation. Il a vite dû constater que ses moteurs ne permettaient pas d’être en conformité avec le nouveau seuil et a eu recours au même procédé que Volkswagen en installant un petit programme capable de réduire la puissance du moteur en situation de test de façon à répondre aux normes. La supercherie a été découverte et le constructeur a dû payer 1 milliard de dollars d’amende.
Pour les automobiles aussi, les normes applicables au diesel sont plus sévères aux États-Unis qu’en France ou en Europe. Les constructeurs automobiles se sont retrouvés confrontés aux mêmes problèmes que les constructeurs de camions quinze ans plus tôt et le même scénario s’est reproduit : deux constructeurs ont choisi la technologie de l’urée
– Mercedes et BMW –, un autre a choisi la recirculation et a triché de la même manière –Volkswagen. L’incitation à utiliser la vieille technologie était cependant encore plus forte que pour les camions car remplir un second réservoir est plus contraignant pour les automobilistes. Les professionnels routiers acceptent plus volontiers de s’arrêter tous les x kilomètres que les conducteurs particuliers, qui ont perdu l’habitude de s’astreindre à ce genre de choses. Aujourd’hui, plus personne n’accepterait de faire une vidange tous les 1 500 kilomètres.
Pourquoi ai-je dit n’avoir pas été surpris que cette tricherie ait eu lieu chez Volkswagen et pas chez un autre constructeur ? Cette entreprise, que je connaissais bien, a connu une grande réussite industrielle : il y a dix ans, elle valait moins que Renault en bourse ; aujourd’hui, elle est le premier constructeur mondial. Trois traits principaux marquaient sa culture : premièrement, elle était animée d’une telle volonté de réussite entrepreneuriale que tout obstacle était considéré comme illégitime – dès lors, tricher n’apparaissait pas comme un vrai péché ; deuxièmement, personne ne pouvait contredire les ordres donnés par le chef ; troisièmement, il était impossible d’avouer que l’on n’avait pas réussi à exécuter lesdits ordres. Dans ces conditions, vous pouvez aisément imaginer que si le chef a dit qu’il ne fallait pas contraindre le conducteur avec un réservoir supplémentaire, qui risquait de dégrader la performance et d’accroître les coûts, les salariés ont répondu qu’ils y arriveraient car c’était à la limite du possible. Je ne sais pas du tout qui a décidé de tricher, il y a une enquête en cours. Toutefois, il est clair que le mécanisme de la tricherie peut être enclenché dès lors que personne ne discute les ordres du chef et n’ose avouer qu’ils n’ont pas pu être mis en œuvre.
Venons-en aux tests et aux normes en France en Europe. Par rapport aux tests américains, ils sont doublement plus faciles : premièrement, ils sont plus éloignés des conditions réelles de circulation ; deuxièmement, les valeurs de pollution qu’ils autorisent sont plus tolérantes pour le diesel, comme je l’ai dit. Pourquoi ? Ce n’est pas parce que nous aimons davantage la pollution en Europe mais parce que la baisse de la consommation est un non-sujet aux États-Unis où le carburant est trois à quatre fois moins cher qu’en Europe. Les constructeurs européens, eux, doivent en permanence faire un arbitrage entre consommation et pollution. La Commission elle-même recherche un équilibre entre ces deux variables dans les négociations. Il me paraît évident qu’après ce qui s’est passé aux États-Unis, il faut rendre les tests plus représentatifs, ce qui revient à les rendre plus sévères même si la quantité d’oxydes d’azote prise en compte ne change pas. Cela implique qu’il faudra construire de nouveaux moteurs, ce qui prendra deux à trois ans, et éliminer ceux qui ne peuvent être améliorés.
Je pense toujours que l’objectif à long terme est la convergence des normes de pollution applicables aux moteurs diesel et aux moteurs à essence. Cela se traduira par une plus grande difficulté à réduire les émissions de CO2 et la consommation au kilomètre des voitures, à puissance constante.
Après, on peut discuter sur le point de savoir si on a besoin d’avoir des voitures de 500 chevaux pour faire du 130 kilomètres l’heure. En réalité, le fait qu’il existe en Allemagne un millier de kilomètres d’autoroutes sans limitation de vitesse définit le standard automobile pour l’Europe et même pour le monde. Lorsque j’étais patron de Renault, j’étais le seul constructeur automobile à faire du lobbying contre cette exception à la limite générale de vitesse. Et cet isolement réduisait à néant mes chances de gagner, d’autant que les constructeurs allemands étaient en étroite liaison avec leur gouvernement.
Parlons maintenant de la filière industrielle. La Plateforme de la filière automobile constitue un progrès. Elle a un objet un peu différent du Conseil national de l’industrie, structure publique tout à fait utile mais qui est davantage un lieu de concertation entre l’État et les entreprises qu’un lieu de travail entre les entreprises elles-mêmes. Cependant, elle a des limites qui tiennent à ce trait français que j’ai souligné dans mon exposé liminaire : les constructeurs dans notre pays remettent en concurrence les fournisseurs au lieu d’entretenir une relation durable avec l’un d’eux en particulier. Ils vont, par exemple, mettre en concurrence Delphi, Nippon Denso et Bosch sur un système d’injection. La coopération est moins naturelle qu’en Allemagne où historiquement, les constructeurs se fournissaient chez Bosch et Siemens, ce qui faisait que toute la filière était industriellement intégrée : le dialogue était tout naturel entre des entreprises qui travaillaient continument ensemble.
Y a-t-il des redondances dans les structures ? Je ne le pense pas. Il y a d’un côté, une organisation qui rassemble les entreprises, la Plateforme de la filière automobile ; il y a de l’autre, le CNI. Le nombre de réunions n’est pas tel que les constructeurs y gaspillent leur temps. Plus ils se voient, mieux c’est. Nous n’avons pas d’inquiétudes à avoir sur un excès de dialogue. Dans mes nouvelles fonctions, j’ai essayé de les encourager à travailler encore plus ensemble. Il y a cependant des limites à cela, pour des raisons que j’ai exposées au début de notre réunion.
Abordons les questions liées au programme des investissements d’avenir lui-même. D’abord, madame la rapporteure, merci de vos compliments sur les améliorations que vous avez constatées. Nous essayons effectivement de simplifier et d’accélérer nos procédures. D’énormes progrès ont été enregistrés, notamment avec l’ADEME. Nous avons supprimé toutes les doubles instructions, nous avons allégé certaines procédures, en réduisant par exemple le nombre de pages que doivent comporter les dossiers des petits projets. Nous ne disposerons qu’au début de l’année prochaine d’un système de suivi automatique des délais entre dépôt du dossier et contractualisation de l’aide. Mon ambition est de parvenir à un délai de trois mois pour les projets simples. Aujourd’hui, ce délai n’est que rarement atteint et il vaut plutôt pour la durée qui sépare le dépôt du projet de la décision du Premier ministre ou du commissaire général d’accorder l’aide. Toutefois, depuis trois ou quatre ans, nos sondages ont montré que les délais avaient été divisés par trois ou quatre. C’est un progrès important car de trop longs délais présentent de multiples inconvénients : ils risquent de nuire à l’innovation, les projets se périmant vite dans un monde concurrentiel ; ils ne peuvent être supportés par les PME, qui, nous le savons, ont des problèmes de trésorerie ; enfin, ils risquent de décourager certains. Nous poursuivons nos efforts, mais il reste du chemin à parcourir.
Pourquoi avons-nous insisté sur l’année 2016 pour le PIA 3 ? Les crédits relatifs aux subventions et aux avances remboursables, qui entrent dans le déficit budgétaire au sens de Maastricht, et qui sont ceux qui suscitent le plus de compétition, auront été totalement engagés à la mi-2017. Si le PIA 3 était voté en 2017, il y aurait six mois de vide car il faut au moins six mois pour répartir les crédits, contractualiser avec les organismes, définir les procédures, lancer des appels à projets. Or l’on sait que lorsque l’on interrompt un processus, il y a un coût au redémarrage et une perte d’efficacité, comme dans les systèmes industriels. Un vote en 2016 éviterait une telle coupure.
Quant au rôle limité du PIA à l’égard de l’industrie automobile, j’en ai exposé les raisons aussi bien que je le pouvais dans mon propos introductif. L’automobile est souvent en second rang pour l’absorption de l’innovation, du fait de la contrainte des coûts. La structure compétitive entre Renault et PSA ainsi qu’entre les grands équipementiers rend plus difficile le travail coopératif, qui est la base du PIA. En d’autres temps, j’avais voulu que les deux grands constructeurs français explorent ensemble la possibilité de construire des moteurs hybrides diesel, mais comme l’un des deux pensait être plus avancé que l’autre, il n’avait pas envie de coopérer. L’esprit coopératif n’est pas encore suffisamment établi parmi les industriels pour qu’ils entrent volontiers dans un système de recherche collaborative.
Enfin, sur le manque de qualité des projets et les projets abandonnés, je vais laisser le soin à M. Jean-Luc Moullet de vous en dire plus. Par définition, ne me sont soumis que les projets de qualité : je ne vois pas passer les mauvais projets. Quant aux projets abandonnés, je n’en connais pas la liste.
M. Jean-Luc Moullet, directeur du programme « Compétitivité, filières industrielles et transports » au Commissariat général à l'investissement. L’écart entre les 450 millions d’euros de crédits décidés et les 350 millions nets s’explique de manière assez simple.
Les projets retenus sont par définition techniquement difficiles : ils essaient de dépasser l’état de l’art technologique et comportent une part d’inconnu dans leur réalisation. Durant les trois à quatre années que nécessite leur réalisation, les industriels peuvent parfois se heurter à une difficulté technique qu’ils ne parviennent pas à dépasser. Ils sont alors obligés de tirer un constat d’échec par rapport aux hypothèses initialement retenues et de mettre un terme à leur projet. Ces 100 millions d’euros d’écart correspondent à ces reprises sur projets arrêtés.
Cet écart pourrait d’une certaine manière être interprété comme une mesure des risques qui sont propres à chaque projet retenu. Ce ratio d’un peu moins de 20 % est un chiffre qui s’observe, ce n’est pas un critère de management. Dans un monde sans risques, les 450 millions de crédits seraient engagés en totalité.
M. Louis Schweitzer. Nous pouvons prendre deux types de risques suivant la nature des crédits que nous engageons. Il s’agit, premièrement, des subventions et avances remboursables, qui entrent dans le périmètre maastrichtien. Ils nous permettent de prendre des risques techniques et, à cet égard, je trouve d’une certaine façon sain que des projets échouent. Il s’agit, deuxièmement, de nos investissements en fonds propres, non maastrichtiens, pour lesquels nous sommes soumis à une double contrainte : d’une part, trouver un co-investisseur privé ; d’autre part, être considéré comme un investisseur avisé du point de vue européen, c’est-à-dire un investisseur qui a des espoirs de retours à proportion du risque qu’il prend, ce qui limite la prise de risques puisque les chances de gain doivent être supérieures aux risques de pertes.
Vous avez encore évoqué les investissements ne correspondant pas à l’esprit du PIA. Reconnaissons que la limite entre ce qui relève de l’esprit du PIA et ce qui n’en relève pas est quelquefois un peu artificielle. Nous ne considérons pas que les bornes de recharge se situent hors de l’esprit du PIA même si elles ne sont plus vraiment innovantes et qu’elles appartiennent plutôt au champ du Plan Juncker, c’est-à-dire à un système de diffusion. Nous avons commencé à faire un effort en faveur de leur déploiement. De la même manière, nous ne considérons pas que la couverture de la France en très haut débit se situe en dehors de l’esprit du PIA même si ce grand programme gouvernemental ne correspond pas entièrement à ses critères. Nous avons financé son démarrage et continuons de le gérer, mais en dehors des enveloppes du PIA car nous avons trouvé des relais de financement.
On chiffre les redéploiements hors esprit PIA à environ 5 milliards sur le total de 47 milliards du PIA 1 et PIA 2. Que recouvrent-ils ? Je citerai deux exemples parmi d’autres. Tout d’abord, la recherche militaire du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) : si elle allie innovation et excellence, elle ne repose ni sur une forte coopération ni sur le recours à des appels à projets et constitue pour nous une boîte noire absolue. Ensuite, les avances remboursables pour les Airbus 350 qui, jusqu’à l’apparition du PIA, étaient financées sur le budget de l’État. Autant de projets qui ne sont pas mauvais en eux-mêmes mais qui ont été placés, un peu par facilité, dans le champ de financement du PIA alors qu’ils relevaient auparavant du budget de l’État. Cela n’a aucun impact sur le déficit au sens de Maastricht : que le financement passe ou non par le PIA ne change rien en ce domaine. Cela a toutefois une incidence au regard de la norme de dépense publique intérieure telle qu’elle est approuvée par le Parlement, laquelle prend en compte d’autres critères que celui des 3 % maastrichtiens, car le PIA se situe hors norme de dépense.
M. Jean-Michel Villaumé. Monsieur Schweitzer, commentant l’affaire Volkswagen dans Les Échos, vous avez déclaré : « ce qui serait désastreux, c’est de conclure que le diesel doit mourir ». Certes, en termes d’émissions de CO2, il est moins polluant que l’essence. Toutefois, du point de vue de la santé, on sait qu’il est particulièrement dangereux à cause des émissions de particules fines, auxquelles l’Organisation mondiale de la santé attribue 40 000 morts par an. Est-il donc raisonnable d’affirmer que le diesel fait partie de l’avenir de la filière automobile ?
Par ailleurs, pouvez-vous nous indiquer quelles évolutions technologiques vous envisagez pour la filière automobile ? Dans la perspective de la COP21, il est beaucoup question de ce qu’elle pourra apporter à la croissance à travers le développement des véhicules propres.
M. Denis Baupin. J’aimerais souligner toute l’importance de votre remarque sur les mille kilomètres d’autoroutes allemandes qui déterminent la puissance du parc automobile mondial. Je dois dire que c’est assez effrayant. Effrayant en termes de pouvoir d’achat : les ménages surpaient des véhicules dimensionnés pour atteindre des vitesses élevées sur les autoroutes allemandes. Plus effrayant encore en termes d’impact climatique : s’il y a bien un domaine dans lequel on peine à réduire les émissions de gaz à effet de serre, c’est la mobilité, notamment dans notre pays. Je suis un grand défenseur des alternatives à l’automobile mais nous savons bien que dans une grande partie des territoires, la solution ne réside pas dans le transport collectif mais bien dans le modèle automobile. La consommation des véhicules, donc la puissance des moteurs, est un facteur déterminant dans la lutte contre le dérèglement climatique, y compris si l’on ne veut pas laisser à nos enfants et nos petits-enfants une planète vidée de toutes ses ressources pétrolières.
J’aimerais vous demander, vous qui avez eu de très grandes responsabilités dans l’industrie automobile et qui êtes un observateur attentif de ce secteur, s’il n’est pas temps de sortir du paradigme de la voiture à tout faire, qui prévaut depuis des décennies. Les voitures conçues pour emmener une famille en vacances ne servent, l’essentiel du temps, qu’à une seule personne. L’entreprise que vous avez dirigée a lancé la Twizy, une innovation intéressante : ce véhicule, qui n’est pas considéré comme une voiture aujourd’hui, permet d’expérimenter un autre modèle de mobilité dans les zones urbaines.
Le fait que les constructeurs aient tellement de mal aujourd’hui à respecter les normes de pollution n’est-il pas lié à ce paradigme ? Si l’on décide que les objectifs relatifs à la qualité de l’air, à la lutte contre le dérèglement climatique, à la mobilité de nos concitoyens sont à privilégier par rapport à la vitesse sur ces mille kilomètres d’autoroutes, ne serait-il pas temps de passer à autre paradigme, qui permettrait d’ailleurs peut-être de sauver la filière automobile ?
Mme la présidente. Les PIA ont déjà six ans, avez-vous une visibilité sur ce qui pourrait être l’innovation de rupture dans le domaine de l’industrie automobile ? Quels seraient les délais d’achèvement ?
Ne pensez-vous pas qu’il serait utile, dans une optique de bonne gestion de deniers publics, que vous supervisiez certains pôles qui, outre leur rôle d’animation de réseaux, sont amenés à financer des projets en collaboration avec les régions, qui gèrent les aides du Fonds européen de développement régional (FEDER) ? Ne pourriez-vous pas veiller à établir une hiérarchie dans les intervenants, afin d’éviter les chevauchements dans les investissements et les pertes de fonctionnement en ligne ? Il me paraît important d’encourager les actions financées par des fonds propres, plus efficaces que celles financées par des subventions et de veiller à ce que l’argent aille bien au financement de projets au lieu d’être consommé par des animateurs sur le terrain qui ne sont pas forcément très efficaces.
M. Louis Schweitzer. Je commencerai par l’avenir du diesel. Comme je l’ai dit, dans un horizon non déraisonnable, il me semble souhaitable que la pollution engendrée par les véhicules diesel soit égale à celle des véhicules à essence. Dans nos villes, ce n’est toutefois plus un sujet majeur. Tokyo, grâce à des normes sévères, a ainsi réussi à réduire considérablement la pollution automobile. Les villes vraiment polluées, il faut les chercher dans d’autres types de pays.
Une autre question qui se pose est de savoir si l’avantage fiscal dont bénéficie le diesel est légitime. Aucun argument rationnel ne me paraît justifier un tel écart. Ma conviction personnelle est qu’une convergence progressive de la fiscalité du diesel et de l’essence n’est pas déraisonnable. Il faut toutefois avoir à l’esprit qu’une telle convergence conduira à réduire la valeur patrimoniale des véhicules diesel détenus par les ménages et s’attacher à une certaine progressivité. Un délai de cinq ans me paraîtrait un peu brutal à l’aune de la durée de vie de quinze ans des automobiles.
Je reste persuadé que le diesel, même soumis à des normes de pollution plus sévères, restera plus efficient en termes d’émissions de CO2 que l’essence, notamment pour les transports lourds. Je n’imagine pas qu’on construise à nouveau des camions à essence et je ne considère pas que la généralisation du gaz soit une réponse entièrement satisfaisante.
Les techniques alternatives, reconnaissons-le, n’ont pas que des avantages.
L’électricité pose encore des problèmes : en termes d’autonomie, en termes d’environnement aussi puisque le recyclage des batteries n’est pas encore une question qui va de soi. De plus, il ne sera pas facile de donner aux automobilistes l’envie de passer d’un véhicule qui peut parcourir 1 000 km sans s’arrêter à un véhicule qui devra être rechargé tous les 100 km.
Les moteurs à hydrogène ne polluent pas certes, mais l’hydrogène qui les alimente se fabrique pour le moment avec de l’électricité, ce qui suppose en amont une centrale
– centrale au charbon en Allemagne et en Pologne. Le gain environnemental pour la planète est donc très faible.
Les véhicules hybrides ne sont pas forcément adaptés aux conditions de roulage européennes alors qu’au Japon, ils se développent bien mieux car la récupération d’énergie de freinage est constante. Rouler avec un véhicule hybride sur une autoroute française, c’est, du fait de la charge supplémentaire d’une soixantaine de kilos du moteur, consommer plus qu’un véhicule à essence, qui lui-même consomme plus qu’un véhicule diesel.
Le diesel a donc un avenir mais nécessite qu’une double convergence, en termes de fiscalité et de pollution, s’opère. Il est difficile toutefois d’établir des délais car dans le domaine automobile, on a toujours une vue déformée. Le plein effet attendu d’une norme ne se fait sentir que vingt ans après qu’elle a été définie étant donné qu’il faut cinq ans pour qu’elle soit appliquée et quinze ans pour que le parc de voitures relevant de la norme précédente soit remplacé. Vous décidez donc aujourd’hui en fonction d’une perception des villes qui reflète des normes vieilles de dix ans. Cette échelle temporelle fausse beaucoup de choses.
En un mot comme en cent, je ne peux pas vous annoncer que le PIA est en train de financer la solution miracle. Je ne pense pas qu’il en existe une.
Monsieur Baupin, entendons-nous bien, j’ai dit que les mille kilomètres d’autoroutes allemandes fixaient la norme de la puissance des voitures. Cette norme ne s’applique pas à tous les véhicules : quand vous achetez une Twingo ou une Dacia, qui n’ont pas été conçues pour circuler sur ces autoroutes, vous ne surpayez pas. Toutefois, on observe que la part des voitures chères augmente : c’est le secteur le plus profitable pour les constructeurs.
Vous voulez que l’industrie automobile sorte du paradigme de la voiture à tout faire. Cela me paraît être une illusion pour 90 % des modèles. Il se trouve que dans une vie antérieure, j’ai eu à négocier avec M. Hayek, le créateur de Swatch, pour la mise au point de la Smart. Son projet partait d’un raisonnement simple : plus de 80 % des trajets en voiture s’effectuent sur de toutes petites distances avec deux personnes au maximum à bord et sans bagages. J’ai dû lui dire que même si je trouvais son idée passionnante, je ne fabriquerais sûrement pas cette voiture car j’y perdrais ma chemise. Et effectivement, Mercedes, vers qui il s’est finalement tourné, a perdu sa chemise en en construisant. Ce qui fait la force de l’automobile, c’est sa polyvalence : certes, la majeure partie du temps, vous l’utilisez seul pour de petits trajets, mais le week-end, en vacances, vous avez la possibilité de profiter de tout l’espace qu’elle contient. La Smart se vend comme deuxième voiture d’une personne seule ou comme troisième voiture d’un couple. La Twizy se rapproche de ce concept mais il faut bien dire que ses ventes restent confidentielles – ce qui était prévisible.
Il me paraît plus performant d’un point de vue environnemental de changer le mode d’utilisation de la voiture que de construire des modèles d’automobiles spécialisés : covoiturage, voiture dont on n’est pas propriétaire, voiture parisienne que vous ne possédez pas et que vous utilisez dans la ville.
Pour les projets d’avenir du PIA, madame la présidente, il est un peu tôt pour établir un bilan. Seuls 12,5 milliards ont été décaissés. Un groupe d’experts extérieurs, que nous n’avons pas choisis, présidé par M. Maystadt, ancien vice-Premier ministre belge et ancien président de la Banque européenne d’investissement, se livre à une évaluation du PIA et rendra ses conclusions avant que ne soit soumis au Parlement un éventuel PIA 3. Par ailleurs, chaque financement dédié à un laboratoire d’excellence, une université d’excellence, un IRT, un ITE est soumis au bout de quatre ans à une évaluation qui n’a rien d’une formalité, je peux vous le dire.
Nous disposons de plusieurs indicateurs qui montrent que les choses évoluent : nombre de start-up créées dans les universités que nous soutenons, nombre de brevets commercialisés dans les instituts de recherche que nous finançons, nombre de publications dans les meilleures revues à comité de lecture. Pour les 170 laboratoires d’excellence que nous finançons, nous constatons que la concentration de l’effort sur les très bons leur a permis de décoller par rapport aux autres et nous espérons qu’il y aura un effet d’entraînement.
Lors de ma rencontre, lundi dernier, avec le président de l’Association française des pôles de compétitivité, nous avons échangé sur la façon de travailler ensemble. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de mettre en place une supervision centrale. Un tri va s’opérer parmi les pôles par une sorte de sélection darwinienne, certains ayant beaucoup de vitalité, d’autres moins. Une administration d’État ne serait pas dans son rôle en désignant ceux qui ont le droit de vivre et ceux qui ne l’ont pas, étant donné que nous ne les finançons pas. Même s’il y a quelques frottements et inefficacités, nous n’avons pas l’impression qu’il y ait beaucoup de redondances : il n’y a pas de projets qui ne soient pas co-financés par les entreprises et les acteurs entrepreneuriaux n’ont pas envie de gaspiller de l’argent.
En revanche, nous réfléchissons, dans la perspective du PIA 3, au développement d’une régionalisation partielle, que nous avons commencé de mettre en œuvre dans le PIA 2. Nous avons mis au point un système de décision au niveau régional dans cinq régions : État et région apportent les mêmes montants, co-décident sur instruction de Bpifrance, et le CGI se réserve trois ou quatre jours de réflexion pour s’assurer que les projets correspondent bien aux critères du PIA – choix par des experts, excellence, coopération et innovation. Ce système fonctionne très bien, du moins dans quatre des cinq régions test puisqu’une région a refusé de s’engager dans ce processus. Nous proposons d’aller beaucoup plus loin dans le PIA 3 avec une enveloppe non plus de 50 millions sur un total de 47 milliards mais de 500 millions sur un total 10 milliards. Ce serait un changement d'échelle significatif, cohérent avec la loi NOTRe. Nous avons constaté que les décisions au niveau régional étaient prises rapidement et efficacement, au plus près du terrain, au plus près des petites entreprises, avec de très bons projets – nous n’avons eu à exercer notre censure que sur deux projets :
Mme la rapporteure. C’était implicite dans vos propos, monsieur Schweitzer, mais je préfère que les choses soient dites clairement : vous considérez bien que l’enveloppe consacrée au sein du PIA aux projets concernant directement ou indirectement l’industrie automobile est suffisante ?
M. Louis Schweitzer. Oui !
Mme la rapporteure. Est-il nécessaire qu’il y ait plus de projets ? Et si oui, comment agir en ce sens ? Vous avez évoqué les problèmes de coopération entre acteurs de la filière. L’exemple d’une technologie nécessitant pour son développement industriel la collaboration de plusieurs partenaires nous a été cité lors d’une précédente audition. Faut-il développer les partenariats entre Renault et PSA ? Est-ce encore possible ?
Vous avez évoqué les conséquences d’une convergence fiscale entre l’essence et le diesel sur le marché de l’occasion. Ne faut-il pas aussi prendre en compte les enjeux d’adaptation industrielle ? Je pense au développement de chaînes de production modulables. Considérez-vous que cette adaptation de l’outil de production industriel appelle un accompagnement public – en dehors du PIA car ce n’est pas son rôle ? Quel serait le bon levier à actionner ?
Vous avez souligné que la généralisation du gaz pour le transport lourd ne vous paraissait pas être une bonne idée. J’aimerais que vous développiez votre point de vue dans la perspective de nos futures auditions.
M. Louis Schweitzer. Comment permettre qu’il y ait plus de projets ? Il s’agit d’abord de faire en sorte que les procédures ne soient pas décourageantes. Il s’agit ensuite de mieux informer : notre notoriété est faible et nos appels à projets sont mal connus. Désormais, chaque appel à projets, document toujours un peu indigeste, est accompagné d’une page de synthèse que l’on diffuse aussi largement que possible, notamment via notre site internet. Il s’agit encore de donner aux entreprises l’envie d’investir et d’innover : beaucoup sont réticentes à la prise de risques. Il s’agit, en outre, de développer dans tous les secteurs l’excellent système mis au point dans le cadre du PIA 2 qui consiste à soutenir les entreprises dans leur croissance étape par étape : soutenir une idée par une subvention de 200 000 euros, aider à la mise au point d’un prototype en allant jusqu’à 2 millions d’euros d’avances remboursables ; puis fournir une aide en fonds propres jusqu’à 20 millions. Nous voulons éviter cette situation où les idées naissent en France et donnent lieu à des créations d’entreprises aux États-Unis ou ailleurs.
Mon expérience de l’automobile me fait dire que les chaînes flexibles ne sont pas une bonne solution au long cours pour les gros volumes, car elles induisent des surcoûts et une perte d’efficacité. Elle peut être intéressante pour les petites séries, par exemple pour la construction de V6 ou V8. Par ailleurs, la flexibilité n’est souvent que théorique : les besoins réels liés à l’innovation supposent des changements qui ne sont pas ceux qui avaient été envisagés initialement. Cela dit, nous soutenons les automatisations dans des domaines où la flexibilité est un atout. Nous aidons ainsi les projets d’usine du futur, mais dans des secteurs où l’on n’est pas, comme dans l’automobile, à 5 centimes près sur le prix d’un moteur
– l’industrie automobile est toujours près de ses sous : gagner un euro par véhicule suppose un énorme effort.
Le gaz est un carburant de complément qui constitue une bonne solution dans les zones de pollution locale importante, en milieu urbain. Il suppose des contraintes techniques : taille du réservoir plus importante, conditions de remplissage plus difficiles, risques d’inflammation dans des zones sensibles comme les tunnels. Et je ne suis pas certain que le bilan CO2 soit si bon, je crois même qu’il est même un peu moins bon que le diesel, si je me souviens bien des données pour les camions aux États-Unis. Certes, la fiscalité appliquée au gaz n’est pas du tout la même que pour l’essence ou le gazole mais il n’y a pas plus de raisons théoriques de défiscaliser le gaz que n’importe quel autre hydrocarbure, à moins qu’il y ait des pénuries. Le gaz ne saurait constituer la solution de référence. Il offre une solution de complément dans les villes : il permet ainsi de dépolluer les bus plus rapidement que le diesel. Par ailleurs, il est un peu moins contraignant que l’électricité.
M. Denis Baupin. Votre réponse à propos de la voiture polyvalente est intéressante. Vous vous placez du point de vue des industriels. J’ai envie de reformuler la question : n’est-ce pas un luxe ? La Dacia, que vous avez citée comme modèle consommant peu, peut atteindre une vitesse maximale de 160 à 180 kilomètres à l’heure alors même que la vitesse est limitée partout en France – même si je sais bien qu’il faut une certaine puissance pour pouvoir doubler trois fois par an sur l’autoroute un véhicule roulant à 130 kilomètres à l’heure. Une enquête parue, il y a quelques jours, dans le magazine L’Automobile, a montré que tous les véhicules testés – et il y en a 1 000 – ont une consommation supérieure de 40 % en fonctionnement normal aux références affichées et même de 60 % pour les véhicules répondant à la norme Euro 6 diesel. Compte tenu des enjeux liés au climat, à la pollution de l’air, à la consommation et donc au pouvoir d’achat, n’y a-t-il pas un plafond de verre qui pousse l’industrie automobile à ne pas vouloir sortir du paradigme de la voiture polyvalente ?
J’entends en partie votre réponse qui consiste à dire qu’il est plus facile de changer les usages de la voiture polyvalente que les modèles eux-mêmes. Mais le changement de mode de vie – qui a paru d’ailleurs auparavant peu envisageable – qui a permis l’essor du covoiturage ne prépare-t-il pas d’autres changements ? Ne pourrait-on envisager d’utiliser pendant l’année une voiture à une ou deux places et d’en louer une autre plus grande pour les vacances ou bien de recourir au covoiturage ? Pourquoi ne pas imaginer d’autres business models et d’autres modèles de mobilités qui répondraient aux enjeux auxquels nous sommes confrontés ?
M. Louis Schweitzer. Je sais d’expérience que les voitures monovalentes ne se vendent pas, monsieur Baupin. Les constructeurs automobiles ont pour métier de vendre des voitures achetables. La Smart répondait à des critères rationnels et devait être, dans l’esprit de M. Hayek, une voiture populaire. Qu’en est-il en réalité ? Elle est le véhicule supplémentaire de gens riches. Le problème n’est pas de nature technique – les constructeurs savent installer des moteurs couchés à l’arrière – mais commercial : il faut pouvoir trouver des clients. L’industrie automobile ne va pas concevoir des voitures dont elle sait qu’elles ne se vendront pas.
M. Denis Baupin. Qu’est-ce qui pourrait contribuer à changer le business model ?
M. Louis Schweitzer. Que les clients aient envie d’acheter des voitures monovalentes !
Ce qui est déterminant pour la plupart des conducteurs, ce n’est pas de pouvoir dépasser les limites de vitesse mais d’avoir un véhicule capable de tenir une vitesse en légère montée avec des temps d’accélération qui ne soient pas ceux d’un train, c’est-à-dire qui ne nécessitent pas d’attendre quatre kilomètres pour rouler à 130 kilomètres à l’heure. Cela suppose fatalement de pouvoir atteindre les 150 kilomètres à l’heure.
Les normes européennes sont ainsi faites qu’il y a toujours un écart entre la pollution réelle et la pollution testée. Il faut établir des conditions de test plus réalistes, ce qui revient à rendre les normes plus sévères.
M. Denis Baupin. Le test portait non pas sur la pollution mais sur la consommation.
M. Louis Schweitzer. Il fut un temps où les constructeurs affichaient des niveaux de consommation très bas car les tests étaient menés avec des essayeurs experts au pied léger qui passaient les vitesses au moment adéquat avec des pneus légèrement surgonflés. Puis, devant les protestations, il y a eu un retour au réalisme. Sont ensuite intervenues les normes de consommation moyennes établies par les autorités européennes : les constructeurs ont eu intérêt à justifier de consommations plus faibles, au risque de payer des amendes et de priver leurs clients d’un régime fiscal plus favorable, et il y a un retour, dans les limites de la loi, à l’optimisation par rapport aux conditions normales de conduite. Ce jeu réglementaire et normatif a sans doute contribué à recréer un écart. Il y aura peut-être un retour de balancier par la suite.
Mme la présidente. Je vous remercie, monsieur Schweitzer, pour toutes vos réponses.
La séance est levée à dix-huit heures quarante.
◊
◊ ◊
8. Audition, ouverte à la presse, de M. Frédéric Dionnet, directeur général du Centre d’étude et de recherche en aérothermique et moteurs (CERTAM), de M. David Preterre, toxicologue et chef de département qualité de l'air, métrologie des nanoparticules aérosolisées et évaluation et de M. Frantz Gouriou, physicien spécialiste de la métrologie des particules fines.
(Séance du mercredi 25 novembre 2015)
La séance est ouverte à onze heures trente-cinq.
La mission d’information a entendu M. Frédéric Dionnet, directeur général du Centre d’étude et de recherche en aérothermique et moteurs (CERTAM), de M. David Preterre, toxicologue et chef de département qualité de l'air, métrologie des nanoparticules aérosolisées et évaluation et de M. Frantz Gouriou, physicien spécialiste de la métrologie des particules fines.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Je souhaite la bienvenue à nos invités. Le Centre d’étude et de recherche en aérothermique et moteurs (CERTAM) est une structure légère. Créé en 1991, il a été conçu comme un pont entre la recherche académique et l’innovation industrielle. Installé dans l’agglomération rouennaise, le CERTAM a été notamment soutenu par la région Haute-Normandie. Il a noué de nombreux partenariats, tant avec le secteur privé qu’avec le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et l’Institut national de la recherche médicale (Inserm). Le CERTAM est également membre de l’Institut Carnot « Énergie et systèmes de propulsion » et du pôle de compétitivité Mov'eo depuis sa création.
Étant donné votre expérience commune et vos spécialisations individuelles, messieurs, les appréciations que vous portez sur les tests d’homologation des véhicules et sur l’efficacité des contrôles techniques obligatoires dans le domaine des polluants à l’échappement intéressent particulièrement notre mission. Le CERTAM, qui dispose de ses propres bancs d’essais moteurs, a-t-il des propositions à exposer ? Avez-vous mis au point vos propres procédures de tests, voire des « contre tests » distincts des tests officiels ?
La mission souhaite vous entendre exposer les avantages et les inconvénients des filtres à particules. Est-ce la seule formule concevable de limitation de la pollution d’un point de vue économique ? Des progrès significatifs ont-ils été réalisés en ce domaine ? Que peut-on dire aujourd’hui du caractère nocif des polluants à l’échappement des véhicules ? La situation s’aggrave-t-elle ou peut-on espérer une dépollution progressive, notamment dans les grandes villes ? En tablant uniquement sur le renouvellement naturel du parc de véhicules, à quelle date approximative commencera-t-on à constater des résultats durables et probants ?
M. Frédéric Dionnet, directeur général du Centre d’étude et de recherche en aérothermique et moteurs. Je vous dirai dans un premier temps ce qu’est le CERTAM. Vous avez rappelé qu’il a été créé il y a vingt-cinq ans à l’initiative du CNRS et du ministère de la recherche et de la technologie, avec le soutien de la région Haute-Normandie. Il s’agissait de monter un centre de recherches technologiques plus appliquées que les recherches fondamentales en combustion conduites par le CNRS dans la région de Rouen. Dans ce cadre, nous avons développé de nouvelles techniques d’évaluation des émissions, qui vont au-delà des mesures physico-chimiques classiques des polluants réglementés
– monoxyde de carbone, hydrocarbures imbrûlés, oxydes d’azote et particules en nombre et en masse. Le partenariat noué il y a plus de dix ans avec l’Inserm nous a conduits à mettre au point un système d’évaluation biologique des émissions.
C’est que la combustion, phénomène éminemment complexe, implique des centaines de réactions d’espèces chimiques qui se font concurrence et émettent non seulement les polluants réglementés déjà cités mais des centaines d’autres espèces, non toujours prévisibles, qui peuvent avoir des effets divers sur la santé humaine. Au terme de discussions avec M. Jean-Paul Morin, scientifique à l’Inserm, il nous a paru intéressant de déterminer le potentiel toxique de ces émissions pour la santé humaine, et nous en sommes venus à développer un système d’exposition in vitro directe d’échantillons biologiques – des tranches de poumon animal en culture organotypique – à des émissions moteur. Nous sommes les seuls au monde à avoir conjugué des équipes de physiciens et de biologistes pour étudier ce phénomène à la croisée des sciences. C’est la grande originalité de notre centre de recherches.
Le CERTAM a aussi développé des compétences relatives à l’évaluation des émissions de polluants tant « classiques » que non encore réglementés. Il nous fallait affiner les mesures pour apprécier comment remédier à ces pollutions et permettre aux industriels chargés de réduire ces émissions d’y travailler.
Notre structure est légère mais nous faisons partie d’un réseau au maillage serré. Nous travaillons avec l’Institut Carnot « Énergie et systèmes de propulsion », dont les recherches fondamentales nous permettent le ressourcement nécessaire à la mise au point de nouvelles technologies et métrologies. Participer au pôle de compétitivité Mov'eo a renforcé nos liens avec l’industrie ; c’est indispensable, car nous ne saurions exercer notre métier sans travailler pour les industriels de l’automobile. Pour rester pertinents, nous ne pouvons demeurer dans un univers strictement universitaire : nous devons suivre les évolutions technologiques, voire participer à leur développement. S’il en était autrement, nous accuserions très vite un retard de cinq ou dix ans. Enfin, parce que nous sommes une structure privée d’une trentaine de salariés, nous vivons des contrats de recherche et développement que nous remportons auprès des industriels du pétrole et de l’automobile et aussi des pouvoirs publics par le biais d’organismes tels que l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ou l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).
Avant qu’avec votre autorisation je reprenne la parole pour répondre à vos autres questions, Frantz Gouriou traitera des avantages et des inconvénients des filtres à particules et David Preterre de la nocivité des émissions.
M. Frantz Gouriou, physicien spécialiste de la métrologie des particules fines. Parce que l’on ne peut stocker indéfiniment les substances issues de la combustion, le post-traitement consiste à les transformer, mais les produits qui résultent de cette transformation ne sont pas obligatoirement des polluants ; c’est ce que nous essayons de déterminer. L’effet des particules sur la santé ne peut être considéré de la même manière que celui des gaz. Nous avons longuement étudié les particules que sont les poussières céréalières, avec l’indicateur de particules en suspension PM10, puis avec l’indicateur PM2,5, meilleur, mais qui devra évoluer – cette évolution a déjà eu lieu pour l’automobile, avec l’introduction du comptage particulaire. Toutes les particules de poussières céréalières n’ont pas la même taille, mais leur diamètre moyen est bien supérieur à celui des particules issues de la motorisation diesel, qui est d’environ un dixième de micron : avec l’indicateur massique PM10, une poussière céréalière correspondra, à iso-masse, à une fourchette de 10 000 à 100 000 particules diesel ; on comprend que l’effet sur la santé ne sera pas le même. De plus, la poussière céréalière, parce qu’elle a un assez gros diamètre, pénétrera, heureusement, assez mal dans l’appareil respiratoire : on admet qu’il y a un tiers de chance qu’elle s’arrête dans les voies supérieures – le nez et la gorge. En revanche, il y a une chance sur deux pour que les particules du diesel gagnent les alvéoles pulmonaires. C’est pourquoi les choses devront évoluer et pour l’automobile et pour les émissions industrielles en cheminées.
Le filtre à particules du diesel est maintenant largement répandu, et c’est heureux. Même si on peut relever quelques travers, il fonctionne globalement bien. Il a d’abord un effet physique : il arrête la matière particulaire. Pendant que le filtre se charge progressivement de particules, les émissions sont pratiquement inexistantes. Les taux d’efficacité varient selon les conditions d’utilisation mais sont extrêmement élevés : de 100 à 1 000, voire 10 000, ce qui signifie qu’il n’y a pratiquement plus aucune matière particulaire à la sortie du filtre. Mais le filtre à particules ne peut stocker la matière indéfiniment ; il doit donc être régénéré. Cela s’obtient par une combustion qui brûle la matière particulaire piégée dans le filtre. Il en résulte du CO2 et de l’eau, et, minoritairement, des polluants en quantité relativement faible du point de vue massique.
On a entendu dire que le filtre à particules ne filtrerait pas les particules les plus fines ; c’est inexact. Lors de la mesure, l’efficacité de la filtration est observée sur toute la gamme de taille des particules solides – la suie de combustion. Mais, à l’échappement d’un moteur, on observe également une très faible fraction d’hydrocarbures imbrûlés qui peuvent condenser, produisant une particule qui n’est plus solide et que l’on ne peut donc considérer de la même manière. L’exemple éloquent de la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle explicitera mon propos. Là-bas, on note assez souvent une forte odeur de kérosène. C’est que les moteurs d’aéronefs n’étant pas à pistons, la combustion est très mauvaise pendant la phase de roulage des avions ; elle produit une forte émission d’hydrocarbures imbrûlés sous forme gazeuse ou partiellement particulaire, particulièrement lorsque la température décroît. Cet aérosol représente des quantités négligeables d’un point de vue massique mais tout à fait mesurables en nombre, et les quantités numériques observées sont extrêmement faibles, très en deçà de ce que l’on mesurerait en amont d’un filtre à particules. J’ajoute que, à la sortie d’un filtre à particules, il n’y a plus la matrice carbonée particulaire – ou alors, elle est très minoritaire –, ce qui facilite l’observation des particules volatiles.
Mais tout n’est pas aussi rose, car la dépollution est un exercice très compliqué. Depuis plusieurs années, David Preterre et moi-même réalisons des mesures sur route avec un véhicule-laboratoire dans les tunnels franciliens – notamment ceux de l’A 86 pour le compte de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France (DRIEA) –, sur les autoroutes, à Paris et en province. Pour les particules de combustion, nous avons observé une diminution d’un bon facteur 2 au cours des cinq ou six dernières années, grâce au renouvellement du parc automobile, qui fait son effet même si cela prend du temps. Cela peut paraître surprenant puisque l’on entend dire pendant les épisodes de pollution qu’il y a de plus en plus de particules en suspension. Il faudra faire évoluer les indicateurs, car les particules de combustion sont actuellement très mal représentées dans l’indicateur fourre-tout PM10 et même dans l’indicateur PM2,5. L’indicateur PM10 mesure des particules qui ont jusqu’à cent fois la taille d’une particule diesel ; on répertorie aussi, concomitamment, les poussières de freinage, d’usures de pneumatiques, ou encore des poussières issues de l’industrie et de la chimie atmosphérique. Cet indicateur, d’une utilisation très difficile, n’est pas intrinsèquement mauvais mais il n’est pas suffisant. Pour avoir une image précise de la filtration des particules issues de la motorisation et de ce que deviennent les polluants automobiles, il faut vraiment passer aux observations numériques.
En résumé, même si rien n’est jamais parfait, les filtres à particules sont des produits efficaces, sur lesquels il n’y a pas beaucoup à redire. Ils ont un coût économique et énergétique puisque le filtre à particules augmente légèrement la consommation en freinant l’échappement, mais tout cela est quantifié. Nous mesurons l’évolution lors des roulages, et nous savons que les choses vont plutôt mieux. En revanche, nous n’observons rien de tel pour les émissions d’oxydes d’azote (NOx) car la dépollution en NOx étant balbutiante, on ne peut bénéficier de l’effet du renouvellement du parc automobile – et nous ne disposons pas de retours à ce sujet, sinon au banc moteur.
M. David Preterre, toxicologue et chef de département Qualité de l'Air, métrologie des nanoparticules aérosolisées et évaluation. Avant d’évoquer les aspects toxicologiques des émissions, je rappellerai comment s’opérait, précédemment, la toxicologie des polluants. Parce qu’il était difficile d’avoir accès à des cellules d’essais moteur de dernière génération et de faire travailler ensemble physiciens et biologistes, les laboratoires achetaient des particules standardisées supposées être représentatives d’émissions du diesel, ou travaillaient sur des gaz synthétiques, et réalisaient des suspensions de particules dont on évaluait la toxicologie en les instillant directement dans des poumons animaux. Mais, dans la réalité, les aérosols ne pénètrent pas de cette manière dans l’arbre respiratoire. Les particules émanant du diesel en suspension dans un liquide, ayant tendance à s’agréger, n’ont plus la même taille, et la biodisponibilité est complétement différente ; de plus, avec ce procédé, on ne respecte pas la dosimétrie à laquelle la population peut être exposée.
C’est pourquoi nous avons décidé, avec le docteur Jean-Paul Morin, il y a une quinzaine d’années, d’ouvrir une antenne biologique au CERTAM, où nous bénéficions des cellules d’essais moteur et où nous avons pu réaliser des cycles conformes à la réalité. Les mesures se font en prélevant continûment les échappements moteur, en les diluant et en exposant directement des cultures organotypiques de poumons animaux à ces émissions, de manière à caractériser, par dosages de marqueurs, leur effet toxique ou leur innocuité.
Cette approche permet des prélèvements en amont et en aval des systèmes de post-traitement et la réalisation d’expositions en parallèle. Ainsi peut-on caractériser l’effet de « stress oxydant » – et, ces dernières années, de « stress génotoxique » – des émissions des différents systèmes de post-traitement et des nouveaux carburants, dans des conditions parfaitement maîtrisées. Le procédé donne très rapidement une vision de l’innocuité ou de la dangerosité supposée d’un système de post-traitement qui transforme des espèces chimiques réglementés en d’autres substances qui ne le sont pas et qui peuvent avoir un effet soit sur l’environnement, soit sur la santé.
Se pose la question de la représentativité des émissions auxquelles les systèmes biologiques sont exposés de la sorte. Nous travaillons en relations étroites avec les constructeurs automobiles. Ils nous fournissent les moteurs et les supports nécessaires à leur fonctionnement dans des conditions représentatives de la réalité, en cycle « homologation » ou en cycle « roulage routier ». Dernièrement, nous avons réalisé une étude pour l’ADEME en prélevant des véhicules dans le parc automobile pour les placer directement sur un banc d’essai à rouleaux. Les émissions sont prélevées à l’arrière des échappements des véhicules conduits par un chauffeur qui suit une trace censée être représentative d’un type de roulage donné. Nous devons nous en tenir à des cycles normalisés. En effet, les expérimentations doivent être reproductibles pour que définir des valeurs statistiques moyennes. L’objet de l’étude est de caractériser l’impact toxicologique lié à l’évolution des normes, depuis les normes Euro 3 jusqu’aux normes Euro 6 ; ses conclusions seront remises à l’ADEME à la fin de l’année.
M. Frédéric Dionnet. Il s’agit donc de vérifier si la transformation des espèces chimiques induite par la réduction progressive des émissions des polluants réglementés imposée par les normes européennes d’émissions dites « Normes Euro » a pour conséquence potentielle la fabrication de substances qui pourraient être moins bonnes pour la santé. Des travaux ont été conduits à ce sujet depuis des années ; dans le cadre du 5e programme-cadre pour la recherche et le développement technologique, des tests ont été menés et validés avec des collègues de laboratoires du monde entier. Nous maîtrisons cette technique complexe. Nous ne nous limitons donc pas à vérifier le respect des seuils réglementaires, nous nous assurons que les technologies mises sur le marché ne sont pas contre-productives. Les conclusions de l’étude ne sont pas encore entièrement dépouillées, mais les premiers résultats, plutôt positifs, montrent l’amélioration du potentiel sanitaire en fonction de l’évolution des normes.
M. David Preterre. La concentration de polluants réglementés chute, mais celle des autres polluants également. Nous sommes parvenus à dissocier l’effet « particule » de l’effet « phase gazeuse » des échappements et nous avons pu observer que le retrait de la phase particulaire diminue le stress inflammatoire observé sur le système biologique exposé. Nous avons aussi observé que l’utilisation de carburants de type bio-fuels provoque l’élévation substantielle des émissions de certains polluants non réglementés, qui peuvent avoir un impact sur certains paramètres biologiques ; ces données doivent être vérifiées.
La catalyse de l’oxydation a été introduite très tôt dans la réglementation européenne – depuis les normes Euro 2 ou Euro 3 pour les moteurs diesel. Un certain reportage diffusé par France 2 avait fait grand bruit, car on y évoquait le potentiel mutagène exacerbé des émissions d’échappement de moteurs diesel non post-traitées. Mais les journalistes avaient omis de préciser que dans les résultats obtenus après post-traitement, l’effet mutagène était très amoindri. Ce reportage inabouti était quelque peu partial.
M. Frédéric Dionnet. Nous sommes en train de diffuser notre savoir-faire technologique en Europe et dans le monde. Nous l’avons transféré à l’Université de Bienne et à celle de Thessalonique, c’est en cours avec l’Académie des sciences de Prague et nous sommes en discussion avec la Chine à ce sujet. Notre objectif est que l’outil soit largement utilisé par les scientifiques du monde entier, avec une harmonisation maximale de manière à pouvoir donner les mêmes types de réponses à des problèmes divers.
Les données permettant de répondre si la situation globale s’aggrave sont en accès libre dans l’inventaire national des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques en France établi par le Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique, opérateur du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. À sa lecture, on constate que les transports routiers constituent une part importante des émissions de CO2, avec 120 millions de tonnes en 2014, soit 28 % des émissions de gaz à effet de serre.
Permettez-moi une incise : il convient de distinguer les émissions de gaz à effet de serre, nocifs pour le climat, des émissions de polluants, toxiques pour la santé. Un motoriste qui réduit les émissions de CO2 augmente les émissions de NOx, et inversement. À un moment, il faut définir une priorité – mais y en a-t-il une ?
Ces 120 millions de tonnes d’équivalent CO2 représentent un accroissement de 19 % entre 1990 et 2013 ; pendant la même période, le trafic routier a augmenté de 34 %. Cela montre qu’un progrès a été réalisé en matière de consommation des véhicules mais qu’il ne suffit pas à endiguer l’augmentation du parc automobile. Le transport routier représente la première source d’émission de gaz à effet de serre ; le résidentiel/tertiaire émet annuellement 70 millions de tonnes d’équivalent CO2, l’industrie manufacturière 80 millions de tonnes.
Les émissions de NOx ont été mises en avant parce que les motorisations diesel en produisent beaucoup. En 2014, le trafic routier dans son ensemble a représenté 54 % des émissions de NOx, mais la tendance est à la décroissance : en 1990, elles s’établissaient à 1,2 million de tonne, et à 0,5 million de tonnes en 2013. Cela s’explique par la mise au point du système de dépollution dit LCR et, plus récemment, du système de recyclage des gaz d’échappement (EGR), encore en cours de développement, qui permet de limiter les émissions de NOx par dilution de la charge carburée.
Les motoristes ont résolu la question des particules par les filtres, je l’ai dit. Comme l’a souligné Frantz Gouriou, l’indicateur PM10 est peu représentatif de ce qu’émet un moteur automobile, puisque l’on trouve dans cette catégorie toutes sortes de poussières et jusqu’au sable saharien. Pour les particules PM1, la chute des émissions est constante : on est passé de 60 kilotonnes d’émissions en 1993 à 18 kilotonnes en 2014. Avec 82 kilotonnes d’émissions sur un total de 129 kilotonnes en 2014, le secteur résidentiel/tertiaire précède largement le transport routier, qui représente 16 % de ces émissions, une proportion relativement faible. Il s’agit là de l’amélioration de la qualité moyenne de l’air dans les villes ; bien entendu, les expositions aux émissions augmentent sur le périphérique parisien et dans certaines rues « canyons » mais, somme toute, elles suivent l’évolution moyenne, qui se traduit par des émissions moins importantes que les années précédentes, même si des pics se produisent. En matière de pollution, la tendance globale est donc à l’amélioration.
D’autre part, les cartes d’émissions qui figurent sur le site Prev’Air montrent le transport de ces polluants, et notamment des particules, à l’échelle continentale. Les mesures permettent de prévoir la pollution atmosphérique à grande échelle et l’on constate que les pollutions aux particules ne sont pas des phénomènes essentiellement locaux ; ils touchent le continent entier. Ainsi, des feux de forêts dans la Ruhr ont pour effet l’apparition de panaches de fumée dans la région parisienne.
Les méthodes de mesure utilisées par le réseau français des 24 associations agréées de surveillance de la qualité de l’air ont changé. L’évolution technologique a permis une approche beaucoup plus fine, et l’on mesure désormais aussi les aérosols liquides de petites particules condensées ; on constate qu’elles contiennent une importante proportion de nitrate d’ammonium, principalement issu des épandages d’engrais, avec des pics en mars.
Toutes ces données sont publiques, mais il est vrai qu’il faut se donner un peu de mal pour aller les chercher sur les différents sites concernés, les rassembler et les analyser. En ma qualité de scientifique, je dirai pour conclure à ce propos qu’en raison de l’accroissement du parc automobile les émissions de CO2 ne sont pas contenues mais que les émissions de polluants semblent l’être, ce qui n’exclut pas l’existence de zones polluées, et qu’il faut y travailler. Donc, le secteur du transport prend en compte le réchauffement planétaire.
En matière automobile, vingt années sont généralement nécessaires à la diffusion large d’une invention. Le processus peut être abrégé par la réglementation et par la fiscalité. Il faut 8,5 ans pour que la moitié du parc automobile soit renouvelé. Aussi, les normes Euro 6, entrées en vigueur en septembre 2015 et qui visent à réduire les émissions de NOx, n’auront d’effet que dans une dizaine d’années. Au décalage dans le temps des conséquences de la réglementation s’ajoute l’effet de l’accroissement du parc automobile. Dans les pays membres de l’OCDE et notamment en France, où la croissance du parc stagne, cet effet est assez peu significatif, mais dans le pays en développement tels que la Chine et l’Inde, on peut s’inquiéter de l’effet de cette augmentation sur la qualité de l’air.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Nous aimerions mieux comprendre le statut juridique du CERTAM, son fonctionnement et son financement. Recevez-vous des subventions ? Pouvez-vous nous en dire davantage sur le rôle que vous jouez auprès des pouvoirs publics ? Parce que vous faites de la recherche appliquée, vous avez qualifié d’« indispensables » vos liens avec les industriels ; êtes-vous pour eux des prestataires de services de recherche ou bien des sous-traitants ? Font-ils appel à vous très en amont, dans la phase de développement de leurs projets ?
Vous avez souligné les réels progrès technologiques de la lutte contre les émissions polluantes ; les moteurs ont-ils la capacité de respecter les normes ?
Quels sont, selon vous, les polluants non réglementés dont les effets sur la santé sont les plus préoccupants et qui, tôt ou tard, seront réglementés ?
Les moteurs fonctionnant à l’essence et à injection directe devraient-ils être obligatoirement équipés d’un filtre à particules ?
L’affirmation selon laquelle les émissions de particules PM10 ont diminué d’un facteur 2 m’a étonnée ; cela ne correspond pas aux données publiées par Airparif. Pourriez-vous nous donner des explications complémentaires ?
Le filtre à particules a-t-il un effet sur les émissions de NOx qui, selon Airparif, ont doublé entre 1998 et 2012 le long du trafic ?
Quelle est l’efficacité comparée des différentes technologies tendant à traiter les émissions de NOx ? Quels sont les effets induits par la transformation et notamment par la production d’ammoniac ?
Enfin, vous intéressez-vous à la motorisation des poids lourds, des véhicules utilitaires et des deux-roues ? Que pouvez-vous nous en dire ?
M. Frédéric Dionnet. Le CERTAM est régi par les dispositions de la loi de 1901 sur les associations, mais il a des salariés et des charges et opère dans l’économie de marché. Nous recevons des subventions dans le cadre des plans État-région successifs ; elles oscillent entre 5 et 10 % de notre budget. Parce que nous appartenons à l’Institut Carnot, nous recevons également des subventions pour l’ensemble de nos contrats de recherche avec l’industrie automobile de l’année N-1 ; elles représentent quelque 4 % de notre budget. Les quelque 90 % restants proviennent des contrats de recherche et développement que nous réalisons pour des tiers, publics ou privés. Ce sont d’une part les industriels de l’automobile et du pétrole ainsi que, de plus en plus souvent, en raison de nos compétence en matière d’aérosols, des laboratoires pharmaceutiques et de cosmétique. D’autre part, nous travaillons bien entendu pour les pouvoirs publics ; ainsi avons-nous réalisé pour la DRIEA d’Île-de-France des mesures de pollution routière dans les tunnels.
Nous entretenons avec les industriels des relations « client-fournisseur » classiques ; le mécénat qui pouvait avoir cours lorsque j’étais au CNRS il y a 25 ans n’est plus ! Les industriels frappent à notre porte en raison de nos compétences spécifiques : parce que nous sommes capables de construire, année après année, une vision de ce que seront leurs besoins de métrologie et que – grâce, notamment, au crédit impôt recherche – nous développons des programmes de recherche en métrologie de dépollution et de consommation qui leur seront utiles dans cinq ou dix ans. Ainsi avons-nous été sélectionnés par un grand groupe industriel, au terme d’une compétition avec d’autres laboratoires européens, pour mesurer l’impact de la qualité de l’huile sur la consommation de carburant. Si nous avons emporté ce marché, c’est que nous sommes très en avance ; le système d’évaluation toxicologique des émissions déjà évoqué nous donne un fort potentiel d’innovation. Nous avons aussi développé des systèmes permettant de mesurer les particules en dynamique dans les cheminées, et nous mettrons bientôt sur le marché un autre système nouveau. Nous devons, pour vivre, mettre au point des produits commercialisables de haut niveau technologique, et pour cela disposer de moyens très importants. Les aides déterminantes de la Région Haute-Normandie et du Fonds européen de développement régional (FEDER) nous ont permis de faire des investissements très coûteux. En ces domaines, la science et les hommes ne suffisent pas ; il nous faut des équipements, et ils sont très onéreux.
Les nouvelles motorisations et les systèmes de post-traitement permettent de diminuer les émissions et de respecter les normes Euro. Les discussions sont permanentes entre les constructeurs et les équipementiers d’un côté et les États d’un autre côté sur ce que doivent être les seuils d’émissions, chacun tirant la corde de son côté. Mon avis de scientifique est que l’on est à peu près à l’équilibre et que les moteurs équipés des systèmes actuellement développés savent passer les normes, en motorisation essence et en motorisation diesel. Mais il reste très compliqué d’y parvenir.
Les technologies de dépollution des émissions des moteurs sont développées depuis 25 ans. Le premier angle d’attaque consiste à améliorer l’aérodynamique interne des chambres de combustion pour favoriser le mélange et permettre une combustion de très bonne qualité. C’est le cas aujourd’hui, si bien qu’un minimum de polluants se forme dans l’échappement, mais il s’en forme néanmoins ; un post-traitement est donc nécessaire. Aussi a-t-on mis au point la « catalyse 3 voies » pour les moteurs à essence. Ce fut un pas en avant très important, mais cette technique ne peut être mise en œuvre pour les moteurs diesel. Cela a conduit à développer le système de réduction catalytique sélective (SCR). Cette nouvelle technologie permet aux moteurs diesel de passer les normes Euro 6. Le CERTAM et les constructeurs consacrent énormément de temps et des fonds considérables à la mise au point des technologies de post-traitement. Cela se répercute dans le prix de fabrication et donc dans le prix de vente des véhicules, qui a augmenté. À la fabrication, le prix d’un système de post-traitement permettant de respecter la norme Euro 6 est de 1 200 euros environ ; à quelque chose près, c’est celui du moteur. Aujourd’hui, la moitié du prix d’un groupe motopropulseur dépollué tient donc à la dépollution. De lourds investissements sont nécessaires pour parvenir à dépolluer les moteurs automobiles et les mettre en conformité avec les normes Euro, mais le sujet, comme il se doit, n’a pas été pris à la légère.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Les moteurs actuels respectent-ils la norme Euro 6 ou ne la respectent-ils pas ?
M. Frédéric Dionnet. Les moteurs les plus récents en ont la capacité technique. Ensuite, si des manipulations ont lieu, cela sort de mon domaine…
Savoir quels polluants non réglementés il faudrait surveiller est une question épineuse. Cette interrogation nous a poussés il y a 15 ans de mettre au point un système permettant d’avoir une idée du potentiel de l’effet biologique des émissions sur la santé. On commence à avoir les idées plus claires et l’on sait que les polluants mis en exergue par la réglementation ne sont pas forcément les plus pertinents. Il existe de grandes familles de polluants, notamment les produits pro-oxydants, tel le NO2, qui sont susceptibles de provoquer l’oxydation des systèmes biologiques et en conséquence leur vieillissement prématuré. Cet effet est amoindri par la SCR pour les émissions des moteurs diesel et par l’une des voies de la catalyse à 3 voies pour les moteurs à essence. Mais ces post-traitements peuvent eux-mêmes entraîner la formation de substances – ainsi de l’ammoniac lors de la réduction catalytique sélective, comme vous l’avez souligné. Les dosages à opérer sont donc délicats, mais ils commencent à être bien au point ; cependant, dans les phases transitoires
– quand on lève le pied ou quand on appuie sur l’accélérateur – les ajustements peuvent être imparfaits et des dégagements d’ammoniac peuvent se produire. Pour parer à ces débordements, on combine un SCR et un système réducteur de l’ammoniac résiduel, dit ASL. Cela explique le prix très élevé d’un système complet de dépollution de moteur diesel.
Au nombre des polluants non réglementés à surveiller, on citera l’acétaldéhyde et le formaldéhyde, produits que l’on rencontre de manière significative dans les émissions de certains bio-carburants. Les bio-carburants ont l’avantage que leur production crée des puits de carbone, mais leur combustion peut créer des substances de ce type. C’est encore plus vrai pour les huiles végétales. D’une manière générale, on subit des espèces chimiques produites dans la chambre de combustion et on les post-traite au mieux.
La technologie du moteur essence et à injection directe a été beaucoup travaillée il y a plusieurs années pour limiter la consommation de carburant. Les progrès technologiques réalisés depuis lors ont incité à reprendre cette voie, mais l’on se rend compte que, comme pour les technologies du diesel, cela conduit à l’émission de particules de combustion – en bien moins grand nombre qu’avec un moteur diesel, mais un peu plus que pour un moteur à essence équipé d’un filtre à particules. La question se pose donc de la nécessité d’un filtre à particules pour ce type de moteurs.
M. Gérard Menuel. Quel regard porter sur l’utilisation de bioéthanol ? Peut-on envisager la montée en puissance des bio-carburants, dont la fiscalité permet un gain important pour le consommateur ? Dans un autre domaine, le CERTAM travaille-t-il en réseau avec des laboratoires d’autres pays européens ?
M. Frédéric Dionnet. La culture des plantes destinées à la fabrication de bioéthanol crée des puits de carbone, ce qui est une bonne chose ; je n’entrerai pas dans le débat relatif aux utilisations concurrentes des terres arables. Dans tous les cas, il faut être attentif aux espèces produites lors de la combustion de ces carburants et les exploiter au mieux. De plus, pour que la combustion soit au meilleur de son rendement, il faudrait modifier le taux de compression selon le taux d’octane des carburants. Or, pour que les moteurs bicarburation puissent brûler et l’éthanol et l’essence, qui sont disponibles en même temps à la distribution, on est contraint à une cote mal taillée. On résoudra ce problème par le moteur à taux de compression variable. Cette grande innovation née en France et en cours de développement par la société MCE-5, permettra de brûler des carburants dont les taux d’octane sont très différents, dans des moteurs à allumage commandé de toutes sortes. C’est très intéressant pour les pays en développement, où l’offre de carburants est très variée.
M. Frantz Gouriou. À propos de la diminution des particules de combustion, je souligne que les mesures auxquelles j’ai fait référence ont été effectuées dans des tunnels routiers, lieux où elles sont présentes en grand nombre. L’intérêt de ces mesures est de fournir une image immédiate de ce qu’émettent les véhicules. D’autre part, nous n’avons pas mesuré les PM10 mais les PM1, à la fois parce que les particules de combustion étant ultrafines l’indicateur PM10 n’est pas le bon et parce que nous ne sommes pas capables de mesurer les PM10 lors des roulages. On note par ailleurs que, dans la fraction PM10, les quantités d’émissions dues à la friction des organes de freinage et à l’usure des pneus sont du même ordre, bien que les concentrations particulaires soient beaucoup plus faibles, le diamètre de ces particules étant beaucoup plus grand.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Travaillez-vous sur les particules issues du freinage ?
M. Frantz Gouriou. Nous avons engagé un projet qui vise à les quantifier.
M. Frédéric Dionnet. Il n’y a pas de grandes différences technologiques dans les systèmes de dépollution selon qu’il s’agit de moteurs de voitures particulières ou de véhicules utilitaires. Les moteurs de poids lourds ont de l’avance en matière de dénitrification – « dé-NOx » –, et ceux des voitures particulières, principalement sous l’impulsion de PSA, pour les filtres à particules.
M. Frantz Gouriou. Les poids lourds roulent depuis longtemps avec une catalyse à l’urée car elle est plus facile à mettre en œuvre pour les véhicules qui font plutôt des trajets routiers que des trajets urbains.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Pourriez-vous préciser le lien entre filtre à particules et production de NOx ?
M. Frédéric Dionnet. Il y a des années, on avait entrepris de régénérer les filtres à particules en installant un catalyseur d’oxydation. Ce procédé a été abandonné car il provoquait l’émission de dioxyde d’azote. Les technologies actuelles sont soit la catalyse, soit le filtre à particules à régénération continue mis au point par PSA. Dans ce système, l’injection d’oxyde de cérium a pour effet d’abaisser la température de brûlage des particules, qui deviennent ainsi plus facilement combustibles, ce qui réduit les émissions de NOx.
De manière générale, le filtre à particules a réduit les émissions de NOx : les moteurs émettent plus de particules mais elles sont piégées, ce qui a permis un réglage plus sévère des émissions de NOx à la sortie des chambres de combustion. Le même processus vaut aujourd’hui pour la réduction catalytique sélective : elle est potentiellement émettrice de NOx mais, parce qu’elle réduit la consommation des moteurs, elle diminue les émissions de CO2, qui sont désormais post-traitées.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Pour nous résumer, est-ce qu’un moteur équipé d’un filtre à particules mais non d’un système de traitement des NOx conduit à la production de plus de dioxyde d’azote qu’un moteur sans filtre à particules ?
M. Frédéric Dionnet. Non.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Messieurs, je vous remercie.
La séance est levée à midi cinquante-cinq.
◊
◊ ◊
9. Audition, ouverte à la presse, de M. Laurent Benoit, président-directeur général de l’UTAC-CERAM et de Mme Béatrice Lopez de Rodas, directrice de la marque « UTAC ».
(Séance du mercredi 25 novembre 2015)
La séance est ouverte à seize heures dix.
La mission d’information a entendu de M. Laurent Benoit, président-directeur général de l’UTAC-CERAM et Mme Béatrice Lopez de Rodas, directrice de la marque « UTAC ».
Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente. Nous recevons M. Laurent Benoit, président-directeur général du groupe UTAC-CERAM (Centre d’essais et de recherche appliqués à la mobilité), une structure privée se déclarant indépendante, héritière de l’Union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), créée en 1945. M. Benoit est accompagné par Mme Béatrice Lopez de Rodas, directrice de la marque « UTAC ».
L’UTAC est un organisme connu et reconnu dans le milieu de l’automobile pour ses activités tenant à l’homologation, à la certification ainsi qu’aux expertises et essais sur véhicules.
Nous vous demanderons, madame, monsieur, de nous préciser, en premier lieu, les caractéristiques de chacune de ces activités et en fonction de quelles bases réglementaires elles s’exercent. On peut légitimement penser que, pour l’homologation des véhicules neufs, l’UTAC intervient dans le cadre d’une sorte de délégation de service public, donc qu’elle est placée sous une ou plusieurs tutelles ministérielles. D’ailleurs, l’UTAC est-elle en situation de monopole pour l’homologation de véhicules des constructeurs français, au moins pour leur mise en circulation sur le marché national ? Ou bien une concurrence existe-t-elle dans un cadre européen entre organismes comparables ?
L’affaire Volkswagen a mis en lumière, aux États-Unis, des fraudes de la part de ce groupe, du moins jusqu’aux révélations d’organisations non gouvernementales (ONG) et de milieux universitaires. Parmi les premières réponses apportées à cette affaire, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a chargé l’UTAC d’une opération de vérification du respect des normes d’émission à l’échappement sur une centaine de véhicules tirés au sort, donc a priori non directement fournis par les constructeurs. Comment avez-vous procédé et sur la base de quel protocole technique ? Il semble que les premiers résultats confirment les défaillances mises à jour outre-Atlantique ; la question est de première importance car plus de 900 000 véhicules concernés par ces fraudes auraient été commercialisés en France par le seul groupe Volkswagen.
En outre, deux organismes placés dans le cadre des activités de l’UTAC peuvent retenir l’attention de notre mission.
Le premier est l’Organisme technique central (OTC) dont les pouvoirs publics ont conféré la gestion à l’UTAC. Cette structure a pour vocation de recenser, au plan national, les résultats du contrôle technique obligatoire, d’abord pour les véhicules légers puis, plus récemment, pour les poids lourds. L’UTAC ou l’OTC ont-ils formulé des propositions de réforme à partir des résultats des contre-visites pour défauts constatés en matière de pollution moteur ? D’après les rapports annuels de l’OTC, ce motif de contre-visite existe bien mais il arrive loin après les défaillances constatées sur les pneumatiques, l’éclairage ou le freinage. Comment cela s’explique-t-il ? Que mesure-t-on en matière de pollution lors d’un contrôle technique ? Quelle est la différence avec les normes requises pour l’homologation d’un véhicule neuf ?
Le second organisme est le Bureau de normalisation automobile (BNA), initialement créé par les constructeurs en 1927. Dans le domaine des émissions à l’échappement, le BNA a-t-il été amené à faire des propositions techniques ou réglementaires aux pouvoirs publics ? Enfin, au titre de sa mission d’assistance des industriels et des administrations, a-t-il été impliqué dans les négociations conduites à l’échelon européen et qui ont abouti, le 28 octobre dernier, à de nouvelles normes assorties d’un calendrier de transition ?
M. Laurent Benoit, président-directeur général de l’UTAC-CERAM. L’UTAC est en effet une société privée qui réalise 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et travaille avec de nombreux clients puisque ses activités sont très diverses, qu’il s’agisse de l’homologation – son activité historique, qui représente de 15 à 20 % du chiffre d’affaires de l’entreprise –, du contrôle technique, des essais – soit plus de la moitié du chiffre d’affaires –, mais aussi de l’événementiel – nous louons nos deux circuits automobiles à l’occasion du lancement de nouveaux produits, ou bien, sur l’autodrome de Linas-Montlhéry, nous faisons revivre les grandes heures de la course automobile… Nous nous déployons en outre au niveau international et sommes implantés en Russie et en Chine notamment, surtout dans le cadre de notre activité d’homologation.
Le BNA, par ailleurs, logiquement rattaché à l’UTAC, s’occupe des normes, comme lorsqu’il s’est agi de la standardisation, au niveau européen, des charges des véhicules électriques – Allemands et Français s’étaient affrontés sur la question de savoir quelle était la bonne prise – au passage : nous avons perdu. Nous évoquerons aujourd’hui devant vous davantage la réglementation, sur laquelle s’appuie, précisément, l’homologation. Nous disposons d’un service dédié, la réglementation étant une activité spécifique.
Nous avons, je l’ai dit, deux circuits automobiles, l’un, donc, à Linas-Montlhéry, créé en 1924, où se trouvent également des laboratoires techniques développés par l’UTAC arrivée en 1945 ; l’autre centre, situé à Mortefontaine, à côté de Senlis, dans l’Oise, est avant tout un circuit automobile fondé par la société SIMCA en 1956.
Je précise pour finir que le groupe compte 360 collaborateurs.
Mme Béatrice Lopez de Rodas, directrice de la marque « UTAC ». Nous sommes chargés des activités de réglementation et d’homologation – c’est le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, par le truchement de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE) de l’Ile-de-France et, en son sein, du Centre national de réception des véhicules (CNRV), lui-même dépendant du Service énergie, climat, véhicules (SECV), qui délègue l’autorité d’homologation.
L’UTAC est par conséquent le service technique désigné par les autorités françaises pour réaliser les essais d’homologation dans le cadre des réglementations européennes. Après les essais, nous rédigeons un rapport accompagné d’un dossier technique et le transmettons au CNRV qui signe les fiches d’homologation en vue de la commercialisation des véhicules.
En France, nous sommes le seul service technique mais il faut savoir qu’une homologation délivrée par un État membre de l’Union européenne (UE) est valable dans les vingt-sept autres.
M. Laurent Benoit. J’ajoute que cela signifie que les constructeurs français ne sont pas obligés de passer par nous.
Mme Béatrice Lopez. C’est d’ailleurs le cas avec les groupes PSA et Renault auxquels il arrive d’aller dans d’autres pays membres de l’UE pour faire homologuer leurs véhicules – je pense à la Roumanie, à l’Espagne… Donc un constructeur n’est pas lié à un pays en particulier.
M. Laurent Benoit. Reste que nous réalisons la majorité des homologations pour PSA et Renault. Cela s’explique par notre proximité géographique : nous sommes à Montlhéry et Renault à Lardy, c’est-à-dire à 10 ou 15 kilomètres et PSA à Vélizy-Villacoublay, soit à 25 ou 30 kilomètres ! Il est dans l’intérêt pour le constructeur d’être proche de nos centres pour homologuer ses prototypes. Le fait que la qualité de nos services techniques soit connue et reconnue compte également.
Mme Béatrice Lopez. Pour ce qui est de la concurrence, on entend souvent que nous subissons une pression de la part des constructeurs pour délivrer des homologations. Il faut savoir que nous appliquons les textes. Certes, tout texte est interprétable et il est vrai que certaines autorités en ont une lecture différente. Cela étant, s’il n’est pas exact que nous subissions une pression, on nous fait valoir que telle autorité interpréterait le texte de telle manière. Or, j’y insiste, nous nous en tenons strictement à la réglementation et ce n’est pas l’UTAC seule qui décide de la lecture des textes, nous le faisons en lien avec le ministère en charge de l’écologie et de l’environnement.
Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente. Vous venez de préciser que les constructeurs peuvent aller faire homologuer leurs véhicules dans n’importe quel pays de l’Union européenne (UE). Les sociétés chargées de l’homologation sont-elles soumises aux mêmes exigences, aux mêmes normes que vous ? Cette question me préoccupe quelque peu.
Mme Béatrice Lopez. La norme en question est européenne et identique pour tout constructeur désireux de commercialiser ses véhicules en Europe. Certains services peuvent se révéler plus cléments lorsque sont en jeu de nouvelles technologies qui ne sont pas forcément prises en compte par la réglementation – les premières évoluant parfois plus vite que la seconde.
Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente. Et vos services, concernant ces nouveautés, appliquent-ils immédiatement la réglementation, en vue de l’homologation ?
Mme Béatrice Lopez. Tout dépend de la nouveauté …
Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente. Donnez-nous un exemple.
Mme Béatrice Lopez. Le décalage que je mentionnais vaut rarement pour tout ce qui concerne les émissions polluantes – nous parvenons, en la matière, à bien encadrer l’exercice. Je pensais davantage à des domaines comme la signature lumineuse où la conception va parfois loin dans l’innovation, le constructeur souhaitant alors faire homologuer une nouvelle technologie qui n’est pas encore autorisée par la réglementation. Aussi, certaines autorités accepteront quand d’autres ne le feront pas. En cas d’acceptation, la directive qui encadre les exercices d’homologation prévoit qu’on ne saurait homologuer une innovation qui présenterait un quelconque risque en matière de sécurité et en matière d’environnement. On peut homologuer une innovation et ensuite demander des amendements au texte.
M. Laurent Benoit. J’ajouterai que la Commission européenne s’est saisie de l’affaire et a examiné la qualité des services techniques. Nous disposons de l’expertise nécessaire pour réaliser les essais dans nos laboratoires. Nous avons une autre expertise
– reconnue au plan international – en matière de réglementation : nous allons défendre la réglementation future dans l’ensemble des domaines liés au secteur automobile aux niveaux européen et mondial. Je précise à cet égard que si le label Technischer Überwaschungs Verein (TÜV), en Allemagne, est gage de sérieux, il n’en va pas de même pour certains services techniques dans d’autres pays qui n’ont pas de laboratoire et ne travaillent pas sur la réglementation européenne et pour lesquels un « ménage » s’imposerait.
Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente. Ce que vous dites là est important, pouvez-vous aller plus loin dans vos explications ?
Mme Béatrice Lopez. Il existe deux instances réglementaires : l’Union européenne à Bruxelles et l’Organisation des nations unies (ONU) à Genève. Au sein de l’UE, différents comités réunissant les industries, les ONG, les fédérations, élaborent les textes qui ensuite sont examinés par le Conseil européen et par le Parlement européen. À Bruxelles, nous discutons surtout de la partie politique et des spécificités européennes. À l’ONU, nous travaillons davantage sur les procédures, les essais. L’UE et l’ONU tendent à se rapprocher en ce qui concerne les procédures d’essais. À Genève, la Commission européenne représente les 28 États membres, aux côtés des autres parties contractantes : Japon, États-Unis, Chine, Inde … Je précise que, n’étant pas autorisés à voter les textes, nous agissons en tant qu’experts techniques auprès des autorités françaises.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Pouvez-vous nous indiquer le coût d’une homologation pour un constructeur ? Je souhaite une réponse très précise. Ces coûts sont-ils identiques pour les différents services d’homologation des différents pays européens puisque vous évoquiez la possibilité pour un constructeur de faire homologuer ses véhicules dans son pays ou un autre au sein de l’UE ?
L’UTAC a-t-elle homologué des véhicules des marques Audi, Skoda, Seat, Volkswagen et Porsche, toutes concernées par la fraude au dioxyde de carbone par rapport à la norme européenne ?
Avez-vous déjà refusé d’homologuer un véhicule ? Il est de notoriété publique qu’existent des pratiques d’optimisation des tests dans la perspective d’une homologation ; aussi, de quelles garanties déontologiques pouvez-vous vous prévaloir dès lors qu’à ma connaissance l’actionnaire principal de l’UTAC est le Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA) ? Cette question ne vaut pas que pour l’UTAC, d’ailleurs, mais pour l’ensemble des organismes européens de certification, dont la situation est comparable.
Enfin, j’ai noté avec grand intérêt quelles étaient les parties prenantes au sein des comités qui, à Bruxelles, discutent des textes. En effet, la Commission européenne refuse d’en communiquer la liste aux députés français !
Mme Béatrice Lopez. Quand vous souhaitez connaître le coût d’une homologation, s’agit-il du coût d’une homologation consommation-émissions ou bien le coût global d’une homologation ?
M. Laurent Benoit. C’est très compliqué.
Mme Béatrice Lopez. Il existe en effet 70 réglementations et je serais incapable de vous donner le coût de chacune.
Mme la rapporteure. Et en ce qui concerne les émissions polluantes ?
Mme Béatrice Lopez. Le coût d’un test d’émissions sur un banc à rouleaux est difficile à évaluer car le véhicule peut passer en une fois ou, si l’on n’atteint pas tel pourcentage de la valeur limite, on procède à un deuxième voire à un troisième essai, la moyenne de ces trois essais devant être inférieure à la limite.
Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente. Vous avez tout de même un ordre d’idée…
Mme Béatrice Lopez. Il faut tenir compte d’autres essais préalables : il faut caler le véhicule avant l’essai d’émissions, il faut mesurer la résistance à l’avancement sur piste… Aussi, je dirais : quelques milliers d’euros. Nous vous communiquerons de toute façon les données que vous souhaitez.
M. Laurent Benoit. Selon moi, il s’agirait de plus de 10 000 euros au total.
Mme Béatrice Lopez. C’est qu’il y a, en effet, comme je viens de l’indiquer, toute une série d’essais à réaliser avant l’essai proprement dit.
Mme la rapporteure. Il serait utile, pour les travaux de la mission d’information, que vous nous communiquiez le détail des coûts depuis le point de départ jusqu’au point d’arrivée.
M. Laurent Benoit. Il est rare qu’un véhicule soit totalement nouveau, que la plateforme soit nouvelle, le moteur soit nouveau… On reprend donc, en général, des parties existantes. Nous pourrons donc plus facilement vous communiquer des données dans l’hypothèse où tout est nouveau.
Mme Béatrice Lopez. Je précise, pour votre compréhension, que l’essai est le même pour mesurer la consommation et les émissions de polluants.
Avons-nous déjà refusé des homologations ? La réponse est : oui. Si le véhicule ne respecte pas les limites fixées par la réglementation, il sera de toute façon refusé. Le constructeur reprend alors le véhicule, effectue de nouveaux réglages et reviendra et finira par passer, en tout cas pour ce qui concerne les émissions. Pour ce qui est de la consommation, nous vérifions à 4 % près la valeur de consommation déclarée par le constructeur.
Mme la rapporteure. Le dossier d’homologation est-il public ?
Mme Béatrice Lopez. Il n’est pas public mais vous pouvez, je suppose, l’obtenir auprès des autorités françaises.
Mme la rapporteure. Ce point reste à vérifier : j’ai entendu dire qu’il y avait un débat assez dur à propos de la communication de ces informations, notamment pour des raisons de concurrence entre constructeurs.
Mme Béatrice Lopez. Nous ne sommes pas habilités, en effet, à divulguer ces données ; mais une fois que le véhicule est commercialisé, je ne vois pas pourquoi ces informations devraient rester confidentielles.
M. Laurent Benoit. En matière de sécurité, si le véhicule ne respecte pas la réglementation, le constructeur le reprend, ce qui occasionne des retards. J’ignore si Renault ou PSA ont décidé de lancer le Kadjar, mais il finira bien sur le marché, même avec six mois de retard à cause de la nécessité de l’améliorer s’il ne satisfait pas aux normes. Aucun constructeur ne bénéficie d’un quelconque passe-droit. Aucune homologation de l’UTAC n’a jamais été remise en cause, ce qui montre bien la qualité des dossiers que nous élaborons.
Par ailleurs, pour répondre à une autre de vos questions, nous n’avons malheureusement pas homologué de véhicule Volkswagen – que nous aimerions bien avoir pour client, indépendamment de l’affaire qui a éclaté il y a peu… Ce sont probablement les TÜV qui ont homologué Volkswagen et nous n’aurions pas, a priori, mieux décelé qu’eux la fraude aux émissions d’oxyde d’azote (NOx) puisqu’il s’agissait, pour le constructeur, de faire en sorte que le service réglementaire ne voie pas la fraude.
Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente. Ce n’est pas rassurant.
Mme Béatrice Lopez. Vous avez également évoqué l’optimisation. Elle est permise par les textes en vigueur et pratiquée, par conséquent, légalement : des tolérances sont admises pour certains paramètres d’essais. La Commission européenne s’est emparée du sujet afin de limiter cette flexibilité et c’est pourquoi nous travaillons, depuis 2009, sur cette fameuse procédure Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures (WLTP), laquelle devrait être adoptée début 2016. La tâche est d’autant moins facile que nous sommes vingt-huit autour de la table : industrie, services techniques, laboratoires, experts, ONG… Aussi cette nouvelle réglementation sera-t-elle le fruit de compromis environnementaux, techniques, politiques…
Quant à la Real Driving Emission (RDE), elle doit permettre de mesurer les émissions polluantes en conduite réelle. Ce type d’essai est complètement différent des essais sur banc à rouleaux. On ne pourra jamais obtenir de coefficient 1, à savoir l’équivalence des essais sur banc à rouleaux et des essais en conduite réelle : c’est techniquement impossible puisque l’environnement extérieur, pour ceux-ci, va influer sur la mesure, qu’il s’agisse du vent, de la température, du revêtement, de la façon dont le véhicule est conduit…
Mme la rapporteure. J’en reviens à ma question relative à la garantie d’indépendance de l’homologation, étant donné que votre organisme, comme ceux qui lui sont comparables dans les autres pays européens, sont la propriété des constructeurs.
M. Laurent Benoit. Nous réalisons les dossiers mais nous ne les validons pas nous-mêmes ; c’est en effet le rôle du CNRV qui dépend lui-même de la DRIEE et qui est donc un organisme public – et nous travaillons en bonne intelligence avec le CNRV.
Mme Béatrice Lopez. Avant tout essai d’homologation nous avons des discussions avec le CNRV : nous nous mettons d’accord sur le type de véhicule à tester et dans quelle configuration. Ce dialogue se poursuit après que nous leur avons fourni les résultats des essais et le dossier, afin que nous signifiions éventuellement au constructeur ce qui ne va pas. Nous sommes donc bel et bien contrôlés par les autorités.
Mme la rapporteure. De quelle manière la désignation de tel ou tel organisme comme service technique est-elle matérialisée juridiquement ?
Mme Béatrice Lopez. C’est un arrêté qui le fixe.
M. Laurent Benoit. Je reviens sur votre question initiale concernant notre indépendance. L’UTAC est une union de syndicats liés à la mobilité comme le CCFA, donc, mais également la Fédération des industries des équipements pour véhicules (FIEV), les syndicats représentants les deux roues, les trois roues, les carrossiers… Or le budget de l’UTAC n’est pas financé par des cotisations de ces syndicats, mais par la vente de prestations à des clients. PSA et Renault représentent ainsi 12 ou 13 millions d’euros sur les 50 milliards de chiffre d’affaires de l’UTAC. Nous leur vendons tous types de prestations – événementiel y compris. Nos bénéfices sont destinés à l’autofinancement de notre croissance et il n’y a aucun flux financier avec les syndicats en question. Notre façon de travailler est en outre contrôlée par un comité technique. Le fait que nous soyons une union de syndicats présente plusieurs avantages dont celui de ne pas être opéable, ce qui garantit notre complète indépendance.
Mme la rapporteure. Selon mes informations, l’UTAC-CERAM serait une société anonyme par actions simplifiée (SAS) avec un actionnaire unique, en l’occurrence le CCFA.
M. Laurent Benoit. Non. L’UTAC est bien une union de syndicats. Reste que parmi ces derniers figurent effectivement des SAS, des sociétés commerciales – nous devons pouvoir vendre nos prestations. Au sein du conseil d’administration, le CCFA est minoritaire en voix.
M. Denis Baupin. Est-ce votre organisme qui a réalisé l’homologation de la Renault Espace diesel ? Que pensez-vous dès lors, question subsidiaire, des révélations d’une ONG allemande dont on parle depuis un peu moins de vingt-quatre heures ? Avez-vous des éléments à ce sujet et vous paraissent-ils crédibles ? Si oui, y a-t-il eu une réelle optimisation ou bien un trucage, s’il s’avérait en effet que les véhicules en question émettaient 25 fois plus de NOx qu’annoncé, selon ladite ONG ?
Ensuite, une enquête du magazine Auto Plus a mis en évidence des écarts très significatifs – 40 % en moyenne – entre la consommation des véhicules révélée par les tests et celle constatée. Avez-vous des éléments d’information sur la façon dont a été réalisée cette enquête ?
Plus globalement, on admet désormais que tout le monde – du moins dans un cercle relativement restreint dont le consommateur était exclu – savait qu’il existait un écart entre les résultats des tests et la réalité du fonctionnement du véhicule. Dans la mesure où de nombreuses données issues de vos tests restent confidentielles, la rapporteure l’a rappelé, trouvez-vous normal que, lorsque l’on vend un véhicule à un client, on affiche une consommation – homologuée – dont vous admettez pourtant clairement que les critères ne sont pas représentatifs du fonctionnement du véhicule ? N’y a-t-il pas là un problème éthique ? Ne devrait-on pas prévoir des règles interdisant au constructeur de se prévaloir de chiffres qui relèvent presque de la publicité mensongère, quitte à prévoir des clauses selon lesquelles il conviendrait de déclarer que la réglementation n’a pas été enfreinte mais que les chiffres annoncés ne correspondent pas vraiment à la réalité ?
Visiblement, afin de rassurer les consommateurs, PSA a décidé de s’associer avec l’ONG Transport & Environnement pour réaliser des tests sur ses véhicules. Avez-vous des informations à ce sujet ? Ces tests sont-ils différents de ceux que vous pratiquez, sont-ils plus crédibles parce que réalisés par une ONG ?
À la suite du scandale de Volkswagen, l’idée d’une agence d’homologation européenne est en discussion. Quel est votre avis sur un éventuel passage à un autre statut ?
Enfin, l’UTAC reçoit l’ensemble des données des contrôles techniques des véhicules. Il y a là une matière gigantesque à même de contribuer à la compréhension de la vie des véhicules. Selon vous, sans révéler d’informations confidentielles, dans quelle mesure la mission pourrait-elle enquêter sur ces données ?
Mme Béatrice Lopez. Pour ce qui est des écarts constatés entre la consommation affichée à la suite des tests et la consommation réelle, je puis affirmer qu’en trente ans de métier, jamais il n’a été avancé que les mesures réalisées en laboratoire seraient représentatives de la réalité. J’ai été interrogée sur le sujet il y a trente ans et je déclarais la même chose. Les essais faits en laboratoire le sont à des fins de comparaison entre véhicules. Encore une fois, des paramètres maîtrisés en laboratoire ne le sont pas en service réel. La nouveauté concerne plutôt les émissions polluantes.
Nous avons découvert dans la presse ce qui a été révélé sur le Renault Espace. Nous souhaitons nous assurer que le protocole utilisé est bien le même que lors de l’homologation. J’y insiste : avant l’essai sur banc, il convient de réaliser d’autres essais – dont il s’agit ici de savoir s’ils ont bien été effectués.
M. Laurent Benoit. En effet, l’Espace a été « épinglée », vous y avez fait allusion, par l’ONG Deutsche Umwelthilfe (DUH) qui se dit sérieuse et qui avait déjà « épinglé » l’Opel Zafira, ces deux véhicules devant d’ailleurs passer en phase 2 chez nous. Ignorant le protocole suivi par DUH, nous ne savons pas ce qu’il vaut mais il n’y a pas de raison, si cette association a trouvé quelque chose, que nous ne le trouvions pas à notre tour.
Mme Béatrice Lopez. Je vous donnerai la même réponse à propos de l’enquête du magazine Auto Plus : nous ne connaissons pas les protocoles utilisés. Il est prévu de prendre contact avec eux pour connaître leur méthodologie. En attendant, nous ne pouvons pas juger des écarts observés.
M. Laurent Benoit. L’association Global New Car Assessment Program (Global NCAP) mène une réflexion au niveau européen sur ces questions touchant à l’environnement, dans le but, éventuellement, de définir une sorte de protocole, de Green NCAP plus précis que la réglementation et plus proche de la réalité.
Euro NCAP, le programme d’évaluation européenne des automobiles, organisme international indépendant, est plus sévère que la réglementation en vigueur. Le protocole d’Euro NCAP est très sérieux en matière de sécurité.
Mme la rapporteure. Dans quelle mesure peut-on considérer que l’intransigeance du contrôle d’homologation est plus stricte, aujourd’hui, pour ce qui concerne la sécurité du véhicule, qu’en ce qui concerne la pollution ?
Dans le cadre de vos conseils aux autorités françaises, avez-vous recommandé le dépassement de 110 % de la norme NOx entre 2017 et 2019 et de 50 % à partir de 2020, critères retenus le 28 octobre dernier par la Commission européenne ?
Pourriez-vous en outre répondre aux questions de la présidente et de M. Baupin sur le contrôle technique ? Vous avez un rôle de collecteur des données – que nous allons demander aux bons interlocuteurs – mais également un rôle quant aux méthodes de contrôle, quant à l’information et à la formation des contrôleurs…
Enfin, on nous a affirmé, d’un côté, qu’il fallait procéder à un travail de démontage coûteux pour vérifier qu’il y a une triche ou non, au moment du contrôle technique des véhicules censés être équipés d’un filtre à particules, quand d’autres nous ont déclarés que cette vérification ne figurait pas au nombre des critères de contrôle.
Mme Béatrice Lopez. Les critères d’homologation sont les mêmes en matière de sécurité et en matière d’environnement. Il s’agit des deux critères principaux retenus par la directive-cadre 2007/46/CE.
En ce qui concerne la décision du 28 octobre dernier, encore une fois, nous intervenons en tant qu’expert technique. Nous n’avons donc pas droit à la parole, au sein du Technical Committee on Motor Vehicles (TCMV), sur les décisions politiques.
Mme la rapporteure. Que vous a-t-on demandé alors ?
Mme Béatrice Lopez. Ce jour-là, de ne rien dire. (Sourires.) Nous sommes là en tant que support technique.
En amont de ce comité technique, se réunissent des groupes de travail qui élaborent la réglementation, mais nous n’intervenons qu’en ce qui concerne les procédures d’essais. Nous pouvons en effet, grâce à nos laboratoires, réaliser des essais préparatoires au futur protocole. Une fois que le protocole des essais est défini, la discussion passe au niveau politique auquel nous n’avons pas accès.
Mme la rapporteure. Si je comprends bien, vous avez été amenés à intervenir sur le détail du protocole WLTP ou sur le détail du protocole RDE, mais pas sur les décisions relatives au dépassement de normes.
Mme Béatrice Lopez. C’est tout à fait exact. Nous n’intervenons que sur les protocoles d’essais.
Ensuite, comme vous l’avez très bien dit, nous hébergeons tous les résultats des contrôles techniques et nous en faisons des analyses statistiques pour le compte du ministère. En tant qu’expert technique, nous participons aux protocoles donnés dans les centres de contrôle technique. Vous vous doutez bien que les mesures réalisées dans le cadre des contrôles techniques ne peuvent être de même nature que les essais réalisés en laboratoire d’homologation. Lors du contrôle technique d’un véhicule diesel, la mesure des fumées, de nature optique, n’a ainsi rien à voir avec celle, beaucoup plus précise, des particules, en masse et en nombre, effectuée en laboratoire.
M. Denis Baupin. Sur quoi portent les statistiques que vous établissez ?
Mme Béatrice Lopez. Le nombre de véhicules refusés, les défauts constatés, la plus ou moins grande sévérité des centres… Il ne s’agit pas de statistiques portant sur le fait de savoir, par exemple, si tel véhicule a tant de mètres moins un en opacité.
M. Laurent Benoit. Si le contrôle n’est pas concluant en ce qui concerne les fumées, l’automobiliste doit aller faire réparer son véhicule. Sur cette partie, c’est du « on-off », alors que sur d’autres points, l’évaluation peur être plus qualitative. Aussi, pour répondre à votre question, il y a, selon moi, une vraie pauvreté des données du contrôle technique sur le fait de savoir comment un véhicule vieillit – ce n’est donc pas le bon biais.
Mme la rapporteure. Ça pourrait l’être…
Mme Béatrice Lopez. Des réflexions sont en cours au niveau européen pour rendre le contrôle technique plus « parlant ». Nous pratiquons désormais un essai relatif aux systèmes de diagnostics embarqués (OBD, pour On Board Diagnostics), qui permet de vérifier que le véhicule détecte bien des défauts du dispositif antipollution, cela par le signalement lumineux, de couleur orange, au conducteur qui doit donc aller chez son garagiste. Dans le cadre du contrôle technique on va seulement vérifier si la lampe orange fonctionne – ici aussi, c’est du « on-off », ce qui reste assez sommaire.
M. Denis Baupin. Et en ce qui concerne une éventuelle agence européenne d’homologation ?
Mme Béatrice Lopez. L’UTAC y est très favorable. Nous en avons véritablement « ras le bol » que les autorités se montrent plus clémentes ! Nos laboratoires sont soumis à la norme ISO/CEI 17025:2005, ce qui coûte très cher. D’autres autorités n’ont pas de laboratoire et donc n’investissent pas en la matière. Aussi, si l’on pouvait harmoniser les processus d’homologation avec des exigences plus sévères, nous serions preneurs.
Nous investissons dans la compétence à hauteur de 10 % de notre chiffre d’affaires. Il s’agit de maintenir nos moyens, de les renouveler en fonction des nouvelles réglementations. Nous investissons enfin dans de nouvelles orientations automobiles. Il serait donc bon que, comme leur nom l’indique, tous les services techniques aient une compétence technique.
Mme la rapporteure. Y a-t-il une forme de concurrence entre organismes d’homologation en Europe et, si ce n’est sur le prix, est-ce sur la sévérité du contrôle ?
Mme Béatrice Lopez. Les prix sont à peu près tous équivalents, mais il est vrai qu’on peut noter une différence quant au nombre d’essais. Quand on connaît le prix d’un prototype, si nous exigeons trois essais alors que tel autre service n’en demandera qu’un, vous vous doutez bien que le coût ne sera pas le même. C’est en jouant sur les à-côtés qu’on pourra faire varier le coût d’une homologation.
Mme la rapporteure. Nous ne vous avons guère interrogés sur les procédures en cours : deux membres de la mission s’en occupent en particulier et nous poserons certaines questions directement au ministère dont vous êtes le service technique délégataire, étant donné que vous ne pouvez naturellement pas nous communiquer certaines informations.
M. Laurent Benoit. Nous ne savons pas du tout ce que PSA et Transport & Environnement vont enfanter. J’ai lu dans la presse que l’ONG était censée proposer à PSA des tests les plus cohérents possibles. Nous aurons l’occasion de voir demain M. Cuenot, de Transport et environnement, et comme il parle beaucoup (Sourires), nous en saurons plus sur son point de vue. Cette ONG est visiblement très indépendante et souvent très dure avec les constructeurs, aussi le groupe PSA n’a-t-il pas choisi le partenaire le plus facile.
Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente. Nous vous remercions.
La séance est levée à dix-sept heures vingt.
◊
◊ ◊
10. Audition, ouverte à la presse, de Mme Aliette Quint, du groupe Air Liquide, secrétaire générale de l’Association française pour l’hydrogène et les piles à combustible (AFHYPAC) et de M. Fabio Ferrari, de la société SymbioFcell.
(Séance du mardi 1er décembre 2015)
La séance est ouverte à seize heures quarante.
La mission d’information a entendu Mme Aliette Quint, du groupe Air Liquide, secrétaire générale de l’Association française pour l’hydrogène et les piles à combustible (AFHYPAC) et de M. Fabio Ferrari, de la société SymbioFcell.
Madame Delphine Batho, rapporteure. Nous recevons aujourd’hui deux représentants de l’Association française pour l’hydrogène et les piles à combustible (AFHYPAC), une organisation professionnelle qui a saisi directement notre mission pour être auditionnée. Il s’agit de Madame Aliette Quint, qui est la secrétaire générale de l’association et qui travaille au sein du groupe Air Liquide. Elle est accompagnée par Monsieur Fabio Ferrari, qui représente une start-up, la société Symbio Fcell.
Notre mission ne récuse aucune source d’énergie. Elle entend comprendre en quoi la filière de l’hydrogène peut contribuer positivement à la transition énergétique, spécialement dans les transports routiers. Je ne vous cache pas que des interlocuteurs de la mission se sont montrés dubitatifs, lors d’auditions précédentes, sur la possibilité de développer une voiture « grand public » qui fonctionnerait à l’hydrogène. Certains nous ont d’ailleurs expliqué que, travaillant dans l’automobile depuis plusieurs décennies, ils en avaient souvent entendu parler mais sans constater de débouchés concrets.
La presse fait état d’avancées récentes, mais non sans préciser que pour produire de l’hydrogène à des coûts acceptables, il faudrait recourir à des ressources fossiles comme le charbon ou le gaz naturel. Il est donc légitime de s’interroger sur le caractère économiquement viable du modèle économique du véhicule à hydrogène.
De grands groupes comme Air Liquide ou encore Michelin s’intéressent à la filière dans ses aspects « mobilité ». Ainsi, Michelin est entré au capital de la société Symbio Fcell en soutenant son ambition de produire, à l’horizon 2016, un millier de voitures Kangoo équipées de nouvelles piles à hydrogène. Ce programme bénéficie du soutien de l’ADEME, du FEDER et de collectivités territoriales.
Au-delà de nos frontières, nous souhaitons savoir où en sont les autres pays en matière de développement de la mobilité liée à l’hydrogène, notamment en Europe. Nos deux constructeurs et les grands équipementiers suivent-ils avec intérêt le développement de la filière ? Un récent article de presse faisait état d’une forte implication des constructeurs asiatiques Hyundai, Toyota et Honda dans les technologies de l’hydrogène – j’ai moi-même eu l’occasion, lors d’un déplacement au Japon, de constater que Nissan développait un certain nombre de projets dans ce domaine. Pouvez-vous nous dire où en sont ces constructeurs ?
Nous allons vous écouter au titre d’un exposé liminaire, avant que mes collègues et moi-même ne vous posions quelques questions.
Madame Aliette Quint. Je vous remercie de nous auditionner comme nous l’avons souhaité, estimant être en mesure d’apporter une contribution au débat portant sur l’avenir des transports propres en France. L’AFHYPAC est une association regroupant de nombreux membres de la filière industrielle et de la recherche en France, et représentant toute la chaîne de valeur de l’hydrogène énergie ; on y trouve de grands groupes tels qu’Air Liquide ou Michelin, ENGIE, GRTgaz, Siemens, mais aussi des PME comme Symbio, McPhy, HASKEL, Hydrogène de France, et de grands laboratoires de recherche tels que le Commissariat à l’énergie atomique (CEA), l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) ou le CNRS. Elle a récemment été rejointe par le Conseil national des professions de l’automobile (CNPA), ce qui montre l’intérêt de la filière automobile française pour le développement de l’hydrogène énergie.
Si votre mission s’intéresse spécifiquement à la problématique du transport, la technologie de l’hydrogène représente une solution globale et même incontournable pour la décarbonisation du transport, mais aussi de l’énergie : elle répond aux deux grands enjeux de la transition énergétique que sont le transport propre et l’intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Il faut donc bien avoir à l’esprit que le développement des marchés de masse tel celui de la mobilité propre va également permettre, à terme, d’engendrer une rentabilité économique effective de l’intégration des renouvelables, puisque l’hydrogène est l’un des moyens les plus efficaces de stocker l’énergie renouvelable en grande quantité et sur la durée.
Il ne me paraît pas inutile de rappeler brièvement comment nous produisons l’hydrogène-énergie. Aujourd’hui, l’hydrogène est produit à 95 % par un procédé de reformage du gaz naturel, consistant à casser la molécule CH4 – le méthane – pour obtenir de l’hydrogène d’une part, du CO2 de l’autre. Il s’agit d’une production industrielle de masse, pratiquée essentiellement par les raffineurs, qui désulfurent le gaz de synthèse obtenu afin de réduire la pollution engendrée par les gaz carburants. L’inconvénient de ce procédé est qu’il produit du CO2 : l’utilisation de l’hydrogène carboné dans les véhicules électriques à hydrogène – le bilan CO2 « du puits à la roue » – se traduit par une réduction globale des émissions de CO2 de 20 % à 30 %, ce qui demeure insatisfaisant. Pour décarboner la molécule d’hydrogène, il faut soit utiliser du biométhane à la place du gaz naturel, ce qui ne pose pas de problèmes sur le plan technologique, soit casser des molécules d’eau par un procédé d’électrolyse de l’eau pour obtenir des molécules H2 d’une part, O2 de l’autre ; à condition d’utiliser de l’électricité renouvelable – obtenue non pas à partir d’énergies fossiles, mais du vent ou du soleil, par exemple – pour effectuer l’électrolyse, on produit un hydrogène parfaitement propre.
Pour ce qui est du véhicule à hydrogène, c’est un véhicule électrique ayant exactement les mêmes propriétés qu’un véhicule à batteries. Sa seule particularité étant de disposer d’une réserve d’énergie embarquée sous la forme d’un stockage d’hydrogène, destiné à alimenter une pile à combustible. En combinant l’hydrogène à l’oxygène, on provoque une réaction d’oxydation de l’hydrogène, et une production d’électricité qui va servir à alimenter le moteur du véhicule. Dans la mesure où l’on effectue une opération exactement inverse à celle de l’électrolyse de l’eau, le seul résidu obtenu est de la vapeur d’eau : on ne produit aucun oxyde d’azote (NOx), aucun polluant, aucune particule fine. L’autonomie est aujourd’hui de l’ordre de 500 à 600 kilomètres – ce sera demain 700 à 800 kilomètres –, et l’utilisateur peut faire le plein d’hydrogène aussi simplement qu’il fait son plein d’essence aujourd’hui, en trois à cinq minutes. Le véhicule à hydrogène combine donc le meilleur des deux mondes en étant aussi simple à utiliser qu’un véhicule à moteur thermique, et beaucoup plus écologique.
Aujourd’hui, il n’y a plus aucune raison de se demander si cette technologie est mature ou non : elle l’est incontestablement. J’en veux pour preuve que de grands constructeurs tels que Toyota, Hyundai et Honda ont mis sur le marché des véhicules basés sur cette technologie, et que ces véhicules roulent sans problème. J’insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas de prototypes, mais de véhicules de série – certes, nous parlons ici de petites séries, ce qui explique le coût encore relativement élevé de ces véhicules : il faut compter environ 60 000 euros pour un SUV.
L’un des freins au développement de cette technologie est la problématique de l’approvisionnement en hydrogène des véhicules, qui suppose la mise en place d’une infrastructure adaptée. Un certain nombre de pays ont réglé cette question de manière volontariste. Ainsi, l’Allemagne a lancé un grand plan de déploiement des infrastructures grâce à un partenariat public-privé : un fort soutien public a été accordé en contrepartie d’un engagement des industriels de mettre de l’argent sur la table. Le gouvernement japonais a également fait preuve de sa volonté de déployer l’infrastructure d’approvisionnement. Le Department of Energy (DOE) américain a soutenu très fortement le lancement de la technologie hydrogène sur le marché. La Californie a ainsi mis en place un programme aux termes duquel les constructeurs doivent s’engager à mettre sur le marché un certain quota de véhicules propres – c’est-à-dire de véhicules électriques à batteries ou à hydrogène. Le Danemark s’est doté d’un réseau de cinq stations couvrant tout son territoire – ce qui est plus facile puisqu’il s’agit d’un relativement petit pays – et produisant l’hydrogène sur place, à partir de l’électrolyse de l’eau, ce qui permet à une petite flotte de véhicules de circuler au Danemark.
Pour ce qui est de la rentabilité économique, on peut penser que si les constructeurs automobiles ont investi des millions dans le développement de cette technologie, c’est qu’ils espèrent bien en tirer profit. Toyota a récemment annoncé son intention de passer sa production à 20 000 ou 30 000 véhicules dans les trois prochaines années.
La rentabilité de l’infrastructure constitue une problématique certaine. Air Liquide a décidé d’investir en partant du principe selon lequel la rentabilité dépend du taux de charge de la station : à partir du moment où des véhicules roulent à l’hydrogène, il existe un marché et le modèle devient rentable, ce qui justifie que nous fassions tant d’efforts pour développer cette technologie. Nous avons investi dans le consortium allemand, mais aussi en France, au Japon, au Danemark et aux États-Unis, c’est-à-dire dans tous les pays où le déploiement des technologies basées sur l’hydrogène énergie bénéficie d’un soutien public.
Au bout du tunnel, la rentabilité économique du modèle est au rendez-vous, mais avant d’en arriver là, il faudra franchir ce que nous appelons la « Vallée de la Mort » : à l’horizon 2020 ou 2025, les choses sont très compliquées puisque l’hydrogène n’est encore qu’une énergie de substitution. Cela dit, si la volonté politique de décarboner la société, notamment les transports, à l’horizon 2050, se confirme, elle nécessitera une électrification générale des transports par le recours à deux solutions non pas opposées, mais complémentaires, à savoir la batterie pour les transports urbains et l’hydrogène pour les trajets sur une plus longue distance.
Monsieur Fabio Ferrari. Comme vous l’a dit Madame Quint, l’électrolyse de l’eau produit de l’hydrogène et de l’oxygène. Pour notre part, nous faisons exactement l’inverse avec nos piles à combustible, en produisant de l’électricité et de l’eau à partir de l’hydrogène et de l’oxygène : c’est ce processus qui permet que les véhicules utilisent les énergies renouvelables.
Il y a actuellement une forte volonté des villes de purifier leur atmosphère. Ainsi, Paris connaît certains jours des pics de pollution équivalents à ceux des villes chinoises…
Madame Delphine Batho, rapporteure. La situation est grave, mais tout de même pas autant qu’en Chine.
M. Fabio Ferrari. Il n’est pas rare que les taux atteignent des niveaux très élevés, ce qui justifie que, dans certaines villes, la réglementation impose des restrictions d’accès au centre pour les véhicules polluants. C’est le facteur essentiel de transition du véhicule diesel vers le véhicule électrique, qui commence à créer un marché. Toutefois, pour le moment – c’est-à-dire tant qu’une réglementation ne viendra pas provoquer une bascule généralisée en valorisant le véhicule décarboné –, le prix du kilomètre le moins cher sera toujours obtenu avec cette technologie éprouvée et optimisée depuis une centaine d’années qu’est le diesel : les consommateurs n’abandonneront pas le diesel pour le véhicule écologique si un effet prix ne les incite pas à le faire.
Les restrictions réglementaires d’accès aux centres des villes constituent une incitation pour les professionnels à passer au véhicule propre. Cela dit, tant que chaque ville possédera sa propre réglementation en matière d’accès, de zones piétonnes et d’horaires de livraison, ce sera un vrai casse-tête pour le gestionnaire d’une flotte de véhicules d’optimiser – en termes de prix du kilomètre parcouru ou de la tonne de marchandises distribuées – l’organisation des tournées en centre-ville dont il est responsable. D’ores et déjà, La Poste et des grands transporteurs privés tels que DHL ou TNT commencent à passer au véhicule propre, et ce n’est ni par bonté d’âme ni par conviction écologique, mais bien parce que cela leur permet de réaliser un retour sur investissement.
Dans ce contexte, le seul véhicule permettant de franchir toutes les barrières réglementaires est le véhicule électrique, reconnu propre – le véhicule hybride n’étant, lui, qu’un véhicule thermique qui consomme moins, mais pollue tout de même. Par ailleurs, le véhicule électrique est apprécié des chauffeurs pour sa facilité d’utilisation. Le point faible des véhicules à batterie est l’autonomie, les technologies actuelles ne permettant pas à ces véhicules de concurrencer les véhicules diesel sur ce point. Les gestionnaires de flottes professionnelles sont demandeurs de véhicules disposant d’une autonomie d’au moins 200 kilomètres, voire 300 kilomètres par jour, afin d’accomplir une mission donnée. Or, dans les conditions d’utilisation réelle – la distribution de marchandises en centre-ville –, l’autonomie des véhicules à batteries n’excède pas 100 kilomètres : comme vous le savez, le fait de s’arrêter et de redémarrer à de très nombreuses reprises, comme le fait un postier ou un livreur, se traduit par une consommation deux ou trois fois plus élevée – que ce soit en diesel ou en électricité – que celle résultant d’une utilisation standard. Aujourd’hui, le véhicule à batterie permet de remplir certaines missions, mais il n’est pas assez performant en termes d’autonomie pour remplacer tout le parc de véhicules diesel : c’est ce qui explique que La Poste, par exemple, n’ait remplacé que 5 000 de ses 40 000 véhicules.
Certains constructeurs, tel Tesla, tentent de remédier à la contrainte de l’autonomie en équipant les véhicules d’un plus grand nombre de batteries. Le problème, c’est que cela se traduit par une hausse de prix – plus de 50 % du prix d’un véhicule électrique correspond au prix des batteries dont il est doté – et par une réduction de la capacité d’emport, ce qui pose un problème pour une utilisation professionnelle. Certains consommateurs sont disposés à remplacer leur véhicule diesel par un véhicule électrique, à condition que celui-ci dispose d’une plus grande autonomie. Une étude réalisée par le groupe de travail « H2 Mobilité France » a mis en évidence que, pour les professionnels, le prix au kilomètre était le même avec un véhicule électrique équipé d’un prolongateur d’autonomie à hydrogène qu’avec un véhicule diesel : il est donc possible d’atteindre un seuil de rentabilité économique avec un véhicule électrique, pour peu que la réglementation incite les utilisateurs à franchir le pas – car si les deux types de véhicule donnent les mêmes résultats, les personnes possédant un véhicule diesel n’auront pas de raison de changer leurs habitudes.
Il faut réfuter le mythe selon lequel les véhicules à hydrogène coûteraient très cher ! Aujourd’hui, les technologies mises en œuvre – souvent en France – permettent d’obtenir un prix du kilomètre équivalent à ceux des véhicules diesel. Il nous manque donc seulement un coup de pouce pour faire vraiment décoller les ventes. C’est l’objectif du projet HyWay, soutenu par l’ADEME, consiste à déployer cinquante véhicules utilitaires hybrides batteries-hydrogène, autour de deux stations de distribution d’hydrogène à Lyon et Grenoble. Dès que la production atteindra un certain niveau, nous n’aurons plus besoin d’aide pour vendre des véhicules électriques au prix du diesel, et certains constructeurs ont déjà bien compris que construire un véhicule hydrogène coûtait moins cher que de construire un véhicule diesel dépollué – car réduire les émissions de NOx et de CO2 de manière efficace se traduit par un surcoût.
Pour ce qui est de l’écosystème automobile, les constructeurs français ont fourni très tôt de gros efforts pour développer le véhicule électrique, mais ont malheureusement dû réduire la recherche et le développement dans ce domaine pour des raisons budgétaires. Chez Renault, c’est Nissan qui explore la technologie électrique, notamment la pile à hydrogène. Pour ce qui est de PSA, après avoir été un pionnier dans ce domaine – nous utilisons une technologie issue de celle développée en France par le groupe –, il a dû mettre fin pour des raisons budgétaires à sa R&D sur ce thème. Il existe donc peu de véhicules à hydrogène développés aujourd’hui par les constructeurs français. En revanche, les équipementiers investissent dans cette technologie, assez largement mise en œuvre par autres constructeurs dans le monde. Ainsi, les Allemands sont prêts à mettre des véhicules sur le marché et n’attendent pour cela que le déploiement de l’infrastructure nécessaire – 400 stations devraient équiper nos voisins d’outre-Rhin d’ici à 2023. Nous travaillons avec les équipementiers à la mise au point des réservoirs, des stacks – les empilements de cellules électriques – et de nombreux autres éléments constitutifs du système de la pile à combustible.
La viabilité économique du modèle de la voiture à pile à combustible ne fait plus aucun doute, étant précisé que dans ce domaine, les cycles d’introduction de nouvelles technologies sont assez longs. Toyota a mis une dizaine d’années à introduire la technologie aujourd’hui mise en œuvre sur la Prius, et nous pensons pouvoir obtenir une très bonne rentabilité économique de la technologie hydrogène dans le même laps de temps. C’est ce qui nous fait dire que nous devons investir dès maintenant dans cette technologie, afin d’être prêts quand il y aura vraiment un marché – et les constructeurs et les équipementiers pensent la même chose. Je vous invite à lire le position paper qui vient d’être publié par la Plateforme de la filière automobile (PFA), qui souligne que le marché sera d’abord un marché de niches, limité à la livraison et aux services en centre-ville, et ne deviendra un marché grand public que lorsque les infrastructures nécessaires seront présentes. Toute la question est de savoir si la France sera en avance ou en retard dans le développement de cette infrastructure, ce qui relève de la proactivité politique.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Madame Quint, vous avez évoqué une politique de quotas mise en œuvre en Californie. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?
Nos conclusions auront d’autant plus d’impact que nous aurons su observer la plus grande neutralité technologique. Je ne doute pas que vous soyez convaincus de la pertinence de la technologie dont vous les représentants, mais force est de constater que l’on entend parler depuis longtemps des véhicules fonctionnant sur le principe d’une pile à combustible, et que l’on s’explique mal que cette technologie ne se soit toujours pas imposée. Vice-présidente du conseil régional d’Alsace, une fonction dans le cadre de laquelle j’ai été chargée de l’innovation, de la recherche et de l’enseignement supérieur jusqu’à l’année dernière, je me souviens qu’il y a plusieurs années, les écoles d’ingénieurs locales travaillaient déjà, avec le concours du CNRS, au déploiement des infrastructures de recharge et au développement des technologies que vous dites aujourd’hui être matures. Existe-t-il des freins en la matière ? En particulier, la question de la dangerosité des véhicules est-elle évoquée, comme elle l’a été pour les véhicules roulant au GPL ?
Sur le plan économique, vous dites qu’un modèle mature n’a besoin que d’une incitation réglementaire et d’un soutien pour le lancement des cinquante premiers véhicules. Or, j’ai lu récemment un excellent rapport démontrant que le réglementaire ne jouait aucun rôle dans l’amélioration de la qualité de l’air dans les centres urbains – si ce n’est celui d’afficher la volonté politique des équipes en place d’agir dans ce domaine –, les résultats les plus intéressants étant ceux résultant de la mise en place d’équipements permettant de nouveaux modes de mobilité. En tout état de cause, il me semble qu’une production de cinquante véhicules représente bien peu pour que l’on puisse parler d’un modèle économique mature, et qu’il est sans doute nécessaire d’augmenter la production afin que le prix de vente de ces véhicules devienne accessible à la majorité des Français, ce qui est loin d’être le cas avec des voitures vendues 60 000 euros !
Mme Aliette Quint. Le programme californien que j’ai évoqué est le Zero-Emissions Vehicle (ZEV) Program. Il consiste en l’obligation pour les constructeurs automobiles de mettre sur le marché californien une certaine proportion de véhicules propres, et prévoit la possibilité, pour les constructeurs ayant atteint les objectifs assignés, de revendre aux autres leurs quotas excédentaires. Ce système, consistant en une espèce de marché carbone des véhicules propres, a ensuite été repris par une dizaine d’autres États des États-Unis, et la Californie souhaite désormais créer une alliance ZEV ouverte à tous les États du monde disposés à prendre part au grand marché de quotas des véhicules propres – les Pays-Bas se sont d’ores et déjà déclarés intéressés.
Datant de 2003, le programme connaît actuellement une accélération due à la mise en place de pénalités pour les constructeurs n’atteignant pas leurs quotas de véhicules. Ce système fait la fortune de Tesla, qui revend ses quotas sur le marché. Par ailleurs, il incite de nombreux constructeurs à diriger leurs flottes de véhicules propres en Californie afin de bénéficier du programme ZEV.
Le principe de neutralité technologique est effectivement important, et nous estimons d’ailleurs qu’à terme, ce n’est pas une technologie unique qui s’imposera, mais un panel de technologies complémentaires, pour aboutir à un transport propre. Il est évident qu’à l’horizon 2030, tous les types de technologie – batteries, hydrogène, hybride, diesel etc. – cohabiteront encore, et qu’il faudra sans doute attendre 2050 pour voir les véhicules électriques individuels devenir prédominants, à côté des véhicules roulant au gaz naturel – grâce aux technologies Liquefied Natural Gas (LNG) et Compressed Natural Gas (CNG). L’un des intérêts du programme ZEV est de ne pas privilégier une technologie au détriment des autres : il exige simplement que soient mis sur le marché des véhicules qualifiés de propres en fonction de critères strictement définis. L’Allemagne et le Japon ont fait le choix de soutenir aussi bien les véhicules à batteries que les véhicules à hydrogène et ceux au gaz naturel.
Nous pensons que les véhicules à hydrogène sont intéressants surtout sur les segments C et D, c’est-à-dire des véhicules relativement lourds, représentant 75 % de la pollution engendrée par le parc automobile, tandis que les véhicules à batteries sont, eux, intéressants sur les plus petits véhicules : cette répartition découle de la nécessité de placer plus de batteries sur les véhicules ayant vocation à disposer d’une autonomie plus importante – c’est ce qui fait que certains véhicules Tesla embarquent 1,4 tonne de batteries pour une autonomie de 600 kilomètres, ce qui ne paraît pas très raisonnable en termes d’efficacité. Pour les gros camions parcourant de longues distances, c’est le GNL qui sera le plus adapté. Comme vous le voyez, à chaque segment correspond un type de motorisation plus intéressant que les autres.
Pour ce qui est des freins au développement des véhicules à pile à combustible, Air Liquide a pris en charge la coordination du programme « Hydrogène Énergie en France », destiné à développer des marchés de niche sur l’hydrogène. Au départ, le Graal recherché par tous les acteurs était le marché de masse de la mobilité, un objectif jamais atteint parce que les constructeurs n’étaient pas au rendez-vous et que les recherches dans ce domaine étaient coûteuses et compliquées. Les niches ont donc semblé offrir des opportunités intéressantes, qu’il s’agisse des systèmes de sauvegarde de données, des tours de télécommunication ou de la logistique, et Air Liquide s’est lancé à la conquête de ces marchés avec l’aide d’un certain nombre de partenaires français.
Les constructeurs automobiles nous ont un peu pris de court, certains d’entre eux – notamment Daimler, Toyota, Hyundai et même Peugeot, avec un prototype – affirmant détenir la technologie leur permettant de faire rouler des véhicules à l’hydrogène. Nous avons cru un moment qu’il serait possible d’introduire de l’hydrogène dans les moteurs thermiques, avant de nous rendre compte que cette technique complexe basée sur la combustion n’était pas très efficace sur le plan énergétique. À partir du moment où certains constructeurs, tel Toyota, ont commencé à dépasser certains blocages en maîtrisant les moteurs électriques à hydrogène, qui sont des moteurs hybrides, et où la miniaturisation des piles à combustible a conduit à une division de leur prix par dix ou vingt, nous avons été en mesure d’équiper les véhicules de piles à combustible sans que celles-ci n’occupent une place excessive. L’autre avancée majeure a consisté en la possibilité d’embarquer de l’hydrogène sous forme de gaz comprimé, en quantité suffisante pour procurer une autonomie rivalisant avec celle des véhicules à batteries et même celle des véhicules à moteur thermique. Une fois ces avancées obtenues, les constructeurs sont revenus vers nous en nous demandant où en était l’infrastructure, que nous nous sommes donné pour mission de faire progresser.
La question de la dangerosité est importante. La molécule d’hydrogène est très légère et s’échappe facilement, ce qui nécessite certaines précautions – vous vous souvenez peut-être de cette expérience réalisée en classe de troisième, lors de laquelle on fait « aboyer » un tube à essais contenant de l’hydrogène en approchant une allumette de son embouchure, afin de démontrer le caractère détonant du mélange hydrogène-oxygène. Sur ce point, les constructeurs ont fait leur travail, et s’il serait intéressant pour vous de les auditionner, je peux d’ores et déjà vous dire que lors des crash-tests extrêmement sévères auxquels sont soumis les véhicules à hydrogène, le réservoir contenant l’hydrogène est la partie du véhicule qui résiste le mieux aux chocs – c’est même, lors des tests les plus intenses, la dernière pièce du véhicule à rester intacte.
Pour ce qui est de la résistance au feu, les pompiers sont désormais formés à combattre les incendies ayant pris sur des véhicules à hydrogène, et ils vous diront tous qu’ils sont beaucoup plus à l’aide sur un feu de ce type que sur l’incendie d’un véhicule à essence. En effet, la flamme d’hydrogène produit très peu de radiations, ce qui signifie qu’elle produit peu de chaleur : vous pouvez ainsi placer votre main très près d’une flamme à hydrogène sans vous brûler. Lors de l’incendie d’un véhicule, un dispositif va se déclencher, laissant l’hydrogène s’échapper vers le haut en produisant une flamme qui ne dégagera pas de radiations, donc pas de chaleur, vers les sièges arrière du véhicule ; sur un véhicule à essence, l’ensemble de l’habitacle est détruit en quelques minutes.
Nous travaillons avec les Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ainsi qu’avec la Direction générale de la prévention des risques (DGPR), afin de mettre en place une réglementation relative aux stations d’approvisionnement des véhicules qui prenne en compte l’ensemble des standards internationaux relatifs à la sécurité. De ce point de vue, nous devons être extrêmement stricts, afin de ne pas refaire les erreurs commises avec les véhicules au GPL.
M. Fabio Ferrari. Il existe en matière de sécurité des véhicules une norme européenne et une norme internationale. Par ailleurs, comme vient de le dire Madame Quint, nous travaillons avec les pompiers, formés aux procédures d’intervention et convaincus par la fiabilité de nos produits au point de nous acheter des véhicules – les pompiers du département de la Manche ont ainsi été les premiers à s’en équiper.
J’insiste sur le fait que pour convaincre les usagers de véhicules diesel de passer à un véhicule à hydrogène, il faut créer une incitation d’ordre réglementaire, en édictant des restrictions d’accès ou en agissant sur le coût – par l’instauration d’une taxe sur le diesel ou de primes à l’achat de véhicules à hydrogène. En tout état de cause, l’incitation doit avoir pour effet de diminuer le coût de possession du véhicule hydrogène par rapport au véhicule diesel, dont la technologie est amortie depuis plus de cent ans et dont la production en énormes quantités autorise un prix de vente réduit. Pour vous donner un ordre de grandeur, les piles à hydrogène que nous fabriquons aujourd’hui coûtent entre 1 500 et 2 000 euros du kilowatt, à rapporter au coût de 50 euros pour la production automobile classique. Or, à défaut d’élément incitatif, nous n’atteindrons jamais l’effet volume recherché.
Mme la rapporteure. Nous sommes déjà parfaitement conscients de l’enjeu de la technologie hydrogène et avons besoin, pour progresser dans nos travaux, que vous nous donniez des éléments très factuels et très précis, et pas seulement des éléments généraux sur les perspectives d’évolution de la mobilité à l’horizon 2030.
Que pouvez-vous nous dire sur le coût de production d’un véhicule à hydrogène par rapport à ceux d’un véhicule électrique et d’un véhicule thermique ?
Par ailleurs, vous avez indiqué que certains constructeurs s’engageaient dans des programmes de développement de l’hydrogène. Pouvez-vous nous donner des détails sur la nature de ces programmes ?
Que pensez-vous de la situation et des perspectives de la France en matière de développement des technologies hydrogène ? Estimez-vous qu’il y ait un blocage, et que nous soyons en retard ? Quelles sont précisément vos attentes et vos demandes vis-à-vis des pouvoirs publics pour vaincre les freins au développement de votre activité ?
Pour ce qui est de l’infrastructure de distribution de l’hydrogène, j’entends bien le raisonnement consistant à dire que, plutôt que d’exiger des pétroliers qu’ils fassent en sorte de permettre l’introduction d’urée dans les carburants afin de réduire les NOx, il serait plus efficace de s’orienter directement vers la mise en place d’une infrastructure de distribution d’hydrogène. Pouvez-vous nous dire si la réglementation a évolué en la matière au cours des deux ou trois dernières années, et où en sont l’Allemagne et le Japon, qui avaient exposé des programmes assez ambitieux en la matière : ces pays respectent-ils leurs calendriers ? Ce que vous avez dit tout à l’heure au sujet de la Prius ne me paraît pas recevable dans la mesure où, contrairement aux véhicules à hydrogène, ce véhicule n’était pas confronté au problème de l’infrastructure de recharge.
M. Fabio Ferrari. Pour ce qui est du coût des véhicules, je me bornerai à vous donner des éléments d’information sur ceux produits par la société Symbio Fcell. Aujourd’hui, notre modèle Kangoo équipé d’un prolongateur d’autonomie à hydrogène est vendu 30 000 euros au client, déduction faite d’une aide de 10 000 euros – ce qui couvre à peine notre coût de production de 40 000 euros pour le véhicule équipé de son kit de prolongation d’autonomie. Il nous reste donc 10 000 euros à gagner pour commencer à prendre un peu de marge sur les ventes de nos véhicules – aujourd’hui limitées à une série de cinquante, ce qui est dérisoire au regard des productions de véhicules standard.
L’objectif que j’ai évoqué tout à l’heure, consistant à passer à un coût de production de 50 euros du kilowatt, ne résulte pas de nos calculs, mais d’une estimation du Department of Energy (DOE) américain, qui effectue actuellement un sondage auprès des constructeurs mondiaux, afin de déterminer où ils en sont de leur courbe de décroissance et de leurs estimations du coût de fabrication des piles à hydrogène. En France, nous travaillons avec un ensemble de partenaires que je ne peux vous citer, afin de voir si la moyenne internationale estimée par le DOE est atteignable avec nos moyens de production : nous sommes très proches du seuil de 50 euros en dessous duquel nous serions moins chers qu’un véhicule diesel.
Comme vous le dites, il n’y a pas lieu de comparer la situation des véhicules à hydrogène de celle de la Prius, dans la mesure où celle-ci n’a pas été confrontée à la problématique de l’infrastructure que nous devons résoudre. Je n’ai cité cette comparaison que dans la mesure où le groupe Toyota le fait lui-même. Ce que les responsables de Toyota ne disent pas, c’est qu’ils souhaitent mettre en place un modèle de déploiement de la technologie hydrogène – ils y travaillent aux États-Unis, notamment avec Air Liquide – visant à s’affranchir de la problématique de l’infrastructure, en proposant des packages incluant non seulement le véhicule, mais aussi la fourniture de l’énergie. Aujourd’hui, la Tesla est vendue avec sa recharge gratuite – le coût de l’électricité est compris dans le prix de vente de la voiture –, et c’est ce modèle qu’ils cherchent à imiter. Notre démarche est un peu similaire avec notre approche de flotte captive : dès lors qu’il se trouve un ensemble de véhicules à un endroit donné, un opérateur d’énergie va être en mesure de proposer une offre d’approvisionnement. En gros, il est intéressant d’installer une station à partir du moment où un peu plus de vingt véhicules sont susceptibles de venir y faire le plein.
Mme la rapporteure. Quel est le seuil de rentabilité d’une station ?
M. Fabio Ferrari. Environ quarante véhicules – c’est d’ailleurs le seuil à partir duquel les banques sont disposées à consentir des prêts –, mais il est possible d’envisager l’installation d’une station à partir d’une vingtaine de véhicules venant s’approvisionner régulièrement.
Mme Aliette Quint. Nous avons installé environ 75 stations de distribution d’hydrogène dans le monde, ce qui représente 30 % de parts de marché – car nous avons évidemment des concurrents. Le consortium regroupant Air Liquide, Total, la compagnie pétrolière autrichienne OMV, Shell, Daimler et notre principal concurrent dans les domaines du gaz industriel, le groupe Linde AG, a installé dix-huit stations en Allemagne sur les cinquante dont le pays a décidé de se doter à l’horizon 2017. Il y a donc un peu de retard dans le calendrier – ce que les autorités allemandes nous rappellent régulièrement – en raison des délais administratifs d’ouverture des stations plus longs que prévu et, dans une moindre mesure, de la difficulté pour nous de maintenir un rythme d’investissement très soutenu.
Pour ce qui est du Japon, nous y avons installé deux stations, en partenariat avec la société Toyota Tsusho, et sommes en pourparlers en vue de la poursuite du déploiement des stations, le pays ayant pour objectif de disposer de cent stations d’ici à 2020. Je ne dispose pas d’éléments précis sur l’état du calendrier, mais je vais me renseigner et reviendrai vers vous pour vous faire part des informations que j’aurai recueillies.
Mme la rapporteure. La réglementation en matière de sûreté des véhicules et des stations, qui paraissait constituer un frein majeur au développement de l’hydrogène-énergie il y a deux ou trois ans, a-t-elle évolué favorablement ?
Mme Aliette Quint. Dans ce domaine, nous saluons le travail du ministère de l’environnement, en particulier de la DGPR. Des groupes de travail, auxquels l’AFHYPAC a pris part, ont été mis en place afin de remédier à divers points de blocage. Ainsi, un arrêté ad hoc a été rédigé afin de permettre la distribution d’hydrogène pour les chariots élévateurs électriques. Cet arrêté visant un certain nombre de points critiques a été adressé à toutes les DREAL, qui délivrent désormais beaucoup plus facilement les autorisations nécessaires, faisant ainsi passer l’instruction des dossiers de dix-huit à trois mois, ce qui constitue une avancée considérable ; il vient d’être soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques (CSPR), et devrait être publié très prochainement.
Pour ce qui est des stations destinées au grand public ou aux flottes captives, nous sommes en discussion avec la DGPR afin de mettre en place les prochaines étapes du groupe du travail. Les choses avancent bien, même si la réglementation doit encore évoluer, notamment en ce qui concerne les seuils d’autorisation et de déclaration.
J’insiste sur le fait qu’à ce jour, le principal obstacle reste l’insuffisance d’engagement politique, en particulier de soutien financier public qui faciliterait les premiers déploiements. Si le déploiement des bornes de recharge électrique bénéficie d’un fort soutien, rien n’est fait encore fait pour les infrastructures de distribution d’hydrogène. Nous discutons avec le ministère dans le cadre du plan Nouvelle France Industrielle (NFI), dirigé par Florence Lambert. Nous avons ainsi proposé un certain nombre d’actions, notamment une aide équivalente à celle offerte par le Gouvernement pour les véhicules à batteries, et espérons être entendus afin de pouvoir entreprendre le déploiement initial sur le sol français. Dès que les ministères de l’industrie et de l’environnement auront donné leur aval, nous serons en mesure de faire connaître notre plan de déploiement, précisant combien de stations nous entendons installer, pour approvisionner combien de véhicules, et à quels emplacements – ce qui dépendra de la situation des flottes captives.
Il faudra ensuite mettre au point la phase 2, consistant en un déploiement plus large, pour un investissement plus important que les 50 millions d’euros initiaux. À ce stade, nous devrons passer des financements publics aux financements privés, en nous efforçant d’intéresser les banques à un projet de déploiement d’infrastructures énergétiques de substitution, qui constitue un investissement risqué. Nous réfléchissons avec CDC Climat aux moyens qui pourraient permettre de diminuer le risque, notamment dans le cadre d’un partenariat avec l’Allemagne.
M. Fabio Ferrari. Nous nous félicitons de constater que l’hydrogène est cité dans la loi de transition énergétique : c’est un acquis fondamental, car cette filière était jusqu’alors assez peu présente dans les textes de loi. Nous avons bénéficié de quelques aides publiques qui nous ont permis de déployer les premières stations : au niveau national, avec l’ADEME et la région Rhône-Alpes, mais aussi au niveau européen, avec le programme TEN-T, qui va permettre le financement d’une quinzaine de stations en Normandie. Quatre premières stations ont d’ores et déjà été financées par l’Europe au stade de la R&D afin de tester les nouvelles infrastructures, et huit autres devraient l’être à terme. Nous en sommes actuellement à quatre stations ouvertes au public en France, et Air Liquide va inaugurer lundi prochain sa première station à Paris.
Mme Aliette Quint. Cette station parisienne sera installée de façon temporaire à proximité du pont de l’Alma, dans le cadre d’un partenariat conclu entre Air Liquide et une société de taxis électriques parisiens qui a décidé de passer à l’hydrogène dès que des véhicules fabriqués en série ont été disponibles sur le marché – les véhicules à batteries qu’ils utilisaient précédemment leur posaient des problèmes en termes d’autonomie. Cinq taxis viendront donc s’approvisionner à cette station temporaire durant quelques mois, jusqu’à ce que l’on ouvre des stations fixes autour de Paris – en commençant par les aéroports – afin de permettre, au terme d’une montée en puissance du dispositif, le ravitaillement de 500 ou 600 taxis. Le financement des infrastructures s’est fait grâce à des financements européens, mais le modèle a vocation à se rentabiliser très rapidement compte tenu de la flotte de taxis qui viendra s’approvisionner à nos stations.
M. Fabio Ferrari. Une dernière station a été achetée par la Mairie de Paris afin d’alimenter sa flotte de Kangoo utilitaires. Comme vous le voyez, le déploiement planifié par « H2 Mobilité France » est désormais une réalité, et une vingtaine de villes sont aujourd’hui intéressées par notre modèle. Nous cherchons un soutien en termes de financement, que nous devrions trouver dans le cadre du plan Nouvelle France Industrielle.
Mme la rapporteure. En ce qui concerne les financements privés, le modèle du consortium allemand est-il un bon modèle ? Par ailleurs, je m’étonne que vous mentionniez le plan Nouvelle France Industrielle sans rien dire des programmes d’investissements d’avenir (PIA) ni de la convention « Véhicules du futur » : est-ce parce qu’aucun appel à projets n’a été lancé dans ce cadre ?
M. Jean Grellier. Quand il est fait appel aux financements publics comme c’est le cas avec la technologie hydrogène, je ne peux m’empêcher de me demander si le principe de neutralité technologique est bien respecté. Il y a deux ou trois ans, le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) a été appelé à contribution pour la mise aux normes des stations d’essence et de gazole, et les collectivités locales ont été sollicitées pour le déploiement des bornes de recharge électrique. Or, il semble aujourd’hui que la technologie de l’hydrogène ait vocation à prendre le dessus, ce qui va nécessiter la mise en place d’une nouvelle infrastructure. Il va falloir faire un choix car, à défaut, les effets de volume, de production industrielle et de prix finiront bien par nous rattraper – or, je n’ai pas l’impression que les grands constructeurs soient disposés à abandonner du jour au lendemain le modèle du véhicule thermique.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. La société Symbio a-t-elle été approchée en vue d’un éventuel rachat ?
M. Fabio Ferrari. Nous procédons actuellement à des levées de fonds, mais n’avons pour le moment que des investisseurs français, et la présence de Michelin dans notre capital nous protège certainement de certaines convoitises.
Mme Aliette Quint. Le modèle allemand est un modèle exemplaire de partenariat public-privé, avec des partenaires privés motivés pour faire progresser le modèle économique, notamment le constructeur automobile Daimler. Nous sommes tous conscients qu’il nous faut franchir la « Vallée de la Mort », et que nous n’y parviendrons pas seuls : nous aurons toujours le temps de nous battre entre nous lorsqu’il y aura un marché, ce qui n’est pas le cas pour le moment. Cela dit, le modèle allemand présente quelques contraintes particulières, notamment la nécessité de déployer l’infrastructure avant de penser aux véhicules. De ce point de vue, le modèle français, basé sur le principe consistant à déployer prioritairement l’infrastructure à proximité des flottes captives qui vont permettre de rentabiliser plus rapidement les investissements, paraît plus vertueux. Nous ne sommes pas opposés à l’idée de mettre en place en France un partenariat public-privé à l’instar de ce qui se fait en Allemagne, et c’est d’ailleurs ce qui est envisagé dans le cadre du plan NFI.
Si je n’ai pas évoqué le Commissariat général à l’investissement (CGI), chargé de la mise en œuvre du Programme d’investissements d’avenir, c’est qu’il nous a été clairement indiqué qu’il n’avait pas vocation à financer le déploiement d’infrastructures en dehors des bornes de recharge électrique.
M. Fabio Ferrari. Qui constituaient une exception.
Mme Aliette Quint. Effectivement, en l’occurrence, le principe de neutralité technologique ne s’est pas appliqué. Cela dit, nous pensons que le CGI va participer à la mise en place de financements dans le cadre du plan NFI.
M. Fabio Ferrari. Au sujet de la vision à long terme, je souligne que l’étude sur l’hydrogène-énergie réalisée avec le concours d’énergéticiens a mis en évidence la synergie qui pouvait exister entre ce vecteur énergétique qu’est la mobilité, et d’autres usages. Si ces autres usages n’offraient pas des débouchés supplémentaires à l’hydrogène, nous n’aurions pas pu nous lancer. Évidemment, tout dépend du développement des énergies renouvelables, et nous ne pouvons tirer des plans sur la comète, mais une augmentation des besoins en stockage d’énergie paraît inévitable et, pour les énergéticiens consultés, la meilleure solution pour un stockage en quantité est l’hydrogène – or, si le stockage de l’hydrogène pour les ENR est rentable, il le sera également pour la mobilité.
Par ailleurs, au niveau économique, il sera toujours moins cher de stocker l’électricité directement dans une batterie que de passer par le vecteur hydrogène – car il faut bien amortir l’électrolyseur. Dès lors, quand on n’a pas besoin de stocker beaucoup d’énergie dans le véhicule et que la flexibilité d’usage – le fait de refaire le plein en trois minutes – n’est pas une priorité absolue, la voiture à batteries constitue la meilleure solution, c’est-à-dire celle présentant le plus faible prix d’utilisation au kilomètre. Dans le cas contraire, c’est-à-dire quand on a besoin de stocker de l’énergie à bord du véhicule et de disposer d’une grande flexibilité, l’hydrogène est le plus rentable, car le stockage de trop nombreuses batteries n’est pas une bonne solution.
Mme Aliette Quint. Comme je l’ai dit tout à l’heure, Air Liquide a travaillé avec CDC Climat pour réfléchir à un modèle de financement alternatif des infrastructures. En fait, il s’agit de déterminer comment attirer le financement bancaire. Pour cela, CDC Climat a passé au crible tout notre business plan de déploiement des infrastructures à l’horizon 2020-2040. La conclusion de cette étude est claire : notre modèle est rentable, il n’y a aucun doute quant au fait qu’il puisse rapporter de l’argent. Les banques sont donc intéressées en dépit de quelques risques : il faut que les véhicules soient bien présents, et que le prix du carbone reste suffisamment élevé pour permettre le développement de carburants alternatifs, notamment l’hydrogène. Il suffit que 1 % de la flotte mondiale de véhicules se convertisse à l’hydrogène pour que se constitue un marché de 15 milliards d’euros. Pour ce qui est des constructeurs automobiles, je ne peux m’exprimer en leur nom et sans doute faudra-t-il que vous les auditionniez au sujet de leur modèle économique – qui, a priori, paraît solide.
Mme la rapporteure. Que pouvez-vous nous dire au sujet de la technologie développée par PSA, que vous avez évoquée tout à l’heure ?
M. Fabio Ferrari. Les systèmes de piles à hydrogène étaient autrefois produits selon des processus qui n’étaient pas optimisés pour le monde automobile. Lorsqu’ils se sont intéressés à la question, les ingénieurs de PSA se sont demandé comment produire une pile à hydrogène au meilleur coût possible, et ont mis au point un nouveau procédé avec le concours du CEA. Ils ont donc breveté dans les années 2000 les premiers systèmes de piles à hydrogène constituées de plaques bipolaires métalliques, qui constituaient alors une innovation mondiale et leur ont donné de l’avance sur leurs concurrents en matière de densité énergétique.
Depuis, nous avons mis au point une nouvelle génération de piles avec le CEA, puis une autre avec Michelin, qui détenait également une technologie avancée de son côté
– toujours dans l’objectif de produire moins cher.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. PSA n’a donc pas poursuivi sa R&D afin de chercher à rentabiliser son procédé initial ?
M. Fabio Ferrari. Non, le groupe a dû y renoncer pour des raisons budgétaires, car l’entretien des brevets et la rémunération des équipes de R&D ont un coût très élevé, qu’il ne pouvait supporter sans être certain de trouver une application immédiate aux avancées obtenues. Cela dit, nous avons récupéré une partie de son équipe technique. Tout n’est donc pas perdu.
Mme Aliette Quint. Je reviendrai vers vous dès que possible afin de vous donner des éléments d’information sur les calendriers allemand et japonais, et vous préciser le fonctionnement du mécanisme californien ZEV et du mécanisme de financement innovant.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Nous vous remercions pour vos explications.
La séance est levée à dix-huit heures.
◊
◊ ◊
11. Audition, ouverte à la presse, de M. Philippe Maler, inspecteur général de l’administration du développement durable et de M. Jean-Bernard Erhardt, administrateur en chef des affaires maritimes du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD).
(Séance du mercredi 2 décembre 2015)
La séance est ouverte à douze heures cinq.
La mission d’information a entendu M. Philippe Maler, inspecteur général de l’administration du développement durable et M. Jean-Bernard Erhardt, administrateur en chef des affaires maritimes du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD).
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Nous recevons aujourd’hui deux hauts fonctionnaires, MM Philippe Maler et Jean-Bernard Erhardt, qui, dans le cadre du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), ont récemment rédigé un rapport sur la coordination des actions ministérielles pour l’usage du gaz naturel liquéfié (GNL) comme carburant dans les transports routiers.
Ce travail s’inscrit dans la continuité d’une réflexion administrative plus large et de moyen terme. Le GNL est en effet reconnu comme l’une des composantes de la transition énergétique à l’échelon européen.
Notre mission d’information entend examiner les potentiels de chacune des filières « carburant », comme nous l’avons fait hier pour l’hydrogène et les piles à combustible. Le GNL est d’ailleurs considéré comme un carburant alternatif au sens de la directive européenne n° 2014/94 du 22 octobre 2014. À ce titre, la France sera tenue de notifier, avant la fin de l’année prochaine, son cadre national de déploiement des infrastructures de distribution du GNL.
Le gaz naturel liquéfié a pour particularités positives de très peu émettre d’oxydes d’azote (NOx) et de particules fines, contrairement au diesel, et de réduire sensiblement le niveau sonore des moteurs. Son utilisation pour les poids lourds devrait donc être favorisée. Pourtant, à ce jour, on ne compterait que quelques dizaines de véhicules de transport recourant, en France, à ce carburant. En outre, il n’existerait actuellement aucune station-service délivrant du GNL dans un cadre public : les points de distribution restant limités à des entreprises ou à des collectivités.
Au-delà du transport de marchandises, pourquoi le recours au gaz naturel liquéfié semble-t-il peu envisageable pour les véhicules légers ?
À l’expérience le gaz de pétrole liquéfié (GPL), qui concerne depuis plus de vingt ans les véhicules légers, et qui, après avoir enregistré des périodes de relative diffusion, ne paraît plus être considéré comme très « porteur ». Les situations sont-elles comparables ?
Pourrez-vous nous expliquer pourquoi la France est en retard ? Une fiscalité nettement plus favorable au GNL par rapport au diesel serait-elle la condition première au développement de ce carburant propre ?
Ces interrogations sont d’autant plus légitimes qu’il existe en France de grands groupes gaziers ainsi qu’une tradition de recherche et développement qui devraient nous placer à la tête de cette technologie.
M. Philippe Maler, inspecteur général de l’administration du développement durable. Le CGEDD est un organisme placé auprès de la ministre chargée de l’écologie. Il est consulté sur toutes les politiques entrant dans le champ d’action du ministère et, en l’occurrence, le transport et la transition énergétique.
Les travaux de notre mission n’ont concerné que les aspects relatifs à l’entreprise et à la filière du transport, alors qu’au départ il s’agissait d’une question contingente regardant le domaine maritime.
Le gaz naturel liquéfié est un produit industriel transformé dans les pays de production depuis le gaz naturel, et liquéfié à moins 160 degrés Celsius ; son volume est 600 fois moindre que celui du gaz naturel. Il est transporté dans des navires appelés méthaniers vers l’un des trois – bientôt quatre – terminaux méthaniers de France, où il est regazéifié afin d’être utilisé comme un gaz classique. Depuis quelques années, l’utilisation du GNL comme produit industriel, notamment comme carburant, constitue un fait nouveau : certaines entreprises ont d’ailleurs abandonné le fioul ou le gaz naturel.
Le GNL n’est pas un gazole froid. Il est stocké à basse température dans des réservoirs cryogéniques. Son volume est deux fois moindre que celui du gaz naturel compressé (GNC). Il offre une autonomie double de celle du GNC, et permet une puissance des moteurs supérieure. En revanche, une de ses caractéristiques est qu’il faut beaucoup rouler – plusieurs centaines de kilomètres par jour – afin de vider le réservoir, car la stagnation du produit entraine une vaporisation du gaz susceptible de nuire à sa qualité.
En 2012, une mission nous a été confiée pour répondre à un problème posé par le transport maritime utilisant principalement comme carburant le fioul, un produit dont les caractéristiques écologiques sont très mauvaises mais dont le prix est très bas. Or, une réglementation internationale et européenne prohibant l’émission de soufre par les navires circulant – en ce qui nous concerne – en Manche et en mer du Nord, est intervenue. Force est de reconnaître que, à la différence des pays scandinaves, l’armement maritime français n’y a guère été sensible : la ministre de l’écologie a donc été saisie de la question.
Au départ, notre mission ne devait durer que quelques mois, mais il s’est avéré que la question à traiter excédait largement celle de la propulsion des navires. Cela nous a conduits à travailler durant à peu près deux ans, en mettant en relation professionnels et administrations afin de créer un environnement favorable à l’utilisation du GNL comme carburant maritime. Nous avons ainsi été amenés à étudier les conditions objectives, réglementaires et financières, dans lesquelles fonctionne le secteur.
Le GNL n’est pas, en France, une success-story, pour la simple raison que, le prix du pétrole s’étant effondré, le gazole marin est devenu aussi peu coûteux que l’était antérieurement le fioul. Cela a sans doute été profitable aux entreprises – une étude du ministère a montré que les risques de faillite étaient sérieux, particulièrement pour les ferries –, mais cela a retardé la promotion du GNL, car les investissements nécessaires dans les navires et les installations de stockage à terre sont très lourds.
En 2013, le ministère a étendu le mandat de la mission aux secteurs routier et fluvial.
Le transport routier de marchandises représente 40 000 emplois : la flotte est composée de 250 000 camions – de plus de 3,5 tonnes – et de 200 000 tracteurs, appartenant pour une partie à des entreprises effectuant du transport en compte propre ; c’est un chiffre assez faible au regard du nombre de véhicules circulant en France. Toutes les normes techniques et réglementaires applicables au secteur sont d’origine européenne, alors que la concurrence internationale est extrêmement forte puisqu’une part importante du kilométrage réalisé dans la zone est le fait de non-résidents. De fait, les trajets au départ de la France ne représentent que 15 % du trafic international, et 0 % du transit : le camion étranger circulant sur notre territoire constitue donc un réel sujet d’intérêt.
Mais, si le nombre des véhicules concernés est relativement faible, le volume des émissions polluantes est, en revanche, considérable : selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), le trafic des véhicules de plus de 3,5 tonnes – ce qui inclut les autocars – a produit 23 % des émissions françaises de NOx en 2011. De son côté, le Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) estime que ce trafic a été à l’origine de 7,2 % des émissions nationales de CO2 en 2012. On constate ainsi que les politiques de réduction des émissions de polluants concernent un secteur stratégique ; à cet égard, il faut reconnaître que la profession est parfaitement au fait de la question et a proposé des solutions intelligentes, sans pour autant renoncer au carburant diesel qui reste dominant.
Bien que les avis demeurent partagés, notre rapport a procédé à un certain nombre d’évaluations de l’impact éventuel du recours au GNL en termes d’émissions polluantes. Si les chiffres relatifs au NOx ne sont guère probants, ils le sont bien plus pour le CO2, quand bien même, là aussi, des estimations très divergentes sont en circulation. Le volume de 25 % est souvent avancé, mais il ne concerne que la mesure effectuée entre le réservoir et la roue
– l’hélice pour le maritime – ; or, s’agissant du CO2, ce qui importe, ce sont les émissions mesurées à partir du puits jusqu’à la roue ou l’hélice.
Afin d’arriver à définir une position française officielle, nous sommes parvenus à un accord entre les gaziers et l’ADEME et à définir une méthode commune de mesure des émissions de CO2 dues au transport, sachant qu’au sein de l’Union européenne chaque pays rencontre les mêmes difficultés. C’est là un point essentiel, qui fait d’ailleurs l’objet de l’une des recommandations de notre rapport.
Le recours au bio-GNL comme au bio-GNC constitue indéniablement une solution d’avenir, qui concerne un volume de production très important et permettrait de résoudre à la fois le problème des émissions de polluants et celui des émissions de CO2. Au demeurant, la mise en œuvre de cette perspective théorique pose des questions d’arbitrages et d’équilibres ne relevant pas des travaux de notre mission.
Le rapport explore les pistes d’utilisation du GNL et du GNC, les vertus de ces deux gaz étant les mêmes dans leur usage en tant que carburant destiné aux véhicules. Pour sa part, l’investissement se décompose en deux sujets : celui du réseau de distribution, beaucoup moins coûteux pour le domaine terrestre que pour le secteur maritime, et celui des véhicules. Aujourd’hui, les véhicules adaptés à ces nouveaux carburants sont coûteux puisque fabriqués en très petites séries, à la différence des poids lourds ; par ailleurs, les aides ne concernent que les véhicules particuliers. À cet égard, notre questionnement est le suivant : si peu de véhicules sont concernés, leur construction n’en relève pas moins d’investissements d’entreprise ; il existe tout de même divers moyens de faciliter ce type d’investissements sans nécessairement recourir à la prime.
En ce qui concerne l’approche industrielle, 13 800 camions, soit 5,7 % du parc, et 20 000 tracteurs, soit 10 % du parc, ont été construits en 2014. À la différence des véhicules légers, il n’existe pas de constructeurs français ; en revanche, trois entreprises construisent des camions sur notre sol : Iveco, Renault Trucks – suédois depuis une quinzaine d’années – et Scania. Toutefois, la France est exportatrice nette de moteurs à gaz, puisque Iveco construit une part non négligeable de ces moteurs en France, dans son usine de Bourbon-Lancy : la France dispose donc d’un savoir-faire dans la construction de moteurs à gaz. Les données relatives aux emplois issus de ces activités nous proviennent des industriels eux-mêmes : environ 1 000 équivalents temps plein (ETP), dont 150 créations nettes.
Enfin, la filière GNL concerne tout ce qui relève de la cryogénie, ce qui excède le seul transport routier ou maritime, pour laquelle la France détient un indéniable savoir-faire industriel en développement, et, depuis deux ans, nos industriels s’y intéressent beaucoup plus, à l’instar du groupe Air Liquide. Je tiens à signaler qu’il existe dans notre pays un fort potentiel au sein du secteur du gaz, même si cela outrepasse le cadre du rapport. La technologie du moteur à gaz, qu’il soit comprimé ou liquéfié, est maîtrisée, ce qui signifie que nous n’avons pas de recherche et développement à faire, à l’exception du biogaz et, surtout, de l’hydrogène.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Notre mission ne s’intéresse pas uniquement aux véhicules particuliers, mais aussi au transport routier, qui est singulièrement stratégique. Vous considérez dans votre rapport que, pour les deux décennies à venir, le GNL constitue la seule solution technologiquement au point pour le transport routier ; j’aimerais que vous puissiez nous apporter des précisions.
Pourriez-vous, par ailleurs, fournir des informations ainsi que des comparaisons au sujet de la situation et des perspectives des pays européens, mais aussi dans d’autres zones géographiques, comme la Chine et les États-Unis ?
Enfin, vous n’avez pas abordé la question stratégique des réseaux, sur laquelle nous serions heureux d’entendre vos conclusions.
M. Gérard Menuel. Il me semble que vous avez tenu des propos quelque peu contradictoires, en évoquant, au sujet du GNL, la contrainte de couvrir beaucoup de kilomètres quotidiens, tout en considérant qu’il n’y avait plus de travaux de recherche et développement à accomplir : n’y aurait-il pas justement là une recherche à mener ?
M. Jean Grellier. Les trois constructeurs de poids lourds que vous avez évoqués disposent-ils tous du même savoir-faire industriel, ou certains sont-ils plus avancés que d’autres ?
M. Philippe Maler. Dans le domaine de la construction de véhicules à gaz, Iveco est, de loin, le principal constructeur européen ; c’est une filiale du groupe Fiat, qui se consacre, lui, aux véhicules légers.
M. Jean Grellier. Pouvez-vous nous renseigner au sujet des diverses filières du gaz, biogaz compris, susceptible d’être utilisé comme énergie pour les moteurs ? Des réflexions sont actuellement en cour concernant le rétrofit – ou réaménagement –, concernant notamment les bus ; il s’agirait d’accroître leur longévité en adaptant leurs moteurs au gaz.
M. Philippe Maler. Le rétrofit est couramment pratiqué en Espagne ; en France, il se heurte au manque d’enthousiasme des compagnies d’assurance ; au demeurant, les camions fonctionnant au GNL sont très utilisés et, en conséquence, très vite revendus – après avoir roulé 100 000 kilomètres au minimum, généralement hors de notre pays. Aussi ne suis-je pas sûr que le rétrofit puisse constituer une solution, du moins pour des camions, a fortiori pour des tracteurs de remorques. La profession n’a d’ailleurs pas exprimé de demandes particulières à cet égard.
M. Jean-Bernard Erhardt, administrateur en chef des affaires maritimes (Conseil général de l’environnement et du développement durable). Le GNL est conditionné dans des réservoirs. A ma connaissance, ceux de marque Chart sont à 8 bars ; une soupape d’évaporation sert à prévenir l’échauffement du GNL non utilisé au-delà de 16 bars. C’est pourquoi, afin de maintenir le GNL froid dans le réservoir, il faut l’utiliser régulièrement et faire plusieurs centaines de kilomètres par jour. En effet, le modèle économique veut que le transporteur achète du gaz en tant qu’énergie, et non pour qu’il se trouve éventé : ne pas utiliser le GNL acheté constituerait un non-sens économique.
Afin d’éviter ce phénomène de vaporisation – le boil-off gas –, il est possible d’utiliser le GNL compressé dans des réservoirs à 200 bars, ce qui réduit les risques et permet de ne pas utiliser son véhicule pendant plusieurs jours. Stocké à moins 163 degrés Celsius, le GNL est essentiellement formé de méthane ; de son côté, le gaz de pétrole liquéfié, qui est du butane propane, est stocké à pression atmosphérique liquide à moins quinze degrés.
Pour répondre à votre question sur les enseignements tirés de l’utilisation du GPL, madame la présidente, et particulièrement sur les accidents liés aux valves, j’indiquerai que, dans le domaine du GNL, toutes les normes techniques sont définies ou en cours de définition, notamment pour les stations-service d’approvisionnement. Les véhicules utilisant le GNL répondent à un règlement international édicté par la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) et qui est entré en vigueur à l’automne dernier : il définit les normes applicables à ces véhicules, y compris celles du réservoir.
Dans notre rapport, nous avons souligné l’enjeu que constitue la formation de tous les acteurs impliqués dans la chaîne logistique qui seront conduits à manipuler du GNL, de façon à éviter les erreurs dues à l’absence de procédures ou les réactions inappropriées en cas d’incident. L’Association française du gaz (AFG), avec laquelle nous travaillons, a déterminé un référentiel de formation des chauffeurs-livreurs ; par ailleurs, notre mission approfondit actuellement ce point en participant aux travaux du sous-groupe GNL du Forum européen du transport durable.
Dans le cadre de la préparation de la programmation pluriannuelle de l’énergie, nos travaux au sein des ateliers biogaz ont montré qu’il faut partir de ce gaz et l’épurer afin d’obtenir du biométhane pour parvenir à une qualité susceptible d’être utilisée comme carburant. À partir du biométhane, on obtient du bio-GNC compressé à 200 bars, ou, en le liquéfiant – à condition d’avoir de petites unités de liquéfaction – afin de l’obtenir sous forme liquéfiée à moins 163 degrés Celsius.
Le rapport insiste sur la nécessité de mettre en place une chaîne logistique de bio-GNL. Nous devons aussi étudier avec l’ADEME quels peuvent être les gains attendus de la liquéfaction du biométhane en termes de réduction des émissions de CO2. Aussi, des travaux supplémentaires de recherche et développement, restent probablement à mener, et nous souhaitons rencontrer des équipementiers, notamment le groupe Air Liquide, afin d’évoquer la question des stations GNL.
M. Philippe Maler. Le transport routier constitue un métier nécessitant de potentiellement pouvoir aller partout ; cela signifie que vos véhicules doivent pouvoir se rendre là où ils sont appelés. Ainsi, une compagnie de ferries, dans le cadre d’une série de deux ou trois liaisons fixes, peut parfaitement fonctionner avec ses propres réserves de carburant. De son côté, un transporteur routier peut tout faire partout, surtout si sa flotte est composée de gros véhicules. Il faut donc être assuré, où que l’on se trouve, de trouver du carburant à un prix économiquement valable. Cela vaut aussi pour le GNL maritime.
Nous savons que la ressource est d’une ampleur et d’un coût tels que, dans la durée, il constituera un carburant compétitif ; faudra-t-il encore qu’il le soit écologiquement. Nous avons consulté bien des acteurs, dont l’ADEME : tout en restant prudents, nous avons estimé que nous disposons de deux décennies pour ne pas dire d’avantage ; dans un tel laps de temps, plusieurs camions seront nécessaires, ce qui n’est pas le cas des navires.
M. Jean-Bernard Erhardt. En ce qui concerne la Chine, la littérature disponible montre un fort développement du GNL dans le transport routier, mais aussi fluvial, sur le Yang-Tsé, ainsi que maritime. Préoccupé par la pollution, ce pays investit dans la lutte pour la qualité de l’air. On assiste à une augmentation consistante du nombre d’unités de liquéfaction du gaz et de terminaux destinés à maintenir le circuit d’approvisionnement. De très nombreux véhicules terrestres et autres transports fluviaux utilisent désormais le GNL comme carburant, en outre, les projets de construction de bateaux compatibles se multiplient.
Les États-Unis mènent une politique à l’échelon fédéral : la United States Environmental Protection Agency (EPA) et la United States Maritime Administration (MARAD) promeuvent les projets GNL, à la fois pour la navigation maritime et fluviale, sur les Grands Lacs ainsi que pour les transports routiers. Le très bas prix du gaz dans ce pays favorise le développement de l’utilisation du GNL par les opérateurs de transport.
Par ailleurs, des États fédérés, tels la Californie, ou même des États dépourvus de littoraux, encouragent activement le recours au GNL et au GNC et développent des stations-service adaptées au transport routier.
M. Philippe Maler. Le site internet de la société américaine UPS Express décrit la composition de la flotte et retrace les quantités de GNL utilisées ainsi que les zones où il est recouru à l’hybride électrique et au diesel. La rationalité de l’organisation en fait le cas d’école d’une entreprise ayant compris son intérêt.
En Europe, l’usage du GNL est récent ; il existe, en plus forte proportion qu’en France, dans trois pays. En Grande-Bretagne, le recours au GNL s’est développé à la manière d’une génération spontanée, il n’existe pas de politique globale : la Vehicle Certification Agency (VCA) édicte les règles applicables à la propreté des véhicules terrestres. Ce pays s’est récemment équipé d’un terminal méthanier à South Hook, sans pour autant disposer de plateformes compatibles.
Les Hollandais se sont dotés du Gate Terminal, plateforme GNL fonctionnant comme une sorte de club, auquel des gaziers, des transporteurs et des industriels peuvent s’affilier moyennant un droit d’entrée : tout est organisé autour de ce terminal, à partir duquel le gaz est distribué ; cette organisation diffère en tout de la nôtre. Les Hollandais dominent le transport routier européen depuis longtemps : leur organisation est rationnelle et fonctionnelle ; leur flotte comprend 300 véhicules environ, certaines entreprises disposent de 20 camions et les chiffres du kilométrage sont éloquents. Il faut garder à l’esprit que, dans ce pays, la préoccupation de la qualité de l’air préside à toute construction d’infrastructure, bien plus qu’en France.
En Espagne, le mouvement a été inverse puisque c’est le monde économique qui s’est constitué en association, impliquant les deux domaines maritime et routier ; l’administration n’est impliquée que dans une moindre part. Cette situation s’explique par la présence, dans ce pays, de huit terminaux méthaniers qui ne connaissent pas, aujourd’hui, une activité florissante, au point que l’un d’entre eux, bien qu’inauguré, n’a jamais fonctionné. Le réseau « tuyau » étant peu développé, le GNL, très utilisé, doit être acheminé.
Les Espagnols ont beaucoup investi le sujet ; ils recourent largement au rétrofit, car la crise économique n’encourage guère l’acquisition de camions neufs. La politique suivie est très volontariste : leur plan de développement prévoit 2 000 poids lourds fonctionnant au GNL à l’horizon 2020.
M. Jean-Bernard Erhardt. Depuis plusieurs années, les pays nordiques sont les plus avancés dans l’utilisation du GNL comme carburant maritime. La Norvège utilisait déjà ses ressources gazières et disposait d’un fonds « NOx » résultant de cotisations d’entreprises. Avec ce pays, la Suède, le Danemark et la Finlande constituent un réseau de petits terminaux méthaniers qui approvisionne en GNL les flottes terrestres et maritimes.
Sur la petite centaine de navires recourant aujourd’hui au GNL, la moitié au moins se trouvent dans ces pays, surtout en Norvège : les projets se multiplient dans les pays nordiques, mais aussi en Allemagne ; en Espagne, l’armateur Balearia transforme ses ferries afin d’utiliser ce carburant. Nous avons appelé l’attention de l’administration maritime et des ports français sur le développement de la concurrence des ports européens : depuis Zeebrugge, tous les ports de la mer du Nord disposent de leur propre réglementation et de leur logistique d’approvisionnement des navires en GNL. Aussi les ports français ne doivent-ils pas rater ce rendez-vous s’ils veulent demeurer compétitifs.
M. Philippe Maler. À l’époque où nous établissions notre rapport, il n’y avait pas, en France, de stations publiques de distribution de GNL terrestre ; aujourd’hui, il en existe deux et d’autres sont en construction, dont certaines bénéficient de financements communautaires. Nous encourageons nos partenaires à recourir à ces financements, que d’autres pays ont su utiliser beaucoup mieux que nous dès le départ, car ils sont stratégiques.
M. Jean-Bernard Erhardt. Dans le cadre financier pluriannuel européen 2007-2013, un ensemble de projets d’infrastructure a bénéficié de plus de 500 millions d’euros de financement, et de 160 millions d’euros du fonds dédié au réseau de transport transeuropéen. La part française a été très faible : trois projets seulement, pour un peu plus de 2,5 millions d’euros. Sur cette période, nous avons utilisé les sources de l’Agence pour l’innovation et les réseaux (INEA), qui gère les financements du réseau de transport transeuropéen (RTE-T). Avec le Bureau de promotion du shortsea shipping (BP2S), l’AFG et l’Association française du gaz naturel pour véhicules (AFGNV), nous avons conduit des actions d’information des opérateurs.
À cette occasion, nous avons pu examiner des dossiers déposés par des opérateurs français dans le cadre du dernier appel publié par la Commission européenne en 2014. Au cours de cette année, 25 projets d’utilisations du GNL ont été retenus par la Commission : dix sont axés sur les transports routiers, parmi lesquels trois sont français, ce qui dénote un intérêt plus marqué de nos entreprises pour les financements européens d’infrastructures. L’attractivité de l’aide par subventions réside en ce que les études sont cofinancées à 50 % par le RTE-T, les travaux à 20 % pour le routier et à 30 % pour les autoroutes de la mer.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Messieurs, nous vous remercions pour cette présentation riche et détaillée.
La séance est levée à douze heures quarante-cinq.
◊
◊ ◊
12. Audition, ouverte à la presse, de M. Francis Duseux, président de l’Union française des industries pétrolières (UFIP), de Mme Isabelle Muller, déléguée générale et de M. Bruno Ageorges, directeur des relations institutionnelles et des affaires juridiques.
(Séance du mardi 8 décembre 2015)
La séance est ouverte à dix-sept heures.
La mission d’information a entendu M. Francis Duseux, président de l’Union française des industries pétrolières (UFIP), Mme Isabelle Muller, déléguée générale et M. Bruno Ageorges, directeur des relations institutionnelles et des affaires juridiques.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Nous recevons ce soir M. Francis Duseux, le président de l’UFIP, l’Union française des industries pétrolières. Il est accompagné par Mme Muller, la déléguée générale de cette organisation professionnelle et par M. Ageorges, chargé des relations institutionnelles.
L’UFIP est une organisation dont les origines remontent au début de l’utilisation des produits pétroliers en France, il y a plus d’un siècle. Elle rassemble la totalité des groupes qui opèrent en France « du puits à la pompe », c’est-à-dire qu’il est notamment le porte-parole des raffineurs et distributeurs de carburants.
Notre mission d’information s’intéresse naturellement aux carburants routiers, à leurs poids économique et, bien sûr, à leur régime fiscal.
Il semble que les ventes de carburants automobiles connaissent depuis quelques années une relative stagnation, voire certaines baisses saisonnières. Mais, au total, le gazole représente toujours environ 80 % des livraisons de carburants routiers ! À lui seul, ce chiffre montre à quel point tout rééquilibrage significatif du parc entre motorisations diesel et essence prendra du temps.
L’expérience professionnelle de M. Duseux, qui a accompli toute sa carrière au sein du groupe Exxon, en France et à l’étranger, nous permettra sans doute de mieux comprendre certains points et certains enjeux. Par exemple, pourquoi la France importe-t-elle massivement le gazole alors qu’il représente une part aussi importante du marché français ? Est-il économiquement plus lucratif pour les groupes pétroliers d’importer constamment et massivement ce carburant plutôt que de le produire au sein de raffineries françaises ? En tout état de cause, les importations de gazole – dont nous souhaiterions connaître les pays d’origine, notamment européens – pèsent sur notre balance commerciale.
Par ailleurs, nous aimerions savoir quelles sont les propositions de l’UFIP s’agissant de la fiscalité des carburants et de leur impact sur les prix. Par exemple, êtes-vous inquiets de l’entrée en vigueur puis de la montée en puissance de la contribution climat-énergie ? Plus généralement, quelles sont les projections de l’UFIP sur le marché pétrolier français et quelles sont les anticipations stratégiques que vos membres auraient engagées en conséquence ?
Pouvez-vous nous présenter quelques exemples concrets de l’adaptation des entreprises pétrolières françaises sur la voie de la transition énergétique dans les domaines du transport routier ?
La mission va vous écouter, dans un premier temps, pour un exposé de présentation et de situation. Puis, Mme Delphine Batho, notre rapporteure, vous posera un premier groupe de questions. Elle sera suivie par les autres membres de la mission qui, à leur tour, vous interrogeront.
M. Francis Duseux, président de l’Union française des industries pétrolières (UFIP). Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir donné l’opportunité d’échanger avec vous aujourd’hui. Dans l’esprit de la COP21, nous sommes évidemment désireux de consommer moins et de consommer mieux. Il n’est plus question, pour les pétroliers, d’être climato-sceptiques. Pour ma part, je considère qu’il faut engager des changements pour contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air et à la limitation des émissions.
Nous avions déjà engagé une action en ce sens, entre 1997 et 2000, avec le programme « Auto-Oil II » dont l’objectif était de définir un cadre pour différentes options de réduction des émissions, portant sur le coût, l’efficacité scientifique et la transparence.
Dans ce propos liminaire, j’aborderai quatre sujets : le défi climatique et la baisse de consommation prévue, qui devrait entraîner une importante réduction des émissions ; le défi de compétitivité pour nos industries, notamment nos raffineries ; la fiscalité et ses impacts potentiels ; enfin, un petit mot sur le rôle des biocarburants.
Premièrement, la réponse au défi climatique, qui est lié à la problématique de la qualité de l’air.
On s’est engagé avec Bercy sur les neuf solutions industrielles qui ont été définies en mai 2015 et répondent désormais au nom générique d’« Industrie du futur ». Dans ce cadre, le thème de la mobilité écologique rassemble, notamment, les projets liés à la réduction de la consommation des véhicules jusqu’à 2 litres aux 100, dont nous avions beaucoup parlé avec nos collègues de l’industrie automobile.
Les émissions de CO2 des véhicules légers neufs ont déjà beaucoup baissé, et cette tendance va se poursuivre : moins 1 % jusqu’en 2007, pour atteindre 160 g par km ; moins 4 % par an à compter de 2008, pour atteindre 118 g par km en 2013. Et comme vous le savez, l’objectif de 2020 est de 95 g, et celui de 2025 de 75 g par km.
Nous avons rencontré nos collègues énergéticiens pour essayer de voir ce que la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) signifiait pour nous, pour nos industries, nos raffineries, et pour la consommation en France. Nous continuons à travailler avec le Gouvernement sur le sujet, mais je peux vous donner les grandes tendances qui se dessinent.
La demande en énergie dans les transports va baisser d’environ 20 %, et la demande en carburant pétrolier d’origine fossile va baisser de 30 %. Il y a bien sûr des incertitudes et en tant que pétroliers, nous ne contrôlons pas tout. Malgré tout, si l’on tient compte de l’évolution des véhicules, ce chiffre nous paraît réaliste. Cela représente environ 10 millions de tonnes par an de produits, et essentiellement de gazole. Nous aborderons un peu plus tard, à votre demande, la question de la fiscalité. Mais cette étude a été lancée même avant que l’on ne parle du rattrapage de celle-ci.
Quoi qu’il en soit, on assiste à une stagnation de la consommation d’essence et à une forte baisse de la consommation du diesel pour les véhicules légers. Reste la problématique du transport poids lourds, que l’on évoquera sans doute séparément.
Il y aura de plus en plus de véhicules électriques en milieu intra urbain. Par ailleurs, à l’horizon 2030, une voiture sur deux devrait être un véhicule hybride rechargeable – idéal pour faire 60 ou 80 km par jour pour vous rendre au travail avec le moteur électrique, et pour partir plus loin, par exemple en vacances, avec le moteur thermique. Cela conduira à une très forte baisse de la consommation. Le phénomène nous paraît inéluctable. Et tous nos échanges avec les constructeurs automobiles vont dans le même sens.
J’en viens aux biocarburants. L’objectif du Gouvernement est de porter à 15 % la part de l’utilisation des énergies renouvelables dans les transports à l’horizon 2030, et à 10 % à l’horizon 2020.
Mais la situation est un peu compliquée. Récemment, l’Europe a limité l’introduction de bio dans les carburants à un pourcentage de 7 % – grâce à la France, semble-t-il. Et pour le moment, on n’ira pas plus loin.
Par ailleurs, l’Institut français du pétrole-Énergies nouvelles (IFP-En) – dont nous avons vu le président, Monsieur Didier Houssin – a engagé des études sur l’utilisation des biocarburants de deuxième génération. L’objectif est louable, mais il n’y a même pas de pilote en place !
Voilà pourquoi, en tant que pétroliers, nous considérons qu’il sera difficile de mettre au point des processus industriels relativement économiques pour parvenir à un pourcentage de 15 % – ce qui suppose 8 % de biocarburant de deuxième génération. Dans ce domaine, il faut faire attention aux hypothèses sur lesquelles on se base.
Ensuite, on prévoit une augmentation de 5 à 6 % de l’utilisation du biogaz, GNV ou GPL, certaines flottes privées de transport par camions étant appelées à se développer. Je pense que ce sont les politiques qui décideront, ou non, du rythme de cette augmentation.
Enfin, la part de l’électricité devrait rester assez faible, à 1,5 %.
L’important, pour votre commission, est de savoir que l’on va accompagner, sans autre mesure fiscale, le mouvement qui est prévu en termes de transition énergétique. Cela va se traduire par une baisse de consommation de 30 %, essentiellement du gazole. Voilà le premier message que je voulais faire passer.
Deuxièmement, le défi de compétitivité pour le raffinage et la logistique pétrolière.
Je rappelle qu’en France l’industrie pétrolière emploie environ 200 000 personnes. Mais nous y associons souvent nos collègues de la pétrochimie, qui lui est fortement liée.
Il existe actuellement huit raffineries en métropole, plus une en Martinique. Le secteur a fait l’objet d’une forte rationalisation, qui s’est traduite par de nombreux problèmes politiques, sociaux et humains. En effet, au cours de ces cinq dernières années, les marges des raffineries étaient très déprimées. Il faut dire qu’en Europe, la tendance globale de la demande est à la baisse, alors même que la concurrence est à la hausse.
Cette concurrence vient de trois endroits et surtout, maintenant, des Etats-Unis. Ces derniers ont complètement transformé leur modèle pétrochimique et de raffinage. Ils étaient à peu près dans la même situation que nous, avec des raffineries un peu vieillissantes et des rationalisations. Mais depuis deux ans, ils ont accès à un combustible trois fois moins cher que celui dont on dispose en Europe, à savoir le gaz de schiste, et ils réinjectent des milliards de dollars dans leur outil pétrochimique. Malgré leur niveau de consommation, ils s’approchent de l’indépendance énergétique. Ils arrivent non seulement à satisfaire leurs propres besoins, mais encore à exporter du gazole vers l’Europe et les ports français. En outre, ils vont exporter massivement du polyéthylène et du polypropylène, produits chimiques qui ne sont pas des carburants, mais qui entrent dans la production des véhicules automobiles.
Il ne nous reste donc plus que huit raffineries en métropole. En effet, après Dunkerque dans le Nord, puis Reichstett en Alsace, ce fut au tour de la raffinerie de l’Étang de Berre de fermer, en raison de pertes trop conséquentes – LyondellBasell ne conservant que la partie chimie. Enfin, plus récemment, après de nombreux allers et retours, la raffinerie de Petit-Couronne a fini par fermer ; il n’y avait pas eu d’investissements pendant douze ou treize ans dans cette raffinerie, et il aurait fallu réinjecter 700 à 800 millions d’euros pour la relancer, ce qui était impossible.
Aujourd’hui, Total a annoncé qu’il allait reconvertir en bio raffinerie la raffinerie de La Mède, sur l’étang de Berre ; il va arrêter la distillation classique de pétrole brut et, au travers du retraitement d’huiles usagées, produire des biocarburants ; il va également maintenir une activité essence aviation, et faire un parc de cellules éoliennes. Je pense qu’il a cherché à conserver le maximum d’emplois. Mais cela va réduire encore le traitement de pétrole brut dans notre pays.
Ainsi, en raison de pertes très importantes, la France a procédé à une rationalisation très marquée de son activité de raffinage. C’est un peu moins le cas dans le reste de l’Europe, en particulier en Italie où l’outil de raffinage reste surdimensionné.
Au-delà de ces huit raffineries, notre outil logistique est assez sophistiqué. C’est sans doute un des meilleurs d’Europe. Des pipe-lines, dont le réseau est très élaboré, acheminent les produits finis, qui sont stockés dans les dépôts. Il y a 190 dépôts dans toutes les régions de France, et à la demande du Gouvernement, nous disposons de trois mois de stocks stratégiques pour faire face en cas de crise. Enfin, il y a 11 350 stations-service.
Le nombre de ces stations-service a beaucoup chuté. À une époque qui n’est pas si lointaine, on en comptait 40 000 ! Mais pour des raisons de rentabilité, on a procédé à une rationalisation, au point qu’aujourd’hui, certaines petites villes rencontrent des problèmes d’approvisionnement. La situation risque de s’aggraver si, comme on l’a prévu, la demande continue à baisser dans les prochaines années. Il faudra donc se soucier du maillage de notre territoire en stations-services. S’il est possible d'utiliser les transports en commun dans les grandes villes, ce n’est pas le cas dans les zones rurales. Je pense que pendant très longtemps encore, leurs habitants auront besoin d’utiliser leur véhicule pour aller au travail, se déplacer, faire les courses, etc.
La baisse de la demande constitue un premier défi pour le raffinage et la logistique pétrolière. Il y en a d’autres. Je citerai le niveau très élevé des coûts, en particulier ceux de l’énergie, qui représentent 50 % des coûts d’une raffinerie, et la réglementation française et européenne, qui est extrêmement pénalisante – limitation des émissions, plans de prévention des risques technologiques (PPRT). Il convient, certes, d’être exemplaires et d’éviter les accidents industriels. Mais cela finit par nous handicaper par rapport au reste de l’Europe, et surtout par rapport au reste du monde. Sans compter le déséquilibre essence-gazole qui nous a pénalisés pendant vingt ans.
De fait, nos raffineries avaient été conçues dans les années soixante, époque où l’objectif était essentiellement de fabriquer de l’essence. Mais avec le temps, on est passé d’un ratio de 80 % de consommation de gazole contre 20 % de consommation d’essence. Et une fois que nous sommes parvenus à extraire le maximum de gazole d’un baril de pétrole, il nous a fallu en importer. Voilà pourquoi, comme vous l’avez rappelé, madame la présidente, sur à peu près 40 millions de tonnes de gazole que nous consommons par an, nous en importons 20 millions de tonnes. Ce n’est pas bon. Cela pèse, je crois, pour 65 milliards sur notre balance commerciale.
Ce gazole vient d’un peu partout dans le monde. Pendant des années, c’était du gazole russe, parce qu’il était disponible. Il est maintenant concurrencé par le gazole américain et par celui du Moyen-Orient ou même de l’Inde. Cette année, une raffinerie ultramoderne, construite en Arabie saoudite – 400 000 barils jour, pas de contrainte au niveau des émissions, une main d’œuvre relativement faible, etc. – est venue concurrencer gravement nos usines en France. Enfin, le groupe Reliance, établi en Inde, a construit une énorme raffinerie, produisant un million de barils/jour soit 50 millions de tonnes/jour. Elle était destinée à satisfaire le marché intérieur indien. Mais comme les infrastructures routières n’ont pas suivi, les Indiens se trouvent face à d’importants surplus qu’ils exportent vers l’Asie et l’Europe. Les VLCC (Very Large Crude Carriers), ces énormes bateaux faits, à l’origine, pour transporter du pétrole brut, arrivent désormais dans nos ports chargés de produits finis, dont le produit de revient est inférieur de 10 à 15 euros la tonne par rapport à ce que nous pouvons faire. C’est donc un vrai problème.
Je vais vous donner maintenant quelques chiffres :
Le marché des produits pétroliers représentait en 2014 à peu près 60 millions de tonnes de produits vendus, dont 45 millions de tonnes de carburants : 34 millions de tonnes de gazole ; 4,5 millions de tonnes de gazole non routier, du fuel à bas soufre destiné aux tracteurs, engins de chantier, etc. ; enfin, 7 millions de tonnes de supercarburant, dont 30 % de E10 – un carburant qui inclut 10 % de bio, alors que le supercarburant sans plomb classique en contient au maximum 5 %. À ce propos, il semblerait qu’il y ait une volonté politique d’encourager la consommation du 10 par des avantages fiscaux, sur lesquels j’aurai sans doute l’occasion de revenir.
Par ailleurs, notre industrie contribue largement à l’approvisionnement de l’industrie chimique, soit sous forme de molécules lourdes, soit sous forme d’équivalent gazole, soit sous forme de naphtas, plus légers. C’est un point important. Si l’on se projette à vingt ou trente ans, il faut prendre également en compte l’industrie pétrochimique.
Nous posons régulièrement à nos différents ministres la question suivante : est-ce que, pour vous, le raffinage est un secteur stratégique ? En effet, avec ce qui se passe dans le reste du monde, on pourrait penser que la France va s’approvisionner par des importations de produits, et abandonner tout le raffinage. Or, je crois qu’il y a une volonté politique de conserver une industrie du raffinage en France. Pour un grand pays comme le nôtre, qui est la cinquième puissance mondiale, il serait relativement facile, même sans passer par les groupes pétroliers, de sécuriser son approvisionnement en brut, avec un ou plusieurs producteurs. Mais en conservant une industrie française, on garde la maîtrise de ce que l’on fabrique, on s’assure de sa qualité et on contrôle la logistique. Cette logistique n’est d’ailleurs pas adaptée à une importation massive. Enfin et surtout, importer 100 % de nos produits pétroliers poserait, à terme, un problème d’indépendance énergétique à notre pays.
Pour vous donner une idée des contraintes qui pèsent sur nous, je vous précise que l’énergie nous coûte 12 euros la tonne, soit trois ou quatre fois plus qu’ailleurs, auxquels il faut ajouter le coût des réglementations – les réglementations françaises venant s’ajouter aux réglementations européennes – soit environ 6,50 euros la tonne. Cela fait, au total, 18 euros la tonne. C’est énorme !
Certes, il faut éviter les incidents et protéger les populations autour de nos raffineries. Mais alors que, dans les années soixante, quand nous avons construit nos raffineries, nous étions complètement isolés, avec le temps, les habitations se sont rapprochées. C’est un problème difficile, qui est celui de tous les industriels de ce pays.
Troisièmement, la fiscalité et son impact potentiel.
Pendant vingt ans, nous avons demandé, pour des raisons d’ordre simplement industriel, qu’on ne laisse pas filer le gazole. Or vous savez que l’on est arrivé jusqu’à 20 centimes d’écart entre le gazole et l’essence ; sans compter la déductibilité de la TVA sur les flottes d’entreprise. Le différentiel de coût était tel, pour les entreprises comme pour les particuliers, qu’il y a eu jusqu’à 80 % de vente de véhicules neufs diesels dans notre pays. Je crois que la moyenne française est encore aujourd’hui de 67 %. Et comme la durée de vie moyenne du parc automobile est de douze ans, quelles que soient les décisions que prendra le Gouvernement, la situation ne pourra pas changer du jour au lendemain. Ce sera forcément très progressif.
Pour notre part, nous avons toujours soutenu le rééquilibrage de la fiscalité entre le gazole et l’essence. On a parlé d’augmenter le gazole d’un centime et de baisser l’essence d’un centime, puis de ne baisser que le 10, etc. Je ne sais pas quelle sera la décision finale. Nous proposons que l’on réduise la fiscalité sur toute l’essence, quitte à donner un coût de pouce au 10. Cela étant, nous sommes bien conscients que l’industrie automobile française ne peut peut-être pas reconvertir ses chaînes de fabrication du jour au lendemain. Pour le bien de ce pays, il faut faire attention, étudier les impacts des éventuelles décisions et procéder doucement.
On parle d’un rattrapage en cinq ans. Cela nous paraîtrait suffisamment lent pour permettre à l’industrie automobile de modifier ses chaînes de fabrication. Mais je ne me sens pas qualifié pour m’exprimer à ce propos. Disons simplement que nous sommes favorables au rééquilibrage, et que nous sommes contents que la décision en ait été prise.
De la même façon, nous avons toujours prôné la déductibilité de TVA sur l’essence pour les véhicules d’entreprise. Je crois que cette déductibilité a été votée vendredi par l’Assemblée, et que le Sénat aura à se prononcer prochainement à ce sujet. Mais là encore, nous ne connaissons pas les contraintes auxquelles l’industrie automobile est soumise. Par exemple, j’ai cru comprendre qu’il ne faudrait pas l’appliquer aux voitures étrangères, dans la mesure où les constructeurs étrangers sont mieux positionnés que les constructeurs français sur les véhicules à essence. En conclusion, nous sommes plutôt favorables à cette mesure, à condition, bien sûr, qu’elle ne nuise pas à notre industrie automobile.
Cela étant, nous sommes un peu inquiets, aussi bien comme pétroliers que comme citoyens, de l’impact que pourrait avoir l’augmentation des taxes sur le gazole – mesure que les ministres ont d’ailleurs longtemps considéré comme étant la plus impopulaire. En effet, si l’on veut un rattrapage en cinq ans, il faudra augmenter le gazole de dix centimes par litre. Par ailleurs, la loi de transition énergétique ayant conduit au vote d’une taxe carbone sur les carburants de 100 euros la tonne à l’horizon 2030, il faudra augmenter le gazole de 32 centimes par litre. Et cela représente, au total, une augmentation de 42 centimes par litre de gazole !
Aujourd’hui, le baril de pétrole brut est à peine au-dessus de 40 dollars le baril, en raison d’une baisse extraordinaire de plus de 50 %. Cette baisse s’est traduite immédiatement par une baisse massive des investissements de la part de tous les grands groupes pétroliers. Et assez rapidement, la baisse des investissements va se traduire elle-même par une baisse de la production. Or, en parallèle, la demande mondiale, tirée par l’Inde, la Chine et les pays émergents – mais pas par les pays européens, dont la consommation est étale – va augmenter d’à peu près 1,5 million de barils jour, ce qui est énorme.
Cet été, le déséquilibre entre l’offre et la demande était de 2 millions de barils jour. C’est beaucoup pour faire chuter les prix du brut, et c’est ce qui est arrivé ; les stocks ont monté. Mais ce n’est pas beaucoup si l’on réinjecte l’augmentation d’1,5 million de barils jour qui se profile. Je précise que ce sont là les chiffres de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), et pas ceux de compagnies comme BP, Exxon ou Total.
On annonce par ailleurs une baisse de la production de pétrole de schiste américaine de l’ordre de 900 000 barils jour. Celle-ci sera peut-être compensée par une reprise de la production de l’Iran, estimée à plus 500 000 barils jour.
Le bilan que l’on peut faire est que, à la fin de 2016, l’équilibre entre l’offre et la demande sera bien meilleur et que, vraisemblablement, les prix repartiront à la hausse. Ils n’augmenteront sans doute pas jusqu’à 110 dollars le baril. Mais 80 dollars le baril serait un prix tout à fait normal.
Cela étant, l’impact d’une augmentation du pétrole de 20 ou 30 dollars le baril sera au moins de 20 à 30 centimes par litre de gazole sur la matière première. Ajoutés aux 42 centimes dont nous parlions tout à l’heure, l’augmentation pourrait, à terme, atteindre 70 centimes par litre. Aujourd’hui, le litre de gazole est environ à 1,10 euro. Cela veut dire qu’en 2020, il pourrait être à 1,80 euro ! Il y a de quoi s’inquiéter, en particulier pour ceux qui ont absolument besoin de leur voiture et qui n’ont pas d’alternative. Cette réflexion est plutôt d’ordre politique, je le reconnais. Malgré tout, je pense qu’il est de notre rôle de mettre une telle éventualité sur la table.
Tout aussi grave serait le renchérissement du transport, qui menacerait d’une façon générale la compétitivité de nos entreprises, à moins que vous ne mettiez en place des systèmes de compensation ou de subventions – comme ceux dont bénéficient aujourd’hui les taxis ou les transporteurs. Quoi qu’il en soit, les ordres de grandeur de cette augmentation sur le gazole font peur, car celle-ci pourrait avoir des conséquences très importantes sur la vie des citoyens et sur la compétitivité des entreprises.
Quatrièmement, le rôle des biocarburants.
Nous avons toujours soutenu le développement des biocarburants. Depuis plusieurs décennies, on peut dire que nous jouons un rôle important en la matière. Grosso modo, nous intégrons 10 % de biocarburants dans l’ensemble « gazole et essence », ce qui est tout de même énorme. Donc, on sait faire et on accompagne.
Le Gouvernement avait proposé qu’au 1er janvier de cette année, on passe au B8, c’est-à-dire à une incorporation de 8 % de bio dans les carburants, alors que la législation européenne en était encore au B7, soit à 7 % - sans doute pour soutenir l’industrie agricole de notre pays. Nous n’avons pas refusé, parce que nous savons le faire. Mais il ne faut pas oublier que nous devons protéger les consommateurs contre des pannes éventuelles. Nous avons donc demandé aux constructeurs si pour eux, il était acceptable de passer du B7 à B8 dans leurs voitures.
Pour Renault ou Peugeot, dans le contexte français, l’affaire est assez neutre. Mais pour tous les autres constructeurs, et en particulier les constructeurs allemands, il n’en est pas question. Ils ne sont pas d’accord, et ils ont dit qu’ils nous tiendraient pour responsables si des flottes de véhicules tombaient en panne. En fait, nous ne sommes ni pour ni contre. Nous savons faire, mais nous demandons que les mesures liées aux biocarburants soit prises au niveau européen. Comme vous le savez, de très nombreux véhicules venant des autres pays européens traversent notre pays lorsqu’ils vont en vacances, ou lorsqu’ils vont en Espagne. Si dans un pays, l’incorporation du bio est à 4 % et dans un autre à 12 %, ce sera ingérable, aussi bien pour les pétroliers que pour les constructeurs automobiles.
Si dans quelques années, il faut passer à B8 ou B10 ou B15, la décision devra être prise avec les constructeurs automobiles européens. Nous ne ferons que subir, nous n’avons pas de position tranchée dans un sens ou dans un autre. Mais il est impossible, pour nous, de mettre à la consommation des produits français dont la teneur en bio serait supérieure à celle que l’Europe a acceptée et que les constructeurs européens ont admise. On ne peut pas le faire, parce que cela pourrait entraîner d’énormes problèmes juridiques et de qualité.
Voilà ce que l’on pouvait vous dire en introduction.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Monsieur le président, vous avez abordé l’évolution de la consommation des énergies fossiles dans les années qui viennent. Pour ma part, je m’en tiendrai à l’objet de notre mission, qui est l’évolution du secteur automobile et des transports routiers dans une approche énergétique et fiscale, mais également technologique.
Cela étant, il me semble que la crise pétrolière et la baisse des prix du baril n’avaient pas vraiment été prévues. D’où ma première question : pouvez-vous nous confirmer qu’une remontée des prix du pétrole est envisageable dans un horizon assez proche ?
Ensuite, vous avez rappelé que le nombre de nos raffineries était passé de 24 en 1975, à 8 aujourd’hui. D’où ma deuxième question : sommes-nous toujours en surcapacité ?
Je crois me souvenir que le déficit de la balance commerciale lié aux importations de gazole était, en 2012, de 13 milliards. D’où ma troisième question : quelle serait l’incidence, pour le secteur du raffinage français, d’un rattrapage de la fiscalité entre le gazole et l’essence ? J’aimerais également que nous nous parliez du rythme de ce rééquilibrage, y compris pour les véhicules d’entreprise.
S’agissant du transport routier, certains plaident pour le développement du GNV. D’où ma quatrième question : l’UFIP a-t-elle un point de vue sur le sujet ? Je pense plus particulièrement au réseau de distribution.
Enfin, pour réduire la production de dioxyde d’azote (NO2) par les véhicules diesel, les constructeurs automobiles sollicitent la mise en place, dans les stations-service, d’un réseau de distribution d’urée à la pompe. D’où mes dernières question : cela vous paraît faisable ? En avez-vous discuté avec les constructeurs automobiles ?
M. Charles de Courson. Monsieur le président, j’ai cru comprendre que vous étiez favorable à l’égalisation de la fiscalité entre les deux carburants principaux : essence et gazole. Pourriez-vous nous préciser comment vous voyez cette égalisation, sachant qu’il n’est pas envisageable de perdre un sou dans l’opération ?
J’ai cru comprendre également que vous étiez favorable à la déductibilité de la TVA sur l’essence pour les flottes automobiles d’entreprises. Qu’en est-il ? Nous en avons encore discuté dernièrement, et des amendements ont été déposés en ce sens – j’en ai moi-même déposé un. Le Gouvernement semble prêt à bouger. J’ajoute que la mesure ne serait pas très onéreuse.
Par ailleurs, pensez-vous que cette modification de la fiscalité pourrait aboutir assez rapidement à un partage du marché automobile à peu près à 50/50 ? L’idéal, pour notre industrie pétrolière du raffinage, serait au moins d’arriver au prorata gazole/essence ; mais nous n’en sommes pas là. Faut-il aller encore un peu plus loin ? En effet, on ne doit pas confondre parité et parité énergétique : chacun sait qu’un litre d’essence n’est pas équivalent, du point de vue de l’énergie produite, à un litre de gazole : l’écart est de 5 ou 7 % – en faveur du diesel.
Mais venons-en aux biocarburants. Vous dites, et je partage assez largement votre diagnostic, que les biocarburants de deuxième génération sont d’abord un sujet de colloque et de discours, notamment dominicaux, et vous remarquez qu’il n’y a pas de pilote en place. Ce n’est pas tout à fait exact, parce que le pilote « Futur Oil » est quasiment construit à Bazancourt. Mais peu importe. Le vrai problème qui se pose est celui l’approvisionnement et du coût. Actuellement, les prix de revient sont élevés, même si l’on peut espérer qu’ils vont baisser progressivement, je reste sceptique sur l’avenir des biocarburants de deuxième génération.
Quant aux arguments que vous avancez à propos des biocarburants de première génération, je les entends depuis trente ans et j’y reste insensible. On peut augmenter de 2, 3, 5 %, etc. la proportion du bio dans les moteurs. Cela ne pose aucun problème technique, notamment sur les moteurs diesel.
Il suffit de regarder ce qui se passe dans les stations-service où, pour faire des économies, les automobilistes font eux-mêmes des mélanges. Et ils ne se limitent pas à 7 % : 80 % de biocarburant E85 à la première pompe, et 20 % d’essence à la deuxième. C’est une part significative du marché, notamment pour les plus modestes.
Mais il y a aussi ceux qui rajoutent de l’huile. Si cela sent de temps en temps la friture dans les voitures diesel, c’est simplement parce que l’on a ajouté dans le réservoir de l’huile achetée en grande surface ! Voilà pourquoi, dans certaines grandes surfaces, la consommation d’huile explose. On n’en parle jamais, mais il y a un manque de cohérence entre la fiscalité de l’huile dite de consommation domestique, et l’autre. Et le marché n'est absolument pas étanche.
Qu’en pensez-vous donc ?
Vous avez ensuite évoqué le défi de compétitivité auquel sont confrontées vos industries en général, et vos raffineries en particulier.
Nous ne sommes pas compétitifs. Pourriez-vous nous donner les chiffres des pertes ? Je crois que nous en étions à 500, 700 millions par an, et que nous en sommes maintenant à 100, 200 millions par an. Mais le problème réside dans la rentabilité relative. Nous avons à peu près atteint l’équilibre à coup de fermetures de raffineries, mais il nous en reste huit. Où va-t-on ? Celles-ci ne risquent-elles pas toutes de fermer, comme certains l’annoncent ? Et le phénomène ne touche pas que la France : il touche toute l’Europe et profite aux industries pétrolières du Golfe, des États-Unis ou d’ailleurs.
En dernier lieu, je vous interrogerai sur les véhicules hybrides : pensez-vous que ceux-ci pourront prendre rapidement 50 % du marché ? Je suis très sceptique.
Selon vous, les véhicules électriques devraient atteindre 1,5 % du marché. Je pense qu’on pourrait déjà se satisfaire de 1 ou 1,5 %, dans la mesure où ces véhicules ne peuvent couvrir que de petites distances. Ce n’est pas le cas des véhicules hybrides. Sauf que ceux-ci posent tout de même des problèmes de prix, auxquels les consommateurs sont évidemment sensibles.
M. Philippe Duron. Monsieur le président, vous avez été très complet dans votre exposé liminaire. Je tiens à vous en remercier. Vous avez montré que vous étiez favorable à un rééquilibrage gazole-essence, et précisé qu’il n’était pas déraisonnable d’envisager un rattrapage en cinq ans. Vous avez également évoqué l’évolution et l’adaptation des véhicules légers. Mais vous n’avez rien dit sur la consommation des poids lourds ni sur leur évolution technologique. J’aimerais que vous nous en parliez. J’aimerais enfin savoir si les techniques du raffinage vont évoluer et gagner en efficacité.
M. Francis Duseux. Madame la rapporteure, nous avons toujours travaillé avec les constructeurs automobiles, qui doivent résoudre deux problèmes : le poids des matériaux et les frottements. Et sans être un spécialiste de ces questions, je sais que, dans tous les grands groupes, on a fait d’énormes progrès sur les huiles qui permettent de réduire les frottements.
Ensuite, depuis l’application des normes Euro 6, le prix élevé de l’installation d’un filtre à particules sur les petits véhicules diesel incite les automobilistes à se tourner vers les petits véhicules à essence. Ainsi, depuis le mois de janvier, les courbes sont en train de s’inverser.
Enfin, ces véhicules ne consomment que 4 litres aux cent, et il est réaliste de penser qu’il sera bientôt possible de baisser cette consommation à 3 litres aux cent. Rappelons-nous qu’il y a dix ou douze ans, certaines voitures consommaient dix ou douze litres aux cent ! Aujourd’hui, c’est fini.
Cela signifie que, collectivement, nous avons fait des progrès, qui auront un impact positif sur les émissions et sur le climat.
Maintenant, comme vous l’avez fait remarquer, on n’a jamais une bonne vision de ce qui se passe. On peut malgré tout dégager des tendances lourdes. Les grands groupes, Total, Exxon, Mobil, BP et Shell, vous l’avez lu, ont limité leurs investissements dans la recherche, que celle-ci pote sur le conventionnel ou sur le non conventionnel. Vous le savez, entre le moment où l’on décide d’investir et le moment où l’on en récolte les fruits, il faut attendre trois, quatre ou cinq ans ; l’effet n’est pas immédiat, mais ce qui a été investi auparavant continue à produire ses effets. Mais dès que l’on arrête d’investir, on en subi les conséquences. Et je ne parle pas de l’impact que peuvent avoir les conflits géopolitiques. Dans mon jeune temps, au moindre bruit de bottes, le baril prenait dix dollars. Nous n’en sommes plus là. Il n’empêche que l’aggravation des conflits pourrait affecter le marché. Tout cela pour vous dire que nous allons tout de même vers une remontée du prix du baril.
Vous m’avez demandé si, dans le domaine du raffinage, la France était surcapacitaire. Nous avons procédé à de nombreuses restructurations, et une raffinerie s’apprête à modifier son traitement. Aujourd’hui, notre capacité est légèrement inférieure à la demande française. Je pense donc qu’en France, nous avons fait le travail qu’il fallait. Maintenant, je ne peux pas savoir ce qui va se passer. Tout dépendra des marges de rentabilité.
Il faut toutefois être honnête : les marges de 2015 sont excellentes. Nous voyons à cela deux raisons essentielles : d’une part, une baisse du prix du brut qui signifie, pour nous qui chauffons nous fours pour faire de la distillation, une baisse du prix de l’énergie ; d’autre part, une certaine élasticité de la demande aux prix, que nous n’avions pas prévue.
Les prix ont baissé. Le phénomène est moins net en France, à cause de l’effet amortisseur des taxes ; reste que le litre d’essence ou de gazole a tout de même chuté de 30 centimes, ce qui n’est pas rien. Il en va différemment aux États-Unis, où les taxes sont quasiment inexistantes. Selon un article de presse, un ménage américain récupère ainsi 1 000 dollars par an de pouvoir d’achat ; et il les consomme. Voilà pourquoi les Américains se mettent à racheter des SUV (Sport Utility Vehicles) et recommencent à consommer beaucoup de carburant. Plus généralement, la baisse du prix des produits a relancé la demande. Même en France, alors que la consommation avait baissé de 1 à 2 % ces dernières années, on a observé que celle-ci avait augmenté de 2 % en octobre. La tendance s’est inversée. On peut donc parler d’élasticité.
L’augmentation de demande mondiale est là, tout comme la baisse de la capacité de production. On devrait donc revenir à un équilibre.
J’ai peut-être oublié de vous dire que nous avions été frappés par le fait que pendant les cinq années précédant 2015, on avait estimé qu’environ 3,5 milliards d’euros avaient été perdus dans le raffinage, ce qui fait beaucoup. Si la situation devait perdurer parce que l’on n’est vraiment pas compétitif, parce que le raffinage américain connaît une relance et nous inonde de produits bien moins chers, il faudrait être vigilant. On en a parlé avec Monsieur Macron, comme avec tous nos interlocuteurs que cela préoccupe. Pour l’instant, on connaît une bonne relance, et après tout, on est dans une industrie cyclique. Mais si on accumule vraiment trop de pertes, on risque de devoir fermer des usines.
Madame la rapporteure, je reconnais avoir peu parlé du GNV. Mais d’après ce que je connais, il n’y a aucun projet tangible en ce domaine, à part ceux de quelques entreprises locales qui investissent elles-mêmes et qui développent. On peut malgré tout penser que, pour consommer moins et mieux, on s’orientera vers la récupération des déchets. J’ai cru comprendre que cela passait par un tri extrêmement sélectif, et par des investissements importants au niveau d’une commune : 4 à 5 millions d’euros. Des tentatives ont eu lieu, mais le résultat a été mitigé.
Le schéma idéal serait, selon moi, le suivant : une bien meilleure récupération des déchets, une production de méthane injectée dans les circuits de gaz et, progressivement, si c’est rentable, une utilisation supérieure du gaz dans les poids lourds. Mais il faudra tout de même des investissements. Et pour être très honnête, nous n’avons pas établi de scénario précisant ce que cela coûte, les investissements à engager, les moyens de financement à mobiliser et ce que cela suppose pour nos stations-service.
J’ai été frappé par le fait que les Américains, qui ont des poids lourds énormes roulant sur de grandes distances, ont commencé à utiliser du GNV. Les adhérents de l’UFIP ne m’en ont pas parlé, mais on pourrait imaginer d’installer quelques stations de GNV à la frontière espagnole pour les flottes de camions qui viennent d’Allemagne et de Hollande et qui traversent notre pays. Il faudrait en parler avec vos services.
C’est tout le problème de la transition énergétique : on se fixe des objectifs ambitieux avant même de connaître les coûts, les moyens de financement et l’impact sur les emplois. Il n’est pas question de polémiquer, mais si on ne fait pas preuve de réalisme, on ira droit dans le mur. La compétitivité est mondiale, et il faut tout de même s’en préoccuper.
Enfin, la réduction de NOx dans le diesel passe par des injections d’urée. Nous en avons discuté il y a quinze jours avec nos collègues de l’automobile, et nous avons été étonnés d’apprendre qu’il fallait injecter l’équivalent d’un plein tous les quatre pleins.
Mme Isabelle Muller, déléguée générale de l’UFIP. Que font les distributeurs de produits pétroliers par rapport à cette demande ?
Les constructeurs automobiles nous ont alertés. Vous savez que pour les poids lourds, cette nécessité existe déjà. On distribue donc en station-service de l’urée pour les poids lourds. A chaque fois qu’ils font le plein de carburant, ils font le plein d’urée.
La nécessité de mettre à disposition de l’urée pour les futurs véhicules diesel est bien prise en compte. Mais il ne faut pas oublier qu’en France, la grande distribution occupe plus de 60 % du marché des produits pétroliers. Donc, la question qui peut se poser, mais qu’il faut adresser aux distributeurs en grande surface, est de savoir comment ils se préparent.
Les pétroliers que nous représentons l’ont pris en compte, et les investissements nécessaires seront faits pour assurer la distribution de l’urée dans les stations-service. Et je ne peux pas croire que les stations-service de la grande distribution ne s’y préparent pas également.
Mme la rapporteure. Il n’y a pas de difficulté technique ?
Mme Isabelle Muller. Non, on sait distribuer. La difficulté est de savoir comment. Faudra-t-il faire le plein deux fois, d’abord le plein de diesel et ensuite le plein d’urée ? Certains constructeurs réfléchissent avec nous pour développer des réservoirs où l’on ferait le plein en une seule fois avec deux tuyaux. Ce serait plus simple pour tout le monde, mais c’est encore au niveau de la R & D.
D’autres difficultés non négligeables se posent aux distributeurs de produits. Il revient cher de mettre en place de nouvelles cuves et de nouvelles pompes ; dans tous les cas en effet, il faut adapter les infrastructures. En outre, les stations-services se trouvent souvent dans des endroits où il n’est pas facile d’obtenir des autorisations : ce ne sont donc pas des difficultés techniques, mais des difficultés d’ordre réglementaire ou relatives à la disponibilité du terrain.
M. Francis Duseux. Je pense que l’on saura faire. On le fait déjà à une toute petite échelle. Mais compte tenu de l’échelle envisagée, cela risque d’être assez considérable en volume et en coût.
Vous le savez comme moi, en France, dans le domaine de la distribution du carburant, la concurrence est terrible entre les grandes surfaces et les réseaux. S’il faut modifier 11 000 stations-service, nous avons intérêt à y travailler ensemble. L’idéal est tout de même que l’on change les pompes, et que l’automobiliste remplisse en gazole, puis en urée. Mais les volumes en jeu sont énormes.
Sur la modification de la fiscalité, je crois qu’on vous a dit notre sentiment. Nous y sommes favorables, pour mieux protéger nos raffineries. Cinq ans nous paraissent raisonnables. Mais plus vite on rétablit un équilibre, moins on vend de gazole et plus on vend d’essence, et mieux c’est pour nous. Cela étant, je pense que l’industrie automobile et les constructeurs sont prioritaires en ce domaine.
Quel serait l’impact financier, sur le secteur du raffinage, d’un rattrapage de la fiscalité ? Grosso modo, 40 millions de tonnes de gazole sont consommées par an, et 20 millions de tonnes sont importées. Notre hypothèse actuelle, sur la base de la transition énergétique, sans autre mesure contraignante, fiscale ou autre, est qu’à l’horizon 2030, soit dans quinze ans à peine, on consommerait 10 millions de tonnes de moins. Cela réduirait d’autant les importations de gazole et le déficit commercial. Cela va donc dans le bon sens.
Mme Marie-Jo Zimmermann. Monsieur le président, vous êtes très sympathique, et vous ai écouté avec beaucoup d’attention. Mais certains de vos propos m’ont préoccupée : croyez-vous que les constructeurs aient les moyens financiers de changer leurs outils de fabrication en cinq ans ? En effet, ils viennent tout juste de se lancer dans des investissements lourds, de plusieurs milliards d’euros, en accord avec les pouvoirs publics, pour rendre leurs moteurs moins polluants. Et de fait, aujourd’hui, les nouveaux moteurs diesel sont nettement moins polluants que les moteurs à essence.
Vous dites que vous avez des relations avec les constructeurs. Dans ce cas-là, ils vous ont sûrement dit la même chose qu’à nous, à savoir que financièrement, ils ne pourront pas suivre. N’oublions pas que des milliers d’emplois sont en jeu. Que peut-on répondre aux constructeurs ? Comment les accompagner ?
M. Francis Duseux. Madame, c’est pour cela que j’ai pris la précaution de dire que, sur le plan économique, la priorité était de s’aligner sur les constructeurs, et que nous nous contenterions de suivre. Il faut aller à leur rythme. Le rééquilibrage est souhaitable pour nos usines, mais ce n’est peut-être pas à nous de dire qu’il faut le réaliser rapidement. C’est beaucoup plus compliqué que cela.
Maintenant, les problématiques de l’essence et le gazole sont différentes. Le gazole reste plus performant que l’essence sur le plan énergétique – d’environ 15 % sur une distance égale. Le gazole et l’essence ne polluent pas de la même façon. En matière d’émission de CO2, les moteurs diesel sont maintenant moins polluants que les moteurs à essence. Mais, comme vient de le rappeler Madame Batho, les moteurs diesel produisent des oxydes d’azote. Malgré tout, ceux-ci peuvent être éliminés par des injections d’urée.
Je reste assez confiant parce que je sais que la technologie va évoluer dans le bon sens. Nous devons donc chercher des solutions pour résoudre, notamment, les problèmes de pollution. Mais inutile d’opposer les uns aux autres. Il n’est pas question d’inverser rapidement la tendance si cela devait se faire au détriment des constructeurs automobiles. J’ai notamment cru comprendre que les constructeurs automobiles étrangers étaient plus en pointe que les constructeurs français sur les modèles essence…
Mme Marie-Jo Zimmermann. Pourtant, aujourd’hui, les Japonais font le chemin inverse ! Ils investissent davantage sur le diesel.
Mme la rapporteure. C’est plus compliqué que cela…
Mme Marie-Jo Zimmermann. Il faut tout de même être cohérent, et prendre en compte le travail qui a déjà été fait dans notre pays, comme celui qui se fait dans les autres pays !
M. Francis Duseux. Grâce aux nouvelles normes Euro 6, on a considérablement amélioré les carburants. D’une manière générale, on a limité la pollution, ce qui était tout de même l’objectif premier. Mais pour améliorer durablement la qualité de l’air dans notre pays, et notamment dans les grandes villes, il faudra trouver le moyen d’éliminer rapidement les véhicules qui ont plus de dix ans, car ce sont eux qui engendrent le plus de pollution.
Après, il faut bien voir que l’achat d’un modèle essence, d’entrée de gamme, sans filtre à particules, répond à une logique économique. Un petit véhicule essence convient aujourd’hui aux personnes qui ont du mal à boucler leur fin de mois, comme à celles qui font moins de 15 000 ou 20 000 km par an.
Mme la rapporteure. Qu’une discussion soit engagée, avec les industriels de l’automobile, sur la vitesse du rattrapage et les capacités d’adaptation industrielle est un point certain, qui fait l’objet de nos travaux. Mais ce n’est pas l’objet de votre audition.
Malgré tout, un consensus est en train de s’établir sur le fait que la fiscalité doit redevenir « neutre », à savoir qu’il faut fixer les règles de la puissance publique à partir de normes d’émissions polluantes, que ce soit le CO2, que ce soit les particules, et ne pas privilégier une technologie par rapport à une autre.
Tout à l’heure, Monsieur de Courson vous a demandé comment, selon vous, il faudrait procéder à ce rattrapage. Vous avez évoqué la taxe carbone et les discussions qui ont eu lieu avec le Gouvernement sur la question de savoir s’il fallait baisser le prix de l’essence et augmenter celui du gazole, ou seulement aligner par le haut le prix du gazole sur celui de l’essence. Mais vous n’avez pas répondu à Monsieur de Courson. Or sa question était importante.
M. Francis Duseux. Parce que nous raisonnons souvent en ingénieurs et que le ratio « vente d’essence/vente de gazole » est de « 80/20 » nous aurions trouvé logique de mettre « plus un » sur le gazole et « moins quatre » sur l’essence. En effet, pour un rattrapage rapide, il faut tenir compte du ratio de la production.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. C’est cela, la neutralité fiscale. Il faut agir à recettes fiscales stables.
Mme la rapporteure. Sauf que la recette fiscale est faite pour accélérer le renouvellement du parc.
M. Francis Duseux. Cette formule, certes simpliste, aurait permis un rattrapage rapide. Pour autant, nous avons bien conscience que, pour les constructeurs automobiles, la logique est tout autre.
Je terminerai sur un sujet dont je n’ai pas eu le temps de parler, et qui inquiète les industriels.
L’extension de la taxe sur l’électricité au gaz et aux carburants va déjà peser lourd dans la facture – 6 milliards cette année, 8 milliards dans deux ans, 15 milliards dans trois ans, etc. Mais maintenant, on envisage d’étendre la CSPE aux carburants, au fuel domestique et au gaz. Ce sont des choix politiques. Mais si cela vient se rajouter à tout ce que je vous ai dit, la situation risque de devenir intolérable ! En outre, cela posera un problème de fond : l’usager de l’électricité ne connaîtra plus la vérité des prix. Cela peut conduire à toutes sortes de dérives.
C’est un point de vue un peu personnel, mais je crois tout de même que le fait de tout faire financer par les carburants, en accumulant les taxes, affectera tôt ou tard gravement le pouvoir d’achat de nos concitoyens. Quelqu’un qui a acheté une voiture diesel l’année dernière va l’utiliser pendant dix ans. On ne peut pas le « matraquer » comme cela, avec un gazole à 2 euros au litre. Politiquement, cela me paraît totalement irréaliste. Et puis, si l’on décide d’aller vers les renouvelables, pour l’électricité, il faut que cela se traduise par la vérité des prix au niveau électrique. Sinon, on dévie complètement la mécanique de décision des investissements. Je trouve cela très grave.
Rien n’est décidé encore, mais j’ai cru comprendre que taxe carbone et extension de CSPE seraient confondues. Je ne sais pas ce qu’il en est, mais ce serait pour nous une source de très grande inquiétude. Bien sûr, vous pourriez prendre des mesures de compensation ou de relance du pouvoir d’achat. Mais comme vous le savez, les industries françaises ont perdu 10 points de PIB en douze ans. C’est l’origine de la baisse de la consommation générale d’énergie, et c’est aussi l’origine du chômage.
Mme Marie-Jo Zimmermann. Exactement !
M. Francis Duseux. Pourquoi taxer encore les transports, alourdir les coûts au travers de taxes sur les produits pétroliers et plomber la compétitivité des entreprises françaises ? J’y vois là un très grand danger. Collectivement, nous devons être très vigilants. Nous devons plutôt attirer les investisseurs, redonner de l’oxygène aux entreprises, en reconstruire de nouvelles et nous redonner la chance de créer des emplois.
Peut-être faudrait-il chiffrer l’impact que cela risque d’avoir sur les transports. Dans tous les cas, cela risque d’être très conséquent. Je suis très inquiet.
Mme Marie-Jo Zimmermann. Moi aussi, vous avez raison : c’est immoral !
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Merci, monsieur le président, pour la franchise de vos réponses.
La séance est levée à dix-huit heures quinze.
◊
◊ ◊
13. Audition, ouverte à la presse, de M. Jacques Mauge, président de la Fédération des industries des équipements pour véhicules (FIEV) et conseiller du président de Faurecia, de M. Guy Maugis, président de Bosch France et de M. Olivier Rabiller, vice-président, directeur général, en charge de l’innovation, des fusions–acquisitions, de l’après-vente et des régions en forte croissance de la société Honeywell Transportation System.
(Séance du mercredi 9 décembre 2015)
La séance est ouverte à seize heures trente.
La mission d’information a entendu M. Jacques Mauge, président de la Fédération des industries des équipements pour véhicules (FIEV) et conseiller du président de Faurecia, M. Guy Maugis, président de Bosch France et M. Olivier Rabiller, vice-président, directeur général, en charge de l’innovation, des fusions–acquisitions, de l’après-vente et des régions en forte croissance de la société Honeywell Transportation System.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Nous avons le plaisir d’accueillir une délégation de la Fédération des industries des équipements pour véhicules – la FIEV – conduite par son président M. Jacques Mauge. Il est accompagné par M. Guy Maugis, qui préside le groupe Robert Bosch France et par M. Olivier Rabillier, cadre dirigeant de la division systèmes de transport d’Honeywell.
La FIEV est une organisation professionnelle qui regroupe de grands groupes à vocation internationale, mais aussi de grosses PME régionales. Au-delà de ce qu’il est convenu d’appeler les équipementiers « de rang 1 », vos activités concernent, en France, de très nombreux sous-traitants de plus petite taille.
Le secteur a subi de plein fouet la crise automobile des années 2008-2009. Cette crise a incité les pouvoirs publics à créer un Fonds de modernisation des équipementiers automobiles, le FMEA – récemment rebaptisé Fonds Avenir Automobile (FAA) – qui est géré par Bpifrance. Dans ce contexte, le secteur a fait preuve d’une remarquable capacité de rebond. Il a engagé des efforts de productivité parfois conjugués à des délocalisations. En prenant des initiatives technologiques, il a relevé ses objectifs de recherche et développement (R&D). Il n’est pas rare aujourd’hui que des équipementiers français réalisent plus de 50 % du chiffre d’affaires à l’exportation.
Autre trait caractéristique du secteur : il compte d’importantes usines de groupes étrangers, souvent présents en France depuis longtemps, comme c’est le cas de Bosch, ici représenté, ou encore de l’américain Delphi.
Il faut également souligner que près de 80 % du prix de revient d’un véhicule relève des équipementiers. De même, les activités de réparation et d’entretien sont par nature fortement consommatrices de vos produits.
Concernant certaines productions de vos entreprises, la conception des filtres à particules et des autres systèmes de dépollution que vous fournissez aux constructeurs intéresse au plus haut point la mission d’information.
Par ailleurs, vous pourrez nous donner des précisions sur l’utilisation des fonds débloqués au titre du Fonds de modernisation, à présent FAA.
Dans le même esprit, nous souhaiterions en savoir plus sur l’implication de vos entreprises dans le cadre des programmes du « Véhicule du futur », et sur l’apport dont vous avez pu bénéficier à partir du programme des investissements d’avenir, le PIA.
Enfin, au plan européen, existe-t-il des aides à l’innovation et à la recherche plus spécialement ciblées sur vos activités ?
M. Jacques Mauge, président de la Fédération des industries des équipements pour véhicules (FIEV). La filière automobile française emploie plus de 434 000 personnes. En France, les équipementiers de « rang 1 » représentent plus de 73 000 emplois directs, soit un tiers du total des emplois liés au noyau de la filière automobile. Ils sont regroupés au sein de la FIEV – Fédération des industries des équipements pour véhicules – que j’ai l’honneur de présider.
De simples sous-traitants, les équipementiers sont devenus les partenaires technologiques et stratégiques des constructeurs automobiles. Ils sont au cœur de l'innovation, et fournissent plus de 80 % du contenu des véhicules.
En matière de dépollution pour toutes les motorisations, et notamment le diesel, de nombreux équipements sont fruits de la recherche commune entre équipementiers et constructeurs : les turbocompresseurs, les systèmes d'injection à rampe d'alimentation commune, les vannes EGR, les convertisseurs catalytiques, les filtres à particules, les systèmes de post-traitement des NOx, telle la SCR – réduction catalytique sélective – ou les pièges à NOx, et bien d'autres encore dont la liste serait trop longue.
Sur le plan économique, les équipementiers représentent une part importante de notre industrie. En 2014, les équipementiers ont dégagé un chiffre d’affaires en France de 15,6 milliards d’euros, dont 54 % à l'export, avec un solde commercial excédentaire de 1,54 milliard d’euros, et regroupaient trois cent trente établissements pour 73 767 emplois.
Il faut noter que les effectifs ont chuté de 35 % entre 2007 et 2014, et de 42 % depuis 2001, en conséquence de la chute de production de véhicules légers en France et de la naturelle adaptation du système de production pour maintenir la compétitivité. La filière a fortement souffert de la crise de 2009, et la valeur de la production des équipementiers pour la première monte a été divisée par deux : proche de 30 milliards d’euros en 2001, elle s’est établie à 15,6 milliards d’euros en 2014, suivant en cela le volume de production.
Enfin, il faut noter que la croissance de l'industrie automobile mondiale profite de manière globale aux équipementiers, qui ont su s'implanter sur les marchés internationaux et diversifier leur portefeuille de clientèle. En effet, le chiffre d’affaires à l’échelle mondiale des cinq premiers équipementiers français plus Michelin – qui n’en est pas un mai qui procède de la même logique – est en forte progression constante, à plus de 57 milliards d’euros en 2014, tandis qu’il est stagne pour la France à 13 milliards d’euros.
Les équipementiers occupent une place décisive et croissante dans l'industrie automobile, grâce à des investissements massifs en R&D. Ils consacrent en moyenne de 6 à 7 % de leur chiffre d’affaires à cette activité. On peut le constater en observant le score en dépôt de brevets de neuf équipementiers figurant parmi les cinquante premiers déposants en France en 2014 : Faurecia, qui a déposé 505 brevets dans le monde dont 120 en France ; Valeo, en cinquième place, avec 473 dépôts ; Bosch en neuvième position, avec 327 dépôts ; Saint Gobain, quinzième, avec 139 dépôts ; Continental, vingtième position, avec 86 dépôts ; SNR, vingt-huitième, avec 45 dépôts ; Plastic Omnium, en trentième position, avec 44 brevets ; et SKF, en trente-troisième position, avec 41 brevets déposés.
Très logiquement, les équipementiers sont fortement ancrés dans les territoires et participent au développement de la filière en région. Des équipementiers de rang 1 comme Faurecia, Valeo, Bosch ou Continental Automotive ont mis en place des programmes – des grappes – pour aider au développement de leurs fournisseurs – aide à l'innovation, développement à l'international – et à l’amélioration de leur performance industrielle, ce que l’on appelle le lean manufacturing.
Les équipementiers ont également abondé le Fonds Avenir Automobile, notamment Bosch, Faurecia, Plastic Omnium, Valeo et Hutchinson. Ainsi, 400 millions d’euros ont été investis dans vingt-neuf entreprises, dont des membres de la FIEV. Le Fonds dispose d'une capacité d'investissement de 230 millions d'euros pour le développement à l'international et pour soutenir l'innovation. Cette initiative est très appréciée par la filière.
Les équipementiers sont aussi très présents au sein des pôles de compétitivité. Les principaux pôles de compétitivités avec lesquels nous avons des relations sont Mov’eo, iD4CAR, i-Trans, LUTB, Pôle Véhicule du futur, Institut VeDeCom, Elastopôle. Grâce à ces pôles, nous pouvons développer le tissu de R&D et favoriser l'innovation et la collaboration avec les PME et TPE au niveau des territoires.
Les équipementiers sont également très présents au sein de la PFA, la plateforme automobile. Trois d’entre eux – Faurecia, Plastic Omnium et Valeo –, la FIEV et Michelin en sont membres fondateurs et appartiennent à ses instances de gouvernance. La FIEV y représente les équipementiers implantés en France.
Enfin, 10 000 personnes travaillent directement pour la production et la commercialisation des moteurs et véhicules diesel. Cette filière diesel est une filière d'excellence reconnue dans le monde entier depuis de nombreuses années. Elle bénéficie de l'écosystème particulièrement favorable qui vient d'être décrit, ainsi que du caractère pionnier de la France dans le développement des motorisations diesel.
Cela a contribué à la création de l’Alliance « Diesel XXI », qui est représentée devant vous aujourd'hui. « Diesel XXI » rassemble des acteurs internationaux qui ont décidé de fortement s'implanter en France en raison des compétences rares disponibles ici et des conditions favorables à la recherche et au développement.
M. Olivier Rabiller, vice-président, directeur général, en charge de l’innovation, des fusions-acquisitions, de l’après-vente et des régions en forte croissance de la société Honeywell Transportation System. Les équipementiers impliqués dans le diesel ont ressenti le besoin de se regrouper, bien avant l’affaire Volkswagen, pour corriger la communication négative qui commençait à apparaître en France autour de ce moteur, et rééquilibrer son image, en donnant les arguments techniques. Nous voulons expliquer en quoi le diesel est une technologie importante dans un mix de dépollution visant à une limitation des émissions de dioxyde de carbone, et pourquoi nous pensons que les technologies nous permettrons de rendre le diesel propre à l’avenir.
C’est l’objet de la création de cette alliance d’équipementiers locaux et internationaux qui utilisent la France comme une base de développement de leurs efforts de R&D sur le diesel, puisque notre pays était en pointe jusqu’à présent. Tel est le cas de mon entreprise, dont le centre de développement mondial du diesel est situé à Thaon-les-Vosges près d’Épinal.
Aujourd’hui, nous voulons faire passer ce message : il est possible de rendre le diesel propre – nous disposons technologies pour y parvenir –, il fait partie d’un mix de carburants et de solutions qui permettent de réduire les émissions de CO2. Un véhicule diesel émet en moyenne douze à treize grammes de CO2 de moins au kilomètre que la meilleure technologie disponible en essence, grâce à des technologies issues d’un savoir-faire largement basé en France. À cet égard, au-delà du rôle qu’elle joue pour limiter ses propres émissions, la France est regardée par le monde entier s’agissant de la façon dont elle va traiter le diesel à l’avenir. Beaucoup de pays dans lesquels le diesel était banni du mix énergétique sont en train de reconsidérer leur position. Au Brésil, par exemple, où nous participons également à des alliances d’industriels du diesel, nous constatons une bien meilleure écoute que par le passé. Le Japon a lui aussi décidé de donner au diesel une part importante de son mix énergétique.
Au-delà même de l’impact local – le marché français ne représente que 1,5 à 2 millions de voitures par an sur un marché mondial de 80 millions de véhicules –, la France joue un rôle d’exemple auprès des autres pays, et c’est ce qui nous inquiète dans la communication négative que nous avons perçue.
Pour résumer : nous avons les technologies pour rendre le diesel propre et le monde entier l’utilise de plus en plus. Sur l’année écoulée, seules la France et l’Inde enregistrent une baisse du taux de pénétration du diesel. Même aux États-Unis, après l’affaire Volkswagen, des constructeurs américains ont commencé à lancer des véhicules diesel sur le segment des pickups légers. Nous avons donc besoin d’une neutralité technologique de la réglementation pour éviter de pénaliser une technologie par rapport à une autre dans la lutte pour la réduction des émissions de CO2. La mise en place de la vignette automobile, par exemple, a fait l’objet d’arbitrages qui vont empêcher le diesel d’être dans la catégorie mieux-disante en termes d’émissions.
M. Guy Maugis, président de Bosch France. Je souscris totalement aux propos qui viennent d’être tenus : la neutralité technologique est essentielle, pour nous. Nous fabriquons des équipements pour des véhicules diesel, essence, hybrides et électriques. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, notre intérêt économique ne nous pousse donc pas forcément à défendre à tout prix le diesel parce que ce serait bon pour nos affaires.
Aujourd’hui, si l’on veut respecter les objectifs de réduction des gaz à effet de serre et d’émissions de CO2, on ne peut se passer du diesel. C’est le seul carburant qui, par sa capacité technologique intrinsèque, permet de consommer 15 à 20 % de moins et d’émettre 15 à 20 % de CO2 de moins qu’un moteur à essence. C’est d’autant plus vrai que les véhicules sont lourds. Ainsi, pour les poids lourds, il n’y a pas d’autre solution que le diesel, car un moteur à essence n’a pas la puissance suffisante, ou alors il consommerait trois ou quatre fois plus que son équivalent diesel. Pour réduire les émissions de CO2, le diesel est donc pour nous la seule solution technique possible.
Certes, les moteurs diesels anciens présentaient un certain nombre d’inconvénients, notamment celui d’émettre des particules. Ce problème a été progressivement réglé avec l’évolution des normes et la mise en place des filtres à particules. Il faut noter, à cet égard, que les moteurs à essence modernes à injection directe commencent à émettre des particules : il faudra donc les équiper eux aussi de filtres à particules au fur et à mesure du renforcement des normes. En tant qu’industriels, nous sommes tout à fait partisans d’un durcissement de ces normes, nous plaidons simplement pour que cette évolution suive le rythme des capacités technologiques et de la faculté des ménages à payer le surcoût induit par cette mise aux normes des véhicules.
Un autre sujet a été récemment porté à l’attention du public, celui des oxydes d’azote, abréviés NOx. Nous avons les solutions technologiques – SCR ou piège à NOx – pour respecter des normes très restrictives en la matière, comme les normes américaines. C’est encore un peu coûteux, mais avec la massification de ces technologies, nous arriverons à en réduire le coût.
L’idée selon laquelle le diesel est plus polluant que l’essence est donc une idée du passé. Les technologies modernes donnent à peu près la même neutralité polluante, avec cependant un avantage en termes de CO2 pour le diesel.
D’autres technologies permettent de réduire la consommation, notamment sur des cycles courts en ville, je pense aux véhicules hybrides. Mais il ne faut jamais oublier qu’un véhicule hybride fonctionne avec un moteur à explosion, qui est parfois un moteur diesel, comme le fait PSA avec son moteur « HYbrid4 ».
Pour revenir sur la vignette, nous sommes déçus de constater que l’arbitrage qui a été rendu n’est pas neutre technologiquement. Les véhicules diesel « Euro 6 » vont en effet se retrouver dans une catégorie qu’ils « ne méritent pas », car si l’on s’en tient uniquement aux mesures techniques et scientifiques des niveaux de particules et de NOx émises, ils répondent au même niveau d’exigence environnementale que les véhicules essence « Euro 6 ».
Mme Delphine Batho, rapporteure. Vous avez rappelé les chiffres des destructions d’emplois au sein des équipementiers depuis les années 2000, ils sont très impressionnants.
Au moment des états généraux de l’automobile en 2008 et 2009, la relation entre les constructeurs et les équipementiers avait été au centre des débats. Quelle est votre appréciation sur la structuration de la filière automobile aujourd’hui, à la suite à tout ce qui a été mis en place après les états généraux de l’automobile ? Parmi les personnes que nous avons entendues précédemment, certaines considéraient que la situation était satisfaisante, d’autres étaient plus nuancées.
S’agissant du scandale Volkswagen, nous avons demandé à plusieurs interlocuteurs une évaluation du volume d’activité des fournisseurs de Volkswagen. Quel est le nombre d’emplois, en France, lié à Volkswagen ? Concernant plus spécialement le groupe Bosch, il a été fait état d’une éventuelle implication de cette entreprise dans le scandale, qu’en est-il ?
Dans votre propos introductif, monsieur Mauge, vous avez évoqué le poids économique de tous les équipements liés à la dépollution. Vous avez fait état d’une longue liste d’équipements, pourriez-vous nous faire parvenir des éléments de chiffrage du volume d’activité de l’ensemble du secteur ?
J’en viens à la question du diesel. Nous constatons que les normes sont largement théoriques. Même si un véhicule récent émet beaucoup moins de particules qu’un véhicule vieux de cinq ou dix ans, nous constatons tout de même un écart entre la réalité et les normes théoriques, ce qui renvoie à la question des nouveaux tests.
Sur le projet de rendre le diesel propre, je voudrais rappeler que le diesel propre n’existe pas à ce jour. De même, le diesel « Euro 6 » n’est pas à égalité avec l’essence. Il émet 20 % de particules en plus, et soixante-deux fois plus de dioxyde d’azote. Ce sont les faits même s’ils présentent, en effet, un avantage en matière d’émission de CO2. Je souhaite donc avoir des précisions lorsque lorsque vous nous dites que vous avez les solutions technologiques. S’agit-il seulement de la réduction catalytique sélective (SCR) ?
M. Denis Baupin. Je souhaite d’abord vous dire combien je suis d’accord avec vous, messieurs, lorsque vous parlez de neutralité technologique. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous nous battons pour supprimer toutes les niches fiscales favorables au diesel qui ont conduit à ce que notre parc automobile soit l’un des plus diésélisés, donc l’un des plus empoisonneurs, car vous reconnaissez vous-même que les diesels anciens étaient polluants. Je note que vous êtes pour une neutralité de la fiscalité en la matière : nous pourrons nous prévaloir du soutien de la FIEV sur ce point !
Comme la rapporteure, je tiens à souligner combien les termes « diesel propre » peuvent paraître choquants. Pourquoi ne pas parler aussi d’« amiante propre » ? Je me souviens des propos de Michel Elbel, un élu RPR qui n’était donc pas de ma famille politique, mais qui a longtemps été président d’Airparif. Il disait qu’il croirait à la « voiture propre » le jour où un constructeur serait d’accord pour s’enfermer pendant une demi-heure dans son garage avec sa voiture en marche … Utilisons donc des termes adaptés !
Je partage entièrement les propos de la rapporteure sur les écarts que nous pouvons constater, y compris sur banc d’essai, entre les tests – certains effectués par Automag – et la réalité. Des études enregistrent des écarts de consommation allant jusqu’à 60 % entre les mesures des tests et le fonctionnement en conditions réelles, pour des véhicules diesels français aux normes « Euro 6 ». On peut donc s’interroger sur la réalité des chiffres affichés.
J'ai quelques questions concernant des aspects qui n'ont pas été évoqués. Vos activités d'équipementiers incluent la fourniture de logiciels. Quel type de logiciels fournissez-vous ? Quelle capacité ont les pouvoirs publics à en contrôler la qualité, sachant que les logiciels sont composés de centaines de milliers de lignes de programme et qu'identifier le petit dispositif qui permettra de truquer les tests est évidemment difficile. L'accès au code source des logiciels est donc crucial.
En tant qu'équipementier que change, en termes d’emplois, le fait de travailler sur des moteurs essence ou des moteurs diesel ? Si l'on remplaçait, en France, tous les véhicules diesel par des véhicules essence, y aurait-il des pertes d'emplois, ou s’agirait-il uniquement d’un problème de reconversion, qui n'en serait pas simple pour autant ? J’ai du mal à imaginer en quoi les véhicules diesel nécessiteraient plus d’emplois.
En ce qui concerne la maîtrise de l'énergie, et notamment l'objectif de deux litres aux cent kilomètres, considérez-vous que ces technologies permettront des créations d'emplois pour les équipementiers ?
S’agissant enfin de l'amélioration des véhicules existants, ce qu'on appelle retrofit en matière de bâtiment, est-ce un secteur que vous estimez potentiellement porteur d’emplois ? La loi de transition énergétique a prévu que la prime à l'achat de véhicules peu polluants bénéficiera aussi aux véhicules d'occasion. C'est de notre point de vue un élément social, puisqu’il permet à des ménages n'ayant pas les moyens d'acheter un véhicule neuf d'accéder à un véhicule propre, mais sur un plan économique, cela permettra aussi de créer des emplois dans le secteur des équipementiers et des réparateurs, et non chez les constructeurs.
M. Charles de Courson. Le but de notre mission est de réfléchir à l'évolution de la filière automobile au regard des grandes décisions à prendre en matière de fiscalité énergétique.
Dans ce cadre, êtes-vous favorables à la neutralité énergétique de la fiscalité ? Sachant qu'un litre de diesel représente à peu près 1,07 litre d'essence aujourd'hui, nous pourrions arriver à la parité en cinq ou six ans, et nous supprimerions la non-déductibilité de la TVA sur les véhicules à essence détenus par les sociétés – bizarrerie qui résulte de la politique menée depuis quarante ans.
Monsieur Rabiller, je vous ai trouvé très favorable au diesel. Je m'attendais à ce que vous me disiez que vous pouviez vous adapter à toutes les technologies pourvu que les changements soient graduels et lisibles. C'est ce que demandent les grands industriels : Carlos Ghosn a ainsi déclaré ici que ce n'était pas un problème si on leur laissait cinq à sept ans pour s'adapter. Qui plus est, vous n'êtes pas les seuls concernés, il y a aussi l'industrie pétrolière. Sans correction de notre part, nous allons voir disparaître les huit dernières raffineries qui existent en France.
Vous avez très peu parlé du véhicule électrique. Quel est son avenir, selon vous ? Pensez-vous comme beaucoup de spécialistes que cela représente un petit créneau – entre 1 % et 2 % du marché ? Croyez-vous que l'industrie sera capable de résoudre le problème vieux de soixante ans du prix des accumulateurs et des capacités de stockage de l'électricité dans les véhicules ?
M. Yves Albarello. Je ne voudrais pas apparaître comme le défenseur à tout prix de la filière diesel. J'ai déjà rappelé que nous avions gagné les 24 heures du Mans avec un moteur diesel, et j'en suis fier. Dans cette filière, il faut souligner l’excellence française. En outre, et le fait que les moteurs diesels émettent douze à treize grammes de CO2 de moins que les moteurs essence en témoignent, de gros progrès ont été réalisés. De même, les filtres à particules sont de plus en plus efficaces. Je suis donc d'accord pour un rééquilibrage de la fiscalité, mais veillons à ne pas mettre à mal la filière diesel. Je serai là pour la défendre.
Vos industries exportent pour 57 milliards d'euros, tandis que le chiffre d'affaire réalisé en France est de 13 milliards. Vous travaillez donc plus pour l'exportation. Cela conforte les propos d’un excellent professeur que nous avons auditionné au début des travaux de cette commission. Il a dit que dans dix ans, nous n'aurons plus de constructeur automobile : l'un aura été absorbé par les Japonais, l'autre par les Chinois. Cela fera peut-être plaisir à certains, pas à moi.
Dans la valeur d'un moteur, quelle est la part apportée par les équipementiers, et celle du constructeur ?
M. Jean Grellier. Depuis le début de ces auditions, nous nous rendons compte qu’il existe une grande diversité de solutions proposées : continuer avec des voitures plus propres avec des moteurs thermiques, recourir aux voitures électriques … La semaine dernière, nous avons auditionné une entreprise qui propose un dispositif de recharge des batteries par pile à combustible. On parle aussi de l’hydrogène, du gaz naturel, du biogaz.
Derrière chacune de ces solutions, il y a des demandes de réseaux. La puissance publique contribue à entretenir les réseaux de distribution d’essence ou de gasoil en milieu rural et cofinance le déploiement de bornes électriques ; on évoque pour le futur des stations à hydrogène, ou des stations de gaz naturel. Pensez-vous qu’il soit possible que ces différentes solutions coexistent, ou, au contraire, une filière va-t-elle s’affirmer et répondre aux différents besoins ? Ces choix soulèvent des enjeux en matière de fiscalité.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Que pensez-vous des déclarations récentes de Carlos Ghosn en marge du salon de Tokyo ? Il a programmé la fin prochaine du diesel, et s’est élevé contre l’idée de pratiquer des tests en réel. Il estime en effet qu’il faut une base de tests conforme pour tous les constructeurs, et que les tests en situation de conduite sont irréalistes du fait de la variabilité des résultats selon les conducteurs.
Concernant l’argent public investi dans les différents pôles de compétitivité, grappes et autres clusters, en faisant abstraction de l’argent nécessaire pour le fonctionnement des pôles, combien estimez-vous qu’un euro d’argent public entraîne d’investissement privé pour les projets de R&D collaboratifs ?
M. Jacques Mauge. La première de vos questions porte sur la situation de la filière automobile en France, notamment la mise en place des structures visant à aider la filière à traverser la crise et à rebondir. De bonnes initiatives ont vu le jour à cet égard, telle la création de la Plateforme automobile et l’établissement d’un comité stratégique de filière. Elles ont permis aux constructeurs et aux équipementiers de fonctionner globalement ensemble, et non plus dans le cadre des relations de fournisseur à client. Cette mise en commun des réflexions et des stratégies permet d’optimiser les directions stratégiques, de R&D, etc. Toute la filière en est reconnaissante.
Mais il est difficile d’en mesurer les effets sur l’emploi. En 2014, nous avons assisté à un rebond par rapport à 2013, qui sera probablement confirmé en 2015. Cette inflexion positive es-elle le résultat des initiatives qui ont été prises ? Je n’en suis pas certain. La baisse de la production – et donc des effectifs – me semble assez durable, car lorsque l’on cesse de produire des véhicules en France, il est très difficile, pour des raisons économiques, d’y revenir.
En conclusion, l’initiative est très importante pour toute la filière et permet d’optimiser les moyens. En matière d’emploi, on assiste à un léger rebond, mais il n’est pas possible de conclure qu’il soit significatif et durable.
M. Guy Maugis. S’agissant de l’impact de l’affaire Volkswagen sur les équipementiers, il est extrêmement difficile à chiffrer. A priori, le marché européen ne sera pas affecté. Peut-être achètera-t-on un peu moins de Volkswagen et un peu plus d’autres marques. Pour des équipementiers qui n’ont pas de part de marché plus forte chez Volkswagen, cela ne devrait pas changer fondamentalement l’activité, c’est localement que cela pourra affecter une usine qui ne livrerait que Volkswagen.
Globalement, on ne sent pas d’impact majeur sur le marché. Certes, il est à parier que Volkswagen vendra beaucoup moins de véhicules aux États-Unis – on le constate déjà au mois de novembre – mais il est très difficile d’évaluer le temps que durera cet effet psychologique.
M. Jacques Mauge. L’impact ne se fait pas sentir en France, mais il est réel pour les grands équipementiers français qui travaillent à l’international. On peut ainsi considérer que l’investissement est quasiment perdu pour celui qui fournit une usine Volkswagen aux États-Unis.
Vous m’avez ensuite demandé quel était le volume d’activité sur les équipements de dépollution, je n’ai pas la réponse dans l’immédiat.
S’agissant des mesures, en tant qu’équipementiers, nous testons nos équipements, mais pas dans leur environnement final. Ils répondent aux spécifications avec une très grande précision, sans élément de variabilité. Mais lorsque nos produits sont placés dans l’environnement automobile, ils subissent des contraintes économiques, de marketing, qui peuvent alors faire varier les résultats.
Je suis d’accord pour rejeter l’expression de « diesel propre ». Dans la mesure où il est question d’un moteur à combustion, il y a forcément des émanations, des gaz, et on ne peut pas parler d’un processus propre. En revanche, nous sommes convaincus de l’équivalence de l’effet polluant des moteurs essence et diesel avec les nouvelles technologies.
Le vrai problème du diesel est celui du parc diesel roulant en ce moment en France, dont les deux tiers n’est pas protégé. Je pense aussi qu’il faut une neutralité technologique en termes de fiscalité, mais s’il y avait un élément de fiscalité à imaginer, il faudrait trouver comment évacuer ces vieux diesels extrêmement pénalisants.
M. Guy Maugis. Je voudrais rappeler quelques éléments sur la façon dont on mesure les émissions d’un véhicule. En 1973, la profession a mis en place un cycle standard, le cycle NEDC, qui représente autant que possible des conditions de roulage. Les véhicules sont placés sur des bancs à rouleaux, et on procède ensuite à des accélérations avec un palier, pendant vingt minutes. Ces accélérations font passer de zéro à cinquante kilomètres par heure en vingt-six secondes. Essayez de conduire à ce rythme dans Paris, tout le monde klaxonnera, à moins que vous ne provoquiez un accident ! Ces conditions de test étaient représentatives de la dynamique des véhicules d’alors – en gros de la 2CV et de la 4L. Quelques progrès sont intervenus depuis, mais la réglementation n’a pas évolué.
Cela fait plusieurs années que la profession a mis au point de nouveaux tests. Ceux-ci seront appliqués en 2016 ou 2017. Il s’agit d’un nouveau cycle dans lequel les véhicules seront plus sollicités : les accélérations seront plus franches, et le palier sera plus long. Cela nous rapprochera davantage de l’utilisation en conditions réelles.
Ces tests sont effectués sur des bancs à rouleaux car ils doivent être reproductibles et permettre des comparaisons fiables. Ce qui rend toute la profession suspecte, c’est que ce cycle ne correspond pas à l’utilisation sur route. En effet, un particulier va accélérer plus fort, donc consommer plus, va grimper des côtes… Accessoirement, le test ne prend pas en compte la charge de la batterie, ce qui va favoriser les véhicules hybrides.
En tout état de cause, nous sommes tous conscients que le test mis en place il y a quarante ans ne correspond plus à la réalité. La première urgence est d’en avoir un plus proche de la réalité.
Cela étant, de quoi parle-t-on lorsque l’on évoque les conditions d’utilisation réelle ? Le périphérique à dix-huit heures ? Une route de campagne plate ? L’ascension du mont Ventoux avec la caravane pendant les vacances ? C’est ce que voulait dire Carlos Ghosn : un test en condition réelle ne sera pas scientifiquement reproductible, il donnera une information mais ne pourra pas servir de base de comparaison. Il faut donc savoir ce que l’on recherche en procédant à ces tests : un élément de normalisation et d’homologation, ou l’information du grand public sur la consommation approximative qu’il peut espérer ?
Il en va de même pour les NOx. J’invite M. Baupin à lire le rapport de l’ONG américaine qui a levé le lièvre Volkswagen : trois véhicules sont testés, et l’un tient la norme de quarante-trois grammes de NOx dans toutes les conditions de circulation, y compris en conditions réelles. Il s’agit d’un BMW X5, qui n’a pas forcément l’image du véhicule le moins polluant, et qui n’est manifestement pas bas de gamme. C’est le point que je soulevais précédemment : les solutions technologiques sont coûteuses et plus faciles à mettre en place dans les poids lourds et les véhicules haut de gamme. Mais l’histoire de l’industrie automobile au cours des trente dernières années nous a appris que les solutions technologiques telles que l’ABS ou l’ESP étaient d’abord installées sur les véhicules chers avant de se démocratiser. Aujourd’hui, l’ABS ou l’ESP équipent tous les véhicules, mais les coûts ont été divisés par dix en trente ans. Les laboratoires technologiques sont donc la Formule 1 et les véhicules premiums.
M. Jacques Mauge. Le vrai inconvénient du diesel, c’est son coût. Si l’on veut atteindre des niveaux de dépollution comparables à ceux de l’essence, le coût est plus important. Mais nous avons la conviction que les deux technologies permettent d’aboutir au même niveau de performance.
M. Guy Maugis. Le surcoût est de l’ordre de 500 à 1 000 euros par véhicule, c’est loin d’être négligeable.
M. Jacques Mauge. Mais le diesel a un avantage en termes de consommation. Tout dépendra donc de l’usage : si l’on parcourt beaucoup de kilomètres, on peut récupérer l’investissement d’origine ; c’est moins intéressant si l’on roule surtout en ville.
M. Guy Maugis. Actuellement, le seuil de rentabilité du diesel se situe autour de 20 000 kilomètres par an. Dans une situation de parité fiscale, il serait un peu plus élevé, autour de 25 000 kilomètres par an.
S’agissant des véhicules électriques, notre groupe investit environ 500 millions d’euros par an dans cette technologie, ce n’est donc pas anecdotique. En tant qu’équipementier spécialisé dans la motorisation, notre difficulté est qu’il n’y a pas une seule technologie capable de tout faire. Le monde était beaucoup plus simple lorsqu’il n’y avait que des moteurs à essence…
Aujourd’hui, nous devons améliorer les technologies diesel, car elles ont un avantage et nous pensons que nous avons encore une marge de 20 à 30 % de réduction de la consommation et d’amélioration des normes. Mais nous devons aussi travailler sur les moteurs à essence, qui restent peu chers et rendent d’excellents services, ainsi que sur l’hybridation et l’électrique. Nous investissons sur les batteries, et nous pensons que d’ici à cinq ans, nous pourrons doubler la quantité d’énergie par kilogramme de batterie et diviser les prix par deux. Nous visons donc des autonomies de trois cents kilomètres, ce qui représente la bonne maille pour un voyage.
Le but est d’arriver à ce que les véhicules électriques aient le même ordre de coût que les véhicules à essence ou diesel, la batterie pouvant être considérée comme un investissement ou une consommation. À cet égard, la question de la fiscalisation de la recharge des batteries – actuellement exonérée de TIPP – va devoir être posée. Nous pensons qu’à l’horizon 2025, l’électrification, qu’il s’agisse de véhicules tout électrique, hybrides ou rechargeables, représentera à peu près 20 % du marché mondial.
Mais il est difficile d’accepter l’idée que l’on passe du véhicule à tout faire à des véhicules performants pour un type d’utilisation. Si vous roulez 500 kilomètres sur l’autoroute, il vaut mieux un véhicule diesel ; si vous ne circulez que dans Paris, un véhicule électrique convient très bien ; et l’hybride peut être une solution intermédiaire.
M. Charles de Courson. Du point de vue du marketing, y a-t-il une segmentation du marché correspondant à la segmentation technologique, ou bien faut-il des véhicules à plusieurs motorisations ?
M. Guy Maugis. Il existe des moteurs « bi fuel » qui fonctionnent à l’essence et à l’éthanol. Aujourd’hui, les consommateurs achètent un véhicule pour ses capacités maximales, ce qui constitue d’une certaine façon un gaspillage. Il serait en effet extraordinairement pratique d’avoir un véhicule différent pour chaque usage, comme aux États-Unis où chacun a trois ou quatre véhicules, mais cela poserait des problèmes de stationnement. Nous devons donc trouver comment adapter les parcs et les usages. C’est une question à poser aux constructeurs.
M. Charles de Courson. Mais quelle famille utilise un véhicule électrique uniquement pour faire les courses, un autre à moteur diesel pour les longues distances et un troisième pour les distances intermédiaires ? Ce n’est absolument pas à la portée des ménages, c’est une solution uniquement pour les riches comme le dirait notre collègue Denis Baupin.
M. Denis Baupin. Alors que nous inventons des choses nouvelles dans le secteur de l’énergie, nous pouvons imaginer que cela va se faire aussi dans le domaine de la mobilité.
M. Charles de Courson. Le problème tient à la contradiction entre la mono-technologie et la multi-utilisation.
M. Olivier Rabiller. Il faut trouver le bon compromis. C’est ce que font les constructeurs. En outre, le client est rationnel lorsqu’il choisit son automobile et voit combien elle lui coûte lorsqu’il passe à la pompe.
M. Denis Baupin demandait pourquoi ne pas faire uniquement des véhicules à essence, et quel impact aurait une telle transformation sur l’emploi. Si tel est le cas un jour, un seul centre de développement suffira, contre deux aujourd’hui – un pour le diesel et un pour l’essence. Cela aura donc un impact direct sur une filière qui a développé une excellence en matière de R&D.
S’agissant de neutralité technologique de la fiscalité, elle sera tout à fait possible si tout le monde a le temps de s’adapter dans la filière. Dans certains pays, le diesel est plus cher que l’essence, mais le taux de pénétration du diesel y progresse quand même. En Suisse, par exemple, la part de véhicules diesel a augmenté de dix points, alors que le gazole y est plus taxé du fait de sa une valeur énergétique supérieure – cela dissuade les poids lourds de traverser le pays. Cette progression s’explique car le client s’y retrouve. Il va choisir son véhicule en fonction de l’utilisation qu’il en fera, et du bénéfice qu’il peut en tirer du point de vue de la consommation, mais aussi de la performance. Un véhicule diesel offre plus de couple, il est donc mieux adapté pour les véhicules de poids plus élevé, et le plaisir de conduite est plus grand. Ce n’est pas un hasard si les Américains achètent de plus en plus de véhicules diesels, en commençant par les plus gros.
M. Guy Maugis. Monsieur Baupin, vous avez demandé si les équipementiers fournissaient des logiciels. C’est en effet le cas ; c’est même une part de plus en plus importante de notre métier d’équipementier. Dans un groupe comme le nôtre, 40 000 ingénieurs travaillent sur les logiciels, et cela représente des millions de lignes de programme par calculateur. Un véhicule moderne compte une quinzaine de ces calculateurs.
Un calculateur moteur comprend plusieurs éléments. Nous fournissons systématiquement un programme de base, qui permet d’injecter le carburant dans la chambre de combustion. Le calculateur va ensuite moduler cette injection en fonction d’un certain nombre de données telles que la position de la pédale, la température ou la quantité d’oxygène qui reste dans le moteur. Un bon millier de paramètres est pris en compte, et c’est généralement le constructeur qui paramètre le calculateur que nous lui fournissons. De même que lorsque vous achetez un ordinateur de bureau, vous pouvez, par exemple, régler la vitesse de la souris.
Les constructeurs ajoutent ensuite un certain nombre de briques logicielles dont ils sont propriétaires. C’est le cas des systèmes d’antidémarrage et de codage avec la clé du véhicule, que nous n’avons pas à connaître. Nous livrons une boîte avec une couche de logiciel, qui va être « flashée » par le constructeur. Et nous n’avons pas la connaissance complète de ce qui est installé dans le calculateur.
M. Jacques Mauge. Ainsi, lorsque certains constructeurs partagent des blocs-moteur, comme c’est le cas de PSA et BMW, les moteurs sont exactement identiques, mais les logiciels complètement différents.
M. Guy Maugis. S’agissant maintenant de l’affaire Volkswagen, mon groupe a livré un calculateur avec les logiciels de base sur les véhicules incriminés. À ce jour, des investigations sont en cours, notamment aux États-Unis. Je ne suis pas en mesure de vous dire quelle a été notre implication dans la rédaction du logiciel : il faut attendre que l’enquête soit terminée. Nous pouvons faire confiance à la justice américaine pour aller chercher le moindre détail permettant de déterminer les responsabilités.
M. Charles de Courson. Vous n’avez jamais eu la curiosité d’acheter des véhicules utilisant vos programmes pour étudier ce qui avait été modifié ?
M. Guy Maugis. Les codes sont bloqués. De plus, ces calculateurs sont des monstres de dizaines de milliers de lignes de code et de paramètres. Prenons l’exemple d’un calculateur moteur que nous fournissons à PSA, certaines briques de ce calculateur sont fournies par nos concurrents. Ainsi, nos chers amis d’Honeywell peuvent fournir le sous-programme qui va réguler la vitesse du turbocompresseur. Il s’agit d’une boîte noire dans laquelle nous ne pouvons pas entrer.
M. Yves Albarello. Mais dans certains garages spécialisés, il est possible en branchant une valise de modifier les programmes, par exemple pour supprimer le bridage des moteurs à 250km/h.
M. Guy Maugis. Nous avons connaissance d’une partie du logiciel, mais pas de toutes les fonctionnalités et de toutes les boucles. Ce serait un travail de titan, et dans quel but le ferions-nous ? S’il y a des idées géniales, elles font l’objet d’un brevet.
M. Jacques Mauge. Concernant l’impact sur l’emploi d'un abandon éventuel de la filière diesel, les équipementiers fournissant tous les véhicules, il s’agirait donc pour eux de se repositionner. Si un marché disparaissait, nous nous repositionnerions, ce qui entraînerait un coût. En effet, poussés par la législation et les constructeurs, nous avons fait des investissements importants dans le diesel et nous avons trouvé d’excellentes solutions. Mais il est toujours difficile d’obtenir le retour sur investissement espéré lorsqu’une activité est interrompue. C’est un vrai sujet de préoccupation pour nous.
Mme la rapporteure. Êtes-vous capables de chiffrer les investissements qui ont été réalisés ?
M. Guy Maugis. Sur le site de Rodez, qui ne fabrique que des injecteurs diesel, nous avons investi 200 millions d’euros au cours des cinq dernières années. Ces injecteurs diesel sont très sophistiqués. Pour les moteurs à essence, l’injection est moins coûteuse en investissement et en capital. Le risque de délocalisation serait donc beaucoup plus élevé. Si tout le parc diesel passait à l’essence, je ne donne pas cher de la fabrication d’injecteurs diesel à Rodez, et elle ne serait probablement pas remplacée par des injecteurs essence, dont les prix de vente sont trop faibles ; nous les fabriquerions plutôt dans un pays à bas coût de main-d’œuvre.
M. Jacques Mauge. De plus, les constructeurs et les équipementiers français ont un avantage par rapport à la concurrence concernant le diesel. Renoncer au diesel nous ferait perdre cet avantage compétitif. D’autant que la technologie diesel, certes plus coûteuse, aboutit à la même performance que l’essence. Nous sommes scientifiquement confiants sur ce point. Abandonner notre avantage compétitif pour des raisons qui ne paraissent pas techniquement justifiées nous pose donc problème.
M. Charles de Courson. Si nous arrivions à la parité énergétique en matière de fiscalité, comment pensez-vous que le marché se répartirait entre diesel et essence ?
M. Olivier Rabiller. En Europe, le diesel est à 53 % de parts de marché pour les véhicules légers. Nous pensons que ce chiffre restera stable, à plus ou moins 5 %. Dans le transport routier, c’est de l’ordre de 100 %.
Aux États-Unis, le taux de pénétration du diesel augmente fortement : nous sommes passés de 2 % à 5 % cette année. Cela concerne d’abord les véhicules les plus lourds, pour lesquels les bénéfices sont plus évidents. S’agissant des camions, ils fonctionnent aussi avec du diesel, car il n’y a pas de solution technique de remplacement.
M. Jacques Mauge. Vous nous avez également interrogés sur les opportunités de créations d’emplois offertes par la recherche de maîtrise d’énergie. Je pense effectivement qu’il y a là des gisements d’emplois. Mais, selon des principes bien connus, les ruptures économiques entraînent dans un premier temps des pertes d’emplois, avant de permettre de retrouver le même niveau, voire de créer plus d’emplois.
Nous savons nous adapter à ces changements, et nous investissons dans nos centres de R&D de manière à identifier ces nouvelles technologies. Mais nous ne cherchons pas à forcer l’adoption d’une technologie qui n’est pas mûre et à en abandonner une qui a simplement besoin d’un perfectionnement. Nous cherchons nous aussi les ruptures technologiques, mais en organisant la transition le plus intelligemment possible au niveau de nos entreprises.
M. Olivier Rabiller. M. Albarello nous demandait quelle était la part de valeur apportée par les équipementiers sur les moteurs. Le moteur de base est un bloc-moteur et des pistons qui se déplacent – c’est ce que font les constructeurs. Ce sont les chefs d’orchestre de l’industrie, parce qu’ils ont la capacité à tout intégrer. Mais les premiers violons sont les équipementiers. Toutes les innovations qui ont permis d’atteindre les niveaux d’émissions que nous connaissons aujourd’hui – sur le diesel ou l’essence – viennent des équipementiers, qu’il s’agisse de l’injection directe ou du turbo à géométrie variable. Ces innovations ne se font pas en une vague. Sur les dix dernières années, nous avons développé quatre à cinq générations de turbos à géométrie variable pour les diesels. Cet exemple illustre le niveau d’intensité de R&D que les équipementiers déploient pour soutenir l’évolution des constructeurs.
M. Guy Maugis. Vous nous avez demandé ce que les équipementiers fournissaient. Autour de la culasse et du bloc-moteur, nous fournissons un démarreur, un alternateur, une série d’injecteurs pour le carburant, un turbo, un calculateur moteur qui permet de faire marcher tout cela, et j’en oublie certainement. Ce sont des pièces qui coûtent cher sur le moteur. Nous devons fournir autour de 80 % de la valeur des pièces incorporées par le constructeur.
Mme la rapporteure. Vous ne m’avez pas répondu sur les solutions technologiques en préparation. Dites-nous si vous ne pouvez pas entrer dans les détails pour des raisons de secret industriel, mais nous avons besoin d’avoir une réponse.
M. Olivier Rabiller. Des développements sont en cours ; les technologies que nous développons pour le moteur diesel ne sont pas figées. Non seulement nous allons pousser les technologies existantes plus loin, mais d’autres éléments vont venir s’ajouter sur le moteur.
Au-delà, nous travaillons sur des combinaisons de solutions venant d’environnements différents. Prenons l’exemple de l’électrification du véhicule. Nous parlons de moteurs hybrides, donc d’une source d’électricité disponible pour la motricité du véhicule. Aujourd’hui, avec huit kilowatts d’énergie électrique, on peut choisir de placer cette énergie dans les roues ou dans le turbo, comme cela se fait en Formule 1, et c’est alors l’effet de quarante à cinquante kilowatts au niveau des roues qui est obtenu.
Les technologies évoluent individuellement et se combinent les unes aux autres pour rendre le véhicule beaucoup plus efficient. Et cette tendance s’accélère.
M. Guy Maugis. Nous poursuivons le travail commencé il y a une vingtaine d’années sur l’amélioration de la combustion, avec des pressions d’injection de plus en plus élevées. Alors qu’auparavant nous injections à 1 000 bars dans un moteur diesel, nous atteignons maintenant des pressions de 2 000 bars, c’est un exemple typique de développement pour lequel les 24 heures du Mans ont aidé à progresser. Il s’agit donc d’amélioration continue.
Sur le traitement des NOx, nous avons les deux systèmes dont vous avez déjà entendu parler : la trappe à NOx, qui fonctionne plutôt mieux à basse température qu’à haute température, et le SCR pour lequel c’est l’inverse. Le véhicule qui a passé avec succès l’ensemble des tests de l’ONG américaine est équipé des deux, ce qui entraîne un surcoût. Mais ces systèmes en sont à leurs débuts industriels. Ils vont s’améliorer, nous allons les rendre plus légers, moins coûteux, plus efficaces. Nous allons également injecter bientôt un mélange d’ammoniac dans le gaz d’échappement. Au vu de la décrue des émissions au cours des trente dernières années, on peut rendre hommage aux équipes de recherche qui ont permis des améliorations fantastiques en termes de consommation ou de réduction des émissions polluantes. Ces progrès vont se poursuivre. Il n’y a pas de percée révolutionnaire, mais nous sommes certains que nous arriverons à améliorer encore les choses année après année, sur l’ensemble des motorisations.
M. Jacques Mauge. Le vrai problème de ces technologies, c’est le coût. Aujourd’hui, elles passent donc mieux sur du moyen ou haut de gamme que sur du bas de gamme, où le moteur à essence reste parfaitement compétitif, même s’il consomme un peu plus.
Si l’on réduit le volume du parc diesel, nous n’aurons plus la possibilité de descente en gamme par l’amélioration économique de ces technologies. On bloquera ainsi la diffusion de ces technologies, qui sont moins consommatrices d’énergie.
M. Olivier Rabiller. En tant qu’industriels, nous cherchons un retour sur investissement sur la R&D. Si nous voyons poindre une incertitude sur les technologies ou les domaines sur lesquels nous travaillons, nous aurons plutôt tendance à réduire notre effort de R&D et à investir ailleurs. C’est pour cela que nous avons créé cette alliance entre équipementiers, car si une incertitude entraîne une rupture sur le diesel, nous allons être amenés à faire des arbitrages d’investissement et sans doute passer par pertes et profits une technologie dont nous sommes pourtant persuadés qu’elle est nécessaire pour réduire le CO2 et qu’elle a énormément de potentiel.
M. Jacques Mauge. Une de vos questions portait sur les déclarations de Carlos Ghosn sur la fin du diesel et la réalité des tests.
En effet, des constructeurs très impliqués dans le diesel parlent déjà de la fin de cette technologie. Faut-il s’obstiner ? Si le diesel a une mauvaise image, peut-être faut-il investir ailleurs ? Certes, le coût de la rupture technologique sera très important, mais le premier à démarrer pourrait peut-être rebondir sur d’autres technologies et prendre les concurrents de vitesse. Renault applique les lois du marché. Cela étant, je pense comme mon collègue qu’au final, nous serons perdants car nous n’arriverons pas à atteindre les normes difficiles qui ont été définies sur la pollution sans le diesel. Il va apporter sa part de solution, pourvu que les volumes produits le permettent.
Mme la rapporteure. Le problème est que nous devons à la fois nous soucier du climat et de la qualité de l’air !
M. Jacques Mauge. Nous pouvons sembler naïfs en affirmant notre confiance dans le fait que nos technologies diesel sont équivalentes à l’essence, alors que les tests ne sont pas faits de manière correcte. Nous voyons donc d’un bon œil la volonté de redéfinir ces tests pour leur donner une vraie valeur. Ce sera probablement difficile, et nous n’y arriverons sans doute pas du premier coup, mais la démarche est très vertueuse.
La disparité des tests a également un aspect malin : des industries, voire des pays, sont très forts en effet pour établir des normes qui les favorisent tout en pénalisant leurs concurrents. Les Américains sont les champions du monde en la matière : ils arrivent à imposer des normes mondiales sans avoir à les respecter ! D’autres arrivent à imposer des normes qu’ils sont seuls capables de respecter. Il faut donc être attentifs, et nous améliorer dans le jeu de l’établissement des normes. Il ne faut pas laisser cet aspect aux bons soins de nos concurrents.
M. Charles de Courson. Nous n’avons pas parlé des biocarburants. Quelle est votre position sur l’adaptabilité des moteurs ? Vous n’avez pas non plus évoqué le moteur à hydrogène et au gaz.
M. Jacques Mauge. L’hydrogène est une excellente technologie qui pose cependant d’énormes problèmes en termes de distribution. Une station d’essence est un investissement raisonnable. S’il faut stocker et distribuer de l’hydrogène, cela devient une usine à gaz au sens technique du terme. Les investissements sont alors beaucoup plus lourds. Nous travaillons en tout cas sur cette merveilleuse technologie, qui sera probablement très coûteuse à mettre en œuvre.
M. Guy Maugis. C’est en débat. L’Allemagne y croit beaucoup et c’est Air Liquide – grande entreprise française – qui est en pointe sur ce sujet.
Sur les biocarburants, nous menons des recherches pour adapter les moteurs existants, notamment au Brésil, où le bioéthanol est largement disponible. Cela va certainement se développer. Aujourd’hui, et c’est une grande difficulté pour nous, toutes ces technologies sont disponibles, et il est impossible de savoir si l’une émergera plus que les autres. Notre seule certitude, c’est qu’un jour il n’y aura plus de pétrole, mais nous ne savons pas quand.
Mme la présidente. Messieurs, je vous remercie infiniment.
La séance est levée à dix-huit heures.
◊
◊ ◊
14. Audition, ouverte à la presse, de M. Xavier Timbeau, économiste, directeur principal de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).
(Séance du mardi 15 décembre 2015)
La séance est ouverte à dix-huit heures quinze.
La mission d’information a entendu M. Xavier Timbeau, économiste, directeur principal de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Nous accueillons monsieur Xavier Timbeau, directeur principal de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), un organisme scientifique qui est le centre de recherche économiques de Sciences Po.
La mission d’information a déjà entendu un économiste, le professeur Élie Cohen. Il nous a donné une description argumentée mais plutôt inquiétante de la situation de la construction automobile française.
Au titre de ce qu’il a appelé un « décrochage industriel », ce spécialiste de l’économie industrielle a souligné un véritable effondrement de l’activité en termes de véhicules produits en France, donc en termes d’emplois, mais aussi un important retard en matière de recherche et développement en comparaison des constructeurs allemands.
La semaine passée, les responsables de la Fédération professionnelle des équipementiers, la FIEV, nous ont également indiqué que les emplois relatifs à leurs activités françaises avaient fortement décliné au long des vingt dernières années.
La situation est d’autant plus préoccupante que les équipementiers ont su faire face à la crise de 2008-2009, par des efforts de productivité et d’innovation. La rentabilité économique de leurs activités s’est même plutôt favorablement rétablie. Toutefois, ces industriels ne nous ont pas caché que les perspectives d’une croissance significative de leurs emplois en France restent faibles.
Monsieur Timbeau, la mission d’information est intéressée par vos analyses sur une situation qui relève probablement d’un déficit de compétitivité. Mais elle pourrait aussi avoir d’autres causes ; nous souhaitons profiter sur ce point de vos éclairages. Vous avez beaucoup travaillé sur les questions tenant à la durée du travail et à la productivité. Peut-être pourrez-vous nous préciser quels sont les véritables défis posés aux constructeurs français sur ces thématiques ?
Plus généralement, quelles sont les spécificités en termes d’investissement ou d’innovation qui singulariseraient défavorablement nos constructeurs vis-à-vis de leurs concurrents allemands ou asiatiques ? Des interrogations semblent pouvoir être soulevées s’agissant des stratégies comparées des grands groupes.
Différents point sont à évoquer s’agissant de nos constructeurs : le choix de fabriquer des véhicules de gamme moyenne voire low cost et en tout cas éloignés du haut de gamme générateur des plus fortes marges ; le déséquilibre de leur production entre les motorisations diesel et essence ; des choix peut-être trop exclusifs en faveur d’une filière technologique, comme c’est le cas du véhicule électrique pour un des deux constructeurs français.
Enfin, quel est, monsieur Timbeau, votre analyse sur les conséquences possibles de l’affaire Volkswagen pour l’économie de l’ensemble du secteur ? La défiance des consommateurs affectera-t-elle durablement le secteur ? En quoi les constructeurs devront-ils prioritairement évoluer dans leur business model comme dans leur communication et leur stratégie de marketing ? Que doivent exiger d’eux les pouvoirs publics et quelles modifications réglementaires et fiscales du cadre de leurs activités vous paraissent-elles les plus urgentes ?
Nous allons vous écouter, dans un premier temps, pour un exposé liminaire de présentation. Puis madame Delphine Batho, rapporteure de la mission, vous posera une première série de questions. Elle sera suivie par les autres membres de la mission qui, à leur tour, vous interrogeront.
M. Xavier Timbeau, économiste, directeur principal de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE). Je ne suis pas un spécialiste du secteur automobile, mais je m’y intéresse parce qu’il joue un rôle important dans l’économie française, dans la réponse à la question environnementale et dans la définition des politiques publiques. Ces dernières sont en effet confrontées au défi de savoir comment préserver l’emploi industriel et comment anticiper ses perspectives d’avenir.
L’automobile d’aujourd’hui n’a pas grand-chose à voir avec celle que nous connaîtrons dans cinquante ans ; nos manières de nous déplacer auront elles aussi changé du tout au tout. Les politiques publiques sont nécessairement impliquées dans cette évolution.
L’affaire Volkswagen nous pose des questions sur lesquelles je vous livrerai mon analyse. Certes, je ne contredirai pas Élie Cohen et ses prévisions sombres pour le secteur automobile français, qui me semblent justifiées. Mais j’y apporterai peut-être quelques nuances. Les constructeurs français sont spécialisés dans le milieu de gamme, ce qui explique pour partie que leurs résultats sont moins flamboyants que ceux des constructeurs allemands. Mais il ne faut pas les comparer avec les constructeurs allemands haut de gamme. Dans le milieu de gamme, tous les constructeurs se sont retrouvés exposés à une baisse de la demande notamment en Espagne et en Italie, avec l’austérité imposée là-bas à la classe moyenne, le chômage qui y sévit et une paralysie du secteur bancaire qui limite l’accès au crédit, moyen de financement très populaire dans le secteur automobile. Tous ces facteurs n’ont pas manqué de toucher profondément le secteur automobile français.
Il pâtit aussi d’un manque de recherche et développement, ainsi que d’une trop faible flexibilité en cas de perturbations du marché, notamment au vu des solutions qui existent outre-Rhin –je rejoins Élie Cohen sur ce point. En Allemagne, si le contrat de travail est garanti à long terme dans l’automobile, il existe cependant des possibilités de réduire temporairement la masse salariale, par du chômage partiel, voire par une baisse des salaires. En France, cette marge d’adaptation n’existe pas vraiment, de sorte que l’ajustement se produit sous la forme de licenciements. Quand l’activité repart, les constructeurs se trouvent ainsi dans une position plus difficile.
Il en va de même pour les sous-traitants. Prenons garde d’oublier en effet le réseau des petites entreprises qui sont étroitement intégrées aux constructeurs. La crise a coûté cher dans cet écosystème de relations. Elle a brisé des tabous sur l’externalisation hors de France, qui fait désormais l’objet de moins de doutes et d’une approche plus pragmatique.
J’ajouterai un petit élément d’optimisme. Les groupes PSA et Renault ont ajusté leur situation. Non seulement sur le plan capitalistique, ce qui ne fut pas aisé pour le groupe PSA, mais aussi du point de vue de leur gamme, en revoyant en conséquence l’organisation de leur appareil productif. En outre, il est possible que se produise une reprise très forte du marché automobile européen, qui leur permettrait de retrouver des couleurs. L’un des arguments qui plaide en ce sens est l’âge moyen des véhicules en Europe, qui a augmenté d’un an et demi depuis la crise. Les décisions de renouvellement ont été repoussées, mais l’âge moyen devrait désormais diminuer, provoquant une accélération des marchés.
Le secteur reste néanmoins soumis à des mutations. Les entreprises les ont-elles assez anticipées, de même que les politiques publiques d’ailleurs ? La première mutation est environnementale. À l’avenir, il conviendra de réduire non seulement les émissions de dioxyde de carbone (CO2), mais aussi d'oxydes d'azote (NOx), à cause de l’affaire Volkswagen. La pollution locale, les nuisances sonores et la congestion urbaine devront également être réduites. En matière d’émissions de CO2 et de NOx, le schéma européen reposait sur un dialogue entre le régulateur et les producteurs, qui devaient en diminuer les volumes en développant des véhicules plus efficaces, réduisant la production de CO2 par kilomètre.
L’affaire Volkswagen a aiguisé le regard critique sur cette approche. S’agissant d’abord des émissions de CO2, on peut dire que la stratégie a fonctionné, puisque leur volume moyen pour le parc a diminué de 10 % depuis 2004 en France. Si cette valeur est intéressante, soulignons néanmoins qu’à ce rythme, il faudrait cent ans pour arriver à supprimer totalement les émissions. À mon sens, cela montre que laisser le constructeur agir sans que l’impact soit trop sensible sur le consommateur, grâce à des solutions techniques est insuffisant. Il faudra sans doute passer à l’avenir à une action directe sur le consommateur, en l’incitant à rouler moins, à recourir à d’autres modes de transport, voire à s’acquitter d’une taxe CO2.
Quant aux émissions de NOx, un problème de crédibilité des normes employées s’est fait jour. À ce stade des auditions, vous devez savoir mieux que moi comment les valeurs des véhicules sont calculées sur la base d’un banc d’essai correspondant à des conditions et à un schéma particuliers, de sorte que les automobiles peuvent réagir elles-mêmes au cycle par un comportement particulier. Dans les conditions réelles, en revanche, les valeurs d’émission observées sont bien supérieures. Impropre à rendre compte de l’évolution des émissions, la norme se révèle donc illusoire. Du fait de l’optimisation des véhicules par rapport au cycle, les résultats produits ne sont pas du tout les résultats attendus.
Le risque se fait donc jour que le régulateur soit capturé par les constructeurs, qui lui imposent leurs objectifs et leurs contraintes. À l’origine, les normes étaient pourtant utilisées comme des instruments de compétitivité pour développer un marché de véhicules vertueux du point de vue environnemental, susceptibles ultérieurement d’être exportés.
En 1989, l’introduction du moteur TDI de Volkswagen a marqué un tournant. Ce moteur a pu contribuer jusqu’à 60 % des bénéfices de l’entreprise, sous ses diverses formes, se révélant surtout particulièrement utile pour entrer sur le marché américain en 2005. Il y fut en effet présenté comme un moteur propre et efficace sur le plan des émissions de CO2. Plus petits et plus performants sur le plan énergétique, ils permettaient de réaliser des gains de CO2 d’environ 20 % par rapport aux autres moteurs. Le président Obama lui-même en avait fait la publicité en déclarant que le moteur est un élément de solution au problème des émissions de CO2. Cela aurait pu profiter également aux constructeurs français.
La révélation d’une certaine connivence avec le régulateur européen a conduit à nuancer ce jugement. Le groupe Volkswagen s’était trop reposé sur celle-ci et le régulateur américain en a tiré parti pour s’en prendre à son avantage compétitif.
Le moteur diesel reste un actif dans le portefeuille technologique des constructeurs européens. Il continue d’être utilisé par ceux qui sont le mieux placés sur le marché automobile mondial et il a le mérite de réduire les émissions de CO2, tout en conservant aux conducteurs le même agrément d’utilisation. Cependant, s’il ne remplit pas ses objectifs en matière d’émissions de NOx et de particules fines en suspension (particulate matters, PM), l’expérience américaine montre qu’il sera difficile d’utiliser l’argument environnemental en sa faveur.
Dès lors, vers quel modèle d’incitation aller en Europe ? Faut-il conserver une stratégie d’élévation graduelle des normes, s’appuyant sur le passage d’un moteur quatre cylindres à un moteur trois cylindres doté d’une bride compensant la petite taille du moteur ou bien faut-il envisager une rupture plus forte avec la solution du véhicule tout électrique, d’un recours moins systématique au transport individuel et d’une mobilité différente ? Cela ferait tourner la page d’une industrie porteuse sur le continent européen, qui continue d’exporter beaucoup d’automobiles.
Le choix sera difficile. Il va falloir produire des réductions d’émissions de CO2 et de PM assez fortes pour satisfaire les engagements pris au terme de la récente Conférence de Paris sur le climat (COP 21). Or il est n’est pas sûr que les solutions techniques proposées par les constructeurs soient toujours compatibles avec ces engagements.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Vous venez d’évoquer deux stratégies, l’une de rupture forte, l’autre d’élévation graduelle des normes. J’observerai cependant que plus les normes sont hautes, plus grand est aussi l’écart entre elles et la réalité ; le progrès tangible n’est jamais au niveau attendu. En tout état de cause, vous posez seulement l’alternative, en vous gardant de choisir entre ses deux termes.
S’agissant de votre comparaison entre la compétitivité du secteur automobile en Allemagne et en France, pensez-vous que l’écart s’explique plutôt par le modèle économique ou par l’organisation du travail ?
Vous nous annoncez une possible reprise du marché automobile européen. Outre les chiffres encourageants qui sont parus aujourd’hui, disposez-vous aussi de prévision de tendance sur les moyen et long termes, ou vous basez-vous seulement sur les chiffres de 2015 ?
Enfin, vous avez publié des travaux sur d’autres sujets, notamment sur un New Deal vert qui pourrait relancer l’économie européenne. Le plan envisagé affecterait 2 % du PIB à des investissements dans la transition énergétique. S’il devait comporter un volet automobile, ou plutôt un volet mobilité, quelles devraient être à vos yeux ses priorités ?
M. Philippe Duron. L’industrie automobile est depuis longtemps une industrie motrice qui exerce un effet d’entraînement sur l’ensemble de ses sous-traitants. Elle est génératrice à la fois de valeur ajoutée et d’emploi. Après un mouvement de concentration dans le secteur, des évolutions se font jour : certains constructeurs, tel Volkswagen, développent des plateformes communes qui leur permettent de réduire leurs coûts ; d’autres nouent des ententes, comme Chrysler et Fiat ou encore Renault et Nissan ; enfin, des constructeurs nouveaux tels que Tesla ou Bolloré émergent, sur le segment de la voiture électrique.
Leur émergence vous paraît-elle durable ou bien les gros constructeurs vont-ils reprendre le leadership dans le domaine, en s’appropriant l’innovation et en l’intégrant à leur modèle ? Verrons-nous au contraire apparaître un nouveau modèle lié à la transition énergétique ou bien un développement des véhicules autonomes ?
Aujourd’hui, il existe plusieurs alternatives au couple classique diesel et essence. Quelles sont pourtant les solutions techniques qui ouvrent les plus grandes perspectives : le véhicule électrique, le moteur à hydrogène ou quelque autre encore ?
Enfin, vous avez suggéré que le diesel est susceptible de s’améliorer encore. Mais ne pensez-vous pas que l’affaire Volkswagen lui a porté un coup fatal aux États-Unis ?
M. Jean-Michel Villaumé. Vous aviez déclaré dans la presse, au début de l’année, que vous étiez assez optimiste quant à la croissance du PIB en 2015, la chiffrant à 1,5 %, ce qui allait au-delà des prévisions du Gouvernement. Où en êtes-vous de vos appréciations sur ce sujet ? Le frémissement de reprise qui s’observe vous semble-t-il durable, alors qu’un fléchissement notable a eu lieu sur le plan mondial ?
Vous avez également développé des considérations de politique industrielle et de compétitivité. Que pensez-vous au sujet de la TVA sociale, parfois rebaptisée TVA compétitivité ? Pratiquée en Allemagne entre 2006 et 2008, cette hausse de la TVA, concomitante à une baisse des charges salariales, y avait produit des résultats.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Vous avez bien détaillé les avancées de la technologie actuelle. Mais comment évaluez-vous la capacité de notre secteur automobile à s’y adapter ? Il semble qu’il n’y ait plus de rupture majeure à attendre, mais seulement quelques innovations, en matière de moteur classique. La branche, forte de 750 000 emplois, devra cependant s’adapter à l’évolution générale du secteur.
En ce moment même, notre assemblée débat en séance publique sur la possible déduction de TVA à l’achat d’un véhicule automobile. Notre rapporteure générale voudrait l’étaler sur deux ans seulement ; cela me semble du délire complet, car la mesure ne pourrait vraiment produire d’effet que si la déduction s’étalait sur quatre à cinq ans. Au passage, je déplore que les travaux de notre mission ne puissent être pris en compte, car le débat se noue à un moment où nous n’avons pas encore livré nos conclusions.
S’agissant des relations entre régulateur et constructeurs, vous avez employé le terme, fort et lourd, de connivence. Quand je me suis rendu à Bruxelles la semaine dernière, rien de tel ne m’a cependant été confirmé, du moins au cours de la partie des auditions à laquelle j’ai pu assister. Pensez-vous vraiment que le régulateur était au courant ?
Quant à votre appréciation d’ensemble sur l’économie, je sais que vous appartenez à l’école keynésienne. Pour ma part, j’estime qu’il faut plutôt faire des économies pour retrouver des marges de compétitivité.
M. Xavier Timbeau. Mes propositions sur un New Deal vert et sur des investissements sont nées d’une réflexion sur le phénomène dit de la stagnation séculaire, faite d’une crise qui dure, d’un fort risque de déflation et de comptes budgétaires publics déficitaires et d’une inquiétude croissante au sujet de l’environnement. Dans ce contexte, comment combiner des éléments de réponse ? Je suis parti du constat que, si nous prenons vraiment au sérieux la transition énergétique, il y a alors un train d’investissements à faire, tant dans les bâtiments que dans les infrastructures de mobilité, chez les consommateurs comme dans les entreprises. Face à ce mur d’investissement, un besoin de financement se fait jour et il doit être possible de l’utiliser comme un moyen de déclencher un mécanisme de sortie de crise. Telle est l’idée d’un New Deal vert.
Le point central en est le prix du carbone. C’est lui qui résout la question du partage entre investissements publics et privés, car il fait naître une demande privée autonome, ne favorisant que les infrastructures de ferroutage qui peuvent être suffisamment utilisées pour être rentables. Le prix du carbone agit comme un déclencheur. Bien sûr, son introduction a pour corollaire une dépréciation d’une partie du capital existant, de ce que nous autres économistes appelons le capital sale, à savoir celui qui produit des émissions de dioxyde de carbone. Mais le mécanisme, dans son ensemble, provoquerait un choc d’investissement susceptible de faire sortir de la stagnation séculaire.
Il y a cependant un problème d’acceptabilité relativement à cette solution. Provoquant un changement relatif des prix, elle aurait en effet des conséquences pour les consommateurs, outre les pertes à encaisser pour la dépréciation d’une partie du capital existant. Si l’on ne répond pas à ces deux défis, l’on se heurtera à un problème d’acceptabilité. C’est pourquoi il est difficile d’instituer un prix du carbone. Là où cela avait été fait, un retour en arrière s’est même parfois observé. Aussi les investissements publics pourraient-ils financer des dispositifs de compensation transitoire aux perdants de cette mutation. J’insiste sur l’adjectif « transitoire », car ces perdants finiraient, au bout d’un certain temps, par s’adapter à cette situation nouvelle.
Quant à voir dans ce mécanisme un type de relance keynésienne, c’est je crois une critique que l’on ne peut m’adresser, car il est au contraire dominé par le souci de ne pas générer de dette qui ne soit couverte par la naissance d’un actif, qu’il soit public ou privé. Je reconnais seulement que, parmi ces actifs, il y aurait l’actif collectif et immatériel que représente le fait d’échapper aux conséquences du changement climatique. Même si cet actif n’est pas individualisable, il représente une valeur considérable, comme chacun s’accordera à en convenir, à moins d’être climato-sceptique.
Pour ce qui est du régulateur, il n’était pas au courant des irrégularités découvertes par l’affaire Volkswagen. Mais un écart croissant s’observait avant elle entre les valeurs du cycle et les performances réelles des véhicules. Le site de communication grand public de la Commission européenne donne sur ce point toutes les informations nécessaires. Le régulateur savait déjà qu’il devait modifier le cycle, faire apparaître la divergence et placer les constructeurs devant le résultat. S’agissant du dioxyde de carbone, la corrélation des résultats du cycle avec la réalité demeurait suffisante pour qu’une évolution ait lieu dans les faits. Dans le cas des NOx, l’écart entre le cycle et la réalité est tel qu’on pourrait douter de la capacité de la norme à en réduire effectivement l’émission, alors même qu’un récent rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) classait le diesel comme substance cancérigène potentielle. Cette parution a fait l’effet d’un coup de tonnerre. Elle a rappelé à tous que la stratégie européenne pouvait échouer sur la voie d’une diminution des émissions de NOx sous les seuils définis par l’OMS.
En ce qui concerne la connivence dont j’ai parlé entre régulateur et constructeurs, cette qualification repose seulement sur le constat d’échec du régulateur et sur le danger qu’il semblait y avoir à le révéler, car cela revenait à annoncer que les constructeurs ne sauraient tenir leurs promesses ! Les échanges qui ont eu lieu entre le régulateur et ceux-ci sont désormais publics, tant sur le calendrier que sur l’évolution des normes relatives au diesel.
Aux États-Unis, les normes sont plus strictes qu’en Europe s’agissant des NOx, mais elles le sont beaucoup moins pour le reste. Il s’y observe des problèmes similaires à ceux que l’on connaît en Europe, à savoir une connivence « douce » entre régulateur et constructeurs. Le régulateur n’est certainement pas payé par les constructeurs, mais il est enfermé dans un système de régulation inoffensif, car il craint de porter un dommage trop important à l’industrie et à la collectivité. Il en résulte une désillusion certaine quant à la capacité de ces normes à faire émerger des moteurs propres.
Quant à l’alternative entre une élévation graduelle des normes ou une véritable rupture, je dirais que, dans un premier temps, nous resterons dans une approche progressive, mais que nous devons nous préparer à une rupture, parce qu’un échec des normes est possible. Des solutions de rupture existent aussi déjà, telles que le véhicule autonome. Elles permettent d’imaginer un avenir où le transport individuel du vingtième siècle deviendra une question de mobilité plus que d’automobile, changeant radicalement de signification. Que deviendront nos constructeurs automobiles dans ce contexte ? Il faut y réfléchir dès maintenant.
Faut-il des acteurs nouveaux ou les acteurs existants continueront-ils à dominer demain ? Les groupes automobiles détiennent des portefeuilles technologiques et d’innovation et sont de bons connaisseurs du domaine. Il n’en demeure pas moins que la capacité de rupture paraît venir de l’extérieur. Tesla en est l’exemple, même s’il n’a pas encore fait la preuve de sa rentabilité. Sur ce créneau, Porsche pourrait atteindre ce seuil critique, avec un contenu technologique similaire, ce qui montre que les entreprises détiennent un avantage comparatif.
Toutefois, elles enregistrent aussi un passif. L’automobile est un produit cher qui engage la responsabilité d’un constructeur sur quinze ans. L’affaire Volkswagen ne paraît pas faire de dommage ni à l’image de marque de l’entreprise, ni à sa capacité de gagner des parts de marché, car ses véhicules restent loin d’être les plus mauvais ; mais l’affaire crée des dettes et des obligations de remboursement, ainsi que des obligations de modifier les véhicules. A contrario, les entreprises nouvelles jouissent donc d’un avantage, car elles ne devront pas porter un tel passif.
Cela n’est cependant vrai que dans un premier temps. Qu’en sera-t-il demain pour Tesla si ses batteries prennent feu ou que ses véhicules sont impliqués dans des accidents mortels ? L’entreprise a-t-elle la capacité de devenir un opérateur sérieux ? Ce n’est pas sûr.
Il faudra trouver l’équilibre entre ce business extrêmement compliqué qui fait naître de lourdes responsabilités et est soumis à des exigences élevées en matière d’innovation, de performance et de qualité, et l’activité des nouveaux acteurs, innovateurs de rupture. Le jeu est ouvert ; les constructeurs n’y ont du reste pas forcément perdu toute possibilité.
Vous m’avez demandé lequel, de l’hydrogène ou du véhicule électrique, était la solution qui a le plus d’avenir, à moins qu’une autre encore apparaisse. Faute d’avoir une boule de cristal, je vous ferai une réponse de jésuite. De nombreuses innovations verront encore le jour, car l’évolution ne s’arrête jamais. Aussi ne peut-on savoir sir les infrastructures électriques –les bornes de rechargement– seront encore utilisées dans cinq ou dix ans ; elles seront peut-être déjà inutiles et obsolètes, alors qu’elles coûtent très cher. Cette incertitude sert la stratégie graduelle, car elle fournit des résultats dès aujourd’hui, même s’ils sont seulement partiels.
S’agissant de la flexibilité des salaires et du temps de travail, les accords compétitivité-emploi signés sous la présidence de Nicolas Sarkozy, puis l’accord national sur l’emploi y ont contribué. Mais il faut encore absorber le passif de la crise et nous ne verrons si ces instruments sont utiles qu’à l’issue de la prochaine crise.
Quant aux mesures de type crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi et à la TVA, ils ont certainement joué un rôle en Allemagne, mais le succès du secteur automobile de ce pays ne saurait s’y réduire.
Le diesel est-il quant à lui en danger ? Il me paraît rester promis à un avenir en Europe, mais sa capacité à être exporté est assurément compromise. Il pâtit désormais d’un problème d’image. En outre, les pays européens ne sont pas les seuls à pouvoir produire des normes. L’affaire Volkswagen a montré qu’un régulateur peut en trouver qui barre la route aux constructeurs européens. Ils ne sauraient donc axer sur le diesel leur compétitivité à moyen terme. Dans un scénario optimiste, le moteur diesel pourrait évoluer pour produire moins de NOx en conditions réelles ; sur le plan technique, l’essai se trouverait ainsi transformé. Dans un scénario plus pessimiste, le temps nécessaire pour réaliser ces adaptations sera mieux mis à profit par d’autres technologies que le diesel.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Et les perspectives du marché européen ?
M. Xavier Timbeau. C’est vrai, je ne vous ai pas répondu sur ce point, non plus que sur celui de la reprise en France. Un mouvement de reprise économique s’observe en effet en Europe. Le rythme en est encore trop décevant, et nous n’avons pas manqué de signaler que le chômage met trop de temps à baisser. Néanmoins, nous ne sommes plus dans une phase de croissance zéro. Cela pose la question du marché automobile, notamment en Espagne et en Italie. Des chiffres positifs circulent ; même s’ils sont largement conjoncturels, ils n’en sont pas moins spectaculaires, mettant en évidence la volatilité du marché automobile européen. Rappelons que ce marché est du reste très lié au secteur du crédit et au marché de l’emploi.
Indicateur fiable entre tous, l’âge moyen des véhicules dans le parc automobile européen demeure à un niveau historiquement élevé. L’automobile est un bien durable, dont la durée de vie moyenne s’établit à quinze ans. Or les automobiles européennes ont en moyenne 9,2 années aujourd’hui. C’est un plus haut. Ce facteur induit un renouvellement des véhicules, d’où une croissance du secteur.
Du point de vue des politiques publiques, n’est-ce pas dès lors le moment d’inciter à une rupture ? Les voitures neuves dégagent en moyenne 100 grammes de CO2 au kilomètre, ce qui correspond à la norme Euro 6. Telle serait la norme appliquée si le renouvellement devait avoir lieu aujourd’hui. La question est de savoir s’il faut aller encore plus loin. En tout état de cause, le facteur de l’âge moyen induit une reprise forte. Mais les constructeurs français seront-ils ceux qui en profitent le plus ?
M. Philippe Duron. Certains constructeurs se préparent à offrir des solutions de location de voiture ou des services de mobilité définis de manière large. Cela peut-il avoir un effet sur le volume des ventes et sur le chiffre d’affaires des entreprises ?
M. Xavier Timbeau. Nous passons d’une économie de propriété à une économie d’usage, ce qui induit une réduction du parc et du nombre de véhicules, mais aussi du nombre de kilomètres consommés, car le consommateur qui loue un véhicule constate l’intégralité du coût : cela peut lui faire préférer d’autres modes de transport. Pour le propriétaire d’un véhicule, il en va différemment, puisque le coût marginal du déplacement, égal à celui du carburant et de l’entretien, est pour lui très bas. Cela peut induire une surconsommation. Le développement de la location conduira donc à une baisse de la demande.
Mais l’on peut aussi défendre l’idée que cette évolution va fluidifier le marché, mettant en circulation des véhicules plus jeunes, plus avancés technologiquement et plus en phase avec les usages. Cela peut créer de nouvelles façons de consommer de la mobilité. L’effet final serait bénéfique pour les constructeurs, qui verraient évoluer la typologie de leurs clients, la segmentation du marché, la diversité de l’offre et leurs marges. Les nouvelles formes de demande ne sont donc pas dénuées de sens pour les constructeurs. Pour le consommateur, l’offre devrait être à l’avenir moins monolithique et mieux adaptée. La voiture autonome peut même être un déclencheur en la matière.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Monsieur, je vous remercie.
La séance est levée à dix-neuf heures quinze.
◊
◊ ◊
15. Audition, ouverte à la presse, de M. Ariel Cabanes, directeur de la prospective et de Mme Clémence Artur, chargée des relations publiques du Conseil national des professions de l’automobile (CNPA).
(Séance du mercredi 16 décembre 2015)
La séance est ouverte à onze heures trente.
La mission d’information a entendu M. Ariel Cabanes, directeur de la prospective et Mme Clémence Artur, chargée des relations publiques du Conseil national des professions de l’automobile (CNPA).
Mme Sophie Rohfritsch, présidente. Nous recevons les représentants du Conseil national des professions de l’automobile (CNPA), Monsieur Ariel Cabanes, directeur de la prospective, et Mme Clémence Artur, en charge des affaires publiques.
Le CNPA a vocation à représenter tous les métiers de l’automobile autres que les constructeurs et les équipementiers.
Il s’agit d’activités diverses qui vont de la vente à la réparation et au dépannage, des carrossiers aux centres de contrôle technique, sans oublier le secteur des poids lourds et donc une grande partie des professionnels que l’on peut appeler les « diésélistes ».
Plus de vingt grands métiers sont représentés. Sans les énumérer tous, on peut citer également les détaillants de carburants et de lubrifiants, les recycleurs, les distributeurs de pneumatiques ou encore les installateurs de systèmes GPL et même les concessionnaires de motocycles et de voiturettes.
Combien d’emplois sont concernés par ces activités qui sont autant de réseaux actifs et répartis sur l’ensemble du territoire ?
Cette audition est l’occasion de vous entendre sur les défis d’adaptation auxquels vos activités sont confrontées, tant en termes d’emplois, de formation professionnelle que d’investissements.
Dans le domaine de la vente de véhicules, par exemple, les relations des agents et des concessionnaires avec les constructeurs ont-elles évolué au cours des dernières années ? À cet égard, peut-on, identifier certaines spécificités de la part des deux constructeurs français ?
Quelle appréciation portez-vous sur l’évolution du marché de l’occasion et notamment sur les perspectives pour les véhicules diesel des anciennes générations ?
Les membres de la mission seront également très attentifs à vos interrogations comme à vos propositions, en matière réglementaire ou fiscale, au-delà du seul rééquilibrage, au demeurant progressif, des taxations sur l’essence et le diesel, qui devrait être engagé.
M. Ariel Cabanes, directeur de la prospective du Conseil national des professions de l’automobile. Le CNPA représente les entreprises qui forment l’aval de la filière automobile, l’amont étant occupé par les industriels, constructeurs et équipementiers, qui sont regroupés depuis 2009 au sein de la Plateforme automobile (PFA). Nous comptons d’ailleurs proposer que la France adopte une vision systémique de l’amont et de l’aval qui fait défaut aujourd’hui.
L’aval est constitué de 21 métiers très divers, qui vont effectivement de la distribution à la réparation et aux services autour de la mobilité – vous n’avez toutefois pas cité les parcs de stationnement qui peuvent avoir leur importance dans la réflexion sur la mobilité urbaine. Ces activités concernent un peu plus de 100 000 entreprises et, au total, un peu plus de 400 000 emplois.
Nous avons demandé une étude à la Banque de France afin de connaître, en s’appuyant sur des chiffres précis, l’évolution entre 2009 et 2014 des différents métiers, classés en quatre grandes familles parmi lesquelles le commerce et la distribution ou l’après-vente. La filière aval se caractérise par la place qu’occupent les indépendants – 80 % des entreprises ne sont pas liées à l’amont. Autre caractéristique de cette filière, elle compte près de 50 000 très petites entreprises – autoentrepreneurs ou entreprises à zéro salarié –, ce qui impose des exigences fortes en termes de formation et d’évolution de l’emploi pour s’adapter aux mutations de la mobilité et aux nouveaux véhicules.
L’aval représente 400 000 des 600 000 emplois du secteur automobile, soit les deux tiers des emplois.
Lors des États généraux de la filière aval, organisés en mars 2015 à Bercy sous l’égide du ministre, M. Emmanuel Macron, il nous a été demandé de rédiger un Livre blanc de la filière aval. Depuis le mois d’avril, nous avons mené un travail d’analyse, métier par métier, pour identifier les caractéristiques de la filière et pour déterminer les moyens d’en faire un atout pour la transformation des mobilités, de préparer les métiers aux nouvelles technologies et de développer l’emploi.
L’une des caractéristiques des métiers que représente le CNPA tient à leur très grande capillarité. Le petit garagiste en milieu rural, qui souvent répare la voiture mais aussi la tondeuse ou le matériel agricole, est un élément de mobilité et de proximité ; il contribue à l’emploi en permettant à un demandeur d’emploi de se déplacer et à un artisan de travailler en milieu rural. Les mutations de la mobilité préoccupent aussi les territoires ruraux.
Je ne suis pas en mesure de vous présenter aujourd’hui le Livre blanc puisqu’il sera remis officiellement à la fin du mois de janvier mais je peux en dire quelques mots.
Ce Livre blanc rappellera la fiche d’identité des différents métiers. Il doit proposer des pistes pour que ceux-ci se préparent aux mutations qu’implique le passage d’une économie d’usure du véhicule à une économie de l’usage. Il abordera la dématérialisation de la propriété, la gestion de flottes, les systèmes collaboratifs. Il cherchera à répondre à ces questions : comment cette filière, qui est une filière à part entière et pas seulement l’aval des industriels, peut se prendre en charge ? Quels sont les atouts qu’elle peut mettre au service des transitions en cours ?
Ce Livre blanc, intitulé « Un pacte de mobilité », comportera six axes, dont trois axes de transformation : comment préparer les métiers aux évolutions ? Comment faire face aux différentes réglementations et à leurs évolutions ? Comment promouvoir l’emploi et faciliter l’intégration des jeunes à travers des contrats d’apprentissage et des politiques de formation ?
Le CNPA, ce sont aussi des organismes comme l’Association nationale pour la formation automobile (ANFA), et le Groupement national pour la formation automobile (GNFA), qui, du CAP jusqu’au bac + 5, forment à tous les métiers de l’automobile. Comment, à travers ces organismes de formation, va-t-on préparer les jeunes à réparer des véhicules électriques ou à hydrogène ou à gérer des technologies différentes – les véhicules connectés supposent des garages connectés et des services connectés ? Ces nouveaux métiers doivent être mis en place – certains le sont déjà – mais toute la filière doit réussir à former des jeunes pour prendre en charge le véhicule, une fois vendu. Sans des garages et des services connectés, le véhicule connecté mettra du temps à se développer.
Le Livre blanc identifie trois piliers de prospective, à l’horizon 2020, autant de sujets qui sont déjà au cœur de notre actualité : le premier d’entre eux est l’économie circulaire ; l’aval de la filière, c’est avant tout la gestion et l’entretien du parc roulant. Comment entretient-on les véhicules et comment fait-on pour prolonger la vie des véhicules afin d’économiser de la matière première lors de la conception des véhicules ? Comment rendre la maintenance des véhicules beaucoup plus vertueuse en matière de sécurité mais aussi d’environnement ? Le Livre blanc doit comporter des propositions pour « une maintenance verte » des véhicules existants qui sont souvent des véhicules assez anciens – l’âge moyen du parc automobile français est de 8,7 ans. Il faut être conscient que l’impact sur l’environnement ne doit pas être mesuré uniquement pour les nouveaux véhicules mais aussi pour le parc roulant.
1,8 million de véhicules neufs avec des technologies récentes, respectant les normes Euro 5 ou Euro 6, faiblement émetteurs de gaz à effet de serre ou de particules, sont mis sur le marché tandis que l’aval doit prendre en charge un peu plus de 38 millions de véhicules en service aujourd’hui.
Il ne faut pas non plus oublier la fin de vie des véhicules, avec le système de collecte et de recyclage ; ces branches – la collecte, les pneumatiques usagés, les pièces de réemploi ou encore les véhicules hors d’usage (VHU) – sont extrêmement importantes. La filière aval a un rôle à jouer pour assainir les activités de collecte. On sait très bien que subsistent encore beaucoup de zones d’ombre, en dépit de la réglementation, européenne ou française, qui proscrit la destruction sauvage de véhicules ou les marchés parallèles de pièces et de pneumatiques. On connaît les circuits qui permettent aux véhicules ou aux pièces de revenir en France.
Deuxième pilier prospectif, le numérique. L’apparition du véhicule connecté implique des mutations dans les garages et les services afin d’être en mesure d’établir un diagnostic intelligent et de réparer le véhicule, voire le remettre dans l’état initial, l’ambition n’étant pas seulement de faire rouler le véhicule. Nous pourrons aborder la question du contrôle technique, sujet majeur.
Dernier pilier, les énergies alternatives – le véhicule électrique, le véhicule à hydrogène – sur lesquelles nous pourrions nous engager fortement. Quelles peuvent être les ambitions sur ce sujet ? Quels sont les modes de financement que nous envisageons pour pouvoir déployer ou expérimenter ces innovations dans certaines régions ?
Enfin, nous proposons au ministre, sous l’égide du comité stratégique de filière, la création d’une plateforme de la mobilité, aux côtés de la PFA, qui prenne en compte l’ensemble des métiers de l’aval dont le rôle est extrêmement important dans la gestion du parc automobile.
Mme Clémence Artur, chargée des affaires publiques. Les 400 000 emplois de la filière aval ne sont pas « délocalisables ». Ce sont des emplois de service et de proximité.
80 % des emplois ne sont pas dans le giron des constructeurs, ce qui n’empêche pas que subsistent des relations contractuelles ou économiques qui peuvent être compliquées avec certains donneurs d’ordre, que ce soit les compagnies d’assurance ou les pétroliers pour la distribution de carburants.
Depuis la fin du règlement européen d’exemption, subsiste un flou sur le statut du distributeur automobile, qui n’est pas juridiquement défini aujourd’hui. Cela pose des problèmes aux entrepreneurs, à la tête de grosses entreprises – la distribution automobile représente environ 150 000 emplois. Ces chefs d’entreprise doivent assumer des investissements très conséquents afin de respecter les cahiers des charges imposés par les constructeurs pour les showrooms. En outre, ces surfaces sont soumises à la taxe sur les surfaces commerciales. L’environnement économique est donc assez complexe. Or, on observe un léger tassement des ventes de véhicules neufs malgré une année 2015 plutôt satisfaisante. La rentabilité de cette activité est donc quelque peu rognée. L’absence de statut pour le distributeur recrée une relation de dépendance économique importante à l’égard du constructeur. Ainsi, un patron de concession automobile ne peut, aujourd’hui, pas choisir seul la personne qui va reprendre son entreprise ; cette décision fait l’objet d’une négociation avec le réseau « constructeur ». Il n’est pas question de noircir le tableau car, sur le terrain, les choses se passent bien : les réseaux dialoguent avec les distributeurs automobiles. Nous valorisons ce dialogue au travers de la « cote d’amour » des constructeurs, une étude que nous réalisons chaque année auprès de nos concessionnaires et qui donne lieu à un palmarès.
Les relations contractuelles, déjà compliquées, ont toutefois été aggravées par l’article 31 de la loi pour la croissance et l’activité, c’est-à-dire par un article destiné à s’appliquer à la grande distribution. Or, une fois de plus, la distribution automobile tombe sous le coup des différentes réglementations visant la grande distribution. Cet article prévoit une résiliation automatique de l’ensemble des contrats entre un réseau et les différents magasins. Or, un distributeur automobile est lié par trois types de contrats avec son constructeur : un contrat de vente de pièces, un contrat de maintenance, un contrat de vente de véhicules. Cela fait partie d’une nécessaire souplesse dans les relations contractuelles avec les constructeurs que de pouvoir mettre fin à l’un des trois contrats sans pour autant mettre fin aux autres. Les contrats sont en outre assez complexes à renégocier. Les distributeurs sortent rarement gagnants de ce type de rapports de forces. Nous avions alerté sur les difficultés que risquait de faire peser sur nos entreprises cet ajustement législatif qui partait d’une bonne intention mais pour la grande distribution.
M. Ariel Cabanes. Selon l’étude de la Banque de France, entre 2009 et 2014, le nombre d’emplois pour l’ensemble de l’aval a diminué de 4,3 %. Cette décrue s’observe particulièrement dans le domaine du commerce et de la distribution, en conséquence de la baisse des ventes de véhicules neufs : le nombre d’emplois est ainsi passé de 200 000 à 178 000. Dans le même temps, les services ainsi que le commerce et la réparation, eux, créent des emplois. Dans le domaine de l’après-vente et de la réparation, le nombre d’emplois est passé de 142 000 à 146 000. Depuis 2011, on observe un rééquilibrage, notamment en faveur du contrôle technique et de la maintenance des parcs. La filière assume son rôle dans la gestion du parc roulant en créant des emplois.
Autre point encourageant, 64 % des entrepreneurs ont moins de 50 ans et 32 %, moins de 40 ans. Si la formation et la qualité professionnelle sont au rendez-vous et si l’activité répond à un besoin identifié des consommateurs, ces petites entreprises, souvent bâties par un autoentrepreneur, créent des emplois et contribuent au maillage territorial.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Je vous remercie pour la vision stratégique très éclairante que vous nous avez présentée. Nous sommes très intéressés par la lecture du Livre blanc et de l’étude de la Banque de France qui devraient être publiés dans des délais compatibles avec le calendrier de nos travaux.
Quelles sont les perspectives d’évolution en termes d’emplois pour la filière ?
Le renouvellement du parc roulant est au cœur de nos travaux tant les différences entre anciens et nouveaux véhicules sont marquées en matière d’émissions polluantes. Quel est votre point de vue sur le marché de l’occasion et la gestion du parc roulant ? Faut-il selon vous accélérer le renouvellement du parc ?
Vous avez mentionné rapidement le contrôle technique. Quelle part de l’activité représente-t-il ? Nous nous interrogeons sur son contenu et sa possible évolution en matière de respect des normes d’émissions polluantes.
Que pouvez-vous nous dire de la pratique du « défapage » ?
L’association UFC-Que choisir, lors de son audition, a insisté sur l’ouverture à la concurrence du marché des pièces détachées. Quel est votre point de vue ?
L’aval de la filière étant en relation directe avec les consommateurs, d’après les informations qui remontent de votre réseau, quel est l’impact de l’affaire Volkswagen ?
Enfin, pouvez-vous nous en dire plus sur la cote d’amour des constructeurs que vous avez mentionnée ?
M. Jean Grellier. Voyez-vous pour l’avenir une égale répartition entre les différentes sources d’énergie – électricité, biogaz, hydrogène – ou pensez-vous que l’une d’elles peut prendre le dessus ? La baisse du cours du pétrole est-elle conjoncturelle ou structurelle ?
S’agissant des pièces détachées, est-il nécessaire de maintenir le monopole des constructeurs français ?
Peut-on envisager une démarche industrielle pour la déconstruction des véhicules viable économiquement ?
M. Philippe Duron. Comment voyez-vous l’évolution du marché de l’occasion face à la progression de l’électrification du parc ? Le marché de l’occasion pour les véhicules électriques, aujourd’hui embryonnaire, peut-il vraiment se développer ?
L’économie d’usage est-elle vouée à être captée par les grands constructeurs et leurs distributeurs ou permettra-t-elle l’émergence d’autres acteurs ?
Depuis la remise en cause de l’exclusivité, comment les distributeurs se positionnent-ils face aux contraintes que leur imposent les constructeurs ? Sont-ils favorables au maintien de l’exclusivité de marque ou à une plus grande liberté qui leur permettrait de vendre un bouquet de produits ?
M. Gérard Menuel. Nous avons retenu des auditions précédentes que le véhicule à hydrogène est une perspective très lointaine. Vous semblez être plus optimistes. Pouvez-vous préciser dans quel calendrier vous inscrivez cette perspective ?
L’âge moyen du parc automobile connaît-il des évolutions ? Et comment se situe la France par rapport aux autres pays européens ?
M. Yves Albarello. Je souhaite également des éléments de comparaison européenne sur le vieillissement du parc.
Il reste beaucoup à faire en matière de collecte – il suffit de constater le nombre de pneus et de carcasses de voitures qui jonchent nos routes de campagne. Les constructeurs mènent-ils une réflexion sur ce sujet pour mettre un terme à ces pratiques ?
M. Gérard Menuel. Peut-on d’ailleurs imaginer demain des pneus dont la durée de vie serait identique à celle du véhicule ?
M. Ariel Cabanes. Au risque de vous décevoir, la réponse est non.
Les services ont vocation à se développer. Il ne faut pas envisager les évolutions par le seul prisme du véhicule particulier. Nous parlons de l’ensemble des véhicules, les véhicules utilitaires légers, les poids lourds et les parcs de semi-remorques ou les bus. S’agissant de l’âge moyen du parc, les véhicules industriels sont un peu plus jeunes, leur renouvellement est plus rapide – l’âge moyen est entre six et sept ans – ; pour le matériel tracté, l’âge varie de dix à quinze voire dix-huit ans. Les problématiques sont donc différentes.
Nous ne disposons pas de prévisions sur l’évolution de l’emploi. Parallèlement à la diminution du nombre d’emplois, on observe un phénomène de vases communicants : les modes de commercialisation et de distribution devenant plus efficients, l’emploi dans ce secteur risque peut-être de se contracter encore mais rien ne le laisse présager pour l’instant. En revanche, l’activité de services va prospérer, c’est une évidence. Nous avons la conviction que les services vont se développer pour pouvoir gérer le parc mais aussi pour mettre en place le garage « social », concept auquel le CNPA est très attaché.
Une personne propriétaire d’un véhicule, âgé de plus de dix ans, ne l’est pas par plaisir mais par nécessité, notamment pour se rendre sur son lieu de travail. Nous devons être inventifs pour lui proposer la réparation ou la remise en état de son véhicule non pas avec des pièces d’origine mais avec des pièces de réemploi, à condition que celles-ci suivent un circuit encadré et soient utilisées dans des filières professionnelles qui respectent les règles de l’art. Nous proposons de mettre en place des « garages sociaux » afin que les vieux véhicules puissent être réparés et entretenus en garantissant la sécurité routière et, quand c’est possible, un verdissement. Grâce ces améliorations, le véhicule continuera ainsi à être utilisé de la manière la plus vertueuse possible.
Mme Sophie Rohfritsch, présidente. Pourquoi faudrait-il des garages dédiés ? Ces garages « sociaux » ne peuvent-ils pas être intégrés dans le réseau classique ?
M. Ariel Cabanes. Ils pourraient trouver leur place dans le circuit classique, bien entendu.
Dans l’après-vente, il faut gérer deux types de véhicules : les véhicules récents sous garantie pour lesquels les réparations sont faites avec des pièces d’origine de la même marque. Pour ces véhicules, il y a l’obligation de remettre le véhicule presque à l’état neuf. En revanche, pour les véhicules au-delà de huit ans, même si l’État propose des mesures incitatives pour le renouvellement du parc – je ne dis pas qu’il ne faut pas les prendre –, leur effet ne se fera pas sentir tout de suite. Nous avons essayé par le passé les bonus et les malus, nous savons qu’ils demandent du temps pour produire leurs effets car l’introduction de nouveaux véhicules sur le marché prend du temps. Nous pourrions imaginer d’aider les acquéreurs d’un véhicule d’occasion répondant aux normes Euro 5 au minimum en leur offrant un contrôle technique gratuit ou encore une carte grise gratuite etc. Les professionnels peuvent s’engager sur une telle mesure, tout en la jugeant insuffisante.
Mais qui peut s’acheter un véhicule d’occasion Euro 5 qui coûte au bas mot 10 000 à 12 000 euros ? Le propriétaire d’un véhicule dont la moyenne d’âge est au-delà de huit ans et la valeur entre 2 000 à 3 000 euros, n’a pas les moyens de s’acheter un véhicule Euro 5.
Grâce au « garage social » utilisant des pièces de qualité, approuvées et garanties par des professionnels, mais issues du démontage du véhicule hors d’usage, le véhicule peut continuer à rendre service.
Mme Clémence Artur. Il est intéressant de différencier ce qui relève du service pour des véhicules neufs qui vont connaître de grandes mutations et ce qui relève de la maintenance pour l’ensemble du parc dont, je le rappelle, l’âge moyen est de 8,7 ans.
L’âge moyen de destruction d’un véhicule dépasse aujourd’hui dix-neuf ans. Le marché de l’occasion nous échappe en partie puisque trois cinquième des transactions se font de particulier à particulier.
Les propriétaires de véhicules anciens, dont on peut préjuger qu’ils connaissent souvent des difficultés économiques, vont se détourner assez rapidement des professionnels de l’automobile, d’abord des réseaux de distributeurs qui sont réputés plus chers et, à terme, du garagiste indépendant en raison de l’essor de l’économie collaborative – le voisin va proposer de faire lui-même les réparations. Cette filière illégale ou grise, qui revêt des formes très différentes – un professionnel qui fait du dépannage le week-end à titre privé comme une personne qui s’y connaît un peu – grignote de plus en plus de parts de marché, tant pour la réparation que, de façon plus sensible encore, pour le recyclage.
L’ADEME estime qu’un véhicule sur deux n’est pas remis dans les centres VHU
– centres de destruction des véhicules hors d’usage – parce qu’ils sont démontés ailleurs, et ce pour deux raisons.
D’abord, les particuliers ignorent parfois leurs obligations à l’égard de leur véhicule qui n’est plus en état de rouler – vous connaissez ces affiches aux feux rouges qui proposent de reprendre le véhicule en échange de 300 ou 400 euros, une solution plus attractive que de faire venir un dépanneur et payer 150 euros pour pouvoir l’emmener en centre VHU. Ensuite, il reste moins coûteux de choisir une autre solution que le centre VHU.
Cette offre de services à caractère social pour les véhicules particuliers est aussi une façon de maintenir de l’emploi. Il sera toujours plus avantageux pour le consommateur de faire appel à un garage avec des professionnels qui utiliseront des vraies pièces de réemploi qui seront traçables, donneront des garanties en matière de sécurité routière et permettront de profiter d’un véhicule au maximum de ses capacités énergétiques, toutes choses que le voisin dont je parlais n’est pas à même d’offrir.
Pour le renouvellement du parc, des mesures incitatives sont mises en œuvre. Toutefois, la prime à la casse a surtout conduit à détruire des véhicules qui avaient à peine une dizaine d’années et qui auraient pu continuer à rouler avec un entretien écologique satisfaisant. Elle a surtout permis aux classes moyennes de s’acheter un véhicule plus performant. Le gros du parc polluant n’en a pas profité. C’est toute la difficulté de ces mesures de bonus ou de prime à la casse que de toucher le bon public : les personnes qui devraient bénéficier d’aide pour l’acquisition de véhicules moins polluants n’en profitent pas. C’est pourquoi le livre blanc envisage la possibilité d’aides à l’acquisition pour les véhicules d’occasion, aides aujourd’hui inexistantes ; les personnes qui possèdent des véhicules norme Euro 4 ou moins ne peuvent pas s’acheter des véhicules norme Euro 5 et ne peuvent pas entretenir leur véhicule dans des conditions satisfaisantes en matière de sécurité et d’environnement.
Mme Marie-Jo Zimmermann. Combien d’années seront nécessaires pour gérer le stock énorme de véhicules – 38 millions – en garantissant les meilleures performances en matière de respect de l’environnement ?
M. Ariel Cabanes. Premier élément de réponse, un certain temps… Pour résoudre ce problème, la proposition qui nous paraît simple à mettre en œuvre consiste à imposer un contrôle technique annuel systématique au-delà de la septième année. Il s’agit d’une mesure concrète, très claire, qui peut compléter les dispositifs de maintenance avec des pièces de réemploi effectuée par des professionnels. Cette mesure permettrait une photographie du parc, au lieu des études actuelles fondées sur les cartes grises, puisque la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) centralise l’ensemble des données lors du contrôle technique. Le contrôle technique systématique permettrait un meilleur contrôle ainsi qu’une meilleure gestion de l’évolution du parc roulant ancien, et peut-être une accélération de sa mise à niveau ou de son rajeunissement.
Mme Clémence Artur. Le volet pollution du contrôle technique a été renforcé par l’article 65 de la loi relative à la transition énergétique qui est compliqué à mettre en œuvre.
Initialement, le projet consistait en un entretien à visée écologique. Mais il fait plus sens dans le cadre du contrôle technique qui comporte déjà un volet pollution pour certains véhicules et qui est le bon lieu pour poser un diagnostic sur les taux d’émission de CO2. Pour les véhicules utilitaires légers, la visite complémentaire pollution a lieu entre deux contrôles techniques tous les ans à partir de la cinquième année.
La possibilité d’un contrôle technique systématique a été discutée lors de l’examen de la loi sur la transition énergétique et écartée pour des raisons de coût, ce qui est parfaitement audible. Le CNPA avait demandé une enquête du Gerpisa, le réseau international de l’automobile, pour évaluer le coût réel du contrôle technique rapporté au coût d’un véhicule sur une année. Le volet pollution est évidemment moins cher que le contrôle technique complet. Au vu des prévisions à long terme et de comparaisons européennes, il apparaît qu’un contrôle technique plus régulier, sur les deux aspects – pollution et sécurité –, permet d’éviter des réparations très coûteuses par la suite et encourage un entretien préventif. Le CNPA entend parallèlement accompagner les propriétaires de véhicules grâce à l’installation de ces garages sociaux qui leur permettront de faire les réparations au fil de l’eau, et pas uniquement des réparations curatives qui parfois vont coûter très cher, en particulier pour des véhicules dont la valeur intrinsèque n’est plus très importante.
On peut également imaginer des aides sociales ou une TVA incitative, à l’instar de celle qui s’applique dans le bâtiment pour les travaux d’amélioration de la qualité énergétique. La TVA, aujourd’hui à 20 %, pourrait être réduite pour un nettoyage du moteur, l’installation ou le remplacement d’un filtre à particules, la pièce de réemploi, diminuant ainsi les coûts de la réparation. Le contrôle technique reste le point d’entrée, quelles que soient les mesures complémentaires.
M. Ariel Cabanes. Nous voyons croître un marché parallèle des pièces de réemploi mais il échappe à tout encadrement. Il suffit d’aller sur le site Leboncoin.fr…
Mme la rapporteure. Des inspections avaient été diligentées pour mettre fin aux décharges illégales. Quel en est le bilan ?
Mme Clémence Artur. La Direction générale de la prévention des risques (DGPR) est très alertée sur le sujet. Mais, première difficulté, elle inspecte les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), elle ne se déplace donc pas chez votre voisin. Ensuite, nos professionnels signalent régulièrement aux préfectures des activités illégales. Mais on constate une certaine forme de tolérance qu’on peine à comprendre.
Sur le site Leboncoin.fr, nous avons, de manière empirique, répertorié les annonces pour une journée, en écartant celles des professionnels – certains s’inscrivent pourtant comme professionnels mais renseignent leur adresse personnelle, laissant à penser qu’ils n’agissent pas dans le cadre de leur entreprise. Au terme de cette compilation, le montant des pièces détachées proposées s’élevait à 3 millions d’euros ! À titre de comparaison, la filière VHU réalise un chiffre d’affaires annuel de 300 millions d’euros. Quant au particulier qui met en vente dans la même journée 50 airbags – alors que les éléments pyrotechniques n’ont pas le droit d’être vendus, y compris par les professionnels –, il ne s’agit pas d’activité de brocante, c’est évident. Il conviendrait d’instaurer une surveillance de ces marchés parallèles.
M. Ariel Cabanes. C’est bien là toute la difficulté. Nous avons des propositions pour mieux encadrer les marchés mais c’est compliqué. Toutes ces activités parallèles échappent à la TVA.
C’est pourquoi nos propositions portent sur le contrôle technique, les garages sociaux, une TVA adaptée pour des véhicules d’un certain âge. De telles mesures seraient incitatives tant le coût est rédhibitoire pour les populations concernées.
On peut inciter les propriétaires de véhicules âgés à entretenir ces derniers dans des conditions économiques acceptables pour eux et au bénéfice de la collectivité.
Autre enjeu, l’après-entretien, on l’a dit, un véhicule sur deux n’est pas démonté. Il suffit d’observer les trafics aux frontières qui alimentent les marchés parallèles. Là aussi, la surveillance doit être améliorée.
Aujourd’hui, les pneus sont collectés presque à 100 % – c’est l’une des filières les plus vertueuses. La collecte fonctionne parce qu’elle s’appuie sur une véritable industrie de valorisation. Si la collecte et le recyclage pour les véhicules ne sont soutenus que par des subventions, sans industrie de valorisation, cela ne marche pas. Bon nombre de recycleurs s’installent attirés par une incitation locale ou des subventions, mais, après quelques années, ils disparaissent.
L’ADEME a réalisé une étude à la demande de la DGPR en 2014 qui souligne la nécessité de créer une industrie de la valorisation. Il y a beaucoup à faire dans le domaine de la déconstruction et de la récupération des matériaux. Les parcs roulants espagnols ou italiens sont un peu plus vieux qu’en France – la crise économique a aussi laissé des traces – ; en Allemagne, le parc est un peu plus dynamique ; en Angleterre, le parc est de même nature. Mais, en matière de recyclage et de valorisation, au Danemark, en Angleterre ou en Allemagne, ont été créées de véritables industries de la valorisation matière. Le ticket d’entrée est entre 200 et 300 millions d’euros mais les industriels investissent. La Chine est très en avance dans le domaine de la récupération des produits en fin de vie, les industries de la valorisation y sont extrêmement fortes. En France, il faut créer un élan pour inciter à la création d’une industrie de la valorisation. Aujourd’hui, le cours des matières premières est un problème. Le modèle économique est remis en question dès lors que les pièces neuves valent moins cher que celles issues du recyclage. Or, le problème n’est pas conjoncturel : le baril de pétrole restera à moins de 50 euros pendant encore quelques années.
Le « défapage » est aussi lié au coût du filtre à particules. Il suffit de déconnecter une partie électronique et le véhicule marche aussi bien.
Mme la rapporteure. Que peut-on faire pour lutter contre cette pratique ?
M. Ariel Cabanes. On peut effectuer une vérification dans le cadre du contrôle technique, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Avec le Livre blanc, nous souhaitons présenter des propositions efficaces dont l’impact est fort mais les coûts pour l’État et les entreprises aussi faibles que possible. La mesure relative au contrôle technique est simple et facile.
Dans un autre registre, on peut parler d’éducation routière puisque le CNPA représente aussi les auto-écoles. Une mesure facile à mettre en œuvre consisterait à proposer le permis de conduire à 1 euro pour les jeunes qui rentrent dans la filière afin d’améliorer son attractivité. Il existe nombre de sujets de cette nature, disparates mais qui donnent une cohérence à l’ensemble, en faveur de cette mobilité nouvelle et un peu plus verte.
Mme la rapporteure. Est-il facile de vérifier la présence d’un filtre à particules dans les points du contrôle technique ?
M. Ariel Cabanes. C’est une constatation très facile à faire.
Mme Clémence Artur. Le délit de « défapage » figure désormais dans la loi sur la transition énergétique. Il est dommage de ne pas avoir prévu les moyens de le constater !
Mme la rapporteure. Je vous livre une annonce que je viens, à l’instant, de trouver sur le site Leboncoin.fr : « … Vous avez des messages d’erreur, votre véhicule se met en mode dégradé, perte de puissance et d’accélération ? Cette modification d’enlever le filtre à particules offre un gain de puissance et une diminution de consommation mais surtout plus jamais de dépenses supplémentaires dues à un filtre à particules défectueux ; cette modification est définitive et indétectable ; elle n’entraîne aucun code défaut et n’altère en rien le passage au contrôle technique … ». Il manque le prix mais une autre annonce propose le « défapage » à 250 euros !
Mme Clémence Artur. Selon les professionnels que nous avons interrogés, les demandes de « défapage » sont rares. Cette pratique s’observe plutôt en dehors des garages comme en témoigne cette annonce.
M. Ariel Cabanes. Aujourd’hui le contrôle technique est visuel, à l’exception de la sonde lambda qui mesure les émissions. Tant que le contrôle reste visuel, l’absence de filtre à particules, comme le dit l’annonce, est indétectable. Il suffit que le contrôle technique soit équipé des moyens de diagnostic dont disposent les garagistes. En connectant la valise de diagnostic, vous êtes averti d’un dysfonctionnement dans la cartographie du moteur. Cela soulève une autre question récurrente et qui sera de plus en plus prégnante : le partage des données entre l’amont et l’aval – les données du véhicule et les données d’usage. Si les données du véhicule sont verrouillées au profit du seul constructeur ou de telle filière, cela interdit aux autres de réparer, d’entretenir ou d’effectuer le contrôle technique.
Nous plaidons donc pour une ouverture des data aux professionnels. Dans le Livre blanc, figure une proposition en faveur d’une « carte Vitale du véhicule ». Le petit garagiste du fin fond de la Lozère ou le centre de contrôle technique auraient accès aux données, ce qu’ils ne peuvent pas faire aujourd’hui. Nous avons entre les mains un outil extrêmement puissant qui permet de mieux contrôler le parc et de le rendre plus vertueux mais il faut donner les moyens aux professionnels de diagnostiquer jusqu’au bout.
Mme la rapporteure. Comment peut-on concilier ouverture des données et secret industriel, argument qui vous sera inévitablement opposé ?
Mme Clémence Artur. La question de l’accès aux données techniques n’est pas récente. Le secret industriel peut être un argument mais si ce secret empêche un garagiste d’intervenir sur un véhicule pour le réparer, la notion de filière avec un grand F perd tout son sens. Je ne pense que ce soit l’intérêt des constructeurs d’entraver la maintenance des véhicules.
Mme Marie-Jo Zimmermann. Le contrôle technique semble incontournable. La modification que vous proposez relève-t-elle du domaine réglementaire ou législatif ?
Mme Clémence Artur. Tout le contenu du contrôle technique relève du domaine réglementaire.
M. Ariel Cabanes. Notre proposition porte sur les véhicules de sept ou huit ans. Cette mesure ne résoudra pas tous les problèmes mais elle est efficace.
Dans le domaine de l’autopartage, des expérimentations sont mises en place par des membres du CNPA, notamment en Bretagne, qui fonctionnent très bien. Un véhicule peut être utilisé par quelqu’un d’autre dans la journée. Il n’est pas immobilisé.
Mme Clémence Artur. Quant au risque que cette économie d’usage soit captée par les réseaux constructeurs et distributeurs, nous constatons que ces réseaux sont en retard, ils n’ont pas encore pris conscience du potentiel de cette économie.
Une expérimentation soutenue par le CNPA dans la région Bretagne permet d’utiliser pour l’autopartage le parc de véhicules d’occasion qui ne sont pas encore vendus par les distributeurs. L’autopartage est plutôt le fait des nouveaux acteurs de l’économie collaborative ou des particuliers. Ce marché se situe aujourd’hui en dehors du champ professionnel, ce qui nous permet d’avoir des discussions enrichissantes avec ces acteurs.
M. Ariel Cabanes. S’agissant des véhicules électriques et à hydrogène, l’offre n’est pas vraiment riche. On ne va pas refaire l’histoire. Mais l’ensemble des membres du CNPA sont en train de s’engager : pour le véhicule électrique, le partenariat avec l’Association nationale pour le développement de la mobilité électrique (AVERE) peut être un levier très puissant ; l’AVERE vient de signer avec le ministère de l’écologie et du développement durable dans le cadre des certificats d’économie d’énergie pour la période 2016-2018 pour le déploiement de 24 000 bornes de recharge sur le territoire français. Or, les professionnels du CNPA peuvent contribuer au maillage territorial. L’ambition est de parvenir sur les trois ans au déploiement des 24 000 bornes. L’idée est simple : les entrepreneurs ont envie d’investir, la demande existe. Un agent, un concessionnaire ou un carrossier peut posséder comme véhicule de prêt un véhicule électrique de sa marque et en même temps, parce qu’il souhaite promouvoir ce type de mobilité, installer une borne de recharge visible avec un accès au grand public.
Quant à l’hydrogène, il faut avoir la volonté d’avancer ; il existe plusieurs expérimentations. Dans la région de Grenoble, un entrepreneur, concessionnaire Renault, possède aujourd’hui 500 Kangoo à hydrogène qui roulent dans sa région, avec quatre points de recharge. Avec 15 kilos d’hydrogène, l’autonomie est de 400 à 500 kilomètres.
M. Yves Albarello. Quel est le coût d’installation d’un point de recharge ?
M. Ariel Cabanes. Je précise que nous parlons de flottes fermées qui intéressent les professionnels ou les collectivités locales. Ces flottes captives vont se déployer, selon le principe du cluster. Nous comptons promouvoir un certain nombre d’expériences afin qu’elles fassent tache d’huile.
Il existe deux manières pour obtenir l’hydrogène : soit l’hydrogène industriel dont le coût au kilo est plus faible, qui est livré sous forme de bonbonnes. Cette solution permet d’installer des stations plus rapidement et à un coût plus faible. L’électrolyse est plus coûteuse, les bornes de recharge autosuffisantes représentent un investissement d’environ 200 000 à 250 000 euros. Dans les deux cas, il faut s’inscrire dans une logique de gestion de flotte bien identifiée. Une collectivité locale, avec l’appui des partenaires sur le terrain – concessionnaires, garagistes, stations-service – va pouvoir mettre en place cette démarche.
Mme la rapporteure. Qu’en est-il de la réaction des consommateurs à l’affaire Volkswagen ?
M. Ariel Cabanes. On observe un peu de « diesel bashing », c’est évident. Dans les premiers jours qui ont suivi, le contrecoup s’est traduit par une baisse de la fréquentation des halls d’exposition.
Le problème se pose pour les loueurs et les flottes, d’abord au sujet du coût de la reprise des véhicules concernés. Tous les loueurs, de courte ou longue durée, remettent leurs véhicules sur le marché ou les exportent.
Mme la rapporteure. Que représente le marché de la location en France, en termes d’emplois et en nombre de véhicules ?
M. Ariel Cabanes. Nous vous donnerons ces précisions. Le CNPA ne représente que les loueurs de courte durée qui emploient 13 000 personnes.
Le business model des loueurs de longue durée est exclusivement financier.
Lorsque vous êtes propriétaire de votre véhicule, votre approche en matière d’entretien est différente de celle d’un loueur avec un parc de 5 000 véhicules à gérer. Les loueurs exercent une contrainte sur les prix ou le type d’entretien qui va s’accentuer. Mais cette mutation est inéluctable : avec la dématérialisation de la propriété, le citoyen va vouloir être à la fois piéton, cycliste, automobiliste et consommer de la mobilité de différentes manières : il louera une voiture quand il en a besoin. Il faut être attentif à ces nouveaux business models. Des partenariats se nouent avec tous les réseaux – entretien, maintenance, réparation, contrôle technique – mais ils sont contraignants. L’exemple des assureurs l’illustre bien. On revendique la liberté du choix du réparateur là où bien souvent l’assureur vous impose le lieu des réparations. Les choses sont en train de changer. Mais, en matière de dépannage, les plateformes d’assureur vous imposent leur choix. Il reste donc des problèmes à régler.
Mme la rapporteure. Je vous remercie pour cette audition passionnante. Nous sommes impatients de prendre connaissance du Livre blanc et de l’étude de la Banque de France. Nous serons sans doute amenés à nous revoir puisque vous nous avez soumis plusieurs propositions intéressantes.
La séance est levée à treize heures.
◊
◊ ◊
16. Rencontre, non ouverte à la presse, entre Mme la rapporteure et M. Michel Rollier, président de la Plateforme de la filière « Automobile et mobilités » (PFA) et président du conseil de surveillance de Michelin
(Séance du mercredi 16 décembre 2015)
La séance est ouverte à dix-sept heures dix.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Nous accueillons, aujourd’hui, M. Michel Rollier, industriel qui a l’expérience de la direction d’un grand groupe international. En sa qualité d’associé gérant commandité, il a dirigé, de 2006 à 2012, le groupe Michelin dont il préside toujours le conseil de surveillance. Sans être constructeur ni, à proprement parler, équipementier, l’entreprise Michelin n’en occupe pas moins une place essentielle dans l’industrie française. Le rang qu’elle tient à l’échelon mondial et la permanence d’une recherche et développement (R&D) de très haut niveau lui confèrent la position de référence de qualité reconnue de longue date. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que M. Rollier ait été désigné à la présidence de la Plateforme automobile PFA, dont nous avons déjà entendu le directeur général, M. Poyeton.
Monsieur Rollier, vous avez été membre du comité de pilotage du débat national sur la transition énergétique, ce qui fait de vous un interlocuteur de premier plan pour ce qui regarde les mutations de la filière automobile. Nous souhaitons vous entendre à propos des évolutions majeures attendues dans le secteur automobile pour les prochaines années. Dans cette perspective, les industriels européens et français disposent-ils d’atouts leur permettant de tirer leur épingle du jeu ?
Nous aimerions également que vous nous parliez de la notion du « fabriqué en France », à tous les échelons de la filière industrielle.
Enfin, l’affaire qu’il est désormais convenu d’appeler « Volkswagen » est-elle révélatrice de défaillances du système de contrôle des normes en vigueur, et contribue-t-elle, selon vous, à entamer la confiance des consommateurs ?
M. Michel Rollier, président de la Plateforme de la filière « Automobile et mobilités » (PFA) et président du conseil de surveillance de Michelin. Le transport routier mondial est à l’origine d’environ 23 % des émissions de CO2 et de 15 % des gaz à effet de serre, le méthane et d’autres gaz contribuant, eux aussi, à ce phénomène. Dans ce domaine, l’industrie automobile a réalisé des progrès importants que l’on peut mesurer en comparant les évolutions respectives de l’offre et du parc automobile. En 1995, les véhicules vendus en France consommaient en moyenne 7 litres de carburant aux cent kilomètres ; depuis les années 2013-2014, ce chiffre est passé en dessous de 5 litres. Il est généralement admis qu’un litre de carburant correspond à 25 grammes d’émission de CO2 environ. L’objectif fixé par Bruxelles pour 2020 se situe en dessous de 100 grammes de CO2, et nos projections pour cette échéance sont de 3,8 litres de carburant aux cent kilomètres en moyenne.
Du point de vue du marché, lorsque la consommation moyenne des véhicules construits en 1995 était de 7 litres, celle du parc installé était de 8 litres, et elle atteignait 6,8 litres en 2013 alors que les véhicules composant l’offre consommaient moins de 5 litres. En 2020, alors que nous proposerons des véhicules consommant 3,8 litres afin de respecter la norme européenne, la consommation moyenne sera encore de 5,8 litres.
S’agissant des émissions, trois points sont donc à noter : l’industrie automobile a accompli des progrès considérables ; le potentiel, très important, n’est pas encore tangible, car le renouvellement du parc automobile n’est pas encore réalisé ; le premier facteur d’amélioration de la situation environnementale en Europe et en France est la vitesse de ce renouvellement, sachant qu’il faut dix ans au parc pour se renouveler.
Bien sûr, on sait que les tests de consommation ne sont pas tout à fait représentatifs de la réalité, puisque effectués sur un banc d’essai dont les normes ont été définies en 1990. La mise en œuvre de la Real Driving Emission (RDE) dès 2017 devrait aboutir à des chiffres légèrement différents. Néanmoins, sur la base de tests appliqués de façon continue entre 1995 et 2015, on constate que la baisse de 30 % obtenue du côté de l’offre met plus de temps à passer dans la réalité.
S’agissant des émissions, qui constituent un sujet très sensible comme l’ont encore montré hier les débats du Parlement européen, le transport routier représente 50 % des émissions mondiales d’oxydes d’azote (NOx) et 14 % à 17 % des particules. À l’avenir, il s’agit de passer de 500 à 50 milligrammes pour les grosses particules et de 80 à 4,5 grammes pour le NOx, les coefficients étant pratiquement les mêmes pour les petites particules. J’ai effectué à votre intention le calcul suivant : considérant que notre parc automobile actuel répond à raison de 10 % à la norme européenne d’émission Euro 3 définie en 2001, de 70 % aux normes Euro 4 et Euro 5 et de 20 % à la norme Euro 6, qui est la nouvelle, l’accession à cette dernière se traduirait par une division par 2,5 des émissions de NOx et par 4 des particules.
J’y insiste donc, le premier facteur de diminution des atteintes portées à l’environnement reste le renouvellement du parc automobile. Il est plus ou moins rapide, mais le plus gros des efforts à fournir est déjà annoncé par le secteur. Il suffit désormais de laisser le temps faire son œuvre, mais nous savons que, malheureusement, le taux de rotation des véhicules s’étale sur dix ans.
Pour atteindre la norme de 95 grammes attendue en 2020, tous les experts de l’automobile s’accordent à dire que le diesel sera incontournable puisqu’il représentera environ 12 grammes de l’écart attendus entre les 132 et les 95 grammes. L’adaptation du diesel pose plutôt des problèmes de coût que de technique. Selon certains experts, qui ne sont pas eux-mêmes constructeurs automobiles, les filtres à particules répondant à la norme Euro 3 représentent un surcoût de l’ordre de 500 euros ; appliqué à la norme Euro 6, ce surcoût s’élèverait 1 500 euros. On peut en déduire qu’à l’avenir, on reviendra à des petits véhicules fonctionnant à l’essence, le diesel étant réservé aux plus gros, sur lesquels l’écart de prix sera acceptable.
À mesure que les taux d’émission de CO2 et de NOx des véhicules diminuent, on regarde d’autres émetteurs, dont les pneus qui, en s’usant, sèment des particules. Depuis une dizaine d’années, les onze plus grands fabricants de pneumatiques, dans le cadre du Tire Industry Project (TIP) placé sous l’égide du World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), ont lancé onze études dirigées par les trois plus importants fabricants que sont Bridgestone, Michelin et Goodyear, soit un Américain, un Européen et un Asiatique.
Au moins une fois par an, le TIP communique les résultats de ces études, qui sont réalisées par des experts internationaux. Les premières conclusions ont conduit à élargir les travaux sur l’usure des pneus (Tire Wear Particles) à l’usure des pneus et de la route (Tire and Road Wear Particles), car la chaussée est, elle aussi, émettrice de particules. Les études réalisées aux États-Unis, en France et au Japon, pour les plus grosses particules, et à Los Angeles, Tokyo et Londres, pour les plus petites, montrent que ces particules étant plus lourdes que l’air, on n’y retrouve que 1 % des plus grosses et 0,4 % des petites, qui sont inférieures à 2,5 microns. L’ensemble de ces particules ne représente donc pas de risque pour la santé ; de plus, elles sont dépourvues de toxicité puisqu’elles demeurent au sol et sont entraînées par l’écoulement des eaux.
Dans le cadre la Nouvelle France industrielle, l’idée est d’atteindre l’objectif des 50 grammes en développant des véhicules du segment B, de type Clio ou Peugeot 208, consommant 2 litres de carburant aux cent kilomètres, qui soient vendables et abordables. Ce programme est construit sur cinq briques de base : l’allègement du véhicule, le poids étant responsable de 20 % des émissions, à raison de 10 grammes de CO2 pour 100 kilogrammes ; la résistance à l’avancement, causée par les frottements et pneumatiques qui absorbent jusqu’à 30 % de l’énergie du véhicule et qui entre pour 10 % dans les émissions ; l’amélioration du moteur à combustion, pour 35 % ; l’hybride électrique, pour 25 % ; la connectivité et l’autonomie, qui concourent à l’amélioration de la conduite, pour 10 %. Aujourd’hui, ce programme fait l’objet de quatre-vingt-dix dossiers, en plus des grands groupes. Il occupe soixante PME, et les dépenses de recherche sont estimées à 875 millions d’euros d’ici à 2016, avec un niveau d’aides publiques de 280 millions dans le cadre du programme d’investissement d’avenir (PIA).
Lorsque l’on parle de l’industrie automobile française, on prend en compte les entreprises dont 20 % de l’activité est consacrée au secteur, ce qui rend parfois les statistiques peu lisibles. Aussi considère-t-on qu’elle regroupe 4 000 entreprises qui emploient 125 000 salariés à la construction et 375 000 dans l’équipement. L’activité de cette industrie est dominée par trois tendances de fond : la mondialisation, dans laquelle la part du marché français représente à peine 2 % du marché mondial ; la croissance des nouveaux marchés, caractérisée par l’émergence de nouveaux acteurs, qui exacerbe la concurrence ; la migration continue – et encore inachevée – de la valeur ajoutée des constructeurs vers leurs fournisseurs. Ce dernier aspect est fondamental. En 1985, un cabinet de consultants reconnu estimait que 44 % de la valeur ajoutée était le fait du constructeur ; aujourd’hui, il la chiffre à 22 %. Pour ce qui est de la recherche, alors qu’elle était effectuée à 60 % par les constructeurs et à 40 % par les fournisseurs, le rapport est passé à 45 % pour les premiers à 55 % pour les seconds. Le dialogue entre les constructeurs et les équipementiers s’établit donc désormais à l’échelle mondiale. Concrètement, cela signifie que nos constructeurs doivent nécessairement acquérir une dimension internationale. De fait, ils ne représentent aujourd’hui qu’un peu plus de 25 % de la production mondiale : en France, avec Toyota et Smart, Renault et Peugeot fabriquent à peu près 1,5 million de véhicules ; dans le monde, c’est quelque 6 millions.
La segmentation des diverses catégories de fournisseurs est devenue indispensable. La catégorie la plus importante par sa valeur ajoutée est désormais constituée par les équipementiers. Certains conçoivent des systèmes complets, d’où leur appellation de systémiers. Plastic omnium en est le meilleur exemple, qui conçoit l’avant du véhicule, tout le réservoir de carburant et le système d’alimentation. Valeo et le groupe Faurecia font aussi partie de cette catégorie. Les autres grands équipementiers sont les fabricants de modules, qui sont des concepteurs. Plastic omnium conçoit le système d’alimentation en carburant, mais achète sa pompe chez Bosch, équipementier allemand. De même, il conçoit l’avant du véhicule, mais les phares lui sont fournis par Valeo, ce qui fait de celui-ci également un fabricant de modules. La troisième catégorie est celle des sous-traitants, qui travaillent à partir de spécifications ; leur position concurrentielle est donc radicalement différente. Un cabinet de consultants a noté qu’il y a vingt-cinq ans, les constructeurs automobiles mondiaux avaient 30 000 fournisseurs ; aujourd’hui, ils en ont 2 500 puisque les anciens sous-traitants sont devenus les fournisseurs des équipementiers.
Ces évolutions emportent pour les équipementiers à la fois l’obligation d’acquérir une dimension internationale et celle de se placer dans le peloton des trois premiers dans leur champ d’activité. Cela ne signifie pas nécessairement qu’ils sont les plus grands. Ainsi, Valeo est beaucoup plus petit que Bosch, mais l’entreprise a retenu quatre segments dans lesquels elle est première ou seconde ; Plastic omnium, depuis le rachat, intervenu hier, de l’activité Automotive Exteriors de Faurecia, est devenu leader en matière d’avants de carrosserie en composite. En conséquence, la recherche se décline, elle aussi, à l’échelon international. La recherche fondamentale est beaucoup plus centrée sur le pays d’origine. Le centre de recherche fondamentale de Michelin, par exemple, se trouve à Clermont-Ferrand. Par contre, il est essentiel que la recherche appliquée soit conduite au plus près des plateformes des clients. Ainsi, Michelin fait de la recherche appliquée au Brésil et au Japon, et partout où il a des clients. La semaine dernière, Plastic omnium a annoncé l’ouverture de son vingtième centre de recherche au Japon. À leur tour, les sites de production doivent être proches des besoins.
La contrepartie est la présence d’équipementiers étrangers en France, où ces entreprises réalisent plus de la moitié du chiffre d’affaires du secteur ; ce qui signifie que la part des constructeurs et des équipementiers en termes d’activité consolidée est appelée à descendre en dessous de 10 %. Ainsi, Michelin réalise environ 12 % de ses ventes en France, Plastic omnium et Valeo, près de 90 % ; cela constitue une contrainte à laquelle on ne peut se dérober.
Les équipementiers comptent cinq leaders mondiaux : Plastic omnium, Valeo, Faurecia, Hutchinson, la filiale de Total, et Michelin – même si son activité de remplacement représente les trois quarts de son activité. Moins connus sont les dix ou douze équipementiers français, qui sont encore considérés comme des entreprises de taille intermédiaire (ETI) alors que le chiffre d’affaires de certains d’entre eux dépasse 1 milliard par an. Citons MGI Coutier, un des leaders dans le secteur du plastique aux États-Unis ; LISI, que le ministre Emmanuel Macron a visitée récemment ; SNOP, dans le secteur de l’emboutissage ; Plastivaloire ; ARaymond ; Le Bélier. Toutes ces entreprises ont une base de clients français mais elles ont su acquérir une stature internationale, même si, particulièrement les plus petites d’entre elles, maintiennent sur le territoire national une recherche de proximité. Restent encore 100 à 200 équipementiers de taille plus modeste, qui occupent 120 000 salariés, mais devront consentir à procéder à des opérations de consolidation. De fait, il est impossible à une entreprise de vivre avec seulement 2 % du marché mondial. J’ai trop souvent entendu mes clients me faire part de leur satisfaction de trouver des produits Michelin en Allemagne, aux États-Unis et au Japon, mais me reprocher de ne pouvoir le faire en Amérique du Sud, en Russie, au Moyen-Orient ou en Inde. Ils m’ont tous clairement signifié que, si cette situation devait perdurer, ils changeraient de fournisseur de référence.
Dans la concurrence qui oppose la France à d’autres pays, l’enjeu est de conserver les centres de décision sur notre sol face aux risques de départ, par exemple, pour des raisons fiscales ou de transfert à la suite d’un rachat destructif. À cet égard, la société Continental, qui dispose d’un centre de recherche dans le sud-ouest de la France et est considérée par sa maison mère allemande comme un leader international dans certains domaines, pourrait être exposée. Dans ce maintien en France des centres de décision et des centres de recherche et développement, et cela dans toutes les branches d’activité, le crédit d’impôt recherche (CIR) joue un rôle essentiel – j’aurais d’ailleurs quelques mots à dire de certaines difficultés le concernant. Un autre enjeu est de garder une activité de production compétitive, mais qui ne peut être qu’inévitablement marginale par rapport à la capacité totale du groupe.
Ce qu’il faut retenir, c’est que les équipementiers apportent une valeur ajoutée qui est attendue par les constructeurs. Leurs marges opérationnelles se sont d’ailleurs améliorées au fil des dernières années et leur permettent désormais de financer eux-mêmes leurs investissements.
La situation des sous-traitants est totalement différente. Le fichier de PFA en compte 2 500, mais je me garderai d’affirmer qu’il est complet. Il s’agit d’un secteur très complexe au sein duquel la taille des entreprises est variable, mais souvent plus petite. Leur problème est que l’essentiel de leur activité étant tourné vers la France, parfois l’Allemagne, l’un des critères déterminants de différenciation est le prix du produit rendu à l’usine. La compétition est donc très forte. Cependant, il n’y a pas de fatalité. Pourvu qu’il ait des fonds propres et un certain niveau de profitabilité, un sous-traitant peut parvenir à proposer un coût de revient inférieur à celui d’une importation. La sous-traitance a un avenir en France, mais celui-ci passera par l’indispensable renouvellement du parc industriel, singulièrement en matière d’automatisation, domaine dans lequel la France est en retard, avec un taux n’atteignant que la moitié de celui de l’Italie et le quart de celui de l’Allemagne.
Mme la rapporteure. Merci d’avoir brossé ce tableau très instructif, particulièrement au sujet de l’évolution comparée des marges bénéficiaires des constructeurs et des équipementiers. Du coup, quid de la marge des premiers ? Que peut-il être envisagé pour l’avenir ?
Après les états généraux de 2008-2009, et compte tenu de la façon dont la filière s’est restructurée, comment voyez-vous le rôle de l’État en termes de stratégie industrielle ? Lors de son audition au sujet du programme d’investissements d’avenir, M. Louis Schweitzer a indiqué que le nombre de projets était insuffisant, particulièrement dans le domaine de la recherche et développement. À cet égard, je suis intéressée par ce que vous avez à dire au sujet du crédit d’impôt recherche.
S’agissant du renouvellement du parc automobile français, on nous a dit que les mécanismes utilisés par le passé avaient suscité des effets d’aubaine et qu’ils n’avaient modifié que le calendrier sans apporter d’évolutions structurelles. Quel est votre avis à ce sujet et comment ce renouvellement peut-il être accéléré ?
Vous avez évoqué les incontestables progrès réalisés en matière de normes. En même temps, plus celles-ci sont exigeantes, plus leur mise en œuvre semble éloignée. On peut donc s’interroger sur la capacité d’atteindre dans la réalité les objectifs fixés en termes d’amélioration des émissions, qu’elles soient de CO2 ou autres. Vous avez évoqué les cinq briques de base au projet 50 grammes. Quelle y est la place de l’hybride ? Faut-il le généraliser ? Bref, comment répondre concrètement aux exigences des normes, sans se contenter des tests tels qu’ils sont réalisés aujourd’hui ?
M. Michel Rollier. Les marges bénéficiaires des grands équipementiers se sont améliorées grâce à un effort de recherche considérable. Ils sont ainsi devenus des acteurs capables de valoriser leurs produits. En ce qui concerne les constructeurs, Louis Gallois, dans son rapport sur la compétitivité française, avait mis en regard la compétitivité industrielle et la valorisation du produit. Avant la crise, par exemple, le groupe Volkswagen réalisait le plus gros de son chiffre d’affaires avec la marque Audi. Les Français construisent d’excellentes voitures, dont, même en Allemagne, la qualité n’est pas contestée, mais qui, probablement pour des raisons historiques – liées à des époques où la qualité n’était pas ce qu’elle est aujourd’hui –, se sont vendues moins cher que des produits allemands équivalents, en raison de l’attractivité de leurs marques. Les constructeurs allemands ont ainsi bénéficié de la montée en gamme des gros véhicules qui ont fait leur fortune. En matière de pneumatiques, des véhicules équipés en pneus Michelin auront une valorisation supérieure à ceux d’une marque qui ne le seraient pas. En quelque sorte, Michelin est au pneumatique ce que l’Allemagne est à l’automobile.
De façon quelque peu tardive, principalement pour des raisons politiques qui rendaient les restructurations nécessaires difficiles, un considérable effort de compétitivité a été engagé. Aujourd’hui, les constructeurs français connaissent une dynamique positive : Nissan a ouvert en Grande-Bretagne une usine qui produit 400 000 véhicules par an ; le renouvellement des gammes françaises est très prometteur ; les positions prises en Chine, en particulier, sont très encourageantes du point de vue des impératifs de production. De son côté, le groupe PSA a su améliorer la productivité de son personnel en procédant à nombre de simplifications, particulièrement dans le champ de ses gammes. Sa situation s’en est trouvée largement améliorée.
S’agissant du rôle de l’État, vous avez compris que la plupart des acteurs recherchent avant tout un environnement porteur, particulièrement dans le domaine de la recherche. Tous réclament une plus grande souplesse, singulièrement les sous-traitants qui redoutent toute forme de consolidation, même si certaines sont inévitables à l’avenir. La réflexion doit être conduite à l’échelon des bassins d’emploi. La Plateforme automobile travaille avec les associations régionales de l’industrie et l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), parfaitement outillée pour cet exercice. L’intérêt de travailler au sein des bassins d’emploi tient à la demande d’emploi ainsi qu’à la possibilité de procéder à des rééquilibrages entre branches professionnelles, mais aussi à l’intérieur de la branche automobile elle-même. Il faut faciliter ce type de mouvements. Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a, certes, été bien reçu par tous, toutefois, dans notre pays, le système des charges fiscales et sociales demeure trop complexe et les rigidités, toujours trop nombreuses.
Le crédit d’impôt recherche est fondamental : au cours des dernières années, beaucoup de décisions ont été prises sur la base de son existence. Michelin vient ainsi de reconstruire entièrement son centre de recherche à Clermont-Ferrand, alors que le gouverneur de l’État de Caroline du Sud nous déroulait le tapis rouge, car la qualité des ingénieurs français est mondialement reconnue. Cependant, le CIR est plus difficile à utiliser par les moyennes entreprises qui font de la recherche appliquée : les experts universitaires qui effectuent des contrôles conçoivent mal que celle-ci puisse relever du domaine de la recherche. C’est pourtant bien le cas. Quel est, pour une entreprise, l’intérêt de la recherche fondamentale si elle ne trouve pas à s’appliquer ? J’avais déjà appelé l’attention de M. Macron sur ce point.
L’État a étalement un rôle en termes de stratégie industrielle, notamment à travers les programmes d’investissement d’avenir. Nous avons fait des progrès dans ce domaine ; depuis que vous avez reçu M. Louis Schweitzer, nous l’avons quelque peu saturé avec nos projets. La mise en route a été longue mais, dans le champ de la R&D, nous nous sommes dotés d’outils, notamment de Road Maps dans lesquelles les grands acteurs ont défini environ quatre-vingt-dix thèmes fondamentaux.
Les pôles de compétitivité jouent également un rôle important, mais sont trop dispersés. C’est, pour une part, ma responsabilité au sein de la PFA, et nous travaillons à une meilleure mutualisation des moyens, mais aussi à une meilleure direction et optimisation des sujets.
Du point de vue des nouvelles motorisations, la part de l’hybride et de l’électrique apparaît souvent décevante. Mais les 25 % que je vous ai annoncés sont appelés à augmenter. J’ai ainsi pu constater, à l’occasion du deuxième salon international des solutions de transport routier et urbain (Solutrans), que dans la gestion dite du « dernier kilomètre », l’offre était à 90 % électrique, y compris pour des véhicules frigorifiques.
Le rôle de l’État est donc avant tout de créer le cadre, singulièrement pour les petites et moyennes entreprises de la sous-traitance, et, partout où il le peut, de faciliter les consolidations qui seront nécessaires.
En ce qui concerne le renouvellement du parc, on sait bien que les propriétaires de vieilles voitures ne les changent pas faute de moyens. Pour ceux-là, une prime de 1 000 euros ne sert à rien ; elle constitue plutôt un effet d’aubaine pour les autres. Hélas ! je n’ai pas de solution à proposer pour retirer de la circulation les véhicules diesel les plus anciens. L’idéal serait de pouvoir proposer leur remplacement par des voitures neuves, électriques ou hybrides, mais, financièrement, cela est irréalisable. Le régime de la sanction est probablement à envisager, à condition de ne pas mettre en faillite des artisans ou de petites entreprises qui ont besoin de se rendre tous les jours à Paris, par exemple.
S’agissant des normes, il est évident que plus tôt nous passerons au Real Driving Emission, plus tôt nous aurons une plus juste vision des choses ; cela est programmé pour 2017. Malgré tout, le test actuel a été utilisé tout au long de la période, et l’évolution qu’il retrace me semble très positive. Au demeurant, sans parler de la tricherie, je ne pense pas qu’un essai sur banc puisse sérieusement rendre compte de ce qui se passe réellement sur la route. Par ailleurs, la définition du Real Driving Emission fait débat entre Français et Allemands qui proposent des tests réalisés sur route à 130 kilomètres heure, ce que nous ne pouvons pas accepter. Si vous faites rouler un véhicule hybride à une telle vitesse, que vous utilisiez l’énergie électrique ou l’énergie fossile, la consommation sera la même : le moteur fossile sera à son meilleur couple, alors que le couple du moteur électrique est constant. En revanche, à basse vitesse, l’électrique est bien plus avantageux que le carburant classique, ce qui fait l’intérêt de l’hybride. C’est pour cela que de nombreux constructeurs français se tournent vers le Plug-in Hybrid Electric Vehicle (véhicule rechargeable), solution astucieuse : son autonomie est plus faible que celle d’une voiture tout électrique, mais suffisante pour les déplacements urbains, tout en offrant une meilleure sécurité en matière d’alimentation.
À ma connaissance, depuis que Volkswagen a reconnu avoir triché, tous les contrôles ont pu être faits et les organisations non gouvernementales n’ont pas manqué d’agir. Je ne pense pas que d’autres formes de triche ont été trouvées, mais tous les constructeurs mondiaux ne me font pas leurs confidences, loin de là. En revanche, un facteur de correction limité est certainement nécessaire, mais l’abaisser de façon par trop drastique, dans un délai trop court, serait industriellement impossible.
M. Denis Beaupin. Lorsque j’étais maire-adjoint à Paris, nous travaillions sur les zones d’actions prioritaires pour l’air (ZAPA), et nous avions constaté que c’étaient les vieux véhicules diesel qui circulaient le moins. Leurs propriétaires n’ont certes pas les moyens de changer de voiture, mais, dans le cadre d’un renouvellement du parc, ce ne sont probablement pas ces véhicules qu’il faudrait remplacer en priorité, puisque ce ne sont pas ceux qui polluent le plus.
En ce qui concerne la tricherie, j’observe que d’autres marques que Volkswagen sont suspectées, notamment Renault, avec le modèle Espace.
M. Michel Rollier. Il existe bien un doute, mais attendons l’avis des experts. En tout état de cause, le nouveau modèle Espace que vous évoquez n’a qu’un an, aussi, le cas échéant, l’impact serait nul.
M. Denis Beaupin. La marque Mercedes est aussi mise en cause. Je suis membre de la commission chargée d’une enquête approfondie sur les émissions de polluants des véhicules légers, créée par la ministre de l’écologie, et qui va procéder à des tests aléatoires sur des véhicules afin de déterminer s’il y a eu tricherie. Il convient donc de rester très prudent dans les affirmations dédouanant par avance des constructeurs.
On sait que des logiciels permettant de tricher existent depuis dix ans. J’ai déjà eu l’occasion de mentionner un article paru dans la revue AutoMoto, datant de 2005, qui faisait état des moyens de dissimuler la réalité des émissions polluantes. Vous paraît-il crédible que seul Volkswagen ait pu recourir à ce moyen sans que ses concurrents s’en soient rendu compte ?
En ce qui concerne la fiabilité des tests, il est notable qu’à l’instar des pratiques d’optimisation fiscale, les constructeurs font tout ce qui est possible pour contourner la loi ; c’est la raison pour laquelle ces tests vont être modifiés. Mais en matière de consommation, des doutes planent aussi sur la réalité des chiffres affichés par les constructeurs. Une enquête publiée par Auto magazine démontre une surconsommation en fonctionnement ordinaire de 40 % par rapport à ce qui est annoncé. Il y a quelques semaines, à l’occasion d’une réunion de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) portant sur cette question, j’ai interrogé ceux des constructeurs automobiles qui avaient eu le courage de venir, en l’occurrence PSA et Renault. Ils ont reconnu que les chiffres de consommation affichés à la vente des véhicules étaient ceux qui résultaient de l’homologation, pas les chiffres réels ; en revanche, ils ont refusé de divulguer l’indice de satisfaction des consommateurs.
Or de ces chiffres découlent ceux des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation de pétrole. Ils entraînent aussi un pouvoir d’achat moindre pour les automobilistes dont la facture de carburant se révèle supérieure de plusieurs centaines d’euros à ce qui a été affiché. Ne conviendrait-il pas de distinguer les chiffres obtenus dans le contexte très particulier des tests réalisés par les constructeurs et ceux qu’ils sont autorisés à afficher dans leur publicité ?
Vous avez considéré que le diesel est incontournable. S’il est tellement avantageux, pourquoi continuer à le subventionner par le biais d’avantages fiscaux ? Vous paraît-il équitable que l’attribution de ces avantages, principalement au bénéfice des flottes d’entreprises, repose sur l’ensemble des contribuables, y compris ceux qui ne possèdent pas de voiture ?
Les véhicules les plus récents seraient, selon vous, beaucoup moins polluants, ce qui justifierait de laisser au parc le temps de son renouvellement. Il n’empêche que des pays comme l’Inde, dont le parc automobile n’est pas aussi ancien que le nôtre, vient d’interdire la circulation des 4X4 diesels dans New Delhi pendant trois mois, et que la Chine, même si le plus clair de sa pollution atmosphérique provient du charbon, a dû prendre des mesures similaires. On constate que, même avec un parc plus jeune que le nôtre, les taux de pollution sont largement supérieurs à l’admissible. Les efforts réalisés par les constructeurs sont-ils réellement suffisants pour atteindre les objectifs en matière de pollution et d’émissions de gaz à effet de serre ? Ne faudrait-il pas plutôt changer le paradigme de l’automobile à tout faire, fondé sur des véhicules de quatre places régulièrement utilisés par une personne seule, alors que les nouvelles technologies permettent de concevoir une autre organisation ?
M. Jean Grellier. Je suis élu de la circonscription dans laquelle se trouvait l’entreprise Heuliez. Dans les années 2008-2009, elle avait établi un partenariat avec Michelin afin de développer un procédé dénommé WILL. Considéré comme révolutionnaire, ce procédé de traction électrique disposé dans les roues a été abandonné. Pensez-vous qu’il pourrait aujourd’hui trouver sa place dans la panoplie des nouvelles énergies ?
Nous souhaitons tous voir les relations entre les constructeurs et leurs sous-traitants s’améliorer. En tant que président de PFA, quelle perception en avez-vous ? Que faire pour passer du rapport de force au gagnant-gagnant ?
Devant l’émergence de nouvelles technologies, qui concerne aussi bien les formes d’énergie que l’amélioration de l’existant, quel pourrait être, d’après vous, la solution qui sera retenue compte tenu des équipements associés qu’il faudra déployer ? Dans ce contexte, la baisse du prix du pétrole vous semble-t-elle conjoncturelle, structurelle ou stratégique ?
M. Michel Rollier. Vous considérez que l’affaire Volkswagen ne peut pas être un cas isolé. Je vous rappelle que la tricherie a eu lieu aux États-Unis où elle était plus facile à déceler, car le diesel n’y existe pas. Dans ce pays, les véhicules ne doivent pas produire de NOx ; la situation est donc toute différente en France. Enfin, c’est une chose de gonfler un peu plus un pneu sur un banc d’essai pour limiter le frottement, mais c’en est une autre que d’installer un logiciel destiné à tromper.
Quant à savoir qui doit pratiquer les tests, dans le secteur du pneumatique beaucoup sont le fait d’organismes indépendants des constructeurs, même si, dans le scandale des implants mammaires, Technischer Überwachungsverein (TÜV), l’association d’inspection technique chargée de l’homologation des prothèses mammaires, a montré que l’infaillibilité n’est jamais garantie. La consommation d’un véhicule est très délicate à mesurer, car elle est sensible à bien des facteurs : un filtre défectueux fait perdre 10 %, des pneus sous-gonflés vont augmenter la consommation d’un litre aux cent kilomètres. Une chose est certaine, et tous les conducteurs vous le diront : il y a dix ans, il n’était pas possible de couvrir l’aller-retour Paris-Clermont-Ferrand sans s’arrêter une ou deux fois dans une station-service. Par ailleurs, en termes de consommation, le mode de conduite est décisif. D’ailleurs, en plus de fournir des pneumatiques à basse résistance au roulement, Michelin propose de former les conducteurs des flottes de transport à une conduite économe en carburant. Je ne serais pas choqué que l’on autorise les campagnes publicitaires affichant les résultats de tests réalisés par des organismes indépendants. Je pense même que cela serait bon pour les constructeurs français qui n’ont que peu à craindre dans ce domaine.
Le diesel est effectivement plus cher à l’achat, et il est vrai qu’il est utilisé par les flottes d’entreprises qui sont taxées au moins deux fois : au titre de la taxe sur les véhicules de société, et au titre de règles d’amortissement assez pénalisantes.
M. Denis Baupin. Pourquoi existe-t-il alors un avantage pour le diesel et pas pour l’essence ?
M. Michel Rollier. Parce que le diesel est plus cher, et que, malgré tout, il apporte un plus à la balance commerciale française, puisque ceux qui l’utilisent consomment moins de carburant.
Mme la rapporteure. C’est l’inverse qui se produit : le diesel pèse pour 13 milliards dans le déficit de la balance commerciale, car la France produit de l’essence qu’elle ne parvient pas à écouler sur son sol et doit importer du diesel.
M. Michel Rollier. Il est vrai que nous pourrions réadapter notre appareil productif. Il n’empêche que l’essence coûte plus cher et que, pour leurs véhicules de société, les entreprises sont déjà très largement taxées.
J’ai insisté sur le facteur temps, car je le considère comme essentiel compte tenu de la pente d’amélioration. Loin de moi l’idée de laisser faire le temps et d’oublier tout le reste. Le covoiturage, qui fait partie des moyens de réduction des émissions, est déjà très répandu en France. À Clermont-Ferrand, par exemple, les parkings de covoiturage qui se sont multipliés en dehors de la ville sont remplis ; les formules comme BlaBlaCar connaissent une indéniable vogue. Les constructeurs français ne sont absolument pas opposés à cette mutation des modes de déplacement ; ils souhaitent même s’y associer en fournissant des services tendant à réduire l’usage du véhicule. Je partage votre point de vue, l’économie coopérative comme le digital participent de ce mouvement qui ne peut que favoriser le décongestionnement urbain et les économies de carburant, ce qui n’est pas quantifiable aujourd’hui, mais n’en demeure pas moins réel.
Il faut cependant conserver à l’esprit que, si cette tendance se concrétise, elle aura des conséquences sur le dimensionnement de l’industrie. D’ores et déjà, le nombre de kilomètres parcourus par chaque Français diminue tous les ans. En outre, l’âge moyen pour l’achat d’une voiture neuve est passé à cinquante-cinq ans aujourd’hui. C’est un mouvement sociétal qui est engagé et il est irréversible, l’industrie française n’entend pas le nier. S’y inscrivent aussi le rapprochement des lieux de travail et d’habitat, la dissociation entre propriété et usage des véhicules, la moindre appétence des jeunes générations pour l’obtention du permis de conduire et l’achat d’un véhicule.
Pour ce qui est de la WILL, c’était une très belle idée consistant à placer le moteur électrique dans la roue – ce qui nécessite l’installation de deux moteurs. Supprimant la transmission, ce système apportait une simplification très appréciable. La plus grande difficulté rencontrée par ce projet était la nécessité de disposer de moteurs électriques de petite dimension, afin de pouvoir les loger dans les roues qui, néanmoins, devaient conserver un couple suffisamment puissant. L’idée est géniale, susceptible de connaître des développements, en passant à quatre roues motrices par exemple, ce qui permettrait une grande capacité d’adaptation, particulièrement dans un contexte urbain. Pour ces raisons, cette idée demeure aujourd’hui à l’état d’incubateur, car beaucoup d’aspects techniques restent encore sans solution.
La question des relations se pose entre les constructeurs et les équipementiers de rang un et deux, puisque la place aujourd’hui prise par ces derniers amène les constructeurs à avoir toujours moins de fournisseurs. Ce problème n’existe pas pour les grands équipementiers qui disposent d’une large capacité de négociation grâce à la valeur ajoutée qu’ils apportent. D’après nos enquêtes, le code de bonnes pratiques signé par tous les patrons de l’automobile est mieux respecté qu’on ne le pense. Restent un ou deux points en cours de traitement que je préfère ne pas évoquer pour le moment. Certains sujets sont particulièrement délicats et techniquement difficiles à traiter, comme les questions de propriété intellectuelle. Une seconde enquête, sans précédent à ce jour dans l’industrie, a été lancée pour analyser la qualité de la relation, en particulier pour savoir si elle était mutuellement profitable. Les réponses se sont révélées beaucoup moins négatives qu’attendu : un point, en particulier, m’a frappé relatif à la durée de la relation entre le donneur d’ordres et son fournisseur. Beaucoup reste à faire, il est vrai, notamment dans la famille des sous-traitants qui subissent le phénomène du landed cost imposé par les acheteurs dont les marges sont très serrées et qui sont donc très attentifs aux prix. Des points durs subsistent, mais la situation n’est pas si mauvaise. Enfin, un organe de médiation a été instauré : il est assez rarement saisi.
L’avenir du parc automobile tel que je l’envisage pour les dix prochaines années ne verra pas de grand gagnant ni de grand perdant. Plusieurs technologies vont coexister, et la part de l’hybride va croître – particulièrement dans le mode plug-in. Pour ce qui est des biocarburants, le sujet est délicat et je préfère ne pas l’aborder, car il pose le problème de la ressource. S’agissant de la motorisation par pile à combustible, aujourd’hui, les constructeurs français sont en retrait, car ils ont des priorités à court terme et des ressources allouées qui sont ce qu’elles sont. En revanche, le Japon et la Corée investissent fortement dans le développement de cette technologie, qui présente l’avantage d’avoir d’autres utilisations que dans l’automobile. Le Japon, par exemple, envisage de se doter de quartiers fonctionnant avec pile à combustible.
De son côté, la France a la chance d’avoir l’air liquide, avec néanmoins quelques problèmes restant à résoudre. La production d’hydrogène est encore obtenue à partir d’hydrocarbures, ce qui est très polluant, et la méthode par électrolyse n’est pas encore au point. Se posera ensuite la question du réseau de distribution. Le stockage à plusieurs centaines de bars, qui présentait des problèmes de sécurité, a, me semble-t-il, été traité. Les experts fiables considèrent qu’en 2025, le nombre de véhicules fonctionnant avec cette technologie pourrait atteindre 100 000 ou 200 000 unités par an. Aujourd’hui, l’hydrogène ne constitue pas une préoccupation majeure pour les constructeurs français. Pour autant, ils devront ne pas laisser passer le train et s’y investir le moment venu, ne serait-ce que pour bénéficier de l’écosystème nécessaire. En tout état de cause, l’hydrogène et les barrages constituent les seules voies de stockage de l’énergie non fossile, en dehors des piles électriques qui posent les problèmes écologiques que l’on sait.
Je conjecture que le tout-électrique, particulièrement pour les véhicules de livraison dont le nombre ne peut que croître du fait la congestion de villes et du développement de l’économie numérique, va déferler. Pour les véhicules à usage familial ou autres, la motorisation hybride devrait progressivement prendre une place croissante. Quant au moteur thermique, même si l’on peut espérer un gain de 35 % en consommation, son rendement reste désespérément faible.
Mme la rapporteure. Lorsque nous l’avons entendu, le professeur Élie Cohen a prophétisé l’effondrement du secteur automobile français en s’appuyant sur la comparaison des budgets de recherche et développement de Volkswagen et Renault, qui s’élèvent respectivement à 249 % et à 8 %. L’effort fourni dans ce domaine par l’ensemble de la filière vous paraît-il suffisant ?
L’industrie française a beaucoup investi dans le diesel. Or il est certain que l’usage va en reculer en France. Ce mouvement a d’ailleurs été amorcé avant même les décisions gouvernementales modifiant la fiscalité. Au-delà du débat sur la pollution atmosphérique dans les villes, c’est par simple calcul économique que les utilisateurs de petits véhicules effectuant des déplacements limités se détournent du diesel. Mais les constructeurs français ont aussi orienté leur stratégie diesel vers l’export. Or l’affaire Volkswagen conjuguée au problème d’émissions polluantes semblent mettre cette stratégie en difficulté. Par-delà la question de l’adaptation et des évolutions à conduire, pensez-vous que la filière automobile a intégré ce fait et va se repositionner ?
M. Michel Rollier. Le niveau de recherche et développement des équipementiers français n’a rien à envier à la concurrence étrangère. J’ai récemment visité le centre de recherche de Plastic Omnium à Compiègne, entièrement consacré aux réservoirs d’essence et à l’alimentation du moteur en carburant : c’est impressionnant ! Aucun équipementier au monde ne dispose d’un centre de recherche de cette qualité. Et si Bosch est une société plus importante que Valeo, cette dernière a la sagesse de s’assigner quatre domaines dans lesquels être dans le peloton de tête. Cela dit, je reconnais que les équipementiers de taille plus modeste n’ont pas des capacités aussi importantes.
De leur côté, les constructeurs ont été obligés de comprimer drastiquement leur effort de recherche et d’investissement, ce qui rend encore plus impressionnante la masse d’investissements consentie par Volkswagen avant la crise. Néanmoins, Renault partage une large partie de sa recherche avec Nissan. Quant à PSA, même si le groupe a conséquemment diminué ses dépenses de recherche et développement, cette réduction est largement compensée par l’investissement considérable réalisé par les équipementiers ainsi que par leur grande connaissance des plateformes qui font le véhicule – et chacun reconnaît que les plateformes de PSA sont les meilleures du monde. Je ne suis pas trop inquiet, car une part croissante du futur véhicule autonome sera fournie par les équipementiers produisant des caméras, des capteurs, des centrales à inertie… Le talent de Renault et Peugeot sera de détecter les bons prestataires.
S’agissant du diesel, le mouvement est clairement lancé, et s’il faut laisser jouer le facteur temps, c’est pour ne pas déstabiliser notre industrie par un mouvement trop brutal. Les constructeurs français commencent à proposer de petits moteurs à essence : c’est bien qu’ils ont amorcé leur réorientation. Il demeurera néanmoins une clientèle pour des véhicules de taille plus importante, même à l’étranger. On entend beaucoup que le diesel est mal vu ; pour ma part, je suis frappé par la communication adoptée par les acteurs allemands. Bosch ou la Fédération automobile allemande (VDA) montrent habilement qu’avec une captation des émissions correctement traitée, le diesel a un avenir. Quant au message du cabinet allemand Roland Berger, il annonce un retour progressif à l’essence pour les petits véhicules mais ne donne aucune raison de changer pour les plus gros. Le scandale Volkswagen ne doit pas occulter que la technologie de captation des émissions des moteurs diesel existe bel et bien ; ce n’est qu’une question de prix.
Mme la rapporteure. Cette dernière remarque renvoie aux infrastructures que nécessiteraient les diverses solutions. Nous soulevons régulièrement la question du rôle de l’État pour déterminer dans quel type d’infrastructure il apparaîtrait le plus pertinent d’investir, du point de vue des pouvoirs publics. Ainsi, il n’est pas évident de trancher sur l’intérêt de disposer d’une infrastructure d’urée dans toutes les stations-service, même si cela existe déjà pour les poids lourds. Les constructeurs nous ont renvoyés vers l’industrie pétrolière, que nous avons interrogée sans que personne ne puisse nous fournir une réponse probante.
M. Michel Rollier. Je ne suis pas armé pour vous répondre. Je ne peux que vous répéter ma conviction, que je vous ai livrée tout à l’heure de façon certes brutale, qu’on n’atteindra pas la norme 2020 sans une part importante de diesel. Ou alors, il faudra modifier la norme.
Mme la rapporteure. La réflexion conduite au sein des instances européennes a séparé le débat portant sur le CO2 de celui concernant les émissions polluantes ; de ce fait, nous sommes confrontés à deux réglementations qui s’ignorent, alors qu’elles s’impactent mutuellement. Nous sommes allés à Bruxelles où l’on nous a assuré que la convergence des réglementations était prévue pour 2030. C’est sidérant !
M. Michel Rollier. De leur côté, contrairement aux Européens, les Américains ne se sont focalisés que sur les émissions en se désintéressant complètement du CO2. À l’évidence, les deux questions doivent être traitées solidairement.
La réunion s’achève à dix-huit heures trente-cinq.
17. Audition, ouverte à la presse, de M. Bernard Fourniou, président de l’Observatoire du véhicule d’entreprise (OVE) et de M. Philippe Noubel, directeur général délégué d’Arval.
(Séance du mardi 12 janvier 2016)
La séance est ouverte à douze heures vingt.
La mission d’information a entendu M. Bernard Fourniou, président de l’Observatoire du véhicule d’entreprise (OVE) et M. Philippe Noubel, directeur général délégué d’Arval.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Nous recevons M. Bernard Fourniou, président de l’Observatoire du véhicule d’entreprise (OVE) et M. Philippe Noubel, directeur général délégué d’Arval.
Monsieur Fourniou, vous représentez une organisation qui rassemble les loueurs de longue durée, activité qui a connu un fort développement, mais dont le modèle économique est généralement présenté comme de nature principalement financière.
L’OVE a été créé en 2002. Vous en êtes le président depuis un peu moins d’un an. Vous avez accompli l’essentiel de votre carrière au sein du groupe BNP Paribas, notamment dans sa filiale spécialisée Arval, peu connue du grand public, mais très active auprès des professionnels.
Notre mission se devait de s’intéresser aux flottes d’entreprise. Quelle est leur part globale au sein du parc roulant, sans oublier les flottes des collectivités, un parc public parfois externalisé ?
Les flottes d’entreprise représentent un marché qui totalise près de 50 % des ventes de certains constructeurs, et plus encore pour des types de véhicules conçus quasi exclusivement pour les professionnels. Votre activité dispose donc d’un réel pouvoir commercial vis-à-vis des constructeurs, et l’on peut penser qu’elle est même capable de peser sur leurs orientations en termes de gammes. Vous êtes donc bien placé pour nous parler des évolutions du parc et du marché de l’occasion.
La motorisation diesel domine le parc des véhicules d’entreprise à près de 90 %. Ce point est capital : on ne perçoit pas un commencement de rééquilibrage avec la motorisation essence, mais peut-être une progression de l’hybride et de l’électrique. La possibilité de déduire, dans des conditions comparables au gazole, la TVA sur l’essence consommée vient cependant d’être repoussée en loi de finances. Un autre exemple vient à l’esprit : l’assujettissement à la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS).
Monsieur Fourniou, cette audition est précisément l’occasion de nous rappeler les propositions de votre organisation dans les domaines de la fiscalité et des textes réglementaires applicables à votre secteur. Si vous disposez de comparaisons éclairantes avec la situation qui prévaut dans d’autres pays européens, elles intéresseront évidemment beaucoup la Mission.
M. Bernard Fourniou, président de l’Observatoire du véhicule d’entreprise (OVE). L’Observatoire du véhicule d’entreprise, que je préside depuis le mois de juillet 2015, a été créé en 2002, sous l’impulsion de BNP Paribas et de sa filiale Arval, société spécialisée dans la location de flotte de voitures dont elle est le leader français et européen. Notre association a pour but de répondre aux besoins des entreprises et des collectivités locales sur tous les sujets relatifs aux véhicules d’entreprise.
Avant d’être président de l’OVE, j’ai été, à partir de 1998, secrétaire général d’Arval France et plus particulièrement chargé des ressources humaines et de la politique voitures. Philippe Noubel, qui est directeur général délégué d’Arval et l’un des fondateurs de l’OVE, a accepté de se joindre à moi. Il fut aussi directeur général d’Arval France. Il est aujourd’hui chargé d’une grande partie de l’Europe. Aussi connaît-il très bien les dispositions la concernant. Son éclairage complétera donc celui que je pourrai vous apporter.
Je vous ai remis un document comportant des chiffres et des repères sur le marché du véhicule d’entreprise, qui est essentiel pour l’économie et présente de fortes spécificités. C’est d’abord un marché en croissance continue depuis de nombreuses années et qui tire le nombre des immatriculations automobiles en France. C’est dire s’il est intéressant pour les constructeurs. C’est aussi un marché qui se caractérise par le poids prépondérant du diesel : les choix y sont dictés par les considérations fiscales au détriment d’arguments plus raisonnés.
L’année dernière, 2,295 millions de véhicules ont été vendus en France, dont 50 % à des sociétés. Si l’on excepte les loueurs de courte durée et les constructeurs, les entreprises que nous suivons ont acheté ou loué 731 000 véhicules en 2015, ce qui représente un tiers des immatriculations totales, soit une progression de 6,3 % sur un an.
En France, 57,2 % des véhicules immatriculés en 2015 fonctionnent au diesel, soit une diminution de 6,7 % par rapport à 2014, et 38,6 % fonctionnent à l’essence, les 4,2 % restant étant soit des véhicules hybrides, soit des véhicules électriques, ces derniers représentant 1 % du parc. Je précise que les véhicules hybrides consomment aussi de l’essence et du diesel.
Dans l’entreprise, la répartition est tout à fait différente puisque le poids du diesel est de 87 % en incluant les véhicules particuliers et les véhicules utilitaires. Je signale que 95 à 97 % des véhicules utilitaires roulent au diesel, ce phénomène étant lié aux constructeurs puisqu’il n’y a pas d’autre offre que le diesel.
Sur le fond, cette situation s’explique par une fiscalité plus avantageuse et un meilleur coût d’usage lié à des kilométrages importants parcourus en entreprise. Le kilométrage annuel moyen au sein des entreprises est de 30 000 kilomètres.
Enfin, l’âge moyen des véhicules d’entreprise est de quatre à cinq ans, c’est-à-dire deux fois moins élevé que sur le marché en général, où il est de huit ans environ. On considère à juste titre que, dans leur grande majorité, les véhicules d’entreprise sont vertueux.
Nous assurons trois missions essentielles. La première est une veille réglementaire et fiscale sur tout ce qui a trait aux véhicules d’entreprise. Nous suivons les évolutions fiscales, les évolutions sociales et leurs conséquences. Nous publions, en collaboration avec les mémentos Francis Lefebvre, un mémento automobile qui reprend toutes les règles fiscales et juridiques relatives au véhicule d’entreprise. Notre objectif est d’aider nos interlocuteurs
– entreprises, chefs de parc, directeurs généraux, directeurs financiers, directeurs des ressources humaines – à prendre des décisions en la matière.
Nous publions ensuite un document, le TCO Scope 2015, qui fait le point sur le coût d’usage sur lequel les loueurs appellent en général l’attention de leur chef de parc. Le choix du véhicule dépend essentiellement de son coût, fiscalité comprise – Philippe Noubel dit souvent que ceux qui décident d’acheter un véhicule raisonnent de sang-froid et tiennent compte essentiellement du coût d’usage. Pour nous, le coût d’usage est donc un indicateur clé.
Enfin, nous prenons la parole sur tout ce qui a trait au véhicule d’entreprise, en organisant par exemple des événements. Vous trouverez sur notre site internet les statistiques que nous élaborons et de précieuses informations sur les solutions proposées aux décisionnaires pour faciliter la mobilité de leurs collaborateurs. Nous ne nous intéressons pas seulement aux services financiers, mais à tout un ensemble de prestations : télématique, formation à l’éco-conduite, éco-entretien, gestion des amendes, assurance, etc. Nous mettons à la disposition du directeur des ressources humaines ou du gestionnaire du parc un ensemble de services et de produits lui permettant de considérer la voiture comme un outil de travail. Les entreprises n’utilisent pas leurs voitures pour leurs loisirs, mais pour se rendre chez leurs clients. Ces véhicules doivent être disponibles, comme un ordinateur, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Nous développons le confort dans les véhicules et suivons le comportement des conducteurs au sein des flottes de voitures.
Quels sujets doivent retenir notre attention à l’avenir ? Nous défendons l’entreprise pour l’aider à choisir ses véhicules en fonction de l’usage réel qu’elle en fait, dans le sens d’une optimisation durable et en répondant aux contraintes environnementales. Le document que je vous ai remis montre que les flottes de voitures sont aujourd’hui bien plus vertueuses que celles du marché en général. Ce n’est pas le fruit du hasard : nous contribuons à éduquer les entreprises à choisir leurs véhicules en fonction des coûts et de l’environnement.
C’est dans cet esprit que l’OVE a récemment pris la parole, à plusieurs reprises, sur l’extension de la déductibilité de la TVA à l’essence. Cette mesure n’aurait en aucun cas remis en cause la prédominance du véhicule diesel, ce qui n’était d’ailleurs pas son objectif : le kilométrage annuel moyen étant de 30 000 kilomètres, le véhicule diesel reste le véhicule repère de l’entreprise en cas de trajets de longue durée. Si l’extension de la déductibilité de la TVA à l’essence avait été décidée, les entreprises auraient eu moins le réflexe du tout diesel. Cela aurait permis de clarifier leur choix et de diversifier les énergies dans les parcs, non plus sur la base de simples critères fiscaux, mais en fonction du coût réel d’usage et de l’utilisation. Il n’est pas opportun de choisir un véhicule diesel lorsque l’on roule régulièrement en zone périurbaine et que l’on parcourt entre 15 000 et 20 000 kilomètres. La réforme ne visait pas à bouleverser les constructeurs – nous avons trop de respect pour le travail qu’ils réalisent pour le faire. J’ajoute que c’est un modèle Peugeot qui a été élu à la fin du mois de décembre 2015 meilleur moteur essence.
Nous souhaitons sensibiliser le législateur aux modes de déplacement de demain. Les entreprises n’auront plus les mêmes pratiques. Si la voiture demeure le mode de déplacement le plus facile, car il est toujours à disposition, les entreprises essaient de plus en plus d’organiser leurs déplacements. Nous travaillons à la combinaison des systèmes de mobilité : une meilleure utilisation du covoiturage, de l’autopartage, des transports en commun. Nous espérons mettre en place à terme, comme cela se pratique déjà dans le nord de l’Europe, la carte mobilité. En France, cet outil développé par Ubeeqo s’adresse davantage aux particuliers, mais il y aura certainement de la place pour les entreprises. Encore faudra-t-il se pencher sur le régime social et fiscal de ces cartes mobilité. Il serait intéressant qu’on puisse y réfléchir ensemble.
Il existe un engouement exceptionnel en faveur de la voiture autonome : un grand rassemblement sur ce thème se tient actuellement à Las Vegas. Dans ce domaine, les constructeurs français sont plutôt en avance, ce qui me réjouit. Nous publions à la fin du mois un document qui fait le point sur les évolutions technologiques attendues en la matière. Me Josseaume, avocat spécialisé en droit routier, y évoque les défis que l’Assemblée nationale et l’Union européenne auront à relever : que deviendra le permis de conduire ? qui sera responsable en cas d’accident, le constructeur ou le conducteur – que l’on appellera peut-être coconducteur ? Autant de sujets sur lesquels nous devons travailler pour n’être pas pris au dépourvu en 2020, lorsque sera lancée la voiture autonome.
M. Philippe Noubel, directeur général délégué d’Arval. Arval est une société de location de longue durée de véhicules d’entreprise. Nous sommes fiers de représenter la partie du marché du véhicule d’entreprise qui participe le plus au rajeunissement de ce parc, et donc du parc roulant dans son ensemble. La durée moyenne de détention d’un véhicule est divisée par deux pour ce qui concerne la sous-catégorie des véhicules de location de longue durée. La durée moyenne des contrats de location de longue durée étant de l’ordre de trois à quatre ans, cela signifie que le parc moyen a deux ans. C’est sûrement le parc le plus performant d’un point de vue technologique et d’efficacité économique et écologique.
Notre métier nous offre un autre élément de satisfaction : nous introduisons sur le marché de l’occasion des véhicules de meilleure qualité que ceux des autres circuits. Ce phénomène crée un effet papillon : une mécanique industrielle qui fournit à un rythme assez soutenu des produits récents et de très bonne qualité améliore globalement la qualité du parc, non seulement national, mais aussi mondial, puisqu’une partie des véhicules d’occasion français vont à l’étranger, dans des pays d’Europe centrale notamment. Cela permet aussi de mettre à la casse plus rapidement des véhicules moins performants sur le plan environnemental.
Arval s’est intéressée à ces sujets avant qu’ils ne deviennent à la mode et a été l’une des premières sociétés à s’inscrire au Global Compact de l’ONU. Il s’agissait d’une volonté interne politique à laquelle Bernard Fourniou a participé. Nous sommes partis d’une idée extrêmement simple : la voiture a de nombreux défauts – elle pollue, elle est chère et dangereuse – et il faut trouver des modalités économiques pour y remédier. En utilisant au mieux les avancées technologiques des constructeurs, il nous semble que nous participons modestement à l’amélioration de la situation d’ensemble dans le cadre d’une politique de RSE (responsabilité sociale de l’entreprise) à laquelle nous sommes très attachés.
Bernard Fourniou a beaucoup insisté sur la fiscalité. C’est un levier extrêmement puissant dans le choix des entreprises qui sont en effet des animaux à sang froid. Ce qui leur importe, in fine, c’est le coût d’usage des véhicules. Aussi les décisions prises par les autorités politiques en matière de fiscalité ont-elles un poids déterminant dans le choix des sociétés. Dans l’ensemble des pays européens – ce n’est pas le cas de la France –, la composante écologique s’est fortement concentrée sur les émissions de CO2 qui ne sont pas des polluants, mais des gaz à effet de serre. Ainsi la fiscalité a-t-elle été basée sur ce facteur, dont on mesure aujourd’hui les conséquences, puisque, en matière de gaz à effet de serre, les véhicules diesel sont plus efficaces que les véhicules essence. Si l’on se préoccupe plutôt des polluants, l’approche peut être différente. C’est pourquoi les politiques doivent porter une attention particulière sur les effets induits.
Je regrette que la proposition défendue par M. Baupin, qui visait à aligner, pour les flottes d’entreprises, la TVA de l’essence sur celle du diesel, n’ait pas été adoptée. Elle aurait permis aux entreprises de faire des choix un peu plus rationnels et de faire jouer leur fibre écologique. Les constructeurs ont craint qu’une modification de la fiscalité n’entraîne un changement de comportement massif. Nous n’avons pas la même approche : nous pensons que ce mouvement pourrait s’amorcer en douceur dans le temps. Le refus de la proposition de M. Baupin est d’autant plus regrettable que c’est le véhicule d’un constructeur français qui a récemment été élu meilleur véhicule essence du marché. Il faudra donc peut-être revenir sur le sujet pour que, les esprits évoluant, on puisse parvenir à un rééquilibrage entre les différentes motorisations possibles, notamment au sein des flottes d’entreprises qui constituent un élément accélérateur de la qualité générale du parc.
M. Bernard Fourniou. La page 13 du document que je vous ai remis détaille la composition du parc de véhicules diesel. En 2015, le parc automobile français comptait 20 millions de véhicules diesel, dont 5,2 millions sont aux normes euro 3, euro 2 et euro 1. Ces véhicules, qui sont très anciens, ne font pas partie des flottes d’entreprises. S’il est une mesure à prendre, c’est bien d’éliminer ces véhicules. Les politiques fiscales qui ont la plus grande portée, tant pour le particulier que pour l’entreprise, sont celles du bonus-malus. C’est ce qui a permis de gouverner en grande partie ces dernières années et qui a guidé le choix d’achat de véhicules neufs. On pourrait progresser très rapidement en passant à la norme euro 6 et en éliminant les véhicules qui sont aux normes euro 3, euro 2 et euro 1.
M. Philippe Noubel. En matière de consommation, donc d’émission de CO2, une voiture de norme euro 6 consomme environ 30 % de moins qu’une voiture de norme euro 3 : c’est une performance considérable. En ce qui concerne les émissions de particules ou d’oxydes d’azote (NOx), qui sont deux éléments extrêmement importants pour la santé publique, les rapports d’efficacité sont de 1 à 10 – et je ne parle que des véhicules euro 3. Dix voitures de norme euro 6 ont le même impact écologique qu’une voiture de norme euro 3. Toute mesure de nature à améliorer la qualité du parc est donc extrêmement bienvenue.
M. Bernard Fourniou. La page 13 montre également l’évolution qui a été possible au fil des années en matière d’émissions de CO2 et de NOx, grâce aux recommandations mises en place par le Gouvernement en matière de pollution des voitures.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Je veux d’abord souligner l’importance, pour notre mission d’information, de votre expertise et de votre témoignage sur le marché du véhicule d’entreprise. Vous apportez des éléments de pragmatisme et de sérénité au secteur automobile qui est au cœur de débats épineux, voire de polémiques récentes.
Vous avez expliqué le rôle de l’OVE, son origine, le service ou le conseil qu’il peut apporter aux entreprises. Pouvez-vous nous en dire davantage sur la façon dont vous travaillez, sur vos moyens ? Comment collectez-vous les données ?
La page 2 de votre document montre l’évolution structurelle des immatriculations des véhicules des particuliers et des entreprises de 1991 à 2015. Comment voyez-vous l’évolution de ces deux courbes à l’avenir ? Vont-elles se croiser ?
Vous préconisez l’élargissement de la déductibilité de la TVA à tous les véhicules, car la situation actuelle ne laisse pas l’entreprise libre de choisir le véhicule le mieux adapté à son usage. Comment pensez-vous qu’il soit possible d’y parvenir ? De manière progressive ou d’un seul coup ? À quel horizon ?
Je souhaiterais que vous commentiez le tableau de la page 12, qui, sauf erreur de ma part, démontre que les coûts d’usage sont sensiblement identiques.
Comment voyez-vous évoluer l’usage de l’automobile en entreprise, la flotte de véhicules d’entreprises et le rapport des entreprises à leur parc automobile ?
Les dispositifs fiscaux et réglementaires visant à encourager les entreprises à s’équiper de véhicules électriques ou totalement écologiques, quelles que soient les technologies – certains penseront à l’hydrogène, d’autres au gaz, etc. – sont-ils suffisants ? Je sais qu’il y a eu des mouvements d’à-coups concernant l’éligibilité des entreprises aux aides pour l’achat d’un véhicule électrique.
N’hésitez pas à aborder devant nous tous les autres sujets réglementaires ou fiscaux qui seraient des héritages du passé. Récemment, on m’a dit qu’un agriculteur devait obligatoirement acheter un véhicule deux places pour pouvoir récupérer la TVA.
Vous n’avez pas parlé des chiffres en stock, mais seulement des chiffres en immatriculation nouvelle par rapport aux véhicules particuliers et véhicules d’entreprise.
S’agissant de l’accélération du renouvellement du parc automobile, quelles seraient pour vous les pistes autres que celles du bonus-malus qui s’applique aux achats de véhicules neufs ?
M. Gérard Menuel. Vous intéressez-vous au parc des collectivités territoriales ? Si oui, quelle part représente-t-il et comment évolue-t-il ?
Pour pouvoir récupérer la TVA, un agriculteur qui achète un ou deux véhicules pour ses collaborateurs doit obligatoirement choisir un véhicule deux places. Les entreprises agricoles font-elles partie des sociétés que vous observez ?
M. Denis Baupin. Je vous remercie pour vos propos concernant la mesure que j’ai présentée. Soyez assurés que je la défendrai à nouveau, car la fiscalité actuelle ne doit plus pénaliser à la fois l’écologie et les entreprises qui, de fait, n’ont pas le choix.
Ce que vous avez indiqué sur le kilométrage moyen d’usage des véhicules est un point important qui peut justifier qu’un certain nombre d’entreprises choisissent d’acheter des véhicules diesel qui sont plus rentables sur de longues distances. En revanche, inciter des entreprises qui ont un usage plus urbain et sur des distances plus courtes à acheter un véhicule diesel est évidemment pénalisant en matière de coût et néfaste pour l’environnement. Car, s’il y a bien un endroit où l’utilisation des véhicules diesel est pénalisante en termes de pollution, c’est bien en zone urbaine. La mairie de Paris veut supprimer le diesel dans la ville à l’horizon 2020. Mais, si les entreprises qui y circulent doivent acheter des véhicules qui leur coûtent plus cher qu’un véhicule diesel, une politique de protection de la qualité de l’air risque d’être discriminatoire pour elles. Je partage pleinement votre constat, et j’aimerais que chacun puisse se rendre compte que vous proposez en fait une certaine neutralité en matière de fiscalité.
Vous avez souligné que la fiscalité avait été fortement fondée sur le CO2. Là, en l’occurrence, ce n’est pas le cas. Les mesures prises en faveur du diesel datent de 1970, à une époque où l’on ne parlait pas beaucoup du réchauffement climatique. Il s’agissait alors d’inciter à l’usage du diesel pour des raisons économiques. Je suis favorable à des fiscalités incitatives en fonction des pollutions. Malheureusement, notre politique fiscale est contre-productive.
J’ai cru comprendre que de plus en plus d’entreprises pouvaient choisir de faire appel à des services d’autopartage, ce qui rejoint un peu la question de la carte mobilité. Quelle est la part des entreprises qui y font appel ? Quelle est l’évolution depuis quelques années ? Lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés pour rentabiliser des véhicules qui sont davantage utilisés le week-end ou le soir, l’autopartage lui permet de mieux équilibrer ses comptes. Il peut y avoir un intérêt conjoint de part et d’autre.
Ma dernière question concerne la taille des véhicules d’entreprise. A priori, nombre de ces véhicules sont utilisés la plupart du temps par une personne seule. Finalement, avoir un véhicule qui ne transporte qu’une personne alors qu’il est conçu pour emmener une famille en vacances n’est peut-être pas le choix le plus pertinent. Vous nous avez dit tout à l’heure que le seul critère qui prévalait pour les entreprises était le coût. Est-ce vraiment le cas ? La capacité du véhicule à donner une certaine image de marque n’est-elle pas un élément déterminant ?
Quelle est la consommation moyenne des véhicules qui sont utilisés ? Existe-t-il des disparités qui permettraient d’avoir une politique incitative en faveur des véhicules moins polluants et les plus économes en matière de consommation énergétique ? Le Gouvernement a lancé une politique en faveur du véhicule consommant deux litres aux cent kilomètres, objectif qui peut être obtenu en allégeant les véhicules, en améliorant les capacités des moteurs, mais aussi en partie grâce à des véhicules qui n’offriraient pas nécessairement quatre places. Cette perspective vous paraît-elle intéressante pour les véhicules de société ?
M. Bernard Fourniou. Notre association, qui compte trois collaborateurs, regroupe 8 000 adhérents et ne travaille pas seule. Les données qu’elle réunit proviennent soit du Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA), soit de l’Association auxiliaire de l’automobile, dite « 3 A ». Nous travaillons aussi en étroite collaboration avec des organisations comme le Syndicat national des loueurs de voitures en longue durée (SNVLD) ou avec le premier loueur de flottes de voitures, qui bénéficie lui-même d’un ensemble de données intéressantes reflétant réellement le marché.
Les données qui remontent au sein des entreprises générales de location sont de plus en plus pertinentes, car de nouveaux dispositifs, dits de télématique, collectent automatiquement les données d’information sur le kilométrage, la consommation, les dates d’entretien, etc. Les loueurs de véhicules détiennent donc des éléments qui leur permettent de mieux informer chefs de parc et conducteurs, et d’assurer encore mieux l’entretien des véhicules, mais aussi des données d’analyse comportementale du chef de parc et des conducteurs. On s’aperçoit ainsi que, entre les mains de deux personnes différentes – l’une conduisant de manière nerveuse, l’autre de manière plus vertueuse –, une même voiture présente des écarts de consommation pouvant atteindre 40 %. En la matière, nous jouons un rôle d’éducation, en sensibilisant conducteurs et chefs de parc.
M. Philippe Noubel. L’OVE est la maison mère de l’initiative de mise à disposition du marché de nos travaux et de nos compétences. Elle a sa déclinaison dans d’autres pays, et pas seulement dans les pays européens, avec la même philosophie, avec des moyens identiques dans certains grands pays et plus modestes dans d’autres.
M. Bernard Fourniou. Nous pourrons à l’avenir publier des statistiques réelles de consommation moyenne.
Vous nous demandez comment évolueront les deux courbes de la page 2 de notre document. Ce qui nous étonne, c’est que la moyenne d’âge d’un particulier qui acquiert un véhicule neuf est de cinquante-cinq ans. Cela veut dire qu’il commence à avoir une autre approche à l’égard de l’automobile. Le nombre de personnes possédant un véhicule particulier a plutôt tendance à diminuer. Si l’on suit ce raisonnement, les deux courbes devraient effectivement se croiser. Mais je n’en suis pas si sûr, les dernières statistiques n’allant pas dans ce sens. Cela dit, c’est le véhicule d’entreprise qui intéresse beaucoup les constructeurs.
J’en viens à votre question sur les composantes du coût d’usage d’une voiture. À la page 11 de notre document, nous avons pris l’exemple d’une entreprise qui prévoit de faire 100 000 kilomètres et de conserver un véhicule particulier pendant quarante-huit mois, soit un peu moins que la durée moyenne. Le coût de la dépréciation représente 40 %, et la fiscalité 20 %. On entend par la fiscalité les charges sociales sur les avantages en nature, la carte grise, la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) et les amortissements non déductibles, pour un total de 20 %. Le coût de l’énergie n’est que de 13 %. Il faut prendre également en compte le coût de l’assurance, de l’entretien, les pneus, bref tout ce qui permet à un véhicule de bien rouler. Enfin, les frais financiers ne représentent que 4,7 %.
Le coût d’usage est représenté par le total cost of ownership (TCO) véhicules. D’autres facteurs influent sur le coût d’usage, notamment l’assurance sinistre. Plus le nombre d’accidents est élevé, plus l’assurance coûte cher. Aussi mettons-nous en place des actions de prévention des risques pour que les entreprises aient des comportements vertueux.
L’entretien et la remise en état du véhicule en cas d’accident ont également un impact sur la consommation. Si le chef de parc prend en compte ces éléments, il peut sensibiliser les conducteurs sur la manière dont ils conduisent, sur l’accidentologie, et alerter sur les comportements anormaux.
Enfin, nous intervenons sur le TCO flotte, c’est-à-dire toute l’organisation de la gestion. L’entreprise a besoin d’être aidée pour savoir si elle doit acheter ou plutôt louer, connaître le nombre de salariés dont elle dispose pour gérer sa flotte, savoir si elle doit embaucher quelqu’un pour gérer les amendes, car c’est devenu un vrai métier.
Le tableau de la page 2 est un exemple de coût d’usage. Nous avons pris le cas de véhicules qui ont parcouru 20 000 kilomètres par an pendant trois ans, soit 60 000 kilomètres, c’est-à-dire moins qu’un véhicule d’entreprise. Nous démontrons que le coût d’usage est quasi identique, qu’il s’agisse d’un véhicule diesel ou essence, malgré toutes les aides accordées sur le diesel. Pourtant, dans la plupart des cas, les entreprises ont préféré choisir le modèle diesel.
M. Philippe Noubel. Cet exemple montre que le phénomène pourrait s’inverser en cas d’alignement de la fiscalité de l’essence sur celle du diesel. Il est regrettable que les entreprises, dont les collaborateurs n’effectuent pas beaucoup de kilomètres, continuent à faire appel à des véhicules diesel, alors que l’utilisation d’un véhicule essence serait plus rationnelle. En revanche, pour les entreprises dont les salariés doivent parcourir beaucoup de kilomètres, le véhicule diesel demeure le plus performant même en cas d’alignement de la fiscalité.
Les entreprises de location de longue durée ont la chance d’être à l’abri de toutes les difficultés économiques, tant nationales qu’internationales. Dans les vingt-sept pays où nous intervenons, nous avons observé que l’utilisation du véhicule d’entreprise via la location de longue durée augmentait. Ce n’est pas parce que les parcs généraux des pays sont en progression, mais parce que la part du parc de location de longue durée croît. Je le répète, nous sommes assez fiers de contribuer à l’amélioration du parc.
Cette évolution est liée à deux facteurs. Le premier est un mécanisme historique, tandis que le second est dû à notre action en tant qu’opérateur de location de longue durée. À l’origine, si les grandes entreprises ont eu recours à la location de longue durée, c’est parce qu’il leur était difficile de gérer elles-mêmes des flottes importantes. Aujourd’hui, toutes les grandes entreprises utilisent la location de longue durée. Leur parc n’augmente pas, il est plutôt rationalisé. Si le parc global augmente, c’est que d’autres utilisateurs interviennent, notamment les entreprises moyennes et, depuis quelques années, les petites entreprises. Dans des pays comme la France, l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas ou la Belgique, l’accroissement du marché est dû à l’intérêt que les petites entreprises et les entrepreneurs témoignent à ce type d’approche : cela préfigure peut-être ce que sera, dans un futur plus ou moins proche, le comportement du particulier lui-même. Ainsi commence-t-on à voir, en Angleterre et dans une moindre mesure en France, des particuliers s’intéresser à des formules locatives – location de longue durée ou location avec option d’achat. Ce phénomène participe à l’accélération du renouvellement des véhicules, permet aux constructeurs de faire tourner les usines et contribue à l’accélération de l’amélioration de la qualité du parc, ce qui in fine est bon au plan écologique.
Nous constatons aussi une augmentation des services associés à nos produits de location de longue durée, comme l’entretien, le véhicule relais, l’assurance, les réparations. Les entreprises s’intéressent de plus en plus à une composante qui contribue à la politique contrôle sanction automatisé (CSA) des entreprises, mais aussi à la nôtre, à savoir le comportement du conducteur. Aujourd’hui, l’élément le plus discriminant en matière de coût d’usage d’un véhicule est la façon dont le conducteur utilise son véhicule : s’il roule vite, il consomme davantage et a plus d’accidents, etc. Conscientes de cet élément et de son impact dans le cadre d’une politique CSA, les entreprises nous demandent comment elles peuvent améliorer le comportement de leurs conducteurs. Dorénavant, tous les acteurs proposent des stages de formation ou de sensibilisation, qui sont régulièrement renouvelés, car on a tendance à oublier les bonnes habitudes.
Nous commençons aussi à investir dans la télématique embarquée. La puissance de cette technologie n’est pas sans susciter des interrogations : ne risque-t-elle pas de se transformer en Big Brother ? On peut évacuer la question pour ne garder que les composantes les plus intéressantes et les plus sociétales.
En résumé, l’augmentation du nombre des services a pour objectif de parvenir à une optimisation des coûts d’usage qui ont un impact considérable sur l’environnement. En effet, si l’on consomme moins, le coût est moindre et la pollution moins importante.
M. Bernard Fourniou. Les entreprises ont besoin d’un outil de travail adapté. Ce mois-ci, l’un des deux constructeurs français va commercialiser trois voitures de gamme business fonctionnant à l’essence. On entend par véhicule de gamme business une voiture confortable, connectée, dans laquelle le collaborateur peut travailler.
Je veux revenir un instant sur les nouvelles formes de mobilité. Il est difficile d’utiliser le covoiturage dans l’entreprise, car tout le monde ne se déplace pas en même temps. En revanche, l’autopartage se développe, surtout dans les grandes entreprises qui ont suffisamment de collaborateurs pour partager les véhicules. C’est une optimisation de l’utilisation des véhicules. S’agissant de l’autopartage, de plus en plus de véhicules sont électriques. Quand le véhicule n’est pas utilisé, il est rechargé. Bon an mal an, il peut être utilisé de manière confortable toute la semaine. Des formules de covoiturage permettent au collaborateur d’utiliser un véhicule, moyennant souvent une participation quand il s’agit de petits déplacements personnels. Cela évite au salarié d’acheter une voiture ou d’en avoir deux : une pour le week-end et une pour la semaine.
M. Philippe Noubel. Voilà vingt-cinq ans que j’entends parler de l’utilisation rationnelle des véhicules, mais personne n’a encore résolu l’équation suivante : concilier les périodes d’utilisation maximale et d’utilisation moindre ? Pendant 320 jours par an, on a besoin d’une voiture qui ne transporte qu’une seule personne et, pendant les quarante jours restants, il faut qu’elle puisse transporter deux ou trois enfants, le chien et les sacs de plage. De nombreuses tentatives ont été faites pour trouver des solutions, notamment en coopération avec des sociétés comme la nôtre ou des organismes de location de courte durée. Mais on se heurte très vite au fait que tout le monde a besoin du même type de véhicule en même temps. Pour autant, il serait extrêmement regrettable de ne rien faire.
M. Bernard Fourniou. La location de moyenne durée, c’est-à-dire de deux mois à vingt-quatre mois environ, est un produit qui se développe. Ce type de service intéresse des entreprises faisant appel à des collaborateurs qui effectuent des missions ponctuelles ou sont employés à titre précaire. Cela permet une meilleure utilisation de l’ensemble des véhicules.
Vous nous demandez si les aides en faveur des véhicules électriques sont suffisantes. Ce ne sont pas les aides qui sont les principaux facteurs de décision pour une entreprise. J’ai insisté dès le départ sur le fait que l’entreprise avait besoin d’un véhicule disponible en permanence et qui réponde à ses besoins et attentes. Si l’utilisation du véhicule électrique ne décolle pas, ce n’est pas en raison de sa technologie, mais à cause de son autonomie.
Mme la rapporteure. Selon vous, la suppression de l’aide accordée aux entreprises pour l’achat d’un véhicule électrique n’a donc pas constitué un problème.
M. Bernard Fourniou. Même avec les aides octroyées actuellement, un véhicule essence ou diesel est au même prix qu’un véhicule électrique. Le coût d’un véhicule électrique est excessif. Nous allons bientôt étudier le coût de l’électricité pour savoir si, en termes de coût d’usage, le véhicule électrique est économique. Cela nous permettra de voir quel est l’avenir du véhicule électrique.
Mme la rapporteure. Nous serions intéressés pas une telle étude !
M. Bernard Fourniou. Un véhicule électrique est confortable et agréable à conduire. Mais on sait bien que l’autonomie annoncée de 200 kilomètres n’est en réalité que de 150. Sur toutes les grandes autoroutes, on est en train de construire des corridors électriques tous les soixante à soixante-dix kilomètres – l’association nationale pour le développement de la mobilité électrique (AVERE) serait bien placée pour vous en parler. Mais, si deux ou trois prises de courant seulement sont installées et que, tous les cent kilomètres, vous devez attendre une demi-heure pour recharger votre véhicule, vous vous heurtez à un problème de praticité. Je crois en l’avenir du véhicule électrique, mais il faut beaucoup travailler sur les batteries. Une solution peut être trouvée avec la pile à combustible à hydrogène qui pourrait même, à terme, être vendue dans les grands magasins. Cela permettrait de doubler l’autonomie des véhicules électriques. Sur le papier, ce système semble intéressant, mais je ne sais pas si l’on parviendra à le commercialiser.
M. Philippe Noubel. Peut-être faut-il engager une réflexion sur un meilleur usage de certains véhicules. Prenons l’exemple de notre maison mère qui a une flotte importante de véhicules dits de service – un véhicule de service est un véhicule qui est utilisé pendant la semaine, mais pas le week-end. Je suis persuadé qu’il y a une réponse électrique à l’utilisation journalière de véhicules qui parcourent cent kilomètres environ. Pendant plusieurs mois, j’ai eu l’occasion de rouler dans un véhicule électrique d’une marque allemande qui a l’énorme avantage d’être électrique, mais aussi d’être équipé d’un range extender, c’est-à-dire un petit moteur thermique qui recharge la batterie lorsqu’elle n’a plus de courant. Cela permet une sécurité d’esprit totale en région parisienne. Comme la batterie électrique apporte une autonomie de 130 kilomètres et que le range extender y ajoute 130 kilomètres, l’autonomie totale est de 260 kilomètres. Cela dit, cette voiture a l’inconvénient d’être très chère et de cumuler deux technologies, un moteur électrique et un moteur thermique. Chaque technologie est moins optimisée que s’il n’y en avait qu’une seule. Par ailleurs, le poids entraîne une consommation supplémentaire lorsque vous roulez avec le moteur thermique, ce qui fait qu’un véhicule hybride est moins efficace qu’un véhicule uniquement thermique.
Le véhicule hybride est parfaitement adapté à un usage majoritairement urbain, mais complètement inadapté à un usage sur autoroute. Les entreprises doivent donc réfléchir à l’utilisation objective des véhicules pour mieux segmenter leur offre. C’est plus difficile intellectuellement, mais ce sera, in fine, le seul moyen de résoudre l’équation.
Mme la rapporteure. J’aimerais que vous reveniez sur l’élargissement ou le rythme de la déductibilité.
M. Bernard Fourniou. Les constructeurs sont très sensibilisés à ce sujet. Ceux avec lesquels j’ai discuté m’ont indiqué que le changement était trop rapide, et j’en suis convenu avec eux. Nous avons donc fait une première proposition, avec M. Baupin, qui a été de parvenir à un alignement sur deux ans. Mais, comme nous avons senti que ce délai était encore trop court, je ne vous cache pas que j’ai poussé pour que soit proposé un alignement sur quatre ans. Cette mesure permettait aux entreprises de se préparer progressivement. J’ai du mal à voir comment on peut faire mieux, mais je suis prêt à y réfléchir. Il est important de mettre le pied à l’étrier.
M. Philippe Noubel. Il y a quelques années, l’amélioration de la qualité du parc automobile a été possible grâce à une prime à la casse accordée en contrepartie de l’achat d’un véhicule neuf. Comme on sait qu’il n’y a guère que les seniors et les entreprises qui achètent aujourd’hui des véhicules neufs, on limite considérablement le champ des possibles. Dès lors, pourquoi ne pas imaginer d’accorder une prime à la casse à un véhicule de norme euro 2 ou euro 1 s’il est remplacé par un véhicule de norme euro 5 ? Il est choquant de voir que les seuls qui peuvent participer à l’amélioration de la situation écologique du parc automobile sont ceux qui ont les moyens d’acheter un véhicule neuf.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Messieurs, nous vous remercions.
La séance est levée à à treize heures quarante.
◊
◊ ◊
18. Audition, ouverte à la presse, de Mme Catherine Foulonneau, directeur stratégie et territoires de GRDF, de Mme Catherine Brun, directrice commercial de GRTgaz, de M. Vincent Rousseau, directeur de projet mobilité de GRTgaz, de M. Jean-Claude Girot, président de l'Association française du gaz naturel pour véhicules (AFGNV) et de M. Gilles Durand, secrétaire général de l'AFGNV.
(Séance du mardi 19 janvier 2016)
La séance est ouverte à quatorze heures.
La mission d’information a entendu Mme Catherine Foulonneau, directeur stratégie et territoires de GRDF, Mme Catherine Brun, directrice commercial de GRTgaz, M. Vincent Rousseau, directeur de projet mobilité de GRTgaz, M. Jean-Claude Girot, président de l'Association française du gaz naturel pour véhicules (AFGNV) et M. Gilles Durand, secrétaire général de l'AFGNV.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Nous recevons cet après-midi les représentants de GRTgaz et d’ERDF qui, au sein de l’Association française du gaz naturel pour véhicules (AFGNV), font la promotion du gaz naturel pour véhicules (GNV) et du biogaz.
Mme la rapporteure et moi-même tenons à informer la Mission d’initiatives que nous avons prises au regard des derniers développements de l’actualité.
En premier lieu, nous avons cosigné une lettre recommandée au président de Volkswagen France qui se refuse à être auditionné, alors que nous l’avions saisi de notre volonté de l’entendre il y a plus d’un mois. Cette audition étant indispensable, nous lui avons fait part du maintien de sa date d’audition au mercredi 27 janvier à onze heures trente. En outre, nous lui avons indiqué qu’à défaut de le voir reconsidérer sa position, nous n’hésiterions pas à demander au président de l’Assemblée nationale de conférer à la Mission les pouvoirs de contrôle analogues à ceux d’une commission d’enquête, comme nous en ouvre le droit l’ordonnance de 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et les articles 145-1 et suivants de notre règlement. Nous pourrions ainsi le contraindre et même exiger de lui la transmission de tous les documents internes en vertu du contrôle sur place et sur pièce.
S’agissant des difficultés rencontrées par Renault en matière d’émissions polluantes, Mme Batho avait saisi par un courrier du 12 novembre 2015 la ministre de l’environnement afin d’obtenir les résultats des tests que la ministre avait diligentés en urgence et des précisions quant aux modèles concernés et aux caractéristiques du protocole adopté. À ce jour, aucune réponse n’a été apportée à cette demande qui pourtant prenait soin de mentionner qu’une confidentialité des données transmises serait garantie tant qu’aucun résultat officiel n’était publié. Il s’agissait d’une demande légitime d’information à destination de la rapporteure et de la présidente, soucieuses ne pas empiéter sur le rôle dévolu à la commission dite indépendante qui devait suivre ce processus.
Ces précisions données, nous allons interroger les personnalités reçues cet après-midi sur les caractéristiques du gaz comme carburant alternatif du point de vue économique et environnemental.
Quels sont les coûts et les avantages de l’usage du GNV ou du biogaz pour un véhicule particulier ou pour un véhicule de transport ? Aujourd’hui, environ 10 % du parc des grandes agglomérations utiliseraient ces types de carburant ; quels gains ceux-ci offrent-ils s’agissant des rejets polluants – dioxydes de carbone, dioxydes d’azote et particules fines ? Des comparatifs scientifiquement établis avec les motorisations diesel ou essence intéressent évidemment notre mission, y compris pour des usages en bicarburation : essence/gaz ou diesel/gaz.
La RATP, dont l’équipement en bus « propres » doit impérativement faire l’objet d’efforts, a conclu, en 2014, un partenariat avec GDF Suez avec un objectif a priori ambitieux : disposer d’une flotte comprenant jusqu’à 20 % de bus à gaz naturel à l’horizon 2025. Plus généralement, la France semble accuser un retard. L’Italie compterait 900 000 véhicules motorisés au gaz naturel et disposerait d’un réseau de distribution de plus de 1 100 stations accessibles aux particuliers. Où en est-on précisément en France ? Quel est le parc en circulation et avec quelles perspectives de marché ? Existe-t-il même un embryon de réseau de distribution et, actuellement, quels sont les prix publics du GNV ou du biogaz ? N’est-ce pas le moment de lancer un vrai plan d’installation de dispositifs d’approvisionnement car la loi de finances pour 2016 vient de confirmer la position privilégiée du GNV, avec, pour 2016 et 2017, un écart favorable de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) de 44 centimes d’euro par rapport au gazole ?
La Mission a déjà auditionné deux hauts fonctionnaires qui ont étudié, dans le cadre du Conseil général de l’environnement et du développement durable, les perspectives d’usage du gaz naturel liquéfié (GNL) dans les transports. Le développement de cette autre filière, voisine de la vôtre, nous a semblé assez limité, sauf peut-être pour quelques activités de transport routier de marchandises. Vous allez nous dire en quoi votre filière se distinguerait de celle du GNL, voire du gaz de pétrole liquéfié (GPL). En comparaison, quel pourrait être le principal potentiel de développement du GNV et du biogaz ?
M. Jean-Claude Girot, président de l’AFGNV. Votre volonté de nous auditionner prouve que les politiques s’intéressent à notre filière. Notre association existe depuis vingt ans et regroupe aujourd’hui quatre-vingt adhérents : des entreprises gazières, dont certaines sont représentées ici, et des constructeurs de camions. Malheureusement, nous ne comptons plus dans nos rangs qu’un seul constructeur de voitures, l’entreprise italienne Fiat. C’est la conséquence du silence que le gaz a subi depuis quelques années : le Grenelle de l’environnement ayant privilégié l’électrique, les constructeurs français ont préféré s’orienter vers ce type d’énergie. Mais les constructeurs de camions, qui considèrent le gaz – GNV et GNL – comme la seule alternative réelle au diesel, nous soutiennent. Le dernier d’entre eux devrait bientôt rejoindre l’association.
L’AFGNV essaie de convaincre les fédérations professionnelles de transporteurs, très intéressées. Nous intervenons dans tous les congrès de transporteurs routiers. Ce matin encore, j’ai visité une fédération bien connue qui s’intéresse au développement du gaz comme moyen de répondre aux villes qui souhaitent limiter la circulation des véhicules diesel sur leur territoire. Pour les camions, le gaz représente la seule alternative, l’électrique n’étant viable que pour de petits véhicules de moins de 3,5 tonnes. Le remplacement du diesel par le gaz – un carburant plus propre – peut être créateur d’emplois puisque les usines de méthanisation, qui recyclent des déchets ménagers ou agricoles, seraient forcément situées en France. Il dynamiserait également notre industrie du camion : Renault Trucks construit tous ses camions en France ; un autre constructeur suédois assemble les véhicules sur notre territoire ; les autres constructeurs y possèdent des usines de moteurs.
Nos clients transporteurs s’interrogent sur le nombre de stations – encore limité – et sur la fiscalité relative au gaz. Très intéressante aujourd’hui par rapport au gazole, celle-ci peut évoluer ; or pour investir dans un outil industriel relativement cher, les transporteurs ont besoin de prévoir leurs dépenses, pour ne pas se retrouver devant une contrainte économique qu’ils n’auraient pas prévue au départ. Ils craignent que si le gaz se développe comme nous le pensons, la fiscalité qui pèse aujourd’hui sur le diesel ne soit transférée sur cette source d’énergie. Nous ne demandons pas un blocage du prix du gaz ou des taxes correspondantes, mais l’assurance que l’écart actuel de fiscalité entre le diesel et le gaz reste constant sur les cinq ans à venir. L’échéance de 2025 nous semble raisonnable par rapport à d’autres délais très courts qui posent des problèmes économiques aux transporteurs ; en effet, on ne peut pas remplacer un parc de camions aussi vite.
La demande de notre filière de voir l’amortissement de 140 %, prévu par la loi Macron, s’appliquer à tous les camions a été refusée ; en revanche, l’on a accepté la mesure pour les véhicules à gaz – malheureusement, pour deux ans seulement. Ce délai est court pour les investissements, mais c’est déjà un grand pas. Nous remercions ceux qui ont pris cette décision et qui ont porté les amendements correspondants.
Vous avez cité les deux experts avec lesquels nous travaillons étroitement. Dans le cadre de la directive européenne sur les carburants alternatifs, nous avons créé un groupe de travail présidé par M. Vincent Rousseau, ici présent.
Mme Catherine Brun, directrice commerciale de GRTgaz. Je vous prie d’excuser M. Thierry Trouvé, directeur général de GRTgaz, qui n’a pas pu se rendre disponible ; j’ai l’honneur de le représenter dans le cadre de mes missions sur les marchés prospectifs.
Je développerai d’abord en quoi le GNV constitue une alternative réelle au carburant pétrolier pour les poids lourds et les véhicules utilitaires et à terme, légers. Je vous présenterai ensuite les premières conclusions des travaux que nous menons au sein de l’AFGNV, dans le cadre de la directive européenne sur les carburants alternatifs. Enfin, je vous indiquerai dans quelle mesure les infrastructures gazières peuvent accompagner le développement du GNV.
Le GNV représente une alternative réelle au carburant pétrolier pour trois types de raisons : techniques, pratiques et économiques. D’un point de vue technique, le GNV est une technologie mature – 20 millions de véhicules roulent aujourd’hui grâce à ce carburant – qui présente des dispositifs de dépollution simples et peu onéreux. Elle est tout à fait adaptée au renforcement futur des normes environnementales, à des coûts raisonnables. Cette technologie permet une véritable amélioration en matière d’écologie. Les expériences des derniers mois incitent à la prudence, mais une étude de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) menée avec l’entreprise Casino, en conditions réelles, sur des poids lourds neufs compatibles avec la norme Euro 6 montre que la réduction des émissions de CO2 va jusqu’à 10 % avec le GNV, et jusqu’à 80 % avec le biogaz, ce dernier chiffre étant relatif aux émissions « du puits à la roue ». En tout état de cause, il s’agit de réductions notables. Les réductions d’oxydes d’azote (NOx) atteignent 70 %. On note enfin une quasi-absence de particules fines. On ne dispose pas aujourd’hui d’études aussi précises pour les véhicules utilitaires légers, mais nous pensons qu’elles livreraient des résultats comparables. De plus, le recours au GNV permet de diviser par deux le bruit – élément particulièrement appréciable pour l’usage urbain : bennes à ordures ménagères, bus et véhicules utilitaires légers.
Le GNV représente également une alternative crédible du point de vue pratique et opérationnel. Pour une entreprise, le service rendu par un véhicule à gaz est très proche de celui d’un véhicule diesel. La substitution d’une énergie à une autre doit se faire sans modifier les modes de travail d’une entreprise ; par exemple, la RATP ne devrait pas changer la manière dont elle effectue sa recharge de bus. Aujourd’hui, les technologies GNV permettent une autonomie de 400 kilomètres à la journée – chiffre compatible avec bon nombre d’usages couverts par le diesel – et un temps de remplissage de quelques minutes, ce qui, le plus souvent, n’oblige pas les entreprises à réinventer tous leurs procédés de travail.
Le GNV apparaît enfin comme une véritable alternative économique. Comme le faisait remarquer M. Girot, si l’on tient compte du dispositif d’aide en vigueur – l’écart de taxes ou les soutiens à l’achat –, et sans même tenir compte des externalités, notamment des avantages écologiques, il y a aujourd’hui un intérêt économique à choisir le GNV pour le transport de marchandises sur le segment de 100 000 kilomètres par an. Pour des parcours plus longs à l’année, l’intérêt serait moindre. À terme, les gains dus aux économies d’échelle sur la production des poids lourds devraient même réduire la différence de prix d’achat et rendre le transport de marchandises au GNV encore plus intéressant.
La déclinaison française de la directive européenne constitue une véritable opportunité pour formuler des ambitions en matière de GNV. Le parc GNV représente aujourd’hui 13 000 véhicules, pour moitié des véhicules utilitaires légers, et quarante-et-une stations publiques, sans compter les stations privées.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Combien y a-t-il de stations privées ?
Mme Agnès Boulard, responsable des relations institutionnelles de GRTgaz. Environ 230.
Mme Catherine Brun. Dans le cadre du travail que nous menons avec la filière pour proposer une stratégie de développement du GNV, nous retenons un scénario qui sera tiré par le transport de marchandises. À l’horizon 2020, nous prévoyons 12 000 poids lourds, soit une multiplication par sept, 20 000 véhicules utilitaires – une multiplication par trois –, 4 000 véhicules légers et 3 000 bus. Ce scénario de développement est très proche du projet de stratégie nationale pour une mobilité propre.
Pour permettre à ces véhicules de fonctionner, il faut, pour commencer, un réseau de 150 stations-service pour les poids lourds, ouvertes également à d’autres véhicules. Cela représenterait un investissement d’environ 150 millions d’euros. Nous n’avons pas le temps de l’aborder aujourd’hui, mais nous avons également étudié les lieux possibles d’implantation. Si l’on pérennisait le dispositif actuel de stimulation de la demande sur quatre ou cinq ans, ce réseau de stations émergerait naturellement au travers de l’investissement privé. Il devrait être complété par un réseau de proximité : encore 150 stations, pour un investissement plus léger, de l’ordre de 50 millions d’euros. Ces stations de proximité permettraient aux territoires de mettre en œuvre la politique d’amélioration de la qualité de l’air. En revanche, si le premier réseau peut émerger naturellement, ces stations de plus petite taille, qui correspondent à une demande plus diffuse, auraient besoin du soutien de la puissance publique, par exemple par le biais du programme d’investissements d’avenir.
Enfin, les infrastructures gazières représentent un réseau de transport et de distribution – 32 000 kilomètres pour GRTgaz –, mais également quatorze lieux de stockage souterrain et trois terminaux méthaniers. Les hypothèses du scénario de développement que j’ai évoqué conduiraient à des consommations de gaz de l’ordre de 3 térawattheures en 2020, soit 0,5 % de la consommation française. Le réseau est tout à fait capable d’accueillir ces quantités. Les infrastructures sont donc dimensionnées pour raccorder les futures stations.
Les stockages souterrains peuvent renfermer jusqu’à 20 % de la consommation nationale de gaz et sont en mesure d’assurer des niveaux de sécurité d’approvisionnement équivalents à ceux aujourd’hui en vigueur pour les carburants pétroliers.
Mme Catherine Foulonneau, directrice stratégie et territoires de GRDF. GRDF est un réseau de distribution qui travaille beaucoup avec les territoires ; c’est donc à cette échelle que je situerai mon intervention pour évoquer la démarche que nous avons effectuée en région Rhône-Alpes. Le débat sur le gaz naturel pour véhicules a toujours souffert du syndrome de la poule et de l’œuf : faut-il d’abord créer un réseau de stations ou bien fabriquer les véhicules ? Mais pour avoir des poussins, il faut mettre un coq dans la basse-cour ; de même, seule l’implication des pouvoirs publics, en l’occurrence des territoires, peut permettre de lancer le processus. En Rhône-Alpes, dans le cadre de la démarche « GNVolontaire », l’ADEME a octroyé des aides à l’acquisition de poids lourds aux sociétés qui s’engageaient à utiliser une station. On a donc combiné l’engagement de la puissance publique territoriale, celui du constructeur de véhicules et celui d’investisseurs susceptibles de créer des stations. La démarche était réservée aux poids lourds de plus de dix-neuf tonnes. En moins de deux mois, huit entreprises et une collectivité se sont portées acquéreurs de poids lourds à gaz naturel, pour un total de quinze véhicules. On a donc réussi à faire émerger des stations. Dans le domaine du GPL, on a créé des stations, mais elles attendent toujours les véhicules ; faire rouler des véhicules sans stations est tout aussi délicat. L’exemple que j’évoque montre que sur un territoire, la problématique locale de pollution peut pousser les gens à utiliser des véhicules au biométhane.
Si l’on généralise l’expérience à l’ensemble du territoire national, elle coûterait 16 millions d’euros sur cinq ans – une somme relativement modeste. En 2020, les camions GNV représenteraient une part de marché de 10 % sur les véhicules poids lourds neufs. Ce scénario, construit par le MEDEF, fait consensus au sein de la filière. Par rapport au 1,5 milliard d’euros du fonds de financement de la transition énergétique ou par rapport au programme d’investissements d’avenir, l’objectif de 16 millions d’euros nous semble atteignable. En revanche, ce serait aux territoires de décider où ce genre d’initiatives est le plus opportun. C’est exactement la démarche qui a présidé à la création des territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV).
Si l’État investit dans la filière GNV, un euro d’argent public générerait, par effet de levier, dix euros d’investissement privé. Ainsi, 225 000 euros d’investissement public
– 15 000 par camion – permettraient de construire quinze camions à 110 000 euros pièce et une station à 1 million d’euros. Les véhicules seraient de fabrication française et les stations, animées par des opérateurs français. L’effet démultiplicateur est donc important et générateur d’emplois en France ; pourquoi s’en priver ?
Le biométhane est une énergie fabriquée à partir de déchets ; le gaz épuré est injecté dans le réseau. L’ADEME estime que la meilleure valorisation du biométhane est le carburant, en remplacement des carburants fossiles tels que le diesel. Aujourd’hui, la filière se développe. On en est à quatorze sites qui injectent dans notre réseau et trois autres sites : un sur le réseau de GRTgaz, un à Strasbourg et un sur le réseau TIGF. La filière démarre donc avec dix-sept sites et 260 gigawattheures. On espère avoir vingt autres sites l’année prochaine. Comme vous le savez, les projets de méthanisation ne se décrètent pas à Paris, mais appartiennent aux territoires, qui pensent forcément à la valorisation. Or comme le montrent tous nos projets, la valorisation carburant est naturelle. À Forbach, par exemple, on a fait rouler des bus et des bennes à ordures au gaz ; la RATP veut également agir en matière de biométhane carburant. Un système de garanties d’origine permet enfin une réelle traçabilité, du début à la fin, du biométhane utilisé.
Dans le cadre du Comité national biogaz, l’on a créé plusieurs groupes de travail, pilotés par l’administration, dont un atelier bio-GNV. Les propositions faites dans ce cadre sont stimulantes : la stabilisation de la TICPE, votée dans le projet de loi de finances – dont nous sommes très satisfaits –, ou l’amortissement accéléré des poids lourds. Nous souhaiterions cependant aller plus loin pour obtenir que le biométhane carburant soit moins taxé. En effet, une étude montre que le biométhane dégage moins de 188 grammes de gaz à effet de serre par kilowattheure ; donc plus on utilise du biométhane, moins il y a de gaz à effet de serre puisqu’on capte en même temps des déchets et qu’on remplace des engrais fabriqués aujourd’hui à partir d’énergies fossiles. Globalement, il s’agit donc d’une énergie très propre. Or si les taxis qui roulent aujourd’hui au diesel sont partiellement détaxés, ceux qui roulent au biométhane ne le sont pas ; cela n’incite pas à adopter ce type de carburant !
Contrairement à la directive sur les énergies renouvelables, la législation française ne reconnaît pas encore le biométhane comme un biocarburant avancé. Il n’est donc pas compté dans les objectifs de 10 % de carburants renouvelables à l’horizon 2020 et de 15 % à l’horizon 2030, que fixe la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Nous sommes persuadés que le biométhane pourrait demain être intégré dans ces objectifs et que la filière des carburants pourrait se tourner vers ce type d’énergie, comme elle se tourne vers le bioéthanol ou le biodiesel. Nous espérons que votre mission d’information pourra y aider.
Les territoires se sont saisis de cet enjeu : quatre-vingt-quatorze TEPCV intègrent la problématique du gaz, et trente-quatre – parmi lesquels le Grand Troyes, Forbach, Saint-Étienne métropole, Mont-de-Marsan ou Maremne Adour Côte-Sud – ont identifié le GNV comme action prioritaire. Cette dynamique est notamment portée par la volonté des villes d’accompagner le mouvement en matière de logistique du dernier kilomètre. Les municipalités prennent conscience de l’intérêt qu’elles ont à utiliser les déchets et les stations d’épuration pour faire rouler les bus et les bennes à ordure. Le travail réalisé à Lyon montre que ces solutions sont parfaitement envisageables.
Nous commençons à être entendus dans le monde politique, surtout au niveau territorial. De plus en plus de territoires, de transporteurs et de fabricants de camions souhaitent voir les bus et les camions passer au gaz, et nous nous en réjouissons.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Que s’est-il passé ? L’association France nature environnement a attiré mon attention sur un protocole signé en 2005 entre le ministère de l’industrie et une série d’entreprises – Gaz de France, Carrefour, Total, PSA Peugeot Citroën, Renault et Renault Trucks –, qui prévoyait 100 000 véhicules GNV et 300 stations en 2010. Dans votre propos liminaire, vous avez évoqué le Grenelle de l’environnement. Qu’est-ce qui a été fait par rapport à ces engagements ? Comment la France se situe-t-elle par rapport à d’autres pays en matière de développement du GNV ?
On voit bien l’intérêt de la technologie dans le domaine du transport de marchandises et des poids lourds. Mais quelle en est la pertinence pour les véhicules particuliers ? Ce sujet est-il clos en France ? Vous avez évoqué le fait qu’il n’y avait plus de constructeurs français au sein de votre association ; pouvez-vous développer ?
En parlant de fiscalité, faisiez-vous allusion à la taxe carbone ?
Un des scénarios de développement de la méthanisation passe par la logique de l’injection au réseau ; dans ce cas, comment isoler cette source d’énergie pour la faire bénéficier du soutien public ou d’une fiscalité avantageuse ?
M. Denis Baupin. Mon attachement au GNV est connu. Je suis surpris d’apprendre que la PPE n’intègre pas le biométhane dans l’objectif des 10 % de carburants renouvelables. Une mission parlementaire suivra la mise en œuvre de la loi de transition énergétique ; la PPE faisant partie du domaine sur lequel je suis rapporteur, j’étudierai le sujet avec attention.
Vous avez beaucoup parlé des véhicules de marchandises ; qu’en est-il des véhicules particuliers ? La directive européenne sur les carburants alternatifs prévoit que chaque État devra dresser un plan pour le déploiement de ces carburants. De votre point de vue, combien faudrait-il de stations de GNV pour rendre le réseau suffisamment attractif pour les particuliers ? Avez-vous une idée du coût que cela représenterait ?
Remplacer une partie des véhicules utilitaires légers qui roulent au diesel par des véhicules à gaz représente une solution très intéressante, notamment dans les zones urbaines. Il faudrait probablement aider les artisans pour le remplacement de leurs camionnettes. J’ai cru comprendre qu’il existait aujourd’hui des mini-compresseurs qu’on pouvait mettre dans son garage, permettant de recharger le véhicule via le réseau de gaz. Que pensez-vous de cette solution ? Est-elle fiable du point de vue de la sécurité ? Quel en serait le coût ? On m’a parlé de quelques centaines d’euros. Ne pourrait-on pas proposer aux artisans à la fois le véhicule et le compresseur, avec un amortissement sur dix ans ? Vu la différence de prix entre le gaz et le gazole, l’opération apparaît pertinente, à condition de l’accompagner d’une ingénierie financière adéquate.
M. Charles de Courson. Vous n’avez pas évoqué la question de la sécurité. Président du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Marne depuis presque trente ans, je sais que les pompiers sont très réticents à l’égard de ces solutions et ne veulent plus intervenir dans des espaces fermés, tels que les parkings souterrains, lorsque s’y trouvent des véhicules à gaz. En effet, il y a eu des explosions qui ont gravement blessé, voire tué des pompiers. Quid en cas d’accident ? A-t-on réalisé des progrès en matière de sécurité des véhicules ?
Vous avez à juste titre évoqué le problème fiscal, suggérant que si l’on veut développer un parc GNV, il faut que le rapport entre la fiscalité du gaz et celle du gazole soit relativement stable. Mais quelle est la situation dans les autres pays d’Europe ? L’écart entre la fiscalité sur le gaz et celle qui pèse sur les autres énergies non renouvelables ne constitue-t-il pas une anomalie française ? Vous êtes, je trouve, bien habiles en marketing puisque vous avez réussi à faire croire que le gaz était naturel alors que le pétrole ne le serait pas… Blagues à part, cette différence énorme de fiscalité s’explique par des raisons historiques : avant la découverte du gaz de Lacq, la fiscalité sur le gaz et le pétrole était équivalente. C’est parce qu’on a voulu développer un réseau de gaz en France qu’on a sorti cette énergie, au début des années 1960, du périmètre de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP).
M. Jean-Yves Caullet. Avec le gaz carburant, on a affaire à des intérêts gigognes. Quelle que soit l’origine du gaz, fossile ou non, il existe des avantages en matière d’émissions et de performances moteur. Ensuite, si l’on passe au biogaz, on intègre dans les avantages le fait que la ressource est renouvelable.
Aujourd’hui, quelle proportion du biogaz peut-on mobiliser pour l’utiliser comme carburant ? Que faudrait-il faire pour améliorer cette proportion, étant entendu que puisque l’énergie passe dans le réseau, seuls des systèmes de traçabilité permettent de garantir qu’on utilise au moins l’équivalent de telle ou telle fraction de gaz renouvelable ?
M. Xavier Breton. Vous dites que les véhicules au GNV sont bien développés en Italie ; comment cela s’explique-t-il ? Ce pays offre-t-il un régime fiscal attractif pour ce type d’énergie ?
Quels sont les enjeux particuliers au développement de la filière des véhicules industriels par rapport à celle des automobiles ?
M. Jean-Claude Girot. Vous avez raison de mentionner le protocole de 2005. Outre les gaziers, les fondateurs de l’association étaient Renault, PSA et Renault VI – futur Renault Trucks. Deux constructeurs de camions nationaux s’intéressaient donc déjà au gaz. Il y a vingt ans, on avait tenté de développer des véhicules à gaz, mais ces efforts n’ont pas été suivis d’effet car il n’y a pas eu de politique suffisamment attrayante pour développer cette filière. Il en est allé de même pour l’électricité : les voitures électriques existaient déjà il y a vingt ans, voire bien avant. En effet, un des premiers véhicules électriques – un corbillard ! – avait été fabriqué en 1924 par Marius Berliet, mais la filière ne s’est alors pas développée. Les trois constructeurs cités étaient très intéressés par le gaz, mais ils se sont rendu compte que les véhicules seraient plus chers à construire, et que le monde économique et politique n’allait pas aider au développement de cette filière. Le Grenelle de l’environnement a mis un coup d’arrêt au gaz en privilégiant l’électrique ; en 2009, Renault, PSA et Renault VI ont donc quitté l’association, qui s’est retrouvée en danger tant chacun se demandait si le gaz avait un avenir dans le domaine du transport. Renault Trucks est finalement revenu, ainsi que tous les constructeurs de camions ; mais malheureusement, les constructeurs français de voitures se sont orientés un sur l’électrique, l’autre sur l’hybride, délaissant le gaz. L’Italie, pays producteur, a depuis longtemps développé le gaz pour les véhicules légers comme lourds, grâce à des avantages fiscaux. Aujourd’hui, ils sont les premiers en Europe dans cette filière.
La fiscalité ne concerne pas uniquement la taxe carbone – qui ne différencie pas entre les carburants –, mais les taxes qui pèsent sur le carburant diesel ou essence. Ce sont ces taxes qui font l’essentiel du prix du diesel en France ; si dans les années à venir il y a un transfert important du gazole vers le gaz, le Gouvernement, quel qu’il soit, risque de vouloir taxer celui-ci plus lourdement afin de compenser le manque à gagner. Cette absence de visibilité pour les investisseurs constitue un handicap ; c’est pourquoi nous ne demandons pas un blocage du prix ou de la fiscalité, mais le maintien d’un écart comparable à celui qui existe aujourd’hui.
Contrairement aux voitures, les véhicules utilitaires légers – les camionnettes – n’ont jamais bénéficié de primes. On donne aujourd’hui 10 000 euros par voiture pour acheter une voiture électrique ; les véhicules à gaz n’ont jamais fait l’objet d’aides comparables. Pour notre filière de véhicules industriels, nous demandons depuis plusieurs années une aide à la modernisation du parc, qui aurait permis de relancer une industrie en difficulté. Cette année, les chiffres d’immatriculation des camions ont légèrement remonté, mais restent bien en dessous des meilleures années. Une aide à la modernisation du parc aurait permis de développer les usines en France, donc de relancer la machine économique et d’aider les transporteurs. En facilitant le renouvellement des véhicules Euro 2, Euro 3 et Euro 4 – encore très polluants par rapport à Euro 6 diesel ou évidemment par rapport au gaz –, elle aurait surtout permis d’arriver à des résultats écologiques très intéressants. Or il n’y a jamais eu d’aides à la modernisation du parc, ni aucune aide pour les camions, les véhicules utilitaires légers ou les voitures. Malgré les difficultés des finances publiques, on octroie bien 10 000 euros pour les véhicules électriques. L’interdiction de Bruxelles est un autre argument qui ne tient pas : puisqu’il l’autorise pour les véhicules électriques, pourquoi l’interdirait-il pour les véhicules GNV ?
Monsieur de Courson, l’accident auquel vous faites référence doit concerner une voiture roulant au GPL. Or il ne faut pas confondre le GPL, le GNV, le gaz naturel liquéfié (GNL) et le gaz naturel comprimé (GNC). Le gaz que l’on met dans nos véhicules n’est pas plus dangereux que l’essence ou le gazole. Si un véhicule à essence prenait feu dans un parking souterrain, les résultats pourraient être tout aussi dramatiques.
En tant que spécialiste de la fiscalité, vous avez raison d’évoquer le gaz de Lacq. La différence de la fiscalité a, en effet, été décidée par l’État. Quant aux raisons qui y ont conduit, c’est aux politiques de s’y intéresser…
Mme Catherine Foulonneau. Dans tous les pays où la filière a émergé – la Suède, la Suisse, l’Italie ou l’Allemagne –, le succès a reposé sur la collaboration entre l’État, les constructeurs et les entreprises fournissant les stations. En Italie, la loi correspondante s’appelait « Salva Italia » : c’est dire si l’État s’était engagé ! Fiat a suivi et l’entreprise ENI a développé un réseau de stations. Les constructeurs de stations et de véhicules ne peuvent pas y arriver seuls ; il faut forcément les trois acteurs, au moins au départ, comme le prouve notre expérience dans les territoires. Aujourd’hui, en Italie, il n’y a plus de subventions, mais le secteur continue à fonctionner. Il faut donc commencer par lancer le marché de manière pérenne. Or en matière de véhicules légers, personne n’est actuellement prêt : ni les fabricants de véhicules, ni les constructeurs de stations, ni les pouvoirs publics. Mieux vaut commencer par les poids lourds – domaine où les fabricants de camions, les territoires et les constructeurs de matériel veulent d’ores et déjà s’engager, et où l’on peut trouver des candidats pour financer les stations. Même la Caisse des dépôts et les syndicats de l’énergie commencent à s’y intéresser. Commençons donc par le plus facile, et lorsque nous aurons démontré ce que nous pouvons apporter à la collectivité, nous pourrons aborder le secteur des véhicules légers.
Le biométhane est en effet injecté dans les réseaux, mais la garantie d’origine permet d’en assurer la traçabilité jusqu’à la consommation. Par appel d’offres du ministère, GRDF est le gestionnaire du registre des garanties d’origine. Cette traçabilité servirait pour l’incorporation du GNV dans les biocarburants.
Y aura-t-il assez de gaz demain pour le GNV ? La loi sur la transition énergétique fixe un objectif de 10 % de gaz vert sur quelque 30 térawattheures à l’horizon 2030 ; le scénario du MEDEF évoque 10 % sur 25 térawattheures à l’horizon 2020. Le GNV pour les camions démarre, ainsi que le biométhane ; à nous de faire rencontrer ces courbes. Si l’on reconnaît le GNV comme un biocarburant avancé et qu’on fait de l’incorporation, on peut y arriver.
M. Vincent Rousseau, directeur de projet mobilité de GRTgaz. Monsieur Baupin, le gaz est aujourd’hui avant tout intéressant pour les poids lourds, et c’est cette étape qu’il faut réussir jusqu’en 2020. Combien de stations faut-il ? Si l’on regarde nos voisins européens, l’Italie dispose aujourd’hui de plus de 1 000 stations, le réseau allemand
– 900 stations – est également assez dense. Si l’on fait le parallèle avec le GPL – 1 500 stations –, on voit l’asymptote vers laquelle il faudra tendre. Avec un réseau de 1 500 stations, on devrait couvrir le territoire correctement et mettre le gaz carburant, d’origine renouvelable ou non, à disposition du plus grand nombre, quel que soit le segment, du poids lourd au véhicule léger.
Le coût ne serait pas forcément exorbitant : une station coûte plus cher qu’une borne de recharge, mais il en faut beaucoup moins. Nous estimons qu’il s’agirait de 700 à 800 millions d’euros, sachant que dans ces 1 500 stations, il y aurait à la fois des stations pour poids lourds et des stations pour véhicules légers, nombreuses en Allemagne et en Italie. Les premières coûtent plus cher que les secondes : 1 million d’euros contre environ 300 000 euros.
S’agissant de la différence entre le GPL et le GNV, le GPL est un mélange avec du butane – C4H10 – et du propane – C3H8. Le gaz naturel et le biométhane, c’est du méthane : CH4. Le rapport entre le carbone et l’hydrogène est donc bien plus avantageux pour le méthane que pour le GPL.
L’autre différence notable tient au fait que le GPL est un produit issu du raffinage, donc un produit fatal récupéré au cours de la transformation du brut en sous-produit – diesel ou essence –, alors que le gaz naturel est d’origine fossile pour la partie naturelle et de plus en plus d’origine renouvelable. Mais c’est bien la même molécule.
Une autre question portait sur les véhicules disponibles. Aujourd’hui, sur le segment poids lourds, l’offre commence à être relativement intéressante, équivalente à ce qu’on voit dans d’autres pays européens. Acheter un véhicule utilitaire, a fortiori léger, est beaucoup plus compliqué : l’offre existe, mais bon nombre de constructeurs ne commercialisent pas leurs véhicules en France, à cause du manque de stations.
S’agissant des compresseurs à domicile, le développement du gaz concerne aujourd’hui surtout le segment des poids lourds, alors que cette solution est orientée vers les véhicules utilitaires légers, notamment particuliers. De plus, elle s’adresse à seulement une catégorie d’acteurs – il faut disposer d’un garage, souvent d’un pavillon –, loin de la logique d’accessibilité du carburant au plus grand nombre. L’AFGNV estime néanmoins que la solution est intéressante ; elle est d’ailleurs en cours de relance en Suisse, et des entreprises travaillent également sur le sujet aux États-Unis. Mais avant de mettre en œuvre ce moyen de ravitaillement, il faudrait créer un réseau de stations digne de ce nom, pour apporter, en premier ressort, le même type de recharge que pour les carburants classiques.
M. Denis Baupin. Ces compresseurs ne présentent donc pas de problèmes de sécurité ?
M. Vincent Rousseau. Des compresseurs à domicile avaient été déployés à la suite du plan « GNV 2005 » ; il a ensuite fallu les retirer pour des questions de réglementation, au grand dam de leurs utilisateurs. À ma connaissance, les problèmes de sécurité n’ont jamais été avérés. La preuve, c’est que la Suisse cherche aujourd’hui à relancer cette solution, offrant le compresseur à domicile en même temps que la voiture. C’est donc une offre qui intéresse nos voisins. Mais les véhicules légers ne sont pas le segment sur lequel on attend aujourd’hui le gaz en France.
Mme Véronique Bel, chef de projet mobilité de GRDF. Il reste encore des compresseurs en France, mais ils ne sont utilisés que par des professionnels et des collectivités locales disposant de deux ou trois véhicules légers. Il n’y a pas de problèmes en matière de sécurité ; mais pour installer ces compresseurs dans les pavillons, il fallait déroger à l’arrêté relatif au gaz dans les bâtiments d’habitation.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Mesdames, messieurs, je vous remercie.
La séance est levée à quatorze heures cinquante-cinq.
◊
◊ ◊
19. Audition, ouverte à la presse, de M. Christian de Perthuis, professeur à l’Université de Paris Dauphine, titulaire de la Chaire d’économie du climat.
(Séance du mardi 19 janvier 2016)
La séance est ouverte à seize heures trente.
La mission d’information a entendu M. Christian de Perthuis, professeur à l’Université de Paris Dauphine, titulaire de la Chaire d’économie du climat.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Nous recevons M. Christian de Perthuis, professeur d’économie associé à l’université de Paris-Dauphine et fondateur de la chaire d’économie du climat, après avoir été chargé de mission « Climat » à la Caisse des dépôts et consignations. Il nous fera part de son expertise sur des sujets intéressant directement notre mission, notamment les points relatifs à la fiscalité.
Vous avez, monsieur de Perthuis, présidé le Comité pour la fiscalité écologique depuis sa création, à la fin de l’année 2012, jusqu’à l’automne 2014. Peut-être pourriez-vous nous rappeler pourquoi vous avez décidé de démissionner de cette responsabilité.
La convergence progressive entre la taxation de l’essence et du diesel demeure un objectif. Ce processus vous semble-t-il aussi déterminant qu’il y paraît ? Quelles devraient être, selon vous, les autres mesures susceptibles de faire raisonnablement évoluer le parc français en un ensemble progressivement « dépollué », donc d’enregistrer des résultats significatifs en termes de rejets, notamment en zone urbaine ?
Plus généralement, quelles conclusions peut-on tirer de l’actualité récente avec le scandale Volkswagen révélé aux États-Unis, mais aussi avec les difficultés apparemment rencontrées par Renault dans le cadre de nouveaux contrôles des émissions dont les caractéristiques du protocole mis en œuvre restent toutefois inconnues ? Ce point nous amène également à nous interroger sur l’opacité des procédures jusqu’alors adoptées, au niveau européen, dans la fixation des normes.
M. Christian de Perthuis, professeur de l’Université Paris-Dauphine, titulaire de la chaire d’économie du climat. Je ne suis pas à proprement parler spécialiste du secteur automobile, qui fait l’objet de votre mission d’information. Aussi mon propos tournera-t-il plutôt autour des mesures environnementales et de leurs répercussions sur l’industrie automobile et éventuellement d’autres industries.
J’ai démissionné du Comité pour la fiscalité écologique, car j’avais le sentiment de ne plus disposer des moyens de le faire fonctionner, à cause de difficultés pratiques. J’avais écrit aux deux ministres de tutelle pour savoir si le Comité devait continuer ses travaux. Sans réponse de leur part et face à l’abandon de l’écotaxe poids lourds, j’ai préféré abandonner une présidence d’un comité qui risquait de n’être que potiche.
Pour autant, la création du Comité pour la fiscalité écologique s’est avérée extrêmement utile, puisque ce dernier a servi de caisse de résonance entre les pouvoirs publics – Gouvernement et Parlement – et la société civile dans sa diversité. Puisse le nouveau comité qui l’a remplacé poursuivre et amplifier la tâche engagée.
La fiscalité environnementale s’envisage dans un contexte de long terme et de court terme. Sur le long terme, l’on constate que la fiscalité de l’énergie s’est constituée par strates successives et qu’elle est le fait de l’histoire, sans que se soit exprimé le souci d’envoyer des incitations en termes écologiques ou sanitaires. C’est plutôt la recherche du rendement qui a dominé.
Ainsi, la taxe intérieure pétrolière (TIP), ancêtre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), fut instituée en 1928 pour des raisons de rendement. Elle a remplacé l’impôt … sur le sel, dont le produit baissait régulièrement. Saluons la grande clairvoyance du Parlement qui a su trouver comme base de taxation une nouvelle matière physique, l’essence et le pétrole, qui s’est révélée avoir de l’avenir. La fiscalité de l’énergie est donc née de préoccupations de rendement ; plus rarement, elle a pu servir d’instrument de soutien économique. Ce n’est que tardivement que s’est exprimée la volonté de concilier ses dispositions avec les enjeux environnementaux. Il s’agit d’un phénomène récent.
À court terme, il faut souligner que le baril de Brent s’échange aujourd’hui à moins de 30 dollars et que le prix hors taxe et le prix toutes taxes comprises du pétrole sont déconnectés l’un de l’autre. Ce contexte de baisse des prix des hydrocarbures est particulièrement propice à une accélération des mesures fiscales en matière énergétique, et il la rend plus facile aujourd’hui qu’il y a trois ans, lorsque le baril de Brent était à plus de 100 dollars. Le levier fiscal peut être utilisé à l’heure actuelle pour envoyer les bons signaux en termes écologiques.
S’agissant des avantages accordés au diesel, il faut distinguer, au sein de notre grille de fiscalité, le régime général des mesures spécifiques. Pour le régime général, la TICPE accorde historiquement un avantage au diesel par rapport à l’essence. Quand je présidais le Comité pour la fiscalité écologique, il se chiffrait à 17 centimes par litre de carburant ; au 1er janvier 2016, il n’était plus que de 12 centimes, mais l’écart demeure encore important, au profit du diesel. Cet avantage concerne essentiellement les véhicules particuliers et les petits véhicules utilitaires.
Des systèmes particuliers dérogatoires existent par ailleurs, qui concernent principalement les taxis et les véhicules de société, même si je me demande si la loi de finances de 2016 n’a pas gommé l’avantage consenti à ces derniers.
M. Charles de Courson. Je vous le confirme, pour ce qui est de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Sa non-déduction sur l’essence sera supprimée en quatre ans pour ces véhicules. Je suis l’auteur de l’amendement à l’origine de cette disposition, qui avait reçu le soutien de M. Christian Eckert, ministre du budget. Elle a été votée en deuxième lecture. Mais je vais immédiatement vérifier.
Mme Delphine Batho, rapporteure. À mon sens, cette disposition avait plutôt été écartée au cours de la seconde délibération, même si elle avait été initialement adoptée.
M. Christian de Perthuis. Je vous avoue que j’étais surtout accaparé, pendant le débat budgétaire, par les travaux de la conférence de Paris sur le climat (COP21).
Un deuxième bloc de dérogations concerne trois professions : les agriculteurs, les travaux publics et les transporteurs routiers. Il faut bien dissocier entre ces deux blocs, car les mesures à prendre à leur endroit, et les méthodes à suivre pour ce faire, varient grandement selon leur spécificité.
Quant à la justification de la fiscalité de l’énergie actuelle par rapport aux enjeux écologiques, je me permettrai de vous renvoyer à l’avis n° 3 du Comité pour la fiscalité écologique, rendu le 18 avril 2013. Je n’aurais pas une ligne à y changer aujourd’hui : historiquement, la fiscalité de l’énergie s’est construite sans prise en compte des impacts environnementaux et sanitaires des différents carburants.
À mesure que les connaissances scientifiques ont progressé, il est apparu que les deux types de carburant que sont le diesel et l’essence n’ont pas la même incidence écologique. Un litre de diesel contient 15 % de dioxyde de carbone (CO2) de plus qu’un litre d’essence. Ce point est mal connu, et le diesel est souvent perçu comme étant plus favorable à l’action climatique car le rendement du moteur diesel est plus élevé. En outre, les polluants locaux y sont plus présents, notamment les oxydes d’azote (NOx) et les microparticules, dont on mesure mieux la présence, mais aussi l’impact sanitaire négatif, du fait du progrès des connaissances. D’autres sources dégagent cependant les mêmes particules, comme l’a montré le bilan du Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) pour la France. Le bois est ainsi une source très importante d’émissions de particules.
Indubitablement, le diesel joue un rôle dans les pics de la pollution urbaine. Il n’y a aucune justification environnementale à donner un avantage au diesel sur l’essence, quelle que soit la métrique utilisée. L’on pourrait penser que la parité de taxation permettrait d’établir un équilibre total ; ce n’est pourtant pas le cas, car le diesel est plus polluant que l’essence. Pour prendre en compte la mesure des impacts sanitaire et environnementaux, il conviendrait donc de taxer davantage le diesel.
Il serait cependant compliqué d’en définir le juste niveau de taxation. Dans un moteur à combustion, la masse de dioxyde de carbone dégagée correspond bien à celle qui est contenue dans le réservoir, de sorte qu’il est facile d’évaluer son niveau de pollution. Mais l’émission des NOx varie selon les types de véhicule et de pot catalytique utilisés. Elle dépend aussi de l’entretien de ces pots catalytiques ou encore de leur mode d’usage, car les pots catalytiques filtrent efficacement lorsqu’ils sont chauds, mais pas quand ils sont froids.
Pour trouver un bon système tarifaire qui impute à l’utilisateur la pollution locale, il faudrait se tourner vers des solutions analogues au péage urbain mis en place à Stockholm. Il est différencié selon la classe technique des véhicules et selon l’heure d’utilisation. Ce système tarifie donc de manière fine les pollutions locales.
L’écart de fiscalité entre diesel et essence a un impact à la fois économique et industriel. Comme je le disais précédemment, le faible niveau du baril de Brent offre l’occasion à court terme de les modifier.
Sous le régime général de taxation, le premier impact économique de l’écart de fiscalité se fait sentir sur l’industrie du raffinage, notamment française. L’avantage fiscal consenti au diesel conduisant à sa surconsommation en France, et la production du diesel étant pratiquement indissociable de celle de l’essence, on se retrouve dans la situation de devoir importer du diesel tandis qu’on a du mal à trouver des débouchés rentables à l’essence qui sort des raffineries françaises. Cette industrie se porterait donc mieux si un rééquilibrage durable avait lieu.
S’agissant du secteur automobile, je ferai trois observations. En premier lieu, la prédominance du diesel est un phénomène français et européen, à l’exception du Royaume-Uni. Aux États-Unis, en Asie également, la norme de carburant des petits véhicules est l’essence. Les Japonais n’ont développé de véhicules diesel que pour entrer sur le marché européen. Dans les pays hors de l’Europe continentale, la structure de taxation fait que le diesel est plus imposé que l’essence pour les véhicules des particuliers.
En deuxième lieu, le coût de la mise aux normes des véhicules récents s’élève à plusieurs milliers d’euros par véhicule. Ce surcoût imputable aux pots catalytiques fait qu’il est de moins en moins rentable de développer de nouveaux modèles. La tendance naturelle est donc à l’évolution du marché des petites cylindrées à usage urbain vers des modèles à essence. Pour les grosses cylindrées, il est encore aujourd’hui plus rentable et plus facile de vendre des modèles diesel. Tout le problème est là.
J’en viens, en troisième lieu, aux avantages spécifiques du diesel. S’agissant des véhicules de société, il faut réduire le plus rapidement possible cet écart de taxation entre essence et diesel pour les flottes professionnelles, car il n’a aucune légitimité. D’autant que la part des ventes de véhicules particuliers qui constituent ces flottes captives augmente. L’avantage dont bénéficient les taxis est plus réduit et peut être a-t-il été supprimé. Quoi qu’il en soit, il n’y a aucune raison de le maintenir, puisqu’ils peuvent répercuter les coûts dans leurs tarifs.
J’en termine par les trois professions jouissant d’un régime particulier : agriculteurs, travaux publics, transporteurs de marchandises. Il faut chercher des solutions avec eux. Comme président du Comité pour la fiscalité écologique, j’avais noué des contacts tout à fait intéressants avec leurs représentants. Ceux de la profession agricole étaient, bien sûr, attachés au soutien dont ils bénéficient, mais ils n’étaient pas fermés à ce qu’il prenne d’autres formes, peut-être plus efficaces, que cette aide à l’achat de carburant. Il en va de même pour les bâtiments et travaux publics. Dans ces activités, il n’y a pas de lien direct entre le prix du carburant et la compétitivité internationale du secteur, qui est déterminée par de nombreux autres facteurs.
La situation est différente pour les transporteurs routiers. Le coût salarial chargé d’un routier est de 10 % à 15 % plus élevé en France qu’en Allemagne. D’autres éléments que le coût du carburant pèsent donc dans le coût d’exploitation. Ne faut-il pas réfléchir, avec la profession concernée, à d’autres leviers pour soutenir son activité ? J’observe toutefois, ayant été invité au congrès annuel de la Fédération nationale des transports routiers, que le statut du carburant professionnel fait, pour ainsi dire, partie de l’identité de ce secteur. Il y a une forte tradition.
M. Charles de Courson. Vérification faite, la disposition dont nous parlions tout à l’heure fut adoptée par notre assemblée en première lecture du projet de loi de finances pour 2016, mais le Sénat l’a supprimée en première lecture. Après l’échec de la commission mixte paritaire, la TVA sur l’essence des véhicules de société demeure donc non déductible.
M. Christian de Perthuis. À faire la prochaine fois !
Mme la rapporteure. Depuis l’avis, rendu le 18 avril 2013, du Comité pour la fiscalité écologique, le débat sur la fiscalité de l’énergie a progressé et des mesures ont été prises. Le Premier ministre n’a pas hésité à affirmer que la diésélisation massive avait été une erreur. Un mouvement de rééquilibrage a été engagé. Aujourd’hui, le débat porte moins sur la nécessité de principe que sur la manière et le rythme des mesures à prendre pour réduire l’écart de fiscalité entre diesel et essence.
Pour ce qui est de la manière, il y a débat sur la double convergence, c’est-à-dire la baisse de la taxation de l’essence parallèlement à la hausse de celle du diesel. S’agissant du rythme, quel est votre point de vue ? La convergence peut-elle être progressive et sur quelle durée doit-elle s’étaler ? Telle est la question que se posent les industriels, qui ont compris que cette convergence aurait lieu. Il reste pour eux à envisager l’adaptation de leurs capacités industrielles.
D’autres interlocuteurs ont mis en avant la nécessaire neutralité technologique de la fiscalité. Ce principe, qui me paraît assez juste, veut que l’État ne s’immisce pas, à travers les critères de la fiscalité, dans les choix de technologies des industriels. À cet égard, il faut d’ailleurs indiquer que les nouvelles motorisations à essence émettent, elles aussi, des particules. Même si le diesel propre n’existe pas, il a fait des progrès, tandis que les nouvelles motorisations à essence requerront, elles aussi, des filtres à particules. Faut-il que l’État se fonde seulement sur l’émission de CO2 ou qu’il prenne aussi en compte les émissions de particules ? La fiscalité est-elle, du reste, le seul levier à actionner ou est-il préférable de recourir à des dispositifs de bonus/malus ?
M. Frédéric Barbier. Les moteurs à essence vont se développer pour les petites cylindrées, avez-vous indiqué. Quelle est la limite supérieure de cette catégorie ?
Par ailleurs, s’agissant de la fiscalité, quelle est la part de marché de la motorisation au diesel dans les flottes d’entreprises et dans les véhicules détenus par les particuliers ?
M. Charles de Courson. Que serait la neutralité fiscale entre l’essence et le gazole ? Les uns prétendent qu’elle pourrait se fonder sur la parité énergétique, concept utile si l’on se souvient que le contenu énergétique d’un litre d’essence n’est pas le même que celui d’un litre de gazole. Mais vous nous dites qu’il faut aller au-delà. Jusqu’où préconisez-vous exactement d’aller dans l’écart positif entre essence et diesel ?
Vous n’avez pas parlé des autres énergies utilisées pour le transport automobile. L’électricité est produite en France à 82 % ou 83 % par des centrales nucléaires ou thermiques. Or elle échappe à la taxation de sa composante non renouvelable. Cela a des répercussions sur les véhicules électriques. Comment voyez-vous les choses ?
De même, pourquoi le gaz jouit-il d’un régime particulier ? Au-delà de l’amusante distinction de marketing entre le gaz, qui serait naturel, et le pétrole, qui ne le serait pas, qu’est-ce qui justifie cette anomalie sur la fiscalité du gaz et ses différents composants, qu’il s’agisse du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou du gaz liquide, lorsqu’ils sont utilisés par des véhicules de transport ?
M. Michel Heinrich. Vous nous avez dit que les filtres à particules placés sur les derniers modèles ne seraient peut-être pas si efficaces. Dans les publications et revues spécialisées, à mon sens plutôt objectives, j’ai lu des avis différents, selon lesquels le moteur diesel émettrait, grâce à ces filtres, à la limite moins de particules que le moteur à essence classique.
Les industriels, en particulier les fabricants de turbo, s’inquiètent de la baisse attendue sur les moteurs diesels. Les fabricants de moteur, mais aussi les spécialistes de l’injection, craignent de voir disparaître leur industrie. Vous dites n’être pas spécialiste du secteur automobile, mais savez-vous si l’on a pu estimer le temps de conversion nécessaire pour ce secteur ou certains métiers sont-ils purement et simplement condamnés ?
M. Philippe Duron. Monsieur le professeur, je partage votre point de vue sur l’abandon de l’écotaxe sur les poids lourds et sur le renoncement à la tarification de la route, alors que nous étions engagés dans un processus vertueux. D’autres pistes sont explorées aujourd’hui, telle que la convergence des prix entre essence et gazole. C’est de cette façon que l’État a pallié, l’année dernière, la disparition de la recette des poids lourds pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).
Comme économiste, comment jugez-vous que doive être affecté le produit de la fiscalité écologique ? Doit-il plutôt financer la modernisation d’infrastructures ou la recherche et le soutien en faveur d’une rupture des modes de mobilité ?
M. Yves Albarello. Un reportage diffusé hier soir à la télévision traitait du vieillissement du parc automobile. Il n’est pas rare que, au vu du coût élevé des véhicules neufs, des jeunes se rabattent sur l’achat de modèles qui ont dix-sept ou dix-huit ans, et qui polluent donc beaucoup. Que pensez-vous de ce phénomène ?
Comme l’a déjà remarqué notre collègue Charles de Courson, vous n’avez pas évoqué la filière du gaz. Qu’en est-il du biogaz, qui contribue au développement de l’économie circulaire ? Alors que nous disposons de gisements un peu partout dans ce pays, sa production n’est pas forcément favorisée.
M. Christian de Perthuis. Madame la rapporteure, vous m’avez interrogé sur le rythme de réforme dans le domaine de la fiscalité de l’énergie. Je répéterai qu’il faut être convaincu de ce que l’acceptabilité sociale des mesures fiscales en matière énergétique est bien différente selon que le baril est à moins de 30 dollars ou à plus de 100 dollars. J’ai transmis ce message aux pouvoirs publics à l’automne. Je crois qu’il faut utiliser l’opportunité que nous offre le contexte conjoncturel pour accélérer des réformes qui seront de toute façon nécessaires.
Hors de France, des pays tentent des réformes fiscales ambitieuses. J’ai fait deux conférences en juin aux Émirats arabes unis. J’ai pu y constater que, à l’occasion de contacts auprès du fonds souverain de l’émirat d’Abou Dhabi, que la baisse des prix du brut y coïnciderait cette année avec une hausse du prix de l’essence.
En réalité, les constructeurs automobiles nationaux ont déjà entamé la révolution vers des modes de mobilité différents. Il faut accélérer le processus : telles sont les bonnes incitations à leur envoyer. Reste à savoir s’il faut qu’ils l’achèvent en trois ans, en cinq ans ou en sept ans.
S’agissant de la taxation du diesel et de l’essence, faut-il baisser d’un côté et augmenter de l’autre ou ne faire qu’augmenter d’un côté ? Les grandes déclarations faites à l’occasion de la COP21 plaideraient en faveur d’une accélération impérieuse vers une économie bas carbone. Je pense qu’il faut donc converger vers le haut, même si cette approche n’est pas populaire. Il faut garantir la cohérence entre, d’une part, les discours sur les intentions, comme la loi relative à la transition énergétique, et, d’autre part, les moyens que l’on se donne pour les réaliser. Dans ce contexte, il serait contre-productif de promettre une baisse des prix de l’essence, ce qui n’exclut pas des mesures compensatoires.
J’en viens à la neutralité technologique de la fiscalité, question complexe. Nous héritons malheureusement d’une fiscalité absolument orientée ! Ainsi, le gaz a été détaxé pour permettre le développement du site de Lacq dans les années 1950. Si l’on raisonne correctement en prospective, il faut s’orienter vers une fiscalité énergétique à deux composantes. La première est le contenu énergétique des combustibles, qui doit servir de base à la taxation. Cette dernière repose aujourd’hui tantôt sur le litre tantôt sur le mètre cube, ce qui est tout à fait irrationnel. Pour progresser vers une société qui recherche l’efficacité énergétique, il faut que le prix de l’énergie devienne de plus en plus significatif. Le premier levier de l’économie d’énergie reste donc une bonne tarification, qui repose sur le contenu énergétique, totalement neutre du point de vue technologique mais qui va inciter les acteurs économiques à adapter leurs réponses.
La deuxième composante de la fiscalité de l’énergie doit avoir un caractère environnemental. S’agissant du carbone, on a une idée claire, puisqu’un gramme de CO2 présent dans le carburant sort nécessairement par la cheminée ou par le pot d’échappement, du fait qu’il n’y a pas de système pour le capter. Les autres nuisances environnementales appellent un dispositif plus complexe car, suivant la normalisation et les caractéristiques techniques des véhicules, il n’en sortira pas la même quantité de polluants.
Le mode d’usage entre aussi en ligne de compte. J’ai dit, non pas que le pot catalytique est inefficace, mais que son efficacité dépend de son entretien et du bon renouvellement des filtres. Or personne ne vérifie que cet entretien est correct ; certaines études laissent même penser que beaucoup de véhicules fonctionnent avec des filtres mal entretenus. À cela s’ajoute le fait que les pots catalytiques fonctionnent bien quand ils sont chauds, mais beaucoup moins bien quand ils sont froids. En tout état de cause, la tarification par le seul carburant ne serait pas suffisante. Cela renvoie à la question des péages urbains tels que celui qui est pratiqué à Stockholm.
S’agissant des particules émises par les moteurs à essence, nous avons encore des incertitudes sur la présence de particules encore plus fines. Notre connaissance des nuisances environnementales est liée à nos capacités techniques tant pour opérer les relevés que pour les évaluer.
Monsieur Barbier, vous m’avez interrogé sur les contours exacts de la catégorie des petites cylindrées. Malheureusement, je ne saurais même pas quoi vous dire pour ma propre Clio ! Je connais mal la nomenclature, je pense cependant que la direction est claire. Quant à la part du diesel dans les flottes professionnelles, elle est extrêmement élevée.
Mme la rapporteure. Non moins de 87 % !
M. Christian de Perthuis. L’avantage TVA dont ce type de véhicules bénéficie est, en effet, considérable. Quand je pilotais le Comité pour une fiscalité écologique, nous avions été invités à orienter notre attention non seulement vers la fiscalité des carburants, mais aussi vers la TVA applicable aux flottes professionnelles. En tout cas, la part des véhicules particuliers vendus à des flottes et des loueurs est en augmentation constante. Cette observation rejoint, me semble-t-il, les considérations sur l’achat de vieilles voitures par des jeunes.
Monsieur de Courson, la bonne neutralité fiscale suppose, en effet, de se fonder sur le contenu énergétique, et non sur le volume, des carburants. Il faut aller jusqu’à la parité. Plus précisément, dans la loi sur la transition énergétique, il est prévu que la valeur de la tonne de CO2 augmente jusqu’à s’établir à 100 euros en 2030. Cela correspond à une augmentation mécanique de 15 % de plus du diesel, plus riche en CO2 que l’essence classique. Mais il faut traiter séparément la question du CO2 et celle des pollutions sanitaires et locales.
Ces dernières ne peuvent être gérées en faisant seulement varier le coût du carburant. Il faut des mesures complémentaires, soit normatives, soit analogues au péage institué à Stockholm. S’agissant des normes, il est de notoriété publique que le système européen de normalisation ne reflète pas les conditions réelles d’utilisation des véhicules. Là est l’origine du scandale Volkswagen. Les États-Unis imposant des normes plus contraignantes, il était nécessaire, pour ainsi dire, de truander pour cette entreprise qui voulait entrer sur le marché américain. Nous ne devrions pas, de notre côté, connaître de scandale sur un logiciel français, car un constructeur comme PSA ne vend pas de véhicules aux États-Unis. Cette expérience nous apprend qu’il faut revoir la métrique pour la rapprocher des conditions réelles d’utilisation des véhicules, et adopter un dispositif de gouvernance qui reste à définir.
Au demeurant, compte tenu de la diversification attendue, il faudra élargir ce système de normes à tous les types de motorisation – essence, gaz, électricité –, tant pour les polluants locaux que pour le CO2. Même l’émission de CO2 liée aux véhicules électriques devra être calculée, dans une logique de prise en compte de la pollution « du puits à la roue ». Car si leur utilisation ne dégage pas de CO2, cela n’est pas le cas de leur production.
L’écart de fiscalité entre le diesel et l’essence n’est que la partie émergée d’une problématique plus complexe. Certes, la majorité des véhicules a basculé vers une motorisation alimentée par l’un ou l’autre de ces carburants, mais une transition est en cours vers d’autres types de motorisation. Nul ne peut dire à l’avance lesquels l’emporteront.
Les véhicules électriques ne sont certes pas taxés au titre de l’émission de CO2, mais la production carbonée de ces voitures est taxée par le système européen d’échanges de quotas de CO2. Il est aujourd’hui en fort mauvaise posture, puisque le prix du quota s’établit à 8 euros la tonne, même si ce prix remonte un peu. Cela va poser des problèmes dans les pays qui lèvent une taxe carbone nationale : en Irlande, en France, plus encore en Suède, où cette taxe est progressive. Nous allons observer un phénomène de ciseau, entre carburants soumis à une taxation carbone et carburants qui en resteront exemptés ; elle n’aura pas beaucoup de signification économique pour la filière.
Je conviens avec vous de l’anomalie que constitue la fiscalité du gaz. Mais la fiscalité des bioénergies est une anomalie plus grande encore. De manière ahurissante, la taxe carbone ne distingue pas entre le carbone d’origine fossile et le carbone d’origine biologique. Le biogaz, que nous commençons à valoriser en France avec beaucoup de retard, comporte du carbone à cycle court qu’il faut taxer différemment. Je crois que nous allons progresser en la matière.
J’observe, en deux mots, que derrière la question de la fiscalité de l’énergie se profile celle du financement des énergies renouvelables. Il faudra bien s’interroger sur la contribution au service public de l’électricité (CSPE), qui reporte sur une partie des consommateurs la charge de leur développement.
Monsieur Heinrich, les filtres sont, en effet, de plus en plus efficaces. C’est indubitable. Mais leur efficacité n’en est pas moins liée à leur mode d’utilisation et à leur entretien.
Je n’ai pas de compétence directe pour juger de l’impact que peut avoir sur la filière automobile une réforme de la fiscalité de l’énergie. Ne nous voilons pas la face : certaines filières d’approvisionnement automobile vont devoir se reconvertir, d’autres vont apparaître. L’industriel Bolloré a, par exemple, ouvert une nouvelle usine cette semaine. La question du rythme de l’évolution est cependant importante. Il me semble qu’une partie du produit fiscal supplémentaire doit effectivement financer la reconversion, car elle est toujours d’autant plus coûteuse qu’elle n’a pas été anticipée.
Monsieur Duron, je ne peux que partager votre avis sur l’abandon de l’écotaxe. Quant à l’usage qui doit être fait du produit de la fiscalité écologique, les économistes développent à son propos la notion de double dividende, parfois difficile à faire entendre au pouvoir politique, qu’il s’agisse de l’exécutif ou du législatif. Cette notion veut que l’augmentation de la fiscalité écologique aille de pair avec la baisse d’autres impôts. Cette baisse compensatoire doit elle-même porter sur les impôts pesant le plus sur la compétitivité des entreprises. C’est pourquoi une majorité d’économistes préconisent, non de réinjecter ces recettes nouvelles dans des politiques de transition énergétique, mais dans une baisse des charges qui pèsent sur le travail. Il s’agit cependant d’une règle qui peut ne pas être appliquée à 100 % : les économistes n’ont pas à se présenter devant les électeurs.
Aussi, les recettes nouvelles pourraient-elles en partie être dirigées vers un usage social. Les réformes fiscales sont, en effet, loin d’être neutres et renchérissent le coût de la vie. Or certains de nos concitoyens ne peuvent absorber cette hausse des coûts. Les recettes nouvelles pourraient aussi aller partiellement à la recherche et développement, et à des dépenses d’investissement en général, telles que des dépenses d’infrastructures. À cet égard, je vous avoue que je n’ai pas été horrifié de voir que le centime additionnel sur le gazole ait pu financer l’an dernier l’AFITF, même si, en économiste, j’aurais préconisé une baisse des charges sociales.
Monsieur Albarello, vous avez soulevé la question du biogaz. C’est sans doute dans ce secteur que l’on a fait le moins bien en France. J’avais eu l’occasion de me pencher sur le sujet lorsque je présidais le Comité pour la fiscalité écologique. Le système de tarification des déchets est complexe ; il n’envoie pas les bonnes incitations économiques. En ce domaine, la politique n’est pas suffisamment ambitieuse vis-à-vis du secteur agricole, qui a pourtant un incroyable potentiel de développement.
Beaucoup d’usages du gaz vont être favorisés, mais le résultat n’est pas le même, en termes écologiques, selon que le cycle de production du gaz biologique est court ou long. Il y a également beaucoup à faire dans le domaine de la mobilité. En zone urbaine, il apparaît que la tendance est favorable à la motorisation électrique. Mais, sur les longues distances, il n’y a pas beaucoup de solutions alternatives aux fossiles ; dans ce contexte, le biogaz est intéressant. En tout état de cause, la fiscalité du gaz naturel et du pétrole, énergies fossiles, doit être différente de celle du biogaz, qui constitue un substitut d’avenir possible à ces énergies, pour le transport de marchandises.
S’agissant de l’achat de vieilles voitures par des jeunes, je n’ai pas vu le reportage télévisé évoqué. Il est étonnant de constater que les plus de cinquante-cinq ans constituent désormais la majorité des acheteurs de véhicules neufs. Il n’y a plus de jeune pour acheter une voiture neuve. Le phénomène s’explique en partie par des aspirations différentes entre générations, mais aussi par les contraintes particulières auxquelles cette catégorie de la population se trouve soumise. Il y a pourtant des méthodes pour faire sortir du parc les vieux modèles de voiture, telles que la prime à la casse. Vu son coût pour l’État, cette dernière ne doit pas être employée de manière trop large, mais elle permettrait de retirer assez vite ces véhicules du parc automobile.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Monsieur le professeur, je vous remercie.
La séance est levée à dix-sept heures trente.
◊
◊ ◊
20. Audition, ouverte à la presse, de M. Joseph Beretta, président du conseil d’administration de l’Association nationale pour le développement de la mobilité électrique (AVERE France).
(Séance du mercredi 20 janvier 2016)
La séance est ouverte à onze heures trente-cinq.
La mission d’information a entendu M. Joseph Beretta, président du conseil d’administration de l’Association nationale pour le développement de la mobilité électrique (AVERE France).
Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente. Nous recevons ce matin M. Joseph Beretta, président de l’Association nationale pour le développement de la mobilité électrique, plus connue sous l’appellation AVERE-France. Créée en 1978 sous l’impulsion des autorités européennes, cette organisation est la « détentrice historique » de la propulsion électrique, aux origines très anciennes : on se souvient, par exemple, des premiers réseaux de tramways ou de trolleybus qui équipaient les grandes villes. L’originalité d’AVERE est de rassembler la majeure partie des acteurs participant à l’écosystème de la mobilité électrique – industriels, énergéticiens, chercheurs et collectivités publiques. M. Beretta dispose ainsi d’une vision transversale et constamment actualisée du secteur.
Si le véhicule électrique progresse, il ne représente encore que 1 % environ des ventes de véhicules neufs en France. Sa part de marché atteint toutefois un peu plus de 4 % si l’on y ajoute les différents modèles hybrides, dont les constructeurs multiplient les offres. L’usage du véhicule électrique retient plus particulièrement l’attention de la mission, car il représente une véritable rupture, notamment dans les villes, grâce au succès des systèmes d’utilisation partagée.
Des freins demeurent cependant. L’autonomie des véhicules pose toujours problème, tant en termes de durée d’utilisation que de modalités de recharge. La ligne de partage entre les différentes solutions techniques paraît encore confuse. Les batteries lithium-ion seront-elles dépassées par les batteries lithium-métal polymère, que produit aujourd’hui le groupe Bolloré ? Enfin, existe-t-il réellement une filière industrielle française du véhicule électrique, ou sommes-nous toujours tributaires d’importations, notamment asiatiques, voire de brevets étrangers, pour ses équipements-clés ?
M. Joseph Beretta, président du conseil d’administration de l’Association nationale pour le développement de la mobilité électrique (AVERE). Vous avez bien synthétisé, Madame la présidente, l’histoire de l’Association des véhicules électriques routiers européens, dont je représente la section française. Il existe également un échelon européen, AVERE-Europe, qui fédère les associations nationales de la mobilité électrique et dont je suis le vice-président. Nous sommes également en contact avec les associations homologues des continents américain et asiatique.
L’association AVERE-France a connu une grande mutation en 2008, avec le passage du véhicule électrique à la notion de mobilité électrique. Pour faire émerger cette mobilité, il ne faut pas, en effet, se concentrer sur le véhicule, mais rassembler tous les acteurs de la filière. C’est sans doute ce qui a manqué à la première génération de véhicules électriques, née vers 1995, lorsque seuls les constructeurs de véhicules et les énergéticiens la défendaient. Aujourd’hui, AVERE-France regroupe vraiment tous les acteurs, y compris les assureurs et les opérateurs de mobilité.
Réunissant quelque 140 membres, l’association mène trois types d’actions. Elle vise tout d’abord à ce que la mobilité électrique trouve sa place dans la mobilité de demain. Pour ce faire, elle formule des propositions d’évolution des textes législatifs et réglementaires, ainsi que des suggestions qu’AVERE-Europe fait remonter au niveau européen. Le deuxième défi est celui de l’information et de l’éducation : la mobilité électrique ne saurait remplacer du jour au lendemain la mobilité classique, après cent ans passés à utiliser du pétrole pour nous déplacer. Certains prérequis devant être intégrés pour que cette mutation s’opère dans de bonnes conditions, nous organisons des congrès et des manifestations au plus près des utilisateurs. Enfin, notre troisième axe est celui de la régionalisation. Nous œuvrons à l’émergence, dans les différentes régions, de relais d’associations comme les nôtres – qui soient également au plus près des acteurs industriels et territoriaux. Nous sommes convaincus que la mobilité électrique est durable et a du sens pour les années futures.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Que pensez-vous de l’étude de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) relative à l’analyse du cycle de vie (ACV) et au bilan carbone global de la voiture électrique ?
Comment voyez-vous l’avenir proche de la performance des batteries et de leur durée d’autonomie ? Sur quels segments d’usage le développement potentiel de la voiture électrique est-il pertinent ? Ce développement est-il circonscrit, comme certains l’affirment, à un usage urbain ?
Lorsque j’étais ministre de l’écologie, j’ai lancé le financement des bornes de recharge par le programme d’investissements d’avenir (PIA). Leur installation, qu’il s’agisse des bornes de recharge rapide ou moins rapide, progresse-t-elle, ou bien connaît-elle un certain retard ?
Enfin, les règles applicables aux bonus ne cessent de changer. Au 1er janvier 2014, le bonus est passé de 7 000 à 6 300 euros pour les véhicules électriques, de 4 000 à 3 300 euros pour les véhicules hybrides et de 5 000 à 4 000 euros pour les hybrides rechargeables. Au 1er janvier 2015, il a encore été ramené de 3 300 à 2 000 euros pour les véhicules hybrides. Puis, au 1er janvier 2016, il est passé de 2 000 à 750 euros pour les véhicules hybrides et de 4 000 à 1 000 euros pour les hybrides rechargeables, alors que les ventes de véhicules hybrides ont augmenté de 41 %, que celles de véhicules hybrides rechargeables ont triplé et que celles de véhicules électriques ont augmenté de 70 % – même si elles ne représentaient encore que 11 779 unités. Que pensez-vous de cette instabilité récurrente des dispositifs de soutien public ?
M. Joseph Beretta. L’instabilité des dispositifs concernant les aides, tant fiscales que directes, pose problème aux industriels comme aux réseaux de vente. Cela étant, il faut être conscient du fait que le système de bonus n’est pas voué à durer éternellement. Il convient aussi de faire des projections de marché pour les années à venir et de préparer l’arrivée sur le marché de l’occasion des premiers véhicules électriques, car le marché automobile, pour perdurer, a besoin d’un marché de l’occasion digne de ce nom.
À la fin de l’année 2015, nous avions immatriculé 22 187 véhicules particuliers et utilitaires légers électriques à batterie, ce qui représente certes une progression de 60 %, mais seulement 1 % du marché. En Norvège, le véhicule électrique représente plus de 17 % du marché, et ce pays poursuit ses aides à l’achat : ayant atteint l’enveloppe qu’il s’était fixée, il l’a multipliée par deux, si bien que le marché norvégien va probablement continuer à se développer au même rythme. Il serait idéal que le marché français atteigne un tel niveau, en incluant dans ce pourcentage les véhicules à batterie et hybrides rechargeables. Nous n’en sommes pas là, mais notre association fait tout son possible pour y parvenir.
Quant aux bonus, ils me paraissent nécessaires, dans cette phase de maturation du marché, pour garantir l’équation économique de la mobilité électrique, en attendant que le coût des composants de base baisse.
Cette remarque me conduit à évoquer la performance des batteries, qui occupent le premier poste de coût d’un véhicule à traction électrique. Une batterie valant aujourd’hui dans les 10 000 euros, l’aide de l’État, qui s’élève à 6 300 euros, couvre un peu plus de 50 % de son coût. Celui-ci, selon les projections des constructeurs, devrait diminuer de moitié d’ici à 2020, et les performances des batteries augmenter. Mais les constructeurs se trouvent face à un dilemme : soit ils maintiennent le niveau de performance actuel, et le coût des batteries pourra être divisé par deux ; soit ils augmentent cette performance, et le coût diminuera dans une moindre mesure. Toutes les études que nous avons menées démontrent que l’acheteur fixe à 200 ou 250 kilomètres le seuil d’autonomie au-delà duquel il juge intéressant d’acquérir de tels véhicules. Or, l’autonomie est actuellement comprise entre 120 et 150 kilomètres, et Nissan et Renault annoncent que leur prochaine génération de véhicules atteindra les 200 kilomètres pour un coût légèrement supérieur au coût actuel puisque les gains dus à la réduction du coût des batteries n’ont pas encore été enregistrés. Le bonus est donc nécessaire pour garantir une bonne équation économique, mais le sera moins dans les années à venir. On peut donc programmer la fin du dispositif, mais il convient néanmoins de garantir la stabilité de la mesure.
Les différences de bonus entre véhicules hybrides rechargeables et véhicules électriques peut se justifier, d’une part, par la part de marché que cela représente – 3 % pour les véhicules hybrides et 1 % pour les véhicules électriques – et, d’autre part, par les bénéfices environnementaux des deux dispositifs. L’hybride rechargeable n’a été introduit en France qu’en 2012-2013, le véhicule électrique l’a été en 2010. Quant au parc roulant des hybrides rechargeables, il est de l’ordre de 8 000 véhicules, quand celui des véhicules électriques à batterie – utilitaires légers et particuliers – est de l’ordre de 85 000, y compris les 10 000 véhicules du parc roulant de première génération. Du fait de sa fonctionnalité d’usage, l’hybride rechargeable devrait atteindre les volumes de l’hybride classique.
Introduit en juin 2015, le super-bonus a très bien fonctionné, puisqu’il a entraîné un changement radical dans le comportement des acteurs. Alors que, avant cette date, c’étaient principalement des entreprises qui achetaient des véhicules électriques, le super-bonus, davantage ciblé sur les particuliers, a permis d’inverser la tendance, de sorte qu’à la fin de l’année 2015 on comptait pratiquement autant de voitures électriques achetées par des particuliers que par des entreprises. Ce super bonus est très bénéfique à l’environnement, puisque les vieux véhicules diesel sont mis au rebut et remplacés par des véhicules n’émettant ni gaz polluants, ni CO2 ni particules issues des freins et des pneus.
Notre association a été très surprise de la publication de l’étude ACV de l’ADEME, avec laquelle nous avons longuement dialogué à ce sujet. Je crois que cette étude a dépassé la portée du message sur lequel l’Agence souhaitait communiquer. L’ADEME étant très stricte d’un point de vue scientifique, elle a appliqué les mesures réglementaires de calcul d’ACV, qui ne prennent pas en compte tous les bénéfices annexes du véhicule électrique, tels que la durée de vie réelle des batteries. Les principales données dont nous disposons, qui nous proviennent du plus grand fournisseur de voitures électriques, le groupe Nissan, sont assez encourageantes : les batteries au lithium ont très peu perdu en performance, ce qui laisse augurer de durées de vie de l’ordre de dix ans. De plus, une batterie que l’on extrait d’un véhicule au terme de ces dix ans peut encore servir pendant cinq ans dans des applications stationnaires. Une batterie a donc une durée de vie totale de quinze ans, ce qui diminue sensiblement son impact environnemental et donc la pertinence de l’étude de l’ADEME, qui s’en tient à dix ans de durée de vie.
D’autre part, l’étude ACV ne prend pas en compte les bénéfices liés à la qualité de l’air. Les mesures réglementaires incluent les émissions de CO2, l’eutrophisation et certaines pollutions principalement dues aux batteries. Or, lorsque l’on examine l’étude en détail, on s’aperçoit que l’écart entre un véhicule thermique et un véhicule électrique s’explique par le poids de la batterie. Par conséquent, plus l’on fait baisser ce poids, plus le véhicule électrique devient comparativement intéressant.
Outre la possibilité d’allonger la durée de vie de la batterie, il convient aussi de prendre en compte la faculté de la recycler. On a souvent montré du doigt le carbone et le lithium contenu dans une batterie. Mais si le lithium n’est, aujourd’hui, pratiquement pas recyclé, c’est parce que le nombre de batteries reste insuffisant. Le principal usage de ce matériau est le fait de la verrerie, mais il est tellement dispersé dans le verre qu’il n’est pas recyclable. L’arrivée sur le marché de plus grandes quantités de batteries permettra donc de recycler le lithium pour fabriquer d’autres batteries – mais il faudra encore quinze ans pour qu’on y parvienne. Les autres composants « nobles » et métaux rares de la batterie sont déjà recyclés. Restent le carbone et le graphite, mais il existe des procédés de substitution pour les remplacer et limiter ainsi l’impact environnemental des batteries.
S’agissant des émissions de CO2, l’étude de l’ADEME s’appuie sur des calculs que je qualifierai d’« interprétables »... En essayant de définir à partir de combien de kilomètres la quantité de CO2 émise par un véhicule électrique serait acceptable par rapport à celle émise par le véhicule thermique, l’Agence a dérogé aux règles de l’analyse du cycle de vie, qui ne peut être interrompue en cours de route puisqu’on ne peut dresser de bilan qu’en fin de cycle. Or, au bout de quinze ans, le bilan d’un véhicule électrique est bien plus positif que celui d’un véhicule thermique.
J’en viens à présent à ma vision de l’avenir. J’ai déjà évoqué l’évolution de la performance des batteries, qui va doubler la distance pouvant être parcourue sans recharge par un véhicule électrique, et donc permettre au marché de poursuivre son développement. C’est le signe que la mobilité électrique entre dans les mœurs et va trouver sa juste place. Vous avez affirmé que le véhicule électrique était pertinent en milieu urbain, mais il n’y a pas que là qu’il le soit.
Mme la rapporteure. Ce n’est pas moi qui l’affirme : c’est ce qu’on entend dire.
M. Joseph Beretta. C’est effectivement ce qu’on entend. C’est pourquoi notre association se bat, dans le cadre de ses actions d’éducation et d’information, pour expliquer que le véhicule électrique est tout aussi pertinent – voire plus pertinent – en milieu rural puisque, celui-ci étant majoritairement pavillonnaire, l’installation de prises de charge ou de wallbox n’y pose aucun problème. En milieu urbain dense, c’est plutôt l’auto-partage que la voiture électrique particulière qui s’est développé, du fait d’un problème d’infrastructures. Nous soutenons donc grandement toutes les actions visant au développement de ces infrastructures, qui doivent être menées de concert. À la fin de l’année 2015, on comptait quelque 10 161 points de charge accessibles au public. J’appelle d’ailleurs votre attention sur la distinction entre bornes et points de charge, ces derniers étant des prises tandis qu’une borne peut regrouper plusieurs prises. Ne sont pas comptés, parmi ces 10 161 points de charge, ceux qui sont installés à domicile ou dans des lieux fermés au public – entreprises ou administrations.
Le déploiement des infrastructures, dont nous présentons sur notre site un bilan régulier, est en bonne voie : seules six ou sept régions restent encore peu dotées en points de charge, ayant du mal à s’engager dans la voie de la mobilité électrique. Les autres régions ont complètement basculé dans cette voie et commencent à mailler leur territoire. À cela s’ajoute l’action lancée par l’État et menée par de grands opérateurs nationaux, dont deux sont aujourd’hui identifiés : le groupe Bolloré, qui prévoit de développer 16 000 points de charge de sept kilowatts d’ici à 2017-2018, et la Compagnie nationale du Rhône (CNR), 52 points de charge rapide. L’avantage des points de charge de sept kilowatts est d’offrir une charge certes normale, mais quelque peu accélérée puisque tenant compte de l’évolution des batteries. En effet, il faut six à sept heures pour recharger des batteries ayant une autonomie de 150 kilomètres sur des bornes de trois kilowatts ; lorsque les batteries tiendront 250 kilomètres, il faudra dix à douze heures pour les y recharger, d’où la nécessité d’implanter des bornes de sept kilowatts. Enfin, le déploiement des infrastructures financées par l’État et installées par les collectivités territoriales comprend de nombreux points de charge accélérée à 22 kilowatts.
Parallèlement, la charge rapide se développe aussi : un grand projet partiellement financé par l’Union européenne va couvrir le continent de points de charge rapide, de 45 à 150 kilowatts. EDF, opérateur du projet pour la France, installera 200 de ces points de charge sur les autoroutes françaises ou à leurs abords.
Le maillage du territoire en bornes est donc en cours, de sorte qu’en 2017, le déploiement des infrastructures devrait être en phase avec le parc roulant tel qu’il se sera développé. Encore faut-il ajouter, à tous ces points de charge publics, les points de charge privés, car lorsqu’un particulier achète une voiture électrique, le premier de ses réflexes est de se demander où il va la brancher chez lui. C’est pourquoi nous œuvrons activement pour que l’accès au droit à la prise, aujourd’hui reconnu par la loi, soit facilité dans les immeubles de copropriété – les copropriétaires devant aujourd’hui attendre l’assemblée générale de copropriété, soit parfois jusqu’à un an, pour exprimer leur volonté d’installer une prise, et les coûts d’installation étant entièrement à leur charge, ce qui n’est pas logique. Nous prônons le même mode de financement que pour le câble : le pré-câblage est pris en charge par la collectivité, à la suite de quoi chacun paie son raccordement au câble. C’est déjà le cas dans les immeubles neufs, où le pré-câblage est obligatoire.
Mme la présidente m’a demandé si le lithium-métal polymère allait prendre le dessus sur le lithium-ion. Ces deux technologies fonctionnent différemment. La technologie lithium-ion a un électrolyte liquide et fonctionne à température ambiante. Le lithium métal polymère a un électrolyte solide, de sorte que, pour activer la conduction ionique, on est obligé de chauffer le lithium à 80 degrés. Les voitures Bolloré qui utilisent ce type de batteries ont donc besoin de rester branchées pour maintenir leur batterie à température. Leur usage en est ainsi limité. Ce système fonctionne bien pour un usage en libre-service ou une flotte d’entreprise, car les véhicules revenant systématiquement à leur lieu de stationnement et de recharge et sont prêts à repartir le lendemain avec une batterie chaude : lorsqu’une batterie au lithium métal polymère refroidit, il faut quand même attendre six à sept heures ! Les deux technologies sont à peu près au même niveau de performance : le lithium polymère est plus énergétique, mais moins puissant que le lithium-ion. C’est pourquoi ce dernier est aujourd’hui la seule solution possible pour les applications de véhicules hybrides ou hybrides rechargeables, qui nécessitent peu d’énergie mais beaucoup de puissance.
M. Philippe Duron. Vous avez indiqué tout à l’heure que vous représentiez la branche française d’une association européenne, et fait allusion à la Norvège qui s’est équipée d’un parc de véhicules électriques plus important que le nôtre. Quelles sont les stratégies des différents États européens en la matière ? Leurs résultats sont-ils probants ?
Vous avez en outre rappelé que la promotion de la voiture électrique avait été un fiasco il y a une quinzaine d’années, notamment parce qu’il n’était pas possible de la revendre d’occasion. Sachant que la moyenne d’âge des acheteurs de voitures neuves se situe aujourd’hui autour de 55 ans, ne conviendrait-il pas d’instaurer une aide de l’État à l’achat de véhicules électriques d’occasion, afin qu’un marché de l’occasion réussisse à s’implanter avec succès ?
Enfin, vous avez souligné qu’il ne fallait plus parler de « voiture » électrique, mais de « mobilité » électrique. Toutefois, vous n’avez pas abordé la question du fret. On sait qu’en France les premiers camions poubelles électriques ont été mis en circulation à Paris par la société Sita, et que le « dernier kilomètre » de livraison se fait de plus en plus à l’aide de véhicules électriques. Où en est le fret électrique aujourd’hui ? Que préconise votre association en la matière ?
M. Charles de Courson. Le véhicule électrique ne représente aujourd’hui qu’1 % du marché, soit une petite flotte. Mais si l’on projette d’atteindre 10 % du parc, on risque, avec le montant de l’aide actuelle, de faire exploser le budget de l’État. Ce montant, qui est tout de même de 10 000 euros par véhicule, est-il justifié au regard des avantages que procure le véhicule électrique ? Et a-t-on tenu compte, dans les analyses du cycle de vie, de l’origine de l’électricité consommée, sachant qu’en France 82 % de cette électricité est produite à partir d’énergie nucléaire, 14 % à partir d’énergies renouvelables et 4 % à partir d’énergie thermique ?
D’autre part, le grand problème technologique auquel on se heurte depuis cinquante ans est celui des batteries. On peut les améliorer un peu, mais les spécialistes considèrent qu’aucune rupture technologique n’est prévisible dans les quinze ans à venir. Dès lors, comment justifier une politique extrêmement coûteuse au regard des économies réalisées ? On pourrait tout aussi bien consacrer de telles sommes d’argent à l’amélioration des véhicules thermiques ou hybrides – cette dernière solution étant l’une de celles qui, si je puis dire, « tient la route » le mieux.
M. Gérard Menuel. On voit bien que le marché évolue au gré des interventions publiques, qu’elles prennent la forme de réductions de taxes ou d’aides à l’achat. C’est pourquoi on constate des écarts importants, allant de 1 à 17, entre les parts de marché du véhicule électrique dans les différents pays de l’Union européenne.
Vous avez indiqué que la recherche avançait et que le coût des batteries allait pouvoir baisser de moitié. Mais la recherche sur les véhicules thermiques évolue également. J’ai notamment l’impression que, chez PSA, les montants consacrés à la recherche sont beaucoup plus importants pour baisser la consommation ou pour limiter l’émission de polluants que dans le secteur électrique. Cela veut dire que la concurrence perdurera en termes de performance. Demain, les véhicules thermiques consommant « deux litres aux cent » auront 1000 kilomètres d’autonomie et des modes de filtration beaucoup plus performants. Le véhicule électrique n’est donc pas seul à évoluer vers des solutions heureuses pour l’environnement et le consommateur. N’est-on pas trop optimiste en affirmant que demain, il représentera 10 à 15 % du marché ?
M. Joseph Beretta. Je commencerai par aborder la stratégie des différents États européens. La Norvège est aujourd’hui le premier marché du véhicule électrique, devant la France, puis l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas – peloton de tête des États dans lesquels la mobilité électrique croît. L’Allemagne fait néanmoins exception puisqu’elle n’accorde aucune aide directe à l’achat de véhicules électriques. La Norvège applique de nombreuses exonérations fiscales : les voitures thermiques, surtout celles roulant au diesel, sont tellement taxées qu’une Audi TT coûte beaucoup plus cher qu’une Tesla !
M. Charles de Courson. L’électricité norvégienne est massivement produite à partir de l’hydraulique, c’est-à-dire une énergie renouvelable, à des prix extrêmement bas.
M. Joseph Beretta. Tout à fait. La Norvège est aussi un des principaux producteurs de pétrole européens.
En plus des aides fiscales, la Norvège octroie aux utilisateurs de véhicules électriques de nombreux avantages en termes de stationnement et d’accès aux zones à péage et aux couloirs de bus – ce dernier avantage commençant d’ailleurs à provoquer des embouteillages. Tout n’est donc pas bon à prendre en Norvège !
L’Allemagne, qui privilégie plutôt les aides aux constructeurs qu’aux acheteurs, est le troisième marché de la voiture électrique, même si l’Angleterre est en train de la rattraper rapidement, ayant institué des aides à l’achat et quelques avantages d’accès aux zones à péage et à certaines zones interdites aux véhicules les plus polluants. Enfin, les Pays-Bas offrent des aides à l’achat. Dans les autres pays, les actions menées sont plus disparates, et souvent minimes.
S’agissant du marché de l’occasion, il est clair que les acheteurs de véhicules neufs sont aujourd’hui, pour une grande part, soit des particuliers de plus de 55 ans, soit des entreprises et des sociétés de location de courte ou longue durée. Cela pose problème, car si les particuliers gardent longtemps leur véhicule, les entreprises et les sociétés de location revendent les leurs au bout de quatre ou cinq ans. La majorité des véhicules électriques vendus en 2012-2013, qui étaient destinés à la location, vont donc arriver sur le marché de l’occasion, et nous serons alors confrontés au problème de leur valeur résiduelle, valeur actuellement estimée soit par le constructeur, soit par le loueur. Tant que les volumes concernés sont faibles, la question reste secondaire, mais si les volumes augmentent, le loueur va l’examiner de plus près. Il faut donc absolument que la valeur résiduelle soit en adéquation avec l’équilibre du marché, tout en tenant compte de la disparité entre les aides accordées
– 5 000, 7 000 ou 10 000 euros. L’écart risquant d’être parfois faible entre le prix d’une voiture neuve bénéficiant d’aides et celui d’une voiture d’occasion, il conviendrait d’instaurer, non pas une aide directe, mais plutôt un crédit d’impôt pour que l’acheteur particulier ait intérêt à acheter un véhicule d’occasion et que l’existence d’un marché de l’occasion garantisse la pérennité de la filière.
La question du fret me tient beaucoup à cœur. Nous avons d’ailleurs, au sein de notre association, un groupe de travail consacré à la « livraison du dernier kilomètre » qui comprend notamment des logisticiens. Il convient, à ce sujet, de distinguer les livraisons en ville du transport entre les plateformes et les villes – pour lequel il existe une offre de véhicules utilitaires légers, mais pas encore d’offre de véhicules électriques de type fourgon.
La livraison du dernier kilomètre est confrontée à un problème majeur de la logistique du transport : l’absence d’autorité centrale pour orchestrer les livraisons. Des expérimentations ont été réalisées, à La Rochelle et à Paris, consistant à regrouper en plateformes plusieurs transporteurs. Mais cela reste encore assez difficile. Il faudrait que la profession opère elle-même sa mutation pour que l’on puisse promouvoir cette mobilité électrique. Aujourd’hui, il arrive que des livreurs viennent en centre-ville avec un camion de 3,5 tonnes, voire un semi-remorque, même si les restrictions à la circulation sont de plus en plus importantes. Seules se développent actuellement les initiatives ponctuelles de quelques gros clients, comme Monoprix, qui souhaitent « verdir » leur image en faisant livrer leurs supérettes par des camions électriques. Sur ce sujet, ce n’est pas l’État qui a la main, mais les collectivités locales : c’est à elles qu’il appartient d’imposer ou de rendre avantageuse la livraison électrique, par exemple en lui accordant des plages horaires élargies et des zones de livraison dédiées et équipées de bornes de recharge rapide. Comme vous le voyez, tout est à faire, et nous achoppons sur le fait que les acteurs de la logistique de transport sont encore très contraints par les coûts d’usage et d’exploitation liés au pétrole. Ils ont aujourd’hui un peu plus de marges, mais cela ne saurait durer indéfiniment : il faut qu’ils saisissent le moment actuel pour investir.
Monsieur de Courson m’a demandé s’il ne vaudrait mieux pas accorder des aides à d’autres formes de mobilité qu’à la mobilité électrique. Rappelons que le principal problème actuel est celui de la qualité de l’air en milieu urbain, qui est fonction des émissions polluantes des gaz d’échappement des véhicules, mais aussi des particules de freinage. Une étude de l’ADEME a d’ailleurs montré que la part relative des particules de freinage augmentait dans la mesure où, contrairement aux moteurs, les systèmes de freinage n’avaient guère connu d’amélioration – en dehors de la possibilité d’y installer des aspirateurs. Or, nous avons calculé que la voiture électrique émettait 80 % de particules de freinage de moins qu’un véhicule thermique. Ce calcul vaut également pour les véhicules hybrides, dont le freinage se fait essentiellement en mode électrique sans recourir aux plaquettes ni aux disques de frein. Ainsi, non seulement la voiture électrique n’émet aucun polluant atmosphérique, mais elle émet aussi beaucoup moins de particules de freinage. Et, s’il me semble effectivement difficile aujourd’hui de parvenir à 10 % de voitures électriques sur l’ensemble du parc, il est possible d’atteindre 10 % des ventes.
M. Charles de Courson. Si l’on atteint les 200 000 véhicules et que l’aide à l’achat est maintenue à 10 000 euros, elle représentera une charge budgétaire de 2 milliards d’euros.
M. Joseph Beretta. Certes, mais l’aide est en train de diminuer et n’est pas faite pour durer indéfiniment. Elle sert à asseoir le marché. Les véhicules hybrides représentant 3 % du marché, il est normal que l’aide accordée à leurs acheteurs diminue, d’autant que l’on s’attend à une baisse du coût des batteries et à un accroissement de leur performance.
Les batteries ne connaîtront effectivement aucune révolution technologique. Mais nous entrons dans la phase d’apprentissage industriel de tous les composants de la voiture électrique, qui ont à peine cinq à six ans d’historique de fabrication, donc de réduction des coûts industriels et d’optimisation de l’ensemble. Le doublement annoncé de l’autonomie des batteries suppose une meilleure exploitation de celles-ci. Aujourd’hui, lorsqu’on connaît mal la technologie, on prend des marges de sécurité en évitant de trop décharger sa batterie. Mais à mesure qu’on maîtrise mieux la technologie, on réduit ces marges. Des gains d’autonomie peuvent donc déjà être obtenus, sans changement technologique, grâce à une meilleure exploitation de la batterie.
Une deuxième évolution vise à mieux fabriquer la batterie et à optimiser l’usage des matières actives qu’on y intègre sans en accroître la quantité, en augmentant les surfaces d’échange ionique grâce à des technologies de type fractal. Ces évolutions technologiques sont en cours.
Enfin, la dernière voie consiste en l’amélioration du packaging extérieur à la batterie – réduction de son poids et du coût d’assemblage. Tout cela nous conduit à affirmer qu’en 2020, le coût de la batterie sera divisé par deux. Il existe donc des pistes d’amélioration sans que l’on puisse parler de révolution ni de nouveau couple batterie. De toute façon, même si un nouveau couple batterie – lithium-silicium, par exemple – était introduit dans les véhicules, il devrait d’abord passer de la phase de recherche à la phase industrielle, ce qui prend un peu de temps. En revanche, la phase industrielle du lithium-ion a été lancée ; de plus en plus d’unités vont être fabriquées de sorte que leur coût va diminuer.
Vous avez également abordé la question de la recharge électrique et du mode de production de l’électricité. La France doit effectivement se préparer à mieux utiliser la recharge de la voiture électrique. Si cette dernière atteint les 10 % du parc, il nous faudra changer drastiquement les modes de recharge – ce qui représente à la fois un défi et une chance.
Un défi, car il ne faut pas imposer au réseau l’utilisation du charbon pour pouvoir répondre à la demande de la voiture électrique. C’est pourquoi nous prônons une recharge intelligente : les bornes de recharge doivent pouvoir communiquer avec le réseau de façon à pouvoir y échanger de l’information et y renvoyer de l’énergie.
Une chance, car plus il y aura de véhicules en circulation, plus il y aura de batteries sur roulettes, qui pourront être utilisées par le réseau comme systèmes de stockage. L’Allemagne a assez bien compris que, lorsqu’on utilise des énergies renouvelables, il faut s’intéresser à leur stockage, qui peut s’effectuer soit grâce à l’hydrogène, soit grâce aux batteries. Mais tout est encore à construire s’agissant des batteries, qu’il s’agisse du modèle technique, puisqu’il faut des chargeurs réversibles, ou du modèle économique, puisque le coût d’utilisation de la batterie à l’arrêt du véhicule doit être remboursé à l’utilisateur.
L’hybride semble être le Graal ! Et l’hybride rechargeable être le modèle le mieux adapté à nos contraintes futures puisqu’il a la capacité de traverser les villes en tout électrique et de faire de la longue distance. Le véhicule électrique nous conduit cependant à ne plus raisonner en termes de véhicule, mais en termes d’usage. Le véhicule le plus adapté aux petits trajets quotidiens, inférieurs à 200 kilomètres par jour, est le véhicule électrique ; pour des trajets de longue distance, le véhicule thermique restera utile ; pour des trajets mixtes, le meilleur véhicule sera hybride ou hybride rechargeable.
Il n’y a pas vraiment de concurrence entre le véhicule électrique et le véhicule thermique : c’est la question de l’usage qui permet de trancher entre les deux. Les véhicules thermiques vont continuer à évoluer. Si les constructeurs investissent beaucoup dans ces véhicules, c’est parce qu’ils représentent encore plus de 90 % de leurs revenus. Mais leur coût est appelé à augmenter, car ils vont devoir être équipés de systèmes de dépollution de plus en plus complexes et contraignants. Tous les modèles diesel seront ainsi équipés de systèmes de traitement des oxydes d’azote à l’urée, ce qui contraindra l’utilisateur à faire à la fois le plein de carburant et d’urée. Quant aux véhicules à essence, leurs systèmes d’échappement devront être équipés de filtres à particules. C’est pourquoi, si les véhicules thermiques ont l’avantage d’avoir un volume de production suffisant pour que le coût de leurs composants soit minimisé, leur coût risque d’augmenter. Il sera donc impossible de parvenir à construire des véhicules thermiques, destinés à transporter des personnes ou des familles, qui ne consomment qu’un litre aux cent kilomètres. Or, un véhicule électrique consomme l’équivalent d’1,5 litre. Quant aux moteurs hybrides, ils permettront de faire baisser la consommation des véhicules et l’hybride rechargeable me semble très adapté.
Mme la rapporteure. Quels sont les coûts d’usage comparés de ces différents véhicules ?
M. Joseph Beretta. Pour un usage de l’ordre de 10 000 kilomètres par an, un véhicule électrique ne coûte pas plus cher qu’un véhicule diesel, si l’on tient compte des aides de l’État – d’un montant de 6 300 euros actuellement.
Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente. Nous vous remercions de vos explications détaillées.
La séance est levée à douze heures trente-cinq.
◊
◊ ◊
21. Audition, ouverte à la presse, de MM. Jean-Marc Jancovici et de Alain Grandjean, associés fondateurs de Carbone 4, cabinet de conseil spécialisé dans la stratégie carbone.
(Séance du mardi 26 janvier 2016)
La séance est ouverte à seize heures trente-cinq.
La mission d’information a entendu MM. Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean, associés fondateurs de Carbone 4, cabinet de conseil spécialisé dans la stratégie carbone.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Nous accueillons messieurs Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean, en leur qualité d’associés-fondateurs du cabinet de conseil et d’expertise Carbone 4.
Ce cabinet, qui a presque dix ans, est un spécialiste incontestable des bilans carbone. Mais ses deux cofondateurs, l’un et l’autre polytechniciens d’origine, ont par leurs interventions et leurs écrits un rôle important d’animateurs du débat sur la transition énergétique et, plus généralement, sur la conciliation de l’écologie avec les activités productives.
Leur approche des problèmes semble assez voisine des orientations de la fondation Nicolas Hulot, même si Carbone 4 est une structure totalement indépendante. Par exemple, monsieur Grandjean a été président du comité des experts du débat national sur la transition énergétique. Ainsi, c’est à titre de grands experts que nous avons souhaité entendre messieurs Jancovici et Grandjean. Nos interrogations dépasseront donc les seules spécialités du cabinet Carbone 4.
Ce qu’il est convenu d’appeler l’« affaire Volkswagen », puis, à présent, les difficultés d’autres constructeurs à respecter des niveaux d’émission qu’ils annoncent pourtant sur certains véhicules, posent de sérieux problèmes. Une perte de crédibilité risque d’entacher la réputation de tout un secteur. En tout cas, ces événements perturbent les consommateurs.
À cet égard, le choix de la motorisation diesel est devenu hasardeux à bien des points de vue, d’autant que le régime de taxation de ce carburant est appelé à s’alourdir. Nous aimerions obtenir de votre part une analyse sur la validité des politiques conduites sur les pollutions atmosphériques, notamment en zone urbaine. Sur ce point, les enjeux de la mobilité restent déterminants.
Au-delà des rejets de CO2, comment et à quel rythme revient-il de traiter les questions relatives au NOx et aux particules fines, c’est-à-dire des problématiques au moins aussi sensibles, mais dont le public ne découvre les impacts que depuis peu ?
Messieurs, nous allons, dans un premier temps, vous entendre au titre d’un exposé de présentation. Puis, madame Delphine Batho, notre rapporteure, vous posera un premier groupe de questions. Enfin, les autres membres de la mission d’information vous interrogeront à leur tour.
M. Jean-Marc Jancovici, associé fondateur de Carbone 4. Nous nous partagerons l’exposé de présentation, Alain Grandjean et moi-même. Je replacerai la problématique des transports dans la stratégie générale Énergie-climat ; il vous fera part d’éléments plus pragmatiques.
Quelle est la part des transports dans la problématique du climat ? L’évolution des choses dépend-elle de notre bon vouloir ou sommes-nous soumis à des contraintes externes ? Pour entamer ce cadrage macroscopique, voici quelques éléments à avoir en tête : il faut s’attendre à ce que la récession appartienne au paysage structurel, interdisant de recourir à des mesures gourmandes en capitaux ; la production de pétrole restera contrainte, ce qui ne signifie pas que sa consommation va augmenter en France ; le raffinage continuera, comme par le passé, à donner du diesel en même temps que de l’essence. À cet égard, la prohibition du diesel nous laisserait donc sans solution pour 30 % du pétrole utilisé sur la terre.
Au mois de décembre 2015, l’accord de Paris sur le climat a été salué comme un grand succès diplomatique. J’ai publié à ce sujet une chronique dans Les Échos intitulée de manière taquine : « Victoire ! Tout reste à faire ». Si vous observez les chiffres publiés par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), vous constaterez que 2 000 milliards de tonnes de CO2 ont été émises dans l’atmosphère depuis 1850. Le pétrole n’est pas seul en cause, puisque ces émissions sont également imputables au charbon, à la déforestation ou au gaz. À l’époque du sommet de Copenhague, certaines associations écologistes prétendaient que le pétrole tue le climat ; en réalité, il y contribue, mais d’autres facteurs agissent aussi.
Le GIEC a mis en relation ces émissions avec l’augmentation de la température planétaire. Compte tenu de l’inertie du système climatique, notamment dans ses compartiments océanique et cryogénique –les calottes polaires–, nous savons déjà qu’une augmentation de 1,2° est acquise pour 2100, à plus ou moins un demi-degré près.
Pour que l’augmentation cumulée ne dépasse pas 2 °d’ici 2100, il faudrait en tout cas que l’émission totale de CO2 ne dépasse pas 3 000 milliards de tonnes depuis 1850. Vu que 2 000 milliards de tonnes de CO2 ont déjà été émises, une simple soustraction vous indique qu’il ne faudra pas dépasser 1 000 milliards de tonnes de CO2 d’émissions supplémentaires d’ici 2050. Or, les émissions précédentes ont eu lieu alors que la planète ne comptait qu’entre un milliard et sept milliards d’habitants, qui ne possédaient majoritairement pas de voiture ou du pouvoir d’achat pour acquérir des billets d’avion à prix cassé. Jusqu’en 2100, la planète portera plutôt entre sept et neuf milliards d’habitants.
Nous devons donc diviser par trois les émissions mondiales d’ici 2050. En France, le volume des émissions devra même être divisé par cinq pour s’approcher d’une moyenne par habitant plus proche de la moyenne mondiale. Pour cela, il faudra frapper ailleurs que dans la production électrique nationale, peu carbonée. Je dois donc vous dire que, dans le débat national sur la transition énergétique (DNTE), on s’est trompé de problème à l’entrée.
Observons maintenant les diverses origines des émissions mondiales de CO2. Un cinquième, ou plus précisément 21 %, provient des centrales à charbon, première source de production d’électricité au monde. Ce volume s’est accru, en quatorze ans, quinze fois plus vite que le photovoltaïque. Il y a peu, la Chine mettait encore en service l’équivalent d’un EPR (European Pressurized Reactor) par semaine en capacité de centrale à charbon. L’explosion de la production d’énergie électrique au charbon est le fait marquant des dernières années. Cumulées, ces centrales à charbon représentent une puissance installée de 1 800 gigawatts, contre seulement 63 gigawatts de capacité nucléaire installée en France.
D’autres centrales électriques fonctionnent quant à elles au gaz et au pétrole, à hauteur de 6 %. La production d’électricité à base d’énergie fossile représente donc 27 % du total de l’énergie électrique produite dans le monde. À la lumière de cette observation, force est de se demander si, dans les transports, le mode de propulsion électrique est toujours une affaire sur le plan climatique. Dans une étude récente, nous avons pu prouver que les émissions dues à un tram électrique, en particules en CO2, peuvent être équivalentes à celle d’une ligne de bus au diesel, à ceci près que les émissions n’ont simplement pas lieu au même endroit.
Si nous poursuivons, nous nous apercevons que 5 % des émissions de CO2 sont imputables aux cimenteries. Le reste de l’industrie, en représentent 10 %, (dont les aciéries, pour 4% ou 5 %) et les chaudières de bâtiment 6 %.
Les transports dans le monde ne sont donc la cause que de 13 % des émissions de CO2. Ils ne constituent donc qu’un sujet parmi d’autres. La part de ces émissions se décompose comme suit : 4 % pour les camions, 4 % pour les automobiles, 2 % pour les bateaux et 2 % pour les avions. Viennent enfin d’autres sources, telles que l’agriculture, pour 20 %, et la déforestation, pour 8 %.
Qu’en est-il en Europe ? Nous observons que les transports sont à l’origine de 20 % des émissions de CO2 sur ce continent, trois quarts des émissions étant imputables aux transports routiers. Encore est-il difficile de savoir, sur le plan statistique, comment affecter les émissions dues aux véhicules utilitaires, qui peuvent être aussi bien considérés comme des véhicules particuliers que comme des véhicules de transports de marchandises : la camionnette du plombier a-t-elle pour première fonction de lui permettre de se déplacer ou de transporter son matériel ? Les utilitaires constituent tout de même 20 % de la consommation totale de carburant dans le pays. La marine marchande et l’aviation ne viennent qu’ensuite dans l’ordre des activités émettrices.
Soulignons qu’en Europe, l’approvisionnement en pétrole est déjà en décrue depuis 2006. Cela est dû à la géologie. Encore faut-il distinguer entre pétrole et pétrole. L’on a coutume de classer sous cette appellation de liquides, des extra-lourds, tels que les sables bitumineux du Canada, aussi bien que le brut (crude), le vrai pétrole ; ceux sont de vrais carburants, mais des condensats de gaz naturel (natural gas condensate, NGL) sont également inclus dans cette catégorie, où l’on retrouve également le gaz liquide, éthane, butane ou propane. La production de pétrole stricto sensu n’augmente plus depuis 2005.
La crise actuelle trouve son origine dans le fait que le prix du pétrole a cessé d’augmenter. De ce fait, les prix de l’immobilier se sont retournés aux États-Unis en 2006. Tout le reste a suivi. Ce n’est pas la crise financière qui a provoqué la crise économique : c’est un ralentissement sensible de la production industrielle dans tous les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui a déclenché la crise économique, qui a généré la crise financière.
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, j’entrevois à un horizon de six mois à deux ans un coup de tabac sur les marchés financiers. Car la baisse des prix du pétrole va rendre non rentables certains projets de production, contraignant à due proportion la croissance du produit intérieur brut (PIB). Cela signifie que l’argent sera de moins en moins disponible pour financer des politiques publiques.
J’en viens à la décomposition des produits raffinés. Depuis 1965, la part des produits légers stagne, tandis que la part du fioul et du gaz augmente un peu. En tout état de cause, le diesel constitue un tiers des produits qui sortent des raffineries. S’il ne doit plus être utilisé comme carburant, il continuera à être produit au cours de la distillation de l’essence, laissant ouverte la question de son emploi éventuel. Car le parc mondial de raffinerie ne saurait changer du jour au lendemain, chaque unité installée coûtant quelques milliards d’euros… Les métaux lourds, tel le fioul utilisé dans la marine marchande, représentent eux aussi un tiers du total.
Le carburant qui vous intéresse aujourd’hui, le diesel, représente un tiers du total produit dans le monde par les raffineries. À l’heure où la production de pétrole est orientée à la baisse, il est tout à fait possible de se passer du diesel. Mais la contrepartie en termes de contrainte immédiate sur la mobilité est réelle, car il ne saurait être remplacé rapidement par un autre carburant.
De manière contre-intuitive, le pétrole reste pour sa part peu cher malgré la contrainte à la baisse qui s’exerce sur lui. Car, même si volumes et prix interagissent, à six mois ou un an, il n’existe pas d’élasticité sur le long terme entre les volumes produits et le prix du pétrole. Ils varient de manière erratique, et complètement indépendants l’un de l’autre. C’est pourquoi je n’ai jamais affirmé qu’un pétrole contraint serait plus cher.
De manière caricaturale, on pourrait dire qu’il n’existe que deux régimes de cours du pétrole : l’un où les volumes sont stables tandis que le prix évolue de manière imprévisible, l’autre où le prix est stable tandis que les volumes évoluent de manière erratique. Ne croyons donc pas une seconde qu’un approvisionnement pétrolier se répercute sur un prix perpétuellement croissant. Les faits le démentent.
En revanche, un approvisionnement contraint à la baisse peut avoir pour effet une récession, comme on l’a vu en 2007 et en 2011. Dans notre ouvrage, Le Plein s’il vous plaît !, nous avions défendu l’idée qu’une taxe carbone est le meilleur impôt qui soit, car elle permet de conserver la rente pétrolière chez soi. Sinon, à chaque hausse du pétrole, c’est le producteur qui encaisse la rente. Ainsi, la taxe carbone protège, et non saigne le consommateur. Ce livre avait été envoyé par notre éditeur à tous les députés. En tout cas, nous devrions nous partager le bénéfice de la baisse actuelle du pétrole.
Si nous ne le faisons pas, nos enfants ne nous remercieront pas ! Les projections de prix régulièrement publiées par l’Agence internationale de l’énergie sont souvent démenties par les faits, comme le prouvent celles qui ont été produites entre 2003 et 2014. Je ne m’y fierais donc pas. Pour ce qui est du cours du pétrole, c’est le Fonds monétaire international qui voit juste, en ne faisant de prévisions qu’à douze mois, sans s’aventurer au-delà. Mais je suis sûr en revanche que, si le baril reste à un bas niveau pendant cinq ans, la récession sera forte au niveau mondial. Car le pétrole conditionne l’économie. La variation de la production de pétrole par rapport à la population est un bon indicateur avancé de la variation du produit intérieur brut par habitant.
Passons à l’approvisionnement européen en pétrole depuis 1965. Avant les chocs pétroliers, il venait pour l’essentiel des importations. À partir de 1970, le pétrole de la mer du Nord a commencé de se développer. Il est passé par un maximum en 2000. Ensuite, depuis 2006, l’approvisionnement en pétrole a baissé de 20 % en Europe, sans que cela procède de la mise en œuvre d’une politique publique. Parallèlement, la production recule dans tous les pays de l’Union européenne, sauf l’Allemagne. Cela est dû au fait qu’on importe de moins en moins de pétrole, que de moins en moins de camions circulent et que la machine économique se grippe. Cela va au demeurant continuer.
J’en viens à la variation du PIB européen depuis cinquante ans. Jusqu’en 1975, elle s’établissait à 5 % ; elle est ensuite descendue à 2 % en moyenne jusqu’en 2007 ; depuis cette date, elle est quasi-nulle. Et je ne parierais pas mon dernier euro d’économie sur le fait que cela va repartir à la hausse ! La dette publique a augmenté, tant en France qu’au Royaume-Uni. Aux États-Unis, elle a même doublé entre 2007 et 2013. Ainsi, avant les chocs pétroliers, le rythme de croissance de l’énergie vous donnait le rythme de croissance de la production industrielle, qui vous donnait le rythme de croissance du PIB. Depuis les chocs pétroliers, la croissance de l’énergie a été moins élevée ; en apparence, une dématérialisation se dessine, ce qui pourrait passer pour une bonne nouvelle si elle n’allait de pair avec une croissance de la dette. À mon sens, une partie de cette dématérialisation est indissociable de la croissance de la dette, car elle n’est ni plus ni moins que de l’inflation d’actifs.
Nous pouvons en dégager quelques règles cardinales pour l’avenir, y compris pour l’avenir du diesel dans les transports. D’abord, il faudra apprendre à faire plus avec moins. Ensuite, il faut s’attendre à ce que le trafic soit stable, voire baisse –il s’agit d’une règle de prudence pour évaluer les projets d’infrastructure. Enfin, l’on peut considérer que les taux longs sont devenus nuls, et qu’il faut donc actualiser à taux nul les prévisions économiques, ce qui n’est pas sans modifier l’ordre de mérite des projets que l’on peut financer.
La technologie ne règlera pas tout, comme cela est démontré historiquement. Au contraire, les usages technologiques se sont plutôt multipliés, plutôt qu’ils ne se sont remplacés. Il faut donc manier l’obligation ou l’interdiction, agir par la réglementation et se souvenir de ce que j’ai écrit dans le livre que je vous citais : la subvention vide les caisses de l’État, tandis que la fiscalité les remplit, car je vois arriver l’apurement de la dette publique sous la forme d’un défaut obligataire sur la dette souveraine. Dans un monde sans inflation, c’est la seule forme d’apurement possible. Il se produira donc tôt ou tard, c’est évident !
Dans un monde sans croissance, il ne faut pas compter sur les seuls ingénieurs pour sauver la situation. Le monde sans croissance n’est pas un monde facile. Au contraire, il convient de faire des choix. Mon cadrage était à dessein un peu appuyé, mais il aurait été le même au sujet de la loi de finances, des subventions aux énergies renouvelables ou de la rénovation des bâtiments.
S’agissant des transports, je crois pouvoir dire qu’il restera des voitures dans le futur. L’étalement urbain ne disparaîtra pas en une semaine. Un tiers des trajets individuels effectués en France aujourd’hui sont des trajets entre domicile et travail. Un magasinier trop heureux d’avoir trouvé un emploi à trente kilomètres de chez lui ne saurait y renoncer au motif qu’il ne doit pas prendre sa voiture.
Dans notre économie, les types de métier sont de plus en plus spécialisés, de sorte que ces derniers deviennent la variable d’ajustement de la rencontre entre offre et demande d’emploi. J’ai eu l’occasion de m’en rendre compte à l’occasion de la réalisation du premier bilan carbone d’une grande surface en périphérie. Les salariés venaient souvent de très loin. Il ne sera donc pas possible de diviser par deux en dix ans les déplacements individuels.
La mesure urgente à prendre est de diminuer la consommation unitaire des véhicules. Cela signifie, vu les impondérables des sciences physiques, que leur volume et leur masse doit baisser. Je peux seulement prendre l’exemple de la deux-chevaux hybride à air comprimé telle qu’en fabrique Peugeot. Il faut aller vers des voitures de 500 kg, atteignant au plus 110 ou 120 kilomètres à l’heure en pointe, pour un moteur de 30 chevaux. Car de telles voitures consomment sans difficulté seulement deux litres aux cent.
Pour encourager leur production, de fortes incitations fiscales et réglementaires sont nécessaires, comme un système de bonus/malus, une vignette ou une prime à la casse, qui soit étroitement corrélée à la variation de la consommation du véhicule acquis par rapport à celle du véhicule mis à la casse.
Enfin, il est nécessaire, pour conduire une politique industrielle intégrer, de protéger dans une certaine mesure le marché. Car nul ne saurait faire des investissements de plusieurs milliards d’euros sans assurance de les rentabiliser. Les règles européennes de libre concurrence devraient pouvoir supporter quelques entorses lorsqu’il s’agit de sauver le climat ou de garantir l’approvisionnement énergétique de l’Europe.
En tout état de cause, il faut aller le plus vite possible vers des véhicules ne consommant que deux litres aux cent. Cette solution vaut non seulement pour le diesel, mais aussi pour tous les autres types de carburant. Elle ouvre la voie à des substitutions de carburant vers du carburant propre, car la substitution portera alors sur un contenu énergétique trois fois moindre.
Il convient également de favoriser des solutions du type du bus périurbain du grand Madrid, que l’on pourrait comparer, par sa taille, à l’Île-de-France. Grâce à ce bus, le taux de transport par les transports en commun est l’un des meilleurs d’Europe, meilleur même qu’aux Pays-Bas. Ces bus effectuent en effet une boucle de ramassage à vingt ou vingt-cinq kilomètres du périphérique, puis amènent d’une traite leurs passagers à la station de métro la plus proche.
De tels bus périurbains pourraient être rapidement mis en place en Île-de-France. Il ne coûte pas si cher de construire un arrêt de bus. Des aménagements des gares de RER seraient cependant nécessaires. Mais ils apporteraient de la mobilité à ceux qui sont chassés de l’usage de la voiture, sans induire de grandes dépenses d’investissement en capital.
Par comparaison, les investissements au titre du Grand Paris s’élèvent à 40 milliards d’euros, qu’il faut multiplier par le chiffre π (3,14). Une règle d’airain veut en effet que tous les grands investissements d’infrastructure coûtent au total ce multiple de l’investissement initialement prévu, comme l’ont montré l’EPR d’Olkiluoto ou Eurotunnel. Or ces investissements du Grand Paris ne permettront à peu près aucun transfert modal. Soit les nouvelles stations de métro seront construites en zone dense, déjà desservies ; soit elles seront construites dans des milieux moins peuplés, dans l’attente de futures constructions… Je puis cependant vous affirmer que, sur le plateau de Saclay, l’habitat diffus n’incite pas à l’utilisation des transports en commun.
Avec cette même somme de 40 milliards d’euros, il serait possible de financer à 80 % l’acquisition par les ménages de voitures ne consommant que deux litres aux cent. Telle serait la solution, plutôt que de se concentrer exclusivement sur le diesel.
M. Alain Grandjean, associé fondateur de Carbone 4. Je descendrai dans des considérations plus ciblées sur la mobilité. L’arbitrage entre les particules fines et les émissions de dioxyde de carbone doit être fait de telle manière que l’objectif central de freiner le changement climatique ne conduise pas à détériorer la qualité de l’air inspiré par tous, et vice versa. Le secteur des transports est le deuxième en France pour la consommation d’énergie. Il représente 30 % des émissions de gaz à effet de serre.
La voiture constitue 83 % du volume des transports individuels. Cette part est remarquablement stable depuis vingt-cinq ans. Il ne faut pas s’attendre à que les choses puissent changer très vite, ni à ce que la répartition modale évolue rapidement. Cela vous semble sans doute une évidence, mais peut-être vous rappelez-vous qu’au moment du Grenelle de l’Environnement, beaucoup avaient fondé des espoirs sur le report modal.
Il y a cependant une bonne nouvelle, à savoir que la mobilité par personne se stabilise. Elle stagne en effet depuis l’an 2000. Certains ont cru pouvoir affirmer que le PIB croît avec la mobilité. Ils ont reçu le démenti des faits. Sur les graphiques, les courbes de mobilité évoluent de toute apparence vers une asymptote. À partir d’un certain point, le besoin de mobilité paraît pleinement satisfait.
Le nombre des voitures particulières stagne depuis 2000. La baisse des émissions de gaz à effet de serre observable à la même période n’est donc due qu’à la baisse de la consommation unitaire par véhicule. Ne nions pas d’ailleurs que celle-ci soit liée à la progression des véhicules diesel.
Je voudrais maintenant dessiner quelques scenarii pour le futur. Contrairement à ce que l’on a cru, ou craint, par peur de la décroissance, il sera impossible de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre sans faire baisser la consommation d’énergie. Cela étant dit, cette dernière repose sur cinq grandes variables : le nombre de voyageur-kilomètre ; la répartition modale entre les véhicules particuliers, les bus, les trains et les avions ; le type de motorisation, éventuellement hybride ou électrique ; le taux de remplissage des véhicules de transports, amélioré par des mises en réseau comme Blablacar ou par les bus dont mon associé vous a parlé ; l’efficacité énergétique des moteurs employées, exprimée en kilowatts-heure.
En fonction de ces paramètres, quatre scenarii de facteur 4 sont envisageables, c’est-à-dire des scenarii qui permettent d’arriver à une baisse très forte des gaz à effet de serre : soit on décarbone par l’électricité, soit on mise sur une forte sobriété énergétique et une efficacité accrue, soit on adopte l’une ou l’autre de deux hypothèses intermédiaires, l’une prévoyant une diversité plus forte des moyens technologiques. Il me semble en tout cas qu’il faut privilégier une hypothèse de croissance faible.
Comment la part modale de la voiture, qui s’établit aujourd’hui, comme nous l’avons dit, à 83 %, est-elle envisagée par ces scenarii très volontaristes ? Il vaut la peine de constater que, malgré leur ambition, ils se contentent, pour l’un, de n’envisager qu’une quasi-stagnation de cette part, à 82 %, ou bien, pour deux autres, de ne la voir diminuer qu’à 67 % ou 71 %. Nous parions, et nous recommandons de parier, quant à nous sur une stabilité de cette part.
J’en viens à la répartition des types de motorisation dans les véhicules particuliers : moteur électrique, moteur au gaz, moteur à l’hybride rechargeable, moteur à l’essence. Il est bien difficile de dire quelle motorisation l’emportera. Aussi ne faut-il pas privilégier un choix technologique plutôt qu’un autre quand les décisions prises engagent l’argent public.
Quel est d’ailleurs l’impact du véhicule électrique en termes de rejets de dioxyde de carbone ? La question est posée si l’on envisage l’ensemble de son cycle de vie. En centre-ville, il répond en effet au problème des particules fines et du dioxyde d’azote de manière plutôt efficace, hormis pour ce qui est des plaquettes des pneus, auquel le tramway est seul apte à répondre.
Du point de vue du gaz à effet de serre, le véhicule électrique paraît performant en France métropolitaine. Selon des études publiées par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), un véhicule électrique sera responsable de l’émission de neuf tonnes de dioxyde de carbone dans l’atmosphère pour un cycle de vie complet et une distance totale parcourue de 150 000 kilomètres, contre vingt-deux tonnes pour un véhicule classique. Si l’émission de gaz à effet de serre est plus forte pour un véhicule électrique au stade de la production, cela est donc compensé au stade de son usage, puisqu’il fait mieux que la voiture traditionnelle dès qu’il a parcouru 25 000 kilomètres.
C’est cependant une affaire française, s’expliquant par le fait que notre mix électrique est bas carbone. Il en va de même en Norvège, où l’hydroélectricité prédomine. En revanche, l’analyse ne vaudrait pas en Chine ou en Allemagne, car l’électricité y est très fortement carbonée. Dans ces pays, l’usage de la voiture électrique ne serait pas très écologique.
Je termine sur la voiture électrique par deux derniers points. D’abord, contrairement à une idée reçue, la multiplication des voitures électriques ne devrait pas faire naître d’énormes besoins en électricité. Le moteur électrique a en effet un rendement élevé. Il est si efficace qu’il ne faudrait, pour un parc de un million de voitures, que la capacité équivalent au quart de la production d’un réacteur nucléaire. Ensuite, la question de l’appel de puissance se pose, en termes de déploiement d’un réseau de rechargement. Indubitablement, il faudra de la puissance installée pour que les batteries électriques puissent reconstituer leur contenu.
J’en viens aux mesures qu’il faudrait envisager de prendre. Comme l’a dit mon associé, ce serait actuellement le moment de relever la taxe carbone, en profitant de la baisse du baril de brut de 100 dollars à 50 dollars. Oui, partageons-nous la baisse ! Cette baisse correspond, par son ampleur, à une taxe carbone de 100 euros par tonne de dioxyde de carbone. Or l’instrument fiscal est l’un des meilleurs pour déplacer l’offre de voitures vers des véhicules moins gourmands en carburant, comme le montre le parallèle entre le marché américain et le marché européen.
D’autres mesures de moindre ampleur sont envisageables. La baisse de la vitesse limite sur les routes et autoroutes en fait partie. Ce serait une incitation magistrale à la construction de voitures à basse consommation, plus légères et plus rapides. Sur le plan de la sécurité, l’énergie cinétique étant proportionnelle au carré de la vitesse, il serait au demeurant dangereux, dans l’éventualité de collisions, de laisser des voitures légères rouler trop vite, alors que d’autres véhicules plus lourds circulent sur les mêmes voies.
Il serait également envisageable d’accélérer le rajeunissement du parc de voitures particulières, la vignette annuelle de CO2 étant le meilleur outil pour atteindre cet objectif. Une aide à la conversion des véhicules utilitaires pourrait être accordée ; je crois que l’on ne s’en occupe pas assez. Les voitures électriques pourraient aussi être favorisées dans les centres villes, qui concentrent la plupart des problèmes d’asthme. Je pense aussi qu’il faut aider l’usage du vélo et du vélo électrique : en ce domaine, la principale difficulté réside dans le risque d’accident ; ce problème de sécurité freine le développement de ce moyen de locomotion, comme en témoignent les sondages d’opinion. Des pistes cyclables, mais aussi d’autres aménagements, sont à prévoir. Particulièrement polluants, les deux roues jouent également un rôle croissant dans la mobilité intra-urbaine ; les scooters électriques devraient être étudiés. Enfin, il convient de favoriser le bus au biocarburant ; pour la voiture particulière, le gaz ne paraît pas viable, du moins en France.
S’agissant du transport de marchandises, nous devons travailler sur la logistique du dernier kilomètre. Des enseignes comme Carrefour et Monoprix s’équipent déjà. Voilà un axe sur lequel parier dans les dix ans à venir. Il faudrait enfin étudier la possibilité d’ouvrir des autoroutes électriques, qui consisterait à réserver aux camions sur les autoroutes, sur laquelle ils seraient alimentés à l’électricité ; il faudrait cependant évaluer la rentabilité de tels projets. Enfin, la relance du fret ferroviaire mérite d’être mentionnée.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Notre mission d’information a pour objet l’offre automobile française dans une approche industrielle, énergétique et fiscale, mais j’ajouterais également écologique et sociale, en termes d’emploi.
Monsieur Jancovici, vous avez bien démontré que les perspectives économiques font que les instruments à privilégier sont le levier fiscal et le levier réglementaire. D’un point de vue sanitaire, écologique et industriel, le faible renouvellement du parc –dû à une détention de plus en plus longue des véhicules, mais aussi à l’acquisition de plus en plus tardive de voitures neuves– pose problème. Peut-on cependant revenir sur les instruments de politique publique déjà en place ? Le bonus est déjà réduit chaque année, pour compenser le malus. Quant aux primes à la casse, elles sont coûteuses et provoquent des effets de rebond : après le soutien d’abord apporté à la demande, un tassement s’observe souvent.
En étudiant les mesures fiscales et réglementaires existantes, notre mission constate que le législateur, tant au niveau français qu’européen, paraît avoir deux cerveaux. L’un ne fonctionne en ayant en vue que le climat, l’autre en n’ayant en vue que la qualité de l’air. Ainsi, en France, nous nous sommes engagés dans un soutien au diesel, dans une perspective de lutte contre le réchauffement climatique ; les particules fines et le dioxyde d’azote ont été ce faisant peut-être oubliés. Au niveau européen, les directives sur le climat côtoient de même les normes sur les émissions polluantes des véhicules. Quelle pourrait être l’approche systémique et globale intégrant tous ces paramètres ?
S’agissant de la vignette que vous préconisez, serait-elle calculée de manière annuelle en fonction de la pollution émise par le véhicule, en dioxyde de carbone comme en particules fines ? Enfin, que pensez-vous du volet « mobilité » de la récente proposition de loi sur l’énergie ?
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Monsieur Jancovici, considérez-vous que l’injection massive de liquidités freine ou accélère la récession ?
M. Jean-Marc Jancovici. Je dirais plutôt qu’elle la reporte. Car une partie de la progression actuelle du PIB ne correspond, à cause de l’assouplissement quantitatif pratiqué par les banques centrales, qu’à une inflation des actifs. Une fois qu’ils s’effondreront, par exemple sous la forme d’un krach immobilier, la récession s’accentuera.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Comment s’est passée l’instauration de la taxe carbone en Californie ? A-t-elle vérifié vos hypothèses de réflexion en la matière ?
M. Jean-Marc Jancovici. S’agissant de la proposition de loi évoquée par la rapporteure, je ne saurais vous répondre, car je n’en ai pas pris connaissance. À propos de l’exemple californien, que je ne connais pas en détail, je rappellerais seulement que la taxe carbone n’a nulle part été fixée à un niveau assez élevé pour produire un effet sur la consommation de carburant. Pourtant, comme l’a bien dit mon associé, une baisse de cinquante dollars par baril correspond à une taxe carbone de 100 euros par tonne de dioxyde de carbone.
Il n’est donc pas raisonnable d’attendre que le prix du brut baisse pour tenter d’instaurer une taxe carbone. Si le prix remonte alors que cette taxe n’est pas en place, c’est le producteur qui simplement la plus-value. Or, pour que la taxation du carbone soit efficace, pour qu’elle conduise par exemple à une électrisation du parc des voitures particulières, il faut qu’elle s’élève à un montant oscillant entre 100 euros et 500 euros par tonne de dioxyde de carbone.
A contrario, les tramways qui roulent autour de Paris, sur la petite ceinture, n’attirent souvent qu’un trafic d’induction. Ceux qui les empruntent prenaient auparavant le bus, le métro ou bien marchaient. À part certaines responsables politiques, personne n’irait prétendre que plus d’un passager du tramway sur dix empruntait auparavant sa voiture pour le même déplacement. Il faut mesurer à cette aune l’efficacité réelle des projets de tramway du point de vue des émissions de dioxyde de carbone évitées, pour mesurer le bon emploi des finances publiques comme des investissements privés. Nous évaluons approximativement le coût de la tonne de dioxyde de carbone évitée à quelques centaines d’euros, quand la solution emprunte la voie technologique.
Or je ne connais pas un marché du dioxyde de carbone où l’on ait mis la tonne à seulement 150 ou 200 euros. Pour revenir à l’exemple californien, je vous ferai deux réponses : d’abord, ne m’étant pas penché de près sur le sujet, je ne saurais rien vous dire de précis ; ensuite, vu le niveau auquel cette taxation doit être fixée, je serais tout de même prêt à parier avec vous que son effet sur le report d’un mode de transport à l’autre est non perceptible.
Comment fait-on pour subventionner une prime à la casse quand l’argent public fait défaut ? Cela fait partie des quelques cas de figure où la subvention est efficace. Un investissement est en effet rentable à partir du moment où il permet de faire baisser la consommation de combustible à service constant : l’isolation des logements chauffés au fioul ou gaz, mais non à l’électricité, en est un exemple ; la baisse de la consommation des véhicules à déplacement constant en constitue un autre. En effet, des importations se trouvent ainsi évitées et remplacées par des services domestiques, qui emploient des gens en France. Ces mesures sont donc favorables à la croissance.
Avant la chute des cours, le montant annuel des importations de pétrole oscillait en France entre 80 milliards et 90 milliards de dollars. J’évaluerais aujourd’hui leur montant à 50 milliards d’euros, ou même un peu moins. Si nous parvenons à diviser par deux ces importations, cela représente une économie de 25 milliards d’euros par an. En multipliant ce montant par cinquante, vous obtenez le montant de l’investissement que vous pouvez réaliser sans effet macro-économique évident, puisque le revenu annuel correspondant est assuré par ces moindres importations. Or cela représente tout de même une somme importante…
Par comparaison, il y a trente millions de véhicules qui circulent en France. Si vous estimez chaque véhicule à 20 000 euros, cela représente 600 milliards d’euros d’actif circulant. La prime à la casse constitue donc l’un des rares cas de figure où l’investissement est rentable, car il y a l’externalité positive que constitue l’externalité évitée. Cela ne serait pas vrai dans le cas d’un investissement ne permettant pas de réduire les importations. Je pourrais par ailleurs évoquer la filière du biogaz.
Dans le domaine des transports, les agents économiques ont une logique budgétaire, comme l’a bien établi l’économiste Jean-Pierre Orfeuil. Si l’offre de transports est plus accessible, ils en consommeront davantage. Cela veut dire que, si la consommation des véhicules descend à deux litres aux cent, plutôt que six, il faudra multiplier par trois le prix de l’essence, en instituant par exemple une vignette fonctionnant comme une taxe annuelle à la détention de véhicules. Car les usagers des transports en commun, comme l’avait analysé Jean-Pierre Orfeuil, demeurent aujourd’hui des automobilistes contrariés. La vignette doit donc avoir un prix dissuasif pour les véhicules qui consomment dix litres aux cent. Il ne s’agit ni plus ni moins que de la fameuse vignette qu’on a supprimée en 2000.
M. Alain Grandjean. Le montant de cette vignette CO2 devrait cependant être fixé en fonction non seulement de la puissance du véhicule, comme autrefois, mais aussi en fonction de ces externalités négatives, de ses émissions polluantes. Par rapport à un système de bonus/malus, la vignette présente l’intérêt de se rappeler au bon souvenir de l’automobiliste chaque année, ce qui doit l’inciter à réfléchir à un possible changement de véhicules, puisque le renouvellement du parc constitue l’enjeu majeur.
Comme le souligne mon associé, l’effet rebond peut cependant être problématique. Si la baisse de la consommation des voitures individuelles n’est pas compensée par une hausse de la taxe carbone, les automobilistes seront tentés d’en consommer davantage.
Madame la rapporteure. Est-ce que cette taxe pourrait être différenciée selon les départements ?
M. Jean-Marc Jancovici. Je crois plutôt que le prix de l’énergie doit être unique pour tous. La réglementation doit être claire. Il ne faut pas que l’incitation à ne pas faire devienne illisible. Si des aménagements sont à prévoir, il convient de privilégier des solutions telles qu’une aide à la mobilité dans les zones peu denses, mais se garder de moduler le prix de manière illisible.
S’agissant du biogaz, nous devons aller en priorité vers les investissements qui mobilisent le moins de capitaux par unité de résultat espéré. Commençons donc par les mesures qui demandent le moins de dépenses d’investissements en capital (capital expenditures ou capex) pour obtenir une substitution aux carburants pétroliers, plutôt que de favoriser la génération électrique, qui a encore reçu un coup de pouce supplémentaire sous la forme d’une suppression de l’obligation de valorisation de la chaleur…
Dans les départements ruraux et dans les petites villes, il faut valoriser sous forme de carburant le biogaz issu des déchets agricoles, par exemple en organisant des dessertes locales ou régionales de ramassage scolaire ou de liaison avec les villes moyennes. Car c’est sous forme de carburant que le biogaz apporte le plus d’externalités négatives évitées, qu’il s’agisse des moindres importations ou de l’emploi induit.
M. Alain Grandjean. Dans la définition de la contribution carbone actuellement présente, il n’y a pas de distinction entre le dioxyde de carbone d’origine biogénique et le dioxyde de carbone d’origine fossile, à moins que cela ait été récemment modifié.
Mme la rapporteure. Sous le regard du président du groupe d’études sur ce sujet, ici présent, je signalerai que nous avons entendu sur ce point la semaine dernière des représentants de GRTgaz, qui nous expliquait que la mention de la garantie d’origine réglait le problème.
M. Alain Grandjean. Je dirais plutôt qu’ils ont trouvé une manière de contourner l’obstacle. En tous les cas, il est important, pour réduire les émissions de particules fines en centre-ville, de se pencher sur la question. Il y a une liaison entre les capacités de production et l’usage qui est fait de ces véhicules. Du point de vue industriel, le développement du bus ou du camion au gaz peut tirer toute la filière.
M. Jean-Marc Jancovici. Venons-en en effet au volet industriel lié au déploiement de ces véhicules. Il y a des compétences en France pour fabriquer des bus et des camions. Le groupe Iveco a une usine de gros moteurs à gaz. Sur ce segment, les barrières à l’entrée sont telles qu’une délocalisation de la production paraît difficilement envisageable. Les acteurs français sauraient donc rapidement tirer parti des mesures d’aide octroyées dans ce secteur.
Il n’en va pas de même sur le segment des voitures. Pour atteindre le seuil de rentabilité, l’investissement dans une chaîne de production de voitures ne consommant que deux litres aux cent doit pouvoir compter sur la vente de plusieurs centaines de milliers de véhicules par an. Or, le marché français ne représente que deux millions de voitures neufs par an, volume en baisse, car les automobilistes conservent de plus en plus longtemps leur voiture, comme tous leurs autres biens, en période de finances contraintes. Et la situation n’est pas près de changer.
Si vous voulez que Peugeot investisse les quelques milliards d’euros nécessaires dans la construction de véhicules faiblement consommateurs, vous devez donc avoir en tête que ce groupe ne le fera que s’il bénéficie de garanties au sujet de son retour sur investissement, en d’autres termes s’il peut compter sur un marché protégé pour un temps long et pour des volumes importants. Le protectionnisme a mauvaise presse, mais, sur des infrastructures lourdes, le principe de libre concurrence n’est qu’une ânerie sans nom ; elle conduit à perdre du capital, non à améliorer le sort commun.
Dans les domaines qui exigent des investissements très lourds, un oligopole bien régulé est bien préférable. Autrement dit, on encadre la rente de l’acteur privé à un niveau tel que cela reste socialement acceptable. Dans l’industrie lourde des transports –je ne parle certes pas des vélos, mais des trains, des voitures et des avions– la fabrication va de pair avec des besoins capitalistiques au vu desquels les bienfaits de la libre sont une simple vue de l’esprit.
Au niveau européen, les Britanniques font d’ailleurs tout l’inverse de ce qu’ils professent depuis vingt ans à la Commission européenne, puisqu’ils investissent massivement dans la production d’une électricité et de transports à eux. Ce n’est rien d’autre que du jacobinisme. Le maire du Grand Londres, Boris Johnson, joue en outre un rôle central en exerçant son autorité sur l’ensemble du réseau de transport de ce périmètre, quel que soit le mode de locomotion.
Soyons donc intelligemment régulateurs. Je ne veux pas dire par là que l’État devrait s’occuper du sort de chacun, loin de là. Mais il y a des domaines où il faut accepter que la concurrence libre et non faussée ne fasse pas forcément le bonheur des peuples à long terme. Compte tenu des moyens en jeu, la substitution des moyens de transport n’arrivera pas automatiquement par la main invisible.
Quant à la fabrication des véhicules à deux litres, elle va de pair avec une réflexion sur de possibles exceptions à la règle de la libre concurrence. Les préoccupations de sauvegarde de la planète ou d’un moindre approvisionnement énergétique sûr de l’Union européenne en produits carbonés devraient être autorisées à justifier ces exceptions. Mais il y a là, bien sûr, une haie à franchir, pour régler cette question de la politique industrielle intégrée à la politique environnementale.
Nous avons beau mener une bonne politique environnementale, nous ne sommes toujours pas équipés pour faire également la bonne politique industrielle correspondante.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Avez-vous une idée du calendrier de la reconversion industrielle qui se dessine ?
M. Jean-Marc Jancovici. Il faut en tout cas qu’elle soit la plus rapide possible.
M. Alain Grandjean. Le calendrier industriel dépend en vérité du calendrier politique. Les bâtiments et le logement ont une durée de vie de cent ans, les automobiles une durée d’existence de seize à dix-huit ans. Les constructeurs raisonnent à partir de ces horizons temporels. Je voudrais être plus précis, mais comment le pourrais-je ?
Les industriels attendent en tout cas une certaine stabilité et une vision stratégique en matière de normes et de règles. Si nous déplorons aujourd’hui que des signaux contradictoires aient été envoyés, les uns sur les émissions de dioxyde de carbone, les autres sur les particules fines et le dioxyde d’azote, il conviendra d’être à l’avenir attentif à envoyer le signal juste sur les unes comme sur les autres. En 2007, les industriels nous auraient taxés de folie pour vouloir jouer sur les deux tableaux. Mais le progrès technologique a rendu aujourd’hui possible ce qui ne l’était pas alors.
M. Philippe Kemel. En entendant votre ode aux oligopoles et au monopole, je me demande quel est le chemin à prendre pour les constituer, en termes de système financier et d’organisation. Quels sont les modes de financement que vous préconisez ?
M. Jean-Marc Jancovici. En réalité, ces oligopoles existent déjà. Si vous observez le marché de la construction de voitures en France, vous remarquerez qu’il ne compte qu’une dizaine d’acteurs tout au plus. Il en va de même des gestionnaires d’infrastructures : il n’en existe que trois pour les autoroutes concédées, un pour le réseau ferré, un pour les routes nationales, même si des délégations existent par petits morceaux… Quand la barrière capitalistique à l’entrée est monstrueusement haute, poursuivre à toute force un objectif de libre concurrence, c’est perdre son temps. Cela n’aurait pas de sens de construire trois Eurotunnels parallèles au motif qu’il faut de la concurrence sur le trafic trans-Manche.
Ce dont nous avons besoin en revanche, ce sont des décideurs politiques qui s’expriment sur un horizon de vingt ans. L’État doit redevenir un acteur crédible dans sa capacité à définir des cadres de moyen et long terme qui créent une confiance partagée avec les acteurs qu’il a en face de lui. Tel doit être le sujet majeur de préoccupation pour le monde politique.
Mme la rapporteure. Je partage votre opinion sur le caractère prévisible et planifié de la réglementation. Des normes européennes sont censées s’appliquer dès 2017, alors qu’elles ne sont même pas encore décidées en 2016 !
Vous nous avez dit que l’argent public ne saurait se concentrer de manière considérable sur tel ou tel choix technologique. Mais, pour développer le transport de marchandises par camions roulant au biogaz, nous avons un problème d’infrastructures. Il y en a un autre de même nature pour le développement des véhicules électriques, qui ont besoin de rechargement.
Ainsi, l’État doit sans doute respecter une neutralité technologique dans la réglementation qu’il édicte, en définissant des critères objectifs en matière d’émissions de dioxyde de carbone ou de particules fines. Mais il ne saurait s’exonérer de faire des choix.
M. Jean-Marc Jancovici. Je voulais dire qu’à un moment où le jeu est encore ouvert, parce que des technologies concurrentes permettent d’arriver à un résultat identique, il ne faut pas préempter l’avenir en en privilégiant une en particulier.
M. Alain Grandjean. Plus exactement, à l’heure où se vendent seulement vingt mille voitures électriques par an, il semble prématuré de tout parier sur cette technologie. Est-on sûr qu’elles font l’emporter sur le véhicule hybride rechargeable ? La motorisation à deux litres aux cent ne gagnera-t-elle d’ailleurs pas la partie ? Voilà ce que j’ai dit.
En revanche, je n’ai en revanche pas dit qu’il ne fallait faire aucun investissement dans des infrastructures. Il me semble prématuré d’investir dans un réseau d’installations de rechargement électrique qui couvrirait toute la France. Si j’ai insisté sur les flottes professionnelles et sur les bus, c’est parce que tant la RATP à Paris que Keolis à Lyon ont montré qu’ils disposent de la capacité nécessaire en matière de dépenses d’investissement en capital.
M. Jean-Marc Jancovici. Je conclurai en disant que la taxe carbone est nécessaire, mais pas suffisante. L’arbitrage technologique est si populaire parce qu’il permet de nommer le projet et de lui attribuer le mérite de créations d’emploi ; il est facilement perceptible par l’opinion publique. Cela est compréhensible. Il y a seulement un équilibre perpétuel à trouver entre les différents types de mesures, loin de toute écologie punitive.
En matière d’investissement, il faut cependant calculer en termes de litre de pétrole ou de tonne de dioxyde de carbone évités. Sur cette base, un solide tri pourrait déjà avoir lieu.
La seule question que nous devons nous poser aujourd’hui en matière de voitures électriques, c’est celle de leur nombre : cinquante mille ou un million ? Telle est la question. Mais il est évident que le procédé va se développer. Les choix politiques doivent être visibles, mais les règles de gestion qui président à ces choix doivent être neutres sur le plan technologique.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Messieurs, je vous remercie.
La séance est levée à dix-huit heures quinze.
◊
◊ ◊
22. Audition, ouverte à la presse, de M. Jacques Rivoal, président du directoire de Volkswagen France.
(Séance du mercredi 27 janvier 2016)
La séance est ouverte à onze heures quarante.
La mission d’information a souhaité entendre M. Jacques Rivoal, président du directoire de Volkswagen France.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Mes chers collègues, je ne peux que constater avec vous l’absence de M. Jacques Rivoal, président du directoire de Volkswagen France, que nous devions entendre aujourd’hui en audition. Bien que convoqué à deux reprises par écrit, il, n’a pas souhaité se rendre à notre invitation.
Je vais donc saisir le Président de l’Assemblée nationale de ces faits.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Cette attitude est d’autant plus regrettable que le groupe Volkswagen est le premier importateur français d’automobiles et le troisième distributeur en France. Je rappelle que les consommateurs français concernés par les rappels de véhicules de cette marque sont plus nombreux que les consommateurs américains.
L’attitude de M. Rivoal est d’autant moins compréhensible que les responsables du groupe Volkswagen ont été entendus par les parlementaires en Italie, en Allemagne, aux États-Unis ainsi qu’au Royaume-Uni. Je soutiens naturellement la présidente de notre mission d’information dans sa démarche de saisine du Président de l’Assemblée nationale : le président du directoire de Volkswagen France doit être entendu.
M. Jean Grellier. Une telle attitude est surprenante de la part du représentant d’un groupe industriel aussi important. Ce comportement à l’égard d’une mission d’information parlementaire ne peut que nous conduire à nous interroger sur ce qui la motive, et le Bureau de l’Assemblée nationale doit réagir avec fermeté.
Cette absence est d’autant plus regrettable que nos travaux sont très riches, comme le montre le nombre et la diversité des réunions tenues par notre mission d’information.
M. Yves Albarello. Je rappelle que les tricheries dont s’est rendu coupable le groupe Volkswagen au sujet de la mesure des émissions de ses moteurs diesel constituent un scandale de dimension planétaire, qui a ébranlé l’ensemble de la chaîne automobile mondiale. Il a été rappelé que ce groupe est le premier importateur français et le troisième distributeur en France, ce qui signifie que de très nombreux propriétaires français de ces véhicules sont susceptibles d’être concernés par cette affaire.
Je ne conçois pas, qu’à ce niveau de responsabilité au sein d’un grand groupe international, on puisse se comporter de la sorte à l’égard de la représentation nationale ; cette attitude est scandaleuse et je souhaite que le Président de l’Assemblée nationale soit saisi et que M. Jacques Rivoal se rende aux obligations qui sont les siennes.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Nous avons entendu vos propos, et nous vous tiendrons informés des suites que nous ne manquerons pas de donner à cette affaire.
La séance est levée à onze heures quarante-cinq.
◊
◊ ◊
23. Non-audition, ouverte à la presse, de M. Jacques Rivoal, président du directoire de Volkswagen France
(Séance du mercredi 27 janvier 2016)
La séance est ouverte à onze heures quarante.
La mission d’information a souhaité entendre M. Jacques Rivoal, président du directoire de Volkswagen France.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Mes chers collègues, je ne peux que constater avec vous l’absence de M. Jacques Rivoal, président du directoire de Volkswagen France, que nous devions entendre aujourd’hui en audition. Bien que convoqué à deux reprises par écrit, il, n’a pas souhaité se rendre à notre invitation.
Je vais donc saisir le Président de l’Assemblée nationale de ces faits.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Cette attitude est d’autant plus regrettable que le groupe Volkswagen est le premier importateur français d’automobiles et le troisième distributeur en France. Je rappelle que les consommateurs français concernés par les rappels de véhicules de cette marque sont plus nombreux que les consommateurs américains.
L’attitude de M. Rivoal est d’autant moins compréhensible que les responsables du groupe Volkswagen ont été entendus par les parlementaires en Italie, en Allemagne, aux États-Unis ainsi qu’au Royaume-Uni. Je soutiens naturellement la présidente de notre mission d’information dans sa démarche de saisine du Président de l’Assemblée nationale : le président du directoire de Volkswagen France doit être entendu.
M. Jean Grellier. Une telle attitude est surprenante de la part du représentant d’un groupe industriel aussi important. Ce comportement à l’égard d’une mission d’information parlementaire ne peut que nous conduire à nous interroger sur ce qui la motive, et le Bureau de l’Assemblée nationale doit réagir avec fermeté.
Cette absence est d’autant plus regrettable que nos travaux sont très riches, comme le montre le nombre et la diversité des réunions tenues par notre mission d’information.
M. Yves Albarello. Je rappelle que les tricheries dont s’est rendu coupable le groupe Volkswagen au sujet de la mesure des émissions de ses moteurs diesel constituent un scandale de dimension planétaire, qui a ébranlé l’ensemble de la chaîne automobile mondiale. Il a été rappelé que ce groupe est le premier importateur français et le troisième distributeur en France, ce qui signifie que de très nombreux propriétaires français de ces véhicules sont susceptibles d’être concernés par cette affaire.
Je ne conçois pas, qu’à ce niveau de responsabilité au sein d’un grand groupe international, on puisse se comporter de la sorte à l’égard de la représentation nationale ; cette attitude est scandaleuse et je souhaite que le Président de l’Assemblée nationale soit saisi et que M. Jacques Rivoal se rende aux obligations qui sont les siennes.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Nous avons entendu vos propos, et nous vous tiendrons informés des suites que nous ne manquerons pas de donner à cette affaire.
La séance est levée à onze heures quarante-cinq.
24. Audition, ouverte à la presse, de M. Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat au Ministère du développement durable.
(Séance du mercredi 27 janvier 2016)
La séance est ouverte à seize heures trente.
La mission d’information a entendu M. Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, et M. Cédric Messier, chef du bureau des voitures particulières au sein de la sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Nous recevons Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat. M. Michel dispose d’une connaissance approfondie de certains des thèmes majeurs qui nous intéressent : il a en effet occupé, précédemment, le poste de directeur de la prévention des pollutions et des risques.
À l’évidence, la politique de lutte contre les pollutions atmosphériques comporte un volet « automobile » important. La question du diesel en constitue, sinon le point central, du moins un élément-clé, notamment dans les zones urbaines.
La Cour des comptes a toutefois récemment relevé que cette politique avait besoin d’être mieux structurée, tout en insistant sur la nécessité de taxer le gazole. Vous allez nous préciser, si vous le voulez bien, monsieur le directeur général, si une telle vision correspond pleinement aux actions engagées par vos services.
Une grande partie de la procédure d’homologation des véhicules relève également des compétences de votre direction générale. Ce sujet est très important pour la mission. Il est même devenu hautement sensible voire un objet de critiques, au regard de l’actualité.
La mission a déjà auditionné les responsables de l’UTAC-CERAM. Ils nous ont dit avec insistance qu’un des services qui est placé sous votre autorité, le Centre national de réception des véhicules (CNRV), « signe » – tel est le mot qu’ils ont employé – les fiches techniques d’homologation sur la base des dossiers techniques qui lui étaient précisément transmis par l’UTAC.
Vous comprendrez que nous souhaitions en savoir un peu plus sur cette procédure, donc sur le travail et la responsabilité de chacun dans un tel cadre.
Par ailleurs, nous aimerions également connaître les intentions du Gouvernement pour améliorer le contrôle technique obligatoire des véhicules. Pour les émissions polluantes à l’échappement, plusieurs interlocuteurs de la mission ont souligné les lacunes ou les insuffisances de ce contrôle, tant pour les véhicules légers que pour les utilitaires.
M. Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. La question de la pollution atmosphérique – dont l’un des facteurs est l’automobile – est l’une des attributions de la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC). Nous avons par conséquent une responsabilité globale concernant la sécurité et des émissions des véhicules – c’est pourquoi je suis accompagné de M. Messier.
J’aborderai cinq points en commençant par donner quelques éléments d’information sur les grands déterminants de la pollution atmosphérique et, en particulier, sur la part des transports dans cette pollution.
Nous disposons, globalement, d’un état des lieux concernant les principaux polluants réglementés – oxydes d’azote, particules, oxyde de soufre… En France, comme dans d’autres pays européens, les sources massives de polluants – notamment les grandes industries – ont été traitées, si bien que les sources sont à peu près, désormais, équivalentes : industrie, résidentiel tertiaire, transports, agriculture – les agriculteurs n’émettant pas de particules mais contribuant à la formation de particules par recombinaison. Environ 15 % des émissions de particules et 56 % des émissions d’oxyde azote proviennent du secteur des transports.
Grâce aux efforts menés dans tous les secteurs de réglementation et grâce à l’amélioration des technologies, les émissions et les concentrations ont baissé dans des proportions variables. Ainsi, depuis l’année 2000, les concentrations moyennes en dioxyde de soufre ont été divisées par cinq, les taux d’oxydes d’azote ou des particules dites PM 10 ont diminué en moyenne de 10 à 20 %. Cela n’empêche pas que, pour une part importante de la population française, les valeurs limites, notamment de particules ou de dioxyde d’azote, peuvent être dépassées.
Dans ce contexte, j’en viens à mon deuxième point, la réduction des émissions polluantes dans le secteur des transports est un enjeu important. En ce qui concerne les véhicules légers, en simplifiant à l’extrême, on peut avancer que, depuis plus de quarante ans de réglementations européennes relatives d’abord aux carburants – avec par exemple la suppression du plomb dans l’essence –, puis aux véhicules eux-mêmes, la réduction des émissions polluantes a été significative. Pour ce qui est des technologies des motorisations, a été définie toute une série de normes, depuis la norme Euro 1 jusqu’à la norme Euro 6 en vigueur. Depuis l’adoption de la norme Euro 5, les particules provenant du diesel ont baissé de 95 à 97 %. Les valeurs limites ont ainsi été renforcées concernant les oxydes d’azote – la norme Euro 4 fixait le seuil maximal d’émission d’oxyde d’azote à 250 milligrammes par kilomètre alors que la norme Euro 6 la fixe à 80 milligrammes par kilomètre. Ce renforcement de la réglementation porte ses fruits.
Reste que, et la récente affaire Volkswagen l’a bien montré, la réduction réelle des émissions polluante n’est pas aussi forte que celle constatée lors des tests d’homologation et que celle prévue par la réglementation.
M. Denis Baupin. C’est le moins que l’on puisse dire.
M. Laurent Michel. Voilà qui me conduit à mon troisième point relatif aux essais, à l’homologation et au contrôle technique.
Dès la publication de la directive 2007/46/CE, la Commission européenne a lancé une série de réflexions sur l’entrée en vigueur de deux cycles d’essais, l’un censé mesurer les émissions d’oxyde d’azote – le cycle Real Driving Emission (RDE) –, un autre celles de dioxyde de carbone – le cycle Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures (WLTP). Le débat en est à la définition d’un cycle RDE et de valeurs de conformité, adopté par un comité technique le 28 octobre dernier et qui doit maintenant être soumis à la procédure d’objection ou de non-objection du Parlement européen et du Conseil européen, Mme Royal ayant jugé trop élevé le dépassement toléré prévu, dans les mesures en situation de conduite, pour la phase 2017 et pour la phase 2019. Un débat aura donc lieu en Conseil des ministres de l’UE et, probablement, en séance plénière au Parlement européen début février. Là, au sein de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, une assez large coalition a demandé le rejet du compromis proposé par le comité technique.
Nous partageons, au ministère, l’idée qu’il faut renforcer les tests afin qu’ils soient plus proches des conditions de circulation réelle. Cela renvoie à la question plus large du système d’homologation, de la surveillance de la production et du marché, enfin du contrôle technique. Aujourd’hui même, la Commission européenne a adopté une proposition ayant pour objet une refonte majeure du cadre de la réception dite « UE par type » pour les véhicules à moteur fabriqués en série. Cette homologation, globale, délivrée par un État qui s’appuie sur un ou plusieurs organismes d’essais – en France le CNRV, qui dépend du ministère de l’écologie –, fait l’objet d’une reconnaissance mutuelle. Le CNRV est un service de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE), l’un des services déconcentrés du ministère en Ile-de-France – où se trouvent traditionnellement les constructeurs nationaux, tout au moins pour ce qui concerne les véhicules légers. En effet, nos collègues de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de la région Rhône-Alpes sont chargés de la réception pour les poids lourds et autres bus. Le CNRV, où travaillent vingt-sept personnes, est rattaché au service énergie, climat, véhicules (SEVC) de la DRIEE et tient ses instructions techniques de la direction générale de l’énergie et du climat et, en particulier, de la sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules.
Comme nous l’avons déjà souligné dans nos discussions préalables avec les représentants de la Commission européenne, nous avons besoin de renforcer le système d’homologation, qu’il s’agisse des services qui réalisent les essais ou des services administratifs qui délivrent les homologations. Les critères de compétences et de moyens doivent être plus clairs, plus sévères. Il faut que l’agrément des services en question aient une durée limitée et qu’ils puissent faire l’objet d’audits, y compris de la part de la Commission européenne. D’autre part, une plus grande capacité de réaction des autorités – États membres et Commission européenne – est souhaitable, dès lors qu’est détecté un problème de non-conformité. Le système en vigueur implique en effet que seul l’État membre où a été délivrée l’homologation peut procéder à un retrait, une suspension ou à une mesure de sauvegarde efficiente. Or, en cas d’atteinte grave à l’environnement, n’importe quel État devrait pouvoir le faire.
Voilà qui nous ramène à une affaire médiatisée, en son temps, en France. La marque Daimler refusait obstinément d’utiliser pour ses véhicules un fluide de climatisation obligatoire, avançant des arguments que nous avons jugés fallacieux, si bien que nous avons suspendu la vente de ces modèles. Le Conseil d’État a cependant estimé que la clause de sauvegarde ne pouvait pas être activée parce que le nombre de véhicules concernés n’était pas suffisamment important pour constituer un risque grave pour l’environnement. Nous avons porté le dossier auprès de la Commission européenne qui a ouvert une procédure en novembre dernier, soit plus de deux ans après le déclenchement de l’affaire. Or la réforme proposée par la Commission devrait permettre aux États membres ou à elle-même d’appliquer de telles mesures de sauvegarde si sont constatées des non-conformités majeures. Il convient par ailleurs que les États puissent prendre des sanctions plus opératoires, je pense aux amendes administratives, la voie pénale se révélant, pour ce genre d’affaires, longue et donc pas forcément très efficiente. Enfin, il faut renforcer les échanges entre la Commission et les États membres sur tous les problèmes rencontrés dans le but de moraliser certaines pratiques d’homologation. En effet, plusieurs organismes délivrent un nombre considérable d’homologations alors qu’ils sont dépourvus des moyens techniques et de l’expérience nécessaires – dans le jargon du secteur on parle de type approval shopping : on va chercher son approbation là où il est le plus facile de l’obtenir !
Par ailleurs, il existe des systèmes de surveillance de la production et des systèmes de surveillance sur le marché. Il faut, comme c’est le cas pour diverses réglementations, prévoir un dispositif d’autosurveillance pour les constructeurs automobiles, de la même manière qu’on oblige un exploitant dont l’activité implique des rejets industriels polluants en sortie de cheminée ou en sortie de station d’épuration, à réaliser lui-même des contrôles en recourant, en général, à des organismes agréés. On doit assortir un tel dispositif de la faculté pour les autorités de déclencher des contrôles inopinés comme c’est le cas pour les rejets polluants. Ce système s’inscrit dans la logique « pollueur-payeur ».
J’en viens au contrôle technique en fonctionnement. Ce n’est pas le tout d’avoir des véhicules sûrs et non polluants une fois sortis d’usine, encore faut-il que leur état d’entretien soit suffisant pour garantir de bonnes performances : c’est l’objet des contrôles techniques introduits progressivement ces dernières décennies et qui intègrent d’ores et déjà des éléments environnementaux. En application de la récente loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, nous avons récemment proposé à la ministre de l’écologie de lancer une consultation publique avec les acteurs concernés dans les tout prochains jours, et, à cette fin, nous lui avons soumis un projet de décret en application de l’article 65 de la loi visant à renforcer « le contrôle des émissions de polluants atmosphériques et des particules fines émanant de l’échappement des véhicules particuliers ou utilitaires légers […] lors du contrôle technique », article dont les modalités d’application doivent être précisées par décret avant le 1er janvier 2017.
Le projet de décret que nous avons soumis à la ministre prévoit de compléter le contrôle des véhicules essence par la mesure des émissions d’oxyde d’azote et de particules fines et, pour les véhicules diesel, par la mesure des émissions de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures imbrûlés, d’oxydes d’azote, de dioxyde de carbone et d’oxygène. L’idée est que ce dispositif soit opérationnel à partir du 1er janvier 2018, afin qu’au 1er janvier 2019 nous disposions de valeurs de référence. Il s’agit de passer progressivement de l’information – votre véhicule dépasse les normes admises – à l’obligation – vous devez procéder aux réparations et contre-visites nécessaires.
Quatrième point, ces dernières années, le Gouvernement a pris certaines mesures pour que le parc automobile soit plus équilibré dans sa composition – notamment entre les véhicules essence et les véhicules diesel – et moins polluant. Vous l’avez rappelé, madame la présidente, plusieurs rapports, dont celui de la Cour des comptes, ont évoqué la nécessité, au regard des avantages et des inconvénients respectifs des différents carburants, de mettre en place une fiscalité plus équilibrée entre les carburants et tenant plus compte des bilans énergétiques et environnementaux. Ainsi la loi de finances pour 2014 a-t-elle ajouté, dans le calcul de la taxe sur les véhicules de société (TVS), jusque-là basé sur les émissions de dioxyde de carbone, des critères d’émission de polluants. En outre, l’écart de taxation du diesel et de l’essence, qui était de dix-sept centimes en 2014, a été réduit de deux centimes en 2015, avec un centime de plus pour le diesel et un de moins pour l’essence, notamment, et de façon mathématique, par l’introduction de la taxe carbone, mais aussi, donc, par l’ajout de deux centimes de rattrapage destinés, en particulier, au financement des infrastructures de transport – dont il a été amplement débattu à l’occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 2016. L’idée est d’accentuer cette convergence dans les prochaines années.
Les mesures visant à rénover le parc de véhicules légers ont été introduites en 2015 avec la prime de conversion des véhicules diesel de plus de quinze ans d’âge, à partir du 1er avril, cela dans le cadre de la norme Euro 6. Au vu du faible nombre de conversions en véhicules thermiques, il a été décidé que l’éligibilité à la prime serait étendue aux véhicules de plus de dix ans d’âge, soit les véhicules répondant aux normes Euro 1, 2 et 3. Par ailleurs, la prime pour les véhicules thermiques est à la fois recentrée et renforcée puisque son montant est porté à 1 000 euros pour l’achat d’un véhicule de norme Euro 6 émettant moins de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre, ou bien à 500 euros pour l’achat d’un véhicule de norme Euro 5 – voilà, dans ce dernier cas, qui ouvre la possibilité d’acheter des véhicules relativement peu polluants et peu chers ; mais le bénéfice du dispositif est réservé aux seuls véhicules essence afin d’être en cohérence avec l’objectif de réduire la pollution atmosphérique.
J’en viens à mon cinquième et dernier point qui concerne le développement des véhicules à très faibles émissions. Le bonus pour le véhicule électrique est maintenu cette année encore à hauteur de 6 300 euros avec en sus, éventuellement, la prime de conversion. La loi relative à la transition énergétique prévoit l’implantation de prises électriques dans les parkings, l’achat de véhicules à faibles émissions – chaque catégorie, véhicules légers, véhicules lourds, bus et cars, devant faire l’objet d’un décret – à raison de 50 % pour l’État, 20 % pour les collectivités, 10 % pour les flottes importantes de taxis ou de sociétés de location de véhicules. La loi prévoit le renouvellement de 50 % à 100 % des véhicules pour les flottes de bus. Les décrets sont en préparation et devraient, dans les toutes prochaines semaines, être mis en consultation.
Un ensemble d’aides au déploiement des infrastructures est également prévu. Un programme de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), dans le cadre des Investissements d’avenir, soutient, à hauteur d’environ 50 millions d’euros, les projets des collectivités locales investissant dans des réseaux de recharge des véhicules électriques. Ont été par ailleurs instaurées des possibilités d’exonération fiscale pour l’élaboration de réseaux nationaux de bornes pour véhicules électriques, les deux plus connus étant celui de la société Bolloré et celui de la Compagnie nationale du Rhône, d’autres étant en cours d’agrément.
Enfin, nous soutenons le développement de carburants alternatifs. Ainsi, par exemple, à titre transitoire, pour les poids lourds, le gaz naturel mais aussi l’hydrogène peuvent être des pistes intéressantes. La programmation pluriannuelle de l’énergie, prévue par la loi relative à la transition énergétique, comportera un volet de stratégie pour le développement de la mobilité propre qui donnera des indications sur le développement des infrastructures telles que stations de gaz ou stations d’hydrogène, deux technologies pour lesquelles nous nous efforçons de définir des dispositifs de type appels à projets. Je rappelle que la loi de finances pour 2016 prévoit des aides à l’achat de poids lourds au gaz, l’idée étant que les entreprises en équipent leur flotte afin de favoriser un partenariat entre elles et un vendeur de gaz quel qu’il soit, la station pouvant par la suite être ouverte à d’autres véhicules que ceux appartenant à la flotte de l’entreprise.
Toutes ces mesures s’inscrivent dans un ensemble de dispositifs plus larges destinés à améliorer la qualité de l’air. Je signale que devrait très prochainement être signé l’arrêté interministériel révisant le cadre des arrêtés préfectoraux de mesures d’urgence. Par ailleurs, sont en consultation les décrets et arrêtés qui instaureront la possibilité, pour les collectivités locales, de créer des zones à circulation restreinte en s’appuyant sur les dispositifs dits de la pastille ou certificat qualité de l’air. Je mentionnerai pour finir deux dispositifs : le lancement par l’ADEME d’un appel à candidatures auprès des collectivités locales pour la mise en place conjointe, par l’État et les collectivités, du fonds air-bois destiné à favoriser le remplacement des vieilles chaudières à bois des particuliers, ainsi que l’appel à projets « Ville respirable » par le biais duquel vingt collectivités – en général des métropoles ou des zones où l’on constate des dépassements de polluants – ont été sélectionnées pour recevoir chacune, en moyenne, un accompagnement financier de l’ordre de 1 million d’euros.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Merci beaucoup pour cette introduction et ce large panorama. Je propose d’abord de revenir sur tous les sujets se rapportant aux règlements et aux procédures en vigueur, avant d’évoquer leur réforme et l’avenir. Il y a une question que je pose traditionnellement à tous nos interlocuteurs que je souhaite donc vous poser : est-ce qu’il y avait dans votre administration connaissance à quelque niveau que ce soit, même par ouï dire, de dispositifs d’invalidation chez Volkswagen ? Est-ce qu’il y a eu, depuis les révélations du mois de septembre, des échanges avec le constructeur Volkswagen, entre vos services et ce constructeur ? Est-ce qu’il y a des véhicules Volkswagen qui ont été homologués en France ?
Et ceci m’amène à une question par rapport au règlement européen, le règlement 715/2007 dont l’article 5 prévoit « l’utilisation des dispositifs d’invalidation qui réduisent l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions est interdite » ; « dispositif d’invalidation » se comprend comme tout dispositif de nature à moduler, retarder ou désactiver le fonctionnement de tout ou partie du système de contrôle des émissions. Et ce même règlement européen prévoit dans son article 13 que « les États membres établissent les dispositions sur les sanctions applicables aux infractions aux dispositions du présent règlement ». Les types d’infraction qui donnent lieu à sanction sont notamment : « b) la falsification des résultats des tests de réception ou de conformité en service, […] d) l’utilisation de dispositif d’invalidation ». Ce que je voulais vous demander, c’est en fait, au niveau réglementaire français, par rapport à l’application de cet article 13 du règlement européen, je me suis référé au décret 2009-493 et à l’arrêté du 4 mai 2009 qui reviennent sur toutes les dispositions réglementaires d’application du règlement européen, et j’ai l’impression, mais peut-être mon inventaire n’est pas complet, qu’en fait, à ce jour, c’est-à-dire en 2009 en réalité, la France n’a pas mis en place de dispositif de sanction spécifique par rapport à l’application de ce règlement européen. Voilà mes premières questions.
M. Laurent Michel. Nous n’avions pas connaissance de l’utilisation d’un logiciel trompeur par Volkswagen ou par d’autres constructeurs. Tout ce que nous savions, c’est que, à des degrés divers, les véhicules émettent plus en conditions réelles que lors des tests et qu’il existe des pratiques d’optimisation des tests – qui expliquent du reste les discussions autour des procédures RDE et WLTP.
Depuis la sortie de l’affaire, nous avons échangé avec Volkswagen France et nous avons auditionné des spécialistes. La société mère s’est adressée aux ministres des pays membres de l’Union européenne pour exposer son travail visant à remédier à la situation. Nous avons dû enjoindre à Volkswagen de cesser toute vente de véhicules équipés d’un defeat device – pour reprendre l’appellation en langue anglaise.
Dans le cadre de la commission indépendante mise en place par la ministre de l’écologie, nous avons testé des véhicules Volkswagen dont nous savions qu’ils étaient équipés d’un logiciel trompeur, afin de vérifier que nous étions à même de tromper le logiciel trompeur.
M. Cédric Messier, chef du bureau des voitures particulières au sein de la sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules. Lorsque nous avons eu connaissance de l’affaire Volkswagen, nous avons vérifié avoir bien notifié les sanctions qui relèvent plutôt, en l’occurrence, du code de la consommation – nous pourrons vous les transmettre.
J’ajoute aux informations que vous a données M. Michel concernant les interdictions de commercialisation de véhicules Volkswagen frauduleux que, lorsqu’une nouvelle norme entre en vigueur, on peut accorder une dérogation de stock pour les véhicules relevant de la norme précédente. La norme Euro 6 étant entrée en vigueur le 1er septembre 2015, nous avons donc retiré la dérogation de stock accordée à Volkswagen pour la commercialisation des véhicules relevant de la norme Euro 5 – c’est la seule mesure que nous puissions prendre au plan national.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Cela ne porte que sur le marché du neuf, cela ne concerne pas l’occasion ?
M. Laurent Michel. C’est le cas, en effet, et, donc, Volkswagen, depuis la décision que nous avons prise, ne peut plus écouler de véhicules neufs répondant à la norme Euro 5.
Mme la rapporteure. Vous ne m’avez pas répondu sur le point de savoir s’il y a des véhicules Volkswagen qui ont été homologués en France.
M. Laurent Michel. À ma connaissance, non.
M. Cédric Messier. Je confirme.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Ensuite, sur la procédure d’homologation, pour rentrer dans le détail concret et plus spécialement sur la façon dont les choses se passent entre l’UTAC, en fait, et le rôle de l’administration. Vous l’avez évoqué tout à l’heure dans votre intervention en disant : le CNRV analyse des dossiers. Est-ce que c’est seulement, j’allais dire, un contrôle de forme, est-ce que c’est un contrôle très approfondi ? Est-ce que le CNRV se retourne vers l’UTAC en disant : « Mais attention, il y a tel et tel point où on a un questionnement, on a besoin de complément », sachant qu’effectivement c’est le dossier d’homologation global dans lequel il n’y a pas seulement la partie émissions polluantes ; voilà, si vous pouvez un petit peu nous décrire concrètement comment les choses se passent.
M. Laurent Michel. Je ne suis pas un spécialiste de l’homologation des véhicules, n’y ayant jamais procédé personnellement, mais j’ai un long passé, notamment à la tête d’une direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE), et, à ce titre, je connais quelque peu le fonctionnement du système. La réception, par type ou isolée, n’est pas un acte administratif exécuté rapidement. Nos équipes analysent les dossiers à fond, pouvant les refuser, demander des compléments d’information, tout en échangeant avec l’UTAC qui, par exemple, réalise les crash tests dont les résultats figureront dans les dossiers. L’équipe du CNRV est plutôt importante puisqu’elle compte, je le répète, vingt-sept personnes. Elle peut se retourner vers l’administration centrale qui dispose d’un bureau chargé des voitures particulières et d’un bureau chargé des motocycles et des poids lourds, lesquels bureaux peuvent apporter leur concours dans l’interprétation juridique des textes.
Aussi l’homologation par type prend-elle du temps, de même que la décision d’accorder une dérogation. Prenons l’exemple d’un véhicule GPL (gaz de pétrole liquéfié) dont le réservoir avait été homologué par un État membre de l’UE que je ne citerai pas : jugeant que ce réservoir n’était pas conforme aux exigences essentielles de sûreté, nous avons rappelé le constructeur afin qu’il conçoive un autre réservoir.
L’homologation est donc réalisée de façon approfondie et par des personnels assez spécialisés.
M. Philippe Duron. Vous avez surtout évoqué les véhicules individuels, les véhicules légers, mais fort peu les poids lourds, les véhicules industriels, sinon pour préciser que leur homologation avait lieu à Lyon. Il serait intéressant que vous nous en disiez davantage.
Vous êtes revenu, par ailleurs, sur la convergence tarifaire entre le gasoil et l’essence. Ne pensez-vous pas que baisser le prix de l’essence était une erreur puisqu’il s’agit également d’une énergie carbonée et émettrice de particules fines ?
Enfin, vous avez mentionné la possibilité pour les poids lourds de s’équiper de dispositifs à gaz. Combien de temps faudra-t-il, selon vous, pour que les systèmes de ravitaillement soient opérationnels au-delà des flottes régionales ?
M. Laurent Michel. L’homologation des poids lourds relève du même type de travail, même si les séries sont plus courtes et même si certains types de véhicules nécessitent des aménagements particuliers – je pense aux camions de pompiers.
Pour ce qui concerne la fiscalité sur l’essence et le diesel, pour l’année 2016, pour tous les carburants, la composante carbone de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques augmente et, je le répète, afin d’envoyer un signal en faveur de la réduction des émissions de dioxyde de carbone, la taxation du diesel a augmenté d’un centime alors qu’elle a diminué d’un centime pour l’essence.
Pour ce qui concerne le temps nécessaire au déploiement des systèmes de ravitaillement en gaz pour les poids lourds, je ne suis pas en mesure de vous répondre. Que ce soit pour le rétrofit des poids lourds ou même pour l’achat de nouveaux poids lourds ou de bus au gaz – mais cela vaut pour les véhicules électriques –, il convient de créer un cercle vertueux en installant des stations-service. Il faudrait que, d’ici à quatre ou cinq ans, les poids lourds concernés puissent en effet se ravitailler plus facilement, sachant que leur autonomie n’implique pas la présence d’une station tous les cinq kilomètres – il faut en effet plutôt songer à un maillage autoroutier et au développement, dans de grands centres, de plateformes multimodales.
M. Denis Baupin. Vous avez indiqué avoir eu des échanges avec la Commission européenne avant qu’elle ne publie, aujourd’hui même, ses propositions législatives visant à une refonte majeure du cadre de la réception dite « UE par type » pour les véhicules à moteur. Or vous n’avez pas évoqué une disposition très nouvelle consistant à tester des véhicules non plus seulement avant leur mise sur le marché, mais des véhicules déjà en circulation et qui seraient sélectionnés au hasard. Avez-vous une idée des modalités d’application d’une telle proposition ?
M. Laurent Michel. Les producteurs réalisent également des contrôles en service qui sont en eux-mêmes une bonne chose. Une des manières de procéder consisterait à faire des prélèvements auprès des sociétés de location. Les experts considèrent tous qu’il est en effet nécessaire de pouvoir établir la traçabilité d’un véhicule pour que les mesures soient exploitables. Or cette traçabilité, nous l’avons chez les loueurs qui ont un carnet d’entretien permettant le calibrage des véhicules.
On peut imaginer que, pour 100 000 voitures vendues, l’État demande à telle société d’en contrôler cent, par exemple, et de financer le prélèvement et le test. Cette procédure peut très bien faire l’objet d’une décision administrative.
M. Denis Baupin. Nous nous sommes posé cette question au sein de la commission mise en place par la ministre et chargée de réfléchir sur les tests sur les véhicules et il nous est apparu que la mise en place juridique d’une telle procédure serait particulièrement complexe.
M. Laurent Michel. Vous avez raison, nous devons imaginer des méthodes permettant à ces contrôles d’être représentatifs. Tant au moment de l’homologation qu’à celui du contrôle, nous devons veiller à ce que le véhicule respecte la norme sans logiciel truqueur. Autre chose est la vérification, en condition de conduite, que le véhicule reste conforme aux critères définis par la réglementation et c’est là qu’il nous faut trouver un parc représentatif. Cette question mérite en tout cas d’être approfondie, ne serait-ce que pour vérifier le bon équilibre coût-efficacité du procédé, équilibre que nous aurons peut-être atteint si, avec 10 % des tests, on trouve 95 % des critères recherchés.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Alors justement, j’en reviens à ces questions de tests. Le rôle de notre mission d’information n’est pas sur le même périmètre, il est indépendant de ce que fait le Gouvernement et il est complémentaire de la commission qui a été mise en place par la ministre sur les contrôles des émissions polluantes. Pour la clarté des choses, au regard de toutes les informations qui ont été rendues publiques, je voudrais vous demander de nous décrire les protocoles qui ont été suivis par cette commission sur deux aspects : si j’ai bien compris, il y a un protocole de détection d’éventuels logiciels truqueurs, d’une part, donc de nous décrire un peu comment vous avez construit ce protocole, et il y a, d’autre part, un protocole de tests en conduite réelle. Sur ce point, j’aimerais savoir si ce protocole, c’est le même que le futur RDE, si c’est exactement le même au plan technique et scientifique que le protocole RDE en cours de discussion au niveau européen.
M. Laurent Michel. Dans le cadre des essais sur banc, nous procédons, en premier lieu, au test réglementaire puis à un autre test qui commence comme le test réglementaire mais des critères duquel nous nous échappons volontairement. Ce dernier test a ainsi permis de tromper le logiciel trompeur de Volkswagen qui, à un moment donné, n’a plus reconnu le cycle d’essai. Quant au protocole sur route, il est un peu différent du protocole RDE.
M. Cédric Messier. Nous avons en effet trois types de tests dont l’un, nommé D3, se rapproche du futur test RDE mais en diffère quant au parcours et au conditionnement de la voiture. À la demande des membres de la commission, nous avons lancé vingt tests RDE sur les voitures. Nous pouvons donc comparer, pour certains modèles, les résultats obtenus en fonction de notre essai D3 avec ceux que donne le futur protocole RDE et il se trouve que notre essai permet d’obtenir, grosso modo, les mêmes valeurs.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Donc, pour être très clair, par exemple, avec les constructeurs, ou le constructeur qui a été pointé du doigt pour des dépassements, nous sommes sur des véhicules qui étaient homologués, qui passaient les tests d’homologation et qui, quand on les soumet à un test qui n’est pas encore prévu par la réglementation mais qui est un test qui se rapproche du futur RDE, que ce soit le protocole D3 ou que ce soit le strict protocole RDE, on trouve à peu près la même chose sur le dépassement en conditions réelles ?
M. Laurent Michel. Exactement.
Mme Batho. OK, d’accord.
M. Laurent Michel. J’ajoute que nous mesurons également les émissions de dioxyde de carbone pour comparer nos résultats à ceux des tests réglementaires ; nous avons ainsi constaté un moindre écart concernant le dioxyde de carbone que concernant l’oxyde d’azote.
Mme Delphine Batho, rapporteure. La ministre a dit, toujours à propos des informations qui ont été communiquées le 14 janvier, que ces contrôles n’étaient pas suffisamment poussés. Donc, est-ce que cela veut dire que, d’ores et déjà, dans les homologations qui auraient lieu la semaine prochaine, dans quinze jours ou dans trois semaines, des modifications seraient apportées aux procédures d’homologation ?
M. Laurent Michel. Je n’étais pas présent quand la ministre s’est exprimée, aussi ai-je quelque difficulté à répondre à votre question.
Pour être homologué, il faut réussir les tests. Reste qu’on a constaté, chez un constructeur ou deux, un écart considérable entre les résultats obtenus lors des tests et ceux qu’on peut mesurer en conditions réelles. Quand cet écart est de un à deux ou de un à quatre, nous demandons des explications au constructeur et, si cet écart devait dépasser le rapport de un à quatre, je demanderais à mes services de ne pas signer l’homologation. Certains constructeurs pourraient faire valoir qu’ayant réussi le test, ils doivent être homologués ; seulement, le règlement européen précise, en une phrase quelque peu complexe, qu’on doit vendre des véhicules qui assurent des performances, notamment environnementales, dans des conditions « normales ». En cas de trop grande distorsion, après les explications évoquées, nous demandons l’application de mesures compensatoires pour revenir à un écart plus proche de la norme. Un tel contexte ne peut que conduire à revoir les critères de l’homologation sans même attendre l’entrée en vigueur du cycle RDE. Nous échangeons sur la question avec nos collègues de l’Autorité fédérale allemande des transports (Kraftfahrt-Bundesamt-KBA) ; or ils établissent le même genre de constat que nous et, comme nous, souhaitent que l’on en revienne à des dépassements de moindre ampleur.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Est-ce que le problème constaté sur un modèle qui était homologué et qui rencontre dans la suite de son fonctionnement des difficultés avait été signalé auprès de vos services, en fait avant les travaux de votre commission ?
M. Laurent Michel. Non, aucune anomalie ne nous a été signalée.
M. Jean Grellier. La présente mission a également une approche fiscale de la question automobile. On ne sait pas très bien quelle technologie va l’emporter sur l’autre dans les prochaines années. Or, si la fiscalité sur les véhicules thermiques a un certain rendement, pour les autres technologies, la puissance publique souhaitant leur développement, c’est plutôt une approche de soutien qui est privilégiée. Êtes-vous à même d’établir des projections sur la façon dont on pourrait assurer l’équilibre entre ces différents éléments ? D’autre part, selon vous, la fiscalité pourra-t-elle être un déterminant majeur dans le choix d’une technologie ?
M. Laurent Michel. Nous échangeons avec nos collègues du ministère de l’économie et nous sommes capables de procéder à des simulations. Notre connaissance de l’état du parc automobile et de l’évolution des ventes – on sait ainsi qu’après une forte « diésélisation », on assiste à un rééquilibrage assez rapide entre l’essence et le diesel – nous permet de modéliser les rentrées fiscales de façon assez fiable à l’horizon 2016-2018 – toutes choses étant égales par ailleurs, bien sûr. De même, nous sommes à mêmes de modéliser le système du bonus-malus.
Réfléchir à ce que sera le secteur automobile dans dix ou quinze ans relève davantage de la conjecture que de la prévision. Il fut un temps où, lorsqu’il s’est agi de dimensionner leurs besoins en électricité, on prévoyait qu’il y aurait quelque 3 millions de véhicules électriques en 2030. Or il est vraiment difficile de savoir aujourd’hui si ce chiffre sera de un ou de six millions, si bien que les implications en matière de consommation d’électricité ne sont plus du tout les mêmes.
Le choix de la loi relative à la transition énergétique est l’augmentation, dans la fiscalité, de la composante climat-énergie, qui s’est traduite dans la loi de finances pour 2016 par une hausse de la taxation de la part carbone et par des baisses concomitantes ciblées d’impôts. Nous n’en sommes pas encore au stade où l’irruption massive du véhicule électrique sur le marché engendrerait une baisse des rentrées fiscales d’ampleur macroéconomique.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Pour rester sur le même sujet, pas celui de la fiscalité, mais celui du bonus, est-ce que les règles actuelles du bonus, si je prends un cas de figure où nous serions dans une logique de sanction par rapport à une situation où on constaterait un non-respect de la réglementation, même après homologation, de véhicules qui auraient bénéficié de l’attribution de bonus, est-ce que les règles actuelles du bonus, permettent à l’État, dans cette hypothèse-là, de demander un remboursement des bonus ? Quelles sont les choses possibles ou impossibles en la matière ? À votre avis, il y a-t-il des compléments à apporter sur cette question ? Dans quelle mesure l’État, confronté à un dispositif de tromperie, pourrait exiger le remboursement des bonus ?
M. Laurent Michel. C’est bien notre intention, pour peu que le consommateur ne soit pénalisé en rien. Les dispositions du code de la consommation permettraient de lancer une procédure à l’encontre du constructeur incriminé. Ainsi Volkswagen a clairement indiqué vouloir prendre à sa charge un tel remboursement.
Mme la rapporteure. C’était au moment où était posée la question du nouveau sujet CO2 sur lequel ils sont ensuite revenus en arrière en indiquant qu’il n’y avait que 14 000 véhicules concernés.
M. Laurent Michel. Il est certes plus simple qu’un constructeur reconnaisse des erreurs. Reste que si le contrevenant n’est pas bénévolent, quand bien même nous « musclerions » les textes, il trouverait toujours le moyen de faire durer une procédure.
Mme Delphine Batho, rapporteure. J’en viens au nouveau protocole RDE et à la comitologie donc à la décision qui a été adoptée dans le fameux comité TMCV le 28 octobre dernier, qui fait l’objet de la procédure d’objection actuellement en cours. Est-ce que vous pouvez nous retracer le cheminement de la position française sur le contenu du protocole RDE et puis aussi sur les fameuses règles de dérogation par rapport au niveau d’émission de NOx que prévoit cette décision de comitologie donc avec un facteur d’abord de 2,1 et ensuite un facteur de 50 % ? Est-ce que vous pouvez nous retracer la position française puisque je crois que c’est la DGEC qui siège dans ce comité pour la France ? J’imagine qu’il y a eu des arbitrages interministériels. Voilà, si vous pouvez revenir sur ce sujet et nous en dire plus sur la position française.
M. Laurent Michel. Dresser un historique complet serait long, lourd et complexe. En résumé, le débat ne porte pas tant sur la nature du test que sur les dates d’entrée en vigueur de la décision et sur le facteur de conformité qui représente la marge de tolérance ou d’incertitude par rapport à la valeur réglementaire et par rapport à ce qui sera mesuré.
La France a demandé un certain nombre d’ajustements au CTVM et sur le facteur de conformité et sur les dates d’entrée en vigueur. Un large consensus s’est finalement dégagé au sein du comité, même si nous jugeons les facteurs de conformité un peu trop élevés : nous aurions préféré un facteur de 1,2 plutôt que de 1,5 pour la seconde phase.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Sur la nature du test, je voudrais quand même revenir sur un point : est-ce que, dans le long cheminement depuis 2010, c’est-à-dire dans cette discussion, la France s’était prononcée ou opposée au fait que le cycle RDE prévoit un cycle de conduite au-delà de 130 kilomètres heure ?
M. Cédric Messier. Nous nous sommes en effet opposés à cette disposition puisque cette vitesse excède la limite réglementaire ; elle n’en figure pas moins dans le texte, du fait de la pression allemande notamment. Je ne saurai vous dire si le texte sera révisé. Quoi qu’il en soit, les tests sont réalisés sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Au-delà du débat sur la logique de la réunion du 28 octobre, par rapport à une difficulté réelle, qui est que du point de vue des constructeurs il y a besoin que les règles du jeu soient fixées rapidement par rapport à une entrée en vigueur qui a déjà trop tardée. Voilà donc l’arbitrage entre ces deux enjeux : l’enjeu de nécessité d’avoir une décision et une règle européenne et puis le contenu de cette règle sur les dépassements. Est-ce que vous pouvez nous rappeler juste quelle était la position de la France à l’entrée dans la discussion Je sais que la position initiale de la Commission, c’était un facteur de 1,6, qui est donc largement dépassé, on nous a dit que la position de la France était un facteur inférieur à 2, mais j’aimerais bien savoir ce qu’il en est précisément.
M. Laurent Michel. Au début de la discussion, nous pouvions accepter une valeur inférieure à 2 pour la première phase et nous étions favorables, pour la seconde phase, à ce que le facteur soit compris entre 1,4 et 1,6. C’étaient les instructions.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Merci beaucoup. Ensuite j’ai une question, vous savez, la question des vignettes qui ont été annoncées, donc qui sont basées en fait sur les normes Euro des véhicules, donc c’est là qu’on retombe sur la question du contrôle technique puisque, dans le système actuel, par exemple un véhicule Euro 5 dont le filtre à particules aurait été enlevé, il n’y a pas de possibilité de vérifier, comment dire, la vignette elle est attribuée sur la base d’un, comment dire, d’un critère théorique qui n’est pas vérifié en pratique. Et puis si vous pouvez nous dire où en est ce processus de mise en place de ces vignettes.
M. Laurent Michel. Vous avez tout à fait raison : à ce stade, pour des motifs d’opérationnalité, en instaurant la vignette, on part du principe que les performances intrinsèques d’un véhicule, en matière de pollution, sont données par sa norme Euro, et qu’il est dans un bon état d’entretien. Il est donc important de mener la réflexion que j’ai déjà évoquée sur l’article 65 de la loi relative à la transition énergétique, et en particulier sur le renforcement du contrôle technique sur les polluants. La vignette n’aura qu’une couleur et non deux – l’une correspondant à des données théoriques et l’autre à des données pratiques révélées par le contrôle technique.
Donc en termes de déploiement et de développement, nous avons mis au point avec l’Imprimerie nationale et le ministère de l’intérieur un système qui va lier la vignette avec ce qu’on appelle le système d’immatriculation des véhicules (SIV) , ordonnancé par le ministère de l’intérieur, en gros les cartes grises où il y a tout et dedans : on dispose ainsi du numéro de série qui permet des renvois afin d’identifier clairement l’Euro 5, 6 etc. Aujourd’hui, le système a été défini, un arrêté est en cours de consultation du public, il y a « une + trois » classes : la classe des véhicules non thermiques, à zéro émissions thermiques, et puis les classes 1, 2, 3… Vous savez peut-être, à un moment il avait même été envisagé sept classes, « une + six », et en fait, seuls les véhicules les plus propres, en gros une grosse moitié, pourront avoir cette étiquette. Donc l’idée c’est, après la consultation, de finaliser le texte et puis de lancer par ailleurs une expérimentation sur une ou des agglomérations candidates. On discute pour le tester avant de le mettre en service. C’est aussi simple à dire que compliqué à faire, le lien entre le demandeur, son adresse et le SIV et l’envoi de la vignette. L’Imprimerie nationale, qui est très expérimentée dans les titres sécurisés nous a, à raison, fortement incités à faire une phase de tests. Nous avons passé une convention avec l’imprimerie nationale sur la globalité c’est-à-dire sur le développement puis, d’ores et déjà, sur la phase de test.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Dans quels territoires le dispositif va-t-il être expérimenté ? Cherche-t-on des territoires d’expérimentation ?
M. Laurent Michel. Je vois que vous avez mis le doigt sur un léger blanc dans mon intervention. Nous avions des territoires candidats, nous sommes toujours en discussion avec ces territoires candidats voire nous en cherchons d’autres. À la fin, si on n’a pas de territoire candidat il faudra trouver une autre façon de faire le test. Le test n’a pas tellement pour but de tester l’utilisation des pastilles que de tester l’attribution. En même temps, il était intéressant de le faire avec une collectivité car cela permettrait aussi à une collectivité de le réaliser à une grandeur réelle, de se rôder elle-même et de dire : « Et bien voilà ! », donc de faire de la communication auprès des habitants. Il faut tester en grandeur réelle.
Mme Delphine Batho, rapporteure. J’en ai presque terminé. J’ai des questions que je vais grouper. Elles portent sur des sujets très différents. Le premier, dans ce que sont les règlements pollués, pardon, les polluants réglementés, notamment sur la question des particules ultra fines, est-ce que vous identifiez des émissions polluantes aujourd’hui qui ne rentrent pas dans les grilles de la réglementation et qui vont, d’après l’analyse que vous en faites, et pour les années à venir, être un sujet pour la réglementation des émissions polluantes des véhicules ? Telle est ma première question. Deuxièmement, au regard de votre expérience, notamment sur la commission qui a été mise en place par la ministre, est-ce que vous avez un point de vue, j’allais même dire, qui ne serait pas une position de l’État mais une conviction ou un sentiment sur les technologies les plus efficaces en matière de traitement des NOx et donc des choix technologiques à recommander aux différents constructeurs ?
M. Laurent Michel. La question des polluants réglementés ou non réglementés présente de multiples facettes. Pour élaborer leurs directives, l’Union européenne et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) établissent des normes de valeurs dans l’air ambiant qui sont des moyennes, des maximums à ne pas dépasser, des combinaisons en fonction des effets des polluants ; ces normes concernent ce qu’on peut appeler les grands classiques : ozone, oxydes d’azote, composés organiques volatils, mercure, plomb, particules... Et cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’autres polluants, ainsi les micropolluants organiques qui ne proviennent pas seulement des transports mais encore des pesticides ou des procédés industriels. Ce qui renvoie à la question des spéciations pour les particules totales ou les particules fines, voire pour les nanoparticules ou particules ultra-fines. Il s’agit de trouver un équilibre entre réduction à la source et interdiction. Le règlement REACH (Registration Evaluation Autorisation of Chemicals ; Enregistrement évaluation autorisation des substances chimiques) induit à ce sujet de nombreuses réflexions et actions.
Notre administration a signé une saisine de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) pour faire le point sur l’ensemble des connaissances afin de savoir comment appréhender les polluants parmi ceux qui ne sont pas les mieux « balisés » : suivant les cas, vaudra-t-il mieux privilégier une analyse de risque-substitution ou bien une approche valeur ambiante et réduction tous azimuts des émissions ?
En ce qui concerne plus spécifiquement les véhicules, je perçois deux sujets importants : celui, pour les émissions des diesels, du rapport entre dioxyde d’azote et oxyde d’azote, et celui des particules d’abrasion et autres particules qui ne proviennent pas des moteurs et qui devront faire l’objet d’une réglementation – de nombreuses personnes y travaillent.
J’en viens à votre question sur les technologies les plus efficaces. À ce stade, le Gouvernement n’a pas à avoir de position particulière, d’autant qu’on ne saurait prendre parti pour telle ou telle technologie dans la mesure où, le plus souvent, elles sont combinées, qu’il s’agisse de la réduction catalytique sélective (RCS), de systèmes de réduction des oxydes d’azote par injection d’urée, qui fonctionnent bien, ou alors des systèmes de recirculation des gaz d’échappement ou de piège à oxydes d’azote, lesquels semblent pour le moment rencontrer certaines limites. Les constructeurs, dans la perspective du durcissement de la réglementation avec l’entrée en vigueur de la procédure RDE, s’efforcent d’améliorer leurs technologies.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Quand on examine la réglementation européenne et ses déclinaisons nationales, il est frappant de constater qu’on a jusqu’à présent abordé, d’un côté, la question du dioxyde de carbone, et, de l’autre, celle des émissions polluantes. À votre avis, la réglementation, l’homologation, les systèmes de bonus-malus sont-ils amenés à devenir multicritères, intégrant les paramètres de consommation, et donc de dioxyde de carbone, autant que les paramètres d’émissions polluantes ?
Et la dernière de toutes mes questions : ce qui est très frappant, ce n’est pas une question nouvelle et cela nous renvoie d’ailleurs aux questions posées par notre collègue Jean Grellier sur la fiscalité, mais quand on regarde la réglementation européenne et puis ensuite sa déclinaison dans beaucoup de politiques publiques, y compris dans les dispositifs de soutien à l’achat de véhicules peu polluants, il y a eu quand même jusqu’ici une approche où on regardait d’un côté la question du CO2, et d’un autre côté la question des émissions polluantes. Est-ce qu’à votre sens nous irons vers des approches prenant en considération l’ensemble des dispositifs, que ce soit de réglementation, d’homologation, de soutien financier éventuel, que ce soit du bonus ou du malus, qui sera « multicritères », en intégrant aussi bien les paramètres de consommation et donc de CO2 que d’émissions polluantes ?
M. Laurent Michel. On a d’abord réglementé les émissions polluantes et, depuis quelques années, est apparue la question des émissions de dioxyde de carbone, la réglementation européenne fixant à chaque constructeur des objectifs : d’abord 120 grammes par kilomètre puis 95 grammes, norme pondérée par divers facteurs correctifs plus ou moins techniques – et qui n’ont pas toujours été tous pertinents comme celui aux termes duquel plus un véhicule était lourd, plus il avait le droit d’émettre du dioxyde de carbone, ce qui se conçoit peut-être en termes de rapports de force mais guère au plan intellectuel…
Avec la norme Euro 6 on assiste, à nouveau, à un durcissement des contraintes concernant la pollution atmosphérique, orientation qui n’est pas sans conséquence, vu le coût de ces technologies, sur le prix des petits véhicules peu chers – ainsi l’équation économique pour un petit diesel est-elle rendue plus difficile à résoudre.
Les systèmes de soutien, au moins en France, au moment du lancement du bonus-malus, ont été centrés sur le dioxyde de carbone. Je me souviens qu’en 2007-2008 les propositions visant à prendre en compte l’émission de particules, dans le calcul du bonus, n’ont pas été retenues. Aujourd’hui, les systèmes de soutien – bonus-malus ou primes de conversion – s’efforcent de mâtiner les deux approches. Ainsi, la prime de conversion d’un vieux véhicule polluant varie en fonction de l’émission de dioxyde de carbone – vous touchez une surprime de 3 700 euros si vous achetez un véhicule « zéro émission » ; et vous pouvez acheter un véhicule thermique mais il doit émettre moins de cent grammes de dioxyde de carbone par cent kilomètres et répondre, dans le même temps, aux normes Euro 5 ou Euro 6 – la prime étant plus importante dans ce dernier cas. Le système du bonus-malus commence donc d’intégrer ce double objectif. De même, j’ai déjà évoqué la volonté de rééquilibrage fiscal à propos de la TVS – volonté traduite par plusieurs dispositions de la loi de finances pour 2014 –, de savants calculs sur les externalités négatives des deux carburants ayant permis d’ajouter au critère basé sur le dioxyde de carbone, un critère lié aux émissions polluantes. Tous les acteurs – constructeurs, décideurs, administration –, sur le plan national comme au niveau européen, me semblent désormais avoir cette double approche.
Mme Sophie Rohfritsch, présidente. Pouvez-vous préciser le temps qui vous semble nécessaire aux adaptations futures, à la fois sur le plan fiscal et sur le plan technologique ?
M. Laurent Michel. Comme à chaque fois, ma réponse sera prudente : tout dépendra de l’ampleur des évolutions... Une émission ne concerne pas que le moteur et il faut tenir compte de l’allégement des véhicules, de la durée de conception… Les cycles durent cinq à sept ans. Ainsi, les plus anciens des véhicules en service répondant à la norme Euro 6 ont un moteur de 2011 et les plus récents de 2013. Les constructeurs des premiers, dans la perspective du durcissement de la réglementation qu’impliquera l’adoption du protocole RDE, sont en train de développer leurs nouveaux modèles pour 2016-2017.
En revanche, pour les dépassements qui, dans certains cas, seraient plus importants que la moyenne, il faudra trouver des solutions que les constructeurs avec lesquels nous échangeons promettent à échéance de quelques mois seulement. Le système de rappel permet même, quant à lui, de régler les problèmes mineurs en quelques semaines.
Mme Sophie Rohfritsch, présidente. Nous vous remercions infiniment.
La séance est levée à dix-huit heures dix.
◊
◊ ◊
25. Table ronde avec des représentants de la presse automobile et des associations d’automobilistes. Elle a entendu : Mme Alexandrine Breton des Loÿs, présidente du groupe Argus M. Grégory Pelletier, chef du service rédactionnel de l’édition grand public de L’Argus ; M. Arnaud Murati, chef de rubrique à L’Argus ; M. Laurent Chiapello, directeur des rédactions d’Auto Plus, de L’Auto Journal et de Sport Auto ; M. Daniel Quéro, président de l’association 40 millions d’automobilistes ; M. Didier Bollecker, président de l’Automobile Club Association ; M. Stéphane Meunier, rédacteur en chef d’Automobile Magazine ; M. Brice Perrin, chef de rubrique à L’Auto Journal ; M. Alexandre Guillet, rédacteur en chef du Journal de l’automobile ; M. Lionel Robert, directeur de la rédaction d’Auto-Moto.
(Séance du mardi 2 février 2016)
La séance est ouverte à seize heures trente-cinq.
La mission d’information a organisé une table ronde avec des représentants de la presse automobile et des associations d’automobilistes. Elle a entendu : Mme Alexandrine Breton des Loÿs, présidente du groupe Argus M. Grégory Pelletier, chef du service rédactionnel de l’édition grand public de L’Argus ; M. Arnaud Murati, chef de rubrique à L’Argus ; M. Laurent Chiapello, directeur des rédactions d’Auto Plus, de L’Auto Journal et de Sport Auto ; M. Daniel Quéro, président de l’association 40 millions d’automobilistes ; M. Didier Bollecker, président de l’Automobile Club Association ; M. Stéphane Meunier, rédacteur en chef d’Automobile Magazine ; M. Brice Perrin, chef de rubrique à L’Auto Journal ; M. Alexandre Guillet, rédacteur en chef du Journal de l’automobile ; M. Lionel Robert, directeur de la rédaction d’Auto-Moto.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Mes chers collègues, nous sommes réunis ce soir pour tenir cette table ronde tant attendue avec des responsables des principales rédactions de la presse automobile ; nous avons également tenu à inviter deux associations d’automobilistes parmi les plus actives.
L’affaire Volkswagen, née aux États-Unis, a eu l’effet d’une onde de choc en Europe. En France, la mise en place d’évaluations spécifiques des pollutions à l’échappement, telles que décidées et conduites par les pouvoirs publics, suscite nombre d’interrogations et de commentaires. Un processus exceptionnel est ainsi en cours, des « découvertes » récentes risquent même d’être périlleuses pour certains constructeurs français et étrangers, les marchés financiers l’ont bien compris.
Quoi qu’il en soit, tout le secteur de l’automobile, y compris de grands équipementiers, est nécessairement concerné par cette succession d’évènements.
Nous attendons de cette table ronde l’expression la plus libre possible sur ce que vous inspire la situation présente : vos lecteurs et vos adhérents sont-ils perturbés par cette situation ? Une perte de crédibilité pourrait-elle même plus ou moins durablement affecter les constructeurs ?
De longue date, vos essais mettent en cause ou simplement rectifient ce que nous pouvons appeler certaines données constructeurs. Il en a fréquemment été ainsi pour leurs données relatives à la consommation, essence comme diesel.
Notre collègue Denis Baupin a fait état devant la mission d’un article d’Auto-Moto qui, dès 2005, dénonçait les possibilités de tromper certains tests normalisés en configurant les boîtiers et logiciels électroniques désormais installés dans tous les véhicules. Cet article bien documenté pour l’époque ne citait aucun constructeur en particulier, mais révélait que les milieux de l’automobile étaient d’ores et déjà au fait d’un risque potentiel.
Plus de 900 000 véhicules commercialisés en France par les marques du groupe Volkswagen devraient subir des mesures de service après-vente afin de modifier certains calibrages moteurs. Leurs propriétaires peuvent légitimement s’inquiéter des conséquences de ces retours dans les concessions, ne serait-ce que des modifications de performance qui en résulteraient ou encore des pertes des valeurs de revente.
Voilà des sujets sur lesquels il importe à la mission de vous entendre.
Dans un premier temps, chacun des titres ou associations invités va se présenter et nous préciser, en quelques minutes, l’orientation générale de vos réactions, sans doute déjà exprimées concernant ces thèmes de réflexion. Puis notre rapporteure, Delphine Batho, vous posera un premier groupe de questions. Enfin les autres membres de la mission vous interrogeront à leur tour.
Mme Alexandrine Breton des Loÿs, présidente du groupe Argus. Nous avons commenté l’affaire Volkswagen comme les autres journaux automobiles, sans vraiment prendre parti, car les faits ont d’abord eu lieu aux États-Unis et n’étaient pas encore avérés en France. Le groupe Argus dispose des mêmes logiciels que ceux qu’utilisent et distribuent les concessionnaires et leurs succursales chez nous ; nous sommes leader dans ce domaine. Ces logiciels gèrent le marché de l’automobile d’occasion en France ; ils permettent de connaître le prix de rachat et de vente des véhicules pratiqué par les professionnels.
À la fin du mois de septembre dernier, nous avons créé un observatoire de toutes les voitures concernées par l’affaire Volkswagen, ainsi que de l’ensemble de leurs concurrentes. Nous cherchions à savoir si cette crise avait une incidence sur le nombre des annonces passées par les particuliers et les professionnels ainsi que sur le prix d’achat et de vente de ces voitures ; jusqu’à la fin de l’année 2015, nous n’avons pas constaté d’incidence sur ces prix. En revanche, une diminution du volume des échanges est apparue : en attendant d’avoir plus de visibilité sur le marché, les professionnels ne souhaitaient pas avoir en stock ce type d’automobile, et les particuliers préféraient ne pas les revendre. Nous serons bientôt en mesure de fournir une étude, Volkswagen France nous a d’ailleurs demandé d’établir un tableau de bord afin de suivre l’évolution de la situation.
M. Arnaud Murati, chef de rubrique à L’Argus. Je représente l’édition professionnelle de L’Argus automobile, je suis tout particulièrement l’activité économique du secteur automobile dans son ensemble au quotidien. Depuis cinq mois, les affaires d’homologation et de tricherie sur la « propreté » des véhicules nous occupent énormément.
M. Alexandre Guillet, rédacteur en chef du Journal de l’automobile. Au sein de la presse professionnelle, le groupe Altice Média est plus concerné par l’activité économique que par le produit lui-même. C’est avec beaucoup d’intérêt que nous avons observé les évènements lorsque le scandale a éclaté aux États-Unis, et dont nous avons étudié les conséquences en Europe et en France avec la SOFRES. Nous avons constaté un moindre attachement des clients à leur marque ; en ce qui concerne les intentions de rachat, le décrochage est en revanche assez marginal pour l’instant. La crise n’a guère nui au groupe Volkswagen, dont on peut penser qu’il bénéficie d’une bonne image ; le cas pourrait être différent pour des fabricants ne jouissant pas d’une telle renommée.
Par ailleurs, nous suivons attentivement les travaux de la commission mise en place par Madame Ségolène Royal ; certains constructeurs seraient susceptibles d’être mis en cause et leurs services de communication demeurent prudents, car des marques sont mentionnées et d’autres non. Aussi ne souhaitons-nous pas tirer de conclusions hâtives au sujet d’opérateurs qui vivent de la vente et de la réparation des véhicules de ces marques, et attendons d’avoir plus d’informations avant d’établir des comparaisons.
M. Lionel Robert, directeur de la rédaction d’Auto-Moto. Nous portons intérêt aux questions environnementales depuis longtemps, et l’affaire Volkswagen ne nous a pas surpris. En effet, l’écart considérable existant entre les mesures provenant des constructeurs et la réalité nous était connu de longue date.
Cela nous conforte dans notre conviction ancienne que le diesel, dans certaines conditions de circulation, n’a plus sa place en France. Les évènements récents favorisent la prise de conscience que les coûts de dépollution des voitures diesel sont très élevés, alors que ces véhicules n’offrent pas toutes les garanties. Il est temps – et le Gouvernement a là un rôle à jouer – que la fiscalité évolue de façon que le diesel ne soit plus le carburant le plus prisé des consommateurs.
M. Brice Perrin, chef de rubrique à L’Auto-Journal. Mon travail porte principalement sur les enquêtes et l’actualité ; je tiens par ailleurs une rubrique ouverte aux lecteurs qui y parlent de leurs voitures. J’ai ainsi constaté que peu de préoccupations ont été exprimées au sujet des véhicules de marque Volkswagen ; j’attribue cela à la bonne réaction du réseau en France qui, contrairement à son homologue américain, a su faire preuve de transparence. Nos lecteurs sont assez confiants quant à la valeur résiduelle de leur véhicule ou à l’impact des modifications à apporter sur les performances ou la consommation ; pour notre part, nous ne pourrons partager pleinement cette confiance tant que nous n’aurons pas effectué de nouvelles mesures. Cela fait des années que nous écrivons qu’il existe une différence flagrante entre les normes « constructeur » et la réalité, puisque nous savons que les cycles normalisés de la consommation et des émissions polluantes sont très éloignés de l’usage réel. Les choses devraient cependant s’améliorer dès l’année 2017.
Nous avons longuement étudié les divers polluants, car l’institution en 2008 du bonus-malus écologique, qui prend en compte les émissions de CO2, a induit de la confusion dans les esprits en faisant croire que le CO2 était un polluant et constituait l’indice de référence. Ce dispositif fiscal a, fâcheusement, favorisé les ventes de petits véhicules diesel très polluants circulant toujours aujourd’hui, même si leur part a évolué, ajoutant par-là de la confusion à la confusion.
M. Laurent Chiapello, directeur des rédactions d’Auto Plus, de L’Auto-Journal et de Sport Auto. Nous mesurons, sur des centaines de voitures, les taux effectifs de consommation et de pollution depuis des décennies ; nous disposons de techniciens employés à plein temps, nos essais sont réalisés dans des conditions réelles, et nous dénonçons régulièrement les faux chiffres avancés par les constructeurs.
À l’occasion du scandale Volkswagen, nos lecteurs et internautes ont plus été choqués par la tricherie, c’est-à-dire par la faute morale du groupe, que par le problème de la pollution émise par leurs véhicules, qui n’est pas au premier rang de leurs préoccupations. Je rappelle que, en dehors des questions d’argent, le premier objet de motivation pour l’achat d’une automobile est son design et son image en général.
M. Daniel Quéro, président de l’association 40 millions d’automobilistes. Nous avons été surpris par le peu de réactions dont nous ont fait part nos adhérents, même au plus fort du scandale Volkswagen ; sur d’autres sujets, ils sont bien plus virulents. La préoccupation la plus couramment exprimée a concerné le risque de décote des véhicules ; les consommateurs font confiance à leur constructeur pour trouver des solutions, et beaucoup lui restent fidèles. Nous avons diligenté des enquêtes afin de savoir à quel point les questions de pollution entraient dans le choix d’une voiture au moment de l’achat : 70 % de nos interlocuteurs ont montré leur désintérêt pour le sujet, le prix demeurant le premier critère. Toutefois, l’affaire Volkswagen a bloqué les ventes pendant le premier mois, ce dont beaucoup de concessionnaires se sont plaints.
Nous avons entendu tout et n’importe quoi, d’aucuns ont prétendu que tous les constructeurs trichaient ; à cet égard je sais gré à Madame Royal d’avoir créé une commission technique indépendante, à laquelle je siège, et qui procède à des tests aléatoires ainsi qu’à des auditions. Des écarts sont effectivement constatés entre les différentes mesures, mais, les tests réalisés par l’Union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), pour le compte de cette commission sont différents des tests d’homologation des constructeurs : ils sont plus proches des conditions habituelles d’utilisation d’un véhicule. C’est pourquoi il est demandé à certains constructeurs de venir s’expliquer.
À quelque chose malheur est bon puisque, dès 2017, de nouveaux tests, plus exigeants et mieux vérifiés, seront instaurés, ce qui permettra de réaliser des progrès en termes d’émissions. Certes, beaucoup de diesels sont polluants, les petits n’étant pas les moindres, mais il faut conserver à l’esprit que ce type de voiture représente 66 % des automobiles en circulation : il ne sera pas possible de modifier brusquement la fiscalité. L’usage du diesel se justifie certainement pour les véhicules de milieu et haut de gamme, mais la norme Euro 6 rend ces voitures plus propres ; aujourd’hui, les diesels Mazda circulent à nouveau dans Tokyo. En revanche, du fait de son coût, la dépollution des petits véhicules sera difficilement réalisable.
M. Didier Bollecker, président de l’Automobile Club Association. L’Automobile Club Association est la branche française de la Fédération internationale de l’automobile (FIA) et compte 840 000 membres. Nombre de nos adhérents nous ont fait part de leurs interrogations, mais – faut-il le déplorer ? – moins sur les éventuelles émissions polluantes de leurs voitures que sur le risque de perte de performances. Je partage le constat établi par MM. Quéro et Chiapello : les consommateurs se préoccupent assez peu du bilan énergétique de leur véhicule au moment de l’achat.
Les automobilistes sont plus troublés par l’incohérence et le manque de transparence des tests et de la réglementation : ils ont été incités à acquérir des automobiles diesel – la prime au diesel a perduré après le Grenelle de l’environnement – et l’on voue aujourd’hui ce carburant aux gémonies en prônant le retour à l’essence. Ces changements de législation sont mal compris, mais peuvent être l’occasion d’un rééquilibrage entre les parts de marché respectives de l’essence et du diesel. Alors que la part des véhicules diesel est de 66 % en Europe – ce qui est considérable –, je rappelle qu’elle n’est que de 1 % aux États-Unis ; c’est pourtant dans ce pays que le scandale a connu le plus d’ampleur.
Nous demandons que de nouveaux tests soient utilisés, mais nous demandons aussi une stabilisation de la réglementation ; nous ne savons toujours pas – même dans les villes-tests comme Strasbourg – quel sera le devenir du pastillage de différentes couleurs en fonction du taux d’émissions polluantes des voitures. Je ne pense pas par ailleurs qu’aucune pastille n’a jamais supprimé la pollution : il faut donc trouver autre chose, et l’attente de nos adhérents est forte dans ce domaine.
M. Grégory Pelletier, chef du service rédactionnel de l’édition grand public de L’Argus. Depuis le commencement de l’affaire Volkswagen, nous nous sommes attachés à fournir à nos lecteurs des informations techniques afin de déterminer les éléments sur lesquels la tricherie avait porté. Le groupe Volkswagen a fourni très peu de réponses, notamment en ce qui concerne les immatriculations, et par conséquent, le nombre, des véhicules concernés en France ; nous avons publié ses informations. Responsable de l’occasion et de la fiabilité au sein de L’Argus, je suis le groupe Volkswagen depuis longtemps. Nos lecteurs trouvent injuste le fait que, à la différence des Américains, les consommateurs européens ne bénéficient pas de la prime de dédommagement de 1 000 dollars ; à cela, Volkswagen répond que les véhicules seront remis aux normes, sans plus de commentaires.
Nous savons tous que les constructeurs optimisent le cycle européen de conduite, dit New European driving cycle (NEDC), l’évolution vers des tests beaucoup plus proches de la réalité aura un coût ; or on veut leur imposer des normes Euro 6. Cn qui ne seront définies qu’à l’automne 2017. Ainsi, les solutions techniques propres à diminuer le taux d’émission de NOX existent, mais leur coût est tel que les vendeurs considèrent qu’il sera impossible de commercialiser les véhicules susceptibles d’en être équipés. De fait, les consommateurs ne sont pas disposés à payer pour du CO2 ou du NOX, et, lorsque nos lecteurs nous interrogent, c’est afin de savoir si leur voiture va perdre de la puissance et s’il y a lieu de répondre au rappel.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Je tiens à saluer le remarquable travail effectué par la presse, que nous lisons attentivement et avec profit. Nous avons tous constaté que, de façon quelque peu curieuse, l’affaire Volkswagen concerne plus d’automobilistes français qu’américains. Ces évènements ont mis en lumière deux aspects d’une même question : celui de l’écart existant entre les résultats des tests d’homologation et l’usage réel des véhicules et celui des logiciels servant la tricherie : étiez-vous au fait de l’existence ces logiciels ? L’article publié par Auto-Moto en 2005 considère que : « La multitude de capteurs calculateurs installés aujourd’hui dans les voitures constitue autant d’espions électroniques facilitant les petits ajustements avec la réglementation. Capables de déterminer si le véhicule est en train de passer un cycle de dépollution, ils permettent le plus simplement du monde de basculer l’électronique moteur sur le programme spécial homologation. » Voilà qui est très précis !
M. Didier Bollecker. Selon mes informations, cela était un secret de polichinelle à Bruxelles.
M. Stéphane Meunier, rédacteur en chef d’Automobile Magazine. Depuis les années 1980, une simple baisse de tension de la diode éclairant le compartiment moteur permet de faire savoir à une automobile si elle est à l’arrêt et si le capot est ouvert : la présence d’un cycle adapté à l’homologation est donc possible depuis cette période. La tricherie dont Volkswagen s’est rendu responsable est connue aux États-Unis depuis plusieurs mois, les autorités américaines ont demandé au groupe de se mettre en conformité, celui-ci a fait des promesses qu’il n’a pas tenues. Dans ce pays, vous êtes prévenu une fois, puis une deuxième, pas davantage : Volkswagen a dû reconnaître la tricherie afin de pouvoir continuer à importer des voitures et rester présent aux États-Unis, car toutes ses gammes étaient menacées.
Ces tests d’homologation, ressemblent à une épreuve d’anglais du baccalauréat dont l’organisateur, en l’occurrence le législateur, communiquerait à l’avance les sujets au candidat, ici, le constructeur automobile. On imagine mal pourquoi un candidat souhaitant être reçu ne potasserait pas ces sujets à l’avance ; le fait de savoir si l’intéressé parle réellement anglais est une tout autre question…
La norme Euro 6 rend d’ores et déjà l’examen bien plus compliqué, et les diesels qui y répondent sont attaqués, alors qu’il est trop tard ! Il n’empêche que cette norme ainsi que le nouveau cycle Real Driving Emission (RDE) sont en cours de discussion et sont réclamés par les constructeurs. Cela reviendra à tirer les sujets de l’examen au hasard, et ces sujets devront être contradictoires : si vous connaissez bien Shakespeare, vous devrez aussi être bon en littérature moderne ; enfin, je précise qu’Automobile Magazine n’a pas eu connaissance d’une quelconque tricherie avérée.
Mme la rapporteure. Je ne commettais pas de confusion avec les questions d’écart entre les cycles d’homologation, etc. Mon sujet était celui des logiciels permettant la tricherie : vous répondez qu’elle est théoriquement possible depuis l’avènement de l’électronique, mais, à part la remarque sur Bruxelles, en aviez-vous entendu parler avant que l’affaire n’éclate aux États-Unis au mois de septembre ?
M. Arnaud Murati. La pratique de l’optimisation était malheureusement un secret de polichinelle, pas celle des logiciels de trucage, cependant, de mémoire, dès 2013, un rapport du Conseil mondial de la recherche (Global Research Council, GRC) avait éveillé les soupçons sur ces dispositifs. L’éclatement de l’affaire Volkswagen au mois de septembre dernier n’a pas constitué une surprise.
M. Alexandre Guillet. Des témoignages anonymes publiés par Politico, au cours des derniers mois, montent que beaucoup de gens étaient au fait des choses au sein des instances européennes.
M. Lionel Robert. Comme l’a dit Stéphane Meunier, on peut seulement reprocher à Volkswagen d’avoir été meilleur élève et d’avoir mieux su optimiser ses tests. Nous verrons bien ce qu’il se passera avec Renault, qui se défend d’avoir triché puisqu’il aborde le sujet différemment ; Volkswagen a dû aller plus loin afin de répondre aux normes américaines qui sont plus exigeantes que les nôtres. Que croyez-vous que Renault aurait fait s’il avait été placé dans la même situation ?
Mme la rapporteure. Les réglementations américaines et européennes ne sont pas les mêmes, puisque l’Europe proscrit tout dispositif d’invalidation lors des tests, et il existe bien une différence entre un logiciel de trucage et les différentes pratiques d’optimisation.
Depuis longtemps, beaucoup d’entre vous procèdent à des tests et des essais comparatifs. Vos protocoles sont-ils constants et vérifiés ? L’écart que vous constatez entre les tests réalisés dans les conditions d’usage et les chiffres des constructeurs a-t-il augmenté au cours des dernières années ?
M. Stéphane Meunier. Plusieurs titres de presse automobile destinée au grand public procèdent à des mesures depuis une quarantaine d’années, tels Auto Plus ou L’Auto-Journal ; Automobile Magazine mesure 300 items par voiture, depuis une dizaine d’années, nous avons demandé la certification ISO 9001 pour ce protocole, à l’instar de ce qui existe dans l’industrie.
Plusieurs magazines automobiles valident les mesures objectives fournies par les constructeurs, depuis toujours nous divulguons les écarts de consommation constatés, ceux-ci n’ont guère augmenté, car les techniques utilisées sont bien plus précises qu’il y a dix ans. Le véhicule tricheur le plus polluant aujourd’hui est beaucoup plus vertueux que le véhicule honnête d’il y a dix ans.
En 2010, à l’occasion du Mondial de l’automobile, Automobile Magazine a publié un hit-parade de la pollution, fondé sur des données de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), et qui a été repris par de grands médias. À l’époque, nous avions été critiqués par la présidente de l’ADEME, qui, quelques années plus tard, a reconnu la nocivité des petits véhicules diesel. Ce débat est constant au sein de la presse automobile, nous savons que les consommations annoncées par les constructeurs sont théoriques, or l’ADEME se fonde sur ces données pour établir ses barèmes de pollution : ils sont donc tout aussi théoriques.
M. Lionel Robert. Il faut préciser qu’aucune publication française n’étudie autre chose que la consommation de carburant. On ne parle donc que de CO2, et personne ne mesure le NOX, qui est pourtant bien plus dangereux.
M. Laurent Chiapello. Le grand public comme la réglementation française viennent de découvrir le NOX,mais la Conférence de Paris de 2015 sur le climat (COP 21) n’a évoqué elle-même que le changement climatique, donc le CO2. Peut-être faudra-t-il, à l’avenir, revoir l’échelle des priorités, mais c’est un autre débat.
En ce qui concerne les écarts de mesure constatés entre la réalité et ce qu’annoncent les constructeurs, nous ne constatons pas d’augmentation. En revanche, certains se comportent mieux que d’autres : cela prouve que, s’il n’est pas possible d’atteindre pleinement la vérité, on peut y tendre si l’on en a la volonté.
M. Jean-Michel Villaumé. Je suis un lecteur régulier d’Auto Plus. Vous pratiquez des tests et des essais sur des véhicules mis à votre disposition par les constructeurs dans de bonnes conditions. Cependant, la presse spécialisée est financée par la publicité de l’industrie automobile : dans ces conditions, quelles sont les garanties de votre objectivité ?
M. Laurent Chiapello. C’est une très bonne question. Le plus clair de notre financement provient de la vente hebdomadaire des quelque 300 000 exemplaires de notre revue. Les voitures que nous testons, comme l’ensemble de la presse automobile, nous sont fournies par les constructeurs et sont optimisées, mais nous les comparons entre elles : c’est là que se révèlent les bons et les mauvais élèves dans le domaine de la consommation de carburant.
Nous effectuons ces mesures sur le circuit de Montlhéry, nous disposons d’appareils sophistiqués et de deux techniciens employés à plein temps. Les constructeurs nous reprochent de ne pas prendre en compte les conditions météorologiques, qui ne sont pas constantes, mais nous établissons un lissage des données recueillies et nos résultats sont singulièrement plus proches de la vraie vie que ne le sont les normes actuelles.
M. Stéphane Meunier. Ces mesures réalisées à Montlhéry impliquent la location d’un box, un technicien employé à plein-temps, ainsi qu’un matériel électronique coûteux que nous renouvelons et faisons certifier chaque année par un organisme indépendant. Cela représente un investissement de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Ce serait cher payé pour être les complices des constructeurs : mieux vaudrait se contenter de reprendre leur documentation technique, ce qui simplifierait la vie de nos éditeurs…
M. Jean-Marie Beffara. Vous confirmez donc ne tester que les écarts existant entre les consommations de carburant annoncées et les consommations réelles.
M. Laurent Chiapello. Nous mesurons une série de performances : accélération, freinage, etc. Ensuite, la consommation et, partant, les émissions de CO2.
M. Jean-Marie Beffara. À l’occasion de ces tests, qui ne portent donc pas sur les émissions de NOX, constatez-vous des écarts plus importants entre vos mesures et celles des constructeurs lorsque ceux-ci ont recouru à des logiciels de trucage ?
M. Laurent Chiapello. Nous pratiquons ces tests depuis des décennies, et l’affaire Volkswagen n’a pas modifié notre pratique. Il n’est donc pas possible d’affirmer que cette marque se comporte moins bien que les autres dans ce domaine. Dans le cadre d’un cycle mixte représentant une moyenne des consommations, nous avons constaté 40 % d’écart entre la norme et ce que nous mesurons dans la réalité ; au sein de ces 40 %, certains constructeurs se situent à plus 60 % de consommation, d’autres entre 10 % à 20 %. Selon les modèles et les générations, Volkswagen se place dans une moyenne relativement neutre ; aucun pic de surconsommation n’a été constaté.
M. Daniel Quéro. Je rappelle que tous les constructeurs ont satisfait à la procédure d’homologation. Quand bien même certains auraient optimisé les tests, les consommations mesurées l’ont été à vitesse stabilisée, dans le cadre d’un usage mixte.
De son côté, la presse automobile a le devoir d’informer le public. C’est à cette fin qu’elle réalise des tests, probablement plus proches de la réalité et plus exigeants, dont les résultats diffèrent forcément de ceux des constructeurs, cela est indéniable. Toutefois, l’homologation a la vertu de placer tout le monde sur un pied d’égalité ; ce qui modifie considérablement la consommation d’un véhicule, c’est la façon de le conduire.
M. Laurent Chiapello. Les tests d’homologation existant aujourd’hui sont à des kilomètres de la réalité. Certes, les conditions doivent être les mêmes pour tous, mais le problème, c’est qu’actuellement elles ne correspondent à rien.
Comme Stéphane Meunier l’a dit, les constructeurs ont tout fait pour réussir ces tests et uniquement ceux-là ; j’ai été frappé de constater cette attitude de la part de certains constructeurs, notamment français, qui ne réalisent de mesures des émissions réelles de leurs véhicules que depuis peu de temps, ce qui est pour le moins curieux.
M. Didier Bollecker. Je considère pour ma part que le consommateur n’est absolument pas dupe. Il consulte, sans y croire, la documentation fournie par le constructeur, il consulte aussi les tests réalisés par la presse, certes plus proches des conditions réelles ; mais il sait que sa consommation de carburant sera déterminée par son type de conduite. Dans ces conditions, il est difficile d’évoquer une tromperie.
Mme Alexandrine Breton des Loÿs. Ce qui intéresse le consommateur, c’est de connaître sa consommation : de quelle quantité de carburant a-t-il besoin pour un kilométrage donné ? Monsieur Bollecker a raison de dire que l’automobiliste oublie, il achète un modèle, un look. Il est vrai que les constructeurs ont fait des normes, que ce soit dans les domaines du CO2 ou de l’European New Car Assessment Programme (Euro NCAP), des atouts commerciaux, des arguments marketing forts ; à cette fin, ils ont tout fait pour que leurs gammes soient bien notées.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Dans votre pédagogie journalistique, avez-vous envisagé de présenter des modèles en fonction de l’usage en tenant compte de l’ensemble des critères : assurance, amortissement, pannes, consommation, etc… ? C’était l’une des recommandations d’UFC-Que choisir.
M. Brice Perrin. Pendant longtemps, on a beaucoup parlé de diesel car les consommateurs, sans tenir compte des avis de la presse automobile, étaient incités à acheter ce type de véhicules par les mesures fiscales existantes. J’ai été très surpris récemment en apprenant que le Sénat avait rejeté la proposition de déduction de la TVA des entreprises pour l’essence, ce qui leur aurait permis d’utiliser des voitures moins polluantes pour des trajets courts ou urbains.
La presse automobile ne fait que tenir compte des mesures fiscales en vigueur pour donner des conseils. Nous tâchons de dissuader nos lecteurs de recourir aux petits véhicules pour les faibles kilométrages annuels ou l’usage en ville. Cependant, lorsqu’on lui propose un bonus de 1 000 euros, le consommateur considérera que la revente de sa voiture sera plus profitable et que le gazole, bien que plus coûteux à la production, est par ailleurs fiscalement avantagé.
M. Didier Bollecker. Pour répondre à votre question, je ne peux que vous inciter à lire cette excellente parution que nous publions depuis vingt-cinq ans : Le budget de l’automobiliste. Elle présente le profil type de trois ou quatre conducteurs, selon que la voiture est neuve ou d’occasion, que son propriétaire est petit ou grand rouleur, que le moteur est diesel ou essence. Tous les coûts sont inclus : achat ou vente du véhicule – donc son amortissement –, garage, péages autoroutiers, assurance, carburant, réparations ; cela permet à chacun de déterminer quel est le modèle le plus approprié. De fait, il est évident que, pour quelqu’un qui roule peu – moins de 10 000 kilomètres par an –, le diesel ne se justifie absolument pas.
M. Grégory Pelletier. En début d’année, en collaboration avec M. Bollecker, L’Argus publie le prix de revient kilométrique (PRK) d’environ 4 000 véhicules en fonction de leur kilométrage et de l’année de leur fabrication.
Mme la rapporteure. Certaines associations considèrent que l’information relative au coût d’usage ou au PRK devrait être rendue obligatoire, considérez-vous que cela est de votre ressort et qu’il serait inutile de l’imposer au constructeur ou au concessionnaire ?
M. Stéphane Meunier. Songez-vous à l’électroménager, par exemple ?
M. Didier Bollecker. Il n’y a apparemment pas de forte demande de la part des consommateurs à ce sujet…
M. Laurent Chiapello. L’Auto Journal le faisait par le passé, mais nous avons cessé, car le numéro en question ne se vendait pas. L’intérêt pour ce type d’étude n’est guère développé en France. Les variables relatives aux conditions d’utilisation du véhicule étant nombreuses, il était trop complexe d’établir des profils dans lesquels le consommateur aurait été susceptible de se reconnaître.
M. Brice Perrin. Le prix de revient kilométrique constitue une information qui intéresse particulièrement les professionnels gestionnaires de flotte. Les particuliers, qui représentent aujourd’hui 50 % du marché, ne font pas le même calcul.
M. Daniel Quéro. L’automobile est un produit particulier qu’on ne peut pas comparer à un objet domestique. Lorsque l’on achète une voiture, le prix de revient kilométrique est seulement un critère parmi d’autres.
M. Stéphane Meunier. L’automobile n’est ni un réfrigérateur, ni un lave-vaisselle, mais un produit extrêmement complexe. Vous utilisez un produit électroménager dans votre cuisine ou votre cellier où il fait douze degrés, alors qu’une voiture doit fonctionner aussi bien par moins quarante que par plus cinquante. Et il y a autant d’électronique que dans un airbus A 319.
Nous ne sommes pas là pour défendre l’industrie automobile, mais pour l’inciter à progresser en matière de dépollution, de sécurité des véhicules, etc. Pour les deux tiers des gens, l’achat d’un véhicule est un achat-plaisir malgré les énormes contraintes qui y sont liées, et un achat irrationnel motivé par des données rationnelles comme la consommation, le PRK, le coût de l’assurance, etc. On voit vraiment que c’est un achat irrationnel lorsqu’un client, qui achète une petite voiture de 14 000 euros, c’est-à-dire, selon nos confrères de L’Argus, le prix moyen d’achat d’une voiture en France, hésite parce qu’il doit payer un malus de 150 euros, malus qu’il n’acquittera qu’une fois !
M. Didier Bollecker. J’ai coutume de dire que la voiture est le seul rêve qui nous transporte… (Sourires.)
M. Jean Grellier. Vous avez un poste d’observation privilégié pour évaluer l’évolution de l’automobile. Jusqu’à maintenant, nous avons parlé des moteurs thermiques dont la situation est particulière actuellement puisque les prix des carburants sont bas. Quelles pourraient être, selon vous, les évolutions à court et moyen terme, sachant que les moteurs thermiques sont rentables au plan fiscal tandis que les autres sources d’énergie nécessitent d’être soutenues si l’on veut que le consommateur se tourne vers elles ?
M. Brice Perrin. Tout à l’heure, M. Bollecker. a indiqué que le secteur avait besoin de stabilité. La France est spécialiste du lancement de filières mort-nées, alors qu’en Italie le gaz naturel marche bien, qu’en Suède l’éthanol fonctionne bien, et qu’en Allemagne le gaz de pétrole liquéfié (GPL) marche bien aussi. Dans notre pays, on a dû vendre trois voitures au gaz naturel et deux convertisseurs, le GPL vivote et l’E85 ne marche que parce que des gens convertissent à l’E85, avec plus ou moins de bonheur, des voitures essence qui ne devraient pas fonctionner avec cette énergie. Certaines stations-service regroupent jusqu’à une dizaine de carburants différents, alors qu’elles sont étranglées financièrement parce que la distribution de carburant n’est pas une activité rentable – le nombre de stations-service est passé, en France, de 40 000 à 11 000.
Actuellement, c’est l’hydrogène qui retient l’attention. Jusqu’en 2012-2013, les véhicules à hydrogène étaient interdits en France. Aujourd’hui, ils sont autorisés, mais il existe seulement deux pompes ! D’ici à ce que l’on puisse développer un réseau de distribution en hydrogène, la densité énergétique des batteries sera suffisante pour parcourir 600 kilomètres – c’est ce que propose aujourd’hui un véhicule à pile à combustible. Mieux vaudrait mener une réflexion à plus long terme et surtout dans un cadre stable et durable, car en France, lorsqu’on lance une nouvelle filière énergétique, on n’en assure pas le développement, ce qui perturbe à la fois les constructeurs, les consommateurs et les distributeurs de carburants.
M. Stéphane Meunier. La mission du législateur est d’imaginer un cadre de contraintes et de progrès, pas de trouver les solutions techniques et énergétiques. C’est pourtant ce qui a été fait pendant longtemps, en France, avec le diesel, et l’on a vu les difficultés que nos constructeurs français ont rencontrées à l’exportation, en Europe et au-delà. Les moteurs diesel et essence, qui sont bien plus performants que par le passé, peuvent encore progresser si on aide cette énergie thermique par des énergies électriques.
Il faut savoir que la citerne qui livrerait une station hydrogène aurait consommé l’équivalent de cette citerne au bout de 400 à 500 kilomètres. Il faudra m’expliquer comment on produit de l’hydrogène sans émettre de CO2 et d’autres polluants. La réflexion sur l’hydrogène est à mener sur vingt, trente, quarante ans. Dans les pays scandinaves et en Allemagne, la filière hydrogène existe depuis les années 1920. Hormis certains bastions industriels, l’hydrogène n’est pas une solution mobile. Une batterie électrique, c’est beaucoup de masse. Or la masse est l’ennemie de l’économie d’énergie. Il faut donner un cadre contraignant, précis, mais stable aux constructeurs. Sinon, ils se tourneront vers ce qui est le plus efficient pour eux. À eux de trouver les solutions techniques, ce qu’ils ont fait avec les airbags, les ceintures de sécurité, les cellules de survie dans les voitures, et d’optimiser les énergies qui existent.
M. Lionel Robert. Contraignons-les surtout à construire des voitures qui polluent de moins en moins. En clair, faisons le contraire de ce qui a été fait en France pendant des décennies !
Je ne suis pas d’accord avec Monsieur Meunier en ce qui concerne l’hydrogène. Il semblerait qu’il y ait des ressources d’hydrogène naturelles qui permettraient de contourner le problème de la production d’hydrogène, qui est aujourd’hui le problème majeur en dehors de celui de sa distribution. Demain, il n’y aura pas une seule solution, mais tout un panel de solutions, la meilleure étant celle, à inventer, qui s’adapterait à l’usage que l’on ferait de la voiture. Le législateur doit s’en inspirer pour établir une nouvelle fiscalité qui privilégie autant que possible l’intérêt de la planète plutôt que le portefeuille.
M. Didier Bollecker. Il est vain de croire que l’humanité n’épuisera pas les ressources en hydrocarbure disponibles. Si nous ne le faisons pas, d’autres pays le feront.
Le bilan énergétique des voitures électriques mérite d’être examiné à la loupe. Remplacer la voiture à moteur thermique par la voiture électrique revient aujourd’hui à un transfert de pollution. Si ce transfert de pollution peut être intéressant, dans les villes en particulier, il ne faut pas oublier que l’électricité est toujours fabriquée avec des hydrocarbures, du charbon – et, en France, avec un peu de nucléaire. On en revient donc toujours au même problème : il faut regarder la chaîne complète.
M. Alexandre Guillet. Il faut effectivement faire la distinction entre la pollution globale et la pollution locale. En la matière, les lignes bougent depuis quelques années. Certaines municipalités prennent leurs responsabilités ; c’est le cas dans toute l’Europe, et même en Chine, où de premières décisions viennent d’être prises. L’enjeu de la pollution locale ne dépend pas des technologies. Il va falloir contraindre les usagers à ne plus entrer dans les villes, mais ce sera très compliqué car cela ne doit pas se faire au détriment de l’économie. Cet enjeu peut être traité sans évoquer les technologies, la question étant toutefois différente pour les transports en commun.
M. Philippe Duron. Monsieur Meunier a raison de dire que l’on tend vers des standards automobiles mondiaux qui dépasseront les standards nationaux. En revanche, je suis un peu plus sceptique quand il dit que l’hydrogène ne marchera pas. Il y a une quinzaine d’années, lorsque Toyota a fait le choix de l’hybride, les constructeurs français n’y croyaient pas du tout, et la presse spécialisée y croyait modérément. Pourtant, la filière s’est bien développée. Aujourd’hui, les constructeurs français font le choix de développer l’hydrogène. J’ai quelques hésitations à affirmer qu’ils se trompent ou qu’ils sont dans une impasse. Il y a peut-être, effectivement, des perspectives d’évolution.
Que pensez-vous de l’évolution de l’industrie automobile ? Actuellement, les véhicules qui se vendent le mieux sont les 4x4, les sport utility vehicles (SUV), donc les voitures lourdes qui consomment et rejettent du CO2. Comment modifier les goûts des consommateurs ? En se dirigeant plutôt vers la vente ou la location de l’usage plutôt que vers la vente de l’objet ?
Enfin, les constructeurs sauront-ils encore mettre sur le marché des produits qui procurent du plaisir tout en offrant davantage de vertus écologiques ?
M. Laurent Chiapello. Les constructeurs sont contraints au plaisir, si je puis dire. Sinon, on ne vendra plus 1,8 million de voitures neuves en France chaque année ! Le consommateur achètera une voiture comme il achète un réfrigérateur, c’est-à-dire en choisissant l’objet qui offre le meilleur rapport qualité-prix, et il en changera le moins souvent possible. Or, c’est un achat irrationnel puisque les gens sont prêts à investir beaucoup d’argent dans l’achat d’un véhicule. Les constructeurs sont contraints d’entretenir le plaisir, de raconter de belles histoires au consommateur, de s’investir dans le sport automobile, etc., sinon ils disparaîtront.
Mais il y a un paradoxe. Aujourd’hui, on vend ce que l’on appelle des SUV, ces espèces de 4x4 civilisés dont on pourrait penser qu’elles consomment beaucoup, alors qu’en réalité elles consomment bien moins que les berlines traditionnelles qui étaient sur le marché il y a dix ou quinze ans. Le consommateur est pragmatique : comme le prix des carburants est bas actuellement, il circule davantage. Le basculement vers des énergies plus « vertes » ne pourra donc pas avoir lieu si le prix des carburants n’augmente pas de façon spectaculaire. Tant que le prix des carburants restera au niveau actuel, les gens continueront à rouler à l’essence ou au diesel. Du reste, Toyota a révisé à la baisse, il y a quelques semaines, ses prévisions de vente de la nouvelle Prius à cause de la baisse du cours du pétrole. Certes, le consommateur prend peu à peu conscience des problèmes de pollution, mais ce qui compte avant tout pour lui, c’est son portefeuille.
M. Brice Perrin. Le problème n’est pas tant celui du coût de l’énergie que celui de sa disponibilité. On sait qu’il faut deux euros pour parcourir cent kilomètres avec un véhicule électrique. Celui-ci est donc bien plus compétitif que le meilleur véhicule diesel. En 2009, le Grenelle de l’environnement a annoncé l’installation de milliers de bornes, mais on les attend toujours, même si 95 % des recharges se font sur des prises domestiques ou des wallbox au domicile ou au bureau. Une loi assez récente oblige désormais les immeubles dépassant une certaine taille à prévoir des raccordements, mais il faudra beaucoup de temps avant que tout le parc immobilier s’équipe. Pour ma part, j’habite dans un appartement qui a été livré neuf il y a cinq ans, mais rien n’a été prévu pour brancher un véhicule électrique – il y a juste une prise dans les parties communes. J’ai branché ma voiture une fois, mais j’ai reçu un courrier du syndic deux jours après ! Le même problème de disponibilité existe pour l’hydrogène puisque deux stations seulement, dont une en Normandie, distribuent cette énergie. Quant au coût d’usage, il est plus ou moins identique à celui du diesel. À l’exception des flottes captives, je ne vois aucun particulier se lancer dans la démarche.
Mme Alexandrine Breton des Loÿs. Il faut regarder quel est le profil des acheteurs. En France, de moins en moins de particuliers achètent une voiture, tandis qu’il y a de plus en plus de véhicules loués ou de véhicules d’entreprise. Le profil des acheteurs doit influer sur le choix. Il est probable que le loyer d’une grosse berline est presque identique à celui d’un SUV, dont l’acheteur fait sans doute plus le choix du « statut » que celui de la berline. Tout cela influe sur la structure du parc automobile.
M. Daniel Quéro. Le véhicule électrique demeure d’usage restreint en raison d’un problème d’autonomie et non à cause du nombre de bornes disponibles. Il est exclu que l’on parte en vacances avec sa famille dans un véhicule électrique : c’est un véhicule fait pour les gens aisés, en tant que deuxième ou troisième voiture.
La première voiture était électrique. Dans les années 1900, la majorité du parc était électrique. En 1905, les taxis parisiens avaient une autonomie de soixante kilomètres. Cent ans plus tard, on en est à 120 kilomètres : c’est dire si on a eu du mal à faire des progrès en la matière. En 1900, personne ne savait que le pétrole serait l’énergie du XXe siècle. Aujourd’hui, on teste un certain nombre d’énergies. Faisons confiance à la technologie, aux constructeurs, quitte à leur imposer des contraintes pour qu’ils progressent. Peut-être y aura-t-il, demain, une énergie qui dominera, que ce soit l’hydrogène ou une nouvelle énergie qui n’existe pas encore. Je pense qu’on la trouvera à un moment ou à un autre.
M. Alexandre Guillet. Il faut aussi promouvoir les programmes européens. Ils existent, mais ils sont quelque peu éparpillés. Quand Toyota s’est lancé dans la voiture hybride à la fin des années 1990, il avait provisionné des pertes sur plusieurs années. Un constructeur comme PSA, même avec l’aide de Dongfeng, n’a pas les moyens de le faire. On voit de plus en plus de grands groupes se regrouper avec des équipementiers au sein de consortiums. Ne soyons pas naïfs : certains pays ne nous attendront pas très longtemps, ou se montreront plus laxistes sur le choix des normes. Promouvoir les programmes européens est du ressort du législateur et de la classe politique.
M. Stéphane Meunier. Le choix politique et stratégique de Toyota est mercantile. Toyota s’est lancé dans l’hybride essentiellement pour le marché américain. La voiture hybride n’y a pas été vendue comme une voiture verte ou écologique, mais comme une voiture à effet turbo, c’est-à-dire que l’apport de l’électricité donne un dynamisme à la voiture – puisqu’aux États-Unis le seul plaisir automobile qui reste est d’être le premier à 55 miles per hour. Toyota dispose d’un trésor de guerre immense. Il est le seul constructeur, avec Mercedes, à pouvoir traiter toutes les énergies en même temps, à avoir des cellules de travail avancées sur tous les modes énergétiques.
À l’époque, la presse automobile n’a pas soutenu l’hybride de Toyota : elle a discuté des qualités intrinsèques du premier produit qui a été mis en vente. C’était une analyste très factuelle d’un produit, par rapport à un consommateur et à une décision d’achat. Regardons quelles sont aujourd’hui les motivations des constructeurs japonais dans leur ensemble par rapport à la voiture à hydrogène, et quels sont les efforts de l’État japonais en la matière. Comme je me rends régulièrement au Japon, je vois que les constructeurs et l’État travaillent main dans la main sur la question de l’hydrogène. Il en est de même en Allemagne. Il faut considérer l’hydrogène, à moyen terme, comme un carburant complémentaire.
M. Didier Bollecker. Je veux appeler votre attention sur le devenir de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).
Si, aujourd’hui, un plein d’électricité coûte un ou deux euros, c’est parce qu’il n’est pas taxé. Je vous rappelle que, chaque année, 34 milliards d’euros sont prélevés sur les automobilistes via la TICPE. Si l’on passe au tout-électrique, aucun Gouvernement ne renoncera à ces 34 milliards ! D’ailleurs, le fait que l’ancienne taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) s’appelle depuis deux ans maintenant taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques laisse penser que le législateur a une idée derrière la tête. Un jour ou l’autre, l’électricité de nos voitures sera taxée, peut-être pas à la prise parce que le système sera très compliqué à mettre en place, mais on peut très bien imaginer qu’un mouchard, installé sur votre véhicule, calculera le nombre de kilomètres parcouru, et qu’on vous enverra une facture. Tout le modèle économique de la voiture électrique doit être apprécié au regard d’une éventuelle modification de la législation et des taxes sur cette énergie.
Mme la rapporteure. Ce n’est pas à l’ordre du jour.
L’utilisation des énergies fossiles « jusqu’à plus soif » risque d’engendrer beaucoup de problèmes pour la planète. Se pose aussi un problème économique de pouvoir d’achat, de résilience par rapport à une situation qui changerait en ce qui concerne les cours du pétrole.
Nous avons bien vu, au fil nos travaux, qu’il fallait redéfinir le rôle de l’État, clarifier les règles et intégrer le critère de pollution globale et celui de pollution locale sans faire de choix technologiques. Nous devons dire aux constructeurs quelle est l’exigence de la puissance publique et quelles sont les règles. Ensuite, à eux de se débrouiller.
Pensez-vous que la France aurait intérêt à faire un choix mono-technologique, par exemple celui du véhicule électrique, ou bien qu’elle doit garder des scénarios ouverts en s’intéressant aussi bien au gaz – pour les camions – qu’au biogaz ou à l’hydrogène ? En posant cette question, je ne parle pas des énergies thermiques, dont les performances doivent et vont certainement encore progresser.
Comment voyez-vous les évolutions structurelles du marché, à travers les contacts que vous avez avec vos lecteurs ou dans le rapport même à l’objet automobile tel qu’il a été évoqué tout à l'heure ?
Présidence de M. Jean Grellier, secrétaire de la mission d’information
M. Lionel Robert. Le Gouvernement n’est pas là pour imposer une voie technologique unique. C’est plutôt aux constructeurs qu’il appartient de décider, puis aux consommateurs de se situer par rapport à tout cela. Le seul critère que le Gouvernement devrait introduire dans la fiscalité est celui de l’écologie. Depuis un an, nous faisons un calcul tout simple qui, je pense, intéresse beaucoup l’actuelle ministre de l’écologie : il s’agit d’attribuer une note écologique qui ne tienne pas seulement compte des rejets de CO2 mais de l’ensemble des polluants. Le Gouvernement pourrait très bien s’appuyer sur cette note pour décider d’une fiscalité qui mettrait toutes les technologies sur un pied d’égalité et permettrait ainsi de définir quelles sont les voitures les plus ou les moins polluantes et de les taxer en fonction de ce critère.
M. Stéphane Meunier. Encore faudrait-il que ce calcul de pollution soit réalisé par un organisme indépendant. Or, actuellement, en ce qui concerne les normes d’émissions, on est obligé de faire confiance aux données des constructeurs ! À la suite de l’affaire Volkswagen, nous avons essayé, comme nos camarades d’Auto Plus, d’étudier la question du coût d’un analyseur d’émissions. L’appareil représente un investissement de 200 000 euros, auxquels il faut ajouter les coûts logistiques et humains. Créons un organisme indépendant, en France ou en Europe, qui réalisera les tests une fois que les normes européennes auront été fixées, et qui vérifiera ainsi la volonté écologique de nos constructeurs.
La France ne peut pas imposer un schéma directeur électrique quand toutes ces questions énergétiques peuvent être traitées en même temps en Allemagne et au Japon. Le Gouvernement français a eu la volonté de favoriser l’énergie électrique. Mais on le voit, on ne tire pas d’avantage à cette prise de parole électrique des constructeurs français, essentiellement de Renault. Nissan en tire plus de bénéfices au niveau mondial. Il y a là un paradoxe.
M. Lionel Robert. Cet organisme indépendant est censé déjà exister : c’est l’UTAC. Le problème c’est qu’il est financé par les constructeurs. Pourquoi ne le serait-il pas par le Gouvernement ?
M. Arnaud Murati. En matière de soutien aux énergies de propulsion, le « monothéisme », si j’ose dire, est vraiment une très mauvaise idée. Le Gouvernement a choisi de soutenir le véhicule électrique par tous les moyens, essentiellement par des primes à l’achat. L’électrique représente aujourd’hui 0,9 % de l’achat des véhicules neufs, avec 6 300 euros de bonus auxquels s’ajoutent la prime à la conversion et tout le reste...
Il ne faut surtout pas négliger les autres modes de propulsion, même ceux qui paraissent polluants, comme le GPL ou l’E85. Certaines filières ont eu de grands espoirs – ce matin encore, j’ai assisté à une conférence de presse organisée par les marchands d’éthanol –, mais elles ont explosé en vol. C’est regrettable, car tous les carburants présentent à un moment donné un bilan écologique qui peut se révéler plus intéressant que celui de l’essence ou du diesel.
M. Laurent Chiapello. Deux évolutions ont vraiment marqué le marché de la voiture neuve depuis ces dernières années : la baisse de gamme – les gens achètent des voitures plus petites, ce qui est sans doute un effet de la crise – et la progression de la location. On peut donner plusieurs explications à ce phénomène : la volonté de se rassurer, d’appliquer à l’automobile un modèle qui s’est développé avec les box Internet, les téléphones portables etc. Si on loue une voiture au lieu de l’acheter, il n’en demeure pas moins qu’on la choisit. Cela ne modifie donc pas en profondeur le rapport à l’automobile : c’est toujours « ma voiture que j’aime ».
Mme Alexandrine Breton des Loÿs. Je partage les propos de M. Chiapello. Les publicités des constructeurs ne mentionnent plus le prix de la voiture, mais le coût mensuel de son loyer. Par exemple, on parle de la Twingo à partir de 129 euros par mois. Ce phénomène est nouveau, il existe depuis environ vingt-quatre mois. Vous utilisez votre voiture pendant quarante-huit mois, puis vous la rendez au concessionnaire sans vous soucier de la revente. Vous consommez la voiture selon votre envie ou votre besoin du moment.
M. Laurent Chiapello. Bien entendu, c’est un business bien plus intéressant pour les constructeurs, qui fidélisent leurs clients en leur proposant une voiture neuve dès que le contrat arrive à échéance.
M. Alexandre Guillet. De nouveaux usages de l’automobile sont appelés à se développer, comme l’autopartage. Là aussi, il faut analyser l’aspect économique en plus de l’aspect écologique. On sait que le parc mondial est promis à une très forte croissance jusqu’en 2040. Ces solutions vont davantage se développer dans les pays matures, c’est-à-dire les nôtres, qui sont susceptibles de vendre moins de véhicules puisque ceux-ci seront davantage partagés et moins possédés. Cela pose un autre problème : celui du lieu où seront produites les voitures. Les usines risquent de disparaître principalement chez nous, mais pas en Inde, par exemple, où le marché va exploser. On n’a pas anticipé non plus le problème de la fiscalité. Un très grand acteur de l’autopartage dont je tairai le nom ne paie des impôts que sur le coût de l’intermédiation, pas sur les recettes globales qu’il dégage. Si l’idée est géniale pour construire des hôpitaux et des écoles, ce n’est peut-être pas l’idéal dans le domaine qui nous occupe.
M. Stéphane Meunier. Depuis tout à l’heure, nous parlons d’achat de véhicules neufs. Or, l’année dernière, seulement 1,9 million de voitures neuves ont été vendues en France, dont 960 000 à des particuliers, tandis que 5 millions de voitures d’occasion ont été achetées, principalement par les particuliers puisque les entreprises n’achètent quasiment pas de voiture d’occasion. Les questions d’écologie, de durabilité de ces produits sont cruciales. Cela corrobore le fait que les gens continuent à se faire plaisir quand ils achètent une voiture, mais qu’ils ont des contraintes budgétaires très fortes.
Mme Alexandrine Breton des Loÿs. Plus de la moitié de ces 5,4 millions de voitures d’occasion ont plus de quinze ans. Ce sont des voitures qui coûtent de 750 à 1 200 euros et qui sont loin des normes antipollution.
M. Daniel Quéro. Beaucoup de gens ne peuvent pas acheter de voitures neuves, même s’ils bénéficient d’aides. Ne pourrait-on les inciter à acheter des véhicules d’occasion récents qui polluent moins que les véhicules anciens ? Si l’on remettait sur le marché les véhicules qui ont été achetés par les entreprises et si l’on facilitait l’achat de ces véhicules par les particuliers, ils auraient des voitures qui polluent moins.
Mme la rapporteure. La question de l’accélération du renouvellement du parc automobile est cruciale. Un grand nombre de personnes que nous avons auditionnées nous ont décrit l’effet pervers des « primes à la casse » sur la production industrielle : au départ, cette mesure soutient l’achat, donc la production. Mais le véhicule qui est acheté plus tôt dans le temps n’est pas acheté plus tard, ce qui entraîne une diminution des ventes. Cette mesure a donc en quelque sorte un effet artificiel.
Outre l’éligibilité des véhicules d’occasion relativement récents à certaines formes de bonus, quelles mesures seraient de nature à encourager le renouvellement du parc ancien ?
M. Daniel Quéro. A priori, je n’en vois pas. Certaines personnes ne pourront jamais acheter un véhicule neuf. Il faut donc s’intéresser à toutes les catégories de véhicules d’occasion, favoriser l’achat d’un véhicule plus récent. À vous de trouver les bons systèmes… Etant donné que beaucoup de véhicules d’entreprise sont mis sur le marché, il y a peut-être là une voie à explorer.
Mme la rapporteure. Selon vous, à quelle vitesse doit s’effectuer le rééquilibrage entre la fiscalité de l’essence et la fiscalité du diesel ? Doit-on le faire tout de suite ou en trois, cinq, voire huit ans ? Il ne faut pas négliger non plus l’impact que peut avoir une telle mesure sur le marché de l’occasion et sur la valeur des véhicules à la revente.
Enfin, j’aimerais que vous abordiez la question du véhicule autonome et du véhicule connecté.
M. Brice Perrin. Le développement du véhicule connecté et du véhicule autonome est inéluctable. C’est une direction que prennent tous les constructeurs. Il y a cinq niveaux d’automatisation de la conduite. Le premier niveau, c’est système antiblocage des roues (Antiblockiersystem, ou ABS) et l’électrostabilisateur programmé (ESP), qui sont déjà une assistance à la conduite. Nombre de véhicules mis sur le marché aujourd’hui disposent d’un freinage automatique d’urgence ou d’une aide au maintien dans la voie. On sait qu’en 2020 il y aura déjà sur le marché beaucoup de véhicules hautement autonomes, et qu’entre 2025 et 2030 apparaîtront les premiers véhicules totalement autonomes. Ceci est rendu possible grâce à une extraordinaire accélération de la technologie, à la fois du matériel et du logiciel, puisque c’est une combinaison des deux qui permet d’avoir la puissance nécessaire pour rendre la voiture autonome.
S’agissant de la voiture connectée, des pistes intéressantes sont à l’étude, notamment la communication entre les voitures et avec l’infrastructure. Les enjeux sont nombreux : ils sont économiques puisque cette technologie permet de libérer du temps pour les personnes, d’avoir des navettes sans chauffeur, des véhicules qui consommeront moins, donc qui pollueront moins. Enfin, l’enjeu est énorme en ce qui concerne la sécurité routière : aujourd’hui, dans les pays développés, 95 % des accidents ont pour origine une erreur humaine. C’est une tendance que les constructeurs français ont bien comprise puisque PSA annonce que la remplaçante de la 508 sera hautement autonome pour 2018. De son côté, Renault Nissan a annoncé une dizaine de véhicules autonomes pour 2020.
Je ne sais pas s’il faudra adapter la législation ; en tout cas il conviendra de faciliter la mise sur le marché et la circulation de ces véhicules.
M. Didier Bollecker. Une étude américaine publiée récemment indique que le seul fait d’équiper les véhicules de l’anticollision dans l’axe longitudinal et de croisement réduirait de 84 % le nombre d’accidents par collision entre deux véhicules.
Je constate que le fait de baisser d’un centime le prix de l’essence et d’augmenter d’un centime celui du diesel fait peser 360 millions d’euros de plus sur le budget des automobilistes. Le calcul est très simple : une baisse d’un centime sur l’essence représente un manque à gagner de 120 millions pour l’État et une hausse d’un centime sur le diesel rapporte 480 millions, les véhicules roulant au diesel étant bien plus nombreux que ceux roulant à l’essence.
En deux ans, le taux de taxation est passé, pour le gazole, de 99 % à 210 %, et, pour l’essence, de 136 % à 214 %, simplement parce que le prix de l’essence a baissé alors que la TICPE est assise sur le volume mesuré en litres. Si cet argent servait à financer le rachat de véhicules moins polluants, on pourrait le comprendre. Je rappelle que, lorsqu’elle a été créée, la TIPP devait abonder un fonds destiné à faire de la recherche sur des énergies nouvelles… On voit ce que cela a donné !
M. Stéphane Meunier. La voiture connectée est une réaction des constructeurs face aux smartphones. La voiture est déjà connectée dans les faits, puisque tout le monde possède un smartphone connecté à son tableau de bord. Mais les constructeurs, pour rattraper ce handicap, savent trouver quantité d’arguments, par exemple celui selon lequel la voiture autonome tuera moins et polluera moins.
M. Laurent Chiapello. Le vrai saut technologique, c’est la voiture autonome, celle qui conduira toute seule dans les embouteillages le matin pendant que vous lirez les journaux ou vos courriels, et qui vous procurera du plaisir quand il n’y aura personne sur la route. Elle sera forcément connectée. L’État et l’Europe ont un rôle essentiel à jouer en matière de législation, mais, pour le moment, on ne voit pas les choses beaucoup bouger. Le premier business, avant même la voiture propre, c’est la voiture autonome et connectée. Elle va en effet mobiliser l’énergie des constructeurs au détriment de la voiture propre : tout le monde voudra une voiture autonome, mais il est moins sûr que tout le monde veuille une voiture propre – à moins que le carburant soit cher, ce qui incitera à s’y convertir. La voiture autonome risque d’écraser sur son passage toutes les autres priorités.
M. Daniel Quéro. Si quelques voitures autonomes seulement se promènent au milieu du parc de véhicules d’aujourd’hui, la sécurité routière risque de ne pas être facile à gérer… On se dirige sans doute vers la voiture autonome, mais cela va prendre beaucoup de temps.
M. Lionel Robert. Madame la rapporteure, quand vous parlez de fiscalité, je suppose que vous pensez au différentiel entre le prix à la pompe de l’essence et le prix du diesel.
Mme la rapporteure. Oui, je pense au fait de mettre les taxes au même niveau. Comme vous le savez, la discussion porte sur la façon d’y parvenir dans le temps. Doit-on procéder à une hausse progressive du diesel en même temps qu’à une diminution progressive de l’essence, ou doit-on seulement augmenter le diesel ? Et quelle sera l’affectation de la recette budgétaire ?
M. Lionel Robert. La convergence dans les deux sens serait bien mieux perçue. Elle permettrait au marché de s’adapter à la nouvelle donne, de se renouveler et d’accroître la part de l’essence.
M. Didier Bollecker. Le consommateur préférerait certainement une baisse de la taxation de l’essence.
M. Brice Perrin. En 2014, la part de marché du véhicule diesel représentait 64 %, contre 57 % l’année dernière et 51 % au mois de janvier dernier. On assiste donc déjà à une évolution, avant même qu’il y ait eu convergence de la fiscalité.
Mme la rapporteure. Cette évolution est due à certaines publications, qu’elles émanent de vous ou d’associations de consommateurs, relatives au coût d’usage des véhicules et aux types d’utilisation pour lesquels le diesel n’est pas pertinent, indépendamment de l’affaire Volkswagen.
M. Arnaud Murati. Certes, il faut parvenir à la convergence. Mais, lors de l’examen du dernier projet de loi de finances rectificative, le doigt a été mis sur un point intéressant : veut-on revenir sur l’avantage fiscal accordé au diesel, ou continuer à distinguer entre le carburant vendu aux professionnels et celui vendu aux autres utilisateurs ?
M. Alexandre Guillet. Je pense qu’il faut programmer dans le temps la hausse sur le diesel, à cause de son impact social. On parle toujours des usines de construction automobile, mais il y a aussi de très belles usines de construction de moteurs, qui représentent un nombre non négligeable d’emplois. Certes, ils peuvent coller au marché, ils ont des variables d’ajustement, mais cela ne doit pas se faire au détriment de l’emploi.
Mme la rapporteure. C’est une question dont nous avons bien pris conscience lorsque nous nous sommes rendus dans la principale usine concernée. Ma question concernait surtout le pouvoir d’achat des automobilistes et l’usage qu’ils font de leur véhicule.
M. Laurent Chiapello. Je crois que les automobilistes ont besoin, comme les constructeurs automobiles, de visibilité. De toute façon, une augmentation des taxes sera toujours impopulaire. En revanche, je pense que les automobilistes sont prêts à repasser à l’essence, et ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à envisager d’abandonner le diesel, notamment parce que les constructeurs développent une offre de véhicules à essence de plus en plus compétitive.
Nous avons besoin de stabilité des règles du jeu, d’une direction claire qui ne soit pas remise en cause d’une année sur l’autre. Nombre de nos lecteurs ont été surpris de voir le bonus accordé aux véhicules hybrides brutalement réduit, alors même que l’on est censé encourager cette technologie ! Que les règles soient modifiées sans explication et sans logique apparente perturbe beaucoup les automobilistes.
M. Stéphane Meunier. S’agissant de la norme Euro 6, on a beaucoup parlé d’excès de NOx pour les véhicules diesel, mais pas du tout pour les véhicules essence, puisque la plupart des moteurs à essence à injection directe bénéficient de dérogations en vue de la future norme. Le diesel est systématiquement attaqué puisqu’il dégage une pollution visible avec les suies. En matière de NOx, beaucoup de moteurs à essence sont moins performants, moins vertueux que les véhicules diesel de norme Euro 6, qui ne trichent pas.
M. Daniel Quéro. C’est exact. Il serait dangereux de piloter la technologie par la seule fiscalité. Qui peut dire si, demain, on ne remettra pas en question l’essence parce qu’on lui aura trouvé quelque chose de néfaste ? On aurait l’air malin d’avoir défendu l’essence contre le diesel, après avoir favorisé celui-ci au motif qu’il émettait moins de CO2. N’oublions pas que 66 % des gens roulent au gazole aujourd’hui.
M. Jean Grellier, président. Je vous remercie tous pour votre participation.
La séance est levée à dix-huit heures dix.
◊
◊ ◊
26. Audition, ouverte à la presse, de M. Fabrice Godefroy, président de l’association Diésélistes de France et directeur général du groupe IDLP et de M. Yann Le Moal, porte-parole de l’association Diésélistes de France et directeur de la société NED.
(Séance du mercredi 3 février 2016)
La séance est ouverte à onze heures trente-cinq.
La mission d’information a entendu M. Fabrice Godefroy, président de l’association Diésélistes de France et directeur général du groupe IDLP et M. Yann Le Moal, porte-parole de l’association Diésélistes de France et directeur de la société NED.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Nous recevons ce matin M. Fabrice Godefroy, président de l’association Dieséliste de France, et M. Yann Le Moal, porte-parole de l’association.
Il va sans dire que, dans sa communication, Dieséliste de France est à la pointe de l’action « pro diesel ». Son site internet souligne les avantages de cette motorisation, en rappelant notamment qu’elle est moins émettrice de CO2. Cette communication va même jusqu’à souligner la nocivité des moteurs essence à injection directe en matière d’émissions de particules. Le décor est donc planté !
Nous aurons sans doute l’occasion en cours d’audition de repréciser avec vous, messieurs, certains de ces points.
Plus généralement, il nous importe de connaître votre sentiment sur les suites de « l’affaire Volkswagen ». Constatez-vous une inquiétude, plus ou moins diffuse, dans votre clientèle ? Que savez-vous, à ce jour, des rectifications qui doivent être réalisées en après-vente sur des milliers de modèles de marques du groupe ? Et existe-t-il un risque de dégradation des performances des véhicules concernés, ce qui s’accompagnerait d’une chute de leur valeur de revente ?
Un tout autre point ne concerne pas directement cette affaire, mais il a déjà été évoqué devant nous : il s’agit de la pratique dite du « défapage ». Certains propriétaires de véhicules diesel sont apparemment tentés de désactiver, voire de faire enlever le filtre à particules. Leurs motivations seraient, semble-t-il, souvent financières en raison des coûts d’entretien, voire de remplacement du filtre à particules.
Nous allons, dans un premier temps, vous écouter au titre d’un bref exposé de présentation de votre association professionnelle et également de la situation générale de votre secteur d’activité. Puis Mme Delphine Batho, rapporteure de la mission d’information, vous posera un premier groupe de questions. Enfin, les autres membres de la mission vous interrogeront à leur tour.
M. Fabrice Godefroy, président de l’association Diéséliste de France et directeur général du groupe IDLP. Nous vous remercions de nous recevoir. Je suis directeur général du groupe Italie Diesel Lobjoy et Peltret (IDLP), spécialisé dans la distribution de pièces détachées automobiles, toutes marques. Nous distribuons notamment toutes les pièces pour la réparation d’équipementiers de première monte – Bosch, Delphi, Valeo, etc. ; c’est ce qu’on appelle le marché de la rechange indépendante. Nous sommes également spécialisés dans la réparation et la gestion moteur, tous types de véhicules
– diesel, essence, hybride et électrique. Autrement dit, notre panel est très large.
Entreprise familiale qui fête ses soixante-dix ans cette année et dont je représente la quatrième génération, le groupe IDLP est devenu leader sur le marché de la rechange indépendante. Il est entouré, le plus souvent, de groupes financiers dont la plupart ne sont plus basés en France – les entreprises familiales ont pratiquement disparu de ce secteur.
Je suis également président de l’association Diéséliste de France, qui a pour but d’assister les professionnels du moteur diesel, en favorisant l’échange d’expériences et en assurant à nos adhérents une veille technologique. Les diésélistes exercent en effet un métier assez complexe et très évolutif : la technologie évolue très vite, et il faut être capable de la suivre et de s’adapter en termes d’investissements et de formations. La plupart d’entre eux font également de la gestion moteur tous types de véhicules.
Depuis deux ans, nous sommes régulièrement sollicités pour réagir aux diverses polémiques qui se sont développées autour du diesel, ce qui nous a amenés à collecter toutes les informations en la matière pour en faire un résumé, que nous allons vous présenter.
Je suis accompagné par Yann Le Moal, qui est tout à la fois le directeur de la société National Électrique et Diesel (NED), située à Gennevilliers, et le porte-parole de l’association Diéséliste de France, ce qui l’amène souvent, comme moi, à intervenir dans les médias.
Nous allons vous présenter un diaporama, mais nous serons prêts à répondre à vos questions dans le même temps. Nous n’aurons pas réponse à tout, car nous ne représentons pas les constructeurs, mais les spécialistes de la réparation.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Vous êtes des spécialistes de la réparation de tous types de moteurs. Pourquoi avoir choisi une telle dénomination pour votre association ?
M. Fabrice Godefroy. Nous aurions pu choisir « Spécialiste de la gestion moteur », mais cela n’aurait pas été parlant. Il faut comprendre que le diesel est une spécialité. Je fais le parallèle avec les kinésithérapeutes, qui sont aussi parfois ostéopathes : parmi les professionnels de la gestion moteur, certains sont spécialisés dans le diesel moyennant des formations et des équipements très spécifiques – et d’ailleurs très coûteux. Voilà l’explication de la dénomination « Diéséliste de France », que nous assumons.
M. Yann Le Moal, porte-parole de l’association Diéséliste de France et directeur de la société NED. Notre présentation se compose de trois parties : les projets de l’association et les idées défendues ; la pertinence de l’avantage fiscal accordé au diesel et sa justification en ce qui concerne les émissions polluantes ; l’impact économique de l’avantage fiscal sur l’industrie et le parc automobiles.
Notre première partie va se décliner autour des idées suivantes : communiquer au plus grand nombre avec des données factuelles sur les avantages et les inconvénients de chaque type de motorisation ; apporter notre expertise aux médias afin que des messages pertinents soient diffusés ; conseiller les décideurs afin que la réglementation évolue de façon pragmatique ; aider au développement de la mixité de notre parc roulant, tout en assurant une cohérence économique et écologique.
La pollution, la santé, où en sommes-nous ?
En 2012, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé les émissions des moteurs diesel des années 1960 à 1980 parmi les cancérogènes, avant de corriger le tir en 2013, en indiquant que la pollution atmosphérique était cancérigène.
Les études toxicologiques sur les émissions des moteurs diesel ont montré en 2006 que les oxydes d’azote (NOₓ) ont des effets gênants sur les systèmes pulmonaire et cardiaque. Ce constat est avéré. En 2014, le programme ACES de Health Effects Institute a, par contre, conclu à l’absence de potentiel cancérogène des émissions moteur norme US 2007, équivalent de notre norme Euro 5.
Sur la base de ces différentes communications, on peut dire donc que les moteurs diesel ancienne génération sont effectivement dangereux pour la santé, mais que les moteurs modernes – respectant les normes européennes Euro 5 et Euro 6 – ne sont plus cancérigènes.
Mme la rapporteure. On ne peut pas dire qu’ils ne sont pas cancérigènes.
M. Yann Le Moal. En tout cas, ils le sont beaucoup moins : les moteurs récents provoquent moins de décès que ceux des années 1980.
Mme la rapporteure. On peut s’en tenir aux mesures aujourd’hui en vigueur…
M. Yann Le Moal. La décision politique doit tenir compte des caractéristiques des moteurs qui sortent des usines et qui répondent aux nouvelles normes, et non de moteurs qui datent de trente ans.
M. Fabrice Godefroy. Nous nous basons sur les résultats de l’analyse la plus récente, réalisée par Health Effects Institute, qui a conclu à l’absence de potentiel cancérogène des émissions des moteurs diesel nouvelle génération, type Euro 5 notamment, équipés de filtre à particules. Or ils n’ont constaté aucun effet cancérigène. Les choses ont évolué.
M. Yann Le Moal. Comment choisir sa motorisation lors de l’achat de son véhicule ?
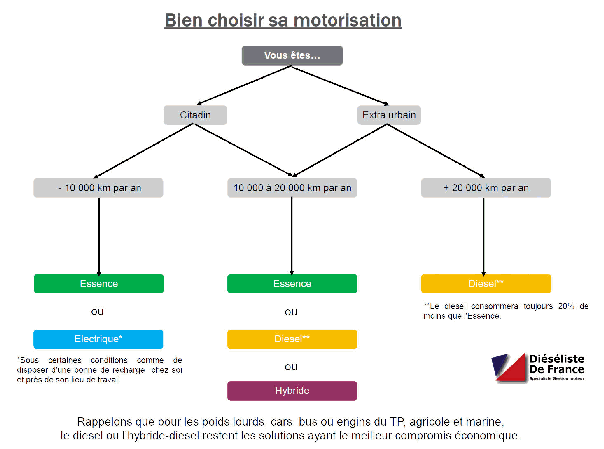
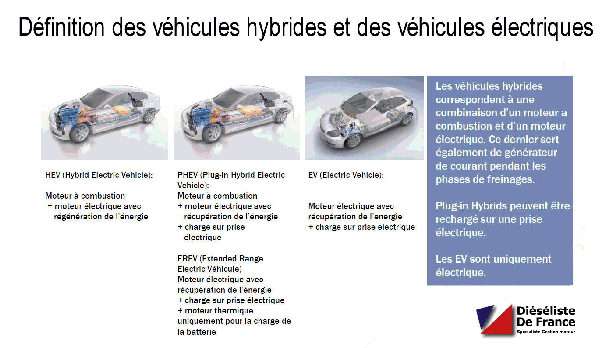
À l’heure actuelle, le choix du véhicule devrait répondre exclusivement à des considérations économiques. Rouler en Twingo diesel pour faire cinq kilomètres par jour est une aberration ! Le développement aberrant du diesel en France depuis les années 1970 doit impérativement laisser place à une mixité dans le choix des véhicules et de carburants. Ainsi, selon que l’on est citadin ou extra-urbain, il convient de choisir le véhicule correspondant le mieux à son utilisation, c’est-à-dire en fonction du nombre de kilomètres parcourus par an. Au-dessus de 20 000 kilomètres par an, le diesel est incontestablement le plus adapté – nous allons expliquer pourquoi –, alors qu’un petit véhicule essence ou électrique sera plus intéressant pour moins de 10 000 kilomètres par an.
Le terme « véhicule hybride » est vague. On distingue trois sortes d’hybrides.
Les premiers, à gauche sur l’image, sont équipés d’un moteur essence ou diesel et d’un moteur électrique utilisé uniquement dans les phases de démarrage et d’accélération. Cette solution a permis de diminuer les émissions de CO2 sur la base des normes d’homologation en vigueur.
Nouvelle génération de véhicules hybrides, les hybrides connectés sont équipés d’une batterie plus importante : le moteur électrique est utilisé sur une phase plus longue et l’autonomie électrique varie de 25 à 80 kilomètres suivant les constructeurs.
Un autre type de véhicule hybride est équipé d’un moteur électrique utilisé 100 % du temps et d’un moteur thermique installé dans le coffre et qui sert uniquement, à recharger la grosse batterie, ce qui permet une autonomie électrique de 130 à 300 kilomètres.
Le véhicule 100 % électrique quant à lui, permet, sur la base de l’offre actuelle, une autonomie réelle de 130 ou 150 kilomètres – à part ceux d’un constructeur américain, mais ses véhicules ne sont pas à la portée de tout le monde.
L’hydrogène comme un futur carburant ?
Toyota commence à vendre des véhicules à hydrogène en Europe. Le « moteur à hydrogène », est en fait un moteur électrique alimenté par une pile à combustible qui utilise de l’hydrogène. En associant l’hydrogène et l’oxygène, la pile à combustible crée un courant électrique et rejette de la vapeur d’eau sans aucunes émissions polluantes. Or le développement de la pile à combustible reste coûteux ; et surtout, isoler l’hydrogène reste un procédé polluant et très énergivore. A l’heure actuelle, les infrastructures ne sont pas forcément adaptées, si bien que cette énergie devrait être développée de façon cohérente pour une utilisation dans quinze à vingt ans.
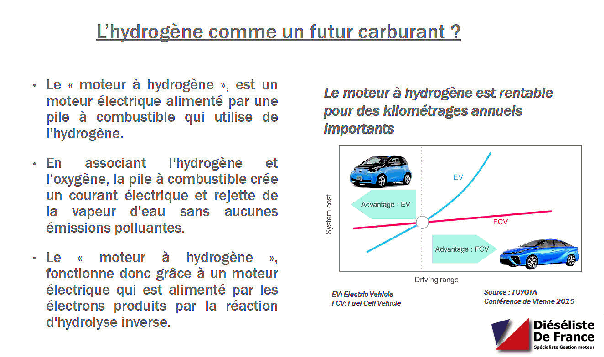
Comme l’analyse Toyota sur le graphique de droite, l’hydrogène ne présentera un intérêt que pour les véhicules lourds – bus, camions. Ainsi, l’hydrogène n’est pas la solution de demain pour tous les types de véhicules, et certainement pas pour les véhicules urbains petits rouleurs.
Actuellement, Mme la ministre de l’environnement propose une prime de conversion avantageuse pour l’achat d’un véhicule électrique en remplacement d’un vieux diesel. Pour notre part, nous pensons que cela serait trop réducteur. Pourquoi ?
Prenons le cas d’un particulier qui fait environ 30 000 kilomètres par an et qui souhaite remplacer son véhicule diesel polluant du début des années 2000 par un véhicule plus propre. Actuellement, l’État ne l’incite que pour acheter un véhicule électrique. Or l’offre actuelle en véhicules électriques sur le marché ne permet pas de rouler 30 000 kilomètres par an. Nous pensons donc que la prime de conversion devrait être proposée, non seulement aux véhicules électriques à usage urbain, mais aussi aux véhicules diesel ou essence propres – respectant les dernières normes –, neufs ou d’occasion. En effet, tout le monde n’a pas les moyens d’acheter un véhicule neuf, d’une part, et un véhicule Euro 5 de trois ou quatre ans est fortement dépollué en diesel comme en essence, d’autre part, ce qui le fait contribuer à la dépollution du parc global, ainsi qu’à l’éradication des anciens véhicules du début des années 2000, voire ceux d’avant, de notre parc automobiles.
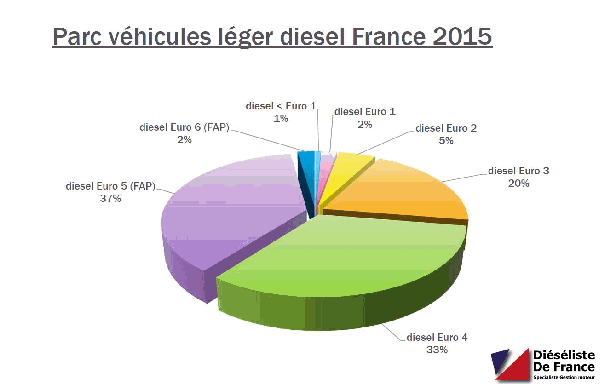
Désormais, les véhicules diesel les plus polluants – Euro 1 et Euro 2 – sont minoritaires dans notre parc. Sur les véhicules moins polluants, Euro 3 et Euro 4, qui représentent 53 % du parc, nous allons vous faire une proposition.
M. Fabrice Godefroy. Les véhicules Euro 5 et Euro 6, les moins polluants grâce aux filtres à particules et au système « SCR » d’élimination des oxydes d’azote, représentent dorénavant 40 % du parc diesel. Ces derniers mois, les constructeurs ont noté un renouveau des ventes. Ainsi, le renouvellement du parc se fait assez rapidement.
M. Yann Le Moal. Aujourd’hui, pour le consommateur, il n’existe donc qu’une solution : l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion. Pourquoi, en effet, ne pas dépolluer le parc existant ou, en tout cas, les véhicules qui peuvent être sauvés – les mettre à la casse n’est pas forcément écologique ?
La solution du retrofit a été développée à différentes reprises. Les véhicules diesel Euro 3 et Euro 4, des années 2000 à 2010, pourraient être dépollués à faible coût – aux alentours de 500 euros –, en rajoutant un filtre à particules. Certes, ce procédé ne réduirait pas 99,9 % des émissions de particules comme le font les filtres d’origine, mais il les diminuerait fortement, par exemple dans certaines zones urbaines.
Mme la rapporteure. Dans quelles proportions ces émissions polluantes seraient-elles réduites ?
M. Yann Le Moal. Ce procédé permet de réduire entre 30 % et 70 % les émissions de particules, selon le type de véhicule et l’utilisation – il ne concerne pas les NOx. Ne faut-il pas d’ores et déjà réduire les particules ne serait-ce que de 30 %, plutôt que ne rien faire ?
M. Fabrice Godefroy. L’équipementier allemand HJS fabrique ce système pour les véhicules légers : 500 000 véhicules ont déjà été équipés en Allemagne. En France, seuls les bus et les poids lourds sont équipés d’un système fabriqué par un équipementier anglais, Eminox.
Mme la rapporteure. L’équipement des 500 000 véhicules légers en Allemagne a-t-il pu être réalisé grâce à des obligations réglementaires ou des incitations financières ?
M. Yann Le Moal. Les deux : des obligations réglementaires pour les zones de faibles émissions dans certaines agglomérations et des aides financières qui couvraient pratiquement 100 % de l’équipement.
Mme la rapporteure. Il s’agit donc d’une politique locale ?
M. Yann Le Moal. Effectivement.
Mme la rapporteure. Que pensez-vous de l’analyse en France selon laquelle le retrofit est pertinent pour les poids lourds, mais pas pour les véhicules légers ?
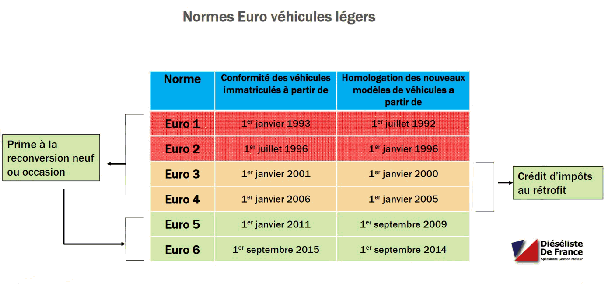
M. Fabrice Godefroy. C’est une question de coût. Pour les poids lourds et les bus, ces filtres à particules sont technologiquement pertinents puisqu’ils ont des performances identiques à ceux d’origine, mais ils sont coûteux – entre 4 000 et 6 000 euros. Pour les véhicules légers, le coût doit être moins élevé, sans compter la problématique technologique, ce qui explique que ces appareils sont moins efficaces par rapport à un filtre d’origine.
M. Yann Le Moal. Les véhicules les plus polluants – Euro 1 et Euro 2 – doivent disparaître de nos routes, et les véhicules Euro 3 et Euro 4 peuvent devenir moins polluants grâce à l’installation du retrofit encouragé par un crédit d’impôt. Pour les Euro 1 à Euro 4, une prime à la conversion pour l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion Euro 5 ou Euro 6 –, quel que soit le type de carburant, permettrait de dépolluer rapidement le parc.
Passons à la deuxième partie : la pertinence de l’avantage fiscal accordé au diesel et sa justification en ce qui concerne les émissions polluantes.
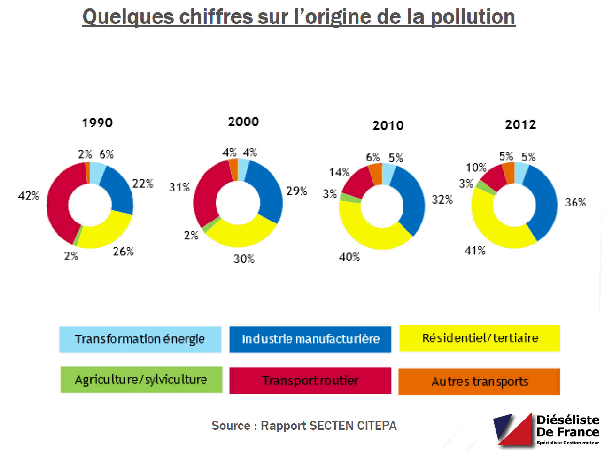
Entre 1990 et 2012, la pollution atmosphérique due au transport routier est passée de 42 % à moins de 10 % ; aujourd’hui, c’est le résidentiel-tertiaire et l’industrie manufacturière qui contribuent le plus à la pollution globale. Par conséquent, taxer certains carburants ne résoudra pas le problème dans son ensemble.
Mme la rapporteure. Ces chiffres sont des moyennes : ils ne correspondent pas à la réalité de la pollution locale en ville.
M. Yann Le Moal. La solution n’est donc pas de surtaxer certains carburants en raison d’un problème local spécifique aux grandes villes, car cela pénaliserait l’ensemble de nos concitoyens.
Mme Marie-Jo Zimmermann. Absolument ! Voilà qui remet quelques idées en place… Merci !
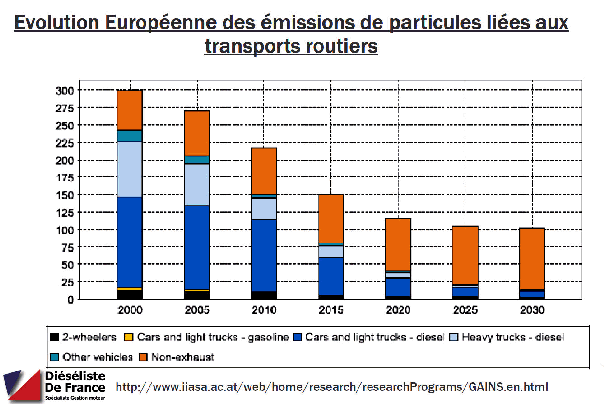
M. Yann Le Moal. Depuis les années 2000, les émissions de particules des moteurs diesel ont baissé de pratiquement 50 %, alors que les particules émises par les freins, les pneus, l’usure de la route, bref, tout ce qui ne sort pas du pot d’échappement, n’ont pas diminué. Grâce à l’évolution programmée des technologies, la pollution liée à l’échappement sera inférieure à 10 % en 2030. La solution n’est donc pas de tout révolutionner, mais plutôt de faire baisser les émissions fines générées par les pneus, le revêtement routier et les freins – la poussière noire sur vos jantes, ce sont des particules pures !
M. Fabrice Godefroy. Les équipementiers qui fabriquent des plaquettes de frein réfléchissent d’ores et déjà à l’éco-friction, c’est-à-dire à la problématique des particules liées au freinage. Un petit équipementier français, Tallano Technologie, a mis au point un système de captation des particules par aspiration, qui peut être adapté sur différents véhicules.
Mme Marie-Jo Zimmermann. Une étude comparative entre les différents véhicules – diesel, essence, électrique – serait opportune, un rapport de l’ADEME ayant montré que les véhicules électriques sont, eux aussi, polluants.
M. Yann Le Moal. Il faut noter que les véhicules électriques sont parfois plus lourds que leurs homologues diesel, à cause du poids des batteries, mais ils bénéficient d’un frein moteur beaucoup plus puissant dans la mesure où leur moteur leur sert alors à récupérer l’énergie pour recharger les batteries, si bien qu’ils ont tendance à émettre un petit moins de particules – de l’ordre de 5 % – que les autres types de véhicule lors du freinage.
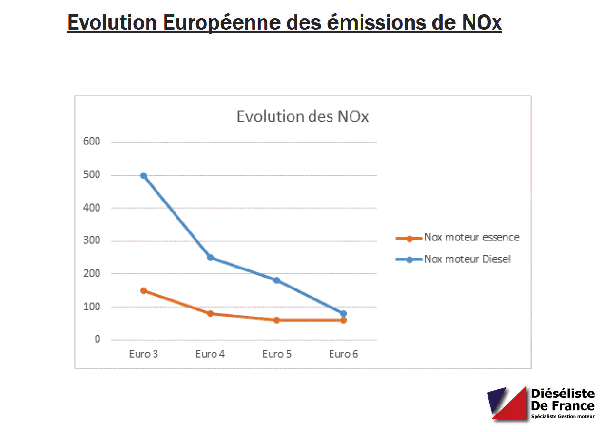
S’agissant des émissions d’oxydes d’azote, le moteur diesel est arrivé au niveau du moteur essence. En effet, si les émissions de NOx des véhicules Euro 3 sont cinq fois supérieures à celles des moteurs à essence, les émissions des véhicules Euro 6 sont désormais identiques à celles des moteurs à essence. Là encore, le débat est dépassé.
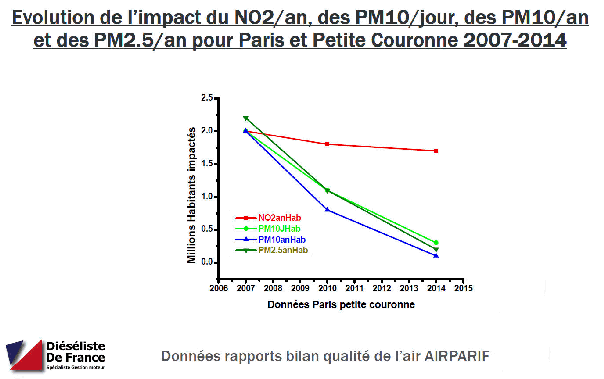
M. Fabrice Godefroy. Dans son rapport 2015, Airparif note une baisse très importante des particules entre 2007 et 2014, mais une faible baisse des NOx, puisque la norme Euro 6 ne vaut que pour les immatriculations à partir de 2015.
M. Yann Le Moal. Cette courbe montre que, entre 2007 à 2014, le nombre d’habitants de Paris et de la Petite Couronne affectés par les particules fines a fortement diminué. Ce chiffre commence à diminuer pour les oxydes d’azote, grâce à la mise sur le marché des véhicules Euro 5, et cette évolution sera plus marquée dans les trois à quatre années à venir grâce à l’arrivée des motorisations Euro 6.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Cette courbe est à rapprocher de celle de l’agglomération strasbourgeoise, et notamment de la surmortalité observée.
M. Yann Le Moal. Si le diesel émet des polluants, même si l’écart avec les autres moteurs s’est considérablement resserré, il présente cependant un avantage au niveau des émissions de CO2. Du fait même de son principe de fonctionnement, un véhicule diesel émettra toujours entre 15 % et 20 % de CO2 en moins qu’un moteur essence. Si le parc européen était constitué de 50 % de véhicules essence et de 50 % de véhicules diesel, la production de CO2 augmenterait de 67 millions de tonnes par an, sur un total de 826 millions de tonnes émises annuellement. Décourager le diesel ferait donc exploser le niveau de CO2 et ne permettrait pas aux constructeurs d’atteindre l’objectif européen de 95 grammes au kilomètre de CO2 en 2021. Par conséquent, il est nécessaire d’assurer une mixité du parc.
Je rappelle donc les raisons pour lesquelles il ne faut pas surtaxer le diesel.
Le diesel est essentiel pour répondre aux objectifs en matière de CO2 de l’Union européenne pour 2021.
Le raffinage du pétrole brut donnera toujours le même pourcentage de gazole et d’essence. Par conséquent, le développement du diesel dans les années 1970 a été une erreur, puisqu’il représente aujourd’hui 70 % du parc : il ne faudrait pas faire la même erreur en sens inverse.
Le diesel est une alternative indispensable pour limiter le développement des centrales – charbon, fioul et nucléaire. Dans un contexte de réduction de la part du nucléaire, mettre rapidement des véhicules électriques sur la route n’est pas logique ; mieux vaudrait prévoir un laps de temps assez long pour développer la production électrique grâce aux énergies renouvelables comme la biomasse.
Les secteurs de l’industrie, des BTP, de la marine, de l’agriculture et de l’artisanat, n’ont pas d’autres choix que d’utiliser le diesel pour les véhicules lourds. Surtaxer le diesel entraînerait de grandes difficultés économiques pour tous ces secteurs.
En conclusion de cette deuxième partie, la différence de consommation d’énergie fossile et d’émissions de CO2 entre le diesel et l’essence sera toujours de 15 à 20 % – à l’avantage du diesel. La somme des polluants d’un moteur essence sera toujours supérieure à celle d’un moteur diesel. Et le niveau d’émissions de CO2 des moteurs essence et diesel reste inférieur à celui d’un véhicule électrique, sur une base « du puits à la roue », c’est-à-dire de la fabrication du véhicule jusqu’à sa destruction.
J’en viens à notre troisième partie : l’impact économique de l’avantage fiscal sur l’industrie et le parc automobiles.
L’État doit fixer des règles du jeu : une fiscalité claire et visible à long terme, d’une part, et des normes pour plus de stabilité, d’autre part, surtout pour les futurs véhicules. En effet, les constructeurs français de véhicules électriques, notamment, sont laissés « à l’abandon » par l’État car ils n’ont actuellement pas les mêmes normes. DU coup, ils adoptent des stratégies totalement contradictoires.
Grâce à des règles du jeu claires, les constructeurs pourront développer une gamme de produits adaptée, et le secteur de l’après-vente pourra effectuer les investissements nécessaires pour maintenir le futur parc au niveau de dépollution de sortie d’usine. Cette perspective répond à la problématique du défapage, que vous avez évoquée en introduction : il faut trouver des solutions pour que les véhicules restent au même niveau de dépollution tout au long de leur vie.
L’alignement de la fiscalité de tous les carburants est une bonne chose pour développer une mixité du parc, car les conducteurs choisiront le carburant et le véhicule en fonction de leur utilisation, et non uniquement en fonction des taxes sur les carburants ou des aides d’État à l’achat.
D’un point de vue financier, l’alignement fiscal sera bénéfique à plusieurs titres.
S’agissant des particuliers, il contribuera à la dépollution du parc, car ces derniers seront incités à installer des dispositifs de dépollution sur leur véhicule ou à changer de véhicule.
Concernant les professionnels et les entreprises, il encouragera l’investissement dans le renouvellement du parc. Ces derniers investiront dans des véhicules propres, mais en fonction de l’utilisation qu’ils ont à en faire. On n’achètera pas un camion électrique pour faire Paris-Marseille toutes les nuits !
Du côté des constructeurs, cet alignement fiscal soutiendra l’investissement dans le développement des nouvelles gammes. Il est important que les constructeurs sachent ce qu’ils doivent développer. Dans l’électrique, l’un de nos deux constructeurs ne fait que des véhicules hybrides haut de gamme et très chers, et l’autre une sorte de voiturette de golf qui ne ressemble à rien et qui est invendable ! Ou bien l’État fixe un objectif de 10 % pour l’électrique, et les constructeurs y mettront les moyens pour développer une offre attrayante, ou bien le flou perdure, et l’offre restera incohérente avec aucun acheteur et moins de 3 % de véhicules électriques en circulation, en comptant les Autolib.
Enfin, s’agissant du secteur après-vente, cette manne financière soutiendra l’investissement en faveur des outils de travail permettant le maintien du niveau de dépollution. Car, je l’ai dit, les véhicules dépollués doivent le rester tout au long de leur vie.
Mme la rapporteure. Vous êtes évidemment totalement libres de votre introduction… Si certains éléments de votre présentation sont tout à fait exacts et incontestables, comme le rapprochement des motorisations essence et diesel en termes de pollution, d’autres sont inexacts, je pense au bilan carbone, à l’analyse du cycle de vie de la voiture électrique, ou au développement de l’électrique qui obligerait à la remise marche de centrales à charbon…
À vous entendre, surtaxer le diesel serait une aberration, mais aligner la fiscalité de l’essence et du diesel relèverait du bon sens. Or ce n’est pas encore le cas aujourd’hui. À quelle vitesse faudrait-il aller afin de parvenir à cet alignement ?
Selon les personnes auditionnées avant vous, les primes à la casse ont créé un effet d’aubaine, en soutenant artificiellement le renouvellement du parc, immédiatement suivi d’une diminution des achats. Autrement dit, les véhicules achetés avant ne sont plus achetés après. D’où leurs réserves à l’égard d’un tel dispositif. Qu’en pensez-vous ?
Enfin, le contrôle technique pose problème. Les nouveaux véhicules sont incontestablement moins polluants que les anciens. Le problème est celui de l’écart entre les nouvelles normes et la réalité ; et plus les normes se sont durcies, plus l’écart est allé grandissant. Or, en l’état actuel des choses, le contrôle technique ne vérifie quasiment rien… D’où la réflexion de notre présidente sur le dérapage. Quelles obligations vous paraîtraient pertinentes en termes de vérification des dispositifs antipollution au moment du contrôle technique, tant en ce qui concerne le filtre à particules que les systèmes anti-NOx ?
M. Jean Grellier. Chaque année, 1,8 million de véhicules neufs et 5,5 millions de véhicules d’occasion sont vendus en France, dont la moitié a plus de quinze ans. Le retrofit n’est pas très développé pour les poids lourds et les bus, bien qu’il semble intéressant. Pour les véhicules particuliers, la dimension industrielle aurait-elle un intérêt ? Si oui, quelles mesures d’incitation seraient opportunes ?
M. Fabrice Godefroy. À partir du moment où l’on admet que les gens doivent acheter un véhicule en fonction de l’utilisation qu’ils vont en faire, et sachant que l’utilisation idéale d’un diesel est comprise entre 20 000 et 40 000 kilomètres par an, quand bien même l’essence et le diesel seraient au même prix à la pompe, les grands rouleurs diesel seraient toujours avantagés en consommant 20 % à 25 % de moins qu’un rouleur essence. Ainsi, la différence de consommation est très importante – et il en est de même pour les émissions de CO2 : d’où notre proposition sur la fiscalité. J’ajoute que si la TVA sur le diesel est actuellement récupérable pour les entreprises, il ne faut pas se tromper en décidant de rendre déductible la TVA sur l’essence, sachant que l’enjeu est de taille pour les entreprises, dont le poste transport est très lourd.
M. Yann Le Moal. S’agissant des particuliers, le rapprochement des fiscalités peut être assez rapide, pour peu qu’il soit correctement expliqué.
Pour les entreprises, l’impact est autrement plus important, d’autant qu’elles utilisent des véhicules légers mais aussi des véhicules utilitaires et des véhicules lourds. Mais quand bien même elles approuveraient un alignement essence-diesel, elles ne pourront pas acheter des poids lourds essence : cela n’existe pas…
Mme la rapporteure. Il ne s’agit pas de supprimer la récupération de la TVA pour le diesel, mais d’accorder la déductibilité à d’autres types de motorisation.
M. Yann Le Moal. Dans ce cas, il n’y aurait aucun problème. Mais il ne faudrait pas que les choses s’inversent.
M. Fabrice Godefroy. Ce serait parfait, puisque cela permettrait aux entreprises d’acheter des véhicules en fonction de leurs besoins. Mais pour l’heure, il est inenvisageable pour un chef d’entreprise d’acheter un véhicule essence.
M. Yann Le Moal. S’agissant des primes à la conversion, « jupettes », « balladurettes » et autres mesures du même genre, notre proposition concerne les véhicules neufs ou d’occasion. Cela doperait partiellement le marché du neuf, tout en permettant de dynamiser le marché d’occasion récent, avec des véhicules aux normes Euro 5 et Euro 6, qui auront trois à cinq ans maximum.
S’agissant du contrôle technique, il est aberrant que les gens puissent ne pas entretenir leur véhicule, voire le défaper sans aucun problème, alors que les normes d’homologation des véhicules sont aussi drastiques. Un véhicule mal entretenu multiplie par deux, voire par cinq, ses émissions polluantes. Pour maintenir en bon état les éléments de dépollution des véhicules vieillissants, il faut changer des pièces. Or du fait de leur coût élevé, les filtres à particules sont purement et simplement retirés par certains propriétaires. Cette situation impose une adaptation du contrôle technique, incapable actuellement de contrôler la pollution, puisqu’il intervient encore sur la base des technologies des années 1980-1990 ! Mais cette adaptation suppose la mise au point d’une base de données métrologiques légale – qui n’a commencé à être complétée qu’à partir des années 2009. Tant qu’il s’agit de distribuer des vignettes de couleur, ce n’est pas trop gênant, mais sitôt que cela peut conduire à interdire un véhicule ou lui coller une amende, cela pose un gros problème de légalité.
Plus précisément, sur les véhicules à partir de la norme Euro 4, équipés d’un filtre à particules ou non, les outils utilisés dans les centres de contrôle technique peuvent détecter des particules visibles à l’œil nu, mais ils sont incapables de détecter des particules microscopiques, si bien qu’ils ne peuvent pas non plus indiquer la présence, ou non, d’un filtre à particules. En effet, les défapages sont réalisés « ni vu ni connu » : il suffit d’ouvrir le silencieux, de retirer la partie céramique à l’intérieur, puis de refermer le silencieux – et de mettre un leurre électronique dans le calculateur : du coup, le voyant ne s’allume plus et le client roule sans pouvoir être inquiété. Par conséquent, la détection des défapages impose d’équiper les centres de contrôle technique et les forces de l’ordre affectées aux contrôles routiers d’outils dignes de ce nom, c’est-à-dire capables de déceler des particules visibles au microscope. Des outils existent, ils sont assez coûteux, mais ils ne sont pas déployés, car aucune obligation n’existe en la matière.
Mme la rapporteure. Le défapage est-il une pratique minoritaire ou largement répandue ?
M. Yann Le Moal. Cette pratique était peu répandue il y a deux ou trois ans, mais elle se généralise et va exploser en raison du vieillissement des véhicules. De fait, les véhicules équipés de filtre à particules commencent à vieillir, d’où une multiplication des pannes. Or quand il doit payer un filtre à particules 1 200 euros pour un véhicule de cinq à huit ans dont la valeur vénale n’est plus que de 2 000 à 2 500 euros, le propriétaire préférera défaper. Sans législation, 70 % à 75 % du parc – les véhicules au-dessus de 150 000 à 180 000 kilomètres – seront défapés d’ici cinq à six ans.
Mme la rapporteure. Quel est le coût des outils permettant de déceler la présence ou non d’un filtre à particules ?
M. Yann Le Moal. Ces outils coûtent entre 8 000 et 10 000 euros.
M. Fabrice Godefroy. En France, 9 000 bus et poids lourds sont retrofités, mais les véhicules légers sont très peu concernés : pourtant ces équipements fonctionnent très bien ; nous les avons nous-mêmes testés et nous les avons en disposition, tout un chacun peut nous les commander.
En Allemagne, le retrofit est un succès car non seulement les propriétaires bénéficient d’une aide financière, mais cette modification leur permet de circuler dans les zones de basse émission.
Les zones de faible émission – qui n’existent pas encore en France –, couplées au système des vignettes pendant les pics de pollution, s’avéraient beaucoup plus efficaces que la circulation alternée qui ne cible pas les véhicules de façon sélective. Le retrofit ne peut se développer qu’en parallèle d’un tel dispositif. Idéalement, le développement du retrofit nécessiterait donc, tout à la fois, la restriction – les zones de faible émission avec autorisation aux véhicules de vignettes 1 et 2 de circuler pendant les pics de pollution, et interdiction de rouler aux vignettes 3 et 4 – et une aide de l’État à l’équipement. C’est ce qu’a fait l’Allemagne. La Belgique avait mis en place l’aide, mais sans la restriction : cela n’a pas marché. Il faut faire les deux.
Madame la rapporteure. Si je comprends bien, l’acceptabilité de l’alignement fiscal essence-diesel sera possible si le produit de cette fiscalité est entièrement affecté au financement des mesures d’aide à la dépollution – primes à la conversion et aide au retrofit ?
M. Yann Le Moal. Tout à fait. Il faudrait également aider les centres de contrôle technique à s’équiper d’outils permettant la détection des défapages, afin qu’ils soient en mesure de contrôler que le parc reste dépollué. Il faudrait enfin soutenir les constructeurs afin qu’ils puissent développer une vraie mixité du parc, avec de vraies offres dignes de ce nom, que ce soit en véhicules électriques, essence ou hybride.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Messieurs, il ne nous reste plus qu’à vous remercier.
La séance est levée à douze heures trente-cinq.
◊
◊ ◊
27. Audition, ouverte à la presse, de M. Jacques Rivoal, président du directoire de Volkswagen France.
(Séance du mardi 9 février 2016)
La séance est ouverte à seize heures trente.
La mission d’information a entendu de M. Jacques Rivoal, président du directoire de Volkswagen France.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Nous recevons aujourd’hui M. Jacques Rivoal, président du directoire de Volkswagen Groupe France. M. Rivoal a accompli toute sa carrière dans l’automobile dans les domaines du marketing et de la vente. Avant de prendre la tête de la filiale française de Volkswagen, il a dirigé une autre importante filiale pendant près de neuf ans, celle du groupe Renault en Allemagne. Il connaît donc parfaitement les méthodes de travail comme les principes de fonctionnement du secteur automobile outre-Rhin !
Parler en introduction de l’importance de la filiale française de Volkswagen, c’est rappeler qu’avec différentes marques, dont Audi, SEAT et Skoda, ce constructeur est en France le premier importateur. Les ventes du groupe atteignent près de 13 % de notre marché avec un réseau qui compte environ 15 000 salariés.
Notre mission s’intéresse à l’offre automobile française dans sa totalité. Il était inconcevable qu’elle n’auditionne pas la direction de Volkswagen, même si cette société ne produit pas en France, compte tenu la place occupée par votre groupe sur le marché national. Les atermoiements autour de votre venue, monsieur Rivoal, ne doivent pas masquer cet aspect.
L’« affaire Volkswagen », comme il est convenu de l’appeler, est née aux États-Unis. Certes, la stratégie du groupe n’est pas décidée en France par des dirigeants français mais relève du siège allemand. Toutefois, près de 950 000 véhicules commercialisés en France sont concernés par les calibrages de moteurs bien particuliers qui ont été mis au jour aux États-Unis avec la découverte de logiciels truqueurs. Il y a en Europe, et notamment en France, beaucoup plus de propriétaires de véhicules de vos marques directement touchés par cette crise qu’il n’y en a en Amérique du nord !
Notre préoccupation première est la défense des consommateurs français sans omettre pour autant les éventuels dégâts collatéraux d’une crise de confiance susceptible d’affecter tout un secteur.
La représentation nationale se devait de vous entendre.
Notre démarche n’est d’ailleurs en rien exceptionnelle. Nous avons auditionné d’autres constructeurs et vos homologues à la tête des filiales italienne ou encore britannique du groupe ont déféré aux convocations des commissions parlementaires de leur pays d’implantation. Pour sa part, le patron de Volkswagen North America a immédiatement été entendu par le Congrès des États-Unis qui, nous n’en doutons pas, poursuivra autant qu’il lui plaira ses investigations. En Allemagne, nos collègues du Bundestag questionnent sans doute quasi quotidiennement des responsables de votre groupe.
Monsieur le président, votre présence doit servir à clarifier une situation complexe. Il vous faut aller au-delà des premières formules généralement employées au titre d’une communication de crise.
Nous avons conscience des difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Les possesseurs de véhicules de vos marques sont inquiets, ils veulent connaître les rectifications qui vont être réalisées sur les différents types de moteurs concernés. Ils souhaitent également savoir selon quel calendrier vont s’échelonner ces opérations qui n’ont rien d’anodin. D’ailleurs, votre réseau est-il, à lui seul, capable de traiter autant de véhicules ? Leurs performances et leur consommation risquent-elles d’être atteintes ? La valeur de revente sera-t-elle affectée ? Autant de questions qui amènent les propriétaires français à se demander s’ils sont en droit d’attendre de votre part une indemnisation, à l’instar de celle mise en place aux États-Unis.
Ces inquiétudes sont légitimes de la part de particuliers qui, par leur achat, ont témoigné d’une confiance envers vos marques.
Nous allons, dans un premier temps, vous écouter au titre d’un exposé liminaire. Puis Madame Delphine Batho, rapporteure de notre mission, vous posera un premier groupe de questions. Elle sera suivie par les autres membres de la mission qui vous interrogeront à leur tour.
M. Jacques Rivoal, président du directoire de Volkswagen France. Madame la présidente, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les députés, j’articulerai mon propos liminaire autour de quatre points.
Je ferai, dans un premier temps, une présentation rapide du groupe Volkswagen France qui me permettra de vous décrire ses activités et de circonscrire les sujets sur lesquels je suis en mesure de vous apporter des éléments d’information.
Comme j’ai bien compris que l’objet de cette audition était ce que les médias ont appelé l’« affaire Volkswagen », j’en tracerai une rapide chronologie et vous donnerai de plus amples informations sur celle-ci. Je tiens à vous préciser que n’étant ni juriste ni ingénieur, je ne pourrai sans doute pas répondre à toutes vos questions sur les sujets juridiques ou technologiques les plus complexes.
Ensuite, je vous expliquerai ce que nous avons fait depuis le 20 septembre et ce que nous allons continuer à faire, en vous précisant ce qui dépend de ma responsabilité directe. J’insisterai sur ce qui constitue pour nous une priorité : rassurer nos clients en communiquant avec eux.
Enfin, je vous donnerai quelques informations sur la stratégie de notre groupe en matière d’électro-mobilité.
Je veux vous indiquer que je suis guidé par un souci de totale transparence et animé de la volonté de coopération que j’ai affichée depuis le 21 septembre. En préambule, je veux éclaircir deux points.
Je regrette le malentendu qui a fait que je n’étais pas présent à l’audition du 27 janvier. Cela a pu être mal interprété. Sachez qu’en aucun cas je n’ai voulu froisser la représentation nationale : je suis un citoyen qui respecte profondément la République. Ceci est derrière nous, il nous faut maintenant avancer.
Ensuite, je tiens à réaffirmer que les véhicules qui feront l’objet des mesures de service après-vente tout au long de l’année 2016 ne présentent en aucun cas des problèmes de sécurité. Ils sont techniquement sûrs et sont en parfait état de marche. Par ailleurs, tous les véhicules que nous commercialisons depuis fin septembre 2015 sont en totale conformité avec les normes environnementales en vigueur.
J’en viens à mon premier point. Volkswagen Groupe France (VGF) est une filiale d’importation et de distribution de véhicules neufs. Notre siège social se situe à Villers-Cotterêts dans l’Aisne et comprend depuis un peu plus d’un an une antenne à Roissy. Implantés en France depuis 1960, nous disposons d’environ mille points de vente et de réparation. Nous sommes le premier importateur en France, avec plus de 260 000 véhicules neufs vendus en France, ce qui place notre part de marché entre 13 % et 14 %.
En matière d’emploi – j’imagine que vous aurez des questions sur les répercussions éventuelles de cette crise en ce domaine – sachez que nous employons directement 650 personnes. Si l’on prend en compte notre réseau de distribution, ce sont plus de 15 000 personnes qui travaillent directement ou indirectement pour nous. Nous n’avons aucun site de production de véhicules particuliers en France mais il y a à Saint-Nazaire et à Nantes deux usines de production de véhicules industriels, MAN et Scania, filiales intégrées au groupe Volkswagen gérées directement par l’Allemagne, qui emploient chacune environ 700 à 750 personnes.
Enfin, il faut souligner le poids économique de notre groupe en tant que client très important des trois grands équipementiers français : nos commandes représentant entre un quart et un tiers du chiffre d’affaires de Valeo, Plastic Omnium et Faurecia.
Le domaine de responsabilité de VGF porte exclusivement sur la revente de véhicules que nous importons – nous n’homologuons pas nous-mêmes.
Pour ce qui est de la chronologie relative aux émissions d’oxydes d’azote – NOx – , rappelons que le 20 septembre sont mis en cause aux États-Unis les résultats des tests de certains modèles du groupe Volkswagen. C’est à cette date que je prends connaissance de l’affaire, n’ayant eu auparavant strictement aucune information sur ce qui se passait. Le 29 septembre, Volkswagen AG, autrement dit la maison-mère allemande, établit un plan d’action pour modifier les véhicules équipés des moteurs diesel EA189 répondant aux normes Euro 5. Des solutions techniques sont développées et présentées aux autorités compétentes en octobre 2015.
Le 1er octobre, nous apprenons par la presse que le ministère de l’écologie met en place une commission destinée à effectuer des tests sur cent véhicules représentatifs des marques vendues en France. À ce jour, nous ne disposons que d’informations partielles sur leurs résultats, essentiellement par voie de presse. Je tiens toutefois à préciser que dès que cette commission est créée, je suis sollicité par la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) et que je facilite une rencontre entre celle-ci, l'Union Technique de l'Automobile, du motocycle et du Cycle (UTAC) et des experts allemands venus de la maison-mère. Cette rencontre a lieu le 26 octobre, soit trois semaines après l’annonce de l’installation de cette commission et trois mois avant que n’aient lieu des auditions d’autres constructeurs depuis également concernés par la question des émissions de NOx.
Dès le 2 octobre, soit dix jours après le communiqué de presse, nous mettons à la disposition de nos clients toute une série de moyens de communication afin qu’ils puissent se renseigner. Il s’agit d’un site internet – sur les quelque 950 000 clients concernés, 150 000 s’y sont connectés pour pouvoir savoir si leur véhicule était concerné –, d’un Numéro Vert – qui reçoit entre cinquante et cent appels chaque jour –, d’une plateforme de relations avec la clientèle – qui a reçu 8 000 courriers à ce jour –, sans oublier une messagerie instantanée.
Le 12 octobre, nous prenons la décision de suspendre la vente et les immatriculations de véhicules Euro 5 concernés.
Le 15 octobre, le Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), l’office fédéral de régulation du secteur automobile allemand, décide que les véhicules équipés du moteur diesel EA189 doivent faire l’objet d’actions techniques. Notre groupe accepte de les effectuer, afin de rassurer ces clients.
Point important : le groupe Volkswagen ne considère pas que le logiciel concerné constitue un dispositif d’invalidation interdit par la réglementation européenne. Nous estimons que cette question devra être examinée par les experts et l’autorité judiciaire, laquelle sera amenée, le moment venu, à dire le droit.
La volonté du groupe a été de dépasser ces débats techniques ou juridiques et d’agir très concrètement. Le 25 novembre, des mesures techniques sur les moteurs diesel EA189 de 1,2 litre, 1,6 litre et 2 litres sont présentées au KBA. Les mesures correctives sont désormais déterminées pour la majorité des véhicules concernés. Pour le moteur d’1,2 litre, qui représente 4 % des volumes, nous indiquons que lesdites mesures seront présentées à la fin du mois.
Le 16 décembre, nous informons nos clients de la mise en œuvre de ces mesures. Nous avons détaillé sur un transparent le calendrier de mise en œuvre des solutions techniques jusqu’à la dernière semaine de 2016, selon les différents moteurs – 1, 2 litre, 1, 6 litre, 2 litres. Au tout début de ce mois, la première procédure a été effectuée sur un moteur de 2 litres du modèle Amarok, en présence du ministre allemand des transports.
Les clients concernés seront informés par notre groupe puis contactés directement par le concessionnaire chez qui ils ont acquis leur véhicule, à mesure que les plans d’action techniques seront validés par le KBA. Cette procédure prendra la forme d’une opération de rappel, réservée généralement aux véhicules affectés par des problèmes de sécurité, ce qui n’est pas le cas ici, je le rappelle.
Une fois la solution technique validée par le KBA, le client sera contacté par le concessionnaire afin qu’il amène son véhicule dans son atelier. Grâce à une valise-diagnostic, celui-ci communiquera le numéro de série à la maison-mère qui confirmera si le moteur est bien concerné. Si la réponse est positive, il mettra à jour le logiciel de la voiture, grâce à la nouvelle version que la maison-mère lui aura envoyée dans la nuit.
Il s’agit, vous le voyez, d’une opération simple qui dure entre une demi-heure pour les moteurs de 1,2 litre et de 2 litres et trois quarts d’heure pour le moteur d’1,6 litre qui nécessite l’ajout d’un régulateur de flux, petite pièce en plastique qui permet de canaliser l’arrivée d’air dans le moteur.
Si le calendrier s’étale sur toute l’année, c’est que le KBA valide les solutions techniques moteur par moteur, version par version, marque par marque, modèle par modèle, selon la nature de la boîte, qu’elle soit manuelle ou automatique. La construction de la pièce en plastique pour le moteur de 1,6 litre décalera l’opération pour les véhicules concernés au mois de septembre.
Beaucoup de clients se demandent quelles seront les conséquences éventuelles de ces solutions techniques sur les prestations de leur véhicule. Il faut savoir que le KBA procède à une double validation : outre le plan d’action technique, il valide le fait que cette opération n’a strictement aucune conséquence sur la consommation du véhicule, donc sur les émissions de CO2, sur la puissance maximum, sur le couple et sur le bruit. Cela implique qu’il n’y a aucune conséquence, normalement, pour la valeur du véhicule.
Nous avons commencé ces opérations en France. Je me suis rendu vendredi dernier dans une concession parisienne pour accueillir le premier client concerné, une dame propriétaire d’un Amarok.
J’en arrive à mon quatrième point : les priorités de Volkswagen Groupe France.
Il s’agit d’abord de la coopération avec toutes les autorités compétentes. Comme je l’ai précisé, j’ai été le premier à rencontrer l’UTAC, en présence d’experts allemands le 26 octobre, ce qui a permis à la commission dite « Royal » de débuter les tests. J’ai également rencontré différents collaborateurs du ministère des finances et du ministère de l’environnement ainsi que du secrétariat général de l’Élysée. J’insiste sur le fait que nous avons fourni tous les éléments demandés par les autorités.
Il s’agit ensuite de veiller à maintenir la confiance de nos clients. Tout ce qui a été dit sur notre entreprise est de nature à les interpeller. Nous prenons soin de rappeler régulièrement que les véhicules concernés ne souffrent d’aucun problème de sécurité ou de qualité. Nous insistons sur le fait que les véhicules nouvellement mis en vente étant conformes aux normes Euro 6, ils ne sont pas du tout appelés à faire l’objet d’une solution technique. Nous avons envoyé un premier courrier et nous nous apprêtons à en envoyer un deuxième qui donnera de plus amples informations à nos clients.
J’ai également donné deux interviews, l’une au Figaro, l’autre au Journal du dimanche, essentiellement centrées sur la pédagogie à l’égard de nos clients.
Comme disent les Chinois, dans toute crise, il y a une opportunité. Pour le groupe Volkswagen, cette crise offre une occasion de changer profondément son organisation. Il s’engage à la réformer par une plus grande décentralisation, une meilleure écoute des marchés et des marques, tout en concentrant les synergies sur les domaines où il nous faut avancer plus rapidement, comme le digital ou la compliance.
Il entend aussi induire un changement de culture. Notre nouveau management appelle à plus d’ouverture, plus de transversalité, plus d’audace et de créativité.
Enfin, le groupe a décidé d’accélérer sa stratégie, qui reste concentrée sur le développement durable. À ma connaissance, Volkswagen est le seul constructeur à s’être engagé formellement sur l’objectif fixé par la Commission européenne d’émissions de CO2 de 95 grammes au kilomètre en 2021. Nous comptons l’atteindre dès 2020. De la même manière, alors que l’objectif était de 132 grammes pour 2015, nous avons confirmé que nous nous étions fixé 120 grammes, et la crise n’a pas affecté notre détermination.
Le groupe investit dans tous les domaines de l’électro-mobilité, l’optimisation des performances des émissions des moteurs thermiques, l’offre de véhicules électriques, hybrides mais également hybrides rechargeables. Nous avons également, même si elle est peu développée en France, une offre de gaz naturel de ville, intéressant certaines administrations. Nous sommes le seul groupe à avoir en France une offre de biocarburant. La France est le premier producteur mondial de betteraves et nous avons publié la semaine dernière un communiqué concernant la Golf bioéthanol. Ajoutons à ces offres les prototypes roulant avec une pile à combustible, technologie appelée à davantage se développer sur le long terme.
Malgré la crise qu’il traverse, le groupe Volkswagen a décidé d’augmenter ses investissements au titre de l’électromobilité, à hauteur de 100 millions d’euros.
Il a investi dans une plateforme dédiée aux véhicules électriques pour l’ensemble de ses marques : à l’horizon 2020, son offre couvrira vingt modèles électriques ou hybrides.
Il ne s’agit pas de science-fiction. Prenons l’exemple de la Golf, modèle mythique chez nous : c’est le seul véhicule en France à pouvoir fonctionner avec toutes les énergies alternatives existantes – version électrique, version hybride rechargeable, version bioéthanol, version GNV. J’insiste aussi sur le fait que nos deux modèles équipés de technologies hybrides rechargeables, l’Audi A3 e-tron et la Golf GTE, représentent 50 % des véhicules hybrides rechargeables vendus en France.
En guise de conclusion, je dirai que l’enseignement majeur que nous tirons de cette crise est qu’il existe un consensus dans la société pour passer du système de mesure des émissions de NOx en laboratoire, qui permettait depuis plus de quarante ans une comparaison entre constructeurs, à un système de mesure en situation réelle, sur route, permettant de vérifier la conformité à des normes environnementales toujours plus exigeantes.
Le groupe est prêt à s’engager dans ce processus et soutient la réglementation Real Driving Emissions (RDE) mise en place récemment en place par la Commission européenne.
Le transparent que je vais vous présenter le prouve. Il porte sur l’écart des émissions de NOx–Euro 6 mesurées en conditions réelles et en banc d’essai. Le graphique croise en abscisse les modèles de différents constructeurs et en ordonnée l’écart mesuré de 1 à 18. La ligne verte indique ce que pourrait être en 2017 la norme dans l’esprit du nouveau règlement, soit 110 % de 80 mg. Quelques-uns de nos modèles la dépassent mais la plupart s’y conforme. Vous constaterez que le meilleur modèle de tout le panel est issu de notre groupe : le Volkswagen Sharan.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Je commencerai par indiquer quelques données complémentaires. Sur les 200 milliards d’euros de chiffre d’affaires du groupe Volkswagen à l’échelon mondial, 6 milliards sont réalisés en France, où il se situe en troisième place sur le marché national. Rappelons aussi son poids économique en termes d’emplois et de commandes aux grands équipementiers.
La révélation du scandale du logiciel truqueur a été un tremblement de terre. Cette affaire grave a montré – et je parle à titre personnel – jusqu’où peut conduire la course effrénée aux profits. Elle a fait trois types de victimes : les consommateurs dont la confiance a été trompée ; la santé et l’écologie, du fait de l’absence totale de conscience de ce qu’est la responsabilité environnementale d’une entreprise au XXIe siècle ; l’industrie automobile elle-même, à double titre. D’abord, ce procédé a constitué une forme de concurrence déloyale par rapport à d’autres constructeurs qui, eux, s’efforcent non sans difficultés de respecter les normes. Il y a une grande différence entre l’usage d’un logiciel truqueur destiné à contourner les tests d’homologation et les écarts constatés entre les différents protocoles d’homologation et les tests en conditions réelles. Ensuite, cette affaire a provoqué une crise de confiance qui porte préjudice à l’ensemble d’un secteur industriel stratégique.
Mme la présidente l’a rappelé, 946 000 véhicules sont concernés en France, soit deux fois plus qu’aux États-Unis. Des procédures judiciaires et administratives sont engagées. Nous n’avons pas l’intention d’interférer avec le cours de la justice en raison du principe de séparation des pouvoirs. Reste que plusieurs parlements se sont emparés de l’affaire pour connaître les mesures de réparation destinées aux consommateurs mais aussi examiner ses causes profondes et cerner la responsabilité des pouvoirs publics – certaines personnes auditionnées par notre mission d’information ont utilisé le terme de « complicité ».
Ce scandale a été révélé grâce à l’action non des autorités publiques mais d’une modeste ONG, à laquelle je veux ici rendre hommage, l’International Council on Clean Transportation (ICCT), et elle l’a été aux États-Unis et non pas en Europe.
Le PDG de Volkswagen, Matthias Müller, a affirmé : « Franchement, c’est un problème technique, nous n’avons pas eu la bonne interprétation de la loi américaine et nous avions fixé certains objectifs pour nos ingénieurs. Ils ont résolu le problème, atteint les objectifs en trouvant une solution avec un logiciel qui n’est pas compatible avec la loi américaine. C’est ce qui s’est passé ».
J’aimerais insister sur le fait, monsieur Rivoal, que ce logiciel n’est pas davantage compatible avec la réglementation européenne. Je voudrais tordre le cou à l’affirmation selon laquelle les normes auraient été violées aux États-Unis mais pas en Europe. Examinons les chiffres. La norme Euro 5 fixe les émissions de NOx à 180 milligrammes par kilomètres. Un dépassement de quarante fois la norme américaine équivaut à 1 720 mg par km, soit une valeur très supérieure à la norme européenne. Par ailleurs, le règlement européen de 2007 affirme explicitement dans son article 5 que « l’utilisation de dispositifs d’invalidation qui réduisent l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions est interdite ». Il définit à son article 3, paragraphe 10, lesdits dispositifs comme « tout élément de conception qui détecte la température, la vitesse du véhicule, le régime du moteur en tours/minute, la transmission, une dépression ou tout autre paramètre aux fins d'activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement de toute partie du système de contrôle des émissions, qui réduit l'efficacité du système de contrôle des émissions ». Les choses sont claires.
Ma première question porte sur les mesures de rappel : sont-elles validées pour tous les véhicules ? Le KBA a confirmé le 30 novembre avoir reçu de Volkswagen les solutions techniques pour l’Europe pour les trois types de moteurs affectés. Le 27 janvier, dans un communiqué, il indiquait qu’il a donné l’autorisation finale pour les moteurs utilitaires de 2 litres mais que l’autorisation pour les autres moteurs concernés était encore en cours d’examen, contrairement à ce qu’indiquait Volkswagen dans son communiqué du 16 décembre.
Deuxièmement, comment expliquez-vous que les mesures en question soient validées par le KBA mais invalidées par l’Environmental Protection Agency aux États-Unis ? L’EPA a en effet rejeté les propositions techniques de Volkswagen pour la mise aux normes des véhicules incriminés. Par ailleurs, la Commission européenne a demandé toutes les informations techniques à Volkswagen pour s’assurer que les mesures correctrices envisagées sont efficaces. Enfin, on peut se demander si le KBA est le mieux placé pour se prononcer sur la validité des solutions techniques proposées. Cet office fédéral est placé sous l’autorité du ministre des transports et confie les tests à réaliser au Technischer Überwachungsverein (TÜV), autrement dit l’organisme qui a homologué les véhicules incriminés. Il n’y a donc pas de regard extérieur sur les plans d’action techniques. Ajoutons que le KBA accrédite comme laboratoires de tests des filiales d’entreprises comme Bosch ou une filiale directe de Volkswagen située au siège même du groupe, ce qui soulève un problème de conflit d’intérêts, qui n’est pas spécifique à l’Allemagne, je veux tout de suite le préciser.
J’en viens au calendrier de mise en œuvre des solutions techniques. J’aimerais savoir à quoi correspondent les pourcentages dans le document que vous avez présenté. Dans les interviews que vous avez données, monsieur Rivoal, vous avez indiqué que parmi les 600 000 clients s’étant manifestés auprès de Volkswagen France, seuls 150 000 avaient été identifiés comme propriétaires d’un véhicule touché. On sait que 946 000 véhicules au total sont concernés. Qu’allez-vous faire pour les quelque 800 000 propriétaires n’ayant pas été identifiés. La mesure de rappel est-elle obligatoire à vos yeux ? Certains consommateurs s’inquiètent des performances de leur véhicule après rectification. Peut-on avoir l’assurance que les 946 000 propriétaires concernés en France bénéficieront de solutions de correction s’agissant d’émissions polluantes qui, si elles n’entraînent pas de problème de sécurité, posent assurément des problèmes de santé publique ?
M. Jacques Rivoal. L’ensemble des mesures techniques pour les trois types de moteurs concernés ont été aujourd’hui validées par le KBA. La validation a d’abord concerné les moteurs de 1,2 litre et de 2 litres, qui ne nécessitent qu’une mise à jour du logiciel ; elle a été plus longue pour le moteur de 1,6 litre, qui réclame l’ajout d’un régulateur d’entrée d’air.
Le KBA est en train d’effectuer le deuxième processus de validation qui porte sur l’absence de conséquences de la mise en œuvre de ces solutions techniques sur les prestations du véhicule. Elle est effectuée modèle par modèle et nous procéderons progressivement. Après l’Amarok viendra la Passat, puis l’Audi A4. Nous sommes confiants : dans la mesure où les premiers modèles ont été validés, les autres suivront.
Nous avons choisi d’effectuer des opérations de rappel, procédure usuelle dans notre industrie lorsque des problèmes de sécurité se posent. L’histoire de l’automobile a été ainsi ponctuée par le rappel de véhicules qui prenaient feu, qui se retournaient, qui étaient affectés de problèmes de freinage, avec parfois des morts. Toutefois, si cette procédure est usuelle, il faut bien voir que les précautions prises par Volkswagen sont exceptionnelles. Généralement, les constructeurs traitent les véhicules rappelés sans faire valider les solutions techniques appliquées par un organisme extérieur. Non seulement nous avons choisi de les faire valider par le KBA mais nous lui soumettons aussi l’absence d’incidences sur la sécurité, les prestations du véhicule, donc sa valeur. C’est comme si un constructeur français concerné par un problème d’émissions de NOx faisait valider par l’UTAC ses opérations de rappel.
Une fois la procédure de mise à jour du logiciel effectuée, le concessionnaire colle une pastille sur le véhicule traité, qui est de nature à rassurer nos clients.
La situation est différente aux États-Unis. Les normes ne sont pas les mêmes, elles fixent les émissions maximales de NOx à 31 mg par kilomètre contre 180 mg pour la norme Euro 5. En outre, les solutions techniques ne sont pas encore validées.
Pour les chiffres concernant les propriétaires concernés en France, permettez-moi d’apporter des précisions pour plus de clarté. Entre 2007 et 2012, près de 950 000 personnes en France ont acheté des véhicules construits par le groupe Volkswagen équipés du moteur EA189. Sur ce total, 150 000 aujourd’hui se sont connectées sur notre site internet pour savoir si elles étaient concernées. Cela ne veut pas dire que les autres propriétaires ne seront pas contactés. Nous avons déjà envoyé un courrier à la totalité des 950 000 clients pour expliquer la procédure que nous mettions en œuvre. Nous allons leur adresser un deuxième courrier dans les jours qui viennent dans lequel nous entrerons davantage dans le détail des opérations. Ensuite, ils recevront un troisième courrier pour les prévenir que leur concessionnaire les appellera – il en sera ainsi fin février pour les propriétaires de Passat. Enfin, quatrième étape, le concessionnaire contactera chaque client pour l’inviter à se présenter dans son atelier. Le pourcentage de 100 % qui était indiqué sur le transparent repose bien sur la totalité des véhicules concernés, soit 950 000.
Mme Delphine Batho, rapporteure. J’aurai deux questions complémentaires :
Premièrement, quel seuil d’émissions de NOx sera atteint après rectification ?
Deuxièmement, que se passera-t-il si certains propriétaires de véhicules concernés ne souhaitent pas procéder à la mise à jour du logiciel ?
M. Jacques Rivoal. Le but de l’opération est de permettre à tous les véhicules de conserver leur homologation, sachant que le KBA ne l’a pas retirée dans la mesure où nous procédions à ces plans d’action. La mise à jour du logiciel vise à établir une conformité avec la norme Euro 5.
Notre objectif est de faire en sorte que 100 % des clients concernés confient leur véhicule à nos ateliers. Nous sommes mobilisés avec les 15 000 collaborateurs de notre réseau pour transformer ce qui aurait pu être perçu comme une contrainte en une expérience valorisante. La meilleure manière pour nous de restaurer cette confiance qui a pu être mise à l’épreuve est de faire en sorte que l’opération de rappel se déroule dans de bonnes conditions. Nous avons rencontré tous les concessionnaires pour leur expliquer les diverses étapes et les former aux techniques. Le rappel de 950 000 véhicules représentera d’après nos estimations une augmentation des entrées en atelier de 20 %, ce qui constitue une lourde charge de travail mais aussi une formidable opportunité en matière d’emploi. Ce surcroît de travail supposera en effet de recruter au cours de l’année 2016 et certainement aussi au début de l’année 2017 900 mécaniciens ou conseillers-clients supplémentaires dans le cadre de contrats à durée déterminée ou d’intérim. Nous subventionnerons 50 % du coût de recrutement. Alors que nous venons de lancer l’opération il y a une semaine, notre réseau a déjà identifié 400 besoins de recrutement.
Notre priorité est de réduire au maximum les désagréments pour le client : l’immobilisation du véhicule durera entre trente minutes et quarante-cinq minutes et dans 30 % des cas, cette opération pourra être effectuée à l’occasion de la visite classique d’entretien qui a lieu tous les deux ans ; bien sûr, tout cela est gratuit et un véhicule de courtoisie sera mis à disposition du client s’il en a besoin ; un lavage extérieur et intérieur, un contrôle des éléments de sécurité sera offert. Nous voulons faire en sorte que ce qui aurait pu être vécu de façon négative pour les clients le soit de façon positive.
Mme la présidente. Quelle présentation séduisante ! Au fond, tout cela permettrait de créer des emplois. Je vois quelques collègues sourire et leur laisse sans plus attendre la parole.
M. Philippe Duron. Le scandale américain qui a révélé une tromperie à l’égard des consommateurs et des autorités de contrôle a eu de quoi surprendre : Volkswagen avait bâti sa réputation de sérieux sur un savoir-faire technique exceptionnel, la qualité et la robustesse de ses véhicules et une gamme largement diversifiée autour d’une plateforme rationalisée.
Vous nous dites que votre volonté est d’atteindre en avance les nouveaux objectifs fixés par les normes européennes. On est tentés de vous demander ce qui vous a empêchés de trouver les solutions techniques permettant de respecter les normes américaines et ce qui vous permettra d’élaborer celles qui vous mettront en conformité avec les normes européennes. Il me semble qu’une firme comme la vôtre était en mesure de relever les défis technologiques induits par les normes américaines.
Par ailleurs, comment et dans quels délais entendez-vous retrouver la confiance de vos clients mais aussi de l’opinion ?
Enfin, avez-vous estimé le coût qu’impliquent pour vous non seulement l’opération de rappel, avec le surcroît d’activité qu’elle implique, mais également les moindres ventes provoquées par la crise de confiance.
M. Yves Albarello. La publicité de Volkswagen avec le slogan « Das Auto » a disparu depuis quelques semaines. Cela veut bien dire quelque chose. Votre sérénité et votre calme, monsieur le président, donnent l’impression que rien ne s’est vraiment passé alors qu’il s’agit d’un scandale planétaire. Je dois dire qu’il est difficile de voir se refléter dans votre attitude les attentes des parlementaires et les inquiétudes des consommateurs.
L’opération de rectification ne durerait qu’une demi-heure. Je ne suis pas technicien de l’automobile mais je ne comprends pas comment une simple mise à jour de logiciel et l’ajout d’une petite pièce de plastique permettraient de polluer moins. J’aimerais avoir sur ce sujet une explication de votre part.
M. Frédéric Barbier. Nous avons tous le même genre d’interrogations. Nous découvrons qu’en quinze jours de recherches, vous avez mis au point un système qui permet aux véhicules de répondre aux normes de pollution tout en conservant les mêmes performances en termes de puissance et de consommation, autrement dit un système qui vous aurait permis d’éviter cet immense scandale. Pourquoi ne l’avoir pas installé plus tôt ?
Ma deuxième question concerne les autres constructeurs. Je veux parler de ceux qui ont consenti de lourds efforts de recherche et développement et qui ont investi des montants élevés pour s’assurer que leurs véhicules répondaient aux normes. Ne considèrent-ils pas que ce logiciel truqueur constitue une forme de concurrence déloyale ? Quels contacts avez-vous avec eux, si tant est que vous en ayez ?
M. Gérard Menuel. Le hasard du calendrier fait qu’en ce moment même, la commission du développement durable étudie la proposition de résolution européenne concernant la révision des procédures de mesure des émissions des polluants atmosphériques automobiles.
J’ai salué le fait que vous approuviez la mise en place d’un nouveau cycle d’essai fondé sur la mesure des émissions en conditions réelles. Il est heureux que vous reveniez à des intentions plus vertueuses.
Cet épisode scandaleux aura-t-il des répercussions sur le plan économique, notamment en termes d’emplois en France et ailleurs dans le monde ? Quelles sont les incidences sur vos ventes partout dans le monde ?
M. Éric Straumann. Volkswagen a effectivement commis une erreur, une erreur importante, de là à dire, cher collègue Albarello, qu’il s’agit d’un scandale planétaire, c’est peut-être aller trop loin. Les journalistes de la presse spécialisée que nous avons auditionnés nous ont dit qu’ils savaient que tous les constructeurs adaptaient un peu leur système électronique pour pouvoir passer les tests. Je pense qu’il ne faut pas jeter ainsi l’opprobre sur un constructeur européen de qui dépendent beaucoup d’emplois dans notre pays – je pense en particulier à l’usine Bugatti à Molsheim, fleuron de l’économie locale. Faisons la part des choses. Les véhicules construits par d’autres constructeurs européens n’auraient pas forcément répondu aux contraintes techniques du marché américain. Je ne cautionne pas le procès unilatéral que l’on intente à Volkswagen, qui reste un grand constructeur de notre continent. Il ne faudrait pas que nous nous tirions nous-mêmes une balle dans le pied. Pour finir, je précise qu’en tant qu’élu du Haut-Rhin, je roule en Peugeot !
M. Jacques Rivoal. Ce n’est pas parce que j’essaie de vous expliquer les choses sereinement que Volkswagen prend cette affaire à la légère. L’impact de cette crise est énorme pour nous. Et je peux vous dire que cela implique pour moi de consacrer beaucoup de temps à rassurer nos collaborateurs, nos concessionnaires et nos clients.
Pour ce qui est des conséquences financières, le groupe a communiqué en toute transparence des chiffres : nous avons provisionné un montant de 6,7 milliards au troisième trimestre 2015.
Les coûts engendrés par les campagnes de rappel seront intégrés dans les comptes de 2015. Nous ne disposons pas encore des résultats financiers définitifs du groupe. Nul doute qu’ils seront affectés par ce qui s’est passé.
Le groupe s’apprête à faire des économies grâce à des mesures d’efficacité. Nous examinons toutes les dépenses et tous les investissements dans la volonté de donner la priorité au développement de nouveaux produits et de nouvelles technologies auxquelles nous consacrons 100 millions d’euros en plus. Nous entendons ne pas faire de sacrifices sur tout ce qui concerne les renouvellements de moteurs et de modèles. Certains investissements sont en revanche gelés. Par exemple, le projet de centre de design à Wolfsburg a été repoussé.
Le groupe est solide, il pourra traverser cette crise et rebondir. Nous nous engageons auprès de nos salariés à tout faire pour préserver l’emploi. Il n’y a eu aucune conséquence négative en ce domaine en Allemagne. En France, la même volonté prévaut. Nous avons même décidé il y a un mois d’augmenter nos effectifs de soixante personnes avec des recrutements en contrat à durée indéterminée à Villers-Cotterêts et Roissy, essentiellement dans les métiers du marketing, de la communication et du digital. La digitalisation est un grand défi sur lequel le groupe veut avancer plus vite. Nous avons besoin de préparer l’avenir et d’acquérir de nouvelles compétences dans ces métiers-là.
S’agissant des ventes, je ne vais pas vous dire que les mois de septembre et octobre ont été les meilleurs. Cependant, depuis le mois de novembre, surtout depuis le mois de décembre, nous observons un retour à la normale. Nous entrons dans l’année 2016 avec un portefeuille de commandes supérieur à celui de la fin de l’année 2015. Pour le mois de janvier, les immatriculations sont en augmentation par rapport à l’année dernière, elles sont mêmes supérieures à la hausse du marché. Il n’y a donc pas de blocage de nos ventes.
Si les ventes ont connu cette normalisation, c’est que nous avons beaucoup communiqué pour expliquer à nos clients ce qui allait se passer et les rassurer.
S’agissant des mesures techniques, je comprends que vous vous interrogiez mais je ne suis pas plus ingénieur que vous. Je ne pourrai vous donner de réponses plus complètes que celles que je vous ai déjà fournies. L’important est de rappeler que l’autorité de régulation, le KBA, a validé ces opérations techniques. La mise à jour de logiciel concerne des moteurs construits il y a plus de dix ans. En une décennie, les technologies ont évolué : nous savons faire aujourd’hui des choses qui n’étaient pas envisageables auparavant.
Vous avez évoqué la réputation de notre groupe. Nos marques sont fortes. À nous de rassurer nos clients. Un changement de culture est initié par le nouveau management. Le slogan « Das Auto » n’est en effet plus utilisé, ce qui est un signe fort. Il avait été choisi pour montrer que la marque s’était imposée comme le référent du segment. Mais, nous vous l’accordons, mieux vaut que ce soient les clients qui le disent plutôt que ce soit la marque qui l’affirme. Ce slogan pouvait être perçu comme un peu arrogant. Nous voulons faire preuve d’humilité et de modestie et revenir à l’ADN de ce qu’est la marque Volkswagen : la voiture des gens, la voiture du peuple, faite par des ingénieurs qui ont du savoir-faire. Plutôt que nous centrer sur la technologie en elle-même, nous voulons insister sur ce qu’elle apporte aux clients.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Je dois dire que le graphique que vous nous avez présenté portant sur l’écart des émissions de NOx mesurées en conditions réelles et lors de bancs d’essai m’incite à la prudence. Les données proviennent en effet de l’Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) qui, en 2014, a été reconnu coupable de manipulation au profit de Volkswagen pour le vote portant sur la voiture préférée des Allemands ainsi que pour les neuf années précédentes. Je vérifierai donc l’exactitude des chiffres présentés.
Revenons à l’historique de la révélation du scandale, sans même évoquer les informations sur les échanges avec le fabricant à partir de 2007. Les normes américaines de 2008 étaient particulièrement exigeantes en matière d’émissions de NOx. Il paraissait dès lors évident que sans une technologie satisfaisante, les objectifs fixés ne pouvaient être atteints. Les tests de l’ICCT ont commencé en 2013. En 2014, le groupe a eu des échanges avec l’autorité californienne de la qualité de l’air, le California Air Resources Board (CARB). Cette même année, il a rappelé 500 000 véhicules aux États-Unis pour un correctif informatique. Il a donc eu mille fois l’occasion de reconnaître le recours à son logiciel truqueur – defeat device – et d’en informer les autorités compétentes et les consommateurs européens.
Venons-en maintenant aux échanges avec les autorités françaises. Vous avez indiqué les dates de réunion qui ont précédé les déclarations par lesquelles la ministre de l’écologie a confirmé la « tricherie » de Volkswagen. J’aimerais que vous nous aidiez à éclaircir un point. Lors de son audition, Laurent Michel, directeur de la DGEC, a affirmé que c’était l’administration française qui avait enjoint le groupe de cesser toute vente de véhicules neufs dotés du fameux logiciel alors que vous nous avez dit que l’arrêt de ces ventes provenait d’une décision du groupe du 12 octobre, comme cela a été le cas en Espagne. Qui donc est à l’origine de cette décision ?
M. Jacques Rivoal. J’ai très rapidement pris contact avec un collaborateur de M. Michel à la DGEC : je vous confirme que c’est nous qui avons décidé d’arrêter la commercialisation de ces véhicules. Un courrier, dont je peux vous transmettre une copie, a été envoyé au réseau le vendredi 9 octobre.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Cette décision ne concernait que les véhicules neufs ?
M. Jacques Rivoal. Effectivement.
Je ne dispose pas d’informations suffisantes pour évoquer les procédures aux États-Unis. En Europe, des investigations sont en cours, qu’il s’agisse des procédures lancées par la justice allemande, des audits internes mais aussi des audits externes menés par le cabinet d’avocats Jones Day et le cabinet Deloitte afin de comprendre ce qui s’est passé. Nous ne disposons pas de résultats détaillés. Des éléments partiels ont déjà été diffusés. Le groupe s’est engagé à faire une communication plus approfondie en avril. L’investigation prendra sans doute du temps.
Le management du groupe, modifié à 80 % depuis ces événements, s’est engagé à faire toute la lumière sur ces événements afin que nous puissions en tirer les conséquences qui s’imposent pour que cela ne se reproduise pas.
Mme la présidente. Pourquoi les véhicules vendus en Europe étaient-ils eux aussi dotés du logiciel incriminé alors que ce n’était pas indispensable, compte tenu de la réglementation européenne ?
M. Jacques Rivoal. Les moteurs EA189 ont tous été équipés du même logiciel, aux États-Unis comme en Europe.
Mme Delphine Batho, rapporteure. J’aimerais revenir sur le moteur d’1,6 litre, en citant le journal L’Argus : « En revanche, la mesure qui sera appliquée au 1,6 litre TDI au cours du troisième trimestre a de quoi surprendre. Alors que le patron de Volkswagen Angleterre aurait révélé qu’il faudrait sûrement remplacer les injecteurs, le groupe s’en tire avec une refonte du logiciel destiné à optimiser la quantité d’injections et le montage d’un régulateur de flux d’air. Ce dernier est censé calmer le flux en amont du débitmètre et améliorer sa précision. Ce système détermine le débit massique de l’air, essentiel pour optimiser la combustion. Un tamis en plastique d’une dizaine d’euros, une demi-heure de main-d’œuvre et l’affaire est dans le sac. En découle une première interrogation : pourquoi Volkswagen ne l’a-t-il pas installé auparavant ? Pourquoi avoir pris de tels risques ? »
M. Jacques Rivoal. Madame Batho, je ne suis pas ingénieur. Je le répète, le KBA a validé cette solution technique. Le KBA étant l’autorité de régulation, équivalent de l’UTAC en France, j’ai tendance à me fier à ses conclusions.
Si ces solutions n’ont pas été appliquées avant, c’est parce que, encore une fois, depuis dix ans que ces moteurs ont été construits, nos connaissances technologiques ont évolué. Il existe aujourd’hui des solutions qui n’existaient pas auparavant.
Mme la rapporteure. Sur la question des responsabilités, vous avez évoqué les audits internes et les procédures judiciaires. Je n’aborderai pas cette question.
J’aimerais vous interroger sur vos choix technologiques en matière de systèmes de traitement des émissions de NOx pour aujourd’hui et pour l’avenir. Quelle est la solution de référence soit pour le groupe soit pour les différents constructeurs en ce domaine ? Vous avez abandonné le slogan « Das Auto », renoncerez-vous également à vos publicités sur le « clean diesel » ?
Il y a une affaire dans l’affaire à propos des émissions de CO2. Le groupe avait annoncé qu’il était plausible qu’il y ait des écarts importants concernant les émissions de CO2. Il a même adressé un courrier à Michel Sapin pour préciser qu’il prendrait en charge les conséquences fiscales à la place des consommateurs si ce problème était confirmé. Il a été indiqué par la suite que « presque tous les modèles » étaient exempts de ce soupçon. Cela implique que quelques-uns sont concernés. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Des magazines de presse automobile français, notamment Auto Plus, mesurent régulièrement les écarts entre les chiffres de consommation donnés par les constructeurs et ceux qui sont observés en conditions réelles, ce qui renvoie à la question du protocole que vous avez abordée tout à l’heure. Pour Volkswagen, les écarts observés étaient en moyenne de 55 % à 65 % et s’élevaient pour les véhicules hybrides à 140 %. Pouvez-vous nous donner des précisions à ce sujet ?
Ma troisième question porte sur la réparation du préjudice évoquée par Mme la présidente. Les clients américains bénéficient d’un dédommagement de 1 000 dollars. Volkswagen a également annoncé aux États-Unis qu’il serait prêt à racheter 115 000 véhicules. En France, vous soulignez que les rappels sont gratuits, ce qui est tout de même la moindre des choses. Le 22 janvier, la Commission européenne, après avoir reçu Matthias Müller, a demandé une nouvelle fois que les consommateurs européens soient traités de la même manière que les consommateurs américains. Quelle réponse le groupe compte-t-il donner à cette légitime demande ?
M. Jacques Rivoal. Pour traiter les émissions de NOx, notre choix va clairement à la technologie SCR combinée à l’AdBlue, je n’entre pas dans le détail car, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste.
S’agissant des émissions de CO2, les différentes démarches d’investigation ont permis d’identifier après les événements liés aux émissions de NOx ce que l’on a considéré dans un premier temps comme des irrégularités. Cela a conduit notre président, en conformité avec cette nouvelle culture de transparence, à déclarer que 800 000 véhicules en Europe pouvaient être concernés. Il a alors pris deux engagements, qui ont communiqués aux ministres des finances et de l’écologie concernés : premièrement, faire homologuer à nouveau tous les véhicules ; deuxièmement, assumer les conséquences fiscales afin d’éviter au client d’être pénalisé. Je n’entrerai pas dans les détails techniques, le sujet étant complexe techniquement – pour les homologations, entre les normes sur banc d’essai et les normes en situation de production, il y a des niveaux de tolérance. Les investigations ont finalement montré que très peu de modèles étaient affectés : ils feront l’objet de ré-homologation. En France, ces écarts sont observés pour seulement sept modèles dont un aujourd’hui arrêté, soit 1 600 véhicules, et ils sont tellement infimes – 2 à 3 grammes de CO2 – qu’ils n’impliquent aucun changement de tranches dans le barème du dispositif du bonus-malus. Certains ont affirmé que nous avions réagi trop vite : nous voulions clairement montrer qu’il y avait un changement de culture en interne et que nous tenions, dès qu’un problème survenait, à communiquer dessus au lieu de le cacher.
Vous avez posé, madame la rapporteure, l’importante question des réparations. Les situations sont très différentes aux États-Unis et en Europe. La législation est différente : 31 mg au kilomètre aux États-Unis contre 180 mg en Europe. Les émissions de NOx sont une donnée contractuelle aux États-Unis et pas en Europe où l’acte de vente ne comporte nulle mention de ces émissions. En Europe, les solutions techniques sont validées par le KBA pour tous les modèles concernés et n’ont aucune conséquence sur les prestations du véhicule ; aux États-Unis, elles ne sont pas validées, les véhicules sont bloqués à la vente
– un propriétaire de véhicule équipé d’un moteur EA189 ne peut le revendre – et on ne sait pas combien de temps cette situation perdurera – nous sommes dans un brouillard total. Pour toutes ces raisons, nous considérons qu’il n’y a pas de préjudice pour nos clients en Europe, qui vont faire l’objet d’opérations de rappel.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Je tiens à vous indiquer qu’avec 1700 mg de NOx, on se situe très loin, même avec un coefficient de 2,1, des 180 mg de la réglementation européenne. Certes, les émissions de NOx ne figurent pas dans l’acte de vente mais elles sont intégrées dans la norme d’homologation.
Ce que je déduis de votre réponse, c’est que cette affaire aurait dû entraîner le retrait des homologations. La décision américaine d’une interdiction de vente de tous les véhicules concernés a sa légitimité et sa logique. Cela renvoie à la gestion par les pouvoirs publics européens de cette affaire.
Mme Sophie Rohfritsch, présidente. Je vous remercie, monsieur Rivoal.
La séance est levée à dix-sept heures cinquante-cinq.
◊
◊ ◊
28. Audition, ouverte à la presse, de M. Flavien Neuvy, directeur de l’Observatoire CETELEM de l’automobile.
(Séance du mercredi 10 février 2016)
La séance est ouverte à onze heures trente-cinq.
La mission d’information a entendu M. Flavien Neuvy, directeur de l’Observatoire CETELEM de l’automobile.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Nous recevons, ce matin, M. Flavien Neuvy, directeur de l’Observatoire CETELEM de l’automobile. Cette structure a été créée par un établissement financier spécialiste du crédit à la consommation, occupant le premier rang des établissements de cette nature en France, et également actif dans d’autres pays européens.
Chaque année, l’Observatoire CETELEM publie un rapport sur les évolutions du marché automobile, qui synthétise notamment certaines comparaisons sur l’évolution des différents marchés nationaux. Notre mission attend de vous, monsieur Neuvy, que vous lui fassiez part des grandes orientations sociologiques et d’usage de l’automobile, plutôt que de statistiques brutes, accessibles par ailleurs.
L’âge moyen de l’acheteur d’un véhicule neuf nous a surpris : il semble aujourd’hui plus élevé que jamais. Toujours sur le marché du véhicule neuf, notre mission a également constaté la part désormais importante, et même en passe de devenir majoritaire, des véhicules de sociétés, auxquelles s’ajoutent les acquisitions par les loueurs, elles aussi très nombreuses.
Vos derniers travaux soulignent une tendance perceptible depuis quelques années, à savoir l’émergence du numérique. La voiture connectée et, à terme, la voiture autonome, vont bouleverser des usages qui ont déjà sensiblement évolué. Il nous a été dit qu’à l’horizon 2020-2025, l’offre automobile sera sans doute profondément revisitée.
Pensez-vous que les constructeurs, et notamment les deux groupes français, sont sur de bonnes pistes en matière d’innovation, et ont pris la mesure des révolutions qui s’annoncent ?
Quels sont, selon vous, les constructeurs européens les plus en avance pour être commercialement les plus séduisants ? Par exemple, le choix du « tout électrique » s’avère-t-il aussi probant qu’il pouvait le paraître, y compris en zone urbaine ?
En ce qui concerne la motorisation diesel, vos réflexions nous importent également. Un rééquilibrage de la fiscalité entre le diesel et l’essence, s’il se réalise en quelques années, aurait-il des effets massifs sur les choix d’acquisition des consommateurs ? Selon vous, la disparition des « petits diesels » est-elle inéluctable ?
Enfin, s’agissant du marché de l’occasion, dont votre établissement finance sans doute une partie des transactions, quelle tendance constate-t-on ? Le vieillissement du parc est-il un phénomène plus marqué en France que dans d’autres pays comparables ?
Nous allons, dans un premier temps, vous écouter au titre d’un exposé liminaire, avant que la rapporteure de la mission d’information, Mme Delphine Batho, ainsi que certains de nos collègues, ne vous posent des questions.
M. Flavien Neuvy, directeur de l’Observatoire CETELEM de l’automobile. Madame la présidente, madame la rapporteure, mesdames et messieurs les députés, je vous remercie de me donner l’occasion de m’exprimer devant vous. Depuis son installation, votre mission d’information a eu l’occasion d’entendre de très nombreux experts et, en lisant le compte rendu de vos auditions, j’ai eu le sentiment que vous disposiez déjà d’un niveau d’information très important. On ne peut écarter totalement le risque que je vous dise des choses que vous savez déjà, mais je vais m’efforcer de le limiter en m’en tenant à un propos liminaire assez court, afin de laisser une plus grande place à l’échange de questions et réponses.
Le CETELEM a été créé en 1953, à une époque où l’achat d’un réfrigérateur représentait six mois de salaire moyen pour un Français : c’est justement pour financer cet équipement que le CETELEM a ouvert son premier dossier de crédit, dans un magasin de la banlieue parisienne. Depuis, nous n’avons cessé d’entretenir des liens très forts avec le monde du commerce – celui lié à l’équipement de la maison, mais aussi le commerce automobile, dont nous connaissons bien les différents acteurs, à savoir les concessionnaires, les clients et les constructeurs. Ce positionnement pivot nous a conduits à mettre en place, en 1985, une étude annuelle sur le marché automobile français, avec l’objectif de fournir une information complémentaire à nos clients, à savoir les concessionnaires. Depuis cette époque, nous réalisons chaque année une étude consistant à analyser les grandes tendances et évolutions en matière d’automobile et de mobilité. Initialement limitée à la France, cette étude est devenue européenne au milieu des années 2000, et elle s’est étendue à l’échelle mondiale il y a deux ans : elle porte désormais sur quinze pays dans le monde, ce qui représente environ 70 % des ventes de véhicules neufs.
J’ajoute que nous réalisons également des études portant plus largement sur la consommation des ménages, ce qui nous a amenés à étudier, il y a trois ans, l’évolution de la consommation collaborative, qui touche le monde de la mobilité. Nous disposons donc d’une vision assez complète de l’évolution des attentes des consommateurs que sont les automobilistes. Nos études sont réalisées de manière tout à fait indépendante : nous autofinançons nos études, qui consistent à retranscrire ce que nous disent les consommateurs, et ne dépendons donc pas du tout des constructeurs. Enfin, nous ne parlons jamais de crédit dans nos études, qui ont pour objet d’analyser et d’anticiper les attentes des consommateurs.
Mon propos liminaire comprendra trois points. Je vais d’abord procéder à un rapide tour d’horizon du contexte de l’industrie automobile et des défis majeurs auxquels elle doit faire face – des défis qui n’ont jamais été aussi nombreux et difficiles à relever. Je m’attarderai ensuite sur le marché français et ses particularités, avant de conclure en évoquant les critères d’achat des automobilistes français, notamment le critère environnemental.
Le premier point positif que l’on peut relever au sujet de l’industrie automobile, c’est que les ventes mondiales sont dans une phase de croissance spectaculaire. Alors qu’en 2009 – une année qui, il est vrai, a constitué un point bas en termes de ventes en raison de la crise financière –, il s’est vendu 62 millions de véhicules légers neufs – particuliers et utilitaires – dans le monde, le nombre de ventes a atteint 88 millions d’unités en 2015, ce qui représente une hausse de 40 % en très peu de temps.
Nous pensons qu’il s’agit d’une croissance forte et durable, et que le cap des 100 millions de voitures neuves vendues chaque année dans le monde pourrait être franchi en 2020. Cela ne se fera pas grâce à la croissance des pays développés, où le taux d’équipement des ménages est déjà très élevé – on compte déjà environ 800 voitures pour 1 000 habitants aux États-Unis et 600 voitures pour 1 000 habitants en Europe –, mais sera basé sur la demande dans les pays émergents, qui sont très en retard – on compte encore moins de 100 voitures pour 1 000 habitants en Chine –, car il existe une corrélation très forte entre d’une part le niveau de vie d’un pays, son développement économique, et d’autre part le taux de motorisation de ce pays. Au fur et à mesure que les pays émergents vont se développer, leurs classes moyennes vont disposer de moyens financiers plus importants et acheter plus de véhicules.
Pour autant, il ne faudrait pas croire que la filière de l’automobile jouit d’une santé florissante : le secteur reste fragile. N’oublions pas, par exemple, que General Motors a fait faillite en 2009, ce qui paraissait impensable compte tenu de la taille de l’entreprise. Peu de temps après son entrée en fonction, Barack Obama s’est attaqué à ce qui a été son premier gros dossier selon une ligne de conduite très claire, consistant à dire que les dizaines de milliards de dollars demandés aux contribuables américains devaient avoir deux contreparties. Premièrement, General Motors, qui s’est placée sous la protection du chapitre 11 de loi américaine sur les faillites, devait mettre sur le marché des véhicules consommant moins, donc de plus petits véhicules – le résultat attendu n’a pas été au rendez-vous, puisqu’il ne s’est jamais vendu autant de 4x4 et de pick-up aux États-Unis qu’en 2015, année où le pays a retrouvé son niveau économique, mais aussi ses habitudes d’avant la crise. Deuxièmement, l’administration américaine a insisté sur le fait que la société devait poursuivre son activité, quitte à fermer certains sites, ce qui s’est traduit par une restructuration extrêmement violente pour le secteur industriel américain ; un autre choix a été fait en Europe, celui d’amortir le contrecoup de la crise au moyen d’aides publiques du type des « aides à la casse ».
Le secteur automobile doit faire face à une multitude de défis, parmi lesquels quatre me paraissent particulièrement importants. Le premier défi réside dans le fait que, derrière une croissance d’une ampleur significative, on constate de nombreuses disparités : si, globalement, tout semble aller bien, à mieux y regarder, on s’aperçoit que le monde d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec celui du début des années 2000. À l’époque, le marché chinois n’existait pas : il ne se vendait en Chine que quelques centaines de milliers de voitures chaque année. Depuis 2009, il est devenu le premier marché mondial, avec 24 millions de voitures neuves vendues l’an dernier, ce qui représente près de 20 % des immatriculations mondiales. Pour les dix premiers constructeurs mondiaux, dont les deux constructeurs français font partie, il est impossible de se tenir durablement en dehors de ce marché, surtout en raison des perspectives qu’il offre à moyen terme. Renault vient d’ailleurs d’ouvrir sa première usine en Chine avec l’appui de Nissan, qui s’y trouve implantée depuis longtemps.
Alors même que la Chine montait en puissance, le poids relatif de l’Europe diminuait : il est passé d’un quart des ventes mondiales en 2005 à seulement 15 % aujourd’hui. Cela pose problème en termes de production, car l’industrie automobile est une industrie lourde, qui nécessite de vendre les véhicules à proximité de leur lieu de production, le plus souvent sur le territoire du pays concerné – une condition souvent imposée par les réglementations nationales. L’industrie automobile a donc dû s’adapter en un laps de temps très court à ce changement brutal de la géographie des ventes. À cet égard, il est intéressant de constater que si les ventes mondiales ont progressé d’environ 1,5 % en 2015 – ce nouveau record sera sans doute battu dès l’année prochaine –, le marché sud-américain s’est effondré, chutant de presque 25 %, de même que le marché russe, qui semblait extrêmement prometteur il y a quelques années, ce qui avait incité les constructeurs, notamment Renault, à y investir. En résumé, le premier défi pour les constructeurs consiste donc à investir massivement et rapidement sur les zones paraissant prometteuses, tout en sachant qu’ils ne sont jamais à l’abri d’un retournement de situation en quelques mois.
Le deuxième défi est environnemental. Au-delà du scandale Volkswagen, il est indéniable que les contraintes environnementales et en termes de sécurité ont obligé les constructeurs à investir massivement : c’est le sens de l’histoire que de produire des voitures toujours plus propres et plus sûres. Or, chaque gramme de CO2 gagné au kilomètre coûte très cher aux constructeurs en termes de recherche et développement – cela se chiffre en centaines de milliards d’euros – et, moins les voitures sont polluantes, plus il est difficile de faire mieux dans ce domaine, ce qui impose d’investir de façon constante et massive pour obtenir des résultats.
J’ajoute que les contraintes environnementales et les normes de sécurité diffèrent selon les zones géographiques, ce qui complique encore la tâche des constructeurs. De ce point de vue, si les États-Unis sont souvent cités en exemple pour leurs normes très restrictives en ce qui concerne le diesel – notamment pour ce qui est des émissions de particules et de NOx –, on oublie parfois que les gros 4x4, très nombreux sur les routes américaines, ne sont pas des modèles en matière de protection de l’environnement.
Enfin, il arrive que des politiques publiques totalement contradictoires se succèdent au sein d’un même État à quelques années d’intervalle. Je pense évidemment au système de bonus-malus écologique mis en place en France à l’issue du Grenelle de l’environnement d’octobre 2007. Incitant les Français à acheter des voitures émettant moins de CO2, cette mesure a connu un succès au-delà de toutes les espérances – comment aurait-il pu en être autrement, lorsque nos concitoyens avaient l’impression d’accomplir une action vertueuse, tout en touchant de l’argent pour cela ? Constatant que les automobilistes achetaient en masse des véhicules diesel – souvent des petits modèles, pas toujours fabriqués en France –, les industriels ont beaucoup investi en recherche et développement pour mettre au point de nouveaux systèmes de dépollution et anticiper le passage aux normes d’émission Euro 5 et Euro 6. Or, quelques années plus tard, ils se sont entendu dire que, le diesel étant très nocif en termes de santé publique, il fallait revenir en arrière en rapprochant les prix de l’essence et du diesel, afin de rééquilibrer le parc automobile au profit des véhicules à essence.
Ces grands coups de volant en termes de politiques publiques, extrêmement difficiles à suivre pour les constructeurs, ne sont pas non plus sans conséquences pour les automobilistes : dès lors que l’on décide d’harmoniser les prix de l’essence et du diesel, on prononce la fin des ventes de véhicules particuliers diesel. Ainsi, la part des ventes de véhicules diesel en France aura subi d’énormes fluctuations, passant d’environ 33 % au début des années 1990 pour atteindre 75 % à la fin des années 2000 et redescendre à 50 % cette année, en un mouvement qui ne cesse d’accélérer. À partir du moment où les prix des carburants sont les mêmes, pour amortir le surcoût à l’achat et à l’usage – car un véhicule diesel est plus coûteux à entretenir –, il ne faudra plus faire 20 000 kilomètres par an, mais sans doute 30 000 ou 40 000 : dès lors, plus personne n’aura intérêt à acheter une voiture diesel. Dans un tel contexte, la valeur des véhicules diesel à la revente va diminuer, et leurs propriétaires vont subir une décote d’environ 20 % – ce qui peut représenter une perte de 1 000 euros pour un véhicule de 8,5 ans et 70 000 à 80 000 kilomètres au compteur, donc une perte potentielle totale de 20 milliards d’euros si l’on considère que 20 millions de véhicules sont concernés en France.
Enfin, les distributeurs vont eux aussi être touchés, car ils proposent de plus en plus souvent des locations avec option d’achat, et vont donc devoir racheter des véhicules à une valeur fixée contractuellement, alors que la valeur réelle des véhicules aura, elle, nettement diminué.
Dès lors que l’on acte collectivement la fin du diesel en France pour les véhicules particuliers, on doit accepter de se retrouver presque exclusivement avec des véhicules à essence – les véhicules électriques et hybrides sont, certes, appelés à se développer, mais ils sont pour le moment présents en faibles proportions –, qui consomment davantage d’énergie fossile et émettent plus de CO2, ce dont chacun doit avoir conscience.
Le troisième défi auquel les constructeurs doivent faire face est d’ordre technologique – et son importance n’est pas la moindre, loin s’en faut. Il s’agit tout d’abord de tenter de déterminer quelle sera la technologie dominante dans quinze ou vingt ans. Or, il est pratiquement impossible de répondre à cette question, le champ des possibles en matière d’énergies et de motorisations étant immense. Il est très risqué, voire impossible, pour les constructeurs, de faire l’impasse sur quelque choix que ce soit : ils sont donc obligés d’engager des sommes considérables en recherche et développement dans toutes les directions. Ainsi, les sommes très importantes affectées par Renault-Nissan à la recherche et au développement dans le domaine du véhicule électrique ne sont qu’une partie des énormes investissements effectués par l’alliance dans tous les secteurs, notamment celui du véhicule hybride, du moteur au gaz naturel, voire des agrocarburants de deuxième génération.
Le deuxième défi technologique a constitué une surprise pour les industriels qui, s’ils l’avaient vu venir, n’y ont pas cru au départ : il s’agit de la voiture autonome, qui risque pourtant de secouer sérieusement le monde de l’automobile. Si la voiture autonome – et connectée – a de grandes chances d’être perçue comme une véritable révolution, c’est qu’elle pourrait modifier en profondeur le modèle économique qui s’est imposé jusqu’à présent dans le secteur de l’automobile : à l’avenir, il pourrait y avoir plus d’argent à gagner dans les services liés à l’utilisation du véhicule que dans sa fabrication. C’est ce qui explique que certains acteurs extérieurs au monde de l’automobile montrent de l’intérêt pour la voiture autonome : si Google travaille sur ce thème depuis plus de dix ans, c’est bien parce que ses responsables ont une idée derrière la tête – et je ne pense pas qu’il s’agisse de fabriquer des voitures, car cela ne correspond pas à leur modèle économique, consistant à dégager une forte rentabilité à partir de peu de capitaux. Google dispose d’ores et déjà des moyens technologiques et financiers de se lancer dans une telle entreprise, d’abord parce que cela fait dix ans que la firme de Montain View s’intéresse à ce projet, ensuite parce que la capitalisation boursière est supérieure à celle, cumulée, des dix premiers constructeurs automobiles mondiaux.
Les industriels de l’automobile se doivent de relever le défi, et ont commencé à le faire : en 2015, des constructeurs automobiles allemands ont racheté Here, une cartographie appartenant à Nokia, pour un montant de plusieurs milliards d’euros. Cependant, cette réaction est très récente : les industriels sont longtemps restés persuadés que personne ne pouvait pénétrer dans un cercle qu’ils maintenaient soigneusement fermé, et où la concurrence ne s’exerçait qu’entre eux. On sait aujourd’hui que c’était une erreur et que Google, mais aussi d’autres acteurs du monde de l’internet, sont capables de s’emparer d’une partie de leurs revenus potentiels.
Le quatrième défi est sociétal : il s’agit de la place de la voiture dans notre société et de l’évolution de la mobilité d’une façon générale. Au cours des dix dernières années, le secteur a vu apparaître une multitude d’offres alternatives à la propriété pure et simple de son véhicule, qui a été le modèle exclusif depuis l’existence même de la voiture. La plupart des automobilistes étant très attachés à leur voiture, on a pu penser que ce modèle était immuable, ce qui n’était pas le cas. Aujourd’hui, il existe d’autres modes d’utilisation de la voiture, qu’il s’agisse du covoiturage, de la voiture en libre-service, de la location de voiture entre particuliers, ou encore de la location de longue durée aux particuliers. Dans les grands centres urbains, vous pouvez vous déplacer très facilement tous les jours en voiture sans jamais en posséder une.
Lorsque des offres alternatives apparaissent – dans le secteur de l’automobile comme dans d’autres –, il est fréquent que les acteurs historiques partent du principe que cela ne marchera pas. Ce n’est pas un constructeur qui a lancé BlaBlaCar, ce ne sont pas les grands loueurs qui ont eu l’idée d’offrir un nouveau service de location de voiture entre particuliers, ce n’est pas un industriel de l’automobile qui a pris l’initiative de proposer des voitures électriques en libre-service ! Presque systématiquement, l’apparition d’offres alternatives suscite au mieux du scepticisme, quand ce ne sont pas des ricanements ironiques. Les parlementaires que vous êtes sont bien placés pour connaître le moment où une formule commence à bien marcher : il suffit d’attendre que les acteurs historiques viennent frapper à votre porte en criant à la concurrence déloyale, c’est un signe qui ne trompe pas.
L’évolution de la mobilité bouscule les constructeurs pour une raison simple : sous l’effet des offres alternatives, la voiture, qui est longtemps restée le mode de transport individuel par excellence, devient un objet que l’on partage beaucoup plus. Au lieu de rester au garage durant 90 % du temps, elle va être largement plus utilisée : le covoiturage, par exemple, se traduit par des voitures mieux remplies. De ce fait, il est permis de se demander si, dans dix ou vingt ans, nous aurons collectivement besoin d’autant de voitures qu’aujourd’hui dans les sociétés développées. Je précise que les moins de trente ans sont les plus ouverts à ces nouvelles formes de mobilité.
Pour résumer, les constructeurs doivent investir des milliards pour s’adapter à la mutation géographique des ventes, mais aussi pour répondre aux contraintes réglementaires et pour essayer de deviner quelles seront les motorisations du futur. Cela fait beaucoup d’argent, donc beaucoup de risques, pour des résultats extrêmement faibles par rapport aux capitaux investis.
Le deuxième point dont je veux vous parler est relatif aux évolutions structurelles du marché français. J’en ai identifié quatre.
D’abord, comme vous le savez, notre parc automobile vieillit : il a aujourd’hui 8,5 ans en moyenne. Je précise que cette tendance s’observe sur la quasi-totalité des marchés développés. Le parc automobile allemand a le même âge que le nôtre, le belge 8 ans, le britannique un peu moins de 8 ans, l’italien 10 ans, l’espagnol 11 ans, le japonais 8 ans et l’étasunien plus de 11 ans. Seule la Chine se différencie avec une moyenne d’âge de 4,5 ans, ce qui s’explique par la jeunesse de ce marché. La France n’est donc pas une exception, et il s’ajoute à cela que les Français roulent de moins en moins : en moyenne un peu moins de 13 000 kilomètres par an actuellement, et ce chiffre diminue de 100 kilomètres par an environ – surtout dans l’intra-urbain, en raison du développement de l’offre de transport en commun. C’est justement cette diminution du kilométrage parcouru annuellement – jointe au fait que les voitures sont plus fiables – qui permet aux Français de conserver leurs véhicules plus longtemps.
Il existe une deuxième tendance durable : comme celui du parc automobile, l’âge moyen de l’acheteur d’un véhicule neuf ne cesse d’augmenter. Il est aujourd’hui de plus de 55 ans en France, contre 52 ans en Allemagne, 48 ans en Espagne, 50 ans en Italie et au Japon, 52 ans aux États-Unis et 55 ans au Royaume-Uni : la comparaison avec les autres pays n’est donc pas à notre avantage. J’ajoute que les constructeurs français ont un profil d’acheteur encore plus âgé – 56 ans pour Renault, 58 ans pour Peugeot et 60 ans pour Citroën, me semble-t-il.
Les moins de 35 ans, eux, n’achètent quasiment pas de voitures neuves : ils ne représentent effectivement que 10 % des acheteurs. Nous nous sommes interrogés sur ce point et avons même réalisé une étude sur le thème « Les jeunes et l’automobile », qui a mis en évidence des résultats plus complexes que ceux auxquels je m’attendais. Les jeunes ne disent pas qu’ils envisagent de passer toute leur vie sans acheter une voiture, ils ne disent pas que la place de la voiture sera moins importante dans dix ans, ni qu’aucune voiture ne leur fait envie : en réalité, s’ils n’achètent pas de voiture neuve, c’est essentiellement parce qu’ils n’ont pas les moyens de le faire, le budget moyen qu’ils consacrent à l’achat d’un véhicule étant de 9 000 euros. Cela n’a rien d’étonnant quand on sait que l’on entre le plus souvent sur le marché du travail avec un CDD et un salaire modeste, ce qui rend l’obtention d’un crédit relativement difficile. C’est un vrai problème pour les constructeurs, car rien ne dit que les jeunes d’aujourd’hui achèteront des voitures quand ils auront l’âge des acheteurs actuels : en trente ans, de nombreuses évolutions peuvent survenir.
La troisième tendance, c’est que les Français achètent de moins en moins de voitures neuves. L’an dernier, 962 000 voitures particulières neuves ont été vendues aux 28,3 millions de ménages français, ce qui représente un taux de ménages acheteurs de 3,4 %, le plus faible niveau qu’ait connu notre marché au cours des trente dernières années – ce taux était de 7 % au début des années 1990 : plus de 1,5 million de voitures neuves étaient alors vendues aux ménages chaque année. Les ventes aux particuliers, qui représentaient 75 % du marché il y a 25 ans, sont tombées à 50 % aujourd’hui, et ne cessent de diminuer.
Les raisons de cette chute sont multiples. D’abord, la voiture n’a plus tout à fait la même place qu’il y a trente ans. Elle est moins statutaire : les Français considèrent que ce n’est plus le meilleur moyen de montrer que l’on a réussi dans la vie, et se demandent s’il est bien utile de dépenser 22 000 euros – le prix moyen actuellement – pour acheter un véhicule neuf alors qu’un véhicule d’occasion peut suffire – ce qui explique que le marché de l’occasion soit surdimensionné par rapport à celui du neuf. Le prix des voitures neuves est un problème qui n’a rien de simple à résoudre. Il est difficile de disposer de chiffres fiables sur l’évolution du prix de vente des voitures, notamment en raison du fait que l’INSEE produit des chiffres corrigés en supprimant l’effet qualité. Ce qui est certain, c’est que les voitures coûtent de plus en plus cher, pour deux raisons principales : d’une part, les contraintes réglementaires que j’ai évoquées précédemment – les constructeurs doivent en effet amortir les investissements importants effectués pour mettre au point des moteurs moins polluants, par exemple ; d’autre part le fait que, ces dernières années, les constructeurs ont eu tendance à suréquiper les véhicules en équipements électroniques en laissant le moins en moins à l’acheteur le choix des options, regroupées par packs, afin de tirer les marges vers le haut. Un automobiliste âgé de 65 ans n’utilisera jamais la très grande majorité des équipements électroniques dont son véhicule est doté, et il ne sait probablement pas à quoi ils peuvent servir ! Si, pour lui, le prix de ces équipements n’a qu’une importance relative – il n’a plus de crédit immobilier et dispose donc de ressources plus importantes –, il n’en est pas forcément de même pour les acheteurs potentiels moins âgés.
Les constructeurs affirment que le prix de vente n’est pas un problème, puisque le mix des ventes fait apparaître un prix moyen assez élevé, correspondant à des voitures bien équipées. Ils oublient que les ventes ont beaucoup diminué en volume, et que les personnes qui achètent aujourd’hui une voiture ont tendance à faire le choix d’une baisse de gamme par rapport à leur véhicule précédent – ils vont, par exemple, passer d’une Mégane à une Clio –, alors que c’était l’inverse jusqu’à présent ; cela leur permet souvent de choisir un véhicule mieux équipé. Dans le budget des ménages français, le premier poste est celui du logement, auquel nos concitoyens consacrent beaucoup plus d’argent que leurs voisins allemands.
Par ailleurs, l’évolution de nos modes de vie réduit progressivement les marges de manœuvre financières des ménages. Ainsi, les dépenses en matière de téléphonie représentent une part croissance du budget. Il y a aujourd’hui 70 millions de cartes SIM en France, ce qui représente quatre téléphones portables pour une famille composée de deux adultes et deux enfants, et un budget correspondant qui peut atteindre 150 à 200 euros par mois, soit l’équivalent d’un crédit automobile – or, si un crédit automobile a une fin, les dépenses relatives au téléphone portable ont vocation à durer toute la vie. Ainsi, les dépenses contraintes ou pré-engagées des ménages ont tendance à limiter les marges de manœuvre financières des ménages, qui procèdent à des arbitrages au détriment de l’achat de véhicules neufs.
La dernière tendance à évoquer, liée à la précédente, est que le peu de Français qui achètent une voiture neuve optent le plus souvent pour un petit modèle, moins cher. Ces voitures génèrent moins de marge pour les constructeurs et une grande partie des modèles concernés est fabriquée à l’étranger. Aux États-Unis, on assiste à la situation inverse : non seulement le marché a retrouvé et même dépassé ses niveaux d’avant la crise, mais les véhicules vendus sont le plus souvent de gros modèles, permettant aux constructeurs de dégager des marges confortables.
J’en viens au dernier point que je voulais évoquer, à savoir les critères d’achat des automobilistes français. Autant le dire tout de suite, les critères environnementaux ne sont pas pris en compte au moment d’acheter une voiture – du moins est-ce un critère mineur pour les acheteurs : si, dans l’absolu, ils n’ont rien contre une voiture moins polluante, ils préfèrent toujours préserver leurs intérêts financiers plutôt que l’environnement – or, la plupart du temps, c’est-à-dire en l’absence de prime à la casse, ils doivent choisir entre les deux. Les critères les plus importants sont d’abord le prix – qui inclut la consommation de carburant –, puis la fiabilité du modèle, enfin le design. De ce point de vue, je ne suis pas sûr que le scandale Volkswagen ait un impact important sur les ventes du groupe à moyen et long terme : si un contrecoup assez fort a été observé au lendemain du scandale, c’est-à-dire en octobre et novembre 2015, je pense que l’image de la marque ne souffrira pas très longtemps, la qualité et la fiabilité de ses modèles n’ayant pas vraiment été mise en cause. Il est à noter, d’ailleurs, que les campagnes de rappels auxquelles procèdent régulièrement tous les constructeurs pour des problèmes de sécurité – qu’il s’agisse du freinage ou des airbags, par exemple – n’ont jamais de conséquences durables sur leurs ventes. Je terminerai en disant que les jeunes générations – les moins de trente ans – intègrent un peu plus la dimension environnementale que leurs aînés, notamment en ce qui concerne les émissions de polluants.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Je salue la pertinence et la clarté de votre longue introduction mettant en perspective les enjeux clés en matière de vente de véhicules.
J’aimerais que vous nous expliquiez de façon sommaire la méthodologie à laquelle vous avez recours pour réaliser vos études, et d’où proviennent les données que vous traitez.
Vous avez évoqué une perspective de croissance forte et durable du marché automobile mondial, tout en disant qu’il existait une sorte d’indexation du marché automobile sur la croissance mondiale. Or, la croissance mondiale n’est pas au beau fixe actuellement : on constate un net ralentissement, y compris en Asie, et certains évoquent le risque que survienne une nouvelle crise financière. Comment le secteur de l’automobile peut-il résister aux à-coups et aux retournements engendrant une forte instabilité économique ?
Pouvez-vous nous dresser un bref panorama mondial du diesel ?
Vous avez dit que l’alignement de la fiscalité entre l’essence et le diesel signait la fin du diesel. Or, ce n’est pas exactement ce qui nous a été dit lors d’autres auditions : nombreux de nos interlocuteurs estiment qu’il restera un marché pour le diesel car, pour les automobilistes roulant beaucoup, il y aura toujours un avantage économique à opter pour une motorisation permettant de consommer moins – j’insiste sur le fait que cet avantage n’existera pas pour les faibles kilométrages et les petits véhicules.
Voyez-vous la voiture autonome et connectée comme un relais de croissance, une sorte de technologie de rupture pour les constructeurs ?
Vous avez parfaitement décrit ce qui est en train de se passer dans le domaine de l’économie de la fonctionnalité, de l’évolution des usages – avec l’apparition d’offres disruptives – et de l’enjeu générationnel qu’elle comporte. Dans ce contexte, quels conseils donneriez-vous aux constructeurs ?
Le marché du neuf en France étant ce qu’il est, et une grande partie des problèmes environnementaux étant liée à l’ancienneté du parc automobile, pensez-vous qu’une mesure de soutien au renouvellement du parc, ciblée sur le marché de l’occasion, pourrait être pertinente ? Je précise que nous sommes conscients des effets pervers des mécanismes de soutien basés sur un seul critère environnemental, et non sur une approche globale : une nouvelle mesure d’incitation devrait donc éviter de reproduire les erreurs du passé – je pense évidemment aux effets indésirables du bonus écologique, que vous avez décrits.
Enfin, vous n’avez pas évoqué le rapport des automobilistes à la marque et au constructeur de leur véhicule. De quelle façon ce rapport évolue-t-il ? Acheter français reste-t-il un critère important lors de l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion ?
M. Gérard Menuel. On peut se demander si les constructeurs ne fixent pas le prix des véhicules neufs en tenant compte du pouvoir d’achat moyen du pays où il est vendu. J’ai observé, par exemple, qu’une marque française vendait l’un de ses véhicules plus de 1 000 euros moins cher en Espagne qu’en France.
Par ailleurs, je m’interroge sur la notion de véhicule neuf. Lorsqu’on se présente chez un concessionnaire pour acheter un véhicule neuf, on obtient très vite un rabais, avant d’être orienté vers des véhicules de collaborateur affichant 1 000 kilomètres au compteur : ne s’agit-il pas de véhicules neufs proposés sous une forme déguisée, afin d’afficher un prix légèrement inférieur au prix catalogue ?
Enfin, savez-vous pourquoi il y a une telle différence de prix entre les véhicules à boîte manuelle et ceux à boîte automatique ? Cette différence est-elle justifiée ?
M. Philippe Duron. J’aimerais savoir quelle est la part du crédit automobile dans le crédit à la consommation. Si le volume des ventes diminue, quel est l’avenir du crédit automobile, et celui d’une société comme la vôtre ?
Vous avez évoqué la baisse de la capacité d’achat des consommateurs. Faut-il en déduire que Renault a eu raison de se lancer, il y a quelques années, dans une stratégie consistant à vendre des véhicules low cost ? Cette stratégie emporte-t-elle l’adhésion des consommateurs, au-delà de ceux qui n’ont pas le choix de faire autrement, étant contraints dans leurs moyens financiers ?
Alors que les techniques de vente évoluent beaucoup, pensez-vous que l’on puisse assister à des changements profonds en matière de vente des véhicules ? Va-t-on enfin se mettre en conformité avec les injonctions de la Commission européenne visant à ce que les concessionnaires puissent faire le choix d’être multimarques ? La grande distribution peut-elle s’engouffrer dans le marché de l’automobile, et peut-on imaginer d’acheter des voitures sur internet ?
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Il est déjà possible d’acheter une voiture sur internet, cher collègue.
M. Philippe Duron. Enfin, si l’on parle beaucoup des nouveaux véhicules, on évoque rarement les infrastructures chargées de les accueillir. Pensez-vous que la voiture du futur sera à l’origine de profondes évolutions en matière de guidage, de stationnement, de stockage, de ravitaillement du véhicule, ou même dans l’usage que l’on pourrait faire de son temps libre à bord ?
Mme Marie-Jo Zimmermann. Monsieur Neuvy, je vous remercie pour votre intervention. En effet, elle répond parfaitement à ce que j’attends de notre mission d’information. Je partage tout à fait votre point de vue sur le fait que la mise en place d’une fiscalité unique pour l’essence et le diesel aurait pour effet de marquer la fin du diesel, et je trouve cela extrêmement inquiétant, car je crains que les industriels n’aient pas le temps de s’adapter aux nouvelles conditions qui leur sont imposées : après le dispositif de bonus écologique de 2008, il leur est demandé de repartir dans la direction contraire ! Pouvez-vous nous préciser à quelle échéance vous situez la fin du diesel, et si vous estimez qu’une telle évolution est réaliste pour l’économie française ?
Concernant la voiture autonome, quelle pourrait être, selon vous, sa part du marché de l’automobile dans une vingtaine d’années ?
Pour conclure, je voudrais insister sur l’importance du secteur de l’automobile en France : en dépit des difficultés auxquelles il est confronté, il est toujours facteur de croissance de l’économie et emploie des milliers de salariés, ce qui justifie que nous nous demandions comment le préserver.
M. Flavien Neuvy. En ce qui concerne la méthodologie, nous travaillons sur la base d’échantillons représentatifs, en interrogeant chaque année plusieurs dizaines de milliers de consommateurs par l’intermédiaire d’un grand institut de sondage qui nous assure la représentativité de nos échantillons dans chaque pays. Pour réaliser nos prévisions macroéconomiques, nous travaillons avec la recherche économique de BNP Paribas, mais aussi avec le cabinet d’études et de conseil BIPE. Enfin, nous menons des entretiens qualitatifs, dans le cadre desquels nous avons interrogé 300 000 à 400 000 consommateurs de par le monde au cours des dix dernières années. Comme vous le voyez, les échantillons dont nous disposons nous permettent d’avoir une vision globale des attentes des consommateurs.
Pour ce qui est du ralentissement de la croissance mondiale et de l’impact qu’il pourrait avoir sur les ventes de voitures neuves, je dirai que nous nous référons plutôt à l’indicateur de l’évolution du niveau de vie : il y a en effet une corrélation très forte entre le PIB par habitant et le nombre de voitures mises en circulation, car l’achat d’un véhicule est souvent le premier effectué par les classes moyennes dès qu’elles en ont les moyens. Aujourd’hui, pour acheter une voiture de milieu de gamme, le rapport entre le taux d’effort pour un couple à revenus moyens aux États-Unis et le taux d’effort pour un couple chinois est d’un à treize : en l’état actuel, il faut cinq ans de salaire en Chine pour se payer cette voiture
– ce qui correspond à l’achat d’un bien immobilier dans le monde occidental. La classe moyenne supérieure chinoise commence à acheter des voitures, mais ce n’est que le tout début, c’est pourquoi le marché chinois offre encore de bonnes perspectives en dépit du ralentissement de croissance actuel. L’Afrique constitue également un marché prometteur, et les constructeurs – français, notamment – commencent à se positionner sur ce marché qui constituera certainement un des relais de croissance au cours des prochaines décennies.
Je considère que nous ne devons pas être particulièrement inquiets à moyen et long termes, dès lors que nous admettons que la croissance se fera essentiellement en dehors des pays développés. Pour le moment, l’Europe est très loin d’avoir retrouvé son niveau d’avant la crise et, en dépit des restructurations auxquelles elle a procédé, ses capacités de production sont très excédentaires : on peut y fabriquer entre 17 et 18 millions de véhicules par an, dont 14 millions seulement sont écoulés dans l’Union européenne. Cela dit, les marchés des pays matures continueront d’offrir pendant un certain temps une certaine récurrence dans les immatriculations.
Le diesel est une spécificité européenne : pour les véhicules particuliers, cette motorisation n’existe nulle part ailleurs, si ce n’est en Inde et en Turquie. Les constructeurs et les équipementiers européens ont su s’emparer de ce caractère spécifique pour faire du diesel une filière d’excellence et, en mettant fin au diesel, nous allons supprimer l’avantage concurrentiel dont nous disposions jusqu’à présent par rapport aux autres grands constructeurs, notamment les américains et les japonais.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Un avantage cependant limité au marché européen ?
M. Flavien Neuvy. Effectivement. Demain, quand la fiscalité du diesel sera identique à celle de l’essence, pour amortir le surcoût à l’achat et à l’entretien d’un véhicule diesel – qui sera toujours proposé –, il ne faudra plus faire 20 000 kilomètres par an, mais plutôt 30 000 ou 40 000 : on ne vendra donc quasiment plus de véhicules diesel neufs aux particuliers – en tout état de cause, cette motorisation représentera moins de 10 % à 15 % des immatriculations.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Je m’interroge sur le surcoût à l’achat des véhicules diesel dans les années à venir. Dans la mesure où les moteurs essence à injection directe vont devoir, eux aussi, être équipés de systèmes de dépollution, le surcoût qui va en résulter ne va-t-il pas compenser celui des véhicules diesel ?
M. Flavien Neuvy. Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question aujourd’hui, mais on peut effectivement penser que l’écart entre le prix des véhicules essence et diesel va se réduire. L’automobiliste est un agent économique rationnel, qui anticipe beaucoup : de ce point de vue, le scandale Volkswagen a marqué une très nette rupture en termes de ventes de véhicules diesel – pas seulement pour la marque concernée, mais pour l’ensemble des constructeurs, et sans doute ce mouvement va-t-il se poursuivre et s’amplifier dans les mois à venir. Il est difficile d’établir des prévisions précises sur les ventes de diesel à l’horizon de quatre ou cinq ans mais, en tout état de cause, on peut dire qu’elles vont subir une baisse sensible.
Se demander si la voiture autonome et connectée va faire vendre plus de voitures revient à se demander si l’innovation fait vendre plus. Comme nous l’avions dit de manière un peu provocatrice dans l’une de nos études, il faut distinguer l’innovation utile, qui va permettre de vendre plus de voitures, de l’innovation futile, qui servira tout au plus à dégager une marge légèrement supérieure. Ce que j’appelle l’innovation futile, ce sont les équipements électroniques que l’automobiliste n’utilisera pratiquement jamais. L’innovation utile, elle, permet à l’automobiliste d’économiser de l’argent. Si les moteurs plus performants, qui consomment moins, font partie de l’innovation utile, je ne suis pas sûr qu’il en soit de même de la voiture autonome, et que le propriétaire d’une voiture qui a huit ans d’âge va se décider à en changer pour l’unique raison qu’il pourra lâcher le volant : cette innovation ne constitue pas une rupture technologique de nature à inciter les automobilistes à acheter massivement des voitures neuves.
Pour ce qui est des offres collaboratives, je me garderai bien de donner des conseils aux constructeurs. En une période compliquée pour tout le monde sur le plan économique, les grandes entreprises sont toujours convaincues que la meilleure façon de se protéger contre ceux qui pourraient être tentés de venir les concurrencer dans leur activité consiste à se concentrer sur leur cœur de métier, que personne ne saurait faire aussi bien qu’elles. Ce faisant, elles adoptent un mode de gestion excluant toute prise de risque, alors même que l’économie collaborative nécessite de sortir des sentiers battus. L’arrivée de nouveaux acteurs du monde de l’économie collaborative – dans le secteur de l’automobile comme dans d’autres – a pour effet de bousculer les positions établies des acteurs historiques, d’apporter un vent de fraîcheur et souvent de créer des emplois. Il arrive alors que certains constructeurs, notamment américains, prennent acte du fait qu’ils ont raté le coche, et réagissent en rachetant l’un des nouveaux acteurs – une société de covoiturage ou de location de voiture entre particuliers –, comme leurs considérables moyens financiers le leur permettent.
En ce qui concerne les mesures de soutien que l’on pourrait imaginer en faveur du renouvellement du parc automobile français, il n’y a pas de solution miracle, du moins n’est-elle pas connue. Le système de la prime à la casse a été très efficace : un million de voitures ont été « bonussées », et nous avons calculé que cette mesure aurait provoqué 600 000 ventes par anticipation. Quant au bilan économique, il n’est pas simple à établir, car les ventes anticipées se sont traduites par des retombées de TVA, ainsi que par un fonctionnement accru de l’outil de production et des réseaux de distribution : on ne peut donc pas dire que la prime a coûté 1 000 euros nets par véhicule concerné. Par ailleurs, cette mesure a eu un effet positif en matière environnementale, mais aussi en termes de sécurité, car les nouveaux véhicules sont mieux équipés en airbags ou en dispositifs d’aide à la conduite tels les stabilisateurs de trajectoire – ce qui contribue à faire diminuer le nombre de morts sur les routes. Le plus gros inconvénient d’un système de ce type, c’est le contrecoup qui se fait ressentir quand la mesure prend fin, et rien ne permet d’y remédier.
Vous avez évoqué, madame la rapporteure, la relation qu’entretiennent les consommateurs vis-à-vis des marques et également de la nationalité du constructeur. Pendant très longtemps, la puissance de la marque a constitué un élément déterminant dans l’acte d’achat : dans une famille, on pouvait être Peugeot, Citroën ou Renault, et n’acheter que des véhicules de sa marque fétiche. Un tel attachement n’existe pratiquement plus chez les jeunes, qui sont capables de passer d’une marque à une autre. Par ailleurs, 55 % des personnes interrogées dans le monde entier dans le cadre de l’une de nos études se sont déclarées prêtes à acheter une Google Car ou une Apple Car : certes, ce sont là des marques puissantes, ce qui explique qu’elles puissent inspirer confiance, mais il ne s’agit pas, à l’heure actuelle, de professionnels de l’automobile. Pour ce qui est des Français, ils préfèrent toujours acheter des voitures fabriquées en France, à condition que cela ne se traduise pas par un surcoût trop important. Par ailleurs, il n’est pas toujours facile de savoir ce que recouvre l’appellation made in France pour une voiture : si j’achète une Toyota fabriquée dans le Nord de la France, est-ce ou non du made in France ?
Mme Delphine Batho, rapporteure. Oui, c’est du made in France !
M. Flavien Neuvy. La même question se pose pour une petite citadine de marque française, mais fabriquée en Europe centrale : comme on le voit, ce n’est pas évident.
Pour ce qui est du prix de vente des véhicules neufs, la situation est souvent ubuesque : les prix de départ sont tellement élevés que les constructeurs sont obligés de pratiquer des politiques commerciales agressives et de consentir presque systématiquement des rabais, ce qui est destructeur de valeur et réduit fortement, parfois jusqu’à zéro, la marge du concessionnaire. Quant à l’automobiliste, il en vient à ne plus savoir quel est le prix réel d’une voiture.
Je ne suis malheureusement pas en mesure de vous répondre, monsieur Menuel, au sujet de la différence constatée entre le prix de vente des véhicules à boîte de vitesses manuelle et celui des véhicules à boîte automatique.
Vous avez raison en ce qui concerne les différences de prix de vente d’un pays à l’autre pour le même véhicule neuf : on trouve encore des véhicules moins chers en Espagne ou en Belgique, étant toutefois précisé que cela se fait de moins en moins, les prix ayant tendance à s’harmoniser au sein de l’Europe. De même, le phénomène consistant en l’importation massive en France, par des canaux parallèles, de véhicules neufs en provenance d’Europe centrale ou du sud, à des prix très inférieurs à ceux des voitures sortant de nos chaînes de production, s’est beaucoup calmé après avoir été très répandu.
Le crédit automobile est stratégique pour la vente de voitures neuves, puisque deux sur trois sont achetées à crédit par les particuliers. Selon les chiffres fournis par l’Association Française des Sociétés Financières (ASF), la production totale de crédits automobiles consentis sur le lieu de vente – englobant les crédits pour les véhicules neufs et d’occasion, ainsi que la location avec option d’achat (LOA) – s’est élevée à 10 milliards d’euros pour 2015, ce à quoi il faut ajouter les prêts personnels non affectés, qui peuvent aussi servir à financer l’achat d’un véhicule. Le marché du crédit à la consommation est très loin d’avoir retrouvé le niveau d’avant la crise – il est encore 20 % en dessous de ce niveau –, ce qui s’explique par le fait que les Français ont reporté certains de leurs achats, notamment les achats automobiles.
Par ailleurs, le marché français présente la particularité d’être hyperconcurrentiel : aujourd’hui, le consommateur qui veut prendre un crédit peut donc faire jouer la concurrence entre les différents établissements financiers, qu’il s’agisse des sociétés de financement classiques comme la nôtre, des captives financières appartenant à une société dont l’activité principale n’est pas le financement – chaque constructeur est désormais doté d’une société financière qui propose des financements sur le lieu de vente –, ou encore des banques traditionnelles ou des assureurs. Bref, celui qui veut souscrire un crédit pour acheter une voiture n’a que l’embarras du choix, et les taux actuellement très bas contribuent à ce que le contexte soit très favorable à l’acquisition d’un véhicule – mais cela ne se traduit pourtant pas par une activité élevée en ce moment. À mon arrivée au CETELEM en 1995 – je m’occupais alors des dossiers de prêts aux particuliers –, les taux étaient beaucoup plus élevés, puisque l’acquisition d’une voiture neuve pouvait alors être financée à un taux moyen de 10 %, et l’on consentait néanmoins plus de prêts qu’aujourd’hui : comme vous le voyez, le taux d’emprunt n’est pas le critère essentiel dans la décision d’acheter une voiture.
La stratégie low cost de Renault, mise en œuvre par le biais de sa filiale Dacia, a été un coup de maître – étant précisé qu’au départ, l’objectif affiché n’était pas de vendre des véhicules de ce type en Europe. Aujourd’hui, cette offre rencontre partout le succès. Elle prend des parts de marché importantes dans les pays matures – pas seulement auprès des personnes qui disposent de peu de moyens, mais aussi auprès de celles qui envisageaient initialement l’achat d’un véhicule d’occasion – comme dans les pays émergents. Aujourd’hui, bien que son modèle ait très bien marché, la société Renault n’a été imitée par aucun de ses concurrents, ce qui s’explique par le fait que la mise en place d’une filiale low cost soit très compliquée.
En ce qui concerne les techniques de vente, elles connaissent effectivement de nombreuses évolutions. Le rapport entre concessionnaires et concédants est toujours assez déséquilibré au détriment du concessionnaire, qui se trouve pieds et poings liés et doit constamment réinvestir dans son showroom, ne serait-ce que pour se mettre en conformité avec les nouvelles normes. L’automobiliste, lui, est tout à fait disposé à passer à un système multimarque, qui lui permettra de voir des véhicules de différentes marques en se rendant dans une concession. Par ailleurs, il est prêt à acheter des voitures sur internet : du fait de la réassurance par la marque, il n’a pas de raison d’être inquiet au sujet de la qualité du produit acheté. Si ce type d’offre reste actuellement peu développé, c’est que les constructeurs souhaitent protéger leurs réseaux de distribution exclusifs, mais on peut penser que si un grand constructeur mettait des voitures en vente sur son propre site, cela marcherait très bien – on peut même penser que cela permettait de réaliser des ventes supplémentaires.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Cela suppose tout de même que les gens aient pu essayer les voitures par d’autres moyens ?
M. Flavien Neuvy. En fait, la proportion de personnes testant réellement une voiture avant de l’acheter reste faible.
Pour ce qui est de la voiture autonome, je ne suis pas sûr que son développement nécessite la mise en place d’infrastructures supplémentaires, au contraire de la voiture électrique, qui peine justement à prendre son essor pour cette raison : si les automobilistes n’ont rien contre le fait de conduire une voiture électrique, comme nous avons pu le constater en mettant des voitures électriques à la disposition du public au cours d’une journée constituant un test grandeur nature – nous avions d’ailleurs eu du mal à obtenir ces véhicules, que les constructeurs étaient réticents à nous prêter –, la question de la recharge les préoccupe beaucoup. La gestion du temps libre à l’intérieur de l’habitacle de la voiture autonome est un vrai sujet de société si l’on se réfère au temps que l’on passe dans sa voiture ou dans les transports en commun pour se rendre au travail et en revenir dans les grandes villes, surtout à Paris : si, demain, ce temps pouvait être utilisé pour se reposer ou pour faire autre chose, ce serait une vraie révolution.
Je ne suis pas en mesure de vous dire dans combien de temps on verra des voitures autonomes sur nos routes. Ce qui est sûr, c’est que ce sera progressif : ce n’est pas du jour au lendemain que l’on pourra utiliser des voitures autonomes à 100 %. Si faire rouler une voiture autonome sur une autoroute n’est pas très compliqué, la faire évoluer dans les centres urbains, ce qui suppose qu’elle soit capable d’anticiper des comportements humains par nature imprévisibles, est impossible pour le moment : c’est le dernier palier avant que l’on puisse parler de voitures véritablement autonomes, mais il est extrêmement difficile à franchir. En fait, on peut penser que l’on commencera par lâcher le volant sur certains secteurs, et que ces secteurs s’étendront au fil du temps. Tous les constructeurs travaillent à la mise au point de ce qui sera, à n’en pas douter, la voiture du futur, mais je ne suis pas sûr que tous – je pense notamment aux constructeurs français – disposent des moyens financiers nécessaires à la fois pour se développer dans les pays émergents d’Asie et d’Afrique, pour trouver la motorisation qui va s’imposer demain, et pour mettre au point la voiture autonome. De ce point de vue, la course à la taille critique est un enjeu essentiel : il faut vendre énormément de voitures pour être en mesure d’amortir tous les investissements que je viens de citer.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Nous vous remercions pour votre intervention précise et détaillée, qui a fort utilement complété les auditions auxquelles nous avions déjà procédé.
La séance est levée à midi quarante-cinq.
◊
◊ ◊
29. Audition, ouverte à la presse, de M. Éric Le Corre, directeur des affaires publiques du Groupe Michelin et de M. Éric Vinesse, directeur pré-développement.
(Séance du mardi 1er mars 2016)
La séance est ouverte à douze heures.
La mission d’information a entendu M. Éric Le Corre, directeur des affaires publiques du Groupe Michelin et M. Éric Vinesse, directeur pré-développement.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Nous accueillons ce matin M. Éric le Corre, directeur des affaires publiques du groupe Michelin, et M. Éric Vinesse, directeur du pré-développement.
Géant du pneumatique, Michelin occupe le deuxième rang mondial des manufacturiers, immédiatement après Bridgestone, qui résulte de la fusion réalisée en 1988 entre une firme japonaise et l’Américain Firestone.
Présent sur tous les continents, Michelin fabrique et vend massivement en Amérique du Nord et emploie plus de 110 000 salariés, dont 20 000 en France.
L’internationalisation du groupe n’a pas empêché la firme de conserver son siège et une part importante de son activité à Clermont-Ferrand. La maison mère a opté pour un statut particulier, celui de société en commandite par action, qui garantit le maintien de son indépendance. L’action Michelin est cotée au CAC 40.
Ce qui intéresse plus particulièrement notre commission est l’effort en matière de recherche et développement (R&D) et d’innovation, déployé de longue date par votre entreprise. Cet effort est reconnu internationalement, souvent primé et salué par les marchés. Le pneumatique et le freinage sont des facteurs non négligeables d’émissions de particules, et la problématique de l’adhérence au sol des véhicules constitue, avec le caractère plus ou moins abrasif des chaussées, une source de polluants.
Vous allez pouvoir nous préciser, messieurs, l’état des connaissances sur ce sujet, qui est moins connu du grand public que celui des émissions à l’échappement.
Estimez-vous que des progrès significatifs ont été réalisés dans ces domaines et quels sont ceux que l’on peut attendre ? Quels axes de recherche privilégiez-vous sur ces problématiques ? On peut penser que votre groupe ne travaille pas seul sur des voies d’amélioration et que vous collaborez avec des constructeurs et des équipementiers.
Par ailleurs, notre mission ne peut totalement ignorer la question du recyclage des pneus usagés, ainsi que celle du rechapage. On rappellera, à ce titre, l’existence d’une éco-contribution sur les pneumatiques, qui est parfois improprement baptisée « écotaxe ». Quel est l’impact de ce dispositif sur le recyclage, qui demeure imparfait ? Un pneu rechapé est-il a priori plus polluant qu’un pneu neuf ? La filière du rechapage a-t-elle un réel potentiel de développement ?
Les produits bon marché et d’entrée de gamme, souvent d’origine asiatique, présentent-ils les mêmes garanties d’usage que des pneus plus élaborés, si l’on considère leur dégradation particulaire ?
La presse s’est fait l’écho du succès des pneus chinois à bas prix, qualifiés de « mono-vie », donc insusceptibles d’être rechapés. Ces pneus équiperaient notamment de nombreux poids lourds. Sont-ils moins fiables, en termes de sécurité, mais aussi pour la santé, s’agissant des émissions de particules ?
Ces interrogations semblent appeler une action plus efficace dans le domaine de l’homologation des pneus. Sans parler de protectionnisme, l’Europe ne devrait-elle pas, face à de tels enjeux, renforcer ses critères quantitatifs et qualitatifs minimaux ?
Après un bref exposé liminaire de votre part, messieurs, Mme Delphine Batho, notre rapporteure, vous posera des questions. Puis, à leur tour, les autres membres de la mission vous interrogeront.
M. Éric Le Corre, directeur des affaires publiques du groupe Michelin. Madame la présidente, madame la rapporteure, mesdames et messieurs les députés, nous vous remercions de nous donner aujourd’hui l’occasion d’intervenir devant vous. Avec Éric Vinesse, nous tenterons, dans notre propos liminaire, de répondre à vos interrogations sur l’état de la recherche et du développement. Nous répondrons ensuite aux questions plus spécifiques sur le rechapage, lors de la séquence questions-réponses.
Trois points sont au cœur de la démarche de Michelin.
Premièrement, Michelin agit de manière proactive pour l’environnement et la réduction de la consommation d’énergie dans le transport, et ce depuis longtemps. C’est l’une des raisons d’être du groupe quand nous parlons de mobilité durable, c’est-à-dire d’une mobilité encore plus respectueuse de l’environnement et encore plus sûre. Les deux sont indissociables dans notre esprit, comme dans nos actions.
Le deuxième élément au cœur de la démarche de Michelin procède d’une double exigence : d’abord, il nous paraît indispensable, dans les tests et l’évaluation de nos produits, de nous rapprocher le plus possible de l’expérience réelle vécue par le consommateur ; ensuite, pour être pertinents, les tests doivent être à la fois représentatifs et reproductibles. Représentatifs, c’est-à-dire qu’ils doivent représenter, lorsqu’ils sont réalisés en laboratoire, le plus fidèlement possible les conditions d’usage dans la vie réelle ; reproductibles, autrement dit que nous avons l’assurance de retrouver toujours les mêmes résultats, quel que soit le laboratoire où ils sont réalisés.
Chez Michelin, nous nous employons depuis toujours à travailler sur ces deux dimensions en même temps, et donc à nous rapprocher le plus possible de la réalité de l’expérience vécue par le consommateur, pour avoir des tests représentatifs et reproductibles.
Troisième élément au cœur de la démarche de Michelin, notre exigence de rigueur et de transparence, au-delà du respect scrupuleux de la réglementation, s’accompagne d’une volonté permanente d’aller plus loin que ce qu’imposent normes et réglementations.
Si nous avons été proactifs jusqu’à aujourd’hui en ce qui concerne l’effort mené pour réduire la consommation d’énergie grâce à nos produits, nous continuons à l’être et nous avons l’ambition d’aller plus loin. Je vous ferai part tout à l’heure des axes de travail que nous envisageons.
Vous avez évoqué, madame la présidente, la dimension mondiale de notre groupe. Nous intervenons aujourd’hui dans près de 170 pays et nous sommes implantés industriellement dans soixante-huit usines, dans dix-sept pays, sur tous les continents. Le marché sur lequel nous intervenons n’est pas seulement celui du pneumatique, c’est aussi celui des services associés. C’est un marché véritablement mondial, qui représente quelque 1,6 milliard de pneumatiques vendus chaque année et à peu près 180 milliards de dollars en valeur annuelle.
Sur 1,6 milliard de pneumatiques, les pneumatiques pour voitures et camionnettes représentent 1,4 milliard, soit à peu près 60 % du marché en valeur, contre 30 % pour les pneumatiques poids lourds.
Les ventes de pneumatiques aux constructeurs ne représentent que 25 % du marché mondial des pneus pour voitures, et 10 % pour les pneus pour poids lourds. Sur ce marché, les prix sont tendus et ne sont discutables qu’avec des arguments techniques majeurs. Les pneus dits « de remplacement » représentent donc de très loin l’essentiel du marché, en volume comme en valeur.
Si le marché mondial a connu globalement des évolutions très contrastées au cours de ces dernières années sur le plan géographique, avec notamment une baisse durable du marché européen depuis 2007, contrairement au marché nord-américain, Michelin attend, à moyen et long terme, une croissance forte et structurelle des marchés du pneumatique. Le nombre de véhicules en circulation devrait quasiment doubler d’ici à trente-cinq ans et passer de 850 millions de véhicules, pour l’heure principalement des voitures et des camions, à un peu plus de 1,5 milliard. Cette croissance sera essentiellement le fait des pays émergents.
Ces évolutions s’inscrivent dans un contexte de concurrence internationale forte. La part des dix principaux manufacturiers pneumatiques mondiaux est ainsi passée de 83 % du marché en 2000, à 63 % en 2014, alors que, dans le même temps, en moins de dix ans, les manufacturiers pneumatiques chinois ont presque doublé leurs parts de marché, qui atteignent désormais 15 %. Ils ont aussi très substantiellement accru leur capacité de production, largement au-delà des besoins liés à la croissance, au demeurant forte, de leur marché domestique.
Dans ce contexte concurrentiel, la stratégie de Michelin est de s’adapter en permanence. Nous faisons en sorte de préserver la compétitivité de notre outil industriel. Le maître mot, pour nous, est l’anticipation. Cela est vrai partout où nous sommes présents, mais il n’est pas question, pour nous, de privilégier les marchés ou les pays à forte croissance au détriment de l’Europe en général et de la France en particulier. Nous travaillons au contraire à maintenir une empreinte industrielle équilibrée et compétitive. Nous continuons ainsi à investir en France. Nos investissements industriels devraient atteindre près de 800 millions d’euros dans notre pays pendant la période 2013-2020, dont 480 millions ont déjà été réalisés à ce jour.
La complexité et le haut niveau technologique du pneumatique requièrent aussi des investissements importants en recherche-développement, surtout si nous voulons, comme c’est notre cas chez Michelin, continuer à faire la course en tête. De fait, aucun autre acteur de notre industrie n’investit autant que nous dans l’innovation. Nous y consacrons chaque année plus de 600 millions d’euros. Nous avons ainsi investi, en 2015, près de 690 millions.
Michelin est un groupe responsable, soucieux de la qualité écologique de ses produits. Sous notre impulsion, les onze principaux manufacturiers mondiaux de pneumatiques se sont regroupés, dès 2005, sous l’égide du World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), pour traiter les sujets de développement durable de nature non concurrentielle qui concernent les pneus. Le premier sujet abordé dès 2006 a été, par exemple, l’évaluation scientifique de l’impact des particules d’usure des pneus sur la santé et l’environnement.
M. Éric Vinesse, directeur du pré-développement. Je vous propose de revenir en détail sur les trois points clés mentionnés dans le propos liminaire d’Éric Le Corre.
Je commencerai par les enjeux associés à l’engagement proactif de Michelin pour la réduction de la consommation d’énergie des émissions de CO2 liées aux transports.
On peut estimer qu’en un peu plus de vingt ans, les efforts réalisés par Michelin pour améliorer l’efficience énergétique de ses produits ont permis d’économiser environ 330 millions de tonnes de CO2, soit à peu près l’équivalent de la quantité d’émissions produites par un pays comme la France en 2014.
Comment cela est-il possible ?
Rappelons d’abord quelques chiffres sur le transport et la consommation d’énergie.
Le transport représente approximativement 15 % du total des émissions de CO2 générées par l’activité humaine. Dans ces 15 %, le transport routier est majoritaire, avec environ 12 %. Dans ces 12 %, la contribution que l’on peut attribuer aux pneumatiques représente à peu près un quart, c’est-à-dire 2,8 % du total des émissions de CO2 générées par l’activité humaine. Cela montre que le pneumatique a un rôle significatif à jouer dans la réduction des émissions de CO2 dans les années à venir, comme c’est déjà le cas depuis quelques décennies.
Le pneumatique joue un rôle essentiel dans sa phase d’usage, c’est-à-dire lorsqu’il est monté sur un véhicule et que celui-ci roule. Cette phase représente à elle seule plus de 90 % de la consommation totale d’énergie liée au pneumatique dans tout son cycle de vie, c’est-à-dire depuis l’acquisition des matières premières jusqu’à son recyclage en fin de vie.
L’origine de cette contribution, c’est qu’à chaque fois que le pneumatique entre en contact avec le sol, à chaque tour de roue, une force de résistance à l’avancement s’exerce, que le moteur doit vaincre pour maintenir le véhicule en mouvement. On appelle cette force la résistance au roulement du pneumatique. On peut aussi entendre parler, à charge donnée, de « coefficient de résistance au roulement ».
Plus la résistance au roulement est élevée, plus le moteur doit fournir de l’énergie pour faire avancer le véhicule ; et plus il fournit de l’énergie, plus il y a d’émissions de CO2. À l’inverse, un pneumatique à très basse résistance au roulement est un équipement dont les composantes techniques, les briques technologiques permettent de limiter la dissipation énergétique et par le fait de moins solliciter le moteur et de réduire les émissions de CO2.
Michelin est engagé depuis plusieurs décennies pour améliorer la contribution énergétique de ses produits, et donc réduire la consommation d’énergie liée aux transports. Dès les années quatre-vingt, nous avions lancé nos premiers programmes de recherche en interne pour identifier des technologies, de nouveaux matériaux qui nous permettraient d’améliorer significativement la résistance au roulement des produits.
Ces travaux ont débouché, dès 1992, sur la mise sur le marché des premiers « pneus verts », les pneus « Energy Saver », dans lesquels l’introduction de la silice, à la place du noir de carbone, dans la formulation des mélanges « caoutchoutiques », permettait de réduire la résistance au roulement, mais surtout de le faire sans impact négatif sur les autres performances du pneumatique, et notamment les performances d’adhérence sur sol mouillé, qui constituent un critère essentiel sur le plan de la sécurité dans la mesure où le pneumatique est le seul point de contact physique entre la voiture et le sol.
Vingt-cinq ans après, nous en sommes aujourd’hui à la cinquième génération de pneus verts et nous sommes en train de préparer la sixième. Nos pneumatiques les plus efficients ont atteint à ce jour un niveau de résistance au roulement inférieur de moitié à ce qu’il était il y a vingt-cinq ans. Dans le même temps, nous avons pu faire progresser de manière significative l’adhérence sur sol mouillé de nos produits.
Dans l’avenir, le groupe Michelin a l’ambition de poursuivre cette démarche d’amélioration de l’efficience énergétique de ses produits et de le faire sur l’ensemble des produits qu’il développe, au rythme d’au moins 1 % par an pour les quinze ans à venir.
Deuxième point clé, les méthodes de test et d’évaluation des pneumatiques.
Michelin s’est toujours fait un devoir d’assurer que les conditions dans lesquelles ses pneumatiques sont testés et évalués représentent au mieux les conditions rencontrées par les usagers dans leur vie de tous les jours. C’est ce que l’on appelle la « représentativité » des tests. De nombreuses études ont été conduites depuis les années soixante-dix, par Michelin ou, aux États-Unis, par la National Highway Traffic Safety (NHTSA) ou l’Environmental Protection Agency, ou encore au Japon. Ces études montrent l’effet des conditions de test de la résistance au roulement dans leur relation à la consommation d’énergie vue en usage réel sur le véhicule.
Mais si l’on veut juger une méthode de test, il faut aussi prendre en compte la précision avec laquelle elle permet de donner une information. Si vous testez des pneumatiques selon la méthode recommandée, mais pas le même jour ou sur une machine de test différente, le résultat doit être toujours le même, faute de quoi l’information apportée a peu de valeurs. Il faut donc juger une méthode de test à la fois sur sa représentativité et sur sa reproductivité. Nos efforts dans ce domaine visaient évidemment à progresser sur les deux aspects.
Nous avons ainsi contribué de façon proactive, depuis plus de dix ans, au progrès des méthodes normatives sur les tests de résistance au roulement du pneumatique.
Notre engagement pour l’évaluation de nos produits est un engagement de qualité. À ce titre, nous nous positionnons résolument pour le respect des réglementations en vigueur, tant dans la règle que dans l’esprit, partout dans le monde. Nous allons même souvent au-delà.
Pour illustrer mon propos, je prendrai deux exemples dans le domaine de l’homologation.
L’homologation E2, réalisée en France, permet la mise sur le marché européen de tout nouveau pneumatique, qu’il soit vendu sur le marché des pneus de remplacement ou à nos clients constructeurs. Il existe un autre type d’homologation : l’homologation par le constructeur d’un pneumatique développé pour son véhicule à sa demande.
L’homologation E2 est délivrée par le Gouvernement français, sur la base d’un dossier que nous lui soumettons et qui contient, notamment, tous les procès-verbaux des tests réalisés sur un nouveau produit pour assurer sa conformité aux requis réglementaires.
La qualité des informations contenues dans le dossier d’homologation est essentielle. Elle est garantie par de nombreuses exigences. Certaines de ces exigences sont définies dans le cadre réglementaire. D’autres vont au-delà, que nous nous imposons par nos propres systèmes qualité et nos propres processus internes.
La première exigence concerne les laboratoires dans lesquels sont faits ces tests. Un cadre réglementaire impose que ces laboratoires soient accrédités. Nos laboratoires sont accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC). Cette accréditation est suivie d’audits annuels de surveillance. Au-delà de ce cadre réglementaire, le groupe Michelin a souhaité étendre cette accréditation à tous les tests qui sont faits dans le cadre du labelling, c’est-à-dire de l’étiquetage.
La deuxième exigence concerne l’audit des laboratoires. Le règlement exige que nous soyons audités tous les ans par l’Union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), qui agit en tant que service technique du Gouvernement, tant sur le plan de nos systèmes qualité que sur le plan technique.
La troisième exigence concerne les méthodes de test. Les tests de résistance au roulement doivent respecter la norme mondiale ISO 28580. Le règlement, qui s’appuie sur cette norme, définit les conditions précises dans lesquelles le test peut être conduit. Il impose aussi des conditions très strictes d’alignement entre les laboratoires où sont conduits ces tests. Un laboratoire qui fournit des données en vue de l’homologation sur la résistance au roulement selon la norme doit aussi garantir son alignement à un ensemble de dix laboratoires européens de référence. L’alignement entre ces laboratoires de référence est lui-même revu tous les deux ans pour obtenir une précision de l’ordre de 2 %, quel que soit l’endroit où vous testez vos pneumatiques tant que vous êtes dans des laboratoires alignés entre eux. Cette mesure de résistance au roulement est extrêmement précise.
Michelin a fortement contribué à l’élaboration de cette norme, unique au monde par son exigence, qui est aujourd’hui reprise mondialement. Les États-Unis, qui s’acheminent vers un système de seuils et d’étiquetage, s’appuient sur cette norme pour mesurer la résistance au roulement.
La quatrième exigence concerne les lieux de fabrication de nos produits. Le règlement requiert que les usines où sont fabriqués ces produits soient elles-mêmes évaluées pour la fabrication des pneus homologués E2. Elles deviennent alors éligibles à un audit réglementaire par l’UTAC tous les trois ans. Cela sous-entend qu’au-delà du dossier d’homologation, l’exigence de garantie se situe dans la durée, c’est-à-dire que la conformité au règlement doit porter, pour tous les pneumatiques fabriqués dans nos usines, sur toute la durée de leur fabrication.
Le règlement de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, ou United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) exige de prouver la conformité de tous les types de pneumatiques produits tous les deux ans. C’est ce que l’on appelle la Conformity of production (COP), qui est vérifiée par l’UTAC.
Chez Michelin, nous allons au-delà : chaque jour, chaque pneumatique produit est soumis à des contrôles rigoureux. Toutes les caractéristiques qui déterminent ses performances, depuis les propriétés physiques des matériaux qui entrent dans sa composition jusqu’au positionnement géométrique de ces matériaux à l’intérieur du pneumatique aux diverses étapes de fabrication, sont vérifiées chaque jour, pour chaque type de produit. Ces informations sont archivées et consultables lors des audits.
Telles sont, en résumé, les exigences qui tournent autour de l’homologation E2 pour le marché européen.
J’en viens à l’homologation d’un pneumatique par le constructeur automobile pour l’un de ses véhicules.
Tout constructeur qui développe un nouveau véhicule rédige un cahier des charges pour les pneumatiques qui vont équiper ce véhicule. Ce cahier des charges couvre un large ensemble de performances attendues, depuis des performances très génériques, comme les caractéristiques de masse et de géométrie, jusqu’à des performances, beaucoup plus fines, de perception subjective, qui seront évaluées par des pilotes professionnels.
Michelin fournit des pneumatiques répondant au cahier des charges des constructeurs lors des homologations techniques, puis respecte le cahier des charges agréé lors des livraisons de pneumatiques sur toute la durée du contrat commercial.
Pour prendre un exemple concret, lorsqu’un constructeur vient nous voir au sujet d’un véhicule qu’il est en train de développer pour une mise sur le marché d’ici à quelques années, il nous soumet un cahier des charges pour les pneumatiques qui équiperont ce véhicule.
Dans une première phase, nous échangeons techniquement avec le constructeur, sur la base de calculs ou de simulations et sur la faisabilité du cahier des charges qu’il nous soumet. Il est important de noter que, dans cette première phase, nous intégrons aussi nos propres exigences de performances qui, dans un certain nombre de cas, vont au-delà des minima requis par le constructeur automobile, s’agissant, par exemple, de la durée de vie des pneumatiques.
Une fois la faisabilité acquise, nous engageons une seconde phase, itérative, de développement de pneumatiques permettant de répondre au cahier des charges. À chacune des itérations, les produits sont testés par nous-mêmes et par le constructeur, sur machine, sur nos véhicules et sur ses véhicules. En fonction du retour d’informations qui nous est fait, nous pouvons adapter légèrement la conception du pneumatique.
Après plusieurs itérations et une fois que nous avons suffisamment convergé, à la fois dans la conception du véhicule et dans la conception du pneumatique, nous engageons une phase d’industrialisation pour assurer la conformité du pneumatique fabriqué en usine au modèle répondant aux attentes du constructeur. Car ce sont bien les pneumatiques issus de productions, que l’on peut appeler les pneumatiques de grande série, qui sont, au bout du compte, testés par nous-mêmes et par le constructeur, et sur lesquels porte notre engagement de respect de performance.
Enfin, pour faire le lien avec la première homologation dont j’ai parlé, c’est Michelin qui fournit au constructeur la preuve de la conformité des pneumatiques à la réglementation du pays dans lequel sera mis en vente le véhicule. J’ai évoqué tout à l’heure le règlement UNECE et l’homologation E2 pour l’Europe ; ce serait également le cas pour la Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) aux États-Unis.
Par contre, une fois les pneumatiques homologués pour le véhicule, le groupe Michelin ne participe pas au processus d’homologation technique du véhicule lui-même, qui relève de la responsabilité du constructeur automobile.
J’espère avoir clairement démontré, dans tous les exemples que j’ai donnés, que l’engagement de qualité et de représentativité de la performance de nos produits était au cœur de notre démarche.
M. Éric Le Corre. Je revins sur le troisième point clé de notre démarche, que je n’ai pas développé dans mon intervention liminaire : Michelin veut être une force de proposition, pour aller au-delà de ce que nous venons de vous présenter. Pour ce faire, il convient de retenir trois axes structurants.
Premièrement, Michelin, qui a favorisé, en Europe comme ailleurs dans le monde, notamment au Japon et aux États-Unis, la mise en place d’un étiquetage des pneumatiques, milite aujourd’hui pour le contrôle effectif de cet étiquetage.
Deuxièmement, nous sommes aussi engagés pour le développement de technologies qui permettent de prolonger la performance d’adhérence du pneumatique jusqu’à la fin de sa vie, ceci pour qu’avec la société civile, les consommateurs en retirent les avantages associés en termes de sécurité, de consommation d’énergie et de matière première.
Troisièmement, en ce qui concerne la prise en compte des pneumatiques dans les processus d’homologation du véhicule, Michelin souhaite souligner devant vous les évolutions positives déjà en cours et pour lesquelles nous avons été force de proposition, évolutions qui visent à une prise en compte précise des valeurs réelles de résistance au roulement des pneumatiques lors des cycles de tests, ainsi que lors des calculs des émissions de CO2 d’un véhicule.
C’est vrai pour la prise en compte des valeurs de résistance au roulement des pneumatiques telles qu’elles sont maintenant intégrées dans l’outil informatique VECTO, développé par la Commission européenne, qui calcule les émissions de CO2 des poids lourds ; de la même manière, les travaux en cours pour le développement de la méthode Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures (WLTP) pour le calcul des émissions de CO2 d’un véhicule individuel vont dans le bon sens. En permettant de prendre en compte plus précisément l’impact du pneumatique dans ces simulations, ces travaux contribueront à renforcer la représentativité des estimations faites pour le véhicule individuel.
Je ne m’attarderai pas, faute de temps, sur le renforcement du contrôle de l’étiquetage des pneumatiques européens, mais je tiens à revenir sur le dernier axe de travail dans notre démarche consistant à aller plus loin que la réglementation existante : je veux parler de la pérennité des performances du pneumatique.
Nous voulons permettre au consommateur d’utiliser leurs pneumatiques en toute sécurité le plus longtemps possible. Contrairement aux performances environnementales, à la résistance au roulement et au bruit qui s’améliorent au fur et à mesure que celui-ci s’use, l’adhérence sur sol mouillé est à son niveau maximal lorsque le pneumatique est neuf. Elle va décroître, dans l’expérience réelle du consommateur, tout au long de la vie du pneu. Cette déchéance peut varier significativement, du simple au double, selon les différentes conceptions de pneumatiques.
Michelin s’attache, par les règles de conception de ses produits, à minimiser cette déchéance et investit significativement en recherche et développement pour identifier des technologies permettant d’aller encore plus loin. Ainsi, les solutions que nous développons ont déjà permis, sur certains segments du marché, de concevoir des pneumatiques qui, à mi-usure, freinent plus court que leurs meilleurs concurrents lorsqu’ils sont neufs.
Les enjeux, vous l’imaginez, sont multiples. Il s’agit, bien sûr, de renforcer la sécurité de la conduite sur route mouillée, mais aussi de réduire la consommation de matière et d’énergie. Pouvoir utiliser ses pneumatiques plus longtemps en toute sécurité, c’est aussi une économie de consommation et même une économie de matière première dans la mesure où l’on est moins souvent amené à remplacer ses pneumatiques.
Il nous semble donc important de fournir à l’utilisateur une information sur la performance des pneumatiques pendant toute leur durée d’usage. Nous avons l’ambition de poursuivre ces efforts de recherche et d’innovation afin de garantir aux consommateurs qu’ils peuvent utiliser leurs pneumatiques jusqu’à la fin de leur vie.
Voilà ce que nous souhaitions partager avec vous, ce matin, sur le pneumatique, dont M. Vinesse a rappelé qu’il était le seul point de contact entre le véhicule, quel qu’il soit, et la route : un avion, par exemple, ne pourrait pas décoller ni atterrir sans ses pneumatiques…
Mme Delphine Batho, rapporteure. Pensez-vous que les réglementations nouvelles en matière d’homologation doivent être plus précises et interdire explicitement, concernant les pneus, certaines formes d’optimisation ?
Vous avez parlé de l’impact de la résistance au roulement sur les émissions de CO2, mais vous n’avez pas développé la question des émissions de particules au freinage. Quelles innovations envisagez-vous en la matière ?
En ce qui concerne la filière du rechapage et l’économie de matière première, nous avons entendu annoncer ce matin même la fermeture d’un site en Allemagne et d’un atelier à Clermont-Ferrand. L’inquiétude est grande. Je crois savoir que vous aviez développé dans ce domaine un savoir-faire exemplaire et que d’autres produits à bas prix viennent concurrencer vos productions. Pouvez-vous faire le point sur cette question ?
Mme Odile Saugues. Le groupe Michelin a effectivement annoncé ce matin, il y a moins d’une heure, la fermeture de l’atelier de La Combaude, à Clermont-Ferrand, spécialisé dans le rechapage et tué par la concurrence chinoise. L’atelier ne fonctionnait plus qu’à 62 % de ses capacités.
Que peut faire l’Europe pour lutter contre la concurrence chinoise, qui n’est pas toujours soumise aux mêmes critères de qualité ? Par ailleurs, leurs pneus n’étant pas rechapés, que faire pour éliminer les déchets ?
Par ailleurs, j’aimerais que vous donniez à notre mission d’information des précisions sur les autres sites européens qui travaillent sur le rechapage, car il est important de rappeler que Michelin fait encore du pneu rechapé.
M. Gérard Menuel. Cela est peut-être dû à mes origines agricoles et troyennes, mais j’ai constaté, dans ma vie professionnelle, que les pneus Michelin étaient d’une autre qualité que ceux que proposent notamment les constructeurs de tracteurs : les vendeurs se contentent désormais de dire à l’acheteur, au moment de signer le bon de commande, que s’il souhaite des pneus Michelin, ce sera 5 000 euros de plus…
Le comportement des constructeurs est en cause. Dans le domaine automobile, la qualité des pneus Michelin, en termes de confort, de consommation et de durée de vie, fait qu’ils sont plus chers sur le marché. La réponse des constructeurs, par rapport à leur cahier des charges, consiste à proposer à la consommation d’autres pneus moins chers. Pourquoi ne font-ils pas d’emblée état de la qualité des pneus dans les actes de vente ? On parle de consommation et d’éléments de confort lorsqu’on propose une automobile, mais très rarement de la qualité des pneus, qui est pourtant un élément essentiel.
M. Philippe Duron. Michelin a construit, dès les origines de la manufacture, sa réputation et son développement sur l’innovation.
Vous avez indiqué, messieurs, votre souci constant en matière d’innovation et de recherche et développement, ainsi que les importants montants que vous y consacrez.
Mais, c’est vrai pour le rechapage et pour le low cost, la question du prix joue un rôle de plus en plus déterminant dans l’achat du pneu, surtout dans les pays émergents qui s’équipent. Existe-t-il un modèle économique qui puisse vous contraindre à trouver un équilibre entre la qualité, la sécurité et le prix, pour pouvoir garder vos marchés et poursuivre votre développement à l’international ?
M. Jean-Michel Villaumé. On parle beaucoup, dans l’actualité, des voitures connectées. J’aimerais vous entendre, messieurs, sur la place du pneu dans ce concept, car je suppose qu’il aura un rôle important à jouer. On parle d’un pneu technologique, doté de capteurs… Pourriez-vous nous en dire plus sur ce sujet ?
M. Éric Le Corre. Je répondrai d’abord à la question du rechapage et de la concurrence. Puis je laisserai M. Vinesse répondre plus spécifiquement aux questions concernant l’innovation et les produits. Je reprendrai ensuite la parole pour parler des émissions de particules d’usure puisque je faisais référence dans mon propos à l’initiative commune de l’industrie, le Tire Industry Project, lancé à l’initiative de Michelin en 2005. C’est l’un des sujets qui a été étudié par l’ensemble de l’industrie pneumatique mondiale.
Vous connaissez sans doute tous le concept de recreusage et de rechapage. Le recreusage consiste à recreuser des sculptures dans le pneumatique lorsque celles-ci sont usées ; nos pneus sont recreusables, c’est-à-dire qu’ils ont suffisamment de gomme pour que nous puissions recreuser des sculptures après qu’ils ont parcouru quelques centaines de milliers de kilomètres. Le rechapage consiste à remplacer purement et simplement la bande de roulement.
Il existe deux techniques de rechapage.
Le rechapage à chaud consiste à reconstruire le pneumatique en usine, à poser une bande de roulement « crue » et à remettre le pneu dans un moule qui imprime les sculptures. C’est ce qui se fait dans les ateliers Michelin, notamment dans celui de La Combaude.
Le rechapage à froid, qui est la spécialité des Pneus Laurent, à Avallon, consiste simplement à remettre des bandes de roulement préformées sur des carcasses qui peuvent être des carcasses d’autres marques que Michelin, mais qui ont fait l’objet d’une vérification en termes de qualité et de sécurité. Les pneumatiques sont ensuite installés dans des étuves pour obtenir l’adhésion entre la gomme et la carcasse.
En rechapant un pneu une fois et en le recreusant deux fois, c’est-à-dire en faisant un premier recreusage, puis en rechapant pour remplacer la bande de roulement et en recreusant ensuite cette bande de roulement, un pneu Michelin peut parcourir à peu près un million de kilomètres, contre environ 250 000 kilomètres pour un pneu mono-vie classique. Le rechapage est la pierre angulaire de l’approche « économie circulaire » du groupe Michelin.
Nous travaillons sur quatre axes : premièrement, la réduction, c’est-à-dire l’écoconception, qui consiste à concevoir des pneus plus légers, donc plus économes en matière première, des pneus plus sobres énergétiquement et rechapables ; deuxièmement, la réutilisation, avec le recreusage, le rechapage, et éventuellement la réparation des pneumatiques poids lourds ; troisièmement, le recyclage en boucle courte – pouvons-nous réutiliser du pneu dans la fabrication de nouveaux pneus ? C’est un peu compliqué techniquement. Pouvons-nous valoriser de manière énergétique ou sous forme de matière première secondaire les pneus en fin de vie ? Quatrième axe enfin : le renouvellement, qui consiste à remplacer des ressources finies par des ressources renouvelables, et peut-être à utiliser plus de caoutchouc naturel, l’hévéa étant un arbre qui produit et qui se renouvelle pendant trente-cinq ans. Nous travaillons également sur des fabrications de butadiène biosourcé au lieu de butadiène issu de la chimie du pétrole, comme c’est le cas aujourd’hui.
Pour répondre à votre question sur les éléments du marché européen du poids lourd et à son impact sur le rechapage, je citerai quelques chiffres.
Le marché européen du pneumatique poids lourds de remplacement est d’environ 24 millions de pneus vendus chaque année. Il faut comparer ce marché avec un marché mondial de 140 millions de pneumatiques vendus chaque année – je parle ici du pneu radial, c’est-à-dire ce que nous fabriquons.
Le marché européen du pneumatique poids lourds de remplacement a reculé de 14 % entre 2007 et 2015, avec 24 millions de pneus annuels vendus en 2015, contre presque 30 millions en 2007. Dans le même temps, le marché du rechapage a reculé de 25 % en Europe.
L’essentiel de la baisse du marché du rechapage s’est concentré sur les quatre dernières années. Pendant la période 2011-2015, la baisse atteint presque 20 %, soit, aujourd’hui, un marché de 5,4 millions de pneumatiques rechapés par an, contre 6,8 millions en 2011. Dans le même temps, les importations de pneumatiques poids lourds neufs à bas coût en provenance du Sud-Est asiatique ont augmenté de près de 100 % : 4,4 millions de pneus contre 2,2 millions en 2011.
Je vous ai parlé, dans mon propos liminaire, des capacités industrielles en Chine. En ce qui concerne le pneumatique poids lourd, il y a, aujourd’hui, pour un marché mondial de 140 millions de pneus radiaux vendus chaque année, une capacité installée de l’ordre de 180 millions de pneus, la différence étant largement supérieure à la taille du marché européen. L’essentiel de cette surcapacité se trouve effectivement en Chine.
Pourquoi cette baisse du rechapage ? Vous l’avez dit vous-même, les transporteurs préfèrent, aujourd’hui, acheter des pneus neufs d’entrée de gamme à bas coût plutôt que de faire rechaper leurs pneus poids lourds. Plus de 50 % des flottes de transporteurs européens ont moins de vingt camions et sont confrontées à des difficultés de trésorerie, qui sont prioritaires par rapport à la notion de coût réel d’usage, c’est-à-dire ce que peut apporter le pneu rechapé. Le pneu rechapé présente un coût de revient kilométrique largement inférieur à celui d’un pneu neuf ; encore faut-il, au départ, sortir la trésorerie nécessaire pour acheter ce pneu qui, en effet, coûte plus cher.
Quelles sont les conséquences pour l’industrie du rechapage et pour Michelin ?
Mme Saugues a évoqué le chiffre de 62 %. Ce pourcentage ne s’applique pas à l’atelier de La Combaude ; c’est la capacité moyenne utilisée dans nos usines de rechapage européennes qui fabriquent du rechapage à chaud, et ce, en dépit des annonces que nous avons faites en novembre dernier sur la fermeture d’une activité de rechapage à Oranienburg, en Allemagne, et sur la fermeture d’un atelier de rechapage à Alessandria, en Italie.
Les évolutions de marché se sont accélérées dans le mauvais sens pour l’industrie du rechapage, qui emploie plus de 18 000 personnes en Europe. Ce qu’il se passe au niveau européen n’affecte pas seulement le groupe Michelin : notre concurrent Goodyear a annoncé la fermeture de son site de rechapage de Wolverhampton, au Royaume-Uni, ce qui représente une centaine d’emplois ; notre concurrent italien Marangoni a annoncé un plan social de 150 personnes pour son usine de Rovereto. De nombreux petits acteurs allemands sont en train de déposer leur bilan, comme Respa ou Haemmerlin. Il y aurait également de nombreuses fermetures d’ateliers de rechapage en Europe centrale. Au total, d’après notre estimation, à peu près 1 800 emplois dans ce secteur ont été supprimés en Europe depuis 2011.
Pourquoi faut-il sauver le rechapage ? Il n’appartient pas au groupe Michelin de juger la loyauté de la concurrence exercée par ses concurrents, en particulier asiatiques. En revanche, il nous semble que tous les moyens devraient être mis en œuvre pour sauvegarder le modèle du rechapage, éminemment vertueux.
Vertueux socialement, parce que ce secteur emploie 18 000 personnes en Europe. Ces emplois ont la particularité de mailler tout le territoire puisque l’on parle en l’occurrence de gens qui vont collecter les carcasses partout en Europe. Il s’agit aussi de postes très intensifs en travail humain.
Vertueux économiquement, parce que les pneus rechapés figurent parmi les solutions les moins onéreuses du marché du remplacement. Toutes mes études démontrent que l’on peut générer un gain de l’ordre de 10 % en termes de coût d’usage total si l’on équipe une flotte poids lourds de pneus rechapés Michelin, plutôt que de pneumatiques mono-vie.
Le rechapage est aussi un modèle vertueux sur le plan environnemental. Vous avez parlé, madame la rapporteure, des pneus en fin de vie. Le rechapage est la seule solution acceptable sur le plan de l’environnement.
Dans le cas d’un transporteur qui achète deux pneus mono-vie, vous aurez, en termes d’usage de matière première, deux fois soixante-huit kilos, ce qui représente 136 kg de matière première, contre quatre-vingt-six kilos pour un pneu rechapé, c’est-à-dire le pneu d’origine plus vingt kilos pour la bande de roulement qui a été posée sur ce pneu, soit une économie de matière première de 35 %.
En termes de déchets, s’agissant de la première solution, une fois que la bande de roulement est usée, le poids de la carcasse et du reste de gomme représente à peu près cinquante-cinq kilos. L’économie est de 50 % par rapport au poids de deux pneus pesant chacun cinquante-cinq kilos, soit 110 kg, qu’il faudra gérer en termes de fin de vie, contre cinquante-cinq dans le cas d’un pneu neuf et d’un pneu rechapé.
Bien sûr, l’analyse environnementale doit aussi prendre en compte l’analyse du cycle de vie du pneumatique. M. Vinesse a indiqué que l’usage du pneumatique représentait près de 90 % de celui-ci en termes d’émission de CO2. J’insiste sur le fait qu’un pneu rechapé, en termes de résistance au roulement, et donc, d’émissions de CO2, est aussi favorable, voire plus favorable qu’un pneu mono-vie Tier 3, d’entrée de gamme, importé du Sud-Est asiatique.
Enfin, vous n’êtes pas sans savoir que la Commission européenne a publié son paquet « économie circulaire » en décembre dernier. Il serait, pour nous, regrettable d’assister au démantèlement de tout un ensemble qui répondra peut-être, d’ici à quelques années, à une vraie demande économique, sociale et politique.
L’une des pistes est d’aider les flottes à surmonter leur problématique conjoncturelle de trésorerie pour qu’elles puissent bénéficier du coût d’usage total que leur apporterait le rechapage. Faut-il mettre en place des certificats d’économie circulaire, des certificats d’économies de matière première, ou d’autres systèmes ? Il nous semble important de creuser ces pistes pour essayer d’apporter des solutions.
En ce qui concerne les annonces de ce matin, dont vous n’avez peut-être pas eu le temps de prendre intégralement connaissance, je voudrais insister sur le traitement social.
Nous avons annoncé ce matin que, dans le contexte du marché européen du rechapage, après avoir investi près de 50 millions d’euros au cours des dix dernières années dans l’atelier de rechapage de La Combaude, nous avions fait le choix de le fermer. Cela concerne 330 personnes, dont 262 ouvriers. Mais il faut noter que l’évolution de la pyramide des âges du groupe à Clermont-Ferrand se traduira par environ 1 500 départs à la retraite dans les trois prochaines années. Du coup, cette fermeture d’atelier se traduira simplement par une offre de reclassement pour 330 personnes dans des postes de travail, à conditions comparables, sur les sites clermontois. Autrement dit, cela se fera sans départs contraints ni licenciements.
Dans le même temps, nous avons annoncé que nous allions investir 90 millions d’euros sur les sites clermontois, le site des Gravanches, le site de Cataroux et le site de La Combaude, qui ne fait pas que du rechapage, mais qui accueille aussi des activités logistiques, ainsi que des activités de moules en impression 3D, la fabrication additive métal. Si vous avez suivi l’actualité, vous savez peut-être que Michelin a annoncé, il y a quelques mois, la création d’une coentreprise avec Fives sur ce sujet, sur lequel nous sommes largement en avance par rapport à nos concurrents.
Mme la rapporteure. Quels sont les échanges avec les pouvoirs publics nationaux ou européens en ce qui concerne les mesures à prendre pour sauver le rechapage ?
Vous parlez d’aider les flottes à surmonter leurs problèmes de trésorerie. N’y aurait-il pas des leviers plus simples, d’ordre réglementaire, pour ce qui est de la qualité des pneus ?
M. Éric Le Corre. Il faudrait déjà assurer une surveillance effective et réelle des marchés. J’ai eu l’occasion d’intervenir, il y a deux ans, devant la Commission d’enquête sur les causes de la fermeture de l’usine Goodyear d’Amiens-Nord. Le rapport issu des travaux de cette commission soulignait déjà qu’il conviendrait déjà de s’assurer que la surveillance des marchés soit effective par rapport aux réglementations mises en place.
Je suis désolé de dire qu’il ne s’est pas passé grand-chose depuis… La France est le dernier pays à avoir désigné une autorité de surveillance des marchés en ce qui concerne la réglementation sur les seuils de performance et l’étiquetage des pneumatiques, à savoir la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). La France n’a pas encore participé au comité ADCO – administrative coopération –, qui se tient régulièrement en Europe. D’autres pays européens sont, sur ces sujets, largement en avance par rapport à nous, notamment l’Allemagne.
Nous travaillons auprès des autorités européennes pour faire comprendre les enjeux, mais vous savez comme moi que beaucoup d’autres éléments entrent en ligne de compte.
M. Éric Vinesse. En ce qui concerne l’homologation du pneumatique et les conditions de cette homologation, les méthodes de tests sont clairement définies. Nous avons contribué à faire progresser ces méthodes pour qu’elles prennent en compte, non seulement les conditions précises de mesure et d’évaluation, mais aussi les méthodes d’alignement entre les laboratoires qui testent les pneumatiques.
Quant au processus d’homologation, il répond, sur le marché européen, à un certain nombre de critères d’harmonisation entre les différents pays, définis dans la directive 2007/46, et qui concernent, non seulement le pneumatique, mais aussi l’ensemble des composantes du véhicule.
Aujourd’hui, la Commission européenne vient de faire une proposition de règlement pour remplacer cette directive et aller plus loin dans l’harmonisation et la définition des obligations de l’ensemble des intervenants sur le processus d’homologation : États membres, autorités de surveillance, laboratoires et manufacturiers.
L’un des objectifs de cette proposition semble être d’aller vers une meilleure harmonisation et une plus grande clarté des pratiques dans le cadre du processus d’homologation. Nous sommes, bien sûr, favorables à tout effort allant dans ce sens, car cela conduira à une plus grande homogénéité en Europe sur ce sujet.
Je reviens sur la question du labelling et de l’étiquetage du pneumatique.
Lorsqu’il est introduit sur le marché, le pneumatique doit avoir une étiquette indiquant son niveau de performance en termes de résistance au roulement, d’adhérence sur sol mouillé et de bruit.
Les méthodes utilisées pour obtenir les résultats indiqués sur l’étiquette sont clairement définies et harmonisées par le règlement européen (CE) n° 1222/2009. Dans toute l’Europe, chaque manufacturier ou chaque importateur qui introduit un pneumatique sur le marché doit le tester selon une méthode en accord avec les principes d’harmonisation définis dans la réglementation et indiquer les résultats des tests sur l’étiquette.
Ce processus est en autocertification, c’est-à-dire que le manufacturier ou l’importateur réalise ces tests dans le respect du règlement et indique lui-même sur l’étiquette les résultats obtenus. Il relève de la responsabilité de chaque État membre de vérifier que le processus est appliqué suivant les requis du règlement n° 1222/2009. Le niveau de contrôle est absolument essentiel pour donner de la crédibilité aux résultats obtenus dans le cadre de cet étiquetage.
Nous avons, avec l’Association européenne des manufacturiers de pneumatiques, l’European Tyre and Rubber Manufacturers Association (ETRMA), dès le démarrage du labelling, mis en place un certain nombre de contrôles pour identifier, à travers des échantillons, l’agrément des résultats obtenus par rapport à la définition donnée par le règlement.
M. Éric Le Corre. Vous m’avez posé une question, madame la rapporteure, sur les particules d’usure.
Les onze principaux manufacturiers pneumatiques mondiaux se sont saisis de ce sujet dès 2006 dans le cadre d’un projet intitulé Tire Industry Project (TIP), qui nous rassemble sur des sujets concernant l’environnement, la sécurité et la santé, sujets de nature non concurrentielle. Chaque réunion se fait, bien sûr, dans le respect des règles antitrust, mais nous avons travaillé ensemble sur un certain nombre de sujets concernant le pneumatique et l’environnement.
Nous mandatons des consultants extérieurs indépendants qui mènent des recherches, vérifiées par des comités scientifiques et publiées. L’un des premiers sujets examinés a été celui des débris d’usure générés par les pneus.
Dans une première étape, nous avons découvert que ces débris étaient constitués de particules de route et de pneu intimement liées, que nous appelons les Tire and Road Wear Particles (TRWP). Ces particules sont trop volumineuses pour rester suspendues dans l’air. Seule une très faible partie d’entre elles, les plus petites, est susceptible de constituer une pollution atmosphérique. Nous avons fait examiner scientifiquement, mais aussi en faisant mener des enquêtes sur le terrain dans plusieurs grandes agglomérations mondiales, ce que l’on retrouvait effectivement dans l’air.
Les particules d’origine pneumatique représentent moins de 1 % des PM10 – c’est-à-dire les particules d’une taille inférieure à 10 microns – présentes dans l’atmosphère. Nous avons ensuite examiné les particules d’une taille inférieure à 2,5 microns, qui peuvent se retrouver dans les poumons et, au travers des alvéoles, passer dans le système sanguin. Moins de 0,4 % du total des PM2.5 de toutes origines sont présentes dans l’atmosphère.
Nous avons ensuite étudié, notamment sur des rats, la toxicité des particules qui se retrouvent dans le sol mais également dans l’eau. Les résultats ont démontré que ces particules n’avaient pas d’effet adverse, même avec des durées d’exposition longues et à forte concentration.
M. Denis Baupin. Je suppose que les chiffres que vous avez donnés portent sur l’air ambiant de la France dans son ensemble. S’agit-il d’une moyenne, sachant qu’il y a, selon les activités menées, plus de particules dans certains territoires ? Ou bien s’agit-il d’un pourcentage calculé en zone agglomérée, où une part significative de la pollution est due à l’automobile ?
Quant à la toxicité, est-ce vous qui l’avez mesurée ? Ou bien des organismes indépendants, comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ? Quelle est la validité scientifique et sanitaire de vos études ?
M. Éric Le Corre. Les pourcentages sont calculés dans de grandes agglomérations, sur les particules d’une taille inférieure à 2,5 microns. Des études ont été conduites dans les agglomérations de Los Angeles, Londres et Tokyo. Il ne s’agit donc pas d’une moyenne nationale. Nous avons lancé des études pour conduire les mêmes analyses dans des agglomérations de grandes métropoles chinoises ou indiennes afin d’avoir une idée exacte de la situation.
Les mesures de toxicité ne sont pas conduites par les manufacturiers de pneumatiques, mais par des organismes indépendants spécialisés dans ce domaine. Elles sont revues et évaluées par un comité scientifique, puis publiées, après avoir été discutées avec l’OMS et d’autres acteurs internationaux. L’objectif est vraiment de travailler ensemble sur des enjeux qui nous semblent, en tout cas aux yeux des onze manufacturiers présents au sein du TIP, être de notre responsabilité collective.
M. Éric Vinesse. Je vous propose de revenir aux questions concernant le modèle économique et l’innovation en termes de pneumatiques et la réponse aux attentes des clients, s’agissant notamment des clients constructeurs.
Nous nous sommes engagés à faire progresser, aux yeux du consommateur, la valeur de son pneumatique à travers ses progrès en termes de performance, c’est-à-dire de ne pas faire de trade-off ou de changer une performance pour une autre, ce qui n’apporte rien au consommateur ni à la société. Il s’agit d’apporter par l’innovation des solutions qui permettent de décaler l’équilibre des performances et de progresser sur plusieurs dimensions à la fois.
Nous sommes engagés pour une meilleure utilisation de la matière, en apportant plus de performance pour plus longtemps, avec des solutions toujours plus efficientes. C’est dans cette efficience que le consommateur et la société trouveront les bénéfices de l’innovation que nous apportons.
Cela commence par la longévité des produits. On peut remonter, dans notre histoire, jusqu’à l’innovation du pneumatique radial qui, à l’époque, permettait déjà de multiplier par deux la durée de vie des produits. Au niveau des particules d’usure également, un pneumatique qui s’use deux fois moins vite représente un progrès essentiel.
C’est aussi tout ce que nous avons dit sur le rechapage des pneumatiques poids lourds, qui permet de réutiliser la carcasse plusieurs fois et de ne changer que la partie nécessaire, en apportant toujours la meilleure performance au consommateur.
Je peux également donner l’exemple du pneumatique X One, aux États-Unis. Un seul pneumatique de ce type permettait de remplacer deux pneumatiques sur les remorques américaines et de porter la même charge avec 30 % de moins en termes de masse et en faisant une économie de consommation d’énergie de 10 %. C’est un gain important pour le client en termes de consommation, pour la société en termes de baisse de masse, et c’est un gain d’efficience globale. L’innovation génère, là encore, un bénéfice pour le consommateur et la société.
Nous avons aussi introduit, dans les années quatre-vingt-dix, les lamelles Y, qui permettaient, s’agissant des pneus neige, de poursuivre plus longtemps les performances d’adhérence sur neige pendant toute la vie du pneumatique. Le consommateur pouvait utiliser son pneumatique plus longtemps sans avoir à le remplacer, et donc, réaliser des économies sur le coût d’achat de son pneumatique et sur la performance obtenue.
Dans le domaine agricole également, nous avons introduit de nouvelles technologies qui permettent au pneumatique de fonctionner à plus basse pression, ce qui limite l’impact sur le compactage des sols et améliore le rendement économique de la terre par l’utilisation de ces pneumatiques. Là encore, l’innovation permet de faire progresser à la fois sur l’efficience vue par le consommateur et par la société. C’est notre engagement depuis toujours que de faire progresser le pneumatique grâce à l’innovation.
Je peux aussi mentionner les Michelin Durable Technologies, qui ont été introduits pour les poids lourds dans les années quatre-vingt-dix et qui permettent au consommateur, en « régénérant » de la motricité pour les pneus poids lourds pendant toute leur vie, de pouvoir utiliser en toute confiance son produit plus longtemps.
S’agissant de la pérennité des performances, nous avons introduit, en 2014, aux États-Unis, le pneu Premier All-Season qui, grâce à des bandes de roulement évolutives, au fur et à mesure que le pneumatique s’use, voit ses performances et sa sculpture évoluer, ce qui permet de régénérer de la performance et de la traction. Ainsi, le client sait que les qualités de son pneumatique en termes d’adhérence et de sécurité seront prolongées pendant toute la vie du produit.
Toutes ces solutions marquent un progrès, pour le consommateur comme pour la société.
Le pneu connecté enfin est pour nous un axe de travail extrêmement important. Il y a trois ans, nous avons été les premiers à introduire l’identification du pneumatique, en particulier pour les flottes de bus. Cette identification permet de fournir une information sur ce qu’est le pneu, mais aussi sur son état. En combinant cette information en matière d’identification, de pression et de température du pneumatique, on peut fournir aux flottes une information leur permettant de savoir précisément quel est l’état d’un pneumatique et s’il faut le changer, et donc, d’optimiser la maintenance de leur flotte.
Nous avons mis en place toute une série de services dédiés. Le suivi en temps réel permet au client de réduire le temps d’immobilisation du véhicule, d’optimiser l’entretien et d’anticiper le renouvellement de l’enveloppe.
Nous avons également mis en place une offre de services à travers une plateforme Internet baptisée « My Account » où nous mettons toute la puissance du digital à disposition des industriels du transport. Cette offre de services vise à aider ces clients à adopter une maintenance préventive, et non plus curative, et surtout à réduire les coûts de maintenance des pneumatiques.
Dans le cadre de ces services dédiés aux flottes, le groupe a créé « Michelin solutions », qui offre aux transporteurs une gestion optimisée des postes pneumatiques. Nous pouvons également souligner l’acquisition de la société Sascar, leader brésilien de la gestion numérique des flottes.
Comme vous pouvez le constater, nous sommes actifs sur tous ces sujets d’offre digitale et d’intégration de l’électronique dans le pneumatique.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Je vous remercie, messieurs, pour ces explications très détaillées.
La séance est levée à treize heures quinze.
◊
◊ ◊
30. Audition, ouverte à la presse, de M. Martin Vial, commissaire aux participations de l’État (APE), de M. Aymeric Ducrocq, directeur de participations industrie et de M. Jérôme Baron, secrétaire général.
(Séance du mardi 1er mars 2016)
La séance est ouverte à seize heures trente-cinq.
La mission d’information a entendu M. Martin Vial, commissaire aux participations de l’État (APE), M. Aymeric Ducrocq, directeur de participations industrie et M. Jérôme Baron, secrétaire général.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Nous accueillons aujourd’hui M. Martin Vial, commissaire aux participations de l’État, qui, à ce titre, dirige l’Agence des participations de l’État (APE).
L’APE a été créée en 2004 ; sa mission consiste à améliorer la cohérence des interventions de l’État actionnaire dans une optique stratégique, sans s’immiscer dans la gestion courante des entreprises concernées. Le rôle de l’APE est quelquefois mis en cause, notamment en ce qui concerne la politique des dividendes exigés par l’État. On rappellera toutefois que les besoins en dividendes ne sont pas souverainement définis par l’APE : ils sont généralement tributaires de la contrainte budgétaire.
Depuis août 2012, l’APE a connu trois directeurs généraux : M. David Azéma, puis M. Régis Turrini, qui occupa le poste à peine une année, et M. Martin Vial, nommé à la fin de l’été dernier. Certains pourraient en conclure que l’exercice des missions de l’APE n’est pas sans difficultés pratiques.
M. Martin Vial a pour atout une solide expérience entrepreneuriale : il a dirigé une des plus grandes entreprises publiques, le groupe La Poste, puis Europ Assistance, une entreprise privée qui lui doit une grande partie de son développement international.
Par son objet, notre mission se focalise sur les participations de l’État au capital des deux constructeurs français.
Les années 2014 et 2015 ont été riches en événements les concernant.
En premier lieu, il a fallu sauver le groupe PSA, qui était en grande difficulté. L’opération s’est traduite par l’entrée de l’État dans le capital, avec, dans le même temps, la recherche d’un partenaire, le groupe chinois Dongfeng. Pour quelque 800 millions d’euros, Dongfeng a acquis 14,1 % du capital, c’est-à-dire un apport et une participation identiques à ceux de l’État.
Devant la dilution des intérêts de la famille Peugeot, l’État a aussi réorganisé la gouvernance de PSA, mouvement qui s’est notamment traduit par l’accession de M. Louis Gallois à la présidence du conseil de surveillance. À en juger aux résultats qui viennent d’être annoncés, l’opération aura été payante pour tous les partenaires. En second lieu, M. Macron, ministre de l’économie, a considéré, au cours de l’année 2015, qu’il convenait de clarifier les modalités de l’alliance entre Renault et Nissan.
À cette fin, il a fait jouer un des dispositifs de la loi du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle, dite « loi Florange », en portant la participation de l’État de 15 % à près de 20 % du capital de Renault et en tablant sur la mécanique des droits de vote doubles.
Si l’on en juge par l’audition récente de M. Carlos Ghosn devant la commission des affaires économiques, le résultat n’a pas été tout à fait au niveau des espérances gouvernementales, la capacité de résistance des représentants de Nissan ayant, peut-être, été sous-estimée. L’État aurait dépensé 1,2 milliard d’euros environ pour acquérir les 5 % d’actions supplémentaires.
L’opération impacte directement l’APE qui avait sans doute d’autres priorités comme, par exemple, la recapitalisation d’Areva. L’État semble même avoir été pris à contre-pied dans cette opération. Monsieur Vial, vous allez nous apporter d’autres précisions sur les conditions et les finalités d’une opération au demeurant compliquée.
S’agissant du groupe chinois Dongfeng, des éclaircissements semblent également nécessaires à notre information. Est-il un véritable constructeur, ou s’agit-il plutôt d’un conglomérat industriel et financier proche des autorités chinoises ?
Existe-t-il un risque de conflit d’intérêts, lorsque l’on considère que Dongfeng est à la fois actionnaire de référence de PSA et le principal partenaire industriel et commercial de Renault en Chine ?
Vous aurez constaté que nous avons beaucoup de questions à adresser à l’APE…
D’autres questions se posent en effet. Quand est-il, par exemple, des relations entre l’APE et la Banque publique d’investissement (BPI) ? L’APE a-t-elle la préoccupation de soutenir, au-delà de ses seules participations directes en capital, tout un secteur, notamment les équipementiers ?
Un fonds de modernisation des équipementiers automobiles (FMEA) avait été créé en 2009, auquel a succédé le Fonds avenir automobile (FAA) de la BPI. Vos orientations stratégiques englobent-elles la recherche et développement et l’innovation de l’ensemble de la filière ?
Monsieur le directeur général, nous allons vous écouter au titre d’un bref exposé liminaire, puis notre rapporteure, madame Delphine Batho, vous posera un premier groupe de questions, elle sera suivie par les autres membres de la mission d’information qui, à leur tour, vous interrogeront.
M. Martin Vial, commissaire aux participations de l’État (APE). Merci, madame la présidente, pour vos propos aimables. Vous avez soulevé un certain nombre de questions qui sont au cœur de notre intervention quotidienne en tant qu’actionnaire, particulièrement dans le secteur automobile.
Je prie les membres de la mission qui appartiennent également à la commission des finances de bien vouloir excuser par avance les redites que je suis susceptible de commettre par rapport à mon audition par cette commission il y a quelques mois.
J’ai trois convictions au sujet de notre intervention dans le secteur automobile. La première est que la présence de l’État au sein des groupes Renault et PSA s’inscrit dans la doctrine générale de l’État actionnaire. La deuxième est que nous agissons en tant qu’actionnaire de long terme. La troisième est que nous entendons, en tant qu’actionnaire de Renault et de PSA — mais aussi à travers la BPI — aider le secteur automobile français à relever plusieurs grands défis.
Pourquoi l’État est-il présent aujourd’hui au sein des groupes Renault et PSA ?
Tout d’abord parce que cette présence s’inscrit dans la doctrine globale de l’État en tant qu’État actionnaire. Elle s’articule autour de quatre lignes directrices.
La première est que l’État intervient en tant qu’actionnaire dans les secteurs stratégiques majeurs et relevant de la souveraineté, tels le nucléaire ou la défense nationale. La deuxième est que l’État intervient dans les entreprises qui ont contribué ou contribuent au fonctionnement économique et à la vie sociale du pays, ce qui est typiquement le cas de La Poste, du domaine ferroviaire, du transport urbain parisien, mais aussi des entreprises de réseau comme Orange. La troisième est la contribution au soutien ainsi qu’à la structuration de certains secteurs essentiels pour l’économie française : c’est ce que nous avons fait dans le domaine de la défense, avec le rapprochement entre Nexter et son homologue allemand Krauss-Maffei Wegmann (KMW), afin de bâtir un opérateur de l’armement terrestre de taille européenne ; c’est aussi l’une des motivations de notre présence au sein des groupes Renault et PSA. La quatrième est que nous intervenons, de façon exceptionnelle, dans des entreprises présentant un risque systémique lorsqu’elles vont mal, ce qui a été le cas pour Dexia alors qu’elle était menacée de faillite.
La présence de l’État au sein des groupes Renault et PSA s’inscrit dans la troisième ligne directrice de notre politique d’investissement. S’agissant de Renault, sans remonter à la Régie de 1945, l’État est historiquement présent dans cette entreprise, dont la privatisation est intervenue en 1996. Jusqu’au printemps 2015, il détenait 15 % de son capital contre près de 20 % aujourd’hui. Malgré la privatisation, nous avons accompagné les décisions historiques structurelles du groupe, en particulier la prise de contrôle de Dacia ainsi que la première étape de l’alliance avec Nissan en 1999, puis, en 2002, le renforcement des accords avec cette marque, ce qui a permis de faire de cette alliance l’un des premiers groupes industriels au monde.
La présence de l’État dans PSA est plus récente, puisque la première prise de participation au capital a eu lieu en 2014, à un moment où le groupe traversait une grave crise existentielle ; cette intervention a produit des résultats financiers très positifs. Elle marque une rupture avec les pratiques antérieures : en 2009, après la faillite de la banque Lehman Brothers, notre intervention a pris la forme d’un prêt de 3 milliards d’euros, puis d’une garantie financière importante émise en 2012 sur les dettes émises par la filiale bancaire du groupe, PSA Banque.
L’État est entré dans le capital du groupe PSA en tant qu’« investisseur avisé » : le retour sur investissement est très positif, ce qui a d’ailleurs été reconnu par la Commission européenne. Le bon rendement ne constituait toutefois pas la seule motivation de notre intervention : il s’agissait aussi d’accompagner le développement du groupe avec un nouveau plan stratégique, dans le cadre d’une alliance tripartite incluant Dongfeng et la famille Peugeot. Ce plan, intitulé Back in the Race, a favorisé le redressement de PSA, et les résultats publiés montrent que les objectifs ont été atteints en 2015, avec deux ans d’avance sur ce qui avait été prévu au moment où l’État est entré dans le capital du groupe.
Notre intervention au sein de ces deux entreprises procède d’enjeux assez similaires du point de vue de l’État actionnaire qui, chez Renault comme chez PSA, est actionnaire de référence, mais il n’est pas le seul puisque Nissan détient 15 % du capital de Renault et que Dongfeng et la famille Peugeot sont présents chez PSA. La présence de l’État garantit une stabilité et une solidité dans l’actionnariat de ces entreprises, ce qui s’est vérifié lors des interventions au plus fort de la crise en 2009.
Dans le secteur de l’automobile, la présence d’un actionnaire de référence fort au sein des grands groupes n’a rien d’exceptionnel. Beaucoup de constructeurs de dimension mondiale disposent d’actionnaires de référence, publics ou privés : en Allemagne, avec 13 % du capital, le Land de Basse-Saxe est un actionnaire public très important du groupe Volkswagen ; en Italie, la famille Agnelli, détentrice de 29 % du capital, est l’actionnaire de référence historique de ce qui est aujourd’hui le groupe Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Ainsi la présence de l’État a permis au groupe Renault de déterminer le cadre de son alliance avec Nissan, et, depuis deux ans, au groupe PSA de définir les bases du développement de son partenariat stratégique avec Dongfeng : voilà la raison de notre intervention dans ces industries automobiles.
Le rôle de l’APE consiste à agir au sein de ces groupes en tant qu’actionnaire avisé de long terme, notre préoccupation est la stratégie, pas la gestion quotidienne, car si elle est un actionnaire important, l’Agence n’est pas majoritaire dans leur capital.
S’agissant de Renault le plan Drive the Change vise, à l’horizon de la fin 2016, un chiffre d’affaires de 50 milliards d’euros ainsi qu’une marge opérationnelle supérieure à 5 %, avec, chaque année, un autofinancement net – free cash flow – positif. L’objectif des 50 milliards d’euros est à la fois très ambitieux et très important pour le groupe Renault : la croissance est revenue après des années de baisse, et les résultats assignés en termes de marge opérationnelle ont été atteints en 2015, soit deux ans avant la date escomptée. Actionnaire stratégique, nous allons aider le groupe à préparer en 2016 son nouveau plan à trois ans. De son côté, le groupe PSA a réalisé son plan Back in the Race avec deux ans d’avance, lui aussi.
Dans les deux cas, l’APE s’est assurée que les plans stratégiques ont été conduits de façon extrêmement dynamique. Je tiens à saluer le travail fourni par l’encadrement et les salariés de ces deux entreprises, qui les a menées au succès.
La deuxième préoccupation de l’actionnaire à long terme est la gouvernance. En réponse à votre question relative à l’évolution du rôle de l’État actionnaire, madame la présidente, j’indiquerai que nous disposons désormais de deux administrateurs dans le conseil d’administration de Renault et de deux administrateurs au sein du conseil de surveillance de PSA. À ce titre, nous jouons le rôle d’actionnaire « normalisé » dans le fonctionnement des instances de gouvernance de ces entreprises, qui ont ainsi gagné en maturité ; au demeurant, nous sommes actionnaire attentif à la qualité de cette gouvernance. Nous siégeons par ailleurs dans divers comités – d’audit, d’éthique, de nominations et des rémunérations – des entreprises, afin de nous assurer que l’État, premier actionnaire de référence chez Renault et actionnaire de référence important chez PSA, peut intervenir sur les grands axes de gouvernance de l’entreprise.
La troisième préoccupation de l’État est l’exemplarité, car il n’est pas un actionnaire banal : il a des responsabilités particulières. Il est ainsi particulièrement attentif au taux de féminisation au sein des organes de gouvernance, celui-ci atteint pratiquement 40 % dans le groupe PSA, ce qui est supérieur aux exigences de la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle, dite « loi Copé-Zimmermann » et du code de gouvernement d’entreprise des sociétés adopté par l’Association française des entreprises privées (AFEP) et le Mouvement des entreprises de France (MEDEF). S’agissant du groupe Renault, cet effort de féminisation doit être poursuivi ; c’est d’ailleurs la raison pour laquelle, à l’occasion de la prochaine assemblée générale, le taux de féminisation sera augmenté, un point sur lequel nous demeurons attentifs.
Le niveau de rémunération des dirigeants de ces entreprises est, lui aussi, objet de notre vigilance ; en 2012, l’État a fixé des règles dans ce domaine, en demandant une baisse de 30 %, l’absence de cumul avec la rémunération par jetons de présence, ainsi que la suppression des retraites-chapeaux, sujet sensible dans le public et les entreprises. Si, en tant qu’actionnaire minoritaire, nous ne sommes pas en mesure de décider, nous exprimons en revanche très clairement nos positions, tant en conseil d’administration qu’en assemblée générale, à travers la règle du say on pay par laquelle les actionnaires d’une entreprise se prononcent sur la rémunération des dirigeants.
L’État actionnaire exige encore l’exemplarité en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), domaine dans lequel les marges de progrès sont considérables ; cela est vrai pour toutes les entreprises, et le secteur automobile ne fait pas exception. À cet égard, le groupe PSA constitue une référence puisque, en 2014, l’entreprise a été leader en matière de réduction des émissions de CO2, et a su faire évoluer à la baisse le taux d’accidents du travail de façon très sensible. De son côté, Carlos Ghosn, président-directeur-général du groupe Renault, a intégré la responsabilité sociale et sociétale dans les critères d’appréciation de la performance ; par ailleurs, le comité d’audit de l’entreprise se consacre à la pratique de l’éthique au sein de l’entreprise. Je ne prétends pas que nous sommes arrivés au bout du chemin dans le domaine de la RSE, mais nous tâchons, avec les moyens qui sont les nôtres, de peser sur ces deux groupes afin que, sur le long terme, ils soient exemplaires.
L’État actionnaire, investisseur avisé et de long terme, a aussi le souci du rendement de l’actif. De ce point de vue, l’investissement réalisé au sein du groupe PSA s’est avéré rentable, puisque les 800 millions d’euros investis au moment de l’augmentation de capital valent aujourd’hui 1,5 milliard d’euros, soit une plus-value potentielle de plus de 700 millions. Jusqu’à présent, l’entreprise connaissant une phase de redressement, nous n’avons pas réclamé de dividendes, car il était sain que l’actionnaire ne cherche pas à puiser dans la trésorerie ; cette politique évoluera toutefois à l’avenir, à mesure que les bons résultats du groupe se confirmeront.
S’agissant de Renault, la position historique de l’État au sein du groupe empêche l’évocation de la notion de plus-value. Nous menons cependant une politique de modération dans la distribution de dividendes, particulièrement au lendemain d’une situation de crise ; nous n’entendons pas moins revenir, à terme, à une situation plus habituelle. À cet égard, nous avons veillé à ce que l’entreprise normalise sa politique de dividendes, car une grande partie de ce qui était versé par Renault provenait des dividendes que lui servait le groupe Nissan. Ainsi, depuis l’année 2015, la contribution propre de Renault a augmenté : l’État a perçu 110 millions d’euros de dividendes et en percevra 140 millions pour 2016.
En réponse à votre question, madame la présidente, je puis indiquer que, lors de l’assemblée générale du groupe de 2015, l’État a acquis pour environ 1,2 milliard d’euros de titres afin de garantir à Renault un pouvoir de vote double au sein de l’entreprise, ce qui sera effectif dès le printemps prochain. Je rappelle que le ministre de l’économie a indiqué que, comme il s’y est engagé, l’État cédera ces titres lorsque les conditions du marché le permettront. Aujourd’hui le cours est légèrement inférieur à 85 euros : nous sommes sans doute assez proches du moment où la réalisation des actifs sera profitable.
L’APE est également présente, au-delà de ces deux entreprises, pour accompagner le secteur automobile français dans les grands défis qu’il doit relever aujourd’hui et dans les années à venir. De fait, ce secteur ne se limite pas aux deux constructeurs leaders français : il comprend aussi la chaîne des équipementiers au sein de laquelle sont présentes les grandes entreprises bien connues tels Valeo, Faurecia, Plastic Omnium, etc., certains équipementiers de premier rang ayant des relations capitalistiques avec les constructeurs ; viennent ensuite de plus petites entreprises, équipementiers de deuxième rang.
Nous sommes attentifs à ce que ces équipementiers de second rang – entreprises de taille moyenne et PME – puissent traverser dans les meilleures conditions la période de grande transformation technologique à laquelle ils sont confrontés, et la BPI est un acteur important de l’accompagnement de ces entreprises, à travers le Fonds de modernisation des équipementiers automobiles qui a versé plus de 600 millions d’euros. La BPI doit soutenir ce segment du secteur dans les domaines de la recherche et développement et de la modernisation de l’outil de production.
Le deuxième défi à relever par le secteur automobile est celui de l’internationalisation, ce qui implique la recherche d’une taille critique : comparés aux grands leaders mondiaux, qui fabriquent et immatriculent plus de dix millions de véhicules par an, les groupes Renault et PSA, avec deux à trois millions de véhicules, demeurent modestes. C’est pourquoi, nous avons le souci que ces deux entreprises trouvent les partenaires susceptibles de les accompagner dans une stratégie de rang mondial : Renault y est parvenu avec le groupe Nissan ; quant à PSA, nous accueillerons positivement tout projet d’alliance crédible et de nature à conduire l’industriel de façon durable vers les marchés européens.
L’internationalisation s’impose comme une absolue nécessité : Renault et PSA ne sauraient être dépendants du seul marché français – ce qui n’est d’ailleurs plus le cas – car celui-ci est loin d’être le plus dynamique d’Europe et du monde. Il est donc indispensable que ces deux constructeurs disposent de bases commerciales importantes dans le monde entier.
Le troisième défi auquel est confronté le secteur automobile est celui de la technologie : Renault et PSA doivent être au rendez-vous de la voiture connectée – qui est déjà une réalité – et de la voiture autonome, réalité technologique qui n’est pas encore aujourd’hui une réalité industrielle ni opérationnelle. Il faut néanmoins s’y préparer, et c’est pourquoi nous entendons aider ces deux groupes dans les stratégies propres à la conclusion des bonnes alliances dans le domaine de la technologie. Renault et PSA doivent en outre opérer les bons choix en matière de pollution afin d’être, là aussi, exemplaires.
Pour conclure, je dirai que le rôle que l’APE compte jouer auprès de ces deux groupes, comme dans l’ensemble du secteur automobile, est celui d’actionnaire de long terme – ce qui ne signifie pas que nous ne nous préoccupons pas du rendement de court terme – afin d’accompagner ces entreprises dans leurs alliances et dans leur développement international et technologique. Nous les voulons également exemplaires dans les domaines de l’environnement et de responsabilité sociétale.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Vous avez décrit l’État comme un actionnaire de long terme s’intéressant à la stratégie industrielle des groupes Renault et PSA : comment les choses se passent-elles concrètement ? Comment sont organisés vos échanges, quelle en est la périodicité ? S’agissant des choix technologiques tels que le traitement des oxydes d’azote (NOx), l’APE est-elle consultée ? Intervient-elle ?
À plus court terme, comment sont défendus les intérêts de l’État ? Concrètement, avant le 11 janvier dernier, journée au cours de laquelle le cours des actions du groupe Renault a chuté de 20 %, le Gouvernement a-t-il fait part à l’APE des informations dont il disposait à ce sujet ? L’Agence a-t-elle été avisée ?
Par ailleurs, dans le cadre de l’examen des choix stratégiques de l’entreprise, une discussion est-elle en cours sur les éventuelles réorientations technologiques de l’entreprise dans le domaine des NOx, la présentation d’un plan étant annoncée pour fin mars ?
La comparaison des budgets de recherche et développement entre les divers constructeurs a frappé la mission d’information : c’est un enjeu stratégique, qui requiert les capacités d’investissement nécessaires.
Vous n’êtes pas sans savoir que le Gouvernement a annoncé un rattrapage de la différence de fiscalité entre l’essence et le diesel : la mission d’information souhaite étudier – ce qui est inédit – les conséquences industrielles des choix fiscaux et technologiques, particulièrement ceux portant sur les types de motorisation. Le virage fiscal est amorcé et un débat est en cours au sujet de la façon dont il doit être négocié dans le temps afin d’être supportable par l’industrie ; toutefois, la question de l’accompagnement du groupe PSA dans cette démarche demeure posée. Sachant que l’État est actionnaire et que nous évoluons dans le cadre des règles de concurrences européennes, comment envisager un accompagnement de la capacité d’investissement afin de rendre l’outil de production plus flexible devant les choix de motorisation ?
Lorsque nous l’avons entendu, l’économiste Élie Cohen s’est interrogé, de façon quelque peu provocatrice, sur la pertinence de l’intervention de l’État, considérant que, si la préoccupation de l’État est d’éviter la délocalisation d’activités et la défense de l’emploi, il existe d’autres voies pour atteindre ces fins que la participation de l’État dans le capital. Pensez-vous que, à long terme, cette forme d’intervention de l’État demeurera de mise ?
M. Charles de Courson. Ma première question sera radicale : faut-il être actionnaire durable pour influencer la stratégie des deux groupes automobiles français, notamment en matière environnementale puisque c’est l’objet de nos travaux ? La Régie Renault a été créée par confiscation au sortir de la guerre pour faits de collaboration, Louis Renault ayant aidé l’effort de guerre allemand. S’agissant de Peugeot, cela est tout à fait différent, l’intervention de l’État a eu pour but le redressement de l’entreprise ; nous ignorons d’ailleurs à quel moment des actions seront recédées.
Par ailleurs, la présence d’un actionnaire étatique ne nuit-elle pas à la bonne gestion d’un groupe ? Au regard de la façon dont les choses se sont passées au sein du groupe Renault-Nissan, cette gestion par l’État n’est-elle pas de nature à détourner les investisseurs privés, les alliances éventuelles et les stratégies mondiales, ces groupes n’étant plus français, quand bien même ils ont encore leurs sièges en France ?
Enfin, l’État a acquis pour 1,2 milliard d’euros d’actions Renault afin d’atteindre 20 % du capital et de bénéficier du double droit de vote dans le but de pouvoir bloquer une délibération relative aux dirigeants de l’entreprise. Quelle est aujourd’hui la valeur du capital investi, et quel est le montant de la perte potentielle ? Vous évoquez un cours de 85 euros et dites que l’État revendra ses actions lorsque leur coût d’achat sera dépassé, mais on peut difficilement prévoir les évolutions de la Bourse.
M. Yves Albarello. Ancien chef d’entreprise, j’ai été quelque peu choqué par les trois critères que vous avez évoqués en premier lieu : la féminisation, les retraites-chapeaux et jetons de présence, la responsabilité sociétale. Je vous rappelle que nous sommes l’État actionnaire. Il s’agit donc de l’argent des Français, de notre argent ; lorsque nous investissons des sommes importantes dans un groupe industriel, le premier des critères n’est-il pas la performance et la rentabilité de l’entreprise ?
Cette année, le groupe Peugeot PSA a connu un résultat positif d'un milliard d’euros, ce dont on ne peut que se réjouir, et une prime de 2 000 euros sera attribuée à chaque salarié. Mais les 1,2 milliard d’euros investis par l’État actionnaire valent aujourd’hui 800 millions, ce qui constitue une mauvaise affaire : le temps n’est-il pas venu de revendre une partie des participations ?
M. Philippe Duron. Dans un contexte tel que celui de la crise de 2008, il est légitime que l’État se préoccupe de politique industrielle. J’observe d’ailleurs que, dans un pays aussi libéral que les États-Unis, l’État est intervenu massivement pour renflouer General Motors. On peut s’interroger sur la date de sortie, mais il est utile d’être actionnaire de référence afin d’avoir un suivi des politiques industrielles sur le long terme.
Le groupe Dongfeng n’est-il pas le partenaire de long terme dont le groupe PSA a besoin, car se situant au cœur d’un marché émergent qui offre des perspectives durables de développement ?
Enfin, les sous-traitants ne sont plus les fournisseurs exclusifs des constructeurs français, même lorsque, à l’instar de Faurecia et du groupe Peugeot, ils entretiennent des liens capitalistiques avec eux : comment analysez-vous la position des sous-traitants français dans le marché automobile international, et à quel avenir peuvent-ils prétendre face à la concurrence de l’Allemagne ou des pays émergents de l’Asie du Sud-Est ?
M. Jean Grellier. Fin 2008, l’État a créé le Fonds stratégique d’investissement, qui est intervenu chez certains sous-traitants : quel est le résultat de cette action ? Par ailleurs, quelle est la présence de la BPI dans le secteur automobile, sous-traitance y comprise ?
M. Martin Vial. Vous avez soulevé, madame la rapporteure, la question du dialogue avec l’entreprise ; celui-ci se déroule dans le cadre des organes de gouvernance du groupe, et l’État joue un rôle particulier dans le processus de préparation des plans stratégiques. Ses représentants font partie des comités stratégiques de chacune des deux entreprises. À ce titre, son rôle est plus important que celui des autres administrateurs ou organes de décision, et il dispose par ailleurs de ses propres études sectorielles.
Fort pertinemment, vous m’avez interrogé sur les choix technologiques se rapportant à la lutte contre les émissions polluantes, particulièrement le NOx ; je dois tout d’abord confesser que l’APE ne dispose pas de compétences techniques industrielles particulières, car ce n’est pas son rôle, qui est celui d’un actionnaire. Dans ce contexte, notre dialogue avec les groupes est de comparaison des performances des différents opérateurs et de ce que nous connaissons de leurs orientations stratégiques.
À Monsieur de Courson, j’indiquerai que nous avons eu connaissance par voie de presse de la visite de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) chez Renault – qui a été révélée par une information syndicale –, et nous n’avons pu que constater son impact sur le cours des actions du groupe ; mes services n’ont pas bénéficié d’une information particulière en amont. Sans trahir les secrets des travaux des organes de décision de l’entreprise, je puis indiquer que nous avons été informés de façon très précise par le management de Renault sur les motivations qui, après le scandale Volkswagen, ont présidé à cette perquisition ainsi qu’aux questions posées par la commission technique indépendante chargée d’effectuer les tests – lesquels ne sont pas terminés – sur une centaine de véhicules. Par ailleurs, à l’occasion du comité d’audit qui a suivi, ainsi qu’au sein du conseil d’administration, nous avons eu des échanges relatifs aux choix technologiques et aux plans à mettre en œuvre pour réduire les émissions de NOx. Les dispositions prises pour le rappel de véhicules, au demeurant peu nombreux, annoncées par l’entreprise, ainsi que les modifications à apporter aux nouveaux véhicules promis à la vente, ont aussi été évoquées.
Ainsi, l’État actionnaire, par le truchement de l’APE, entretient un dialogue stratégique permanent avec les deux groupes, qui concerne aussi les choix portant sur le diesel et la transformation du parc de véhicules. Comme vous l’avez souligné, madame la rapporteure, la fiscalité a longtemps favorisé l’utilisation du diesel, et la transition liée à l’évolution de ce régime fiscal fait partie des interrogations stratégiques du groupe PSA, qui est davantage concerné que Renault ; notre préoccupation est que cette transition s’effectue le mieux possible. C’est aussi la raison pour laquelle la réflexion sur la stratégie de ces deux groupes ne se borne pas à la France, mais porte sur l’ensemble du marché : il est donc indispensable que des débouchés soient ouverts dans des régions où les contraintes environnementales ne sont pas de même nature.
Nous sommes aussi attentifs à l’évolution des budgets de recherche et développement des deux entreprises. Aujourd’hui, celui du groupe PSA se situe entre 4 % et 5 % du chiffre d’affaires ; c’est un montant significatif, proche de celui de Renault, et lorsque l’on y intègre les autres investissements, il atteint 8 % à 9 %. C’est pourquoi la comparaison des chiffres d’affaires respectifs de PSA et Renault avec ceux des grands groupes mondiaux tels que Volkswagen, General Motors ou Toyota ne peut que conduire à contracter des alliances majeures : c’est le sens de l’alliance, que nous encourageons fortement, de Renault avec Nissan. Les synergies et les économies ainsi obtenues sont certes industrielles et commerciales, mais concernent aussi la recherche et développement ; nous poussons ces deux opérateurs à accroître leur taille critique afin d’acquérir une « force de frappe » importante.
Vous avez cité, madame la rapporteure, Élie Cohen, qui, comme Monsieur de Courson, s’interroge sur la nécessité pour l’État d’être actionnaire des groupes Renault et PSA. C’est une question que l’on se pose lorsque tout va bien, et elle ne s’est d’ailleurs pas posée aux États-Unis après la faillite de Lehman Brothers : le soutien que le gouvernement américain a apporté au secteur automobile, entièrement privé, a été sans précédent. Quant à la Grande-Bretagne, elle est le pays qui procédé au plus grand nombre de nationalisations de banques, alors qu’il était traditionnellement le plus opposé aux interventions étatiques. L’intervention étatique est liée aux périodes de crise, et c’est lorsque le groupe PSA a connu de graves difficultés que l’État français s’est porté à son secours.
La seconde question de Monsieur de Courson portait sur le fait de savoir si la présence de l’État dans le capital des entreprises n’est pas nuisible à la croissance de l’entreprise, au développement de ses alliances, etc. En tant que commissaire aux participations de l’Etat, telle n’est pas ma conviction, faute de quoi j’aurais conseillé à l’État de se désengager de Renault et de PSA. La présence de l’État ne nuit pas, quand bien même il peut y avoir des débats avec le management des entreprises ou d’autres actionnaires ; sa présence apporte un grand confort en matière d’actionnariat, la probabilité que ces entreprises puissent faire l’objet d’une offre publique d’achat (OPA) soudaine étant des plus faibles.
Par ailleurs, au cours de la décennie passée, le rôle de l’État actionnaire a gagné en maturité, lui permettant d’agir en partenaire minoritaire ordinaire – bien que de référence. Aussi, le débat avec Nissan a été celui de deux actionnaires détenant, à l’époque, chacun 15 % du capital, et dans lequel il était normal que l’État fasse valoir que, de son point de vue, la remise en cause de l’accord-cadre passé en 2002 avec Renault n’était pas acceptable. Le différentiel considérable de droit de vote et d’intervention en assemblée générale dont dispose l’État a permis que l’accord soit maintenu.
Je ne prétends pas que les choses soient faciles tous les jours, car l’État est souvent un actionnaire envers lequel on fait preuve de plus d’exigence : tour à tour on attend qu’il soit présent et puissant lorsque l’on a besoin de lui, mais qu’il soit passif en d’autres moments, chose que l’on ne demanderait pas à un actionnaire privé. Cette dialectique est constante, c’est notre lot quotidien, et c’est pourquoi l’APE souhaite tenir une place d’investisseur avisé de long terme, disposant de toute sa légitimité en tant qu’actionnaire de référence. S’agissant du rendement de l’actif engagé, j’ai dû mal m’exprimer, car je pense l’avoir clairement mentionné comme critère effectif. J’ai cité ce rendement last but not least car, pour l’actionnaire soucieux du patrimoine de l’État, il constitue une préoccupation permanente, sans pour autant être la seule motivation de notre action.
En ce qui concerne la valeur des titres acquis par l’État, si je ne cherche pas à m’esquiver, il m’est difficile de répondre, et j’ai d’ailleurs promis à la commission de finances – ou à la mission d’information si elle le souhaite – d’y revenir. Si ces actions ont été achetées dans des conditions publiques, n’est pas public, en revanche, ce que l’on appelle le « point mort », c’est-à-dire le niveau de cours à partir duquel ces titres sont susceptibles d’être revendus : il s’agit en effet d’une information de marché, dont la divulgation risquerait fortement d’obérer leur valeur. Je ne cherche pas à me « défiler » ni à masquer une information, mais à éviter une perturbation du marché qui, le cas échéant, nous serait reprochée.
M. Charles de Courson. La question que je vous ai posée est la suivante : à quel cours avez-vous acheté ces actions pour un montant total de 1,2 milliard d’euros, sachant que ce cours se situe aujourd’hui à 85 euros ? Je ne vous ai pas demandé à quelle date et à quel taux vous entendiez revendre…
M. Martin Vial. Dès lors que je vous indique quel est le prix de revient de cette opération, je vous révèle ce qu’on appelle le « point mort »…
M. Charles de Courson. Il suffit que je me reporte aux comptes de l’État pour avoir le prix. Le cas échéant, vous serez obligé de répondre à la commission des finances…
M. Martin Vial. Je le ferai volontiers. Encore une fois, je ne cherche pas l’esquive…
M. Charles de Courson. Si tel est votre souhait, nous pouvons vous entendre à huis clos. Ce que nous voulons, c’est votre réponse. Il s’agit de l’argent du peuple, nous représentons le peuple et entendons que vous répondiez aux questions de ses représentants : sinon, nous ne sommes plus en démocratie. Certes, je suis un peu dur, mais je connais la haute fonction publique… Aux États-Unis, lorsqu’un haut fonctionnaire ne répond pas aux questions du Congrès, on appelle la garde et il va en prison !
M. Martin Vial. Je m’engage à revenir vers vous, mais je ne peux divulguer une information de marché ; ce que je peux vous dire, c’est que nous sommes proches du point mort.
M. Charles de Courson. Il suffit de diviser 1,2 milliard d’euros par le nombre d’actions. C’est une donnée publique, et je ne comprends pas pourquoi vous refusez d’indiquer que vous avez acheté ces titres à un coût moyen pondéré de 90 ou 93 euros grosso modo.
M. Martin Vial. Je vous promets de revenir, Monsieur le député…
Je n’ai pas bien saisi la question de M. Albarello. J’ai indiqué que l’État avait investi 800 millions d’euros dans PSA ; aujourd’hui, la valeur de ces titres dans nos livres est de 1,5 milliard ; la plus-value potentielle est donc de 700 millions.
S’agissant de Dongfeng, que Mme la présidente et M. Duron ont évoqué, il est notre partenaire chez PSA tout en étant aussi un partenaire industriel et commercial de Renault en Chine ; cette pratique est assez courante chez les constructeurs chinois, qui peuvent avoir plusieurs partenaires susceptibles d’être concurrents, même si, dans le cas d’espèce, Dongfeng n’est pas actionnaire de Renault. Dongfeng est-il un partenaire de long terme pour PSA ? L’avenir le dira. Pour l’heure, ce partenariat triangulaire est très positif : le groupe accompagne Renault dans son accession à ce marché qui s’ouvre, et se comporte en actionnaire de long terme.
S’agissant des sous-traitants, le Fonds stratégique d’investissement a, en son temps, réalisé un investissement important dans Valeo, prenant 10 % du capital en 2009 ; la BPI n’a plus aujourd’hui qu’une participation résiduelle dans cette entreprise. Elle a pris le relais du FSI auprès des équipementiers, à travers le Fonds avenir automobile doté de plus de 600 millions d’euros. Cet instrument est strictement dévolu à l’accompagnement des ETI et des PME sous-traitantes qui sont des intervenants de deuxième rang. Il s’agit de les soutenir dans l’effort de recherche et développement et de modernisation de l’outil industriel dans le secteur automobile, mais aussi d’accompagner leur diversification, tant industrielle que géographique, afin de gagner des marchés hors de France. La BPI poursuit ainsi l’action du FSI, qu’elle a toutefois réorientée vers les PME.
Mme la rapporteure. Vous avez indiqué que l’APE ne dispose pas de compétences techniques et industrielles particulières. Dès lors, qu’en est-il de la coordination interne de l’État lui-même, s’agissant d’enjeux environnementaux et industriels majeurs ? Pour n’évoquer que les NOx, Renault est lié par un choix technologique dont la pertinence peut tout à fait être discutée et qui n’est pas le même que celui de PSA. J’observe par ailleurs que le ministère de l’industrie dispose, lui, de ces compétences techniques : pourquoi ne pas en doter l’Agence des participations de l’État ?
M. Martin Vial. Nous dialoguons évidemment avec la direction générale des entreprises (DGE) qui, au sein du ministère en charge de l’industrie, détient cette compétence ; son directeur général est d’ailleurs membre du conseil d’administration du groupe Renault. En tant qu’actionnaire, dans le cadre des discussions portant sur les orientations stratégiques, nous faisons appel à ces compétences afin d’être en mesure d’apprécier des choix opérés par les constructeurs. Au demeurant, c’est bien à des compétences extérieures que nous recourons pour appuyer notre analyse de ces décisions d’entreprise.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Je vous remercie, Monsieur le Commissaire, d’avoir bien voulu répondre à nos questions.
La séance est levée à dix-sept heures cinquante.
◊
◊ ◊
31. Audition, ouverte à la presse, de M. Christian Peugeot, président du Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA), et de M. Nicolas Le Bigot, directeur des affaires environnementales et techniques, accompagnés de M. François Roudier, directeur de la communication.
(Séance du mardi 8 mars 2016)
La séance est ouverte à seize heures dix.
La mission d’information a entendu M. Christian Peugeot, président du Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA), et M. Nicolas Le Bigot, directeur des affaires environnementales et techniques, accompagnés de M. François Roudier, directeur de la communication.
Mme Sophie Rohfritsch, présidente. Nous accueillons aujourd'hui M. Christian Peugeot, nouveau président du Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA) depuis le 1er janvier 2016.
Le Comité rassemble essentiellement les groupes français Renault et PSA mais a la particularité de compter parmi ses membres Renault Trucks, constructeur de poids lourds initialement français appartenant désormais au suédois Volvo AB.
Pour leur part, les constructeurs étrangers et les importateurs sont représentés par un organisme distinct, la Chambre syndicale internationale de l'automobile et du motocycle (CSIAM).
Notre mission est évidemment attentive à l'évolution du marché automobile. Elle l'est particulièrement pour ce qui concerne les comparaisons entre ventes de véhicules essence et de véhicules diesel.
Nous aimerions également vous entendre sur les perspectives de la balance commerciale du secteur automobile. Les plans de charge des principaux sites de fabrication français semblent en nette amélioration. Ce point est évidemment positif. Toutefois, peut-on encore dire qu'il subsiste, au niveau européen, des surcapacités de production ? N'oublions pas qu'il y a seulement un peu plus d'un an, certains articles de presse alarmistes prévoyaient la fermeture d'au moins dix sites de production en Europe !
Un autre sujet préoccupe notre mission : il s'agit des conditions d'homologation des véhicules qui seront applicables à partir de septembre 2017. Ces nouvelles normes prévoient des dérogations temporaires s'agissant des émissions de polluants comme les oxydes d’azote (NOx).
Sur ce thème de l'homologation, le statut et le rôle de l'UTAC soulèvent certaines interrogations. L'UTAC se présente comme une « union de syndicats ». À ce titre, le CCFA exerce un contrôle sur cet organisme : quatre de ses membres siègent à son conseil d'administration. Cette situation résulte probablement de l'histoire. Sans même évoquer le risque de conflits d'intérêts, pensez-vous qu'une imbrication de cette nature puisse longtemps subsister ? La question se pose car, sous l'effet du droit européen, beaucoup de choses sont appelées à changer pour l'homologation des véhicules.
En outre, les interventions de l'UTAC ne se limitent pas à aux homologations et aux essais des véhicules. La semaine dernière, des responsables de Michelin nous ont indiqué que cet organisme avait aussi un rôle dans l'homologation des processus industriels concernant les pneumatiques E2, au sens de la réglementation européenne, tout en effectuant également des audits réguliers des laboratoires de ce manufacturier. Il nous a été dit que l'UTAC intervenait ainsi par délégation mais en tant que « service technique du Gouvernement ». Une double question se pose sur son indépendance et ses missions.
Monsieur le président, nous allons d'abord vous écouter au titre d'un exposé liminaire. Mme Delphine Batho, notre rapporteure, vous posera ensuite un premier groupe de questions, puis les autres membres de la mission d'information vous interrogeront.
M. Christian Peugeot, président du Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA). Madame la présidente, madame la rapporteure, je vous remercie de m’avoir invité à m’exprimer devant votre mission d’information. Je suis en effet le tout jeune président du CCFA, syndicat professionnel né en 1909, qui réunit aujourd’hui les groupes Renault et PSA ainsi que Renault Trucks.
Nous inscrivons cette audition dans la continuité des actions lancées par mon prédécesseur depuis la crise provoquée par la fraude de Volkswagen. Les constructeurs français et leurs organisations professionnelles ont suivi une démarche de concertation totale avec les pouvoirs publics et maintenant avec vous, mesdames, messieurs les députés, représentants de la nation.
Tous nos débats sont sous-tendus par une volonté réelle d’explication. Il nous importe d’être didactiques et ne nous exprimer sans tabou ni dissimulation.
Le 22 septembre 2015, le CCFA avait délivré aux médias un message très clair : les constructeurs français n’ont pas triché ; ils approuvent l’idée d’une enquête indépendante ; ils soutiennent la mise en place de tests de roulage sur route ouverte, dits RDE – Real Drive Emissions. Après la réunion fondatrice du 24 septembre au ministère de l’environnement entre les constructeurs et Mme la ministre de l’environnement, nous nous sommes engagés dans la coopération la plus ouverte avec la commission indépendante qui a été mise en place. Avant même les premiers résultats annoncés en janvier, les constructeurs français, chacun de leur côté, ont annoncé la mise en place d’actions et de solutions.
Mon propos liminaire s’articulera autour de quatre points : premièrement, je rappellerai l’empreinte industrielle de notre secteur ; deuxièmement, je présenterai le parc de véhicules en France, le marché et ses évolutions en faisant le point sur la fiscalité et les normes d’émission de CO2 ; troisièmement, je m’attarderai plus particulièrement sur la baisse du diesel et son impact sur le marché français ; je terminerai par l’évolution des normes Euro relatives aux émissions de polluants et les progrès qu’apporteront à notre sens les nouveaux tests RDE.
L’activité de nos adhérents s’appuie sur une quarantaine de sites en France : usines d’assemblage, usines de production de moteurs et de mécanique, centres de recherche et développement – à cet égard, je tiens à souligner que bien que les constructeurs français aient une dimension mondiale, ils réalisent les trois quarts de leur R & D en France et envisagent de la maintenir dans ces proportions.
Pour les véhicules particuliers et les véhicules utilitaires légers, inférieurs à 3,5 tonnes, la production a évolué en passant d’un point haut de 3 millions d’unités au début des années 2000 à un point bas d’1,5 million en 2013. Ce chiffre correspond au nombre de véhicules assemblés mais, fort heureusement, l’activité globale n’a pas diminué de moitié : les activités de fabrication de moteurs, de boîtes de vitesses, la R & D se sont maintenues et la valeur ajoutée par voiture a progressé. Depuis 2013, la production remonte, grâce notamment aux accords de compétitivité signés par les deux groupes automobiles.
La production mondiale des constructeurs français s’élève à plus de 6 millions de véhicules en 2015, dont 80 % sont vendus à l’extérieur de la France. Nos adhérents construisent plus de voitures en France qu’ils n’en vendent : notre pays reste pour eux une base d’exportation.
Dans cet environnement, les exportations des produits des industries automobiles de la France ont, en 2015, dépassé le chiffre de 40 milliards d’euros, en progression par rapport à 2014. L’industrie automobile est toujours l’un des premiers secteurs exportateurs de notre pays, aux côtés de l’aéronautique et l’agroalimentaire. Elle représente 9 % des exportations totales françaises.
Selon la dernière enquête du ministère de l’économie, le secteur industriel automobile se compose au total d’environ 4 000 établissements pour 500 000 emplois. Mais si l’on prend en compte les emplois induits – commerce, réparation, assurances, transports routiers –, on arrive au chiffre de 2,3 millions d’emplois associés à l’automobile.
Bref, il serait bien réducteur de résumer cette industrie aux nuisances relatives aux émissions du parc automobile. Elle est source d’une activité économique importante pour notre pays.
L’enjeu, pour cette industrie lourde, est de rester agile dans un environnement extrêmement volatil. Au niveau international, il nous faut nous positionner sur des marchés en croissance, pour certains d’entre eux, mais aussi d’autres en forte chute – je pense à la Russie ou aux pays de l’Amérique du Sud.
La crise de 2008 a fait perdre au marché européen le quart de ses ventes, soit 4,5 millions de voitures au total dont plus d’1 million pour les constructeurs français. L’outil industriel a dû s’adapter et aujourd’hui, en dépit d’un rattrapage significatif, nous restons à des niveaux sensiblement inférieurs aux niveaux d’avant la crise.
Je tiens à signaler que les mesures de soutien au marché mises en œuvre en France
– je pense notamment aux primes à la casse – au pire moment de la crise ont bien fonctionné. Elles ont permis de limiter l’ampleur de la chute et donc de préserver l’activité industrielle dans nos usines.
Après de longues années de baisse, la production en France remonte depuis 2013. Les accords de compétitivité, signés par les partenaires sociaux, ont permis de s’engager dans une démarche partagée et positive, ayant pour but de maintenir des volumes de production en France. Tous les leviers d’optimisation ont été actionnés : flexibilité, modération salariale, formation, pour n’en citer que les principaux.
J’en viens au marché français et à ses évolutions.
Le parc automobile français est constitué de 38 millions de véhicules, dont au moins 80 % sont utilisés soit pour des trajets domicile-travail, soit pour des déplacements professionnels. C’est donc un parc actif qui ne reste pas inutilisé. L’utilisation de la voiture trouve toute sa pertinence dans les zones péri-urbaines et rurales, qui caractérisent le paysage français et où il n’est pas économiquement rentable de développer des offres de transports collectifs. La voiture est ainsi le support de la vie des territoires français et de leurs activités économiques. Il ne faut pas avoir une vision parisiano-centrée de son usage – je le dis d’autant plus volontiers que je suis moi aussi un bobo parisien, habitant le centre de la capitale. Les enquêtes menées par divers organismes le montrent : la voiture demeure un outil de liberté, utile et irremplaçable.
Le marché automobile français se caractérise par une part importante de petites voitures de type Clio, 208, C3, qui représentent plus de la moitié du marché, alors que ce segment ne constitue en Europe que 40 % des ventes. Cette caractéristique s’explique en partie par une fiscalité qui oriente le marché vers ce type de véhicules. Je citerai le dispositif du bonus-malus et la taxe sur les véhicules des sociétés (TVS). Historiquement, la France a eu tendance à surtaxer les grosses voitures, ce qui a des vertus sur le plan environnemental mais implique une contradiction, car cela rend difficilement rentable la production de petites voitures ou de voitures d’entrée de gamme.
En Allemagne, où le coût du travail est également important, la production s’oriente plus facilement vers les véhicules à plus forte valeur ajoutée. Il existe en effet un marché-socle de véhicules premium plus important. Pour avoir vécu dans ce pays quelques années afin d’essayer d’y vendre des voitures françaises, je peux témoigner que les Allemands achètent en priorité les voitures allemandes, avec un support des pouvoirs publics bien connu.
Mme Marie-Jo Zimmermann. Absolument !
M. Christian Peugeot. La deuxième caractéristique du marché français, c’était la part élevée des véhicules diesel qui, comme vous le savez, émettent 15 % à 20 % de CO2 de moins que les véhicules essence.
Ces deux caractéristiques placent la France dans une position très favorable sur le plan des émissions de CO2. Elle apparaît régulièrement aux trois premiers rangs des trente marchés européens à cet égard. En 2015, la moyenne des émissions de dioxyde de carbone a ainsi été de 111 grammes par kilomètre. Les constructeurs français ont profité de leur forte part de marché en France – plus de la moitié, de manière régulière – pour répondre aux obligations liées au règlement européen limitant les émissions de CO2. Les deux groupes français font ainsi partie des trois groupes les plus vertueux en ce domaine au niveau européen.
Selon les statistiques du ministère de l’écologie, les émissions totales de véhicules particuliers ont baissé de 10 % depuis 2004 alors que, dans le même temps, la demande de transports calculée en nombre de voyageurs par kilomètre a crû d’environ 2 %. Il s’agit donc, en masse, d’une véritable baisse. C’est une traduction concrète des efforts des constructeurs pour l’amélioration continue de la performance énergétique des nouveaux véhicules mis sur le marché. Ces efforts vont se poursuivre sur le marché européen. L’objectif de 95 grammes de CO2 par kilomètre à atteindre en 2021 équivaut en fait à une réduction de 41,5 % par rapport à 2005, soit un rythme d’amélioration de 2,6 % par an.
J’aborderai mon troisième point, en vous donnant des éléments plus précis sur la baisse du diesel et son impact sur le marché français.
Sur les dix dernières années, la part des véhicules diesel a atteint son niveau le plus élevé en 2012, avec 73 % du marché français. Parmi les explications de ce que l’on peut appeler un engouement, il y a l’agrément de ces véhicules, grâce à un très bon couple à bas régime, les économies de carburant, et une bonne valeur de revente. La politique environnementale en matière de fiscalité, fondée sur les émissions de CO2, a bien sûr participé à ce phénomène.
Aujourd’hui, le contexte est différent. Personne ne niera que, ces dernières années, le diesel a fait l’objet de nombreuses attaques au sujet des émissions. Les bonus sur les véhicules thermiques n’existent plus et les annonces du Gouvernement sur la convergence de la fiscalité de l’essence et du diesel, qui a été entamée dans les dernières lois de finances, sèment le doute dans les esprits. En outre, le dispositif envisagé pour l’accès dans les grandes villes, à savoir la mise en place de zones à circulation restreinte, comporte une cote différente pour les véhicules diesel et pour les véhicules essence.
Pour résumer, le diesel a perdu quinze points de parts de marché en France ces trois dernières années. Nous sommes passés des 73 % que j’évoquais tout à l’heure à 58 % en 2015. Il s’agit d’une évolution brutale, surtout pour une industrie lourde qui doit adapter ses moyens de production. Les ménages ont d’ores et déjà largement modifié leurs habitudes de consommation. Ils sont passés d’une proportion d’achat de véhicules diesel de deux tiers à un peu plus d’un tiers. Le marché des véhicules diesel d’entreprise suit une tendance analogue.
Cette baisse, rapide et continue, est appelée à se poursuivre. Nous pensons que les véhicules diesel représenteront 50 % du marché français dès 2016 et non pas en 2020, comme nous l’avions d’abord prévu. Et l’on peut redouter qu’il y ait un effet boule de neige entraînant la chute de la valeur résiduelle pour les particuliers.
Les taux de véhicules diesel des constructeurs français sont supérieurs en France et en Europe à ceux de leurs concurrents généralistes. Toutefois, les plus « dieselés » des constructeurs sont les trois marques premium allemandes avec un taux de plus de 80 %. Cela signifie que cette technologie, à condition d’évoluer, a un avenir, sinon elles n’investiraient pas autant.
Mme Marie-Jo Zimmermann. Effectivement !
M. Christian Peugeot. La baisse importante de la part du diesel, plus forte en France qu’en Europe, aura un impact sur la performance des constructeurs français en matière de CO2. Dans ce contexte, en effet, l’objectif réglementaire européen de 95 grammes sera plus difficile à atteindre. Au regard du poids du marché français dans leur vente, les constructeurs français seront arithmétiquement plus pénalisés que leurs concurrents européens. Je tiens à rappeler ici que l’objectif de 95 grammes par kilomètre s’exprime sous forme de moyenne à l’échelon européen et que chaque constructeur a un objectif qui lui est propre. Cet objectif est établi en fonction de la masse moyenne des véhicules qu’il vend. Pour les constructeurs français, l’objectif assigné est plus sévère que pour les constructeurs allemands, notamment les spécialistes, puisqu’il s’élève à 95 grammes contre 100 grammes.
Le règlement européen prévoit des pénalités très importantes en cas de non-respect des objectifs, des pénalités tellement élevées qu’elles sont censées pousser les constructeurs à déployer les efforts nécessaires pour se conformer aux seuils. En 2021, ces pénalités seront de 95 euros par gramme supplémentaire et par véhicule. Pour un constructeur produisant 1 million de voitures en Europe, une émission d’un gramme supplémentaire aboutirait ainsi à près de 100 millions d’amende.
J’en viens aux progrès des normes Euro et aux tests en conditions réelles.
Sur la question des émissions, il faut rappeler que les évolutions successives des réglementations des normes Euro, et les technologies mises en œuvre pour s’y conformer, ont permis au niveau national de réduire les émissions des véhicules, malgré l’importante hausse de la circulation intervenue entre 1990 et aujourd’hui. Depuis 1990, les émissions de particules et d’oxyde d’azote du parc routier ont respectivement baissé de 65 % et de 55 %, selon une étude du Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique (CITEPA) fondée sur des données proches de l’usage réel. Il me paraît important de rappeler cette amélioration.
S’agissant de la qualité de l’air, le problème se concentre dans les zones urbaines où les populations peuvent être plus particulièrement exposées. En moyenne, au plan national, selon le bilan de la qualité de l’air établi par le ministère de l’écologie, une amélioration très sensible est observable depuis 2000.
Les évolutions technologiques des véhicules neufs ont permis de faire baisser les émissions du parc. Toutefois, les gains se font au rythme de son renouvellement, qui est d’environ 6 % par an pour les véhicules particuliers. La moyenne d’âge du parc a tendance à augmenter : elle est de neuf ans actuellement. L’accélération du renouvellement apparaît comme le levier à actionner en priorité pour la réduction des émissions des polluants issus du transport routier. Comment y parvenir ? C’est une autre question.
Je finirai en évoquant les émissions des véhicules en usage réel qui font débat actuellement. Les émissions de NOx ont été considérablement réduites par les normes Euro mais des écarts demeurent entre les niveaux d’émission en homologation et les niveaux en situation réelle d’usage. Ces écarts sont liés à l’obsolescence du cycle d’homologation actuellement en vigueur, qui date des années soixante-dix, le cycle NEDC, dont les caractéristiques sont assez éloignées de l’usage réel : vitesse trop faible, non prise en compte de l’apparition de la sixième vitesse dans les boîtes de vitesses. Ce cycle va être remplacé par un nouveau protocole, Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures (WLTP), qui sera plus représentatif des conditions réelles de roulage.
Pour limiter ces écarts, une réforme structurelle du système actuel de réception des véhicules a été initiée par la Commission européenne. Les tests RDE – Real Driving Emissions – mis en place ont pour objectif de mesurer en conditions d’usage réel, sur route ouverte, les émissions, ce qui implique de s’y prendre à plusieurs fois pour établir des données car la mise en œuvre est plus complexe qu’en laboratoire. Cette démarche, par son ampleur, est une première mondiale dans la réglementation relative aux émissions des véhicules.
La Commission européenne indique qu’il existe pour les émissions de NOx un écart allant d’un à cinq entre les tests en laboratoire et les tests en conditions réelles. La procédure RDE impose en 2017 un premier objectif, qui consiste à ne pas dépasser un écart de 2,1, soit deux fois moins que l’écart actuel. La Commission fixe pour 2020 l’ambitieux objectif d’un facteur de 1,5 correspondant à la marge d’erreur des appareils de mesure. Cette valeur ne s’imposera pas ad vitam aeternam puisque les mesures ont vocation à être plus précises : l’objectif restera une disparition des écarts, soit un facteur de 1.
Les constructeurs français ont très tôt demandé à ce que cette réglementation soit adoptée rapidement. Pour nous adapter, il nous faut un certain temps, les sites de développement industriel doivent procéder à des validations par étapes pour les nouvelles technologies. Il est toujours compliqué de se conformer à un objectif dont on ne connaît pas la valeur, or une incertitude régnait quant au niveau de performance à atteindre.
La réduction des émissions des véhicules a pu être obtenue grâce au développement de technologies, d’innovations qui ont entraîné des surcoûts. Mais nous n’avons rien à redire à cela.
La difficulté technique pour nous consiste à devoir traiter en même temps la réduction des émissions de CO2 et celles de NOx – je n’oublie pas les particules, je considère seulement qu’elles ont été traitées. En effet, ces objectifs sont quelque peu contradictoires, dioxydes de carbone et oxydes d’azote ayant des comportements antagonistes. Par parenthèse, je soulignerai qu’aux États-Unis, si les émissions de NOx sont suivies de près, celles de CO2 font l’objet d’une moindre attention – je ne crois pas que les gros 4x4 à moteur V6 soient des champions en la matière.
Enfin, il y a une contrainte à ne pas oublier. Si, nous, constructeurs pouvons faire évoluer nos produits en en faisant des véhicules performants énergétiquement, nous ne pouvons pas les vendre à des consommateurs qui ne seraient pas en mesure de les acquérir parce que leur prix serait trop élevé. Nous devons en permanence nous tenir sur un chemin étroit, borné d’une part par la nécessité d’introduire de nouvelles technologies afin de respecter les normes environnementales et les normes de sécurité et, d’autre part, par nos objectifs de vente. C’est une voie qui n’est pas évidente mais nous avons bien compris qu’il fallait essayer de la suivre dans les meilleures conditions.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Merci, monsieur le président, pour cet exposé liminaire. Je vous poserai une première série de questions portant sur les normes et l’environnement puis une deuxième sur la stratégie industrielle.
S’agissant de l’affaire Volkswagen, nous avons considéré qu’elle a fait plusieurs victimes : l’environnement et la santé publique, les consommateurs qui ont été trompés mais aussi, d’un certain point de vue, l’industrie automobile elle-même, à un double titre. Celle-ci a été victime d’une sorte de concurrence déloyale puisque les règles du jeu qui s’imposent à tous ont été contournées et la confiance des consommateurs à son égard a été affectée.
Nous avons senti une certaine gêne chez les constructeurs français, qui se sont sentis obligés d’affirmer qu’eux n’avaient pas triché, bien loin de l’attitude de Fiat en Italie, qui n’a pas hésité à lancer une campagne proposant d’offrir 1 500 euros pour la reprise d’un véhicule Volkswagen en échange de l’achat d’un véhicule de sa gamme.
Je vous poserai la traditionnelle question que nous posons à tous nos interlocuteurs : avez-vous eu connaissance de l’existence d’un logiciel truqueur avant que le scandale n’éclate ?
Ma deuxième question portera sur les normes. Des progrès indéniables ont été accomplis, notamment avec l’installation de filtres à particules. Toutefois, à mesure que les normes se renforcent, on constate des écarts toujours plus grands entre conduite en situation réelle et cycles d’homologation. Tout se passe comme si les efforts menés par les industriels pour réduire les émissions polluantes plafonnaient.
J’aimerais que vous nous exposiez la position du CCFA sur le protocole WLTP, sur la procédure RDE et sur les autorisations de dépassement établies par le fameux Technical Committee on Motor Vehicles (TCMV). Votre organisation a-t-elle la même position que l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA) ? Votre remarque sur la différence d’impact de la directive CO2 pour l’industrie automobile allemande et pour l’industrie française vaut-elle aussi pour les émissions de NOx et de particules ? Selon vous, la France pèse-t-elle ou non dans les décisions qui sont prises en matière de normes ?
Considérez-vous, comme nous, qu’il soit plus logique qu’il n’y ait qu’une seule norme ? La puissance publique poserait une exigence en matière d’émissions de CO2, de NOx et de particules sans pour autant orienter les choix industriels et technologiques. Il leur appartiendrait de s’y conformer en choisissant le moyen d’y parvenir, soit à travers l’essence, le diesel, les moteurs hybrides. Cela impliquerait d’aller plus rapidement vers une convergence des normes relatives au diesel et à l’essence.
Toujours en matière de normes, j’aimerais avoir la position du CCFA sur la question des délais nécessaires aux industriels pour se conformer à une nouvelle norme. Certains nous disent qu’il leur faudrait trois ans, d’autres nous disent cinq ans.
Enfin, j’aimerais que vous reveniez sur l’indépendance des organismes d’homologation, notamment l’UTAC. Il me semble qu’il est de l’intérêt de tous qu’il n’y ait pas de doute sur le contrôle qu’ils exercent.
J’en viens au diesel. J’aimerais connaître le nombre d’emplois que représente la filière du diesel en France. Vous avez souligné les différences entre débouchés nationaux et débouchés européens. Nous voyons bien qu’il y a des difficultés à l’exportation. Compte tenu de la mondialisation du marché automobile, le rééquilibrage n’a-t-il pas aussi un sens en termes de stratégie industrielle ?
Comment envisagez-vous le rythme du rééquilibrage fiscal, tant en matière de rapprochement de la fiscalité des carburants que de récupération de TVA pour les véhicules d’entreprise ? Quelle serait, selon vous, la meilleure manière d’y parvenir ? Vous connaissez le débat : faut-il procéder par une convergence dans les deux sens ou seulement par une augmentation du diesel ?
Ma dernière question porte sur le renouvellement du parc. Cet enjeu apparaît d’autant plus stratégique, compte tenu des tendances du marché du neuf – allongement de la durée moyenne de détention d’un véhicule, hausse de l’âge au premier achat d’un véhicule neuf. Quelles mesures envisager pour accélérer la résorption du parc ancien, eu égard aux problèmes de pollution urbaine ? Vous avez évoqué la prime à la casse. Actuellement, il existe une prime à la conversion, dont les montants sont trop négligeables pour avoir un impact sur le marché automobile. Certains ont évoqué la nécessité de mettre en place un bonus pour encourager l’achat de voitures d’occasion vertueuses sur le plan environnemental, correspondant aux normes Euro 5 ou Euro 6. Nous savons que l’âge des véhicules échangés sur le marché de l’occasion est très élevé. Quelle est la position du CCFA en la matière ? Je vois, bien sûr, d’emblée la contradiction entre ces objectifs et la nécessité de vendre du neuf.
M. Marcel Bonnot. Je vous remercie, monsieur Peugeot, de la qualité de vos observations et de leur caractère synthétique.
De vos propos, je retiens que la maîtrise du diesel chez les constructeurs français est meilleure qu’ailleurs. Élu du « fief » de PSA, je note que ce constructeur, avec son filtre à particules, a une position de leader. Il a consacré des sommes très importantes à la recherche et développement mais il ne bénéficie toujours pas, loin s’en faut, d’un retour sur son investissement. Dans le même temps, un pays comme l’Allemagne reste grandement focalisé sur le diesel qui représente, comme vous l’avez souligné, 85 % ventes des trois marques premium. Le Japon, lui, s’est relancé dans une offensive pro-diesel et les États-Unis ne le boudent plus.
Dans ce contexte mondial, il faut se demander si la convergence fiscale prônée par la France ne va pas porter atteinte aux constructeurs français. Elle conduit déjà les consommateurs à déserter le diesel : depuis trois ans, la baisse des ventes est continue et rapide.
M. Denis Baupin. Je ne ferai sans doute pas la même ode au diesel que M. Bonnot. En revanche, je partage le souhait exprimé par notre rapporteure de voir émerger des normes équivalentes, quelles que soient les technologies. Il m’a semblé, monsieur Peugeot, que vous approuviez Mme Batho sur ce point. Sans doute, cela implique-t-il une convergence de la fiscalité et la disparition de biais qui favorisent une technologie par rapport à une autre, tant qu’il n’a pas été démontré qu’elle est meilleure pour la qualité de l’air.
Certaines de vos affirmations, je dois le dire, m’ont fait un peu sursauter.
Vous avez dit qu’il était difficile pour les constructeurs automobiles de se préparer aux nouveaux dispositifs d’homologation car il y avait une incertitude sur la performance à atteindre. Ces objectifs n’ont-ils pas été fixés par des directives européennes il y a près de dix ans ? Mais peut-être visiez-vous les actions de lobbying qui ont été menées pour obtenir des dérogations et retarder les échéances ? Si vous pensez que cela a contribué à créer une incertitude, elles auraient donc pénalisé plutôt qu’aidé les constructeurs, ce qui serait éminemment dommageable, j’en conviens.
Par ailleurs, vous avez indiqué que vous considériez que le problème des particules était réglé. Pour ma part, je le considérerai comme réglé lorsque les médecins nous le diront. J’imagine que vous vous référiez aux véhicules neufs et non pas au parc existant. Or rien n’a été démontré pour l’instant. M. Michel Elbel, qui était président RPR d’Airparif, avait pour habitude de dire qu’il croirait aux véhicules propres le jour où un constructeur accepterait de s’enfermer pendant une demi-heure dans son garage avec le moteur de sa voiture qui tourne ! Il faudrait pouvoir mesurer en conditions réelles les émissions non seulement de particules au niveau du pot d’échappement mais aussi de particules secondaires, qui se recombinent dans l’atmosphère. Il me semble que ce problème majeur de santé publique doit nous inciter à faire preuve de prudence.
Par ailleurs, vous avez reconnu qu’il existait des écarts significatifs entre les tests d’homologation et les conditions en usage réel. Ne pensez-vous pas qu’il serait souhaitable, tant qu’un nouveau système d’homologation fiable n’a pas encore été établi, que les constructeurs automobiles s’abstiennent de faire des publicités sur la base de résultats de tests qu’on sait non-représentatifs ? De telles pratiques induisent le consommateur en erreur et sont pénalisantes pour la crédibilité des constructeurs. L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), à la suite d’un rapport et d’une table ronde que j’ai organisée avec Mme Fabienne Keller, sénatrice, a préconisé de suspendre l’utilisation des résultats des tests d’homologation dans les publicités pour les voitures dans l’attente de tests fiables.
Vous avez indiqué qu’il était difficile pour les constructeurs de réduire en même temps les émissions de CO2 et de NOx, propos qui ont déjà été tenus devant notre mission d’information. C’est vrai, si les constructeurs ne changent pas de modèle automobile. En revanche, s’ils cherchent à élaborer des véhicules consommant moins, par exemple 2 litres aux 100 kilomètres, de plus petite taille – des modèles conçus non pas pour emmener toute une famille en vacances mais pour être utilisés par une seule personne, en meilleure adéquation avec la réalité des trajets quotidiens –, ils parviendront peut-être à casser ce cycle infernal. J’ai pu me rendre compte grâce aux travaux de notre mission d’information et ceux de la commission mise en place par madame Ségolène Royal à quel point les constructeurs avaient tendance, pour ne pas avoir à changer de modèle automobile, à accumuler les systèmes de dépollution, ce qui contribue à une surconsommation de carburant et à un encrassement des moteurs qui aboutissent à ne les faire fonctionner qu’à temps partiel. Cette course sans fin, rendue encore plus complexe par les nouveaux systèmes d’homologation, trouvera peut-être une limite. Il faut se tourner vers des véhicules à une ou deux places, à faible consommation, pour une partie de la clientèle obligée de se déplacer en voiture, qui n’a pas forcément envie de payer un surcroît de carburant à cause de modèles qui surconsomment.
S’agissant des véhicules d’occasion, enfin, nous voyons bien que l’intérêt des constructeurs automobiles est plutôt d’encourager l’achat de véhicules neufs. Toutefois, le client doit pouvoir savoir qu’il pourra revendre sa voiture facilement. En ce sens, encourager le marché de l’occasion, c’est aussi encourager l’achat de véhicules neufs. Un marché de l’occasion avec validation peut contribuer à aider une partie de la profession automobile
– professionnels du marché de l’occasion, de la réparation. Dans le cadre de la loi sur la transition énergétique, j’ai déposé des amendements, qui ont été adoptés, qui visaient à intégrer les véhicules d’occasion dans les dispositifs d’aide à l’achat. Cela me paraît être une mesure sociale : l’achat de véhicules d’occasion permet à une frange de la population n’ayant pas accès au marché du neuf de passer de véhicules polluants à des véhicules moins polluants.
M. Christian Peugeot. S’agissant de Volkswagen, c’est peu dire que nous avons été surpris. Cette affaire nous a fait l’effet d’un tsunami. Les conséquences de ce scandale touchent tous les constructeurs, particulièrement en France, où les commentateurs ont eu tendance à transformer le « Volskwagengate » en « Dieselgate ». Volkswagen, avec ce logiciel frauduleux qui aurait aussi bien pu être appliqué à d’autres véhicules que des véhicules diesel, a créé un climat de suspicion générale. Pour autant, nous n’avons pas comme Fiat voulu profiter de ce scandale pour lancer des opérations promotionnelles. Cela ne nous a pas semblé correct, compte tenu de la gravité des enjeux.
L’affaiblissement d’un concurrent, particulièrement fort, se solde généralement par une amélioration de sa propre performance concurrentielle potentielle. Dans la réalité, cela nous a beaucoup gênés. Nous sommes obligés de fournir des explications et de répéter que nous ne sommes pas dans un schéma de tricherie.
S’agissant des normes, les industriels, de manière générale, préféreraient que le choix des règles permette une visibilité de long terme afin de mieux développer leurs technologies, au lieu d’être soumis aux fluctuations des gouvernements successifs. Le fait est que les pouvoirs publics prennent des mesures qui, pour des raisons variées, poussent les constructeurs à aller dans un sens ou dans un autre. C’est le cas de la fiscalité favorable au diesel, qui a eu des effets sur la durée. Les groupes industriels français ont ainsi développé des technologies de construction de moteurs diesel particulièrement performantes.
La neutralité de la fiscalité ne nous choque pas en elle-même. Nous voulons simplement des règles qui permettent d’anticiper et de laisser leur place aux meilleures technologies. Ce n’est pas une seule technologie qui va permettre de résoudre l’ensemble des problèmes mais probablement un panel de technologies variées, ne serait-ce que parce qu’il y a des clientèles différentes avec des besoins différents, comme vous l’avez souligné, monsieur Baupin.
Vous m’avez interrogé, madame la rapporteure, sur le délai souhaitable. Un délai de cinq ans s’approcherait davantage du temps nécessaire à la mise au point d’une nouvelle génération de voitures – sachant qu’il faut plus de temps encore pour l’élaboration de nouveaux moteurs, même si certaines adaptations de groupes motopropulseurs sont plus courtes. La construction automobile est une industrie lourde. Nous ne pouvons pas prendre de décisions du jour pour le lendemain, d’autant que l’exigence de qualité pour les clients est tellement haute que cela nécessite de valider un ensemble de processus.
Dans le principe, une certaine neutralité ne nous pas pose pas problème. Dans les faits, elle n’existe pas encore. Si la fiscalité doit évoluer dans ce sens, il faut nous donner du temps. Du reste, que les pouvoirs publics n’encouragent pas la neutralité dans tous les domaines nous paraît légitime. C’est le cas par exemple pour les véhicules électriques, dont le développement est encore marginal. Il faut essayer d’être rationnel et faire preuve de bon sens.
En dehors de la fiscalité, il faut prendre en compte le traitement du diesel par les médias qui ont beaucoup insisté sur ses méfaits. La chute des ventes de véhicules diesel n’est pas tant liée à la convergence fiscale qu’à cette perte de confiance que l’affaire Volkswagen n’a fait qu’amplifier.
Sur le nombre d’emplois liés à la filière diesel, je ne saurais vous donner une réponse précise, madame la rapporteure. Les technologies sont très imbriquées, comme vous avez pu le constater lors de votre visite de l’usine PSA à Trémery. Une chaîne de moteurs diesel est difficilement transformable en chaîne de moteurs à essence.
Vous avez évoqué, monsieur Bonnot, le marché du diesel à l’échelle mondiale. L’Europe constitue aujourd’hui le principal marché, sachant qu’il était assez stable, hors la France, malgré l’affaire Volkswagen. Aux États-Unis, le marché du diesel est minoritaire, et l’offensive des Allemands pour le développer risque sans doute de tourner court. L’engouement du Japon a pu surprendre puisqu’il n’y avait pratiquement de véhicules diesel dans ce pays. Les autorités japonaises ont considéré que, compte tenu de ses faibles émissions de CO2, le bilan global du diesel était intéressant, et ont pris des mesures fiscales pour l’encourager. Mazda a lancé un véhicule ne fonctionnant qu’au diesel sur son marché – et seulement à l’essence aux États-Unis. J’estime que le diesel est une technologie qu’il faut essayer de pousser au meilleur niveau, en étant aussi irréprochable que possible.
Sur les particules, nous avons déjà eu plusieurs débats et nous sommes prêts à participer à d’autres, comme M. Tavares a eu l’occasion de le dire. Aujourd’hui, la maîtrise des particules se fait par filtration mécanique. Vous me direz sans doute, monsieur Baupin, que cette technologie ne parvient pas à les éliminer toutes. Mais vous savez comme moi que l’endroit de Paris où il y a le plus de particules, c’est le métro : leur niveau y est vingt fois supérieur à la voie publique, du fait notamment des frottements dus au freinage.
Mme la rapporteure. C’est d’ailleurs un grand problème pour les agents qui y travaillent.
M. Christian Peugeot. Nous considérons que nous avons traité le problème pour les voitures. Les véhicules essence à injection directe seront eux aussi munis de filtre à particules.
M. Denis Baupin. Donc le problème n’est pas réglé.
M. Christian Peugeot. Les nouvelles technologies appliquées aux véhicules à essence réduisent les émissions de NOx et de CO2 mais créent potentiellement un petit peu de particules qu’il faut traiter.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Pas qu’un petit peu !
M. Denis Baupin. La question des particules secondaires n’est absolument pas réglée !
Mme Delphine Batho, rapporteure. Je vais essayer de vous mettre tous d’accord. Il y a deux types de particules : les grosses particules, que les systèmes de filtrage parviennent à traiter, et les particules en nombre, plus petites, qui entraînent des phénomènes de réaction en chaîne dans l’atmosphère.
M. Christian Peugeot. C’est un débat.
Mme la rapporteure. Certes, les progrès sont réels, mais cela ne veut pas dire pour autant que les problèmes ont été éliminés.
M. Charles de Courson. Je poserai deux questions subsidiaires.
Premièrement, quel est selon vous l’avenir de la voiture électrique ?
Deuxièmement, comment envisagez-vous les évolutions vers une voiture autonome et plus largement le développement des systèmes de conduite automatisée ?
M. Christian Peugeot. Je prends bonne note de vos questions, monsieur de Courson, et y répondrai après m’être consacré aux précédentes.
Vous m’avez interrogé, madame la rapporteure, sur la meilleure manière d’accélérer le renouvellement du parc. Sincèrement, nous ne sommes pas très favorables à un dispositif de primes données aux acquéreurs de voitures d’occasion récentes. En dehors du fait que cela ne favorise pas la production de voitures neuves, et donc les emplois qui y sont liés, nous considérons que si l’État met de l’argent partout, y compris au milieu du marché, cela pourrait avoir des effets paradoxaux, tels l’importation de voitures étrangères d’occasion. Aujourd’hui, nous ne demandons pas non plus de mesures de type prime à la casse, qui a été favorable dans une période où la chute de la production était telle qu’il était nécessaire de trouver un moyen de faire tourner les usines.
Sur le plan écologique, la meilleure solution est de favoriser la production de voitures neuves et de faire en sorte que les voitures anciennes restent en bon état, grâce notamment aux contrôles techniques. Mieux vaut un renouvellement naturel du parc que des mesures ponctuelles de subventions.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Il existe un marché d’occasion très spécifique de voitures quasiment neuves, qui ne sont pas éligibles aux dispositifs tels que le bonus-malus, lesquels ne fonctionnent que pour le neuf.
M. Christian Peugeot. Le bonus écologique n’est applicable aujourd’hui qu’aux véhicules électriques.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Précisément, regrettez-vous la disparition du bonus écologique pour les véhicules thermiques ?
M. Christian Peugeot. Vous savez, nous nous adaptons. De toute façon, l’effort qui consiste à réduire les émissions de CO2, nous devons le consentir : la réglementation européenne comme le bon sens nous y obligent.
S’agissant des véhicules à deux places, monsieur Baupin, Toyota a arrêté la commercialisation de l’IQ, faute de clients. Reste la Smart, qui a une clientèle ciblée. On ne peut pas considérer que l’offre des constructeurs français en matière de petites voitures est insuffisante par rapport à la concurrence : la Twingo, la 108 et la C1 connaissent du succès. Il reste toutefois difficile d’offrir sur le marché des petites voitures à des prix peu élevés, surtout si elles n’ont que deux places.
J’en viens aux véhicules électriques. Ils représentent une part marginale du marché mais ont leur avenir devant eux. Le groupe Renault montre la voie, avec un bon timing
– PSA s’était engagé beaucoup trop tôt sur ce marché. Logiquement, le marché va se développer. La question est de savoir jusqu’à quel niveau. Tant que le rayon d’action de ces véhicules sera limité, les consommateurs ne les choisiront pas comme première voiture. Les Chinois considèrent aujourd’hui qu’il faut développer une bonne proportion de ces véhicules sur le marché. Nous devons répondre à des besoins variés avec des technologies diversifiées : véhicules électriques purs, hybrides rechargeables ou non, véhicules à basse consommation, véhicules de taille moyenne permettant de transporter plus de personnes à un coût raisonnable.
S’agissant des voitures autonomes, je soulignerai que les constructeurs automobiles sont en train d’évoluer rapidement dans la mise au point de systèmes d’aide à la conduite qui aboutissent, le cas échéant, à une forme d’autonomie au moins partielle. Ces mécanismes parviennent à remplacer le conducteur pour des gestes ponctuels, comme le freinage, et dans des conditions précises : soit sur autoroute, soit sur une file dans un embouteillage. La voiture totalement autonome ne constitue pas, selon moi, un objectif à court terme. D’abord, les conducteurs ont sans doute envie de continuer à maîtriser leur véhicule. Ensuite, son développement nécessite une évolution de la législation mondiale, de la convention de Vienne, en particulier, qui exige que le conducteur garde les deux mains sur le volant. Je suis persuadé que les aides à la conduite et l’autonomisation de la conduite constituent des évolutions favorables à la fois pour la sécurité, car elles induisent une diminution du nombre d’accidents, et pour la consommation. C’est une piste importante de travail pour les constructeurs, avec la performance des moteurs et des boîtes de vitesses. Ils y consacrent beaucoup d’argent.
L’intervention de l’UTAC s’insère dans une démarche bien maîtrisée de la part des pouvoirs publics français : le Centre national de réception des véhicules (CNRV) sollicite cet organisme pour procéder à des homologations. Les constructeurs paient, effectivement, pour cette prestation, qui est effectuée par les services ministériels, précisons-le. Rappelons qu’il serait toujours possible pour les constructeurs de faire homologuer leurs véhicules à l’étranger. Ils s’y refusent toutefois car il leur paraît plus logique de le faire dans leur propre pays : aller en Slovénie, en Croatie ou au Luxembourg ne serait sans doute pas perçu comme une démarche de transparence.
L’UTAC fonctionne de manière parfaitement maîtrisée : il s’agit d’un organisme d’homologation pour le compte de l’Etat. Et, comme les constructeurs français n’ont pas du tout le sentiment que leurs relations avec cet organisme leur ouvrent des passe-droits, ils sont tout à fait favorables à ce qu’une démarche de suivi, de contrôle, de contre-tests soit mise en place au niveau européen.
En matière d’informations, monsieur Baupin, nous sommes persuadés qu’il importe de donner confiance aux consommateurs et de les rassurer. Les constructeurs ont entrepris des démarches, y compris en relation avec des ONG, afin que les annonces publicitaires soient cohérentes avec les réalités que vivent nos clients. Simplement, les normes n’ont pas été faites par les constructeurs.
Dans mes fonctions précédentes, j’ai eu l’occasion à plusieurs reprises de participer aux réunions de l’ACEA. Il est clair que les constructeurs français n’ont pas la même sensibilité que les constructeurs allemands. C’est ainsi que, pour l’objectif réglementaire européen, ces derniers ont imposé des calculs en fonction de la masse des véhicules vendus au lieu de s’en tenir à la règle selon laquelle à 1 gramme de CO2 vaut 1 gramme de CO2, à laquelle nous tenions. Il y a eu des négociations et un compromis.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Le CCFA porte-t-il la voix des constructeurs français à Bruxelles ou bien chaque constructeur français préfère-t-il se faire entendre au sein de l’ACEA ?
Quelle est l’influence de la France sur les normes européennes ? Vous paraît-elle suffisante ou au contraire insuffisante ? Qu’est-ce qu’il conviendrait d’améliorer ?
Monsieur Frédéric Barbier, vice-président, remplace Madame Sophie Rohfritsch à la présidence.
M. Christian Peugeot. Ce sont bien les constructeurs qui agissent directement, le CCFA n’est pas leur porte-parole. Nous sommes en face d’une très puissante industrie allemande dont les relations avec les pouvoirs publics sont très proches, voire très, très proches, même si l’affaire Volkswagen est passée par là. L’Allemagne est le seul pays à avoir conservé des portions d’autoroutes où ne s’applique aucune limitation de vitesse. Je n’ai pas encore trouvé quelqu’un qui soit prêt à parier qu’ils allaient mettre fin à cette spécificité dans les cinq ans qui viennent. Les constructeurs allemands souhaitent valoriser leurs grosses voitures, captables de freiner à 200 km à l’heure sur l’autoroute. Cette démonstration de marketing est soutenue par les pouvoirs publics allemands. Dans la procédure RDE, il est même prévu des tests à 160 km à l’heure, à la demande des Allemands.
Mme Delphine Batho, rapporteure. En 2015, à l’heure de la reprise du marché automobile, le déficit de la balance commerciale en France s’est creusé : les exportations comme les importations ont augmenté. Quelle lecture faites-vous de cette évolution ?
Les budgets de recherche et développement constituent un enjeu stratégique. Vous avez insisté sur l’implantation en France des équipes de R&D, ce qui renvoie à la question du soutien des pouvoirs publics à la compétitivité française. La comparaison avec les constructeurs des autres pays montrent qu’il existe des marges de progression, notamment pour ce qui concerne les véhicules propres et les véhicules autonomes. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Enfin, j’aurai une dernière question à propos de la modernisation des outils de production. Avez-vous des éléments à nous donner sur les usines du futur ? Que pensez-vous du développement de chaînes de production plus flexibles en fonction des évolutions d’un marché, sans doute plus erratiques à l’avenir ?
M. Christian Peugeot. Le solde du commerce extérieur se calcule par la différence entre le flux des exportations, qui augmentent, et le flux des importations, qui augmentent également car le marché se porte mieux. Si nous n’avions pas d’industrie en France, logiquement, le déficit serait encore plus accusé puisqu’il n’y aurait pas de flux sortant. Le déficit n’est que léger et les constructeurs eux-mêmes sont globalement positifs. Il faut bien voir qu’en Europe, en dehors de l’Allemagne et de l’Espagne, aucun pays n’a de solde positif. Maintenant, je ne souhaite qu’une chose, c’est que les Français préfèrent acheter des voitures françaises plutôt qu’étrangères.
Au sujet de la R&D, je ne peux vous en dire beaucoup plus que ce que je vous ai déjà dit. Les deux constructeurs français ont choisi de baser leurs équipes d’innovation en France, considérant qu’il était plus efficace de concentrer leurs ingénieurs afin de favoriser le travail en commun plutôt que de les disperser. Il existe selon certains marchés des équipes implantées à l’étranger, au Brésil, par exemple, pour la mise au point de moteurs à alcool, ou en Chine pour s’adapter aux variations de design. Globalement, le pourcentage de R&D effectuée en France est appelé à rester stable. Si un contexte favorable impliquait une augmentation d’activité en ce domaine, notre pays en bénéficierait.
Quant aux usines du futur, les constructeurs français y sont très attachés. Une usine moderne, c’est une usine plus compacte, où les flux sont bien maîtrisés avec des fournisseurs à proximité. Je citerai, monsieur Bonnot, le cas du site de Sochaux où des fournisseurs se sont implantés dans des anciens locaux de PSA rachetés par la Ville. L’efficacité industrielle est en progrès. Les deux groupes français ont signé avec leurs salariés des accords de compétitivité qui ont favorisé une bonne démarche humaine. Du fait que les coûts en France sont assez importants, il est essentiel d’accroître notre efficacité et les constructeurs français font le nécessaire pour être au meilleur niveau.
M. Frédéric Barbier, vice-président. Notre mission d’information aura aujourd’hui couvert un large spectre allant de l’automobile au métro, où la présence de particules est particulièrement importante, preuve qu’il y a des efforts à faire dans d’autres secteurs.
M. Denis Baupin. Il n’y a aucun doute à ce sujet : il y a des particules fines dans le métro et la nouvelle présidente de la RATP a bien souligné lors de son audition avant sa nomination que c’était l’un de ses sujets de préoccupation. La différence avec l’automobile, c’est que la présence de particules fines n’augmente pas avec le nombre de personnes qui empruntent ce mode de transport. En outre, ce n’est pas parce qu’il y a des particules dans le métro qu’il ne faudrait pas régler le problème en surface pour les véhicules. Nous devons soigner et la peste et le choléra.
M. Frédéric Barbier, vice-président. Je vous remercie, monsieur le président, pour vos réponses.
La séance est levée à dix-sept heures trente-cinq.
◊
◊ ◊
32. Audition, ouverte à la presse, de M. Nicolas Paulissen, délégué général de la Fédération nationale des transporteurs routiers (FNTR), accompagné de M. Benoit Daly, secrétaire général, et de Mme Élisabeth Charrier, déléguée régionale.
(Séance du mardi 15 mars 2016)
La séance est ouverte à onze heures quarante.
La mission d’information a entendu M. Nicolas Paulissen, délégué général de la Fédération nationale des transporteurs routiers (FNTR), accompagné de M. Benoit Daly, secrétaire général, et de Mme Élisabeth Charrier, déléguée régionale.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Nous accueillons ce matin les représentants de la Fédération nationale des transports routiers (FNTR), en la personne de M. Nicolas Paulissen, délégué général, accompagné de M. Benoit Daly, secrétaire général, et de Mme Élisabeth Charrier, déléguée régionale.
La FNTR est la première organisation professionnelle représentative d’un secteur que l’on sait vital pour notre activité économique.
En France, le transport routier de marchandises reste dominant pour l’acheminement des biens et des matières premières. Il est indispensable à toute activité commerciale, y compris pour la problématique complexe des livraisons au sein des zones urbaines.
Le trafic routier est même en croissance sur certains grands axes, mais avec une présence toujours plus importante des transporteurs étrangers sur le réseau français. Dans le même temps, les transporteurs français ont enregistré une perte de compétitivité de leur activité à l’international, à l’exception de quelques grandes sociétés.
La FNTR est une organisation responsable qui veut être une force de proposition. Son positionnement sur la mise en œuvre de l’écotaxe témoignait de cet état d’esprit, jusqu’à l’abandon brutal de ce dispositif par le Gouvernement.
Sans relancer un débat sur ce thème, on notera qu’en Allemagne la mise en œuvre de la LKW-Maut, l’équivalent de l’écotaxe, a été l’occasion pour les pouvoirs publics de soutenir la modernisation du parc.
Des aides ont été accordées aux entreprises du transport routier pour acquérir des véhicules aux normes Euro 5+ ou Euro 6. L’Allemagne a ainsi favorisé le développement d’un parc plus performant et nettement moins polluant. Ce pays a donc consolidé la compétitivité de son secteur des transports.
Vous allez, bien évidemment, évoquer devant nous la problématique des émissions de polluants. D’abord, en nous faisant part des éléments en votre possession sur l’âge moyen et les autres traits d’évolution du parc « poids lourds » français.
Le diesel restera longtemps le mode de motorisation indispensable au trafic routier de marchandises sur les longues distances.
L’électricité, le gaz naturel pour véhicules (GNV) et, plus loin encore, l’hydrogène représentent des solutions spécifiques, mais susceptibles d’être mises en œuvre de façon progressive, et d’abord dans les transports urbains. Pour les camions, il existe toutefois certaines solutions de moteurs diesel hybrides, une voie qui ne semble pas aussi prometteuse pour les véhicules légers.
Nous allons d’abord vous écouter, au titre d’un bref exposé de présentation. Puis, Mme la rapporteure, Delphine Batho, vous posera un premier groupe de questions.
M. Nicolas Paulissen, délégué général de la Fédération nationale des transports routiers (FNTR). Je souhaite évoquer, dans mon propos liminaire, la problématique du développement durable dans notre secteur. Je suis accompagné de Mme Élisabeth Charrier, qui est déléguée régionale de la FNTR, mais aussi secrétaire générale de la FNTR Île-de-France, et donc, au courant des problématiques du dernier kilomètre et de la livraison en ville, et de M. Benoit Daly, secrétaire général de la FNTR, également responsable, chez nous, de toutes les questions de développement durable.
Notre secteur, le transport routier de marchandises, joue un rôle d’intérêt général, notamment dans le B to C (Business to Consumers – « des entreprises aux particuliers »), mais également, ce qui est moins connu, dans le B to B (Business to Business – « des entreprises aux entreprises »). Quand on évoque notre secteur et le développement durable, il faut mesurer le rapport coût-bénéfice pour l’économie. Nous avons, certes, des externalités négatives, mais également des externalités positives, qu’il faut prendre en compte.
Les entreprises de transport routier de marchandises, que défend la FNTR, ne sont pas tout le transport routier. Nous représentons plus spécifiquement ce que nous appelons le « transport pour compte d’autrui » – nos entreprises travaillent pour d’autres –, qu’il faut distinguer du « transport pour compte propre », assuré par des entreprises qui possèdent en propre des flottes pour assurer leur distribution.
En 2013, le compte d’autrui représentait à peu près 50 % du parc de poids lourds français.
Les poids lourds assurant le transport routier de marchandises représentent 4,8 % de la circulation, contre 71 % pour les voitures particulières immatriculées en France. Cela explique que nos poids lourds ne représentent que 6,7 % des émissions de CO2 en France. L’ensemble du transport routier représente à peu près 34 % des émissions, dont 19 % pour les véhicules particuliers. Nous ne représentons que 17 % de la consommation de diesel en France.
Ces distinctions ne nous exonèrent pas de nos responsabilités, mais nous sommes convaincus qu’il faut bien distinguer les secteurs pour bien traiter les problèmes et prendre les mesures adaptées à chacun des modes de transport routier.
Le transport routier de marchandises (TRM) s’inscrit pleinement dans le développement durable depuis vingt-cinq ans. Nous sommes convaincus que, en la matière, le transport routier de marchandises n’est pas le problème, mais la solution. Il faut donc accompagner notre secteur dans ses efforts de développement durable. C’est ce que nous souhaitons démontrer aujourd’hui devant vous.
En ce qui concerne la lutte contre les gaz polluants, par exemple, des progrès considérables ont été accomplis dans notre secteur au cours des vingt-cinq dernières années. Je fais référence à la démarche européenne visant à mettre en place les normes Euro, qui a commencé au début des années quatre-vingt-dix et a donné des résultats spectaculaires en ce qui concerne les quatre gaz polluants réglementés par l’Union européenne.
Les émissions ont diminué de 97 % pour les NOx, de 97 % pour les particules, de 94 % pour les hydrocarbures et de 86 % pour le monoxyde de carbone.
On n’a pas assez souligné les performances de la norme Euro 6, qui sont aujourd’hui reconnues par les autorités publiques, notamment par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), et qui sont particulièrement nettes dans la lutte contre les gaz polluants. Le ministère du développement durable reconnaît, dans l’un de ses documents, que la norme Euro 6 est la mesure la plus efficace pour réduire les gaz polluants dans le transport routier.
Bien entendu, les progrès que je vous ai signalés ne prennent pas en compte l’effet de renouvellement du parc. Ce renouvellement est assez rapide dans le secteur du transport routier de marchandises. Selon les chiffres de 2015, les deux dernières normes, Euro 5 et Euro 6, représentent déjà 57,5 % de l’ensemble du parc, en prenant en compte le transport pour compte d’autrui et le transport pour compte propre. Les normes antérieures à la norme Euro 3 ne représentent plus que 10,6 % du parc.
Si je me réfère aux chiffres du Comité national routier, qui travaille sur un échantillon de quelques centaines d’entreprises particulièrement représentatives de notre secteur, l’effet de renouvellement du parc est beaucoup plus accentué puisque les véhicules aux normes Euro 5 et Euro 6 représentent 77,6 % du parc de l’échantillon considéré, soit plus des trois quarts, contre 0,9 % pour les véhicules soumis à des normes antérieures à la norme Euro 3. Cela montre que le renouvellement du parc est plus rapide dans les entreprises pour compte d’autrui que dans les entreprises pour compte propre, ce qui est bien naturel puisque nos véhicules, roulant beaucoup plus que ceux des entreprises pour compte propre, sont soumis à un renouvellement plus important. Nos entreprises investissent 420 millions d’euros par an pour le renouvellement du parc, sachant qu’un véhicule soumis à une norme supérieure est évidemment plus cher.
J’en viens à une autre préoccupation des pouvoirs publics, la lutte contre le CO2. L’ensemble du transport routier représente 34,1 % des émissions de CO2 en France, les poids lourds ne représentant que 6,7 %, contre 19,1 % pour les véhicules particuliers. Pour être exact, si l’on rajoute aux poids lourds les véhicules utilitaires légers, on atteint, pour les émissions de CO2, le chiffre de 13,5 %.
Cela étant, nos émissions de CO2 n’ont augmenté que de 1,8 % entre 1990 et 2012, en dépit d’une l’augmentation de 27 % de l’activité de nos entreprises pendant la même période. On peut donc dire qu’il y a, depuis vingt ou vingt-cinq ans, une stabilité des émissions de CO2 dans le secteur du transport routier de marchandises, ce qui s’explique par une performance énergétique de nos véhicules plus importante qu’auparavant. Les émissions de CO2 par tonne de marchandises transportées ont diminué de 28 % par rapport à leur niveau de 1995. Cette performance énergétique est due aux évolutions technologiques des véhicules, mais aussi à une meilleure organisation des flux au sein de nos entreprises, à l’utilisation des outils informatiques et à la volonté qu’elles ont de s’inscrire dans le développement durable.
De ce point de vue, deux opérations ont donné des résultats tout à fait positifs dans notre secteur. La démarche des engagements volontaires de réduction de nos émissions de CO2, que l’on appelle la charte « Objectif CO2 », a permis à nos entreprises d’économiser un million de tonnes de CO2, selon les chiffres de l’ADEME.
Jeudi prochain aura lieu le lancement officiel du « label CO2 », en présence des ministres, Mme Royal et M. Vidalies. Ce label vise à reconnaître, non pas les progrès accomplis par nos entreprises, comme la démarche « Objectif CO2 », mais les performances environnementales en termes d’émissions de CO2 que nous avons pu atteindre.
La profession a travaillé à ce dispositif avec l’ADEME et le ministère du développement durable. Nous tenons beaucoup à ce label, dont les enjeux sont très forts en termes de développement durable et dont nous allons assurer la promotion auprès de nos entreprises, qui sont essentiellement des PME et des TPE.
Il s’agit là de démarches volontaires : nous avons été proactifs dans la lutte contre les gaz polluants et les émissions de CO2, et nous avons obtenu des résultats. Nous devons maintenant réussir la transition énergétique. Jusqu’à ce jour, il était difficile de recourir à des énergies alternatives. L’électrique et l’hybride étant réservés à la distribution urbaine, au dernier kilomètre, il s’agissait plutôt d’un marché de niche. Mais, depuis un an ou deux, se développe la possibilité de recourir au gaz naturel pour véhicules. Cela devrait faciliter la transition énergétique, mais nous devrons privilégier un mix énergétique et le diesel restera bien entendu un carburant largement utilisé par nos entreprises. Autrement dit, à chaque transport correspond son énergie, car une énergie donnée convient mieux à certains types de trafic, selon les distances parcourues ou la nature des trajets. Notre objectif est d’utiliser la meilleure énergie pour chaque usage, dans un contexte de développement durable.
C’est pourquoi nos entreprises s’intéressent au GNV, qui permet d’éliminer la problématique des particules liées au gazole, très prégnante en ville, ainsi qu’une diminution moyenne de 50 % des oxydes d’azote, les NOx. Le GNV marque également un avantage par rapport au diesel en matière de CO2. L’intérêt de cette énergie nouvelle est indéniable, d’autant plus quand on fait appel au biométhane, qui mérite d’être amplement développé.
J’en viens aux coûts externes. Permettez-moi d’abord d’insister sur la question des externalités, pour regretter l’absence d’études sérieuses et globales en la matière. Bien des chiffres sont cités, mais il est difficile de se faire une idée précise. En ce qui concerne les finances publiques, je rappelle que le mode routier rapporte beaucoup plus à l’État qu’il ne lui coûte. Selon les chiffres de 2011, les dépenses consacrées aux routes s’élèvent globalement à 16 milliards d’euros, alors que les recettes sont de 38 milliards.
En ce qui concerne l’écotaxe, notre profession a pris ses responsabilités en acceptant l’augmentation de 4 centimes sur le gazole au 1er janvier 2015, 2 centimes au titre de la taxe carbone et 2 centimes au titre de l’augmentation de la Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Nous en avions été exonérés au titre de l’écotaxe ; l’écotaxe ayant été abandonnée, nous avons accepté cette augmentation de 4 centimes, pour solde de tout compte. Le secteur verse donc sa contribution à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), comme il s’y était engagé lors de la suspension sine die de l’écotaxe.
En conclusion, je voudrais rappeler brièvement ce que la FNTR demande aux pouvoirs publics. Nous souhaitons être accompagnés dans nos efforts en termes de développement durable. Nos entreprises ont besoin de stabilité et d’une visibilité fiscale pour développer, notamment, le GNV, car les véhicules utilisant cette énergie, plus chers que ceux roulant au gazole, entraînent un surcoût à l’investissement et à l’entretien. L’outil fiscal en matière de GNV est donc important dans notre secteur.
Nous sommes opposés à l’écotaxe, notamment sous sa forme régionale, car sa mise en œuvre entraînerait d’inacceptables distorsions de concurrence entre les entreprises en fonction de leur localisation régionale. Nous sommes conscients de la problématique du trafic de poids lourds étrangers, mais en Île-de-France, par exemple, ceux-ci représentent moins de 5 % du trafic des poids lourds. On peut donc se demander s’il est bien judicieux d’« écotaxer » toutes les entreprises de transport routier de marchandises, dont 95 % sont françaises, pour toucher 5 % de poids lourds étrangers.
Il doit y avoir une cohérence des politiques en matière de développement durable. Ainsi, la FNTR est opposée à la circulation alternée, mais favorable aux critères des normes Euro. Nous soutenons également les mesures d’identification des véhicules, qui permettront de moduler la circulation des véhicules en fonction des normes Euro qu’ils respectent, notamment dans les zones à circulation restreinte et en cas de pic de pollution. Nous déplorons simplement que le projet d’arrêté sur la classification des poids lourds ne reconnaisse pas à sa juste valeur la norme Euro 6, alors qu’elle est particulièrement performante en matière de gaz polluants et de gaz à effet de serre.
Toutes ces mesures liées aux modulations de circulation en fonction de la norme Euro ne seront acceptables économiquement pour nos entreprises que si elles s’inscrivent dans le cadre d’un calendrier réaliste, prenant en compte nos contraintes économiques et les efforts déjà consentis. C’est pourquoi je parle de cohérence des pouvoirs publics. Nous avons besoin de temps pour nous adapter et pour que le renouvellement du parc se fasse dans des conditions optimales.
Enfin, nous sommes particulièrement heureux du lancement officiel, jeudi prochain, du label CO2.
M. Xavier Breton. Vous avez bien montré les efforts souvent méconnus qu’a consentis la filière des véhicules industriels en matière de développement durable.
Ma première question concerne les affaires qui ont fait la une de l’actualité dans le domaine automobile. Le camion pourrait-il être concerné ? Les systèmes de contrôle antipollution et d’homologation sont-ils les mêmes que ceux qui existent pour les automobiles ?
Ma seconde question porte sur le renouvellement du parc. Y a-t-il, au niveau européen, des dispositifs d’accompagnement permettant d’améliorer les normes environnementales, dont nous pourrions nous inspirer ? Il reste encore des camions soumis aux normes Euro 3 ou Euro 4. Existe-t-il des dispositifs d’incitation qui permettraient d’accélérer le renouvellement du parc ?
M. Nicolas Paulissen. En ce qui concerne le dossier Volkswagen, les normes Euro ne sont pas les mêmes pour les poids lourds et pour les véhicules particuliers. Les normes poids lourds sont beaucoup plus strictes. Évidemment, aucun secteur n’est à l’abri des fraudes, mais, c’est une obligation pour les constructeurs, les seuils théoriques fixés par la norme Euro 6 doivent être effectifs en situation réelle pendant sept ans. Il n’est pas question que les émissions bondissent trois jours, voire un an après la mise en circulation du véhicule. C’est, en l’occurrence, une question de contrôle.
L’Europe n’interdit pas les dispositifs d’accompagnement pour le renouvellement du parc, sauf lorsque la norme est devenue obligatoire. Ainsi, il ne serait pas possible, aujourd’hui, d’aider les entreprises à passer à la norme Euro 6, qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2014. Les États sont libres de mettre en place des dispositifs avant que les normes Euro ne deviennent obligatoires, ce qui fut le cas de la LKW-Maut en Allemagne.
En revanche, le vote par la représentation nationale, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2016, de l’extension de l’amortissement exceptionnel du plan Valls aux poids lourds roulant au GNV est un signal positif envoyé à nos entreprises.
Nous sommes aussi particulièrement attentifs au projet de l’ADEME, qui vise à créer un fonds pour aider les entreprises à acquérir des véhicules roulant au GNV – bien que l’offre des constructeurs, dont les investissements ont privilégié la norme Euro 6, soit peu importante en la matière –, en prenant en charge une partie du surcoût occasionné, mais aussi à mettre en place des stations d’avitaillement, trop peu nombreuses pour l’instant. Sachant qu’il faut à peu près quinze véhicules pour qu’une station d’avitaillement au GNV trouve son équilibre économique, ce fonds permettrait en effet de lutter contre l’absence de stations publiques : notre organisation est particulièrement favorable au développement de celles-ci, même si des stations privées peuvent également s’installer à l’initiative de certains grands chargeurs.
En ce qui concerne l’amortissement exceptionnel, ce type de dispositif existe déjà en France. Nous attendons le lancement officiel du fonds prévu par l’ADEME et espérons que le feu vert sera donné par les politiques. Ce dispositif se fonde sur l’expérimentation « GNVolontaire » qui s’est déroulée en Rhône-Alpes, qui a donné des résultats positifs et que l’ADEME souhaite pouvoir reproduire sur l’ensemble du territoire national. Nous y sommes tout à fait favorables et sommes même partie prenante du projet.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Vous connaissez sans doute les débats sur l’homologation, dont vous dites qu’elle est plus stricte pour les poids lourds. L’écart entre les cycles d’homologation et la réalité est en effet moins important pour les camions que pour les véhicules particuliers. Avez-vous des remarques à nous communiquer sur ce processus d’homologation, les règles qui y président et sur les structures chargées du processus ? Vous connaissez probablement les doutes qui existent sur l’indépendance de ces structures et le débat sur la révision des règles européennes en la matière.
Estimez-vous que le rétrofit soit une solution d’attente moins onéreuse pour faire baisser les émissions polluantes des poids lourds les plus anciens ? Ou bien pensez-vous que ce n’est pas une solution pertinente ?
Vous avez évoqué le besoin de stabilité fiscale, mais les exemples que vous avez cités à ce propos n’étaient pas très clairs. Pourriez-vous développer davantage la question de l’écart entre le diesel et l’essence ?
En ce qui concerne le GNV, nous avons procédé à des auditions qui montrent l’intérêt de cette énergie. Pensez-vous qu’elle deviendra la solution de référence en Europe pour le transport de marchandises ? Faut-il tout miser sur le GNV ou laisser la porte ouverte à d’autres solutions ? Et si oui, lesquelles ? D’autres pays sont-ils plus avancés que la France, s’agissant notamment des infrastructures en matière de GNV ? Je précise que j’ai bien entendu ce que vous avez dit sur l’offre des constructeurs.
M. Benoit Daly, secrétaire général de la FNTR. Concernant l’homologation des véhicules de transport routier de marchandises et les écarts entre cycles réels et cycles théoriques, les procédures prévoient des vérifications régulières des véhicules. Ces écarts sont nettement moins importants que ceux constatés pour les véhicules particuliers et nous permettent de confirmer les allégations des constructeurs. Nous avons lancé en Rhône-Alpes, dans le cadre du déploiement d’une solution GNV, une expérimentation intitulée « Équilibre », encadrée par des scientifiques, notamment par l’ADEME, et qui vise à vérifier si les consommations et les émissions alléguées par les constructeurs sont réelles, y compris pour les émissions de CO2, de NOx et de particules.
L’intérêt technique du rétrofit, qui permet d’atteindre des normes supérieures, est évident, mais, dans notre secteur, dont la marge bénéficiaire annuelle, extrêmement faible, est de l’ordre de 1 %, la question principale reste celle du coût de revient des opérations. Pour un poids lourd ancien, déjà passablement amorti et ayant plusieurs centaines de milliers de kilomètres au compteur, l’utilisation d’un dispositif de rétrofit, notamment dans le traitement des post-carburations, revient extrêmement cher, représentant quasiment 50 % de la valeur résiduelle du véhicule, ce qui rend le procédé inopérant du point de vue économique.
M. Nicolas Paulissen. Si nous souhaitons que nos entreprises recourent au GNV, énergie plus performante du point de vue environnemental, nous devons avoir de la visibilité sur la fiscalité. Notre secteur, qui n’utilise pas l’essence, ne demande pas de modification de l’écart de fiscalité entre le diesel et l’essence, mais les pouvoirs publics pourraient inciter nos entreprises à développer le GNV et à adopter des solutions plus respectueuses de l’environnement.
Si l’on replace la question du GNV dans un contexte plus européen, on voit que certains pays sont plus avancés que le nôtre en la matière. C’est notamment le cas en Italie où le GNV ne concerne pas seulement les poids lourds, mais aussi les véhicules particuliers : cela explique d’ailleurs la légère avance que peut avoir le constructeur IVECO, d’origine italienne, dans l’offre de véhicules roulant au GNV. Mais les autres constructeurs se lancent et vont proposer de nouveaux types de véhicules. Si le GNV se développe dans notre secteur, l’offre des constructeurs suivra donc.
En matière d’énergies alternatives, il n’y a pas de solution qui s’imposera à l’échelle européenne. Pour l’instant, si l’on considère les débats bruxellois, l’Europe se tourne plutôt vers l’électrique, les Allemands, par exemple, vers l’hydrogène, et vers l’électrique pour les véhicules particuliers. Quant à nous, nous pensons que notre transition énergétique se fera par le biais du mix énergétique. Si l’on souhaite être pragmatique dans la lutte contre les gaz à effet de serre et contre les gaz polluants, il faut que nos entreprises puissent recourir à l’énergie qui leur semble la plus adaptée en fonction du trajet parcouru. On sait, par exemple, que le GNV, aujourd’hui, est plus performant sur les moyennes distances.
Benoit Daly va vous donner des chiffres concernant l’autonomie des véhicules.
M. Benoit Daly. En ce qui concerne le transport routier de marchandises sur porteur, la distance moyenne parcourue, avec un plein d’énergie, est de 125 kilomètres pour un véhicule électrique, 250 pour un véhicule hybride, 400 pour un véhicule roulant au gaz naturel comprimé (GNC) et 700 pour un véhicule roulant au gaz naturel liquéfié, contre 1 000 kilomètres pour un véhicule identique roulant au gazole. L’autonomie du véhicule électrique –125 kilomètres – est donc largement inférieure aux 650 kilomètres parcourus en moyenne quotidiennement par un véhicule.
Mme Delphine Batho, rapporteure. On voit se dessiner aujourd’hui un schéma de développement en faveur de l’électrique pour les livraisons au dernier kilomètre et les utilitaires. Mais, en l’occurrence, je parlais du transport de marchandises par route. Le gaz et les énergies apparentées, y compris le biométhane, seront-ils la solution de référence ? Ou faut-il aussi regarder du côté de l’hydrogène ?
M. Benoit Daly. En ce qui concerne la motorisation, les fournitures et la capacité à accéder à la molécule, le gaz est une technologie tout à fait au point et accessible à l’échelle européenne. L’hydrogène est une énergie pour laquelle les motorisations restent très expérimentales. C’est une énergie de stockage d’énergies renouvelables, mais elle est extrêmement consommatrice en termes de production. En outre, la création d’une infrastructure de distribution peut être beaucoup plus coûteuse, car, en l’espèce, on ne peut pas s’adosser à une infrastructure existante, comme c’est le cas pour le gaz.
M. Nicolas Paulissen. Nous pensons que c’est le GNV qui se développera dans les prochaines années. Si l’hydrogène devait se développer, ce serait l’étape suivante et certains chargeurs, pour anticiper le coup d’après, s’y intéressent déjà, mais, en attendant, le GNV peut être une option, toujours dans le cadre d’un mix énergétique, car il n’y a pas de solution miracle. Le diesel restera, dans notre secteur, un carburant important dans les années à venir, et c’est pourquoi la norme Euro 6, dont j’ai souligné les performances, est décisive.
Mme Élisabeth Charrier, déléguée régionale de la FNTR. D’autres solutions que le GNV et l’hydrogène sont expérimentées ou en cours de développement. Peut-être resteront-elles à la marge, mais chaque énergie aura sa part dans le mix énergétique. Ainsi, la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) vient d’autoriser la commercialisation du bioéthanol : sa production doit se plier à des règles assez strictes, pour qu’elle n’entre pas en conflit avec l’agriculture alimentaire, mais des producteurs commencent à s’y intéresser. Cela pourrait correspondre à une niche dans le marché des énergies. D’autres expérimentations sont menées avec le biodiesel B30, ou sont en attente de validation, car devant faire l’objet d’une dérogation à l’interdiction de réutilisation des huiles usagées, avec le B100.
Il faut travailler sur la diversité de l’offre des motorisations. Certains constructeurs s’y emploient. C’est à travers ces expérimentations que nous verrons peut-être émerger des niches de marché par destination, avec des utilisations énergétiques particulières.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Madame, messieurs, je vous remercie pour votre participation à nos travaux.
La séance est levée à douze heures vingt.
◊
◊ ◊
33. Audition, ouverte à la presse, de M. Yann Delabrière, président-directeur général de FAURECIA, et M. Hervé Guyot, vice-président chargé de la stratégie.
(Séance du mercredi 16 mars 2016)
La séance est ouverte à onze heures trente-cinq.
La mission d’information a entendu M. Yann Delabrière, président-directeur général de FAURECIA, et M. Hervé Guyot, vice-président chargé de la stratégie.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Nous recevons ce matin M. Yann Delabrière, président-directeur général de Faurecia, et M. Hervé Guyot, vice-président exécutif en charge de la stratégie. Faurecia est l’un des grands équipementiers européens et a pour premier actionnaire PSA, qui détient un peu moins de la moitié de son capital. Initialement connue pour son activité de sièges et de revêtements intérieurs de véhicules, l’entreprise a décidé de se développer dans quelques pôles spécialisés, dont l’un intéresse plus particulièrement notre mission : intitulé Emissions Control Technologies, ce pôle produit principalement des catalyseurs, des lignes d’échappement complètes et des systèmes de dépollution. Votre groupe a ainsi mis au point des dispositifs de réduction catalytique sélective (SRC), une technologie qui marque un progrès significatif en faveur de la réduction des oxydes d’azote (NOx). Au total, vos activités relatives aux émissions sont en pleine croissance. Elles représentent un peu plus de 3,4 milliards d’euros de ventes, sur un chiffre d’affaires mondial du groupe de plus de 20 milliards.
Quelles sont vos perspectives de progression en ce domaine, tant du point de vue technique que commercial ? Le positionnement industriel de Faurecia semble déterminant, alors que l’affaire Volkswagen a mis en lumière les enjeux de la réduction des émissions pour l’ensemble de la filière automobile.
Quelles sont vos réflexions et vos éventuelles interrogations quant à l’évolution des normes d’émissions définies par l’Union européenne et aux différentes étapes imposées par cette dernière aux constructeurs ?
Plus généralement, notre mission s’intéresse à la façon dont les grands équipementiers ont passé le cap de la crise de 2008-2009, que d’aucuns avaient crue fatale à leur activité. Tout au contraire, les grands équipementiers français en sont sortis renforcés. Comment expliquez-vous cette relance, parfois fulgurante, de leur activité ? Les pouvoirs publics ont-ils aidé à ce développement en favorisant l’innovation au bon moment ? L’internationalisation de vos activités, accompagnée de productions spécialisées au plus près des différents marchés, sur les continents américain ou asiatique, est-elle la clé du succès ?
Autre question complexe : il nous a été dit qu’un transfert de la valeur ajoutée s’opérait au bénéfice des équipementiers de premiers rang et donc plutôt aux dépens des constructeurs. Ce mouvement ne pourrait-il pas être contrebalancé par une activité de recherche et développement fortement coopérative encore entre équipementiers et constructeurs ? À cet égard, les efforts à accomplir en termes de réduction des émissions semblent constituer un champ d’activité à partager car des pans entiers restent à découvrir.
Votre présence au niveau mondial vous permet sans doute des comparaisons révélatrices. Diriez-vous qu’il existe toujours un « écosystème automobile français » au sein duquel les équipementiers auraient désormais un rôle déterminant ? Leur implication dans la Plateforme automobile ou auprès de certains pôles de compétitivité sert-elle de levier en faveur de leur développement à l’international ? En d’autres termes, reste-t-il indispensable de conserver et d’entretenir de solides bases nationales ?
M. Yann Delabrière, président-directeur général de Faurecia. Le groupe Faurecia a réalisé l’an dernier environ 21 milliards d’euros de chiffre d’affaires et emploie un peu plus de 100 000 personnes dans le monde.
L’entreprise est spécialisée dans quatre segments d’activité. Le premier, que nous appelons en interne Emissions Control Technologies, couvre effectivement le traitement acoustique et environnemental des émissions des voitures et des camions. Cette activité représente 7 milliards d’euros de chiffre d’affaires, mais on cite souvent plutôt le chiffre de 3,5 milliards d’euros, car il y a une part importante de métaux précieux dans les systèmes d’échappement, métaux dont nous ne sommes pas producteurs. Notre deuxième activité, qui représente à peu près 6 milliards d’euros de chiffre d’affaires, consiste à fabriquer des sièges d’automobile. Nous fabriquons également tout le reste de l’habitacle de la voiture – cockpits, panneaux de porte, revêtement acoustique, habillage du sol –, pour un total de quelque 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Nous avons aussi une activité consacrée à toutes les pièces en plastique de l’extérieur de la voiture – principalement des pare-chocs et des hayons arrière – pour environ 2 milliards d’euros.
Nous sommes le sixième équipementier mondial : se trouvent devant nous deux équipementiers allemands bien connus, Continental et Bosch ; deux japonais, Denso et Aisin ; enfin, l’entreprise nord-américaine Magna.
Nous opérons à l’échelle mondiale : nous réalisons environ 50 % de notre chiffre d’affaires en Europe, 30 % en Amérique du Nord et un peu moins de 20 % en Asie – le solde se répartissant entre l’Amérique du Sud et l’Afrique du Sud. Du fait de cette expansion mondiale, notre base de clients est également mondiale. Notre premier client est le groupe Volkswagen qui représente autour de 20 % de notre activité, nos trois clients allemands
– BMW, Daimler et Volkswagen – constituant entre 35 % et 40 % de celle-ci. Notre deuxième client est le groupe Ford qui occupe entre 16 % et 17 % de notre activité, nos trois clients Américains – Chrysler, Ford et General Motors – totalisant à peu près 30 % de celle-ci. Renault-Nissan est notre troisième client, avec environ 14 % de notre activité, et PSA, le quatrième, avec 13 %. Du fait de la répartition de notre clientèle, notre entreprise est à cheval entre la France et l’Allemagne, nos effectifs ayant un poids comparable dans chacun de ces deux pays : nous employons environ 14 000 personnes en France et de l’ordre de 12 000 en Allemagne. Mais, depuis peu, notre premier pays d’implantation est la Chine où nous employons environ 15 000 personnes. Naturellement, nous sommes très implantés aussi dans des pays à forte composante industrielle tels que la Pologne, l’Espagne, le Portugal, la République Tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et le Mexique.
L’entreprise s’est développée très rapidement après la grande crise de 2008-2009 : notre chiffre d’affaires a doublé entre 2009 et 2013, passant de 9 à 18 milliards d’euros. Depuis, notre croissance est plus modérée. Cette croissance a été de 12 % l’an dernier, aidée en cela par la légère dépréciation de l’euro ; abstraction faite de cette évolution monétaire, elle a été de 6 %. Cette dynamique, qui devrait se poursuivre dans les années à venir, est soutenue par nos clients, d’une part, et par nos technologies, d’autre part.
Je conclurai cette présentation des principales caractéristiques de l’entreprise en indiquant que compte tenu de notre taille et des segments que nous couvrons, nous sommes parmi les premiers fournisseurs de la plupart de nos clients : le premier de PSA, et parmi les trois premiers de Volkswagen comme de Renault-Nissan. Nous avons donc avec ces clients des relations très étroites.
S’agissant de l’avenir, le monde automobile bénéficie depuis plusieurs années d’une dynamique de croissance relativement forte, de 3 à 4 % par an, qui va probablement se poursuivre dans les années à venir, même si les équilibres entre régions se modifient. En outre, ce secteur s’est engagé depuis plusieurs années dans des évolutions technologiques majeures, accélérées par rapport à celles des décennies précédentes. Ces évolutions sont marquées par deux grandes directions : la performance environnementale, d’une part, l’objectif étant de réduire les émissions de dioxyde de carbone et de polluants – dioxyde d’azote et particules – et la transformation de l’usage de la voiture, d’autre part, avec la voiture connectée et la voiture autonome.
Ces évolutions nécessitent des investissements très rapides et importants en recherche et développement et tendent à transférer une part significative de la valeur ajoutée aux équipementiers automobiles, car la plupart des solutions techniques des années récentes et à venir sont conçues et développées par ces derniers, même si les constructeurs restent maîtres de l’architecture et de la conception de leurs voitures et continueront à jouer un rôle déterminant dans les choix techniques, architecturaux et de produits des véhicules. Les constructeurs restent les concepteurs de l’ensemble du système tandis que les équipementiers sont les « proposeurs » des solutions qu’ils développent. On peut donc parler d’un jeu coopératif et d’interactions fortes entre ces deux types d’acteurs. Si la taille de ceux-ci n’est pas nécessairement identique, elle est néanmoins « adjacente » : PSA réalise un chiffre d’affaires d’une quarantaine de milliards d’euros dans le secteur automobile, nos collègues de Continental 45 milliards, et nous 21 milliards.
Vous avez évoqué la crise de 2008-2009 : elle a effectivement constitué un formidable accélérateur et transformateur de l’industrie des équipementiers – plus que de celle des constructeurs automobiles. Elle a en effet ravagé l’industrie de l’équipement automobile en Amérique du Nord, quand les constructeurs ont été très fortement soutenus par les pouvoirs publics américains. Nous avons donc quadruplé notre chiffre d’affaires outre-Atlantique entre 2009 et 2013. Autre raison qui explique cette évolution, entre 1995 et l’entrée en crise, les constructeurs automobiles ont en grande partie fondé leurs stratégies d’achats et de coûts sur un éparpillement des fournisseurs, de manière à les mettre en concurrence directe et, ainsi, à faire baisser les prix – un peu comme dans la distribution.
Pareille stratégie leur a coûté beaucoup d’argent pendant la crise, car ils ont dû faire face aux difficultés des petits équipementiers. Ils font donc désormais confiance à de grands équipementiers, capables de supporter leurs nouvelles stratégies de coûts et de fournir des plateformes mondiales en étant présents sur l’ensemble de la planète. Par ailleurs, ils ont besoin que les équipementiers puissent investir dans des moyens humains et financiers importants pour la recherche et le développement de nouvelles technologies. Tout cela a sensiblement changé le paradigme des relations entre les constructeurs et les équipementiers au tournant de la crise de 2008-2009. Aujourd’hui, tous les grands équipementiers automobiles mondiaux se développent rapidement. Nous en sommes un parfait exemple, mais nos collègues sont dans des situations relativement comparables, car les constructeurs ont besoin de partenaires à qui se fier pour gérer les plateformes mondiales et développer les technologies nécessaires. Ce phénomène a encore été renforcé par des problèmes techniques, tels que les airbags défectueux de Takata, qui ont montré que les équipementiers de petite taille ou trop spécialisés posaient problème aux constructeurs.
Quant à la recherche et développement, elle est aujourd’hui au cœur de l’évolution de l’industrie. L’ensemble du secteur est confronté à des enjeux technologiques importants qui, certes, dépendent en partie des normes choisies par les autorités des grandes régions automobiles mais dont nous connaissons les grandes orientations. Notre force de frappe en matière de recherche et développement est supérieure à un milliard d’euros par an et comprend 6 000 ingénieurs et techniciens : 3 000 en Europe, 1 500 en Amérique du Nord et plus de 1 500 en Asie dont 1 000 en Chine, 600 en Inde et une centaine en Corée. En Europe, nos forces sont réparties de manière à peu près identique entre la France et l’Allemagne, à hauteur de 1 500 ingénieurs et techniciens dans chaque pays.
La R&D est essentielle : notre métier ne peut survivre aujourd’hui sans investissements importants dans ce secteur, si nous voulons faire face aux deux grands enjeux dont j’ai parlé tout à l’heure. En ce domaine, il est donc essentiel pour nous d’être, partout dans le monde, en lien direct et étroit avec nos clients, les constructeurs automobiles qui, in fine, font les grands choix d’architecture technique et technologique pour leurs voitures. Nous sommes aujourd’hui signataires d’un peu plus de soixante-dix contrats de recherche et développement avec l’ensemble de nos clients mondiaux. Parmi eux, Volkswagen vient de lancer un programme interne, FAST – acronyme de Future Automotive Supply Tracks –, qui consiste à désigner des équipementiers en mettant un fort accent sur la capacité technologique. Une cinquantaine de fournisseurs sont dans cette catégorie, et nous y sommes trois fois, notamment du fait d’Audi qui représente environ la moitié de notre chiffre d’affaires chez Volkswagen. Ce qui vaut pour Volkswagen vaut aussi pour Ford, Renault-Nissan, PSA et Hyundai. Faisant de la dépollution de camions, nous avons noué un partenariat très étroit avec Cummins, le premier fournisseur mondial de moteurs pour camions. Il est donc encore une fois important que Faurecia ne soit pas seulement en France, mais partout où sont nos clients, et que ces derniers nous perçoivent ainsi : nous sommes un fournisseur allemand en Allemagne, américain en Amérique du Nord, coréen en Corée, et ce sont effectivement des équipes de chacune de ces nationalités que nos clients ont face à eux.
D’autre part, il est particulièrement important pour nous de nous adosser de plus en plus à des partenariats académiques, c’est-à-dire à la partie amont de la recherche. Partout dans le monde, nous avons conclu des partenariats avec des universités, des laboratoires de recherche publique ou semi-publique. La progression de cette capacité de l’industrie à travailler avec ces laboratoires est à la fois l’un des aspects les plus remarquables de l’évolution française des dix ou quinze dernières années, et un élément déterminant qui change la donne de l’économie industrielle du pays. De ce point de vue, nous ne sommes pas loin de rattraper ce que font les Allemands depuis un certain temps par le biais des instituts Fraunhofer, qui sont à l’interface entre la recherche et les applications technologiques de l’industrie. En France, nous travaillons avec l’institut Jules-Verne de Nantes et avons une construction très spécifique – et très réussie – à Flers, dans l’Orne, combinant un énorme centre industriel et un centre de recherche et développement. Nous sommes également en train de nous associer à des laboratoires de recherche dans la région de Bordeaux. Les régions sont selon moi les points de contact privilégiés en ce domaine, car elles ont une bonne compréhension d’objectifs précis et une capacité de décision rapide. Compte tenu de leur rôle déterminant, la meilleure décision que l’on puisse prendre consisterait à renforcer encore leur rôle en la matière.
Les pôles de compétitivité, que vous avez évoqués, souffrent de ce point de vue d’une ambiguïté fondamentale. La manière dont ils interviennent n’est pas claire. Sont-ils des entités thématiques ou des entités régionales ? Qui décide exactement, et comment ? Nous travaillons donc peu avec eux et n’avons, à vrai dire, guère envie de le faire. La capacité à faire l’interface avec les organismes régionaux et à construire de véritables partenariats avec les milieux académiques et de recherche et développement au niveau régional est un élément essentiel.
Je vous ai déjà en partie répondu concernant la notion d’écosystème français : nous ne pouvons, dans nos relations avec les constructeurs, raisonner en ces termes. Nous devons travailler avec tout le monde. Je ne puis être plus proche de PSA que de Volkswagen, de Hyundai ou de Ford. Je dois traiter tous les constructeurs sur un pied d’égalité. En revanche, en amont, les capacités de notre arrière-cour jouent un rôle déterminant dans la production d’idées et la conception de produits et de technologies.
M. Hervé Guyot, vice-président chargé de la stratégie. S’agissant des normes, Faurecia joue un rôle important dans la réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) puisque nous fournissons à peu près un quart de l’ensemble des équipements constituant le poids d’une voiture. Nous avons développé des solutions pour alléger ce poids, notamment en recourant à des matériaux composites.
Les nouvelles normes européennes qui entreront en vigueur en 2020, prévoyant des émissions maximales de 95 grammes de CO2 par kilomètre, seront certainement plus difficiles à respecter si l’équilibre entre les moteurs roulant à l’essence et les moteurs roulant au diesel se fait au détriment de ces derniers : les véhicules diesel sont critiqués pour nombre de raisons mais ils consomment moins que les véhicules essence. Il sera donc important d’assurer cet équilibre pour que les constructeurs puissent atteindre les objectifs qui leur sont fixés en matière d’émissions de CO2.
La réduction du poids des voitures risquant de prendre de l’importance, nous avons lancé le projet « Force » dans le cadre d’un consortium rassemblant des partenaires industriels pour concevoir une fibre de carbone à bas coût qui puisse être utilisée pour l’automobile et qui soit dotée de caractéristiques techniques moins importantes que dans l’aéronautique.
M. Yann Delabrière. La base technique de ce projet est à Bordeaux.
M. Hervé Guyot. Vous n’êtes pas sans savoir, compte tenu de vos nombreuses auditions, que de nouveaux cycles de mesures d’émissions vont être utilisés, que les véhicules seront de plus en plus testés en conditions réelles, et non plus seulement optimales. Dès lors, il est clair que le recours aux technologies de réduction catalytique sélective (SCR), dans la conception desquelles Faurecia est un des leaders sur le marché, va se généraliser dans les quelques mois qui viennent.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Avant de vous interroger, je tiens à souligner qu’il était essentiel que nous vous auditionnions dans le cadre de nos travaux, étant donné l’importance de Faurecia dans le paysage automobile mondial.
Redoutez-vous que l’affaire Volkswagen ait un impact sur votre entreprise, sachant que Volkswagen est votre premier client et que vous avez conclu avec lui un partenariat stratégique ? Je ne suis pas sans savoir qu’en septembre dernier, lorsque l’affaire a éclaté, une réaction boursière vous a affectés, mais que vous avez immédiatement mis les choses au clair en indiquant que vous ne fournissiez aucun logiciel dans le cadre des systèmes de traitement des émissions.
Sachant que vous êtes le numéro un mondial du contrôle des émissions, pourriez-vous passer en revue une par une les différentes technologies de limitation de ces émissions ? Le SCR est-il en train de devenir la solution de référence mondiale de l’industrie automobile pour le traitement des oxydes d’azote ? Je crois savoir que vous fournissez aussi des systèmes de stockage et de diffusion d’urée, des filtres à particules destinés aux nouveaux moteurs essence à injection et des systèmes de récupération de chaleur et d’énergie à l’échappement. Vous avez évoqué l’allègement du poids des véhicules grâce aux matériaux composites : pourriez-vous développer ce point ? On a en effet entendu deux discours sur celui-ci, l’un selon lequel ces matériaux sont adaptés à l’aéronautique mais trop chers pour l’automobile, l’autre les présentant comme la solution d’avenir. Ces matériaux ne demeurent-ils pas en phase préindustrielle ? À quel horizon de temps pénétreront-ils vraiment le secteur automobile ?
Toutes les technologies dont je viens de rappeler l’existence permettent-elles de satisfaire aux normes du nouveau protocole d’homologation en conditions réelles ? Les constructeurs se heurtent-ils à une difficulté technologique ou d’équation financière par rapport au coût final du véhicule ?
Quelles sont vos perspectives de développement technologique et de profit dans le domaine du contrôle des émissions polluantes ? La cession à Plastic Omnium de votre activité de fabrication de pare-chocs signifie-t-elle que vous vous inscrivez aujourd’hui dans une logique de spécialisation ?
Par ailleurs, quel impact la convergence des fiscalités de l’essence et du diesel a-t-elle sur Faurecia ?
Enfin, nous avons entendu dire en audition que depuis la crise de 2008-2009, beaucoup avait été fait pour améliorer les relations commerciales entre équipementiers et constructeurs et aussi entre équipementiers de premier et second rangs. Sur le terrain, nous avons cependant entendu un autre son de cloche : des tensions referaient actuellement surface. Qu’en est-il selon vous ?
M. Charles de Courson. Combien le crédit impôt recherche (CIR) rapporte-t-il à votre groupe et pour quel montant total de recherche en France ? Avez-vous réussi à inclure dans l’assiette de ce crédit d’impôt des recherches effectuées dans vos établissements étrangers ?
Quel différentiel de coût y a-t-il entre vos unités françaises et vos unités allemandes, américaines et chinoises ? Comment ce différentiel évolue-t-il dans le temps ?
Quelles seront les conséquences, sur votre entreprise, de la fixation à parité des fiscalités sur le gasoil et sur l’essence, d’ici à quatre ou cinq ans ?
Quel avenir la voiture autonome a-t-elle selon vous ?
Enfin, quelles sont les perspectives de la voiture électrique ? Quelles en sont les conséquences sur votre groupe ?
M. Yves Albarello. Quels sont vos axes de développement en matière de recherche et développement, mis à part la voiture autonome ?
Sur quels dispositifs travaillez-vous pour parvenir à respecter les normes – très strictes – applicables aux véhicules diesel aux États-Unis ?
Le carbone est-il le principal matériau composite permettant d’alléger le poids des véhicules ?
M. Marcel Bonnot. Vous avez indiqué qu’il existait une interaction forte entre constructeurs et équipementiers. Ma question n’est pas désintéressée puisque l’implantation de Faurecia dans l’espace socio-économique qui est le mien est importante. Quelle demeure la place de Faurecia chez PSA, compte tenu de l’actuelle stratégie de restructuration de M. Tavares ?
Depuis l’affaire Volkswagen, le diesel devient de plus en plus la bête noire. C’est néanmoins un élément compétitif pour certains de nos constructeurs, tels que PSA. Nos systèmes d’homologation européens demeurent-ils véritablement fiables ?
En 2009, lors de la crise économique, a été créé le Fonds de modernisation des équipementiers automobiles (FMEA) pour les équipementiers de premier rang, auquel ont été dédiés 600 millions d’euros. Ce fonds a-t-il permis aux équipementiers que vous êtes de passer la rampe comme nous l’espérions ?
M. Jean-Michel Villaumé. Vous venez d’équiper en première mondiale une voiture Hyundai hybride d’un système de récupération de chaleur à l’échappement. Quels sont les intérêts, d’un point de vue environnemental et économique, de cette nouvelle technologie ?
M. Philippe Duron. Je vous félicite, monsieur le président, pour vos propos sur les régions et l’excellente collaboration que l’industriel que vous êtes a su établir avec le milieu universitaire. Je souscris à votre analyse de la gouvernance des pôles de compétitivité et à l’affirmation selon laquelle la marginalisation des régions au sein de ces pôles a probablement gêné leur développement et leur lisibilité.
Alors que l’Union européenne envisageait un temps la préparation d’un nouveau « paquet routier », il semble, au vu des dernières discussions ayant eu lieu à Bruxelles, qu’elle s’oriente plutôt vers une démarche volontariste de décarbonation. Comment analysez-vous cette évolution ? Pensez-vous qu’on puisse s’orienter vers une rupture technologique à moyen terme ? Quelles en seraient les conséquences pour les constructeurs et les équipementiers ?
M. Frédéric Barbier. Mon collègue Marcel Bonnot et moi-même étions hier sous le charme, dans un véhicule autonome C4 Picasso qui roulait, sans personne pour tenir le volant, à 110 kilomètres par heure sur autoroute dans le secteur de Montbéliard. On ressent une concurrence très vive dans la mise au point de ce véhicule. Je suppose qu’en tant qu’équipementier vous êtes partie prenante à ce combat entre les différents fabricants à travers le monde. Certains pays nouent des partenariats très forts avec les universités pour accélérer la mise au point de ce véhicule autonome. Qu’en pensez-vous ?
Quelles seront pour vous les incidences, en termes de recherche et développement, de la restructuration en cours depuis la cession de votre activité de fabrication de pare-chocs à Plastic Omnium ? Cette restructuration est-elle susceptible de vous apporter de la rapidité et ainsi vous permettre de garder la place de numéro un mondial que vous occupez ?
M. Yann Delabrière. L’affaire Volkswagen a essentiellement trois conséquences.
En Amérique du Nord, elle met en cause la responsabilité civile du constructeur, ce qui coûtera certainement beaucoup d’argent à ce dernier. Mais, compte tenu de la surface financière de Volkswagen, l’existence même de l’entreprise n’est pas en cause. Cette affaire ne contribuera assurément pas à l’essor du diesel en Amérique du Nord, mais, comme ce carburant n’y a jamais été développé de manière significative, elle n’aura pas de portée fondamentale de ce point de vue.
Bien qu’ayant eu lieu aux États-Unis, l’affaire entraînera en outre des modifications très profondes des normes européennes : le changement du cycle de tests, avec l’apparition de tests sur route et de tests de Real drive emissions, suppose des évolutions technologiques importantes, compte tenu des nouvelles contraintes imposées aux constructeurs automobiles.
Enfin, l’affaire pourrait entacher l’image de Volkswagen partout dans le monde. Mais ce n’est pas la première ni probablement la dernière grande affaire technique à affecter un constructeur automobile.
Par le passé, aucune affaire n’a jamais amoindri les performances économiques et commerciales des constructeurs. Pourtant, il y a eu des affaires bien pires. Aucun d’entre vous ne se rappelle sans doute les Ford équipées de pneus Firestone qui faisaient des tonneaux au début des années 2000 et qui ont causé plusieurs dizaines de morts aux États-Unis : cela n’a jamais affecté les performances de Ford. Plus récemment, l’affaire des démarreurs de General Motors, qui a fait des morts en quantité non négligeable en Amérique du Nord, n’a perturbé en aucun cas les performances du constructeur. Je ne crois donc pas que l’affaire en cours aura des conséquences significatives et durables sur Volkswagen.
Bref, la principale retombée est une modification profonde des normes européennes aux conséquences technologiques positives pour nous puisque nous allons devoir équiper plus de voitures de technologies plus évoluées et plus sophistiquées.
J’en viens à présent à la question technologique. Il y a en ce domaine trois grands enjeux : les émissions de dioxyde de carbone consécutives à la consommation de carburant, les émissions de dioxyde d’azote et les émissions de particules – les autres rejets étant désormais définitivement traités.
S’agissant des émissions de dioxyde d’azote, il existe trois grandes technologies. La plus simple, dite Exhaust Gas Recirculation (EGR), consiste à faire re-circuler les gaz d’échappement à l’entrée d’air de la voiture de manière à obtenir des mélanges plus pauvres en oxygène pour minimiser les chances de formation de dioxyde d’azote. Cette technologie donne néanmoins des résultats insuffisants pour permettre la dépollution des voitures, compte tenu du renforcement des réglementations qui interviendra à partir de la fin de l’année 2017. Cette technologie continuera donc à exister mais pas seule. La deuxième technologie, appelée NOx trap, consiste en un filtre permettant de piéger les particules de dioxyde d’azote pour ensuite les brûler. Enfin, la technologie SCR permet de réduire, au sens chimique du terme, les oxydes d’azote. Le réducteur le plus utilisé est l’ammoniac (NH3) qui n’est pas facilement stockable à l’état naturel. On utilise donc de l’urée, liquide qu’il suffit de chauffer et de pulvériser pour qu’il libère de l’ammoniac. Ce dernier se combine alors avec l’oxyde d’azote pour former de l’azote et de l’eau.
La technologie la plus efficace en termes de réduction des oxydes d’azote étant le SCR, c’est elle qui va se généraliser. Elle présente néanmoins l’inconvénient de ne fonctionner qu’à partir d’une certaine température, car il faut chauffer l’urée pour qu’elle libère de l’ammoniac. Les technologies NOx trap n’ayant pas cet inconvénient, il est probable qu’au fur et à mesure du renforcement des normes, la technologie finale soit une combinaison de SCR et de NOx trap. Cela dépendra beaucoup du cycle : plus il comprendra de tests à basse vitesse, plus cela créera de problèmes de température du moteur. Faurecia a développé une technologie de stockage de l’ammoniac à l’état gazeux, différant de la technologie SCR, qui ne nécessite pas de chauffage particulier puisqu’elle libère directement de l’azote à l’état pur. Cette technologie, que nous continuons à développer, est relativement coûteuse si bien que nous ne l’avons pas encore commercialisée. Nous avons une chance raisonnable de la commercialiser en Corée sur des camions ou des bus.
Mme Sophie Rohfritsch, présidente. Les brevets sont-ils déposés par votre entreprise ou en commun ?
M. Yann Delabrière. Les deux cas existent. Faurecia dépose environ 500 brevets par an. Lorsque nous concevons des équipements en collaboration avec des constructeurs, les contrats prévoient généralement une copropriété du brevet.
Le changement des cycles est né d’un problème d’émissions de dioxyde d’azote mais aura un impact sur les autres types d’émissions.
Le problème des émissions de particules va donc à nouveau se poser. Par ailleurs, comme l’a évoqué la rapporteure, plus les moteurs à essence sont efficaces, plus ils ont tendance à émettre de particules, car plus l’on se rapproche de mélanges pauvres en oxygène, moins les particules sont brûlées par l’oxygène résiduel. Nous avons effectivement introduit un premier filtre à particules sur les moteurs à essence il y a dix-huit mois sur un véhicule de très haut de gamme, mais nous pensons que cette technologie se généralisera dans les dix ans à venir grâce à la combinaison d’une généralisation des moteurs à injection directe en mélanges pauvres et des changements de cycles de tests. C’est pour nous un marché relativement important, susceptible selon nous de se développer.
Vous avez évoqué la récupération d’énergie à l’échappement. Cette technologie est effectivement importante pour nous, car 40 % de l’énergie brute produite par un moteur est perdue en énergie thermique, les gaz d’échappement ayant une température de 800 à 1 000 degrés à la sortie du moteur, mais d’une centaine de degrés seulement à la sortie du pot d’échappement, soit un gradient de 900 degrés qui se perd entre les deux. Il serait donc intéressant de récupérer ne serait-ce qu’une faible quantité de cette énergie. Pour ce faire, nous développons deux techniques. La première consiste à récupérer et à recycler de la chaleur pour chauffer les organes mécaniques de la voiture. Car lorsque ces organes sont à froid, il y a des frictions importantes qui sont autant de déperditions d’énergie. Chauffer le moteur et la boîte de vitesses permet de faire baisser la consommation de la voiture lorsqu’elle démarre à froid. Nous avons lancé ce premier équipement sur la Hyundai ionique qui vient d’être présentée à Genève, qui est un concurrent direct de la Prius et qui a été qualifiée comme émettant 79 grammes de CO2 lors du cycle de tests. Nous contribuons pour deux à trois grammes à la performance de la voiture grâce au système dont je viens de parler, et nous estimons qu’à terme ce système pourra représenter entre 3 et 7 % d’économies de consommation sur une voiture hybride. Il fonctionne en effet mieux sur ce type de véhicule qui émet moins de chaleur et qui a donc encore plus besoin de chaleur complémentaire pour réchauffer ses organes mécaniques, notamment lorsqu’il est en mode électrique. Or, les moteurs hybrides vont se développer de manière importante : nous envisageons qu’à l’horizon de 2025-2030, ils représenteront à peu près 40 % du total des motorisations. La seconde technique consiste à recycler l’énergie sous forme électrique grâce à un convertisseur d’énergie. Nous travaillons sur ces deux familles de solutions techniques, probablement en vue de les appliquer au camion au début des années 2020, à la voiture à un horizon plus lointain.
Quant aux composites, ils associent en général une résine plastique et des fibres. Il en existe des quantités considérables, car il existe à la fois une grande variété de résines plastiques et un grand nombre de fibres différentes. Ces dernières se répartissent en trois grandes catégories : les fibres naturelles telles que le lin et le chanvre, les fibres de verre et les fibres de carbone. Il ne faut donc pas réduire les composites à ceux qui contiennent des fibres de carbone. Nous utilisons déjà d’autres familles de fibres dans l’industrie automobile, proposant notamment, y compris sur des voitures françaises telles que la 308 de Peugeot, des panneaux de porte en propylène et fibres de chanvre, permettant des gains de poids de l’ordre de 20 %. Le choix des matériaux à associer est dicté par les qualités mécaniques souhaitées – les fibres de carbone étant beaucoup plus résistantes mécaniquement que les fibres de verre ou les fibres naturelles –, par les conditions de formabilité et de recyclabilité, et enfin par les considérations de coût.
Dans la voiture, certains composants sont relativement passifs sur le plan mécanique, d’autres sont actifs, notamment en termes de résistance aux chocs. Plus la dimension mécanique des composants structurels est forte, plus il faudra de renforcements. Plus les composants sont passifs, moins on en aura besoin.
Nous fabriquons notamment aujourd’hui pour Renault un support de roue de secours, plancher du coffre arrière, qui ne nécessite pas beaucoup de résistance mécanique. En revanche, de nombreuses parties de la voiture ont grand besoin de qualités mécaniques fortes, ce qui explique que nous nous intéressions très activement aux composites comprenant des fibres de carbone. Mais nous butons sur un problème du coût. Là est la différence entre les industries aéronautique et automobile. La fibre de carbone coûte aujourd’hui à peu près seize euros le kilogramme, ce qui ne pose aucun problème aux constructeurs aéronautiques, mais qui n’est pas rentable dans l’industrie automobile. Il faudrait abaisser ce coût de 50 % pour que la fibre de carbone soit rentable au regard des normes futures. L’objectif du projet « Force », évoqué il y a un instant par Hervé Guyot, est précisément de créer un procédé de fabrication de fibre de carbone à moins de huit euros le kilogramme. Leaders de ce projet, nous espérons aboutir à une solution technique d’ici à deux ans et à une solution industrielle d’ici à quatre ou cinq ans. C’est un enjeu important nécessitant des ruptures technologiques significatives. Et encore une fois, ce n’est pas le seul enjeu des matériaux composites.
Vous avez fait allusion à l’impact de l’évolution de la fiscalité du diesel sur Faurecia. L’ensemble de l’industrie automobile est désormais convaincu que la part du diesel va baisser en Europe, et ce pour des raisons essentiellement économiques, car si le diesel reste une solution très favorable en termes d’émissions de CO2, le renforcement des normes d’émissions de polluants aura un impact très fort sur les petits moteurs diesel. Le diesel se maintiendra donc essentiellement sur les moteurs les plus puissants tels que les deux litres par tour et les V6. Faurecia n’étant pas particulièrement spécialisée dans le diesel, l’évolution précitée n’aura pas d’impact fondamental sur notre activité, raison pour laquelle nous sommes tout à fait neutres dans ce dossier.
Nous ne pouvons nous prononcer quant à la capacité des constructeurs à respecter les normes de real drive emissions. Nous avons néanmoins le sentiment qu’ils sont tous en mesure de parvenir aux prochaines étapes de normalisation, qu’il s’agisse du changement de cycle en 2017 ou de l’introduction du corporate average fuel economy (CAFE) en Europe en 2020-2021. La question se posera véritablement aux étapes ultérieures. La Commission européenne a en effet lancé une discussion relative à une nouvelle étape en 2025-2030 ainsi qu’un débat portant sur une fourchette de 68 à 78 grammes de CO2 contre 95 grammes en 2020-2021. La fixation d’un tel objectif supposerait certainement des ruptures technologiques importantes, notamment liées à l’usage de composites comprenant des fibres de carbone, tous les moyens aujourd’hui disponibles ayant été mis dans la balance pour atteindre l’objectif de 95 grammes. Un composite comprenant des fibres de carbone représente une économie de poids de 50 % par rapport à l’acier, à qualité mécanique comparable. On peut donc grâce à cette fibre gagner 100 à 150 kilogrammes sur une voiture, sachant que 10 kilogrammes représentent environ un gramme de CO2.
La cession de nos pare-chocs à Plastic Omnium n’implique nullement une spécialisation de notre activité, bien au contraire. Les constructeurs automobiles sont aujourd’hui à la recherche d’équipementiers globaux – ce que nous sommes déjà – et couvrant une plage relativement large du spectre des technologies automobiles. On peut même presque parler de déspécialisation.
Nous avons déjà parlé tout à l’heure des relations entre les équipementiers et les constructeurs. Elles sont de l’ordre du « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette » ou du « Je t’aime, moi non plus ». (Sourires.) Notre structure étant relativement intégrée sur le plan technologique, nous avons plus de sous-traitants que de relations avec des équipementiers de second rang. C’est d’ailleurs une des difficultés de la France : il y a quatre ou cinq grands équipementiers automobiles et quasiment personne derrière.
Il est, me semble-t-il, trop tard pour redresser cette situation, sauf à ce qu’un équipementier ait une capacité technologique extraordinairement forte.
Nous bénéficions d’environ 30 millions d’euros de crédit impôt recherche, versés en totalité au titre de la recherche que nous effectuons en France. Nous faisons dans ce pays environ un quart de notre recherche et développement, ce qui représente quelque 250 millions d’euros. Nous bénéficions donc de 12 à 13 % de crédit d’impôt. Hervé Guyot fera parvenir à Mme la rapporteure des chiffres plus précis.
Vous avez soulevé la question de la compétitivité de la France par rapport à celle de l’Allemagne, des États-Unis et de la Chine. Dans le secteur automobile, l’industrie et les marchés se structurent par grandes régions : l’Amérique du Nord, l’Europe et enfin, en Asie, la Chine, le Japon et la Corée. On ne compare donc jamais la compétitivité de la France à celle de la Chine. Nous n’exportons aucun produit de Chine vers l’Europe ni inversement : nous fabriquons de grosses pièces intransportables, tant pour des raisons de coût que pour des raisons logistiques. La compétitivité s’observe donc à l’échelle régionale. La France et l’Allemagne sont aujourd’hui assez proches à cet égard et sans doute la première est-elle un peu plus compétitive que la seconde. En Allemagne, les coûts se renchérissent significativement, tandis qu’en France les partenaires sociaux ont, depuis cinq ans, fait preuve d’un grand réalisme dans leur approche des coûts. C’est là une autre évolution remarquable de notre pays. Nous avons pour notre part signé quantité d’accords de compétitivité. Bien entendu, il ne faut pas demander d’efforts salariaux insupportables, mais les partenaires sociaux ont été très réalistes quant au temps de travail et à la flexibilité. Faurecia est une entreprise extrêmement décentralisée sur le plan social. Le dialogue social y est très actif à l’échelon local, est fondé sur un constat réaliste de la situation et la recherche de solutions tout aussi réalistes aux problèmes qui se posent – ce qui donne de vrais résultats. Même dans les pires difficultés, nous n’avons jamais calé dans nos relations sociales, quel que soit le site concerné.
Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, la parité fiscale entre l’essence et le diesel n’est pas un enjeu pour nous.
L’inconvénient de la voiture autonome est le suivant : quels que soient les progrès réalisés sur la voiture, son fonctionnement nécessite, d’une part, que l’ensemble du parc soit équipé et, d’autre part, de fournir des investissements dans les infrastructures. Or, je ne vois pas par qui ces derniers vont être financés. Qui va payer 500 euros par feu rouge pour y installer une borne électronique ? Regardez également l’état des lignes blanches sur les routes françaises, même nationales : pour guider une voiture autonome sur une route, il faut au minimum que ces lignes blanches soient lisibles. Qui va payer pour qu’on les repeigne tous les deux ans et qu’elles soient détectables par une voiture autonome ? De tels investissements représentent des dizaines, voire des centaines de milliards d’euros. Je ne doute pas que Google soit capable de fabriquer une voiture qui sache jouer au go... Le problème n’est pas là. J’ai plutôt tendance à penser que la voiture autonome est un rêve.
Quant au débat sur la voiture électrique, il est presque clos. Malgré le déluge d’aides accordées, cette filière ne démarre pas, sauf là où les aides sont gigantesques. Cette voiture pose en outre des problèmes scientifiques – et non pas technologiques – qui ne sont pas près d’être résolus. On ne sait pas aujourd’hui fabriquer une batterie qui soit capable de stocker et de restituer de l’énergie de manière efficace et qui ait une durabilité suffisante. Cela étant, je ne suis pas un spécialiste de la question. Nos principaux axes de développement en matière de recherche et développement visent, d’une part, à la réduction des émissions d’oxydes de carbone – nous avons parlé tout à l’heure de la réduction du poids des véhicules et des systèmes de recyclage d’énergie à l’échappement – et, d’autre part, à la conception de la voiture connectée qui suppose une transformation du cockpit.
Vous avez évoqué l’interaction entre le constructeur PSA et l’équipementier que nous sommes : PSA étant pour nous un client comme les autres. Nous travaillons donc avec lui comme avec les autres. C’est un grand et un très bon client. Nous travaillons bien avec lui sans qu’il y ait de différence fondamentale avec la manière dont nous procédions auparavant.
Nous n’avons jamais bénéficié du FMEA. Nous en avons même été contributeurs, puisqu’une partie du fonds était destinée aux équipementiers de second rang.
Je crois avoir déjà répondu s’agissant des nouvelles étapes de normalisation prévues par l’Union européenne : elles impliqueront une rupture technologique à inventer. Nous n’avons pas conclu de partenariats de conception de véhicules autonomes. Le véhicule autonome nécessite essentiellement des capteurs – caméras, sensors, radars et nidars – et des logiciels, ce qui n’est pas du tout notre domaine. Nous sommes en revanche très impliqués dans la conception du véhicule connecté qui suppose la transformation du cockpit de la voiture.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Comment voyez-vous l’avenir de la France dans l’industrie automobile, compte tenu de la potentielle contraction du marché automobile ?
D’autre part, vous avez été très critique à l’égard de la voiture électrique. Travaillez-vous sur d’autres technologies que les véhicules thermiques et hybrides, telles que les moteurs à hydrogène ou à gaz ?
M. Yann Delabrière. Il convient de distinguer l’industrie automobile française de l’industrie automobile en France. Je ne doute pas que les deux grands constructeurs français aient les capacités de se développer et de réussir dans l’industrie automobile. S’agissant de l’industrie automobile en France, il y a d’une part la recherche et développement et, d’autre part, la production. En matière de recherche et développement, notre pays a toutes les capacités nécessaires pour former de grands écosystèmes – la transformation enregistrée au cours de ces dernières années en ce domaine ayant été un grand succès. La France est même attractive aujourd’hui de ce point de vue. Dans le domaine de la production, beaucoup a été fait également. La compétitivité s’est améliorée au cours des vingt dernières années.
S’agissant des modes de motorisation, il est aujourd’hui consensuel d’envisager un développement important des moteurs hybrides, qu’ils soient complètement hybrides, ou full hybrid, comme la Prius, ou hybrides rechargeables, ou plug-in-hybrid – les véhicules étant alors des sortes de voitures électriques n’ayant pas les inconvénients de la voiture électrique. Il nous semble que la pile à combustible et la voiture à hydrogène sont une piste très sérieuse, pour plusieurs raisons. D’abord, on sait depuis toujours que stocker l’énergie sous forme liquide est ce qu’on sait faire de mieux. Ensuite, il existe déjà aujourd’hui des infrastructures de distribution d’hydrogène. Enfin, il y a une continuité technologique très forte entre une voiture hybride et une voiture à hydrogène. Cette piste pose certes des problèmes de sécurité importants, tant dans le réseau de distribution que dans la voiture, mais ceux-ci sont traitables. Il n’y a aucune barrière scientifique ni technologique majeure à l’usage de ces véhicules. C’est pourquoi l’industrie japonaise est en train de s’engager pleinement dans cette voie : Toyota puis Honda ont d’abord opté pour une stratégie hybride qu’ils combinent maintenant avec une stratégie fondée sur la pile à combustible, ou fuel cell.
Je vous prie de m’excuser si je me suis exprimé trop rapidement sur la voiture électrique. Nous n’avons guère le temps d’en débattre. Il peut y avoir des ruptures scientifiques et les décisions des États peuvent jouer un rôle significatif, mais l’on voit bien que, malgré des décisions déjà très lourdes de leur part, la voiture électrique ne progresse guère.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Nous vous remercions de toutes vos réponses.
La séance est levée à treize heures dix.
◊
◊ ◊
34. Audition, ouverte à la presse, de M. Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, de M. Alexandre Rochatte, délégué adjoint à la sécurité et à la circulation routières, de Mme Marie Boursier, chargée d’études au bureau de la signalisation et de la circulation de la sous-direction de l'action interministérielle à la délégation à la sécurité et à la circulation routières, de M. Rodolphe Chassande-Mottin, chef du bureau de la signalisation et de la circulation de la sous-direction de l'action interministérielle à la délégation à la sécurité et à la circulation routières, et de M. Joël Valmain, conseiller technique "Europe-International" auprès du délégué interministériel à la sécurité routière
(Séance du mardi 22 mars 2016)
La séance est ouverte à seize heures trente.
La mission d’information a entendu M. Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, M. Alexandre Rochatte, délégué adjoint à la sécurité et à la circulation routières, Mme Marie Boursier, chargée d’études au bureau de la signalisation et de la circulation de la sous-direction de l'action interministérielle à la délégation à la sécurité et à la circulation routières, M. Rodolphe Chassande-Mottin, chef du bureau de la signalisation et de la circulation de la sous-direction de l'action interministérielle à la délégation à la sécurité et à la circulation routières, et M. Joël Valmain, conseiller technique "Europe-International" auprès du délégué interministériel à la sécurité routière
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Nous recevons aujourd’hui M. Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière depuis avril 2015, accompagné de proches collaborateurs.
Au regard de l’intitulé de la mission et des premières orientations de nos travaux, il peut paraître étonnant que nous nous intéressions au domaine de la sécurité routière. Mais la vocation interministérielle de votre fonction, Monsieur le délégué, devrait nous permettre d’aborder avec vous de nombreux sujets. Plusieurs grandes thématiques ne peuvent être ignorées lorsque l’on considère un peu attentivement l’âge moyen d’un parc automobile vieillissant, son état général et le niveau de son entretien ou encore les conditions de circulation des poids lourds.
Votre champ de compétences porte sur de nombreuses questions débattues et réglementairement encadrées à l’échelon européen. À cet égard, les récents exemples concernant les nouveaux seuils d’émissions à l’échappement et la mise en œuvre annoncée de cycles d’homologation plus réalistes des véhicules ont montré l’importance du rôle du lobby automobile, dont on peut imaginer qu’il a de puissants relais à Bruxelles. Nous avions été surpris de constater que les pouvoirs publics dialoguent sur toute réforme d’importance dans le cadre de processus dits de « comitologie » bien peu transparents. Vous connaissez sans doute fort bien, Monsieur Barbe, ces processus de négociation, puisque vous avez occupé de hautes fonctions au Secrétariat général aux affaires européennes entre 2009 et 2012.
Un autre sujet retient l’attention de la mission : les évolutions restant à décider dans le domaine du contrôle technique, dont certains points sont manifestement à revoir. Il en est ainsi du contrôle des émissions par les véhicules diesel, qui n’établit aucune distinction entre les niveaux des différents polluants, sans parler des particules. Il est toujours procédé à un contrôle d’un autre âge, limité à l’opacité des fumées. C’est dire si des marges de progrès existent !
Où en est-on des projets de réforme ? Votre délégation est-elle partie prenante dans les travaux qui devraient être en cours sur ce point ? Rappelons que l’article 65 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a posé un principe de modification des règles actuelles dans le sens d’une plus grande rigueur. Un décret devrait d’ailleurs intervenir en ce sens avant le 1er janvier 2017.
Notre mission s’interroge également sur la pratique du « défapage », qui progresse. Certains professionnels continuent de proposer des interventions de ce type par voie de publicité, notamment par internet, en dépit d’une interdiction désormais posée par une disposition du code de la route intervenue en 2015. Notre rapporteure, Delphine Batho, a saisi le ministre de l’intérieur de cette question, il y a plus d’un mois ; je crois qu’à ce jour, aucune réponse n’a été donnée à son courrier.
Monsieur le délégué, je vous laisse la parole pour un bref exposé de présentation. Puis la rapporteure, suivie des autres membres de la mission d’information, vous interrogera.
M. Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière. Les compétences de la direction de la sécurité et de la circulation routières (DSCR) ont récemment été allégées puisqu’elle n’a plus en charge le dossier des taxis. Mes compétences concernent désormais toutes les politiques de sécurité routière liées au volet « comportement » du triptyque « route-véhicule-comportement » dont traite la sécurité routière. La route et le véhicule dépendent principalement du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE) ; ma délégation ayant en charge les règles du code de la route, la signalisation, la communication du Gouvernement ainsi que la mise en place du contrôle automatisé par les radars. Nous travaillons en lien avec la police et la gendarmerie sur les doctrines de contrôle, qui relèvent toutefois de leur responsabilité. Tout ce qui concerne le véhicule, qui par le passé dépendait de ma direction lorsqu’elle était placée sous l’autorité du ministre chargé des transports, relève aujourd’hui du secrétariat d’État aux transports. Nous travaillons bien sûr avec lui sur tous les sujets qui concernent la sécurité routière. Il existe, d’ailleurs, une instance, le Groupe interministériel permanent de la sécurité routière (GIPSR), que je suis le seul à pouvoir présider, et qui rend des avis exigés par le Conseil d’État sur les textes réglementaires relatifs à la sécurité routière.
La direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) est compétente pour le contrôle technique des véhicules, mais elle nous consulte pour les aspects qui concernent la sécurité. En revanche, lors de la tenue du comité interministériel de la sécurité routière (CISR), nous avons tenu à ce qu’un contrôle technique soit institué pour les deux-roues motorisés. La DGEC a alors ajouté à notre champ de compétence les questions de l’environnement et de la pollution.
Pour ce qui regarde les routes, nous travaillons avec la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM), qui nous consulte sur les aspects relevant de la sécurité. Dans quelques cas, qui concernent principalement la signalisation, j’exerce une compétence pour le ministre des transports.
Ce qui rapproche le plus ma direction des travaux de votre mission d’information relève du domaine de la technologie, singulièrement le véhicule autonome sur le plan européen et international, car un fort impact est attendu en matière de sécurité routière. Au demeurant, l’étendue des compétences devant être mobilisées par l’émergence du véhicule autonome est très vaste et ne manquera pas d’impliquer de nombreux secteurs ministériels.
À juste titre, vous avez évoqué le vieillissement du parc automobile et l’âge moyen des acheteurs de véhicules neufs est, en France, de cinquante-trois ans, c’est-à-dire à moment de la vie où l’on est « rangé des voitures » en termes de prise de risque. Ces comportements concernent surtout les hommes, les femmes adoptant naturellement un mode de conduite plus prudent. Elles constituent, d’ailleurs, un appui considérable en matière de sécurité routière.
En résumé, tout ce qui touche au monde de l’automobile et du camion nous concerne, mais nous sommes en consultation, non en compétence propre.
Pour finir, je signale que nous traversons une mauvaise période au regard de la sécurité routière : depuis deux ans, l’accidentologie repart à la hausse. Cette situation a conduit le Gouvernement à adopter de nombreuses mesures touchant aux véhicules et, à l’occasion de la dernière réunion du CISR, à appeler l’Union européenne, qui détient, ainsi que vous l’avez mentionné, Madame la présidente, beaucoup de compétences, à adopter un certain nombre de mesures relatives à l’équipement des véhicules.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Dans le cadre des prochaines normes européennes, le nouveau protocole d’homologation des véhicules prévoit un cycle à 160 kilomètres à l’heure. Quel est votre avis à ce sujet ? Avez-vous été consulté lorsque la France a défini sa position sur ce protocole et sur ce cycle qui dépasse de 30 kilomètres à l’heure la vitesse maximale autorisée sur son territoire ?
L’un des thèmes majeurs de réflexion de notre mission d’information est la politique industrielle, qui comprend la conception industrielle des véhicules. En matière d’accidentologie, notamment s’agissant des accidents mortels, avez-vous constaté l’existence d’une relation entre les accidents et la puissance des véhicules ou encore l’évolution des comportements d’achat, par exemple vers des véhicules 4X4, plus lourds et puissants, qui seraient sécurisants en cas d’accident ? Que resterait-il à améliorer dans la conception des véhicules au regard de la sécurité routière ?
Le véhicule autonome appellera nécessairement des évolutions lourdes de la réglementation. L’État a-t-il adopté une position à ce sujet, car de multiples adaptations des règles européennes et internationales devront être adoptées ?
M. Denis Baupin. Beaucoup a été fait dans le domaine de la réglementation afin d’améliorer la sécurité : vitesse, contrôles radars, airbags, ceinture de sécurité. Ne faudrait-il pas, maintenant, poser la question de la responsabilisation des constructeurs dans ce qu’ils mettent entre les mains des automobilistes, particulièrement en termes de puissance des véhicules ? De même qu’on ne doit pas s’étonner que les gens utilisent des armes si elles sont mises à disposition, il ne faut pas s’étonner que les conducteurs soient tentés de faire usage de toute la puissance des véhicules, dont les spots publicitaires et les constructeurs font leur principal argument. Il est plus facile de convaincre une dizaine de constructeurs que des millions d’automobilistes ! Ne devrait-on pas constater une baisse du nombre des accidents si les voitures mises sur le marché étaient limitées à 130 kilomètres heure ? Avez-vous fait des études à ce sujet ?
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Les conducteurs français ont le droit de rouler ailleurs qu’en France, et sont donc susceptibles de dépasser les 130 kilomètres à l’heure à l’étranger.
M. Denis Baupin. Ils ne sont pas obligés de rouler à plus de 130 kilomètres à l’heure, même lorsqu’ils sont hors de France. Il n’y a pas d’obligation de rouler à une vitesse supérieure.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Ils peuvent simplement en avoir envie.
M. Denis Baupin. Certes, mais faut-il, pour le plaisir de quelques-uns, laisser la possibilité de rouler à des vitesses dangereuses dans des véhicules surpuissants ?
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Tout ne peut pas relever de l’encadrement et de la réglementation.
M. Denis Baupin. J’attendais cette réflexion. C’est pourquoi j’ai parlé de responsabilisation des constructeurs et pas d’encadrement.
M. Gérard Menuel. Quelle est la part des défaillances mécaniques dans le pourcentage des accidents ?
Quel serait, selon vous, le premier élément de sécurité à privilégier dans la conception des véhicules ?
M. Jean-Michel Villaumé. Je suis député de Haute-Saône, département dans lequel un tronçon de la route nationale 57 a été choisi pour expérimenter la limitation de vitesse à 80 kilomètres à l’heure. Disposez-vous d’un premier bilan de cette opération ?
Les poids lourds sont à l’origine de beaucoup d’accidents graves, souvent liés à des vitesses excessives, sur tous les types de voie. Une réflexion est-elle en cours sur la réglementation qui leur est applicable et sur leur contrôle ? Gendarmes et préfets me disent qu’il est plus difficile de contrôler des poids lourds que des véhicules particuliers et qu’il serait même parfois impossible de lire leurs plaques d’immatriculation lorsqu’ils roulent trop vite !
M. Yves Albarello. Les dirigeants de Faurecia nous ont récemment expliqué qu’ils croyaient plus en l’avenir du véhicule hybride qu’en celui du véhicule autonome, pour des raisons qui tiennent, non pas à la technologie, mais à la lourdeur des investissements auxquels les États devraient consentir tant en matière d’aménagement routier que de connectique. Quel est votre avis à ce sujet ?
M. Emmanuel Barbe. S’agissant du cycle à 160 kilomètres à l’heure, bien que nous ne fussions pas concernés au premier chef, nous avons été saisis : nous avons exprimé notre plus totale opposition. Ce cycle était demandé par les constructeurs allemands, alors qu’il désavantage les constructeurs français dont les moteurs ne sont pas conçus pour avoir de tels rendements. La négociation s’est déroulée en comitologie ; je n’en étais pas directement chargé. La France a voté pour un texte permettant de ne pas l’imposer à tous, un compromis tel qu’on les pratique à Bruxelles avec la formule « sous réserve de la législation nationale ». La difficulté provient toujours de ces tronçons d’autoroutes allemandes sur lesquels la vitesse n’est pas limitée.
Des améliorations apportées à la conception des véhicules ont eu des résultats très positifs sur l’accidentologie. Je pense à la capacité d’absorption des chocs par la carrosserie, à la ceinture de sécurité, en particulier au pré-tendeur. D’autres ont porté sur la sécurité active, tels les systèmes antiblocages des roues ABS et EBR, et demain le système de freinage automatique d’urgence AEB qui permettra de diminuer le temps de réaction d’une seconde. Toutefois, ces progrès n’ont d’intérêt que s’ils sont assimilés par des conducteurs prudents. Les débuts de l’ABS ont montré que des conducteurs roulaient plus vite, car ils pensaient freiner mieux, ce qui est évidemment faux puisque le système ne diminue pas la distance de freinage. En 2014, 400 personnes sont décédées parce qu’elles n’étaient pas attachées. Les constructeurs nous aident en équipant toujours plus les voitures de dispositifs telle l’alerte sonore, qui devient de plus en plus entêtante tant que la ceinture n’est pas attachée à l’avant. Il reste cependant des conducteurs qui fixent la ceinture dans leur dos. La sonnerie pour les ceintures placées à l’arrière du véhicule sera bientôt obligatoire ou devrait progresser.
On constate généralement qu’il faut une vingtaine d’années pour que les équipements de sécurité au départ installés sur les modèles haut de gamme deviennent obligatoires. Petit à petit, ces normes sont intégrées par les autorités européennes. Les ministres Ségolène Royal et Bernard Cazeneuve ont transmis à ces autorités un courrier, rédigé par nos soins, demandant que toute une série d’équipements de sécurité devienne obligatoire. Par ailleurs, très récemment, certains constructeurs se sont engagés, de leur propre initiative, à ne plus produire que des véhicules dotés du système AEB. Il m’a été donné de tester ce système dont les performances sont très impressionnantes.
Les dispositifs de sécurité sont très onéreux, l’entreprise Faurecia a dû vous le dire. Le dernier modèle haut de gamme et le plus cher de BMW donne l’image des équipements qui seront disponibles sur tous les véhicules dans vingt ans. Cette évolution sera constante.
La vraie question aujourd’hui est de parvenir à ce que les gens ne roulent pas trop vite. Je ne vais pas éluder votre remarque : il existe un lien entre la puissance des véhicules et l’excès de vitesse, et cela peut être démontré. Je ne suis pas en mesure de publier les statistiques dont je dispose, car il manque un correctif important qui est le nombre de kilomètres parcourus par chaque modèle. C’est pour cela que nous demeurons prudents dans nos publications. Néanmoins, il est vrai que les voitures les plus puissantes sont plus régulièrement « flashées » que les modèles courants. Je ne souhaite pas entrer dans le débat sur l’opportunité d’interdire les véhicules capables de dépasser 130 kilomètres à l’heure. Des recours auprès du Conseil d’État ont été tentés contre des constructeurs, mais un certain nombre de principes juridiques ont conduit à choisir de ne pas interdire les véhicules puissants.
Nous privilégions une politique de radars bien pensée, susceptible de dissuader les conducteurs de rouler vite, aussi ces considérations me dépassent-elles. Je refuse toutefois de penser que la politique de sécurité routière puisse être conçue sans prendre en considération la vie sociale dans sa globalité. Sinon, je pourrais dire qu’à mes yeux, la situation idéale est l’embouteillage : il y a très peu d’accidents à Paris, par exemple. Mais cela reviendrait à s’opposer à toute mesure tendant à rendre la circulation plus fluide. Les politiques de sécurité routière ne doivent pas être absolutistes, et il est indispensable que les 45 millions d’usagers de la route y adhèrent. Qui plus est, des urbanismes se sont développés autour de l’usage de l’automobile ; il n’est donc pas possible de l’abandonner du jour au lendemain.
À l’avenir beaucoup de progrès procèderont de la conception même du véhicule, tels les dispositifs de lutte contre la somnolence, de plus en plus perfectionnés : ils devraient beaucoup sécuriser la conduite sur autoroute. De notre côté, nous allons rendre disponible en open data un registre des vitesses maximales autorisées sur les routes françaises et consultable sur GPS afin que tous les conducteurs soucieux du respect de ces limitations – et ils sont nombreux – puissent disposer d’une information qui n’est pas toujours évidente.
Le développement de systèmes tel l’AEB interurbain, comme tous les systèmes de freinage automatique anticipant les réactions, ou des systèmes d’éclairage laser qui permettent de rouler en permanence comme en pleins phares, concourent à l’amélioration de la sécurité routière. De ce point de vue, les constructeurs ne sont pas en reste.
Indépendamment des questions de puissance des véhicules qui me dépassent, j’ai été frappé, au Salon de Francfort, de constater à quel point on s’efforce aujourd’hui d’imaginer une voiture qui serait un smartphone à quatre roues. En termes de sécurité routière, cela est problématique : certains modèles proposent des écrans immenses, disposant de fonctions tactiles très complexes ne pouvant que distraire le conducteur ; dans certaines publicités récentes, les automobilistes sont incités à téléphoner ou composer des SMS au volant. J’ai eu l’occasion de faire part de mes réserves aux constructeurs intéressés.
La question du téléphone au volant n’est pas tant celle d’avoir l’appareil en main que celle de la disponibilité du cerveau humain qui, contrairement à ce que l’on croit, n’est pas multitâches : il n’a pas la capacité de consacrer suffisamment de ressource à chacune des deux activités. Il aurait peut-être fallu poser cette interdiction il y a trente ans.
Aujourd’hui, cela serait socialement complexe. On a su interdire les oreillettes, mais aucun pays n’a interdit de téléphoner, d’autant qu’il serait impossible de vérifier l’infraction. Il ne me semble pas souhaitable d’adopter des normes qui ne sont pas contrôlables : cela affaiblit l’État comme la règle.
S’agissant du véhicule autonome, les conventions internationales en vigueur exigent la permanence d’un contrôle humain du véhicule ; une voiture sans conducteur ressemblerait à la Google car, automobile dépourvue de volant et de freins, et aménagée comme un salon. Les textes internationaux autorisent déjà l’expérimentation du véhicule autonome, mais ils doivent encore évoluer afin de ne pas entraver les recherches et les essais. Les États-Unis, qui n’ont pas ratifié exactement les mêmes conventions, sont en avance dans ce domaine. Aujourd’hui, on ignore comment un tel véhicule qui serait autorisé en France pourrait circuler, voire même exporté, dans les autres pays européens. Les pays se vivant comme un continent en soi auront plus de facilité à s’affranchir des barrières réglementaires et légales. Les grands équipementiers, tel que Faurecia, sont intéressés par le véhicule autonome ; il me paraît important que la réglementation européenne puisse évoluer afin de ne pas brider l’innovation dans ce domaine. Les administrations des pays membres devraient mieux se coordonner sur ce sujet dont l’Europe doit s’emparer.
Nous publions les résultats de nos travaux dans le rapport de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONSIR). Nous essayons d’estimer la part de défaillances mécaniques dans le nombre total des accidents de la circulation : elle est évaluée de 1 % à 2 %. Toutefois, il faut être conscient que, sauf circonstances le justifiant – l’accident de Puisseguin en Gironde où le Bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA) est intervenu, par exemple –, des analyses approfondies du véhicule sont rarement effectuées à l’occasion d’un accident de la route. Qu’il s’agisse d’automobiles ou de deux-roues, cette estimation appelle la plus grande prudence, le nombre d’accidents mortels étant trop élevé pour que des recherches très poussées soient possibles, mais mon sentiment est que le taux de défaillance mécanique est plus élevé que l’on ne pense couramment.
À M. Menuel, je répondrai que j’ai évoqué les évolutions que nous appelons de nos vœux, et rappellerai que si nous construisons de bonnes routes, par exemple, les conducteurs peuvent être tentés de rouler vite. Aussi, les progrès réalisés peuvent se révéler contre-productifs si les règles de la sécurité ne sont pas intériorisées par les usagers.
L’expérimentation du passage de la limitation de vitesse de 90 à 80 kilomètres à l’heure doit s’étendre sur deux années. À ce stade, les résultats demeurent délicats à analyser. Aussi, compte tenu des aspects polémiques caractérisant la question, je préfère rester prudent et ne pas communiquer de données.
Une mission composée de plusieurs inspections générales, dont celle des finances et celle de l’administration (IGA), et du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) notamment, travaille à la question du contrôle des poids lourds. La compétitivité de nos entreprises de transport est en cause, car une forte rupture de la concurrence est observée : les règles de conduite comme la réglementation relative à l’état des véhicules ne sont pas respectées. On constate que certains camions sont vétustes et mal entretenus, le coût d’achat est moindre, ce qui fausse la concurrence, et, par ailleurs, se révèle très dangereux. Beaucoup de contrôles sont effectués par la gendarmerie en lien avec les directions départementales des territoires. Des logiciels sophistiqués, à la conception desquels participe le ministère des transports, permettent, par aspiration des données, d’établir une analyse de la conduite du chauffeur et de le verbaliser pour non-respect des temps de conduite qui auraient été commis dans d’autres pays. Je concède cependant que nous souffrons d’un relatif manque de moyens au regard du nombre des poids lourds concernés.
Le rôle de cette mission est donc de mieux coordonner les différents services et administrations afin d’améliorer le contrôle. Par ailleurs, les législations les mieux conçues et les plus strictes s’appliquent à certaines tailles de camions. Or, dans certains pays où la main-d’œuvre est très peu chère, ces lois sont contournées par le recours à des véhicules utilitaires qui n’y sont pas soumis. Cette situation est préoccupante, et nous constatons un accroissement des accidents mortels dans lesquels les véhicules utilitaires sont impliqués.
Au regard du nombre de kilomètres parcourus, les poids lourds, conduits par des professionnels de la route, ne sont pas à l’origine d’un nombre élevé d’accidents, même si lorsque ceux-ci surviennent, ils sont souvent cause de la mort de tierces personnes. Les véhicules légers connaissent le plus fort taux d’accidents – actuellement en hausse, hélas ! –, ce qui ne saurait surprendre puisqu’ils sont largement plus nombreux à circuler.
En ce qui concerne le véhicule autonome, il est vrai que les investissements à réaliser seront considérables, mais ils ne porteront pas nécessairement sur la voirie. J’ai plutôt vu qu’on établissait une cartographie routière très précise. Beaucoup reste à faire, mais il n’est pas douteux que la technologie parvienne à ses fins. J’en veux pour preuve cette machine qui a récemment battu un joueur de go à plusieurs reprises. Reste le problème de l’évolution du parc et de l’interaction entre voitures classiques et véhicules autonomes. Ainsi, l’entreprise Valéo a placé dans le système de freinage un dispositif adressant des informations au véhicule suivant ; encore faudra-t-il que celui-ci soit capable de les lire.
À mes yeux, ce n’est pas l’investissement qui constituera le premier obstacle au développement du véhicule autonome : l’atavisme humain qui fait que les gens aiment la conduite pèsera bien plus. Ce qui devrait se développer dans les deux prochaines décennies, c’est la conduite automatisée dans les situations rebutantes, tels les embouteillages. Déjà, des dispositifs permettent de régler la vitesse de croisière sur celle du véhicule précédant. De ce fait, la question se pose, en termes de sécurité, de savoir si de tels systèmes ne risquent pas de favoriser la déconcentration des conducteurs.
Enfin, le véhicule autonome ne manquera pas de poser des problèmes de responsabilité assez complexes et de représenter un défi pour les compagnies d’assurances en faisant diminuer le risque, sur lequel précisément est assise leur activité. Des questions éthiques se poseront par ailleurs, car, au moment de l’accident, l’être humain ne réfléchit pas, il commet un acte instinctif, alors qu’un logiciel aura le temps de choisir qui il sacrifie ou qui il tue. La programmation de ces outils sera donc délicate. Une réflexion est en cours entre plusieurs pays sur ces questions qui risquent de se révéler plus complexes que celle des capitaux.
M. Philippe Duron. Selon vous, assiste-t-on à une érosion de l’efficacité des radars due à l’effet de prudence ou d’annonce ? Des solutions sont-elles à l’étude afin de parer à cette situation ?
La longueur des camions semble devoir évoluer : il y a peu, les 44 tonnes ont été autorisés ; aujourd’hui, des syndicats professionnels du transport routier demandent l’autorisation de faire circuler des convois longs de plus de 25 mètres – de quoi impressionner ! Quel est votre point de vue à ce sujet et comment les législations pourraient-elles être adaptées ?
Mme Delphine Batho, rapporteure. Le véhicule autonome est présenté par ses promoteurs comme l’instrument de la fin de l’insécurité routière par l’élimination du facteur humain. Quel est votre sentiment à cet égard ?
M. Emmanuel Barbe. Nous faisons le même constat au sujet des radars, celui de l’érosion de leur efficacité. Je dois dresser un bilan tous les mois et l’exercice est décevant : alors que les radars sont plus nombreux et performants qu’auparavant, la vitesse moyenne constatée sur nos routes augmente à nouveau. Or, en accidentologie, la vitesse excessive est un risque. À l’instigation du Premier ministre, le 2 octobre dernier, le Gouvernement a décidé l’adoption d’une stratégie entièrement nouvelle, dont l’objectif n’est pas l’augmentation du nombre des amendes, car cela pose un problème d’acceptabilité.
La sécurité routière se fonde uniquement sur des schémas de sécurité. Les considérations financières, notamment le rendement des amendes, ne sont pas prises en compte dans notre réflexion.
Nous avons choisi de maintenir les panneaux annonçant les radars, qui contribuent à faire baisser la vitesse, ce que nous recherchons. En revanche, pour remédier à l’effet d’érosion, dû à la connaissance des conducteurs de l’emplacement des radars et à l’aide que leur apportent certaines applications dédiées, nous allons développer la furtivité et la mobilité des radars. Différentes techniques sont à notre disposition, tels les leurres, déjà utilisés à l’étranger. Un premier dispositif consiste à définir des parcours très accidentogènes le long desquels seront installés beaucoup de panneaux entre lesquels un radar autonome sera déplacé sans qu’on sache jamais où il se trouve. Ainsi, les automobilistes sont prévenus qu’ils doivent faire attention. Un autre dispositif est celui des radars-leurres, c’est-à-dire qu’on ne sait pas si les cabines mobiles sont équipées de radar ou pas. Notre message est que nous ne souhaitons pas particulièrement voir augmenter le nombre des amendes, ni les automobilistes perdre leurs points de permis, mais obtenir des gens qu’ils roulent moins vite.
Nous disposons, aujourd’hui, de voitures radars, pilotées par deux policiers ou gendarmes, qui accomplissent là une tâche très inférieure à leurs compétences puisque l’un conduit et l’autre appuie sur le bouton des vitesses.
M. Philippe Duron. Il faut inventer la voiture autonome embarquant un radar !
M. Emmanuel Barbe. Nous allons rendre autonome la mesure de la vitesse autorisée, et déléguer à des sociétés agréées la circulation de ces véhicules sur des itinéraires que nous choisirons. Cette circulation ainsi que le respect des itinéraires prescrits feront l’objet d’un contrôle a priori et a posteriori. Ces véhicules seront en mesure d’indiquer à tout moment la vitesse autorisée, sachant qu’une vérification permanente sera effectuée par un officier de police judiciaire à Rennes et que la possibilité de former un recours demeure ouverte. Nous souhaitons rendre toujours plus crédible le contrôle de la vitesse, sans pour autant que les conducteurs perdent tous les points de leur permis, car il est important qu’ils soient en possession de ce document.
Ces évolutions sont en cours ; elles appellent la passation de marchés publics ainsi que des modifications réglementaires. Le premier itinéraire bordé de panneaux et équipé d’un radar mobile a été testé entre Arras et Le Touquet. Nous avons constaté un ralentissement significatif de la vitesse et espérons que l’effet d’adaptation saura ne pas trop se faire ressentir.
S’agissant des camions, la demande d’autorisation de convois plus longs ne m’est pas revenue. Au demeurant, il est notoire que les convois trop longs représentent un danger puisque, pour les dépasser, les automobilistes prennent des risques inconsidérés. Si nous devions être consultés sur cette question, nous prendrions, bien entendu, le temps de la réflexion, mais il est douteux que la réponse soit favorable. Le cas des convois exceptionnels, réglementés et avec des trajets prédéfinis, renvoie à d’autres considérations.
Le véhicule autonome sonnera-t-il le glas de l’accident par l’élimination du facteur humain ? Cela serait probable si le nombre de ces voitures était suffisamment élevé.
La question demeure posée de savoir si l’homme sera toujours capable de répondre à des situations trop complexes pour être gérées par une machine. En conduisant très peu, le risque est de perdre de l’expérience, et la transition risque d’être difficile. Reste l’éventualité de la panne : comment y faire face ? La technologie devrait conduire à une meilleure sécurité routière ; les systèmes de freinage automatique en sont l’illustration, de même que les dispositifs de prévention de l’assoupissement ou d’avertissement lorsque l’on se trouve trop près d’un véhicule, et qui provoquent un freinage autonome. Au demeurant, il convient de rester vigilant devant deux tentations auxquelles les conducteurs risquent de succomber : celle de neutraliser les systèmes automatiques de sécurité et celle de rouler plus vite parce que la voiture offre beaucoup de sécurité.
M. Philippe Kemel. S’agissant des véhicules autonomes se pose la question de la réglementation et de sa signalétique. Or il me semble que la réglementation n’est pas appliquée de la même manière sur l’ensemble du territoire national. J’ai pu constater, dans ma ville, des erreurs de signalétique, et je pense que cela peut être le cas dans d’autres communes. Avez-vous conduit des investigations à ce sujet, et envisagez-vous des mesures correctives ? De fait, la signalisation obéit à des règles complexes mais les particularités de terrain la rendent parfois difficile à implanter de manière homogène. Or le véhicule autonome suivra sans doute un référentiel précis. Ne doit-on pas s’attendre à des difficultés ?
M. Denis Baupin. Je me souviens que Monsieur Louis Schweitzer a considéré devant la mission d’information que l’industrie automobile surdimensionnait les véhicules produits en fonction des quelques centaines de kilomètres d’autoroutes allemandes où la vitesse n’est pas limitée. Il serait intéressant de procéder à une étude comparative des coûts et des bénéfices pour la société du privilège octroyé à quelques personnes circulant à ces grandes vitesses au regard de l’ensemble des conséquences en matière de pollution, de consommation d’énergie, d’émissions de gaz à effet de serre, d’accidentologie, de pouvoir d’achat des consommateurs touchés à la fois lors de l’achat de véhicules outrepassant largement leurs besoins et en consommation de carburant, même en ville. Cette réflexion gagnerait à être menée afin que nous sachions s’il est vraiment nécessaire que la possibilité soit offerte à quelques-uns de rouler à plus de 130 kilomètres à l’heure sur quelques centaines de kilomètres en Allemagne.
M. Gérard Menuel. Je suis très sollicité au sujet de défaillances d’organismes dispensant des stages de sensibilisation à la sécurité routière permettant de récupérer des points de permis de conduire. Des stages sont prévus, puis repoussés ou annulés, et des personnes circulent en croyant avoir récupéré leurs points sans que cela soit le cas. Cela pose un problème concret.
M. Emmanuel Barbe. En ce qui concerne la signalétique, la question peut être étendue à la circulation de véhicules autonomes à l’étranger. Un groupe réfléchit à l’évolution des infrastructures : c’est là un des problèmes que les ingénieurs ont le plus de difficultés à maîtriser, lorsque le marquage au sol vient à faire défaut, par exemple. Des solutions ne manqueront pas d’être trouvées, mais je vous concède qu’il y a là une difficulté supplémentaire. Au demeurant, on pourrait souhaiter que les trois gestionnaires de voirie – l’État, les départements et les communes –, développent davantage des référentiels communs pour rendre plus homogène la signalisation hic et nunc, car ce problème ne concerne pas que la voiture autonome à venir.
S’agissant des stages de sensibilisation à la sécurité routière, nous avons dénoncé auprès de la DSCR cette situation à l’origine de laquelle se trouvent des sociétés qui pratiquent l’intermédiation pour la vente de ces stages, et qui annoncent beaucoup plus de sessions que disponibles, ce qui piège les consommateurs. Une première réponse sera apportée par la multiplication par cinq des contrôles – quand bien même cela peut sembler modeste –, qui seront raccourcis afin que chacun des 3 300 centres de stages soit vérifié au moins une fois par an. Par ailleurs, une circulaire à l’attention des préfets va être prise par le Premier ministre très prochainement afin de contrôler les annonces publiées sur Internet et qui affichent des prix si bas qu’elles sont suspectes. Il faudra aussi informer le consommateur.
Je vais, en outre, m’adresser à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) afin qu’elle vérifie si certaines annonces ne sont pas mensongères, car trop de sites Internet comportent des annonces trompeuses, y compris pour l’apprentissage de la conduite. Nous tâchons de communiquer et d’inciter les consommateurs à se tourner vers les institutions les plus sérieuses – je pense en particulier à la très ancienne association, la Prévention Routière, qui organise des stages de façon sérieuse sans poursuivre un but lucratif.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Nous vous remercions infiniment.
La séance est levée à dix-sept heures vingt-cinq.
◊
◊ ◊
35. Audition, ouverte à la presse, de M. Gilles Le Borgne, directeur de la recherche et du développement, membre du comité exécutif de PSA Peugeot Citroën.
(Séance du mardi 29 mars 2016)
La séance est ouverte à seize heures quinze.
La mission d’information a entendu M. Gilles Le Borgne, directeur de la recherche et du développement, membre du comité exécutif de PSA Peugeot Citroën.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Mes chers collègues, nous recevons cette après-midi M. Gilles Le Borgne, directeur de la recherche et du développement, membre du comité exécutif de PSA Peugeot Citroën. Il est accompagné de Mme Virginie de Chassey et de Mme Valérie Lachouque, chargées des affaires publiques pour le groupe.
M. Le Borgne est un expert réputé en matière de conception automobile et exerce à ce titre d’autres responsabilités au sein de la filière. Il codirige en effet le programme 2 litres/100 km, dont nous avons déjà beaucoup parlé, et assure depuis 2015 la présidence du comité technique de la plateforme de la filière automobile.
Monsieur, nous allons vous interroger sur des données importantes pour l’information de notre mission. Pourriez-vous nous indiquer le montant consacré chaque année à la recherche et au développement par votre groupe, nous donner des exemples de ce qui relève d’innovations de rupture ou simplement d’améliorations techniques ? La distinction entre ces deux catégories est souvent incertaine : si les constructeurs insistent sur les nouvelles options technologiques que le conducteur pourra utiliser, le bénéfice de ces options est la plupart du temps peu perceptible par les utilisateurs et le grand public.
Nous souhaitons également connaître le coût moyen pour un constructeur des actuelles procédures d’homologation d’un nouveau véhicule – sur ce point, les organismes concernés ne nous ont pas apporté de réponses très assurées. Ces coûts seront certainement bien plus élevés quand les nouvelles normes seront en vigueur, c’est pourquoi nous aimerions connaître votre évaluation des coûts actuels et à venir.
Pour ce qui est de la réduction de la consommation des véhicules et des émissions de CO2, considérez-vous que les différents modes d’hybridation des moteurs essence ou diesel constituent des formules ayant vocation à se généraliser dans toutes les gammes ? Un récent article du quotidien Les Échos faisait état d’une nouvelle technique d’hybridation légère, le « mild hybrid », moins coûteuse et pouvant être adoptée par de nombreux constructeurs, y compris pour des véhicules d’entrée de gamme.
Enfin, pour ce qui est des objectifs de réduction des oxydes d’azote – les NOx –, PSA valorise avec succès un système de dépollution dit Selective catalytic reduction (SCR). Pensez-vous faire école sur ce point et avez-vous d’ores et déjà constaté un intérêt pour ce type de dispositif de la part des autres constructeurs ? Un effet d’entraînement aurait toute son importance pour convaincre les pétroliers – que nous auditionnons régulièrement, comme nous le ferons encore demain – de distribuer dans leurs stations l’additif à base d’urée qui permet un fonctionnement optimal de ces systèmes de dépollution.
Je vous donne la parole pour un exposé liminaire, à la suite duquel Mme la rapporteure et les députés qui le souhaitent vous poseront des questions.
M. Gilles Le Borgne, directeur de la recherche et du développement, membre du comité exécutif de PSA Peugeot Citroën. Madame la présidente, madame la rapporteure, mesdames et messieurs les députés, je vais commencer par une bonne nouvelle : PSA va mieux. En 2015, nous avons enregistré le premier exercice bénéficiaire depuis cinq ans, avec un résultat net de 1,2 milliard d’euros et une marge opérationnelle de 5 % de la division automobile. Nous revenons de très loin, puisque nous étions au bord de la faillite en 2013, et nous ne voulons plus nous retrouver dans une telle situation : de ce point de vue, notre performance constitue notre seule protection dans la durée. Pour que PSA soit maître de son destin, l’agilité et l’excellence opérationnelle sont indispensables dans tous nos métiers. Dans ce contexte, PSA expliquera le 5 avril prochain son nouveau plan stratégique, baptisé « Push to pass ».
Nous sommes actuellement confrontés à des défis technologiques gigantesques, dont les deux plus importants sont la transition énergétique et l’offensive pour l’émergence du véhicule autonome et connecté. Pour ce qui est de la transition énergétique, nous investissons d’une part dans les moteurs thermiques diesel et les moteurs essence performants, d’autre part dans les chaînes de traction électrique, que ce soit avec le plug-in hybrid ou la nouvelle génération de véhicules électriques, développée avec notre partenaire chinois Dongfeng Motor Corporation (DFM). Ces lancements interviendront à partir du début de l’année 2019, afin d’être en concordance avec les limites de CO2qui seront imposées en Europe en 2020, puis en 2021.
Le deuxième volet de notre offensive technologique concerne l’émergence du véhicule autonome et connecté. La première raison d’être de cette technologie est de renforcer la sécurité de nos clients. Comme vous le savez sans doute, 90 % des accidents corporels sont aujourd’hui liés à une erreur humaine : l’automatisation de la conduite peut donc améliorer grandement la situation. Nous souhaitons également redonner du temps utile à nos clients, afin de pallier le fait que certaines conditions de circulation, notamment en ville, ne sont pas susceptibles de procurer du plaisir de conduite. Enfin, le véhicule autonome permettra de fluidifier la circulation en centre-ville.
Nous devons relever ces défis dans des conditions difficiles. Il s’agit d’abord d’un cadre réglementaire instable et tardif, en Europe comme en Chine. Le facteur le plus consommateur de ressources est celui constitué par les objectifs en matière de dépollution. Globalement, un délai de cinq ans est indispensable entre deux normes, et un délai d’application entre la première application et la généralisation à la flotte est idéalement compris entre dix-huit et vingt-quatre mois. En effet, l’industrie automobile est fortement capitalistique, et les développements auxquels nous procédons requièrent du temps en R&D comme au stade de la mise en place industrielle. À défaut – c’est plutôt la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui –, ces évolutions ne se font pas dans de bonnes conditions, notamment au regard de l’optimisation économique pour le constructeur, mais également du point de vue des clients.
La deuxième source de difficulté pour nous réside dans la plus grande sévérité des normes, à l’origine de surcoûts plus difficiles à assumer par les constructeurs généralistes que par les constructeurs de véhicules premium.
Loin de moi l’idée de critiquer les normes : je ne fais que souligner que leur coût relatif diffère en fonction de la gamme des véhicules. Proportionnellement, un surcoût de 1 000 euros de technologies nouvelles est plus facile à transférer à l’acheteur d’une voiture coûtant 45 000 euros à 50 000 euros qu’à l’acheteur d’une voiture de 20 000 euros.
Enfin, l’affaire Volkswagen, sur laquelle je ne m’étendrai pas, a jeté l’opprobre sur tout le secteur automobile.
Face à toutes ces difficultés, PSA n’a qu’une solution, consistant à élever le niveau d’efficience de ses investissements, à ajuster ses périmètres en R&D et dans le domaine industriel sur ses métiers clés, dont certains sont complètement nouveaux – je pense notamment à la transition énergétique. En matière de R&D, les dépenses en jeu sont considérables. Le coût pour le passage d’une norme Euro – d’Euro 3 à Euro 4 ou d’Euro 4 à Euro 5, par exemple – est variable, mais s’établit entre 1 et 1,5 milliard d’euros, ce qui correspond à la totalité de notre résultat net pour 2015. À chaque évolution de norme – la norme Euro 6 s’est divisée en trois normes, la première s’appliquant en 2014, la deuxième en 2017 et la troisième en 2020 –, nous avons 250 applications véhicule – par véhicule, j’entends un ensemble de groupes motopropulseurs associés à une silhouette – à modifier en Europe, et plus de 100 en Chine : ce sont donc, à chaque fois, plus de 350 applications à modifier complètement.
Le coût de développement d’une chaîne de traction hybride, par exemple le plug-in hybrid sur lequel nous sommes en train de travailler, est de l’ordre de 450 millions d’euros en R&D et en capital expenditure (CAPEX). Quand nous développons from scratch – en partant de zéro – une toute nouvelle famille de moteurs, comme nous l’avons fait récemment avec le moteur PureTech, cela nécessite d’investir un milliard d’euros – ce qui couvre l’ensemble des coûts de développement, à la fois pour le moteur atmosphérique et pour le moteur turbo – qui, je le rappelle, s’est vu décerner en 2015 le prix « Moteur de l’année » dans sa catégorie par un jury international. Nous travaillons d’arrache-pied pour que chaque euro investi le soit de la manière la plus efficace possible.
En matière industrielle, nous avons les mêmes soucis. Même si PSA a l’intention de développer un certain nombre de moyens industriels dans le domaine de la traction électrique en France, la transition ne pourra se faire qu’avec la montée en puissance de cette technologie sur le marché. Or, la chute accélérée du diesel en France et en Europe, à un rythme bien plus rapide que nos prévisions ne le laissaient penser, amènera forcément à des évolutions, que nous avons en partie anticipées avec l’augmentation du volume du moteur EB turbo. Aujourd’hui, notre groupe produit la totalité de ses moteurs diesel en France, contrairement à nombre de ses concurrents qui produisent leurs moteurs au plus près des usines de consommation.
En janvier 2016, la part du diesel dans les ventes de véhicules particuliers en France est tombée à 52 %, ce qui représente 7 points de moins par rapport à janvier 2015 et 22 points de moins par rapport à janvier 2012. Désormais, le diesel ne représente plus que 38 % des achats des ménages. Au total, le recul du diesel, combiné à la montée en puissance des nouvelles technologies, plus coûteuses et moins rentables – je rappelle que l’écart de coût entre un véhicule thermique et un véhicule électrique est de l’ordre de 7 000 euros – risque de peser sur les volumes et sur les marges, ce qui nous oblige à constamment nous adapter et à réfléchir à des évolutions pour protéger la performance de l’entreprise, seule condition de sa viabilité. Pour cela, nous devons plus que jamais faire preuve d’anticipation, comme nous le faisons avec la transition énergétique et la transition technologique que constitue la mise au point du véhicule autonome.
Nous anticipons d’abord dans le domaine de la dépollution. Comme Carlos Tavares et moi-même l’avons rappelé ici même en avril 2015, PSA est l’inventeur du filtre à particules, qu’il a introduit en première mondiale dans sa gamme de véhicules diesel en 2000, avec plus de dix ans d’avance sur la réglementation.
Aujourd’hui, nous sommes le seul constructeur à avoir généralisé la technologie SCR, reconnue comme la plus efficace pour traiter les oxydes d’azote. Nous l’avons introduite sur l’ensemble de nos moteurs diesel à partir de septembre 2013 afin de répondre à la première version de la norme Euro 6, et elle est présente sur la totalité de notre ligne de produits depuis septembre 2015. Grâce au potentiel de la SCR et à son savoir-faire – là encore, nous serons certainement pionniers –, PSA saura se conformer à l’objectif d’un facteur de conformité de 1 plus 0,5 – ce deuxième chiffre correspondant à l’incertitude de mesure, sur laquelle je reviendrai – pour les émissions d’oxydes d’azote en 2020 : nous serons même en mesure d’atteindre cet objectif dès 2017.
Il est absolument essentiel que le réseau de distribution d’AdBlue, c’est-à-dire de l’urée nécessaire au fonctionnement du dispositif SCR, se développe de manière à ce que l’ensemble de nos clients puisse facilement refaire le plein d’AdBlue – nos véhicules sont équipés d’un réservoir de dix-sept litres de ce produit.
Nous avons également anticipé en matière de réduction des émissions de CO2. Depuis plus de dix ans, PSA est dans le trio de tête en Europe – la région la plus exigeante dans ce domaine – du point de vue du Corporate average fuel economy (CAFE), c’est-à-dire la moyenne pondérée de la consommation par nos ventes. Depuis deux ans, nous occupons même la position de leader européen, avec une flotte de véhicules neufs ayant émis, l’an dernier, 104,4 grammes de CO2par kilomètre, alors que la moyenne du marché se situe à un peu moins de 120 grammes par kilomètre. Compte tenu de la masse moyenne de ses véhicules, l’objectif assigné à PSA pour 2021 est de 91 grammes par kilomètres, alors que l’objectif fixé par l’Union européenne à la même date est de 95 grammes au kilomètre
– peut-être avons-nous travaillé trop tôt ou trop vite à la réduction de la masse de nos véhicules par rapport à nos concurrents, puisque les constructeurs allemands se situent plutôt aux alentours de 100 grammes. L’atteinte de cet objectif va beaucoup dépendre du mix essence-diesel et des véhicules électrifiés. Or, le coût de ces solutions est très variable et aujourd’hui, le diesel est de loin la motorisation présentant le meilleur rapport coût-efficacité pour gagner des grammes de CO2.
Accélérer la transition énergétique se traduit évidemment par des surcoûts assumés par le constructeur, le client ou l’État. Dans tous les cas, seule la performance va protéger notre entreprise, qui se doit de pouvoir absorber les surcoûts par des efforts supplémentaires, faute de pouvoir les transférer sur ses clients dans un monde ultra-concurrentiel.
Un autre élément d’anticipation réside dans la démarche de transparence que nous avons adoptée à la suite de la crise provoquée par l’affaire Volkswagen. La consommation exprimée en litres aux 100 kilomètres et les émissions de CO2 en grammes par kilomètre sont directement proportionnelles. Compte tenu de sa légitimité en matière de réduction de consommation, PSA a pris l’initiative de travailler avec deux ONG, Transport & Environment (T&E) et son partenaire français, France Nature Environnement (FNE), afin de mesurer la consommation de ses véhicules en usage réel.
Le protocole de test est aujourd’hui défini, et nous l’avons présenté dans le cadre du dernier salon de Genève. Pour être recevable, il est supervisé par le Bureau Veritas, qui apporte les voitures et scelle les trappes à carburant, les valves des pneus, le calculateur moteur et le body control unit – en français « boîtier de servitude intelligent » (BSI) –, qui est une sorte de calculateur centralisant les informations reçues par les différents capteurs du véhicule. Le 1er mars dernier, nous avons annoncé les consommations en usage réel de trois de nos véhicules de grande diffusion ; nous disposons aujourd’hui des résultats d’une dizaine de véhicules, et allons continuer nos essais de manière à publier cet été une trentaine de résultats mesurés selon ce protocole, qui seront accessibles à nos clients sur le site Internet de nos trois marques.
Cette initiative unique va permettre de fournir au public une information totalement transparente sur les consommations réelles, et nous invitons tous les constructeurs à nous rejoindre. Dans un deuxième temps, à l’horizon mi-2017, avec la mise en place du Real driving emissions, nous produirons selon le même protocole les mesures d’émissions d’oxydes d’azote. Je rappelle qu’une telle mesure n’est pas prévue par la réglementation actuelle.
Dans le domaine de la voiture communicante, PSA a une fois de plus joué un rôle précurseur en étant pionnier de l’appel d’urgence, qui permet aux clients, en cas de panne ou d’accident, d’être pris en charge par un opérateur qui les identifie, les localise et leur envoie une assistance technique ou les secours – notamment quand un airbag s’est déclenché, ce que nous pouvons détecter à distance. Ces services équipent déjà plus de 1,8 million de véhicules PSA en circulation, et nous avons eu 16 000 appels à des services d’urgence dans seize pays différents depuis le lancement du service eCall en 2003, que la réglementation ne rendra obligatoire en Europe que courant 2018.
Pour ce qui est des véhicules autonomes, nous avons été les premiers en juillet dernier à faire circuler sur les routes de France – avec l’autorisation des ministères concernés, que nous remercions – quatre prototypes de différents niveaux d’automatisation, sur plus de 10 000 kilomètres de route ouverte, ainsi que sur plusieurs routes en Espagne. Nous avons réalisé de nombreuses expériences prometteuses au niveau 2 – hands off – et au niveau 3 – eyes off, en attendant de pouvoir le faire au niveau 4 – mind off – et au niveau 5 – driverless. En novembre 2015, nous avons effectué 3 000 kilomètres de roulage autonome entre la France et l’Espagne ; nos premières fonctions d’automatisation de conduite apparaîtront dès 2018 sur les voies rapides et les parkings, tandis que les fonctions de conduite autonome se mettront en place à partir de 2020, en commençant par la circulation sur voie rapide. Nous aurons d’ailleurs besoin d’un changement de la législation pour être autorisés à mettre ces véhicules sur le marché.
Même en anticipant une transition énergétique progressive et technologiquement neutre, nul ne sait aujourd’hui quelle technologie va l’emporter. Chez PSA, nous insistons beaucoup sur le fait qu’une approche des pouvoirs publics privilégiant la neutralité technologique est indispensable : il s’agit de raisonner sur les résultats recherchés et non sur la solution technique. À condition que ces résultats nous soient indiqués suffisamment à l’avance, je peux vous garantir que nous disposons des laboratoires – je ne pense pas seulement à ceux de PSA, mais à l’ensemble de ceux auxquels nous pouvons faire appel – et des ingénieurs capables de trouver et de développer les solutions dont nous aurons besoin.
Cela dit, cette transition aura un coût, qui ne sera que partiellement supporté par le consommateur, ce qui suppose pour nous d’accélérer nos gains de compétitivité. La filière a besoin d’un dialogue continu avec les pouvoirs publics afin de trouver le meilleur équilibre entre l’état de l’art et le coût financier de la réglementation. En tant que constructeur généraliste, nous devons offrir des véhicules pour tous.
Il existe des technologies nouvelles pour lesquelles PSA investit et monte en puissance. Pour autant, elles sont peu abordables pour une clientèle de masse et leur diffusion sera progressive. À court terme, le diesel que nous qualifions de propre, c’est-à-dire conforme à la norme Euro 6 dans toutes ses versions, est la solution la plus abordable et la plus répandue pour atteindre les objectifs de CO2 à l’horizon 2020-2021.
Enfin, il est essentiel que la France et l’Europe ne deviennent pas des territoires « autophobes », car les constructeurs automobiles sont synonymes de force industrielle pour la France et pour l’Europe.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Je rappelle, afin d’éviter de rouvrir des débats que j’estime dépassés, qu’il n’existe ni diesel « propre », ni essence « propre ».
Pouvez-vous nous dire ce que vous inspire l’affaire Volkswagen ? Le fait qu’un constructeur fasse appel à un logiciel truqueur vous a-t-il surpris ?
Pouvez-vous nous en dire plus sur le protocole que vous avez mis en place en partenariat avec Transport & Environment et France Nature Environnement en réaction à l’affaire Volkswagen et à la prise de conscience par le grand public de l’écart existant entre les protocoles actuels d’homologation et les conditions réelles de circulation des véhicules ? Pourquoi, en l’état actuel, excluez-vous les NOx des informations que vous rendez publiques sur la consommation et les émissions des véhicules ?
Au sujet des NOx, vous avez dit que vous seriez capables de respecter la norme européenne de 2020 dès 2017.
M. Gilles Le Borgne. Je n’ai pas que ce serait facile !
Mme la rapporteure. Cela permet d’éclairer le débat sur le facteur de conformité et d’illustrer le fait que certains constructeurs sont techniquement capables de l’atteindre plus vite. Pourriez-vous entrer dans les détails du fonctionnement de la SCR, notamment en ce qui concerne la température requise pour le mettre en œuvre ?
Vous avez évoqué la technologie faisant appel à l’urée. Cela ne pose-t-il pas la question des rejets d’ammoniac ?
Enfin, vous avez évoqué la nécessité que les pouvoirs publics fassent preuve de neutralité technologique, et indiqué qu’un délai de cinq ans était indispensable pour effectuer la R&D et le développement industriel permettant d’assurer le passage d’une norme à la suivante. J’aimerais savoir si la recherche nécessitée par l’évolution des normes absorbe la totalité du budget de R&D d’un constructeur, ou si la recherche peut, au contraire, devancer des évolutions de normes futures – je pense notamment à l’un de vos concurrents, qui présente aujourd’hui un plan de vision de long terme à l’horizon 2050 sur la façon dont il va développer un certain nombre de technologies.
M. Charles de Courson. Voyez-vous dans les années qui viennent – le cas échéant, dans quel délai – des innovations technologiques majeures de nature à permettre d’allonger fortement la distance d’autonomie des véhicules ? Sur ce point, la plupart des constructeurs que nous avons auditionnés considèrent que si l’hybride est prometteur, il semble plus difficile d’envisager des avancées décisives dans le domaine du moteur intégralement électrique.
Quelle part de marché voyez-vous à terme pour la voiture intégralement électrique et les véhicules hybrides, pour les particuliers et les professionnels ?
Le concept de véhicule autonome s’installe progressivement en France, mais reste actuellement cantonné à des usages très précis – je pense notamment à l’aide au stationnement. Ne pensez-vous pas que le cadre juridique, ou plutôt son absence, freine les efforts de recherche dans ce domaine ?
Enfin, pour ce qui est du crédit d’impôt recherche, pouvez-vous nous dire à combien s’élève la somme consolidée que vous récupérez à ce titre, et ce que vous pensez de la brillante idée de certains de nos collègues, consistant à calculer le CIR au niveau du groupe ? À votre avis, à combien s’élèverait la perte subie par PSA si une telle mesure était adoptée ?
M. Gérard Menuel. Pour ce qui est des objectifs du véhicule 2 litres/100 km, est-ce l’évolution du moteur qui constitue l’élément essentiel, ou peut-on considérer que d’autres paramètres importants entrent en jeu – je pense notamment au poids des véhicules, qui influe beaucoup sur la consommation ? La mise au point de nouveaux matériaux composites vous permet-elle d’accomplir des progrès dans ce domaine ?
M. Julien Dive. Vous avez indiqué que le coût de développement d’un nouveau moteur hybride se traduisait par un coût de 450 millions d’euros en R&D, tandis que la recherche nécessaire à la mise au point d’une nouvelle famille de moteurs coûtait un milliard d’euros.
M. Gilles Le Borgne. J’ai en fait donné deux exemples : d’une part, celui du coût de développement d’une chaîne de traction hybride, de l’ordre de 450 millions d’euros, d’autre part, celui de la mise au point des versions atmosphérique et turbo de l’EB PureTech - , s’élevant à un milliard d’euros.
M. Julien Dive. J’aimerais savoir si ces montants sont propres à PSA, ou recouvrent également les recherches que peuvent effectuer les entreprises auxquelles vous faites appel en tant que donneur d’ordre – je pense aux équipementiers de rang 1 et de rang 2, notamment à Valeo et au centre d’essais turbo de Bruay-la-Buissière, le CRITT M2A.
Par ailleurs, j’aimerais savoir si la notion de maintenance prédictive a vocation à s’appliquer particulièrement au véhicule intelligent et connecté : peut-on imaginer qu’il soit possible d’identifier à l’avance les probables points de rupture ou les risques d’encrassement du moteur ou de pollution ?
Enfin, au sujet des moteurs thermiques, vous avez évoqué le diesel « propre ». Cependant, ayant eu la chance de visiter votre site de la Française de Mécanique à Douvrin, près de Lens, où sont produits les moteurs essence, j’ai cru comprendre que la dynamique actuelle semblait plutôt s’appuyer sur les moteurs essence hybrides downsized, c’est-à-dire des moteurs dont le poids a été réduit, afin d’alléger le poids du véhicule.
M. Denis Baupin. Je remercie notre rapporteure d’avoir clos le dossier du diesel « propre », ce qui a calmé la quinte de toux qui m’avait pris quand le sujet a été évoqué.
Une fois n’est pas coutume, je veux saluer la démarche du constructeur automobile qu’est PSA, consistant à travailler en partenariat avec Transport & Environment, France Nature Environnement et Veritas. Cela montre qu’il est possible d’innover en matière de gouvernance sur les questions de pollution de l’air et, même si nous attendons des résultats concrets, il s’agit d’une initiative méritant d’être soulignée, car il est évident que T&E et FNE ne délivreront pas leur label sans avoir pu procéder à des vérifications rigoureuses. Vous dites que les chiffres de consommation réelle seront consultables sur votre site, et j’aimerais savoir si ce seront désormais les seuls chiffres auxquels vous ferez référence dans vos publicités.
Vous avez dit que l’une des difficultés auxquelles vous ayez à faire face résidait dans le caractère tardif du cadre réglementaire, mais n’est-ce pas en partie en raison du lobbying exercé par les constructeurs automobiles afin de retarder les choses au maximum que la mise en œuvre de ce cadre réglementaire traîne en longueur ? Par ailleurs, quand vous nous dites être en mesure de respecter dès 2017 la norme qui ne s’imposera qu’en 2020, doit-on en déduire que PSA ne demande pas qu’il y ait en 2017 des facteurs de conformité supérieurs à 1,5 ?
En ce qui concerne le moteur Hybrid Air, on espérait beaucoup que l’alliance avec DFM permette un développement de cette technologie prometteuse en matière d’absence de pollution. Où en êtes-vous ?
La technologie SCR présente l’inconvénient de produire de l’ammoniac, comme l’a dit notre rapporteure, mais aussi du protoxyde d’azote, qui est un gaz à effet de serre très puissant. Avez-vous des précisions à nous apporter sur ce point ?
Enfin, pensez-vous que le paradigme de la voiture à tout faire, c’est-à-dire capable d’emmener une famille en vacances, mais ne servant la plupart du temps qu’à transporter une personne seule, va se perpétuer, ou que d’autres visions de l’automobile soient susceptibles de se développer – je pense à des véhicules plus adaptés à un usage individuel ?
M. Yves Albarello. Je m’associe à Denis Baupin, ce qui est rare, pour féliciter PSA pour son spectaculaire redressement, qui n’a pas été facile, et ma satisfaction de voir l’image des marques Citroën et Peugeot prendre trois points par rapport au trimestre dernier – vous occupez actuellement les quatrième et cinquième positions au classement faisant apparaître l’image des constructeurs, ce qui est une bonne performance.
Les constructeurs semblent miser sur une hybridation légère, et j’ai lu que PSA sortirait dès 2017 un nouveau modèle basé sur cette technologie. Pouvez-vous nous en dire plus sur les avantages de cette solution ? Par ailleurs, votre concurrent direct, Renault, va sortir un modèle qui ne devrait émettre que 76 grammes de CO2 au kilomètre, ce qui est très peu. Pensez-vous être en mesure d’égaler ce niveau d’émission avec votre propre modèle diesel ?
M. Jean Grellier. J’aimerais savoir ce que vous pensez des véhicules 2 litres/100 km : cette technologie vous semble-t-elle porteuse d’avenir ?
Les véhicules à hydrogène constituent-ils pour PSA une piste de réflexion à courte ou brève échéance ?
Vous plaidez en faveur de la neutralité technologique des pouvoirs publics, mais ne faudrait-il pas que l’État et les grands constructeurs se concertent un tant soit peu ? Ne pas le faire risque en effet d’avoir des conséquences malheureuses en termes de fiscalité et d’équipement – je pense à la distribution des énergies qui s’imposeront demain.
Je me félicite du redressement de PSA – vos dirigeants aussi, si l’on se réfère à ce qui vient d’être dit dans la presse à leur sujet –, mais je me fais toutefois l’écho des critiques émises par certains sur le fait que PSA n’élargisse pas sa gamme de véhicules à la production de 4X4 ou de coupés très haut de gamme, par exemple. Est-ce vraiment l’expression d’une stratégie de la part de votre groupe, et le cas échéant comment la justifiez-vous ? Avez-vous, au contraire, l’intention d’étendre votre production à d’autres secteurs du marché automobile que ceux que vous occupez actuellement ?
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Je vous précise que vous pouvez faire l’impasse sur la question portant sur la rémunération des dirigeants de PSA, puisque nous auditionnerons prochainement M. Tavares et M. Ghosn.
M. Gilles Le Borgne. L’affaire Volkswagen nous a évidemment beaucoup étonnés – je n’en dirai pas plus, car nous ne commentons jamais ce qui se passe chez nos concurrents.
Pour ce qui est du protocole conclu avec T&E et FNE, nous avons annoncé cette initiative exactement un mois après l’affaire Volkswagen, c’est-à-dire en octobre dernier. Nous avons ensuite consulté largement afin de trouver des partenaires disposés à travailler avec nous et, en novembre, nous avons fait part de notre association avec T&E, l’organe technique et scientifique avec qui nous travaillons tous les jours, FNE, qui est la principale ONG française dans son secteur d’activité, et le Bureau Veritas. Je précise que nous ne payons pas les ONG, par nature indépendantes, mais que nous rémunérons le Bureau Veritas.
En pratique, les essais sont réalisés par Veritas, et l’organisation T&E peut venir y participer quand elle le souhaite. Nous avons défini un protocole en ouvrant la totalité de nos bases de données marketing – ce que nos clients achètent – et la banque de données d’usage, à laquelle la R&D se réfère pour savoir comment les utilisateurs conduisent – y sont mesurés de nombreux facteurs, parmi lesquels les enfoncements de pédales, les freinages et la consommation. Nous disposons également des données climatiques, correspondant à un client moyen. L’ensemble de ces renseignements a permis de définir des conditions d’usage pour un client moyen représentatif de la consommation pour un modèle donné et un carburant donné, que l’on va transposer à l’ensemble des clients ayant acheté ce modèle. Cette approche, basée sur le principe du client moyen, n’exclut pas que l’on puisse se trouver en présence de très grands écarts-types de consommation en fonction de la personne utilisant le véhicule.
En résumé, nous avons défini scientifiquement un client moyen avant d’affecter l’ensemble des paramètres associés – la masse, les équipements de la voiture, les niveaux d’accélération, les vitesses moyennes – dans un parcours Real driving emissions (RDE) situé à Carrières-sous-Poissy. Cela nous permet de déterminer la consommation moyenne de nos clients, et ceux-ci devraient même être en mesure de paramétrer leur consommation en fonction de leur style de conduite – calme, dynamique, faisant beaucoup de route… D’ici à l’été, nous allons publier la consommation de trente de nos voitures pour un client moyen. Tout le monde ne consommera pas la même chose, mais une personne ayant une consommation beaucoup plus élevée que l’estimation moyenne devra se poser des questions sur sa conduite, et tirera sans doute grand profit d’un stage d’éco-conduite !
Si les essais que nous effectuons portent uniquement sur le CO2, c’est pour répondre à ce qui constituait une importante préoccupation pour nos clients ; nous les étendrons aux NOx dès que nous disposerons des premiers véhicules devant avoir le Real driving emissions, c’est-à-dire au printemps de l’année prochaine. Nous nous sommes mis d’accord avec nos collègues et amis de T&E et FNE afin d’aller progressivement vers une transparence complète, qui ne s’arrêtera pas aux NOx : dès que les appareils le permettront, nous ferons des essais pour mesurer les particules en nombre, le monoxyde de carbone (CO) et tous les éléments sur lesquels portera la deuxième évolution de la norme Euro 6, s’appliquant à l’homologation des nouveaux types à partir de septembre 2017.
La SCR est un procédé assez simple consistant à injecter, en amont du catalyseur SCR, de l’urée en solution aqueuse à environ 30 %. Sous l’effet de la température élevée – la réaction commence à un peu moins de 200 °C –, l’urée se décompose en ammoniac, qui réagit à son tour avec les oxydes d’azote pour former, par réduction, du diazote et de l’eau. L’une des difficultés est que l’urée, liquide aqueux, doit être protégée du gel par un dispositif de réchauffage. Nous avons opté pour un réservoir de dix-sept litres d’urée, implanté sur l’ensemble de notre plateforme et qui nous permet d’afficher, pour la norme Euro 6, une autonomie concordant avec le rythme auquel les vidanges moteur doivent être effectuées. Cette autonomie va diminuer lorsque le facteur de conformité va être fixé à 1,5, c’est-à-dire 1 plus 0,5.
Le chiffre de 0,5 correspond à la dispersion liée au portable emissions measurement system (PEMS), un système de mesure des émissions embarqué sur le véhicule, constitué d’une plate-forme fixée sur l’attelage du véhicule à tester et reliée au tube d’échappement, ce qui permet d’analyser l’intégralité du flux des gaz d’échappement. Le PEMS est un système dynamique, dans lequel la voiture se déplace sur un parcours, et son utilisation se traduit par une dispersion, c’est-à-dire une incertitude de mesure de l’ordre de 45 milligrammes au kilomètre – selon l’estimation fournie par le Joint Research Centre (JRC), un laboratoire européen faisant référence. Ce dispositif coûte 100 000 euros, contre 2,5 millions d’euros pour un banc à rouleaux, consistant en un système de rouleaux sur lesquels la voiture à tester roule dans une pièce fermée, l’intégralité des gaz émis étant emprisonnée dans un grand sac avant d’être analysée.
Atteindre l’objectif de 1 plus 0,5 n’a rien de facile, mais nous avons déjà investi dans la technologie SCR et estimons donc pouvoir atteindre cet objectif dès septembre 2017.
Quand nous avons pris la décision d’exploiter la solution de l’urée, il y a quatre ans et demi, j’ai eu pour tâche, en tant que chef des plateformes, de déterminer la meilleure façon d’y installer le réservoir de 17 litres, ce qui n’a pas été une mince affaire. Nous avons pris le parti de caler nos volumes de manière à ce que la présence du réservoir soit transparente pour le client, qui dispose aujourd’hui d’une autonomie de l’ordre de 20 000 à 25 000 kilomètres, s’inscrivant dans les pas de vidange moteur : le plein d’urée se fait en temps masqué par rapport à l’intervalle entre deux vidanges.
Atteindre l’objectif de 1,5 va nécessiter de consommer plus d’urée, ce qui va avoir pour effet de diminuer l’autonomie. Il va donc falloir que l’urée soit disponible dans les stations-service : or, si celles-ci sont équipées d’un réseau de pompes délivrant de l’urée à 40 litres/minute pour les poids lourds, rien n’est encore prévu pour les véhicules particuliers. Nous avons engagé des discussions avec les pétroliers, qui hésitent encore à investir sur une technologie diesel. Nous avons donc besoin que vous nous aidiez en les incitant à mettre en place un réseau de distribution sur l’ensemble du territoire européen.
Comme je l’ai dit, la technologie SCR produit de l’ammoniac, un gaz dangereux théoriquement susceptible de glisser vers la canule d’échappement en l’absence de NOx à réduire. Cela dit, nous sommes aujourd’hui en mesure d’affirmer que nous avons trouvé le moyen de supprimer ce risque, et nous garantissons qu’il n’y a aucune fuite d’ammoniac à la sortie de nos pots d’échappement.
Mme la rapporteure. Si je comprends bien, vous n’avez pas fait le choix de changer la taille du réservoir, mais celui d’imposer des pleins d’urée plus fréquents. Quelle sera l’autonomie des véhicules concernés ?
M. Gilles Le Borgne. Cela dépend du style de conduite, mais je dirai en moyenne 6 000 à 7 000 kilomètres.
Mme la rapporteure. Lorsque nous allons passer des tests New European Driving Cycle (NEDC) aux tests real driving emissions (RDE), l’injection de l’urée va se faire sur une plage de temps beaucoup plus longue. Mais que se passe-t-il tant que la température proche de 200 °C n’est pas encore atteinte ?
M. Gilles Le Borgne. On règle les paramètres du moteur afin d’être dans les conditions dites low NOx. Dans un moteur diesel, vous avez une relation directe entre les NOx émis et le CO2. On va donc dégrader la combustion du moteur pour émettre moins de NOx et davantage de CO2. Lorsque la température requise est atteinte, il y a production d’ammoniac et réduction des NOx.
Pour ce qui est de la nécessité d’adopter une attitude de neutralité technologique, je dirai que le véhicule décarboné représente environ 50 % de notre effort en R&D. Le restant se répartit comme suit : 25 % affectés au véhicule connecté autonome, 25 % correspondant à diverses actions liées à l’attractivité pour nos marques. Nous avons maintenant des ADN de marques bien identifiés – le confort Citroën, le i-cockpit de Peugeot, les matériaux nobles de chez DS… – qu’en tant que patron de la R&D, je me dois de nourrir.
Il m’a été demandé quel était le coût des règlements pour une voiture. Sur une centaine d’objets réglementaires, je dois me conformer à 49 à 52 règlements européens pour obtenir des Mines le numéro d’enregistrement européen d’un véhicule. Le coût global, noyé parmi les validations auxquelles nous procédons à chaque fois que nous sortons un nouveau modèle de voiture, s’élève à quelques centaines de kilo-euros. Des essais particuliers sont réalisés, soit sur les composants eux-mêmes, soit sous la forme d’essais de synthèse réalisés sur les véhicules.
En revanche, les coûts en valeur peuvent être beaucoup plus élevés. Ainsi, on estime que la première version de la norme Euro 6 s’était traduite par un surcoût de plusieurs centaines d’euros – j’ai coutume de dire plus de deux cents euros mais moins de cinq cents. Le tire-pressure monitoring system (TPMS), c’est-à-dire le système permettant de détecter le sous-gonflage des pneus, les normes sur les émissions de bruit, ou encore le remplacement du fluide frigorigène R-134 par le R-1234yf dans les systèmes de climatisation – rendu célèbre par un contentieux judiciaire impliquant Mercedes – ont un coût réglementaire variant d’une à quelques dizaines d’euros. Plus que le coût d’obtention de l’homologation, s’élevant à quelques centaines d’euros, c’est la somme des coûts de chacun de ces éléments qui, pour un véhicule donné, va avoir la répercussion la plus importante sur le coût total du véhicule.
Peut-être vous rappelez-vous que PSA avait lancé en 1994 des 106 et des Saxo électriques basées sur la technologie nickel-métal hydrure. Depuis, nous sommes passés à la technologie lithium-ion, qui représente un progrès énorme en termes de densité énergétique des batteries. Les batteries équipant les véhicules actuels sont comprises entre 100 et 130 wattheures par kilo (Wh/kg) ; elles devraient passer aux environs de 200 Wh/kg à l’horizon 2020, puis à 250 ou 260 Wh/kg. Ces batteries étant installées dans un volume fini, leur autonomie est proportionnelle à leur taille. Si l’on peut atteindre une autonomie de 300 à 350 kilomètres pour une voiture de taille normale, il est clair qu’à l’heure actuelle, nous ne disposons pas de la vision technologique permettant à un véhicule électrique de rallier Paris à Marseille en une fois.
Un véhicule hybride se définit par la quantité d’énergie électrique embarquée. Le micro-hybride, qui est un stop & start, ne comporte pas de batteries supplémentaires. Le mild hybrid embarque 0,2 à 0,5 kWh. Le full hybrid, dont il existe des modèles chez Toyota, mais aussi chez nous, avec le HYbrid4, embarque 1 kWh, ce qui offre 3 ou 4 kilomètres d’autonomie en mode zero emission vehicle (ZEV) – mais la plupart du temps, la batterie n’est utilisée que comme réservoir de puissance pour économiser du carburant : les véhicules ne sont pas vraiment équipés d’une traction électrique. On passe ensuite au plug-in hybrid, qui embarque environ 10 kWh de batterie, soit dix fois plus que le full hybrid et vingt fois plus que le mild hybrid, ce qui offre une autonomie de 50 à 60 kilomètres en mode ZEV – cette technologie n’a de sens que si l’utilisateur recharge les batteries : à défaut, il est en mode de traction thermique, avec l’inconvénient d’embarquer 200 kg de batterie ! Enfin, le véhicule électrique embarque de 30 à 70 kWh de batterie.
Nous estimons que l’ensemble constitué par les véhicules électriques et les plug-in hybrids représentera pour PSA, à l’horizon 2020-2025, environ 10 % des véhicules vendus, avec sans doute une prépondérance des véhicules hybrides, dans une proportion que je ne peux préciser.
En matière d’autonomie des véhicules, il existe cinq niveaux. Le niveau 1 correspond au foot off, qui équipe déjà un grand nombre de véhicules, avec le système active cruise control ; le niveau 2 est le hands off, où la voiture se conduit elle-même, mais sous le contrôle du conducteur ; le niveau 3 est le eyes off, qui permet d’envoyer des SMS ou de lire le journal, mais avec des temps de réquisition du chauffeur de l’ordre d’une dizaine de secondes ; le niveau 4 est le mind off, qui permet théoriquement au « conducteur » de dormir dans la voiture ; enfin, le niveau 5 est le driverless, qui ne nécessite pas d’être au volant – ce niveau est illustré par le test de la Google Car par une personne aveugle.
M. Yves Albarello. Ce n’est plus une voiture !
M. Gilles Le Borgne. Les fonctionnalités que je viens de décrire sont amenées à se développer dans les mois et les années qui viennent. Nous avons prévu à l’horizon 2020 d’introduire le niveau 2, puis le niveau 3, avec le système traffic jam chauffeur, qui permettra à l’utilisateur de laisser la voiture se conduire toute seule sur le périphérique.
Pour cela, encore faut-il que la législation évolue, car nous sommes aujourd’hui limités au niveau 2 – hands off – à basse vitesse. La convention de Vienne, à laquelle se réfèrent les codes de la route de tous les pays, exige en effet que le conducteur tienne le volant. Évidemment, en l’état actuel de la législation, il n’est pas conseillé de croiser les gendarmes en mode hands off : il y a toutes les chances pour que cela vaille une amende au conducteur concerné. Le Comité technique automobile, que je préside, adresse régulièrement des position papers aux administrations dans le but de faire évoluer la réglementation, à commencer par la convention de Vienne.
Le crédit d’impôt recherche représente 113 millions d’euros pour PSA. Il s’agit d’une somme importante, correspondant à celle engagée par notre direction de la recherche et de l’ingénierie avancée (DRIA) pour l’advanced engineering, c’est-à-dire l’ensemble des travaux amont, présentant des maturités inférieures à 6 sur notre échelle de classement et sur lesquels on ne peut donc s’engager, leur viabilité n’étant pas démontrée.
Le véhicule 2 litres/100 km n’est pas vraiment un véhicule, mais plutôt un cadre général constituant l’une des actions du plan de la Nouvelle France industrielle, et ayant pour objectif de développer des briques technologiques. Même si Renault et PSA sont très actifs sur ce projet, ils restent concurrents, comme le sont entre eux Michelin, Valeo et Plastic Omnium : nous avons tous pour objectif de développer des produits susceptibles d’intéresser des clients, y compris à l’étranger. Le cadre du véhicule 2 litres/100 km comporte quatre axes : l’hybridation – avec l’objectif de parvenir à une émission moyenne d’environ 50 grammes de CO2 par kilomètre ; le rendement, que nous cherchons à améliorer en allégeant les masses en mouvement dans le moteur, en réduisant les frottements et en travaillant sur la thermodynamique ; la consommation, abordée dans le cadre d’une approche holistique – nous traitons l’ensemble de la voiture, qu’il s’agisse de sa masse, de ses moteurs, de sa consommation électrique, ou du contact des pneumatiques avec la route, aidés en cela par notre champion national, Michelin ; enfin, la connexion, car si vous êtes bloqué dans un embouteillage, il est intéressant que la voiture puisse vous indiquer un chemin plus fluide afin que vous consommiez moins.
Depuis le lancement de ce cadre en septembre 2013, quarante projets sont en cours, ce qui représente 458 millions d’euros de R&D et environ 150 millions d’euros d’aides publiques – sous forme d’aides directes ou d’avances remboursables. PSA et Faurecia n’étaient jusqu’à présent pas éligibles aux aides publiques, se trouvant placées sous le statut de l’entreprise en difficulté, mais cela vient de changer et, fin 2016, nous aurons 90 projets en cours pour 690 à 850 millions d’euros et des aides de l’ordre de 250 millions d’euros – je précise que plus de soixante PME sont associées à ces projets. J’insiste sur le fait que le véhicule 2 litres/100 km est un cadre dans lequel le Comité technique automobile que j’ai l’honneur de présider donne des axes de travail : il définit en quelque sorte un champ magnétique général au sein duquel s’alignent dix pôles – les laboratoires, les pôles de compétitivité, ou encore l’Association régionale de l’industrie automobile (ARIA).
Pour ce qui est du projet Hybrid Air, nous sommes en stand-by. Nous avons atteint le niveau de maturité TRL6, ce qui signifie que nous sommes prêts à nous lancer dans le développement, mais nous n’avons pas réuni les conditions technico-économiques qui nous permettraient de le faire. Un coup décisif, si ce n’est fatal, a été porté à ce projet quand les autorités chinoises ont confirmé que les aides associées à la réglementation new energy vehicle (NEV) seraient réservées aux plug-in hybrids (PHEV) et aux véhicules électriques (BEV). Il nous a semblé extrêmement difficile de nous lancer dans le développement d’un projet pour lequel nous ne recevrions aucune aide, c’est pourquoi nous y avons renoncé en 2013, à une époque où nous ne disposions pas de capacités de financement.
Mme la rapporteure. Ne vous faudrait-il pas d’autres partenaires ?
M. Gilles Le Borgne. À l’origine, notre partenaire Bosch devait développer le moteur tandis que nous étions chargés de la chaîne de traction, nous avait demandé de trouver au moins un autre partenaire du secteur de l’automobile, avec un volume d’au moins 400 000 unités par an. Aujourd’hui, ces conditions ne sont pas réunies.
J’en viens au paradigme de la voiture, évoqué par M. Baupin. Ce qui dimensionne une voiture, c’est avant tout sa capacité d’accélération, la vitesse maximale n’ayant qu’une valeur indicative compte tenu des limitations de vitesse réglementaires : l’accélération, elle, constitue un important facteur de sécurité, en ce qu’elle permet au conducteur de se dégager rapidement en cas de besoin. Pour ce qui est du nombre de places, il se trouve que l’acheteur d’un cabriolet – je pense à la 206 CC ou à la 207 CC, par exemple – est toujours rassuré de pouvoir compter sur deux places supplémentaires, fussent-elles symboliques : c’est ce que l’on appelle « l’alibi d’usage » dans notre jargon, et c’est un élément extrêmement important de la relation entre un automobiliste et sa voiture, dont nous devons tenir compte en prospective.
Vous m’avez demandé si désormais, nos publicités feraient exclusivement référence aux chiffres correspondant à la consommation réelle de nos véhicules. La réponse est non, puisque nous avons l’obligation légale de communiquer sur le seul règlement qui s’impose à nous, un règlement datant des années 1970, revu dans les années 1990, mais aujourd’hui complètement obsolète, puisqu’il ne prend pas en compte la climatisation ni les boîtes à six vitesses – il serait interdit de passer la sixième vitesse sur le banc à rouleaux. En revanche, nos clients pourront accéder librement aux informations relatives aux consommations réelles, sans doute au moyen d’un comparateur. Par ailleurs, tous les nouveaux véhicules – je pense notamment à la future 3008 ou à la future C3 – seront soumis à la nouvelle procédure et les tests correspondants seront disponibles lors de l’achat.
Pour ce qui est d’un lobbying supposé de l’automobile, je vous invite à relire toutes les déclarations faites par PSA au Sénat ou à l’Assemblée nationale : vous constaterez que nous avons toujours demandé à ce que le règlement WLTP soit mis en œuvre le plus rapidement possible. Aujourd’hui, il y a un écart entre la réglementation et la consommation de nos clients – entre 1,5 et 1,8 litre/100 km d’écart pour les trois premiers véhicules sur lesquels nous avons communiqué au salon de Genève –, que la mise en œuvre du nouveau cycle va permettre de réduire de moitié. Comme nous sommes bien placés en termes de consommation réelle, nous avons tout intérêt à ce que le cycle de réglementation qui nous est imposé soit le plus représentatif des usages réels de nos clients, car cela évite des incompréhensions, voire des retours qualité suscités par la déception de constater des écarts entre les valeurs affichées en fonction du cycle imposé réglementairement et l’usage réel du véhicule.
J’insiste sur le fait qu’atteindre l’objectif de 1 plus 0,5 dès 2017 n’aura rien de facile : nous travaillons sur des dispositifs récents, dont la mise au point n’est pas terminée. Les tests WLTP et WLTC s’effectuent toujours sur des bancs à rouleaux, car ces dispositifs nous permettent de garantir les résultats obtenus grâce à la certification de Bureau Veritas. L’objectif de 1 plus 0,5 ne constitue pas l’horizon ultime de nos performances, puisque le progrès n’a pas de limites. Cela dit, il convient de veiller à ce que les normes réglementaires soient en cohérence avec la capacité technique des systèmes : plus l’objectif se rapproche de zéro, plus il devient difficile de gagner ne serait-ce qu’une décimale.
M. Denis Baupin. Puisque vous êtes prêts à passer à 1,5, vous ne demandez pas à ce que le facteur de conformité soit fixé à 2,1 en 2017 ?
M. Gilles Le Borgne. Je répète que nous dimensionnerons nos modèles à 1,5 dès septembre 2017.
La technologie mild hybrid, qui constitue le deuxième niveau d’hybridation, embarque environ 350 wattheures de batterie. Elle comporte un système électrique réversible de l’ordre d’une dizaine de kilowatts, associé la plupart du temps à un dispositif dédié de 48 volts, ce qui permet de gagner 8 % à 10 % de consommation en moyenne. Nous travaillons sur cette technologie avec nos partenaires, et allons prochainement prendre la décision d’engager ou non son développement.
J’ai coutume de dire que PSA est en veille active sur le dossier du véhicule à hydrogène. Recourir à cette technologie n’a de sens que si l’hydrogène mis en œuvre est propre, c’est-à-dire s’il ne provient pas du cracking de méthane, qui l’assimile à une énergie fossile. On pourrait d’ailleurs étendre ce raisonnement à la totalité des technologies de propulsion électrique : du fait de l’origine de l’électricité, un véhicule électrique produit, du puits à la roue, de 20 à 30 grammes de CO2 au kilomètre en France ; en Allemagne, où 50 % de l’électricité est d’origine nucléaire, la production de CO2 est de l’ordre de 105 grammes au kilomètre, et l’on avoisine les 150 grammes en Chine ! La traction électrique résout les problèmes d’émissions polluantes localisées, mais elle n’est pas une solution du point de vue du réchauffement climatique. Pour en revenir à l’hydrogène, il existe par ailleurs un certain nombre de freins technologiques liés à la compression, au transport et à la distribution de l’hydrogène, qui justifient que nous n’ayons pas entrepris pour le moment de programme actif dans ce domaine, même si nous n’y sommes pas hostiles.
Pour ce qui de l’extension de notre ligne de produits, notre core models strategy nous a conduits à diminuer fortement notre nombre de modèles – 26 véhicules pour l’ensemble du monde. Par ailleurs, un programme spécifique va nous permettre de développer des véhicules haut de gamme.
Mme la rapporteure. Au sujet de votre vision stratégique et prospective, vous avez évoqué dans votre propos liminaire une chute rapide du diesel en France, notamment pour les voitures des ménages. Comment voyez-vous le segment de marché du diesel pour l’avenir, tant en ce qui concerne les véhicules que les usagers ?
Lorsque nous avons auditionné l’économiste Élie Cohen, il a établi des comparaisons entre la croissance de l’effort de recherche de certains constructeurs européens et celle d’un constructeur français – autre que PSA –, montrant que la première était très supérieure à la seconde sur la période 2003-2013. Que pouvez-vous nous dire sur l’effort de R&D de PSA ?
Selon vous, de quelle manière l’État peut-il encourager l’innovation et la R&D ? Lorsque la Commission des affaires économiques a auditionné Carlos Ghosn, il a expliqué que le crédit d’impôt recherche ne faisait que compenser les écarts de coûts d’ingénierie de la France par rapport à d’autres pays. Selon lui, « le coût chargé – c’est-à-dire les salaires plus les charges – de l’ingénierie en France est l’un des plus élevés au monde (…). Le CIR permet de ramener le coût de l’ingénierie française à des niveaux acceptables ». Qu’en pensez-vous ?
Au sujet des pôles de compétitivité, vous nous aviez dit, lors de notre visite, qu’ils se faisaient concurrence entre eux. Quel rôle pourrait jouer l’État pour organiser un soutien efficace à l’innovation et à la R&D ?
Le programme 2 litres/100 km ne constitue-t-il pas un objectif déjà dépassé ? De ce point de vue, le rôle de la puissance publique n’est-il pas de fixer un horizon technologique plus ambitieux, comme nous l’ont dit certaines des personnes que nous avons auditionnées ?
Comment voyez-vous, en termes de stratégie, la question de l’évolution des usages, c’est-à-dire d’un marché qui va de plus en plus vers le véhicule d’entreprise au détriment du véhicule particulier, et où l’âge moyen de l’acheteur d’une voiture neuve ne fait qu’augmenter – les jeunes générations ayant une relation différente à l’automobile, en tout état de cause moins basée sur le rapport de possession ?
M. Gilles Le Borgne. Je commencerai par répondre à la question de M. Dive relative aux montants de R&D. Les montants que j’ai indiqués – 450 millions d’euros pour le développement d’une chaîne de traction hybride, un milliard d’euros pour la mise au point de la nouvelle famille de moteurs EB – s’entendent R&D et CAPEX confondus : une partie de cette dépense correspond donc à l’achat de l’outillage des équipementiers. Il peut toujours y avoir des écarts entre le prix amorti des pièces et ce que l’on paye upfront, mais globalement cela représente bien la totalité des capitaux que nous devons investir pour sortir nos produits.
Pour ce qui est du diesel, il est clair que nous assistons aujourd’hui à un rééquilibrage. Le mécanisme est extrêmement fort en France, où nous n’avons pas attendu le scandale Volkswagen pour assister à un véritable « diesel bashing ». Le phénomène est beaucoup moins prononcé en Europe : l’évolution de la part du diesel est nulle en Allemagne, et l’on n’assiste qu’à une très légère diminution au Royaume-Uni. Pour notre part, nous anticipons une normalisation du marché entre diesel et essence et, quand nous avons annoncé l’année dernière une augmentation capacitaire pour notre moteur EB turbo PureTech, cela témoignait de notre volonté de prendre acte du rééquilibrage en cours. Nous sommes là avant tout pour servir nos clients, à qui nous devons proposer un éventail de technologies parmi lesquelles ils puissent choisir. Cela dit, un diesel moderne est une superbe machine constituant une vraie solution pour réduire le CO2, et nous aurons besoin d’une proportion significative de diesel pour atteindre les objectifs de 2020.
Dans le cadre de notre feuille de route « Back in the Race » de 2014, Carlos Tavares avait situé l’effort de recherche à accomplir entre 7 % et 8 % du chiffre d’affaires de la division automobile, ce qui représente 2,9 milliards d’euros – environ 1,8 milliard d’euros en R&D et 1,1 milliard d’euros de CAPEX pour l’année 2016. Ces chiffres peuvent apparaître faibles par rapport à ceux de certains de nos concurrents. Cela dit, nous disposons depuis quelque temps d’un plan de travail visant à optimiser chaque euro investi. Dans le cadre de la core model strategy, nous séparons les développements de nos véhicules particuliers en cinq programmes, avec énormément de carry over et de carry across entre les véhicules d’un même programme, et nous travaillons aussi pour d’autres marques, notamment Opel, qui peuvent ainsi proposer des véhicules très différents des nôtres en apparence, mais qui ont en réalité beaucoup de points communs.
Par ailleurs, nous nous efforçons d’être sélectifs dans les programmes que nous décidons de développer, ce qui explique, par exemple, que nous soyons restés en veille active sur les véhicules à hydrogène. Nous avons également décidé de ne développer qu’une technologie, la SCR, lors de la mise en application de la norme Euro 6. Nombre de nos concurrents ont, eux, fait le choix de développer deux technologies, à savoir à la fois la SCR et le lean NOx trap avec EGR (recirculation de gaz d’échappement) haute pression et basse pression.
Enfin, dans le cadre du programme DRIVE, nous nous sommes fixé pour objectif d’obtenir des gains en rupture sur l’ensemble des domaines de la R&D, qu’il s’agisse des gains de structure, d’organisation, sur les schémas opérationnels de développement – moins un développement dure longtemps, moins il coûte –, ou encore résultant de l’utilisation massive du numérique : depuis 2007, contrairement à nombre de constructeurs, nous n’avons plus d’outillage prototype pour réaliser nos voitures. L’ensemble de ces mesures permet de réaliser des gains très importants, de l’ordre de 300 millions d’euros, ce qui représente une voiture nouvelle complète par an.
Mme la rapporteure. Quel est le coût de la R&D effectuée en France ?
M. Gilles Le Borgne. Comme je l’ai dit tout à l’heure, nous bénéficions d’un crédit d’impôt recherche de 113 millions d’euros, ce qui est très significatif et correspond à nos dépenses d’advanced engineering.
Il y a aujourd’hui cinq pôles de compétitivité travaillant dans le domaine de l’automobile – j’y inclus le pôle i-Trans situé dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, consacré en grande partie aux bus. Les pôles de compétitivité sont des organisations comprenant des adhérents, le plus souvent des petites et moyennes entreprises, qu’ils aident à préparer des dossiers de financement ; ils ont également vocation à irriguer le champ de tout ce qui intéresse les grands donneurs d’ordre de l’industrie automobile française, de façon à ce que tous les programmes de recherche rencontrent des clients.
Leur organisation régionale, et qui couvre pratiquement l’ensemble des technologies, ne me paraît pas forcément une bonne chose : il serait plus logique qu’ils soient spécialisés par domaine et qu’ils couvrent la totalité du territoire national, voire qu’ils s’étendent au-delà, afin de mieux répondre aux défis européens et mondiaux. On pourrait, par exemple, avoir un pôle « systèmes » en Île-de-France, un pôle « matériaux métalliques » dans le grand Est et un pôle « matériaux composites » dans le grand Ouest. Cela permettrait aux pôles de disposer d’une meilleure connaissance du tissu français, et non simplement régional, et de créer un effet de masse dans un domaine donné afin de gagner en efficacité. J’ajoute que certains équipements coûtant extrêmement cher, par exemple des cabines moteur, sont actuellement dispersés un peu partout alors qu’une meilleure disposition permettrait de créer un effet de synergie.
L’objectif consistant à proposer des véhicules 2 litres/100 km n’est certainement pas dépassé, surtout si l’on précise que ces véhicules doivent être abordables.
Mme la rapporteure. Même en tant qu’horizon technologique ?
M. Gilles Le Borgne. La mise au point d’un véhicule 2 litres/100 km abordable, c’est-à-dire à moins de 15 000 euros, constitue un challenge extrêmement ambitieux. Ensuite, tout dépend du taux d’hybridation choisi, mais comme je vous l’ai expliqué, embarquer de trop grandes quantités d’énergie électrique a pour effet de faire monter les coûts dans des proportions impossibles à transférer aux clients.
L’évolution des usages est une vraie question. L’acheteur d’un véhicule neuf a 53 ans en moyenne pour ce qui nous concerne. Chaque décennie a sa mode : ainsi, il y a quelques années, l’analyse générationnelle nous conduisait à distinguer les « momos », les « bobos », les « yoyos »… En réalité, on continue à constater qu’à partir d’un certain âge, les adultes fondent une famille et ont des enfants qu’il faut bien véhiculer – et ce n’est pas le phénomène de la famille recomposée qui réduira les besoins de solutions de transport ! Il est en revanche une évolution incontestable, celle du passage de la propriété à l’usage du véhicule. C’est un élément sur lequel nous réfléchissons beaucoup, en observant notamment les pratiques de peer-to-peer qui se développent, mais il est encore un peu tôt pour en parler.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Nous vous remercions pour vos explications passionnantes et détaillées.
La séance est levée à dix-sept heures cinquante-cinq.
◊
◊ ◊
36. Audition, ouverte à la presse, de M. Raymond Lang, membre du directoire "transports et mobilités durables" de France nature environnement (FNE), de M. Jean Thévenon, pilote du réseau "transports et mobilités durables" de France nature environnement (FNE), de Mme Lorelei Limousin, responsable des politiques climat–transports du Réseau action climat France (RAC France) et de M. François Cuenot, responsable de l’ONG Transport & Environnement.
(Séance du mercredi 30 mars 2016)
La séance est ouverte à onze heures quarante-cinq.
La mission d’information a entendu M. Raymond Lang, membre du directoire "transports et mobilités durables" de France nature environnement (FNE), M. Jean Thévenon, pilote du réseau "transports et mobilités durables" de France nature environnement (FNE), Mme Lorelei Limousin, responsable des politiques climat–transports du Réseau action climat France (RAC France) et M. François Cuenot, responsable de l’ONG Transport & Environnement.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Nous recevons Mme Lorelei Limousin responsable des politiques « climat-transports » du Réseau action climat France, MM. Raymond Lang et Jean Thévenon qui animent le secteur « transports et mobilités durables » de France nature environnement (FNE), et M. François Cuenot, que nous avons déjà rencontré à Bruxelles, représentant l’ONG européenne Transport et Environnement (T&E) dont le travail est en partie à l’origine du scandale Volkswagen.
Madame, messieurs, vous appartenez à des organisations fédératives qui occupent une place importante dans certains des débats inscrits au cœur des réflexions et des interrogations de notre mission d’information.
Transport et Environnement, par exemple, a suivi de près les négociations qui se sont tenues à Bruxelles, et qui ont abouti, le 28 octobre 2015, à l’élaboration des futures normes de pollution. M. Cuenot nous précisera, notamment après l’affaire Volkswagen qui a fait réagir son organisation très rapidement, comment fonctionne la « comitologie » assez peu transparente, et qui semble plutôt réceptive aux divers lobbyings.
FNE et Réseau action climat ont également des choses à nous dire. Ces deux organisations sont membres de la commission dite « Royal », mise en place après les révélations sur le logiciel truqueur de Volkswagen. Elles ont pris l’initiative de faire connaître les premiers écarts entre les pollutions à l’échappement constatées en laboratoire et celles, manifestement plus élevées pour certains modèles, relevées sur un circuit routier. Nous souhaitons connaître ce qui les a conduits à communiquer ainsi par anticipation – ce qui a provoqué une chute des cours boursiers des entreprises concernées –, alors qu’il semblait convenu que les résultats des tests devaient demeurer secrets jusqu’au terme des travaux de la commission.
Notre mission est également intéressée par le protocole conclu entre le constructeur PSA, d’une part, et, FNE et Transport et Environnement, d’autre part, afin d’effectuer des tests réalistes dans des conditions normales de circulation.
Cette démarche animée par un souci de transparence anticipe-t-elle le futur test européen dit « RDE » – pour Real driving emissions ? La mission d’information souhaite évidemment obtenir plus de précisions sur ce sujet essentiel.
M. Raymond Lang, membre du directoire « transports et mobilités durables » de France nature environnement (FNE). Vous me permettrez, en guise d’introduction, d’évoquer la juste place de la voiture dans la mobilité de demain. Pour contribuer à la réflexion sur ce sujet, France nature environnement a publié, en septembre 2014, un petit guide, rédigé avec la fondation PSA Peugeot Citroën, Mobivia Groupe, et Keolis.
Nous vivons dans une société dominée par la voiture dont les impacts environnementaux, sociaux et sanitaires sont nombreux. Le transport automobile est une activité polluante qui ne paie pas ses externalités. La voiture individuelle est à l’origine de plus des trois quarts des émissions de gaz à effet de serre produites par le secteur des transports. Elle provoque un étalement urbain qui ne fait qu’accentuer le phénomène, et qui est la cause de l’artificialisation des sols et de la fragmentation des espaces naturels et agricoles, compromettant ainsi la fonctionnalité des écosystèmes.
Notre modèle de mobilité affecte aussi fortement la santé. Outre l’accidentologie dont la tendance baissière s’est interrompue ces dernières années, il compromet notre santé en raison des émissions de polluants, essentiellement les oxydes d’azote et les particules fines, issues de la combustion des carburants d’origine pétrolière, principalement le gazole. Ces effets en la matière ont été largement sous-estimés en raison de l’application de normes d’homologation fort éloignées de la réalité des émissions nocives, mais aussi des positions de certains membres du corps médical qui ont eu tendance à minorer les résultats d’études scientifiques. Ces émissions constituent un problème sociétal majeur que nos sociétés développées doivent régler rapidement.
Ce modèle a également des impacts sociaux. Nous observons le développement d’une mobilité subie, éloignée d’un modèle de liberté associé à la possession de biens, en vogue dans les années 1960, période de grande motorisation. La dépendance aux hydrocarbures devient de plus en plus nette, et la demande énergétique pousse à rechercher toujours plus de sources d’approvisionnement, ce qui accroît la pollution. Il serait temps de penser à utiliser d’autres moyens pour faire fonctionner les véhicules que les énergies fossiles. Même si les phénomènes de congestion semblent avoir tendance à s’atténuer dans les villes en raison de l’émergence de modes de transport doux, ils constituent toujours un problème. Il faut impérativement aller plus loin pour y mettre fin.
Le véhicule électrique a paru être une solution à privilégier dans le cadre de la transition énergétique. Cependant, les études nous montrent aujourd’hui que son empreinte écologique globale est très forte si l’on tient compte du cycle de vie intégral de tous les éléments qui le compose. La voiture électrique n’est « propre » que sur son lieu de consommation : si l’on adopte une approche globale, elle ne l’est pas davantage que les autres véhicules.
Il existe cependant un carburant plus propre. Même s’il peut être d’origine fossile, le gaz naturel est également produit de façon renouvelable et écologique. Dans ce dernier cas, l’impact de sa combustion sur l’effet de serre est quasiment nul. Cette donnée n’est pas bien prise en compte en France, alors que d’autres pays développent la carburation au gaz naturel. Je pense en particulier aux grands pays émergents comme la Chine, le Brésil, et l’Argentine où le gaz naturel est presque devenu le premier des carburants. Il faut trouver un cadre fiscal qui permette aux carburants les plus respectueux de la santé publique d’émerger dans notre pays. Certains de nos voisins, comme l’Allemagne ou l’Italie, ont déjà emprunté cette voie depuis longtemps. La France s’y était engagée en signant, en 2005, d’un « Protocole pour assurer le succès du gaz naturel véhicule (GNV) en 2010 », mais sans aboutir. Nous avons sans doute perdu une dizaine d’années ; il est temps d’envisager d’adopter un mix énergétique qui donne sa juste place au gaz naturel, c'est-à-dire au méthane.
M. Jean Thévenon, pilote du réseau « transports et mobilités durables » de France nature environnement (FNE). Pour compléter les propos de M. Lang, je dirai quelques mots sur la fiscalité.
Je rappelle que le projet de loi de finances rectificatives de 2015 a augmenté la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicable au gazole et qu’elle a réduit celle portant sur l’essence. Cette évolution nous permet de nous acheminer vers une égalité de traitement des carburants fossiles, même si je note que nous irions plus loin en introduisant un critère prenant en compte la pollution. Cela dit, les décisions que vous prenez depuis quelques années, et celles que vous comptez manifestement prendre, vont dans le bon sens.
Les entreprises récupèrent la TVA applicable aux carburants, y compris à la TICPE. Mais si pour leur consommation de gazole et de super éthanol 85 (E85) – ce dernier carburant n’étant quasiment pas utilisé en France –, elles sont remboursées à 100 % pour les véhicules utilitaires, et à 80 % pour les véhicules légers, elles ne sont pas remboursées du tout pour leur consommation d’essence. Autrement dit, notre pays, dans lequel les véhicules de société représentent une part croissante des immatriculations, oblige les entreprises à acheter des véhicules motorisés au diesel – il est clair que lorsque vous dirigez une entreprise, et que vous tenez vos comptes, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas récupérer la TVA sur les carburants. À la fin de l’année dernière, votre assemblée avait voté un amendement visant à modifier ce système ; le Gouvernement s’y est opposé. Ce levier reste essentiel pour faire évoluer la situation en matière de pollution des diesels. La fiscalité en vigueur ne permet pas aux entreprises qui le souhaiteraient d’acquérir des véhicules à essence : elle les pénalise beaucoup trop fortement. Il ne faut pas oublier que la fiscalité constitue un outil puissant qui peut favoriser un carburant. Le cas du gaz est parlant.
M. Raymond Lang. Aujourd’hui, le gaz naturel n’est pas une énergie favorisée. Pour stimuler la demande, il faudrait offrir aux utilisateurs professionnels des aides à l’acquisition des véhicules roulant au GNV ou au biogaz, qui compenseraient une partie du surcoût à l’achat de véhicules ne bénéficiant pas actuellement des prix de productions en grande série. La France ne mène pas de politique suffisamment ciblée pour développer l’usage du gaz ni, surtout, du biogaz. Le système fiscal ne devrait pourtant pas ignorer que le biogaz, essentiellement produit à partir de déchets, est un produit renouvelable et écologique. Le bioGNV n’est, aujourd’hui, pas reconnu comme un biocarburant avancé dans la réglementation française, alors même que la directive européenne sur les énergies renouvelables l’identifie bien dans cette catégorie. De ce fait, il ne peut bénéficier en France du mécanisme de soutien obligeant les distributeurs à incorporer des biocarburants dans les carburants soumis à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). France nature environnement souhaite qu’il soit mis fin à cette anomalie afin que le bioGNV puisse participer, sous une forme encore à définir, à cette obligation d’incorporation des biocarburants dans les carburants soumis à la TGAP. En effet, outre ses avantages environnementaux, il présente d’autres intérêts. Il permet d’une part, d’améliorer l’indépendance énergétique de la France, et, d’autre part de créer des emplois locaux pérennes, non délocalisables et souvent qualifiés. Il s’agit d’atouts forts à prendre en compte.
Son handicap majeur réside aujourd’hui dans son coût de production, supérieur à celui des carburants d’origine fossile. Nous proposons des mesures qui favoriseraient le gaz naturel biologique. C’est un enjeu essentiel pour le développement de notre société et pour la santé de nos enfants.
Mme Lorelei Limousin, responsable des politiques climat-transports du Réseau action climat France (RAC France). Le Réseau action climat fédère seize associations nationales comme Greenpeace, les Amis de la terre, ou le CLER, réseau pour la transition énergétique. Nous sommes membres de la fédération Transport et Environnement comme une cinquantaine d’ONG qui travaillent sur la question des transports, aux côtés notamment de France nature environnement.
Nous suivons tout particulièrement les dossiers et les réglementations européennes qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre des transports – ce secteur est le premier émetteur en France, et il n’est pas loin de l’être également en Europe.
Environ six mois après le déclenchement du scandale Volkswagen, nous sommes heureux d’avoir l’occasion d’en tirer des enseignements devant vous. Les ONG internationales, comme Transport et Environnement (T&E) ou International council on clean transportation (ICCT), avaient lancé de nombreuses alertes. En France, nous avions fait de même avec nos petits moyens. Nous dénoncions tous l’écart croissant entre les émissions réelles de CO2 et de polluants atmosphériques, et les chiffres officiels des tests d’homologation.
Cet épisode a permis de mettre à jour les failles et les lacunes du système de tests d’homologation européen. Il est frappant de constater que, sans l’agence gouvernementale américaine de l’environnement, la United States Environmental Protection Agency (EPA), l’affaire n’aurait probablement pas éclaté. Nous ne serions toujours au courant de rien. Il nous semble en conséquence utile que l’Union européenne s’inspire de modèles étrangers d’homologation, comme celui des États-Unis qui fonctionne manifestement mieux que le nôtre.
Le Réseau action climat est évidemment très attaché à la mise en place de normes et de réglementations contraignantes afin de diminuer les émissions de polluants et de CO2 des véhicules. Il faut respecter nos objectifs à l’horizon de 2020, de 2030, et au-delà, mais il faut que ces normes s’appliquent et soient véritablement effectives. Des tests en conditions réelles de conduite, les tests RDE, seront bientôt pratiqués au niveau européen pour mesurer les émissions de polluants atmosphériques. Nous connaissons maintenant leur pertinence : ils pourront nous fournir des données qui se rapprocheront davantage de la réalité que celles dont nous disposions jusqu’à maintenant. Malheureusement, ces tests ne seront pas mis en place pour contrôler les émissions de CO2, dont nous savons qu’elles sont beaucoup plus élevées que les valeurs d’homologation recueillies en laboratoire. Sachant combien la mise en place de ces tests est longue et complexe, nous préconisons de commencer dès aujourd’hui à nous acheminer vers leur généralisation à l’ensemble des émissions polluantes. M. François Cuenot pourra faire un point sur ce sujet tel qu’il est traité dans le cadre du partenariat avec PSA.
Au-delà de la mise en œuvre du nouveau cycle de conduite automobile WLTC, du protocole WLTP, pour Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures, et du test RDE portant sur les NOx, il nous semble essentiel de procéder à une refonte du système de tests d’homologation. La Commission européenne a présenté, le 27 janvier dernier, une proposition en ce sens. Nous la saluons, même si elle n’est pas parfaite. Elle permettra de mettre en place un système de tests plus fiable et plus indépendant, qui responsabilisera davantage les services techniques et administratifs.
Vous connaissez les biais du système de tests en vigueur. Ils tiennent notamment aux liens financiers qui unissent les laboratoires et les constructeurs, à l’absence totale de tests de conformité sur les véhicules en circulation, et à celle d’un contrôle indépendant effectué par des autorités nationales d’homologation. La Commission propose en conséquence de procéder elle-même à des contrôles a posteriori sur des véhicules déjà en circulation, mais aussi de se donner la possibilité, en cas de non-conformité aux valeurs d’homologation, d’imposer des amendes pouvant aller jusqu’à 30 000 euros par véhicule à l’encontre des services techniques auxquels sont délégués les tests, mais aussi des constructeurs.
Les propositions de la Commission visent à rendre les services techniques d’homologation plus responsables et plus indépendants. Les frais versés par les constructeurs pour l’homologation seront centralisés par les autorités nationales. Ainsi, la présence d’un intermédiaire garantira une plus grande indépendance. Les services techniques seront aussi soumis à des normes plus exigeantes, et ils seront audités régulièrement. En revanche, nous regrettons que la Commission n’ait pas choisi d’imposer des contrôles et des audits aux autorités nationales d'homologation : elles ne seraient soumises qu’à un examen par les pairs au sein d’un forum.
Les autorités nationales et la Commission européenne devront effectuer des tests supplémentaires sur les véhicules déjà sur le marché et en circulation. S’ils ne sont pas concluants, les véhicules pourront être retirés du marché par la Commission et par les États membres.
La Commission pourra surveiller le marché elle-même par l’intermédiaire de son centre de recherche, le Joint research center. Dans ce cadre, les constructeurs seront tenus de présenter les logiciels embarqués – j’avoue que j’ignore si cela permettra d’éviter l’usage de logiciels fraudeurs.
Selon nous, la proposition de la Commission européenne doit être renforcée à trois niveaux.
La Commission devrait exercer une surveillance accrue des autorités nationales d’homologation. Il faudrait qu’elle ait accès au certificat des véhicules et qu’elle puisse tester à nouveau des modèles qui l’ont déjà été. Si elle constate des lacunes dans le travail des agences nationales, nous suggérons, avec T&E, qu’elle leur retire le droit de certifier des véhicules.
Afin de rompre véritablement le lien financier entre les constructeurs, les services techniques, et les services administratifs, le système d’homologation et les tests de la Commission européenne pourraient être financés par une taxe prélevée sur les ventes de véhicules par les constructeurs, qui serait versée à un fonds dédié.
Nous pensons que les tests a posteriori sur les véhicules en circulation devraient être obligatoires. Il ne suffit pas d’affirmer que les autorités nationales d’homologation ont la possibilité de les effectuer ; elles devraient obligatoirement tester un nombre minimal de nouveaux modèles tous les ans, et il faudrait aussi prévoir des tests supplémentaires après un certain nombre de kilomètres parcourus. Ces tests utiliseraient le protocole RDE bientôt disponible.
Évidemment, l’accès à toutes les informations liées à la certification des véhicules devra être libre. Les autorités nationales d’homologation doivent pouvoir échanger de l’information, mais, idéalement, celle-ci devrait être publique.
J’ai pris de temps de présenter nos préconisations car le débat européen commence à peine. La Commission vient de présenter sa proposition, le Parlement se prépare à se saisir du sujet, et l’on imagine que le sujet donnera lieu à une âpre bataille au sein du Conseil !
Il ne faut pas manquer l’opportunité qui se présente à nous de mettre en place un système de vérification et de contrôle des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques par les véhicules.
En matière de réglementations et de normes, il nous faut s’interroger sur l’après 2020. Une norme d’émission de CO2 s’applique jusqu’en 2021, et l’on sait que la norme Euro 6 ne sera pas respectée après 2020 puisque les autorités européennes ont approuvé un facteur de conformité – les émissions de NOx pourront dépasser la norme de 50 %. Il nous semble en conséquence essentiel de mettre en place, après 2020, des réglementations plus ambitieuses dans le cadre du paquet énergie-climat 2030.
Pour que l’objectif de 40 % de réduction des gaz à effet de serre soit atteint à cette date, il faut fixer au secteur des transports un objectif ambitieux qui ne sera atteint que si des réglementations sont mises en place avant cette échéance. Nous recommandons en conséquence de prévoir un objectif d’émission de CO2 par kilomètre pour 2025 pour les véhicules légers afin de laisser aux constructeurs le temps nécessaire pour sortir de nouveaux modèles.
La stratégie nationale bas-carbone qui découle de la loi relative à la transition énergétique et à la croissance verte prévoit la généralisation des véhicules consommant 2 litres aux 100 kilomètres d’ici à 2030 pour les véhicules neufs, ce qui équivaut peu ou prou à une émission de 50 grammes de CO2 par kilomètre. La mise en place d’un objectif 2025 au niveau européen se situe dans le prolongement de nos objectifs nationaux de développement de véhicules à plus faible émission d’ici à 2030. Ce sujet sera notamment à l’ordre du jour du conseil informel des ministres des transports de l’Union européenne, au mois d’avril prochain. Nous espérons qu’il fera l’objet d’une communication de la Commission européenne en juillet 2016.
M. François Cuenot, représentant l’ONG européenne Transport et Environnement (T&E). J’ai entendu le président du directoire de Volkswagen France s’exprimer devant votre mission d’information, le 9 février dernier. Il indiquait clairement que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Selon lui, en Europe, Volkswagen n’était pas coupable d’avoir utilisé des logiciels truqueurs – defeat devices. Le constructeur a pourtant reconnu les faits s’agissant des mêmes moteurs, des mêmes instruments, et des mêmes logiciels aux États-Unis.
Cette différence de posture pourrait s’expliquer par l’écart entre le droit européen et le droit américain. Le contexte légal aux États-Unis est pourtant très proche de celui de l’Union européenne : les définitions du système d’invalidation sont identiques, et les exemptions sont les mêmes. La seule nuance notable repose sur le fait que, aux États-Unis, lors de la demande d’homologation, il y a obligation de déclarer l’utilisation de systèmes d’invalidation. Volkswagen s’appuie sur ce point, mais les choses ne sont pas claires.
En effet, si, en Europe, on considère que l’utilisation de ces systèmes est interdite, rien ne précise si leur usage peut être déclaré, auprès de qui il faut le faire, ou qui est responsable. L’ONG International Council on Clean Transportation (ICCT) a publié la semaine dernière, une note qui compare le cadre légal aux États-Unis et en Europe.
L’Office fédéral allemand de régulation du secteur automobile, le Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), a cependant exigé que les véhicules Volkswagen soient remis en condition en Europe, ce que le constructeur fait de façon « volontaire » puisqu’il ne reconnaît pas s’être placé dans l’illégalité. Il y a une sorte de flou en Europe : je suppose que plusieurs actions légales seront entamées, des ONG y travaillent. Nous en faisons partie, car il importe de savoir si Volkswagen ou d’autres constructeurs se sont placés dans l’illégalité.
La plupart des constructeurs entendus par la commission Royal, au sein de laquelle je siège au nom du RAC, indiquent que leur système de contrôle d’émissions, en particulier la vanne dite EGR – pour Exhaust gas recirculation, recirculation des gaz d’échappement –, cesse de fonctionner, ou fonctionne seulement, dans des conditions très strictes de température. Pourtant la réglementation européenne prévoit clairement que les constructeurs doivent donner des détails sur la stratégie de fonctionnement des systèmes EGR en incluant des informations sur l’utilisation à basse température. À ce jour, les autorités françaises n’ont pas fourni de détails sur les éléments dont elles disposaient avant que n'éclate l’affaire Volkswagen ; nous devrions aborder ce sujet lors de la prochaine réunion de la commission. Cette question importante touche directement au moins un constructeur français.
Pour en venir à la « comitologie », l’affaire Volkswagen a provoqué des réactions différentes de la part de la Commission européenne, des États membres, et des ONG.
La Commission a bien mesuré l’ampleur du problème : elle rédige actuellement des textes aux ambitions plus grandes que par le passé.
Le 28 octobre dernier, à Bruxelles, se trouvait ainsi sur la table une proposition relative aux tests d’émissions de gaz polluants effectués selon la procédure RDE, incluant des facteurs de conformité plutôt ambitieux de 1,6 à court terme et de 1,2 à moyen terme. Cependant, les États membres se sont retranchés derrière une ligne business as usual – certains d’entre eux restent sous l’emprise des constructeurs automobiles. Ils ont affaibli ces facteurs de conformité qui sont passés respectivement à 2,1 et 1,5, ce qui se révèle assez peu ambitieux après le scandale Volkswagen. Nous le déplorons.
De la même façon, s’agissant de la procédure d’homologation, la Commission a mis sur la table une proposition assez ambitieuse. Nous verrons quelle attitude adopteront les pays membres. Il semble que la France s’apprête à suivre la Commission et qu’elle comprenne que pour gagner en crédibilité, il faut un système robuste.
Paradoxalement, l’affaire Volkswagen a rendu la tâche des ONG européennes plus complexe. Il est en effet aujourd’hui plus difficile qu’hier d’obtenir des informations de façon informelles en raison de l’exposition médiatique très forte des sujets en question.
Vous m’avez aussi interrogé sur la collaboration de FNE et de Transport et Environnement avec PSA. Notre objectif est double. Nous voulons augmenter la transparence, et donner des valeurs plus crédibles aux consommateurs sur la consommation de leur véhicule dans la réalité. Nous définissons un nouveau protocole, robuste, représentatif et reproductible, qui reste à développer.
Nous pensons qu’il est possible d’influencer les prochaines politiques européennes, notamment pour ce qui concerne l’après 2020-2021, avec l’objectif de 95 grammes de CO2 au kilomètre, ou l’application des tests RDE aux mesures de pollution de l’air. Certains éléments en développement dans le cadre de la mise en place de la procédure RDE se trouvent déjà dans le protocole en cours avec PSA, comme le démarrage à froid, ou l’impact de la régénération du filtre à particules. Nous espérons que le législateur européen profitera de nos travaux.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Que pouvez-vous nous dire les uns ou les autres des réactions et des stratégies des États membres après l’affaire Volkswagen ? Nous savons que la France compte deux fois plus de consommateurs concernés par les véhicules équipés de logiciels truqueurs que les États-Unis. Un règlement européen proscrit très clairement les dispositifs d’invalidation, mais il semble qu’il subsiste un problème d’interprétation juridique. Il n’y a eu, en Europe, aucun retrait d’homologation.
Qu’en est-il du dispositif proposé par Volkswagen pour traiter les véhicules équipés du logiciel truqueur ?
Pouvez-vous nous parler de la commission Royal ?
Vous avez évoqué les propositions de la Commission européenne visant à mettre en place un nouveau cadre. Sur ce sujet, une prise de décision rapide est-elle opportune selon vous, ou serait-il plus judicieux d’attendre que les investigations en cours aillent à leur terme, notamment celles de la commission d’enquête parlementaire européenne portant sur l’affaire Volkswagen ?
Vous avez fait référence au modèle américain. Il ne s’agit pas d’une légère variante du modèle européen qui permettrait de contrôler des véhicules en circulation. Nous avons en effet constaté lors de nos travaux que, pour ce qui concerne la partie qui relève des États membres de l’Union européenne, l’homologation ne faisait l’objet que d’un contrôle purement formel et administratif et d’aucun contrôle réel. Pensez-vous qu’il faille aller vers une réforme en profondeur des organismes chargés de l’homologation en prévoyant une phase ultérieure de contrôle sur les véhicules en circulation ? Faudrait-il plutôt faire prévaloir une autre logique s’inspirant davantage du modèle américain qui prône un self-control des constructeurs – les bancs d’homologation se trouvent sur leurs sites ? Cette dernière solution, assortie de systèmes de certification, ne constituerait pas une énorme réforme de l’homologation, en revanche, il faudrait l’accompagner d’un dispositif lourd de contrôle de la conformité par rapport à l’homologation initiale des véhicules en circulation, ainsi que de sanctions extrêmement fortes. Aujourd’hui, les sanctions notifiées par la France à la Commission dans le cadre du règlement européen sont absolument ridicules au regard des préjudices.
Êtes-vous favorables à la neutralité technologique pour le contenu des normes ? La puissance publique européenne ou nationale doit-elle édicter des normes générales s’appliquant à toutes les voitures en circulation – un taux maximal d’émission pour le CO2, un autre pour le NOx, un autre pour les particules fines… – et laisser au constructeur le choix des technologies qui lui permettront de les respecter ?
Êtes-vous cependant d’accord avec les constructeurs qui affirment avoir besoin de prévisibilité pour mettre en place de nouvelles normes ? Ils estiment qu’il faut prévoir une durée minimale entre l’énoncé d’une norme et son entrée en vigueur. En 2020, il faudrait pouvoir connaître la norme applicable en 2025, et avoir une idée de ce que sera la norme 2030.
Les constructeurs considèrent que le diesel reste incontournable pour atteindre les objectifs fixés en matière d’émission de CO2. Ils indiquent que les nouveaux diesels Euro 6 n’ont pas les mêmes facteurs d’émission de polluants que ceux qui roulaient avant les filtres à particules. Estimez-vous qu’il faut interdire le diesel, ou vous contentez-vous de demander le respect d’une norme sans tenir compte de la technologie utilisée ? Je reviens en quelque sorte à ma question sur la neutralité technologique.
M. Gérard Menuel. Vous avez les uns et les autres des positions bien arrêtées. Vous les exprimez avec assez peu de nuances, mais cela permet d’aller au fond des choses.
Vous souhaitez que la fiscalité du biogaz évolue à l’instar de ce qui existe déjà s’agissant de cette source d’énergie pour les réseaux de chaleur. Il n’en demeure pas moins que l’installation de méthaniseurs pose des problèmes très complexes dans notre pays : les associations environnementales s’y opposent souvent dans de nombreuses parties du territoire.
Vous avez traité rapidement du carburant E85. Il n’est faiblement utilisé que parce que l’on ne compte en France que trois cents points de distribution en France. Que pensez-vous de son impact sur l’environnement ? De façon plus générale, quelle est votre position sur les biocarburants ? Elle était très affirmée dans le passé ; est-ce toujours le cas s’agissant en particulier de l’éthanol ?
Je vois un certain paradoxe dans le fait que vous collaboriez avec le principal promoteur du diesel en France et en Europe – PSA connaît en la matière des succès indéniables tant sur le plan commercial que sur celui de la protection de l’environnement.
M. Denis Baupin. Vous êtes des observateurs de longue date de tout ce qui concerne l’automobile. Vous paraît-il crédible que personne n’ait été au courant du trucage de logiciel par Volkswagen ?
Monsieur Cuenot, dans le travail effectué avec PSA, quelles émissions de polluants mesurez-vous aujourd’hui ? Qu’en sera-t-il demain – je pense aux NOx ou aux particules secondaires ?
Lorsque, du fait de cette collaboration, nous disposerons des chiffres en circulation presque réelle, vous paraîtra-t-il légitime que les constructeurs continuent de mettre en avant d’autres données dans leur publicité ?
Au-delà de la neutralité technologique sur laquelle vous avez été interrogés par notre rapporteure, êtes-vous favorables à la neutralité fiscale – au moins à une fiscalité qui inciterait à aller vers les véhicules les moins polluants ?
L’homologation des véhicules par une agence européenne plutôt que par des agences nationales peut-elle constituer une solution ?
M. Christophe Premat. Les logiciels embarqués peuvent permettre d’améliorer les émissions polluantes. En Europe du Nord, où l’on travaille beaucoup sur l’intermodalité et les flux de circulation, les constructeurs bénéficient d’une capacité de prescription à partir des informations fournies par ces dispositifs. Je m’interroge toutefois sur le moyen de contrôler les logiciels, car il existe entre les constructeurs une véritable concurrence en termes de services numériques. Nous avons évoqué la neutralité technologique, êtes-vous favorables à la neutralité de l’outil numérique ? Que pensez-vous de tout ce qui concerne l’intelligence embarquée et de la dépendance qu’elle induit par rapport aux logiciels ?
Comme M. Baupin, je m’interroge sur le rôle que pourrait tenir une agence européenne en matière d’homologation et de contrôle de la pollution. On parle beaucoup des agences nationales, mais encore faut-il leur donner les moyens de fonctionner correctement.
La récupération des données, telle qu’elle se pratique en Suède ou au Danemark, permet aussi de répartir les coûts entre les utilisateurs des véhicules en circulation, par exemple pour les voitures de plus de six ans, afin d’éviter qu’ils se reportent uniquement sur les constructeurs, mais aussi pour améliorer les performances environnementales. Qu’en pensez-vous ?
M. François Cuenot. Madame la rapporteure, nous avons observé deux types de réactions du côté des États membres après que l’affaire Volkswagen a éclaté. En France et en Allemagne, des décisions similaires ont visé à mettre en place des commissions d’investigation avec des campagnes d’essais assez détaillées. Les deux approches sont toutefois différentes puisqu’en France les membres de la commission Royal forment un panel qui représente assez bien tous les interlocuteurs, parmi lesquels le RAC, FNE ou encore M. Denis Baupin. Les résultats constatés ne devaient pas être diffusés avant la finalisation des essais, mais cela n’a pas été le cas. En tout état de cause, ces résultats sont fournis aux constructeurs impliqués. Le ministère les rencontre avant de faire part des données à la commission, ce qui est tout de même assez surprenant !
En Allemagne les choses sont encore plus obscures : le ministère procède à des essais, mais les acteurs impliqués sont très peu nombreux. Il n’y a quasiment pas eu de fuite – il semble qu’un mail a été envoyé « par erreur » à Greenpeace. (Sourires.) La France travaille correctement avec le KBA sur ces tests.
La Commission européenne a encouragé les États membres à mener des investigations sans trop s’impliquer elle-même sur ce dossier. L’Espagne, le Royaume-Uni et quelques autres ont annoncé avoir effectué des tests, sans donner davantage de détails. Ils ont conclu que tout était normal. Je l’ai dit, la majorité des États membres reste sous l’influence assez forte des constructeurs, en particulier les pays d’Europe du Sud et de l’Est soumis à un chantage à l’emploi.
Faut-il attendre les résultats de la commission d’enquête du Parlement européen pour mettre en place de la réforme de l’homologation de la Commission ? S’agissant de dispositions qui relèvent de la procédure de codécision, je ne pense pas que le Parlement vote quoi que ce soit avant d’avoir achevé ses propres travaux.
Vous évoquiez le modèle américain qui ne fait pas intervenir les autorités avant la mise sur le marché du véhicule. Nous proposons de prendre le meilleur des deux mondes en conservant les agences d’homologation nationales qui effectuent les tests avant la mise sur le marché, et en instaurant un contrôle plus rigoureux des véhicules en circulation par la Commission européenne – elle jouerait en quelque sorte le rôle de l’agence américaine EPA. Le cas des liquides réfrigérants de climatisation de Mercedes a été cité devant votre mission d’information : rien n’incite une agence nationale d’homologation à retirer l’homologation qu’elle a elle-même donnée. Elle se tirerait une balle dans le pied ! Ce pouvoir et celui d’imposer des sanctions devraient revenir à une agence européenne ou aux autorités d’un autre pays membre.
Pour ne pas créer de nouvelle agence, la Commission et les autorités européennes suggèrent que ces contrôles soient effectués par le Joint research center (JRC), même s’il ne s’agit pas aujourd’hui de sa mission première. Dans les faits, on créerait une nouvelle agence sans le dire, car il faudra bien attribuer au JRC des moyens supplémentaires.
T&E reste partisan de la neutralité technologique s’agissant des énergies fossiles mais, l’année dernière, notre fédération a rompu avec ce paradigme en matière fiscale au profit du véhicule électrique – sur ce point nous ne sommes pas toujours en accord avec tous nos membres, en particulier les membres français. T&E estime désormais que la neutralité technologique ne permet pas d’accélérer suffisamment l’introduction sur le marché du véhicule électrique. Nous avons mis en place une plateforme d’électromobilité, et nous sommes favorables à un favoritisme au moins fiscal en la matière, à condition qu’il s’accompagne de dispositifs favorables à la mobilité partagée ou à la production d’électricité propre. Nous sommes tous conscients qu’il n’y aura pas de véhicule électrique propre sans électricité propre. Il a fallu une dizaine d’années pour que le véhicule hybride représente 1 % du marché européen sans changement réel de l’utilisation du véhicule. La voiture électrique représente à mon sens le meilleur moyen d’atteindre la mobilité zéro carbone – le biométhane me semble limité en termes de ressources. Nous devons prendre des mesures spécifiques si nous voulons qu’elle se répande rapidement. Il est clair qu’il faut maintenir une neutralité au regard des seuils d’émissions, mais nous estimons que ce n’est probablement pas le cas s’agissant de la fiscalité. Il n’est pas facile de faire un choix en matière technologique : T&E a fait celui de la mobilité électrique.
Le diesel est-il indispensable pour réduire les émissions de CO2 ? Certains pays comme le Japon ont imposé des normes aussi ambitieuses que l’Europe alors que le diesel ne représente que 1 ou 2 % de leur parc automobile. La solution, au Japon, passe plutôt par les petits véhicules – avec les moteurs de 800 cm3 – et par l’hybridation. Pour atteindre des normes de CO2 ambitieuses, le diesel n’est donc pas indispensable.
Monsieur Baupin, vous nous demandez si quelqu’un savait avant que n’éclate l’affaire Volkswagen ? Disons que nous avions de fortes suspicions. Lorsque la norme est dépassée de dix ou vingt fois, cela suscite des questions, mais comment prouver quoi que ce soit ? Je vous conseille la vidéo d’un hacker qui a regardé dans le calculateur d’un Volkswagen Sharan. À mon avis, les autorités n’étaient pas au courant, mais elles n’étaient pas dupes. Cela ne serait pas aisé à démontrer, et le soupçon est facile.
Le lien est fait avec la question posée par M. Premat sur le contrôle des logiciels. Il est vrai qu’aujourd’hui, tous les éléments physiques d’un véhicule sont homologués, jusqu’à la dernière ampoule, alors que personne ne regarde jamais les calculateurs. Il n’y a aucune raison de ne pas homologuer aussi les logiciels – c’est un peu ce que font les États-Unis en obligeant les constructeurs à déclarer les stratégies de contrôle d’émissions. Sachant que tout passe par l’électronique, nous ne pourrons plus longtemps éviter de regarder les codes des logiciels et la programmation des véhicules.
Le portable emissions measurement system (PEMS), système de mesure des émissions de CO2 embarqué sur le véhicule en est encore aujourd’hui au stade de l’expérimentation ; des progrès restent à accomplir en la matière. Nous ne sommes pas parvenus à nous accorder avec PSA sur la publication immédiate d’autres résultats. En 2017, des données seront fournies sur le NOx puis, dès que l’équipement en développement dans le troisième paquet RDE sera disponible, celles relatives aux particules fines seront présentées. Nous publierons les valeurs d’émissions de NOx dès que sortiront les véhicules PSA compatibles avec la procédure RDE, avec un protocole qui sera, je l’espère, plus exigeant que le protocole officiel européen RDE.
Pour revenir au contrôle des logiciels, nous avons des chances de voir émerger le monitoring des émissions en temps réel. Nous disposons aujourd’hui de systèmes embarqués qui permettent de connaître les émissions d’un véhicule en temps réel. Ils restent aujourd’hui largement sous le contrôle des constructeurs qui ne donnent accès qu’aux informations qu’ils souhaitent diffuser. Il faut donc rester très prudent et espérer la mise en place de systèmes plus ouverts avec des logiciels interchangeables entre constructeurs – même si cela fait courir un risque en termes de piratage.
M. Raymond Lang. Personnellement, je crois que les États savaient que les normes n’étaient pas respectées. Une sorte de connivence prévalait à ce sujet entre ces derniers et les constructeurs. Je crois savoir que des alertes ont été émises sur les dépassements de valeurs d’émissions sans que cela ne fasse réagir les acteurs concernés. L’affaire Volkswagen a eu l’avantage de faire savoir à l’opinion publique que ni les États ni les constructeurs n’avaient vraiment pris soin de la qualité de l’air.
Le système comporte de graves failles. Tout d’abord, des normes ont été édictées sans que l’on sache comment les mesurer dans les conditions réelles. Ensuite, une fois que le véhicule est homologué, il ne fait plus vraiment l’objet de contrôles, et le constructeur sait qu’il n'est quasiment plus responsable de rien. Dans le prochain règlement européen, la responsabilité du constructeur devra être engagée pour la durée normale d’utilisation du véhicule dans des conditions normales. Ce qui est valable pour d’autres biens devrait l’être également pour l’automobile.
Il reste beaucoup de progrès à accomplir car nous ne mesurons pas bien aujourd’hui les émissions des principaux polluants. Nous avons vu avec PSA ce qu’il en est de la mesure du NOx, quant à celle des particules fines, elle n’est pas maîtrisée.
Cela me permet de souligner qu’il existe un carburant qui ne produit pas de particules fines : le gaz naturel. Le méthane, CH4, est le plus léger et le plus simple des hydrocarbures dont la combustion n’émet quasiment pas d’imbrûlés. Autrement dit, en utilisant du gaz, il est possible de supprimer l’une des pollutions majeures, celle qui sera peut-être la plus difficile à maîtriser. Je rappelle que les nanoparticules pénètrent les tissus pulmonaires, passent dans le sang, et se retrouvent dans le cerveau.
La mesure de la pollution et celle du danger réel que représentent les particules fines constituent des enjeux majeurs qui nécessitent un travail très lourd en termes de développement. Certes le diesel permet de faire des progrès en termes d’émissions de CO2, ce qui a son importance pour l’évolution du climat, mais la première urgence consiste tout de même à parvenir à éliminer correctement les particules fines, et, que je sache, nous n’y parviendrons pas avec les moteurs diesels ! Il faut faire des choix : soit nous parvenons à maîtriser les émissions de NOx, et nous absorberons davantage de particules fines, soit nous tentons d’éliminer les particules fines. Le problème est complexe.
C’est la raison pour laquelle je plaide pour une neutralité technique – la norme Euro 6c prévoit déjà de ne pas faire de distinctions selon les carburants utilisés. L’impact d’un véhicule sur notre environnement doit être analysé « du puits à la roue ». Il faut que chaque élément qui compose chaque partie du véhicule, par exemple ses batteries, soit pris en compte. Cette approche fondera la neutralité qui s’imposera pour savoir si, globalement, un système est acceptable pour l’environnement, la santé publique, et le changement climatique. Il n’y a aucune raison de faire une différence entre les divers moteurs. Je crois que nous aurons à terme un mix énergétique. Même si je suis partisan du développement du gaz naturel, en particulier sous sa forme renouvelable et écologique, je considère que le véhicule électrique a aussi sa place sur le marché. Toutefois, son usage est aujourd’hui limité aux courtes distances et aux zones urbaines où la suppression des émissions et la diminution des bruits sont essentielles – ce serait autre chose sur des grandes distances car il faudrait engager des coûts énormes.
Le diesel ne m’apparaît pas être un élément incontournable pour lutter contre les émissions de CO2.
La proposition de règlement européen comporte beaucoup de bonnes choses. Je pense qu’à un moment ou un autre, nous devrons en passer par la création d’une agence européenne. Des agences européennes se sont créées dans d’autres secteurs…
Mme Delphine Batho, rapporteure. Ce ne sont pas nécessairement des réussites !
M. Raymond Lang. Ce qui s’est produit en la matière dans le domaine ferroviaire a tout de même constitué un progrès…
Mme Delphine Batho, rapporteure. Est-ce vraiment un modèle ?
M. Raymond Lang. Au niveau national ou européen, il est surtout essentiel qu’il y ait une séparation claire entre le responsable de l’analyse technique des données et celui qui procède à l’homologation. Ce dernier doit par ailleurs être en mesure de contrôler le travail de l’entité technique. La mise en place d’une agence européenne me semble se situer dans la logique de la construction européenne mais, en attendant, et cela pourrait être long, les agences nationales peuvent parfaitement jouer leur rôle.
Notre position est assez claire concernant les biocarburants de première génération. Ils sont renouvelables, mais ils ne peuvent être considérés comme des carburants écologiques. J’estime que l’on fait presque systématiquement une erreur grossière de mesure lorsque l’on mise sur des carburants obtenus à partir de cultures dédiées, car leur empreinte écologique est lourde. La production de ce type de carburant ne peut être envisagée qu’à partir de cultures intermédiaires.
Pour permettre le développement du biogaz, il serait judicieux de mettre en place des certificats d'origine qu’il faudrait valoriser. Les distributeurs de carburants classiques achèteraient ces certificats afin d’éviter de payer des pénalités. Une fois valorisé, le biométhane renouvelable et écologique trouverait les voies de son développement. Il faudra imposer qu’il soit injecté dans le méthane d’origine fossile et, progressivement, il se substituera à ce dernier. Ce développement peut être relativement rapide.
Je reconnais qu’il faut prendre toutes les précautions nécessaires lors de la construction de méthaniseurs. J’en ai visité plusieurs sans constater de gros problèmes. Je ne nie pas que des problèmes se posent sur d’autres sites, car il n’est pas si simple de produire du méthane. Cependant, cela ne doit pas nous dissuader de laisser grandir cette filière en gestation. Toutes les précautions doivent être prises, mais il s’agit de l’une des voies qui permettra à la France de trouver son indépendance énergétique. Notre pays dispose en effet de la biomasse nécessaire à la production d’un carburant naturellement propre qui pourra nous faire rouler tous – sur ce point, je suis en désaccord avec M. Cuenot, d’autant que je crois que nous devrons réduire la mobilité automobile.
J’ai été surpris de constater que des chiffres sortaient de la commission Royal alors que l’on nous avait demandé de rester discrets. Aucun de ses membres ne s’est exprimé. C’est la ministre qui a abordé le sujet au début du mois de novembre…
Mme Delphine Batho, rapporteure. Ségolène Royal a seulement annoncé le 14 janvier qu’il n’y avait pas de logiciel de fraude…
M. Raymond Lang. Peut-être son propos était-il limité. Il reste que, logiciel fraudeur ou pas, le comportement des constructeurs est identique : ils s’ingénient à présenter des véhicules qui passent les tests sans tenir compte de la pollution émise en conditions de circulation réelles. Cela démontre que les tests étaient insuffisamment proches de la réalité et qu’ils ne servaient pas à grand-chose. Si nous voulons vraiment améliorer la qualité de l’air, il faut intégralement revoir la méthode d’homologation et, surtout, engager la responsabilité des constructeurs sur le long terme. Elle ne peut pas s’évanouir après la mise sur le marché des véhicules : si les règles d’entretien sont observées, les normes d’émissions de substances polluantes doivent être respectées durant une durée normale d’utilisation.
Mme Lorelei Limousin. Nous avons salué la création par la France d’une commission indépendante en réaction à l’affaire Volkswagen, tout comme le fait que nous puissions y participer, ainsi que l’extension des tests aux émissions de CO2 – les écarts très importants entre les valeurs d’homologation et les résultats des tests effectués par l’Union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) pour la commission montrent que nous avons eu raison de faire cette demande.
Le retrait d’homologation aurait constitué une sorte de double peine pour les consommateurs. Non seulement ils auraient pâti des mensonges des constructeurs sur la consommation de carburant et souffert de la pollution de l’air, mais on leur aurait aussi retiré leur véhicule. Pour autant le travail entamé par la commission Royal montre que les choses ne sont pas encore parfaitement claires, notamment sur le plan légal et juridique. La directive européenne semble permettre l’utilisation de logiciels servant à désactiver les dispositifs de dépollution…
Mme Delphine Batho, rapporteure. Il ne s’agit pas de permettre une tromperie au moment de l’homologation !
Mme Lorelei Limousin. Effectivement, mais cela permet aux émissions d’être largement supérieures à celles enregistrées lors des tests si le système de dépollution porte atteinte…
Mme Delphine Batho, rapporteure. Il ne faut pas faire de confusion entre deux différents débats. L’écart entre le cycle d’homologation et la réalité renvoie au fait que les dispositifs de traitement des émissions polluantes sont calés pour être actifs au niveau des points de fonctionnement du moteur qui sont ceux du cycle. C’est une tout autre affaire de mettre au point un logiciel truqueur qui détecte le fait que l’on se trouve en phase de test et qui induit alors un fonctionnement spécifique. Les choses sont juridiquement différentes.
M. François Cuenot. Moi, je ne vois pas de différence. Si l’on ne fait fonctionner le moteur de façon convenable que sur les points d’observation du cycle d’homologation, cela signifie que l’on détecte le cycle.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Pas du tout !
M. Raymond Lang. Je ne vois pas non plus la différence ! Dans un cas le constructeur prépare son véhicule pour qu’il réponde aux conditions spécifiques du test ; dans l’autre, le constructeur programme un logiciel pour qu’il identifie les conditions de test et qu’il modifie en conséquence les performances du véhicule.
Mme Lorelei Limousin. Renault considère qu’il n’est pas illégal que son EGR ne fonctionne qu’entre 17 et 35 degrés Celsius en s’appuyant sur la directive européenne qui interdit les logiciels truqueurs mais qui permet la désactivation des dispositifs lorsqu’ils portent atteinte à la sécurité du moteur.
M. François Cuenot. Il s’agit de choix stratégiques des constructeurs. En arguant de problèmes de fiabilité de ses moteurs, Renault affirme que son EGR ne fonctionne plus sous 17 °C, alors que BMW annonce se retrouver dans un cas similaire à partir de 10 °C. Pourquoi les EGR des véhicules Renault sont-ils désactivés entre 10 et 17 °C alors qu’ils fonctionnent sur les BMW ?
Mme Lorelei Limousin. Renault a annoncé pour la fin mars un nouveau plan d’action pour étendre la plage de fonctionnement de son EGR. Cela montre bien que le constructeur avait auparavant les moyens de mettre en place un système de dépollution qui fonctionne de façon plus fréquente.
M. François Cuenot. Le moteur qui fonctionne selon les conditions du cycle d’homologation à un point donné pourrait parfaitement fonctionner dans les mêmes conditions à d’autres points.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Ce que j’entends me semble empreint d’une grande confusion alors qu’il s’agit d’un point important.
Il faut distinguer la tricherie qui utilise un logiciel truqueur d’un autre problème qu’il ne s’agit pas de minorer : les constructeurs ne respectent que littéralement les obligations qui leur sont faites, ils ne se conforment qu’à ce qui est précisément écrit en utilisant tous les paramètres prévus pour se libérer des contraintes qui leur sont imposées. Si le cycle prévoit une mesure à une température donnée, certains systèmes ne fonctionneront qu’à cette seule température. Si les émissions de NOx sont mesurées à des points donnés de fonctionnement moteur, la réduction catalytique sélective ne va fonctionner que dans ces cas de figure. Les constructeurs sont en permanence au plancher des exigences de la réglementation – qui peut, il est vrai, donner parfois lieu à des débats légitimes d’interprétation.
Selon moi, il existe une différence de nature entre ce qui a été découvert avec le scandale Volkswagen, et les disparités constatées entre les résultats des tests d’homologation et ceux de tests effectués en conditions réelles de conduite. Je me permets de reprendre la comparaison que vient de me souffler notre présidente : c’est la différence entre la fraude fiscale et l’optimisation fiscale.
M. Raymond Lang. C’est un peu un poncif, mais nous pourrions dire que Volkswagen a travaillé « à l’allemande » en mettant en place un système de détection de l’homologation alors que les autres constructeurs n’ont fait que se préparer aux tests. Les choses peuvent être juridiquement différentes, l’une est interdite et l’autre ne l’est pas, mais le résultat est le même : les constructeurs mettent sur le marché des véhicules qui ne respectent pas des normes.
Ces normes ne correspondent pas à la réalité me direz-vous. Il est vrai que nous devons parvenir à établir un lien entre les tests et les mesures sur route – ces dernières pourront toujours être contestées car on ne se baigne jamais dans le même fleuve. Un travail statistique pourrait cependant permettre de se situer dans des valeurs acceptables, entre les essais sur banc, qui sont reproductibles, et les essais sur route, qui ne le sont pas. J’imagine que l’on peut comprendre que les constructeurs soient réticents à s’engager sur des valeurs non reproductibles. Évidemment pour ma part, je préfère que les tests correspondent à des conditions réelles de circulation.
M. François Cuenot. La définition du système d’invalidation est très claire dans la réglementation européenne qui évoque « tout élément de conception qui détecte la température, la vitesse du véhicule, le régime du moteur en tours/minute, la transmission, une dépression ou tout autre paramètre aux fins d'activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement de toute partie du système de contrôle des émissions ».
Le dispositif de Renault qui désactive l’EGR sous 17 °C est bien un système d’invalidation. Il est mis en place en raison de problèmes de fiabilité ; disons que c’est un peu un détournement du sens des textes. Mais, que l’on utilise un « logiciel fraudeur » ou que l’on désactive un dispositif volontairement sous 17 °C, l’approche légale est la même : il s’agit de deux systèmes d’invalidation. C’est d’ailleurs toute l’argumentation de Volkswagen qui affirme respecter la réglementation européenne en utilisant un logiciel qui est un système d’invalidation en raison de problèmes de fiabilité moteur – ce qui est bien difficile à démontrer. Renault avance par exemple l’argument de la fiabilité pour justifier légalement l’utilisation d’un système d’invalidation, alors que ses propres données montrent que la casse moteur est devenue nulle avec la norme Euro 6. M. Thierry Bolloré, directeur délégué à la compétitivité du groupe n’a pas été en mesure de m’apporter une réponse sérieuse sur ce sujet lors de son audition par la commission Royal. Renault pourrait diminuer les émissions en modifiant la programmation d’un logiciel, mais il choisit de ne pas le faire – en partie peut-être pour des problèmes de fiabilité, mais sans doute principalement parce que l’EGR a des effets importants sur la réponse du véhicule et sur l’agrément de conduite.
Mme Lorelei Limousin. Les constructeurs ont donné des explications diverses à la commission Royal sur le fait que leurs systèmes de dépollution ne fonctionnaient pas. Nous pensons qu’il faut pousser les investigations sur ce sujet. Nous voulons savoir comment les écarts seront corrigés, et si les systèmes de dépollution fonctionneront dans des conditions normales d’utilisation.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Aujourd’hui, les systèmes de dépollution fonctionnent dans le cadre du nouveau cycle européen de conduite (NEDC). La question est renvoyée par les constructeurs à la nature du protocole d’homologation. La mission d’information découvre qu’ils ne semblent être soumis à aucune obligation, mises à part celles prévues dans le cycle d’homologation…
M. François Cuenot. Ce n’est pas exact : le règlement européen indique explicitement que les limitations effectives d’émissions auxquelles doivent se conformer les constructeurs concernent les « conditions d’utilisations normales » du véhicule. L’interprétation des constructeurs consiste à affirmer que les tests correspondent aux conditions normales de conduite. Cet argument fait vraiment sourire la Commission européenne. Il faut prendre cette interprétation des constructeurs avec des pincettes.
Mme Lorelei Limousin. Les constructeurs automobiles demandent une certaine visibilité en matière de cadre réglementaire. Nous sommes évidemment en accord sur ce point. Nous avons constaté qu’il fallait environ sept à huit ans entre la définition d’une norme par la Commission et son entrée en vigueur. Nous proposons en conséquence de travailler dès aujourd’hui à une norme pour 2025. Selon nous, il ne faut pas attendre, d’autant que les constructeurs se mettent déjà en ordre de bataille. Une récente étude de l’Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) tend à montrer qu’il n’y aurait pas besoin de normes supplémentaires pour atteindre les objectifs du paquet énergie-climat 2030, mais sur la base d’hypothèses erronées. L’étude table sur une baisse de la consommation de 40 % en 2020 par rapport à 2005 – alors que les affaires en cours nous apprennent que cet écart est inférieur de 50 % –, sur une diminution du poids des véhicules – alors que, dans les faits, elle augmente plutôt en Europe où les ventes sont dopées par l’achat de 4x4 –, ou sur la rénovation des routes pour des montants astronomiques en milliards d’euros.
M. François Cuenot. Les normes Euro 5 et 6 avaient été adoptées simultanément en 2007 afin de permettre que les constructeurs développent les technologies adaptées à une norme Euro 6 assez ambitieuse. Nous avons constaté ce qu’ils ont fait du temps qui leur a été donné ! La plupart l’ont utilisé pour « optimiser » les véhicules et répondre aux tests, et non pour réduire les émissions. L’anticipation réglementaire est une bonne chose, mais je crains qu’elle ne pousse pas toujours les constructeurs à aller dans le bon sens.
Mme Delphine Batho, rapporteure. La participation des ONG et des associations de consommateurs, telle qu’elle se pratique aujourd’hui dans la commission Royal, devrait-elle, selon vous, être pérennisée dans une gouvernance idéale du secteur, qu’elle soit nationale ou européenne ?
Mme Lorelei Limousin. Cela me paraîtrait pertinent, mais encore faut-il disposer des capacités nécessaires, des compétences en ingénierie, et des moyens financiers pour suivre ce type de travaux complexes. Il ressort clairement de la commission Royal que, pour avancer, notamment sur les tests, il est essentiel d’organiser un débat contradictoire, tant sur le plan juridique qu’industriel. L’idée de créer un forum au niveau européen pour des échanges entre les autorités d’homologation et les services techniques pourrait être enrichie si les ONG y étaient intégrées : elles apporteraient leur regard indépendant.
M. Raymond Lang. Notre participation à la commission Royal a été plutôt positive. Elle nous permet de nous informer mais aussi de faire progresser la maîtrise des sujets. Il est bon que des organisations diverses, qu’elles traitent de la défense du consommateur ou de l’environnement, soient présentes dans le débat.
M. François Cuenot. Malheureusement, il faut que les ONG soient impliquées ! Lorsque je constate qu’une ministre vole au secours d’un constructeur parce que l’État en détient des parts de capital, cela me paraît dangereux. C’est à la limite du conflit d’intérêts.
Les ONG indépendantes ont donc leur rôle à jouer, même si l’ensemble des compétences techniques est concentré entre les mains des États qui sont parfois soumis à des intérêts plus puissants que la seule défense de l’environnement.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Je vous remercie vivement tous les quatre.
La séance est levée à treize heures vingt.
◊
◊ ◊
37. Audition, ouverte à la presse, de M. Thierry Pflimlin, secrétaire général de la branche marketing et services du Groupe Total et de M. Philippe Montantème, directeur stratégie de la branche marketing et services.
(Séance du mercredi 30 mars 2016)
La séance est ouverte à seize heures vingt-cinq.
La mission d’information a entendu M. Thierry Pflimlin, secrétaire général de la branche marketing et services du Groupe Total et M. Philippe Montantème, directeur stratégie de la branche marketing et services.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Nous accueillons aujourd’hui MM. Thierry Pflimlin et Philippe Montantème, respectivement secrétaire général et directeur de la stratégie de la branche « marketing et services » du groupe Total. Nous devions auditionner M. Philippe Boisseau, numéro deux du groupe et patron de cette branche mais son audition a dû, dans un premier temps, être reportée en raison de son état de santé. Puis, la presse ayant révélé les nouvelles orientations de sa carrière, nous avons proposé de vous entendre.
Notre mission, créée par la Conférence des présidents à la suite de l’affaire Volkswagen, s’intéresse à la filière automobile dans une approche énergétique, fiscale et industrielle. La sortie des énergies fossiles et les questions liées aux différents types de carburants fossiles sont au cœur de nos travaux. Si l’Union française des industries pétrolières (UFIP) nous a déjà fait part, lors de son audition, des conséquences des écarts entre la fiscalité de l’essence et celle du diesel notamment pour l’industrie du raffinage, il nous paraissait important d’entendre le groupe Total. Nous reviendrons sans doute aussi au cours de cette audition sur les questions liées aux biocarburants.
M. Thierry Pflimlin, secrétaire général de la branche marketing et services du groupe Total. Nous représentons la branche « marketing et services » du groupe Total qui commercialise 85 millions de tonnes de produits pétroliers dans 130 pays et qui assure tous les services associés à cette commercialisation. Notre activité se développe en étroite collaboration avec le monde de l’automobile, avec la conception et la fourniture de carburants et de lubrifiants. En France, en particulier, notre groupe a développé un partenariat dans le domaine des lubrifiants et des carburants avec les deux grands constructeurs automobiles, Renault et PSA. Cette collaboration est possible grâce à notre centre de recherche de Solaize qui regroupe 250 chercheurs. Notre proximité avec le monde de l’automobile est aussi assurée à travers notre réseau de près de 4 000 stations-service sur le territoire français, qui accueille près d’un million de clients par jour, des professionnels et des particuliers, dans nos villes et nos campagnes. Notre mission est de fournir les automobilistes en énergie de manière durable, en lien avec la transition énergétique.
M. Philippe Montantème, directeur stratégie de la branche marketing et services. La mission du groupe Total est de répondre à la fois à une demande mondiale croissante d’énergie et aux préoccupations de la transition énergétique. Notre organisation et nos choix répondent à ces deux exigences. Nous souhaitons accompagner nos clients avec les technologies, les produits et les services que nous pouvons leur offrir tout en inscrivant l’entreprise dans un climat de modernité et d’innovation.
Avant de répondre à vos questions, j’évoquerai trois points : la conjoncture pétrolière mondiale, l’évolution du mix énergétique et l’évolution du parc automobile, des technologies, de la mobilité et des énergies nouvelles qui doivent trouver leur place dans ce mix.
S’agissant tout d’abord de la conjoncture pétrolière mondiale, le prix du baril est très bas, ayant baissé de plus de 50 % en un an. Cela est notamment dû à une offre croissante d’huile et de gaz de schiste américains et à une croissance plus faible de la demande. Ainsi s’est créé un écart entre l’offre et la demande d’environ deux millions de barils par jour pour une demande globale de 95 millions par jour. La baisse des prix a conduit à un redémarrage de la demande qui a crû de 1,8 million de barils par jour en 2015, contre un million par jour au cours des années précédentes. Ce redémarrage a été le fait de pays dont la demande est élastique aux prix, tels que les États-Unis, où la fiscalité est faible, ou la France qui a enregistré une croissance de 1 % de la demande en 2015 pour des raisons de prix et des raisons géopolitiques. En revanche, la demande a stagné dans des pays où les prix n’ont pas varié – les gouvernements ayant soit réduit leurs subventions soit augmenté leur fiscalité. On a même vu des pays producteurs comme le Nigéria, l’Arabie Saoudite ou le Venezuela augmenter leurs prix à la pompe. Nous anticipons un rééquilibrage du marché à la fin de l’année 2016 ou au début de l’année 2017 : la décroissance naturelle des champs pétroliers et le ralentissement des investissements sur ces champs devraient affecter la croissance de l’offre et le maintien de prix relativement bas devrait entraîner un maintien du niveau de la demande. Ce rééquilibrage devrait conduire à une révision des prix à la hausse à cette période.
Dans cet environnement, les défis du mix énergétique vont évoluer mais nous aurons besoin de toutes les énergies pour répondre à la demande – aujourd’hui croissante. Il y aura moins de pétrole mais plus de gaz et plus d’énergies renouvelables Les énergies fossiles – charbon, pétrole et gaz – représentent aujourd’hui 81 % du mix énergétique et devraient constituer 65 % de ce mix en 2035, dans le scénario le plus sévère, établi par la 21e Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21) : il prévoit un réchauffement planétaire de deux degrés et la limitation des émissions de CO2 à 450 parties par million (450 ppm). Une telle baisse de consommation d’énergies fossiles est significative mais leur laisse encore une part importante. Vous noterez la part importante des transports dans l’usage de celles-ci : ils pèsent pour 60 % de la consommation de pétrole, part qui devrait croître puisque c’est dans ce secteur que la substitution entre énergies est la plus difficile, compte tenu de la densité énergétique du fossile pétrolier et de la facilité à le manipuler.
Que l’on retienne un scénario à « deux degrés » ou de « business as usual » comme le qualifie l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la demande de produits pétroliers baissera en Europe. La baisse de 1,5 % par an constatée en France au cours des dernières années devrait se poursuivre, la loi de transition énergétique fixant un objectif de -30 % entre 2012 et 2030, cohérent avec le scénario dit « deux degrés » dans lequel nous nous inscrivons. La baisse portera principalement sur les véhicules légers et le secteur résidentiel : leur consommation diminuera respectivement de 30 % et de 55 %.
Il nous faut, pour atteindre ces objectifs, utiliser tous les leviers : poursuivre l’amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules et tendre vers les deux ou trois litres aux cent kilomètres ; élargir les capacités d’incorporation de biocarburants tels que le diesel B10 et l’E85 ; accélérer la pénétration de solutions innovantes ou en rupture tels que le recours au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène ; enfin, faire évoluer le comportement des consommateurs.
En tant que fournisseur de la plupart de ces énergies, Total a inscrit sa stratégie dans un scénario compatible avec celui dit des « deux degrés ». Nous prévoyons ainsi d’augmenter notre production de gaz, qui devrait passer de 52 à 65 % de notre portefeuille d’activité dans vingt ans ; de développer notre production d’énergies renouvelables qui devraient représenter 20 % de notre portefeuille à la même échéance – ce qui est particulièrement vrai pour l’énergie solaire, secteur dans lequel Total est aujourd’hui le troisième acteur mondial – ; de sortir dès 2016 de la production de charbon ; enfin, de progresser en termes d’efficacité énergétique, non seulement dans le cadre de nos activités qui enregistrent un gain annuel d’1,5 % d’efficacité mais aussi vis-à-vis de nos clients à qui nous proposons des carburants, des lubrifiants et des services spécifiques.
J’en viens à présent à l’évolution des parcs automobiles. En tant qu’industriel et distributeur, nous avons à la fois des contacts quotidiens avec nos clients – professionnels et particuliers – et des partenariats avec de nombreux constructeurs – français mais aussi coréens, chinois, allemands et américains. Pour vous donner un exemple emblématique de coopération, nous avons fourni à PSA des lubrifiants destinés aux moteurs et aux boîtes de vitesse qui ont fait économiser 5 % de consommation aux véhicules neufs – ce qui représente plusieurs grammes de CO2.
Je vais à présent vous exposer notre point de vue sur chacune des énergies.
Le diesel est une spécificité européenne en pleine évolution. Deux véhicules sur trois roulent au diesel aujourd’hui. Aucun autre pays du monde n’atteint un tel seuil à part peut-être l’Inde et le Maroc. La tendance s’inverse très rapidement : les ventes de diesel sont passées de 77 % en 2008 à 57 % en 2015 et devraient passer à 40 % en 2030. La part des particuliers est déjà de 44 % en 2015, ce qui signifie que l’essentiel de la diésélisation provient actuellement des flottes de véhicules professionnels. Compte tenu des surcoûts liés à la dépollution du diesel et aux taxations, le diesel ne devient rentable qu’à partir de 20 000 kilomètres de trajet, ce qui explique aussi ce resserrement de son développement.
Le diesel a la vertu de consommer moins que l’essence, ce qui représente un gain de 15 % d’émissions de CO2. La quantité d’émissions d’oxydes d’azote a quant à elle été très fortement réduite au cours des dernières années grâce au post-traitement à l’urée : après dépollution, le niveau d’émissions des véhicules diesel neufs, de l’ordre de 80 milligrammes par kilomètre, est très voisin de celui des moteurs à essence qui est de 60 milligrammes. De même, la quantité de particules a été divisée par dix sur les véhicules diesel. Les véhicules neufs sont même à un niveau légèrement inférieur à celui des véhicules essence. Les spécifications relatives aux particules seront identiques en 2017 pour les deux types de motorisation.
C’est pourquoi, d’un point de vue technologique, technique et environnemental, nous n’avons pas de raison, en tant que fournisseur, de privilégier une énergie par rapport à une autre, le diesel et l’essence ayant atteint les mêmes niveaux d’émission. Nous avons toujours été en faveur d’un rééquilibrage entre l’essence et le diesel vis-à-vis des capacités de production du raffinage, le marché français étant fortement excédentaire en essence et déficitaire en diesel.
Nous prônons un rééquilibrage progressif, c’est-à-dire une réduction du taux de diésélisation, par le biais des ventes de véhicules neufs. Sachant qu’aujourd’hui, ce sont principalement les flottes des entreprises qui sont concernées, une des solutions pour y parvenir consiste en une déductibilité de la TVA sur les essences.
J’en viens à un sujet connexe à celui du diesel : l’AdBlue, solution d’urée qui, par injection dans les gaz d’échappement, permet de réduire les émissions d’oxydes d’azote. Je pense pouvoir affirmer que Total répond présent à cette nouvelle demande. Installé sur pratiquement tous les camions depuis de nombreuses années, le dispositif de réduction catalytique sélective (SCR) équipera la quasi-totalité des véhicules diesel à partir de 2017. Historiquement, Total a accompagné la sortie des poids de lourds équipés de ce dispositif : nous avons équipé d’une pompe d’AdBlue plus de 1 000 stations en Europe, dont 200 en France. En 2020, toutes nos stations poids lourds seront équipées.
Le développement est en cours pour les véhicules légers : aujourd’hui, leur consommation est telle que le plein peut être fait entre deux vidanges, lors de la maintenance, soit entre 15 000 et 20 000 kilomètres de parcours. L’utilisateur ne se rend donc pas compte qu’il est équipé d’un réservoir d’AdBlue. Pour les véhicules vendus à partir de 2017, la consommation d’AdBlue sera d’un à trois litres tous les 1 000 kilomètres. Les utilisateurs devront donc faire un plein d’AdBlue tous les quatre pleins de diesel. Pour éviter l’immobilisation des véhicules, nous avons décidé de mettre à disposition des bidons de cinq et dix litres d’AdBlue dans toutes les stations Total de France. Ces bidons auront un embout flexible permettant d’accéder au bouchon. Aujourd’hui, le remplissage se fait plutôt dans les coffres, ce qui est assez compliqué. Demain, il se fera en façade. Nous allons aussi installer des pompes dans environ une station sur sept dans les années à venir. Nous nous sommes également intégrés dans la chaîne logistique car si l’urée est un produit assez courant, la solution liquide d’AdBlue l’est moins. Nous avons donc installé deux unités de production d’AdBlue, l’une à Marmande dans notre filiale Alvéa, l’autre sur le site de l’ancienne raffinerie de La Mède. Nous allons également installer une unité de conditionnement à Lyon.
Quant à la consommation d’essence, elle est en évolution continue. La progression des moteurs à essence tient, d’une part, à une réduction de leur taille et, d’autre part, à l’hybridation – classique ou rechargeable. D’ici à 2030, la moitié des véhicules à essence sortant sur le marché devraient être équipés d’un moteur hybride, représentant 10 % du parc. Aujourd’hui, la principale contrainte est celle du prix mais nous sommes vraiment désormais sur la voie d’une forte réduction de la consommation des moteurs à essence qui ne devraient plus avoir besoin que de quelques litres aux cent kilomètres. Toyota a vendu plus de 8 millions de véhicules hybrides depuis 1997. Total avait en 2013 développé avec PSA un démonstrateur consommant deux litres aux cent kilomètres et offrant un confort de conduite remarquable, grâce à une hybridation très poussée et à un allègement du véhicule.
En dehors des énergies classiques, il existe des énergies plus nouvelles.
Le gaz naturel nous semble une alternative crédible au diesel, à tout le moins en zone urbaine et pour les livraisons de zones périurbaines. La technologie est bien connue, mûre et très développée dans certains pays comme l’Argentine, le Brésil, l’Iran et le Bangladesh. Nous avons nous-mêmes 400 stations-service vendant du gaz dans tous les pays du monde où nous sommes présents, notamment au Pakistan. Cette énergie présente un véritable intérêt en termes de réduction des émissions sonores et de particules. Les coûts d’infrastructure sont relativement raisonnables car lorsque l’on dispose d’un réseau de gaz relativement développé comme cela est le cas de la France, il suffit de s’y brancher et l’installation est relativement simple à intégrer dans nos stations. L’usage du gaz nécessite donc moins de transport routier de matières premières. L’avantage en termes d’émissions de CO2 est cependant assez réduit, sauf à intégrer au moins 15 % de biogaz dans sa consommation de gaz naturel. Le marché du gaz naturel se développe dans les zones urbaines, surtout dans les pays producteurs de gaz tels que les États-Unis mais aussi la Chine, pour des raisons environnementales – les véhicules diesel n’y étant pas équipés de filtres à particules.
Quant aux véhicules électriques, ils constituent, selon nous, une solution viable, adaptée principalement au développement urbain. Ils ne produisent évidemment, lors de leurs déplacements, aucune émission de CO2 ni de particules et que de faibles émissions sonores. En revanche, la production d’électricité entraîne des émissions de CO2 – sauf si elle est issue d’énergie nucléaire ou renouvelable. Le manque d’autonomie des véhicules électriques est certes un frein mais ce dernier n’est pas aussi important qu’on peut l’imaginer : 50 % des déplacements en véhicule étant inférieurs à cent kilomètres, ils pourraient très bien être effectués dans une voiture électrique. De plus, le développement futur de nouveaux types de pratiques d’autopartage et de location de courte durée devrait aussi faciliter l’utilisation de ces véhicules. Ceux-ci posent cependant aujourd’hui un problème de surcoût. Les gains d’autonomie des batteries seront lents et l’on n’envisage pas de rupture technologique qui puisse significativement augmenter cette autonomie à des prix raisonnables, du moins pas à court terme. Il faut donc principalement concentrer l’usage de ces véhicules sur des parcours urbains. La charge lente à domicile, sur le lieu de travail ou dans un parking nous semble la solution la plus vertueuse. Elle permet de lisser la consommation électrique. La recharge rapide présente en revanche plusieurs inconvénients. C’est tout d’abord un appel d’énergie très important sur le réseau électrique à un endroit non prévu à l’avance. Cela a aussi un impact négatif sur la durée de vie des batteries – qui supportent bien mieux une charge lente. Enfin, c’est une perte de temps difficilement acceptable pour le consommateur. Nous considérons donc la charge rapide comme une solution de dépannage. Nous accompagnons néanmoins le mouvement et travaillons en partenariat avec Sodetrel pour installer une cinquantaine de bornes de recharge rapide dans nos stations-service dans le courant de l’année 2016. Nous estimons que les véhicules électriques devraient représenter environ 5 % des ventes à l’horizon 2030 et une part minimale de la flotte de véhicules.
L’hydrogène, lui, est utilisé pour accroître l’autonomie des véhicules électriques : cinq kilogrammes d’hydrogène suffisent pour parcourir 500 kilomètres, ce qui permet un ravitaillement classique, en quelques minutes. L’usage de cette énergie ne se fera néanmoins qu’à long terme car il pose encore des défis techniques et économiques importants. Il y a trois marchés pionniers aujourd’hui dans le monde : le Japon et la Corée, la Californie et l’Allemagne. Total est présent sur le marché allemand et participe au partenariat H2 Mobility afin d’acquérir une compétence sur ce marché. Nous avons déjà neuf stations d’hydrogène en Allemagne et avons prévu d’en avoir quatre-vingt-onze à l’horizon 2025 dans ce pays. Nous assurons une veille active sur le marché français en collaboration avec Air Liquide et avons en France quelques projets de stations pour des flottes captives comme celle de La Poste ou certains taxis. Point essentiel, si la production d’hydrogène se fait à base de gaz naturel, les émissions de CO2 seront significatives. Cette énergie ne présente donc d’intérêt que si elle est produite à partir d’énergies renouvelables.
Enfin, vous avez mentionné les biocarburants dont Total est le leader en Europe. La question des biocarburants doit être étudiée selon trois axes – réglementaire, technique et de durabilité. En matière réglementaire, les choses sont claires : le secteur de la mobilité doit atteindre un objectif de 10 % d’énergies renouvelables en 2020 – objectif qui pourrait être porté à 15 % conformément à la loi de transition énergétique. Les contraintes techniques sont surtout liées à la présence de composés oxygénés. Nous nous assurons pour notre part d’être au maximum de ce qui est acceptable par les constructeurs automobiles. Ainsi, l’E10 représente 70 % de nos ventes alors que le marché français n’en est qu’à 35 %.
Pour lever cette contrainte technique, nous développons des solutions de traitement spécifique des huiles végétales, notamment dans le cadre du projet « HVO » que nous menons à l’usine de La Mède. Nous allons pouvoir y traiter 500 000 tonnes de biodiesel pour en faire des hydrocarbures neutralisés injectables dans du diesel sans contrainte technique.
La troisième contrainte concerne la durabilité. La limite est aujourd’hui fixée à 7 % de biocarburants de première génération – qui sont en compétition avec l’alimentaire. Nous avons pris en compte cette contrainte dans le choix des matières premières dans notre usine de La Mède – matières premières qui seront constituées à 40 % d’huiles de friture ou encore de produits recyclés ou inaptes à l’alimentaire. Nous avons également réalisé des investissements à plus long terme dans des biotechnologies de deuxième génération dans le cadre des projets Futurol en France, BioTfueL et avec la start up américaine Amyris pour la transformation de sucre en diesel.
En conclusion, Total est résolument engagé dans la transition énergétique. Nous aurons encore besoin des hydrocarbures dans le futur mais ce besoin devra être intégré dans la transition. Il n’y a pas selon nous de contradiction entre l’investissement dans les hydrocarbures et le développement des énergies renouvelables. Nous accompagnons le développement de toutes les énergies – qu’il s’agisse du gaz, de l’hydrogène ou des biocarburants à un rythme d’investissement adapté à la flotte de véhicules. Ces investissements doivent se faire dans un cadre réglementaire stable, offrant de la visibilité non seulement aux consommateurs mais aussi aux producteurs et aux fournisseurs d’énergie.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Je suis tout d’abord obligée de vous demander si le point de vue émis par Michel Aubier, médecin conseil de Total, lors de son audition au Sénat, sur les effets sanitaires du diesel engage de quelque façon que ce soit le groupe Total.
Quelles seront les conséquences pour le raffinage en France du déséquilibre actuel entre la fiscalité du diesel et celle de l’essence, qu’il s’agisse de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) ou de la récupération de TVA sur les véhicules d’entreprise ? Pourquoi, alors que l’écart de TICPE est de 12 à 13 centimes, la différence de prix à la pompe entre un litre de gazole et un litre d’essence sans plomb 95 est-elle de 20 centimes ? Y a-t-il, comme on nous l’a dit, un excédent de gazole sur le marché européen induisant une tendance à la baisse du prix de ce carburant, au-delà de la baisse du prix du baril ? En cas de convergence fiscale de l’essence et du gazole, y aura-t-il toujours potentiellement un écart de prix à la pompe entre ces deux carburants du fait de phénomènes de marché ?
Pourriez-vous nous éclairer sur la qualité de vos carburants ? Quelle est, par exemple, la différence entre les diesel Premium et Excellium proposés chez Total ?
Vous nous avez indiqué que vous comptiez rendre disponibles rapidement des bidons d’urée de cinq litres permettant de faire le plein de dix-sept litres du réservoir des véhicules et que les nouveaux modes d’homologation des véhicules neufs allaient nécessiter, à partir de 2017, de faire le plein tous les 6 000 kilomètres et non plus tous les 20 000 kilomètres comme aujourd’hui. Compte tenu de la diminution du nombre de véhicules diesel neufs en circulation, l’équipement en urée d’une station sur sept constitue-t-il un choix d’investissement ou une prévision ?
Le biodiesel, ou diester, a-t-il un avenir, compte tenu de ce qu’affirme la Cour des comptes quant à son coût financier ?
D’après l’UFIP, ce n’est pas demain matin que nous utiliserons les biocarburants de deuxième génération, pour des raisons de modèle économique ! Enfin, ayant évoqué le projet de reconversion de la raffinerie de La Mède en plus grande bio-raffinerie de France, vous avez cité le chiffre de 40 % d’huiles usagées. Cela étant, le bénéfice environnemental de la substitution d’une énergie produite à partir d’huile de palme importée aux énergies fossiles paraît particulièrement discutable et inquiète la filière du colza.
Le fait que les entreprises pétrolières italiennes aient également investi de longue date dans le gaz a, semble-t-il, incité l’Italie, avec un temps d’avance sur la France, à développer des infrastructures gazières en faveur de la mobilité des véhicules particuliers. Il ressort clairement de toutes nos auditions une perspective favorable au gaz s’agissant du transport de marchandises par les poids lourds ainsi que les véhicules utilitaires et de livraison. Comment doit-on envisager les infrastructures de distribution de gaz ?
Enfin, les constructeurs automobiles en France paraissent réticents à l’égard de l’hydrogène ou, du moins, affirmer qu’on n’y recourra pas avant 2030 alors que des pays comme le Japon développent aujourd’hui des programmes d’investissement en la matière. Ces constructeurs devraient-ils, selon vous, s’y intéresser davantage ?
M. Julien Dive. En 2015, vous avez acquis des parts dans Polyblend, fabricant de composites en polypropylène auxquels sont ajoutés des adjuvants tels que le talc afin de réaliser des pièces thermoplastiques pour l’automobile. Polyblend n’étant pas implanté en France, quelle est votre position concernant les plasturgistes qui le sont – que ce soient Faurecia, Mecaplast, Plastic Omnium ou Reydel ex-Visteon – et les matériaux composites dits bio-sourcés ?
J’exprimerai d’autre part un point de désaccord avec votre propos relatif à la recharge rapide des véhicules électriques. De nombreux centres de recherche, tels que la plateforme « Steeve » qui avait d’ailleurs été inaugurée par notre rapporteure à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS), dans l’Oise, mènent aujourd’hui des travaux pour améliorer l’endurance des batteries et leur permettre d’absorber une forte charge d’énergie en un bref laps de temps. Ce temps de recharge ne me semble pas perdu pour le consommateur puisqu’on peut y associer une offre de services.
M. Thierry Pflimlin. À aucun moment le professeur Aubier n’est habilité à prendre la parole au nom du groupe Total au sein duquel il exerce depuis près d’une vingtaine d’années une fonction de suivi de santé d’une partie du personnel. Il y a une séparation très nette entre cette fonction et celle qu’il peut exercer par ailleurs à l’hôpital Bichat. Par conséquent, nous ne commentons pas ni ne soutenons les déclarations qu’il a faites dans le cadre de cette seconde fonction.
M. Philippe Montantème. Les prix de l’essence et du diesel sont construits à partir des cotations internationales en tonnes, beaucoup plus voisines entre elles que le prix au litre en raison d’un effet de densité. Mais il y a aussi effectivement des situations de marché très différentes entre ces deux carburants en fonction des saisons. Le prix des essences est plutôt tendu en été en raison d’un accroissement de la demande américaine pendant la « driving season » tandis que le prix du diesel augmente pendant l’hiver, cette énergie étant également utilisée pour le chauffage. Des écarts de prix peuvent donc se creuser entre les deux. Enfin, il y a aujourd’hui au niveau mondial une tension sur le marché des essences en raison du regain de croissance de la demande des ménages américains et européens consécutif à la baisse des prix. Parallèlement, la demande de diesel a baissé en Chine en 2015 tandis que les ventes d’essence y ont flambé de 5 à 10 %. Il y a un tel excès de diesel sur le marché que les cotations de diesel sont plus basses aujourd’hui et celles de l’essence, plus tendues.
La demande d’essence est plus élastique que celle du diesel qui, permettant le transport de marchandises, est très lié à la croissance économique et donc peu sensible au prix. Le ralentissement de la croissance chinoise et l’accroissement de la demande américaine ont fait baisser le coût du diesel et tendu le marché des essences. À cela s’ajoute un effet de densité qui entraîne un écart de six centimes d’euros entre le prix hors taxe du litre d’essence et celui du litre de diesel. Ces deux marchés évoluent donc différemment : la Chine s’apprêtant à devenir un gros exportateur de diesel, le marché du diesel reste assez déprimé.
Le gasoil Excellium contient des additifs dont nous détenons la technologie et dont l’objectif est de tenir le moteur propre et éventuellement de nettoyer les dépôts qui pourraient se trouver sur les injecteurs, ce qui permet un meilleur fonctionnement et une meilleure efficacité du moteur. Au-delà du continent européen, nous sommes en train de développer la distribution de ces carburants additivés au niveau mondial. Ceux-ci permettent des gains de consommation de 1 % sur les véhicules légers et de 3 à 4 % sur les poids lourds, les bus et les engins de chantier. Nous avons d’ailleurs obtenu des certificats d’économie d’énergie grâce à l’usage de ces carburants additivés dans les moteurs diesel des camions.
S’agissant de l’impact sur le raffinage du déséquilibre entre essence et diesel, le marché français doit importer 20 millions de tonnes de diesel et exporte quelques millions de tonnes d’essence. La disproportion est telle que même si l’on arrêtait de vendre des voitures diesel, le déséquilibre persisterait dans les années à venir. Les leviers d’action sont tellement faibles que le marché sera durablement importateur de diesel. La part de l’essence est plutôt décroissante, compte tenu des efforts de productivité réalisés sur les véhicules – beaucoup plus difficiles à accomplir sur les poids lourds – et de la croissance économique qui soutient celle de la consommation de diesel. On ne peut donc plus revenir, à l’horizon de dix à quinze ans, à une situation d’équilibre entre ces produits. Je ne dis pas qu’un rééquilibrage ne sera pas bénéfique au raffinage : ce le sera dès le premier jour mais avec des effets relativement limités à court terme.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Qu’en sera-t-il de notre balance commerciale ?
M. Thierry Pflimlin. Elle restera déficitaire car il faudra toujours importer du pétrole brut.
Votre question concernant l’AdBlue est très pertinente : nous n’avons effectivement pas pour l’instant les moyens de fournir du jour au lendemain tous nos clients à l’aide de volucompteurs comme c’est le cas pour les carburants. Mais nous avons des plans de développement importants : à l’horizon 2020, une station sur sept sera équipée et à l’horizon 2025, une station sur trois. Avec un tel maillage, les consommateurs pourront s’approvisionner de manière confortable sans devoir manipuler des bidons. Mais la présence de ces bidons dans chaque station, que nous pouvons assurer très rapidement sans que cela demande une logistique importante, est quand même une sécurité car avec les nouveaux moteurs, les voitures ne pourront plus démarrer sans Adblue.
M. Philippe Montantème. Les voitures seront équipées d’un système d’alarme permettant aux conducteurs d’être prévenus longtemps à l’avance qu’ils doivent faire le plein d’AdBlue.
L’équilibre économique des biocarburants ne relevant pas de mon domaine de compétence, je préfère éviter d’intervenir sur ce point.
S’agissant du modèle de deuxième génération, c’est la fabrication d’éthanol cellulosique qui est la plus avancée. Cela notamment dans une première usine dont vous avez dû entendre parler en Italie et qui semble avoir des difficultés à démarrer et à fonctionner. Les sites américains ont eux aussi des difficultés de traitement initial de la biomasse. L’éthanol est néanmoins un enjeu d’avenir sur lequel il faut travailler. C’est pourquoi nous sommes dans les groupements Futurol et BioTfueL. Les investissements sont très importants, de plusieurs centaines de millions d’euros sur chaque site et c’est pour nous un enjeu majeur représentant l’avenir des biocarburants. Mais ce modèle n’aura pas d’impact direct avant cinq à dix ans.
Nous conférons effectivement une part importante du profil de traitement de l’usine de La Mède à des produits de deuxième génération – que ce soit des huiles de friture ou encore des coproduits ou des sous-produits de la transformation d’huiles végétales impropres à la consommation humaine. De toute façon, la réglementation impose aujourd’hui 30 % de gains d’émissions de CO2 sur toutes les matières utilisées pour faire des biocarburants, dans un cycle de vie complet – ce pourcentage devant aller jusqu’à 50 ou 60 % demain. Nous respecterons bien évidemment cette règle. Nous avons effectivement affirmé que nous pourrions traiter de l’huile de palme. Notre usine est suffisamment flexible pour traiter toute huile végétale – que ce soit du colza produit en France ou de l’huile de palme – sans la moindre contrainte technique. Ensuite, c’est bien sûr une question économique.
L’utilisation du gaz est effectivement moins à l’ordre du jour pour les véhicules particuliers que pour les poids lourds. Si l’Italie, comme d’autres pays, ont pris de l’avance en ce domaine, c’est notamment parce qu’elle avait des gisements de gaz locaux faciles à exploiter comme on le faisait d’ailleurs dans le Sud-Ouest de la France avec le gaz de Lacq ou encore aux Pays-Bas. Il y a donc une poche de consommation italienne liée à cette donnée historique. Certains constructeurs, comme Volkswagen, développent aujourd’hui des véhicules au gaz. Nous ne pensons pas que cette énergie ait un gros potentiel de développement car elle pose des problèmes d’autonomie. Mais de toute façon, il s’agit systématiquement de véhicules à bicarburation. Nous allons donc concentrer nos efforts sur des stations destinées aux poids lourds.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Avez-vous des projets précis ?
M. Philippe Montantème. Oui. D’une part, les transporteurs installent chez eux des pompes distributrices de gaz, au même titre qu’ils ont des pompes pour du diesel, et d’autre part, Total a un plan d’installation de distribution de gaz, qui peut se faire dans des stations existantes, notamment en banlieue et dans le sud de la région parisienne. Nous maillons notre réseau de stations-service en détectant celles qui sont à proximité de pipes de gaz. Le système est relativement simple en termes d’infrastructures et compte tenu de la densité du réseau français de gaz, nous n’avons pas de problème pour trouver des emplacements.
M. Thierry Pflimlin. C’est simple en termes d’infrastructures mais l’installation d’un compresseur exige tout de même un certain périmètre ainsi que certaines caractéristiques permettant d’assurer la sécurité du stockage du gaz. On ne peut donc y procéder dans toutes les stations.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Cela suppose-t-il par exemple de déposer un nouveau dossier de demande d’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ?
M. Thierry Pflimlin. Oui, je crois.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Le gaz va-t-il, selon vous, devenir la solution de référence pour les poids lourds en Europe ?
M. Philippe Montantème. Je ne pense pas car il pose toujours des problèmes d’autonomie. Aux États-Unis, l’architecture des camions favorise le développement de l’usage du gaz sur des distances plus importantes car elle peut accueillir beaucoup de réservoirs. En Europe, le gaz pose un problème d’encombrement sur des distances supérieures à 500 kilomètres. Cette solution était très adaptée dans le passé aux bennes à ordures et aux bus. Elle pourrait se développer sur le trafic régional et la livraison du dernier kilomètre. Sur de très longues distances, il faudrait utiliser du gaz liquéfié, technologie utilisée en Chine mais qui pose d’autres problèmes de sécurité.
Les Japonais Toyota et Honda sont effectivement très en avance dans l’usage de l’hydrogène. Daimler, l’un de nos partenaires dans le cadre du projet H2 Mobility, a lui aussi annoncé qu’il allait se lancer en ce domaine. Je ne puis m’exprimer au nom des constructeurs français mais je ne pense pas qu’ils soient en retard. Il me semble que si le marché se développe, l’adaptation sera relativement rapide pour Renault qui conçoit déjà des véhicules électriques – un véhicule hydrogène n’étant jamais qu’un véhicule électrique équipé d’une pile à combustible. BMW, avec qui nous coopérons, a conclu un accord avec Toyota pour utiliser ses piles à combustible : les choses peuvent donc aller relativement vite sur le plan technologique si les constructeurs concluent des partenariats comparables. L’usage de l’hydrogène me semble cependant relever du long terme et je pense que les constructeurs français seront capables d’être au rendez-vous s’il le faut. Cela étant, c’est le problème habituel de l’œuf et de la poule : nous sommes, pour notre part, relativement prêts à créer des stations mais cela manque encore de véhicules ! Je pourrais faire la même remarque concernant le gaz.
M. Thierry Pflimlin. Je suis absolument incompétent pour vous répondre quant à l’acquisition de Polyblend par notre filiale Hutchinson mais nous vous transmettrons une réponse par écrit.
M. Philippe Montantème. Je suis conscient que des progrès ont été accomplis dans le domaine des batteries. D’ailleurs, les montants investis en recherche et développement sont massifs. Mais il ne faudrait pas attendre que leur autonomie s’accroisse pour considérer que le véhicule électrique a sa place sur le marché : il a une vraie utilité dans le monde urbain. De plus, dans la perspective du producteur d’électricité que nous allons progressivement devenir, la charge lente me semble présenter l’avantage de permettre un lissage de la consommation – avantage que n’a pas la charge rapide. Une station de recharge de Tesla représente un mégawatt de puissance installée : cela est très difficile à mettre en place dans une station d’autoroute située au milieu de la campagne. Faire de la charge lente à domicile et à heures creuses est en revanche vertueux en termes de consommation d’énergies renouvelables et permet d’écrêter des excédents d’énergie. Il nous semble donc préférable de privilégier cette deuxième option et l’usage urbain.
M. Julien Dive. Tout dépend de l’usage que fait le consommateur de son véhicule. La charge lente peut suffire à certains types de déplacements mais la charge rapide sera plus à même de répondre aux besoins d’une personne qui se déplace beaucoup, en particulier en milieu rural. Il y a effectivement encore un fossé technologique à combler mais on ne peut balayer d’un revers de main la recharge rapide qui est une solution réelle face à certains besoins.
M. Philippe Montantème. C’est aussi une sécurité et une solution de dépannage impérative.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Messieurs, nous vous remercions pour vos réponses.
La séance est levée à dix-sept heures vingt.
◊
◊ ◊
38. Audition, ouverte à la presse, de Mme Nathalie Homobono, directrice générale de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
(Séance du mardi 5 avril 2016)
La séance est ouverte à douze heures cinq.
La mission d’information a entendu Mme Nathalie Homobono, directrice générale de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Nous accueillons, ce matin, Mme Nathalie Homobono, directrice générale de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), accompagnée de M. Vincent Designolle, son directeur de cabinet.
Madame la directrice générale, nous n’allons pas vous interroger sur les interventions de votre administration qui concerneraient des actions judiciaires en cours, voire sur des procédures qui n’en seraient qu’au stade d’enquêtes préliminaires, donc diligentées par le parquet.
Nous savons néanmoins, par la presse, que des agents de la DGCCRF ont perquisitionné chez des constructeurs dans plusieurs sites industriels ou sur des sites de recherche. S’agissant notamment de l’affaire Volkswagen, nous avons auditionné le président du directoire de la filière française, M. Rivoal.
Il nous a clairement précisé qu’aux États-Unis, la fraude caractérisée par l’existence d’un logiciel truqueur affectait les conditions mêmes du contrat de vente entre le constructeur et ses clients. En revanche, selon ce qu’il nous a indiqué, il n’en va pas de même au regard du droit français.
Madame la directrice générale, partagez-vous cette analyse juridique ? La question a toute son importance, car, en France, plus de 960 000 véhicules équipés de ce logiciel ont été vendus, alors qu’aux États-Unis, il n’y en a « que » 650 000 environ.
Plus généralement, la DGCCRF a-t-elle pris l’initiative de contacts avec les administrations qui sont ses homologues en Europe ? Perçoit-on des différences d’approche, selon les pays sur un sujet aussi complexe ? De quel type de recours disposent les possesseurs de véhicules dotés de ce fameux logiciel ? En tout état de cause, Volkswagen et ses différentes marques ne peuvent-ils pas être inquiétés, au moins pour publicité mensongère, ou encore être accusés par des concurrents de pratiques à tout le moins déloyales ?
À ce jour, les autres constructeurs ont contenu leurs critiques à l’égard d’un concurrent puissant, qui occupe 13 % des parts du marché français. Pour autant, ils seraient en droit de se plaindre si la défaillance d’un seul portait atteinte à la crédibilité de tout un secteur.
Par ailleurs, comment la DGCCRF va-t-elle veiller à la bonne exécution des opérations de rectification des moteurs dans le réseau ? Il semble qu’aux États-Unis, les autorités fédérales n’aient toujours pas accepté les propositions techniques de Volkswagen.
Enfin, il importe également à la mission de connaître les principaux griefs, en termes de consommation et de concurrence, que la DGCCRF a eu à traiter au cours des dernières années, dans le secteur automobile en général, donc en dehors de l’affaire précitée.
Madame la directrice générale, je vous propose de vous écouter, dans un premier temps, pour un exposé liminaire. Puis, Mme Delphine Batho, la rapporteure de la mission, vous posera un premier groupe de questions. Enfin, les autres membres de la mission d’information vous interrogeront à leur tour.
Mme Nathalie Homobono, directrice générale de la DGCCRF. Madame la présidente, mesdames, messieurs les députés, l’affaire Volkswagen, qui a été révélée par l’Agence américaine de protection de l’environnement en septembre 2015 est l’élément déclencheur qui a conduit le Gouvernement et la ministre de l’environnement à mettre en place une commission d’enquête indépendante. Vous avez peut-être déjà auditionné les services du ministère de l’environnement.
Cette commission a accès aux résultats des essais qui ont été réalisés, à ce jour, sur quarante à cinquante des cent véhicules devant être contrôlés. C’est un point d’appui pour notre action, s’agissant notamment de l’enquête sur les émissions atmosphériques, que nous avons ouverte à l’automne pour examiner les pratiques des constructeurs qui destinent une partie de leurs véhicules au marché français.
N’ayant pas nous-mêmes les moyens d’effectuer ces contrôles, les conclusions de la commission d’enquête et les résultats des analyses effectuées par les laboratoires de l’Union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) sont des éléments très importants, sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour mener notre enquête.
Suite aux révélations de l’Agence américaine de protection de l’environnement, (EPA), selon lesquelles il y avait eu une action délibérée pour contourner les normes des émissions polluantes aux États-Unis, nous avons lancé cette enquête. Elle concerne une quinzaine de constructeurs automobiles sur le territoire national. Nous nous sommes intéressés, dans un premier temps, aux véhicules de la marque Volkswagen, ce qui nous a conduits à mener une perquisition – dont a dû vous parler le président du directoire de Volkswagen France –, le 16 octobre 2015.
Nous voulions avant tout récupérer des éléments d’information pour compléter ceux que nous avions obtenus lors de nos premiers contacts, dès septembre 2015, au siège de Volkswagen France, d’où il ressortait que l’entreprise présente en France ne faisait qu’appliquer les décisions émanant principalement des autorités allemandes, concernant la construction des véhicules et la publicité. Celles-ci étaient relayées et mises en œuvre notamment par le représentant de la marque en France, à savoir la société Volkswagen Group France. Il nous a donc semblé nécessaire de nous procurer des éléments complémentaires, lesquels ont été recueillis lors de la perquisition que nous avons menée en octobre 2015.
Suite à cela, il nous est apparu que Volkswagen France et Volkswagen Allemagne avaient, de manière manifeste et délibérée, mis en place des dispositifs pour fausser les résultats des contrôles. Le logiciel qui pilote les véhicules avait pour objectif d’identifier les tests, de fausser les paramètres d’émissions, et donc, de permettre aux véhicules de passer avec succès les tests d’homologation concernant les émissions atmosphériques.
Nous avons adressé au parquet de Paris un procès-verbal pour tromperie, dans lequel figuraient les éléments caractérisant l’infraction au plan matériel, c’est-à-dire les lignes de code du logiciel ayant pour but de fausser les résultats des contrôles. Il nous appartenait également de démontrer le caractère intentionnel de la fraude, c’est-à-dire la volonté manifeste du groupe de mettre en place ce dispositif pour atteindre le niveau d’émissions permettant de passer avec succès les tests d’homologation. L’affaire est aujourd’hui entre les mains du parquet de Paris, qui a désigné des juges d’instruction.
Parallèlement, nous avons mené des investigations auprès des autres constructeurs qui commercialisent une partie des véhicules en France, sous leur marque. Nous avons également participé aux travaux de la commission d’enquête indépendante, sous la houlette du ministère de l’environnement. Compte tenu des résultats des tests communiqués par l’UTAC sur les véhicules sélectionnés par la commission d’enquête, il nous a semblé que d’autres situations méritaient un examen approfondi.
C’est ce qui nous a amenés à nous intéresser plus particulièrement au constructeur Renault ; les résultats transmis par l’UTAC marquant un gros écart par rapport aux résultats des tests, dans le cadre de la procédure normalisée de l’homologation.
Nous avons donc auditionné, en lien avec le ministère de l’environnement, les représentants de Renault. Il nous a semblé utile de compléter les éléments que Renault nous avait spontanément remis à la fin de l’année 2015 par une perquisition, qui a eu lieu le 7 janvier 2016, au siège de Renault, dans un centre technique et au Technocentre. Les éléments que nous avons recueillis dans le cadre de cette perquisition sont en cours d’examen.
Lors d’une perquisition, nous pouvons prélever des documents papier, mais également des éléments de la messagerie des cadres et des agents qui travaillent chez Renault. Ces perquisitions sont faites « en bloc », sachant qu’au niveau de la messagerie, nous ne pouvons pas faire usage, dans le cadre de notre enquête, de la correspondance de l’entreprise avec ses avocats.
Nous collectons l’ensemble des éléments de la messagerie qui nous paraissent avoir un lien possible avec notre enquête, puis nous vérifions, pièce par pièce, s’ils relèvent des échanges ou de la correspondance avec les avocats du groupe, auquel cas nous devons les retirer de l’ensemble des éléments sur lesquels nous pouvons appuyer notre enquête. Nous effectuons ce tri en présence des représentants de Renault et de leurs avocats.
Nous en sommes aujourd’hui à la phase d’audition d’un certain nombre de personnels de Renault, à qui nous demandons des explications complémentaires sur certaines pièces nécessaires à notre enquête. Les auditions des cadres de Renault, en présence des avocats de l’entreprise, ont commencé mi-mars et se poursuivent aujourd’hui.
La commission d’enquête indépendante pourrait se réunir dans quelques jours. Si la date est confirmée, il pourrait y avoir d’autres réunions, au cours desquelles de nouveaux résultats concernant d’autres constructeurs pourraient être communiqués, ce qui veut dire que nous pourrions être amenés à poursuivre nos investigations auprès de ces constructeurs.
La commission a auditionné Renault, ainsi que d’autres constructeurs, tels que Mercedes, Ford ou Opel, sur les dépassements des normes d’émissions polluantes et les écarts par rapport aux résultats des tests d’homologation.
En ce qui concerne l’articulation de ces actions nationales avec des actions menées dans un cadre plus large, une réunion de coopération entre les autorités judiciaires des États de l’Union européenne, sous l’égide d’Eurojust, s’est tenue le 10 mars dernier.
Sur les vingt-huit États membres, dix-neuf pays ont assisté à cette réunion, qui a permis un premier échange de vues, en particulier entre les autorités judiciaires françaises et allemandes, s’agissant notamment de l’articulation entre les procédures nationales de chacun des deux pays, afin de savoir s’il n’y avait pas empiètement ou chevauchement.
Il y a, en particulier, une règle selon laquelle on ne peut pas juger deux fois un auteur suspecté d’une infraction pour les mêmes faits. Un premier examen a eu lieu pour déterminer s’il y avait chevauchement entre les procédures françaises et les procédures allemandes et s’il était nécessaire de revoir le périmètre de l’une ou de l’autre.
Une réflexion est en cours sur ce sujet. Il semble qu’il n’y ait pas chevauchement, ce qui veut dire que la coopération entre les autorités judiciaires françaises et allemandes va se poursuivre, notamment pour clarifier le contour des procédures de l’un et l’autre pays.
J’en viens à une question que vous m’avez posée indirectement tout à l’heure.
Le cadre juridique qui s’applique n’est pas tout à fait le même dans l’ensemble des pays de l’Union européenne.
Dans certains pays, par exemple, il est possible de poursuivre les personnes morales, dans d’autres, de poursuivre les personnes morales ou les personnes physiques. Les moyens d’action ne sont donc pas harmonisés sur le territoire de l’Union européenne, ce qui incite à poursuivre les échanges entre les autorités judiciaires.
C’est un peu la même chose pour le droit de la consommation, même s’il est déjà très largement harmonisé. Cela étant, s’il existe un socle minimal identique dans les différents États de l’Union européenne, le cadre juridique peut être plus ou moins fourni selon les pays. Par conséquent, les moyens d’action peuvent aussi différer d’un pays à l’autre.
En ce qui concerne nos homologues, nous avons eu un premier contact avec les autorités de protection des consommateurs, mais les autorités de surveillance du secteur automobile ne sont pas forcément nos homologues au quotidien, s’agissant notamment de la protection des intérêts économiques des consommateurs. Nombre de mes homologues s’occupent de la protection des intérêts financiers des entreprises, par exemple, mais pas des questions de sécurité. Nos homologues, je le répète, ne sont pas toujours les personnes avec lesquelles nous échangeons quotidiennement.
La Commission européenne réunit, une fois par semestre, les autorités de protection des consommateurs, au sens générique du terme. Il est ressorti des échanges que nous avons eus que peu de pays avaient lancé des investigations aussi larges et approfondies que celles que nous avons menées, en tant qu’autorité de protection des consommateurs.
En ce qui concerne la remise en conformité des véhicules, nous ne sommes pas, dans le cadre des responsabilités actuelles. L’autorité de surveillance du marché des véhicules, c’est le ministère de l’environnement qui en a la charge, comme il a celle du contrôle de la conformité des véhicules qui sortent des lignes de fabrication françaises, sur la base des homologations qui leur sont, d’ailleurs, délivrées par ce ministère.
Aujourd’hui, nous ne sommes pas compétents en la matière, c’est-à-dire que nous n’exerçons pas de surveillance sur la mise en conformité des véhicules, même si nous faisons régulièrement le point, en lien avec le ministère de l’environnement, avec certains des constructeurs – notamment Volkswagen – pour savoir s’ils ont rappelé les véhicules pour les remettre en conformité, et à quel rythme.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Était-il fréquent, auparavant, que la DGCCRF diligente des contrôles sur le secteur automobile en général ? Y avait-il déjà eu une procédure concernant les émissions polluantes ?
Nous souhaiterions également connaître votre interprétation du règlement européen sur ce qu’est un dispositif d’invalidation. Volkswagen considère qu’il y a une différence de réglementation entre les États-Unis et l’Europe. Pourtant, le règlement européen interdit explicitement les dispositifs d’invalidation.
Par ailleurs, avez-vous les moyens de contrôler les codes sources ? Compte tenu de l’augmentation de l’informatique embarquée et des évolutions futures concernant le véhicule connecté et le véhicule autonome, disposez-vous des compétences et des moyens techniques nécessaires dans ce domaine ?
En ce qui concerne vos procédures et votre ministère de tutelle, lorsqu’une enquête administrative est diligentée par la DGCCRF, le ministère est-il informé ? Ou bien s’agit-il de contrôles en propre ?
Vous dites que vous n’avez pas les moyens d’effectuer les contrôles et que vous vous adressez à l’UTAC, un organisme qui a potentiellement homologué les véhicules sur lesquels vous diligentez des investigations. Estimez-vous nécessaire qu'à l’avenir, la DGCCRF dispose en propre de moyens de contrôle et de mesure complets, concernant la question des émissions polluantes ? Faute de quoi, cette problématique renvoie à la question du statut de l’UTAC et des moyens existants.
En ce qui concerne les évolutions des cadres réglementaires et des procédures de contrôle, il se pose la question d’instituer un contrôle indépendant aléatoire dans la vie du véhicule en conditions réelles de circulation. La DGCCRF pourrait-elle effectuer ce contrôle, comme le fait l’Environmental protection agency (EPA) aux États-Unis ? Quelle est, pour vous, la plus-value de la commission Royal ?
Le périmètre des clauses contractuelles dans la réglementation en vigueur en Europe semble assez faible. Estimez-vous que ces clauses contractuelles doivent être enrichies et développées afin de clarifier le cadre juridique dont relèvent les engagements des constructeurs vis-à-vis des consommateurs ?
M. Denis Baupin. Que risque Volkswagen, une fois le dossier transmis au parquet ? Quelle est la suite de la procédure ? Quelle est la pénalité maximale encourue, au regard de la fraude que vous dites avérée ?
Vous avez diligenté une perquisition chez Renault, suite aux chiffres fournis par l’UTAC, qui ont été l’élément déclencheur. Ce n’est pas la version la plus courante qui a été donnée de cette affaire. Pouvez-vous nous dire quel est aujourd’hui l’objectif de l’enquête ? Que cherchez-vous ? Un logiciel truqueur, comme celui trouvé chez Volkswagen ?
Par ailleurs, des chiffres anormaux ayant été mis en évidence chez d’autres constructeurs que Renault, avez-vous également mené une enquête ou diligenté des perquisitions chez Mercedes, Ford ou Opel, par exemple ?
Mme Nathalie Homobono. Les résultats communiqués à la commission indépendante sont, pour nous, des éléments extrêmement importants. Ils révèlent des écarts importants entre les résultats des tests d’homologation et les résultats communiqués par l’UTAC dans le cadre de nouveaux tests, ce qui nous amène à approfondir notre enquête.
Dans ce cas, nous demandons, dans un premier temps, des explications plus précises au constructeur – nous avons procédé de la même façon avec Volkswagen et avec Renault. Si nous jugeons les arguments suffisamment probants, nous pouvons en rester là. Si nous considérons que les éléments qui nous sont fournis appellent des explications complémentaires, cela peut déclencher une perquisition. Autrement dit, les écarts constatés entre les deux formes de tests et des explications insuffisantes de la part des représentants du constructeur sont les deux facteurs déclencheurs d’une perquisition.
À ce jour, il y a eu deux perquisitions, l’une chez Volkswagen, l’autre chez Renault.
J’en viens aux peines encourues par Volkswagen pour tromperie. Le code de la consommation prévoit, pour les personnes physiques, des peines d’emprisonnement jusqu’à deux ans et des peines d’amendes jusqu’à 300 000 euros, contre 1,5 million d’euros pour les personnes morales, amende qui peut être portée jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois dernières années.
Mme Delphine Batho, rapporteure. C’est donc la loi Hamon qui s’applique.
Mme Nathalie Homobono. Absolument. Le ministre avait considéré que les peines antérieures n’étaient pas proportionnées aux profits illicites et retirés de ces pratiques. Aujourd’hui, la peine d’amende peut être très élevée.
Par ailleurs, la lecture juridique que nous faisons aujourd’hui du règlement européen et des directives qui encadrent la réception des véhicules amène à la conclusion que les dispositifs d’invalidation sont interdits. Cette lecture est la nôtre, mais la justice française en fera peut-être une autre.
Nous avons réalisé, dans le passé, très peu d’enquêtes sur les véhicules, notamment parce que nous ne sommes pas une autorité de surveillance du marché. Nous avons été conduits à mener une enquête, dans un passé relativement récent, à la demande d’un ministre – qui n’était pas le ministre de tutelle de la DGCCRF –, qui voulait obtenir des clarifications sur les performances des véhicules, notamment en matière de consommation. Cette demande faisait suite à des soupçons émis par les autorités du continent nord-américain.
Notre enquête a abouti à la conclusion qu’il pouvait y avoir des écarts entre les tests normalisés prévus par la réglementation européenne pour l’homologation et les résultats concernant la consommation des véhicules en conditions réelles de circulation.
Dans la mesure où nous ne sommes pas une autorité de surveillance du marché, nous ne sommes dotés ni de compétences techniques ni de moyens techniques pour exercer un contrôle. Aujourd’hui, nous ne disposons pas de moyens d’expertise des logiciels, voire des codes sources.
Dans le cas de Volkswagen, nous avions déjà des éléments pour nous guider. Notre travail s’en est trouvé facilité, mais nous n’avons pas d’expertise particulière dans ce domaine.
Nous n’avons pas non plus de moyens de contrôle en propre pour procéder à des tests en dehors de l’UTAC. Si vous avez auditionné des représentants de l’UTAC, ils vous ont probablement indiqué le coût des matériels. Il faut, en outre, des infrastructures spécifiques et des experts en la matière.
Si nous devions être amenés à confier des contrôles à une autre entité que l’UTAC, je ne vois pas d’autre possibilité que les laboratoires notifiés par les États de l’Union européenne. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure option, sauf à avoir un doute sur les conditions dans lesquelles l’UTAC aurait mis en œuvre ces contrôles. Cela étant, je ne dispose d’aucun élément qui me conduise à m’interroger sur ce point.
Les autorités se sont donc légitimement tournées vers l’UTAC pour refaire les contrôles, d’autant que les autorités n’ignorent pas que les tests normalisés qui existent aujourd’hui dans le cadre de l’homologation ne sont pas représentatifs des émissions atmosphériques ni de la consommation en conditions réelles d’utilisation des véhicules.
J’en viens à la façon dont nous procédons lorsque nous décidons de lancer une enquête.
La DGCCRF a un large pouvoir d’initiative. Autrement dit, nous réalisons, de notre propre initiative, de très nombreuses enquêtes au cours de l’année, soit pour vérifier que les évolutions réglementaires sont comprises et connues des professionnels, soit parce que nous avons reçu de nombreuses réclamations ou plaintes de consommateurs ou de tiers, soit parce que nous relançons régulièrement des investigations dans des secteurs donnés, afin de nous assurer que le cadre législatif et réglementaire est respecté.
Pour lancer des investigations de ce type, il me semble souhaitable d’en informer préalablement le ministre. Pour répondre à l’objectif de cette enquête, je lui avais fait part, suite aux événements révélés par l’EPA, de la nécessité, à nos yeux, de lancer des investigations sur les véhicules vendus sur le territoire national et une enquête auprès de l’ensemble des constructeurs qui commercialisent ces véhicules. Une fois informé, le ministre n’a formulé ni suggestion ni réserve sur cette enquête, que nous avons donc menée.
Mme Delphine Batho, rapporteure. L’enquête que vous avez engagée en septembre était donc bien à l’initiative de la DGCCRF ?
Mme Nathalie Homobono. En effet, c’est nous qui avons pris l’initiative de la mener, mais il m’a paru légitime d’en informer le ministre.
En ce qui concerne les clauses contractuelles, il me semble que vous voulez savoir si nous avons fait une lecture des contrats de vente aux particuliers…
Mme Delphine Batho, rapporteure. Les émissions de NOx, par exemple, font l’objet d’une clause contractuelle aux États-Unis. On informe l’automobiliste qui achète une voiture de ses performances, y compris en matière d’émissions de NOx, ce qui n’est pas le cas en Europe.
Mme Nathalie Homobono. Je ne peux pas vous apporter de précisions sur ce sujet.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Lorsque nous avons auditionné les associations de consommateurs, leurs représentants nous ont dit qu’il était difficile, voire impossible, en Europe, de lancer une action de groupe se fondant sur des clauses contractuelles qui n’existent pas – je pense notamment à l’affaire Volkswagen.
Mme Nathalie Homobono. Dont acte.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Quel est, selon vous, à l’avenir, le rôle de la DGCCRF ? Certains proposent la création d’une agence européenne et un contrôle effectué par les pairs des services d’homologation. Quoi qu’il en soit, la question se pose du contrôle a posteriori et aléatoire, comme vous le faites dans d’autres secteurs. Selon vous, la DGCCRF pourrait-elle jouer un rôle, voire chapeauter la question du contrôle aléatoire a posteriori, chaque année, d’un certain nombre de véhicules en circulation pour vérifier qu’ils sont conformes à la procédure d’homologation ?
M. Denis Baupin. Vous n’avez pas répondu, madame Homobono, à ma question concernant l’objectif de votre enquête chez Renault.
Vous avez dit que vous n’enquêtiez pas si vous estimiez que les arguments étaient probants. Pour avoir assisté notamment à l’audition des représentants de Mercedes, je puis vous dire que les arguments présentés ne m’ont en rien semblé probants. De votre côté, vous avez peut-être d’autres éléments.
Par contre, Renault nous a fourni des explications relativement transparentes sur le dispositif mis en place, lequel ne fonctionne que lorsque la température extérieure est supérieure à dix-sept degrés, ce qui semble très restrictif au regard des températures que nous connaissons quotidiennement dans une ville comme Paris ! Cela signifie que le système de dépollution ne fonctionne qu’entre 15 et 20 % du temps, ce qui n’est pas du tout satisfaisant. Cela étant, nous avons eu une explication claire.
Compte tenu de ces éléments de réponse, est-il nécessaire, selon vous, de poursuivre l’enquête pour comprendre le fonctionnement du dispositif ? Estimez-vous qu’un dispositif qui ne fonctionne que peu de temps dans l’année constitue une forme de fraude ? Ou bien cherchez-vous d’autres éléments ?
Mme Nathalie Homobono. En ce qui concerne ce cas précis, ne suis pas en mesure de vous répondre.
L’objectif de notre enquête était de vérifier si les autres constructeurs avaient mis en place des logiciels ou d’autres dispositifs ayant pour but de fausser les résultats des tests normalisés et d’obtenir l’homologation. Compte tenu de l’affaire Volkswgen, nous avons anticipé les questions qui pourraient se poser, concernant les autres constructeurs qui vendent des véhicules sur le territoire national, car il nous faut déterminer s’il y a eu volonté manifeste de tromper les autorités d’homologation, et donc, les acquéreurs des véhicules.
En ce qui concerne Renault, nous n’avons pas été tout à fait convaincus par les arguments de ses représentants, ce qui nous a amenés à lancer une perquisition. Nous sommes en train d’exploiter les éléments recueillis au cours de cette perquisition, afin de déterminer si tel ou tel dispositif a une utilité en conditions réelles de circulation du véhicule, ou un objet plus circonscrit. C’est sur ces points que nous interrogeons les représentants et les salariés de l’entreprise.
S’agissant de la mise en place de contrôles a posteriori, nous ne sommes pas des experts en la matière. Nous ne sommes donc pas les mieux placés.
N’étant pas l’autorité de surveillance du marché et n’ayant ni expertise technique particulière ni moyens spécifiques à faire valoir, nous considérons qu’il est préférable d’en rester au partage actuel des responsabilités.
En revanche, s’il était nécessaire de mener une enquête en complément de contrôles a posteriori, nous nous joindrions volontiers aux investigations menées par nos collègues, s’agissant de sujets qui relèvent du domaine de compétence de la DGCCRF, comme la protection économique des consommateurs. En ce qui concerne l’aspect technique, nous considérons que nous n’avons pas d’expertise et que cela ne justifie pas de faire évoluer la répartition des responsabilités.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Avez-vous ces compétences dans d’autres domaines du droit de la consommation ?
Si j’ai bien compris, vous pensez qu’on doit vous adresser les suspicions de fraude, à la suite de quoi vous intervenez, mais qu’il doit y avoir une autorité de surveillance en propre.
Cela étant, exercez-vous cette fonction de surveillance et de contrôle dans d’autres domaines ?
Mme Nathalie Homobono. Oui, dans des domaines où nous avons l’expertise. Nous sommes une autorité de surveillance du marché pour des produits autres qu’alimentaires. L’essentiel de notre action est de faire des prélèvements. C’est la même démarche que celle consistant à faire des contrôles a posteriori de manière aléatoire.
Nous avons contrôlé des jouets, des équipements de protection individuelle et de nombreux autres produits qui demandent une expertise technique.
En ce qui concerne les jouets, nous avons acquis cette expertise au fil du temps et nous l’entretenons puisque notre programme de contrôle est annuel.
S’agissant des équipements de protection individuelle, nous avons un certain nombre de repères et de réflexes. Les enquêteurs savent à peu près quels équipements peuvent poser problème.
En outre, nous avons recours à des laboratoires pour faire des tests sur les équipements et vérifier si nos interrogations, voire nos suspicions, sont fondées.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Vous dites que vous n’avez ni les moyens ni l’expertise technique, mais personne d’autre ne les a. Le contrôle a posteriori étant inexistant, à l’exception du service d’homologation, il va falloir se doter de moyens de contrôle et d’expertise qui n’existent pas aujourd’hui.
Cela étant, même si des moyens nouveaux d’expertise et de contrôle étaient dégagés pour le contrôle a posteriori, vous ne semblez pas penser que le pilotage doive revenir à la DGCCRF…
Mme Nathalie Homobono. Sur des sujets qui évoluent de cette façon, il faut avoir des ressources nombreuses qui entretiennent les compétences. Vous avez raison de dire qu’aujourd’hui, ce sont essentiellement les services d’homologation, soit les équipes de l’UTAC, soit les constructeurs, qui ont cette expertise. Elle repose sur peu de personnes et elle doit être très régulièrement entretenue pour rester viable.
Je me suis occupée, autrefois, de l’homologation des véhicules. C’est un sujet sur lequel, pour rester pertinent, il faut rester très affûté dans la durée.
M. Denis Baupin. En ce qui concerne Renault, vous avez dit que les dispositifs d’invalidation étaient proscrits.
En l’occurrence, les constructeurs ont indiqué que, s’ils faisaient fonctionner le système de dépollution à une température inférieure à dix-sept degrés, ils risqueraient de casser le moteur et que la directive prévoyait, s’il y avait un risque de porter atteinte au véhicule, la possibilité de ne pas faire fonctionner le système de dépollution. Or même s’il n’est pas fait pour tromper, ce logiciel indique qu’il fait dix-sept degrés et, de fait, empêche la mise en œuvre du système de dépollution.
Où est la limite entre un logiciel conçu pour contourner la réglementation et un logiciel créé pour que le système de dépollution ne fonctionne qu’une partie du temps, et notamment pendant les tests d’homologation ? Existe-t-il une jurisprudence sur ce point ? Une part de subjectivité ?
Mme Nathalie Homobono. Il n’y a, à ma connaissance, que très peu de jurisprudence en la matière. Elle va s’établir à la faveur des procédures qui seront examinées par la justice, en s’appuyant, notamment, sur le procès-verbal de tromperie que nous avons dressé à l’encontre de Volkswagen, et peut-être sur d’autres actions que nous mènerons par la suite.
Nous faisons d’abord une enquête administrative. Il nous faut réunir des preuves ou un faisceau de présomptions, qui peuvent nous amener à considérer qu’il y a, soit des dispositifs qui visent à améliorer, par exemple, les émissions, soit des dispositifs dont l’unique objectif est de fausser les résultats des tests d’homologation. Par conséquent, il y a une part d’appréciation dans notre analyse, mais nous essayons d’avoir un standard de preuves assez robuste et des éléments concordants.
Quoi qu’il en soit, c’est la justice qui donnera les suites qu’elle jugera utiles, en considérant que notre analyse est pertinente ou en portant une appréciation différente de la nôtre.
À ce stade, les questions qui se posent concernent des dispositifs qui existent sur les véhicules Renault. Il s’agit de savoir s’ils sont exclusivement destinés à passer avec succès les tests d’homologation ou bien s’ils sont, notamment, utiles dans ce cadre, mais aussi d’une façon plus générale.
Nous devrons également nous forger notre propre appréciation sur des éléments complémentaires, qui ne sont pas uniquement de nature technique.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Je rappelle que notre commission n’est pas une commission d’enquête, mais qu’elle a néanmoins vocation à travailler sur l’offre automobile française dans son acception la plus large. Aussi, madame la directrice générale, je vous remercie pour cet exposé général.
La séance est levée à treize heures cinq.
◊
◊ ◊
39. Audition, ouverte à la presse, avec les représentants du secteur de l’automobile au sein des grandes centrales syndicales, avec la participation de : pour Force ouvrière-Métaux (FO-Métaux) : M. Christian Lafaye, M. Laurent Smolnik, M. Jean-Yves Sabot et M. Jean-Philippe Nivon ; pour la Fédération générale des mines et de la métallurgie-CFDT (FGMM-CFDT) : M Philippe Portier, M. Franck Daout, M. Jean-François Nanda et M. Sébastien Sidoli ; pour la CFTC : M. Albert Fiyoh Ngnato, M. Eric Heitz, M. Emmanuel Chamouton et M. Franck Don ; pour la Fédération de la Métallurgie–CGC (CFE-CGC) : M. Éric Vidal, M. Jacques Mazzolini et M. Frédéric Vion
(Séance du mardi 5 avril 2016)
La séance est ouverte à seize heures quarante.
La mission d’information a organisé une table ronde avec des représentants du secteur de l’automobile au sein des grandes centrales syndicales. Elle a entendu : pour Force ouvrière Métaux (FO-Métaux) : M. Christian Lafaye, délégué syndical central FO PSA, M. Laurent Smolnik, délégué syndical central FO Renault, M. Jean-Yves Sabot, secrétaire fédéral en charge de l’industrie automobile à la Fédération FO Métaux et M. Jean-Philippe Nivon, ingénieur qualité Valéo ; pour la Fédération générale des mines et de la métallurgie-CFDT (FGMM-CFDT) : M Philippe Portier, secrétaire général, M. Franck Daout, délégué syndical central Renault, M. Jean-François Nanda, délégué syndical central adjoint Renault et M. Sébastien Sidoli, du comité stratégique PSA ; pour la Fédération des travailleurs de la metallurgie – FTM-CGT : M. Richard Gentil, administrateur Renault, M. Denis Bréant, animateur du collectif fédéral automobile, M. Vincent Labrousse, animateur du collectif fédéral emboutissage, M. Fabien Gache, délégué syndical central de Renault ; pour la CFTC : M. Albert Fiyoh Ngnato, responsable des services de l’automobile, M. Eric Heitz, membre du bureau Fédéral de la CFTC Métallurgie et responsable CFTC équipementier automobile, M. Emmanuel Chamouton, responsable CFTC au sein de la direction de la recherche et du développement PSA Peugeot Citroën et M. Franck Don, délégué syndical central CFTC PSA ; pour la Fédération de la Métallurgie–CGC (CFE-CGC) : M. Éric Vidal, responsable du dossier filière automobile, M. Bruno Azière, délégué syndical central Renault, M. Jacques Mazzolini délégué syndical central PSA Peugeot Citroën et M. Frédéric Vion, représentant syndical CFE-CGC au comité de groupe JTEKT.
Mme Delphine Batho, présidente et rapporteure. Nous accueillons aujourd’hui les responsables des grandes organisations syndicales de la filière automobile.
Il s’agit de FO Métaux, de la Fédération générale des mines et de la métallurgie-CFDT, de la CFE-CGC et de la CFTC.
La Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie, qui avait donné son accord pour participer à cette table ronde et constitué sa délégation, nous a prévenus, en début d’après-midi, qu’elle ne pourrait pas y assister.
Je remercie les présents d’avoir répondu à notre invitation et d’avoir constitué des délégations qui représentent différents groupes ou entreprises du secteur.
Nous avons considéré qu’il était indispensable d’entendre les organisations syndicales alors que nous multiplions les auditions et les visites de sites industriels.
Je rappelle que la présente mission d’information a été créée par la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale cet automne, après ce qu’il est convenu d’appeler l’« affaire Volkswagen », mais qu’elle entend aborder la problématique de l’offre automobile en France sous plusieurs angles : industriel bien sûr, mais aussi énergétique, fiscal et social.
Nous ne limitons pas notre réflexion aux seuls constructeurs français et nous souhaitons porter notre attention sur la filière dans son ensemble. Cela signifie que la situation économique et de l’emploi chez les équipementiers, grands et petits, relève aussi des problématiques retenues par la mission.
Dans un premier temps, je propose que chacune de vos organisations puisse exposer son analyse de la filière et des grands enjeux économiques ou sociaux durant cinq minutes. Puis nous vous poserons un certain nombre de questions plus précises.
M. Jean-Yves Sabot, secrétaire général chargé de l’industrie automobile à la Fédération FO-Métaux. Je concentrerai mon intervention sur tout ce qui concerne le monde du travail.
En France, la filière automobile représente encore près d’un salarié sur dix. C’est donc un des pans importants de l’activité industrielle française.
La crise économique de 2008 a placé la filière automobile dans une situation difficile. Nous avons vu un grand nombre d’externalisations, un grand nombre d’établissements fermer, la situation des sous-traitants devenir extrêmement délicate et la filière redimensionner son appareil productif à la baisse, tout cela de manière durable.
Nous n’avons eu de cesse, comme je le crois, nos collègues présents aujourd’hui autour de cette table, de souligner, lors de la mise en place de la filière automobile, à la suite des Etats généraux, qu’il était important de réfléchir à la manière de regagner des volumes de production en France et à se préparer à la redimensionner. Aujourd’hui, le risque est de devoir compter avec une filière automobile moribonde.
Nous avons constaté que certaines compétences ont pu être perdues, notamment chez les équipementiers, ce qui peut poser des problèmes à la filière automobile.
La situation de l’emploi est déterminée par le niveau de production en France. Nous avons assisté à beaucoup d’externalisations. Aussi, tous les discours sur la réindustrialisation nous laissent-ils un peu sceptiques ! Nous aimerions que l’hémorragie soit limitée à terme, et que l’on puisse conserver un bon niveau de production en France.
On a beaucoup parlé, ces dernières années, de la nécessaire internationalisation de la filière. Les grands constructeurs, les grands équipementiers sont devenus des groupes mondiaux qui raisonnent au plan international. En France, la filière s’est beaucoup attachée à la capacité d’internationalisation des entreprises françaises. FO souhaite rappeler qu’il ne faut pas oublier non plus nos capacités d’exportation et nos savoir-faire. Si l’on veut défendre nos emplois et nos savoir-faire, il convient de continuer à soutenir nos établissements, nos usines, nos centres de recherche.
J’en viens au diesel qui a été au cœur du scandale Volkswagen, mais pas uniquement. Comme les organisations qui sont autour de cette table, nous ne sommes pas insensibles aux questions environnementales. Il est donc important de se diriger vers une industrie propre. Il faut trouver le point d’équilibre entre l’intérêt économique des entreprises, la problématique environnementale et surtout le volet social. J’appelle l’attention de la mission d’information sur l’enjeu que représente la diésélisation de la filière pour l’emploi en France.
Les constructeurs français sont des diésélistes tout à fait performants au plan mondial, et le parc automobile est diésélisé dans une très forte proportion. Il faut prendre garde aux évolutions et à leur rythme, pour permettre des reconversions raisonnées des établissements.
Il ne faudrait pas voir fermer, comme cela fut le cas après 2008 chez les constructeurs, les usines de motorisation. Nous préférerions pouvoir travailler sur des reconversions douces.
Il est important également d’envisager la situation de notre industrie automobile en France à travers le prisme de ce qui se passe chez nos principaux voisins, notamment les Allemands qui ont une forte capacité de lobbying et savent très bien comment protéger leur propre industrie.
J’appelle votre attention sur le fait qu’il faut bien mesurer quelles sont les mutations importantes, pour que les groupes qui sont implantés sur le territoire – ils ne sont pas tous français – puissent maintenir des emplois et des savoir-faire.
Enfin, il faut intégrer l’aval de la filière dans la réflexion sur l’automobile. En effet, ce secteur compte pour beaucoup – le commerce représente 400 000 salariés – et il tiendra probablement une grande place dans les réflexions à venir sur les mutations de l’automobile.
M. Christian Lafaye, délégué syndical central FO PSA. PSA est très attaché au sujet du diesel. Nous avions demandé des contrôles indépendants sur les émissions polluantes. Il serait intéressant de savoir où en sont ces contrôles.
M. Jean-Philippe Nivon, ingénieur qualité chez Valeo, délégué syndical central FO. Je concentrerai mon propos sur les équipementiers puisque je fais partie de Valeo.
Les équipementiers ne se focalisent pas sur un constructeur plutôt que sur un autre. Vous avez parlé du dieselgate. La communication a été très forte en France par rapport au nombre de véhicules concernés aux États-Unis. Cette affaire a eu un impact important sur la vente de véhicules en France puisque les gens se sont rués sur les véhicules essence : c’est ce que j’appelle, en tant que Lyonnais, une décision parisienne. Or le diesel est vital pour les gens qui habitent à la campagne car l’essence coûte très cher. Faites attention aux conséquences que pourraient entraîner les décisions que vous prendrez, à l’issue de vos travaux, en ce qui concerne le pourcentage de véhicules diesel et de véhicules essence.
Pour sortir des problèmes de pollution auxquels elle est confrontée, la Chine va importer beaucoup de véhicules diesel. Le lobbying anti-diesel que l’on constate actuellement en France n’est-il pas trop poussé ? Voilà une question que je voulais poser, les équipementiers étant directement affectés par les stratégies des constructeurs, qu’ils soient français – Renault, PSA – ou étrangers – BMW, Volkswagen –, car, comme l’a dit M. Sabot, les équipementiers travaillent avec tous les constructeurs.
M. Éric Vidal, responsable du dossier filière automobile, Fédération de la métallurgie-CGC. Je vous remercie de nous donner l’occasion de nous exprimer.
Je souhaite vous présenter la délégation de la CFE-CGC. Frédéric Vion, qui travaille dans la région lyonnaise, est représentant syndical CFE-CGC au comité de groupe de l’entreprise JTEKT, et Jacques Mazzolini est délégué syndical central de PSA. Pour ma part, je travaille chez Renault, et je suis animateur pour la filière automobile, pour la CFE-CGC. Par ailleurs, je tiens à excuser Bruno Azière, souffrant, qui est délégué syndical central de Renault, pour la CFE-CGC.
Cela fait longtemps que la CFE-CGC est active dans la filière automobile qu’elle soutient.
Force est de reconnaître que l’automobile n’a pas bonne presse. On entend plus facilement que l’automobile tue les gens et qu’elle pollue les villes plutôt qu’elle emploie 700 000 personnes en France, si l’on inclut ceux qui construisent les automobiles et ceux qui en font le commerce, la maintenance et l’après-vente. Il faudrait le rappeler plus fortement ; j’espère que c’est ce que vous ferez dans votre rapport.
Cette mauvaise image est due également au nombre d’emplois détruits. Il y a effectivement moins de gens qui travaillent aujourd’hui dans le secteur automobile qu’en 2001 ou encore en 2011. Cela dit, même s’il y a moins d’emplois, il y a toujours autant d’embauches. Il devrait même y avoir, je le pense, des vagues d’embauches à venir. Mais je ne suis pas certain que cela soit ancré dans la tête de tout le monde !
L’industrie automobile a externalisé certaines de ses fonctions qui sont sorties parfois du giron de la métallurgie. Mais si l’on constate des pertes d’emplois dans la métallurgie, ce n’est pas le cas pour d’autres branches qui travaillent pour l’automobile – je pense à la branche des services. D’un point de vue comptable, ces gens-là sortent de l’automobile alors que ce secteur pourvoit à ces emplois.
Nous nous attendions à ce que la France soit un des piliers des véhicules électriques, et de manière générale décarbonés. Aujourd’hui, nous nous demandons si ce ne sera pas plutôt la Chine qui sera leader en la matière. C’est grave, car c’est une avance technologique qu’il ne faut pas laisser aux autres puisqu’elle générera des emplois. Ce sujet nous préoccupe beaucoup.
Les métiers de l’industrie automobile bougent énormément. Si les gens sont de moins en moins mécaniciens, ils sont compétents en matière de numérique et de contrôle d’objets connectés, ce qui veut dire qu’il y a là un vivier d’emplois et de compétences phénoménal. Les enjeux en termes de formation initiale, et surtout de formation continue, sont importants. Il faut permettre aux gens de se former à de nouvelles technologies, et ainsi de monter en compétences.
Les équipementiers pressentent qu’il va y avoir encore des rapprochements, ce qui, d’un point de vue social, nous fait frémir car, en général, qui dit rapprochement dit diminution d’effectifs. Il faudra donc être vigilant.
La filière a su passer la crise de 2008-2009, certes avec des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE), mais tout cela s’est fait dans un contexte social relativement calme compte tenu de la tempête à laquelle elle a fait face. Aujourd’hui, l’industrie automobile française se relance, grâce surtout à la signature d’accords de compétitivité avec les organisations syndicales.
Quand une entreprise ou un site a signé un accord de compétitivité, le problème c’est de trouver les gens pour faire le travail et non de trouver du travail. Ce qui est important, c’est la négociation sur le terrain, au plus près des besoins, soit des établissements, soit des petites ou des grandes entreprises, et d’avoir la possibilité de parler le plus en amont possible de tous les sujets délicats. J’entends par sujet délicat par exemple un rapprochement entre deux entreprises. En la matière, les représentants du personnel et les organisations syndicales doivent être mis au courant le plus tôt possible, de façon à voir comment le virage peut être pris.
M. Jacques Mazzolini, délégué syndical central PSA Peugeot Citroën, Fédération de la métallurgie-CGC. Je veux revenir sur les évolutions qui attendent la filière automobile.
Nos collègues ont décrit la situation actuelle. Le nombre d’emplois a effectivement considérablement chuté dans le périmètre de la filière tel qu’on a l’habitude de le considérer, étant entendu que le périmètre n’est pas nécessairement représentatif de l’ensemble des personnes qui travaillent pour la filière automobile et que cette filière va considérablement évoluer dans un futur proche pour intégrer d’autres compétences que mécaniques, notamment toute la technologie embarquée. Partout, en Europe ou ailleurs, le virage du véhicule électrique, de l’hybridation, de la connectivité et du numérique, sera pris. Nous avons intérêt à ce qu’il soit plutôt pris chez nous pour que les premiers emplois soient générés sur notre territoire et que les technologies irradient depuis l’Europe, et non que l’Europe devienne un réceptacle de technologies qui seront développées ou construites en Chine, par exemple.
M. Frédéric Vion, représentant syndical CFE-CGC au comité de groupe JTEKT. J’ai lu avec attention parmi les premières auditions que vous avez faites, celles d’Éric Poyeton, directeur de la Plateforme automobile et mobilités (PFA), et de Louis Schweitzer, le Commissaire général à l’investissement. Ce dernier a fort bien décrit le dieselgate.
Aujourd’hui, la filière automobile française est en retard par rapport à la filière automobile allemande s’agissant de sa structuration. Comme le véhicule sera demain davantage un moyen de communication qu’un moyen de transport, il faut à tout prix que vous exhortiez la PFA et la filière automobile française à rattraper le retard qu’elle a pris par rapport à ses concurrentes, notamment à l’Allemagne, de façon que le lobbying fait au niveau européen puisse s’exercer également au niveau français et que la pépite que constitue encore aujourd’hui la filière automobile française ne soit pas gâchée dans dix ou quinze ans.
M. Franck Don, délégué syndical central CFTC PSA. J’ai le plaisir de vous présenter Albert Fiyoh Ngnato, responsable des services de l’automobile, Éric Heitz, responsable CFTC équipementier automobile, et Emmanuel Chamouton, responsable CFTC au sein de la Direction de la recherche et du développement de PSA Peugeot Citroën. Pour ma part, je suis délégué syndical central CFTC chez PSA.
Effectivement, la filière automobile a connu un choc en 2008, avec les conséquences que l’on sait, notamment des restructurations. Puis a éclaté l’affaire du diesel, que l’on peut regretter. Cette affaire n’est peut-être pas arrivée au bon moment et elle n’a peut-être pas été suffisamment anticipée. La « maison automobile » est donc aujourd’hui en grande restructuration et elle connaît de profonds changements.
Ces changements sont liés d’abord aux orientations politiques environnementales. Il est clair que des progrès importants ont été effectués en ce qui concerne le diesel. Mais qui peut soutenir que le diesel existera encore dans trente, quarante ou cinquante ans ? Il faut donc rapidement exploiter d’autres filières. Cela veut dire qu’il va falloir commencer à procéder à un rééquilibrage entre moteurs essence et moteurs diesel. En parallèle, et dans la foulée, il faut travailler sur les moteurs hybrides et faire en sorte que ceux-ci montent en puissance et soient améliorés pour assurer au moins l’interface avec le véhicule tout électrique. C’est ce que l’on voit apparaitre avec des sociétés comme Tesla. L’idée paraît séduisante, tant en termes de performance que d’autonomie du véhicule.
Ces changements sont liés ensuite à l’adaptation des points de vente, de l’après-vente, grâce à des moyens digitaux, pour satisfaire le client. Un constructeur pourrait très bien, à l’avenir, élargir sa gamme de services en proposant, par exemple, une assurance, un parking, l’entretien, etc. Il pourrait y avoir également des points de vente multimarques, des réseaux de pièces de rechange. Bref, il y a là de nombreuses idées à creuser pour essayer de sortir le constructeur automobile du carcan dans lequel il est enfermé, c’est-à-dire ne fabriquer que des automobiles.
Au-delà de nos points de vente, il faudra aussi adapter nos usines – on parle beaucoup de l’usine 4.0 – en les équipant de nouveaux robots intelligents et d’une communication entre les différents outils de production et les chaînes d’approvisionnement. Tout cela nécessite d’anticiper la formation des salariés, de ceux qui sont en place aujourd’hui et, dans un deuxième temps, des futurs salariés. Aussi faudra-t-il travailler en amont, avec l’Éducation nationale, pour former les gens qui viendront travailler dans ces usines du futur.
On oublie souvent que la vision des usagers sur la mobilité a évolué. Je pense à l’autopartage, au covoiturage. On pourrait très bien avoir un véhicule selon le besoin du moment. Par exemple, si je suis à Paris la semaine, une petite voiture électrique me suffit bien pour aller au travail. Par contre, comme j’ai des enfants, il me faut le week-end une voiture plus grande et d’une plus forte cylindrée. Pourquoi ne pas envisager de payer une certaine somme chaque mois pour bénéficier d’un service qui me permettrait d’avoir un véhicule qui correspondrait à une situation donnée ? J’ajoute que les jeunes n’ont pas la même perception de la possession d’un véhicule que ma génération. Je pense que la filière automobile est restée un peu trop longtemps « droit dans ses bottes ». Il est encore temps de changer.
Bien sûr, il faut développer le véhicule autonome, qui peut avoir un impact positif sur la sécurité routière. L’usager de demain pourra allumer son ordinateur alors que sa petite voiture électrique autonome le conduira jusqu’à son travail. Et comme elle est électrique, elle aura aussi l’autre avantage de ne pas polluer.
Mais toutes ces évolutions exigent une révolution dans nos entreprises avec un élargissement des compétences et de ne plus raisonner en simple fournisseur d’un produit mais d’un service. La CFTC, qui a compris cet aspect, est prête à l’accompagner parce qu’elle pense que c’est le seul moyen moderne aujourd’hui de préserver les emplois et les sites industriels sur le territoire français. Bien sûr, comme je l’ai dit, il conviendra de former les salariés pour assurer la transition, et de recourir à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) telle qu’elle a été conçue, c’est-à-dire en anticipation et pas attendre que les problèmes surviennent pour mettre en place des mesures qui ne sont plus de la GPEC, du moins dans l’esprit.
Les sites industriels doivent anticiper plutôt que subir, être en action plutôt qu’en réaction, faire les investissements nécessaires pour intégrer les nouvelles technologies. Bien évidemment, des aides pourraient leur être attribuées dans ce cadre-là.
Nous regrettons que les organisations syndicales de manière générale ne soient pas associées aux décisions de l’entreprise. Des comités paritaires stratégiques commencent à voir le jour ; c’est un beau premier pas, mais ce n’est pas suffisant. On doit aller plus loin dans la démarche. Nous sommes encore loin, très loin du système de cogestion à l’allemande – je ne sais pas si je le verrai pour ma part. Avant d’arriver à un tel système de cogestion à l’allemande, on pourrait peut-être trouver un système intermédiaire que l’on pourrait appeler de co-construction avec les organisations syndicales. Ce serait déjà un premier pas.
M. Albert Fiyoh Ngnato, responsable des services de l’automobile, CFTC. Je souhaite intervenir sur la filière aval qui est très importante. En réalité, avec 470 000 salariés, c’est la cinquième branche en France. En fait, au total ce sont 700 000 personnes qui vivent de toute cette filière.
Comme l’a dit mon collègue de la CFE-CGC, la filière automobile est décriée. Pourtant, aucun autre secteur n’a fait autant d’innovations en matière d’écologie, et il n’a pas attendu pour se lancer dans l’économie solidaire. De plus, pour minimiser ses coûts, l’automobile a dû se réinventer : en utilisant les produits issus de la déconstruction pour fabriquer de nouvelles voitures, elle participe à la politique décarbonée. Et elle dépense beaucoup d’argent dans le traitement des huiles.
Quand on parle de mobilité, on pense à toutes les entreprises qui tournent autour du GAFA ou de la finetech. Mais n’oublions pas que c’est l’automobile et toute la filière aval qui ont créé l’autopartage et les modes de déplacement doux.
La filière automobile dépense beaucoup d’énergie pour se faire accepter alors qu’elle est en grande souffrance en matière fiscale. Regardez les bénéfices qu’engendrent les entreprises de la finetech par rapport à l’entreprise automobile traditionnelle que nous connaissons qui est pourtant créatrice d’emplois. Si Blablacar est un très bon concept pour le pays, en réalité elle ne génère pas autant d’emplois qu’un constructeur automobile. Il en est de même des gens qui vendent des voitures sur Internet et qui ont le statut d’autoentrepreneur !
On demande aux entreprises de mener demain une politique décarbonée. Mais encore faudrait-il leur donner les moyens en termes fiscal et humain. À l’instant, M. Don a cité Tesla. Mais cela reste à démontrer que cette entreprise, qui s’inscrit dans un marché de niche, est meilleure qu’une entreprise automobile traditionnelle de masse qui fait vivre des millions de familles. On ne peut pas raser du jour au lendemain une industrie qui a tant fait pour la croissance de la France et qui est porteuse d’une espérance sociale pour tant de gens. Et je ne suis pas sûr que le législateur soit prêt à tout changer. Pour que les voitures connectées fonctionnent correctement demain, encore faudrait-il que le législateur modifie les lois. Le code de la route tel qu’il existe aujourd’hui n’est pas adapté à ces véhicules. Et a-t-on prévu des parades au cas où des hackers paralyseraient l’économie ?
Il faut donc continuer à soutenir l’industrie automobile française, afin qu’elle soit compétitive demain, et cela alors que la Chine est en train de prendre une place de plus en plus importante.
M. Philippe Portier, secrétaire général de la Fédération générale des mines et de la métallurgie-CFDT (FGMM-CFDT). Je partage très largement les propos de mes collègues en ce qui concerne notamment la mauvaise image de l’automobile. En regardant les personnes présentes autour de cette table, je me dis aussi que nous avons encore certains efforts à faire en matière de mixité !
Mme Delphine Batho, présidente et rapporteure. Ce n’est pas propre au secteur automobile !
M. Philippe Portier. Mais il ne faut pas lâcher l’affaire !
Renault a signé un accord de compétitivité de 710 000 véhicules par an, volume qui n’est pas encore atteint. Cela devrait sécuriser les sites d’assemblage, ce qui est important. Chez PSA, l’objectif est d’un million de véhicules. Par contre, tous les sites ne sont pas forcément sécurisés.
Le Gouvernement a mis en place une politique dite de l’offre sur le plan macroéconomique. Bien entendu, la filière automobile en profite. Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et le Pacte de responsabilité ont des effets qui se feront certainement sentir davantage encore en 2016, parce que les salaires sont plus élevés dans l’industrie que dans les services par exemple. Ils seront donc davantage concernés par les réductions de charges.
Les entreprises ont vu leurs marges améliorées, ce qui est dû aussi à l’embellie du secteur et pas uniquement au CICE et au Pacte de responsabilité. On voit aussi le retour des investissements, ce qui est une bonne chose. Dans le même temps, des entreprises continuent à demander à leurs salariés de consentir beaucoup d’efforts alors qu’un patron se permet de doubler son salaire…
Les accords de compétitivité ont leur raison d’être, mais la compétitivité-coût trouve rapidement ses limites. Il faut s’intéresser de plus près à la compétitivité hors coût. Développer la fibre de carbone pour alléger les véhicules est un élément structurant pour toute la filière. On peut penser aussi à l’expérimentation des véhicules consommant deux litres aux 100 kilomètres qui est très fédératrice pour la filière.
On parle moins de l’esprit collaboratif tout au long de la filière. Je pense aux donneurs d’ordres vis-à-vis de leurs sous-traitants et de leurs fournisseurs et aux fournisseurs vis-à-vis de leurs sous-traitants. Cet aspect me semble économiquement plus efficace que la compétitivité-coût. Il faut savoir que, dans une usine d’assemblage, la masse salariale représente 5 % de son chiffre d’affaires. Aussi, pour gagner 10 % de masse salariale, on agit sur 5 % du chiffre d’affaires. Si ce raisonnement est psychologiquement important pour les chefs d’entreprise et pour M. Gattaz, il ne tient pas la route en termes économique.
En 2014, le groupe de sous-traitance automobile Altia a fait faillite. Ce groupe avait été construit de bric et de broc grâce au Fonds de modernisation des équipementiers automobiles (FMEA) qui avait été créé lors des Etats généraux de l’automobile. Il était constitué de beaucoup de rachats de sociétés qui étaient en redressement ou en liquidation judiciaire. Le consortium Altia voulait permettre à des entreprises de ressembler aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) allemandes. Avec la CGT, nous avions tiré la sonnette d’alarme à plusieurs reprises, mais nous n’avons jamais été entendus ! C’est regrettable, car l’État, qui était actionnaire à hauteur de 20 % je crois, a perdu beaucoup d’argent.
Il manque donc à la filière automobile des lieux où pourrait s’instaurer un dialogue social. C’est un élément sur lequel on pourrait progresser sensiblement.
La filière automobile en France est très hétérogène. On peut donc difficilement avoir un raisonnement standardisé. Certaines entreprises ont une masse salariale qui représente 5 % du chiffre d’affaires, tandis que pour d’autres elle atteint les 20 %. Les enjeux et les remèdes ne sont donc pas les mêmes. Voilà pourquoi nous sommes attachés à tout ce qui peut être négocié au niveau de l’entreprise.
C’est à ce niveau que l’on trouvera des solutions intelligentes et non en prenant de grandes dispositions qui concerneraient toute la filière.
On note aussi que les fournisseurs et les sous-traitants voient leur part à l’exportation augmenter, passant d’un tiers en 2010 à la moitié aujourd’hui.
On peut s’interroger sur ce qui se passe actuellement au Maghreb où beaucoup de nouvelles capacités sont en train de se développer. Je me souviens que, lorsque les capacités se sont développées dans l’est de l’Europe, le discours était le même : cela devait concerner le marché local. Or on a vu les surcapacités ainsi engendrées et les difficultés que tout cela a entraîné. Aussi faut-il avoir une vision très précise sur le Maghreb. Je ne dis pas qu’il ne faut rien développer là-bas, bien au contraire. Mais cela doit faire l’objet d’un dialogue, ce que les Allemands savent mieux faire que nous. Ils sont capables de dire en effet que telle chose peut être délocalisée tandis que telle autre doit être gardée sur leur territoire. Ce dialogue n’existe pas en France, ce qui est fort regrettable.
La France devra faire preuve de rigueur et de fermeté en ce qui concerne les futures normes d’émissions de dioxyde de carbone (CO2) en Europe pour 2030, car il y aura beaucoup de lobbyings de la part de pays qui ne souhaitent pas aller dans ce sens.
Certains constructeurs ont un discours ambivalent puisque, d’un côté, ils sont plutôt favorables à des normes exigeantes, tandis que, de l’autre, ils se livrent à du lobbying pour qu’elles ne le soient pas trop pour des questions de rentabilité de leur capital ou de leurs investissements. Pour autant, je pense que l’industrie française a intérêt à ce que les normes soient les plus dures possible. On a vu, avec la crise aux États-Unis, que c’était un bon point pour l’industrie européenne.
Nous avons aussi beaucoup de mal à lire ce qui se passe autour du bonus-malus. Nous n’arrivons pas à cerner la logique des changements…
Mme Delphine Batho, présidente et rapporteure. Ça change chaque année !
M. Philippe Portier. Tous ces changements ne sont pas sains, car le bonus-malus est un outil de politique industrielle.
Enfin, s’agissant du prix de l’essence et du diesel, à mon sens rien ne justifie de privilégier le diesel par rapport à l’essence.
M. Franck Daout, délégué syndical central Renault, FGMM-CFDT. PSA et Renault ont un savoir-faire en matière de motorisation, à tel point que même des constructeurs allemands ou étrangers font tout pour avoir nos moteurs dans certaines de leurs voitures. J’ajoute que, jusqu’à preuve du contraire, Peugeot et Renault n’ont pas triché et n’ont pas l’intention de tricher sur le passage des différentes normes.
Renault et Peugeot possèdent respectivement une et deux usines de moteurs. Cette activité ne nous inquiète pas, à court et moyen terme. Je rappelle qu’à Cléon, en Normandie, 300 millions d’investissements sont prévus d’ici à 2018, ce qui nous rassure.
L’hybridation est dans les cartons chez Renault comme chez Peugeot, et Carlos Tavares l’a confirmé ce matin à la radio. Il en est de même en ce qui concerne la motorisation électrique où Renault est le leader sur le marché. Ce qui nous inquiète, par contre, c’est la posture politique. Par définition, une voiture électrique a besoin d’être rechargée.
Or il y a un décalage entre les discours et la réalité. Si Renault sait, en interne, que 95 % des utilisateurs de voitures électriques sont tellement satisfaits de leur voiture qu’ils ne feraient rien pour en changer, il est conscient aussi que ces utilisateurs rencontrent bien des difficultés pour la recharger. Dès le départ, il y a eu un quiproquo puisque la population que l’on a visée, c’était celle qui était capable d’acheter une voiture électrique comme voiture citadine, alors que les proches banlieues, les néoruraux ont peut-être davantage la capacité d’utiliser la voiture électrique que les citadins. Même si Autolib’ est un modèle économique qui fonctionne bien, il est clair que c’est bien hors des villes et non pas dans les villes, qui par ailleurs font le nécessaire pour améliorer leurs transports, qu’il est possible d’étendre ce modèle.
Nous pensons que, pour avoir un constructeur fort et une filière forte, il faut également un dialogue social fort et innovant. Certes, des avancées ont été obtenues avec les accords de compétitivité chez Peugeot et Renault, mais il reste encore de la marge. S’il fallait faire passer un message, c’est bien de faire en sorte que, dans un avenir proche, le dialogue social fasse partie de la performance économique des entreprises.
M. Sébastien Sidoli, du comité stratégique de PSA, FGMM-CFDT. Nous sommes à l’aube du tournant du digital, qui est pourvoyeur d’emplois et de compétences. Aussi faut-il insister sur la formation des salariés et leur évolution vers ces nouveaux emplois.
Comme l’a dit mon collègue, nous sommes à l’aube du nouveau contrat social N°2 qui sera bientôt examiné chez PSA.
M. Philippe Portier. En 2008, nous avions déjà proposé de choisir deux régions ou des territoires sur lesquels on mettrait en place des infrastructures de recharges électriques avec la bonne densité. Cela permettrait de lancer la pompe de la production en série de ces véhicules et de tester en grandeur nature les infrastructures associées à des véhicules électriques largement déployés. Des incitations fiscales pourraient accompagner cette expérimentation.
Mme Delphine Batho, présidente et rapporteure. Vous avez indiqué quels sont les défis d’avenir auquel le secteur est confronté.
Certains d’entre vous ont parlé de l’image du secteur. Notre travail est de chercher les solutions pour sortir de la crise de confiance actuelle par le haut. Bien évidemment, nous travaillons sur les questions relatives aux normes, aux contrôles, nous réfléchissions à la manière de garantir une transparence et une fiabilité vis-à-vis des consommateurs et à redéfinir la position de l’État par rapport à la question des choix technologiques.
Certaines des personnes que nous avons auditionnées parlent de neutralité de l’État, c’est-à-dire que l’État exigerait une norme sur les émissions polluantes. Ensuite, il appartiendrait aux constructeurs de la respecter avec la technologie de leur choix.
Le parc ancien roulant émettant des particules polluantes substantielles, nous avons clairement identifié dans nos travaux que la filière aval pouvait jouer un rôle d’entretien et d’incitation au renouvellement du parc.
Plusieurs d’entre vous ont dressé le paysage d’un marché complètement mondialisé, globalisé et hyperconcurrentiel.
Vous pensez, les uns et les autres, que l’évolution des usages de l’automobile et du numérique va aller beaucoup plus vite que ce que tout le monde avait prévu. Dans ce contexte, comment voyez-vous l’avenir du rôle de l’État actionnaire chez Renault et chez PSA ? Quelles sont vos remarques en la matière ?
Plusieurs d’entre vous ont parlé du dialogue social à l’échelle de la filière, même si je vois que certains sujets ne peuvent être traités que par entreprise. À travers vos interventions, j’ai compris que des sujets globaux comme la formation ou la compétitivité globale du secteur mériteraient un traitement à l’échelle de la filière. Un processus de cette nature a-t-il eu lieu lors des Etats généraux de l’automobile en 2008-2009 ? Que faudrait-il mettre en place concrètement pour aller vers un dialogue social innovant ?
M. Jean-Michel Villaumé. Dans la presse d’aujourd’hui, on évoque le nouveau plan stratégique de PSA, avec des objectifs que l’on peut retrouver chez d’autres constructeurs, notamment chez Renault, comme la baisse des coûts, l’augmentation de la rentabilité, le développement des marchés et le lancement de nouveaux modèles. Par exemple, PSA devrait proposer vingt-six nouveaux modèles dans les cinq prochaines années et développer la voiture électrique et hybride. Que pensez-vous de la politique mise en place chez PSA ? S’agit-il de bonnes nouvelles pour vous les salariés ? Pour ma part, je suis élu de l’aire urbaine Belfort-Montbéliard, située à dix kilomètres de Sochaux.
Lors de la 21e Conférence des parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP21), les organisations syndicales et patronales de la branche des services de l’automobile ont signé un « Pacte climat ». En quoi cela consiste-t-il concrètement ? Quels sont les engagements de ce pacte ?
M. Jean Grellier. Je vous remercie pour vos témoignages. Ce qui nous rassure, c’est que vos analyses ont beaucoup de cohérence.
Vous avez parlé, à plusieurs reprises, de la formation. Au sein du Conseil national de l’industrie, une démarche transversale a été faite entre les différents comités stratégiques de filière, et un rapport a été présenté par Mme Isabelle Martin, de la CFDT. De quelle manière pouvez-vous agir pour que les programmes de formation générale et de formation professionnelle puissent intégrer les orientations qui ont été produites dans ce rapport qui a fait l’objet d’un consensus entre les différents partenaires des comités stratégiques de filières ? Ils abordent les éléments fondamentaux de l’avenir de l’ensemble des filières industrielles.
Vous avez parlé également des choix technologiques – Madame la rapporteure a parlé de neutralité technologique. Comment voyez-vous ce sujet ? J’ai dit aux constructeurs qu’il fallait plaider pour une concertation entre les acteurs de la filière et les pouvoirs publics car les réseaux de distribution d’énergie sont fonction des choix qui sont faits. Là aussi, les partenariats sont nécessaires pour les développer. Je crois que cela fait partie des éléments fondamentaux de l’avenir de la filière.
Je partage votre position sur la restructuration de la filière, pour faire en sorte qu’un certain nombre d’activités soient associées au développement de la filière automobile.
Enfin, je peux témoigner qu’une usine automobile, c’est bien, c’est beau, c’est enrichissant pour un territoire et c’est très triste quand ça ferme !
M. Jean-Philippe Nivon. Actuellement PSA et Renault représentent 30 % des activités de Valeo. Serait-il possible que l’État actionnaire donne, à travers la stratégie de ces deux constructeurs, un peu plus d’activité aux sites implantés en France ? Les sites comme Valeo ou d’autres équipementiers procurent de l’activité à des équipementiers de rang 2, voire de rang 3.
M. Franck Don. À titre personnel, je ne suis pas persuadé qu’un État actionnaire puisse avoir une impulsion industrielle. Par contre, il doit avoir une impulsion sociale et agir pour modifier et embellir le dialogue social, ce qui permettra un bon climat social. Ce serait une erreur que de faire intervenir l’État actionnaire dans les décisions industrielles. D’ailleurs, on a vu que les usines où l’État était actionnaire étaient les premières à s’externationaliser et à s’implanter ailleurs – on l’a appris bien plus tard !
M. Villaumé nous demande ce que nous pensons quand un patron annonce la baisse des coûts, l’augmentation de la rentabilité et des externalisations. Je lui répondrai que nous pensons la même chose que lorsque le Chef de l’État parle de diminuer le chômage et la pauvreté : ces objectifs sont tout à fait louables. La baisse des coûts et l’augmentation de la rentabilité ne sont pas des gros mots. L’important est de savoir comment on le fait, avec quels accompagnements et ce que l’on propose aux salariés. Si on considère que la rentabilité est un gros mot et qu’il ne faut pas en faire, on risque de rencontrer des problèmes qui seront du ressort de la pauvreté et du chômage.
M. Albert Fiyoh Ngnato. Effectivement, nous étions à la COP21 et pas uniquement pour y faire de la figuration. Nous avons signé un accord pour faire partie de tout le schéma, de la construction de l’automobile jusqu’à sa destruction, et contribuer à faire baisser l’impact carbone de toute la filière.
Nous pensons depuis longtemps que l’automobile doit prendre toute sa place dans la politique nationale sur tout ce qui a trait à l’écologie : la mobilité, l’éco-partage, les politiques douces, la formation du consommateur pour qu’il puisse utiliser la voiture autrement. Tout cela contribue clairement à faire changer les mentalités, à voir l’automobile autrement.
M. Emmanuel Chamouton, responsable CFTC au sein de la direction de la recherche et du développement PSA Peugeot Citroën. Tout à l’heure, il a été question de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. En la matière, on oublie trop souvent le mot « prévisionnelle » qui renvoie à une vision à moyen et long termes. Or quand un problème surgit, on est plutôt dans sa résolution à court terme, ce qui peut conduire à des mécanismes qui ne correspondent pas aux objectifs de la GPEC. Il faut réfléchir à ce qu’il convient de faire pour gérer correctement le devenir de l’entreprise tout en étant en mesure de faire évoluer les salariés vers des métiers d’avenir. Or on ne forme pas un électronicien, par exemple, en quinze jours. Il faut réussir le challenge de l’évolution des salariés pour qu’ils soient capables de réaliser les tâches dans l’entreprise. Et si l’on apporte de réelles compétences pour une activité, on pourra éviter aussi des externalisations. Si chaque collaborateur apporte de la valeur ajoutée, le problème de l’externalisation se posera beaucoup moins.
M. Sébastien Sidoli. Je pense que l’État a son mot à dire sur le salaire de nos PDG et sur la fermeture d’une usine !
M. Franck Daout. L’État a son rôle, chez Peugeot comme chez Renault. Il y a quelques années, quand Peugeot a traversé des difficultés, heureusement que l’État était là pour reconstruire un avenir à l’entreprise.
L’État a aussi sa place chez Renault. À cet égard, je ne reviendrai pas sur le chahut qui a eu lieu l’an dernier à la même époque à propos des droits de vote double ! Pour notre part, nous avions pris une position très claire sur cette affaire.
L’État pourrait même aider les organisations syndicales qui siègent maintenant dans les conseils d’administration. Ce serait la moindre des choses que les parts variables des salaires de M. Tavares ou de M. Ghosn répondent à des critères sociaux, voire à la RSE. Cela se fait un peu aujourd’hui, mais de façon timide. Nous aimerions que l’État s’exprime sur ce sujet et qu’il s’associe à nos demandes.
Les accords de compétitivité ont permis de discuter hors des coûts directs. On a abordé les autres coûts, ce qui est positif et a permis un zoom sur la qualité et les compétences des salariés. Mais les deux accords de compétitivité, tant chez Peugeot que chez Renault, vont être rediscutés. On voit les mauvaises habitudes réapparaître, c’est-à-dire que l’on nous compare avec des usines chinoises et espagnoles ! J’ai bien peur que l’on retombe dans les travers que l’on a connus dans les années 2013. On aura une filière forte et des constructeurs forts si et seulement si on a un dialogue social fort et de qualité.
M. Jacques Mazzolini. L’État est un actionnaire de circonstance. En tout cas, c’est ce qui s’est passé récemment avec PSA. Mais ce fut vrai aussi pour Renault bien avant. L’État, comme tout actionnaire, a un certain nombre d’exigences à faire valoir. Il est entré au capital de ces entreprises parce qu’elles ont eu besoin d’aide, mais aussi parce qu’il a la volonté de conserver en France, à la fois des entreprises et une filière automobile forte, et de préserver l’emploi sur le territoire.
Comme l’a dit Franck Don, il ne s’agit pas d’avoir un État stratège et industriel qui donne le cap industriel de l’entreprise. Par contre, cela rassure les salariés de savoir qu’un actionnaire de référence s’attache à maintenir des activités sur le territoire national et qu’il veille au respect des clauses réciproques dans des accords, et c’est un gage de stabilité pour l’entreprise.
M. Franck Don. Je suis tout à fait d’accord avec ce que vient de dire Jacques Mazzolini.
M. Éric Vidal. Je veux revenir sur le dialogue social à l’intérieur de la filière. Ce que voulait dire tout à l’heure Philippe Portier, c’est qu’il n’y a pas, au niveau de la filière, un endroit pour parler avec un peu de hauteur sur des sujets vraiment difficiles. Depuis un ou deux ans, on arrive toutefois à parler localement des sujets difficiles…
Mme Delphine Batho, présidente et rapporteure. Permettez-moi de vous interrompre. Existe-t-il un endroit où les entreprises de la filière parlent entre elles des sujets stratégiques et difficiles ?
M. Éric Vidal. Peut-être. Je dis « peut-être » parce qu’il y a une partie de la filière automobile qui n’est pas accessible aux organisations syndicales, c’est tout ce qui concerne le déploiement de politiques technologiques et de stratégies.
Mme Delphine Batho, présidente et rapporteure. Vous voulez donc dire que ces élaborations stratégiques ne sont pas partagées avec le corps social.
M. Éric Vidal. Elles peuvent être partagées au sein de comités stratégiques qui sont attachés à des accords de GPEC, mais pas à un niveau stratégique plus global au niveau de la filière. Et je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable.
Je souhaiterais qu’il y ait une espèce d’instance supérieure qui permettrait, quand un problème survient, d’y réfléchir tous ensemble.
J’ai participé à l’élaboration du rapport qui a été présenté par Mme Isabelle Martin. Vous demandez ce que l’on peut faire dès à présent. Je vous répondrai qu’il a fallu attendre que les nouvelles régions, qui sont l’un des grands acteurs de la formation, se dessinent. Nous allons travailler dans chaque région au sein de toutes les instances qui existent, notamment les comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l’emploi et la formation (COPAREF), pour faire avancer les choses.
J’ajoute que la filière automobile cherche actuellement à structurer des campus des métiers et des qualifications dans les régions. Il est clair que les organisations syndicales ont leur rôle à jouer en la matière. Cette demande a été portée via un projet d’investissements d’avenir. Dès que tous les feux seront au vert, de belles choses pourront être faites pour répondre aux questions que vous posez sur la formation.
M. Christian Lafaye. Je pense que l’État ne soutient pas beaucoup sa filière automobile.
Je veux dire au parlementaire qui a posé une question tout à l’heure avant de partir…
Mme Delphine Batho, présidente et rapporteure. Il doit participer à un vote en ce moment même.
M. Christian Lafaye. …qu’une circonscription autour de Sochaux a fait, soi-disant, un appel d’offres pour un parc autonomie, et qu’elle a finalement investi dans des Fiat. Belle moralité de nos élus…
L’État doit soutenir beaucoup plus fortement ses constructeurs automobiles.
Mme Delphine Batho, présidente et rapporteure. Doit-il soutenir ses constructeurs automobiles ou les automobiles produites en France ?
M. Christian Lafaye. Vous avez raison de poser cette question. L’État doit soutenir les automobiles produites en France.
J’entends les uns et les autres tirer à boulets rouges sur le moteur thermique, et en particulier sur le moteur diesel. On se soucie peu des grands projets de certains constructeurs sur des moteurs qui consomment très peu. PSA développe aujourd’hui des moteurs qui consomment deux litres aux 100 kilomètres. Si l’on n’appelle pas cela lutter contre la pollution, je ne sais pas ce que c’est ! En la matière, on aurait vraiment besoin que l’État nous aide à soutenir ces projets.
Mme Delphine Batho, présidente et rapporteure. C’est le cas du projet deux litres aux 100 kilomètres qui est soutenu par le programme des investissements d’avenir.
M. Christian Lafaye. Tout à l’heure, je me suis permis un petit tacle car j’ai vu que le parc automobile de l’Assemblée nationale n’était pas français à 100 % !
J’ai fait partie de ceux qui ont porté le projet de l’autocontrôle indépendant. J’avais demandé que l’État contrôle les véhicules produits en France de façon indépendante. Mais aujourd’hui, on ne voit pas grand-chose arriver. On sait que les deux constructeurs français sont très propres. Cela pourrait constituer un atout en termes de marketing. On montrerait à la nation que nos véhicules sont sains.
M. Jacques Mazzolini. Quand on parle de pollution, il faut savoir qui est exactement notre ennemi ! On parle beaucoup des particules émises par le diesel dans l’agglomération parisienne. Mais il ne faut pas oublier que la lutte contre le changement climatique passe par la réduction des émissions de CO2. Il sera compliqué, voire impossible, d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixé en termes d’émission de CO2 sans recourir fortement au diesel, parce que les motorisations à essence ne nous le permettront sans doute pas.
M. Christian Lafaye. Savez-vous où il y a le plus de particules fines ? Au niveau des stations de métro, en raison des plaquettes de frein des rames de métro.
Mme Delphine Batho, présidente et rapporteure. Je connais un peu le problème, mais il ne faut pas opposer les sujets les uns aux autres. Ce n’est pas parce qu’un problème de santé se pose pour les salariés de la RATP, question qui doit par ailleurs être prise à bras-le-corps, qu’il ne faut pas traiter les autres problèmes de pollution aux particules.
M. Jean-Yves Sabot. La filière aval, qui est une branche en tant que telle, celle des services de l’automobile, dispose de son propre organisme paritaire collecteur agréé (OPCA). La question du dialogue social ne se pose donc pas tout à fait dans les mêmes termes que dans le secteur industriel où il n’y a pas d’OPCA dédié à l’automobile, ni de convention collective de l’automobile. Nous aimerions, et je rejoins en cela ce qu’ont dit mes collègues, avoir des lieux de dialogue social un peu plus performants qu’aujourd’hui.
En matière de formation dans la filière aval, des choses très intéressantes ont été faites ces dernières années, notamment grâce aux différents plans « Compétences-emplois » qui se sont succédé et qui ont été soutenus par l’État. Ces plans ont permis de vrais résultats. Cela permet d’apporter une aide aux entreprises en matière de formation tout en leur demandant, en contrepartie, des engagements sur l’emploi.
Le pacte climat relève un peu de cette même logique. Toutes les organisations qui se sont engagées sur le pacte climat se sont aussi engagées sur les différents plans « Compétences-emplois ». Cela semble cohérent, tant de la part des partenaires sociaux que des organisations d’employeurs, qui cherchent des solutions pour l’emploi et souhaitent afficher leur volonté de proposer des solutions de mobilité propres pour l’avenir. En cela, ils contribuent à redorer l’image de l’automobile.
Concernant le dialogue social dans la filière automobile, je ferai remarquer que la PFA n’est pas paritaire. Faut-il qu’elle le soit ? Je ne le sais pas. Les organisations syndicales ne sont pas associées à la réflexion sur toute une série de sujets. Il y a bien un comité stratégique automobile composé d’un bureau qui se réunit régulièrement, mais la plateforme qui anime vraiment la vie de la filière n’est pas paritaire.
Au niveau de l’aval, une réflexion est en cours pour constituer une plateforme de la mobilité. Notre organisation syndicale espère que cette plateforme sera paritaire, en tout cas que les partenaires sociaux et les représentants des organisations syndicales y auront une véritable place pour pouvoir appréhender le dialogue social de manière un peu plus satisfaisante que ce qui a pu vous être dit autour de cette table. Si j’ai bien compris, cette structure pourra travailler de manière associée, et non concurrentielle, avec la PFA.
M. Éric Vidal. Structurer la filière automobile est un sacré chantier. On parle de 4 000 entreprises très hétérogènes. On peut penser qu’elle met beaucoup de temps à se structurer depuis qu’ont eu lieu les États généraux de l’automobile. Mais on n’a pas encore trouvé le bon modèle. Tout le monde veut y concourir. Pour ma part, je suis peut-être optimiste, mais j’ai bon espoir que l’on parvienne, à force de discussions, à faire valoir que les organisations syndicales sont aussi de grandes parties prenantes de ce qui se passe dans la filière automobile. C’est long, mais je ne vois pas comment on pourrait aller beaucoup plus vite avec 4 000 entreprises et autant d’hétérogénéité.
M. Philippe Portier. S’agissant du dialogue de filière, on pourrait peut-être expérimenter une démarche de responsabilité sociale des entreprises, c’est-à-dire ne pas borner le dialogue aux seuls partenaires sociaux et l’élargir aux organisations non gouvernementales (ONG) qui s’occupent de l’environnement, aux collectivités territoriales, bref à toutes les parties prenantes qui sont concernées. On le voit, l’automobile est à un vrai tournant et il serait intéressant de mettre tous les acteurs autour de la table, ce qui permettrait de trouver les pistes les plus optimales et de mettre tout le monde dans le sens de la marche. En tout cas, c’est quelque chose que nous défendons ardemment. Aujourd’hui, pour PSA et Renault, la RSE consiste surtout à faire de belles brochures sur un papier glacé, à collecter beaucoup d’informations, mais guère plus.
Mme Delphine Batho, présidente et rapporteure. Vous avez parlé de pollution locale et de pollution globale. Il faut peut-être introduire une vision des choses qui prenne en compte tous les différents facteurs, sinon on risque de retomber dans ce qui a été vécu par le passé, c’est-à-dire qu’un choix de politique publique a un effet pervers sur l’autre, par exemple le bonus écologique basé seulement sur le CO2 qui a eu un impact sur les particules, d’autant que les véhicules diesel de l’époque ne sont pas les mêmes que ceux qui sont disponibles aujourd’hui. Une nouvelle approche reviendrait à prendre en compte l’ensemble des émissions, qu’il s’agisse des émissions de CO2, de particules ou d’oxydes d’azote (NOx), et d’avoir un système de tableau de bord qui permettrait de prendre en compte l’ensemble des facteurs. Sinon, on aboutit à des effets pervers et on commet des erreurs.
M. Éric Vidal. Je veux poser une question de béotien : le bonus-malus change-t-il tous les ans ? Peut-on y changer quelque chose pour avoir une vision plus stratégique ?
Mme Delphine Batho, présidente et rapporteure. Que ce soit en termes d’investissement d’infrastructures ou de dispositifs de soutien à l’évolution du type de véhicule, il est évident que la question de la prévisibilité, de la lisibilité et de la stabilité des dispositifs de l’État est absolument majeure. Je vous confirme que nous dirons un certain nombre de choses sur le sujet et que nous ferons des recommandations. Mais nous n’en sommes pas encore là puisque nous poursuivons nos auditions.
M. Jacques Mazzolini. Tout à l’heure, M. Villaumé a fait allusion au plan que M. Tavares a annoncé aujourd’hui. Nous sommes effectivement dans une entreprise qui bouge beaucoup, ce qui nous rappelle qu’il y a quelques années elle était en passe de ne plus bouger du tout. Nous préférons qu’elle soit dans l’état dans lequel elle est aujourd’hui, même si cela pose des questions d’un point de vue social parce que les bouleversements que vit cette entreprise ont des conséquences sur les salariés qui sont obligés de suivre, de s’adapter à des rythmes quelquefois importants. Et on en revient encore une fois à l’importance du dialogue social en interne, et peut-être au rôle de régulation de l’État qui veille à ce que l’entreprise puisse continuer à être bien vivante, voire remuante et en pleine adaptation, tout en s’inscrivant dans un contexte de régulation sociale qui permette aux salariés d’en tirer profit en termes de bénéfices individuels et de sécurité en ce qui concerne leur vie dans l’entreprise.
Mme Delphine Batho, présidente et rapporteure. Nous avons bien entendu le message.
M. Jean-Philippe Nivon. S’agissant de la formation, je ferai une métaphore. La filière automobile est un peu comme un iceberg : au-dessus il y a PSA et Renault, et au-dessous les équipementiers de rang 1, de rang 2 et de rang 3. Toutes les décisions qui sont prises pour les constructeurs ont un impact sur les autres.
Soyez vigilants sur les orientations qui vont figurer dans votre rapport, car elles risqueraient d’avoir un impact positif pour les constructeurs mais négatif pour les équipementiers. Tout à l’heure, M. Portier a parlé d’Altia que je connais bien puisque c’est un des fournisseurs avec lequel j’ai travaillé. Valeo a été l’un des grands contributeurs de sa chute puisqu’il y avait des problèmes de qualité mais aussi des problèmes financiers. Quand un grand constructeur et un gros équipementier font travailler d’autres petits équipementiers, les conséquences sont importantes.
Les petits équipementiers n’ont pas accès à la formation. Passer à l’industrie 4.0 fait peur aux petits qui ont une quarantaine de salariés, parce que cela signifie la fermeture de leur entreprise. Mettre des robots est en effet synonyme de perte d’emplois !
M. Albert Fiyoh Ngnato. J’appelle votre attention sur le fait que la filière aval comprend 125 000 entreprises. Cela dit, elles sont déstabilisées actuellement, notamment par les entreprises qui s’installent dans le digital. Le secteur de l’auto-école, par exemple, qui fait également partie de cette filière aval connaît actuellement de grandes difficultés car n’importe qui peut s’installer et donner des cours de conduite, ce qui aura un impact direct sur la sécurité routière. En réalité, il s’agit d’un métier très spécifique. Donner des cours de conduite ne s’improvise pas.
Je veux revenir un instant sur le Pacte climat. Quand vous allez aujourd’hui dans une station-service, vous ne voyez plus d’huiles posées n’importe où car elles sont désormais complètement recyclées. Quant à la filière des pneus, c’est une filière d’excellence. Des usines se créent pour recycler tous les détritus issus de l’automobile.
M. Laurent Smolnik, délégué syndical central FO-Métaux Renault. L’État a, bien évidemment, toute sa place et toute son utilité. Il devrait faire très attention aux partenariats que peut avoir Renault et à ses alliances qui sont uniques au monde. Je parle, bien évidemment, de Nissan.
Tout à l’heure, j’ai entendu parler du danger du Maroc. Renault à Tanger, deuxième usine de l’alliance Renault-Nissan, a bénéficié d’une fabrication dans une zone franche qui lui permet d’exporter plus de 80 % de sa production hors de son pays. À l’époque, FO avait évoqué la création de zones franches en France permettant d’y réintroduire des productions pour mieux les exporter. Il faut savoir que Renault est son propre importateur de véhicules : il fabrique moins que ce qu’il vend sur le territoire. Cette question avait été posée à Carlos Ghosn et au ministre Arnaud Montebourg. Il faudrait une fiscalité qui permette une plus grande exportation vers les autres pays, ce qui a d’ailleurs été fait à Tanger.
Mme Delphine Batho, présidente et rapporteure. On produit plus que ce que l’on vend en France.
M. Laurent Smolnik. Je parle de Renault, pas de Peugeot. Actuellement, Renault produit quelque 600 000 véhicules et l’objectif est de 710 000 unités. Et nous espérons faire beaucoup plus. Quant à Peugeot, il en produit 1 million.
À une époque, alors que la Clio était fabriquée en Turquie et à Flins, il a été question d’affecter une partie de la production de cette voiture vers la Turquie. Après un débat politique et médiatique, Renault a revu sa copie pour réaffecter des véhicules sur l’usine de Flins.
On vient d’affecter une partie de la production de la Clio en Slovénie en raison, semble-t-il, d’une sur-demande. En fait, nous sommes un peu victimes de notre succès. Le communiqué de presse de Renault parle de l’affectation sur Flins de la Micra, tout en annonçant qu’il va investir sur la Slovénie pour fabriquer la Clio. Ce que je comprends, c’est que l’on ne récupérera jamais ce qui va partir sur la Slovénie. L’État a donc tout à fait son rôle, surtout quand il est actionnaire dans une entreprise comme la nôtre.
Pour le moment, on peut estimer que la Micra devrait se vendre, mais ce sont les clients qui décideront. On voit que ce qui fait fonctionner un site de production en général – et ce n’est pas innocent si Toyota a investi à une époque à Onnaing, près de Valenciennes – ce sont les véhicules de segment B, puisque ce qui se vend avant tout ce sont les voitures de segment A et B, de la Twingo à la Clio en passant par la Yaris. Certes, on est content que les modèles haut de gamme soient fabriqués à Douai, mais les volumes restent infimes. Certes, on est content que les véhicules électriques soient fabriqués à Flins – ce sont environ 25 000 véhicules qui sont produits sur une année. Mais ce sont les voitures des segments A et B qui représentent des volumes très importants. Une fiscalité plus intéressante sur des territoires nous permettrait de réintroduire des productions dans l’hexagone.
Mme Delphine Batho, présidente et rapporteure. Messieurs, je vous remercie pour votre disponibilité.
La séance est levée à dix-huit heures quarante.
◊
◊ ◊
40. Audition, ouverte à la presse, de M. Gaspar Gascon Abellan, membre du comité exécutif et directeur de l’ingénierie du Groupe Renault, accompagné de Mme Véronique Dosdat, directrice des affaires publiques, de M. Jean-Christophe Beziat, directeur des relations institutionnelles environnement et innovation et de Mme Louise d’Harcourt, directrice des affaires parlementaires et politiques.
(Séance du mercredi 6 avril 2016)
La séance est ouverte à dix-sept heures cinq.
La mission d’information a entendu M. Gaspar Gascon Abellan, membre du comité exécutif et directeur de l’ingénierie du Groupe Renault, accompagné de Mme Véronique Dosdat, directrice des affaires publiques, de M. Jean-Christophe Beziat, directeur des relations institutionnelles environnement et innovation et de Mme Louise d’Harcourt, directrice des affaires parlementaires et politiques.
M. Frédéric Barbier, président. Mes chers collègues, avant d’accueillir nos interlocuteurs, je souhaite excuser notre présidente, Sophie Rohfritsch, qui aurait aimé être parmi nous aujourd’hui.
M. Gascon Abellan a fait toute sa carrière dans le groupe, en débutant dans son pays d’origine, l’Espagne, où Renault est implanté depuis de nombreuses années et dispose de trois grands sites de production et de développement.
On oublie souvent que l’Espagne est le second producteur européen après l’Allemagne, en 2015, la production des constructeurs présents dans ce pays, avec 2,7 millions de véhicules, a enregistré la plus forte croissance en Europe : 13 %.
Vous avez, monsieur le directeur, occupé précédemment d’importantes responsabilités techniques, notamment en tant que directeur des projets diesel au sein de l’ingénierie mécanique du groupe. Vos compétences font de vous l’homologue de M. Gilles Le Borgne, de chez PSA, que nous avons récemment auditionné.
Cette expérience de motoriste devrait permettre à la mission de connaître vos analyses sur l’évolution des moteurs diesel et plus particulièrement, sur l’avènement puis, à présent, la régression des diesels de faible cylindrée dont la pertinence pour des véhicules à vocation citadine est dorénavant clairement remise en cause.
Vous allez pouvoir nous expliquer plus en détail les mesures annoncées hier par Renault quant aux rectifications des vannes EGR – acronyme d’exhaust gas recirculation, soit la recirculation des gaz d’échappement et aux NOx traps – « pièges » à oxydes d’azote – qui équipent certains véhicules.
Cette initiative ne semble toutefois viser que certains modèles récents. S’agit-il du premier volet à un plan d’amélioration plus ambitieux, au sujet duquel le groupe se serait d’ailleurs engagé devant la commission dite indépendante ?
Mais des dispositifs de type SCR – acronyme de selective catalytic reduction, soit réduction catalytique sélective – ne devraient-ils pas se substituer rapidement à ces pièges à NOx, y compris pour des modèles essence à injection directe ?
Plus généralement, pouvez-vous nous nous dire à combien s’élève l’effort annuel de recherche et développement de Renault ? Quels sont les principaux choix d’innovation et de développement dans le domaine des moteurs et les coopérations engagées sur ce thème dans le cadre de l’alliance avec Nissan ?
Renault est parfois critiqué pour avoir trop concentré ses efforts sur le véhicule électrique. Aujourd’hui, il reste avéré que ce constructeur est en avance sur le marché, du moins au regard des seuls résultats des ventes de véhicules électriques, notamment auprès des particuliers. En outre, avec ce choix, Renault n’a-t-il pas capitalisé des connaissances qui pourraient lui conférer certains avantages dans le développement de l’hybridation des moteurs diesel et essence, solution qui devrait connaître un fort développement dans l’offre des constructeurs ?
Monsieur le directeur, voilà quelques-unes des questions qui se posent à la mission, après nos auditions et nos rencontres avec de nombreux acteurs de la filière automobile.
Nous allons, dans un premier temps, vous écouter au titre d’un bref exposé de présentation, puis, Mme Delphine Batho, rapporteure de la mission, vous posera un premier groupe de questions.
M. Gaspar Gascon Abellan, membre du comité exécutif et directeur de l’ingénierie du Groupe Renault. Je voudrais tout d’abord vous remercier de m’avoir invité à m’exprimer devant votre mission d’information ; cela me permettra d’apporter ma contribution à la réflexion engagée par l’Assemblée nationale. Nous avons été heureux de vous accueillir dans notre centre technique de Lardy, et nous nous préparons à vous faire découvrir notre usine de mécanique de Cléon, le 11 avril prochain. Vous avez une bonne connaissance du sujet et avez procédé à un grand nombre d’auditions.
Notre président-directeur-général, M. Carlos Ghosn, a eu l’honneur, le 17 février dernier, de présenter la stratégie de Renault devant la commission des affaires économiques et la commission des finances de votre assemblée. Il a souligné que le groupe Renault est financièrement sain et solide : nos résultats financiers pour 2015 sont positifs, avec un chiffre d’affaires de plus de 45 milliards d’euros, en progression de 10,4 % et une marge opérationnelle de 5,1 %, soit 2,3 milliards d’euros. Renault a réussi le renouvellement de sa gamme avec des voitures qui plaisent : 2,8 millions de véhicules vendus en 2015, record pour le groupe.
Nos objectifs sont clairs : conforter Renault comme première marque automobile française dans le monde, positionner le groupe de manière durable comme deuxième marque automobile en Europe, installer l’alliance Renault-Nissan dans le Top 3 des constructeurs automobiles mondiaux. En tant que patron de l’ingénierie de Renault, je suis fier de contribuer avec mes équipes à ce résultat.
Comme vous pouvez vous en douter en m’écoutant, je viens de l’autre côté des Pyrénées, j’ai effectué toute ma carrière d’ingénieur chez Renault avant d’arriver au poste de directeur de l’ingénierie, dont la mission consiste à transformer les souhaits du client en véhicules, produits en grande série, répondant à ses attentes en matière de prestations, et rentables pour l’entreprise.
Pour mener à bien cette mission, Renault a investi l’an dernier 2,3 milliards d’euros en recherche et développement. La France est une base très importante, qui concentre plus des trois quarts de nos dépenses de R&D, ainsi, l’ensemble des activités de recherche et développement de l’ingénierie mécanique, c’est-à-dire les moteurs et boîtes de vitesses s’y trouve.
Je rappelle que la France reste le premier marché du groupe, avec 22 % des ventes en 2015, et son premier pays producteur.
L’ingénierie de Renault en France, ce sont près de 6 000 ingénieurs et techniciens, répartis sur cinq sites en Île-de-France, le Technocentre étant le centre névralgique de cette organisation. Concrètement, les activités de l’ingénierie vont de la recherche amont jusqu’à l’industrialisation du véhicule, en passant par les essais sur piste, la validation et la mise au point, c’est-à-dire l’ensemble de la chaîne de valeur.
Il est important de souligner que Renault et son ingénierie s’impliquent fortement dans les trente-quatre plans industriels annoncés par le gouvernement français en 2013, et plus particulièrement le plan « véhicule autonome » – piloté par M. Carlos Ghosn lui-même –, le plan « véhicule deux litres aux 100 km » – piloté par Gilles Le Borgne de PSA et moi-même – et le plan « infrastructure de charge », auquel Renault contribue activement.
Le groupe Renault dispose de cinq centres de recherche dans le monde : en France, mais aussi au Brésil, en Corée du Sud, en Inde et en Roumanie. En dépit de l’attractivité des quatre centres basés à l’international, tant pour la compétence de leurs ingénieurs, que pour leurs structures de coûts, le groupe a fait le choix de maintenir en France plus des trois quarts de sa R&D mondiale.
Dans ce contexte, le crédit d’impôt recherche (CIR) est un facteur essentiel, qui a permis à Renault d’être bien placé dans la course mondiale à l’innovation, de ne fermer aucun site en France – contrairement à d’autres constructeurs également bénéficiaires du CIR – et de créer des emplois. Le CIR permet de réduire de 11 % le coût de l’ingénierie en France. Ce coût est intégré dans nos équations économiques et dans les arbitrages internes relatifs à la localisation des projets de recherche et développement au sein des différents centres de recherche du groupe.
Enfin, Renault dépose environ 600 brevets chaque année en France, ce qui marque la force de la recherche et développement du groupe.
Après Twingo, Clio et Captur, en 2014, l’année 2015 a vu arriver dans les concessions le fruit de plusieurs années de travail de l’ingénierie, avec cinq nouveaux véhicules : Espace, Kadjar, Talisman, Kwid et Duster Oroch. Deux d’entre eux, Espace et Talisman, pour le haut de la gamme, sont produits en France, à Douai. Tous ces véhicules ont marqué un tournant pour Renault en matière de design, d’attractivité pour les clients, et ce sur tous nos marchés.
Cette cadence n’a jamais été aussi intense chez Renault, en particulier pour son ingénierie, ce qui a demandé des efforts importants. Cela en valait la peine et nous étions prêts à le faire et à le faire bien.
Le Kadjar, notre sport utility vehicle (SUV) du segment C, s’est déjà vendu à 90 000 exemplaires, et figure sur la liste du « Top 10 » des ventes en France, et le Nouvel Espace enregistre quatre fois plus d’immatriculations que sa version précédente en 2014.
Il est encore trop tôt pour parler des ventes de Talisman, mais l’entreprise attend beaucoup de ce véhicule élu plus belle voiture de l’année 2015 en France.
Quant à Kwid, notre nouveau véhicule d’entrée de gamme en Inde, ses commandes ont largement dépassé nos attentes pour atteindre les 122 000 unités, en cinq mois de commercialisation seulement. La version pick-up du Duster, baptisée Oroch, est très bien accueillie en Amérique latine et a été élue pick-up de l’année.
L’année 2016 sera encore plus intense, avec le lancement de dix nouveaux véhicules : en Europe, nous avons lancé la nouvelle Mégane, et nous lancerons le nouveau modèle du Scenic, qui constitue une vraie rupture.
Par ailleurs, nous sommes de retour en formule 1, qui sera au cœur de nos efforts pour accroître la notoriété de notre marque. Ce sera également un accélérateur de transfert de technologies de la piste à la route. Le sport automobile et les voitures de sport sont profondément ancrés dans l’héritage du groupe Renault. C’est pour cela que nous avons annoncé en février la relance d’Alpine, qui permettra d’élargir l’offre du groupe et d’attirer de nouveaux clients passionnés de sport automobile. La voiture, qui sera dévoilée d’ici la fin de l’année 2016 et vendue en 2017, sera fabriquée dans son usine d’origine à Dieppe. Les équipes de Renault sport technologies, installées aux Ulis, sont partie intégrante de l’ingénierie de Renault, et sont en charge du développement des gammes Renault Sport et Alpine.
Concernant les moteurs et transmissions, 2015 a vu la sortie de notre nouveau moteur diesel à double turbo dCi 160 CV qui équipe notamment l’Espace, illustration de notre stratégie de downsizing consistant à diminuer la cylindrée en conservant les performances, dans le but de réduire la consommation, donc les émissions de dioxyde de carbone (CO2). Les motorisations essence ne sont pas en reste : après le renouvellement de nos petits moteurs essence et l’arrivée des trois cylindres de moins d’un litre de cylindrée, nous avons lancé un moteur 1.6 litres à turbo-injection directe pouvant développer jusqu’à 220 CV. Ces moteurs sont souvent associés à nos nouvelles boîtes de vitesses automatiques à double embrayage DCT (Dual clutch transmission), technologie la plus économe en consommation.
Nous avons également lancé la production de notre premier moteur électrique Renault conçu en interne, et produit à Cléon, en Normandie. Ce moteur, proposé sur Zoé, présente une efficacité énergétique améliorée qui permet d’augmenter l’autonomie du véhicule électrique. Enfin, nous avons annoncé à Genève l’introduction de l’hybridation 48 V qui sera lancée cette année sur le Scenic et la Mégane.
Les résultats sont au rendez-vous et à la hauteur de nos espérances, grâce au renouvellement de la gamme et à une couverture géographique équilibrée et robuste.
L’alliance Renault-Nissan, en consacrant un budget annuel à la recherche et développement et à l’investissement de plus de 10 milliards d’euros, a une puissance de frappe significative.
Un enjeu-clé de l’industrie automobile consiste bien évidemment à limiter les impacts environnementaux des voitures sur l’ensemble de leur cycle de vie.
Le premier impact est l’utilisation des ressources ; la réponse est le développement de l’économie circulaire. Aujourd’hui, plus de 30 % de la masse des véhicules produits est constituée de matériaux recyclés. Les véhicules en fin de vie sont valorisables à 95 %. Nous recyclons en boucle certains métaux ou matériaux critiques comme le cuivre, les aciers ou les plastiques. Notre usine de Choisy-le-Roi a débuté en 1949 son activité de rénovation de pièces mécaniques permettant de proposer au client des pièces de réemploi dites d’« échange standard », à moindre coût par rapport aux pièces neuves.
Le deuxième impact est le réchauffement climatique, imputable aux émissions de gaz à effet de serre, essentiellement le CO2 : la réponse est la réduction de la consommation de carburant.
Le rôle de l’ingénierie est de concilier en permanence des contraintes contradictoires : ainsi, la consommation de carburant est intrinsèquement liée à la masse du véhicule. L’allègement des véhicules est donc une priorité. Mais en parallèle, les demandes des clients en termes d’équipements de confort, et les exigences de sécurité, telle la résistance au choc, vont plutôt dans le sens inverse. Dans ce contexte, nous sommes parvenus à gagner 250 kilogrammes sur l’Espace 5 par rapport à la génération précédente.
L’aérodynamique est également un axe de travail important pour la réduction de la consommation, car la forme la plus aérodynamique d’après les lois de la physique, c’est-à-dire la goutte d’eau, n’est pas la plus adéquate pour accueillir quatre, cinq ou sept personnes à bord !
Enfin, les moteurs et boîtes de vitesses font également l’objet de progrès permanents, visant à réduire les frottements, améliorer la combustion, réduire la cylindrée – le downsizing – et, enfin, associer une machine électrique au moteur thermique.
L’ensemble de ces trois axes de travail : allègement, aérodynamique, motorisation, s’est illustré en 2014 sous forme d’un véhicule de démonstration : Eolab, vitrine technologique de Renault sur ces sujets, et qui était le fruit, pour Renault, du programme « Véhicule deux litres aux 100 km ».
La réduction des émissions de CO2, c’est, pour le client, la réduction de la consommation de carburant, et, pour les constructeurs, une obligation réglementaire, avec à l’horizon 2020 un objectif très ambitieux nécessitant de proposer au choix du client des technologies variées : essence, diesel, hybridation plus ou moins poussée, jusqu’au véhicule 100 % électrique, sur lequel je reviendrai.
Les politiques publiques liées plus ou moins directement à ces technologies, et notamment la fiscalité, doivent évoluer à un rythme compatible avec la vitesse de nos développements et supporter le déploiement des nouvelles technologies. L’industrie automobile a besoin de visibilité lui permettant d’anticiper.
Enfin, le troisième impact est la qualité de l’air, et les émissions polluantes liées à la combustion : la réponse, depuis quarante ans, consiste à limiter la production de polluants par le moteur, et en parallèle à les traiter dans la ligne d’échappement : pot catalytique, filtre à particules.
À cet égard, dans le contexte d’une réglementation de plus en plus complexe à appréhender par les citoyens, et d’une fraude de la part d’un de nos concurrents, qu’il me soit permis de saluer le travail de la commission technique indépendante. Cette commission procède actuellement à des essais sur 100 véhicules, dont 25 produits par Renault, reflétant notre part de marché en France. Elle a pu établir, sur la base des premiers tests réalisés sur nos véhicules, que Renault n’a pas équipé ses véhicules de logiciel de fraude ; le groupe respecte la réglementation et les normes en vigueur, au fur et à mesure de leur évolution.
Ces essais ont mis en évidence le fait que nous avions des marges de progression possibles en matière d’émissions d’oxydes d’azote sur nos véhicules devant répondre à la norme Euro 6 b. Le groupe Renault a annoncé hier un ensemble d’actions de réduction significative de ces émissions, sans impact perceptible sur la performance ou la consommation. Elles seront appliquées en usine sur les véhicules diesel à partir du mois de juillet 2016.
À compter du mois d’octobre 2016, les clients déjà en possession d’un véhicule diesel Euro 6 b pourront également bénéficier, sans frais, de ces évolutions via un simple passage dans notre réseau.
Par ailleurs, le groupe Renault développe de nouvelles technologies pour préparer la prochaine étape Euro 6 d qui devrait entrer en vigueur en septembre 2017 pour les nouveaux types, et nous étendrons à l’ensemble de nos véhicules la technologie SCR déjà présente sur nos utilitaires Trafic et Master, ainsi qu’un nouveau système EGR.
S’agissant des émissions de polluants et de CO2, la réponse ultime est, bien sûr, le véhicule électrique, qui par définition garantit l’absence d’émissions de gaz d’échappement. Avec plus de 4 milliards d’euros investis depuis 2008, l’Alliance est pionnière et N° 1 mondial dans le domaine, avec un véhicule électrique sur deux vendu dans le monde, Renault occupant la première place en Europe. La France, grâce à l’action de l’État pour soutenir le développement des infrastructures de charge et les aides à l’achat pour le consommateur, est devenue au premier trimestre 2016, le premier marché européen devant la Norvège.
Le véhicule électrique reste plus que jamais une priorité pour Renault. Les investissements en cours permettront à court terme de doubler l’autonomie ; ce progrès lèvera un des freins à l’achat et facilitera le déploiement de cette technologie à plus grande échelle.
L’innovation sur le véhicule connecté et le véhicule autonome va également se poursuivre chez Renault. D’ici 2020, l’Alliance lancera plus de dix véhicules équipés à des degrés divers de la conduite automatisée.
La personnalisation de la voiture va bouleverser notre marché, comme le smartphone a bouleversé celui des terminaux mobiles. L’an prochain, la première gamme de « systèmes multimédias de l’Alliance », verra le jour. Elle fournira les systèmes multimédias et de navigation les plus modernes, intégrant complètement les smartphones.
Dans le domaine du véhicule autonome, nous nous engageons vers le « contrôle de voie unique », fonction qui permet à la voiture de rouler de façon autonome et sans risque dans le trafic autoroutier. Le 14 avril prochain, nous aurons le plaisir d’en faire la démonstration aux ministres des transports européens réunis à Amsterdam pour le conseil informel des ministres des transports.
En 2018, les technologies évolueront vers le « contrôle de voies multiples ». Cette fonction permettra de négocier automatiquement en fonction des besoins des changements de voie sur autoroute. Enfin, à partir de 2020, des véhicules complètement autonomes, y compris en ville, pourront être mis sur le marché, ce qui nécessitera des évolutions réglementaires.
Notre objectif est plus que jamais de développer des voitures innovantes et accessibles pour tous.
Enfin, avant d’entendre vos questions et d’y répondre, je soulignerai simplement que c’est une fierté pour la recherche et développement de notre groupe – qui est française à plus de 75 % – d’être aux avant-postes des enjeux du véhicule du futur, un des objets d’étude de votre mission d’information.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Les tests effectués par la commission technique indépendante, ainsi que la procédure engagée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), que la mission d’information a entendue hier, ont révélé des écarts importants dans la mesure des émissions polluantes des véhicules Renault. Le groupe a fait hier des annonces à ce sujet ; dès le mois de décembre dernier, Thierry Bolloré, directeur délégué à la compétitivité, avait reconnu que Renault n’était pas « le meilleur de la classe » dans ce domaine.
Comme vous l’avez rappelé, nous nous sommes rendus à Lardy et nous irons prochainement à Cléon ; de mon côté, j’ai, en tant que rapporteure de la mission d’information, rencontré M. Bolloré au mois de janvier. L’annonce des résultats des tests a fait chuter les actions du groupe Renault à la Bourse.
Dans votre propos, vous avez évoqué la visibilité, la norme Euro 6 avait été annoncée dès 2006-2007 ; a posteriori le choix du recours à la technologie EGR et NOx trap, dont on constate que les performances sont limitées, ne vous paraît-il pas inopportun ?
Le Gouvernement, pour sa part, a déclaré que « les tests montrent un dépassement des normes pour le CO2 et les oxydes d’azote », alors même qu’il s’agit de véhicules homologués. Sur un plan juridique, ces écarts sont-ils dus à la présence d’un dispositif d’invalidation proscrit par la réglementation européenne, alors que vous l’auriez considéré conforme au regard d’un risque éventuel pour le moteur ?
Pourriez-vous, par ailleurs, revenir sur l’historique des difficultés que vous avez rencontrées avec l’EGR ?
Au mois de juillet dernier, Renault a constaté des anomalies sur le modèle Captur, pourtant homologué ; à quelle occasion ce constat a-t-il été établi, et pourquoi les mesures de rappel n’ont-elles été annoncées qu’au début de l’année 2016 ?
Pouvez-vous préciser en quoi consistent les modifications annoncées hier par le groupe ; portent-elles sur des logiciels ou des éléments techniques ? Quel sera le nombre de modèles et de véhicules concernés ?
Les corrections immédiates que vous avez annoncées sont-elles comprises dans le plan de 50 millions d’euros engagé au moment où les écarts ont été connus ?
Dans le cadre des solutions prévues à relativement court terme pour la mise en conformité avec la norme Euro 6 d, ont été évoqués le SCR — dont certains de vos véhicules sont déjà équipés — ainsi qu’un nouveau système EGR : pouvez-vous nous apporter des compléments d’information ?
M. Gaspar Gascon Abellan. Aujourd’hui, dans un moteur diesel, 85 % des NOx sont traités par le système EGR, technologie de recirculation des gaz d’échappement qui consiste à réintroduire ces gaz dans le collecteur d’admission afin d’abaisser la température de combustion, à laquelle la production de NOx est proportionnelle : plus la température est basse, plus la génération de NOx est limitée. C’est, en quelque sorte, l’arme fondamentale en matière de contrôle des émissions d’un moteur diesel. Le traitement des 15 % restants – nécessaire pour le respect de la norme – relève de dispositifs du type NOx trap ou SCR.
Les procédures d’homologation sont aujourd’hui fondées sur un cycle bien défini et sont exécutées en laboratoire ; elles présentent l’inconvénient de ne pas être représentatives de toutes les conditions d’usage par les conducteurs, mais ont l’avantage d’être reproductibles, ce qui permet d’établir des comparaisons entre les différents constructeurs.
Nous avons été conduits à équiper nos véhicules de dispositifs de post-traitement des gaz polluants et des NOx, qui satisfaisaient aux normes d’homologation, mais, hors de ce contexte, dans certaines circonstances, nous étions conduits à limiter le recours au système EGR. C’est dû au fait que, depuis 2005 environ, c’est-à-dire depuis le début de l’introduction massive des moteurs diesel modernes, des problèmes de fiabilité touchant les moteurs et le bon fonctionnement des systèmes de contrôle des émissions ont été constatés. Le régime des émissions polluantes est très dépendant de la température extérieure ; il se produit à l’intérieur du moteur des phénomènes de dévernissage, de colmatage des dépôts de suie sur les vannes EGR et, dans certaines conditions, de condensation d’eau – les gaz d’échappement en contenant beaucoup –, tous susceptibles d’induire des défaillances du moteur.
Beaucoup de véhicules ont dû être repris, et nous avons été amenés à modifier les critères de réglage de ces moteurs. Cela a conduit à ce que des moteurs remplissant parfaitement les normes d’homologation produisent, dans les conditions réelles d’usage, plus d’émissions polluantes que ce qu’autorise la réglementation. Je répète qu’en aucun cas nous n’avons cherché à contourner les normes d’homologation.
Il faut garder à l’esprit que, à l’époque où ces moteurs ont été développés, la technologie disponible ne permettait pas de pratiquer de contrôle des émissions polluantes en condition réelle d’usage. L’appareil portatif de mesure des émissions polluantes, le portable emissions measurement system (PEMS), est apparu sur le marché il y a deux ans seulement, et nous sommes encore loin de disposer de matériel suffisamment précis pour effectuer des mesures répétables.
Nous avons préparé le passage à la norme Euro 6 b, et, en 2015, après la définition de la nouvelle norme Euro 6 d et des nouvelles conditions d’homologation et de contrôle, fondées sur le cycle Real driving emission (RDE), qui a fait l’objet de beaucoup de discussions ; nous nous y sommes adaptés. Au cours de cette période, nous avons travaillé à réduire le taux d’émissions polluantes et d’oxyde d’azote en condition d’usage réel des véhicules. En comparant nos résultats qualité obtenus auprès de nos clients, nous avons constaté que des marges importantes de progrès existaient. Cela nous a conduits à élargir l’utilisation de l’EGR à des zones de températures beaucoup plus larges afin de réduire automatiquement le taux d’émissions polluantes, et nous pensons pouvoir encore progresser.
Les résultats des essais réalisés par la commission technique indépendante, qui a procédé à plusieurs types de tests afin de détecter la présence éventuelle de logiciels de fraude, ont été pour nous l’occasion de constater que les logiciels de calibrage du NOx trap n’étaient pas assez robustes. Nous avons réalisé que, dans certaines conditions, nous pouvions remplir le NOx trap et limiter encore plus les émissions. Pour ce faire, nous avons augmenté la fréquence des purges tout en les rendant plus élastiques dans toutes les circonstances de conduite ; car le NOx trap stocke les NOx pour, ensuite, les traiter et les transformer en azote et en oxygène. Il fonctionne comme une éponge, et, lorsqu’il est plein, il faut le purger au moyen d’un cycle que nous appelons « deNOx », consistant à augmenter la température du NOx trap et à produire ainsi la réaction chimique qui transformera l’oxyde d’azote en azote et oxygène.
Ces deux leviers sur lesquels nous avons joué permettent une réduction sensible d’émission des NOx dans des conditions d’usage allant bien au-delà des conditions d’homologation : je le répète, Renault n’a jamais contourné les normes et n’a jamais installé dans ses moteurs de logiciel de fraude.
Lorsque les autorités européennes ont exigé une limitation conséquente des émissions de CO2 par les véhicules automobiles, Renault s’est lancé dans une course à trois directions : le programme de voitures électriques, le renouvellement complet de la gamme des moteurs essence et une nouvelle génération de moteurs diesel – celle actuellement présente sur le marché.
À l’époque, le groupe avait retenu le dispositif le plus innovant de tout le marché : le système EGR à basse pression, qui prélève les gaz d’échappement à la sortie du filtre à particules afin de les refroidir, ce qui constitue le meilleur moyen de contrôler les émissions de NOx. Cette technique n’en comportait pas moins quelques contraintes d’usage, particulièrement une certaine sensibilité à la température externe, et c’est au cours des années, au fur et à mesure des réactions que nous recevions de nos clients, que nous avons pu apporter des améliorations.
Comme toute technologie, ce système dispose d’une durée de vie limitée, et tous les cinq ou six ans, il faut renouveler les générations de moteurs ; aussi, dans la perspective de l’entrée en vigueur de la norme Euro 6 d, préparons-nous une nouvelle génération de moteurs diesel recourant au dispositif SCR, qui demeure le plus efficace, même s’il n’est pas nécessaire pour répondre à la nouvelle norme, sauf pour les applications lourdes. C’est pourquoi nous y recourrons pour les véhicules utilitaires, mais pas pour les voitures particulières ; c’est un système performant, que la rigueur de la norme Euro 6 d rend pratiquement obligatoire.
Par ailleurs, nous allons entièrement reprendre le système EGR en substituant l’eau à l’air pour le refroidissement, ce qui permettra d’élargir encore la plage d’utilisation du dispositif dans tous les contextes thermiques.
Ces deux systèmes constitueront les éléments les plus caractéristiques de la prochaine génération de nos moteurs diesel.
La commission technique indépendante a procédé à des essais sur le modèle Captur, et les tests d’homologation sur banc n’ont pas été conformes. Nous avons analysé les raisons de cette non-conformité, et découvert une erreur de calibration de l’automate qui règle le cycle du « deNOx », c’est-à-dire du traitement des NOx accumulés dans le NOx trap. De ce fait, la consigne de température à laquelle le NOx trap doit exécuter la procédure de désulfuration est faussée ; en effet, non content de cumuler les oxydes d’azote, le NOx trap se charge du soufre présent dans le gazole, ce qui rend nécessaire un cycle de désulfuration. Cette opération est réalisée à une température de 700 degrés, et l’erreur constatée empêchait son déroulement ; le NOx trap se chargeait alors excessivement en soufre, élément chimique qui a pour effet négatif de neutraliser l’efficacité du dispositif de stockage d’oxyde d’azote.
Malheureusement pour nous, cette anomalie avait été détectée bien avant les essais de la commission technique indépendante et avait été corrigée en juillet et septembre sur les véhicules Captur et Kadjar, mais une erreur interne à l’entreprise a fait que l’ingénieur devant signaler qu’il fallait réaligner les calibrations des véhicules a omis cette mention. Ceci a conduit à ce que les véhicules mis sur le marché avant la détection du dysfonctionnement n’ont pas été rappelés. C’est pour cette raison que le nombre de véhicules concernés n’était pas supérieur à 15 000 : 11 000 d’entre eux avaient été vendus, et les autres ont été traités avant leur mise en vente.
Comme tous les constructeurs, j’imagine, Renault procède à des vérifications avant le stade de la production des véhicules et mesure les émissions polluantes ; cependant, un véhicule qui n’a jamais roulé n’est pas chargé en soufre ; il est impossible de découvrir l’anomalie. Ce n’est qu’après avoir roulé sur plusieurs milliers de kilomètres que cette accumulation se produit jusqu’à la neutralisation du NOx trap. S’agissant de véhicules très récents, nous n’avions pas encore procédé aux contrôles des audits réalisés sur des véhicules présents sur le marché, ce qui nous a empêchés de détecter l’erreur par nos propres moyens. Nous l’avions en revanche détectée à l’occasion d’essais internes de validation du nouveau véhicule, comme je l’ai indiqué précédemment.
Outre le gain réalisé dans le domaine des températures, nous avons amélioré l’automate de pilotage du NOx trap. L’impact du dispositif EGR sur la consommation des véhicules est inférieur à 1 %, et il est négligeable sur les performances : des tests réalisés sur des véhicules montrent des variations de consommation n’excédant pas 10 %.
Nous consacrons 50 millions d’euros au contrôle des émissions de NOx. La difficulté ne réside pas tant dans les questions techniques que dans la diversité des modèles de véhicules à traiter. Par ailleurs, il n’est pas possible d’apporter des modifications au moteur d’un véhicule sans s’assurer qu’il n’y a aucun risque pour sa fiabilité et sa sûreté. Depuis juillet 2015, nous procédons à des tests d’endurance, à des simulations et à des validations afin de nous assurer que cet élargissement de la zone d’utilisation de l’EGR ne crée aucun problème dans ces domaines. Je peux dire aujourd’hui que c’est le cas, et que nous allons pouvoir mettre en œuvre les contre-mesures décidées.
Comme je l’ai indiqué, nous sommes en phase intensive de développent des moteurs compatibles avec la norme Euro 6 d afin de les mettre sur le marché au plus tôt, si possible dans leurs versions définitives ; nous nous efforçons d’apporter la meilleure performance en matière de contrôle des émissions polluantes.
Mme la rapporteure. Au sujet du choix de l’EGR, vous avez indiqué que votre protocole d’homologation en matière d’émission de NOx était fondé sur le nouveau cycle européen de conduite – en anglais : New European driving cycle (NEDC). Mais la nouvelle procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers – Worldwide harmonized light vehicles test procedures (WLTP) – et la RDE sont en discussion depuis cinq ans, et le groupe Renault n’ignorait pas que la procédure d’homologation allait évoluer. Cela vaut aussi pour certains de vos concurrents qui ont pu faire d’autres choix technologiques.
Vous indiquez par ailleurs que l’EGR traite 85 % des NOx à 17 degrés…
M. Gaspar Gascon Abellan. Dans la définition existante avant les modifications, entre 17 et 35 degrés.
Mme la rapporteure. Si j’entends bien, à l’avenir, vous ferez fonctionner ensemble les dispositifs SCR et EGR.
M. Gaspar Gascon Abellan. Il n’existe aucun moteur sur le marché – Renault ou autre – qui ne soit pas équipé du système EGR, lequel constitue la base du moteur diesel ; il permet au moteur d’émettre le moins de NOx possible, ce qui reste doit être traité par le NOx trap ou par le SCR, dont l’avantage réside dans sa capacité à être actif dans une plage bien plus large de température interne du système.
Mme la rapporteure. Vous entendez donc équiper tous vos véhicules diesel du SCR, auquel cas, je vous interrogerai sur la gestion de l’urée. S’agissant de la capture des NOx, vous avez indiqué que l’anomalie n’était constatable que sur des véhicules ayant roulé, et non lors de l’homologation, et que, par ailleurs, c’est une erreur humaine qui aurait conduit à ce que la mesure de rappel soit différée.
Les modifications que vous apporterez sur les véhicules concernés porteront-elles sur des logiciels ou s’agira-t-il d’une intervention mécanique ?
M. Gaspar Gascon Abellan. Notre préoccupation d’être efficaces, mais les plus rapides possible : les modifications hardware sont très lourdes et nécessitent un temps de préparation, d’intervention et de validation considérable, qui nous aurait conduits jusqu’au moment de la mise en œuvre de la nouvelle norme avant d’avoir terminé l’opération ; nous avons donc privilégié les modifications software. Le nombre des véhicules concerné dépendra de la date de mise en œuvre, donc du nombre de voitures nécessitant des modifications qui auront alors été vendues. Nous allons adresser un courrier à chacun de nos clients en les invitant, s’ils le souhaitent, à se rendre chez les concessionnaires, et le recalibrage – opération très simple consistant à charger une valise permettant de changer le software du calculateur du moteur – sera effectué à titre gracieux.
Nous équiperons tous nos véhicules du système SCR, qui est le plus performant ; aucune autre solution ne répond aux facteurs de conformité exigés dans le domaine du post-traitement. Cela nécessite le recours à l’urée, et répondre aux critères de conformité n’est pas facile à mes yeux : la question la plus difficile est celle de la mesure, qui ne se pose pas pour le WLTP. La difficulté portera sur le cycle R 2 que nous avons défini, qui est en fait une condition d’enveloppe et qui, dans la mesure où les données obtenues varient considérablement en fonction du type de conduite, aboutit à des résultats de tests très différents et donc peu répétables. Nous avons dû acquérir des bases de données d’entreprises concurrentes qui mesurent avec le PEMS les émissions résultant de la mise en œuvre du cycle R 2, et lorsque nous répétons la mesure, nous obtenons des valeurs qui, parfois, varient du double à la moitié, avec des facteurs de 1,5 à 2,1. Cela pourrait être problématique. Nous serons donc très attentifs aux dispositions légales qui détermineront les conditions réelles d’homologation.
Pour répondre à la norme Euro 6 d, tous les véhicules diesel devront être équipés de ces dispositifs de post-traitement comportant un EGR très performant, complété par un SCR ; certains installent même un double système en fonction de la sévérité de la norme. Les réseaux de distribution d’urée devront s’équiper en conséquence afin de pouvoir fournir facilement les consommateurs puisque l’utilisation de ce produit va augmenter ; il faudra aussi adapter les conditions de remplissage des réservoirs d’urée.
Dans ce cadre, les constructeurs français travaillent avec la Plateforme de la filière automobile (PFA) et avec la commission technique indépendante à promouvoir une solution aussi standardisée que possible.
M. Frédéric Barbier, président. J’ai cru comprendre que le système SCR consommait beaucoup d’urée : l’évolution des dispositifs de réduction des émissions de NOx permettra-t-elle de réduire cette consommation ?
M. Gaspar Gascon Abellan. Lorsque nous avons conçu les moteurs diesel utilisés aujourd’hui, le SCR était quasi inexistant : le temps de développement d’un moteur diesel est de quatre à cinq ans, ce qui signifie que les véhicules mis sur le marché en 2011 avaient été conçus au cours des années 2006-2007. Parler de SCR à cette époque relevait de la science-fiction. Par la suite, les systèmes SCR mis sur le marché étaient inspirés des moteurs de camions, avec une longue ligne de traitement par injection, éloignée de l’engin.
Aujourd’hui ce dispositif évolue, nous recourrons au système close-coupled, qui est un dispositif SCR très compact, embarqué et accroché au moteur, très près de la zone de combustion, ce qui le rend plus efficace car il chauffe plus facilement ; en revanche, nous rencontrons des difficultés à intégrer un injecteur d’urée et à dégager l’espace nécessaire à sa vaporisation afin de garantir le bon remplissage de la zone de traitement. Nous avançons vers des solutions satisfaisantes, toutefois, nous ne pourrons pas diminuer la consommation d’urée : les seuils d’émissions autorisés étant plus bas, il faut traiter plus de NOx – dans des conditions très diverses et donc utiliser plus d’urée. Cela pose la question de l’autonomie permise par les réservoirs d’urée car, s’ils sont trop grands, ils alourdiront le véhicule. En fonction des applications, nous envisageons des réservoirs d’une contenance allant de 17 à 20 litres ; ce poids supplémentaire accroît la consommation de carburant. En tout état de cause, l’application de la nouvelle norme aura pour effet l’augmentation de la consommation d’urée.
Mme la rapporteure. Que répondez-vous à ceux qui considèrent que les annonces faites hier par le groupe Renault prouvent que, dès le départ, vous auriez pu recourir à ces dispositifs de façon plus large ?
M. Gaspar Gascon Abellan. Je reconnais que nous aurions pu le faire plus tôt, mais toutes les équipes de développement étaient mobilisées par le passage à la norme Euro 6 d. Je rappelle qu’un tel changement de norme nécessite la mise au point de plus de 300 applications nouvelles pour couvrir l’ensemble de la gamme, ce qui signifie 300 utilisations différentes devant être testées, validées et homologuées.
Il faut encore reconnaître que la question de la connaissance des émissions réelles est, malgré tout, assez récente : nous avons acquis nos premiers dispositifs PEMS il y a à peine un an et demi, ce qui est un temps trop court pour changer complètement la donne.
Nous avons présenté à la commission technique indépendante les graphiques de retour qualité des moteurs. Nous avons connu plusieurs crises importantes à cause du dispositif EGR, ce qui a conduit à adopter des règles de conception pouvant être considérées comme conservatrices. Faire évoluer le système a pris un certain temps.
D’aucuns peuvent considérer que nous avons tardé, mais les conditions idéales, en termes de dispositifs de mesure et de normes, nous conduisant à nous extraire des conditions classiques d’homologation, comme les ressources disponibles nécessaires, n’étaient pas présentes dès le départ.
En tout état de cause, la volonté de Renault est de mettre sur le marché les produits les plus performants, non seulement dans le domaine des prestations apportées aux clients, mais surtout dans celui du respect des normes environnementales ; le groupe a toujours été respectueux de la réglementation.
Mme la rapporteure. Savez-vous quel investissement représente pour le groupe un changement de norme ? Beaucoup d’interlocuteurs de la mission d’information ont considéré que, au regard des développements technologiques et industriels nécessaires, un délai de cinq ans – qui devrait être érigé en règle – était requis pour l’anticipation des normes nouvelles. Est-ce votre point de vue ?
Sur le plan industriel, quel est pour vous le rythme d’adaptations des moteurs diesel et essence ? Envisagez-vous d’installer des filtres à particules sur les moteurs à essence ?
Pourriez-vous, par ailleurs, adresser à la mission d’information une note exhaustive relative aux actions menées par le groupe Renault dans le domaine de l’économie circulaire, puisque vous être les premiers à l’évoquer ? Nous avons de nombreuses interrogations au sujet de la place de l’industrie dans ce type d’économie, et, à ce titre, votre expérience nous intéresse.
Enfin, vous avez évoqué le doublement à court terme de l’autonomie des véhicules électriques, pouvez-vous nous indiquer vos prévisions en termes de temps ?
M. Gaspar Gascon Abellan. Le développement d’une génération de moteurs adaptée à un changement de norme représente un investissement de l’ordre de 1,2 à 1,5 milliard d’euros, en fonction du nombre d’applications à mettre au point. Cela nécessite un fort investissement de départ pour le développement, auquel s’ajoute l’adaptation de l’outillage du groupe et de ses fournisseurs pour fabriquer les moteurs de base, plus une sorte de forfait pour chaque application, car chaque véhicule fait l’objet d’une motorisation particulière, au minimum en termes de calibrage, et est équipé de quelques pièces en propre.
Nous ne pouvons financer de tels montants que tous les cinq ou six ans, car, à eux seuls, ils consomment parfois toute une année de bénéfices de l’entreprise.
Une autre contrainte résulte du temps nécessaire à la conception des moteurs, qui est de quatre ans dans le meilleur des cas. Une norme qui évoluerait dans un délai moindre serait impossible à suivre : un changement tous les deux ou trois ans représente une perturbation majeure et des dépenses considérables.
Mme la rapporteure. Quelle est la part du traitement de l’ensemble des émissions polluantes dans votre budget de recherche et développement ?
M. Gaspar Gascon Abellan. Un tiers de notre budget de création en engineering, là où nous créons la valeur, est consommé par ce que nous appelons les « basiques », c’est-à-dire la régulation, c’est-à-dire l’application des normes. Le véhicule autonome et le véhicule connecté représentent chacun un autre tiers.
L’anticipation des normes prend donc du temps. Ce qui est insupportable, bien que beaucoup pensent que nous les connaissons très à l'avance, c’est le nombre d’hypothèses différentes auxquelles nous sommes confrontés, car chacune appelle des solutions techniques différentes. Comme tout industriel, nous avons besoin de dégager des bénéfices, et il n’est pas possible de multiplier inconsidérément les applications.
Le rythme est de quatre ans minimum pour anticiper les évolutions des normes ; il faut trouver un accord dans ce domaine. Certes, nous recourrons toujours plus aux simulations, au digital, ainsi qu’à l’ingénierie prédictive, mais nos produits étant de plus en plus complexes, le temps nous est toujours nécessaire.
Renault ne joue pas particulièrement sur le volet du diesel : nous l’utilisons parce que c’est aujourd’hui en Europe le système le plus efficace pour réduire les émissions de CO2, et qu’il représente des avantages certains en affordability, c’est-à-dire en coût pour les clients. Depuis 2009, nous nous sommes engagés sur les trois voies de l’électrique, du diesel et de l’essence, en modernisant les solutions conventionnelles et en maîtrisant la technologie des véhicules 100 % électriques ; franchir des pas intermédiaires n’était donc pas trop contraignant pour nous.
Le groupe dispose aujourd’hui d’un outil industriel assez flexible, et nous parvenons parfois à construire des moteurs essence et des moteurs diesel sur les mêmes lignes de fabrication ; il faut néanmoins adapter nos fournisseurs. Nous avons donc une bonne capacité d’adaptation, mais il n’empêche que faire un changement de mix important nécessite un an et demi ou deux ans.
Nous réalisons des simulations d’adaptation de filtres à particules sur des moteurs à essence pour toutes nos applications. Les résultats sont variables, et nous déciderons si cela est nécessaire. Jusqu’à présent, nous pensions utiliser un filtre à particules passif, car les moteurs à essence sont naturellement chauds, mais la norme Euro 6 d nous conduira à installer des filtres actifs nécessitant calculateur et logiciel afin de calibrer les conditions de régénération au sein du dispositif. Cette nouvelle technologie ne sera donc pas neutre en termes de surcoûts.
L’autonomie des véhicules électriques constitue un vrai sujet. Elle devrait augmenter très prochainement de façon notable, du fait de l’augmentation de la densité énergétique des batteries. Le prix de ces véhicules ne baissera pas pour autant, mais ils offriront beaucoup plus de prestations : à ce stade, je ne souhaite pas dévoiler ce qui constitue une exclusivité commerciale pour la marque.
M. Frédéric Barbier, président. Merci beaucoup pour vos explications techniques très claires.
La séance est levée à dix-huit heures vingt-cinq.
◊
◊ ◊
41. Audition, ouverte à la presse, de Mme Bénédicte Barbry, directrice des relations extérieures et affaires publiques et de M. Christophe Delannoy, responsable services atelier Norauto, du Groupe Mobivia sur les protocoles d’écoentretien des véhicules.
(Séance du mardi 26 avril 2016)
La séance est ouverte à seize heures trente-cinq.
La mission d’information a entendu Mme Bénédicte Barbry, directrice des relations extérieures et affaires publiques et M. Christophe Delannoy, responsable services atelier Norauto, du Groupe Mobivia sur les protocoles d’écoentretien des véhicules.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Nous recevons aujourd’hui les représentants de Mobivia, groupe spécialisé dans l’entretien et l’équipement de véhicules multimarques, qui rassemble treize enseignes dont les plus connues sont Norauto et Midas.
Vous avez sollicité notre mission d’information pour être entendus sur le protocole « Éco Entretien » et le dispositif « Éco Performance » à mettre en œuvre dans certains de vos centres. Dans un courrier, vous soulignez que ce type d’intervention a notamment pour objectif d’« assurer un retour à un niveau d’émission proche de son état d’origine, quel que soit l’âge du véhicule ». Selon vos indications, cette intervention permet le contrôle le plus complet à ce jour, car portant non seulement sur les émissions de dioxyde de carbone (CO2), mais aussi sur les oxydes d’azote (NOx) ainsi que sur les particules. Votre courrier précise également qu’il s’agit d’une analyse dite « cinq gaz » dont on peut penser qu’elle anticipe ce que pourrait être le futur contrôle technique obligatoire pour les véhicules légers.
L’article 65 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit effectivement un renforcement du contrôle des émissions, selon des modalités à préciser avant le 1er janvier 2017. Nous rappelons que le contrôle technique se limite, en l’état actuel, à une vérification de l’opacité des fumées à l’échappement s’agissant des véhicules diesel, ce qui est vraiment peu de chose…
Vous allez nous dire ce que vous pensez de l’évolution de la réglementation sur ce point, du moins telle que les pouvoirs publics semblent la concevoir. Votre groupe ou votre fédération professionnelle considèrent-ils que l’on va dans la bonne direction ? Ont-ils d’ailleurs été consultés par les ministères concernés sur la prochaine réglementation des émissions au titre du contrôle technique ?
La mission d’information souhaite savoir quel type d’instruments est employé pour réaliser vos contrôles « Éco Performance ». Sont-ils aisément accessibles sur le marché, et à quel coût unitaire ? Qui les fabrique, et sont-ils dorénavant fiables pour un contrôle « cinq gaz » ?
S’agissant justement de ce contrôle dit « cinq gaz », quelles mesures sont effectuées ? Le contrôle porte-t-il sur le dioxyde d’azote (NO2), qui est le polluant le plus dangereux pour la santé parmi les NOx ? Concernant les particules, le contrôle porte-t-il seulement sur les particules de type PM10, c’est-à-dire sur les plus grosses particules, qui affectent néanmoins les voies respiratoires supérieures ?
Nous allons, dans un premier temps, écouter votre exposé de présentation, puis Mme Delphine Batho, notre rapporteure, vous posera un premier groupe de questions.
Mme Bénédicte Barbry, directrice des relations extérieures et des affaires publiques du groupe Mobivia. Je présenterai les activités de Mobivia selon deux axes, en évoquant en premier lieu ses métiers et son positionnement particulier au sein de la filière automobile, ainsi que la mutation que connaît notre entreprise depuis quelques années. En second lieu, j’évoquerai une innovation particulière, développée par Norauto en collaboration avec la Fédération des syndicats de la distribution automobile (FEDA), et qui a trait au contrôle « cinq gaz » et au diagnostic « Éco Performance ».
Mobivia est un groupe familial né en 1970 dans le nord de la France, avec un premier centre sous enseigne Norauto. Il est devenu, en quarante-cinq ans, le leader européen de l’entretien et de l’équipement des véhicules. Il réalise 1,7 milliard d’euros de chiffre d’affaires et emploie un peu plus de 11 000 collaborateurs, sur des emplois dont la majorité, par nature, ne peuvent être délocalisés. Le capital est détenu à 5 % par les salariés, car le groupe a développé, depuis sa création, une politique d’intéressement. Nous sommes implantés dans seize pays, principalement en Europe, mais aussi en Argentine.
Aujourd’hui, Mobivia fédère une quinzaine d’enseignes, dont les plus connues sont Norauto et Midas, mais il y a également des sociétés prestataires dans le domaine de l’entretien et de la réparation automobile. Nous nous mettons, progressivement, à travailler avec de nouvelles entreprises, notamment des start-up innovantes dans le domaine de la mobilité. Le réseau Mobivia compte 1 300 centres en Europe, dont environ 750 en France, où il est présent dans tous les départements. Il s’inscrit dans une dynamique de développement régulier avec environ trente nouveaux centres par an, soit une création nette de 500 emplois chaque année, pour un recrutement annuel de 1 600 salariés.
Notre métier historique est l’entretien et l’équipement automobile, principalement pour les centres Norauto et Midas ; il consiste à changer des pneus, faire des vidanges, des révisions, etc. Pour autant, il n’a pas cessé d’évoluer depuis quarante-cinq ans. Si l’on se rappelle ce qu’était une automobile à l’époque – quatre roues et un peu de tôle – les choses n’ont aujourd’hui plus rien à voir, et c’est plus vrai encore avec la perspective ouverte par le véhicule autonome. Nous accompagnons ces évolutions en permanence, faute de quoi, je ne serais pas devant vous. Nous investissons continuellement, en particulier dans la formation : si, il y a quarante-cinq ans, nos salariés mécaniciens disposaient de savoir-faire simples, les compétences sont désormais beaucoup plus pointues, orientées vers l’électronique et bientôt le numérique, qui constituent les enjeux de demain.
Nous ne sommes pas des constructeurs automobiles : notre « terrain de jeu » est le parc roulant, qui représente aujourd’hui 39 millions de véhicules en France, soit trois fois plus qu’il y a quarante-cinq ans. Nous considérons que notre mission est d’« upgrader » ce parc, et le diagnostic « Éco Perfomance » constitue notre principal outil : nous allons améliorer le parc en recourant à des innovations à même de le rendre moins polluant. Nous voulons aussi améliorer les véhicules dans les domaines de l’éco-conduite, avec des boîtiers, des véhicules connectés et une grande variété de nouveaux services sur lesquels nos équipes travaillent.
Nous considérons donc qu’il existe de considérables potentialités de développement liées à l’automobile ainsi qu’à la mobilité en général, et qui font intervenir des métiers situés au cœur des enjeux économiques, en termes de pouvoir d’achat comme de création d’emplois, mais aussi des enjeux environnementaux et sociaux. De fait, on parle beaucoup de renoncer à la voiture, mais 70 % des Français l’utilisent pour se rendre à leur travail, car il est très difficile de s’en passer à la campagne et en périphérie des grandes villes.
La deuxième partie de notre métier se rapporte aux mutations en cours, et c’est pourquoi nous nous présentons aujourd’hui comme Mobivia Groupe, et non plus comme Norauto Groupe qui était notre nom avant 2010. Il ne s’agit pas d’une simple question de communication ou d’affichage : depuis toujours, le groupe s’est engagé dans le domaine environnemental, notamment dans le retraitement des déchets automobiles. Sa direction a pris conscience que la pérennité de nos métiers dépendait de la capacité à inventer des solutions tenant compte de l’évolution de l’usage de la voiture, qui fait désormais partie d’un écosystème de possibilités de mobilité, et du fait que nos clients n’ont plus du tout le même rapport à l’automobile qu’il y a une vingtaine d’années.
Nous souhaitons accompagner ces nouveaux usages que sont la voiture partagée, le véhicule connecté et les mobilités douces : c’est ainsi que Norauto est devenu le premier vendeur de vélos à assistance électrique en France. Le groupe veut être un acteur innovant de cette évolution et élargir considérablement le périmètre de ses activités. Les perspectives ouvertes par le véhicule partagé et le véhicule connecté nous ont conduits à créer ce que nous nommons l’« accélérateur d’entreprises » Via-ID, qui a pour objet de soutenir des start-up dans le développement des innovations qui feront la mobilité de demain. Certaines de ces start-up ne vous sont pas inconnues : Drivy, le N°1 de la location de voitures entre particuliers ; Smoove, acteur du vélo en partage ; Wayz-Up, spécialiste du covoiturage de courte distance ; Eliocity qui développe le premier boîtier pour véhicule connecté, etc.
Ainsi, le périmètre des activités du groupe Mobivia excède largement le cadre de ses métiers historiques que sont la vidange et le pneumatique.
Nous mesurons le chemin parcouru depuis 2009 avec la FEDA pour rendre le parc automobile plus propre. À l’époque, on parlait beaucoup de prime à la casse et, s’il peut sembler vertueux de rajeunir le parc, nous avions toutefois conscience que les émissions polluantes résultant de la construction de voitures neuves ne manqueraient pas d’obérer le bilan environnemental global. Par ailleurs, la prime ne s’adressait qu’à ceux qui avaient les moyens de financer un véhicule neuf ; or nous constatons que bien peu, parmi ceux qui se rendent dans nos centres, sont en mesure d’acheter ces merveilleux véhicules neufs électriques ou hybrides.
Nous avons donc considéré qu’apporter des améliorations, même minimes, à une grande partie du parc roulant représenterait, en raison de l’effet de masse, un progrès considérable. En conséquence nous nous sommes associés aux travaux que la FEDA avait commencés avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS), et avons fourni un effort important de recherche et développement. Nous avons mis à leur disposition les ateliers et l’institut de formation, recherche et développement de Norauto afin de mettre au point les services « Éco Entretien » et « Éco Performance ».
À cet égard, nous nous réjouissons que l’article 65 de la loi relative à la transition énergétique mentionne le contrôle des émissions polluantes, car cela constitue à nos yeux un grand pas en avant : à ma connaissance, c’est la première fois que le levier de progression que constitue le parc roulant est pris en compte. Jusqu’à présent, la réglementation ignorait cette dimension : ainsi, dans le domaine de la pollution, le contrôle technique se résume aujourd’hui à 2 % de contre-visites, ce qui ne correspond absolument pas à la dégradation du parc roulant, encore moins à l’usage actuel du diesel. Nous surveillons donc l’entrée en vigueur de cet article 65, car il semble qu’elle soit reportée à 2019, alors que nous disposons d’une mesure efficace susceptible d’être mise en œuvre immédiatement.
M. Christophe Delannoy, responsable des services atelier de Norauto. Norauto France compte 375 centres répartis sur l’ensemble du territoire national, et 92 % des établissements sont certifiés ISO 14001 ; 14 millions de clients figurent dans notre base, nos ateliers reçoivent 2,5 millions de clients par an, et nous employons 5 500 salariés en France. Chaque atelier est capable de proposer 140 prestations, dont l’offre « Éco Performance ».
Cette offre « Éco Performance » est constituée d’un ensemble de prestations, au premier rang desquelles un éco-diagnostic du fonctionnement des moteurs – essence comme diesel – ainsi que leurs émissions polluantes, au titre des cinq gaz qui sont le monoxyde de carbone (CO), le CO2, les NOx, les hydrocarbures (HC) et le dioxyde d’azote (NO2). En fonction des résultats obtenus, nous proposons à nos clients une palette de services afin de mettre les véhicules en conformité.
Cette démarche procède d’une demande de nos clients, qui avaient constaté des dysfonctionnements des vannes EGR – acronyme d’Exhaust gas recirculation, c’est-à-dire la recirculation des gaz d’échappement – et des filtres à particules des moteurs diesel. Or, à l’époque, très peu d’outils de diagnostic étaient disponibles sur le marché. Il ne faut pas oublier qu’un moteur reste une machine thermique, certes pilotée par un certain nombre de calculateurs. Depuis 2004, nous disposons d’outils de diagnostic pour la partie électronique, mais pas pour la partie thermique, car la seule mesure possible, effectuée à l’occasion des contrôles techniques, était l’opacité des fumées. Ce dernier outil sert toutefois plus à la sanction qu’au diagnostic ; c’est pourquoi, avec la FEDA, nous avons développé l’analyse des gaz d’échappement, qui existait déjà pour les moteurs à essence.
Nous disposons donc aujourd’hui d’un dispositif d’analyse « cinq gaz », fonctionnant sur les moteurs à essence comme sur les moteurs diesel, piloté par un logiciel. Le diagnostic est réalisé en deux minutes et demie et comporte différentes phases allant du ralenti à l’accéléré. Le logiciel analyse ces séquences seconde par seconde, délivre un bilan compréhensible par le client et fournit des informations sur l’origine des dysfonctionnements. Nous sommes alors en mesure de proposer diverses prestations, allant du nettoiement des injecteurs au remplacement des pièces usées – nous proposons alors à nos clients des pièces de réemploi ou des pièces adaptables afin de réduire les coûts d’entretien du véhicule.
Nous sommes partis du principe que les moteurs, propres à l’origine, s’encrassent au fil du temps, particulièrement en ville, et nous avons voulu apporter à nos clients une solution à bas coût. Le nettoyage d’un injecteur, par exemple, coûte 80 euros, alors que le remplacement de quatre injecteurs revient à 1 600 euros environ. Nous avons commencé à proposer ces prestations en mai 2013, et avons réalisé, depuis, quelque 340 000 éco-diagnostics. Nous avons intégré l’éco-diagnostic dans le programme d’entretien courant des véhicules, ce qui participe à nos yeux d’une politique de prévention ; nous avons réalisé 320 000 contrôles à ce titre, les 20 000 diagnostics restants relevant du traitement curatif, réalisé à la demande du client rencontrant un problème de carburation ou de performance énergétique.
Dans le cadre de la réalisation des diagnostics préventifs, nous avons constaté que 24 % des véhicules connaissaient un mauvais fonctionnement du système de dépollution ; pour les diagnostics curatifs, la proportion s’élève à 57 %. Le taux de transformation réalisé sur la base du volontariat par nos ateliers est de 15 %.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Vous avez ainsi constaté un mauvais fonctionnement du système de dépollution sur 24 % des véhicules ?
M. Christophe Delannoy. Parmi ces 15 %, nous n’avons pas distingué entre le préventif et le curatif, mais ils portent bien sur les 24 % que j’ai mentionnés.
Le diagnostic « Eco Perfomance » permet un gain de consommation de 5 % en moyenne, ainsi qu’une réduction de 20 % des émissions polluantes. Toutefois, notre dispositif ne permet pas la détection des particules, que seul l’opacimètre peut faire, mais, comme je l’ai dit, celui-ci demeure un outil de sanction, et c’est pourquoi nous ne l’avons pas retenu.
Mme Bénédicte Barbry. En l’absence de normes réglementaires, ces interventions sur les véhicules sont réalisées sur la base du volontariat : c’est à l’occasion d’une visite d’entretien que l’éco-diagnostic est établi, et le client est libre de son choix, dans lequel interviennent notamment des motivations financières. Cela explique la différence constatée entre le nombre des dysfonctionnements et les améliorations demandées par les clients.
L’article 65 de la loi relative à la transition énergétique aurait un impact très fort s’il imposait une remise à niveau, mais, à ce stade, nous n’avons pas de certitudes à ce sujet.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Quel est le coût d’un éco-diagnostic pour vos clients ?
M. Christophe Delannoy. 29,90 euros.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Tous vos centres sont-ils équipés de l’appareil permettant la mesure des cinq gaz ?
M. Christophe Delannoy. Sur les 375 centres du réseau, 315 en sont équipés, l’équipement des autres centres étant en cours.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Vous avez dit que la discrimination par type de particules n’était pas possible aujourd’hui, sauf à recourir à l’opacimètre.
M. Christophe Delannoy. À ma connaissance, en effet, il n’existe que l’opacimètre, appareil conçu dans les années 1970 et qui pourrait être amélioré en fonction de l’évolution des moteurs, par exemple afin de mesurer les défapages.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Pouvez-vous nous donner plus de détail sur les dysfonctionnements des vannes EGR et des filtres à particules ?
M. Christophe Delannoy. Nous constatons souvent que la vanne EGR n’est pas la cause du problème, le contrôle des cinq gaz montrant qu’à l’origine se trouve une pulvérisation déficiente des injecteurs, qui entraîne une mauvaise combustion, ce qui crée des particules et bouche les lignes d’échappement. Dès lors, la vanne EGR encrasse l’ensemble du système, au niveau du turbo comme de l’admission du moteur, qui se trouve réduite : un cercle vicieux s’enclenche alors. Dans ces conditions, remplacer la vanne ne suffit pas : il vaut aussi traiter soit le problème d’injection, soit le problème d’échappement.
Il n’existe pas aujourd’hui d’outil capable d’établir un diagnostic précis des filtres à particules ; nous proposons soit un traitement par additifs lorsque le filtre est légèrement colmaté, ce qui coûte 79 euros. Si l’état est trop avancé, nous proposons l’échange standard ou le remplacement par des pièces adaptables. Un filtre à particules peut coûter entre 500 et 4 000 euros selon les modèles.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Constatez-vous des difficultés particulières avec les traitements à urée et les systèmes de réduction catalytique sélective (RCS) ?
M. Christophe Delannoy. Ces systèmes sont apparus récemment, avec la norme Euro 6. Or l’âge moyen des véhicules que nous sommes amenés à traiter est de huit ans : dans les premières années, le client va plutôt chez le concessionnaire, puisqu’il bénéficie encore de la garantie. Nous pratiquons des remises à niveau de systèmes SCR et ADBlue, mais pas encore la maintenance ; nous nous bornons à remplir les réservoirs d’urée.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Quelles seraient vos recommandations dans le domaine de l’évolution du contrôle technique ?
M. Christophe Delannoy. La technologie « cinq gaz » est adaptée à l’ensemble du parc automobile français, mais le délai est lointain, puisque la publication des décrets est annoncée pour janvier 2019. Pour notre part, nous avançons pas à pas, en mettant en place les éléments les plus simples, ce qui est le cas de l’abaissement du seuil de détection afin d’identifier les véhicules ayant fait l’objet d’un défapage. À l’occasion du contrôle technique, il pourrait être procédé à une contre-visite des mesures effectuées avec le dispositif de diagnostic embarqué (OBD), qui signale les dysfonctionnements des systèmes antipollution du véhicule lorsqu’il surconsomme et pollue à l’excès.
Pour les véhicules à essence, nous pourrions réduire la plage de tolérance, qui est plus large chez les constructeurs, ce qui permettrait de supprimer les voitures les plus polluantes.
Enfin, l’application de l’article 65 de la loi relative à la transition énergétique permettrait de rendre systématique le contrôle « cinq gaz » sur les véhicules thermodynamiques.
Mme la rapporteure. Vous avez évoqué, à l’occasion du contrôle technique, l’information de vos clients ainsi que la nécessité d’une contre-visite.
Mme Bénédicte Barbry. Au regard de l’ensemble du parc roulant, le simple diagnostic et l’information lors du contrôle technique n’apportent rien. Le taux de 15 % de clients volontaires pour modifier leur véhicule est très faible, alors qu’il serait possible d’aller bien au-delà. L’ambition de la loi relative à la transition énergétique, à travers son article 65, consiste, non pas à se borner à mesurer, mais à agir, en imposant une éventuelle contre-visite en fonction des résultats du contrôle technique.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Au-delà des questions liées au contrôle technique, se pose celle de l’intérêt direct du conducteur à mieux maîtriser sa consommation, donc de l’éco-conduite. Quelle est la politique de formation continue de vos personnels au regard de la rapidité des évolutions technologiques, dans le domaine numérique notamment ?
Par ailleurs, quelles sont les perspectives de création d’emploi dans l’ensemble du secteur ?
Mme Bénédicte Barbry. Les innovations techniques apportées au parc roulant contribuent à améliorer la qualité de l’air. Les constructeurs produisent des véhicules connectés sur lesquels des boîtiers peuvent être appairés ; à cet égard, j’évoquais notre partenaire Eliocity, qui propose notamment des modules d’éco-conduite. Ces dispositifs permettent au conducteur d’établir des statistiques relatives à son mode de conduite. Nous développons aussi des partenariats avec les assureurs, qui impliquent l’automobiliste dans une démarche vertueuse en modulant le montant des primes en fonction de son type de conduite.
Nous sommes donc très actifs dans ce domaine, car c’est la mission d’un groupe comme le nôtre que de suivre ce mouvement, mais aussi de pérenniser nos métiers et de créer des emplois. Ainsi, notre service « Éco Performance » a créé cinquante emplois supplémentaires au sein des centres Norauto, compte tenu des heures supplémentaires et du nombre de clients concernés.
M. Christophe Delannoy. Les perspectives de mise en œuvre des dispositions de l’article 65 de la loi relative à la transition énergétique laissent espérer la création de 4 500 emplois, compte tenu du volume du parc de véhicules de plus de quatre ans, soit 18 millions de véhicules, si l’on considère que 40 % d’entre eux nécessitent une intervention.
Mme Bénédicte Barbry. À ces horizons ouverts par les évolutions technologiques, il faut ajouter des pratiques en cours de développement, comme le partage des véhicules et l’optimisation de leur usage. Cela conduira le parc des véhicules à être plus vertueux et moins carboné, d’autant que les nouveaux modèles arrivant sur le marché sont moins polluants.
Il existe plusieurs registres sur lesquels il faut jouer, et le véhicule neuf n’est pas des moindres. C’est pourquoi nous estimons avoir un rôle à tenir dans le développement du véhicule électrique. Certains de nos clients sont propriétaires de véhicules de plus de huit ans et ces perspectives les intéressent ; aussi tous nos centres proposent-ils des véhicules de courtoisie électriques afin de mieux faire connaître cette technologie.
Mme Delphine Batho, rapporteure. S’agissant des nouveaux usages, particulièrement de la mobilité globale recourant à divers types de véhicules, dont les deux-roues, motorisés ou non, quelle place assignez-vous aux centres Norauto et qu’y trouve-t-on ? Je crois savoir que cela diffère grandement des pratiques « classiques » antérieures ?
Mme Bénédicte Barbry. Le développement des activités nouvelles, dont celles des start-up, appelle une mutation et un élargissement de notre offre de services. Le client qui vient changer ses pneus est le même que celui qui est confronté aux problèmes de congestion urbaine, dont les enfants ne passent plus le permis, et dont le budget est contraint – ce qui l’incite à pratiquer le covoiturage. De fait, le budget d’entretien d’une automobile est important, et la possibilité de louer son véhicule lorsqu’il n’en a pas l’usage permet à l’automobiliste de diminuer les coûts fixes : c’est ce qu’offrent des start-up comme Drivy.
Dans la mesure où notre « ADN » est l’automobiliste, nous devons être là pour lui proposer des solutions lorsqu’il souhaite se déplacer en ville avec un véhicule électrique à deux roues, en mobilisant nos enseignes historiques comme Norauto et Midas ; l’emblème de notre groupe est d’ailleurs l’homme mobile. Nous voulons accompagner nos clients en plaçant la mobilité au cœur de notre profession. Il y va de la pérennité de nos métiers, et nous devons évoluer en même temps que les pratiques liées à l’automobile et ses usages, faute de quoi nous n’existerons plus dans vingt ans.
Dans ce contexte, nous sommes très attentifs à la transversalité et la complémentarité des métiers ; il y a un an, nous avons rejoint le Conseil national des professions de l’automobile (CNPA) afin de créer une branche consacrée à nos professions, car nous souhaitons coopérer avec les activités proches des nôtres. Ainsi, Norauto a été en première ligne dans le domaine de l’éco-entretien, mais nous avons la conviction que la pleine efficacité ne sera atteinte que lorsque tous les acteurs du secteur s’en seront emparés.
Au sein du CNPA, Christophe Delannoy pilote un groupe de professionnels afin que, le moment venu, tous soient prêts ; nous considérons qu’il relève de notre rôle de leader du secteur d’emmener l’ensemble de la filière, car les défis à relever sont nombreux.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Que faudrait-il faire, selon vous, pour accroître le recours aux pièces de réemploi ? Cet usage est-il courant aujourd’hui ?
M. Christophe Delannoy. Notre politique commerciale consiste à proposer à nos clients des pièces d’origine et des pièces de réemploi, ce qui fait partie du label éco-entretien, pour lequel nous faisons l’objet d’audits, et nous sommes tenus de faire cette offre.
Désormais, les filières sont bien développées Il est possible de trouver, en réemploi, pratiquement toutes les pièces nécessaires à l’entretien des véhicules ; le système est donc au point.
Mme Bénédicte Barbry. Nous travaillons beaucoup avec des filières actives dans le secteur des produits automobiles issus des véhicules en fin de vie ; Mobivia est troisième dans le domaine du pneumatique. Notre culture, en tant que groupe, est celle du « faire durer », car nous sommes conscients de l’enjeu que représente la limitation des ressources et nous développons l’économie circulaire dans le champ des pièces automobiles. Les potentialités de ce secteur sont importantes, y compris dans le domaine de l’emploi.
Mme la rapporteure. Quels seraient, à vos yeux, les potentiels restant à conquérir dans l’économie circulaire au sein du secteur automobile ?
M. Christophe Delannoy. En tant que prestataire multimarques, nous ne parvenons pas encore à accéder à tous les systèmes électroniques des constructeurs…
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Vous avez dit être implanté dans plusieurs pays d’Europe. L’approche est-elle la même partout ? Vos concurrents ont-ils une approche équivalente à la vôtre, ou cherchez-vous à vous démarquer ?
Mme Bénédicte Barbry. Notre démarche liée à la nouvelle mobilité concerne surtout la France, ou s’exerce 70 % de l’activité du groupe. Avec la FEDA, nous avons développé notre service « Eco Performance » en Belgique, en Espagne et au Portugal, pays qui ne disposent cependant pas encore d’une réglementation comparable à la nôtre. Nous souhaitons être en tête de ce mouvement en Europe.
En termes de périmètre d’activités, notre groupe n’a guère d’équivalent au sein de la filière automobile. Les plus proches de nous pourraient être les constructeurs, comme PSA qui est très impliqué dans le concept de mobilité et propose certains services à sa clientèle. Dans le secteur de nos métiers historiques, nous avons des concurrents, comme Speedy, Feu Vert etc., que nous rencontrons au sein du Conseil national des professionnels de l’automobile (CNPA), mais ils demeurent très centrés sur l’entretien des véhicules. Nous sommes toutefois la « courroie d’entrainement » et nos concurrents commencent à se mobiliser en proposant, par exemple, des véhicules deux-roues de courtoisie. En tout état de cause, notre groupe est le seul à valoriser pleinement la nouvelle mobilité, singulièrement dans la partie aval. Par ailleurs, le CNPA a lancé un Pacte de mobilité, ce qui montre que les perspectives sont de plus en plus partagées.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Quelles sont les raisons qui expliquent que votre groupe ne soit pas présent en Allemagne ?
Mme Bénédicte Barbry. Historiquement, notre groupe a étendu son champ d’action dans des pays où il était susceptible d’apporter une valeur ajoutée en proposant des services nouveaux. Le rapport à l’automobile est différent en Allemagne, où un réseau de centres d’entretien a toujours été présent, et très fréquenté par les conducteurs, et où nous avons un concurrent qui a grandi en même temps que nous : le réseau Auto-Teile-Unger (ATU). Il était donc moins intéressant, et beaucoup plus difficile, de nous implanter dans ce pays. La situation est comparable en Angleterre, où domine le réseau Halfords.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Nous vous remercions.
La séance est levée à dix-sept heures trente.
42. Audition, ouverte à la presse, de M. Carlos Tavarès, président du directoire du Groupe PSA.
(Séance du mercredi 4 mai 2016)
La séance est ouverte à onze heures.
La mission d’information a entendu M. Carlos Tavarès, président du directoire du Groupe PSA.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Mes chers collègues, nous avons le plaisir et l’honneur de recevoir ce matin M. Carlos Tavarès, président du directoire du groupe PSA.
Monsieur le président, vous dirigez ce groupe depuis le début de l’année 2014, après avoir effectué une grande partie de votre carrière au sein de Renault, jusqu’à atteindre le poste de numéro 2.
Votre connaissance des stratégies de l’industrie automobile vous a naturellement amené à diriger un groupe qui a connu une des plus graves crises de son histoire en 2012.
Avec le plan dénommé « Back in the Race », vous avez, en à peine plus de deux années, restauré les fondamentaux du groupe. Désormais, vous entendez mettre en œuvre un nouveau plan de croissance stratégique, sous l’appellation « Push to Pass ». Pour chacun de ces plans, vous avez choisi des appellations offensives, empruntées à votre passion de la compétition automobile.
Il faut donc comprendre que PSA est de retour dans le grand jeu mondial, qui oppose les constructeurs dans un contexte de marché à bien des égards bouleversé.
Après avoir rétabli le profit opérationnel de votre groupe, l’objectif est de rénover complètement l’offre de modèles en améliorant fortement la marge par véhicule. De vos propos, il semble d’ailleurs que cet objectif de marges l’emporte sur les volumes produits.
Pouvez-vous nous préciser quels sont vos objectifs de production, qui peuvent avoir des conséquences sur les usines ou les centres de développement français ?
Pour sortir de cette crise, l’actionnariat de PSA a été sensiblement modifié. L’État et le groupe chinois DongFeng sont entrés au capital à hauteur de 14 % chacun.
Nous avons déjà auditionné les représentants de l’État actionnaire, en la personne de M. Vial, qui dirige l’Agence des participations de l’État (APE). Selon vous, quels sont à ce jour les apports de ces deux nouveaux actionnaires en termes de stratégie ? Il paraît également nécessaire de vous interroger sur vos éventuels partenariats avec d’autres constructeurs.
L’histoire de votre groupe compte en effet un certain nombre de tentatives inabouties ou inachevées comme avec Fiat, Mitsubishi, BMW ou encore General Motors. Cette question se pose car il est souvent dit que le groupe PSA ne peut rester seul face à des concurrents comme Volkswagen, ou encore Fiat depuis son rachat de Chrysler.
Dans un premier temps, nous allons vous écouter au titre d’un exposé de présentation. Nous vous demandons de bien vouloir contracter autant que possible ce propos liminaire. En effet, nous savons que vous avez des obligations à compter de 12 heures 15. Il est néanmoins important que Mme Delphine Batho, notre rapporteure, puis les autres membres de la mission puissent vous poser directement leurs questions.
M. Carlos Tavarès, président du directoire de PSA. Madame la présidente, madame la rapporteure, mesdames et messieurs les députés, je suis à la fois honoré et très heureux de pouvoir partager avec vous les éléments essentiels du tout nouveau plan de croissance rentable organique du groupe PSA.
Vous l’avez souligné, grâce à « Back in the Race » et surtout grâce à la mise en œuvre de ce plan par les collaborateurs de PSA, nous avons pu, en l’espace de deux ans, à la fois rétablir les fondamentaux en matière de rentabilité, de suppression de la dette – puisque l’entreprise n’a plus de dettes aujourd’hui – et générer des flux de trésorerie positifs, ce qui nous assure notre capacité à investir dans l’avenir. Cela a été obtenu par optimisation de l’utilisation de nos ressources, l’amélioration de nos prix nets, et l’accélération de la réduction des coûts variables.
En bref, « Back in the Race » nous a rapprochés de l’excellence opérationnelle. Nous comptons bien continuer à utiliser les grands principes de "Back in the Race » pour, chaque fois que possible, nous rapprocher de cette excellence opérationnelle qui fait la différence entre les constructeurs. Mais ce n’est pas suffisant. Au-delà, il nous faut une démarche stratégique à moyen et long terme, qui permette à l’entreprise de se bâtir un avenir.
Vous avez évoqué, madame la présidente, un certain nombre de questions que je tenterai de traiter au cours de cet exposé.
« Push to Pass » est un plan stratégique qui vient se superposer à un plan « Back in the Race » qui nous a rapprochés de l’excellence opérationnelle. Pour le bâtir, nous avons commencé par reconnaître qu’il y a, dans les sociétés dans lesquelles nous opérons, un certain nombre de changements. Il s’agit pour nous, non pas de contrer ces changements, mais simplement d’en prendre acte. Je ne vais pas les reprendre en détail, mais il faut en retenir deux: d’abord, un centrage de plus en plus marqué sur la mobilité et de moins en moins sur le produit automobile ; ensuite, le fait que l’expérience prend le pas sur la notion de propriété. Cela aura évidemment des conséquences sur la manière dont nous allons nous organiser pour préparer l’avenir.
Nous prenons acte de ces évolutions et de la vitesse de changement des attentes de nos clients. Il est évidemment de notre responsabilité d’adapter l’entreprise aux attentes de ceux-ci. En effet, seule la satisfaction de ces attentes permet de donner à l’entreprise la pérennité et la prospérité à laquelle nous aspirons.
Nous avons donc décidé de mettre le client au cœur de nos préoccupations et d’ouvrir l’entreprise à une influence plus forte du monde extérieur, en particulier de nos clients. Cela se traduit, dans notre activité, par la mise en place de deux piliers.
Le premier, que l’on peut qualifier de « connu », est celui du constructeur automobile ; de ce point de vue, nous voulons devenir un constructeur automobile de référence dans l’industrie automobile mondiale pour son efficience. En complément de cela, nous voulons préparer notre entreprise à l’éventualité d’une fourniture de services de mobilité qui serait associée à cette idée que l’usage et l’expérience de la mobilité deviendront, pour certaines parties de la population, plus importantes que l’objet de mobilité en lui-même. Voilà pourquoi le second pilier est celui du fournisseur de mobilité, qui vient compléter et créer des synergies avec celui de constructeur automobile de référence en termes d’efficience.
Une fois que l’on a intégré ces deux éléments essentiels de notre modèle d’affaires, le plan « Push to Pass » s’articule autour de trois axes majeurs.
Le premier axe est celui d’une offensive produits et technologique sans précédent dans l’histoire de l’entreprise. C’est très important de le comprendre. Je me souviens en effet d'avoir eu avec vous un dialogue sur ce thème il y a à peine deux ans. À l’époque, une des grandes questions qui nous étaient posées était de savoir si nous n’étions pas en train d’assécher le pipe-line produits de l’entreprise. Le risque était qu’à l’issue de sa reconstruction économique, celle-ci n’ait plus ni produits ni technologie, et ne puisse donc plus assurer son avenir. La réponse est là : nous avons protégé nos investissements pendant la phase de reconstruction économique et à peine sommes-nous sortis de cette phase que nous lançons, avec « Push to Pass », une offensive produits sans précédent.
Voici quelques chiffres de référence, qui sont très marquants : sur les six prochaines années, nous allons lancer 28 nouveaux produits en Europe, 20 en Chine, 23 en Afrique et Moyen-Orient, 17 en Amérique latine et 17 en Eurasie. Cela signifie que pendant la phase de reconstruction, nous avons continué à investir et à développer nos produits et nos technologies. Notre gamme deviendra de plus en plus mondiale, ce qui permettra d’améliorer significativement l’efficience de tout l’amont créatif de l’entreprise.
La « gamme cœur » du constructeur automobile comprend ainsi 34 véhicules, avec 26 véhicules particuliers et 8 véhicules utilitaires. Nous l’avons renforcée avec l’introduction d’un pick-up d’une charge utile d’une tonne, que nous allons développer au cours des prochaines années.
Deux plateformes porteront l’ensemble de ces applications véhicules. La planification stratégique du produit a été complétement refondue, pour nous permettre de vérifier la pertinence du plan produits, non pas à partir du centre de l’entreprise, mais à partir des fenêtres régionales qui voient arriver les nouveaux produits sur les marchés où elles opèrent. Pour cela, nous nous sommes dotés d’une stratégie de planification des produits qui, à partir de 2018, procurera à chaque région la possibilité de voir arriver tous les ans une nouvelle Peugeot, une nouvelle Citroën et une nouvelle DS.
Cette nouvelle manière de planifier nos développements et de planifier l’introduction de ces produits assurera une certaine régularité dans la croissance de notre business.
Sur le plan technologique, nous prévoyons également une poussée sans précédent.
Non seulement, nous allons continuer à améliorer les émissions de nos moteurs à combustion interne, notamment les moteurs à essence, mais nous avons lancé tous les programmes d’électrification de nos groupes motopropulseurs : arrivée des hybrides rechargeables/essence dès 2019 ; arrivée d’une technologie électrique de deuxième génération dès 2019 ; déploiement sur un certain nombre de véhicules jusqu’en 2021. Cela nous permettra, en 2021, d’avoir sept véhicules hybrides rechargeables à essence et quatre véhicules purement électriques, en accentuant ainsi fortement l’électrification de notre gamme. Mais déjà, au cours du premier trimestre de 2016, le taux de croissance de nos ventes de véhicules électriques en Europe a été de 100 % - soit un doublement de nos ventes. Nous sommes donc en train de démarrer fortement notre activité commerciale dans ce domaine.
Enfin, nous allons continuer à différencier nos marques avec : une marque Peugeot qui se positionne comme le généraliste de haut de gamme du marché ; une marque Citroën qui est de plus en plus centrée sur l’humain et sur l’utilisation agréable et aisée du véhicule au quotidien, avec une dimension de confort qui fait partie de son ADN, déployée cette fois à 360 degrés ; et une marque Premium DS qui exprimera le luxe et l’esprit avant-gardiste à la française sur l’ensemble des marchés mondiaux.
On doit donc retenir du premier axe de « Push to Pass », que c’est une offensive produits et technologique sans précédent dans l’histoire de l’automobile, avec pas moins de 121 lancements de nouveaux modèles sur l’ensemble des six régions qui nous occupent au niveau de notre activité commerciale mondiale.
Le deuxième axe de ce plan consiste à réduire, si ce n’est annuler, la vulnérabilité de notre entreprise qui est aujourd’hui très dépendante du marché européen et du marché chinois – pour l’essentiel, du marché européen. Dans ces conditions, les crises ou les périodes difficiles qui peuvent se produire sur un seul marché risquent de tirer l’ensemble de l’entreprise vers le bas.
La seule solution est évidemment de répartir nos ventes sur un nombre plus important de marchés mondiaux pour la protéger, statistiquement, d’une crise régionale à un seul endroit du monde. Cela suppose d’avoir un volant d’affaires suffisamment copieux sur un nombre suffisant de marchés. C’est particulièrement important.
Il y a deux ans, dans une salle semblable à celle-ci, on se disait que cela n’allait pas très bien en Europe mais qu’heureusement, il y avait la Chine. Maintenant, c’est exactement l’inverse, c’est l’Europe qui va beaucoup mieux et la Chine qui se porte beaucoup moins bien. Donc, on voit bien que si nous avions au même moment des difficultés sur les deux régions, on mettrait l’entreprise en difficulté. Vous voulons donc sortir de cette vulnérabilité en ayant un volant d’affaires sur un nombre plus important de régions qui, statistiquement, ne seront pas toutes au point bas – il y aura toujours quelques régions au point haut et d’autres régions au point bas. Cela constitue la protection de l’entreprise.
Donc, deuxième axe très important de « Push to pass » : une offensive à l’international, en introduisant nos marques et nos services dans des marchés où nous ne sommes pas présents aujourd’hui.
Cela passe : d’abord par un développement en Afrique et au Moyen-Orient, sur lequel nous avons un potentiel de progrès très important ; par l’arrivée sur le marché de l’Asie du Sud-Est, un marché commun qui s’appelle l’ASEAN, dans lequel nous sommes très marginalement présents aujourd’hui – essentiellement en Malaisie ; par l’arrivée sur le marché indien, où nous ne sommes pas du tout présents ; et par le retour programmé et progressif sur le marché d’Amérique du Nord qui, comme vous le savez, avec l’Europe et la Chine, représente les trois gros marchés automobiles mondiaux. Nous voulons revenir sur ces marchés, développer nos marques, nos affaires rentables, précisément pour protéger l’entreprise d’éventuelles crises régionales.
Le troisième axe de développement est lié la mobilité, à l’idée que la mobilité est centrée sur l’usage, sur l’expérience et que les besoins de mobilité des générations futures sont en croissance exponentielle. L’opportunité, pour l’industrie automobile, est d’être capable d’accompagner ces besoins de mobilité. Mais cette mobilité s’exprime davantage sur une dimension de l’usage et de l’expérience, que sur une dimension de propriété de l’objet de mobilité. Voilà pourquoi nous nous plaçons pour préparer l’entreprise à cette éventualité.
Cela suppose que nous nous positionnions pour être des fournisseurs et des opérateurs de mobilité Si nous sommes nous-mêmes les opérateurs, nous pourrons bien comprendre les attentes des utilisateurs. Car il est fort probable que les besoins des utilisateurs de mobilité vont se traduire par une conception des objets de mobilité qui sera divergente par rapport à la conception des véhicules aujourd’hui en propriété. Dans le cas d’Autolib, par exemple, vous voyez bien comment les véhicules sont traités. Ces véhicules vont devoir se développer sur des dimensions de connectivité, de fonctionnalité de l’habitacle, de résistance de l’habitacle à un usage plus intensif.
Nous avons là une carte à jouer, car les attentes de ces clients vont rejaillir sur la manière de concevoir les objets de mobilité. On peut penser qu’à l’avenir, les objets de mobilité en partage auront une conception différente de celle des objets de mobilité en propriété. Nous devons nous y préparer, et surtout utiliser les synergies qui vont exister entre un constructeur automobile et un opérateur de mobilité. C’est pour nous davantage une opportunité qu’une menace. C’est même une « disruption » que nous appelons de nos vœux, parce que nous sommes une entreprise qui est devenue plus agile au travers de la reconstruction de ses fondamentaux et des épreuves que nous avons traversées. Nous allons donc travailler dans ce sens. J’observe qu’en matière de mobilité, il n’y a pas que les services de mobilité : il y a aussi les services connectés.
Nous devons être capables de développer notre business de vente de véhicules d’occasion. Nous devons aussi pouvoir fournir des solutions de mobilité regroupant à la fois l’objet de mobilité, la maintenance et l’assurance, et offrir une mobilité sans souci, avec un seul acte d’achat de l’ensemble de ces paramètres. Nous avons enfin programmé, de manière très progressive et à partir de l’autopartage, notre retour en Amérique du Nord. Car ce qui est important, ce n'est pas notre retour, mais le fait d’y revenir de manière solide, progressive, voire de manière prudente, pour y rester.
Je souhaite maintenant vous présenter les objectifs économiques sur lesquels nous nous engageons, et qui correspondent à une forme d’élévation du niveau de jeu du groupe PSA dans le monde automobile.
Nous nous engageons sur une marge opérationnelle de la division automobile, qui représente le cœur de notre métier, et qui passera de 1 % à 4 %. En d’autres termes, nous proposons de multiplier par quatre notre rentabilité sur le cœur de notre modèle d’affaires. Nous sommes partis sur la moyenne de la marge opérationnelle qui a été de 1 % au cours de ces quinze dernières années, soit de de 2001 à 2015. Sur les trois prochaines années, 2016-2018, nous nous engageons à ne pas faire moins de 4 % de marge opérationnelle. C’est un engagement sur la durée, qui démontre que nous élevons le niveau de jeu de l’entreprise à une autre catégorie.
De la même manière, madame la présidente, nos volumes ont progressé. Pendant que nous reconstruisions les fondamentaux économiques de l’entreprise, les volumes de PSA mondiaux ont crû de 5,5 % sur cette période de deux ans. J’ajoute que de notre point de vue, la croissance des volumes est la récompense d’un travail bien fait. Ce n’est pas une fin en soi, mais le signe que nous avons bien fait tout le reste, que nous avons rendu nos clients heureux et que nous avons su apporter sur les marchés des produits attractifs.
Nous proposons également de multiplier par quatre le taux de croissance du chiffre d’affaires de l’entreprise – qui mélange à la fois la vente de véhicules et la vente de services. Nous prenons en référence le taux de croissance annuelle de ces quinze dernières années, qui était de 0,8 %. Nous nous engageons donc à le porter à 3,2 % sur les trois prochaines années. Ainsi, nous conjuguons à la fois l’amélioration de l’efficience de l’entreprise par l’amélioration de la marge opérationnelle, et la multiplication par quatre du taux de croissance du chiffre d’affaires.
Après vous avoir présenté les trois axes majeurs du nouveau plan « Push to pass »
– une offensive, produits et technologique, sans précédent ; une offensive à l’international pour réduire la vulnérabilité de l’entreprise à des crises régionales ; la préparation de l’entreprise aux enjeux de la mobilité de demain sans propriété – je tiens à vous rappeler les éléments essentiels de ce qui concerne la France, puisque c’est le pays de notre entreprise, où se trouve le cœur de l’entreprise.
Nous avions pris des engagements dans le cadre du contrat social que nous avions signé en octobre 2013 : d’abord, produire en France un million de véhicules en 2016 : en 2015, nous avons produit 995 000 véhicules. Nous sommes donc déjà tout près du million. Ensuite, affecter un véhicule par site industriel sur la période 2014-2016 : l’ensemble de ces affectations ont été faites et chacun des sites industriels connaît maintenant le véhicule qu’il aura à produire sur les prochaines années. Enfin, investir 1,5 milliard d’euros en France sur la période 2014-2016, ce qui a été réalisé, et maintenir pas moins de 75 % de notre volume d’activité recherche et développement en France à l’horizon 2016, ce qui est en passe d’être réalisé.
J’ai ici une longue liste, que je ne vais pas énumérer, de tous les investissements qui ont été réalisés sur l’ensemble de nos sites industriels. Nous sommes résolument engagés dans une démarche que je qualifierai de « co-construction » de l’avenir avec nos partenaires sociaux, avec lesquels nous avons un dialogue très ouvert et très transparent, sur la manière de continuer à construire la compétitivité de notre entreprise. En effet, il est maintenant bien compris et bien admis par l’ensemble de nos collaborateurs et de nos partenaires que la meilleure façon de donner à l’entreprise un avenir prospère et de les protéger, c’est de donner à celle-ci un niveau de performance lui permettant de continuer de croître de manière rentable.
Je terminerai sur quelques données quasiment philosophiques de la manière dont nous voyons la conduite de notre business.
Pour une entreprise comme la nôtre, la performance compte plus que la taille. La taille est toujours le résultat d’un travail bien fait, apportant à nos clients un niveau de satisfaction élevé. Nous considérons que ce qui est important, c’est d’être à la pointe de l’efficience de tout ce que nous faisons, que ce soit dans le domaine de la qualité, du service, ou de toutes les activités du cœur de métier de l’entreprise.
Nous reconnaissons que le client a un besoin de mobilité qui ne passe pas obligatoirement par la propriété. Nous nous préparons à devenir un fournisseur de mobilité. Puisque nous considérons que la croissance est toujours le résultat d’un travail bien fait, nous nous concentrons sur l’excellence de l’exécution. Et comme vous l’avez souligné, madame la présidente, nous avons besoin de rendre l’entreprise plus robuste.
Rendre l’entreprise plus robuste passe par deux dimensions : la première est l’excellence opérationnelle et la préparation aux enjeux de la mobilité de demain ; la seconde est d’être en bonne situation, en bonne forme pour pouvoir négocier une éventuelle alliance stratégique, que nous n’écartons évidemment pas. Nous restons les yeux grands ouverts pour saisir toute opportunité. Mais nous voulons placer l’entreprise dans une position où une alliance stratégique ne fera que rajouter de la valeur à un plan stratégique déjà ambitieux et robuste, et pas dans une situation où une alliance stratégique serait une condition nécessaire pour sauver l’entreprise. Nous n’avons pas besoin d’une alliance pour sauver l’entreprise. Mais étant nous-mêmes prospères et en croissance rentable, nous nous mettons en situation de pouvoir éventuellement saisir une opportunité pour devenir un acteur encore plus important.
En dernier lieu, je voulais partager avec vous ce slide, qui est celui du changement d’identité de notre entreprise, qui s’appelle désormais « PSA Groupe » groupe avec « e » pour bien mettre en lumière évidemment le fait que nous sommes une entreprise française et fiers de l’être.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Monsieur le président, à l’issue de l’intervention de Mme la rapporteure, peut-être pourrez-vous répondre à ma question concernant l’apport des anciens actionnaires, DongFeng et l’État ?
Mme Delphine Batho, rapporteure. Merci beaucoup, monsieur le président, pour cette présentation.
Le point de départ de la création de notre mission d’information par la Conférence des présidents fut évidemment l’affaire Volkswagen, qui est loin d’être terminée. Je voudrais vous interroger à ce propos. Je n’aborderai pas l’aspect technique de cette affaire, puisque nous avons longuement rencontré vos équipes et M. Gilles Le Borgne. Mais j’aimerais savoir ce que celle-ci a eu comme conséquences sur la relation entre les consommateurs et l’industrie automobile, et sur la confiance que ces derniers lui accordent. À ce propos, je tiens à saluer la démarche que vous avez initiée avec Transport et Environnement, France Nature Environnement et le Bureau Veritas, même si elle méritera d’être complétée par la suite.
Diriez-vous que la tricherie d’un constructeur constitue une concurrence déloyale pour les autres constructeurs ? Cette affaire peut-elle être l’opportunité de remettre à plat les règles sur les normes et les contrôles, et de rétablir la confiance ?
Pourriez-vous également nous parler de la procédure entamée par la direction générale de la concurrence, la consommation et la répression des fraudes (DGCCRF) il y a quinze jours ?
Concernant « Push to Pass », je dois dire que c’est la première fois qu’un constructeur nous présente un plan qui semble en phase avec ce que nous avons entendu sur l’évolution des usages de l’automobile et de la relation des consommateurs à l’automobile, et la révolution que cela représente de passer d’un constructeur à un fournisseur de services de mobilité.
Mais 2021, c’est demain, même si, dans votre secteur, les changements sont extrêmement rapides. D’autres constructeurs nous ont présenté leur vision à l’horizon 2050. Votre plan sous-tend une vision stratégique à plus long terme, et j’aimerais savoir ce qu’il faut en attendre en termes de mutation des emplois du secteur et des compétences dans l’entreprise.
Cela m’amène à ma troisième question, qui concerne le maintien des sites industriels en France. Vous avez rappelé les engagements du plan « Back in the Race », qui ont été tenus.
D’abord, le maintien des sites jusqu’à 2016. Et après ? Qu’y a-t-il dans le plan « Push to Pass » ?
Ensuite, 1,5 milliard d’euros d’investissements en France. Et dans « Push to Pass » ? En se déplaçant sur sites, nous avons constaté un enjeu de modernisation et d’adaptation de l’outil de production industrielle, notamment sur les moteurs, qui sont à 85 % fabriqués en France. Il y a déjà eu des investissements, mais qu’a-t-on prévu pour l’avenir ?
Enfin, vous avez aujourd’hui quinze modèles « origine France garantie » ? Sur les nouveaux modèles qui sont annoncés, comptez-vous maintenir une stratégie « origine France » ?
Quatrièmement, lors de votre audition par la commission des affaires économiques en 2015, vous aviez invité à la neutralité technologique de l’État, notamment dans le débat essence/diesel. La neutralité technologique suppose la neutralité fiscale et donc un rééquilibrage de la fiscalité, lequel est maintenant enclenché. Quels investissements, quel accompagnement cela suppose-t-il si l’on veut préserver l’activité industrielle de PSA en France ?
Par ailleurs, souhaitez-vous que les pouvoirs publics prennent des mesures en faveur de l’accélération du renouvellement du parc automobile ? C’est important si l’on veut, par exemple, sortir du parc roulant les véhicules qui ne sont pas équipés de filtres à particule.
Ma dernière question portera évidemment sur le partage de la réussite. Vous vous êtes exprimé publiquement à propos de votre salaire. D’autres exemples défraient la chronique et l’État menace de légiférer, sans jamais le faire. Que pouvez-vous nous dire sur le partage de la réussite avec les salariés ?
Je crois qu’une nouvelle négociation d’accord de compétitivité doit s’engager. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?
M. Charles de Courson. Monsieur le président, que représente le crédit d’impôt-recherche (CIR) dans votre effort de recherche et développement (R & D) ? On a dit qu’il était le plus avantageux des systèmes d’incitation à la R & D dans la plupart des pays développés. A-t-il eu des conséquences sur l’implantation de votre effort de recherche en France ?
Par ailleurs, est-ce que la vitesse de réalisation de la neutralisation fiscale, à parité énergétique bien sûr, est cohérente avec la vitesse d’adaptation de l’entreprise ? En d’autres termes, est-ce que l’on va trop vite ou pas assez ?
J’aurai une question subsidiaire portant sur l’oxygénation des carburants : comment se pose le problème en Europe par rapport au reste du monde, puisque vous allez vous implanter un peu partout dans le monde ?
Ensuite, en France, le niveau de la pression fiscale est assez élevé, notamment sur les bénéfices, puisque nous avons le taux d’IS parmi les plus élevés. Cela a-t-il des conséquences sur l’organisation de votre groupe ? Je pense à son organisation juridico-financière et au choix des implantations de vos nouvelles unités.
Enfin, vous avez beaucoup développé le troisième axe de votre nouveau plan qui vise, notamment, à faire de la location et à développer des prestations autour de la mobilité. Cela ne va-t-il pas se traduire par des besoins en capitaux bien plus considérables ? Qui va porter ces actifs ? Une structure dédiée du groupe ?
En d’autres termes, ces trois axes sont très ambitieux. Comment allez-vous les financer ? Ne risquez-vous pas de déstabiliser l’actionnariat ? Ne faut-il pas faire rentrer d’autres actionnaires ?
M. Éric Straumann. J’ai bien noté que vous vouliez passer de la propriété à l’usage. Nous étions récemment au siège de Google à Paris. Croyez-vous à l’avenir de la Google car, c’est-à-dire de la voiture sans pilote ? Est-ce que vous vous y préparez ?
Par ailleurs, la France est aujourd’hui très absente du marché des deux roues. Pourtant, Peugeot a une tradition très forte en ce domaine. Je crois à un très fort potentiel du deux roues, s’agissant notamment du scooter électrique. Avez-vous des projets en la matière ?
M. Gérard Menuel. Monsieur le président, je voudrais d’abord saluer la stratégie que vous avez présentée, parce qu’elle est très claire et qu’elle intègre bien les enjeux de la mobilité de demain. C’est particulièrement rassurant.
Ensuite, vous avez précisé l’évolution de votre offre par rapport à vos concurrents. Vous avez parlé d’efficience. Mais au niveau national, comment vont évoluer les réseaux de vente et de distribution ? À côté de chez moi, j’ai un acteur dans le e-commerce. Chaque semaine, des centaines de voitures neuves sont vendues à des particuliers ou à des groupes. Traditionnellement, il y a des réseaux de distribution avec un service après-vente, etc. Cela ne risque-t-il pas, demain, d’être perturbé ?
Enfin, en ce moment même, l’accord de partenariat transatlantique, le TAFTA, est en cours de discussion. Peut-il avoir des conséquences sur un groupe comme le vôtre, au niveau international ?
M. Philippe Kemel. Monsieur le président, vous avez présenté l’évolution de votre marge opérationnelle, qui est particulièrement positive.
En tant que parlementaire, nous souhaitons évaluer les politiques que nous menons, notamment la politique du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Quelle part représente donc le CICE dans cette marge opérationnelle ?
En termes d’usage de cette marge opérationnelle, je rejoindrai les propos de Mme la rapporteure. Quelle sera la part d’investissements réalisée grâce à cette marge opérationnelle ? Comment allez-vous orienter ces investissements, particulièrement en France, pour renforcer votre système productif, notamment le système productif de partenariat que vous avez mis en place avec un certain nombre d’entreprises ?
J’ai une veille sur une entreprise de mon territoire, qui s’appelle la Française de mécanique. Ce partenariat a précisément permis de donner aux salariés de la lisibilité sur leur emploi. Va-t-on le renforcer, s’agissant notamment de la production des nouveaux moteurs ?
M. Yves Albarello. Monsieur le président, vous avez déclaré récemment sur une radio nationale : « Nous avons chez PSA un potentiel et une énergie que nous allons libérer ». Est-ce l’énergie du plan « Push to Pass » que vous venez de nous présenter ?
Mes deux autres questions concernent l’international.
Je reviens d’une mission parlementaire à Taïwan où, sur 23 millions d’habitants, on compte 15 millions de scooters. Les Taïwanais sont en train de travailler sur la transition énergétique. J’ai visité une start-up très innovante, qui s’appelle Gogoro, et qui n’a que huit mois d’existence. Elle a sorti un produit fantastique : un scooter recyclable, à base d’aluminium, électrique, non rechargeable. Il faut retirer la batterie, la déposer à une station-service, et en reprendre une autre pour repartir. Le scooter est connecté à un I Phone, qui indique le temps restant à parcourir et où aller rechercher une nouvelle batterie. On paie par abonnement, ce qui est intéressant. Travaillez-vous sur de tels sujets ?
J’ajoute qu’en visitant Taïwan, je n’ai pas vu beaucoup de voitures Peugeot. Mais dans une arrière-cour, j’ai rencontré un réparateur de voitures qui en réparait. Je pense que le plan ambitieux que vous souhaitez développer demandera beaucoup de de travail. Je pense aussi qu’il vous reste d’extraordinaires parts de marché à conquérir.
En définitive, le monde a changé, puisque l’on parle d’autos et de scooters connectés. Vous avez été très longtemps seul sur votre secteur. Est-ce que ce n’est pas aujourd’hui un handicap, pour le secteur automobile, de vivre une telle révolution ?
M. Frédéric Barbier. Monsieur le président, j’ai eu la chance, grâce à vos équipes de Montbéliard/Sochaux, de pouvoir essayer votre véhicule autonome. Sur autoroute, c’est véritablement bluffant ! Peugeot n’est pas en retard sur la technologie.
Cela dit, je crois savoir qu’un particulier utilise son véhicule personnel pendant 15 à 17 % de son temps. Avant, on avait un véhicule par famille, puis deux, puis trois. Le véhicule autonome aura-t-il un impact sur le nombre de véhicules par famille et les productions de véhicules ?
Enfin, même si nous discutons de l’automobile, pourquoi ne parlerions-nous pas des scooters ? L’usine Peugeot Scooters est à Mandeure, dans ma circonscription. L’actionnariat est partagé – à 49 % chez Peugeot Scooters, et à 51 % chez Mahindra. Dans d’autres pays, les scooters électriques sont en train de se développer et sur mon secteur, j’attends de voir de nouvelles productions. Vous-même et vos équipes avez été capables de redresser Peugeot automobiles. Qu’en est-il de la partie scooters ? Certaines grandes villes ont acheté des scooters électriques .Y a-t-il des Peugeot ? Vous en avez déjà fabriqué. Où en êtes-vous de votre réflexion s’agissant des scooters ?
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Je rappelle tout de même que nous sommes dans le cadre d’une mission d’information sur l’offre automobile…
Mme Marie-Jo Zimmermann. Monsieur le président, j’ai dans ma circonscription, à Trémery, la première usine du monde de moteurs diesels. Mais aujourd’hui, beaucoup de salariés s’inquiètent. Des attaques successives ont été lancées contre le diesel, malgré les recherches qui ont été faites sur le diesel propre. L’existence même de notre mission d’information les amène à s’interroger. Et je sais que les cadres de cette usine travaillent aujourd’hui sur la modification de l’outil de travail pour produire des moteurs à essence.
La direction de PSA pourrait-elle leur délivrer des messages d’espoir ? En effet, je suis convaincue que tout le travail que vous avez fait sur le diesel sera fait sur l’essence. Et je sais que votre potentiel en matière de recherche et d’innovation est largement supérieur à celui des autres entreprises. Mais comment apaiser les esprits et rassurer vos salariés, qui travaillent avec beaucoup de conviction sur les moteurs ?
M. Carlos Tavarès. Je vais essayer de répondre à vos questions dans l’ordre où elles m’ont été posées.
Vous m’avez d’abord interrogé sur la fraude de Volkswagen. Évidemment, comme beaucoup d’autres dirigeants d’entreprises automobiles, j’ai été surpris, choqué par ce qui s’est produit. Et je voudrais le relier à certains des propos que j’ai tenus pendant mon exposé, à savoir que la stratégie qui consiste à faire en sorte d’être le plus gros ne fonctionne pas. On l’a observé non seulement avec le groupe Volkswagen, mais également avec d’autres entreprises – une grande entreprise japonaise et une grande entreprise américaine. Au cours des vingt ou trente dernières années, toutes les grandes entreprises automobiles qui se sont fixé comme stratégie d’être les plus grosses ont connu de graves dysfonctionnements : soit des fraudes, comme celles que vous avez mentionnées pour Volkswagen, soit de gravissimes problèmes de qualité, ce qui est le cas pour les autres.
Cette affaire a donc fini par me convaincre que la croissance n’est jamais que la conséquence juste et heureuse de la satisfaction des clients, mais ne peut pas être une fin en soi. Il faut donc rester concentré sur l’essentiel : la qualité, l’éthique et le respect des règles qui nous sont imposées par les sociétés dans lesquelles nous opérons. Il est important de le comprendre.
De fait, cette affaire de fraude a eu un grave impact et a causé un lourd préjudice à l’ensemble de l’industrie automobile, et en particulier à PSA qui est le leader des émissions de CO2 sur le marché européen, ce qui nous a beaucoup chagrinés et préoccupés.
La meilleure réponse que nous ayons trouvée pour essayer de préserver la confiance de nos consommateurs a été l’initiative soulignée par Mme la rapporteure. Une ONG étant plus crédible qu’un constructeur aux yeux des consommateurs, nous avons soumis à l’une d’entre elles l’idée de définir un protocole de mesure de la consommation – qui est proportionnelle aux émissions de CO2 – et de faire en sorte que le cycle de mesure soit totalement représentatif des usages clients.
Nous avons défini ce protocole au cours du premier trimestre 2016, et nous l’avons officiellement présenté dans le cadre du Salon de Genève en début mars 2016. Nous sommes actuellement en train de le mettre en œuvre. Il s’agit de mettre à la disposition de nos clients toute une série de mesures qu’ils pourront visualiser sur le site de Transport & Environnement d’ici aux prochains congés d’été. Ainsi, progressivement, les consommateurs pourront prendre connaissance de ces informations.
Je m’empresse de dire que ce protocole de mesures repose sur une heure et demie d’essais et 90 km de mesures, plutôt que sur quelques minutes d’essais et 11 km de mesures, sur le cycle simplifié de la norme actuelle. Le dispositif a été placé sous le contrôle de Bureau Veritas, en ce qui concerne le respect strict du protocole de mesures, pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté.
L’avenir nous dira si cela a été, on non, une réussite. Reste que nous avons essayé d’être à la fois proactifs en prenant les devants pour construire cette démarche avec une ONG, et transparents en montrant les mesures que nous avons effectuées nous-mêmes. Nous souhaitons ainsi préserver, et si possible renforcer encore, la confiance des consommateurs dans nos marques et dans notre entreprise.
La DGCCRF a fait son travail. Elle est venue demander des informations et interroger nos techniciens. Nous avons bien évidemment mis à sa disposition tous les documents et toutes les équipes. Jusqu’à présent, nous avons eu, comme avec toutes les commissions qui ont été nommées, et notamment la commission Royal, un dialogue constructif, transparent, techniquement circonstancié sur la manière dont fonctionne notre dispositif de traitement des émissions.
En particulier, sur les NOx, nous avons une excellente conformité par rapport aux règles et aux cycles qui nous sont demandés. Et je crois que nous avons fait la démonstration que le système SCR (Selective Catalytic Reduction) que nous utilisons est celui qui a aujourd’hui, du point de vue technologique, les meilleures performances sur le marché, même si on peut reconnaître qu’en valeur absolue, ce n’est pas suffisant. D’ailleurs, plus on se rapproche de l’utilisation réelle du véhicule par le client, plus cette technologie fait la différence par rapport aux autres technologies et par rapport à nos concurrents, en particulier sur un aspect qui est très important, à savoir la plage de température pendant laquelle ce système est actif. Donc, non seulement nous sommes conformes aux réglementations, mais nous sommes parmi les plus performants, sinon les plus performants en utilisation qui se rapproche de la réalité du client.
Maintenant, vous m’avez demandé si « Push to Pass » regardait suffisamment loin. Vous avez raison car c’est fondamental. Il est exact que nous avons limité notre plan à six ans, soit un peu plus que la durée actuelle des plans des grandes entreprises, qui durent entre trois et cinq ans. Il est exact aussi que la question à laquelle nous ne pouvons pas répondre, et à laquelle nous ne pouvons répondre qu’en travaillant ensemble, c’est celle de la place des objets de mobilité dans la société. En particulier, la différence qui va inévitablement apparaître entre les milieux urbains et non urbains, relèvera assez rapidement de l’aménagement du territoire. Mais face à toutes les interrogations qui vont se faire jour, le groupe PSA veut se positionner comme un apporteur de solutions.
Pour que nous soyons un apporteur de solutions, il faut que l’on puisse visualiser ensemble, dans une perspective d’aménagement du territoire, comment nous voyons la place des objets de mobilité dans la société, dans les milieux urbains, dans les milieux non urbains, dans les milieux périurbains, et comment nous voyons la coexistence des objets de mobilité avec d’autres formes de transport. Mais il faut reconnaître que les constructeurs automobiles, qui peuvent avoir des idées et qui emploient des gens très talentueux, n’ont pas de visibilité au-delà du moyen terme.
Cela étant, je tiens à faire état de la disponibilité du groupe PSA pour réfléchir avec les autorités et les administrations qui voudraient bien se pencher sur la place des objets de mobilité dans la société, qu’elle soit urbaine ou non-urbaine. Il y a là matière à un travail constructif et prospectif de qualité qui, à coup sûr, nous emmènera au-delà de la perspective de 2021, comme vous l’avez souligné à juste titre.
J’en viens à la question des sites en France. Vous m’avez demandé ce qui se passerait au-delà de 2016, qui est en effet la dernière année de l’actuel contrat social que nous avons signé avec nos partenaires. Il se trouve qu’à l’heure même où je vous parle, nous sommes en train de construire avec nos partenaires ce que nous appelons le « Nouveau contrat social 2 ». Pour ma part, je préfère parler d’un travail de co-construction de l’avenir avec nos partenaires sociaux, qui consiste à partager de manière très simple, transparente et respectueuse les enjeux de l’entreprise, laquelle se protège elle-même par sa performance. En d’autres termes, la protection de l’entreprise est la conséquence naturelle de la performance qui va générer sa prospérité et son avenir.
À l’issue des discussions qui vont se dérouler ces prochaines semaines, nous aurons – du moins, je l’espère – conclu un accord avec nos partenaires sociaux. Mais encore une fois, je préfère parler de co-construction de l’avenir que de dialogue social ou de contrepartie. Car finalement il n’y a pas véritablement de contrepartie, mais la volonté de construire un avenir qui soit aussi prospère, aussi souriant que possible et faire en sorte que chacun, à sa place, puisse y participer. Je pense qu’il y a une véritable complémentarité à rechercher, plutôt qu’une opposition. En tout cas, c’est comme cela que nous avons vécu le premier contrat social. C’est comme cela que s’engagent les discussions du deuxième. J’espère que nous aurons l’opportunité d’en rediscuter tous ensemble lorsque cette démarche se sera conclue. En tout cas, je peux vous dire que cela a très bien démarré, et que l’on se comprend sur ce qui constitue aujourd’hui les enjeux de l’entreprise pour l’avenir.
Vous m’avez demandé ce qu’il fallait penser du CIR. C’est un excellent outil. Selon les années, il représente entre 80 et 100 millions d’euros pour l’entreprise. C’est donc une somme très conséquente, qui participe de manière concrète au fait que nous gardons en France la partie la plus noble de notre R & D, à savoir l’Advanced Engineering, c’est-à-dire toute la partie amont de l’ingénierie, où nous concevons les nouvelles technologies, les nouveaux objets, les nouveaux services et les nouveaux équipements.
Nous la développons en France, et c’est ce que nous voulons. L’une des raisons tient au crédit impôt recherche. L’autre raison, c’est qu’ainsi nous utilisons au mieux l’excellence de notre système éducationnel scientifique français. Ce système produit d’excellents techniciens et ingénieurs. Voilà pourquoi nous avons une force qui s’appelle l’ingénierie de PSA. Nous comptons continuer à utiliser cette force qui résulte de l’excellence du système éducationnel français et du CIR, pour continuer à développer toutes les technologies d’avant-garde – dont le véhicule autonome, l’électrification des groupes motopropulseurs et tout ce qui touche à la connectivité.
Ensuite, vous m’avez interrogé sur la neutralité fiscale et sur la vitesse à laquelle on évoluait vers cette neutralité. C’est une question à la fois sensible et importante. Gilles Le Borgne vous a expliqué qu’une nouvelle norme d’émission entraînait à peu près un milliard d’euros de dépenses, et qu’il était difficile pour nous de nous adapter sans conséquence à des changements plus fréquents qu’une nouvelle norme tous les cinq ans.
(Mme Marie-Jo Zimmermann remplace Mme Sophie Rohfritsch à la présidence.)
En cinq ans, on est capable, par notre agilité et notre dialogue interne, de converger vers cette nouvelle norme en adaptant l’entreprise. C’est d’ailleurs notre travail. Nous devons adapter en permanence notre entreprise aux changements des milieux dans lesquels nous opérons.
En revanche, si l’on demande à l’entreprise de s’adapter plus rapidement, on génère une succession de coûts qui risquent de porter atteinte à notre capacité d’investissement dans d’autres domaines. Par exemple, une fréquence excessive sur les normes d’émission peut se traduire par notre incapacité à investir sur le véhicule autonome, sur la connectivité ou sur des services de mobilité puisque la capacité d’investissement de l’entreprise est par définition contrainte. Cela peut nous conduire à des problèmes technologiques si on n’est pas capable de suivre de manière efficace les requêtes qui nous sont faites en matière d’amélioration des émissions.
Voilà pourquoi la convergence vers la neutralité nécessite une certaine progressivité. Nous sommes capables de suivre la progressivité qui a été jusqu’à présent décidée par les élus. Mais nous devons faire attention. En effet, la convergence vers un mix essence/diesel nettement différent – et notamment l’impact que cela peut avoir sur la partie « B to B », c’est-à-dire la vente aux flottes – est quelque chose d’extrêmement quantique. Je veux dire par là que si l’on va trop rapidement vers cette convergence, et que brutalement, les flottes d’entreprise basculent d’un côté à l’autre, 50 % du marché basculera brutalement. Du point de vue de l’industrie, nous ne serions pas capables de suivre. Par ailleurs, si on basculait rapidement, on dégraderait la rentabilité de l’entreprise dans la mesure où, aujourd’hui, les marges des véhicules diesel sont supérieures à celles des véhicules essence. Cela aurait évidemment un impact sur les marges, et donc sur la capacité d’investissement dans d’autres technologies.
Je voudrais que vous gardiez en tête ces ordres de grandeur : cinq ans entre deux normes successives ; et si possible, ensuite, dix-huit mois à deux ans pour l’extension de l’application à l'ensemble des modèles concernés par cette nouvelle norme.
M. Charles de Courson. En d’autres termes, deux ou trois centimes par an. Cela vous va, mais pas plus ?
M. Carlos Tavarès. Oui. Et pour moi, le véritable enjeu réside dans la fiscalité des flottes. C’est là que l’on peut faire beaucoup de dégâts, si l’on va trop vite.
M. Charles de Courson. Sur l’assujettissement à la TVA, vous souhaiteriez donc une progressivité ?
M. Carlos Tavarès. En tout cas, un dialogue qui nous permette de définir ensemble la vitesse à laquelle on va vers cette neutralité – puisqu’il n’y a pas de doute sur le fait que l’on va y aller. C’est cela qu’il faut que nous soyons capables de visualiser et de construire ensemble.
Mme la rapporteure. En fait, il s’agit de rendre éligibles à la même déduction de TVA d’autres motorisations. Dans ces conditions, s’agissant des véhicules d’entreprise, ne pensez-vous pas que, pour un segment non négligeable du marché, le choix se portera vers le carburant qui consomme le moins ?
M. Carlos Tavarès. Sur un plan général, vous avez raison. Il faudrait que l’on discute avec quelques grands clients de flottes. Ceux-ci raisonnent en effet en coût total d’utilisation du véhicule au km. Donc, si l’on arrive à préserver un coût total d’utilisation au km qui permette une évolution progressive, pourquoi pas ? Mais il faut que l’on s’entende bien sur le critère que l’on va utiliser pour piloter cette évolution.
En tout cas, comme je l’ai dit tout à l’heure, PSA se positionne comme un apporteur de solutions. Je pense qu’il est de l’intérêt des sociétés – des citoyens – de s’exprimer sur des résultats à atteindre, plutôt que sur des choix de technologies. En effet, si vous vous exprimez sur des résultats à atteindre, vous bénéficierez de toute la puissance d’ingénierie de tous les constructeurs du monde qui chercheront des solutions performantes pour atteindre ces résultats au meilleur coût pour le consommateur. En revanche, si l’on impose une technologie, les constructeurs concentreront leur travail sur cette seule technologie, éventuellement au détriment d’autres solutions plus performantes pour le consommateur et le citoyen.
Cela étant dit, on s’inscrit dans cette évolution. On souhaite simplement pouvoir piloter avec vous la vitesse à laquelle on converge, pour qu’il n’y ait pas d’impact industriel, et donc forcément social, pour notre pays.
Vous m’avez également interrogé sur les carburants. Je rappelle que l’importance du diesel en Europe est une particularité que l’on ne retrouve pas dans le reste du monde, qui utilise essentiellement de l’essence. Et si nous sommes dans cette situation-là, c’est parce que nous avons piloté, par le système fiscal, ce que nous voulions.
Vous m’avez interpellé sur la pression fiscale, qui est un très bon sujet. Aujourd’hui, deux effets de ciseau se cumulent.
D’abord, le pouvoir d’achat de nos consommateurs – je vais raisonner au niveau européen – ne s’accroissant pas ou s’accroissant de manière marginale, la pression sur le pouvoir d’achat est très forte. Concrètement, les clients ne sont pas prêts à payer plus cher les automobiles qu’ils veulent acheter.
Ensuite, la pression sur les coûts, qui est la conséquence des réglementations est elle-même extrêmement forte – à raison de plusieurs centaines d’euros par an. Quand on les regarde une par une, ces réglementations sont censées, raisonnables et souhaitables. Mais leur accumulation génère une inflation sur les coûts.
La pression sur les prix, l’ouverture du marché européen qui reste beaucoup plus ouvert que tous les autres marchés au monde et qui renforce la pression sur les coûts, et l’inflation des coûts qui est la conséquence de l’accumulation des réglementations aboutissent à une réduction des marges des entreprises qui pèse sur leur capacité d’investissement, ce qui constitue évidemment un problème.
Si l’on veut protéger notre capacité d’investissement pour préparer l’avenir au travers de marges qui nous garantissent un flux de trésorerie positif, il faut évidemment être capable de générer de la productivité. La productivité, c’est ce qui nous permet de faire plus avec moins, et donc de contrecarrer cet effet de ciseau entre la pression sur les prix et l’inflation des coûts issue de l’accumulation des nouvelles réglementations.
Nous sommes arrivés à la conclusion que, tous métiers confondus, il fallait que l’entreprise puisse générer tous les ans pas moins de 5 % de productivité pour contrecarrer cet effet de ciseau. Donc, soit vous enlevez des coûts pour l’entreprise – des coûts de toute nature, y compris la pression fiscale ; soit vous nous mettez dans une situation où il faut que l’on génère 5 % de productivité par an dans tous les domaines.
Souvent, les médias me disent : « Monsieur Tavarès, vous sortez de la reconstruction économique de l’entreprise, vous avez fait « Back in the Race », les collaborateurs ont beaucoup travaillé et vous leur demandez encore des efforts ! » C’est parce que la réalité de l’industrie automobile fait que des efforts nous sont imposés par l’effet de productivité que je viens de vous décrire. D’ailleurs, dans cette industrie hyper compétitive, nous ne considérons pas le mot « effort » comme un gros mot. L’effort fait partie de notre travail, tout comme il fait partie de l’intérêt que nous avons au travail : produire des efforts pour atteindre des résultats. Ainsi, au sein du groupe PSA, nous produisons des efforts, nous travaillons en équipe, nous travaillons de manière collective pour faire gagner PSA et donner à l’entreprise un avenir plus prospère et plus visible.
Vous vous êtes exprimés à propos de la mobilité. Celle-ci va-t-elle peser énormément sur les besoins en capitaux ?
D’abord, soyez assurés que nous avons, avec « Push to Pass », les moyens de financer ce plan. Et nous avons les moyens de le financer, tout en conservant ce que nous appelons un free cash flow positif, c’est-à-dire un flux de trésorerie positif. Il n’est pas question de laisser l’entreprise replonger dans la dette.
En d’autres termes, nous allons piloter le niveau d’investissement, tout en préservant un free cash flow positif, qui se traduira par le fait que l’on ne va pas créer de dette. Et nous avons, par notre capacité à être productifs et à aller chercher de nouvelles manières d’être productifs, la capacité de transformer notre rentabilité en capacité d’investissement tout en protégeant un free cash flow positif.
Voilà pourquoi il est tellement important de gagner de l’argent, et si possible beaucoup d’argent. Quand on gagne de l’argent et que l’on fait du profit, on dégage de la capacité d’investissement pour préparer l’avenir, tout en protégeant un free cash flow positif qui ne génère pas de dettes supplémentaires, et on conserve à l’entreprise un équilibre économique particulièrement sain.
Vous m’avez aussi interrogé sur la transition énergétique, les moteurs à combustion interne et l’origine France.
Nous allons nous atteler très prochainement à l’accompagnement industriel de la transition énergétique. Vous l’avez entendu, nous allons développer l’électrification des groupes motopropulseurs, soit pour faire des véhicules hybrides rechargeables essence, soit pour développer la deuxième génération de véhicules électriques – les véhicules électriques à autonomie augmentée. Tout cela va se traduire par des nouvelles chaînes de traction et de nouveaux groupes motopropulseurs.
La question à laquelle nous allons nous atteler est la suivante : comment transformer nos sites industriels non pas uniquement en fabriquant des moteurs à combustion interne, mais aussi en fabriquant des composants de la chaîne de traction électrique ? Nous sommes en train d’y travailler. Nous ferons très prochainement quelques annonces dans ce domaine. Nous allons étudier la manière dont nous pouvons fabriquer en France des éléments de chaînes de traction électrique et des éléments de chaînes de traction hybride.
Tout à l’heure, vous avez évoqué, à juste titre, l’inquiétude. Dans notre pays, l’inquiétude est le premier sentiment qui jaillit dès le moment où une incertitude apparaît. Nous allons le gérer tout comme nous avons géré la reconstruction économique de l’entreprise, en disant : oui, il est normal que les fabrications de moteurs à combustion interne aillent decrescendo, tout simplement parce que le mix diesel baisse.
On voit bien que la pression économique sur les moteurs essence augmente parce les marges sur les diesels sont plus importantes que les marges sur l’essence. Et on voit bien que toute la société, française et européenne, nous oriente vers l’électrification. Donc, nous allons devoir remplacer les moteurs à combustion interne par des éléments de la chaîne de traction électrique ou hybride.
Nous allons le faire en utilisant, notamment, nos sites France. En effet, ces sites nous offrent la possibilité de faire appel à une accumulation d’expertise et à une éducation scientifique. Nous sommes en train d’y développer des process qui sont d’un bon niveau de compétitivité. Développant de nouvelles technologies, nous avons intérêt à maîtriser les process de fabrication de ces nouvelles technologies.
Nous avons la volonté d’utiliser nos sites France, en étant conscients que nous allons être confrontés à une difficulté, qui est la dynamique du changement. De fait, en tant que président du directoire, je me demande toujours si nous sommes en train d’avancer à une vitesse suffisante pour accompagner l’évolution du monde extérieur, mais une vitesse qui ne soit pas excessive pour pouvoir être digérée non seulement par mon entreprise, mais par le corps social dans lequel nous évoluons. C’est une ligne de crête : de temps en temps on glisse d’un côté, de temps en temps on glisse de l’autre, mais il faut continuer à courir, si possible tous ensemble, sur cette ligne de crête pour ne pas se retrouver dans la situation où nous étions en 2012, où nous nous sommes laissés dépasser par les évènements. L’exercice est évidemment délicat.
Maintenant, sommes-nous demandeurs d’incitations à des modifications du parc automobile ? Au risque de vous surprendre, je vous répondrai par la négative. Il y a deux raisons à cela. La première raison est que si elles augmentent les dépenses de l’État français, cela aura à un moment donné – pas immédiatement – des conséquences négatives sur les entreprises. Nous ne souhaitons donc pas contribuer à l’augmentation des dépenses de l’État français. La seconde raison est que, d’expérience, nous savons qu’une fois que l’on a mis ce subside dans le marché et qu’on le retire, les conséquences qui en résultent sur la destruction de valeur au niveau des prix de vente sont considérables. En effet, la tentation de nos commerçants est de continuer à donner aux clients, avec nos propres ressources commerciales, ce qui était précédemment donné par l’État français. Cela détruit les marges de l’entreprise. La rupture de ces incitations a donc un effet très pervers.
Ainsi, le groupe PSA n’est pas demandeur de ces incitations. Il est plutôt demandeur d’un travail collaboratif pour gérer les transitions à une vitesse qui, à la fois, satisfait les sociétés et nous permet de nous adapter. Ayant l’avantage de ne pas être un dinosaure énorme dans l’industrie automobile, nous possédons une agilité suffisante pour y parvenir.
Sur le mix essence/diesel, je comprends parfaitement l’inquiétude de nos collaborateurs. Ils voient les médias comme nous les voyons tous, et ils se disent que d’un jour à l’autre, nous pourrions nous trouver dans une impasse. Assez rapidement, nous allons donc les mettre dans cette perspective de la transition énergétique, et leur indiquer, notamment, comment on affectera, sur les sites France, un certain nombre des composants de la chaîne de traction électrique.
Cela nécessitera que l’on développe de nouvelles compétences. Cela nécessitera également, comme nous l’avons fait sur l’usine de Rennes, que l’on se lance, avec un état d’esprit ouvert, dans de nouvelles fabrications. Ainsi, à Rennes, nous avons commencé à fabriquer, avec notre partenaire Bolloré, des véhicules électriques. Bien sûr, nous avons dû essuyer les quolibets de ceux qui ont critiqué la faiblesse des volumes produits. Mais il faut commencer par apprendre la technologie et les nouveaux process avant de songer à se développer. À l’inverse, on nous critiquerait tout autant si on ne développait pas en France les nouvelles technologies de demain. Commençons donc par le début. C’est la raison pour laquelle je compte sur votre soutien pour gérer cette transition.
J’en viens aux questions. Est-ce que « Push to Pass » est le plan qui doit libérer l’énergie et le plein potentiel du groupe PSA ? Oui, trois fois oui. C’est bien le but de ce plan.
J’avoue que je ne connaissais pas le cas de Taïwan. Je m’en excuse auprès de vous et je vais m’empresser de l’étudier.
Est-ce que la vraie révolution est celle du véhicule connecté et du véhicule autonome ? Dans tous les cas, sur le véhicule autonome, je vous assure que l’on fera ce qu’il faut pour rester dans le peloton de tête, comme nous le sommes aujourd’hui. Car nous n’avons pas fini de tout découvrir.
J’ajoute que nous ne partageons pas, avec tout le respect que nous avons pour cette entreprise, le point de vue de Google selon lequel il faudrait passer « one shot », directement, au véhicule totalement autonome. C’est une question de sécurité. La technologie est extrêmement complexe et pointue, et l’on ne peut pas passer de zéro à 100 % d’autonomie sans avoir consolidé les étapes intermédiaires de l’assistance à la conduite, qui permettent de garantir à tout instant au consommateur une sécurité absolue dans l’usage du véhicule. Nous préférons y aller suivant un road map que vous connaissez sûrement déjà : 2016, 2018, 2021. Nous prévoyons trois étapes d’assistance progressive à la conduite pour arriver à ce niveau.
Monsieur Barbier, est-ce que le temps d’utilisation du véhicule est inférieur à 15 % ? Selon les start-up californiennes qui font de l’auto-partage, il ne dépasserait pas 5 %.
Mme la rapporteure. 1,5 % !
M. Carlos Tavarès. En tout cas très peu…
Mais est-ce que cela signifie que l’on va fabriquer beaucoup moins d’automobiles ? Je ne suis pas devin, mais j’observe que nos enfants ont des besoins exponentiels de mobilité ; ils voyagent beaucoup et se déplacent beaucoup plus que moi-même à leur âge. Si les besoins de mobilité sont exponentiels et si les objets de mobilité venaient à être majoritairement utilisés en auto-partage, leur usage sera également beaucoup plus intense. Si cet usage est beaucoup plus intense, le nombre de km parcourus sera lui aussi bien plus élevé. À partir d’un tel raisonnement, il n’est pas dit que l’on aura moins d’objets de mobilité à construire.
En revanche, il faudra que l’on soit capable de concevoir et de construire des objets de mobilité sans propriété qui soient parfaitement adaptés aux véhicules en autopartage. D’où l’importance de la synergie dont je vous ai parlé tout à l’heure : entre le constructeur automobile et le fournisseur de mobilité, qui doit imaginer l’objet de mobilité qui va répondre aux besoins.
On assistera probablement à une divergence : les véhicules en propriété seront plus sophistiqués, et technologiquement très complexes, sans doute plus élitistes ; et les objets de mobilité en partage devront s’adapter à un mode d’usage du véhicule, qui sera probablement différent.
Je ne suis pas négatif par rapport à cette évolution. Je pense simplement que l’on n'a pas tout vu et qu’il va falloir, là encore, s’adapter progressivement. En tout état de cause, l’éventuelle généralisation du véhicule autonome se fera à un horizon de vingt-cinq ans, pas avant. Donc, une entreprise comme PSA, qui se veut agile, aura le temps de s’adapter. Nous allons donc faire en sorte, dès maintenant, d’être dans le peloton de tête du développement des véhicules autonomes.
Enfin, vous avez été plusieurs à parler des vélos électriques. C’est un sujet sur lequel je vais devoir me pencher. Je pense notamment à Peugeot Scooters. Comme vous l’avez mentionné, nous sommes dans un partenariat stratégique avec Mahinra. Il se trouve que les problèmes fondamentaux que Peugeot Scooters a connus pendant dix ans ne sont pas encore totalement résolus, et que l’on va devoir y apporter une attention accrue, ne serait-ce que pour savoir s’il ne faut pas envisager le « Back in the Race » de Peugeot Scooters. Peut-être cela n’a-t-il pas encore été imaginé avec notre partenaire Mahinra.
Mme la rapporteure. Monsieur le président, vous n’avez pas répondu à toutes les questions. Certaines d’entre elles me paraissent pourtant importantes : l’apport de l’État actionnaire et de DongFeng ? Les investissements sont-ils liés, ou non, au contrat social ? Où en est le programme d’investissement lié à « Push to Pass » ?
M. Carlos Tavarès. Les investissements ne constituent pas pour nous un sujet. Nous aurons les moyens de financer notre plan, et l’accent que nous mettons sur les investissements est lié à l’efficience de ces mêmes investissements.
Je voudrais partager avec vous une idée surprenante : il y a le bon investissement et le mauvais investissement. Lorsque nous sommes en train de travailler avec un site industriel sur l’affectation d’un futur véhicule, et que nous imaginons le modèle d’affaires et la rentabilité de ce projet, nous prenons en compte : le coût d’achat des pièces, le coût de fabrication du véhicule dans l’usine terminale, le coût de la transmission et du moteur, ainsi de suite, les moyens commerciaux à mettre en œuvre pour distribuer la voiture, le ticket d’entrée, etc. On voit s’il faut y aller ou pas, et quel est le meilleur site pour fabriquer ce véhicule.
Dans le coût de fabrication d’un véhicule, intervient tout ce qui résulte de l’utilisation des matières premières et des ressources humaines, ainsi que l’amortissement. L’amortissement compte évidemment dans le coût total de fabrication de la voiture. Si au cours des dix années précédentes, on a fait preuve d’exagération en matière d’investissements et qu’on plombe le coût de fabrication d’une usine avec un excès d’amortissement, on est en train de condamner sa capacité à se présenter de manière compétitive à la prochaine affectation véhicule.
Je pourrais vous faire une longue liste de ce que je considère comme étant des excès d’investissement commis dans le passé par mon entreprise. Je ne le ferai pas, mais je tiens à dire que c’est le juste investissement, dans la bonne capacité et la bonne technologie, qui est utile pour concilier à la fois la compétitivité des coûts de cette usine et sa capacité à mettre en œuvre les process de l’avenir. Cela suppose une appréciation pointue des process.
En d’autres termes, il faut faire attention à ne pas raisonner uniquement sur le montant de l’investissement, mais sur le montant juste nécessaire pour être compétitif lorsqu’il faudra à la fois fabriquer une voiture avec une nouvelle technologie, et être compétitif par rapport aux autres sites industriels.
Nous allons faire en sorte que l’équilibre entre la rentabilité de l’entreprise et les besoins de financements soit tel que l’on n’ait pas besoin de s’endetter et qu’on soit, dans le même temps, capables de financer le plan. Avec les 4 % de valeur plancher de notre marge opérationnelle, nous n’aurons pas de problème de financement. Mais nous resterons très attentifs au rendement de l’argent dépensé.
C’est un grand changement. De fait, dans le passé, on se disait qu’on ne pouvait pas financer l’avenir parce que l’on perdait de l’argent. Car à chaque fois que l’on augmentait l’investissement, on aggravait la dette. Et à chaque fois que l’on aggravait la dette, on entraînait l’entreprise dans une spirale négative. Cela est désormais derrière nous : nous sommes rentables, nous avons un free cash flow positif, donc nous générons de l’investissement.
Je terminerai sur la question du partage de la réussite de l’entreprise, qui est une question de dimension sociétale. C’est avec nos partenaires sociaux un sujet apaisé. Je peux partager avec vous, sans citer personne, le fait qu’ils ont été tous en soutien et chagrinés de ce qui s’est passé il y a quelques semaines à propos de ma rémunération. J’ai d’ailleurs apprécié que le président du conseil de surveillance soit monté au créneau – et Dieu sait si Louis Gallois a autorité et crédibilité dans notre Nation – pour expliquer que, finalement, l’évolution de mon salaire n’était que la conséquence de l’évolution des résultats de l’entreprise. Je précise que quand j’ai pris le risque d’aller chez PSA alors que l’entreprise était en grande difficulté, personne ne m’a mis en garde devant le fait qu’une part très importante de mon salaire varierait en fonction des résultats de l’entreprise, et que si j’échouais, ce serait pour moi une très mauvaise affaire.
C’est une raison assez simple qui m’a conduit à prendre la décision d’aller malgré tout chez PSA. Je n’ai pas la nationalité française, je suis d’éducation française, et j’ai voulu rembourser une dette que j’ai envers la France : le fait d’avoir été boursier de l’État français à un moment critique de ma vie où, probablement, mes parents n’auraient probablement pas pu subvenir à mon éducation. C’était il y a trente ans, je ne l’ai pas oublié et j’ai donc accepté d’aller chez PSA, de tenter de redresser l’entreprise et de rendre à la France son plus gros constructeur automobile.
M. Yves Albarello. Bravo!
M. Carlos Tavarès. J’observe que c’est le conseil de surveillance qui fixe les objectifs de Carlos Tavarès et qui évalue les résultats ; la dimension sociétale de cette question me dépasse. Je pense d’ailleurs que le fait que nous n’arrivions pas à nous débarrasser de ce genre de discussion est un problème pour la France, s’agissant de sa capacité à s’inscrire dans la dynamique du monde. Mais c’est un autre sujet…
Quoi qu’il en soit, la gouvernance de PSA est très rigoureuse. L’assemblée générale des actionnaires a approuvé ma rémunération à hauteur de 76 %, bien que l’État français ait voté contre – je ne trahis aucun secret puisqu’il l’a dit publiquement. Malgré cela qui a ramené la base de vote probablement vers 80 %, 76 % des actionnaires se sont prononcés en faveur de ma rémunération.
J’ai pris un risque personnel que j’assume. Je suis heureux de travailler chez PSA, qui est une grande et belle entreprise. Je pense qu’elle a un énorme potentiel et qu’elle peut encore progresser. Comme je l’ai dit, je me considère comme un joueur de football ou comme un pilote de Formule 1, pour lesquels y a un marché. Je suis payé le tiers ou la moitié de mes pairs. Ce sont des faits qui ne sont pas audibles, et j’en ai pleine conscience. Mais c’est la réalité de notre monde. Peut-être, comme chacun d’entre vous, individuellement, je n’ai pas la capacité ni forcément la volonté de changer le monde, car je suis un parmi de nombreux milliards.
Voilà la réponse que je peux vous faire, madame Batho.
Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente. Merci beaucoup, monsieur le président pour votre intervention et pour votre conclusion, qui était très positive.
La séance est levée à douze heures vingt-cinq.
◊
◊ ◊
43. Audition, ouverte à la presse, de M. Christian Eckert, secrétaire d’État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics.
(Séance du mercredi 21 septembre 2016)
La séance est ouverte à onze heures trente.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Mes chers collègues, nous recevons ce matin M. Christian Eckert, secrétaire d’État au budget.
Il était impossible, monsieur le ministre, de conclure nos travaux sans vous avoir entendu sur un sujet clé : celui de la fiscalité des carburants, avec en premier lieu la question du rattrapage progressif des niveaux de taxation entre le diesel et l’essence.
Je rappelle que la fiscalité des carburants est composée de trois éléments majeurs : la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), qui a succédé à la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) ; la TVA dont la récupération sur le diesel ou le superéthanol E 85 est permise à 100 % pour les véhicules utilitaires et à 80 % pour les véhicules particuliers des sociétés et la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).
Depuis 2014, la TICPE intègre une composante carbone progressive et proportionnée aux émissions de CO2 des produits énergétiques.
À cet égard, on rappellera que les véhicules diesel sont moins émetteurs de CO2 que les véhicules essence, l’intégralité des auditions que nous avons conduites l’a confirmé, même si l’on doit mentionner qu’ils sont émetteurs d’autres polluants et notamment les oxydes d’azote (NOx).
Au moment où l’on peut penser que les arbitrages relatifs à la loi de finances pour 2017 ont tous été arrêtés, il paraît essentiel de connaître les termes du rééquilibrage à venir de la fiscalité entre l’essence et le diesel. Le principe de ce rééquilibrage est acté depuis la loi de finances rectificatives pour 2015.
Sur quel rythme, monsieur le ministre, ce rattrapage va-t-il être poursuivi ?
Il est juste de rappeler que sur la problématique générale de la fiscalité des carburants tous les gouvernements successifs ont en quelque sorte « navigué à vue ».
En 1998, le gouvernement de Lionel Jospin avait déjà laissé entrevoir un rééquilibrage de la taxation entre le diesel et l’essence, objectif qui avait d’ailleurs été abandonné.
On évoquera également un autre sujet sensible : celui de l’éventuelle ouverture du droit à une récupération, même partielle, de la TVA sur l’essence concernant les véhicules utilitaires ou professionnels.
Une tentative parlementaire en ce sens a été amorcée l’année dernière ; elle n’a pas reçu l’aval du Gouvernement.
La question reste pourtant entièrement posée. Car cette voie serait peut-être propice à l’accélération d’un renouvellement du parc : certains pensent qu’une telle mesure aurait pour effet de susciter des achats de véhicules essence de nouvelle génération donc moins polluants.
N’oublions pas que le marché français du véhicule neuf se caractérise désormais par un taux d’achats par des professionnels voisin de 50 %.
Il est évident que les considérations fiscales sont de puissants leviers pour rééquilibrer le parc automobile français que l’on présente, à tort ou à raison, comme « surdiésélisé ».
Monsieur le ministre, nous allons vous écouter attentivement au titre d’un exposé liminaire, puis les membres de la mission d’information, avec en premier lieu Delphine Batho, notre rapporteure, vous interrogeront à leur tour.
M. Christian Eckert, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics. Je souhaiterais tout d’abord réagir à quelques-unes des allusions contenues dans votre propos liminaire.
En premier lieu, les arbitrages relatifs aux textes financiers devant être présentés en fin d’année sont assez largement arrêtés, bien qu’un certain nombre de sujets demeurent ouverts pour la loi de finances rectificative. J’imagine que le Parlement apportera sa pierre à l’édifice, notamment sur les sujets que vous avez évoqués.
En second lieu, et je réagis au terme quelque peu provocateur que vous avez utilisé : en patois lorrain, on dirait que vous avez « chtiplé » ; peut-être le dit-on aussi en alsacien, madame Zimmerman…
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Cette expression n’existe pas en Alsace, on n’y « chtiple » jamais… (Sourires.)
M. le secrétaire d’État. Pardonnez-moi ce clin d’œil régional…
Vous avez évoqué une « navigation à vue » ; au cours des dernières années, nous avons donné beaucoup plus de visibilité, notamment à la trajectoire de la contribution climat-énergie (CCE), communément appelée « taxe carbone », mais aussi à la question du rapprochement diesel-essence. Certes, il est toujours possible d’aller plus loin dans la visibilité, il n’empêche que nous avons posé des jalons importants sur lesquels je reviendrai.
Enfin, vous avez utilisé le terme de « progressivité ». Je donnerai un point de vue plus personnel, bien qu’assez largement partagé au sein du Gouvernement : l’idée de progressivité est importante car, si les enjeux environnementaux et économiques ne connaissent pas nécessairement la même échelle de temps — sujet qui pourrait nourrir de longs débats —, ils n’en nécessitent pas moins de la prévisibilité, mais aussi de la progressivité.
Cependant, avant d’en venir directement à la question de la fiscalité qui s’applique spécifiquement à la construction automobile, je souhaiterais brosser un panorama rapide de la fiscalité environnementale, sur laquelle nous avons beaucoup progressé depuis 2012.
La grande avancée, vous le savez, a été la contribution climat-énergie.
Alors que le précédent gouvernement avait échoué à mettre en place une taxe carbone, nous sommes parvenus, avec le Parlement, à prendre en compte le coût du carbone dans la consommation des énergies. Cette réforme a introduit une évolution des tarifs des trois taxes intérieures de consommation sur les énergies fossiles : la TICPE, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) et la taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et cokes (TICC), en prenant en compte, pour chaque produit énergétique, ses émissions en carbone selon une trajectoire intégrant une valeur de la tonne de carbone. Cette trajectoire est connue, elle a été votée : 7 euros par tonne en 2014, 14,5 euros par tonne en 2015, 22 euros en 2016. Elle sera de 30,5 euros l’année prochaine.
À travers la valeur du carbone, c’est au réchauffement climatique plus directement qu’à la qualité de l’air que la CCE a donné un prix. C’est une trajectoire ambitieuse. Elle suppose d’accepter que les automobilistes supportent, chaque premier janvier, une hausse de fiscalité de 2 centimes d’euro le litre pour l’essence, et de 2,5 centimes d’euro le litre pour le gazole. Ce qui contribue au rapprochement de la fiscalité entre les deux types de carburants.
Comme vous le savez, les recettes de la contribution climat-énergie permettent de financer les dépenses de transition énergétique. Depuis le 1er janvier 2016, un compte d’affectation spéciale dédié au sein du budget de l’État finance, grâce aux produits de la fiscalité énergétique, les avantages de tarif pour l’achat d’énergie renouvelable, pour un total de dépenses de l’ordre de 5 milliards d’euros par an. Cette réforme très structurante a été adoptée l’an dernier dans nos textes financiers.
L’autre réforme est celle qui a été votée contre la pollution de l’air pour engager la convergence progressive entre l’essence et le diesel. En 2015 demeurait un écart de taxation de 15,59 centimes d’euro par litre en faveur du diesel, ayant contribué à la « diésélisation » du parc automobile français. Avec le mouvement de « +1/–1 » que nous avons fait adopter pour 2016 et pour 2017, nous amorçons un mouvement de convergence en six à sept ans. Ce qui s’intègre dans le cadre de la progressivité que j’ai précédemment évoquée. Nous avons estimé que ce signal était important pour nos industries dans la perspective d’une « dédiéselisation » du parc en France.
Se pose désormais, comme vous le savez, la question de la déductibilité de la TVA sur l’essence, qui sera certainement débattue au cours de l’automne. Le Gouvernement aura alors l’occasion d’indiquer dans quelle ampleur et à quel rythme il souhaite suivre les propositions qui ne manqueront pas de survenir à l’occasion de la discussion des textes budgétaires. En tout état de cause, il me semble que ce mouvement devra être pris en compte, et nous définirons le cadre de cette progressivité nécessaire pour laisser à chacun le temps de s’adapter. Ce sont bien les possesseurs d’anciens véhicules qui n’ont pas la possibilité d’en changer, ainsi que les industriels, qui sont les plus directement concernés ; c’est pourquoi il est essentiel de trouver le bon équilibre.
Dans le même temps, nous avons voulu encourager les biocarburants, en différenciant la fiscalité applicable au E 5 qui intègre moins de 5% de bioéthanol et le E l0 qui en intègre jusqu’à 10 %. Encourager les biocarburants, c’est réduire les émissions et utiliser une énergie renouvelable. C’était le deuxième « +1/–1 » – au sein des essences, cette fois –, qui a été adopté en loi de finances rectificative. Les émissions polluantes sont par ailleurs soumises à la taxe générale sur les activités polluantes. Dix-huit substances y sont assujetties aujourd’hui, dont douze depuis 2013. Il s’agit d’une véritable imposition incitative, internalisant dans le coût privé des entreprises le coût social de la pollution de l’air.
Dans le domaine de la mobilité ensuite, outre le soutien au développement des infrastructures de transport collectif, qui contribue en longue période à la réduction des émissions de CO2, l’État intervient directement pour favoriser l’acquisition de véhicules propres au travers du dispositif de bonus-malus automobile, financé par un compte d’affectation spéciale dédié, pour un total d’environ 300 millions d’euros par an. Cet outil, initialement ciblé sur la pollution au CO2, a été complété en 2015 par un volet de lutte contre les particules fines, à travers une prime en faveur de la conversion des vieux véhicules diesel en véhicules propres. Cette prime, qui permet de bénéficier d’une aide totale de 10 000 euros pour l’acquisition d’un véhicule électrique, est reconduite pour toute l’année 2016 et le sera à nouveau en 2017 ; elle s’applique désormais aux vieux véhicules dès dix ans d’âge et non plus quinze ans.
À l’inverse, les véhicules polluants sont soumis au malus automobile, qui est une taxe assise sur le nombre de grammes de CO2 émis par kilomètre, ainsi qu’à la taxe additionnelle sur les certificats d’immatriculation reposant sur un barème par gramme de CO2 croissant selon les émissions du véhicule par kilomètre. Elle est due lors des renouvellements de certificats, donc lors des achats d’occasion. Le malus annuel ou à la taxe sur les véhicules de société tient également compte des émissions de polluants.
Ce dispositif de bonus-malus va évoluer en 2017 tout en conservant sa logique d’ensemble. Le bonus sera recentré sur les véhicules électriques qui en constituent le cœur de cible, ce qui signifie que le bonus pour les véhicules hybrides, qui avait progressivement diminué, sera éteint au 1er janvier 2017. Le bonus sera par ailleurs complété par un volet « deux-roues », dont les contours restent encore à affiner. Le barème du malus sera quant à lui revu, à la fois pour assurer l’équilibre financier du dispositif, qui est dans sa nature même, mais aussi pour aller plus loin dans l’objectif de mutation du parc automobile. Son rendement prévisionnel sera de l’ordre de 350 millions d’euros, soit le même que celui constaté en 2014 après la dernière réforme du malus. Le barème sera par ailleurs lissé pour plus de cohérence, en passant d’un malus par tranche de 5 grammes d’émission de CO2 à un malus par gramme d’émission de CO2. L’ensemble de ces éléments sera détaillé dans le projet de loi de finances qui sera présenté la semaine prochaine en conseil des ministres, puis, à midi, à votre commission des finances.
Enfin, je rappelle qu’il existe quatre taxes spécifiques, tenant compte des émissions de CO2 : le malus automobile, la taxe additionnelle sur les certificats d’immatriculation, le malus annuel, qui est une taxe annuelle sur la détention des véhicules les plus polluants, la taxe sur les véhicules de société, prévue à l’article 1010 du code général des impôts (CGI), qui comporte une part dépendant des émissions de CO2, et rapporte 750 millions d’euros.
Je vous propose maintenant de répondre à vos questions, dont certaines m’ont courtoisement été communiquées.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Merci, monsieur le ministre, pour ces informations, particulièrement pour la communication d’un certain nombre d’arbitrages arrêtés par le Gouvernement au sujet du bonus-malus dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017.
S’agissant de la convergence entre l’essence et le diesel, vous avez rappelé qu’elle était engagée, et devait s’étaler sur six ou sept ans : ce comput commence-t-il à l’année 2015 ?
En termes de recettes fiscales, le rendement de cette convergence ne fait pas l’objet d’un compte d’affectation spécial : vers quoi a-t-il été orienté ? On se souvient que, la première année, il avait pour partie compensé l’abandon de la taxe carbone ?
Ainsi que vous l’avez implicitement souligné, nous sommes confrontés au fléau de la pollution urbaine. Toutefois, les usagers ayant le plus besoin de leur véhicule au quotidien résident dans les territoires ruraux ; il y a là une source d’inégalités sociales et territoriales. De ce fait, tous les Français ne sont pas également exposés à la hausse de cette fiscalité sur le diesel. Dès lors, considérez-vous que des contreparties devraient être apportées ?
Mon interrogation porte particulièrement sur la façon dont la suite de la convergence entre l’essence et le diesel se répercutera ou non sur le barème kilométrique.
Le point de départ des travaux de notre mission d’information a été le scandale Volkswagen, même si les NOx étaient plus concernés que le CO2, je souhaite vous poser une question de principe. Si, à l’avenir, des informations sur lesquelles l’État se serait fondé pour l’attribution de bonus à certaines catégories de véhicules se révélaient fausses, l’État est-il aujourd’hui juridiquement et techniquement en mesure d’exiger le remboursement de ces bonus ? Le sujet me paraît très important au regard de l’effort fourni par les pouvoirs publics en faveur du déploiement de véhicules plus propres.
Par ailleurs, je souhaiterais savoir sur quels critères de performance écologique se base l’extinction de l’attribution du bonus aux véhicules hybrides. Les travaux conduits par notre mission d’information ont mis en évidence la tendance de fond à la généralisation de diverses formes d’hybridation ; une étude d’impact a-t-elle été menée à ce sujet ?
Certes, le véhicule « zéro émissions » et le véhicule électrique doivent être encouragés, mais le fait que chaque année les règles du jeu du bonus-malus changent n’est-il pas déstabilisant au point de vue industriel ? L’importance des signaux — les drivers en anglais — donnés par les pouvoirs publics ne saurait être méconnue.
M. le secrétaire d’État. S’agissant de l’affectation des produits de mouvements de fiscalité, notamment le « +1/–1 », celui-ci est de l’ordre de 250 à 300 millions d’euros par an. Dans la mesure où les véhicules diesel sont plus nombreux que les véhicules à essence, augmenter la fiscalité pesant sur le diesel tout en diminuant celle qui pèse sur l’essence produit du rendement aussi longtemps que les premiers demeurent majoritaires.
À l’occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 2016, et le Gouvernement l’avait clairement indiqué, nous avions adopté cette disposition — qui, certes n’a rien à voir, mais l’exercice budgétaire consiste en la présentation d’un équilibre global — qui finançait la mesure de retour à l’exonération d’impôts locaux d’un certain nombre de contribuables de condition modeste. Le public visé, que certains appellent les « petits vieux », représentait les contribuables exonérés jusqu’alors, et qui ne l’étaient plus du fait de l’augmentation du revenu fiscal de référence dû à l’inclusion dans l’assiette de prélèvement de la demi-part des veuves, les majorations de pensions notamment.
Encore une fois, il s’agissait de garantir l’équilibre du budget entre le moment de sa présentation et son état après le débat au Parlement.
Le Gouvernement entend conserver ce rythme de « +1/–1 » par an, sachant que la progression de la contribution climat-énergie représente un demi-centime de rapprochement.
L’inégalité existant entre le secteur urbain et le secteur rural a fait l’objet de bien des débats et a constitué, pour des raisons d’ordre constitutionnel, la principale source de difficulté pour les gouvernements précédents dans la mise en place de la taxe carbone.
Il me semble qu’il convient d’éviter les questions trop complexes ; certains de nos dispositifs fiscaux le sont déjà, d’aucuns disent qu’ils le sont trop. Aussi établir des distinctions entre secteur rural, secteur de montagne, secteur urbain, tout en voulant prendre en compte les situations locales des transports collectifs ne pourrait que nous conduire à des difficultés de mise en œuvre incommensurables. De fait, le secteur de montagne connaît une situation bien particulière, et ce type de dispositions ne manque jamais de connaître des zones intermédiaires. Le Parlement se déterminera, mais je ne souhaite pas m’engager dans des distinguos dont l’application comporterait trop de difficultés.
Notre administration étudie de près la question du barème kilométrique ; le barème usuel est fondé sur le type de véhicule concerné. Les contribuables n’optant pas pour ce barème kilométrique, des salariés ou certains professionnels, peuvent évaluer les frais de carburant d’après un barème « carburant » correspondant au prix réel.
Ce barème évolue chaque année en fonction de plusieurs paramètres, dont l’évolution de l’indice des prix à la consommation (IPC) et l’évolution des prix hors tabac. Pour mémoire, l’évolution du barème en fonction de l’évolution des prix hors tabac a été retenue au cours de la campagne précédente : faut-il faire évoluer ce dispositif ? Le Parlement en débattra.
Les contribuables qui optent pour ce régime pourront donc effectivement obtenir une compensation partielle de l’augmentation du prix du diesel résultant de la hausse de ce carburant sous l’effet du rattrapage entre l’essence et le diesel si le premier, frais réels, ou le second barème est choisi. Seul le maintien du barème de l’année précédente ou le choix d’un renchérissement d’un élément extérieur n’entrant pas dans le calcul de l’indice retenu permettraient d’éviter cette compensation.
Dans la pratique, le nombre de personnes optant pour les frais réels est relativement stable sur les trois dernières campagnes : 5,7 millions pour les revenus 2015, 5,5 millions pour les revenus 2014, 5,5 millions pour les revenus 2013. Nous n’observons donc pas de rupture de tendance qui traduirait un contournement de la mise en œuvre de la contribution climat-énergie…
Mme la rapporteure. Tel n’était pas le sens de ma question …
M. le secrétaire d’État. Peut-être faudra-t-il que nous en reparlions. J’avais cru comprendre que l’évolution de la fiscalité, compte tenu du recours au barème kilométrique, pouvait donner lieu à contournement puisque le régime des frais réels permettait de déduire plus qu’auparavant.
Mme la rapporteure. La question portait plutôt sur la neutralisation quasi automatique, du fait de l’application du barème kilométrique, de l’incidence sur le pouvoir d’achat de la convergence entre l’essence et le diesel.
M. le secrétaire d’État. Il s’agit là d’un mécanisme d’assiette ; le taux d’imposition du revenu n’est heureusement pas de 100 % ; 95 % des contribuables sont imposés à un taux inférieur à 10 %, aussi l’impact de la mesure d’augmentation des frais réels n’est-il que de 10 %.
S’agissant de ce que l’on appelle le « scandale Volkswagen », qui concerne les constructeurs défaillants, vous n’ignorez pas qu’une enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est en cours.
Une fois ses conclusions connues, deux difficultés s’opposeront à un redressement des groupes automobiles concernés.
Le redevable légal des taxes est le propriétaire de la voiture, alors que le fautif est le constructeur ; or il est inconcevable de pénaliser un particulier du fait de la faute d’un fabricant. Par ailleurs, les documents pris en référence pour le calcul de ces taxes sont les documents initiaux fournis par le constructeur. Il faudrait alors virtuellement reconstituer les documents de départ, notamment le certificat d’immatriculation, ce qui sera difficile ; toutefois, cette question a déjà été étudiée.
L’intention du Gouvernement est d’engager une action en responsabilité et pour faute contre les fabricants, à raison du préjudice causé par le manque à gagner fiscal. Il n’y aura ni complaisance ni sévérité particulière, mais l’application d’un juste retour à la responsabilité des constructeurs. Cette action que nous envisageons doit rassurer les particuliers, j’ai lu tout ce qui s’est écrit à ce sujet, le préjudice ne porte pas que sur le bonus-malus, etc. : il porte aussi sur la revente rendue plus difficile de véhicules qui auraient été grevés par des documents non conformes à la réalité des faits.
Nos services juridiques, comme ceux d’autres ministères, conduisent une analyse juridique, et le Gouvernement a fermement l’intention d’engager ce type d’actions lorsque l’enquête de la DGCCRF sera achevée.
En réponse à votre question portant sur les bonus attribuables aux véhicules hybrides, j’indiquerai que nous souhaitons concentrer les aides publiques sur les véhicules les moins polluants que sont les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables. Le bonus significatif attribué aux véhicules hybrides rechargeables sera maintenu ; cette évolution est progressive, et ce bonus a diminué au cours des dernières années, il n’y aura donc pas de surprise, car cette tendance a été annoncée.
Mme Marie-Jo Zimmermann. J’ai noté, monsieur le ministre, que vous vous donniez cinq à sept ans pour réaliser la convergence entre l’essence et le diesel. Je vous suis par ailleurs reconnaissante d’avoir été attentif l’an dernier à nos préoccupations car, si certains constructeurs n’ont pas pleinement respecté les normes, d’autres ont fourni des efforts considérables ainsi qu’un extraordinaire travail de recherche. La compétitivité ainsi acquise dans le secteur du diesel était dès lors susceptible de nourrir des inquiétudes au regard d’une éventuelle convergence.
S’agissant de la dédiéselisation de notre parc automobile, pouvez-vous nous indiquer en combien d’années celle-ci est envisagée ?
Je rappelle que ce sont les pouvoirs publics qui avaient demandé aux constructeurs de fournir un effort extraordinaire, et ceux-ci ont adapté leurs outils de fabrication aux moteurs diesel. Or, aujourd’hui, on rétropédale pour parler de dédiéselisation. Aussi, souhaiterais-je obtenir quelques précisions, car les perspectives de cette reconversion semblent plus éloignées dans le temps. À cet égard, dans ma circonscription, la société PSA se livre à un travail considérable afin de changer ses outils de fabrication, car l’arrivée du moteur électrique lui ouvre de nouveaux horizons.
En résumé, que signifie concrètement le terme de dédiéselisation ? En combien d’années est-il prévu qu’elle soit conduite ? Est-ce vraiment la politique qui sera menée par les pouvoirs publics ?
On observe que, dans d’autres pays, les moteurs diesel sont des moteurs propres. Trop souvent, on raisonne sur des moteurs dont l’âge est très avancé, or les travaux de la mission d’information ont montré que les industriels ont recouru à des techniques permettant l’adaptation de ces moteurs. Une réflexion est-elle conduite à ce sujet afin de conduire le parc existant à son terme ?
Lorsque les travaux d’adaptation du parc automobile sont évoqués, l’accent est souvent mis sur les transports en commun car, le ferroutage mis à part, les transports comme les poids lourds et les autobus sont source d’une pollution au moins équivalente. Une réflexion est-elle conduite à ce sujet ?
Enfin, des recherches suffisantes sont-elles menées dans le domaine de l’hydrogène ainsi que sur d’autres carburants susceptibles, à terme, de compléter notre panoplie de véhicules ? En effet, des efforts restent à faire en matière de véhicules électriques, qui concernent les batteries, les freins et les pneus.
Etant donné qu’il n’existe pas de véhicules propres par définition, quelles sont vos perspectives s’agissant de l’évolution du parc automobile ?
M. Frédéric Barbier. Nous constatons effectivement l’impact de la fiscalité sur les moyens de transport ; la dédiéselisation ne s’est pas faite en un jour, et le cap de 50 % de véhicules à essence a été franchi : ils sont désormais majoritaires dans notre pays.
Ce que j’ai entendu aujourd’hui me convient, mais je rappelle que nos constructeurs, à l’époque, ont lourdement investi dans le diesel ; ils sont déjà engagés dans une autre démarche, aussi convient-il de leur laisser le temps nécessaire. Le site historique Peugeot-Citroën de Sochaux se trouve dans ma circonscription, et le véhicule hybride diesel-essence représente des emplois et des gens gagnant leur vie en fabriquant des véhicules. Il ne faudrait donc pas créer de situations difficiles aux industriels présents sur notre territoire, qu’il s’agisse de Renault, Citroën ou Peugeot.
Il conviendra donc d’adapter le rythme d’évolution de cette fiscalité, qui devra être rééquilibrée entre l’essence et le diesel.
Le centre industriel Peugeot Scooters, lui aussi implanté dans ma circonscription, a réalisé des progrès extraordinaires dans le secteur des véhicules deux-roues et trois-roues, tant dans le domaine de la sécurité que dans celui de la performance environnementale.
Dans la mesure où l’on soutient le véhicule hybride rechargeable et le véhicule électrique, pourquoi ne pas soutenir ce moyen de transport intéressant, susceptible de diminuer les embouteillages de façon conséquente, y compris sur les autoroutes, et répondant aux normes environnementales ? Il serait donc très intéressant de soutenir la filière du deux-roues et du trois-roues par un dispositif de bonus ; aussi souhaiterais-je connaître l’état d’avancement de votre réflexion sur ce sujet.
Au risque d’excéder le cadre de cette réunion, je souhaite évoquer le transport du fret : dans ma circonscription, comme Mme Zimmermann l’a évoqué, nous avons mis un terme à la taxation ainsi qu’à l’utilisation des portiques. Je suis surpris de constater, et cela vaut aussi à l’échelon européen, que, malgré les véhicules aujourd’hui connectés et les transports routiers traçables, nous ne sommes pas capables de facturer le vrai prix du transport par route. Ceci permettrait de rééquilibrer le poids du transport routier par rapport au transport ferroviaire. Avec ces moyens, nous pourrions assurer la traçabilité des transports routiers dans toute l’Europe, sujet qui concerne l’entreprise Alstom située très près de chez moi, et qui fait l’actualité aujourd’hui.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Je souhaiterais connaître la position du Gouvernement sur les nouveaux usages comme le véhicule sans conducteur. On sait qu’ils nécessitent une infrastructure adaptée : des routes relativement homogènes, des carrefours et, plus généralement, tout ce qui est propre au développement de ce type de moyens de transport afin que leurs performances nouvelles produisent tous les effets attendus sur l’environnement et le coût du transport.
M. le secrétaire d’État. Je vous remercie pour ces questions. Toutefois, je rappelle que vous avez devant vous le secrétaire d’État au budget, compétent sur les questions à caractère fiscal. Malgré ma formation scientifique poussée et mon enracinement dans une région, la Lorraine, qui concentre beaucoup de constructeurs automobiles ainsi qu’un important centre de recherches sur le stockage de l’hydrogène — un sujet qui, à titre personnel, me passionne —, je ne suis pas habilité à m’exprimer au nom du Gouvernement sur des sujets concernant le transport en général… Mme Royal, MM. Vidalies et Sirugue seraient plus à même que moi pour parler au nom du Gouvernement de ces questions lourdes de conséquences pour l’avenir.
J’ai évoqué la dédiéselisation ; beaucoup de nos industries sont conduites à connaître des mutations représentant le contraire de ce qu’on leur a demandé de faire il y a une ou plusieurs décennies. L’agriculture même est concernée par un questionnement sur son modèle de développement, comme l’a été la sidérurgie ; et il est vrai que l’industrie automobile a suivi une orientation impulsée par les pouvoirs publics.
J’ai rencontré des constructeurs automobiles, et les inflexions nouvelles, sous la réserve de leur mise en œuvre progressive, ne les conduisent pas à rejeter en bloc cette évolution. Cela a pu être le cas lorsque des évolutions plus brutales avaient été annoncées par les uns ou par les autres. Aujourd’hui, les choses se font dans la transparence et la concertation, selon un rythme prenant en compte les intérêts respectifs de chacun, et en observant les échelles de temps nécessaires aussi bien aux questions de pollution et de santé, qui sont évidemment essentielles, qu’aux questions économiques qui sont également importantes.
Le dialogue a eu lieu entre le Gouvernement et les constructeurs automobiles, qui ne semblent pas être alarmés par ce qui a été arrêté. C’est pourquoi nous souhaitons leur donner une certaine visibilité, à travers une fourchette temporelle qui, toutefois, devra prendre en compte les résultats des travaux parlementaires et les enseignements de la médecine. De fait, il n’est pas choquant que, à la lumière de l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre de la dédiéselisation et de ses conséquences, alors que nous disposons aujourd’hui du recul nécessaire sur le diesel, la communauté française prenne conscience de la nécessité de donner une impulsion inverse à celle qui avait lancé ce type de motorisation
– ce qui ne dispense pas d’observer les précautions que j’ai évoquées.
S’agissant des transports en commun, question qui, elle aussi, relève d’autres ministères, j’ai été amusé de lire dans un journal local que des élus reconnaissaient qu’il valait parfois mieux un autocar bien rempli qu’un train quasi vide. Ces élus, qui sont aussi animés par des préoccupations environnementales, admettent qu’il peut être préférable de recourir au transport par bus car, après tout, le train, à travers le matériel roulant et les infrastructures, produit aussi du carbone ; pour ma part, je demeure partisan de la multimodalité.
Par ailleurs, à titre personnel, je crois en l’avenir de l’hydrogène ; je connais la problématique du stockage de ce carburant ainsi que la nécessité de son développement comme de celui de l’énergie électrique qu’il induit. Cela permettrait de réguler l’utilisation des énergies renouvelables en stockant cette électricité par exemple, afin d’y recourir pour lisser les pics de production, quand bien même les véhicules à hydrogène sont aujourd’hui au stade expérimental.
Toutefois, il faudra peut-être, le cas échéant, réfléchir à la fiscalité, domaine qui constitue pour moi un sujet de réflexion quotidien ; bien qu’abondamment critiquée, la fiscalité produit une recette. L’exercice connaît toutefois ses limites : entre la fiscalité incitative, la fiscalité coercitive ou l’interdiction, il convient de tracer des frontières et d’être conscient que la fiscalité ne peut pas tout.
Il se trouve que je connais personnellement l’entreprise Peugeot Scooters, qui est désormais un peu moins Peugeot, car vendue récemment, et je sais, monsieur Barbier, que, comme nous tous, vous êtes attaché au maintien de sa production en France. Il est vrai que le scooter peut constituer une alternative intéressante, pour laquelle je répète que nous présenterons un certain nombre de dispositions ; ma collègue ministre chargée de l’environnement doit d’ailleurs recevoir le patron de cette entreprise dans les prochains jours. Nous ne serons probablement pas prêts pour présenter ces mesures dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017 ; en revanche nous serons en mesure de le faire en loi de finances rectificative.
S’agissant du fret ferroviaire, consistant à transporter des camions par le rail, les expériences tentées n’ont pas toujours été concluantes, les grandes lignes de fret mises en place entre le Nord-Est et le Sud-Ouest n’ayant pas fait la preuve de leur fécondité. Je crois beaucoup aux possibilités de ce mode de transport pour l’avenir, mais il nous appartient de pousser plus avant la réflexion.
Par ailleurs, madame la présidente, j’avoue n’avoir guère d’éléments à vous apporter au sujet du véhicule sans conducteur ; je pense que vous pourriez utilement interroger mes collègues. En tout état de cause, il n’existe pas aujourd’hui de dispositions fiscales attachées à ce type de véhicules.
Enfin, je n’ignore pas – je pense que Madame Batho va aborder le sujet – que certains s’interrogent sur la recherche en général, et plus particulièrement sur le crédit d’impôt recherche (CIR) ; j’imagine que nous aurons l’occasion d’y revenir.
Mme la rapporteure. S’agissant de la déductibilité de la TVA sur l’essence, vous avez laissé entendre, monsieur le ministre, que la mission d’information ferait certainement des propositions précises sur cette question.
Vous avez par ailleurs indiqué, et c’est important, que l’État aurait la possibilité d’engager une action en responsabilité pour faute contre les constructeurs automobiles. Pouvez-vous préciser si cette action envisagée est bien liée à la question de l’obtention du remboursement de bonus ayant été indument attribués ou si votre propos concernait le cas plus général de tromperie des consommateurs ? Le barème sur lequel l’établissement du bonus était jusqu’à présent établi reposant essentiellement sur un critère d’émission de CO2, sommes-nous outillés pour engager une action en responsabilité pour faute portant sur les émissions de NOx à l’encontre des fabricants ?
En outre, les perspectives d’un bonus attribué aux deux-roues ne manqueront pas de s’inscrire dans le contexte de la révolution, évoquée par Mme la présidente, que constituera l’avènement du véhicule autonome notamment. Nous serons alors conduits à nous interroger sur nos catégories, ce qui sera le cas pour la définition du deux-roues ; car les objets roulants excédant les législations et réglementations jusque-là appliquées seront toujours plus nombreux.
Tous les acteurs de la filière automobile entendus par la mission d’information ont considéré que le CIR était indispensable au maintien en France des centres de recherche et développement. Je rappelle que le secteur automobile représente le premier secteur de la recherche privée dans notre pays, alors qu’il n’est pas le premier bénéficiaire du CIR. Je n’ignore pas que ce dispositif a fait l’objet de nombreux travaux, et a France le défend d’ailleurs à Bruxelles afin qu’il ne soit pas considéré comme une aide d’État. Toutefois, ne serait-il pas possible que le CIR vienne soutenir encore plus les filières industrielles confrontées à de multiples révolutions simultanées cumulant les enjeux écologiques, l’avènement du big data et du numérique dans le secteur de l’automobile ainsi que le bouleversement des usages ? Ces perspectives appellent de fait un effort de recherche et développement sans précédent.
M. le secrétaire d’État. S’agissant de la déductibilité de la TVA, j’attends d’avoir connaissance de vos propositions, que nous confronterons avec celles du Gouvernement, mon idée dominante étant celle de la progressivité.
Par ailleurs, une fois les résultats de l’enquête conduite par la DGCCRF connus, nous avons l’intention d’engager une action en responsabilité pour faute en raison du manque à gagner fiscal, sans préjuger d’autres préjudices sur lesquels nous pourrions nous fonder.
En revanche, je ne partage pas votre point de vue sur le CIR qui, dans la mesure où il est universel et s’adresse indifféremment à toutes les entreprises, ne fait précisément pas l’objet de recours contentieux européens. Si nous souhaitions le limiter à certains secteurs industriels ou le renforcer pour d’autres, nous encourrions le risque d’un contentieux au titre des aides d’État. Aussi, quand bien même cette possibilité peut paraître séduisante sur un plan intellectuel, économique ou environnemental, ne souhaité-je pas que nous nous engagions dans cette voie.
Depuis quelques années, je me suis arc-bouté pour que l’on ne touche pas au crédit d’impôt recherche, singulièrement à son ciblage — et certains nous en font le reproche. D’aucuns considèrent que certaines entreprises éligibles n’en ont pas besoin ; d’autres souhaiteraient que son cumul avec le CICE ou d’autres dispositifs, tel le calcul par filiales ou par groupes, soit limité. À chaque lecture des lois de finances, à l’occasion de l’examen de chaque texte financier, des discussions s’engagent sur ce point.
Pour des raisons de lisibilité, de stabilité et de sécurisation juridique, particulièrement sur le plan européen, je souhaite que ce dispositif soit conservé en l’état, sans être modifié ni dans un sens limitatif ni dans le sens d’un renforcement au profit de certaines filières. Dans le cas contraire, il est probable que nous rencontrions des difficultés avec nos interlocuteurs.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Merci, monsieur le ministre, pour vos réponses.
La séance est levée à douze heures vingt-cinq.
44. Audition, ouverte à la presse, de M. Alain Vidalies, secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche, et de M. Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat.
(Séance du mercredi 21 septembre 2016)
La séance est ouverte à dix-sept heures cinq.
Mme la présidente Sophie Rohfritsch. Après avoir reçu ce matin M. Christian Eckert, secrétaire d’État au budget, nous accueillons à présent M. Alain Vidalies, secrétaire d’État chargé des transports. Ces deux auditions étaient indispensables alors que la mission d’information aborde la partie conclusive de ses travaux. Elles sont évidemment complémentaires : la partie « fiscalité » et la partie « environnementale » sont même indissociables lorsque l’on étudie la question de l’offre automobile.
Le scandale des logiciels truqueurs de Volkswagen a éclaté aux États-Unis sur un des marchés les moins « diéselisés » au monde. Il a au moins eu le mérite de mettre en lumière des questions auxquelles il est urgent d’apporter des réponses. De profondes réformes de la réglementation en vigueur concernant les normes relatives aux émissions de polluants à l’échappement s’imposent. Les normes actuelles sont décrédibilisées. En fonction des choix qui seront définitivement faits en ce domaine, la filière automobile devra adapter son outil industriel.
L’offre automobile va nécessairement évoluer rapidement. Le diesel sera-t-il en conséquence sacrifié ? Quelle que puisse être sa motorisation, tout véhicule devra intégrer des sauts qualitatifs majeurs dans son rendement énergétique et sa propreté. Pour les constructeurs et les équipementiers, ces impératifs s’ajoutent à la course déjà engagée pour le développement de l’automobile connectée puis véritablement autonome. De toute son histoire, l’industrie automobile n’a sans doute jamais été confrontée à l’obligation de relever un aussi grand nombre de défis dans une durée aussi contrainte. Le Gouvernement a-t-il engagé une réflexion sur ce que pourrait être un plan de soutien à la filière, s’agissant de telles évolutions ?
Plus généralement, on s’interrogera quant à l’opportunité et à la méthode de la commission indépendante mise en place par Mme Royal. Le rapport final de cette commission, publié en toute discrétion au cœur de l’été, n’a pas fait l’effet d’une bombe. Il jette même un trouble dans l’opinion sans véritablement tracer de pistes claires. Il confirme tout au plus ce que l’on savait déjà au titre des investigations du KBA (Kraftfahrt Bundesamt) allemand et du ministère britannique des transports qui avaient rendu leurs conclusions bien avant la « commission Royal » : effectivement, les procédures d’homologation et les normes d’émissions ne correspondent en rien à la réalité de fonctionnement d’un moteur essence ou diesel.
Nous nous interrogeons toujours sur ce qu’a été et ce que sera la position française dans les négociations, assez peu transparentes, conduites à Bruxelles sur ces deux thèmes.
Monsieur le secrétaire d’État, nous allons vous écouter avec attention dans un premier temps au titre d’un exposé qui constituera un point de situation. Puis les membres de la mission vous interrogeront à leur tour. Mais en premier lieu, notre rapporteure, Madame Batho, vous posera ses questions, immédiatement après votre exposé liminaire.
M. Alain Vidalies, secrétaire d’État auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche. Je réitèrerai tout d’abord les excuses de Ségolène Royal qui aurait souhaité répondre à votre invitation mais qui se trouve actuellement à New York pour l’Assemblée générale de l’Organisation des nations unies (ONU).
Il y a précisément un an, l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) révélait une faute grave du groupe Volkswagen en mettant en évidence la présence de logiciels modifiant les performances de ses véhicules diesel lors des tests d’homologation. Quelques jours plus tard, le constructeur allemand reconnaissait que ces logiciels truqueurs équipaient plus de 11 millions de véhicules dans le monde.
Ségolène Royal a alors saisi dans la foulée les commissaires européens chargés de l’industrie, du climat, et de l’environnement afin qu’ils se rapprochent de l’Agence américaine dans les plus brefs délais pour qu’une procédure similaire soit élaborée par l’Union européenne. En parallèle, la ministre a lancé un programme de contrôle portant sur une centaine de véhicules, choisis de façon aléatoire sur le parc automobile français. Le suivi des résultats a été assuré par une commission indépendante regroupant des associations, des parlementaires, les services des ministères de l’écologie, de l’industrie et de l’économie, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et des experts scientifiques.
Je reviendrai sur les résultats de cette démarche mais je veux dire ici qu’un travail d’investigation considérable a été réalisé : des tests ont été accomplis sur quatre-vingt-six véhicules par l’organisme de contrôle UTAC-CERAM (Union technique de l’automobile et du cycle/Centre d’essais et de recherches automobiles de Mortefontaine) ; des tests complémentaires plus poussés ont été effectués sur quelques modèles par l’Institut français du pétrole et des énergies nouvelles (IFPEN), ; enfin, la commission a auditionné une douzaine de constructeurs. La France a été le premier pays à adopter une telle démarche. Celle-ci reste, à ce jour, la plus ambitieuse par le nombre de véhicules testés et la transparence des résultats.
Avant d’aborder plus précisément les résultats obtenus et le contenu du rapport présenté par la commission indépendante, je reviendrai sur le cadre réglementaire européen des émissions polluantes des véhicules. En trente ans, les émissions de polluants réglementés des véhicules neufs ont été considérablement réduites dans l’Union européenne : à la source d’une part, avec des actions sur les carburants telles que la généralisation de l’essence sans plomb, la diminution de la teneur en benzène et la diminution progressive des teneurs en soufre des carburants ; sur le traitement technologique des émissions, d’autre part, avec l’installation des pots catalytiques pour les véhicules à essence en 1993, des filtres à particules sur les véhicules diesel neufs et maintenant des systèmes de réduction catalytique sélective (SCR) et pièges à oxyde d’azote (NOx trap) pour le traitement des oxydes d’azote (NOx) sur les véhicules diesel.
Le durcissement des normes introduites par la réglementation européenne a joué pour cela un rôle majeur. Dans le cas particulier des NOx, on peut utilement rappeler que la norme Euro 6, applicable depuis le 1er septembre 2015 à tous les véhicules particuliers neufs, limite à 80 milligrammes par kilomètre les émissions d’oxydes d’azote des voitures particulières à motorisation diesel, soit une réduction de plus de 50 % par rapport à la norme Euro 5. Le respect de ces normes est vérifié en laboratoire suivant des procédures qui doivent normalement permettre de garantir la reproductibilité des tests et la comparaison avec des essais réalisés dans d’autres laboratoires en Europe. Se pose alors la question de la représentativité de ces tests.
Ce sujet n’est pas nouveau. Dès 2007, lors de l’adoption du règlement CE n° 715/2007 définissant les normes d’émission des polluants Euro 5 et Euro 6 des véhicules légers, la Commission européenne a proposé, d’une part, le remplacement du cycle actuel d’homologation NEDC (nouveau cycle européen de conduite), utilisé depuis plus de trente ans, par un nouveau cycle d’homologation international WLTP (World harmonized Light vehicles Test Procedures), plus représentatif, pour mesurer en laboratoire la consommation de carburant ainsi que les émissions de CO2 et de polluants des véhicules ; d’autre part, la création d’un test de contrôle des émissions polluantes en conditions réelles de conduite sur la voie publique, dite « RDE », en complément des essais réalisés en laboratoire.
Le défaut de représentativité des tests en laboratoire était donc connu avant le scandale Volkswagen. En revanche, l’ampleur des dépassements, les modalités de mise en œuvre des dérogations prévues par la réglementation et l’existence de fraudes sophistiquées ne l’étaient pas. Les travaux de la commission indépendante mise en place par Ségolène Royal ont mis en exergue l’étendue du problème. Quatre-vingt-six véhicules ont été testés par l’UTAC sous le contrôle de cette commission regroupant des associations, des parlementaires, les services des ministères précités, l’ADEME et des experts.
Les conclusions sont sensiblement les mêmes que celles esquissées sur le premier échantillon de cinquante-deux véhicules dont les résultats ont été publiés dès le mois d’avril. Les tests n’ont pas permis d’identifier de dispositif d’invalidation frauduleux c’est-à-dire de logiciel truqueur. Ils n’ont pas non plus permis de conclure formellement à l’absence de tels logiciels. Ces essais ont en tous cas montré des dépassements significatifs en conditions réelles de circulation, en particulier sur les oxydes d’azote. Les auditions ont révélé que de nombreux constructeurs choisissaient de ne pas faire fonctionner les systèmes de dépollution dans des plages de fonctionnement des véhicules assez larges pour éviter différents dommages sur le moteur.
Pour autant, certains constructeurs ne font pas ce choix et commercialisent des véhicules performants, y compris en dehors des conditions d’essai sur banc. Tous les résultats détaillés sont disponibles dans le rapport publié le 29 juillet 2016 – dans lequel sont également formulées treize recommandations. Nous pourrons revenir sur celles-ci plus en détail si vous le souhaitez, mais j’aimerais, dans la suite de mon propos liminaire, vous signaler certaines des mesures que nous avons d’ores et déjà mises en œuvre et qui répondent à certaines de ces recommandations. Celles-ci doivent par ailleurs faire l’objet de nouveaux échanges avec la commission indépendante, notamment demain jeudi 22 septembre.
Une chose est sûre : beaucoup de constructeurs doivent améliorer sans attendre leurs systèmes de traitement des émissions pour que les véhicules concernés soient davantage respectueux de l’environnement et conformes aux limites réglementaires, non seulement sur banc mais aussi dans des conditions d’usage normal. En la matière, les autorités d’homologation des différents États membres ont la main sur les modèles qu’elles ont elles-mêmes homologués. Pour notre part, nous avons d’ores et déjà demandé aux constructeurs français de proposer des actions en ce sens. PSA a lancé avec l’organisation non gouvernementale Transport et Environnement une initiative pour mieux informer les consommateurs sur la consommation de ses voitures. Renault a proposé un plan d’action pour améliorer la performance environnementale des véhicules en agissant sur le système de recirculation des gaz d’échappement (EGR) ainsi que sur les purges des pièges à NOx. Nous suivons bien sûr d’ores et déjà la mise en œuvre de ce plan d’action, répondant en cela à la première des treize recommandations de la commission indépendante.
Par ailleurs, sans attendre l’entrée en vigueur du règlement européen RDE en septembre 2017, nous avons demandé à l’autorité de réception, qui dépend de la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) du ministère, de ne pas homologuer un véhicule qui dépasserait un coefficient de conformité de 5, lors du monitoring RDE, répondant également ainsi aux recommandations de la commission – notamment la troisième recommandation qui demande que l’on anticipe sur les tests RDE. Lors de l’homologation, nous portons un soin tout particulier à la justification de l’utilisation d’éventuels dispositifs qui débranchent tout ou partie des systèmes de traitement de la pollution, par exemple en ce qui concerne les plages de fonctionnement de ces dispositifs au regard de la température de l’air admis dans le moteur.
Mais ces consignes sont nationales, en limite de ce que le droit européen permet. Nous devons donc également agir au niveau européen. Nous travaillons plus particulièrement avec nos homologues allemands pour proposer notamment une nouvelle rédaction du fameux article 5.2 du règlement 715/2007 qui permet aujourd’hui, de façon dérogatoire, d’installer dans certaines conditions, des dispositifs d’invalidation, ce qui permettra de répondre également aux cinquième et septième recommandations formulées par la commission.
Le processus d’homologation doit également être renforcé.
Les autorités françaises soutiennent des positions ambitieuses en ce sens dans le cadre des négociations en cours au Conseil. Elles agissent notamment avec force pour que le nouveau protocole de mesure qui sera mis en œuvre pour le contrôle des émissions polluantes, fondé sur de nouvelles méthodes de mesure en laboratoire plus représentatives, soit plus robuste et appliqué avec toute la rigueur nécessaire. Elles agissent également pour que les nouveaux essais sur route (RDE) soient eux aussi renforcés et que l’on obtienne rapidement de la Commission européenne une révision des facteurs de conformité qui entreront en vigueur en 2017 – facteurs que nous jugeons trop élevés au regard des enjeux de santé publique qu’impose une réduction drastique des émissions polluantes dues aux transports. Ceci répond également à la sixième recommandation de la commission.
Enfin, la France est en pointe au niveau européen pour réclamer que, dans le cadre de la révision en cours des textes régissant les modalités d’homologation des véhicules, tout soit fait pour aboutir à de nouveaux règlements ne laissant plus la place aux errements révélés dans le cadre de l’affaire Volkswagen. À cet égard, dès le mois de janvier, la France est intervenue, en de multiples occasions, auprès de la Commission européenne et des autres États membres afin que, dans le cadre de la révision de la directive qui traite de l’homologation des véhicules, les mesures suivantes soient adoptées : la mise en place d’une autorité européenne chargée de veiller à l’indépendance et à la compétence des services techniques et des autorités d’homologation, à la validité des homologations délivrées et à la transparence des essais réalisés ; l’instauration d’une contribution financière des constructeurs et de leurs mandataires au financement de la délivrance des homologations et de la surveillance du marché ; un renforcement des contrôles en production et en service ; enfin, la mise en place de sanctions financières et administratives harmonisées et proportionnées en cas de non-respect des normes par les constructeurs – ce qui correspond aux huitième et neuvième recommandations de la commission.
Enfin, nous devons également prendre de nouvelles mesures pour mieux informer nos concitoyens sur les niveaux de consommation de carburant et les émissions réelles de polluants des véhicules qu’ils achètent. Ce n’est pas le cas aujourd’hui et la ministre de l’environnement souhaite qu’en la matière, la Commission européenne propose rapidement une révision des dispositions relatives à l’étiquetage des voitures neuves dans le sens d’une plus grande transparence et d’une meilleure information du public, ce qui répondra également à la recommandation n° 13 de la commission indépendante.
Je terminerai mon intervention en évoquant certaines informations parues dans la presse – notamment l’article paru le 22 août dans le Financial Times – selon lesquelles certains résultats d’essais ne figureraient pas dans le rapport final publié à la fin du mois de juillet. Ségolène Royal a publié un démenti le 24 août en indiquant clairement que ce rapport reproduisait intégralement l’ensemble des résultats obtenus pour les quatre-vingt-six véhicules testés ainsi que les informations recueillies lors des auditions des constructeurs entendus par la commission. La ministre de l’environnement s’est également exprimée sur les actions d’ores et déjà engagées en réponse aux recommandations formulées par la commission, actions dont je vous ai moi-même fait état dans mes propos.
D’autres actions restent engagées, notamment l’enquête conduite par le Service national d’enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à propos des anomalies constatées sur certains modèles de véhicules. Cette enquête a débouché au début de l’année sur une première saisine du Parquet portant sur les agissements du groupe Volkswagen constituant une tromperie du consommateur. D’autres investigations se poursuivent sur d’autres constructeurs, français et étrangers. Elles pourront le cas échéant déboucher sur de nouvelles saisines du Parquet mais nous ne pouvons à ce stade préjuger du résultat des enquêtes en cours.
Les pouvoirs publics français sont déterminés, d’une part, à faire la transparence sur les actions entreprises pour corriger les errements constatés et, d’autre part, à agir aux niveaux national et européen pour que les nouvelles réglementations et leur mise en œuvre garantissent la mise sur le marché de véhicules respectant parfaitement les normes imposées.
Mme Delphine Batho, rapporteure. Je vous remercie, monsieur le ministre, de cet exposé liminaire dans lequel vous avez anticipé un certain nombre de nos questions. Je sais qu’une réunion de la commission technique se tiendra demain. Est-il envisagé de prolonger la durée de vie de cette instance ad hoc ?
Vous avez évoqué les tests de l’IFPEN. C’est certainement de ceux-ci qu’il a été dit qu’ils n’avaient pas été publiés. Ces tests complémentaires pourraient-ils nous être expliqués sur le plan technique ? Ayant déjà eu l’occasion d’auditionner longuement M. Laurent Michel, nous ne poserons pas à nouveau les questions que nous luis avons déjà posées. Cela étant, nous n’avions pas évoqué ce point précis à l’époque.
Vous avez indiqué que dès après la révélation du scandale, la France avait alerté la Commission européenne quant à la nécessité d’adopter une procédure européenne de contrôles qui, en réalité, se sont plutôt déroulés en ordre dispersé. Je fais ici référence à ce qui a été mis en place en France, d’une part, en Allemagne, d’autre part, et au Royaume Uni, d’autre part encore. La France établit-elle aujourd’hui une sorte de constat de carence quant au rôle de la Commission européenne, en termes de surveillance de marché après l’affaire Volkswagen ?
Vous avez mentionné les mesures que différents constructeurs avaient présentées à la commission. S’agissant de la Renault Captur, le plan de mise en conformité présenté par Renault le 5 avril dernier a-t-il été validé par l’autorité de tutelle et l’autorité d’homologation ?
Enfin, vous avez abordé la demande, formulée par la France, de nouvelle rédaction de l’article de la réglementation européenne sur le dispositif d’invalidation. Je voudrais revenir sur cette question puisque lors d’un Conseil européen en juin, l’Allemagne a soutenu cette proposition et que la position française à l’époque divergeait de la position allemande quant à la nécessité de réécrire les dispositions qui autorisent aujourd’hui de multiples dérogations. Dans la perspective de cette révision du règlement européen, la position de la France consiste-t-elle à demander l’interdiction du dispositif d’invalidation ?
M. le secrétaire d’État. Le devenir de la commission ad hoc n’a pas encore été complètement fixé. Il sera abordé lors des débats qui se dérouleront demain. On pourrait envisager de lui confier le suivi de ses recommandations. Mais une instance plus généraliste pourrait aussi y pourvoir – par exemple, une commission spéciale du Conseil national de la transition écologique (CNTE). On pourrait également lui confier la supervision des nouveaux tests – qui sont toutefois à définir. La première série de quatre-vingt-six tests a permis de bien mettre en évidence la carence des procédures mais ne peut guère aller plus loin. Des tests devront être conduits à des fins de surveillance du marché au profit d’enquêtes judiciaires mais ne relèvent pas particulièrement du champ de la commission. Troisième mission possible : la supervision de la mise en œuvre des règlementations européennes – par exemple, la supervision des données récupérées lors de la première année de mise en œuvre de la procédure RDE qui pourront servir, notamment, à recaler les coefficients de conformité. Le débat doit avoir lieu demain avec la commission elle-même.
Concernant Renault Captur, les investigations conduites sur dix-sept véhicules du groupe Renault ont montré à la fois des dépassements des normes sur certains tests sur banc et des émissions en situation réelle de conduite importantes. La transparence totale a été faite sur les résultats. Dans un cas, il y avait une erreur de paramétrage. De manière plus générale, les difficultés rencontrées s’expliquent par une plage de fonctionnement trop étroite en termes de température du système de recirculation des gaz d’échappement (EGR – Exhaust gas recirculation) – dispositif que Renault avait mis en place à la suite d’incidents moteurs fréquents provoqués par ce dispositif au début des années 2000. Ensuite, le pilotage des purges et nettoyages du dispositif était perfectible – le piège à oxydes d’azote était trop variable en fonction du comportement des usagers. Outre la résolution du problème sur le modèle Captur, Renault a proposé au ministère et présenté devant la commission un plan d’amélioration autour de ces deux axes. Une extension de la plage de pleine efficacité de l’EGR entre dix et quarante-cinq degrés de température, au lieu de dix-sept et trente-cinq aujourd’hui, et un pilotage du piège à oxydes d’azote moins sensible à la variété des usagers clients, notamment l’augmentation de la fréquence et de la robustesse des purges pour l’ensemble des conditions de roulage. Renault a également présenté un plan d’amélioration qui concerne les nouvelles homologations, les nouveaux véhicules produits ainsi que les véhicules déjà en circulation. Renault s’est engagé également, pour les véhicules diesel Euro 6 vendus avant ces évolutions, à faire bénéficier gratuitement chaque client qui le souhaitera d’une opération de recalibrage dans le réseau qui sera possible à partir du quatrième trimestre 2016. Quant au véhicule Renault Captur 110 CV, il a enregistré de mauvais résultats à tous les tests, y compris à celui reproduisant les tests officiels, l’homologation. Le véhicule était officiellement non-conforme et plusieurs essais sur d’autres véhicules l’ont confirmé. Renault a donc pris des dispositions pour que ce véhicule soit rectifié. C’est en effet au sujet de ce dernier que la ministre et la commission ont donné des instructions sévères dans la mesure où il présentait des difficultés très singulières par rapport aux autres.
M. Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat. Madame la rapporteure nous a demandé si nous pourrions soutenir une position commune avec l’Allemagne sur l’article 5.2 du règlement européen qui, aujourd’hui, autorise – sous conditions particulières – des dispositifs dits d’invalidation qui débranchent les systèmes de dépollution. Cette disposition, effectivement assez générale, ouvre la porte à des interprétations difficiles voire laxistes. Sa rédaction même ne nous permet pas forcément en droit de faire ce que nous souhaiterions. Il est donc nécessaire de réécrire cet article. Nous travaillons entre autres avec nos collègues allemands, que j’ai encore rencontrés la semaine dernière, pour définir une position commune sur ce sujet. À défaut d’une interdiction totale de ces dispositifs, on pourrait à tout le moins imposer une limitation très sévère des cas dans lesquels ils seraient autorisés. On pourrait par exemple en conditionner l’utilisation à l’obligation de faire la preuve – non pas verbale mais documentée – que cette utilisation est nécessaire pour protéger le moteur et qu’il n’existe pas de meilleure technique permettant d’éviter le recours à ce dispositif d’invalidation. C’est l’une des pistes que nous explorons. Nous espérons pouvoir proposer à nos ministres puis dans le débat européen une clarification et une restriction très nette du champ d’autorisation de ces dispositifs d’invalidation dans le cadre de la réforme.
M. le secrétaire d’État. S’agissant de Capture, Renault a fait le choix du piège à NOx comme technologie de dépollution finale. Pour son bon fonctionnement, une régénération de ce piège est nécessaire tous les dix kilomètres – opération que l’on appelle « dé-NOx ». Par ailleurs, un empoisonnement du piège à NOx par l’accumulation de sulfates dégrade l’efficacité de ce piège et impose une désulfatation tous les mille kilomètres. Les investigations menées par Renault ont fait apparaître une anomalie dans le paramétrage du calculateur permettant de déterminer l’empoisonnement du piège à NOx c’est-à-dire la masse de soufre présente sur celui-ci. À la suite d’un mauvais réglage, le calculateur recevait l’information que le niveau de soufre était remis à zéro à chaque régénération du piège à NOx, soit tous les dix kilomètres. L’accumulation de soufre n’était donc pas calculée. Le calculateur n’a jamais identifié que la masse de soufre maximale était atteinte si bien que l’opération de « dé-NOx » n’a jamais été déclenchée. Cet encrassement a particulièrement dégradé l’efficacité du piège à NOx. Renault a indiqué que les véhicules commercialisés aujourd’hui n’étaient plus concernés par ce problème dans la mesure où le calculateur avait été re-paramétré depuis.
M. Laurent Michel. Les résultats des tests de l’IFPEN seront présentés demain, pour les essais qui sont achevés. Quatre véhicules ont été testés à la demande de la commission, dont des Renault et des Fiat.
M. le secrétaire d’État. La rapporteure nous a adressé une question générale portant sur la Commission européenne. Je n’utiliserai pas les termes de « constat de carence » dans un domaine où les règles européennes confèrent des pouvoirs à chacun des États. Nous partageons le constat que l’efficacité de ces règles est déficiente. Cela soulève deux questions : celle des tricheurs – ayant donné lieu à des réponses sur le plan pénal – mais aussi celle de savoir si les tricheurs n’utilisent pas aussi les largesses ou l’absence de précision du règlement européen. De ce point de vue, il y a coresponsabilité, ainsi que je l’ai dit dans mon propos introductif. Au fond, la question se posait déjà dès 2007. On pensait que les contrôles étaient insuffisants. Et la fraude a remis la question à l’ordre du jour. Je ne pense pas qu’il faille renvoyer la balle à la Commission européenne en termes de responsabilité. Le discours aujourd’hui tenu par la France, par la voix de la ministre, est extrêmement précis quant aux améliorations à apporter.
M. Frédéric Barbier. Vous avez présenté au début du mois d’août avec la ministre de l’environnement, Ségolène Royal, une ordonnance visant à permettre l’expérimentation des véhicules autonomes sur route. À mon sens, ce texte simplifie grandement les dossiers que devaient déposer les constructeurs automobiles pour pouvoir expérimenter leurs véhicules en dehors des autoroutes sur lesquelles ils le faisaient jusqu’alors. Sochaux, le site historique de Peugeot, se trouve dans ma circonscription : ce constructeur étant à la pointe de cette technologie, avez-vous déjà des premiers retours quant à la décision que vous avez prise ?
Ma deuxième question porte également sur une entreprise de ma circonscription, Peugeot scooters. Nous sommes, là aussi, en phase d’expérimentation du véhicule deux roues en interligne pour faire en sorte qu’il puisse passer entre les files de voitures. Cela fait quelques mois que cette expérimentation est en cours dans certaines agglomérations. Avez-vous eu des retours d’expérience à ce sujet ? Cherche-t-on à favoriser le deux roues en France ?
Enfin, je vous adresse une question que j’ai également posée ce matin au ministre du budget concernant le transport ferroviaire. Le transport routier ne paie pas le vrai prix de son incidence sur nos routes. L’écotaxe et les portiques ont été abandonnés et me semblent un peu dépassés puisqu’un véhicule connecté peut envoyer toute information sur les voies communales, départementales et autoroutière qu’il aura utilisées. Il serait donc assez facile de lui adresser une facture du vrai coût du transport routier, ce afin de rééquilibrer son prix par rapport à celui du transport ferroviaire et de développer le fret ferroviaire – avec des retombées sur Alstom, une entreprise qui m’est chère à Belfort.
M. le secrétaire d’État. La question du fret ferroviaire s’inscrit aujourd’hui dans un cadre particulier : le fret est ouvert à la concurrence depuis 2004. Et depuis cette date, la part du fret ferroviaire dans le transport de marchandises en France a beaucoup diminué, ne représentant plus aujourd’hui que 10,5 % de l’ensemble du transport de marchandises. Depuis deux ou trois ans, cette proportion remonte un peu mais la marche est haute, ne serait-ce que pour revenir aux 20 % d’il y a une dizaine d’années. Il est beaucoup d’explications à cette situation : elles sont non seulement économiques mais aussi conjoncturelles. La concurrence est assez féroce et le rapport entre la route et le fer est au cœur des politiques de financement des infrastructures que nous menons en France. Le budget de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) reçoit essentiellement des ressources de la route – taxe de domanialité payée par les autoroutes – et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), y compris la TICPE spécifique que nous avons mise à la charge des poids lourds à la suite de l’abandon de la dernière formule d’écotaxe. La taxe poids lourds rapporte 330 millions d’euros par an au budget de l’AFITF. Nous menons ainsi une politique de report modal via le financement des infrastructures. Il n’est d’ailleurs pas impossible de s’interroger quant à la poursuite ou à l’amplification de cette démarche.
Deux questions se posent s’agissant des scooters. L’une concerne la sécurité routière. Le secrétariat d’État aux transports est très large mais n’a pas encore compétence en la matière qui relève du ministère de l’intérieur. Je ne m’aventurerai donc pas sur un terrain qui n’est pas le mien. En revanche, Christian Eckert vous a donné des indications ce matin et je vous confirme que nous essayons aujourd’hui de trouver un dispositif permettant d’accompagner le développement des scooters électriques – mode de déplacement qui peut être pertinent en ville, compte tenu des problèmes de pollution.
Le déploiement des véhicules autonomes est probablement l’avenir de la construction automobile, en dépit de nombreux problèmes non résolus. La mobilisation des États et des constructeurs va en ce sens. Vous avez fait référence à l’ordonnance que nous avons présentée avec Ségolène Royal au mois d’août : ce texte était nécessaire pour permettre le développement des expérimentations en cours dans des zones de circulation ouvertes. On a déjà une certaine expérience sur circuit fermé – parkings, zones d’usines – mais la vraie question – compte tenu notamment de l’accident survenu sur un véhicule de la marque Tesla – est celle de la validation de l’expérimentation en circulation ouverte. En France, cette démarche s’inscrit dans le plan industriel « Véhicule autonome » qui a été lancé dès le mois de juillet 2014 et qui comprenait six axes prioritaires. Eu égard aux véhicules à délégation de conduite, nous avons eu des démonstrations sur site privé. Sur les routes ouvertes, plusieurs expériences ont déjà été faites, notamment à La Rochelle et lors du congrès sur les systèmes de transport intelligents à Bordeaux. Pour répondre plus précisément à votre question, des expériences sont déjà en cours en site fermé. Pour les développer sur site ouvert en dehors des situations très particulières que je viens de citer, nous avons besoin d’un cadre général : tel est l’objectif de l’ordonnance. Depuis la publication de cette dernière, le ministère a enregistré une quinzaine de dossiers. Pour avoir rencontré souvent mes homologues du monde entier et les responsables politiques et industriels de ces pays, je puis dire que la course est engagée. La France tient sa place à ce stade mais il faut effectivement qu’elle accélère.
Mme Delphine Batho, rapporteure. En réaction à ce que vous venez de dire, je précise que nous ferons des propositions fortes concernant les véhicules autonomes et leur expérimentation. Car comme vous venez de le souligner, la compétition mondiale est absolument déterminante pour l’avenir de l’industrie automobile. Et il nous semble – ou du moins, avons-nous entendu – que les pouvoirs publics ont encore une certaine marge de progrès à accomplir en ce domaine pour favoriser la place de la France dans cette compétition.
Auriez-vous un commentaire politique ou une observation technique à formuler en réaction au titre de l’édition d’hier d’un grand quotidien du soir sur la France « Championne d’Europe des voitures sales » ? Le quotidien présentait des graphiques compilant sinon l’ensemble des données brutes, à tout le moins, les différentes commissions de tests mis en place en France, en Allemagne et au Royaume-Uni – tests dans lesquels, étonnamment, le tricheur initial apparaît comme étant particulièrement performant ! Cela vous inspire-t-il un commentaire ?
Pourriez-vous, monsieur le secrétaire d’État, nous parler de la partie « mobilité » de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), en ce qui concerne plus particulièrement l’automobile ? J’aurais notamment voulu savoir si, à la suite de l’avis de l’Autorité environnementale – critique sur plusieurs points mais surtout sur la partie « mobilité » –, la nouvelle version de la PPE qui vient d’être mise en consultation a notablement évolué ?
S’agissant des poids lourds, nous avons entendu beaucoup de choses très intéressantes sur les capacités de déploiement du gaz liquéfié comme substitut du diesel. Différents projets peuvent être soutenus par les pouvoirs publics ou par l’ADEME, par exemple. La transformation du poids lourds de marchandises, pour l’adapter à ce type de motorisation – qui est d’ailleurs pour une part fabriquée en France – pourrait-elle être un axe fort de votre ministère ?
Enfin, je ne veux pas rouvrir le débat sur le financement des infrastructures et la fiscalité des carburants – débat que vous avez lancé la semaine dernière et qui, je l’ai compris, est clos. Mais le Gouvernement considère-t-il ce débat comme définitivement clos ? Ou bien, comme vous nous l’avez dit à l’instant, le problème de ce financement n’est-il pas tel qu’il va de toute façon falloir rechercher des solutions ?
M. le secrétaire d’État. Le montant des crédits inscrits pour le financement des infrastructures en 2017 est aujourd’hui envisagé à hauteur de 2,2 milliards d’euros, ce qui apporte à l’AFITF une augmentation importante de crédits par rapport à l’année dernière. Mais les perspectives de dépenses, notamment à partir de 2018-2019, laissent entier le problème des capacités de financement de l’agence. J’avais, il est vrai, envisagé certaines pistes de solutions mais la question, légitime, reste posée et nous aurons l’occasion d’y revenir dans le débat parlementaire. Des engagements ont été pris en faveur de grandes infrastructures sans parler des contrats de plan. Il y a aujourd’hui inadéquation entre les recettes escomptées et les dépenses prévues entre 2018 et 2025. Peut-être la réponse ne doit-elle pas être apportée de façon urgente dès 2017, compte tenu du mécanisme des crédits de paiement mais il ne servirait à rien de cantonner le débat à l’an prochain.
Le recours au gaz pour les poids lourds est un sujet qui m’intéresse beaucoup. Un travail doit être accompli pour convaincre les professionnels qui sont aujourd’hui confrontés à un système extrêmement concurrentiel. Le transport de marchandises par la route pose de nombreuses difficultés, notamment celles des conditions d’exercice d’une concurrence loyale. J’ai présidé avant-hier une réunion d’une mission d’évaluation des politiques publiques sur le contrôle du transport routier. Ayant accompagné les agents lors d’un contrôle, j’ai découvert à cette occasion des moyens de fraude extrêmement sophistiqués qui visent non pas à dissimuler des pollutions mais à contourner les règles sociales applicables, notamment à l’aide de systèmes informatiques espions qui neutralisent les moyens de contrôle des camions. Ce problème est aujourd’hui prégnant dans le monde des transports. Mais nous voulons – Ségolène Royal l’a rappelé – donner un signe fort dans le sens que vous souhaitez. Dans le cadre du Programme des investissements d’avenir (PIA), nous avons lancé un appel à projets en faveur du changement des flottes. Un travail de pédagogie et d’accompagnement des entreprises est absolument nécessaire, cette évolution étant un passage obligé dans les années à venir compte tenu des contingences en matière de protection de l’environnement. Nous sommes donc en phase sur ce point.
M. Laurent Michel. Le rapport de « Transport et Environnement » présente plusieurs graphiques et commentaires sur les émissions, en conditions réelles de conduite, de diverses marques. Il est vrai que globalement, Volkswagen enregistre plutôt de bons résultats sur un certain nombre de véhicules Euro 6 alors que les résultats des véhicules Euro 5, eux, étaient moins bons – indépendamment du problème du logiciel trompeur. D’autres constructeurs comme BMW, PSA ou Toyota enregistrent globalement aussi une performance, les émissions de leurs véhicules étant assez basses et très proches des normes. À l’autre extrémité, on voit dans cette étude, de même qu’à lecture de nos résultats et des rapports britanniques et allemands, que des constructeurs comme Daimler, Renault, Opel ou Fiat ont plutôt plus de véhicules dépassant d’un facteur important les normes en conditions réelles de circulation. Sur le plan technique, ce rapport n’est guère discordant par rapport à nos propres résultats. Chaque pays a testé plus de modèles tandis que nos tests tenaient davantage compte des parts de marché. Ainsi nos collègues anglais ont-ils beaucoup testé Jaguar et Land Rover tandis que nous, pas du tout. Quoi qu’il en soit, nous ne sommes guère surpris par cette étude. Il ne faut pas non plus regarder ces graphiques comme illustrant la valeur absolue de la performance d’un parc. On y trouve néanmoins certaines tendances.
M. le secrétaire d’État. En résumé, nous n’avons pas d’objection de fond. Nous partageons plutôt les constats établis qui ne sont pas non plus surprenants. Dans le cas de Volkswagen, la différence importante entre les véhicules Euro 6 et Euro 5 est réelle mais c’est bien pour les véhicules Euro 5 qu’un problème s’est posé. On a supposé que les véhicules Euro 5 testés n’avaient pas de système frauduleux. Or, on peut constater cette pollution majeure.
M. Laurent Michel. La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) comprend effectivement un volet intitulé « Stratégie de développement de la mobilité propre ». L’ensemble du document est en consultation publique depuis le 15 septembre pour une durée d’un mois. Nous avons pris en compte les observations de l’Autorité environnementale et l’avis du Conseil national de la transition énergétique qui nous ont amenés à mieux remettre en perspective les documents, les objectifs et le chapitre consacré aux impacts économiques et financiers de cette programmation. S’agissant du gaz naturel (GNV) et des carburants alternatifs, que vient d’évoquer M. le secrétaire d’État, la PPE fixe un objectif, en 2023, de 3 % de poids lourds au GNV : cela semble peu mais il convient de tenir compte du renouvellement du parc. D’autres objectifs et actions sont définis qui visent à soutenir, par le biais d’appels à projet, le développement des infrastructures permettant d’alimenter ces camions. Ayant tenu compte des avis précités, nous sommes parvenus à définir un ensemble plus clair et plus hiérarchisé d’objectifs et d’actions dans ce volet « Mobilité propre ». Après le 14 octobre, nous publierons une nouvelle version de la PPE tenant compte de la consultation en cours.
M. Jean Grellier. Lors de nos auditions, il a souvent été question de neutralité technologique de la part des pouvoirs publics. Les décisions fiscales ou de soutien à l’une ou l’autre des options retenues en matière énergétique peuvent contribuer à atténuer cette neutralité. A également été présentée comme problématique la mutation technologique des véhicules existants, notamment par le biais du rétrofit des moteurs. Y a-t-il des réflexions en ce domaine, les industriels étant un peu réservés à l’égard de ces possibilités ? Qu’en pensez-vous ?
M. le secrétaire d’État. La notion de neutralité technologie relève d’un débat conceptuel dont il faut se méfier. Dans une économie ouverte où les industriels peuvent intervenir, les pouvoirs publics n’ont certes pas à avoir de préférences. Mais dès lors que nous voulons mener une politique de protection de l’environnement et de mobilité urbaine, il serait paradoxal que nous nous abritions derrière un tel concept pour ne pas assumer nos responsabilités.
Les véhicules existants soulèvent plusieurs problèmes. Nous avons constaté des anomalies sur les véhicules récents. Nous travaillons donc aujourd’hui avec les équipementiers dans la perspective de pouvoir mettre en place un rétrofit. Si je distingue plusieurs catégories de véhicules, c’est qu’il n’est pas encore techniquement possible aujourd’hui de procéder à ces modifications sur des véhicules plus anciens sans que cela pénalise les acheteurs. Notre objectif est donc de commencer par les véhicules les plus récents d’autant que ce sont eux qui, pensons-nous, resteront le plus longtemps en circulation.
Mme la rapporteure. Je précise à l’attention de Jean Grellier qu’à la suite de ses interventions sur cette question lors de plusieurs réunions de la mission, nous avons approfondi le sujet. Je remercie d’ailleurs les services de la DGEC d’avoir répondu à nos questions. Notre rapport comportera ainsi des informations précises sur le rétrofit.
Je vous remercie, messieurs, pour les réponses apportées à nos questions.
La séance est levée à dix-huit heures.
1 () La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
© Assemblée nationale