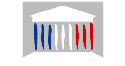______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 février 2017.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
AU NOM DE LA MISSION D’INFORMATION
sur les relations politiques et économiques
entre la France et l’Azerbaïdjan au regard des objectifs français
de développement de la paix et de la démocratie au Sud Caucase (1)
TOME II
Président
François ROCHEBLOINE
Rapporteur
Jean-Louis DESTANS
Députés.
——
(1) La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
La mission d’information sur les relations politiques et économiques entre la France et l’Azerbaïdjan au regard des objectifs français de développement de la paix et de la démocratie au Sud Caucase est composée de :
– MM. François Rochebloine, président, et Jean-Louis Destans, rapporteur ;
– MM. Alain Ballay, Jean-Luc Bleunven, Mme Pascale Crozon, MM. Michel Destot, Patrick Devedjian, Jean-Pierre Door, Yves Foulon, Sauveur Gandolfi-Scheit, Jean-Marc Germain, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, MM. Jean-Claude Guibal, Henri Jibrayel, Jérôme Lambert, François-Michel Lambert, Jean Launay, François Loncle, Mme Véronique Louwagie, MM. Jean-François Mancel, Thierry Mariani, Christophe Premat, François Pupponi, Didier Quentin, Mme Marie-Line Reynaud, MM. Marcel Rogemont, François Scellier, Gabriel Serville, Jean-Michel Villaumé et Michel Voisin, membres.
SOMMAIRE
___
Pages
AUDITIONS DE LA MISSION D’INFORMATION 7
Ÿ Audition de Mme Florence Mangin, directrice de l’Europe continentale au ministère des affaires étrangères (jeudi 13 octobre 2016) 7
Ÿ Audition de Mme Sandrine Gaudin, chef du service des affaires bilatérales et de l’internationalisation des entreprises à la direction générale du Trésor (jeudi 13 octobre 2016) 25
Ÿ Audition de M. Jean-Pierre Lacroix, directeur des Nations unies, des organisations internationales, des droits de l’Homme et de la francophonie au ministère des affaires étrangères (mercredi 19 octobre 2016) 37
Ÿ Audition de Mme Aurélia Bouchez, ambassadeur de France en Azerbaïdjan (jeudi 20 octobre 2016) 49
Ÿ Audition de Son Excellence M. Elchin Amirbayov, ambassadeur d’Azerbaïdjan en France (mercredi 2 novembre 2016) 67
Ÿ Audition de M. Pierre-Yves Le Borgn’, député, rapporteur de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme (jeudi 3 novembre 2016) 93
Ÿ Audition de M. Philippe Gautier, directeur général de MEDEF international, accompagné de M. Bogdan Gadenne-Feertchak, chargé de mission senior pour les Balkans, la Turquie, le Caucase et l’Asie centrale (jeudi 3 novembre 2016) 109
Ÿ Audition de M. Philippe Errera, directeur général des relations internationales et de la stratégie au ministère de la défense, accompagné de M. Laurent Rucker, chef du bureau Europe orientale, et de M. Emmanuel Dreyfus, chargé de mission Europe orientale (mercredi 9 novembre 2016) 125
Ÿ Audition de M. Stéphane Heddesheimer, directeur du pôle Europe et Communauté des États indépendants (CEI) du groupe Suez (jeudi 10 novembre 2016) 139
Ÿ Audition de M. Philippe Delleur, vice-président d’Alstom, chargé des affaires publiques (jeudi 10 novembre 2016) 151
Ÿ Audition de M. Bertrand Fort, délégué pour l’action extérieure des collectivités territoriales au ministère des affaires étrangères (mercredi 16 novembre 2016) 163
Ÿ Audition de M. Thierry Braillard, secrétaire d’État auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports (jeudi 17 novembre 2016) 179
Ÿ Audition de M. Arnaud Erbin, directeur international d’Engie, accompagné de M. Philippe Hochart, directeur de projet à la direction internationale, et de Mme Valérie Alain, directrice des relations institutionnelles (jeudi 17 novembre 2016) 189
Ÿ Audition de M. Michael Borrell, directeur Europe et Asie centrale de l’exploration et de la production de Total (mercredi 23 novembre 2016) 205
Ÿ Audition de M. Johann Bihr, responsable du bureau Europe de l’Est et Asie centrale, et de Mme Emma Lavigne, chargée de recherche Europe et Asie centrale, de Reporters sans frontières (jeudi 24 novembre 2016) 221
Ÿ Audition de Mme Anne Castagnos-Sen, responsable des relations extérieures pour Amnesty International France (jeudi 24 novembre 2016) 237
Ÿ Audition de Mme Agnès Romatet-Espagne, directrice des entreprises, de l’économie internationale et de la promotion du tourisme au ministère des affaires étrangères et du développement international (mercredi 30 novembre 2016) 251
Ÿ Audition de M. Pierre Andrieu, ambassadeur, ancien co–président français du Groupe de Minsk de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) (jeudi 1er décembre 2016) 263
Ÿ Audition de M. Antoine Biquillon, directeur général de Lactalis-Caspi (jeudi 1er décembre 2016) 275
Ÿ Audition de M. Jean Lévy, ancien ambassadeur pour le sport, conseiller auprès du président de la Fédération internationale de l’automobile (FIA) pour les relations internationales (mercredi 7 décembre 2016) 289
Ÿ Audition de M. Jacques Soppelsa, professeur des universités, président honoraire de l’université Paris I Panthéon Sorbonne, président de l’Académie internationale de géopolitique (mercredi 7 décembre 2016) 297
Ÿ Audition de M. Philippe Vinogradoff, Ambassadeur pour le sport (jeudi 8 décembre 2016) 313
Ÿ Audition de M. Michel Forst, rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de l’Homme (jeudi 8 décembre 2016) 321
Ÿ Audition de M. Denis Masseglia, président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) (jeudi 8 décembre 2016) 335
Ÿ Audition de M. Jean de Gliniasty, directeur de recherche à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) (jeudi 15 décembre 2016) 345
Ÿ Audition de Mme Marie-Claire Aoun, directrice du centre « Énergie » de l’Institut français des relations internationales (IFRI) (jeudi 15 décembre 2016) 357
Ÿ Audition de Mme Claire Mouradian, directrice de recherche au CNRS, et de M. Stéphane de Tapia, directeur du département d’études turques de l’université de Strasbourg (jeudi 15 décembre 2016) 367
Ÿ Audition de Mme Marie-Ange Debon, directrice générale adjointe du groupe Suez chargée de l’international, présidente du conseil de chefs d’entreprise France-Azerbaïdjan de MEDEF International, accompagnée de M. Bogdan Gadenne-Feertchak, chargé de mission senior de MEDEF International pour les Balkans, la Turquie, le Caucase et l’Asie centrale (mardi 10 janvier 2017) 389
Ÿ Audition, en visioconférence, de M. Laurent Richard, journaliste (mercredi 11 janvier 2017) 401
Ÿ Audition de Mme Alexandra Koulaeva, responsable du bureau Europe de l’Est et Asie centrale de la Fédération internationale des droits de l’Homme (FIDH) (jeudi 12 janvier 2017) 417
Ÿ Audition de M. Olivier Achard, vice-président de la zone Eurasie pour Thales International, et de Mme Fanny Mounier, chargée de mission auprès du vice-président chargé des relations internationales (jeudi 12 janvier 2017) 431
Ÿ Audition de M. Pascal Pacaut, directeur du département Asie de l’Agence française de développement (AFD) (mercredi 18 janvier 2017) 439
Ÿ Audition de M. Matthieu Combe, conseiller chargé de l’Europe orientale et de l’Asie centrale à la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne (mercredi 18 janvier 2017) 445
Ÿ Audition de M. Matthias Fekl, secrétaire d’État auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger (jeudi 19 janvier 2017) 459
AUDITIONS DE LA MISSION D’INFORMATION
(par ordre chronologique)
Ÿ Audition de Mme Florence Mangin, directrice de l’Europe continentale au ministère des affaires étrangères (jeudi 13 octobre 2016)
M. le président François Rochebloine. Pour cette première audition organisée par notre mission, nous avons le plaisir d’accueillir Mme Florence Mangin, directrice de l’Europe continentale au ministère des affaires étrangères.
L’objet de la mission est de faire le point sur les relations politiques et économiques entre la France et l’Azerbaïdjan au regard des objectifs de développement de la paix et de la démocratie au Sud Caucase. Bien entendu, il s’agit d’aborder tant ce qui favorise que ce qui défavorise l’atteinte de ces objectifs.
Vos compétences, madame la directrice, vous mettent à même de nous donner un état synthétique desdites relations bilatérales, que ce soit sous leur aspect politique, entendu au sens large, ou sous leur aspect économique. Sans limiter aucunement votre liberté de parole, je précise que la mission entendra cet après-midi Mme Sandrine Gaudin, chef de service à la direction générale du Trésor.
Vous ne serez pas étonnée que j’exprime la préoccupation de la mission quant à la situation des droits de l’Homme en Azerbaïdjan et que je souhaite connaître l’appréciation portée officiellement par la France à ce sujet.
Enfin, même si ce n’est pas le sujet central des travaux de la mission, j’imagine que vous ne manquerez pas d’évoquer la politique menée par la France dans le Caucase du Sud, notamment, mais pas exclusivement, dans le cadre du groupe de Minsk.
Mme Florence Mangin, directrice de l’Europe continentale au ministère des affaires étrangères. La France et l’Azerbaïdjan entretiennent depuis 1992 des relations d’amitié et de coopération, qui sont en constant développement. Je n’entrerai pas dans le détail de ces relations secteur par secteur, dans la mesure où d’autres auditions vous apporteront un éclairage en la matière. Je suis néanmoins à votre disposition pour répondre à vos questions à ce sujet. Avant de vous exposer les principaux enjeux politiques de la relation franco-azerbaïdjanaise, je crois utile de vous présenter le contexte régional et de rappeler les objectifs de notre action dans le Caucase du Sud.
L’Azerbaïdjan est le pays le plus étendu et le plus peuplé du Caucase du Sud, bande montagneuse qui relie la mer Noire à la mer Caspienne. Géographiquement proche de l’Europe, cette région revêt une importance stratégique à plusieurs titres. Il ne s’agit pas seulement des ressources en hydrocarbures qui s’y trouvent ou y transitent, et qui garantissent la diversification de l’approvisionnement énergétique de l’Europe. Il s’agit, plus généralement, des défis de sécurité que pose cette région, mosaïque de peuples, de religions et de cultures, située au carrefour des influences des puissances voisines, qui font par ailleurs beaucoup parler d’elles à l’échelle mondiale.
Premier voisin important : la Russie. Ancienne puissance tutélaire, elle est toujours présente militairement dans les provinces sécessionnistes de la Géorgie ainsi qu’en Arménie, où elle entretient une base militaire et assure la protection de la frontière turco-arménienne. Elle est le quatrième partenaire commercial de l’Azerbaïdjan et le premier de l’Arménie, laquelle a par ailleurs adhéré à l’Union économique eurasiatique en 2015.
Deuxième puissance voisine : la Turquie. Elle est un partenaire stratégique de l’Azerbaïdjan, auquel elle est liée par la proximité linguistique et culturelle. Elle est aussi son premier fournisseur. Ankara suit de très près le conflit du Haut-Karabagh, dont la résolution constitue une condition à la normalisation de ses relations avec l’Arménie. La position géographique de la Turquie en fait le débouché des routes et des ressources caucasiennes vers l’Europe.
Troisième puissance régionale : l’Iran. Il compte une communauté azérie estimée à 25 millions de personnes, soit plus qu’en Azerbaïdjan même. Bakou et Téhéran entretiennent des relations complexes, ce qui tient en partie au fait que ces deux pays à majorité chiite ont des modèles politiques radicalement différents. L’Iran constitue actuellement le seul débouché méridional de l’Arménie et souhaite profiter de sa réintégration dans la communauté internationale après la signature de l’accord sur le nucléaire l’an dernier pour promouvoir son projet d’axe nord-sud transitant par le Caucase du Sud.
En conséquence de cet enchevêtrement d’enjeux locaux et régionaux et de la dislocation brutale de l’Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) en 1991, la région est marquée par trois conflits territoriaux non résolus, appelés parfois improprement « conflits gelés ». Le plus virulent d’entre eux est celui du Haut-Karabagh, qui oppose, depuis 1988, l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Notre pays est directement impliqué dans sa résolution depuis 1992, d’abord en tant que membre, puis, à partir de 1997, en qualité de co-président du groupe de Minsk de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), qui est chargé de la médiation entre les parties. Notre rôle de médiateur nous impose un devoir rigoureux d’équilibre et d’impartialité entre lesdites parties.
En avril dernier, nous avons pu voir à quel point la qualification de « conflit gelé » était impropre en ce qui concerne le Haut-Karabagh : les affrontements qui s’y sont déroulés ont été si violents qu’on les a qualifiés de « guerre des quatre jours ». Sans l’action diplomatique menée par la coprésidence du groupe de Minsk, qui a permis de rétablir un certain calme sur le terrain, les affrontements auraient pu conduire à une crise grave qui, impliquant d’une façon ou d’une autre la Russie et la Turquie, aurait pris, dès lors, une tout autre ampleur. Malgré la reprise des négociations entre Bakou et Erevan en juin dernier, ce risque demeure, et je crains qu’il ne soit en train de s’aggraver après la relative accalmie de cet été. Le co-président français du groupe de Minsk évoquera de manière plus détaillée la situation actuelle au Haut-Karabagh lorsque vous l’auditionnerez. Pour ma part, en ce qui concerne les relations bilatérales, je considère que la persistance de ce risque rend d’autant plus nécessaire le maintien de rapports de confiance tant avec l’Azerbaïdjan qu’avec l’Arménie, afin que nous puissions poursuivre de manière efficace et crédible notre travail de co-médiation.
Tel est le contexte régional dans lequel évoluent nos relations avec les trois États du Caucase du Sud. L’enjeu pour nous, depuis la disparition de l’URSS, est de contribuer à la stabilité de cette région en accompagnant chacun de ces pays vers la démocratie et le développement. Il s’agit également de favoriser la résolution négociée des conflits – je l’ai dit –, la coopération régionale et un partenariat aussi étroit que possible entre ces pays et l’Union européenne.
J’en viens à la relation bilatérale franco-azerbaïdjanaise. Je la présenterai en abordant successivement trois thèmes : le dialogue, les échanges et l’influence.
Le dialogue politique constitue le premier pilier de nos relations avec l’Azerbaïdjan. Les visites et les entretiens bilatéraux sont réguliers. Nous vous en avons communiqué une liste exhaustive, qui figure aussi sur le site internet du ministère.
Pour m’en tenir à l’année en cours, le Président de la République s’est entretenu avec son homologue azerbaïdjanais le 9 juillet en marge du sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) à Varsovie. Il a mis à profit cette occasion pour s’entretenir également avec son homologue arménien. Au niveau ministériel, le ministre azerbaïdjanais des affaires étrangères a effectué deux visites à Paris cette année, en mai et septembre, au cours desquelles il s’est entretenu avec le ministre des affaires étrangères et avec le secrétaire d’État chargé des affaires européennes, M. Harlem Désir. Celui-ci s’était rendu à Bakou le 26 avril pour des entretiens avec le président et le ministre azerbaïdjanais des affaires étrangères. J’ajoute que le dialogue par le biais des deux ambassades est très régulier.
Ce dialogue est franc et ouvert à tous les niveaux. Il porte non seulement sur l’ensemble de nos échanges et de notre coopération, mais aussi sur les questions de démocratie et de droits de l’Homme : le porte-parole du Quai d’Orsay est intervenu régulièrement sur ces questions au cours des derniers mois et des dernières années – je tiens la liste de ses prises de position à votre disposition. En outre, la France mène avec l’Azerbaïdjan un dialogue intense et discret à ce sujet au plus haut niveau politique : le Président de la République a écrit à son homologue azerbaïdjanais à plusieurs reprises, notamment au sujet de Leyla et Arif Yunus. Ces questions font partie de notre relation bilatérale. Nous les abordons sans tabou, avec calme et sérénité. Cette sérénité fait que nos messages sont, je crois, appréciés et écoutés.
Je précise que, compte tenu de notre rôle de co-président du groupe de Minsk, nous veillons toujours à maintenir, autant que possible, un équilibre dans notre dialogue avec Bakou et Erevan. Nous avons été particulièrement attentifs au respect de ce principe dans la période qui a suivi la « guerre des quatre jours » : le secrétaire d’État chargé des affaires européennes avait fait précéder son déplacement à Bakou le 26 avril d’une étape à Erevan ; selon le même principe d’équilibre, les ministres des affaires étrangères arménien et azerbaïdjanais ont eu, l’un et l’autre, des entretiens au Quai d’Orsay en mai et en septembre.
Deuxième pilier de notre relation bilatérale : les échanges économiques, sur lesquels Mme Sandrine Gaudin reviendra certainement de manière plus précise cet après-midi. Le volume de notre commerce bilatéral avec l’Azerbaïdjan est important : il a atteint 1,3 milliard d’euros en 2015, chiffre néanmoins en légère baisse par rapport à 2014 en raison de la crise économique qui touche le pays. Notre balance commerciale est clairement déficitaire, à cause du poids de nos importations d’hydrocarbures, qui s’élèvent à 1,1 milliard d’euros.
Malgré ce déficit, la France est un investisseur important en Azerbaïdjan : en 2014, elle a été la cinquième source d’investissements directs étrangers dans ce pays. Je citerai quelques secteurs dans lesquels les entreprises françaises sont présentes et actives. Dans le secteur de l’énergie, Total participe au développement du gisement gazier offshore d’Apchéron. Le secteur des transports a représenté le tiers de nos exportations en 2015, notamment avec la fourniture de 150 bus Iveco et de trois rames de métro Alstom à la ville de Bakou. Dans le secteur de l’environnement, Suez a signé en 2014 un contrat de formation et de transfert de savoir-faire avec la compagnie nationale de l’eau Azersu. Enfin, le secteur des produits chimiques, parfums et cosmétiques constitue également un poste important de nos exportations.
La conjoncture est devenue moins favorable du fait des difficultés budgétaires que connaît l’Azerbaïdjan en conséquence de la chute du prix des hydrocarbures. Cependant, la volonté des autorités azerbaïdjanaises de diversifier leur économie ouvre des perspectives intéressantes pour notre diplomatie économique. Notre ambassadrice, que vous auditionnerez prochainement, est très active en la matière. De nombreuses entreprises françaises ont marqué leur intérêt pour ce processus de diversification, qui prendra du temps, mais correspond à un vrai besoin de l’économie azerbaïdjanaise.
Il va de soi que l’activité de nos entreprises est totalement compatible avec nos obligations internationales, notamment l’embargo décrété par l’OSCE sur les ventes d’armes destinées aux forces engagées dans le conflit du Haut-Karabagh.
Troisième pilier de notre relation avec l’Azerbaïdjan : la politique d’influence. Elle a connu un essor tout à fait significatif au cours des cinq dernières années, sous l’impulsion directe des chefs d’État français et azerbaïdjanais. La coopération culturelle et universitaire recèle encore un fort potentiel. Je citerai deux réalisations emblématiques de la qualité de notre relation dans ce domaine. En 2013 a été inauguré le lycée français de Bakou, établissement homologué par la Mission laïque française, qui compte aujourd’hui une centaine d’élèves et pourrait en accueillir, à terme, trois cent cinquante. Le 15 septembre dernier, le ministre azerbaïdjanais de l’éducation et notre ambassadrice à Bakou ont inauguré l’Université franco-azerbaïdjanaise (UFAZ), qui sera pilotée, du côté azerbaïdjanais, par l’Université du pétrole et de l’industrie de Bakou et, du côté français, par l’université de Strasbourg, qui définira les programmes et fournira les enseignants. De même qu’en Arménie, où l’Université française d’Arménie (UFAR) a considérablement renforcé notre présence dans le milieu universitaire, nous espérons que l’UFAZ pourra contribuer à la formation des élites et pérenniser l’influence française en Azerbaïdjan.
Au titre de l’influence, je mentionne également la coopération décentralisée, révélatrice du développement et de la diversification de notre relation avec l’Azerbaïdjan. Depuis 2012, treize accords de coopération ont été signés entre des collectivités azerbaïdjanaises et françaises, parmi lesquelles Cognac, Mulhouse, Chablis, Megève, Colmar, Évian-les-Bains et le département de l’Yonne, pour ne citer que les plus récents. Un comité de pilotage, dont la création a été décidée par les deux gouvernements en novembre 2015, doit débuter ses travaux d’ici à la fin de l’année, pour donner de la cohérence et une plus grande visibilité à cette coopération. Au regard des partenariats déjà engagés, nous escomptons que le développement de la coopération décentralisée permettra la diversification de nos échanges et de notre influence dans quatre domaines principaux : le tourisme, l’agriculture, l’éducation et la formation professionnelle, la valorisation du patrimoine culturel. Telles sont les pistes sur lesquelles nous travaillons en liaison avec les collectivités territoriales.
Pour conclure, permettez-moi de rappeler les enjeux politiques de notre relation bilatérale avec l’Azerbaïdjan : maintenir un dialogue régulier et global pour promouvoir notamment la démocratie et la paix, à commencer par la résolution du conflit du Haut-Karabagh et la réconciliation arméno-azerbaïdjanaise ; développer et diversifier nos échanges à un moment où l’Azerbaïdjan réfléchit au modèle qu’il souhaite adopter à l’ère du « post-pétrole » ; conforter notre influence à long terme, car la paix et la démocratie sont inévitablement des enjeux à long terme. Ces éléments constituent le dénominateur commun de notre présence et du rôle que nous voulons jouer, à l’échelle de nos moyens, dans cette région.
M. le président François Rochebloine. Merci, madame la directrice. J’ai un certain nombre de questions complémentaires.
Quel est l’impact des considérations de politique énergétique – sécurité et maîtrise de la production, conditions d’exportation – dans le rapprochement récemment annoncé entre Ankara et Moscou, au-delà de la construction d’un gazoduc ?
Quel est l’état des relations politiques, d’une part, et économiques, d’autre part, entre les États-Unis et l’Azerbaïdjan ?
Dans un document officiel que vous connaissez sans doute, on peut lire : « La faible diversité de l’économie locale, la vulnérabilité de ses comptes extérieurs aux fluctuations des cours de matières premières, la mauvaise gestion des ressources, la corruption, un climat des affaires difficile et l’absence de concurrence risquent de faire obstacle au développement à long terme du pays. » Que pensez-vous de cette analyse ? À votre connaissance, comment se caractérise la corruption en Azerbaïdjan, notamment dans le domaine des affaires ? Les entreprises françaises ont-elles été mises en garde contre les facteurs de risque énumérés dans cette citation, notamment contre la corruption ?
Parmi les facteurs d’instabilité habituellement mentionnés figurent les différends frontaliers en suspens entre l’Azerbaïdjan et l’Iran, qui portent sur l’application ou la non-application des accords passés entre l’URSS et l’Iran en 1921 et 1940 sur la Caspienne. Qu’en est-il ?
La France est-elle disposée à subordonner la reprise des négociations sur l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan, suspendues en 2014, à des garanties réelles et sérieuses d’amélioration des droits de l’Homme ?
Quelle appréciation la France porte-t-elle sur la situation des organisations non gouvernementales (ONG) en Azerbaïdjan, notamment au regard de la législation restrictive de 2013 ?
Mme Florence Mangin. Les ONG ne sont pas interdites en Azerbaïdjan, mais elles doivent travailler dans un cadre très strict, qui se traduit, de fait, par un contrôle permanent des autorités sur leurs activités et leur financement. Plusieurs d’entre elles ont été amenées à limiter, voire à suspendre leurs activités, sous la menace de poursuites administratives et judiciaires. Nous notons un durcissement récent de l’attitude des autorités azerbaïdjanaises à l’égard des ONG. Le mois dernier, les ambassades des pays de l’Union européenne représentés à Bakou ont écrit aux autorités azerbaïdjanaises à ce sujet en donnant un certain nombre d’exemples – que je n’ai pas à indiquer ici.
Les discussions sur un nouvel accord entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan, destiné à remplacer l’accord de partenariat et de coopération (APC) de 1996, avaient été suspendues à l’automne 2014 précisément à cause de la situation des droits de l’Homme dans ce pays. Depuis lors, ces relations se sont apaisées, Bakou ayant pris des mesures significatives en faveur de plusieurs personnalités emprisonnées dont le Parlement européen demandait la libération. Le cas le plus emblématique était celui de Leyla et Arif Yunus. Depuis ces libérations, l’Union européenne a décidé de reprendre les travaux. Le 29 février dernier, Mme Federica Mogherini, Haute Représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, s’est rendue à Bakou pour prendre acte de l’amélioration de la situation et relancer la négociation du nouvel accord. Les États membres discutent actuellement du mandat de négociation en groupe de travail. Sans entrer dans le détail – je n’ai pas à le faire –, ces discussions se passent plutôt bien, dans un esprit à la fois cordial et constructif, et nous espérons qu’elles seront achevées d’ici à la fin de l’année. La question des droits de l’Homme fera évidemment partie du vaste éventail des sujets qui seront traités dans l’accord, aux côtés de la gouvernance, de l’État de droit et de la démocratie, car il convient d’adopter une approche large en la matière.
En ce qui concerne la mer Caspienne et les différends à propos de l’application des accords signés en 1921 et 1940 entre l’URSS et l’Iran, deux problèmes distincts, mais liés entre eux, se posent.
Le premier, sans doute le plus important, est la fixation du régime juridique de la mer Caspienne – qui n’est pas couverte, je le rappelle, par la convention des Nations unies sur le droit de la mer, dite convention de Montego Bay. Les cinq États riverains négocient depuis une vingtaine d’années un traité à ce sujet. La dernière étape significative a été la signature, à l’issue du sommet des cinq chefs d’État qui s’est tenu à Astrakhan en septembre 2014, d’une déclaration qui donne les grandes lignes du futur accord. On semble se diriger vers la solution juridique promue par Moscou et Téhéran, à savoir celle d’un condominium sur la mer plutôt que celle d’un partage pur et simple entre les cinq États. Au-delà des 25 milles nautiques à partir des côtes, la déclaration fait référence à une « zone commune », au sein de laquelle les activités d’exploitation du sol et du sous-sol seraient soumises à la règle du consensus ou de l’unanimité. Cela donnerait donc un droit de veto à chaque État, dont la Russie, sur la construction d’oléoducs ou de gazoducs à travers la Caspienne. On voit se dessiner les linéaments d’un accord, mais on peut estimer que les discussions à venir seront difficiles, car un tel droit de veto ne plaît pas nécessairement à tout le monde.
Le deuxième problème est le différend frontalier non résolu qui oppose l’Azerbaïdjan, l’Iran et le Turkménistan au sujet du gisement d’Alov, qui renfermerait d’importantes quantités de gaz naturel. Ce différend constitue un handicap pour les États et les autres partenaires intéressés, car il empêche toute recherche et toute exploitation dudit gisement. Il fait l’objet de discussions relativement discrètes et confidentielles.
S’agissant de la corruption, je vous avoue ne pas connaître le passage que vous avez cité.
M. le rapporteur. Il s’agit d’un extrait de la page de présentation de l’Azerbaïdjan publiée sur le site internet du ministère des affaires étrangères.
Mme Florence Mangin. Le problème de la corruption n’est pas spécifique à l’Azerbaïdjan : on le retrouve assez fréquemment dans la zone que je couvre, des Balkans à la Russie, en passant par l’Asie centrale et le Caucase du Sud. C’est évidemment un problème pour nos entreprises : dans certains cas, alors que les besoins existent et que l’offre française y répond de manière évidente, il arrive que le mauvais climat des affaires, l’absence de transparence et les pratiques de corruption empêchent le développement des contrats en question. J’ai plusieurs cas précis en tête dans des pays de ma zone, mais aucun en Azerbaïdjan en ce moment. Bien évidemment, les entreprises sont informées de la situation par la direction des entreprises du Quai d’Orsay, par Bercy, par Business France et par notre ambassade – Mme Sandrine Gaudin pourra vous en parler mieux que moi. Chaque fois qu’un cas problématique est connu, le réseau de la diplomatie économique se mobilise et pointe très précisément le sujet auprès des acteurs politiques et économiques locaux. La fluidité qui existe désormais entre les différents services concernés fait que nous sommes beaucoup plus efficaces pour intervenir et soutenir nos entreprises, lorsque cela s’avère nécessaire, et que nous pensons que cela peut être utile.
Ces préoccupations figurent évidemment en haut de la liste dans le cadre de notre accompagnement de l’Azerbaïdjan vers l’Union européenne. Nous devrons exercer une vigilance particulière à ce sujet dans le cadre du nouvel accord dont le mandat est en cours de discussion : il faut encourager l’Azerbaïdjan à adopter le maximum de règles de transparence, lesquelles constituent un élément commun à tous les États de l’Union européenne et correspondent à des normes de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). C’est par ce biais technique et concret que nous pourrons améliorer la situation. Ces règles de transparence n’empêchent pas les pratiques, mais elles les rendent plus compliquées.
La relation entre les États-Unis et l’Azerbaïdjan est très importante, plus importante néanmoins en termes politiques et de sécurité qu’en termes économiques.
L’approche des États-Unis vis-à-vis de l’Azerbaïdjan a très longtemps consisté à tenter de détacher ce pays de l’influence russe, notamment en apportant un soutien politique et probablement financier au GUAM, groupe constitué par la Géorgie, l’Ukraine, l’Azerbaïdjan et la Moldavie, quatre anciennes républiques soviétiques marquées par des différends territoriaux dans lesquels la Russie joue un rôle prépondérant. Aujourd’hui, la politique américaine à l’égard de l’Azerbaïdjan est essentiellement mue par les défis de sécurité dans le Caucase du Sud : Washington se soucie en premier lieu de la sécurité énergétique de ses alliés, mais aussi de la lutte contre les filières et les circuits du terrorisme international, le Caucase du Sud étant à la fois une région très fragile et une zone de transit.
Les États-Unis sont co-président du groupe de Minsk aux côtés de la Russie et de la France. Ils souhaitent contribuer aux négociations pour le règlement du conflit et le font. Leur dernière initiative en date a été l’organisation en mai, à Vienne, d’une réunion au format dit « 3+2 », c’est-à-dire avec les présidents arménien et azerbaïdjanais et les trois ministres des affaires étrangères du groupe de Minsk. Ce format, avec la présence des trois médiateurs au niveau politique, au-delà des représentants habituels, doit nous inspirer pour la suite. La réunion de Vienne a, à l’évidence, donné une impulsion : elle a créé un minimum de confiance entre les parties, qui en ont très peu l’une pour l’autre, et a abouti à un corps de décisions, dont la mise en œuvre s’avère néanmoins assez compliquée. Nous ne pouvons que saluer cette initiative américaine et ses résultats.
Les États-Unis ne font pas partie des tout premiers partenaires économiques de l’Azerbaïdjan : en 2015, ils se sont classés au cinquième rang des partenaires commerciaux du pays, derrière l’Italie, la Russie, la Turquie et la France. De manière générale, ils sont soucieux d’entretenir un dialogue avec Bakou sur toutes les questions de développement, de gouvernance et de sécurité.
Les contacts bilatéraux entre les deux pays sont relativement fréquents, à la mesure de l’intérêt que présente l’Azerbaïdjan pour les États-Unis. Le président Aliev a été reçu par le président Obama en mars dernier, en marge du sommet sur la sécurité nucléaire à New York. Au mois de février précédent, l’envoyé spécial du Département d’État pour les affaires énergétiques internationales avait participé à une réunion à Bakou sur le Corridor sud. On voit bien l’intérêt spécifique des Américains pour la dimension énergétique.
La relation entre la Turquie et l’Azerbaïdjan est ancienne, étroite et fidèle, compte tenu notamment de la proximité culturelle et linguistique entre les deux pays. Au lendemain de la tentative de coup d’État en Turquie le 15 juillet dernier, Ankara a demandé à plusieurs de ses partenaires de « faire le ménage » chez eux, en faisant la chasse aux gülenistes. Bakou a répondu positivement à l’appel, ce qui n’a pas manqué de créer un certain trouble dans la communauté internationale.
Au titre de ses relations avec ses voisins, la Turquie a un intérêt évident à la résolution du conflit du Haut-Karabagh. Elle en a fait une condition sine qua non à la normalisation de ses relations avec l’Arménie. Cependant, nos interlocuteurs turcs, avec lesquels nous abordons de nombreux sujets, – par exemple l’ambassadeur de Turquie, que je reçois régulièrement – nous parlent très rarement du Haut-Karabagh. Nous savons qu’ils suivent le sujet de près. Peut-être même sont-ils actifs : il est notamment possible qu’ils passent des messages aux Azerbaïdjanais pour les inciter à faire preuve de souplesse dans la négociation. Mais ils n’évoquent guère la question. Cette discrétion est inversement proportionnelle à l’importance du sujet pour eux.
M. Jean-François Mancel. Je vous remercie, madame la directrice, pour la concision, la clarté et la pertinence de votre propos. Vous avez parfaitement montré les très bonnes relations qui existent entre la France et l’Azerbaïdjan.
Permettez-moi un aparté, monsieur le président : vous avez fait part de la préoccupation de la mission d’information quant à la situation des droits de l’Homme en Azerbaïdjan ; or je ne partage pas votre point de vue. S’il fallait constituer une mission d’information sur chaque pays ayant des problèmes en matière de droits de l’Homme, il faudrait le faire vraisemblablement pour tous les membres de l’Organisation des Nations unies ! Cette remarque vaut d’ailleurs aussi pour les problèmes de corruption.
Il me paraît plus intéressant de relever la volonté d’indépendance de l’Azerbaïdjan, alors même que sa situation est plutôt compliquée : au Nord, il a pour voisin la Russie, ancien pays sous la domination duquel il a vécu à l’époque des Tsars et pendant le régime soviétique ; à l’Ouest, il se retrouve en guerre avec l’Arménie, qui occupe 20 % de son territoire ; au Sud, il est frontalier de l’Iran, dont chacun connaît la situation politique et religieuse. Or, depuis sa renaissance en 1991, l’Azerbaïdjan s’est toujours efforcé d’être indépendant. Il a notamment refusé, à la différence de l’Arménie, de rejoindre l’Union économique eurasiatique lancée par la Russie. Il a des positions très équilibrées tant par rapport à Moscou que par rapport à Téhéran. Pouvez-vous nous en dire plus, madame la directrice, sur ce positionnement assez original dans la région ? C’est en partie ce qui justifie les bonnes relations qu’entretiennent l’Azerbaïdjan et notre pays, lequel cultive lui aussi, ou a cultivé pendant longtemps, une volonté d’indépendance.
Mme Florence Mangin. Il est exact que la volonté d’indépendance manifestée par l’Azerbaïdjan est singulière et forte, et que cela nous motive, si besoin en était, pour renforcer notre accompagnement de ce pays.
La relation de l’Azerbaïdjan avec la Russie est en effet compliquée. Alors que, pendant longtemps, la Russie a été un pourvoyeur de sécurité à la seule Arménie, elle vend désormais des armes aussi à l’Azerbaïdjan. Vu de Bakou, la Russie est un voisin important et considéré. Pour autant, vous avez tout à fait raison, monsieur le député : l’Azerbaïdjan a à cœur d’entretenir une relation de qualité et de confiance avec les pays occidentaux, notamment avec les États-Unis et avec l’Union européenne. La reprise des discussions entre l’Union et l’Azerbaïdjan, en février dernier, en vue de conclure un nouvel accord, c’est-à-dire de recréer un cadre de coopération concret, est un élément essentiel. L’absence d’un tel cadre constituait une anomalie. C’est pour cette raison que nous avons tous insisté, collectivement, pour que les autorités azerbaïdjanaises prennent les décisions attendues en matière de droits de l’Homme.
Il faut aussi dire un mot de l’OTAN. L’Azerbaïdjan fait partie du Partenariat pour la paix depuis 1994, ce qui facilite la connaissance mutuelle et crée une relation de confiance. Pour autant, les autorités azerbaïdjanaises n’ont jamais manifesté l’intention d’adhérer à l’OTAN.
Mentionnons toutefois un bémol dans les relations de l’Azerbaïdjan avec les organisations internationales, qui constitue, pour nous, un sujet de déception : les autorités azerbaïdjanaises ont une approche rigoureuse et restrictive à l’égard de l’OSCE. Elles ont demandé la fermeture du bureau de l’OSCE à Bakou. Nous estimons que cela n’est pas irréversible. Nous évoquons la question chaque fois que nous voyons nos partenaires azerbaïdjanais, en les incitant à adopter une approche cohérente avec celle qu’ils ont à l’égard de leurs autres partenaires, l’Union européenne, l’OTAN ou l’OCDE.
Il est en effet notable que l’Azerbaïdjan a constamment refusé d’adhérer à l’Union économique eurasiatique. Lorsque l’on sait l’importance que la Russie accorde à ce processus et la force avec lequel elle le conduit, c’est, à l’évidence, une marque d’indépendance tout à fait remarquable.
L’Azerbaïdjan mène effectivement une diplomatie multi-vectorielle, que nous souhaitons accompagner. À cet égard, nous aimerions que ses rapports avec l’OSCE soient pacifiés.
M. le président François Rochebloine. Dans le passé, la Russie a vendu des armes à l’Arménie – j’ai pu le constater –, mais il semble qu’elle en vend désormais davantage à l’Azerbaïdjan qu’à l’Arménie, vis-à-vis de laquelle elle a adopté une politique plus restrictive. Qu’en est-il ?
Mme Florence Mangin. Nous ne disposons pas nécessairement de données très précises sur les ventes d’armes, mais il est exact que des livraisons d’armes russes à l’Azerbaïdjan au cours de la période récente ont permis un rééquilibrage du rapport de forces entre les deux parties.
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. Merci, madame la directrice, pour votre exposé liminaire.
Quel est le poids des populations d’origine azérie en Turquie ? Comment cela influence-t-il la qualité des relations entre la Turquie et l’Azerbaïdjan ?
Mme Florence Mangin. Je ne connais pas le chiffre de la population azérie en Turquie.
En Iran, il y a environ 25 millions d’Azéris, à comparer aux 9,5 millions d’habitants en Azerbaïdjan même.
M. le rapporteur. Vous avez indiqué que l’Azerbaïdjan était partenaire de l’OTAN. Comment ce partenariat évolue-t-il ? Comment le pays se positionne-t-il vis-à-vis de l’élargissement de l’OTAN ? Quelles positions prend-il sur les sujets qui opposent assez régulièrement la Russie et les pays de l’OTAN ? Prend-il des positions claires sur ces sujets ?
Mme Florence Mangin. La participation de l’Azerbaïdjan au Partenariat pour la paix est une illustration de sa volonté d’autonomie et d’équilibre entre les différents partenaires. C’est à la fois un symbole et un signe politique. En revanche, l’Azerbaïdjan n’a jamais manifesté son intérêt pour une adhésion à l’OTAN, contrairement à la Géorgie qui souhaite très fortement s’engager dans une démarche d’intégration.
Sur les sujets opposant la Russie à l’OTAN, l’Azerbaïdjan reste très prudent et discret. En raison du conflit du Haut-Karabagh, il privilégie logiquement les principes d’intégrité territoriale et de non-ingérence. Lors de la crise ukrainienne, qu’il a observée de très près, il est d’abord resté très en retrait face aux événements de Maïdan. Après l’annexion de la Crimée par la Russie, il a affiché un soutien à l’intégrité territoriale de l’Ukraine, mais de manière peu déclamatoire. Il a voté la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies en ce sens.
M. le rapporteur. Vous avez évoqué les investissements français en Azerbaïdjan. Quels sont les investissements azerbaïdjanais en France. Quelles sont, par ailleurs, les interventions de la fondation Heydar Aliev dans notre pays ? Est-elle active dans d’autres États européens ?
En matière de diplomatie sportive, quelle est la présence de l’Azerbaïdjan en France, qu’il s’agisse des hommes ou des entreprises ? Quelles sont les différentes contributions financières accordées par les Azerbaïdjanais pour l’organisation de manifestations sportives ou en tant que détenteurs de clubs sportifs ? Nous connaissons tous ici le cas du Racing Club de Lens (RC Lens).
Mme Florence Mangin. La Fondation Heydar Aliev mène une diplomatie culturelle très active en France, soit à travers des opérations de mécénat relatives au patrimoine, parfois en liaison avec l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), soit à travers l’organisation d’événements culturels ou de promotion touristique, visant à faire connaître l’Azerbaïdjan en France. Je pense notamment à l’opération « Village d’Azerbaïdjan », dont la troisième édition a eu lieu cette année dans le 7e arrondissement de Paris. La fondation œuvre également dans d’autres pays européens, notamment en Belgique, en Italie et en Allemagne. Elle est un important vecteur d’influence. Il serait d’ailleurs plus juste de parler de diplomatie culturelle et d’influence que d’investissement.
En ce qui concerne la diplomatie sportive, nous avons en effet tous en tête le cas du RC Lens : le club avait été acquis par un investisseur azerbaïdjanais, mais celui-ci a dû se retirer en mai dernier car sa société faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. À ma connaissance, il n’y a pas d’autre investissement azerbaïdjanais en cours dans le domaine du sport. Notons que la Société pétrolière nationale de la République d’Azerbaïdjan (SOCAR) a été l’un des partenaires de l’Union des associations européennes de football (UEFA) pour l’Euro 2016.
Pour les autres secteurs, d’après ce que nous dit l’ambassadeur d’Azerbaïdjan à Paris, son pays s’intéresse beaucoup au domaine du tourisme, qui constitue, vous le savez, un élément d’attractivité de notre territoire. Cependant, à ce stade, il n’y a pas de concrétisation en la matière.
M. Marcel Rogemont. La France participe à la mission de bons offices sur le conflit du Haut-Karabagh. Un chemin se dessine-t-il qui permettrait aux parties de faire au moins quelques pas ensemble ?
Mme Florence Mangin. La France est un médiateur actif et attentif, qui entretient des relations de bonne qualité avec les deux parties. Telle est la condition de la crédibilité de toute œuvre de médiation.
Au moment de la « guerre des quatre jours », la coprésidence du groupe de Minsk a été très active pour faire cesser les combats et a eu gain de cause. Mais, soyons honnêtes, c’est la voix russe qui a été prépondérante au sein du « trio » du groupe du Minsk. Nous en sommes d’ailleurs heureux : si ces affrontements d’une rare violence n’ont duré que quatre jours, c’est grâce à l’intermédiation très active de la Russie.
Le groupe de Minsk a repris son travail de bons offices à trois très rapidement. La conférence de Vienne, que j’ai mentionnée précédemment, a été très utile. Elle a permis un accord sur trois sujets : le respect du cessez-le-feu ; l’instauration de deux mesures de confiance de l’OSCE, à savoir, d’une part, le renforcement de l’équipe du représentant personnel du président en exercice de l’OSCE sur le terrain et, d’autre part, la création d’un mécanisme d’investigation sur les violations du cessez-le-feu ; la poursuite des négociations sur le règlement du conflit. Il n’était pas du tout évident que ce troisième point ferait l’objet d’un accord : nous avons tous craint, après la « guerre des quatre jours », que la voie de la négociation ne fût fermée à tout jamais.
Sur les trois engagements de Vienne, seul le premier a été vraiment tenu : le cessez-le-feu est globalement respecté, même si quelques violations se produisent en ce moment, après une accalmie notable cet été. En revanche, les deux mesures de confiance peinent à être appliquées, car elles se heurtent à un refus assez marqué de la part de l’Azerbaïdjan.
Depuis la réunion de Vienne, le ministre des affaires étrangères, M. Lavrov, fait la navette entre Bakou et Erevan pour tenter d’obtenir l’accord des parties sur un plan russe de règlement du conflit par étapes. Le président Poutine a reçu ses homologues arménien et azerbaïdjanais en juin à Saint-Pétersbourg pour évoquer ce plan. Force est de constater que les discussions en cours, importantes en soi, n’aboutissent pas à grand-chose pour l’instant. Lors de chaque entretien politique, la France marque sa disponibilité pour accompagner et compléter les efforts russes – il serait inapproprié de nous poser en alternative à ces efforts – sur la base des travaux qui avaient été menés à Paris en octobre 2014. Cette disponibilité a notamment été réaffirmée par le Président de la République à ses homologues arménien et azerbaïdjanais en juillet dernier en marge du sommet de l’OTAN à Varsovie. Nous avons offert d’organiser un nouveau sommet sur le modèle de celui d’octobre 2014. Cependant, cela suppose au préalable de progresser vers un accord.
M. Marcel Rogemont. Quelle est la valeur ajoutée de la France au sein du groupe de Minsk ?
Mme Florence Mangin. Nous voyons très bien quelle est cette valeur ajoutée en ce moment. Si les efforts de médiation des Russes, tout à fait réels et louables, n’aboutissent pas, nous avons le sentiment, sans certitude ni arrogance, que nous pouvons les compléter en abordant l’ensemble des éléments d’un règlement : il s’agit notamment de la restitution des districts azerbaïdjanais et de l’exercice du droit à l’autodétermination du Haut-Karabagh. Tant qu’on n’inclut pas tous ces éléments, on peut comprendre que la très grande défiance qui existe entre les deux parties demeure, puisque l’une des deux ne voit pas les points qui l’intéressent détaillés de la même manière. Dans la mesure où nous entretenons avec les deux pays des relations de qualité et équilibrées, nous pouvons faire une proposition qui restaure un peu la confiance.
M. François Loncle. Qui est le responsable français au sein du groupe de Minsk ? Ce diplomate est-il employé à plein temps pour le groupe de Minsk ? De combien de personnes est-il entouré ?
Mme Florence Mangin. Le diplomate représentant de la France à la coprésidence du groupe de Minsk est, depuis 2014, M. Pierre Andrieu. C’est un ancien ambassadeur, russophone, qui connaît bien la zone. Il est employé à plein temps sur ce sujet, sachant qu’il a une deuxième casquette : il est aussi ambassadeur thématique chargé du Partenariat oriental de l’Union européenne. Depuis qu’il a pris ses fonctions en 2014, ce deuxième dossier ne l’a pas beaucoup occupé car il n’y a pas eu de sommet du Partenariat oriental au cours de cette période. En effet, le dialogue entre l’Union européenne et les pays du Partenariat oriental est essentiellement mené – de manière très satisfaisante – par nos collègues du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et par la Commission européenne. À ce titre, de fréquentes réunions sectorielles sont organisées à Bruxelles, auxquelles participent les ministres des six pays du Partenariat oriental, mais où les États membres sont spectateurs. On nous a annoncé récemment qu’un sommet du Partenariat oriental aurait lieu en 2017, sans doute sous présidence estonienne. Dans cette perspective, M. Andrieu aura donc davantage d’activité à déployer sur cette partie de ses responsabilités.
M. François Loncle. Encore neuf mois de vacances !
Mme Florence Mangin. M. Andrieu est aussi le coprésident français du groupe de Minsk. Il est entouré de ma direction, notamment du sous-directeur et du rédacteur compétents. Nous sommes, en quelque sorte, la « cheville ouvrière » de ses travaux : il accomplit sa mission de médiation sur la base des travaux préparatoires que nous lui fournissons.
M. le président François Rochebloine. Notre mission auditionnera M. Pierre Andrieu.
M. Jean-François Mancel. Pouvez-vous nous rappeler précisément la position de la France sur le conflit du Haut-Karabagh ? Ainsi que vous l’avez souligné très justement, la France a vraiment un rôle à jouer.
Le président Rochebloine a fait part tout à l’heure de sa préoccupation sur la question des droits de l’Homme. L’Azerbaïdjan est un pays qui n’a que vingt-cinq ans d’âge. Où en était donc la France vingt-cinq ans après 1789 en matière de droits de l’Homme ? Rappelons que l’Azerbaïdjan a accordé le droit de vote aux femmes en 1918, soit vingt-sept ans avant la France !
Pour en revenir à la situation actuelle, avez-vous le sentiment, madame la directrice, que la situation en matière de droits de l’Homme évolue positivement ou bien qu’elle régresse ? Vous avez exprimé tout à l’heure votre préoccupation à l’égard des dispositions concernant le financement des ONG. Nous aurions besoin de précisions sur ce point, car le sujet est assez complexe : ce cadre vise aussi à éviter que des mouvements subversifs ne mènent, par l’intermédiaire d’organisations installées dans le pays, des actions qui pourraient porter atteinte à son intégrité ou à sa sécurité. Nous avons le même problème en France.
Mme Florence Mangin. La position de la France sur le conflit du Haut-Karabagh est claire et constante : nous considérons que la négociation est le seul moyen de le résoudre ; la violence, telle qu’elle a éclaté en avril dernier, a non seulement des conséquences catastrophiques pour les deux pays concernés, mais elle est aussi lourde de risques pour l’ensemble de la zone – ainsi que je l’ai indiqué, l’un des enjeux de notre diplomatie est la stabilité et la concorde dans cette zone. Tel est donc le premier élément de notre position : c’est non pas par un rapport de forces, mais uniquement par le dialogue, même s’il est lent et fastidieux, qu’une solution pourra être apportée.
Deuxième élément : nous sommes attachés à l’ensemble des principes dits « de Madrid », qui doivent structurer la solution à ce conflit. Je dis bien « l’ensemble », car tel est le problème aujourd’hui. Ces principes sont le non-recours à la force, l’intégrité territoriale ainsi que le droit à l’autodétermination. C’est en les imbriquant de manière très intime qu’une solution sera possible. Si l’on ne met en avant qu’un seul de ces principes, un accord est impossible. Il serait évidemment inapproprié, connaissant le rôle de la Russie dans la zone, de prétendre nous substituer à elle sans son accord, surtout dans le contexte actuel. Nous devons donc dialoguer avec Moscou sur ce point, sachant que d’autres sujets sont prioritaires actuellement. Nous devons présenter notre éventuelle initiative comme complémentaire de la leur. Si elle était perçue comme s’y substituant, elle serait vouée à l’échec.
M. Jean-François Mancel. Comment peut-on mettre en œuvre concrètement le principe d’autodétermination, dès lors qu’il n’y a presque plus d’Azerbaïdjanais sur les territoires considérés ? Il y a d’ailleurs un important problème de réfugiés en Azerbaïdjan.
Mme Florence Mangin. L’outil évident pour la mise en œuvre du principe d’autodétermination est le référendum. Les modalités d’un tel référendum sont très compliquées, mais ce n’est pas infaisable. Même si les deux conflits ne peuvent pas être comparés, nous avons le même problème, mutatis mutandis, pour la résolution de la crise dans le Donbass : comment y organiser des élections alors qu’il y a 1,8 million de personnes déplacées ? Néanmoins, il existe des précédents, et le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’Homme (BIDDH) de l’OSCE nous aide beaucoup à élaborer des propositions. Il faut prévoir un dispositif ad hoc. Ce n’est pas simple, mais on trouve toujours des modalités techniques. Il faut écrire les choses avec beaucoup de précision.
Sur la question des droits de l’Homme, la photographie actuelle est contrastée. Ainsi que je l’ai indiqué précédemment, l’Azerbaïdjan a pris des décisions tangibles pour libérer plusieurs prisonniers politiques, conformément à ce qui était demandé par la communauté internationale. Ces décisions ont permis la reprise des discussions avec l’Union. C’est évidemment un mieux, que nous avons salué de manière très claire et avec grand plaisir. Cependant, ainsi que je l’ai également évoqué, les ambassades européennes à Bakou relatent un durcissement de la situation au cours des derniers mois : les autorités azerbaïdjanaises restreignent la liberté d’expression ou entravent le fonctionnement de certaines ONG, et exercent des pressions sur certaines personnalités, sans toutefois les mettre en prison. C’est une source de préoccupation. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous fournir une liste de cas précis.
M. le président François Rochebloine. Madame la directrice, comme d’autres, je me suis rendu au Haut-Karabagh et je suis interdit de séjour en Azerbaïdjan. Cela peut se comprendre. En revanche, l’année dernière, mon collègue et ami René Rouquet, président de la délégation française à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), s’est vu d’abord attribuer, puis retirer un visa par l’Azerbaïdjan, alors qu’il devait se rendre à Bakou pour une réunion du bureau et de la commission permanente de l’APCE. La France a-t-elle réagi ? Je peux admettre que l’on interdise à un parlementaire de se déplacer à titre personnel, mais non à un représentant de la France à titre officiel.
Je souhaite bien sûr que l’on parvienne à faire la paix au Haut-Karabagh, dans l’intérêt des deux peuples : des Azerbaïdjanais, des Arméniens et des habitants du Haut-Karabagh. Du temps du président Chirac avait été élaboré un accord dit de Paris, qui avait été accepté par Heydar Aliev, père du président actuel, mais rejeté ensuite à Key West, aux États-Unis, un ou deux ans plus tard. Une réflexion est-elle encore engagée sur la base de cet accord ?
Mme Florence Mangin. Je n’étais pas en fonction à l’époque où le visa a été refusé à M. René Rouquet. Je suis persuadée que notre représentation permanente auprès du Conseil de l’Europe a réagi, compte tenu de sa qualité de président de la délégation française à l’APCE. Je peux rechercher l’information et vous faire connaître la réponse.
M. le président François Rochebloine. Pour sa part, l’APCE a décidé que ses commissions ne se réuniraient pas en Azerbaïdjan pendant deux ans.
Mme Florence Mangin. Les travaux qui ont conduit au sommet d’octobre 2014 s’inspiraient de l’accord de Paris – même si je ne peux pas vous dire ce qu’il en est ligne à ligne. Les éléments principaux de la position française, que j’ai résumée tout à l’heure, étaient déjà sur la table à l’époque. Il s’agit, malheureusement, d’un conflit ancien, sur lequel les discussions durent depuis vingt ans. En réalité, les fondamentaux n’ont pas vraiment changé.
M. Jean-François Mancel. Le problème que vous avez soulevé en matière de visas, monsieur le président, n’est pas spécifiquement azerbaïdjanais. On le rencontre partout : qu’aurait fait la France entre 1870 et 1914 si un membre du Congrès américain s’était rendu en Alsace-Lorraine ? Lorsqu’une personnalité se rend dans un territoire occupé par un autre pays, l’État qui considère que son territoire est occupé se méfie d’elle.
M. le président François Rochebloine. Encore une fois, je comprends que cette interdiction puisse être appliquée pour des déplacements à titre personnel.
M. Jean-François Mancel. Après l’invasion de la Crimée par la Russie, nous avons cessé de délivrer des visas à certaines personnalités russes importantes.
M. le président François Rochebloine. Je vous remercie, madame la directrice, pour la clarté et la précision de votre propos, tant dans votre exposé liminaire que dans les réponses que vous avez apportées à nos différentes questions.
*
* *
Ÿ Audition de Mme Sandrine Gaudin, chef du service des affaires bilatérales et de l’internationalisation des entreprises à la direction générale du Trésor (jeudi 13 octobre 2016)
M. le président François Rochebloine. Nous avons le plaisir d’accueillir Mme Sandrine Gaudin, responsable des affaires bilatérales et de l’internationalisation à la direction générale du Trésor.
Cette mission vise à faire le point sur les relations politiques et économiques entre la France et l’Azerbaïdjan au regard des objectifs de développement de la paix et de la démocratie dans le Caucase du Sud.
La croissance des revenus tirés de l’exportation de produits pétroliers a constitué jusqu’ici un puissant adjuvant au développement économique pour l’Azerbaïdjan, qui pourrait cependant commencer d’éprouver les conséquences des aléas qui affectent les cours mondiaux des matières premières, lesquels ont connu une nette tendance à la baisse ces derniers mois.
Pouvez-vous, madame, nous dresser à grands traits le tableau économique de l’Azerbaïdjan et nous présenter sa politique économique, y compris les mesures de diversification des activités économiques ? Quelle est la position de l’Azerbaïdjan concernant les projets d’oléoducs et de gazoducs servant à acheminer et à exporter les produits pétroliers vers l’Ouest ? Enfin, quel est l’état des relations commerciales entre la France et l’Azerbaïdjan ? À quel niveau se situent les investissements privés français en Azerbaïdjan – et inversement – et de quelle nature sont-ils ?
Mme Sandrine Gaudin, chef du service des affaires bilatérales et de l’internationalisation des entreprises à la direction générale du Trésor. Pour la France, l’Azerbaïdjan présente un enjeu de premier plan, même s’il traverse des difficultés économiques somme toute classiques en lien avec le faible niveau des cours des hydrocarbures. La présence française en Azerbaïdjan se confirme et s’appuie sur le vif intérêt que nos entreprises manifestent pour ce pays, en dépit du « trou d’air » dû à la conjoncture actuelle, qui incite la France à assurer un suivi plus étroit de certains projets de financements.
L’Azerbaïdjan est la première puissance économique du Caucase, et notre premier partenaire commercial dans la région. Il figure au quatrième rang des destinations des exportations françaises dans la Communauté des États indépendants (CEI), derrière la Russie, l’Ukraine et le Kazakhstan. Cette puissance énergétique, bien que modeste – elle assure 1,1 % de la production mondiale de pétrole et 0,5 % de la production mondiale de gaz – est un partenaire stratégique pour la France et l’Union européenne, car il nous permet de diversifier nos sources d’approvisionnement énergétique et d’éviter de nous cantonner aux fournitures de pétrole et de gaz en provenance de la Russie, du Golfe et d’Afrique du Nord.
M. le président François Rochebloine. Peut-on considérer l’Azerbaïdjan comme un pays émergent ?
Mme Sandrine Gaudin. Oui, et même davantage, puisqu’il n’est déjà plus éligible à un certain nombre d’instruments d’appui aux exportations en raison de son niveau de richesse.
La relation économique et commerciale entre la France et l’Azerbaïdjan est forte. Un élan lui a été donné lors de la visite qu’y a effectuée le Président de la République en mai 2014 ; notons que dans les pays de la CEI, encore très centralisés, les relations personnelles entre chefs d’État ont un effet sur le volume des grands contrats. C’est ainsi que notre relation bilatérale s’appuie sur la réunion régulière d’une commission mixte ; de même, les visites officielles, a fortiori présidentielles, constituent des moments importants qui accélèrent la conclusion de contrats majeurs. La visite du Président Hollande en 2014 a donné lieu à la signature d’une multitude de contrats pour un montant de plus de 400 millions d’euros, ainsi qu’à la conclusion d’une dizaine d’accords de coopération.
Si l’Azerbaïdjan est riche de son énergie, il dépend largement de la rente qui en découle. De ce fait, sa croissance est fortement affectée par le choc de la baisse des prix au point qu’il est entré dans une phase de récession prononcée en 2016, son économie ayant connu une contraction de 1,9 %, même si une reprise est attendue pour 2017. Cette récession est comparable à celle que traversent plusieurs pays voisins, également producteurs de pétrole et de gaz.
M. le président François Rochebloine. Outre la baisse des cours, cette récession ne s’explique-t-elle pas également par la hausse des coûts de production à mesure qu’il faut forer plus profondément pour atteindre le pétrole ? Quel est l’état des stocks ?
Mme Sandrine Gaudin. L’Azerbaïdjan a atteint un pic de production de pétrole en 2010 avec 50 millions de tonnes. Ce volume n’a cessé de reculer depuis. L’objectif national de production s’établit à 42 millions de tonnes par an. Comme dans d’autres pays producteurs, la baisse de la production de pétrole s’accompagne d’une hausse parallèle de la production de gaz, qui constitue un relais de croissance. Ainsi, l’Azerbaïdjan n’exploitait que 9 milliards de mètres cubes de gaz en 2006 ; il en produit aujourd’hui 29 milliards. La recherche et l’exploitation du gaz se sont intensifiées à la suite de la découverte de l’un des plus grands gisements détectés au cours des vingt dernières années, celui de Shah Deniz.
Si la récession due à la chute des cours du pétrole et du gaz peut sembler forte, l’Azerbaïdjan s’appuie sur de solides bases économiques : le niveau d’endettement est très faible – de l’ordre de 20 % du PIB – et un fonds pétrolier souverain, le State Oil Fund of Azerbaïdjan (SOFAZ), détient entre 35 et 40 milliards de dollars d’actifs. Les perspectives de production de gaz sont immenses, car tous les gisements ne sont pas encore exploités. Les exportations de gaz vers la Turquie sont prometteuses, et plusieurs corridors sont en cours d’ouverture vers l’Union européenne, d’où des perspectives intéressantes qui pourront se concrétiser à partir de 2020.
Dans la région, le Kazakhstan est très affecté par la chute des cours du pétrole, qui a entraîné une dévaluation de la monnaie bien plus importante qu’en Azerbaïdjan. Le Turkménistan connaît lui aussi une récession. Comme ces deux pays, néanmoins, l’Azerbaïdjan demeure pour la France un enjeu majeur en termes de grands contrats pétroliers et gaziers. De ce point de vue, les entreprises françaises attendent que le trou d’air soit passé.
En raison de la crise des hydrocarbures, nous assurons tout de même un suivi particulier de ce pays, et les soutiens qu’accorde la Coface font l’objet d’une attention plus grande afin de tenir compte de ses vulnérabilités.
M. le président François Rochebloine. Quelles sont-elles ?
Mme Sandrine Gaudin. La viabilité du pays n’est pas en cause : vu le faible niveau de la dette, les perspectives de remboursement des prêts sont bonnes. En revanche, il existe des risques concernant l’exécution des contrats, les autorités pouvant décider de reporter des décisions ou d’allonger les délais de mise en œuvre de tel ou tel projet en raison de la situation d’incertitude qui prévaut. À l’évidence, le risque d’incident est plus élevé en période de récession qu’en période de croissance forte et durable, car les mesures prises peuvent se traduire par le ralentissement du rythme des affaires et la contraction de leur volume. Peut-être faisons-nous preuve d’une prudence excessive, mais nous avons fait le choix de placer ce pays, comme d’autres pays de la région, sous une surveillance particulière par notre ambassade et notre service économique.
Un mot sur la structure de nos échanges commerciaux bilatéraux. Il va de soi que nous importons davantage que nous n’exportons, puisque 86 % de nos échanges avec l’Azerbaïdjan consistent en importations d’hydrocarbures. Nos importations représentent un montant total de 1,129 milliard d’euros, et nos exportations 174 millions d’euros. Nous exportons principalement du matériel roulant – matériel ferroviaire et véhicules automobiles – ainsi que des produits chimiques, des cosmétiques, des machines industrielles et des machines agricoles. Notre déficit commercial est assez classique s’agissant d’un pays auquel nous achetons des produits énergétiques.
Une quarantaine d’entreprises françaises est présente en Azerbaïdjan, y compris les principaux grands groupes : Total, bien entendu, mais aussi Alstom, Iveco et Thales dans le secteur des transports, Suez et CNIM dans le domaine de l’environnement. Nous entretenons une coopération dynamique dans le secteur aéronautique et aérospatial : Airbus et Thales Alenia Space (TAS) fournissent des satellites. La France est le cinquième investisseur en Azerbaïdjan, où ses investissements sont consacrés à 75 % au secteur de l’énergie.
Comme dans d’autres pays de la CEI qui ont hérité d’une économie centralisée et où les réflexes de marché ne sont pas encore enracinés, les entreprises naviguent en terrain difficile et le climat des affaires n’est pas optimal. Il existe notamment des problèmes d’ordre réglementaire liés aux normes et procédures héritées de l’époque soviétique, les formalités bureaucratiques freinant quelque peu les processus de décision, à quoi s’ajoutent des questions relatives aux taxes et autres licences. En clair, les affaires sont encore largement soumises aux autorisations délivrées par des administrations. De surcroît, certains services douaniers font parfois du zèle et les contrôles fiscaux peuvent se multiplier. L’administration, issue d’un monde où la vie des affaires n’était pas naturelle, demeure tatillonne, d’où un climat parfois contraignant.
Il faut cependant reconnaître la nette prise de conscience du gouvernement de l’Azerbaïdjan en la matière, contrairement à d’autres pays de la région comme le Turkménistan, par exemple. Le gouvernement azerbaïdjanais a adopté un train de réformes – un sujet dont s’est d’ailleurs saisi notre commission mixte, qui se réunit chaque année – visant par exemple à améliorer les conditions de concurrence en créant une autorité de la concurrence. C’est un signe de maturité et de volonté de créer un environnement des affaires qui soit conforme aux normes internationales. L’Azerbaïdjan figure à la 63e place du classement Doing Business de la Banque mondiale. Ce classement a cela d’utile qu’il incite à faire des réformes ; c’est ce à quoi s’est attelé l’Azerbaïdjan. Plusieurs procédures électroniques ont été instaurées pour alléger les formalités de douane, y compris en substituant une procédure de déclaration aux anciennes autorisations ex ante. En somme, la situation s’améliore, même si l’Azerbaïdjan n’atteint pas encore les normes européennes : les entreprises françaises nous signalent régulièrement des difficultés.
J’en viens au soutien financier accordé aux entreprises françaises qui souhaitent exporter vers l’Azerbaïdjan. De ce point de vue, notre politique d’assurance-crédit est ouverte : nous apportons une garantie publique aux bons projets afin de couvrir des risques éventuels lors de l’exécution du contrat. Chaque cas, cependant, est examiné avec attention, compte tenu de la crise économique qui affecte le pays. Le cas échéant, l’avis des ministres compétents est sollicité. À ce jour, nous n’avons jamais refusé de couvrir un contrat passé avec l’Azerbaïdjan. Ouverture, donc, mais prudence.
M. le président François Rochebloine. Quelle est la politique de la Coface ?
Mme Sandrine Gaudin. La Coface agit pour le compte de l’État ; de ce fait, elle se fonde sur sa propre analyse et sur celle que fait l’État du niveau de risque qui prévaut dans le pays. Sa position est celle-ci : il faut agir, mais avec prudence.
Étant donné son niveau de richesse, l’Azerbaïdjan ne peut plus bénéficier de prêts concessionnels ; il demeure en revanche éligible aux prêts du Trésor non concessionnels, même si aucune demande ne nous a été adressée à cet effet. L’Agence française de développement (AFD) est autorisée à intervenir en Azerbaïdjan depuis 2012 au titre de son mandat relatif à la croissance verte et solidaire. Elle accorde régulièrement des prêts, en particulier des prêts souverains. L’un d’entre eux, par exemple, a contribué au financement des ateliers d’entretien d’une usine de fabrication de nouvelles locomotives installée par Alstom. L’AFD conduit d’autres projets dans le domaine du développement urbain, de l’énergie et du tourisme durable.
La commission mixte est présidée par le ministre du commerce extérieur. Sa prochaine réunion se tiendra en décembre. Le MEDEF dépêche régulièrement des missions en Azerbaïdjan, avec un certain succès : trente à quarante entreprises y participent à chaque fois, y compris des entreprises qui ne sont pas encore présentes dans le pays. Je vous communiquerai la composition de la dernière délégation qui s’est rendue sur place.
L’enjeu principal auquel fait face l’Azerbaïdjan – comme tous les autres pays producteurs de pétrole et de gaz – est celui de la diversification de son économie. La volonté de réformer existe ; il reste à lui donner corps et, pour ce faire, l’Azerbaïdjan doit s’appuyer sur des acteurs extérieurs. À cet égard, toutes les institutions internationales sont présentes sur place : outre l’AFD, l’agence de coopération allemande, KfW, intervient aussi, ainsi que toute la palette des institutions financières internationales : la Banque mondiale, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Banque asiatique de développement (BAD). La diversification de l’économie suppose de nouer de coopération pour fabriquer de nouveaux produits d’exportation. De ce point de vue, le Gouvernement manifeste son souhait de s’appuyer sur des compétences extérieures. C’est un signe encourageant, d’autant plus que la France est déjà présente et a fait ses preuves sur place.
Cette diversification porte sur des domaines habituels dans ce type de situation : produits d’exportation, valorisation et transformation de la production agricole, tourisme. C’est un processus ardu. Le Fonds monétaire international (FMI) encourage fortement l’Azerbaïdjan à aller en ce sens en renforçant l’implication du secteur privé face à l’emprise de certaines entreprises publiques héritées de l’ère soviétique, et en restructurant le secteur bancaire. Pour relever ce défi, l’Azerbaïdjan s’est doté cette année d’une autorité de supervision bancaire – signe qu’il lui reste encore du chemin à parcourir pour atteindre les normes internationales en la matière. Pour améliorer l’environnement des affaires, le FMI préconise également une politique monétaire plus flexible permettant de faire face à la volatilité du cours du pétrole. D’autre part, l’Azerbaïdjan a beaucoup fait pour s’adapter aux normes internationales de transparence fiscale, de lutte contre la fraude et l’optimisation et d’échange d’informations depuis son adhésion au Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales. C’est là encore, à notre sens, un signe très encourageant.
M. le président François Rochebloine. Selon quelles modalités, pour quels types de bénéficiaires et pour quels montants le Trésor a-t-il, au cours des cinq dernières années, ouvert aux entreprises françaises établies en Azerbaïdjan les concours du Fonds d’étude et d’aide au secteur privé (FASEP) ?
À votre connaissance, quelles ont été les suites, en termes d’échanges commerciaux et de contrats, de la participation des entreprises françaises au Forum économique de Bakou en mai 2014 ? La visite d’une délégation du MEDEF à Bakou, deux ans plus tard, a-t-elle permis des avancées et des clarifications à ce sujet ? Avez-vous contribué à la préparation de cette visite ?
Permettez-moi de citer un document officiel : « La faible diversité de l’économie locale, la vulnérabilité de ses comptes extérieurs aux fluctuations des cours des matières premières, la mauvaise gestion des ressources, la corruption, un climat des affaires difficile et l’absence de concurrence risquent de faire obstacle au développement à long terme du pays ». Que pensez-vous de cette analyse ? À votre connaissance, comment se caractérise la corruption en Azerbaïdjan, notamment dans les activités économiques des entreprises et dans les échanges commerciaux avec l’étranger, le cas échéant avec la France ? La direction du Trésor intègre-t-elle les comportements à adopter en la matière dans les conseils qu’elle donne aux entreprises françaises ?
Enfin, quelle est votre appréciation du respect par l’Azerbaïdjan des obligations de transparence financière imposées par le comité d’experts ad hoc du Conseil de l’Europe, Moneyval, et de ses obligations fiscales édictées par le Forum mondial pour la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales ?
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. Vous nous avez indiqué, madame Gaudin, que le pic de production pétrolière de 2010 avait été relayé par une montée en puissance de la production de gaz, liée notamment aux perspectives ouvertes par le gisement de Shah Deniz. Quels sont les principaux opérateurs intervenant sur ce champ gazier ? Quelle est l’incidence – que l’on sait forte – du cours du pétrole sur le prix du gaz ? Celui-ci est-il toujours indexé directement sur le prix du pétrole ou a-t-il été désindexé comme dans d’autres parties du monde ? À quel niveau s’établissent les coûts de prospection par rapport au prix actuel de vente du gaz ?
Nos opérateurs Total et Engie renforcent-ils leur engagement en Azerbaïdjan ou, au contraire, demeurent-ils prudents ?
Qu’en est-il des gazoducs, en particulier du corridor Sud, important pour l’Europe parce qu’il peut lui permettre de réduire sa dépendance à l’égard du gaz russe ? Les volumes nécessaires à sa rentabilité ont-ils été obtenus ?
J’en viens au statut de la mer Caspienne. Le fait qu’il soit encore régi par les accords de 1921 et 1940 ne limite-t-il pas les possibilités de prospection dans les eaux azerbaïdjanaises ?
Quels sont les secteurs dans lesquels les entreprises françaises se distinguent de leurs concurrents et possèdent des avantages comparatifs, outre le secteur ferroviaire – par exemple le secteur de la grande distribution et de l’alimentation ?
Enfin, l’engagement des bailleurs internationaux que vous avez mentionnés – AFD et KfW, mais aussi Banque mondiale, BAD et BERD – est-il important ou marginal par rapport à la structure économique du pays ?
Mme Sandrine Gaudin. Parmi les aides, soutiens et financements que la Coface et le Trésor accordent, le FASEP vise à financer la réalisation d’études de faisabilité de projets de grande ampleur afin d’en orienter les spécifications de sorte que les entreprises françaises puissent y répondre plus favorablement. Actuellement, le FASEP accorde à Suez Environnement une aide de 1 million d’euros pour financer une étude concernant un projet de cogénération à partir des boues résiduelles du traitement de l’eau et un plan directeur de réduction des pertes en eau dans le réseau d’eau potable.
La Coface, quant à elle, conduit plusieurs opérations de soutien et de garantie pour un encours total qui s’élevait à 862 millions d’euros au 31 août 2016. Sont notamment couverts les contrats suivants, conclus lors de la visite du Président de la République en 2014 : la fourniture par Airbus d’un satellite d’observation, pour 127 millions, la contribution d’Arianespace au lancement d’Azerspace, pour 56 millions, la fourniture par Alstom de cinquante locomotives fabriquées sur place, pour 266 millions, le prospect par MBDA d’un système de défense antiaérien pour 291 millions, et la fourniture par Iveco de 150 autobus, pour 46 millions.
M. Jean-François Mancel. Précisons que nous devons ce contrat d’Iveco au secrétaire d’État chargé des sports, M. Braillard, qui, lors des Jeux européens de 2015, a convaincu le président Ilham Aliev d’acheter des autobus d’Iveco.
Mme Sandrin Gaudin. L’Azerbaïdjan figure au cinquième échelon du classement de l’OCDE par niveau de risque, qui en compte sept par ordre croissant de risque – les scores des pays voisins n’étant guère meilleurs puisque le Kazakhstan figure au même niveau, l’Arménie au niveau 6, le Turkménistan au niveau 7. C’est donc un classement médiocre qui s’explique principalement par le climat des affaires et l’absence de transparence dans certains domaines. C’est pourquoi nous exerçons un suivi étroit des projets que nous soutenons.
M. le rapporteur. Les activités de nos entreprises donnent-elles lieu à un nombre élevé de contentieux fiscaux et juridiques ?
Mme Sandrine Gaudin. Non. Nous nous heurtons cependant à l’insuffisance, pour dire le moins, des renseignements fiscaux fournis par l’Azerbaïdjan. Quoi qu’il en soit, l’avis du ministre est systématiquement sollicité pour tout projet de soutien de la Coface dépassant 50 millions d’euros ; en deçà de ce montant, la Coface décide en interne. Le volume d’aide – 862 millions d’euros – est assez important ; à titre de comparaison, il atteint 1 milliard d’euros au Kazakhstan, un pays pourtant bien plus vaste.
La délégation du Medef qui s’est rendue à Bakou comptait une quarantaine d’entreprises, preuve que ce pays, qui est notre premier partenaire dans le Caucase malgré le contexte difficile, suscite un fort intérêt.
L’Azerbaïdjan est membre du comité Moneyval, le pendant du Groupe d’action financière (GAFI) pour l’Europe. L’évaluation du pays, réalisée en 2008, a révélé un certain nombre d’infractions et de défaillances fondamentales concernant le régime de lutte contre le blanchiment des capitaux. À la suite de la publication de ce rapport d’évaluation très négatif, et même à charge – au point que l’Azerbaïdjan a décidé en 2010 de quitter le processus de suivi du GAFI –, l’engagement politique a néanmoins été pris au plus haut niveau de faire progresser le pays en adoptant des réformes. En 2014, le GAFI et Moneyval ont publié un nouveau rapport constatant les progrès accomplis en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux. Les principales défaillances observées en 2008 avaient été surmontées, même si des progrès sont encore attendus pour que le pays se hisse aux normes – assez élevées – prescrites par le GAFI. Fin 2015, celui-ci a également examiné le dispositif de lutte contre le financement du terrorisme de l’Azerbaïdjan et l’a jugé satisfaisant, même si la procédure de gel des avoirs internationaux demeure lente – ce qu’explique encore une fois la pesanteur administrative qui prévaut dans le pays.
J’en viens aux questions fiscales. L’Azerbaïdjan est membre du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales depuis février 2013 : c’est un signe positif, d’autant plus que tous les États de la CEI n’y participent pas. Ce forum ausculte régulièrement les dispositifs légaux et réglementaires de ses membres afin d’évaluer leur conformité aux normes internationales, et l’examen de l’Azerbaïdjan est en cours. Plusieurs problèmes ont d’ores et déjà été constatés, en particulier le respect lacunaire de l’obligation faite à toutes les entreprises du pays de tenir une comptabilité, l’accès insuffisant de l’administration fiscale à l’information et les difficultés entravant l’échange de renseignements entre administrations fiscales car, bien que l’Azerbaïdjan soit signataire de la Convention de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, il n’a pas encore manifesté de velléité de l’appliquer. De ce fait, il pourrait rejoindre dès l’année prochaine la liste des juridictions non coopératives que l’OCDE établit afin d’exercer une pression supplémentaire de sorte que les pays concernés ne se contentent pas d’adopter le cadre juridique, mais qu’ils le traduisent en pratique en répondant à toute demande d’information à caractère fiscal. Précisons que plusieurs pays de la région sont dans le même cas. Cela étant, l’Azerbaïdjan a accepté de participer au Forum mondial, ce qui atteste de sa bonne volonté en la matière.
M. le président François Rochebloine. Que pensez-vous de l’extrait que je vous ai cité, qui est issu de la fiche du ministère des affaires étrangères sur l’Azerbaïdjan ?
Mme Sandrine Gaudin. Cette position reflète le constat que fait le FMI, et nous ne craignons pas de l’aborder en commission mixte. La corruption, en effet, est pour nous une préoccupation majeure : nous tenons à ce que nos partenaires adhèrent aux mécanismes internationaux les plus exigeants en la matière et qu’ils les appliquent. Or, de ce point de vue, on constate souvent des pratiques d’un autre âge dans cette région, dans la CEI en général et, hélas, partout ailleurs. Beaucoup reste à faire, par exemple, pour que les procédures douanières échappent à toute corruption. De même, l’acharnement dont sont parfois victimes les entreprises étrangères de la part de l’administration fiscale de l’Azerbaïdjan ne cesse souvent que moyennant des actes de corruption. Encore une fois, nous abordons régulièrement ces sujets en commission mixte, et le ferons de nouveau en décembre.
L’Azerbaïdjan détient les 20e réserves mondiales de pétrole et les 25e réserves mondiales de gaz. Cet exportateur net de gaz alimente la Géorgie, la Russie, la Turquie et l’Iran, et alimentera demain l’Union européenne. La production gazière est passée de 9 milliards de mètres cubes en 2006 à 29 milliards en 2015, soit une progression importante. La deuxième phase d’exploitation du gisement de Shah Deniz offre des capacités d’extraction atteignant 36 milliards de mètres cubes, soit l’équivalent de la consommation de la France en 2014 et un peu moins que sa consommation l’année suivante. L’ensemble du gisement de Shah Deniz contiendrait des réserves globales d’environ 1 200 milliards de mètres cubes de gaz et de 240 milliards de mètres cubes de condensat ; autrement dit, c’est un gisement gigantesque. La deuxième phase d’exploitation de Shah Deniz est destinée à couvrir les perspectives de hausse de la demande sur les marchés turc et européen grâce à la construction déjà quasiment achevée des gazoducs transanatolien (TANAP) et transadriatique (TAP). Le consortium qui exploite et achemine le gaz depuis Shah Deniz est dirigé par l’entreprise BP, à hauteur de 30 %, en partenariat avec un opérateur turc, un autre russe et le Malais Petronas. BP pilote également le projet de corridor gazier Sud avec la SOCAR, la société nationale azerbaïdjanaise. Total a revendu sa participation dans l’exploitation de ce champ en 2014 dans le cadre d’une recomposition générale de ses activités mondiales – la rentabilité de cette opération étant jugée trop faible – et a préféré redéployer son activité vers le gisement d’Apchéron en lien avec la SOCAR et Engie.
Dans cette région, les coûts de prospection et de production sont relativement élevés. L’extraction en mer coûte cher en raison de la profondeur des forages et des difficultés géologiques. De plus, les coûts d’exploitation sont plus élevés s’agissant d’une mer fermée. S’y ajoute le fait que l’acheminement est très onéreux, le projet de corridor Sud n’étant pas encore abouti. Selon la SOCAR, le coût de production d’un baril s’établit à 20 dollars ; à titre de comparaison, il est de 4 à 6 dollars en Arabie Saoudite, 15 à 18 dollars au Kazakhstan et 40 dollars en Angola. Autrement dit, c’est un coût non négligeable, qui renforce d’autant l’impact de la chute du cours mondial des hydrocarbures. Cela étant, la deuxième phase d’exploitation de Shah Deniz devrait permettre de ramener ce coût à 18 dollars.
Malgré la baisse des cours du pétrole et du gaz, aucune entreprise française engagée en Azerbaïdjan n’a quitté le pays ; comme ailleurs, la stratégie adoptée est celle de l’attente d’un retournement du marché. Total a conclu avec la SOCAR un accord de partage de production concernant le gisement en mer d’Apchéron. Engie va devenir le premier acquéreur européen de gaz azerbaïdjanais et participe avec Total à l’exploitation du gisement d’Apchéron.
M. le rapporteur. Est-ce que BP demeure le principal opérateur ?
Mme Sandrine Gaudin. Oui, avec la SOCAR, mais BP exploite le gisement de Shah Deniz. Total exploite celui d’Apchéron mais s’intéresse également deux nouveaux gisements, Ümid et Babek, et répondra à l’appel d’offres que lancera la SOCAR afin de trouver un partenaire d’exploitation.
Le corridor gazier Sud permettra à l’Union européenne d’accroître ses importations de gaz azerbaïdjanais et, du même coup, de réduire sa dépendance à l’égard de la Russie. L’Azerbaïdjan devrait ainsi pouvoir acheminer 16 milliards de mètres cubes de gaz par an vers la Turquie et l’Union européenne, dont environ 10 milliards vers l’Union – et même 20 milliards à terme. Reste à savoir quelle position les pays de la région adopteront à l’égard de ce projet, en particulier le Turkménistan, que l’Azerbaïdjan cherche à associer au projet de corridor vers l’Europe mais qui envisage également la réalisation d’un corridor vers l’Afghanistan, le Pakistan et surtout l’Inde, très gros importateur. Ce choix politique n’est pas encore tranché.
M. le rapporteur. Le projet de corridor Sud est-il stratégique de notre point de vue ?
Mme Sandrine Gaudin. Oui, et nous sommes très favorables à sa réalisation. Il est vital, en effet, que nous puissions diversifier nos sources d’approvisionnement en construisant les « tuyaux » nécessaires.
Outre le secteur de l’énergie, la France a d’autres intérêts majeurs en Azerbaïdjan. Dans le secteur des transports, Alstom et Iveco sont présentes, mais aussi Thales, qui fournit des équipements de contrôle et d’automatisation de la gestion des trains et du métro de Bakou. Dans le domaine spatial, la présence française est très forte : un satellite d’observation à des fins civiles a été fourni, et un deuxième satellite d’observation plus précis à des fins de défense pourrait l’être même si, à ce stade, la décision d’achat est gelée en raison de restrictions budgétaires. Arianespace a conclu un contrat de lancement des satellites de télécommunications, l’un d’entre eux ayant déjà été lancé en février 2013. La coopération spatiale est donc dense et, à ce stade, uniquement à des fins civiles. Dans le domaine de l’environnement, du traitement des déchets et de l’eau, la France compte également plusieurs entreprises en pointe – Suez, Veolia, Sade – qui ont d’immenses possibilités à saisir en Azerbaïdjan. De même, plusieurs entreprises françaises y sont en position de force dans le secteur de la ville durable et de l’aménagement urbain : Bouygues, Eiffage, Vinci, Egis, Veolia ou encore Keolis proposent des offres compétitives.
Un mot sur les institutions financières internationales, enfin : la Banque mondiale accorde des prêts pour des projets d’assainissement, de gestion des déchets et de développement rural à hauteur de 300 millions de dollars environ. La BAD accorde des financements de plusieurs types en faveur du développement du secteur privé et de la diversification de l’économie, pour plus de 1 milliard de dollars. La BERD intervient dans plus de 155 projets de diversification de l’économie pour un montant cumulé d’investissement de 2 milliards de dollars, y compris via des prises de participation dans des entreprises locales, dont certaines financent la deuxième phase de développement du gisement de Shah Deniz. La Banque islamique intervient à hauteur de 1,7 milliard de dollars. Les montants engagés par la KfW et l’AFD sont plus modestes : la première consacre 120 millions d’euros à un projet de gestion de l’eau, la seconde un peu plus de 100 millions d’euros à trois projets différents.
M. François Loncle. Notre président a cité une note du ministère des affaires étrangères qui, en réalité, vaut également pour une centaine d’autres pays en vertu de ce que l’on pourrait appeler le principe du grand parapluie : une cellule de ce ministère décrète des zones rouges dans lesquelles il est déraisonnable de se rendre, y compris s’agissant de pays d’Afrique pourtant sûrs. Ces consignes, de mon point de vue, constituent l’une des aberrations de notre diplomatie.
S’agissant de l’AFD, pouvez-vous nous préciser la nature et le montant des prêts accordés ? Consent-elle des dons ?
M. Jean-Michel Villaumé. La France exporte-t-elle des armements et matériels militaires en Azerbaïdjan ? Quels sont nos liens avec ce pays en matière de défense ?
M. Jean-François Mancel. L’Azerbaïdjan, vous nous l’avez rappelé, est notre premier partenaire dans la région et demeure un pays attractif pour nos grandes entreprises. Qu’en est-il des PME ? Il existe pourtant des domaines dans lesquels elles pourraient s’implanter dans ce pays. Je pense en particulier au tourisme de montagne, un secteur qui s’y développe à grande vitesse malgré des équipements encore lacunaires et dans lequel la France a incontestablement une expertise de pointe. Pourtant, ce sont des entreprises suisses et autrichiennes qui remportent les appels d’offres. Les grands hôtels luxueux de Bakou ne doivent pas masquer le besoin considérable de structures hôtelières plus modestes en province et, dans ce domaine, les entreprises françaises possèdent un véritable savoir-faire. Il en va de même dans le secteur du médicament. Sans doute conviendrait-il d’aborder la question de l’implantation des PME lors de la prochaine réunion de la commission mixte.
Permettez-moi enfin de vous interroger sur deux marchés sur lesquels les entreprises françaises et l’AFD pourraient intervenir : le premier concerne l’acquisition de patrouilleurs pour la mer Caspienne, et le second l’entretien des gares du réseau ferroviaire et du métro – la Compagnie internationale de maintenance, la CIM, s’intéresse à cet appel d’offres. Qu’en est-il ?
Mme Sandrine Gaudin. L’AFD n’accorde pas de dons à l’Azerbaïdjan, mais des prêts uniquement, pour un montant de 112 millions d’euros dans le cadre de son mandat relatif à la croissance verte et solidaire, à quoi s’ajoutent les prêts de PROPARCO pour un montant de 23 millions. L’AFD intervient principalement dans les secteurs du développement urbain, des énergies propres et du tourisme durable. En l’occurrence, les 112 millions consacrés au financement des ateliers d’entretien de locomotives constituent un prêt souverain. Quoi qu’il en soit, l’Azerbaïdjan n’est pas un partenaire éligible aux dons de l’AFD.
J’en viens à notre relation de défense, sachant que l’objectif de l’Azerbaïdjan vise à sécuriser ses ressources naturelles, en particulier les gisements de gaz et de pétrole. Plusieurs prospects commerciaux sont actuellement à l’arrêt en raison de contraintes budgétaires (installation d’un système de défense antiaérienne et satellite d’observation). En matière de défense, notre principal concurrent en Azerbaïdjan est Israël.
En 2014, le Président de la République, lors de sa visite officielle, a signé un accord de coopération dans le domaine de la défense, et l’Azerbaïdjan intensifie sa relation avec l’OTAN, bien qu’il ne souhaite naturellement pas y adhérer à ce stade, compte tenu de sa situation géographique délicate entre Russie, Iran et autres. Cela étant, il entend diversifier ses fournisseurs d’équipements de défense, d’où son intérêt à entamer des discussions qui, quoiqu’étant allées assez loin, n’ont pas abouti concrètement faute de ressources budgétaires.
Les perspectives d’implantation et de renforcement des entreprises françaises en Azerbaïdjan sont importantes, y compris dans le domaine du tourisme de montagne, monsieur Mancel, même si les Autrichiens sont déjà très présents. En ce qui concerne les PME, en revanche, je préfère rester prudente, car le terrain n’est pas des plus faciles. Sans doute peut-on encourager les établissements de taille intermédiaire (ETI) déjà habitués à s’implanter à l’étranger, en particulier dans le Caucase et en Asie centrale, et proposant des produits compétitifs répondant à une demande, mais il ne serait pas responsable d’encourager un primo-exportateur à s’aventurer en Azerbaïdjan dans le seul but de diversifier ses activités.
M. le Président François Rochebloine. Je vous remercie, Madame, pour la clarté et la précision de votre intervention et de vos réponses.
*
* *
Ÿ Audition de M. Jean-Pierre Lacroix, directeur des Nations unies, des organisations internationales, des droits de l’Homme et de la francophonie au ministère des affaires étrangères (mercredi 19 octobre 2016)
M. le président François Rochebloine. Nous recevons aujourd’hui M. Jean-Pierre Lacroix, directeur des Nations unies, des organisations internationales, des droits de l’Homme et de la francophonie au ministère des affaires étrangères.
L’objet de cette mission d’information est de faire le point sur les relations politiques et économiques entre la France et l’Azerbaïdjan au regard des objectifs de développement de la paix et de la démocratie au Sud Caucase. La semaine dernière, Mme Mangin, directrice de l’Europe continentale, a fait un exposé d’ensemble sur ce sujet. Aujourd’hui, nous vous serions reconnaissants de nous apporter un éclairage particulier, à la croisée de vos compétences : la promotion des droits de l’Homme et l’action de la France dans les organisations internationales.
En effet, les violations des droits de l’Homme et des libertés fondamentales par l’Azerbaïdjan ont fait l’objet de nombreuses condamnations, en particulier dans le cadre du Conseil de l’Europe et de son assemblée parlementaire, à laquelle j’appartiens. Pourriez-vous dresser un état de la situation des droits de l’Homme dans ce pays ? Quel est, selon vous, l’impact des condamnations prononcées par la Cour européenne des droits de l’Homme sur la politique du gouvernement de Bakou, d’une part, et sur la jurisprudence et la pratique des administrations azerbaïdjanaises, d’autre part ?
Nous aimerions savoir également si, dans le cadre des relations bilatérales franco-azéries, la question des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en Azerbaïdjan a été évoquée et, dans l’affirmative, comment et en quels termes.
Enfin, nous souhaiterions connaître les directives données à nos représentants dans les organisations internationales pour exprimer la position de la France lorsque la question des droits de l’Homme en Azerbaïdjan vient à l’ordre du jour des travaux de ces organisations.
M. Jean-Pierre Lacroix, directeur des Nations unies, des organisations internationales, des droits de l’Homme et de la francophonie au ministère des affaires étrangères. Je vais tenter de dresser un panorama des relations entre la France et l’Azerbaïdjan, notamment au regard de la situation des droits de l’Homme dans ce pays, situation que nous suivons avec beaucoup d’intérêt. Nous le faisons d’abord dans le cadre d’une politique générale qui accorde une grande importance au comportement qu’ont dans ce domaine les différents partenaires de la France. Notre ministre, Jean-Marc Ayrault, montre en effet un intérêt tout particulier pour cette question. Ainsi a-t-il consacré son premier déplacement, quelques jours après sa nomination, à l’ouverture de la session du Conseil des droits de l’homme à Genève. Depuis lors, il a donné son accord à presque toutes les propositions que nous lui avons soumises en ce domaine.
Cette politique s’est notamment traduite par l’envoi récent à nos ambassades de directives et d’instructions concernant l’action de nos postes en matière de droits de l’Homme qui mettent l’accent sur le rôle qu’elles peuvent jouer, en lien avec nos partenaires sur le terrain, en faveur des défenseurs des droits de l’Homme, ce qui est particulièrement pertinent en ce qui concerne l’Azerbaïdjan.
M. le président François Rochebloine. Je précise à ce propos que nous accueillerons, demain, Mme l’ambassadeur de France en Azerbaïdjan.
M. Jean-Pierre Lacroix. Elle pourra donc vous donner davantage d’éléments sur l’action de notre poste à Bakou dans ce domaine.
J’en viens plus précisément à la situation qui prévaut en Azerbaïdjan. Les pouvoirs y sont fortement concentrés entre les mains du Président, et cette concentration a été encore renforcée par le référendum du 26 septembre dernier, qui a accru ses prérogatives. Par ailleurs, les activités de la société civile sont de plus en plus réduites ; elles sont notamment soumises, comme dans plusieurs autres pays, à des restrictions en matière de financement. Les partis politiques d’opposition, dont les conditions de fonctionnement sont déjà difficiles, ont également vu leurs marges de manœuvre se réduire encore au cours des dernières années. Outre la limitation de leurs financements, les ONG sont soumises à des conditions restrictives d’enregistrement qui compliquent leur travail. Quant aux journalistes d’opposition, ils subissent arrestations, fermetures de bureaux, gels de comptes bancaires, etc.
Ce pouvoir répressif a donc plutôt tendance à resserrer l’étau, mais il a fait, à diverses reprises, des gestes d’ouverture, de sorte que l’on pourrait dire qu’il souffle le chaud et le froid – et cela n’est pas indifférent du point de vue des actions que nous pouvons mener avec nos partenaires pour inciter l’Azerbaïdjan à s’ouvrir davantage. Parmi ces gestes, on peut relever la libération d’opposants : lors de la fête du Novruz, en mars dernier, 148 personnes – journalistes, militants politiques et membres d’ONG – ont été amnistiées ; plus récemment, la journaliste Khadija Ismaïlova, qui avait été emprisonnée en 2014, a été libérée, de même que les époux Yunus, qui ont été libérés à la fin de 2015, puis autorisés à quitter le pays en avril 2016. Ces gestes suggèrent, selon moi, que l’Azerbaïdjan est sensible à nos interventions en faveur des droits de l’Homme et que nous avons donc intérêt à les poursuivre.
Ces interventions prennent diverses formes. Dans les enceintes multilatérales, la France a ainsi exprimé, lors de la dernière session du Conseil des droits de l’homme, en septembre dernier, dans le cadre du « point 4 » – consacré à la situation de pays spécifiques –, son inquiétude « quant à la dégradation de la situation en Azerbaïdjan ».
Nous évoquons également ces questions dans le cadre du dialogue que nous entretenons, à tous les niveaux, avec les autorités azerbaïdjanaises. Florence Mangin, notre directrice de l’Europe continentale, a ainsi évoqué devant vous les rencontres de haut niveau qui sont intervenues récemment, qu’il s’agisse de celle du Président de la République avec le Président Aliev le 9 juillet dernier, de la visite à Paris du ministre des affaires étrangères de l’Azerbaïdjan, au cours de laquelle il s’est entretenu avec son homologue français et notre secrétaire d’État aux affaires européennes, ou du déplacement de ce dernier à Bakou le 26 avril dernier. À chaque occasion, nous évoquons de manière générale, et parfois de manière plus spécifique, la situation de la démocratie et des droits de l’Homme en Azerbaïdjan. Par ailleurs, notre ambassade à Bakou a développé des contacts avec des membres de la société civile, qu’elle soutient et encourage. Nous nous efforçons également de sensibiliser les responsables, les administrations, à l’État de droit et au fonctionnement des institutions démocratiques en attribuant à des fonctionnaires azerbaïdjanais des bourses de court séjour.
Nous pensons que le dialogue que nous entretenons avec les autorités a contribué aux gestes qui sont intervenus dans la période récente. Le Président de la République s’était, du reste, personnellement engagé sur le cas des époux Yunus, qu’il avait évoqué avec le Président Aliev.
M. le président François Rochebloine. Êtes-vous toujours en contact avec les époux Yunus ?
M. Jean-Pierre Lacroix. Pas à notre niveau, mais nous vous donnerons des éléments complémentaires sur ce sujet.
Ces contacts bilatéraux méritent donc d’être poursuivis, car plusieurs opposants sont toujours détenus, notamment M. Ilgar Mammadov. Son cas a été évoqué avec le secrétaire général du Conseil de l’Europe en vue de sensibiliser les membres du Conseil à son sort, et nous continuerons bien entendu à travailler à sa libération dans le cadre de notre dialogue avec les autorités azerbaïdjanaises, qui connaissent bien notre position puisque nous l’évoquons régulièrement au Comité des ministres.
En ce qui concerne les différents forums multilatéraux, notre politique consiste d’abord à assurer un suivi régulier de la situation et à maintenir un certain niveau d’attention et de pression. La Cour européenne des droits de l’homme rend, chaque année, plusieurs arrêts – dix-neuf en 2015, concernant notamment M. Mammadov – sanctionnant la violation par l’Azerbaïdjan de la Convention européenne des droits de l’homme. Mais ce pays est souvent réticent à appliquer les arrêts de la Cour. L’Azerbaïdjan fait également l’objet de rapports de l’Assemblée parlementaire et d’autres organes du Conseil de l’Europe, qui soulignent les problèmes persistants en matière de respect des droits de l’Homme en Azerbaïdjan, sans négliger, le cas échéant, les quelques évolutions ou efforts constatés. La Commission de Venise a ainsi relevé les modifications apportées à la loi sur les ONG qui ont permis certaines avancées limitées sans pour autant prendre en compte un grand nombre des recommandations formulées par elle-même dans son avis de 2011.
Avec l’OSCE, les relations sont globalement tendues et difficiles. J’en veux pour preuve la dernière réunion annuelle d’examen de la mise en œuvre des engagements de ce que l’on appelle la « dimension humaine de l’OSCE », en octobre dernier. La situation de l’Azerbaïdjan a occupé une place importante dans les débats, d’autant plus que ceux-ci sont intervenus au moment de la tenue du référendum constitutionnel sur le renforcement des pouvoirs du Président. Par ailleurs, les relations entre l’OSCE et l’Azerbaïdjan se sont aggravées après la décision très regrettable qu’a prise ce pays de fermer le bureau de l’OSCE à Bakou en juin 2015. Le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’Homme de l’organisation a, de son côté, décidé d’annuler l’observation des élections législatives de décembre 2015, en raison des difficultés rencontrées avec les autorités pour définir les modalités de cette observation, notamment la taille de la mission.
Globalement, le panorama n’est donc guère réjouissant. Néanmoins, on observe, et ce n’est pas propre à l’Azerbaïdjan, une tendance de ce pays à vouloir se présenter, au moins juridiquement, comme un bon élève. Il a ainsi ratifié la presque totalité des grandes conventions relatives aux droits de l’Homme des Nations unies, à l’exception, me semble-t-il, de celle qui porte sur les disparitions forcées, à laquelle nous attachons une importance particulière car nous avons joué un rôle de premier plan dans son élaboration. Il a également été membre du Conseil des droits de l’Homme entre 2007 et 2009, après avoir pris, dans le cadre de sa candidature, un certain nombre d’engagements volontaires. Il n’est toutefois pas partie au statut de Rome relatif à la Cour pénale internationale. Globalement, l’Azerbaïdjan veut donc être en mesure de dire à l’opinion publique internationale qu’il est en règle vis-à-vis des grands textes internationaux sur les droits de l’Homme.
On relève du reste quelques points de relative convergence avec la France. S’agissant de la peine de mort – qui est, pour notre pays, un thème très important que nous défendons de manière résolue dans les enceintes internationales –, l’Azerbaïdjan est un pays abolitionniste, qui vote avec nous les résolutions bisannuelles en faveur d’un moratoire universel sur la peine de mort qui sont adoptées par l’Assemblée générale des Nations unies. Bakou est également très active et engagée sur l’émancipation de la femme, suivant le modèle de la Turquie kémaliste en quelque sorte, ce qui n’est pas étonnant dans la mesure où ce pays est soumis notamment à l’influence turque. En ce qui concerne la liberté religieuse, l’Azerbaïdjan a également une approche qui se veut laïque, même s’il ne fait pas de cette notion une interprétation tout à fait identique à la nôtre. Ainsi, lorsque l’OSCE a récemment débattu du projet d’adopter des déclarations sur l’islamophobie ou la christianophobie, la France, qui considère qu’il s’agit d’une très mauvaise idée – car cela engagerait un processus infini de dénonciations en contradiction avec notre conception universelle des droits de l’Homme – a eu, à ce sujet, avec l’Azerbaïdjan, mais aussi avec l’Allemagne, des discussions difficiles. J’ajoute que l’Azerbaïdjan est également membre de l’Organisation de la coopération islamique et il a, à ce titre, des réflexes de solidarité avec les autres pays membres de cette organisation.
En résumé, je dirai que nous sommes face à une situation qui n’est, hélas ! pas propre à l’Azerbaïdjan : celle d’un pays autoritaire, qui durcit graduellement sa position sur la liberté d’expression, la liberté de la presse et de la société civile, bref : tout ce qui concourt à une vie démocratique saine et active. Cependant, il souffle le chaud et le froid, puisqu’il lui arrive de libérer ponctuellement certains opposants, ce geste pouvant du reste être suivi de l’emprisonnement d’autres opposants, comme cela s’est produit récemment. Il s’efforce également de présenter une façade respectueuse, au moins dans les textes, des normes internationales en matière de droits de l’Homme, et met en avant son respect de la laïcité, la promotion de la femme et une certaine forme de modernité. En somme, il travaille beaucoup son image, ce qui signifie qu’il est sensible à ce que disent ses grands partenaires, notamment la France et l’Allemagne. On sait, par ailleurs, que ce pays se situe dans un environnement difficile en raison du conflit du Haut-Karabagh et des relations complexes qu’il entretient avec l’influente et puissante Russie, qui a des affinités avec l’Arménie.
Nous avons le sentiment que nos messages sont utiles, et que nous avons donc intérêt à continuer à parler régulièrement de l’Azerbaïdjan, en liaison avec nos partenaires, notamment ceux de l’Union européenne, dans les enceintes multilatérales. Nous devons également poursuivre le dialogue avec les autorités et continuer à leur envoyer des messages sur la situation générale et sur celle de personnes précises, et ce à tous les niveaux, y compris, lorsque cela est justifié, au plus haut niveau. Nous devons enfin continuer à soutenir, sur le terrain, là encore en liaison avec nos partenaires de l’Union européenne, la société civile, qu’il s’agisse des ONG, des défenseurs des droits de l’Homme ou des journalistes en difficulté, en leur offrant, par exemple, la possibilité de séjourner en France pendant une certaine période. En tout état de cause, il faut faire le nécessaire pour que ces forces puissent poursuivre leur activité, malgré les contraintes fortes qu’elles subissent.
D’une manière générale, l’Azerbaïdjan a un profil relativement effacé aux Nations unies. Son positionnement international est d’abord très marqué par le conflit du Haut-Karabagh, qui limite sa possibilité d’avoir une plus grande exposition. De fait, ce pays n’a pas une présence significative dans les opérations de maintien de la paix des Nations unies et il ne prend pas d’initiatives particulières. Il est, en outre, sous la surveillance de ses grands voisins. La politique extérieure de l’Azerbaïdjan est ainsi une politique d’équilibrisme permanent, ce qui, là encore, justifie que l’on poursuive nos interventions en faveur des droits de l’Homme.
En ce qui concerne la francophonie, nous entretenons avec ce pays une coopération linguistique et culturelle, que nous avons intérêt à développer. En revanche, la question de l’adhésion de l’Azerbaïdjan à l’Organisation internationale de la francophonie est hypothétique, car on peut imaginer la position que l’Arménie, qui est déjà membre de cette organisation, adopterait dans la perspective d’une telle adhésion qui, au demeurant, n’a pas été sollicitée.
M. le président François Rochebloine. Monsieur le directeur, je vous remercie pour votre exposé. Je souhaiterais vous poser quatre questions.
Premièrement, quelle appréciation la France porte-t-elle sur la réforme du statut des ONG entrée en vigueur en 2013 ? Celle-ci a-t-elle fait l’objet de remarques ou d’observations de la part du gouvernement français auprès des autorités azéries, et sinon, pourquoi ?
Deuxièmement, combien de ressortissants azéris ont-ils demandé à la France, au cours des cinq dernières années, le statut de réfugié politique, garanti par la convention de Genève de 1951, et combien ont obtenu satisfaction ?
Troisièmement, quelle appréciation la France porte-t-elle sur le traitement infligé par les autorités politiques et judiciaires azéries à M. et à Mme Yunus ?
Enfin, comment concilier le développement d’une coopération culturelle avec le constat, résultant des délibérations d’ONG, de violations constantes des droits de l’Homme et des libertés fondamentales par l’Azerbaïdjan ?
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. Merci, monsieur le directeur, pour votre exposé très intéressant. Vous avez souligné l’ambivalence de l’Azerbaïdjan : d’un côté, ce pays souhaite s’inscrire dans la modernité internationale, qu’il s’agisse des droits des femmes ou de sa manière d’appréhender les problèmes religieux, mais, de l’autre, la pression politique y est très forte et la démocratie a du mal à s’y installer, comme l’illustre le dernier référendum, qui montre que le pouvoir tend davantage à se durcir qu’à s’ouvrir. Cette ambiguïté est difficile à comprendre.
J’en viens à mes questions. Tout d’abord, M. Michel Forst a été mandaté par le Conseil des droits de l’Homme des Nations unies pour se rendre en Azerbaïdjan du 14 au 22 septembre dernier. Avez-vous connaissance des conclusions de cette mission ?
Ensuite, la situation des personnes déplacées de l’intérieur, qui a fait l’objet de rapports très critiques des Nations unies en 2010, semble s’être améliorée au cours des dernières années. Qu’en est-il exactement aujourd’hui ? Des solutions durables sont-elles recherchées ?
Par ailleurs, vous avez évoqué le rôle plutôt effacé de l’Azerbaïdjan au sein des Nations unies. Peut-on dire que, lors des grands votes, ce pays s’aligne plutôt sur la Russie ou fait-il preuve d’une plus grande neutralité ?
Enfin, quelle est la position de l’Azerbaïdjan vis-à-vis, d’une part, de l’Union européenne et, d’autre part, de l’OTAN, puisque ce sujet fait l’objet de débats importants avec son voisin géorgien ?
M. Jean-Pierre Lacroix. S’agissant de la réforme du statut des ONG, cela fait maintenant plusieurs années que le régime en place à Bakou a adopté des lois restrictives. La première d’entre elles, qui date de 1998, portait déjà sur les subventions et elle a été durcie en 2013 puis en 2014. La situation actuelle est la suivante. Les personnes morales étrangères ne peuvent pas accorder de subventions aux ONG azerbaïdjanaises, sauf si elles ont reçu l’accord du ministère de la justice, de sorte que la dépendance de ces ONG vis-à-vis du pouvoir et des sources internes de financement s’est accrue, dans un pays dont on connaît le climat économique. Cette situation a été critiquée publiquement à diverses reprises, notamment par la Commission de Venise, qui a émis, en 2014, un avis négatif sur les récentes modifications de la législation, au motif que celles-ci restreignaient davantage encore les activités des ONG.
Ces dernières font, par ailleurs, l’objet d’une méfiance institutionnalisée qui se traduit, un peu comme en Russie du reste, par des pressions et des accusations permanentes reposant, d’une part, sur la thèse de l’influence étrangère – thème qui est facile à exploiter dans le contexte conflictuel qui est celui de l’Azerbaïdjan – et, d’autre part, sur l’argument de la lutte contre le fondamentalisme islamique, laquelle est par ailleurs perçue comme étant de nature à apaiser les critiques occidentales. C’est pourquoi il nous paraît pertinent – et c’est d’ailleurs une politique que nous jugeons adaptée à beaucoup de situations de ce type – de continuer à mettre l’accent sur le soutien apporté aux défenseurs locaux des droits de l’Homme, de façon à montrer aux autorités que nous menons également des actions concrètes.
En ce qui concerne les époux Yunus, nous avons suivi de très près la situation de ces personnalités qui occupent une place majeure dans le paysage de la défense des libertés et des droits de l’Homme en Azerbaïdjan. Cette préoccupation s’est traduite par des démarches constantes, à tous les niveaux ; j’ai évoqué, à ce propos, l’intervention du Président de la République lorsqu’il a rencontré, le 25 avril 2015, à Bakou, en tête-à-tête, le Président Aliev. M. Yunus a ainsi été libéré en novembre 2015, puis la condamnation de son épouse a été commuée en peine avec sursis. Ils ont pu quitter l’Azerbaïdjan en avril dernier, et ils se trouvent aujourd’hui aux Pays-Bas. Les résultats que ces démarches ont produits attestent de ce que nous pouvons faire collectivement – car si la France a joué un rôle de premier plan, elle n’a pas agi seule – et confirment que l’Azerbaïdjan est sensible à nos interventions. De fait, ce pays n’a pas la même taille que la Russie, et il a besoin du partenariat avec l’Union européenne. Nous disposons donc de leviers, qu’il nous faut utiliser au mieux. Cela signifie qu’il nous faut doser de manière adéquate nos déclarations publiques et nos interventions privées, car nous devons être utiles. Cependant, nous devons être attentifs à ce que l’évolution positive de certaines situations individuelles et symboliques – le cas de M. Mammadov est néanmoins toujours pendant – ne soit pas manipulée par les autorités de manière à en faire une sorte de pôle de cristallisation susceptible de faire passer au second plan la situation de fond qui, elle, n’évolue pas positivement. Mais vous connaissez cette dialectique complexe entre la nécessité de traiter les cas spécifiques et l’attention que nous devons porter à la situation de la société civile ou de la presse ; elle n’est pas propre à l’Azerbaïdjan.
Quant au nombre des réfugiés politiques présents sur notre sol venant d’Azerbaïdjan et des demandes effectuées en France, je ne peux pas vous l’indiquer aujourd’hui, mais nous ferons en sorte de vous communiquer ces éléments très rapidement.
Par ailleurs, nous constatons un certain intérêt de l’Azerbaïdjan pour le développement de la coopération culturelle, et ce pour différents motifs liés à un souci d’image, ainsi qu’à une volonté de renforcer les structures éducatives. Cette forme d’ouverture peut paraître paradoxale au regard de la situation politique du pays, mais elle est réelle. Nous pensons que nous avons intérêt à poursuivre ces partenariats, notamment avec les universités, et à encourager, le cas échéant, le développement de coopérations avec d’autres pays francophones. Ceci n’est pas contradictoire avec la grande vigilance que nous exerçons sur la question des droits de l’Homme, car il s’agit précisément de mener une politique qui favorise l’ouverture partout où elle est possible. La création, cette année, avec l’aide de l’Université de Strasbourg, de l’Université franco-azerbaïdjanaise sera très significative à cet égard. Par ailleurs, l’Université des langues de Bakou s’est rapprochée de l’association universitaire de la francophonie ; ce mouvement nous paraît également positif et nous souhaitons l’encourager. Encore une fois, une coopération culturelle bien calibrée, qui n’oublie pas qu’elle s’inscrit dans un contexte particulier et qu’elle doit favoriser des objectifs liés à la promotion des droits de l’Homme me semble positive.
M. le rapporteur m’a interrogé sur la mission de M. Forst. Dans son rapport, celui-ci analyse les pressions exercées sur les défenseurs des droits de l’Homme et, plus spécifiquement, sur les journalistes et leurs familles, ainsi que sur celles des prisonniers politiques et sur les avocats, emprisonnés ou placés sous un régime de liberté surveillée. Il s’est également intéressé à l’impact de la nouvelle législation sur les ONG, et j’ajoute qu’il a pu rencontrer M. Mammadov.
Ses conclusions vont globalement dans le sens que j’ai indiqué tout à l’heure. Il esquisse également quelques orientations, en insistant en particulier sur le fait qu’il est important que les représentations diplomatiques sur place évoquent de manière régulière auprès des autorités le cas des activistes emprisonnés, notamment de ceux qui ne bénéficient pas de l’attention médiatique. Par ailleurs, il propose – ce qui est louable, même si je ne sais pas dans quelle mesure les autorités y seront réceptives – de mettre en place une procédure plus systématique afin d’avancer, dans le cadre d’un dialogue avec les autorités azerbaïdjanaises, sur la voie de la création d’un État de droit plus performant. Cette idée mérite d’être encouragée, car c’est une manière d’exercer une pression sur ces autorités que de leur dire que nous sommes prêts à nous engager dans un tel processus. Reste, bien entendu, à évaluer son degré de faisabilité.
En tout état de cause, les critiques et les conclusions de M. Michel Forst sont globalement en ligne avec notre appréciation du contexte et de la situation des droits de l’Homme en Azerbaïdjan. Il est particulièrement positif qu’il mette l’accent sur la responsabilité de nos pays et de nos ambassades sur place.
En ce qui concerne les personnes déplacées, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) évalue leur nombre à plus de 600 000, dont la moitié sont installées à Bakou. Le HCR estime que des efforts sont faits par le Gouvernement pour favoriser leur intégration, mais l’accès à l’emploi, au logement ou à l’intégration sociale demeure globalement plus difficile pour ces personnes que pour le reste de la population.
S’agissant des votes de l’Azerbaïdjan aux Nations unies, nous ne disposons pas d’une analyse exhaustive et précise. Quoi qu’il en soit, ce pays est relativement peu présent. Il a cependant été membre du Conseil de sécurité en 2012 et 2013 et les positions qu’il a prises à ce titre ne nous ont pas posé de difficultés dans le cadre des discussions que nous avions, à cette époque, sur le dossier du nucléaire iranien. Néanmoins, l’Azerbaïdjan a toujours été plus réservé sur la question des sanctions, qui l’affectent indirectement. Sur la Syrie – dans un contexte différent du contexte actuel puisque l’implication russe était moindre –, la position de l’Azerbaïdjan a été globalement proche des positions occidentales, à un moment où il existait une assez grande convergence entre la Turquie, la France et le Royaume-Uni. On peut imaginer qu’aujourd’hui, ce serait globalement encore le cas, avec peut-être une sensibilité un peu plus grande au positionnement de la Russie, mais la proximité avec la Turquie est, de ce point de vue, très importante.
Bien entendu, la question du Haut-Karabagh est surdéterminante. Plusieurs éléments sont importants à cet égard : le besoin qu’a l’Azerbaïdjan de la solidarité des autres membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), sa relation un peu compliquée avec la Russie et son souci de ne pas se détacher de ses partenaires européens afin qu’ils prennent en compte les intérêts de l’Azerbaïdjan dans ce conflit.
Inutile de dire que, lorsque ce pays a l’occasion de se positionner sur les droits de l’Homme, il le fait rarement dans le sens de nos positions, sauf sur les questions que j’ai évoquées tout à l’heure : celle de la peine de mort et celle des droits de la femme – mais il faudrait vérifier ce dernier point, car l’Azerbaïdjan est sans doute, là aussi, dans une position d’équilibriste, compte tenu précisément des positions de l’OCI en la matière.
J’en viens à l’Union européenne. Nous sommes actuellement en négociation avec l’Azerbaïdjan pour la conclusion d’une sorte d’accord de partenariat. Nous considérons que ces négociations doivent être l’occasion de mettre la question du respect des droits de l’Homme et de l’État de droit sur la table. On n’a rien sans rien, quelles que puissent être les considérations stratégiques qui plaident en faveur de la conclusion de cet accord. C’est en tout cas le sens des recommandations que nous avons faites, et je pense qu’elles ont été suivies.
Sur la relation de l’Azerbaïdjan avec l’OTAN, je ne dispose pas d’éléments particuliers, mais je m’efforcerai de vous les communiquer très rapidement.
M. Jean-Marc Germain. Ma question porte sur le Haut-Karabagh. Quelle connaissance avez-vous du déroulement des événements lors de la « guerre des quatre jours » qui a eu lieu entre le 1er et le 4 avril dernier ? Quelles sont les atteintes aux droits de l’Homme qui ont pu être constatées et comment cette frontière pourrait-elle être surveillée par les organisations internationales, puisque je crois que tel n’est pas le cas actuellement ?
M. Jean-François Mancel. Première question, monsieur le directeur : combien de pays dans le monde pourraient faire l’objet des mêmes remarques que celles que vous avez faites sur l’Azerbaïdjan ? C’est le fond du problème, finalement.
Deuxièmement, vous n’avez évoqué que partiellement la situation du pays sur le plan historique. N’oublions pas que celui-ci n’est indépendant que depuis vingt-cinq ans ! Où en était la France vingt-cinq ans après 1789 ? L’État était-il particulièrement démocratique ?
Par ailleurs, il faut rappeler que les personnes déplacées – j’aimerais d’ailleurs savoir si la France aide l’Azerbaïdjan dans ce domaine – ont été chassées de leurs terres, de leur pays, par les Arméniens. À ce propos, il faut préciser que 20 % du territoire de l’Azerbaïdjan sont actuellement occupés. Or, il est bien évident que, dans ces conditions, on est incité à prendre des mesures qui peuvent être considérées comme autoritaires mais qui sont liées à la situation du pays. Ainsi, c’est un pays occupé et en guerre et qui a, qui plus est, pour voisins la Russie, au Nord, et l’Iran au Sud, ainsi que des ONG dont on ne connaît pas le financement et qui pourraient être, un jour ou l’autre, des organismes séditieux. Ces éléments ont des incidences non négligeables sur l’État de droit azerbaïdjanais.
Vous avez, en revanche, évoqué à juste titre la situation des femmes, qui ont obtenu le droit de vote en 1918, et l’abolition de la peine de mort intervenue en 1998. Mais vous n’avez peut-être pas suffisamment insisté sur la coexistence pacifique des différentes communautés, qu’elles soient religieuses ou ethniques. On constate en effet, lorsqu’on se rend dans le pays, que les musulmans chiites, les musulmans sunnites, les juifs, les chrétiens, orthodoxes ou catholiques, vivent dans un respect mutuel.
M. Jean-Pierre Lacroix. Sur la « guerre de quatre jours », je pense que ma collègue Florence Mangin a plus d’expertise que moi. Ce conflit est traité politiquement d’une manière bien spécifique dans le cadre du groupe de Minsk, qui est, du reste, l’un des rares formats dans lesquels il existe encore une coopération positive entre les États-Unis, la Russie et la France, qui y joue un rôle important. Cela mérite d’être noté car, au plan multilatéral, nous assistons globalement à un durcissement des relations avec nos partenaires, notamment la Russie. Je le constate tous les jours au Conseil de sécurité, où l’on perçoit une érosion graduelle mais visible du climat dans lequel nous travaillons.
Je n’ai pas d’éléments particuliers sur les conditions du déclenchement de cette guerre, mais il est certain que ces événements ne sont pas les premiers : ils s’inscrivent dans une séquence d’incidents frontaliers qui témoignent, d’une part, de la très grande tension qui continue de régner et, d’autre part, de l’absence de volonté politique des parties – c’est un constat, et non une critique – de faire des pas en avant dans un tel contexte. Toutefois, malgré les événements récents, nous pouvons continuer à travailler, et donc espérer progresser, dans le cadre du groupe de Minsk. C’est un élément important, car il n’y a guère de solution alternative : le traitement du conflit par les Nations unies n’est pas envisageable, compte tenu de la configuration du Conseil de sécurité. Nous avons donc intérêt à faire vivre ce qui constitue le seul espoir de faire évoluer la situation. Je sais qu’un certain nombre de partenaires régionaux, dont la Turquie, souhaiteraient être associés plus étroitement au groupe de Minsk. Mais il faut être prudent en la matière, car ce format doit rester viable.
M. le président François Rochebloine. Nous auditionnerons prochainement le co-président français du groupe de Minsk.
M. Jean-Pierre Lacroix. L’approche que nous essayons d’adopter vis-à-vis de l’Azerbaïdjan n’est pas en noir et blanc. Bien entendu, elle tient compte des éléments que nous jugeons préoccupants, voire très préoccupants, pour la liberté de la presse, la situation des ONG ou les partis d’opposition, mais le constat n’est pas entièrement négatif. J’ai évoqué la position de ce pays sur la peine de mort. C’est un élément assez significatif, car beaucoup de pays sensiblement plus « démocratiques » que l’Azerbaïdjan ont une approche tout à fait différente de cette question… Nous ne négligeons pas non plus la situation des femmes, ni la coexistence des différentes minorités. Ce n’est pas de la langue de bois que de dire que chaque contexte historique est spécifique ; nous essayons de nous garder d’avoir une approche trop tranchée qui ne tienne pas compte de tous les éléments.
Au-delà du cas de l’Azerbaïdjan, force est de constater que nous assistons à un durcissement de la situation des droits de l’Homme et des libertés publiques dans de nombreux pays et, dans les enceintes multilatérales, le combat de cultures est beaucoup plus âpre qu’au cours des dix ou vingt dernières années – je pense à l’évolution de pays tels que la Turquie, la Russie ou certains partenaires de l’Union européenne. Cette évolution crée un contexte susceptible d’encourager des régimes, tels que celui de l’Azerbaïdjan, à aller plus loin, de même qu’en Afrique centrale, le fait qu’un président change la Constitution pour se faire réélire incite ses voisins à faire de même. Ce contexte n’est pas particulièrement encourageant, et il s’étend aux questions de société : sur la famille ou la situation des femmes, la polarisation est plus forte qu’auparavant. Cela ne doit pas nous inciter à désarmer, au contraire. Nous devons continuer à travailler avec nos partenaires les plus proches, notamment les membres de l’Union européenne, pour faire valoir nos intérêts, au fond, car la défense des droits de l’Homme est une question de principe mais concerne aussi nos intérêts. C’est en tout cas la conviction du ministre.
M. le président François Rochebloine. Je vous remercie, monsieur le directeur, pour la qualité de votre intervention et de vos réponses.
*
* *
Ÿ Audition de Mme Aurélia Bouchez, ambassadeur de France en Azerbaïdjan (jeudi 20 octobre 2016)
M. le président François Rochebloine. Nous avons le plaisir de recevoir Mme Aurélia Bouchez, ambassadrice de France en Azerbaïdjan. Je vous remercie, madame, d’avoir répondu à notre invitation.
Après que Mme Florence Mangin, directrice pour l’Europe continentale, et M. Jean-Pierre Lacroix, directeur pour les Nations unies, les organisations internationales, les droits de l’Homme et la francophonie au ministère des affaires étrangères, nous ont présenté la position officielle de la France, ce que vous nous ferez savoir de votre expérience directe nous sera précieux.
Quelle appréciation portez-vous sur l’état des relations politiques et économiques entre la France et l’Azerbaïdjan ? Existe-t-il une concertation, formelle ou informelle, entre les ambassades en Azerbaïdjan des États de l’Union européenne ? Quelle analyse faites-vous de la situation politique intérieure ? Quelle est votre interprétation de la réforme institutionnelle – qui, selon M. Lacroix, renforce les pouvoirs de l’Exécutif ? Vous connaissez l’appréciation négative sur le respect des droits de l’Homme et des libertés en Azerbaïdjan portée par plusieurs organisations internationales, dont le Conseil de l’Europe. Qu’en est-il de la liberté d’opinion, de la liberté de circulation et du respect des droits de l’opposition ? Enfin, quel est l’impact de la baisse des cours du pétrole sur la politique budgétaire et sociale du gouvernement azerbaïdjanais ?
Mme Aurélia Bouchez, ambassadeur de France en Azerbaïdjan. Je vous remercie de m’avoir invitée à vous présenter l’Azerbaïdjan, pays où je suis en poste depuis un an mais où il me semble l’être depuis plus longtemps tant les relations bilatérales sont dynamiques, riches et diversifiées et tant la région connaît d’évolutions.
Deux éléments caractérisent le contexte régional : le conflit du Haut-Karabagh, sujet sur lequel je ne m’attarderai pas puisqu’il est de la compétence de M. Pierre Andrieu, co-président du Groupe de Minsk, que vous recevrez ; la présence de voisins de poids que sont la Russie, l’Iran et la Turquie, ainsi que la Géorgie. Tous ont connu récemment des évolutions majeures. Je citerai la tension russo-turque, la réintégration de l’Iran dans le jeu régional après la levée de la plupart des sanctions internationales, l’affirmation militaire russe dans la Caspienne, la convergence irano-russe en Syrie, la tentative manquée de coup d’État en Turquie. Outre que ces événements ont, à des degrés divers, des répercussions en Azerbaïdjan, ils se déroulent dans un contexte général marqué, de manière particulièrement sensible dans cette partie du monde, par la montée du fondamentalisme, le renforcement du risque terroriste et aussi la baisse persistante du prix du pétrole, qui affecte la plupart des économies de la région.
L’Azerbaïdjan doit de plus faire face à la crise économique la plus sérieuse connue après les débuts de son indépendance – crise qui provoque changements et réformes – tout en finançant l’essentiel des dépenses liées au corridor gazier Sud. Il finance en effet quelque 60 % du coût du segment trans-anatolien du gazoduc, le TANAP, et presque un quart du segment trans-adriatique, le TAP.
Tel est le cadre de l’action bilatérale franco-azerbaïdjanaise. Il s’agit avant tout d’un dialogue politique au plus haut niveau. Entre 2014 et 2016, le président de la République et le président Ilham Aliev se sont entretenus trois fois. Deux rencontres ont eu lieu à Bakou, la troisième en marge du sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), à Varsovie, en juillet dernier. Les rencontres au niveau ministériel sont fréquentes : en 2016, le ministre azerbaïdjanais des affaires étrangères est venu deux fois à Paris, et le Secrétaire d’État chargé des Affaires européennes, M. Harlem Désir, s’est rendu à Bakou. De 2014 à 2016, douze visites de présidents, de ministres ou de secrétaires d’État ont eu lieu ; ce nombre est impressionnant. Lors de ces entretiens, le dialogue porte sur une grande diversité de sujets d’ordre politique, culturel et économique. En matière politique, les discussions ont trait à la situation du Haut-Karabagh et aux évolutions régionales, mais aussi aux questions intérieures, le sujet de l’État de droit étant toujours présent.
L’Azerbaïdjan est pour la France un partenaire important à plusieurs titres. En raison, d’abord, de sa situation géographique : en matière de sécurité et de stabilité, et compte tenu de la proximité du Proche-Orient et du Moyen-Orient, c’est pour nous un interlocuteur clef quand nous cherchons à évaluer l’évolution des défis sécuritaires autour de la Caspienne, au Daghestan, en Iran et dans les pays d’Asie centrale, lesquels sont confrontés au retour des combattants revenus d’Afghanistan et aux trafics divers, dont celui de stupéfiants. Par ailleurs, l’Azerbaïdjan entretient de bonnes relations avec la Russie, la Turquie et l’Iran, et parvient à les maintenir même lorsqu’ils se querellent entre eux. Parler à l’Azerbaïdjan, c’est avoir une discussion ouverte sur l’évolution politique de partenaires politiques majeurs pour la France ; c’est également l’occasion de faire partager nos propres analyses stratégiques. Cet apport de la France est important en soi, et aussi parce que l’Azerbaïdjan s’emploie fortement à préserver sa souveraineté nationale, son indépendance de décision et sa stabilité, ce qu’il sait ne pouvoir faire qu’en maintenant des relations équilibrées avec l’ensemble de ses grands voisins. Cette diplomatie d’équilibre ne se conçoit que si l’Azerbaïdjan donne toute sa place à l’Occident et en particulier à la France. Le président Ilham Aliev rappelle cette doctrine à tous ses interlocuteurs, et de manière systématique dans ses déclarations publiques. Il arrive que la présidence azerbaïdjanaise critique l’Occident, mais sans jamais remettre en cause l’importance du dialogue avec nous, comme les actes le prouvent.
Nous entretenons donc un dialogue confiant sur les considérations stratégiques régionales avec un partenaire attaché à la stabilité et aux rapports de bon voisinage. Mais ce dialogue franc et ouvert n’élude pas les questions relatives à la situation intérieure du pays. Nous rappelons, à tous les niveaux, que la stabilité durable à laquelle aspire l’Azerbaïdjan ne peut être fondée que sur l’État de droit et que le dialogue inclusif avec l’ensemble des composantes de la société civile et politique est le meilleur gage de stabilité. Nous transmettons ce message régulièrement, en faisant alterner, selon les sujets, une diplomatie publique et une diplomatie plus discrète. Nous usons de la diplomatie publique pour exprimer des positions de principe – ce que la France a fait parfois seule, parfois dans le cadre de l’Union européenne ou de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) – et aussi lors de l’arrestation de certains opposants, tels M. et Mme Yunus ou Mme Khadija Ismaïlova. Parce qu’il importe de faire preuve d’une position équilibrée, nous avons aussi réagi de manière positive lorsqu’ils ont bénéficié d’une libération conditionnelle. Nous utilisons une diplomatie plus discrète pour obtenir des résultats précis. Je rappellerai à cet égard le cas célèbre de la libération pour cause humanitaire des époux Yunus. Après que Mme Yunus eut reçu en 2013 les insignes de la Légion d’honneur des mains du président François Hollande et que la France eut exprimé publiquement sa position au sujet de la situation de ce couple, nous avons aussi entretenu un dialogue discret avec les autorités pour obtenir que les époux Yunus puissent, comme ils le souhaitaient, être autorisés à titre humanitaire à sortir d’Azerbaïdjan pour recevoir à l’étranger les soins requis par leur état de santé. Notre action diplomatique, publique ou discrète, s’adapte aux circonstances et recherche des résultats. Elle est appréciée par les opposants et les activistes. Les remerciements que j’ai reçus en sont la démonstration. Mais l’on peut toujours faire plus et mieux, et il faut persévérer.
Sans nous départir d’une approche critique, nous devons prendre en compte les évolutions positives, qu’elles soient de fait ou en germe. Au nombre des premières, je citerai la position de l’Azerbaïdjan sur la peine de mort – le pays a, sur ce plan, toujours été aux côtés de la France – et sur la laïcité, entendue comme le droit pour chacun d’exercer sa religion librement, sans être passible d’amende ou d’emprisonnement parce que l’on ne porte pas le voile, comme cela se produit ailleurs. En Azerbaïdjan, la pratique laïque, garantie par la Constitution, est réelle. Cela a été souligné par le pape François lors de sa récente visite comme par le Bureau international de la démocratie et des droits de l’Homme (BIDDH) de l’OSCE, dont le président a rendu hommage à cette tolérance religieuse. Cette position remarquable en un temps où les pays musulmans modérés respectant les libertés se font rares, doit être soutenue car l’état d’esprit, dans les pays voisins de l’Azerbaïdjan, n’est pas toujours le plus propice à cette approche laïque de l’islam, étant donné l’influence qu’y exercent l’Iran, le mouvement salafiste wahhabite venu du Daghestan et des États du Golfe. Le multiculturalisme traduit la volonté de l’Azerbaïdjan d’être un pont entre l’Asie et l’Europe et entre les religions ; le pays a d’ailleurs pour intéressante particularité d’être membre à la fois du Conseil de l’Europe et de l’Organisation de la coopération islamique.
Au nombre des évolutions prometteuses vers une démocratie plus affirmée et plus claire, je mentionnerai la reprise du dialogue, le 21 septembre dernier, entre l’Azerbaïdjan et le Parlement européen et, plus généralement, avec l’ensemble des institutions européennes. Le plus visible est la négociation actuelle du mandat en vue d’un accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan ; tous les accords de ce type comportent systématiquement un important volet relatif à l’État de droit. Autre élément concret : l’accord en vigueur entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan prévoit l’existence d’un sous-comité bipartite « justice, affaires intérieures, droits de l’homme, démocratie, migration et asile », et l’Azerbaïdjan a donné son accord pour une réunion de ce sous-comité, qui a eu lieu la semaine dernière, avant l’ouverture des négociations du nouvel accord. Enfin, à la suite de la visite à Bakou de Mme Federica Mogherini, Haute-Représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et des pressions exercées par certains États dont la France, certains opposants au régime, y compris les époux Yunus et Mme Ismaïlova, ont bénéficié de libérations conditionnelles et 148 personnes ont été amnistiées, dont plusieurs activistes des droits de l’Homme inclus.
M. le président François Rochebloine. Combien d’opposants sont encore emprisonnés ?
Mme Aurélia Bouchez. Les estimations varient. Quelques dizaines, sans doute, mais tout dépend des critères utilisés pour les définir et des informations que nous donnent les organisations non gouvernementales (ONG). Certes, nous ne sommes pas au bout du chemin, mais notre rôle est d’accompagner les étapes. Tels sont les éléments positifs, et je pense que l’on n’en est qu’au début.
J’ajoute que les réformes économiques peuvent enclencher une dynamique de plus grande transparence et une lutte plus efficace contre la corruption. C’est en tout cas ce qui est annoncé par les plus hautes autorités. Ainsi, l’Agence d’État pour le service public et l’innovation sociale (ASAN) vise à éliminer par des procédures électroniques la petite corruption administrative, la plus sensible par les citoyens. Notre rôle est d’encourager les évolutions positives tout en maintenant une vigilance intacte.
Notre action comporte désormais un troisième volet, celui de la coopération décentralisée, qui en est encore à ses débuts. À ce jour, un peu plus d’une douzaine d’accords ou de partenariats ont été conclus entre des municipalités françaises et azerbaïdjanaises. Ce sera pour nous une manière de favoriser les contacts et peut-être des opportunités pour nos entreprises – MEDEF International est intéressé – et de promouvoir notre conception de la gouvernance, sachant qu’une décentralisation réelle est un facteur clef de démocratie vivante. Nous espérons pouvoir progresser en ce sens.
Nos relations avec l’Azerbaïdjan se traduisent aussi par une coopération économique. Malgré la crise qu’il connaît, le pays reste notre principal partenaire économique dans le Caucase, et la quatrième destination de nos exportations dans l’espace de l’ancienne URSS. Nous sommes le troisième acheteur de gaz azerbaïdjanais ; le pays est donc un élément important dans notre stratégie d’approvisionnement et de sécurité énergétique. Cependant, on ne peut sous-estimer la gravité de la crise qui affecte l’Azerbaïdjan. Elle a eu pour effet, en 2015, deux dévaluations qui ont fait perdre à la monnaie l’essentiel de sa valeur, et une inflation qui devrait être de 10 % au moins cette année. En conséquence, par un tour de force assez laborieux, le budget, qui avait été établi sur la base d’un baril à 60 dollars a dû être recalculé en cours d’exercice sur la base d’un baril à 25 dollars.
De manière remarquable, dans l’allocution qu’il a prononcée en janvier dernier au sommet de Davos, le président Aliev a affirmé que la crise que connaît l’Azerbaïdjan offre une chance de faire les réformes nécessairement douloureuses dont l’abondance de l’argent du pétrole avait, par facilité, dispensé le pays jusqu’alors. Ce sera, a dit le président, l’occasion de renforcer la transparence, de lutter contre la corruption et les monopoles, de favoriser la concurrence et de diversifier l’économie – car la crise illustre les méfaits de la dépendance au pétrole. Pour obtenir ces résultats, il faut attirer des investisseurs étrangers, ce qui incite à rendre le pays attractif et à améliorer le climat des affaires. C’est ainsi que peut s’enclencher une spirale vertueuse. J’ai immédiatement appuyé cette approche, en indiquant que nous veillerions à ce que les entreprises françaises fassent connaître leur point de vue sur ce qui pourrait améliorer la marche des affaires en Azerbaïdjan. J’ai des contacts réguliers avec la présidence, qui est le moteur des réformes. Nos conseillers du commerce extérieur sont en relation avec les chambres de commerce et les entreprises, et nous avons de nombreux échanges avec des autorités azerbaïdjanaises ainsi qu’avec l’ASAN. Ces relations sont très ouvertes car les autorités savent que nous cherchons à les aider et à les encourager.
Les réformes seront laborieuses parce que l’Azerbaïdjan a un héritage soviétique, compliqué par la facilité qui a prévalu au cours des belles années pendant lesquelles la croissance annuelle, fondée sur le commerce des hydrocarbures, était parfois de 30 %. Maintenant s’ouvre une phase difficile. Les premiers pas ont été convaincants : ce fut la réforme des douanes, qui a facilité la vie de nos entreprises. Mais ce n’est qu’un début, et je n’aimerais pas laisser entendre que la situation est subitement passée du noir profond au blanc pur. La procédure d’appel d’offres pour les commandes publiques a également été réformée et une réforme des impôts et taxes est en cours – mais la précédente réforme, laborieuse, est encore inachevée.
Les priorités retenues pour la diversification économique et les avantages afférents devraient être dévoilés en novembre. Des signaux ont déjà été donnés : ainsi, l’agriculture bénéficie de conditions favorables en matière de taxation et de financement. Nous espérons que cette politique se prolongera car les entreprises françaises sont particulièrement bien placées pour en bénéficier. En effet, nos entreprises du secteur de l’énergie sont présentes en Azerbaïdjan, mais aussi des entreprises de secteurs appelés à devenir prioritaires dans la diversification économique à venir, dont nous avons déjà quelque idée. Se trouvent ainsi déjà en Azerbaïdjan des entreprises françaises de transport telles qu’Alstom, Thales et d’autres encore. Or, l’Azerbaïdjan envisage de devenir un hub régional de transport multimodal. Nous avons donc une carte que nous ne manquerons pas de jouer, et nous sommes sûrs d’être au cœur de ce volet de la diversification projetée. De même, des entreprises françaises sont bien placées pour participer au développement d’un secteur agricole et agro-alimentaire encore balbutiant, de l’industrie aéronautique et spatiale et de celle de l’environnement. Ce n’est d’ailleurs pas un mystère, et cela a été mis en valeur, le 13 mai dernier, lors d’une visite particulièrement réussie d’une délégation d’une quarantaine de chefs d’entreprise adhérentes de MEDEF international, qui a notamment été reçue par le président Aliev pour un entretien à bâtons rompus d’une heure et demie. Cette audience témoigne de l’importance qu’accorde la présidence à ce que les technologies françaises, qui jouissent d’un prestige mérité en Azerbaïdjan, peuvent apporter à la diversification économique du pays. Le président Aliev m’a d’ailleurs indiqué qu’« acheter français » est pour lui un gage de réussite.
Pour autant, le contexte, difficile, demeure celui d’un État qui a hérité beaucoup de la bureaucratie de l’ancienne Union soviétique, et les réformes n’en sont qu’à leur début. Quand les entreprises françaises rencontrent des problèmes, elles demandent le concours de l’ambassade. Nous intervenons à haut niveau, et nous sommes entendus.
Un mot sur les hydrocarbures. La France, je vous l’ai dit, est le troisième acheteur de gaz azerbaïdjanais. Les entreprises françaises sont présentes en Azerbaïdjan dans le secteur de l’énergie et elles le resteront. Engie sera l’un des principaux acheteurs du gaz extrait à Shah Deniz 2 – c’est une contribution importante à la viabilité du corridor gazier Sud – et Total devrait assurer la production de gaz du très important champ offshore d’Apchéron. Je rappelle que l’Azerbaïdjan est au 23e rang mondial des pays producteurs de gaz naturel, classés en fonction de leurs réserves.
Nous avons mobilisé l’Agence française de développement (AFD), qui contribue au financement de projets dans le secteur ferroviaire.
Ces relations bilatérales, riches et équilibrées, concernent aussi la culture et l’éducation. Le terreau est exceptionnel. Dès le XIXe siècle, via la Russie et l’Empire ottoman, l’Azerbaïdjan a découvert l’Europe. Tous les intellectuels azerbaïdjanais rêvaient d’aller à Saint-Pétersbourg perfectionner leur connaissance de la langue russe et apprendre le français avant de partir à Paris. La tradition a perduré et elle a été favorisée par le boom pétrolier de la fin du XIXe siècle : les investisseurs étrangers – les frères Nobel, la famille Rothschild – et les magnats azéris, tel Zeynalabdin Taghiev, partageaient la même culture européenne amoureuse des Lumières, culture qui a poussé, à cette époque, à l’ouverture d’écoles de filles sur le modèle français et qui a inspiré la première République azerbaïdjanaise, laquelle a reconnu en 1918 le droit de vote aux femmes. Ce terreau est favorable aux relations culturelles entre l’Azerbaïdjan et la France, et nous menons à ce sujet une politique structurée en trois axes : contribuer à la modernisation et à l’ouverture d’esprit de la société ; partager les valeurs de la République française, qu’énonce sa devise ; entretenir le dialogue avec la société civile azerbaïdjanaise, la jeunesse en particulier, dans un pays où les ONG sont peu développées.
La présence française est marquée par l’Institut français d’Azerbaïdjan, lieu d’apprentissage du français et de débats d’idées avec des personnalités venues de France. Elle l’est aussi par le lycée français de Bakou, qui est une réussite et qui fonctionne en coopération entre la Mission laïque française et la Société pétrolière nationale de la République d’Azerbaïdjan (SOCAR). Elle l’est encore par la nouvelle Université franco-azerbaïdjanaise (UFAZ) que j’ai inaugurée le 15 septembre dernier ; né de la coopération entre le ministère de l’éducation d’Azerbaïdjan et les universités de Strasbourg et de Rennes, l’établissement préparera à des doubles diplômes d’ingénieur. Plus largement, l’Azerbaïdjan prend le système éducatif français comme référence pour la modernisation de son propre système éducatif, à tous les niveaux.
Nous nous attachons à promouvoir l’apprentissage du français. Après le russe et l’anglais, c’est la troisième langue étrangère étudiée en Azerbaïdjan, où l’on compte 43 000 élèves de français. Nous aidons à former des professeurs locaux, à Bakou et en province, et nous avons porté à treize le nombre de bourses accordées à de jeunes Azerbaïdjanais partant faire leurs études supérieures en France, qui s’ajoutent à une dizaine de bourses européennes Erasmus. Nous avons noué une coopération, très appréciée, avec l’Université Paris-Sorbonne Abu Dhabi pour orienter par ce biais les élèves vers la culture française. Nous utilisons au maximum les financements accordés par l’Union européenne au titre de l’Instrument d’assistance technique et d’échange d’informations (TAIEX, selon l’acronyme anglais), pour promouvoir l’expertise de nos administrations publiques ; c’est très important pour la modernisation de l’État. Dans ce cadre, la France a participé à des travaux sur l’efficacité du système de retraite, participe à l’amélioration du système de protection sociale des personnes handicapées et coopère également avec l’Azerbaïdjan en matière d’épidémiologie vétérinaire. La France est, après l’Allemagne, celui des pays de l’Union qui utilise le plus ces financements européens en Azerbaïdjan.
En conclusion, dans un contexte de crise économique durable génératrice de changement et d’instabilité régionale, notre ambassade s’attache à renforcer la présence française dans des domaines variés et complémentaires afin d’avoir avec ce pays un partenariat équilibré, orienté vers l’avenir. Nous veillons à encourager l’Azerbaïdjan sur le chemin des réformes et à appuyer la volonté d’indépendance et de souveraineté nationale qui se manifeste par une diplomatie équilibrée, multivectorielle, qui fait sa place à l’Union européenne et en particulier à la France.
Quelques précisions maintenant, pour répondre à vos questions, monsieur le président. S’agissant de la concertation entre l’ambassade de France et celles – une bonne vingtaine – des autres États de l’Union européenne en Azerbaïdjan, des réunions ont lieu tous les quinze jours. Les échanges sont ouverts et chaleureux, et l’approche est convergente : chacun dresse un bilan mitigé en matière de droits de l’homme, mêlant des éléments préoccupants et des éléments plus positifs, et souligne une dynamique, notamment européenne, qui va dans le bon sens – mais il faudra être attentif à chacune des étapes. Cela étant, en arrière-plan, la concurrence économique demeure et, en dépit de la crise, l’Azerbaïdjan demeure un pôle d’intérêt pour beaucoup. La concurrence économique est à l’œuvre avec de très nombreux pays européens – Allemagne, Espagne, Italie, Pologne, République Tchèque et Royaume-Uni plus particulièrement pour le pétrole – mais aussi avec la Corée du Sud et le Japon et, dans une moindre mesure, avec la Chine et les États-Unis. Israël est également un concurrent important. Cette concurrence est un encouragement à renforcer encore le dialogue et la coopération économique entre la France et l’Azerbaïdjan.
Pour ce qui est du référendum du 26 septembre dernier, la Commission de Venise a montré que l’allongement du mandat du président, la création de postes de vice-présidents nommés par lui, la faculté qui lui est donnée de dissoudre le Parlement, ainsi que d’autres dispositions, sont autant de pouvoirs supplémentaires confiés à un président qui en a déjà beaucoup, au détriment d’un Parlement déjà faible. De plus, certains des 29 amendements à la Constitution appellent des éclaircissements. Je les ai demandés aux autorités ; elles ont fait valoir que les dispositions considérées étaient liées à la mise en œuvre et à l’accélération des réformes. On peut juger cet argument de différentes manières. Une précision cependant : la seule source d’impulsion des réformes est la présidence, et elle rencontre des difficultés dans leur mise en œuvre car elles froissent certains intérêts.
Le rôle du Parlement dans la mise en œuvre de la révision constitutionnelle est très limité. Le principe de la hiérarchie des normes n’existant pas tel que nous le connaissons, beaucoup dépendra de l’utilisation qui sera faite, ou qui ne sera pas faite, des dispositions nouvelles. Je note que le président Aliev a déjà indiqué à la presse qu’il n’entendait pas convoquer d’élection présidentielle anticipée, comme il le pourrait. Quant aux dispositions relatives au droit de propriété foncière, elles sont présentées comme indispensables à la réalisation du hub régional de transport multimodal : si l’on veut construire une voie ferrée, il faut une base juridique permettant à l’État d’acquérir des terrains ; or, dans la tradition soviétique, l’acquisition d’un terrain est toujours problématique. Il faudra voir quelle est la pratique, et nous exercerons notre vigilance habituelle.
La population a payé un lourd tribut à la crise économique et les critiques virulentes de la gestion du gouvernement parues dans la presse traduisent les tensions sociales. Apparemment, le message a été entendu puisque, au sein d’un budget dans lequel l’ensemble des recettes et des dépenses est en baisse de 13 %, les dépenses sociales et de santé augmentent de 32 %. Je ne dis pas que cela suffit à régler les difficultés de la société azerbaïdjanaise, notamment celles des classes sociales les moins aisées, mais cela témoigne d’une prise de conscience.
M. le président François Rochebloine. Je vous remercie, madame, pour cet exposé et pour le travail que vous accomplissez à l’ambassade de France à Bakou. Quelle est votre appréciation de la liberté d’opinion, de la liberté de circulation, du respect des droits des opposants au Parlement ? Combien de journaux peuvent réellement s’exprimer ?
Quelle est, d’autre part, l’orientation de l’Azerbaïdjan dans la lutte internationale contre le terrorisme ? Des Azerbaïdjanais ont-ils été recensés comme soutenant Daech ? Quelle est la position officielle des autorités à ce sujet ? Quelle est la part des dépenses militaires dans le budget du pays et quelle est l’évolution de cette ligne budgétaire ? La France a-t-elle une relation économique avec l’Azerbaïdjan en matière d’armement ?
Quelle est la part des initiatives privées, françaises et azéries, en matière culturelle et pour quel montant ?
Enfin, le site Vision azerbaïdjanaise, relatant la remise de vos lettres de créance au président Ilham Aliyev, le 11 novembre 2015, vous fait déclarer que vous appréciez « hautement la stabilité et la tolérance religieuse en Azerbaïdjan, en espérant que celles-ci serviront d’exemple pour les pays européens ». Ce compte rendu transcrit-il fidèlement les propos que vous avez tenus ?
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. Madame l’ambassadrice, je vous remercie pour cet exposé très complet. Pourriez-vous préciser combien de ressortissants russes, américains et turcs résident en Azerbaïdjan et, pour chaque nationalité, le motif principal de leur présence ? Les Azerbaïdjanais éprouvent-ils un sentiment de proximité culturelle avec les Turcs ? Quel est le poids de l’Iran, où vivent 25 millions d’Azéris ? Quelle est l’influence du chiisme et quel est le poids de la religion dans cet État laïc ? Par ailleurs, les relations israélo-azerbaïdjanaises se résument-elles à la livraison d’équipements de défense par Israël ou vont-elles au-delà ?
Vous avez évoqué l’attraction de l’Occident chez les élites azéries au XIXe siècle, mais qu’en est-il de l’opinion publique aujourd’hui ? L’Azerbaïdjan ayant été l’une des républiques de l’Union soviétique, la population regarde-t-elle davantage vers la Russie ou vers l’Occident ? Plus généralement, quelle est l’image de l’Occident ?
Enfin, s’agissant des droits de l’Homme, êtes-vous beaucoup sollicitée, ès qualités, par les journalistes, les avocats, les défenseurs des droits de l’Homme ? Si tel est le cas, intervenez-vous, et quel écho trouvent vos interventions auprès du président et du gouvernement d’Azerbaïdjan ?
Mme Aurélia Bouchez. J’ai dit, lorsque j’ai été reçue par le président Aliyev, que la tolérance religieuse avait valeur d’exemple « dans la région ». Je suis heureuse que votre question me donne l’occasion de dissiper toute ambiguïté, car il arrive que l’on me prête des propos que, bien entendu, je n’ai jamais tenus.
Les libertés fondamentales existent en principe en Azerbaïdjan. Le problème tient au cadre légal dans lequel elles s’exercent. Ainsi, la liberté de manifestation est prévue dans les textes et, plusieurs fois, en septembre dernier, des manifestants ont demandé l’annulation du référendum et protesté contre la situation sociale. Ces manifestations se sont déroulées sans trop de difficultés, mais elles doivent être autorisées et elles sont confinées loin du centre-ville.
M. Jean-François Mancel. Comme en France !
M. le président François Rochebloine. Qu’obligation soit faite aux manifestants de se réunir en banlieue ne m’était jamais apparu.
Mme Aurélia Bouchez. Le cadre légal limite l’exercice des libertés, de manière diverse selon les cas. Ainsi, la presse écrite est étroitement encadrée, mais l’Internet est libre – cela dit, tout dépend de ce que l’on peut écrire sur l’Internet. Il faut prendre en compte le fait que l’Azerbaïdjan est confronté à des menaces fondamentalistes et terroristes, et l’Internet, là comme ailleurs, est un vecteur extrêmement nuisible sur ce plan.
M. le président François Rochebloine. Cela est vrai en tous lieux.
Mme Aurélia Bouchez. L’administration azerbaïdjanaise fait de son mieux pour débusquer le wahhabisme et les autres factions dangereuses. Un certain contrôle est nécessaire, qui peut se comprendre ; la question est de savoir jusqu’où ce contrôle peut aller. L’impression d’ensemble est que les libertés existent en théorie mais qu’elles sont contraintes par le cadre légal qui s’est durci depuis quelques années, comme en Russie, au Kazakhstan et ailleurs, après les manifestations de la place Maïdan à Kiev et les Printemps arabes. On le voit, en Azerbaïdjan, avec la loi soumettant le financement des ONG par des fonds étrangers à des conditions si strictes qu’il en devient très difficile. Cela nous choque et nous le disons. On nous répond qu’un financement européen est par définition bienveillant, mais que l’Azerbaïdjan doit pouvoir identifier, contrôler et stopper les financements venant d’Arabie saoudite – et il y en a –, d’Iran et d’autres pays. Nous avons demandé si l’on ne pourrait envisager de distinguer ces financements en fonction de leur origine ; les autorités azerbaïdjanaises n’ont pas trouvé la solution adéquate à ce jour, mais elles y travaillent car elles ont conscience du problème et l’Azerbaïdjan n’a aucune envie de se couper des financements européens potentiels à cause de cette loi. La négociation à venir d’un nouvel accord de partenariat entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan sera un facteur d’accélération de cette prise de conscience, certains pays, dont la France, demandant que la loi sur les ONG soit évoquée dans ce cadre. Même si l’évolution est lente, elle va dans le bon sens.
Le budget consacré à la défense et à l’armement est de ceux qui ont bénéficié d’une hausse ; elle est de 25 %, moindre, donc que celle du budget des dépenses sociales et de santé, qui est de 32 %. Les dépenses de défense représentent 15,3 % du total des dépenses du budget (18,49 milliards de manats azerbaïdjanais).
M. le président François Rochebloine. Indépendamment de la hausse en proportion, il est intéressant de savoir quels sont les montants respectivement consacrés à ces budgets.
Mme Aurélia Bouchez. Je vous les communiquerai. L’Azerbaïdjan souhaite être en position de force pour répondre aux défis sécuritaires qu’elle doit affronter. On pense au Haut-Karabagh, mais le pays s’inquiète de plus en plus de la montée des risques autour de la Caspienne, et il est prêt à dépenser beaucoup d’argent – argent qui n’est pas perdu pour nos amis israéliens et russes – pour assurer la sécurité de ses plateformes pétrolières, lutter contre les trafics d’armes et se prémunir contre la militarisation de la Caspienne. Peut-être y a-t-il aussi le facteur iranien, mais il est difficile de l’affirmer. L’Azerbaïdjan ne veut pas se trouver en position d’infériorité. Outre cela, la crainte de la menace terroriste est réelle, même si, étant donné l’effectivité du contrôle des frontières, l’Azerbaïdjan n’est pas un pays à risque élevé pour l’instant.
En matière de coopération culturelle, les initiatives sont publiques et privées. L’UFAZ est financée par le ministère azerbaïdjanais de l’Éducation – d’ailleurs, le budget consacré à l’éducation est en hausse de 4 % dans un budget globalement en baisse de 13 %. Le lycée français de Bakou, qui compte 132 élèves pour sa troisième rentrée, est financé par la SOCAR, très grande entreprise publique. À mesure que l’effectif des élèves augmentera, le lycée deviendra autonome sur le plan financier. Il y a donc de larges financements publics ou quasi-publics en matière de partenariats éducatifs. En matière culturelle, la Fondation Heydar Aliev a, un temps, joué un rôle actif, contribuant en particulier à l’ouverture du département des arts de l’islam au Musée du Louvre ; c’est moins le cas maintenant, la Fondation semblant désormais privilégier des actions en faveur de l’éducation et l’aide caritative.
M. le président François Rochebloine. Comment est-elle financée ?
Mme Aurélia Bouchez. Nous n’avons guère de détails sur le budget de la Fondation car nous n’avons pas de coopération directe avec elle.
Les situations des populations russe, turque et américaine diffèrent. La présence des Russes en Azerbaïdjan est ancienne, remontant au XVIIIe siècle et même avant, et des Russes sont restés après l’indépendance tandis que d’autres sont venus ; on estime leur nombre total à 120 000 environ ; avec les Ukrainiens et les Tatars, ils forment une population de presque 200 000 personnes, que l’on trouve en particulier dans les élites intellectuelles et universitaires et dans le monde des affaires. Il y a une familiarité réelle entre eux et les élites azerbaïdjanaises, qui ont souvent suivi des études supérieures à Moscou – le fait d’avoir étudié en Russe leur valant brevet de prestige culturel… et d’européanité. Les Russes sont donc très présents : l’université d’État Lomonossov de Moscou a une antenne à Bakou. Pratiquement tout le monde parle fort bien le russe et ce n’est un secret pour personne que la Russie fournit l’Azerbaïdjan en matériel militaire ; c’est d’ailleurs classique dans les pays de l’ancienne URSS, qui ont hérité de stocks importants de matériel soviétique – et l’on ne change ni de matériel ni de formation du jour au lendemain. Cela n’empêche pas l’Azerbaïdjan d’être membre du partenariat pour la paix de l’OTAN.
Les Turcs ne sont pas très nombreux mais la relation entre les Azerbaïdjanais et eux est forte et instinctive, en premier lieu parce que l’azéri est une langue turcique. Selon un dicton, en Azerbaïdjan, « les élites sont russes, la rue est turque ». Il existe une grande sympathie pour le voisin turc, une confiance profonde qui tranche avec la méfiance persistante à l’égard de la Russie qu’expliquent les massacres commis au cours des temps, le plus récent ayant eu lieu le 20 janvier 1990. Cette confiance historique ne signifie pas que les autorités azerbaïdjanaises approuvent tout ce que font les Turcs ; l’évolution actuelle, moins séculière, de la Turquie suscite des interrogations, mais elles ne sont jamais exprimées publiquement. La Turquie est très présente dans le domaine économique. Sa présence culturelle est si diffuse qu’elle ne s’appuie pas sur une politique d’implantation de réseau.
Après la chute de l’Union soviétique, les États-Unis ont consenti un fort investissement initial en Azerbaïdjan pour contrer ce qu’il y restait de l’URSS et pour sécuriser l’accès des Occidentaux aux ressources pétrolière et gazière. Ils ont jeté les bases du corridor gazier Sud, et veillé à ce que le « contrat du siècle » soit remporté par un consortium largement occidental mené par British Petroleum (BP). Cet intérêt d’ordre géopolitique et énergétique s’est ensuite amoindri – mais cette appréciation doit être tempérée par le fait que les États-Unis co-président, avec la Russie et la France, le groupe de Minsk et se tiennent donc informés par ce biais de l’évolution du pays. Ce désengagement relatif s’est infléchi il y a plusieurs mois : les États-Unis redécouvrent en quelque sorte l’importance de l’Azerbaïdjan, d’abord pour des raisons énergétiques. On est au cœur de la politique de diversification des routes énergétiques, en particulier celles qui tendent à contourner la Russie ; tel est le cas du corridor gazier Sud dans son nouveau tracé, et l’Envoyé spécial des États-Unis pour l’Énergie a assisté au conseil ministériel relatif au corridor gazier Sud qui a entériné les deux segments – le TANAP (gazoduc transanatolien) et le TAP (gazoduc transadriatique) – et les financements gigantesques que demande l’achèvement de ce projet. Les États-Unis sont aussi conscients de l’importance stratégique de l’Azerbaïdjan, pays de transit réel ou potentiel, dans la lutte contre le terrorisme dans la Caspienne. Les Américains sont relativement nombreux en Azerbaïdjan, mais moins qu’autrefois car ils étaient présents par le biais d’ONG qui pour certaines ont dû plier bagage. Ils gardent toutefois une forte influence, et la visite du président Aliev au président Obama lors du 4e sommet sur la sécurité nucléaire, fin mars dernier, a été un élément positif, comme l’a été la visite de Mme Federica Mogherini, Haute Représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
Les rapports entre l’Azerbaïdjan et l’Iran sont complexes. La relation entre les deux pays est très ancienne. De nombreuses provinces azéries ont fait partie de la Perse, la frontière entre les deux pays a bougé, comme l’illustre l’exemple de la ville de Tabriz, et au moins 25 millions de personnes de souche azérie vivent en Iran, où cette minorité joue un rôle réel mais non décisif. Le président Aliev privilégie une stratégie pragmatique que je pense avisée : mettant à profit le caractère réformiste de M. Hassan Rohani, président de la République islamique d’Iran, il a noué des contacts avec l’Iran il y a quelques années, alors que ce pays espérait la levée des sanctions internationales, et a fait savoir que l’Azerbaïdjan était prêt à contribuer à la reprise de l’économie iranienne et à la modernisation des infrastructures. Une dizaine d’accords de coopération technique ont été signés dans ce cadre ; c’est aussi une manière pour l’Azerbaïdjan de garder un œil sur les projets iraniens, qu’il s’agisse de l’extraction pétrolière et gazière ou de circuits d’évacuation du gaz, puisqu’il y a en ce domaine un potentiel iranien et peut-être aussi irano-turkmène. Ces accords permettent à l’Azerbaïdjan de nouer une relation lui donnant un bon angle de vue, sachant que la situation économique de l’Iran est telle que l’Azerbaïdjan ne craint pas sa concurrence dans le secteur des hydrocarbures avant bon nombre d’années. Le président Aliev a aussi réussi un coup de maître en créant le format trilatéral russo-azerbaïdjano-iranien concrétisé par les réunions ministérielles, des coopérations techniques et, surtout, un sommet au début du mois d’août à Bakou qui a fait couler beaucoup d’encre. Je ne suis pas certaine que la Turquie ait été particulièrement enthousiaste, mais l’Azerbaïdjan était peut-être heureux de s’affirmer.
Entre l’Azerbaïdjan et Israël existe une relation de confiance solide depuis quelques années déjà. Israël est très présent et les relations sont excellentes, y compris avec des membres du gouvernement israélien.
M. le président François Rochebloine. Pour vendre des armes ?
Mme Aurélia Bouchez. Oui, mais pas seulement : les Israéliens ont, par exemple, une expérience appréciée de l’agriculture en milieu aride. Pour ce qui est des matériels militaires, Azad Systems, co-entreprise israélo-azerbaïdjanaise, a été créée pour produire des drones. Le matériel de défense israélien a une réputation très établie, et Israël ne s’impose pas obligatoirement les limitations que s’imposent les pays membres de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
Les relations de l’Azerbaïdjan avec l’Occident sont ambiguës. L’Occident suscite une réelle fascination, les jeunes rêvent d’aller y étudier, et tout ce qui est européen, singulièrement français, jouit d’un prestige considérable. D’autre part, une frustration s’exprime dans la presse, en substance comme il suit : « Nous vous aimons mais vous nous aimez beaucoup moins et ne nous comprenez pas ». La différence entre une critique constructive et une critique qui ne l’est pas n’est pas toujours perçue. De plus, toute laïque que soit la société azerbaïdjanaise, elle reste patriarcale et assez traditionnelle, et certaines mœurs européennes sont mal comprises.
En matière de droits de l’Homme, la France veille à réagir comme je l’ai décrit, par des critiques ou par des encouragements selon que les choses sont négatives ou positives. Mon adjointe et moi-même avons des contacts réguliers avec les défenseurs des droits de l’Homme et les partis d’opposition. Nous recevons les avocats des personnes emprisonnées, et nous sommes également en contact avec les ONG. Nos interventions ont des échos variés. Il faut parfois des efforts prolongés pour obtenir un résultat, mais je vous ai parlé de cas précis pour lesquels nos interventions ont abouti. Il convient de poursuivre cette action avec ténacité, en portant une attention particulière aux cas qui ont fait l’objet de jugements de la Cour européenne des droits de l’Homme, non pour chapitrer nos interlocuteurs mais parce que quand un État prend des engagements, on s’attend qu’il s’y conforme et qu’il applique les décisions de la Cour. Nous nous devons d’avoir des contacts avec tout le spectre de la société azerbaïdjanaise, et les autorités savent très bien que nous rencontrons des personnalités de l’opposition et de la société civile.
M. Michel Voisin. Je m’intéresse à l’Azerbaïdjan dans le cadre de l’OSCE et en ma qualité de président du groupe d’amitié France-Azerbaïdjan de l’Assemblée nationale. À ce sujet, je déplore, comme mon homologue du Sénat, l’absence de contacts avec nos collègues azéris. J’ai tenté d’organiser une mission, mais ce projet a été contrarié par les contraintes budgétaires et j’ai invité, en vain, une délégation parlementaire par le truchement de l’ambassadeur d’Azerbaïdjan en France. Pouvez-vous intervenir pour que les relations entre nos Parlements s’approfondissent ?
Comme vous le savez puisque vous nous avez aimablement reçus, j’ai participé aux équipes chargées d’observer le déroulement du référendum sur les amendements à la Constitution. Les conclusions de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur l’organisation du scrutin montraient que l’on allait dans le bon sens au regard de ce que nous avons observé au cours d’autres missions.
Ma dernière question, incidente, s’adresse au président de notre mission. Nous devions entendre M. Pierre Andrieu en sa qualité de co-président du Groupe de Minsk, mais l’on apprend qu’il a été remplacé dans cette fonction ; son audition sera-t-elle maintenue ?
M. le président François Rochebloine. Comme vous, j’ai appris cette nouvelle aujourd’hui. L’audition est maintenue, à une date qui sera précisée ultérieurement.
Mme Geneviève Gosselin-Fleury. Comment ont évolué les relations politiques entre l’Azerbaïdjan et la Russie après que celle-ci a annexé la Crimée ?
Mme Aurélia Bouchez. Je ferai le maximum pour encourager les contacts interparlementaires et en particulier toute invitation de la partie française.
L’Azerbaïdjan, lors du vote au Nations unies au sujet de la Crimée, a pris une position reflétant son attachement au principe du respect de l’intégrité territoriale ; mais si les autorités se sont montrées critiques, elles n’ont pas été particulièrement virulentes, par la suite, à l’égard de la Russie. Le sujet, délicat pour les deux pays, n’est évoqué qu’accessoirement. Toutefois, cet épisode a provoqué un dommage collatéral en ravivant le sentiment qu’une politique de « deux poids, deux mesures » s’exerce aux dépens de l’Azerbaïdjan. « Qu’en est-il de l’application du droit international pour nous ? » nous ont dit les autorités, constatant la vigoureuse réaction de l’Union européenne envers la Russie après l’épisode de la Crimée. Cela a renforcé les critiques à l’encontre du Groupe de Minsk.
L’Azerbaïdjan n’a pas voulu que ces événements obscurcissent ses relations avec la Russie, qui sont bonnes. La Russie est le premier partenaire économique de l’Azerbaïdjan – le deuxième étant la Turquie – et les intérêts communs sont trop nombreux pour qu’ils soient remis en cause. Les relations entre le président Aliev et le président Poutine sont, semble-t-il, assez bonnes, et la proximité culturelle des élites est celle que j’ai décrite. On se méfie des Russes en Azerbaïdjan mais on sait comment travailler avec eux. Enfin, l’Azerbaïdjan tient à maintenir de bonnes relations avec la Russie pour s’assurer une partie de ses faveurs dans le dialogue politique sur le Haut-Karabagh. Ces différents éléments font que la relation avec Moscou reste aussi importante qu’elle l’était avant l’épisode de la Crimée.
M. Didier Quentin. J’ai appartenu au corps diplomatique, où il se dit parfois que nos chefs de poste sont victimes d’une sorte de « syndrome de Stockholm », avec une tendance à se faire les défenseurs auprès de Paris du pays dont ils sont les hôtes plutôt que de la position française dans leur capitale de résidence… Votre brillant exposé, madame l’ambassadeur, a présenté des éléments favorables à l’Azerbaïdjan ; quels sont les éventuels petits points noirs ?
M. Jean-François Mancel. Mes félicitations vont à Mme l’ambassadrice pour la clarté et l’exhaustivité de son propos – ce à quoi on pouvait s’attendre de la part d’une diplomate qui, pour avoir précédemment dirigé la délégation de l’Union européenne à Astana, connaît bien la région. Le groupe de l’Union des démocrates et indépendants vous aurait-il entendue avant de réclamer la création de cette mission d’information qu’il ne l’aurait certainement pas demandée – mais cela nous aurait privé du plaisir de vous entendre, madame.
M. le président François Rochebloine. Tout au contraire. Je suis très heureux d’avoir entendu Mme l’ambassadrice, que je félicite pour le travail qu’elle accomplit au nom de la France, mais je juge cette mission d’information plus que jamais nécessaire. Il est dommage, monsieur Mancel, que vous n’ayez pas fait la même observation après avoir entendu M. Jean-Pierre Lacroix, qui a exprimé un autre point de vue.
Mme Aurélia Bouchez. Le risque d’être victime du « syndrome de Stockholm » est toujours possible… Il l’est d’autant plus que les ambassadeurs de France sont très bien accueillis en Azerbaïdjan. Pour autant, dès le début, on perçoit les lacunes et les faiblesses du pays, et j’ai le sentiment d’avoir signalé les principales. Mais un ambassadeur doit agir et, de manière déterminée, nous aidons nos amis à combler les manques et à aller dans le bon sens. J’ai mentionné les points noirs et pour commencer, bien entendu, la situation de l’État de droit. J’ai signalé que les libertés fondamentales existent mais qu’elles s’exercent dans un cadre légal qui les restreint à l’excès. Cela peut s’expliquer par les raisons que j’ai dites ; pour autant, cela ne doit pas conduire à abandonner la lutte visant à ce que les libertés fondamentales s’exercent conformément aux engagements pris auprès de l’Union européenne et de l’OSCE. Un chemin s’est ouvert avec la reprise du dialogue avec le Parlement européen en dépit de sa déclaration très raide de novembre 2015. Notre rôle est d’orienter dans la bonne direction tout en dénonçant les manques connus, comme le fait l’Organisation des Nations unies (ONU). J’ai reçu M. Michel Forst, rapporteur spécial de la Commission des droits de l’Homme de l’ONU sur la situation des défenseurs des droits de l’Homme ; nous étions sur la même longueur d’onde et il a fait état devant moi de la défense des familles de détenus, question importante sur laquelle, grâce à lui, nous avons mis l’accent.
M. le président François Rochebloine. Sans parler de l’état de santé des prisonniers. On a vu quel était celui de M. et Mme Yunus quand ils ont été libérés.
Mme Aurélia Bouchez. J’ai en effet constaté, au fil des visites que je leur ai rendues, combien ils s’affaiblissaient.
Une partie du travail de l’ambassade consiste à venir en aide aux entreprises françaises en proie aux maux habituels que sont le manque de transparence, l’annihilation de la concurrence par des monopoles, des retards de paiement et des remises en cause de contrats ; tous ces éléments leur compliquent singulièrement la vie, et le mot est faible. Je suis intervenue deux fois au plus haut niveau de l’État et nous avons été entendus, mais il faut pour cela, si j’ose dire, mobiliser la « grosse artillerie », c’est-à-dire insister sur la perte de crédibilité de l’Azerbaïdjan auprès des investisseurs étrangers quand de tels épisodes se produisent. Ces difficultés peuvent s’expliquer par la crise budgétaire, par une bureaucratie excessive et par mille autres choses, mais ce n’est pas parce que l’on comprend que l’on accepte. Le rôle d’un ambassadeur est de donner à comprendre, mais cela ne nous empêche pas d’agir fermement. C’est aussi pourquoi je soutiens les réformes en cours ou à venir, qui devront mettre fin à ces situations – mais nous n’y sommes pas encore.
M. le rapporteur. Tout de même ! L’équilibre des pouvoirs est inexistant, l’exercice du pouvoir est dominé par l’Exécutif incarné par son président et le pouvoir du Parlement est extraordinairement limité.
M. le président François Rochebloine. Quel est le nombre des députés d’opposition ?
Mme Aurélia Bouchez. Il n’y en a plus véritablement. Il y a des indépendants.
M. Jean-François Mancel. L’essentiel est d’avoir un bon président : c’est le cas en Azerbaïdjan, pas en France…
Mme Aurélia Bouchez. Les pouvoirs du Parlement ont encore été affaiblis par la révision constitutionnelle, mais le Parlement, peut-être parce qu’il est faible, n’est pas un organe où l’opposition a sa place : il n’y a plus de vrais partis d’opposition depuis que les manifestations de la place Maïdan ont provoqué une crispation progressive. Dans ce contexte, l’investiture du gouvernement par le Parlement ne signifie pas grand-chose. Rappelons-nous que l’Azerbaïdjan est influencé par le formalisme soviétique. Le Parlement ne peut peser que sur la base d’élections vraiment libres, sans quoi l’on est dans un théâtre d’ombres. Or le BIDDH a vivement critiqué le déroulement des avant-dernières élections législatives, et il n’a pas envoyé d’observateurs lors des dernières élections. Nous sommes dans un cadre très contraint. Le président Aliev joue un rôle clef dans la réforme. Cela ne dispense évidemment pas de faire fonctionner les institutions de manière démocratique, mais les choses seront lentes et il existe aussi une crainte sécuritaire croissante.
M. le président François Rochebloine. À l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, les membres de la délégation d’Azerbaïdjan se répartissent entre les différents groupes politiques alors qu’ils appartiennent tous au même parti !
M. Michel Voisin. Lors des élections de 2013, le BIDDH, qui avait accompli une mission de longue durée, a exprimé des réserves sur ce qui s’est passé avant et après les élections. Mais l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et l’Union européenne, ainsi que les observateurs de l’OSCE présents pour la mission de courte durée dont j’étais le coordonnateur ont conclu que les élections s’étaient déroulées normalement. Le BIDDH n’est pas toujours objectif ; c’est un organisme politique aux mains de certains, et il rend des conclusions orientées, différentes de celles du Conseil de l’Europe.
Mme Aurélia Bouchez. Au nombre des faiblesses de l’Azerbaïdjan, je mentionnerai la critique régulière du Groupe de Minsk. Je défends constamment, au plus haut niveau de l’État et devant les journalistes, ce que nous faisons dans ce cadre, et rappelle la nécessité absolue d’une solution pacifique. Le fait de ne pas toujours prendre toutes ses responsabilités, des deux côtés, et d’en imputer les conséquences aux co-présidents est dommageable et nous ne pouvons le tolérer.
Enfin, la lutte contre le terrorisme est une priorité pour l’Azerbaïdjan qui craint la radicalisation et le retour de combattants. Les autorités reconnaissent le départ de 500, peut-être 600, de leurs ressortissants vers le théâtre syrien. Aux frontières, sont contrôlés qui part et surtout qui revient ; ceux qui rentrent de Syrie sont interpellés, fichés, et emprisonnés quand la preuve est apportée qu’ils ont commis des actes de barbarie. Les Azerbaïdjanais partis en Syrie grossissent le bataillon des russophones de Daech venus du territoire de l’ancienne URSS. L’Azerbaïdjan a institué une formation des imams et la surveillance de la teneur des prêches, à Bakou et en province ; la formation des imams à l’étranger ou grâce à des financements de sources étrangères est désormais interdite. La majorité du pays est chiite, mais une bonne proportion des habitants est sunnite. Les recrutements peuvent se faire dans la sphère wahhabite mais aussi du côté chiite. L’Azerbaïdjan veut se tenir le plus éloigné possible du conflit syrien dont il craint les effets collatéraux.
M. le président François Rochebloine. Madame l’ambassadrice, je vous remercie.
*
* *
Ÿ Audition de Son Excellence M. Elchin Amirbayov, ambassadeur d’Azerbaïdjan en France (mercredi 2 novembre 2016)
M. le président François Rochebloine. Nous souhaitons la bienvenue à Son Excellence M. Elchin Amirbayov, ambassadeur d’Azerbaïdjan en France.
Monsieur l’ambassadeur, il y a maintenant six ans que vous représentez votre pays en France, en étant parallèlement ambassadeur d’Azerbaïdjan auprès du Saint-Siège et à Monaco. Ainsi, vous connaissez bien notre pays, sa vie politique, ses caractéristiques économiques et sa culture.
Le but de notre mission d’information est d’examiner les relations politiques et économiques entre la France et l’Azerbaïdjan, au regard des objectifs français de développement de la paix et de la démocratie au Sud Caucase. Vous entendre sur ce vaste ensemble de thèmes est donc très opportun, et je vous remercie d’avoir bien voulu vous prêter à cet échange.
M. Elchin Amirbayov, ambassadeur d’Azerbaïdjan en France. Monsieur le président, je tiens tout d’abord à vous remercier de m’avoir invité aujourd’hui, et j’espère que cette audition vous permettra d’enrichir vos connaissances sur l’Azerbaïdjan et d’apprécier notre vision des relations que nous entretenons avec votre beau pays, la France.
Je commencerai par resituer l’Azerbaïdjan dans son contexte géopolitique, en rappelant que le pays est situé dans le Sud du Caucase, sur les rivages de la mer Caspienne, et qu’il est bordé au nord par la Russie, à l’Ouest par la Géorgie, au Sud-Ouest par l’Arménie et la Turquie, et au Sud par l’Iran.
Au cœur des luttes d’influence entre les deux grandes puissances régionales, l’Azerbaïdjan a subi, au début du XIXe siècle, les deux guerres successives russo-persanes, qui ont entraîné l’annexion des territoires du Nord par l’Empire russe et des territoires du Sud par l’Empire perse, à la suite des traités de Golestan et de Turkmanchai.
Aujourd’hui, avec plus de 9,5 millions d’habitants et un territoire de 86 600 kilomètres carrés, l’Azerbaïdjan est, par sa démographie et sa superficie, le plus grand pays du Caucase du Sud.
Forte d’une histoire millénaire, cette terre, qui fut l’un des plus anciens foyers de peuplement humain, a vu se développer le polythéisme – notamment le zoroastrisme – comme le monothéisme sous ses différentes formes – judaïsme, christianisme et Islam – ferments d’une identité forte, enrichie au fil des siècles par une multiplicité d’apports culturels. Au plan géostratégique, l’Azerbaïdjan s’inscrit par ailleurs au carrefour des civilisations, sur l’ancienne route de la Soie, et joue ainsi le rôle de « pont naturel » entre le Nord et le Sud, l’Est et l’Ouest.
La proclamation de la République démocratique d’Azerbaïdjan, en 1918, marque l’adhésion de ce pays oriental aux valeurs républicaines importées d’Europe. Un Parlement national est créé – dont le premier président est d’ailleurs enterré au cimetière de Saint-Cloud – où sont représentés les différents groupes ethniques et religieux du pays ; un certain nombre de droits et libertés individuels sont garantis, et le droit de vote est accordé aux femmes dès 1918. La République d’Azerbaïdjan de 1918-1920 constitue ainsi la première tentative réussie d’établir un régime laïque et démocratique dans le monde musulman. Malheureusement, cette république n’aura duré que vingt-trois mois puisque, le 28 avril 1920, l’Armée rouge des bolcheviks occupe l’Azerbaïdjan, qui est intégré à l’URSS en 1922.
En octobre 1991, l’Azerbaïdjan restaure son indépendance. Les premières années de l’indépendance sont marquées aux plans politique et socio-économique par d’importantes difficultés. Tandis que la crise économique et l’inflation frappent de plein fouet la population, qui voit son niveau de vie s’effondrer, le pays connaît une période d’anarchie tandis que l’Arménie mène contre lui une guerre non-déclarée.
Dans ce contexte, les premières missions du nouveau régime vont donc consister à restaurer et à consolider les institutions démocratiques, à moderniser les pratiques politiques et économiques du pays, mais également à assurer sa sécurité face aux menées de l’Arménie dans la région du Haut-Karabagh de l’Azerbaïdjan, dont nous subissons les conséquences depuis près de vingt-cinq ans.
Ce n’est qu’à partir de 1996 que l’Azerbaïdjan peut jouir d’une stabilité politique qui va lui permettre de lancer des réformes économiques et politiques importantes. Après soixante-dix ans de régime soviétique, le pays se tourne de nouveau vers l’Occident et, à cet égard, la République d’Azerbaïdjan est bien l’héritière de la première République de 1918 : membre de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) depuis 1992, partenaire de l’Union européenne depuis 1996, membre du Conseil de l’Europe depuis 2001, l’Azerbaïdjan, depuis la restauration de son indépendance, ne cesse de se moderniser et de se rapprocher de l’Europe en harmonisant progressivement sa législation par une série de réformes politiques, économiques et institutionnelles. Ainsi la peine de mort a-t-elle été abolie en 1998, tandis que, membre du Conseil de l’Europe, le pays se soumet à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme et a adopté plusieurs conventions du Conseil de l’Europe ainsi que leurs protocoles additionnels. Un défenseur des droits – ombudsman – a été institué en 2002, et les femmes, qui ont le droit de vote depuis 1918, participent activement à la vie politique et sociale du pays, qui a effectué en parallèle sa transition vers l’économie de marché.
L’Azerbaïdjan a collaboré très étroitement avec la Commission de Venise du Conseil de l’Europe pour modifier le code électoral. Des réformes du système judiciaire ont également été menées avec l’aide des experts du Conseil de l’Europe, et différentes collaborations ont été mises en place avec les organisations internationales – le Conseil de l’Europe et l’Union européenne notamment – dans le cadre de projets liés aux médias, au développement du dialogue avec la société civile et à la lutte contre la corruption. L’une des réformes essentielles méritant d’être citée ici est la création, en 2012, par décret présidentiel, du Réseau azerbaïdjanais de services et d’évaluation – Azerbaijani Service and Assessment Network (ASAN), qui permet aux citoyens azerbaïdjanais d’accéder directement à des services publics plus modernes, plus efficaces et plus transparents.
Au cours de la dernière décennie, l’Azerbaïdjan a connu un fort développement économique. Grâce à sa stratégie pétrolière et aux réformes institutionnelles entreprises, nos performances économiques ont quasiment été multipliées par trois entre 2004 et 2010, et notre PIB a doublé ces dernières années, pour représenter à lui seul près de 75 % du PIB total des trois pays du Sud-Caucase. Nous connaissons un taux de croissance élevé – jusqu’à 34,5 % en 2006 et 29,3 % en 2007, selon la Banque mondiale –, ce qui a permis de fait chuter le taux de pauvreté de 49 % en 2008 à 5 % en 2016. Quant au taux de chômage, il se situe autour de 5 %.
Aujourd’hui, l’Azerbaïdjan se présente donc comme un partenaire économique intéressant, notamment du fait de ses ressources en hydrocarbures et de sa position géographique. La mise en exploitation prochaine de l’important gisement du gaz naturel Shah Deniz 2 en mer Caspienne, projet sur lequel nous avons étroitement collaboré avec Total, ouvre de très larges perspectives, tandis que, dans l’hypothèse où le gazoduc transcaspien serait réalisé, l’Azerbaïdjan se situerait sur la route de transit du gaz en provenance du Turkménistan vers l’Europe de l’Ouest. Parallèlement à l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC), l’Azerbaïdjan a construit, en collaboration avec ses partenaires, le gazoduc Bakou-Tbilissi-Erzurum, via la Géorgie et la Turquie, qui assure l’approvisionnement en gaz naturel des marchés européens. Enfin, l’Azerbaïdjan utilise également d’autres voies de transit pour exporter ses hydrocarbures, comme l’oléoduc Bakou-Soupsa et le chemin de fer Bakou-Batoumi, via la Géorgie.
Tous ces projets favorisent le développement d’infrastructures régionales communes non seulement en matière d’hydrocarbures mais, plus largement, grâce au déploiement d’un réseau de routes et de communication, entièrement modernisé : je pense en particulier au projet de chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars, qui doit relier l’Azerbaïdjan à la Géorgie et à la Turquie, et constituer un lien crucial entre l’Est à l’Ouest du corridor caucasien, avec l’ambition de ressusciter l’ancienne route de la Soie en reliant la Chine, l’Asie centrale et le Caucase du Sud à l’Europe occidentale.
Si le pays a connu grâce à ses ressources pétrolières une croissance très rapide dans les années 2000, cette forte croissance s’appuie également sur la diversification et la modernisation de l’économie azerbaïdjanaise. Depuis plusieurs années, l’Azerbaïdjan développe en particulier ses infrastructures et a choisi d’investir dans les transports et les technologies de la communication et de l’information. Nous sommes ainsi le seul pays de la région à avoir lancé en 2013, en coopération avec la France, notre propre satellite de télécommunications, dans la perspective de devenir un hub de communication régionale. Nous développons également un programme spatial, toujours en collaboration avec, pour partenaire principal, la France, dont le savoir-faire et l’expertise sont particulièrement reconnus.
Le pays a traversé la crise de 2008 sans trop de dommages et affichait toujours en 2009 une croissance enviable de 9 %. En 2014, le FMI a estimé à plus de 8 000 dollars le PIB par habitant et, dans le rapport sur la compétitivité globale de 2014-2015 du World Economic Forum, l’Azerbaïdjan est classé 38e sur 144, devant la Russie, la Géorgie et l’Arménie et ses autres voisins, ce qui s’explique principalement par de bonnes performances macroéconomiques : forte croissance, faible inflation, faible niveau de dette publique. Il a gagné une place dans le classement pour l’année 2015-2016 en se positionnant au 37e.
Il est vrai qu’en 2015 la croissance économique s’est considérablement ralentie, du fait, d’une part, de la crise mondiale qui se poursuit et a particulièrement affecté les pays voisins et, d’autre part, de la forte baisse des prix du pétrole. C’est pourquoi le Gouvernement a accéléré les réformes visant à diversifier l’économie, afin de réduire notre dépendance par rapport aux revenus pétroliers et gaziers. Nous avons ainsi enregistré en 2015 une croissance de 8,4 % dans le secteur non énergétique.
L’Azerbaïdjan constitue également un partenaire politique dont l’intérêt est non négligeable, du fait, d’abord, de sa position géostratégique mais également parce qu’il a fait le choix d’une diplomatie que l’on pourrait qualifier de prudente et équilibrée. L’ancien espace soviétique se caractérise en effet par une sorte de bipolarisation opposant, d’un côté, les pays en conflit avec la Russie qui cherchent le soutien occidental – l’Ukraine, la Géorgie et la Moldavie – et, de l’autre, ceux qui ont accepté d’entrer dans l’Union eurasiatique avec la Russie, comme la Biélorussie, le Kazakhstan ou l’Arménie. L’Azerbaïdjan quant à lui a adopté une position indépendante qui lui a permis jusqu’à présent de maintenir de bonnes relations aussi bien avec la Russie qu’avec l’Occident. Il n’est candidat ni à l’entrée dans l’OTAN, ni à l’entrée dans l’Union européenne, ni à l’entrée dans l’Union eurasiatique. Après avoir signé, en 1996, l’Accord de partenariat et de modernisation avec l’Union européenne, l’Azerbaïdjan a pris place dans la « politique de voisinage » de l’Union européenne, et le Partenariat énergétique stratégique conclu en 2006 entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan constitue un excellent exemple de coopération bénéfique pour l’ensemble des parties. Les accords sur l’assouplissement du régime des visas et les accords de réadmission sont entrés en vigueur le 1er septembre 2014. Enfin, lors du sommet du partenariat oriental qui s’est tenu à Riga les 21 et 22 mai derniers, l’Azerbaïdjan a proposé à Bruxelles un projet d’accord bilatéral avec l’Union européenne sur le partenariat stratégique. Nous sommes dans l’attente de la décision du Conseil des ministres de l’Union européenne, qui doit être prise à la mi-novembre, afin de pourvoir entamer les négociations autour de ce nouvel accord bilatéral, qui marquera une nouvelle étape dans nos relations avec l’Union européenne.
L’Azerbaïdjan est également membre du Partenariat pour la paix de l’OTAN, et bénéficie à ce titre d’un plan d’action individuel de partenariat. En témoignage de sa volonté de coopérer, le pays a pris part à la Force internationale d’assistance à la sécurité en Afghanistan (FIAS), à laquelle il a fourni un détachement militaire et diverses formes de soutien, notamment la formation des forces de sécurité et des diplomates afghans, des opérations de déminage ou encore l’autorisation de survol de son territoire ou de transit accordée aux pays de l’OTAN. L’Azerbaïdjan est par ailleurs le seul pays de la région à avoir été élu membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, où il a siégé en 2012-2013. L’Azerbaïdjan est très attaché au caractère laïque de l’État, à la tolérance religieuse et au respect mutuel de toutes les confessions qui existent dans le pays. De ce fait, il constitue une plateforme naturelle pour le dialogue interculturel et interreligieux. L’Azerbaïdjan, où différentes religions ont longtemps trouvé refuge, est un pays à 90 % musulman – avec 65 % de chiites et 25 % de sunnites ; le judaïsme, présent depuis le premier millénaire avant Jésus-Christ autour de trois communautés distinctes, représente environ 25 000 personnes, qui n’ont jamais été persécutées ; quant au christianisme, il rassemble 5 % de la population, répartis entre orthodoxes russes, protestants et catholiques romains. Cette diversité explique que l’Azerbaïdjan soit une république laïque, qui assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. C’est aujourd’hui le seul pays à majorité chiite qui s’affiche laïque et a développé une forte tradition de tolérance religieuse.
Ce n’est donc pas un hasard si un chef de l’Église catholique a visité ce pays du Caucase à majorité musulmane à deux reprises : que ce soit le pape Jean-Paul II, en mai 2002, ou le pape François, le 2 octobre dernier, les deux souverains pontifes ont reconnu l’Azerbaïdjan comme un modèle de tolérance religieuse et de coexistence harmonieuse entre représentants des différentes religions.
Par ailleurs, l’Azerbaïdjan accueille depuis plusieurs années, en coopération avec différentes organisations internationales comme l’UNESCO, le Conseil de l’Europe ou l’ONU, de grands événements internationaux – Forum mondial du dialogue interculturel et interreligieux, Forum mondial humanitaire –, ainsi que de grands événements culturels et sportifs, comme la première édition des Jeux européens ou, pour la première fois, le Grand Prix d’Europe du Formule 1. Cette année, c’est à Bakou que s’est tenu le septième Forum mondial de l’alliance des civilisations des Nations unies, en présence de plusieurs chefs d’État et de gouvernement.
Bref, l’Azerbaïdjan est aujourd’hui un pays stable qui poursuit son développement et conduit une diplomatie indépendante, prudente et équilibrée, fondée sur l’entretien de bonnes relations avec tous ses partenaires.
En ce qui concerne les relations franco-azerbaïdjanaises, je suis ravi de constater qu’elles sont excellentes et demeurent au beau fixe. Nous ne pouvons oublier en effet que la France a été l’un des premiers États à avoir reconnu l’Azerbaïdjan, quelques jours à peine après la restauration de notre indépendance. L’Azerbaïdjan indépendant a, dès le départ, accordé une grande importance au développement de ses relations avec la France, et les présidents de la République successifs ont choisi de réserver à la France leur première visite à l’étranger : cela a été le cas pour Heydar Aliev en 1993 et pour Ilham Aliev en 2004. Depuis, la France conserve une place privilégiée dans la politique étrangère de l’Azerbaïdjan. Du côté français, les deux derniers présidents français se sont rendus trois fois, en 2011, 2014 et 2015, en Azerbaïdjan. Les deux pays ont ainsi instauré un dialogue politique au plus haut niveau qui a permis d’approfondir les relations dans beaucoup de domaines.
Je ne peux pas enfin ne pas évoquer ici le rôle que la France joue dans les tentatives de règlement du principal problème international auquel l’Azerbaïdjan est confronté, celui du conflit avec l’Arménie. Le conflit du Haut-Karabagh a pour origine les revendications territoriales de l’Arménie, et une large partie du territoire de l’Azerbaïdjan – près de 20 % –, allant bien au-delà du Haut-Karabagh, est occupée aujourd’hui par l’armée arménienne. Cette occupation a été condamnée à quatre reprises par le Conseil de sécurité des Nations unies, dont les résolutions, qui exigent un retrait immédiat, unilatéral et sans conditions des forces arméniennes des territoires occupés en Azerbaïdjan, sont malheureusement restées lettre morte, tout comme la résolution adoptée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
Ce conflit a entraîné le déplacement d’une part importante de la population azerbaïdjanaise : on parle d’un million de réfugiés et déplacés internes, soit 11 % de la population. L’événement le plus sanglant s’est produit en février 1992, lors de la prise de la ville de Khodjaly, dont les habitants ont été victimes d’un massacre sans précédent. Lors de cette tragédie, connue sous le nom de « génocide de Khodjaly », 613 civils azerbaïdjanais ont été exterminés en une nuit, tandis que la ville était entièrement rasée, comme a été détruit le patrimoine historique, culturel et naturel de notre peuple dans tous les territoires occupés.
La France copréside avec la Russie et les États-Unis le Groupe de Minsk de l’OSCE, mais, malheureusement, ses efforts n’ont pas encore abouti au règlement de ce conflit tragique. Néanmoins, l’implication de la France est appréciée par l’Azerbaïdjan. Nous sommes notamment très reconnaissants au Président de la République française, François Hollande, d’avoir réuni à Paris, en octobre 2014, les présidents azerbaïdjanais et arménien pour tenter de faire progresser les négociations.
Par ses provocations constantes, par le renforcement de sa présence militaire dans les territoires occupés dont elle modifie, en toute illégalité, la physionomie géographique, culturelle, économique et démographique en y implantant des Arméniens, y compris en provenance de Syrie, l’Arménie montre clairement ses visées annexionnistes sur les territoires de l’Azerbaïdjan et sa volonté de consolider le statu quo actuel, lequel a pourtant été jugé inacceptable à maintes reprises par les chefs d’États des pays coprésidant le Groupe de Minsk. L’escalade de violence meurtrière qui s’est produite sur la ligne de contact début avril 2016, à la suite d’une provocation militaire de l’Arménie qui visait la population civile azerbaïdjanaise, a montré à quel point la situation reste fragile. Je ne suis donc pas d’accord avec ceux qui qualifient ce conflit de conflit « gelé », et ces récents incidents montrent que la menace d’une reprise des hostilités reste vive.
L’Azerbaïdjan a maintes fois attiré l’attention de la communauté internationale sur le fait que la présence illégale des forces armées arméniennes dans les territoires occupés de l’Azerbaïdjan était la principale cause des risques d’embrasement et qu’elle constituait une menace pour la paix et la stabilité dans la région. Depuis les derniers événements sanglants, deux sommets ont réuni, à Vienne en mai et à Saint-Pétersbourg en juin, les chefs d’État azerbaïdjanais et arménien, mais, à cause de la position de l’Arménie qui, sous différents prétextes, continuent de torpiller le processus de négociations, celles-ci sont actuellement dans une impasse.
Pour en revenir aux relations entre la France et l’Azerbaïdjan, il faut souligner qu’elles sont d’abord justifiées par des enjeux économiques ou géostratégiques. L’Azerbaïdjan est le premier partenaire économique et commercial de la France dans la région du Sud-Caucase, avec un montant d’échanges s’élevant en 2015 à 1,3 milliard d’euros.
Les importations françaises en provenance d’Azerbaïdjan sont composées pour l’essentiel de produits énergétiques. Les exportations françaises à destination de l’Azerbaïdjan sont, elles, plus diversifiées et en progression ces dernières années. Citons entre autres les autobus et autres véhicules, les produits pharmaceutiques, les machines, les composants électriques, les boissons alcoolisées ou encore les métaux ferreux et leurs dérivés.
Les entreprises françaises sont bien placées dans les secteurs pétrolier et parapétrolier, mais aussi dans les domaines de la banque, des télécommunications et des transports. Environ cinquante sociétés françaises sont implantées avec succès en Azerbaïdjan, et le volume des investissements français dans le pays s’élève à 2,4 milliards de dollars. Au cours de ces dernières années, des accords prévoyant la réalisation de projets d’infrastructures – vingt-six au total – ont été signés, pour un montant global supérieur à 2 milliards de dollars.
La coopération décentralisée constitue un autre axe important des relations franco-azerbaïdjanaises et a connu ces dernières années un développement considérable. Plus de dix villes azerbaïdjanaises et françaises ont créé des liens à travers le jumelage ou la signature de chartes d’amitié. Cette coopération couvre divers domaines tels que la culture, l’économie, l’éducation et le sport. Afin d’approfondir ces liens entre nos villes et nos régions, les deux gouvernements ont convenu de leur donner une base institutionnelle.
La coopération avec la France dans les domaines de la culture, de l’éducation et de la recherche font partie de nos priorités. L’inauguration, en septembre 2012, du service culturel de l’ambassade d’Azerbaïdjan à Paris, la création du lycée français de Bakou, la fondation d’une université franco-azerbaïdjanaise (UFAZ) cette année à Bakou symbolisent ce remarquable rapprochement entre nos deux pays.
L’UFAZ est un exemple de coopération universitaire unique et innovant, qui permet aux 141 étudiants azerbaïdjanais sélectionnés cet été d’étudier à Bakou dans les mêmes conditions qu’en France : ils recevront, sans quitter leur pays, le même diplôme que les étudiants français, et la carte d’étudiant strasbourgeoise leur permettra d’accéder aux services en ligne de l’université de Strasbourg mais aussi à tous les services réservés aux étudiants s’ils devaient se déplacer en France.
Lancé en octobre 2014, à l’initiative du Président de la République française lors de sa visite à Bakou, ce projet majeur de la coopération franco-azerbaïdjanaise vient de voir le jour deux ans plus tard, grâce au soutien du Président de la République d’Azerbaïdjan : la première rentrée officielle de l’UFAZ s’est déroulée le 15 septembre 2016. Ce jeudi 27 octobre, Mme Aurélia Bouchez, ambassadrice de France en Azerbaïdjan, a remis leurs cartes d’étudiant françaises aux étudiants de l’université, au Centre international du Mugham de Bakou, en présence des représentants de l’Université du pétrole et de l’industrie, de l’université de Strasbourg et du ministère azerbaïdjanais de l’éducation. Je précise que la création du lycée français de Bakou et de l’UFAZ a été entièrement financée par le gouvernement azerbaïdjanais.
L’Azerbaïdjan déploie sa diplomatie culturelle en France et dans divers pays du monde, et peut se prévaloir de quelques belles réussites ces dernières années. Depuis 2011, des manifestations ont ainsi été organisées chaque année à Paris et dans diverses régions françaises, qu’il s’agisse de concerts, d’expositions ou de démonstrations culinaires. Les trois éditions du « Village d’Azerbaïdjan », organisées successivement dans le 6e, le 1er et le 7e arrondissements, en plein cœur de Paris, ont, pour notre plus grande fierté, été accueillies très chaleureusement par les Parisiens et les Français. En outre, l’État azerbaïdjanais a contribué à la création du nouveau département des arts de l’islam du musée du Louvre, inauguré en 2012.
Je veux ici dire un mot de la contribution essentielle de la Fondation Heydar Aliev, la plus grande organisation laïque et non-gouvernementale du Caucase du Sud, au développement de notre diplomatie culturelle. La Fondation a pour vocation de soutenir la culture, les sciences, l’éducation et la santé, tout en promouvant l’image de l’Azerbaïdjan dans le monde. Depuis quelques années, elle mène ainsi des actions de mécénat partout à l’étranger. La liste des projets soutenus par la Fondation Heydar Aliev est longue, mais il me faut en citer quelques-uns. En 2009, la fondation a contribué à la rénovation des merveilleux vitraux de la cathédrale de Strasbourg, qui datent du XIVe siècle et représentent un épisode de la vie de la Vierge Marie et de Jésus-Christ ; elle a également contribué à financer la restauration d’une vingtaine de petites églises rurales en Basse-Normandie ; elle a soutenu les travaux de l’école de musique de L’Aigle, cité millénaire. Enfin, parmi les chefs-d’œuvre restaurés grâce au soutien de la fondation, il faut citer les sculptures du parc du château de Versailles, une Amazone et un vase avec anses en forme de tête de faune, inscrits sur la liste du patrimoine culturel mondial depuis 1979.
À travers ces activités, l’Azerbaïdjan transmet au monde, à un moment où l’on observe partout la montée des conflits et de la haine, un message de paix invitant à la cohabitation et au respect des autres.
Je redirai pour terminer combien l’Azerbaïdjan apprécie les efforts déployés par la France au sein du Groupe de Minsk de l’OSCE pour trouver une solution pacifique au conflit du Haut-Karabagh.
Nous nous réjouissons du fait que nos relations bilatérales avec la France, qui se fondent sur le principe du respect réciproque et répondent aux intérêts mutuels de nos deux pays, sont excellentes. Les échanges dans les domaines politique, économique, culturel ou de l’éducation se développent, ainsi que dans bien d’autres domaines. Nous pouvons néanmoins aller encore plus loin dans l’approfondissement de nos relations, et c’est dans cet esprit que nous continuerons notre travail, compte tenu de l’importance que nous attachons au partenariat qui nous lie à votre beau pays.
M. le président François Rochebloine. Monsieur l’ambassadeur, nous vous remercions pour cet exposé détaillé.
Ma première question concerne les fluctuations du cours des produits pétroliers, traditionnellement source de difficultés pour la conduite de la politique budgétaire des pays producteurs qui tirent une part importante de leurs ressources de la vente de ces produits sur le marché international. Comment ces difficultés se sont-elles traduites dans les choix budgétaires qu’a pu faire le gouvernement azerbaïdjanais ? Y a-t-il eu des dépenses sanctuarisées, c’est-à-dire préservées d’une évolution des crédits et, si oui, lesquelles ?
Pouvez-vous nous donner des indications sur l’évolution des grandes masses de dépenses budgétaires – dépenses civiles et dépenses militaires – de votre pays, au cours des cinq dernières années ?
Pouvez-vous nous décrire les mesures prises ou envisagées par votre gouvernement pour accroître la diversification de l’économie et en diminuer la dépendance par rapport aux activités pétrolières ?
Quelle place tiennent dans ces mesures d’ouverture de l’économie azerbaïdjanaise les investissements étrangers ?
La garantie de la sécurité et de la régularité des procédures d’investissement fait désormais partie des exigences couramment formulées dans les négociations industrielles, financières et commerciales qui entourent les investissements d’entreprises étrangères dans un pays. Comment l’Azerbaïdjan répond-il à ces exigences ? Plus précisément, quelles décisions a-t-il prises pour honorer les engagements qu’il a accepté d’assumer en adhérant en 2013 au Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales ? Sera-t-il en mesure de pratiquer à l’échéance prévue – 2017 ou 2018 – l’échange automatique d’informations sur les comptes bancaires entre les pays membres ? À défaut quelle serait l’échéance de réalisation d’un tel échange ?
Quel est en Azerbaïdjan le régime juridique applicable aux actions de coopération décentralisées entre collectivités territoriales, et quel est pour nos deux pays l’état de réalisation de cette coopération ? Votre Parlement s’est-il saisi, d’une manière ou d’une autre, de cette question ?
Enfin, la Fondation Heydar Aliev déploie ses activités en France dans des domaines variés, en liaison avec de nombreux partenaires. Pouvez-vous nous indiquer quel est le statut de la fondation, quels en sont les organes de direction et quel est son budget ? Pour la France, la fondation a-t-elle d’autres partenaires que notre ambassade à Bakou, mentionnée sur son site ? Quelles sont les activités de la fondation en France ? Quel est le montant des projets qu’elle finance dans notre pays ? Quels sont, comparativement, les montants engagés dans les projets qui concernent d’autres pays de l’Union européenne ? Selon quelle procédure ces projets ont-ils été choisis ?
Enfin, la représentation en France de la compagnie pétrolière nationale azerbaïdjanaise, la SOCAR, est-elle organisée de manière permanente ? Si oui, pourrions-nous auditionner, avant la mi-janvier, la personne responsable ou, à défaut, l’un des membres dirigeants de cette société lors de son passage à Paris ?
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. Quelles relations l’Azerbaïdjan entretient-il avec les États-Unis, la Turquie, la Russie et l’Iran ? Quels sont par ailleurs les pays de l’Union européenne avec lesquels vous entretenez également des relations étroites ?
En matière de droits de l’Homme, envisagez-vous une évolution de votre législation dans la perspective de l’accord d’association qui se négocie entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne, notamment sur deux points précis : d’une part, en ce qui concerne le statut des organisations non gouvernementales (ONG) et la réforme de 2013, qui a suscité un certain nombre de critiques ; d’autre part, en ce qui concerne la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme et le fonctionnement de la justice ?
Si le Haut-Karabagh n’est pas au cœur des travaux de notre mission, nous souhaiterions néanmoins que vous nous donniez la position officielle de votre pays, à la fois sur les origines de la « guerre de quatre jours », sur les raisons qui ont conduit, fort heureusement, au cessez-le-feu, et sur le plan russe de règlement du conflit par étapes ?
Enfin, en ce qui concerne le statut de la mer Caspienne, quel résultat se profile, compte tenu de la convergence entre la Russie et l’Iran, et quel aurait été, selon l’Azerbaïdjan, le statut le mieux adapté et pourquoi ?
M. Elchin Amirbayov. Étant un pays dont l’économie repose très largement sur les revenus provenant du pétrole et du gaz, l’Azerbaïdjan a naturellement été touché par les dernières évolutions des cours mondiaux, sur lesquels nous avons assez peu d’influence dans la mesure où les quantités que nous produisons sont très inférieures à celles des grands pays producteurs comme les pays du Golfe.
Cela étant, la société azerbaïdjanaise a depuis longtemps anticipé l’après-pétrole. Depuis des années, le Gouvernement réinvestit les revenus du pétrole dans le but de diversifier l’économie nationale et diminuer notre dépendance vis-à-vis des revenus pétroliers et gaziers. Ainsi, 70 % des investissements consacrés à ce projet de diversification économique sont d’origine nationale, ce qui signifie qu’une partie des revenus issus des hydrocarbures ont été investis dans l’agriculture, le tourisme ou les technologies informatiques, pour ne citer que ces secteurs.
Il faut se souvenir de l’état dans lequel se trouvait l’Azerbaïdjan au moment de son indépendance, non seulement confronté à d’immenses défis en matière de santé ou d’éducation, mais également obligé de gérer la situation des centaines de milliers de nos compatriotes, victimes de guerre.
Si nous avons fait de la diversification de notre économie une priorité, c’est donc moins à cause de la chute des prix du pétrole que par nécessité et avec l’objectif de préparer notre avenir. C’est dans cette perspective que nous entretenons d’étroites relations de coopération avec de nombreuses sociétés françaises, Alstom, Bouygues, Thales ou Veolia notamment, mais également avec toutes celles qui participent et contribuent aujourd’hui à cet effort de diversification.
Vous avez fait allusion à l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE). Je tiens tout d’abord à souligner que l’Azerbaïdjan a été le premier pays à se soumettre volontairement au contrôle de validité mis en place par l’ITIE, et que la majorité absolue des exigences de celle-ci ont été respectées.
Lors de sa réunion au Kazakhstan il y a une semaine, le conseil d’administration international de l’ITIE a décidé de prolonger l’adhésion de l’Azerbaïdjan. Il a reconnu que notre pays avait accompli des progrès significatifs dans la mise en œuvre de la norme ITIE, et que certaines exigences avaient fait l’objet d’améliorations considérables par rapport à la première validation menée en 2015. Un ensemble de mesures correctives a été défini, et je crois que l’année prochaine, on aura l’occasion de constater de nouveaux progrès dans l’ouverture du secteur pétrolier.
De fait, l’ancien Premier ministre suédois, Fredrik Reinfeldt, a déclaré : « L’Azerbaïdjan a nettement progressé dans l’ouverture du secteur pétrolier, et je considère que les récents projets de réformes gouvernementales en faveur d’un renforcement de la transparence sont encourageants. J’espère que le gouvernement poursuivra les efforts récemment engagés pour que la société civile puisse jouer le rôle qui lui incombe dans ce processus, sous peine de jeter une ombre sur les progrès accomplis ».
On reconnaît donc que l’Azerbaïdjan a pris conscience qu’il lui fallait encore faire des efforts. Mais l’important est d’avoir la volonté politique de poursuivre cette coopération avec l’ITIE et de nous soumettre à son contrôle. Cinquante-et-un pays sont membres de cette initiative. Je crois que la France n’y est pas encore, mais qu’elle a l’intention – comme l’Allemagne – d’y adhérer.
Il n’est pas question, pour nous, de cacher quoi que ce soit ou de faire de la rétention d’informations. Il nous faut seulement prendre en compte certaines réalités qui sont celles d’aires géographiques plus larges. Mais les progrès qui ont été récemment constatés par les dirigeants de l’ITIE montrent que nous avançons dans la bonne direction.
Vous vous êtes interrogé, monsieur le président, sur l’état de la coopération décentralisée.
M. le président François Rochebloine. Quel est son régime juridique ?
M. Elchin Amirbayov. Il est très facile à décrire. Nous avons commencé à nous rapprocher des différentes régions françaises par le biais de la coopération culturelle. L’Azerbaïdjan n’étant pas présent « physiquement » en France, dans la mesure où on n’y trouve pas de communauté importante d’Azerbaïdjanais pour des raisons objectives et subjectives, ce n’est pas un pays connu. Voilà pourquoi nous avons donné une place importante au volet culturel de notre action diplomatique en France.
Nous avons organisé des semaines culturelles de l’Azerbaïdjan dans plusieurs régions et villes françaises. Depuis 2011, vingt-trois villes françaises ont été concernées. À cette occasion, j’ai eu le plaisir de constater que les Français sont très curieux de découvrir un pays – « exotique » pour certains – qui mérite d’être mieux connu.
Dans certaines de ces villes, les élus locaux ont manifesté la volonté d’aller au-delà des échanges culturels et, par exemple, d’aborder le domaine économique. Voilà pourquoi, après ces premiers contacts, nous avons atteint un autre niveau de coopération qui nous a permis de signer des conventions avec ces collectivités territoriales : chartes de jumelage et chartes de coopération et d’amitié. Il s’agit d’approfondir les échanges interhumains entre les différentes collectivités, mais aussi d’imaginer d’éventuels échanges économiques. Comme on ne peut pas tout faire au niveau de l’État ou en passant par les ministères, certaines collectivités territoriales peuvent être intéressées par telle ou telle forme de coopération.
Nous allons continuer nos efforts dans ce sens. Certains des projets qui ont été signés récemment montrent que c’est une coopération « gagnant-gagnant ». Mais il va sans dire que s’il n’y avait pas d’intérêt réciproque, il n’y aurait ni chartes d’amitié, ni chartes de jumelage. On ne peut pas imposer cette coopération.
J’en viens à la Fondation Heydar Aliev, sur laquelle je vous ai déjà donné quelques informations. C’est une ONG à but non lucratif.
Dans un premier temps, celle-ci a mené des actions à l’intérieur du pays, qu’il s’agisse d’aider à la réalisation de certains projets d’envergure dans le domaine de l’éducation, de la santé, de l’amélioration des conditions de vie des personnes déplacées et réfugiées, ou à la protection du patrimoine national.
Dans un second temps, la Fondation a voulu prouver que le patrimoine culturel mondial ne connaissait pas les frontières, et elle s’est engagée dans certaines opérations de mécénat, en France et ailleurs. Je peux citer des pays de l’Europe de l’Est comme la Bulgarie ou la Roumanie, mais aussi d’autres pays comme l’Italie, l’Allemagne, etc. L’idée est que tous ceux qui en ont les moyens doivent considérer comme une priorité de contribuer à la protection du patrimoine.
Comme ce n’est pas une institution à but lucratif, elle ne gagne pas d’argent. Son budget est constitué par des subventions en provenance de différents acteurs privés et par des subventions en provenance de l’État. Mais la plupart des financements viennent de ses partenaires. Sur le site internet de la Fondation, vous pouvez trouver la longue liste de tous ceux avec lesquels certaines opérations ont été réalisées.
M. le président François Rochebloine. Quel est le montant de son budget ?
M. Elchin Amirbayov. Je ne peux pas vous en donner exactement les chiffres qui varient selon les années, selon les projets et les fonds nécessaires pour les réaliser.
La Fondation Heydar Aliev a participé à une opération très importante, qui illustre le rôle que l’Azerbaïdjan joue dans la promotion du dialogue religieux et interculturel : le financement de la restauration des Catacombes de Rome, qui ont une valeur très importante pour le monde chrétien. Le projet, qui portait sur trois ans, consistait à restaurer certaines sections des Catacombes et à les ouvrir au public. Un accord a donc été signé entre le ministère de la culture du Vatican et la Fondation.
L’activité de la Fondation s’étend donc à de nombreux pays. Par exemple, au Pakistan, après le tremblement de terre, elle a financé la construction d’une école pour filles, montrant ainsi notre attachement à l’égalité des sexes et à la promotion des droits des femmes. Et en Roumanie, après les inondations qui avaient touché certains pays de l’Europe de l’Est, elle a mené des actions de mécénat.
M. François Rochebloine. Quels sont les organes de direction ?
M. Elchin Amirbayov. Mme Mehriban Alieva, qui est la première dame de la République d’Azerbaïdjan, tout en étant membre du Parlement et présidente du groupe d’amitié Azerbaïdjan-France, préside la Fondation. Le secrétaire général dirige au quotidien la mise en œuvre des projets. Mais la Fondation est dirigée par un collectif, le Board of Directors, dont certains figurent parmi ses partenaires.
Vous m’avez également interrogé à propos de notre compagnie pétrolière nationale, la SOCAR.
Sans doute avez-vous constaté à quel point elle s’est impliquée dans l’Euro 2016. C’était la première fois qu’elle intervenait en tant que partenaire de l’UEFA, et nous étions ravis de pouvoir contribuer à cette fête qui fut une réussite – ce dont je félicite la France.
Mais la SOCAR n’a pas de représentation officielle en France. Je ne sais pas si, dans les prochaines semaines, certains de leurs représentants vont se rendre à Paris. Cela étant, la SOCAR est une compagnie d’État. Vous pouvez donc nous envoyer les questions qui vous intéressent, et nous essaierons de vous fournir les réponses.
M. le président François Rochebloine. Et s’ils passent par Paris, vous n’êtes pas opposé à ce qu’on les auditionne ?
M. Elchin Amirbayov. Bien sûr que non. Je ne crois pas que cela soulève de difficultés.
La SOCAR a un bureau de trading à Genève…
M. le président François Rochebloine. Ce n’est pas loin, Genève.
M. Elchin Amirbayov. En effet. D’ailleurs, d’autres compagnies pétrolières, y compris Total, y ont installé leur bureau de trading.
Monsieur le rapporteur, vous m’avez interrogé sur les relations que l’Azerbaïdjan entretenait avec les pays de la zone, notamment la Russie, la Turquie et l’Iran, avec les États-Unis et les pays européens.
Dans mon exposé, j’ai essayé de vous faire part de notre ambition de préserver la politique d’équilibre et de bon voisinage avec tous nos voisins. Le seul voisin avec lequel nous ayons encore à régler un problème est l’Arménie. Mais une fois la question du Haut-Karabagh résolue, il n’y aura pas d’obstacle, selon moi, à la restauration des relations diplomatiques entre nos deux pays.
Nos relations avec les États-Unis sont très importantes. Dès le début, ils ont soutenu des projets de grande envergure qui ont renforcé notre indépendance économique et politique, en particulier le projet de construction de l’oléoduc principal Bakou-Tbilissi-Ceyhan, qui transporte les exportations pétrolières de l’Azerbaïdjan vers la Méditerranée et au-delà, vers l’Europe de l’Ouest. Depuis, bien sûr, nous avons engagé un dialogue très fort et très efficace avec les différentes administrations américaines.
Les États-Unis restent un partenaire privilégié de nos relations commerciales. Les sociétés américaines sont très présentes dans le secteur pétrolier, mais aussi dans d’autres secteurs.
Nous coopérons avec eux. Nous avons témoigné de notre attachement à la lutte contre le terrorisme. Juste après les attentats, l’Azerbaïdjan s’est rallié à la coalition internationale pour lutter contre le terrorisme.
Avec la Turquie, nous avons une relation de grande proximité historique, culturelle et linguistique. C’est un pays qui a vraiment beaucoup aidé l’Azerbaïdjan depuis la restauration de son indépendance. On peut dire que, parmi tous nos voisins, c’est le partenaire privilégié.
La Russie est un grand voisin avec lequel nous avons pu développer des relations de proximité, de coopération et même d’amitié, basées sur le respect mutuel, malgré notre volonté de ne pas nous associer aux différents clubs et organisations – par exemple, les organisations de sécurité collective ou l’Union eurasiatique. Nous pouvons rester des amis, de bons voisins, mais tout ce qui concerne notre indépendance est intouchable. Je crois que les Russes ont compris le message. Avec la Russie, nous entretenons un dialogue de grande qualité.
Bien sûr, la Russie joue un rôle très important dans la résolution du conflit du Haut-Karabagh avec l’Arménie. Nous espérons que l’activisme russe de ces derniers mois produira des résultats réels et concrets. Mais je crois que les relations avec les Russes vont au-delà. Elles ont un caractère historique : de nombreux Azerbaïdjanais vivent en Russie, et d’assez nombreux Russes en Azerbaïdjan. Nous avons des liens très étroits, dans les domaines culturel, humanitaire et économique. La Russie reste un partenaire incontournable pour l’Azerbaïdjan.
Avec l’Iran, je l’ai déjà mentionné, nous avons des liens historiques. Peut-être le savez-vous, mais aujourd’hui il y a beaucoup plus d’Iraniens d’origine azérie en Iran – 25 à 30 millions – que d’Azerbaïdjanais en Azerbaïdjan – 9 millions. Cela explique nos relations de proximité et de bon voisinage, malgré les différences que nous pouvons avoir sur de nombreux points – notamment au niveau du régime politique.
Quoi qu’il en soit, l’Iran reste pour nous un grand voisin avec lequel nous partageons 730 kilomètres de frontière – dont 123 sont contrôlés par l’Arménie suite au conflit. Les échanges sont très étroits entre les populations, non seulement entre les parents, mais aussi entre les Iraniens et les Azerbaïdjanais. Récemment, avec tout ce qui s’est passé autour de l’Iran, on a pu constater une certaine accélération des échanges commerciaux et économiques. Encore une fois, l’Iran est un pays très important pour l’Azerbaïdjan dans cette région.
Maintenant, quelles sont nos relations avec les autres pays de l’Union européenne, en dehors de la France ?
Nous entretenons des relations très importantes avec l’Allemagne et le Royaume-Uni, qui reste le plus grand investisseur en Azerbaïdjan – BP y est présent depuis le début de l’indépendance.
M. le président François Rochebloine. Dispose-t-on de chiffres ?
M. Elchin Amirbayov. Je crois que nous sommes à même de vous envoyer tous les chiffres qui concernent les grands pays européens.
Vis-à-vis de la France, le peuple azerbaïdjanais éprouve une affection particulière, qui va au-delà de tout intérêt pragmatique. Cette affection nous porte vers la culture, la littérature et la musique françaises, qui sont très bien implantées dans l’esprit collectif de notre pays. D’où notre volonté de nous rapprocher de la francophonie, et nos investissements pour créer des lycées, l’université et d’autres mécanismes d’échanges humanitaires avec votre pays.
Monsieur le rapporteur, vous m’avez interrogé à propos des droits de l’Homme. Encore une fois, il ne faut pas oublier que notre chemin vers la démocratisation a commencé après soixante-dix ans passés sous le joug soviétique, avec un voisinage pas toujours commode et d’importantes difficultés d’ordre politique, économique et sécuritaire après la restauration de notre indépendance. Il nous a donc fallu un certain temps pour entamer des réformes politiques. Voilà pourquoi nous n’avons commencé à nous rapprocher des valeurs européennes et démocratiques que depuis vingt ans.
L’important reste notre volonté politique de continuer dans ce sens. Mais nous avons déjà bien avancé.
Nous avons aboli la peine de mort ; le pays est devenu membre du Conseil de l’Europe, et s’est ainsi soumis à la Cour européenne des droits de l’Homme ; cinquante-cinq partis politiques sont enregistrés dans le pays ; l’internet est libre, avec des sites d’opposition ; il existe plus de cinq cents journaux, une vingtaine d’agences d’information, une dizaine de chaînes de télévisions nationales et de nombreuses télévisions locales et chaînes de radio, sans compter les journaux. Pendant les campagnes électorales, chaque candidat est assuré d’avoir accès à la chaîne de télévision publique. En outre, au niveau national, les observateurs internationaux sont toujours invités au scrutin.
Nous avons réalisé la transition de l’économie collective vers le libre marché, ce qui n’a pas toujours été facile. Enfin, nous avons engagé le dialogue avec la société civile.
Cela m’amène à une autre de vos questions. Voici quelques mois, à l’initiative du Gouvernement, une plateforme de dialogue a été créée en réponse aux critiques que l’on a entendues, pour renforcer la coopération, la communication et le partenariat entre les institutions d’État et la société civile, et pour contribuer à la mise en œuvre des principes et des valeurs de la société civile en Azerbaïdjan.
En instituant ce dialogue, nous engageons les différents représentants de la société civile à faire des propositions constructives pour améliorer la situation. La création de cette plateforme prouve qu’il n’y a pas de tabous dans notre pays, et que nous voulons continuer à œuvrer dans ce sens.
Nous continuons à ouvrir l’Azerbaïdjan vers le monde tout en restant très fermement attachés aux notions d’indépendance, de souveraineté et de laïcité. Et nous profitons beaucoup de notre participation au Conseil de l’Europe, de nos contacts avec les différents pays, et de notre coopération bilatérale.
J’en viens aux décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme. Depuis 2003, la Cour a rendu 117 décisions et 159 arrêts. On peut dire que la très grande majorité des décisions ont été mises en application par l’Azerbaïdjan, certaines requêtes ayant été préalablement rejetées par la Cour pour irrecevabilité.
Dans ce domaine aussi, le dialogue continue. Nous ne nous enfermons pas dans le déni, nous ne prétendons pas qu’il n’y a pas de problèmes. Comme on dit en anglais, the sky is the limit : nous savons que l’on peut toujours s’améliorer, mais nous sommes également conscients que nous allons devoir faire beaucoup plus rapidement ce que d’autres ont fait sur une longue période de temps. La raison en est que nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre des siècles pour parvenir aux standards d’autres pays.
C’est dans cette logique qu’en tant qu’État jeune, indépendant et attaché à ses valeurs, nous travaillons avec le Conseil de l’Europe et la Cour européenne des droits de l’Homme.
Vous vous êtes demandé quelles étaient les raisons des événements qui ont eu lieu dans la région du Haut-Karabagh en avril.
Elles sont très simples : au début du mois, l’Azerbaïdjan a été attaqué depuis des territoires aujourd’hui sous occupation arménienne, au nord de la région du Haut-Karabagh. Au cours de cette attaque, nous avons perdu huit civils. La ligne de contact du côté azerbaïdjanais est en effet très peuplée.
Cela s’est produit au moment où les présidents azerbaïdjanais et arménien s’étaient rendus aux États-Unis pour le sommet sur la sécurité nucléaire. La provocation était très claire et ne pouvait rester sans réponse de la part de l’Azerbaïdjan. Non seulement on ne peut pas tolérer cette occupation illégale qui dure depuis vingt-cinq ans, mais on ne peut pas garder son calme à chaque provocation. Cette fois, des enfants ont été tués.
Après la réaction de l’Azerbaïdjan, on a assisté à une escalade du conflit, qui a duré quelques jours. Et finalement, grâce aux efforts de la Russie, le nouvel accord sur le cessez-le-feu a été obtenu à Moscou en présence des chefs d’état-major de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan et de la Russie.
Vous avez évoqué la proposition russe, ou le plan russe, que certains appellent « plan Lavrov ». Ce plan ne change pas grand-chose sur le fond. En fait, on ne peut pas espérer que le conflit puisse se résoudre dans le cadre du statu quo, à savoir la présence militaire illégale des forces arméniennes sur les territoires de l’Azerbaïdjan.
Vous voyez sur la carte que l’on vous a distribuée que le Haut-Karabagh n’est pas le seul territoire de l’Azerbaïdjan qui ait été occupé : sont également concernées sept provinces qui entourent le Haut-Karabagh et qui n’ont rien à voir avec les prétentions des Arméniens sur le Haut-Karabagh, dans la mesure où elles n’ont jamais été peuplées par les Arméniens.
Ces sept provinces et le Haut-Karabagh ont fait les frais de la politique d’épuration ethnique de l’Arménie, au point qu’aujourd’hui il n’y a plus un seul Azerbaïdjanais dans les territoires qu’elle occupe. Ainsi, lorsque je parle d’un million de personnes réfugiées et déplacées, je ne vise pas seulement les 200 000 Azerbaïdjanais qui ont été expulsés d’Arménie et se sont réfugiés en Azerbaïdjan, mais aussi les 750 000 Azerbaïdjanais déplacés dans leur propre pays du fait de l’agression arménienne.
Donc, si le statu quo se maintient, si les Arméniens ne se retirent pas des territoires autour du Haut-Karabagh, je ne vois pas comment le conflit pourrait se régler. Le « plan Lavrov », comme toutes les autres solutions proposées par d’autres médiateurs, préconise de passer par plusieurs étapes ; en effet, il y a tellement de points à examiner qu’on ne peut pas envisager d’aboutir du jour au lendemain. Voilà pourquoi il faut commencer par le début, à savoir l’évacuation des territoires, au minimum autour du Haut-Karabagh. Mais cela suppose, de la part de l’Arménie, qu’elle ait la volonté politique de le faire.
Il reste encore beaucoup de questions sur la table. Sans doute aurez-vous l’occasion d’entendre bientôt l’ambassadeur Pierre Andrieu, qui pourra vous expliquer plus précisément comment le médiateur voit les choses. Pour l’Azerbaïdjan, elles sont claires : nous sommes prêts à discuter, car il n’y a pas pour nous de question taboue. Mais on ne peut pas à la fois laisser le statu quo se maintenir à la faveur de manœuvres dilatoires et de provocations militaires, et s’exprimer en faveur d’un règlement pacifique du conflit.
Il faut donc être clair. En ce sens, le rôle des pays qui coprésident le Groupe de Minsk est très important. Bien des gens ne sont pas conscients de toutes les conséquences de ce conflit, ni des menaces qu’il représente, non seulement pour les régions du Caucase du Sud, mais pour toute l’Europe.
En deux mots, le plan russe envisage plusieurs étapes : d’abord l’évacuation des territoires autour du Haut-Karabagh par les forces armées arméniennes ; puis la restauration des communications entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, et peut-être entre l’Arménie et la Turquie ; la réouverture de toutes les voies de communication, des frontières ; enfin, le commencement du retour des personnes déplacées dans les territoires autour du Haut-Karabagh.
Cela peut permettre de rétablir un minimum de confiance entre les deux parties, et nous aider à aborder d’autres questions importantes si l’on veut parvenir au règlement du conflit.
La dernière question de M. le rapporteur portait sur le statut de la mer Caspienne.
Malheureusement, il n’y a pas beaucoup de choses à en dire. Aujourd’hui, la mer Caspienne, qui est le lac le plus grand du monde et dont cinq pays se partagent le littoral, n’a toujours pas de statut juridique. Des accords bilatéraux entre l’Azerbaïdjan et la Russie, entre l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan, et entre le Kazakhstan et la Russie, ont tout de même été conclus.
L’absence de statut juridique fait que l’on est obligé de continuer à travailler dans le cadre de coopérations économiques et commerciales. Mais j’espère que les cinq pays concernés auront un jour le courage de progresser dans le bon sens.
M. le président François Rochebloine. Monsieur l’ambassadeur, merci pour les réponses que vous avez apportées aux différentes questions. Mais avant de passer la parole à nos collègues qui souhaitent vous interroger, je voulais vous dire que nous vous adresserions sans doute quelques demandes de précisions portant sur les chiffres – il était bien normal que vous ne puissiez pas nous répondre immédiatement.
M. François Pupponi. Merci, monsieur l’ambassadeur, pour votre présence et pour vos réponses. J’ai plusieurs questions à vous poser.
J’observe, à propos du conflit au Haut-Karabagh, que la version des faits diffère selon les parties. Chacune considère que c’est l’autre qui a été à l’initiative de ce qui s’est produit, et que c’est l’autre qui a commis des exactions insupportables. C’est ce qui s’est passé au mois d’avril. Des photos ont circulé, qui montraient des soldats azerbaïdjanais paradant avec une tête d’Arménien. Cela dit, c’est toujours très compliqué.
De mon côté, je me suis permis un jour d’aller au Haut-Karabagh, dont une partie est incontestablement arménienne de par son histoire, de par sa culture. Cela étant, que tous les territoires occupés ne soient pas forcément arméniens, je crois que tout le monde est prêt à en discuter.
Quoi qu’il en soit, je retiens de vos propos qu’il est sans doute possible de trouver un juste milieu, et qu’il y a une volonté affirmée d’essayer de trouver une solution. De fait, on ne peut pas laisser perdurer un conflit larvé comme celui-ci, qui fait plusieurs centaines de morts de chaque côté tous les ans.
Comment voyez-vous les choses ? Si chacun campe sur ses positions, on n’arrivera jamais à trouver un accord de paix. La France sait bien que parfois, pour pouvoir faire la paix avec ses ennemis, il faut collectivement faire des efforts pour trouver un modus vivendi et faire évoluer la situation. Et c’est vrai dans tous les pays du monde. Quel effort l’Azerbaïdjan serait-il prêt à faire pour que l’on puisse trouver une solution acceptable pour tout le monde, dans ce terrible conflit ?
Par ailleurs, un livre qui vient de sortir sur le Qatar met en cause un certain nombre de personnes, appartenant notamment au groupe d’amitié France-Qatar. De la même façon, une émission de télévision a évoqué les relations difficiles et parfois complexes entre certains parlementaires français et l’Azerbaïdjan.
Dans le premier cas, j’ai demandé au président de l’Assemblée nationale que l’Assemblée porte plainte, dans la mesure où ce livre met en cause le fonctionnement d’un groupe d’amitié dans sa globalité, en jetant l’opprobre sur les membres de ce groupe. Dans le second cas, qui concerne l’Azerbaïdjan, y a-t-il eu dépôt de plaintes ? En l’occurrence, un certain nombre d’élus et de personnalités françaises avaient été mis en cause dans l’émission d’Élise Lucet, Cash investigation.
Enfin, vous avez parlé de l’ensemble des minorités religieuses au cours de votre intervention, mais pas des Arméniens. Or ne peut pas à la fois revendiquer le fait que le Haut-Karabagh est en Azerbaïdjan, et nier le fait qu’il y existe une importante communauté religieuse arménienne. Comment voyez-vous les choses ?
M. Jean-François Mancel. Monsieur le président, l’ambassadeur d’Azerbaïdjan ayant répondu de manière très précise à toutes les questions, cela réduit la dimension des miennes... Je voudrais juste revenir d’un mot sur la situation au Haut-Karabagh en lui demandant ce qu’il attend de la France, puisque nous aurons l’occasion d’entendre bientôt l’ambassadeur Andrieu.
M. le président François Rochebloine. Cette audition prévue la semaine prochaine est malheureusement reportée, mais elle aura lieu.
M. Jean-François Mancel. Ma deuxième question rejoint un peu les propos de notre collègue François Pupponi. Finalement, quel peut être le processus de paix ? On a bien compris ce qui devait être fait s’agissant des territoires occupés. Mais, dans un processus de paix, il est fréquent d’évoquer le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Or il est un peu difficile de demander à un peuple de faire un choix sur son appartenance, à partir du moment où une partie de ce peuple a été chassée.
Cela m’amène à ma troisième question. On parle beaucoup des droits de l’Homme à propos de l’Azerbaïdjan, mais on parle peu des droits des déplacés et des réfugiés. Or l’invasion arménienne en 1991 a provoqué le départ d’à peu près 900 000 Azerbaïdjanais qui ont dû quitter leur sol, leur maison, leur village et qui ont dû repartir, certes, pour rester en Azerbaïdjan mais dans des lieux qui n’étaient pas les leurs. Que sont-ils devenus ? Comment vivent-ils ? Quelle est leur situation ?
Enfin, vous avez parlé du réseau ASAN, qui est un système de facilitation de la vie administrative à l’usage de tous les Azerbaïdjanais, et aussi un moyen de lutter contre une bureaucratie qui peut avoir tendance à favoriser la corruption. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce système particulièrement novateur ?
M. le président François Rochebloine. Avant de redonner la parole à notre invité, je rappellerai que l’objet de notre mission n’est pas le règlement du conflit du Haut-Karabagh, mais les relations économiques et politiques entre la France et l’Azerbaïdjan. Et je préciserai à notre collègue que s’il a eu raison d’évoquer le principe d’autodétermination, le Haut-Karabagh a déclaré son indépendance le 2 septembre 1991, avant même que l’Arménie et l’Azerbaïdjan ne le fassent.
M. Elchin Amirbayov. Merci pour ces questions. Avant d’y répondre, je ferai une remarque : il est tout à fait normal que l’on évoque ici, dans cette mission, la question du Haut-Karabagh. En effet, on ne peut pas examiner les relations entre la France et l’Azerbaïdjan sans évoquer l’implication de la France dans la médiation sur le conflit du Haut-Karabagh, un sujet d’importance pour l’Azerbaïdjan. J’apprécie donc toutes ces questions, qui me permettent d’éclairer certains points et peut-être de dissiper certains mythes.
Monsieur Pupponi, vous avez évoqué certaines photos. Je peux vous montrer aussi quelques photos de corps d’enfants azerbaïdjanais victimes de cette attaque.
Certes, et vous avez raison de le dire, chaque camp essaie de justifier sa position. Mais il y a aussi la réalité sur le terrain. Et aujourd’hui, la réalité n’est pas que l’Azerbaïdjan occupe le territoire de l’Arménie, mais que l’Arménie occupe 20 % du territoire de l’Azerbaïdjan. Cette occupation a été enregistrée et reconnue par le monde entier, y compris par le Conseil de sécurité des Nations unies, qui l’a condamnée à quatre reprises et qui a demandé le retrait des forces arméniennes.
Vous avez des doutes sur l’appartenance du Haut-Karabagh. Selon vos propos, il serait arménien depuis toujours. Si vous le permettez, nous vous fournirons quelques informations, qui ne sont pas de source azerbaïdjanaise, mais de sources plutôt neutres, pour vous éclairer.
Pour tous les historiens, le Haut-Karabagh a toujours été une terre appartenant à l’Azerbaïdjan. Ce n’est pas notre faute si, en raison de l’épuration ethnique à laquelle les Arméniens ont procédé, il n’y a plus aujourd’hui d’Azerbaïdjanais physiquement présents dans ces territoires. Ce n’est pas notre faute si notre patrimoine culturel y a été rasé, détruit, si l’on a donné aux noms géographiques une consonance plutôt arménienne, et si nous avons été les victimes de ce nettoyage ethnique. Comment parler de justice, quand il n’y a plus un seul Azerbaïdjanais dans ces territoires ?
À propos des événements du mois d’avril, je rappelle encore une fois que l’Azerbaïdjan ne pouvait que se défendre contre cette provocation, qui a visé notre population civile.
Par ailleurs, je n’ai pas mentionné les Arméniens en tant que tels, dans la mesure où je faisais référence aux religions. Et j’ai dit, si je me souviens bien, que 90 % de la population de l’Azerbaïdjan était aujourd’hui de confession musulmane – 65 % de chiites et 25 % de sunnites. Mais j’ai également fait référence aux chrétiens et aux juifs qui sont là de longue date.
Je n’ai pas mentionné spécifiquement les Arméniens, dans la mesure où il y a aussi des Ukrainiens, des Russes et d’autres citoyens de l’Azerbaïdjan qui sont chrétiens. Mais il y a en effet des Arméniens en Azerbaïdjan, et pas seulement dans les territoires occupés aujourd’hui par l’Arménie. Certains continuent à vivre confortablement à Bakou – 20 000 à 30 000 Arméniens qui ont contracté des mariages mixtes – sans y être menacés.
Monsieur Pupponi, nous n’avons malheureusement pas eu l’occasion de vous voir en Azerbaïdjan quand vous l’avez visité, mais ceci est une autre histoire… Quoi qu’il en soit, je crois qu’il est important de dire qu’il faut respecter les principes du droit international, parmi lesquels la souveraineté et l’intégrité territoriale des pays. Et je trouve bizarre qu’il y ait parfois deux poids deux mesures : en effet, des parlementaires qui visitent la Crimée annexée sont critiqués, mais pas ceux qui visitent les territoires occupés de l’Azerbaïdjan, dont fait partie la région du Haut-Karabagh.
Vous m’avez demandé comment je voyais les choses. Selon moi, c’est assez facile : il convient simplement d’appliquer le droit international. On peut toujours avoir différentes versions de ce qui s’est passé. Mais, pour obtenir un résultat et faire évoluer la situation, et je crois que c’est le devoir des médiateurs, il faut appliquer les normes du droit international et les exigences de la communauté internationale à toutes les parties.
Votre question m’amène, d’une certaine façon, à celle de M. Mancel : qu’attendons-nous de la France ? En raison de l’amitié et de la proximité des relations entre l’Arménie et la France, nous attendons qu’elle puisse exercer une certaine influence sur les dirigeants arméniens.
Monsieur Mancel, nous serions reconnaissants à France si elle parvenait à convaincre l’Arménie et ses dirigeants d’exprimer leur volonté politique de s’engager dans un dialogue constructif. Hors de tout langage diplomatique, cela veut dire que si, demain, ce pays montrait sa volonté politique de se retirer de ces territoires qui n’ont jamais appartenu, même en rêve, aux Arméniens, nous nous dirions que le président Serge Sarkissian cherche sérieusement à progresser…
Si ce n’est pas le cas, si l’on continue à avancer des prétextes pour différer les choses et pour consolider le statu quo, on ne pourra pas résoudre ce conflit. Et cela nous rapprochera d’une voie dangereuse, d’ordre militaire. Bien sûr, l’Azerbaïdjan, pas plus que l’Arménie, du moins je l’espère, ne souhaite relancer la guerre. Mais c’est un fait que le statu quo n’est pas tenable et que l’on ne peut pas encore attendre vingt-cinq ans pour parvenir à une solution. Je crois que c’est dans cet esprit que la présidence française a récemment réitéré son intention de continuer ses efforts pour trouver une solution, en essayant d’inviter les dirigeants des deux pays à un nouveau sommet de Paris.
Encore une fois, il ne s’agit pas de réinventer la roue, mais d’appliquer le droit international. Les accords d’Helsinki de 1975 ont établi dix principes, un « décalogue » qui définit un modus vivendi applicable à tous les pays du monde. Et il en ressort clairement qu’on ne peut pas mettre en œuvre le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes en violation de l’intégrité territoriale des pays.
On peut trouver de nombreux exemples de la façon dont on peut concilier le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, tout en respectant la souveraineté et l’intégrité territoriale des pays. C’est le sens de la proposition des médiateurs. Je crois que lorsque M. Andrieu, après sa visite à Vienne, viendra ici pour répondre à vos questions, il tiendra le même discours.
Mais vous avez raison de vous demander comment on peut satisfaire certaines parties de cette population en l’absence de minorités. On peut toujours nettoyer n’importe quel territoire de la présence de minorités, puis organiser un référendum et proclamer l’indépendance. C’est exactement ce qui s’est passé au début du conflit. Voilà pourquoi il n’est pas question, pour nous, de commencer par un vote qui viendrait contredire le droit international comme la loi de l’Azerbaïdjan ; en effet, notre Constitution ne permet pas d’organiser des référendums dans une seule partie du territoire.
Au minimum, il faut laisser rentrer chez eux ceux qui ont été victimes du nettoyage ethnique. Pour ma part, je suis tout à fait favorable à la coexistence entre les Arméniens et les Azerbaïdjanais. Selon certaines théories très racistes et très dangereuses en provenance d’Erevan, les Arméniens ne pourraient jamais vivre avec les Azerbaïdjanais, parce qu’ils ne seraient pas « compatibles ». Or l’histoire a montré que, même au Haut-Karabagh, même en Azerbaïdjan, et même s’ils étaient en minorité au siècle dernier, les Arméniens sont capables de coexister avec les Azerbaïdjanais, de nouer des amitiés avec eux, et que les mariages mixtes sont possibles. Bien sûr, après le conflit, la situation a changé…
Maintenant, je suis d’accord avec ce que vous avez dit sur les personnes réfugiées et déplacées.
Je suis toujours étonné de constater que l’on oublie complètement qu’en Azerbaïdjan, des centaines de milliers de personnes ont vu leurs droits fondamentaux bafoués : elles ont été chassées de leur maison, ont perdu leurs parents au cours de différents massacres, et depuis presque un quart de siècle, se trouvent déplacées dans leur propre pays. Je ne parle pas des 200 000 personnes d’origine azerbaïdjanaise qui ont fui l’Arménie : elles ont franchi les frontières internationales et, selon le droit international élémentaire, elles ont acquis le statut de réfugiés. Je parle des 750 000 personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays.
Quoi qu’il en soit, les personnes réfugiées et déplacées représentent à peu près un million. Or, malgré leur nombre, personne ne parle de cette population.
Aujourd’hui, grâce aux efforts du gouvernement de l’Azerbaïdjan, la situation de ces personnes s’est améliorée. Celui-ci a puisé sur ses revenus pétroliers pour faire sortir ce million – ou presque – d’Azerbaïdjanais des camps de réfugiés. Ce n’est pas moi qui le dis, mais le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Selon lui, l’Azerbaïdjan s’est acquitté de façon exemplaire des responsabilités qui incombent à tout État vis-à-vis des victimes de conflits internes. Par exemple, l’Azerbaïdjan a beaucoup investi pour loger ces personnes dans des conditions normales. Mais cela ne veut pas dire que ces personnes seront toujours là, ni qu’elles se satisfont d’avoir été chassées et de ne pas pouvoir visiter les tombes de leurs ancêtres.
Dernier point : le réseau ASAN a été mis en place en 2012 dans le cadre des réformes globales de modernisation de l’administration publique, lancées par la présidence de la République. C’est une nouvelle approche des services publics mis à la disposition des citoyens.
Les centres de service ASAN sont des guichets uniques – one stop shot – qui réunissent les représentants de diverses institutions gouvernementales et entreprises privées. Vous pouvez y faire toutes vos démarches, et accéder aux services publics qui y sont installés. C’est une expérience assez novatrice, que l’on pourrait partager avec d’autres, et sur laquelle je pense qu’il faudrait communiquer davantage.
L’Azerbaïdjan n’est pas le seul pays qui tente d’améliorer ses services publics. Je sais que certains pays voisins font des efforts en ce sens – comme la France, d’ailleurs. Mais le fait que nous ayons su investir dans certains secteurs pour lutter contre la corruption montre bien quelles sont les préoccupations du Gouvernement.
Enfin, pour ne pas abuser de votre temps, je vais vous laisser aussi une petite fiche qui vous donnera des informations supplémentaires sur le réseau ASAN.
M. le président François Rochebloine. Monsieur l’ambassadeur, vous vous êtes bien prêté au jeu des questions et des réponses, même si certaines étaient sans doute difficiles. Nous vous enverrons un questionnaire sur les points que j’ai déjà évoqués, et sur lesquels nous souhaiterions obtenir des précisions.
Je vous remercie.
*
* *
Ÿ Audition de M. Pierre-Yves Le Borgn’, député, rapporteur de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme (jeudi 3 novembre 2016)
M. le président François Rochebloine. Chers collègues, je suis heureux de souhaiter la bienvenue à notre collègue Pierre-Yves Le Borgn’. C’est en sa qualité de rapporteur de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) que nous l’entendons aujourd’hui.
Sa venue me permet de rappeler que la CEDH fait partie des institutions dont les pays démocratiques européens ont souhaité la création sous l’égide du Conseil de l’Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L’évaluation de l’exécution de ses arrêts par les États membres est un critère précieux pour mesurer la capacité de chaque État à faire sien le projet politique du Conseil de l’Europe, assis sur les droits de l’Homme et les libertés fondamentales. Cette remarque générale s’applique bien entendu à l’Azerbaïdjan.
M. Pierre-Yves Le Borgn’, député, rapporteur de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je suis heureux de pouvoir intervenir ce matin devant vous au sujet de la mise en œuvre des arrêts de la CEDH par l’Azerbaïdjan. Il me paraît bon que ceux d’entre nous qui siégeons à l’APCE puissent être auditionnés. De session en session, nous accumulons à Strasbourg une connaissance à propos de divers pays et de matières complexes que nous ne partageons pas suffisamment.
M. le président François Rochebloine. C’est vrai.
M. Pierre-Yves Le Borgn’. Pour m’adresser à vous, je me permettrai d’employer un langage direct, à la fois parce que j’estime qu’il faut dire les choses telles qu’elles sont et parce que je considère que cela favorise les échanges.
Depuis quinze ans que l’Azerbaïdjan est devenu le quarante-troisième État membre du Conseil de l’Europe, on constate une dégradation marquée de la liberté d’expression, de la liberté de réunion et de la liberté d’association dans ce pays. Pour dire les choses clairement, telles que je les ressens, de manière nécessairement subjective, l’Azerbaïdjan n’est pas une démocratie. Il est légitime même de s’interroger sur le bien-fondé de sa présence comme État membre au sein d’une organisation, le Conseil de l’Europe, dont la vocation est d’être la maison européenne du droit. De la lecture de nombreux rapports consacrés à ce pays, rédigés par des collègues appartenant à l’ensemble des groupes parlementaires – Parti populaire européen, groupe socialiste, Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe – se dégage un même constat : l’État de droit non seulement n’y a pas progressé, mais il a reculé. Je ne suis pas certain que si l’Azerbaïdjan redéposait une demande d’adhésion au Conseil de l’Europe aujourd’hui, celle-ci serait acceptée. Je suis même convaincu du contraire.
Quelle est la difficulté au cœur de ces dérives ? Sans doute la volonté du régime du président Aliev de réduire au silence tous, je dis bien tous, les défenseurs des droits de l’Homme en Azerbaïdjan, lesquels se trouvent aujourd’hui ou bien en prison, ou bien à l’hôpital, ou bien en exil. De ce fait, il devient impossible pour le Conseil de l’Europe, notamment pour son assemblée parlementaire, pour le Commissaire aux droits de l’Homme, pour la Commission européenne pour la démocratie par le droit, dite Commission de Venise, de travailler efficacement sur la question des droits et libertés en Azerbaïdjan afin de permettre aux citoyens de ce pays de bénéficier de progrès.
J’énumérerai plusieurs types de dérives.
Le premier type se rapporte aux poursuites pénales pour divers motifs, la plupart du temps très fantaisistes, exercées à l’encontre de personnes critiques du régime : opposants politiques, journalistes, blogueurs, militants des droits de l’Homme. Tous ceux qui coopèrent avec les organisations internationales pour dénoncer les violations des droits de l’Homme font l’objet de harcèlement judiciaire et de représailles systématiques. Il est très fréquent, voire quasi-systématique, que des personnes portant témoignage de la situation de la démocratie en Azerbaïdjan devant des instances internationales se retrouvent confrontées à la police de retour chez elles. Je me souviens du cas douloureux d’une très jeune femme azerbaïdjanaise qui, après être venue courageusement parler devant la commission des questions juridiques et des droits de l’Homme à Madrid, à la fin du mois d’octobre 2014, a découvert à son retour à Bakou que son appartement avait été mis à sac en présence de son petit garçon de sept ans. Ce harcèlement judiciaire et ces représailles systématiques marquent immensément les relations entre les défenseurs des droits de l’Homme et les autorités azéries – et de fait, indirectement, celles qu’ils entretiennent avec les membres de l’APCE. Cela se traduit encore par des détentions préventives illimitées, sans passage devant le juge, sous divers motifs, le plus souvent fantaisistes. Autant de pratiques qui font l’objet de nombreux arrêts de la CEDH.
Le deuxième type de dérives est la pénalisation de la diffamation et la condamnation au paiement d’indemnités disproportionnées dans le cadre de procédures civiles. L’Azerbaïdjan sur ce point ignore systématiquement les recommandations du Conseil de l’Europe, qu’elles émanent du comité des ministres, de l’Assemblée parlementaire ou de la Commission de Venise, tout comme la jurisprudence de la CEDH. La pénalisation de la diffamation est le meilleur moyen de réduire les journalistes au silence : pour celui qui a voulu exprimer des opinions libres, elle est synonyme d’emprisonnement et de ruine financière. Elle entraîne l’autocensure, par peur pour soi et par peur pour les siens. Le débat est monocolore et sans aspérité, si bien que les enjeux politiques ne sont jamais mis en lumière. En cela, l’Azerbaïdjan n’est malheureusement pas un exemple unique. L’utilisation par un régime autoritaire de la pénalisation est un moyen d’éviter l’expression de toute voix critique dans le débat public, de telle sorte que les enjeux ne sont jamais présentés ni même pressentis.
Troisième type de dérives : les restrictions imposées aux activités des organisations non gouvernementales (ONG) depuis une loi de 2014, adoptée sans tenir compte des critiques et des recommandations que la Commission de Venise a formulées en 2011 et 2013. Nombre d’ONG, se heurtant à la complexité des exigences en matière d’enregistrement – refus non motivés, traitement très long des demandes –, se retrouvent de facto à fonctionner en marge de la loi ; dès lors, elles sont immédiatement poursuivies pour évasion fiscale et autres activités illicites. Les ONG internationales sont en outre soumises à l’obligation d’obtenir un accord préalable du ministre de la justice en personne, après avoir démontré qu’elles respectent les « valeurs morales nationales » et ne sont pas impliquées dans une « propagande politique ou religieuse ». Jamais l’une ou l’autre de ces conditions n’ayant été précisément définie, il suffit d’invoquer ces termes très vagues pour interdire à ces organisations d’opérer. Cela est d’autant plus facile aux autorités azerbaïdjanaises qu’il est interdit de percevoir des fonds étrangers supérieurs à 185 euros sans accord préalable du ministre de la justice… Les comptes bancaires de nombreuses ONG – l’Association azerbaïdjanaise des avocats, l’Institut pour la liberté et la sécurité des reporters, Transparency International ou Oxfam – ont ainsi été gelés.
Quatrième type de dérives : l’usage excessif de la force contre des manifestations pacifiques. Beaucoup d’arrêts de la CEDH portent sur l’arrestation de participants, placés en détention administrative pour une durée longue et condamnés ensuite à de lourdes amendes.
Cinquième type de dérives : la violation du droit de propriété par la démolition d’habitations sans droit de recours effectif. Les spoliations ont été monnaie courante ces dernières années.
J’en termine par l’une des plus importantes dérives, la fraude électorale, sur laquelle porte depuis plus de dix ans un nombre important d’arrêts de la CEDH : ces cas vont d’irrégularités dans le processus électoral à l’invalidation arbitraire des résultats des opposants, en passant par l’absence d’examen des plaintes déposées. On note dans les commissions électorales mises en place lors de chaque élection une présence massive de représentants du parti au pouvoir, de sorte que le contradictoire ne s’exerce pas vraiment. Je voudrais citer ici le cas symbolique d’Anar Mammadli, militant des droits de l’Homme, qui a été directeur d’une organisation reconnue de surveillance électorale. Son engagement en faveur d’élections libres et ses critiques à l’encontre des fraudes dans son pays lui ont valu cinq ans d’emprisonnement. Il se trouvait déjà en prison au moment où l’APCE lui a décerné le prix Václav Havel en 2014. Citons encore Ilgar Mammadov, opposant politique au régime du président Aliev, qui a été arrêté peu de temps avant les élections et condamné à sept ans de prison pour troubles à l’ordre public. Cette situation est tellement insupportable que l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a décidé de retirer sa mission de surveillance des élections.
Je tiens à souligner que le Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, Nils Muižnieks, a fait usage dans le cas de l’Azerbaïdjan de la possibilité d’intervenir en qualité de tierce partie devant la CEDH. La convention l’y autorise mais c’est en vérité une procédure d’ordinaire assez peu fréquente. Il y a eu recours cinq fois en 2015 et une fois en 2016. Ces interventions ne contiennent aucun commentaire sur les faits ou la substance de la requête, mais visent à fournir à la CEDH des informations objectives et impartiales sur les éléments d’inquiétude concernant le respect des droits de l’Homme. En 2015, elles ont concerné Hilal Mammadov, Intigam Aliyev, condamné à sept ans et demi de prison, Rasul Jafarov, condamné à six ans et trois mois, Anar Mammadli, Leyla et Arif Yunus, condamnés respectivement à huit ans et demi et sept ans de prison, avant d’être assignés à résidence pour raisons médicales puis expulsés de leur pays. Ils vivent aujourd’hui en exil aux Pays-Bas. Je vous parle d’eux en particulier car la France a su les reconnaître : Leyla Yunus a été faite chevalier de la Légion d’honneur. À l’occasion d’une session de l’APCE à Strasbourg, j’ai pu rencontrer leur fille unique, une jeune femme d’une vingtaine d’années qui se bat toute seule pour ses parents, déjà malades au moment de leur arrestation et davantage encore après leur séjour en prison. Quand on recueille un tel témoignage, on prend très concrètement la mesure des violations des droits et libertés dont se rend coupable l’Azerbaïdjan.
Nous nous trouvons face à l’impossibilité de travailler avec ce pays. Le secrétaire général du Conseil de l’Europe, Thorbjørn Jagland, a décidé, il y a quelques mois, de retirer son représentant du groupe de travail sur les droits de l’Homme, mis en place dans l’espoir justement de renouer le dialogue et de progresser.
Je terminerai en évoquant le suivi par le comité des ministres des arrêts de la CEDH. Hier, 2 novembre 2016, on recensait 164 affaires concernant l’Azerbaïdjan. Elles renvoient essentiellement à l’application arbitraire du droit pénal dans le but de limiter la liberté d’expression : affaire Mahmudov et Agadze, Ilgar Mammadov, Rasul Jafarov. Les recommandations – car le Conseil de l’Europe ne se contente pas de dénoncer, il entend aussi indiquer les voies d’amélioration – portent sur l’indépendance du pouvoir judiciaire et des procureurs. Ces réformes nécessaires, réclamées par le Conseil de l’Europe – comité des ministres, assemblée parlementaire, commission de Venise – et la CEDH, sont rejetées par le régime du président Aliev. Le seul léger progrès à noter concerne le moratoire sur les peines longues pour diffamation : il semble que, sur ce point, les choses évoluent dans un sens moins défavorable.
Le comité des ministres a demandé de manière réitérée la libération immédiate d’Ilgar Mammadov et a appelé l’attention sur la situation de l’ancien ministre de la santé Ali Insanov, condamné à onze ans de prison sous divers motifs pour le moins fantaisistes et contre qui de nouvelles charges ont été invoquées à neuf jours de sa libération, ce qui l’a immédiatement reconduit en détention préventive…
Le comité des ministres pointe également l’impossibilité pour les personnes déplacées durant le conflit au Haut-Karabagh de retrouver leurs maisons et leurs biens. Elles ne disposent d’aucun moyen effectif leur permettant de faire valoir leurs droits.
Enfin, il souligne l’arbitraire dans le contrôle de la régularité des élections.
Tel est le tableau sombre et même désespérant que je viens de dresser devant vous, mes chers collègues ; pareille situation devrait, me semble-t-il, susciter une réprobation unanime du monde parlementaire.
Les droits de l’Homme supposent un long combat auquel il ne faut pas renoncer. Et un événement récent devrait nous inciter à un peu d’optimisme : l’APCE a élu comme juge azerbaïdjanais à la CEDH une personne qui m’a paru très estimable, ancien représentant dans son pays du Comité de prévention contre la torture. Mais elle avait auparavant rejeté trois listes de candidats azerbaïdjanais, dont l’une comprenait l’agent du gouvernement azerbaïdjanais auprès de cette institution… C’est dire si le chemin est long.
M. le président François Rochebloine. Je vous remercie, cher collègue, pour le travail que vous effectuez à l’APCE. Vous avez aussi raison de rappeler que l’Azerbaïdjan n’est pas le seul pays dans ce cas : il y en a d’autres.
Comme vous l’avez rappelé, le commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, M. Nils Muižnieks, est intervenu en qualité de tierce personne dans plusieurs affaires concernant l’Azerbaïdjan – cinq en 2015 et une en 2016. Il a écrit un article intitulé « Azerbaïdjan : une zone de ténèbres » où l’on peut lire : « La seule chance qu’a l’Azerbaïdjan de renverser son isolement international croissant est de montrer son respect des valeurs démocratiques et d’effacer les procédures pénales diligentées contre tous les défenseurs des droits de l’Homme, les journalistes et autres personnes emprisonnées en raison de leur action ou parce qu’elles s’opposent au pouvoir établi ».
Quelle est votre appréciation sur les probabilités de réalisation de ce souhait ?
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. Je vous remercie, mon cher collègue, pour la clarté de votre exposé.
Ma première question concernait les différentes péripéties qui ont accompagné l’élection du juge azerbaïdjanais à la CEDH mais vous y avez déjà répondu.
J’aimerais en savoir plus sur la coordination entre les diverses institutions chargées des droits de l’Homme, Conseil de l’Europe, Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme, Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’Homme (BIDDH) de l’OSCE et représentant de l’OSCE pour la liberté des médias. Existe-t-il des réunions de coordination ? Si oui, selon quelle fréquence ? À quel type de rapport ou de démarche aboutissent-elles ?
Ma deuxième question porte sur la méthodologie. Vous travaillez selon une démarche d’évaluation par les pairs, dont l’efficacité, reconnue dans de nombreux domaines, est moindre pour ce qui concerne les droits de l’Homme. Comment l’expliquez-vous ?
M. Pierre-Yves Le Borgn’. Monsieur le président, je partage les conclusions de Nils Muižnieks sur la « zone de ténèbres » qu’est devenu l’Azerbaïdjan en matière de droits de l’Homme. Sans doute le commissaire aux droits de l’Homme est-il la personne la plus habilitée pour établir ce constat puisqu’il travaille avec les défenseurs des droits au sens large, militants des droits de l’Homme, dirigeants d’ONG ou d’associations. Il a abouti au constat que tous ses interlocuteurs avaient fini par disparaître : ils sont soit emprisonnés, soit hospitalisés, soit poussés à s’exiler. Lors de son dernier séjour en Azerbaïdjan, il a dû passer un temps infini à se déplacer d’une prison ou d’un hôpital à l’autre pour rendre visite à ceux qu’il rencontrait une année auparavant dans leurs bureaux à Bakou. C’est là un signe qui ne trompe pas.
Dans quelle mesure l’appel adressé par le commissaire aux droits de l’Homme aux autorités azerbaïdjanaises pour leur demander d’effacer les procédures pénales contre les militants des droits de l’Homme sera-t-il entendu ? Hormis le moratoire sur les peines longues en matière de diffamation, je ne vois malheureusement aucun signe tangible qui nous permettrait d’espérer un avenir meilleur, au moins dans un très court terme. C’est le rôle des assemblées parlementaires, et a fortiori du Conseil de l’Europe, organisation paneuropéenne du droit et des droits, de son Assemblée parlementaire et du commissaire aux droits de l’Homme d’exercer toujours plus de pression. L’évaluation par les pairs, l’opprobre international sont bien souvent des forces irrésistibles. Il n’est toutefois pas simple de parvenir à faire passer ces messages lorsque le pays en question dispose d’atouts économiques et représente un marché important pour un certain nombre de nos pays.
Entre nous, je peux vous dire que j’étais intervenu auprès du Président de la République au nom de Leyla Yunus avant qu’il ne se rende à Bakou en lui révélant ce que j’avais pu apprendre de la conversation avec sa fille et en lui rappelant comme la République française avait su honorer cette femme. Je veux imaginer que le fait que Leyla Yunus et son mari aient été libérés – certes pour être assignés à résidence puis expulsés, sans être réhabilités, mais au moins cela leur a-t-il permis de bénéficier de soins médicaux qu’ils ne recevaient pas – est peut-être la conséquence de ce genre de démarche mais je n’en suis pas absolument certain.
Pour revenir à l’élection du juge azerbaïdjanais, monsieur le rapporteur, je dois vous préciser que je n’ai assisté qu’à une partie des débats car la commission de sélection des juges à la CEDH dans sa configuration actuelle a été mise en place il y a deux ans alors que la procédure de sélection avait déjà commencé. Trois candidatures sont soumises aux membres de la commission de sélection qui établit ensuite un ordre de préférence en vue du vote de l’APCE. Il nous arrive de rejeter des listes lorsque nous nous apercevons que les candidats ne sont pas au niveau…
M. le président François Rochebloine. C’est arrivé encore récemment.
M. Pierre-Yves Le Borgn’. …ou bien qu’ils ne sont pas de même stature, quand par exemple un État joue à envoyer un bon candidat entouré de deux candidats dont on sent qu’ils ne sont que des alibis. Pour la dernière liste azerbaïdjanaise que nous avons rejetée, c’était clairement le cas. Elle comprenait deux candidats qui n’étaient absolument pas en situation de siéger à la CEDH pour diverses raisons – méconnaissance du droit, méconnaissance de la jurisprudence, absence de pratique de l’anglais et davantage encore du français – et un troisième, très prolixe, agent de l’Azerbaïdjan depuis longtemps actif auprès de la CEDH, que le gouvernement de son pays, par un procédé très peu subtil, voulait placer au sein de la Cour. Nous avons choisi de rejeter cette liste à l’unanimité, estimant que de telles choses ne se faisaient pas. Au demeurant, si l’agent d’un pays auprès de la Cour devient juge – ce qui est possible car il n’y a pas d’incompatibilité –, il doit se déporter de tous les arrêts pour lesquels il est intervenu. Compte tenu du nombre de sujets qui concernent l’Azerbaïdjan, cela aurait fait beaucoup d’affaires pour lesquelles le juge n’aurait pas pu siéger…
Monsieur le rapporteur, vous m’avez également interrogé sur la coordination des organisations internationales en matière de droits de l’Homme. Elle existe, davantage de manière informelle que formelle, à l’échelle de la direction de chacune des organisations concernées. Pour l’APCE, elle se fait moins sentir. Il est possible que Pedro Agramunt qui, avant d’être élu président de l’APCE, était le rapporteur pour le « monitoring » sur l’Azerbaïdjan, ait eu des échanges avec l’OSCE. En tant que rapporteur pour l’exécution des arrêts de la CEDH, je dois dire que je n’entretiens pas ce type d’échanges, sans doute parce que je suis en quelque sorte dans un silo puisque je ne m’occupe que des arrêts de la Cour, même si j’essaie de me documenter par la lecture des rapports réguliers du commissaire aux droits de l’Homme ou par des échanges avec le cabinet de M. Jagland.
Il est vrai que l’évaluation par les pairs est difficile en matière de droits de l’Homme. Toutefois, je ne vois pas quelle démarche pourrait être meilleure. Je ferai une comparaison avec l’Accord de Paris sur le climat dont le caractère contraignant a fait l’objet de nombreux débats – la vérité étant qu’il n’est pas aussi contraignant qu’on a pu le dire. Un examen transparent relevant de la sphère publique internationale vaut parfois mieux que certaines condamnations en cours.
Je ne suis membre de l’APCE que depuis quatre ans et j’ai senti dans notre hémicycle une prise de conscience croissante sur l’Azerbaïdjan, ce qui est un encouragement. Et c’est ce côté positif que je veux regarder, plutôt que de ne prendre en compte que le fait que les choses patinent un peu pour l’exécution des arrêts de la Cour.
M. François Loncle. Avant d’en venir à me deux questions, je voudrais faire une remarque d’ordre général, tirée de mon expérience limitée des missions d’observation électorale. J’ai participé à deux missions de ce type : l’une en Azerbaïdjan – à laquelle participait aussi Michel Voisin – pour le Conseil de l’Europe ; l’autre lors d’élections législatives au Burkina Faso, dans le cadre de l’Assemblée parlementaire de la francophonie.
Je n’accepterai plus aucune mission de ce genre. Pourquoi ? Arrivés la veille des élections, les nombreux observateurs – qui n’étaient pas seulement des Français – ont assisté dans les deux cas au déroulement d’un scrutin absolument impeccable. En Azerbaïdjan, j’étais surpris de constater que l’organisation – bureaux de vote, déroulement du scrutin, dépouillement – était même plus rigoureuse que dans notre propre pays ! Le problème est que les observateurs ne participent en rien à tout ce qui constitue l’amont de l’élection : la campagne électorale, l’exercice de la liberté d’expression et de communication, la répartition des temps de parole, les réunions publiques, l’égalité entre les candidats, etc. Aucune mission d’observation électorale ne participe à ce processus qui précède l’élection proprement dite.
J’ai le souvenir d’un récit de notre cher collègue Loïc Bouvard qui participait à de nombreuses missions. Accompagné d’un membre du parti socialiste, il était venu devant la Commission des affaires étrangères rendre compte du déroulement d’une élection présidentielle en Géorgie. Tous les deux nous avaient raconté à quel point tout s’était magnifiquement bien déroulé ; ils ne trouvaient rien à redire concernant ces élections ; tout était impeccable. Le lendemain, une révolution éclatait en Géorgie, l’élu était renversé et de nouvelles élections étaient organisées quelques mois plus tard… Leurs observations ne correspondaient visiblement pas au ressenti des gens sur place. Il faut donc rappeler les limites de ce type d’exercice.
Le Conseil de l’Europe est une très belle institution, trop méconnue, insuffisamment pratiquée par les responsables politiques de tous bords, mais qu’il faut sauvegarder à tout prix. Comme François Rochebloine, j’y siège depuis longtemps, et je tiens à dire que le travail de Pierre-Yves Le Borgn’ est absolument remarquable et d’une très grande rigueur. La première question que je veux lui poser est double. Sur les quarante-sept pays appartenant au Conseil de l’Europe, combien ne respectent pas les valeurs de l’Europe dans le domaine des droits de l’Homme et de la démocratie, à l’instar de l’Azerbaïdjan ? Pour ma part, je pense qu’ils sont une dizaine dans ce cas. Pour une telle institution, c’est un ratio élevé. À l’inverse, combien de pays du Conseil de l’Europe remplissent les critères que vous avez énumérés en négatif à propos de l’Azerbaïdjan ?
Malheureusement, la description de Pierre-Yves Le Borgn’ est un réquisitoire contre la diplomatie française. En tout cas, je l’ai prise comme telle. Ce réquisitoire vise en particulier le Président de la République, le ministre des affaires étrangères et l’ambassadrice Aurélia Bouchez qui, pendant une heure, nous a fait ici une description de ce pays qui ne correspond absolument pas à ce que ressent Pierre-Yves Le Borgn’ au Conseil de l’Europe. Nous sommes bien obligés de constater le jugement contradictoire que suscite ce pays membre du Conseil de l’Europe avec lequel la France entretient des relations d’un très haut niveau dans les domaines économique, politique, etc. Si ce que vous dites est exact, nous pouvons légitimement nous poser la question suivante : pourquoi la France, le Président de la République, le ministre des affaires étrangères et son ambassadrice ne nous le disent pas la même chose ?
M. le président François Rochebloine. D’abord, je voudrais renchérir sur les propos de François Loncle relatifs à la qualité du travail de Pierre-Yves Le Borgn’.
Ensuite, je voudrais revenir sur le travail que nous pouvons effectuer, les uns et les autres, dans le cadre de missions électorales. Nous arrivons en effet la veille ou l’avant-veille, même s’il y a une mission pré-électorale. Pour ma part, et j’ai dénoncé la situation au Conseil de l’Europe, j’ai surtout l’impression de remplir des papiers qui vont surtout servir à élaborer des statistiques. Il est vrai que, le jour du scrutin, on ne voit souvent pas grand-chose. Malgré tout, on peut citer des cas contraires : en Russie, Josette Durrieu et René Rouquet étaient arrivés dans un bureau de vote où l’urne était recouverte d’un papier opaque. En insistant, ils étaient parvenus à faire enlever le papier et ils avaient découvert qu’elle était pleine à huit heures du matin… Cela étant, je vous l’accorde, le plus important est ce qui se passe durant les semaines et les mois qui précèdent l’élection.
M. Jean-François Mancel. Je vous remercie pour ce que François Loncle a qualifié, à juste titre, de réquisitoire. Vous aviez d’ailleurs prévenu en préambule que votre exposé serait subjectif. C’est effectivement un réquisitoire subjectif.
Première remarque : les quelques individus concernés sont toujours les mêmes. J’en entends parler depuis des années, de manière récurrente. Je ne pense pas que leur cas soit symbolique de la situation réelle de tout un pays. Si c’était aussi grave que vous semblez le dire, nous n’aurions pas seulement quatre ou cinq noms ; nous pourrions en aligner des centaines, voire des milliers. Or les noms des personnes concernées tiennent sur les doigts des deux mains.
Deuxième remarque : nous pouvons débattre des procédures à l’infini. Auditionné hier par notre mission, l’ambassadeur d’Azerbaïdjan en France a évoqué quelques sujets de ce type et il a fait la démonstration contraire. Quant à notre ambassadrice à Bakou, elle était en désaccord avec ce qui vient d’être évoqué par notre collègue Le Borgn’. On peut toujours retourner tous les arguments. En ce qui concerne la loi sur la presse, Pierre-Yves Le Borgn’ considère que la pénalisation est grave. Pour ma part, je me dis que notre loi sur la presse est nettement trop laxiste, ce qui produit tous les excès que l’on connaît. Il y a des équilibres qui peuvent être recherchés dans un pays comme dans l’autre.
Ma première question est relative aux statistiques de la CEDH, instance que je suis sans doute le seul ici à avoir saisie à titre personnel, obtenant la condamnation de la France. En consultant les statistiques de la CEDH pour l’année 2014, les seules que j’aie trouvées ce matin sur internet, je n’ai pas vu l’Azerbaïdjan apparaître parmi les pays le plus souvent mis en cause. En revanche, il semble que l’Italie soit l’un des pays les plus poursuivis, condamnés et mis en cause par la CEDH. Je passe sur la France dont le rang ne semble pas merveilleux. Cette première question tend à relativiser la force du réquisitoire…
Ma deuxième question va au-delà des limites du propos de Pierre-Yves Le Borgn’ mais je la lui pose car j’ai bien conscience de ses qualités de juriste et d’homme. Qu’en est-il des droits de l’Homme des 900 000 Azerbaïdjanais chassés par l’invasion arménienne qui s’est produite dans le Haut-Karabagh et dans les sept provinces voisines ? Au sens juridique du terme, certains d’entre eux sont des déplacés et d’autres sont des réfugiés.
M. le président François Rochebloine. Lorsque nous l’avons reçu hier, l’ambassadeur d’Azerbaïdjan en France a évoqué l’existence de cinquante-trois partis politiques dans son pays.
M. Michel Voisin. Ce n’est pas un critère génial…
M. le président François Rochebloine. Certes ! Quoi qu’il en soit, j’aimerais savoir ce que vous en pensez, monsieur Le Borgn’.
M. Michel Voisin. Pour avoir participé à un nombre assez important de missions d’observation électorale, je dois dire que les mêmes problèmes se rencontrent partout, mais que les missions à long terme – pour lesquelles les observateurs arrivent au moins quarante jours avant l’élection – sont très différentes. Si vous lisez les prérapports, au fil de leur publication, vous constaterez une évolution constante dans le ton : le premier parle d’une amélioration ; le suivant tempère le propos ; le dernier est totalement défavorable. Le pire que j’ai vu concernait les États-Unis où je me rends d’ailleurs lundi prochain…
Les observateurs de courte durée de l’Union européenne, du Conseil de l’Europe ou de l’OSCE émettent souvent un avis totalement contraire à celui des observateurs de longue durée. Nous avions suggéré que les chefs de mission de courte durée et de longue durée fassent leur rapport de façon coordonnée afin que l’on puisse trouver matière à apporter des précisions. Pourquoi ? Je pense que ce serait désinvolte vis-à-vis des gens qui se déplacent pour aller voter que de tout mettre dans le même panier. Des fraudes peuvent avoir lieu avant le scrutin, mais si vous voulez décourager la démocratie, il faut continuer à totalement pénaliser l’expression publique.
Cette réflexion est le fruit de mon expérience : je siège à l’OSCE depuis 1992 et j’ai participé à plusieurs dizaines de missions. En Russie en 2004, la délégation française avait émis un avis contraire à celui du BIDDH de l’OSCE. Il faut faire très attention quand on lit les conclusions. Contrairement aux parlementaires, certains observateurs sont rémunérés après avoir été recrutés par les organisations par le biais d’appels à candidatures émis par les ministères des affaires étrangères. Une fois, en Bosnie-Herzégovine, j’ai eu un différend avec un Suisse : il voulait emporter notre dossier commun, au motif qu’il était rémunéré 4 000 francs suisses et qu’il était donc là pour travailler. Comme si, pour ma part, j’avais été là pour m’amuser ! La différence est que les gens rémunérés le sont dans un but à atteindre.
M. Pierre-Yves Le Borgn’. Sachant le rôle que joue l’OSCE dans le domaine des élections, je parle sous le contrôle de Michel Voisin. Rares sont les situations dans lesquelles une observation ponctuelle, effectuée par des gens qui débarquent le vendredi précédant les élections du dimanche, fait apparaître une fraude massive, très peu subtile, que tout esprit à peu près alerte détecterait rapidement.
En réalité, la plupart du temps, le dérapage se produit en amont, bien avant que n’apparaissent les observateurs, du simple fait que les débats n’ont pas lieu. J’en reviens au problème de la pénalisation de la diffamation : il est très facile de tuer le débat. Si un journaliste sent que ses articles ou ses interventions à l’antenne peuvent le conduire à la ruine et à la prison, il y réfléchira à deux fois avant de rapporter des situations critiques.
L’exemple de la Macédoine – qui fait partie de ma circonscription des Français établis à l’étranger – est encore plus criant que celui de l’Azerbaïdjan. En apparence, le débat public y semble sain. Rien d’inquiétant n’apparaît dans le compte rendu des observateurs électoraux. En réalité, la plupart des électeurs ne connaissent pas les candidats, ils n’ont pas la moindre idée de ce qui est proposé par tel ou tel parti, ni de ce qu’il y a dans les programmes. Rien ne leur a jamais été présenté. C’est le fond du débat. Pour moi, cette question de la pénalisation de la diffamation est fondatrice. Le Conseil de l’Europe mène depuis des dizaines d’années un combat qui vise à exclure la diffamation du droit pénal, non pas pour empêcher toute poursuite pour ce motif mais pour en faire une question de droit civil.
Combien de pays du Conseil de l’Europe ressemblent à l’Azerbaïdjan par certains travers ? Plusieurs, en effet. Si je me place sous l’angle unique des difficultés d’exécution des arrêts de la CEDH, je dois dire que l’Italie rencontre en effet des problèmes récurrents. La France a aussi ses dossiers comme celui de la reconnaissance des droits des enfants nés à l’étranger par gestation pour autrui (GPA). On peut penser ce que l’on veut de la GPA, mais les enfants existent et la France a été condamnée trois fois au cours des deux dernières années à ce sujet.
Klaas de Vries, mon prédécesseur comme rapporteur sur l’exécution des arrêts de la CEDH, avait élaboré un rapport en deux parties. Dans la première, il avait recensé l’importante jurisprudence, ce qui représente une masse de travail incroyable, concernant les dix pays qui se distinguent en matière de mauvaise exécution des arrêts. Vous y trouvez la Fédération de Russie, la Turquie, la Roumanie, la Bulgarie, l’Italie – ce qui tend à montrer ces dérapages ne sont pas l’apanage des pays de l’Est de l’Europe et que chacun doit balayer devant sa porte.
Les Britanniques font une fixation sur le droit de vote des prisonniers et ils ont fait le choix politique de ne pas appliquer les arrêts qui les condamnent de manière récurrente. Prenez la Hongrie, comme le suggère François Loncle. Prenez la Bosnie-Herzégovine : l’arrêt Sejdić et Finci de décembre 2009 portait sur l’impossibilité pour un Rom et un Juif de se présenter aux élections présidentielles. En effet, conformément à la Constitution, seules les personnes déclarant leur appartenance à l’une des trois nations fondatrices, à savoir les Bosniaques, les Croates et les Serbes, ont le droit de se présenter à ces élections. Les exclus représentent 30 % de la population bosnienne. La Bosnie a été condamnée mais elle est incapable d’exécuter l’arrêt de la CEDH parce qu’il faudrait revenir sur la construction du pays, consécutive aux accords de Dayton. Voyez la mécanique… Les problèmes d’exécution sont souvent de nature très structurelle et, pour les surmonter, il faudrait changer l’organisation institutionnelle d’un pays, laquelle dépend parfois des puissances internationales. Tout cela fait que l’on ne s’en sort pas. Je ne veux pas donner l’impression de faire, à mon tour, une fixation sur l’Azerbaïdjan. Pour autant, il faut dire que ce pays se détache aussi, non par le nombre des problèmes soulevés mais par leur acuité. La pénalisation de la diffamation est un élément parmi d’autres.
François Loncle voit dans mon propos une forme de réquisitoire contre la diplomatie française. Je n’y avais pas pensé mais, en effet, intervenant sous l’angle du seul droit, ce que je peux vous dire ici est décalé par rapport à un exercice diplomatique un peu plus large, qui intègre immanquablement un volet économique. Ceci pourrait être valable pour d’autres pays du monde. Est-ce vraiment un réquisitoire ? Je vous ai cité l’exemple de Leyla et Arif Yunus. Je n’ai pas la preuve que le message que j’ai essayé de faire passer au Président de la République, à travers Jean-Pierre Jouyet, ait eu un impact. J’ai tendance à considérer que le Président de la République, dans le huis clos, a pu faire passer ce type de message.
Je n’ignore rien des conditions de la concurrence économique et des contrats qui peuvent être conclus avec un pays comme l’Azerbaïdjan – je pense aux trains et pas seulement aux hydrocarbures. Cet aspect de la relation doit être pris en compte. Cependant, un pays ne peut pas faire silence sur le respect des droits de l’Homme, surtout quand ce pays se décrit au plan international comme étant porté par une certaine vision universaliste. C’est ce que je défends comme parlementaire. C’est ce que je défendais aussi dans ma vie précédente d’industriel. Je n’ai pas l’impression d’avoir changé de casquette en passant de l’entreprise à l’Assemblée nationale. Quand on fait du « business », on n’est pas en dehors du cadre des droits et des libertés fondamentales.
Jean-François Mancel, vous disiez que les individus que j’ai cités, notamment les nombreux Mammadov qui ne portent pas le même prénom, sont toujours les mêmes. On peut le voir ainsi, mais ce n’est pas mon cas. Il y a quand même 164 arrêts sous surveillance du comité des ministres. Ceux qui sont condamnés sont ceux qui ont été tout à la fois les plus malchanceux et les plus courageux. Ces gens-là ont un fil conducteur commun : la défense des droits, soit qu’ils soient à la tête d’organisations, d’associations impliquées dans la surveillance des élections, dans la protection des droits de l’Homme, soit qu’ils soient des opposants politiques, ce qui est légitime dans un pays qui se voudrait démocratique.
Ils ont payé la défense de la liberté d’opinion par la perte de leur propre liberté. En tant que tel, c’est déjà condamnable, à moins de considérer que tout cela n’est que scories du débat public, ce qui n’est pas ma philosophie du respect des droits de l’Homme. Sur le principe, cela me choque profondément, surtout quand c’est très récurrent et que cela dure depuis longtemps : je vous parle ici d’arrêts parfois vieux de dix ans et sur lesquels nous n’obtenons aucun résultat. Dans l’intervalle, faut-il le rappeler, l’Azerbaïdjan a présidé le comité des ministres ! Il est cruellement ironique d’imaginer qu’un pays, qui a tant de mal avec l’exécution des arrêts, s’est retrouvé à présider l’instance précisément chargée de leur exécution.
Au sujet de la pénalisation de la diffamation, vous disiez que la France aurait beaucoup à apprendre, à moins que j’aie mal compris votre propos. Est-ce à dire que vous jugez utile de pénaliser la diffamation ?
M. Jean-François Mancel. Je m’interroge.
M. Pierre-Yves Le Borgn’. Pour tout vous dire, moi je m’y oppose fondamentalement parce que la pénalisation marque le début de la fin du débat. Si vous intimidez la presse de cette manière, si vous prévoyez des peines de prison pour délit d’opinion, alors vous avez un souci. C’est l’un des plus grands combats que mène le Conseil de l’Europe depuis longtemps et qu’il a gagné dans beaucoup d’États. C’est pour cela que je continue à avoir un regard positif sur ce qu’il est possible d’obtenir en Azerbaïdjan. Par la continuité de ce combat, le Conseil de l’Europe a réussi à libérer plusieurs pays de la pénalisation de la diffamation et à donner ainsi au débat public l’ampleur dont il a besoin pour que les élections soient ensuite réellement libres.
M. François Loncle. La sanction de la diffamation existe en France !
M. Pierre-Yves Le Borgn’. Elle n’entraîne pas les mêmes condamnations qu’en Azerbaïdjan. On ne va pas en prison.
M. François Loncle. Pour parler clair, j’ai été condamné pour des propos tenus dans les locaux de l’Assemblée nationale. Certes, la condamnation était symbolique et sous forme d’amende mais l’affaire est allée jusqu’en cassation.
M. Pierre-Yves Le Borgn’. La dernière question de Jean-François Mancel portait sur les 900 000 personnes chassées de leur lieu de vie au Haut-Karabagh. Je n’ai pas à juger qui a raison et qui a tort, mon travail consiste à faire en sorte que soient exécutés les arrêts de la CEDH. En l’occurrence, j’observe que la question de la propriété est interprétée avec constance par la CEDH. S’il y a des arrêts portant sur la spoliation de ces personnes et leur statut de réfugié – et c’est certainement le cas – le droit doit être appliqué pour elles autant que pour les autres.
S’agissant des partis politiques en Azerbaïdjan, leur grand nombre ne signifie pas que la démocratie s’exerce de manière irrésistible. En France, il existe un parti de la loi naturelle, par exemple, qui ne remporte pas beaucoup de voix lors des élections.
M. le président François Rochebloine. Tous ces partis existent-ils réellement en Azerbaïdjan ?
M. Pierre-Yves Le Borgn’. Ils existent réellement, mais quelle peut être leur influence s’il n’y a pas vraiment de débat, s’il leur est impossible de faire connaître leurs propositions en raison du climat menaçant qui règne autour d’eux ? Quitte à être encore beaucoup plus subjectif que lors de mon propos introductif, je peux vous dire ce qui me frappe lorsque s’expriment nos collègues azerbaïdjanais à l’APCE : on les retrouve au groupe libéral, au groupe des conservateurs européens (CE) et au groupe du Parti populaire européen (PPE).
M. le président François Rochebloine. Au groupe socialiste aussi !
M. Pierre-Yves Le Borgn’. Non, pas à l’APCE.
M. Michel Voisin. Si, il y en a un et il s’appelle Mammadov !
M. Pierre-Yves Le Borgn’. L’expression de ces collègues azerbaïdjanais est quand même très monocolore. J’ai relativement peu d’échanges avec eux. Comme vous, monsieur le président, je vois souvent M. Rafael Huseynov qui est membre de la commission des affaires juridiques. Il m’est arrivé de dire à nos collègues arméniens qu’il est vain de vouloir utiliser l’APCE dans le but exclusif de régler ses comptes avec le pays voisin : cela ne mène à rien. Quand on vient siéger à Strasbourg, c’est pour des raisons qui dépassent ce conflit, aussi lourd soit-il. À Strasbourg, on est porté par une conscience européenne au service de quarante-sept États et de près d’un milliard de personnes. On se doit de penser un peu plus large. L’aspect monocolore des interventions azerbaïdjanaises m’a toujours surpris, mais je peux ignorer certaines choses et émettre un jugement injuste.
M. le président François Rochebloine. Contrairement aux Azerbaïdjanais dont les interventions sont effectivement très monocolores, il arrive aux Arméniens de débattre entre eux, car ils n’ont pas les mêmes positions.
Au nom de tous nos collègues, je voudrais vous remercier très sincèrement, monsieur Le Borgn’ pour le travail, essentiel, que vous réalisez au Conseil de l’Europe.
*
* *
Ÿ Audition de M. Philippe Gautier, directeur général de MEDEF international, accompagné de M. Bogdan Gadenne-Feertchak, chargé de mission senior pour les Balkans, la Turquie, le Caucase et l’Asie centrale (jeudi 3 novembre 2016)
M. le président François Rochebloine. Mes chers collègues, notre mission d’information a le plaisir d’accueillir aujourd’hui M. Philippe Gautier, directeur général de MEDEF International, accompagné de M. Bogdan Gadenne-Feertchak, chargé de mission senior pour les Balkans, la Turquie, le Caucase et l’Asie centrale.
Créée en 1989, l’association MEDEF International est au service du développement des activités françaises à l’étranger. Elle promeut le savoir-faire de nos entreprises, les échanges commerciaux, la coopération technologique, les partenariats de long terme et la recherche d’accords d’investissements.
Bien évidemment, les conditions de réalisation de ses objectifs varient en fonction des caractéristiques économiques et politiques de chaque pays, en particulier du degré d’implication des pouvoirs publics dans les choix d’investissements et la définition des conditions d’accueil des entreprises étrangères.
Notre mission d’information a pour objet l’examen des relations politiques et économiques entre la France et l’Azerbaïdjan au regard des objectifs français de développement de la paix et de la démocratie au Sud Caucase.
Les rapports entre les entreprises françaises et l’économie azerbaïdjanaise contribuent pour une large part à dessiner le paysage de ces relations, c’est pourquoi votre audition est particulièrement importante pour notre mission. Nous en attendons d’abord des informations statistiques de base sur le nombre d’entreprises françaises présentes en Azerbaïdjan, sur les secteurs d’activité auxquels elles appartiennent, et sur les montants des investissements français dans ce pays. Enfin, il est légitime de s’interroger sur la question de la réciprocité des investissements : en d’autres termes, nous souhaitons savoir s’il existe des investissements azerbaïdjanais en France.
Il nous a été indiqué que l’Azerbaïdjan était le premier partenaire de la France dans le Sud Caucase, ce que vous nous confirmerez, le cas échéant. Pouvez-vous nous préciser quels sont, du point de vue de MEDEF International et des entreprises, les facteurs d’attractivité de ce pays pour les entreprises françaises ?
Quand on évoque les investissements dans les pays émergents, on évoque aussi les facteurs de risque qui pèsent sur eux. Quelle est votre évaluation de ce risque en Azerbaïdjan ?
Les incertitudes affectant le cours des produits pétroliers ont-elles un effet sur le développement des investissements en Azerbaïdjan et, plus largement, sur le développement des relations commerciales entre nos deux pays ?
Enfin, la transparence des échanges économiques et financiers est une préoccupation de plus en plus prise en compte dans l’organisation des échanges internationaux. Le MEDEF, et MEDEF International en particulier, ont-ils défini une doctrine ou des orientations à ce sujet pour la conduite des négociations bilatérales avec les différents pays dans lesquels les entreprises françaises sont appelées à investir ? Comment appréciez-vous le respect par l’Azerbaïdjan de cette préoccupation ?
Monsieur le directeur, je vous laisse maintenant la parole pour une intervention liminaire d’une vingtaine de minutes, avant que le rapporteur et les autres membres de notre mission qui le souhaitent ne vous posent quelques questions.
M. Philippe Gautier, directeur général de MEDEF international. Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, je vous remercie pour votre invitation.
Si MEDEF International se caractérise par une grande indépendance, notre association travaille en étroite concertation avec les pouvoirs publics, notamment le ministère de l’économie et des finances et le ministère des affaires étrangères, et tout ce que nous faisons s’inscrit dans le cadre de la diplomatie économique et de la politique économique et financière de la France à l’international : nous sommes donc quotidiennement en contact avec le quai d’Orsay pour les aspects diplomatiques et diplomatico-économiques de notre action, et avec Bercy pour les aspects financiers et tout ce qui relève du cadre des investissements – je crois savoir que vous avez déjà auditionné Mme Sandrine Gaudin, chef du service des affaires bilatérales et de l’internationalisation des entreprises à la direction générale du Trésor, qui dispose exactement des mêmes statistiques que nous.
Pour ce qui est des aspects économiques, au cours des trente dernières années, MEDEF International s’est attaché à développer des relations stables et durables avec tous les pays du monde, en particulier avec les pays émergents et en développement, à l’exception de la Chine – un comité France-Chine a en effet été mis en place il y a plus de trente ans, c’est-à-dire avant la création de notre association.
Nous sommes présents dans tous les pays où nous estimons qu’il y a une dynamique à créer dans la durée. C’est pourquoi nos actions en Europe et aux États-Unis sont extrêmement limitées : elles se résument le plus souvent aux demandes spécifiques que nous adresse le MEDEF. Ainsi, nous nous sommes rendus en Grande Bretagne après le Brexit afin de faire le point avec nos collègues d’outre-Manche.
Nous animons plus de 80 conseils géographiques dans tous les secteurs, présidés par une soixantaine de chefs d’entreprise français en activité – par ailleurs, nous développons des actions par filière depuis cinq ans. Nos actions sont toutes collectives et nous sommes autofinancés par les entreprises, comme association à but non lucratif.
Pour l’Azerbaïdjan comme pour beaucoup d’autres pays, nous avons créé un conseil d’affaires – en l’occurrence, le conseil de chefs d’entreprise France-Azerbaïdjan Vous aurez, je crois, l’occasion d’auditionner prochainement Mme Marie-Ange Debon, directrice générale adjointe de Suez, que nous avons choisie pour présider nos conseils de chefs d’entreprise pour le Caucase en raison de l’activité importante de Suez dans cette région du monde. Elle pourra vous indiquer très précisément ce que nous attendons de ce marché et vous dira certainement qu’en matière d’infrastructure et d’environnement, il y a beaucoup à faire en Azerbaïdjan, où la compétence de la France est reconnue dans ce domaine comme elle l’est dans tout le Caucase.
Nous avons commencé à nous intéresser au Caucase – pas seulement à l’Azerbaïdjan, mais aussi à l’Arménie, à la Géorgie et à la Turquie – depuis longtemps, pour ce qui est de cette dernière. L’Iran fait également partie de nos interlocuteurs : nous n’avons pas attendu les accords de 2015 pour engager le dialogue avec ce pays et, dès février 2014, nous y avons effectué une mission. Cela nous a valu et nous vaut encore de nombreux courriers de protestations de la part de différentes ONG internationales – le plus souvent des organisations américaines.
M. Michel Voisin. L’Iran et l’Azerbaïdjan sont limitrophes, et l’on ne peut exonérer l’un plutôt que l’autre !
M. Philippe Gautier. L’Azerbaïdjan entretient des liens assez forts du côté turc comme du côté iranien, mais aussi avec la Russie, pour des raisons historiques. C’est un lieu de mélange des cultures et des langues : on constate, en particulier, une influence mutuelle du persan et de l’azéri, des deux côtés de la frontière. Bogdan Gadenne-Feertchak vous confirmera qu’elles sont pratiquées des deux côtés de la frontière – pour ce qui est de l’azéri, il est parlé par 25 millions de locuteurs en Iran.
Dès l’indépendance de l’Azerbaïdjan en 1991, nous avons pris contact avec ce pays et examiné les opportunités qui s’y présentaient. Toutefois, celles-ci ne se sont vraiment développées qu’au cours des années 2000 et c’est à partir de cette période que nous avons commencé à effectuer des missions régulières en Azerbaïdjan – la dernière a eu lieu en mai 2016. Nos missions, qui ne rassemblaient au départ qu’une quinzaine d’entreprises, en réunissent aujourd’hui une cinquantaine.
M. le président François Rochebloine. Dans quels secteurs d’activité ?
M. Philippe Gautier. On distingue trois types d’entreprises, à commencer par les entreprises historiquement actives parmi lesquelles on trouve les sociétés pétrolières ou parapétrolières – présentes avant l’ère soviétique – et le secteur de la sécurité et de la défense, qui ont eu un intérêt assez soutenu par le passé.
Un deuxième groupe est constitué d’entreprises qui, à partir d’une base assez fortement implantée dans la région, à la fois en Russie et en Turquie, ont commencé à regarder du côté de l’Azerbaïdjan, qui compte environ 10 millions d’habitants et où le pouvoir d’achat a beaucoup augmenté au cours des années 1990, et surtout 2000, jusqu’à la chute des cours du brut ; c’est aussi un pays dont les besoins en infrastructures ne peuvent laisser indifférentes les entreprises désireuses d’investir. La transformation de la capitale, Bakou, a été impressionnante au cours des dernières années…
M. le président François Rochebloine. Et pour ce qui est des autres villes ?
M. Bogdan Gadenne-Feertchak, chargé de mission senior pour les Balkans, la Turquie, le Caucase et l’Asie centrale. Leur développement ne se fait pas au même rythme que celui de Bakou, mais d’importants travaux de modernisation sont néanmoins réalisés dans certains centres régionaux, notamment à Ganja et à Gabala, où nous avons eu l’occasion de nous rendre pour observer le développement économique et politique de la région.
M. Philippe Gautier. Le développement le plus spectaculaire est celui de Bakou, où se concentrait autrefois une activité pétrolière et pétrochimique désormais repoussée un peu plus loin, ce qui a entraîné d’importants travaux en matière d’infrastructures – notamment hôtelières –, de bâtiments et d’environnement. Les Azerbaïdjanais ont remis au goût du jour les grands bâtiments haussmanniens et rénové tout leur réseau de transport. Nous nous sommes évidemment intéressés à toute cette activité et, si nous n’avons pas toujours remporté les marchés correspondants, nous sommes aujourd’hui présents au sein d’un certain nombre de services publics.
M. le président François Rochebloine. Quels sont vos principaux concurrents ?
M. Philippe Gautier. Aujourd’hui, nos concurrents sont essentiellement européens, israéliens dans la défense, turcs, – le président turc a coutume de dire que l’Azerbaïdjan et la Turquie forment un seul peuple sur deux États.
M. le président François Rochebloine. C’est très intéressant.
M. Philippe Gautier. En tout état de cause, la concurrence turque est très forte, surtout dans le bâtiment et les travaux publics. Nous avons également des concurrents coréens et malaisiens – plutôt dans le pétrole et le gaz pour ce qui est de ces derniers.
En ce qui concerne les Européens, nos principaux concurrents sont les Allemands, les Néerlandais et les Italiens.
M. le président François Rochebloine. Qui occupe la première place parmi les Européens ?
M. Bogdan Gadenne-Feertchak. Les Britanniques, grâce aux investissements de BP.
M. Philippe Gautier. Même hors pétrole, je pense que les Britanniques et les Allemands restent devant nous.
Avec les entreprises de la défense et du pétrole, la France est également présente en Azerbaïdjan dans les secteurs de la construction, des infrastructures et de la fourniture d’énergie.
Enfin, depuis quatre ou cinq ans, un troisième groupe d’entreprises, qui ne disposait pas précédemment de bases en Russie ou en Turquie, commence à travailler en Azerbaïdjan.
M. le président François Rochebloine. La State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR) a fait beaucoup de publicité en France lors des matchs de l’Euro 2016. Le MEDEF est-il intervenu d’une manière ou d’une autre à cette occasion ?
M. Philippe Gautier. Non, nous ne sommes pas intervenus à ce titre. SOCAR fait partie des sociétés azerbaïdjanaises qui s’intéressent beaucoup à la France, et je crois qu’elle a également sponsorisé un club de football français, le RC Lens.
M. Jean-François Mancel. SOCAR n’a jamais sponsorisé le RC Lens !
M. Philippe Gautier. C’est exact. Quoi qu’il en soit, nous connaissons SOCAR mais n’avons jamais cherché à attirer cet investisseur en France : notre activité consiste bien davantage à exporter les entreprises françaises – Pierre Gattaz s’emploie beaucoup à vendre la France lors de ses déplacements à l’étranger.
Pour ce qui est de notre positionnement concurrentiel, à l’instar de ce que nous faisons dans les pays émergents ou en développement, notre action en Azerbaïdjan consiste en grande partie à faire valoir la technologie que les entreprises françaises sont en mesure de proposer – des briques technologiques plus que des solutions clé en main –, et nous sommes assez bien placés dans certains secteurs.
Nous avons constaté au cours des dernières années que les sociétés publiques et privées d’Azerbaïdjan cherchent à se rapprocher des standards européens en matière environnementale. En la matière, nous sommes en mesure de proposer des entreprises travaillant selon ces standards.
Par ailleurs, comme bon nombre de pays, les Azerbaïdjanais cherchent à acquérir des savoir-faire et sont donc très demandeurs de formations, qu’il s’agisse de formation professionnelle ou de formations techniques plus avancées.
En ce qui concerne nos handicaps, je mentionnerai d’abord une concurrence qui n’a fait que s’accroître au cours des dernières années. Par ailleurs, le pouvoir d’achat a baissé en même temps que les cours du brut, et le budget de l’État ne lui permet pas toujours de poursuivre les projets de développement d’infrastructure qu’il avait envisagés. Pour ce qui est de la recherche de solutions de financement, quand nos grands concurrents européens – l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne – viennent avec des projets, ils sont dotés des financements pour les mener à bien ; or, il s’agit là d’une condition indispensable à qui veut réaliser un projet en Azerbaïdjan aujourd’hui. Nous travaillons sur cette question, notamment avec l’Agence française de développement (AFD), la Caisse des dépôts et consignations et Bpifrance, et avons constaté des évolutions tout à fait favorables à ce sujet en France. Dans bon nombre de pays émergents ou en développement, l’AFD peut avoir un effet de levier intéressant ou nous préparer le terrain dans le cadre de programmes d’assistance technique, afin de nous permettre de travailler sur la base de standards proches de ceux en vigueur en Europe.
Les concurrents dont nous avons le plus à craindre sont ceux qui, proposant des offres moins qualitatives ou acceptant de recourir à des pratiques que nous jugeons inacceptables sur le plan éthique, sont plus compétitifs en termes de prix.
M. le président François Rochebloine. La concurrence est-elle rude ?
M. Philippe Gautier. Indéniablement. Je reviens de Brazzaville où, comme c’est souvent le cas dans les pays en développement, celui qui remporte le marché est systématiquement « le plus offrant ». Cela ne pose aucun problème dans certains pays, où la concurrence est tout à fait ouverte…
M. le président François Rochebloine. Qui gagne : le moins-disant ou le mieux-disant ?
M. Philippe Gautier. Je dirai « le plus offrant », puisque telle est la pratique – comme dans bon nombre de pays.
Même quand il existe un appel d’offres public, financé par un bailleur de fonds public, la tendance est tout de même au moins-disant, précisément là où nous ne sommes pas compétitifs, puisque nous ne nous battons pas à armes égales. Pour notre part, nous nous référons à un cadre OCDE – s’appliquant aussi bien à l’intérieur de l’OCDE qu’à l’extérieur – que respectent toutes les entreprises cotées, et sans doute la grande majorité des autres. Quand nous nous trouvons en concurrence frontale avec des entreprises ne respectant aucune règle, il est évident que la concurrence est difficile.
M. le président François Rochebloine. J’en reviens aux questions que j’avais formulées en introduction. Pouvez-vous nous renseigner sur le nombre d’entreprises françaises présentes en Azerbaïdjan, sur les secteurs d’activité dans lesquels elles interviennent, sur le montant des investissements français dans ce pays, et sur l’existence éventuelle d’investissements azerbaïdjanais en France ?
M. Philippe Gautier. En commerce international, il est de plus en plus difficile de déterminer le nombre d’entreprises d’une nationalité donnée présentes dans un autre pays, car la plupart des entreprises ont une approche régionale : ainsi, celles qui sont présentes en Turquie ou en Russie rayonnent dans les pays environnants, notamment en Azerbaïdjan.
M. Bogdan Gadenne-Feertchak. La participation aux actions de nos conseils de chefs d’entreprise n’est pas soumise à un membership par conseil : nous travaillons en termes d’entreprises intéressées par un pays, qu’elles soient en phase d’approche ou qu’elles aient déjà décidé de s’y implanter avec une, dix ou vingt personnes. Pour cette raison, une entreprise peut être très active en Azerbaïdjan depuis son centre de Moscou, sans être pour autant comptabilisée comme étant implantée dans le pays. Nous préférons donc nous en tenir à la méthode des douanes ou à la méthode statistique de la direction du Trésor, basées sur des critères stables dans le temps.
Cela dit, pour vous donner quelques ordres de grandeur, lorsque nous avons commencé à travailler sur l’Azerbaïdjan en 1992-1993, le nombre d’entreprises françaises concernées ne dépassait pas quinze ; aujourd’hui, nous avons un flux constant de cinquante à soixante entreprises ayant un intérêt récurrent à participer à nos actions et à s’engager sur des missions soit techniques, soit de prospection, soit d’après-vente après la signature d’un contrat.
M. le président François Rochebloine. Y a-t-il des PME parmi les entreprises françaises présentes en Azerbaïdjan ?
M. Bogdan Gadenne-Feertchak. Le premier groupe est constitué d’entreprises qui avaient, en 1992, les épaules suffisamment solides pour aborder un marché en transition politique et économique, et le deuxième groupe est arrivé il y a dix ans, lorsque les questions urbaines et environnementales ont rejoint les priorités politiques.
Un troisième groupe est aujourd’hui constitué d’entreprises se trouvant dans une phase d’internalisation complète et s’intéressant à des segments particuliers, par exemple les briques à haute résistance thermique et sismique, ce qui peut rejoindre les préoccupations d’un pays comme l’Azerbaïdjan, qui est confronté à une problématique de régénération urbaine tenant compte de ces contraintes, et qui a créé une agence pour construire des logements sociaux. Nous incitons les entreprises de ce type à se joindre à nous lors des déplacements collectifs que nous organisons, afin qu’elles comprennent comment fonctionnent les affaires en Azerbaïdjan. Ce n’est pas parce qu’une entreprise française a déjà pris part à deux ou trois missions dans un pays étranger que nous considérons qu’elle y est implantée ; cela dit, nous avons pour objectif d’accompagner une telle entreprise sur le long terme à partir du moment où elle forme le projet d’avoir une relation commerciale avec le pays en question – et peut-être la comptabiliserons-nous, dans quelques années, comme une entreprise implantée, c’est-à-dire ayant un courant d’affaires régulier avec le pays.
M. le président François Rochebloine. Trouve-t-on une chambre de commerce franco-azerbaïdjanaise à Bakou ?
M. Bogdan Gadenne-Feertchak. Effectivement, une chambre de commerce franco-azerbaïdjanaise a été portée sur les fonts baptismaux à l’occasion de la visite du Président de la République, en mai 2014. Son actionnariat est vraiment français et azerbaïdjanais et, si elle a commencé son activité à un rythme modeste, elle a le mérite d’exister, et tient régulièrement des réunions associant les communautés d’affaires locales. Nous travaillons en bonne intelligence avec ce type de structure, en Azerbaïdjan et ailleurs ; nous nous félicitons de l’existence de cette chambre dont la vision et l’action sont complémentaires de la nôtre.
M. Philippe Gautier. Je précise qu’il ne s’agit pas d’une structure de services, mais simplement d’une sorte de club de chefs d’entreprise.
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. Vous nous avez dit que les entreprises françaises étaient présentes dans le secteur de l’énergie, des travaux publics, de l’environnement, des grands contrats et des marchés de niche technologique. A-t-on vu également de grands groupes français s’impliquer dans le développement du commerce courant, de la distribution ou de l’hôtellerie ?
M. Bogdan Gadenne-Feertchak. Je ne suis pas un expert en la matière, mais le commerce courant tel qu’on le conçoit en France, notamment la grande distribution, est un secteur qui n’a pas encore été très exploré par les sociétés françaises – ce qui n’empêche pas un grand groupe laitier d’avoir des activités en Azerbaïdjan. Pour ce qui est du tourisme, un leader français multi-enseigne du tourisme cherche actuellement à enrichir l’offre hôtelière azerbaïdjanaise, portant essentiellement sur le haut de gamme, et qui pourra être utilement complétée par une offre médium dans le cadre de l’accompagnement du développement du tourisme, notamment dans les régions.
Il y a actuellement une demande des autorités azerbaïdjanaises de mieux comprendre le savoir-faire français en la matière. Des acteurs français, tel l’École internationale d’hôtellerie et de management Vatel, ont été sollicités à cette fin par les autorités azerbaïdjanaises ; de même, je crois, que le Syndicat national des agences de voyages (SNAV) s’est livré à une brillante démonstration du savoir-faire français.
M. le rapporteur. L’environnement économique, fiscal et financier est-il propice au développement du commerce courant, ou existe-t-il encore beaucoup de freins en la matière ? Le code des investissements est-il simple ? Les rapatriements financiers sont-ils faciles ? La fiscalité donne-t-elle lieu à des redressements spectaculaires nécessitant ensuite de longues négociations, comme c’est le cas dans certains pays ? D’une manière générale, que préconiseriez-vous pour faire évoluer cet environnement ?
M. Bogdan Gadenne-Feertchak. L’analyse de l’environnement juridique et d’investissement est une tâche lourde et complexe dans les pays du pourtour de la Caspienne et de l’ex-URSS, où des pans entiers du droit sont en construction ou en reconstruction. Celle à laquelle nous avons procédé est double, et fondée à la fois sur des classements effectués par de grandes organisations internationales telles que la Banque mondiale et, sur le terrain, par des cabinets d’avocats d’envergure qui ont des implantations permanentes et accompagnent la signature des accords internationaux.
Il ressort des renseignements que nous avons recueillis que la valeur du contrat n’est pas remise en cause en Azerbaïdjan, qu’une loi permet l’arbitrage international et que le rapatriement des bénéfices ne connaît pas de limitation – c’est l’une des différences majeures avec l’Ouzbékistan par exemple, où le rapatriement des bénéfices est quasiment impossible.
La progression de l’Azerbaïdjan dans les classements internationaux est relativement lente, mais la valeur de ce type de critères doit être relativisée. En effet, au classement Doing Business de la Banque mondiale, l’Azerbaïdjan occupe une place suivant de peu celle de la Turquie, où de nombreuses entreprises françaises ont connu des success stories ; or, des pays sont bien mieux classés, alors qu’aucune entreprise française n’y est présente. En tout état de cause, le contrat a une valeur suffisamment reconnue en Azerbaïdjan pour que cela ne soit pas de nature à faire hésiter une entreprise française à y faire des affaires.
M. Philippe Gautier. À l’exception de la Turquie, l’Azerbaïdjan est sans doute, dans la région, l’une des meilleures terres d’implantation, notamment grâce une assez bonne stabilité juridique. Je crois que la Turquie et l’Azerbaïdjan occupent respectivement la 69e et la 65e place au classement Doing Business, portant essentiellement sur la facilité à faire des affaires dans un pays donné – création et fermeture de société, droit du sol, etc. Comme l’a dit Bogdan Gadenne-Feertchak, il faut relativiser la valeur de ce classement, où la France occupe d’ailleurs une place assez éloignée des premiers.
M. le rapporteur. Notre pays occupe environ la 29e place, me semble-t-il.
Présidence de Mme Véronique Louwagie, vice-présidente de la mission d’information
M. Bogdan Gadenne-Feertchak. Il faut citer l’initiative présidentielle de création du Réseau azerbaïdjanais de services et d’évaluation (ASAN), dont l’objectif est de digitaliser les services publics et qui a reçu une récompense de l’Organisation des Nations unies (ONU). Cette agence s’appuie sur les meilleures pratiques et technologies disponibles, a simplifié la délivrance des documents courants émis par l’administration – permis de conduire ou licences d’activité économique. Les pays ayant appartenu à l’URSS doivent lutter contre la corruption au quotidien, et cette agence a permis d’assainir les rapports entre les entreprises et l’administration publique. Devant cette réussite, les compétences de l’agence seront élargies et comprendront les visas électroniques et la simplification des opérations de douane. Les centres de l’ASAN sont présents dans toutes les villes de province et dans tous les arrondissements de Bakou. La vitesse de ce déploiement s’avère étonnante. En se rendant dans l’un de ces centres, on peut avoir accès à un ordinateur qui délivre l’essentiel des actes publics utiles dans la vie courante. Ces progrès bénéficient directement à l’activité quotidienne des entreprises.
M. Philippe Gautier. On aide les entreprises du secteur de l’administration électronique, y compris celles de petite taille, à s’implanter dans des pays qui souhaitent accroître l’efficacité de leur administration.
Nous n’avons plus l’information relative au risque pays, mais il est bien classé dans la région grâce à la relative stabilité du cadre juridique, à l’accès facile au travail et à la fiabilité du système bancaire.
M. Bogdan Gadenne-Feertchak. Le système bancaire se recompose actuellement autour des acteurs les plus solides.
La toile de fond des pays producteurs de pétrole dans la région est assez grise, et ils subissent des coupes budgétaires importantes. Lors de notre visite de trois jours à Bakou, nous avons rencontré le président de la République, qui cherche à conserver la qualité de la relation contractuelle pendant cette période budgétairement difficile, avant de repartir vers l’avant quand les revenus de l’État seront stabilisés. On ne retrouve pas cet état d’esprit dans tous les pays de la région, car l’on nie dans certains d’entre eux la relation contractuelle pour s’affranchir du paiement des dettes. L’Azerbaïdjan attache de l’importance aux relations contractuelles et partenariales avec les sociétés françaises, car elles structurent certains secteurs de l’économie locale. Il faudra travailler dans les dix-huit prochains mois pour que ces entreprises ne quittent pas le pays et bénéficient, lorsque l’environnement économique le permettra, de conditions d’exercice favorables à la réalisation de leurs projets. Il importe de rappeler ce message fort du chef de l’État aux investisseurs, alors que la morosité économique fait la une de la presse.
M. le rapporteur. Y a-t-il d’autres banques que la Société Générale en Azerbaïdjan ?
M. Bogdan Gadenne-Feertchak. La BNP suit ce pays depuis Istanbul et le Crédit agricole depuis Paris. Je n’ai pas eu de contacts avec Natixis. Ces trois banques marquent un intérêt constant pour les projets de financement des sociétés françaises.
Mme Véronique Louwagie, présidente. Vous avez pointé le manque de financement des banques pour les offres présentées par les entreprises françaises et avez évoqué le soutien de la Caisse des dépôts et consignations (CdC), mais pas de Bpifrance. Cette dernière est-elle impliquée en Azerbaïdjan ?
Le MEDEF a-t-il pu évaluer l’impact des visites des délégations françaises, notamment celle de mai 2016 ?
Existe-t-il des projets de développement d’offres touristiques entre nos deux pays ?
M. Philippe Gautier. Nous travaillons étroitement avec Bpifrance, qui a maintenant élaboré une offre, même si elle reste limitée par rapport à la demande de financement de projet. Nous nourrissions beaucoup d’espérance sur la fusion entre l’Agence française de développement (AFD), la CdC et Bpifrance, car nous manquons d’une force de frappe en matière de financement à l’international, et ce projet nous aurait donné environ la moitié de la puissance de la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) allemande. Cette dernière comprend l’IPEX, qui agit en bilatéral et qui correspond aux réserves pour les pays émergents (RPE) et aux prêts du Trésor français, ces deux outils étant extrêmement limités par rapport à la demande mondiale. On a besoin d’un outil capable de rivaliser avec l’Allemagne ou l’Espagne, ainsi que d’une aide liée, instrument qui reste légal dans un certain cadre et qui sert d’effet de levier à une offre de prêt ou en capital.
L’AFD est présente, mais elle traite avec des États. Nous arrivons après elle, et seulement si nos offres sont compétitives. Jusque très récemment, l’AFD pratiquait le moins-disant ; on a travaillé quatre ans avec l’équipe des marchés publics de l’AFD pour insérer des aspects qualitatifs dans les offres. Aucun bailleur de fonds n’intègre des normes de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), à l’exception de l’AFD et de la KfW, qui le font ensemble depuis un an pour les marchés de travaux. On a mis en place deux groupes de travail sur ce sujet, car le paysage évolue favorablement ; nous travaillons efficacement avec Bpifrance, la CdC, l’AFD et des acteurs privés comme des compagnies d’assurances et des sociétés d’investissement pour financer du solaire à vingt-cinq ans, des bâtiments à dix ou quinze ans et des transports à quinze ou vingt ans. Dans ce cadre, nous insistons sur la nécessité de défendre notre modèle de partenariat public-privé (PPP). Nous affrontons des acteurs qui ne respectent aucune des règles éthiques élaborées par l’OCDE et d’autres qui disposent d’outils de financement très performants – les États-Unis développent actuellement le programme Power pour l’Afrique. Nos outils de financement pour des petites et moyennes entreprises (PME) en Afrique sont américains ; ils sont efficaces et permettent d’obtenir des « tickets » de 10 à 50 millions d’euros qu’on ne trouve pas en France – Proparco finance avant tout des banques et non des projets d’entreprise.
M. Bogdan Gadenne-Feertchak. Le tourisme fait partie des secteurs de la diversification économique. Il faut rester prudent sur ce sujet, car de nouvelles stratégies pour le développement de ces secteurs d’ici à 2025 seront annoncées dans quelques semaines : huit priorités, dont le tourisme, seront dégagées. Le tourisme en Azerbaïdjan était jusqu’à maintenant essentiellement régional et interne. Pour son développement, le pays peut compter sur de bonnes infrastructures, notamment aéroportuaires. En outre, il a déployé cet été un système de visa simplifié pour les ressortissants des pays du Moyen-Orient, qui a permis un afflux significatif de nouveaux touristes. Enfin, il doit étoffer la gamme des services pour que le tourisme dure tout au long de l’année ; les stations de ski de Tufandag et de Shahdag ont peu de pistes, mais elles sont technologiquement très bien équipées. Le pays tente également de mettre en valeur, dans une optique écologique, les zones maritimes, et lutte contre le tourisme sauvage à la plage.
Le tourisme événementiel international reste centré sur de grandes compétitions sportives de Formule 1 et de football – le pays accueillera des matchs du championnat d’Europe en 2020. D’autres championnats, moins médiatiques, se révèlent importants pour certaines professions.
Ce travail commence à porter ses fruits, car le nombre de langues européennes parlées dans les sites touristiques augmente, tout comme celui de guides capables d’accompagner un groupe en anglais. Si les efforts d’investissement public et de structuration de la filière se maintiennent, les entreprises françaises pourront faire valoir leurs atouts. Les groupes français hôteliers et de formation sont les bienvenus et même sollicités par le ministère du tourisme que l’on a rencontré au mois de mai dernier. Le climat économique n’est pas propice à la dépense touristique, mais la conjoncture finira bien par se retourner.
La visite du mois de mai dernier a atteint son objectif de donner aux entreprises déjà implantées dans le pays un accès de haut niveau au gouvernement azerbaïdjanais ; nos entreprises ont d’autant plus apprécié cette évolution qu’elle ne dépendait pas du niveau de leur représentation ; elles ont pu présenter leur stratégie, leurs attentes et leurs besoins, et les nouveaux acteurs ont pu nouer des contacts avec les bons interlocuteurs, notamment dans les secteurs agricole et agroalimentaire, qui font également partie de la diversification économique, mais également dans ceux de la construction et de la logistique. Il s’agissait d’une prise de contact pour les entreprises de la délégation, aucune d’entre elles n’ayant présenté de contrat à signer. À l’occasion de la commission mixte France-Azerbaïdjan, le 13 décembre prochain, nous travaillerons sur les sujets difficiles, souvent d’ordre financier. Notre but est de consolider la relation bilatérale en attendant l’amélioration de l’environnement économique et financier.
M. Michel Voisin. Le logo de la compagnie nationale pétrolière d’Azerbaïdjan (SOCAR) est apparu sur tous les terrains de football, y compris celui de Saint-Étienne, lors du championnat d’Europe, organisé cette année dans notre pays : quelle fut la teneur de l’appel d’offres lancé par l’Union des associations européennes de football (UEFA) ? Cette attribution du marché publicitaire à la SOCAR fut-elle légale ?
M. Philippe Gautier. Nous ne pouvons pas répondre à votre question, monsieur le député, l’UEFA n’entrant pas dans notre champ de compétences. Nous pouvons travailler avec l’AFD et la Banque mondiale pour améliorer les règles de marché, mais uniquement si des entreprises françaises sont concernées.
M. Michel Voisin. Président du groupe d’amitié France-Azerbaïdjan, j’ai accompagné des entreprises françaises dans ce pays où l’accès au marché s’avère beaucoup plus difficile que vous ne le dites. Ces entreprises évoluent dans les domaines de la dépollution des sols et de la recherche dans l’hydrogène, mais les contacts ne sont pas aisés à nouer.
M. Philippe Gautier. Ces secteurs sont en effet assez fermés, mais les Azerbaïdjanais s’y intéressent, car il leur manque des compétences.
M. Michel Voisin. Les entreprises françaises sont bien placées, mais rencontrent d’énormes obstacles pour simplement soumissionner.
M. Bogdan Gadenne-Feertchak. Les questions écologiques sont suivies par beaucoup d’entreprises, notamment celles spécialisées dans la dépollution des sols dans le quartier de White City. Les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire sont en cours de structuration et se trouvent encore dans une situation oligopolistique, mais le marché fera son œuvre pour ouvrir le système. En Azerbaïdjan, le partenariat s’avère très important pour réussir, et la relation entre le client et le fournisseur est valorisée pour son apport technologique dans les services. Comme d’autres dans la région, les Azerbaïdjanais mettent un point d’honneur à ce qu’une composante azerbaïdjanaise entre dans les projets ; cette demande ne prend pas la forme des quotas, contrairement au Kazakhstan où l’on peut exiger des entreprises l’embauche de sept travailleurs locaux pour un expatrié. En Turquie, la réussite dépend du choix du bon partenaire, qui aide à effectuer le décryptage institutionnel et réglementaire.
M. Michel Voisin. Les procédures sont excessivement longues.
M. Bogdan Gadenne-Feertchak. Oui, car les normes peuvent être très lourdes, mais un projet peut être l’occasion de revoir la législation. Les entreprises, petites et grandes, doivent avoir un partenaire local fort, parce qu’il est très difficile de se présenter seul, à moins d’être le leader mondial d’un secteur très particulier.
M. Philippe Gautier. Au moment de la chute du bloc soviétique, tous les pays de cette région sont entrés dans une phase transition qui s’avère longue. Le corpus réglementaire et le processus de prise de décision sont parfois difficiles à saisir, voilà pourquoi nous amenons rarement dans cette région une entreprise faisant ses premiers pas à l’international. Il faut être aidé, avoir un très bon partenaire ou posséder une technologie inexistante dans le pays. Il convient de prendre avec du recul le classement Doing business, car il est difficile d’entrer dans ces pays si l’on n’est pas un acteur incontournable de son secteur.
M. Bogdan Gadenne-Feertchak. Les pays du Caucase veulent devenir des puissances agricoles et nous demandent des éléments pour entrer en contact avec les acteurs français de la grande distribution.
M. François Loncle. La France est-elle accessible ?
M. Bogdan Gadenne-Feertchak. Les entreprises géorgiennes ou azerbaïdjanaises souhaitant exporter en France des produits issus de la transformation agricole invoquent les normes en vigueur en Europe.
M. Philippe Gautier. Partout dans le monde, on reproche à l’Union européenne la difficulté d’accéder à son marché agroalimentaire, en raison des normes.
M. François Loncle. Des sociétés comme Carrefour s’implantent dans le monde entier.
M. Philippe Gautier. Ces entreprises font appel au marché local pour s’installer, et 90 % de leurs produits sont locaux.
M. François Loncle. Utilisez-vous les services d’Expertise France pour travailler avec des pays comme l’Azerbaïdjan ?
M. Philippe Gautier. Nous n’avons pas encore eu l’occasion de le faire, et je ne suis pas sûr qu’Expertise France ait eu des contrats en Azerbaïdjan.
M. Bogdan Gadenne-Feertchak. Expertise France et d’autres agences publiques viennent régulièrement à nos manifestations, mais nous n’avons pas reçu de demandes concrètes portant sur des projets en Azerbaïdjan. Nous avons également des contacts avec Campus France, qui, chargée de la promotion de l’enseignement français, se trouve en relation avec le lycée français de Bakou et l’université franco-azerbaïdjanaise.
M. Philippe Gautier. Vendre de l’expertise française est très important, car cela constitue la source des affaires. Si vous pouviez encourager des coopérants français à rejoindre ces pays, cela s’avérerait très utile. On cherche toujours la présence d’un expert français dans un ministère ou une agence nationale d’un pays que l’on connaît peu.
Les lycées français représentent des atouts extraordinaires !
M. Michel Voisin. En effet, visitez le lycée français de Bakou ! Toutes les collectivités locales aimeraient compter des établissements aussi extraordinaires que celui-là. Des professeurs à la retraite partent enseigner là-bas et sont très contents de leur expérience.
M. Philippe Gautier. Cet outil est essentiel, et on pourrait remplir deux ou trois fois ce lycée.
M. Michel Voisin. Il compte 120 élèves actuellement.
M. Philippe Gautier. Il a été inauguré lors de la dernière visite officielle du Président de la République. Les lycées français constituent une force de frappe reconnue partout dans le monde, et il faudrait développer ce réseau pour gagner de l’influence.
M. François Loncle. Vous n’avez pas besoin de me convaincre, car je suis rapporteur des crédits alloués aux lycées français à l’étranger pour la commission des affaires étrangères de notre assemblée. Il s’agit de vitrines culturelles et éducatives formidables, mais les budgets s’avèrent insuffisants.
M. Michel Voisin. L’Alliance française effectue également un travail remarquable.
Mme Véronique Louwagie, présidente. Connaissez-vous les conditions de l’implantation de Casino en Azerbaïdjan ?
Les premiers Jeux européens se sont déroulés à Bakou : y a-t-il eu des constructions d’infrastructures et des retombées économiques ?
M. Bogdan Gadenne-Feertchak. Je n’ai aucune information sur l’implantation de Casino.
La société GL Events s’était positionnée pour deux contrats concernant le Centre pour les médias et deux autres installations à l’occasion des Jeux européens, mais il ne s’agissait pas de gros contrats d’opérations car les infrastructures étaient déjà construites ou en passe de l’être.
M. Michel Voisin. Le groupe Casino a ouvert de petits magasins – de la taille d’un SPAR – et non des supermarchés.
Mme Véronique Louwagie, présidente. Ma question portait davantage sur les conditions d’octroi du marché, mais vous ne pouvez pas détenir toutes les informations !
M. Jean-François Mancel. Il y a eu un appel d’offres, et Casino a été sélectionné parmi plusieurs grandes centrales commerciales. Les produits Casino, qui sont excellents, sont de plus en plus prisés en Azerbaïdjan, et notamment par un acheteur français qui agit pour les plus gros hôtels de la côte de la mer Caspienne.
On auditionnera le directeur de Lactalis en Azerbaïdjan, qui nous parlera de l’évolution positive, que vous avez justement mentionnée, des droits de douane. Il m’a récemment indiqué que son activité avait été transformée grâce à cette réforme.
Monsieur le directeur, le MEDEF a un rôle à jouer pour aider les entreprises françaises à se positionner sur les marchés. En effet, elles ont été absentes de l’équipement des stations de ski – les marchés allant à des sociétés suisses et autrichiennes –, alors que nous possédons un savoir-faire dans ce domaine et que Megève est jumelée avec Gousar.
Grâce à l’action de M. Thierry Braillard, secrétaire d’État chargé des sports, les bus Iveco ont remporté le marché de la ville de Bakou.
Considérez-vous que l’Azerbaïdjan fasse des efforts, malgré la crise pétrolière, pour accueillir des entreprises étrangères et françaises ?
M. Bogdan Gadenne-Feertchak. Oui, car ce pays possède des élites politiques capables de fixer des priorités claires et d’y consacrer des financements ; cela représente un gain de temps considérable et le distingue d’autres pays de la région où tout est prioritaire et où rien n’est financé. Ce pays s’inscrit dans une démarche d’ouverture à l’offre internationale, même si des difficultés existent.
Le chef de l’État et le Gouvernement ont initié un mouvement de simplification de la vie des entreprises avec l’Azerbaïdjan investment company, AZPROMO et l’ASAN. Nos entreprises bénéficient de ces avancées : ainsi, il était auparavant difficile de rencontrer des entreprises azerbaïdjanaises, alors qu’il suffit dorénavant d’adresser une demande à AZPROMO qui renvoie des réponses claires. Si l’on met de côté les aspects conjoncturels, financiers et budgétaires, ce pays devrait attirer de plus en plus d’entreprises européennes. Les sociétés françaises ont donc intérêt à surveiller les échéances des grands projets de diversification économique, car le calendrier peut s’accélérer. Il peut s’avérer long de trouver le bon partenaire, mais les projets avancent une fois cette condition remplie, alors qu’ils s’engluent dans les failles de la gouvernance économique au Kazakhstan. Les vols directs simplifient en outre l’accès à l’Azerbaïdjan et à cette région qui comprend l’Iran, la Russie et la Turquie ; ce pays peut donc justifier un investissement en temps et en argent.
M. Philippe Gautier. Nous avons sollicité les entreprises françaises spécialisées dans les installations de sports d’hiver, notamment Poma qui a bien réussi en Géorgie, et nous étions aux côtés d’Iveco dans sa conquête du marché de Bakou.
M. Michel Voisin. Les conditions d’accès aux marchés azerbaïdjanais et kazakh sont similaires.
M. Philippe Gautier. La situation conjoncturelle va contraindre l’implantation de nos entreprises, mais l’Azerbaïdjan, comme l’Arabie saoudite, prend des mesures fortes pour diversifier son économie. Il faut donc suivre ce pays, mais il ne constitue pas un bon marché pour les débutants.
Mme Véronique Louwagie, présidente. Messieurs, je vous remercie pour la qualité de vos interventions.
*
* *
Ÿ Audition de M. Philippe Errera, directeur général des relations internationales et de la stratégie au ministère de la défense, accompagné de M. Laurent Rucker, chef du bureau Europe orientale, et de M. Emmanuel Dreyfus, chargé de mission Europe orientale (mercredi 9 novembre 2016)
M. le président François Rochebloine. Monsieur le directeur général, votre carrière professionnelle s’est souvent située à la frontière des questions de défense et de diplomatie. Vous avez également été associé de près, comme conseiller puis directeur de cabinet de M. Kouchner, alors ministre des affaires étrangères, aux choix fondamentaux de politique extérieure de la France.
Votre concours nous est donc précieux au moment où nous entreprenons nos travaux.
Notre première préoccupation est d’y voir un peu plus clair dans le jeu complexe d’alliances et de convergences dont la région du Sud Caucase est le théâtre, et dans le positionnement qu’y adopte l’Azerbaïdjan.
Comment définir les objectifs et les moyens d’action de la Russie et de la Turquie sur ce théâtre ? Y a-t-il confrontation, neutralisation ou alliance objective entre les puissances, que semble animer un renouveau de tentation impérialiste ? Quelle influence cette évolution peut-elle exercer sur les autorités de Bakou ?
Pour prendre un exemple précis, comment interprétez-vous l’accord gazier que la Russie et la Turquie ont passé le mois dernier ?
Quelle peut être la conséquence de ces manœuvres générales sur la sécurité des investissements réalisés en Azerbaïdjan par les entreprises occidentales, notamment françaises, dans le secteur du pétrole et de l’énergie ?
Notre deuxième préoccupation concerne la concurrence des politiques de défense. Le gouvernement de l’Azerbaïdjan fait état d’un accroissement considérable de son effort budgétaire dans ce domaine ; cette année encore, il augmente de 25 %, malgré la baisse des prix du pétrole. À votre connaissance, monsieur le directeur général, quelle est précisément la réalité statistique correspondant à cet effort ? Comment évaluer qualitativement et quantitativement l’importance, en effectifs et en moyens, des forces armées azéries ?
Pouvez-vous mettre en regard de la politique de défense azerbaïdjanaise l’effort de dépense militaire et la puissance militaire des deux autres pays du Caucase du Sud, l’Arménie et la Géorgie ?
Ma troisième interrogation portera sur l’approvisionnement de l’Azerbaïdjan en armes et moyens de défense.
Depuis février 1992, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) « demande à tous les États participants et aux États de la région d’imposer un embargo sur toutes les livraisons d’armes et de munitions aux forces engagées dans des combats dans la région du Haut-Karabagh ». Dans quelles conditions la signature d’accords pour la fourniture d’armement à l’Azerbaïdjan – comme à l’Arménie, d’ailleurs – demeure-t-elle possible compte tenu des termes de cet embargo ?
Quels sont les principaux fournisseurs de l’Azerbaïdjan ?
La presse a indiqué que ce pays faisait partie des quinze premiers clients des industries d’armement françaises en 2015. Cette information est-elle exacte ? Si oui, demeure-t-elle valable en 2016 ?
Quel est le montant des commandes passées par l’Azerbaïdjan à nos industries, et pour quelle catégorie d’armes et d’équipements, depuis une dizaine d’années ? Quelles sont les perspectives de ce marché ?
M. Philippe Errera, directeur général des relations internationales et de la stratégie au ministère de la défense. Je me réjouis de participer à cette mission d’information.
Pour tenter de répondre à vos questions, avant de vous exposer les principales caractéristiques de notre relation de défense avec Bakou, je souhaiterais vous présenter notre analyse sur l’environnement stratégique de l’Azerbaïdjan.
L’Azerbaïdjan, comme l’Arménie et la Géorgie, les deux autres pays du Caucase du Sud, évolue dans un contexte régional marqué par la réaffirmation de la puissance militaire russe. Le conflit du Haut-Karabagh, le poids de la Russie, de l’Iran et de la Turquie dans la région, le terrorisme islamiste constituent ses principales préoccupations stratégiques.
Le conflit du Haut-Karabagh représente l’enjeu de défense le plus important pour Bakou et structure la politique de défense azerbaïdjanaise. Opposant l’Azerbaïdjan à l’Arménie depuis 1988, ce conflit se caractérise par la persistance de ce que l’on a appelé une guerre de basse intensité. Alors que, jusqu’en 2014, il faisait en moyenne une quinzaine de morts par an, essentiellement du fait de snipers, l’année 2016, avec probablement plus de 200 morts, a été la plus meurtrière depuis la conclusion du cessez-le-feu en 1994. La montée des tensions qui s’est produite en avril dernier au Haut-Karabagh, avec la « guerre des quatre jours », nous a rappelé que ce conflit n’était en rien gelé. Sans le travail du Groupe de Minsk – dont la France est membre depuis 1992 et co-présidente depuis 1997 – et de nos collègues du ministère des Affaires étrangères, cette « guerre des quatre jours » aurait pu prendre une tout autre ampleur.
La politique russe dans la région s’articule autour de trois facteurs.
Premier facteur : le renforcement de l’influence de la Russie dans l’espace post-soviétique par tous les moyens, y compris le recours à la force, comme l’ont montré les interventions militaires en Géorgie, en 2008, et surtout en Ukraine, depuis 2014. Pour le dire de manière peut-être simpliste, en tout cas simplificatrice, l’objectif de Moscou est d’empêcher de nouveaux élargissements de l’Union européenne et de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) dans cet espace, et d’y réduire l’influence occidentale.
Deuxième facteur : la proximité du Caucase avec le Moyen-Orient, zone dans laquelle Moscou entend jouer un rôle de plus en plus affirmé. Les tirs de missiles de croisière effectués en octobre 2015 à partir des bâtiments de la flottille de Caspienne contre des cibles en Syrie illustrent la place que Moscou accorde à la région de la Caspienne et du Caucase dans le dispositif stratégique que la Russie met en place de la Baltique au Moyen-Orient.
Troisième facteur : avec la levée des sanctions à l’encontre de l’Iran, la Russie regarde avec un intérêt accru le Caucase du Sud, et l’Azerbaïdjan en particulier – je songe aux ambitieux projets de corridor ferroviaire Nord-Sud reliant la Russie à l’Iran via l’Azerbaïdjan.
Sur le plan politique, cette stratégie russe s’est notamment traduite par l’adhésion de l’Arménie à l’Union eurasiatique, en 2015, et par un important renforcement de la relation entre la Russie et l’Azerbaïdjan, avec la densification de la relation d’armement – j’y reviendrai – et la multiplication des visites de haut niveau, dont trois visites de Vladimir Poutine à Bakou depuis 2013.
Sur le plan militaire, le renforcement est encore plus patent : conclusion de nouveaux accords d’intégration et densification de la présence militaire russe dans les deux régions séparatistes géorgiennes, l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud ; en Arménie, extension à 2059 du bail de la 102e base militaire russe de Gumri, forte de 2 500 hommes ; octroi en 2014 d’un prêt de 200 millions de dollars pour l’achat d’armement ; signature d’un nouvel accord de défense aérienne avec la Russie en 2015.
Ce renforcement a lieu alors que la présence militaire russe en Arménie est déjà conséquente. En témoignent la surveillance conjointe des frontières avec la Turquie et l’Iran à l’aide de plusieurs milliers d’hommes du FSB (Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie) et le fait que la défense de l’espace aérien arménien soit de facto assurée par les forces russes, dans le cadre du système de défense aérienne de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC). S’y ajoute l’étroitesse des relations de défense entre industries de défense, dont atteste l’existence de joint-ventures russo-arméniennes. La Russie est en outre pour le moment le seul pays disposé à vendre de l’armement moderne à l’Arménie dans des conditions très avantageuses.
Enfin, la relation d’armement entre la Russie et l’Azerbaïdjan s’est elle aussi considérablement accrue ces dernières années. J’y reviendrai ultérieurement. Moscou a également renforcé sa présence en mer Noire, à la suite de l’annexion de la Crimée et conformément à la nouvelle doctrine navale russe, qui date de l’été 2015.
Dans ce contexte, l’Azerbaïdjan entretient de bonnes relations avec Moscou. C’est d’ailleurs le seul pays du Caucase du Sud sans présence militaire russe sur son territoire depuis l’évacuation de la station radar russe de Gabala en 2013. Cependant, le renforcement de la présence militaire russe aux frontières de l’Azerbaïdjan est suivi avec attention par Bakou.
Vous m’avez interrogé sur le terrorisme. Pays majoritairement chiite mais doté d’une forte minorité sunnite – plus d’un tiers de la population –, l’Azerbaïdjan est confronté à la menace du terrorisme islamiste, en raison à la fois de sa proximité géographique avec le Caucase du Nord et de l’attractivité des théâtres syrien et irakien pour certains Azerbaïdjanais radicalisés. Plusieurs centaines d’entre eux – entre 400 et 1 000 selon les estimations – seraient ainsi parties combattre au Levant ces dernières années, et une centaine y aurait été tuée.
M. le président François Rochebloine. Hommes et femmes ?
M. Philippe Errera. Nous ne disposons pas de données précises sur la présence de femmes parmi les personnes arrêtées en Azerbaïdjan pour fait de terrorisme. Mais celle-ci n’est pas à exclure.
Contrairement à la Géorgie, qui peut servir de pays de transit pour des ressortissants russes cherchant à se rendre au Levant via la Turquie, l’Azerbaïdjan ne semble pas être utilisé comme zone de passage pour les individus radicalisés, du moins pas à la même échelle.
Pour l’instant contenue, cette menace inquiète les autorités azerbaïdjanaises, qui craignent des attentats visant notamment les infrastructures énergétiques, ainsi qu’une remise en cause du mode de fonctionnement laïque du pays, tributaire de l’absence de tension entre la majorité chiite et la minorité sunnite. La crise économique et sociale que traverse l’Azerbaïdjan, liée à la chute du cours des hydrocarbures, et les jeunes des familles déplacées du Haut-Karabagh pourraient offrir un terreau favorable à la diffusion de la propagande islamiste. Face à cette menace, les autorités azerbaïdjanaises ont pris plusieurs mesures, comme la fermeture de certaines mosquées ou encore le gel des avoirs des personnes soupçonnées de financer le terrorisme. Elles ont aussi prononcé de lourdes peines de prison – d’une quinzaine d’années – à l’encontre de citoyens azerbaïdjanais.
M. le président François Rochebloine. Sait-on combien il y a de mosquées, et combien ont été fermées ?
M. Philippe Errera. Dès 2009, l’Azerbaïdjan avait initié une politique de fermeture des mosquées soutenant une idéologie jugée contraire aux valeurs du pays, que ces sites soient sunnites ou chiites. En 2016, il existait 31 mosquées majeures en Azerbaïdjan (sur un total d’environ 2 000).
Après cette description de l’Azerbaïdjan et de son environnement stratégique, j’en viens à la politique de défense du pays, avant de conclure sur la relation de défense franco-azerbaïdjanaise.
Selon les données officielles, le budget de défense azerbaïdjanais s’élevait en 2015 à 4,5 milliards d’euros. Il pourrait en réalité être moins élevé, en raison des difficultés économiques liées à la baisse des cours du pétrole et de la double dévaluation du manat. Il reste plus important que les budgets de défense des autres pays du Caucase du Sud : celui de la Géorgie s’élève à environ 250 millions d’euros, et celui de l’Arménie est d’environ 415 millions d’euros.
L’Azerbaïdjan dispose d’une armée de conscription, essentiellement constituée de forces terrestres : 57 000 soldats dans l’armée de terre, contre 4 000 pour l’armée de l’air et 2 000 environ pour la marine. Les effectifs des forces armées arméniennes sont comparables : environ 45 000 hommes, dont la grande majorité sert dans l’armée de terre. Les forces armées géorgiennes comptent environ 25 000 hommes.
La sécurisation des gisements et infrastructures énergétiques, principales sources de revenus pour Bakou, représente une priorité de la politique de défense azerbaïdjanaise. Plus largement, la sécurité énergétique de l’Azerbaïdjan constitue un élément fondamental de la stabilité du Caucase du Sud ; elle permet notamment de garantir la sécurité et l’indépendance énergétique de la Géorgie, qu’elle approvisionne en hydrocarbures, via notamment le gazoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC).
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. La sécurité des sites est assurée par l’armée ou la gendarmerie ; il n’y a pas sur place de police d’État. Est-ce l’armée qui assure la sécurité de l’approvisionnement pétrolier ?
M. Philippe Errera. Ce sont des forces militaires et des unités de l’armée. Pour ce qui concerne les installations offshore, leur protection est vraisemblablement garantie par les forces navales et les garde-côtes. S’agissant des infrastructures terrestres, elles sont surveillées par les forces du ministère de l’Intérieur.
Bakou entretient une étroite relation de défense avec Ankara, comprenant des échanges de haut niveau, des programmes d’assistance, de la coopération en matière de renseignement, d’entraînement, de médecine militaire et d’industries de défense. Des cadres turcs participent à la formation des officiers azerbaïdjanais. La Turquie encourage également le rapprochement de l’Azerbaïdjan avec l’OTAN et s’efforce de le soutenir depuis l’intérieur de l’organisation. Cet axe de coopération, qui reste toutefois modeste, s’inscrit dans le cadre de la modernisation de l’outil de défense azerbaïdjanais.
La coopération avec l’Occident est une autre composante de la politique de défense azerbaïdjanaise. L’Azerbaïdjan a rejoint le Partenariat pour la paix de l’OTAN en 1994, ce qui lui a permis de contribuer aux opérations de l’Alliance au Kosovo, puis en Afghanistan – à la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS), puis à l’opération Resolute Support qui lui succède, à hauteur de 94 hommes, intégrés au contingent turc et participant essentiellement à des activités de déminage et d’assistance médicale.
Hormis la participation de Bakou aux opérations extérieures de l’Alliance, la coopération est limitée à quelques domaines. L’OTAN soutient ainsi Bakou dans son processus de réforme des secteurs de la défense et de la sécurité, l’une des priorités de ces programmes étant le renforcement du contrôle démocratique et civil des forces armées.
La destruction des munitions non explosées constitue un autre axe de coopération. L’Alliance a ainsi contribué, pratiquement et financièrement, à la dépollution d’une zone de plus de 5 millions de mètres carrés située autour d’un ancien dépôt de munitions ayant explosé en 1991.
Avec le soutien de l’OTAN, l’Azerbaïdjan développe également ses capacités nationales de gestion des situations d’urgence et des catastrophes dans le domaine civil.
J’insisterai sur la dimension concrète de cette coopération. Au niveau politique, le dialogue entre l’Azerbaïdjan et l’OTAN est limité, surtout parce que Bakou n’a pas pour objectif de rejoindre l’Alliance. Il n’y a pas de bureau de l’OTAN à Bakou.
S’agissant de la politique d’armement, composante importante, voire essentielle, de la politique de défense du pays, le cours élevé des hydrocarbures a longtemps permis à l’Azerbaïdjan de financer une politique d’armement ambitieuse, visant à moderniser son outil de défense. L’Azerbaïdjan mène une politique d’acquisition ciblée sur quelques grands pays fournisseurs, pour l’essentiel la Russie, Israël, la Turquie.
Je signalerai d’emblée que les principaux fournisseurs d’armement de l’Azerbaïdjan ne respectent pas les résolutions de l’OSCE – dont ils sont membres, à l’exception d’Israël – et du Conseil de sécurité des Nations unies. Ces textes n’imposent pas un embargo total sur les exportations de matériels de guerre.
M. le président François Rochebloine. C’est pourtant ce qui est demandé par l’OSCE !
M. Philippe Errera. Ce qui est demandé dans la résolution telle que nous la comprenons, c’est la limitation des exportations vers Bakou ou Erevan de matériels susceptibles d’être utilisés dans le conflit au Haut-Karabagh. Il ne s’agit donc pas d’un embargo total, à l’instar de celui qui a touché l’Iran ou de celui qui concerne le Soudan. Cela étant, il nous semble bien que la grande majorité des matériels exportés par les principaux fournisseurs de l’Azerbaïdjan ne respecte pas les résolutions.
L’embargo de l’OSCE résulte d’une « décision du comité des hauts fonctionnaires sur le Nagorno-Karabakh » du 28 février 1992. Ce texte, qui n’est pas juridiquement contraignant, enjoint les États membres d’appliquer un embargo sur les ventes d’armes et de munitions pouvant être utilisées par les forces en présence au Haut-Karabagh. La résolution 853, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 29 juillet 1993, appelle les États membres à ne pas livrer d’armes et de munitions pouvant mener à une intensification du conflit.
Voilà pour le cadre. S’agissant maintenant du contenu, c’est d’abord vers la Russie que Bakou se tourne afin de moderniser son outil de défense. De 2010 à 2015, le montant des ventes de matériels russes à l’Azerbaïdjan est estimé à environ 4 milliards de dollars. Quant au budget de défense azerbaïdjanais, il oscillait officiellement entre 2,5 et 4 milliards d’euros de 2011 à 2014 ; c’est ensuite qu’il a chuté.
Ces ventes comprennent notamment la livraison de chars et de véhicules de combat d’infanterie, d’hélicoptères, de lance-roquettes multiple (LRM) et d’autres pièces d’artillerie, ainsi que de systèmes sol-air. Des accords pour la production sous licence en Azerbaïdjan de fusils d’assaut AK-74 ont également été conclus.
Afin de ne pas dépendre exclusivement de la Russie, l’Azerbaïdjan a aussi développé des partenariats industriels avec d’autres fournisseurs. C’est dans cette perspective que Bakou s’est rapprochée d’Israël et a conclu à partir du milieu des années 2000 plusieurs contrats avec des entreprises israéliennes de défense. Ce partenariat, en particulier pour les drones, pour les systèmes antiaériens et pour les technologies de pointe, constitue l’une des priorités des autorités azerbaïdjanaises en matière d’armement.
Bakou entretient également une importante relation d’armement avec la Turquie. De nombreuses joint-ventures ont été créées afin de produire du matériel en commun : systèmes d’artillerie, chars, missiles.
La Biélorussie et l’Ukraine figurent parmi les autres fournisseurs en armement de l’Azerbaïdjan, plutôt dans des domaines moins sophistiqués.
Je voudrais maintenant vous présenter les principaux enjeux de notre relation de défense avec Bakou.
Celle-ci se compose d’une coopération militaire très modeste, encadrée par un arrangement technique signé à Paris en janvier 2014 par les ministres français et azerbaïdjanais de la défense lors de la visite de ce dernier, ainsi que d’un partenariat dans le domaine industriel. Cette relation est mise en œuvre par notre attaché de défense en Géorgie, non-résident pour l’Arménie et l’Azerbaïdjan.
M. le président François Rochebloine. C’est le même pour les deux pays.
M. Philippe Errera. Exactement. C’est avec la Géorgie que nous entretenons la relation de défense la plus dense dans la région ; par ailleurs, dans un souci d’équilibre compte tenu de notre statut de co-président du Groupe de Minsk, notre attaché de défense assure la relation de notre pays avec l’Arménie et l’Azerbaïdjan sur un pied d’égalité.
Notre relation de défense avec Bakou est en effet parfaitement symétrique de celle qui nous lie à Erevan. Nous tenons à cette symétrie, gage, je le répète, de la crédibilité de notre engagement en tant que co-président du Groupe de Minsk ; nous veillons bien entendu à ce que nos activités de coopération, tant avec l’Azerbaïdjan qu’avec l’Arménie, ne puissent être exploitées de quelque manière que ce soit par les différentes concernées par le Haut-Karabagh. C’est bien entendu le cas s’agissant des exportations d’armement, puisque nous nous conformons strictement aux décisions de l’OSCE et du Conseil de sécurité ; mais cela concerne aussi, plus largement, le type de coopération militaire que nous entretenons avec l’un ou avec l’autre. Les actions que nous menons dans ce domaine restent neutres : elles touchent par exemple à l’enseignement du français ou à la formation des officiers.
Nous entretenons depuis quelques années un partenariat industriel avec Bakou qui se conforme lui aussi au respect le plus strict des résolutions du Conseil de sécurité et de la décision de l’OSCE : il vise exclusivement à aider Bakou à protéger ses infrastructures critiques en mer Caspienne et à contribuer à la sécurité énergétique de l’Azerbaïdjan et, par là même, de l’Europe. Plusieurs de nos sociétés, dont Total et Engie – certains de leurs responsables ont été auditionnés par votre mission ou vont l’être –, sont fortement impliquées dans des activités d’exploitation d’hydrocarbures azerbaïdjanais. Total a beaucoup investi dans le gisement d’Apchéron et Engie sera le premier client du gaz provenant du nouveau gisement Shah Deniz 2. Je conclurai en rappelant que notre relation avec l’Azerbaïdjan vise prioritairement à soutenir la résolution du conflit au Haut-Karabagh et la réconciliation entre Bakou et Erevan, et que notre relation de défense avec Bakou, au demeurant très modeste, s’est construite en fonction de cet impératif politique et diplomatique, auquel nous ne dérogerons pas.
M. le président François Rochebloine. Vous n’avez pas répondu à une de mes questions : la presse a rapporté que l’Azerbaïdjan figurait parmi les quinze premiers clients de l’industrie de défense française en 2015. Cette information est-elle exacte, et qu’en est-il en 2016 ? Quel est le montant des commandes passées par l’Azerbaïdjan à nos industries ?
M. Philippe Errera. Cette information est inexacte. Plus précisément, elle se fonde sur un chiffre exact, mais qu’il faut manier avec plus de précautions : celui du montant des licences accordées pour mener des prospects en Azerbaïdjan, qui est de 900 millions d’euros. Or le système français de contrôle des exportations sensibles est très strict : les industriels doivent impérativement demander une licence dès le début de la prospection. Le montant total des contrats potentiels, pour lesquels des licences ont été demandées, est effectivement de 900 millions d’euros ; mais seule une toute petite partie de ces démarches aboutit réellement.
Ainsi, en 2015, la commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG) a au total accordé des licences pour 160 milliards d’euros ; les contrats conclus la même année représentaient 16 milliards seulement, soit dix fois moins.
M. le rapporteur. Merci de cet exposé clair et complet.
Vous avez évoqué la présence russe en Arménie et en Azerbaïdjan. La Russie cherche-t-elle à respecter un certain équilibre ? Essaie-t-elle de réduire la présence occidentale en Azerbaïdjan ? La Russie a-t-elle une doctrine en la matière ?
Quant aux équipements livrés à l’Azerbaïdjan, permettent-ils à ce pays de disposer des capacités offensives qui lui manquaient ?
Vous avez également évoqué les partenariats de l’OTAN avec les trois pays du Sud-Caucase. Quelle gradation – du plus étroit au plus lointain – établiriez-vous entre ces partenariats ? À vous entendre, la relation entre l’OTAN et l’Azerbaïdjan est assez formelle : l’Azerbaïdjan s’en contente-t-il, ou bien attend-il plus de l’OTAN ?
Enfin, en ce qui concerne la mer Caspienne, c’est une mer stratégique pour la Russie à tous points de vue, puisqu’elle y dispose d’une flotte – celle qui a envoyé des missiles de croisières vers la Syrie le 9 octobre 2015 – mais aussi parce qu’elle est la clef de l’exportation des hydrocarbures des États d’Asie centrale, notamment du Turkménistan, vers l’Europe. C’est enfin une cible potentielle pour des attaques terroristes, puisqu’il y existe des installations offshore. Quelles sont les capacités des grandes flottes présentes en mer Caspienne ? Quels sont les équipements actuels et les éventuels besoins de l’Azerbaïdjan en la matière, notamment pour la protection des installations offshore ?
M. Philippe Errera. La Russie veut sans doute que sa position soit comprise comme équilibrée, afin d’être à même de continuer à jouer son rôle de co-présidente du groupe de Minsk. Mais ce facteur joue un rôle moins important que pour nous, compte tenu de ce que Moscou perçoit comme des impératifs stratégiques – la Russie entretient une relation de défense extrêmement étroite avec l’Arménie – mais aussi des retombées importantes des commandes de ces pays pour son industrie de défense.
S’agissant de l’influence russe en Azerbaïdjan, mon sentiment est qu’il s’agit moins pour Moscou de jouer la concurrence avec les pays occidentaux que d’assurer ses intérêts stratégiques et énergétiques.
M. Laurent Rucker, chef du bureau Europe orientale (DGRIS). La politique de la Russie dans le Caucase du Sud s’inscrit d’abord dans une politique plus générale vis-à-vis de l’espace post-soviétique que nous voyons à l’œuvre depuis le milieu des années 2000, c’est-à-dire bien avant la crise ukrainienne : il s’agit de renforcer par tous les moyens, y compris le recours à la force, l’influence russe dans une zone stratégiquement importante pour Moscou, puisqu’elle se situe au carrefour entre le Caucase du Nord, le Sud de la Russie, la mer Caspienne, l’Iran, au Sud, le Moyen-Orient, à l’Ouest, la Turquie et plusieurs pays membres de l’OTAN. La Russie est également impliquée au premier chef dans le conflit du Haut-Karabagh, et elle dispose de leviers d’action sur les deux États belligérants. C’est la combinaison de ces facteurs qui détermine la politique russe dans la région.
M. Philippe Errera. La relation de l’Azerbaïdjan avec l’OTAN demeurera sans doute modeste. Le champ des coopérations possibles est relativement restreint.
Du point de vue de l’OTAN, il existe une différence fondamentale entre la Géorgie, d’une part, l’Arménie et l’Azerbaïdjan, de l’autre.
La Géorgie est le partenaire le plus important de l’OTAN dans le Sud Caucase. Il existe un cadre de coopération établi depuis plusieurs années qui permet de soutenir la réforme des forces armées géorgiennes. Celles-ci participent aux opérations de l’OTAN de façon essentielle : en Afghanistan, la contribution géorgienne est la plus importante après celle des États-Unis. En termes de coopération, dans différents domaines, il y a donc plus de potentialités. En revanche, il n’existe pas de consensus au sein de l’OTAN sur le processus d’adhésion de la Géorgie. La participation de la Géorgie aux opérations de l’Alliance – comme d’ailleurs de l’Union européenne, puisqu’elle a contribué de façon importante à l’opération EUFOR RCA – et le processus d’adhésion à l’OTAN sont deux sujets différents.
S’agissant de la mer Caspienne, effectivement un enjeu stratégique, je ne dispose pas aujourd’hui des données que vous me demandez sur les capacités des grandes flottes.
En ce qui concerne la protection des infrastructures énergétiques en mer Caspienne, l’Azerbaïdjan réfléchit à des systèmes qui permettraient une meilleure perception des situations, des radars aériens par exemple, éventuellement couplés à des systèmes de défense des installations, avec des rayons d’action adaptés à la protection ponctuelle de sites précis.
M. le président François Rochebloine. Merci de ces réponses précises.
Avez-vous connaissance des procédures azerbaïdjanaises de commande d’armes et d’équipements militaires ? Quel est l’interlocuteur institutionnel des fournisseurs ?
Les contrats de vente à l’Azerbaïdjan comportent-ils ou impliquent-ils des contreparties d’achat de biens, ou de services ou d’investissement en Azerbaïdjan, autrement dit des rétro-commissions ?
Quelle est la force des mouvements islamistes en Azerbaïdjan ? Quelle est l’attitude des autorités de Bakou à leur égard, en particulier vis-à-vis des ressortissants azéris qui reviendraient des zones actuellement ou anciennement contrôlées par l’État islamique ?
M. Philippe Errera. Je ne connais pas les procédures internes de l’Azerbaïdjan. L’interlocuteur institutionnel du ministère de la défense français est le ministre de la défense azerbaïdjanais, le général Zakir Hasanov, en place depuis 2013.
S’agissant des contrats, aucun des contrats autorisés par la CIEEMG ne saurait évidemment contenir de clauses illégales. Par ailleurs, je n’ai connaissance d’aucune stipulation du genre de celles que vous évoquez dans ces contrats.
En ce qui concerne les mouvements islamistes, l’attitude de l’Azerbaïdjan est particulièrement ferme. Pour un pays comme la France, exposé aux risques que vous connaissez, cela peut apparaître très légitime. Néanmoins, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a exprimé certaines inquiétudes sur la protection des droits de l’Homme en Azerbaïdjan, le risque étant qu’une politique de prévention et de répression du terrorisme ne soit pas suffisamment bien ciblée et finisse par renforcer au contraire l’attraction exercée par ces réseaux.
M. Alain Ballay. Quelles sont les perspectives d’évolution du conflit du Haut-Karabagh dans les années à venir ?
Quel regard porte la population azerbaïdjanaise sur ce conflit armé, ainsi que sur son armée ?
M. Philippe Errera. Le conflit du Haut-Karabagh ne peut pas, je l’ai dit, être considéré comme gelé ; reste qu’il dure depuis longtemps, et tout porte à craindre que les perspectives de résolution ne demeurent très lointaines. Le travail du groupe de Minsk a permis d’aboutir au moins à un accord sur un certain nombre de paramètres de résolution du conflit, les fameux « principes de Madrid ». Je ne suis toutefois pas optimiste sur leur mise en œuvre rapide.
De plus, il faut prendre en considération l’imprévisibilité, ou, pour reprendre l’expression du Président de la République, les incertitudes nées de l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, notamment en ce qui concerne les futures relations américano-russes. Je ne pense pas que tous les yeux à Washington soient rivés sur le conflit du Haut-Karabagh, mais celui-ci pourrait se trouver affecté.
Il paraît d’autant plus important que la France demeure pleinement engagée dans la résolution de ce conflit, afin d’éviter qu’une éruption de violence comme la « guerre des quatre jours » ne se reproduise, et que le conflit ne se prolonge indéfiniment.
En ce qui concerne le regard de la population azerbaïdjanaise, il faut souligner que l’armée est une force de conscription.
M. Emmanuel Dreyfus, chargé de mission Europe orientale (DGRIS). L’adhésion de la population à la politique menée au Haut-Karabagh est très forte. L’issue de la « guerre des quatre jours » a suscité une véritable liesse populaire. La majorité de la population est sur ce point en phase avec la position de ses autorités.
M. Jean-François Mancel. Les chiffres de dépenses de défense que vous avez donnés sont intéressants ; il serait néanmoins bon, je crois, de les rapporter au PIB de chaque État, ou au montant de son budget total. Il y a presque autant d’hommes sous les drapeaux en Azerbaïdjan qu’en Arménie, disiez-vous : or les populations ne sont pas du tout les mêmes.
S’agissant de l’Arménie, vous avez évoqué des livraisons d’armes russes non négligeables notamment des missiles, mais aussi d’importantes facilités financières, et l’existence d’une base russe de 2 500 militaires. Au vu de la faiblesse économique de l’Arménie, il me semble que ces données doivent nous inviter à nous interroger sur une véritable domination russe en matière militaire.
Considérez-vous que les moyens alloués par l’Azerbaïdjan à sa défense nationale, ainsi que leur répartition, indiquent une volonté de ce pays de préserver son indépendance, dans une zone où les voisins puissants et dangereux ne manquent pas ?
M. le rapporteur. Je me permets de rappeler ma question sur les achats d’armement de l’Azerbaïdjan : ont-ils permis à ce pays d’acquérir les capacités critiques qui lui faisaient défaut ?
M. le président François Rochebloine. L’Azerbaïdjan compte en effet quelque 9 millions d’habitants, contre 3 millions environ en Arménie. Pourriez-vous dresser une comparaison de leurs budgets de défense ? L’évolution du prix du pétrole a énormément modifié les données. Mais, il y a quelques années, le budget de défense de l’Azerbaïdjan était égal à 2,5 fois le budget total de l’Arménie. Qu’en est-il aujourd’hui ? Comment évoluent ces budgets ?
M. Philippe Errera. Les moyens de l’Azerbaïdjan correspondent-ils à ses objectifs ? Il est toujours difficile de distinguer les équipements offensifs des équipements défensifs. L’Azerbaïdjan peut indiquer qu’il ne souhaite qu’assurer sa souveraineté et son indépendance d’action et de décision, ainsi que la défense de son territoire, même si une partie des équipements qu’il détient, compte tenu de leur nature mais surtout de leur volume, vont au-delà de ce qui serait strictement nécessaire pour assurer uniquement la défense d’un territoire.
M. le président François Rochebloine. Pouvez-vous établir des comparaisons entre les budgets de défense de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie ? Les informations dont nous disposons laissent à croire que le budget de défense de l’Azerbaïdjan serait égal à deux ou trois fois le montant du budget total de l’Arménie. Est-ce exact ou pas ?
M. Laurent Rucker. Le budget de l’État arménien représentait environ 2,6 milliards d’euros en 2015, et celui du ministère de la défense environ 415 millions d’euros, soit environ 16 % de la dépense publique annuelle et environ 4 % du PIB. Il est globalement stable depuis plusieurs années. Le budget de défense de l’Azerbaïdjan a connu d’importantes hausses en 2013 et en 2014. Il s’élevait respectivement à 3,4 et 3,6 milliards d’euros, soit environ 18 % du budget de l’État et 5 % du PIB. Pour la Géorgie, le budget annoncé est à peu près stable ces quatre dernières années : environ 250 millions d’euros, soit 6,5 % du budget de l’État et 2,3 % du PIB.
M. Philippe Errera. Ces chiffres constituent un ordre de grandeur mais ils sont à manier avec précaution : le périmètre des dépenses publiques peut en effet considérablement varier d’un pays à l’autre, même dans les pays européens. Il faut donc se montrer extrêmement prudent avant de tirer des conclusions plus précises.
À la question de savoir si l’Azerbaïdjan a acquis suffisamment de matériels de pointe pour remplir ses objectifs de défense et de sécurité, seuls les Azerbaïdjanais pourraient répondre. On peut noter que les efforts pour acquérir de nouveaux types d’armement, et pour augmenter les volumes d’achats, se poursuivent : mon sentiment est qu’ils souhaitent continuer à renforcer leurs capacités de défense.
M. le président François Rochebloine. Messieurs, merci beaucoup de vos réponses précises.
*
* *
Ÿ Audition de M. Stéphane Heddesheimer, directeur du pôle Europe et Communauté des États indépendants (CEI) du groupe Suez (jeudi 10 novembre 2016)
M. le président François Rochebloine. Nous accueillons M. Stéphane Heddesheimer, directeur du pôle Europe et CEI du groupe Suez, que je remercie pour sa disponibilité. En effet, il était initialement prévu que nous recevions Mme Marie-Ange Debon, directrice générale chargée de l’international de Suez Environnement et présidente du groupe des chefs d’entreprise France-Azerbaïdjan de MEDEF International. Malheureusement, celle-ci est en déplacement à l’étranger.
Nous traiterons donc, monsieur Heddesheimer, du sujet qui relève de vos responsabilités propres. Comme tout Français, je ne peux que me réjouir de voir une entreprise française de haute valeur économique et technologique telle que Suez s’implanter sur des marchés internationaux, y compris en Azerbaïdjan.
Je souhaiterais donc que, dans un premier temps, vous nous fassiez l’historique de l’implantation de Suez dans ce pays, vous nous indiquiez l’ampleur financière des affaires que vous y traitez et la nature des prestations que vous y assurez.
J’imagine que cette description vous conduira, dans un deuxième temps, à nous dépeindre le paysage contractuel de ces relations. À quel niveau de la structure politique et administrative, ministères, régions et collectivités locales, selon quelles procédures préparez-vous et concluez-vous des contrats ? Les autorités auxquelles vous avez à faire émettent-elles des exigences, des vœux, des suggestions, quant à l’éventuelle implication, dans ces relations contractuelles, d’entreprises azerbaïdjanaises ?
Enfin, j’aimerais connaître votre évaluation générale des conditions de travail de Suez en Azerbaïdjan – qualité de l’exécution des obligations contractuelles ; intervention de la sous-traitance ou d’une procédure assimilable ; rapidité, efficacité des procédures administratives ?
Après votre propos liminaire, je donnerai la parole à notre rapporteur, pour qu’il puisse vous poser un certain nombre de questions. Et je vous en poserai moi-même quelques autres.
M. Stéphane Heddesheimer, directeur du pôle Europe et CEI du groupe Suez. Merci de nous donner l’occasion de venir parler de nos activités en Azerbaïdjan.
Je ferai d’abord un rapide tour d’horizon du groupe et de nos métiers, et, parmi eux, de ceux que nous exerçons en Azerbaïdjan. Cela m’amènera sans doute à aborder plusieurs des questions que vous venez de me poser. Et je serai à votre disposition pour approfondir certains points, si vous le vous souhaitez.
Suez est un groupe qui opère dans les métiers de l’environnement. Il y a encore peu de temps, il s’appelait « Suez Environnement ». Nous avons simplifié son nom en « Suez », ce qui nous permet d’être moins souvent confondus avec un groupe cousin, actionnaire de Suez, aujourd’hui Engie, anciennement GDF-Suez…
M. le président François Rochebloine. …que nous auditionnerons prochainement.
M. Stéphane Heddesheimer. Engie conserve une participation de l’ordre de 33 % dans Suez, mais ce sont deux entreprises indépendantes : Engie qui opère dans le domaine de l’énergie, et Suez qui opère dans les métiers de l’environnement proprement dit.
Les métiers de Suez sont essentiellement liés à la gestion de l’eau, que ce soit la réalisation d’installations de traitement de l’eau ou d’épuration des eaux usées, la distribution de cette eau au bénéfice des collectivités locales, ou le traitement de l’eau des industriels. Je pense que l’on aura l’occasion d’y revenir dans la mesure où c’est l’une de nos cibles en Azerbaïdjan.
Nous intervenons aussi dans un autre domaine d’activité, y compris en Azerbaïdjan : la gestion des déchets, qu’ils soient solides ou liquides, dangereux ou banals.
Enfin, nous avons un métier moins important en termes de chiffre d’affaires, mais qui n’en est pas moins stratégique pour nous, notamment dans le cadre des implantations préliminaires : le consulting, que nous réalisons au travers d’une filière qui s’appelle Suez Consulting.
Nous sommes présents sur les cinq continents, dans soixante-dix pays. Nous réalisons un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 15 milliards d’euros, pour un résultat net de l’ordre de 400 millions d’euros. Un peu plus de 80 000 personnes travaillent chez Suez dans le monde entier.
Notre implantation en Azerbaïdjan est relativement ancienne.
Dès 2001, nous avons été amenés à vendre des unités d’ultrafiltration d’eau, donc de production d’eau potable, à la présidence de la République pour équiper un certain nombre de résidences présidentielles ou de ministères. La fourniture d’eau potable en Azerbaïdjan en général et à Bakou en particulier n’était pas, notamment à cette époque, de la qualité requise. Mais cette première prestation n’avait pas donné lieu à une implantation proprement dite dans la mesure où nous fabriquions ces équipements en France avant de les exporter et de les installer.
Un peu plus tard, en 2009, nous sommes intervenus dans le domaine du traitement de l’eau industrielle pour le compte d’un de nos grands clients, BP, qui est l’un des principaux producteurs de pétrole en Azerbaïdjan. Nous lui avons fourni une unité de traitement d’eau – ce que l’on appelle l’eau produite. Lors du processus d’extraction pétrolière, on est obligé de retirer de la poche d’extraction l’eau qui a été injectée pour faire sortir le pétrole ; il faut donc traiter cette eau, polluée, avant de la rejeter dans le milieu naturel. C’est à cette fin que nous avons fourni à BP une unité de traitement d’eau sur le terminal de Sangachal, à 70 kilomètres de Bakou. Nous continuons à assurer, pour le compte de BP, des prestations d’entretien de cette installation de maintenance, ce qui nous amène à employer sur place deux personnes qui contrôlent et maintiennent l’instrumentation de l’installation.
Mais l’implantation de Suez a pris un nouveau tournant, à compter de la visite en Azerbaïdjan du président de la République française en mai 2014. Ce fut pour nous l’occasion de signer un partenariat, un contrat de formation et de transfert de savoir-faire au bénéfice d’Azersu, la société publique d’eau et d’assainissement d’Azerbaïdjan.
Ce contrat avait bien entendu été préparé par de nombreuses études préliminaires, discussions et négociations tout au long des années 2013 et 2014, mais la venue du Président de la République a fourni l’occasion de sa signature et, presque dans la foulée, du démarrage de son exécution.
D’une valeur d’un peu plus de 22 millions d’euros sur cinq ans, ce contrat consiste à assurer la formation et l’assistance technique au bénéfice de la société Azersu. À ce stade, Azersu nous a demandé de concentrer nos efforts sur Bakou, où se trouve l’essentiel de la population, et où les problèmes sont les plus aigus. Nous avons donc mobilisé une équipe de spécialistes en provenance de nos exploitations françaises et internationales pour assurer cette formation et ce transfert de savoir-faire.
Cela reste un contrat de taille intermédiaire portant sur des prestations de services, sans équipements, sans constructions, sans fournitures de matériel de quelque nature que ce soit. Notre équipe permanente comprend quatre expatriés, plus un volontaire international en entreprise (VIE), et une demi-douzaine de personnels locaux. Et en tant que de besoin, nous faisons appel à des ressources du groupe, généralement françaises, parfois espagnoles, pour assurer un transfert de savoir-faire supplémentaire.
M. le président François Rochebloine. Pourquoi espagnoles ?
M. Stéphane Heddesheimer. Parce que Suez est très présent en Espagne, à travers la société Agbar dont les compétences et les savoir-faire sont reconnus, et parce que nos interlocuteurs souhaitent avoir une large vision de ce qui peut se faire dans les pays développés.
Il est toujours intéressant de montrer, d’abord ce que nous faisons en France, bien sûr, mais aussi ailleurs. Nos partenaires ont ainsi visité nos exploitations à Casablanca puisque Suez y assure la gestion de l’eau. Hors de France, les contextes sont parfois plus proches de leur situation propre.
Ce premier contrat nous a permis de mettre en place une succursale et une implantation stable en Azerbaïdjan, à partir de laquelle nous avons, au-delà de l’exécution du contrat proprement dit, cherché à développer nos autres activités, notamment nos activités dans le domaine du déchet.
Ces efforts ont abouti début 2016 à la signature d’un premier contrat dans le domaine de la dépollution des sols, un contrat d’étude de faisabilité pour le compte de l’agence gouvernementale Tamiz Shahar – « ville propre » en français – qui a en charge la gestion des déchets dans la ville de Bakou.
Il ne s’agit pas de très gros montants : on parle d’un premier contrat de 4 millions d’euros, pour effectuer une étude de faisabilité et des tests, et préconiser une filière de traitement des sols pollués aux hydrocarbures autour du lac Boyuk Shor qui se trouve en plein Bakou, à côté du stade olympique. Le site fait l’objet d’un programme de remédiation de développement immobilier, mais auparavant, il faut le dépolluer. Le moment venu, le chantier sera gigantesque. Pour le moment, nous participons à une étude de faisabilité.
M. le président François Rochebloine. Il n’y a pas d’autres pays étrangers concernés ?
M. Stéphane Heddesheimer. Si, bien sûr. Nous faisons face, en Azerbaïdjan, à la concurrence étrangère dans nos différents métiers. De façon générale, les Turcs sont très présents. Mais il y a également des Européens, notamment des Allemands et des Néerlandais. Pour des raisons liées à leur histoire, les Néerlandais ont développé des compétences très solides en matière de dragage, avec des bureaux d’études spécialisés. Or, à Boyuk Shor, avant de faire de la dépollution, il faut faire du dragage.
Ce sont nos concurrents. Nous ne sommes pas moins bons qu’eux, mais…
M. le président François Rochebloine. Nous ne sommes pas les premiers ?
M. Stéphane Heddesheimer. Dans ce domaine, nous n’étions pas les premiers sur place, puisqu’un grand cabinet de consulting néerlandais, Witteveen et Bos, avait déjà travaillé avec Tamiz Sharar. Mais, comme beaucoup de clients, cette agence ne souhaite pas avoir un partenaire unique, pour pouvoir tester les compétences de différentes sociétés. C’est à ce titre que, dans le cadre d’un appel d’offres concurrentiel, nous avons remporté ce contrat. Nous sommes en train de réaliser une étude pour une première tranche, et nous sommes en lice pour la deuxième tranche.
Quelles perspectives nous donnons-nous dans ce pays ?
Nous souhaitons, bien sûr, réaliser les contrats que l’on a obtenus mais, au-delà, les transformer en une implantation durable. Nous avons également comme cible le projet de réhabilitation de la grande raffinerie Heydar-Aliev de la SOCAR, l’entreprise pétrolière d’État. Ce projet comporte tout un volet de traitement de l’eau, sur lequel nous souhaitons nous positionner.
M. François Rochebloine. À combien évaluez-vous ce marché ?
M. Stéphane Heddesheimer. Pour cette raffinerie, entre 15 et 20 millions d’euros probablement.
Comme vous le constatez, Suez déploie en Azerbaïdjan l’ensemble de ses métiers : ceux liés à l’eau municipale, avec la formation au bénéfice d’Azersu ; ceux liés à l’eau industrielle – cela a même été notre point d’entrée avec BP, et peut-être demain avec SOCAR ; ceux liés à la gestion des déchets, avec le traitement des sols pollués.
Nous sommes également sollicités pour apporter notre expertise dans le domaine de la collecte des déchets ménagers. Le pays souhaite se moderniser en la matière, notamment à Bakou.
Il faut dire que Tamiz Sharar est assez proche des entreprises françaises. Le plus gros investissement, en tout cas à ma connaissance, qui a été fait dans le secteur de l’environnement l’a été en partenariat avec le groupe français Constructions industrielles de la Méditerranée (CNIM), qui a fourni le process et l’ensemble de l’installation de traitement des déchets par incinération à Bakou. C’est une installation de taille significative, de 500 000 tonnes par an. L’investissement a été réalisé par le client Tamiz Sharar, mais fourni par CNIM, qui en assure également l’exploitation. Le contexte est donc assez favorable pour les entreprises françaises du secteur de l’environnement, dont les compétences sont reconnues.
Dans le domaine du traitement de l’eau, nos concurrents sont turcs, allemands, néerlandais, mais aussi coréens et anglais. Azersu a récemment signé un protocole avec un concurrent britannique de taille moyenne, pour investir dans le domaine des stations de traitement d’eau et d’assainissement. Nous ne sommes donc pas seuls sur ce marché, qui est très concurrentiel, mais nous essayons d’y prendre toute notre part.
J’ai évoqué l’impact de ces contrats sur l’emploi. En termes d’équivalents temps plein, il est d’environ six expatriés, un VIE et cinq à six recrutés locaux. Et nous estimons qu’au sein de nos équipes localisées en France – direction technique, direction de l’innovation, direction de la formation –, ce sont environ trois équivalents temps plein (ETP) qui sont affectés à la réalisation du contrat passé avec Azersu.
Qu’en est-il des procédures d’attribution des marchés ou de sous-traitance ?
Je commencerai par les procédures de passation des marchés.
S’agissant de nos relations avec nos clients publics, je distinguerai deux cas de figure. D’abord, le contrat avec Azersu, qui a été signé de gré à gré, mais décidé par le président Aliev.
M. le président François Rochebloine. Pas par le ministère ?
M. Stéphane Heddesheimer. Non, cela s’est joué au niveau du président, qui voulait que le niveau de formation des opérateurs d’Azersu s’améliore significativement.
Avec la chute des prix du pétrole, le contexte a beaucoup changé ces deux dernières années. Mais pendant toute la phase où les prix du baril étaient très élevés, les Azerbaïdjanais ont eu la capacité d’investir dans leurs infrastructures, et en particulier dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. Mais c’est une chose de pouvoir investir et d’avoir accès à des technologies coûteuses ou performantes, et c’en est une autre de disposer des personnels compétents pour exploiter ces technologies et faire fonctionner les installations.
On rencontre très souvent cette problématique dans les pays émergents. Les institutions financières internationales y financent, au moyen de dons, de prêts ou d’investissements, des usines de traitement d’eau, des stations d’épuration, des réseaux, etc. Or la capacité qu’ont les sociétés gestionnaires à faire fonctionner de façon optimale ces ouvrages est souvent déficiente.
Les autorités en Azerbaïdjan avaient compris qu’il ne fallait pas uniquement investir dans les moyens techniques, dans les installations, les infrastructures et les technologies, mais aussi dans la compétence des personnels qui seraient chargés de les exploiter. Et c’est le sens du contrat passé avec Azersu : renforcer les connaissances et les compétences des opérateurs.
Le gouvernement algérien, qui est l’un des grands partenaires de Suez, s’est basé sur le même raisonnement pour nous demander de prendre en charge un contrat d’assistance technique, un management contract, au bénéfice de la Société des eaux d’Alger : il s’agit d’assurer la distribution de l’eau à Alger, 24 heures sur 24, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent, en investissant, non pas seulement dans des infrastructures, mais également dans les capacités de l’opérateur.
Le contrat avec Azersu a donc été conclu de gré à gré. C’est un mode de passation courant en Azerbaïdjan. En revanche, les contrats de consulting, d’études de faisabilité dans le traitement du déchet, ont été passés dans le cadre de procédures d’appel d’offres auxquelles nous avons répondu avec d’autres. Je ne l’ai pas mentionné, mais nous avons perdu un appel d’offres dans le domaine de la dépollution, et nous en avons remporté un autre. C’est le jeu classique des affaires.
De la même façon, les contrats industriels avec BP et SOCAR ont été conclus sur appels d’offres.
J’en viens à l’exécution des affaires proprement dites. Elle varie, comme souvent, en fonction des clients et de la nature des contrats. Azersu est une administration compliquée…
M. le président François Rochebloine. Exigeante ?
M. Stéphane Heddesheimer. Pas tellement. Le problème est plutôt d’avoir en face de soi des interlocuteurs capables d’expliciter clairement leurs attentes et qui, une fois que l’on s’est mis d’accord, mettent en place les moyens nécessaires. Par exemple, quand on fait de la formation, on a d’abord besoin de stagiaires ; il faut les identifier, les réunir et leur donner de quoi travailler.
En l’occurrence, nous avons mis un peu plus de temps que prévu, parce que notre client n’était pas familier avec ce type d’actions managériales internes. Quoi qu’on en dise, former ses collaborateurs n’est pas toujours une évidence. Cela demande un minimum d’infrastructures et d’organisation, et un service de ressources humaines qui mette en place les services.
Je précise également que nos contrats n’impliquent pas d’exportation de matériel, ni de sous-traitance significative. Cela signifie que nous ne sommes pas tributaires du régime douanier, qui fait couler beaucoup d’encre et qui préoccupe beaucoup les partenaires de l’Azerbaïdjan. Nous n’avons pas été confrontés à ces problématiques parce que nous n’avons pas eu à passer par les douanes. Je ne dis pas que ce ne sera pas le cas un jour, mais jusqu’à aujourd’hui, on n’en a pas fait directement l’expérience.
Je terminerai par la sous-traitance.
Nous sommes amenés, notamment dans le cadre de notre contrat d’études de remédiation de sols, à travailler avec des partenaires locaux pour des analyses de sols, des travaux de laboratoire ou des travaux liés à la bonne compréhension de la réglementation existante…
M. le président François Rochebloine. On vous les indique ?
M. Stéphane Heddesheimer. Le marché n’est pas si vaste. On peut nous orienter vers les trois ou quatre entreprises qui ont déjà réalisé des prestations pour nos clients. Après, c’est à nous de faire nos recherches et notre choix. On peut tout à fait découvrir des partenaires qu’on ne connaissait pas au préalable.
M. le président Rochebloine. Monsieur le directeur, merci pour ces réponses, précises et claires.
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. Vous l’avez rappelé, la signature de votre premier contrat était liée à la visite du Président de la République en Azerbaïdjan. Avez-vous le sentiment que le soutien politique est nécessaire pour obtenir des marchés ?
On connaît, pour la vivre en France aussi, l’interpénétration forte entre politique et économie dans le secteur de l’eau et des déchets notamment. Êtes-vous aujourd’hui encore dépendants de la dimension politique ou pouvez-vous commencer à naviguer de manière autonome ?
Quelles sont les difficultés auxquelles vous vous heurtez au quotidien dans vos relations avec les administrations locales ? Les autorités azerbaïdjanaises mettent en avant les réformes en cours en matière fiscale, administrative et douanière. Considérez-vous qu’elles sont en train de porter leurs fruits ?
Par ailleurs, l’effondrement des cours du pétrole a-t-il eu pour conséquence d’exacerber la concurrence ou de faire disparaître des compétiteurs faute de moyens ?
Enfin, quelle est la procédure pour les appels d’offres ? Le critère retenu est-il plutôt le mieux-disant ou le moins-disant ? Face à la concurrence des entreprises turques, qui sont souvent moins chères, le mieux-disant peut-il vous permettre de gagner des marchés ?
M. Stéphane Heddesheimer. S’agissant de notre capacité à voler de nos propres ailes, il est difficile de répondre de manière tranchée à votre question car tout dépendra de la nature des contrats visés.
Dans le domaine des déchets, nous avons acquis une légitimité vis-à-vis de nos partenaires, qui nous sollicitent désormais sur d’autres sujets, comme la collecte. Mais il est toujours nécessaire d’accompagner les liens commerciaux d’une relation politique dans tout le bon sens du terme. L’ambassadrice de France en Azerbaïdjan effectue un travail important de promotion des intérêts économiques français. Lors de ses entretiens avec les autorités politiques, elle soutient toujours les démarches des entreprises françaises, ce que nous apprécions.
L’Azerbaïdjan reste un pays dans lequel la relation politique d’homme à homme est importante. La relation forte qu’entretiennent les plus hautes autorités est perçue de manière positive par les acteurs publics et économiques qui sont ainsi enclins à la développer sur le plan économique. Il y a une forme d’endossement de cette relation qui favorise les offres de services et la signature des contrats. L’appui politique n’est pas une condition suffisante mais il facilite les choses.
Dans le cas d’Azersu, c’est parce que les responsables de la société n’étaient pas satisfaits des prestataires turcs – notamment la Société des eaux d’Istanbul –, qu’ils ont cherché d’autres partenaires plus compétents. C’est ainsi que nous sommes parvenus à signer le contrat. Il faut un contexte et des besoins. Ensuite, la relation politique à haut niveau facilite l’obtention des contrats, notamment dans le cas de contrats de gré à gré.
Quant aux réformes en cours, nous ne sommes pas concernés par la réglementation douanière. En matière fiscale, nous sommes confrontés à la paperasserie et à la mauvaise foi de l’administration – l’Azerbaïdjan n’ayant pas le monopole dans ce domaine, je ne lui en ferai pas grief outre mesure.
Les réformes portent-elles leurs fruits ? Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question puisque nos contrats ne sont pas liés à ces réformes. Nous développons la plupart de nos activités dans le cadre de la délégation de service public – BOT en anglais, build, operate, and transfer –, qui consiste à financer, construire et exploiter une installation pendant une durée longue et à se rembourser au travers de l’exploitation. Nous avons développé de très nombreux projets dans le monde entier dans ce cadre. Il a été mis en place en Azerbaïdjan mais il n’a pas encore été expérimenté. Nous pourrons peut-être en juger dans quelques années.
Je n’ai pas constaté un effet massif des réformes. En revanche, la chute du prix du pétrole a eu des répercussions importantes en asséchant les grands investissements – le domaine de l’environnement n’y fait pas exception – et en exacerbant la concurrence : les projets sont moins nombreux et les concurrents toujours présents.
L’Azerbaïdjan traverse une période difficile sur le plan macro-économique et budgétaire, qui l’incite à la prudence sur les dépenses. L’environnement a été une priorité lorsqu’il fallait accompagner le développement industriel, mais, en période de vaches maigres, il n’échappe pas aux restrictions.
La procédure d’appel d’offres repose sur le critère du moins-disant avec une sélection préalable fondée sur les références – il faut être en mesure de démontrer que l’on a réalisé des prestations comparables ailleurs. C’est sur la base de cette présélection que le critère du moins-disant est appliqué.
Je ne connais pas de pays, dans cette zone en tout cas, qui travaillent autrement.
M. le rapporteur. Puisque vous êtes en charge des pays membres de la CEI, avez-vous le sentiment que l’Azerbaïdjan, en comparaison des autres, est plus ou moins compliqué, ou plus spécifique ?
M. Stéphane Heddesheimer. Suez est très peu implanté dans les autres pays de la CEI pour différentes raisons, soit parce qu’ils ne manifestent pas – c’est le cas de la plupart d’entre eux – de préoccupation environnementale, soit parce que le cadre juridique n’y est pas approprié à nos interventions, soit parce que nous nous y refusons au nom de l’éthique des affaires.
M. le président François Rochebloine. Dans quelles conditions le groupe Suez travaille-t-il en Azerbaïdjan ? Est-il amené à passer des contrats avec des collectivités décentralisées ? Dans l’affirmative, la pratique fait-elle apparaître une intervention ou un contrôle de l’État, en droit ou en fait ?
Par ailleurs, il est écrit dans le rapport du département d’État américain sur l’Azerbaïdjan en 2016 : « Bien qu’il existe une législation anti-corruption et que le gouvernement ait pris des mesures pour combattre la corruption de bas niveau, les pratiques de corruption continuent de faire barrière à la croissance des investissements étrangers. » Quel est votre sentiment sur cette affirmation ?
Enfin, votre groupe a rendu publique une charte éthique qui mentionne la lutte contre la corruption parmi les actions découlant des valeurs fondamentales de l’entreprise. Avez-vous détecté des comportements de corruption active ou passive qui pourraient entacher la conduite des affaires en Azerbaïdjan ? Cette même charte fait également référence à l’action en faveur des droits humains. Comment votre groupe cherche-t-il à agir en ce sens dans le pays ?
M. Stéphane Heddesheimer. À ce jour, nous n’avons pas répondu à des consultations autres que celles lancées par la société nationale des eaux ou la société en charge de la gestion des déchets à Bakou. Nous n’avons donc pas de contrats avec des collectivités décentralisées. Je ne suis par conséquent pas en mesure de répondre à votre question sur l’autonomie des collectivités dans la passation des marchés. Dans le cadre du contrat avec Azersu, nous avons été amenés à intervenir dans d’autres régions, notamment celle de Ganja, pour des diagnostics et pour la formation des équipes locales.
S’agissant de la législation anti-corruption, notre entreprise est régie par une charte éthique qui interdit tout recours à la corruption pour obtenir un marché. Aucun des marchés que nous avons obtenu dans le pays n’entre dans le cadre de ces pratiques. Nous n’ignorons toutefois pas qu’elles peuvent exister. Il m’est difficile d’être plus précis.
M. le président François Rochebloine. Qu’en est-il pour vos concurrents ?
M. Stéphane Heddesheimer. Je n’ai pas à juger les pratiques de nos concurrents. Il me paraît hasardeux d’imaginer que nous avons perdu des marchés à cause de valises offertes par d’autres…
Nous sommes toutefois interpellés par le fait qu’au sein d’Azersu, les marchés de construction d’usine ou de réseaux restent extrêmement fermés. Nous avons du mal à obtenir des informations sur les appels d’offres et à pouvoir y participer de manière efficace. La presse locale s’en est fait l’écho récemment.
Nous n’avons pas été amenés à rencontrer de pratiques de corruption – ou, en tout cas, nous avons réussi à nous en tenir éloignés.
Nos métiers sont au cœur des droits humains : l’accès à l’eau, le droit à vivre dans un environnement propre, qu’il s’agisse du traitement des eaux usées ou des déchets. Nous avons le sentiment d’y contribuer, dans la mesure de nos moyens, à travers les contrats que nous exécutons.
Nous sommes attentifs à promouvoir la diversité, mais nos équipes sur place sont assez restreintes. Notre action au sein d’Azersu me semble positive car elle permet d’améliorer la formation des opérateurs et des cadres. Celle-ci est structurée par des diplômes pour permettre aux salariés de voir leur parcours de formation reconnu.
M. le président François Rochebloine. Je vous remercie, monsieur, pour vos réponses précises, détaillées et sans langue de bois.
*
* *
Ÿ Audition de M. Philippe Delleur, vice-président d’Alstom, chargé des affaires publiques (jeudi 10 novembre 2016)
M. le président François Rochebloine. Monsieur, on peut considérer que votre parcours professionnel comporte deux périodes disctintes. Vous avez travaillé, durant presque un quart de siècle, au service de l’État, au sein de ce qu’il est désormais convenu d’appeler les « ministères financiers », où vous étiez principalement en charge des échanges extérieurs de la France. Depuis maintenant dix ans, vous occupez, dans le groupe Alstom, divers postes de responsabilités. L’année dernière, vous en êtes devenu le vice-président chargé des affaires publiques.
De récents événements, sans lien direct avec l’objet de notre réunion de ce jour, nous ont rappelé l’importance des activités du groupe Alstom pour l’économie française. Nous ne pouvons donc que nous réjouir de voir une entreprise française de haute valeur économique et technologique s’implanter en Azerbaïdjan.
Il y a deux ans, en mai 2014, était annoncée la signature d’un contrat portant sur la fourniture de cinquante locomotives à la compagnie ferroviaire azérie, ainsi que l’engagement d’un partenariat avec le gestionnaire du métro de Bakou. Je souhaite que vous nous décriviez l’historique de l’implantation d’Alstom en Azerbaïdjan, l’ampleur financière des affaires que le groupe y traite, et la nature des prestations assurées. Cela devrait vous amener à nous dépeindre le paysage de vos relations avec ce pays, en particulier en termes de contrats.
Dans les exemples que j’ai cités, Alstom signe des contrats avec des entités distinctes de l’État. De manière générale, à quel niveau de la structure politique et administrative se situent vos interlocuteurs ? Avant de signer un contrat, vos partenaires émettent des vœux ou présentent des exigences quant à l’éventuelle implication d’entreprises azéries. Pouvez-vous nous en parler ? Enfin, quelle est votre évaluation globale des conditions de travail de votre groupe en Azerbaïdjan ? Qu’en est-il de la qualité de l’exécution des obligations contractuelles, de l’intervention éventuelle de la sous-traitance, de la rapidité et de l’efficacité des procédures administratives ?
M. Philippe Delleur, vice-président d’Alstom, chargé des affaires publiques. Comme chargé des affaires publiques au sein d’Alstom, je suis responsable des relations avec le gouvernement français et avec les gouvernements étrangers pour l’ensemble des affaires du groupe. Depuis l’année dernière, Alstom s’est recentré sur son activité de transport ferroviaire, activité qui l’amène à être présent en Azerbaïdjan.
M. le président François Rochebloine. Alstom est sur place depuis quand ?
M. Philippe Delleur. Pour ce qui concerne le transport ferroviaire, nous sommes en Azerbaïdjan depuis la signature du contrat que vous évoquiez, en mai 2014. Nous avions auparavant des activités dans le domaine de l’énergie qui nous avaient amenés à nouer des partenariats avec l’Azerbaïdjan et les autres pays de la région. Dans ce secteur, il faut dire que, jusqu’au jour de 2015 où nous avons cédé nos activités à General Electric, nous étions présents dans quasiment tous les pays du monde. Nous étions implantés industriellement dans une quinzaine de pays et, commercialement, dans une soixantaine. Il n’est guère de pays où l’on ne trouve pas, encore aujourd’hui, au moins une vieille turbine d’un barrage ou d’une centrale électrique construite dans l’une des usines historiques d’Alstom, groupe lui-même constitué progressivement par le rachat de différentes sociétés et marques. Nous étions très présents en Azerbaïdjan où notre dernière réalisation majeure fut la réalisation d’un centre de régulation du système électrique azéri.
M. le président François Rochebloine. La visite du Président de la République française en Azerbaïdjan, en 2014, a été déterminante dans la réorientation de vos activités ?
M. Philippe Delleur. Dans ce pays, nous étions novices dans le domaine ferroviaire. Nos activités en la matière ont effectivement commencé avec le contrat de mai 2014, signé lors de la visite du Président de la République qui s’était rendu ensuite en Arménie et en Géorgie. Notre présence déjà ancienne dans le secteur de l’énergie nous a clairement ouvert un certain nombre de portes. Le patron d’Alstom sur place, de nationalité azérie, est d’ailleurs resté à son poste.
M. le président François Rochebloine. Comment cette personne est-elle impliquée au sein du groupe ?
M. Philippe Delleur. Il représente le groupe à Bakou. La plupart des responsables du groupe à l’étranger sont des nationaux des pays concernés. Il est devenu rare qu’un expatrié occupe ce type de poste, mis à part pour nos plus grandes implantations.
Fort de cette présence ancienne, et bénéficiant des très bonnes relations bilatérales entre la France et l’Azerbaïdjan, nous avons pu signer un contrat de 288 millions d’euros lors de la visite présidentielle, portant sur l’achat par les chemins de fer azéris de cinquante locomotives.
Ce contrat, signé au mois de mai 2014, n’est entré en vigueur qu’au début de l’année 2016. Ce délai est d’abord dû au fait que les chemins de fers azéris ont fait évoluer le contrat en commandant non plus cinquante locomotives pour du transport de fret, mais quarante locomotives de fret et dix autres pour le transport de passagers. Le montant du contrat n’a pas été modifié, bien que les locomotives pour transport de passagers soient un peu moins chères, car il a été complété par des commandes d’équipements électriques et électroniques, comme des éléments de signalisation.
M. le président François Rochebloine. Alstom intervient aussi pour les rails ?
M. Philippe Delleur. De façon générale, nous sommes en mesure d’intervenir pour tout ce qui concerne l’infrastructure ferroviaire. Nous pouvons poser des rails, mais nous ne les fabriquons pas ; nous les achetons. Nous ne réalisons jamais les travaux de génie civil préalable à la pose. En revanche, nous prenons de plus en plus souvent la responsabilité de l’ensemble de l’électromécanique qui comprend, au-delà de la livraison du train lui-même, la pose des rails, l’installation des équipements électriques, la fourniture des équipements de signalisation et d’électrification de la ligne, et la responsabilité globale de la livraison du projet clés en main à un client.
En l’espèce, le contrat azerbaïdjanais ne portait que sur des locomotives, même s’il a été complété par la commande de quelques équipements de signalisation embarqués dans les locomotives.
Le temps nécessaire à la mise en œuvre du contrat s’explique ensuite par la nécessité de boucler un financement qui repose principalement sur un crédit bancaire contracté auprès d’un consortium de banques, dirigé par la Société générale, bénéficiant d’une garantie de la Coface. Tout cela a demandé un certain délai, ce qui est normal dans ce genre d’affaire assez complexe.
Ce marché avait fait l’objet d’une concurrence extrêmement âpre avec les entreprises qui se trouvent habituellement face à nous : Siemens, Bombardier… Je ne me souviens plus de la liste complète, mais je suis certain que des groupes asiatiques étaient également sur les rangs.
M. le président François Rochebloine. Quels étaient les délais de livraison ?
M. Philippe Delleur. La livraison des cinquante locomotives commence en ce moment, et elle se fera de façon fractionnée. Je n’ai pas les détails en tête, mais j’imagine qu’elle sera étalée sur deux ou trois ans.
Dans ce contexte, à la fois particulièrement complexe et très concurrentiel, notre présence au Kazakhstan a constitué l’un des éléments qui nous a permis de l’emporter. Notre unité sur place livre depuis un certain temps déjà des locomotives aux chemins de fer kazakhs, ce qui nous a conduits à installer une ligne d’assemblage de locomotives de fret à Astana. Le fait de livrer en grande série au Kazakhstan nous a donné la possibilité de proposer un prix concurrentiel à l’Azerbaïdjan. Si nous n’avions dû livrer que cinquante locomotives dans la région, nous n’aurions certainement pas pu proposer le prix qui a été le nôtre, et qui nous a permis d’emporter ce marché.
Il reste qu’environ la moitié de la valeur du matériel fournit par ce contrat de 288 millions d’euros provient d’unités de production d’Alstom situées sur le territoire français. Les bogies proviennent du Creusot ; les moteurs, du site d’Ornans ; les transformateurs de puissance, du Petit-Quevilly ; les blocs électriques, de Tarbes ; des équipements électriques, de Villeurbanne, et le fameux site de Belfort, particulièrement impliqué dans ce contrat, assure la gestion du projet, le développement du produit, la plateforme logistique, et également l’assemblage des dix locomotives pour train de passagers. Les autres locomotives sont assemblées au Kazakhstan où sont également produits quelques bogies et transformateurs – mais ils proviennent pour la plupart de France. Six de nos sites en France, soit la moitié de nos implantations sur le territoire national, sont impliqués dans ce contrat pour un total de 500 000 heures de travail.
Le fait que quasiment 50 % de la valeur du contrat proviennent d’équipements fabriqués en France rendait ce dernier éligible à la garantie de la Coface, qui couvre, selon les règles habituelles, 85 % du contrat. Il s’agissait d’un montage complexe car il nous fallait expliquer l’économie spécifique du projet, l’implication des usines françaises, et le rôle de notre joint-venture au Kazakhstan, tout en intégrant les modifications demandées par les chemins de fer azéris. Cela justifie que les dernières décisions de la Coface ne soient intervenues qu’au mois de septembre dernier. Finalement, nous n’avons touché un premier acompte qu’en avril, et le premier tirage sur le crédit date seulement du 30 septembre.
M. le président François Rochebloine. Une telle configuration existe-t-elle dans les relations d’Alstom avec d’autres pays ?
M. Philippe Delleur. Lorsque nous avons répondu à leur commande de locomotives, les Kazakhs avaient exigé une localisation partielle de la production sur leur territoire. Nous avons investi sur place et conçu notre implantation industrielle en ayant conscience que nous pourrions couvrir la zone de l’Asie centrale et du Caucase. Il est clair qu’il est intéressant de disposer d’un site industriel à proximité des marchés auxquels on veut avoir accès, ne serait-ce que pour des raisons de logistique.
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. Comment les locomotives sont-elles acheminées ?
M. Philippe Delleur. Ces matériels voyagent soit par bateau, soit par les lignes de chemin de fer, mais cela a un coût. En tout état de cause, disposer d’un site de production à proximité des marchés permet d’améliorer notre compétitivité.
M. le président François Rochebloine. L’approche des marchés kazakhs et azéris est-elle semblable ?
M. Philippe Delleur. Ces deux pays ont en commun, comme tous ceux de la région, le fait de connaître encore une forte influence russe – eux-mêmes disent plutôt « soviétique » – à laquelle ils cherchent à échapper. Initialement, nous avons monté notre filiale kazakhe dans une joint-venture avec un grand partenaire russe, TMH, qui est un peu l’Alstom russe – il est aujourd’hui en train de se détacher de ce partenariat. Dans cette zone, il est toujours utile de commencer par apparaître avec un « nez russe », mais nos clients, qu’ils soient kazakhs ou azéris, sont aussi demandeurs de technologies européennes. En matière ferroviaire, les deux pays ont besoin de renouveler leur flotte et de leurs infrastructures, l’un conditionnant l’autre, car le matériel européen ne peut rouler que si l’écartement des voies respecte les normes internationales – alors que l’écartement des voies kazakhes et azéries correspond au standard russe qui est différent. La transformation ne pouvant s’opérer que progressivement, il était important, dans un premier temps, d’être capable de proposer des matériels compatibles avec les équipements déjà installés dans ces pays.
J’ai rencontré, il y a quelques semaines, le Premier ministre ukrainien en visite à Paris. Les Ukrainiens sont confrontés au même problème d’évolution des standards anciens pour moderniser leur pays.
Quoi qu’il en soit, la proximité avec les clients permet de signer plus facilement des contrats. L’implantation locale constitue à chaque fois une nécessité.
M. Jean-Michel Villaumé. En tant qu’élu de Haute-Saône, je m’intéresse particulièrement au contrat signé par Alstom, en 2014, en Azerbaïdjan, car il a des répercussions sur le site de Belfort.
Dans votre secteur d’activité, beaucoup de groupes européens ont eu affaire à la justice pour avoir versé des commissions occultes au cours de leurs relations commerciales avec les pays de la Communautés des États indépendants (CEI). On a aussi parlé d’une société monégasque qui aurait servi d’intermédiaire – les médias ont cité le nom d’Unaoil. Nous sommes à huis clos, pouvez-vous nous en dire plus sur la façon dont Alstom travaille ?
M. le président François Rochebloine. Monsieur Villaumé, tout ce qui se dit dans cette salle figurera au compte rendu !
M. Philippe Delleur. Le code d’éthique d’Alstom est extrêmement précis : il interdit tout paiement illicite, que ce soit au regard des lois internationales ou des lois de chacun des pays dans lesquels nous travaillons. Dans le passé, Alstom a pu être condamné lors d’affaires anciennes sur lesquelles il ne m’appartient pas de me prononcer aujourd’hui devant votre mission d’information. En revanche, il est parfaitement clair qu’il n’existe aujourd’hui aucune transaction telle que celles que vous évoquiez, monsieur le député. Il ne peut pas en être autrement, car les règles internes du groupe sont d’une très grande clarté en la matière.
Mon expérience des sujets de commerce international, en particulier dans l’administration, m’incite à penser qu’il ne suffit pas de fixer des règles : il faut s’assurer que vos collaborateurs les respectent – Alstom emploie 30 000 collaborateurs dans le monde entier. En conséquence, nous avons mis en place divers dispositifs s’agissant de ces sujets, tant en termes de formation que de communication. Depuis plusieurs années, des « ambassadeurs de l’éthique » sont nommés dans chaque unité industrielle ou commerciale de tous les pays du monde : ils sont chargés de rappeler les règles, car nous sommes conscients que la corruption se pratique dans de nombreux pays, en particulier pour les grands projets d’infrastructures – les rapports des ONG compétentes le montrent bien. Nous travaillons dans un secteur particulièrement exposé, ce qui nous oblige à être d’autant plus vigilants.
S’agissant du contrat avec l’Azerbaïdjan, monsieur le député, je ne connais pas du tout les sociétés dont vous parlez, elles n’ont eu aucune part dans la transaction qui a été conclue.
Alors que vous venez d’adopter le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dit loi « Sapin 2 », j’ajoute que nous avons intérêt à ce que les règles soient les plus strictes possible afin de contraindre nos concurrents à les appliquer comme nous le faisons nous-mêmes – car nous savons que certains d’entre eux ne les appliquent pas.
Depuis le contrat signé en mai 2014, Alstom a d’autres affaires en cours en Azerbaïdjan, même si, en volume, elles sont de moindre importance.
Le mois suivant la visite de la Président de la République, en 2014, nous avons signé un petit contrat de 17 millions d’euros pour livrer trois rames au métro de Bakou. À l’époque, l’Azerbaïdjan était en pleine croissance grâce aux revenus du pétrole dont le prix était au plus haut. Le pays avait de très gros projets d’infrastructure, notamment liés à la préparation des premiers jeux européens de Bakou de juin 2015. Les trois rames destinées à densifier le trafic ont été fabriquées par notre filiale russe, selon les normes locales, ce qui a permis de les livrer en moins d’un an.
Alstom a également signé à cette époque un memorandum of understanding concernant le développement du métro de Bakou, qui prévoit l’éventuelle livraison de 300 voitures de métro de technologie européenne.
M. le président François Rochebloine. Pourquoi « éventuelle » ?
M. Philippe Delleur. Parce que nous en sommes toujours au stade du memorandum of understanding. Le projet existe, mais il a été mis de côté en raison de la dégradation rapide de la situation financière du pays. Honnêtement, nous n’envisageons pas que la discussion relative à la signature d’un contrat puisse reprendre à court terme. L’existence de ce document constitue tout de même une première étape ; c’est mieux que rien. Le jour où le prix du pétrole remontera suffisamment, nous serons là.
M. le président François Rochebloine. Sur quel volume financier ce contrat porterait-il ?
M. Philippe Delleur. C’est difficile à dire car rien n’a encore été négocié. Nous sommes sans doute dans un ordre de grandeur similaire à celui du contrat des locomotives.
M. le rapporteur. La RATP ou la SNCF seraient-elles impliquées en termes d’ingénierie pour un contrat de cette nature ?
M. Philippe Delleur. Non, nous disposons nous-mêmes de ces compétences. En revanche, s’agissant de l’exploitation du métro, Bakou pourrait tout à fait demander le soutien de la RATP.
M. le président François Rochebloine. Vous traitez toujours avec l’État ?
M. Philippe Delleur. Nous avons négocié avec les chemins de fer ou avec le métro de Bakou, qui sont des entités publiques, mais ces sujets sont trop importants pour ne pas remonter au Président de la République d’Azerbaïdjan.
M. le président François Rochebloine. Les ministres ne jouent-ils donc aucun rôle ? Nous avons eu ce sentiment ce matin en entendant M. Stéphane Heddesheimer, le directeur du pôle Europe et CEI du groupe Suez.
M. Philippe Delleur. Les ministres sont évidemment partie prenante, mais ce genre de décision est centralisé. Le contrat des chemins de fer a d’ailleurs finalement été signé lors de la visite du Président de la République française.
Pour conclure ma présentation, j’en viens aux opportunités qui se présentent pour le groupe en Azerbaïdjan. Sous réserve de sa situation financière, et au-delà, des à-coups conjoncturels, le potentiel du pays est grand. En termes d’intérêt ferroviaire, il se situe de façon stratégique au croisement de deux axes majeurs qui reprennent de l’importance : l’axe Est-Ouest de la nouvelle route de la Soie, entre la mer Caspienne et la mer Noire, et l’axe Nord-Sud, de la Russie vers l’Iran. Fort de notre présence auprès des chemins de fer azéris, nous discutons de différents projets qui en restent aujourd’hui à ce stade.
S’agissant de l’axe Nord-Sud, les présidents d’Iran, de Russie, et d’Azerbaïdjan ont signé en septembre dernier un accord sur la réouverture et la remise en état d’une ligne existante. Le gouvernement azéri s’est engagé à financer 150 kilomètres de cette ligne en Iran. La Banque asiatique de développement a fait savoir son intérêt pour le projet. Nous le suivons de très près car il peut comporter pour nous des opportunités diverses : électrification, signalisation, fourniture éventuelle de locomotives additionnelles par rapport au contrat actuel…
S’agissant de l’axe Est-Ouest, il existe un projet de ligne Bakou-Tbilissi-Kars, reliant l’Azerbaïdjan, la Géorgie et la Turquie – Kars se trouve en Turquie près de la frontière avec l’Arménie. Ce projet commence à prendre forme avec un financement turc. Les trois gouvernements manifestent leur souhait que le trafic routier par camion se reporte sur le rail, ce qui justifie l’harmonisation de la ligne et l’achat de matériels supplémentaires.
Nous discutons enfin, en ce moment, de la signature d’un contrat de maintenance des locomotives que nous avons vendues à l’Azerbaïdjan. Il pourrait être signé pour vingt-cinq ans, ce qui nous conduirait à ouvrir une petite implantation industrielle à Bakou.
Les règles que nous nous imposons nous évitent de rencontrer des difficultés lorsque nous faisons des affaires en Azerbaïdjan. Aujourd’hui, nos clients savent très bien comment nous travaillons. Nous n’avons pas eu de problème particulier pour signer des contrats. Si l’on met à part l’évolution récente de la situation financière du pays, nous constatons globalement que les conditions dans lesquelles se font les affaires en Azerbaïdjan se sont plutôt améliorées. Nous souhaitons nous inscrire dans cette tendance plutôt favorable qui se retrouve dans tous les pays de la région – nous entendons travailler avec tous, indépendamment des problèmes qu’ils peuvent avoir entre eux. Cependant, ces pays, comme l’Arménie ou la Géorgie, dans lesquels nous étions présents lorsque nous étions spécialistes de l’énergie, n’ont, pour l’instant, pas offert de perspective particulière dans le domaine ferroviaire.
M. le président François Rochebloine. Ils n’ont sans doute pas les mêmes moyens que l’Azerbaïdjan !
M. le rapporteur. Merci pour cet exposé. Je ne reviendrai pas sur le rôle des visites politiques et des visites de délégations d’entreprise, puisque la nature même de vos activités implique d’être en relation avec les responsables politiques et ceux des chemins de fer, qui sont des entités publiques.
Concrètement, est-ce que vous rencontrez des difficultés avec les administrations locales et vos partenaires locaux dans le quotidien des affaires, notamment en matière fiscale, administrative ou douanière ? Que pouvez-vous nous dire de la situation dans le pays et de votre expérience d’entreprise en la matière ?
Avez-vous la liberté de choisir vos sous-traitants, ou êtes-vous contraints de travailler avec certaines entreprises ‒ locales ou venant de pays tiers ‒ que vous ne connaissez pas forcément ? De manière pragmatique, quelle part pouvez-vous réserver aux sous-traitants français ?
La contraction des revenus de l’économie azerbaïdjanaise du fait de la baisse du prix du brut a-t-elle accru la concurrence sur place, ou un certain nombre de vos concurrents ont-ils quitté le marché ?
Enfin, en matière d’appels d’offres, la règle azerbaïdjanaise est-elle celle du moins disant ou du mieux disant ? Comment se passent les marchés publics ?
M. Philippe Delleur. Sur les sujets administratifs, douaniers, fiscaux ou autres, nous constatons plutôt une amélioration. Mais avec cette réserve : nous n’en sommes qu’au début de l’exécution du contrat sur les locomotives, qui est notre principale activité en Azerbaïdjan.
Il ne serait pas étonnant qu’au cours de l’exécution, nous rencontrions les problèmes auxquels nous sommes classiquement confrontés dans ce type de contrats. Surtout que ce contrat fait appel à un schéma contractuel assez complexe impliquant la France, le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan. À ce jour, les retours de nos petites équipes locales font plutôt état d’une amélioration des choses, mais je prends cela avec prudence.
En matière de sous-traitance, en l’occurrence, il n’y a pas de sous-traitants azerbaïdjanais, la part locale est infime. Nous traitons directement avec les chemins de fer d’Azerbaïdjan. En revanche, la part du Kazakhstan est importante. Et l’essentiel de nos sous-traitants est en France. Dans cette affaire comme dans la plupart des autres, nous faisons travailler beaucoup de sous-traitants en France, qui bénéficient également de ce contrat à l’exportation. En moyenne, nous estimons qu’une commande pour Alstom fait travailler un salarié dans nos usines et trois chez nos sous-traitants.
Il n’y a donc aucun emploi créé en Azerbaïdjan, et je n’ai pas en tête le nombre d’employés qui travaillent dans l’usine au Kazakhstan. Le contrat représente 500 000 heures de travail dans nos usines françaises, et le chiffre est beaucoup plus faible pour le Kazakhstan.
M. le président François Rochebloine. La majeure partie du travail est donc réalisée en France, seul le montage se fait à Astana.
M. Philippe Delleur. Le montage des locomotives de fret, oui. Le montage des locomotives de passagers se fera à Belfort.
La baisse du prix du pétrole a surtout conduit à l’arrêt de projets. En premier lieu le projet de métro, sur lesquels nous comptions beaucoup.
M. le rapporteur. La concurrence a-t-elle été découragée ?
M. Philippe Delleur. Tout le monde reviendra dès que les projets ressortiront, je ne me fais aucune illusion sur ce point. Mais entre-temps, nous aurons développé notre présence locale, et nous serons mieux armés pour bien comprendre les besoins du client et essayer de les satisfaire.
En matière d’appels d’offres, nous étions les moins-disants en l’occurrence ; le facteur décisif réside cependant dans le financement. C’est parce que nous faisons la meilleure offre que nous gagnons une affaire. C’est pourquoi il est nécessaire d’être très compétitif, et c’est la raison du schéma que nous avons monté avec le Kazakhstan. Certes, tout n’est pas fabriqué en France, mais il vaut mieux 50 % de quelque chose que 100 % de rien. En tout état de cause, ce contrat, une fois signé, ne serait pas entré en vigueur si nous n’avions pas été capables de mettre en place un financement. De ce point de vue, l’intervention du gouvernement français par l’intermédiaire de la Coface a été totalement décisive. Cela signifie que 500 000 heures de travail pour nos usines françaises ont été acquises grâce à l’intervention de la Coface.
M. le président François Rochebloine. L’adhésion du Kazakhstan à l’Union économique eurasiatique, à la différence de l’Azerbaïdjan, peut-elle modifier quelque chose ?
M. Philippe Delleur. Je ne pense pas que cela ait des conséquences immédiates sur nos affaires. Notre sujet est celui des normes. Si l’appartenance à cette union amenait les pays à choisir certaines normes plutôt que d’autres, cela aurait un effet sur l’offre que nous pouvons faire.
Notre partenaire russe nous permet d’offrir des équipements correspondants aux anciennes normes soviétiques. Dans ce cas, nous intégrons beaucoup moins de composants français. Nous essayons de développer les composants français chez notre partenaire russe, mais ce n’est pas la même proportion que sur des matériels faits en France, ou partant de technologie française.
L’évolution des normes est donc vraiment le facteur clé. Mais dans les discours des responsables politiques ou du secteur ferroviaire de ces pays, la tendance est de passer aux normes internationales, meilleures en termes de sécurité et de fiabilité.
M. le président François Rochebloine. Vous avez très clairement répondu à la question de notre collègue sur les lois anticorruption.
Au niveau du code d’éthique, Alstom adhère aux règles internationales et nationales de lutte contre la corruption, notamment à la convention OCDE régissant cette matière.
Conformément à ces normes, le groupe et/ou les sociétés qui le composent ont-ils mis en place des procédures et des outils spécifiques pour détecter les comportements de corruption active et passive ? Ces outils peuvent-ils affecter la conduite des affaires en Azerbaïdjan ? Avez-vous reçu des signalements de tels comportements ? Et le cas échéant, quelles conséquences en avez-vous tiré ?
M. Philippe Delleur. Cette question se pose particulièrement à propos du recours éventuel à des consultants extérieurs en matière commerciale.
Nous avons recours à des consultants extérieurs dans tous les domaines ‒ des juristes, des fiscalistes ‒ parce que nous n’avons pas toutes les compétences, nous sommes surtout une entreprise d’ingénieurs. En matière fiscale ou autre, nous avons besoin d’expertise extérieure.
Notre groupe est extrêmement décentralisé. Si nos équipes jugent que pour leur approche commerciale, ils ont besoin d’un appui extérieur, ce sujet est particulièrement fléché, car il est très sensible quant aux risques de corruption.
Dans ce domaine plus particulièrement, nous avons mis en place des procédures extrêmement strictes : aucun engagement ne peut être pris par aucun membre du groupe sans passer par une analyse du département de l’éthique et de la conformité. C’est un département totalement centralisé au sein du département juridique au siège du groupe. Toute demande de soutien commercial fait l’objet d’une investigation spécifique pour comprendre les raisons d’un tel besoin, et s’assurer que l’entité à laquelle nous aurions recours est honorablement connue. Cette entité doit prendre des engagements de ne pas recourir à des paiements illicites, en particulier vis-à-vis des personnalités officielles ou des autorités publiques.
Il existe donc bel et bien des procédures spécifiques, elles ont d’ailleurs été auditées par une société spécialisée dans la certification des procédures anticorruption il y a déjà plusieurs années, suite aux déboires du groupe Alstom. Maintenant, les procédures sont considérées comme au meilleur état de l’art en ce domaine. Nous continuons d’ailleurs à veiller à les perfectionner si nécessaire.
Ce sont ces procédures que nous divulguons dans les efforts de communication et de formation dont j’ai parlé tout à l’heure.
Dans le cas particulier de ce contrat, nous n’avons absolument pas eu de problèmes, aucun drapeau rouge n’a été levé pour signaler un risque.
M. le président François Rochebloine. Merci pour vos réponses précises, qui ne prêtent pas à contestation.
*
* *
Ÿ Audition de M. Bertrand Fort, délégué pour l’action extérieure des collectivités territoriales au ministère des affaires étrangères (mercredi 16 novembre 2016)
M. le président François Rochebloine. Mes chers collègues, nous accueillons aujourd’hui M. Bertrand Fort, délégué pour l’action extérieure des collectivités territoriales au ministère des affaires étrangères depuis le mois de novembre 2014.
La délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT) a pour mission le soutien aux actions de coopération décentralisée engagées par les collectivités locales, les départements et les régions. Selon le site internet du ministère des affaires étrangères, elle met en œuvre des stratégies géographiques de développement des coopérations décentralisées, et met en place des outils favorisant la cohérence et la mutualisation.
Nous comptons sur vous, monsieur Fort, pour traduire en termes concrets ce que signifient ces expressions complexes dans le cas particulier de l’Azerbaïdjan.
Quels services proposez-vous aux collectivités engagées dans des actions de coopération décentralisée ?
Nous vous serions par ailleurs reconnaissants de bien vouloir retracer l’histoire de ces actions entre les collectivités françaises et azerbaïdjanaises, en indiquant notamment combien sont engagées, depuis quelle date, et quels sont leurs objectifs.
Comme vous le savez, en France, la libre administration des collectivités locales est un principe constitutionnel ; peut-être pourriez-vous nous préciser le mode d’organisation de ces collectivités, ainsi que leur degré d’autonomie par rapport à l’État en Azerbaïdjan.
Enfin, comment la délégation concilie-t-elle le respect de ce principe avec l’immixtion inévitable dans la vie des collectivités concernées qu’implique l’accomplissement de sa mission ?
Monsieur Fort, je vous cède la parole pour un exposé liminaire, qui sera suivi d’un temps de questions et réponses.
M. Bertrand Fort, délégué pour l’action extérieure des collectivités territoriales au ministère des affaires étrangères. La DAECT est un service du ministère des affaires étrangères. Dans le même temps, elle est le bras d’application de la Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD), dont le secrétaire général est organiquement le délégué pour l’action extérieure des collectivités territoriales au ministère des affaires étrangères, et qui est présidée par le Premier ministre.
La CNCD constitue l’instance officielle de dialogue entre l’État dans ses différentes composantes, soit douze ministères, les opérateurs, et les collectivités territoriales représentées par leurs associations. Elle donne les grandes orientations, fait des recommandations, et produit des publications. Dans ce contexte, au titre des activités de la CNCD, le délégué pour l’action extérieure des collectivités territoriales cumule les fonctions de directeur d’une entité du ministère des affaires étrangères avec un rôle interministériel.
Les lois régissant l’action extérieure des collectivités territoriales ont évolué, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 2 février 2007 relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements, dite « loi Thiollière ». Les collectivités locales disposent aujourd’hui d’une quasi-liberté d’agir dans le cadre de leurs relations extérieures. J’use de cette expression, car dans un nombre de cas très marginaux, nous pouvons intervenir par le truchement des préfets, au titre de la hiérarchie des normes juridiques, lorsque des actions de collectivités territoriales seraient en contradiction avec la politique étrangère de la France. Cette liberté quasi totale vaut pour tous les pays susceptibles d’être des partenaires de coopération, y compris l’Azerbaïdjan ainsi que l’ensemble de la région du Caucase.
Le rôle de la DAECT auprès des collectivités territoriales est, en premier lieu, de les conseiller dans les modalités de leur action internationale afin d’apporter une sécurité juridique à leurs engagements internationaux.
À titre d’exemple, la loi d’orientation et de programmation du 7 juillet 2014 relative à la politique de développement et de solidarité internationale, dernier texte législatif en date dans ce domaine, a instauré le mécanisme du « 1 % déchets », qui permet de réserver une part de la taxe sur les ordures ménagères pour l’action internationale dans les pays en voie de développement en matière de déchets. Cela fait l’objet d’interprétations opérationnelles très précises afin de déterminer le type de collectivités et le type de situations concernées, de préciser les buts poursuivis, etc. C’est là que la DAECT joue son rôle de conseil.
Ainsi la semaine dernière sommes-nous intervenus auprès d’une commune des Alpes-Maritimes qui souhaitait faire un don à une collectivité connaissant de sérieuses difficultés humanitaires. Cette collectivité souhaitait savoir quel article du code général des collectivités territoriales devait être invoqué pour la délibération du conseil municipal. Ce type de conseil est permanent.
La délégation fait aussi des recommandations sectorielles afin, par exemple, de conseiller ses interlocuteurs au sujet de l’action internationale des collectivités locales dans tel ou tel domaine thématique. Très récemment, nous avons accompagné un grand nombre de collectivités dans le secteur de l’atténuation du changement climatique ou de la jeunesse et de la formation professionnelle. Lorsque nous recommandons un domaine d’intervention, nous tâchons de constituer des « consortiums » permettant aux collectivités de travailler à plusieurs, avec des organisations internationales et des opérateurs de l’État. Une telle mutualisation permet aux actions engagées d’être plus efficaces et mieux coordonnées.
L’action internationale vient en complément de la politique étrangère de la France : elle contribue à son rayonnement, à sa solidarité, ainsi qu’à son attractivité. Toutefois, force est de constater que l’action internationale des collectivités territoriales s’est concentrée sur un certain nombre de pays. Quand bien même des variations annuelles peuvent être constatées, sont présents dans le groupe de tête des dix principaux pays concernés, le Sénégal, Madagascar, le Maroc, le Liban, le Burkina Faso, le Bénin, l’Arménie, Haïti et la province du Québec.
Notre souhait est d’accompagner les collectivités dans une diversification de leurs pays partenaires, de manière à éviter une surconcentration susceptible d’être préjudiciable à l’image de la France et à l’efficacité de l’action internationale des collectivités territoriales. Ainsi, au Sénégal, la seule ville de Saint-Louis fait-elle l’objet de quinze actions de coopération décentralisée.
Nous formulons donc des recommandations sur la géographie, afin d’inciter à agir là où il y a peu de coopérations décentralisées avec la France. Avec le poste diplomatique au Sénégal, nous essayons, par exemple, d’établir des coordinations avec des collectivités actives à Saint-Louis et nous recommandons à celles qui souhaitent s’investir dans les pays de la région d’aller là où des besoins restent à satisfaire. Je rappelle qu’aujourd’hui, cent trente partenariats sont recensés au Sénégal, contre seulement trois en Guinée.
Par ailleurs, nous cofinançons des projets, et attribuons des bonus afin d’inciter à aller là où un moins grand nombre de collectivités territoriales est impliqué, de façon à améliorer l’impact de l’ensemble des actions menées.
M. le président François Rochebloine. Pouvez-vous être plus précis au sujet de ces bonus ?
M. Bertrand Fort. Nous faisons des appels à projets, et les collectivités territoriales choisissant d’intervenir dans les pays où peu d’initiatives interviennent, reçoivent dix points de cofinancement supplémentaire. J’apporte cette précision, car elle s’applique précisément à l’Azerbaïdjan, où très peu de collectivités territoriales françaises sont impliquées. Une dizaine de collectivités territoriales françaises entretient des relations avec des collectivités azéries à des niveaux très variables. De fait, la différence est grande entre une simple charte d’amitié, un jumelage et une coopération concrète engageant des fonds et de la ressource humaine.
La liste de ces coopérations est la suivante.
Un jumelage existe de façon assez virtuelle entre la capitale Bakou et la ville de Bordeaux. Une coopération active s’exerce entre le département de l’Yonne et Gandja. Une coopération également active a été établie entre Auxerre et Shamkir. Un partenariat s’amorce entre Chablis et Göygöl. Balaken et le département de l’Yonne entretiennent des liens de coopération concrets. L’accord passé entre Gaillard et Shamakhi n’existe que sur le papier. L’Aigle et Naftalan ont signé une déclaration d’intention de jumelage. Une coopération active s’exerce entre Cognac et Tovuz, ainsi qu’entre Mulhouse et Evlax. Les relations entre Megève et Goussar sont virtuelles. Le partenariat entre Colmar et Skaki est assez actif, et celui tissé entre Cannes et Gabala devrait l’être prochainement, ainsi que les relations entre Évian et Ismayilli. Enfin, l’accord passé entre Altkirch et Horadiz peut être qualifié d’émergent.
Ces collectivités se sont engagées d’elles-mêmes dans ces relations, sur leur propre initiative ou sur celles des Azerbaïdjanais.
M. le président François Rochebloine. Je vous ai par ailleurs interrogé sur le degré d’autonomie des collectivités locales d’Azerbaïdjan par rapport au pouvoir central : quelle comparaison est-il possible d’établir avec la situation en France ?
M. Bertrand Fort. Il faut considérer qu’en dehors des pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la décentralisation est balbutiante. Cela est aussi vrai pour les pays à revenu intermédiaire et se vérifie en Azerbaïdjan, État pour lequel il est d’ailleurs préférable d’évoquer une très faible déconcentration – situation qui n’est pas sans limiter les possibilités de coopération décentralisée. En effet, les élus locaux français préfèrent toujours avoir pour interlocuteur une entité disposant d’une réelle autonomie de décision ; la question de l’autonomie des collectivités locales constitue d’ailleurs l’un des sujets que nous abordons régulièrement dans notre dialogue avec les autorités azerbaïdjanaises.
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. En considérant la liste des divers accords que vous avez dressée, je suis frappé de constater qu’en dehors de la charte de jumelage existant entre Bordeaux et Bakou, qui est ancienne et n’a que peu de contenu, beaucoup de chartes d’amitié, de jumelage ou de protocoles de coopération ont été adoptés à partir de l’année 2012, puis en 2014 et 2015. Ces actes correspondent-ils à une offensive azerbaïdjanaise en direction des collectivités françaises ? Cela s’est-il traduit par des visites effectuées sur notre sol ?
Certaines de ces coopérations ont-elles un contenu économique ? Il m’est revenu que l’une d’entre elles porte sur le vin.
Par ailleurs, vous n’avez pas évoqué les accords universitaires passés entre des universités françaises et azéries, auxquels je suis très favorable. Que traduisent ces accords : de la reconnaissance de diplômes, des échanges d’étudiants ; sont-ils favorables à la diffusion de la langue française en Azerbaïdjan ?
Selon vous, l’Azerbaïdjan cherche-t-il à développer un niveau de coopération comparable à celui des pays du Caucase, voisins et de taille équivalente, que sont la Géorgie et l’Arménie ?
M. Bertrand Fort. La loi fait désormais obligation aux collectivités locales de déclarer leurs coopérations décentralisées à la CNCD par le truchement d’un enregistrement automatisé sur internet. Depuis 2012 environ, nous constatons une croissance de ces partenariats de coopération décentralisée avec l’Azerbaïdjan, qu’ils soient virtuels pour la plupart ou réels pour quelques-uns. Cette croissance ne saurait être analysée sans prendre en compte le contexte du Caucase et la coopération décentralisée franco-arménienne. Chacun est au fait des tensions régnant entre les deux pays du Caucase. Nous constatons que, depuis les années 2010, l’Azerbaïdjan a souhaité renforcer cette dimension de la relation bilatérale, en se comparant avec la richesse, la diversité et l’intensité qui caractérisent les relations entretenues avec l’Arménie par beaucoup de collectivités territoriales françaises.
Nous avons ainsi appris que les représentants de l’Azerbaïdjan en France, soit par des visites, soit par l’intermédiaire de leur ambassade, ont entrepris un certain nombre de démarches ; comme le font d’ailleurs de très nombreux pays. Ainsi, l’ambassade d’Argentine mène actuellement une campagne intense afin de renforcer la coopération entre nos deux pays. Ceci est aussi le cas du Québec. Une dizaine de pays au moins sont très actifs et cherchent à resserrer ces liens de coopération décentralisée. Nous demandons d’ailleurs à nos ambassades à l’étranger de faire de même, comme au Vietnam ou au Liban où je me trouvais encore hier.
Les instances diplomatiques ont ainsi un rôle important à jouer, et je ne m’étonne pas de constater que l’ambassade d’Azerbaïdjan a exercé cette fonction d’influence, de contacts et de persuasion, qui a produit ses effets.
Il faut toutefois reconnaître que ces résultats sont aujourd’hui limités puisque, par-delà les chartes d’amitié, une poignée seulement de ces accords a un impact concret sur la coopération décentralisée effective.
Ainsi que vous l’avez indiqué, monsieur le rapporteur, avec le département de l’Yonne et la ville de Cognac, la coopération est active dans le secteur des vins et spiritueux, et l’essentiel des accords passés entre ces collectivités s’est concrétisé. À ma connaissance, il n’y a pas eu d’autres objets de partenariat, alors que des souhaits sont exprimés dans le domaine du tourisme.
Il n’est par ailleurs pas exact de parler de coopération décentralisée au sujet des échanges universitaires. Les liens entre élus sont certes susceptibles de favoriser les rapprochements universitaires, mais les universités ne dépendent pas des collectivités territoriales et sont autonomes. L’expérience montre que les initiatives de contact prises par ces établissements ne sont malheureusement pas toujours couronnées de succès, même si quelques réussites sont observées.
Mais les relations universitaires excèdent le champ de la coopération décentralisée, et partant, celui de ma compétence. Un certain nombre de partenariats universitaires ont été permis, ou non, par la coopération décentralisée sur la base de relations institutionnelles entre collectivités territoriales. Je ne peux toutefois pas répondre au sujet de la reconnaissance de diplômes, mais je suis au fait d’échanges d’étudiants ainsi que d’enseignants ; par ailleurs des souhaits ont été formés sur les échanges de chercheurs.
M. le président François Rochebloine. Si ces relations universitaires ne sont pas tissées par les collectivités territoriales, le sont-elles par les ministères ?
M. Bertrand Fort. Elles sont le fait des universités, qui dialoguent entre elles directement, sans que les ministères concernés interviennent. J’ai d’ailleurs pu constater dans plusieurs pays qu’il était regretté que le ministère chargé de l’enseignement supérieur ne tienne pas le compte des accords universitaires et des flux d’échanges universitaires bilatéraux avec tel ou tel pays. Or ces échanges sont foisonnants, et il serait difficile d’en tenir le livre.
Le domaine universitaire échappe donc bien au champ de la coopération décentralisée, même si les contacts entre responsables territoriaux peuvent favoriser les partenariats ; il en va de même pour le domaine des affaires, sans que pour autant les élus locaux soient responsables des accords commerciaux susceptibles d’être passés entre les pays concernés.
Au début du mois de décembre prochain, les assises de la coopération décentralisée franco-arménienne se tiendront à Erevan et, encore une fois, elles en souligneront la richesse. Il s’agit d’ailleurs pratiquement de l’unique cas où la coopération décentralisée est nettement supérieure à la coopération d’État en termes de budget. Son impact au sein des relations de coopération bilatérale est ainsi très important, et la DAECT favorise, conseille et cofinance un grand nombre de projets franco-arméniens.
En tout état de cause, il faudra beaucoup de temps pour que le nombre des partenariats franco-azerbaïdjanais atteigne la moitié de ceux conclus entre la France et l’Arménie. Cet écart s’explique en partie par l’ancienneté de la relation unissant la France à ce pays, ainsi que par le nombre important de ressortissants arméniens présents sur notre sol ou le nombre de nos compatriotes d’origine arménienne, mais aussi par les liens tissés au cours de l’histoire.
Force est de reconnaître que de tels liens n’existent pas avec l’Azerbaïdjan.
Le degré de coopération décentralisée avec la Géorgie est de niveau comparable à celui de nos relations avec l’Azerbaïdjan, la Géorgie faisant preuve d’un moindre volontarisme proactif pour multiplier les partenariats.
M. Michel Destot. À juste titre, monsieur le délégué, vous avez indiqué que la France plaide en faveur de la diversification des pays partenaires de coopération décentralisée. Aux termes mêmes de la Charte des Nations unies, tous les pays sont égaux, mais certains sont « plus égaux que d’autres »… Ainsi la diplomatie française s’adapte-t-elle et porte-t-elle un regard particulier sur certains États du monde avec lesquels les liens sont plus aisés.
Il en va de même pour les collectivités territoriales, qui ne sont toutefois pas assujetties aux mêmes règles que les pays. J’ai été, pendant dix-neuf ans, maire de Grenoble, ville qui a noué une vingtaine de coopérations décentralisées à travers le monde ; si nous avons tissé ces relations avec Oxford, Essen, Constantine ou Sevan, c’est que des communautés issues des pays d’origine sont présentes sur le sol grenoblois.
D’un autre côté, si nous avons établi des relations avec la Chine, le Japon et les États-Unis, c’est que nous avons considéré que cela était important du point de vue économique, scientifique et universitaire.
Ces critères sont les mêmes lorsque l’on se tourne vers la région du Caucase. Au titre de l’intérêt de ces échanges et coopérations, nous prenons en considération les communautés présentes dans nos territoires, ainsi que la question de la francophonie. En tant que délégué pour l’action extérieure des collectivités territoriales, vous disposez d’un point de vue privilégié pour observer l’Arménie, l’Azerbaïdjan et le Haut-Karabagh, singulièrement du fait des retours d’expérience des collectivités territoriales.
Que peut-on dire de la coopération décentralisée au Haut-Karabagh ? Des interventions des pays voisins sont-elles constatées ? Je pense bien entendu à l’Azerbaïdjan et l’Arménie, alors que l’un de ces pays souhaite favoriser la coopération tandis que l’autre cherche à dissuader les collectivités territoriales françaises de s’y engager.
Les autorités azéries interviennent-elles afin de faciliter ou, au contraire, s’opposer à ce que des coopérations s’établissent dans les domaines social, éducatif ou culturel avec le Haut-Karabagh ?
M. Bertrand Fort. Comme vous le savez, la France est coprésidente du Groupe de Minsk qui a pour objet de rapprocher les parties en conflit, et de trouver une solution de paix dans le Caucase. Dans ce contexte, la France, pas plus que l’Union européenne ou l’Arménie, n’a reconnu l’entité Haut-Karabagh comme constituant un État souverain.
À l’instar de la situation de la Crimée, dès lors que la France ne reconnaît pas l’annexion d’un territoire, notre droit interdit aux collectivités territoriales de constituer légalement des coopérations décentralisées. Les collectivités territoriales françaises ne peuvent donc pas entretenir de coopérations décentralisées avec les collectivités territoriales du Haut-Karabagh.
En cas de dépense ou d’acte engagés dans ce contexte par une assemblée locale délibérante, le préfet est fondé à déclarer la nullité de ces actes ou dépenses ; il lui est par ailleurs loisible de déférer le cas devant le tribunal administratif. C’est sur le fondement de ce point de droit précis que les Azerbaïdjanais plaident pour l’application de la loi.
M. Michel Destot. Pouvez-vous nous exposer des cas concrets ?
M. Bertrand Fort. Des chartes d’amitié ont été signées entre des collectivités territoriales françaises et du Haut-Karabagh, et l’ambassade d’Azerbaïdjan est intervenue pour dénoncer leur illégalité.
M. Jean-Michel Villaumé. J’ai bien entendu, monsieur le délégué, votre réponse à notre collègue Destot, mais, sans vouloir insinuer que vous pratiquez la langue de bois, j’observe que vous avez évoqué la liberté quasi totale des collectivités territoriales pour ajouter aussitôt qu’elle ne devait toutefois pas entrer en contradiction avec la politique étrangère conduite par le Gouvernement.
Vous avez cité la Crimée, et mon collègue le Haut-Karabagh. Pour ma part, j’ai eu connaissance d’une circulaire interministérielle signée par le ministre des affaires étrangères et le ministre de l’intérieur, en date du 9 juillet 2015, qui détermine un cadre.
M. Bertrand Fort. Qui rappelle le cadre légal…
M. Jean-Michel Villaumé. La ville de Nice a renouvelé une convention avec Yalta en mars 2016 ; je souhaiterais connaître votre opinion à ce sujet.
M. Bertrand Fort. J’ai pesé mes propos ; c’est peut-être de la langue de bois, mais c’est le droit. J’ai évoqué des actes pris en assemblée délibérante de collectivités territoriales, pas des déclarations politiques ou des actes signés qui ne feraient pas l’objet de délibération d’un conseil municipal.
À notre connaissance, la charte d’amitié passée avec Yalta n’a pas fait l’objet d’une délibération du conseil municipal de Nice. Il s’agit donc d’une prise de position politique du maire de Nice qu’il ne m’appartient pas de juger, les élus français étant parfaitement en droit d’adopter les postures politiques qu’ils souhaitent.
M. le président François Rochebloine. Et de signer une charte d’amitié !
M. Bertrand Fort. Une charte d’amitié qui n’a aucune valeur juridique dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’une décision de la part d’une assemblée délibérante.
M. le président François Rochebloine. Aucune loi n’interdit aux communes françaises de passer des accords de jumelage ni, a fortiori, de signer des chartes d’amitié avec des localités situées dans des entités non reconnues par la France. Il y a des exemples : Saint-Cyr-sur-Loire avec Morfou à Chypre du Nord, Bordeaux avec Ramallah, Dunkerque avec Gaza. Des chartes d’amitié ont été signées : quelle est la différence ?
M. Bertrand Fort. Encore une fois, lorsque le document signé n’est pas validé par le conseil municipal, départemental ou régional, il n’a aucune valeur juridique : c’est une déclaration politique. Or, en France, les autorités locales ont le droit de faire des déclarations politiques.
M. le président François Rochebloine. Dans les cas que j’ai cités, de Ramallah…
M. le rapporteur. À Ramallah, il y a l’Autorité palestinienne.
M. Bertrand Fort. Nous reconnaissons l’Autorité palestinienne.
M. le président François Rochebloine. Certes, mais qu’en est-il de Chypre du Nord ?
M. Bertrand Fort. Nous avons des relations avec Chypre du Nord ; pas avec les autorités du Haut-Karabagh ni de la Crimée.
M. le président François Rochebloine. Si je vous entends bien, les collectivités territoriales peuvent très bien entretenir des relations avec des entités non reconnues par la France, à condition que ces relations ne fassent pas l’objet d’une délibération.
M. Bertrand Fort. Tout à fait, et sous la réserve que ces relations ne trouvent pas une traduction budgétaire : il est interdit d’engager les fonds du contribuable français dans des coopérations qui, de fait, sont illégales.
M. Christophe Premat. Quelle est l’évaluation de la coopération décentralisée ? Le contrôle de gestion s’applique aux crédits du ministère des affaires étrangères, comme le législateur avait recommandé de le mettre en place il y a quelques années. Ainsi, pour ce qui concerne les manifestations culturelles, il comporte une rubrique portant sur l’évaluation de la coopération décentralisée, et le dispositif précise le public visé ainsi que l’effet de levier, qui est calculé.
Dans le cadre de la coopération culturelle, universitaire et scientifique, les agents du ministère évaluent la part versée par les divers organismes impliqués afin d’en apprécier le bénéfice en termes d’influence de la France. Comment est-il possible d’évaluer de façon plus fine la part des partenariats décentralisés dans notre politique nationale de coopération ?
M. Bertrand Fort. Nous entrons là dans des considérations de technique budgétaire qui ne concernent pas seulement l’Azerbaïdjan.
La DAECT évalue l’effet de levier de ses propres crédits, qui viennent en cofinancement des projets des collectivités territoriales. Sans en avoir certitude puisque certaines collectivités ne déclarent pas leurs coopérations décentralisées, nous estimons cofinancer entre un cinquième et un quart des projets de coopération décentralisée. Cela signifie que le reste se fait sans cofinancement du ministère ; nous n’en avons donc pas connaissance directe.
Dans notre rapport d’activité annuel, nous mentionnons les crédits de cofinancement que nous mettons en œuvre pour les projets qui nous sont soumis, et que nous sélectionnons. C’est sur cette part que nous faisons rapport. Nous ne disposons que d’une image très imparfaite de ce qui est réalisé par ailleurs. C’est comme si nous n’éclairions qu’une partie d’une rue : nous pouvons facilement décrire ce qui est éclairé, non ce qui ne l’est pas.
M. le président François Rochebloine. Avez-vous connaissance des règles applicables à la coopération décentralisée en Azerbaïdjan ?
M. Bertrand Fort. La décentralisation n’est que fort peu développée en Azerbaïdjan. Ce pays n’étant pas pour la France un territoire de coopération intense, nous ne connaissons que très imparfaitement ces règles. Nous avons demandé à notre poste diplomatique de nous en dire plus afin de savoir dans quel cadre les collectivités territoriales françaises vont évoluer, pour, le cas échéant, déterminer comment les conseiller, leur faire des recommandations, éviter certains pièges, etc.
Nous ne sommes pas en terra incognita, mais pour l’instant nous ne nous sommes pas beaucoup intéressés aux modalités de la décentralisation en Azerbaïdjan.
M. le président François Rochebloine. À quel stade du développement de la relation entre ces collectivités la délégation est-elle informée ? Cela passe-t-il par les préfectures ?
M. Bertrand Fort. Les collectivités territoriales sont astreintes à une obligation de déclaration ; elles n’y satisfont pas toujours, et nous estimons à un cinquième environ la part de l’action internationale qui n’est pas déclarée. Mais il ne s’agit que d’une estimation.
Toutefois, nous disposons de recoupements provenant des préfectures, ainsi que des collectivités elles-mêmes, car nous les rencontrons, nous nous rendons sur place, et nous travaillons avec des réseaux régionaux multiacteurs. Très récemment, j’étais à Grenoble pour la réunion du réseau régional multiacteurs de Rhône-Alpes-Auvergne. Nous dialoguons avec ces acteurs qui ont une connaissance territoriale plus fine, car nous cofinançons ces réseaux. Ils constituent de bons vecteurs d’information et de diffusion du travail effectué en commun.
Par le truchement de ces réseaux, des collectivités et des associations de collectivités comme l’Association des maires de France (AMF), Régions de France, l’Assemblée des départements de France (ADF), France urbaine, et grâce aux associations spécialisées telle l’Association française du Conseil des communes et régions d’Europe (AFCCRE) et, pour le reste du monde, Cités Unies France – qui sont nos partenaires quotidiens –, nous améliorons la pixellisation d’une image qui est parfois assez floue. Il s’agit d’un travail de recoupement d’informations.
Il y a une autre source d’information : l’obligation, pour les collectivités locales, de déclarer leur aide publique au développement (APD). Cela concerne uniquement les pays non-membres de l’OCDE, où l’action des collectivités est en effet comptabilisée comme de l’aide publique au développement.
La CNCD a demandé à la DAECT de procéder à cette collecte d’informations. Chaque année, j’envoie une circulaire, via les préfectures de région, à toutes les collectivités locales pour les inviter à déclarer leur APD. Via cette information obligatoire, qui n’est pas totalement respectée, il faut le reconnaître, nous recoupons les informations et nous parvenons in fine à une cartographie relativement bien définie, avec, parfois, des zones de flou, mais de façon assez précise pour certains pays.
M. le président François Rochebloine. Ces différentes actions de coopération décentralisée sont-elles accompagnées, ou incluent-elles la réalisation de contacts avec des PME françaises ?
M. Bertrand Fort. D’une façon générale, nous incitons les collectivités françaises à inclure les entreprises de leur territoire dans leur coopération décentralisée, comme nous les incitons à inclure les établissements publics, privés, d’éducation ou de santé, en fonction de la pertinence de leur coopération. Cela concourt au soutien à l’export, à l’attractivité de nos territoires et, éventuellement, aux investissements directs étrangers en France.
J’ai cru comprendre qu’à Cognac un investissement azerbaïdjanais assez important était en cours. Cela résulte certainement des contacts que le maire de Cognac a pris avec son partenaire de ce pays.
M. le président François Rochebloine. Avez-vous appelé l’attention des collectivités françaises qui ont souscrit, sous une forme quelconque, des accords de coopération décentralisée avec des collectivités azerbaïdjanaises, sur la situation très controversée des libertés publiques et des droits de l’Homme en Azerbaïdjan ?
M. Bertrand Fort. Oui. Nous le faisons informellement, comme nous le faisons avec tous les pays qui ne sont pas pleinement démocratiques. Nous incitons les collectivités françaises à renforcer leur coopération avec la Russie, qui n’est pas un modèle parfait de démocratie, ainsi qu’avec le Vietnam et la Chine, où se sont récemment tenues des assises.
Le ministère des affaires étrangères incite les collectivités locales à travailler dans ces pays, car elles sont des vecteurs d’ouverture, de bonne gouvernance, de démocratisation, au plus près des populations et des autorités locales. Cela permet, à côté des échanges avec les autorités nationales, d’ouvrir d’autres voies pour le dialogue, de diversifier les canaux de coopération. Il en va de même pour la coopération économique et la coopération universitaire. Plus il y a de voies de coopération, plus cela contribue à l’ouverture de pays qui ont parfois des relations particulières avec les droits de l’Homme.
M. le président François Rochebloine. Ma question concernait l’Azerbaïdjan, mais pouvait effectivement viser d’autres pays.
M. Jean-François Mancel. La circulaire ministérielle de 2015 à laquelle il a été fait allusion rappelle les conditions, qui figurent d’ailleurs dans le code général des collectivités territoriales, dans lesquelles une collectivité française peut conclure une convention avec une collectivité étrangère, mais je voudrais citer deux exemples très concrets.
Notre collègue Pupponi, maire de Sarcelles, a réuni en 2015 son conseil municipal pour lui proposer une charte d’amitié avec une commune du Haut-Karabagh, territoire azerbaïdjanais dont l’occupation par l’Arménie n’est pas reconnue par la France. Un membre du conseil municipal lui a demandé s’il était normal, conforme à la législation, d’établir des liens avec une collectivité d’un territoire dont nous ne reconnaissons pas l’indépendance, et le maire a répondu que la partie arménienne, avec qui il avait pris contact parce qu’il souhaitait nouer des liens d’amitié avec l’Arménie, lui avait suggéré de choisir une commune du Haut-Karabagh. Savez-vous s’il y a eu des suites à cette affaire ? Si le préfet du département a déféré la délibération au tribunal administratif ? Que veut dire la circulaire quand elle parle de convention ? Est-ce qu’une charte d’amitié entre dans ce cadre ?
Une deuxième commune se trouve dans le même cas : Bourg-lès-Valence, dont la maire appartient à l’opposition – ce qui, pour le coup, rétablit l’équilibre sur le plan politique – et qui a conclu une charte d’amitié avec la ville de Choucha, qui se trouve également au Haut-Karabagh, où elle constituait même un important foyer culturel azéri avant son occupation par l’Arménie en 1992, occupation qui a entraîné la destruction quasi-complète du patrimoine architectural de la ville et l’expulsion de l’intégralité de sa population azérie. La ville de Bourg-lès-Valence a donc probablement suivi le même processus juridique, mais y a-t-il eu délibération du conseil municipal ? Le préfet est-il intervenu ?
Ces sujets ne sont pas sans importance, car il faut comprendre les autorités azerbaïdjanaises, qui peuvent s’étonner et s’attrister que des collectivités françaises concluent des accords avec des autorités se trouvant sur des territoires occupés qu’ils considèrent comme leur appartenant – et que les Nations unies considèrent également comme tels. Cela risque de remettre indirectement en cause le rôle de la France comme coprésidente du Groupe de Minsk, qui s’attache à une solution équilibrée du conflit.
M. Christophe Premat. L’Azerbaïdjan souhaiterait adhérer à l’Organisation internationale de la francophonie (OIF). Savez-vous s’il y a eu des démarches en ce sens auprès de l’Association internationale des maires francophones (AIMF) ?
M. le président François Rochebloine. J’ajoute, monsieur le délégué, que, jusqu’à preuve du contraire, Taïwan n’est pas reconnue par la France. Or la commune de Versailles a signé une charte avec Taïwan.
Je regrette que notre collègue Pupponi ne soit pas là, car il aurait été intéressant qu’il puisse réagir et donner son point de vue, mais il aura l’occasion de lire le compte rendu de notre réunion.
Je vous laisse la parole pour répondre à nos collègues Mancel et Premat.
M. Bertrand Fort. Suite à la circulaire conjointe de juillet 2015 des ministres des affaires étrangères et de l’intérieur, la délégation a interrogé tous les préfets de région et de département susceptibles d’être concernés par ces cas litigieux. Tous ont répondu n’avoir pas eu connaissance de tels cas et n’avoir donc pas eu à en déférer au tribunal administratif. Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas eu de cas, mais les préfets n’en ont pas repéré, ni donc déféré. Comme nous n’avons pas de correspondant à Sarcelles ni à Bourg-lès-Valence, nous nous en sommes remis aux préfectures, qui ne nous ont rien révélé d’illégal. Nous en sommes donc restés là.
On constate de la part du Haut-Karabagh un volontarisme similaire à celui de l’Azerbaïdjan pour nouer des partenariats ou des coopérations, qui peuvent prendre des formes très diverses : conventions, échanges de lettres, chartes d’amitié ou de solidarité… Il n’existe pas de codification de ce type d’échanges ; ce qui est codifié, en revanche, ce sont les délibérations portant sur un échange de documents signés par les parties.
Le volontarisme azerbaïdjanais est un peu l’écho du volontarisme – pour employer un euphémisme – manifesté par les autorités arméniennes et par l’ambassade d’Arménie en France pour inciter les collectivités territoriales françaises à engager des partenariats avec des entités administratives du Haut-Karabagh.
Ne voulant pas prendre position dans ce conflit, précisément pour garder une position équidistante des deux parties afin de continuer à jouer son rôle d’intermédiaire dans le cadre du Groupe de Minsk, la France veille avec scrupule à ne pas mettre le doigt dans l’engrenage d’un côté ni de l’autre.
En ce qui concerne votre question sur la francophonie, monsieur Premat, je n’ai pas connaissance d’une demande spécifique d’adhésion à l’OIF ni d’une démarche particulière à l’égard de l’AIMF ou d’autres entités francophones.
M. le président François Rochebloine. Avec quelle ville Nice a-t-elle signé un accord ?
M. Bertrand Fort. Yalta, en Crimée – région ukrainienne, pour la France.
En ce qui concerne Taïwan, la France n’a pas de relations diplomatiques d’État, mais elle reconnaît Taïwan. Il y a un représentant officiel de Taïwan en France. Nous n’avons pas d’ambassade à Taïwan, mais nous y avons un bureau de représentation.
M. le rapporteur. Comme pour la Palestine.
M. Bertrand Fort. C’est exact. Nous avons un consul général à Jérusalem, qui a compétence pour les territoires palestiniens.
M. le président François Rochebloine. Je vous remercie, monsieur le délégué, de n’avoir éludé aucune de nos questions et de nous avoir donné des réponses claires et précises.
*
* *
Ÿ Précisions complémentaires ultérieurement portées à la connaissance de la mission d’information (jeudi 17 novembre 2016)
M. le président François Rochebloine. Mes chers collègues, je me réjouis de la manière dont se déroulent nos travaux. Mais il y a eu hier un échange malheureux. Je souhaite que l’on s’abstienne d’évoquer la situation d’une personne en son absence ; or Jean-François Mancel – avec qui tout se passe très bien par ailleurs – a parlé d’une déclaration de François Pupponi en conseil municipal à Sarcelles alors que celui-ci n’était pas là. On a pu regretter cette absence, mais elle n’est la faute de personne. Afin de clarifier les choses, j’ai fait part à François Pupponi des propos qui ont été tenus, et que Jean-François Mancel aurait d’ailleurs sans doute formulés de la même manière en sa présence. Il me paraît important de donner maintenant la parole à François Pupponi afin qu’il puisse dire ce qui s’est passé.
M. François Pupponi. Je suis désolé d’avoir été absent hier et présent par intermittence ce matin, mais il fallait absolument que je sois dans l’hémicycle.
Ce qu’a dit hier notre collègue correspond à la réalité. Il a par ailleurs posé des questions. J’aimerais donc apporter des précisions sur la façon dont les choses se sont passées au niveau de la municipalité de Sarcelles.
Nous avons voulu procéder de la manière la plus limpide possible. Nous avons donc voté une délibération qui m’autorisait à signer une charte d’amitié avec le Haut-Karabagh, en étant parfaitement conscients du contexte géopolitique local et en assumant notre démarche. Lorsque la charte a été approuvée par le conseil municipal, des élus ont posé des questions, auxquelles j’ai répondu. La charte a ensuite été envoyée au contrôle de légalité : rien n’a alors été trouvé à y redire.
Nous n’avons pas voulu agir en cachette, nous l’avons fait officiellement.
M. Jean-François Mancel. Je n’ai jamais soutenu le contraire. J’ai rapporté exactement ce qui s’est dit lors du conseil municipal.
M. François Pupponi. La question de savoir s’il y avait eu un contrôle de légalité a été posée. Je précise pour y répondre que le préfet n’a fait aucune remarque.
M. Jean-François Mancel. C’est la question que nous avons posée ensuite à Bertrand Fort.
M. François Pupponi. Le préfet n’a pas déféré la délibération, c’est-à-dire qu’il l’a acceptée. Le cas de Bourg-lès-Valence a suscité un peu d’émotion, mais la plainte déposée contre Bourg-lès-Valence ne l’a pas été contre la ville de Sarcelles.
M. le président François Rochebloine. À propos de ce qui peut être reproché aux municipalités, voici ce qui nous a été dit très clairement. Lorsqu’une délibération est soumise au contrôle de légalité, les préfets peuvent en connaître ; encore faut-il que la délibération soit transmise. On nous a cité l’exemple des relations entre les villes de Yalta et de Nice : une collaboration existe, mais aucune délibération n’a été adressée au préfet. Jean-François Mancel a demandé à juste titre si des préfets ont porté plainte ; aucun ne l’a fait à ce jour.
M. François Pupponi. Le préfet aurait pu demander dans un premier temps le retrait de la délibération. Mais le contrôle de légalité n’a débouché sur aucune réaction.
M. le président François Rochebloine. Il y en a eu dans d’autres communes. Je voulais simplement vous réunir…
M. Jean-François Mancel. Il n’y a aucun problème entre nous !
M. le président François Rochebloine. … pour éviter que l’on risque de voir se colporter des choses fausses. Tout est maintenant clair.
*
* *
Ÿ Audition de M. Thierry Braillard, secrétaire d’État auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports (jeudi 17 novembre 2016)
M. le président François Rochebloine. Chers collègues, nous avons le plaisir d’accueillir ce matin M. Thierry Braillard, secrétaire d’État auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports.
Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de votre présence. Vous le savez, notre mission vise à faire le point sur les relations politiques et économiques entre la France et l’Azerbaïdjan au regard des objectifs de développement de la paix et de la démocratie dans le Caucase du Sud.
L’Azerbaïdjan a une stratégie de relations publiques très active, multipliant les initiatives propres à le faire connaître, de préférence favorablement, hors du champ politique. Cette stratégie ne pouvait pas ignorer le sport, tant il est vrai que les compétitions sportives, occasions ou prétextes de rencontres, sont devenues, et pas seulement pour ce pays, de véritables instruments d’action extérieure parallèle.
L’Azerbaïdjan n’a pas épargné ses efforts pour faire donner à plein sa « diplomatie sportive » en direction de l’Europe : il a organisé à Bakou les premiers Jeux européens du 12 au 18 juin 2015, puis le Grand Prix d’Europe de Formule 1 le 19 juin dernier, et enfin le championnat d’Europe de football des moins de dix-sept ans cette année encore. Des investisseurs azerbaïdjanais se sont intéressés à des clubs de foot : en France le RC Lens, en Espagne l’Atlético de Madrid. Enfin, l’Azerbaïdjan a participé à l’Euro 2016 et tout le monde a pu remarquer à cette occasion les emplacements publicitaires loués par la SOCAR, compagnie pétrolière azerbaïdjanaise dont je rappelle que le capital est entièrement détenu par l’État.
Bien entendu, votre secrétariat d’État n’intervient pas directement dans l’organisation de ces manifestations. Cependant, en raison du pouvoir de tutelle qu’il détient sur les fédérations sportives nationales et de ses attributions générales de définition de la politique générale de la France, il est amené à exercer une fonction de veille sur le déroulement des compétitions dans lesquelles sont engagées, à l’étranger, des équipes françaises et il a un certain droit de regard sur les compétitions organisées en France, telles que l’Euro 2016, ainsi que sur le financement des activités des clubs professionnels de football français.
Je vous serais donc reconnaissant, monsieur le secrétaire d’État, de bien vouloir rappeler à la mission les règles internationales et nationales qui président à l’organisation des compétitions sportives du type de celles que j’ai énumérées tout à l’heure, et en particulier les normes de calcul et de répartition de la charge financière correspondant à ces compétitions.
Par ailleurs, quelles sont les règles applicables aux investissements étrangers dans des clubs de football professionnel français ?
Quelles sont les modalités de l’information du ministère sur les transactions correspondantes et du contrôle qu’il peut éventuellement exercer sur ces transactions ?
L’application des normes en cause à l’Azerbaïdjan a-t-elle révélé des difficultés particulières ?
Le cas spécifique de l’investissement azerbaïdjanais dans le RC Lens a-t-il retenu votre attention ? Si oui, pour quelles raisons et quelles leçons en avez-vous tirées ?
Mais avant de vous donner la parole, je rajouterai quelques questions à celles que M. le rapporteur vous a communiquées.
Quel est l’état des relations sportives bilatérales entre l’Azerbaïdjan et la France ? Comment sont définies les conditions de financement des activités internationales que suppose le développement de ces relations ?
Le ministre chargé des sports a-t-il été associé à l’organisation des Jeux européens de Bakou et en particulier à la définition des conditions de son financement ? Quelle est la genèse de cette compétition ?
Avez-vous des informations sur les conditions dans lesquelles des entreprises françaises implantées en Azerbaïdjan auraient apporté une participation au financement de ces Jeux européens ?
Enfin, avez-vous des informations sur d’éventuels projets d’investissement dans les clubs sportifs français de la part de ressortissants azerbaïdjanais ? Quels sont les moyens dont disposent les autorités françaises du sport pour évaluer la solidité et la fiabilité des plans de financement présentés par ces investisseurs ? Le ministère a-t-il des moyens juridiques propres pour empêcher des opérations d’investissements sportifs – venant d’Azerbaïdjan ou d’ailleurs – lorsqu’il a de sérieux motifs d’en mettre en cause la solidité ?
M. Thierry Braillard, secrétaire d’État chargé des sports. Mesdames et messieurs les députés, je commencerai mon propos liminaire en vous disant que l’Azerbaïdjan, à l’instar d’autres pays émergents comme le Kazakhstan ou le Qatar, ou d’autres pays comme la Chine, a une stratégie clairement tournée vers une politique de communication à travers le sport.
Cette stratégie a pour but de mieux faire connaître et comprendre le pays, sa culture, et très clairement, de montrer une image positive à travers les compétitions sportives qu’il organise. C’est donc un choix stratégique qui, dans le même temps, cumule la recherche de performances, la recherche de médailles, et une reconnaissance au niveau international. Cette recherche de reconnaissance était tout à fait évidente lors des Jeux européens qui ont eu lieu à Bakou du 12 au 28 juin 2015 – et où je me suis moi-même rendu.
Quel est l’état des relations, sur le plan sportif, entre la France et l’Azerbaïdjan ? Elles se sont intensifiées à partir de 2013-2014. Mme Valérie Fourneyron, alors ministre des sports, avait déjeuné en juillet 2013 avec la « première dame », Mme Mehriban Alieva, qui était en même temps présidente du comité d’organisation des Jeux européens, et qui se trouvait en visite à Paris. La politique menée par le Quai d’Orsay consistait à promouvoir une filière « sport », et à mettre en avant les entreprises françaises à l’étranger pour qu’elles puissent gagner des marchés. À deux ans des Jeux européens, il était donc important pour le Gouvernement de valoriser le savoir-faire des entreprises françaises. Ce fut le cas. Les entreprises Alstom, Iveco, et aussi GL Events ont emporté des marchés lors de l’organisation de ces Jeux européens.
GL Events est sans doute l’entreprise française qui a conclu le plus grand nombre de marchés avec le Comité international olympique (CIO) pour l’organisation des Jeux olympiques ou paralympiques, avec la Fédération internationale de football association (FIFA) concernant la Coupe du monde, voire avec les organisateurs de la Ryder Cup de golf. Nous trouvions normal de promouvoir les entreprises françaises à l’étranger à l’occasion de ces Jeux européens.
En mai 2014, en marge de la visite du président de la République en Azerbaïdjan, Mme Najat Vallaud-Belkacem, qui était alors ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, avait visité les installations destinées à accueillir ces jeux.
Enfin, en novembre 2014, je me suis moi-même rendu à une réception à Paris organisée, là encore, par la présidente du comité d’organisation.
M. le président François Rochebloine. Est-ce le CIO qui a décidé que les premiers Jeux européens se tiendraient à Bakou ?
M. le secrétaire d’État. Non, c’est le Comité olympique européen – mais je reviendrai sur le sujet.
Lors de cette visite, j’avais suggéré à mon homologue Azad Rahimov d’aller visiter l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP), les Azerbaïdjanais étant très intéressés par le savoir-faire français en termes d’organisation des sports. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait.
Comme je vous l’ai expliqué, j’étais présent à la cérémonie d’ouverture des premiers Jeux européens. La France y avait envoyé un grand nombre d’athlètes, témoignant ainsi de l’importance qu’elle attache aux sports, aux valeurs qu’ils véhiculent, et à ces Jeux européens.
J’ajoute qu’en matière de diplomatie sportive institutionnelle, l’Azerbaïdjan a noué des relations assez fortes.
Au sein du Conseil de l’Europe, dont il est membre, il montre un grand intérêt pour les politiques sportives internationales et participe activement aux travaux sur ces questions. Par exemple, il a soutenu les mesures prises dans le cadre la Convention pour lutter contre les manipulations des compétitions sportives – mesures que la France a elle-même cosignées.
Par ailleurs, lors de ces Jeux européens, une réunion informelle s’est tenue à Bakou avec tous les ministres européens du Conseil de l’Europe pour échanger sur la diplomatie sportive. J’y ai moi aussi participé.
Je terminerai en soulignant la volonté de l’Azerbaïdjan d’organiser de grands événements sportifs en dépit de la crise économique. Aujourd’hui, les Azerbaïdjanais souhaitent surtout dialoguer sur l’expérience de l’INSEP. Cela étant, les problèmes budgétaires qu’ils connaissent ne leur permettront sans doute pas de créer l’équivalent de cet institut à Bakou. De la même façon, ils sont très intéressés par le développement des techniques de médecine du sport qu’ils ont vues à l’INSEP, mais ils ont du mal à mettre en place une filière universitaire spécialisée dans ce domaine.
Voilà ce que je voulais vous dire des relations entre la France et l’Azerbaïdjan. J’ai eu l’occasion de rencontrer mon homologue lors des Jeux olympiques de Rio de Janeiro, où il était présent, sachant que l’Azerbaïdjan a investi sur certains sports pour avoir des performances. Je pense principalement aux sports de combat, à la lutte, à la boxe, mais aussi à l’athlétisme et, plus récemment, au football.
J’en viens à vos questions et à celles que m’a fait parvenir le rapporteur.
Je pense avoir répondu à celles relatives aux relations sportives bilatérales entre l’Azerbaïdjan et la France. Celles-ci sont bonnes et se sont même intensifiées depuis 2013.
Comment sont définies les conditions du financement des activités internationales que suppose le développement de ces relations ?
Elles dépendent des budgets des ministères et de l’action bilatérale que nous menons avec tous les pays avec lesquels on peut la mener : avec certains pays, nous avons signé des conventions de coopération ; avec d’autres, comme le Brésil, nous sommes en train de travailler à la rédaction d’une convention de coopération ; avec d’autres, comme l’Azerbaïdjan, nous avons des relations intenses mais qui ne dépendent pas d’une convention ; enfin, avec d’autres pays, nous n’avons quasiment pas de retour ni de lien. Il y a donc différents niveaux de relation. L’Azerbaïdjan se situerait au niveau « 3 plus », c’est-à-dire qu’il n’est pas exclu de réfléchir à la rédaction d’une convention de partenariat. Mais pour le moment, une telle convention n’existe pas.
Vous m’avez également interrogé sur les règles nationales et internationales qui président à l’organisation de compétitions sportives, et en particulier sur les normes de calcul et de répartition de la charge financière.
S’agissant des Jeux européens, la compétition appartient au Comité olympique européen. Celui-ci était présidé par M. Patrick Hickey, un Irlandais qui a eu quelques difficultés cet été à Rio, puisqu’il a été impliqué dans une affaire de revente supposée de billets. J’ai appris qu’il sortait ce matin de sa prison du Brésil pour retourner dans son pays, et qu’une instruction judiciaire avait été ouverte à son encontre. Mais le Comité olympique européen n’en existe pas moins : c’est une structure qui réunit 49 comités sportifs olympiques nationaux reconnus par le CIO, dont le Comité national olympique et sportif français (CNOSF).
La décision de principe de la création des Jeux européens a été prise en 2012 à une très forte majorité. L’idée était de faire vivre l’olympisme en Europe – notamment les sports d’été – plus souvent que tous les quatre ans, avec une particularité : certains sports présents aux Jeux européens ne le sont pas aux Jeux olympiques. Je pense principalement au karaté, dont les athlètes ont concouru en 2015 à Bakou, alors que ce n’était pas encore un sport olympique.
J’en viens aux normes de calcul et de répartition correspondant à ces compétitions.
À Bakou, on a accueilli vingt sports, dont certains n’étaient pas des sports olympiques. Trente disciplines étaient représentées et 6 000 athlètes présents – contre 10 500 aux Jeux olympiques et 4 500 pour les Jeux paralympiques.
Les normes sont celles des fédérations européennes et internationales, comme pour toute compétition officielle, et la charge financière est supportée par le pays organisateur. À titre personnel, je n’ai pas d’information concernant la contribution qu’a versée ou qu’aurait pu verser le Comité olympique européen. Je pense que le président du CNOSF sera plus à même de vous répondre. Cela étant, le coût de ces jeux a été estimé à 1,25 milliard de dollars, dont près de la moitié pour le stade olympique. Je sais aussi que l’Azerbaïdjan a été très attentif à « l’héritage » des gros investissements. Ainsi, le village olympique, que j’ai eu l’occasion de visiter, a été transformé en logements qui ont été mis en accession à la propriété.
M. le président François Rochebloine. Est-ce que chacun des 49 pays membres du Comité olympique européen dispose d’une voix ?
M. le secrétaire d’État. Oui. Je précise que la décision de créer des Jeux européens et de choisir l’Azerbaïdjan a été prise à une majorité de 83 %.
M. le président François Rochebloine. Qui est le représentant français ?
M. le secrétaire d’État. Le président du CNOSF.
Quelles sont les modalités de l’information du ministère sur les transactions correspondantes, et du contrôle qu’il peut exercer sur ces transactions ? À ma connaissance, il n’y a pas d’information du ministère des sports sur les projets de rachat de clubs.
Le ministère des sports a-t-il été associé à l’organisation des Jeux européens de Bakou ? Non : comme je vous l’ai expliqué, c’est une décision qui a été prise par le Comité olympique européen.
Les Jeux européens ont-ils été un succès pour l’Azerbaïdjan ? Le pays a-t-il fait preuve de réelles capacités d’organisation ? Les retombées, économiques et en termes de notoriété, ont-elles été à la hauteur de l’investissement ?
Les Jeux européens ont été un grand succès pour l’Azerbaïdjan, qui a été salué par le CIO et par le Comité olympique européen. À titre personnel, j’ai trouvé qu’ils étaient bien organisés. Les sportifs qui ont participé à ces jeux ont d’ailleurs estimé qu’ils avaient atteint le niveau des Jeux olympiques en termes d’organisation. Cela pose même un problème au Comité olympique européen. En effet, la barre a été placée tellement haut par l’Azerbaïdjan, s’agissant de la qualité de l’organisation comme du volume des investissements réalisés, qu’à ce jour aucun pays ne s’est porté candidat pour de nouveaux Jeux européens. Je me souviens par exemple que la cérémonie d’ouverture n’était pas loin de valoir une cérémonie d’ouverture de Jeux olympiques, tant par le nombre de bénévoles que par la qualité de la représentation. C’était extrêmement impressionnant. Et pour votre information, la délégation française était l’une des plus importantes.
M. le président François Rochebloine. Dans quelles conditions les entreprises françaises en Azerbaïdjan auraient-elles apporté une participation au financement des jeux de Bakou ?
M. le secrétaire d’État. Je pense qu’elles ont plutôt gagné des marchés…
M. le président François Rochebloine Mais ont-elles concouru au financement de ces jeux ? Cela n’aurait d’ailleurs rien de choquant.
M. le secrétaire d’État. Parmi les partenaires officiels des jeux, je n’ai pas vu d’entreprises françaises – ni Total, ni Engie. Cela m’aurait tout de même interpellé. En revanche, je sais que l’on a contribué à faire en sorte que des entreprises françaises emportent des marchés. Certaines ont participé à l’organisation de ces Jeux européens, comme Iveco qui a fourni 300 autobus, Schneider Electric qui a assuré l’éclairage des stades, ou GL Events.
Venons-en au football et au cas du RC Lens. Ce dossier ne nous concerne pas, dans la mesure où il s’agit d’une société privée et d’un investisseur privé, qui veut racheter des parts sociales. Le Gouvernement n’a strictement rien à y voir. Si on commence à se mêler de cela, on se mêle de tout.
M. le président François Rochebloine. Mais il y a bien, de manière générale, des règles applicables aux investissements étrangers ?
M. le secrétaire d’État. Pas plus dans le sport qu’ailleurs.
M. le président François Rochebloine. Je ne parlais pas du RC Lens…
M. le secrétaire d’État. Il n’y a pas eu que le cas de l’Azerbaïdjanais Hafiz Mammadov. Nous avons vécu bien d’autres mauvaises aventures : des Japonais, qui avaient repris le FC Grenoble, sont partis sans coup férir, laissant ce club à l’abandon et la ville de Grenoble avec un stade tout neuf qui ne servait plus à rien ; un Roumain, qui avait voulu racheter l’Olympique de Marseille, est parti sans crier gare ; plus récemment, un Franco-Brésilien a voulu racheter le club du Havre, mais, finalement, il n’avait rien.
Pour éviter d’autres mésaventures, j’ai mis en place, il y a plus de huit mois, une grande conférence sur le sport professionnel. Il s’agissait de chercher les moyens d’assurer davantage d’éthique, de transparence, de régulation et de compétitivité au sport professionnel. Cette conférence a travaillé six mois et a rendu un rapport. De ce rapport est née une proposition de loi qui a été votée à l’unanimité au Sénat, et qui viendra le 12 janvier prochain devant l’Assemblée – qui, je l’espère, saura se mettre au niveau du Sénat.
Il se trouve que l’article 5 de cette proposition de loi autorise la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) à vérifier la qualité des investisseurs étrangers qui souhaitent venir en France, pour éviter les cas que je vous ai cités – celui de M. Mammadov, mais aussi celui des Japonais, du Roumain, etc. N’oublions pas non plus que les Chinois essaient de plus en plus souvent d’investir chez nous – par exemple, à Nancy et à Auxerre. L’idée est d’obtenir beaucoup plus d’informations sur les opérations qui auront lieu.
Voilà exactement ce que je pouvais dire sur l’affaire du RC Lens qui, incontestablement, était d’ordre purement privé. L’État azerbaïdjanais, qui disposait d’informations contradictoires, n’avait aucun lien direct a priori avec l’investisseur.
Enfin, les seules informations que le ministère pourrait avoir sur les fonds étrangers proviendraient de TRACFIN.
Les athlètes français étaient-ils mobilisés en nombre pour ces Jeux européens ? Oui. La France a rapporté 42 médailles, se classant à la sixième place.
Je précise que la France a contribué à l’organisation de cette compétition, mais pas en y envoyant directement des experts. Les experts européens qui sont intervenus dépendaient du Comité olympique européen.
Vous avez noté que Bakou avait finalement renoncé à se porter candidate pour l’organisation des Jeux olympiques de 2024. Selon moi, cette décision est uniquement liée à des difficultés économiques et à la baisse du prix du pétrole. En effet, les Azerbaïdjanais avaient les infrastructures qu’il fallait pour organiser ces jeux. Ils ont d’ailleurs organisé récemment un Grand Prix de Formule 1, le Grand Prix d’Europe.
M. le président François Rochebloine. Que signifie « Grand Prix d’Europe » ?
M. le secrétaire d’État. Là encore, il s’agit d’une organisation privée. En l’occurrence, le patron de la Formule 1, M. Bernie Ecclestone, confie chaque année un Grand Prix européen à un pays qui ne veut s’impliquer qu’une seule fois dans ce genre de compétition. En effet, l’habitude est de signer des conventions qui engagent les pays sur trois ou cinq ans. Cela veut dire que l’année prochaine, le Grand Prix d’Europe pourra avoir lieu dans un autre pays que l’Azerbaïdjan.
Le problème de M. Ecclestone est qu’il ne peut organiser chaque année qu’un nombre limité de Grands Prix et qu’il doit s’en tenir au calendrier prévu. Ce Grand Prix d’Europe lui assure une certaine souplesse.
L’Azerbaïdjan soutient-il la candidature de la France pour l’organisation des Jeux olympiques à Paris en 2024 ?
Premièrement, l’Azerbaïdjan n’a pas de représentant au CIO qui soit en passe de voter le 13 septembre 2017 à Lima.
Deuxièmement, jusqu’au 3 février, on ne peut annoncer quelque soutien officiel que ce soit. Le CIO a des règles. À partir du 6 février, on pourra éventuellement le faire. Je vous indique d’ailleurs que notre délégation repart aujourd’hui de Doha, où elle a fait sa présentation. Les échos que j’en ai eus sont extrêmement positifs.
Troisièmement, je ne sais pas quelles sont les relations de l’Azerbaïdjan avec les États-Unis ou avec la Hongrie. Mais en tout cas, avec la France, et en matière de diplomatie sportive, ces relations sont bonnes. Cela peut donc constituer un atout pour notre pays.
M. le président François Rochebloine. Pensez-vous que l’élection de M. Trump soit plutôt positive pour la France, s’agissant des Jeux olympiques de 2024 ?
M. le secrétaire d’État. Monsieur le président, je vais vous décevoir : les règles veulent que l’on ne commente pas les autres candidatures.
Enfin, monsieur le rapporteur, vous m’avez demandé comment la diplomatie sportive conduite par l’Azerbaïdjan était pilotée au sein du gouvernement et de la présidence azerbaïdjanaise.
Il est clair qu’il existe un lien direct avec la présidence. Que la « première dame » d’Azerbaïdjan ait été la présidente du comité d’organisation des Jeux européens n’a rien de fortuit. Quant au ministre des sports, il joue un rôle extrêmement important au sein du gouvernement.
M. le président François Rochebloine. J’aurai une dernière question à vous poser. Ces Jeux européens ont été un succès sur le plan sportif. Mais la population a-t-elle pu y assister librement ? Le prix des places était-il abordable pour tous ? On a vu au Brésil que la population n’avait pas répondu comme on l’aurait souhaité.
M. le secrétaire d’État. Pour avoir vécu les Jeux européens à Bakou et les Jeux olympiques et paralympiques à Rio, j’ai trouvé que la population azerbaïdjanaise avait été particulièrement bien associée aux Jeux. Comparativement, on a vu cet été à Rio que les salles de compétition n’étaient pas toujours combles. Ce n’était peut-être pas dû seulement à un manque d’intérêt pour la compétition, mais peut-être aussi à certains aspects de l’organisation des Jeux. Par exemple, je connais une famille lyonnaise qui voulait aller voir la joueuse de badminton française. Sur le site internet des Jeux, on lisait « Sold out ». Mais, le jour de la compétition, un siège sur deux était vide !
Pour la cérémonie d’ouverture et toutes les compétitions auxquelles j’ai assisté, les gens de Bakou étaient présents. C’était particulièrement net pour les sports où l’Azerbaïdjan avait des chances de médaille. Pour assister à la compétition de lutte, pour laquelle le pays nourrit une vraie passion, la salle était archicomble et il y avait une ambiance de feu ! D’ailleurs, si les sportifs qui ont participé à ces premiers Jeux européens en ont tiré un bon souvenir, c’est parce que la population y a participé. Moi-même, quand je me suis rendu à Bakou, j’ai vécu pleinement ces jeux.
Si vous souhaitez aller plus loin, je vous suggère d’en parler avec le chef de mission de la délégation française aux Jeux de Bakou, M. Alain Bertholom, président de la Fédération française de lutte. Il pourra témoigner, lui aussi, du fait qu’il n’y a eu aucun problème d’organisation sur place.
M. le président François Rochebloine. Dans quelques jours, nous allons auditionner M. Denis Masseglia, président du CNOSF.
Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie.
*
* *
Ÿ Audition de M. Arnaud Erbin, directeur international d’Engie, accompagné de M. Philippe Hochart, directeur de projet à la direction internationale, et de Mme Valérie Alain, directrice des relations institutionnelles (jeudi 17 novembre 2016)
M. le président François Rochebloine. Nous accueillons aujourd’hui, M. Arnaud Erbin, directeur international de GDF Suez, devenu Engie en juillet 2015, accompagné de M. Philippe Hochart, directeur de projet à la direction internationale, ainsi que de Mme Valérie Alain, directrice des relations institutionnelles. Merci d’avoir répondu favorablement à cette audition, car il était évidemment important, dans le cadre de cette mission d’information que nous puissions échanger avec vous.
Tout le monde sait à quel point la possession de très importantes réserves d’hydrocarbures assure à l’Azerbaïdjan, pour de longues années encore, d’amples ressources financières, même s’il est apparu, au cours de la période récente que l’économie du pays restait vulnérable, exposée à la baisse prolongée du cours des produits pétroliers sur le marché international.
Deux chiffres illustrent cet avenir. Les réserves du pays sont estimées à 7 milliards de barils équivalents pétrole et à plus de 1 200 milliards de mètres cubes de gaz naturel. La gestion de cette ressource est confiée pour l’essentiel à une société nationale, la SOCAR – State Oil Company of Azerbaijan Republic –, dont le capital est détenu en totalité par l’État. Plusieurs sociétés étrangères, dont Engie, interviennent dans l’exploitation des gisements, notamment des ressources offshore de la mer Caspienne.
Sans doute voudrez-vous nous indiquer dans quelles conditions juridiques Engie exerce cette activité de production et avec quels partenaires. Plus généralement, nous souhaiterions savoir quelles sont les règles applicables, selon la loi nationale de l’Azerbaïdjan, à l’implantation d’entreprises étrangères dans le secteur de la production de pétrole et de gaz naturel.
Votre société a signé avec le consortium azéri Shah Deniz, en 2013, un contrat à long terme pour la fourniture de gaz naturel portant sur des volumes annuels de quelque 2,6 milliards de mètres cubes. Vous nous préciserez sans doute quel est le lien de ce consortium avec l’État d’Azerbaïdjan, qui en détient le capital et quelles sont les conditions principales de ce contrat – durée, conditions financières et obligations des parties. Nous vous demanderons également, comme aux précédents responsables d’entreprises étrangères implantées en Azerbaïdjan, si les autorités auxquelles vous avez affaire émettent des exigences, des vœux, des suggestions, quant à l’éventuelle implication dans ces relations contractuelles d’entreprises azéries autres, cela va de soi, que la société nationale précitée.
Le but de la mission est d’examiner nos relations politiques et économiques avec l’Azerbaïdjan, au regard des objectifs français du développement de la paix et de la démocratie au Sud Caucase. Dans cette perspective, pouvez-vous nous dire dans quelle mesure l’instabilité politique et diplomatique de la région est susceptible d’avoir un effet sur vos activités industrielles qui, par nature, s’étendent sur le long terme ? Comment analysez-vous, dans le secteur des hydrocarbures où vous opérez, les intentions des principaux intervenants politiques que sont la Russie, les États de la région mais aussi les États-Unis ?
Si nous sommes intéressés par ce que vous pourrez nous dire de l’activité actuelle d’Engie en Azerbaïdjan, de ses contraintes et de ses perspectives de développement, nous aimerions également entendre votre analyse des effets, sur votre activité et sur celle des autres entreprises étrangères du secteur, de la situation politique et économique du pays et de son évolution récente qui ne va pas, vous en conviendrez, dans le sens d’une libéralisation politique.
Enfin, nous aimerions également que vous nous fournissiez des éléments d’appréciation sur la concurrence que peuvent éventuellement se livrer dans la région États ou sociétés étrangères dans le secteur de la production du gaz naturel. Le Gouvernement azéri a-t-il mis en place des procédures de mise en concurrence entre les différentes entreprises du secteur ?
M. Arnaud Erbin, directeur international d’Engie. C’est un honneur et une obligation pour une entreprise comme Engie de répondre présente lorsqu’une mission comme celle que vous présidez l’interpelle, et ce d’autant plus que l’Azerbaïdjan est stratégique pour une entreprise dont une part importante de l’activité se déploie dans le domaine du gaz.
Si l’Azerbaïdjan est stratégique, c’est non seulement du fait de ses très importantes réserves gazières mais également du fait de sa localisation géographique. Il a en effet permis d’ouvrir le corridor Sud, que l’Union européenne appelait de ses vœux et qui permet une diversification non seulement des sources mais également des routes d’approvisionnement – en l’occurrence via les gazoducs transanatolien (TANAP) et transadriatique (TAP) –, ce que toute entreprise telle qu’Engie, attachée à la fois à une saine concurrence et à la sécurité d’approvisionnement dans la durée, voit d’un œil extrêmement favorable.
Pour resituer la présence de notre groupe en Azerbaïdjan dans une perspective historique et stratégique, Engie est une entreprise de 155 000 collaborateurs, dont les deux tiers basés en France. Nous déployons notre activité dans soixante-dix pays, probablement le double si l’on compte les pays dans lesquels nous avons une activité d’ingénierie et des activités de service.
Nous sommes très actifs en matière de recherche et développement, l’accent étant mis de plus en plus, du fait de la révolution énergétique, sur les nouvelles technologies plutôt que sur les grands systèmes centralisés, comme c’était le cas auparavant. Cette orientation a naturellement un impact indirect sur la dimension de nos ambitions en Azerbaïdjan.
Sur la période 2016-2018, les investissements d’Engie se montent à 22 milliards d’euros – 7 milliards consacrés à la maintenance et 15 milliards au développement. C’est un montant considérable mais néanmoins en baisse par rapport à ce que le groupe investissait il y a quelques années, ce qui s’explique par les difficultés que traverse le secteur européen de l’énergie et qui touchent l’ensemble de nos confrères. En 2015, notre chiffre d’affaires était de 70 milliards d’euros.
Les activités d’Engie sont structurées autour de trois métiers. Le premier regroupe les services à l’énergie, représente 16 milliards d’euros de chiffre d’affaires et emploie près de 100 000 personnes. Regroupées dans des sociétés comme Engie Cofely et Engie Ineo, ce sont sans doute les activités les moins capitalistiques du groupe ; elles englobent tout ce qui a trait à l’efficacité énergétique, à la vente d’énergie, aux réseaux urbains de chaleur et de froid et à la gestion de nos clients, qui sont plus de vingt millions dans le monde. Bien que ce ne soit pas notre métier le plus connu, nous sommes néanmoins leader mondial dans le domaine : nous y tenons, car travailler dans l’énergie aujourd’hui, ce n’est plus seulement vendre de l’énergie mais également assurer les services qui vont avec.
Notre deuxième métier se déploie dans le secteur de l’électricité. Si notre renommée en la matière est moindre que celle d’une autre grande entreprise française, nous sommes néanmoins le premier producteur indépendant d’électricité dans le monde et le premier producteur d’éolien et de solaire en France. Au total, nous opérons avec une capacité de 117 gigawatts, soit à peu près l’équivalent de notre grand concurrent français, ce qui représente un peu plus que la capacité installée en France, sachant parallèlement que nous nous orientons de plus en plus vers les énergies renouvelables.
Notre troisième métier, celui qui intéresse le plus votre mission d’information, s’opère dans le secteur du gaz naturel, sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’exploration à la production – c’est le cas, par exemple en Azerbaïdjan, où nous avons une participation dans le champ de la presqu’île d’Apchéron. Nous sommes présents dans le stockage, le transport, la distribution, les terminaux méthaniers, le gaz naturel liquéfié (GNL) et, bien sûr, dans l’approvisionnement, c’est-à-dire qu’indépendamment du fait que nous produisions du gaz et du pétrole, nous signons également des contrats d’approvisionnement en gaz et en GNL.
Concernant ce dernier point, le groupe croit depuis longtemps, en effet, que le marché du GLN est amené à se développer plus rapidement que le marché du gaz dans son ensemble et plus rapidement que la consommation globale d’énergie, ce qui va entraîner une évolution majeure du secteur et constitue un facteur déterminant de notre stratégie en Azerbaïdjan.
Tandis qu’autrefois le monde gazier était un monde de gazoducs, la part du GNL a tendance à s’accroître et ses producteurs sont de plus en plus nombreux, que ce soient les États-Unis avec le gaz de schiste (shale gas), le Qatar ou l’Australie, qui accroissent leurs capacités. Pour une entreprise comme la nôtre, essentiellement active sur l’aval ou le milieu de la chaîne de valeur, c’est une situation favorable, puisqu’elle génère un surcroît d’offre, donc un surcroît de compétition, ce qui nous permet de négocier les prix. Plus globalement d’ailleurs, on constate une évolution des prix du pétrole et du gaz plutôt à la baisse.
Le développement du GNL a en outre un deuxième effet, dans la mesure où il tend à créer un marché mondial du gaz, alors qu’historiquement on parlait plutôt de marchés régionaux organisés autour de prix différents : ainsi, alors qu’il y a quelques années, les prix du marché européen étaient deux fois ceux du marché américain, et ceux du marché asiatique deux fois ceux du marché européen, on assiste aujourd’hui, grâce au GNL, à un rééquilibrage et à une homogénéisation des prix.
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. Dans la mesure où les infrastructures nécessaires à l’exploitation du GNL requièrent un amortissement de long terme, je suppose que la contractualisation entre les pays producteurs et les opérateurs s’en trouve modifiée et que sont privilégiés les accords de long terme ?
M. Arnaud Erbin. Vous avez raison mais, en vérité, l’industrie gazière traditionnelle a construit ses infrastructures gazières en s’appuyant sur des contrats d’approvisionnement à long terme ; c’est notamment vrai pour la Russie, mais également pour l’Algérie, qui approvisionne une chaîne de GNL, avec des terminaux de liquéfaction, du transport par méthanier et des terminaux de regazéification en France. Dans les deux cas donc, le financement des infrastructures s’appuie sur des contrats de long terme. Aux États-Unis par exemple, où l’exploitation du gaz de schiste se développe beaucoup, les usines de liquéfaction du gaz qui vont permettre l’exportation du GNL sont financées par des contrats de ventes à long terme.
M. le rapporteur. J’imagine que ces relations commerciales nouées sur le long terme nécessitent d’avoir une vision assez stable du prix du gaz.
M. Arnaud Erbin. Oui et non. En réalité, la tendance est aujourd’hui au développement d’un marché spot. Dans un contexte de surcroît d’offre par rapport à la demande, on voit se développer des marchés structurés autour de hubs gaziers, qui fixent un prix de marché – c’est le cas pour la totalité du gaz aux États-Unis avec Henry Hub, et c’est de plus en plus le cas en Europe, où l’on a un mix de prix de marché et de prix indexés sur le pétrole. Même les producteurs traditionnels comme la Russie, la Norvège ou les Pays-Bas, qui étaient très récalcitrants face à ce système, ont fini par renoncer à l’indexation des prix sur le pétrole pour se rallier à des formules d’indexation sur les prix du marché et les prix des hubs. Le dernier pays actuellement à résister est l’Algérie.
Le contrat d’approvisionnement avec l’Azerbaïdjan, qui porte sur 2,6 milliards de mètres cubes par an, a une clause d’indexation marché.
M. le président François Rochebloine. Est-ce vous qui l’avez définie ?
M. Philippe Hochart. Cela s’est fait dans le cadre des négociations entre le vendeur et les acheteurs – car nous n’étions pas les seuls. Nous avons fait valoir les modalités de fixation du prix du gaz en Europe.
M. le président François Rochebloine. Ma question n’est pas innocente, mais quel était votre principal concurrent lorsque vous avez remporté le marché azéri ?
M. Philippe Hochart. Deux projets étaient en concurrence : le gazoduc Nabucco, qui devait, à partir de la Turquie, alimenter les pays d’Europe centrale jusqu’en Autriche, pays qui est également l’un des points d’arrivée du gaz russe ; une voie passant plus au Sud, par la Grèce et l’Italie, les entreprises derrière chaque projet défendant l’un ou l’autre essentiellement en fonction de leurs propres débouchés.
M. le président François Rochebloine. Le pouvoir politique, français ou azeri, a-t-il joué un rôle dans l’attribution du marché ?
M. Philippe Hochart. Peut-on vraiment parler d’attribution de marché ? Il s’agit surtout d’un choix économique et commercial fait par le consortium de vente qui réunit, BP, l’opérateur du gisement de Shah Deniz, Total, Statoil, la SOCAR et d’autres compagnies régionales comme l’iranienne NICO ou la TPAO turque.
Leur choix s’est surtout fondé sur des critères économiques, notamment en ce qui concerne le transport qui représente un poste d’investissement considérable – de l’ordre de 15 à 20 milliards de dollars. Pour des raisons où entraient sans doute davantage de motifs en lien avec l’intérêt général, l’Union européenne et les États-Unis soutenaient le projet Nabucco.
M. le président François Rochebloine. Qu’est-ce qui vous a permis de remporter ce marché ?
M. Philippe Hochart. Il faut distinguer le choix des routes de celui des acheteurs. Néanmoins, l’un et l’autre sont liés car le choix des routes d’acheminement du gaz est lié aux marchés potentiels dont elles se rapprochent. Il s’agit de marchés de long terme, qui exigent donc de la confiance dans la solidité de la demande. C’est ce qui a guidé le choix qui a été fait, en plus de la confiance dans le projet de transport lui-même.
M. le rapporteur. Où est fixé le prix du marché ?
M. Arnaud Erbin. En l’occurrence, c’est un prix de marché européen, plus précisément d’Europe du Sud, puisque le gaz arrivera par là.
Pour remettre en perspective ce que dit Philippe Hochart, il faut savoir que l’Azerbaïdjan a ouvert son secteur des hydrocarbures aux entreprises internationales, au premier rang desquelles BP, qui s’y trouve en position dominante. Au regard de cette situation, on peut donc considérer que le fait qu’Engie et Total soient parvenus à s’implanter en Azerbaïdjan, est très positif en termes d’influence de la France dans la région, a fortiori si l’on considère que l’ouverture du corridor Sud est une donnée géopolitique essentielle.
Les projets comme Shah Deniz ou Apchéron sont développés par des consortiums, dont font partie des investisseurs privés qui raisonnent en termes économiques. Ils considèrent avant tout les investissements nécessaires au développement des champs et vont chercher, pour les financer, les contrats de long terme qui leur paraissent les plus avantageux. Ce qui signifie que notre offre a dû leur paraître compétitive et que, par ailleurs, elle comportait des garanties satisfaisantes pour ce qui concernait la liquidité du marché et les risques encourus.
M. le président François Rochebloine. Quel est le lien entre l’État d’Azerbaïdjan et le consortium dont vous venez de faire état ?
M. Philippe Hochart. L’État d’Azerbaïdjan n’est pas présent directement dans le consortium : il y est représenté par la SOCAR.
M. le président François Rochebloine. Mais la SOCAR c’est l’Azerbaïdjan !
M. Philippe Hochart. Oui, si l’on considère que Gaz de France, c’était la France, puisqu’il y a quinze ans encore c’était une société nationale, détenue à 100 % par l’État.
M. le président François Rochebloine. C’est donc la SOCAR qui détient le capital du consortium ?
M. Philippe Hochart. Sa participation est de l’ordre de 20 % ; les opérateurs majoritaires sont les sociétés occidentales.
M. le président François Rochebloine. Le contrat a été conclu pour une durée de vingt-cinq ans, c’est bien cela ?
M. Arnaud Erbin. Oui, avec première livraison prévue vers 2020.
M. le président François Rochebloine. Je suppose qu’on a dû vous imposer certaines exigences ?
M. Arnaud Erbin. Nous sommes dans le cadre d’une négociation commerciale. Néanmoins, vous devez savoir que, très sincèrement, pour une entreprise comme la nôtre, les risques éthiques et tout ce qui peut nuire à notre image en la matière, sont probablement parmi les rares risques mortels. Notre gouvernance est donc extrêmement solide sur ce point, et un comité du conseil d’administration, spécifiquement dédié à ces questions-là, supervise toutes les procédures mises en place. Lorsqu’ils existent, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, tous les contrats d’intermédiaires sont revus, de façon à éviter la corruption.
M. Philippe Hochart. Par ailleurs, il faut savoir que deux types de négociations se mènent en parallèle. Les premières, auxquelles nous sommes partie, opposent les acheteurs et le vendeur, c’est-à-dire le consortium et portent sur l’achat et la vente du gaz. Les secondes, auxquelles nous ne participons pas, se déroulent au sein du consortium de production et concernent la stratégie de développement du gisement – et là-dessus, Total pourra vous en dire davantage.
Pour notre part, nous étions face au consortium, dirigé par BP et dans lequel les arbitrages commerciaux sont faits par BP, Statoil, Total et SOCAR. Chacun a fait valoir ses intérêts.
M. Arnaud Erbin. Pour en revenir à Engie, notre portefeuille d’approvisionnement à long terme, c’est-à-dire sur 20 à 25 ans, est composé à 26 % d’achat de gaz en provenance de Norvège, à 20 % de Russie, à 15 % d’Algérie et à 11 % des Pays-Bas, pour ne mentionner que nos fournisseurs les plus importants. Ce portefeuille représente au total 554 térawattheures, soit 50 milliards de mètres cubes, ce qui équivaut à un peu plus que la consommation française annuelle.
Diversifier ainsi nos fournisseurs, est une manière de garantir la sécurité de notre approvisionnement et de favoriser une saine concurrence entre ces fournisseurs. À cet égard, l’arrivée d’un nouveau venu comme l’Azerbaïdjan est essentielle, tout comme l’est l’ouverture d’une nouvelle route.
M. le rapporteur. Que représentera en quantité l’achat de gaz azéri ?
M. Arnaud Erbin. Environ 5 % de notre portefeuille de long terme. En réalité, au-delà de l’importance de notre gros contrat d’approvisionnement avec le consortium de Shah Deniz, l’autre intérêt de l’Azerbaïdjan pour Engie, réside dans notre participation au projet d’Apchéron, où, cette fois-ci, nous intervenons en amont, c’est-à-dire au stade de l’exploration et de la production, aux côtés de la SOCAR – assez incontournable, il faut le dire, dans le pays – et de Total. Nous sommes partenaire à hauteur de 20 %, Total étant l’opérateur avec 40 %, la SOCAR détenant elle aussi 40 %.
Nous nous sommes lancés dans l’exploration et la production à une époque où le marché du gaz était assez différent de ce qu’il est aujourd’hui et où il était plutôt difficile de trouver des sources d’approvisionnement : il était donc important de gagner en crédibilité à la fois vis-à-vis des grands clients et des majors pétrolières, et nous avons pour cela développé une activité assez significative dans ce domaine. Elle représente un dixième de celle de Total, sachant que c’est nous comparer à l’une des plus grandes sociétés mondiales. Nous disposons de 700 millions de barils en réserve et produisons 60 millions de barils par an, ce qui équivaut aux deux tiers de la production mondiale quotidienne, qui est de l’ordre de 92 millions de barils par jour – Total, pour sa part, produit chaque année l’équivalent de sept jours de la production mondiale –, ce qui nous situe au rang des compagnies indépendantes telles que celles qui existent notamment aux États-Unis.
Enfin, le gaz et le pétrole que nous produisons ne sont pas destinés à l’approvisionnement de la France et ne sont pas non plus intégrés à notre portefeuille ; pour l’essentiel, nous le vendons sur le marché, aux prix du marché.
M. le président François Rochebloine. Avez-vous des contrats d’achat de gaz en Russie ?
M. Arnaud Erbin. Bien sûr. Ce sont les 20 % que j’ai mentionnés dans notre portefeuille d’approvisionnement. Ce sont des contrats historiques, et nous avons fêté cette année quarante ans d’amitié avec Gazprom.
M. le rapporteur. Vous parliez tout à l’heure d’une modification dans la structure des prix et de la tendance à une harmonisation mondiale : comment se situent aujourd’hui le prix du gaz russe et le prix du gaz norvégien, par rapport au gaz d’Azerbaïdjan ?
M. Arnaud Erbin. Je parlais d’harmonisation des prix de marché. Les prix d’approvisionnement varient, eux, d’un contrat à l’autre : si vous cherchez à vendre du gaz, que vous l’écouliez sur le marché asiatique, européen, ou américain, le prix sera le même ; en tant que fournisseur, le prix du gaz que vous achetez varie en fonction des contrats. Tout cela est assez compliqué et relève du « sur-mesure ».
M. le rapporteur. Dans les négociations d’approvisionnement, la tendance est-elle plutôt à la hausse ou à la baisse ?
M. Arnaud Erbin. À la baisse. On s’attend à ce que, pour une dizaine d’années encore, l’offre excède la demande sur le marché gazier, du fait de la production massive de GNL.
M. le président François Rochebloine. Aviez-vous prévu cette évolution ?
M. Arnaud Erbin. Personne ne l’avait véritablement prévue. Un titre fameux de l’Agence internationale de l’énergie, ne se référait-il pas à « l’âge d’or du gaz » il y a deux ans, quelques mois avant que les cours du gaz aient commencé leur chute ?
Il faut savoir qu’historiquement, le marché du gaz est assez cyclique. S’ajoutent actuellement des facteurs conjoncturels, la crise, une croissance en berne, et surtout une consommation chinoise très inférieure aux prévisions et à ce sur quoi l’on misait. Nous vendons certes du gaz naturel liquéfié à la Chine, mais les projections que nous faisons aujourd’hui n’ont rien à voir avec celles que l’on faisait il y a deux ans.
M. le président François Rochebloine. Pensez-vous que cette évolution puisse avoir des incidences politiques ?
M. Arnaud Erbin. Bien sûr, mais ce dont il faut se préoccuper avant tout en ce qui concerne le monde de l’énergie, comme le souligne Isabelle Kocher, notre nouveau directeur général, c’est de la révolution énergétique à l’œuvre. Ce n’est pas exactement pour demain, mais l’on va passer d’un monde de grandes installations centralisées à un monde décentralisé de petites installations dédiées à la production solaire ou éolienne. Cela va avoir pour conséquence de diminuer l’importance des gros contrats d’approvisionnement et de réduire les liens de dépendance entre pays consommateurs et pays producteurs. C’est confirmé par l’Agence internationale de l’énergie, qui a rendu aujourd’hui son rapport annuel, World Energy Outlook, dans laquelle elle met en exergue le développement rapide de l’éolien et du solaire, qui, d’ici à quelques années, mettront un terme à la prépondérance des énergies fossiles.
Cela étant dit, pourquoi l’Azerbaïdjan ? Parce qu’Engie estime que la place du gaz dans le bouquet énergétique européen est amenée à croître, ou, en tout cas, à rester significative. Or, si l’on regarde une carte des réserves gazières situées à proximité de l’Europe, se détachent deux grandes sources qui sont d’ailleurs les plus compétitives en termes de prix : d’une part, la Russie, et, d’autre part, une zone qui s’étend autour de la Caspienne et qui comprend l’Azerbaïdjan, le Turkménistan et l’Iran, qui, jusque très récemment, était fermé.
M. le président François Rochebloine. Finalement, les réserves de l’Azerbaïdjan sont minimes par rapport à celles du Turkménistan et de l’Iran.
M. Arnaud Erbin. Le Turkménistan a un tropisme chinois : il envoie son gaz en Chine.
M. le président François Rochebloine. Les réserves de l’Azerbaïdjan sont comparables à celles de l’Ouzbékistan.
M. Philippe Hochart. Ou des Pays-Bas à l’époque où ces derniers ont commencé à alimenter significativement l’Europe en gaz. Les Pays-Bas ont été, avec Lacq – qui jouait toutefois un rôle assez marginal –, à l’origine du développement du gaz en Europe dans les années 1960 : ils se sont fournis eux-mêmes et ont fourni l’Allemagne, l’Italie, la France et la Belgique. De manière un peu analogue, l’Azerbaïdjan ouvre une nouvelle route. Cela commence par un pays qui est en situation de le faire, après quoi les « gros » suivent : c’était le cas de l’URSS jadis, et la Russie a suivi.
M. Arnaud Erbin. C’est cette nouvelle route qui explique que nous nous intéressions à l’Azerbaïdjan. Elle peut comporter des confluences : pour Engie – comme, j’imagine, pour Total –, le fait d’être présent en Azerbaïdjan permet de se trouver autour de la table lorsque les ressources de la mer Caspienne en général sont en jeu. Si nous sommes en Azerbaïdjan, les Iraniens et les Turkmènes le savent, des accords de swap (d’échange) peuvent être passés, etc.
J’en viens aux gazoducs situés autour de la mer Caspienne. Il convient ici de souligner l’importance du rôle de la Turquie, puisque le gaz d’Azerbaïdjan passe par les gazoducs TANAP et TAP. Cela nous intéresse aussi, car Engie a dans ce pays une activité de distribution de gaz. La Turquie est elle-même une grande consommatrice de gaz et souhaite diversifier sa route d’approvisionnement. Notre présence en Azerbaïdjan nous fournit donc un sujet de conversation intéressant et encourageant avec les Turcs. Par ailleurs, l’Italie, où débouche le gazoduc TANAP-TAP, est aussi un marché important pour Engie. Nous y sommes présents et nous y avons des clients.
Enfin, le tracé du corridor gazier Sud témoigne des liens entre la Turquie et l’Iran et du fait que cette route sud peut voir confluer différentes ressources à terme.
M. le rapporteur. La Turquie joue ici un rôle essentiel.
M. Arnaud Erbin. Oui, comme pays de transit et comme pays consommateur. On ne le sait pas toujours, mais c’est l’un des premiers acheteurs de gaz, avant la France.
M. Philippe Hochart. Le marché turc est aujourd’hui comparable au marché français alors qu’il n’en représentait que 10 % il y a quinze ans.
M. le président François Rochebloine. Les événements politiques actuels en Turquie vous posent-ils des problèmes ?
M. Arnaud Erbin. Nous y sommes attentifs, car nous préférons opérer dans des pays où l’État de droit est en vigueur.
Le gaz de Shah Deniz représentera 16 milliards de mètres cubes par an lorsque son plateau de production aura été atteint, dont 6 destinés à la Turquie et 10 à l’Europe de l’Ouest. Avec 2,5 milliards, soit un quart du total destiné à l’Europe occidentale, nous sommes le premier racheteur de cette région.
M. le rapporteur. Achetez-vous le gaz à l’arrivée ou au départ ?
M. Philippe Hochart. À l’arrivée, livré.
M. Arnaud Erbin. En Italie.
M. le rapporteur. Dès lors, les éventuels problèmes qui peuvent se produire avant cette étape sont sans conséquence.
M. Philippe Hochart. Ils peuvent en avoir sur les livraisons, mais en tout cas nous ne sommes pas impliqués, nous n’avons pas d’investissements ni de capitaux en jeu dans les gazoducs TANAP et TAP.
M. Arnaud Erbin. Un problème peut se poser si le gaz que nous avions prévu de vendre ne nous est pas livré. Mais c’est une autre affaire.
Je conclurai sur la stratégie actuelle d’Engie, qui n’est pas sans rapport avec l’Azerbaïdjan. Le groupe a décidé assez récemment de trois axes clairs de développement.
Premièrement, dans le domaine de l’électricité qui ne nous concerne pas aujourd’hui, aller vers une production moins émettrice de CO2.
Deuxièmement, réduire notre exposition au prix des commodités, donc du pétrole. À ce titre, le groupe a annoncé qu’il cesserait son activité d’exploration et de production. Cela concerne la participation que nous détenons dans Apchéron aux côtés de Total et de la SOCAR – même si, je le répète, nous n’y sommes pas opérateurs. Cette activité a vocation à sortir à plus ou moins brève échéance du périmètre d’intervention du groupe. Engie n’est d’ailleurs plus présent physiquement en Azerbaïdjan, les contrats d’achat de gaz ne le nécessitant pas : nous avons fermé l’an dernier le bureau que nous avions ouvert en 2009 en prenant une participation dans Apchéron.
Le troisième axe de développement est donc l’aval.
En conséquence, le groupe prévoit d’investir 22 milliards d’euros au cours des trois prochaines années et de vendre 15 milliards d’actifs pour financer ces investissements, dont l’activité d’exploration et de production, dite E & P.
Voilà pour le contexte historique et stratégique de notre position en Azerbaïdjan. J’espère avoir répondu au moins en partie à certaines de vos questions.
M. le président François Rochebloine. Je note que vous n’êtes pas présents en Azerbaïdjan : vous négociez, après quoi vous n’êtes plus concernés.
M. Arnaud Erbin. De fait, nous n’y sommes pas présents physiquement. Pour tout vous dire, nous avons essayé de l’être, mais pour différentes raisons, y compris celles que vous évoquiez dans votre propos liminaire, nous n’avons pas donné suite. Nous avons étudié les possibilités d’y développer nos autres métiers, mais nous ne l’avons pas fait.
M. le rapporteur. Merci de votre exposé, qui a répondu par anticipation à plusieurs des nombreuses questions que j’avais à vous poser.
D’après une étude réalisée en juin 2015 par l’Oxford Institute for Energy Studies, la production de gaz naturel par l’Azerbaïdjan devrait doubler d’ici aux années 2020 et encore augmenter par la suite. Allez-vous accroître proportionnellement vos achats, ou leur niveau est-il fixé une fois pour toutes par le contrat que vous avez signé ?
Quelles sont les conséquences de la chute des prix des hydrocarbures sur les perspectives de développement de votre société et de l’Azerbaïdjan lui-même ? Ce renversement de conjoncture vous a-t-il conduits à reporter ou à redimensionner vos projets d’investissement ? Quel serait, selon vous, l’avenir du pays si la chute des cours devait se prolonger encore plusieurs années ?
Plusieurs des personnes que nous avons entendues nous ont indiqué que les relations bilatérales entre la France et l’Azerbaïdjan, concrétisées notamment par la visite du Président de la République sur place, avaient joué un rôle déterminant dans la négociation des contrats. Était-ce le cas pour votre société, ou bien les négociations en sont-elles restées à la dimension commerciale traditionnelle ?
M. Arnaud Erbin. Avons-nous l’intention d’accroître nos achats ? Nous avons commencé à négocier le contrat Shah Deniz en 2006 ; nous sommes entrés dans le projet Apchéron en 2009. À l’époque, le monde des hydrocarbures était complètement différent de ce qu’il est aujourd’hui : le prix du pétrole était élevé et, sur le marché du gaz, c’étaient les vendeurs qui dictaient leur loi, alors qu’il s’agit plutôt, actuellement, d’un marché d’acheteurs. Si nous cherchons toujours à diversifier notre approvisionnement, ce n’est donc pas notre priorité absolue.
Par ailleurs, il convient d’être prudent s’agissant de ce type de projections, qui sous-entendent que des investissements seront réalisés alors que – c’est votre deuxième question – les prix des hydrocarbures ont évidemment un effet direct sur les activités d’exploration et de production ainsi que sur les investissements. En outre, l’Azerbaïdjan, comme d’ailleurs l’Iran, réinjecte une bonne partie de son gaz dans les puits pétroliers pour contribuer à la production pétrolière. Cet élément doit être pris en considération par les entreprises qui, comme la nôtre, cherchent à acheminer du gaz vers l’Europe et rencontrent alors une forme de concurrence. La Turquie peut également représenter un débouché assez facile pour le gaz en provenance d’Azerbaïdjan.
Aujourd’hui, il n’est pas dans nos intentions de développer massivement nos contrats d’approvisionnement en gaz, car il est facile de trouver du gaz spot à des prix intéressants.
Pour en revenir à la chute des cours, nous l’avons vécue en direct dans le cadre de notre projet Apchéron. Alors que nous en sommes à la phase de définition de ce que l’on appelle le projet de développement, nous avons dû redimensionner le projet pour tenir compte des moindres revenus à attendre du pétrole, étant donné les prix actuels.
En ce qui concerne votre question sur les contrats, la visite d’un Président de la République est toujours une bonne nouvelle, car elle permet d’accélérer la réalisation d’un projet, de souligner la qualité de la relation bilatérale, etc. Pour nous, cela a-t-il été déterminant ?
M. Philippe Hochart. Cela crée un contexte favorable, mais nos arguments sont strictement gaziers.
M. le rapporteur. Autrement dit, aucun élément politique n’entre dans la signature des contrats ?
M. Arnaud Erbin. Honnêtement, non. Les raisons sont vraiment économiques. Ce qui intéresse les acteurs, c’est l’investissement : combien investir, combien l’on peut espérer en tirer, etc. Il s’agit d’un consortium avec des sociétés internationales.
M. le président François Rochebloine. Dans le rapport particulier qu’il a consacré à l’Azerbaïdjan et qui a été publié le 3 juin 2015, le groupe de travail de l’Organisation des Nations unies sur la question des droits de l’Homme et des sociétés transnationales et autres entreprises déclare avoir noté, à l’occasion de ses réunions avec les responsables de la SOCAR, un faible niveau de compréhension des responsabilités propres de cette société à l’égard des droits de l’Homme. Partagez-vous cette analyse ?
Tout en reconnaissant que les pouvoirs publics azerbaïdjanais ont pris plusieurs initiatives formelles, notamment par la voie législative, pour définir des règles de lutte contre la corruption, bon nombre d’observateurs internationaux mettent en cause le caractère largement nominal de cet effort, au regard des pratiques qu’ils constatent. Le guide « Les pratiques de l’éthique » que votre groupe a publié exprime votre adhésion aux instruments internationaux de lutte contre la corruption. De ce point de vue, quelle est votre appréciation de la situation en Azerbaïdjan ?
Le même guide recommande d’entretenir « un dialogue et un partenariat avec des organisations non gouvernementales (ONG) des secteurs environnementaux et humanitaires ». Cette recommandation est-elle mise en pratique en Azerbaïdjan ? Si oui, avec quelles ONG êtes-vous en relations, et pour mener quelles actions ?
Enfin, certains groupes européens concurrents appartenant à votre secteur se sont fait « toquer » par la justice pour commissionnement occulte dans certains pays de la Communauté des États indépendants (CEI). Comment votre groupe résiste-t-il – je ne doute pas qu’il le fasse – aux sollicitations de ce type dans un pays comme l’Azerbaïdjan ? La question peut également se poser ailleurs.
M. Arnaud Erbin. Les préoccupations de notre groupe en matière d’éthique s’expriment non seulement dans le guide que vous avez cité, mais également, je l’ai rappelé, dans notre gouvernance elle-même : nous avons au sein de notre conseil d’administration – ce n’est pas le cas de tous les groupes du CAC40 – un comité éthique qui revoit régulièrement les procédures utilisées par le groupe afin d’éviter à celui-ci d’être exposé aux risques de corruption, de non-respect des droits de l’Homme, etc. Le contrôle et la vérification concernent aussi les intermédiaires et les contreparties.
Nous ne sommes pas présents en Azerbaïdjan, puisque c’est Total et non Engie qui est opérateur à Apchéron.
M. le président François Rochebloine. Total est-il plus concerné que vous ?
M. Arnaud Erbin. Je veux simplement dire que c’est Total qui est opérateur, qui est représenté sur le terrain. Mais Total a ses propres procédures. En outre, dans cet univers, il n’y a guère d’intermédiaires : nous avons en face de nous la société d’État, la SOCAR.
Quant à ce qui se passe dans le pays, nous aurions des choses à en dire, mais en tant que citoyens.
M. Philippe Hochart. Nous n’en savons pas plus que ce que l’on peut lire dans les journaux ou dans les rapports.
M. le président François Rochebloine. J’apprécie les réponses que vous nous avez apportées jusqu’à présent, mais je comprends évidemment que vous ne puissiez pas nous dire certaines choses…
M. Arnaud Erbin. Le groupe considère vraiment que le risque éthique et de réputation est l’un des seuls qui puissent le détruire, et le prend donc très au sérieux. En pratique, notre réponse se situe au niveau de la gouvernance, avec ce comité du conseil d’administration qui veille au respect d’un certain nombre de règles. L’Azerbaïdjan n’est certainement pas le pays où l’on respecte le plus les droits de l’Homme – à l’instar d’autres grands partenaires commerciaux de la France…
M. Philippe Hochart. Les ressources naturelles sont malheureusement situées dans ce type de pays… La Norvège fait exception, de même que les Pays-Bas.
M. le président François Rochebloine. Merci de votre franchise.
M. François Pupponi. Comment procédez-vous dans un pays où les droits de l’Homme ne sont pas respectés, un pays en guerre, qui plus est ? L’Azerbaïdjan est en conflit armé avec l’Arménie depuis de nombreuses années, et, dans ce cadre, des événements graves ont eu lieu au printemps dernier. Comment vivez-vous cette situation ?
Une émission d’Élise Lucet a mis en cause plusieurs groupes français, dont le vôtre, je crois, à propos du versement de commissions et rétrocommissions. Avez-vous porté plainte ?
M. Arnaud Erbin. À ma connaissance non, mais je ne vois pas très précisément ce à quoi vous faites référence.
M. François Pupponi. De mémoire, il était question de lobbying, assorti de rémunérations, en vue d’obtenir des marchés, et de rétrocommissions. C’est ce qui ressortait de l’émission ; je ne dis pas que c’est vrai. Je voulais simplement savoir si les groupes mis en cause avaient porté plainte.
M. Arnaud Erbin. Pas que je sache, dans notre cas. Mais nous allons vérifier.
M. le président François Rochebloine. Merci de nous le confirmer, pour notre rapport.
Mme Valérie Alain, directrice des relations institutionnelles. Bien sûr.
M. Arnaud Erbin. Notre groupe est en ce moment même en mission pour quatre jours en Arménie, où il va rencontrer l’ensemble du Gouvernement. Cela ne concerne pas le gaz, puisque l’Arménie n’en a pas, mais d’autres domaines d’activité que nous cherchons à développer.
M. le président François Rochebloine. Lesquels ?
M. Arnaud Erbin. Le solaire, les énergies renouvelables en général, les prestations d’ingénierie hydroélectrique.
Pour le reste, je ne peux que vous répéter ce que je vous ai déjà dit : nous sommes très attentifs à ces questions et nous ne transigeons pas avec elles. C’est le discours invariant de Gérard Mestrallet et d’Isabelle Kocher : zéro tolérance en matière d’éthique.
M. le président François Rochebloine. J’aimerais revenir sur la question posée par François Pupponi. Vous dites qu’a priori vous n’avez pas porté plainte. Pour ma part, je ne porte aucun jugement ; mais une émission a été diffusée au cours de laquelle certains propos ont été tenus, suffisamment graves pour que l’on doive savoir ce qu’il en est. Sinon, le soupçon pourrait subsister, et ce serait pire que tout. Si les mises en cause sont infondées, il faut les dénoncer.
M. Arnaud Erbin. En matière de communication, nous préférons parfois ne pas répondre à certaines invectives.
M. le président François Rochebloine. Nous aurons l’occasion d’en reparler. Madame, messieurs, je vous remercie.
*
* *
Ÿ Audition de M. Michael Borrell, directeur Europe et Asie centrale de l’exploration et de la production de Total (mercredi 23 novembre 2016)
M. le président François Rochebloine. Nous avons le plaisir de recevoir M. Michael Borell, directeur Europe et Asie centrale de l’exploration et de la production de Total SA, accompagné de ses collègues M. Thierry Darrigrand, délégué pays pour le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan et le Tadjikistan, et M. François Nahan, directeur des relations institutionnelles pour la France.
Nous avons déjà entendu plusieurs responsables de grandes entreprises qui interviennent en Azerbaïdjan, comme Alstom et Engie. Dès le début de nos travaux, le ministère des affaires étrangères a attiré notre attention sur l’importance du développement des relations économiques entre les entreprises de nos deux pays, non seulement pour des raisons commerciales, mais aussi parce que la contribution que ces relations sont susceptibles d’apporter à la prospérité économique du pays pourrait favoriser la libéralisation du régime et de la société, qui connaît encore des hauts et des bas, pour dire le moins.
Je vous propose donc, monsieur le directeur, de détailler les activités de Total en Azerbaïdjan, l’histoire de votre implantation, les accords sur lesquels elle se fonde depuis l’origine et la nature de vos activités de production dans ce pays, ainsi que le cadre juridique local dans lequel s’inscrit votre présence sur place, en particulier vos relations avec la société d’État SOCAR.
Total n’est pas la seule entreprise pétrolière étrangère qui intervient en Azerbaïdjan. Comment s’organisent les relations avec vos voisins, qui sont aussi vos concurrents ?
J’ai relevé dans le Guide de l’intégrité que vous publiez sur votre site une affirmation forte à laquelle je souscris : « La corruption détruit la confiance, socle de l’économie et de la vie en société ». S’ensuit une liste de lignes de conduite contre la corruption. Il est de notoriété publique que la corruption constitue un risque non négligeable dans la vie concrète des activités économiques de nombreux pays de la zone. Qu’en est-il en Azerbaïdjan selon l’expérience de votre entreprise et de ses collaborateurs ?
M. Michael Borrell, directeur Europe et Asie centrale de l’exploration et de la production de Total. Permettez-moi de commencer par me présenter brièvement : citoyen britannique, je travaille dans le groupe Total depuis trente ans et je m’occupe actuellement de l’Europe et de l’Asie centrale – autrement dit la mer du Nord, principalement, ainsi que la France, l’Italie et la Bulgarie en Europe continentale et, en Asie centrale, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Tadjikistan, ainsi que la Russie au Nord.
Il se trouve que l’Azerbaïdjan est un pays important pour le secteur du pétrole et du gaz puisque c’est le berceau de notre industrie : c’est là qu’a été découvert en 1848 le premier champ de pétrole au monde, Bibi-Heybat, dix ans avant les premières découvertes aux États-Unis. En 1900, l’Azerbaïdjan assurait la moitié de la production mondiale de pétrole, et c’est ce pays qui a le premier exploité un gisement en mer – un type d’exploitation dont l’intérêt ne s’est jamais démenti depuis. Après avoir atteint un pic de production à 1 million de barils de pétrole et de condensat par jour en 2010, l’Azerbaïdjan produit aujourd’hui quelque 800 000 barils par jour, la production mondiale étant de l’ordre de 92 millions de barils. La fraction de la production azerbaïdjanaise consommée sur place est très faible et l’essentiel est exporté via l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC) dans lequel nous avons une participation de 5 % et qui relie l’Azerbaïdjan à la Méditerranée par le port turc de Ceyhan.
Notre activité en Azerbaïdjan est essentiellement gazière. Le pays produit 16 milliards de mètres cubes par an – à titre de comparaison, la France consomme 38 à 40 milliards de mètres cubes chaque année. L’Azerbaïdjan consomme environ la moitié de sa production gazière et exporte l’autre moitié vers l’Ouest, en particulier vers la Géorgie et la Turquie. Aux termes du projet que nous venons de signer cette semaine, nous produirons environ 1,5 milliard de mètres cubes, soit 15 % de la consommation locale.
L’économie de l’Azerbaïdjan dépend fortement du pétrole et du gaz. Ces dernières années, l’État a consenti des investissements considérables, en particulier à Bakou, en lien avec l’évolution du prix du brut entre 2000 et 2014, date à laquelle le cours a chuté. Les effets les plus manifestes de ces investissements ont été les Jeux européens et le Grand prix d’Europe de Formule 1.
Les activités de Total en Azerbaïdjan concernent pour l’essentiel l’exploration et la production. Nous exerçons certes une activité de trading qui consiste à acheter du brut à SOCAR, la société pétrolière d’État, pour le distribuer dans nos raffineries et le vendre ailleurs dans le monde, et une modeste activité de vente de produits lubrifiants, de l’ordre de 1 400 tonnes par an. Cependant, ces activités sont marginales par rapport à l’exploration et la production.
Dans ce domaine, disons d’emblée que l’entreprise BP exerce depuis la chute de l’Union soviétique un quasi-monopole en Azerbaïdjan. Elle a signé en 1994 un contrat considérable de développement pétrolier du champ Azeri-Chirag-Gunashli (ACG) – que les Azerbaïdjanais ont baptisé « le contrat du siècle ». La production a démarré en 1997 et elle est pour l’essentiel exportée via l’oléoduc précité, qui est à l’origine de l’enrichissement récent du pays et du développement de l’activité de BP. Il y a deux ans, BP employait quelque 800 expatriés en Azerbaïdjan ; à titre de comparaison, nous y employons 27 personnes dont quatre ou cinq expatriés. C’est dire la dimension de BP qui, dans ce pays, n’est pas pour nous un partenaire, mais un véritable concurrent.
BP a entrepris d’exploiter un deuxième champ, celui de Shah Deniz – un gisement gazier en mer auquel nous avons participé à hauteur de 10 % lors de la première phase de développement. La production a démarré en 2006 et a atteint un plateau de 9 milliards de mètres cubes par an, soit l’équivalent de la consommation du pays, même si l’essentiel de ce gaz est exporté vers la Géorgie et la Turquie. En 2013, BP a proposé une deuxième phase de développement à ses partenaires, qui l’ont approuvée, pour doubler le volume de production ; la moitié de ces 18 milliards de mètres cubes est destinée à la Turquie, l’autre à l’Europe – c’est là l’origine des trois oléoducs du fameux corridor Sud : le premier (SCP) traverse le Caucase méridional, le deuxième (TANAP) l’Anatolie et le troisième (TAP) la Grèce, l’Albanie et la mer Adriatique, cette infrastructure devant entrer en service en 2019.
Nous avons décidé que ce projet de deuxième phase ne remplissait pas nos critères de rentabilité et, lors de la décision finale d’investissement, nous avons vendu notre part de 10 % à la société nationale turque TPAO, qui est un investisseur et un partenaire important pour l’Azerbaïdjan, pour SOCAR et pour la livraison de gaz par le gazoduc TANAP. L’investissement requis pour développer la deuxième phase d’exploitation du gisement de Shah Deniz s’élève à 30 milliards de dollars, sans compter l’augmentation des capacités des oléoducs SCP, TANAP et TAP, soit 5, 10 et 5 milliards de dollars respectivement. Autrement dit, nous ne sommes désormais plus producteurs de gaz en Azerbaïdjan.
M. le président François Rochebloine. Pourquoi avez-vous vendu vos parts ?
M. Michael Borrell. En raison de l’économie et de la rentabilité du projet. Les autres acteurs qui y participent ont adopté des critères de rentabilité différents ; la société norvégienne Statoil, en revanche, a appliqué les mêmes critères que Total et a également vendu ses parts, en l’occurrence à SOCAR et à TPAO. Si BP poursuit le développement de ce projet, c’est parce que ses intérêts dans le gisement ACG – et donc dans le pays tout entier – sont beaucoup plus importants que les nôtres, ce qui explique qu’elle accepte d’autres critères de rentabilité compte tenu de son portefeuille d’activités en Azerbaïdjan.
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. Votre retrait du projet est-il lié à une analyse purement économique ou d’autres considérations ont-elles joué un rôle ?
M. Michael Borrell. De nombreuses considérations ont joué un rôle, mais l’économie du projet et son niveau de risque ont été les éléments décisifs.
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. Le risque a donc joué ?
M. Michael Borrell. Tout à fait, même si son évaluation entre dans le champ de l’analyse économique. Nous avons estimé que le risque de dérapage des coûts de développement était élevé pour un projet nécessitant déjà un investissement de 30 milliards de dollars, notamment parce que les puits sont difficiles à forer. De surcroît, s’il est vrai que nul n’anticipait à la fin 2013 une chute aussi brutale des cours que celle qui s’est produite en 2014, le prix du gaz – indexé sur celui du brut – risquait tout de même de baisser en Europe et en Azerbaïdjan. Toutes ces incertitudes nous ont incités à ne pas participer au projet. En outre, le moment était opportun pour vendre car la décision finale d’investissement résout une partie des risques, ce qui explique que TPAO ait vu un intérêt stratégique à participer au projet et à acheter nos parts au prix convenu.
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. Les risques d’ordre géopolitique ont-ils eu une incidence ?
M. Michael Borrell. Ils existent naturellement dans la zone, mais ce ne sont pas les risques majeurs de notre point de vue. À l’époque, le débat sur le corridor Sud – et la construction du gazoduc Nabucco ou du TANAP – était sur le point d’être tranché, et il n’a pas constitué un argument déterminant dans notre décision de vente. Nous estimions que la capacité de Nabucco serait trop importante et qu’il valait mieux procéder par étapes, car le gaz n’arriverait pas immédiatement et l’économie du corridor Sud s’en trouverait affectée. L’exploitation du gisement de Shah Deniz répond à cette logique de développement progressif du gaz azerbaïdjanais à destination de l’Europe.
J’en viens au gisement qui est au cœur de l’activité de Total en Azerbaïdjan : Apchéron. Cette nouvelle découverte se trouve à une centaine de kilomètres en mer à l’Est de Bakou, entre les gisements d’ACG – qui se trouve à trente kilomètres environ – et de Shah Deniz. L’histoire pétrolière d’Apchéron est très intéressante. La formule juridique des permis d’exploitation des gisements azerbaïdjanais en mer, qu’il s’agisse d’ACG, d’Apchéron ou de Shah Deniz, est celle de l’accord de partage de la production ou production sharing agreement (PSA). Un PSA est un contrat passé entre la co-entreprise (joint venture) – en l’occurrence Total, Engie et SOCAR – et l’État, sachant que SOCAR est présente de part et d’autre puisqu’elle est notre partenaire mais qu’elle exerce aussi la fonction de régulateur et qu’elle est de surcroît une société d’État à qui il arrive de signer des contrats en lieu et place de l’État, d’où un risque de conflit entre ses différentes branches. Dans le cas d’Apchéron, notre partenaire est en réalité une filiale de SOCAR créée ad hoc.
M. le président François Rochebloine. La présence de l’État se fait-elle sentir dans cette entreprise publique ?
M. Michael Borrell. Non, c’est une société d’État dotée d’un président, d’un état-major et de différentes directions.
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. Comment les éventuels conflits d’intérêts sont-ils gérés entre la branche qui signe les contrats et celle qui participe au développement des projets ?
M. Michael Borrell. C’est à nous de les gérer en nous assurant que ce qui est dit d’un côté se reflète de l’autre.
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. De tels conflits se produisent-ils ?
M. Michael Borrell. Parfois. L’accord que nous venons de conclure cette semaine au sujet de la première phase de développement du gisement d’Apchéron en offre un exemple : SOCAR est partenaire du projet mais aussi acheteur du gaz ainsi produit. Le conflit est donc manifeste. Dans les discussions relatives au prix du gaz, néanmoins, nous nous assurons que c’est l’état-major de SOCAR qui négocie avec nous en toute indépendance et qui ne représente que l’intérêt de l’État. Dans le même temps, nous veillons naturellement à ce que la filiale de SOCAR qui participe au projet, et qui applique un critère de rentabilité, approuve le prix convenu.
M. Jean-Michel Villaumé. Quelle part prend Engie dans ce projet ?
M. Michael Borrell. Engie est partenaire à hauteur de 20 %, Total et SOCAR se partageant le reste à hauteur de 40 % des parts chacune. À l’origine, Total et SOCAR étaient les seuls acteurs du projet, mais nous avons décidé de confier 20 % des parts à Engie afin d’abaisser notre propre participation.
Un PSA consiste à rembourser les coûts de production assumés par la joint venture grâce au produit de la vente, puis à partager les bénéfices supplémentaires entre les partenaires du projet et l’État – d’où la notion de partage de la production.
M. le président François Rochebloine. Utilisez-vous cette formule dans d’autres pays ?
M. Michael Borrell. Très souvent, à l’exception de la mer du Nord où les gisements sont exploités dans le cadre de concessions. En effet, un PSA est un contrat privé conclu entre les entreprises partenaires du projet et l’État ou la société nationale. Il comporte notamment des clauses spécifiques concernant l’arbitrage international, qui est destiné à protéger les deux parties en cas de changement de régime ou de gouvernement par exemple. Nous utilisons ce cadre juridique, qui permet le cas échéant de recourir à un arbitrage pour interpréter les clauses contractuelles, dans de nombreux pays, du Kazakhstan et de l’Angola à l’Indonésie et au Nigeria.
Pour ce qui concerne Apchéron, nous avons conclu un premier PSA en 1997 en prenant une participation de 20 %, Chevron étant l’opérateur principal. En 2001, nous avons foré un premier puits sur la structure d’Apchéron, un bel objet dont les lignes sismiques nous révèlent la surface et dans lequel nous espérions trouver du gaz ou du pétrole. Ce puits, foré à une profondeur de cinq cents mètres environ sous le niveau de la mer, était sec : nous y avons décelé quelques traces de gaz, mais surtout de l’eau. L’existence du système pétrolier ne fait pas de doute, puisqu’il y a du gaz au Sud et du pétrole au Nord, mais il reste à trouver l’endroit où le gaz se trouve piégé. Après avoir déclaré le puits sec, nous avons donc rendu la licence et les différents partenaires se sont retirés. Nos géologues ont pourtant été intrigués par l’absence de découverte d’un gisement et ont poursuivi leurs études. La structure, orientée du Nord-Ouest vers le Sud-Est et longue d’une trentaine de kilomètres pour environ cinq kilomètres de large, comporte une faille centrale. En étudiant le bassin pétrolier, nos géologues ont émis l’hypothèse d’un mouvement hydrodynamique allant du Sud vers le Nord qui pourrait se traduire par un plan d’eau incliné, voire séparé en deux niveaux par la faille. Nous avons donc décidé en 2009 de reprendre le bloc avec SOCAR puis Engie, et de forer un nouveau puits entre 2010 et 2011, cette fois-ci de l’autre côté de la faille, à près de cinq kilomètres du premier site de forage ; c’est alors que nous avons découvert le gisement. C’est une remarquable histoire pétrolière pour les géologues ! Depuis 2011, nous envisageons les moyens de développer cette découverte.
Je précise que ces puits sont très difficiles à forer : la profondeur d’eau atteint cinq cents mètres et les puits sont forés jusqu’à sept mille mètres, dans des conditions de très haute pression. La haute pression est souvent liée à une haute température, mais ce n’est pas le cas à Apchéron, parce que ce bassin géologique est relativement récent, de l’ordre d’un million d’années seulement ; les hautes températures ne sont donc pas encore remontées. Quoi qu’il en soit, ces forages sont techniquement délicats : en l’espèce, il nous a fallu plus de douze mois pour forer ce puits.
Nous avons programmé le forage de quatre puits de développement dont un puits avec un double objectif de production et d’appréciation. La production devait avoisiner les 5 milliards de mètres cubes par an, c’est-à-dire la moitié de la consommation de l’Azerbaïdjan, pour un investissement d’environ 6 à 7 milliards de dollars. Cependant, la chute du prix du brut a complètement remis en cause l’économie de ce projet et les coûts qui lui étaient associés.
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. Dans les conditions actuelles, le coût de production du mètre cube de gaz est-il supérieur au prix de vente sur le marché, qui est indexé sur celui du pétrole ?
M. Michael Borrell. J’y viens. Étant donné le volume de la production envisagée, il était difficilement imaginable qu’il soit intégralement absorbé par la consommation locale. Certes, la production de gaz de l’Azerbaïdjan décline quelque peu – hormis la deuxième phase de développement du gisement de Shah Deniz, qui est principalement destinée à l’exportation – mais un tel volume allait inonder le marché national. Il faut donc exporter, d’où les difficultés que nous rencontrons concernant le prix du gaz par rapport à la dimension du projet. Au début 2016, nous avons finalement conclu que nous ne parviendrions pas à réaliser un tel développement tout de suite, et qu’il convenait de procéder par étapes en réduisant les coûts et en développant plus vite un projet plus limité et destiné au marché local. Nous avons donc décidé que ce projet ne serait pas isolé et doté de ses propres infrastructures de traitement du gaz à terre, mais que nous raccorderions un puits unique aux installations que SOCAR possède à une trentaine de kilomètres, à Oil Rocks, sur l’un des premiers champs en mer du pays, pour ensuite vendre le gaz dès l’arrivée à terre à SOCAR et récupérer à Ceyhan, en Turquie, le condensat produit dans l’intervalle. Ce projet plus modeste permettra de démarrer la production plus rapidement. En effet, l’Azerbaïdjan a besoin de gaz tout de suite pour son propre marché. Il exporte beaucoup de gaz à partir du gisement de Shah Deniz, au point qu’il va devoir importer du gaz russe pour satisfaire ses propres besoins. Il est donc très intéressant, de son point de vue, d’obtenir rapidement du gaz du gisement d’Apchéron.
Avec un seul puits, nous pourrons produire 1,5 milliard de mètres cubes par an, soit 15 % du marché local, ce qui correspond précisément aux besoins du pays pour 2019-2020. Depuis le mois d’avril, nous sommes en discussion sur l’ensemble des éléments du projet : coût de développement, utilisation d’un appareil de forage que SOCAR est en train de construire localement, besoins du marché local du gaz, prix de vente suffisant pour garantir l’économie du projet. Ces discussions ont abouti à l’accord que nous venons de signer lundi. Le premier puits sera foré en septembre prochain ; la décision finale d’investissement concernant le reste du projet sera prise dans un an environ, et la production annuelle de 1,5 milliard de mètres cubes pourra démarrer fin 2019, moyennant une économie de projet satisfaisante pour un groupe comme Total ou Engie. Sachant qu’une production de 1,5 milliard de mètres cubes de gaz correspond à peu près à 35 000 barils d’équivalent pétrole, un tiers de ce volume consiste en condensat, lequel, compte tenu de son prix, représente la moitié des revenus du projet – c’est dire s’il est un élément-clé du projet.
J’en viens au prix. Sur le marché local, il dépend de l’acheteur. Il est difficile de donner des chiffres précis en raison de la dévaluation récente du manat, la devise azerbaïdjanaise, mais le prix du gaz s’établit à environ 70 dollars par millier de mètres cubes, soit 2 dollars par million de British thermal unit (BTU) – ou MBTU. Autrement dit, le gaz est vendu sur le marché local à un prix oscillant entre 2 et 4 dollars par MBTU. Le prix dont nous sommes convenus avec SOCAR se situe précisément dans cette fourchette et suffit à rentabiliser l’investissement du projet.
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. Pour quel coût de production ?
M. Michael Borrell. Je ne peux que vous donner l’ordre de grandeur de l’investissement consenti pour ce projet : entre 1 et 1,1 milliard de dollars.
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. Je comprends que vous ne puissiez pas nous indiquer un coût de production précis, mais pouvez-vous au moins nous confirmer qu’il se situe au-dessus du point de rentabilité ?
M. Michael Borrell. Absolument ; nous ne conclurions pas l’accord autrement s’agissant d’un projet de 1,1 milliard de dollars, dans lequel nous participons comme SOCAR à hauteur de 40 %, les 20 % restants étant détenus par Engie. Je ne peux en revanche pas communiquer le coût de production, étant entendu qu’il est naturellement inférieur au prix de vente et que nous produirons un mélange de gaz et de condensat.
Le forage du puits d’Apchéron aura lieu rapidement, et nous allons nous atteler au volet développement du projet, qui représente un défi technique. En effet, le puits aura 7 700 mètres de profondeur. Le gaz en sort à très haute pression et le fond de la mer Caspienne étant très froid, il est nécessaire d’isoler le gazoduc qui reliera le puits à Oil Rocks, à une trentaine de kilomètres. Nous emploierons pour ce faire une technologie d’isolation thermique consistant à créer une double paroi concentrique (pipe-in-pipe) qui permettra d’éviter la formation de cristaux d’hydrate ou de blocs de paraffine. Il se trouve à Oil Rocks une installation qui réduit la pression du gaz et une station de comptage du gaz et du condensat, qui est ensuite traité sur place. Tous ces travaux techniques dureront un an, suite à quoi nous disposerons du prix définitif.
Encore une fois, ce projet est intéressant pour SOCAR car il répond à ses besoins de disposer de gaz rapidement pour alimenter le marché local au prix convenu. Nous finançons habituellement de tels projets par apport de fonds propres, mais SOCAR financera sa part par emprunt. Total aidera à monter le dossier. Nous présenterons le projet à l’Union européenne, pour laquelle il revêt un intérêt stratégique car, s’il est destiné au marché azerbaïdjanais, il permet de libérer d’autres productions afin qu’elles soient exportées vers l’Europe, notamment dans le cadre du développement du corridor Sud.
En tant qu’acteur majeur de l’énergie responsable, Total mène également d’autres projets dans le pays : dans le domaine éducatif, par exemple, nous envoyons des étudiants azerbaïdjanais en France. En dix ans, une trentaine d’étudiants ont ainsi reçu une formation pétrolière, certains ayant ensuite été recrutés par Total, d’autres par SOCAR. Nous avons conclu un partenariat avec le lycée français de Bakou. Nous participons par ailleurs à un projet local d’élevage des esturgeons, et nous parrainons différentes activités culturelles.
M. le président François Rochebloine. Puisque Total a mis au point un guide de l’intégrité, pouvez-vous nous faire part de votre sentiment sur la corruption en Azerbaïdjan ?
D’autre part, avez-vous rencontré des conflits d’intérêts qui nécessitent le recours à une instance d’arbitrage ?
Enfin, SOCAR et Engie ont déployé des publicités très visibles au cours de l’Euro 2016 en France. Le groupe Total y était-il associé d’une manière ou d’une autre ?
M. Michael Borrell. Il est vrai que SOCAR a été très visible lors de l’Euro 2016, mais cette stratégie a été décidée sans que le groupe Total n’y soit associé d’une quelconque manière, même si nous avons naturellement accueilli comme il se doit Rovnag Abdullayev, le président de SOCAR, à l’occasion de la compétition. Je l’ai interrogé lundi dernier sur sa stratégie de parrainage dans le milieu du football car, de mon point de vue, cette activité est héritée de l’ère où le prix du brut s’établissait à 100 dollars et les liquidités étaient abondantes. Total n’a pas du tout cette politique. Nous venons de lancer un projet de parrainage plus modeste, pendant sept ans, de la Coupe d’Afrique des nations et de différents championnats nationaux africains, y compris des championnats féminins et des compétitions de jeunes. Nous pensons en effet qu’une telle stratégie est plus adaptée pour atteindre non seulement nos consommateurs, mais aussi les populations affectées par nos installations pétrolières.
S’agissant des conflits d’intérêts au sein de SOCAR, nous nous assurons que toute position exprimée est celle du groupe tout entier. Sur le prix d’achat du gaz, par exemple, je ne me satisfais pas d’entendre la seule position de la filiale de SOCAR qui est notre partenaire ; je tiens à m’assurer que c’est aussi celle de l’État et de SOCAR en tant qu’acheteur. C’est ainsi que nous gérons les éventuels conflits d’intérêts. Nous agissons à l’égard de SOCAR en toute transparence : nous comprenons certes les difficultés qu’a ce groupe d’aligner les positions de ses différentes branches, mais nous sommes attentifs à poser toutes les questions pertinentes aux acteurs concernés. Quant aux contrats qui sont signés in fine¸ qu’ils portent sur le prix du gaz, les plateformes, l’utilisation des installations d’Oil Rocks ou toute modification apportée au PSA ou à l’accord d’exploitation commune, nous veillons à la cohérence de SOCAR au plus haut niveau et ne les signons qu’avec M. Abdullayev lui-même ou son équipe personnelle.
M. le président François Rochebloine. Combien SOCAR emploie-t-elle de salariés ?
M. Michael Borrell. Soixante mille.
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. Je ne peux m’empêcher de constater le caractère schizophrène de votre situation : c’est en effet à l’opérateur extérieur qu’il revient d’évaluer l’action des différentes branches de SOCAR et de prendre des arbitrages !
M. Michael Borrell. C’est une situation particulière, en effet. Il est vrai qu’un PSA suppose l’existence d’un régulateur qui n’assume que la seule mission de régulation et qui représente l’État auprès des opérateurs extérieurs, lesquels, dans des pays comme l’Azerbaïdjan, sont très souvent liés à la société nationale par un partenariat. Les conflits entre la société nationale et l’État sont donc inévitables. J’en veux pour preuve le cas du Kazakhstan : KMG, la société nationale, est partenaire du projet que nous développons dans ce pays, et assumait également la fonction de régulateur jusqu’à ce que l’État décide de dissocier ces deux fonctions en confiant la mission de régulation au ministère – ce qui est plus normal, car c’est un gage d’indépendance. Même ainsi, nous avons éprouvé de grandes difficultés à Kachagan et avons dû exclure KMG des renégociations avec l’État parce qu’elle était en situation de conflit d’intérêts, dans la mesure où elle est tout à la fois notre partenaire et le représentant de l’État.
Cela étant, nous n’avons jamais eu à utiliser la clause d’arbitrage en Azerbaïdjan. Nous l’avons invoquée une fois au Kazakhstan mais l’affaire s’est finalement soldée par un règlement amiable. L’Azerbaïdjan, de son côté, s’enorgueillit de n’avoir jamais suscité de contentieux international dans le secteur pétrolier, et de n’avoir même modifié aucun contrat pétrolier.
La corruption, enfin : nous avons élaboré un guide extrêmement précieux, car il est très clair et répond à toutes les situations de conflit éventuel. Je n’ai eu à l’utiliser qu’une fois dans ma carrière, au cours d’une négociation, et nos interlocuteurs ont immédiatement compris sur quelles bases nous travaillons en toute transparence ; aucun doute n’est permis sur ce point. De ce fait, nous n’avons jamais été réellement exposés à des faits de corruption en Azerbaïdjan, car nos interlocuteurs connaissent nos codes de conduite et nos positions, et savent parfaitement quelle réponse leur serait apportée à la moindre tentative de corruption.
M. François Nahan, directeur des relations institutionnelles pour la France, Total. J’ajoute, s’agissant de la corruption, que les 90 000 employés du groupe Total reçoivent tous une formation sur l’intégrité et l’anticorruption, ainsi que des « piqûres de rappel » tous les ans ou tous les deux ans, afin qu’ils se remémorent régulièrement nos positions très intègres en matière de conduite des affaires.
M. Michael Borrell. En effet, nous sommes particulièrement exigeants sur la question de l’intégrité, qui est au cœur de nos activités.
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. Votre branche à Bakou n’employant directement que 27 personnes, à combien de sous-traitants avez-vous recours ? Comment les choisissez-vous ? Subissez-vous des pressions pour retenir tel ou tel ?
Quelles sont précisément les règles d’évolution des contrats d’exploration et de production ? Avec qui négociez-vous ? Comment qualifieriez-vous le déroulement des négociations ? Quelles sont les redevances et les taxes à payer à l’État, et les procédures de recouvrement ? Comment est effectué le contrôle de la quantité produite ?
S’agissant de la concurrence à laquelle le groupe Total est confronté en Azerbaïdjan et dans l’ensemble de la région, il semble – ce n’est qu’une impression – qu’elle s’apparente moins à une féroce rivalité qu’à une coopération entre les grandes sociétés internationales, en particulier dans le secteur de l’exploration et de la production. Confirmez-vous cette impression, ou la concurrence est-elle rude ?
Enfin, il nous a été indiqué qu’en Azerbaïdjan, les contrats sont respectés et que les bénéfices peuvent en être rapatriés sans limite, ce qui est à l’évidence avantageux en comparaison d’autres pays. Quelle appréciation faites-vous du climat des affaires en Azerbaïdjan par rapport au reste de la Communauté des États indépendants, y compris la Russie, et aussi la Turquie ?
M. Michael Borrell. À ce stade, nous n’employons directement que 27 personnes à Bakou, mais ce nombre est appelé à évoluer rapidement dès que les opérations débuteront. Nous recruterons alors d’autres employés et notre branche connaîtra une croissance rapide, même si elle ne sera jamais très importante pour un développement tel que celui-là. Le forage du puits nécessitera de constituer une équipe d’une cinquantaine de personnes à Bakou ; outre la fonction logistique, s’y ajouteront des employés venus en soutien de la maison mère ainsi que les employés en poste sur la plateforme de forage – une plateforme semi-submersible de cette taille occupant environ 200 personnes. Cela étant, le total des emplois mobilisés sera beaucoup plus élevé que le seul nombre d’employés par notre filiale. Nous allons en effet sous-traiter avec différentes sociétés pour forer le puits, pour acheminer les besoins logistiques par la mer, pour l’ingénierie, pour construire la plateforme et sa structure de surface ou encore pour construire et installer le gazoduc, et ainsi de suite. Il est donc difficile de vous indiquer avec précision le nombre d’emplois que générera cette première phase de développement.
Les groupes comme Total ont généralement une politique de sous-traitance qui repose sur des appels d’offres ouverts avec une portée précisément définie et une programmation claire. La sélection se fait tout à la fois en fonction de critères techniques et du prix. C’est ainsi que nous procédons partout dans le monde, y compris en Azerbaïdjan. La difficulté de ce pays, toutefois, tient au fait que la mer Caspienne est fermée ; nous ne pouvons donc pas accéder à l’ensemble des contractants auxquels nous recourons en mer du Nord, par exemple, ou encore en Asie. Les modules de plateforme utilisés dans le golfe de Guinée, par exemple, sont souvent construits en Corée ou en Chine et acheminés par voie maritime ; en Azerbaïdjan, nous sommes limités par le volume pouvant être transporté sur les canaux de la Volga, ce qui restreint considérablement le nombre de contractants capables de nous fournir les équipements nécessaires. Nous faisons donc au mieux sur place : l’Azerbaïdjan compte deux chantiers de construction et un troisième en cours de construction, que nous allons mettre en concurrence pour répondre à nos besoins – qui, en l’occurrence, sont modestes. Il ne s’agit en effet que d’un projet d’un milliard de dollars qui consiste en un oléoduc et une petite plateforme dotée de deux séparateurs pour compter le gaz et le condensat : c’est assez limité. Il n’est guère nécessaire de mettre de nombreux acteurs en concurrence pour s’assurer des services au prix adéquat, d’autant plus que nous disposons d’un large éventail mondial de prix de référence pour déterminer si les prix proposés sont trop élevés.
Concernant les quantités, le comptage est effectué à tous les stades et par tous les acteurs, et ne pose aucune difficulté. Très souvent, il nous faut un brut liquide et un gaz de qualité très pure pour pouvoir les compter au plus près ; pour ce projet, nous disposerons de deux séparateurs qui permettront de compter l’un et l’autre, et c’est sur cette base que nous facturerons nos quantités.
J’en viens à la concurrence avec d’autres acteurs pétroliers. Nous sommes très souvent partenaires, comme dans le cas présent avec SOCAR et Engie. Lorsque nous avons obtenu le permis d’Apchéron et conclu le nouveau PSA, notre principal concurrent était BP, qui voyait d’un mauvais œil l’arrivée d’un nouvel opérateur à proximité du gisement ACG, dans une zone qui constitue pour ce groupe une sorte de pré carré – extrêmement rentable, qui plus est. L’État et SOCAR cherchaient précisément un nouveau partenaire, Total, et nous leur avons de surcroît proposé un nouveau mode opératoire de développement qui consiste à créer une société d’exploitation commune dans laquelle Total et SOCAR participent à égalité. C’est cette société qui sera l’opérateur du projet, et non pas Total en tant que tel. Le groupe BP, au contraire, agit en tant qu’opérateur direct. La formule que nous proposons permettra à SOCAR de développer ses compétences et son expertise et de les réutiliser ailleurs. Autrement dit, nous entretenons avec les autres sociétés pétrolières des liens de partenariat ou de concurrence selon les cas.
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. En clair, vous ne vous faites pas la guerre.
M. Michael Borrell. Pas du tout et, d’ailleurs, c’est rarement le cas, même si la concurrence peut parfois être féroce, notamment lors de l’acquisition des blocs.
Cela étant, BP possède de nombreuses installations en Azerbaïdjan ; nous allons donc essayer d’utiliser leur expertise pour nos propres opérations. S’ils n’utilisent pas certains bateaux à temps plein, par exemple, nous pourrons les louer à moindre coût, d’où un bénéfice mutuel ; de même, nous pourrions utiliser l’une de leurs têtes de puits. Des coopérations de nature technique peuvent donc être envisagées.
Enfin, il m’est difficile de comparer l’Azerbaïdjan aux autres pays de la région, parce que nos activités y sont très différentes.
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. Étant donné les réformes entreprises par ce pays, l’environnement juridique, économique et financier vous y paraît-il plus favorable que dans d’autres pays d’héritage soviétique, ou qu’en Turquie ?
M. Michael Borrell. Par rapport au Kazakhstan, au Turkménistan et au Tadjikistan, le comportement de l’Azerbaïdjan à notre égard est plutôt favorable, tant du point de vue juridique qu’en termes de relations professionnelles. Au Kazakhstan, par exemple, l’approche juridique et les relations me semblent plus conflictuelles qu’en Azerbaïdjan, mais peut-être cette impression évoluera-t-elle à mesure que notre projet s’y déploie. Nos collègues de BP, très actifs dans le pays, arrivent toujours à trouver avec l’État et SOCAR des solutions qui conviennent aux deux parties. De plus, la structure politique de l’Azerbaïdjan est plus simple à décrypter que celle du Kazakhstan. En Turquie, nos activités sont de nature différente.
M. le président François Rochebloine. Quelle appréciation faites-vous du développement futur de l’exploitation pétrolière et gazière en Azerbaïdjan compte tenu des différends qui l’opposent à ses voisins concernant la propriété des gisements sous-marins, de l’évolution prévisible du coût d’extraction des ressources qu’ils contiennent et de l’évolution des cours mondiaux des produits pétroliers ?
Quelle a été l’implication des autorités politiques – le Président de la République, le Premier ministre et les ministres compétents – dans la conduite des négociations préalables à votre implantation ?
Mme Geneviève Gosselin-Fleury. Et avez-vous été accompagné lors de ces négociations par des agences publiques ou parapubliques françaises ?
Autre question : il y a quelques années, l’un de vos cadres supérieurs a été nommé à l’ambassade de France en Azerbaïdjan. N’est-ce pas une source de conflits d’intérêts, et quelle serait votre position si une telle situation venait à se reproduire ?
M. Jean-François Mancel. Vous faites sans doute référence à Pascal Meunier, qui fut un temps détaché auprès du groupe Thales.
Pouvez-vous, monsieur le directeur, nous donner des précisions sur l’organisation et le fonctionnement de SOCAR, son savoir-faire et le type de relations que vous entretenez avec elle ?
Par ailleurs, les PME françaises présentes en Azerbaïdjan sont peu nombreuses. Le groupe Total peut-il jouer un rôle en matière de tutorat, par exemple, au profit de PME françaises qui opèrent dans votre secteur élargi ?
Enfin, que pensez-vous de la main-d’œuvre azerbaïdjanaise, de son niveau de formation et de ses connaissances, qu’il s’agisse des cadres ou des salariés de base ?
M. Michael Borrell. Le projet que nous avons programmé sur le gisement d’Apchéron n’est qu’une première phase de développement. À terme, nous pourrions tripler voire quadrupler le volume de production déjà programmé, à condition de trouver un modèle économique qui soit satisfaisant pour Total et pour l’Azerbaïdjan. En effet, un groupe comme Total ne peut se contenter de produire 35 000 barils d’équivalent pétrole dans un pays. Nous devrons donc trouver d’autres activités pour pérenniser notre implantation en Azerbaïdjan, et nous sommes d’ores et déjà en discussion au sujet des champs d’Umid et de Babek, deux structures réparties de part et d’autre d’un col sous-marin. La première a déjà été découverte par SOCAR ; la seconde n’est qu’une hypothèse, mais elle laisse présager de bonnes perspectives. D’autres gisements à découvrir nous permettront également de poursuivre notre développement en Azerbaïdjan, d’où notre optimisme tant pour Total que pour ce pays. C’est d’ailleurs le principal message que Patrick Pouyanné, directeur général de Total, a transmis au Président Aliev lorsque nous l’avons rencontré lundi à l’occasion de la signature de notre accord : il faut poursuivre nos travaux sur le champ d’Apchéron, mais aussi sur d’autres objets, de sorte que Total s’implante durablement comme deuxième opérateur dans le pays aux côtés de BP.
Il reste en effet des litiges frontaliers en mer Caspienne. Les zones d’exploitation pétrolière sont clairement délimitées avec la Russie et le Kazakhstan, mais des différends demeurent avec le Turkménistan et l’Iran. Nous avons exprimé un intérêt pour un gisement se trouvant dans la zone contestée entre l’Azerbaïdjan et le Turkménistan, mais nous nous sommes retirés de la discussion dès qu’il est apparu que le litige devrait être réglé par les deux États et que Total n’avait pas de rôle à jouer, à moins d’être sollicité à cet effet. Le Président Aliev nous a confirmé lundi que les relations bilatérales concernant cette zone se sont nettement améliorées : l’Azerbaïdjan a fait une offre et il semble que la question soit en voie de résolution, ce qui pourrait ouvrir une perspective de développement pour Total, même s’il convient de rester très prudent.
Je travaille depuis neuf ans sur le Turkménistan et j’ai toujours cru que l’année suivante serait celle de l’ouverture et de notre implantation ; de ce fait, je reste là aussi très prudent. Quant à l’Iran, il est encore trop tôt pour se prononcer : il reprend peu à peu pied sur la scène internationale, même si les relations avec les États-Unis demeurent très précaires et difficiles. L’Azerbaïdjan et l’Iran ont l’un et l’autre intérêt à s’entendre pour se développer. D’ailleurs, une partie du gaz turkmène transite déjà par l’Iran vers l’Azerbaïdjan, même s’il n’y a guère eu de publicité autour de cette activité, ce qui témoigne d’une certaine coopération dans la Caspienne méridionale.
Il a souvent été question d’un oléoduc transcaspien. Il me semble très difficile, sur le plan politique, que les pays riverains, en particulier la Russie et l’Iran, acceptent de se mettre d’accord pour promouvoir un tel projet, qui était pourtant l’un des éléments-clé du dispositif d’exportation du gaz turkmène vers l’Europe dans le cadre du projet Nabucco. L’option consistant à passer par l’Iran pour rejoindre l’oléoduc TANAP me paraît beaucoup plus crédible et probable – à condition de parvenir à exploiter le gaz turkmène de manière rentable.
Encore une fois, je ne peux pas communiquer sur l’évolution des prix du brut mais, en la matière, nous sommes humbles : les prix sont volatils.
Il va de soi que nous tenons l’ambassadeur de France, le ministère des affaires étrangères et les autorités politiques au courant de notre action ; lors de sa visite en Azerbaïdjan en 2014, le Président Hollande était informé de l’avancée de nos discussions. De même, l’équipe de M. Matthias Fekl est tenue au courant de l’ensemble de nos activités en vue de la Commission mixte. Nous maintenons ce lien d’information pour les cas où nous aurions besoin de l’aide des autorités françaises comme cela s’est produit au Kazakhstan, par exemple, au sujet de la législation sur l’environnement. Les négociations pétrolières, en revanche, relèvent de notre seule compétence. Les autorités politiques azerbaïdjanaises, quant à elles, interviennent très peu, car c’est SOCAR qui gère l’activité pétrolière dans le pays. À chacun de mes déplacements dans le pays, je rencontre le ministre de l’énergie, Natig Aliev, mais il est peu influent dans l’ensemble ; c’est SOCAR et son président, Rovnag Abdullayev, un ancien de la société, qui gèrent directement les relations avec les opérateurs étrangers. Pour avoir une vision globale de la situation, j’échange avec trois instances : SOCAR, le ministre de l’énergie et SOFAZ, le fonds souverain qui a par exemple financé la plateforme en construction. Les négociations, en revanche, relèvent exclusivement de SOCAR.
SOCAR me semble de bon niveau. Fière de ses résultats passés, cette société est déterminée à enrichir son expérience et son expertise, et nous l’y aidons. C’est précisément pourquoi nous avons souhaité la création d’une société d’exploitation commune, car cette formule favorisera le développement de SOCAR. Elle nous a également offert un avantage concurrentiel : si nous avons obtenu ce contrat, c’est parce que nous offrions un élément supplémentaire. Certes, je me méfie de certaines des manières de faire de SOCAR sur le plan technique, car leurs installations présentent parfois des caractéristiques que nous n’accepterions pas sur les nôtres, mais un effort de pédagogie nous permettra de bien vivre ensemble.
Enfin, nous cherchons naturellement à emmener des PME françaises dans notre sillage. C’est pourquoi nous accueillons des jeunes dans nos bureaux dans le cadre de volontariats internationaux en entreprise. De même, nous avons accueilli en Azerbaïdjan la visite d’une délégation d’Evolen, l’association regroupant les entreprises et les professionnels du secteur parapétrolier et paragazier. Cela étant, notre activité dans ce pays est relativement limitée car, même si elle porte sur des montants importants, elle implique un nombre restreint de contractants. Il n’en reste pas moins que nous essayons d’associer des entreprises françaises lorsque c’est possible. Quant au niveau de la main-d’œuvre locale, il est relativement bon.
M. le président François Rochebloine. Nous vous remercions.
*
* *
Ÿ Audition de M. Johann Bihr, responsable du bureau Europe de l’Est et Asie centrale, et de Mme Emma Lavigne, chargée de recherche Europe et Asie centrale, de Reporters sans frontières (jeudi 24 novembre 2016)
M. le président François Rochebloine. Nous sommes heureux d’accueillir M. Johann Bihr, responsable du bureau Europe de l’Est et Asie centrale, et Mme Emma Lavigne, chargée de recherches Europe et Asie centrale, de Reporters sans frontières (RSF).
Cette organisation non gouvernementale (ONG) se donne pour objectif de défendre la liberté de la presse et la protection des sources d’information des journalistes partout dans le monde. Il me semble que le respect scrupuleux des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dont la liberté de la presse, est un facteur primordial pour la construction de relations équilibrées et durables, elles-mêmes sources d’une paix authentique. C’est pourquoi, madame, monsieur, en accord avec notre rapporteur Jean-Louis Destans, j’ai souhaité votre venue devant notre mission.
Reporters sans frontières porte un jugement sans nuances sur l’Azerbaïdjan. Votre site internet classe le pays au 163e rang mondial sur 180 pour la liberté de la presse – en 2002, il était 101e sur 134. Dans votre galerie des « prédateurs de la liberté de la presse », vous écrivez : « Non content d’avoir anéanti toute espèce de pluralisme, le président Ilham Aliev mène depuis 2014 une guerre impitoyable contre les dernières voix critiques. » Et encore : « S’ils résistent aux pressions, aux tabassages, aux tentatives de chantage ou de corruption, les journalistes et blogueurs indépendants sont jetés en prison. Les médias libres sont asphyxiés économiquement ou fermés manu militari (Radio Azadlig). Dernière trouvaille pour atteindre les journalistes qui continuent de travailler en exil : faire condamner des membres de leur famille, en général pour trafic de drogue. » Je remarque que certains des procédés de pression que vous citez ont été autrefois utilisés en Europe de l’Est, notamment en Pologne, et seraient donc – ce qui ne saurait les justifier – un héritage de l’époque soviétique. Les accusations que vous portez ainsi sont particulièrement graves. Aussi souhaiterions-nous obtenir à leur propos des précisions et des justifications.
Pourriez-vous également nous donner un aperçu de la législation sur la presse en vigueur en Azerbaïdjan, qu’il s’agisse du statut des entreprises de presse, de la législation pénale et notamment de la définition de la diffamation, ou encore des pratiques administratives qui encadrent, voire restreignent, la publication des organes de presse ?
M. Johann Bihr, responsable du bureau Europe de l’Est et Asie centrale de Reporters sans frontières. Je vous remercie de nous donner l’occasion d’évoquer devant vous la situation catastrophique de la liberté de la presse en Azerbaïdjan. Cet État occupe effectivement le 163e rang mondial sur 180 pour la liberté de la presse, ce qui se passe de commentaire, et la répression n’a fait qu’y croître au cours des dernières années, notamment depuis la dernière élection présidentielle, fin 2013. Elle s’est particulièrement accentuée en 2014, année au cours de laquelle les principaux défenseurs des droits de l’Homme et grands journalistes indépendants ont été jetés en prison, les autres ayant été contraints à l’exil ou au silence.
On a constaté une petite accalmie au début de l’année 2016, alors que l’Azerbaïdjan commençait sans doute à ressentir une pression venant de l’extérieur – je pense notamment à une résolution assez ferme du Parlement européen sur la situation des droits de l’Homme en Azerbaïdjan. Un projet de loi a également été déposé au Congrès américain, envisageant, sur le modèle de la loi Magnitski qui concernait la Russie, des sanctions ciblées – gels d’avoirs et interdictions de visa – à l’égard de personnalités qui se seraient rendues coupables de violations des droits de l’Homme en Azerbaïdjan. Ce projet de loi, qui n’a pas encore été débattu, semble cependant avoir déjà fait mouche.
Enfin, lorsque le président Aliev a manifesté le souhait de participer au sommet nucléaire qui devait se tenir à Washington à la fin de mars 2016, l’Administration américaine a conditionné sa présence à certains progrès relatifs aux libertés en Azerbaïdjan, notamment la libération des prisonniers politiques les plus emblématiques. Le régime azerbaïdjanais a accédé à cette demande en libérant les principaux prisonniers politiques, et c’est à cette occasion que la journaliste d’investigation Khadija Ismaïlova, ancienne directrice du service azerbaïdjanais de Radio Free Europe et journaliste d’investigation de grand renom – elle a été récompensée par de nombreux prix à travers le monde –, a été libérée. D’une manière générale, le nombre de journalistes, blogueurs et collaborateurs de médias emprisonnés a légèrement décru pour s’établir aujourd’hui à huit.
Derrière ces concessions de façade, aucune amélioration durable n’a été apportée à la situation de la liberté de la presse, qui reste toujours aussi critique, avec un pluralisme réduit à néant. La situation s’est même encore tendue à la suite de la tentative de coup d’État en Turquie de cet été. Les autorités azerbaïdjanaises étant très proches du pouvoir turc, elles ont trouvé, en invoquant la nécessité de s’attaquer à la mouvance Gülen – cet opposant au régime turc exilé aux États-Unis et désigné comme responsable de la tentative de coup d’État en Turquie –, un prétexte pour lancer une nouvelle vague d’arrestations. Dans ce cadre, de nombreux blogueurs et militants de l’opposition ont été arrêtés, ainsi que le responsable financier du dernier journal d’opposition, Azadlig, ce qui a des conséquences très concrètes pour ce journal.
M. le président François Rochebloine. Quelles actions votre organisation a-t-elle engagées lors de l’arrestation de Faïg Amirov, directeur financier du journal Azadlig, accusé de complicité avec le mouvement de Fethullah Gülen ?
Mme Emma Lavigne, chargée de recherche Europe et Asie centrale de Reporters sans frontières. Nous avons publié à deux reprises des communiqués de presse et nous sommes entrés en contact avec Dunja Mijatović, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), qui a adressé un courrier aux autorités azerbaïdjanaises : elle attend toujours une réponse et, si rien n’est fait, elle exprimera une position publique.
Alors que l’état de santé de M. Amirov est critique – il est atteint d’une maladie chronique de l’estomac –, les soins de première nécessité, et même une nourriture adéquate, lui sont refusés : il a perdu vingt kilos en deux mois, et nous sommes très inquiets à son sujet.
Son arrestation s’est effectuée au motif qu’il était en possession de deux livres – qui ne sont pourtant pas interdits en Azerbaïdjan, et à la rédaction desquels ont participé des personnes haut placées – alors que, d’après lui, c’est la police qui a mis ces volumes dans sa voiture. De toute façon, il est probable que ce chef d’inculpation sera bientôt remplacé par un autre, puisqu’une enquête a été ouverte sur de possibles financements illégaux d’Azadlig. Du fait de son arrestation, le journal ne dispose plus de la signature nécessaire pour les transactions avec la banque – la signature du nouveau directeur financier, nommé par intérim, est refusée –, ce qui fait que les créanciers ne peuvent être payés : le journal a donc très vite cessé de paraître. M. Ali Rzayev, rédacteur en chef adjoint d’Azadlig, également responsable du site internet et de tous les contenus, a dû fuir pour Strasbourg, où il a fait une demande d’asile, et même les personnes qui avaient passé des petites annonces dans le journal ont été inquiétées : on leur reproche d’avoir participé à une entreprise de publicité déguisée.
M. Seymour Khazi, autre célèbre plume d’Azadlig, a été condamné début 2015 à une peine de cinq ans de prison pour hooliganisme aggravé : il aurait agressé un passant avec une bouteille d’eau – alors qu’il n’aurait, en réalité, fait que se défendre face à une provocation.
M. le président François Rochebloine. Avez-vous réussi – vous ou certains de vos confrères journalistes – à entrer en contact avec M. Khazi depuis qu’il est emprisonné ?
M. Johann Bihr. Il est très difficile de le contacter directement, mais nous communiquons avec son avocat et d’autres journalistes mobilisés pour le défendre. Presque partout dans le monde, nous nous appuyons sur un réseau de correspondants – nous en avons dans 150 pays. Si, en Azerbaïdjan, notre correspondant doit rester incognito – ce qui en dit long sur l’état de la liberté de la presse dans ce pays –, il n’en constitue pas moins une importante source d’information.
Nous sommes également en contact étroit avec Khadija Ismaïlova, cette grande journaliste d’investigation, aujourd’hui fortement mobilisée pour obtenir la libération de Seymour Khazi. Une plainte a été déposée auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) pour violation du droit à un procès équitable, en particulier du droit à la défense. Saisie de cas similaires, la CEDH a presque systématiquement prononcé des condamnations en faveur de journalistes emprisonnés en Azerbaïdjan. Le commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, Nils Muižnieks, s’est lui-même joint en tant que tierce partie (third party) aux plaintes des journalistes concernés – ce qui est exceptionnel – dans trois dossiers ayant tous abouti à des condamnations prononcées par la CEDH pour violation systématique du droit au procès équitable et du droit à la défense. Il est à noter que la situation des journalistes emprisonnés en Azerbaïdjan est tout à fait comparable à celle des défenseurs des droits de l’Homme en général.
Mme Emma Lavigne. Il est déjà arrivé que des journalistes meurent dans les prisons azerbaïdjanaises faute d’avoir reçu des traitements appropriés à leur état – la dernière fois remonte à 2009 –, c’est pourquoi nous sommes très inquiets pour Faïg Amirov.
M. Johann Bihr. Le journaliste décédé en détention en 2009, Novruzali Mammadov, était rédacteur en chef du journal Tolishi Sado, une publication ayant pour objet de défendre la minorité persanophone talysh. Son successeur a lui aussi été arrêté et a passé près de cinq ans en prison avant d’être libéré à l’occasion de l’amnistie dont ont bénéficié plusieurs journalistes au début de 2016.
Les journalistes qui ont été libérés vivent souvent sous une épée de Damoclès. Dans bien des cas – notamment celui de Khadija Ismaïlova –, ils ne bénéficient que d’un sursis, systématiquement assorti d’une interdiction de voyager et, de facto, d’une interdiction d’exercer leur profession, sans parler de la menace de retourner en prison au moindre geste considéré comme suspect. Les libérations effectuées en 2016 constituent donc une ouverture très limitée, d’autant que les arrestations de journalistes sont toujours monnaie courante.
Pour ce qui est de la liquidation du pluralisme, ce que vous avez relevé sur notre site internet correspond effectivement à la réalité. Le secteur audiovisuel azerbaïdjanais est totalement sous contrôle.
M. le président François Rochebloine. Combien le pays compte-t-il de radios et de télévisions ?
M. Johann Bihr. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais il existe plusieurs dizaines de chaînes de télévision et plusieurs centaines de stations de radio. Les rares radios indépendantes du pouvoir ont toutes été écartées de la bande FM en 2009. La principale d’entre elles, le service azerbaïdjanais de Radio Free Europe, a été fermée manu militari à la fin de 2013 à l’issue d’une descente de police et d’une mise sous scellés de ses locaux – ce qui rappelle une pratique actuellement courante en Turquie pour de nombreux médias. Tous les collaborateurs de cette station ont été convoqués très régulièrement par le parquet dans le cadre d’enquêtes sur de prétendus abus de pouvoir – c’est à ce titre qu’a été poursuivie Khadija Ismaïlova.
La tactique la plus courante depuis plusieurs années est celle consistant à étouffer économiquement les médias critiques. Ainsi l’un des journaux indépendants au plus fort tirage, qui paraît sous le titre de Zerkalo en russe et d’Ayna en azéri – ce qui signifie « miroir » dans les deux langues –, a-t-il été contraint de fermer en mai 2014. Pour obtenir ce résultat, les autorités font en sorte de contrôler totalement le réseau de distribution. Dans nombre de cas, notamment celui d’Azadlig, le réseau de distribution de presse cesse de verser aux journaux le produit de leurs ventes. Ce produit est au demeurant déjà fort maigre, lesdites ventes étant entravées de différentes manières. Ainsi la réfection à neuf des kiosques de la capitale a-t-elle été l’occasion d’en faire disparaître la presse indépendante. De même, la vente par les crieurs de rue et dans le métro est désormais interdite.
Un autre moyen de faire pression sur les journaux est le contrôle exercé par l’État sur le marché publicitaire. Les entrepreneurs qui prendraient le risque de faire publier de la publicité dans des journaux critiques savent qu’ils feraient immédiatement l’objet de représailles, c’est pourquoi ils s’en abstiennent.
M. le président François Rochebloine. Des entreprises françaises font-elles de la publicité dans les journaux azerbaïdjanais ?
M. Johann Bihr. Dans la presse azerbaïdjanaise en général, mais pas dans les journaux indépendants – du moins, pas à ma connaissance. Un journal comme Azadlig n’a donc pas accès aux annonceurs, ce qui le prive d’une partie de ses revenus. Comme vous l’a dit Mme Lavigne, les autorités font aujourd’hui pression sur les personnes ayant publié des petites annonces dans Azadlig, en leur reprochant d’avoir participé à un financement illégal du journal.
M. le président François Rochebloine. De quoi les journaux d’opposition vivent-ils, si le pouvoir les prive de toutes leurs ressources ? Bénéficient-ils de financements extérieurs ?
M. Johann Bihr. Il existe un fonds d’État pour le développement de la presse, qu’Azadlig percevait avant d’être privé de cette ressource il y a environ deux ans. La principale source de financement des médias indépendants provient de l’extérieur, en l’occurrence de mécènes plus ou moins intéressés à leur cause. Cela constitue cependant un modèle économique extrêmement fragile, ce qui explique qu’Azadlig ait dû renoncer à sa publication papier. Depuis, il ne reste plus aucun titre de presse véritablement critique, mais seulement certains journaux entretenant une attitude ambiguë à l’égard du pouvoir – je pense notamment à Yeni Müsavat, proche du parti du même nom. Évidemment, il faut tenir compte du fait que le tirage de la presse papier est en chute libre, comme dans le reste du monde. La plus grande partie de la population, qui n’a pas toujours accès à internet, ne peut que regarder la télévision contrôlée par l’État et lire les journaux locaux, distribués selon un système d’abonnement contraint – encore un héritage de la période soviétique – et n’a donc pas accès à une information indépendante.
On assiste cependant à un bourgeonnement des médias en exil, déclenché notamment à la suite de la vague de répression accrue de 2013 et 2014. Les journalistes qui n’avaient pas été emprisonnés ont été contraints à l’exil et ont lancé, de là où ils ont trouvé refuge, de nouveaux médias. Ainsi le rédacteur en chef d’Azadlig, Ganimat Zahid, qui vit à Strasbourg, a-t-il créé un programme diffusé par satellite, intitulé Azerbaycan Saati – « L’heure azerbaïdjanaise » –, récemment converti en une véritable chaîne de télévision, Turan TV, qui émet en Azerbaïdjan en passant par un satellite turc – pour le moment, les studios sont à Strasbourg et les moyens techniques en Turquie. De même, le célèbre blogueur Emin Milli, exilé à Berlin après avoir été emprisonné durant plusieurs années, a-t-il lancé une télévision en ligne, Meydan TV.
Ces deux personnalités majeures de l’opposition font l’objet d’un harcèlement touchant leur famille, y compris des personnes très éloignées, avec lesquelles elles n’ont pratiquement aucune relation. Un cousin et un neveu de Ganimat Zahid ont été condamnés en juin 2016 à six ans de prison sur des accusations fallacieuses de détention de drogue. Quant à Emin Milli, il a été désavoué publiquement par vingt-trois membres de sa famille, contraints de signer une lettre ouverte où était formulée la demande de ne pas être associés à la traîtrise de leur parent.
Mme Emma Lavigne. Le cousin et le neveu de Ganimat Zahid condamnés à six ans de prison ont, eux aussi, dû se résoudre à un désaveu public dans l’espoir d’obtenir une grâce et d’être libérés.
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. Vous nous dites que huit journalistes sont emprisonnés et que des procédures visent ceux qui essaient de s’exprimer depuis l’étranger, mais pourriez-vous nous donner quelques informations générales sur le monde de la presse en Azerbaïdjan – je pense aux activités des médias, au nombre total de journalistes et à la proportion de ceux faisant partie de l’opposition ?
À quelle préoccupation du pouvoir répond la répression exercée sur les journalistes d’opposition ? En d’autres termes, s’agit-il de faire taire une presse d’idées contraires à celles du pouvoir, ou une presse de dénonciation des abus et de la corruption ?
La pression du pouvoir s’exerce-t-elle également sur les réseaux sociaux, ou l’accès à internet est-il facile en Azerbaïdjan ?
La presse étrangère est-elle présente en Azerbaïdjan, par le biais de correspondants ou de titres diffusés ?
Enfin, le 20 avril 2016, Meydan TV, réputée pour ses enquêtes journalistiques, a annoncé que le procureur général d’Azerbaïdjan avait ouvert une enquête criminelle contre elle. Avez-vous des informations sur l’état d’avancement de cette enquête ?
M. Johann Bihr. La diffamation est passible de prison, et les dispositions relatives à cette infraction ont encore été durcies récemment, notamment en ce qui concerne la diffamation sur internet. Nous appelons évidemment à la dépénalisation de la diffamation, étant toutefois précisé que les persécutions pénales contre les journalistes empruntent rarement la voie des poursuites judiciaires telles que nous pouvons les connaître, mais plus souvent la forme de procès montés de toutes pièces sur la base de charges fantaisistes – celles de hooliganisme et de détention de drogue étant les plus fréquemment invoquées.
Je n’ai pas de données précises en tête au sujet de la presse et du nombre de journalistes en Azerbaïdjan, mais nous allons faire des recherches et vous transmettrons ces renseignements dès que possible. Si la population azerbaïdjanaise est bien plus réduite que celle de la Turquie, par exemple, on compte tout de même plusieurs milliers de journalistes en Azerbaïdjan, dont les journalistes indépendants et d’opposition forment la portion congrue.
Bien avant 2013, les journalistes étaient déjà soumis à de très fortes incitations à ne pas être trop critiques. Ainsi existe-t-il en Azerbaïdjan un système d’attribution de logements aux journalistes, hérité de l’époque soviétique, dont sont exclus ceux qui refusent de se plier aux exigences des autorités – des barres d’immeubles entières, appartenant à l’État, sont ainsi réservées aux journalistes faisant preuve de loyauté à l’égard du pouvoir. Avant que la répression ne se durcisse il y a quelques années, la corruption était un moyen très employé : plutôt que de punir les récalcitrants, il s’agissait de récompenser ceux qui acceptaient de se taire. Pour toutes ces raisons, les journalistes d’opposition sont aujourd’hui très peu nombreux, et leur sentiment d’isolement d’autant plus grand que les autorités ont réussi à instaurer un climat de méfiance généralisée : le journalisme est une profession divisée, où la solidarité professionnelle existe peu. Il existe un conseil de la presse ayant théoriquement vocation à défendre les journalistes et à trancher les questions de diffamation en dehors du système pénal, mais, dans les faits, ce n’est qu’un organe de contrôle et de pression aux mains du pouvoir.
La presse étrangère est peu présente en Azerbaïdjan : on n’y compte que quelques rares correspondants permanents, appartenant aux plus grandes agences de presse internationales, telle l’AFP – ici aussi, on perçoit les effets de la crise de la presse.
M. le rapporteur. Les correspondants étrangers présents en Azerbaïdjan exercent-ils leur profession en toute liberté ?
M. Johann Bihr. Ils sont peu nombreux, mais je n’ai pas eu connaissance de pressions exercées récemment sur eux. La plupart du temps, les journalistes étrangers viennent en reportage en Azerbaïdjan, sans y être basés. C’est notamment le cas de nombreux journalistes basés en Turquie, qui font des allers-retours entre les deux pays, ou, dans une moindre mesure, de correspondants basés à Moscou ou en Asie centrale.
Pour ce qui est de la présence de titres de la presse étrangère dans les kiosques, je crois qu’elle se limite à un ou deux titres russes disponibles à Bakou.
La presse azerbaïdjanaise comprend des titres indépendants, parmi lesquels il y avait jusqu’en 2014 Zerkalo, un journal ne s’attachant pas spécialement à dénoncer le pouvoir, mais qui pouvait aussi bien se montrer très critique vis-à-vis des politiques mises en place par les autorités, notamment en matière de politique étrangère, que rapporter des nouvelles jugées positives, ou donner la parole à des représentants des autorités. Elle comporte aussi des médias d’opposition, s’attachant à dénoncer les abus des autorités, notamment en matière de corruption. Au sein de la presse indépendante, Khadija Ismaïlova est une journaliste d’investigation qui, sans servir une cause politique particulière, brasse des masses de documents de la Cour des comptes et d’autres institutions, et démontre ainsi que le Président de la République et ses proches ont fait main basse sur des pans entiers de l’économie, dont ils ont accaparé les secteurs les plus rentables : des proches du Président de la République ont ainsi, par l’intermédiaire de sociétés offshore, le monopole dans le secteur de la téléphonie mobile.
Le régime exerce la même pression à l’égard des deux types de presse, cherchant à faire taire toute critique et toute investigation indépendante. Quant à la motivation, elle est un peu plus difficile à établir en l’absence de menace réelle contre un pouvoir bien établi. Le président Ilham Aliev a succédé à son père, Heydar Aliev, qui avait aussi été chef du KGB de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan dans les années 1960. Le boom économique azerbaïdjanais, consécutif à la construction de l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC), consolide encore les ressources, la stabilité et les amitiés extérieures de ce régime.
À mon avis, cette campagne de répression est alimentée par un sentiment d’impunité : les autorités font taire toutes les voix critiques parce qu’elles sentent qu’elles peuvent le faire ; elles ne s’arrêteront que quand elles ne le pourront plus. En 2011, dans la foulée des printemps arabes, des manifestations de quelques centaines de personnes avaient eu lieu au centre de Bakou pour protester contre le régime. Elles avaient été vite réprimées, bien avant de prendre l’allure de camps de tentes à la Maïdan. De tels mouvements sont totalement inenvisageables en Azerbaïdjan où il n’y a vraiment pas de menace directe de soulèvement populaire. La répression s’abat parce que c’est possible. Les réseaux sociaux ne sont pas systématiquement censurés, mais ils peuvent l’être, au besoin, comme ce fut le cas lors des manifestations de 2011 et 2012. Les autorités sont tout à fait capables de bloquer l’intégralité de Facebook ou de YouTube.
Mme Emma Lavigne. En Azerbaïdjan, la diffamation est passible de trois ans de prison. Depuis 2013, cette mesure a été étendue aux contenus d’internet. En outre, l’usage d’un pseudonyme est en passe de devenir une circonstance aggravante dans toutes les affaires de diffamation ou de contenu jugé illégal par les autorités. Toute atteinte à l’honneur et à la dignité du président est passible d’une peine de deux ans de prison. Un amendement a été déposé le 15 novembre dernier, afin d’étendre l’application de la mesure à la sphère internet.
M. le rapporteur. L’opposition et les contestataires sont-ils très actifs sur les réseaux sociaux ?
M. Johann Bihr. Certains blogueurs d’opposition utilisent Facebook, mais les quelques mouvements constitués, qui étaient actifs sur ces plateformes, ont été décapités. C’est le cas de Nida, un mouvement fondé par de jeunes partisans de la démocratisation du pays. Plusieurs groupes de ce type fournissent les plus gros contingents de blogueurs emprisonnés. Précisons que les activistes politiques ne sont pas comptabilisés dans les statistiques de Reporters sans frontières, puisque nous ne recensons que les personnes emprisonnées du fait de leurs activités dans le domaine de l’information. Plusieurs dizaines de blogueurs activistes politiques sont actuellement emprisonnées.
En ce qui concerne Meydan TV, l’enquête suit son cours : les collaborateurs de la chaîne continuent à être convoqués au parquet et la plupart de ceux qui sont encore en Azerbaïdjan ont interdiction de quitter le territoire. Le but principal de cette enquête étant de faire pression, il n’est pas évident qu’elle aboutisse un jour à un procès.
M. le président François Rochebloine. Quelle signification revêt, selon vous, le moratoire appliqué aux condamnations pour diffamation ?
Le journaliste indépendant Rasim Aliev est mort à Bakou le 9 août 2015, des suites d’un passage à tabac. Il avait dénoncé publiquement le comportement provocateur d’un footballeur azéri qui avait brandi un drapeau turc au cours d’une rencontre opposant son équipe à une équipe chypriote. Le 1er avril dernier, un tribunal de Bakou a condamné les auteurs de ce crime à des peines de neuf à treize ans de prison. Que pensez-vous de ce jugement qui semble en contradiction avec les pratiques que vous déplorez ?
M. Johann Bihr. En effet, le cas de Rasim Aliev est assez particulier dans la mesure où ses agresseurs directs – le footballeur et des membres de sa famille – ont été condamnés. C’est un fait rare, et donc à noter, puisque la règle générale est plutôt l’impunité pour les auteurs de violences contre les journalistes.
En 2005, aucune enquête crédible n’a été diligentée quand Elmar Huseynov, rédacteur en chef de Monitor, le principal journal indépendant de l’époque, a été tué. Même chose dans le cas de Rafiq Tagi, dont on a célébré hier le cinquième anniversaire de la mort. Journaliste laïc, critique notamment à l’égard du régime iranien, il a été poignardé à Bakou en 2011.
Un fait intrigant relie Rasim Aliev à Rafiq Tagi : ils ont tous les deux fait l’objet de négligences médicales graves avant de succomber à l’hôpital – le même – où ils avaient été admis. Ni l’un ni l’autre n’était dans un état désespéré à son arrivée ; tous les deux ont commencé par aller mieux avant de décéder brutalement. Rafiq Tagi avait même accordé plusieurs interviews à la presse sur son lit d’hôpital et avait quitté l’unité de soins intensifs. A priori, son état était satisfaisant lorsque, brutalement, il est mort d’une hémorragie interne.
Rasim Aliev est également mort d’une hémorragie interne. Si ses agresseurs directs ont été emprisonnés, il subsiste des zones d’ombre, notamment sur ce qui s’est passé dans cet hôpital. Alors que Rasim Aliev avait été roué de coups, le médecin qui l’a examiné n’a pas diagnostiqué de déplacement de côte. Or c’est une côte déplacée qui a percé des organes et causé l’hémorragie. C’est une négligence étonnante.
Rasim Aliev était très engagé au sein de notre organisation partenaire en Azerbaïdjan, l’Institute for reporters’ freedom and safety (IRFS). Comme toutes les autres organisations de soutien des médias, l’IRFS a été fermé durant l’été 2014 sur la base d’accusations concernant son financement, et en application de lois, directement inspirées de la législation russe, qui entravent les activités des ONG. Lorsque, en août 2014, un mandat d’arrêt avait été lancé contre lui, le directeur de l’IRFS, Emin Huseynov, s’était caché chez Rasim Aliev, puis s’était réfugié à l’ambassade de Suisse où, les autorités azerbaïdjanaises étant au courant de sa présence, il était resté bloqué pendant près d’un an, avant d’être exfiltré l’été dernier par les autorités helvétiques.
Des doutes subsistent sur les causes de sa mort. Les auteurs des coups en sont-ils les seuls responsables ? On n’en est pas certain, mais on ne peut rien affirmer. Les faits restent assez troublants. La condamnation du footballeur et de ses proches n’est pas totalement satisfaisante. En tout cas, elle ne doit pas gommer le fait que l’impunité est la règle en ce qui concerne les assassinats, agressions ou enlèvements de journalistes. Il arrive en effet que des journalistes soient enlevés par les services de sécurité. Seymour Khazi, qui est actuellement emprisonné, a été enlevé en 2011 et on lui a fait subir un simulacre d’exécution. Alors qu’il couvrait les manifestations, il a été emmené dans une voiture où on lui a mis un sac sur la tête et un pistolet sur la tempe. Pendant toute la journée, on lui a dit qu’il devait arrêter de faire ce qu’il faisait. Il a finalement été relâché le soir, au bord d’une route.
Quant au moratoire sur la diffamation, il date de 2005 et n’a plus aucune portée pratique. La persécution des journalistes prend désormais des formes plus fantaisistes que les attaques en diffamation.
M. le rapporteur. Vous avez indiqué au tout début de votre intervention que l’Azerbaïdjan était au 163e rang sur 180 pays dans votre classement pour la liberté de la presse, ce qui m’a étonné. Je ne le voyais pas aussi mal classé, aussi près de la Corée du Nord. Comment élaborez-vous ce classement ? Quels critères retenez-vous ?
M. Johann Bihr. Pour établir notre classement mondial, nous recensons d’abord les violations de la liberté de la presse tout au long de l’année, en nous appuyant sur nos organisations partenaires sur le terrain. La mort de Rasim Aliev a ainsi pu peser sur le rang de l’Azerbaïdjan. Toutefois, le paramètre « violations de la liberté de la presse » est moins important pour nous que le questionnaire que nous adressons, dans chaque pays, à divers interlocuteurs – journalistes, professeurs de journalisme, universitaires, observateurs –, et qui porte sur plusieurs thèmes : le pluralisme, l’indépendance, le cadre légal, l’environnement, la qualité des infrastructures soutenant la production de l’information. Par environnement, nous entendons le climat dans lequel évoluent les journalistes : font-ils l’objet de menaces, de manœuvres d’intimidation ou autres ? En matière de qualité des infrastructures, nous nous intéressons notamment aux efforts consentis par les autorités pour rendre internet accessible ou pour permettre aux journaux d’être édités. Tous ces critères sont pondérés, les principaux étant le pluralisme et l’indépendance.
La même méthodologie est appliquée dans tous les pays et, au cours des dernières années, l’Azerbaïdjan n’a cessé de reculer dans le classement. Dans cette zone de l’ex-URSS, le pays reste mieux classé que l’Ouzbékistan et le Turkménistan qui occupent respectivement la 166e et la 178e place. En revanche, il s’est fait devancer par le Kazakhstan qui est désormais en 160e position. La Géorgie, au 64e rang, distance les autres pays de la zone, quand l’Arménie est 74e. La Turquie occupait la 151e place au mois de mars, et sa position ne va pas s’améliorer. La Russie figure à la 148e place, et la Corée du Nord est 179e sur 180.
Mme Geneviève Gosselin-Fleury. Vous avez évoqué le sentiment d’impunité qu’éprouve le pouvoir en place par rapport à la population d’Azerbaïdjan. Pensez-vous qu’il éprouve le même sentiment vis-à-vis de la communauté internationale, en dépit des récentes condamnations de la CEDH et des pressions exercées par les États-Unis ?
M. Johann Bihr. Tout à fait, et cela, me semble-t-il, explique dans une large mesure la répression qui s’abat actuellement sur les voix critiques. Nous ne sommes pas aveugles et nous comprenons très bien que des intérêts économiques et stratégiques lient l’Azerbaïdjan à ses partenaires, notamment occidentaux. Les autorités azerbaïdjanaises jouissent d’autant plus d’un sentiment d’impunité qu’elles ont pu penser s’en tirer à bon compte avec les libérations symboliques du printemps dernier : la pression a baissé alors qu’elle avait enfin commencé à monter au tournant de l’année 2015-2016.
Depuis la libération des principaux prisonniers politiques et de Khadija Ismaïlova, les pressions n’ont pas été renouvelées, du moins de manière publique. Nous avons au contraire l’impression d’en être revenus au business as usual. Dans ce contexte, il nous semble d’autant plus important de rappeler que, malgré de menus changements de façade, aucune amélioration concrète n’est notable en Azerbaïdjan en ce qui concerne la situation des droits de l’Homme en général et de la liberté de la presse en particulier.
Pourtant, on l’a constaté au début de l’année, les pressions fonctionnent. Le peu qu’on arrive à obtenir, c’est grâce à des pressions. Les partenaires de l’Azerbaïdjan ne doivent pas les alléger, au contraire, après ces quelques libérations. Le Congrès américain envisage des sanctions – gel des avoirs et retrait de visa – ciblées sur certaines personnes impliquées dans des violations des droits de l’Homme. Ce sont des sanctions qui semblent faire peur à l’Azerbaïdjan tout en ne nuisant pas à la population dans son ensemble ou au bien-être économique.
La manière dont les autorités azerbaïdjanaises appréhendent leurs relations avec l’étranger est marquée par l’héritage soviétique : elles fonctionnent en termes de rapport de force. Essayer de s’attirer les bonnes grâces de Bakou n’est pas un gage de bonnes relations avec ce pays. D’un strict point de vue d’investisseur, on peut d’ailleurs s’interroger sur la fiabilité d’un partenaire qui maquille ses statistiques et fait taire toute investigation sur la réalité économique du pays. Le soutien à ces voix indépendantes est de l’intérêt même des partenaires de l’Azerbaïdjan, y compris de la France.
M. le président François Rochebloine. À ce propos, que pensez-vous de l’attitude de la France ? Les gouvernements successifs en ont-ils fait assez ?
M. Johann Bihr. Les autorités françaises ne font pas suffisamment pression sur l’Azerbaïdjan. Nous leur sommes très reconnaissants d’octroyer des visas à des journalistes ou à des défenseurs des droits de l’Homme qui sont en danger, et qui peuvent ainsi gagner notre pays pour y déposer des demandes d’asile. C’est important, et il faut continuer de le faire. Dans ce cadre-là, nous avons des échanges de bonne tenue avec les autorités françaises. Cependant, en matière de plaidoyer politique, il conviendrait d’être beaucoup plus ferme et critique vis-à-vis des exactions commises par les autorités azerbaïdjanaises.
M. le président François Rochebloine. Vous pensez que le business empêche de le faire ?
M. Johann Bihr. Oui, à l’évidence. Certains pays, comme les États-Unis, parviennent à maintenir des liens économiques et stratégiques avec l’Azerbaïdjan, tout en ne se privant pas d’appeler un chat un chat en matière de violations des droits de l’Homme. Nous n’appelons évidemment pas à cesser de dialoguer et de commercer avec l’Azerbaïdjan ; la situation des droits de l’Homme peut tout à fait s’inscrire dans le cadre d’un dialogue sincère. L’Azerbaïdjan respectera d’autant plus la France qu’il n’aura pas l’impression d’être face à un partenaire insincère, qui cache certains points de vue. Nous appelons à une diplomatie beaucoup plus claire.
Nous n’ignorons pas que des messages peuvent être passés en sous-main. Au cours des dernières années, les relations entre la France et l’Azerbaïdjan se sont intensifiées et les visites d’État se sont multipliées dans les deux sens : le président Ilham Aliev vient à Paris et le président François Hollande va à Bakou chaque année. Cette intensification des relations devrait aller de pair avec un dialogue honnête sur la situation des droits de l’Homme en Azerbaïdjan. Leyla Yunus, militante des droits de l’Homme, avait été faite chevalier de la Légion d’honneur par François Hollande, à l’occasion de l’une de ses visites. Elle avait malgré tout été emprisonnée quelques mois plus tard.
M. le président François Rochebloine. Elle est restée près de deux ans en prison !
M. Johann Bihr. En effet, dans un état de santé déplorable, souffrant de diabète !
M. le président François Rochebloine. Nous avions demandé sa libération.
M. Jean-François Mancel. Notre éminent rapporteur a déjà posé ma première question sur votre classement que je trouve un peu étonnant : l’Italie est 77e, et la France, qui donne des leçons de morale à tout le monde, 45e. Une appréciation sur la France me paraît bizarre : les Français doutent de plus en plus de la vérité que disent les journalistes, est-il indiqué sur votre site. Tout cela est assez relatif !
M. le rapporteur. Quel est le premier du classement ?
M. Johann Bihr. La Finlande.
M. Jean-François Mancel. Vous dites d’ailleurs que la plupart des pays du secteur sont très mal classés.
Ma deuxième question va plus loin : qu’est-ce qui m’oblige à vous croire ? Sur tous les cas concrets que vous avez évoqués, l’État azerbaïdjanais dit exactement le contraire.
Enfin, je connais bien l’un de vos cofondateurs, Robert Ménard, qui fut secrétaire général de RSF de 1985 à 2008. Il m’est arrivé de croiser le fer avec lui : il était à l’extrême gauche, alors qu’il est maintenant maire d’extrême droite d’une ville de France ! Cela montre bien le caractère très subjectif de tout ce que vous pouvez dire. Si j’avais auditionné Robert Ménard il y a quinze ans, il n’aurait certainement pas dit ce qu’il dit aujourd’hui.
M. le président François Rochebloine. C’est valable pour beaucoup d’hommes politiques !
M. Jean-François Mancel. Mais à l’époque il était journaliste, et, en l’occurrence, c’est le journaliste cofondateur de RSF qui nous intéresse. Je m’interroge sur le caractère très subjectif de ce que nous entendons et qui n’est étayé par rien de très solide. Pour chaque sujet que vous abordez, on peut apporter un éclairage totalement opposé.
M. le président François Rochebloine. Du moins les questions sont-elles clairement posées, et c’est bien tout l’intérêt de cette mission.
M. Johann Bihr. Vous n’êtes pas sans savoir que Robert Ménard n’a plus aucun lien avec RSF depuis 2009. Sur la situation de la liberté de la presse en Azerbaïdjan, je pense qu’il vous aurait dit la même chose que nous aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, son parcours politique lui appartient et n’a aucune incidence sur RSF.
Quand vous dites qu’il n’y a rien de solide dans nos informations, vous m’étonnez quelque peu : on peut porter des jugements et des appréciations, mais on peut difficilement contester des faits précis tels que l’emprisonnement des journalistes cités ou la fermeture de toutes les organisations de défense de la liberté de la presse en Azerbaïdjan. J’entends bien que les autorités azerbaïdjanaises disent exactement l’inverse. Cela nous fait d’ailleurs rire de voir à quelle fréquence le président Ilham Aliev se vante sur les réseaux sociaux – notamment sur Twitter –, de la liberté de la presse qui règne dans son pays.
Il n’en reste pas moins que certains faits sont têtus. Qui sont les assassins de Rafiq Tagi et d’Elmar Huseynov ? Je ne les connais pas, et les autorités azerbaïdjanaises non plus. Peut-on apporter la preuve des faits d’extorsion de fonds et d’abus de pouvoir dont a été accusée la plus grande journaliste d’investigation azerbaïdjanaise ? De quelle influence bénéficie donc le « lobby arménien » – dont nous faisons évidemment partie – pour contraindre la CEDH à condamner l’Azerbaïdjan pour tous les emprisonnements de journalistes que nous avons cités ? Qu’est-ce qui oblige le commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe à s’associer, comme il le fait très rarement, aux plaintes de défenseurs azerbaïdjanais des journalistes ou des droits de l’Homme ?
Hélas, des faits solides attestent de la réalité de la répression en Azerbaïdjan. Entendons-nous bien : nous n’en tirons aucun bénéfice et aimerions beaucoup que cela change. Notre organisation existe depuis trente ans et a un statut consultatif auprès des Nations unies, mais, c’est vrai, rien ne vous oblige à nous croire. Cependant, je vous invite à auditionner des journalistes et des défenseurs des droits de l’Homme azerbaïdjanais. Ils vous diront la même chose que nous, si ce n’est pire. Plusieurs d’entre eux vivent en France, et nous vous communiquerons avec plaisir les coordonnées de Ganimat Zahid, rédacteur en chef d’Azadlig, et de quelques-uns de ses collègues, comme Agil Khalil, un journaliste qui a fait l’objet de trois tentatives d’assassinat en 2007 et 2008, alors qu’il n’avait que dix-huit ou dix-neuf ans. Les témoins ne manquent pas pour vous raconter les expériences qu’ils ont vécues.
M. Jean-François Mancel. Connaissez-vous l’Azerbaïdjan ?
M. Johann Bihr. J’y suis allé quelquefois.
M. Jean-François Mancel. Pour ma part, j’y vais très souvent et je n’y vois pas les mêmes choses que vous.
M. Johann Bihr. Je serais fort étonné que vous y trouviez beaucoup de médias critiques ! Nous avons un correspondant sur place depuis vingt ans. Il ne s’agit pas de contester le fait que l’Azerbaïdjan est une république laïque, par exemple, mais là n’est pas l’objet de la discussion, me semble-t-il.
M. le président François Rochebloine. Nous vous remercions pour votre contribution à nos travaux et pour ce que fait RSF au niveau international, en Azerbaïdjan et dans tous les pays.
*
* *
Ÿ Audition de Mme Anne Castagnos-Sen, responsable des relations extérieures pour Amnesty International France (jeudi 24 novembre 2016)
M. le président François Rochebloine. Nous sommes heureux d’accueillir Mme Anne Castagnos-Sen, responsable des relations extérieures pour la branche française d’Amnesty International.
Il est sans doute inutile de faire une présentation détaillée d’Amnesty International dont l’action en faveur des droits de l’Homme est connue de tous. Comme l’indique son site internet, celle-ci se décline sur le triple registre de l’enquête sur les atteintes aux droits de l’Homme, des pressions sur les autorités politiques et les entreprises pour faire cesser ces atteintes, et de l’assistance aux personnes pour la revendication de leurs droits fondamentaux.
Madame, notre mission d’information a pour objet les relations politiques et économiques entre la France et l’Azerbaïdjan au regard des objectifs français de développement de la paix et de la démocratie au Sud Caucase. Je considère, pour ma part, que le respect scrupuleux des droits de l’Homme et des libertés fondamentales est un facteur important pour la construction de relations équilibrées et durables, elles-mêmes sources d’une paix authentique.
Aussi, notre mission souhaiterait connaître votre appréciation de la situation des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en Azerbaïdjan, les actions concrètes que vous menez actuellement en relation avec ce pays et votre appréciation sur les perspectives d’une évolution positive vers un respect réel des droits de l’Homme et des conditions propres à y parvenir. Nous aimerions aussi avoir des informations sur la situation effective des organisations non gouvernementales (ONG) dans ce pays, dont on nous a dit qu’elle avait connu récemment une dégradation manifeste.
Bien entendu, il vous sera possible, si vous le souhaitez, de compléter les réponses que vous allez nous donner aujourd’hui en nous adressant des informations et des documents complémentaires. Je suis cependant obligé d’appeler votre attention sur le fait que le calendrier politique général de cette fin de législature ne nous laisse pas beaucoup de temps.
Mme Anne Castagnos-Sen, responsable des relations extérieures pour Amnesty International France. Monsieur le président, je vous remercie d’avoir invité Amnesty International à faire part de ses préoccupations et de ses recommandations devant votre mission d’information.
La section française d’Amnesty International travaille depuis plusieurs décennies sur l’Azerbaïdjan. Ceux de nos chercheurs qui sont plus particulièrement chargés du dossier du Caucase sont basés à Londres. J’avais sollicité la venue de celui qui effectuait les missions sur place, mais il ne peut plus le faire aujourd’hui, puisque nous n’avons plus accès au pays…
M. le président François Rochebloine. Pour quelle raison ?
Mme Anne Castagnos-Sen. Nous n’avons plus accès au pays depuis les Jeux européens de Bakou…
M. le président François Rochebloine. Étiez-vous présents lors des Jeux ?
Mme Anne Castagnos-Sen. Non, c’est à cette époque que nous sommes devenus persona non grata dans le pays. Notre dernière mission date de mars 2015. Nous avons alors publié un premier rapport essentiellement axé sur la liberté d’expression et les prisonniers d’opinion. Nous avons rendu un second rapport en juin 2015, à la veille des Jeux européens de Bakou. Il était prévu que nous nous rendions à Bakou pour le lancement du rapport et pour y rester plusieurs semaines, afin de suivre les Jeux. Malheureusement, nous avons été interdits de séjour. Les autorités azerbaïdjanaises ont fait savoir à notre secrétariat national que nous n’étions pas les bienvenus. Nous avons donc annulé le voyage.
Six mois après, le 7 octobre 2015, nous avons fait à nouveau une tentative de déplacement dans le pays, avec deux chercheurs de nationalité géorgienne, qui n’avaient donc pas de problème de visa. Ils ont pris l’avion, mais, lorsqu’ils se sont présentés à l’aéroport, ils ont été expulsés.
M. le président François Rochebloine. Sans aucune explication ?
Mme Anne Castagnos-Sen. Aucune. Notre secrétariat demande régulièrement aux autorités azerbaïdjanaises la motivation de cette décision, sans jamais recevoir de réponse. Nos collègues de Human Rights Watch ont eux aussi été expulsés en 2015.
D’habitude, Amnesty travaille sur le terrain : pour qu’ils soient impartiaux et disposent d’une plus grande marge de manœuvre, nos chercheurs ne sont pas basés dans le pays, mais se rendent sur place pour effectuer des missions. C’était le cas en Azerbaïdjan. Comme nous y sommes aujourd’hui interdits de séjour, nous sommes obligés de travailler à partir de témoignages recueillis par des opposants en exil ou, en faisant preuve d’une extrême prudence, par nos contacts restés en Azerbaïdjan, dont la plupart ne veulent pas témoigner à découvert dans nos rapports. Soit les noms sont changés, soit ils ne sont pas mentionnés.
En ce qui concerne les modes de répression, les parents et la famille proches des opposants en exil sont de plus en plus harcelés, menacés, détenus, interrogés… On a observé cette année une aggravation de la répression. Depuis qu’une chape de plomb s’est abattue sur la société civile, on s’en prend aux réseaux sociaux, aux médias et on contrôle internet.
Je comprends vos contraintes de calendrier, monsieur le président, mais j’avais demandé s’il était possible de reporter cette audition de quelques jours, car, le 5 décembre prochain, nous recevons M. Turgut Gambar, défenseur azerbaïdjanais des droits humains qui vit encore dans le pays et que nous accueillons dans le cadre de notre action « 10 jours pour signer », organisée autour du 10 décembre, jour anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme. M. Gambar vient témoigner de la situation de la société civile dans son pays et plaider la cause de deux de ses amis blogueurs du mouvement prodémocrate Nida, qui sont détenus. J’ignore si vous aurez la possibilité de le recevoir dans les prochains jours. Nous avions aussi demandé à nos chercheurs s’ils pouvaient être présents, mais ils n’étaient pas disponibles aujourd’hui.
M. le président François Rochebloine. Vous pourrez éventuellement nous communiquer un compte rendu de l’entretien que vous aurez avec M. Gambar.
Mme Anne Castagnos-Sen. Nous avons déjà pris rendez-vous pour lui le 6 décembre, au Quai d’Orsay, avec la direction des Nations unies et la direction géographique compétente du ministère des affaires étrangères.
Nous vous avons remis un dossier contenant de nombreux éléments sur des cas individuels et la liste des quatorze prisonniers d’opinion que nous avons établie en recoupant les informations, en nous documentant, avec la prudence bien connue d’Amnesty International, auprès de leur avocat ou de leur famille. Mais nous savons que nous sommes très en dessous de la réalité : tous nos partenaires en Azerbaïdjan font plutôt état de soixante-dix prisonniers d’opinion.
Au cours des dernières années, le gouvernement azerbaïdjanais a consenti d’importants efforts pour redorer son blason, en vain si l’on en juge par les récentes réactions de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), de l’Union européenne ou du Conseil de l’Europe. Des investissements considérables ont été réalisés pour donner l’image d’un pays moderne, dynamique, et attirer les investisseurs étrangers, y compris français, en organisant notamment de très grands événements sportifs et culturels : Eurovision en 2012, Jeux européens de Bakou en juin 2015, Grand Prix d’Europe de Formule 1 en juin 2016. Chaque fois, de même que dans les périodes électorales qui jalonnent la vie politique, sinon démocratique, du pays, on assiste à une recrudescence des arrestations et de la répression à l’encontre de la société civile. Il y a un lien évident entre ces événements internationaux, sportifs ou culturels, et la répression.
M. le président François Rochebloine. Au contraire, ce devrait être positif pour le pays.
Mme Anne Castagnos-Sen. Ces événements sont positifs, mais c’est l’occasion, pour les opposants, les journalistes, les militants des droits de l’Homme, de manifester leur mécontentement et de donner un écho international à leurs critiques, car la présence de nombreux journaux et médias étrangers offre aux voix critiques de la société civile, aux journalistes, aux opposants azerbaïdjanais, une véritable caisse de résonance. Il est donc logique que la politique répressive tente de museler ces voix et de mettre les opposants derrière les barreaux au moment où ils pourraient s’exprimer. C’est sans doute la raison pour laquelle Amnesty et Human Rights Watch n’ont pas été autorisés à rentrer dans le pays depuis les Jeux européens de Bakou, soit depuis dix-huit mois.
Le pays reste fermé à toute observation extérieure indépendante sur son bilan en matière de droits humains. Nous avons, bien sûr, salué le décret ordonnant, le 17 mars 2016, la libération de 148 prisonniers, d’autant que, sur la liste, figuraient douze de nos prisonniers d’opinion. Dans le même temps, notre rapport, publié en juin et intitulé Revolving doors, fait état du principe des « portes-tambours », c’est-à-dire qu’on libère certains prisonniers tandis qu’on en réincarcère d’autres. Sur ce rapport, figure le nom des personnes incarcérées depuis mars 2016.
Ces libérations ont eu lieu à la suite de très vives pressions internationales, les détenus étant, pour la plupart, d’éminents opposants, et dans un contexte économique de plus en plus difficile pour le pays, la baisse du prix du pétrole ayant entraîné une forte hausse des prix et une baisse du pouvoir d’achat. Il y a donc un grand risque de contestation sociale. Les autorités tentent de faire croire à une sorte d’équilibre, mais c’est de la poudre aux yeux.
Plusieurs facteurs assombrissent le tableau. Puisqu’elle n’était pas autorisée à travailler en toute indépendance, l’OSCE, pour la première fois depuis l’indépendance du pays, a refusé d’observer l’élection d’octobre 2015 et a suspendu ses activités sur le terrain. La Commission européenne a également annulé une mission pour laquelle elle avait posé comme préalable la libération de certains prisonniers.
Vous avez sans doute entendu parler de la réaction, le 21 novembre dernier, du Secrétaire général du Conseil de l’Europe, devant le refus de la Cour suprême azerbaïdjanaise d’annuler les condamnations qui pèsent sur M. Mammadov. Dès 2014, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) avait déclaré que cette détention était contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme, ce qui aurait dû être suivi d’effet, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe ayant ensuite demandé la libération de M. Mammadov.
M. le président François Rochebloine. Cette affaire va être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Comité des ministres du Conseil de l’Europe.
Mme Anne Castagnos-Sen. La situation est très tendue, alors même que le Conseil de l’Europe est une organisation politique intergouvernementale qui s’efforce a priori d’arranger les choses de l’intérieur plutôt que d’arriver au point de rupture. Le Conseil de l’Europe s’est déjà retiré d’un groupe de travail sur la question des droits humains, parce qu’il a estimé ne pas être en capacité d’œuvrer correctement dans cette enceinte. On arrive là à un nouveau point de rupture, ce qui, malheureusement, accrédite tous les constats que font, depuis des années, des organisations comme la nôtre.
La situation des ONG et des associations est très inquiétante. Selon les informations dont nous disposons, quasiment toutes les associations de défense des droits humains ou des droits fondamentaux – par exemple d’assistance juridique aux victimes – sont dans l’incapacité de travailler. Elles ont été fermées, les bureaux sont sous scellés, les comptes et les avoirs des organisations gelés, leurs dirigeants harcelés, intimidés, voire incarcérés. Les douze prisonniers libérés en mars dernier sont dans l’incapacité absolue de reprendre leurs activités. Leur condamnation n’a pas été annulée, mais certains l’ont vue commuée en une peine avec sursis, et elle reste donc comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Leurs avoirs et comptes personnels ont été gelés. Enfin, on leur interdit en général toute fonction publique. Pour des journalistes ou des avocats, c’est, de fait, une mort économique.
On est dans une situation où toute voix critique indépendante, qu’elle soit médiatique ou associative, est dans l’incapacité absolue de se faire entendre dans le pays. Pour répondre à la question liminaire que vous m’avez posée, monsieur le président, on constate une véritable aggravation de la situation.
Pour ce qui concerne Amnesty, nous avons perdu quasiment tous les contacts que nous avions sur place depuis des années. Soit ils sont en détention, soit ils ont été libérés, mais ils sont dans l’incapacité de prendre contact avec nous. Nous avons beaucoup de mal à maintenir le lien que nous avions noué avec eux depuis de nombreuses années.
Par ailleurs, il y a eu, cette année, nombre de nouvelles arrestations. Des obstacles législatifs ont été posés en 2009, puis en 2013, en ce qui concerne l’enregistrement et la légalisation du travail des associations, ainsi que leur activité en toute liberté.
Dès 2009, la loi a introduit l’obligation d’enregistrer les dons faits aux associations auprès du ministère de l’intérieur. Je vous laisse imaginer le caractère dissuasif de cette disposition auprès des donateurs… C’est, là encore, la marque d’une volonté de paralyser économiquement toute association ou faire taire toute voix libre et critique.
En 2013, de nouveaux amendements ont visé à limiter le montant des dons aux associations et obligé le destinataire du don à être également le titulaire du compte bancaire, ce qui veut dire qu’on ne peut pas verser de dons sur le compte bancaire d’une association, mais qu’on peut le faire sur celui d’un président d’association. Il y a un vrai risque de corruption et de détournements de fonds : or ce sont des accusations classiques portées à l’encontre des militants des droits de l’Homme et des dirigeants d’association. Certaines associations, qui refusent que les dons soient versés sur le compte de leurs dirigeants, sont dans l’incapacité de se financer. C’est un grand classique, et pas seulement en Azerbaïdjan : quand on veut empêcher les ONG de travailler, on légifère pour les étrangler économiquement.
La loi concernant l’enregistrement des dons est extrêmement rigoureuse et appliquée de façon totalement arbitraire. Certaines organisations tentent, depuis des mois, voire des années, de se faire enregistrer auprès du gouvernement sans aucun succès et sans que les refus soient motivés.
S’agissant des cas sur lesquels nous avons pu nous documenter, les dirigeants d’associations, les journalistes, les opposants politiques sont sous le coup d’accusations forgées de toutes pièces, qui répondent toutes à la même logique. Pour ce qui est du trafic de stupéfiants, nous avons la preuve avérée que les policiers, lorsqu’ils arrêtent quelqu’un, glissent dans ses poches, dans sa voiture ou dans sa maison, un peu d’héroïne. Et c’est toujours le même schéma. Il est tout de même troublant que tous les dirigeants d’associations et opposants politiques soient des trafiquants de drogue… Les accusations de fraude, d’évasion fiscale ou d’activité illégale des entreprises sont d’autres grands classiques. Portées à l’encontre de toute voix critique à l’égard du gouvernement, elles ne reposent sur rien.
Tous les avoirs et comptes personnels sont gelés et la plupart des personnes qui ont été libérées sont encore sous le coup d’une interdiction de voyager : elles ne peuvent donc pas quitter le pays. Telles sont les accusations et les sanctions classiques imposées aux défenseurs des droits humains, au sens très large du terme – j’y inclus les opposants politiques, les journalistes, les dirigeants associatifs et les blogueurs.
En ce qui concerne les cas emblématiques, vous avez sans doute entendu parler d’Intigam Aliev, qui fait partie des personnes libérées le 28 mars 2016. Sa peine a été commuée en cinq ans de prison avec sursis. Il est donc toujours sous le coup de sa condamnation, il ne peut pas voyager sans autorisation et ses avoirs ont été gelés.
M. le président François Rochebloine. Avez-vous des contacts avec ces personnes ?
Mme Anne Castagnos-Sen. Nous avons des contacts avec sa famille et ses avocats. Amnesty International France n’a pas de contact avec Intigam Aliev en personne, mais je pense que nos chercheurs en ont. Nous avons eu un contact direct ou indirect avec toutes les personnes dont je vous parlerai aujourd’hui et toutes celles qui sont recensées dans nos rapports. Cela fait des années que nous sommes en contact avec ces éminents opposants, comme Intigam Aliev ou Ilgar Mammadov.
S’agissant d’Intigam Aliev, nous avons des informations directes et recoupées. Il est le fondateur d’une organisation très connue, la Société pour l’éducation juridique, qui propose un soutien juridique aux victimes de violation des droits humains. Aujourd’hui, il ne peut exercer aucune activité publique. Il a été condamné à une amende de 45 000 dollars et on l’empêche de travailler comme avocat, qui est son métier à l’origine.
Rasul Jafarov s’est fait connaître de la communauté internationale au moment de l’Eurovision, en 2012, avec la campagne « Chanter pour la démocratie ». Puis il a lancé son association, Sport for Rights, c’est-à-dire « Le sport pour les droits », à la suite de quoi il a été détenu à la veille des Jeux européens de Bakou pour éviter qu’il puisse lancer sa campagne « Le sport pour les droits ». Lui aussi a été victime de fausses accusations, condamné à une peine de prison de six ans et demi et à une amende de 5 000 dollars. Il a été libéré grâce au décret de 2016, mais sa condamnation n’a pas été annulée, ses comptes bancaires ont été gelés et son association Sports for Rights n’a pas pu être enregistrée. Il a « bénéficié » d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme déclarant sa détention arbitraire, puisque fondée sur ses seules activités pacifiques concernant la liberté d’expression.
Khadija Ismaïlova, journaliste et directrice du service azerbaïdjanais de Radio Free Europe – lequel a été fermé depuis –, enquêtait sur des affaires de corruption au plus haut niveau de l’État, et y compris sur la famille présidentielle. Elle a été arrêtée en 2014, puis libérée en 2016. Elle est sous le coup d’une interdiction de voyager et d’exercer une activité dans le domaine public. Sa condamnation n’a pas été annulée, mais commuée en une peine de trois ans et demi de prison avec sursis.
Ilgar Mammadov, dirige Republican Alternative (REAL), l’un des rares groupes d’opposition qui subsiste. Cela étant, à chaque élection, qu’il s’agisse de l’élection présidentielle ou des législatives d’octobre 2015, ou encore du référendum constitutionnel de septembre dernier, tous les partis d’opposition qui existent sur le papier, mais qui ne sont pas représentés au Parlement, sont systématiquement empêchés de faire campagne et n’ont pas accès aux médias, qui sont tous sous contrôle gouvernemental. Les législatives de 2015 ont été boycottées par les partis d’opposition.
J’ignore ce qu’il en a été pour le référendum sur des modifications de la Constitution, le 26 septembre dernier, mais je crois que le taux de participation n’a pas dépassé 30 %, ce qui est très faible (1).
M. le président François Rochebloine. Seulement ?
Mme Anne Castagnos-Sen. La loi prévoit un taux de participation de 25 % pour que le référendum soit validé. Les modifications ont donc été adoptées, avec une extension importante des pouvoirs du Président et des moyens supplémentaires de muselage et de répression envers la société civile. L’objectif général est de faire taire la société civile dans toutes ses composantes.
Il y a deux modes de répression « nouveaux » ces dernières années. Il s’agit, d’une part, de la répression en ligne. Après s’être assurées du contrôle quasi total de l’expression dans la sphère publique, les autorités resserrent l’étau sur tous les espaces d’expression en ligne. Facebook, notamment, est sous étroite surveillance. Les responsables des sites internet sont régulièrement menacés de sanctions, voire d’arrestations. Des sanctions et des amendes sont imposées aux auteurs de toutes les critiques en ligne. Les sanctions vont des intimidations et menaces à la détention administrative arbitraire de courte durée, et elles peuvent aller jusqu’à la détention pure et simple.
Je parlerai tout à l’heure des deux cas particuliers dont nous nous occupons. Je voudrais évoquer, dans le cadre de notre action autour du 10 décembre, les cas particulièrement emblématiques de deux jeunes blogueurs du mouvement Nida, le mouvement des jeunes démocrates, Giyas Ibrahimov et Bayram Mammadov.
M. le président François Rochebloine. Compte tenu du temps qui nous est imparti, nous n’allons peut-être pas évoquer les cas individuels, car nous souhaiterions vous poser des questions après votre intervention.
Mme Anne Castagnos-Sen. Le dossier que je vous ai transmis est assez complet. Vous y trouverez des éléments d’information concernant ces cas.
J’ai oublié de préciser que, la plupart du temps, les allégations de mauvais traitements, autrement dit des passages à tabac, ne sont jamais confirmées par des médecins légistes. Les demandes des avocats et des familles pour qu’un médecin légiste indépendant ait accès aux détenus ne sont jamais acceptées, mais les avocats constatent fréquemment des traces de coups sur leurs clients.
Le second élément nouveau, d’autre part, c’est le harcèlement et les arrestations de proches et de parents concernant les opposants en exil. Le journaliste Ganimat Zahid a été détenu quatre ans en Azerbaïdjan avant de quitter son pays en 2011 et de se réfugier en France, où il a créé une chaîne de télévision par satellite et un journal en ligne. Le 20 juillet 2015, un de ses neveux et son frère ont été arrêtés et contraints de signer des aveux selon le scénario déjà décrit : on a glissé de l’héroïne dans la poche de l’un d’eux durant le transport au commissariat et on a « trouvé » de la drogue en perquisitionnant dans la maison et la voiture de l’autre. L’un encourt une peine de douze ans de prison pour détention d’héroïne et l’autre attend encore son procès.
Leurs avocats ont également constaté des irrégularités manifestes au regard même du droit azerbaïdjanais, qui n’est déjà pas très libéral, et ce notamment dans la manière dont ont été menées les perquisitions : l’avocat commis d’office n’était pas présent, il n’y avait qu’un seul témoin au lieu des deux requis, et, dans l’un des cas, le témoin était un chauffeur de taxi qui passait par là et a été forcé de signer le protocole de perquisition.
En conclusion, les recommandations d’Amnesty International sont la libération immédiate et inconditionnelle des prisonniers d’opinion. Amnesty distingue prisonniers d’opinion et prisonniers politiques. Les prisonniers d’opinion sont des personnes qui ont exercé pacifiquement leurs droits à la liberté d’expression, d’association, d’opinion. Pour les prisonniers politiques, qui ont pu recourir à la lutte armée, Amnesty International demande bien sûr un procès équitable, mais non une libération inconditionnelle et immédiate.
Nous demandons que, pour toutes ces personnes, y compris celles qui ont été libérées, les condamnations soient annulées et les interdictions levées, qu’elles soient en mesure d’exercer leurs métiers et d’exprimer leurs opinions, fussent-elles critiques envers le président ou sa famille.
Nous demandons la restauration d’un environnement sûr pour l’ensemble de la société civile – défenseurs des droits humains, journalistes, militants associatifs –, ainsi que la garantie de procès équitables, ce qui est loin d’être le cas. Nous demandons notamment que ne soient plus reconnus des aveux obtenus de force, sous la contrainte, voire sous la torture, et que les jugements soient revus lorsqu’il est avéré qu’ils s’appuient sur des preuves fausses, forgées de toutes pièces. Ce sont là des garanties de procès équitable conformes aux normes internationales.
Enfin, nous demandons aux partenaires de l’Azerbaïdjan et à la communauté internationale de porter en toutes circonstances ces messages auprès des autorités du pays, soit en bilatéral, soit au sein des enceintes multilatérales.
Tel est le tableau général que nous brossons du pays. Malheureusement, nos observations vont nettement en s’aggravant.
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. Merci pour cette présentation, assez accablante pour l’Azerbaïdjan. À quelle place se situe ce pays dans votre classement annuel ? Pouvez-vous dresser un tableau de la région du Caucase et des ex-Républiques soviétiques ?
Il existe une certaine ambivalence dans le pouvoir azerbaïdjanais, qui, d’un côté, cherche à s’ouvrir aux démocraties occidentales, sur le plan non seulement économique mais aussi culturel, et, de l’autre, présente la situation que vous décrivez, où tant la législation que les pratiques s’aggravent. En même temps, le pouvoir politique azerbaïdjanais n’est pas menacé. Cette ambivalence résulte-t-elle de pratiques anciennes héritées du pouvoir soviétique ou bien cela correspond-il à une réelle volonté du régime d’écraser toute forme de contestation ?
Mme Anne Castagnos-Sen. Amnesty International n’établit jamais de classement, que ce soit dans son rapport annuel ou dans d’autres publications, par principe et parce que, de toute façon, les paramètres à prendre en considération sont très compliqués. Ainsi, lors d’élections au Conseil des droits de l’Homme, au Conseil de sécurité ou dans d’autres enceintes, nous ne demandons jamais à ne pas voter pour tel ou tel pays. Nous demandons aux États électeurs de veiller au respect d’un certain nombre de critères, mais nous ne nous prononçons pas pour ou contre des pays. Je défends cette position, car le classement et les comparaisons pourraient donner à penser que, ici ou là, la situation n’est pas si grave. Nous avons des chercheurs dans tous les pays, y compris en France, mais ce n’est pas notre rôle d’établir des comparaisons.
M. le président François Rochebloine. En France, il n’y a pas de problème avec la liberté de la presse.
Mme Anne Castagnos-Sen. Non, mais vous connaissez peut-être les alertes que nous avons lancées sur la mise en œuvre de l’état d’urgence ou la situation des Roms. Dans chaque pays, nous essayons de porter un message permettant d’améliorer la situation des droits humains.
Je pense qu’il y a une certaine cohérence dans la logique politique de l’Azerbaïdjan. Ce pays cherche à redorer son blason à l’international et avait jusque-là les moyens économiques de le faire. Mais une contrainte économique pèse sur lui : il doit s’ouvrir à l’extérieur, et il déploie des efforts considérables pour attirer les investissements étrangers. C’était très frappant aux Jeux européens de Bakou : c’est la première fois que le pays d’accueil d’une grande manifestation sportive finance intégralement les déplacements et le séjour de toutes les équipes. Cela a coûté très cher.
M. le président François Rochebloine. Avez-vous le chiffre ?
Mme Anne Castagnos-Sen. Non, mais je peux le retrouver. Cela nous avait beaucoup frappés.
Le régime azerbaïdjanais est encore très marqué par le régime soviétique et il existe une crainte réelle que l’ouverture économique s’accompagne d’ouverture démocratique et de plus grandes libertés pour la population, ce que le pouvoir ne souhaite en aucun cas. En conséquence, l’ouverture économique s’accompagne en réalité d’un accroissement de la répression. On observe également cela dans d’autres pays. Il se produit un effet de balancier extrêmement toxique qui ne correspond pas du tout à la manière dont, en France, nous voyons l’ouverture économique. Jamais Amnesty International ne demande le boycott, économique ou sportif, d’un pays. Nous demandons au contraire que l’ouverture économique s’accompagne d’une amélioration équivalente en matière de droits humains et de libertés.
Je ne peux vous répondre sur la politique régionale, car je n’ai pas les compétences, mais je me renseignerai auprès de nos chercheurs et nous vous adresserons une note.
M. le président François Rochebloine. L’Azerbaïdjan, comme d’autres pays dans cette région du monde, est une jeune République, qui n’a que vingt-cinq ans. On a tendance à nous dire que, si les droits de l’Homme sont certes respectés en France, cela n’a pas toujours été le cas et cela a pris du temps. Que pensez-vous d’une telle remarque ?
Certains soutiennent également que les atteintes aux libertés publiques ne touchent qu’un nombre limité de personnes militantes et se produisent dans une relative indifférence de la société civile. Qu’en pensez-vous ?
Parmi les condamnations et les autres actes de persécution que vous avez constatés, certains ont-ils pour origine l’invocation de faits de corruption ?
S’agissant des Jeux européens de Bakou, Amnesty International a publié un rapport intitulé Azerbaïdjan : Les Jeux de la répression. Quelles ont été les répercussions de cette publication dans les États qui ont participé aux jeux, de la part des autorités politiques comme des milieux sportifs ?
Enfin, avez-vous noté des points positifs pour l’Azerbaïdjan, malgré votre rapport « accablant », pour reprendre le terme de notre rapporteur ?
Mme Anne Castagnos-Sen. Si l’on commence à tenir le raisonnement que l’Azerbaïdjan est une jeune République et que cela a pris deux siècles à la France pour reconnaître les droits de l’Homme, on ne fait plus rien pour aucun pays. Ce n’est pas du tout notre analyse. Je ne pense pas non plus que les personnes actuellement détenues soient sensibles à l’argument selon lequel l’Azerbaïdjan respectera les droits humains dans cent ans.
M. le président François Rochebloine. Vous avez souligné qu’Amnesty International n’établissait pas de classement, mais indiquez-vous tout de même si les choses vont dans le bon ou dans le mauvais sens ?
Mme Anne Castagnos-Sen. Oui, mais ce n’est pas en comparaison avec d’autres pays. Pour l’Azerbaïdjan, indépendamment de la libération, que nous avons saluée, des douze prisonniers d’opinion documentés par Amnesty, les choses vont clairement dans la mauvaise direction. Nous n’avons pas qualifié cette libération de poudre aux yeux, car elle est importante pour les personnes libérées, mais, si elles ne sont plus détenues, elles ne sont pas encore libres de voyager, et plusieurs autres de leurs droits fondamentaux sont violés. En outre, des arrestations continuent d’avoir lieu, tout aussi graves.
Le fait que la répression ne touche qu’un certain nombre de gens est quelque chose que nous entendons dans beaucoup de pays. Ce n’est pas faux, il n’y a pas d’arrestations massives en Azerbaïdjan, mais je ne suis pas convaincue que la population ne soit pas sensible à la répression. Il n’existe du reste aucune enquête sérieuse sur ce point. Il n’y a qu’à voir les difficultés qu’a rencontrées quelqu’un comme Élise Lucet pour enquêter en Azerbaïdjan. En tout état de cause, l’absence de médias indépendants, de société civile, d’associations capables de défendre les droits fondamentaux et d’apporter un soutien juridique aux victimes touche beaucoup plus de gens que ceux qui sont directement privés de liberté. Cela fait tache d’huile. Imaginez que nous n’ayons plus en France d’associations, de médias indépendants…
M. le président François Rochebloine. Il y aurait des manifestations !
Mme Anne Castagnos-Sen. Vous demandez également si, parmi les accusations portées contre la société civile, on trouve des faits de corruption. Certains sont accusés de détournement de fonds, ce qui n’est pas exactement la même chose, mais je n’ai pas trouvé de condamnation pour corruption dans les cas que nous avons documentés. Les accusations pour détournement de fonds sont quant à elles facilitées par la loi sur les ONG qui oblige à verser les dons sur les comptes personnels des dirigeants.
En France, notre publication sur les Jeux de Bakou a été médiatiquement très bien reçue, ce qui n’était pas gagné, car l’Azerbaïdjan est un peu le trou noir des médias français. Nous avons travaillé conjointement avec la Fédération internationale des droits de l’Homme (FIDH) et Human Rights Watch, avec qui nous avons mené toutes nos démarches médiatiques et de plaidoyer. Nous avons rencontré l’Assemblée nationale, la ministre Mme Fourneyron, le Quai d’Orsay. Dinara Yunus, la fille de Leyla et d’Arif, qui étaient encore en prison à l’époque, elle-même réfugiée aux Pays-Bas comme ses parents aujourd’hui, nous accompagnait. Notre satisfaction est que, chaque fois que les Jeux européens de Bakou ont été traités, les médias ajoutaient au volet sportif la question des droits humains.
M. le président François Rochebloine. Avez-vous envoyé votre rapport au journal L’Équipe ?
Mme Anne Castagnos-Sen. Nous avons envoyé un communiqué de presse à tous les médias, mais je ne saurais dire si L’Équipe l’a repris ou non.
Nous avions contacté le président du comité d’organisation, qui nous a répondu en citant la charte olympique et en expliquant que le comité veillerait à son respect, mais nous n’avons pas eu de rendez-vous. Le rapport a été très bien reçu en Allemagne, il a été assez bien couvert dans les pays européens, mais je ne sais pas ce qu’il en est au-delà.
Nos espoirs sont fondés sur les pressions que peuvent exercer des États comme la France en bilatéral. C’est un axe cardinal de notre action. Nous ne demandons pas de rompre les relations diplomatiques, de cesser d’investir ou de boycotter un pays, car cela risquerait d’avoir des conséquences dramatiques pour les populations, mais nous espérons que des pays amis pourraient obtenir des effets positifs. Nous ne croyons pas que le fait de ne pas aborder les questions qui fâchent soit le meilleur moyen de faire avancer les choses.
M. le président François Rochebloine. Certains avaient prôné le boycott des Jeux olympiques en Chine. Je trouve personnellement qu’il aurait été regrettable de ne pas nous rendre à ces jeux et que nous avons bien fait d’y aller, en affirmant un certain nombre de choses par ailleurs.
Mme Anne Castagnos-Sen. La politique de la chaise vide n’est en effet pas ce qu’il faut. J’ai davantage confiance dans les pressions que peuvent exercer des États « amis » et les instances multilatérales telles que le Conseil de l’Europe, et je ne crois pas trop à une soudaine prise de conscience du Gouvernement azerbaïdjanais.
M. Jean-François Mancel. Nous divergeons, madame, mais je salue avec respect votre présentation de grande qualité, ainsi que votre engagement.
Vous affirmez votre espoir que la France dise des choses à l’Azerbaïdjan, mais vous avez aussi dénoncé la France comme un pays liberticide, dans les lois qu’elle a adoptées à la suite des attentats de 2015. Comment pouvons-nous donner des leçons aux autres alors que votre institution souligne que nous avons voté des lois liberticides à la quasi-unanimité ?
Vous dites aussi que le référendum a porté atteinte aux droits fondamentaux. Ce référendum prolonge le mandat du Président de cinq à sept ans : nous avons longtemps eu un mandat présidentiel de sept ans en France, il a été réduit à cinq ans et beaucoup disent aujourd’hui que sept ans ce n’était pas si mal. Le référendum donne aussi au Président la possibilité de dissoudre le Parlement : or le Président de la République française a le droit de dissoudre l’Assemblée depuis 1958. Dans tous ces domaines, il est possible de présenter une interprétation négative comme une interprétation positive ; c’est subjectif.
Je ne nie pas que l’Azerbaïdjan puisse progresser en matière de démocratie, mais, avec seulement vingt-cinq années d’indépendance, après soixante-dix ans de soviétisme et des décennies de tsarisme, on peut tout de même prendre un peu de temps.
M. le président François Rochebloine. Je salue, comme notre collègue, le travail que vous conduisez dans le monde entier. Heureusement qu’Amnesty International existe.
Mme Anne Castagnos-Sen. Le référendum constitutionnel s’inscrit dans un mouvement répressif général, dans une série de lois qui vont toutes dans le même sens ; il ne faut pas le considérer isolément.
Je ne suis pas sûre que nous ayons employé le terme de « liberticide » pour la France mais peu importe. Quand nous parlons avec des diplomates, ils nous disent qu’il est important que d’autres disent : « Vous n’êtes pas non plus parfaits », car cela permet des échanges. Nous pouvons, les uns et les autres, faire des pas et progresser.
M. le président François Rochebloine. Merci, madame, pour cet échange et, encore une fois, continuez votre action !
*
* *
Ÿ Audition de Mme Agnès Romatet-Espagne, directrice des entreprises, de l’économie internationale et de la promotion du tourisme au ministère des affaires étrangères et du développement international (mercredi 30 novembre 2016)
M. le président François Rochebloine. Mes chers collègues, nous accueillons aujourd’hui Mme Agnès Romatet-Espagne, directrice des entreprises, de l’économie internationale et de la promotion du tourisme au ministère des affaires étrangères et du développement international. La diplomatie économique était l’une des priorités que s’était données, lors de sa nomination au ministère des affaires étrangères, M. Laurent Fabius. Rassemblant les services du ministère compétents en matière d’économie internationale, de soutien aux entreprises et d’attractivité de notre pays pour les investisseurs étrangers, la direction dont vous êtes chargée, madame la directrice, est en quelque sorte le bras armé de cette action. L’objet même des travaux de notre mission nous conduit à accorder un intérêt primordial à votre audition. Je vous remercie donc, au nom de mes collègues, de vous être rendue disponible.
Les auditions auxquelles nous avons déjà procédé nous ont fait prendre une conscience plus juste de l’importance des relations économiques qu’entretiennent l’Azerbaïdjan et la France et de leur développement récent – j’insiste sur ce qualificatif. Peut-être pourrez-vous nous aider à en avoir une vision d’ensemble et à mieux en cerner les causes – stratégie politique et économique des autorités de Bakou, plans d’investissement des groupes industriels français, etc. Sensibilisés par nos différents interlocuteurs à l’étendue nouvelle de ces relations, nous sommes également prévenus des risques qu’elles présentent pour les entreprises françaises potentiellement désireuses d’investir en Azerbaïdjan : des risques économiques et financiers résultant de la fragilité structurelle de l’économie du pays, directement affectée par la baisse des ressources tirées de la vente des produits pétroliers et dérivés ; également des risques juridiques, des risques tenant à des défaillances administratives ou à des comportements de corruption ; enfin, des risques liés à la structure politique autoritaire du régime, qui se traduit par des violations graves et répétées des libertés les plus fondamentales mais aussi par une certaine imprévisibilité des décisions politiques qui peut affecter les investissements des entreprises.
Nous aimerions donc, madame la directrice, connaître votre sentiment sur les conditions générales de l’investissement des entreprises françaises en Azerbaïdjan au regard de ces risques mais aussi des atouts que peut présenter ce pays. Nous souhaiterions également connaître les modalités d’intervention de votre direction auprès des entreprises françaises en Azerbaïdjan, de leur prise de connaissance du pays – de ses capacités et de ses limites – à la gestion de leurs investissements et des difficultés qu’elles peuvent rencontrer.
Votre exposé sera suivi d’un échange de questions et de réponses ouvert par notre rapporteur.
Mme Agnès Romatet-Espagne, directrice des entreprises, de l’économie internationale et de la promotion du tourisme au ministère des affaires étrangères et du développement international. Je vous confesserai tout d’abord que l’Azerbaïdjan est un pays sur lequel je n’ai pas eu l’occasion moi-même d’investir intellectuellement, pour des raisons qui tiennent peut-être à la rareté des échanges à haut niveau. Comme vous le savez, les coups d’accélérateur que peut connaître l’activité des administrations tiennent largement aux échanges à très haut niveau. Or j’ai été nommée à mon poste après le déplacement que le Président de la République y avait effectué.
Au demeurant, les sollicitations des entreprises amenées à y travailler ne sont pas quotidiennes, du moins à Paris, probablement parce que leur implantation sur place est assez ancienne et qu’elles ont depuis longtemps les réseaux nécessaires, le mode de fonctionnement adéquat…
M. le président François Rochebloine. Ce sont tout de même des échanges assez importants !
Mme Agnès Romatet-Espagne. L’Azerbaïdjan est le quatre-vingt-dix-huitième client de la France – le quatrième au sein de la Communauté des États indépendants (CEI), derrière la Russie, l’Ukraine et le Kazakhstan, avec 2,4 % des exportations françaises dans la région. Certes, c’est le premier partenaire commercial de la France dans le Caucase, mais notre solde reste déficitaire, à cause des hydrocarbures, et nos exportations se sont contractées en 2015.
Je ne porte pas d’appréciation sur le pays lui-même. Il ne figure simplement pas en « pôle position » dans la hiérarchie des pays auxquels nous devons consacrer du temps et de l’énergie. Il n’est pas dans un angle mort, car des choses s’y passent, mais, pour le dire crûment, ce n’est pas un pays auquel je consacre beaucoup d’équivalents temps plein (ETP).
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. Le Président de la République a quand même mis un accent particulier sur ce pays au cours des dernières années, avec des échanges à haut niveau à plusieurs reprises.
Mme Agnès Romatet-Espagne. Au cours de ces quatre dernières années, c’est au moins avec une cinquantaine de pays que nous avons eu des échanges – et des engagements – à très haut niveau. Bien sûr, le jour où on nous annonce la perspective de contrats d’un montant très important avec un pays, nous mobilisons davantage d’énergie, mais, soyons francs, avec l’Azerbaïdjan, cela n’a pas été le cas récemment.
Cela ne veut pas dire que le pays soit oublié de notre tissu économique. Vous avez déjà auditionné Mmes Florence Mangin, directrice de l’Europe continentale au ministère des affaires étrangères et du développement international, et Sandrine Gaudin, chef du service des affaires bilatérales et de l’internationalisation des entreprises à la direction générale du Trésor, et j’espère que vous ne m’en voudrez pas si je ne fais parfois que répéter leur propos.
Vous avez évoqué l’investissement, monsieur le président, mais nous ne savons pas, je veux le souligner, quel est le montant exact des investissements français en Azerbaïdjan. Le chiffre que je tiens de la Banque de France n’est pas significatif. De manière générale, j’appelle votre attention sur le fait que les montants dont nous disposons en matière d’investissement à l’étranger sont inexacts, quel que soit le pays concerné.
M. le président François Rochebloine. C’est grave !
Mme Agnès Romatet-Espagne. C’est une vérité qu’il faut connaître. La définition même de ce qu’est un investissement ne fait pas consensus, et les écarts sont parfois spectaculaires.
Selon la Banque de France, le montant de nos investissements en Azerbaïdjan s’élève à 78 millions d’euros. C’est franchement absurde ! Nous sommes le cinquième investisseur en Azerbaïdjan, et les seuls investissements de Total se chiffreraient plutôt en centaines de millions d’euros, sinon en milliards.
Une difficulté majeure tient à l’identification de l’origine des investissements dans un certain nombre de pays, les structures porteuses de ces investissements n’apparaissant tout simplement pas comme des structures françaises. La Banque de France pourra ainsi indiquer que tels investissements proviennent des îles anglo-normandes, des Bahamas, etc. En poste en Australie, j’avais moi-même constaté que les Bahamas y étaient le deuxième investisseur étranger !
M. le président François Rochebloine. Savez-vous ce qu’il en est du Qatar ?
Mme Agnès Romatet-Espagne. Je n’ai pas les chiffres.
M. le président François Rochebloine. Mais le problème est-il le même ?
Mme Agnès Romatet-Espagne. Je pense que les Qatariens font les choses plus « en direct ».
Les chiffres de la Banque de France ne sont pas toujours fiables. Essayer de retrouver la véritable nationalité de l’entreprise qui investit quelque part est d’ailleurs un exercice auquel tous les services économiques se livrent. Je l’ai vérifié en Inde, la semaine dernière. Le montant des investissements français qui nous avait été communiqué était ridicule, et nous avons constaté avec l’ambassadeur et le service économique qu’un travail d’identification et de précision de la réalité de ces investissements était nécessaire. C’est pourquoi j’appelle votre attention sur ce problème.
Pour sa part, l’ambassadeur d’Azerbaïdjan à Paris vous a donné le chiffre de 2,4 milliards d’euros. Voilà qui est loin des 78 millions d’euros de la Banque de France !
Ces montants sont-ils appelés à augmenter ? Oui, du fait des investissements que souhaite effectuer Total, qui prennent forme. Le président-directeur général de Total était à Bakou le 21 novembre dernier et y a conclu un accord avec la SOCAR, la compagnie nationale azerbaïdjanaise, qui devrait conduire à l’accélération des projets de Total sur place. Total voudrait que sa plateforme locale de forage soit prête en 2017 et entre en production à partir de 2022, via quatre puits, soit 5 milliards de mètres cubes par an, essentiellement destinés au marché local.
M. le président François Rochebloine. Nous tenons effectivement des chiffres de cet ordre des représentants de Total.
Avez-vous des relations avec la SOCAR ?
Mme Agnès Romatet-Espagne. Personnellement, je n’en ai pas, mais je suppose que notre ambassadrice à Bakou a demandé à rencontrer ses représentants, cela me paraît naturel.
Total a pour objectif de devenir opérateur en Azerbaïdjan, dans l’exploration-production, ainsi qu’Engie, mais il y a aussi des projets dans le transport. Tout cela se traduira par une hausse des montants investis par nos compagnies du secteur de l’énergie.
J’ajoute que l’investissement devrait également augmenter dans ce pays pour une autre raison, très directement liée au fait que nous sommes au-delà de ce qu’on appelle, pour le transport des produits frais, la barrière des 1 200 kilomètres – si vous devez franchir 1 200 kilomètres avec du frais, c’est trop cher et vous n’êtes plus compétitifs.
M. le président François Rochebloine. Nous allons précisément recevoir un représentant de Lactalis.
Mme Agnès Romatet-Espagne. Très bien. J’espère qu’il pourra vous confirmer cette indication, que je tenais de Lactalis et de Danone. Ils vont procéder par acquisition locale ou développement local, en se fournissant localement.
M. le président François Rochebloine. Par acquisition locale ?
Mme Agnès Romatet-Espagne. Probablement. En tout cas, c’est ce que je ferais à leur place. En matière de produits laitiers, les goûts locaux sont toujours très particuliers, il faut y coller, et vous avez intérêt à travailler à partir de ce qui se fait déjà sur place. Ils ont déjà lancé une opération de co-packaging, Danone a déjà lancé une production de yaourts au Sud du pays, donc tout cela va se faire localement.
Plus généralement, une tendance à l’implantation et au sourcing local, soit par acquisition externe, soit par développement d’une activité ex nihilo, est observée dans la plupart des pays. Cette manière de faire permet de surmonter les obstacles à l’accès au marché, spécialement en ce qui concerne les produits agroalimentaires. Et, de façon générale, les pays soumettent de plus en plus l’ouverture de leur marché national à une implantation locale. Il n’y a pas de raison que l’Azerbaïdjan échappe à cette quasi-règle.
Ce qui est intéressant, c’est l’intérêt plus grand que manifestent les investisseurs azerbaïdjanais pour la France. C’est là une évolution qui me semble plus surprenante. Pour la deuxième année, nous avons organisé – c’était au mois d’octobre dernier – le Invest in France Month. Cette initiative a été lancée à la demande de Laurent Fabius et reprise par Jean-Marc Ayrault. L’idée est, pendant un mois, dans chacun des pays retenus pour l’opération, de faire parler notre ambassadeur, Business France, son opérateur, mais également des « témoins de moralité », par exemple des entreprises qui ont déjà investi en France et peuvent expliquer les raisons de leur choix, et de leur satisfaction, des cabinets d’avocats, des cabinets d’experts-comptables. L’année dernière, nous avons conduit cette opération dans une cinquantaine de pays ; cette année, nous l’avons étendue à vingt autres, dont l’Azerbaïdjan. Selon notre ambassadrice, qui a réussi à réunir sur place une soixantaine d’hommes d’affaires, le fonds souverain pétrolier SOFAZ et l’Azerbaijan Investment Company, il y a pour la suite de fortes manifestations d’intérêt de la part des participants. Nous travaillons dans la foulée à l’organisation, avec Business France, d’un programme VIP, en particulier pour les représentants du fonds souverain. Ce programme de découverte se déroulerait au début de l’année 2017, sur l’ensemble de notre territoire, et serait articulé autour des sujets qui les intéressent.
M. le président François Rochebloine. Quels sont-ils ?
Mme Agnès Romatet-Espagne. Il s’agit notamment de l’hôtellerie et du tourisme, ce qui n’est guère surprenant, mais aussi de l’agroalimentaire, ce qui l’est davantage, de l’immobilier de la vigne. Cet intérêt pour l’hôtellerie et le tourisme est concomitant d’une volonté de très forte montée en gamme de l’Azerbaïdjan sur le terrain du tourisme. Il est intéressant de noter que les Azerbaïdjanais veulent diversifier leurs actifs et investir aussi dans ce domaine. En ce qui concerne l’agroalimentaire, il nous faut voir de quoi il retourne exactement et savoir ce qu’ils ont en tête – sans doute surtout le vin et les spiritueux.
M. le rapporteur. Ils investissent déjà dans le cognac.
Mme Agnès Romatet-Espagne. Absolument. Ils construisent d’ailleurs un hôtel de luxe à Cognac ce qui est heureux puisque la question de la montée en gamme de notre hôtellerie se pose et que nous manquons dramatiquement d’hôtels à forte capacité, surtout dans nos territoires.
M. François Pupponi. Pourquoi ce manque d’hôtels ?
Mme Agnès Romatet-Espagne. Au cours des cinquante dernières années, nous n’avons pas développé les liaisons aériennes directes.
Pour des Allemands d’un certain âge – je rappelle que les Allemands étaient notre première clientèle touristique – il n’est pas aussi simple de prendre l’avion, de descendre à Roissy, d’y récupérer sa valise et d’aller prendre un train que d’emprunter un vol direct Düsseldorf-Bordeaux. C’est une évidence et c’est la forme de tourisme sur trois ou quatre jours qui se développe le plus en Europe. À l’initiative de Matthias Fekl, secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger, nous avons donc créé un observatoire de la connectivité aérienne, ferroviaire et routière pour mieux mesurer les besoins dans le domaine aérien mais aussi ferroviaire, sans parler du sujet du dernier kilomètre.
M. François Scellier. Au-delà de la question de l’hôtel, il y a celle de l’accueil dans l’hôtel.
Mme Agnès Romatet-Espagne. Il y a l’accueil, le numérique, les prix, le produit touristique, la promotion de la destination…
Mme Agnès Romatet-Espagne. J’ai été surprise du succès remporté en Azerbaïdjan par cette opération Invest in France Month, organisé dans un certain nombre de pays choisis avec la direction générale du Trésor – des pays bénéficiant de revenus, dotés de fonds souverains un peu actifs, avec des hommes d’affaires ou des fortunes personnelles qui pouvaient justifier l’organisation d’une telle manifestation. Nous verrons comment ce succès se traduit concrètement.
Pour l’heure, je reviendrai sur quelques domaines dans lesquels nos échanges bilatéraux sont appelés à se développer avec l’Azerbaïdjan.
Le premier, c’est l’énergie. Il me semble assez habile d’investir en Azerbaïdjan maintenant, compte tenu du prix du baril. Les investissements se sont effondrés avec les cours, et leur coût est aujourd’hui bien moindre qu’il y a dix ans, mais aussi bien moindre qu’il ne le sera dans vingt ans. Par ailleurs, il y a là des gisements de qualité. Derrière Total, il y a toute la filière qui suit : Air Liquide, Engie, Spiecapag, Europipe… L’intérêt, c’est de les emmener tous pour qu’ils puissent offrir une offre consolidée dans le cadre de ces projets. Dans ce dispositif, j’accorde un grand prix à ce que peut faire l’Institut français du pétrole et des énergies nouvelles (IFPEN), particulièrement habile et efficace. Sa filiale Axens a d’ailleurs un contrat avec la SOCAR et est très active en Azerbaïdjan et peut former des ingénieurs dans la langue azérie. Cette transmission de notre savoir-faire peut être le moyen de nouer des liens très solides. Schneider Electric est également présent sur le marché local de l’électricité depuis 1994, mais aussi, très largement, sur d’autres créneaux.
Néanmoins, relativisons la part de l’Azerbaïdjan dans notre mix énergétique, dont le pétrole représente aujourd’hui 30 %. L’Azerbaïdjan nous fournit 6,3 % de ce pétrole, c’est notre septième fournisseur derrière l’Arabie saoudite, le Kazakhstan, le Nigeria, la Russie, l’Angola et l’Algérie. Cette part devrait augmenter, mais les projets de Total concernent avant tout le marché local. Relativisons donc notre éventuelle dépendance au pétrole azerbaïdjanais.
Je répéterai quelque peu les informations qu’a pu vous donner Alstom à propos du transport urbain et ferroviaire, autre secteur prometteur pour nos entreprises. S’ils n’auront certes pas l’ampleur de ce que l’on pouvait espérer compte tenu du prix du baril, des projets sont en cours, et nous pensons être en mesure de proposer une offre consolidée.
M. le président François Rochebloine. Les représentants d’Alstom avancent tout de même des chiffres relativement importants.
Mme Agnès Romatet-Espagne. Alstom a effectivement vendu une cinquantaine de locomotives, pour environ 300 millions d’euros, en 2014. Ce qui est intéressant, c’est que ce qu’ils ont vendu est fabriqué en France – à Belfort et Tarbes, au Creusot, à Villeurbanne et Ornans, au Petit-Quevilly. Des négociations sont aussi en cours à propos de la signalisation embarquée, et Alstom avait également livré des rames de métro pour les Jeux européens de 2015. L’entreprise est donc connue, et implantée. Jusqu’à présent, à ma connaissance, les Azerbaïdjanais n’ont pas exigé l’implantation locale d’une usine de montage en contrepartie de l’ouverture de leur marché – c’est souvent ainsi que les discussions s’ouvrent.
Toute notre filière ferroviaire et de transport est connue en Azerbaïdjan : Iveco a fourni des bus, Systra pilote le consortium international pour les études de rénovation et d’extension du métro de Bakou, Thales aussi a travaillé sur les stations de métro et sur le contrôle automatique du trafic – Communication Based Train Control (CBTC). Ce marché présente un potentiel, même s’il est un peu « gelé » pour l’instant.
Un mot sur le pétrole : il semble que l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), réunie à Vienne, soit parvenue à trouver un accord qui consisterait à diminuer la production d’environ 1,3 million de barils par jour, ce qui provoquerait sans doute un frémissement du prix du baril, mais confirmerait la tendance suivante : l’ère du baril à plus de 100 dollars est révolue, le prix étant durablement établi autour de 50 dollars. Certes, les investissements dans le secteur vont mécaniquement reprendre pour entretenir les champs vieillissants ; il n’est pas certain, toutefois, que l’économie mondiale puisse absorber la production des pays de l’OPEP au cours des prochaines années, surtout en cas de relance de la production des gaz de schiste aux États-Unis. Toutes les économies reposant sur l’exploitation des matières premières en sont affectées. Certaines, qui disposent de fonds souverains, sont plus solides ; d’autres jouissent d’une assez bonne réputation sur les marchés pour pouvoir emprunter, comme l’Arabie saoudite qui vient pour la première fois d’émettre des emprunts obligataires ; d’autres en revanche rencontreront de graves difficultés. L’Azerbaïdjan, qui possède un fonds souverain et qui ne s’est pas endetté à l’excès, pourra sans doute faire le gros dos pendant quelque temps, quitte à reculer sur certains grands projets comme le font toutes les autres économies.
L’industrie spatiale est l’un de ces grands chantiers industriels. En décembre 2014, nous avons vendu un satellite d’observation à Azercosmos et Arianespace doit prochainement lancer un deuxième satellite après un premier lancement en 2013 mais, dans les deux cas, ce sont des satellites américains. L’aéronautique, en revanche, demeure l’un de nos points forts dans la balance des échanges de biens : Airbus équipe la compagnie nationale azerbaïdjanaise. Avec onze appareils vendus, le volume de vente n’est pas encore considérable, mais Airbus a réussi à s’implanter dans le secteur du moyen-courrier et du long-courrier, jusque-là occupé par Boeing, et est bien parti pour renouveler une partie de la flotte azerbaïdjanaise, vieillissante. Enfin, la Société générale est la seule banque d’affaires française présente en Azerbaïdjan.
En clair, l’Azerbaïdjan n’est pas pour nous un pays de premier rang, mais notre flux d’affaires avec ce pays est déjà important, et structuré par le MEDEF, qui a déjà envoyé des délégations de chefs d’entreprise à Bakou.
L’un des secteurs les plus prometteurs est celui du tourisme. L’Azerbaïdjan, en effet, a l’ambition de s’ériger en destination touristique de haut de gamme, comme substitut de la Turquie. Ces dernières années, la fréquentation aurait augmenté de 7 % à 8 % par an, en partie grâce à un effet de déport, au détriment de la Turquie, de touristes venus d’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de Russie et d’Iran. C’est le résultat d’une politique de visas très favorable, puisque les ressortissants des pays d’Asie et du Golfe en sont exemptés. En outre, l’Azerbaïdjan projette de construire des infrastructures très ambitieuses, surtout en zone de montagne. Ajoutons que le pays vient d’être élu à la présidence du conseil exécutif de l’Organisation mondiale du tourisme, fonction qu’il exercera à partir du 1er janvier prochain.
La France, première destination touristique mondiale, souhaite exporter son savoir-faire dans des pays appelés à accueillir une partie du milliard de touristes supplémentaires qui voyageront en 2030. La famille des métiers du tourisme a été structurée sous l’égide d’un fédérateur, M. Jean-Emmanuel Sauvée, président et fondateur de la Compagnie du Ponant, et regroupe une centaine d’entreprises qui ont vocation à se projeter avec notre appui sur des marchés porteurs comme celui de l’Azerbaïdjan, sachant que l’association Cluster Montagne est déjà très présente sur place.
Inversement, les Azerbaïdjanais sont intéressés par des investissements dans le domaine du tourisme en France, sans doute en partie pour parfaire leur maîtrise dans ce secteur. Ainsi, la fondation Heydar Aliev souhaite financer avec Voies navigables de France (VNF) la replantation des arbres du canal du Midi ; le fonds souverain pétrolier SOFAZ a racheté un immeuble de la place Vendôme ; l’industriel Javad Marandi a racheté les chais Monnet à Cognac, autour desquels il prévoit des opérations de développement touristique ; le groupe Pasha Holding souhaite investir dans des résidences de tourisme en France ; enfin, la société Azimport est intéressée par le développement du secteur de l’hôtellerie sur la Côte d’Azur.
J’en viens à la lutte contre la corruption. L’Azerbaïdjan est signataire de la Convention des Nations unies contre la corruption, et le code pénal azerbaïdjanais prévoit l’incrimination générale des faits de corruption active et passive commis par des personnes publiques ou privées. Le bureau du Procureur général comporte un département de lutte contre la corruption. Plusieurs lois ont été adoptées concernant les lanceurs d’alerte et la répression des conflits d’intérêts. Les agents publics étrangers peuvent être incriminés pour des actes de corruption, et cette possibilité ne se limite pas au cadre du commerce international.
Cela étant, il existe en Azerbaïdjan un système d’auto-dénonciation que d’aucuns pourraient interpréter comme une incitation à pratiquer la corruption. Aucune liste noire des auteurs de faits de corruption n’est établie. Les immunités, les statistiques et l’administration des avoirs et de leur gel présentent des insuffisances manifestes. Le secret bancaire n’a pas été réaménagé. Enfin, la coopération internationale dans ce domaine n’est pas des plus évidentes.
L’Azerbaïdjan est membre du Groupe d’États contre la corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe, dont le quatrième cycle d’évaluation a porté sur la prévention de la corruption des parlementaires, juges et procureurs. Le rapport, adopté en 2014, mentionne un indice de corruption élevé et note le caractère « systémique » de la corruption dans le pays. Il recommande d’approfondir les lois anti-corruption et leur mise en œuvre impartiale. En clair, il existe encore une marge de progrès.
Certes, aucune entreprise ne m’a fait part de son incapacité à travailler en Azerbaïdjan en raison du niveau de corruption. Dans le cas contraire, j’aurais naturellement été liée par un devoir de signalement. Je suis néanmoins consciente des conclusions figurant dans plusieurs rapports informés sur le sujet.
L’Azerbaïdjan n’est pas membre à part entière du Groupe d’action financière (GAFI), une structure faîtière de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux qui compte une trentaine de membres et dont les travaux sont abrités à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). En revanche, l’Azerbaïdjan fait partie du Comité d’experts du Conseil de l’Europe sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Moneyval) qui a le statut de membre associé du GAFI.
Lors d’une première évaluation de l’Azerbaïdjan en 2008, le GAFI a révélé des défaillances notables. En février 2010, le pays a été inscrit sur la liste « grise » et menacé de passer en liste noire, raison pour laquelle il s’est engagé à un très haut niveau à remédier aux problèmes signalés. En juin de la même année, un cadre juridique nouveau a été adopté à cet effet, et le GAFI, ayant constaté in situ les progrès accomplis, a retiré l’Azerbaïdjan de la liste grise en octobre 2010. Toutefois, une nouvelle évaluation de février 2014, effectuée dans le cadre de Moneyval, a révélé les principales infractions au blanchiment de capitaux suivantes : vol, fraude, évasion fiscale, détournement de fonds, production et trafic d’armes et de stupéfiants, contrebande et corruption. Le rapport d’évaluation relève que l’Azerbaïdjan a pris des mesures, mais que des lacunes persistent : en matière de financement du terrorisme, le code pénal ne contient pas de définition des notions de terroriste individuel et d’organisation terroriste, la responsabilité pénale au titre du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme n’a pas été élargie aux personnes morales, l’incrimination du blanchiment de capitaux n’est pas correctement appliquée et aucune poursuite n’a jamais été engagée sur le fondement de cette seule infraction.
M. le président François Rochebloine. La situation s’est en effet améliorée, mais l’Azerbaïdjan a-t-il sollicité la France ou l’Union européenne pour y parvenir ?
Mme Agnès Romatet-Espagne. Tout l’intérêt du GAFI consiste précisément à ce que nous puissions aider les pays qui le souhaitent à progresser, et je vous confirmerai si notre expertise ou celle de nos partenaires européens a été sollicitée en l’espèce. En tout état de cause, un rapport de suivi de Moneyval, paru en décembre 2015, fait état de progrès concernant la mise en œuvre d’une approche fondée sur les risques et leur évaluation, ainsi que sur la cellule de renseignement financier. La procédure de suivi régulier suit son cours, le pays devant remettre son rapport de suivi ce mois-ci, même si la prochaine visite sur site n’est prévue qu’en 2021.
Enfin, l’Azerbaïdjan figure au 119e rang du classement de l’indice de perception de la corruption de Transparency International et, sur le terrain plus général du climat des affaires, au 65e rang du classement de Doing Business.
M. le rapporteur. Quelle appréciation faites-vous du « risque pays » associé à l’Azerbaïdjan compte tenu de la baisse des recettes budgétaires et des capacités d’investissement ? Comment l’Azerbaïdjan se situe-t-il en la matière rapport aux autres pays du Caucase ou encore au Tadjikistan ? Avez-vous des retours positifs concernant les réformes entreprises par l’administration azerbaïdjanaise dans le domaine des douanes et des formalités administratives, notamment depuis le lancement du portail de paiement en ligne ASAN Service ? Enfin, quels sont les projets en cours dans le domaine de l’environnement, de l’eau et du traitement des déchets ménagers ?
Mme Agnès Romatet-Espagne. Selon moi, l’Azerbaïdjan ne figure pas sur la carte des pays à risque majeur car, d’une part, l’exposition française y est minime, et, d’autre part, il n’est pas surendetté (environ 20 % de son PIB en 2015). Dans les autres pays du Caucase et au Tadjikistan, nos intérêts économiques sont encore moins importants. Le Kazakhstan présente des points communs avec l’Azerbaïdjan : dans l’un et l’autre pays, de grands projets sont gelés et la commande publique se rétracte, ce qui est d’ailleurs raisonnable. Le Kazakhstan, cependant, a lancé davantage de grands projets, tandis que l’Azerbaïdjan me semble avoir été plus prudent. Le Kazakhstan accueillera par exemple une grande exposition internationale à Astana en 2017 ; Bakou aurait envisagé sa candidature – contre Paris – à l’organisation de l’Exposition universelle en 2025 mais, compte tenu de l’évolution du prix du baril de pétrole, le risque serait important.
Dans le secteur de l’eau, du traitement des déchets et, plus généralement, des services collectifs, la France propose une offre globale concernant la « ville intelligente et durable ». Il va de soi que l’Azerbaïdjan fait partie des pays dans lesquels nous avons des parts de marché à gagner dans ces secteurs, car notre offre est de qualité et nos grandes entreprises savent travailler intelligemment dans des pays de ce type. Reste à s’assurer que la commande publique est gérée dans des conditions irréprochables.
M. François Pupponi. Confirmez-vous que l’Agence française de développement (AFD) s’apprête à intervenir en Azerbaïdjan dans les domaines du transport et de l’agriculture pour un montant supérieur à 100 millions d’euros ?
Par ailleurs, le recul des investissements lié à la situation économique du pays et à la baisse du prix du baril touche-t-il également les investissements dans le secteur de l’armement ?
Mme Agnès Romatet-Espagne. En matière de défense, certains grands projets envisagés il y a encore deux ans ne sont plus à l’ordre du jour, mais je ne peux pas entrer dans les détails sur ce point.
L’AFD a été autorisée en avril 2012 à intervenir dans les trois États du Caucase pour y proposer des prêts non ou peu concessionnels. L’Azerbaïdjan ne figure pas, en effet, dans la catégorie des pays en développement, et n’est donc pas éligible aux fonds de la Réserve pays émergents (RPE). En revanche, il peut bénéficier des procédures relevant du Fonds d’étude et d’aide au secteur privé (FASEP) géré par la direction générale du Trésor. L’AFD peut intervenir dans les domaines suivants : le développement urbain, en particulier les transports urbains, l’eau, l’assainissement et la gestion des déchets, les énergies propres et renouvelables, le tourisme durable, le financement du secteur privé – via Proparco – ainsi que la gouvernance et la protection sociale. L’engagement de l’AFD s’élève à un montant total de 112 millions d’euros. Ces aides déliées, qui correspondent à une stratégie économique de bon sens, doivent autant que possible permettre à nos entreprises d’en retirer des bénéfices.
M. le président François Rochebloine. Quel rôle jouent à votre connaissance les autorités politiques azerbaïdjanaises dans les négociations d’investissement, qu’il s’agisse de la présidence, des ministères de l’économie et de l’énergie ou encore de la SOCAR ?
Mme Agnès Romatet-Espagne. L’imbrication de la SOCAR et du fonds souverain SOFAZ au plus haut niveau de l’État ne fait aucun doute. Certaines personnes privées réalisent des investissements, mais je ne peux pas confirmer qu’elles le fassent au nom personnel du président de la République ou de certains de ses ministres.
M. le président François Rochebloine. Avez-vous eu connaissance des conditions dans lesquelles a été présenté le projet de rachat par un investisseur azerbaïdjanais du Racing Club de Lens ? Si oui, avez-vous pris des mesures ? De façon générale, votre direction exerce-t-elle un rôle d’alerte et de vigilance au bénéfice des entreprises françaises sur la sécurité financière et juridique des investissements qu’elles envisagent de réaliser en Azerbaïdjan ? Êtes-vous, enfin, en relation avec TRACFIN ?
Mme Agnès Romatet-Espagne. Oui, nous sommes en lien permanent avec TRACFIN. Quant à l’investissement dans le Racing Club de Lens, je ne l’ai découvert qu’après coup et nous n’avons pas été contactés à ce sujet. En revanche, lorsque j’ai été informée par hasard d’un projet d’investissement saugrenu dans l’AJ Auxerre, j’ai pris l’initiative d’alerter les services intérieurs pour leur demander une enquête de moralité et, compte tenu des conclusions de cette enquête, j’ai fait passer un message en conséquence.
Vous connaissez comme moi les conditions dans lesquels ce type d’investissements peut être réalisé en France. En déplacement à Berlin le 17 novembre dernier, le Premier ministre a appelé à une coopération allemande renforcée sur ce sujet ; nous y travaillons. Ajoutons que les clubs de football ne relèvent évidemment pas du « décret Montebourg » relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable, puisque ces investissements ne sont pas jugés stratégiques. Sauf cas de blanchiment, nous ne disposons donc pas des outils juridiques permettant de les empêcher, ce qui est d’ailleurs normal.
M. le président François Rochebloine. Madame la directrice, je vous remercie.
*
* *
Ÿ Audition de M. Pierre Andrieu, ambassadeur, ancien
co–président français du Groupe de Minsk de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) (jeudi 1er décembre 2016)
M. le président François Rochebloine. Mes chers collègues, je suis heureux d’accueillir aujourd’hui M. Pierre Andrieu, ambassadeur, qui a co-présidé, au nom de la France, le Groupe de Minsk de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), d’avril 2014 à octobre dernier.
Monsieur l’ambassadeur, comme vous le savez, l’objectif de notre mission d’information est d’examiner les relations politiques et économiques entre la France et l’Azerbaïdjan au regard des objectifs français de développement de la paix et de la démocratie au Sud-Caucase. Il n’est donc pas de chercher à évaluer la manière dont la France a compris sa mission à la co-présidence française du Groupe de Minsk au cours de ces dernières années, encore moins de porter un jugement sur la conduite, au jour le jour, des négociations organisées dans cette instance.
Nous aimerions en revanche que vous nous aidiez à mieux connaître le fonctionnement concret du Groupe de Minsk depuis les origines de sa création : quand et comment a-t-il été créé ? Comment sont fixés le rythme et l’ordre du jour de ses réunions ? Peut-on estimer que les co-présidents du Groupe de Minsk ont tous la même vision du rôle et des buts de cette instance ? Dans le cas contraire, comment ces différences se marquent-elles dans les travaux du groupe ? Sans vous demander de vous livrer à un exercice de voyance, quelles pourraient être, à votre avis, les voies d’un déblocage de négociations dont tout porte à constater qu’elles n’avancent guère aujourd’hui ?
Vous avez maintenant la parole. Après votre exposé, le rapporteur, puis moi-même, puis ceux de nos collègues qui le souhaiteront vous poseront quelques questions complémentaires.
M. Pierre Andrieu, ambassadeur, ancien co-président français du Groupe de Minsk de l’OSCE. J’ai en effet pris mes fonctions de co-président du Groupe de Minsk le 1er avril 2014. C’était une période politiquement intéressante et, à la fin du mois d’octobre de cette année-là, le Président de la République a organisé un sommet qui a rassemblé non seulement les présidents azerbaïdjanais et arménien, mais aussi – contrairement aux autres sommets qui ont été organisés, notamment par la Russie – les trois co-présidents. J’y étais donc avec mes deux collègues, russe et américain.
Je rappelle que le Groupe de Minsk est constitué par treize pays qui, au sein de l’OSCE, ont décidé d’aider l’Arménie et l’Azerbaïdjan à essayer de régler le conflit du Haut-Karabagh…
M. le président François Rochebloine. À quelle période ?
M. Pierre Andrieu. Tout de suite après la guerre de 1992-1993, après la signature du cessez-le-feu de mai 1994.
Au début, il n’y avait qu’un seul président, mais il a très vite été décidé qu’il y aurait trois co-présidents : la Russie, les États-Unis, et un troisième pays – d’abord l’Italie, la Finlande, la Suède, puis la France depuis la fin des années 1990.
L’ordre du jour dépend évidemment des deux pays. Nous fixons nous-mêmes le calendrier de nos voyages, de nos rencontres en fonction de l’agenda des présidents des deux États et des deux ministres des affaires étrangères.
M. le président François Rochebloine. Y a-t-il des divergences entre les trois co-présidents ? Peut-on parler d’une approche commune ?
M. Pierre Andrieu. En réalité, nous sommes quatre, comme les Trois Mousquetaires... Nous travaillons en effet avec le représentant personnel de la présidence tournante de l’OSCE, qui est la même personne depuis vingt ans : un diplomate polonais, Andrzej Kasprzyk. Celui-ci, à force de sillonner la région, a constitué une équipe représentée dans les quatre capitales – Bakou, Erevan, mais aussi Stepanakert et Tbilissi. Il connaît parfaitement bien les données du problème et a la confiance des deux présidents, arménien et azerbaïdjanais.
Il n’y a pas de divergences entre nous. Nous travaillons dans une atmosphère extrêmement ouverte et nous discutons de bonne foi – y compris avec le co-président russe. Bien sûr, cela dépend, pour beaucoup, des initiatives des uns et des autres. Les Américains ont pris des initiatives qui ont, notamment, débouché sur le sommet de Key West, en Floride.
M. le président François Rochebloine. Avant Key West, il y a eu Paris. Il y a même eu un accord de principe à Paris, qui a été ultérieurement remis en cause au sommet de Key West.
M. Pierre Andrieu. Malheureusement, cela n’a pas abouti, en raison d’événements qui avaient eu lieu à Erevan.
Par la suite, en octobre 2014, le Président de la République a fait une proposition pour essayer de rapprocher les positions des deux parties. L’idée était de demander aux deux présidents, azerbaïdjanais et arménien, de faire des déclarations publiques et croisées : le président arménien acceptait l’évacuation de territoires et, en échange, le président azerbaïdjanais acceptait de reconnaître la validité du vote qui aurait lieu sur le futur du Haut-Karabagh. Dans ce cadre, soit le président azerbaïdjanais fixait une date et l’Arménie évacuait les sept territoires limitrophes du Haut-Karabagh qu’elle occupe, soit il ne fixait pas de date et le président arménien n’évacuait que cinq territoires et se maintenait dans les deux territoires qui relient directement le Haut Karabagh et l’Arménie.
C’était un engagement public et croisé. Mais ce n’étaient que des déclarations, ce qui n’impliquait pas de les concrétiser dans l’instant. Malheureusement, aucun des deux présidents n’a donné son accord – alors même que c’était une idée arménienne.
Outre ce projet politique de règlement, la France a proposé un certain nombre de mesures de confiance pour faire revenir, justement, la confiance et permettre la reprise du dialogue. Parmi ces mesures de confiance, il faut citer une mesure humanitaire relative à l’échange des données sur les disparus de la guerre, sous l’égide du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). En effet, c’est la seule mesure qui ait été acceptée par les deux parties, et que l’on a d’ailleurs commencé à appliquer.
C’est ainsi que le CICR, depuis des années, poursuit la collecte de données ADN au sein des familles, notamment en Azerbaïdjan, de façon à pouvoir, le moment venu, croiser ces données avec celles prélevées sur les restes de soldats qui seraient exhumés – essentiellement sur le territoire du Haut-Karabagh. La Croix-Rouge poursuit son travail à sa manière, c’est-à-dire extrêmement discrète et sérieuse. Elle espère pouvoir procéder aux premières exhumations l’année prochaine, si toutefois il ne se produit pas, d’ici là, d’incident grave ni de conflit ouvert.
En résumé, pour répondre à votre question, il règne entre les trois co-présidents du Groupe de Minsk une atmosphère de travail, de sérieux et de confiance.
M. le président François Rochebloine. Quand vous vous déplacez sur les lignes de contact, que ce soit du côté azerbaïdjanais ou du côté arménien, le faites-vous ensemble ou séparément ?
M. Pierre Andrieu. Toujours ensemble, tous les trois, ou plutôt tous les quatre. Une fois que nous avons décidé d’aller sur place, nous choisissons l’endroit et l’équipe d’Andrzej Kasprzyk prend contact avec les deux parties pour les prévenir, faire préparer le terrain, le déminer et nous assurer de bonnes conditions de sécurité.
En général, nous sommes conduits à quelques kilomètres de là, sur une route. Nous mettons des gilets pare-balles et des casques. Sous un grand drapeau de l’OSCE, nous traversons à pied jusqu’à la ligne de contact elle-même, accompagnés, si nous sommes du côté arménien, par l’armée arménienne, qui nous « remet » à l’armée azerbaïdjanaise. C’est très impressionnant, car la ligne de contact nous ramène, visuellement, au conflit de 14-18, avec des tranchées, des barbelés, des soldats qui se font face à dix ou quinze mètres. Puis nous sommes escortés par les soldats azerbaïdjanais jusqu’à un endroit où nous rencontrons des responsables. Enfin, nous sommes ramenés à Bakou, soit en voiture, soit en hélicoptère. Les deux ou trois fois où je me suis rendu sur la ligne de contact, cela s’est déroulé ainsi.
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. Monsieur l’ambassadeur, considérez-vous que le rapport de force sur le dossier du Haut-Karabagh a été substantiellement modifié par les événements d’avril 2016 ? Et les principes de Madrid constituent-ils toujours une base crédible de règlement de conflit ?
Dans le même esprit, pensez-vous que le format de dialogue « un plus deux », c’est-à-dire associant Russie, Azerbaïdjan et Arménie, pourrait prendre le pas sur le format du Groupe de Minsk dans les prochains mois ?
Pourriez-vous nous faire un état précis des forces en présence – forces armées du Haut-Karabagh, soldats arméniens, soldats azerbaïdjanais – de part et d’autre de la ligne de contact ?
Enfin, pouvez-vous faire un point sur les minorités dans le Haut-Karabagh, ainsi que dans les districts de l’Azerbaïdjan occupés par l’Arménie et dans les zones du Haut-Karabagh restées sous contrôle azerbaïdjanais ?
M. Pierre Andrieu. S’agissant du rapport de forces, on considérait généralement, depuis une vingtaine d’années, jusqu’à la « guerre des quatre jours », que l’équilibre entre les deux parties penchait en faveur de l’Arménie, dans la mesure où celle-ci est puissance occupante et où ses soldats étaient retranchés dans des régions très montagneuses, le fait d’être en défense donnant une sorte d’ascendant. Au moment où j’avais pris mes fonctions, j’en avais parlé avec la direction du renseignement militaire (DRM). On m’avait expliqué qu’il serait très difficile, même pour une armée très moderne, de reprendre pied et de reprendre la région.
Voilà pourquoi, malgré le déséquilibre des populations et des économies, on considérait que l’équilibre des forces était en faveur de l’Arménie. Les événements du début d’avril 2016 ont montré qu’il n’en était pas ainsi. Les Azerbaïdjanais ont sans doute voulu montrer que le rapport de forces était en train de changer. Vous savez que le budget militaire de l’Azerbaïdjan dépasse la totalité du budget de l’État arménien.
M. le président François Rochebloine. De deux fois et demie !
M. Pierre Andrieu. L’Azerbaïdjan a fait un énorme effort en matière d’armement et d’entraînement, notamment grâce aux armes russes, car les Russes continuent plus que jamais à lui vendre des armes.
M. le président François Rochebloine. L’Azerbaïdjan utilise aussi des armes israéliennes.
M. Pierre Andrieu. Et les troupes azerbaïdjanaises s’entraînent avec les Turcs. Mais, vous avez raison, les Israéliens ont vendu à l’Azerbaïdjan des drones offensifs, et c’est la première fois que ces drones entraient en action sur un champ de bataille.
Donc, les Azerbaïdjanais ont voulu montrer que le rapport de forces était en train d’évoluer en leur faveur, rappeler à la communauté internationale que le conflit du Haut-Karabagh perdurait – même si on l’oublie un peu – et, surtout, faire de la propagande.
L’Azerbaïdjan a essayé de transformer ses deux ou trois petits succès militaires – il semble qu’ils aient repris deux ou trois collines – en succès politiques vis-à-vis de sa population, mais aussi vis-à-vis de la communauté internationale. Il s’agissait pour lui de démontrer qu’il avait désormais la maîtrise du calendrier et du contenu des négociations.
Nous nous sommes rendus dans la région, dans les trois capitales, quelques jours avant la « guerre des quatre jours ».
M. le président François Rochebloine. Vous vous doutiez, à ce moment-là, de ce qui allait se passer ? Vous n’aviez pas de craintes ?
M. Pierre Andrieu. Bien sûr, on craint toujours que la situation ne dérape, à la suite de telle ou telle provocation, d’un côté ou de l’autre. Mais nous ne nous doutions pas de ce qui allait se passer, d’autant que les deux présidents se trouvaient à l’étranger.
Sur place, quelques jours après, nous avons rencontré des responsables azerbaïdjanais extrêmement sûrs d’eux, qui disaient : « Maintenant, nous pouvons faire ce que nous voulons ». De l’autre côté, il faut reconnaître que les responsables arméniens semblaient avoir reçu un coup sur la tête. Pour eux, c’était vraiment une mauvaise surprise.
Il n’est pas exclu que les Russes aient été au courant de cette affaire et que, pour des raisons politiques, ils se soient bien gardés d’agir, de façon à calmer l’Arménie qui ne voulait pas discuter de la proposition qu’ils avaient faite.
Mais maintenant, la situation a changé. En effet, les Russes, voyant qu’ils avaient beaucoup perdu en crédibilité et en popularité en Arménie, ont peut-être décidé de reprendre l’affaire en mains et de rassurer l’Arménie. Ils lui ont livré à peu près les mêmes armes qu’à l’Azerbaïdjan, sans doute à un prix beaucoup moins élevé puisque l’Arménie fait partie de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC).
En octobre, quand nous sommes retournés sur place, les Arméniens paraissaient beaucoup plus sûrs d’eux, et tenaient un discours qui était à peu près le suivant : « Maintenant, on va voir ce qu’on va voir, on va tout reprendre »… Nous avons discuté avec leur nouveau ministre de la défense, M. Viguen Sakissian, qui est l’ancien conseiller diplomatique du président et qui n’est pas un militaire. Son discours était beaucoup plus politique et surtout beaucoup plus offensif : il est allé jusqu’à comparer la situation entre les deux pays à la Guerre froide, avec destruction mutuelle assurée – même sans armes stratégiques.
Voilà où nous en sommes aujourd’hui : d’un côté, l’Azerbaïdjan perd patience en disant que les négociations politiques n’ont pas commencé, contrairement à ce que ses dirigeants voulaient. De l’autre côté, les Arméniens maintiennent plus que jamais leur discours, qui est le suivant : il faut d’abord appliquer les mesures de confiance avant d’engager les négociations politiques. Des deux côtés, l’opinion publique est extrêmement remontée. La situation est donc assez fragile et dangereuse.
M. le rapporteur. Le format des négociations vous paraît-il adapté ?
M. Pierre Andrieu. Le format des négociations est celui qui existe depuis vingt ans, et il faut reconnaître qu’il n’y a pas eu beaucoup de résultats positifs. Cela étant, le succès d’une entreprise de médiation dépend beaucoup de la volonté des deux parties. Si celles-ci ne veulent pas discuter, ne veulent pas faire de concessions, aucune médiation, aussi bonne soit-elle, n’aboutira jamais.
Néanmoins, je pense que ce format est bon. Les trois pays qui co-président le groupe de Minsk sont tout de même la Russie, sans laquelle la question ne pourra pas se régler ; les États-Unis, qui sont ce qu’ils sont ; et la France, qui a sa spécificité au sein de l’Union européenne. Ces trois pays veulent avoir de bonnes relations avec l’Azerbaïdjan, notamment sur le plan économique, veulent la paix dans la région, et ont chez eux une minorité arménienne nombreuse – que ce soit la Russie, les États-Unis ou la France.
Souvent, les Azerbaïdjanais, ou d’autres, disent qu’il faudrait élargir le cercle à d’autres pays, à l’Allemagne, à la Turquie, etc. Évidemment, en Arménie, cela ne « passe » pas… Et puis on voit bien que ces demandes visent à noyer le problème.
M. le président François Rochebloine. À ce que je sache, selon l’accord de cessez-le-feu de mai 1994, il devait y avoir des représentants du Haut-Karabagh dans les discussions et négociations.
M. Pierre Andrieu. En effet, et ils ont d’ailleurs signé. Mais c’est l’Arménie qui, un jour, a décidé de les éliminer.
M. le président François Rochebloine. Vraiment ? Merci de cette information étonnante !
M. Pierre Andrieu. Je crois que c’était sous le président Robert Kotcharian. L’initiative venait en tout cas d’Erevan.
M. le président François Rochebloine. Je suis surpris, mais si vous me le dites. Quoi qu’il en soit, ne serait-il pas important que les représentants du Haut-Karabagh participent au moins aux discussions ? Entendre tout le monde faciliterait sans doute ce retour à la paix que nous souhaitons tous.
M. Pierre Andrieu. Sur le fond des négociations, les trois co-présidents ont pris, chacun à leur tour, des initiatives qui ont toujours été bien accueillies par les deux autres. Après la France au cours des années 1990, c’est aujourd’hui le tour de la Russie. Celle-ci a décidé il y a près de deux ans de proposer ce qu’elle appelle une approche par étapes. Il s’agit, à partir des principes de Madrid, qui sont la « bible » de cette négociation, de procéder en deux ou trois étapes : la première étape porterait sur les questions réputées les plus faciles – l’évacuation des territoires, l’ouverture des frontières, la fin du blocus, la reprise des échanges économiques et commerciaux, le déploiement d’une force de maintien de la paix. Les questions les plus difficiles – le statut provisoire ou final du Haut-Karabagh – seraient reportées à une deuxième étape. Les Russes ont proposé deux textes, qui sont devenus trois : le premier texte, qui a vocation à être signé par les deux présidents, azerbaïdjanais et arménien, aurait trait à la première étape ; le deuxième texte, qui formaliserait la deuxième étape, serait signé par les trois co-présidents du Groupe de Minsk ; enfin, le troisième texte prendrait la forme d’un projet de résolution à soumettre au Conseil de sécurité des Nations unies en vue du déploiement d’une force de maintien de la paix.
Cette proposition est sur la table. Inutile de vous dire que les deux parties ont réagi très différemment. Les Arméniens ont été extrêmement réticents et continuent de l’être. Sachant cela, les Azerbaïdjanais ont approuvé la proposition. Le ministre des affaires étrangères et le président russes – qui a repris la main – poursuivent cette diplomatie de la navette. À leur demande insistante, les Américains et les Français ont été mis « dans le bain » assez rapidement, mais nous n’avons pas vraiment la main : ce sont les Russes qui sont à la manœuvre.
Les discussions se poursuivent. Il y a quelques mois, elles étaient bloquées. Un sommet s’est tenu à Vienne en mai, à l’initiative des Américains, au cours duquel ont été évoquées uniquement les mesures de confiance. Malheureusement, la déclaration adoptée par les trois co-présidents n’a pas été respectée. Il avait été décidé lors de ce sommet d’augmenter les moyens humains et matériels de l’équipe d’Andrzej Kasprzyk, représentant personnel du président en exercice de l’OSCE, afin de renforcer les missions de monitoring. Or, certains responsables azerbaïdjanais, dès la fin de la réunion, ont nié avoir validé ces décisions, tout en affirmant ne pas y être opposés sur le principe à condition que l’Arménie accepte d’engager les négociations politiques. Le document avait été signé par les ministres des trois pays qui co-président le Groupe de Minsk. Pour le moment, nous en sommes là. Les Russes ont voulu accélérer un peu les choses. Le président Poutine a organisé, en marge du forum économique international qui se tient chaque année à Saint-Pétersbourg, un sommet avec les deux présidents. Nous avons fait antichambre pendant très longtemps, puis nous avons été invités pour le dessert. Malheureusement, le désaccord entre les deux pays persiste. La situation est assez fragile et instable.
M. le rapporteur. Après toutes ces années, percevez-vous une volonté des deux parties d’aboutir, ou pensez-vous que le statu quo arrange finalement tout le monde ?
M. Pierre Andrieu. Il est difficile de répondre à une telle question. Je ne perçois malheureusement pas de volonté d’aboutir, de la part d’aucune des deux parties, pour diverses raisons qui tiennent notamment au rapport entre les présidents et leurs opinions publiques respectives. Tant en Azerbaïdjan qu’en Arménie, les opinions publiques sont très remontées – ce sont deux nationalismes qui s’opposent. Les contacts et les discussions se poursuivent néanmoins. Les deux parties ont besoin du Groupe de Minsk et de la médiation, ne serait-ce que pour maintenir le contact et essayer de faire avancer leurs thèses.
Le manque de confiance entre les deux parties est grand. Une seule mesure de confiance a été acceptée, qui est en fait une mesure humanitaire : la collecte et l’échange de données sur les personnes disparues, sous l’égide du CICR, qui est une organisation très sérieuse, compétente et expérimentée dans ce domaine. C’est une mesure très importante pour les familles, notamment azerbaïdjanaises, qui ont vu leurs enfants ou leurs pères disparaître.
M. le président François Rochebloine. Les difficultés économiques que connaît l’Azerbaïdjan en raison de la baisse du prix du pétrole ont-elles eu un effet sur les réunions du Groupe de Minsk ?
M. Pierre Andrieu. Non. L’Azerbaïdjan, comme l’Arménie, conserve des positions extrêmement rigides.
M. le président François Rochebloine. Les questions économiques jouent-elles un rôle dans les discussions ?
M. Pierre Andrieu. Absolument pas.
M. le président François Rochebloine. On a évoqué la présence de mercenaires turcs lors de la « guerre des quatre jours ». Pouvez-vous confirmer cette information ?
M. Pierre Andrieu. C’est difficile à vérifier. On a évoqué la présence de mercenaires, si on peut les appeler ainsi, des deux côtés. Il s’agirait notamment d’Arméniens de la diaspora, venus de France et des États-Unis, qui ont déjà fait la guerre en 1994 et qui seraient revenus, mais nous manquons d’éléments tangibles.
M. le président François Rochebloine. Quelle influence peut exercer sur les travaux du Groupe de Minsk la solidarité notoire entre la Turquie et l’Azerbaïdjan ?
M. Pierre Andrieu. La Turquie soutient depuis longtemps l’Azerbaïdjan, pour des raisons sans doute historiques, et aussi idéologiques. Ses positions pro-azerbaidjanaises lui interdisent de coprésider le Groupe de Minsk puisque, pour proposer sa médiation, il faut s’abstenir de prendre parti. La Turquie peut naturellement, cela dit, jouer un rôle. Nous devions nous rendre dans ce pays les 14 et 15 juillet, mais la tentative de coup d’État nous a obligés à annuler notre visite. Le Caucase du Sud est une région importante pour la Turquie. Un début de solution de ce conflit passe par le règlement du contentieux entre la Turquie et l’Arménie. Les tentatives menées en ce sens il y a quelques années n’ont pas abouti. Il faut encourager les deux parties à reprendre langue et à négocier.
M. le président François Rochebloine. Vous faites référence aux protocoles de Zurich ?
M. Pierre Andrieu. Malheureusement, ils ne sont pas entrés en vigueur.
M. le président François Rochebloine. Les incursions de chaque côté donnent lieu à des accusations mutuelles. Rien de plus classique, me direz-vous. Pourrait-on envisager de recourir à des moyens techniques – des observations satellitaires, par exemple – pour aider le Groupe de Minsk à déterminer de manière objective les responsabilités et à savoir qui est le premier à avoir attaqué ?
M. Pierre Andrieu. Nous avons prôné le renforcement des moyens de l’équipe de M. Kasprzyk et l’installation d’un mécanisme de détection capable d’établir qui tire le premier, mais cette proposition n’a pas été retenue.
M. le président François Rochebloine. Qui s’y est opposé ?
M. Pierre Andrieu. L’Azerbaïdjan, au motif que le mécanisme ne pourra être installé qu’une fois que les Arméniens auront évacué les lieux. Or, c’est précisément maintenant que ce mécanisme serait utile. Les co-présidents essaient de faire pression en faveur de cette solution, sans succès à ce jour. Toutefois, je ne suis pas sûr que le dispositif de même nature installé en Ukraine ait fait la preuve de son efficacité.
M. le président François Rochebloine. Vous quittez vos fonctions de co-président – j’en profite pour vous remercier pour le travail que vous avez effectué – en même temps que le représentant américain. Ne craignez-vous pas que ce changement crée des difficultés ?
M. Pierre Andrieu. Je ne le crois pas. Le représentant américain, après trois années de co-présidence, est appelé à de nouvelles fonctions, mais les États-Unis restent engagés, et un intérim sera assuré jusqu’à l’installation de la nouvelle administration. Reste à savoir si celle-ci manifestera le même intérêt que les précédentes pour cette question, dans une région qui reste importante pour les États-Unis pour des raisons stratégiques et économiques, notamment du fait de la présence de pétrole.
Quant à la Russie, cette région fait partie de sa zone d’influence ; les Russes n’ont pas intérêt à un conflit majeur alors qu’ils sont déjà engagés en Syrie. Ils ont intérêt au maintien de l’équilibre. Lors de la « guerre des quatre jours », ce sont eux qui ont « sifflé la fin de la récréation ».
L’Union européenne, pour sa part, a intérêt à la stabilité de la région et à des relations apaisées et de confiance avec ses voisins.
M. Jean-François Mancel. Vous laissez entendre que le statu quo satisfait finalement les deux belligérants. Mais ne peut-on pas considérer qu’il joue davantage en faveur de l’Arménie, dans la mesure où elle est la puissance occupante ? Plus l’occupation perdure, plus le territoire devient progressivement, dans les faits, celui de l’Arménie.
Il semble par ailleurs que des Arméniens, venus notamment de Syrie, se soient récemment installés au Haut-Karabagh et dans les provinces voisines. Est-il possible d’appréhender le phénomène de colonisation qu’on a observé au début – les Azerbaïdjanais étant chassés de leur territoire au bénéfice des Arméniens ?
Enfin, le Groupe de Minsk s’intéresse-t-il au sort des réfugiés et des déplacés qui ont dû quitter leur territoire, notamment celui des sept provinces, dont nul ne conteste que la population était majoritairement azérie, contrairement à celle du Haut-Karabagh lui-même ?
M. Pierre Andrieu. Chaque fois que nous nous rendons à Bakou, nous rencontrons des représentants des réfugiés azerbaïdjanais qui ont dû quitter le Haut-Karabagh et les territoires alentour. Il s’agit aujourd’hui de la deuxième, voire de la troisième génération de réfugiés. Le gouvernement a fait beaucoup d’efforts pour les installer ; ils vivent aujourd’hui dans de bonnes conditions, ils sont logés, leurs enfants sont scolarisés, mais ils veulent évidemment retourner sur leurs terres, ce qui est tout à fait normal.
M. le rapporteur. Quel est le nombre de réfugiés et de déplacés ?
M. Pierre Andrieu. Entre 300 000 et 400 000, je ne suis pas sûr.
M. Jean-François Mancel. Selon mes informations, le nombre de déplacés est estimé à 200 000, celui des réfugiés à 700 000.
M. Pierre Andrieu. Dans l’autre sens, de nombreux Arméniens ont aussi été obligés de quitter Bakou, qui était auparavant une ville cosmopolite.
M. le président François Rochebloine. Les Azerbaïdjanais réfugiés provenaient certainement plus des provinces que du Haut-Karabagh.
M. Pierre Andrieu. Ils provenaient des deux régions. Des villes comme Choucha et Stepanakert – que les Azerbaïdjanais tiennent à appeler Hankendi – étaient des villes où vivaient de très nombreux Azéris, qui en ont été chassés.
S’agissant du statu quo, il est vrai qu’il est plus profitable à l’Arménie. Les Arméniens ont gagné la guerre, ils sont en position d’occupant, retranchés dans les montagnes, difficilement expugnables. Du point de vue stratégique, leur position est favorable. Objectivement, le statu quo les arrange.
Chaque fois que nous allons en Arménie, nous posons la question, notamment celle des Arméniens réfugiés de Syrie. Il faut quand même avoir conscience que le Haut-Karabagh est un territoire peu hospitalier, où les localités sont à moitié détruites.
M. le président François Rochebloine. Les réfugiés restent plutôt en Arménie même.
M. Pierre Andrieu. Quelques-uns vont au Haut-Karabagh, mais ils n’y restent sans doute pas longtemps. La plupart sont en Arménie, avec l’espoir de continuer leur route vers l’Occident.
M. François Loncle. Je souhaiterais que le rapport de la mission d’information comporte une note objective et exhaustive sur le Groupe de Minsk – son fonctionnement, ses actions et ses échecs. Ce serait très utile à la compréhension de chacun.
Il m’est arrivé d’interroger les ministres des affaires étrangères pour savoir ce que faisait le Groupe de Minsk. Avec tout le respect que je dois à votre fonction et à votre personne, je me suis souvent étonné de cette « instance » qui donnait une image un peu caricaturale de l’impuissance de la communauté internationale.
M. le président François Rochebloine. Je suis tout à fait favorable à cette proposition.
M. Pierre Andrieu. Lors du sommet de Paris, le Président de la République a proposé plusieurs mesures de confiance, mais elles ne sont pas exhaustives. On peut en imaginer d’autres. Je pense notamment que l’Assemblée nationale pourrait jouer un rôle en organisant des rencontres entre des parlementaires azerbaïdjanais et arméniens.
M. François Loncle. Comme au Conseil de l’Europe !
M. le président François Rochebloine. Où ce n’est déjà pas simple…
M. Pierre Andrieu. Rien n’est simple. Vous parlez de l’impuissance du Groupe de Minsk, mais la médiation ne peut donner des résultats que si les deux parties sont prêtes à faire des compromis. Apparemment, aucune des deux ne le souhaite.
M. le président François Rochebloine. Monsieur l’ambassadeur, je vous remercie et vous souhaite bonne chance dans vos futures fonctions.
*
* *
Ÿ Audition de M. Antoine Biquillon, directeur général de Lactalis-Caspi (jeudi 1er décembre 2016)
M. le président François Rochebloine. Nous recevons cet après-midi M. Antoine Biquillon, directeur général Lactalis-Caspi LLC, la filiale azerbaïdjanaise du groupe Lactalis. Ainsi, nous poursuivons, dans le secteur agroalimentaire cette fois, la série d’auditions d’entreprises françaises actives en Azerbaïdjan qui nous ont conduits à entendre des représentants d’Alstom, d’Engie ou encore de Total.
Monsieur le directeur, nous aimerions, dans la perspective de notre mission, qui est d’étudier le développement des échanges entre la France et l’Azerbaïdjan, que vous nous donniez des informations générales sur l’activité de votre société, vos objectifs de marché et l’analyse qui a conduit les responsables du groupe Lactalis à s’implanter en Azerbaïdjan.
Bien entendu, nous aimerions également savoir quelles sont les règles applicables à une telle implantation : régime juridique, conditions fiscales, éventuellement obligations sociales. Nous apprécierions aussi que vous nous indiquiez quelles règles éthiques sont en vigueur dans votre groupe et comment vous les appliquez, éventuellement en les interprétant, au cas particulier de l’Azerbaïdjan. Plus généralement, nous aimerions savoir quelle est la structure du secteur de la production laitière en Azerbaïdjan et le rôle de la puissance publique à l’égard de ce secteur.
M. Antoine Biquillon. Je travaille chez Lactalis depuis 2007 et toute ma carrière dans le groupe s’est déroulée dans les pays de la Communauté des États indépendants (CEI) : Russie, Ukraine, Kazakhstan, Moldavie, Biélorussie, et les trois pays du Caucase.
M. le président François Rochebloine. Dans quel pays vous êtes-vous rendu au moment de votre entrée dans le groupe Lactalis ?
M. Antoine Biquillon. Au Kazakhstan.
M. le président François Rochebloine. Vous n’avez pas du tout exercé en France ?
M. Antoine Biquillon. Non. Avant d’entrer chez Lactalis, je travaillais chez Renault en Ukraine, où j’ai commencé ma carrière en 2004 dans le cadre d’un volontariat international en entreprise (VIE) ; je sortais de l’École de management de Lyon.
Je commencerai par vous parler du groupe Lactalis, puis je vous expliquerai la stratégie du groupe en zone CEI, avant de dire les raisons pour lesquelles nous avons décidé de nous implanter en Azerbaïdjan, en évoquant les quelques problèmes que l’on peut rencontrer sur ce marché ainsi que les effets des réformes de 2016 et l’amélioration du climat des affaires dans le pays. Enfin, je présenterai quelques chiffres clés ainsi que nos perspectives de développement en Azerbaïdjan.
« Plus de quatre-vingts ans de passion laitière » : la grande particularité du groupe Lactalis est qu’il s’agit toujours d’un groupe familial. Le groupe a été fondé par André Besnier dans les années trente et développé après-guerre par Michel Besnier, son fils, qui a fait de Lactalis une grande entreprise nationale en accompagnant le développement de la grande distribution pendant les Trente Glorieuses. À partir des années 2000, Emmanuel Besnier, le petit-fils du fondateur, a fortement accéléré la croissance internationale du groupe par une politique de rachats très ambitieuse.
Après le rachat du groupe Parmalat en 2011, Lactalis est devenu le numéro un mondial des produits laitiers, avec 75 000 collaborateurs dans quatre-vingt-cinq pays, 17 milliards d’euros de chiffre d’affaires et à peu près autant de litres de lait collectés par an. Dans un groupe laitier diversifié, un euro de lait collecté, c’est souvent un euro de chiffre d’affaires.
M. le président François Rochebloine. Ces quatre-vingt-cinq pays couvrent toute l’Europe, je suppose.
M. Antoine Biquillon. Nous avons au total 232 sites de production, répartis sur 43 pays. Nous n’en avons pas dans tous les pays d’Europe, en Allemagne ou au Danemark, par exemple. Dans certains pays, comme l’Azerbaïdjan, nous avons des collaborateurs mais pas de sites de production. Commercialement, nous sommes présents dans plus de deux cents pays.
Ces chiffres font de Lactalis le quinzième groupe agroalimentaire mondial et, si je ne me trompe, le deuxième groupe français. Nous sommes présents sur tous les continents. La concentration du groupe ces dernières années a été très importante en Amérique latine, avec le Brésil et le Mexique, mais aussi en Australie, en Inde et en Turquie.
M. le président François Rochebloine. Quels sont les liens entre la Turquie et de l’Azerbaïdjan ?
M. Antoine Biquillon. Il y a un lien culturel et linguistique d’abord. Sur le plan économique, cela m’a donné une source de produits supplémentaires : les produits de la gamme Ülker, que nous avons rachetée en Turquie étaient déjà distribués en Azerbaïdjan. Les volumes de commercialisation que j’ai repris à cette occasion ont augmenté mon activité d’environ 50 %. Un tiers de mes ventes en Azerbaïdjan proviennent aujourd’hui de Turquie. Le reste de mes importations en Azerbaïdjan vient principalement de France – à hauteur de 40 % –, et un peu d’Italie, ensuite d’Ukraine et de Russie. Mon principal produit importé est le beurre, qui provient intégralement de France.
Le modèle de développement de Lactalis est assez unique dans la mesure où nous sommes présents sur l’ensemble des métiers du lait, tandis que nos concurrents se sont concentrés sur certains segments. Nous avons commencé avec le fromage mais, depuis les rachats des années 2000, nous sommes également devenus un acteur majeur dans le lait et le yaourt.
Nous avons trois marques mondiales, deux italiennes et une française, qui ont vocation à être présentes partout dans le monde : Président, Galbani et Parmalat. Parallèlement, nous avons des marques internationales à vocation régionale : c’est le groupe Lactalis qui fabrique par exemple la marque La Laitière, dans une joint-venture avec Nestlé en Europe. Nous avons enfin des marques locales, les « diamants » du groupe, gardiennes de traditions locales très importantes. Il n’y a pas de modèle unique chez Lactalis, nous avons un grand respect pour les traditions laitières de chacun des pays et en particulier pour les appellations d’origine protégée (AOP) en France ou ailleurs.
M. le président François Rochebloine. Vous appliquez les mêmes normes, que le produit soit fabriqué en Turquie ou en France ?
M. Antoine Biquillon. La première priorité est d’appliquer les normes sanitaires locales, qui peuvent différer d’un pays à l’autre, mais nous avons une politique de qualité définie pour l’ensemble du groupe.
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. Le fait de respecter les marques et les traditions locales signifie-t-il que vous n’avez pas mis en place de processus de rationalisation de la production sur l’ensemble de vos établissements ? Par exemple, si vous rachetez en Grèce une marque de féta produite de manière traditionnelle, pas vraiment perfectionnée, n’introduisez-vous pas pour ces marques locales les modes de production que vous appliquez dans des entreprises plus productives ?
M. Antoine Biquillon. Comme tout grand groupe industriel, nous avons une politique de partage des meilleures pratiques, afin de rationaliser les coûts et d’augmenter les performances, mais il y a des exceptions à la règle. Cette année, par exemple, nous avons repris la fromagerie Graindorge, qui est entrée dans notre division Lactalis AOC, spécialisée dans les appellations protégées, où la gestion industrielle est beaucoup plus light, si je puis dire. Certains produits Président sont AOC.
En zone CEI, nous avons une stratégie mixte d’importation et de production locales. Nous avons été agressifs dans notre politique d’implantation dans chacun des pays afin de maîtriser notre distribution et nos investissements de marketing, et de développer nos marques et la consommation des produits, y compris ceux que nous exportons de France.
Le premier pays dans lequel nous avons été présents est l’Ukraine, depuis 1996. Nous y avons renforcé notre présence en 2007 par le rachat de la société Fanni, à Pavlograd. Nous réalisons 51 millions d’euros de ventes, avec environ 900 emplois et deux usines. Lactalis est un acteur majeur du marché laitier en Ukraine. Nous avons beaucoup souffert dans ce pays depuis 2014 du fait de la situation économique et politique mais, comme nous avons une production locale, nous sommes capables de résister et de continuer à croître en parts de marché. L’Ukraine est aussi un fournisseur en produits traditionnels – crème fraîche, ou smetana, faisselle, ou tvorog… – pour les pays du Caucase.
Nous sommes implantés depuis 1997 en Russie, où nous avons construit une usine de fromage fondu à Istra en 2001, en greenfield, autrement dit à partir de rien. Le rachat de Parmalat en 2011 nous a donné une usine à Belgorod et une autre à Ekaterinbourg. Istra se trouve à côté de Moscou, Belgorod est à 700 kilomètres au sud, Ekaterinbourg à 1 500 kilomètres à l’est, aux portes de la Sibérie. Nous avons une quatrième usine à 400 kilomètres au sud de Moscou, à Toula. L’embargo russe a durement touché le groupe Lactalis dans la mesure où nous étions l’un des premiers importateurs de produits laitiers en Russie. Notre activité a néanmoins été sauvée par nos sites de production locaux, sur lesquels nous avons localisé un certain nombre de productions. Nous fabriquons aujourd’hui de la mozzarella italienne et du brie français à Toula : nous n’avons pas d’autre choix si nous voulons continuer à proposer ces produits aux consommateurs russes.
Nous nous sommes implantés au Kazakhstan en 2004 avec le rachat de la société Foodmaster. C’est aujourd’hui l’une des plus belles implantations à l’étranger du groupe. Sur un pays de seulement 16 millions d’habitants, nous parvenons à réaliser 90 millions d’euros de chiffre d’affaires, avec 1 900 emplois et trois usines. Nous sommes leader sur ce marché et, chose assez rare dans le groupe, nous exploitons deux fermes laitières – environ 3 000 vaches au total – au Kazakhstan.
Nous sommes également implantés en Moldavie depuis 2004 et le rachat de Foodmaster. Nous y réalisons 10 millions d’euros de chiffre d’affaires, avec 400 emplois et une usine, à savoir une fromagerie importante qui exporte vers tout le reste de la zone CEI.
Enfin, en 2011-2012, nous avons décidé d’ouvrir des filiales commerciales en Géorgie, Azerbaïdjan, Arménie et Biélorussie. L’objectif était d’importer les produits de la zone CEI dans nos usines existantes, mais aussi de développer les importations d’Europe et de Turquie. La Géorgie pour nous est un peu le modèle à suivre : à la suite d’une croissance très significative des ventes dans ce pays, nous avons décidé de racheter le leader des produits laitiers en Géorgie, la société Sante. Même dans un petit pays d’un peu plus de 4 millions d’habitants, nous sommes capables de nous implanter industriellement avec succès. Nous souhaiterions faire de même en Biélorussie, en Arménie et en Azerbaïdjan.
M. le président François Rochebloine. Ces implantations à l’étranger vous sont-elles facilitées ? Comment cela se passe-t-il ?
M. Antoine Biquillon. En termes de climat des affaires, la Géorgie se distingue des autres pays de la CEI depuis 2004-2005. Elle a adopté une politique très pro-business et surtout, elle a éradiqué la corruption.
M. le président François Rochebloine. Il n’y a pas de corruption en Géorgie ?
M. Antoine Biquillon. En tout cas pas de corruption de bas niveau : la corruption de policiers ou de douaniers, c’est fini.
M. le président François Rochebloine. On peut en dire autant au Kazakhstan, en Azerbaïdjan, en Arménie ?
M. Antoine Biquillon. Je vais y venir.
M. le rapporteur. Quand vous rachetez une entreprise en Géorgie ou ailleurs, placez-vous à sa tête des ingénieurs français ? Le contrôle est-il poussé ou bien vous contentez-vous de reporting ?
M. Antoine Biquillon. Nous sommes un groupe relativement centralisé, où la décision est prise par des directions régionales qui rendent compte assez rapidement au comité exécutif du groupe, mais le management local est souvent sauvegardé. Le directeur général de Sante, par exemple, est le même qu’au moment du rachat. L’intégration se fait surtout par l’adoption de méthodes industrielles. Notre valeur ajoutée porte sur la réduction des pertes de matière et l’optimisation des coûts industriels. Nous mettons plus de moyens en marketing si nous sentons que les marques existantes ont un vrai potentiel. La marque Sante est une fierté géorgienne : nous allons capitaliser dessus comme nous avons capitalisé sur la marque Foodmaster, devenue une fierté kazakhe.
Du point de vue du consommateur et du management local, l’intégration est donc light. Nous avons relativement peu d’expatriés, si ce n’est pour les directions d’usine et quelques postes spécialisés.
M. le président François Rochebloine. Autrement dit, on trouve très peu de Français dans vos différents sites.
M. Antoine Biquillon. Très peu. Nous devons avoir actuellement cinq ou six expatriés sur toute la zone CEI, peut-être dix en comptant les fermes. C’est curieusement pour les fermes que nous avons le plus de mal à trouver des ressources locales. Nous y envoyons des VIE.
En Azerbaïdjan, Lactalis importe 40 % des produits du groupe en provenance de la France et de l’Union européenne – 38 % pour la France et 2 % pour le reste de l’Union –, 25 % d’Ukraine, 10 % de Russie, et 25 % de Turquie depuis le rachat d’Ülker. Nous avons ouvert une SARL de droit local contrôlée à 100 % par la holding du groupe Lactalis.
La première raison pour laquelle nous nous sommes implantés en Azerbaïdjan est la forte consommation laitière dans ce pays. Dans le dossier, je vous ai mis des photos de rayons de vente de beurre à la coupe en Azerbaïdjan : le beurre se vend au kilo… Cela vous montre l’importance de la consommation.
La deuxième raison tient au potentiel de nos marques ambassadrices, associées à des nations. L’Italie est le premier partenaire commercial de l’Azerbaïdjan, du fait qu’elle est le premier client du pétrole et du gaz azéris. S’y ajoute la relation avec la Turquie : le fait que nous possédions Ülker était pour nous une opportunité. Mais notre marque Président reste une ambassadrice de la France ; or la relation culturelle entre la France et l’Azerbaïdjan est riche. Nous nous appuyons sur la sympathie envers la France qui existe dans de nombreux pays de l’ex-URSS.
M. le rapporteur. Votre marketing s’appuie sur les marques ? Autrement dit, vous mettez en avant Galbani Italia et non Galbani Lactalis.
M. Antoine Biquillon. Lactalis n’existe pas vis-à-vis du consommateur, ce n’est pas une marque commerciale.
M. le rapporteur. Autrement dit, vous vendez Galbani, Ülker et Président…
M. Antoine Biquillon. Principalement. Nous vendons nos grandes marques mais aussi toute une gamme de petites marques : je vends par exemple du cheddar Seriously Strong aux Anglais présents en Azerbaïdjan, dont beaucoup travaillent chez BP.
L’estimation suivante du marché import est assez prudente. Nous voyons un marché d’environ 100 millions de dollars, dont un gros marché de beurre, avec 36 millions de dollars. Ce beurre vient de Nouvelle-Zélande. L’Azerbaïdjan est le début de la zone de distribution des produits laitiers néozélandais, importés via l’Iran.
M. le président François Rochebloine. Existe-t-il des relations entre l’Azerbaïdjan et la Nouvelle-Zélande autres qu’alimentaires et économiques ?
M. Antoine Biquillon. Je ne suis pas spécialiste du sujet mais je pense que c’est une relation principalement beurrière… Par ailleurs, la Lituanie, depuis les années quatre-vingt-dix, exporte beaucoup de fromage vers l’Azerbaïdjan.
La troisième raison tient au potentiel agricole. Quand je suis parti en Azerbaïdjan, je pensais arriver dans un désert. En réalité, les niveaux de pluviométrie à quelques centaines de kilomètres de Bakou, que ce soit au Nord, à l’Ouest ou au Sud, sont supérieurs à ceux de la Bretagne. En fait, c’est un pays très vert. Son potentiel agronomique n’a guère été exploité du temps de l’URSS, pour qui, dans sa division du travail, l’Azerbaïdjan était un pays pétrolier. Ce modèle classique de « maladie hollandaise » s’est maintenu par la suite, freinant le développement des autres secteurs d’activité.
Ce potentiel agricole commence à être mis en valeur. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) organise en ce moment le voyage d’une délégation française entre Bakou et Tbilissi pour trouver des débouchés à nos prestataires de services ou de matériels agricoles.
M. le président François Rochebloine. Est-ce que cela entre dans le cadre de l’aide de l’Agence française de développement (AFD) ?
M. Antoine Biquillon. Je ne pense pas que l’AFD s’occupe encore de projets agricoles ; je crois qu’il n’y a pour le moment qu’un projet de gare de triage en Azerbaïdjan, mais je ne suis pas au courant de tout.
Nous sommes partenaires de cette mission d’exploration car nous serions intéressés pour développer la production laitière dans l’ouest de l’Azerbaïdjan, en vue d’une éventuelle implantation industrielle mais d’abord pour alimenter notre usine à Tbilissi, assez proche.
La dernière raison qui nous a conduits à ouvrir une filiale en direct en Azerbaïdjan, c’est le potentiel économique du pays. Au moment où nous avons pris cette décision, l’Azerbaïdjan avait connu une forte croissance autour de 2005. C’est d’assez loin le pays le plus intéressant du Caucase en termes de PIB par habitant.
Cela dit, le pays connaît une crise économique depuis 2015. La forte dépendance au pétrole a fait chuter les recettes en devises de façon dramatique. La monnaie locale, le manat, a été dévaluée plusieurs fois depuis le début de 2015. Alors que 78 centimes de manat valaient un dollar il y a un an et demi, nous sommes aujourd’hui à 1,85 manat pour un dollar.
M. le rapporteur. Vos importations en Azerbaïdjan sont bien facturées en euros ou en dollars, n’est-ce pas ?
M. Antoine Biquillon. Ce sont des transactions intragroupe. Les autres filiales du groupe me facturent en euros et je les paye en euros, mais la dépréciation de la monnaie a conduit à une forte inflation de tous les produits importés. Cette inflation a conduit à la fois à une chute de la consommation et à un transfert vers les produits locaux, dont le prix n’a pas augmenté dans les mêmes proportions.
Comme dans tous les pays de l’ex-URSS, l’Azerbaïdjan a souffert d’un problème de transparence au niveau des douanes et de la fiscalité, d’un système de monopoles non officiels accordés à des groupes d’intérêts, et d’un problème de recouvrement des créances, dans la mesure où les recours juridiques sont souvent inopérants. Dès le départ, notre stratégie a été de ne pas nous plier aux habitudes locales : nous avons été une des premières filiales étrangères à importer les produits « en blanc », c’est-à-dire en exigeant de payer les droits de douane et la TVA officiels, même quand c’était plus que ce que payaient des concurrents qui avaient d’autres pratiques ou les opérateurs locaux.
Ce pari de respecter la loi nous a valu quelques problèmes avec les douanes azéries mais nous avons été très fortement soutenus par l’ambassade de France et nous avons réussi à imposer notre manière de travailler. Mais nous avons eu pendant plusieurs années une épée de Damoclès au-dessus de nous : nos camions étaient régulièrement bloqués et, compte tenu du type de produits qu’ils transportent, dont la date de péremption est assez courte, nous avons subi des pertes assez importantes à chacun de ces épisodes.
M. le rapporteur. Vous avez été les premiers, mais pas les derniers, j’espère…
M. Antoine Biquillon. Nous avons très vite été suivis par Danone. Nous avions d’ailleurs été précédés par Coca-Cola et Procter & Gamble qui, de par leur importance sur le marché, avaient pu imposer leur façon de travailler aux douanes azéries.
Depuis la fin de l’année dernière, le président de l’Azerbaïdjan a engagé une politique volontariste de réformes, de promotion des investissements étrangers et de diversification économique. Nous avons immédiatement constaté un réel progrès : les douanes fonctionnent désormais de manière transparente, si bien que tous les acteurs du marché travaillent maintenant « en blanc ». Les monopoles d’importation ont été démantelés, si bien que tout le monde peut importer ce qu’il veut en Azerbaïdjan, pour peu qu’il paie les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Par cette mesure, le pouvoir cherchait aussi à réduire l’inflation en encourageant une concurrence plus forte pour limiter l’effet de la dévaluation de la monnaie.
La banque centrale a été réformée et un taux de change flottant a été institué ; il n’y a donc plus de dévaluations brusques, et le taux évolue de façon progressive au jour le jour en fonction de la demande et de l’offre.
M. le rapporteur. Un panier de monnaies est-il pris comme référence ?
M. Antoine Biquillon. Le fonds souverain azerbaïdjanais SOFAZ et la banque centrale organisent deux ou trois ventes aux enchères de devises par semaine auprès des banques, et le cours constaté devient le cours officiel. Il n’est pas complètement flottant et se trouve encadré par ce système d’enchères, mais il est beaucoup plus transparent qu’auparavant. L’évolution du taux de change dépend de la demande et de l’offre consentie par le SOFAZ et la banque centrale en fonction de leurs rentrées pétrolières : les variations du cours du pétrole renseignent donc sur celui du change.
Nous avons facilement accès au conseiller spécial auprès du président chargé d’améliorer le climat des affaires, qui vient d’être nommé. Il n’a souvent même pas besoin d’intervenir : les douanes et l’administration fiscale savent que nous sommes en relation avec lui, ce qui exerce une pression positive sur elles car elles auraient un problème d’image si nous devions le solliciter…
L’évolution de notre chiffre d’affaires depuis 2011 fait apparaître l’effet de la crise en 2014 et en 2015 et le développement d’une croissance intéressante, qui doit néanmoins être relativisée du fait de la dévaluation.
Nous avons investi environ 500 000 euros en équipement en Azerbaïdjan, en acquérant notamment une flotte de camions de distribution et des équipements d’entrepôt, mais également 1,2 million d’euros en marketing, principalement pour la marque Président. Nous avons acheté de la publicité à la télévision nationale et avons réalisé beaucoup de promotion en magasin ou dans des salons professionnels, en faisant venir un meilleur ouvrier de France.
Nous avons 18 employés en 2016, ce chiffre ayant diminué en 2015 du fait du début de la crise : j’ai transféré une partie de la distribution des supermarchés que nous gérions en direct à un distributeur local, afin de réduire les coûts et de nous adapter à la baisse des volumes.
Nous ambitionnons d’accroître nos parts de marché et notre rentabilité en profitant de l’amélioration du climat des affaires ; nous avons une carte à jouer dans le nouvel environnement économique. Nous profiterons sans doute de l’apparition d’une grande distribution moderne, grâce aux supermarchés Bravo qui ont été ouverts par le groupe Pacha en partenariat avec le groupe Casino.
M. le rapporteur. La centrale d’achats de Casino ne risque-t-elle pas de vous court-circuiter localement ?
M. Antoine Biquillon. Casino exporte directement une gamme de produits à Bravo, dont une partie provient du groupe Lactalis ; en outre, nous pouvons leur apporter des produits à haute valeur ajoutée, comme des fromages européens, que le professionnalisme de leurs supermarchés permet de vendre par le biais de promotions efficaces. La présence de Casino contribue donc à augmenter significativement nos volumes. Leur premier supermarché, ouvert au début de cette année, est déjà devenu notre premier client en Azerbaïdjan. L’ouverture des hypermarchés du groupe Bravo par Casino l’année prochaine nous rend plutôt enthousiastes.
Nous souhaitons également développer la consommation de produits premium : le beurre représente le plus gros marché en Azerbaïdjan, mais c’est un marché à bas prix sur lequel nos produits venant d’Europe ne sont pas compétitifs. Nous nous concentrons donc sur les produits à haute valeur ajoutée, en ciblant le développement du consommateur local. C’est la stratégie que nous avons suivie en Russie à la fin des années 1990 où nous avons appris au consommateur de Sibérie ce qu’étaient un camembert, un brie ou d’autres spécialités bien françaises. Nous offrons également des produits traditionnels et plus accessibles de la communauté des États indépendants (CEI) et de Turquie pour le cœur du marché. Enfin, si les conditions économiques continuaient à s’améliorer en Azerbaïdjan et si une opportunité se présentait, nous pourrions, en nous appuyant sur un business sain, procéder à une acquisition.
M. le rapporteur. Y a-t-il une industrie laitière en Azerbaïdjan ?
M. Antoine Biquillon. Oui, mais elle est récente : jusqu’à 2007, elle était presque inexistante, mais au moins cinq projets se sont développés depuis. Cinq ou six laiteries de fortes capacités se sont construites, même si elles tournent pour l’instant un peu à vide en raison de l’insuffisance de la production laitière. L’Azerbaïdjan doit prioritairement développer des champs de fourrage et importer du bétail pour produire du lait localement.
Je conseille de visiter notre page Facebook « Président Azerbaïdjan », qui déploie du marketing très efficace en temps de crise ; l’Azerbaïdjan est un pays très connecté, et la marque Président est leader dans l’univers digital azerbaïdjanais.
M. le rapporteur. Votre périmètre régional s’étend au Caucase, à la Biélorussie, à l’Ukraine et au Kazakhstan. Quel est pour vous le pays où il est le plus facile de travailler ?
Afin de réduire vos coûts en temps de crise, vous dites avoir fait appel à un sous-traitant pour le transport. Avez-vous été libre pour le trouver ou avez-vous subi des pressions ?
M. Antoine Biquillon. Je ne suis responsable que de l’Azerbaïdjan, mais j’ai précédemment été directeur financier pour la zone de la CEI. La Géorgie est le meilleur pays de la région pour faciliter les affaires, car les réformes y ont été radicales. Très efficaces, elles ont assuré une grande transparence : tout peut être déclaré en ligne, et le système fiscal a été simplifié puisqu’il n’existe que quatre impôts avec des taux uniques.
M. le rapporteur. Un peu comme en France…
M. Antoine Biquillon. Exactement ! (rires)
L’Ukraine part de très loin, car la situation était très difficile sous le précédent gouvernement, mais le climat des affaires s’est spectaculairement amélioré depuis les changements que vous connaissez. Nous n’avons pas rencontré beaucoup de problèmes au Kazakhstan. La Russie offre également un environnement plutôt simple pour les grandes entreprises internationales.
Nous avons été totalement libres de choisir notre sous-traitant et n’avons subi aucune pression. D’autant que nous avons pris cette décision en 2015, date à laquelle la situation monopolistique était en voie de disparition.
M. le président François Rochebloine. Avez-vous une activité en Arménie ?
M. Antoine Biquillon. Oui, nous y avons le même type d’organisation qu’en Azerbaïdjan, avec une filiale de droit local contrôlée à 100 % par le groupe Lactalis et qui importe des produits des mêmes pays.
M. le président François Rochebloine. Quelles obligations incombent à votre société à l’égard des autorités politiques de l’Azerbaïdjan et des administrations compétentes pour la réglementation ou la surveillance de votre champ d’activité ?
M. Antoine Biquillon. Nous ne sommes soumis à aucune obligation. En revanche, j’espère que des réformes seront mises en œuvre en 2017 dans le champ sanitaire ; elles sont pour l’instant dans les cartons. Quatre ministères sont aujourd’hui impliqués dans la délivrance de certificats d’analyse autorisant l’importation de produits laitiers en Azerbaïdjan. Le ministère de la santé délivre des certificats d’une durée de six mois après avoir effectué des analyses ; le ministère de l’agriculture contrôle chaque produit entrant dans le pays et procède également à des analyses ; le ministère des douanes lui aussi étudie des échantillons et facture cette opération, et le ministère chargé des poids et des mesures demande des certificats de conformité aux normes azerbaïdjanaises, qui proviennent souvent du système soviétique – les normes GOST (Государственный стандарт). Ces analyses se recoupent, elles sont chères – elles représentent environ 1 % du chiffre d’affaires, taux beaucoup plus élevé qu’ailleurs pour l’industrie –, et des projets existent pour créer une agence de la sécurité alimentaire en Azerbaïdjan, qui regrouperait l’ensemble des compétences actuellement éclatées dans ces quatre ministères. J’espère que le pays engagera rapidement cette réforme.
M. le président François Rochebloine. Compte tenu des difficultés économiques et financières que connaît l’Azerbaïdjan, comment évaluez-vous le risque financier inhérent à la poursuite d’activités économiques par votre groupe dans ce pays ?
M. Antoine Biquillon. Notre exposition est directement liée à notre besoin de fonds de roulement (BFR), libellé en monnaie locale ; chaque dévaluation de la monnaie nous fait perdre l’équivalent de l’écart de change, le groupe finançant notre BFR par des fonds en euros ou en dollars.
M. le président François Rochebloine. Cette situation vous pose donc quelques difficultés ?
M. Antoine Biquillon. Tous les investisseurs en Azerbaïdjan font face à un risque de change, mais nous espérons que les dévaluations sont terminées et que les réformes mises en place par la banque centrale permettront de mieux réguler l’évolution du taux de change.
M. le rapporteur. Tant que vous n’avez pas racheté un opérateur, vous n’êtes pas très exposés.
M. Antoine Biquillon. Je suis très exposé en tant que directeur général de Lactalis-Caspi, mais pour le groupe Lactalis, cela reste limité.
M. le rapporteur. À quoi avez-vous consacré votre investissement de 500 000 euros et quelles sont vos autres dépenses ?
M. Antoine Biquillon. Nous avons investi sur des immobilisations et avons engagé des dépenses de publicité. En outre, le BFR représente 1,5 million de manats.
M. le président François Rochebloine. Après deux ans de présence, quels sont les points positifs et les principales difficultés – d’ordre juridique, économique, politique ou autre – qui se font sentir dans l’activité de Lactalis-Caspi ?
M. Antoine Biquillon. Les points positifs, je l’ai dit, sont le potentiel agricole, l’envie de consommer des produits venant d’Europe et le potentiel économique – ce pays a des perspectives intéressantes malgré les difficultés actuelles qui devraient se prolonger encore un à deux ans, et aura des revenus importants quand certains projets, comme Shah Deniz 2 et Apchéron avec Total, seront déployés – figurent au rang des atouts de ce pays.
M. le rapporteur. L’augmentation du pouvoir d’achat, même ralentie actuellement, se traduit-elle dans une européanisation du goût en Azerbaïdjan ?
M. Antoine Biquillon. Notre page Facebook « Président Azerbaïdjan » présente des vidéos de recettes, qui sont en alternance azerbaïdjanaises et françaises. Nous demandons à des chefs connus de Bakou de tourner dans ces vidéos, et les recettes européennes rencontrent un grand succès auprès des femmes – ce sont principalement elles qui cuisinent dans ce pays. Il y a une soif de mieux connaître la gastronomie européenne.
M. le président François Rochebloine. Dans le cadre de cette mission d’information, nous avons auditionné Mme Sandrine Gaudin, chef de service à la direction générale du Trésor, qui a déclaré : « L’acharnement dont sont parfois victimes les entreprises étrangères de la part des administrations fiscales de l’Azerbaïdjan ne cesse souvent que moyennant des actes de corruption ». Que pensez-vous de ces propos ?
M. Antoine Biquillon. Nous avons eu des problèmes avec l’administration fiscale, qui se sont traduits par des redressements officiels. Ceux-ci n’étaient pas la conséquence d’actes volontairement frauduleux de notre part, mais certaines opérations s’avèrent difficiles à effectuer officiellement, du fait des complexités locales. Par exemple, si notre produit laitier n’a pas été vendu par le magasin au moment de sa date limite d’utilisation optimale (DLUO), nous le reprenons ; or la loi azerbaïdjanaise, complexe bien qu’en voie de simplification, dispose que nos clients doivent enregistrer cette transaction de retour dans un système officiel et en ligne de taxe, ce qu’ils ne faisaient pas. Lorsque j’ai demandé la déductibilité des retours de mon chiffre d’affaires à l’administration fiscale, elle me l’a refusée pour ce problème de forme. Nous avions pourtant tous les documents papier prouvant la légitimité de cette déductibilité. Mais nous avons refusé tout arrangement autre que celui de payer le montant du redressement.
M. le président François Rochebloine. Cela s’est donc fait dans la transparence totale ?
M. Antoine Biquillon. Oui. Nous étions gênés, car nous trouvons cette loi difficile à respecter, ce que nous n’avions pas identifié au moment où nous avons commencé notre activité. Nous avons donc changé notre mode de fonctionnement en accordant des ristournes aux clients plutôt que de reprendre les produits non vendus. Je ne sais pas si un acteur local aurait réglé le problème de façon différente… Les entreprises étrangères ne sont pas sollicitées pour participer à de la corruption d’ordre fiscal.
M. le président François Rochebloine. Sentez-vous que la corruption existe ou non ?
M. Antoine Biquillon. L’inspection fiscale azerbaïdjanaise exerce une pression fiscale intense, mais elle ne sollicite pas de corruption. Les inspecteurs fiscaux sont financièrement intéressés par le niveau officiel des recettes qu’ils collectent.
Mme Geneviève Gosselin-Fleury. Monsieur Biquillon, quel sentiment avez-vous sur votre vie quotidienne en Azerbaïdjan ? Avez-vous l’impression d’y vivre en toute liberté ? La presse est-elle libre ? La presse européenne et française est-elle diffusée dans ce pays ?
M. Antoine Biquillon. Je suis très heureux à Bakou ; on peut se rendre partout où on le souhaite.
M. le président François Rochebloine. Comment votre personnel vit-il ? Parlez-vous de ces sujets avec lui ?
M. Antoine Biquillon. La situation est difficile et il y a du mécontentement en Azerbaïdjan, mais celui-ci s’exprime très rarement contre le président. Ce n’est pas de la peur : les gens ont confiance dans leur président, même si l’opposition démocratique est assez invisible. En tant qu’expatrié et personne ne faisant pas de politique, je n’ai aucun problème en Azerbaïdjan.
M. Jean-François Mancel. Monsieur Biquillon, je vous remercie pour vos intéressants propos, qui reflètent l’expérience très concrète de quelqu’un qui vit en Azerbaïdjan, qui voit comment les choses se passent et qui se rend compte des difficultés.
M. le président François Rochebloine. Monsieur Biquillon, je vous indique que nous vous avons invité sur la proposition de M. Jean-François Mancel, et je ne regrette pas du tout cette rencontre !
M. Jean-François Mancel. J’ai eu à connaître l’affaire des camions Lactalis bloqués à la frontière et j’avais pu vérifier l’extraordinaire réactivité des autorités supérieures azerbaïdjanaises. La réforme consistant à éviter que les douanes profitent de leur pouvoir pour bloquer, de manière peut-être intéressée, les véhicules étaient déjà dans les tuyaux, et les choses ont rapidement changé.
La réforme constitutionnelle créera des pôles regroupant plusieurs ministères, afin d’éviter le chevauchement de normes et de réglementations que vous avez évoqué à propos du domaine sanitaire. À ce sujet, le taux de participation au référendum avancé par la représentante de l’organisation non gouvernementale (ONG) Amnesty International que nous avons reçue, 30 %, était totalement faux puisqu’il s’est en réalité élevé à 69 %.
Enfin, on constate que l’internet est très libre en Azerbaïdjan : Lactalis n’investirait pas dans une page Facebook si personne n’y allait !
M. Antoine Biquillon. Effectivement, le pays est très connecté, et il n’y a pas de filtrage.
M. le président François Rochebloine. Monsieur le directeur général, nous vous remercions de nous avoir consacré cette heure d’échanges et d’avoir répondu à nos questions. Il était intéressant de connaître l’expérience d’une entreprise française en Azerbaïdjan.
*
* *
Ÿ Audition de M. Jean Lévy, ancien ambassadeur pour le sport, conseiller auprès du président de la Fédération internationale de l’automobile (FIA) pour les relations internationales (mercredi 7 décembre 2016)
M. le président François Rochebloine. Chers collègues, nous avons le plaisir d’accueillir ce matin M. Jean Lévy, ancien ambassadeur pour le sport, actuellement conseiller auprès du président de la Fédération internationale de l’automobile (FIA) pour les relations internationales – mais aussi pour la sécurité routière.
J’avais salué en son temps la création de cette fonction nouvelle d’ambassadeur pour le sport, dont vous fûtes, monsieur, le premier titulaire. M’étant fermement prononcé, avec ma collègue Valérie Fourneyron, en faveur de la consolidation et de la pérennisation de cette fonction nouvelle, je me félicite que nous ayons été entendus par le Gouvernement. Nous vous avions rencontré dans le cadre de la préparation de notre rapport sur la diplomatie sportive de la France et son impact économique. Les échanges que nous avions alors eus avec vous nous avaient convaincus de l’utilité et de l’importance de votre travail. Devant la commission des affaires étrangères, Valérie Fourneyron disait à juste titre, le 8 juin dernier, que « le sport est un révélateur de la marche du monde ». La diplomatie sportive est ainsi un outil de plus en plus utilisé par les États pour asseoir leur réputation sur la scène internationale, et aussi pour nouer ou renouer, lorsque les canaux diplomatiques traditionnels sont impraticables, des relations nouvelles. Aussi était-il naturel de faire appel à votre expérience dans le cadre de notre mission.
L’Azerbaïdjan ne manque pas de faire grand usage des ressources de la diplomatie sportive. Nous en avons eu un exemple particulièrement éclatant avec les premiers Jeux européens, qui se sont tenus à Bakou au mois de juin 2015 et dont nous avons compris – mais vous nous le confirmerez – qu’ils avaient été organisés sous l’autorité, ou du moins la supervision, directe du président Ilham Aliev. Au moment où ces Jeux européens s’ouvraient, vous veniez de quitter votre mission d’ambassadeur pour le sport ; autrement dit, vous étiez en fonction pendant toute la période préparatoire de cette compétition, dont l’organisation a nécessairement demandé plusieurs mois.
Nous serions heureux de savoir dans quelle mesure et de quelle manière vous avez été amené à intervenir dans la préparation de la participation française à cette compétition, dont le secrétaire d’État chargé des sports nous a décrit en termes très élogieux l’organisation par le pays d’accueil. Êtes-vous, en particulier, entré en relation avec notre ambassade à Bakou ? Avez-vous eu à connaître, d’une manière ou d’une autre, des modalités de financement de ces Jeux ? Le ministre ayant évoqué un coût global de 1,25 milliard de dollars, la question n’est pas indifférente.
Plus généralement, avez-vous eu à connaître d’autres initiatives de l’Azerbaïdjan dans le domaine sportif, que ce soit l’organisation de compétitions dans ce pays – le Grand Prix d’Europe de Bakou, par exemple – ou la participation à des manifestations sportives dans notre pays ?
M. Jean Lévy, ancien ambassadeur du sport, conseiller auprès du président de la Fédération internationale de l’automobile pour les relations internationales. Je suis très honoré d’être auditionné par votre mission d’information, monsieur le président. En effet, j’ai eu l’occasion de vous rencontrer lorsqu’avec Mme Fourneyron vous prépariez ce rapport qui s’est révélé extrêmement utile et pertinent sur les aspects économiques de la diplomatie sportive. J’ai ensuite eu l’occasion de reparler avec vous, en privé, de ces questions, notamment des grands événements sportifs internationaux (GESI) organisés en Azerbaïdjan.
Précisons bien le contexte de ma mission d’ambassadeur pour le sport.
J’étais ambassadeur pour le sport en France. Mon travail était de mobiliser l’appareil diplomatique français sur un certain nombre d’initiatives et de candidatures que nous allions préparer et de mobiliser les entreprises françaises. Il s’agissait, premièrement, d’être en mesure de s’intéresser à de grandes manifestations sportives internationales à l’étranger et, deuxièmement, de faire connaître, ici, en France, notamment avec ce qui s’appelait alors Ubifrance, l’offre française dans un certain nombre de clusters. Mon activité était essentiellement tournée vers l’étranger pour encourager nos ambassades, nos réseaux diplomatiques et économiques à s’intéresser à ces grands événements.
J’ai été en fonction entre octobre 2013 et avril 2015. Je suis arrivé alors que les Jeux européens avaient déjà été attribués Bakou, et j’ai quitté mes fonctions avant qu’ils ne se tiennent. Je n’ai donc pas été en mesure d’y assister. Par ailleurs, si j’ai accompagné le Président de la République lors de la tournée qu’il a faite au mois de mai 2014 dans le Caucase – en Azerbaïdjan, en Arménie, en Géorgie –, les choses étaient déjà lancées, si j’ose dire.
J’ai eu à connaître uniquement l’aspect économique de la préparation des Jeux. Chaque année, nous organisons un séminaire sur ces grands événements sportifs internationaux, comme l’a fait Ubifrance entre la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre 2014. Sont invités tous les pays qui organisent, au cours des trois années suivantes, de tels événements et tous les pays candidats à l’organisation des grands événements sportifs internationaux. Il s’agit de leur présenter l’offre française.
Au cours de cette période, de nombreux pays ont tenté d’organiser des diplomaties sportives. C’est d’ailleurs sans doute la raison pour laquelle un ambassadeur pour le sport a été nommé en France. J’aurais souhaité que l’on dise « pour le sport business ». Las ! Le ministre des affaires étrangères, qui était alors M. Fabius, avait considéré que c’était un peu trop réducteur, ou franglais. Il fut très intéressant de constater la contribution du sport aux relations internationales, et à la paix, notamment dans cette région du Caucase dont vous savez quels conflits l’agitent – la diplomatie française, nos ambassades dans la région sont particulièrement attentives à la situation au Haut-Karabagh et aux travaux du groupe de Minsk.
Nous avions donc invité l’Azerbaïdjan à cette réunion d’Ubifrance. Les organisateurs des Jeux européens de Bakou y ont été représentés par leur ambassadeur, un champion olympique de judo et député français. Lesdits jeux ont effectivement été organisés, monsieur le président, sous la supervision directe du ministre de la jeunesse et des sports, du président azerbaïdjanais et de Mme Alieva. Celle-ci est d’ailleurs venue à Paris à l’occasion de manifestations de promotion classiques pour ce type d’événement, afin de le présenter, de le médiatiser et d’encourager les touristes à venir.
M. le président François Rochebloine. Si j’ai bien compris, vous étiez associé à ces rencontres.
M. Jean Lévy. J’y étais invité. Beaucoup de gens du Quai d’Orsay ont participé à une manifestation, voire à deux. Avec le ministère des finances et Ubifrance, nous étions les organisateurs de cette réunion annuelle dédiée aux GESI, à laquelle M. David Douillet a participé en sa qualité d’ambassadeur des Jeux de Bakou – je n’ai pas retrouvé les noms des personnes qui l’accompagnaient, le dossier étant resté au ministère.
Peu d’entreprises françaises ont été concernées par l’organisation des Jeux. Ce sont essentiellement des entreprises britanniques qui en ont été chargées, même si un ressortissant français a pris en charge une part minime de ce qui concernait les médias et qu’un contrat avait été signé par Iveco, au cours de la visite du Président de la République, au mois de mai précédent, pour la fourniture d’un nombre important d’autobus.
Ce dont j’ai eu à connaître était donc relativement marginal, la préparation de l’événement était déjà lancée, et il était organisé par l’Azerbaïdjan avec des sociétés britanniques. Il n’y eut pas d’entreprises françaises directement chargées de l’organisation, même si Schneider a notamment fourni un certain nombre d’éclairages de stades.
M. le président François Rochebloine. Quid du financement ?
M. Jean Lévy. C’est une affaire qui ne relève pas du ministère français des affaires étrangères.
M. le président François Rochebloine. Comme je l’ai dit tout à l’heure, ces jeux ont été remarquablement organisés, mais pour un coût très élevé – 1,25 milliard de dollars ! –, à tel point qu’il n’y a actuellement pas de candidat pour en organiser d’autres ! Vous avez pu, d’une façon ou d’une autre, avoir quelques informations.
M. Jean Lévy. J’ignore ce qu’il en est de mes successeurs, notamment de M. Vinogradoff que vous auditionnez demain, mais, pour ma part, tout ce que j’ai pu apprendre, je l’ai lu dans les journaux. À l’époque où j’étais en fonction, personne n’avait une idée du coût ; je n’en avais moi-même jamais entendu parler.
M. le président François Rochebloine. Et qu’en est-il du Grand Prix d’Europe ?
M. Jean Lévy. Tout d’abord, la FIA est organisée sur deux piliers : un pilier « sport », à Genève ; un pilier « mobilité », à Paris.
Au sein du pilier « mobilité », une mission a été confiée par le secrétaire général des Nations unies à Jean Todt. M. Ban Ki-Moon a désigné ce dernier comme son envoyé spécial pour la sécurité routière, dans le cadre de la décennie 2011-2020 des Nations unies. Le but est de mobiliser l’ensemble des gouvernements du monde sur cette question. Vous le savez, l’insécurité routière est un fléau colossal, dont on ne parle pas – peut-être pour des raisons culturelles ou religieuses, peut-être par fatalisme, je ne sais. Ce sont 1,2 million de personnes qui meurent chaque année, 50 millions qui sont blessées, la plupart gravement, ce sont 500 enfants qui, chaque jour, sont tués en allant à l’école ou en en revenant – je ne parle pas de ceux qui restent paralysés à vie, de ceux qui doivent être amputés… Ce grave fléau ne suscite pas l’attention et ne donne pas lieu à une mobilisation suffisante, mais Jean Todt s’est mobilisé depuis très longtemps sur ces questions. Avec l’appui du gouvernement français, il a obtenu au mois d’avril 2015 que cette mission lui soit confiée, et il y travaille énormément. Compte tenu de mon expérience professionnelle passée et de ma bonne connaissance des Nations unies, il m’a demandé de venir l’aider dans ce travail de mobilisation des gouvernements. Je travaille donc au sein de ce pilier « mobilité », et je ne m’occupe absolument pas du sport automobile.
Par ailleurs, la FIA – pilier « sport » compris – n’a aucune compétence pour déterminer, décider quoi que ce soit pour aucune compétition automobile ; nous sommes un organe de régulation. Pour chaque type de compétition, qu’il s’agisse de Formule 1, de Formule 2, de rallyes, des promoteurs sont désignés et, un peu comme des concessionnaires de service public, ils paient des redevances. Dans le cas de la Formule 1, il s’agit d’une société holding, Formula One, qui était dirigée par Bernie Ecclestone, mais Liberty Media est en train de racheter Formula One – la Commission européenne examine la question d’une éventuelle position dominante. De même que c’est Formula One qui a négocié pour que soit à nouveau organisé au Castellet un Grand Prix de France – ce sera le cas en 2018 –, c’est Formula One qui a directement négocié en Azerbaïdjan avec les responsables de l’organisation. En aucune façon, la FIA n’est impliquée dans ce type de négociation.
M. le président François Rochebloine. Je reviens un instant sur la sécurité routière : 500 enfants tués par jour sur le chemin de l’école, c’est considérable !
M. Jean Lévy. Et c’est méconnu.
M. le président François Rochebloine. En France, les gouvernements successifs ont tout de même fourni des efforts remarquables et remarqués, si bien que le nombre de morts a nettement diminué – il semble cependant avoir atteint un niveau en deçà duquel il ne peut plus guère descendre. La France semble un modèle en la matière.
M. Jean Lévy. Tout à fait. Au cours des trente ou quarante dernières années, la France a obtenu des résultats remarquables. Les pouvoirs publics se sont saisis sérieusement du problème à partir de la présidence de Georges Pompidou.
J’étais d’ailleurs il y a quinze jours à Madagascar dans le cadre du sommet de la francophonie. La FIA, Jean Todt et André Vallini, alors secrétaire d’État chargé du développement et de la francophonie, avaient pris l’initiative d’une résolution pour alerter les gouvernements des pays francophones – 53 pays membres et 27 pays observateurs étaient représentés. La résolution a été présentée avec le Maroc pour mobiliser la planète francophone sur ces questions. Un livre écrit par Christian Gerondeau, en liaison avec la FIA, montre comment l’exemple français peut, dans une certaine mesure – la France est un pays développé mais le fléau frappe essentiellement les pays en développement –, être suivi par l’ensemble francophone.
C’est un drame méconnu, y compris de personnes parfaitement informées, tels les membres de votre mission d’information. Je le constate chaque fois que je rappelle le nombre des morts et des blessés, le nombre d’enfants tués tous les jours – et ce sont entre 3,5 % et 5 % du produit intérieur brut (PIB) de la planète qui sont ainsi gaspillés. La FIA veut vraiment mobiliser les gouvernements et Jean Todt consacre de très nombreux voyages à sa mission. Chaque fois, il présente un certain nombre de mesures qui pourraient être appliquées à la situation locale, et il bénéficie de l’appui de la commission des Nations unies qui se trouve à Genève.
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. Je souhaite, monsieur l’ambassadeur, vous poser trois questions.
Le rapport de Valérie Fourneyron et François Rochebloine sur la diplomatie sportive indique : « Eu égard aux enjeux colossaux des grands événements sportifs pour certains pays qui en font un outil fort de leur diplomatie d’influence, une personnalité de niveau très politique peut parfois être la véritable autorité décisionnaire et il convient alors que la mise en contact soit appuyée au plus haut niveau. C’était le cas en Azerbaïdjan, hôte des premiers Jeux européens en 2015. » Selon votre expérience, est-ce une spécificité azerbaïdjanaise ou bien un modèle répandu dans le milieu sportif ?
Ensuite, que pouvez-vous nous dire de la structure institutionnelle de la diplomatie sportive de l’Azerbaïdjan ? Y a-t-il des personnalités qui ressortent particulièrement ? Aviez-vous un homologue au sein de l’exécutif azerbaïdjanais ?
Enfin, M. le secrétaire d’État Thierry Braillard nous a dit que les Azerbaïdjanais étaient très friands d’expertise en matière d’organisation des sports. Pensez-vous qu’il y aurait des champs de coopération à explorer avec ce pays ?
M. Jean Lévy. Que ce soit au Moyen-Orient ou en Asie centrale – j’ai eu l’occasion de me rendre aussi au Turkménistan dans le cadre de cette mission –, c’est toujours au plus haut niveau que les décisions sont prises pour l’organisation de grands événements sportifs internationaux. Ce n’est d’ailleurs pas quelque chose de spécifique aux problèmes de diplomatie sportive car il s’agit de pays où les compétences sont très souvent centralisées ; c’est ce qu’on appelle la verticale du pouvoir.
En ce qui concerne la structure institutionnelle, en Azerbaïdjan, c’est, comme je l’ai dit, essentiellement le ministre des sports qui est responsable des grands événements sportifs mais, compte tenu du fait que le président Aliev est lui-même président du comité national olympique et que son épouse est la présidente de la fédération azerbaïdjanaise de gymnastique, tous deux en sont aussi directement chargés. Ce n’est pas une spécificité du Moyen-Orient et de l’Asie centrale. Si je me réfère à l’Euro 2016, à la candidature d’Annecy à l’organisation des Jeux d’hiver de 2018 ou à celle de Paris pour les Jeux d’été de 2012, ces questions sont suivies à très haut niveau en France aussi, par le Président de la République et le Premier ministre.
Je n’avais pas d’homologue précis dans la structure institutionnelle. Quand j’ai accompagné le Président de la République en Azerbaïdjan, j’ai demandé si mon interlocuteur serait une personne spécialement compétente ; on m’a dit que ce serait le ministre.
Enfin, la diplomatie sportive française possède à la fois une dimension d’influence politique, car on peut faire passer un certain nombre de valeurs par le biais du sport, une dimension d’influence culturelle, notamment en ce qui concerne la défense de la langue française, et une dimension économique, dans la mesure où 2 ou 3 % du PIB mondial sont consacrés au sport et aux grands événements sportifs. Nous avons des atouts très importants. Au cours de l’année 2014, Decathlon a ouvert une soixantaine d’hypermarchés en Chine.
M. le rapporteur. Ils vendent des produits chinois.
M. Jean Lévy. Ils vendent malheureusement beaucoup de produits fabriqués sur place, mais cela représente tout de même de la logistique.
La qualité de notre expertise en matière sportive est reconnue. Lors de la mission que j’ai conduite avec M. Jean-Pierre de Vincenzi, directeur général de l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP), un organisme créé par le général de Gaulle après notre déconfiture aux Jeux olympiques de Rome en 1960, nous avons essayé d’expliquer qu’un institut de préparation du sport de haut niveau, avec un volet médical, pouvait être intéressant. Nous l’avons fait dans plusieurs pays, et certains, que ce soit le Brésil, l’Inde, la Chine, l’Azerbaïdjan, sont aujourd’hui intéressés par l’idée de créer des « INSEP » locaux. Nous avons en effet, avec l’INSEP, un des instituts les plus réputés au monde, qui entraîne énormément de champions. Sebastian Coe, qui a dirigé la candidature de Londres et les Jeux olympiques de Londres en 2012, rappelle souvent qu’il s’est entraîné, jeune, avant de devenir champion olympique, à l’INSEP.
Avec l’INSEP, avec notre recherche médicale, avec nos systèmes de détection et de formation de jeunes champions, pour le football, le tennis, le judo, nous avons une très bonne réputation, et c’est un modèle qui est en train de se développer à l’étranger, par exemple en Chine pour le football. Cette diffusion de notre expertise a des retombées économiques puisque tout cela est évidemment payant.
M. Christophe Premat. La Fédération internationale du sport universitaire (FISU) a organisé des Jeux universitaires en 2013. Quelle est la position de l’Azerbaïdjan vis-à-vis de la FISU après l’organisation de ces Jeux ?
M. Jean Lévy. Je n’ai aucun élément d’information à ce sujet. À aucun moment cette question n’a été soulevée dans le cadre de mes fonctions.
M. Christophe Premat. Les postes diplomatiques avaient été sensibilisés sur la FISU, en termes de rapports de force.
M. Jean Lévy. J’ai pris mes fonctions en novembre 2013. De cette date à avril 2015, je n’ai pas eu à connaître du sujet.
M. le président François Rochebloine. Comme vous le savez, le Parlement vient d’adopter une proposition de loi permettant à la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de vérifier la qualité des investisseurs étrangers qui s’intéressent aux clubs français. Quel rôle l’ambassadeur pour le sport peut-il jouer, au-delà de ce cadre légal, dans la prévention des situations auxquelles cette loi nouvelle entend riposter ?
M. Jean Lévy. La proposition de loi est en discussion au Sénat. Ayant été nommé il y a un mois et demi président du comité national d’éthique de la Fédération française de football (FFF), qui compte cette question parmi ses compétences, je ne peux être que favorable à un contrôle. Est-ce à l’ambassadeur pour le sport de s’occuper de ce volet ? Ce n’est pas à moi de l’apprécier.
M. le président François Rochebloine. Notre secrétaire d’État chargé des sports a évoqué la stratégie sportive de l’Azerbaïdjan, dont le but est de montrer une image positive du pays à travers les compétitions sportives qu’il organise. En même temps, le régime politique de ce pays se caractérise par des violations répétées des droits de l’Homme qui amènent d’ailleurs des réactions des plus hautes autorités françaises et de notre diplomatie. La question de la caution donnée à un régime autoritaire méconnaissant les droits de l’Homme ne se pose-t-elle pas pour les fédérations sportives internationales, comme celle au service de laquelle vous travaillez maintenant ? La difficulté a-t-elle été évoquée, à votre connaissance, dans l’une ou l’autre de ces fédérations, et en particulier à la FIFA, soit pour le cas de l’Azerbaïdjan soit de manière générale ?
M. Jean Lévy. Nous suivons la ligne définie par le Comité international olympique (CIO) et sommes par conséquent tout à fait apolitiques. Nous ne boycottons aucun événement en fonction du pays. C’est une règle qui me paraît sage car la diplomatie sportive a pour objectif de faire de ces événements de moments de paix, même si nous n’obtenons pas toujours la trêve olympique comme dans l’Antiquité grecque. Le sport a transformé le monde en un stade planétaire : il y a peu d’événements comparables au Championnat du monde de football ou aux Jeux olympiques. Je considère que nous devons, dans ces moments, faire abstraction de toute vision politique car ces événements offrent aux gens un moyen de se parler. Aux jeux de Bakou était présent un pays avec lequel l’Azerbaïdjan est en conflit. Tout ce qui peut permettre aux pays en conflit de dialoguer, de vivre en commun des temps forts par le biais du sport, est un moyen d’exprimer pacifiquement les nationalismes, sous la forme de la compétition sportive plutôt que d’une autre manière.
Le CIO a toutefois décidé de prendre en considération, dans les futures candidatures, un certain nombre de critères. Nous verrons comment ce sera appliqué. Je suis favorable à ce que le CIO poursuive cette politique.
M. le président François Rochebloine. Je partage pleinement votre sentiment. Certains ont boycotté les Jeux olympiques en Chine, mais je pense que c’eût été une erreur, et même une faute, que la France boycotte ces Jeux. Cela n’empêche pas toutefois de dénoncer ce qui peut se passer. Je ne sais pas quels critères le CIO définira, mais, s’il est important de ne pas pratiquer le boycott, il ne faut pas non plus que les grands événements sportifs aient l’air de cautionner des régimes dont les pratiques ne sont pas celles que nous souhaitons.
M. Jean Lévy. Je suis pleinement d’accord avec vous et avec les orientations du CIO. Il s’agit des droits de l’Homme, mais aussi de volets plus économiques et écologiques. Des critères seront ainsi pris en considération pour éviter ce que l’on appelle les « éléphants blancs », c’est-à-dire la construction d’équipements qui ne seront plus utilisés après les jeux ou qui ne sont pas conformes au développement durable ou à une utilisation raisonnable des ressources du pays.
M. le président François Rochebloine. Merci, monsieur l’ambassadeur.
*
* *
Ÿ Audition de M. Jacques Soppelsa, professeur des universités, président honoraire de l’université Paris I Panthéon Sorbonne, président de l’Académie internationale de géopolitique (mercredi 7 décembre 2016)
M. le président François Rochebloine. Nous avons le plaisir d’accueillir, sur la proposition de M. Jean-François Mancel, M. Jacques Soppelsa, professeur des universités, président honoraire de l’université de Paris I Panthéon Sorbonne, président de l’Académie internationale de géopolitique.
Monsieur le président, vous avez, au cours d’une riche carrière universitaire, accumulé les titres et les expériences qui rendront, j’en suis certain, un grand service à notre mission d’information.
Nous inaugurons, en effet, avec vous, une série d’auditions de spécialistes auxquels nous allons demander, si je puis dire, les moyens intellectuels grâce auxquels nous pourrions prendre du champ par rapport à l’objet immédiat de notre démarche qui consiste, je le rappelle, à étudier les relations politiques et économiques entre la France et l’Azerbaïdjan au regard des objectifs de développement de la paix et de la démocratie dans le Sud Caucase.
Il ne serait pas raisonnable, en effet, de mener cette étude sans prendre en considération les relations politiques, les héritages historiques et les conditionnements géographiques qui expliquent le déploiement actuel des stratégies des États, petits et grands, dans cette région.
L’approche par la géopolitique, à laquelle s’attache votre notoriété, nous sera donc très utile dans la perspective de nos travaux.
Bien entendu, vous avez toute liberté pour nous présenter votre appréciation de la situation géopolitique de l’Azerbaïdjan selon les lignes d’analyse qui vous paraissent les plus pertinentes. Je me permettrai seulement de vous interroger sur quatre relations significatives.
D’abord, comment voyez-vous l’évolution des relations entre l’Azerbaïdjan et la Russie depuis la fin de l’Union soviétique ? La question se pose évidemment du point de vue de l’Azerbaïdjan, État indépendant depuis août 1991 : jusqu’à quel point souhaite-t-il et peut-il s’émanciper de la tutelle historique de son voisin ? Mais elle se pose également du point de vue de la Russie : quelle place tient l’Azerbaïdjan dans la complexe stratégie d’équilibre que mène Moscou entre les trois États du Caucase du Sud, à savoir l’Azerbaïdjan, donc, la Géorgie et l’Arménie ?
Qu’en est-il ensuite des relations entre Bakou et Ankara ? Il apparaît – on l’a encore vu récemment avec la répression conduite par le gouvernement de M. Aliev contre de supposés partisans de Gülen établis en Azerbaïdjan – que l’Azerbaïdjan épouse assez facilement la cause du gouvernement turc. Cette proximité est encore plus évidente si l’on se tourne du côté des relations avec l’Arménie, chacun des deux États ayant ses propres raisons de geler indéfiniment ces relations. Pensez-vous, d’ailleurs, que cette situation de blocage soit appelée à durer et, si oui, pour quelles raisons ? Quelle est votre appréciation sur la réalité de l’affirmation laïque des autorités azerbaïdjanaises ? Elle semble désormais plus solide que ne l’est, en Turquie, la tradition d’Atatürk. Mais qu’en est-il dans les profondeurs de la société azerbaïdjanaise ?
La troisième interrogation porte sur les ressorts de la relation de l’Azerbaïdjan avec l’Iran. Il est de notoriété publique qu’une grande partie de la population iranienne ne se distingue pas, en matière culturelle et ethnique, de la population azérie, dont elle partage notamment l’appartenance au chiisme. Comment caractériseriez-vous ces relations et leur évolution possible ?
Un quatrième centre d’intérêt de la mission porte sur les relations avec la France et, au-delà, avec l’Union européenne. Quelles sont les motivations du désir de rapprochement avec l’Europe et avec notre pays, manifesté par le pouvoir azéri ? Jusqu’à quel point les relations avec les trois puissances déjà citées permettront-elles à la coopération bilatérale avec la France de se développer, que ce soit en matière économique, financière, politique ou simplement culturelle ?
M. Jacques Soppelsa, professeur des universités, président honoraire de l’université Paris I Panthéon Sorbonne, président de l’Académie internationale de géopolitique. Je vous remercie de m’avoir présenté en tant que président honoraire de l’université Paris I et en tant que président de l’Académie internationale de géopolitique, mais je suis aussi l’ancien président de la fédération internationale du rugby à XIII – le vrai.
M. le président François Rochebloine. Je suis resté vice-président du département de la Loire pendant vingt-deux ans et nous avions une très belle équipe à Roanne et qui a même été championne de France. Je me suis pour ma part toujours efforcé d’aider le rugby à XV comme le rugby à XIII.
M. Jacques Soppelsa. Mais revenons-en à notre sujet. Je suis universitaire et je crois pouvoir à ce titre me montrer objectif. J’occupe la chaire de géopolitique de l’université Paris I depuis 1978 et je tiens à préciser que je ne suis pas un spécialiste du Caucase. J’ai beaucoup écrit sur les États-Unis, où j’ai réalisé ma thèse, sur l’Amérique latine, où j’ai été diplomate, et, dans une moindre mesure, sur le continent africain. Bref, rien ne m’autorisait a priori à m’exprimer devant vous sauf que, hasard des circonstances, en 2010, un de mes anciens étudiants, Ali Bongo, dont j’ai dirigé la thèse, aujourd’hui président du Gabon, m’a demandé si je pouvais réfléchir sur les risques géopolitiques éventuellement encourus par son pays. Je m’y suis attelé et, avec ma petite équipe de l’Académie internationale de géopolitique, dans un esprit différent de celui de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (Coface), dont les analyses me paraissent trop exclusivement économiques, financières, matérielles…
M. le président François Rochebloine. En même temps, c’est le rôle de la Coface.
M. Jacques Soppelsa. C’est en effet son rôle mais, quand on étudie un pays, il me semble qu’il faut analyser d’autres types de risques que ceux que je viens d’évoquer. Aussi avons-nous, toujours en 2010, défini vingt paramètres.
Deux ans plus tard, à l’occasion d’un forum à Dubaï, j’ai présenté notre méthode en prenant l’exemple du Gabon. Se trouvaient là deux de mes anciens étudiants azerbaïdjanais, qui travaillent aujourd’hui pour la présidence de l’Azerbaïdjan, et qui m’ont demandé si je voulais bien appliquer cette méthode au Sud Caucase, à savoir à l’Arménie, la Géorgie et, donc, l’Azerbaïdjan. C’est ainsi que j’ai découvert les réalités du Caucase, même si, en 1988, j’avais déjà eu l’occasion, en tant qu’adjoint à la culture de Gilbert Mitterrand, maire de Libourne, de me rendre dans l’Azerbaïdjan alors soviétique.
M. le président François Rochebloine. Sport, culture… quel équilibre !
M. Jacques Soppelsa. Au reste, les deux sont très liés.
Avec mon équipe, nous avons donc écrit un article, puis un rapport, enfin un petit livre, épuisé, Azerbaïdjan, État leader du Sud Caucase.
Les paramètres en question, certes pas très originaux, se divisent en sept paramètres externes – contexte géopolitique de l’ensemble de la zone, influence des États voisins, importance des organisations régionales, impact de la criminalité organisée, poids du terrorisme international, évolution de la situation financière de la zone, immigration clandestine – et treize paramètres internes – cohésion nationale, importance des facteurs ethniques, poids du facteur religieux, importance du fait urbain, potentiel énergétique, rôle de l’État, démographie… et, parmi eux, deux paramètres concernent directement le thème de la présente mission : le respect des droits de l’Homme et la corruption, et il s’en faut que les sources soient toutes objectives en la matière.
L’Azerbaïdjan paraît avoir des perspectives encore plus brillantes que ses deux voisins du Sud Caucase, même si Bakou doit faire face à quelques problèmes récurrents : migrations interrégionales – depuis 1992, le pays a « récupéré » un bon million de réfugiés dont l’assimilation n’a pas été évidente, c’est le moins que l’on puisse dire –, inflation, poids des activités rurales. L’Azerbaïdjan est à mes yeux un pays émergent mais fortement marqué par sa ruralité puisqu’elle regroupe, selon le dernier recensement, près de 48 % des actifs.
Ceux qui, en France, s’intéressent à l’Azerbaïdjan, évoquent souvent un pays où les dépenses militaires seraient très importantes. Or j’ai constaté que celui-ci y consacrait annuellement environ 3,4 % de son produit intérieur brut (PIB), soit davantage, certes, que certains pays d’Europe occidentale, mais bien moins, par exemple, que les États-Unis qui consacrent 4,8 % de leur PIB à leur défense, ou que la Fédération de Russie.
M. le président François Rochebloine. Certes, mais l’Azerbaïdjan et les États-Unis n’ont pas les mêmes responsabilités.
M. Jacques Soppelsa. J’entends bien. Alors comparons l’Azerbaïdjan avec ses voisins : l’Arménie consacre 4,4 % de son PIB à ses dépenses militaires, soit un point de plus.
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. Reste que ces deux pays n’ont pas le même PIB et il faudrait comparer les budgets militaires en valeur absolue.
M. Jacques Soppelsa. Tout à fait.
M. le président François Rochebloine. Vous avez raison de rappeler ces pourcentages, monsieur Soppelsa, mais les dépenses militaires de l’Azerbaïdjan – que ce soit justifié ou non, je n’ai pas à me prononcer sur ce point – représentent deux fois et demie le budget total de l’Arménie. Comparons ce qui est comparable.
M. Jacques Soppelsa. Mes sources sont objectives, qu’il s’agisse du Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) ou de l’International Institute for Strategic Studies (IISS)…
M. le président François Rochebloine. Je ne conteste pas la fiabilité de vos sources !
M. Jacques Soppelsa. La part des dépenses militaires dans le budget ou le PIB d’un pays n’est au demeurant pas neutre – ainsi quand on songe qu’elle atteint 12 % du PIB en Arabie Saoudite…
Mais là n’est pas le vrai problème.
Contrairement à ce que prétendent nos amis de Bakou, la corruption n’a pas été totalement éradiquée, même si d’importants efforts ont été fournis à cette fin. Deux tiers de siècle d’occupation soviétique…
M. le président François Rochebloine. C’était l’objet de ma première question.
M. Jacques Soppelsa.… ne sont pas pour rien dans le degré de corruption de la région. Cela étant, d’après des observateurs, notamment de l’Organisation des nations unies (ONU), l’Azerbaïdjan est sur la bonne voie.
M. le président François Rochebloine. D’où provient cette corruption ?
M. Jacques Soppelsa. J’insiste sur le rôle, en la matière, qu’a joué l’Union soviétique, en particulier pour ce qui concerne les républiques musulmanes. Du fait de la conjugaison du poids de la géographie et de l’histoire, la corruption a perduré jusqu’à aujourd’hui dans certains États comme le Turkménistan, l’Ouzbékistan, le Kirghizistan. Il s’agit en outre de lieux privilégiés du trafic de drogue – on songe à la fameuse route de la Soie, la route de l’héroïne, de l’opium…
Les observateurs de l’ONU ont, j’y ai fait allusion, suivi l’application du décret présidentiel de 2007 sur la lutte contre la corruption et ont constaté que le gouvernement était bien déterminé à la mener – une politique vivement soutenue, selon eux, par l’opinion publique et dont les premiers résultats sont positifs. Cela ne signifie toutefois pas que la corruption soit totalement éradiquée.
M. François Rochebloine. Pardon d’insister, mais qui est à l’origine de cette corruption : l’État, les dirigeants, les entreprises ?
M. Jacques Soppelsa. Deux ou trois de mes étudiants, azerbaïdjanais et arméniens, travaillent sur le sujet, en lien avec l’IISS et plusieurs organisations non gouvernementales (ONG). La banalisation du trafic de drogue et sa mondialisation à partir de l’Asie – j’ai mentionné les routes du trafic de drogue, l’Afghanistan n’est pas loin… – expliquent que l’on puisse trouver des mafias ici ou là dans les pays du Caucase. Leur situation géographique est certes positive pour leurs activités commerciales mais, en contrepartie, je ne suis pas assez naïf pour croire que la Géorgie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan ne sont pas au moins en partie gangrenés par l’activité des mafias. Je dirais d’ailleurs la même chose s’il était question de l’Albanie.
M. le rapporteur. Cela signifie-t-il que le crime organisé est implanté…
M. Jacques Soppelsa. Dans l’ex-empire soviétique ? J’en suis persuadé.
M. le rapporteur. Je voulais plus précisément évoquer l’Azerbaïdjan : des mafias, le crime organisé s’y sont-ils implantés ou non ?
M. Jacques Soppelsa. L’État n’est certainement pas en cause, et en tout cas depuis 2007. Reste que, compte tenu des pesanteurs historiques, on n’a pas éliminé toute une génération très liée au système soviétique. Je le répète : la quasi-totalité des républiques, désormais indépendantes, de l’ancien empire soviétique, sont plus ou moins gangrenées par des mafias du crime. Et, j’y insiste, si vous me posiez la question sur l’Albanie, que je connais bien par ailleurs, et qui n’a rien à voir avec notre sujet, je vous répondrais de la même manière.
C’est en tout cas préoccupant. Il y a une trentaine d’années, en effet, on évoquait les mafias italiennes, italo-américaines, le cartel de la drogue colombien… mais très peu les mafias liées à la mondialisation et, surtout, celles liées à l’explosion de l’empire soviétique.
M. le président François Rochebloine. Pouvez-vous évoquer les relations de l’Azerbaïdjan avec la Russie, avec la Turquie, avec l’Iran, enfin avec la France et, au-delà, avec l’Union européenne ?
M. le rapporteur. Pour compléter cette question, je dirai qu’on a du mal à se faire une idée précise des différentes influences qui s’exercent sur l’Azerbaïdjan : quelque 25 millions d’Azéris se trouvent en Iran ; on nous explique que les Azerbaïdjanais vivent à la mode turque ; dans le même temps, les Russes sont actifs sur les plans économique et diplomatique ; en outre, la résolution du conflit du Haut-Karabagh n’avance pas malgré le travail du groupe de Minsk et les conditions posées aux parties ; enfin, la présidence concentre l’essentiel du pouvoir.
En somme, comment, en qualité de géopoliticien, appréhendez-vous l’Azerbaïdjan en tant qu’il se trouve à la confluence de groupes d’influence importants, à la confluence d’États – sans oublier les aspects civilisationnels ?
M. Jacques Soppelsa. Vous avez employé un mot qui a retenu mon attention, celui de « confluence ». Je suis plutôt optimiste sur le potentiel de l’Azerbaïdjan – nonobstant, certes, quelques réserves.
Évoquons la Russie, pour répondre à la première question du président. Elle est surtout, que je sache, un allié privilégié de l’Arménie où se situe la plus grande base militaire extérieure russe.
M. le président François Rochebloine. C’est pour assurer la sécurité de la région.
M. Jacques Soppelsa. Le fait est que les relations entre la Russie et l’Arménie sont excellentes. Et comme l’Arménie, à ma connaissance, n’entretient pas des relations totalement amicales avec l’Azerbaïdjan – le rapporteur vient d’évoquer le drame du Haut-Karabagh…
M. le président François Rochebloine. Ce que vous dites est important : des relations pas tout à fait amicales avec l’Azerbaïdjan ? Vous me permettrez d’en douter…
M. Jacques Soppelsa. Je reprends ma phrase : compte tenu du fait que la Russie a des relations privilégiées avec l’Arménie et que l’Arménie n’entretient pas des rapports totalement amicaux avec l’Azerbaïdjan – c’est le moins que l’on puisse dire –, les relations entre la Russie et l’Azerbaïdjan ne peuvent pas ne pas en être affectées. Ce constat me paraît difficilement niable. Ensuite, les relations entre l’Azerbaïdjan et les États-Unis, d’une part, et celles entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne, de l’autre, sont plutôt positives. Aussi la situation se révèle-t-elle très complexe.
Quant au Haut-Karabagh, il s’agit d’un remarquable exemple de conflit gelé, depuis vingt-cinq ans, et, ne lisant pas dans le marc de café, je ne saurais me hasarder à quelque prévision sur ce qui se passera dans quinze ou vingt ans. Je ne suis par ailleurs pas dans la tête du président Poutine.
Il y a trois ou quatre semaines, Francis Fukuyama, aux États-Unis, m’a dit qu’il voyait émerger trois grands empires, évoquant la velléité de Vladimir Poutine de relancer l’empire russe, celle de Donald Trump de relancer l’empire américain – « America is back », « L’Amérique est de retour » –, enfin celle d’Erdoğan de relancer, si je puis dire, le mythe de l’empire ottoman, dernière hypothèse qui ne me paraît pas devoir être exclue et, en effet, la Turquie peut jouer un rôle – positif comme négatif, là n’est pas la question…
M. le président François Rochebloine. Et avec quelles conséquences ?
M. Jacques Soppelsa. Les conséquences pourraient en être très spectaculaires au Moyen-Orient.
Pour ce qui est de la Turquie, il paraît que c’est un pays européen, ce qui est à relativiser puisque seulement 3 % de son territoire se situent en Europe ; on me dit également qu’Erdoğan est un islamiste modéré, point sur lequel on peut être sceptique.
M. le président François Rochebloine. C’est ce qu’il a déclaré il y a quelques jours.
M. le rapporteur. Voyez-vous le président Poutine laisser le président Erdoğan agir dans le Caucase ?
M. Jacques Soppelsa. La Realpolitik, c’est du donnant-donnant, du gagnant-gagnant. Je ne puis vous répondre, mais il faut réfléchir à votre question. Lâcher le Caucase pour avoir la paix en Ukraine et avec certaines républiques d’Asie plus orientales, ce ne serait pas totalement inutile. Je suppose que le président Poutine a de la mémoire : comparaison n’est certes pas raison, mais souvenez-vous, même s’il s’agit d’une cause directe et non d’une cause profonde, que l’Union soviétique est morte lorsque l’armée rouge entre à Kaboul en 1980 – dans le bourbier afghan. Aussi, si le bourbier caucasien devient de plus en plus inextricable, l’hypothèse d’y laisser agir la Turquie n’est pas totalement à exclure, mais je peux me tromper.
M. le président François Rochebloine. Quelle est votre appréciation sur la réalité de l’affirmation laïque des autorités azerbaïdjanaises ?
M. Jacques Soppelsa. Elle est plutôt positive. Quand j’ai séjourné pour la première fois en Azerbaïdjan, il y a vingt-cinq ans, la république, alors soviétique, était laïque par définition. J’y suis retourné il y a deux ans, des amis m’avertissant que je verrais essentiellement des femmes voilées ; or, jusqu’à la frontière russe, j’ai surtout vu des femmes en minijupe et des églises orthodoxes ouvertes cohabitant avec des mosquées. Il me semble que dans ce pays, qui affiche une constitution laïque faisant référence, vous le savez, à la loi française de 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, comparé aux autres pays émergents voisins, la notion de laïcité ne soit pas totalement surfaite.
M. le président François Rochebloine. Et que pouvez-vous nous dire des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Iran ?
M. Jacques Soppelsa. Le lien est direct.
Mais je reviens un instant sur la laïcité : il est plus facile d’être laïque dans un pays où 95 % de la population a une même religion, que de l’être dans un pays où vous avez 35 % de chiites, 60 % de sunnites etc.
M. le rapporteur. Tout à fait !
M. Jacques Soppelsa. C’est un élément qui, pour l’Azerbaïdjan, me paraît positif.
M. le président François Rochebloine. Tout le monde est laïque musulman ou musulman laïque.
M. Jacques Soppelsa. Ce que j’ai vu en Azerbaïdjan, et je parle sous le contrôle de M. Mancel qui connaît mieux le pays que moi, c’est le déclin spectaculaire de la religiosité – ce dont certains se plaignent d’ailleurs. La sécularisation est sans doute liée aux deux tiers de siècle de soviétisation. Voilà en tout cas qui me rappelle l’évolution que j’ai connue à Libourne : quand j’étais enfant, il y avait un curé, deux diacres, trois vicaires pour une seule paroisse alors qu’aujourd’hui celle-ci est servie par un curé d’origine congolaise et qui se retrouve à gérer huit paroisses en même temps. J’ai eu ce sentiment, en Azerbaïdjan, que la sécularisation…
M. le président François Rochebloine. Entendez-vous par là une baisse de la pratique religieuse ?
M. Jacques Soppelsa. Il me semble. Certaines ONG (organisations non gouvernementales) constatent également ce phénomène. Le rapporteur spécial des Nations unies va également dans ce sens : « L’Azerbaïdjan est en général un pays où règne une grande tolérance religieuse, une véritable harmonie entre les religions, même si la majorité de la population est de plus en plus sécularisée. »
M. le président François Rochebloine. Qu’en est-il des relations avec la France et du désir de l’Azerbaïdjan de se rapprocher de l’Europe ?
M. Jacques Soppelsa. Je crois, comme mon ami Joseph Nye, le professeur américain qui s’en est fait l’apôtre, au soft power.
Je ne suis pas spécialiste de l’économie, mais je crois que les grandes entreprises françaises ont tout intérêt à s’implanter à Bakou qui est en plein développement. La seconde fois que je me suis rendu sur place, j’y ai surtout vu des entreprises allemandes. Je ne suis pas un ami de M. Montebourg, mais il est vrai que si l’on développait les investissements français à l’étranger… C’était une boutade, monsieur le président.
M. le président François Rochebloine. Mais on peut très bien être un ami de M. Montebourg ! (Sourires.)
M. Jacques Soppelsa. En tout cas, Bakou me paraît très demandeur de liens culturels, sportifs et autres. Il semble donc que le gouvernement du président Aliev entende jouer la carte du soft power.
M. le président François Rochebloine. Et la carte des droits de l’Homme ?
M. Jacques Soppelsa. C’est autre chose et je ne vous cache pas que je suis très partagé. Je n’ai pas passé ma vie dans les prisons azerbaïdjanaises ni dans aucune autre prison, d’ailleurs. Je suis, comme tout un chacun, abonné à Courrier international et, dans un article sur les droits de l’Homme dans le monde, on cite, pour l’Azerbaïdjan, les cas de Bayram Mammadov et de Giyas Ibrahimov qui ont apparemment été frappés de cinq ans de prison, si j’ai bonne mémoire, pour avoir tagué : « Bonne fête de l’esclavage », pour parodier le slogan du régime : « Bonne fête des fleurs. »
M. le président François Rochebloine. Je vous laisse imaginer le nombre de prisonniers, en France, si les citoyens qui taguent leur hostilité au pouvoir étaient traités de la même manière.
M. Jacques Soppelsa. L’Azerbaïdjan n’est certainement pas le paradis des droits de l’Homme.
Souvent on me demande – y compris mes étudiants – pourquoi j’ai écrit un livre sur l’Azerbaïdjan quand on songe à l’atrocité du génocide arménien…
M. le président François Rochebloine. À propos du génocide arménien… vous voulez parler de la Turquie, non de l’Azerbaïdjan !
M. Jacques Soppelsa. En effet, car il y a confusion entre la Turquie et l’Azerbaïdjan dans l’opinion publique française…
M. le président François Rochebloine. Mais non !
M. Jacques Soppelsa. Mais si ! Quand j’ai présenté mon livre dans la mairie dont je suis un modeste élu, un certain nombre de personnes sont venues me voir, y compris des intellectuels, qui, sur la question du génocide arménien, confondaient Azerbaïdjan et Turquie…
M. le président François Rochebloine. Alors ce n’étaient pas des intellectuels car il est particulièrement grave que l’on puisse faire une telle confusion.
M. Jacques Soppelsa. Nous sommes bien d’accord. Et inutile de préciser que je rectifie systématiquement.
Reste, je le répète, que je ne considère pas l’Azerbaïdjan comme le paradis du respect des droits de l’Homme. J’ai néanmoins retrouvé une fiche mentionnant que, parmi certaines des républiques ex-soviétiques de l’Asie centrale et du Caucase, l’Azerbaïdjan est le seul pays à avoir adhéré à vingt-trois conventions sur les droits humains – ce qui n’est pas neutre –, comme le pacte international sur les droits civiques, la convention internationale sur les droits de l’enfant, la convention internationale supprimant toute discrimination contre les femmes… Et j’avoue qu’il m’a fallu attendre 2010 pour découvrir que l’Azerbaïdjan avait donné le droit de vote et l’éligibilité aux femmes une trentaine d’années avant la France ! J’ajoute la convention contre la torture, la convention pour l’abolition de la peine de mort… On peut objecter que tout est de façade, pour ainsi dire, et que le régime signe des textes qu’il ne respecte pas, mais il me semble, objectivement, qu’un assez gros effort est fait pour respecter les droits de l’Homme et le rapporteur des Nations unies chargé de la question se rend régulièrement à Erevan, à Tbilissi, à Bakou et, dans un rapport que j’ai sous les yeux, il écrit que « la promotion des droits humains va dans le bon sens ».
M. le président François Rochebloine. Que pensez-vous du classement international de l’Azerbaïdjan en matière de liberté de la presse ?
M. Jacques Soppelsa. C’est autre chose encore et je suis heureux que vous abordiez la question. L’Azerbaïdjan est très mal classé – 132e…
M. le président François Rochebloine. Vous voulez dire : 163e !
M. Jacques Soppelsa. Peut-être, en effet, selon le classement de Reporters sans frontières, l’organisation de Robert Ménard.
M. le président François Rochebloine. Ce n’est plus Robert Ménard, le secrétaire général de Reporters sans frontières ! Il ne faut pas tout mélanger.
M. Jacques Soppelsa. Ah, ce n’est plus Robert Ménard ?
M. François Pupponi. Il est maire de Béziers, désormais…
M. Jacques Soppelsa. J’ai tout de même découvert qu’en matière de liberté de la presse, l’Arménie et la Géorgie étaient mieux classées que l’Italie ! Je veux bien, dès lors, accepter tous les classements que vous voulez en la matière, mais comprenez que je sois relativement réservé.
M. le rapporteur. L’une de vos considérations m’a surpris à propos des relations de la Russie avec l’Arménie et avec l’Azerbaïdjan. Jusqu’à présent, en effet, dans le cadre de nos travaux, on nous a plutôt présenté la Russie « en équilibre » vis-à-vis des deux pays afin de contenir les incidents frontaliers tels ceux qui se sont produits avec le Haut-Karabagh en avril dernier, au cours de la « guerre des quatre jours ». Pouvez-vous approfondir vos affirmations sur ce rôle de la Russie qui serait donc en fait plus déséquilibré que nous ne le pensions, en mettant votre analyse en perspective avec les évolutions qui pourraient avoir lieu dans le cadre du groupe de Minsk ou en dehors de ce dernier, puisque la Russie a des relations bilatérales avec chacun de ces deux pays ?
Ensuite, on nous a affirmé, lors d’une précédente audition, que l’armée turque assurait des formations au bénéfice de l’armée azerbaïdjanaise. Disposez-vous d’informations sur la question ?
M. Jacques Soppelsa. Le fait que la Russie entretienne des relations anciennes et privilégiées avec l’Arménie n’est pas incompatible avec une forme de Realpolitik à l’égard de l’Azerbaïdjan, qui partage une frontière commune avec la Russie. Il n’y a donc pas d’hostilité totale entre Moscou et Bakou, comme en témoigne l’activité de la Russie au sein du groupe de Minsk, où M. Poutine est l’une des principales forces de proposition pour apporter une solution diplomatique au conflit gelé du Haut-Karabagh. Certes, la situation semble déséquilibrée dans la mesure où la Russie possède d’importantes bases militaires en Arménie, mais M. Poutine sait ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
De plus, « l’empire poutinien » ne saurait accepter l’implantation croissante de « l’empire d’Erdoğan » dans le Caucase. Cette tendance est encore limitée, mais il est vrai que l’armée turque participe à la formation de certaines unités militaires azerbaïdjanaises. Compte tenu des liens historiques et religieux que la Turquie entretient avec cette région, elle ne peut se permettre de s’en désintéresser.
M. le président François Rochebloine. Ces derniers temps, pourtant, les relations russo-turques se sont fortement dégradées. Cela a-t-il des conséquences dans la région ?
M. Jacques Soppelsa. Il n’est pas impossible que M. Poutine, grand joueur d’échecs comme M. Erdoğan, accepte de concéder à la Turquie une influence sur l’Azerbaïdjan en raison de sa proximité historique et religieuse.
M. le rapporteur. Autrement dit, l’Azerbaïdjan et le Caucase pourraient constituer une zone tampon entre ces deux empires annoncés ?
M. Jacques Soppelsa. Absolument, comme le sont les petites républiques telles que l’Ossétie et la Tchétchénie. Dans une conférence récente, M. Bill Clinton a d’ailleurs estimé que les deux points chauds les plus sensibles de la planète étaient le Cachemire, d’une part, et le Caucase, d’autre part. Objectivement, il s’agit en effet de deux poudrières, la première étant qui plus est encerclée par des puissances nucléaires. Quoi qu’il en soit, le Caucase est une zone de tension potentielle.
M. François Pupponi. Il semble qu’Israël ait récemment pris position sur le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Le confirmez-vous ?
D’autre part, pensez-vous qu’il existe un moyen – et lequel – de mettre les belligérants autour de la table pour enfin trouver une sortie honorable au conflit du Haut-Karabagh ?
M. Jacques Soppelsa. Mon point de vue est celui de l’ONU : seule la voie diplomatique est envisageable.
M. le président François Rochebloine. Avez-vous eu des échanges avec le groupe de Minsk ?
M. Jacques Soppelsa. Uniquement avec la partie française. Je ne suis pas surpris que le conflit dure depuis près de vingt-cinq ans…
M. le président François Rochebloine. Le cessez-le-feu date en effet de 1994 ; il me semble que la France joue un rôle important dans ce processus, quels que soient les représentants de sa diplomatie.
M. Jacques Soppelsa. Soit ; cela étant, le Haut-Karabagh n’est pas une préoccupation de premier ordre dans la relation russo-américaine, ce qui explique peut-être la lenteur du processus. Les quatre premières résolutions de l’ONU datent tout de même de 1993 et 1994, soit plus d’une vingtaine d’années !
M. le rapporteur. En complément à la question de M. Pupponi sur le règlement diplomatique du conflit du Haut-Karabagh, permettez-moi de vous demander si, selon vous, les États-Unis, la Russie ou la France peuvent faire pression sur les parties prenantes ou si ce conflit gelé, au fond, n’arrange pas tout le monde, y compris les belligérants eux-mêmes ?
M. Jacques Soppelsa. C’est sans doute le cas, hélas : ce conflit gelé arrange tout le monde. Je vois mal le futur président des États-Unis créer des difficultés dans la relation bilatérale avec la Russie au sujet du Haut-Karabagh, comme personne n’a souhaité en créer lors de l’invasion américaine de la Grenade en d’autres temps – ou de l’annexion russe de la Crimée. Sans doute est-ce du cynisme, mais ce conflit gelé risque de l’être aussi longtemps qu’Hibernatus.
J’ignore, monsieur Pupponi, si Israël a exprimé une position sur le conflit.
M. le président François Rochebloine. Précisons qu’Israël vend des armes à l’Azerbaïdjan.
M. Jacques Soppelsa. En effet. Israël est devenu un acteur majeur du marché de l’armement, en Afrique notamment ; cela pourrait expliquer une prise de position en faveur de Bakou.
M. le président François Rochebloine. Le contraste entre les réalisations économiques et culturelles de l’Azerbaïdjan et le caractère rudimentaire de sa culture politique, essentiellement fondée sur un système de pouvoir personnel, est saisissant. Jusqu’à quel point cette situation peut-elle durer sans mettre en péril la cohésion interne du pays et, partant, sa volonté d’exister sur la scène internationale ?
Dans quelle mesure le fait que l’Azerbaïdjan, à la différence de ses voisins, soit somme toute un État de constitution récente, explique-t-il les pratiques autoritaires de ses dirigeants ? À l’inverse, quels sont les ressorts et les sources d’inspiration des opposants au pouvoir de M. Aliev ?
Enfin, certains États voisins, par réalisme politique, ne considèrent-ils pas l’existence à Bakou d’un régime certes autoritaire – chacun en conviendra – mais dont l’emprise globale sur la population paraît assurée, comme le prix à payer pour la stabilité de la région ?
M. Jacques Soppelsa. Je préfère, par souci d’impartialité, parler de régime présidentiel que de régime autoritaire : la Constitution de l’Azerbaïdjan, comme celle des pays voisins d’ailleurs, en fait un régime présidentiel. Certes, il est aussi autoritaire ; il me semble qu’il y a là, qu’on le veuille ou non, un héritage culturel, sensu lato, de deux tiers de siècle de régime soviétique. Le père du président actuel, avant d’être lui-même président – et de donner son nom à une fondation particulièrement dynamique sur le plan culturel – était un dirigeant du Parti communiste soviétique !
M. le président François Rochebloine. Pour être dynamique, il faut de l’argent…
M. Jacques Soppelsa. La rente pétrolière facilite les choses, en effet, quoique l’Arabie Saoudite puisse être citée en contre-exemple. Cette rente, toutefois, est une source de préoccupation : si la situation économique de l’Azerbaïdjan a pu être plutôt euphorique, le poids des hydrocarbures est tel qu’il devrait inciter les autorités à diversifier les activités, comme elles commencent déjà à le faire, dans les secteurs du tourisme, des services ou d’autres industries.
Les classements de telle ou telle ONG sur la corruption valent ce qu’ils valent, mais l’éradication de la corruption reste un défi majeur en Azerbaïdjan, de même que l’achèvement du processus de démocratisation. Certes, il existe officiellement une cinquantaine de partis politiques, comme autrefois le Parti communiste français servait de parapluie à toutes sortes d’organisations affiliées.
Je ne peux guère vous répondre sur les sources d’inspiration des opposants au pouvoir. J’ai rencontré des personnes plutôt occidentalisées qui, convaincues des acquis du régime en matière de santé et d’éducation – ce qui n’est pas sans rappeler le castrisme – reconnaissaient néanmoins des difficultés sur d’autres plans, mais je n’ai pas rencontré d’opposants notoires. En revanche, je constate un fort courant de francophilie ; l’image de la France est excellente dans le monde rural azerbaïdjanais, notamment, au point que l’on nous a proposé des échanges et parrainages éducatifs lors de notre dernier voyage. Je crois profondément à l’action de la francophonie dans cette région.
M. le président François Rochebloine. Je partage totalement ce sentiment.
M. François Pupponi. Avez-vous pu vous rendre au Haut-Karabagh ?
M. Jacques Soppelsa. Non. Certains de mes étudiants travaillent sur le sujet, sous l’angle notamment des possibilités de dégel du conflit.
M. Jean-François Mancel. Selon Les Nouvelles d’Arménie, l’Arménie et la Russie auraient récemment signé une convention sur la défense commune des frontières arméniennes par des troupes provenant des deux pays. Sans doute serait-il opportun que notre mission se renseigne sur cet accord, qui illustre le rôle souvent complexe que joue la Russie auprès de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan dans le conflit du Haut-Karabagh.
M. le rapporteur. Cet accord porterait-il aussi sur les frontières contestées ?
M. Jean-François Mancel. La frontière du Haut-Karakbagh ne serait pas concernée, selon cette revue.
M. le président François Rochebloine. Des échanges ont lieu entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan au niveau ministériel, mais il ne me semble pas qu’une telle convention ait été signée.
M. Jacques Soppelsa. J’ai lu cet article. Les universitaires ont tendance à se méfier des sources journalistiques mais, en l’occurrence, je ne vois guère ce que des journalistes arméniens auraient à gagner à donner cette nouvelle sans preuves. À l’évidence, les relations russo-arméniennes sont très privilégiées. L’article en question n’évoque pas les frontières du Haut-Karakbagh, mais celles des sept enclaves.
M. François Pupponi. Le budget de défense de l’Azerbaïdjan est plus de deux fois plus important que le budget global de l’Arménie ; la Russie entend donc rééquilibrer cette situation. Sur le plan strictement militaire, l’Azerbaïdjan aurait réglé le conflit depuis longtemps si le risque d’une intervention russe aux côtés de l’Arménie n’existait pas.
M. Jean-François Mancel. Il a été suggéré que le gel du conflit arrangeait les parties prenantes, mais ne constitue-t-il pas un inconvénient majeur pour l’Azerbaïdjan ? Ce gel confirme en effet l’occupation par l’Arménie des sept enclaves voisines et celle du Haut-Karabagh lui-même.
M. le président François Rochebloine. Rappelons que les enclaves en question comptent une dizaine de milliers d’habitants.
M. Jacques Soppelsa. Je pense que la pérennisation de ce conflit arrange non pas les belligérants, mais les deux superpuissances que sont les États-Unis et la Russie ; en revanche, elle ne saurait être favorable à l’Azerbaïdjan, qui a perdu un cinquième de son territoire et doit intégrer environ un million de réfugiés. Les sept districts en question, qui sont presque vides, compliquent considérablement la situation. Lorsque le président Aliev a rencontré son homologue arménien à Paris, il s’est déclaré plus que jamais favorable à une résolution du conflit ; n’était-ce qu’une posture diplomatique ?
M. le président François Rochebloine. L’accord de Paris conclu sous le président Chirac entre le président Aliev père et le président Kotcharian a été cassé à Key West par l’Azerbaïdjan. De ce fait, le conflit perdure, malheureusement.
M. Jacques Soppelsa. Pour des raisons géopolitiques, la situation semble s’être inversée et les Azerbaïdjanais sont désormais demandeurs, à mon sens, d’un règlement pacifique du conflit, tandis que l’Arménie est plus en retrait. De surcroît, le caractère fallacieux de la République autonome du Haut-Karabagh, que personne ou presque ne reconnaît officiellement, contribue à geler le conflit.
M. Jean-François Mancel. Chacun sait qu’Israël entretient depuis longtemps de bonnes relations avec l’Azerbaïdjan. Cela n’est-il pas lié au fait qu’il se trouve dans ce pays très majoritairement musulman une communauté juive d’environ 30 000 personnes qui vit très bien depuis des millénaires sur les contreforts du Caucase, et qui témoigne de la capacité de ce pays à favoriser le vivre-ensemble, puisque nous parlions plus tôt de laïcité ?
M. Jacques Soppelsa. Il existe en effet une importante synagogue à Qabala. L’existence de cette petite communauté juive contribue sans doute à justifier les bonnes relations entre Israël et l’Azerbaïdjan, mais elle ne me semble pas être décisive. Quant à la laïcité, il est plus aisé de respecter les autres religions dans les cas où la religion majoritaire représente plus de 95 % de la population que dans les situations moins asymétriques… Quoi qu’il en soit, les intérêts économiques israéliens dans le secteur des armes et des nouvelles technologies me semblent jouer un rôle majeur.
M. Jean-François Mancel. S’agissant du génocide, on confond souvent l’Azerbaïdjan, compte tenu de son image, avec la Turquie. Ne s’ajoute-t-il pas aussi dans l’inconscient collectif le fait que l’Arménie soit un pays chrétien, tandis que l’Azerbaïdjan est musulman ? La combinaison de ces deux éléments n’incite-t-elle pas les pays occidentaux à pencher davantage en faveur de l’Arménie que de l’Azerbaïdjan ?
M. Jacques Soppelsa. Sans aucun doute. Qui plus est, le public français assimile souvent l’Azerbaïdjan aux républiques d’Asie centrale.
M. le président François Rochebloine. On en parle davantage, tout de même, en raison du conflit avec l’Arménie.
M. Jacques Soppelsa. Hélas. Il est vrai que ce pays majoritairement musulman est souvent confondu avec la Turquie.
M. le président François Rochebloine. Les Azerbaïdjanais ne sont-ils pas des Turcs ?
M. Jacques Soppelsa. Certes. En tout état de cause, il n’est pas impossible que cette confusion soit nourrie par le puissant lobby qu’est la diaspora arménienne en France.
M. le président François Rochebloine. Monsieur le professeur, nous vous remercions.
*
* *
Ÿ Audition de M. Philippe Vinogradoff, Ambassadeur pour le sport (jeudi 8 décembre 2016)
M. le président François Rochebloine. Mes chers collègues, je vous prie de bien vouloir excuser notre rapporteur, M. Jean-Louis Destans, qui a été retenu pour des raisons personnelles.
Nous avons le plaisir d’accueillir ce matin M. Philippe Vinogradoff, ambassadeur pour le sport depuis le début de l’année, après avoir représenté notre pays pendant trois ans et demi auprès de la République du Salvador.
Comme vous le savez sans doute, monsieur l’ambassadeur, je me suis engagé depuis très longtemps aux côtés du mouvement sportif, et j’ai eu l’occasion de présenter conjointement, avec Mme Valérie Fourneyron, ancien ministre des sports, un rapport sur la diplomatie sportive et son aspect économique. Dans ce document, nous avions notamment exprimé notre appui à la création de ce poste d’ambassadeur pour le sport, dont le premier titulaire fut M. Jean Lévy.
Les activités sportives sont, pour le meilleur comme le pire, un vecteur important d’influence pour les États : pour le meilleur, comme la France, qui fait valoir les qualités de ses sportifs, celles des nombreuses organisations qui soutiennent leurs performances et celles des entreprises qui interviennent dans le secteur du sport ; pour le pire, dans la mesure où le sport est une vitrine de propagande pour les États dits totalitaires – souvenons-nous comment la Roumanie de Ceausescu avait fait valoir le sourire et les exploits de la petite Nadia Comaneci. Il est donc normal que le sport fasse partie des outils utilisés par le gouvernement de Bakou pour se faire connaître – et avec quel éclat – sur la scène internationale.
Dans le prolongement de ces observations, je souhaiterais que vous nous fassiez une première évaluation de vos nouvelles fonctions. Je pense notamment à la capacité des postes diplomatiques français à vous informer des réalités sportives de leur pays de résidence, et aux initiatives que vous pouvez prendre en retour pour stimuler la promotion, à l’étranger, avec le concours de nos diplomates, du sport français, de ses acteurs et de ses entreprises. Bien entendu, notre curiosité se porte tout particulièrement sur l’accomplissement de ces différentes missions à l’égard de l’Azerbaïdjan.
Vous avez pris vos fonctions six mois après la tenue des Jeux européens de Bakou, qui ont montré concrètement ce que signifiait pour l’Azerbaïdjan la diplomatie sportive. Pouvez-vous nous dire, à la lumière de votre expérience, ce qui pourrait caractériser la stratégie de diplomatie par le sport de Bakou, en termes de prise de décisions internes, de moyens et de méthodes de communication ?
M. Philippe Vinogradoff, ambassadeur pour le sport. Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, comme vous venez de l’indiquer, j’ai pris mes fonctions en février dernier, et je suis le troisième ambassadeur pour le sport. J’ai en effet remplacé le successeur de Jean Lévy, qui est resté très peu de temps, pour des raisons de santé.
Comme vous le savez, le poste d’ambassadeur pour le sport a été créé en 2013, à la suite d’une initiative conjointe de M. Laurent Fabius et de Mme Valérie Fourneyron, qui traduisait la prise de conscience, par la diplomatie française, de l’importance du sport comme outil au service de l’image, du tourisme et de l’économie de notre pays.
Quel est le rôle d’un ambassadeur pour le sport ? Ou plutôt, qu’apporte-t-il de plus, par rapport aux multiples acteurs intervenant dans le domaine du sport et de la diplomatie sportive ?
L’ambassadeur a une fonction de coordination de l’action, dans la mesure du possible, et de mise à disposition du réseau diplomatique au service du sport. Son premier objectif est de promouvoir la France comme terre d’accueil de grands événements sportifs internationaux, et donc de promouvoir des candidatures – et pas uniquement celle de Paris au Jeux olympiques.
Les événements sportifs internationaux sont en effet nombreux. Nous allons ainsi accueillir au mois de janvier les Championnats du monde de handball ; en mai, les Championnats du monde de surf, et les Championnats du monde de hockey sur glace – que nous partageons avec l’Allemagne ; et en août, les Championnats du monde de lutte.
La France est un pays qui a une longue tradition d’accueil de grands événements sportifs – ne serait-ce que cette année, avec l’Euro 2016.
Ce premier volet de mon action passe par la mobilisation du réseau diplomatique et consulaire. Je précise que lorsque je parle du réseau, je ne me limite pas aux ambassades, puisque le réseau intègre pleinement les Instituts, les Alliances françaises, le réseau des établissements français à l’étranger.
Le second volet de mon action consiste à promouvoir le savoir-faire français, particulièrement en matière d’organisation de grands événements sportifs, et donc à promouvoir les intérêts économiques, essentiellement ceux de la filière sport qui a été mise en place avec la collaboration de la direction générale du Trésor, de Business France, pour structurer l’offre économique française en matière de sport.
Voilà les deux grands volets de l’action de l’ambassadeur pour le sport, dont le vrai « plus » est de servir de lien avec le réseau français à l’étranger.
M. le président François Rochebloine. Je crois qu’il y a maintenant dans chaque ambassade un « référent sport ».
M. Philippe Vinogradoff. En effet. L’initiative a été prise par M. Lévy : un « référent sport » est désigné par l’ambassadeur, dans chacune de nos ambassades et dans le monde entier. Vous savez que, dans notre « maison », le mois de septembre est celui des mutations. De nombreux référents « sport » ont donc quitté leur poste. Mais depuis quinze jours, il y a en un à nouveau dans toutes nos ambassades.
M. le président François Rochebloine. Même les plus petites ?
M. Philippe Vinogradoff. En général, dans les plus petites, l’ambassadeur ou son unique collaborateur, est référent dans tous les domaines : sport, archives, etc.
Quel premier bilan en tirer ?
L’expérience est encore très brève. À vrai dire, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose, de nombreux ambassadeurs faisaient de la diplomatie sportive sans le savoir. Il n’empêche que lorsque le concept a été concrétisé, ce fut la surprise. Il n’était pas naturel, en effet, pour beaucoup de mes collègues, de développer des liens avec le monde du sport.
Au bout de presque quatre ans, je crois qu’on peut parler d’une véritable sensibilisation des postes sur tout ce que le sport peut apporter, non seulement en termes d’images, en termes économiques, mais également en termes d’action sur place. En effet, rentrer dans les réseaux ouvre au chef de poste un éventail de contacts qu’il n’aurait pas forcément noués sans cette action liée au sport.
Ce n’est pas encore parfait. La sensibilisation suppose un effort continu. Mais je pense que l’opportunité de la candidature de Paris permettra de cristalliser davantage encore, dans les postes, la « conscientisation » de l’importance de ce domaine. Pour l’instant, ils n’ont pas le droit de parler de la candidature de Paris, puisque les règles du Comité international olympique (CIO) précisent que la campagne internationale ne peut être ouverte qu’à partir du 3 février prochain, date à laquelle les villes candidates remettront le troisième et dernier dossier.
Mais là encore, la campagne internationale est enserrée dans un certain nombre de règles du CIO, qui ne facilitent pas la tâche. Par exemple, seules les villes candidates sont autorisées à faire la promotion de leur candidature à l’étranger. Ainsi, les postes pourront seulement venir en appui, pour donner une teinte « candidature de Paris » à d’autres événements, mais ne pourront pas organiser d’événements de promotion de la candidature de Paris. De même, il est interdit, que ce soit avant ou après le 3 février, de prendre contact avec les membres du CIO pour parler spécifiquement de la candidature. En revanche, pour entretenir les liens, on peut inviter, par exemple à un grand événement culturel, un membre du CIO résidant dans le pays dans lequel l’ambassadeur est en poste…
Je pense donc que dans les postes, il y a une vraie prise de conscience, que nous nous employons à développer, de l’intérêt que peut représenter pour la France la diplomatie sportive. Celle-ci est d’ailleurs mise en place par de plus en plus de pays, avec des objectifs divers et variés. Parfois, elle existe depuis longtemps. C’est le cas aux États-Unis : les Américains ont parlé de « diplomatie sportive » dès les années soixante. Ils intègrent ce concept, à mon sens avec raison, dans la notion plus large de « diplomatie publique » qui consiste à établir des liens, des dialogues et des échanges au-delà de la diplomatie traditionnelle.
Le développement du sport, et surtout le développement médiatique du sport, la répercussion qu’ont les grands événements sportifs internationaux en termes d’image, ont amené de plus en plus de pays, notamment émergents, à mettre en place des diplomaties sportives pour répondre à ces objectifs divers et variés.
Il peut s’agir de « se faire connaître ». Je me suis rendu lundi dernier à Bruxelles pour assister à un séminaire organisé par la Commission sur le thème de la diplomatie sportive. Le Premier ministre des Îles Fidji, qui était présent, nous a ainsi expliqué que grâce à la diplomatie sportive – qui se résume pour eux essentiellement à l’« exportation » de joueurs de rugby – il était désormais plus facile de mettre les îles Fidji sur la carte, très au-delà de leur dimension géographique ou démographique.
Un tel raisonnement peut s’appliquer au Qatar, à l’Azerbaïdjan, au Brésil, à la Russie, à la Chine. C’est une évolution de plus en plus évidente dans le monde de la diplomatie : recourir au sport, avec des objectifs qui varient d’un pays à l’autre, et sur lesquels il ne m’appartient de me prononcer.
Vous m’avez interrogé à propos de l’Azerbaïdjan. Depuis que j’ai pris mes fonctions, je n’ai jamais eu à traiter avec ce pays. D’ailleurs, la coopération directe bilatérale ne relève pas de moi, mais du ministère des sports et, évidemment, des fédérations elles-mêmes.
M. le président François Rochebloine. Nous avons entendu M. Thierry Braillard, secrétaire d’État au sport.
M. Philippe Vinogradoff. Je n’ai pas eu de contact avec la diplomatie sportive d’Azerbaïdjan, dont je comprends que les moyens dont elle disposait ont un peu diminué, compte tenu de l’évolution des prix du pétrole et du gaz. Mais ce pays poursuivra dans cette voie pour exister sur le plan international, le sport donnant une aura.
M. le président François Rochebloine. Ma question vaut pour l’Azerbaïdjan et pour d’autres pays : avez-vous, ou allez-vous nouer des contacts avec les ministres des sports de tel ou tel pays ? Cela fait-il partie de vos fonctions ?
M. Philippe Vinogradoff. Il peut m’arriver de rencontrer les ministres des sports dans le cadre d’autres événements, mais ce n’est pas le centre de mes attributions. L’interlocuteur naturel des ministres des sports étrangers est le ministre des sports français.
Mes interlocuteurs privilégiés à l’étranger sont les comités d’organisation de grands événements sportifs, les grandes fédérations internationales de sport, mon objectif étant de faire connaître l’expérience et l’offre de la France.
M. le président François Rochebloine. Comme vous avez pu le lire dans notre rapport, nous sommes allés avec Mme Fourneyron au Japon, où nous avons constaté l’importance qu’avait là-bas la diplomatie sportive, pour le rugby, le cyclisme, etc. Les Japonais passent des contrats, des conventions avec ASO (Amaury Sport Organisation) et ils font la promotion du sport. Le Japon m’est apparu comme un modèle en matière de diplomatie sportive.
M. Philippe Vinogradoff. Tout à fait. Je compte d’ailleurs me rendre moi-même en février prochain au Japon, avec une délégation d’entreprises françaises, encore en cours de constitution. L’objectif est de rencontrer, d’une part, le club Sport mis en place Mme Fourneyron, et, d’autre part, les organisateurs des Jeux olympiques d’été de 2020 qui se tiendront au Japon.
M. le président François Rochebloine. Monsieur l’ambassadeur, depuis votre entrée en fonction, avez-vous eu connaissance de propositions de l’Azerbaïdjan visant, sous une forme ou sous une autre, à développer les relations bilatérales franco-azerbaïdjanaises dans le domaine du sport ? Dans l’affirmative, quel est le contenu de ces propositions et quelle évaluation en faites-vous ?
Mais si j’ai bien compris vos propos, a priori, il n’y en a pas…
M. Philippe Vinogradoff. En effet, je n’ai pas vraiment d’expérience en la matière.
M. le président François Rochebloine. Par ailleurs, comment peut-on, à votre sens, gérer la contradiction manifeste entre, d’un côté, les valeurs du sport, faites de loyauté, de courage et de respect des compétiteurs, et, de l’autre, les violations des droits de l’Homme par les autorités de Bakou, qui ont été unanimement déplorées, y compris par la France ? Et ce qui est valable pour l’Azerbaïdjan l’est aussi dans bien d’autres pays.
M. Philippe Vinogradoff. Cette question dépasse très largement mes compétences. Je pense toutefois que pour développer une diplomatie sportive, il faut être conscient des réalités. Il ne faut pas se voiler les yeux sur ce qui peut se passer dans certains pays partenaires. La promotion d’une diplomatie sportive est une œuvre de longue haleine, et il ne faut pas demander au sport plus qu’il ne peut apporter.
J’ai assisté à des réunions où l’on disait que le sport allait apporter la paix dans le monde. Non : c’est un instrument qui peut être utile. Je veux dire par là que le fait de développer des liens dans le cadre de la diplomatie sportive, d’organiser des échanges entre les athlètes et les organisations sportives, de développer des dialogues et des coopérations, peut contribuer à la promotion des valeurs du sport qui passent d’abord, comme vous l’avez dit, par le respect de l’autre. Et s’il est vrai que certains de nos pays partenaires ne respectent pas ces valeurs, le fait de nouer avec eux des coopérations sportives peut être une façon d’en faire la promotion chez eux.
Je peux vous citer un exemple. Je me suis rendu la semaine dernière à Monaco pour le forum Peace and Sport, qui, entre autres activités, a récompensé des actions, menées par des organisations sportives ou des ONG. Je peux citer celle d’un Français, Laurent Petrynka, président de la Fédération internationale du sport scolaire et président de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS). Il a organisé un événement à la frontière entre Israël, la Jordanie et le Liban, pour que des jeunes sportifs se rencontrent autour de tables de ping-pong. C’est une façon de promouvoir les valeurs de respect de l’autre. Une autre récompense a été accordée à deux jeunes femmes danoises, qui sont allées mettre en place en Afghanistan une équipe de football féminin. C’est peut-être une goutte d’eau, mais c’est une façon de commencer à faire prendre conscience de la nécessité de respecter les droits des femmes.
Voilà à quoi peut servir le développement de relations sportives avec des pays qui ne respectent pas toujours les valeurs qui nous sont chères.
M. le président François Rochebloine. Monsieur l’ambassadeur, voici les questions que souhaitait vous poser notre rapporteur.
Les difficultés économiques actuelles de l’Azerbaïdjan vont-elles mettre un coup d’arrêt à sa diplomatie sportive très active ?
M. Philippe Vinogradoff. Cela va certainement compliquer le financement de cette diplomatie sportive. Mais je pense, même si je ne connais pas encore l’Azerbaïdjan, que l’option « diplomatie sportive » va demeurer.
M. le président François Rochebloine. Pensez-vous que l’investissement massif fait par l’Azerbaïdjan dans le sport s’avère payant en termes d’image et d’influence ? Quels sont, selon vous, les objectifs recherchés dans des pays tels que l’Azerbaïdjan ?
M. Philippe Vinogradoff. D’après moi, il y a d’abord un objectif d’image, c’est-à-dire la volonté d’apparaître sur la scène internationale.
S’agissant de l’Azerbaïdjan, même si je n’étais pas en fonction à l’époque, je pense que, en termes d’image, les Jeux européens ont été un succès.
M. le président François Rochebloine. Cela nous a été dit et confirmé.
M. Philippe Vinogradoff. Est-ce que cela a été un succès en termes financiers ? Sincèrement, je ne le sais pas. L’évaluation de l’impact des grands événements sportifs internationaux est difficile : d’abord il n’est pas toujours quantifiable en termes monétaires ; ensuite, le plus souvent, il s’apprécie à très long terme. On ne peut donc pas faire un bilan définitif au bout d’un an. C’est trop tôt.
Je peux vous donner l’exemple du Brésil – un pays que je connais très bien puisque j’y ai été en poste – qui a accueilli coup sur coup la Coupe du monde de football, les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Ce pays est encore considéré comme émergent. Mais lorsqu’il s’est porté candidat, il avait déjà franchi un certain nombre d’étapes, et c’était une façon de s’affirmer sur la scène internationale.
En termes d’image – il faudrait demander aux Brésiliens eux-mêmes ce qu’ils pensent – moi qui étais à Rio pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, je pense que ce fut un moment positif pour le Brésil. Pour le reste, il faudrait mener une étude pour apprécier l’héritage, les retombées économiques de ces événements, et ce que les installations sportives apporteront à la population.
Plus généralement, pour ces pays qui s’engagent aujourd’hui – puisque pendant longtemps les grands événements sportifs internationaux étaient limités à une certaine zone géographique – j’estime que l’organisation de ces manifestations est très positive.
M. le président François Rochebloine. Sur le plan extérieur certainement. Mais sur le plan intérieur ? On a tout de même vu que certaines épreuves avaient attiré très peu de spectateurs. Il y a eu des problèmes, on a caché certaines choses…
M. Jean-François Mancel. Pas en Azerbaïdjan !
M. le président François Rochebloine. Je ne parle pas de l’Azerbaïdjan…Je ne faisais que réagir aux propos de M. l’ambassadeur sur le Brésil.
La population azerbaïdjanaise, mais sans doute ne pouvez-vous pas répondre, a-t-elle pu assister aux derniers Jeux européens ?
M. Jean-François Mancel. Tous les stades étaient pleins !
M. le président François Rochebloine. Je sais qu’ils étaient pleins. Mais quel était le pourcentage de la population azerbaïdjanaise parmi les spectateurs ? Et cette question de l’accès de la population locale vaut aussi pour d’autres pays comme le Brésil : aux jeux de Rio, il y avait certes beaucoup d’étrangers, mais combien de Brésiliens ?
Ensuite, quelles peuvent être les retombées économiques de ces grandes manifestations sportives ? Dans le cadre de l’Euro 2016, nous avons accueilli à Saint-Étienne quatre matchs. On nous a annoncé que cela allait rapporter 45 millions d’euros. J’attends les chiffres…
Ces événements peuvent donner une très belle image à l’extérieur. Mais correspond-elle à la réalité intérieure du pays ?
M. Philippe Vinogradoff. Encore une fois, il faut du temps pour pouvoir apprécier l’impact financier.
Mais revenons au dossier du Brésil que je connais bien, et auquel je suis particulièrement sensible. J’ai assisté à de nombreux événements pendant les Jeux olympiques de Rio. Il est vrai que certaines rencontres se sont déroulées dans des stades vides. Il en est ainsi par exemple d’un match de beach volley dans lequel jouait l’équipe brésilienne. Mais si le stade était vide, c’est que le public – dont j’étais – se trouvait à l’extérieur, attendant de pouvoir passer les contrôles de sécurité. En l’occurrence, ce n’était pas un problème de coût.
Oui, les Brésiliens ont pu accéder aux différentes manifestations. Au départ, il y a bien eu des problèmes dus au niveau des prix. Mais le comité organisateur a rapidement opéré des réductions de tarifs. Lors de la cérémonie d’ouverture, à laquelle j’ai assisté, le stade était plein, et au trois-quarts de Brésiliens. Mais je reconnais que c’est un cas particulier.
M. le président François Rochebloine. Tout le monde convient de la réussite des jeux de Bakou. Le secrétaire d’État aux sports nous l’a d’ailleurs confirmé. Mais nous aimerions, au sein de notre mission, connaître les niveaux de participation étrangère et locale.
M. Philippe Vinogradoff. Très sincèrement, je n’ai pas d’éléments de réponse. Comme vous le savez, au moment des jeux en Azerbaïdjan, j’étais très loin de là, au Salvador.
M. le président François Rochebloine. Monsieur l’ambassadeur, je vous remercie pour la clarté de vos réponses.
Bon courage et bonne chance pour la préparation des grands événements sportifs, que nous souhaitons très nombreux en France. Bien sûr, je pense tout particulièrement à Paris 2024.
*
* *
Ÿ Audition de M. Michel Forst, rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de l’Homme (jeudi 8 décembre 2016)
M. le président François Rochebloine. Je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser notre rapporteur, M. Jean-Louis Destans, qui a été retenu ce matin pour des raisons personnelles.
Nous avons le plaisir d’accueillir M. Michel Forst, rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de l’Homme. Son audition s’inscrit dans la série d’entretiens dont, en accord avec notre rapporteur, j’ai souhaité la tenue pour nous permettre d’évaluer la situation effective en matière de droits de l’Homme et de libertés fondamentales en Azerbaïdjan. Je suis en effet convaincu que le respect de ces droits et de ces libertés, fondement d’une société démocratique et condition objective nécessaire du développement convenable d’une nation, détermine la qualité des échanges politiques, économiques et culturels que ce pays peut souhaiter avoir avec d’autres États.
Vous avez été, monsieur Forst, directeur général d’Amnesty International pendant dix ans, et pendant plus de onze ans secrétaire général de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme. Au sortir de cette fonction, vous avez été nommé par le président du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies – peut-être nous direz-vous selon quelle procédure – rapporteur spécial chargé d’évaluer la situation des défenseurs des droits de l’Homme, avec une mission récente en Azerbaïdjan.
Votre déclaration de fin de mission, le 22 septembre 2016, brosse un tableau qui ne laisse guère place à l’optimisme, du moins à court terme. Je n’en développerai pas les conclusions : vous êtes le mieux placé pour le faire, et c’est ce que la mission attend de vous. Vous indiquez dans cette déclaration que vous présenterez votre rapport final en mars 2017. Je suppose que vos conclusions provisoires ont déjà suscité des réactions en Azerbaïdjan ; il nous intéresserait de les connaître, qu’elles émanent du gouvernement, du monde politique ou de la société civile. Il m’a été rapporté que, par la voix de M. Ali Hasanov, conseiller spécial du président Ilham Aliev, les autorités de Bakou avaient mis en cause le caractère unilatéral de votre information et mis votre impartialité en doute en raison de vos engagements antérieurs dans des organisations militantes de défense des droits de l’Homme. Vous avez toute latitude pour faire à ce sujet la mise au point qui vous paraîtra opportune.
M. Michel Forst, rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de l’Homme. Je vous remercie de votre invitation, qui me donnera l’occasion de préciser les contours de ma mission et de corriger certains propos de la presse azerbaïdjanaise mais aussi du gouvernement, qui a réagi immédiatement à mes conclusions provisoires. J’ai été nommé en juin 2014 dans ma présente fonction, dont l’intitulé dit quel est mon rôle : observer la situation des défenseurs des droits de l’Homme dans le monde. Aux termes de la déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme adoptée par l’Assemblée générale en 1998 à l’occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, l’expression « défenseur des droits de l’Homme » désigne toute personne qui, individuellement ou en association avec d’autres, œuvre à la promotion ou à la protection des droits de l’Homme. Le spectre est donc assez large puisqu’il peut s’agir de membres d’organisations non gouvernementales (ONG), de syndicalistes, de journalistes, de blogueurs, de lanceurs d’alerte, de fonctionnaires refusant d’obéir à un ordre injuste… J’ai pour mission de protéger ceux qui, en leur qualité de défenseurs des droits de l’Homme, jouent le rôle positif d’agents de changement.
Nous sommes, au sein de l’Organisation des Nations unies (ONU) un groupe de rapporteurs spéciaux. Certains sont chargés spécifiquement d’un pays donné – j’ai ainsi été pendant quelques années l’expert indépendant des Nations unies sur la situation des droits de l’Homme en Haïti. D’autres, comme c’est mon cas en ce moment, ont mandat pour intervenir dans un domaine particulier : le droit à un logement convenable, le droit à l’éducation, le droit à l’eau potable et à l’assainissement, l’extrême pauvreté … Mon mandat, transversal, est de trois ans, renouvelable une fois ; il sera sans doute renouvelé en mars prochain.
J’agis par le biais d’enquêtes et d’investigations, que je mène après avoir été invité par les États considérés. J’ai ainsi été invité par le gouvernement d’Azerbaïdjan pour conduire cette mission. Je n’agis pas en secret : j’ai été reçu officiellement par le gouvernement et j’ai eu une série d’entretiens dont je vous rendrai compte.
Je suis aussi le destinataire de nombreuses « communications », c’est-à-dire de plaintes de femmes, d’hommes et parfois d’enfants qui sont menacés pour avoir simplement tenté de protéger les droits de l’Homme dans leur pays. J’adresse alors aux États concernés une « lettre d’allégation » ; ils doivent répondre dans les soixante jours aux questions que je leur pose. Mes questions et les réponses faites par les États sont ensuite publiées dans un « rapport sur les communications » qui répertorie les – nombreuses – communications adressées aux États chaque année.
Évidemment, je fais parfois aussi des visites non officielles, à des universités par exemple, ou aux représentations diplomatiques qui m’invitent. Ainsi, je me suis rendu il y a quelques mois à Moscou, à l’invitation de l’ambassadeur de France, qui avait organisé, dans l’enceinte de l’ambassade, une rencontre avec une centaine de défenseurs russes des droits de l’Homme. Bien que cette initiative ait fortement déplu au gouvernement russe, celui-ci m’a accordé un visa car il considère indispensable la coopération avec les rapporteurs spéciaux.
M. le président François Rochebloine. De manière générale, éprouvez-vous des difficultés pour obtenir des visas ?
M. Michel Forst. Pas véritablement. Mais il m’arrive de renoncer à me rendre dans un pays quand j’ai le sentiment que c’est trop compliqué ou qu’il serait trop risqué pour les personnes avec qui je voudrais m’entretenir, de me rencontrer. J’ai ainsi refusé d’aller au Nicaragua au mois d’août dernier après que l’ambassadeur de l’Union européenne me l’a déconseillé, m’indiquant que plusieurs députés et diplomates européens, bien qu’ayant été invités par leurs homologues nicaraguayens, avaient été refoulés à leur arrivée.
Même quand je ne suis pas invité officiellement par un État, j’essaye de rendre visite aux défenseurs des droits de l’Homme menacés ; je suis allé pour cette raison dans une vingtaine de pays cette année, le plus récemment au Venezuela, au Guatemala, au Honduras et en Géorgie.
Si j’ai demandé à être invité en Azerbaïdjan – car il faut demander à être invité –, c’est que j’ai été alerté par des messages de défenseurs locaux des droits de l’Homme, de journalistes, de blogueurs, de lanceurs d’alerte… me signalant que la situation devenait inquiétante et qu’il serait temps de conduire une mission d’enquête et de faire rapport devant le Conseil des droits de l’Homme. J’ai donc adressé un courrier au gouvernement d’Azerbaïdjan qui a immédiatement répondu favorablement, disant sa volonté de collaborer avec les Nations unies et m’invitant à visiter le pays pendant une quinzaine de jours, ce que j’ai fait en septembre dernier.
Toute mission de ce type commence par une rencontre avec le ministre des affaires étrangères, au cours de laquelle sont définis le cadre des travaux, les personnes qui seront rencontrées et les thèmes qui seront abordés, étant précisé que cet emploi du temps officiel sera complété par des rencontres avec de très nombreuses personnes qui demandent à vous parler. Après avoir été reçu par le ministre des affaires étrangères, je me suis ainsi entretenu, en Azerbaïdjan, avec le ministre de l’intérieur, le président de la Cour suprême, le procureur général, des magistrats, d’autres représentants de l’État, des avocats, et aussi avec le Conseil pour la coopération avec les ONG. Cet organisme, créé et contrôlé par l’État, est chargé de recevoir les demandes des organisations de la société civile et d’y répondre ou de les refuser. Ce Conseil reçoit de l’Union européenne et de bailleurs internationaux des fonds destinés à la société civile ; mais comme c’est une instance gouvernementale exclusivement composée de proches du pouvoir, elle redistribue l’argent dont elle a été destinataire aux seules ONG également proches du gouvernement. Celui-ci créé d’ailleurs des organisations non-gouvernementales organisées par le gouvernement – les GONGO – auxquelles il verse les fonds reçus de la communauté internationale, les autres ONG, en particulier les plus efficaces et les plus critiques, en étant privées. Il en résulte qu’un grand nombre d’ONG nationales et internationales sont contraintes de mettre fin à leurs activités en Azerbaïdjan.
La situation générale, extrêmement tendue, est décrite par tous nos partenaires comme étant de plus en plus difficile pour tous les acteurs de la société civile. La récente révision constitutionnelle a accru les pouvoirs présidentiels et créé une sorte de dynastie au sein de laquelle le pouvoir se transmet de manière non-démocratique à des personnes choisies par le régime. Le Parlement est totalement contrôlé, la presse est muselée, l’accréditation des organes de presse refusée, les chaînes de télévision privées ferment et leurs directeurs sont traduits en justice pour des motifs fallacieux. La justice est utilisée à grande échelle pour museler l’opinion. Journalistes, blogueurs, lanceurs d’alerte et ceux qui utilisent leurs comptes sur les réseaux sociaux pour exprimer des opinions critiques voient leurs communications surveillées et filtrées et, sur la base d’interceptions de ces communications privées, ils sont traduits en justice, accusés des pires méfaits : « hooliganisme », bien que l’incrimination n’existe pas dans le code pénal azerbaïdjanais, incitation à la haine raciale, incitation à renverser l’État… En Azerbaïdjan, tout prétexte vaut pour museler la presse et les voix critiques.
Comme dans beaucoup de pays, la justice, loin d’être indépendante de l’exécutif, lui est étroitement liée. Les nominations de magistrats sont faites sur un mode discrétionnaire ; il m’a été dit, mais je ne l’ai pas vérifié, que certains juges sont nommés sans qu’ils aient de compétences en droit mais pour la seule raison de leur proximité politique avec le pouvoir. Autant dire que, souvent, les Azerbaïdjanais qui vont devant la justice pour chercher réparation de torts subis ne l’obtiennent pas ; l’impunité est à peu près généralisée.
Ma description de la situation des droits de l’Homme en Azerbaïdjan peut vous sembler sévère, mais je ne doute pas que vous l’avez déjà entendue. Ce qui me frappe, c’est que la Commission de Venise, le Conseil de l’Europe en général et plusieurs organes de l’ONU – le Conseil des droits de l’Homme avec l’Examen périodique universel, le Comité contre la torture, le Comité des droits de l’Homme, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, d’autres encore – font tous le même diagnostic et formulent les mêmes recommandations, mais le gouvernement azerbaïdjanais refuse d’admettre la réalité. On a le sentiment d’avoir affaire à un patient auquel dix médecins disent successivement qu’il est affligé d’un mal grave et qui, refusant de l’entendre, persiste à écarter le traitement préconisé.
Je juge donc la situation en Azerbaïdjan assez grave et inquiétante. Je reçois toujours plus de communications de personnes menacées qui cherchent une protection. Celle-ci est exercée par la communauté internationale. Heureusement, la délégation de l’Union européenne et quelques ambassades, dont les ambassades de France et d’Allemagne, ont une action positive et reçoivent les doléances de défenseurs des droits de l’Homme. Nous parvenons parfois à les protéger en les faisant sortir officiellement du pays, mais nous avons du mal à trouver un pays d’accueil. Le gouvernement azerbaïdjanais a relâché certaines personnalités parmi les plus connues, telle Mme Leyla Yunus, mais la répression ne cesse de se durcir pour ceux dont les réseaux internationaux sont inexistants.
Lors de mon séjour en Azerbaïdjan, j’ai rendu visite à plusieurs personnes incarcérées. Une liste de noms figure dans mon premier rapport : vous pouvez l’utiliser, elle est publique. J’ai également rencontré M. Ilgar Mammadov, dont vous connaissez le dossier. J’ai rencontré longuement cet homme courageux dans l’établissement pénitentiaire où il est emprisonné. Il vit durement la très grande injustice qui lui est faite – vous savez les raisons de sa condamnation. J’ai été très inquiet de voir à quel point cet homme solide, qui ne se décrit pas comme un militant des droits de l’Homme mais comme un militant politique déterminé, privé de lectures et d’accès à Internet comme il l’est, perd ses repères et s’affaiblit peu à peu.
Les magistrats et les procureurs qui veulent réagir sont immédiatement sanctionnés par leur hiérarchie, mutés dans des provinces reculées et parfois privés de leur emploi tout en continuant de recevoir leur traitement.
Le durcissement, par modifications successives, du cadre juridique régissant le fonctionnement des ONG locales et étrangères est tout aussi inquiétant. Elles sont désormais tenues de s’enregistrer selon une procédure si complexe qu’elles doivent recourir aux services d’avocats, ce qui leur coûte très cher. En particulier, elles sont obligées de citer dans leurs statuts l’intégralité des dispositions légales s’appliquant aux ONG ; cette rédaction, outre qu’elle est coûteuse, est très longue, ce qui les empêche d’exercer les missions pour lesquelles elles souhaitent se constituer en association. Les financements internationaux se font de plus en plus rares parce que les bailleurs de fonds doivent être agréés par le ministère de la justice et par le ministère des taxes, et parce que le demandeur doit être autorisé à percevoir cet argent. Ces exigences multiples rendent le processus très long, parfois impossible à mener à son terme, et décourageant pour les bailleurs de fonds.
Actuellement, sont menacés ceux qui travaillent dans le domaine des droits civils et politiques mais aussi dans les domaines des droits de l’Homme des migrants, de la protection de l’enfance et de la défense de l’environnement.
Le rôle que jouent les entreprises internationales, singulièrement pétrolières, est également inquiétant ; elles s’allient au pouvoir et aux médias pour salir la réputation des défenseurs de l’environnement et multiplient les attaques contre les militants qui refusent l’installation d’usines près de chez eux.
M. le président François Rochebloine. Quelles sont les entreprises en question ?
M. Michel Forst. Vous donner des noms aujourd’hui serait prématuré car d’ultimes vérifications sont en cours. Ils figureront probablement dans le rapport qui sera publié sur le site des Nations unies soixante-dix jours au moins avant la date de sa discussion devant le Conseil des droits de l’Homme du rapport, c’est-à-dire dans les premiers jours de janvier.
Le principe de la liberté de réunion est systématiquement violé. Les directeurs des grands hôtels étant menacés par l’État s’ils ouvrent la porte de leurs établissements à des dissidents, ils ne leur louent ni ne leur prêtent aucune salle. S’il s’en trouve une, c’est à une dizaine de kilomètres de la capitale ; cela empêche ceux qui voudraient se rendre à la réunion de le faire.
Les manifestations sont fortement réprimées. J’ai moi-même constaté, le 17 septembre dernier, la violente répression de celle qui a eu lieu à Bakou à quelques jours du référendum constituant. Ayant recueilli, à la suite de témoignages, une cinquantaine de noms de personnes arrêtées, je les ai transmis au gouvernement pour lui demander des comptes ; je n’ai obtenu aucune réponse à ce jour.
Vous m’avez interrogé sur la réaction du gouvernement azerbaïdjanais à ma mission. La règle veut que, le dernier jour de chacune de mes visites officielles, je sois reçu par le gouvernement, qui invite la plupart des acteurs que j’ai pu rencontrer. C’est ce qui a eu lieu à Bakou. Ayant lu devant une cinquantaine de personnes ma déclaration de fin de mission, synthèse de mes principales observations visant à permettre des échanges avec le gouvernement, j’ai immédiatement été attaqué par le représentant du Conseil de la présidence. Il m’a demandé pourquoi je n’avais pas fait mention d’autres éléments qu’il jugeait plus importants : les droits des personnes déplacées à l’intérieur du pays depuis que l’Arménie occupe une partie du territoire azerbaïdjanais. J’ai répondu à cette interpellation que mon mandat porte sur la protection des défenseurs des droits de l’Homme et qu’il revenait au gouvernement azerbaïdjanais d’inviter le rapporteur spécial sur les droits de l’Homme des personnes déplacées dans leur propre pays s’il le jugeait nécessaire. La situation était assez étrange : on ne parlait pas du tout de la déclaration dont je venais de donner lecture mais l’on me demandait de m’exprimer sur des éléments qui ne relèvent pas de mon mandat.
M. le président François Rochebloine. Votre interlocuteur contestait-il la teneur de vos observations ?
M. Michel Forst. Il contestait mon interprétation des faits à chaque fois que je citais un nom, et pour commencer celui d’Ilgar Mammadov, cet opposant arrêté quelques mois avant les élections présidentielles pour des motifs douteux et condamné à sept ans et demi de prison, prison où il a été sévèrement battu. Le gouvernement azerbaïdjanais, qui le considère non pas comme un défenseur des droits de l’Homme mais comme un opposant politique, l’accuse de « hooliganisme » et d’incitation à renverser le pouvoir. Pour moi, c’est un défenseur des droits de l’Homme qui cherche à faire respecter ces droits et qui a été emprisonné parce qu’il cherche à être élu, à promouvoir des élections libres et démocratiques – ce que ne sont pas les élections en Azerbaïdjan –, la liberté de réunion, inexistante en Azerbaïdjan, et la liberté d’exprimer des opinions dissidentes sans être réprimé. Pour chaque nom cité de défenseur des droits de l’Homme victime de la répression du pouvoir, il m’a été répondu que c’était celui d’un « voyou » condamné pour « hooliganisme » – sans que l’on puisse me donner la définition de ce terme dans le code pénal azerbaïdjanais puisqu’il n’y en a pas. C’était donc un dialogue de sourds.
À l’issue de chacune de mes missions, j’invite la presse nationale et internationale à entendre mon diagnostic sur le pays considéré. Beaucoup de ce que j’ai exposé a été repris dans la presse internationale mais aussi dans la presse locale et contesté de diverses manières par le gouvernement d’Azerbaïdjan. Dès mon départ, le vice-président de la République a publié un communiqué alléguant que j’aurais peut-être des origines arméniennes, ce qui expliquerait mon acharnement à l’encontre de l’Azerbaïdjan. Il a aussi été fait référence à mes activités passées dans des ONG, oubliant qu’elles sont parfaitement légitimes. J’ai également été, comme vous l’avez rappelé, secrétaire général de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme française et j’ai exercé différents mandats à l’ONU et à l’UNESCO.
Ma carrière parle pour moi : mon jugement sur ce que j’ai constaté en Azerbaïdjan n’est pas partial. Il est semblable à celui que j’ai porté sur ce que j’ai vu ailleurs. Cette année, je me suis rendu dans trois pays en mission officielle : en Hongrie en juin, en Azerbaïdjan en septembre et en Australie au mois d’octobre. À chaque fois, même en Australie, les conclusions de mes rapports ont été contestées, assez vivement. Cela ne m’émeut guère : mes collègues rapporteurs spéciaux sont, comme je le suis, toujours vilipendés par le gouvernement en place, que leurs rapports traitent de la torture, des droits de l’Homme des migrants ou de ceux des personnes déplacées dans leur propre pays.
En mars 2017, mon rapport final sera examiné par le Conseil des droits de l’Homme en présence des ambassadeurs. Ce sera l’occasion pour le gouvernement azerbaïdjanais de répondre, par écrit et oralement, aux conclusions du rapport, et pour les ambassadeurs présents à Genève de préciser leur point de vue – mais je sais que mon diagnostic est partagé par la délégation de l’Union européenne.
L’un des leviers pour agir est le pétrole, puisque c’est sur cette ressource que compte le gouvernement azerbaïdjanais. Je signale enfin que j’ai rendez-vous la semaine prochaine à Genève avec l’ambassadeur d’Azerbaïdjan qui souhaite dialoguer avec moi avant la présentation officielle de mon rapport au Conseil des droits de l’Homme.
M. le président François Rochebloine. Je vous remercie. Nous avons reçu l’ambassadeur d’Azerbaïdjan en France et entendu aussi l’ambassadrice de France en Azerbaïdjan. Cela démontre, s’il en était besoin, l’importance d’entendre différents points de vue.
Votre déclaration de fin de mission s’ouvre par des remerciements adressés au gouvernement azerbaïdjanais pour « son excellente coopération » et pour les efforts qu’il a déployés pour s’assurer que vous retiriez « le meilleur profit » de votre visite. Comment s’est manifestée cette coopération ?
M. Michel Forst. J’ai tenu à souligner ce point car sur le plan formel, la coopération a effectivement été excellente. On ne m’a refusé aucune visite, j’ai pu rencontrer toute personne que je souhaitais rencontrer et l’on m’a communiqué les documents que je demandais. Une seule difficulté est apparue, quand j’ai dit vouloir m’entretenir avec des opposants politiques emprisonnés, mais elle a été résolue après une intervention officielle de l’ONU et cela m’a été accordé. Je ne dis pas que mes entretiens en prison n’ont pas été écoutés mais j’ai eu avec de courageuses personnes incarcérées, qui m’ont dit ce qu’elles pensaient de la situation, des échanges de qualité, non limités dans le temps.
M. le président François Rochebloine. Vous faites état de pressions exercées sur des sociétés étrangères pour qu’elles ne fassent pas bénéficier d’annonces publicitaires les journaux insuffisamment favorables au Gouvernement. Comment avez-vous eu connaissance de ces agissements ? Des entreprises françaises sont-elles concernées ?
M. Michel Forst. Oui, mais je ne peux vous en donner les noms aujourd’hui car la règle veut que les vérifications nécessaires soient faites auprès des entreprises. Il se peut que je retire certains noms de la liste actuelle si ces informations contredisent ce que m’ont dit en Azerbaïdjan des journalistes et des directeurs de médias : que certains de ces organes de presse sont en perdition faute de publicité, le gouvernement faisant pression sur les annonceurs, entreprises publiques ou entreprises étrangères, pour qu’ils réduisent ou suppriment leurs investissements publicitaires dans les médias nationaux critiques à l’égard du gouvernement, les privant ainsi de ressources.
M. le président François Rochebloine. Vous indiquez que la législation a été modifiée en 2013 de manière à réduire les informations publiques sur les sociétés et, ainsi, à entraver l’action des ONG luttant contre la corruption ; quels éléments vous permettent d’aboutir à cette conclusion ? Plus généralement, estimez-vous que ceux qui dénoncent la corruption en Azerbaïdjan courent le risque d’atteintes à leurs libertés fondamentales, sous la forme de tracasseries administratives ou de poursuites pénales par exemple ?
M. Michel Forst. Après que ces informations m’ont été données par plusieurs personnes, je me suis entretenu deux fois, longuement, avec le directeur des taxes, afin qu’il m’explique la nouvelle législation et me dise comment l’on pourrait dorénavant connaître la répartition de l’actionnariat d’une société propriétaire d’un hôtel ou d’une entreprise. En pratique, il est maintenant impossible de savoir qui est au capital d’une entreprise et quelles modifications interviennent dans sa composition : ces données sont désormais couvertes par le secret des affaires et nul n’a accès au registre du commerce et des sociétés. Mon interlocuteur m’a indiqué que ces dispositions visaient à mettre fin aux « pressions » et « tentatives de chantage » dont avaient été victimes les porteurs de parts de certaines sociétés dans le passé. Telle est l’explication officielle. Certains disent que de nombreux proches du pouvoir sont directement impliqués dans des opérations frauduleuses ou des actes de corruption, mais Transparency international ne peut plus en faire mention publiquement faute d’avoir accès aux informations qui le démontreraient. Alors que le gouvernement azerbaïdjanais dit lui-même que le niveau de corruption est fort dans le pays, il cache les informations permettant de dénoncer la corruption, rendant très difficile la mise à jour des pratiques frauduleuses ou la corruption des agents de l’État.
M. le président François Rochebloine. Vous avez tiré de votre mission la conclusion provisoire suivante : « Au cours des deux ou trois dernières années, la société civile azerbaïdjanaise a fait face à la pire situation depuis l’indépendance du pays ». Pouvez-vous préciser et justifier cette affirmation ? Comment expliquez-vous cette dégradation récente ?
M. Michel Forst. Ce constat n’est pas seulement le mien ; il a aussi été fait par d’autres agents de l’ONU et dans une publication de l’UNESCO relative à la protection des sources d’information des journalistes. Depuis trois ou quatre ans ont lieu des attaques concertées successives contre la société civile, comme en témoignent le durcissement du régime d’enregistrement et d’accès aux financements pour les ONG, la création de GONGO et de sociétés de service qui remplacent les ONG, les arrestations arbitraires et l’emprisonnement d’un grand nombre de militants des droits de l’Homme. Nous avons des listes de noms des victimes de ces agissements ; elles montrent que le nombre de militants attaqués, menacés et diffamés par les médias, les parlementaires et le gouvernement va croissant. Il en résulte le phénomène bien connu, y compris en Europe centrale, du rétrécissement de l’espace accordé à la société civile.
Malheureusement en effet, alors que l’Europe est le plus grand acteur de la protection des droits de l’Homme dans le monde, des attaques comme il s’en produit en Azerbaïdjan sont de plus en plus fréquentes et violentes en Hongrie, en Pologne, en République tchèque et en Slovaquie. L’impératif de cohérence qui voudrait que l’Union européenne soit vertueuse pour donner des leçons à l’extérieur ne vaut plus, si bien que des gouvernements qui devraient s’inspirer des pratiques vertueuses européennes copient de mauvaises pratiques. Je m’en suis ouvert aux services de Mme Federica Mogherini, et une réunion aura lieu sur la protection de la société civile dans l’espace de l’Union européenne. Il est véritablement fâcheux que le gouvernement de M. Aliev puisse me dire qu’il s’est inspiré de la législation hongroise pour modifier celle de l’Azerbaïdjan. Que l’Europe donne de mauvaises leçons sur la protection de la société civile est inquiétant.
M. le président François Rochebloine. Avez-vous évoqué l’affaire Safarov ?
M. Michel Forst. Non.
M. le président François Rochebloine. Notre rapporteur, Jean-Louis Destans, empêché, m’a prié de vous poser les questions qu’il aurait souhaité vous poser lui-même. La première porte sur la coordination institutionnelle : existe-t-elle entre vous et le commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe ainsi qu’avec le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’Homme (BIDDH) de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ?
M. Michel Forst. J’ai créé une réunion « inter-mécanismes » à laquelle j’invite le commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, le directeur du BIDDH et, pour l’Afrique, ma collègue rapporteure spéciale sur les défenseurs des droits de l’Homme en Afrique, ainsi que la Commission interaméricaine. Une réunion de deux jours a eu lieu la semaine dernière à Bruxelles ; elle visait à renforcer notre coopération pour rendre notre action collective plus efficace. J’ai omis, dans mon propos liminaire, de mentionner le nombre frappant de condamnations de l’Azerbaïdjan par des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) que le gouvernement refuse d’exécuter – par exemple, une série de décisions de la CEDH concernant Ilgar Mammadov.
Je coordonne mon action avec le commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe et le BIDDH et avec l’OSCE dans son ensemble, dont la diplomatie confidentielle est parfois assez efficace. Le commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe est plus véhément ; nous avons récemment publié deux communiqués assez forts : lors des Jeux de Bakou et lors de l’arrestation de défenseurs des droits de l’Homme en Azerbaïdjan.
M. le président François Rochebloine. Les Jeux de Bakou ont été un succès et les stades étaient pleins. Dans quelle proportion les Azerbaïdjanais ont-ils participé aux compétitions ?
M. Michel Forst. Je n’ai pas suivi les Jeux de près. Ils ont été l’occasion de transformer la ville de Bakou, qui a maintenant un nouveau visage. Des investisseurs privés inconnus étaient à la manœuvre, et si la vitrine est très belle, il est frappant de constater que ces immeubles à la façade haussmannienne sont à l’évidence inoccupés.
M. le président François Rochebloine. Autre question de notre rapporteur : quelles sont les possibilités d’action des défenseurs des droits de l’Homme en Azerbaïdjan ?
M. Michel Forst. Elles sont très limitées. J’ai proposé au gouvernement d’Azerbaïdjan de revenir dans quelques mois faire une contre-expertise, une mission de bons offices pour contribuer à la révision de la législation régissant les ONG, la liberté de la presse, les lanceurs d’alerte, les blogueurs… Mais cette proposition visant à améliorer la situation connaît pour l’instant une fin de non-recevoir. Lors de mon rendez-vous, la semaine prochaine, avec l’ambassadeur d’Azerbaïdjan, j’espère le convaincre d’envisager cette visite.
Des pressions efficaces sont néanmoins possibles. L’Azerbaïdjan vit essentiellement de ses revenus pétroliers ; la baisse du prix du pétrole et le fait que le pays soit désormais banni de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives obligent l’Azerbaïdjan à donner des gages de bonne conduite. Je pense que les pressions qui seront exercées par la communauté internationale auront un résultat. Je compte aussi, pour partie, sur les entreprises internationales, qui ont un rôle à jouer pour améliorer la situation des défenseurs de droits de l’Homme. Le fait que des noms de victimes de l’arbitraire soient cités lors de la réunion de mars du Conseil des droits de l’Homme et que les ambassadeurs fassent des recommandations positives pourrait amener les autorités azerbaïdjanaises à reconsidérer sinon toutes leurs pratiques, du moins certaines de celles qui sont néfastes pour les défenseurs de droits de l’Homme.
M. le président François Rochebloine. Le Quai d’Orsay est-il tenu informé de votre action ?
M. Michel Forst. Oui. Même si mes équipes, aux Nations unies, me donnent d’excellentes informations, je peux ainsi affiner mon approche de la situation.
M. le président François Rochebloine. Quelles ONG, aimerait savoir notre rapporteur, sont encore présentes en Azerbaïdjan ?
M. Michel Forst. L’agrément a été refusé à de nombreuses ONG internationales, Amnesty International comprise, si bien que sa section locale ne peut poursuivre ses activités en Azerbaïdjan. La section azerbaïdjanaise de Transparency International survit, et j’ai été heureux de rencontrer l’un de ses membres à la XVIIe conférence internationale de lutte contre la corruption qui vient de se tenir à Panama. La grande ONG américaine Freedom House, financée par USAID, considère que la loi relative aux ONG ne s’applique pas aux agences de développement et de coopération ; elle ne la respecte pas et ne fait pas enregistrer les financements qu’elle apporte aux ONG azerbaïdjanaises. L’Union européenne étant sur la même ligne, cette résistance pourrait contribuer à desserrer l’étreinte qui se referme sur la société civile.
M. le président François Rochebloine. M. Jean-Louis Destans aimerait aussi savoir quelles réformes clefs vous préconisez en matière de justice et de libertés publiques.
M. Michel Forst. Les recommandations figurant dans le rapport répondent à cette question. Il faut reprendre avec le pouvoir azerbaïdjanais une coopération juridique technique permettant de redresser l’État de droit en assurant la séparation des pouvoirs, en réformant la justice et en révisant le code pénal et le code de procédure pénale pour supprimer de la législation toutes les mesures contraires au droit international – et elles sont nombreuses. Reportez-vous au rapport de la Commission de Venise ; il est accablant.
M. le président François Rochebloine. Étant membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, je ne le sais que trop.
M. Jean-François Mancel. Vous êtes, monsieur Forst, un homme très respectable, mais vous êtes le défenseur des droits contre les pouvoirs – contre tous les pouvoirs, vous l’avez dit, et donc pas uniquement contre le pouvoir azerbaïdjanais. Vous avez d’ailleurs cité bon nombre de pays européens qui ne montrent pas l’exemple. Certes, l’Azerbaïdjan n’est pas une démocratie à la française, mais pour ma part, je ne me sens pas capable de donner des leçons de démocratie à l’étranger car je ne suis pas convaincu d’être porteur de suffisamment d’impartialité et de démocratie en France pour cela.
L’Azerbaïdjan n’est indépendant que depuis vingt-cinq ans. Il a, auparavant, subi soixante-dix années de soviétisme pendant lesquelles des habitudes et des traditions ont été prises qui se sont maintenues. Certains comportements culturels et populaires sont la trace de cet asservissement, qu’à l’époque on dénonçait bien peu. De plus, il s’agit d’un pays en guerre, dont 20 % du territoire est occupé ; je gage d’ailleurs que si vous meniez une mission en Arménie, vous y constateriez les mêmes problèmes, dus aux contraintes d’un pays en guerre. Enfin, l’Azerbaïdjan est un pays laïc où vivent de nombreux musulmans et dont les voisins, à commencer par l’Iran, peuvent inquiéter. Pour ces différentes raisons, ne pouvez-vous sinon approuver, du moins comprendre que l’Azerbaïdjan soit conduit à avoir, en matière de respect des droits de l’Homme, une attitude moins ouverte qu’un pays qui n’est confronté à aucune menace ? J’ai rappelé à la représentante d’Amnesty International, quand nous l’avons reçue, que l’ONG au nom de laquelle elle s’exprimait avait jugé liberticide la loi française relative à l’état d’urgence. On peut en débattre, mais cela tient à un contexte général et à des contraintes internes et externes qui s’imposent à nous et font évoluer notre législation.
Vous avez indiqué, et je vous félicite pour votre honnêteté, que vous ne donneriez aucune information qui n’aurait pas été vérifiée. Or, vous avez évoqué ce qui se dit des conséquences de la révision constitutionnelle en Azerbaïdjan ; pour éviter des interprétations hasardeuses, il serait bon de les préciser. Sachant que la porte-parole d’Amnesty International a fait une évaluation erronée de moitié de la participation au référendum en Azerbaïdjan, il faut se méfier des assertions non argumentées. Évoquant les vingt-neuf amendements à la Constitution azerbaïdjanaise qui, selon elle, iraient dans le mauvais sens, elle a cité la disposition portant de cinq à sept ans la durée du mandat présidentiel. Mais la France a vécu dans ce cadre pendant des décennies sans que personne, sinon peut-être Gaston Monnerville en 1958, n’ait jamais considéré cela comme une violation des droits de l’Homme ! Quels sont les exemples concrets d’atteintes aux droits de l’Homme induites par la révision constitutionnelle en Azerbaïdjan ? Pour ma part, je n’en vois aucun.
Vous indiquez avoir été très bien accueilli, mais qu’ensuite deux approches des droits de l’Homme sont entrées en conflit, celle du pouvoir et la vôtre. Vous avez fait valoir que la question des réfugiés et des personnes déplacées en Azerbaïdjan ne vous concernait pas, et vous avez cité le cas de quelques dizaines d’individus. Mais il faut aussi se mettre à la place du gouvernement d’Azerbaïdjan, qui constate qu’on vient lui tirer les oreilles à propos d’une cinquantaine de personnes que l’on considère comme étant victimes d’un traitement injuste alors qu’il prend en charge – très efficacement, nous a dit M. Pierre Andrieu, ancien co-président français du groupe de Minsk – 200 000 personnes déplacées et 700 000 réfugiés dont le territoire est occupé par un pays étranger. Qui est là pour faire respecter les droits de ces 900 000 personnes ?
M. Michel Forst. Le texte publié en ligne sur le site de l’ONU est ma déclaration de fin de mission, un document succinct qui ne peut faire état de toutes les informations que j’ai reçues. Depuis septembre, mon équipe, à Genève, vérifie les sources et attend des confirmations de manière que le rapport final soit complet. Au début de ma déclaration, loin de les nier, je mentionne expressément les difficultés auxquelles le gouvernement azerbaïdjanais est confronté depuis de nombreuses années en raison de problèmes diplomatiques compliqués et des personnes déplacées à l’intérieur du pays. Cela étant, certains pays voisins de l’Azerbaïdjan qui ont connu, eux aussi, le joug communiste s’en sont sortis sans adopter l’attitude répressive, ancienne, des autorités azerbaïdjanaises.
On ne peut comparer la situation de la cinquantaine de cas dont j’aurais pu faire état devant vous et celle de 700 000 personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays car elles ne sont pas comparables. La communauté internationale, par le biais de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), s’est fortement engagée en faveur de ces personnes déplacées ; le fardeau ne repose pas sur le seul gouvernement azerbaïdjanais. En revanche, les quelques cas que j’ai cités sont emblématiques d’un système et de graves violations des droits de l’Homme. Imaginez qu’en France, au moment des élections présidentielles, le Président de la République décide de faire emprisonner son principal opposant et, en l’accusant d’être un dangereux hooligan, le fasse condamner à sept ans et demi de prison, si bien qu’il ne pourra plus se présenter aux élections !
M. Jean-François Mancel. On en a fait écouter un…
M. Michel Forst. Sans doute, mais on n’a pas donné l’ordre à la justice de le mettre en prison !
M. le président François Rochebloine. Et aurait-ce été le cas que nous eussions été les premiers à réagir !
M. Michel Forst. On n’imagine même pas que la justice puisse, en France, répondre à une injonction du président de la République et condamner son principal opposant à sept ans et demi de prison ! La situation faite à M. Ilgar Mammadov montre l’état de déliquescence du pouvoir.
Pour ce qui est de l’effet de la révision constitutionnelle, je ne peux vous dire aujourd’hui quels éléments me semblent le plus inquiétants ; ces précisions figureront dans le rapport final, mais je ne m’attacherai pas tant à cette réforme qu’aux événements qui l’ont accompagnée. Je décrirai par exemple que, le 17 septembre dernier, à la veille du référendum, des personnes voulant manifester ont été arrêtées, embastillées et condamnées à des peines de prison. Je dirai qu’avant même la manifestation, des policiers et des membres des services de sécurité se sont livrés à de l’intimidation en allant chez des gens pour les dissuader de venir manifester. Je me suis entretenu avec le directeur général des services de sécurité – et je salue une nouvelle fois l’ouverture du gouvernement d’Azerbaïdjan – à qui j’ai donné la liste des noms des personnes victimes d’intimidation ou arrêtées. Il a téléphoné devant moi en demandant que l’on enquête ; j’attends toujours sa réponse. Un ensemble d’éléments me laisse à penser que la situation est fortement détériorée sur le plan des libertés fondamentales en Azerbaïdjan.
M. Jean-François Mancel. Mais le droit de manifester existe.
M. Michel Forst. C’est un droit théorique.
M. Jean-François Mancel. En France aussi, on a connu des interdictions de manifester, des arrestations pendant les manifestations et des condamnations ensuite. Ce que vous relatez, c’est l’anticipation de certains comportements par des interdictions de manifester. Cela s’est pratiqué dans notre pays aussi, plusieurs fois, récemment, et cela a été contesté. Cela relativise donc les choses sur ce point.
Par ailleurs, comment peut réagir un État qui attend depuis 1993 l’application de quatre résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies dénonçant l’occupation de 20 % de son territoire et condamnant l’occupant à le quitter, et qui constate que le droit international ne s’applique pas à son profit ? Il peut juger injuste que l’on vienne lui chercher des noises à propos de certains cas individuels alors qu’un cinquième de son territoire est occupé en violation flagrante du droit international.
M. Michel Forst. Nous sommes dans deux registres différents. Combien de résolutions du Conseil de sécurité ne sont pas appliquées dans le monde, avec des situations parfois plus graves – je pense notamment à Israël ? Il s’agit ici d’un droit national en totale contradiction avec les engagements souscrits par un État partie à toutes les conventions internationales et aux deux pactes relatifs à la protection des droits de l’Homme. Les rapports des organes chargés d’observer la manière dont l’Azerbaïdjan respecte ses obligations soulignent unanimement que ce pays viole tous les traités internationaux relatifs aux droits de l’Homme sur son territoire. Cet élément grave dit la situation inquiétante dans laquelle vit le pays actuellement.
M. le président François Rochebloine. Nous avons, en France, la chance de pouvoir manifester librement, chacun doit en convenir.
Je vous remercie, monsieur le rapporteur spécial, pour votre franchise, votre objectivité et la parfaite clarté de vos propos. Votre rapport nous sera d’une grande utilité.
*
* *
Ÿ Audition de M. Denis Masseglia, président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) (jeudi 8 décembre 2016)
M. le président François Rochebloine. Mes chers collègues, je suis heureux d’accueillir en votre nom M. Denis Masseglia, président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF).
Son audition va conclure une série commencée avec celle du secrétaire d’État chargé des sports, M. Thierry Braillard, et qui s’est poursuivie, cette semaine, avec les deux titulaires successifs du poste d’ambassadeur pour le sport, MM. Lévy et Vinogradoff.
Par ailleurs, je dois vous prier de bien vouloir excuser l’absence de notre rapporteur, Jean-Louis Destans, retenu par d’autres obligations.
Je rappelle, à l’intention de M. Masseglia, que notre mission a pour objet d’examiner les relations politiques et économiques entre la France et l’Azerbaïdjan au regard des objectifs français de développement de la paix et de la démocratie au Sud Caucase.
Le sport a toute sa place dans l’analyse de ces relations. En effet, comme Valérie Fourneyron et moi-même l’écrivions en juin dernier – preuve que l’on peut travailler en bonne intelligence tout en ayant des sensibilités politiques différentes – dans notre rapport sur la diplomatie sportive, pour lequel nous avons eu le plaisir de vous entendre, il est « un outil national de rayonnement international, de développement économique et un vecteur de croissance. » L’Azerbaïdjan l’a parfaitement compris, comme en témoignent les efforts qu’il a consentis pour l’organisation des Jeux européens qui se sont tenus à Bakou en juin 2015.
Nous nous posons de nombreuses questions sur l’organisation de ces Jeux. M. Thierry Braillard, auquel nous nous sommes tout d’abord adressés, nous a renvoyés pour l’essentiel aux informations que, nous a-t-il assuré, vous étiez le plus à même de nous donner.
Nous aimerions obtenir tout d’abord des précisions sur la procédure qui a conduit à la décision d’organiser à Bakou les Jeux européens. Cette question est d’autant plus importante que, d’après Thierry Braillard, il n’y aurait plus de candidat aujourd’hui pour de prochains Jeux européens, alors que la première édition a été parfaitement réussie sur le plan sportif.
Qui a pris l’initiative de créer cette compétition et quels motifs ont été invoqués ? Selon quelle procédure et à l’initiative de qui la ville de Bakou a-t-elle été désignée pour l’accueillir ? Des représentants français, éventuellement politiques ou parlementaires, sont-ils intervenus ? Quelle part a prise le CNOSF à la décision de tenir ces Jeux en Azerbaïdjan ?
Il serait intéressant, étant donné votre honnêteté reconnue par l’ensemble du mouvement sportif, de recueillir de votre part des informations sur le déroulement même de la compétition. Pour commencer, quelles ont été les modalités de financement de ces Jeux et quand la question a-t-elle été abordée, par qui et dans quelles conditions ? Quelle est votre évaluation de l’organisation ? A-t-elle fait l’objet de discussions, soit au sein du CNOSF, soit dans les instances olympiques européenne et internationale ?
Tout au long du déroulement des Jeux, les stades ont été remplis, ce dont je ne peux que me réjouir car, s’agissant d’une compétition sportive de cette envergure, et quel que soit le lieu, il est toujours souhaitable que le public soit le plus nombreux possible. Lors des Jeux olympiques de Rio, il avait été constaté que certaines disciplines rencontraient un moindre succès, ce qui n’a heureusement pas été le cas en Azerbaïdjan. Toutefois, le public de certains pays semble avoir été peu présent : à quel pourcentage estimeriez-vous la présence d’Azerbaïdjanais dans les tribunes du public ? Et quelle était, selon vous, la représentativité des ressortissants étrangers venus assister à ces premiers Jeux européens, dont je répète qu’ils ont été une réussite reconnue ?
Par ailleurs, il est venu à ma connaissance que ces Jeux ont vu pour la première fois le pays organisateur financer tel ou tel pays afin qu’il vienne participer à la compétition. Cela peut se justifier pour des pays aux ressources modestes, mais vous avez confirmé que le CNOSF et la délégation française avaient été invités et défrayés pour participer à ces Jeux européens. Ce précédent me paraît assez choquant. On m’a dit que la venue de toutes les délégations invitées avait été financée par l’Azerbaïdjan, ce que l’Arménie aurait refusé tout en participant à la compétition ; je vérifierai cette information, car d’autres m’ont dit le contraire. Quel que soit le pays organisateur, trouvez-vous cette pratique normale, s’agissant d’une manifestation qui constitue, en quelque sorte, de « mini-Jeux olympiques » ?
Je tiens enfin à rendre hommage au travail que vous accomplissez à la tête du CNOSF depuis bientôt huit ans, soit deux olympiades, ainsi qu’au soutien actif que vous apportez à la candidature de Paris pour l’organisation des Jeux olympiques de 2024, même si rien n’est gagné d’avance. Car, dans le sport comme ailleurs, les problèmes de dopage et de corruption sont considérables.
M. Denis Masseglia, président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Vous me posez la question de savoir comment s’est opérée la désignation de Bakou pour ces premiers Jeux européens…
M. le président François Rochebloine. La France a-t-elle joué un rôle ?
M. Denis Masseglia. Avant de procéder à la désignation de Bakou comme ville organisatrice, il a fallu trouver un accord sur le principe même de ces Jeux européens.
M. le président François Rochebloine. Qui a souhaité leur création ?
M. Denis Masseglia. Au début de mon mandat, en 2009, la procédure de concertation a été initiée sous la seule impulsion des Comités olympiques européens (COE). Un groupe de travail a été constitué à cet effet par leur président, Patrick Hickey — qui a défrayé la chronique au sujet d’un trafic de billets lors des Jeux olympiques de Rio —, groupe dont la présidence a été confiée à Zlatko Mateša, le président du comité olympique croate.
La France a été sollicitée pour faire partie de ce groupe de travail ; avec Jean-Pierre Mougin, secrétaire général du CNOSF, nous nous sommes partagé la présence aux réunions, de sorte que notre pays a été représenté à chacune d’elles, qui se sont tenues à Rome, siège des COE. Une majorité assez nette s’est dégagée, motivée par le fait qu’il existait déjà des Jeux asiatiques, des Jeux panaméricains, des Jeux océaniens, des Jeux africains, mais pas de Jeux européens.
M. le président François Rochebloine. Combien y a-t-il de pays participants aux COE ?
M. Denis Masseglia. Cinquante pays sont affiliés, mais cela ne recoupe pas tout à fait la géographie politique, puisque l’Europe au sens des COE s’étend jusqu’à Vladivostok, que des pays d’Asie centrale en sont membres, ainsi qu’Israël…
M. le président François Rochebloine. Le Kazakhstan est-il affilié ?
M. Denis Masseglia. Non. L’Arménie, si, bien sûr, de même que l’Azerbaïdjan…
M. le président François Rochebloine. Qui a décidé du nombre de disciplines sportives représentées ?
M. Denis Masseglia. Une fois la décision d’organiser des Jeux européens entérinée par la commission, il a bien fallu que des candidats se déclarent pour concrétiser le projet. Une assemblée générale s’est tenue à Rome au mois de novembre 2012 et, comme vous le savez, dès lors que tous les membres sont présents, des décisions peuvent être prises qui ne sont pas nécessairement conformes aux usages. Normalement, l’assemblée générale aurait dû se prononcer sur le principe de l’organisation des Jeux, et une période de quatre ans aurait alors été ouverte pour les déclarations de candidature à l’organisation de l’événement.
Le bureau des COE a cependant proposé que la procédure soit accélérée et que les votes successifs interviennent sur l’organisation des Jeux, puis sur la candidature de Bakou.
M. le président François Rochebloine. N’y avait-il pas d’autres candidats ?
M. Denis Masseglia. Non. Bakou, comme Doha, avait posé sa candidature à l’organisation de Jeux olympiques de 2020, et c’est en 2013, soit sept ans avant l’événement, que le Comité international olympique (CIO) devait se prononcer – de même que c’est en 2017, à Lima, qu’il statuera sur les différentes candidatures, dont celle de Paris, pour les Jeux de 2024. Mais, dès mai 2012, la commission exécutive du CIO s’était réunie pour examiner la validité des différentes candidatures, afin de ne retenir, comme le prévoyait la procédure, que les villes répondant aux standards exigés, et avait écarté celles de Doha et de Bakou, pour sélectionner uniquement Madrid, Istanbul et Tokyo.
L’Azerbaïdjan se trouvait donc incité à faire la preuve de sa capacité à organiser des Jeux, alors même que les préparatifs liés à sa candidature étaient déjà très avancés. C’est ainsi que Bakou a décidé de « rebondir » en manifestant auprès du bureau des COE le souhait d’organiser des Jeux européens. Dans la mesure où un certain nombre d’équipements, dont le village olympique, avaient été réalisés, et que les plans pour le reste des installations existaient, le dossier présenté par Bakou, seule ville candidate, a recueilli 83 % des suffrages.
C’est ainsi que le principe de l’organisation des premiers Jeux européens et le choix de la ville de Bakou ont été entérinés dans un même mouvement.
Quant au panel d’épreuves sportives retenu pour ces Jeux, il n’a pas été aligné sur le programme olympique : seules seize disciplines olympiques sur vingt-six ont été retenues, mais une discussion a ensuite eu lieu entre le comité d’organisation et les fédérations européennes afin d’en ajouter éventuellement d’autres. J’ai été sollicité pour faire partie de la commission de coordination, et j’ai assisté à toutes les réunions, sauf une, organisée le jour de la célébration du centenaire du comité olympique algérien, car j’ai choisi de me rendre dans ce pays frère, dont les côtes font face aux nôtres.
Lors de la première réunion, qui a porté sur le programme, j’avais demandé pourquoi la discipline de l’aviron, dont je suis issu, était absente, car la géographie de l’Azerbaïdjan, qui compte de nombreux lacs, paraissait parfaitement propice. Il m’a été répondu qu’il était impossible de dépolluer ces lacs souillés par les remontées de pétrole, et qu’utiliser le port était compliqué. La Fédération européenne d’aviron a dépêché une mission sur place afin d’étudier les conditions de possibilité d’organisation d’épreuves, et renoncé en constatant que le bassin de 500 mètres aménagé pour le canoë-kayak n’était pas adapté à l’aviron.
L’initiative de l’organisation de ces Jeux a donc été prise par les COE. S’agissant du rôle de la France et du CNOSF, je n’ai aucune réticence à dire que je me suis prononcé en faveur de la candidature de Bakou.
M. le président François Rochebloine. C’est vous-même qui avez voté ?
M. Denis Masseglia. Oui. J’ai été favorable à l’organisation des Jeux européens comme au choix de Bakou. Je faisais partie des 83 %...
M. le président François Rochebloine. Y a-t-il eu une intervention politique de la part de la France ?
M. Denis Masseglia. À ma connaissance, ni moi-même ni mes collègues n’avons fait l’objet de pressions, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du comité. Il s’agit d’une décision interne des COE, où le CNOSF est représenté.
M. le président François Rochebloine. Que pouvez-vous nous dire au sujet du financement de cet événement ?
M. Denis Masseglia. J’ignore le coût exact de l’organisation de ces Jeux, qui a été le fait de l’Azerbaïdjan. J’ai entendu dire que la cérémonie d’ouverture, qui était du niveau d’une cérémonie olympique, aurait bénéficié d’un budget de 60 millions d’euros, mais il ne s’agit que de bruits.
M. le président François Rochebloine. Qui a concrètement pris en charge le financement de ces Jeux ? Est-ce l’Azerbaïdjan ?
M. Denis Masseglia. À ma connaissance, ce financement a été le fait de l’Azerbaïdjan, avec éventuellement le concours de sponsors privés.
M. le président François Rochebloine. Qui a défrayé les délégations ?
M. Denis Masseglia. Afin que les choses soient parfaitement claires, je répète que l’Azerbaïdjan a financé les COE ; c’est la première fois que cela se produisait. Le chiffre de 25 millions d’euros a été avancé, mais, n’étant pas membre de l’exécutif des COE – à la différence du comité international des Jeux méditerranéens (CIJM) –, je n’en ai jamais eu confirmation.
Ce financement peut être regardé comme la contrepartie de l’organisation des Jeux. Chaque délégation a en outre reçu des défraiements. Chaque athlète participant a ainsi été pris en charge à hauteur de 600 euros pour le déplacement ; quant à l’hébergement au sein du village sportif, il est gratuit, comme aux Jeux olympiques. Je rappelle que Pékin et Sydney, déjà, avaient financé les déplacements de délégations : cette pratique ne constitue donc pas une première. Lorsque des villes situées au-delà des mers veulent obtenir l’organisation des Jeux olympiques, elles promettent de prendre en charge tout ou partie des frais de déplacement, ce que Rio de Janeiro n’a pas fait, le CIO ayant souhaité limiter la surenchère.
M. le président François Rochebloine. J’ai été très surpris lorsque l’on m’a indiqué que ces Jeux européens n’avaient rien coûté aux délégations puisque l’ensemble de leurs frais avaient été pris en charge, sauf ceux de la délégation arménienne, qui aurait refusé – encore que, comme je l’ai dit, quelqu’un m’ait affirmé le contraire.
M. Denis Masseglia. Je ne peux pas répondre au sujet de l’Arménie, je ne peux témoigner que pour le CNOSF.
M. le président François Rochebloine. Ces Jeux n’ont donc rien coûté à la délégation française ?
M. Denis Masseglia. La prise en charge du transport s’élevait à 600 euros. Le coût du billet d’avion étant de 650 euros environ, on peut considérer que ces Jeux n’ont pratiquement rien coûté à la délégation française.
Par ailleurs, il existait un système de prime à la performance. Ainsi, chaque comité national olympique dont un athlète remportait une médaille d’or recevait une certaine somme. Pour douze médailles d’or, le CNOSF a reçu environ 100 000 euros, qu’il a entièrement reversés aux fédérations récompensées à Bakou. Le CNOSF est en effet en relation non avec les athlètes, mais avec les fédérations, à qui il a signifié qu’elles étaient libres de disposer de ces sommes comme elles l’entendaient. Certaines ont redistribué la totalité des primes aux athlètes, d’autres – les moins riches – la moitié seulement, en considérant que la préparation avait un coût.
M. le président François Rochebloine. Cette pratique de versement de primes par les organisateurs a-t-elle des précédents ?
M. Denis Masseglia. Dans l’olympisme, non. En revanche, cela s’est déjà produit dans les championnats du monde d’athlétisme : l’Azerbaïdjan n’a pas innové dans ce domaine. Nous avons tous su que des Porsche avaient été offertes à des champions du monde d’athlétisme.
M. le président François Rochebloine. De telles pratiques seraient contraires à l’esprit de l’olympisme.
M. Denis Masseglia. En effet, il n’y a jamais eu de gratifications olympiques. Des primes sont versées aux médaillés, le cas échéant, par les pays : la France le fait, et les gratifications obtenues dans le cadre des Jeux olympiques de Rio ont été exemptées de taxes.
M. le président François Rochebloine. Il me semble que nous y sommes pour quelque chose… (Sourires.)
M. Denis Masseglia. Vous m’avez également interrogé sur la fréquentation du public. Lors des Jeux européens, les stades étaient pleins, particulièrement pour les disciplines dans lesquelles des Azerbaïdjanais pouvaient espérer remporter des médailles – ce qui s’est vérifié dans des sports de combat comme le judo, la lutte et la boxe. L’ambiance était alors digne d’un stade de football. Les tribunes étaient toutefois plus clairsemées pour les sports dans lesquels les chances de médailles étaient moindres. Les scolaires ont été incités à assister à ces Jeux, ce que nous faisons aussi en France, le but étant de conduire un maximum de jeunes à pratiquer le sport et à s’inscrire dans un club.
Je dirais qu’il y avait environ 90 % d’Azerbaïdjanais dans les gradins. Les étrangers qui sont venus étaient des gens qui avaient les moyens de faire le déplacement, ou qui étaient intéressés par le fait de voir tel ou tel athlète. Ces Jeux européens ne sont pas des Jeux olympiques : le prestige, l’intensité et la qualité de spectacle ne sont pas les mêmes. En outre, dans la mesure où il s’agissait d’une première édition, personne ne savait à quoi s’en tenir, notamment quant au niveau des épreuves et à la façon dont elles allaient se dérouler. Finalement, l’organisation s’est révélée parfaite, et les conditions d’accueil dans les stades excellentes. Et la chaîne de télévision L’Équipe 21, qui a retransmis toutes les épreuves en France, a connu une audience très satisfaisante.
M. le président François Rochebloine. Le sport, écrivions-nous en juin dernier, « contribue au bien-être et à la fraternité, bien loin de l’agressivité de la puissance dure ». La situation des droits de l’Homme en Azerbaïdjan est jugée des plus préoccupantes par l’unanimité des instances internationales ; nous l’avons encore entendu ce matin. N’y a-t-il pas contradiction entre le respect des valeurs du sport que vous portez et les pratiques politiques des autorités de Bakou ? La question des droits de l’Homme a-t-elle été évoquée à un quelconque moment dans la procédure qui a conduit à la décision de tenir à Bakou les Jeux européens ? Plus largement, est-elle évoquée dans les instances sportives internationales auxquelles, de par vos fonctions, vous participez ?
Par ailleurs, le CNOSF a-t-il joué, directement ou indirectement, un rôle dans la participation d’entreprises françaises à l’organisation des Jeux européens de Bakou ?
M. Denis Masseglia. Dans le cadre de la commission d’évaluation, je me suis rendu à six reprises en Azerbaïdjan, sans compter mon séjour pendant les Jeux européens, mais je ne connais que Bakou. Je ne peux donc témoigner de ce qu’est la vie des gens en dehors de la capitale, mais, à Bakou même, je n’ai pas trouvé que les gens soient malheureux ou aient des difficultés à vivre ensemble : j’ai trouvé au contraire que la vie dans cette ville était harmonieuse.
Comme président du CNOSF, j’ai reçu à trois ou quatre reprises l’association Human Rights Watch et ai expliqué à ses représentants notre souci, en tant qu’organisation sportive membre des COE, à savoir que, dans la mesure où tous les pays européens participaient à ces jeux, nous ne souhaitions pas nous mettre en marge d’un mouvement qui avait pris sa décision à une importante majorité : 83 % des voix pour l’organisation des Jeux européens à Bakou. J’ai moi-même voté pour.
Votre question, si je la reformule, porte sur le comportement que l’on doit avoir avec les pays dits antidémocratiques qui organisent des événements internationaux. Cela a été le cas pour Pékin en 2008. Le CIO considère, et je partage pleinement son point de vue, que l’ouverture est préférable à la fermeture. Quand les populations voient ce que les autres pays peuvent apporter, cet éclairage leur permet de demander plus de libertés individuelles.
M. le président François Rochebloine. La présence étrangère, lors d’événements comme les Jeux olympiques, est en effet une bonne chose, et j’étais contre le boycott des Jeux olympiques de Pékin. Mais les Jeux européens ont été des jeux sans public étranger, ou presque.
M. Denis Masseglia. S’il s’était agi de Jeux olympiques, il y aurait eu beaucoup de monde. Cet événement était une première et ne pouvait pas attirer un grand public international, d’abord parce que, en athlétisme et en natation, qui sont les deux sports majeurs du programme olympique, les meilleurs n’étaient pas là. En revanche, beaucoup de monde est allé voir les Jeux olympiques en Chine.
J’ai été marqué par Pékin. Tout le monde se souvient que c’est Robert Ménard qui menait la campagne des « anneaux-menottes », à laquelle participait Carole Bouquet, par ailleurs marraine du festival du film de Shanghai… Je pense que c’est outrageant pour le mouvement olympique et ceux qui le représentent, et je l’ai très mal vécu. Les sportifs ne peuvent pour porter seuls la misère du monde.
M. le président François Rochebloine. Ils peuvent tout de même appeler l’attention sur certains sujets.
M. Denis Masseglia. Pourquoi leur demanderait-t-on de faire ce que les commerciaux et le monde de la culture ne font pas ? On n’exige aucun boycott de leur part. Il aurait fallu, à ce moment, que tous les échanges avec Pékin soient interrompus.
Pour répondre à votre autre question, il n’y a pas eu d’entreprise française mentionnée comme partenaire des Jeux européens. Peut-être M. Mancel est-il mieux placé que moi pour répondre. Je l’ai rencontré au dîner de célébration avec Mme Alieva. Je considère que l’Azerbaïdjan a fait ce qu’il fallait pour que les Jeux européens soient parfaitement organisés.
M. le président François Rochebloine. Ils l’ont été. J’ai l’habitude de dire que la politique divise et que le sport rassemble. Je souhaite seulement que l’on puisse vivre en liberté dans tout pays, comme nous avons la chance de vivre en France.
Je vais vous poser également quelques questions au nom de notre rapporteur Jean-Louis Destans, qui n’a pu être présent aujourd’hui. Tout d’abord, pensez-vous que les retombées médiatiques, politiques et économiques des Jeux européens ont été à la hauteur de l’investissement réalisé par l’Azerbaïdjan ?
M. Denis Masseglia. Les retombées économiques, non, mais les retombées sociétales, oui, car ces Jeux avaient pour objectif de sensibiliser la population, qui est jeune, à l’intérêt de faire du sport, ce qui est le message de l’agenda 2020 du CIO. Ce but sociétal aurait pu être atteint à moindres frais, mais je pense que l’Azerbaïdjan a tenu à montrer une certaine puissance. Le pays organise un grand prix de Formule 1 de la même manière. Ils ont développé une stratégie de soft power, par le sport mais aussi par la culture, avec, par exemple, l’organisation du concours Eurovision de la chanson, ou encore les actions de la fondation Heydar Aliev.
M. le président François Rochebloine. Autre question de notre rapporteur : comment expliquez-vous le fait que l’Azerbaïdjan, qui fait du sport un levier central de son action extérieure, n’ait pas de représentant au sein du CIO ? Comment la composition de ce comité est-elle arrêtée ?
M. Denis Masseglia. Les membres du CIO sont d’abord les représentants du CIO dans leur pays avant d’être les représentants de leur pays au CIO. Il faut tenir compte du poids de l’histoire. Le Luxembourg, Monaco sont représentés au CIO, qui par son grand-duc, qui par son prince régnant, et il n’est pas facile de faire en sorte que des pays émergents aient une représentation.
M. le président François Rochebloine. Un pays qui a organisé avec succès les Jeux européens ne devrait-il pas avoir un représentant au CIO ? Est-ce que ce sont des critères de droits de l’Homme qui l’empêchent ?
M. Denis Masseglia. C’est absolument indépendant de la question, sinon il n’y aurait pas trois membres chinois ni, peut-être, trois membres russes. La représentation au CIO est liée au poids de l’histoire. Il existe quatre catégories de membres. Les premiers sont les membres permanents : Guy Drut est le représentant du CIO en France. Les seconds sont les représentants des fédérations internationales, au nombre de quinze. C’est pourquoi on trouve trois Suisses au CIO : Patrick Baumann représente la fédération de basket, René Fasel la fédération de hockey sur glace et Gian-Franco Kasper la fédération de ski. Ils étaient même quatre auparavant, avec Sepp Blatter. La troisième catégorie de membres, ce sont les représentants des comités nationaux olympiques : Mme Tricia Smith, par exemple, est présidente du comité national canadien. Ils sont une quinzaine. Henri Sérandour, mon prédécesseur, appartenait à cette catégorie.
Le nombre total de membres est actuellement de quatre-vingt-dix-huit, soit, au maximum, une cinquantaine de pays représentés, compte tenu de ceux qui le sont par plusieurs personnes. L’Azerbaïdjan fait partie des 75 % de pays qui n’ont pas de représentation au CIO. Cela ne lui est pas spécifique.
M. le président François Rochebloine. L’Azerbaïdjan a organisé des Jeux européens de belle facture. Comment la représentation au CIO se renouvelle-t-elle, et que devrait-il faire pour y accéder ?
M. Denis Masseglia. Pour que l’Azerbaïdjan ait un représentant, il faudrait qu’il présente une performance sportive adaptée, et je pense d’ailleurs que ses sportifs sont sur le bon chemin car ils ont été nettement plus brillants qu’auparavant à Rio et à Londres, notamment dans les sports de combat. Ensuite, il faut avoir des présidences de fédérations internationales. Le fait d’avoir organisé les Jeux européens ne suffit pas.
M. Jean-François Mancel. Merci au président Denis Masseglia, qui a été très clair, franc et passionnant.
Je reviens un instant sur les Jeux européens, dont l’organisation a obligé l’Azerbaïdjan à recruter des collaborateurs étrangers dans la mesure où le pays n’avait pas d’expérience en la matière. Ce sont environ un millier de collaborateurs étrangers qui ont ainsi été recrutés pour préparer les Jeux, et les autorités ont doublé chacun d’eux d’une ou d’un jeune Azerbaïdjanais, ce qui a permis à chacun de ces jeunes d’acquérir une formation dans ce domaine. C’est un bon exemple d’association de la population.
M. le président François Rochebloine. J’aime les Azerbaïdjanais comme tous les peuples du monde, et je souhaite que tous vivent en paix et en liberté. Comme me l’a écrit en 1989 le général Michel Aoun, aujourd’hui président du Liban, « il n’y a pas de paix sans liberté ».
*
* *
Ÿ Audition de M. Jean de Gliniasty, directeur de recherche à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) (jeudi 15 décembre 2016)
M. le président François Rochebloine. Avant toute chose, je vous prie d’excuser l’absence de notre rapporteur, Jean-Louis Destans, qui ne peut être présent.
J’ai le plaisir d’accueillir M. Jean de Gliniasty, ministre plénipotentiaire honoraire, qui a été notamment ambassadeur de France en Russie de 2009 à 2013 et qui est actuellement chercheur à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS).
Monsieur l’ambassadeur, votre histoire personnelle autant que les hautes fonctions diplomatiques que vous avez occupées au nom de la France vous prédisposent, si je puis dire, à comprendre particulièrement l’objet de notre mission d’information, qui est de voir comment les relations bilatérales de toute nature et de tout niveau entre l’Azerbaïdjan et la France s’inscrivent dans le jeu complexe des forces politiques, économiques et culturelles au Caucase du Sud.
Dans ce jeu, la Russie est évidemment un acteur majeur. Nous avons parfois du mal à comprendre les orientations de son action, notamment en direction des pays du Caucase du Sud : les Russes sont les garants de la sécurité extérieure de l’Arménie, dont l’économie dépend d’ailleurs étroitement de Moscou ; en même temps, ils ne se privent pas de livrer des matériels militaires à l’Azerbaïdjan, sans pouvoir ignorer que le seul adversaire de ce pays dans la région est l’Arménie. Nous aimerions donc que vous nous exposiez votre vision de la stratégie géopolitique de la Russie, dont les faits que je viens de rappeler ne sont que des illustrations partielles.
Cette stratégie ne peut que prendre en compte les ambitions de la Turquie dans la région. Quelle est, à l’égard de ce pays, la ligne de conduite de la Russie et quelles en sont les conséquences pour les États du Caucase du Sud ?
Dans un contexte marqué par une telle instabilité, pensez-vous qu’il soit possible aux entreprises occidentales – notamment françaises – de mener une politique d’investissement à long terme, source de profits durables, en Azerbaïdjan ?
Bien entendu, vous avez tout loisir d’étendre votre exposé au-delà des explications appelées par mes questions. Cet exposé sera suivi, comme il est d’usage, par des questions complémentaires. Nos débats ne sont pas publics, mais ils feront l’objet d’un compte rendu sur lequel vous pourrez faire toutes les observations qui vous paraîtront nécessaires.
Je vous donne maintenant la parole.
M. Jean de Gliniasty, directeur de recherche à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS). C’est beaucoup d’honneur pour un retraité comme moi que d’être encore écouté par la représentation nationale. Comme vous le disiez, j’ai une expérience russe puisque je suis resté cinq ans en poste à Moscou. À mon grand étonnement, j’ai très peu entendu parler de l’Azerbaïdjan au cours de cette période. Les relations entre la Russie et l’Azerbaïdjan, vues à travers la presse, semblaient alors curieusement sans histoire. Peut-être ne voulait-on pas en parler ? C’est d’autant plus étonnant que l’Arménie fait l’objet d’un suivi assez étroit : il y a beaucoup plus d’Arméniens que d’Azerbaïdjanais dans les cercles du pouvoir, à tous les niveaux ; la symbiose entre la population arménienne et la population russe est quasi-totale, à un point incroyable.
M. le président François Rochebloine. Il y a presque plus d’Arméniens en Russie qu’en Arménie !
M. Jean de Gliniasty. Bien sûr ! Les Arméniens sont partout et leur double allégeance est parfaitement acceptée par les Russes, ce qu’ils ne feraient pas aussi facilement à l’égard des Azerbaïdjanais.
Loin d’être hostile, ce silence sur les relations avec l’Azerbaïdjan était plutôt comme une sorte d’« écran plat », si l’on peut dire. Il signifiait qu’il n’y avait pas de problème, ce qui conduit à s’interroger quand on connaît l’histoire de la région.
Allons au-delà de cette impression très subjective et intéressons-nous au fond de l’affaire. Au moment des indépendances, l’Azerbaïdjan partait avec des handicaps plus lourds que ceux des autres pays de la région. Commencée dès 1988, la guerre du Haut-Karabagh s’est déroulée de manière de plus en plus atroce jusqu’à la médiation russe de 1994. L’Azerbaïdjan est l’un des rares pays – avec l’Estonie – où l’indépendance se soit soldée par des massacres, et l’Armée rouge y avait été envoyée pour calmer les désordres ethniques.
Son deuxième handicap, considérable, est d’avoir des réserves de pétrole et de gaz. Que ce soit en Afrique ou ailleurs, l’expérience montre qu’un pays qui accède à l’indépendance dans ces conditions suscite immédiatement toutes les convoitises et est promis à une période d’instabilité. Seuls des dirigeants très forts et très intelligents peuvent essayer de conjurer cette sorte de fatalité que représente la possession de gisements d’hydrocarbures.
À ces deux-là, il faut rajouter un handicap supplémentaire lié à la mentalité russe qui distingue les pays en stan d’Asie centrale des pays du Caucase. À la veille de la chute de l’Union soviétique, les gens du peuple comme les cadres considéraient que tous ces pays « en stan » leur « suçaient le sang » et qu’il fallait s’en débarrasser. Le Kazakhstan suscite une réaction un peu différente, mais l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan sont considérés comme étrangers à la Russie, parfois plus riches qu’elle, liée à elle par un accident de l’histoire, etc. L’attitude n’est pas du tout la même vis-à-vis du Caucase, région liée de très près à l’histoire intime de la Russie. Le Caucase évoque Mikhaïl Lermontov en Tchétchénie, les conquêtes du Daghestan et surtout le pétrole de Bakou. Les Russes se sont battus avec l’énergie du désespoir pour ce pétrole et ils ont gagné. C’est l’une des médailles accrochées au revers de la Russie soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale.
Pourtant, à la différence de beaucoup d’autres pays du Caucase ou d’Asie centrale, l’Azerbaïdjan s’en est très bien sorti. Pourquoi ? Honnêtement, je pense que la cause principale en est l’intelligence du président Heydar Aliev. Sélectionné par Léonid Brejnev, Heydar Aliev était devenu membre du Politburo, accédant ainsi aux plus hautes responsabilités en Union soviétique. C’est un parcours rare, accompli aussi par Édouard Chevardnadze qui fut membre du Politburo et ministre des affaires étrangères de l’Union soviétique avant de devenir président de la Géorgie.
Heydar Aliev n’est pas arrivé au pouvoir dès l’indépendance de l’Azerbaïdjan. Il y eut d’abord Ayaz Mutalibov puis Abulfaz Eltchibey qui « sautèrent » en raison du conflit du Haut-Karabagh. Rappelons que l’Union soviétique – et Mikhaïl Gorbatchev en particulier – penchait plutôt en faveur de l’Azerbaïdjan dans ce conflit. L’Union soviétique avait préconisé une forme d’autonomie dans les années 1920, et Mikhaïl Gorbatchev avait refusé le rattachement du Haut-Karabagh à l’Arménie. Jusqu’à Mikhaïl Gorbatchev, l’Union soviétique a favorisé le statu quo, qui est souvent la clef non apparente de hautes stratégies russes.
Après le départ d’Abulfaz Eltchibey, Heydar Aliev est arrivé au pouvoir dans un pays à feu et à sang, placé sous l’œil de Moscou, où des centaines de réfugiés avaient afflué après la défaite. La guerre avait été atroce de part et d’autre.
M. le président François Rochebloine. Comme toutes les guerres !
M. Jean de Gliniasty. Comme toutes les guerres qui s’apparentent à des guerres civiles, comme en Syrie. Cette guerre a opposé des gens qui vivaient dans les mêmes villages mais qui avaient des appartenances différentes. Les guerres de ce genre sont les plus atroces de toutes.
Heydar Aliev s’est vraiment très bien débrouillé parce qu’il avait une expérience d’homme d’État et qu’il a compris qu’il devait respecter certaines conditions s’il voulait entretenir une bonne relation minimale avec la Russie. Mon expérience russe me permet d’affirmer que si ces conditions avaient été respectées par la Géorgie, l’Ukraine et la Moldavie, nous n’en serions pas là où nous en sommes actuellement avec ces conflits gelés. Malheureusement, je n’ai pas eu vraiment l’occasion de l’écrire, ayant quitté Moscou avant la crise ukrainienne.
Vis-à-vis des anciennes républiques socialistes soviétiques, la Russie avait globalement trois exigences.
Première exigence : rester neutre par rapport à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Au fil du temps, l’élargissement simultané de l’Union européenne et de l’OTAN a conduit la diplomatie russe à mettre les deux institutions dans le même sac. Pour prévenir ce qu’ils vivaient comme un encerclement, les Russes ont alors demandé aux anciennes républiques socialistes soviétiques de se garder d’être membre de l’Union européenne comme de l’OTAN.
Deuxième exigence : conserver la langue russe, considérée par Moscou comme un attribut de la souveraineté et de l’influence du pays.
M. le président François Rochebloine. Tel est encore le cas aujourd’hui !
M. Jean de Gliniasty. C’est en effet une caractéristique des anciennes langues impériales, dont le français fait partie. La place accordée au français reste un critère important dans nos relations avec les autres pays.
La dernière exigence est un peu liée à celle concernant l’OTAN : pour les questions de sécurité, conserver des relations avec les forces armées russes. Les Russes attendaient sinon un maintien de leurs bases militaires installées un peu partout à l’époque, au moins des négociations à l’amiable sur leur sort. En tout état de cause, ils voulaient que soient maintenus des liens importants en matière de services de sécurité, de livraison d’armement, etc. Tout cela, Heydar Aliev l’a parfaitement compris.
Pour avoir été directeur pour l’Afrique et l’océan Indien au ministère des affaires étrangères, je sais qu’il y a des constantes dans les processus d’indépendance. À un moment donné, les Russes ont cru qu’après avoir accordé leur indépendance à tous ces pays, ils les retrouveraient ensuite dans la Communauté des États indépendants (CEI) et que l’empire serait préservé. Ils auraient dû lire leur histoire. Quand un pays accède à l’indépendance, il commence à mettre des droits de douane, puis il crée une nomenklatura politique qui a un intérêt vital à se maintenir au pouvoir et donc à l’indépendance du pays. Les dirigeants se lancent aussi dans des relations internationales pour faire reconnaître leur indépendance. C’est rédhibitoire.
La France a connu cette mésaventure lors de la décolonisation de l’Afrique. Nous avons longtemps hésité à créer une grande entité francophone sur le modèle du Nigéria pour l’anglais. En fait, partant du constat qu’il y avait de grandes différences entre les pays, nous avons pris le parti de laisser se développer la démocratie dans chacun d’entre eux, pensant qu’ils se réuniraient ensuite dans un bloc francophone. En fait, cette dernière étape ne s’est jamais réalisée, malgré diverses initiatives comme la création de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Tous les efforts sont restés vains. Quand vous avez des nomenklaturas, des droits de douane, des budgets, des forces armées, des généraux, vous êtes entrés dans un processus d’indépendance. Il en a été ainsi pour l’ensemble des pays de la CEI, dont l’Azerbaïdjan.
Heydar Aliev a été très fin. Dans le cadre de cette indépendance à laquelle il n’avait aucune raison de renoncer, loin de là, il a su naviguer en homme d’État. Il a très habilement respecté les lignes rouges. Il s’est rapproché de l’Union européenne et il a été un acteur très actif du partenariat oriental mais en restant dans les limites. Contrairement aux dirigeants de la Géorgie, de l’Ukraine ou de la Moldavie, il n’a jamais demandé le rattachement de son pays à l’Union européenne.
Il a adopté la même stratégie vis-à-vis de l’OTAN. Il fait un petit tour de piste avec l’Organisation pour la démocratie et le développement, dite GUAM car elle regroupe la Géorgie, l’Ukraine, l’Azerbaïdjan et la Moldavie, des États pressentis pour devenir membres de l’OTAN. En fait, le GUAM est tombé en quenouille. Heydar Aliev a fait juste ce qu’il fallait sans franchir la ligne rouge : il n’est pas entré dans l’OTAN ; il est membre de la CEI mais il a refusé d’entrer dans l’Organisation du traité de la sécurité collective (OTSC) qui regroupe la Russie, l’Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan ; il n’est pas membre non plus de l’Organisation de la coopération de Shanghai qui réunit la Russie, la Chine, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan. Pour schématiser, ce traité très intéressant revient à faire une sorte de répartition des responsabilités entre la Chine et la Russie pour maintenir l’ordre en Asie centrale et aux franges européennes.
Heydar Aliev s’est abstenu de tout geste définitif et il a finalement très bien réussi : ses relations avec la Russie sont sans histoire, elles ne défraient pas la chronique et tout le monde y trouve son compte. Le Haut-Karabagh est une sorte de tampon d’identité pour l’Azerbaïdjan, et surtout une justification pour maintenir un pouvoir assez autoritaire. Quand Heydar Aliev a cédé le pouvoir à son fils Ilham en 2003, le Haut-Karabagh a été le facteur de continuité. Le grand projet national était de récupérer le Haut-Karabagh, y compris par les armes si l’on se réfère à la phraséologie politique azérie.
L’affaire a été assez habilement menée pour que tout le monde y trouve son compte, sauf peut-être l’Arménie, et encore. Contrairement à ce qu’on entend dire parfois, je ne crois pas que la Russie ait suscité le trouble afin de pouvoir apparaître comme médiateur. À mon avis, elle est particulièrement ennuyée par ce conflit qu’elle règle in extremis à chaque explosion. Elle souhaite un apaisement qui lui permettrait de développer cette zone. Il est clair que le Haut-Karabagh est un facteur d’instabilité pour l’ensemble du Caucase. Cette instabilité provoque les premiers friselis d’agitation islamiste en Azerbaïdjan et contribue à affaiblir considérablement l’Arménie – un pays qui ne se porte pas bien.
La Russie souhaite la stabilité du Caucase, ce qui explique d’ailleurs en partie sa politique en Syrie qui se trouve à quelques centaines de kilomètres de là. Cela étant, elle est contente d’apparaître comme le faiseur de paix dans la région. C’est le seul pays sorti gagnant de l’attaque lancée le 2 avril 2016 par les troupes azerbaïdjanaises. Dès le 4 ou 5 avril, le premier ministre russe Dmitri Medvedev était sur place. En trois jours, la trêve était signée. Ironie de l’histoire, le 2 avril, au moment du déclenchement des hostilités, Ilham Aliev et le président arménien Serge Sarkissian étaient tous les deux à Washington.
Les Azerbaïdjanais ont attaqué avec de gros moyens car ils possèdent une véritable armée : leur budget de la défense est supérieur au budget total de l’Arménie. Ils ont marqué des points et ils se sont arrêtés. Dmitri Medvedev est arrivé et la paix a été conclue. Les Azerbaïdjanais sont contents d’avoir marqué des points. Les Russes sont contents d’avoir montré leur talent de médiateurs. Les Arméniens, qui ont perdu l’équivalent de trois terrains de football, ne sont pas très contents. L’attaque a sonné comme une alerte en Arménie où des changements sont intervenus, notamment la nomination d’un nouveau Premier ministre – un ancien de Gazprom, ce qui n’est pas pour déplaire à la Russie. Les Russes ont finalement trouvé leur compte dans cette affaire, mais ils ne jettent pas de l’huile sur le feu, loin de là, car ils aimeraient que le conflit soit réglé.
L’Azerbaïdjan s’est ensuite taillé un rôle absolument formidable car le pays a constitutivement des relations avec tous les grands acteurs de la région : l’Iran parce que la population azerbaïdjanaise est majoritairement chiite ; la Turquie parce que les deux peuples parlent une langue turcique ; la Russie dont le système politique est assez proche du sien. Ilham Aliev, tout aussi fin que son père, réussit à tirer le meilleur parti possible de la situation.
Il y a quelques mois, s’est tenu un sommet entre Hassan Rohani, Vladimir Poutine et Ilham Aliev, afin d’organiser les relations avec l’Iran. On a parlé notamment d’une zone commerciale commune dont les Azerbaïdjanais tireraient le plus grand bénéfice. La Turquie a pris parti pour l’Azerbaïdjan dans les heures qui ont suivi le début du conflit, et les relations entre les deux pays sont très bonnes. En 2010, quand j’étais à Moscou, s’est déroulé un épisode intéressant qui est passé totalement inaperçu. Pour des raisons purement commerciales, les Turcs avaient accepté l’ouverture d’un point de passage pour les marchandises arméniennes. Le président Aliev était intervenu de manière très ferme auprès des autorités turques qui avaient alors immédiatement renoncé à appliquer l’accord.
M. le président François Rochebloine. Ils n’acceptent jamais ce type de passage !
M. Jean de Gliniasty. Il me semble que la Géorgie était partie prenante à l’accord mais que, face à la réaction violente des Azerbaïdjanais, les Turcs avaient renoncé à l’appliquer. Ce fut un accord mort-né.
Quoi qu’il en soit, les Azerbaïdjanais ont de bonnes relations avec la Turquie et avec l’Iran. Quant aux Russes, ils veulent stabiliser la région car ils considèrent que le développement du Daghestan, de l’Ingouchie et de la Tchétchénie est crucial pour eux. Dieu sait ce qu’ils dépensent comme argent dans cette région, et « pour des prunes », si j’ose dire, car elle est ingérable en raison de la corruption, de la violence, etc. Les Russes tiennent pourtant à son développement, clef de la stabilisation. L’Azerbaïdjan joue un rôle beaucoup plus positif que l’Arménie, qui est pauvre, sous-peuplée en raison d’une très forte émigration, confrontée à de nombreuses difficultés, et totalement dépendante de la Russie sur le plan militaire.
Parlons de la « doctrine Lavrov », la règle du jeu qui permet à ce système de se maintenir sans trop d’explosions. Les Russes ont fait admettre par les deux parties qu’ils n’interviendraient jamais en cas de guerre dans le Haut-Karabagh entre les Azerbaïdjanais et les Arméniens ou les Karabaghtsi, mais qu’ils sanctuarisaient le territoire de l’Arménie. À la limite, les Azerbaïdjanais peuvent faire ce qu’ils veulent pour reconquérir le Haut-Karabagh, à condition de ne pas prendre un pouce du territoire arménien. Cette règle est assez bien acceptée par les uns et les autres.
M. le président François Rochebloine. Le président Aliev aurait fait aujourd’hui, m’a-t-il été rapporté, une déclaration où il parlerait d’annexion de la ville de Goris, dans le sud de l’Arménie.
M. Jean de Gliniasty. S’il faisait cela, il irait carrément à l’encontre de la doctrine Lavrov et il se heurtera aux troupes russes stationnées à Gyumri et dans les bases arméniennes. Il le sait parfaitement. Il y a une part de gesticulation dans tout cela car le Haut-Karabagh est l’un des facteurs d’identité nationale, d’unité nationale et de justification du pouvoir de la famille Aliev. La rivalité avec l’Arménie est consubstantielle au régime. L’Azerbaïdjan a perdu 20 % de son territoire et vu arriver des centaines de milliers de réfugiés. Une partie de la population azerbaïdjanaise le vit mal, surtout en période de crise. À un moment où les cours du pétrole s’effondrent et où la croissance n’atteint plus 7 % ou 8 % par an comme au début des années 2000, le sujet devient plus brûlant.
Je n’ai pas vu ces déclarations, mais Ilham Aliev ne peut pas ne pas savoir que le territoire arménien est sanctuarisé. En ce moment, il est en train de réussir ses relations diplomatiques dans la région et avec la Russie. D’abord, il a été un instrument de la réconciliation entre les Turcs et les Russes, ce qui a été le tournant dans la guerre en Syrie. Les Russes peuvent bénir Aliev matin, midi et soir. Si le président kazakh Nursultan Nazarbaïev a joué un rôle, c’est Aliev qui a été le réel réconciliateur. La rupture intervenue en août entre la Russie et la Turquie avait été vécue comme un désastre dans la plupart des pays de langue turcique, c’est-à-dire au Turkménistan, en Azerbaïdjan et au Kazakhstan. Les membres de la CEI ont exercé une pression et signifié aux Russes qu’ils ne pouvaient pas se comporter ainsi avec les Turcs.
Pour résumer, Ilham Aliev a réussi son opération. Il apparaît comme l’artisan de la réconciliation russo-turque et un médiateur avec l’Iran, marché absolument formidable. La pauvre Arménie est isolée mais je doute qu’Aliev envisage une opération, malgré les déclarations dont vous parlez et que je n’avais pas entendues…
M. le président François Rochebloine. Cela m’a été rapporté.
M. Jean de Gliniasty. Il sait très bien que s’il fait cela, il enfreint la doctrine russe.
Reste une question majeure : comment se fait-il que la Russie ait accepté si facilement que l’Azerbaïdjan développe une politique indépendante dans le domaine des hydrocarbures ? Ce n’est un mystère qu’en apparence : la Russie a d’abord manifesté une nette opposition au projet Nabucco, jusqu’à son abandon. Elle devrait aujourd’hui s’inquiéter de la mise en exploitation des gisements de Shah Deniz 1 et 2 et des oléoducs Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC), Trans-Adriatic Pipeline (TAP) et Trans-Anatolian Pipeline (TANAP), puisqu’ils diminueront d’autant les débouchés du gaz russe sur le marché européen ; pourtant, elle accepte cette évolution avec philosophie.
Si la position russe a tant évolué, c’est d’abord parce que suite aux sanctions, la production russe a été nettement réorientée vers la Chine. L’accord signé en août 2015 par les présidents Poutine et Xi Jinping porte sur environ 400 milliards de dollars et une trentaine de milliards de mètres cubes de gaz par an, le gazoduc étant construit par les Chinois. La négociation est certes complexe, mais elle aboutira. S’étant assuré le débouché chinois, les Russes sont plus détendus pour ce qui concerne leur accès au marché européen.
Par ailleurs, le gazoduc Nord Stream 1 permet déjà au gaz russe de contourner l’Ukraine, et l’incitation à construire Nord Stream 2 est faible compte tenu de la stagnation du marché européen. Le projet South Stream – dans lequel EDF avait initialement pris une participation, ensuite reprise par Gazprom – est mort, pour se muer en « Turkish Stream », en quelque sorte, puisque la Russie envoie son gaz en Turquie à qui il revient de le répartir vers la Bulgarie, la Grèce ou ailleurs, à quoi s’ajoute le fait que le marché turc lui-même est en pleine croissance.
De ce fait, la Russie accepte avec une certaine équanimité l’exportation du gaz azerbaïdjanais de Shah Deniz. C’est un facteur supplémentaire de stabilisation des relations entre l’Azerbaïdjan et ses trois voisins, l’Arménie s’affaiblissant parallèlement. Le président Aliev est intelligent et lucide ; il est laïque, ce qui se fait rare dans la région. L’Azerbaïdjan est resté très imprégné par la langue russe, qui est la langue des élites. La Russie a d’ailleurs ouvert à Bakou une université qui forme des cohortes de spécialistes du russe. On entend certes parler de maquis islamistes et autres difficultés dues aux fortes inégalités, mais rappelons que l’Azerbaïdjan est un pays chiite qui ne sera pas aussi vulnérable que les pays sunnites à un phénomène extrémiste, car l’Iran ne l’encouragerait pas. En clair, vue de Moscou, la situation en Azerbaïdjan est plutôt positive.
M. le président François Rochebloine. La politique azerbaïdjanaise de la Russie serait dictée par le fait que le régime Aliev constitue un rempart contre l’islamisme. Le président Aliev ne s’est pourtant pas privé de faire appel à la solidarité musulmane face à ce qu’il appelle « l’agression arménienne ». Jusqu’à quel point peut-il s’engager dans cette voie sans cesser de tenir le rôle de rempart que lui attribue selon vous la diplomatie russe ?
M. Jean de Gliniasty. L’Azerbaïdjan est membre de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), ce qui lui permet automatiquement de bénéficier de l’appui de cinquante voix à l’Assemblée générale de l’ONU. N’oublions pas, en effet, que les organisations internationales, dont l’ONU, ont pris position en faveur de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie en 1994. La résolution adoptée à l’époque l’a été à une faible majorité, avec une centaine d’abstentions – ce que l’Azerbaïdjan a vécu comme un camouflet. Il est donc décidé à faire le plein des voix des États islamiques. Dès lors, son approche de l’OCI me semble plus diplomatique que religieuse.
M. le président François Rochebloine. Comment se déploiera selon vous la stratégie russe de développement des infrastructures internationales de transport de produits pétroliers, qui donne lieu à des tractations complexes
M. Jean de Gliniasty. L’avancement des négociations relatives au statut de la mer Caspienne est l’un des facteurs qui rassurent la Russie concernant ses débouchés pétroliers et gaziers. Le traité sur la mer Caspienne interdit à chaque État riverain d’exploiter ses eaux territoriales sans l’accord des autres. La Russie a donc un pouvoir de blocage sur le transport transcaspien. Elle a d’ailleurs bloqué l’accord en cours de négociation pour bien montrer que rien ne se ferait sans son accord. Sauf erreur, cette situation très favorable aux Russes n’a pas évolué ; elle a notamment permis de bloquer plusieurs projets européens.
Plusieurs facteurs se conjuguent : débouché chinois pour le gaz russe, acceptation par la Russie du fait que l’Azerbaïdjan doit exploiter ses gisements et que sa production ne saurait s’écouler via la Russie, et attitude conciliante de l’Azerbaïdjan – même s’il a fait preuve d’une certaine solidarité à l’égard de l’Ukraine, ne goûtant guère, comme les autres États issus de l’Union soviétique, la remise en cause des frontières. De plus, la Russie déploie deux grands projets : Nord Stream d’un côté et Turkish Stream de l’autre. Elle semble donc s’être fait une raison. Autant elle s’était vivement opposée à Nabucco, autant les projets ultérieurs d’exploitation de Shah Deniz n’ont donné lieu à rien d’autre qu’à des négociations et une entente avec la Turquie – laquelle est, rappelons-le, un partenaire de poids dont la Russie a besoin. Or, la Turquie appuie l’Azerbaïdjan par solidarité turcique.
M. le président François Rochebloine. Selon vous, la Turquie souhaite-t-elle réellement adhérer à l’Union européenne ?
M. Jean de Gliniasty. Les partis laïques kémalistes autrefois au pouvoir y étaient sincèrement favorables, car ils y voyaient à juste titre un moyen de pérenniser leur pouvoir. En Europe, les plus réticents à l’adhésion turque estimaient que ces intellectuels de formation souvent française, issus du lycée Galatasaray entre autres, n’étaient que l’écume des jours, comme les démocrates syriens d’aujourd’hui, tandis que l’Anatolie, elle, restait très islamique et religieuse. L’adhésion n’est pas si importante pour le parti actuellement au pouvoir, sauf pour tirer le meilleur parti de l’Union européenne et pour des raisons de prestige.
M. le président François Rochebloine. Quelle appréciation faites-vous de la politique que les États-Unis ont menée dans la région ces dernières années, compte tenu de leurs intérêts politiques et économiques ? Cette politique est-elle susceptible d’évoluer significativement sous la présidence de M. Trump ?
M. Jean de Gliniasty. Après la chute de l’Union soviétique, les Américains – comme les Européens – étaient convaincus des opportunités qui existaient dans les nouveaux pays qui, selon eux, ne demandaient qu’à accéder à la démocratie. C’est l’époque où l’Azerbaïdjan est entré au Conseil de l’Europe. Cet enthousiasme collectif est l’un des grands malentendus de la chute de l’URSS : nous avons pris pour la fin de l’empire ce que les Russes eux-mêmes ne considèrent que comme un affaiblissement momentané.
Aujourd’hui, les États-Unis sont dans une phase de repli très relatif : leur puissance est telle qu’ils exercent un poids intrinsèque considérable. Cela étant, il se produit actuellement en Asie centrale une contre-offensive russe qui, peu à peu, en expulse les Américains en s’appuyant sur la Chine. L’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) est un instrument extrêmement puissant, la Russie et la Chine s’y partageant les compétences – à la première les questions de sécurité, à la seconde les implantations économiques. Cette situation est naturellement appelée à changer mais, à ce stade, les deux pays sont d’accord pour expulser les Américains de la région. Ils se sont d’ailleurs opposés à la demande des États-Unis de participer à l’OCS en tant qu’observateur, alors qu’ils ont accepté l’adhésion de l’Inde et du Pakistan. Autrement dit, la Russie et la Chine réorganisent l’Asie centrale en l’absence des États-Unis et de l’Europe.
La situation est quelque peu différente dans le Caucase, où les Russes reprochent aux Américains d’avoir d’abord favorisé une déstabilisation islamiste. Ils ont notamment vu la main des États-Unis dans les maquis « wahhabites » – une appellation qui, dans la presse russe, désigne tout mouvement islamiste. Cependant, je ne crois pas que les Américains aient joué un rôle dans la déstabilisation de la région.
Dès lors que l’Azerbaïdjan sait naviguer habilement entre les lignes rouges des uns et des autres tout en développant sa propre autonomie, la présence commerciale et pétrolière des États-Unis ne gêne pas les Russes, ce qui ouvre sans doute la voie à une entente avec M. Trump. La véritable difficulté tiendra à la relation avec l’Iran, que M. Trump, qui envisage de revenir sur l’accord signé par M. Obama, a désigné comme un ennemi pendant sa campagne. Or, l’Azerbaïdjan et la Russie ont l’un et l’autre besoin d’entretenir une bonne relation avec l’Iran.
M. le président François Rochebloine. Vous venez de citer cinq pays – la Russie, les États-Unis, l’Inde, le Pakistan et la Chine – qui n’ont pas signé la Convention d’Ottawa sur l’interdiction des mines antipersonnel.
M. Jean de Gliniasty. Cela s’entend aisément pour l’Inde et le Pakistan, qui les utilisent au Cachemire ; c’est aussi le cas de l’Azerbaïdjan, en raison de la situation au Haut-Karabagh.
M. le président François Rochebloine. Au regard de ses intérêts diplomatiques et économiques globaux et de ses intentions spécifiques de présence dans la région, quelle orientation la France devrait-elle donner à la politique qu’elle mène notamment dans le cadre du Groupe de Minsk ?
M. Jean de Gliniasty. Le Groupe de Minsk est la seule instance européenne de la région dans laquelle la France soit encore présente. De mois en mois, en effet, la présence française y a connu une érosion progressive au profit des Allemands, des Scandinaves et d’autres Européens, au point qu’elle a perdu tous ses postes. Il y a quelques années, elle disposait encore de plusieurs représentants au service européen pour l’action extérieure dans cette région ; ce n’est plus le cas. Heureusement, il reste le Groupe de Minsk qui, à l’origine, fut une formidable opération diplomatique française, malgré les imprécations initiales venues de tous bords, les uns jugeant qu’elle était pro-arménienne et les autres pro-azerbaïdjanaise. Pourtant, le Groupe de Minsk a proposé en 2010 une solution de bon sens consistant à restituer la zone de sécurité conquise par les Arméniens autour du Haut-Karabagh, qui représente la moitié du territoire perdu par l’Azerbaïdjan, en échange du maintien du corridor de Latchin et d’une autodétermination future du territoire. S’il doit y avoir une solution au conflit, ce sera celle-là. De ce point de vue, le Groupe de Minsk a rempli son office : il a déterminé les grandes lignes d’un éventuel accord.
Il est essentiel de le préserver, car il est le seul vecteur de la présence française dans la région. Le ministère des affaires étrangères y a nommé des russophones – comme les Américains – car les discussions ont lieu en russe. Nous avons donc voix au chapitre par ce canal, même s’il est désormais entendu, compte tenu du rapport de force, que l’une des parties prenantes – la Russie – est « plus égale » que les autres. Nous participons à cet état de fait dont les Américains se satisfont, n’ayant pas souhaité exercer une quelconque pression dans ce cadre. Ajoutons enfin que le Groupe de Minsk comporte aussi un comité élargi qui ne sert à rien car la Russie refuse de l’impliquer dans les travaux.
M. le président François Rochebloine. Les accords de Paris, conclus sous l’égide du président Chirac entre les présidents Aliev et Kotcharian, ont été cassés quelques mois plus tard lors du sommet de Key West. Comment l’expliquez-vous ?
M. Jean de Gliniasty. Il est vrai que Heydar Aliev était un apparatchik, comme Robert Kotcharian ; ils appartenaient au même monde. Ilham Aliev, en revanche, appartient à la génération de l’indépendance, tandis que le président Sarkissian est originaire du Haut-Karabagh : ils ne sauraient se mettre d’accord. Un règlement du conflit du Haut-Karabagh n’est pas envisageable dans ces conditions. En revanche, la nomination d’un ancien de Gazprom venu de la société civile, M. Karapetian, au poste de Premier ministre en Arménie est une nouveauté : peut-être la prise en compte de la dimension économique du conflit, qui a plombé l’Arménie, en favorisera le règlement.
M. le président François Rochebloine. Monsieur l’ambassadeur, nous vous remercions.
*
* *
Ÿ Audition de Mme Marie-Claire Aoun, directrice du centre « Énergie » de l’Institut français des relations internationales (IFRI) (jeudi 15 décembre 2016)
M. le président François Rochebloine. J’ai le plaisir d’accueillir Mme Marie-Claire Aoun, directrice du centre « Énergie » de l’Institut français des relations internationales (IFRI), dont les recherches sont essentiellement consacrées à la question de l’économie pétrolière. En 2008, vous avez soutenu, madame Aoun, une thèse à l’Université de Paris-Dauphine sur la rente pétrolière et le développement économique des pays exportateurs. Vos compétences s’inscrivent donc parfaitement dans le champ de notre mission.
L’Azerbaïdjan fait, en effet, partie des pays dont le développement a été vigoureusement soutenu en son temps par ce qu’il est convenu d’appeler la « manne pétrolière », mais il se découvre aujourd’hui en situation d’étroite dépendance à l’égard des cours du marché et ne saurait éviter de se poser à terme la question de l’épuisement des ressources naturelles que sont le pétrole et le gaz.
Pourrez-vous commencer par dresser un tableau de l’économie pétrolière en Azerbaïdjan ? Quelle est sa place dans l’économie globale du pays ? Quelle est la part de la rente pétrolière dans les recettes budgétaires ? Comment l’Azerbaïdjan affronte-t-il les risques que lui fait supporter la prépondérance des produits pétroliers dans ses sources de revenus ? Comment appréciez-vous la compétitivité effective du gaz et du pétrole azerbaïdjanais sur le marché mondial ? Quelle peut être l’incidence sur cette compétitivité du récent accord russo-turc concernant le gazoduc dit Turkish Stream ? Comment l’Azerbaïdjan a-t-il répercuté la baisse de ses recettes sur ses choix budgétaires ?
L’exportation de ces produits implique un certain nombre de relations et de projets, en particulier le recours à des oléoducs et à des gazoducs qui les acheminent vers l’Europe occidentale via le Corridor Sud. Les controverses qui ont surgi autour de ces installations présentes et futures ne sont pas seulement techniques, mais aussi géopolitiques. Quelle est la position de l’Azerbaïdjan en la matière ? Est-il davantage un pays de transit qu’un pays producteur ?
Enfin, s’il existe en Azerbaïdjan une société pétrolière d’État, la SOCAR, le pays a fait appel par son intermédiaire à de grandes sociétés étrangères, notamment françaises, pour exploiter son pétrole et son gaz. Pouvez-vous nous donner un aperçu de leurs activités, non seulement en termes quantitatifs mais aussi en incluant des données sur les conditions qualitatives de cette activité, sur la situation actuelle et la rentabilité à terme de ces investissements et sur l’évolution prévisible des coûts de production ? Il semble en effet que les caractéristiques physiques des gisements encore exploités entraînent un alourdissement significatif de ces coûts. Est-ce le cas ?
Mme Marie-Claire Aoun, directrice du centre « Énergie » de l’Institut français des relations internationales (IFRI). Merci beaucoup, monsieur le président, de m’avoir invitée. Je suis très honoré de m’exprimer devant votre mission d’information. Mon intervention portera sur la géopolitique de l’énergie, d’une part sur le secteur gazier, notamment sur la question du Corridor Sud et de ses implications pour l’Europe et pour le jeu russo-turc que vous avez mentionné, d’autre part sur le secteur pétrolier, dans un contexte de baisse des cours depuis 2014. Je ne suis pas certaine de disposer de tous les éléments de réponse aux questions que vous avez posées sur les compagnies pétrolières.
M. le président François Rochebloine. Vous pourrez éventuellement nous transmettre des éléments par écrit après cette audition.
Mme Marie-Claire Aoun. L’Azerbaïdjan dispose de ressources énergétiques très abondantes, notamment de ressources gazières. Ses réserves prouvées de gaz naturel s’élèvent à plus de 1 000 milliards de mètres cubes, ce qui n’est évidemment pas comparable aux réserves de la Russie, de l’Iran ou du Qatar – 24 000 milliards de mètres cubes pour ce dernier pays.
Le gaz azerbaïdjanais provient de trois sources principales : quelques gisements domestiques, qui sont tous en déclin ; le gisement offshore Azeri-Chirag-Guneshli, de gaz associé au pétrole, exploité par SOCAR pour le compte d’un consortium d’une dizaine de compagnies internationales piloté par BP ; le gisement offshore géant de Shah Deniz, découvert en 1999, qui produit aujourd’hui environ 10 milliards de mètres cubes par an, et grâce auquel l’Azerbaïdjan est devenu un exportateur net de gaz en 2007.
L’Azerbaïdjan a une consommation domestique de gaz importante : 10 milliards de mètres cubes par an. Son mix énergétique est composé à 60 % de gaz, à 35 % de pétrole et, pour le reste, d’énergies renouvelables, notamment d’hydroélectricité et d’énergie issue de la biomasse. Il présente à cet égard le même profil que de nombreux autres pays pétroliers, notamment du Moyen-Orient : ces pays préfèrent exporter le pétrole, car la rente pétrolière est très élevée, et garder le gaz pour leur consommation domestique, celui-ci étant beaucoup plus coûteux à produire et, surtout, à transporter.
L’Azerbaïdjan produit actuellement 18 milliards de mètres cubes de gaz par an. Il en consomme 10 milliards, je l’ai dit, et en exporte 6,6 milliards vers la Turquie, 1 à 2 milliards vers la Géorgie et un volume très faible vers le Sud de la Russie. Auparavant, l’Azerbaïdjan importait du gaz russe. Depuis 2007, il exporte du gaz vers la Russie, l’infrastructure ayant été inversée à cette fin. Cependant, il est arrivé ces dernières années, notamment en 2015, qu’il fasse appel à des importations de gaz russe pour satisfaire ses besoins domestiques, en raison d’une baisse de la production de certains gisements liée à des problèmes d’investissement. Il s’agit toutefois de difficultés transitoires.
Il y a une demande croissante pour le gaz azerbaïdjanais, de la part de la Turquie, qui a des besoins très importants en gaz, mais aussi du marché domestique local et, dans une moindre mesure, de la Géorgie.
Le gisement de Shah Deniz produit actuellement, je l’ai dit, 10 milliards de mètres cubes par an. En 2020, après la mise en service d’une deuxième phase du projet, il devrait produire un volume supplémentaire de 16 milliards de mètres cubes, dont 6 milliards seront exportés vers la Turquie et 10 milliards vers l’Europe.
Pour exporter le gaz de Shah Deniz vers l’Europe, l’Azerbaïdjan a retenu, en 2011, les projets de gazoducs Trans-Anatolian Pipeline (TANAP), qui traversent le territoire turc d’Est en Ouest, et Trans-Adriatic Pipeline (TAP), qui relie la Turquie au Sud de l’Italie via la Grèce et l’Albanie. Ces projets étaient en concurrence avec le projet Nabucco, soutenu par la Commission européenne.
M. le président François Rochebloine. C’est donc un échec de l’Europe.
Mme Marie-Claire Aoun. Oui, c’est clairement un échec politique de l’Europe. La Commission européenne soutenait fortement le projet Nabucco, qui visait à diversifier les sources d’approvisionnement pour réduire la dépendance à l’égard du gaz russe, mais il n’y avait pas d’accord entre les États membres. En réalité, Nabucco était un gazoduc très coûteux, qui devait transporter des volumes de gaz très importants et traverser un grand nombre de pays, notamment la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie et l’Autriche. Le Corridor Sud, composé successivement du South Caucasus Pipeline (SCP) – qui relie l’Azerbaïdjan à la Turquie –, du TANAP et du TAP, traversera moins de pays et transportera des volumes plus réduits.
Dans ce contexte, la Turquie est un pays très important. Le marché gazier turc est le seul qui soit en expansion en Europe : le taux de croissance de la demande de gaz est d’environ 7 % en Turquie ; il est presque au niveau de celui de la Chine, ce qui en fait l’un des plus élevés au monde. La Turquie importe la totalité des 48 milliards de mètres cubes de gaz qu’elle consomme. Elle en fait venir la moitié de Russie, soit via l’Ukraine, soit via le gazoduc Blue Stream, qui relie directement les deux pays. Elle se fournit aussi auprès de l’Iran, avec lequel un jeu de pouvoir pourrait se dessiner dans les prochaines années. Elle achète 6 milliards de mètres cubes à l’Azerbaïdjan, soit 12 % du total. Le reste est constitué par des volumes plus réduits de gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance d’Algérie et du Nigeria.
La Russie observe le marché turc de très près : elle essaie de préserver sa part de marché, notamment par rapport à l’Iran. L’Azerbaïdjan est un pays intéressant du point de vue de la Turquie, car il lui permet de diversifier ses sources d’approvisionnement, compte tenu notamment de ses relations compliquées et assez instables avec la Russie.
Le projet de gazoduc Turkish Stream, annoncé en décembre 2014 par Vladimir Poutine, a été mis de côté quelques mois plus tard en raison des tensions diplomatiques avec Ankara, mais est réapparu cet été à la faveur du rapprochement russo-turc. Il vise à remplacer le projet South Stream, qui devait acheminer le gaz russe vers l’Europe à travers la mer Noire, mais a été abandonné en raison du contexte difficile avec l’Union européenne. Turkish Stream reprend en partie le tracé de South Stream, dans lequel Gazprom avait déjà beaucoup investi. Cela explique pourquoi la Russie tient à ce projet.
L’objectif initial était que Turkish Stream transporte 63 milliards de mètres cubes de gaz. Aujourd’hui, ce qui est annoncé, ce sont deux lignes permettant d’acheminer environ 15 milliards de mètres cubes chacune. De nombreux experts estiment cependant que c’est un peu ambitieux et qu’il n’est pas certain que la deuxième ligne soit réalisée. La construction commencerait en 2017 et Turkish Stream serait mis en service en 2020 ou 2022. À cette date, la Russie devrait donc exporter vers la Turquie un volume supplémentaire de 15 à 30 milliards de mètres cubes.
Le gaz azerbaïdjanais est-il compétitif ? Quelles sont les perspectives à long terme ? Il y a quelques années, on pensait que l’Azerbaïdjan avait un fort potentiel dans le domaine gazier, mais les chiffres ont été revus à la baisse ces derniers temps, car il s’agit d’un gaz offshore qui est coûteux à produire et, surtout, qu’il faut transporter sur de longues distances. Il n’est donc pas sûr que ce gaz puisse arriver sur les côtes européennes à un prix intéressant par rapport à celui qui est produit par le géant russe, celui-ci ayant une capacité très importante à réduire les prix.
Dans une étude qu’il a publiée cet été, l’Oxford Institute for Energy Studies estime que l’Azerbaïdjan produira environ 30 milliards de mètres cubes de gaz en 2020. Cette estimation semble assez réaliste : si l’on ajoute à la production actuelle de 18 milliards de mètres cubes les 16 milliards supplémentaires qui seront extraits à Shah Deniz et exportés par le Corridor Sud, en tenant compte par ailleurs du déclin des gisements domestiques, cela fait à peu près 30 milliards de mètres cubes. Pour 2025, alors que l’on annonçait une production de 60 milliards de mètres cubes il y a encore deux ans, on parle désormais plutôt d’un volume maximal de 40 milliards.
M. le président François Rochebloine. Il devrait donc y avoir, à terme, une stabilité de la production ?
Mme Marie-Claire Aoun. Oui, d’autant que la production du gisement de Shah Deniz devrait atteindre un plateau en 2025.
M. le président François Rochebloine. Dès lors, la production pourrait même diminuer ensuite ?
Mme Marie-Claire Aoun. Oui, car c’est un gisement qui n’est pas facile à exploiter. Les coûts de production sont élevés.
Le gaz azerbaïdjanais peut-il être compétitif sur le marché européen ? Dans l’étude que j’ai citée précédemment, l’Oxford Institute for Energy Studies estime que, compte tenu de ses coûts de production et de transport, le gaz azerbaïdjanais pourrait être livré sur les côtes italiennes au prix de 7 dollars par million de British thermal units (BTU) environ. Or, actuellement, le cours du gaz est de 3,5 à 4 dollars, ce qui est à peu près le prix auquel le gaz russe est livré à la frontière allemande dans le cadre des contrats de long terme avec Gazprom. La Russie s’aligne sur les prix du marché.
M. le président François Rochebloine. Cela signifie que la Russie « mange » de l’argent ?
Mme Marie-Claire Aoun. Dans la phase actuelle, les Russes essaient de défendre leur part de marché face au GNL américain, qui arrive sur le marché européen. Ils ont donc réduit leurs prix.
M. le président François Rochebloine. N’y a-t-il pas des limites à cette politique ?
Mme Marie-Claire Aoun. Il y a effectivement des limites, compte tenu de la situation économique difficile que connaît actuellement la Russie.
Pour le marché européen au moins, la Russie a des avantages par rapport à tous les autres exportateurs de gaz : elle possède d’énormes réserves de gaz et dispose d’une capacité de production et de transport excédentaires. Le gaz russe emprunte principalement trois routes vers l’Europe : via l’Ukraine, via la Biélorussie et la Pologne, et via le gazoduc Nord Stream qui aboutit en Allemagne. La route qui passe par l’Ukraine n’est utilisée actuellement qu’à 40 %. Au total, la Russie a la capacité d’exporter 100 milliards de mètres cubes supplémentaires vers l’Europe. Elle est donc en mesure de réduire ses prix pour s’aligner sur ceux du marché. Les prix actuels sont les plus pas que l’on ait observés depuis 2004.
Dans ce contexte, le gaz azerbaïdjanais n’est pas tellement intéressant du point de vue européen, car il est, je le répète, assez coûteux à produire et à transporter. En revanche, il peut être compétitif par rapport au gaz russe sur le marché turc – je ne dispose pas de chiffres précis sur ce point. En d’autres termes, l’Azerbaïdjan est un fournisseur intéressant pour la Turquie.
Par ailleurs, si l’on se place, cette fois, du point de vue de l’Azerbaïdjan, notamment dans la perspective d’un éventuel développement plus poussé du Corridor Sud, il faut avoir en tête que le contexte sur le marché gazier européen n’est pas très favorable à long terme : en 2035, la consommation de gaz au sein de l’Union européenne devrait être au même niveau qu’en 2013, selon le scénario « Nouvelles politiques » de l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Selon les différents scénarios de la Commission européenne, cette consommation, au mieux, augmentera légèrement, mais, plus probablement, stagnera, voire déclinera.
M. le président François Rochebloine. Malgré l’augmentation de la population ?
Mme Marie-Claire Aoun. Oui. La production de gaz décline en Europe, donc les importations vont augmenter : l’Europe aura besoin d’environ 80 milliards de mètres cubes supplémentaires d’ici à 2035, toujours selon le même scénario de l’AIE. Mais la consommation va stagner à long terme. D’où une visibilité très faible pour ceux qui souhaiteraient s’engager dans des investissements lourds dans les infrastructures. Cela constitue une limite supplémentaire pour le développement du Corridor Sud. Rappelons que le projet initial était d’acheminer du gaz non seulement d’Azerbaïdjan, mais aussi du Turkménistan, de l’Iran et de l’Irak. Compte tenu du contexte actuel, de nombreuses incertitudes pèsent sur l’extension de ce projet. De l’avis de la plupart des experts, le Corridor Sud transportera uniquement ce qui est prévu aujourd’hui : 6 milliards de mètres cubes vers la Turquie et 10 milliards vers l’Europe. Sauf changement majeur, tout développement supplémentaire sera pour le long terme.
J’en viens aux acteurs français. Total était auparavant impliqué dans le projet de gazoduc TAP, mais il en est sorti. Aujourd’hui, il est opérateur du bloc offshore d’Apchéron, situé en mer Caspienne, et détient 40 % des parts dans ce projet. SOCAR en détient également 40 % et Engie 20 %. Les coûts de production sont très élevés. Les volumes produits seront assez faibles et destinés essentiellement à la consommation domestique. Une négociation a eu lieu au cours des dernières semaines, et Total se serait vraiment engagé dans ce projet – je n’ai pas de précisions à ce sujet. Total a déclaré qu’il s’agissait aussi pour lui de garder un pied en Azerbaïdjan en cas de changements dans les années à venir.
D’une manière générale, Total et Engie sont actuellement peu présents en Azerbaïdjan. Les coûts de production du gaz y sont élevés, et les perspectives pour acheminer ce gaz vers l’Europe sont relativement limitées.
M. le président François Rochebloine. Dans votre thèse, vous évoquez « l’impact de la démocratie sur la croissance économique » et vous rappelez que « les institutions démocratiques fournissent un contrôle sur le pouvoir du gouvernement et entravent le développement des comportements de recherche de rente ou l’adoption de politiques impopulaires ». Il ne semble pas que l’Azerbaïdjan soit très respectueux des normes démocratiques élémentaires. D’après vous, ce défaut de démocratie peut-il être considéré comme un frein décisif au développement économique du pays ?
Vous indiquez, toujours dans votre thèse, que « la corruption dans les industries extractives est souvent considérée comme systémique » et se manifeste notamment lors de la délivrance de permis ou de licences d’exportation aux entreprises. Cette observation de portée générale trouve-t-elle à s’appliquer, selon vous, à l’Azerbaïdjan ?
Comment évaluez-vous la sécurité politique, juridique et financière des investissements des entreprises pétrolières françaises en Azerbaïdjan ?
Mme Marie-Claire Aoun. L’Azerbaïdjan produit environ 850 000 barils de pétrole par jour. C’est un volume important, mais qui reste relativement limité par rapport à ce qu’extraient les grands producteurs mondiaux. Les exportations pétrolières représentent 80 % environ des exportations totales du pays. L’Azerbaïdjan est donc très dépendant à l’égard des recettes pétrolières. De 2004 à 2014, lorsque les prix du pétrole se sont envolés, jusqu’à 100 dollars et plus le baril à certains moments, à l’instar de nombreux pays producteurs de pétrole, l’Azerbaïdjan a accumulé des sommes très importantes, notamment dans son fonds souverain SOFAZ – State Oil Fund of Azerbaidjan –, dont l’encours a atteint près de 40 milliards de dollars. À partir de juin 2014, les cours du pétrole se sont effondrés.
M. le président François Rochebloine. Vont-ils remonter ?
Mme Marie-Claire Aoun. Ils ont atteint un pic de 110 dollars le baril en juin 2014, puis se sont effondrés. Au début de l’année 2016, ils étaient de 30 dollars le baril, puis sont légèrement remontés. Au bout de presque deux ans, les pays producteurs se sont enfin accordés pour réduire la production : un accord est intervenu en ce sens au sein de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) il y a quelques semaines, et les pays hors OPEP, dont la Russie et l’Azerbaïdjan, ont accepté de participer à cet effort collectif.
D’après les experts, notamment l’Agence internationale de l’énergie (AIE) qui a publié un rapport sur ce sujet il y a quelques jours, le marché pétrolier va de toute façon s’équilibrer d’ici à la fin de l’année 2017 : un certain nombre d’investissements n’ayant pas été réalisés en raison de la baisse des cours, les courbes d’offre et de demande vont de nouveau se croiser. L’accord conclu par les pays producteurs vise à accélérer un peu ce rééquilibrage, car quelques dollars supplémentaires par baril sont précieux pour nombre de ces économies aujourd’hui à terre. Compte tenu de ces éléments, les prix vont probablement augmenter au début de l’année 2017 et pourraient atteindre 55 à 60 dollars le baril.
Cependant, de nombreuses incertitudes demeurent. La grande inconnue, ce sont les pétroles de schiste américains. On constate que la production de ces pétroles, qui est très flexible et résiliente, augmente de nouveau. Dès lors, il est possible que les efforts consentis par les pays producteurs se révèlent inutiles. En tout cas, au vu de la situation actuelle de l’offre et de la demande, il est certain que les cours n’atteindront pas un niveau de 80 ou 100 dollars le baril à moyen terme : ils devraient se situer dans une fourchette de 50 à 60 dollars ; c’est le niveau sur lequel tablent les pays producteurs pour 2017. Toutefois, si les pétroles de schiste américains arrivent de nouveau massivement sur le marché, les prix risquent de baisser derechef.
Compte tenu de sa très forte dépendance à l’égard des recettes pétrolières, l’Azerbaïdjan traverse une crise économique assez marquée. Le pays est en récession : d’après un rapport publié par le Fonds monétaire international (FMI) il y a quelques semaines, le taux de croissance sera négatif en 2016, entre -2 % et -3 %. L’inflation s’élève à environ 8 %, et la monnaie a été dévaluée. Les autorités ont puisé quelques milliards de dollars dans le fonds souverain pour les injecter dans l’économie et la stabiliser. L’encours du fonds SOFAZ s’établit aujourd’hui à environ 33 milliards de dollars, contre 37 milliards en 2015. Signalons un élément intéressant mentionné dans le rapport du FMI : à la différence d’autres pays producteurs de pétroles tels que l’Algérie et l’Arabie saoudite, qui diminuent les salaires des fonctionnaires et les dépenses sociales, l’Azerbaïdjan essaie de mener une politique contracyclique en augmentant légèrement ces dépenses.
M. le président François Rochebloine. C’est ce que nous ont dit l’ambassadrice de France à Bakou et l’ambassadeur d’Azerbaïdjan à Paris.
Mme Marie-Claire Aoun. Cette politique contracyclique est plutôt saluée par les institutions internationales, mais son effet reste très limité.
Les pays producteurs de pétrole, à l’exception, peut-être, de la Norvège, ne parviennent pas à diversifier leur économie et restent extrêmement dépendants de la rente pétrolière. C’est le cas de l’Azerbaïdjan.
L’échec des politiques de diversification s’explique par une série de mécanismes économiques. Selon une théorie largement diffusée dans la littérature de l’économie politique, les ressources pétrolières permettent de retarder toute réforme démocratique dans ces pays. Dans les périodes où les cours du pétrole sont élevés, on redistribue la rente pétrolière à la population : on augmente fortement les dépenses sociales, les salaires des fonctionnaires et les primes, on finance un système largement fondé sur le secteur public et on parvient ainsi à calmer les revendications démocratiques. Dans ces conditions, on n’arrive pas à développer les secteurs qui créent de la valeur ajoutée. Inversement, l’absence ou le déficit de démocratie a un impact négatif sur la croissance économique – ce que certains exemples semblent confirmer, mais d’autres non : on peut notamment penser à la Chine. En tout cas, la rente pétrolière conforte les régimes en place, ainsi que nous pouvons le constater dans les pays du Moyen-Orient. Dans les périodes où les cours sont bas, comme ces deux dernières années, ces régimes se sentent parfois déstabilisés parce qu’ils n’ont plus les moyens d’apaiser les revendications démocratiques.
Selon cette même théorie, la rente pétrolière alimente aussi la corruption. Je n’ai pas étudié de manière précise le cas de l’Azerbaïdjan de ce point de vue. Quoi qu’il en soit, la situation s’est très sensiblement améliorée au cours des dernières années : il y a désormais une transparence accrue dans l’industrie pétrolière, et les initiatives visant à rendre les revenus pétroliers plus transparents se sont multipliées. Les compagnies pétrolières sont désormais obligées de rendre publiques toutes les sommes qu’elles versent aux États, ceux-ci étant pour leur part obligés de rendre publiques toutes les sommes qu’ils reçoivent. Le respect de ces exigences fait partie des critères appliqués par les institutions internationales lorsqu’elles accordent des prêts. L’Azerbaïdjan s’inscrit lui aussi dans ce mouvement de transparence accrue. Son fonds souverain n’est pas nécessairement un modèle de transparence, mais il est considéré comme un exemple de bonne gestion des revenus pétroliers, ce qui est assez unique dans le paysage des pays producteurs de pétrole.
Pour en revenir au potentiel pétrolier de l’Azerbaïdjan, n’oublions pas que nous sommes dans un contexte d’épuisement des ressources pétrolières à long terme. Dès lors, ainsi que le souligne le récent rapport du FMI, il est urgent que l’Azerbaïdjan engage des réformes pour diversifier son économie et créer de nouvelles sources de revenus, à plus forte raison dans le contexte actuel de faibles prix du pétrole.
Je préfère ne pas m’exprimer sur les points plus précis que vous avez soulevés concernant l’Azerbaïdjan, monsieur le président, car ils ne relèvent pas de mon domaine de compétence.
M. le président François Rochebloine. Merci beaucoup, madame, d’avoir accepté notre invitation et d’avoir répondu à nos questions.
*
* *
Ÿ Audition de Mme Claire Mouradian, directrice de recherche au CNRS, et de M. Stéphane de Tapia, directeur du département d’études turques de l’université de Strasbourg (jeudi 15 décembre 2016)
M. le président François Rochebloine. Mes chers collègues, nous concluons aujourd’hui notre série d’auditions d’experts en géopolitique et en histoire en recevant Mme Claire Mouradian, directrice de recherches au CNRS, et M. Stéphane de Tapia, géographe, chef du département d’études turques de l’université de Strasbourg.
Mme Mouradian est responsable depuis de nombreuses années du séminaire de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) intitulé « Le Caucase entre les empires (XVIe-XXIe siècle) ». Impact des enjeux régionaux et des pratiques impériales sur les peuples, les États et les sociétés du Caucase ». Parmi les ouvrages de M. de Tapia, je relève un livre au titre évocateur : La Turquie entre quatre mondes. Nos invités nous offrent ainsi la chance de pouvoir disposer de deux regards complémentaires : celui d’une historienne et celui d’un géographe, le premier davantage centré sur les États du Caucase du Sud, le second sur l’influence, extérieure à la région mais essentielle, de la Turquie.
Comme vous le savez, notre mission a pour objet l’évaluation des rapports entre la France et l’Azerbaïdjan, considérés non seulement en eux-mêmes mais aussi dans le contexte compliqué des relations internationales, c’est-à-dire de l’équilibre des forces, dans le Caucase du Sud. À travers les auditions que nous avons déjà réalisées commence à se dessiner un panorama documenté des échanges économiques et culturels officiels avec l’Azerbaïdjan. Nous avons également enregistré la dénonciation, non réfutée – sauf par l’ambassadeur d’Azerbaïdjan, mais celui-ci est bien sûr dans son rôle –, de pratiques contraires aux droits de l’Homme dans ce pays. On a cependant moins parlé, pour l’instant, sauf en termes généraux, des pratiques « généreuses » du régime azéri et de ses instances satellites.
Nous avons souhaité disposer d’une mise en perspective historique et géographique du cadre dans lequel s’inscrivent les relations bilatérales entre Paris et Bakou. Pouvez-vous donc, madame, monsieur, nous décrire les facteurs proches – constitution de la réalité politique de l’Azerbaïdjan et état de sa société politique, héritages et survivances de l’époque soviétique – et plus lointains – données géopolitiques des rapports de puissance qui s’exercent sur ce pays et leurs conséquences sur sa politique intérieure et extérieure, en particulier avec la Turquie – qui expliquent le comportement des dirigeants de Bakou et l’attitude, à l’égard de ce pays, de la communauté internationale et des États pris individuellement, dont la France ?
Au terme de vos exposés, nous passerons aux questions des membres de la mission, peu nombreux cet après-midi en raison de la discussion budgétaire qui se poursuit en séance publique.
Je voudrais, en terminant, vous prier d’excuser l’absence de notre rapporteur, Jean-Louis Destans, qui ne peut donc être des nôtres pour les auditions de la fin de l’année 2016.
Mme Claire Mouradian, directrice de recherche au CNRS. Tout d’abord, je vous remercie pour cette invitation et pour l’attention que vous voudrez bien m’accorder. Historienne, spécialiste de l’Arménie et du Caucase, j’ai pour sujet d’étude, depuis une quarantaine d’années, la question des nationalités dans les empires russo-soviétique et ottoman. Si mes premiers travaux ont porté sur l’Arménie à l’époque soviétique, j’ai considéré, dès le début, que l’on ne pouvait traiter cette histoire de façon ethno-centrée, sans la replacer dans un contexte plus large, à la fois régional, impérial et international, en relation avec l’histoire des peuples voisins et des ensembles impériaux dont ils faisaient partie. D’où la création de ce séminaire de recherche à l’EHESS, qui a pour objet de tenter de faire dialoguer les histoires nationales et peut-être, au-delà, les nations elles-mêmes et de sortir de ce que l’on pourrait appeler le « malheur caucasien », en référence au titre de l’ouvrage d’Hélène Carrère d’Encausse, Le Malheur russe. Essai sur le meurtre politique, qui fait des violences liées aux successions le moteur de l’histoire russe. Alors que certaines tendances de l’historiographie visent à réhabiliter les empires et l’ordre impérial après les avoir fustigés à l’heure de la décolonisation, il me semble utile de ne pas totalement oublier les conséquences que les idéologies et pratiques des empires, notamment le principe classique « Diviser pour mieux régner », ainsi que les guerres pour le partage des zones d’influence à leurs marges, ont eues sur les peuples locaux.
Dans son Histoire ancienne des peuples de l’Orient classique, Gaston Maspero, l’éminent égyptologue français, écrivait en 1897 : « Certaines contrées semblent prédestinées dès l’origine à n’être que des champs de bataille disputés sans cesse entre les nations. C’est chez elles et à leurs dépens que leurs voisins viennent vider, de siècle en siècle, les querelles et les questions de primauté qui agitent leur coin du monde. On s’en jalouse la possession, on se les arrache lambeau à lambeau, la guerre les foule et les démembre : tout au plus leurs peuples peuvent-ils prendre parti, se joindre à l’un des ennemis qui les écrasent, et l’aidant à triompher des autres, rendre du même coup leur servitude assurée pour longtemps. Un hasard inespéré oblige-t-il enfin leur seigneur étranger à les délivrer de sa présence, ils se montrent incapables de mettre à profit le répit que la fortune leur accorde, et de s’organiser efficacement en vue des attaques futures. Ils se divisent en cent communautés rivales dont la moindre prétend demeurer autonome, et entretient une guerre perpétuelle sur ses frontières, pour conquérir ou pour conserver la souveraineté glorieuse de quelques arpents de blé dans la plaine ou de quelques ravins boisés dans la montagne. C’est, pendant des années, une mêlée sanglante, où de petites armées se livrent de petits combats pour la défense de petits intérêts, mais si rudement et d’un acharnement si furieux que le pays en souffre autant et plus que d’une invasion. Ils ne font trêve à leurs luttes que sous un maître venu du dehors, et ils ne vivent d’une vie personnelle que dans l’intervalle de deux conquêtes : leur histoire s’absorbe presque entière dans celle de plusieurs autres peuples. »
Cette citation résume bien, je pense, le sort de la région, hier et aujourd’hui, et le cadre dans lequel s’insèrent les relations de l’Azerbaïdjan et de ses voisins avec les empires, anciens et actuels, dont ils ont fait partie ou tentent de sortir. Comme les territoires de ses voisins arméniens et géorgiens – et au-delà de quelques variations liées à l’emplacement, à la topographie ou à la composition ethnique et religieuse –, celui de l’actuel Azerbaïdjan n’échappe pas à cette situation de champ de bataille permanent.
Si ces trois pays ont une grande part d’histoire commune, des enjeux et des ennemis communs, la hiérarchie de ces enjeux et de ces ennemis est différente pour chacun, et c’est probablement l’une des principales sources de leurs conflits.
L’identité des Arméniens est fondée sur une langue dotée de son alphabet propre dès le ve siècle, sur une Église nationale, sur la mémoire d’un passé ancien, des heures sombres comme des âges d’or, dont le récit se retrouve aussi bien dans les chroniques nationales que dans les chroniques assyriennes, perses, grecques ou romaines, et sur les cartes géographiques. Pour eux, le principal enjeu n’est donc pas identitaire.
La population arménienne, notamment celle de Tabriz et du Nakhitchevan, voire celle de Crimée, a connu des siècles de déplacements forcés. Elle a subi des massacres, dont les plus récents datent de la fin du xixe siècle et, bien sûr, de 1915.
M. le président François Rochebloine. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur le Nakhitchevan ?
Mme Claire Mouradian. Historiquement, le Nakhitchevan est une province de l’Arménie – cette assertion m’a valu d’être accusée dans la presse azérie de falsifier l’histoire, mais les faits sont là. Lors des guerres ottomano-persanes des XVIe-XVIIe siècles, la population arménienne de Tabriz, dans ce que l’on appelait encore la Persarménie, a été déplacée par le sultan ottoman vers Constantinople. Puis celle du Nakhitchevan, autour de Djoulfa, a été déplacée par le shah à son tour vers Ispahan, la capitale de l’Iran de l’époque, et remplacée par des tribus kurdes et turkmènes notamment, comme gardes-frontières. Ces déplacements étaient une pratique régulière des empires ; ils relevaient d’une politique de la terre brûlée, sans visée exterminatrice. Après la conquête russe, les Arméniens sont revenus au Nakhitchevan ; en 1914, ils constituaient encore la moitié de la population de cette région. Mais ils ont souffert de la Première Guerre mondiale et des guerres territoriales des premières indépendances, de sorte qu’à l’issue de ces conflits, ils ont disparu de la région, qui n’est plus peuplée aujourd’hui que d’Azéris.
M. le président François Rochebloine. Combien sont-ils aujourd’hui ?
Mme Claire Mouradian. Entre 150 000 et 180 000, mais l’émigration vers la Turquie est très importante. En outre, les traces de la présence arménienne ont été effacées en 2005 avec la destruction du cimetière de Djoulfa.
Ces déplacements et ces massacres, puis le génocide de 1915, ont contribué à la dispersion des Arméniens, dont plus des deux tiers vivent actuellement en dehors de l’actuelle République d’Arménie. Pour celle-ci, le premier enjeu est donc la survie dans un environnement « hostile ». C’est également vrai pour la diaspora, du reste, comme en témoigne le sort des Arméniens de Syrie et d’Irak, aujourd’hui forcés à l’exil. Le second enjeu, bien sûr lié au premier, est la sanctuarisation d’un territoire résiduel. Il s’agit, pour les Arméniens, de conserver l’Arménie actuelle, qui représente 10 % du territoire considéré comme historique et un quart de l’Arménie du traité de Sèvres.
Pour les Azéris – et j’utilise ce terme à dessein, plutôt que celui d’Azerbaïdjanais, qui désigne aussi des citoyens d’autres nationalités : Russes, Lezguines, Talyshs, Kurdes, Juifs –, l’enjeu est différent. Il faut rappeler que le nom du pays lui-même n’est pas un ethnonyme, à la différence de celui des autres États de la région. Il est en effet dérivé du nom d’Adropâtes, un satrape mède de l’empire achéménide qui, en se ralliant à Alexandre le Grand lors de la bataille de Gaugamélès, en l’an 331 avant Jésus-Christ, gagna le droit de fonder un royaume indépendant et une dynastie qui durera deux siècles. Ainsi, l’enjeu, pour les Azéris, est d’abord identitaire.
De fait, l’identité azérie est écartelée entre plusieurs mondes dont elle se revendique. Le monde iranien, d’abord. Il ne faut pas oublier que l’Iran, puissance hégémonique pendant vingt-cinq siècles, a déterminé la religion – du zoroastrisme antique, peut-être né à Bakou, au christianisme nestorien ou albanien du Caucase, puis à l’islam chiite – et la culture des élites, qui, jusqu’à l’aube du XXe siècle, se revendiquaient du monde persan plutôt que du monde turc, considéré comme moins prestigieux. Ainsi, la question s’est posée, lors de l’émergence du mouvement national au xixe siècle, du choix de la langue : fallait-il choisir le persan ou le turc ?
Le monde turc, ensuite : la turquisation linguistique est allée croissant à partir des invasions seldjoukides au XI siècle.
Le monde caucasien, dont les Azéris partagent nombre de coutumes et de valeurs.
Le monde russo-soviétique, depuis l’annexion du Nord de la province de l’Azerbaïdjan iranien au début du xixe siècle
De ce fait, l’identité des Azéris s’est construite, comme celle des Turcs, de façon négative et exclusive principalement contre leurs voisins les plus proches, les Arméniens. Ceux-ci sont enviés pour leur succès économique – à Bakou, les pétroliers Mantachev, Ghougassiantz, Mirzoyan, ont contribué à la fortune de la ville – et pour leur proximité supposée avec le pouvoir tsariste chrétien, ce qui est très discutable.
Le second enjeu, pour les Azéris, est la construction d’un État souverain. Le territoire de l’actuelle République d’Azerbaïdjan n’a longtemps existé que comme une province du Nord de l’Iran – dotée d’un statut d’autonomie variable et dont l’essentiel du territoire et de la population est resté en Iran –, sans réelle revendication séparatiste. De fait, les Azéris d’Iran dominent le pouvoir politique et la vie économique du Bazar. Khomeyni et d’autres grands mollahs sont d’origine azérie.
M. le président François Rochebloine. Khomeyni était d’origine azérie ?
M. Stéphane de Tapia, directeur du département d’études turques de l’université de Strasbourg. Il était persan, mais originaire d’une région proche de l’Azerbaïdjan. Cependant, d’autres sont en effet d’origine azérie.
Mme Claire Mouradian. De fait, Tabriz, chef-lieu de la province iranienne, était la capitale du prince héritier. Elle a connu un certain déclin, d’abord après la conquête russe du Caucase et le déplacement forcé des Arméniens et d’autres populations que les Russes ont tenté de ramener vers le Caucase russe pour créer une ceinture de sécurité. Les mouvements de population ont été nombreux ; d’où les conflits actuels pour déterminer les limites du territoire des uns et des autres.
Le premier État azéri apparaît le 28 mai 1918, en même temps que les Républiques d’Arménie et de Géorgie, lors de l’éclatement de l’empire tsariste, et prend le nom de République démocratique d’Azerbaïdjan du Caucase. En effet, lors de la Conférence de la paix, les Iraniens s’opposent au choix de la dénomination « République d’Azerbaïdjan » – pour des raisons analogues à celles des Grecs lorsqu’ils ont refusé que la Macédoine se nomme République de Macédoine. Comme l’Arménie, l’Azerbaïdjan n’est reconnu que de facto par la Conférence de la paix et par la Société des Nations (SDN), car elle a été soviétisée dès avril 1920, après avoir été le théâtre de batailles entre Ottomans et Britanniques.
Si l’Empire ottoman reconnaît tout de suite la République d’Azerbaïdjan, comme il reconnaît l’Arménie et la Géorgie, des difficultés surgissent du côté de l’Iran. Le problème de ce nouvel État est celui de la définition de ses frontières, après les délimitations administratives successives, variées et arbitraires, des empires qui ont dominé la région : empires arabe, persan, russe. En la matière, les enjeux sont différents pour les Azéris et les Arméniens, les premiers faisant plutôt référence à une base économico-administrative, les seconds au principe ethnique.
M. le président François Rochebloine. À l’époque !
Mme Claire Mouradian. En 1918-1920, comme on le voit dans les textes et les cartes déposés à la Conférence de la paix, mais c’est encore vrai aujourd’hui, d’une certaine façon.
M. le président François Rochebloine. Il est important de rappeler qu’à cette époque l’Arménie a été découpée.
Mme Claire Mouradian. En 1918-1920, lors des premières indépendances, après des guerres territoriales entre les trois républiques, la Russie a fini par définir les frontières avec la Turquie dans un accord conclu en 1921 entre Mustafa Kemal et Lénine, qui n’étaient alors, ni l’un ni l’autre, reconnus par la communauté internationale. Ils ont tenté d’empêcher les Alliés franco-britanniques victorieux, de se mêler des frontières de la région, disputées par les nouveaux États indépendants, soit, comme je le disais, au nom du principe ethnique, soit au nom du principe administratif précédent, chacun utilisant les arguments qui lui paraissaient les plus favorables.
Lors de la soviétisation, les frontières intérieures sont délimitées en fonction non seulement du rapport de force issu des guerres mais aussi de l’intérêt de la révolution, qui est alors de séduire les musulmans. Ainsi, l’Azerbaïdjan, soviétisé en avril 1920, accueille dès septembre, à Bakou, le premier Congrès des peuples de l’Orient, le troisième congrès de l’Internationale communiste. Il s’agit alors, pour les bolcheviks, de témoigner de leur intérêt pour le monde musulman et d’agiter les colonies musulmanes contre les empires : russe, en Asie centrale ; britannique, en Inde (dans l’actuel Pakistan), et français.
Selon moi, les conflits actuels sont plutôt « post-coloniaux » ou « post-impériaux » qu’ethniques. Ils s’appuient, en effet, soit sur une argumentation ethnique, archéologique et historique, pour les Arméniens – les premières églises datent du IVe et du Ve siècles, alors que les premières mosquées n’apparaissent qu’à la fin du xviie siècle et datent principalement du xixe siècle –, soit sur une argumentation économico-administrative en allant jusqu’à effacer les traces de la présence ancienne de l’adversaire.
Pendant la période soviétique, l’Azerbaïdjan a vécu au même rythme que les autres républiques nationales, subissant les mêmes influences et les mêmes politiques centrales : purges, terreur, économie étatisée... La République socialiste d’Azerbaïdjan a peut-être fait montre d’une plus grande loyauté envers Moscou, du fait notamment de la présence d’une population russe assez importante liée à l’industrie pétrolière. Par ailleurs, elle n’a pas été trop maltraitée en raison de la politique musulmane de Moscou, même si les révolutionnaires étaient plus nombreux chez les voisins géorgiens et arméniens. Les Azéris se rattraperont cependant par la suite. Ainsi, Heydar Aliev sera chef du KGB en Azerbaïdjan, puis Premier secrétaire du Parti communiste de cette république, et enfin membre du Politburo sous Brejnev ; il perdra la faveur du centre sous Gorbatchev.
Pendant la période soviétique, les républiques utilisèrent les minces marges d’autonomie dont elles disposaient dans l’application des directives centrales entre autres pour se débarrasser de leurs ethnies « encombrantes ». Ce fut le cas aussi bien en Géorgie qu’en Arménie et en Azerbaïdjan, même si, plus dispersés, les Arméniens étaient davantage exposés aux répressions. Un de mes collègues démographes a ainsi montré qu’au goulag, ils étaient deux fois plus nombreux que les Géorgiens et les Azerbaïdjanais.
Lors de la Perestroïka, l’Azerbaïdjan entrera plus tardivement dans le mouvement de démocratisation et d’émancipation nationale, et ce mouvement s’en prendra d’abord aux Arméniens revendiquant le rattachement du Karabagh à l’Arménie, avant de se tourner contre le pouvoir soviétique central. Celui-ci laissera des pogroms se dérouler à Soumgaït, Kirovabad et Bakou mais réagira, lors du « Janvier noir », lorsque la foule s’en prendra au siège du comité central. Cet épisode illustre l’ambiguïté du pouvoir soviétique qui, comme les régimes précédents, a joué un nationalisme contre l’autre. Ce fut aussi le cas lors de la révolution de 1905 au Caucase, ce qui fit dériver les conflits sociaux vers des conflits interethniques, lors de la soviétisation et hâta la victoire de l’Armée rouge, et à la fin du régime. Et, selon moi, c’est encore vrai actuellement : l’attitude de Moscou est supposée favorable aux Arméniens, mais cela peut se discuter.
Ayant lu les comptes rendus des auditions précédentes, je souhaiterais apporter une rectification concernant les territoires dits occupés de l’Azerbaïdjan. On parle toujours de 20 %. Or, la superficie de l’ensemble des districts concernés est de 7 500 kilomètres carrés, soit, même si l’on y ajoute les 4 400 kilomètres carrés du Haut-Karabagh, 14 % du territoire. Quant à la population déplacée, on parle d’1 million de personnes. Mais, si l’on ajoute les 160 000 Azéris d’Arménie à la population totale des districts en question telle qu’évaluée en 1989, on arrive à 600 000 ou 620 000 personnes. Certes, ce sont autant de malheureux, mais il me semblait important d’apporter cette rectification. Par ailleurs, les 475 000 Arméniens d’Azerbaïdjan, notamment de Bakou, ont également tous été chassés, sauf ceux du Haut-Karabagh.
M. Jean-François Mancel. Il y a encore beaucoup d’Arméniens à Bakou !
Mme Claire Mouradian. Ils sont 40 000 à 50 000, et encore : ce sont des personnes issues de mariages mixtes. Dans l’ensemble de l’Azerbaïdjan, leur nombre est passé de 475 000 en 1989 à 120 000, y compris la population du Haut-Karabagh, selon le recensement de 2010. Il reste également quelques Azéris en Arménie, mais on a peu parlé des réfugiés arméniens.
M. le président François Rochebloine. Il est important que vous nous rappeliez les chiffres. Nous avons auditionné de nombreuses personnes ; chacun a sa vérité. Mais il est intéressant que vous évoquiez le chiffre de 14 % s’agissant des territoires occupés.
Mme Claire Mouradian. En comptant le Haut-Karabagh ; sans celui-ci, c’est moins de 10 %.
M. le président François Rochebloine. Quant aux personnes, vous avez indiqué que 450 000 Arméniens d’Azerbaïdjan avaient été déplacés, de sorte que ceux-ci ne seraient plus aujourd’hui qu’environ 50 000. Par ailleurs, vous évoquez, côté azéri, 620 000 personnes déplacées, alors qu’habituellement, on entend plutôt parler de 700 000 ou de 900 000 personnes.
Mme Claire Mouradian. Les chiffres que je cite sont ceux du recensement.
M. le président François Rochebloine. Les chiffres sont ce qu’ils sont ; il ne faut pas les manipuler. Ce que je souhaite, c’est que nous mentionnions dans notre rapport les chiffres véritables, ceux qui sont établis par les recensements.
Mme Claire Mouradian. L’autre point important est la hiérarchie des « ennemis », qui détermine aussi les antagonismes. Si l’on peut dire que les trois nations du Caucase du Sud ont les mêmes ennemis, à savoir les grandes puissances impériales voisines – Turquie, Russie, Iran –, l’ennemi n° 1 reste, pour l’Arménie, la Turquie, pour des raisons que l’on peut comprendre, alors que, pour l’Azerbaïdjan, il s’agit de la Russie. L’Iran occupe sans doute la deuxième position pour l’un et pour l’autre. Chassé par les Ottomans, puis par la Russie tsariste, qui en a fait une sorte de protectorat, l’Iran essaie de revenir dans le jeu régional. La conquête russe a réuni l’essentiel des territoires « géorgiens » – l’enjeu, pour la Géorgie, est donc de sortir de l’empire en conservant tout – alors qu’elle a divisé la province d’Azerbaïdjan en deux et l’Arménie en trois. Quant aux éventuels soutiens extérieurs, ils sont plus ou moins les mêmes qu’en 1918-1920 : les Anglais, aujourd’hui remplacés par les Américains, pour l’Azerbaïdjan ; les Français pour l’Arménie ; les Allemands ou les Américains pour la Géorgie.
Pour comprendre le rôle de la Russie, il faut remonter au début du xixe siècle, époque à laquelle elle a annexé ces régions. Toutefois, l’Empire russe apparaît pour la première fois au Caucase dès le milieu du XVIe siècle, sous Ivan IV – le fameux « Ivan le Terrible ». En effet, en 1556, au lendemain de la conquête du khanat d’Astrakhan, situé à l’embouchure de la Volga, sur la Caspienne, la flotte russe traverse la mer et construit un premier fortin sur les rives du Terek. Ivan IV épouse une princesse kabarde, c’est-à-dire tcherkesse, et commence à s’immiscer dans les affaires régionales, en protecteur des anciens clients du khanat d’Astrakhan, sous la tutelle de la Perse, contre ceux du khanat de Crimée, sous la tutelle ottomane. Il est évident que la Russie n’entend pas « lâcher » en cinq ans ou même quinze ans ce qu’elle a mis cinq siècles à conquérir – un ancien empire ou un ancien État n’oublie jamais qu’il a été empire ou État. La Russie continuera donc probablement de jouer l’équilibre entre les nations ou un nationalisme contre l’autre.
M. Stéphane de Tapia, directeur du département d’études turques de l’université de Strasbourg. Il n’est pas question, pour moi, de paraphraser, ici, ce qui a été dit par les personnes que votre mission d’information parlementaire a déjà entendues, en particulier leurs Excellences l’ambassadrice Aurélia Bouchez et l’ambassadeur Elçin Amirbayov ou, aujourd’hui, ma collègue Mme Claire Mouradian.
Enseignant-chercheur universitaire, professeur de civilisation turque après avoir été chargé de recherche puis directeur de recherche au CNRS jusqu’à 2014, je connais l’Azerbaïdjan en tant que territoire peuplé en grande partie, mais pas exclusivement, de populations turcophones, même si la langue officielle y est le turc d’Azerbaïdjan, l’azәrbaycanca ou azerbaïdjanais. Je n’ai pu me rendre en Azerbaïdjan qu’assez récemment. La première fois, il y a une dizaine d’années, j’avais été invité par l’Université slave de Bakou, suite à l’invitation à Strasbourg, par notre département, du recteur de cette université. Je m’y suis rendu une deuxième fois, pour un colloque international à l’Université privée Xәzәr, auquel s’est ajoutée une demande de prestation, à savoir la correction du texte français d’un ouvrage de prestige, Azerbaïdjan, édité par la fondation Heydar Aliev. Enfin, je suis allé en Azerbaïdjan en tant que membre des délégations universitaires françaises chargées, à la demande des présidents François Hollande et İlham Aliev, de construire avec le ministère azerbaïdjanais de l’Éducation nationale, l’Université franco-azerbaïdjanaise (UFAZ). En effet, l’université de Strasbourg, sous la responsabilité de son président, M. Alain Beretz, de son vice-président chargé des relations internationales, M. Francis Kern, et de M. Eckhart Hötzel, directeur de l’Institut de traducteurs, d’interprètes et de relations internationales (ITIRI), a joué un rôle moteur dans ce projet. Nous avons ainsi reçu, en juillet dernier, le ministre Mikayil Jabbarov, accompagné du recteur Mustafa Babanlı et d’une importante délégation officielle.
Dans le cadre de mes fonctions de directeur de recherche, puis de professeur-directeur du département d’études turques, je rencontre souvent des étudiants azerbaïdjanais, le plus souvent du Nord – şimali Azerbaycan –, moins souvent du Sud – cenubi ou güney Azerbaycan –, pour reprendre une terminologie, assez courante dans les deux Azerbaïdjan et en Turquie, qui souligne clairement une position irrédentiste. Les échanges ont lieu principalement en français – langue des études –, en turc – langue que manient facilement les étudiants de Bakou ou de Tabriz – et en azéri. Cette langue est en effet assez facile à utiliser pour qui est déjà turcophone, mais il est indéniable que les Azerbaïdjanais s’adaptent bien mieux au turc que les Turcs à l’azerbaïdjanais. Ces étudiants, dont le nombre est en augmentation constante à Strasbourg, sont inscrits en licence, master ou doctorat. Ils proviennent de facultés diverses, ont grandement facilité les relations avec la Représentation permanente de la République d’Azerbaïdjan auprès du Conseil de l’Europe et sont souvent très proches des étudiants turcs, venus de Turquie ou enfants de l’immigration turque en France. Nous avions du reste créé, à Strasbourg, une éphémère Maison de l’Azerbaïdjan, qui a fini par se disloquer pour des raisons diverses, alors qu’elle avait à son actif l’organisation de quelques manifestations intéressantes et présentait l’avantage de regrouper des Azerbaïdjanais de Bakou, de Tabriz et de Téhéran, de Turquie, de Russie, ainsi que quelques sympathisants français.
M. président François Rochebloine. Pour quelles raisons cette Maison de l’Azerbaïdjan a-t-elle dû fermer ?
M. Stéphane de Tapia. Pour des raisons internes, très politiques et liées notamment, mais pas uniquement, à l’Azerbaïdjan lui-même.
La présence à Strasbourg, depuis 2005, de la Représentation permanente de la République d’Azerbaïdjan auprès du Conseil de l’Europe, souvent active dans le domaine culturel, aura sans doute influencé le choix de Bakou de demander à l’université de Strasbourg de jouer un rôle moteur dans la création de l’UFAZ. Mais la création de la chaire Nizamî de Gandja à l’Université de Mulhouse-Haute Alsace n’a, en pratique, aucun lien avec cette opération.
Cette introduction très personnelle a surtout pour objectif de montrer que, pour nous, la présence azerbaïdjanaise est quasi-quotidienne. Du reste, l’ancienne directrice de notre département, Mme Irène Mélikoff, avec qui j’ai appris le turc, était elle-même d’origine russo-azerbaïdjanaise, née à Saint-Pétersbourg. Elle fut la première – nous étions encore, alors, à l’époque soviétique – à organiser un colloque franco-azerbaïdjanais à Strasbourg. J’y avais d’ailleurs rencontré l’ambassadeur soviétique auprès de l’UNESCO, M. Ramiz Abutalybov, qui, vingt années plus tard, me souhaitera la bienvenue à Bakou.
À propos de l’Azerbaïdjan lui-même, je commencerai par revenir sur un slogan politique énoncé par le président Heydar Aliev : bir millet, iki dövlet – « une nation, deux États ». Ce slogan illustre parfaitement la très grande proximité de deux nations-sœurs ou de deux peuples-frères – voire trois, si l’on inclut l’Azerbaïdjan iranien – séparés pourtant de longue date. Cette proximité, d’abord linguistique – très comparable à celle qui unit les Français et les Québécois, les Wallons ou les Suisses francophones –, est cependant parfois ambiguë, ne serait-ce que parce que les deux populations sont, majoritairement, de confession sunnite pour les Turcs, chiite pour les Azéris.
Il convient ensuite de mentionner deux fractures historiques. La première correspond à la délimitation, après la bataille de Çaldıran, en 1514, et le traité de Kasr-i Şirin, ou Zuhab, en 1639, de la frontière ottomano-séfévide, qui est l’une des plus stables, sinon la plus stable, du Moyen-Orient. Le second événement a inspiré, en 1957, l’écriture d’une chanson, intitulée Ayrılık, qui fait désormais partie de la tradition musicale des trois pays, où elle a été interprétée par les artistes les plus connus. Parfois comprise en Turquie comme le récit d’une séparation amoureuse, cette chanson évoque en fait la cassure provoquée par les traités de Gülistan et de Türkmençay, signés respectivement en 1813 et en 1828 entre l’Iran des Kadjars, dynastie azerbaïdjanaise, et la Russie des Romanov. Son compositeur, victime de Staline, s’était d’ailleurs réfugié en Iran.
Le slogan Bir millet, iki dövlet souligne une proximité linguistique réelle, puisque trois langues modernes – le turc, l’azéri et le turkmène – sont issues de la langue turque occidentale, nommée oğuz par les linguistes. Compte non tenu de minorités souvent bilingues, comme les Kurdes de Turquie ou les Lezgi d’Azerbaïdjan, leurs locuteurs sont au nombre de 80 millions en Turquie, de 9 millions en Azerbaïdjan, de 20 millions en Iran et de 5 millions au Turkménistan, et ils appartiennent à au moins quatre ou cinq États indépendants – y compris l’Afghanistan –, dont trois sont officiellement turcophones et membres de divers organismes de coopération, souvent créés sur l’initiative de la Turquie à partir de 1989-1992, sous la présidence de Turgut Özal.
Les ambiguïtés sont cependant très nombreuses. La principale d’entre elles est liée à la confession professée, dans un contexte où les laïcités sont assez différentes : l’une, davantage turco-ottomane que française – comme on aime à le dire, à tort –, l’autre plus « turco-mongolo-sino-russe », revue à la soviétique par Staline et conservée par les nouveaux États indépendants turcophones, dont les populations sont en majorité de cultures et de confessions musulmanes.
On relève ensuite des divergences au plan politique et idéologique entre les panturquismes, les eurasismes et les turquismes locaux. Les acteurs et agents turcs, souvent encouragés par les administrations américaines ou européennes, se sont engouffrés dans le vide laissé par la dislocation de l’URSS, mais ils l’ont fait sans préparation, en tout cas sans une réflexion de fond suffisante. Ainsi, ils ont méconnu les contextes locaux, notamment le caractère singulier de dirigeants à très forte personnalité – qu’il s’agisse du président kazakh Nursultan Nazarbayev, du président ouzbek Islam Karimov, du président turkmène Saparmurat Niyazov, du président kirghize Askar Akayev ou des présidents azerbaïdjanais successifs, Ebulfaz Elçibey, très proche de la Turquie, Heydar Aliev et son fils Ilham Aliev – et les réalités sociopolitiques des terrains caucasiens, turkestanais ou russo-sibériens. De fait, l’empire ottoman n’a été présent que très rarement, et par intermittence, dans la région sous domination russe puis soviétique, même dans l’Azerbaïdjan tout proche, et il a été presque totalement absent en Asie centrale et en Haute-Asie jusqu’à la fin du xixe siècle. Les barrières persanes, donc chiites, et russes, avec les Romanov puis les Soviétiques, ont joué un rôle capital dans cette fracture et cette méconnaissance réciproque. Néanmoins, les panturquistes des deux espaces ont eu des contacts denses et riches à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, de sorte que l’on peut dire, à l’instar de François Georgeon, que le nationalisme turc est né sur les rives de la Volga et non sur celles du Bosphore... Ces contacts limités et tardifs, mais riches, ont été de très courte durée, contrairement à ce qui est souvent avancé.
Les intellectuels azéris y ont pris une part importante ; je pense notamment à Akhundzade, Hüseynzade, Mehmet Emin Resulzade ou Ali Mardan Topçubaşev. Connaissant les langues classiques – le turc, l’arabe et le persan – et modernes – le russe, mais aussi le français, l’anglais et l’allemand –, ces intellectuels de haut niveau étaient modernistes, démocrates, dans le contexte qui était le leur, et très ouverts sur l’extérieur. Mais l’émergence du stalinisme, d’un côté, et du nazisme, de l’autre, a profondément changé la donne : ces éléments ont souvent été forcés de s’exiler – en Turquie, en Allemagne ou en France –, laissant place à un panturquisme hypernationaliste, fortement teinté d’islamisme et de racisme, qui fut ouvertement instrumentalisé par l’administration américaine après 1945. En Turquie, cela s’est traduit par l’apparition du Parti de l’action nationaliste, le MHP – Milliyetçi Hareket Partisi, « parti du mouvement national » – et du groupe dit des « idéalistes » – Ülküçüler –, plus connus en Occident sous le nom de « Loups gris ». Plus tard, sous la présidence de Turgut Özal, naîtra le Büyük Birlik Partisi (BBP) – « parti de la grande union » –, lié aux Alperen Oçakları, tentative de récupération islamiste du panturquisme qui, au vu de la situation actuelle, a plutôt réussi.
En résumé, on est donc passé progressivement, des années 1890-1920 aux années 1940-1990, d’un panturquisme plutôt moderniste et relativement modéré – mais prenant des accents nationalistes dès qu’il est question de la concurrence turco-arménienne – à un panturquisme réactionnaire et fascisant. Ainsi, dans la Turquie des années 1950-1990, on ne parle plus que des esir Türkler ou des esaretteki Türkler, les « Turcs prisonniers » – entendre : « prisonniers du communisme ». Toutefois, l’État turc limite très sérieusement les activités des panturquistes, privilégiant la doctrine kémaliste de l’État nation, dans un contexte où le seul État turcophone indépendant est la République de Turquie. Ceci explique largement les incompréhensions entre, d’une part, les aspirations de la Turquie à jouer un rôle de leader dans la région et, d’autre part, celles des peuples turcophones, qui cherchaient plutôt, quant à eux, à obtenir davantage de libertés individuelles et collectives et à se rapprocher de l’Occident pour se libérer de la tutelle russo-soviétique.
On retrouve ici une ambiguïté majeure, d’ailleurs bien analysée par des chercheurs turcs, comme Fahri Türk et Idris Bal, ou français d’origine turque, comme Bayram Balcı. Je veux parler du hiatus entre les aspirations turques et celles des populations, voire des gouvernements des nouveaux pays indépendants officiellement turcophones. Dans le cas azerbaïdjanais, on a même relevé des ingérences malheureuses des services spéciaux turcs à l’époque des présidents Mutalybov et Elçibey, précédant l’arrivée des Aliev père et fils. Dans la bouche d’un dirigeant azerbaïdjanais issu du KGB, le slogan bir millet, iki dövlet ne peut en aucun cas être interprété comme un signe de naïveté ; il s’agit bien plutôt de la marque d’un rapprochement raisonné dans un contexte particulièrement complexe. Je ne parlerai pas, ici, de la dérive autoritaire turque, mais nous pourrons y revenir, dans la mesure où les interférences ne sont pas négligeables et doivent être prises en considération.
La proximité entre Turcs et Azerbaïdjanais est aussi affaire d’intérêts croisés bien compris. En effet, si la Turquie fait partie intégrante de la réflexion politique azerbaïdjanaise, l’inverse est tout aussi vrai, même si la taille, la puissance et les visions stratégiques globales des deux pays diffèrent. En Turquie, il n’est pas possible d’aborder des questions comme celle du génocide arménien de 1915 sans évoquer la guerre du Haut-Karabagh, le massacre de Xocalı (Khodjaly), et vice-versa. Toute déclaration ou initiative de l’un en faveur d’une ouverture vers Erevan, sera automatiquement et violemment mise en cause par l’autre. Les autorités azerbaïdjanaises peuvent du reste compter sur le discours radical turc, qui s’est exprimé, par exemple, lors d’un match de football arméno-turc joué à Bursa, en présence des présidents turc et arménien. L’inverse est également vrai, qu’il s’agisse des questions arménienne et kurde ou de l’élimination de la mouvance de Fethullah Gülen qui, grâce à l’action des décideurs et diplomates turcs, s’était bien implantée en Azerbaïdjan. Je pense à l’université Kavkaz, aux écoles, lycées et collèges, ainsi qu’aux entreprises liées à TÜSKON – la centrale patronale des PME, très liée au mouvement –, à la presse et aux médias. À cet égard, la situation est assez différente de celle qui prévaut en Russie, en Ouzbékistan ou au Turkménistan, où la mouvance a été progressivement éradiquée par les dirigeants nationaux eux-mêmes sur la base d’accusations de prosélytisme islamique.
Enfin, il faut souligner deux faits politiques : premièrement, l’existence de courants panturquistes à coloration panislamiste, donc proches des logiques des partis turcs AKP, MHP et BBP ; deuxièmement, l’idée récurrente de la création d’une diaspora azerbaïdjanaise ayant pour principal objectif de contrer la diaspora arménienne dans le monde. Le gouvernement turc s’est, du reste, ouvertement réclamé à plusieurs reprises de ce modèle pour créer une diaspora turque destinée à devenir un lobby puissant aux ordres du gouvernement d’Ankara.
Tout d’abord, un certain nombre d’intellectuels azerbaïdjanais, souvent historiens et proches de l’ancien président Elçibey, lui-même historien, professent des idées voisines de celles du MHP turc et se réclament de la grandeur turque, de la vocation impériale turque, d’une « Union nationale turque » – Türk Millî Birliği. L’islam joue, là aussi, un rôle important mais ambigu, puisque les Turcs, sunnites, et les Azerbaïdjanais, chiites, ont souvent été opposés. On préfère donc passer cet élément sous silence, ou du moins l’atténuer, et insister sur les origines communes, la langue commune et les intérêts communs. Ces personnalités, souvent députés de l’opposition tolérée, sont parfois inquiétées pour leurs opinions politiques mais publient beaucoup, en azéri et en turc. En tout état de cause, elles sont mieux tolérées que certaines personnes citées dans le compte rendu des auditions précédentes, telles que M. et Mme Yunus.
J’en viens enfin à la question de l’émergence programmée d’une diaspora azerbaïdjanaise de 50 millions de personnes, donc plus nombreuse que la diaspora arménienne. Plusieurs articles ont été publiés en français sur cette question récurrente dans l’espace post-soviétique, notamment par Bayram Balcı ou Adeline Braud. En lisant les documents azerbaïdjanais officiels, on est parfois étonné des statistiques avancées, notamment celles concernant les effectifs de ladite diaspora en Amérique latine, où l’expression los Turcos désigne en fait les immigrés originaires de l’Empire ottoman, lesquels étaient essentiellement des Syro-Libanais ou des Palestiniens. Je pense, par exemple, à l’ancien président argentin Carlos Menem ou à la chanteuse américaine d’origine colombienne Shakira Isabel Mubarak. La Turquie et l’Irak compteraient ainsi chacun au moins 3 millions d’Azéris ethniques, et l’Iran au moins 19 à 20 millions.
Ces calculs sont fondés sur un mélange parfois curieux de vérités historiques – lorsqu’ils comptabilisent les populations minoritaires ou frontalières de Géorgie et de Turquie, les émigrés en Russie ou dans les pays de l’ex-URSS, en Europe et en Amérique du Nord – et de manipulations que l’on pourrait gentiment qualifier d’un peu hasardeuses, lorsqu’ils englobent les locuteurs de dialectes de Turquie orientale, notamment dans la région d’Erzurum, proches des parlers azéris, ou des groupes d’émigrés turcs ou arabes naturalisés, qui seraient bien surpris d’apprendre qu’ils sont décomptés comme membres de la diaspora azerbaïdjanaise. En Turquie, après les questions, complexes, des Arméniens, des Kurdes, des Pontiques, serait-on face à une question azerbaïdjanaise ? Ambiguïté majeure, une de plus, puisque les chantres turcs de cette idée sont des députés du MHP, dont certains sont effectivement d’origine azerbaïdjanaise.
En guise de conclusion provisoire, on peut dire qu’il est évident que parler du Sud Caucase ne peut s’envisager sans prendre en compte le couple turco-azerbaïdjanais, alors que l’Azerbaïdjan, seul État ou entité turcophone à ne pas avoir de nom basé sur un ethnonyme turc, est divisé en deux espaces, relevant historiquement de trois empires et aujourd’hui de trois États nations. Il est tout aussi évident que l’avenir de la région passe par la résolution, un jour ou l’autre, de l’antagonisme arméno-turc ou turco-arménien, qui intégrera Azerbaïdjanais aussi bien que Turcs face aux Arméniens et aux Kurdes.
M. le président François Rochebloine. Quelles sont les origines de la constitution de l'Azerbaïdjan en État de plein exercice ? Pour quelles raisons n'est-il jamais apparu, avant la période soviétique, comme une entité politique autonome, à la différence de tous ses voisins ?
Mme Claire Mouradian. À l’origine, l’Azerbaïdjan est une province multiethnique et multiconfessionnelle de l’Iran qui n’a jamais pu prendre complètement son autonomie, à l’exception de la période très antique d’Adropâtes dont son nom dérive. Il a connu différentes formes administratives – notamment le khanat, que le khan, son gouverneur, essaie de rendre dynastique sans toujours y parvenir – mais n’a jamais été un État constitué. Sur les cartes, le nom d’Azerbaïdjan n’apparaît qu’au XXe siècle. À l’époque tsariste, il n’existe pas de province d’Azerbaïdjan. Lorsque la Russie conquiert la région de l’Est du Caucase – la Géorgie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan – entre 1805 et 1828, elle conserve au début les dénominations nationales : gouvernorat de Géorgie, province arménienne... Les territoires sont ensuite découpés régulièrement en prenant des noms géographiques, celui des chefs-lieux de la province : gouvernorat de Tbilissi, gouvernorat de Bakou, etc. On retrouve ces mêmes processus dont l’objectif est d’effacer le souvenir d’entités nationales ou politiques préexistantes, lors de la création des départements pendant la Révolution française, et aussi dans l’Empire ottoman après la réforme des vilayet (provinces) de 1864.
La domination persane a été plus forte en Azerbaïdjan, mais la population azerbaidjanaise azérie a participé au pouvoir, quand elle n’en a pas été au cœur. La dynastie séfévide est d’origine azérie et est chiite. Les Azéris n’avaient donc aucune tentation séparatiste ; lorsqu’on a un empire à sa disposition, on n’a pas besoin d’un mini-royaume. Les éventuelles tentatives des gouverneurs locaux d’acquérir une plus grande autonomie par rapport au pouvoir central avaient peu de chance de déboucher sur un mouvement d’émancipation nationale.
M. Stéphane de Tapia. En 1040, les Seldjoukides, qui sont des Turcs originaires d’Asie centrale, font irruption en Anatolie et sur le territoire iranien actuel. À partir de cette date vont se succéder en Iran, jusqu’en 1925, des dynasties qui, pour beaucoup, sont turcophones. L’avant-dernière dynastie – celles des Kadjars qui précède les Pahlevis – est turcophone, tout comme les Séfévides. Les Mongols de Gengis Khan, dès lors qu’ils s’installent en Azerbaïdjan, sont très vite « turquisés ». On parle d’ailleurs souvent de « monde turco-iranien ». Le mélange s’opère sur le plan culturel : tous les sultans ottomans sont capables de composer de la musique en persan ; de nombreux Iraniens parlent le turc. Après les guerres civiles dans l’empire ottoman, une partie de celui-ci se trouve « chiitisée ». La population des Qizilbash, originaires d’Anatolie, qui sont en quelque sorte les ancêtres des Alévis de Turquie, émigre vers l’actuel Azerbaïdjan. C’est l’époque de shah Ismaïl et de shah Abbas. Les Turcs d’Azerbaïdjan sont au pouvoir – dans le bazar de Téhéran mais aussi dans les palais. Ce sont les soldats, les gouverneurs.
Je me rappelle une anecdote racontée par le géographe Xavier de Planhol : un derviche azerbaïdjanais fait le tour des grandes mosquées chiites de l’Iran, il est reçu comme un roi parce qu’il est azerbaïdjanais ; plusieurs générations plus tard, à l’époque des Pahlavi, un autre derviche azerbaïdjanais fait le même exercice, mais il est regardé de travers car considéré comme un Turc. On voit apparaître au travers de cette anecdote un nationalisme persan.
M. le président François Rochebloine. Quels sont à votre sens les ressorts de la politique russe dans le Caucase du Sud, notamment dans la définition du « drôle d’équilibre » militaire, politique et économique, qu'elle entretient entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ?
Mme Claire Mouradian. On connaît la politique classique des empires consistant à diviser pour régner. Il faut avoir conscience de l’héritage tsariste et soviétique. À l’époque tsariste, qu’on appelait « la prison des peuples », les délimitations des provinces n’étaient pas établies sur des critères géographiques mais en veillant à diviser les populations de manière à éviter les risques de séparatisme. La révolution a promu une définition sur une base ethno-territoriale, allant jusqu’à insérer des enclaves pour respecter les critères ethniques – la province du Haut-Karabagh dont la majorité de la population était arménienne –, tout en veillant à imbriquer les économies et les strates administratives afin de se prémunir contre les risques de séparatisme. Tout était chapeauté par le parti communiste d’URSS, dont les partis locaux n’étaient que des filiales : les numéros de carte du parti suivaient l’ordre du parti communiste central. L’échafaudage soviétique – politique, économique, administratif – essayait d’empêcher les séparatismes d’une autre manière. Lénine avait dit, en publiant le décret sur les nationalités, que le droit au divorce ne voulait pas dire l’obligation du divorce. L’utopie de l’amitié entre les peuples constituait un autre élément de cohésion.
Aujourd’hui, la dimension idéologique ayant disparu, reste l’argument de la puissance. Chacun cherche toujours à neutraliser l’un en utilisant l’autre. Le rapprochement récent entre Erdoğan et Poutine me fait penser au rapprochement opéré entre Mustafa Kemal et Lénine en 1921 pour évincer l’Occident de la région. C’est une alliance opportuniste de deux régimes autoritaires engagés dans une partie d’échecs où les nations serviront de pions. In fine, les choses se régleront sans doute entre Washington et Moscou, car la Turquie reste une puissance secondaire.
Les moteurs de la politique russe sont bien sûr économiques et militaires : la Russie vend des armes à l’Azerbaïdjan ; elle en vend à l’Arménie ou en installe – l’Arménie a été contrainte d’entrer dans l’Union économique eurasienne, instruite par les exemples de la Géorgie et l’Ukraine de ce qu’il pouvait advenir à trop vouloir s’émanciper en se tournant vers l’Union européenne. Les Arméniens ne sont pas forcément plus russophiles que les autres, ils n’ont pas été mieux traités que les autres, mais depuis le génocide s’est installée l’idée que « mieux vaut les Russes que les Turcs » – ce qui n’était pas toujours vrai jusqu’au milieu du XIXe siècle : les Arméniens préféraient parfois la gouvernance ottomane qui laissait les communautés s’auto-gérer en matière religieuse et culturelle au régime de gendarme de la Russie. Depuis le génocide et avec le négationnisme d’État persistant de la Turquie, ils n’ont pas tellement le choix.
Après la disparition du dernier royaume arménien au XIVe siècle, les Arméniens firent périodiquement appel souverains européens (Philippe II d’Espagne, Louis XIV, le pape, et finalement les tsars russes) pour les soutenir contre les conquérants ottomans ou persans et tenter de restaurer un État. Un épisode du passé est emblématique. Un projet de traité avec la Russie équivalent à celui conclu à Gueorguievsk (1783) avec le royaume de Géorgie, proposait à Catherine II d’aider à reconstituer un État qui serait un protectorat russe. Le contre-projet russe est moins intéressé par le rétablissement de l’ancienne souveraineté arménienne que par des garanties pour la présence de troupes russes bien ravitaillées dans le pays. Ce qui intéresse la Russie, aujourd’hui comme hier, c’est de conserver et de consolider ses frontières extérieures qui restent celles de l’ex-URSS. Les États du Caucase sont son arrière-cour, son « étranger proche » défini comme une zone d’intérêt vital. La stratégie de la Russie ne privilégie ni les uns, ni les autres. C’est une politique de puissance russe.
M. Stéphane de Tapia. En complément, en m’appuyant sur des thèses d’étudiants azerbaïdjanais, je dirai que dans de nombreux pays de l’ex-URSS, les opinions publiques ont été extrêmement déçues de l’absence de puissance des Européens et des Américains. Cela vaut pour le Kazakhstan, le Kirghizstan ou l’Azerbaïdjan. Plusieurs leçons ont été tirées des crises en Géorgie et en Ukraine : les Occidentaux n’étaient pas aussi puissants qu’ils en avaient l’air ; la Turquie, qui semblait le pays idéal pour ouvrir la porte vers l’Occident, était une puissance de second ordre ; il ne fallait pas trop faire confiance et être prudent. C’est à la lumière de ces constats que doit être analysé le rapprochement avec Moscou et Vladimir Poutine, qui sont plus présents et capables d’intervenir directement sur place, y compris militairement. En outre, ces États, depuis l’Union soviétique et les Romanov avant elle, partagent avec la Russie une vision du monde et une culture politique communes. Les Russes, on ne les aime pas forcément mais on les connaît, tandis qu’on ne connaît pas vraiment les Occidentaux et on s’aperçoit qu’on s’est fait beaucoup d’illusions sur leur capacité à intervenir.
Mme Claire Mouradian. La Russie compte une importante communauté azerbaïdjanaise, notamment des oligarques qui tiennent les marchés de Moscou – sur lesquels ils finissent par s’entendre avec leurs voisins du Caucase, mieux que sur place. Il existe des intérêts communs.
Comme le disait Stéphane de Tapia, ces États possèdent tous une culture et une identité russo-soviétique. La Russie en joue, de la même manière que la France en joue dans la « Françafrique » ou l’Angleterre dans les pays du Commonwealth. On ne peut pas ignorer l’héritage de plusieurs siècles de présence. La Russie connaît la région depuis fort longtemps.
M. le président François Rochebloine. Quelle est la part de l’économie azerbaïdjanaise qui relève du secteur privé et comment se répartit la propriété des biens correspondants ?
M. Stéphane de Tapia. Je n’ai jamais travaillé directement sur ces questions, mais, dans tous les pays de l’ancienne URSS, on observe le même phénomène : de nombreuses réformes ont été engagées pour privatiser, en particulier les secteurs de l’agriculture ou du commerce. Cela a plutôt bien fonctionné pour le petit commerce. Dans le très grand commerce, les Turcs sont très présents – les supermarchés peuvent être à capitaux turcs ou russo-turcs. Dans le domaine de l’industrie, les choses ont été lancées mais n’ont pas été très loin ; la part de l’État reste très importante. Tout le monde se plaint du fait que les choses n’avancent pas suffisamment vite en dépit des plans adoptés, des traités signés, et des projets. La logique soviétique perdure. Au Kirghizstan ou au Kazakhstan, on dit que les sovkhozes ou les kolkhozes ont été privatisés sur des bases tribales. Plusieurs articles ont été publiés sur ce sujet : les privatisations auraient profité à des membres de la nomenklatura des partis communistes qui ont réussi à échapper aux périodes staliniennes, des chefs de tribu mineurs – les chefs de tribu majeurs ayant été éliminés durant l’ère stalinienne.
Mme Claire Mouradian. Je n’ai pas suffisamment travaillé sur cette question pour vous apporter une réponse, mais il se dit que le clan Aliev et ses ramifications – il y a de nombreux mariages entre enfants d’oligarques – détiennent l’essentiel de l’économie privée, et même sans doute d’État, que ce soit dans le domaine du pétrole ou du coton. Il en va différemment pour le petit commerce. Un collègue arménien me disait qu’en Arménie, le pouvoir économique est entre les mains d’une quarantaine de familles, en Azerbaïdjan, de deux ou trois, tandis qu’en Géorgie le jeu est plus ouvert.
M. le président François Rochebloine. Le clan Aliev apparaît dans les Panama Papers. Avez-vous des informations à ce sujet ?
M. Stéphane de Tapia. Le terme de clan, d’origine écossaise, n’est pas forcément approprié. Cette notion est très présente au Kurdistan et en Turquie, plus en région kurde qu’en Turquie occidentale – ce sont de grandes familles patriarcales sur bases tribales qui ont été étrillées à l’époque soviétique mais qui ont réussi à perdurer. Le clan correspond souvent à des « localismes », à une solidarité liée à l’origine géographique. La famille Aliev est originaire du Nakhitchevan. On ne s’étonne pas de trouver de nombreux recteurs, députés ou ministres originaires de cette même région. Ces solidarités locales ont été étudiées, avec beaucoup de difficultés car le rouleau compresseur soviétique est passé par là ; théoriquement, il a tout balayé, mais les anthropologues redécouvrent des choses très intéressantes.
M. le président François Rochebloine. Pouvez-vous nous donner des précisions sur la mise en place de l’Université franco-azerbaïdjanaise (UFAZ), créée avec la coopération de l’université de Strasbourg ? Comment s'est déroulée la procédure de sélection de l'université d'accueil, puis de définition du cadre juridique et financier dans lequel l’UFAZ exerce ses activités ? Quels avantages — scientifiques, culturels, financiers ou autres — l’Université de Strasbourg retire-t-elle de cette coopération ?
M. Stéphane de Tapia. Parlant le turc et très proche à un moment du président Alain Beretz dont j’ai admiré la capacité de négociation, j’ai vu les choses de très près. Mon rôle consistait à écouter et à intervenir de manière très discrète, parfois à la demande de la partie azerbaïdjanaise lorsque les choses devenaient complexes – je pouvais discuter directement avec eux puisque je connaissais leur langue.
À l’origine du projet se trouve une demande commune du président François Hollande et du président İlham Aliev de créer une université franco-azerbaïdjanaise. Nous avons été invités à Paris par Campus France et nous avons rencontré une douzaine d’universités azerbaïdjanaises, y compris l’université Lomonossov, université russe qui dispose d’une antenne à Bakou. Certains des contacts que nous avons noués se sont révélés intéressants. J’ai fait le déplacement à Bakou, accompagnant les personnes que j’ai déjà citées – outre le président, le vice-président Francis Kern, qui a joué un très grand rôle, et Eckhart Hötzel, qui dirige l’Institut ITIRI et qui s’est rendu à de nombreuses reprises à Bakou ; Strasbourg reçoit des étudiants azerbaïdjanais, venus apprendre le français comme langue étrangère ou bien la traduction, depuis longtemps.
Lors de ce déplacement, nous avons rencontré les mêmes universités et des recteurs très intéressés par le projet d’une université qui ne devait pas s’inspirer de l’université Galatasaray à Istanbul mais d’un modèle plus souple – nous avions défendu celui de l’université franco-allemande (UFA), qui est plutôt virtuelle mais propose des projets de recherche et pédagogiques, de la co-diplomation, et des doubles cursus.
Nous avons eu petit à petit la mauvaise surprise de constater que l’ambition de cette université – plusieurs disciplines étaient initialement envisagées : le droit, les sciences politiques, les sciences humaines, la langue française, ou encore les travaux publics – était revue à la baisse.
Il faut savoir que les universités azerbaidjanaises ex-soviétiques sont subdivisées en une douzaine d’universités différentes – à l’origine, la grande université de Bakou était composée d’instituts qui sont par la suite devenus des universités.
Nous avons été assez déçus de voir que ce projet se transformait en une sorte de grande école d’ingénieurs – l’Académie du pétrole, devenue entre-temps Université du pétrole et de l’industrie. Le recteur Babanlı est venu à Strasbourg en juillet avec le ministre Jabbarov. Je me suis rendu en Azerbaïdjan à deux ou trois reprises. D’autres délégations ont fait le déplacement. Mais nous avons dû, à la demande de l’Azerbaïdjan, réduire le champ disciplinaire mais aussi géographique du projet. L’envergure de cette université est donc bien plus limitée que ce qui était prévu au départ.
L’emploi de la langue française a donné lieu à de longues discussions. Nous le défendions tout en laissant une place à l’anglais mais aussi au russe. Aujourd’hui, l’université prévoit l’usage du français pour plus tard et peut-être.
M. le président François Rochebloine. Comment expliquez-vous cette évolution ?
M. Stéphane de Tapia. Les Azerbaidjanais ont été déçus de la faiblesse des moyens mis sur la table par la France. En outre, la crise pétrolière a eu pour conséquence de diminuer les ressources de l’État.
Le président Beretz a été reçu pendant près de deux heures par Mme Mehriban Alieva, la « première dame », dans son bureau pendant que nous discutions de points techniques au ministère de l’éducation. Cette rencontre, initialement non programmée, montre combien la présidence azerbaïdjanaise attache beaucoup d’importance à ce projet.
M. le président François Rochebloine. L’UFAZ n’est pas l’université que l’on pouvait espérer. Combien d’étudiants compte-t-elle ?
M. Stéphane de Tapia. Comme dans une école, il n’y a que quelques dizaines d’étudiants, 160 pour la première année ; ce chiffre augmentera évidemment avec le développement de l’enseignement sur quatre années.
J’avoue que les choses ont été assez compliquées, même si la négociation s’est déroulée dans de très bonnes conditions.
Au départ, nous étions une sorte de consortium français d’une douzaine d’universités. À Bakou, nous étions accompagnés des présidents des universités de Rennes, Rouen et de Montpellier, ainsi que des représentants de Nancy et d’universités parisiennes. Finalement, c’est l’université de Strasbourg qui a été en quelque sorte choisie par les autorités azerbaïdjanaises pour construire le projet définitif.
M. Jean-François Mancel. Je reviens sur les chiffres. Les 450 000 personnes que vous avez évoquées n’ont pas toutes été déplacées par les Azerbaïdjanais : un grand nombre sont parties d’elles-mêmes. On peut tout faire dire aux chiffres. Vous avez ainsi estimé à 50 000 le nombre d’Arméniens présents à Bakou aujourd’hui, alors que j’en étais resté au chiffre de 30 000.
Je note, madame, que vous avez un instant prêté à Khomeiny une origine azérie.
Mme Claire Mouradian. Je pense effectivement avoir confondu dans ce cas avec Ali Khamenei. Il n’en reste pas moins que les personnalités d’origine azérie occupent les plus hautes fonctions de l’État en Iran – mon collègue ne m’a pas contredite.
Les populations dans la région ont été sans cesse déplacées au gré des guerres – de force ou parce qu’elles cherchaient refuge. Lors du génocide de 1915, lorsque l’armée ottomane a pénétré le nord de l’Iran, qui était neutre, des personnes ont été déplacées ; la population azérie de Tabriz a refusé d’éliminer les Arméniens, comme on l’y incitait. Des massacres ont toutefois été commis par les Kurdes et par d’autres populations. Les Nestoriens, les Arméniens ont été concernés.
Lors des premières indépendances et des conflits territoriaux qui s’en sont suivis, les populations ont été poussées dehors – les Arméniens de Géorgie et d’Azerbaïdjan, comme d’ailleurs les Azéris d’Arménie. Je ne cherche nullement à occulter ces faits.
Selon les chiffres du recensement soviétique, en 1979, on dénombrait 475 000 Arméniens en Azerbaïdjan ; en 1989, après les premiers pogroms, ils n’étaient plus que 390 000 ; aujourd’hui ils sont très peu nombreux. De même, l’Arménie comptait 170 000 Azéris, qui ont aussi été chassés ou qui ont préféré fuir.
Les chiffres que j’ai cités concernaient la population des districts dits occupés, sans compter que ceux-ci comprenaient aussi des populations kurdes et arméniennes. Si on ajoute au chiffre total le chiffre des Arméniens, sur la base du recensement officiel, on arrive à d’autres chiffres.
Autre aspect, l’ensemble du Caucase ayant connu des conflits, les personnes se sont dispersées ou sont revenues chez elles. Je me suis appuyée sur les chiffres des recensements qui sont publics et disponibles sur internet.
M. Michel Voisin. Lors de mes séjours en Azerbaïdjan pour l’observation des élections, le chiffre de 800 000 déplacés m’a été donné.
Mme Claire Mouradian. J’ai cité les chiffes des recensements de l’époque. Depuis 1989, les années ont passé, les personnes recensées ont eu des enfants… Le chiffre total peut donc être différent aujourd’hui.
M. le président François Rochebloine. Madame, Monsieur, je vous remercie pour la qualité de vos interventions et des réponses que vous nous avez données.
*
* *
Ÿ Audition de Mme Marie-Ange Debon, directrice générale adjointe du groupe Suez chargée de l’international, présidente du conseil de chefs d’entreprise France-Azerbaïdjan de MEDEF International, accompagnée de M. Bogdan Gadenne-Feertchak, chargé de mission senior de MEDEF International pour les Balkans, la Turquie, le Caucase et l’Asie centrale (mardi 10 janvier 2017)
M. le président François Rochebloine. Mes chers collègues, nous accueillons aujourd’hui Mme Marie-Ange Debon, présidente du conseil de chefs d’entreprise France-Azerbaïdjan et du conseil de chefs d’entreprise France-Géorgie de MEDEF International, également directrice générale adjointe du groupe Suez, chargée de l’international. Son audition est donc pour nous intéressante à double titre, et je remercie notre collègue Jean-François Mancel de nous l’avoir suggérée.
Mme Debon n’avait pu se rendre à notre précédente invitation. Son collaborateur, M. Heddesheimer, avait répondu aux questions que nous nous posions spécifiquement au sujet de Suez. Bien entendu, madame, vous êtes tout à fait libre, si vous le souhaitez, de compléter l’information que M. Heddesheimer nous a donnée. Si tel n’est pas votre désir, je vous propose de consacrer plutôt notre entretien de ce jour à vos responsabilités en tant que présidente du conseil de chefs d’entreprise France-Azerbaïdjan dans le cadre de MEDEF International – et présidente du conseil de chefs d’entreprise France-Géorgie.
Comme vous le savez, notre mission d’information a pour objet l’examen des relations politiques et économiques entre la France et l’Azerbaïdjan au regard des objectifs français de développement de la paix et de la démocratie au Sud Caucase.
Le conseil de chefs d’entreprise que vous présidez a de toute évidence un rôle important à jouer pour assurer à la partie économique de ces relations le meilleur développement possible. Nous vous remercions de bien vouloir nous expliquer de quelle manière concrète ce rôle se décline, dans un pays où la vie économique fonctionne encore assez largement, semble-t-il, sur un mode assez proche de l’économie administrée, en tout cas sous la surveillance étroite des autorités politiques et des pouvoirs publics. Quelle est la part de l’information, de la coordination et de l’échange de bonnes pratiques dans votre action ?
Participez-vous à l’organisation de la partie économique de visites à haut niveau telles que celle du Président de la République qui a eu lieu en mai 2014 ? L’évaluation de la situation des entreprises françaises sur le marché de l’Azerbaïdjan fait-elle partie de vos préoccupations ?
Nous aimerions également savoir si le conseil de chefs d’entreprise France-Azerbaïdjan est le lieu d’un échange d’informations, d’impressions, voire d’analyses sur les conditions générales de l’investissement et des affaires dans ce pays. Cela conduit inévitablement à évoquer, après nombre d’observateurs internationaux, le problème de la corruption, mais pas seulement : on a souvent évoqué devant nous les risques que présente, au regard de la stabilité et de la rentabilité sur une longue période, l’investissement en Azerbaïdjan. Ces deux thèmes – corruption et risques d’investissement – font-ils partie des sujets dont on parle au conseil que vous présidez, et dans l’affirmative, quelles sont les réflexions qui ressortent de vos échanges ?
Je vous donne maintenant la parole pour un exposé qui sera suivi d’un temps de questions et de réponses.
Mme Marie-Ange Debon, directrice générale adjointe du groupe Suez chargée de l’international, présidente du conseil de chefs d’entreprise France-Azerbaïdjan de MEDEF International. Monsieur le président, je dirai en introduction quelques mots pour vous prier d’excuser mon absence le jour où Stéphane Heddesheimer est venu à votre invitation en tant que représentant du groupe Suez. Comme je suis amenée à beaucoup voyager, ma disponibilité parisienne n’est pas toujours celle que je pourrais souhaiter. Par ailleurs, je ne préside ce conseil de chefs d’entreprise de MEDEF International que depuis la fin de 2015. La visite du Président de République en Azerbaïdjan, à laquelle vous avez fait référence, ayant eu lieu avant, je ne faisais donc pas partie du voyage, même si j’en ai eu des échos puisque mon entreprise était présente.
MEDEF International m’a demandé il y a quelques mois si j’étais prête à prendre la tête des Conseils de chefs d’entreprise pour l’Azerbaïdjan et la Géorgie. Nous nous efforçons de contribuer à la promotion des entreprises françaises dans ces deux pays et de nous faire l’écho de leurs souhaits et de leurs interrogations auprès des pouvoirs publics français. Il s’agit de voir comment travailler mieux et plus efficacement, dans un souci de rentabilité et de stabilité sur le long terme
Nous tenons des réunions dont la fréquence est régulière. Elles se tiennent surtout sous notre impulsion, ou à l’occasion de rencontres économiques de plus haut niveau, organisées par les deux gouvernements. Depuis que je préside ce conseil, nous avons organisé quatre réunions et une délégation de chefs et représentants d’entreprises.
La délégation d’entreprises s’est déroulée à Bakou sous l’impulsion de MEDEF International ; J’ai conduit un groupe d’une quarantaine d’entreprises françaises au mois de mai 2016.
M. le président François Rochebloine. Quelles activités étaient concernées ?
Mme Marie-Ange Debon. Des activités très diversifiées, notamment dans les secteurs des infrastructures, des routes et des transports. Mon entreprise, bien sûr, et sa principale concurrente, Veolia, étaient présentes. Il y avait aussi des équipementiers, avec Alstom, et d’autres entreprises de taille beaucoup plus petite. Le secteur agricole, celui du tourisme, de la construction, des télécommunications et, bien sûr, le secteur pétrolier, étaient également représentés.
M. le président François Rochebloine. Et l’agro-alimentaire ?
Mme Marie-Ange Debon. Également. L’agriculture, l’agro-alimentaire et des domaines proches, comme les serres et les équipements agricoles.
Une seconde rencontre a eu lieu en décembre, sous l’égide du ministère des finances, présidée par Matthias Fekl, et par le ministre azerbaïdjanais des finances, M. Samir Sharifov.
M. le président François Rochebloine. Où s’est-elle déroulée ?
Mme Marie-Ange Debon. À Bercy, le 13 décembre. Il s’agissait – pour la partie à laquelle nous avons été invités – de faire le tour des initiatives économiques susceptibles d’être soutenues et des perspectives de développement économique offertes aux deux parties.
Nous avons saisi l’occasion de cette commission mixte pour inviter, au titre de MEDEF International, le ministre des finances à venir dialoguer avec les entreprises françaises qui le souhaitaient. Il a accepté. C’est pourquoi, le lendemain de cette réunion à Bercy, nous avons tenu une autre réunion, qui a duré deux heures, avec les entreprises françaises présentes. En complément, nous avons organisé avec le LEEM (Les entreprises du médicament) une table ronde autour du vice-ministre azerbaïdjanais de la Santé, M. Aghaiev.
M. le président François Rochebloine. À peu près les mêmes ?
Mme Marie-Ange Debon. Il y en avait une quarantaine, à peu près les mêmes, qui ont soulevé des questions relatives à leur activité ou au cadre économique.
M. le président François Rochebloine. Des entreprises nouvellement installées en Azerbaïdjan, ou plus anciennement ?
Mme Marie-Ange Debon. Des entreprises déjà installées, mais aussi d’autres. Le pays ayant un programme de diversification et voulant attirer les investissements étrangers, notamment dans le tourisme, certaines entreprises commencent à manifester leur intérêt ; mais elles en sont davantage au stade du prospect que du développement. En revanche, le secteur pétrolier est déjà très actif et très présent en Azerbaïdjan.
Nous servons de caisse de résonance, dans la mesure où nous transmettons les interrogations, les questions ou les souhaits des entreprises aux pouvoirs publics azerbaïdjanais. Lors de notre rencontre de mai dernier, nous avons eu l’occasion de rencontrer non seulement le Président de la République, M. Ilham Aliev, mais aussi un certain nombre de ministres ou de représentants des services ou établissements publics d’Azerbaïdjan. Nous avons pu leur faire part des difficultés que nous rencontrons dans telle ou telle activité, ou de notre perception de l’activité économique. En effet, les ressources de l’Azerbaïdjan étant liées pour une bonne part aux ventes d’hydrocarbures, le pays souffre économiquement, depuis 2014, de la baisse du prix du baril.
M. le président François Rochebloine. Cette baisse a-t-elle modifié vos relations ?
Mme Marie-Ange Debon. Comme dans tous les pays qui sont très dépendants de cette ressource, et c’est aussi le cas en Afrique ou en Amérique latine, les relations économiques sont fortement affectées. Les investissements se réduisent ou sont en suspens. Le niveau de vie des populations se ralentit, ainsi que la consommation.
L’Azerbaïdjan n’est qu’un élément de nos problématiques internationales liées au prix du pétrole, mais, pour autant que je puisse en juger, le pays continue à faire des efforts de diversification, de réforme, ainsi que de réflexion prospective. Reste que le contexte économique est complètement différent.
M. le président François Rochebloine. Pouvez-vous nous dire si la corruption fait partie des sujets que vous évoquez dans le conseil que vous présidez ?
Mme Marie-Ange Debon. Nous évoquons le cadre économique général et la question de la gouvernance en général. Si certaines entreprises ont été confrontées à ce problème, nous n’en avons pas été informés.
À Suez, nous sommes très stricts en la matière. Cela dit, nous n’y avons pas été confrontés à l’occasion des activités économiques que nous avons développées, et qui sont encore relativement limitées aujourd’hui.
En revanche, il nous arrive d’aborder cette problématique dans le cadre des réformes administratives à mettre en place. De nombreux organismes internationaux – comme Transparency International ou la Banque mondiale – classent les pays concernés. De notre côté, nous militons pour que les règles de passation des marchés publics soient améliorées, pour que le numérique se développe, à la fois comme instrument de paiement ou de procédure administrative. Nous suivons d’ailleurs les réformes que plusieurs pays ont entamées pour tenter d’enrayer le phénomène.
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. Merci pour cet exposé liminaire.
Je souhaiterais obtenir quelques éclaircissements sur les conseils de chefs d’entreprise de MEDEF International. Quelles relations régulières avez-vous avec le ministère des affaires étrangères, la direction générale du Trésor, l’Agence française de développement (AFD) et la Coface, ainsi qu’avec l’ambassade d’Azerbaïdjan en France et l’ambassade de France en Azerbaïdjan ?
Estimez-vous aujourd’hui que l’action des entreprises en Azerbaïdjan est autonome, c’est-à-dire déconnectée des relations avec les administrations, qu’elles soient françaises ou azerbaïdjanaises ? Quant à vos relations avec les entreprises azerbaïdjanaises, sont-elles liées au soutien que vous avez de la France, de ses autorités, et de l’Azerbaïdjan ?
Estimez-vous que la stratégie française vis-à-vis de l’Azerbaïdjan soit suffisamment intégrée et efficace ? Je me réfère à l’engagement, somme toute assez modeste, de l’AFD en Azerbaïdjan : 112 millions d’euros. Considérez-vous qu’une amélioration soit nécessaire ?
Par ailleurs, lorsque l’Azerbaïdjan fait paraître dans la presse française des publi-reportages, en passant naturellement, pour cela, par une agence de communication, êtes-vous associés à la conception de ces publi-reportages ?
Enfin, bien que vous ayez avoué n’avoir pas encore acquis une expérience considérable en Géorgie, je vous demanderai ce qui, selon vous, rapproche – ou différencie – le conseil France-Azerbaïdjan du conseil France-Géorgie ? Y a-t-il des leçons à retenir de ce dernier pays pour essayer de faire changer les choses – le cas échéant – en Azerbaïdjan ?
Mme Marie-Ange Debon. Je vais vous répondre sur l’Azerbaïdjan mais, si vous le permettez, j’ouvrirai le débat sur la base de mon expérience de Suez, acquise dans de nombreux pays.
Je suis naturellement favorable à une diplomatie économique active, et je trouve que le ministère des affaires étrangères a évolué de manière très positive, s’agissant de l’appui que ses services – avec les services économiques du ministère des finances – apportent aux entreprises. Il y a quelques années, il était parfois difficile d’intéresser le corps et les services diplomatiques aux problématiques des entreprises. Cette évolution est très importante pour nous, dans la mesure où les entreprises n’ont pas toujours les moyens de maintenir sur place une équipe permanente. Les services économiques et les services diplomatiques peuvent, notamment, les informer sur certains sujets d’ordre économique ou décisionnel.
La situation varie beaucoup, bien entendu, selon la taille du pays concerné. On n’a pas les mêmes attentes vis-à-vis de nos ambassades aux États-Unis, en Allemagne ou même dans d’autres pays de l’Union européenne que vis-à-vis de nos ambassades dans des pays plus petits ou avec lesquels nous avons des relations économiques moins développées, moins anciennes et moins structurées.
L’Azerbaïdjan fait partie de cette dernière catégorie, où l’on trouve aussi beaucoup de pays d’Afrique ou du Moyen-Orient, et où la complexité des structures et la faiblesse des moyens des entreprises rendent d’autant plus utile de pouvoir s’appuyer sur nos services diplomatiques.
Les ambassades constituent donc un relais que nous apprécions. S’agissant de notre ambassade à Bakou, je souligne que l’ambassadrice, Mme Bouchez, et ses services ont été d’un grand appui. Disant cela, je parle au nom de Suez, mais je pense refléter aussi l’avis des entreprises membres de MEDEF International.
Mme Bouchez est attentive aux dossiers et aux problématiques des entreprises. Elle connaît les projets sur lesquels nous voudrions travailler et suit les évolutions économiques du pays – taux d’intérêt, cours du manat, réformes. Elle nous a aidés à obtenir des rendez-vous et à déterminer les plus utiles potentiellement, aux entreprises françaises participantes. MEDEF International ne peut que décerner un satisfecit aux services diplomatiques français.
Nous avons moins de relations avec l’ambassade d’Azerbaïdjan en France. L’ambassadeur, qui est à l’écoute des sujets économiques, relaie les problématiques des entreprises françaises auprès de son gouvernement.
Les entreprises prennent des initiatives autonomes. Elles n’attendent pas leur salut des services de Mme Bouchez, mais apprécient le soutien qui leur est accordé. C’est pour elles un complément très significatif, surtout lorsqu’il s’agit de leur apporter des éléments de compréhension ou de les aider en cas de difficultés.
La stratégie française est-elle suffisamment intégrée et efficace ? La question est plus complexe que cela. Au-delà des ambassades, un certain nombre d’établissements, dont l’AFD, ont évolué dans le sens d’une prise en compte beaucoup plus affirmée des problématiques économiques.
L’Azerbaïdjan connaît un vif accroissement de la concurrence entre les entreprises. C’est un phénomène auquel Suez est confronté, et pas seulement dans ce pays. Les pays émergents deviennent de plus en plus compétitifs, en termes de prix comme de savoir-faire et de technologie. Cela commence à poser problème dans de nombreux secteurs.
En Azerbaïdjan, on voit notamment arriver des entreprises turques, très dynamiques, quelques entreprises chinoises, et des entreprises israéliennes très actives. Nous sommes confrontés à une grande diversité de concurrence de la part des pays émergents. Par ailleurs, la présence des entreprises européennes, britanniques ou allemandes, est ancienne, et vient également nous concurrencer.
M. le rapporteur. Diriez-vous que la concurrence des entreprises des pays émergents respecte les règles déontologiques et celles des marchés publics, ou que celles-ci s’en affranchissent parfois ?
Mme Marie-Ange Debon. J’aurais tendance à choisir la deuxième option…
Je vous réponds d’une manière générale, car je n’ai pas d’exemple spécifique à l’Azerbaïdjan. Je le fais au titre de Suez et de sa division internationale.
Parfois, nous perdons des marchés sans en connaître clairement la raison. C’est une préoccupation partagée par de nombreux pays, qui s’efforcent d’être extrêmement vigilants en la matière. C’est pourquoi nous poussons, nous aussi, à ce que toutes les institutions, françaises ou internationales, comme la Banque mondiale, soient extrêmement vigilantes sur les cahiers des charges, sur les normes en matière de santé, de sécurité, de développement durable et de gestion des personnels. Il s’agit de faire en sorte, au-delà même des problèmes éventuels de corruption, que les entreprises soient placées dans des conditions de concurrence saine et que les cahiers des charges – lorsqu’il y en a, ce qui n’est pas toujours le cas – répondent à des règles précises dans ces domaines.
M. le rapporteur. Avez-vous le sentiment que, de leur côté, les autorités azerbaïdjanaises sont attentives à la définition de ces cahiers des charges ? Veillent-elles à rendre la concurrence la plus transparente possible ?
Mme Marie-Ange Debon. Je pense que, dans un certain nombre de domaines, les autorités azerbaïdjanaises font preuve d’une vigilance que l’on ne retrouve pas dans tous les pays émergents. Par exemple, elles se préoccupent d’éducation et de formation. Et lorsqu’une entreprise française ou européenne remporte des marchés, elles y voient le moyen de faire progresser les compétences au sein des entreprises, des services administratifs ou des collectivités. Elles se préoccupent aussi, dans le cadre des réformes économiques, de la corruption – je crois que le président Aliev l’a évoquée dans ses discours.
Ce sont les seuls points dont je puisse parler. Suez a très peu d’activité en Azerbaïdjan. Quant aux entreprises, je n’entre pas dans le détail des activités économiques qu’elles y développent. C’est avec celles qui sont le plus présentes en Azerbaïdjan qu’il faudrait en discuter.
M. le rapporteur. Je crois savoir que Suez a mis au point une charte éthique ?
Mme Marie-Ange Debon. En effet. Nous avons une charte et organisons des formations. Chaque année, chaque « responsable pays » doit faire un rapport à son supérieur immédiat sur le sujet. Nos procédures internes sont assez encadrées.
Pour en revenir à la question de savoir si la stratégie française est suffisamment intégrée et efficace, je pense que les choses évoluent positivement. Reste que nous sommes confrontés à une forte concurrence. Dans de nombreux pays, il existe des équivalents de l’AFD qui sont très dynamiques, qui ont des moyens financiers très importants, et qui sont peut-être moins regardants sur un certain nombre de règles.
C’est le cas de certains pays européens : l’Allemagne a une agence de développement très active, l’Italie vient de se doter d’une nouvelle agence. C’est le cas de tous les pays asiatiques, notamment la Corée du Sud, le Japon et la Chine, qui sont eux aussi très actifs et consacrent à l’aide économique des moyens importants – sous forme de prêts ou de quasi-subventions – leur permettant d’aider leurs entreprises à gagner des marchés.
En conclusion, nous avons bien progressé, mais nos moyens sont parfois limités par rapport à ceux d’autres pays.
Vous m’avez également interrogée sur les publi-reportages. Je n’en ai pas eu connaissance, ni au titre de MEDEF International, ni au titre de Suez, et je n’y suis pas associée. Vous avez évoqué une agence de communication. Je n’ai pas de contacts avec une telle agence, que je ne connais pas. Je sais seulement que l’Azerbaïdjan a sponsorisé un certain nombre d’événements sportifs. Je n’ai donc pas d’éléments pour vous répondre à propos de ces publi-reportages.
M. le président François Rochebloine. Justement, vous-même ou MEDEF International avez-vous été associés à ces grands événements sportifs ? Avez-vous été sollicités ?
Mme Marie-Ange Debon. Non, pas que je sache. Je n’ai pas été sollicitée au titre de MEDEF International. Encore une fois, je n’en suis pas une permanente. Mais je ne pense pas qu’il s’associe à ce genre d’événements.
M. Bogdan Gadenne-Feertchak, chargé de mission senior de MEDEF International pour les Balkans, la Turquie, le Caucase et l’Asie centrale. Sur la question des publi-reportages, la réponse est clairement non. Notre communication est très simple, et se fait essentiellement sous forme de communiqués de presse publiés sur notre site.
M. le rapporteur. Je voulais savoir si l’agence de communication en question avait recueilli auprès de MEDEF International des éléments sur la stratégie qu’il comptait adopter vis-à-vis de l’Azerbaïdjan afin de cibler ses publi-reportages.
M. Bogdan Gadenne-Feertchak. Non. Ce n’est pas dans nos habitudes de communication. Par ailleurs, nous ne sommes pas associés aux grands événements sportifs, car notre champ d’action n’est pas en lien avec ce genre de manifestations.
Mme Marie-Ange Debon. MEDEF International est une association dont les moyens économiques sont limités. Elle est au service des entreprises.
Par ailleurs, MEDEF International a, sur un certain nombre de pays, des conseils de chefs d’entreprise équivalents à celui que j’anime sur l’Azerbaïdjan.
M. Bogdan Gadenne-Feertchak. On compte 85 conseils de chefs d’entreprise, certains couvrant des régions du monde – il y a, par exemple, un conseil pour l’ensemble des Balkans – et d’autres des filières : villes, énergies renouvelables, santé. Il arrive aussi que se combinent actions géographiques et actions par filière.
Il existe un conseil France-Géorgie, qui a été créé à la même date que le conseil France-Azerbaïdjan, au moment du recouvrement de l’indépendance, en 1992.
Mme Marie-Ange Debon. Ces 85 conseils font à peu près le même type de travail.
M. Bogdan Gadenne-Feertchak. Nous avons été créés par le MEDEF il y a maintenant vingt-six ans. Notre mandat porte sur les relations économiques bilatérales avec les pays étrangers, à l’exception de ceux de l’Union européenne. Nous avons toutefois encore un petit volume d’activité avec les nouveaux entrants dans l’Union, mais nous nous consacrons essentiellement aux pays en développement et émergents. Cela étant, il y a également des conseils avec le Japon, l’Australie, le Canada et pour les Amériques.
Mme Marie-Ange Debon. En fait, MEDEF International est en quelque sorte un réceptacle, un facilitateur. Lorsqu’il y a des visites ministérielles en France et que des entreprises sont représentées dans les délégations, nous assurons la coordination entre les entreprises et les autorités économiques des deux pays. C’est l’occasion d’une rencontre collective.
La Géorgie est probablement, en termes d’activités, un cran au-dessous de l’Azerbaïdjan, pour un certain nombre de raisons : sur le plan économique, elle a moins de ressources ; il y a moins d’entreprises actives en Géorgie ; enfin, étant limitée par le temps, je n’ai pu me consacrer autant que je l’aurais voulu à ce pays.
M. Bogdan Gadenne-Feertchak. La Géorgie a connu, entre 2008 et 2011, deux événements majeurs qui ont affecté sa situation économique : la guerre-éclair avec la Russie et le contrecoup de la crise économique et financière. Cela explique que, pendant une certaine période, nos activités avec ce pays aient chuté, mais la tendance est à la reprise et nous devrions nous rendre en Géorgie au mois de mars 2017. La délégation sera constituée en tenant compte d’un certain nombre de contacts, équivalents à ceux que nous pouvons avoir avec l’Azerbaïdjan, avec le même objectif de promotion des entreprises françaises et de leurs projets. Nous allons essayer d’être aussi dynamiques que pour les conseils de chefs d’entreprise les plus actifs – parmi lesquels figure le conseil France-Azerbaïdjan.
M. le président François Rochebloine. Quel est le statut juridique du conseil France-Azerbaïdjan, au regard de la législation en vigueur dans ce dernier pays ? Est-il tenu d’informer les autorités azerbaïdjanaises sur ses activités, ses comptes, ses ressources ?
Mme Marie-Ange Debon. Il n’a pas de statut juridique. C’est un groupement d’entreprises au sein de MEDEF International. Celles qui désirent y participer sont les bienvenues, qu’elles souhaitent développer leurs activités dans le pays ou simplement s’y implanter.
Nous n’avons par ailleurs, bien entendu, aucune obligation vis-à-vis de l’Azerbaïdjan, et il est hors de question que nous lui fournissions des informations économiques confidentielles – qu’il est au demeurant très rare que nous échangions au cours de ces réunions.
M. Bogdan Gadenne-Feertchak. Le conseil de chefs d’entreprise est une unité d’action au sein de MEDEF International, qui est lui-même une association de la loi de 1901.
En France, nous avons une existence juridique parfaitement légale. En Azerbaïdjan, nous n’avons ni bureau ni représentation. Nous fonctionnons sur un mode partenarial, c’est-à-dire avec un certain nombre d’entreprises partenaires, naturellement en parfaite coopération et information avec le ministère des affaires étrangères français, l’ambassade de France, la direction générale du Trésor et, ponctuellement, les différents ministères qui peuvent être associés à nos actions. Mais nous n’avons de comptes à rendre à personne, sauf au MEDEF.
Nous sommes autonomes dans le périmètre de notre action et dans le cadre de notre objet associatif, lequel est assez limité. Évidemment, nous sommes tenus par des engagements de confidentialité et de neutralité très stricts. Donc, nous ne transmettons à l’extérieur aucune information, même sur le nom des entreprises et des personnes qui prennent part à nos actions, dans la mesure où ce sont les règles de fonctionnement de MEDEF International qui s’appliquent à tous ses conseils de chefs d’entreprise.
M. Alain Ballay. Le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan a-t-il un impact sur les relations économiques que vous pouvez avoir avec ces pays ?
Mme Marie-Ange Debon. Les relations politiques ont toujours un impact sur les situations économiques. Ma perception est qu’il y a une très forte sensibilité des autorités azerbaïdjanaises sur ce sujet. Mais, au quotidien, ce qui affecte le plus la vie économique, c’est, malheureusement, la dévaluation du manat et le bas niveau des prix du pétrole. Cela peut contribuer à tendre les relations entre la France et l’Azerbaïdjan et à créer un environnement politique plus tendu.
Je n’ai pas connaissance de marchés ou de contrats qui auraient été suspendus à cause d’une position politique. Mais, malheureusement, je n’ai que deux ans de recul, dans un contexte économique qui s’est détérioré et où les entreprises françaises n’ont pas gagné beaucoup de marchés.
Il faudrait s’intéresser aux entreprises les plus actives. Je pense qu’un certain nombre d’entre elles progresse : on peut le voir dans les communiqués de presse de sociétés comme Total ou Technip, qui ont annoncé avoir récemment eu quelques succès. La situation politique a-t-elle un impact sur ces entreprises ? Je ne le pense pas directement, mais elle crée un environnement global qui complexifie le fonctionnement économique.
M. le président François Rochebloine. Merci madame, monsieur, d’être venus ce matin. Nous ne regrettons pas d’avoir suivi la suggestion de M. Mancel. Nous vous présentons tous nos vœux pour vous, pour MEDEF International et pour les entreprises françaises en Azerbaïdjan.
*
* *
Ÿ Audition, en visioconférence, de M. Laurent Richard, journaliste (mercredi 11 janvier 2017)
M. le président François Rochebloine. Avant que nous ne commencions notre échange avec M. Laurent Richard, Jean-François Mancel souhaite dire quelques mots.
M. Jean-François Mancel. Je souhaite effectivement rappeler ce que je vous ai écrit il y a quelques jours, monsieur le président, lorsque j’ai appris que M. Laurent Richard serait auditionné. Il y a quelques réunions de cela, lorsque notre collègue Michel Voisin vous a demandé si vous comptiez auditionner Mme Lucet, j’ai pris la parole pour dire que cela me paraîtrait totalement aberrant dans la mesure où Mme Lucet est renvoyée en correctionnelle, comme M. Richard, pour diffamation à l’égard de l’Azerbaïdjan.
La situation est pour le moins extraordinaire s’agissant de cette mission, dont chacun connaît l’origine et que j’ai rappelée lors de notre première réunion, sans que cela figure, d’ailleurs, au compte rendu mis en ligne : le président de la Mission, mis en examen pour diffamation à l’égard de l’Azerbaïdjan, va dialoguer avec un journaliste renvoyé en correctionnelle pour diffamation à l’égard de l’Azerbaïdjan, tout cela dans le cadre d’une mission de l’Assemblée nationale sur les relations entre la France et l’Azerbaïdjan ! Ce pourrait être cocasse si ce n’était extrêmement grave, parce que l’Assemblée nationale s’en trouve très nettement abaissée. Quand il s’agit d’une mission d’information de l’Assemblée nationale, ce n’est pas ainsi que les choses doivent se passer.
J’ai donc exprimé mon vif souhait que Mme Lucet ne soit pas entendue. J’ai également exprimé, dans un courriel que je vous ai adressé, le souhait que M. Richard ne le soit pas non plus. Chacun sait que l’émission de Mme Lucet vise exclusivement à faire de l’audimat pour conforter le fonds de commerce télévisuel de celle-ci. Il me paraît insupportable que l’Assemblée nationale, que les élus du suffrage universel s’abaissent ainsi !
Dans le cadre de son reportage sur l’Azerbaïdjan, Mme Lucet et son équipe sont entrés dans la mairie du 1er arrondissement de Paris pour essayer, avec l’agressivité verbale qui les caractérise, de troubler le déroulement d’une manifestation à laquelle ils n’étaient ni les uns ni les autres invités et où était présente la première dame d’Azerbaïdjan. Vous imaginez l’effet que cela a eu sur les excellentes relations que nous entretenons, notamment sur le plan diplomatique, avec ce pays !
D’ailleurs, monsieur le président, une relecture attentive des comptes rendus de nos très nombreuses réunions permettra de constater la différence entre vos questions et celles du rapporteur. Celui-ci a toujours cherché, avec impartialité et objectivité, à s’informer. Pour votre part, et comme un certain nombre de mes collègues assidus s’en sont rendu compte, vous avez, en permanence, été insidieux.
M. le président François Rochebloine. Je ne vous permets pas !
M. Jean-François Mancel. Vous avez été insidieux et perfide !
M. le président François Rochebloine. Ça suffit !
M. Jean-François Mancel. Cela montre qu’il ne s’agit pas ici d’une mission impartiale ; tout cela relève d’une opération menée par M. Rochebloine contre l’Azerbaïdjan, en cherchant à nous utiliser et à utiliser l’Assemblée nationale. C’est totalement inadmissible, et c’est la raison pour laquelle je ne participerai pas à cette mascarade !
M. le président François Rochebloine. Ce sera très bien ainsi, même s’il est dommage que vous ne restiez pas pour interroger M. Laurent Richard et que vous n’ayez pas le courage de rester pour entendre mes réponses ! Je les donne quand même, pour M. Scellier qui s’est associé à votre demande de renoncer à cette audition.
Tout d’abord, c’est ensemble que le rapporteur et moi-même avons choisi d’auditionner un journaliste – cela aurait pu être Mme Lucet, c’est M. Richard. Si M. le rapporteur n’est pas présent aujourd’hui, c’est malheureusement, et uniquement, pour des raisons de santé, mais il participera à nos travaux demain. Il m’a d’ailleurs prié de l’excuser et de saluer en son nom M. Richard.
Effectivement, M. Mancel m’a écrit pour demander l’annulation de cette réunion, jusqu’à votre jugement, monsieur Richard. Moi-même, je suis également mis en examen, non pas, comme cela a été dit, parce que j’aurais qualifié l’Azerbaïdjan de « pays terroriste » mais parce que j’ai dit que ce pays se comportait « comme » un pays terroriste – c’est quand même très différent. M. Mancel a reçu l’appui de trois collègues – M. François Scellier ici présent, et M. Door et M. Gandolfi, absents –, et seulement de ces trois collègues. Les autres membres de la Mission étaient tout à fait d’accord pour que se tienne cette audition.
Je vous remercie donc, monsieur Richard, d’avoir accepté notre invitation – je remercie également les services de l’Assemblée nationale qui l’ont organisée, car ce n’était pas simple. Pour ma part, je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous.
M. François Scellier. Je souhaite prendre la parole quelques secondes, monsieur le président, car vous m’avez interpellé.
M. le président François Rochebloine. Je vous ai plus simplement cité.
M. François Scellier. Effectivement, par courriel ou par SMS, je vous ai fait connaître ma position : je suis d’accord avec Jean-François Mancel. Cela ne signifie pas que j’approuve entièrement la manière dont il s’est exprimé, notamment il y a quelques instants. J’assisterai donc, pour ma part, à cette audition.
Il ne m’en paraît pas moins dommage que nous en soyons arrivés là. J’aurais aimé que les membres du bureau de la mission soient consultés à propos des auditions, qu’elles ne soient pas simplement décidées par son président et son rapporteur. Cela aurait évité un incident regrettable comme celui-ci.
M. le président François Rochebloine. Cher collègue, merci de rester. Nous avons accepté sans la moindre difficulté, et sans réunir le bureau, un certain nombre de propositions d’audition faites par M. Mancel. Celui-ci a voulu créer la polémique ; il en est très heureux, il a fait du spectacle, comme lors de notre réunion constitutive.
M. Mancel ne voulait surtout pas que cette mission fonctionne. Malheureusement pour lui, elle a très bien fonctionné, et vous-même, cher François Scellier, l’avez reconnu. Peut-être est-ce la lecture de l’édition d’aujourd’hui du Canard enchaîné qui l’a mis en colère, mais je n’accepte pas ces inadmissibles attaques de M. Mancel. Vous-même me l’avez dit, monsieur Scellier : j’ai été très honnête, absolument pas partisan, au cours des travaux de cette mission. Je ne suis le porte-parole de personne.
Je regrette que M. Mancel soit parti ; au lieu d’incendier Mme Lucet et M. Richard, il aurait pu rester pour poser des questions. Ce n’est pas correct de sa part, mais cela ne m’étonne pas.
M. Alain Ballay. Je remercie déjà M. Laurent Richard de prendre un peu de temps pour répondre à nos questions.
Ce qui vient de se passer donne une image un peu déplorable des élus de la nation, mais les débats sont parfois ainsi. Pour ma part, je distingue bien, monsieur Richard, votre travail journalistique de ce que vous pouvez apporter à notre réflexion et à notre connaissance de l’Azerbaïdjan. Et ce n’est pas parce que l’on est mis en examen que l’on est coupable de quoi que ce soit.
M. François Pupponi. J’arrive après l’incident, mais j’ai du mal à comprendre la polémique. Des journalistes ont fait une émission, ils ont des choses à dire ; nous les auditionnons, comme nous avons auditionné d’autres personnes. Chacun dit ce qu’il a à dire, écoutons les témoignages des uns et des autres et faisons la part des choses. Je suis un peu étonné que cela puisse causer un incident.
M. le président François Rochebloine. Chers collègues, nos débats de ce soir auront une forme un peu particulière, puisque notre invité n’est pas physiquement présent parmi nous. Il se trouve aux États-Unis, car il bénéficie d’une bourse de l’université du Michigan au sein du programme Knight-Wallace pour les journalistes, qui se propose d’offrir à des « journalistes exceptionnels par leur travail, leur leadership et leurs potentialités » – ce sont les termes qui figurent sur le site de ladite fondation – une année d’études à l’université du Michigan, axée sur le développement de leurs compétences professionnelles. Comme toujours en pareil cas, le choix de la fondation résulte de l’évaluation des reportages dont M. Richard est l’auteur.
Monsieur Richard, en vous saluant, je rappellerai brièvement que les sujets auxquels vous vous êtes intéressé sont à la fois divers et sensibles. Le dernier reportage dont votre biographie fait état est consacré à la lutte contre Daech. En lui-même, son titre – « Le bourbier : l’impossible coalition contre Daech » – montre que vous ne reculez pas devant le débat.
Votre avant-dernier reportage intitulé, « Mon président est en voyage d’affaires », a été diffusé par France 2 dans le cadre du magazine Cash Investigation dont la responsable est Mme Élise Lucet. Il est consacré à l’Azerbaïdjan et son sujet le place au cœur même des préoccupations de notre mission. Pas plus que vos autres réalisations, mais pas moins, ce reportage ne recule devant les affirmations fortes. Il n’a donc pas manqué de susciter des protestations et vous a attiré une plainte en diffamation de la part de l’Azerbaïdjan, qui n’a encore donné lieu, à ce jour, à aucun jugement.
Il vous revient de décrire à la Mission les raisons qui vous ont poussé à retenir ce thème d’investigation, les méthodes que vous avez utilisées pour réaliser le reportage, les conclusions auxquelles vous êtes parvenu.
Naturellement, les membres de notre mission d’information seront libres, après votre exposé, de formuler, soit à l’égard des modalités de réalisation du reportage, soit sur le fond de ses affirmations, toutes les remarques qui leur paraîtront opportunes. La libre critique est, au Parlement comme dans la société tout entière, un fondement essentiel de la démocratie. Je souhaite qu’elle se déploie pleinement. Bien entendu, vous aurez ensuite toute possibilité de répondre. Chacun, ainsi, pourra juger. Notre échange n’est pas ouvert à la presse, mais fera l’objet d’un compte rendu qui vous sera communiqué.
Je voudrais enfin excuser notre rapporteur, M. Jean-Louis Destans, qui ne peut être des nôtres ce soir.
M. Laurent Richard. Merci, monsieur le président, pour votre sollicitation dans le cadre de cette mission d’information, vraiment importante.
Je suis surpris qu’un député de la République puisse, comme l’a fait M. Mancel, s’opposer à l’audition d’un journaliste français, travaillant pour le service public français, qui n’a fait que son devoir d’enquête et son travail de journaliste dans un pays qui emprisonne les journalistes et les opposants. Heureusement, nous ne sommes pas en Azerbaïdjan, nous sommes bien en France, dans le cadre d’une mission d’information parlementaire, je vais donc pouvoir m’exprimer. Peut-être M. Mancel a-t-il quitté la salle parce qu’il savait qu’il serait gêné par les discussions que nous aurions, par les informations que je vous donnerais. Je n’en regrette pas moins qu’il soit parti, puisqu’il est membre du groupe d’amitié France-Azerbaïdjan et qu’il œuvre activement au sein de l’Association des amis de l’Azerbaïdjan, dont nous allons parler et qui a retenu mon attention lors de mon enquête.
Journaliste, je suis salarié de l’agence Premières Lignes Télévision, qui produit essentiellement des documentaires d’investigation, pour la plupart des chaînes françaises mais surtout pour le service public. Avec Jean-Pierre Canet et Élise Lucet, j’ai créé le magazine Cash investigation, dont j’ai été le premier rédacteur en chef. Diffusé sur France 2, celui-ci a obtenu de nombreux prix et sa qualité ne fait aucun doute. Il jouit d’une excellente réputation au sein de la presse professionnelle française, européenne et même mondiale, puisque l’agence et le magazine participent, au sein du consortium international ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists), aux différentes enquêtes en cours, notamment à la grande mobilisation des médias du monde entier autour des Panama papers.
Pour cette émission d’une durée de 120 minutes, intitulée « Mon président est en voyage d’affaires », mon enquête est partie de l’interrogation suivante : comment, quand on est Président de la République, signe-t-on des contrats dans des pays aussi sensibles que l’Azerbaïdjan ou le Kazakhstan, et comment fait-on avancer la cause des droits de l’Homme ? J’étais parti d’une archive : lors de la campagne présidentielle de 2012, François Hollande avait dit que présider la République ce n’était pas inviter des dictateurs en grand appareil à l’Élysée et promis que son élection serait une mauvaise nouvelle pour les dictatures. Le prenant au mot, j’ai voulu le suivre dans un voyage en Azerbaïdjan et au Kazakhstan pour savoir comment lui, ses équipes de l’Élysée mais aussi les parlementaires français se comportaient en Azerbaïdjan et, surtout, évoquaient la question des droits de l’Homme, sachant qu’ils représentent évidemment les valeurs de la République française. Tel était le point de départ de ma démarche.
Ce voyage a eu lieu au mois de mai 2014. Quand j’ai suivi le déplacement de François Hollande, j’étais accrédité par les services de l’Élysée et, évidemment, par les services azéris. Je disposais d’un visa obtenu via l’Élysée. Quand François Hollande a quitté l’Azerbaïdjan pour poursuivre sa visite dans le Caucase, j’ai décidé de rester sur place – en accord avec les autorités azerbaïdjanaises, puisque je disposais d’un visa –, pour approfondir mon tournage, faire différentes rencontres, enquêter sur l’aspect des droits de l’Homme, sur la possibilité, ou plutôt l’impossibilité, pour les journalistes de travailler sur place et sur la façon dont le régime d’Ilham Aliev accapare les richesses du pays.
J’ai donc fait mon travail avec mon cameraman, mais, au retour, à l’aéroport, nous avons été arrêtés illégalement par les services azerbaïdjanais, qui ont fouillé nos affaires à la recherche des disques durs et des cartes mémoires sur lesquelles nos tournages pourraient avoir été enregistrés. Nous avions évidemment réussi à protéger le plus important, mais, comme lesdits services ont trouvé des cartes mémoires qui contenaient quelques images, nous avons protesté et refusé de quitter le territoire si ce matériel ne nous était pas rendu. Nous avons alors été embarqués de force dans l’avion que nous devions prendre. Nous avons donc été victimes d’une atteinte grave à la liberté de la presse, parfaitement contraire à tous les usages et à de nombreuses conventions. Il n’y a aucune liberté de la presse en Azerbaïdjan, comme ont déjà pu vous le dire le responsable du bureau Europe de l’Est et Asie centrale de Reporters sans frontières (RSF) et une responsable d’Amnesty International ; les journalistes ne peuvent pas y faire leur travail, les journalistes azerbaïdjanais sont même systématiquement arrêtés, emprisonnés, harcelés, menacés. J’ai donc essayé, à ma manière, de continuer le travail qu’ils sont empêchés de poursuivre.
Nous avons continué notre enquête au Kazakhstan, où j’ai pu suivre un autre déplacement de François Hollande. J’y ai enquêté sur le « Kazakhgate », une affaire de contrats d’armements entre des sociétés françaises et le Kazakhstan. C’est le deuxième volet de l’émission, qui n’avait donc pas pour seul objet l’Azerbaïdjan.
Quid de nos méthodes de travail ? Munis de toutes les accréditations, nous n’avons rien fait en cachette, mais cela n’a pas empêché notre arrestation, critiquée par les services de l’ambassade de France en Azerbaïdjan. C’est à eux que nous devons notre libération assez rapide – quelques jours après la visite du Président de la République, cette arrestation d’une équipe de France 2 était effectivement choquante. Ensuite, nous avons passé pas mal de temps à enquêter, à rencontrer d’autres personnes et à monter ce reportage diffusé sur France 2.
Ce qui était intéressant, c’était la question des contrats face aux droits de l’Homme – comment le Président de la République se positionne-t-il ? – mais aussi la manière dont certains parlementaires, membres du Parlement français ou du Parlement européen, s’expriment en Azerbaïdjan ou à propos de l’Azerbaïdjan. J’ai ainsi enquêté sur Rachida Dati, élue européenne en même temps que maire d’arrondissement, mais aussi sur Jean-François Mancel et d’autres membres de l’Association des amis de l’Azerbaïdjan, comme Thierry Mariani, qui se rendent très régulièrement dans ce pays et dont les propos sur une prétendue démocratie ou de prétendus progrès sur la voie de la démocratie, sur un prétendu pluralisme – autant de fables que l’on raconte à des enfants – m’ont toujours étonné. De même, j’ai toujours été étonné que ces élus de la nation française, qui portent les valeurs françaises – la liberté, l’égalité et la fraternité, mais aussi la démocratie, la liberté d’expression, le pluralisme politique, l’accès de l’opposition aux médias –, fassent de tels déplacements, souvent à l’invitation de l’État d’Azerbaïdjan, dans des groupes d’amitié pas vraiment officiels mais un peu « parallèles ». J’ai ainsi eu la surprise de constater, lors du déplacement du Président de la République, que certains parlementaires français étaient invités, non par l’Élysée dans le cadre du voyage officiel, mais par l’État d’Azerbaïdjan lui-même, et ce n’est pas porté à la connaissance du public.
Notre enquête a porté sur la stratégie de l’Azerbaïdjan à l’égard de la France mais aussi de nombreux autres pays membres de l’Union européenne ou même des États-Unis. En effet, de nombreux parlementaires américains se sont rendus en Azerbaïdjan à l’invitation de sociétés azéries ou de l’État d’Azerbaïdjan pour faire de la communication, de l’influence, pour raconter des choses qui ne sont jamais vérifiées ni confirmées par des organisations non-gouvernementales (ONG) réputées comme Amnesty International, Human Rights Watch ou Reporters sans frontières. Au cours de cette enquête, j’ai par exemple demandé au maire de Cognac, M. Gourinchas, membre de l’Association des amis de l’Azerbaïdjan, dont les activités sont soutenues financièrement par la Fondation Heydar Aliev, évidemment azérie, pourquoi il avait prétendu que tel scrutin n’était entaché d’aucune irrégularité, alors que la mission du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’Homme (BIDDH) de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en avait constaté. J’ai posé ce genre de questions à plusieurs parlementaires proches de l’Azerbaïdjan, et leurs réponses étaient toujours étonnantes. M. Mancel donne toujours les mêmes arguments : l’Azerbaïdjan est un pays jeune, à qui il faut donner du temps et dont une partie du territoire est occupée, il faut laisser faire et ne rien dire. Qu’est-ce qui poussait ces parlementaires à agir de la sorte et à tenir des propos rarement confirmés par des observateurs professionnels, comme l’OSCE, ou par des ONG très réputées comme Reporters sans frontières et Human Rights Watch ? Nous avons essayé de mener l’enquête. Notre travail a fait pas mal de bruit, notamment parce que Rachida Dati, après avoir initialement refusé de répondre à nos questions, a répondu de manière très agressive à Élise Lucet au cours d’une entrevue dans un couloir.
Il est suffisamment rare qu’un État porte plainte contre un journaliste qui a employé le mot de « dictature » pour que ce soit souligné. Le terme est pourtant utilisé par de nombreux médias, de nombreuses ONG pour qualifier un régime qui n’admet nul pluralisme, nulle liberté de la presse, qui emprisonne systématiquement ses opposants – de nombreuses affaires permettent de le constater, y compris quand on est membre du Parlement européen. Je suis donc poursuivi pour avoir utilisé le mot « dictature », et nous en sommes au tout début de la procédure judiciaire. Derrière cette plainte, il n’y a rien d’autre qu’une volonté de déstabilisation et de harcèlement.
M. le président François Rochebloine. Où en est exactement la procédure ?
M. Laurent Richard. Nous en sommes au début, au moment, si j’ai bien compris, où est fixé le calendrier de la procédure. Au début du mois prochain, nous saurons la date du procès – sans doute se tiendra-t-il cette année. Celui-ci sera l’occasion, pour de nombreuses ONG et pour nous-mêmes, d’expliquer pourquoi nous considérons que l’Azerbaïdjan est une dictature. Nous ferons témoigner de nombreuses personnes. Finalement, ce procès est extrêmement attendu par les ONG. Un journaliste est-il libre, en France, de qualifier un régime comme celui de l’Azerbaïdjan de dictature ?
Nous avons évidemment sollicité une interview d’Ilham Aliev et de tous les protagonistes de notre enquête. Nous sommes toujours tristes de ne pas pouvoir aller jusqu’au bout d’un travail aussi important et de ne pouvoir les interroger.
M. François Scellier. Je n’ai pas trouvé du meilleur goût les commentaires qu’a pu faire M. Richard sur notre collègue Jean-François Mancel. Je n’ai pas davantage goûté ce qui a été dit ensuite sur la présidence de la République.
Je me suis rendu deux fois en Azerbaïdjan. La première fois, en 2002, alors que je venais d’être élu député. J’étais dans les bagages du ministre délégué au commerce extérieur de l’époque, François Loos, non dans les bagages de l’État d’Azerbaïdjan. J’avais demandé à participer à ce déplacement, parce que j’étais vice-président du groupe d’amitié et que l’ambassadeur de France à Bakou, Chantal Poiret, se trouvait alors être ma cousine germaine, qui m’a tout de suite dit tout l’intérêt qu’elle voyait à ce que je fasse ma première visite en Azerbaïdjan de cette manière. J’y suis retourné il y a quelques semaines, à l’invitation de l’Association des amis de l’Azerbaïdjan. Le voyage s’est déroulé dans d’excellentes conditions, et j’ai pu mesurer l’évolution considérable de l’urbanisme, les efforts fournis en matière d’accueil des touristes, en matière culturelle. Nous n’avons été soumis à aucune contrainte particulière et nous avons pu rencontrer le président ainsi que la première dame – nous nous sommes entretenus exclusivement des relations économiques, culturelles, scolaires et universitaires entre nos deux pays. D’ailleurs, personne ne critique le fait que la compagnie pétrolière de l’État d’Azerbaïdjan finance une université que l’on peut qualifier de « francophile » et des écoles ; le Président de la République s’y est d’ailleurs rendu.
J’en ai donc assez entendu de M. Richard. Certes, l’Azerbaïdjan n’est pas un État qui défend la démocratie et les droits de l’Homme au même niveau que notre pays, mais je répéterai les propos de nombre de ceux qui s’y trouvent : l’Azerbaïdjan est en état de guerre et l’équilibre de la région du Caucase est extrêmement subtil. D’un point de vue géopolitique, un pays comme le nôtre a tout intérêt à développer les relations de tous ordres avec un pays de ce type de manière à le conforter. Vous parlez de dictature, monsieur Richard, je parlerai pour ma part de « pouvoir fort ». Certes, il n’y a pas d’opposition parlementaire, et nous voyons bien que ce n’est pas une démocratie à l’occidentale – nous ne sommes pas idiots ! –, mais nous n’avons pas intérêt à une déstabilisation du Caucase.
M. Laurent Richard. J’aurais voulu deux précisions. Avez-vous bien dit que votre deuxième voyage avait été organisé, non par le groupe d’amitié, mais par l’Association des amis de l’Azerbaïdjan ?
M. François Scellier. En effet. Jusqu’à présent, par manque de moyens, le groupe d’amitié n’a pas organisé de déplacement en Azerbaïdjan – ce serait pourtant utile.
M. Laurent Richard. Qui a financé votre déplacement, concrètement ? Et l’avez-vous déclaré ?
M. François Scellier. Avant de partir, conformément aux règles d’éthique de l’Assemblée nationale, j’ai effectivement indiqué au déontologue que je partais pour trois ou quatre jours en Azerbaïdjan, à l’invitation de l’Association des amis de l’Azerbaïdjan et que ce n’était pas moi qui finançais ce voyage.
M. Laurent Richard. Les activités de l’association en question étant soutenues financièrement par la fondation Aliev, qui, selon vous, a financé votre voyage en tant que parlementaire français ?
M. François Scellier. Je n’en sais rien. Ce que je sais, c’est ce que n’est pas moi.
M. Laurent Richard. Êtes-vous en train de me dire que vous ne savez pas qui a financé votre propre voyage en Azerbaïdjan ?
M. François Scellier. En effet, et ce n’est pas la première fois que cela se passe ainsi – c’est même relativement courant. À une certaine époque, cela se faisait sans formalité ; désormais, il faut le déclarer au déontologue de l’Assemblée, qui vous donne acte de votre déclaration et vous dit que vous pouvez y aller.
M. Laurent Richard. Vous intéresse-t-il de savoir qui a payé votre billet d’avion et votre hôtel ?
M. François Scellier. La situation ne me pose pas de problème éthique. Ce n’est pas le seul pays attaqué sur le fonctionnement de ses institutions ou en raison des contraintes auxquelles il soumettrait tel ou tel qui, par l’intermédiaire d’un organisme, invite des parlementaires pour une opération de communication. Car je sais bien – c’est évident – que c’était une opération de communication !
M. Laurent Richard. Avez-vous le sentiment d’être l’outil d’une politique de communication ?
M. François Scellier. J’ai considéré que ce voyage m’offrait une information complémentaire.
M. le président François Rochebloine. Je crois que vous avez pu poser vos questions à M. Scellier, monsieur Richard, et des membres de cette mission souhaitent vous en poser d’autres.
M. Laurent Richard. La possibilité de poser des questions fait l’intérêt d’un tel échange. J’en ai d’ailleurs une deuxième pour M. Scellier.
Puisque vous avez eu la possibilité de rencontrer qui vous vouliez sans « contrainte particulière » au cours de ce déplacement, avez-vous demandé à rencontrer des prisonniers politiques ?
M. François Scellier. Non. Cela aurait été vécu comme une injure par nos hôtes ; quoi qu’il en soit, je ne me sens coupable en rien.
M. Laurent Richard. Je voulais juste savoir si vous n’aviez pas demandé à rencontrer des prisonniers politiques parce que justement vous étiez invités par l’Azerbaïdjan.
M. le président François Rochebloine. Ceci, monsieur Richard, n’est pas une interview ; je vous propose que nous reprenions le cours normal de notre audition.
M. François Loncle. Avant d’être élu député, j’étais un journaliste issu du Centre de formation des journalistes. J’ai donc le plus grand respect pour cette profession que j’ai exercée jusqu’au jour où, avec 140 journalistes, j’ai été renvoyé de l’ORTF, le pouvoir de l’époque n’ayant pas souhaité que nous l’exercions librement. Je respecte naturellement le journalisme d’investigation, arrivé trop tardivement en France par rapport aux pays anglo-saxons ; en revanche, j’ai peu de respect pour le journalisme d’inquisition. Hélas ! la dérive de l’un à l’autre se produit parfois – je n’accuse personne en particulier, mais nous pourrions dresser une liste.
M. Richard, qui devrait tâcher de mieux comprendre le fonctionnement des activités internationales de l’Assemblée nationale, ne devrait pas tout confondre. Comme M. Scellier, j’estime qu’il a formulé sur les parlementaires et le Président de la République des jugements politiques qui me semblent manquer d’objectivité. Il a, en outre, caricaturé les propos de certains de mes collègues, qui ne sont pas membres de mon groupe politique.
M. Laurent Richard. Lesquels ?
M. François Loncle. Vous avez caricaturé les propos de Jean-François Mancel et Thierry Mariani, avec lesquels je n’ai pourtant pas d’affinités politiques particulières.
J’ajoute que votre défiance à l’égard des parlementaires est l’exact inverse de la confiance totale que vous manifestez aux organisations non gouvernementales (ONG). En tant que parlementaire et ancien journaliste, j’aimerais que les magazines d’investigation enquêtent sur certaines ONG et leurs pratiques. Il serait intéressant, par exemple, de connaître le financement de Transparency International et de sa section française, Transparency France, actuellement présidée par M. Daniel Lebègue, un ancien directeur adjoint du Trésor et directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. J’ai même demandé une enquête parlementaire sur ce sujet.
J’en viens aux groupes d’amitié. J’ai fait deux séjours en Azerbaïdjan, dont le premier au cours de la précédente législature, lorsque le groupe d’amitié était présidé par Jean-Louis Dumont. On nous reproche souvent d’appartenir à des groupes d’amitié avec des pays qui ne sont pas démocratiques : il est pourtant indispensable que les membres de la commission des affaires étrangères participent à des groupes d’amitié avec toutes sortes de pays, quel que soit leur régime – car nous n’aurions guère de travail pendant notre mandat si nous nous contentions d’appartenir à des groupes d’amitié avec des démocraties solidement établies !
Voici ce qui me gêne dans le procès que vous avez indirectement fait à François Scellier : au fond, vous estimez, par votre propos et dans vos reportages, que la participation à un voyage qui ne serait pas intégralement financé par l’Assemblée nationale constituerait d’emblée un facteur de corruption.
M. Laurent Richard. Absolument pas.
M. François Loncle. J’appartiens à de nombreux groupes d’amitié avec des pays africains qui partagent souvent le financement des déplacements avec nous. Ce n’est pas parce que tel pays finance tout ou partie d’un déplacement que les participants agiront de manière à éveiller des soupçons de corruption, comme vous le croyez régulièrement !
Sur ce sujet, je m’efforce d’adopter un point de vue objectif et mesuré. À cet égard, votre objectivité – tant dans vos propos que s’agissant de votre obsession azerbaïdjanaise en général – ne m’apparaît pas lumineuse.
M. Laurent Richard. Je n’ai aucune obsession vis-à-vis de l’Azerbaïdjan ; je ne fais qu’un travail de reportage. Dans le reportage que nous avons fait sur l’Azerbaïdjan, et que vous n’avez sans doute pas vu, nous n’avons pas visé les groupes d’amitié parlementaires mais l’Association des amis de l’Azerbaïdjan, ce qui est très différent. Il va de soi que l’appartenance à un groupe d’amitié avec un pays comme l’Azerbaïdjan ne pose naturellement aucun problème à personne ; c’est même une nécessité pour les parlementaires qui s’intéressent aux affaires internationales.
Nous nous sommes simplement interrogés sur le fonctionnement de l’Association des amis de l’Azerbaïdjan, au conseil d’administration de laquelle siègent plusieurs parlementaires dont M. Thierry Mariani, que nous avons rencontré : il a découvert à cette occasion qu’il siégeait à ce conseil d’administration et n’a pas su nous dire pourquoi.
M. le président François Rochebloine. Il me l’a confirmé, en effet.
M. Laurent Richard. Notre seul objectif était d’enquêter sur des parlementaires qui, hors du cadre des groupes d’amitié officiels, consacrent du temps dans des groupes d’amitié officieux financés par d’autres pays. Il n’y a rien de suspect dans notre curiosité et notre souhait de poser des questions pour obtenir des réponses.
M. François Loncle. Pour compléter mon propos, je précise que j’ai effectué mon deuxième séjour en Azerbaïdjan dans le cadre d’une mission d’observation électorale pour le compte du Conseil de l’Europe et de l’OSCE. Ces missions, dont les participants arrivent souvent dans le pays la veille du scrutin, visent souvent des élections qui se déroulent fort bien mais ne permettent pas d’examiner tout ce qui se déroule en amont, et qui est le plus intéressant. Depuis, je n’ai donc plus jamais participé à une mission d’observation électorale.
M. Laurent Richard. Il me semble que M. Voisin a, lui aussi, pris part à une mission d’observation électorale en Azerbaïdjan, au sujet de laquelle il a donné une conférence de presse avec Mme Tana de Zulueta. Or, en début de conférence, M. Voisin avait reconnu des irrégularités lors du scrutin, ce qui a poussé les autres parlementaires à quitter la salle, suite à quoi M. Voisin est revenu sur ses propos pour affirmer que les élections avaient été libres et justes – un revirement relaté dans le rapport de l’European Stability Initiative (ESI).
M. Michel Voisin. Je préside, sous cette législature, le groupe d’amitié France-Azerbaïdjan, ainsi que la délégation française à l’Assemblée parlementaire de l’OSCE. Permettez-moi de vous dire ceci : je préfère la manière dont se tiennent les élections en Azerbaïdjan que celle dont elles se tiennent aux États-Unis, où je me trouvais l’an dernier et où nous avons été tout simplement expulsés des bureaux de vote alors même que nous étions dûment accrédités par les autorités fédérales.
J’ai effectué de nombreuses missions d’observation électorale. On nous a imposé un rapport commun au Parlement européen, au Conseil de l’Europe et aux observateurs à court terme de l’OSCE – rapport avec lequel Mme de Zulueta n’était pas d’accord. J’ai passé plusieurs heures à travailler avec elle sur ce rapport, et je n’ai jamais accepté de cosigner le rapport des observateurs à long terme. Je dispose certes d’une photographie d’une urne dans laquelle une pile de bulletins aurait été introduite ; soit. Je ne me suis rendu en Azerbaïdjan qu’au titre de l’OSCE et j’ai effectué une dizaine de missions d’observation électorale. J’ai pu constater les efforts déployés par l’Azerbaïdjan pour que ces élections soient parfaites. Précisons concrètement comment les observateurs examinent la votation : ils arrivent dans un bureau de vote le matin du scrutin et observent la chaîne du vote, depuis l’identification et l’émargement des électeurs jusqu’à leur passage dans l’isoloir et au vote proprement dit. Au cours de cette observation, je suis resté en lien direct et permanent avec le ministre des affaires étrangères ukrainien (dont le pays assurait la présidence de l’OSCE) ; les opérations se sont parfaitement déroulées.
Permettez-moi une remarque. Les observateurs à long terme sont des vacataires rémunérés, ce qui n’est pas le cas des observateurs parlementaires à court terme. Or cet outil profite à certaines nations qui l’utilisent dans leur politique extérieure à l’égard de différents États.
Le Kazakhstan m’a invité à participer à une conférence sur le terrorisme et les religions. L’Ambassade du Kazakhstan a financé mon déplacement, qui n’a duré en tout que vingt-quatre heures, le temps d’une intervention sur la laïcité en France. Qu’y a-t-il à redire ? En clair, j’estime que le journaliste d’investigation que vous êtes agit en quelque sorte à la manière d’un procureur.
M. Laurent Richard. Sans doute un jeu de questions et de réponses serait-il plus utile à votre mission d’information que de simples accusations à mon endroit.
Comment, monsieur Voisin, expliquez-vous votre revirement, puisqu’après avoir affirmé que des restrictions à la liberté de vote avaient été constatées, vous vous êtes rétracté une heure plus tard ?
M. Michel Voisin. Je vous propose de consulter mon intervention devant l’Assemblée parlementaire de l’OSCE concernant le rapport sur les élections en Azerbaïdjan ; vous comprendrez mieux. Je ne me suis aucunement rétracté ; on m’a simplement donné une photographie – que je n’ai pas prise moi-même, même si je ne la conteste pas – de bulletins introduits dans une urne.
M. Laurent Richard. N’avez-vous pas déclaré que les élections avaient été entachées d’irrégularités et que la liberté d’expression avait été limitée ?
M. Michel Voisin. Peut-être, puisqu’il existe une photographie, mais cela n’implique pas la nullité de l’ensemble des votations. La délégation d’observateurs à court terme de l’OSCE, qui comptait une trentaine de membres, était présidée par Mme Doris Barnett, députée allemande. Lors de la séance de bilan, nous n’avons relevé qu’une seule irrégularité sur environ 450 bureaux de vote observés. Cela suffit-il à établir que le scrutin était globalement truqué ?
M. Laurent Richard. Ma question ne portait que sur votre première conclusion relative à une restriction de la liberté d’expression, sur laquelle vous êtes revenu après le départ de Mme de Zulueta.
M. Michel Voisin. C’est faux.
M. le président François Rochebloine. Je rappelle que cette mission d’information a pour but d’éclairer les parlementaires – ce que vous avez d’ailleurs commencé par faire en nous relatant les circonstances de votre déplacement en Azerbaïdjan, monsieur Richard. Vous êtes, comme nous, attaché à la protection de notre parlement et de notre démocratie, que bien des pays nous envient. Certes, vous assumez votre rôle de journaliste, mais rappelons que les parlementaires, dans leur quasi-totalité, agissent – et c’est heureux – dans le respect des lois de la République.
J’ai vu votre reportage, qui ne portait d’ailleurs pas seulement sur l’Azerbaïdjan mais aussi sur le Kazakhstan. Je suis favorable à ce type d’émissions, mais il ne faut pas en faire une inquisition. Les questions que vous posez aux députés sont légitimes, mais elles ne relèvent pas du cadre de notre mission.
M. François Pupponi. Qu’avez-vous appris sur l’Association des amis de l’Azerbaïdjan et sur son financement ?
M. Laurent Richard. Sans doute les parlementaires membres de cette association – ce que je ne suis pas – pourront-ils vous en apprendre davantage que moi. Je sais ceci : l’Association des amis de l’Azerbaïdjan a pour mission d’informer officiellement sur l’Azerbaïdjan et organise des manifestations en France via la fondation Heydar Aliev, en particulier lors des visites de la première dame de ce pays. Plusieurs parlementaires se mobilisent régulièrement pour cette association : Jean-François Mancel, qui en est l’un des dirigeants, Rachida Dati, Thierry Mariani, Nathalie Goulet, ainsi que le maire de Cognac, Michel Gourinchas, et des membres de la société civile, Robert Hossein par exemple. Le discours de cette association est systématiquement à la gloire et à l’honneur de l’Azerbaïdjan.
M. François Pupponi. Comment est-elle financée ?
M. Laurent Richard. Il nous est difficile de le savoir. Nous avons interrogé le photographe Reza dont les travaux ont été financés par la fondation Heydar Aliev, ce qui a donné lieu à une exposition dans la mairie du 1er arrondissement de Paris au cours de laquelle nous avons croisé et interviewé M. Mancel. L’association des amis de l’Azerbaïdjan invite régulièrement de nombreux parlementaires. Nous n’en avons guère appris davantage : M. Mariani n’a pas su nous expliquer plus en détail qui était réellement derrière cette association. N’étant ni procureurs ni magistrats, mais simples journalistes, nous n’avons évidemment pas le pouvoir d’obtenir des documents comptables. Nous nous sommes simplement étonnés que des parlementaires aussi visibles que M. Mariani et Mme Dati donnent autant de temps à cette association ; sans doute est-ce au nom d’une grande amitié entre la France et l’Azerbaïdjan. Nous sommes d’autant plus étonnés qu’il existe des groupes d’amitié parlementaires pour mener ce type d’activités.
M. le président François Rochebloine. M. Voisin, président du groupe d’amitié, regrette précisément qu’une délégation de son groupe n’ait pas pu se rendre en Azerbaïdjan au cours de cette législature.
M. Michel Voisin. En effet. Nous devrions prochainement organiser un déjeuner afin de faire le point sur les relations bilatérales, mais aucun déplacement n’est prévu. Il est arrivé que nous recevions des parlementaires azerbaïdjanais, comme cela doit se faire, y compris avec échange de cadeaux protocolaires, rien de plus.
M. Laurent Richard. Permettez-moi de porter une information supplémentaire à votre connaissance. Il y a deux mois, Luca Volontè, parlementaire italien membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, a reconnu dans la presse italienne avoir perçu 2,3 millions d’euros de la part de M. Elkhan Suleymanov, un député azerbaïdjanais que M. Mariani connaît bien puisqu’il organise de nombreux événements en Azerbaïdjan en partenariat avec des parlementaires français. M. Suleymanov aurait transmis cet argent sur le compte de l’une des fondations créées par M. Volontè via les Îles Marshall et d’autres paradis fiscaux – pour rémunérer une mission de consultant, selon M. Volontè. Une enquête pour corruption a été ouverte en Italie.
M. le président François Rochebloine. Nous connaissions cette information. J’ajoute que M. Pedro Agramunt, président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, est également visé par une affaire dans la presse espagnole. Je me garderais bien de tout commentaire tant que ces affirmations n’ont pas été vérifiées.
M. François Loncle. M. Richard évoque la fondation Heydar Aliev : nombreux sont les pays dans le monde qui se sont dotés de fondations émanant plus ou moins officiellement du pouvoir pour faire du lobbying. Nous sommes assez grands pour déterminer dans quelle mesure nous pouvons répondre à telle ou telle invitation.
Vos investigations sont naturellement justifiées, y compris au sujet de l’affaire Volontè. Il existe certainement des moutons noirs parmi les quarante-sept parlements qui composent le Conseil de l’Europe. Vos propos me gênent néanmoins, monsieur Richard, parce qu’ils éveillent immédiatement des soupçons de corruption généralisée. Ces amalgames sont insupportables.
Je conclurai par une question simple : êtes-vous capable, dans les mois qui viennent et puisque vous vous trouvez aux États-Unis, de conduire une enquête sur Transparency International et sur sa branche française ?
M. Laurent Richard. Nous sommes capables de conduire des enquêtes de toutes sortes, qu’elles portent sur cette organisation ou sur un groupe d’amitié parlementaire. Si vous avez des informations utiles, nous sommes naturellement preneurs.
Permettez-moi de conclure en disant l’immense respect que j’ai pour le mandat parlementaire ; c’est précisément parce que la mission de représentation nationale et de défense de nos valeurs démocratiques est essentielle qu’il est si important de s’interroger sur la nature des activités des parlementaires, y compris la participation à des groupes qui sont en lien avec des pays non démocratiques comme l’Azerbaïdjan.
M. le président François Rochebloine. Je vous remercie pour cet échange, qui aura permis d’éclairer ceux d’entre nous qui ont visionné votre reportage.
*
* *
Ÿ Audition de Mme Alexandra Koulaeva, responsable du bureau Europe de l’Est et Asie centrale de la Fédération internationale des droits de l’Homme (FIDH) (jeudi 12 janvier 2017)
M. le président François Rochebloine. Nous avons le plaisir d’accueillir Mme Alexandra Koulaeva, responsable du bureau Europe de l’Est et Asie centrale de la Fédération internationale des droits de l’Homme (FIDH).
Je rappelle que la FIDH a été créée en 1922 à l’initiative des ligues française et allemande des droits de l’Homme. Elle s’est donnée pour mission la promotion et le respect des droits de l’Homme tels qu’ils sont définis par la Déclaration universelle de 1948, en y incluant donc les droits sociaux, économiques et culturels.
Quelque 184 organisations nationales de défense des droits humains, agissant dans 112 pays, ont pris part à son dernier congrès, qui s’est tenu à Johannesburg en août 2016. Elle remplit naturellement un rôle de coordination et de soutien, particulièrement important dans les pays dont les régimes ont une conception restreinte, voire inexistante, de la notion de liberté fondamentale.
Dotée d’un statut consultatif auprès de l’Organisation des Nations unies (ONU), de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) – et du Conseil de l’Europe, la FIDH se donne notamment pour tâche de protéger les défenseurs des droits de l’Homme contre les persécutions et les procédures iniques dont ils sont victimes.
Dans le rapport d’activité de la FIDH pour 2015, l’Azerbaïdjan figure parmi les seize pays où « les autorités restreignent considérablement l’espace de liberté de la société civile » et où elles « n’hésitent pas à s’affranchir du droit avec l’appui de justices aux ordres ou en adoptant des lois de plus en plus liberticides ». Vous faites nommément allusion aux persécutions dont ont été victimes M. et Mme Yunus, bien connus pour leur engagement au service des droits de l’Homme dans leur pays.
Madame, nous souhaitons que vous développiez davantage les motifs qui conduisent la FIDH à porter un jugement aussi négatif sur ce pays et que vous nous indiquiez quelles méthodes et quels documents vous utilisez pour argumenter ce jugement. Vous n’ignorez pas en effet que de telles critiques sont révoquées et radicalement mises en doute par l’Azerbaïdjan et ceux qui soutiennent ce pays. Il semble par ailleurs que vous ne puissiez pas y déployer vos activités : pouvez-vous le confirmer ou l’infirmer ?
Mme Alexandra Koulaeva, responsable du bureau Europe de l’Est et Asie centrale de la Fédération internationale des droits de l’Homme (FIDH). La FIDH travaille sur l’Azerbaïdjan ainsi que sur d’autres pays de la région depuis de nombreuses années. La FIDH n’a plus d’organisation-membre en Azerbaïdjan. Mes collègues et moi-même y avons conduit de nombreuses missions, de plus en plus difficiles à mener, si bien que nous devons avoir désormais recours aux défenseurs des droits de l’Homme originaires de certains pays et qui n’ont pas besoin de visa pour entrer dans le pays. En effet, les missions officielles sont devenues impossibles, l’obtention d’un visa nous ayant été déjà refusée à plusieurs reprises.
M. le président François Rochebloine. Pardon de vous interrompre, mais aux ressortissants de quels pays faites-vous allusion ?
Mme Alexandra Koulaeva. Les ressortissants des pays de l’Europe de l’Est n’ont pas besoin de visa pour se rendre en Azerbaïdjan.
La dernière mission officielle de la FIDH à Bakou, conduite par l’actuelle présidente d’honneur de la FIDH, Mme Souhayr Belhassen, a eu lieu en 2015 alors que la répression contre la société civile était déjà très sévère. Mme Belhassen a pu rencontrer de nombreux défenseurs des droits de l’Homme – journalistes, blogueurs et activistes politiques. Depuis, je l’ai dit, il est devenu plus compliqué de se rendre en Azerbaïdjan et nous n’avons pas pu obtenir la permission d’y mener une mission officielle. Jusqu’en 2013, nous avions accès au pays sans contraintes et avons ainsi pu visiter des prisons à Bakou – où j’ai pu m’entretenir avec des défenseurs des droits de l’Homme et des militants politiques ainsi qu’avec leurs avocats, cela très ouvertement. Et même si notre mission a été suivie, parfois de façon grotesque, par des personnes qui ne cachaient même pas leur présence à l’occasion de toutes nos rencontres, nous étions, dans une certaine mesure, entendus par les autorités et nous jouissions d’une relative présence sur place. C’est également en 2013 que nous avons pu obtenir, pour la dernière fois, un rendez-vous avec des représentants du ministère de la justice, du ministère de l’intérieur, ainsi qu’avec les représentants de toutes les institutions que nous souhaitions.
À partir de 2013, il s’est révélé de plus en plus difficile pour nous d’être présents sur place. Nous n’avons plus obtenu de rendez-vous avec les autorités ni l’autorisation de visiter les prisons. Ainsi, au cours de la dernière mission, en 2015, nous avons formellement demandé à rencontrer nos collègues détenus au centre de rétention préventive de Bakou et, pour la première fois, nous avons essuyé un refus officiel.
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. Ce refus était-il motivé ?
Mme Alexandra Koulaeva. Il n’était assorti d’aucune motivation.
Nous continuons de nous rendre en Azerbaïdjan, mais de façon moins ouverte. Nous entretenons parallèlement des relations très étroites avec nos organisations partenaires qui travaillent de plus en plus clandestinement du fait de la répression de ces dernières années.
Nous avons publié de nombreux rapports faisant état, en Azerbaïdjan, d’une répression sans précédent contre les défenseurs des droits de l’Homme, les blogueurs et les opposants politiques. Il s’agit des trois groupes contestataires les plus réprimés ces derniers temps.
La plupart des défenseurs des droits de l’Homme arrêtés en 2014-2015 ont été relâchés grâce aux pressions internationales – la forte mobilisation de la FIDH dans ce contexte explique en partie le refus absolu de la part des autorités de notre présence dans le pays. Nos rapports relèvent les mauvais traitements dont font l’objet les personnes arrêtées sur le fondement de charges fabriquées, leurs avocats subissant une pression d’intensité presque égale à celle exercée contre leurs clients, au point que certains ont perdu le droit d’exercer leur profession pour avoir défendu des prisonniers politiques. À la suite de cette mobilisation internationale de grande ampleur, ces militants, dont Leyla et Arif Yunus, que vous avez mentionnés, monsieur le président, dans votre intervention liminaire, ont été libérés, mais leurs comptes demeurent gelés, leurs organisations fermées, leurs collègues sous pression. Nombre de ces militants remis en liberté qui souhaiteraient quitter le pays en ont l’interdiction, comme, de plus en plus, ceux qui sont considérés par les autorités comme des opposants ou même des voix critiques.
Selon nos travaux, la deuxième catégorie d’individus les plus menacés est celle des journalistes et, surtout, des blogueurs. Ainsi, il y a quatre jours, Mehman Huseynov a été arrêté, en fait attaqué par huit personnes qui l’ont jeté dans une voiture, l’ont bâillonné et ont enveloppé sa tête d’un sac ; ils l’ont frappé pendant tout le trajet les menant au commissariat, où il est arrivé dans un état physique assez critique – la tête blessée et le nez en sang. Il a ensuite été torturé trois heures durant – on lui a infligé des décharges électriques – afin d’obtenir de lui les codes de ceux qui avaient accès à sa page Facebook ainsi que la promesse de ne plus exercer ses activités. Puisque resté inflexible malgré les tortures dont il a été victime, il a été accusé de résistance à la police ; cela, à l’instar de bien d’autres blogueurs en janvier, en mars, en août et en novembre 2016. Je précise que trois de ces derniers, eux aussi arrêtés et frappés, ont été filmés en train de nettoyer les toilettes du commissariat, ce qui constitue, dans la culture de ce pays, une violente insulte pour un homme ; les images en ont été diffusées par la suite afin d’exercer sur eux une pression.
Enfin, troisième catégorie, les militants politiques, membres des mouvements d’opposition, comme Nida, organisation de jeunes en faveur de la démocratie, sont pour la plupart victimes de harcèlement judiciaire, de harcèlement physique, et sont souvent condamnés à des amendes ou à une détention prolongée. Au moins quinze personnes sont ainsi en prison pour le seul motif d’avoir exercé leur droit d’expression.
En dernier lieu, je souhaite mentionner les pressions dont sont victimes les personnes parvenues à quitter le pays, installées pour beaucoup à Berlinou en Suisse, et qui, comme journalistes indépendants, travaillent sur la situation en Azerbaïdjan. Souvent leur famille en paye le prix. Le frère de l’un de ces journalistes est en effet détenu et les proches des autres sont harcelés ou menacés de harcèlement, interpellés brutalement par les forces de l’ordre afin qu’eux-mêmes fassent pression sur le journaliste exilé pour qu’il cesse ses activités sans pour autant pouvoir revenir en Azerbaïdjan. Le cas le plus célèbre est celui d’Emin Huseynov qui préside l’Institut pour la sécurité et la liberté des reporters – organisation dont l’un des dirigeants a été tué au cours d’une attaque en 2015 et un autre emprisonné il y a peu pour son activité de blogueur. Emin Huseynov vit actuellement en Suisse et ses proches, restés en Azerbaïdjan, subissent en permanence la pression des autorités.
Voilà un aperçu d’une situation fort compliquée. J’insiste sur le fait que lorsque nous menons en Azerbaïdjan une mission, officielle ou non, nous sommes ouvertement suivis autant pour nous surveiller que pour nous intimider.
M. le rapporteur. Merci, madame, pour cet exposé très clair.
Ma première question touche aux institutions. Je souhaite savoir quelles sont les relations qu’entretient la FIDH avec les Nations unies, avec le Conseil de l’Europe – puisque votre organisation y a le statut d’observateur – mais aussi avec l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et en particulier avec son Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’Homme (BIDDH).
Ensuite, je note une certaine ambiguïté dans votre exposé : vous semblez indiquer que l’attitude des autorités à votre égard s’est durcie puisqu’elles vous refusent désormais l’autorisation de vous rendre en Azerbaïdjan, mais vous indiquez dans le même temps que, sous la pression internationale, des résultats ont pu être obtenus quand bien même ils seraient partiels. Si vous deviez qualifier la situation aujourd’hui en Azerbaïdjan – et j’ai bien entendu vos considérations sur le harcèlement dont les blogueurs font l’objet –, jugeriez-vous qu’elle s’est améliorée par rapport aux années précédentes ? C’est en tout cas ce que plusieurs des personnes que nous avons auditionnées nous ont affirmé. Ainsi, d’un point de vue quantitatif, y a-t-il davantage d’Azerbaïdjanais sous pression, emprisonnés qu’il n’y en avait il y a quelques années ?
Je souhaite également que vous nous donniez votre point de vue sur les réfugiés et les personnes déplacées.
Quel est, par ailleurs, le nombre d’organisations de défense des droits de l’Homme en Azerbaïdjan et quelles sont leurs possibilités d’action ?
Enfin, question qui n’est pas la plus facile, quelles sont les quatre ou cinq réformes-clés que vous préconiseriez en matière de justice et de libertés publiques pour que le pays évolue dans le bon sens ?
Mme Alexandra Koulaeva. Nous avons le statut d’observateur, la dénomination pouvant varier, auprès des Nations unies, du Conseil de l’Europe et de l’OSCE. Nous travaillons de façon très étroite avec ces trois institutions.
Pour ce qui est des Nations unies, nous avons un bureau à Genève et un à New York. Nous soumettons les informations dont nous disposons aux organismes de l’ONU concernés et tâchons de les y sensibiliser, à savoir le comité des droits de l’Homme, le comité des droits économiques, sociaux et culturels ou autres instances à même d’examiner le cas de l’Azerbaïdjan – qui n’est pas une exception – en fonction de leur agenda habituel ou exceptionnel.
Nous n’avons pas de bureau auprès du Conseil de l’Europe mais faisons partie de la conférence des organisations internationales non gouvernementales, ce qui nous permet également de transmettre régulièrement les informations à notre disposition. Parfois nous participons à une session de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) où nous présentons nos travaux. En ce qui concerne l’Azerbaïdjan, nous avons été particulièrement actifs au moment – c’était en 2014 et 2015 – où tous nos collègues s’y trouvaient en détention. Nous avons alors sollicité avec insistance le Conseil de l’Europe pour qu’il agisse avec la plus grande fermeté face à cette situation inacceptable.
Nous n’avons pas non plus de bureau permanent auprès de l’OSCE. En revanche, nous participons chaque année à la conférence annuelle de cette organisation pour y présenter nos rapports et nos projets, et l’Azerbaïdjan y est souvent évoqué.
Vous ne l’avez pas mentionné, mais nous disposons d’un bureau à Bruxelles qui travaille avec toutes les instances de l’Union européenne : Commission, Parlement… Il s’agit de l’un des plus grands bureaux de la FIDH et l’Azerbaïdjan fait, bien sûr, partie de ses préoccupations.
J’en viens à l’ambiguïté que vous avez décelée dans mon exposé, monsieur le rapporteur. Je suis d’accord avec vous pour considérer que des militants des droits de l’Homme ont été libérés, mais je maintiens que la situation s’est dégradée – et, travaillant pour ma part sur toute la région de l’ex-Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), je puis affirmer que l’Azerbaïdjan ne constitue pas un cas exceptionnel. Il faut savoir que les personnes arrêtées n’ont pas vocation à purger l’intégralité de leur peine : il s’agit pour les autorités de mettre un terme à leur libre expression critique, certes, mais aussi de renforcer la peur et, ainsi, le contrôle de la société. Il suffit ainsi d’arrêter les six représentants les plus connus des organisations de défense des droits de l’Homme et de porter atteinte à leur intégrité physique et morale de façon suffisamment importante pour intimider ceux restés en liberté. Aussi, dans ces conditions, ne saurait-on soutenir qu’une libération anticipée serait le signe d’une amélioration du respect des droits de l’Homme – le niveau de la peur ayant atteint un degré sans précédent. Et c’est ce qui s’est passé dans les nombreux pays que j’ai eu la chance – ou le malheur – d’observer.
En somme, depuis 2013, la situation s’est, de mon point de vue, incontestablement détériorée. Les gens ont peur, ont du mal à s’exprimer, du mal à témoigner. Trouver même un interprète pour mener une mission relative aux droits de l’Homme est devenu compliqué par crainte, pour lui, des persécutions.
Évidemment, nous avons applaudi à la libération de nos collègues et avons été soulagés concernant leur destin personnel mais je suis profondément convaincue que cela ne changera rien à la répression en cours. J’y insiste : leurs comptes restent gelés, leurs activités interdites – l’illustre avocat Intiqam Aliev n’a toujours pas le droit d’exercer son métier ni d’occuper la moindre fonction publique –, ils ne peuvent pas quitter le pays pour témoigner à l’étranger et les défenseurs azerbaïdjanais des droits de l’Homme qui se trouvent à l’extérieur ne peuvent pas revenir dans leur pays. Si la répression politique était le but, il est parfaitement atteint et je pense que leur libération ne change pas grand-chose, si ce n’est, bien sûr, je le répète, pour leur destin personnel – et nombreux sont ceux qui ont besoin d’un traitement médical poussé après leur libération, tant les conditions de leur détention ont été déplorables.
À ce jour, j’y insiste, je ne constate pas d’amélioration de la situation générale.
Je pensais que la présente audition porterait davantage sur la société civile et les libertés en Azerbaïdjan mais, pour répondre à votre question sur la situation des réfugiés qui n’est pas de mon ressort, je dirai qu’elle reste des plus complexes. Celle des réfugiés du Haut-Karabagh n’est toujours pas réglée : ils vivent dans des conditions précaires et sont donc vulnérables. Plus qu’un fait, on peut avoir l’impression qu’on manipule parfois leur situation. Loin de résoudre leurs problèmes, le pouvoir les désigne toujours comme une blessure ouverte, ce qui lui permet de maintenir un niveau d’alerte patriotique élevé au sein de la société : ainsi, le conflit est toujours présent dans les esprits, dans les mots. Au moment du vif regain de tension des relations avec l’Arménie, en mars-avril 2016, le discours de haine et d’incitation à des actes violents contre les adversaires désignés était très impressionnant – j’ai pu vivre cette situation de près et je dois dire qu’il est difficile de parler de conflit « gelé ».
Vous m’avez également interrogée sur le nombre des défenseurs des droits de l’Homme en Azerbaïdjan et sur leurs possibilités d’action. Il n’est pas facile de répondre à cette question, du fait du niveau de peur et du degré de censure que nous constatons. Certains de nos collègues communiquent chaque jour avec nous et s’ils peuvent sans aucun doute être considérés, selon les critères des Nations unies, comme des défenseurs des droits de l’Homme, il ne faut pas les imaginer comme ceux qui militent en France : ils ne disposent pas de locaux, des mêmes possibilités d’action, de la même capacité à être entendus…
En outre, la répression subie en 2014-2015 par les défenseurs des droits de l’Homme en Azerbaïdjan a sensiblement détérioré leur image auprès de la population. Comment peuvent-ils prétendre défendre les droits des autres s’ils n’ont pas pu se défendre eux-mêmes de sanctions arbitraires, de mauvais traitements ? On n’a pas le réflexe, on a même peur de s’adresser à eux pour sa défense puisqu’ils ont eux-mêmes été arrêtés, battus ou sont susceptibles de l’être. Aussi la possibilité d’action de certains de ces défenseurs des droits de l’Homme se limite-t-elle à une liberté très relative d’expression : celle de dénoncer les violations des droits. Les avocats qui défendent les victimes de ces violations savent très bien qu’ils risquent de perdre la possibilité d’exercer leur métier et donc de gagner leur vie. Les défenseurs des droits de l’Homme eux-mêmes savent tout aussi bien qu’ils peuvent se retrouver en prison facilement ou perdre la possibilité de voyager ; certains ont peur pour leurs proches.
Bref, je renouvelle mon constat : la situation est bien plus dramatique fine 2016 qu’au cours des années précédentes, les capacités d’action des défenseurs des droits de l’Homme se trouvant désormais très limitées.
Je peux vous fournir l’analyse approfondie que la FIDH a faite des nouvelles lois. Les financements ne peuvent arriver qu’avec l’accord du Président de la République ; par le jeu d’institutions prévues à cet effet, le contrôle sur le financement étranger est extrêmement strict. Les possibilités de financement d’activités en faveur des droits humains à l’intérieur du pays sont limitées. Les comptes des individus sont bloqués, certaines organisations ont été fermées tandis que d’autres ont vu leurs activités suspendues, ce qui est une autre forme de fermeture.
Toutes ces mesures empêchent de mener librement les activités de défense des droits humains, d’autant que la population a de plus en plus peur de faire appel aux organisations ou aux personnes susceptibles de les défendre. L’activité des blogueurs et de ceux qui dénoncent les violations existantes est passée au premier plan, devenant le principal motif de répression, parce que c’est le dernier champ d’activité des défenseurs des droits humains et de la liberté d’expression.
Parmi les réformes nécessaires dans cette société, la première, qui n’implique pas de changement de la législation, est de réexaminer les condamnations jugées politiquement motivées par la communauté internationale. La FIDH, Amnesty international, Reporters sans frontières ou les institutions telles que le Rapporteur spécial de l’ONU sur la situation des défenseurs des droits de l’Homme ou le Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe ont des listes de personnes emprisonnées sur le fondement de charges fabriquées de toutes pièces. La composition de ces listes peut varier selon les organisations, mais de manière marginale. Selon les cas, il doit y avoir soit réexamen, soit abandon pur et simple des charges, et ces personnes doivent d’urgence retrouver la liberté.
Mais, pour restaurer un environnement permettant aux sociétés civiles d’agir, ce ne sera pas suffisant. Toutes les restrictions arbitraires qui entravent le travail des organisations de défense des droits humains doivent être abandonnées, notamment le gel des comptes bancaires. Après l’arrestation des défenseurs des droits humains en 2014 et en 2015, leurs comptes personnels et professionnels ont été gelés, bloquant les fonds qui y étaient déposés, et les organisations ont été fermées, ou leur activité a été suspendue, tandis que la liberté de mouvement était restreinte. Comme l’ont indiqué les instances internationales à de multiples reprises, ces mesures doivent être levées. La liberté d’exercice des droits doit être restaurée de façon convaincante pour faire baisser le niveau de peur, actuellement très haut dans la société.
M. le rapporteur. Combien de personnes sont inscrites sur les listes que vous mentionnez ?
Mme Alexandra Koulaeva. Amnesty dénombre quinze personnes qu’elle qualifie de « prisonniers d’opinion », c’est-à-dire emprisonnées uniquement pour l’exercice de leurs droits internationalement reconnus. Il existe de petites différences entre les organisations, mais entre soixante et soixante-dix prisonniers sont en prison pour des charges politiquement motivées. On peut donc craindre que leur condamnation ait été disproportionnée ou injuste du fait de leurs positions ou activités politiques.
Prenons l’exemple de Mehman Huseynov, ou celui des deux blogueurs arrêtés pour un graffiti sur la statue du précédent président de l’Azerbaïdjan, père du président actuel. Ces derniers ont été condamnés à de très lourdes peines : dix ans d’emprisonnement, supposément pour possession de drogues. Mais lors du procès ou des interrogatoires, aucune question ne leur a été posée sur les drogues, ils ont été interrogés uniquement sur le graffiti. Même sans les recherches détaillées qui ont été effectuées, nous aurions pu constater que cette condamnation obéissait à des motifs politiques, les charges de possession de drogues n’ayant fait l’objet d’aucune enquête de la justice !
Dans le domaine législatif, la réforme de l’appareil judiciaire est urgente, car il n’y a pas de procès équitable possible en Azerbaïdjan et il est extrêmement difficile de s’y défendre. Les moyens ne sont pas du tout égaux entre la défense et l’accusation, et sans entrer dans les détails techniques, les avocats ont les plus grandes difficultés à exercer leur métier, et même à accéder à leurs clients. Dans tous les cas relevant de motifs politiques, les avocats n’ont pas accès, durant de longues périodes, aux personnes qu’ils défendent, et l’exercice de leur métier est entravé. Certains perdent le droit d’exercer la profession suite à la défense de cas politiques. La réforme de la justice me semble donc parmi les plus urgentes et les plus nécessaires.
De manière plus générale, le pays doit être plus ouvert à l’observation internationale indépendante. Ni la FIDH, ni les autres organisations de défense des droits humains n’ont libre accès au pays, que ce soit pour observer les élections, les procès politiques…
M. le président François Rochebloine. S’agissant des élections, l’OSCE est présente, ainsi que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
Mme Alexandra Koulaeva. Les institutions sont présentes, mais pas les organisations non gouvernementales (ONG) représentant la société civile. Nous travaillons avec une plateforme européenne des ONG, qui regroupe des observateurs de la société civile. Ces derniers ont eu du mal à accéder au pays, tout comme nos collègues ont eu du mal à accéder au procès de Leyla Yunus quand elle a été jugée : les membres de Human Rights Watch ont été bloqués à la frontière avec la Géorgie. Physiquement, nous n’avons pas eu accès au pays lors des événements que nous souhaitions observer et que nous avions le droit d’observer librement.
M. le président François Rochebloine. Pourriez-vous nous faire part de vos observations sur la dépendance de l’autorité judiciaire en Azerbaïdjan et ses conséquences sur le respect des libertés fondamentales ?
À votre avis, quelle peut être l’influence de la politique russe à l’égard de l’Azerbaïdjan sur la tendance que vous notez à une aggravation des violations des droits de l’Homme dans ce pays ?
Avez-vous des contacts avec des organisations patronales ou des entreprises qui investissent en Azerbaïdjan à propos de la situation des droits de l’Homme dans ce pays ? Nous auditionnons un certain nombre de ces sociétés, qui ont mis en place des chartes d’éthiques.
Mme Alexandra Koulaeva. Lorsque les charges sont politiques, nous constatons les dysfonctionnements de la justice depuis l’arrestation des personnes jusqu’à la période faisant suite à leur libération.
Pour prendre un exemple parmi beaucoup d’autres, Mehman Huseynov a été kidnappé il y a trois jours, et finalement condamné à une amende. Il a témoigné de tortures extrêmement violentes. À l’œil nu, il est possible de constater qu’il a été battu, et lorsqu’il est sorti de son procès, il était dans un état qui témoignait encore des tortures qu’il avait subies. Il a rapporté l’utilisation de décharges électriques, de coups et d’humiliations. Le ministère de l’intérieur, saisi de ces accusations, a répondu que, dans les organes de la police en Azerbaïdjan, les gens ne sont jamais battus ni torturés à l’électricité, et que tout cela n’était que diffamation. Aucune enquête n’a été ouverte, aucune recherche n’a été faite. Le vice-président des services de presse du ministère de l’intérieur a rejeté toute possibilité d’enquête sur ces allégations.
Cet exemple récent et basique montre que dès qu’une personne devient victime de l’arbitraire, elle n’a aucune possibilité de recours. Les cas de tous nos collègues tels que le couple Yunus ou Intiqam Aliev et d’autres activistes sont identiques : non seulement ils sont accusés de choses qu’ils n’ont jamais faites, mais ils sont privés de la possibilité de se défendre et maltraités, parfois battus, toujours humiliés, et détenus le temps nécessaire avant d’être relâchés, selon les termes assez vagues d’un pardon présidentiel qui ne leur rend ni leurs droits civiques, ni l’usage de leurs comptes bancaires, ni la santé qu’ils ont perdue en détention, pas plus qu’il ne restaure leur réputation ou leur image qui a été traînée dans la boue pendant le procès par toute la presse gouvernementale.
En réponse à votre question : je pense que la justice est complètement instrumentalisée en Azerbaïdjan et que, dans les cas relevant de motifs politiques, l’influence de l’Exécutif sur les décisions judiciaires est extrêmement forte et décomplexée. Je peux fonder cette accusation sur de nombreuses décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) faisant état de ces dysfonctionnements, depuis l’arrestation jusqu’à la libération, et encore après, puisque les droits civiques des victimes ne sont pas restaurés après la libération, pour celles qui ont eu la chance d’être libérées.
L’influence éventuelle de la Russie est une question qui sort de notre champ de compétence. Nous travaillons sur des violations des droits humains précises, factuelles et documentées par nos organisations. Je ne peux pas, de manière documentée et factuelle, répondre à cette question dans le cadre de mon mandat.
Enfin, la FIDH rend publics ses rapports, communiqués de presse et appels urgents dans les cas d’attaques personnelles, et les diffuse largement auprès des instances internationales et de ceux qui nous semblent pouvoir être intéressés par ces informations. Nous n’avons pas d’action visant en particulier un des groupes que vous avez rencontrés, mais nous avons utilisé des moments tels que le Grand Prix de Formule 1 de Bakou ou d’autres activités qui portaient l’attention internationale sur Bakou et l’Azerbaïdjan comme point de départ pour les campagnes de sensibilisation sur la situation en Azerbaïdjan, notamment à l’égard des sociétés qui soutenaient ces grands événements. Par exemple, lors des Jeux européens de Bakou en juin 2015, tous nos collègues étaient encore en détention. Nous avons alors créé un outil sur les réseaux sociaux permettant à ses utilisateurs de saisir par Twitter ou Facebook des acteurs soutenant financièrement cet événement en faisant part de nos préoccupations.
Nos actions restent des démarches publiques de sensibilisation, d’alerte et de communication.
M. Jean-François Mancel. Madame, vous nous avez dit que vous vous intéressiez à l’ensemble des anciens pays de l’Union soviétique. Pouvez-vous nous dire brièvement comment les choses se passent ailleurs ? Il serait intéressant d’avoir une vision générale.
Je partage l’idée que tout homme doit être défendu, même s’il est tout seul, mais il faudrait néanmoins relativiser les choses : vous dites qu’il y a au maximum soixante à soixante-dix personnes concernées dans un pays de 9 millions et demi d’habitants.
Vous avez dit que vous n’étiez pas en mesure de parler de manière approfondie des réfugiés parce que ce n’était pas de votre responsabilité. Néanmoins, est-ce que, dans votre fédération, des personnes assument une mission à l’égard des réfugiés, et notamment les réfugiés et déplacés en Azerbaïdjan ? Ce serait intéressant de les connaître et de parler avec eux. Vous avez également dit que les réfugiés étaient « manipulés », alors que ce n’est pas de votre responsabilité. Sur quoi vous fondez-vous ?
Le ressenti est un problème plus général, puisque nous rencontrons beaucoup de nos compatriotes français, dont certains vivent en Azerbaïdjan, et ils n’ont pas du tout les mêmes sentiments que vous. Comment expliquez-vous cela et quelle réponse pouvez-vous apporter à cette apparente contradiction ?
Vous avez évoqué les « discours de haine » à propos du conflit avec l’Arménie. Ne pensez-vous pas que ces discours sont largement partagés d’un côté et de l’autre ?
M. Christophe Premat. Madame, la FIDH a été très active au moment du concours de l’Eurovision, menant une campagne assez efficace. Quelle est la stratégie de votre organisation au regard de l’histoire de l’Azerbaïdjan ? Je pense notamment à la diplomatie des droits de l’Homme : le ministère français des affaires étrangères a mené une grande campagne, sur une vingtaine d’années, pour l’abolition de la peine de mort, qui a porté ses fruits, s’agissant de l’Azerbaïdjan, en 1998.
Des actions efficaces pourraient-elles être menées à l’occasion des vingt ans de cette abolition ? La répression des droits de l’Homme est-elle liée à la situation politique conflictuelle entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, ou est-elle structurelle ? Il faut noter que ce pays a été abolitionniste assez tôt par rapport à ses voisins.
Mme Alexandra Koulaeva. Il est difficile de répondre brièvement à la question sur la situation dans les autres pays de l’ex-Union soviétique. C’est une vaste région, qui a connu des transformations particulièrement importantes au cours des vingt dernières années. Je travaille sur elle au sein de la FIDH depuis quinze ans, et la situation a changé de manière considérable dans tous les pays que nous suivons.
Globalement, nous constatons un recul par rapport aux espoirs suscités il y a vingt ans par l’ouverture de la région sur le monde. La société civile est accusée de représenter les intérêts étrangers et d’être au service de démocraties occidentales malveillantes à l’égard des gouvernements locaux. Le discours est beaucoup moins enthousiaste sur les droits humains universels. Certains droits sont en recul, notamment le droit d’expression.
L’Azerbaïdjan ne constitue pas une exception dans la région, mais je pense qu’il est allé un peu plus loin que beaucoup de ses voisins dans le sens de la répression et du recul des droits humains. Notamment, le nombre de personnes arrêtées exclusivement pour leur activité de défense des droits est beaucoup plus élevé que dans tous les pays voisins, exception faite de l’Asie centrale où la situation est encore plus dramatique dans certains pays.
Pour faire écho à la question de M. Premat, la Biélorussie a conservé la peine de mort, et cela fait partie de nos préoccupations principales. C’est le dernier pays d’Europe dans ce cas et, si nous avons bon espoir de voir un jour le continent sans peine de mort, nous n’en sommes pas encore là. L’existence de cette sentence mortelle et irréversible pose beaucoup de questions, notamment au vu du fonctionnement de la justice. Nous ne blâmons donc pas exclusivement l’Azerbaïdjan.
Sur le nombre de personnes arrêtées rapporté à la population totale, je considère naturellement que chacune d’elles a le droit d’être défendue à titre individuel, mais nous sommes également convaincus que les persécutions qui les frappent ne tiennent pas uniquement à leur personnalité ou à leurs activités, mais sont dirigées contre la liberté d’expression de la population en général, car la répression du droit d’expression vise à augmenter le niveau de peur dans la société. Si les défenseurs des droits humains ont bien été libérés, leur détention, même provisoire, a permis de resserrer d’un cran supplémentaire le contrôle de la population : les défenseurs des droits humains et les militants qui n’ont pas été arrêtés font beaucoup plus attention à ce qu’ils disent et ce qu’ils font.
Lorsque j’ai parlé du sentiment de manipulation des réfugiés, ce n’était pas le résultat d’une recherche, mais un ressenti de ma part et non pas des faits verifiés.
Nous pouvons nous féliciter, monsieur Mancel, que certains de vos compatriotes n’aient pas le même ressenti que moi : en France, il est tout à fait possible d’avoir et d’exprimer des opinions divergentes, ce qui n’est pas le cas en Azerbaïdjan. Vos compatriotes expriment une opinion, moi une autre : c’est la démocratie, et j’ai un profond respect pour ceux qui n’ont pas la même opinion que moi. Sans doute ne nous fondons-nous pas sur les mêmes documents, les mêmes recherches et le même vécu. Je me suis rendue à Bakou à plusieurs reprises et j’ai pu observer un certain nombre de problèmes dont je fais part dans mes rapports, mais l’expérience de personnes qui ont visité le pays dans le cadre d’autres mandats peut être différente.
Je tiens à souligner que nous avons toujours eu le soutien de l’ambassade de France en Azerbaïdjan. La mission diplomatique a toujours été ouverte et nous avons systématiquement rencontré ses membres lors de nos voyages dans le pays. Notre organisation est internationale, mais toute son histoire est liée à la France et nous avons toujours eu des relations très étroites.
M. le président François Rochebloine. À la France et à l’Allemagne.
Mme Alexandra Koulaeva. C’est vrai, mais notre organisation a été fondée en France, bien avant ma naissance – c’est une longue histoire. Nous avons toujours bénéficié du soutien des instances françaises, qui ont toujours été aux côtés de nos collègues. Mme Yunus, notamment, a été distinguée en étant décorée de la Légion d’honneur, juste avant son arrestation. Toutes les mesures symboliques que l’antenne diplomatique française à Bakou pouvait prendre à leurs côtés l’ont été, mais, la situation étant ce qu’elle est, cela n’a sauvé le couple Yunus ni de l’arrestation ni des persécutions. En revanche, je suis persuadée que les efforts de la France, parmi d’autres pays, ont joué un rôle dans sa libération.
Nous avons fait venir en France des défenseurs des droits humains azerbaïdjanais et des membres des familles de personnes emprisonnées. Nous avons pu rencontrer le ministre des affaires étrangères et certains de vos collègues, ainsi que les conseillers du Président de la République, et porter haut et fort nos préoccupations. Nous avons toujours été entendus, même si la capacité d’influence de la France sur la situation n’a pas toujours été aussi grande que nous aurions pu le souhaiter.
La France a toujours porté le sujet de l’abolition de la peine de mort. Tant que nous avions la possibilité de rencontrer les instances officielles de l’Azerbaïdjan, elles ont toujours été fières de dire qu’elles figuraient parmi les premiers abolitionnistes de la région. Nous avons visité avec eux le musée situé à l’intérieur du ministère de la justice, et dans lequel sont exposées toutes les armes avec lesquels des personnes ont été fusillées. J’imagine que cela fait partie de la mémoire de l’Azerbaïdjan, et j’espère que cet exemple pourra être bénéfique à la Biélorussie, qui maintient des relations très étroites avec ce pays. Malheureusement, malgré cette évolution extrêmement positive, des appels répétés se font entendre en faveur de la restauration de la peine de mort. Ils ne sont pas suivis d’effet pour le moment, mais cela fait partie des nouveaux défis que nous constatons dans la région, au Kazakhstan, en Azerbaïdjan et en Russie.
M. le président François Rochebloine. De qui proviennent ces appels répétés ?
Mme Alexandra Koulaeva. Parfois de députés, parfois de journalistes qui travaillent pour la presse contrôlée par le pouvoir. Pour le moment, ces appels ne sont pas suivis d’effet au niveau législatif, mais ce discours n’est pas seulement présent en Azerbaïdjan.
M. Michel Voisin. On l’entend même en France !
Mme Alexandra Koulaeva. En effet. C’est pourquoi il nous semble extrêmement important de défendre avec force l’abolition, pour souligner que cette victoire importante est réversible. Il faut donc continuer à se battre.
Enfin, les discours de haine ne sont pas, c’est vrai, l’apanage d’une partie au conflit, mais nous sommes ici pour parler de l’Azerbaïdjan.
M. le président François Rochebloine. Merci, madame, d’avoir répondu très clairement et très précisément aux différentes questions que nous vous avons posées, et merci pour le travail que vous effectuez partout où les droits de l’Homme sont bafoués, quel que soit le pays concerné.
*
* *
Ÿ Audition de M. Olivier Achard, vice-président de la zone Eurasie pour Thales International, et de Mme Fanny Mounier, chargée de mission auprès du vice-président chargé des relations internationales
(jeudi 12 janvier 2017)
M. le président François Rochebloine. Nous accueillons M. Olivier Achard, vice-président de la zone Eurasie pour Thales International, accompagné de Mme Fanny Mounier, chargée de mission auprès du vice-président chargé des relations internationales.
Madame, Monsieur, je vous rappelle que l’objet de la mission est de faire le point sur les relations politiques et économiques entre la France et l’Azerbaïdjan au regard des objectifs français de paix et de démocratie dans le Sud-Caucase. Cela nous conduit naturellement à nous intéresser au développement des investissements et des transactions des entreprises françaises dans ce pays. Ainsi que nous l’avons demandé précédemment aux représentants d’Engie ou de Suez, par exemple, nous vous invitons à décrire l’historique de l’implantation de votre société dans ce pays, l’ampleur financière des affaires que vous y traitez et la nature des prestations que vous assurez.
Dans un second temps, vous pourriez décrire le paysage contractuel de ces relations, c’est-à-dire, notamment, nous indiquer à quel niveau de la structure politique et administrative, et selon quelles procédures, sont préparés et conclus les contrats. Les autorités auxquelles vous avez affaire émettent-elles des exigences, des vœux ou des suggestions quant à l’éventuelle implication d’entreprises azerbaïdjanaises dans ces relations contractuelles ?
Enfin, nous aimerions connaître votre évaluation générale des « conditions de travail » de Thales en Azerbaïdjan : qualité de l’exécution des obligations contractuelles, intervention de la sous-traitance ou d’une procédure assimilable, rapidité et efficacité des procédures administratives.
M. Olivier Achard, vice-président de la zone Eurasie pour Thales International. L’histoire de Thales en Azerbaïdjan a commencé dans les années 1990. Nous avons ouvert un bureau à Bakou en 2014. Cinq personnes y travaillent actuellement, dont un directeur pays et des key account managers chargés des relations avec nos clients, les deux plus importants étant le métro de Bakou et la compagnie aérienne Azerbaïjan Airlines (AZAL).
Les deux principales activités pour lesquelles nous sommes présents en Azerbaïdjan sont des activités civiles liées l’une et l’autre au domaine des transports.
La première est le contrôle du trafic aérien. C’est l’activité « historique » qui nous a amenés dans ce pays il y a une vingtaine d’années. Aujourd’hui, Thales est le leader mondial en matière du contrôle du trafic aérien. Cette branche emploie environ 1 500 personnes et fabrique deux types de systèmes, des centres de contrôle et des radars, qui servent à surveiller l’espace aérien et à contrôler les avions des compagnies aériennes qui soit se posent dans le pays, soit traversent son espace aérien. Ces systèmes sont identiques à ceux que nous avons fournis à la direction générale de l’aviation civile pour équiper les aéroports français et les centres de contrôle de Reims, Brest ou Aix-en-Provence, ces derniers étant toutefois plus performants, compte tenu de l’importance du trafic aérien dans notre pays.
Étant donné les conflits actuels dans la région, notamment au Moyen-Orient, les routes aériennes ont été sensiblement modifiées, et de nombreux vols traversent désormais le Caucase. Il s’agit donc d’une zone importante du point de vue de la sécurité aérienne. Depuis une vingtaine d’années, nous équipons l’aviation civile azerbaïdjanaise, sachant que le contrôle du trafic aérien dépend de la compagnie nationale, AZAL, comme c’est souvent le cas dans les pays de la région.
Nous produisons l’ensemble de nos radars sur un site en Normandie, inauguré il y a vingt ou trente ans, qui emploie environ 300 personnes. Ainsi que je l’ai indiqué, nous sommes leader dans ce domaine, et ces radars équipent le monde entier.
Nous fournissons aussi à la compagnie AZAL des simulateurs de vol pour ses pilotes – sachant qu’elle achète à la fois des Boeing et des Airbus –, ainsi que des systèmes permettant aux passagers de regarder des films ou de surfer sur internet à bord des avions.
Deuxième grande activité de Thales en Azerbaïdjan : nous équipons les lignes existantes du métro de Bakou de systèmes de signalisation modernes. Dans le passé, le métro de Bakou disposait de systèmes hérités de l’ère soviétique. Aujourd’hui, il installe des systèmes automatisés sur ses lignes, afin d’augmenter le nombre de métros par heure et d’améliorer la sécurité des passagers. On peut faire un parallèle entre ce travail et celui que nous faisons sur la ligne 13 à Paris. Nous appliquons le même concept partout dans le monde pour améliorer la sécurité du métro.
M. le président François Rochebloine. Combien de passagers empruntent le métro de Bakou ?
M. Olivier Achard. Je l’ignore : je n’ai pas encore eu la chance de visiter le métro de Bakou. À en juger par le nombre de personnes que l’on voit sortir des bouches de métro, c’est un moyen de transport fortement utilisé.
Ce qui est sûr, c’est que nous assistons à un changement de génération à la tête des deux entreprises, tant du métro de Bakou que de la compagnie AZAL : des personnes âgées de 40 à 50 ans, formées aux nouvelles technologies et désireuses de les déployer, arrivent aux échelons intermédiaires et supérieurs du management, ce qui est assez intéressant pour une entreprise telle que la nôtre.
Le volume d’affaires de Thales en Azerbaïdjan est de 20 à 25 millions d’euros les bonnes années, de 15 à 20 millions sinon, ce qui est assez faible rapporté au chiffre d’affaires du groupe – 14 à 15 milliards d’euros en 2015.
M. le président François Rochebloine. Ce chiffre d’affaires est-il comparable à celui que vous réalisez dans les autres pays du Sud Caucase ?
M. Olivier Achard. Il est un peu supérieur à celui que nous réalisons en Géorgie, qui varie lui aussi selon les années.
M. le président François Rochebloine. Êtes-vous présents en Arménie ?
M. Olivier Achard. Nous y avons été présents très longtemps. Je me suis moi-même rendu plusieurs fois à Erevan, où j’ai visité le centre équipé par Thales. Nous étions chargés du contrôle du trafic aérien, de la même façon que nous le sommes à Bakou et, dans une moindre mesure, en Géorgie, à laquelle nous fournissons des radars. Nous rêvions d’inciter la Géorgie à nous rejoindre et de créer une coopération à l’échelle régionale, sachant que, dans les domaines civils, le fait d’utiliser les mêmes systèmes facilite le contrôle du trafic. Malheureusement, il y a deux ou trois ans, l’Arménie a choisi de s’équiper de systèmes russes. Jusqu’alors, les Russes n’étaient présents nulle part dans le monde. Après une collaboration de dix ou quinze ans avec l’Arménie, cela a été une déception pour nous.
M. le président François Rochebloine. Le conflit dans le Haut-Karabagh y est-il pour quelque chose ?
M. Olivier Achard. Non. Nos partenaires arméniens ont lancé un appel d’offres, auquel nous avons répondu, et ont finalement choisi les nouvelles technologies proposées par les Russes.
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. Je souhaite vous interroger sur l’environnement des affaires, que vous venez d’ailleurs d’évoquer à propos de l’Arménie. Comment se déroule la passation des marchés ? Les cahiers des charges sont-ils précis ? Les procédures d’appel d’offres sont-elles transparentes ? Sont-elles comparables à celles auxquelles vous vous soumettez habituellement ? Vos contacts se limitent-ils à la sphère privée ou bien avez-vous besoin, comme d’autres, du soutien de l’administration française dans le cadre de discussions serrées avec l’administration azerbaïdjanaise ?
Plusieurs sociétés françaises nous ont indiqué subir une concurrence de plus en plus rude de la part d’entreprises des pays émergents. On nous a notamment beaucoup parlé de la Turquie. Cette concurrence est peut-être moins forte pour Thales, qui propose des technologies spécifiques et sophistiquées. Y êtes-vous néanmoins soumis ? Si tel est le cas, les procédures vous paraissent-elles les mêmes pour vous et pour vos concurrents des pays émergents ?
Vous disposez de cinq personnes sur place et je suppose que vous faites appel à de la main-d’œuvre locale pour mettre en œuvre vos technologies. Quelle appréciation portez-vous sur son niveau de qualification ?
Quel jugement portez-vous sur les réformes conduites par le gouvernement azerbaïdjanais, notamment en matière de simplification et d’informatisation des procédures administratives et douanières, ainsi que de lutte contre la corruption ?
M. le président François Rochebloine. Ces questions rejoignent celles que j’ai posées dans mon intervention liminaire concernant les « conditions de travail » de Thales en Azerbaïdjan.
M. François Scellier. Vous avez indiqué avoir perdu un marché en Arménie face à une entreprise russe. J’observe à l’attention de mes collègues de la mission d’information que l’Azerbaïdjan semble plus soucieux que l’Arménie de son indépendance à l’égard de la Russie. Les équilibres politiques sont délicats dans toute cette partie du Caucase, et lorsque l’on rencontre des interlocuteurs azerbaïdjanais sur place, on sent de leur part une volonté de se tourner davantage vers l’Europe et la France que vers la Russie.
M. Olivier Achard. En ce qui concerne les procédures d’appel d’offres, je vous parlerai des deux domaines civils dans lesquels nous avons remporté des marchés : le contrôle du trafic aérien et la signalisation sont très ouverts aujourd’hui en ce sens que nos clients partagent beaucoup d’informations sur ceux-ci avec leurs collègues et assistent à de nombreuses conférences internationales, telles que celles de l’Association internationale du transport aérien (IATA). Ils lancent donc tous la plupart du temps des appels d’offres. Ils sont très au courant de nos technologies et de nos concurrents. Ils voyagent beaucoup pour aller comprendre chacune de ces technologies – notamment dans les pays émergents qui nous font concurrence. Nous sommes aujourd’hui en concurrence avec la Chine, la Corée et la Russie mais surtout, dans le domaine du contrôle du trafic aérien, avec l’Espagne qui déroule le « tapis rouge » dès qu’un dirigeant azerbaïdjanais vient dans le pays. Nous étions notamment le fournisseur du centre de contrôle de Bakou mais nous avons perdu ce marché il y a quelques années au profit des Espagnols, plus compétitifs et plus réactifs. Les clients civils en Azerbaïdjan nous soumettent à la concurrence : ils recherchent l’innovation et ne sont pas suiveurs, contrairement aux autres clients de la région. Nous avons signé l’année dernière un premier contrat visant au lancement d’un nouveau produit facilitant la gestion des flux aériens. L’Azerbaïdjan souhaite en effet se positionner entre l’Europe et l’Asie en ce domaine et discuter avec Eurocontrol. Bref, dans le cadre des appels d’offres, nous sommes constamment soumis à une forte concurrence en termes de technologies et de prix. La situation est la même pour le marché du métro de Bakou : nos concurrents étrangers Bombardier et Siemens essaient de prendre notre position.
S’agissant de la rapidité contractuelle, les Azerbaïdjanais respectent bien nos contrats : ils paient en temps et en heure, ce qui n’est pas toujours le cas dans cette région.
Comme je le soulignais à l’instant, la concurrence des pays émergents est très forte, le Caucase attirant aujourd’hui l’ensemble des acteurs. Dans les deux domaines dont j’ai parlé, ce n’est pas encore le cas des Turcs – pour répondre à votre question – et nos concurrents sont bien russes, coréens et, surtout, espagnols.
Vous m’avez interrogé quant à la sous-traitance locale : s’agissant des grands systèmes que nous proposons, il nous est difficile de sous-traiter des activités – à l’exception de la conception de radars. Lorsqu’on construit de grands centres de contrôle ou le métro de Bakou, une bonne part du travail consiste en la conception de logiciels, qu’il est difficile de sous-traiter localement.
En revanche, lorsqu’on réalise l’installation de radars, on peut sous-traiter une partie du génie civil pour la construction des tours qui abriteront ces radars. C’est ce que l’on a fait à l’aéroport de Bakou lors des Jeux européens : les Azerbaïdjanais nous ayant demandé de construire une petite tour de contrôle en béton, nous avons dû faire appel à une entreprise locale. Nous avons donc procédé à une mise en concurrence pour choisir des sous-traitants compétents car c’est nous qui étions responsables de l’ouvrage.
Dans le cadre de nos deux projets civils, nous n’avons pas rencontré, à ma connaissance, de difficultés administratives majeures – ce qui n’est pas le cas dans le reste de l’Eurasie où les procédures douanières sont assez compliquées. Je ne me souviens pas que des projets aient été retardés parce que des radars auraient été bloqués en douane. N’ayant pas encore testé le visa électronique, je ne saurais vous en parler. Les Azerbaïdjanais négocient des contrats conformes aux standards internationaux. Leurs équipes sont assez jeunes et très bien formées.
Les projets dont je vous parle ne sont pas très importants mais nous en parlons à l’ambassadrice à chacune de nos visites et celle-ci m’a accompagné la dernière fois que je me suis rendu chez AZAL. L’ambassade nous aide également lors des événements ou des salons qui peuvent avoir lieu dans le pays. J’ai aussi eu l’occasion de rencontrer le ministre des finances d’Azerbaïdjan, lors de sa visite en France, en décembre dernier et il a clairement dit que les entités dont je vous ai parlé sont maintenant très indépendantes financièrement de l’État, qui ne les soutient plus comme par le passé. Elles vivent uniquement sur leurs fonds propres et font donc très attention à leurs investissements, notamment dans un contexte de soubresauts du prix du pétrole. C’est la raison pour laquelle nos projets ne sont pas très importants aujourd’hui. Nous pensions que la dynamique d’investissement serait plus forte mais le soutien du ministère des finances s’est amoindri si bien que la compagnie aérienne et l’aviation civile, par exemple, sont désormais dépendantes des redevances qu’elles facturent aux compagnies exploitant les avions qu’elles contrôlent. Lors de la rencontre de décembre dernier, le ministre des finances azerbaïdjanais en a averti le représentant d’Airbus, soulignant qu’il appartenait au constructeur de vérifier que les entreprises avaient bien les moyens financiers nécessaires pour satisfaire à ses exigences.
M. le rapporteur. Pourriez-vous nous dire quelques mots du volet militaire ?
M. Olivier Achard. L’activité du groupe Thales se répartit à égalité entre le civil et la défense. Nous avons donc bien évidemment des activités militaires que nous essayons de proposer à l’Azerbaïdjan, mais ce sujet avance très doucement car, le cours du pétrole étant bas, il y a peu de projets d’investissement, quels que soient les domaines. Les projets de défense aujourd’hui en discussion concernent surtout la surveillance des côtes et la protection des infrastructures telles que les plateformes pétrolières. Nous avons aussi un projet mêlant le civil au militaire pour assurer la surveillance des vols d’hélicoptères vers les plateformes, dont le flux est très important.
M. le président François Rochebloine. L’influence de la Russie dans la région en matière de vente d’armes a-t-elle des conséquences sur vos marchés en Azerbaïdjan ?
M. Olivier Achard. Dans le domaine de la défense, Thales produit soit des systèmes de surveillance soit des systèmes de communication.
M. le président François Rochebloine. Le programme Félin (Fantassin à Équipements et Liaisons Intégrés) est-il uniquement destiné à la France ?
M. Olivier Achard. Oui. L’Azerbaïdjan a souhaité qu’on lui présente des concepts de surveillance de sites, c’est-à-dire des radars de surveillance des côtes et des plateformes mais à ma connaissance, nous n’avons pas d’autres projets. Je tiens aussi à préciser que nos projets sont tous soumis à autorisation d’exportation de la Commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG).
M. le président François Rochebloine. Le code d’éthique de Thales détaille les dispositions à prendre par ses collaborateurs pour échapper aux tentatives de corruption. Ces dispositions ont-elles trouvé à s’appliquer en Azerbaïdjan depuis le début de votre implantation dans ce pays ?
M. Olivier Achard. La prévention du risque éthique et de la corruption est partie intégrante de la stratégie d’entreprise de Thales. Fanny Mounier, qui nous a rejoints il y a trois ans, m’expliquait que depuis son arrivée, elle a déjà été formée deux fois sur deux sites différents. L’ensemble de nos collaborateurs, quels que soient leur poste et leurs responsabilités, sont formés en ce domaine. Nous appliquons une politique de tolérance zéro sur ce sujet et nous n’avons pas eu de problèmes de ce type jusqu’ici. En même temps, Thales publie beaucoup sur cette question. Le directeur éthique du groupe était en début de semaine à Ljubljana, à l’invitation de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), pour expliquer comment le groupe travaillait sur ce thème. Nos clients savent donc très bien quelles règles nous appliquons. Les partenaires locaux que nous devons choisir sont audités et font l’objet de procédures de diligence raisonnable (due diligence). Ainsi Thales ne veut prendre aucun risque qui pourrait porter atteinte à son image et mettre en péril son volume d’affaires dans le pays.
Mme Fanny Mounier, chargée de mission auprès du vice-président de Thales International chargé des relations internationales. En plus du travail de sensibilisation et de formation des salariés qui a été mis en place depuis maintenant plusieurs années dans notre groupe, un dispositif d’alerte a également été institué pour les salariés : chacun sait qui est son responsable éthique, à contacter en cas de doute. À ma connaissance, aucune alerte nécessitant une action particulière ne nous a été signalée concernant l’Azerbaïdjan.
M. le président François Rochebloine. Je vous remercie, Madame, Monsieur, pour cet échange très instructif.
*
* *
Ÿ Audition de M. Pascal Pacaut, directeur du département Asie de l’Agence française de développement (AFD) (mercredi 18 janvier 2017)
M. le président François Rochebloine. Nous accueillons une délégation de l’Agence française de développement (AFD) conduite par M. Pascal Pacaut, directeur du département Asie de l’Agence, que je remercie d’avoir répondu à notre invitation.
Monsieur le directeur, devant notre mission, l’ambassadrice à Bakou, Mme Aurélia Bouchez a indiqué que l’AFD avait été mobilisée « pour contribuer au financement de projets dans le secteur ferroviaire ». J’ignorais que l’AFD pouvait être amenée à intervenir dans des pays qui, tel l’Azerbaïdjan, connaissent un certain développement grâce aux ressources tirées du pétrole et du gaz ; pourtant, l’engagement de l’Agence en Azerbaïdjan s’élèverait à 112 millions d’euros, montant qui n’est pas négligeable.
Avant que de vous entendre préciser la nature des investissements ainsi aidés, je vous serais reconnaissant de rappeler quelle est la stratégie générale de l’AFD dans le Caucase du Sud et les raisons qui l’ont conduite à s’intéresser plus particulièrement à l’Azerbaïdjan. La question est essentielle car, au-delà de ses aspects directement financiers, chacun sait l’importance du concours que votre établissement apporte à la diplomatie économique de la France. Aussi souhaitons-nous savoir si l’AFD entend poursuivre son action en Azerbaïdjan et, si tel est le cas, selon quelles orientations et pour quels montants.
M. Pascal Pacaut, directeur du département Asie de l’Agence française de développement (AFD). L’AFD vient de fêter son soixante-quinzième anniversaire. Elle intervenait à l’origine dans ce qui était alors les colonies et à ce titre, pour l’Asie, en Indochine, d’où elle est partie quand la France en est partie. Au début des années 1990, le Gouvernement et le Parlement nous ont autorisés à intervenir à nouveau en Asie, d’abord au Vietnam, au Cambodge et au Laos, et, peu à peu, la zone d’intervention de l’Agence s’est ensuite étendue ; ce ne fut jamais à notre initiative mais sur décision de l’État. Aujourd’hui, nous intervenons du Caucase jusqu’à la Chine et dans une grande partie des pays situés au Sud de cette ligne. Notre engagement en Asie est, bon an mal an, de 1,2 milliard d’euros, soit quelque 15 % de notre activité.
Le comité d’orientation stratégique de l’Agence nous a autorisés en juin 2011 à prospecter dans le Caucase du Sud et spécifiquement en Azerbaïdjan. Lors de la visite dans ce pays de M. Nicolas Sarkozy, alors président de la République, en octobre de la même année, un protocole de coopération a été signé entre le gouvernement azerbaïdjanais et l’Agence. Il a défini les secteurs d’intervention prioritaires de l’Agence dans le pays : le développement urbain – l’accent étant mis sur l’eau, l’assainissement, la gestion des déchets, les transports et l’énergie –, le tourisme et le financement du secteur privé. En avril 2012, une lettre de nos tutelles nous a autorisés formellement à intervenir dans dix pays dont l’Azerbaïdjan, dans le cadre d’un mandat spécifique visant à promouvoir une croissance verte et solidaire, sur la base de prêts pas ou peu concessionnels. Mais les relations entre l’Agence et l’Azerbaïdjan ont été interrompues pendant une bonne partie de l’année 2012 : après le vote de la loi Boyer visant à réprimer la négation des crimes de génocide et des crimes contre l’humanité, les autorités azerbaïdjanaises, en janvier 2012, ont invité l’équipe technique de l’AFD qui participait à une mission sectorielle, en partenariat avec la Banque asiatique de développement, à quitter le pays.
M. le président François Rochebloine. Vous ressentez donc l’influence de la Turquie ?
M. Pascal Pacaut. On nous demande de reprendre l’avion, nous reprenons l’avion… Puis les relations se sont normalisées et nous avons effectué plusieurs missions dont l’une, préalable à la visite du président Hollande en mai 2014, a permis de définir le projet que vous avez évoqué, le seul que nous avons financé à ce jour en Azerbaïdjan : le financement de deux ateliers d’entretien de locomotives. Ce prêt est lié à l’attribution, officialisée en mai 2014, d’un marché de locomotives à Alstom ; couplé à un prêt garanti par la Coface, il a permis à Alstom d’emporter ce marché face à Siemens.
M. le président François Rochebloine. Vous établissez donc un lien certain entre l’aide de l’AFD et le marché obtenu par Alstom.
M. Pascal Pacaut. C’est notre point de vue : ce couplage a permis à Alstom d’emporter le marché en proposant un ensemble « locomotives et maintenance ». Le projet de prêt de 112,5 millions d’euros a été soumis à l’approbation de notre conseil d’administration en décembre 2015 et nous sommes en train de mettre la dernière main à l’accord de prêt. Les nouvelles locomotives seront livrées à la fin de cette année et les ateliers de maintenance devront bien sûr être en état de fonctionnement. Nous tenons compte de cette échéance.
L’AFD a été associée à la visite que M. Matthias Fekl, secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, a faite en Azerbaïdjan en juillet 2015. Les perspectives d’autres projets en coopération ne sont pas évidentes. Nous discutons régulièrement avec les autorités azerbaïdjanaises sans que ces échanges aboutissent pour l’instant. L’expérience montre qu’un temps d’acclimatation est nécessaire dans tous les pays nouveaux où nous intervenons. À cela s’ajoute que, dans les anciennes républiques soviétiques, le dialogue est compliqué : qu’il s’agisse des procédures ou des obligations liées à la lutte anti-blanchiment, une bonne dose de pédagogie est nécessaire – mais ce n’est pas propre à l’Azerbaïdjan. Il est donc difficile de tirer des conclusions du fait qu’aucun autre projet n’est prévu pour le moment.
M. le président François Rochebloine. Quels sont vos interlocuteurs ?
M. Pascal Pacaut. Des responsables techniques, mais essentiellement le ministère des finances – davantage que dans d’autres pays.
M. le président François Rochebloine. Qu’est-ce qui a conduit l’AFD à intervenir en Azerbaïdjan ?
M. Pascal Pacaut. Nous répondons aux demandes de l’État. Nos engagements en Asie – 1,2 milliard d’euros en tout, je vous l’ai dit, répartis entre de nombreux pays – représentent un petit montant. Nous sommes un bailleur de fonds modeste dans une zone du monde où beaucoup de ressources sont disponibles, où les marchés financiers sont très liquides et où le coût de l’argent est peu élevé, pour l’instant. Les bailleurs de fonds institutionnels, très présents, offrent des conditions financières plus intéressantes que les nôtres puisque, à la demande de l’État, nous n’intervenons que très peu avec l’argent des contribuables : il nous arrive, en Afghanistan ou au Laos, d’accorder des subventions, mais, très souvent, nos interventions en Asie se traduisent par des prêts non bonifiés, si bien que nous sommes peu compétitifs.
Pour cette raison, nous devons apporter une valeur ajoutée, qui tient à la qualité des échanges bilatéraux. Nos engagements, en Chine comme en Inde, portent sur des montants insignifiants. Mais ce qui, dans l’AFD, intéresse les ministères chinois des finances et du plan n’est pas tant le volume du financement consenti – en Chine, nos engagements ne sont que de 100 millions d’euros par an, bien peu de chose – que l’accès que nous permettons à des réflexions sur les politiques publiques en matière de transport, de politique de la ville, d’aménagement du territoire, d’énergie verte ou de gestion des parcs naturels. Ainsi avons-nous présenté au conseil d’administration, en décembre dernier, un projet de prêt de 75 millions d’euros visant à la création du premier parc naturel chinois, en partenariat avec le parc naturel régional des Ballons des Vosges. Nous devons trouver des points d’accroche avec la France, car c’est ce qui intéresse au premier chef nos interlocuteurs. Il peut s’agir de réflexions sur l’aménagement du territoire, ce qui implique d’établir des liens avec les collectivités locales et les élus ou, comme en Azerbaïdjan, du savoir-faire des entreprises françaises. C’est grâce à ces éléments additionnels que nous parvenons à concrétiser des prêts dont les termes ne sont pas très intéressants et dont le volume est peu élevé.
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. Puisque vous n’avez pas consenti de prêt concessionnel, quelles améliorations avez-vous permises telles qu’Alstom a réussi à emporter ce marché face à l’âpre concurrence de Siemens, fortement soutenu par la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ? Comment, précisément, l’AFD aide-t-elle les entreprises françaises à emporter des marchés en Azerbaïdjan ? Sur un plan général, de quels moyens disposez-vous comparés à ceux des agences concurrentes, européennes et autres, en Azerbaïdjan et dans les autres pays du Sud Caucase ? Quel est le niveau de leur présence et de leurs interventions ?
Retraçant la genèse des relations de l’Agence avec l’Azerbaïdjan, vous avez indiqué qu’elles résultent de la demande politique du président Sarkozy d’abord, du président Hollande ensuite.
Enfin, il a été fait état de possibles coopérations entre nos deux pays dans le secteur agricole ; qu’en est-il ?
M. Pascal Pacaut. Dans le cas spécifique du marché emporté par Alstom, notre valeur ajoutée est faible. Nous avons participé au bouclage du plan de financement. Notre financement a permis de renforcer la compétitivité de l’offre française, en proposant une solution de financement jugée satisfaisante par l’État azerbaïdjanais pour les dépôts d’entretien et de maintenance des locomotives. Nos experts ont favorisé la cohérence technique de l’opération, mais elle était lancée avant même que notre intervention ait été envisagée.
Nous ne sommes pas en concurrence avec d’autres agences en Azerbaïdjan : il y a de la place pour tout le monde. Mais nul ne maîtrise parfaitement le mécanisme de décision des autorités, dont on ne sait pas toujours en fonction de quels critères elles décident de traiter avec un partenaire plutôt qu’avec un autre. Il est atypique, pour nous, d’intervenir dans ce qui pourrait être considéré comme un émirat pétrolier à la gouvernance particulière. La Banque mondiale, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Banque asiatique de développement et la KfW sont très présents. Nous vous communiquerons si vous le souhaitez les informations dont nous disposons, qui ne sont pas nécessairement les plus précises, sur leur exposition respective ; je pense l’engagement de chaque organisme compris entre 2 et 3 milliards de dollars, ce qui n’est pas considérable. C’est que le mode de gouvernance en Azerbaïdjan et les problèmes de transparence incitent à la prudence.
M. le président François Rochebloine. La baisse du prix du gaz et du pétrole a-t-elle une incidence ?
M. Pascal Pacaut. La réduction des ressources freine effectivement le dialogue avec les bailleurs de fonds institutionnels, et la tendance n’est pas de faire appel à des financements extérieurs pour la compenser. Ainsi, le projet de ligne de métro envisagé depuis quelques années n’a plus le même degré de priorité depuis que les ressources budgétaires ont baissé. En Asie, de manière générale, nous entretenons un partenariat très fort avec la Banque asiatique de développement, qui nous a beaucoup aidés à nous réimplanter et à créer un réseau, ainsi qu’avec la Banque mondiale. Nos relations sont un peu plus rares avec la Banque européenne d’investissements (BEI) et avec la KfW, alors que nous travaillons très bien ensemble, en Afrique et dans les pays du pourtour méditerranéen. Avec l’Agence japonaise de coopération internationale – Japanese International Cooperation Agency (JICA) –, nous partageons des réflexions bien davantage que des financements de projets, car la JICA, étroitement liée aux entreprises japonaises, a un programme de diplomatie économique très élaboré qui rend la coopération avec elle difficile.
Rien n’est véritablement engagé dans le secteur agricole. Les échanges sont malaisés car dans toute discussion nos interlocuteurs techniques se mettent en retrait, indiquant très vite qu’à partir de ce moment c’est le ministre des finances qui doit décider. Disons que l’Azerbaïdjan est gouverné de manière un peu centralisée… Par ailleurs, les réactions sont faibles quand on évoque l’aménagement du territoire, le développement ou l’appui aux catégories sociales défavorisées.
M. le rapporteur. Vous intervenez dans trois pays du Caucase du Sud ; quelles sont les spécificités de l’Azerbaïdjan, comparé à la Géorgie et à l’Arménie ?
M. Pascal Pacaut. L’Azerbaïdjan est probablement, des trois, le pays le plus difficile. Celui où nous nous implantons le plus naturellement et le plus facilement est l’Arménie, où nous menons déjà deux projets d’envergure. Nous espérons concrétiser cette année un premier projet important en Géorgie. Jusqu’à présent, nos opérations dans ces trois pays étaient suivies depuis Paris, avec l’aide d’un volontaire international en administration installé à Istanbul. Nous avons renforcé notre dispositif en décembre 2016 en ouvrant un bureau régional à Tbilissi.
M. le président François Rochebloine. Votre interlocuteur institutionnel est donc le ministère des finances, sinon le ministre lui-même. Quels instruments juridiques définissent les modalités des concours versés par l’Agence ? La procédure vous paraît-elle centralisée entre les mains des autorités politiques ?
M. Pascal Pacaut. Dès l’origine, la France a essayé de négocier un accord intergouvernemental pour officialiser la présence et les modalités d’intervention de l’AFD en Azerbaïdjan mais, à la suite du refroidissement sensible des relations entre les deux pays provoqué par le vote de la loi Boyer, cela ne s’est pas fait. L’ambassade d’Azerbaïdjan à Paris nous demande régulièrement quel cadre juridique nous serait nécessaire mais nos propositions renouvelées sur l’accord intergouvernemental ne trouvent pas vraiment d’écho. Bien que ce ne soit pas une situation idéale, il nous est arrivé de monter et de financer un premier projet dans d’autres pays sans l’ombrelle juridique d’un accord inter-gouvernemental officialisant notre présence. Mais notre objectif est qu’après quelques années, quand nous sommes bien établis dans un pays, nous disposions d’un cadre juridique sûr pour travailler dans de bonnes conditions.
M. le rapporteur. Je retiens de vos explications que l’Azerbaïdjan n’est pas une zone d’intervention stratégique pour l’AFD.
M. Pascal Pacaut. C’est un fait. Mais il n’appartient pas aux agents de l’AFD de définir quel doit être le périmètre des interventions de l’Agence.
M. le président François Rochebloine. Je constate qu’aucun de mes collègues ne souhaite vous interroger. Je demeure surpris que l’AFD intervienne dans un pays que l’on ne peut considérer comme dénué de ressources, mais vous avez répondu à nos questions et je vous en remercie. L’occasion m’est aussi donnée de saluer le travail accompli par l’Agence.
*
* *
Ÿ Audition de M. Matthieu Combe, conseiller chargé de l’Europe orientale et de l’Asie centrale à la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne (mercredi 18 janvier 2017)
M. le président François Rochebloine. Mes chers collègues, nous accueillons ce matin M. Matthieu Combe, conseiller chargé de l’Europe orientale et de l’Asie centrale à la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne. Les attributions de M. Combe comportent en effet, parmi de multiples autres sujets, les relations entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne.
Je rappellerai simplement trois dates. En novembre 2006 a été conclu un « plan d’action » comportant le renforcement des coopérations en matière d’État de droit, de démocratisation et de gouvernance économique. L’année 2009 a vu l’intégration de l’Azerbaïdjan dans le Partenariat oriental de l’Union européenne. Enfin, c’est en juillet 2010 qu’ont débuté les négociations sur un éventuel accord d’association à vocation théoriquement plus large.
Depuis cette date, les relations n’ont guère progressé. L’Azerbaïdjan et l’Union européenne ne semblent pas – mais vous nous le préciserez – avoir la même conception de l’ampleur de l’accord d’association envisagé. De plus, Bakou a suspendu unilatéralement les négociations en septembre 2014, après le vote par le Parlement européen de sa résolution du 18 septembre 2014 sur la persécution des défenseurs des droits de l’Homme en Azerbaïdjan, qui souligne notamment que « le respect le plus strict des droits de l’Homme, des principes démocratiques, des libertés fondamentales et de l’État de droit est au cœur du cadre de coopération que constitue le partenariat oriental ».
Il semble cependant que les négociations doivent reprendre au cours du présent semestre.
Nous vous remercions par avance de faire le point sur ce processus, et de nous préciser quel est l’objet exact de la négociation nouvelle – un accord d’association ou une autre forme d’accord – et quels en sont les points principaux.
Rien n’indique que la situation des droits de l’Homme en Azerbaïdjan se soit améliorée depuis le vote de la résolution du Parlement européen en septembre 2014. Dès lors, quelles sont les raisons qui ont motivé la réouverture des négociations ?
Quelle est, également, la position de la France sur le principe de la réouverture des négociations, leur objectif et leurs modalités ?
Je vous donne maintenant la parole pour un exposé liminaire, avant que notre rapporteur, nos collègues et moi-même ne vous posions quelques questions complémentaires.
M. Matthieu Combe, conseiller chargé de l’Europe orientale et de l’Asie centrale à la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne. Monsieur le président, je vous remercie pour votre invitation. Je suis effectivement chargé des relations entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan à la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne et je siège donc, en tant que représentant de la France, au sein du groupe de travail du conseil de l’Union européenne chargé de l’Europe orientale et de l’Asie centrale, c’est-à-dire des six pays du partenariat oriental – Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie et Ukraine – ainsi que de la Russie, et des cinq pays d’Asie centrale – Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan. C’est ce comité qui est compétent pour la négociation du futur accord et, de façon horizontale, pour tous les sujets liés à chacun de ces pays, dont l’Azerbaïdjan.
Je reviendrai brièvement sur les fondements des relations entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan, avant d’évoquer leurs développements depuis 2014 – notamment dans le contexte des résolutions du Parlement européen – et le contenu du futur accord de négociation.
Les relations entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan reposent sur trois fondements. Le premier, qui constitue le cadre contractuel toujours en vigueur, est l’accord de partenariat et de coopération de 1996, entré en vigueur en 1999. Cet accord, similaire à ceux conclus à la même époque avec tous les États nouvellement indépendants de l’ex-URSS, ne comprend pas de dispositions commerciales préférentielles, autres que la clause de la nation la plus favorisée, car les États concernés n’étaient pas membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) lors de sa négociation. Ces accords fixent les principes généraux ainsi que le cadre institutionnel des relations que l’Union européenne entretient avec chacun de ces pays. Pour ce qui est de l’Azerbaïdjan, il s’agit d’un conseil de coopération au niveau ministériel qui se réunit chaque année – le dernier s’est toutefois réuni en 2013 –, d’un comité de coopération ainsi que de ses sous-comités thématiques, ces deux dernières instances étant composées de hauts fonctionnaires. La négociation qui va s’engager vise notamment à renouveler ce cadre contractuel, au moyen d’un nouvel accord qui se substituera à celui en vigueur.
Le deuxième cadre est celui de la politique européenne de voisinage, établie en 2004 et ayant conduit en novembre 2006 à l’adoption d’un plan d’action – d’une durée initiale de cinq ans, mais prorogé de façon tacite – qui détaille les priorités à court et moyen terme. Le plan met l’accent sur les coopérations en matière d’État de droit et de gouvernance économique, ainsi que sur la contribution possible de l’Union européenne à un règlement du conflit du Haut-Karabagh. C’est d’ailleurs dans le cadre de la politique européenne de voisinage que l’Azerbaïdjan est bénéficiaire d’instruments d’assistance, pour des montants assez limités par rapport à d’autres pays de la région. Ainsi, pour la période 2007-2015, l’Azerbaïdjan a reçu 179 millions d’euros au titre de l’Instrument européen de voisinage, qui est le principal outil de cette politique ; pour l’année 2016, l’allocation est de 13,5 millions d’euros. Parmi les six pays du partenariat oriental, l’Azerbaïdjan est le plus petit bénéficiaire de cet instrument, compte tenu du niveau de richesse du pays, mais aussi du fait de son ambition plus limitée que celle de ses voisins et de ses capacités d’absorption. Les fonds reçus représentent environ 2 euros par habitant et par an, alors que d’autres pays, tels que la Moldavie, reçoivent autour de 37 euros par habitant. L’Union européenne est néanmoins le premier bailleur international de l’Azerbaïdjan, en particulier dans le domaine du développement régional et rural, avec comme principal instrument les jumelages administratifs, pour lesquels la France est particulièrement performante, avec sept jumelages en cours depuis 2015 sur les trente et un jumelages européens décidés depuis 2007. Ils sont souvent conduits avec d'autres partenaires tels l’Espagne et la Hongrie.
Je précise que l’Azerbaïdjan n’est plus éligible au schéma de préférences généralisées, un régime d’encouragement commercial assorti d’un certain nombre de conditions, notamment quant au niveau de richesse.
Le troisième cadre des relations entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan est le Partenariat oriental mis en place depuis 2009, qui associe un volet multilatéral de coopération entre les partenaires sous l’égide de l’Union européenne et un volet bilatéral, constitué des relations entre l’Union européenne et chacun des six pays concernés. C’est à ce titre que diverses pistes ont été examinées avec l’Azerbaïdjan. La première, qui devait s’appliquer à chacun des six pays partenaires, consistait à rénover le cadre contractuel, d’où l’intention de négocier un accord d’association, comme nous l’avons fait avec la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine – une négociation avait été finalisée avec l’Arménie, mais l’accord n’a pas été signé. Avec l’Azerbaïdjan, la négociation a été ouverte en juillet 2010, en même temps qu’avec les autres – à l’exception de l’Ukraine, qui avait commencé un peu avant. De fait, elle a été interrompue en 2012 : cela n’a pas été formalisé mais, de fait, les dernières sessions substantielles remontent à mai 2012, Bakou ne semblant alors plus intéressé par l’offre d’association.
M. le président François Rochebloine. L’Azerbaïdjan a d’ailleurs suspendu unilatéralement les négociations en 2014.
M. Matthieu Combe. Plus largement, c’est tout un ensemble de coopérations avec l’Union européenne que l’Azerbaïdjan a suspendu en 2014. Pour ce qui est des négociations en vue d’un accord d’association, elles étaient de fait interrompues depuis 2012 – à l’initiative de Bakou, qui n’était plus demandeur d’une association au sens de celles en négociation, à l’époque, avec la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, c’est-à-dire d’un accord comprenant une association politique et une intégration économique sous la forme d’une libéralisation tarifaire très large en échange d’une reprise de l’acquis communautaire. Pour l’Azerbaïdjan, l’objectif était déjà légèrement différent, puisque l’accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA), qui constitue le volet commercial de l’accord d’association, nécessite que le pays partenaire soit membre de l’OMC, ce qui n’était pas le cas et ne l’est toujours pas. La négociation portait néanmoins sur les aspects sectoriels et supposait une reprise de l’acquis. Bakou a finalement indiqué ne pas être intéressé, probablement parce que cela supposait des ajustements dans certains domaines, auxquels il ne souhaitait pas procéder. Depuis 2012, la rénovation du cadre contractuel, qui est l’un des objectifs du Partenariat oriental, était donc en suspens.
Le deuxième objectif commun à tous les pays du Partenariat oriental est le renforcement de la mobilité, avec comme principal outil l’objectif de long terme de la libéralisation du régime des visas de court séjour. Cet objectif, envisageable dès lors que les conditions d’une mobilité sûre et bien gérée sont réunies, implique de mener à bien un processus long et comprenant un certain nombre d’étapes, dont la première est la négociation et la signature d’accords de facilitation de la délivrance des visas et de réadmission – les deux sont indissociables. Avec l’Azerbaïdjan, ces accords signés en novembre 2013 et février 2014 sont entrés en vigueur le 1er septembre 2014. C’est le même régime qui s’applique à l’Arménie, les accords ayant été signés un peu avant.
La deuxième étape vers la libéralisation est constituée d’un dialogue sur la libéralisation des visas, qu’il appartient au Conseil de décider d’ouvrir – ce qui n’est pas encore le cas pour l’Azerbaïdjan – et au cours duquel on essaie de déterminer si les conditions pour avancer dans cette direction sont réunies non seulement sur le plan technique, mais aussi par rapport à certaines conditions, notamment la gestion des frontières.
M. le président François Rochebloine. C’est ce dialogue qui a permis la réouverture des négociations ?
M. Matthieu Combe. L’objectif de libéralisation existait en 2009 au moment où s’est ouverte la négociation de l’accord d’association.
M. le président François Rochebloine. Mais pourquoi la négociation de l’accord d’association, qui était suspendue, reprend-elle aujourd’hui ?
M. Matthieu Combe. Alors qu’il n’y avait pas eu de négociations sur un nouvel accord d’association pendant quasiment quatre ans – tout au plus quelques tentatives infructueuses, jamais formalisées –, en 2015, lors du sommet du Partenariat oriental, à Riga, l’Azerbaïdjan s’est dit demandeur d’un accord dit de partenariat stratégique. Il s’est écoulé plus d’un an avant que l’Union européenne ne puisse répondre à cette demande, et c’est en novembre 2016 qu’a été adopté un mandat pour un nouvel accord, destiné à remplacer l’accord de partenariat et de coopération de 1996. Cet accord ne portera sans doute pas le titre d’accord d’association, Bakou ne le souhaitant pas, et différera des accords d’association signés avec la Moldavie, la Géorgie ou l’Ukraine, dans la mesure où il ne comprendra pas d’accord de libre-échange complet et approfondi au titre de son volet commercial.
Sur le plan juridique, il s’agira bien d’un accord d’association au sens des traités, la dénomination de l’accord étant quant à elle déterminée à l’issue des négociations, en fonction de son contenu, mais aussi des souhaits des parties. Pour ce qui est de l’Azerbaïdjan, le Conseil a autorisé l’ouverture de négociations pour un accord global, ce qui ne veut pas dire qu’à l’issue de la négociation – si celle-ci parvient à son terme –, l’accord sera qualifié ainsi. L’adjectif « global » qualifie surtout l’intention initiale des parties de voir le futur accord couvrir au moins tous les sujets abordés par le précédent, mais la dénomination ne sera tranchée qu’au terme des négociations, en fonction du contenu de l’accord et du souhait des parties.
De la même façon, avec l’Arménie, l’Union européenne négocie un accord-cadre qui diffère de l’accord d’association qui avait été négocié. En tout état de cause, un accord d’association correspond à un type de relations avec l’Union européenne, dont l’Azerbaïdjan n’est pas demandeur – comme ne l’était plus l’Arménie après son choix de rejoindre l’Union économique eurasiatique.
Parallèlement à la négociation du cadre contractuel, il peut y avoir une négociation sur la mobilité, avec un objectif de libéralisation comprenant un certain nombre d’étapes. Le processus est encore en cours pour la Géorgie et l’Ukraine, et a été mené à son terme pour la Moldavie. Après avoir franchi la première étape, celle des accords de facilitation et de réadmission, désormais en vigueur, l’Azerbaïdjan ne souhaite pas aller au-delà pour le moment. Même si c’était le cas, plusieurs conditions devraient être remplies, à savoir décision du Conseil, discussion technique, évaluation par la Commission et, pour finir, décision politique.
M. le président François Rochebloine. Dans quel délai cela pourrait-il se faire ?
M. Matthieu Combe. En général, on évite de fixer des délais à l’avance : l’issue du processus est ouverte et son avancement dépend du respect des critères. En ce qui concerne l’Azerbaïdjan, ce n’est qu’une perspective théorique, puisqu’il n’y a pas de demande pressante de sa part.
Je précise que ces procédures ne sont pas spécifiques à l’Azerbaïdjan, mais ont vocation à s’appliquer aux six pays du partenariat oriental. Si l’Azerbaïdjan présente une spécificité dans la région, celle-ci réside dans le protocole d’accord sur un partenariat stratégique dans le domaine de l’énergie qui a été signé en novembre 2006, donc en même temps que le plan d’action que vous avez mentionné. C’est une déclaration politique comme l’Union européenne a en fait avec d’autres pays, notamment l’Algérie, et qui a aujourd’hui pour objet de donner un cadre politique au corridor gazier Sud, donc à l’objectif d’utiliser ce corridor pour la diversification des routes et sources d’approvisionnement de l’Union européenne, dans un objectif de sécurité énergétique. L’Azerbaïdjan est, avec l’Ukraine, le seul pays du partenariat oriental à bénéficier de ce cadre politique.
Pour ce qui concerne les développements récents ayant conduit à la reprise des négociations, les années 2014 et 2015 ont correspondu à des phases délicates dans les relations entre l’Union et l’Azerbaïdjan. Vous avez mentionné les résolutions, critiques, du Parlement européen de septembre 2014 et de septembre 2015, auxquelles l’Azerbaïdjan a réagi en réduisant son niveau de coopération avec l’Union européenne, et en prenant la décision, en octobre 2014, de suspendre sa participation aux différents cadres qui avaient été établis par l’accord de 1996 – conseil de coopération, comité de coopération, sous-comités. Il est revenu sur cette décision à l’automne 2016, et les réunions de ces instances ont pu reprendre. Par ailleurs, l’Azerbaïdjan a suspendu ses relations avec le Parlement européen en septembre 2015, y compris dans le cadre de l’Assemblée parlementaire du partenariat oriental – Euronest, une assemblée composée paritairement de parlementaires européens et de parlementaires des pays partenaires –, dont il avait pourtant accueilli la première réunion en 2012. L’Azerbaïdjan a aussi décidé de reporter des contacts techniques prévus pour l’automne 2015, en vue de la négociation du nouvel accord qu’il venait de proposer, lors du sommet de Riga, en mai 2015. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, s’était rendu à Bakou en juillet 2015 pour une visite portant notamment sur les possibilités de renouvellement du cadre contractuel et il avait été décidé d’avoir des contacts techniques à l’automne mais, à la suite de la résolution du Parlement, mais ces contacts se sont trouvés reportés d’un commun accord, traduisant une certaine insatisfaction de Bakou dans ses relations avec l’Union européenne – insatisfaction d’ailleurs réciproque, pour d’autres raisons.
Du côté azerbaïdjanais, la crispation avait notamment trait aux prises de position publiques de l’Union européenne au sujet de la situation des droits de l’Homme – déclarations émanant des institutions européennes, du porte-parole du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), déclarations à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), et résolutions du Parlement européen. Il s’y ajoutait un autre point sensible, celui du conflit du Haut-Karabagh : dans le contexte de la crise ukrainienne, l’Azerbaïdjan considérait qu’il y avait de la part de l’Union européenne un double standard avec la Crimée d’une part et le Haut-Karabagh de l’autre.
Sur ces points, l’Union européenne s’efforce de maintenir une approche associant fermeté sur ses positions de principe et ouverture au dialogue.
C’est pour cette raison qu’en 2015-2016, elle s’est employée à maintenir, autant que possible, des contacts politiques avec l’Azerbaïdjan. Les relations se sont progressivement dégelées, notamment avec la visite à Bakou en février 2016 de Federica Mogherini, Haute Représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Au cours de ce qui constituait une visite régionale – puisqu’elle s’est poursuivie par un déplacement à Erevan –, Mme Mogherini, accompagnée du vice-président pour l’énergie Maroš Šefčovič, a participé à une réunion du Conseil consultatif du corridor gazier Sud. Elle a également rencontré le président Aliev – qu’elle a vu de nouveau en mai 2016 à Vienne, en marge d’une réunion sur le Haut-Karabagh à laquelle participaient les présidents azerbaïdjanais et arménien. Au cours de la visite de février 2016, qui avait été précédée d’une reprise des contacts techniques sur le futur accord, les autorités azerbaïdjanaises ont exprimé le souhait d’avancer vers l’ouverture de négociations et de participer à nouveau aux réunions des instances de l’Union européenne dont elles s’étaient mises en retrait – conseil et comité de coopération, sous-comités –, ainsi que de reprendre les relations avec le Parlement européen à compter de septembre 2016. Une délégation du Parlement européen a donc effectué une visite à Bakou en septembre 2016 pour une réunion du Comité parlementaire Union européenne-Azerbaïdjan. Le Conseil a adopté, en novembre 2015, un mandat pour l’ouverture des négociations avec l’Azerbaïdjan en vue d’un accord – lequel est pour le moment qualifié de global.
Du côté européen, cette dynamique a été possible car ces visites ont été accompagnées de gestes sur les droits de l’Homme de la part de l’Azerbaïdjan. Les amnisties de mars 2016, la libération de l’avocat Intigam Aliev et celle, assortie d’une autorisation de quitter le territoire, des époux Yunus, ont fait suite à la visite de la Haute Représentante Mogherini de février 2016 et à la reprise des contacts politiques entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan. La perspective de négociation d’un nouvel accord doit servir de levier pour obtenir de nouveaux gestes et une évolution de la situation, dans le cadre d’un dialogue structuré avec l’Azerbaïdjan qui nous permette de faire valoir nos sujets de préoccupation, y compris au plus haut niveau.
Le contexte économique et géopolitique a également évolué. D’une part, l’Azerbaïdjan a sans doute remarqué que l’Union européenne avançait dans ses négociations avec l’Arménie en vue de la conclusion d’un accord-cadre. D’autre part, une révision de la politique européenne de voisinage a eu lieu à l’automne 2015 ; la Haute Représentante et la Commission ont ainsi adopté une communication, que le Conseil a endossée, visant à mettre l’accent sur le principe de différenciation au sein de la politique européenne de voisinage. Ce principe, en germe depuis des années, a pour objet une relation plus différenciée, en quelque sorte sur mesure, avec chacun des six pays partenaires. L’Azerbaïdjan a été satisfait de cette évolution, qu’il demandait depuis longtemps, se prévalant notamment d’être le premier pays tiers à avoir lui-même présenté un projet d’accord à l’Union européenne.
Pour ce qui est du futur accord, le mandat a été adopté le 14 novembre 2016. Comme l’Union européenne, la France considère que cette négociation présente un triple intérêt. Premièrement, il s’agit de moderniser l’accord de 1996, qui ne reflète plus la réalité des relations et ne tient pas compte des évolutions survenues au sein de l’Union européenne et en Azerbaïdjan. Ainsi, celui-ci ne comporte pas de référence au Conseil de l’Europe ou à la Convention européenne des droits de l’Homme, puisque l’Azerbaïdjan n’y était pas partie au moment de la signature. Le futur accord sera donc le plus large possible, actualisé et juridiquement contraignant.
Le deuxième objectif de la négociation est de conforter la dynamique en cours dans les relations en les dotant d’un cadre sur mesure. Cette préoccupation avait conduit la France, en septembre 2013, après la décision de l’Arménie de renoncer à son accord d’association, à demander le maintien de la perspective d’un nouvel accord. L’initiative française a pris tout son sens et a produit les effets que l’on en attendait lors du sommet de Vilnius du Partenariat oriental, en novembre 2013, qui s’est déroulé dans une ambiance générale plutôt défavorable à une telle perspective ; aujourd’hui, les négociations sont en cours. Nous devons veiller à maintenir une approche la plus inclusive possible avec les six pays de la région, parce que nous sommes attachés par principe à la politique de voisinage, mais aussi parce que cela répond à la préoccupation particulière de la France dans l’optique du conflit du Haut-Karabagh, lequel nous impose de préserver un équilibre régional et, en tout état de cause, de ne pas donner le sentiment que la relation avec l’Union européenne pourrait être instrumentalisée par l’une ou l’autre des parties qui chercherait à en tirer avantage dans le règlement du conflit. Pour la même raison, lors du lancement du partenariat oriental en 2009, la France avait insisté pour que l’Azerbaïdjan bénéficie, au même titre que l’Arménie et la Géorgie, de la perspective d’un accord d’association, quand bien même Bakou semblait moins demandeur que ses voisins.
Pour répondre à votre interrogation sur la terminologie, je dirai qu’il s’agit sur le plan juridique d’un accord d’association. En tout état de cause, cet accord s’inscrivant dans le cadre de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Parlement européen devra approuver sa conclusion une fois que celui-ci aura été négocié et signé par le Conseil. Par la suite, il reviendra aux États membres de ratifier ce qui sera vraisemblablement un accord mixte. Quant à son contenu, l’accord différera des accords d’association existants avec les autres pays du Partenariat oriental, notamment sur le plan commercial, et sa dénomination dépendra de l’issue de la négociation.
Le troisième intérêt de la négociation réside dans le fait qu’il peut constituer un levier pour la promotion de l’État de droit et du respect des droits de l’Homme. Sans dévoiler le contenu du mandat, par définition confidentiel, je peux dire que ce sera l’un des éléments centraux de la négociation. Ainsi les dispositions relatives au respect des normes internationales et des engagements pris dans les cadres auxquels l’Azerbaïdjan est partie
– Nations unies, Conseil de l’Europe, OSCE – donneront-elles lieu à un dialogue politique au plus haut niveau dans un cadre régulier – la structure institutionnelle actuelle, éventuellement renforcée –, comme à un suivi régulier et constant de l’évolution de la situation par l’Union européenne.
L’autre levier sera constitué par les coopérations sectorielles dans un certain nombre de domaines, que ce soit en matière de réforme de la justice, de liberté, de sécurité ou encore de lutte contre la corruption. Le mandat consacre la possibilité, renforcée par rapport à l’accord de 1996, d’établir des coopérations entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan via les instruments d’assistance prévus.
Sur le plan commercial, les attentes sont limitées. L’Azerbaïdjan n’est pas membre de l’OMC et l’accord de 1996 a fixé un cadre resté quasiment inchangé depuis lors, et que le nouvel accord vise à actualiser pour tenir compte des évolutions intervenues au sein de l’Union européenne et, aussi, de l’OMC, dans la mesure où celles-ci affectent le cadre européen. Nous devrons nous efforcer, autant que possible, d’y intégrer des règles et principes de l’OMC que l’Azerbaïdjan pourrait transcrire dans sa législation, bien qu’il ne soit pas membre de cette organisation.
Le futur accord portera également sur le règlement des conflits : il sera essentiel pour le gouvernement français de s’assurer que la négociation est cohérente avec celle conduite avec l’Arménie – sans donner de droit de regard à l’un sur la négociation en cours avec l’autre, mais en veillant, compte tenu de notre rôle de médiateur, à avoir la même position vis-à-vis des deux pays : il ne faut en aucun cas donner le sentiment que la négociation peut être instrumentalisée par l’une ou l’autre des parties pour déséquilibrer la position de l’Union européenne.
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. Je vous remercie pour cet exposé très complet, qui a répondu à la plupart des questions que j’avais l’intention de vous poser.
Il m’en reste cependant une, à caractère politique. L’histoire des négociations avec l’Azerbaïdjan montre une succession de progrès et de palinodies entraînant des régressions, comme si le pouvoir azerbaïdjanais, pourtant très concentré, était constitué de deux lignes concurrentes. L’une de ces lignes exprimerait une position favorable à la conclusion d’un accord, donc à l’introduction d’un certain nombre de normes internationales, essentiellement européennes, en matière de démocratie et de respect des droits de l’Homme, tandis que l’autre serait marquée par une réticence à faire évoluer les choses, et une tendance marquée à la crispation face à la perspective de voir des changements se concrétiser. Globalement, l’Azerbaïdjan a toujours fait preuve de sa volonté de respecter un certain équilibre géopolitique entre la Russie, l’Europe, et les positions régionales. Pensez-vous que l’Azerbaïdjan va finir par s’engager résolument vers une forme de modernisation démocratique du pays, ou qu’il navigue à vue en fonction de ses impératifs de politique intérieure ?
M. Matthieu Combe. Effectivement, le degré de nécessité pour l’Azerbaïdjan d’engager une négociation a fluctué au cours du temps – du moins, l’idée de cette négociation n’a pas toujours eu la même importance par rapport à ses autres préoccupations, d’ordre interne ou régional. Je pense que le contexte actuel a motivé l’Azerbaïdjan à demander l’ouverture de la négociation et à effectuer les gestes diplomatiques ou politiques que l’Union européenne attendait – implicitement ou explicitement – pour que cette perspective puisse se dessiner. Ce contexte est d’abord celui de la situation régionale : les relations que l’Union européenne entretient avec l’Arménie – en particulier la nouvelle négociation actuellement menée –, l’évolution de la situation vis-à-vis de la Russie, de la Turquie et de la Syrie, ainsi que les préoccupations en matière de sécurité, ont certainement joué un grand rôle dans l’évolution de la position des autorités azerbaïdjanaises. Celles-ci en sont venues à considérer que la relation avec l’Union européenne pouvait leur permettre de conforter l’indépendance et la souveraineté de leur pays, tout en sachant que le fait de s’engager dans un processus de négociation impliquait de devoir composer avec des déclarations de l’Union européenne parfois perçues comme déplaisantes, ainsi qu’avec une attention accrue de l’Union et de ses États membres à sa situation intérieure.
Pour ce qui est d’éventuels rapports de forces internes, on a affaire en Azerbaïdjan à des interlocuteurs exprimant une position plutôt claire et unie. Lors du sommet de Riga de mai 2015, le président Aliev s’est décommandé au dernier moment mais s’est fait représenter par son ministre des affaires étrangères, porteur d’un message consistant à proposer un nouvel accord. Le président azerbaïdjanais a ultérieurement reçu Donald Tusk afin de lui confirmer qu’il souhaitait négocier un nouvel accord et, si les choses ont mis un certain temps à avancer, le dialogue est resté ouvert au plus haut niveau – d’abord avec le président, puis avec les ministres, sur des aspects plus sectoriels.
Ce qui est certain, c’est que l’approche de la négociation qui fait consensus au sein de l’Union européenne vise à ne pas placer nos partenaires – qu’il s’agisse de l’Azerbaïdjan, de l’Arménie ou de la Géorgie – devant une alternative binaire les obligeant à choisir entre une bonne relation avec l’Union européenne, conforme à nos intérêts respectifs, et la préservation des relations entretenues avec leurs voisins et partenaires habituels, dont ils sont plus ou moins proches. Nous avons toujours récusé cette approche binaire, nécessairement conflictuelle, ce qui est l’une des raisons expliquant que l’Azerbaïdjan se montre, comme l’Arménie, désireux de négocier de nouveaux accords avec l’Union européenne : ces pays savent que ces accords seront respectueux de leur souveraineté et, nonobstant certains déséquilibres, notamment sur le plan économique, s’inscriront dans une relation d’égalité sur le plan politique. L’Azerbaïdjan est particulièrement sourcilleux quant à la nécessité que l’Union européenne prenne en considération sa situation particulière, et très sensible à toute prise de position des instances européennes lui paraissant manquer à cette condition. De nôtre côté, sans renier nos principes, nous devons prendre en compte cette préoccupation au moyen d’un renforcement du dialogue politique.
M. le président François Rochebloine. La Russie s’est efforcée de rétablir dans le Caucase du Sud les bases de son influence économique, un temps menacée par la dislocation de l’URSS. Jusqu’à quel point vous paraît-elle pouvoir accepter la progression des négociations entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan, qui s’est jusqu’à présent tenu à l’écart de cet effort de rétablissement ?
M. Matthieu Combe. Il s’agit là d’une question dont nous avons fait l’expérience très concrètement dans le cadre des négociations avec les différents partenaires orientaux. Le postulat de départ est que, si un pays partenaire décide de s’engager dans des négociations avec l’Union européenne, c’est qu’il a préalablement pesé le pour et le contre, et a estimé que cette démarche était globalement avantageuse pour lui. Pour nous, le moyen le plus sûr d’éviter le risque du dérapage consiste, je le répète, à éviter de placer un partenaire devant un choix binaire, où un rapprochement avec l’Union européenne signifierait automatiquement un éloignement, voire un conflit avec un autre partenaire.
En 2013, le sommet de Vilnius a donné lieu à des approches divergentes au sein de l’Union européenne. Certains ont privilégié une approche consistant à vouloir arracher les pays partenaires à la sphère d’influence russe, en mettant l’accent sur cet aspect plutôt que sur les mérites propres de l’offre européenne, qui sont considérables sur le plan commercial, sur celui de la modernisation et sur celui de la reprise des acquis, et présentent l’avantage de fournir un soutien, fût-ce par le bas, à l’indépendance de chacun de nos partenaires.
Pour ce qui est de l’Azerbaïdjan, nous n’avons pas connaissance, à la différence d’autres pays, de prises de position publiques de la Russie, alors que les négociations ne sont pas conduites en secret. Si la négociation proprement dite est confidentielle, elle résulte d’un mandat adopté par le Conseil, qui a donné lieu à une décision publique, et la perspective d’une négociation est sur la table depuis des mois, voire des années : on ne peut donc pas dire que l’Union européenne avance masquée, ou qu’elle aurait des objectifs cachés.
M. le président François Rochebloine. En 2013, nous étions sur le point de signer un accord avec l’Arménie, lorsque celle-ci y a renoncé. J’ai le sentiment que ce sont des préoccupations relatives à la sécurité, en particulier au conflit du Haut-Karabagh, qui l’ont fait reculer, sans doute sous l’influence de la Russie. Le même scénario pourrait-il se reproduire avec l’Azerbaïdjan ?
M. Matthieu Combe. La chronologie de ce qui s’est passé avec l’Arménie est la suivante : les négociations avaient été finalisées en juin juillet 2013, et l’accord devait être paraphé lors du sommet de Vilnius de novembre. C’est début septembre que le président arménien a fait savoir qu’il avait décidé de renoncer à conclure cet accord, à son retour d’un déplacement à Moscou. Un tel scénario ne peut être écarté, et nous ne pouvons jamais avoir la certitude de mener une négociation à son terme.
M. le président François Rochebloine. Cela dit, les négociations avec l’Arménie ont aujourd’hui repris.
M. Matthieu Combe. Oui, notamment parce que la France en a émis le souhait. Dès le sommet de Vilnius, surmontant la déception provoquée par l’annonce de l’abandon d’un accord sur lequel nous travaillions depuis trois ans, nous avions obtenu qu’une déclaration Union européenne-Arménie fasse mention de la perspective d’un nouvel accord avec l’Arménie. Cette attitude était aussi un moyen d’adresser un message politique très clair, selon lequel nous ne sommes pas là pour dicter à nos partenaires les choix qu’ils doivent faire, ou les placer dans des situations binaires. Nous nous efforçons de ne jamais perdre de vue notre intérêt, qui est d’aboutir à un accord le plus large possible et compatible avec les engagements pris par nos partenaires dans d’autres cadres, dans le respect de nos principes et de nos propres engagements – et surtout pas d’entrer dans une logique de confrontation géopolitique. Cette ligne de conduite, mise en œuvre pour l’Arménie, a de bonnes chances d’aboutir à la conclusion prochaine d’un accord – il faut pour cela que les questions qui restent sur la table trouvent une solution –, et nous espérons qu’il en sera de même avec l’Azerbaïdjan, car la logique est la même.
M. le président François Rochebloine. La transparence des échanges, des transactions et des investissements européens en Azerbaïdjan fait-elle partie des éléments de la négociation avec ce pays ?
M. Matthieu Combe. La transparence financière fait effectivement partie des éléments génériques des accords que l’on négocie.
M. le président François Rochebloine. On nous a dit qu’il était très difficile pour les ONG d’obtenir des subventions, puisque leur octroi nécessitait une autorisation du Gouvernement.
M. Matthieu Combe. L’un des intérêts de la négociation est justement d’inciter à un assouplissement du cadre législatif et réglementaire, afin de permettre un soutien de l’UE à des organisations de la société civile en Azerbaïdjan.
M. le président François Rochebloine. Pourriez-vous établir et nous faire parvenir une liste des associations bénéficiaires de subventions, faisant apparaître le montant de celles-ci ?
M. Matthieu Combe. La situation actuelle est compliquée, en raison du cadre réglementaire azerbaïdjanais qui impose un contrôle a priori pour bénéficier de subventions. L’Union européenne étant le premier bailleur de l’Azerbaïdjan et ayant accordé une part importante de son soutien à des organisations de la société civile depuis 2007, un certain nombre de projets ont pu être menés. Cependant, ils sont aujourd’hui réduits en nombre et dans leur périmètre : les projets qui subsistent sont souvent à dimension sociale, et perçus comme étant de nature moins politique. Depuis 2007, 74 projets visant à soutenir des organisations de la société civile azerbaïdjanaise ont été conduits par l’Union européenne, via divers instruments – étant précisé que les choses sont devenues plus difficiles ces derniers temps.
M. le président François Rochebloine. De quel genre de projets s’agit-il ?
M. Matthieu Combe. Il peut s’agir du soutien à une organisation non gouvernementale…
M. le président François Rochebloine. Reporters sans frontières ou Amnesty international, par exemple ?
M. Matthieu Combe. Pas à ma connaissance, car il est impératif qu’il s'agisse d'ONG internationales présentes en Azerbaïdjan.
M. le président François Rochebloine. Nous vous remercions d’avoir répondu librement à toutes nos questions et vous souhaitons bonne chance pour vos négociations.
*
* *
Ÿ Audition de M. Matthias Fekl, secrétaire d’État auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger (jeudi 19 janvier 2017)
M. le président François Rochebloine. Monsieur le secrétaire d’État, je suis heureux de vous accueillir pour cette réunion de notre mission d’information, la dernière avant la présentation du rapport de notre collègue Jean-Louis Destans.
Au-delà, bien au-delà des informations que vous pourrez nous donner, si vous le voulez bien, sur le dernier état des discussions bilatérales entre l’Azerbaïdjan et la France, votre audition est l’occasion d’une récapitulation et d’un échange particulièrement bienvenus.
Nos auditions nous ont d’abord permis de constater le dynamisme des entreprises françaises qui investissent en Azerbaïdjan. Elles ne méconnaissent pas les risques inhérents à la situation mondiale et à une conjoncture locale difficile, liée à l’évolution incertaine des cours du pétrole, mais elles vont de l’avant, avec le soutien de votre ministère, des ministères financiers et de notre ambassade.
Nous avons aussi touché du doigt la complexité de la situation géopolitique dans le Caucase du Sud et l’habileté avec laquelle le gouvernement de Bakou s’est positionné comme garant laïque d’une certaine stabilité, bien désirable dans une région qui n’est pas très éloignée de l’Irak et de la Syrie, pour ne citer que deux pays en guerre.
Enfin, même si des divergences se sont manifestées entre nous sur l’ampleur du problème et sur l’importance des conséquences que nos intérêts nationaux doivent nous amener à en tirer, nos auditions ont fait apparaître de bonnes raisons de s’inquiéter pour l’évolution du respect des libertés publiques et des droits fondamentaux dans un Azerbaïdjan qui ne semble pas très sensible aux requêtes ou aux injonctions qui lui sont adressées à ce sujet par la communauté internationale.
Sur tous ces points, nous souhaiterions, monsieur le secrétaire d’État, que vous nous faisiez part de la position officielle du Gouvernement. Bien sûr, nous serions également heureux que vous nous donniez des informations sur la réunion, le 13 décembre dernier, de la huitième commission mixte franco-azerbaïdjanaise pour la coopération économique et que vous nous disiez quels enseignements vous en tirez.
Merci, monsieur le secrétaire d’État, pour votre présence qui constitue en quelque sorte le point d’orgue de nos travaux, et aussi une forme de reconnaissance.
M. Matthias Fekl, secrétaire d’État auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger. Monsieur le président, je vous remercie pour cette invitation à m’exprimer devant la mission que vous présidez, et pour ces mots, auxquels je suis très sensible.
Pour avoir mené des travaux extrêmement approfondis, vous le savez : l’Azerbaïdjan n’est certes pas le premier partenaire économique et commercial de la France, mais notre pays entretient avec ce pays une relation économique importante à bien des égards, et même une relation stratégique – cela vaut pour notre économie en général et, plus spécifiquement, pour nos entreprises. Du point de vue du Gouvernement, les difficultés économiques que rencontre actuellement l’Azerbaïdjan ne sont d’ailleurs pas de nature à remettre cette ligne en question. Des perspectives de nouveaux contrats, dans un avenir proche, se profilent, et le partenariat économique que la France a noué avec ce pays se double d’un dialogue politique exigeant, intransigeant sur tous les sujets, y compris les libertés publiques ; j’y reviendrai.
Un mot tout d’abord sur la dimension stratégique de notre relation avec l’Azerbaïdjan. Pays le plus peuplé et le plus riche du Caucase du Sud, c’est la quatrième puissance économique de la Communauté des États indépendants (CEI), après la Russie, le Kazakhstan et l’Ukraine. Riverain de la mer Caspienne, au voisinage immédiat de l’Europe et au contact direct de la Russie, de la Turquie, de l’Iran et du Proche-Orient, il est stratégiquement situé, et donc stratégiquement important. Et si l’Azerbaïdjan est une puissance énergétique de rang plutôt modeste, produisant 1,1 % de la production mondiale de pétrole et 0,5 % de celle de gaz, c’est un territoire clé pour la diversification de l’approvisionnement énergétique de l’Union européenne. Une donnée l’explicite très clairement : c’est le troisième producteur d’hydrocarbures en CEI après la Russie et le Kazakhstan.
Aujourd’hui, ce pays est très dépendant de la rente énergétique, ce qui pose des difficultés dans le contexte d’un choc sévère dû à la baisse des prix des hydrocarbures, avec un impact sur la croissance. Selon le comité des statistiques azerbaïdjanais, le pays a connu une récession en 2016 ; son produit intérieur brut (PIB) s’est rétracté de 3,7 % entre janvier et octobre 2016. Au mois de novembre dernier, la Banque mondiale prévoyait pour sa part une récession de 3 % sur l’ensemble de l’année 2016. Une reprise semble cependant se profiler : la Banque mondiale et le FMI prévoient respectivement 1,2 % et 1,4 % de croissance en 2017. Ajoutons qu’avec un fonds pétrolier souverain, SOFAZ (State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan), qui totalise 35 milliards de dollars d’actifs – l’équivalent des deux tiers du PIB azerbaïdjanais – et un taux d’endettement externe limité à 20 % du PIB, les bases économiques du pays restent solides.
Les difficultés rencontrées par l’économie de l’Azerbaïdjan n’en ont pas moins eu un impact sur nos échanges commerciaux, qui se sont contractés en 2015 pour atteindre le montant de 1,3 milliard d’euros, soit une baisse de près de 17 % par rapport à 2014, et cette tendance s’est confirmée sur les neuf premiers mois de 2016. La baisse de la valeur de nos importations l’explique, en raison de la faiblesse des cours des hydrocarbures, qui constituent l’intégralité de nos achats, d’un montant de 1,1 milliard d’euros. Nos exportations ont également diminué en 2015, de 175 millions d’euros, mais notre part de marché a progressé : la France est passée de la quatorzième à la dixième place entre 2014 et 2015.
Les enjeux restent de taille pour nos acteurs économiques, en raison des perspectives avérées de grands contrats et des ressources résultant d’un potentiel de développement non négligeable de ce pays. L’exploitation de champs de gaz à l’horizon 2018-2019 ouvrira notamment des perspectives économiques favorables.
Par ailleurs, la visite du Président de la République, en mai 2014, dans les pays du Caucase, a donné un élan aux relations économiques entre la France et l’Azerbaïdjan. Lors de son passage à Bakou, onze documents ont ainsi été signés dans le domaine économique, dont trois arrangements administratifs visant à développer la coopération dans les domaines de l’agriculture, des transports, de l’énergie, et trois contrats pour près de 360 millions d’euros. Depuis cette visite, les contacts se sont poursuivis : entre 2014 et 2016, pas moins de onze contrats au total ont été conclus par les entreprises françaises, pour un montant total d’environ 630 millions d’euros. Ce sera, pour notre pays, la source d’un flux d’exportations.
La France est aussi un investisseur étranger important pour l’Azerbaïdjan : selon les statistiques locales de 2014, c’est la cinquième source d’investissements directs étrangers (IDE) dans le pays. Près de 75 % des stocks des IDE français en Azerbaïdjan sont concentrés dans l’énergie, même si la présence de nos grandes entreprises dans d’autres secteurs a également été renforcée.
Ce pays fait donc l’objet d’une attention importante et d’un suivi en adéquation avec les enjeux commerciaux et les intérêts des industriels français.
Nous suivons avec attention les projets de nos entreprises qui peuvent rencontrer des difficultés et nous encourageons régulièrement l’Azerbaïdjan, au 65e rang du classement Doing Business de la Banque mondiale, à améliorer le climat des affaires et, en particulier, l’État de droit.
M. le président François Rochebloine. De quelles difficultés parlez-vous ?
M. le secrétaire d’État. Je me suis rendu en Azerbaïdjan en 2015. D’après ce que l’on a nous dit, et d’après nos analyses, cela tient à l’instabilité législative et réglementaire, à des problèmes dans les contacts avec l’administration, et donc à une prévisibilité et une stabilité insuffisantes pour les opérateurs et les entreprises. Soyons clairs : tout ce qui a trait au climat des affaires et aux règles propres à un État de droit doit être amélioré.
De même, nous avons adapté notre dispositif de soutien public aux enjeux de nos entreprises pour ce pays. L’Azerbaïdjan n’est plus éligible à la Réserve Pays émergents (RPE) du fait de son niveau de revenu. En revanche, le pays est éligible au dispositif de dons du Fonds d’étude et d’aide au secteur privé (FASEP). Il est également ouvert, sous conditions, à la politique d’assurance-crédit de Coface, définie chaque année par le ministère des finances
– il s’agit là du seul aspect du commerce extérieur qui n’a pas été confié au ministère des affaires étrangères mais nous y travaillons étroitement avec les ministères financiers – et aussi au regard de l’évolution macroéconomique, que nous suivons attentivement.
Un mot sur l’Agence française de développement…
M. François Rochebloine. Nous avons reçu hier les représentants de l’AFD.
M. le secrétaire d’État. Alors, vous savez tout et je ne m’y attarderai pas. L’AFD est autorisée à intervenir dans le pays depuis 2012, dans le cadre d’un mandat visant à promouvoir une croissance verte et solidaire.
Depuis 2001, notre relation est l’objet d’un suivi au niveau politique. Une commission mixte franco-azerbaïdjanaise sur la coopération économique a été instituée en 2001 et s’est réunie à sept reprises – elle se réunit tous les deux ans, alternativement en France et en Azerbaïdjan. Organisée par la direction générale du Trésor, elle suit l’ensemble des relations économiques bilatérales. La dernière s’est tenue à Paris le 13 décembre dernier, co-présidée par le ministre des finances azerbaïdjanais, M. Samir Sharifov, qu’une importante délégation avait accompagné, et moi-même. Bien sûr, elle a été l’occasion d’entretiens bilatéraux, et elle a permis de soutenir l’offre française sur un certain nombre de grands contrats. Je songe à la première implantation d’Air liquide pour une usine de gaz industriel, à un travail avec Bouygues Construction pour la rénovation d’une station de métro à Bakou, à une offre d’Airbus pour la fourniture d’avions…
M. le président François Rochebloine. Il me semblait que le travail engagé en vue de la rénovation d’une station de métro avait connu un coup d’arrêt.
M. le secrétaire d’État. Il se pose effectivement un problème de liquidités, largement lié à la récession, mais le projet demeure d’actualité.
Thales et Alstom sont, pour leur part, engagés pour le développement du corridor ferroviaire Nord-Sud. Nous avons aussi affirmé le soutien de la France aux grands projets stratégiques azerbaïdjanais, notamment en ce qui concerne l’acheminement du gaz, avec la construction du corridor gazier Sud-européen et le développement de l’exploitation du champ gazier de Shah Deniz ; cela concourt aussi à l’objectif de diversification énergétique de l’Union européenne. C’était évidemment un temps important de notre réunion.
Nous avons enfin fait le point sur notre coopération économique dans différents secteurs et examiné comment diversifier encore la relation économique bilatérale. L’Azerbaïdjan est invité au prochain salon de l’agriculture à Paris, et nous avons envisagé la manière dont nous pouvions ensemble développer le secteur touristique, mais aussi des coopérations dans le domaine du numérique.
Cette réunion a donc été l’occasion d’un large tour d’horizon.
Même si je ne suis moi-même chargé que de questions économiques, le Gouvernement ne considère pas la situation des différents pays à la seule aune de leur intérêt économique. Croyez bien que, lors de chacun de mes déplacements, j’ai toujours à cœur de porter le message de la France, y compris sur les sujets qui fâchent. Notre pays s’honore de porter partout le message des droits de l’Homme, y compris lorsque des contrats sont en jeu. Depuis plus de deux ans que j’ai l’honneur d’exercer ces fonctions, je n’ai jamais mis sous le tapis les sujets qui fâchent, et il n’en est jamais résulté de problème économique. Il y a le dialogue politique, il y a le dialogue économique et il y a des savoir-faire français dont l’excellence est appréciée dans le monde entier ; ce n’est pas un message politique qui nuira à la diplomatie économique, et je n’ai jamais cru – personne n’a jamais cru, notamment pas Laurent Fabius ni Jean-Marc Ayrault – que la diplomatie économique devait conduire à négliger les autres aspects de notre action diplomatique.
M. le président François Rochebloine. Lors de vos contacts, avez-vous évoqué le cas de la famille Yunus ?
M. le secrétaire d’État. Oui. Je l’ai évoqué, ainsi que d’autres, au niveau gouvernemental, lors de ma visite. J’ai indiqué au vice-ministre des affaires étrangères que nous étions préoccupés notamment – mais pas seulement – par la santé de M. et Mme Yunus. Je l’ai fait dans le cadre qui convenait, en direct, et de manière très claire ; cela a d’ailleurs occupé une bonne partie de notre réunion.
M. le président François Rochebloine. Rappelons que Mme Yunus a été décorée de l’ordre de la Légion d’honneur par le Président de la République.
M. le secrétaire d’État. En effet.
Le message est porté lors de chacune de nos visites officielles, publiquement et dans les entretiens en tête-à-tête. La France, l’Union européenne et les instances internationales ne cessent et ne cesseront de porter ce message, parfaitement fondé.
Plus généralement, la question des droits de l’Homme et du respect par l’Azerbaïdjan de ses obligations internationales en la matière fait pleinement partie de notre dialogue politique avec Bakou. Le sujet est abordé lors de chaque visite ; il l’a été lors de celle du Président de la République, lors de celles du ministre des affaires étrangères, lors de la mienne au mois de juillet 2015.
Notre ambassadrice à Bakou, que vous avez bien fait d’auditionner, vous a indiqué que nous entretenons avec le gouvernement azerbaïdjanais un « dialogue franc et ouvert, qui n’élude pas les questions relatives à la situation intérieure du pays ». Cela signifie que notre diplomatie s’adresse à tous les niveaux de la société. J’ai moi-même tenu à rencontrer à la résidence de France des personnalités de la société civile, des dissidents, y compris des personnes qui contestent de manière très directe le régime, des représentants d’organisation de défense des droits de l’Homme. Et ce n’était pas une rencontre en catimini, en cachette : nous avons eu un échange extrêmement riche et instructif. J’ai ainsi témoigné notre soutien à ces personnalités éminentes et respectables, et notre ambassade est en contact régulier avec elles.
J’ajoute que la France exprime publiquement des positions de principe dans le cadre de l’Union européenne, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou pour son compte propre. Elle le fait également à l’occasion de l’arrestation de certains opposants, tels M. et Mme Yunus ou Mme Khadija Ismaïlova.
Par ailleurs, en tant que co-présidente du groupe de Minsk de l’OSCE sur le conflit du Haut-Karabagh qui oppose l’Azerbaïdjan à l’Arménie depuis 1991, la France joue un rôle particulier. Notre responsabilité est de faire preuve d’impartialité et d’équilibre entre les deux pays. Cela touche tous les aspects de nos relations, notamment le dialogue politique que nous menons avec Bakou et Erevan, ainsi que nos échanges commerciaux, qui se font tous dans le respect des décisions de l’OSCE et de l’Organisation des Nations unies (ONU). C’est pour nous la condition sine qua non de la mission qui est la nôtre, aux côtés de nos partenaires russe et américain : veiller au respect du cessez-le-feu, rétablir un minimum de confiance entre les parties et rechercher avec elles un règlement négocié et durable au conflit. Je n’entrerai pas dans le détail de la négociation elle-même, que vous connaissez, d’autant que vous avez auditionné notre ancien co-président du groupe de Minsk, M. Pierre Andrieu.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, les entreprises françaises, pour leur part, sont déterminées à accompagner l’Azerbaïdjan sur le long terme dans ses efforts de diversification industrielle, dans sa volonté de renouer avec la croissance. Elles répondent présent. La taille de la délégation du MEDEF qui s’est rendue à Bakou en mai dernier, composée de quarante-quatre chefs et représentants d’entreprises, couvrant au total une dizaine de secteurs d’activité, atteste en elle-même de l’intérêt porté à ce pays sur le plan économique. Quelles que soient donc les difficultés actuelles, l’Azerbaïdjan constitue donc un fort enjeu au sein de la zone Caucase-Asie centrale. Nous cherchons à y répondre dans le cadre d’une relation dense et de confiance, mais en n’éludant aucun sujet et en ne mettant sous le tapis aucun problème ni aucune difficulté. Cette diplomatie globale de notre pays, avec l’Azerbaïdjan comme avec l’ensemble de nos partenaires, est l’honneur de la France.
M. le président François Rochebloine. Merci pour cet exposé, monsieur le secrétaire d’État.
M. Jean-Louis Destans, rapporteur. Merci, monsieur le secrétaire d’État, pour cet exposé très complet.
Vous avez rappelé l’importance stratégique de l’Azerbaïdjan pour notre pays et évoqué notre dialogue politique, effectivement dense, puisque nos Présidents de la République se sont rendus en Azerbaïdjan, mais le Gouvernement considère-t-il aujourd’hui que les efforts fournis portent leurs fruits ? Avez-vous, monsieur le secrétaire d’État, le sentiment d’un progrès, fût-il lent, sur le plan des institutions, sur le plan législatif, sur le plan des droits de l’homme, à propos desquels le gouvernement azerbaïdjanais a pris quelques mesures symboliques ? Ou bien ne faut-il y voir qu’une alternance de phases de raidissement et de phases d’assouplissement ?
Sur le plan économique, la plupart des grandes entreprises françaises présentes en Azerbaïdjan, dont nous avons entendu les représentants, considèrent que, malgré le contexte post-soviétique et ce qui persiste de l’ancienne administration, les relations sont plutôt normales, que ce soit, par exemple, avec les services des douanes et des finances, ou lors des procédures de marchés publics. Selon elles, le pays a fait un effort, notamment en mettant en place des procédures informatisées pour tenter de contourner les difficultés. Partagez-vous cette analyse, ou les entreprises que nous avons reçues ont-elles pratiqué une sorte de langue de bois afin d’éviter de traiter de sujets gênants ?
En termes de compétitivité, qu’en est-il du positionnement économique et commercial de la France par rapport à ses principaux partenaires européens, mais aussi par rapport à d’autres pays, émergents ou non, comme la Turquie ou Israël, dont la concurrence, avons-nous entendu à plusieurs reprises, ne serait pas toujours sur les mêmes bases ?
Vous avez souligné l’engagement coordonné de l’ensemble de nos administrations en Azerbaïdjan au service de notre diplomatie économique. Dont acte.
Confirmez-vous enfin qu’il existerait des opportunités dans le secteur touristique azerbaïdjanais, notamment pour améliorer les infrastructures du pays ? Les touristes viendraient non pas d’Europe, mais plutôt des pays situés au Nord du Caucase, comme la Russie.
M. le secrétaire d’État. S’agissant de l’efficacité du dialogue politique, nous constatons des progrès sur certains points, mais les avancées demeurent très insuffisantes sur d’autres aspects. La situation reste très dure pour les organisations non gouvernementales : elles ne sont pas interdites, mais elles travaillent dans des conditions extrêmement restrictives. Sitôt qu’elles deviennent gênantes ou dérangeantes, elles sont soumises à des pressions, à des contrôles permanents, et à d’autres formes de harcèlement.
M. le rapporteur. Si elles ne sont pas interdites, mais elles sont empêchées.
M. le président François Rochebloine. Et les pressions concernent aussi leur financement !
M. le secrétaire d’État. Tout est fait pour pourrir la vie des ONG qui dérangent ; c’est incontestable. Cette situation est préoccupante, et la France suit ce dossier. C’est la raison pour laquelle j’ai tenu à rencontrer des représentants de ces ONG lorsque je me suis rendu sur place. Il est essentiel qu’un déplacement, fût-il économique, comporte également cette dimension politique. Il s’agit aussi d’envoyer un signal aux autorités pour leur faire comprendre que notre pays est attentif à une situation générale autant qu’à des cas particuliers.
Quelques progrès ont bien été enregistrés. Des prisonniers, dont certains emblématiques, ont sans doute été libérés grâce à la mobilisation internationale, mais le bilan est extrêmement contrasté. Comprenez bien que je ne veux pas laisser croire que la situation en Azerbaïdjan serait aujourd’hui satisfaisante sur le plan des libertés et de la démocratie ! Ce n’est vraiment pas le sens de mon propos.
Une concurrence féroce sévit sur le terrain économique, c’est normal. Il est satisfaisant de constater que les parts de marché des entreprises françaises ont progressé, et que ces dernières sont très présentes. Sur place, la diplomatie économique française est particulièrement active et dynamique autour de notre ambassadrice. Le travail se fait entreprise par entreprise, opportunité par opportunité.
L’Azerbaïdjan a mis en œuvre un certain nombre de réformes économiques. Des structures de réformes ont été créées pour piloter ces dernières dans le contexte difficile que nous avons évoqué ensemble. Un conseiller aux réformes économiques a été nommé auprès du Président, et un Centre d’analyse des réformes économiques et de la communication a vu le jour. Une nouvelle structure chargée de superviser les marchés financiers a également été mise en place : la Chambre de supervision des marchés financiers azerbaïdjanaise. La création de cette autorité, qui supervise la restructuration en cours du secteur bancaire, a été notée positivement par le Fonds monétaire international lors de sa dernière mission dans le pays.
Des mesures, que nos entreprises ont saluées, ont également été prises pour améliorer le climat des affaires. Depuis le début de l’année 2016, le Comité des douanes a mis en service une déclaration électronique des marchandises à l’import et à l’export. L’accès aux licences a été simplifié, et le nombre d’activités pour lesquelles elles sont obligatoires a été pratiquement divisé par deux, passant de soixante à trente-deux. Les frais d’obtention ont été réduits, elles sont désormais valables pour une durée indéterminée, et leur gestion a été confiée à une agence gouvernementale en charge de l’e-gouvernement, l’Azerbaïdjan Service and Assessment Network (ASAN). La suspension des contrôles non fiscaux des entreprises a été décrétée pour deux ans, et le système d’appels d’offres publics a été refondu. L’Agence pour les appels d’offres a été supprimée : cet organe critiqué – je choisis mes mots – constituait un véritable frein pour les investissements étrangers.
M. François Rochebloine. Quand cette agence a-t-elle été supprimée, et qui étaient ses membres ?
M. le secrétaire d’État. C’est assez récent, mais nous vous transmettrons la date exacte de sa suppression, et sa composition. Le département anti-monopole du ministère de l’économie est aujourd’hui en charge des appels d’offres. Il est certain que cette agence était un lieu peu recommandable. Les autorités d’Azerbaïdjan l’ont elles-mêmes reconnu.
M. le rapporteur. Vous restez diplomate…
M. le secrétaire d’État. On essaie !
M. le rapporteur. Permettez-moi de revenir sur l’une de mes questions. Un certain nombre d’entreprises françaises sont confrontées à des formes de concurrence peu classiques de la part d’entreprises étrangères.
M. le secrétaire d’État. Vous voulez dire que qu’elles seraient peu scrupuleuses et se livreraient à des pratiques auxquelles nos entreprises se refusent, comme la corruption ?
M. le rapporteur. Je ne l’ai pas dit, mais certains l’ont peut-être laissé entendre, en évoquant le comportement de pays géographiquement proches de l’Azerbaïdjan. Disposez-vous d’informations à ce sujet ?
M. le secrétaire d’État. Je ne peux pas vous le confirmer, ni d’ailleurs l’infirmer. Vous mettez sur la table une question très délicate et extrêmement importante qui se pose dans de nombreux pays du monde. Je ne peux pas affirmer que ce que vous dites est vrai, car seule la justice peut établir des faits. Les bruits et les rumeurs peuvent circuler, mais je ne peux jeter l’opprobre sur un pays ou une entreprise sans que des preuves aient été transmises à la justice, et que cette dernière se soit prononcée.
Le tourisme constitue un nouveau domaine de coopération de nos pays. Cette coopération n’est pas aujourd’hui très active, mais nous souhaitons la renforcer, et cela a été clairement évoqué lors de la commission mixte économique du mois de décembre dernier. La France, première destination touristique au monde, détient de nombreux savoir-faire : elle pourra apporter son soutien en matière d’expertise. Il s’agit aussi d’une opportunité pour nos entreprises, particulièrement dynamiques dans ce secteur. Nous les avons fédérées au ministère des affaires étrangères au sein d’une filière, French Travel, notamment afin d’assurer sa présence lors de nos déplacements. En lien avec le tourisme, l’Azerbaïdjan est confronté à un enjeu particulier : la dépollution d’un certain nombre de sites qui lui permettront de développer un écotourisme moderne. Dans ce domaine également, le savoir-faire des entreprises françaises est très grand.
Pour la France, en Azerbaïdjan, tout reste à construire dans le domaine du tourisme.
M. Jean-Michel Villaumé. Monsieur le secrétaire d’État, dans vos propos liminaires, vous avez évoqué l’intérêt stratégique de l’Azerbaïdjan sans toutefois aborder la question des échanges d’équipements militaires. À ma connaissance, ce pays fait depuis deux ou trois ans d’importants efforts budgétaires dans le domaine militaire : ce budget représente plus de 2,8 % du PIB du pays, et il croît tous les ans de plus de 8 %. En tant que membre de la commission de la défense nationale et des forces armées, je suis intéressé par la coopération et les échanges militaires entre nos deux pays. Pourriez-vous nous faire un point sur ce sujet ?
Vous êtes aussi le secrétaire d’État chargé des Français de l’étranger. Pouvez-vous nous donner quelques informations sur leur nombre en Azerbaïdjan, et sur les raisons de leur expatriation ? Qu’en est-il des Français dans les autres pays du Caucase ?
M. le secrétaire d’État. Les aspects de nos relations avec l’Azerbaïdjan relatifs à la défense sont intégralement suivis par ministère de la défense. Les choses sont parfaitement séparées, et je ne suis donc pas en mesure de vous répondre, mais le ministère compétent se tient évidemment à votre disposition.
La communauté française d’Azerbaïdjan, que j’ai rencontrée lors de mon déplacement, est à la fois très modeste en nombre, et très active. Environ deux cents expatriés sont inscrits au registre des Français établis hors de France – je pense qu’en Azerbaïdjan ceux qui ne sont pas inscrits sont peu nombreux. Ces deux cents personnes sont pour la plupart liées à l’implantation économique d’entreprises.
Cette communauté est numériquement assez stable. Il existe un lycée français à Bakou sur lequel nous pourrons vous fournir ultérieurement davantage de précisions.
M. Alain Ballay. Je ne suis pas membre de la commission de la défense, mais de celle des affaires sociales. Nos laboratoires pharmaceutiques disposent eux aussi d’un réel savoir-faire, et la France fabrique des produits pharmaceutiques de qualité. Dans ce secteur, avons-nous des relations particulières avec l’Azerbaïdjan ? Disposez-vous d’informations sur l’état de santé de la population de ce pays et sur le système de santé local ?
M. le secrétaire d’État. J’avoue que je ne dispose pas d’informations sur l’état de santé de la population. Je vous confirme la présence en Azerbaïdjan d’entreprises de notre secteur pharmaceutique, notamment celle de SANOFI. Nous pourrons vous fournir des détails sur ce sujet, mais le marché semble relativement limité.
M. Alain Ballay. J’ai rencontré, hier matin, un groupe de laboratoires pharmaceutiques qui nous alertaient sur la nécessité de développer notre commerce extérieur.
M. le secrétaire d’État. La santé fait partie des filières prioritaires à l’export que nous avons identifiées. M. Jean-Patrick Lajonchère, issu de ce secteur, est le fédérateur de cette filière, et il accomplit à ce titre un travail remarquable sur la structuration de l’offre de santé, qui s’appuie tout à la fois sur une conception très large de la sécurité sociale et de la couverture des risques, sur une recherche publique et privée de très grande qualité et extrêmement innovante et puissante, sur des laboratoires, comme SANOFI, qui sont parmi les meilleurs au monde et mettent au point des vaccins nouveaux, et sur un secteur hospitalier très solide. Notre approche globale des politiques de santé doit permettre à cette filière de se projeter encore davantage à l’international.
M. Jean-François Mancel. L’Azerbaïdjan importe tous ses médicaments. Le pays ne fabrique aucun produit pharmaceutique, mais il souhaite pouvoir le faire. Il y a vraiment une place à prendre pour les entreprises françaises.
M. le secrétaire d’État. Monsieur Mancel, vous avez parfaitement raison, même si le secrétaire d’État chargé du commerce extérieur est toujours heureux que la France exporte. (Sourires.)
M. le président François Rochebloine. Je reviens à un sujet que vous avez déjà abordé. Dans quelle mesure le maintien et le développement de la présence économique française en Azerbaïdjan vous paraissent-ils pouvoir contribuer, au moins indirectement, à une amélioration de la situation des libertés publiques dans ce pays ?
M. le secrétaire d’État. Le lien entre développement économique et amélioration de la situation des droits de l’Homme et des libertés politiques n’est pas du tout automatique. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu’il suffit de commercer pour que la démocratie advienne. Je ne partage pas le discours un peu naïf que l’on a entendu partout à ce sujet ces dernières années. On constate, dans des parties entières du monde, qu’a émergé une sorte de « libéralisme autoritaire » qui permet de conjuguer une croissance économique très soutenue et un autoritarisme de l’État toujours plus marqué. Il ne faut pas ignorer cette réalité.
Si le développement économique n’est pas directement corrélé à celui des libertés publiques, je pense que la présence économique française dans un pays donne à la France des raisons supplémentaires d’être entendue, ou au moins écoutée, lorsqu’elle évoque les droits de l’Homme. On peut choisir de cesser toute relation avec un État qui ne respecte pas les libertés, mais cette solution ne donne pas nécessairement de résultats. Il faut en revanche que notre diplomatie avance sur ces deux jambes : la diplomatie économique, et la diplomatie politique en matière de droits de l’Homme. Dans tous les forums, dans toutes les instances, dans tous les échanges et les contacts, même s’ils sont de nature économique, on doit aussi porter un message global sur l’importance de la démocratie et cibler les dysfonctionnements précis en la matière en évoquant les personnes injustement retenues ou la situation des ONG qui n’est pas satisfaisante. La France et l’Union européenne doivent avancer à la fois sur les aspects économiques, et sur les droits de l’Homme et la démocratie.
M. François Rochebloine. Les amateurs de football comprendront que je vous interroge sur Hafiz Mammadov et le RC Lens. Avez-vous suivi cette affaire ?
M. le secrétaire d’État. Honnêtement, je ne l’ai pas suivie, mais je crois que vous avez reçu M. Thierry Braillard, secrétaire d’État chargé des sports, qui connaît ce dossier mieux que moi.
M. le rapporteur. Monsieur le secrétaire d’État, comme vous, je considère qu’interrompre le dialogue avec un pays parce qu’il ne respecte pas la démocratie et les droits de l’Homme ne constitue pas la bonne solution. Il est préférable d’utiliser ce dialogue politique préservé pour tenter de peser, tout en poursuivant les affaires économiques et en favorisant le développement. Ce dialogue politique vous semble-t-il plus difficile à mener en Azerbaïdjan que dans les autres pays de cette zone géographique, comme l’Arménie ou la Géorgie ? Faut-il le renforcer ?
M. le secrétaire d’État. Je le disais : ce dialogue est contrasté. Il a permis un certain nombre de succès, et nous avons constaté des avancées, mais dans d’autres domaines la situation n’est pas satisfaisante.
Les comparaisons avec d’autres pays sont difficiles, car les enjeux et les situations sont différents. L’important reste de maintenir le dialogue et de préserver la clarté des messages sans jamais penser que la diplomatie économique autoriserait à se dispenser des messages politiques. La mobilisation doit aussi être forte au niveau communautaire avec nos partenaires européens.
M. François Rochebloine. Monsieur le secrétaire d’État, nous vous remercions vivement pour la clarté et la précision des réponses que vous nous avez apportées. Elles seront précieuses pour la préparation et la rédaction de notre rapport sur lequel travaillent en ce moment les administrateurs du secrétariat de notre mission d’information, que je tiens à remercier pour leur forte implication depuis le début de nos travaux.
M. le secrétaire d’État. Puisque l’occasion m’en est donnée, j’en profite pour remercier à mon tour les équipes de mon cabinet, de la direction générale du Trésor, et du Quai d’Orsay qui suivent les questions azerbaïdjanaises et qui ont préparé cette audition.
*
* *
1 () Ultérieurement, Mme Castagnos-Sen a indiqué s’être rendu compte de ce qu’elle avait fait une erreur, en mentionnant un taux de participation à la mi-journée. Le taux de participation au référendum, sur la base des résultats officiels, s’établit à 69 %.
© Assemblée nationale