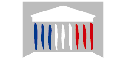______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 février 2017
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 27 avril 2016
sur
sur les acteurs bilatéraux et multilatéraux de l’aide au développement
Président
M. André Scheider
Rapporteur
M. Jean-René MARSAC
Députés
La mission d’information sur les acteurs bilatéraux et multilatéraux de l’aide au développement est composée de : M. André Schneider, président ; M. Jean-René Marsac, rapporteur ; M. Michel Destot, Mme Françoise Dumas, M. Boinali Saïd, Mme Marylise Lebranchu, M. François Scellier, M. Axel Poniatowski et M. Patrice Martin-Lalande.
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 9
I. CONSOLIDER LE CONTINUUM SÉCURITÉ-DÉVELOPPEMENT-ÉMERGENCE 13
A. LE CONTINUUM SÉCURITÉ-DÉVELOPPEMENT 14
1. L’évolution du lien entre sécurité et développement 15
a. La sécurité a toujours fait partie des objectifs de l’aide au développement 15
i. Contexte de guerre froide et décolonisation 15
ii. Un modèle de développement basé sur les politiques publiques 16
b. La question se pose dans des termes différents dans les années 2010 16
i. La stabilisation des États devient l’objectif politique prioritaire 17
ii. Sécurité et développement sont plus que jamais étroitement associés 18
2. Des outils et des thématiques adaptés aux situations de crises 19
a. Des thématiques prioritaires 19
i. Le soutien au renforcement des administrations centrales et territoriales 19
ii. La maîtrise de la croissance démographique 20
iii. Le soutien à la sécurité alimentaire et à l’emploi agricole 22
b. L’émergence d’outils multilatéraux et bilatéraux adaptés aux situations de crise 24
i. L’approche globale 24
ii. La Facilité de soutien à la paix pour l’Afrique 25
iii. Le fonds fiduciaire européen pour la République Centrafricaine (Fonds Bêkou) 28
iv. La Facilité pour la lutte contre la vulnérabilité et la réponse aux crises, outil porté par ’AFD 30
B. LE CONTINUUM DÉVELOPPEMENT ÉMERGENCE 32
1. La diversification du paysage du développement 32
a. L’émergence de nombreux pays depuis 1990 32
i. Des progrès incontestables 32
ii. Des situations plus diverses et complexes 34
b. La transition vers une forme d’aide atténuée 35
i. La stratégie de l’AFD vis-à-vis des « très grands émergents » 35
ii. Une stratégie profitable 36
2. L’évolution de la réflexion sur les objectifs 39
a. L’influence des pays émergents dans la réflexion sur l’aide au développement 39
b. Les Objectifs du Développement durable 40
i. L’émergence de nouvelles thématiques 40
ii. La réduction des inégalités de genre 41
iii. Des objectifs interactifs 42
iv. Des objectifs plus ambitieux 42
v. Des objectifs universels 43
c. L’inclusion du climat dans la réflexion sur le développement 44
i. Le rapprochement entre développement et préoccupations environnementales 44
ii. Le consensus autour de l’accord de Paris 45
II. POURSUIVRE LA RÉORGANISATION INSTITUTIONNELLE ET STRATÉGIQUE DE L’AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT FRANÇAISE 47
A. LE TOURNANT INSTITUTIONNEL ET STRATÉGIQUE DE L’APD FRANÇAISE 47
1. La réorganisation du dispositif français d’aide publique au développement 47
a. Les étapes de la réorganisation institutionnelle 47
i. La réforme de 1998 47
ii. La réforme de 2004 et de 2005 49
iii. Le décret du 5 juin 2009 49
iv. La Loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale de 2014 49
b. Le difficile équilibre du pilotage de l’aide 50
i. Assurer un suivi régulier de la politique française d’aide publique au développement par le Parlement 50
ii. Assurer le suivi interministériel de la politique française d’aide publique au développement 51
c. Le dispositif français dans les pays bénéficiaires de l’aide publique au développement 52
2. La réorganisation des outils de l’aide publique au développement 54
a. Le rapprochement entre l’Agence française de développement et la Caisse des Dépôts et Consignations 54
b. Le renforcement de l’expertise 57
i. Le rôle d’Expertise France 57
ii. Un effort français insuffisant 59
c. Rôle de la coopération décentralisée 60
i. Structurer la coopération décentralisée 61
ii. La Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD) 61
iii. Le rôle du ministère des Affaires étrangères 62
iv. Les cofinancements de la DAECT 63
v. Les efforts de mutualisation 63
vi. Le travail avec les opérateurs 64
III. SORTIR DU DÉBAT BINAIRE ENTRE BILATÉRAL ET MULTILATÉRAL 67
A. L’AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT FRANÇAISE S’EST LARGEMENT TOURNÉE VERS LES CANAUX MULTILATÉRAUX 67
1. Une aide bilatérale encore majoritaire 67
2. Une aide multilatérale en progression au cours des dernières décennies 68
B. UNE AIDE MULTILATÉRALE PRINCIPALEMENT ORIENTÉE VERS LES CANAUX EUROPÉENS ET LES FONDS VERTICAUX 69
1. Les outils européens 69
a. Le Fonds européen de développement 70
b. L’Instrument de financement de la coopération au développement 72
i. Programmes géographiques 72
ii. Programmes thématiques 73
iii. Programme panafricain 73
c. La Banque européenne d’investissement 74
d. Les mécanismes de l’UE combinant prêts et subventions 74
2. Les fonds verticaux 75
3. Les autres institutions multilatérales 76
a. Les institutions de développement onusiennes 76
b. Les banques multilatérales de développement (BMD) 78
c. La francophonie 79
C. PILOTER ET SÉLECTIONNER L’AIDE MULTILATÉRALE 82
1. Promouvoir les modes de fonctionnement français dans l’enceinte multilatérale 82
a. La place du multilatéral 82
b. Combiner l’action des différents types d’acteurs 84
c. Réduire la fragmentation de l’aide internationale 85
2. Promouvoir les intérêts français 86
a. Mieux équiper les acteurs français actifs dans l’enceinte multilatérale 86
b. Promouvoir l’expertise française au sein des organisations multilatérales 87
c. Encourager la définition d’orientations stratégiques différenciées pour les pays les moins avancés (PMA) 88
d. Promouvoir des stratégies d’intervention multilatérales mieux adaptées aux contextes de crise et de fragilité 88
IV. CHERCHER DE NOUVELLES STRATÉGIES FINANCIÈRES 90
A. LES LIMITES DE L’APPROCHE BUDGÉTAIRE 90
1. Le nécessaire accroissement des budgets 90
a. Une augmentation régulière de l’APD mondiale 90
b. Une APD française insuffisante 92
c. La part des dons dans l’APD française est également insuffisante 96
d. La part de l’APD française transitant par les ONG 99
2. Le FSD et les taxes innovantes 100
B. L’ÉMERGENCE DE NOUVEAUX MODES DE FINANCEMENT 101
1. La recherche de nouveaux financements au niveau international 101
a. Le consensus de Monterey 102
b. La conférence de Doha 102
c. Le programme d’action d’Addis Abeba 103
2. Favoriser l’émergence des secteurs privés du Sud 104
a. Proparco 104
i. Le rôle de Proparco 104
ii. Financement du souverain et du non-souverain 105
iii. Champ d’intervention géographique 105
iv. Les pays prioritaires 105
b. La promotion de la microfinance 106
c. Favoriser les modes de développement alternatifs 108
i. L’économie sociale et solidaire 108
ii. Le commerce équitable 110
d. Le financement du développement par les diasporas 114
i. Des sommes supérieures aux budgets d’aide publique au développement 114
ii. Réduire les coûts de transfert 115
iii. L’exemple de la diaspora libanaise 116
e. Les fondations 117
i. L’exemple de la Fondation Gates 117
ii. Une Fondation pour le Développement solidaire 117
V. ÉVOLUER VERS UNE LOGIQUE CONTRACTUELLE 119
A. LES C2D, MODÈLE INTÉRESSANT MAIS DIFFICILE À GÉNÉRALISER 120
1. Le Contrat de Désendettement et de Développement (C2D), une initiative franco-française 120
a. L’initiative pays pauvres très endettés (PPTE) 120
i. Principes de fonctionnement 120
ii. Des résultats tangibles 121
b. Un mécanisme d’optimisation de la dette des pays en développement 122
c. Mécanisme de remboursement-refinancement du C2D 122
d. Processus de mise en place d’un C2D 123
i. Conception et information 123
ii. Négociation et signature du C2D 124
iii. Mise en œuvre du C2D 124
e. Bilan des C2D 124
f. Champ d’application sectoriel et géographique 125
2. D’autres modes de partenariat 126
a. Les documents-cadres de partenariat 126
b. Les référentiels de croissance 126
B. IMPLIQUER PLUS DIRECTEMENT LES PAYS DESTINATAIRES DE L’AIDE 128
1. De l’aide au développement au développement partagé 129
a. S’agit-il encore d’« aide publique au développement » ? 129
b. La difficile coordination d’acteurs désormais nombreux 130
2. Contractualiser l’aide bilatérale 132
C. ORGANISER L’AIDE AUTOUR DE PARTENARIATS INTERNATIONAUX 133
1. Agir dans un cadre européen 133
2. Associer la France à des États francophones en voie d’émergence dans le cadre de coopérations tripartites 134
3. Coordonner les projets de coopération entre les outre-mer et leurs régions environnantes 136
CONCLUSION 139
EXAMEN EN COMMISSION 143
SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS 161
ANNEXE : LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES 165
Le paysage de l’aide publique au développement et du développement lui-même a connu de profonds bouleversements au cours des vingt-cinq dernières années. L’aide publique au développement, qui a longtemps consisté en un transfert de richesses et de compétences du Nord riche vers le Sud pauvre, s’est enrichie de thématiques nouvelles et peu abordées auparavant, tandis que les situations des pays destinataires de l’aide se sont diversifiées.
L’aide publique au développement englobe désormais, outre ses préoccupations traditionnelles de lutte contre la pauvreté et d’amélioration des conditions matérielles d’existence de la population mondiale, des thématiques nouvelles :
- L’aide au développement n’est en effet plus séparable aujourd’hui des préoccupations environnementales, l’association entre les deux thèmes se trouvant formulée dans l’expression « développement durable ». La lutte contre les dérèglements climatiques est désormais étroitement associée aux politiques d’aide au développement et figure parmi les dix-sept objectifs du développement durable adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies en septembre 2015, mais les autres thématiques environnementales font également partie des objectifs que se fixent les politiques d’aide.
- Les sujets sociaux ou sociétaux, au premier rang desquels l’égalité entre hommes et femmes, sont également désormais intégrés à la notion de développement, parfois au travers de thématiques comme celle de la santé, avec notamment les engagements pris par le G8 à Muskoka en juin 2010, parfois au travers de stratégies nationales telle que la stratégie Genre et Développement 2013-2017 adoptée par la France.
- Plus généralement, les Objectifs du Développement durable adoptés en septembre 2015 ont formalisé dans un document comprenant à la fois les dix-sept objectifs en question, 169 cibles et 230 indicateurs le fait que le développement est désormais un objectif universel, qui concerne aussi bien les pays du Nord que ceux du Sud et qui englobe non seulement les objectifs de niveau de vie matériel tels que ceux qui composent l’indice de développement humain du PNUD, mais également les composantes économique, environnementale et sociale du développement durable.
Cette évolution de la réflexion sur le développement a eu lieu alors que le paysage du développement lui-même devenait de plus en plus complexe. Les niveaux de développement des États destinataires de l’aide se sont en effet diversifiés, de même que leurs rôles respectifs dans l’aide internationale. Certains États sont demeurés au cours des dernières décennies dans un état de sous-développement alarmant, et cette stagnation est souvent liée à des facteurs politiques. D’autres pays ont connu une croissance forte et sont parvenus à s’extraire partiellement ou totalement de la pauvreté. D’autres enfin sont aujourd’hui en voie d’émergence.
Cette diversité de situation se retrouve également à l’intérieur même des États. Ainsi, si la Chine côtière a atteint pour certaines régions un degré de développement proche de celui de l’Europe, voire supérieur, ce n’est pas le cas de ses régions orientales et la Chine figure encore à ce jour sur la liste du CAD des pays destinataires de l’aide. Le développement est une affaire de degrés.
C’est ainsi qu’un même pays peut être destinataire et contributeur : destinataire d’une aide internationale adaptée à un pays émergent qui consolide ses infrastructures, améliore son système éducatif et sa gouvernance et accède progressivement aux normes environnementales des États les plus développés ; mais également contributeur vis-à-vis des pays de « son » Sud qui peuvent bénéficier à la fois de leur savoir-faire et de l’expérience d’un développement récent dont les étapes n’ont pas nécessairement été les mêmes que celles qu’ont franchies les pays d’Europe ou d’Amérique du Nord. C’est notamment le cas d’un certain nombre de pays francophones tels que le Maroc, où la mission s’est rendue entre le 12 et le 14 janvier 2016.
Dans ce paysage beaucoup plus complexe et plus divers qu’il ne l’était lorsque les premiers efforts d’aide au développement ont été lancés, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, les acteurs de l’aide au développement, bilatéraux et multilatéraux se sont multipliés, leurs interactions devenant plus complexes et leurs actions plus dispersées.
Les acteurs publics, bilatéraux et multilatéraux, sont plus nombreux. De nouveaux organismes multilatéraux ont été créés, comme des fonds thématiques dits « verticaux » tels que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (FMSTP), la Facilité financière internationale pour la vaccination (IFFIm) ou l’Initiative pour l'alimentation en eau et l'assainissement en milieu rural en Afrique, ou des nouvelles institutions comme la Banque asiatique d’Investissement dans les infrastructures, dont les opérations ont commencé en 2016. Les collectivités territoriales continuent à mettre en œuvre des actions de coopération décentralisée auxquelles l’État cherche à définir une forme de coordination.
Les acteurs privés ou semi privés se sont également multipliés, qu’il s’agisse des ONG, d’acteurs de l’économie sociale et solidaire, d’organismes de microcrédit ou de fondations privées. L’aide elle-même prend des formes plus diverses, qui peuvent aller du commerce équitable aux transferts monétaires des diasporas vers leurs pays d’origine. Ces phénomènes ne sont du reste pas tous nouveaux, mais tendent à être plus qu’auparavant pris en considération par les politiques publiques qui peuvent être amenées à adapter leur cadre juridique ou à rechercher des formes de partenariat public-privé permettant de mieux les prendre en compte.
Ce foisonnement d’acteurs de l’aide, bilatéraux et multilatéraux, publics et privés, rend toutefois difficile la coordination de leurs actions. La mission a pu constater au fil des auditions et lors de son déplacement que la mise en place de procédures ou d’organismes de coordination aboutit fréquemment à une multiplication des procédures, voire à la mise en place de nouveaux organismes, ce qui ne règle le problème que partiellement.
Face à cette évolution, la France a cherché à adapter son outil institutionnel et sa stratégie, avec notamment la mise en place d’Expertise France et le rapprochement entre l’Agence française de développement et la Caisse des Dépôts et Consignations, ainsi que par la poursuite de sa réflexion sur la stratégie française au sein des institutions d’aide multilatérales.
Ce rapport vise donc à présenter, alors que cette législature touche à sa fin, un tableau des évolutions récentes de l’aide publique au développement et de ses acteurs dont le rôle est devenu, ou est appelé à devenir, plus important du fait des nouvelles réalités du développement et des nouvelles nécessités induites par ces dernières.
Il formule des recommandations visant à consolider la stratégie d’aide française, à améliorer son suivi, à promouvoir certaines formes d’aide nouvelles et à inscrire l’aide dans un cadre plus contractuel et partenarial.
Il vise surtout, à travers ces recommandations, à inscrire l’aide au développement dans le temps long, en favorisant l’émergence d’une véritable vision stratégique, par une amélioration du suivi de la politique d’aide française, par une coordination des acteurs renforcée, par une plus grande attention portée aux nouvelles formes d’aide et par la mise en place d’une relation plus contractuelle entre contributeurs et destinataires de l’aide.
I. CONSOLIDER LE CONTINUUM SÉCURITÉ-DÉVELOPPEMENT-ÉMERGENCE
L’aide publique au développement devrait en théorie disparaître une fois son objectif atteint. Dès lors que chaque pays destinataire de l’aide a atteint un stade de développement suffisant pour que son économie n’ait plus besoin d’une aide quelconque, mais seulement d’échanges économiques classiques avec ses partenaires, les politiques d’aide publique au développement perdraient en effet leur justification.
Ce moment n’est pas encore venu. La liste de bénéficiaires de l’aide publique au développement produite par le Comité d’aide au développement de l’OCDE compte, pour la période 2014-2016, 48 États dans la catégorie des pays les moins avancés, quatre dans la catégorie des « pays à faible revenu », 36 dans la catégorie des « pays et territoires à revenu intermédiaires, tranche inférieure » et 58 dans celle des « pays et territoires à revenu intermédiaire, tranche supérieure », cette dernière catégorie incluant des États aussi divers que l’Argentine, Cuba, le Belize ou la Chine.
Cette liste, qui sert de référence à plusieurs traités internationaux, comporte donc un total de 146 États dont les économies sont à des stades de développement extrêmement divers. Or, les politiques d’aide au développement ont non seulement vocation à couvrir l’ensemble de ces situations, mais doivent également accompagner l’évolution des pays destinataires de l’aide en évitant de créer des situations de dépendance ou de laisser en place des outils devenus inutiles, voire contre-productifs.
Les politiques d’aide au développement sont donc aujourd’hui confrontées à deux grands groupes de pays destinataires. Le premier regroupe les États dont les économies n’ont pas décollé malgré les politiques d’aides qui y ont été conduites depuis plusieurs décennies. Cet échec du développement va souvent de pair avec des situations politiques précaires, soit parce que la faiblesse du développement a empêché la mise en place d’institutions efficaces et stables, soit à l’inverse parce que l’instabilité politique et les problèmes sécuritaires ont empêché le développement économique.
Ce premier groupe de pays doit faire l’objet de politiques prenant en considération les difficultés auxquelles font face ces États en matière de gouvernance ainsi que dans des domaines tels que l’alimentation, l’accès aux soins médicaux et la maîtrise de la croissance démographique. L’instabilité politique à laquelle font face certains de ces États appelle par ailleurs des interventions sortant du cadre de l’aide publique au développement mais qui doivent néanmoins être coordonnées à cette dernière.
Le deuxième groupe de pays est constitué de ceux dont les économies se sont développées depuis un peu plus de deux décennies à des vitesses variables, et se caractérise par conséquent par une grande diversité de situations. Si un certain nombre d’États sont tout simplement sortis du champ d’intervention de l’aide au développement, beaucoup ont atteint un stade intermédiaire, et surtout, beaucoup se caractérisent à la fois par une croissance rapide qui peut être elle-même porteuse de problèmes, et par de fortes inégalités régionales ou entre villes et campagnes.
Cette deuxième réalité voit s’effacer les notions de monde « développé » ou « en développement » au profit d’un continuum qui va de la sortie du sous-développement à l’accès au statut de pays émergent, puis de pays pleinement sorti du champ d’action des politiques d’APD.
La croissance et le développement rapide de nombreuses économies à des rythmes variables depuis les années 1990 ont donné naissance à une grande variété de situations ainsi qu’à la prise en compte de problèmes et de demandes nouvelles. La croissance rapide de nombreuses économies a abouti à des situations inédites, avec des inégalités régionales importantes au sein d’une même économie nationale dans de nombreux pays,
A. LE CONTINUUM SÉCURITÉ-DÉVELOPPEMENT
Une proportion importante des pays considérés par la France comme prioritaires en matière d’aide au développement se trouve confrontée à des situations d’instabilité politique. C’est notamment le cas d’États du Sahel tels que le Mali ou le Niger.
Le lien entre stabilité politique et développement relève quasiment de l’évidence. Le développement économique est difficilement concevable sans un niveau minimal de sécurité des biens, des investissements et des personnes. Sans sécurité juridique, le développement d’une économie peut difficilement aller au-delà du stade de l’économie informelle ou de subsistance.
Le défi, pour les politiques d’aide publique au développement, consiste donc à venir en aide aux pays destinataires concernés afin qu’ils puissent faire face à leur situation présente et anticiper leur transition vers un stade de développement plus avancé tout en veillant à ce que ces efforts ne soient pas instantanément annulés par un basculement du pays bénéficiaire de l’aide dans l’instabilité politique.
1. L’évolution du lien entre sécurité et développement
a. La sécurité a toujours fait partie des objectifs de l’aide au développement
i. Contexte de guerre froide et décolonisation
Les politiques modernes d’aide publique au développement peuvent être datées du début de la guerre froide. Inspirées du modèle mis en place à l’initiative des États-Unis pour la reconstruction de l’Europe avec le plan Marshall, les politiques d’aide au développement ont été progressivement mises en place avec deux préoccupations politiques :
- La volonté de contrecarrer l’influence de l’URSS et de ses alliés dans le monde ;
- Après la décolonisation, la volonté de la part des anciennes puissances colonisatrices comme la France et le Royaume-Uni de conserver une influence auprès de leurs anciennes colonies.
Que ce soit dans l’esprit de Truman, de Marshall ou de Michel Debré, l’aide au développement répond avant tout à des objectifs de sécurité. Cette position n’était pas uniquement celle de dirigeants occidentaux préoccupés de contenir les assauts du communisme à l’aube de la guerre froide. C’était aussi celle de l’Assemblée générale des Nations Unies qui, résolution après résolution, n’a cessé de mettre en avant l’impératif du développement pour la paix et la sécurité internationales : La résolution 1710 du 19 décembre 1961, qui lança la « Décennie des Nations Unies pour le développement » considérait ainsi « que le développement économique et social des pays économiquement peu développés est non seulement d’une importance capitale pour ces pays, mais aussi essentiel pour la paix et la sécurité internationales (…) ».
Les arguments que les Nations Unies mettent en avant pour légitimer les efforts demandés aux pays riches pour qu’ils aident les plus pauvres à se développer sont ensuite longtemps demeurés les mêmes. Dès le lancement de la deuxième Décennie du développement, en 1970, l’Assemblée générale évoquait entre autres le danger d’une jeunesse partout en effervescence. Ces préoccupations de Realpolitik étaient du reste parfaitement assumées et n’entraient pas nécessairement en contradiction avec un certain altruisme. C’est également ainsi que plusieurs pays ont clairement, et parfois depuis longtemps, articulé aide au développement et intérêts de sécurité nationale : c’est le cas du Japon, qui a inscrit ce principe dans la loi, ou du Royaume-Uni, où l’une des toutes premières décisions de David Cameron en mai 2010 fut de créer un Conseil national de sécurité auquel participent à égalité de rang le Foreign Office, les ministères de la défense, de l’intérieur, de l’énergie et le DFID. L’idée que le développement des uns profite aux autres et que la prospérité n’est pas un jeu à somme nulle était largement admise au début de la guerre froide comme aujourd’hui. Ce sont les conditions de sa mise en pratique qui ont évolué.
L’aide publique au développement pendant la guerre froide visait donc, dans sa dimension politique, des objectifs d’influence. Il s’agissait alors de consolider des systèmes politiques mis en place au moment de la décolonisation par des politiques largement orientées vers les infrastructures qui laissaient aux gouvernements en place une assez grande marge de manœuvre. L’enjeu politique vis-à-vis d’un pays récemment décolonisé était de permettre à un gouvernement de rester en place, de maintenir son alliance ou tout au moins de bonnes relations politiques avec les États donateurs, tout en assurant une croissance régulière de l’économie.
ii. Un modèle de développement basé sur les politiques publiques
Les politiques d’aide au développement menées entre la Seconde guerre mondiale et la fin de la guerre froide, dont ce rapport n’entend pas dresser l’historique, méritent toutefois d’être brièvement évoquées afin de souligner la distance parcourue depuis cette époque. On se contentera donc d’en souligner deux caractéristiques importantes :
En premier lieu, elles s’appuient généralement sur une conception du développement économique qui envisage ce dernier comme une série d’étapes pouvant être franchies plus rapidement grâce à des politiques publiques ciblées, l’exemple le plus connu d’une telle conception du développement étant fourni par l’économiste américain Walt Rostow1, pour qui le développement passe par cinq stades successifs (la société traditionnelle, les conditions préalables au décollage, le décollage, la marche vers la maturité et l’ère de la consommation de masse). De telles théories laissent peu de place aux incertitudes liées aux évolutions politiques et démographiques.
Elles s’appuient en second lieu également sur un fort soutien aux nouveaux États issus de la décolonisation, notamment dans le cas de l’Afrique subsaharienne francophone, où les administrations continuent pendant de nombreuses années à employer du personnel français, les fonctionnaires coloniaux se transformant progressivement en coopérants. Soucieuse d’échapper à l’accusation de néocolonialisme, la France diversifie néanmoins rapidement sa politique d’aide au développement, mais l’Afrique subsaharienne demeure sa priorité.
b. La question se pose dans des termes différents dans les années 2010
Les choses ont de ce point de vue changé. La stabilité politique de l’Afrique francophone est au moment de la décolonisation globalement assurée et les politiques de développement peuvent s’appuyer sur leurs appareils d’État, souvent renforcés par les coopérants français, dans la perspective d’un développement venant d’en haut et devant suivre une trajectoire linéaire sous la conduite de l’État et de l’administration. Des États tels que l’Iran et l’Afghanistan comptent dans les années 60 et 70 parmi les pays considérés comme prometteurs en termes de développement, du moins aussi longtemps que leurs gouvernements seront en mesure de faire usage de l’aide internationale afin de poursuivre la modernisation de l’économie.
Les bouleversements politiques qui ont eu lieu après la Guerre froide, avec une montée des aspirations démocratiques qui a pu donner lieu à des conflits ou à des soubresauts qui ajoutent aux incertitudes, ont profondément modifié cette situation et les politiques d’aides au développement doivent depuis les années 1990 faire face à des situations politiques plus complexes ainsi qu’à un accroissement de leurs responsabilités.
Mais ce sont les situations de conflit qui posent le problème le plus aigu aux politiques d’aide publique au développement, aujourd’hui confrontées à des situations de crises ou de faillite d’État qui amènent à poser le problème du lien entre aide au développement et stabilité politique d’une façon plus globale.
i. La stabilisation des États devient l’objectif politique prioritaire
À partir des années quatre-vingt-dix, la fin de l’ordre international très imparfait mais relativement prévisible de la Guerre froide, la multiplication des conflits aux enjeux purement locaux et des opérations de stabilisation ont créé une situation dans laquelle l’aide au développement a assumé de façon croissante une fonction de stabilisation des États en place qu’elle n’assumait pas auparavant.
L’exemple de l’Afghanistan, sur lequel s’appuie Serge Michailof dans son ouvrage Africanistan pour souligner la faible adaptation d’une partie du dispositif international d’aide aux objectifs que doivent viser ces politiques, est particulièrement instructif puisqu’il s’agit d’une situation dans laquelle l’aide internationale a été importante, s’est fixé un objectif clair de stabilisation et a été mise en œuvre dans le cadre d’une opération qui comportait un volet militaire important.
L’Afghanistan apparaissait en effet quasiment comme une « page blanche » du point de vue de la reconstruction, qu’il s’agisse du tissu économique ou de la structure politique et administrative du pays, aussi bien nationale que locale.
Or, pour M. Michailof, les résultats ont été décevants. Les Talibans ne sont pas éliminés, l’Afghanistan n’est pas doté d’institutions stables, son économie stagne, alors même que ce pays a bénéficié d’une aide internationale dont le volume promis, pour la période 2002-2007, était de 23 milliards de dollars, soit l’équivalent de cinq ans d’aide de la Banque mondiale à l’ensemble de l’Afrique subsaharienne, ainsi que d’une présence militaire censée assurer un niveau de sécurité suffisant pour permettre la reconstruction et le développement du pays.
Selon son analyse, l’échec s’explique par plusieurs séries de facteurs parmi lesquels le caractère lié de certaines aides, le retard dans la prise de certaines décisions présentant un caractère politique, comme la reconstruction de forces de maintien de l’ordre locales et, plus généralement, une certaine réticence à s’occuper des aspects les plus régaliens de la reconstruction de l’État, du fait notamment du caractère politiquement complexe de la situation interne du pays.
En d’autres termes, obtenir des engagements financiers de la part des principaux donneurs était plus simple que mettre en œuvre une aide au développement efficace et aboutissant réellement à la stabilisation du pays.
Les politiques d’aide destinées aux pays les moins avancées présentent en effet des difficultés particulières.
En premier lieu, lorsque l’État n’est pas en mesure de constituer un relais efficace des politiques d’aide, ce sont les intervenants extérieurs qui doivent soit se substituer aux structures administratives manquantes, soit les reconstruire aussi bien au niveau national que local. Les obstacles politiques aux interventions de ce type sont évidemment nombreux et beaucoup de problèmes présentant principalement un caractère économique ou humanitaire sont susceptibles d’entraîner des conséquences politiques. La façon dont sont réglés les problèmes dus à des déplacements de population peut ainsi avoir des conséquences sur les éventuels processus électoraux organisés dans le cadre du règlement négocié d’un conflit. Les politiques de réintégration des personnes ayant combattu lors d’une guerre civile, qui sont essentielles lorsqu’il s’agit d’éviter une reprise du conflit, sont également politiquement sensibles.
Plus généralement, les fonctions régaliennes de l’État, lorsqu’elles sont à reconstruire comme c’était le cas en Afghanistan à partir de la fin 2001, ne peuvent pas être laissées de côté mais impliquent souvent de véritables choix politiques devant lesquels les coalitions complexes d’acteurs, composées à la fois d’États et d’acteurs multilatéraux, tendent, selon M. Michailof, à reculer.
En deuxième lieu, les problèmes à régler ont souvent besoin de l’être rapidement, notamment lorsque la situation politique de l’État destinataire n’est pas stabilisée de façon définitive. M. Philippe Orliange, citant lors de son audition une parole de M. Jean-Marie Guéhenno, ancien Secrétaire général adjoint au Département des opérations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations unies, estimait que la communauté internationale peut bénéficier, lorsqu’une crise grave a été résolue dans un État, d’une période de fluidité de six à dix mois pour prendre les décisions nécessaires à la mise en place des principaux mécanismes d’aide devant permettre la mise en marche d’un cycle vertueux de stabilisation et de développement.
ii. Sécurité et développement sont plus que jamais étroitement associés
La déstabilisation d’un État peut annuler des années de développement. Il est donc logique de considérer la stabilité politique et la sécurité comme l’enjeu central de l’aide publique au développement.
C’est ainsi que l’une des premières missions de l’aide publique au développement doit être d’accompagner les États en cours de stabilisation. M. Rémy Rioux, directeur de l’Agence française de développement, a fait part à votre rapporteur de la convergence de vues entre son agence et les forces armées sur le fait qu’une opération de stabilisation réussie ne peut l’être par la seule action militaire, et qu’un accompagnement immédiat et coordonné sous forme d’aide au développement est indispensable, ne serait-ce que pour que l’armée n’ait pas besoin de revenir dans un pays où elle a mené une opération de stabilisation.
La stabilité et la sécurité politiques demeurent cependant, en quelque sorte, artificiellement exclues de l’aide publique au développement, comme le montre l’exemple de la Facilité africaine pour la paix, outil créé en 2003 par l’Union européenne et financé via le Fonds européen de Développement (FED) afin d’appuyer les efforts de stabilisation réalisés par les États africains.
2. Des outils et des thématiques adaptés aux situations de crises
Deux exemples d’outils d’aide au développement spécifiquement créés pour faire face aux situations de crise politique indiquent une prise de conscience de la nécessité de disposer d’outils adaptés.
a. Des thématiques prioritaires
Là où le développement n’a pas eu lieu depuis la décolonisation, les politiques d’aides doivent rechercher les causes profondes de la stagnation économique et s’efforcer d’attaquer le mal à la racine. Certaines thématiques sont donc à privilégier dans cette perspective.
i. Le soutien au renforcement des administrations centrales et territoriales
Stabiliser un pays en crise implique des moyens distincts de ceux déployés par l’aide publique au développement, mais préserver à long terme la stabilité d’un État implique toute une série d’interventions très concrètes visant à lui donner les moyens d’assurer ses missions.
C’est pourquoi l’aide en matière de gouvernance a pris une importance particulière dans ce contexte. Il s’agit en effet d’aider les États destinataires de l’aide à remplir les fonctions régaliennes de base (défense, sécurité, justice, administration et pilotage des politiques publiques, législation et cadre réglementaire, gestion publique et fiscalité. Il s’agit concrètement de permettre aux États de délivrer sur l’ensemble du territoire les services publics de base attendus des populations, tant en nombre qu’en qualité suffisante.
Une refonte du dispositif français d’aide au développement dans ce domaine a été engagée depuis 2015, dont il sera question plus loin dans le présent rapport, visant à mettre le dispositif français dans le champ de la gouvernance au niveau de ceux de nos principaux partenaires, avec un pilier financier confié à l’Agence Française de Développement (AFD) et un pilier expertise confié à Expertise France (EF) qui doit agir dans le cadre d’un partenariat privilégié avec l’AFD. L’action du Ministère est donc désormais recentrée sur le pilotage et la définition stratégique des actions dans le domaine de la gouvernance et sur le renforcement de son rôle dans les négociations internationales et le suivi d’initiatives multilatérales tout en assurant la tutelle des opérateurs.
Cette organisation s’applique à l’ensemble des thématiques de la gouvernance démocratique, notamment la gouvernance financière. La responsabilité de l’ensemble des projets bilatéraux d’appui à la mobilisation des ressources domestiques, aux réformes institutionnelles des administrations financières nationales et à l’amélioration de la collecte des impôts sera assurée par l’AFD après le transfert. Le suivi des initiatives internationales, la tutelle des opérateurs et la définition des stratégies seront réalisés conjointement par le MAEDI et le ministère des Finances et des Comptes publics.
ii. La maîtrise de la croissance démographique
Les pays pauvres prioritaires, et plus généralement l’Afrique francophone, font partie d’une région dont la croissance démographique est particulièrement rapide, ce qui ne sera pas sans conséquences.
Estimations et projections de population pour les pays du Sahel (en millions d’habitants)
Année |
Sénégal |
Mali |
Burkina-Faso |
Niger |
Tchad |
Mauritanie |
Total Sahel |
1950 |
2,5 |
4,7 |
4,3 |
2,6 |
2,5 |
0,7 |
17,2 |
2000 |
9,9 |
11,0 |
11,6 |
11,2 |
8,3 |
2,7 |
54,8 |
2050 |
36,2 |
45,4 |
42,8 |
72,2 |
35,1 |
8,0 |
239,8 |
2100 |
75,0 |
93,0 |
81,0 |
209,3 |
68,9 |
13,1 |
540,3 |
Source : Nations Unies, World Population Prospects, Révision de 2015.
Même s’il doit être admis que les projections démographiques sur des périodes voisines d’un siècle sont risquées, la tendance est parfaitement claire en ce qui concerne la génération à venir. L’accroissement de la population des pays du Sahel créera de façon quasiment certaine une situation extrêmement tendue en termes d’emploi et, plus généralement, d’équilibres économiques, sociaux, voire ethniques, avec pour conséquence probable un accroissement des migrations en provenance de ces pays, dont une partie sera dirigée vers les États voisins d’Afrique, dont la capacité d’absorption est limitée, et une partie sera dirigée vers l’Europe.
L’action en matière démographique est cependant délicate car le sujet est sensible pour des raisons politiques et parfois religieuses, aussi bien du côté des pays donateurs que des pays destinataires de l’aide. Le sujet est cependant loin d’être consensuel dans les États concernés et on peut craindre que des politiques volontaristes de maîtrise de la croissance démographique ne soient susceptibles d’entraîner un risque à court terme de déstabilisation politique. Aussi le sujet démographique se retrouve-t-il en filigrane dans les initiatives internationales sur la santé sexuelle et reproductive, dont l’objectif est plutôt la réduction de la mortalité infantile que la maîtrise de la croissance démographique.
C’est ainsi que lors de la réunion du G8 à Muskoka en juin 2010, les chefs d’État et de gouvernements se sont engagés à hauteur de 7 milliards d’euros pour accélérer l’atteinte des Objectifs 4 et 5 du millénaire pour le développement en faveur de la santé de la mère et de l’enfant. À cette occasion, les autorités françaises ont consenti une enveloppe de 500 millions d’euros sur cinq ans à destination des pays alors définis comme prioritaires (18 dont 14 en Afrique subsaharienne).
Il mérite cependant d’être relevé que la plupart des responsables politiques burkinabé rencontrés par la mission lors de son déplacement au Burkina Faso ont insisté sur la nécessité d’une maîtrise de la croissance démographique dans ce pays. Cette préoccupation semble en effet partagée par les dirigeants, mais ces derniers sont parfaitement conscients de la difficulté à la faire partager par la population. Le Président de la République, M. Roch Marc Christian Kaboré, a ainsi fait part à la délégation du recrutement d’agents communautaires placés dans les villages du pays et chargés de la sensibilisation de la population en matière de santé et de démographie. M. Salifou Diallo, président de l’Assemblée nationale du Burkina Faso estime pour sa part que s’il existe des facteurs religieux ou traditionnels « qu’aucun législateur ne peut affronter de face », la démographie peut cependant être maîtrisée par des politiques sociales, notamment l’émergence d’un système de retraite ou de sécurité sociale.
Votre rapporteur note que la maîtrise de la croissance démographique ne figure pas en tant que telle parmi les thématiques mises en avant dans le relevé de décision du 30 novembre 2016 du Comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) (2), même si la préoccupation semble implicite lorsque sont mentionnée la santé reproductive et la thématique « genre et population ». On comprend facilement pour quelles raisons les pays donateurs ne se sentent pas en position de demander aux pays destinataires de l’aide des efforts dans un domaine sensible qui relève clairement de la souveraineté nationale. Lorsque c’est le pays destinataire qui le demande, il devient en revanche envisageable de mettre en place des stratégies plus ambitieuses dans ce domaine.
C’est l’une des raisons pour lesquelles votre rapporteur recommande à la fin du présent de rapport d’inscrire l’aide bilatérale dans un cadre contractuel qui permette au pays destinataire d’exercer une responsabilité accrue sur le choix des thématiques et des projets de développement.
iii. Le soutien à la sécurité alimentaire et à l’emploi agricole
Quels que soient les moyens d’action dont dispose l’aide publique au développement en matière de maîtrise de la croissance démographique, il demeure indispensable d’anticiper les effets à venir de cette dernière, ce qui implique une politique de soutien à l’emploi à long terme centrée sur l’agriculture.
La loi de juillet 2014 fait de l’agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition un secteur prioritaire d’intervention. Dans ce cadre, la France soutient des initiatives permettant à l’agriculture familiale de développer durablement son potentiel : adoption de politiques agricoles cohérentes, renforcement de l’intégration régionale, structuration des marchés agricoles et développement des filières des produits vivriers et des produits de rente, appui aux organisations paysannes, gestion intégrée des ressources en eau, sécurisation du foncier et lutte contre la dégradation des terres, lutte contre la malnutrition, accès aux services en milieu rural, notamment de financement, et formation des différents acteurs concernés.
Cette stratégie d’appui aux agricultures familiales se décline autour de 3 axes majeurs d’intervention :
– l’amélioration de la gouvernance sectorielle de la sécurité : sécurisation du foncier, prévention et gestion des risques, pilotage macro-économique et social du secteur, renforcement des compétences des acteurs des politiques agricoles, y compris des organisations professionnelles agricoles ;
– le développement des territoires ruraux et la conservation de leur capital naturel : connexion des zones de production avec les pôles de consommation, amélioration de la qualité de vie en milieu rural et la préservation des ressources naturelles qui ont un impact sur la productivité des agriculteurs, renforcement des capacités des collectivités locales rurales à exercer des compétences clés pour le développement de leurs territoires, désenclavement logistique et énergétique des zones rurales, accès aux services essentiels dans les zones rurales ;
– la croissance soutenue et riche en emplois des filières agricoles, en connectant les agriculteurs au marché : appui au développement des filières et à la production agricole, soutien aux pratiques d’adaptation au changement climatique, à la transformation des produits agricoles près de leur lieu de production afin de garder de la valeur ajoutée dans les campagnes et aux services financiers et non financiers afin de professionnaliser les acteurs des filières concernées.
Afin de promouvoir cette vision de la sécurité alimentaire dans les enceintes internationales, la France a par ailleurs soutenu le processus de réforme de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la réforme du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) et la réorganisation du Groupe consultatif sur la recherche agricole internationale (CGIAR). Au sein du G7 et du G20, la France continue à pousser la priorité donnée à la sécurité alimentaire, initiée lors de notre présidence du G8 et du G20 en 2011. Elle s’est par ailleurs réengagée en 2015 auprès du Fonds international de développement agricole (FIDA), en participant à la 10ème reconstitution du Fonds. La France est également membre de la Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition (NASAN) qui vise à lutter contre l’insécurité alimentaire et la pauvreté par la stimulation de l’investissement privé dans l’agriculture dans dix pays d’Afrique sub-saharienne.
La montée en charge de la politique française en faveur du développement agricole s’est cependant principalement appuyée sur un accroissement des crédits bilatéraux.
Versements consacrés à l’agriculture et la sécurité alimentaire de 2010 à 2014 (en millions d’euros)
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 | |
Crédits multilatéraux |
23,2 |
23,4 |
23,7 |
23,9 |
22,7 |
Crédits bilatéraux |
275,56 |
336,21 |
352,91 |
323,15 |
427,98 |
Total |
298,76 |
359,61 |
376,61 |
347,05 |
450,67 |
Source : OCDE
Les données concernant l’aide multilatérale prennent uniquement en compte les crédits directement affectés aux institutions internationales dont l’essentiel de l’activité traite de sécurité alimentaire. Ces institutions sont notamment :
– L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), qui joue un rôle de chef de file dans les efforts internationaux de lutte contre la faim. Son mandat consiste à améliorer les niveaux de nutrition, la productivité agricole et la qualité de vie des populations rurales et à contribuer à l’essor de l’économie mondiale ;
– Le Programme alimentaire mondial (PAM), qui est la plus grande organisation internationale d’aide humanitaire du monde. Il conduit des projets dans près de 80 pays, avec un nouveau plan stratégique qui comprend des actions d’urgence, des actions de construction de la résilience des populations à l’insécurité alimentaire et des actions de lutte contre la sous-nutrition infantile ;
– Le Fonds international pour le développement agricole (FIDA), qui finance, essentiellement par des prêts concessionnels, des projets de lutte contre la pauvreté en milieu rural, dans près d’une centaine de pays. Le FIDA cible en particulier les jeunes et les femmes en milieu rural, ainsi que l’agriculture familiale.
Répartition par dons et prêts des versements bilatéraux entre 2010 et 2014 (millions d’euros)
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 | |
Dons |
253,12 |
243,29 |
266,63 |
239,75 |
247,16 |
Prêts |
22,44 |
92,92 |
86,28 |
83,40 |
180,83 |
Source : OCDE
Les dons bilatéraux relèvent du programme 209 « solidarité à l’égard des pays en développement ». Ils sont répartis entre les subventions-projets gérées par l’AFD pour des projets dans les secteurs du développement rural et de l’agriculture, les crédits programmés sur la ligne « aide alimentaire » qui bénéficient à 70% à des organisations internationales (PAM, CICR) et à 30% à des ONG, et une partie des subventions allouées à des ONG à partir des crédits programmés pour le fonds d’urgence humanitaire.
Les crédits multilatéraux proviennent quant à eux à la fois du programme 110 « aide économique et financière au développement » pour la contribution au FIDA, et du programme 105 « action de la France en Europe et dans le monde » pour la contribution obligatoire de la France à la FAO.
b. L’émergence d’outils multilatéraux et bilatéraux adaptés aux situations de crise
Bien que l’approche bilatérale puisse se heurter à un manque de moyens, il demeure important pour la France de disposer d’une capacité à agir, ne serait-ce que pour être en mesure de prendre rapidement des initiatives en matière d’aide au développement dans les situations de stabilisation politique.
La nécessité d’une « approche globale » des crises a émergé à la suite d’une série de crises et de conflits au cours desquels la communauté internationale est intervenue militairement et n’a pas été en mesure de transformer des succès militaires parfois rapides et complets en succès politiques durables, faute d’avoir pris en compte les autres facteurs nécessaires à la stabilisation durable de l’État ou de la région concernée.
Deux objectifs principaux sont assignés à l’approche globale :
- prévenir les conflits pour ne pas avoir à s’y impliquer militairement : prévenir un conflit est en effet bien moins coûteux à tous points de vue que d’intervenir militairement pour tenter de le résoudre. Ainsi, le coût de l’opération Serval en 2013 s’est élevé à environ 650 millions d’euros et le coût de Barkhane à environ 550 millions d’euros par an ! Il faut ajouter à ces sommes la participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, soit à nouveau plus de 500 millions d’euros en 2016.
- transformer un succès militaire en succès politique. Les exemples de l’Afghanistan et de l’Irak montrent la difficulté de l’opération.
Mettre en œuvre une « approche globale » implique ainsi de mieux prévenir les crises, par des actions de coopération structurelle militaire, de coopération civile et de développement. Le développement économique, la construction des structures de l’État, de l’administration, de la justice, sont en effet les plus sûrs moyens de prévenir les crises. Mais il s’agit aussi d’aller plus loin en analysant systématiquement, selon les concepts désormais mis en œuvre par l’AFD, les « facteurs de crise » et les « facteurs de résilience » de chaque situation.
Il faut en outre mieux détecter les signaux avant-coureurs des crises et savoir aussi, dès les débuts de l’intervention militaire quand celle-ci s’avère inévitable, déployer, en coordination avec l’action militaire, des capacités civiles pour créer les conditions d’une stabilisation durable.
Le Livre blanc de 2008, puis celui de 2013, avaient déjà mis en avant cette nécessité d’une approche globale, qui avait conduit à l’adoption, en 2009, d’une stratégie interministérielle de gestion civilo-militaire de gestion des crises extérieures. La France puis l’Union européenne à sa suite ont aussi mis en place des stratégies intégrées pour le Sahel (respectivement en 2008 et en 2011), qui ont toutes les deux pour caractéristique d’inclure un large périmètre d’États dans leur réflexion et d’ambitionner de mener une approche transversale alliant développement, sécurité et gouvernance.
Votre rapporteur estime qu’une telle approche de l’aide au développement est particulièrement utile aujourd’hui. Elle ne doit pas toutefois aboutir à un mélange des genres excessif. Les critiques des ONG, qui craignent que les objectifs de nature stratégique ou politique ne finissent par prévaloir sur les objectifs de développement proprement dit, ne peuvent être balayées d’un revers de main.
Concrètement, la mise en œuvre de ces thématiques, pour être utile dans les situations de crises, suppose l’existence d’outils multilatéraux adaptés, compte tenu à la fois de l’urgence des situations et des moyens requis pour y faire face. Deux outils récemment créés dans cette perspective peuvent être cités : la Facilité de soutien à la paix pour l’Afrique (APF) et le fond fiduciaire européen pour la République Centrafricaine (Fonds Bêkou).
ii. La Facilité de soutien à la paix pour l’Afrique
Créée à la demande des dirigeants africains, la Facilité de soutien à la paix pour l’Afrique (African Peace Fund, APF) a été financée au titre du Fonds européen de développement. Elle représente aujourd’hui la principale source de soutien financier aux efforts de l’Union africaine et des Communautés économiques régionales dans le domaine de la paix et de la sécurité. Entre 2004 et 2015, l’Union européenne a ainsi engagé plus de deux milliards d’euros en faveur de cette facilité.
Cet instrument fait de l’Union européenne le premier bailleur du Programme africain pour la paix et la sécurité, et assure un financement important et prévisible aux efforts de paix et de sécurité de l’Union africaine et des Communautés économiques régionales, parallèlement au soutien politique européen. Depuis sa création en 2004, l’Union européenne a engagé 1,45 milliard d’euros et versé plus d’1,3 milliard d’euros. Ce partenariat s’articule autour de trois priorités intimement liées, qui correspondent aux objectifs spécifiques de l’APF :
- un dialogue renforcé sur les défis à relever en matière de paix et de sécurité ;
- la mise en œuvre de l’architecture africaine de paix et de sécurité (AAPS) ;
- L’appui aux opérations de soutien à la paix (OSP) en Afrique.
L’APF a pour base juridique l’accord de Cotonou et est financée au titre du Fonds européen de développement (FED). Les bénéficiaires directs de l’APF sont l’Union africaine (UA) et les Communautés économiques régionales/Mécanismes régionaux (CER/MR) investis d’un mandat de paix et de sécurité, ainsi que les institutions responsables au sein de l’AAPS ou qui en relèvent. En vertu des règlements du FED, les fonds de l’APF peuvent être utilisés pour financer les frais supportés par les forces africaines de maintien de la paix sous la bannière de l’UA ou d’une CER/MR dans un autre pays.
L’orientation stratégique de l’APF s’appuie sur une approche double : elle associe un financement à court terme pour le règlement de crises récentes à un soutien à plus long terme pour le renforcement des capacités institutionnelles dans le domaine de la paix et de la sécurité.
Conformément aux priorités adoptées, les activités financées par l’APF relèvent des domaines suivants :
- Le renforcement des capacités est une composante majeure de l’APF depuis 2007. Il a pour objectif de développer les capacités de base de l’UA et des CER/MR en matière de planification et de conduite des opérations de soutien à la paix et de mise en œuvre de l’AAPS. Á terme, l’objectif est de permettre aux institutions africaines de garantir elles-mêmes la paix et la sécurité sur le continent, sans aide extérieure.
- Le Mécanisme de réaction rapide (MRR) permet de faire face rapidement à des besoins urgents en assurant une source de financement pour les premières phases des actions de prévention, de gestion et de résolution des crises. L’APF prévoit une enveloppe initiale de 15 millions d’euros pour le MRR, conformément au programme d’action triennal 2014-2016.
Enfin, l’UA et les CER/MR se sont engagées à relever le défi de la paix et de la sécurité en Afrique, en dernier recours par le biais des OSP sous commandement africain. En termes de financement, le soutien aux OPS a représenté le principal domaine d’engagement au titre de l’APF.
L’Accord de financement, doté d’une enveloppe de 750 millions d’euros pour le programme d’action pour la Facilité de soutien à la paix pour l’Afrique 2014-2016 a été signé le 15 juillet 2014. Tout comme dans les précédents programmes de l’APF, les bénéficiaires directs sont toujours l’UA et les CER/MR, dont près de 90 % des fonds reçus servent à soutenir les opérations de paix sous commandement africain. Les fonds restants visent à soutenir la mise en œuvre de l’AAPS et les opérations au titre du Mécanisme de réponse rapide axés sur la prévention des conflits et la gestion des crises. Les règles d’éligibilité des coûts demeurent inchangées. L’APF peut par exemple financer les frais de subsistance des troupes, les salaires du personnel civil, les frais de logistique, de transport et de communication ou encore les frais médicaux, mais elle ne peut en aucun cas financer le matériel militaire, les armes, les munitions ou la formation militaire.
Suite aux conclusions de l’évaluation externe de l’APF menée en 2013 et aux consultations avec les États membres de l’UE, le programme d’action 2014-2016 a introduit quatre nouveaux éléments.
- Une plus grande attention à la nécessité de mettre en place des stratégies de sortie et d’améliorer progressivement la répartition de la charge financière pour les opérations de paix à long terme, afin de renforcer l’appropriation par l’Afrique et d’améliorer la durabilité ;
- le réalignement du soutien de l’APF à l’AAPS et au renforcement des capacités avec un soutien plus ciblé et une diminution progressive du soutien général aux frais de personnel, afin de concentrer ce soutien dans les domaines où il a le plus d’impact sur le développement de capacités durables ;
- Une plus grande attention à la nécessite d’améliorer la cohérence et la complémentarité entre l’APF et les activités financées par le PIR et une plus grande coordination avec les délégations régionales européennes ;
- Une simplification de la procédure décisionnelle de la Commission pour améliorer la rapidité et la réactivité.
Entre 2004 et 2014, l’Union européenne a contractualisé plus de 1,4 milliard d’euros et versé plus de 1,3 milliard d’euros au titre de cet instrument. La France est le deuxième contributeur derrière l’Allemagne, avec une contribution s’élevant à 17 % de l’enveloppe totale.
La logique qui sous-tend la création de cette facilité repose sur la reconnaissance du fait que la paix et la sécurité sont des conditions préalables au développement durable et inversement, constat souligné dans les conclusions du Conseil sur la sécurité et le développement de novembre 2007, qui affirment que le lien entre le développement et la sécurité doit guider les stratégies et les politiques de l’Union européenne. Pourtant, seule une petite partie des sommes décaissées au titre de la facilité, et seulement depuis 2015, ont été inclues dans les montants généraux de l’APD au titre du FED rapportés par l’Union européenne au Comité d’Aide au Développement de l’Organisation de Coopération et Développement économiques (OECD/CAD), dont les règles excluent de l’aide publique au développement la plupart des dépenses liées aux activités de maintien de la paix.
Cela signifie que ces dépenses, qui excluent déjà le matériel militaire, les armes, les munitions ou la formation militaire, ne sont généralement pas considérées comme contribuant à l’aide publique au développement et que l’augmentation de la contribution française à l’APF ne rapprocherait pratiquement pas cette dernière de l’objectif des 0,7 %.
La stabilité et la sécurité politiques demeurent par conséquent, d’un point de vue comptable, artificiellement exclues de l’aide publique au développement, ce que l’on peut regretter.
iii. Le fonds fiduciaire européen pour la République Centrafricaine (Fonds Bêkou)
Le fonds fiduciaire Bêkou a pour but de contribuer à la stabilisation et à la reconstruction de la République Centrafricaine (RCA). Il vise à mieux articuler les programmes de reconstruction et développement avec la réponse humanitaire (Linking Relief, Rehabilitation and Development, ou LRRD) afin de permettre le renforcement des capacités centrafricaines.
Le fonds est établi pour une durée limitée de 60 mois afin d’apporter une réponse de moyen terme. Le fonds fiduciaire est ouvert à tous les États Membres de l’UE qui souhaitent contribuer à la réalisation des objectifs du fonds fiduciaire ainsi qu’à d’autres donneurs.
L’ampleur de la crise politique et sécuritaire de 2013 en République centrafricaine, avec plus de 410 000 personnes déplacées sur le territoire du pays et plus de 427 256 réfugiés dans des pays voisins, et des conditions de plus en plus difficiles en termes d’infrastructures, de délivrance des services de base et de fonctionnement de l’administration, a rendu nécessaire l’organisation rapide et efficace d’une aide internationale structurée et adaptée aux situations de fragilité.
Le règlement financier de 2013 autorise la Commission européenne à créer et à gérer des fonds fiduciaires européens en vertu d’un accord conclu avec d’autres donneurs. Ces nouveaux fonds européens ont été spécialement prévus pour intervenir dans des situations de crise ou d’après-crise, l’expérience ayant montré que la faiblesse des administrations nationales ou locales et la multiplication soudaine des bailleurs entraînent une désorganisation et une fragmentation de l’action de la communauté internationale empêchant de contribuer de manière significative et durable à la reconstruction d’un pays.
C’est dans ce contexte que le premier fonds fiduciaire multi-bailleurs appelé Bêkou — « espoir » en sangho — a été mis en place le 15 juillet 2014 par l’Union européenne et trois de ses États membres, la France, l’Allemagne et les Pays-Bas, en vue d’encourager la stabilisation et la reconstruction de la RCA. Le fonds est établi pour une durée maximale de 60 mois afin d’apporter une réponse à moyen terme.
En juillet 2016, le fonds Bêkou était alimenté à hauteur de 115 millions d'euros. Le montant initial du fonds s'élevait à 64 M€ et se décomposait ainsi : 39 millions d’euros du Fonds de Développement européen (FED), et 2 millions d’euros du budget de l'action humanitaire européen (ECHO), tous deux gérés par la Commission européenne ; 5 millions d’euros en 2014 de la France ; 5 millions d’euros en 2014 de l'Allemagne ; 3 millions d’euros des Pays-Bas.
Le fonds Bêkou permet de dépasser le stade de la coordination entre États membres pour mettre en place une véritable mutualisation des ressources, de l’expertise et des capacités de mise en œuvre. Face à un contexte aussi difficile que celui de la RCA, pays orphelin de l’aide dans lequel l’ensemble des partenaires techniques et financiers avaient déjà de grandes difficultés à exécuter des projets avant la crise actuelle, cet outil vise à rationaliser les dispositifs d’intervention, à concentrer les ressources humaines et techniques déployées sur le terrain et de créer une véritable dynamique commune.
L’approche novatrice de ce fonds est également liée à sa gouvernance, avec une direction collégiale associant les autorités centrafricaines à chacune des étapes, chaque donneur peut s’exprimer durant tout le processus.
Le fonds fiduciaire Bêkou est géré à deux niveaux:
- le conseil stratégique, présidé par l’Union européenne, se compose des États membres et des représentants des autres donneurs. Il définit la stratégie générale du fonds, en association avec les autorités centrafricaines;
- le comité de gestion décide de la sélection des projets, des modalités de mise en œuvre et du suivi. Également présidé par l’Union européenne, il réunit les représentants des donneurs dont la contribution au fonds est supérieure à trois millions d’euros et des autorités de la République centrafricaine.
Le fonds Bêkou est géré par la Commission européenne, et plus particulièrement par une équipe dirigée par le gestionnaire du fonds qui en assure la gestion quotidienne.
Le fonds Bêkou permet non seulement aux autorités centrafricaines d’être renforcées mais également de travailler avec un groupe de partenaires coordonnés qui peut mobiliser d’importantes ressources financières sur plusieurs années. Il contribue à rationaliser l’action des donneurs en :
- réduisant les coûts administratifs liés à la coordination des partenaires internationaux;
- évitant la fragmentation et la désorganisation de l’aide;
- créant un cadre concret pour parvenir à des compromis dans la gestion des programmes d’aide;
- évitant le désengagement précoce des financements internationaux avant une possible reprise économique dans le pays;
- mobilisant une masse critique de financements, palliant ainsi la faiblesse des moyens mobilisables par chaque bailleur séparément.
Du point de vue des bailleurs, le fonds leur offre un moyen flexible et sécurisé pour financer des activités dans le cadre d’une coopération multi-acteurs. Il leur permet de formaliser et de concrétiser leur engagement politique à résoudre la crise centrafricaine sans avoir à assumer des coûts de transaction prohibitifs.
Les bailleurs reçoivent en outre l’assurance que le fonds fiduciaire est géré par la Commission européenne, qui engage sa responsabilité financière et agit selon les principes et normes applicables au budget de l’Union européenne.
De plus, le fonds fiduciaire s’appuie sur l’expertise de partenaires présents en permanence sur le terrain, tels que l’Union européenne et les services français, allemand et néerlandais de coopération au développement. Grâce à leurs connaissances et compétences, ils permettent à d’autres donneurs qui ne sont pas sur place de contribuer à la relance et au développement de la République centrafricaine.
Le fonds fiduciaire est ouvert à tous les États membres de l’Union européenne ainsi qu’aux autres bailleurs de fonds souhaitant contribuer à la réalisation de ses objectifs.
iv. La Facilité pour la lutte contre la vulnérabilité et la réponse aux crises, outil porté par ’AFD
M. Serge Michailof, lors de son audition par la mission, lui a fait part du projet de fonds fiduciaire dont il a défendu le principe à partir de février 2013, visant à combiner les ressources multilatérales, qui sont considérables, avec d’une part l’expertise française en matière de développement au Sahel, et, d’autre part, un mécanisme de décision plus simple et directement orienté vers les objectifs fixés. Il s’agissait de créer un ou plusieurs fonds fiduciaires pour le Mali ou pour le Sahel dans des domaines spécifiques tels que le développement rural ou la gestion municipale, domaines dans lesquels la France dispose d’une expertise particulière.
Pour M. Michailof, une contribution française de 200 millions d’euros permettrait de lever auprès des organismes multilatéraux environ un milliard de dollars par an que l’AFD, avec les appuis des instituts de recherche français et des ONG de développement françaises et africaines, pourrait gérer au mieux.
La réflexion sur un outil de ce type devrait aboutir prochainement à la création par l’AFD d’une « Facilité pour la lutte contre les vulnérabilités et la réponse aux crises ». Cette facilité, qui devrait être dotée au minimum de 100 à 200 millions d’euros par an, somme jugée minimale pour obtenir un effet significatif sur le terrain et exercer un effet de levier sur des ressources externes, européennes et multilatérales, serait logée à l’AFD et gérée par elle, selon des procédures adaptées au contexte des pays vulnérables permettant précisément une mise en œuvre rapide. Elle permettrait à l’Agence, en sanctuarisant des ressources en dons dédiées et pérennes, de concevoir et de mettre en œuvre des projets à impacts immédiats pour les populations.
Cette facilité serait mobilisable dans un nombre limité de zones vulnérables, déterminés d’un commun accord entre l’État et l’AFD. Les moyens de la Facilité seraient additionnels aux ressources traditionnellement mobilisables par l’AFD ou l’État dans les pays concernés. Une réserve d’intervention rapide, représentant 15% du total de la Facilité, serait laissée disponible, pour permettre des interventions précoces.
Plusieurs initiatives régionales seront mises en place dès la création de cet instrument innovant:
- l’initiative « bassin du lac Tchad », annoncée par le Président de la République en mai 2015, financera un ensemble de projets au Niger, au Nigeria, au Tchad et au Cameroun pour répondre à la crise provoquée par Boko Haram ;
- l’initiative « réfugiés syriens et populations hôtes » financera en Jordanie, au Liban, en Irak et en Turquie un ensemble de projets destinés à aider les pouvoirs publics et communautés hôtes à assurer l’accueil des réfugiés. Cette initiative permettrait de mettre en œuvre une partie des engagements annoncés par le Ministre des affaires étrangères lors de la conférence de Londres (février 2016) ;
- l’initiative « paix et relèvement en RCA » serait conçue, en amont de la conférence des bailleurs prévue à l’automne, pour accompagner le nouveau gouvernement centrafricain et le départ des troupes françaises. Elle financerait un ensemble de programmes de développement urbain, de développement rural et de relance de l’activité économique dans une optique de relèvement post-crise.
B. LE CONTINUUM DÉVELOPPEMENT ÉMERGENCE
À côté des efforts visant à sortir tout un groupe de pays de l’ornière du sous-développement, l’aide au développement se trouve depuis les années quatre-vingt-dix confrontée à la situation nouvelle des pays effectivement sortis du sous-développement et engagés sur la voie d’un développement généralement rapide mais contrasté et parfois déséquilibré, qui pose par ailleurs de nouveaux problèmes.
Le quart de siècle qui vient de s’écouler est remarquable au regard de l’histoire puisqu’il a présidé à une réduction de la pauvreté ainsi qu’à une élévation du niveau de vie moyen de la population humaine d’une ampleur jusqu’ici inconnue. Cette évolution a toutefois eu lieu en ordre dispersé et a abouti à la fois à une complexification du paysage de l’aide au développement et des thématiques de l’aide, et à un élargissement des réflexions sur le développement.
1. La diversification du paysage du développement
a. L’émergence de nombreux pays depuis 1990
Si la situation des pays les plus pauvres et des pays en crise frappe par l’extrême difficulté rencontrée par les acteurs de l’aide au développement à faire évoluer leur situation, cette réalité ne doit pas masquer les progrès considérables enregistrés à l’échelle mondiale en matière de développement.
Le rapport des Nations unies sur les objectifs du Millénaire pour le Développement (3) de 2015 dresse ainsi un bilan des progrès réalisés au regard des huit objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), définis en 2000 et qui ont constitué le cadre commun de développement mondial pendant quinze années, jusqu’à l’élaboration des Objectifs du Développement durable définis en 2016.
Pour mémoire, les huit objectifs de 2000 étaient les suivants :
- Objectif 1: Éliminer l'extrême pauvreté et la faim ;
- Objectif 2: Assurer l'éducation primaire pour tous ;
- Objectif 3: Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes ;
- Objectif 5: Améliorer la santé maternelle ;
- Objectif 6: Combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies ;
- Objectif 7: Assurer un environnement durable ;
- Objectif 8: Mettre en place un partenariat mondial pour le développement.
Les données dont le rapport fait état frappent par les progrès qu’elles révèlent, dont on ne prend pas toujours conscience au travers du discours tenu par les acteurs de l’aide au développement.
Pour s’en tenir aux principaux indicateurs, entre 1990 et 2015, les données disponibles indiquent une amélioration sans précédent des conditions de vie de la population mondiale :
- le nombre de personnes touchées par l’extrême pauvreté dans les pays en développement est ainsi passé de 1 926 millions à 136 millions, ou de 47 % à 14 % de la population.
- Le nombre d’enfants non scolarisés en âge d’aller à l’école primaire dans le monde est passé de 100 à 57 millions, tandis que le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire en Afrique subsaharienne passait de 52 % à 80 %.
- Les taux de scolarisation des filles par rapport aux garçons en Asie du Sud est passé de 74 filles à 103 filles pour 100 garçons.
- Le nombre de décès d’enfants de moins de cinq ans dans le monde est passé de 12,7 à 6 millions ;
- le taux de mortalité maternelle, c’est-à-dire le nombre de décès de la mère pour 100 000 naissances vivantes, est passé de 380 en 1990 à 213 en 2013 ;
- l’administration de traitements antirétroviraux concernait 0,8 millions de personnes en 2003, puis 13,6 millions de personnes en 2014 ;
- le nombre de personnes disposant d’eau potable courante est passé de 2,3 milliards en 1990 à 4,2 milliards en 2015.
Ces indicateurs de développement indiquent une hausse importante du niveau de vie moyen des habitants des pays qu’il était convenu d’appeler « pays en développement » à une époque où une coupure relativement nette existait encore entre le « monde industrialisé » et le « tiers monde ». Cette époque a pris fin de façon progressive et depuis les années quatre-vingt-dix, si les États les plus riches sont en grande partie restés les mêmes, l’écart de croissance entre les différentes économies « en développement » s’est fortement élargi et, avec lui, les situations sociales et les conditions de vie de leurs populations.
La croissance mondiale, positive depuis 1990 sauf en 2009, a été de façon croissante « tirée » par les pays émergents. On estime ainsi que si, dans les années 1980, les économies émergentes ne contribuaient que pour 36 % à la croissance mondiale, le chiffre était de 41% pour les années 90, 70% pour les années 2000 et d’environ 80% depuis la crise financière de 2008. En 2012, la croissance des pays émergents en termes réels compte pour 2,5 points dans une croissance mondiale de 3,2 points, et le taux de croissance des économies émergentes depuis 1980 atteint presque 5 % tandis que celui des économies avancées ne dépasse pas 2,5 %.
Le groupe des « pays émergents » forme toutefois un ensemble disparate. Les deux tiers de la croissance de ce groupe en 2012 ont eu lieu en Asie, principalement en Chine, mais également, dans une moindre mesure, en Inde, deux pays dont la taille explique en grande partie l’importance de leur contribution à la croissance mondiale, les économies émergentes des autres grandes zones géographiques étant d’une taille inférieure(4).
La leçon qui s’impose au vu des résultats obtenus en matière de développement depuis les années quatre-vingt-dix est que le développement n’est pas homogène. Dans chaque grande zone géographique, des États émergent tandis que d’autres demeurent dans une situation de précarité persistante. L’inégalité entre États tend naturellement à s’accroître puisque certains s’enrichissent tandis que d’autres demeurent à peu près au même niveau, et les situations intermédiaires tendent à se diversifier.
ii. Des situations plus diverses et complexes
Les niveaux de développement peuvent également varier au sein d’un même État. Le Maroc, où votre rapporteur s’est rendu dans le cadre de la mission au mois de janvier 2017, présente un exemple de pays où une région côtière se développe de façon spectaculaire tandis que la partie Sud du pays peine à se hisser au même niveau de développement. Le cas du Maroc est cependant loin d’être unique et les deux principaux contributeurs à la croissance économique du groupe des pays émergents que sont l’Inde et la Chine présentent à l’intérieur même de leurs territoires des contrastes tout aussi élevés.
Les écarts de revenu, d’espérance de vie ou de niveau d’éducation tendent à s’accroître mécaniquement pendant les périodes de croissance économique, du simple fait de la stagnation de certains secteurs. Des écarts peuvent ainsi être observés à la fois entre les régions urbanisées, connectées au reste du monde et où sont localisés les sièges sociaux des entreprises et des administrations, et les zones rurales, et à l’intérieur même des zones urbanisées et développées, notamment du fait de l’exode rural et de l’installation difficile de populations en provenance des zones rurales. La ville de Ouagadougou est ainsi passée de 59 000 habitants en 1960 à deux millions aujourd’hui, avec tous les problèmes qu’une croissance aussi rapide peut amener en termes d’approvisionnement, d’accès aux services et de gestion urbaine.
Ces problèmes, qu’ont connus autrefois les pays riches d’aujourd’hui, sont communs à l’ensemble des régions ayant fait l’expérience d’une croissance rapide au cours des vingt-cinq dernières années. Cette présente donc une série d’interrogations et d’opportunités.
Dans la situation présente, la finalité de l’aide au développement a en effet été en partie redéfinie. Si la croissance économique n’a jamais été la finalité unique de l’aide, elle en a constitué l’objectif principal aussi longtemps que l’on pouvait identifier un groupe majoritaire de pays, le « tiers-monde », dont l’enrichissement semblait être le besoin le plus urgent. La croissance économique rapide mais dispersée observée au cours du dernier quart de siècle rend désormais nécessaire de réfléchir à la maîtrise de cette croissance et de ses conséquences.
De la même façon, la montée en puissance d’un grand nombre d’États dans le paysage international a également contribué à faire de l’aide au développement une politique d’intérêt commun, évolution qui s’est particulièrement manifestée lors de l’élaboration des Objectifs du développement durable adoptés en septembre 2015.
b. La transition vers une forme d’aide atténuée
i. La stratégie de l’AFD vis-à-vis des « très grands émergents »
La situation en quelque sorte hybride des pays à la fois sortis du sous-développement et malgré tout destinataires d’une forme d’aide au développement ne se traduit généralement pas par une « sortie sèche » du champ de l’aide, mais plutôt par une transition vers le statut de pays émergent. Cette transition s’accompagne d’une modification des politiques d’aide au développement suivies vis-à-vis de ces pays.
La stratégie suivie par l’AFD vis-à-vis des « très grands émergents » illustre cette transition. La liste des très grands émergents a été définie par lettre des ministres de tutelles de l’AFD le 28 juillet 2014 et comprend actuellement sept pays : l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, le Mexique, la Turquie.
Le CICID du 31 juillet 2013 avait précisé que la coopération avec les très grands émergents mobiliserait les acteurs français sans coût financier pour l’État (hors expertise technique). Ce point de principe a été repris dans le Contrat d’objectifs et de moyens avec l’État pour 2014-2016.
Ce principe a ensuite été réaffirmé par la loi du 7 juillet 2014 : « Dans le reste du monde, notamment l'Asie, l'Amérique latine et les Caraïbes, qui comptent majoritairement des pays à revenus intermédiaires à croissance rapide ou émergents, il s'agira d'aller au-delà du concept de l'aide qui n'est plus adapté à leur situation : la France aura pour objectif de rechercher des solutions partagées à des défis communs et d'associer ces pays à la coopération internationale en appui aux pays les plus pauvres. La France y interviendra pour promouvoir une « croissance verte et solidaire », en y favorisant notamment des partenariats économiques. Le partenariat avec les « très grands émergents », qui mobilisera les acteurs français dans leur diversité, est essentiel pour renforcer le dialogue et préparer ensemble les négociations internationales sur les enjeux partagés. Il se fera sans coût financier pour l'État (hors expertise technique). »
La lettre du 28 juillet 2014 précisant la liste des « très grands émergents » précisait également les modalités d’intervention de l’AFD dans ces pays :
- l’intervention de l'AFD y prend la forme de prêts, souverains ou non-souverains, ces interventions étant à conditions de marché, c'est-à-dire non bonifiées ;
- s'agissant de l'Afrique du Sud, l'AFD peut toutefois mobiliser un effort financier de l'État modéré pour les projets à très forte composante sociale ;
- compte tenu des conditions de marché actuelles, les prêts aux très grands émergents sont néanmoins généralement concessionnels au sens du CAD, selon les règles en vigueur à la date de la lettre ;
- pour favoriser la recherche de partenariats économiques avec les pays bénéficiaires, l'AFD peut en outre intervenir sous forme de subvention pour le financement d'une expertise technique, dès lors qu'elle peut contribuer à valoriser l'expérience et les savoir-faire français dans les secteurs où les avantages compétitifs des entreprises françaises et des experts français sont avérés. À cette fin, le fonds d'expertise technique et d'échange d'expériences (FEXTE), a été mobilisé.
Cette lettre précise également les termes du mandat d’intervention de l’AFD dans ces pays : dans le cadre de son mandat de croissance verte et solidaire, l'AFD doit contribuer au développement durable de ces pays, dans ses composantes économique, sociale et environnementale. Son action doit concourir à l'influence économique de la France ainsi qu'à sa capacité à concevoir et projeter une vision française de la lutte contre les changements climatiques, à la suite de la 21ème conférence des parties à la convention-cadre des Nations Unies qui s’est tenue à Paris en 2015. Elle indique également que la soutenabilité financière de l'activité de l'Agence dans ces pays, dont les montants unitaires sont généralement élevés, doit faire l’objet d’une attention particulière.
Les autorisations de financement de l’AFD dans les très grands émergents se sont élevées à près d’un milliard d’euros en 2015, en légère baisse par rapport à 2014. L’activité non souveraine a enregistré un recul important (-63%) en 2015, alors que l’activité souveraine a fortement progressé (+80%).
Autorisations de financement de l’AFD dans les très grands émergents (en millions d’euros)
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
cumul |
Afrique du Sud |
214 |
108 |
100 |
120 |
274 |
817 |
Brésil |
10 |
725 |
352 |
258 |
27 |
1 372 |
Chine |
135 |
131 |
115 |
80 |
65 |
526 |
Inde |
190 |
249 |
330 |
251 |
261 |
1 281 |
Indonésie |
133 |
142 |
215 |
184 |
140 |
813 |
Mexique |
387 |
69 |
152 |
102 |
81 |
789 |
Turquie |
185 |
121 |
310 |
91 |
151 |
857 |
Multipays |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
5 |
Total |
1 256 |
1 544 |
1 574 |
1 088 |
999 |
6 461 |
(Source : Direction générale du Trésor)
La légère contraction de l’activité entre 2014 et 2015 (-4%) masque des situations très diverses. À une forte croissance des autorisations de financement en Afrique du Sud et en Turquie, portées par les activités souveraines, s’oppose une diminution de l’activité dans les autres très grands émergents, particulièrement au Brésil, où l’activité souveraine est en forte baisse car le niveau d’engagement est proche des limites prudentielles, mais aussi en Indonésie et au Mexique, où seuls les prêts souverains sous la forme de prêts budgétaires sont envisageables. En Inde, l’AFD poursuit une croissance équilibrée de ses engagements, en ligne avec les engagements politiques (un milliard d’euros sur la période 2014-2016).
L’effort financier au sens du COM dans les très grands émergents est de 3,4 millions d’euros en 2015.5 Cet effort financier correspond au coût-Etat de deux prêts non souverains en Afrique du Sud bonifiés octroyés à des banques locales pour des financements à de petites entreprises présentant des impacts sociaux.6
Par ailleurs, l’AFD a mobilisé le FEXTE7 en Afrique du Sud (0,85 M€), au Mexique (0,5 M€) et en Turquie (1 M€).
Le FEXTE a été mobilisé dans l’ensemble des géographies du groupe AFD avec une orientation vers les pays émergents, conformément à la vocation de cet instrument. 32% des engagements du FEXTE ont été réalisés dans des très grands émergents (Turquie, Afrique du Sud, Mexique).
Cette diversification des activités de l'AFD dans les très grands émergents, se traduit par un bilan positif à plusieurs égards. Cinq éléments peuvent notamment être identifiés :
- La diversification de l’expérience de l’AFD en matière d’aide au développement : l’activité de l’AFD dans les très grands émergents a permis à l’Agence d’enrichir son expertise technique sectorielle grâce à la diversité des situations où elle intervient désormais, notamment sur les sujets de développement urbain ;
- La diversification des risques : l’élargissement de l’activité de l’AFD aux très grands émergents contribue à la diversification des risques de l’Agence en élargissant le spectre des contreparties de l’Agence ;
- la contribution positive au modèle économique : l’activité dans les très grands émergents contribue à 27% du résultat brut d’exploitation des prêts dans les pays étrangers en 2015 (pour 33% de l’encours), soit 32 millions d’euros. La Turquie et l’Afrique du Sud sont actuellement les premiers contributeurs. L’activité dans les très grands émergents contribue ainsi à l’équilibre économique du modèle financier de l’Agence.
Contribution au résultat brut d'exploitation de l'AFD (en millions d’euros)
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 | |
Afrique du sud |
6,2 |
8,2 |
8,5 |
10,5 |
7,7 |
8,0 |
Brésil |
-3,0 |
-1,9 |
2,6 |
2,4 |
5,2 |
6,4 |
Chine |
-0,8 |
0,1 |
0,5 |
0,4 |
0,8 |
0,7 |
Inde |
-2,3 |
-1,5 |
-0,5 |
0,3 |
1,2 |
1,2 |
Indonésie |
0,3 |
0,4 |
0,9 |
1,4 |
1,7 |
2,8 |
Mexique |
0,1 |
0,0 |
0,6 |
3,5 |
4,7 |
4,8 |
Turquie |
8,6 |
9,6 |
9,3 |
8,7 |
9,2 |
7,7 |
Total |
9,2 |
15,0 |
21,9 |
27,2 |
30,5 |
31,5 |
(Source : Direction générale du Trésor)
- La contribution positive à la lutte contre le changement climatique : les interventions de l’AFD dans les très grands émergents s’inscrivent dans le cadre du mandat de croissance verte et solidaire. De ce fait, la plupart des financements dans ces pays contribuent à la lutte contre le changement climatique. En 2015, 58% du montant des financements de l’AFD dans les très grands émergents ont contribué à la lutte contre le changement climatique, soit 577 millions d’euros.
- Une contribution positive au dispositif d’influence économique : conformément à son mandat, l’AFD contribue à la politique d’influence économique de la France auprès de ses partenaires dans les très grands émergents. L’AFD est notamment positionnée dans des secteurs où l’expertise française est reconnue et permet de mobiliser et de mettre en valeur le savoir-faire français de bureaux d’études, de collectivités locales et d’entreprises sur les sujets de transition énergétique. Cela est notamment le cas dans le domaine de la mobilité urbaine au Brésil, en Inde et en Turquie, et dans le domaine de l’énergie au Mexique, en Indonésie, en Inde et en Chine, ainsi que dans le domaine de l’ingénierie écologique, de la préservation des écosystèmes (en Turquie et en Chine) et de l’écotourisme (en Chine). Enfin, comme indiqué supra, l’AFD est mobilisée, aux côtés des autorités françaises, pour accompagner et valoriser l’expertise française, avec une utilisation du FEXTE principalement concentrée dans les très grands émergents.
Votre rapporteur estime que le bilan positif de la diversification des activités de l’AFD et de leur extension vis-à-vis des pays émergents justifie que l’on songe maintenant à utiliser une partie des gains effectués au travers de ces stratégies pour renforcer l’aide sous forme de dons, comme cela est recommandé plus loin dans le présent rapport.
2. L’évolution de la réflexion sur les objectifs
a. L’influence des pays émergents dans la réflexion sur l’aide au développement
Jusqu’aux années quatre-vingt-dix, la plupart des bailleurs de fonds en matière d’aide publique au développement font partie des pays du Comité d’aide au développement de l’OCDE. Ce n’est plus le cas et de nombreux pays, comme la Chine, l’Inde, le Brésil, le Mexique, l’Afrique du Sud ou la Thaïlande ont aujourd’hui le double statut de pays donateurs et de pays destinataires de l’aide, même s’il s’agit d’aides de niveaux différents.
Une telle situation, à première vue paradoxale, peut s’expliquer de plusieurs manières. En premier lieu, les formes d’aide destinées, par exemple, à maîtriser le développement d’une grande métropole dans un pays émergent diffèrent de celles destinées à soutenir le secteur agricole d’un pays faisant partie du groupe des PMA. La volonté de créer des liens et la recherche d’une influence régionale de la part d’un grand État émergent peut également motiver des politiques d’aide extérieure même lorsque l’intérieur du pays pourrait bénéficier de politiques similaires.
Il convient par ailleurs de mentionner le cas d’États comme le Maroc, qui ne font pas partie, à ce stade, des pays donateurs, mais qui fournissent néanmoins une aide sous forme d’expertise, ce type de coopération apparaissant utile à la fois au titre de la politique d’influence destinée à une région avoisinante, l’Afrique subsaharienne dans le cas du Maroc, et pour le retour d’expérience qu’elle peut procurer.
L’influence de pays dits « nouveaux émergents » (Colombie, Pérou) a ainsi été décisive dans l’élaboration des Objectifs du Développement durable adoptés en 2015. Confrontés à la fois à des problèmes de pays pauvres en matière de protection sociale ou d’éducation par exemple, mais aussi de pays riches en raison de leur croissance économique, ces pays ont pesé pour que des objectifs plus larges, plus intégrés et visant aussi à une croissance inclusive et à la préservation de l’environnement soient pris en compte.
b. Les Objectifs du Développement durable
La caractéristique la plus remarquée des Objectifs du Développement durable (ODD), qui ont succédé en 2015 aux Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), est d’abolir la distinction entre pays « en développement » et « développés ». Le développement est ici envisagé comme un processus continu et jalonné d’objectifs.
Les ODD cherchent en effet à répondre à la fois aux préoccupations nouvelles des pays émergents et à celles des pays pauvres, ainsi dans un certain nombre de cas à des inquiétudes partagées par les pays développés qui sont également confrontés à la nécessité de lutter contre la pauvreté et les inégalités, phénomène qui s’est aggravé avec les crises financières de 2008 et 2010, auxquelles s’ajoutent la prise de conscience croissante de l’impact des dérèglements climatiques.
À l’objectif classique de croissance économique là où elle est trop faible, les ODD ajoutent donc celui de « corriger » en quelque sorte les défauts du modèle classique de croissance, en la rendant mieux partagée et plus soutenable.
Sur le premier de ces deux points, le bilan des OMD, s’il demeure impressionnant d’un point de vue global, demeure imparfait. Ainsi en 2015, selon la Banque mondiale (BM), l’extrême pauvreté – seuil fixé à 1,90 dollar par jour – touche encore près de 10 % de la population mondiale, avec des écarts notables entre l’Afrique subsaharienne (35 %) et l’Asie de l’Est (5,6 %) et du Sud (13,5 %). La nécessité de lutter contre ces disparités a été prise en compte dans la définition des ODD, là où les OMD ne s’inscrivaient que dans un cadre très général.
i. L’émergence de nouvelles thématiques
Les ODD apparaissent donc comme un effort visant à compléter les OMD par une approche plus systématique couvrant un éventail de champs plus large. On note ainsi :
- une plus grande précision des objectifs liés à la pauvreté, à la santé ou à l’éducation ;
- la prise en compte des migrations et des mobilités comme une ressource pour le développement ;
- la mise en avant de la préservation de l’environnement avec pas moins de cinq objectifs qui lui sont dédiés ;
- la prise en compte d’objectifs destinés à rendre la croissance économique inclusive et durable ;
- un élargissement des thématiques et un approfondissement des indicateurs avec 17 ODD (contre 8 OMD), 169 cibles, et près de 230 indicateurs ;
- l’introduction de l'objectif 16 lié à la gouvernance et l’État de droit. Bien que formulé de façon assez vague, cet objectif introduit pour la première fois le pilier paix/sécurité et justice aux côtés des traditionnels piliers économique, social et environnemental du développement durable. Il reflète la prise en compte des répercussions des conflits, des zones de crises et d’une gouvernance défaillante (corruption, poids de l’économie informelle, difficultés à lever l’impôt…) sur le développement ;
- l’inclusion d’un objectif spécifique visant la réduction des inégalités sociales, mais aussi de genre.
ii. La réduction des inégalités de genre
Cette dernière thématique revêt désormais une importance particulière. Étroitement liée à la fois aux problématiques de santé et de maîtrise de la croissance démographique, l’égalité entre les genres pouvait aisément passer au second plan dans le contexte de faible développement qui prévalait encore il y a trente ans. Tel n’est plus le cas aujourd’hui.
La France a développé une stratégie dans ce domaine dès décembre 2007, en se dotant d’un premier document d’orientation stratégique Genre et développement, fixant le cadre de l'action de la France dans le domaine de l’égalité femmes-hommes et des droits des femmes dans sa politique de développement.
Le rapport publié en 2013 par le Haut conseil à l'égalité et la Commission nationale consultative des droits de l’homme dans le cadre d’une évaluation de la mise en œuvre de cette stratégie soulignait la faiblesse de la prise en compte transversale des questions de genre dans la politique de développement de la France, ainsi que le manque de moyens et de visibilité et recommandait de mettre l’accent sur la formation des agents, la mise à disposition d’outils méthodologiques adaptés et la réforme des procédures d’instruction, de suivi et d’évaluation des projets et des programmes, afin d’assurer une véritable intégration des objectifs d’égalité entre les femmes et les hommes dans la politique française de développement.
Le rapport recommandait également d’utiliser le marqueur genre de l’OCDE qui permet d’évaluer la part de l’aide publique au développement française consacrée à la réduction des inégalités liées au sexe, reprenant ainsi les conclusions de l’examen par les pairs mené par le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE la même année.
Pour répondre à ces enjeux, le ministre délégué chargé du Développement, Pascal Canfin, a lancé un processus d’actualisation de la stratégie française en matière de genre et développement associant l’ensemble des acteurs du développement, parmi lesquels les ONG françaises regroupées notamment au sein de Coordination Sud, et les représentants de la coopération décentralisée et de la recherche, débouchant sur la Stratégie genre et développement 2013-2017. Cette dernière définit les priorités de la France dans le domaine de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et constitue un cadre d’action pour tous les partenaires du développement. Adoptée lors de la réunion du CICID du 31 juillet 2013, elle doit faire l’objet d’une évaluation annuelle par le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.
iii. Des objectifs interactifs
Les ODD sont par ailleurs construits de manière à interagir entre eux afin de favoriser une approche transversale, chaque objectif se décomposant en plusieurs cibles qui elles-mêmes renvoient souvent implicitement à des objectifs distincts. C’est ainsi que l’objectif 16 (« Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous ») vise explicitement à une meilleure mise en œuvre de l’ensemble des objectifs et, plus précisément, une meilleure gestion de l’aide financière.
Chaque ODD s’efforce donc de couvrir toutes les dimensions d’une problématique. Par exemple, l’ODD 2 qui vise à « éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable » intègre conjointement les dimensions économique, sociale, environnementale et de gouvernance.
Ainsi, de la même façon qu’il a été établi une quantification de « l’empreinte carbone » des projets de développement en relation avec les questions climatiques, l’incitation sera forte pour développer une « empreinte institutionnelle » et une « empreinte inégalités »1.
Il ne s’agit donc plus d’établir une liste d’objectifs séparés comme le faisaient les OMD, mais davantage d’envisager le développement comme une combinaison d’objectifs indissociables les uns des autres, ne pas atteindre l’un d’entre eux entraînant, en théorie, un échec général.
iv. Des objectifs plus ambitieux
Les ODD tendent à être plus ambitieux que les OMD. Ainsi, alors que l’OMD 1 visait la réduction de la pauvreté et de la faim, l’ODD 1 vise à les éliminer. En matière de santé, l’objectif 3 vise à donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et à promouvoir le bien-être de tous à tous les âges, approche plus ambitieuse que celle des OMD qui visaient de façon ponctuelle à réduire la mortalité infantile (OMD 4), à améliorer la santé maternelle (OMD 5) et à combattre le VIH, le paludisme et d’autres maladies (OMD 6).
En matière d’environnement, l’OMD 7B visait à diminuer la perte de la biodiversité tandis que l’ODD 15 vise à y mettre fin. L’OMD 2, relatif à l’éducation primaire pour tous, est également « dépassé » par l’ODD équivalent qui vise à « ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions d’équité » ainsi qu’à promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. Enfin, à la différence des OMD, les ODD appellent à prendre des mesures relatives aux changements climatiques (ODD 13).
Nombre d’objectifs retenus, ayant trait aux trois piliers du développement durable, économique, social et environnemental, sont par ailleurs davantage susceptibles de se traduire par une assistance technique ou un échange d’expertise que par une aide financière pure et simple. C’est d’ailleurs aussi ce type d’assistance ou d’échange de savoir-faire qui est attendu et souhaité par les pays émergents.
Le caractère et la portée universels des ODD signifient en premier lieu qu’ils concernent et s’appliquent à tous les pays du monde, d’où l’expression. Chaque État est ainsi appelé à mettre en œuvre l’agenda 2030 du développement durable, tant sur son propre territoire que dans le cadre de sa coopération avec des pays tiers.
Les ODD manifestent donc bien une logique de convergence vers des objectifs communs et non plus celle d’un rattrapage des pays du Nord par ceux du Sud. Il s’agit bien de trouver des solutions communes et de mettre fin à l’asymétrie Nord/Sud.
L’universalité des ODD s’applique aussi aux acteurs impliqués, puisque leur mise en œuvre est confiée non seulement aux États, mais également aux collectivités locales, aux associations et ONG, aux entreprises, aux syndicats, ainsi qu’à l’ensemble de la société civile. Ce point est explicité par l’ODD 17 « Partenariats pour la réalisation des objectifs » qui souligne la nécessité de collaborer autour des ODD et de la lutte contre les changements climatiques. C’est dans cet esprit que de nombreux acteurs de la société civile ont été associés aux discussions autour des ODD. Contrairement à la démarche « descendante » qui prévalait pour les OMD, c’est bien une démarche ascendante (« bottom up ») qui a été mise en œuvre pour définir les ODD puis lors de la COP 21, afin d’associer plus étroitement la société civile dont les partenaires sociaux et de tenir compte des préoccupations des acteurs de terrain.
L’ambition de l’agenda des ODD porte en elle-même certains éléments de fragilité qui doivent cependant attirer notre attention. Sans aller jusqu’à reprendre à son compte la critique qu’en fait Serge Michailof dans son ouvrage Africanistan, où il décrit les ODD comme « une liste de vœux pieux mélangeant allègrement objectifs microéconomiques mesurables, louables ambitions en matière de biens publics mondiaux et rêves universalistes » (8), il convient de demeurer réaliste à leur égard et de ne pas perdre de vue les éventuelles faiblesses d’un tel dispositif.
Le caractère universel des ODD en fait un vaste ensemble d’objectifs qui se retrouvent nécessairement mis sur un même plan. Si tous les objectifs sont prioritaires, aucun ne l’est plus que les autres.
Ainsi, par exemple, si la convergence entre des objectifs relevant quasiment de l’urgence humanitaire tels que l’objectif 2 « Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable » et des objectifs environnementaux et sociaux n’est pas en cause, le fait de leur attribuer un même niveau de priorité semble plus discutable.
En tout état de cause, le caractère non contraignant de l’agenda s’en trouve accentué et peut aboutir à fragiliser sa mise en œuvre. Le risque que les États ne prennent pas ces engagements suffisamment au sérieux existe, tout comme celui qu’ils appliquent l’agenda non plus comme un ensemble indivisible et cohérent mais en sélectionnant des ODD et cibles à la carte, leur permettant d’afficher des résultats satisfaisants.
c. L’inclusion du climat dans la réflexion sur le développement
i. Le rapprochement entre développement et préoccupations environnementales
L’introduction progressive de problématiques environnementales dans celle du développement n’allait pas de soi. Développement économique et préservation de l’environnement ne vont pas nécessairement de pair et la réflexion sur l’environnement a souvent été associée à une certaine réticence vis-à-vis de la croissance économique, illustrée en 1972 par le rapport « The Limits to Growth » du Club de Rome. L’objectif de développement économique ne semblait guère compatible avec une conception souvent décrite comme malthusienne de la préservation de l’environnement.
Plus spécifiquement, la problématique de la lutte contre le changement climatique pouvait de son côté se heurter à la réticence de grands États en croissance rapide comme l’Inde, Chine, et les « grands émergents » dont les positions ont contribué à ce qui a souvent été considéré comme l’échec de la COP 15 de Copenhague en 2009. Ces États, émetteurs importants de gaz à effet de serre (GES), faisaient valoir que la consommation d’hydrocarbures correspondait à une phase du développement économique dont les pays riches avaient déjà profité et dont ils entendaient eux-mêmes tirer les bénéfices avant de songer à réduire leurs émissions.
Il a donc fallu plusieurs années de négociations et de réflexions collectives pour aboutir à la fois aux ODD et à l’accord de Paris de décembre 2015, signé lors de la COP 21. Ce dernier texte marque à la fois renouvellement de la volonté des États signataires de lutter résolument contre les dérèglements climatiques, et l’insertion de cette dernière problématique dans celle plus vaste du développement.
ii. Le consensus autour de l’accord de Paris
Comme pour l’agenda des ODD, c’est un consensus général qui a conduit à la signature de l’Accord de Paris : la volonté commune de pays développés et émergents d’avancer résolument vers un modèle plus soutenable.
L’accord prévoit de contenir le réchauffement climatique « bien en dessous de 2° C par rapport aux niveaux préindustriels » et si possible de viser à « poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5° C », un objectif plus ambitieux que ce qui figurait dans le projet d’accord initial et ajouté sous la pression de l’Alliance of Small Island States (AOSIS, Alliance des petits États insulaires), qui regroupe les 44 pays les plus exposés aux effets du changement climatique.
L’objectif d’atteindre la neutralité carbone est affirmé à l’article 4 qui vise à diminuer les émissions de gaz à effet de serre afin qu’elles puissent être compensées au cours de la deuxième moitié du XXIe siècle par les puits de carbone (forêts, océans, techniques de capture et stockage du carbone).
Rappelant le principe des « responsabilités communes mais différenciées » de 1992, l’accord souhaite que « les pays développés continuent de montrer la voie en assumant des objectifs de réduction des émissions en chiffres absolus », les pays en développement devant « continuer d’accroître leurs efforts d’atténuation (...) eu égard aux contextes nationaux différents ».
Une différenciation est donc opérée entre les pays les plus industrialisés et ceux en voie de développement, dont il est reconnu que les intérêts, bien que convergents à long terme, peuvent différer dans un premier temps.
Le plancher de l’aide climatique aux pays en développement a ainsi été fixé à 100 milliards de dollars (91 milliards d’euros) par année et sera revu au plus tard en 2025.
Les objectifs annoncés au niveau national seront révisés d’ici à 2020, puis tous les cinq ans et les objectifs de réduction des émissions ne pourront être revus qu’à la hausse. Un bilan global de l’accord sera effectué en 2023, puis tous les cinq ans. Ce cycle de révision est toutefois susceptible de modifications décidées dans le cadre de COP ultérieures.
L’accord ne prévoit pas d’amendes ni de mesures de rétorsion, la principale obligation instaurée par l’accord étant celle de la transparence. Chaque pays doit en effet soumettre régulièrement ses objectifs de réduction d’émission de GES à des grilles de renseignements et d’analyses communément partagées et compréhensibles par tous.
L’accord n’est cependant que partiellement contraignant d’un point de vue juridique pour les États, et ne donne pas de moyen de vérifier que les objectifs sont atteints, la traduction de l’Accord dans la législation domestique de chaque État devant déterminer le niveau de contrainte effectivement applicable.
La tarification carbone n’est que très brièvement mentionnée dans un paragraphe qui reconnaît le rôle important des incitations à la réduction des émissions, dont la tarification du carbone. L’abandon de l’extraction des énergies fossiles n’a toutefois pas été évoqué, notamment du fait de l’opposition de l’Arabie Saoudite.
Certaines limites de l’accord de Paris ont néanmoins été relevées du point de vue de l’aide publique au développement. Ainsi, les 100 milliards de dollars annuels que les pays du Nord sont invités à verser à ceux du Sud d’ici à 2020 afin de faire face aux impacts du dérèglement climatique sont décrits comme un « plancher », mais les grands pays émergents ne sont invités à y contribuer que la base du volontariat. Par ailleurs, l’accord ne met pas en place d’objectif chiffré sur l’aide à l’adaptation aux changements climatiques.
II. POURSUIVRE LA RÉORGANISATION INSTITUTIONNELLE ET STRATÉGIQUE DE L’AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT FRANÇAISE
En un quart de siècle, le paysage de l’aide au développement a donc radicalement évolué et s’est écarté de façon croissante de l’ancienne dichotomie entre un monde « développé » et un monde « en voie de développement » ou « sous-développé ». Le dispositif français d’aide publique au développement et la stratégie menée par la France dans ce domaine ont évolué de façon à s’adapter à la fois à cette évolution globale et à celle de la place de la France dans le monde.
La mutation de l’aide au développement française a principalement été de deux ordres, institutionnelle et stratégique. Du point de vue institutionnel, le pilotage de l’aide est passé d’un ministère de la Coopération qui avait un rôle particulier à jouer dans le contexte de l’Afrique post-coloniale à un dispositif partagé principalement entre le ministère des Affaires étrangères, celui de l’Économie et des Finances et l’Agence française de développement, avec des outils de concertation chargés d’améliorer la coordination entre les différents acteurs de l’aide.
A. LE TOURNANT INSTITUTIONNEL ET STRATÉGIQUE DE L’APD FRANÇAISE
1. La réorganisation du dispositif français d’aide publique au développement
Le dispositif français d’aide publique au développement a évolué de façon continue depuis les années quatre-vingt-dix. De la réforme de 1998 à la loi de juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, l’outil français de coopération au développement s’est efforcé de demeurer adapté à un contexte international de plus en plus complexe et varié.
C’est cependant la réforme de 1998 qui a marqué la rupture la plus profonde avec l’ancienne politique de coopération, et qui demeure à ce jour l’objet d’une évaluation critique, notamment du fait de la disparition d’un ministère de plein exercice qui a laissé la place à un dispositif au sein duquel se coordonnent plusieurs acteurs responsables chacun d’un aspect particulier de la politique d’aide au développement.
a. Les étapes de la réorganisation institutionnelle
La réforme de 1998 a mis fin au dispositif en vigueur depuis 1961, au sein duquel le ministère de la Coopération, héritier direct du ministère de l’Outre-mer, lui-même issu du ministère des Colonies, autonome administrativement et budgétairement, gérait les dons, tandis que la Caisse centrale de coopération économique, qui fonctionnait comme une banque, octroyait et gérait les prêts, les ministères des Affaires étrangères et des Finances jouant un rôle secondaire. Plusieurs rapports publiés entre 1960 et 1995 appellent à une meilleure coordination au sein du dispositif, cette réflexion aboutissant à la création en 1996 du Comité interministériel de l’aide au développement (CIAD), présidé par le Premier ministre.
La réforme du 4 février 1998 prolonge cette démarche selon trois axes :
- La fusion entre le ministère de la Coopération et le ministère des Affaires étrangères, effective le 1er janvier 1999, avec le regroupement, au sein de la Direction générale de la coopération internationale et du développement (DGCID), des services de la coopération avec ceux chargés de la politique culturelle, scientifique et technique, l’objectif étant de lier institutionnellement les objectifs d’influence et de solidarité. Le ministère des Finances conserve de son côté ses anciennes compétences, notamment la représentation de la France au sein des institutions financières internationales.
- La dissociation de la fonction stratégique de conception et d’orientation de l’aide d’un côté, et de la fonction opérationnelle de mise en œuvre et de gestion des outils de l’autre. La Caisse centrale de coopération économique, devenue en 14992 Caisse française de développement, devient en 1992 l’Agence française de développement (AFD), « opérateur pivot » chargé de gérer les projets et les programmes d’aide sous la tutelle des deux ministères, l’État conservant toutefois le domaine régalien. Le ministère des Affaires étrangères conserve une fonction de gestion limitée à des domaines particuliers dans le cadre du Fonds de solidarité prioritaire (FSP).
- L’évolution des dispositifs d’orientation, d’arbitrage et de coordination entre les acteurs, avec la création du Comité interministériel pour la coopération internationale et le développement (CICID), qui succède au CIAD. Un Haut Conseil de la coopération internationale placé auprès du Premier ministre est créé en 1999 afin de permettre un débat entre la coopération publique, la coopération décentralisée, les organisations non gouvernementales (ONG), les parlementaires, les membres du Conseil économique et social, les représentants de la recherche et de l’université, des syndicats et du secteur privé.
La réforme de 1998 est jugée dans un rapport remis en 1999 au Premier ministre par Yves Tavernier positive pour avoir permis une réorganisation pérenne du dispositif autour de deux pôles ministériels et d’un opérateur pivot, mais trop timide car n’ayant pas permis l’émergence d’une stratégie mobilisatrice. Il lui est également reproché d’avoir laissé en place des centres de décisions multiples et insuffisamment coordonnés. (9)
ii. La réforme de 2004 et de 2005
La seconde étape de la réforme entamée en 1998 a été décidée par les CICID du 20 juillet 2004 et du 18 mai 2005. Elle comporte deux axes principaux :
- Afin de clarifier le partage des tâches dans la définition des orientations de la politique d’aide publique au développement, la réforme conforte le rôle du CICID dans la définition de ses grandes orientations, notamment celles concernant les contours de la zone de solidarité prioritaire, les objectifs et modalités de l’aide, la cohérence des priorités géographiques et sectorielles ainsi que le suivi et l’évaluation des politiques et instruments d’APD. Du point de vue institutionnel, le pilotage de l’aide publique au développement est confié à un secrétaire d’État ou ministre délégué qui préside la Conférence d’orientation stratégique et de programmation (COSP) qui coordonne l’action de l’ensemble des ministres.
- S’inspirant des recommandations de l’examen par les pairs du CAD de l’OCDE de 2004, qui relevait que l’AFD n’était responsable de la gestion que d’environ 10 % du montant de l’aide publique au développement française cette année-là, la réforme renforce le rôle de l’AFD en répartissant les rôles par secteurs. Le ministère des Affaires étrangères conserve alors la mise en œuvre de la coopération en matière de gouvernance, de justice, de police, de sécurité, de culture, de recherche et d’enseignement supérieur, tandis que l’AFD se voit transférer le développement économique et social (agriculture et développement rural, santé, éducation de base, formation professionnelle, environnement, infrastructures et développement urbain.
À la suite des propositions du Livre blanc d’août 2008 sur la politique étrangère et européenne de la France, le décret du 5 juin 2009 modifie les missions et la gouvernance de l’AFD. Cette dernière reçoit la plupart des moyens opérationnels de l’aide au développement, avec notamment, le 1er janvier 2009, le transfert du ministère des Affaires étrangères à l’AFD du cofinancement des initiatives des ONG. Le texte crée également un Conseil d’orientation stratégique présidé par le ministre chargé de la coopération et composé des représentants de l’État au conseil d’administration de l’AFD.
iv. La Loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale de 2014
Première Loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, la loi du 7 Juillet 2014 vise à renforcer le contrôle démocratique et d’améliorer l’évaluation de l’aide au développement. Du point de vue du pilotage de l’aide, la loi de 2014 crée deux nouvelles instances :
- l’Observatoire des politiques de développement, présidé par un parlementaire, réunit des représentants de l’ensemble des acteurs de la société civile et des trois directions d’évaluation du ministère des Affaires étrangères et du développement international, de la direction du Trésor du ministère de l’Économie et des finances, et de l’Agence française de développement ;
- le Conseil national du développement et de la solidarité internationale (CNDSI), instance de concertation pérenne sur les orientations de la politique d’aide au développement qui réunit les représentants du président de la République, du gouvernement, du Parlement, des ONG, des syndicats, des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, des organismes de formation, des entreprises et des collectivités territoriales.
b. Le difficile équilibre du pilotage de l’aide
Le pilotage de l’aide publique au développement française a visé à adapter cette dernière à l’évolution du paysage international de l’aide, qui s’est complexifié. La division des tâches entre deux ministères a depuis lors fait l’objet de critiques. Ainsi, pour Philippe Jahshan, président de Coordination Sud, auditionné par la mission :
« Concernant le bicéphalisme entre Bercy et le ministère des Affaires étrangères, notre point de vue est que la réforme de 1998 a affaibli le pilotage politique de l’APD. Le secrétariat d’État au développement a été régulièrement dépouillé de sa capacité d’action et d’expertise. On perd en capacité de vision et de pilotage au profit d’une logique plus comptable et financière. Le pilotage est également rendu plus complexe. » Le fait que quatre Secrétaires d’État aient occupé ce poste en cinq ans est pour M. Jahshan la manifestation d’un affaiblissement du pilotage de l’aide ainsi qu’un obstacle à la définition d’une stratégie de long terme dans ce domaine. « Il y a un consensus en matière de défense et de sécurité, pas en matière de développement. »
La partition du pilotage de l’aide répond cependant à la répartition au sein de l’administration française des compétences existantes et requises pour assurer le suivi de certaines politiques particulières. Il n’est pas absurde que la Direction générale du Trésor soit chargée du suivi en matière économique et financière, notamment de la représentation de la France au sein des banques de développement, ainsi que des aides budgétaires globales qui aident les pays destinataires à rééquilibrer leur situation budgétaire.
i. Assurer un suivi régulier de la politique française d’aide publique au développement par le Parlement
Plutôt qu’un retour à un pilotage de l’aide par un ministère de plein exercice, votre rapporteur recommanderait plus volontiers, outre un renforcement général des moyens de contrôle du Parlement sur la politique d’aide publique au développement, qu’un débat parlementaire soit organisé tous les trois ans afin que les grandes orientations de la stratégie française d’aide publique au développement soient discutées et définies publiquement.
Un tel débat permettrait à la représentation nationale d’entendre le gouvernement sur les grandes orientations de la politique française d’aide publique au développement ainsi que de procéder à un examen régulier des choix stratégiques que la France doit faire dans ce domaine. Une réflexion menée publiquement à intervalles réguliers contribue en effet fortement à soulever les problèmes qui méritent de l’être et à réduire les effets d’inertie.
Recommandation n° 1 Renforcer les moyens de contrôle du Parlement sur la politique d’aide publique au développement, notamment par l’organisation tous les trois ans un débat au Parlement sur la stratégie française en matière d’aide publique au développement, au cours duquel le gouvernement exposera les grandes orientations de la politique d’aide française. |
ii. Assurer le suivi interministériel de la politique française d’aide publique au développement
Une manière complémentaire de renforcer le suivi de la politique française d’aide publique au développement consisterait simplement à s’assurer que es réunions du Comité interministériel pour la coopération internationale et le développement (CICID) aient effectivement lieu « au moins une fois par an », conformément à l’article 6 du décret n°98-66 du 4 février 1998 qui a présidé à sa création.
Il semble en effet inutile de rappeler l’importance d’une coordination interministérielle régulière et approfondie dans un domaine par nature interministériel comme l’aide publique au développement, et dont le besoin en termes de coordination ne fera qu’augmenter dans les années à venir, pour que la politique française dans ce domaine demeure cohérente.
Or, le CICID ne s’est réuni que onze fois depuis sa création par le décret du 4 février 1998, la dernière réunion ayant eu lieu le 30 novembre 2016. Le CICID étant chargé de fixer « les orientations relatives aux objectifs et aux modalités de la politique de coopération internationale et d’aide au développement dans toutes ses composantes bilatérales et multilatérales », de déterminer les pays de concentration et les secteurs prioritaires de la coopération française, de veiller « à la cohérence des priorités géographiques et sectorielles des diverses composantes de la coopération » et d’assurer « une mission permanente de suivi et d’évaluation de la conformité aux objectifs fixés et aux moyens assignés des politiques et des instruments de la coopération internationale et de l’aide au développement », il est souhaitable que des réunions plus régulières, conformément à la lettre du décret de 1998, l’amènent à faire un point d’étape au minimum annuel afin qu’un véritable suivi régulier de la politique française d’aide publique au développement puisse avoir lieu.
Recommandation n° 2 Veiller à ce que le Comité interministériel pour la coopération internationale et le développement (CICID) se réunisse au moins une fois par an, conformément à l’article 6 du décret n°98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement |
c. Le dispositif français dans les pays bénéficiaires de l’aide publique au développement
La mise en œuvre locale de la politique française d’aide publique au développement demeure répartie entre représentants des trois principaux acteurs de cette politique.
- Le ministère des Affaires étrangères s’appuie principalement sur les services de coopération et d’action culturelle (SCAC) logés à l’intérieur des ambassades qui s’appuient sur le réseau des établissements culturels français, es Alliances françaises et des centres de recherche.
- Le ministère des Finances conserve la gestion de certains instruments spécifiques.
- Les agences de l’AFD, généralement logées hors des ambassades, couvrent la plupart des secteurs d’intervention de la France.
La politique d’aide publique au développement n’échappe cependant pas au ministère des Affaires étrangères puisque la coordination de ces différents acteurs s’effectue sous l’autorité de l’ambassadeur. Ce dernier est en effet responsable du dialogue avec le pays destinataire de l’aide, en particulier s’agissant de la négociation du document cadre de partenariat (DCP), qui fixe les axes principaux de la politique de coopération pour plusieurs années.
L’ambassadeur exerce également un contrôle sur l’instruction et le suivi de l’aide-projet, des aides budgétaires et des C2D.
Lors du déplacement effectué par la mission d’information à Ouagadougou entre le 8 et le 11 janvier 2017, votre rapporteur a pu apprécier le bon fonctionnement à la fois du service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade et de l’agence locale de l’AFD.
Il demeure toutefois que le fonctionnement de la coopération française dans les postes diplomatiques a été profondément modifié par la série de réformes qui ont eu lieu depuis 1998, en particulier du point de vue de la répartition des moyens. Avec un SCAC d’une douzaine de personnes, parmi lesquelles cinq experts, contre treize en 2012, relevant des domaines qui n’ont pas été rattachés à Expertise France, l’ambassade joue désormais un rôle limité en matière d’expertise technique.
Cette situation contraste fortement avec celle qui prévalait il y a une trentaine d’années, lorsqu’environ 700 coopérants français travaillaient au Burkina Faso, dans un contexte, il est vrai, complètement différent. Les raisons qui ont prévalu à la création d’Expertise France sont discutées dans le présent rapport et les avantages liés à l’existence de cet établissement ne sont pas remis en cause, mais il demeure possible d’identifier et, le cas échéant, de corriger certains effets imprévus de cette réorganisation.
Ainsi, les experts techniques ont longtemps constitué pour une ambassade telle que celle de Ouagadougou une source d’information difficile à remplacer, du fait de leur connaissance profonde et quotidienne des réalités locales qui forment l’objet de leur activité. L’organisation et les missions d’Expertise France l’ayant conduit à assigner aux experts techniques des missions présentant plus qu’auparavant un caractère ponctuel, la durée de leur séjour étant par ailleurs fonction de l’importance de la mission, l’expertise technique n’est plus guère en mesure d’assumer aujourd’hui cette fonction de collecte informelle d’informations.
Le rôle de l’ambassade demeure cependant crucial dans sa fonction de supervision et de coordination des politiques d’aide au développement conduites par la France sur place. L’ambassade négocie avec le gouvernement du pays de résidence le document de programmation conjointe, quand il y en a un, qui établit une liste d’objectifs et de priorités pour une période d’environ trois ans. L’ambassade examine et approuve le cas échéant les différents projets de coopération qui lui sont soumis et assure ainsi un suivi de la politique d’aide au développement menée par la France.
Ce mode de fonctionnement encore récent et radicalement différent de celui qui prévalait il y a quelques décennies est dans l’ensemble équilibré. Il a semblé à votre rapporteur que la coordination entre les services de l’ambassade et l’AFD au Burkina Faso fonctionnait bien et ne posait pas de problème majeur.
Il reste que la simple supervision des projets a ses limites. Examiner et approuver chaque projet de développement de façon successive ne donne pas nécessairement le recul indispensable à une vision d’ensemble de la stratégie d’aide au développement devant être appliquée à un pays. Par ailleurs, les ambassades disposent désormais d’une expertise réduite qui leur permet difficilement d’examiner les projets qui leur sont soumis suffisamment en profondeur et, surtout, dans le contexte général de la politique d’aide au développement conduite dans le pays concerné.
Votre rapporteur recommande par conséquent de replacer les ambassades au cœur de l’élaboration des politiques d’aide, en sollicitant leur avis lors de l’élaboration du COM liant l’AFD à l’État. Afin de mieux prendre en compte les conséquences à long terme des politiques d’aide, le COM entre l’AFD et l’État devrait par ailleurs être d’une durée de cinq ans plutôt que trois, avec une procédure d’examen à mi-parcours.
Recommandation n° 3 Instaurer entre l’AFD et l’État un COM de cinq ans plutôt que trois ans, et recueillir dans la phase préparatoire du COM l’avis des ambassades auprès des pays destinataires de l’aide sur les orientations stratégiques de la France et de l’AFD en matière d’aide publique au développement. |
2. La réorganisation des outils de l’aide publique au développement
Outre la réorganisation du pilotage politique de l’aide publique au développement, une réforme de ses outils a été entreprise à partir de 2015 afin de les mettre au niveau de nos principaux partenaires. Le rapprochement entre l’AFD et la Caisse des Dépôts et Consignation et la création d’Expertise France en sont les principaux volets, auxquels s’ajoute la tâche plus difficile à achever d’une meilleure coordination de la coopération décentralisée.
a. Le rapprochement entre l’Agence française de développement et la Caisse des Dépôts et Consignations
Le projet d’adossement de l’Agence française de développement a d’abord été annoncé par le Président de la République lors de la conférence des ambassadeurs le 25 août 2015. Le projet visait deux objectifs principaux.
Il s’agissait en premier lieu d’accroître la capacité d’intervention de l’AFD en lui donnant un accès aux fonds de la Caisse des Dépôts et Consignation.
L’Agence française de développement, du fait de son statut bancaire, se trouve en effet soumise à des contraintes qui limitent son champ d’action. Les règles de Bâle III, traduites dans la directive européenne CRD IV, augmentent le niveau de fonds propres exigé, via l’introduction de matelas de sécurité additionnels, et par un renforcement de leur qualité du fait du durcissement des règles d’éligibilité des quasi fonds propres, ainsi que par la mise en place d’un calcul de fonds propres plus restrictif pour la détermination de la limite des grands risques.
Dans le cadre du Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) 2014-2016 entre l’État et l’AFD, les fonds propres de cette dernière ont été renforcés afin de permettre que son niveau d’activité soit porté de 5,5 à 8,5 milliards d’euros par an en 2016 tout en permettant à l’AFD de construire un modèle financier autonome, sans préjudice de la prise en charge par l’État de la bonification des prêts concourant à l’aide publique au développement, et soutenable à long terme.
Ce renforcement des fonds propres de l’AFD n’était cependant pas suffisant pour permettre à cette dernière de concrétiser l’annonce faite par le président de la République d’accroître le flux annuel de prêts au titre de l’aide au développement de 4 milliards d’euros d’ici 2020. Concrètement, l’action de l’AFD se trouvait encore bridée par les contraintes de fonds propres émanant du statut de Bâle III dans une dizaine de pays à revenus intermédiaires, tels que l’Indonésie ou la Colombie.
En second lieu, à cet objectif technique et financier s’ajoutait un objectif tout aussi important à long terme, cette fois d’ordre stratégique.
Il s’agissait de faire de l’AFD une agence de développement aux compétences accrues et diversifiées, disposant de plus de relais et en mesure de déployer une plus grande gamme de compétences. Selon M. Rémy Rioux, alors en charge de la préfiguration de cette opération, cet objectif devait être considéré comme prioritaire à long terme. Le rapprochement entre l’AFD et la CDC devait en effet profiter aux deux institutions, chacune tirant parti des compétences et du savoir-faire de l’autre.
L’AFD peut apporter à la CDC une plus grande ouverture à l’international et des opportunités dans un secteur, celui du développement, où la CDC n’a jusqu’à présent pas été active. La CDC apportera pour sa part à l’AFD une habitude du travail avec les acteurs locaux français, notamment les collectivités territoriales. En fin de compte, il s’agit pour la France de disposer d’une agence de développement d’une taille conforme aux ambitions du pays.
La mise en œuvre du rapprochement entre les deux institutions a fait l’objet d’un rapport de préfiguration remis au Président de la République en janvier 2016 (10), qui préconisait l’intégration de l’AFD au groupe CDC, l’État renforçant de son côté les fonds propres de l’institution. Cette hypothèse a toutefois été mise de côté du fait de la complexité de ses implications juridiques, notamment en ce qui concerne la compatibilité de leurs statuts juridiques.
Une voie plus simple a été choisie avec une convention, signée le 6 décembre 2016 à l’occasion du 75e anniversaire de l’AFD, entérinant le rapprochement stratégique des deux institutions.
La Charte d’Alliance stratégique signée par les deux institutions et valable pour une durée de cinq ans énumère à l’article premier les principaux objectifs du rapprochement
« - conforter le rôle de l'AFD, opérateur de la politique de développement de la France, en lui permettant de renforcer son positionnement d'institution bilatérale de référence au niveau mondial pour le financement des Objectifs de Développement Durable (ODD), et de contribuer ainsi au rayonnement de la France ;
- renforcer l'ancrage territorial de l'AFD en France, ses liens avec les collectivités territoriales hexagonales et le tissu des acteurs économiques et organisations de la société civile, grâce au lien historique et étroit que la CDC entretient avec ces acteurs et à ses savoir-faire en matière de financement et d'accompagnement des transitions territoriales, numériques, démographiques, écologiques et énergétiques sur le territoire français ;
- appuyer la CDC dans la projection de ses partenaires à l'international (entreprises, collectivités, etc.) et dans sa connaissance des solutions originales adoptées à l'étranger, grâce à la connaissance approfondie de l'AFD de ses pays d'intervention, à son expertise en termes de financement et aux nombreux partenariats qu'elle a noués sur la scène internationale ;
- renforcer l'internationalisation de la CDC, et sa contribution au service de l'intérêt général en renforçant ses partenariats internationaux ;
- dans les Outre-mer, approfondir le partenariat entre l'AFD et la CDC pour un meilleur financement du secteur public et du secteur privé par un renforcement de l'appui public au développement durable, à la cohésion sociale, et à l'intégration régionale de ces territoires. »
L’article 2 traite des convergences des métiers et des expertises entre les deux institutions, l’article 3 « Convergences territoriales en France » prévoit des dispositifs de rapprochement entre les deux institutions à la fois dans les territoires d’outre-mer, où les deux établissements partagent les mêmes objectifs de développement, et dans les collectivités territoriales impliquées dans des actions de coopération décentralisée.
L’article 4 « Convergences internationales » prévoit notamment la construction d’un « véhicule d'investissement en fonds propres s'inscrivant dans la stratégie commune des deux groupes d'appui aux quatre transitions prioritaires énergétique et écologique, numérique, territoriale et démographique », chargé d’investir dans « les infrastructures d'accès aux services essentiels dans les pays en développement: énergies renouvelables; eau et assainissement; télécommunications et infrastructures numériques; traitement des déchets; transports; aménagement du territoire; santé et éducation. » qui « privilégiera l'intervention en fonds propres avec des positions minoritaires, afin de partager !e risque avec d'autres investisseurs, et de permettre un alignement des intérêts du véhicule et des développeurs. II visera une rentabilité financière positive à long terme »
L’article 5 « Collaboration en matière de ressources humaines » traite des modalités de rapprochement entre les personnels des deux institutions. Les articles 6 à 9 sont de portée plus générale.
Compte tenu du caractère récent de la signature de ce document, la présente mission d’information n’est pas en mesure de commenter de façon plus précise la mise en œuvre du rapprochement entre l’AFD et la CDC.
M. Rioux, directeur de l’AFD, auditionné par la mission, a précisé sa conception du projet stratégique qui a présidé au rapprochement : « Concernant les convergences stratégiques entre l’AFD et la CDC, un discours stratégique commun peut être porté, fondé entre autres sur les objectifs du développement durable. Notre idée est de créer un socle stratégique commun à partir de la stratégie de la Caisse, qui englobe notamment les quatre transitions : démographique, territoriale, écologique et climatique, numérique et technologique. Cela nous convient parfaitement. La plupart des ODD peuvent être logés dans ces grands axes et leur ajouter ainsi une dimension internationale.
« Pour notre part, nous intervenons dans les pays fragiles et nous faisons des choses que la Caisse ne fait pas, et nous ajouterons donc une cinquième transition, la transition politique et citoyenne. Il est ainsi possible de bâtir et de porter au niveau européen une lecture plus lisible des ODD. »
Quelle que soit la modalité de mise en œuvre finalement adoptée, l’objectif du rapprochement demeure pour la France de disposer d’un outil capable de mettre en œuvre une stratégie d’aide publique au développement lisible et dont les moyens sont appelés à augmenter. Votre rapporteur se contentera donc de formuler le souhait que cet objectif soit atteint.
b. Le renforcement de l’expertise
L’activité d’Expertise France est la forme qu’a maintenant prise l’ancienne assistance technique de l’époque de la décolonisation, qui employait alors environ 30 000 experts français. L’expertise est depuis devenue un marché très concurrentiel et les pouvoirs publics français ont cherché à adapté l’offre française dans ce domaine à cette évolution.
La création d’Expertise France le 1er janvier 2015, par le regroupement de six organismes distincts, est une illustration de la réflexion sur l’aide au développement qu’appellent les récents engagements de la France à la suite d’Addis-Abeba, de l’adoption des ODD et de la création du fonds fiduciaire européen.
Expertise France compte 250 salariés, et réalise actuellement environ 400 projets. Ses interventions comprennent la mise en œuvre, le conseil, la mise en place de politiques publiques et le conseil à travers le dialogue entre praticiens.
Deuxième axe de la rationalisation du secteur de l’expertise, le ministère des Affaires étrangères, dans le prolongement du transfert d’une partie de l’assistance technique du Ministère des Affaires étrangères vers l’AFD, décidé par le Comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) en 2004 et mis en œuvre à partir de 2005, a transféré en 2016 la responsabilité de l’aide en matière de gouvernance à l’AFD et a demandé à cette dernière de consacrer 25 millions d’euros par an à des contrats avec Expertise France. Pour M. Mosneron-Dupin, directeur général d’Expertise France auditionné par la mission, « Telle est la lettre de l’accord, mais l’esprit de l’accord est que les deux agences doivent apprendre à travailler ensemble régulièrement. Les équipes des deux agences sont ainsi en contact, secteur par secteur. Le même type de contrat existe en Allemagne entre la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) et le Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). »
Expertise France est un établissement public industriel et commercial (EPIC) qui utilise des normes comptables privées et qui vise à une situation d’autofinancement d’ici cinq ans. Il remplit donc une mission de service public avec une gestion privée. L’établissement a traité en 2016 pour environ 130 millions d’euros de contrats, à 65% d’origine multilatérale et à 26% provenant de commandes publiques françaises. Les financements bilatéraux et multilatéraux ne sont toutefois pas exclusifs. Ainsi, certains projets font l’objet de cofinancements entre le ministère des Affaires étrangères français et l’Union européenne.
Ses domaines d’intervention sont variés et ont concerné ces dernières années aussi bien le domaine des finances publiques en Grèce que celui de la ville durable en Turquie, des centres de soins et boulangeries industrielles en Syrie, du travail parlementaire en Tunisie, des services publics de base dans plusieurs localités en RCA, de l’assurance vieillesse en Chine ou de la planification urbaine au Barhein.
Les quatre principaux secteurs d’intervention d’Expertise France sont actuellement :
- La gouvernance démocratique et les finances publiques (institutions démocratiques, migrations, finances publiques, statistiques) ;
- Le développement durable et l’agriculture (engagements COP21, énergie, climat, développement urbain, agriculture) ;
- La santé (systèmes de santé et hospitaliers – Expertise France gère 5% de la contribution française au fonds Sida) ;
- La stabilité et la sécurité (missions régaliennes, police, protection civile, recyclage des anciennes milices, centres de soins dans les États fragiles, boulangeries industrielles, « relèvement précoce », assistance aux ONG).
Expertise France exerce par conséquent une influence politique et économique non négligeables en diffusant les normes françaises à travers le monde. L’Allemagne a parfaitement compris depuis longtemps l’intérêt de procéder ainsi, puisque le GIZ, homologue allemand d’Expertise France, traite pour 2,1 milliards d’euros de contrats par an contre 21 millions d’euros pour Expertise France. L’impact de ce type d’assistance est loin d’être négligeable pour les entreprises nationales lorsque les moyens sont suffisants. Le GIZ a ainsi assisté l’Afrique du Sud pendant dix ans en matière énergétique, et Siemens obtient depuis lors la plupart des contrats dans ce pays.
ii. Un effort français insuffisant
La France aurait par conséquent un intérêt à accroître son effort dans ce domaine stratégique : la part de l’assistance technique dans le budget français du développement est aujourd’hui d’environ 10%, contre 27% pour l’Allemagne et 24% pour le Japon. Environ 23 % des recettes d’Expertise France viennent de l’État, 40% viennent de l’Union européenne, 13% de la Banque mondiale et des banques multilatérales, 4% des collectivités territoriales, 13 à 20% de l’ONU selon les années, mais le chiffre est plus proche de vingt actuellement, Expertise France s’occupant de la logistique de la Minusma (11) avec des entreprises françaises.
Le financement de l’activité dans les pays les moins avancés est actuellement principalement nourri par des subventions, lesquelles dépendent soit du programme 209, soit de l’Union européenne. Ce sont ainsi les subventions européennes qui permettent à Expertise France d’être présente en RCA et d’y diffuser les normes françaises. Le programme 209 et l’Union européenne permettent à Expertise France de consacrer environ 60% de son activité à l’Afrique subsaharienne (l’objectif fixé par le COM étant de 50%). Cela compense la faiblesse relative des dons dans l’aide publique au développement française. Autre cas de figure, la formation d’administrateurs de la ville de Kinshasa est financée par le budget de la ville elle-même. Expertise France s’efforce par ailleurs d’étendre sa coopération avec les collectivités territoriales. Par exemple, un projet d’énergie durable à Kampala fait appel à de l’expertise du Grand Lyon.
Les objectifs du Contrat d’objectifs et de Moyens (COM) passé par Expertise France et l’État et approuvé par la Commission des Affaires étrangères en juin 2016, consistent à doubler le chiffre d’affaire d’Expertise France et à atteindre l’autofinancement en cinq ans tout en répondant au quatre priorités sectorielles. Il faut par ailleurs apaiser le climat social, la croissance de l’agence étant importante et la fusion éprouvante pour son personnel.
Votre rapporteur estime que l’expertise est non seulement un domaine clef de l’aide publique au développement, mais un secteur critique en ce qui concerne la diffusion des normes et de l’influence françaises dans le monde. La création d’Expertise France est donc particulièrement bienvenue et son renforcement est extrêmement souhaitable.
Il reste que le regroupement de l’expertise en son sein, combinée au fait de confier à l’AFD le secteur de l’expertise en matière de gouvernance ont inévitablement abouti à priver les ambassades d’une partie de leurs attributions, de leur capacité propre d’appréciation des projets de coopération, ainsi que de relais auprès des administrations et de la société civile qui peuvent leur faire défaut aujourd’hui.
Il est donc important qu’Expertise France, l’AFD et le ministère des Affaires étrangères entretiennent une coordination étroite et profitable à tous. Compte tenu du caractère récent de la création d’Expertise France, qui vient de valider son premier COM avec l’État, il est trop tôt pour formuler une recommandation pratique. Votre rapporteur souhaite cependant qu’une évaluation soit faite dans les deux ans, par exemple à l’occasion du prochain COM, du bon fonctionnement de la relation entre Expertise France, l’AFD et les postes diplomatiques.
Recommandation n° 4 Renforcer les capacités d’intervention d’Expertise France |
Recommandation n° 5 Évaluer à l’occasion du prochain COM entre Expertise France et l’État le bon fonctionnement de la relation entre Expertise France, l’AFD et les postes diplomatiques |
c. Rôle de la coopération décentralisée
Dès lors que l’aide au développement doit, pour être efficace dans la durée, viser directement des échelons locaux, le rôle joué par la coopération décentralisée est probablement appelé à devenir de plus en plus important. La revalorisation de l’aide directe à la gouvernance locale et à l’expertise des collectivités territoriales est en effet souhaitable, mais « contraire aux habitudes des Nations unies et des États », selon Bertrand Gallet, directeur de Cités-Unies France. Chaque échelon étant le mieux à même d’intervenir à son propre niveau, la coopération décentralisée semble appelée à jouer un rôle de premier plan.
L’importance de la gouvernance territoriale est aujourd’hui, selon M. Gallet, renforcée par la faiblesse croissante de beaucoup d’États centraux. Par exemple, le système politique du Mali se caractérise ainsi par une forte centralisation de la part d’un État qui pourtant parvient difficilement à se manifester en dehors de la capitale. Les collectivités territoriales deviennent alors les seules structures capables d’administrer et de protéger la population, mais sont réduites à faire « du bricolage en matière de santé ou de fiscalité locale ». et à « inventer une gestion locale sans grands moyens, puisque plus aucun fonctionnaire ne veut aller dans ces territoires ».
Ainsi, bien que la coopération décentralisée pèse peu du point de vue financier par rapport à l’aide publique au développement, Cités unies France insiste sur le fait qu’aider à structurer l’action des collectivités territoriales serait aujourd’hui la meilleure façon d’appliquer les Objectifs du Développement durable.
i. Structurer la coopération décentralisée
L’action internationale des collectivités territoriales est en effet imparfaitement répartie. Des régions entières ne sont pas couvertes, tandis que certaines zones font l’objet d’actions simultanées et redondantes de la part de plusieurs collectivités territoriales françaises. Par définition, l’action des collectivités territoriales ne peut faire l’objet d’une stratégie dirigée au niveau de l’État, ne serait-ce qu’en application de l’article 34 de la Constitution et du principe de libre administration des collectivités territoriales. Une forme de coordination est toutefois nécessaire si l’on souhaite que la coopération décentralisée puisse s’insérer dans une stratégie d’aide au développement cohérente.
Cités unies France, fédération de collectivités territoriales créée en 1977 et régie par la loi de 1901, tente d’organiser ce mouvement dans le respect de la constitution et du principe de libre administration des collectivités territoriales. Cependant, même si les risques de contentieux sont éliminés, il reste toutefois certains risques politiques inhérents à une telle démarche.
Le seul mode d’action exempt de tels risques consistait donc à coordonner l’information, d’où la création des groupes pays, système « un peu lourd » selon Bertrand Gallet, dont les résultats sont variables. La mutualisation de l’information est occasionnellement prolongée par l’organisation d’événements.
ii. La Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD)
La coopération décentralisée fait néanmoins l’objet d’une coordination au niveau de l’État. Rattachée au Premier ministre et réunissant tous les acteurs de la coopération décentralisée, la Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD) est une instance d’échanges et de propositions, chargée d’établir un état de la coopération décentralisée. Le secrétariat de la Commission et la mise en œuvre de sa politique sont assurés au sein du ministère des Affaires étrangères et du Développement international par la délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT), en charge de la coordination interministérielle.
La Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT) est un service rattaché à Matignon auquel la loi du 7 juillet 2014 donne mission de tenir à jour l’Atlas de la coopération décentralisée (12), avec l’aide des acteurs locaux, par le moyen d’un recueil annuel d’informations. Le retour d’informations de ces derniers est de plus en plus significatif. En effet, alors qu’une estimation faite il y a deux ans comptait 0 à 30% de défauts de déclarations. Une campagne de relance a permis d’affiner et de mieux connaître la réalité. Aujourd’hui, la marge d’erreur est estimée entre 7 et 10%.
Elle ne sera cependant jamais nulle, même si la loi donne obligation aux collectivités territoriales de déclarer leur aide publique au développement pour obtenir des cofinancements de l’État.
L’aide publique au développement des collectivités territoriales ainsi comptabilisée s’élevait à 57,2 millions d’euros en 2015, contre un maximum de 88 millions d’euros en 2008. Cet effritement lent étant observé malgré les campagnes de relances, donc la chute est peut-être encore supérieure.
Le ministère des Affaires étrangères a par ailleurs publié en novembre 2016 un Livre Blanc intitulé « Diplomatie et territoires, pour une action extérieure démultipliée » (13) , qui passe en revue ce que l’État et les collectivités territoriales ont en commun en matière d’action extérieure, et l’ensemble des interactions existantes.
Ce document fait un tour d’horizon et contient des recommandations aux organismes d’État, aux collectivités territoriales et à leurs opérateurs. Le Livre blanc rappelle entre autres que si la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) a réparti les compétences entre les différents niveaux de collectivité, il n’en est pas de même à l’international, puisque chaque niveau de collectivité territoriale peut agir dans ce domaine. On ne peut pas en effet se passer de l’action internationale des départements ou des métropoles. C’est pourquoi le législateur a maintenu la clause de compétence générale en matière d’action internationale.
iii. Le rôle du ministère des Affaires étrangères
Des initiatives ont été prises concernant le rôle du ministère des Affaires étrangères, avec la nomination en 2015 de conseillers diplomatiques auprès des préfets de région, chargés de coordonner l’action internationale des collectivités territoriales. Des fonctionnaires avaient auparavant été placés auprès des conseils régionaux, mais le bilan était contrasté. Il a donc été jugé préférable de déléguer un conseiller diplomatique auprès du préfet de région, afin qu’il puisse traiter tous les niveaux de collectivités territoriales et qu’il soit subordonné au préfet.
Par ailleurs, dans chaque poste diplomatique, un « correspondant coopération décentralisée » a été nommé, visible par tous et disponible pour les collectivités territoriales.
Selon Bertrand Gallet, les rapports entre les acteurs de la coopération décentralisée et le ministère des Affaires étrangères sont très bons. « La gestion commune élus-États figure dans la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République. Il est bon que la France ait accepté de partager cette compétence. Tout va très bien avec la DAECT, la cogestion a toujours bien fonctionné. » Il en va de même avec les postes diplomatiques : « Il n’y a jamais eu de vrais problèmes avec les ambassadeurs, ni avec la politique étrangère de la France. La loi de 1992 interdit à la coopération décentralisée d’entrer en contradiction avec la politique étrangère de la France, mais pratiquement aucun problème n’a été constaté. »
iv. Les cofinancements de la DAECT
Un autre dispositif existant est celui des cofinancements de la DAECT, modestes mais stables. La DAECT cofinance pour 8 à 9 millions d’euros par an des projets de coopération décentralisée, avec des appels à projet bilatéraux (avec le Maroc, le Mexique, l’Argentine, le Québec, les territoires palestiniens et, récemment, le Sénégal), ainsi que deux fonds d’appui unilatéraux (Tunisie et Liban), mais aussi des appels à projets thématiques (par exemple « lutte contre le changement climatique » ou « mobilité et formation professionnelle des jeunes »).
La DAECT tient compte des informations remontant des collectivités territoriales, notamment, via leurs associations dans la définition des termes de référence des appels à projets.
Selon Bertrand Fort, Délégué à l’Action extérieure des collectivités territoriales : « Concrètement, une priorité est mise sur le suivi et l’évaluation des projets. Les coopérations décentralisées sont en effet devenues pour la première fois un sujet de campagne électorale et les élus doivent plus qu’avant rendre compte de leurs actions internationales auprès des ONG, de la presse et des citoyens. Le suivi et l’évaluation sont donc encouragés pour leur permettre de mieux répondre aux questions posées sur le bien-fondé de leurs projets. »
v. Les efforts de mutualisation
Deuxième priorité, la mutualisation, afin d’éviter la concentration des efforts dans certaines régions au détriment d’autres régions. Là où il y a concentration, il est important que les collectivités territoriales se coordonnent, voire mutualisent leurs efforts, ce que favorise la DAECT en leur attribuant un « bonus » de cofinancement.
Au niveau national, il convient d’abord de mentionner les « groupes pays » organisés par Cités unies France, qui favorisent une mutualisation des informations et avec lesquels la DAECT travaille quotidiennement.
Autre outil, le Comité d’expansion économique de la CNCD créé par la loi de juillet 2014, suite au constat du rapport Laignel de 2013 (14) qui notait une déperdition d’information par les organismes d’État entre la collecte d’information des missions économiques sur les opportunités économiques, et l’information utile qui arrive in fine dans les territoires et dans les PME. La déperdition d’informations est du reste la même dans l’autre sens, vers les postes diplomatiques et leur mission économique, concernant les capacités d’exportation et les innovations des acteurs économiques dans les territoires.
Le Comité d’expansion économique a donc pour mission de rassembler les acteurs territoriaux et nationaux afin de coordonner leur action pays par pays. Il est présidé par le secrétaire d’État au commerce extérieur.
Troisième lieu de mutualisation et de cohérence, les réseaux régionaux multi acteurs (RRMA) : ils ont des statuts variables et existent dans presque toutes les régions. Ce sont des relais d’information indispensables qui font remonter la réalité de ce qui se passe dans les territoires. Ils exercent aussi une fonction de formation des cadres territoriaux. Historiquement, les réseaux régionaux se sont constitués sur la base des collectivités territoriales et des ONG et certains se sont ensuite élargis aux entreprises, à l’enseignement et aux établissements de santé.
La DAECT les soutient de plus en plus au travers de cofinancements qui ont augmenté d’environ 10% par an ces dernières années. Quatre orientations leur sont proposées dans les conventions que la DAECT signe avec eux :
- La cohérence avec la nouvelle carte régionale, grâce à des fusions si nécessaire ;
- La globalisation géographique, afin que les coopérations aient lieu aussi bien avec des pays, en développement qu’avec des pays développés ;
- la globalisation thématique, aucun thème ne devant être exclu à priori ;
- la globalisation des acteurs, tous les acteurs de l’internationalisation des territoires devant être concernés.
vi. Le travail avec les opérateurs
Sept opérateurs sous tutelle ou cotutelle du MAEDI entretiennent des relations permanentes avec les collectivités territoriales françaises pour ce qui concerne leur action internationale : l’Agence française de développement, Expertise France, Business France, Atout France, l’Institut Français, Campus France, et France volontaires.
Le travail avec l’AFD est aujourd’hui, cependant, plus avancé qu’avec les nouveaux opérateurs. Depuis 2007, 28 accords de partenariat entre l’AFD et des collectivités territoriales françaises ou leurs associations ont été signés dont 9 avec des communes, 8 avec des régions, 4 avec des communautés urbaines. Ces partenariats se traduisent par un portefeuille nourri d’opérations qui comprend notamment plus de dix projets ayant impliqué dès leur conception des collectivités françaises et ayant mobilisé plus de 3 million d’euros de l’AFD, ainsi que près de quarante « projets parallèles » au travers desquels une collectivité française appuie une collectivité d’un pays en développement parallèlement à un financement de l’AFD, contribuant ainsi à renforcer l’impact des deux interventions coordonnées.
Les relations entre l’AFD et les collectivités territoriales se sont intensifiées du fait de la mise en place en 2014 de la Facilité de financement des collectivités françaises (FICOL), par laquelle l’AFD finance des initiatives portées par des collectivités. Dans un souci de complémentarité avec les instruments de la DAECT, la Facilité promeut prioritairement les projets comprenant une composante d’investissement « physique», pour lesquels la DAECT ne dispose pas d’une capacité suffisante, par opposition aux projets n’impliquant qu’un transfert de savoir-faire.
Quand la DAECT reçoit un projet de ce type, elle peut cependant financer des études de faisabilité, le projet concerné pouvant par la suite faire l’objet d’un dossier FICOL. Si l’AFD reçoit de son côté un projet sans étude préalable de faisabilité ou d’impact, elle le renvoie à la DAECT qui peut alors aider à sa préparation.
En 2014 et 2015, l’AFD a ainsi financé 6 opérations, pour un montant total de 2,7 millions d’euros, au Mali, à Madagascar, au Burkina Faso, au Bénin et au Cameroun. Pour 2016, l’AFD a présélectionné 8 projets, dont 4 portés par des collectivités d’outre-mer, pour un montant total de projets avoisinant les 7 millions d’euros.
L’AFD vient de procéder deux ajustements, d’une part en augmentant la FICOL (de 1,5 à 3 millions d’euros) et d’autre part en diminuant son seuil d’intervention à 300 000 euros.
Ce dernier point est important. Auparavant, un projet de moins d’un million d’euros de budget semblait avoir peu de chances de bénéficier du soutien de la FICOL, tandis que les projets, de l’ordre de 10 000 à 50 000 euros représentent environ 90% des projets financés de la DAECT. En diminuant son seuil d’intervention, l’AFD se donne les moyens d’aider à la mise en œuvre de projets de montant intermédiaire.
Recommandation n° 6 Augmenter les moyens de la Délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales ou diminuer le seuil d’intervention de la Facilité de Financement des Collectivités territoriales françaises afin que les projets de coopération décentralisée d’un montant situé entre 100 000 et 300 000 euros puissent bénéficier d’une aide de la DAECT ou de la FICOL. |
Le rapprochement avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC) devrait enfin permettre un renforcement de l’ancrage territorial de l’AFD. En théorie, les synergies potentielles entre les deux groupes sont fortes, la CDC pouvant faire bénéficier l’AFD de son réseau en France et de sa connaissance fine des collectivités locales françaises pour améliorer son ancrage territorial, tandis que l’AFD peut mobiliser son réseau international et sa compréhension des environnements des pays du Sud pour accompagner la projection internationale des collectivités.
III. SORTIR DU DÉBAT BINAIRE ENTRE BILATÉRAL ET MULTILATÉRAL
Au cours des vingt-cinq dernières années, la politique française d’aide publique au développement s’est progressivement éloignée du modèle dominé par la coopération bilatérale qui a prévalu au lendemain de la décolonisation, en faveur d’une présence plus importante au sein des organismes multilatéraux d’aide au développement, présence qui va de pair avec une plus importante contribution financière.
Dans le contexte récent de stagnation, voire de diminution des budgets de l’aide publique au développement, le débat sur la répartition de l’aide française entre bilatéral et multilatéral s’est identifié à une série de difficiles décisions de répartition d’une ressource en voie de raréfaction.
La problématique dominante de ce débat repose sur l’idée que l’aide bilatérale permet un pilotage direct par la France qui peut ainsi faire prévaloir ses priorités politiques, thématiques et géographiques, mais avec des moyens limités, tandis que l’aide multilatérale permet de démultiplier l’aide française grâce aux effets de leviers qu’elle procure, mais au prix d’une dispersion de l’effort et d’une dilution des priorités françaises dans un consensus international loin d’être toujours satisfaisant.
L’opposition entre aide bilatérale et aide multilatérale ne reflète cependant que partiellement la réalité. En premier lieu, comme le rappellent régulièrement les ONG, il convient de rappeler que l’aide publique au développement n’est pas simplement un moyen de diffuser l’influence française.
De manière plus fondamentale, l’opposition entre aide bilatérale et aide multilatérale n’est pas aussi tranchée. Chaque forme d’aide internationale permet d’atteindre au mieux certains objectifs et les deux formes d’aides ont vocation à se compléter.
A. L’AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT FRANÇAISE S’EST LARGEMENT TOURNÉE VERS LES CANAUX MULTILATÉRAUX
1. Une aide bilatérale encore majoritaire
Les deux tiers environ de l’aide publique au développement française sont constitués d’aide bilatérale. En 2013, l’aide bilatérale de la France comptabilisée par le CAD de l’OCDE s’est élevée à 6,6 milliards d’euros (2,6 milliards de prêts nets, 607 millions d’annulations de dette ou de rééchelonnement, 586 millions de subventions et 2,8 milliards d’autres dons – coopération technique, frais administratifs). L’aide bilatérale permet à la France de cibler des priorités géographiques et sectorielles et de valoriser l’expertise des acteurs dans des secteurs ou le savoir-faire français est reconnu.
L’aide bilatérale est composée de quatre principaux types de soutiens :
- le financement de projets (37 % en 2011), principalement géré par l’Agence française de développement (AFD) ;
- l’assistance technique (16 %), sous forme de personnel, de formation et d’activités de recherche ;
- les allègements de dettes (15 %) ;
- l’aide budgétaire (7 %) aux États étrangers.
Le quart restant est composé d’un ensemble plus disparate comprenant notamment l’accueil d’étudiants étrangers, l’accueil de réfugiés, l’aide humanitaire et alimentaire, le soutien à des instituts de recherche, et le soutien aux ONG.
L’Afrique subsaharienne est le principal bénéficiaire des dons octroyés par la France, avec près de la moitié de l’APD française (hors Outre-mer). Pour l’année 2015, l’AFD chiffre son aide à environ 3,1 milliards d’euros (soit 38 % de l’activité du groupe AFD). Dans les autres régions du monde elle s’élève à environ 17 % pour l’Asie (soit 1,4 milliard d’euros), 14 % pour la Méditerranée et le Moyen-Orient (soit 1,2 milliard d’euros) et 12 % pour les États d’Amérique Latine et des Caraïbes (soit un milliard d’euros)
2. Une aide multilatérale en progression au cours des dernières décennies
Le rapport publié par la Cour des Comptes en 2012 sur la politique française d’aide au développement (15) observait un accroissement rapide, sur une période de vingt ans, de la part de l’aide publique au développement française allouée aux organismes multilatéraux.
« La part de l’aide multilatérale n’a cessé d’augmenter depuis une vingtaine d’années parmi les donneurs de l’OCDE, pour atteindre 31 % en 2011.
« La France, après avoir enregistré une tendance inverse entre 2001 et 2006, connaît une augmentation marquée de cette aide depuis 2007, faisant de notre pays l’un des membres de l’OCDE qui utilise le plus le canal multilatéral. Sur le plan budgétaire, l’aide multilatérale française représentait en 2010 2,2 milliards d’euros, soit 61 % des dépenses de la mission, qui alimentent les organisations multilatérales.
Cette évolution se fait cependant au profit de quelques organisations et appelle une gestion plus dynamique des contributions. »
Le rapport de la Cour des Comptes notait la concentration de l’aide française transitant par les canaux multilatéraux :
« Pour sa part, la France répartit ses contributions internationales dédiées au développement entre 68 institutions. Comme chez les autres donneurs, son aide multilatérale est très concentrée puisque 80 % des dépenses correspondantes étaient réparties en 2010 entre trois organismes, l’Union européenne (45 %), la Banque mondiale-AID (21 %) et le Fonds mondial sida (15 %). »
B. UNE AIDE MULTILATÉRALE PRINCIPALEMENT ORIENTÉE VERS LES CANAUX EUROPÉENS ET LES FONDS VERTICAUX
Le système multilatéral comprend près d’un millier d’organisations internationales (OI), dont 200 environ exercent une activité pouvant être comptabilisée en aide publique au développement. Dans le champ du développement, cette diversification et complexification croissante du système s’explique par la recherche de solutions différenciées à un nombre significatif de défis locaux et globaux : pauvreté ; dérèglements climatiques ; insécurité alimentaire ; crises sanitaires ; crises humanitaires ; etc.
La politique européenne d’aide au développement remonte au traité de Rome. L’établissement du Fonds européen de développement (FED) en 1957 a créé un lien stratégique entre l’Europe et ses anciennes colonies d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Depuis, la présence de l’Union européenne en tant que donneur s’est affirmée au point qu’elle est aujourd’hui active dans toutes les régions en développement du monde. Toutefois, ce n’est qu’à partir du traité de Maastricht (1992) que la politique de développement est devenue une politique communautaire, complémentaire de celle des États membres.
L’aide européenne au développement est une compétence partagée entre États membres et Union. Elle est ainsi gérée en partie par l’UE, via l’office de coopération EuropeAid (qui dépend de la commission), et s’appuie sur plusieurs instruments, parmi lesquels le fonds européen de développement (FED), qui constitue la première source d’aide publique au développement (11e FED, 2014–2020) ; l’instrument de coopération au développement (ICD), qui a une couverture géographique (Amérique latine, Asie, Moyen Orient et Afrique du Sud ) et thématique bénéficiant à tous les pays en développement (développement humain, acteurs non étatiques et autorités locales, environnement et gestion durable des ressources naturelles, sécurité alimentaire, migrations et asile) ; et l’instrument européen de voisinage (IEV), qui couvre la coopération géographique avec les pays méditerranéens et d’Europe orientale dont l’objectif est d’inciter les pays à mener des réformes de manière plus efficace et cohérente.
Entre 20 et 23 % de l’ensemble de l’APD française emprunte le canal européen. En 2014, la France était le second contributeur au FED avec près de 20 % du Fonds. Avec une contribution à hauteur de 16,44 % de l’ensemble du budget communautaire à la même période, elle participait également au financement des autres instruments européens en faveur du développement, notamment l’Instrument de coopération au développement (ICD), l’Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’Homme (IEDDH) et l’Instrument européen de voisinage (IEV).
Dans le cadre du « Programme pour le changement », la France favorise la convergence entre ses priorités géographiques et sectorielles et les orientations de la politique européenne de développement.
La France soutient la programmation conjointe entre l’Union européenne et les États membres.
Le « Programme pour le changement », dont l’approche a été validée par les États membres en mai 2012, insiste sur la nécessité de différencier les partenariats et les instruments en fonction des revenus des pays partenaires et de l’impact potentiel de l’aide européenne. Il propose notamment de concentrer l’aide de l’UE dans les PMA et vise à renforcer la cohérence des politiques européennes au service du développement et encourage la programmation conjointe de l’aide européenne.
a. Le Fonds européen de développement
Institué en 1957 par le traité de Rome et mis en œuvre pour la première fois en 1959, le Fonds européen de développement (FED) est l’instrument principal de l’aide européenne au développement entre l’UE et 79 pays dits ACP (Afrique subsaharienne sauf Afrique du Sud ; Caraïbes ; Pacifique) et les Pays et territoires d’outre-mer (PTOM).
Abondé hors budget de l’UE par des contributions volontaires des États membres, le 11e FED s’élève à 30,5 milliards d’euros pour la période 2014-2020. Il est entré en vigueur le 1er mars 2015. Deuxième contributeur après l’Allemagne, la France contribue au 11eFED à hauteur de 19,55 %, soit 5,4 milliards d’euros sur 7 ans. En 2014, la contribution de la France s’est élevée à 640 millions d’euros. 95 % des financements du FED sont alloués aux pays ACP et les enveloppes nationales des 16 Pays pauvres prioritaires (PPP) de la France concentrent 19 % des ressources du FED.
Le FED s’articule autour de trois niveaux :
- au niveau des pays de la zone Afrique Caraïbe Pacifique (ACP), les programmes nationaux concernent 21 milliards d’euros (environ 69 %), gérés par la Commission européenne, pour lesquels celle-ci et le pays partenaire élaborent un Programme indicatif national (PIN). Actuellement, les domaines d’action prioritaires sont la gouvernance (y compris l’appui budgétaire), l’agriculture durable et la sécurité alimentaire, et l’énergie ;
- au niveau des grands ensembles régionaux, les programmes régionaux portent sur 3,34 milliards d’euros (environ 11 %), gérés par la Commission, pour lesquels celle-ci et une ou plusieurs organisations régionales dûment mandatées élaborent un Programme indicatif régional (PIR). Suite à la fusion de deux régions, le 11e FED comptera seulement 5 PIR (Afrique de l’Ouest, Afrique centrale, Afrique de l’est, Australe et océan Indien, Caraïbes, Pacifique) ;
- à travers toute la zone ACP, le programme intra-ACP s’élève à 3,59 milliards d’euros (environ 11 %), enveloppe thématique permettant la mise en œuvre des projets transversaux qui touchent toute la zone ACP (par exemple, contribution au Fonds mondial de lutte contre la tuberculose et la malaria, à la Facilité de paix africaine, à l’Alliance globale contre le changement climatique, etc.). Il s’agit d’une coopération de nature géographique et suprarégionale.
La contribution française au Fonds européen de développement s’élève pour l’année 2016 à 742 millions d’euros (pour 701 millions d’euros en 2015), augmentation qui correspond à la constitution du 11e FED pour la période 2014-2020, qui s’élève à 30,5 milliards d’euros.
Les principaux domaines d’action du FED correspondent en grande partie aux priorités françaises, notamment les infrastructures et la gouvernance. Le FED peut aussi financer des instruments flexibles et adaptés tels que le fonds Bêkou, ce qui permet à la France de mobiliser d’importants financements sur ses priorités.
Le FED se caractérise cependant par un mode de prise de décisions complexe, avec un examen par le comité du FED de chaque projet et proposition de programmation, qui font l’objet d’une présentation par la Commission européenne. Chaque État-membre, dont le droit de vote est fonction de sa contribution, doit à son tour procéder à un examen afin de déterminer sa position. S’il est normal que ces financements fassent l’objet d’un examen attentif, la lourdeur des procédures entraîne néanmoins certaine lenteur dans les décaissements qui a abouti en 2013, dernière année du 10ème FED, à ce que les paiements soient inférieurs de presque deux milliards d'euros aux engagements.
Les discussions sur la budgétisation du FED, qui placerait ce dernier sous le contrôle du Parlement européen, sont quant à elles reportées la fin du 11e FED, en 2020. Cette hypothèse se heurte toutefois à un double obstacle :
- un FED « budgétisé » ne serait plus en mesure de financer la plus grande partie de la Facilité de soutien à la paix pour l’Afrique, mentionnée dans la première partie du présent rapport, qui relève de la sécurité ;
- le Royaume-Uni, s’il ne fait plus partie de l’Union européenne, ne pourra plus contribuer à un FED « budgétisé », alors qu’il pourra toujours contribuer au FED dans son mode de fonctionnement actuel.
Votre rapporteur estime par conséquent que la solution est plus à rechercher dans un allègement des procédures. Des progrès peuvent en effet avoir lieu d’une part à travers les procédures d’accréditations permettant à certains opérateurs, comme l’AFD, de mettre en œuvre à travers des conventions de délégation des programmes thématiques regroupant plusieurs projets et d’obtenir des financements avant que l’ensemble des projets ne soit connus. La réforme à venir du règlement financier de l’Union européenne pourrait permettre des progrès dans ce domaine avec l’inclusion, souhaitée par l’AFD, d’un chapitre spécifique sur la coopération déléguée.
Une évolution de ce type est d’autant plus pertinente que l’examen « projet par projet », procédure que l’on retrouve dans beaucoup d’organismes, ne permet pas toujours d’avoir une vision stratégique des politiques suivies. Le coût de chaque projet devrait être évalué non seulement en fonction du budget disponible, mais également en fonction des projets futurs sur lesquels il faudra se prononcer. Une vue plus globale permettrait donc à la fois un allègement des procédures et une meilleure hiérarchisation des projets. Votre rapporteur estime que la France devrait rechercher une évolution dans ce sens des procédures de gestion du FED.
Plus généralement, un allègement des procédures d’examen, notamment au moyen du regroupement des projets, permettra à la stratégie européenne pour le développement de mieux s’inscrire dans le temps long afin que l’Europe occupe la place qui doit être la sienne, aux côtés de la France, dans les géographies prioritaires de notre aide, et notamment en Afrique.
Recommandation n° 7 Chercher à faire en sorte que l’Union européenne intervienne plus, en matière d’aide publique au développement, au niveau des choix stratégiques que dans une gestion dossier par dossier, afin d’alléger la gestion de son aide et de renforcer sa vision stratégique. |
b. L’Instrument de financement de la coopération au développement
L’instrument de coopération au développement (ICD), dont le montant pour la période 2014-2020 s’élève à 19,6 milliards d’euros comprend à la fois des programmes géographiques (10,1 milliards d’euros) et des programmes thématiques (7,7 milliards d’euros). Le principe de différenciation a permis de concentrer plus de 50 % des ressources au profit des Pays les moins avancés (PMA) contre 29,7 % sur la période précédente alors que les pays à revenus intermédiaires voient leurs allocation passer de 24,99 % à 5,89 %.
L’ICD géographique soutient la coopération au développement avec les pays en développement qui figurent sur la liste des bénéficiaires de l’APD établie par le CAD de l’OCDE. Cet instrument concerne la coopération avec des pays et régions partenaires en Amérique latine, Asie du sud-est, Asie centrale, Moyen-Orient ainsi que l’Afrique du Sud.
En sont exclus, les pays bénéficiant d’un financement de l’UE ou d’un autre instrument d’aide extérieure : Fonds européen de développement, instrument européen de voisinage (IEV) ou au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP).
Les programmes thématiques de l’ICD couvrent à la fois les pays éligibles au titre des programmes géographiques de l’ICD, mais aussi les pays éligibles au FED et à l’instrument de voisinage. Doté d’une enveloppe de 7 Mds € pour la période 2014-2020, l’ICD thématique comprend deux programmes :
- Biens publics mondiaux (5,101 mds €) qui vise le renforcement de la coopération, de l’échange de connaissances et d’expériences et de capacités des pays partenaires afin de contribuer à l’élimination de la pauvreté, la cohésion sociale et le développement durable. Ce programme comprend 5 lignes thématiques : environnement et changement climatique (27 %), énergie durable (12 %), développement humain (25 %), sécurité alimentaire (29 %) et migration et asile (9 %).
- Organisations de la société civile et autorités locales (1,907 mds €) qui a pour but d’encourager un environnement favorisant la participation citoyenne ainsi que l’action et la coopération de la société civile, l’échange de connaissances, expériences et capacités des organisations de la société civile et des autorités locales dans les pays partenaires pour l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).
Le programme panafricain vise à financer au niveau continental ou transrégional, des projets complémentaires à ceux déjà mis en œuvre par l’UE et les États-membres.
Le suivi et l’orientation de la programmation de cet instrument, en particulier dans les secteurs de la sécurité et du changement climatique, constituent une priorité pour la France.
Son enveloppe s’élève à 845 M € pour la période 2014-2020 et couvre les priorités politiques convenues dans le cadre du partenariat Afrique-UE :
- Sécurité, gouvernance et droits de l’Homme (10-15 %) ;
- Commerce, intégration régionale et infrastructures (30-35 %) ;
- Migrations, mobilité et emploi (5-10 %) ;
- Changement climatique, environnement, et agriculture (25-30 %) ;
- Éducation supérieure et recherche (15-20 %) ;
- Dialogue politique, développement des capacités et mécanisme de soutien (5-10 %).
c. La Banque européenne d’investissement
L’architecture de l’aide de l’UE comprend également la Banque européenne d’investissement (BEI). Cette dernière apporte des financements de long terme pour soutenir les stratégies de développement et de coopération extérieure de l’UE dans plus de 150 pays partenaires. La plupart des opérations de financement de la BEI hors de l’Union comportent une garantie budgétaire de l’UE, prévue dans le mandat extérieur pour les activités de la BEI dans les autres régions du monde. La BEI est active dans les régions couvertes par le mandat extérieur actuel : pays en phase de préadhésion, voisins méridionaux et orientaux, pays partenaires d’Asie, Amérique latine et Afrique du Sud.
Le mandat de prêt pour les pays ACP et pays et territoires d’outre-mer (PTOM) est lié à l’accord de Cotonou, qui encadre les relations de l’UE avec ses pays partenaires dans la région. Les financements proviennent des budgets des États membres de l’UE par le biais du FED et des ressources propres de la BEI.
d. Les mécanismes de l’UE combinant prêts et subventions
Ces mécanismes mixtes de l’UE sont de nouveaux instruments financiers pour les opérations hors de l’Union. Ils associent des subventions (provenant du budget de l’UE, du FED ou de contributions additionnelles volontaires des États membres) à des prêts (de banques de développement multilatérales européennes comme la BEI, la BERD, la Banque nordique d’investissement, la Banque de développement du Conseil de l’Europe ou de banques ou organismes de développements nationaux). Selon les régions, les mécanismes mixtes de l’UE peuvent prendre différentes formes : subventions pour des investissements directs, garanties d’emprunts, instruments de capital-risque, instruments financiers structurés, aide technique, études préparatoires, bonifications d’intérêt31.
La couverture géographique des mécanismes régionaux de financement mixte s'est progressivement étendue. Ces mécanismes couvrent les 7 régions de la coopération extérieure de l’UE et sont les suivants :
- Facilité d'investissement pour le voisinage (FIV) ;
- Facilité d'investissement pour l'Amérique latine (LAIF) ;
- Facilité d'investissement pour l'Asie (AIF) ;
- Facilité d’investissement pour l’Asie centrale (IFCA) ;
- Facilité d'investissement pour les Caraïbes (CIF) ;
- Facilité d’investissement pour le Pacifique (IFP) ;
- Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures (ITF).
Les fonds thématiques, ou verticaux, font partie des nouveaux vecteurs de l’aide. Ils procèdent d’initiatives internationales ayant pour objectif de financer des approches thématiques, sectorielles ou sous-sectorielles du développement et mobilisent des financements publics et privés importants bénéficiant principalement aux secteurs de la santé, de l’environnement et de l’éducation.
La France est un contributeur important aux fonds thématiques, qui représentent 44 % de son aide multilatérale, hors Union Européenne, contre 21 % seulement pour l’ensemble des donneurs de l’OCDE. Elle contribue ainsi au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (300 millions d’euros par an entre 2008 et 2010), à UNITAID (Facilité internationale d’achat de médicaments pour lutter contre le VIH, le paludisme et la tuberculose) (144 millions d’euros en 2010), au Fonds pour l’environnement mondial (34 millions d’euros) et à la Facilité financière internationale pour l’immigration/alliance mondiale pour les vaccins et l’immunisation (GAVI) (21 millions d’euros), ayant été à l’initiative de la création de certains de ces organismes.
La France a récemment accentué son effort dans le domaine de la santé, où elle est désormais le deuxième donneur en volume après les États-Unis et le premier par rapport à son produit intérieur brut. Elle devra financer sa promesse de contribution au Fonds mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme (FMLSTP) pour un montant de 1,08 Md€, soit 360 M€ par an entre 2011 et 2013.
Le FMLSTP est une institution financière multilatérale, indépendante de l’ONU, qui a été créée en 2002. Défini par la présidence de la République, le niveau contributif de la France a régulièrement augmenté depuis 2002 (50 millions d’euros) jusqu’en 2010 (300 millions d’euros). À partir de 2011, la contribution française s’est stabilisée à 1 080 millions d’euros par période de trois ans, soit 360 millions d’euros par an. Sur cette base, la France est le deuxième contributeur mondial du FMLSTP, pour 12,5 % du total annuel, et dispose, grâce à cet effort, d’un siège d’administrateur. La stabilité pluriannuelle de la contribution résulte, depuis 2011, d’une capacité de financement mixte. En effet, afin de compenser la décrue des crédits budgétaires du programme 209 et pour garantir le niveau de la contribution, des financements extrabudgétaires ont été mobilisés à partir du fonds de solidarité pour le développement (FSD), en particulier grâce à la taxe de solidarité sur les billets d’avion et à la taxe sur les transactions financières.
Le choix de la France d’attribuer une contribution volontaire d’un tel montant à une seule institution n’est pas sans conséquence sur sa participation financière aux autres organisations internationales. Cependant, il convient de noter qu’elle contribue, par le truchement du FMLSTP, à certains projets de santé mis en œuvre par des agences du système de l’ONU. Ainsi, le PNUD a reçu 420 millions de dollars de la part du FMLSTP en 2014, ce qui inclut une contribution indirecte de la France de 53 millions de dollars, montant quatre fois supérieur à celui de la contribution volontaire inscrite au programme 209, mais qui n’est pas enregistré en tant que contribution française aux ressources du PNUD.
Il reste que le montant de la contribution française au FMLSTP semble à votre rapporteur disproportionné par rapport aux enjeux, en comparaison des sommes dont dispose l’APD française dans d’autres domaines, voire sur les mêmes thématiques. Ainsi, selon plusieurs personnes auditionnées par la mission, parmi lesquelles M. Serge Michailof, le renforcement des systèmes de santé nationaux des pays destinataires de l’aide qui en sont le plus dépourvu serait dans bien des cas un moyen plus efficace de lutter contre la propagation des maladies visées par ce fonds, ainsi que d’autres pathologies.
Votre rapporteur juge donc opportun une réduction du montant consacré par la France au FMLSTP, au profit d’un renforcement des dons bilatéraux dont une partie sera consacrée au renforcement des système de santé nationaux des pays concernés.
Recommandation n° 8 Rediriger une partie du montant versé annuellement au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme au profit de l’aide bilatérale sous forme de dons. |
3. Les autres institutions multilatérales
a. Les institutions de développement onusiennes
Les institutions de développement onusiennes ne sont pas une destination prioritaire de l’aide publique au développement française, qui demeure principalement tournée vers les canaux européens et les fonds verticaux.
En 2016, 17 entités des Nations unies ont bénéficié d’une contribution volontaire versée à partir de l’action 05 du programme 209. Ce nombre est en légère baisse depuis 2010 et correspond à la poursuite de la concentration de l’effort financier de la France. La répartition des contributions volontaires répond à une double exigence de priorisation sectorielle et de performance des activités des entités bénéficiaires. Concernant les dix dernières années, le tableau ci-dessous retrace les principales contributions volontaires (plus de 10 millions d’euros sur la période).
Classement par ordre décroissant des contributions pour la période 2006-2016 (millions d’euros).
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Total | |
HCR |
14,6 |
15,6 |
15,7 |
16,0 |
14,5 |
13,8 |
15,2 |
15,0 |
14,7 |
35,8 |
33,9 |
204,8 |
UNICEF |
14,3 |
13,8 |
12,7 |
10,0 |
9,0 |
1,4 |
4,3 |
3,4 |
3,5 |
10,4 |
11,4 |
94,1 |
PAM |
4,2 |
3,5 |
3,2 |
0,1 |
17,1 |
11,0 |
39,0 | |||||
PNUD |
26,0 |
29,5 |
29,7 |
26,0 |
18,0 |
16,0 |
13,8 |
13,8 |
13,5 |
10,6 |
9,2 |
206,1 |
UNRWA |
5,6 |
7,0 |
6,0 |
5,5 |
5,0 |
4,5 |
5,9 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
9,0 |
66,5 |
BCAH |
0,7 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
6,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
3,0 |
17,7 |
OMS |
3,0 |
2,3 |
2,7 |
2,6 |
2,6 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
3,6 |
2,3 |
28,3 |
HCDH |
2,2 |
1,9 |
1,8 |
1,7 |
1,7 |
2,1 |
2,1 |
2,2 |
1,4 |
2,0 |
2,0 |
21,9 |
ONUDC |
1,2 |
1,6 |
1,7 |
1,7 |
1,5 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,0 |
1,1 |
16,2 |
FNUAP |
1,9 |
2,5 |
2,5 |
2,2 |
1,9 |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
14,0 |
Source : Direction générale du Trésor
Il convient cependant de mentionner la contribution de 100 millions d’euros sur deux ans annoncée par le Président de la République en septembre 2015 en faveur de l’aide aux réfugiés, dont la répartition est détaillée dans le tableau ci-dessous (en millions d’euros) :
2015 |
2016 |
Total | |
HCR |
18 |
16 |
34 |
PAM |
17 |
11 |
28 |
UNICEF |
7 |
8 |
15 |
CICR |
5 |
2 |
7 |
SRTF* |
|
3,5 |
3,5 |
UNRWA |
|
3 |
3 |
BCAH |
|
2 |
2 |
Total |
47 |
45,5 |
92,5 |
*Syria Recovery Trust Fund |
| ||
(Source : Direction générale du Trésor)
Cet effort exceptionnel a permis de retrouver un niveau global de contribution légèrement supérieur à celui qui avait été maintenu jusqu’en 2008.
En deuxième lieu, en plus des crédits de l’enveloppe dédiée aux contributions volontaires aux Nations unies de Programme 209, la France s’est engagée entre 2011 et 2015, à travers le Fonds Français Muskoka (créé suite au sommet du G8 tenu à Muskoka au Canada en 2010), à investir un montant total annuel (19 millions d’euros hormis en 2015). Ces crédits ont bénéficié au travail conjoint de quatre agences des Nations Unies – l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’ONU Femmes, le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)- afin de soutenir des programmes en faveur de la santé maternelle et infantile. Les contributions françaises sont retracées dans le tableau suivant (en millions d’euros) :
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2011-2015 | |
OMS |
4,50 |
4,50 |
4,62 |
4,85 |
3,70 |
22,17 |
UNICEF |
8,50 |
8,50 |
8,77 |
8,50 |
6,25 |
40,52 |
FNUAP |
5 |
5 |
4,70 |
4,70 |
3,60 |
23 |
ONUFemmes |
1 |
1 |
0,92 |
0,95 |
0,70 |
4,57 |
TOTAL |
19 |
19 |
19 |
19 |
14,25 |
90,25 |
(Source : Direction générale du Trésor)
b. Les banques multilatérales de développement (BMD)
Les banques multilatérales de développement (BMD) financent aujourd’hui des projets dans des secteurs ou domaines variés (infrastructures, agriculture, promotion de l’égalité́ hommes-femmes, renforcement des capacités administratives), participent de l’élaboration de normes internationales et mettent en œuvre des mesures de soutien lors de crises. Certaines sont anciennes comme la Banque interaméricaine de développement (1959), la Banque mondiale (1944), la banque asiatique de développement (1966) ou encore la Banque africaine de développement (1964). D’autres sont plus récentes comme la banque européenne pour la reconstruction et le développement (1990), la Nouvelle banque de développement et, dernière-née (2016), la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures.
La principale contribution française à cet ensemble passe par l’Association internationale de développement, guichet concessionnel de la Banque mondiale, dont la reconstitution pluriannuelle a fait l’objet en 2017 d’une contribution française de 345,9 millions d’euros, soit le même montant qu’en 2016.
Les ressources de l’AID sont reconstituées tous les trois ans. Elles proviennent des contributions volontaires des États (52 Md USD pour l’AID-17, sur la période 2015-2017), et de ressources propres de l’AID, constituées des remboursements de ses prêts et du transfert d’une partie du résultat de la BIRD et de la SFI.
En s’engageant en décembre 2013 à apporter 1,7 milliard de dollars pour trois ans dans le cadre de la dix-septième reconstitution du cycle de l’AID, la France est le cinquième contributeur de l’AID-17 avec 4,9% des contributions totales des donneurs, derrière les États-Unis (11,1%), le Royaume-Uni (13%), le Japon (10%) et l’Allemagne (6,1%).
La « francophonie institutionnelle » se compose de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), des opérateurs directs que sont l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), TV5Monde, l’Université Senghor d’Alexandrie, l’Association internationale des maires et responsables des capitales et des métropoles partiellement ou entièrement francophones (AIMF) ainsi que des conférences ministérielles permanentes que sont la Conférence des ministres de l’Éducation des pays ayant le français en partage (Confémen) et la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (Conféjes).
Ses missions, énumérées dans le dans le cadre stratégique de la Francophonie adopté à l’occasion du XVe Sommet de Dakar les 29 et 30 novembre 2014 ont notamment pour finalité la solidarité et le développement. Dans le contexte de l’adoption des objectifs du développement durable, l’OIF renforce en particulier ses capacités d’éducation et de formation, de soutien à la diversité culturelle, et ses actions en direction des femmes et des jeunes au sein de l’espace francophone. La mise en œuvre de la Stratégie économique pour la Francophonie, adoptée au Sommet de Dakar, a pris en particulier la forme d’un nouveau programme de promotion de l’emploi par l’entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes.
Pour sa part, l’Agence universitaire de la Francophonie soutient les stratégies de développement des universités francophones membres et travaille, dans le cadre de son réseau de 817 établissements d’enseignement supérieur dans 106 pays, à la formation d’étudiants, d’enseignants et de chercheurs.
Le montant des contributions statutaires (CS) et volontaires (CV) de la France à l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) depuis 2006 s’établit selon le tableau ci-dessous (en millions d’euros) :
Contributions statutaires |
Contributions volontaires | |
2006 |
11,764 |
19,766 |
2007 |
12,058 |
19,823 |
2008 |
12,389 |
19,628 |
2009 |
12,699 |
19,929 |
2010 |
13,017 |
17,790 |
2011 |
13,342 |
14,000 |
2012 |
13,676 |
13,447 |
2013 |
14,018 |
12,567 |
2014 |
14,018 |
10,466 |
2015 |
14,262 |
10,467 |
2016* |
14,476 |
74,193 |
(*) après déduction de la réserve de précaution
S’ajoute à ces contributions, le montant du loyer de la Maison de la Francophonie (soit 5,6 M€ en 2016) qui constitue un engagement obligatoire (convention internationale signée en 2009).
La contribution de la France à l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) n’a pas de caractère formellement obligatoire car l’AUF n’est pas une organisation internationale. Elle est toutefois indispensable au fonctionnement même de l’Agence dans la mesure où elle représente plus de 60% de ses ressources et apparaît de ce fait comme une contribution quasi-obligatoire. Elle s’établit ainsi depuis 2007 (en millions d’euros) :
2007 |
27901317 |
2008 |
19402065 |
2009 |
26819733 |
2010 |
27008363 |
2011 |
25500000 |
2012 |
25500000 |
2013 |
25500000 |
2014 |
22275000 |
2015 |
21595000 |
2016 |
19200000 |
(*) après déduction de la réserve de précaution
La totalité des contributions, obligatoires ou volontaires, versées par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international à l’OIF et à l’AUF relèvent du programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement». Il en va de même pour la prise en charge du loyer de la Maison de la Francophonie.
Toutes les contributions à l’OIF et aux opérateurs de la Francophonie, y compris le loyer de la Maison de la Francophonie, sont déclarées au titre de l’aide publique au développement.
En termes de thématiques, la francophonie intervient en particulier dans le domaine de l’éducation primaire et de l’enseignement du français. L’éducation est évidemment une thématique dont la prise en charge par la francophonie est évidemment souhaitable pour la France, mais également pour les pays francophones destinataire de l’aide, pour lesquels le français joue un rôle de langue véhiculaire d’une importance cruciale du point de vue de la cohésion sociale.
Le programme ELAN-Afrique (« École et langues nationales »), lancé en janvier 2012 à titre expérimental, doté de 4,5 millions d’euros, financé par l’AFD et mis en œuvre par l’OIF avec l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) a ainsi pour objectif de promouvoir dans huit pays – le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la RDC, le Mali, le Niger et le Sénégal – le développement progressif de l’enseignement primaire bilingue langues nationales/français, par le renforcement des capacités des pays en ingénierie linguistique, l’élaboration d’une planification linguistique, l’adaptation des programmes scolaires et l’élaboration des supports didactiques pour l’enseignement bilingue, la formation des enseignants bilingues, la sensibilisation à l’enseignement bilingue, le renforcement du suivi-éducation de l’enseignement bilingue.
Outre la question des moyens matériels, l’enseignement primaire en française se heurte cependant principalement au manque d’enseignants. Le besoin de formation (initiale et continue) des professeurs concerne des centaines de milliers de personnes, tout particulièrement dans le primaire.
C’est pour répondre à ce besoin qu’a été lancée l’Initiative Francophone pour la formation à Distance des Maîtres, né de la mutualisation des moyens de l’Agence Universitaire de la Francophonie et de l’OIF, à la demande des chefs d’État et de gouvernement réunis en Sommet à Bucarest en 2006. IFADEM propose un dispositif de formation en partie à distance conçu et mis en œuvre conjointement avec le ministère en charge de l’éducation de base. Les participants sont le Bénin, le Burundi, Haïti, le Liban, Madagascar, le Niger, la République démocratique du Congo et depuis cette année le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et le Togo. Le premier objectif de l’Initiative est de mettre en œuvre des dispositifs de formation hybride, en introduisant progressivement l’usage des technologies de l’information et de la communication pour l’éducation (TICE). Le second est d’améliorer les méthodes d’enseignement à la faveur de pratiques innovantes, de l’emploi de nouveaux outils didactiques et de nouvelles méthodes pédagogiques. Il s’agit également de renforcer la professionnalisation des formateurs locaux et d’appuyer la définition de stratégies de formation continue des enseignants du primaire. L’enjeu est bien sûr de créer un écosystème permettant d’assurer la pérennité de l’amélioration du système éducatif.
C. PILOTER ET SÉLECTIONNER L’AIDE MULTILATÉRALE
1. Promouvoir les modes de fonctionnement français dans l’enceinte multilatérale
L’influence de la France, et par conséquent sa capacité à orienter l’aide multilatérale vers ses priorités, dépend beaucoup de la stratégie adoptée vis-à-vis de ces institutions. Il convient donc de dépasser la division traditionnelle entre aide bilatérale et multilatérale et de mettre en œuvre une stratégie adaptée à une gamme d’instruments et d’acteurs complémentaires aujourd’hui fortement diversifiée.
En termes financiers, l’aide publique au développement française est majoritairement bilatérale. La part de l’aide française transitant par des organismes multilatéraux a cessé d’augmenter et s’élève en 2015 à 43 %, l’Union européenne constituant son principal vecteur, en incluant à la fois le budget général et les différents fonds, et le FED qui reste extrabudgétaire.
Concernant les institutions financières internationales, la France est un contributeur non négligeable à l’AID. Enfin, ces quinze dernières années, la participation française aux fonds verticaux a augmenté de façon notable.
La contribution aux instances onusiennes est généralement d’un ordre de grandeur inférieur. Ainsi, comme le signalait devant la mission d’information M. Sébastien Lyon, directeur général d’Unicef-France, la contribution française à l’Unicef est par exemple de l’ordre d’une dizaine de millions d’euros, alors que l’Allemagne contribue à cette organisation à hauteur d’environ 200 millions d’euros et le Royaume-Uni à hauteur de 350 millions d’euros. Ce type de contribution résiduelles ou symboliques de la part de la France visent principalement à rester politiquement présents à l’ONU, mais ne permettent pas à la France d’orienter les choix des institutions concernées de façon décisive.
Dans la loi de finances pour 2016, les contributions volontaires au système des Nations unies (figurant à l’action 05 « coopération multilatérale » du programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement ») se sont élevées à 49,1 millions d’euros. L’application de la réserve de précaution de 8 % a conduit à un montant disponible de 45,2 millions d’euros. Une dotation exceptionnelle de 50 millions d’euros a été attribuée au programme 209 pour la mise en œuvre de l’engagement présidentiel en faveur des migrants. 45,5 millions d’euros ont été fléchés vers les contributions volontaires aux Nations unies.
La répartition de ce montant est arbitrée par le comité de pilotage des contributions. Ce comité réunit les services du ministère des Affaires étrangères et du Développement international qui œuvrent dans les domaines des Nations unies et du développement. La France verse la plus grande partie de ses contributions volontaires au profit d’activités opérationnelles de développement, humanitaires et d'urgence, conduites par les fonds et programmes des Nations unies (PNUD, HCR, UNICEF, UNRWA qui représentent 81 % de l’enveloppe allouée).
L’aide au développement et les enjeux relatifs à l’influence française déterminent le choix des entités auxquelles la France participe financièrement. La France contribue aux fonds et programmes des Nations unies ainsi qu’aux institutions spécialisées des Nations unies. Les fonds et programmes ne sont financés qu’à partir des contributions volontaires contrairement aux institutions spécialisées qui bénéficient des contributions obligatoires des États-membres. La présence au sein des conseils d’administration des fonds et programmes étant parfois liée au respect d’un seuil minimal de contributions, la France s’attache à respecter ces seuils afin de participer à la programmation stratégique des fonds et programmes.
La majorité des contributions est employée à financer le budget général des entités bénéficiaires. Elles ne sont pas affectées ou fléchées au financement de programmes ou projets spécifiques. Ce choix de « non affectation » des contributions volontaires répond à la volonté de respecter les mandats déterminés par les actes constitutifs ou les conseils d’administration des entités soutenues, ce que les contributions « fléchées » affaiblissent. Ce procédé contribue ainsi à la soutenabilité financière du système multilatéral. Pour autant, une part des contributions est affectée à des programmes d’urgence ou stratégiques s’inscrivant dans les objectifs prioritaires de l’aide au développement de la France. Ainsi, la contribution au profit du HCR est affectée pour un tiers à des programmes d’urgence soutenus par la France (crises notamment).
La réduction progressive de l’enveloppe globale des contributions volontaires aux fonds et programmes des Nations unies s’est traduite par une concentration toujours plus forte de l’effort financier sur quatre organisations : le HCR, le PNUD, l’UNRWA et l’UNICEF. Ces quatre entités ont recueilli 80 % des contributions volontaires en 2015.
Cette baisse a creusé l’écart qui sépare la contribution de la France de celles du Royaume-Uni (1,5 milliards d’euros) ou de l’Allemagne (890 millions d’euros) en tant que bailleur humanitaire. Lors de la dernière évaluation par les pairs de l’OCDE, en 2013, l’insuffisance de nos crédits humanitaires a été de nouveau soulignée. Selon ce rapport, la France alloue moins de 1 % de son APD à l’aide humanitaire alors que les pays du Comité d’aide au Développement (CAD) de l’OCDE lui consacrent en moyenne 8,2 %.
La réflexion n’a cependant jamais cessé au sein de l’administration à propos de la répartition entre bilatéral et multilatéral. Contrairement à d’autres États, la diplomatie française n’a pas besoin d’une forte insertion dans les instances multilatérales pour « rentrer » dans certains pays car son réseau est universel et la diplomatie française est d’entrée de jeu présente sur l’ensemble des crises. En cela, la situation de la France diffère par exemple de celle de l’Espagne, qui a pu étendre sa coopération via certains canaux multilatéraux, et atteindre ainsi des destinataires avec lesquels elle entretenait très peu de relations bilatérales.
Dans le cas de la France, la répartition entre aide bilatérale et multilatérale est fondée sur une réflexion de longue durée visant principalement à rendre l’action de la France efficace tout en lui permettant, lorsque la volonté politique est présente mais que les moyens sont insuffisants, d’agréger des partenaires autour d’objectifs.
b. Combiner l’action des différents types d’acteurs
La politique française de coopération internationale est mise en œuvre à travers trois principaux canaux : nos opérateurs bilatéraux, les instruments de coopération européens, et les organisations multilatérales. Bien que ces trois types d’institution répondent à des logiques de fonctionnement et des modèles de gouvernance différents, l’interdépendance de leurs activités est considérable. Il paraît donc intéressant de penser l’action de la France à travers ces différents canaux de façon intégrée.
À cet égard, une approche dépassant l’opposition entre instruments bilatéraux et multilatéraux doit être privilégiée. Tirant profit des complémentarités existantes entre ces différents instruments d’intervention, une articulation entre aide bilatérale, aide européenne et aide multilatérale peut être envisagée à quatre niveaux : le financement des actions de coopération, la mise en œuvre des projets financés, la couverture géographique de l’action plurilatérale et sa couverture sectorielle.
Sur le plan financier, le développement de nouveaux montages entre financements français bilatéraux et financements gérés par les partenaires multilatéraux de la France présenterait le triple avantage de rapprocher des équipes françaises travaillant habituellement de façon séparée ; de créer des effets de leviers considérables, notamment à travers l’extension ou la création de nouvelles facilités de mixage prêts/dons ; et d’acquérir un droit de regard et une influence dans la définition de programmes dont l’échelle dépasse la capacité d’action bilatérale de la France.
Sur le plan opérationnel, une telle approche inciterait les opérateurs français à adapter davantage leur offre aux demandes formulées par nos partenaires multilatéraux et améliorerait leur positionnement vis-à-vis des demandes de nos partenaires multilatéraux.
Sur le plan géographique, le renforcement du dialogue avec nos partenaires permettrait à la France d’orienter davantage l’aide internationale vers ses priorités stratégiques, notamment les dix-sept pays pauvres prioritaires du point de vue de la coopération française.
Enfin, sur le plan sectoriel, l’articulation entre nos instruments bilatéraux, européens et multilatéraux se traduirait pareillement par un renforcement des dialogues conduits avec nos différents partenaires et un meilleur positionnement français dans la définition collective des besoins sectoriels les plus urgents à l’échelle de chaque pays d’intervention.
c. Réduire la fragmentation de l’aide internationale
La France a cependant tout intérêt à s’efforcer, dans la mesure de ses moyens, de réduire la fragmentation actuelle de l’aide multilatérale. Le comité d’aide au développement de l’OCDE répertorie près de 200 organisations multilatérales éligibles à l’aide publique au développement (APD) et plus de 1700 fonds fiduciaires rattachés. Bien qu’une gamme diversifiée d’instruments de coopération présente des atouts, les inconvénients de cette fragmentation continue d’un paysage multilatéral déjà complexe tendent dorénavant à prévaloir.
Pour les récipiendaires, l’augmentation du nombre d’organisations, de fonds et de programmes se traduit par une hausse significative des coûts de transaction associés à la gestion des différents partenariats.
Cette complexité bureaucratique se traduit par des difficultés et une certaine inefficacité dans l’allocation et l’usage de l’aide. Pour Serge Michailof, auditionné par la mission, dans un pays comme le Mali, « Il y a trois ou quatre ministères centraux (finances, plan affaires étrangères, budget) et une douzaine de ministères techniques qui se disputent les fonds ; et de l’autre côté une trentaine de donneurs, un millier d’ONG, et aucune coordination. »
Pour les bailleurs, cette diversification institutionnelle entraine également d’importants coûts de transaction (notamment en matière de suivi) et une capacité réduite de contrôle sur la duplication d’initiatives et la coordination des stratégies définies par ces différentes structures. Sur le plan systémique, la complexification croissante du paysage multilatéral pourrait remettre en question, ou rendre inopérante, l’idée même de coordination des déclarations de Paris et d’Accra et de l’accord de partenariat de Busan.
- Promouvoir des mécanismes de financement multi-bailleurs en encourageant les bailleurs nationaux à coordonner leur recours aux contributions fléchées tout en décourageant le financement d’initiatives isolées.
- Promouvoir l’alignement stratégique des fonds fiduciaires sur les orientations générales de leur organisation de rattachement.
- Contribuer à la réflexion sur l’agenda de l’efficacité de l’aide en prenant en considération la multiplication des acteurs du développement, l’implication croissante du secteur privé et la substituabilité de ces différents agents. Multiplier les procédures de coordination administrative n’est peut-être plus aujourd’hui la meilleure réponse aux différents besoins des acteurs du développement.
- Promouvoir l’utilisation des systèmes nationaux, notamment en matière de règles de passation de marchés et de sauvegardes environnementales et sociales, en tirant ces règles par le haut.
2. Promouvoir les intérêts français
a. Mieux équiper les acteurs français actifs dans l’enceinte multilatérale
La défense des intérêts français dans l’enceinte multilatérale peut tout d’abord s’appuyer sur des mesures de bon sens. Il est ainsi important de faciliter la diffusion d’informations clefs afin de favoriser le positionnement stratégique de nos acteurs nationaux, qu’il s’agisse des ONG, des entreprises ou d’opérateurs comme Expertise France, dans la participation ou la mise en œuvre de projets financés par des contributions multilatérales.
Mme Claverie de Saint-Martin, directrice adjointe du développement durable au ministère des Affaires étrangères, a ainsi insisté lors de son audition sur le rôle d’orientation et de conseil que joue la délégation française auprès de la Banque mondiale vis-à-vis des ONG et des collectivités territoriales françaises dans leurs démarches auprès de la Banque.
Le rôle des pouvoirs publics français est en effet essentiel en termes d’information et de mise en relation. Le dispositif français de représentation dans les organisations internationales et dans les institutions financières internationales permet d’ores et déjà, en coordination avec les ministères de tutelle et les ambassades, de créer un lien entre les enceintes multilatérales et les entreprises françaises. Rapporté à nos parts en capital dans les BMD auxquelles nous contribuons, le bilan des appels d’offres remportés par nos entreprises est cependant varié : positif dans certains cas (BM, BAD), négatif dans d’autres (BERD, BAsD et BID).
Pour répondre à cet enjeu, la direction générale du Trésor a élaboré un plan d’action visant à mieux structurer ce dispositif et à mieux informer nos entreprises sur les opportunités offertes par les institutions financières internationales. L’objectif de ce plan d’action est, en partenariat avec Business France et le MEDEF International, de sensibiliser les entreprises françaises à l’importance des financements que mobilisent les banques multilatérales de développement et aux opportunités qui en résultent, aussi bien en termes d’appels d’offre que de financement d’expertise et de projets d’investissements. Les entreprises françaises sont notamment bien placées dans le secteur des partenariats public-privé compris au sens large, c’est-à-dire incluant les concessions de service public en matière de routes, de bâtiments publics ou de services municipaux et pourraient mieux se positionner dans ce domaine. Ce plan a notamment abouti, en septembre 2015, à la signature d’un protocole d’accord entre la direction générale du Trésor, le MEDEF international et Business France en vue de mieux structurer les liens entre les entreprises françaises et les institutions financières internationales pour la période 2015-2017.
Plus généralement, les institutions multilatérales de développement, et notamment les banques multilatérales de développement, sont des enceintes productrices de normes au sein desquelles l’influence exercée par la France peut avoir des effets durables. Cette influence repose le plus souvent sur la capacité de la France à mobiliser des volumes significatifs, mais les institutions multilatérales peuvent également compter sur une mobilisation du savoir-faire français, même lorsque la participation française est relativement réduite, comme dans le cas de la Banque asiatique d’Investissement dans les Infrastructures (BAII).
C’est pourquoi défendre les intérêts des opérateurs et des entreprises françaises au sein des institutions multilatérales de développement n’est pas seulement économiquement utile, mais contribue également à la diffusion des valeurs et des priorités françaises dans le reste du monde. Même si le critère primordial doit rester l’impact en termes de développement des politiques suivies, il demeure pertinent pour la France de tenir compte des intérêts économiques français, dans la perspective d’un bénéfice mutuel, l’appui aux entreprises françaises se traduisant par l’apport aux institutions multilatérales de développement d’une expertise sectorielle reconnue.
b. Promouvoir l’expertise française au sein des organisations multilatérales
La France dispose d’une expertise reconnue en matière d’aide au développement, qu’il importe de promouvoir. Cette expertise se retrouve à travers différentes sphères d’activité, qu’il s’agisse du monde académique, du secteur privé (associations, fondations et entreprises) ou des services français de coopération (Agence française de développement, Expertise France, direction du développement durable/MAEDI, DG Trésor/Ministère des finances).
Les administrations concernées, au premier chef les affaires étrangères et les finances, pilotent depuis longtemps une stratégie de promotion des compétences françaises au sein des organisations internationales. Des marges de progression existent sans doute encore pour que l’expertise française influe davantage sur les orientations idéologiques et stratégiques du système multilatéral. Ces efforts peuvent notamment s’appuyer sur le renforcement des dialogues structurés, impliquant les services compétents et les différents acteurs de la société civile concernés par les thématiques traitées, qui peuvent alimenter les analyses et les efforts de réflexion menés en amont de l’élaboration des stratégies sectorielles françaises.
Une stratégie d’influence systémique peut ainsi s’appuyer sur les différents leviers dont la France dispose, parmi lesquels la production intellectuelle et les partenariats de recherche, le positionnement de nos opérateurs dans les appels d’offre lancés par nos partenaires multilatéraux, le placement d’agents français dans les organisations stratégiques ; la mise en œuvre de collaborations stratégiques non-financières avec certaines organisations multilatérales, la signature d’accords de co-financements avec les organisations multilatérales dont la France est membre ainsi que les partenaires multilatéraux ne recevant aucune contribution française.
c. Encourager la définition d’orientations stratégiques différenciées pour les pays les moins avancés (PMA)
Une meilleure insertion française au sein des institutions multilatérales de développement et une plus grande influence française au sein de ces dernières peuvent permettre d’orienter l’action de ces dernières vers les domaines dans lesquels une certaine inefficacité leur est le plus souvent reprochée. Il en va ainsi des politiques d’aide au développement destinées aux pays fragiles et menacés par l’instabilité politique.
La France peut ainsi encourager les organisations internationales concernées à porter une attention particulière à la situation d’endettement des pays les moins avancés et à y favoriser une allocation des instruments les plus concessionnels. Afin de compenser la baisse de ressources concessionnelles occasionnée chez les pays à revenus intermédiaires, la France peut encourager les organisations internationales à accompagner cette stratégie par une hausse des ressources peu ou non-concessionnelles auprès de ces pays. La création et l’extension de facilités de mixage prêts-dons peuvent aider à lever et canaliser ces nouveaux financements.
Cette approche différenciée vise donc à optimiser l’utilisation des ressources disponibles en vue de répondre, d’une part, aux besoins les plus urgents dans les pays les moins avancés et d’autre part, aux besoins de financement croissants des pays à revenus intermédiaires.
d. Promouvoir des stratégies d’intervention multilatérales mieux adaptées aux contextes de crise et de fragilité
Par ailleurs, la France peut inciter les organismes multilatéraux à mettre en place des stratégies d’interventions adaptés aux États fragiles. Ces derniers se caractérisent par des situations d’extrême vulnérabilité économique, sociale et institutionnelle, faisant face à des crises humanitaires imminentes dont les causes peuvent être naturelles ou politiques, éventuellement secoués par des conflits armés. Les États fragiles en phase de reconstruction ou de sortie de crises sont du reste susceptibles de basculer à nouveau dans l’une de ces situations. Leur fragilité ne se limite pas à l’économie et à l’appareil étatique, mais concerne également les sociétés, en raison notamment d’une rupture du contrat social.
Cette vision de la fragilité gagnerait à être promue dans l’enceinte multilatérale, tant sur le plan stratégique qu’opérationnel. Plus influente dans les enceintes internationales, la France serait en mesure de promouvoir des politiques visant aux objectifs suivants :
- Le renforcement en amont des politiques d’intervention sur la prévention des crises, en améliorant notamment la résilience des populations face aux chocs exogènes et endogènes ;
- L’harmonisation des stratégies de réponse aux crises au sein des différentes structures des organisations multilatérales et des modalités opérationnelles locales sur la base d’une action collective inscrite dans le continuum urgence-réhabilitation-développement (et sécurité dans les contextes de violences armées) ;
- La poursuite du plaidoyer pour l’utilisation d’instruments adaptés à l’urgence, dotés de souplesse et d’une capacité de déboursement rapide, à l’instar des outils comme le fonds Bêkou ou le fonds fiduciaire pour l’Afrique de l’Union européenne, que la France a soutenus dès leur création ;
- La mise en place d’un cadre opérationnel dynamique permettant aux organisations multilatérales d’adapter la composition de leurs équipes locales dès l’émergence d’une situation de crise. La présence de personnel spécialisé s’avère en effet nécessaire afin d’adapter le programme et les modalités d’action des équipes locales à des enjeux dépassant le cadre de leurs fonctions usuelles. La rapidité est également
- Le renforcement de la légitimité des États ainsi que des institutions locales dans leur capacité à remplir leurs missions régaliennes, à fournir des services de base, et à élargir l’espace civique pour une gouvernance inclusive.
Recommandation n° 9 Charger le Conseil national du développement et de la solidarité internationale (CNDSI) d’émettre régulièrement un avis sur les contributions françaises aux organismes multilatéraux et d’auditionner les représentants de la France auprès de ces organismes préalablement à leurs nominations, ce qui permettra d’associer plus étroitement les ONG et les collectivités territoriales aux orientations de la stratégie d’aide française au sein des organismes multilatéraux. |
IV. CHERCHER DE NOUVELLES STRATÉGIES FINANCIÈRES
La réorganisation institutionnelle et la réorientation stratégique de l’aide publique au développement française ne rendront cette dernière plus efficace que dans la mesure où son financement demeurera à la hauteur de ses besoins. L’aide publique au développement de la France doit, comme toutes les autres politiques publiques, être mise en œuvre avec les moyens qui lui sont accordés.
Les moyens de l’aide publique au développement française ont évolué depuis les années soixante de façon irrégulière, avec des périodes de hausse et de baisse, et une diminution des budgets pendant la première moitié des années 2010. La stabilisation puis l’augmentation engagées depuis 2016 sont encourageantes et ce rapport recommandera leur poursuite.
L’aide publique au développement, dont le champ d’action et de réflexion s’est considérablement élargi, ne peut toutefois se contenter des financements publics traditionnels si l’on veut qu’elle soit à la hauteur de ses ambitions. La mission s’est par conséquent intéressée à plusieurs formes de financement de l’aide, directes ou indirectes, qui doivent être mises en cohérence avec les financements publics.
A. LES LIMITES DE L’APPROCHE BUDGÉTAIRE
1. Le nécessaire accroissement des budgets
a. Une augmentation régulière de l’APD mondiale
La multiplication des donneurs depuis les années quatre-vingt-dix rend difficile de mesurer l’augmentation exacte du volume total de l’aide au développement au cours du dernier quart de siècle. Toutefois, si l’on s’en tient aux seuls pays membres du CAD de l’OCDE, le volume d’APD auquel ils ont contribué est passé entre 1990 et 2015 de 83 715 à 146 676 millions de dollars, soit un quasi doublement, et plus qu’un doublement si l’on prend comme année de référence 1997, année où les contributions sont les plus faibles, avec 70 097 millions de dollars.
C’est en effet au cours des années 2000 que les volumes d’aide ont commencé à augmenter rapidement, après une période de croissance relativement lente et irrégulière depuis les années soixante. Entre 1960, les flux nets d’APD augmentent en effet de moins de 1 % par an en moyenne. L’augmentation est plus rapide et se situe aux environs de 4 % par an entre 1973 et 1992, après quoi les volumes d’aide tendent à baisser en proportion du PIB des pays donateurs entre 1992 et 2000, période dite de « fatigue des donneurs » au cours de laquelle une partie de l’aide internationale se réoriente en direction des pays anciennement communistes en transition.
Il est également plausible que la disparition du bloc communiste ait fait disparaître une des motivations de l’aide au développement pendant la guerre froide, consistant à maintenir les États en développement dans le camp occidental en leur fournissant une aide. La dégradation progressive de la situation internationale dans certaines régions du globe qui a eu lieu par la suite, en particulier en Afrique subsaharienne, a pu par conséquent exercer l’effet inverse et faciliter la prise de conscience des pays donateurs, les incitant à reprendre leurs efforts.
La motivation politique de l’aide au développement a toutefois évolué. S’il s’agit pendant la guerre froide de prévenir une évolution diplomatique non souhaitable de la part certains États jugés stratégiques, le constat qui s’impose progressivement à partir des années 1990 est celui de l’importance d’un développement durable et équilibré dans un monde où les interdépendances entre nations développées et pays en développement doivent de plus en plus impérativement être prises en considération.
En volume, l’origine de l’APD mondiale demeure cependant relativement concentrée sur un petit nombre de donneurs. En 2015, sur 146 676 millions de dollars versés par les pays du CAD, 92 877 millions de dollars proviennent des cinq principaux donneurs : les États-Unis (30 765 millions de dollars), l’Allemagne (20 855), le Royaume-Uni (19 919), la France (10 919) et le Japon (10 418).
Ces chiffres ne rendent cependant pas compte de l’effort fourni par chaque donneur en proportion de son PNB, avec des donneurs comme la Suède ou les Pays-Bas dépensant environ deux fois plus par habitant que la France ou les États-Unis.
Il est à noter que l’Afrique subsaharienne a été entre 1998 et 2010 à la fois le premier destinataire de l’APD, en volume ou en proportion du total de l’APD, et le premier destinataire de son accroissement au cours de cette période. Sur un montant total cumulé de 904 milliards de dollars, l’Afrique subsaharienne a reçu près de 357 milliards de dollars, soit 39,5 % du montant total.
Dépenses d’APD des cinq principaux pays donateurs du CAD depuis 1960 (millions de dollars constants)
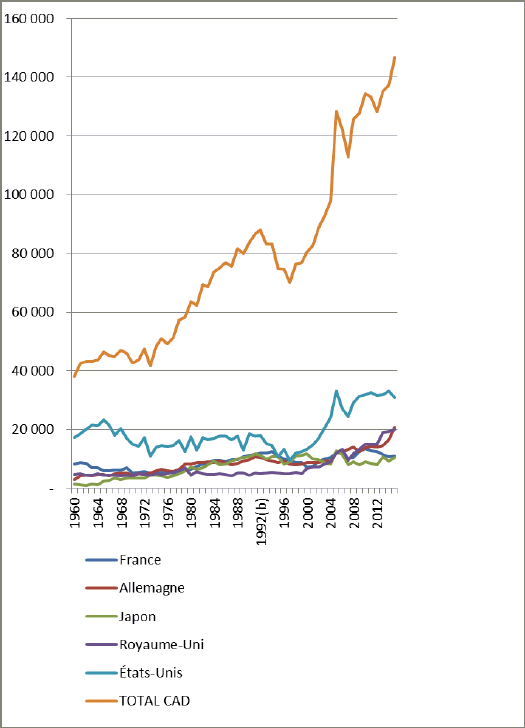
Source : CAD OCDE
b. Une APD française insuffisante
Malgré la priorité africaine marquée de la politique française d’aide au développement, l’évolution de l’APD française pendant la même période a été différente. Son montant est de 11 112 millions de dollars en 1990, de 10 919 millions de dollars en 2015, et elle atteint son maximum en 2010 avec 13 390 millions de dollars. L’APD française est donc passée d’une façon assez régulière de 13,3 % du total du CAD à 7,4 % entre 1990 et 2015.
Cette évolution s’explique autant par l’augmentation du volume d’aide total en provenance des pays du CAD que par une diminution en volume de l’aide française. Le constat de la diminution ou de l’insuffisante augmentation de l’APD française a cependant été fait chaque année depuis le début des années 2010 à l’occasion des discussions budgétaires, au cours desquelles est examiné le budget de la mission « Aide publique au développement », qui ne représente qu’une partie des dépenses publiques françaises dans ce domaine. Plusieurs observations s’imposent.
En premier lieu, comme cela est rappelé chaque année par le rapporteur budgétaire, le contrôle exercé par la représentation nationale sur l’évolution des dépenses françaises en matière d’aide publique au développement demeure limité, la mission « Aide publique au développement » ne représentant qu’une fraction du montant total de l’aide. En deuxième lieu, le montant total de l’aide n’est guère plus facile à établir sur la base des documents budgétaires fournis. En effet, l’addition des différentes actions composant la politique française d’aide publique au développement n’aboutit jamais exactement au même chiffre que le calcul qu’effectue par la suite le CAD de l’OCDE, à qui il revient de valider les différentes dépenses comme relevant ou non de l’aide publique au développement, et qui peut ainsi produire les statistiques utilisées à des fins de comparaisons internationales.
Le mode de calcul du CAD étant lui-même sujet à des modifications, notamment celle en cours, qui concerne la prise en compte des prêts aux États et des remboursements, l’évolution budgétaire réelle d’une politique d’aide au développement, française ou non, n’apparaît qu’avec un retard d’une ou de plusieurs années, ce qui fait de l’examen budgétaire un exercice quelque peu approximatif.
Il reste que la France, au vu des données de l’OCDE, n’a pas suivi le mouvement général d’accroissement de l’aide au développement observable de la part des pays du CAD, auquel il faut ajouter les montants versés par d’autres acteurs qui pour beaucoup d’entre eux n’existaient pas, ou pesaient moins, avant le commencement de la période étudiée.
Les engagements pris par le Président de la République en 2015 sont par conséquent bienvenus. La France prévoit ainsi d’augmenter ses financements de quatre milliards d’euros, dont la moitié en faveur du climat, d’ici 2020, tandis que les dons devraient augmenter de 400 millions d’euros pendant la même période, cette trajectoire financière visant à replacer la France sur le chemin de l’objectif des 0,7% du RNB d’ici à 2030.
Part en pourcentage des cinq principaux donneurs dans l’APD du CAD
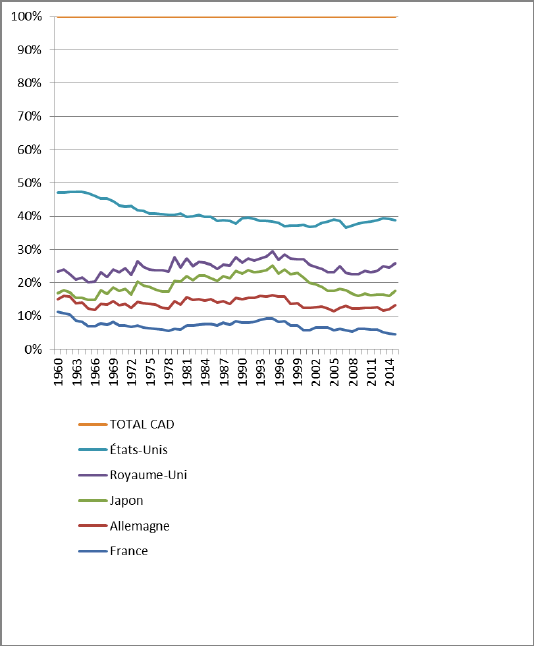
Source : CAD OCDE
Il est vrai que l’objectif du « 0,7 % » conserve un caractère indicatif. Adopté en octobre 1970 lorsque l’Assemblée générale des Nations unies a adopté une Résolution selon laquelle « chaque pays économiquement avancé accroîtra progressivement son aide officielle au développement des pays en voie de développement et s’efforcera particulièrement d’atteindre, au milieu de la Décennie au plus tard, un montant minimum en valeur nette de 0.7 % de son produit national brut aux prix du marché » (16), cet objectif a dû être réaffirmé à de nombreuses reprises et n’a été atteint que par peu de pays.
Aide publique au développement en volume et en pourcentage du revenu national brut (en millions de dollars) :
France |
Donneurs CAD | ||
2010 |
APD nette en volume |
13 390 |
134 497 |
En % du RNB |
0,5 |
0,32 | |
2011 |
APD nette en volume |
12 722 |
133 170 |
En % du RNB |
0,46 |
0,31 | |
2012 |
APD nette en volume |
12 586 |
128 119 |
En % du RNB |
0,45 |
0,29 | |
2013 |
APD nette en volume |
11 397 |
135 329 |
En % du RNB |
0,23 |
0,30 | |
2014 |
APD nette en volume |
10 620 |
137 222 |
En % du RNB |
0,36 |
0,29 | |
2015 |
APD nette en volume |
10 919 |
146 676 |
En % du RNB |
0,37 |
0,30 |
Source : OCDE CAD
Basé sur les données du CAD de l’OCDE et, par conséquent, sur les critères qu’utilise cet organisme pour valider une dépense comme relevant de l’aide publique au développement, il prête le flanc à des critiques qui ne sont pas toutes sans fondement, d’ailleurs dans les deux sens.
La France se voit ainsi reprocher d’inclure dans ses dépenses d’APD des dépenses telles que les frais d’écolage, dont la contribution réelle au développement n’est pas toujours assurée, mais elle ne peut y inclure les dépenses liées aux opérations de stabilisation et de maintien de la paix, sans lesquelles le développement des régions concernées serait compromis. Enfin, ce chiffre ne tient pas compte des dépenses d’ordre privé, dont l’importance n’a fait que croître au cours des dernières décennies.
Il reste que l’objectif des 0,7 %, qui correspond à peu de choses près à un doublement de nos dépenses en matière d’aide publique au développement, constitue une cible raisonnable sur laquelle programmer notre effort d’ici 2030, compte tenu des besoins actuels tels qu’ils ont été définis à travers l’adoption des ODD et des principes de l’accord de Paris. Enfin, la crédibilité d’un État sur la scène internationale dépend en grande partie de sa capacité à tenir ses engagements, et celui-ci ne l’a jamais été. La portée symbolique de cet engagement est par conséquent importante du fait même de son ancienneté et la France gagnerait à atteindre cet objectif dans le délai fixé par le Président de la République.
Passer de 0,37 % à 0,7 % en treize ans suppose une augmentation annuelle du budget de l’ordre de 5%. Votre rapporteur recommande par conséquent que ce chiffre soit retenu et que l’augmentation correspondante soit mise en application dans le projet de loi de finances pour 2018 ainsi que les suivants.
Il importe par conséquent que cette trajectoire soit maintenue année après année, ce qui implique qu’une augmentation de 5 % du budget de la mission « Aide publique au développement » soit inscrite annuellement dans les budgets futurs jusqu’en 2030.
Recommandation n° 10 Inscrire dans les futures lois de finances jusqu’en 2030 une augmentation annuelle de 5 % du budget de la mission « aide publique au développement ». |
c. La part des dons dans l’APD française est également insuffisante
Votre rapporteur estime qu’il est par ailleurs important de renforcer la part des dons dans le budget de l’aide publique au développement française, qui a diminué de façon quasi continue depuis 2008. Généralement utilisés pour l’appui à des projets de grande dimension ou pour des politiques visant à favoriser la croissance économique, les prêts sont surtout utiles aux États à revenu intermédiaire, qui sont en mesure d’en prévoir et d’en assumer le remboursement. Ils peuvent également, dans certains cas, inciter un État à mettre en place les instruments étatiques de gestion des finances publiques qui faciliteront son développement ultérieur, mais il s’agit rarement d’États faisant partie du groupe des pays les moins avancés.
L’aide aux pays à très faible revenu, qui vise souvent des secteurs fondamentaux comme la santé, l’éducation ou la sécurité alimentaire, doit généralement être fournie sous forme de dons, dont la diminution relative par rapport aux prêts aboutit à une situation paradoxale dans laquelle un niveau de développement minimal est requis pour qu’un pays puisse bénéficier de l’aide au développement.
En 2008, la part des dons dans l’APD française était quasiment au même niveau que dans la moyenne des autres pays du CAD. Par la suite, cette part a diminué jusqu’à atteindre 69 %, contre 76 % pour la moyenne du CAD.
Quant aux prêts, leur part en 2007 était de 9 % pour la France comme pour la moyenne des pays du CAD. En 2014, elle est de 30 % pour la France contre 12 % pour les pays du CAD.
Part des Dons (hors annulations de dette) dans l'APD totale brute |
Part des prêts bruts (hors rééchelonnement de dette) dans l'APD totale brute | |||
Année |
France |
Donneurs du CAD |
France |
Donneurs du CAD |
2003 |
53% |
72% |
7% |
10% |
2004 |
63% |
73% |
8% |
9% |
2005 |
59% |
65% |
7% |
7% |
2006 |
62% |
69% |
7% |
7% |
2007 |
76% |
77% |
9% |
9% |
2008 |
74% |
76% |
16% |
9% |
2009 |
69% |
81% |
19% |
11% |
2010 |
66% |
78% |
22% |
12% |
2011 |
63% |
77% |
27% |
11% |
2012 |
61% |
79% |
27% |
11% |
2013 |
69% |
76% |
25% |
12% |
2014 |
70% |
79% |
30% |
12% |
Source : OCDE, Dac2a
* Moyennes non pondérées des montants d’APD totale brute
Le tableau ci-dessous retrace l’évolution du montant des prêts bruts et nets comptabilisés dans l’aide publique au développement (APD) française ces cinq dernières années (en millions d'euros) :
Année |
Prêts nets |
Prêts bruts |
2011 |
1 877 |
2 828 |
2012 |
1 755 |
2 870 |
2013 |
1 347 |
2 435 |
2014* |
1 404 |
2 791 |
2015 |
1 457 |
3 118 |
Source : OCDE
Les dons, hors annulation de dette, comptabilisés dans l’APD française ces cinq dernières années ont évolué ainsi (en millions d’euros) :
Année |
2011 |
2012 |
2013 |
2014* |
2014* |
Dons (hors annulation de dette) |
6519 |
6403 |
6670 |
6579 |
6507 |
*Données définitives transmises au Secrétariat du CAD en juillet 2015, actuellement en cours de traitement et de vérification.
Un bémol doit toutefois être apporté à ces chiffres, puisque ce sont ici les dons « bruts », c’est-à-dire hors annulation de dette, qui sont pris en compte. Or, certaines annulations de dettes ont pris la forme de contrats de désendettement et de développement (C2D), dont il est question plus loin dans le présent rapport. Ce mécanisme permet précisément de transformer une annulation de dette en un contrat de développement qui se traduit par des projets concrets. Le C2D est cependant réservé de facto aux États ayant été en mesure d’emprunter les montants en question, à défaut de pouvoir les rembourser, et demeurent par conséquent généralement en dehors du champ des pays les plus pauvres.
L’augmentation des prêts au détriment des dons, combinée à l’érosion du volume global de l’aide au développement française qui a eu lieu au cours de la décennie, semble aller en sens inverse de ce qui devrait constituer nos priorités.
Recommandation n° 11 Augmenter la part des dons dans le budget de l’aide publique au développement dans la loi de finances pour 2018 |
Lors de l’examen de la loi du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, un amendement avait ainsi rédigé l’alinéa 3 de l’article 4 du texte soumis par le gouvernement :
« Le Gouvernement remet un rapport évaluant la possibilité, pour les organismes publics de l’État chargés à titre principal de l’aide publique au développement, d’utiliser comme dons, dans le cadre de la politique bilatérale d’aide au développement, le produit final des prêts qu’ils ont eux -mêmes octroyés. »
Cet alinéa a cependant été supprimé lors de l’examen du texte en séance publique, au bénéfice d’un dispositif que l’on envisageait alors de faire figurer dans le contrat d’objectifs et de moyens entre l’AFD et l’État dont l’examen devait avoir lieu la même année.
Or, les règles de Bâle III ayant entre-temps rehaussé les exigences de structuration en matière de fonds propres, le résultat de l’agence a été prioritairement affecté au renforcement de ces derniers plutôt qu’à l’augmentation de l’enveloppe de dons.
L’élargissement du champ d’action de l’AFD ces dernières années en direction des pays émergents et « très grands émergents » a été mentionnée plus haut dans le présent rapport. Cette stratégie a permis à l’AFD non seulement d’étendre les bénéfices de son activité et de diversifier son expérience, mais également d’accroître ses dividendes. Même si votre rapporteur est conscient des besoins de l’agence en matière de fonds propres, qui conditionnent entre autres choses la possibilité pour l’AFD de mettre en œuvre de telles stratégies, il demeure souhaitable qu’une réflexion soit engagée dans le sens de l’amendement cité plus haut.
Recommandation n° 12 Évaluer la possibilité, pour les organismes publics de l’État chargés à titre principal de l’aide publique au développement, d’utiliser comme dons, dans le cadre de la politique bilatérale d’aide au développement, le produit final des prêts qu’ils ont eux-mêmes octroyés |
d. La part de l’APD française transitant par les ONG
Il convient enfin de rappeler, comme l’a fait M. Philippe Jahshan, président de Coordination Sud auditionné par la mission, que la part de l’APD française transitant par les ONG est d’environ 3 %, d’après les données du CAD de l’OCDE, quand la moyenne des pays de l’OCDE est d’environ 13 %.
L’importance du rôle des ONG dans l’aide au développement ne doit pas être sous-estimé. Les ONG sont ainsi en mesure de mobiliser des savoir-faire dont les opérateurs publics ne disposent pas toujours. Du fait de leur indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics, elles sont également en mesure d’opérer dans des endroits où les États ne vont pas, comme l’a souligné M. Jahshan.
L’engagement du président de la République au début de son mandat de doubler la part de l’APD française transitant par les ONG s’est traduit par une trajectoire d’augmentation réelle, bien que jugée insuffisante par Coordination Sud. Votre rapporteur estime que cette trajectoire devrait cependant être poursuivie en même temps que la recherche d’une meilleure coordination de leurs actions.
Recommandation n° 13 Poursuivre l’augmentation de la part de l’aide publique au développement française transitant par les ONG afin de mieux mobiliser leur savoir-faire et leur capacité d’action. |
2. Le FSD et les taxes innovantes
En dehors de la mission « Aide publique au développement », le parlement dispose d’un levier particulier puisque la loi de finances permet de modifier, par amendement, l’assiette et le montant de deux taxes, la taxe sur les billets d’avion et la taxe sur les transactions financières, dont les recettes nourrissent le Fonds de Solidarité pour le Développement (FSD).
Conçu pour faire office de réceptacle aux deux taxes en question, le FSD permet en quelque sorte de « sanctuariser » cette partie des crédits de l’aide publique au développement, le FSD a cependant souffert de deux problèmes principaux.
En premier lieu, les financements innovants que sont la taxe sur les billets d’avion et la taxe sur les transactions financières, qui constituent les ressources du FSD, avaient vocation, lorsqu’ils ont été mis en place, à s’additionner à l’effort français d’aide au développement, et non à s’y substituer. Or, c’est en partie ce qui s’est passé à diverses reprises à l’occasion de transfert de dépenses d’un poste budgétaire à l’autre.
En deuxième lieu, le détail de l’affectation exacte des ressources du FSD ne faisant pas l’objet d’une présentation régulière et détaillée du même ordre que le budget de l’État, une partie de l’aide au développement s’est par conséquent trouvée transférée vers un mécanisme de financement moins transparent qui échappe pour partie au contrôle parlementaire.
Ces problèmes devraient être en partie réglés par le Décret n° 2016-1684 du 5 décembre 2016 portant modification du décret n° 2006-1139 du 12 septembre 2006 sur le Fonds de solidarité pour le développement, qui précise ainsi l’affectation des recettes du FSD :
« Les recettes affectées au Fonds de solidarité pour le développement sont utilisées pour le paiement des contributions à la facilité de financement internationale pour la vaccination (IFFIm). Elles financent également les dépenses d'aide multilatérale et, à titre subsidiaire, bilatérale en faveur du développement principalement dans les domaines de la santé, du climat et de l'environnement. »
Ce décret devrait contribuer à la « sanctuarisation » du FSD tout en précisant l’affectation des sommes qui y sont déposées.
Il reste cependant à accroître ces dernières dans la mesure du possible. Plusieurs mesures ont été prises à l’initiative du parlement à l’occasion de l’examen des budgets pour 2016 et 2017, permettant d’accroître la part des recettes de la TSBA et de la TTF affectées au FSD, ainsi que l’augmentation du taux de la TTF, de 0,2 à 0,3 % lors de l’examen du budget pour 2017.
Une mesure supplémentaire adoptée lors du dernier examen budgétaire a été l’élargissement de l’assiette de la TTF aux transactions journalières, mesure susceptible d’en doubler la recette, votée lors de l’examen du budget pour 2016 mais invalidée par le Conseil constitutionnel. L’inclusion de l’« intraday » a bien été validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016, mais n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2018.
Votre rapporteur se contentera donc de recommander que cette entrée en vigueur ait bien lieu à la date prévue.
Recommandation n° 14 Veiller à ce que l’extension du champ de la taxe sur les transactions financières aux acquisitions à titre onéreux de titres de capital dites « intra-journalières », qui ne donnent pas lieu à un transfert de propriété ait lieu à la date mentionnée dans la loi de finances pour 2017, c’est-à-dire le 1er janvier 2018. |
B. L’ÉMERGENCE DE NOUVEAUX MODES DE FINANCEMENT
L’examen de l’évolution des dépenses d’aide publique au développement engagées par les principaux États contributeurs fait apparaître une augmentation régulière et importante à laquelle la France gagnerait à s’associer. L’aide publique au développement ne peut toutefois se limiter à des projets financés par l’argent public des pays riches, et des nouveaux modes de financement du développement ont été recherchés par l’ensemble des acteurs nationaux depuis le début des années 2000.
1. La recherche de nouveaux financements au niveau international
Même s’il faut souhaiter l’augmentation des budgets nationaux d’aide publique au développement, l’élargissement de son champ et de ses ambitions rendent nécessaire de les compléter. La recherche d’autres modes de financement de l’aide a de fait été engagée peu après l’adoption des Objectifs du millénaire pour le développement et s’est poursuivie au travers de trois étapes principales : le consensus de Monterey, la conférence de Doha et le programme d’action d’Adis-Abbeba.
La conférence internationale de Monterey, tenue en 2002, deux ans après l’adoption des objectifs du millénaire pour le développement (OMD), a été la première conférence internationale consacrée au thème du financement du développement. Le « consensus de Monterrey » auquel elle a abouti reposait sur six piliers complémentaires :
- la mobilisation des ressources nationales ;
- les investissements directs étrangers et autres apports du secteur privé ;
- le renforcement du commerce international ;
- l’accroissement de la coopération financière et technique ;
- la réduction de la dette extérieure ;
- le maintien d’une cohérence d’ensemble ;
Le consensus de Monterrey présente les grandes lignes pour la mise en œuvre et la réalisation des OMD au travers des 6 chapitres présentés. Aujourd’hui encore, ce consensus fait l’objet d’un suivi annuel régulier et la Commission européenne réalise chaque année un bilan de sa mise en œuvre.
La conférence d’Addis-Abeba et son programme d’action ont capitalisé sur ce consensus fondateur mais l’ont également fait évoluer pour tenir compte du nouveau paradigme du financement du développement durable.
La conférence de Doha de 2008 a mis en évidence de nouveaux aspects du financement du développement, avec la montée en puissance des pays émergents, à la fois bénéficiaires de l’aide et donneurs, des fonds souverains des pays exportateurs de matières premières, des grandes fondations privées et des fonds mondiaux spécialisés, notamment en matière d’environnement et de santé.
Des progrès significatifs ont ainsi été observés au cours des six années séparant la conférence de Monterrey de celle de Doha, avec une croissance économique sans précédent jusqu’à la crise financière de 2008, une augmentation continue du commerce international et des investissements directs étrangers dans les pays en développement, une forte croissance des transferts de migrants, des annulations de dettes massives et nombreuses et le doublement au cours de cette période de l’aide publique au développement.
De nouveaux mécanismes de financement de l’aide ont également été valorisés à l’initiative de la France. La déclaration de Doha mettait à jour le consensus de Monterrey qui soulignait le besoin de prendre en compte les nouveaux défis apparus, notamment les questions systémiques qui ont des conséquences importantes sur le financement des pays les plus pauvres, la nécessité de renforcer la mobilisation des ressources intérieures, la prise en compte des spécificités propres aux différentes catégories de pays en développement, la promotion d’une croissance équitable et inclusive, la reconnaissance des principes pour l’efficacité de l’aide et des premières initiatives de financements innovants.
c. Le programme d’action d’Addis Abeba
Enfin, la convergence voulue des processus « Objectifs du développement durable » et « financement du développement » au cours des dernières années s’est matérialisée lors de la 3e conférence internationale sur le financement du développement à Addis-Abeba, tenue entre le 13 et le 16 juillet 2015.
Le programme d’action d’Addis-Abeba, adopté à son issue, s’inscrit dans la vision holistique, universelle et durable du financement du développement mise en avant par la France. Les engagements en matière d’aide publique au développement y sont reflétés et le rôle de l’ensemble des acteurs, publics, privés, locaux et internationaux, dans le financement du développement durable et dans la réalisation de l’agenda 2030 y est reconnu.
Plusieurs priorités françaises sont reflétées dans le texte :
- Les ressources domestiques sont mises en avant et identifiées comme sources principales de financement stable et pérenne pour le développement durable. Au cours des négociations, la France a mis en avant ses actions dans le domaine de la coopération fiscale et a annoncé sa participation aux côtés d’une trentaine de pays à l’« initiative fiscale d’Addis ».
- Le texte valorise le rôle des sciences, des technologies et de l’innovation dans le développement durable et insiste sur le renforcement des capacités dans ces domaines. La création du mécanisme de facilitation de la technologie pour la réalisation des ODD (lancé au Sommet de New York en septembre 2015, sur une initiative Française et brésilienne) constitue l’un des principaux résultats concrets de la conférence.
- Il souligne l’importance des financements innovants et des autres mécanismes de mixage qui visent à maximiser l’effet de levier des financements versés aux pays du Sud. Les travaux du groupe pilote sur les financements innovants, dont la France assure le secrétariat permanent, sont salués.
- Il reconnait l’importance des entités locales, qui sont, de par leur proximité aux populations, des acteurs incontournables du financement du développement durable et de la mise en œuvre de l’agenda 2030 pour le développement durable. Le programme d’action d’Addis-Abeba prévoit les moyens nécessaires pour un développement durable, en prenant en compte de manière intégrée les dimensions économique, sociale et environnementale. Il accorde également une attention particulière aux pays les plus vulnérables et dans le besoin, en particulier aux pays les moins avancés (PMA). La dynamique positive amorcée par l’adoption de ce programme d’action en juillet, l’adoption des ODD en septembre a facilité l’adoption de l’Accord de Paris à l’issu de la COP 21 en décembre.
2. Favoriser l’émergence des secteurs privés du Sud
L’aide aux secteurs privés des pays destinataires de l’aide s’inscrit dans une logique d’autonomisation des économies du Sud et dans la volonté d’éviter les situations de dépendance qui ont pu être observées dans le contexte de politiques traditionnelles d’aide publique au développement. La mission d’information s’est intéressée dans cette perspective à Proparco, filiale de l’AFD dédiée au financement du secteur privé, ainsi qu’à la Fondation Grameen-Crédit agricole, qui intervient dans le domaine de la microfinance.
Créée en 1977, La Société de promotion et de participation pour la coopération économique (Proparco) est aujourd’hui une société anonyme et une société de financement sous supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Proparco est également une direction exécutive de l’AFD, à laquelle elle est donc parfaitement intégrée. Son rôle est de favoriser l’investissement dans les pays d’intervention du groupe. Proparco est présente dans environ 80 pays, un périmètre similaire à celui de l’AFD.
Le choix historique qui présidait à la création de la filiale reposait sur l’idée d’une gouvernance distincte de l’AFD, partagée avec des acteurs du privé. L’actionnariat est ainsi détenu à 64% par l’AFD, le reste se partageant entre des institutions financières, qui ne sont pas seulement françaises. Sont ainsi actionnaires, entre autres, la BMCE marocaine, la Caisse andine ou Banque centrale d’Afrique du Sud.
La présence d’acteurs locaux au tour de table ainsi que des industriels qui n’ont pas toujours souscrit aux augmentations de capital mais qui sont présents, comme Bolloré ou Bouygues, est perçue comme une véritable richesse. Les industriels présents dans le capital de Proparco, même s’ils sont moins actifs, suivent les activités de la filiale, ce qui met également cette dernière en position de les accompagner plus efficacement.
L’articulation existant entre Proparco et l’AFD permet l’existence d’un continuum entre les activités touchant au secteur public, financées par l’AFD, et le secteur privé suivi par Proparco. Ce continuum prend une importance croissante dans le contexte des ODD, le secteur privé devant être un contributeur important à l’atteinte de ces objectifs.
ii. Financement du souverain et du non-souverain
Cette articulation entre l’activité de l’AFD et celle de Proparco est particulièrement pertinente en ce qui concerne le soutien aux services publics des États en développement. Constatant l’intérêt du secteur privé pour les partenariats public privé avec les États en développement, les rôles peuvent être répartis entre l’AFD qui prend en charge les aspects publics des projets concernés et Proparco qui intervient auprès des partenaires privés.
Les finances publiques d’un certain nombre de pays, notamment africains, se caractérisant par des taux d’endettement croissants, atteignant parfois 50% du PIB, et des économies peu diversifiées, les ministères des finances se tournent souvent vers des institutions comme Proparco, afin disposer de relais pour leurs politiques publiques. C’est notamment le cas dans les domaines des infrastructures et de la santé.
Il y a donc à la fois une politique publique souvent accompagnée par l’AFD qui cherche des déclinaisons opérationnelles dans le privé, pour lesquelles on se tourne alors vers Proparco ou des institutions similaires.
iii. Champ d’intervention géographique
Le champ d’intervention géographique de Proparco est quasiment le même que celui de l’AFD. Proparco peut intervenir dans tout le champ du CAD, mais suit en réalité l’AFD, dont le champ d’intervention géographique est un peu plus restreint.
De fait, Proparco intervient dans des pays dont le stade de développement est très variable, c’est-à-dire à la fois dans des PMA, des pays fragiles, des pays en sortie de crise, des « très grands émergents », dans des pays du « deuxième cercle » (Indonésie Thaïlande, Mexique), ainsi que des pays avec lesquels la France et l’AFD entretiennent des liens plus historiques comme ceux d’Afrique subsaharienne.
Cette capacité à intervenir dans des pays aussi différents est un atout important, non seulement en termes de positionnement pour Proparco, mais aussi parce que cela lui permet diffuser des bonnes pratiques et d’organiser un partage d’expériences entre les différents pays destinataires, de façon à favoriser les échanges Sud-Sud en accompagnant d’autant plus efficacement le plus grand nombre possible d’acteurs français à l’international.
L’activité de Proparco constitue l’une des réponses possibles au problème posé par la faiblesse des dons en faveur des PMA et des dix-sept pays prioritaires de l’APD française, même si elle ne résoudra pas la question à elle seule.
Il peut en effet exister dans des États peu développés et dont le secteur public est en difficulté une économie informelle dont le dynamisme potentiel est limité, entre autres, par l’absence d’un secteur bancaire fonctionnel ou par le fait que les administrations ne sont pas en état d’exercer un effet d’entraînement. Le rôle d’un organisme comme Proparco peut alors consister à renforcer les systèmes bancaires, de microfinance ou les groupements d’entreprise de ces pays afin d’accélérer la transformation des économies locales.
Proparco s’est ainsi fixé l’objectif de consacrer chaque année 25 % de ses financements aux pays les plus fragiles, comme la République Centrafricaine ou la Guinée post Ebola. Cet objectif a été atteint en 2016 et dépassé en 2015 avec un taux de 32%.
Il apparaît cependant qu’un certain nombre de pays dans lesquels Proparco avait vocation à intervenir se sont développés, notamment au niveau de leur secteur bancaire. Proparco peut alors de plus en plus souvent s’appuyer sur ces derniers pour atteindre les PME locales, ce qui est aujourd’hui le cas pour 50% des engagements de Proparco. Ces systèmes bancaires peuvent alors apporter des financements en monnaie locale sur des durées plus longues qu’auparavant, qui peuvent atteindre 20 ans pour certaines banques d’Afrique du Nord.
Ce type d’intervention peut cependant aller à l’encontre de l’objectif de rentabilité inhérent aux interventions de Proparco, la rentabilité d’interventions dans les PMA étant souvent faible. Proparco, qui ne dispose pas de financements publics, doit donc trouver une solution
Tenant compte du débat, qui a notamment lieu entre la Société financière internationale et le reste du groupe Banque mondiale, sur l’éventuelle utilisation des ressources concessionnelles de l’Association internationale de développement (AID) en faveur du secteur privé,
b. La promotion de la microfinance
La microfinance, ou microcrédit, fournit un exemple d’intervention « à la base », visant à susciter une activité économique spontanée dans les secteurs les plus faibles des sociétés des pays pauvres.
La Grameen Bank, fondée par Mohammed Yunus en 1976, s’est fixé pour objectif de fournir des services financiers aux populations n’ayant aucun accès aux réseaux bancaires traditionnels, avec des prêts de faibles montants, néanmoins suffisants pour financer de petites initiatives économiques individuelles.
La fondation Grameen-Crédit agricole, dont la mission a auditionné le directeur, M. Éric Campos, a été créée en 2008 et a pu déployer son activité à l’international grâce au rapprochement avec M. Yunus, dont la fondation Grameen avait alors plus de vingt ans d’expérience.
La fondation a un statut de fonds luxembourgeois pour des raisons de simplicité. Crédit agricole SA a apporté 50 millions d’euros. La Fondation est indépendante du Crédit agricole. Son Conseil d’administration est composé d’administrateurs du CA, de Grameen et de quatre autres personnes. La stratégie de la Fondation est également indépendante de celle du Crédit agricole, du fait notamment des conséquences des deux crises traversées par le secteur bancaire mondial depuis 2008 qui l’ont éloigné des activités telles que la microfinance.
La microfinance n’est rien d’autre, selon M. Campos, que de la finance de proximité. C’est cependant une fonction que les banques traditionnelles n’assurent plus ou n’ont jamais assurée dans les régions concernées, pour des raisons non seulement financières tenant à la faible rentabilité de cette activité, mais également culturelle, les banques n’étant pas habituées à fonctionner, selon M. Campos, dans des contextes sociaux de grande pauvreté. Selon M. Campos, « l’activité a lieu dans un contexte d’économie informelle, et la méthode de financement de cette économie est la méthodologie de groupe : la caution de la communauté locale. »
Bien que similaire à certaines activités bancaires, la microfinance doit adopter un mode de fonctionnement particulier. La fondation doit ainsi financer 70 % de ses projets en monnaie locale, les risques de change étant trop élevés pour pouvoir procéder autrement.
L’activité d’organismes tels que la fondation Grameen-Crédit agricole consiste dans une certaine mesure à mener ou à promouvoir une activité commerciale classique, mais en cherchant à atteindre les clientèles les moins intéressantes du point de vue de la rentabilité. Les institutions de microfinance (IMF) peuvent en effet atteindre spontanément une certaine rentabilité et se transformer progressivement en établissement bancaires traditionnels, mais leurs activités auront alors tendance à se développer dans des milieux urbains et à laisser de côté les régions rurales, celles où la microfinance a la plus grande utilité. C’est ainsi qu’à l’échelle mondiale, selon M. Campos, seulement 10 % des activités de microfinance ont lieu en Afrique alors que 50% de la pauvreté se trouve sur ce continent.
La Fondation s’est également investie dans le suivi des performances sociales. Appliquant des standards d’évaluation de la performance sociale des IMF, elle travaille de préférence avec les IMF les mieux notées ou cherche à améliorer leur performance sociale. Proparco intervient également dans le domaine de la microfinance en finançant des IMF qui disposent d’ores et déjà de leurs réseaux et en les accompagnant afin de diminuer leurs coûts de structure. De telles interventions impliquent cependant une grande vigilance vis-à-vis de l’organisation et des procédures de ces organismes. Les expériences sont très diverses selon les régions, et Proparco s’efforce de transmettre l’expérience acquise.
M. Campos estime que la forme d’assistance la plus utile pour promouvoir la microfinance consisterait à procurer une couverture des risques de change. Votre rapporteur estime qu’un tel soutien serait opportun afin de soutenir une activité dont l’impact économique et social est potentiellement important mais qui a besoin d’être davantage développée.
Recommandation n° 15 Soutenir la microfinance par un fonds de garantie spécifique lié au risque de change |
c. Favoriser les modes de développement alternatifs
L’économie sociale et solidaire, branche de l'économie regroupant les organisations privées (entreprises coopératives, associations, mutuelles ou fondations) qui cherchent à concilier activité économique et équité sociale, et le commerce équitable, système d'échange dont l'objectif est de parvenir à une plus grande égalité dans le commerce conventionnel, visent tous deux à atténuer les effets secondaires d’une croissance économique rapide et mal maîtrisée. Il a semblé opportun à la mission d’information de s’informer sur le rôle actuel ou potentiel de ces activités dans l’aide au développement actuelle.
i. L’économie sociale et solidaire
La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire visait à créer un cadre juridique pour un secteur de l’économie devenu important en France, mais dont le potentiel est également important dans le cadre de l’aide au développement. Longtemps discrète, l’économie sociale et solidaire est devenue un secteur de l’économie important et omniprésent. Les seules coopératives représentent ainsi un milliard d’individus dans le monde, tandis que les 300 plus grandes coopératives et mutuelles représentent 2500 milliards de chiffre d’affaire cumulé.
En Europe, on estime que l’économie sociale et solidaire représente 12% de l’emploi et un peu plus de 10% du PIB. Environ 65% de la population européenne est concernée d’une façon ou d’une autre par ce secteur.
Le forum « Rencontres du Mont-Blanc », dont la mission a auditionné le président, M. Thierry Jeantet, est un rassemblement des acteurs internationaux des acteurs de l’économie sociale et solidaire. Ce forum a été créé afin d’une part de donner plus de visibilité à ce secteur, d’autre part afin de favoriser les interactions entre les acteurs du secteur, jusqu’alors trop isolés.
Les Rencontres du Mont-Blanc ont également été en mesure de former un réseau international d’acteurs de l’ESS et d’organiser au Japon les premières rencontres inter-économie sociale
Les Rencontres du Mont-Blanc ont également pu susciter dans le cadre de l’ONU la création d’une task force dédiée à l’économie sociale et solidaire, à l’initiative du PNUD, dont les Rencontres sont membre associé.
En 2013, le Président de la République a bien voulu favoriser la création du Groupe pilote international de l'ESS qui s’est réuni pour la première fois à l’ONU le 22 septembre 2014. Ce groupe pilote doit aujourd’hui favoriser les politiques publiques en faveur de l’économie sociale et solidaire. Il comporte trois composantes :
- Des États, dont la France qui préside jusqu’en 2017, le Maroc, le Costa Rica, le Luxembourg, entre autres ;
- Des agences internationales liées à l’ONU ;
- L’économie sociale et solidaire représentée par des organisations et par de grandes fédérations de villes.
Les réunions du groupe se sont tenues depuis lors chaque année au mois de septembre, pendant la réunion de l’Assemblée générale des Nations unies.
Le programme du groupe comporte a trois axes de travail ;
- La création d’un guide international des législations relatives à l’économie sociale et solidaire. La France a adopté la loi de juillet 2014 mais n’était pas tout à fait la première. D’autres pays étudient la question, comme la Roumanie. Ce travail vise également à dresser une comparaison des partenariats publics économie sociale et solidaire. Tous les pays et territoires sont intéressés.
- La préparation d’une conférence internationale sur le financement de l’économie sociale et solidaire et sa contribution au développement.
- L’adoption d’indicateurs d’impact.
Trois groupes de travail sont en place et doivent faire rapport au groupe pilote. Un comité scientifique de 44 membres coordonne ces travaux.
Nouvel acquis plus récent, lors de la réunion de Quito en octobre 2016, le forum international des villes a adopté un document dans lequel l’économie sociale et solidaire était désignée comme un partenaire incontournable des villes et des territoires. Des petites et des grandes villes s’intéressent en effet à l’économie sociale et solidaire, comme Montréal qui lui a dédié un quartier entier. Le maire de Séoul a également décidé de s’inspirer de ce modèle.
Lorsque le groupe pilote a été créé, les deux premiers adhérents ont été l’Équateur et le Maroc. Pour ce dernier pays, l’économie sociale et solidaire fournissait le moyen de relancer certaines productions tout en permettant à la population de rester sur place, donc de diminuer l’émigration. L’économie sociale et solidaire est ici partenaire du développement.
Aujourd’hui, les Rencontres du Mont-Blanc ont créé une agora internationale des projets. Un nouveau site permet à des personnes de se rencontrer et d’agir ensemble, directement ou indirectement. Cela peut consister en mises en réseau commerciales. On est en train de donner une importance plus grande à ce pilier pratique, qui vise à aider l’économie sociale et solidaire, mais aussi le développement proprement dit.
Le commerce équitable figure parmi les actions d’aide au développement dont les effets sont difficiles à mesurer mais réels et croissants.
La Plate-Forme pour le Commerce Équitable (PFCE), qui fédère les professionnels de ce secteur en France, a été créée en 1997. C’est non seulement une organisation professionnelle, mais également un think tank qui compte une trentaine d’adhérents, représentant environ mille structures en France. Ils comptent des entreprises du commerce équitable.
La PFCE rassemble également les différents labels du commerce équitable, ainsi que des réseaux, dont celui du Biocoop. Certains adhérents ne font que du commerce équitable, d’autres ont également une activité telle que le bio, l’économie sociale et solidaire ou l’insertion. Les grands groupes commerciaux sont souvent des interlocuteurs.
La part du non-alimentaire dans le commerce équitable est très faible. Historiquement, le commerce équitable s’est développé avec des produits artisanaux, mais l’alimentaire représente maintenant 92% du marché. Le reste, c’est un peu de textile, de cosmétique et de tourisme.
Parmi les adhérents à la PFCE figurent également des ONG, des associations d’éducation populaire ainsi que des acteurs de la recherche. On peut également citer le réseau FERNES qui regroupe des chercheurs en agronomie, en marketing et dans d’autres disciplines et qui vise à comprendre l’impact du commerce équitable dans les pays du Sud, ainsi que les déterminants de l’achat et les comportements de consommation au Nord.
La PFCE, en tant que représentant institutionnel du secteur, produit une expertise sur le champ du commerce équitable, à partir de laquelle s’articulent ses activités, soit de sensibilisation, soit de formation de ses adhérents, soit de plaidoyer afin que le paysage institutionnel soit favorable.
Son budget est d’environ 500 000 euros, dont 100 000 euros recueillis auprès de ses adhérents, le reste consistant en financements principalement publics, provenant notamment de l’AFD, mais également du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l’Environnement et du ministère de l’Économie sociale et solidaire, ainsi que des collectivités territoriales. La PFCE bénéficie également de financements européens, provenant de la Direction générale du développement et de la coopération (EuropeAid), au titre de l’éducation et du développement. La PFCE est enfin soutenue par la Fondation pour le Progrès de l’homme ainsi d’autres fondations ou entreprises de l’économie sociale.
La loi sur l’Économie sociale et Solidaire du 31 juillet 2014, à son article 94, a fait évoluer la définition du commerce équitable qui figurait dans la loi du 2 août 2005 en la rendant plus précise et en étendant son champ d’application aux échanges avec les producteurs au Nord, notamment français :
« Le commerce équitable a pour objet d’assurer le progrès économique et social des travailleurs en situation de désavantage économique du fait de leur précarité, de leur rémunération et de leur qualification, organisés au sein de structures à la gouvernance démocratique, au moyen de relations commerciales avec un acheteur, qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Un engagement entre les parties au contrat sur une durée permettant de limiter l’impact des aléas économiques subis par ces travailleurs, qui ne peut être inférieure à trois ans ;
« 2° Le paiement par l’acheteur d’un prix rémunérateur pour les travailleurs, établi sur la base d’une identification des coûts de production et d’une négociation équilibrée entre les parties au contrat ;
« 3° L’octroi par l’acheteur d’un montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs, en complément du prix d’achat ou intégré dans le prix, visant à renforcer les capacités et l’autonomisation des travailleurs et de leur organisation.
« Chaque entreprise intervenant dans ces filières est en mesure de produire des informations relatives à la traçabilité des produits.
« Les entreprises faisant publiquement état de leur appartenance au commerce équitable participent à des actions de sensibilisation et d’éducation à des modes de production et de consommation socialement et écologiquement durables. » (17)
Le commerce équitable se définit désormais comme un ensemble de relations commerciales entre une entreprise et un groupement de producteurs devant satisfaire un certain nombre de conditions, dont le paiement d’un prix juste et équitable basé sur les coûts de production. La loi entérine également le principe des contrats pluriannuels de trois ans.
La relation commerciale décrite par la loi est un partenariat qui permet de cofinancer un projet de développement local à travers la prime de développement. La loi entérine enfin le fait que les entreprises de commerce équitable inscrivent leur action dans une démarche de transparence et de traçabilité.
La loi ayant consacré l’universalité du commerce équitable, les producteurs français sont désormais également concernés. Aujourd’hui, un sixième des produits du commerce équitable vendus en France sont également fabriqués en France, par 4500 producteurs.
Un certain nombre de progrès peuvent cependant être faits concernant le commerce équitable.
En premier lieu, les pays d’origine du commerce équitable au Sud ont à ce stade rarement mis en place des politiques publiques visant à le favoriser. C’est cependant le cas des pays andins, c’est-à-dire ceux où le commerce équitable s’est le plus développé, notamment le Pérou, la Bolivie et l’Équateur, où les politiques publiques en faveur du commerce équitable sont très actives. Le commerce équitable a notamment été dans ces pays un outil d’accompagnement du monde paysan.
Une étape importante a cependant été franchie avec le plan d’action nationale en faveur du commerce équitable, lancé le 29 avril 2013 par MM. Canfin et Hamon et qui doit prendre fin en 2017. Doté de sept millions d’euros sur trois ans, ce plan se donne notamment pour objectif d’augmenter la part des produits équitables dans le panier des consommateurs français. L’importance du commerce équitable a été reconnue et cinq grands objectifs et effets de levier ont été identifiés :
1- Stimuler l’offre de produits issus des filières commerce équitable au Sud
- Aider les organisations de petits producteurs du Sud via des programmes de renforcement des capacités financés par le Programme de renforcement des capacités commerciales (PRCC) et le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) ;
- Mener des projets pilotes de tourisme équitable, et en engager un nouveau en 2013 ;
- Renforcer la place du commerce équitable dans la stratégie de l’AFD, notamment en matière de sécurité alimentaire. L’Agence Française de développement (AFD) élabore par ailleurs une stratégie transversale en matière d’économie sociale et solidaire, un statut qui est fréquemment celui des institutions ou entreprises des filières du commerce et du tourisme équitable.
2- Augmenter la quantité de produits du commerce équitable vendus au Nord
- Soutenir la Quinzaine du commerce équitable, instrument de communication, de sensibilisation et de promotion dans toute la France ;
- Soutenir la campagne de promotion auprès des collectivités locales : la campagne annuelle « Territoires de commerce équitable » est soutenue financièrement par l’AFD en 2013 ;
- Promouvoir les achats publics équitables, en sensibilisant les acheteurs publics et les hauts fonctionnaires au développement durable, en diffusant un guide dédié.
3- Conforter la confiance du public dans les logos et mentions du commerce équitable
- Réformer la Commission nationale du commerce équitable : la composition de la CNCE sera renouvelée ; ses missions seront revues et elle apportera au consommateur français un système fiable de reconnaissance des logos et mentions de commerce équitable ;
- Saisir le Conseil national de la consommation (CNC) pour avis, afin de clarifier les conditions d’utilisation des allégations de commerce équitable ;
- Améliorer l’information du public, notamment grâce au site de l’Institut national de la consommation (INC) et au site dédié, http://www.jeconsommeequitable.fr
4- Rééquilibrer les chaines de valeur en faveur des producteurs
- Créer un groupe de travail sur le préfinancement des achats et des récoltes, afin d’appuyer les entreprises du secteur qui préfinancent les petits producteurs et manquent d’outils financiers adaptés. Des recommandations seront proposées avant la fin de l’année 2013 aux ministères concernés ;
- Mobiliser la grande distribution sur ces enjeux, par exemple dans le cadre d’une réunion « Rendez-vous du commerce » de la DGCIS.
5- Soutenir au plan institutionnel les acteurs et les principes du commerce équitable
- Soutenir la Plate-forme française du commerce équitable (PFCE), notamment dans ses dimensions d’animation et de structuration des acteurs du Sud, par la mise en place d’une convention triennale avec le ministère en charge du développement ;
- Soutenir l’Association des opérateurs du tourisme équitable et solidaire (ATES) en établissant une convention avec le ministère en charge du développement ;
- Défendre les principes d’équité du commerce et leur traitement juridique dans les enceintes pertinentes au plan international ; lors du prochain examen global de l’aide au commerce de l’OMC, en juillet 2013, la France organisera un événement parallèle consacré au commerce équitable.
La directive européenne de 2014 a été transposée correctement en France et permet aujourd’hui d’utiliser des labels comme preuve de la conformité sociale et environnementale lors d’appels d’offre. C’est donc un facteur de stimulation très important.
Les achats publics constituent une autre forme de soutien au commerce équitable. Sa principale traduction a eu lieu dans le domaine du textile, secteur compliqué et relativement marginal au sein du commerce équitable, composé à 92 % de produits alimentaire. La difficulté tient principalement au nombre élevé de défis à relever, notamment en matière de distribution. Le coton équitable a cependant trouvé un marché grâce aux achats publics de vêtements de travail. Les seuls industries textiles qui subsistent le font grâce aux achats publics. Cette dynamique doit être poursuivie et soutenue par la France.
Recommandation n° 16 Augmenter la part des sommes recueillies à travers le dispositif du Livret de Développement durable et solidaire destinées à financer les acteurs de l’économie sociale et solidaire déployant une activité dans les pays destinataires de l’aide publique au développement. |
d. Le financement du développement par les diasporas
Les transferts monétaires réalisés par les diasporas vers leurs pays d’origine sont importants par leur volume et appelés à augmenter avec les flux migratoires eux-mêmes. Du fait de leur caractère spontané et privé, ils appellent toutefois peu d’initiatives publiques, sinon pour réduire les coûts de transfert.
i. Des sommes supérieures aux budgets d’aide publique au développement
Représentant, selon la Banque mondiale, 401 milliards de dollars en 2012 contre 381 milliards de dollars en 2011, les envois d’argent des migrants sont en augmentation et constituent l’une des ressources financières extérieures majeures des pays en développement, à un niveau moindre que les investissements directs étrangers, mais supérieur à l’aide publique au développement. Concernant la France, le Rapport annuel 2011 de la balance des paiements publié par la Banque de France évoquait ainsi des transferts vers l’Afrique à hauteur de 3,7 milliards d’euros, dont 3,1 milliards d’euros vers le Maghreb. Les estimations de la Banque mondiale prévoyaient une augmentation du volume de ces transferts de fonds de l’ordre de 8,8 % par an jusqu’à 2015.
Les flux financiers ainsi engendrés constituent une source de financement significative pour réduire la pauvreté, mais aussi pour financer le développement économique. Du fait du soutien apporté par les migrants à leurs familles, ils présentent aussi l’avantage d’être globalement stables et pérennes, ou tout au moins indépendants des éventuelles crises ou catastrophes pouvant survenir dans les pays destinataires. La plus grande partie des montants transférés est dépensée en biens de consommation courante (jusqu’à 80% dans certaines régions d’Afrique subsaharienne), tandis qu’une fraction plus réduite est épargnée ou investie en capital humain (éducation, santé) ou en infrastructures (logement).
ii. Réduire les coûts de transfert
Dans ce contexte, la France, qui apparaît comme un pays majeur d’émission de transferts d’argent, en particulier vers l’Afrique, s’est donné le double objectif de réduire sensiblement les coûts des transferts d’argent (en moyenne de 9,1% en 2013) et d’accompagner une meilleure allocation de ces envois au service du développement économique des pays d’origine des migrants.
La France est ainsi membre du groupe pilote sur les financements innovants pour le développement (18) et participe dans le cadre du G8 aux groupes « Making Finance Work for Africa » et « Global Remittances Working Group », respectivement pilotés par la Banque africaine de développement (BAfD) et la Banque mondiale. Elle inscrit ainsi son action dans l’engagement pris lors du sommet du G8 de l’Aquila en juillet 2009, confirmé et élargi aux membres du G20 lors du sommet de Cannes en novembre 2011, de réduire à 5 % le coût moyen des transferts d’argent d’ici 2014.
Cet engagement est suivi par la Banque mondiale, qui évalue le coût moyen mondial des transferts de fonds des migrants à 9,1 % du montant transféré au 1er trimestre 2013, contre 9,81 % en 2008. Ces coûts restent les plus élevés au monde en Afrique subsaharienne avec un coût moyen de 12,4 % à la fin 2012, contre 6,5 % en Asie du Sud. Dans ce cadre, des actions ont été entreprises par les principaux pays d’immigration, notamment européens, pour accroître la transparence du marché des transferts de fonds.
La France soutient ainsi le site www.envoidargent.fr dont la récente certification par la Banque mondiale permettra d’affiner le suivi des coûts des transferts de fonds depuis la France (diminution de 11,8 % au dernier trimestre 2012 à 10,7 % au premier trimestre 2013).
Une première étude publiée en 2008 sur les transferts des fonds des migrants au Maghreb et dans la Zone franc a été suivie d’ateliers de restitution à Casablanca et à Bamako en 2009. Dans sa continuité, la BAfD et l’AFD, en liaison avec le MAE et le ministère de l’Économie et des Finances, ont mandaté l’association Épargne sans frontières pour mener une nouvelle étude (19), laquelle a fait l’objet d’une présentation officielle à Paris le 21 février 2012.
iii. L’exemple de la diaspora libanaise
Un exemple du rôle que peuvent jouer les transferts monétaires réalisés par une diaspora nous est fourni par le Liban. Le récent rapport d’information de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale sur le Liban, déposé en mars 2015, soulignait ainsi l’importance du rôle joué par la diaspora libanaise dans le financement de l’économie de son pays d’origine, et notamment de son secteur bancaire :
« Si l’on peut difficilement considérer la « fuite des cerveaux » comme un phénomène positif, aussi bien en tant que symptôme qu’en termes de répercussions économiques, les remises de fonds des expatriés apportent un soutien significatif au pays.
« - Il faut d’abord souligner l’ampleur et la fréquence de ces transferts.
« Ils représentent près de 17 % du PIB, contre environ 8 % en Égypte, 7 % au Maroc, et un peu plus de 5 % en Tunisie. Les flux annuels par migrant s’élèvent à peu près à 8 000 dollars depuis les pays arabes, à 9 000 dollars depuis l’Afrique et à 4 000 dollars en provenance des États-Unis et depuis l’Europe.
« Environ un quart des émigrants transfèrent régulièrement de l’argent dans leur pays d’origine. Le taux d’envoi régulier d’argent est de 96 % pour ceux dont le conjoint et les enfants sont restés au Liban et de 44 % pour ceux qui y ont leurs parents. Bien que les remises de fonds soient moins élevées pour ceux qui ont quitté le pays il y a plusieurs décennies, les flux restent substantiels. Trente ans après leur départ, environ 15 % des Libanais continuent à envoyer de l’argent régulièrement ou de temps en temps.
« - Les remises de fonds de la diaspora contribuent à maintenir à flot l’économie libanaise et tout particulièrement, on l’a dit, le secteur bancaire. Selon la Banque mondiale, le climat général au Liban et le niveau élevé de corruption empêchent toutefois d’exploiter pleinement le potentiel d’investissement des expatriés, souvent assez prospères et très attachés à leur pays.
« Il faut également souligner la forte utilisation des transferts de fonds pour des dépenses d’éducation et de santé, ce qui contribue à soutenir le développement humain et à renforcer la qualification des générations suivantes. Environ 39 % des ménages bénéficiant de remises de fonds de l’étranger en dépendent partiellement ou totalement pour leurs dépenses d’enseignement primaire et la proportion s’élève à 46 % pour l’enseignement supérieur. D’une certaine manière, la logique de l’émigration s’auto-entretient, puisque les Libanais passés par l’enseignement supérieur quittent davantage leur pays. La contribution aux dépenses de santé est également significative. On estime que 24 % des ménages bénéficiant de remises de fonds en dépendent pour leurs frais de médicaments. »
i. L’exemple de la Fondation Gates
La mission d’information a enfin jugé utile d’examiner le rôle qui peut être joué par des fondations privées en matière d’aide au développement. L’existence d’un organisme tel que la Fondation Bill et Melinda Gates, dont la mission a auditionné la responsable relations extérieures et affaires politiques pour la France, Mme Béatrice Néré, est incontestablement une chance du point de vue de l’aide au développement, puisque la mise à disposition par M. et Mme Bill Gates ainsi que par M. Warren Buffet d’une part non négligeable de leurs fortunes personnelles a donné lieu en seize ans à un apport de 34 milliards de dollars, principalement dans les domaines de la santé et de l’éducation.
Il s’agit toutefois d’un modèle difficile à reproduire à l’identique, dont on peut tirer toutefois un certain nombre d’enseignements. Votre rapporteur remarque en premier lieu que la Fondation a volontairement limité le nombre de ses employés à 1500 afin, nous a dit Mme Néré, d’éviter la bureaucratisation de l’institution.
Par ailleurs, l’expérience du secteur privé dont bénéficient les fondateurs et dirigeants de la Fondation ont été en mesure d’inciter des entreprises privées à investir dans des secteurs stratégiques en matière d’aide. La fondation a ainsi pu faciliter des activités de recherche pharmaceutique visant à créer certains médicaments destinées aux populations les plus pauvres. À titre d’exemple, la recherche d’un vaccin contre le VIH est coûteuse et financièrement risquée. C’est là, selon Mme Néré, qu’intervient la Fondation qui peut, précisément, prendre de tels risques.
La Fondation Bill et Melinda Gates semble avoir bénéficié en premier lieu de sa puissance financière et en second lieu de la capacité de ses trois dirigeants à fixer des orientations stratégiques claires, autant que possible complémentaires des actions existantes, et sur lesquelles l’action de la Fondation pouvait être décisive, telles que sa contribution à l’éradication, attendue sous peu, de la poliomyélite.
ii. Une Fondation pour le Développement solidaire
Lors de son audition par la mission d’information, M. Jean-Marie Le Guen, Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères et du Développement international, chargé du Développement et de la Francophonie, a souligné le caractère désormais multilatéral des fonds transitant par le FSD, et a suggéré par ailleurs qu’un établissement tel qu’une ONG ou une fondation francophone puisse être mis en place, éventuellement financé au travers du FSD, indépendante de l’État du point de vue de son fonctionnement, afin d’assurer la mise en œuvre de projets d’organismes multilatéraux auxquels la France contribue.
La France et les pays francophones gagneraient en effet à doter leurs politiques d’aide au développement d’un tel organisme, susceptible à la fois de contribuer à la coordination des politiques multilatérales, de permettre l’usage de certains fonds qui tardent à faire l’objet de décaissements, et de s’assurer que leur usage demeure proche des priorités stratégiques de la France et de ses partenaires les plus proches.
Cette fondation pourrait cependant aller plus loin et servir de cadre à une augmentation de l’aide dispensée sous forme de dons, en mixant au-delà du FSD, des fonds publics bilatéraux et multilatéraux, les contributions des citoyens et des entreprises pour renforcer les dons, les fonds de garantie, ainsi que les titres participatifs. Prenant modèle dans une certaine mesure sur la Fondation Bill et Melinda Gates, cette fondation déploierait son activité en partie sur des thématiques similaires. Elle pourrait ainsi prendre en charge, à titre d’exemple, le fonds de garantie dont la création est recommandée par votre rapporteur dans le présent rapport afin de couvrir le risque de change des institutions de microfinance. Elle constituerait une interface entre les financements publics et les acteurs privés de l’aide publique au développement et servirait de cadre à une augmentation de l’aide sous forme de dons.
Recommandation n° 17 Créer une Fondation française, ou, encore mieux, francophone, pour le Développement solidaire chargée de recueillir des fonds et de coordonner une partie de l’aide publique au développement sous forme de dons. Cette fondation pourrait bénéficier d’une première dotation en provenance du fonds de solidarité pour le développement (FSD) sur les nouvelles ressources de la taxe sur les transactions financières. |
V. ÉVOLUER VERS UNE LOGIQUE CONTRACTUELLE
De par sa nature même, l’aide publique au développement semble s’identifier à un flux à sens unique plus qu’à un échange, les pays destinataires bénéficient du flux d’aide venu des pays donateurs sans que ces transferts ne fassent, en apparence du moins, l’objet d’une transaction.
En réalité, les pays donateurs trouvent un intérêt réel dans les politiques d’aide, et ce à plusieurs titres. Outre l’intérêt individuel de chaque État donateur à voir ses entreprises se développer à l’international ou ses normes se diffuser dans le monde grâce à sa coopération en matière d’expertise, le fait d’éviter que ne se creusent les inégalités au niveau mondial est unanimement reconnu comme un gage de stabilité, ne serait-ce que du point de vue de la maîtrise des flux migratoires. La nécessité d’associer tous les États, des plus développés aux moins développés, est également réelle en vue de la maîtrise des phénomènes transnationaux concernant l’ensemble de la population mondiale, que ce soit en matière de climat ou de lutte contre les grandes pandémies. Le caractère vital de l’aide publique au développement pour les pays donateurs n’a pas besoin d’être démontré.
Il reste cependant le gain pour les pays donateurs ne se concrétise qu’à long terme et demeure difficile à mesurer. Les motivations des acteurs non étatiques de l’aide au développement sont pour leur part le plus souvent d’ordre individuel et altruiste et demeurent difficiles à coordonner.
En d’autres termes, l’aide publique au développement ne bénéficie pas d’un fil conducteur qui guiderait spontanément l’action des différents acteurs. Ces derniers étant désormais nombreux et faisant l’objet d’une coordination imparfaite, votre rapporteur estime qu’il est important de réfléchir à la possibilité de concevoir l’aide au développement dans un cadre plus contractuel, et ce pour deux raisons.
En premier lieu, certains dispositifs existants tels que les C2D semblent avoir apporté des résultats satisfaisants. Il convient donc d’en examiner les possibilités de généralisation.
En second lieu, les interlocuteurs rencontrés par la mission lors du déplacement effectué en janvier 2017 au Burkina Faso ainsi qu’au Maroc ont à plusieurs reprise remarqué que la notion d’« aide au développement » avait perdu de sa pertinence au regarde de la réalité actuelle.
Cette remarque, en apparence purement sémantique, semble à votre rapporteur toucher à une réalité plus profonde. Il est exact que la notion d’aide peut donner l’impression d’un rapport de subordination entre d’un côté des pays pauvres et dépendants et, de l’autre, leurs bienfaiteurs du Nord, impression qui serait non seulement fausse mais également dépourvue de pertinence s’agissant d’une politique dont la vocation est de profiter à chacun des partenaires en présence.
Mais de façon plus concrète, il s’agit bien aujourd’hui, compte tenu de la diversité des situations et de la difficulté que peuvent éprouver certains acteurs à coordonner leurs actions, de réfléchir à la mise en place d’une relation véritablement mutuelle qui permette notamment aux pays destinataire de prendre une plus grande initiative en matière d’allocation des flux d’aide et de choix des projets.
A. LES C2D, MODÈLE INTÉRESSANT MAIS DIFFICILE À GÉNÉRALISER
1. Le Contrat de Désendettement et de Développement (C2D), une initiative franco-française
a. L’initiative pays pauvres très endettés (PPTE)
La communauté internationale a reconnu en 1996 que la situation d’endettement extérieur d’un certain nombre de pays très pauvres, la plupart situés en Afrique, était devenue extrêmement difficile et avait un impact négatif sur leurs perspectives de développement. L’initiative pays pauvres très endettés (PPTE) est fondée sur une action coordonnée de la communauté internationale, y compris les institutions multilatérales de développement (Banque mondiale, Fonds monétaire international, banques régionales de développement), visant à réduire le poids de la dette extérieure à un niveau soutenable. L’initiative PPTE a été renforcée en septembre 1999.
i. Principes de fonctionnement
L’initiative PPTE requiert la participation de tous les créanciers, multilatéraux, bilatéraux et créanciers privés. Au-delà des efforts traditionnels de réduction de la dette, le Fonds monétaire international (FMI) définit un « facteur commun de réduction » que tous les créanciers doivent appliquer au stock de leurs créances pour ramener les ratios de dettes des pays concernés à des niveaux soutenables.
Concrètement, un pays doit d’abord être jugé « éligible » à l’initiative PPTE par le FMI et la Banque mondiale selon des critères de revenu, d’endettement et de relation avec les institutions financières internationales. À la fin de cette première phase, une analyse de soutenabilité de la dette est réalisée afin de déterminer la situation d’endettement extérieur du pays. Si celle-ci reste insoutenable et que la mise en œuvre d’un programme avec le FMI a été satisfaisante, le pays atteint le point de décision. À ce stade, la communauté internationale s’engage à apporter une assistance suffisante pour que le pays débiteur atteigne au point d’achèvement de l’initiative des ratios de dette soutenables. Dans la période suivante, les différents créanciers octroient un allègement intérimaire entre le point de décision et la date attendue du point d’achèvement
Lorsque le pays a rempli les conditions fixées en termes de réforme et de bonne application des programmes avec le FMI, il atteint le point d’achèvement. L’assistance résiduelle est apportée à cette date, au travers d’une réduction du stock de la dette.
Fin juin 2015, 39 pays sont considérés éligibles à l’initiative PPTE. Parmi eux, 36 pays ont atteint le point de décision ainsi que le point d’achèvement – dernière étape de l’initiative PPTE.
Les évaluations actualisées les plus récentes du montant total des allègements de dette au titre de la seule initiative PPTE s’élèvent à 74 milliards de dollars en valeur actuelle nette à fin 2012 pour les 39 pays qui ont vocation à bénéficier des allègements de dette.
D’autres allègements de dette se sont ajoutés dans le cadre de l’initiative d’annulation de la dette multilatérale (IADM) adoptée en 2005 à l’initiative du G8 de Gleneagles. Les pays atteignant le point d’achèvement de l’initiative PPTE bénéficient également d’une annulation de l’ensemble de leurs dettes envers le FMI, la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement.
Les allègements de dette ont produit des résultats tangibles tant en termes de viabilité de la dette des pays éligibles que de financement des dépenses sociales. L’évolution positive de la structure des budgets des pays éligibles à l’initiative PPTE se poursuit à mesure que les marges de manœuvre libérées au niveau du service de la dette sont consacrées à l’augmentation des dépenses de santé et d’éducation.
Le FMI et la Banque Mondiale ont ainsi estimé à l’été 2013 que, dix ans après le point de décision, le stock de dette extérieure des 36 pays bénéficiaires a ainsi été réduit d’environ 55 points de PIB en moyenne, et, pour les 35 pays ayant déjà bénéficié d’un allègement complet de leur dette (notamment en incluant les annulations de dette multilatérales IAMD, qui représentent environ 40% de l’effort consenti), la réduction du montant de la dette s’élève à 90% (de 140 à 12 Mds USD en valeur actuelle nette à fin 2011).
L’impact de la mise en œuvre de l’initiative PPTE est surtout sensible au niveau des ratios de service de la dette. Pour les 36 pays ayant franchi le point de décision, le service de la dette rapporté au PIB a ainsi nettement diminué, passant de 2,9% en moyenne en 2001 à 0,9% en 2011.
L’augmentation des dépenses sociales dans ces pays a été équivalente à la réduction du service de la dette. Les dépenses sociales représentent plus de 33,3 milliards de dollars en 2011 contre environ 6,6 milliards en 2001. Ces dépenses sont passées sur la même période de 6,3% à 8,8% du PIB, soit une augmentation de 2,5 points de PIB.
b. Un mécanisme d’optimisation de la dette des pays en développement
Le Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) est un outil relativement nouveau, qui fait suite à l’initiative PPTE, qui visait à conditionner la réduction de la dette à des politiques de lutte contre la pauvreté. Les pays devaient se doter d’un cadre structurel de lutte contre la pauvreté, avec des documents stratégiques de lutte contre la pauvreté, établis avec un appui technique de la BM.
La norme classique consiste à annuler les deux tiers d’une dette et à restructurer le tiers restant (conditions de Naples). Les organismes multilatéraux étant prioritaires en matière de remboursement, la France, très exposée sur les créances résiduelles, sur lesquelles il importait d’éviter l’annulation sèche qui aurait eu un impact Maastrichtien, avait intérêt à un traitement global, assainissant son portefeuille de risques. C’est dans ce contexte qu’a été recherché un mécanisme s’inscrivant à la fois dans une logique de contractualisation et dans celle d’un maintien de l’effort budgétaire de la part du concerné.
Comme la France, de nombreux créanciers bilatéraux membres du Club de Paris sont allés au-delà des seuls allègements de dettes octroyés dans le cadre de l’initiative PPTE et ont mis en place des initiatives complémentaires visant à proposer des allègements sur les créances d’APD avant et après la date butoir résiduelle. Alors que la plupart des créanciers ont opté pour une annulation pure et simple de ces créances, la France, dont les créances restantes portaient sur des montants beaucoup plus importants, a opté pour un mécanisme spécifique d’annulation des dettes bilatérales additionnelles : le C2D. Ces contrats de désendettement et de développement (C2D) prennent la forme d’un refinancement en dons des créances d’APD remboursées par le pays débiteur. Ces dons sont ensuite affectés au financement de projets et de programmes de lutte contre la pauvreté, définis durant la phase de négociation des C2D.
S’il n’est pas le seul mécanisme visant à lier les annulations de dettes au financement de programmes de développement dans les pays bénéficiaires, le C2D est le seul à prévoir un flux financier réel du pays bénéficiaire vers le pays créancier. Cet outil paraît ambitieux à la fois du fait des montants en jeu, de l’importance de la phase de négociation et des multiples formes que peuvent prendre les subventions accordées. Avec le C2D, la France s’est donc dotée du mécanisme le plus sophistiqué, mettant en œuvre un remboursement et un refinancement des créances.
c. Mécanisme de remboursement-refinancement du C2D
Le C2D est un système de refinancement par dons des créances d’APD, qui prévoit que le pays débiteur continue d’honorer le service de sa dette vis-à-vis e la France mais reçoit, sitôt le remboursement effectué, une subvention d’un montant équivalent pour financer les programmes de lutte contre la pauvreté identifiés en amont et inscrits dans le C2D.
Les C2D portent sur deux types de créance d’APD :
- celles détenues par l’État français et figurant à l’actif du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » ;
- celles détenues directement par l’Agence française de développement.
Dans le cas des créances détenues par l’État, le pays débiteur rembourse à échéance le montant dû à la Banque de France ou à Natixis, qui reverse les fonds à l’AFD. La DG Trésor et le service du contrôle budgétaire et comptable des ministères économiques et financiers sont informés du remboursement des échéances, et l’État français annule ces créances en loi de règlement.
Dans le cas des créances détenues par l’AFD, le pays débiteur lui rembourse à échéance le montant dû, et l’AFD efface alors la créance de dette. Afin d’éviter que l’AFD ait à préfinancer les reversements aux pays, l’agence est refinancée par le biais d’un appel de fonds au MAEDI, imputé au programme 209.
Tous les versements octroyés aux pays débiteurs dans le cadre d’un C2D sont réalisés par l’AFD dans un délai de quinze jours après le recouvrement de la créance. Ils prennent la forme de dons versés sur un compte « C2D » ouvert dans la banque centrale du pays débiteur. Les décaissements à partir de ce compte sont soumis à une double signature du gouvernement et du directeur de l’agence AFD, dans les pays où l’AFD est présente, ou de l’ambassadeur de France, dans les pays où les C2D sont mis en œuvre par les services de coopération et d’action culturelle (SCAC).
Une caractéristique essentielle du C2D est que l’annulation des créances résiduelles ne se fait pas en une seule fois, mais de manière échelonnée dans le temps, en fonction de l’échéancier de remboursement défini au préalable. Cet effort budgétaire est donc étalé dans le temps.
d. Processus de mise en place d’un C2D
La préparation d’un C2D commence dès l’approche du point de décision de l’initiative PPTE. Sa mise en place effective a lieu lorsque l’ensemble des dettes éligibles à l’initiative PPTE ont été annulées, c’est-à-dire lorsque le pays concerné atteint le point d’achèvement. La mise en place d’un C2D se décompose en trois temps : la conception et l’information d’abord, la négociation et la signature du C2D ensuite, et enfin sa mise en œuvre.
Un travail de conception du C2D et d’information des pays bénéficiaires est engagé pendant la période qui sépare le point de décision du point d’achèvement de l’initiative PPTE. Il comporte trois étapes :
- une négociation sur le principe d’un C2D avec le pays potentiellement bénéficiaire ;
- un travail d’identification préalable des secteurs et des domaines d’intervention qui pourront faire partie du C2D, réalisé par l’agence locale de l’AFD dans le pays et/ou par des missions sectorielles du siège de l’AFD ;
- sur la base de ce travail, une « mission d’orientation » conduite par la DGM et la direction générale du Trésor (DGT) avec l’appui technique de l’AFD, présente aux autorités du pays bénéficiaire les principes du C2D et les propositions de points d’affectation.
ii. Négociation et signature du C2D
Une fois le point d’achèvement atteint, le processus de négociation du C2D avec le pays bénéficiaire débute. Une « mission conjointe de négociation » menée par la DGM et la DGT, avec l’appui technique de l’AFD, est réalisée afin de définir le contenu du C2D. Il arrive que les partenaires nationaux formalisent de leur côté leur demande dans un document de travail remis avant la mission conjointe de négociation. Une fois le contenu du C2D négocié et arrêté (montants concernés, échéancier, modalités d’exécution, secteurs et points d’affectation retenus), le contrat C2D est signé entre l’ambassadeur de France ou un ministre du gouvernement français et le gouvernement du pays. Si un pays bénéficie de plusieurs C2D successifs, un contrat est signé à chaque fois.
La mise en œuvre du C2D, notamment en ce qui concerne les procédures financières et l’instruction des programmes sectoriels, est de la responsabilité de l’AFD et de la DGM. Le partage des compétences repose sur l’appartenance ou non du pays à la zone de solidarité prioritaire (ZSP). Sur ce dernier point, l’AFD est principalement responsable pour les pays de l’ancienne ZSP et la DGM l’est pour ceux hors de la ZSP2.
La durée des programmes est de trois à huit ans en général. L’AFD pilote le programme de développement en question, dans les États où elle exerce son mandat. L’État est associé à la négociation des points d’application du contrat. En 2016, on compte dix-sept ou dix-huit C2D en cours.
Depuis le premier C2D signé en 2001 avec le Mozambique, trente-trois C2D ont été signés avec dix-huit pays portant sur 3,366 milliards d’euros de créances. Fin 2014, 1,661 milliard d’euros avait déjà été refinancé sous forme de dons aux pays bénéficiaires, soit 31 % du total des dettes à annuler, dont 63 % avaient été décaissés à partir des comptes C2D à la Banque centrale.
À cette même date, cinq pays avaient clôturé leur C2D (Burundi, Ghana, Nicaragua, Ouganda, Rwanda), c’est-à-dire annulé l’ensemble de leur dette éligible au C2D. La Bolivie, le Honduras et le Malawi devaient suivre avant la fin du troisième trimestre 2015.
La première caractéristique des C2D est leur grande diversité, que ce soit au niveau des montants en jeu, des secteurs d’intervention, des modalités d’exécution ou encore des dispositions institutionnelles mises en place.
Les montants des C2D signés sont très variables d’un pays à un autre, allant de 2,3 millions d’euros pour l’unique C2D au Nicaragua à 1,125 milliard d’euros pour le deuxième C2D en Côte d’Ivoire. Sur les dix-huit pays qui ont bénéficié d’un C2D, huit ont profité d’un C2D « allégé », c’est-à-dire portant sur des montants inférieurs à 20 millions d’euros. Trois pays, le Cameroun, le Congo et la Côte d’Ivoire, concentrent, à eux seuls, 86 % des créances à refinancer sous C2D.
f. Champ d’application sectoriel et géographique
Les principaux secteurs d’intervention retenus dans les projets et les programmes financés sous C2D sont les équipements et les infrastructures (25 %), l’éducation et la formation (20 %) et la santé (10 %). Les quatre domaines cibles identifiés dans la doctrine C2D4 représentent 57 % du total des montants approuvés. Une part relativement importante (27 %) porte sur des soutiens non affectés à un secteur en particulier. Le nombre moyen de secteurs retenus par C2D est de 2,5 sur l’ensemble de la période sur laquelle porte la revue, avec un maximum de six pour le premier C2D en Côte d’Ivoire. Ce nombre semble corrélé au montant des C2D : plus le montant des C2D est élevé, plus le nombre de secteurs retenus est important.
Sur le plan des procédures financières de remboursement et de refinancement, les échéanciers et les délais de refinancement ont été largement respectés. Les retards observés se sont concentrés sur un nombre restreint d’échéances et résultaient principalement d’évènements externes au C2D.
En termes de secteurs géographiques, les C2D ne concernent généralement pas les pays les plus pauvres puisque les pays concernés tendent à être ceux dont la capacité d’endettement était au départ suffisante pour que des prêts importants leur soient accordés, même s’il existe des exceptions.
En outre, l’initiative PPTE ayant été imposée par la communauté internationale, le ciblage des pays bénéficiaires, ne relevait pas de décisions françaises, tandis que l’exposition de la France était fonction des flux de crédits passés générés sur ces pays. Les C2D concernent ainsi une minorité de pays (entre quinze et dix-huit, dont le Honduras, la Bolivie et plusieurs États Africains).
Les C2D sont des dons et sont comptabilisés comme tels. L’espace budgétaire offert au pays bénéficiaire a simplement un point d’application prédéterminé lors des missions d’instructions conjointes préalables à la signature des contrats de C2D.
2. D’autres modes de partenariat
Le C2D est une spécificité française regardée avec un certain intérêt par les autres bailleurs, et dont les pays concernés semblent satisfaits. Il serait par conséquent souhaitable de pouvoir étendre ce mécanisme de contractualisation à un champ plus large et correspondant mieux aux priorités géographiques et thématiques de la France.
a. Les documents-cadres de partenariat
C’est dans une certaine mesure ce que tentent de faire les documents-cadres de partenariat élaborés conjointement par la France et les pays destinataires de l’aide, qui rassemblent, généralement pour une période de trois à cinq ans, les principaux objectifs de la coopération française dans chacun des États concernés.
Ces documents sont des contrats moraux dont la réalisation a généralement été satisfaisante et qui présentent l’avantage de ne pas induire pour les finances publiques françaises une contrainte budgétaire pluriannuelle.
Leur rôle tend cependant à diminuer du fait des divers transferts de compétences du ministère des Affaires étrangères vers des opérateurs externes en matière d’aide au développement, les opérateurs en question travaillant en fonction de cadres d’intervention pluriannuels réalisés également avec les pays concernés. En outre, les DCP sont des documents relativement brefs et de portée générale, listant principalement les actions de coopérations à venir de la part de la France mais contenant assez peu d’engagements, même moraux, de la part des pays destinataires. On est donc assez loin du cadre plus rigoureux du C2D.
b. Les référentiels de croissance
La coordination des politiques d’aide au développement peut également s’appuyer sur les plans de développement publiés par plusieurs États destinataires de l’aide. Ces documents d’une centaine de pages sont généralement le fruit d’un travail important et dressent une liste des priorités de l’État concerné en matière de développement économique.
La mission a pu constater lors de son déplacement au Burkina Faso que le Plan national de Développement économique et social élaboré par ce pays pour la période 2016-2020 est accepté par l’ensemble des bailleurs comme le document de référence dans le cadre duquel s’inscrivent la plupart des projets de coopération. Les membres du gouvernement du Burkina Faso, comme on peut s’y attendre, se réfèrent à ce document qui constitue un référentiel commun.
Le document PNDES est structuré en trois parties :
- l’analyse diagnostique de la situation économique et sociale :
- la stratégie de développement économique et social 2016-2020 :
- les dispositions de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation.
Cette dernière partie du document détaille les instruments de mise en œuvre, les acteurs de la mise en œuvre, le cadre organisationnel, les mesures de suivi et d’évaluation, le schéma de financement et contient une analyse des risques. Les annexes du document contiennent des indicateurs et des cibles plus détaillés, dont une évaluation de l’impact des mesures préconisées en termes d’ODD.
En termes sectoriels, le PNDES met l’accent sur trois axes principaux :
- L’éducation et la formation professionnelle, thème sur lequel ont insisté tous les interlocuteurs gouvernementaux que la mission a rencontrés au Burkina Faso. Il s’agit notamment de corriger un déséquilibre
- La réforme de la gouvernance, dont la consolidation de l’état de droit, une thématique centrale puisque la sécurité des investissements indispensables à la mise en œuvre du plan en dépend ;
- L’énergie, notamment l’approvisionnement de la capitale dont la croissance est extrêmement rapide.
L’utilité d’un référentiel de croissance tel que le PNDES ne tient cependant pas tant à la démarche qui préside à sa rédaction qu’à la qualité du document lui-même et à la possibilité réelle de mise en œuvre de ses différents points.
Le PNDES a été présenté le gouvernement du Burkina Faso lors de la Conférence des partenaires du Burkina Faso pour le financement du Plan National de Développement Économique et Social (PNDES), tenue à Paris en France les 7 et 8 décembre 2016. Le coût de mise en œuvre du PNDES est estimé à à 15 395,4 milliards de francs CFA, dont 63,8%, soit 9 825 milliards de francs CFA doivent être financés en interne sur les ressources propres du Burkina Faso et 36,2% soit un montant de 5 570 milliards de francs CFA, doivent être financés par les partenaires et investisseurs étrangers.
L’événement a permis d’obtenir un montant agrégé d’intentions de financement public et privé de 18.000 milliards de francs CFA (23 milliards d’Euros), soit 8.000 milliards de francs CFA par la Conférence consacrée au secteur public hors partenariat public-privé et 10.000 milliards de francs CFA par le Forum des investisseurs.
Ce succès théorique ne peut toutefois se concrétiser d’un point de vue pratique qu’à plusieurs conditions.
En premier lieu, il faut que l’État du Burkina Faso soit effectivement en mesure de fournir les 63,8 % du coût total de la mise en œuvre du PNDES qui lui incombe, objectif dont la réalisation dépendra fortement de la situation économique et sociale du pays et de sa capacité à lever des ressources fiscales. En deuxième lieu, les intentions de financement des bailleurs sont conditionnées à une situation économique, sociale et sécuritaire satisfaisante dans le pays. En troisième lieu, la mise en œuvre effective des financements est conditionnée aux capacités effectives de décaissement du Burkina Faso. Il faut d’abord que les études de faisabilité des projets concernés soient achevées, ce qui n’est pas toujours le cas, et ensuite que le pays dispose des moyens administratifs nécessaires pour respecter les procédures de décaissement des multiples bailleurs, enfin que la mise en œuvre du PNDES ait lieu au rythme prévu, chaque tranche de versement étant conditionnée à la bonne mise en œuvre de la tranche précédente.
Comme on peut le voir, les pays destinataires de l’aide publique au développement ont toutes les raisons de rechercher un mode de fonctionnement de l’aide leur permettant de conserver un part importante de l’initiative, une tâche difficile pour les pays dans lesquels la gouvernance fait partie des domaines dans lesquels les besoins sont élevés. Autant il est important que le pays destinataire puisse jouer un rôle de premier plan dans la coordination des projets mis en œuvre sur son territoire, autant il demeure important que la préparation de plans pluriannuels de coopération demeure étroitement coordonnée entre pays destinataires et bailleurs.
B. IMPLIQUER PLUS DIRECTEMENT LES PAYS DESTINATAIRES DE L’AIDE
Au terme de cette mission, votre rapporteur estime qu’il est aujourd’hui devenu nécessaire de replacer l’aide publique au développement dans un cadre adapté à la diversité des situations, des enjeux et des acteurs.
Il importe en premier lieu de prendre acte de la mutation de l’aide publique au développement au cours des vingt-cinq dernières années, qui s’identifie de plus en plus à une coopération d’intérêt mutuel, et de moins en moins à un flux d’aide à sens unique. Il importe en second lieu de reconnaître que la coordination des acteurs de l’aide ne peut qu’être de plus en plus difficile à mesure que les formes qu’elle prend et les enjeux auxquels elle répond deviennent de plus en plus complexes et variés, tandis que les acteurs eux-mêmes sont de plus en plus nombreux et autonomes.
C’est pourquoi les politiques d’aides au développement doivent également évoluer vers des formes de partenariat susceptibles de prendre en considération ces enjeux.
1. De l’aide au développement au développement partagé
a. S’agit-il encore d’« aide publique au développement » ?
En premier lieu, l’emploi du mot : « aide » donne l’impression d’une relation inégale, voire de subordination, entre pays donateurs et pays destinataires des flux en question. Les interlocuteurs rencontrés par la mission au Burkina Faso comme au Maroc ont été nombreux à exprimer des réserves sur l’emploi de ce terme.
Mais le respect de nos interlocuteurs n’est pas l’unique raison de s’interroger sur l’emploi de ce mot. La réalité du développement et des politiques de développement a radicalement changé en quelques décennies. Comme votre rapporteur s’est efforcé de le montrer dans le présent rapport, il ne s’agit pas tant aujourd’hui d’aider autrui que de s’entraider. Les problèmes rencontrés au Sud affectent plus directement le Nord que ce n’était le cas auparavant. Les politiques en faveur du développement initiées par le Nord en direction du Sud ont également des effets au Nord. Les entreprises du Nord bénéficient de leur activité en faveur du développement du Sud. Les politiques de stabilisation menées par les États du Nord visent entre autres à prévenir des dangers qui les concernent eux-mêmes autant que les pays destinataires de ces politiques.
Les États engagés à des degrés divers sur la voie du développement font face à des obstacles ou à des problèmes qui s’identifient de plus en plus à des questions d’intérêt universel. Les questions climatiques concernent par définition tout le monde. Les problèmes relatifs à l’égalité entre hommes et femmes appellent des solutions dans toutes les régions du monde. Plus généralement, beaucoup de problème sociaux peuvent être dus non pas à une absence de croissance économique, mais au contraire à une croissance rapide et mal maîtrisée, et de ce fait peuvent apparaître aussi bien dans des économies peu développées mais en croissance rapide que dans des économies riches.
C’est pourquoi votre rapporteur estime que le mot « aide » est appelé à tomber prochainement en désuétude, non pas du fait d’une simple évolution du langage mais parce que son sens est de moins en moins adapté à la désignation des politiques dont il est ici question.
Cette évolution, si elle doit avoir lieu, se fera spontanément. Mais la réalité qu’elle recouvre devrait néanmoins être prise en considération dès maintenant dans nos politiques. Cette réalité est l’émergence d’un rapport plus égalitaire et plus transactionnel entre les pays donateurs et les pays destinataires de ce qui sera encore appelé, dans le corps du présent rapport, l’aide publique au développement.
S’il n’est plus nécessaire de démontrer que les pays fournisseurs d’aide au développement trouvent dans ces politiques un intérêt parfaitement légitime, il reste à trouver un moyen d’articuler cet intérêt avec celui des pays bénéficiaires d’une manière claire.
Le rôle que peuvent jouer les pays destinataires de l’aide dans l’aide publique au développement ne se limite pas en effet au fait de développer leurs économies afin que l’on aboutisse à un monde mieux équilibré à tout point de vue. Cette finalité de l’aide au développement demeure certes son principal objectif et, comme l’a souligné M. Philippe Jashan, président de Coordination Sud, il ne faut en aucun cas la perdre de vue. Mais il s’agit d’une finalité à long terme, composée d’objectifs qui, s’ils sont atteints, le seront de façon imprévisible et à des dates qui ne nous sont pas encore connues, même si chacun espère qu’elles sont proches. L’aide au développement est un investissement, même si le calcul exact de sa rentabilité demeure difficile.
b. La difficile coordination d’acteurs désormais nombreux
Ne plus concevoir l’aide publique au développement comme une politique à sens unique semble par ailleurs nécessaire à l’amélioration de la coordination des actions menées sur le terrain, en particulier celle des acteurs de plus petite taille.
Il a été donné à la mission, lors de son déplacement au Burkina Faso, la possibilité de rencontrer les représentants d’une dizaine d’ONG locales travaillant en partenariat avec le SCAC de l’ambassade de France.
Ces ONG opèrent pour la plupart dans le cadre du Fonds d’appui aux Projets innovants de la Société Civile et les Coalitions d’Acteurs (PISCCA) de l’ambassade de France. Les projets financés par ce fonds doivent avoir pour objectifs le développement local, la lutte contre la pauvreté et la satisfaction des besoins essentiels des populations les plus vulnérables. L’enveloppe 2016-2018 a pour thème la promotion et l’accompagnement de la jeunesse et des femmes en faveur d’un développement durable des territoires
Compte tenu de la durée de la rencontre et du nombre élevé d’interlocuteurs que la mission a pu rencontrer à cette occasion, il est impossible de porter une appréciation sur l’action menée par chacun d’entre eux, même si l’action de ces petites organisations paraissait incontestablement à la fois utile et innovante. Les ONG rencontrées opèrent dans des secteurs tels que la santé, l’aide à la création de petites entreprises, la formation professionnelle ou le secteur de l’artisanat.
Il est cependant apparu au cours de l’entretien que la coordination de l’action des ONG locale n’était pas un sujet simple. Tout d’abord, les dispositifs d’aide aux ONG doivent nécessairement comporter une procédure de contrôle de l’activité de ces dernières et d’évaluation de leurs résultats. Une telle évaluation suppose de la part des ONG concernées qu’elles consacrent une partie de leur activité à produire des documents d’évaluation. S’il ne s’agit pas de remettre en cause l’importance d’un tel travail, il convient sans doute d’éviter que des structures de petite taille ne consacrent une part croissante de leur activité à de telles démarches. Si la situation au Burkina Faso, dans le cadre du fonds PISCCA, n’a pas semblé à votre rapporteur poser de problème particulier, on peut facilement imaginer des situations dans lesquelles les démarches auprès de donneurs éventuellement multiples pourraient prendre une importance excessive.
En deuxième lieu, la coordination entre les ONG telles que celles rencontrées par la mission à Ouagadougou semble le plus souvent relever d’une démarche spontanée de leur part, ce qui encore une fois ne semble pas de poser de problème particulier dans ce cas, mais laisse supposer qu’une forme de supervision pourrait conduire à une meilleure optimisation des efforts. Plus précisément, il serait sans doute utile que l’État destinataire de l’aide puisse contribuer à la détermination des besoins et à la répartition d’actions dont l’intérêt est susceptible de diminuer en cas d’éparpillement.
Votre rapporteur a pu constater au cours des auditions conduites par la mission comme à l’occasion de son déplacement que le problème de la coordination de l’aide est constamment invoqué et semble dans beaucoup de cas pratiquement insoluble. La multiplicité des acteurs de l’aide n’est certainement pas à déplorer. C’est le signe d’un intérêt spontané croissant pour le développement de la part des acteurs publics comme de la société civile. Que chacun veuille contribuer à l’effort est évidemment une excellente chose.
Mais l’organisation de ce vaste mouvement est difficile, voire impossible dans un grand nombre de cas. Coordonner les actions des ONG est par définition une entreprise qui comporte des limites, puisqu’il s’agit d’initiatives entièrement privées et répondant aux objectifs que se sont fixés leurs auteurs.
Ainsi, M. Philippe Jahshan déclarait lors de son audition par la mission :
« Quand la France est intervenue au Mali, le ministre nous a demandé une mobilisation, mais aucun instrument ne l’a facilitée, alors que nous avions proposé de tels instruments. Nous proposions en effet de travailler sur une stratégie Mali avec les collectivités territoriales, les ONG et la société civile malienne. »
« Cela n’a pas abouti. La coopération française n’est pas outillée pour cela, sauf peut-être à l’AFD, où nous avions pu promouvoir des instruments pluri-acteurs de cette nature ».
Coordonner les projets de coopération décentralisée, ne serait-ce que dans le but d’éviter les redondances, se heurte à l’article 34 de la Constitution. Les phénomènes de redondance des actions de coopération décentralisée, ou à l’inverse d’absence d’actions de ce type dans des régions où elles seraient utiles, ont également été évoqués par les interlocuteurs rencontrés par la mission.
Les initiatives du secteur privé, dont l’importance est croissante, demeurent parfois en partie liées à des objectifs de rentabilité, certes tempérés mais qui demeurent au cœur de ces actions.
Si des initiatives existent pour améliorer l’organisation de l’aide privée ou semi-privée, elles se limitent dans beaucoup de cas à l’organisation d’une meilleure information ou à des dispositifs incitatifs de portée limitée. En outre, la création d’un organisme de coordination a pour conséquence d’ajouter un acteur supplémentaire à un ensemble qui en comporte déjà beaucoup.
Le problème de la coordination de l’aide est certainement bien présent à l’esprit de chaque interlocuteur rencontré par la mission dans le cadre de l’élaboration du présent rapport. Toutefois, votre rapporteur n’a pu s’empêcher de remarquer qu’une modalité de coordination de l’aide semble être jusqu’à présent restée au second plan : celle qui serait effectuée par l’État destinataire de l’aide.
2. Contractualiser l’aide bilatérale
Une piste que votre rapporteur propose de suivre consisterait à regrouper les actions bilatérales de l’aide publique au développement sous la forme d’un « Contrat international de développement solidaire » que passeront la France et le pays partenaire, dans le cadre d’une relation bilatérale.
Ce document, auquel d’autres partenaires pourront se joindre, aura pour objectif d’inscrire l’aide publique au développement dans une véritable relation mutuelle et de répartir les rôles entre la France et le pays destinataire, chacun jouant un rôle actif dans le projet commun de développement
Basé sur le modèle des C2D, un tel contrat prendra la forme d’un accord négocié et signé par les gouvernements des deux pays partenaires. Il devra faire l’objet d’un travail préparatoire approfondi, avec une identification des secteurs et des domaines d’intervention qui devront être couverts. Sa mise en œuvre aura lieu dans des conditions similaires à celles des C2D, sous la supervision, du côté français, de l’ambassade pour les orientations stratégiques et des opérateurs concernés pour la mise en œuvre des projets.
La durée de ce contrat sera de huit à dix ans, avec une révision intermédiaire à mi-parcours, afin qu’il réponde à une véritable orientation stratégique et qu’il soit l’objet d’un suivi de ses grandes orientations.
La négociation du contrat sera l’occasion d’examiner conjointement avec le pays partenaire les secteurs d’intervention prioritaires. Le fait que cette négociation fasse l’objet d’un dialogue politique de haut niveau permettra de mettre l’accent sur des domaines fondamentaux tels que, selon les cas, la gouvernance, les droits de l’homme, la maîtrise démographique ou l’égalité entre hommes et femmes. Ce dialogue politique permettra d’inclure des sujets connexes au développement, notamment celui des mobilités et des délivrances de visas, du côté français comme de celui du pays destinataire. Cette question, qui peut occasionnellement faire obstacle aussi bien à la venue en France d’étudiants étrangers qu’au suivi de certains projets de coopération décentralisée, pourrait ainsi être traitée plus efficacement ainsi qu’au niveau consulaire.
Le contrat comportera des dispositions visant à mieux coordonner les projets de coopération ou les initiatives privées ou semi-privées, le pays partenaire étant désormais en mesure de sélectionner lui-même, en fonction des priorités figurant dans le document, les projets de coopération mise en œuvre sur son territoire qui feront l’objet d’une aide publique de la part de la France.
Il contribuera ainsi à résoudre le problème de la coordination aussi bien des projets de coopération décentralisée, que des initiatives des ONG, en permettant à la France et au pays destinataire de faciliter conjointement les projets s’inscrivant dans le cadre ainsi défini en orientant, de façon préférentielle, les aides publiques en fonction des priorités négociées conjointement.
Le contrat international de développement solidaire pourra être élargi aussi bien du côté des pays destinataires que des pays contributeurs.
Du côté des pays destinataires, afin que des coordinations régionales soient possibles dans les secteurs où l’échelon national n’est pas suffisant, il sera possible à des pays voisins de rejoindre le contrat international de développement solidaire afin de traiter des thématiques plus pertinentes au niveau régional que national, qu’il s’agisse de sujets par nature transfrontaliers tels que la santé publique ou de projets d’infrastructure transfrontaliers.
Du côté des pays contributeurs, le contrat international de développement solidaire devra tout d’abord lister l’ensemble des contributions françaises à l’aide multilatérale mise en œuvre dans le pays concerné. Il devra également permettre de créer des partenariats internationaux, en particulier avec l’Union européenne, avec des pays francophones émergents et entre les outre-mer et leurs régions environnantes, pour construire des actions coordonnées.
Recommandation n° 18 Mettre en place avec les pays destinataires de l’aide des Contrats internationaux de développement solidaire de huit à dix ans prévoyant une procédure de révision à mi-parcours. |
C. ORGANISER L’AIDE AUTOUR DE PARTENARIATS INTERNATIONAUX
1. Agir dans un cadre européen
Les outils européens d’aide publique au développement ont été évoqués dans le corps de ce rapport, et votre rapporteur a recommandé que les procédures régissant l’aide européenne soient allégées afin que l’Union puisse se concentrer davantage sur la stratégie de son aide au développement.
La politique d’aide publique au développement de l’Union européenne est aujourd’hui fortement liée à l'accord de Cotonou, qui régit les relations entre l'Union européenne (UE) et le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (groupe ACP), arrive à échéance à la fin de l'année 2020. Cette échéance peut être l’occasion pour la France de repenser également son partenariat avec l’Union européenne en matière de développement.
Par rapport au dispositif précédent, le dispositif de Cotonou comporte un dialogue politique renforcé, avec une plus grande place accordée aux initiatives régionales dans une perspective de maintien de la paix et de prévention et de résolution des conflits. En matière d’aide, Le chapitre 5 du texte prévoit un mécanisme de contrôle et d’évaluation de la part des ACP eux même et de la Communauté européenne par le biais d’un comité ACP-CE.
L’accord de Cotonou bénéficie en outre de l’appui d’un certain nombre d’institutions communes. Le Conseil des ministres, composé de membres du Conseil de l’UE et de la Commission ainsi que d’un membre du gouvernement de chaque pays ACP, se réunit une fois par an et a pour but de conduire le dialogue politique et veiller à la bonne mise en œuvre de l’accord. Il s’appuie notamment sur le Comité des ambassadeurs. Enfin, l’Assemblée parlementaire paritaire est un organe consultatif qui se compose des membres du Parlement européen et des représentants des États ACP, siégeant en nombre égal.
Dans sa communication au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen du 12 avril 2005, la Commission européenne soulignait toutefois l’importance d’une amélioration effective de la cohérence des politiques d’aide. Permettre à l’Union européenne d’être présente à la fois dans la négociation et la mise en œuvre du contrat international de développement solidaire permettrait d’inscrire l’aide européenne dans un mécanisme concret comportant à la fois la définition d’objectifs précis, plus proches du terrain, et une participation effective des pays destinataires à l’allocation de l’aide et à l’évaluation de son efficacité, tandis que la France serait mieux positionnée pour veiller à la cohérence des actions des différents bailleurs.
2. Associer la France à des États francophones en voie d’émergence dans le cadre de coopérations tripartites
La mission d’information a souhaité se rendre au Maroc afin de pouvoir s’informer sur un État qui se trouve actuellement dans une situation « intermédiaire », à la fois destinataire de l’aide, et lui-même fournisseur d’aide, non pas en tant que bailleur, mais principalement en tant que fournisseur d’expertise.
La politique du Maroc vis-à-vis de l’Afrique subsaharienne a longtemps été dominée par les préoccupations diplomatiques, l’un de ses principaux objectifs consistant à atténuer les conséquences du litige du Sahara occidental. La coopération restait principalement de nature politique, avec des objectifs d’influence à long terme qui se traduisaient notamment par l’octroi de nombreuses bourses d’études à des étudiants africains. À partir des années 2010, et notamment de 2014, les tournées africaines du roi Mohammed VI ont pris un caractère plus commercial, les chefs d’entreprises devenant plus présent dans les délégations accompagnant le Roi, jusqu’à représenter une quarantaine de personnes sur cinquante, selon M. Abdou Diop, Président de la Commission Afrique et Sud-Sud de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), rencontré par la mission.
À travers une stratégie basée principalement sur la promotion de ses entreprises d’une part, et d’autre part sur une coopération basée principalement sur l’expertise, la création prochaine d’un organisme analogue à Expertise France étant actuellement envisagée, le Maroc est progressivement devenu un point de passage, un « hub », pour les entreprises étrangères souhaitant opérer et s’implanter en Afrique subsaharienne.
C’est ainsi que les activités africaines du groupe Accor sont maintenant concentrées à Casablanca, tandis que le groupe Peugeot va installer une unité de production à Kénitra à destination du marché africain.
Le Maroc est pour sa part devenu en 2015 le premier investisseur étranger en Côte d’Ivoire. Les entreprises marocaines, opérant entre autres dans la finance, le transport aérien, le secteur pharmaceutique, l'immobilier, l'assurance ou les télécoms, sont maintenant solidement installées dans les pays de la sous-région sahélo-sahélienne, comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, mais aussi au Cameroun et au Gabon, voire en Afrique Australe et de l'Est, en Angola et au Burundi. Le Maroc est désormais le premier investisseur africain au sein de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), dont les volumes d'échanges commerciaux ont doublé en quatre ans.
L’expansion de l’activité en Afrique subsaharienne de l’Office chérifien des Phosphates, et plus particulièrement de la filiale du groupe OCP OCP-Africa, se situe au croisement de la coopération et du commerce. Les projets du groupe OCP en Afrique couvrent ainsi l’ensemble de la chaine de valeur, incluant la construction d’usines d’engrais localement – notamment au Nigeria et au Rwanda avec deux projets lancés en 2016, le développement de capacités de logistique et distribution, ainsi que l’investissement dans la recherche pour le développement de formules adaptées aux besoins des sols et des cultures (cartographie de la fertilité des sols africains et besoins respectifs en engrais). La Banque Africaine de Développement (BAD) s’est engagée à accompagner ces différentes initiatives du groupe OCP en faveur du continent africain, tandis que La fondation Phosboucraa a été créée en 2014 avec pour principale mission l'engagement social et sociétal du groupe OCP dans les régions du Sud.
Le Maroc bénéficie enfin en quelque sorte, en termes d’expertise, de sa propre expérience de pays en phase de développement, notamment en raison du faible développement d’une partie de son propre territoire et des projets de développement conduits par l’État marocain, souvent appuyés sur des financements de bailleurs extérieurs, parmi lesquels les États du Golfe dont la participation est uniquement financière. La politique de développement marocaine, active au Maroc même, dispose d’outils et de compétences extrêmement pertinents dans les domaines tels que les infrastructures et le développement agricole.
L’exemple marocain fournit donc une illustration de la nécessité pour la coopération française de renforcer les partenariats tripartites avec les pays émergents ou partiellement émergents, en particulier lorsqu’il s’agit de pays francophones avec lesquels la France entretient une relation particulière. De tels partenariats sont en effet envisageables dans un cadre francophone, avec des États qui d’une part partagent avec la France une histoire commune et des pratiques parfois similaires héritées d’un passé commun, et qui d’autre part évoluent dans un environnement régional dans lequel des interventions sont nécessaires dans l’intérêt commun, l’Afrique subsaharienne pour le Maroc, mais aussi le Moyen Orient pour un État comme le Liban.
De tels partenariats tripartites existent, mais votre rapporteur estime que leur importance est appelée à s’accroître et qu’ils constitueront pour la France un relais d’influence majeur ainsi qu’un démultiplicateur de sa politique d’aide publique au développement générateur d’effets de levier. Leur doit par conséquent être recherché.
Recommandation n° 19 Renforcer les partenariats tripartites avec les pays francophones émergents afin de démultiplier l’effet et l’influence de la politique française d’aide publique au développement |
3. Coordonner les projets de coopération entre les outre-mer et leurs régions environnantes
L’idée de développement solidaire s’applique mieux que partout ailleurs aux outre-mer et à leurs régions environnantes. Qu’il s’agisse de Mayotte et des Comores, de la Réunion et de Madagascar, de la Guadeloupe ou de la Martinique et des États des Caraïbes, ou encore de la Guyane et de Surinam, le sort de ces territoires français est intimement lié à celui de leurs voisins immédiats.
L’expérience des outre-mer français en matière de développement peut être profitable aux États voisins dont la situation économique est souvent difficile, et à l’inverse, faciliter le développement de ces États créera un meilleur environnement pour nos d’outre-mer. Ainsi, la coopération médicale entre Mayotte et les Comores permet d’alléger la charge de la maternité de Mamoudzou, ce qui est d’un intérêt évident pour la population locale. Cette coopération demeure cependant insuffisante.
Les outre-mer français ont donc autant besoin d’un accroissement de la coopération que les États voisins, même lorsque ces derniers sont plus pauvres. Cependant, cette coopération est rendue difficile par la complexité du dispositif français. Selon M. Philippe Orliange, directeur exécutif de la stratégie, des partenariats et de la communication de l’AFD, déclarait à la mission d’information : « On n’a pas utilisé jusqu’à présent tout le potentiel de l’AFD, seule institution publique présente à la fois sur le territoire national et dans les États étrangers voisin. C’est notamment le cas avec Mayotte et les États voisins, ou avec la Guyane, ou la Guadeloupe.
« Depuis que l’on s’attelle à faire émerger la coopération régionale, le résultat reste modeste. Une des raisons est la segmentation des outils français, qui est très forte et qui ne permet pas d’utiliser complètement ces synergies.
« L’AFD reçoit des moyens du ministère de l’outre-mer, comportant assez peu de subventions, mais ces moyens sont consacrés exclusivement aux DOM et aux TOM. Les moyens du ministère des Affaires étrangères sont pour leur part exclusivement consacrés aux États étrangers. Chacun veut faire plus sur l’intégration régionale mais les moyens ne sont pas fongibles. Si on leur dit qu’on a un projet de pont, cela ne marche pas.
« C’est la même chose si l’on veut combiner le FED et le Fonds européen de développement économique régional (FEDER), l’ingénierie administrative défie l’entendement. »
La mise en place d’un dispositif législatif susceptible de libérer le potentiel de coopération qui existe entre les outre-mer et leur voisinage serait éminemment souhaitable mais sort du champ de la présente mission d’information. Votre rapporteur se contentera donc de recommander que soit étudiée la possibilité de conduire dans le cadre d’expérimentations des projets de coopération entre les outre-mer français et les États voisins, pilotés dans la mesure du possible par les territoires concernés, et permettant des retours d’expérience utiles à une future réforme de leur coopération.
Recommandation n° 20 Mettre en œuvre des expérimentations visant à permettre aux outre-mer de piloter des projets d’aide au développement dans leurs régions respectives. |
Au fil de ses travaux, la mission d’information parlementaire sur les acteurs bilatéraux et multilatéraux de l’aide publique au développement a pris conscience de la transformation profonde de ce domaine d’action ainsi que de son objet.
En observant l’évolution de l’aide publique au développement et du développement lui-même au cours des vingt-cinq dernières années, il est apparu que les notions de « monde développé » et de « monde en développement » sont désormais bel et bien dépassées. La situation actuelle se caractérise en effet par l’existence de deux catégories de situations très différentes.
Les premières sont celles des pays qui ne se développent pas ou se développent très lentement, où les conditions de vie des populations sont encore très majoritairement difficiles et ou la pauvreté et l’espérance de vie ont stagné depuis les années quatre-vingt-dix, voire depuis les années soixante. Ces situations sont généralement liées à des problèmes d’instabilité politique ou à l’absence de transition démographique, et appellent des interventions à la fois ciblées sur des thématiques particulières et plus larges dans leur champ d’action que les politiques d’aide au développement traditionnelles.
Les secondes concernent les pays autrefois considérés comme « en développement » qui ont effectué au cours des dernières décennies un rattrapage parfois spectaculaire, atteignant souvent les objectifs fixés par l’agenda des Objectifs du Millénaire de 2000, mais en ordre dispersé, avec des écarts aussi bien entre eux qu’à l’intérieur de leurs territoires et au sein de leurs sociétés. Ces situations de croissance rapide mais souvent inégale ont par ailleurs mis au premier plan des problèmes sociaux ou environnementaux qui n’étaient que rarement pris en considération auparavant, tout en faisant des pays concernés des participants désormais importants et actifs à la réflexion sur les politiques d’aide ainsi que sur leur mise en œuvre.
Le développement lui-même est désormais conçu non plus comme un transfert du Nord au Sud afin de l’aider à rattraper les pays riches, mais de plus en plus comme une politique partagée de maîtrise de la croissance économique visant à la fois à la rendre possible là où elle ne l’est pas et à la rendre plus respectueuse des équilibres sociaux et environnementaux là où elle a lieu, aussi bien au Nord qu’au Sud.
Parallèlement à cette évolution, la politique française d’aide publique au développement a cherché à adapter son outil institutionnel et sa stratégie aux nouveaux enjeux. Elle l’a fait à travers des réformes profondes, dont votre rapporteur ne conteste pas la pertinence mais estime qu’elles doivent s’accompagner d’un pilotage politique plus affirmé, à la fois de la part du Parlement et au niveau intergouvernemental. Sont ainsi proposés dans le présent rapport un CICID plus régulier et plus impliqué, un CNDSI missionné pour orienter les actions multilatérales et un débat parlementaire sur l’aide publique au développement tous les trois ans.
La politique française s’est également adaptée à travers une réflexion stratégique sur la répartition de l’aide, notamment entre aide bilatérale et aide multilatérale, qui doit être poursuivie afin que l’aide publique au développement de la France puisse conserver sa pertinence.
La mission a en effet pu constater au fil de ses travaux que la distinction entre aide bilatérale et multilatérale s’est en grande partie effacée. Si la France n’est qu’un membre parmi d’autres d’organismes comme les institutions onusiennes ou la Banque mondiale, elle occupe en revanche une place centrale au sein de la Francophonie ou de l’Union européenne et peut réellement peser sur leurs choix. C’est pourquoi, plutôt qu’un choix tranché entre ces deux formes d’aides, la mission plaide pour un suivi plus attentif des politiques multilatérales, notamment par le Parlement et le CNDSI.
Le choix binaire entre multilatéral et bilatéral doit donc laisser la place à une réflexion plus centrée sur les thématiques. Ainsi, la recommandation n° 8, qui vise à rediriger une partie du montant versé annuellement au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme au profit de l’aide bilatérale sous forme de dons, n’a évidemment pas pour finalité une diminution de l’aide française en matière de santé, mais plutôt une amélioration de celle-ci, éventuellement par un accroissement de l’aide bilatérale, sous forme de dons, aux systèmes de santé nationaux.
La pertinence et l’efficacité d’une politique d’aide ne peuvent toutefois aller au-delà de ce qu’autorise son financement. Le budget de la politique française d’aide publique au développement connaît actuellement, et depuis peu, une trajectoire d’augmentation qui, si elle est poursuivie, devrait lui permettre d’atteindre enfin l’objectif, poursuivi depuis longtemps mais jamais atteint, des 0,7 % du RNB consacrés à l’aide. Le financement de l’aide s’est cependant diversifié, en particulier avec la mise en place de la taxe sur les billets d’avion et la taxe sur les transactions financières. Votre rapporteur recommande dans le présent rapport que l’extension de cette taxe aux transactions journalières dites « intraday » soit mise en place le 1er janvier 2018, en application du vote émis par le Parlement.
De nouvelles formes d’aide au développement, publique ou non, sont également apparues, sur lesquelles les politiques publiques peuvent s’appuyer. Aussi votre rapporteur recommande-t-il la création d'une Fondation pour le Développement solidaire qui mixe fonds publics bilatéraux et multilatéraux, contributions de citoyens et entreprises pour renforcer dons, fonds de garantie ou titres participatifs.
Enfin, il est apparu à la mission, au fil des auditions qu’elle a conduites et à l’occasion du déplacement qu’elle a effectué au Burkina Faso et au Maroc, que cette diversification des acteurs de l’aide, des modes opératoires des politiques d’aide et des finalités mêmes de l’aide publique au développement, rendait nécessaire l’émergence d’un cadre plus partenarial et plus contractuel entre pays donateurs et pays destinataires de l’aide. Votre rapporteur estime en effet que la terminologie elle-même est devenue en grande partie obsolète, et que l’expression « aide au développement » masque la réalité plus qu’elle ne la désigne. Le développement est certes l’objectif visé, mais il ne pourra être atteint qu’à travers une relation d’égal à égal entre pays du Nord et du Sud, prenant en considération les intérêts communs des partenaires, permettant entre eux une meilleure répartition des rôles et rendant possible une meilleure coordination des acteurs et des projets.
C’est pourquoi votre rapporteur recommande la mise en place de contrats internationaux de développement solidaires entre la France et les pays destinataires d’une durée de huit à dix ans. Cette démarche bilatérale n’exclura cependant pas des formes d’association plus larges, avec notamment une implication forte de l’Union européenne, la mise en place de partenariats tripartites, particulièrement au sein de la francophonie, ainsi que le lancement à titre expérimental de projets de coopération plus ambitieux entre les outre-mer et leurs régions environnantes. Du côté des pays destinataires, le contrat international de développement solidaire permettra également des formes d’association régionale sur des thématiques définies.
Encore une fois, la séparation entre aide bilatérale et multilatérale présente des limites, puisque le contrat international de développement solidaire permettra des formes d’association bilatérales ou non, adaptées avant tout aux nécessités concrètes et aux besoins constatés.
Au terme de cette mission d’information, votre rapporteur dresse par conséquent le double constat d’un foisonnement des acteurs de l’aide publique au développement, des initiatives et des projets dans ce domaine, ce dont on ne peut que se réjouir, et de la difficulté concomitante à piloter des politiques de plus en plus complexes qui doivent et devront encore s’adapter à un monde en mutation.
À travers les différentes recommandations faites dans le présent rapport, il s’agit donc de donner à la France les moyens de rester un acteur majeur de l’aide au développement en inscrivant cette dernière dans le temps long. Il s’agit d’abord de doter la France des moyens financiers de sa politique par une augmentation régulière des budgets jusqu’à ce que l’objectif des 0,7 % soit enfin atteint et par un renforcement de la part des dons dans ces budgets. Il s’agit ensuite de mettre en place un suivi de la stratégie d’aide, par un contrôle plus régulier du Parlement, la réunion plus régulière du CICID et un renforcement de la supervision du CNDSI. Il s’agit enfin de tenir compte de la transformation profonde du développement en faisant évoluer notre politique d’aide vers une politique de développement solidaire inscrite dans un cadre plus contractuel avec les États destinataires.
Au travers des recommandations figurant dans le présent rapport, votre rapporteur espère avoir contribué à ce que la France soit mieux préparée aux évolutions des relations actuelles et à venir avec les pays en grande pauvreté, en développement et en émergence.
La commission des affaires étrangères a examiné le présent rapport d’information au cours de sa séance du mardi 21 février 2017.
Mme la présidente Élisabeth Guigou.
Mes chers collègues,
L’ordre du jour appelle l’examen, ouvert à la presse, du rapport de la mission d’information sur les acteurs bilatéraux et multilatéraux de l’aide au développement présidée par M. André Schneider et dont le rapporteur est M. Jean-René Marsac.
M. André Schneider, président de la mission. Madame la Présidente, mes cher(e)s collègues,
Il y a un peu moins d’un an était créée la mission d’information sur les acteurs bilatéraux et multilatéraux de l’aide publique au développement. Il s’agissait en effet de faire un bilan de la politique française d’aide publique au développement alors que nous arrivions au terme de cette quatorzième législature au cours de laquelle ce sujet a fait l’objet d’une attention soutenue de notre part.
Au cours de ces cinq ans ont eu lieu des événements internationaux importants comme le sommet d’Addis-Abeba, l’adoption des Objectifs du Développement durable à New York en septembre 2015 et la COP21 à Paris, en décembre de la même année. Nous avons adopté en juillet 2014 la loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, et le dispositif français d’aide publique au développement s’est réorganisé avec la création d’Expertise France et le rapprochement entre l’AFD et la Caisse des Dépôts et Consignations.
Nous sommes amenés chaque année à nous pencher brièvement sur la politique française en matière d’aide publique au développement à l’occasion de l’examen du budget, et dans ce domaine, on peut dire que l’action du Parlement est utile puisque nous avons plusieurs fois obtenu une hausse des budgets de l’aide.
Nous avons aussi eu l’occasion d’auditionner les dirigeants de l’AFD et, depuis peu, d’Expertise France, organisme au sein duquel j’ai l’honneur de siéger avec notre collègue François Loncle, notamment lors de l’examen des contrats d’objectifs et de moyens qui lient ces institutions à l’État.
Mais il était important que nous puissions, une dernière fois avant de nous séparer, porter un regard d’ensemble sur la politique d’aide française et essayer de rendre compte de son adaptation à un monde en pleine évolution.
Afin de mesurer cette évolution, il convient d’abord de prendre acte du fait qu’il n’y a plus de « tiers monde ». Nous sommes bel et bien sortis de l’ancien schéma dans lequel un Nord riche et minoritaire vivait à côté d’un Sud représentant la plus grande partie de la population mondiale et vivant dans la pauvreté. Pour simplifier, on peut diviser le monde en développement en deux groupes principaux.
Il y a bien, d’un côté, des zones de pauvreté, et même de grande pauvreté, où le développement n’a pas eu lieu ou n’a eu lieu que très partiellement. Ces pays, dont beaucoup sont situés en Afrique subsaharienne, sont prioritaires pour la politique française. Ce sont des États où le développement économique s’est parfois heurté à une instabilité politique qui a paralysé l’économie, et où la croissance démographique a souvent annulé la croissance économique du point de vue des populations.
Le deuxième groupe est beaucoup plus varié. Il est constitué des pays qui ont effectué depuis les années quatre-vingt-dix un rattrapage souvent spectaculaire et qui ont bien souvent atteint les objectifs fixé par l’agenda des Objectifs du Millénaire adopté en l’an 2000.
Pour s’en tenir à un seul chiffre, entre 1990 et 2015, le nombre de personnes dans le monde touchées par l’extrême pauvreté dans les pays en développement est ainsi passé de presque deux milliards à 136 millions, c’est-à-dire de 47 % à 14 % de la population mondiale.
Mais bien sûr, ce n’est là qu’une moyenne, et la réalité est que ces progrès énormes en matière de développement ont eu lieu en ordre dispersé. Les écarts de richesse entre pays, mais aussi entre territoires à l’intérieur de beaucoup de pays, et au sein même des populations, se sont creusés, et de nouvelles problématiques sociales et environnementales sont apparues dans le paysage de l’aide au développement.
La croissance rapide de certaines régions a aussi créé ses propres problèmes. La maîtrise du climat et l’égalité entre hommes et femmes sont ainsi devenus des sujets majeurs dans les réflexions sur le développement.
Ces dernières ont ainsi abouti en septembre 2015 à l’adoption des Objectifs du Développement durable, qui font du développement un objectif universel auquel doivent s’atteler aussi bien les pays du Nord que ceux du Sud. Le développement durable n’est plus une simple question de richesse, mais englobe désormais des objectifs sociaux et environnementaux. La croissance économique est toujours recherchée, mais elle doit désormais être mieux maîtrisée afin d’éviter les déséquilibres et les inégalités qui s’aggravent lorsqu’elle est trop rapide. L’accord de Paris de décembre 2015 a pour sa part fait de la lutte contre les dérèglements climatiques une composante majeure des politiques d’aide au développement, dont elles doivent désormais tenir compte à toutes les étapes de leur mise en œuvre.
Alors que les problématiques de l’aide sont devenues plus nombreuses et plus complexes, les acteurs, aussi bien bilatéraux que multilatéraux, se sont multipliés au cours des dernières décennies. De nouveaux organismes multilatéraux ont été créés : des fonds thématiques ou « verticaux » ont été constitués tels que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, la Facilité financière internationale pour la vaccination ou l’Initiative pour l'alimentation en eau et l'assainissement en milieu rural en Afrique. De nouvelles institutions internationales se sont créées comme la Banque asiatique d’Investissement dans les infrastructures, dont les opérations ont commencé l’année dernière.
Dans le domaine bilatéral, les acteurs privés ou semi privés se sont également multipliés, qu’il s’agisse des ONG, d’acteurs de l’économie sociale et solidaire, d’organismes de microcrédit ou de fondations privées, tandis que les collectivités territoriales continuent à mettre en œuvre des actions de coopération décentralisée pour lesquelles l’État cherche à définir une forme de coordination.
L’aide elle-même prend des formes plus diverses. Aux transferts de fonds publics qui constituaient l’essentiel de l’aide se sont ajoutés des fondations privées, dont les contributions peuvent être considérables, ou les transferts monétaires des diasporas vers leurs pays d’origine.
Ce foisonnement d’acteurs de l’aide, bilatéraux et multilatéraux, publics et privés, ne va pas sans poser de nouvelles questions.
Il en va ainsi de la coordination des acteurs de l’aide. La mission a ainsi pu constater au fil des auditions et lors de son déplacement qu’il ne suffit pas de mettre en place des procédures de coordination ou, encore mieux, de créer des organismes chargés de coordonner les actions des acteurs de l’aide, pour régler le problème.
Cela est vrai des actions de coopération décentralisée, qui restent dispersées et trop peu soutenues malgré l’existence de la Délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales ou d’organismes comme Cités Unies France, dont la mission a auditionné les dirigeants. Les ONG pour leur part ont mis en place des organismes tels que Coordination SUD, mais le paysage français des ONG se compose principalement de petites organisations, dont une coordination trop stricte affaiblirait le dynamisme et réduirait la capacité d’initiative.
Comme on le voit parfois au niveau international et européen, les efforts de coordination aboutissent fréquemment à une multiplication et à un alourdissement des procédures, voire à la mise en place de nouveaux organismes, ce qui ne règle le problème que partiellement, voire le complique encore un peu plus.
Dans ce contexte, la France a cherché à adapter son outil institutionnel et sa politique d’aide. Une série de réformes, depuis la suppression du ministère de la coopération en 1998 jusqu’à la loi de juillet 2014 qui a notamment créé le Conseil national du développement et de la solidarité internationale, ont abouti au dispositif actuel, parfois critiqué en raison du partage du pilotage de l’aide entre plusieurs ministères.
Plutôt qu’un retour en arrière ou un nouveau partage des rôles entre administrations, la cohérence de la politique d’aide française serait cependant mieux assurée par un renforcement du suivi des politiques. C’est pourquoi le rapport contient des recommandations dans ce sens : des réunions plus régulières du CICID d’une part, conformément à son décret de création, et un renforcement des moyens de contrôle du Parlement d’autre part, avec notamment la tenue tous les trois ans d’un débat sur la stratégie française en matière d’aide publique au développement.
La réorganisation de l’aide publique au développement a aussi concerné les opérateurs, avec notamment la mise en place d’Expertise France et le rapprochement entre l’Agence française de développement et la Caisse des Dépôts et Consignations.
Le rapprochement entre l’AFD et la CDC a été réalisé le 6 décembre dernier avec la signature par les deux organismes d’une Charte d’Alliance stratégique ambitieuse, qui doit permettre la mise en commun d’une partie de leurs moyens et l’émergence d’une agence de développement d’une taille conforme aux ambitions françaises dans ce domaine. Il est cependant trop tôt pour évaluer le résultat de ce rapprochement encore très récent.
La création d’Expertise France vise également à concentrer les capacités françaises en matière d’expertise au sein d’un opérateur auquel ont été assignés des objectifs ambitieux, puisque les objectifs du Contrat d’objectifs et de Moyens (COM) passé par Expertise France et l’État et approuvé par notre commission en juin 2016, consistent à doubler le chiffre d’affaire d’Expertise France et à atteindre l’autofinancement en cinq ans.
Il reste que le regroupement de l’expertise en son sein, combinée au fait de confier à l’AFD le secteur de l’expertise en matière de gouvernance ont inévitablement abouti à priver les ambassades d’une partie de leurs attributions, de leur capacité propre d’appréciation des projets de coopération, ainsi que de relais auprès des administrations et de la société civile qui peuvent leur faire défaut aujourd’hui. La création d’Expertise France étant récente, il est sage d’attendre encore un peu pour en évaluer le bon fonctionnement. Le COM de juin 2016 s’étendant sur une durée de trois ans, notre rapport propose donc, en plus du renforcement des capacités d’Expertise France, d’évaluer à l’occasion du prochain COM entre Expertise France et l’État le bon fonctionnement de la relation entre Expertise France, l’AFD et les postes diplomatiques. Le rapport propose également, afin de renforcer le rôle des ambassades dans la politique d’aide française, de rallonger la durée des COM liant l’État et l’AFD de trois à cinq ans, et que soit recueilli dans sa phase préparatoire l’avis des ambassades auprès des pays destinataires de l’aide sur les orientations stratégiques de la France et de l’AFD en matière d’aide publique au développement.
Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Jean-René Marsac, qui présentera les principales propositions faites par la mission afin de consolider la stratégie française d’aide publique au développement dans ce paysage riche et complexe.
M. Jean-René Marsac, rapporteur de la mission. Madame la Présidente, mes cher(e)s collègues,
Il convient tout d’abord de souligner que la réorganisation institutionnelle, qui date déjà de quelques années mais qui se poursuit, et la réorientation stratégique de l’aide publique au développement française ne rendront cette dernière plus efficace que dans la mesure où son financement sera à la hauteur de ses besoins, ce que nous n’avons cessé de dire. Cette mission est l’occasion de rappeler que le budget de l’aide française, qui en 2017 a retrouvé une trajectoire d’augmentation, doit poursuivre dans cette direction. Le rapport recommande par conséquent une augmentation annuelle du budget de la mission « aide publique au développement » de 5 %, ce qui était le chiffre à l’entrée de notre débat pour le budget 2017. Nous avons abouti à une augmentation de 3,7 % environ. Ce rythme de 5 % est celui qui nous permettrait d’atteindre en 2030 l’objectif des 0,7 % du RNB.
L’augmentation du FSD doit aussi être poursuivie, et le rapport recommande de mettre en œuvre l’extension de l’assiette de la TTF aux transactions dites « intraday » en janvier 2018, conformément à notre vote.
L’augmentation de la part des dons dans l’aide publique au développement est également nécessaire et une des recommandations du rapport vise à ce que soit examinée la possibilité de renforcer les dons, entre autres, en utilisant une partie des dividendes de l’AFD. L’AFD a en effet progressivement, ces dernières années, étendu son activité de prêt aux pays émergents afin de financer des projets qui s’inscrivent dans le cadre des ODD, donc qui relèvent bien de l’aide publique au développement, mais avec une faible concessionnalité.
L’élargissement du champ d’action de l’AFD ces dernières années a permis à celle-ci non seulement d’étendre les bénéfices de son activité et de diversifier son expérience, mais également d’accroître ses dividendes. Même si nous sommes conscients des contraintes pesant sur l’agence en matière de fonds propres résultant du statut de Bâle III, il demeure souhaitable qu’une réflexion soit engagée afin qu’une partie des gains de l’AFD puisse renforcer la part de l’aide publique au développement effectuée sous forme de dons.
Cependant, la question du financement de l’aide publique au développement va bien au-delà de ses seuls aspects budgétaires. Au niveau international, la réflexion sur les objectifs du développement, qui a abouti à l’Adoption des Objectifs du millénaire en 2000 et des Objectifs du Développement durable en 2015, s’est accompagnée d’une réflexion parallèle sur le financement de l’aide, avec le consensus de Monterrey en 2002, la conférence de Doha en 2008 et le programme d’action d’Addis-Abeba en 2015. Cette réflexion a mis en évidence l’importance du financement local du développement et la nécessité de rechercher des moyens de favoriser l’émergence des secteurs privés des pays du Sud, sous des formes qui peuvent aller de la microfinance au commerce équitable par exemple.
La mission a ainsi auditionné des représentants de fondations privées ou d’associations actives dans ces domaines et a pu ainsi mesurer l’importance du soutien au secteur privé, sous des formes qui peuvent aller de la prise de participation dans des entreprises locales par Proparco, par exemple, au soutien apporté à la microfinance par un organisme tel que la Fondation Grameen-Crédit agricole. Le soutien au secteur privé apparaît comme un élément essentiel de l’aide aussi bien dans les pays émergents ou en voie d’émergence que dans les pays les plus pauvres, où l’aide sous forme de dons n’atteint pas un niveau suffisant.
Le soutien au secteur privé est notamment essentiel dans les pays où l’économie est encore largement informelle, et il passe notamment par une aide à la formation professionnelle, dont les dirigeants du Burkina Faso que nous avons rencontrés ont été unanimes à nous dire combien elle était actuellement insuffisante.
Le soutien à la microfinance, pour sa part, vise à stimuler l’émergence de secteurs bancaires embryonnaires dans les régions les plus pauvres, notamment les zones rurales, où le secteur bancaire traditionnel ne va pas, même si nous avons constaté que des technologies de bancarisation par le biais du téléphone, par exemple, se développaient fortement en Afrique, entre autres. Le soutien au commerce équitable et à l’économie sociale et solidaire s’inscrivent plus pour leur part dans une logique de maîtrise des effets de la croissance dans le domaine social et en matière environnementale.
Le rapport fait des propositions pour appuyer ces formes d’aide innovantes, mais il propose surtout la création d’une Fondation pour le Développement solidaire, française ou francophone, chargée de recueillir des fonds et de coordonner une partie de l’aide publique au développement effectuée sous forme de dons. Cette fondation pourrait bénéficier d’une première dotation en provenance du fonds de solidarité pour le développement (FSD), sur les nouvelles ressources de la taxe sur les transactions financières. Je crois que c’est le moment de les mettre en œuvre. Elle constituerait une interface entre les financements publics et les acteurs privés de l’aide publique au développement et elle servirait de cadre à une augmentation de l’aide sous forme de dons.
Enfin, les travaux de la mission nous ont amené à la conclusion que ce foisonnement d’acteurs et d’initiatives rend nécessaire une nouvelle approche de l’aide au développement, plus partenariale et plus contractuelle.
Plus partenariale parce que l’aide au développement n’est plus désormais un simple transfert de richesses du Nord vers le Sud visant à aider ce dernier à rattraper son retard sur les pays riches, ou du moins cela n’en est pas l’unique objet. S’il demeure essentiel d’aider les pays les moins développés à sortir de l’ornière du sous-développement afin que leurs populations puissent à leur tour sortir de la pauvreté, l’aide au développement est désormais avant tout un investissement sur l’avenir. Les pays donateurs ont autant que les pays destinataires de l’aide un intérêt au succès des politiques d’aide. Qu’il s’agisse de la stabilité politique de régions comme le Sahel, étroitement liée au développement des économies locales, de la maîtrise des flux migratoires qui dépend de celle de la croissance démographique et du soutien à l’emploi agricole, par exemple, ou qu’il s’agisse de problématiques partagées comme la préservation de l’environnement ou l’égalité entre hommes et femmes, le constat sur lequel repose les Objectifs du développement durable s’impose à nous tous. Le développement durable et maîtrisé est un objectif commun aussi bien pour le Nord que pour le Sud.
C’est pourquoi nous avons été sensibles, notamment lors du déplacement effectué par la mission au Burkina Faso et au Maroc, au fait que beaucoup de nos interlocuteurs nous aient fait remarquer que l’expression « aide au développement » n’était plus adaptée à la réalité actuelle, ou en tout cas, pas à la totalité de cette réalité, non seulement en raison de son caractère condescendant aux yeux de certains, mais simplement parce qu’elle ne reflète plus la réalité, qui est aujourd’hui celle d’une relation basée sur des intérêts partagés.
La conclusion à laquelle est parvenue la mission est que c’est en tenant compte de cette réalité que l’on pourra évoluer vers une politique d’aide plus adaptée à la complexité des enjeux actuels et à la diversité des acteurs et des initiatives. C’est en renforçant le rôle des pays destinataires de l’aide et en reconnaissant qu’il ne s’agit plus tant d’une aide que d’un partenariat que nous pourrons avancer vers une clarification des rôles et, sans doute, une plus grande cohérence des politiques.
La mission d’information propose ainsi de s’inspirer du modèle des Contrats de désendettement et de développement, dits C2D, qui ont été mis en place afin de régler le problème de surendettement qui concernait dans les années quatre-vingt-dix un certain nombre de pays très pauvres, mais qui avaient néanmoins accédé aux prêts. Parallèlement aux initiatives d’annulations de dettes prises par les bailleurs internationaux, la France a alors mis en place un dispositif, le C2D, dans lequel les sommes remboursées par le pays concerné sont encaissées mais immédiatement reversées par la France, mais dans le cadre d’un programme d’aide qui a préalablement été élaboré précisément et soigneusement, et qui a été négocié conjointement par la France, le pays destinataire et les opérateurs concernés.
La mission propose donc d’inscrire l’aide bilatérale de la France dans un contrat international de développement solidaire, d’une durée relativement longue de huit à dix ans, avec une révision intermédiaire à mi-parcours, afin qu’il fasse l’objet d’un suivi de ses grandes orientations.
Un tel dispositif visera quatre objectifs principaux :
- du fait de sa durée et du suivi dont il fera l’objet, il permettra de donner une véritable orientation stratégique aux politiques qu’il mettra en œuvre ;
- faisant l’objet d’une négociation de haut niveau entre les pays concernés, ce contrat pourra plus facilement mettre l’accent sur des domaines fondamentaux tels que, selon les cas, la gouvernance, les droits de l’homme, la maîtrise démographique ou l’égalité entre hommes et femmes ;
- Ce dialogue politique permettra également d’inclure des sujets connexes au développement, notamment celui des mobilités et des délivrances de visas, du côté français comme de celui du pays destinataire ;
- Il contribuera enfin à résoudre le problème de la coordination aussi bien des projets de coopération décentralisée, que des initiatives des ONG, en permettant à la France et au pays destinataire de faciliter conjointement les projets s’inscrivant dans le cadre ainsi défini en orientant, de façon préférentielle, les aides publiques en fonction des priorités négociées conjointement.
Il s’agira donc de mettre en place une relation plus partenariale dans un cadre bilatéral. Le contrat international de développement solidaire pourra être élargi aussi bien du côté des pays destinataires que des pays contributeurs.
Du côté des pays destinataires, il sera possible à des pays voisins de rejoindre le contrat international de développement solidaire afin que des coordinations régionales soient possibles dans les secteurs où l’échelon national n’est pas suffisant.
Du côté des pays contributeurs, le contrat international de développement solidaire devra d’abord permettre de sortir de l’opposition en partie injustifiée entre une aide bilatérale conforme à nos intérêts et une aide multilatérale inévitablement dispersée et affaiblie par le filtre d’organisations internationales très lourdes et au sein desquelles la France exerce une influence insuffisante.
Cette approche n’est certes pas entièrement infondée mais il convient de la nuancer. L’aide française transitant par les organisations multilatérales est en effet fortement concentrée, en particulier sur l’Union européenne pour 45 %, l’Association internationale pour le Développement de la Banque mondiale pour 21 % et le Fonds mondial sida pour 15 %. Les travaux de la mission l’ont amenée à conclure que plutôt qu’une réduction globale de son aide multilatérale, la France gagnerait à l’optimiser en faisant mieux valoir ses priorités dans l’enceinte internationale et en y agissant de manière coordonnée. Le rapport propose que le Conseil national du développement et de la solidarité internationale émette régulièrement un avis sur les contributions françaises aux organismes multilatéraux et qu’il auditionne les représentants de la France auprès de ces organismes préalablement à leurs nominations, ce qui permettrait d’associer plus étroitement les ONG et les collectivités territoriales, entre autres, aux orientations de la stratégie d’aide française au sein des organismes multilatéraux.
Cela n’exclut pas de modifier certaines contributions afin de rééquilibrer notre aide. C’est pourquoi le rapport recommande également de rediriger une partie du montant versé annuellement au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme au profit de l’aide bilatérale sous forme de dons, et de réorienter ces sommes pour consolider et amplifier les systèmes de soins locaux.
Le contrat international de développement solidaire proposé par la mission listerait aussi les contributions françaises à l’aide multilatérale mise en œuvre dans le pays concerné, afin d’accroître la visibilité de l’aide française. Il permettrait par ailleurs de renforcer l’impact de l’aide bilatérale française à travers la création de partenariats internationaux, en particulier avec l’Union européenne, avec des pays francophones émergents et entre les outre-mer et leurs régions environnantes, pour construire des actions coordonnées.
Avec l’Union européenne, la négociation pour la mise en place d’un nouveau partenariat entre l’Europe et les pays ACP succédant à celui de Cotonou, en 2020, doit être l’occasion de prévoir la possibilité pour l’Union d’être partie prenante aux contrats de développement solidaire.
Avec les pays francophones, il s’agit de mieux s’appuyer sur le rôle que jouent déjà des pays comme le Maroc, où nous nous sommes rendus en janvier. Le Maroc s’est en effet positionné à la fois comme un relais économique et commercial vers l’Afrique et comme un pays bénéficiant d’une expertise et d’une expérience récente en matière de développement dont notre politique peut davantage profiter. Le contrat de développement solidaire permettrait précisément d’inscrire les coopérations tripartites, qui sont souhaitées, comme les Marocains nous l’ont redit, avec les pays francophones dans des politiques plus globales.
L’idée de développement solidaire enfin aux outre-mer et à leurs régions environnantes. Il est apparu au cours des auditions que le potentiel de ces territoires et leur capacité à mettre en œuvre des projets de coopération avec leurs régions environnantes n’est pas exploité comme il pourrait l’être, notamment du fait de la segmentation des outils d’aide français et du pilotage ministériel qui n’est pas complètement interministériel, comme on nous l’a dit à plusieurs reprises. La mission propose donc de mettre en œuvre des expérimentations dans ce domaine, afin de renforcer la capacité d’initiative des outre-mer.
Pour conclure cette présentation, je dirai simplement que l’ensemble des recommandations contenues dans ce rapport visent à inscrire nos politiques d’aide dans le temps long, en les dotant des moyens dont elles ont besoin, en créant un cadre souple pour notre aide bilatérale, en permettant un suivi plus régulier de nos politiques et des stratégies déployées, et surtout en tenant compte du fait que le développement n’est pas un simple rattrapage du Nord par le Sud, mais plutôt une politique à caractère universel, visant à un accroissement régulier et maîtrisé des richesses et du niveau de vie des populations.
Mme la présidente Elisabeth Guigou. Vous nous avez donné une bonne idée à travers votre rapport et vos propositions de tous les débats que nous avons pu avoir - d’ailleurs très convergents dois-je dire - au sein de notre Commission pendant ces cinq ans sur ce que nous voulons et ce que nous souhaitons pour l’aide au développement. Je sais que c’est une mission – comme les autres – qui a beaucoup travaillé car c’est notre sujet fétiche et ce dans un laps de temps réduit avec une participation de tous ses membres, y compris vous monsieur le président et monsieur le rapporteur.
Je passe tout de suite la parole à Michel Destot.
M. Michel Destot. Merci Madame la Présidente, à mon tour de féliciter le président et le rapporteur pour cet excellent travail de synthèse. Nous avons évoqué toutes ces questions à de nombreuses reprises ici. Il en ressort beaucoup d’idées et je pense qu’avec mon collègue Jean-Marie Tétart, nous en ferons notre miel pour intervenir au sein du conseil d’administration de l’AFD.
Ce rapport me semble particulièrement utile car il s’inscrit d’abord dans le temps long et cela est absolument nécessaire si l’on veut établir une stratégie basée sur des contrats d’objectifs et de moyens. Il est d’autant plus utile afin d’inscrire une aide financière conséquente si l’on veut finalement atteindre cet objectif de 0,7% du PIB d’ici 2030. Il permet aussi à mon sens de clarifier ce qui doit ressortir de l’aide multilatérale par rapport à ce qui doit relever de l’aide bilatérale. Au sujet du multilatéral, il ne s’agit pas simplement de ce qui se constitue à partir des fonds internationaux mais également en ce qui concerne les capacités d’aider des pays concernés par cette aide publique qui se regroupent. Cela devrait être une stratégie davantage affirmée et menée car elle me semble être de nature plus efficace et apte à mieux tenir compte de la rareté de ces fonds publics.
Dans cet esprit, pouvez-vous me préciser ce qui, pour vous et pour la France, doit davantage relever d’une part du bilatéral et d’autre part du multilatéral ? Ne devrait-on pas éviter de s’engager trop fortement au titre de l’aide bilatérale quand il s’agit de grands investissements – la plupart du temps couverts par les fonds internationaux, notamment du côté de l’ONU, investissements pour lesquels par ailleurs on a tendance à vouloir y aller afin d’exister – afin de se concentrer en termes d’aide bilatérale sur les thématiques qui mettent plus en avant et valorisent davantage le savoir-faire français et l’influence française ? Je pense évidemment à l’aide rurale, à l’aide urbaine, à l’éducation et à la santé, à la culture et à la langue française.
Enfin, quelles préconisations suggérez-vous pour une aide plus concertée et plus efficace de la France, de l’Union européenne et de l’Afrique au moment où la Grande-Bretagne se retire de l’Union européenne, et au moment où nous redéfinissons à travers une aide confortée une nouvelle stratégie d’aide publique au développement ?
M. André Schneider, président de la mission. Je tiens simplement à faire une petite précision car aussi bien le rapporteur que Michel Destot ont remercié ceux qui ont participé à l’élaboration de ce rapport, je ne voudrais donc pas oublier Marylise Lebranchu et notre collègue de Mayotte, Boinali Said.
M. Jacques Myard. Merci Madame la Présidente, ce travail est fondamental parce que je crois qu’il est aujourd’hui la pierre angulaire d’une possibilité de maitriser notamment les flux migratoires et donc la paix du monde… Il faut regarder les choses telles qu’elles sont ! Néanmoins, j’ai quelques interrogations sur les recommandations qui nous sont faites. Il est évident qu’augmenter le budget de 5% par an d’ici à 2030 est un objectif et il va falloir véritablement y mettre beaucoup d’audace.
A ce titre, l’une des clés de cette augmentation serait – pardon Madame la présidente - de rapatrier un certain nombre de fonds européens qu’on ne maitrise plus, notamment sur les fonds structurels sur lesquels j’ai beaucoup d’interrogations, et de consacrer donc véritablement cet argent public à l’aide au développement.
Deuxièmement, lorsque vous dites qu’il faut – parce que l’on voit très bien quel est l’objectif sous-jacent – favoriser la part de l’aide qui transite par rapport aux ONG, peut-être mais à une condition express, à savoir que l’on ait à l’égard de ces ONG une politique claire et que l’on voie exactement ce qu’elles font car cela peut être parfois la langue d’Esope. Cela peut être efficace dans certaines situations, tout comme peu efficient dans d’autres cas.
Je souhaite également saluer la recommandation numéro 16 lorsque vous voulez mobiliser le dispositif du Livret de Développement durable en faveur de l’aide au développement. Il s’agit en fait d’une idée relativement ancienne. Lorsque j’étais au cabinet de Michel Aurillac qui a été un grand ministre de la Coopération, nous avons justement essayé de mettre en place un plan épargne-logement dès lors qu’il y avait un retour et qui aurait été abondé par l’aide française avec la possibilité d’allers et retours permanents entre ce qui est une création d’entreprise dans un pays en voie de développement et la France. Je ne peux donc que saluer cette recommandation mais qui tarde à venir, à l’évidence.
De manière plus générale, permettre effectivement aux outre-mer de mieux s’intégrer dans leur région tout en jouant un rôle de développeur me parait une bonne idée sauf que – vous le savez – il existe également des immigrations locales qui font que, parfois, nos territoires et départements d’outre-mer subissent aussi des immigrations illégales, et il s’agit d’un problème majeur à maîtriser.
M. Boinali Said. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, votre dernière recommandation portant sur l’outre-mer suggère la mise en place d’expérimentations visant à permettre à ces territoires de piloter des projets d’aide au développement dans leurs régions respectives. Selon vous, quelles formes pourraient prendre la concrétisation de cette recommandation ?
M. Michel Terrot. À mon tour, je voudrais saluer la qualité du travail effectué par le président et le rapporteur, et pour leur courage sur certains sujets. Je crois que cela n’est pas facile de dire que le temps est peut-être venu de prélever un peu d’argent sur le Fonds mondial SIDA afin de l’affecter au bilatéral. Il s’agit là d’une proposition qui va dans le bon sens même si elle n’est pas facile à mettre en œuvre. Je crois que cela est infiniment nécessaire.
Il existe peut-être un point sur lequel mes attentes vont au-delà de ce qui est proposé dans le rapport, à savoir que l’on ne met pas suffisamment le focus sur les pays du Sahel alors que ces derniers sont de fait le maillon faible. Il s’agit des pays les plus pauvres et ce sont ceux qui mettent en proportion de leur budget beaucoup d’argent dans la Défense, et nous en avons bien besoin dans le Nord, afin de lutter contre le terrorisme. Cela est vrai surtout pour le Burkina Faso et également pour le Tchad. Ces pays sont à la limite aujourd’hui de ce qu’il est vraiment possible de faire et c’est la raison pour laquelle j’avais été personnellement très sensible aux propos de M. Serge Michailof que l’on avait auditionné à plusieurs reprises dans le cadre de cette mission. Ce dernier suggérait en effet la création d’un fonds fiduciaire pour venir en aide à ces pays de façon plus concentrée et plus massive. Je pense que c’est une bonne idée qu’il ne faut pas laisser tomber et je tenais ainsi à faire cette observation puisqu’il faudra nécessairement y revenir étant donné que ces pays sont extrêmement fragiles et l’intérêt de la France n’est par ailleurs certainement pas de les voir tomber dans des difficultés plus grandes encore.
Mme la présidente Elisabeth Guigou. Merci cher collègue et je m’associe à cette remarque que vous venez de faire sur le Sahel.
Mme Chantal Guittet. Je voudrais revenir sur votre recommandation numéro 8 concernant la diminution du Fonds mondial au profit d’une aide bilatérale, recommandation que je ne trouve pas pertinente du tout contrairement à vous. J’estime en effet que, pour des problèmes de santé aussi grave que le sida, la tuberculose ou le paludisme – des maladies qui n’ont pas de frontières – le rôle du Fonds mondial est crucial. On voit les problèmes que l’on a avec la tuberculose notamment puisque, lorsqu’on laisse faire le bilatéral, peu de fonds sont finalement alloués pour vaincre cette maladie que l’on sait pourtant guérir, que l’on n’arrive pas à guérir et qui fait au final plus de morts chaque année que le sida. Qu’est-ce qui vous fait donc dire que l’aide bilatérale sous forme de dons serait plus efficace qu’une aide versée annuellement au fonds mondial qui permet à tous les chercheurs du monde entier de se réunir et de travailler, de soigner tous les gens de la planète lorsqu’il le faut ? On a vu avec Ebola que la coordination du Fonds a permis d’arriver à bout de cette épidémie, alors que si cela n’avait été que du bilatéral, je ne suis pas sûre qu’Ebola aurait été aussi vite endiguée. J’aurais donc aimé connaître les raisons sous-jacentes à cette recommandation.
M. Jean-Marie Tétart. Je souhaite saluer à mon tour le travail effectué. Je trouve très raisonnable la proposition d’une augmentation linéaire à raison de 5% par an jusqu’à 2030. Cela donne une ligne directrice et je crois qu’elle serait facilitée si – lorsque nous décidons comme nous l’avons fait pendant toutes ces années de faire accepter des financements de type non budgétaire, à savoir des financements de solidarité TTF ou taxes sur les billets d’avion -, nous essayions de peut-être avoir des assiettes moins grandes ou des taux moins importants si l’on appliquait l’ensemble de la recette à l’aide au développement. Nous jouons de fait un double jeu : l’État se laisse faire à l’issue des débats parlementaires pour créer la taxe mais ensuite met un plafond. D’un certain côté, la solidarité a bon dos car elle permet d’apporter des éléments au budget de l’État sur le prétexte de la solidarité. Il faudrait donc être raisonnable sur ces questions.
Second point : dans le bilatéral et le multilatéral, nous parlons beaucoup de ces rapports-là alors qu’il faudrait plus se focaliser sur le FSD. Tous ces financements innovants sont en plus fléchés sur le FSD (Fonds social de développement) et non pas sur l’APD. Je suis donc surpris que le rapport n’exige pas plus de transparence dans le FSD car nous ne sommes pas du tout associés. Après toutes les discussions que nous avons eues dans l’hémicycle, je m’aperçois qu’en décembre dernier, presque en catimini, un décret visant à allonger la liste des organismes multilatéraux qui vont bénéficier du FSD a été adopté. Je crois donc que ce sujet en particulier, c’est-à-dire la question du multilatéral passant avant tout par le FSD à discrétion de l’État et des gouvernements en place, nécessiterait une recommandation.
Enfin, je suis assez d’accord avec ce que dit ma collègue Chantal Guittet, et je crois que la clé réside dans l’articulation du multilatéral et du bilatéral - pour ce qui est notamment du sida - sur les pays donnés. C’est là qu’on trouve la véritable efficacité d’actions qui sont conduites sous le drapeau français mais qui se raccrochent à une armature multilatérale qui est de bon aloi.
Je crois, pour terminer, qu’il faut également distinguer le multilatéral de l’Union européenne. Mon collègue Jacques Myard est très friand de ramener l’argent de l’Union européenne mais c’est ce qui est fait de plus en plus par l’AFD. Nous avons un taux de retour de nos contributions au FED (Fonds européen de développement) qui est très importante dans les nouveaux mécanismes de financement que l’AFD est en train de mettre en place.
M. Éric Elkouby. Merci beaucoup madame la présidente. Je voudrais souligner la qualité du travail, à la fois de mon ami André Schneider et de Jean-René Marsac.
Je souhaite souligner cependant qu’il faudrait peut-être une vingt-et-unième recommandation sur la mise en place d’un observatoire pour assurer le bon usage des fonds destinés à l’aide. Ce que l’on constate le plus souvent, c’est que les fonds qui pourraient être attribués n’arrivent pas à leurs destinataires. Sinon un observatoire, peut-être faudrait-il donc une commission de suivi.
Quant à la recommandation numéro 8, je voudrais à mon tour, comme Chantal Guittet ou Jean-Marie Tétart, dire que je suis quelque peu sur ma faim quant au fonds sida, paludisme et tuberculose. Il ne faudrait pas en effet déshabiller Paul pour habiller Jacques et nous sommes encore en difficulté sur ces questions aussi bien du sida, du paludisme ou de la tuberculose. Il faudrait donc trouver un équilibre sur ces questions.
M. Patrice Martin-Lalande. Mes félicitations aux auteurs du rapport, je les ai vus travailler. Je crois comme vous tous que l’APD est l’outil de paix dont on attend aussi qu’il puisse stabiliser les flux migratoires, ce qui est un des enjeux considérables de notre époque.
Lors de notre déplacement au Burkina Faso et au Maroc, nous avons été frappés de l’écho que rencontrait le problème de la maîtrise de la croissance démographique. Je crois que l’APD pourrait apporter un concours plus significatif dans ce domaine car cela correspondait véritablement à une attente des personnes que l’on a pu rencontrer.
On constate par ailleurs en Afrique que l’on peut rattraper un certain nombre de retards. Cela s’est vu avec la téléphonie mobile pour passer à l’Internet en sautant la génération de l’Internet fixe – si je puis dire. Il faudrait donc aussi que l’APD puisse aider ce genre de rattrapages technologiques en se tournant vers la technologie de demain pour permettre aux pays en voie de développement d’aller plus vite vers les objectifs qu’on leur souhaite voir réaliser.
Mme Valérie Fourneyron. Merci madame la présidente, ainsi qu’à notre président, à notre rapporteur et à tous ceux qui se sont associés à ce rapport très intéressant.
Ce rapport dresse une stratégie sur le long terme et prend aussi en compte que, dans notre organisation collective, notre organisation institutionnelle est au fond très récente, qu’il s’agisse d’Expertise France, du rapprochement AFD-CDC. Je voulais simplement revenir sur un élément qui a beaucoup occupé nos débats durant cette législature, à savoir l’augmentation des dons. Vous évoquez la possibilité d’utiliser les dividendes de l’AFD, finalement le retour de prêts octroyés. Y-a-t-il aujourd’hui des éléments d’outils pratiques de mobilisation pour obtenir ce résultat ? Quels sont ces outils à actionner en pratique afin d’aboutir à cette réalité d’une augmentation des dons par rapport à cette éventuelle proposition de mobiliser les produits de l’AFD ?
M. André Schneider, président de la mission. Madame la Présidente, mes chers collègues, nous entendons bien toutes vos questions, et le rapporteur essaiera de vous donner le maximum de précisions. Notre objectif commun était double. D’abord, faire une analyse aussi complète que possible de ce qu’il se passe effectivement - c’était bien l’objectif de départ, Madame la Présidente, que vous nous aviez donné au début de cette mission. Ensuite, en fin de législature, et à un rythme accéléré, nous souhaitons vous apporter aujourd’hui – mais avec l’espoir que cela se poursuivra dans le temps – un certain nombre de préconisations sur des directions et des orientations. Nous n’avons pas pu entrer dans le détail de chaque volume. Nous avons aussi mis en exergue les opérateurs, les regroupements, que nous avons mis dans le rapport. Je laisse la parole au rapporteur.
M. Jean-René Marsac, rapporteur de la mission. Merci beaucoup pour vos questions et vos éclairages. Je vais essayer d’être bref et si possible complet.
Par rapport à ce que dit Michel Destot, effectivement dans le rapport nous n’avons pas pris d’options ni sur les questions d’investissements, infrastructures et autres dispositifs de soutien des opérations plus immatérielles, ni en termes de thématiques, parce que je considérais que nous n’avions pas l’expertise immédiate pour le faire. Mais l’idée, plus généralement, et en particulier à travers cette proposition de contrat de développement solidaire négociée de pays à pays ou de pays aux régions concernées, c’est peut-être de mettre davantage de stratégie et de choix politique en face de la montée en puissance - ce qui est très bien - d’opérateurs techniques comme l’AFD ou Expertise France. On l’a vu au Burkina Faso, l’AFD intervenant à 18% dans le montage d’un projet d’infrastructure, on peut s’interroger sur la pertinence de cette intervention. Mais il est vrai qu’Expertise France ou l’AFD raisonnent, et c’est normal, sur la qualité d’un dossier, l’intérêt d’être ou pas présent dans tel ou tel dossier - c’est un choix relevant de la stratégie de l’opérateur. Je pense qu’il faut que cela s’adosse à une autre démarche stratégique avec un dialogue dans le cadre de ce contrat passé de pays à pays : qu’est-ce que le pays concerné souhaite d’une intervention prioritaire de la France, dans quel endroit, dans quel domaine, y compris l’arbitrage entre ce qui est fait dans le cadre multilatéral et le cadre bilatéral ? C’est vrai que le rapport ne prend pas une option directe, mais la question mérite d’être posée. Moi je fais le pari que c’est dans le cadre de ces négociations pour un contrat bilatéral de développement solidaire, à moyen et long terme, que ces questions trouvent leur réponse.
Sur la Grande-Bretagne, le Fonds européen de développement (FED) n’étant pas budgété, la Grande-Bretagne peut rester au FED. On peut souhaiter qu’elle y reste, pour continuer à mener des actions coordonnées.
Jacques Myard évoquait la question de l’orientation budgétaire qu’il approuve. Sur les ONG, là aussi, tout le monde nous a parlé depuis le début des auditions de la question de la coordination des acteurs. Quand on va dans les pays concernés, on nous parle de la dispersion des acteurs, d’ONG multiples. Dans le rapport, nous le disons : il ne faut pas freiner l’initiative, elle est tout à fait positive, il faut au contraire l’accompagner, y compris les opérations de petite dimension des collectivités locales et territoriales. Pur autant il faut qu’elles trouvent un cadre global. Donc plutôt que de coordonner par des rassemblements, des coordinations nouvelles, un système administratif, un système d’évaluation, on préfère mettre cette question de manière prospective dans une négociation qui soit aussi portée peut-être plus fortement par le bénéficiaire. Cela signifie impliquer plus fortement le pays bénéficiaire dans la définition de la stratégie, qu’il ne soit pas simplement le réceptacle, voire quelque fois le spectateur de ce qui se passe sur son territoire. Parfois, trop souvent, il est plus en position d’observation que d’acteur impliqué, donc je pense que la question des ONG, en référence à ce cadre négocié, peut permettre d’apporter une réponse.
Boinali Said posait une question sur la manière de faire en outre-mer en termes d’aide au développement : pour moi tout est ouvert. Simplement, ce qui nous est apparu fortement dans les auditions que nous avons eues, c’est qu’entre les ministères concernés il n’y a pas forcément un travail suffisant, même s’il y a un CICID qui a vocation à faire de l’interministériel de manière générale sur l’aide au développement. Entre le secrétariat d’État chargé du développement d’un côté, le secrétariat chargé des outre-mer de l’autre, il n’est pas certain qu’il y ait un travail approfondi au-delà du CICID pour définir un certain nombre de projets qui puissent porter sur l’eau, la santé, la pêche, etc. Il y a pleins de sujets qui peuvent être abordés de manière concordante dans les régions concernées. La forme que tout cela doit prendre reste à définir. L’AFD nous a avoué aussi que de leur côté, puisqu’ils interviennent également dans les DOM TOM parallèlement aux pays bénéficiaires de l’aide au développement, la coordination n’est pas complètement établie chez eux non plus. Donc à vous de faire des propositions à partir de cela.
Michel Destot, Chantal Guittet et d’autres ont relayé le débat sur le fonds SIDA, je n’ai pas à ce sujet une position complètement arrêtée, mais il s’agit d’un sujet récurrent. La France contribue plus que d’autres en moyenne, puisqu’elle est le deuxième contributeur dans ce dispositif, le sujet est venu à plusieurs reprises, donc je crois qu’il faut vraiment en débattre. La proposition que certains acteurs font est celle d’une réduction de notre contribution, pour y revenir peut-être sous une forme multilatérale. Il s’agit d’aller plus aujourd’hui vers la construction et la consolidation des systèmes de soin dans les pays concernés. Evidemment qu’il faut avoir des outils multilatéraux pour lutter contre les épidémies et les pandémies sur les graves crises sanitaires, évidemment que c’est dans le cadre multilatéral que cela peut se jouer. Pour autant, en termes de prévention, mais aussi en termes de suivi des malades, c’est par le biais d’un système de soin consolidé dans les pays concernés que cela peut se faire. Outre la question du bilatéral et du multilatéral, il y a la question de la meilleure stratégie pour atteindre les objectifs.
Jean-Marie Tetart, ceux qui seront dans la prochaine mandature pourrons suivre, ou pas, cette trajectoire des 5%, j’ai proposé ce chiffre parce que c’est celui avec lequel le gouvernement est entré dans le débat budgétaire cette année. On a atterri à 3,7. Je propose qu’on isole cette question des 5% concernant les lignes budgétaires, parce que c’est là-dessus que l’on peut intervenir de manière directe dans l’hémicycle.
Concernant la TTF, il y a une question à se poser sur le côté friable de l’assiette. On ne sait pas ce que sera l’avenir en termes de places financières, on ne sait pas ce que les pays proposeront, il ne faut pas que les œufs soient mis dans le même panier. C’est pour cela que nous proposons d’autres démarches. Jacques Myard a souligné l’intérêt de la proposition sur le Livret de développement durable et solidaire. C’est la proposition que nous faisons à la suite de ce que Jean-Marie Le Guen a souligné lors de son audition sur l’idée de créer une ONG française qui prenne sa place dans le concert international. On a repris les choses sous un autre angle, en considérant qu’il s’agissait plutôt d’avoir une fondation qui permette de mobiliser des moyens nouveaux. Une ONG, par définition, c’est non gouvernemental, donc il y avait une contradiction.
Sur la question démographique que l’on a beaucoup évoquée avec nos interlocuteurs, en particulier au Burkina Faso, bien évidemment la question est relayée, mais l’on sait que la maîtrise de la natalité est un sujet lourd, compliqué, que les gouvernements aussi ont du mal à aborder. C’est aussi l’intérêt que l’on voit à une démarche concertée et contractuelle entre pays sur du moyen et long terme, c’est de pouvoir mettre en orientation stratégique un certain nombre de ces sujets qui vont demander du temps, pour se décliner en politiques locales qui permettent de changer la trajectoire.
Sur les dividendes de l’AFD, c’est un sujet qui a été abordé mais dans un contexte où l’orientation prioritaire était le renforcement des fonds propres, et cela reste encore une priorité au gré du renforcement des capacités d’adaptation de l’AFD. Mais on nous a rappelé dans quelques auditions que la justification de faire en sorte que l’AFD continue à intervenir dans les pays émergents, outre le fait qu’il y avait encore des questions de développement ciblées qui méritaient une intervention, c’était aussi de mutualiser une ressource pour aller plus fortement vers les pays non bénéficiaires d’aides suffisamment conséquentes, en particulier sous forme de dons, ce débat doit être ouvert.
Quel outil pour y parvenir ? Cela est peut-être à trouver dans le débat parlementaire puisque nous proposons qu’il y ait un débat structuré tous les trois ans. Dans la loi de 2014, nous avions inscrit le fait que le gouvernement fasse un rapport tous les deux ans, ce qui n’a au final pas été fait. Comme souvent lorsqu’on demande des rapports, tout le monde les oublie par la suite, soit par manque de temps pour les examiner ou alors après un examen quelque peu rapide. La proposition est donc de faire en sorte qu’il y ait une inscription – certes je ne sais pas vraiment sous quelle forme étant donné que je ne suis pas spécialiste de l’organisation des débats parlementaires – et des étapes beaucoup plus structurées dans l’hémicycle qui permettent de mettre ces objectifs sur la table.
Au sujet du Sahel, il existe plusieurs initiatives dont l’initiative de l’AFD sur la Facilité pour la lutte contre la vulnérabilité et la réponse aux crises. Un travail est donc en cours même si je ne sais pas si cela est satisfaisant ou pas.
M. Michel Terrot. L’intérêt, c’est qu’il soit doté d’au moins 250 millions d’euros. On ne peut pas opposer le multilatéral au bilatéral, mais il faut bien que le bilatéral soit suffisamment significatif pour entrainer les bailleurs internationaux à venir abonder.
M. Jean-René Marsac, rapporteur de la mission. C’était la proposition de Serge Michailof en effet.
Mme la présidente Elisabeth Guigou. Je suis persuadée qu’il s’agit d’un rapport que nous n’oublierons pas et que l’on s’en servira dans le futur. Vous avez fait un bilan exhaustif de ce qui existe avec des propositions qui méritent d’être discutées mais qui sont quand même très précises.
Etes-vous d’accord pour autoriser la publication de cet excellent rapport ?
La commission autorise la publication du rapport d’information à l’unanimité.
Recommandation n° 1
Renforcer les moyens de contrôle du Parlement sur la politique d’aide publique au développement, notamment par l’organisation tous les trois ans un débat au Parlement sur la stratégie française en matière d’aide publique au développement, au cours duquel le gouvernement exposera les grandes orientations de la politique d’aide française.
Recommandation n° 2
Veiller à ce que le Comité interministériel pour la coopération internationale et le développement (CICID) se réunisse au moins une fois par an, conformément à l’article 6 du décret n°98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement.
Recommandation n° 3
Instaurer entre l’AFD et l’État un COM de cinq ans plutôt que trois ans, et recueillir dans la phase préparatoire du COM l’avis des ambassades auprès des pays destinataires de l’aide sur les orientations stratégiques de la France et de l’AFD en matière d’aide publique au développement.
Recommandation n° 4
Renforcer les capacités d’intervention d’Expertise France.
Recommandation n° 5
Évaluer à l’occasion du prochain COM entre Expertise France et l’État le bon fonctionnement de la relation entre Expertise France, l’AFD et les postes diplomatiques.
Recommandation n° 6
Augmenter les moyens de la Délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales ou diminuer le seuil d’intervention de la Facilité de Financement des Collectivités territoriales françaises afin que les projets de coopération décentralisée d’un montant situé entre 100 000 et 300 000 euros puissent bénéficier d’une aide de la DAECT ou de la FICOL.
Recommandation n° 7
Chercher à faire en sorte que l’Union européenne intervienne plus, en matière d’aide publique au développement, au niveau des choix stratégiques que dans une gestion dossier par dossier, afin d’alléger la gestion de son aide et de renforcer sa vision stratégique.
Recommandation n° 8
Rediriger une partie du montant versé annuellement au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme au profit de l’aide bilatérale sous forme de dons.
Recommandation° 9
Charger le Conseil national du développement et de la solidarité internationale (CNDSI) d’émettre régulièrement un avis sur les contributions françaises aux organismes multilatéraux et d’auditionner les représentants de la France auprès de ces organismes préalablement à leurs nominations, ce qui permettra d’associer plus étroitement les ONG et les collectivités territoriales aux orientations de la stratégie d’aide française au sein des organismes multilatéraux.
Recommandation n° 10
Inscrire dans les futures lois de finances jusqu’en 2030 une augmentation annuelle de 5 % du budget de la mission « aide publique au développement ».
Recommandation n° 11
Augmenter la part des dons dans le budget de l’aide publique au développement dans la loi de finances pour 2018.
Recommandation n° 12
Évaluer la possibilité, pour les organismes publics de l’État chargés à titre principal de l’aide publique au développement, d’utiliser comme dons, dans le cadre de la politique bilatérale d’aide au développement, le produit final des prêts qu’ils ont eux-mêmes octroyés.
Recommandation n° 13
Poursuivre l’augmentation de la part de l’aide publique au développement française transitant par les ONG afin de mieux mobiliser leur savoir-faire et leur capacité d’action.
Recommandation n° 14
Veiller à ce que l’extension du champ de la taxe sur les transactions financières aux acquisitions à titre onéreux de titres de capital dites « intra-journalières », qui ne donnent pas lieu à un transfert de propriété ait lieu à la date mentionnée dans la loi de finances pour 2017, c’est-à-dire le 1er janvier 2018.
Recommandation n° 15
Soutenir la microfinance par un fonds de garantie spécifique lié au risque de change.
Recommandation° 16
Augmenter la part des sommes recueillies à travers le dispositif du Livret de Développement durable et solidaire destinées à financer les acteurs de l’économie sociale et solidaire déployant une activité dans les pays destinataires de l’aide publique au développement.
Recommandation n° 17
Créer une Fondation française, ou, encore mieux, francophone, pour le Développement solidaire chargée de recueillir des fonds et de coordonner une partie de l’aide publique au développement sous forme de dons. Cette fondation pourrait bénéficier d’une première dotation en provenance du fonds de solidarité pour le développement (FSD) sur les nouvelles ressources de la taxe sur les transactions financières.
Recommandation n° 18
Mettre en place avec les pays destinataires de l’aide des Contrats internationaux de développement solidaire de 8 à 10 ans prévoyant une procédure de révision à mi-parcours.
Recommandation n° 19
Renforcer les partenariats tripartites avec les pays francophones émergents afin de démultiplier l’effet et l’influence de la politique française d’aide publique au développement.
Recommandation n° 20
Mettre en œuvre des expérimentations visant à permettre aux outre-mer de piloter des projets d’aide au développement dans leurs régions respectives.
ANNEXE :
LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES
1) A Paris
– M. Sébastien Mosneron Dupin, directeur général d’Expertise France accompagné de Mme Anne de Soucy, directrice de la stratégie, des partenariats et de la communication (7 juin 2016) ;
– M. Bertrand Fort, délégué pour l’action extérieure des collectivités territoriales et secrétaire général de la commission nationale de la coopération décentralisée (22 juin 2016) ;
– M. André Laignel, président du comité des finances locales et auteur du rapport sur l’action extérieure des collectivités territoriales françaises accompagné de Mme Julia Barbier, conseillère technique coopération décentralisée à l’AMF (29 juin 2016) ;
– M. Rémy Rioux, directeur général de l’agence française du développement (AFD), accompagné de M. Philippe Orliange, directeur exécutif de la stratégie, des partenariats et de la communication et de Mme Zolika Bouabdallah, chargée des relations avec les parlementaires français (6 juillet 2016) ;
– M. Bertrand Gallet, directeur général Cités Unies France (13 juillet 2016) ;
– M. Serge Michailof, chercheur associé à l’IRIS (21 septembre 2016) ;
– M. Grégory Clemente, directeur général de Proparco, accompagné de Mme Laure Loaec, chargée d’affaires auprès de la direction générale de Proparco et de Mme Zolika Bouabdallah, chargée des relations avec les parlementaires français (28 septembre 2016) ;
– M. Yves Guicquero, responsable de la division « agenda de l’aide et partenaires internationaux », accompagné de M. Marti Foeth, chargé d’affaires, division secteur financier et appui au secteur privé de l’agence française du développement et de Mme Zolika Bouabdallah, chargée des relations avec les parlementaires français (19 octobre 2016) ;
– M. Philippe Orliange, directeur exécutif de la stratégie, des partenariats et de la communication de l’AFD, accompagné de M. Alexis Fremeaux, adjoint au responsable de la division du pilotage stratégique (26 octobre 2016) ;
– Mme Elisabeth Claverie de Saint-Martin, directrice adjointe, direction du développement durable (MAEDI) accompagnée de M. François Legué, sous-directeur du développement durable (9 novembre 2016) ;
– M. Vincent Larrouzé, chef de la mission de la gouvernance démocratique (MAEDI) (23 novembre 2016) ;
– Mme Marie-Laure de Bergh, cheffe du pôle politique européenne de développement à la direction des biens publics mondiaux du MAEDI (23 novembre 2016) ;
– M. Cyril Rousseau, sous-direction des affaires financières multilatérales et du développement (MULTIFIN) accompagné de M. Pierre Gaudin (chef de bureau « aide publique au développement ») et de son adjoint, M. Manuel Château, ainsi que de M. Bruno Menat, adjoint du chef de bureau « financement multilatéral du développement et du climat » (30 novembre 2016) ;
– M. Thierry Jeantet, président des rencontres du Mont-Blanc (7 décembre 2016) ;
– M. Stefan Emblad, directeur des bureaux européens et représentant spécial à Paris de la Banque Mondiale accompagné de Mme Maria Cristina Mejia, senior international affairs officer et de Mme Laure de Petiville, international affairs associate (8 décembre 2016) ;
– M. Sébastien Lyon, directeur général UNICEF France, accompagné de Mme Marion Libertucci, responsable plaidoyer et expertise et de Mme Sarah El Yafi, chargée des relations avec les pouvoirs publics (14 décembre 2016) ;
– Mme Julie Stoll, déléguée générale plate-forme pour le commerce équitable (14 décembre 2016) ;
– M. Philippe Jahshan, président de coordination Sud, accompagné de Mme Anne-Françoise Taisne, déléguée générale du comité français pour la solidarité internationale (CFSI) (21 décembre 2016) ;
– Mme Beatrice Nere, Bill & Melinda Gates Foundation (18 janvier 2017) ;
– M. Jean-Marie le Guen, secrétaire d’État chargé de la francophonie et du développement (1er février 2016) ;
– M. Eric Campos, délégué général de la fondation Grameen crédit agricole (1er février 2016).
2) au Burkina Faso (8 au 12 janvier 2017)
– M. Xavier Lapeyre de Cabanes, ambassadeur de France au Burkina Faso ;
– Son Exc. Roch Marc Christian Kaboré, Président du Faso ;
– M. Paul Kaba Thieba, Premier ministre du Burkina Faso
– M. Simon Compaoré, ministre d’État, ministre de la sécurité intérieure ;
– M. Alpha Barry, ministre des affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabé de l’extérieur ;
– Mme Hadziatou Rosine Coulibaly, ministre de l’économie et des finances ;
– M. Salifou, Diallo, Président de l’assemblée nationale du Burkina Faso ;
– M. Nicolas Groper, Premier conseiller, ambassade de France ;
– Mme Nadia Fanton, Deuxième conseillère, ambassade de France ;
– M. Yannick Le Roux, conseiller de coopération et d’action culturelle, ambassade de France ;
– M. Adrien Laroze, conseiller de coopération et d’action culturelle adjoint, ambassade de France ;
– Mme Isabelle Baert, attaché de sécurité intérieure, ambassade de France ;
– M. Michel Dhé, chef du service économique, ambassade de France ;
– M. Yves-Nicolas Dosser, attaché de défense, ambassade de France ;
– M. François Cardon, Premier secrétaire, ambassade de France ;
– M. Tanguy Denieul, Directeur de l’Agence française de Développement au Burkina Faso ;
– M. Thierry Liscia, Directeur adjoint de l’Agence française de Développement au Burkina Faso ;
– M. Alain Demaison, attaché de coopération, ambassade de France ;
– M. Paul-Antoine Decraene, attaché de coopération, ambassade de France ;
– M. Philippe Faisandier, expert technique international justice ;
– M. Philippe Doo-Kingue, expert technique international OMS ;
– M. Pierre Crozier, expert technique international ACAME ;
– M. Bernard Bres, expert technique international 2IE ;
– M. Maxime Poissonnier, expert technique international, coordonnateur du projet FSP ACTS ;
– M. Ambroise Kafando, directeur de la coopération internationale au ministère burkinabè de l’économie et des finances ;
– M. Farhat Bouazza, Ambassadeur du Maroc au Burkina Faso ;
– M. Jean Lamy, Ambassadeur, chef de la délégation de l’Union européenne au Burkina Faso ;
– M. Andrew Young, Ambassadeur des États-Unis d’Amérique au Burkina Faso ;
– M. Dietrich Pohl, Ambassadeur d’Allemagne au Burkina Faso ;
M. Lieven de Le Marche, Ambassadeur de Belgique au Burkina Faso ;
– Mme Ulla Naesby Tawiah, Ambassadrice du Danemark au Burkina Faso ;
– M. Masato Futaishi, Ambassadeur du Japon au Burkina Faso ;
– M. Vincent Le Pape, Ambassadeur du Canada au Burkina Faso ;
– M. Max Lamesch, Chargé d’affaires a.i. du Luxembourg au Burkina Faso ;
– Mme Metsi Makhetha, représentante résidente du PNUD, coordonnatrice du Système des Nations Unies au Burkina Faso ;
– M. Cheikh Fatamady Kanté, représentant résident de la Banque Mondiale au Burkina Faso ;
– Mme Mame Astou Diouf, représentante résidente du FMI au Burkina Faso ;
– Mme Antoinette Batumub Wira, représentante résidente de la BAD au Burkina Faso ;
– M. Aristide Ongone Obamé, représentant résident de la FAO au Burkina Faso ;
– M. Jean-Charles Dei, représentant résident du PAM au Burkina Faso ;
– Mme Anne Vincent, représentante résidente de l’UNICEF au Burkina Faso ;
– Mme Edwige Adekambi Domingo, représentante résidente du FNUAP au Burkina Faso ;
– Mme Dr. Fatimata Zampaligré, chargée de programme des politiques et systèmes de santé à l’OMS ;
– M. Armand Beouinde, Maire de la ville de Ouagadougou ;
– M. Boureima Kabore, directeur des études et de la programmation à la ville de Ouagadougou ;
– M. Ousmane Ouedraogo, conseiller consulaire ;
– Mme Françoise L’Étang Yaméogo, conseillère consulaire ;
– Mme Martine Voron, conseillère consulaire ;
– M. Bernard Voron, Président du CMI ;
– M. Olivier Deflandre, Proviseur du lycée français Saint Exupéry ;
– M. Fabrice Avenel, Président de l’APE ;
– Mme Nathalie Biez, directrice de l’école primaire Saint Exupéry ;
– M. Jean-Marc Leblanc, directeur de l’IRD ;
– M. Pierre Montagne, directeur du CIRAD ;
– Mme Marine Leloup, attachée culturelle, directrice adjointe de l’Institut Français du Burkina Faso ;
– M. Thierry Barbe, chef de coopération de la délégation européenne ;
– M. Thomas Huyghebaert, chef de section à la Délégation européenne ;
– M. Christian Geosits, chef de la coopération autrichienne ;
– Mme Saori Deguchi, Deuxième conseillère à l’Ambassade du Japon au Burkina ;
– M. Jean-Bernard Dubois, chef de la coopération suisse ;
– M. Mats Harsmar, chef de la coopération suédoise ;
– M. Albert Bruun Birnbaum, Premier conseiller de l’Ambassade du Danemark et chef de coopération DANIDA ;
– Mme Sarah Bolliri, coopération luxembourgeoise ;
– Mme Angelika Friedrich, directrice résidente de la Coopération technique allemande (GIZ) ;
– Mme Rebecca Edelman, représentante de la KfW ;
– Mme Catherine Mersman, chef du bureau de la coopération belge ;
– M. Mohamed Abarghaz, Premier conseiller à l’Ambassade du Maroc au Burkina ;
– M. Mathieu Rioux, Premier secrétaire (coopération), Ambassade du Canada au Burkina Faso ;
– M. Safia Otokore, cabinet du directeur général de l’AFD ;
- Mme Djénaba Touré, représentante Nationale Burkina Faso & Niger de France Volontaires ;
- M. Nébila Frédéric Bationo, directeur exécutif de l’Agence pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise/Agriculture & Artisanat ;
- M. Boukare Tapsoba, coordinateur de l’Agence pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise/Agriculture & Artisanat ;
- Mme Honorine Denne : chargée de communication de l’Agence pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise/Agriculture & Artisanat ;
- Dr Carsten Walenda, médecin coordinateur de Santé Sud ;
- M. Anirékoun Ferdinand Dabire, superviseur projet de Santé Sud ;
- M. Lassane Ouedraogo, représentant de la de la Plateforme Nationale du Commerce Equitable du Burkina Faso ;
- M. Abdoul Kader Tall, chargé de suivi et évaluation de la Plateforme Nationale du Commerce Equitable du Burkina Faso ;
- M. Paul Sondo, Vice-Président de SOS-Paspanga.
3) au Maroc (12 au 14 janvier 2017)
– M. Jean-François Girault , Ambassadeur de France au Maroc ;
– M. Pierre-Etienne Bouchau, Banque européenne d’investissement ;
– M. Alexandre Von Kap-Herr, représentant de la KfW ;
– M. Abdou Diop, président de la commission Afrique et Sud-sud de la CGEM ;
– M. Mohamed Taleb, représentant de la Banque islamique de Développement ;
– M. Eric Baulard, directeur de l’Agence française de Développement ;
– M. Michael Hamaide, Banque mondiale ;
– M. Fathallah Oualalouu, Senior Fellow, OCP Policy Center;
– M. Abdallah Saaf, Senior Fellow, OCP Policy Center;
– M. Abdelhak Bassou, Senior Fellow, OCP Policy Center;
– M. Abdelaziz Ait Ali, Economist, OCP Policy Center ;
– M. Bicha Moha, division de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique et des Fonds arabes, direction du budget, ministère des Finances ;
– M. Lemghari Mohamed, Chef de Service de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique, direction du budget, ministère des Finances.
1 Walt Rostow, Les étapes de la croissance économique, Seuil, 1983.
2 () Relevé de décisions du Comité interministériel de la coopération internationale et du développement, 30 novembre 2016.
3 () Rapport des Nations unies sur les objectifs du Millénaire pour le Développement, 2015.
4 () Source : « Croissance et richesse mondiale : le grand rééquilibrage », Samuel Delepierre, BSI-Economics.org,
5 Dans le cadre du bilan du COM, l’effort financier consacré aux très grands émergents est calculé en excluant les subventions au titre du FEXTE, le financement du Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM), mais aussi le financement des initiatives d’ONG françaises et les crédits délégués par le Ministère des Affaires étrangères et du Développement international, qui répondent à des logiques et procédures propres.
6 Conformément à la lettre des ministres du 28 juillet 2014 qui autorise l’AFD à mobiliser un effort financier de l’État modéré en Afrique du Sud pour des projets à forte composante sociale.
7 L’indicateur du COM n’inclut pas les montants engagés au titre du FEXTE (« hors expertise technique »).
8 () Serge Michailof, Africanistan, Fayard
9 () La coopération française au développement. Bilan, analyse, perspectives, Yves Tavernier, 1999.
10 () Rapprocher l’AFD et la CDC au service du développement et de la solidarité internationale, rapport au Président de la République, janvier 2016.
11 () Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la Stabilisation au Mali
12 () L’Atlas français de la coopération décentralisée et des autres actions extérieures est une base de données consultable à l’adresse suivante :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/cncdext/dyn/public/atlas/accesMonde.html
13 () Diplomatie et territoires, pour une action extérieure démultiplie, 21 propositions pour un nouveau partenariat MAEDI / collectivités territoriales, novembre 2016.
14 () Rapport sur l’action extérieure des collectivités territoriales françaises nouvelles approches, nouvelles ambitions, rapport présenté à Monsieur le ministre des Affaires étrangères par André Laignel, 23 janvier 2013.
15 () Cour des comptes, La politique française d’aide au développement, juin 2012
16 () « Stratégie internationale du développement pour la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement », Assemblée générale des Nations Unies, Résolution 2626 (XXV), 24 octobre 1970, paragraphe 43. La Décennie en question est celle des années 70.
17 () Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, article 94.
18 () Le groupe pilote sur les financements innovants pour le développement a été fondé à l’issue de la Conférence de Paris sur les financements innovants en 2006. Le Ministère des affaires étrangères et du développement international français assure le secrétariat permanent du groupe. La France anime par conséquent le réseau d’acteurs impliqués dans la groupe pilote, propose des thèmes de travail en lien avec la présidence tournante et prend en charge les aspects logistiques liés aux réunions et événements.
19 () Réduire les coûts des transferts d’argent des migrants et optimiser leur impact sur le développement : outils et produits financiers pour le Maghreb et la Zone franc, décembre 2011.
© Assemblée nationale