——
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 novembre 2012.
RAPPORT
FAIT
PAR LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 2012 (n° 403),
ET PRÉSENTÉ
PAR M. Christian Eckert,
Rapporteur général,
Député.
——
INTRODUCTION 7
AIDE-MÉMOIRE DU PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 9
I.– UNE EXÉCUTION 2012 MARQUÉE PAR LA BAISSE DES DÉPENSES DE L’ÉTAT SUR LE PÉRIMÈTRE « ZÉRO VOLUME » 11
A.– LA BAISSE HISTORIQUE DES DÉPENSES DE L’ÉTAT EN 2012 12
1.– Une économie de 2,4 milliards d’euros sur la charge de la dette en cours d’année en raison de taux d’intérêt particulièrement bas 13
2.– Une économie de 1,2 milliard d’euros des dépenses au sein du périmètre « zéro valeur » 16
3.– L’évolution des dépenses de l’État hors périmètre normé 17
B.– LES MODIFICATIONS DE CRÉDITS PROPOSÉES PAR LE PRÉSENT PROJET DE LOI 17
1.– Les ouvertures de crédits sur le budget général 18
a) L’inévitable progression des dépenses de la mission Ville et logement sous l’effet de la crise 21
b) La sous-évalualuation constante des dépenses de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances 24
c) Le doublement du coût de l’allocation temporaire d’attente en 2012 25
d) Les ouvertures de crédits au titre des aides exceptionnelles en faveur des collectivités victimes d’emprunts structurés 26
e) La nécessité de combler le besoin de financement du CAS Pensions par une ouverture de crédits au sein de la mission Régimes sociaux de retraite 26
f) La problématique de la réorganisation de la société Audiovisuel extérieur de la France (AEF) 27
g) L’ouverture de 910,4 millions d’euros d’autorisations d’engagement pour financer deux opérations immobilières 28
2.– Les annulations de crédits sur le budget général 29
3.– La régulation budgétaire en 2012 33
4.– Les mouvements de crédits sur les comptes spéciaux 35
C.– LA SITUATION FINALE DES CRÉDITS NETS EN 2012 35
II.– LES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL ET LE SOLDE EN 2012 38
A.– L’ÉVOLUTION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL 38
1.– Une surévaluation manifeste de la prévision initiale de recettes fiscales nettes 38
2.– Une quasi-stabilité des recettes du budget général par rapport à la prévision révisée de septembre dernier 40
B.– UN OBJECTIF DE DÉFICIT PUBLIC MAINTENU À 4,5 % DU PIB 43
1.– Le solde de l’État fortement impacté par plusieurs opérations exceptionnelles 43
2.– Le maintien de la prévision de solde des autres sous secteurs d’administration 45
EXAMEN DES ARTICLES 47
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
RESSOURCES AFFECTÉES
Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article premier : Compensation des transferts de compétences aux départements et aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) 47
Article 2 : Compensation à la collectivité de Mayotte des charges résultant de la mise en place du revenu de solidarité active (RSA) 55
Article 3 : Régularisation des montants dus au titre des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) 59
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 4 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 62
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. - CRÉDITS DES MISSIONS
Article 5 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits 65
Article 6 : Comptes spéciaux : ouverture de crédits 66
Article 7 : Renforcement de la lutte contre les fraudes patrimoniales les plus graves 67
Article additionnel après l’article 7 : Extension de la compétence de la commission départementale de conciliation de Paris aux biens situés à l’étranger 77
Article additionnel après l’article 7 : Harmonisation du délai de reprise en cas de fraude révélée devant les Tribunaux 77
Article 8 : Adaptation des procédures de lutte contre les fraudes les plus graves 79
Après l’article 8 97
Article 9 : Lutte contre la fraude TVA sur la vente de véhicules d’occasion 104
Après l’article 9 107
Article 10 : Marquage obligatoire et traçabilité des produits du tabac. Consolidation du dispositif des « coups d’achat » sur Internet 110
Article 11 : Présentation obligatoire de la comptabilité sous forme dématérialisée dans le cadre d’une vérification de comptabilité 121
Article 12 : Modification des modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de la cession à titre onéreux d’usufruit temporaire 127
Article 13 : Application aux plus-values d’apport de titres réalisées par les personnes physiques d’un report d’imposition optionnel en lieu et place du sursis d’imposition en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur 135
Article 14 : Prévention des schémas d’optimisation fiscale dits de « donation-cession » de titres de sociétés 151
Article additionnel après l’article 14 : Suppression de la retenue à la source sur les intérêts de placements antérieurs à 1987 157
Article additionnel après l’article 14 : Allongement du délai global d’investissement des FCPI et des FIP au titre de l’avantage consenti à l’ISF 158
Article 15 : Harmonisation des délais de réclamation applicables en matière fiscale et de réparation des préjudices subis 159
Après l’article 15 168
Article 16 : Précisions des modalités d’imposition en cas de transfert de siège ou d’établissement stable hors de France 170
Après l’article 16 180
Article 17 : Ajustements consécutifs notamment à la suppression de la taxe professionnelle et à la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale 183
Article additionnel après l’article 17 : Ouverture d’une faculté de prise en charge par les collectivités territoriales de tout ou partie de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 210
Article additionnel après l’article 17 : Modification des modalités de révision des attributions de compensation versées par certains EPCI à fiscalité propre 211
Article 18 : Modification du droit de licence dû par les débitants de tabacs 213
Article 19 : Extension des dispenses de caution pour les petits opérateurs en matière d’alcool et de boissons alcooliques 217
Article 20 : Extension de la dispense de caution des taxes dues lors de l’importation et en matière de régimes économiques douaniers. 220
Article 21 : Modification des dispositions relatives à la taxe poids lourds alsacienne (TPLA) et à la taxe poids lourds nationale (TPLN) 225
Après l’article 21 238
Article additionnel après l’article 21 : Modification de certaines modalités de calcul de la contribution au service public de l’électricité 239
Article 22 : Transposition de la directive 2010/45/UE du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation 241
Article 23 : Mise en conformité avec le droit communautaire de diverses dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) 258
Après l’article 23 270
Article 24 : Départementalisation de Mayotte 271
Après l’article 24 272
II.– AUTRES MESURES
Article 25 : Modification de certaines redevances perçues par les agences et offices de l’eau 284
Article 26 : Taxe relative aux produits phytopharmaceutiques, à leurs adjuvants, aux matières fertilisantes et supports de culture affectée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) 290
Après l’article 26 298
Article 27 : Réforme du financement de la revalorisation des rentes 299
Article 28 : Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2013 307
Article 29 : Révision du régime de la garantie de l’État accordée à Dexia en 2011 312
Article 30 : Amélioration du financement des exportations 321
Article 31 : Octroi de la garantie de l’État à la société Banque PSA Finance, filiale de la société Peugeot S.A. 339
TABLEAU COMPARATIF 349
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 549
ANNEXE 577
Exercice traditionnel par excellence, le collectif budgétaire de fin d’année présente cette année certaines particularités : il doit tirer les conséquences en fin de gestion des surévaluations de recettes et des sous-évaluations de dépenses de l’État décidées au moment du débat sur le projet de loi de finances initiale pour 2012 par un autre Gouvernement, émanant d’une autre majorité. Il doit pour autant démontrer la capacité du nouveau Gouvernement à tenir les engagements de réduction du déficit public pris devant nos partenaires européens.
Le pari a été tenu et l’objectif atteint grâce au sens des responsabilités, à la volonté politique et à la réactivité du nouveau Gouvernement. Celui-ci a pris en effet, dès la loi de finances rectificative du 16 août 2012, les mesures nécessaires pour faire face aux dérapages de dépenses identifiés par la Cour des comptes à la suite de l’audit réalisé en juin à sa demande, et pour mobiliser de nouvelles recettes, dans un esprit de rééquilibrage de notre politique fiscale au profit des ménages modestes, ainsi que des petites et moyennes entreprises.
Ce résultat est d’autant plus remarquable que, pour la première fois dans l’histoire budgétaire française, les dépenses de l’État – hors dépenses exceptionnelles – baissent en valeur d’une année sur l’autre d’environ 200 millions d’euros, quand, sur la moyenne des cinq dernières années, elles avaient tendance à augmenter de 5 à 6 milliards d’euros par an. Ce faisant, aucune mesure fiscale de rapport n’est prévue par le présent collectif pour 2012.
S’il faut se féliciter de ce résultat historique, il convient néanmoins de rester vigilant pour au moins deux raisons : d’une part, la moitié de l’économie constatée par rapport à la tendance résulte d’un facteur conjoncturel, lié à la réduction de la charge de la dette de l’État par rapport à la prévision initiale en raison des taux d’intérêt faibles dont a bénéficié la dette française ; d’autre part, le Gouvernement doit aujourd’hui faire face à une nouvelle dépense exceptionnelle, liée à la nécessité de recapitaliser le groupe Dexia, à hauteur de 2,58 milliards d’euros sans connaître à ce stade son impact sur le déficit public de fin d’année, celui-ci dépendant d’une décision d’Eurostat attendue d’ici le 31 décembre 2012.
Si cette dépense exceptionnelle n’est pas prise en compte dans le déficit public, le Gouvernement sera parvenu à réduire le déficit public de 5,7 % en 2011 à 4,5 % du PIB en 2012, grâce à des mesures pérennes réduisant d’autant le déficit structurel de la France et s’inscrivant pleinement dans la programmation des finances publiques définie par le projet de loi de programmation 2012-2017 adopté en première lecture par l’Assemblée nationale en octobre dernier.
AIDE-MÉMOIRE DU PROJET DE LOI DE FINANCES
RECTIFICATIVE POUR 2012
(en milliards d’euros)
I.– LES DÉPENSES (1) A.– Ouvertures de crédits proposées dans le collectif : + 6,8 d’AE et + 5,9 de CP 1. Budget général : 4,26 d’AE et 3,37 de CP dont : • Participation au capital de Dexia : 2,58 • Prévention de l’exclusion : 0,31 (aides au logement) • Solidarité, insertion, et égalité des chances : 0,28 en AE et 0,31 en CP (AAH) • Immigration, asile et intégration : 0,09 en AE et 0,08 en CP (ATA) 2. Comptes spéciaux : + 2,58 (participation au capital de Dexia) B.– Annulations de crédits proposées dans le collectif : – 2,69 en AE et – 1,87 en CP Budget général dont : • charge de la dette de l’État : – 1,01 en CP • aide publique au développement : – 0,28 en AE et – 0,27 en CP • Solidarité, insertion, égalité des chances : – 0,15 en AE et – 0,17 en CP • Écologie : – 0,23 en AE et – 0,20 en CP • Justice : – 0,47 en AE C.– Soldes des mouvements proposés dans le collectif : + 4,15 en AE et + 4,08 en CP 1. Budget général : + 1,57 d’AE et + 1,50 de CP 2. Comptes spéciaux : + 2,58 |
II.– LES RECETTES |
A.– Les modifications par rapport à l’évaluation révisée associée |
• Recettes fiscales nettes : – 2,3 • Recettes non fiscales : – 1,4 • Comptes spéciaux : + 3 (2) |
B.– Les évaluations de recettes après intervention du présent collectif |
• Recettes fiscales nettes : 270,1 Moins-values par rapport à la loi de finances initiale : – 4,8 dont : Ä IR net : – 1 Ä IS net : – 4,6 Ä TVA nette : – 1,1 |
• Ressources non fiscales : 14,1 Moins-values par rapport à la loi de finances initiale : – 1,7 • Prélèvements sur recettes : 74,7 dont : Ä collectivités territoriales : + 0,05 Ä Union européenne : + 0,2 • Ressources nettes du budget général : 209,5 Moins-values par rapport à la loi de finances initiale : – 6,8 |
|
• Estimé à 78,7 en LFI, le montant du déficit prévisionnel est relevé à 83,6 (hors recapitalisation de Dexia). |
I.– UNE EXÉCUTION 2012 MARQUÉE PAR LA BAISSE DES DÉPENSES DE L’ÉTAT SUR LE PÉRIMÈTRE « ZÉRO VOLUME »
L’analyse de l’évolution des dépenses de l’État en 2012 au sein des périmètres « zéro volume » et « zéro valeur » (3) montre que, non seulement les dépenses de l’État hors charges d’intérêt et des pensions ont été réduites de 1,2 milliard d’euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2012, mais surtout que, pour la première fois dans l’histoire budgétaire française, l’ensemble des dépenses de l’État sous le périmètre « zéro volume » devraient baisser en valeur de 0,2 milliard d’euros, par rapport à l’exécution 2011. Ce chiffre est à comparer avec la progression annuelle de 5 à 6 milliards d’euros de ces mêmes dépenses sur la période 2007-2011.
Le Rapporteur général souhaite donc, à titre liminaire, se féliciter de cette baisse historique des dépenses de l’État d’une année sur l’autre. Elle démontre la démarche volontariste du nouveau Gouvernement pour assumer les engagements pris par la France en faveur de la réduction du déficit, à travers une gestion rigoureuse mais juste des dépenses de l’État. Ce résultat est d’autant plus remarquable que, comme l’avait annoncé la Cour des comptes dans son audit des finances publiques en juin 2012 (4), le présent projet de loi de finances rectificative ainsi que le décret d’avance notifié à la commission des Finances le 20 novembre 2012, redéploient 2,2 milliards d’euros de crédits, essentiellement pour faire face aux dérapages des dépenses de personnel (0,6 milliard d’euros) et d’intervention résultant d’ « impasses » de construction en loi de finances initiale imputables au précédent Gouvernement.
Cette situation ne saurait pour autant éliminer le fait que certaines dépenses exceptionnelles – non comptabilisées ni dans les normes annuelles de dépenses de l’État ni dans le déficit public de l’État – sont apparues en 2012 pour des montants très importants : ainsi, la loi de finances rectificative du 14 mars 2012 a-t-elle ouvert 16,3 milliards d’euros en autorisations d’engagement (AE) et 6,5 milliards d’euros en crédits de paiement (CP) pour assurer la participation de la France au Mécanisme européen de stabilité (MES). De même, le présent projet de loi de finances rectificative propose l’ouverture de 2,58 milliards d’euros en AE et CP sur le budget général afin d’alimenter le compte d’affectation spéciale Participations financières de l’État, pour procéder à la recapitalisation de la banque Dexia, pour laquelle le soutien de l’État n’a cessé de croître depuis 2008 (5).
Enfin, les dépenses liées à la compensation de la réforme de la taxe professionnelle – non comptabilisées dans le prélèvement sur recettes en faveur des collectivités territoriales au sein de la norme « zéro valeur » mais pris en compte dans le déficit public – sont également revues à la hausse de 0,15 milliard d’euros dans le présent collectif budgétaire.
Il s’ensuit que les mouvements de crédits constatés sur l’ensemble de l’année sont d’un montant important par rapport à l’exercice précédent, le solde des ouvertures et annulations de crédits nets en cours d’année s’élevant à 21,6 milliards d’euros en autorisations d’engagement et à 7,8 milliards d’euros en CP (contre respectivement 0,7 et 1 milliard d’euros en 2011).
La loi de finances pour 2012 constitue la deuxième année de mise en œuvre de la double norme de dépenses de l’État en volume et en valeur.
Compte tenu du contexte dégradé constaté à la fin de l’année 2011, la loi de finances initiale a fixé un objectif plus strict que le simple respect des normes « zéro volume » et « zéro valeur » : les dépenses de l’État devaient baisser de 0,5 % sous le périmètre de la norme « zéro volume » et de 0,4 % sous le périmètre de la norme « zéro valeur », par rapport à la loi de finances initiale pour 2011. Ainsi, les dépenses de l’État devaient atteindre 361,3 milliards d’euros, et 274,9 milliards d’euros hors charge de la dette et des pensions (contre respectivement 357,9 et 276,1 milliards d’euros en LFI 2011). Cette contrainte budgétaire a encore été renforcée à l’occasion de la première loi de finances rectificative du 14 mars 2012 qui a procédé à une annulation de crédits de 1,2 milliard d’euros au sein du périmètre de la norme « zéro valeur ».
Comme le montre le tableau ci-après, ces objectifs seraient finalement dépassés : ainsi, l’ensemble des dépenses baisserait de 3,6 milliards d’euros par rapport à l’objectif initial, et, pour les seules dépenses sous le périmètre de la norme « zéro valeur », l’annulation de 1,2 milliard d’euros opéré en mars 2012 ne serait pas remise en cause malgré la nécessité de faire face au dérapage de 2,2 milliards d’euros de certaines dépenses incontournables en fin d’année.
In fine, les dépenses de l’État sous le périmètre « zéro volume » devraient s’établir fin 2012 à 357,7 milliards d’euros, soit une réduction de 0,2 milliard d’euros de l’ensemble des dépenses de l’État entre l’exécution 2011 et l’exécution 2012. À titre de comparaison, ces dépenses avaient progressé de 5,2 milliards d’euros entre 2010 et 2011 (6).
ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE L’ÉTAT SOUS LES NORMES « ZÉRO VOLUME »
ET « ZÉRO VALEUR » EN 2012
(en milliards d’euros)
LFI 2012 |
Mouvements de crédits |
Crédits ouverts 2012 |
Prévision d'exécution 2012**** | ||||
LFR 1 |
LFR 2 |
PLFR 3 |
DA*** | ||||
1. Budget général (BG) |
|
|
|
|
|
|
|
Charge de la dette (a) |
48,8 |
– 0,7 |
– 0,7 |
– 1,0 |
0,0 |
46,4 |
46,4 |
Pensions (b) |
37,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37,6 |
37,6 |
Personnels hors pensions (c) |
80,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
81,0 |
81,0 |
Provisions (d) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Autres dépenses BG** (e) |
123,8 |
– 1,2 |
0,0 |
– 0,1 |
– 0,6 |
121,9 |
121,9 |
Total BG |
|
|
|
|
|
| |
dont périmètre « 0 valeur » (c+d+e) |
204,3 |
– 1,2 |
0,0 |
– 0,1 |
0,0 |
203,0 |
203,0 |
dont périmètre « 0 volume » (a+b+c+d+e) |
290,7 |
– 1,9 |
– 0,7 |
– 1,1 |
0,0 |
287,0 |
287,0 |
2. PSR (prélèvement sur recettes) |
|
|
|
|
|
|
|
Collectivités territoriales |
55,6 |
|
|
0,0 |
|
55,6 |
55,6 |
dont PSR collectivités sous norme |
51,7 |
|
|
– 0,1 |
|
51,6 |
51,6 |
Union européenne |
18,9 |
|
|
0,2 |
|
19,1 |
19,1 |
Total PSR |
74,5 |
|
|
0,2 |
|
74,6 |
74,6 |
dont PSR sous norme |
70,6 |
|
|
0,1 |
|
70,7 |
70,7 |
3. Affectations de recettes **** |
3,0 |
|
|
|
|
3,0 |
3,0 |
Total norme élargie |
|
|
|
|
| ||
norme « 0 valeur » |
274,9 |
– 1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
273,7 |
273,7 |
norme « 0 volume » |
361,3 |
– 1,9 |
– 0,7 |
– 1,0 |
0,0 |
357,7 |
357,7 |
* hors mission R&D, dotation au capital du Mécanisme européen de stabilité, recapitalisation de Dexia
** Le projet de décret d’avance prévoit une ouverture nette de près de 0,6 Md€ de crédits de titre 2
*** Prévision nette des fonds de concours, décrets de transfert et de virement
Par définition, l'exécution de la dotation "Provisions" n'est pas prévisible
**** Il s'agit des taxes affectées plafonnées au sens de l'article 46 de la LFI 2012. Pour mémoire, ces affectations de recettes ne sont pas incluses dans la norme « 0 valeur » de l'État en 2012.
1.– Une économie de 2,4 milliards d’euros sur la charge de la dette en cours d’année en raison de taux d’intérêt particulièrement bas
Si la charge des pensions semble conforme à la prévision en exécution 2012, la charge de la dette est en forte baisse, principalement en raison des conditions très favorables dont bénéficient les émissions de dette françaises auprès des investisseurs en 2012 (7).
ÉVOLUTION DE LA CHARGE DE LA DETTE EN 2012
(en milliards d’euros)
Exécution 2011 |
LFI 2012 |
LFR I |
LFR II |
PLFR III |
Prévision d’exécution | |
Charge de la dette |
46,3 |
48,8 |
48,1 |
47,4 |
46,4 |
46,4 |
Évolution |
+ 2,5 |
– 0,7 |
– 0,7 |
– 1,0 |
– 2,4 |
Après les annulations de crédits d’un montant de 0,7 milliard d’euros dans chacune des deux premières lois de finances rectificatives pour 2012, le présent projet de loi propose d’annuler 1,014 milliard d’euros de crédits sur le programme Charge de la dette. Ainsi, par rapport à la loi de finances rectificative du 16 août 2012, la charge de la dette en 2012 s’établirait à 46,359 milliards d’euros compte tenu :
– d’une économie de 800 millions d’euros sur la charge d’intérêts des bons du trésor à taux fixe et intérêts précomptés – BTF (montant ramené à 237 millions d’euros) ;
– d’une économie de 200 millions d’euros sur la charge nette d’intérêts des bons du trésor à intérêt annuel – BTAN – et des obligations assimilables du Trésor – OAT (montant ramené à 41 371 millions d’euros) ;
– d’une économie de 14 millions d’euros sur la charge d’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation (montant ramené à 3 638 millions d’euros).
Cette révision est inférieure de 0,3 milliard d’euros à celle qui avait été annoncée à l’occasion de la présentation en septembre dernier du projet de loi de finances pour 2013 (46,7 milliards d’euros).
Il s’ensuit que la charge de la dette en 2012 s’établirait à un montant quasiment équivalent à celui constaté fin 2011 alors même que l’encours de la dette de l’État a fortement progressé, passant de 1 335 milliards d’euros fin 2011 à 1 387 milliards d’euros fin 2012 (+ 3,9 %).
Sur le champ, largement prépondérant, de la dette négociable (OAT, BTAN et BTF), la quasi-stabilité de la charge de la dette de l’État attendue entre 2011 et 2012 résulterait de la compensation de l’effet « volume » défavorable lié à l’augmentation de l’encours de dette à moyen et long terme (+ 3,4 milliards d’euros), par :
– un effet « taux » très favorable (– 2,1 milliards d’euros) : les taux courts sont devenus légèrement négatifs au deuxième semestre 2012 et les taux de moyen et long termes sont très inférieurs aux taux initialement anticipés (2,7 % contre 3,7 % pour les OAT à 10 ans). Ceci s’explique principalement par l’abondance de liquidités résultant de la décision de la Banque centrale européenne du 5 juillet 2012 d’abaisser les taux de sa facilité de dépôt de 25 points de base à zéro (8);
– un effet « inflation » : la hausse des prix en 2012 a été certes plus importante que prévu, mais est demeurée moindre que celle enregistrée en 2011 (- 1 milliard d’euros) ;
– et un effet « calendaire » : le coût net des émissions à moyen et long termes de l’année, qui dépend essentiellement d’effets calendaires, s’inscrit en retrait en 2012 par rapport à 2011 (– 0,3 milliard d’euros).
Enfin, les autres ressources de trésorerie sont révisées à la hausse dans le présent projet de loi compte tenu d’une augmentation de 3,5 milliards d’euros des dépôts des correspondants du Trésor depuis la dernière loi de finances rectificative.
Le Rapporteur général ne peut que se féliciter de cette évolution à la baisse de la charge de la dette en 2012, qui contribue significativement à la réduction de l’ensemble des dépenses de l’État sous le périmètre « zéro volume », la totalité des économies ainsi réalisées ayant été affectées à la réduction du déficit public.
Toutefois, il convient de rester prudent au regard de la volatilité des marchés en rappelant qu’après Standard & Poor's en janvier 2012, l'agence américaine Moody’s, a retiré son triple A à la France, le 20 novembre dernier, compte tenu des incertitudes sur le regain de compétitivité de notre pays et des risques accrus sur la zone euro pour le pays.
En phase d’incertitudes, les investisseurs pourraient donc se reporter sur d’autres titres – en particulier sur les titres allemands, accroissant ainsi encore l’écart de taux entre nos deux pays – ou réclamer un meilleur rendement du risque, accroissant dès lors la charge de la dette à venir.
Or, le Rapporteur général rappelle qu’une hausse des taux globale et pérenne de 1 %, répercutée sur l’ensemble de la courbe des taux, entraînerait une augmentation des intérêts de la dette d’environ 2 milliards d’euros dès la première année, de 4 milliards d’euros l’année suivante, de 6 milliards d’euros la troisième année, jusqu’à environ 14 milliards d’euros à un horizon de dix ans. Dans une telle situation, la charge de la dette deviendrait rapidement – probablement dès 2015 – le premier poste budgétaire de l’État.
Pour éviter cette situation, il est donc primordial que la France respecte son engagement de réduction du déficit public et mette en œuvre des réformes structurelles nécessaires au renforcement de sa compétitivité et au développement de l’emploi.
Le plafond de dépenses sous le périmètre de la norme « zéro valeur » en loi de finances initiale pour 2012 s’établit à 274,9 milliards d'euros. Les mouvements de crédits intervenus suite à la première loi de finances rectificative pour 2012 ont réduit ce plafond d’un montant de 1,2 milliard d’euros, celui-ci s’établissant alors à 273,7 milliards d’euros. Les redéploiements de crédits intervenus dans le cadre de la deuxième loi de finances rectificative pour renforcer les moyens en faveur de l’enseignement scolaire ont respecté ce nouveau plafond, le Gouvernement ayant par ailleurs décidé un « surgel » de crédits de 1,5 milliard d’euros pour faire face aux dérapages identifiés par la Cour des comptes.
Les ouvertures nettes de crédits prévues par le présent projet de loi de finances rectificative ainsi que par le décret d’avance notifié à la commission des Finances de l’Assemblée nationale le 20 novembre dernier, d’un montant total de 3,2 milliards d’euros en AE et de 2,1 milliards d’euros en CP sur le périmètre « zéro valeur » (hors charge de la dette, Remboursements et dégrèvements et recapitalisation de Dexia) sont entièrement gagées par des annulations de crédits équivalentes, dont 85 % portent des crédits mis en réserve (1,753 milliard d’euros en CP).
Pour le seul présent projet de loi de finances rectificative, les ouvertures nettes de crédits sur le périmètre « zéro valeur » s’élèvent à 1,7 milliard d’euros en AE et 789,8 millions d’euros en CP tandis que les annulations nettes s’élèvent, sur le même périmètre, à – 1,68 milliard d’euros en AE et – 860,2 millions d’euros en CP.
Le solde des ouvertures/annulations de crédits en CP (70,4 millions d’euros) permet de couvrir l’augmentation des prélèvements sur recettes (PSR) entrant dans le périmètre de la norme « zéro valeur » : majoration de 173 millions d’euros du PSR en faveur de l’Union européenne, résultant des besoins de paiement au titre des programmes pluriannuels de l’Union (cohésion, recherche…), partiellement compensée par la sous-exécution des PSR en faveur des collectivités territoriales entrant dans le champ de la norme (– 102 millions d’euros, dont - 126 millions d’euros au titre du fonds de compensation de la TVA et + 24 millions d’euros sur les autres dotations du périmètre).
Fin 2012, la réduction des dépenses de l’État sous le périmètre « zéro valeur » s’élèverait donc à – 1,2 milliard d’euros par rapport à la loi de finances initiale, soit un effort six fois plus important que celui réalisé en 2011 (- 259 millions d’euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2011).
Le présent projet de loi de finances rectificative procède par ailleurs à une majoration de 149,4 millions d’euros des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales relatifs à la compensation de la réforme de la fiscalité directe locale(9), qui n’entrent pas dans le champ des normes « zéro volume » et « zéro valeur » et dont les effets sur le niveau des recettes 2012 et le déficit budgétaire sont analysés dans le III du présent rapport.
Il s’agit principalement d’une régularisation sur le calcul de la compensation relais qui a pour corollaire un dépassement sur la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), ainsi que, dans une moindre mesure, d’une régularisation de la dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 2011 et 2012.
Le présent projet de loi de finances rectificative procède à :
– une ouverture nette de 6,8 milliards d’euros d’AE et 5,9 milliards d’euros de CP, répartie sur les crédits des missions du budget général (+ 4,3 milliards d’euros en AE et 3,4 milliards d’euros en CP) et des comptes spéciaux (+ 2,58 milliards d’euros en AE et CP) ;
– une annulation de 2,7 milliards d’euros d’AE et de 1,9 milliard d’euros de CP sur les seuls crédits des missions du budget général, dont 1,014 milliard d’euros sur le programme Charge de la dette.
Le solde des ouvertures et annulations nettes de crédits prévues par le présent projet s’élève donc à 4,15 milliards d’euros en AE et 4,08 milliards d’euros en CP.
L’article 5 et l’état B du présent projet de loi de finances rectificative tendent à ouvrir des crédits supplémentaires à hauteur de :
– 10,3 milliards d’euros de crédits bruts en AE et 9,4 milliards d’euros en CP (10), soit des montants très supérieurs à ceux ouverts en collectif de fin d’année 2011 (respectivement 2,2 et 1,2 milliards d’euros) et 2010 (respectivement 3,1 et 4,5 milliards d’euros). Comme le montrent les tableaux ci-dessous, ces ouvertures de crédits, qui représentent 2,7 % des AE et 2,5 % des CP initiaux, sont néanmoins relativement concentrées puisqu’elles portent sur 14 missions sur 32 et 20 programmes sur 125 en AE et sur 13 missions sur 32 et 19 programmes sur 125 en CP.
– 4,3 milliards d’euros d’AE et 3,4 milliards d’euros de CP nets des remboursements et dégrèvements (soit 1,4 % des AE et 1,2 % des CP nets initiaux), à comparer avec l’ouverture de 1,8 milliard d’euros d’AE et 0,85 milliard d’euros de CP nets en loi de finances rectificative de fin d’année en 2011, et l’ouverture de 3,9 milliards d’euros en AE et 3,3 milliards d’euros en CP en loi de finances rectificative de fin d’année 2010.
Il convient néanmoins de constater que l’ouverture de 2,58 milliards d’euros d’AE et de CP sur la mission Engagements financiers de l’État au titre du nouveau programme budgétaire Recapitalisation de la banque Dexia constitue une dépense exceptionnelle, résultant de la décision conjointe de la France et de la Belgique du 8 novembre 2012. Ces ouvertures de crédits sont portées en recettes du compte d’affectation spéciale Participations financières de l’État. Cette mesure est commentée sous l’article 29 du présent projet qui propose en outre d’étendre la garantie de l’État en faveur de Dexia.
Comme le montrent les tableaux ci-après, hors recapitalisation Dexia, le montant des ouvertures de crédits nettes proposé par le présent projet s’élève à 1,7 milliard d’euros en AE et à 789 millions d’euros en CP, soit un montant équivalent à l’ouverture de crédits en loi de finances rectificative de fin d’année 2011. Elles représentent 0,6 % des AE et 0,3 % des CP initiaux.
Sans examiner dans le détail chacune de ces ouvertures de crédits, le Rapporteur général souhaite rendre compte des plus significatives, par ordre d’importance décroissante, dans les développements qui suivent et les tableaux récapitulatifs ci-après.
OUVERTURES D’AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT PAR MISSION ET PROGRAMME
DU BUDGET GÉNÉRAL
(en millions d’euros)
Missions et Programmes |
LFI AE |
Ouvertures |
% AE initiales | |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales |
3 739 371 742 |
76 662 |
0,0 % | |
Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires |
2 139 668 606 |
1 500 |
0,0 % | |
Forêt |
349 687 967 |
2 000 |
0,0 % | |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
758 290 338 |
73 162 |
0,0 % | |
Direction de l’action du Gouvernement |
1 094 158 177 |
368 394 209 |
33,7 % | |
Coordination du travail gouvernemental |
607 583 256 |
368 394 209 |
60,6 % | |
Écologie, développement et aménagement durables |
9 649 346 775 |
542 000 000 |
5,6 % | |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables |
3 530 574 681 |
542 000 000 |
15,4 % | |
Engagements financiers de l’État |
49 921 176 591 |
2 585 000 000 |
5,2 % | |
Recapitalisation Dexia (nouveau) |
2 585 000 000 |
|||
Immigration, asile et intégration |
631 891 444 |
89 066 557 |
14,1 % | |
Immigration et asile |
553 453 404 |
89 066 557 |
16,1 % | |
Médias, livre et industries culturelles |
1 248 263 591 |
8 550 000 |
0,7% | |
|
Action audiovisuelle extérieure |
150 087 308 |
8 550 000 |
5,7 % |
Outre-mer |
2 118 665 911 |
5 000 000 |
0,2 % | |
Emploi outre-mer |
1 312 871 975 |
5 000 000 |
0,4 % | |
Recherche et enseignement supérieur |
25 757 630 834 |
18 000 000 |
0,1 % | |
Vie étudiante |
2 171 203 845 |
18 000 000 |
0,8 % | |
Régimes sociaux et de retraite |
6 618 706 092 |
19 453 133 |
0,3 % | |
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 682 050 000 |
19 453 133 |
1,2 % | |
Relations avec les collectivités territoriales |
2 719 642 433 |
25 761 139 |
0,9 % | |
Concours financiers aux départements |
492 859 347 |
667 550 |
0,1 % | |
Concours financiers aux régions |
905 446 505 |
36 895 |
0,0 % | |
Concours spécifiques et administration |
506 055 512 |
25 056 694 |
5,0 % | |
Remboursements et dégrèvements (crédits évaluatifs) |
85 437 930 000 |
6 033 377 000 |
7,1 % | |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État |
75 153 430 000 |
4 926 877 000 |
6,6% | |
|
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux |
10 284 500 000 |
1 106 500 000 |
10,8% |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
12 726 673 939 |
287 386 256 |
2,3 % | |
Handicap et dépendance |
10 531 453 198 |
287 386 256 |
2,7 % | |
Sport, jeunesse et vie associative |
482 254 351 |
1 000 |
||
Jeunesse et vie associative |
229 970 979 |
1 000 |
||
Ville et logement |
7 720 038 082 |
316 142 324 |
4,1 % | |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
1 206 253 547 |
56 700 000 |
4,7 % | |
Aide à l’accès au logement |
5 490 207 727 |
259 442 324 |
4,7 % | |
Total budget |
380 746 233 581 |
10 298 208 280 |
2,7% | |
Total budget hors Remboursement et dégrèvements |
295 308 303 581 |
4 264 831 280 |
1,4 % | |
Total budget hors R et D et hors recapitalisation Dexia |
295 308 303 581 |
1 679 831 280 |
0,6 % | |
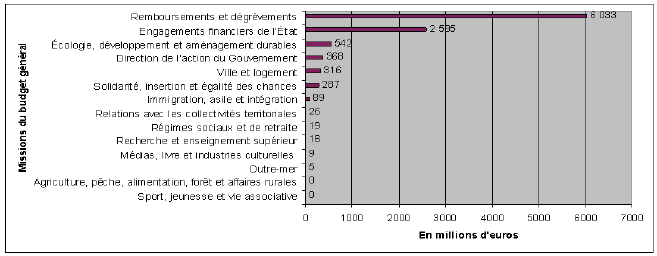
OUVERTURES DE CRÉDITS DE PAIEMENT PAR MISSION ET PROGRAMME
DU BUDGET GÉNÉRAL
(en millions d’euros)
Missions et Programmes |
LFI CP |
Ouvertures |
% CP initiaux | |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales |
3 771 305 865 |
76 662 |
0,0 % | |
Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires |
358 447 263 |
1 500 |
0,0 % | |
Forêt |
2 170 408 692 |
2 000 |
0,0 % | |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
750 547 079 |
73 162 |
0,0 % | |
Engagements financiers de l’État |
49 921 176 591 |
2 585 000 000 |
5,2 % | |
Recapitalisation Dexia (nouveau) |
2 585 000 000 |
|||
Enseignement scolaire |
62 211 682 924 |
6 479 |
| |
|
Enseignement technique agricole |
3 952 435 153 |
6 479 |
|
Immigration, asile et intégration |
631 791 444 |
83 128 587 |
13,2 % | |
Immigration et asile |
560 153 404 |
83 128 587 |
14,8 % | |
Médias, livre et industries culturelles |
1 268 379 591 |
8 550 000 |
0,7% | |
|
Action audiovisuelle extérieure |
274 997 850 |
8 550 000 |
3,1 % |
Outre-mer |
1 966 444 165 |
5 000 000 |
0,3 % | |
Emploi outre-mer |
628 352 190 |
5 000 000 |
0,8 % | |
Recherche et enseignement supérieur |
25 408 785 172 |
18 000 000 |
0,1 % | |
Vie étudiante |
12 511 247 419 |
18 000 000 |
0,1 % | |
Régimes sociaux et de retraite |
6 618 706 092 |
19 453 133 |
0,3 % | |
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers |
4 080 200 000 |
19 453 133 |
0,5 % | |
Relations avec les collectivités territoriales |
2 677 931 621 |
25 761 139 |
1,0 % | |
Concours financiers aux départements |
492 859 347 |
667 550 |
0,1 % | |
Concours financiers aux régions |
905 446 505 |
36 895 |
0,0 % | |
Concours spécifiques et administration |
499 055 512 |
25 056 694 |
5,0 % | |
Remboursements et dégrèvements (crédits évaluatifs) |
85 437 930 000 |
6 033 377 000 |
7,1 % | |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État |
75 153 430 000 |
4 926 877 000 |
6,6% | |
|
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux |
10 284 500 000 |
1 106 500 000 |
10,8% |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
12 693 447 484 |
313 679 733 |
2,5 % | |
Handicap et dépendance |
20 264 381 |
313 679 733 |
1 547,9 % | |
Sport, jeunesse et vie associative |
485 409 688 |
1 000 |
||
Jeunesse et vie associative |
255 438 709 |
1 000 |
||
Ville et logement |
7 596 293 692 |
316 142 324 |
4,2 % | |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
5 490 207 727 |
56 700 000 |
1,0 % | |
Aide à l’accès au logement |
359 849 586 |
259 442 324 |
72,1 % | |
Total budget |
376 151 517 343 |
9 408 176 057 |
2,5% | |
Total budget hors Remboursement et dégrèvements (R&D) |
290 713 587 343 |
3 374 799 057 |
1,2 % | |
Total budget hors R et D et hors recapitalisation Dexia |
290 713 587 343 |
789 799 057 |
0,3 % | |
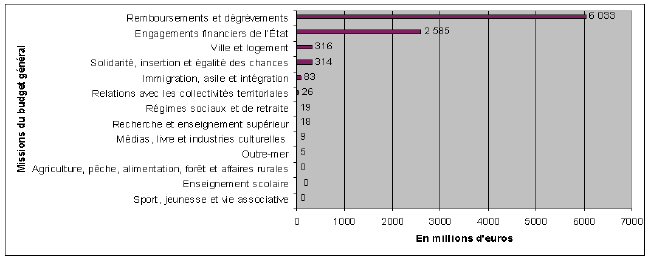
Comme l’avait anticipé la Cour des comptes, les ouvertures de crédits correspondent pour l’essentiel à une insuffisante budgétisation initiale de dépenses d’intervention, dont la dynamique était pourtant connue du précédent Gouvernement au regard de la récurrence des mouvements de crédits déjà opérés sur ces dépenses en loi de finances de fin d’année depuis 2008.
Pour autant, alors que la Cour avait évalué le risque de « dérapage » dans une fourchette comprise entre 1,18 et 2,02 milliards d’euros, la situation s’avère plus sévère encore puisque la somme des ouvertures de crédits dans le présent projet de loi et celles proposées dans le décret d’avance notifié à la commission des Finances de l’Assemblée nationale le 20 novembre dernier s’élève à 2,2 milliards d’euros.
Les dépassements supplémentaires par rapport aux estimations de la Cour portent principalement, en CP, sur les bourses universitaires (+ 30 millions d’euros), les aides au logement (+ 70 millions d’euros), le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne (+ 70 millions d’euros), la masse salariale de l’éducation nationale (+ 80 millions d’euros) et les dispositifs de la mission Travail et emploi (+ 100 millions d’euros), les ouvertures nécessaires sur la mission Défense s’avérant légèrement inférieures (- 100 millions d’euros).
À ces dépassements, il convient d’ajouter le financement de mesures nouvelles décidées par le Gouvernement comme le maintien d’un niveau important de contrats aidés compte tenu de la situation dégradée du marché du travail (dans le décret d’avance) ou le renforcement des moyens consacrés à l’hébergement d’urgence (dans le présent projet de loi).
● + 259 millions d’euros en faveur des aides personnelles au logement
En 2012, les allocations logement sont revalorisées en fonction de l’indice de référence des loyers qui lui-même correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. Sont concernées par cette revalorisation :
– l’allocation de logement sociale (ALS) visée à l’article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, à destination des personnes âgées, des infirmes, des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d’emplois. L’ALS est financée par le fonds national d’aide au logement (FNAL), alimenté à cette fin par une cotisation des employeurs et par une subvention de l’État sur le programme Aide à l’accès au logement ;
– l’aide personnalisée au logement (APL) visée à l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation. Le champ d’application de l’APL comprend, d’une part, l’aide à l’accession à la propriété de logements financés avec des prêts aidés ou réglementés par l’État, d’autre part, l’aide en faveur des locataires. Anciennement assuré par le fonds national de l’habitat (FNH), le financement de l’APL est depuis le 1er janvier 2006 assuré par le FNAL, alimenté à cette fin par une contribution du fonds national des prestations familiales (FNPF) et par une contribution de l’État inscrite sur le programme Aide à l’accès au logement ;
– l’allocation de logement familial (ALF) visée à l’article L. 542-5 du code de la sécurité sociale est intégralement financée par le FNPF, lui-même alimenté par les cotisations allocations familiales des employeurs et par 1,1 point de CSG (hors budget de l’État).
Les trois aides (ALS, APL et ALS) sont versées sous condition de ressources aux personnes qui s’acquittent d’un minimum de loyer ou de mensualité, sous réserve que le logement constitue bien leur résidence principale, c’est-à-dire qu’il soit occupé pendant au moins huit mois dans l’année par elles-mêmes, leur conjoint ou des personnes à charge. Comme le montre le tableau ci-après, depuis 2006 et plus encore depuis le début de la crise économique et financière, le nombre d’allocataires ne cesse de progresser.
NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DES AIDES AU LOGEMENT AU 31 DÉCEMBRE
(en milliers d’euros)
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 | |
APL |
2 797 |
2 751 |
2 708 |
2 637 |
2 586 |
2 567 |
2 482 |
2 496 |
2 620 |
2 619 |
2 622 |
2 681 |
ALF |
1 248 |
1 247 |
1 240 |
1 225 |
1 235 |
1 255 |
1 244 |
1 263 |
1 350 |
1 356 |
1 335 |
1 332 |
ALS |
2 234 |
2 200 |
2 221 |
2 221 |
2 234 |
2 252 |
2 199 |
2 216 |
2 344 |
2 364 |
2 353 |
2 388 |
Total |
6 278 |
6 198 |
6 168 |
6 083 |
6 055 |
6 074 |
5 925 |
5 975 |
6 315 |
6 338 |
6 310 |
6 401 |
Pour 2012, la contribution de l’État au FNAL prévue en loi de finances initiale s’élève à 5,558 milliards d’euros. Les crédits ouverts dans le présent collectif s’établissent à 259,4 millions d’euros en AE et CP (contre 272 millions d’euros en LFR de fin d’année 2011).
Cette majoration de 4,7 % des crédits s’explique par deux phénomènes :
– une hausse continue du nombre d’allocataires (+ 1,9 % entre juin 2011 et juin 2012) combinée à une hausse du coût unitaire de l’aide liée à l’augmentation du nombre de chômeurs, supérieure aux prévisions initiales. Or, l’augmentation du chômage se traduit par une majoration des aides en raison de la diminution des ressources des bénéficiaires qu’elle entraîne pour le calcul des aides au logement ;
– une révision par l’ACOSS à la baisse des prévisions de recettes des cotisations employeurs (– 29 millions d’euros par rapport aux prévisions initiales).
● + 41,7 millions d’euros pour couvrir les dépenses d’hébergement d’urgence
Le présent projet propose tout d’abord d’ouvrir 41,7 millions d’euros en AE et CP sur le programme Prévention et lutte contre l’exclusion, au titre des dispositifs d’hébergement d’urgence et de veille sociale (contre 75 millions d’euros fin 2011), dont 37,5 millions d’euros en faveur du seul dispositif d’hébergement d’urgence, ce qui représente une majoration de 15 % des crédits initiaux (244 millions d’euros).
Le dérapage de ces dépenses s’explique, comme chaque année, par une sous-évaluation du nombre des demandes d’hébergement alors que les capacités d’accueil des centres d’hébergement ne sont pas suffisantes, ce qui nécessite l’ouverture de nouvelles places et le financement de nuitées hôtelières supplémentaires par rapport aux prévisions de la budgétisation. En outre, la prolongation de plusieurs milliers de places hivernales jusqu’en juillet 2012 a contribué à la progression de la dépense.
Le nouveau Gouvernement a donc souhaité améliorer la budgétisation initiale de ces dépenses en proposant, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2013, 275 millions d’euros pour l’hébergement d’urgence, soit des crédits en progression de 31 millions d’euros par rapport aux crédits votés pour 2012. Le Rapporteur général relève néanmoins que cette démarche responsable pourrait s’avérer insuffisante pour couvrir les besoins d’ores et déjà constatés et le financement de 5 000 places d’hébergement d’urgence supplémentaires.
● + 7,5 millions d’euros au titre de l’allocation de reconnaissance en faveur des Français rapatriés
Malgré l’arrêt du Conseil d’État du 6 avril 2007 supprimant la subordination de cette aide au fait d’être de nationalité française (11), le précédent Gouvernement n’a jamais pris la responsabilité de réévaluer à la hausse le montant des dépenses à verser au titre de l’allocation de reconnaissance en faveur des Français rapatriés. Par conséquent, il est devenu traditionnel d’ouvrir entre 4 et 7,5 millions d’euros de crédits supplémentaires en loi de finances rectificative en fin d’année pour couvrir les dépenses effectivement constatées en fonction du rythme d’entrée des dossiers nouveaux.
Souhaitant rompre avec cette pratique, le Gouvernement a proposé dans le cadre du projet de loi de finances pour 2013 de majorer les crédits initiaux destinés à l’action 15 Rapatriés du programme 177 de 4,3 millions d’euros.
● Une progression de 60 % des crédits finançant l’aide au logement temporaire destinée à l’accueil des gens du voyage (+ 7,5 millions d’euros)
Le programme 177 supporte également le cofinancement, à parité avec la CNAF, du fonctionnement des aires d’accueil des gens du voyage via l’aide au logement temporaire, dite « ALT2 ». D’un montant de 12,4 millions d’euros en loi de finances initiale pour 2012, ces crédits sont versés aux organismes gestionnaires de ces aires d’accueil (communes, établissements publics de coopération intercommunale ou personnes morales gérant une ou plusieurs aires permanentes d’accueil), le montant forfaitaire étant fixé à un total de 132,45 euros par mois et par emplacement.
Sans qu’aucune explication ne soit mentionnée dans le présent projet de loi de finances, il est proposé d’ouvrir 7,5 millions d’euros supplémentaires à ce titre. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, la prévision initiale reposait sur une perspective d’économie sur le dispositif ALT2, résultant d’une tarification sur la base des places effectivement occupées et non pas disponibles. La mise en œuvre effective de cette réforme s’est néanmoins heurtée à un manque de préparation et de concertation sur le terrain, si bien qu’elle n’a pas été mise en œuvre, ce qui expliquerait le dérapage constaté.
b) La sous-évalualuation constante des dépenses de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Le montant des ouvertures de crédits de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances, s’élève à 287,4 millions d’euros en AE et 313 millions d’euros en CP.
● Elle concerne principalement le financement de l’augmentation des dépenses de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) qui atteint cette année 291,7 millions d’euros (contre 212 millions d’euros en 2011). Cette croissance s’explique essentiellement par une sous-estimation initiale de la progression des bénéficiaires qui impose une révision à la hausse du nombre total de bénéficiaires (+ 55 400 par rapport à la prévision), et plus particulièrement des titulaires de cette prestation présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % et une difficulté substantielle et durable d’accès à l’emploi.
À la fin de l’année 2012, le nombre total de bénéficiaires devrait atteindre 1 000 200 et la proportion de personnes âgées de 50 ans ou plus, qui représentaient 28,5 % des allocataires en 2000, avoisinerait les 40 % fin 2012. Le coût total de l’AAH pour l’État s’élèverait à 7,8 milliards d’euros en 2012.
Le Rapporteur général rappelle que les travaux conduits par la Cour des comptes à la demande de l’Assemblée nationale (12) montrent que cette dépense est fortement influencée par les plus ou moins grandes facilités à accéder à d’autres revenus de remplacement : le RSA, les préretraites et l’assurance chômage, l’invalidité, l’allocation de cessation d’activité des travailleurs de l’amiante, l’allocation de solidarité spécifique, pour ne citer que les principaux dispositifs de solidarité. Par conséquent, avec l’accentuation de la crise économique, il était prévisible de voir cette dépense encore progresser en 2012, à défaut d’une réforme d’envergure.
● En parallèle, le présent projet propose d’ouvrir sur cette mission 25 millions d’euros en CP au titre du remboursement de dépenses en faveur des services d’aides à domicile et 3 millions d’euros en CP également afin de couvrir les restes à payer d’opérations d’investissements.
L’allocation temporaire d’attente (ATA) est versée aux demandeurs d’asile pendant toute la durée d’instruction de leur demande dès lors qu’ils n’ont pas accès aux centres d’accueil de demandeurs d’asile (CADA), qu’ils viennent de pays d’origine sûrs, qu’ils soient déboutés en procédure de recours devant la Cour nationale du droit d’asile, ou qu’aucune place en CADA ne soit disponible alors qu’ils ont accepté l’offre de prise en charge qui leur a été présentée lors de leur admission au séjour.
La loi de finances initiale pour 2012 a ouvert 89,65 millions d’euros en AE et CP pour financer l’ATA au sein de la mission Immigration, asile et intégration contre 54 millions d’euros en loi de finances initiale pour 2011 (+ 35,65 millions d’euros). Ce « rebasage » était toutefois nettement insuffisant au regard de l’exécution 2011 dans la mesure où il avait été nécessaire d’ouvrir 147 millions d’euros supplémentaires en cours d’année.
Sans surprise, le présent projet propose de doubler les crédits en faveur de cette allocation, en ouvrant 89 millions d’euros en AE et 83 millions d’euros en CP pour faire face à :
– la poursuite de la hausse du flux des demandeurs d’asile (+ 3,9 % sur les dix premiers mois de l’année) ;
– l’allongement des délais d’instruction des demandes d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) – d’environ 15 mois – malgré le renforcement de leurs moyens en 2011 et 2012 (+ 80 emplois).
Compte tenu de la dynamique des dépenses liées à la prise en charge des demandeurs d'asile, le projet de loi de finances pour 2013 entend mettre fin aux sous-budgétisations chroniques constatées sous la précédente législature, en relevant les crédits initiaux destinés à l'allocation temporaire d'attente des demandeurs d'asile, pour les porter à 140 millions d’euros. Il prévoit notamment la création de 1 000 places supplémentaires en centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) et la création de 10 nouveaux emplois d'officiers de protection chargés de l'instruction des demandes à l'OFPRA afin de poursuivre les efforts de réduction des délais de traitement des demandes d'asile.
Le Rapporteur général ne peut que saluer cet effort important à la hausse des crédits initiaux mais craint néanmoins l’apparition d’un besoin supplémentaire en 2013 compte tenu du niveau des dépenses passées (170 millions d’euros en 2012 et 210 millions d’euros en 2011).
d) Les ouvertures de crédits au titre des aides exceptionnelles en faveur des collectivités victimes d’emprunts structurés
Face aux difficultés financières de certaines collectivités territoriales victimes d’emprunts toxiques, le Gouvernement vient d’annoncer la création d’un dispositif d’aide spécifique, pour lequel il propose d’ouvrir 25 millions d’euros dans le présent collectif. À la date de rédaction du présent rapport, le Gouvernement n’a toutefois pas présenté les détails de ce dispositif.
e) La nécessité de combler le besoin de financement du CAS Pensions par une ouverture de crédits au sein de la mission Régimes sociaux de retraite
Le présent projet de loi de finances rectificative propose d’ouvrir 19,4 millions d’euros sur la mission Régimes sociaux de retraite afin d’abonder le CAS Pensions à partir de l’action n° 9 Contributions exceptionnelles au compte d’affectation spéciale "Pensions" du programme Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers.
Comme l’a souligné la Cour des comptes, ce CAS est confronté à une érosion de l’assiette des ressources, imputable en particulier aux effets de la politique de rémunération qui, sous la précédente législature, privilégiait les mesures indemnitaires non soumises à retenue pour pension, au détriment de mesures plus générales affectant le traitement indiciaire.
Les ministères constatant des besoins de crédits de masse salariale hors contributions aux pensions et, dans le même temps, des disponibilités supérieures sur les crédits destinés aux pensions ont mobilisé ces disponibilités en cours d’année par fongibilité au sein des crédits de titre 2 comme le montre le tableau ci-après.
Ministère |
Fongibilité asymétrique au 15/11/2012 (en euros) |
Économie et finances |
4 163 728 |
Éducation nationale |
10 192 211 |
Agriculture, agroalimentaire et forêt |
25 627 371 |
Intérieur |
18 000 000 |
Écologie, développement durable et énergie |
7 000 000 |
Enseignement supérieur et recherche |
260 000 000 |
Il est désormais impératif, pour assurer le versement intégral des montants prévus en loi de finances initiale au CAS Pensions et garantir la neutralité de ces mouvements de crédits sur le champ de la norme « zéro valeur » (qui s’oppose en pratique à la fongibilité des crédits au sein du titre 2), d’ouvrir des crédits sur le titre 2 de la mission Régimes sociaux et de retraites afin d’abonder le CAS Pensions. L’abondement proposé, d’un montant de 19,4 millions d’euros, est néanmoins bien inférieur au besoin constaté en loi de finances rectificative de fin d’année 2011 (+ 70 millions d’euros).
En avril 2008, le précédent Gouvernement avait décidé la création d’une société holding, Audiovisuel Extérieur de la France (AEF). La société AEF détient aujourd’hui 100 % du capital de Radio France international (RFI) et de France 24 ainsi que 49 % du capital de TV5 Monde, celle-ci étant une entreprise multipartite, partenaire et non filiale de la holding AEF. Par ailleurs les crédits alloués à TV5 Monde, Radio France Internationale (RFI) et France 24 font désormais l’objet d’une enveloppe globale, la répartition des dotations incombant à la holding.
Or, le nouveau Gouvernement a confié à M. Jean-Paul Cluzel le 5 juin dernier, une « mission d’évaluation sur l’Audiovisuel extérieur de la France » pour évaluer la pertinence des décisions prises par le précédent Gouvernement et proposer le cas échéant les différentes options alternatives au plan juridique, financier et technique. Les décisions visées par les ministres concernent essentiellement la fusion juridique, effective depuis le 13 février 2012, entre les sociétés France 24, RFI et Monte Carlo Doualiya2 (MCD) avec « Audiovisuel extérieur de la France » (AEF), et celle, non encore mise en place, des rédactions des trois anciennes entités.
Ces décisions ont suscité l’émotion d’une partie significative des personnels de RFI et de Monte Carlo Doualiya comme de France 24. Cette situation a rendu de facto impossible le déménagement des personnels de RFI et de MCD dans un nouvel immeuble conçu pour les accueillir avec leurs collègues des autres entités d’AEF à Issy-les-Moulineaux.
Le Gouvernement a donc demandé au président d’AEF un moratoire d’un mois sur la fusion des rédactions afin d’attendre les conclusions du rapport demandé. Celui-ci a été remis au Gouvernement le 6 juillet 2012 (13). Celui-ci préconise plutôt une « AEF réformée, fondée sur la séparation des relations de France 24 et de RFI, la reconstitution de deux directions d'antenne distinctes et la réaffirmation de l'identité et de la spécificité de France 24 et RFI ». En conséquence, le conseil d'administration de l'AEF a sollicité la remise d'un nouveau projet d'organisation, prévoyant des rédactions distinctes pour RFI et France 24. Le futur projet devra être préalablement soumis aux instances représentatives du personnel.
En ce qui concerne TV 5 Monde, le rapport estime que l'arrivée d'AEF à son capital s'est révélée négative à plusieurs égards. Le Gouvernement a donc exprimé le souhait que TV 5 Monde se rapproche à nouveau de France Télévisions, dans des conditions qui ne pourront être précisées qu'à l'issue d'une concertation entre les partenaires francophones de la chaîne.
Le présent projet de loi de finances rectificative en tire les conséquences en proposant une ouverture de crédits de 8,55 millions d’euros destinée à financer :
– le second plan de départs lié à la réorganisation du groupe consécutive à la fusion de RFI et France 24 au sein du groupe AEF qui ne peut être remis en question (6,3 millions d’euros) ;
– le déménagement de RFI et Monté Carlo Doualiya (MCD) à proximité de France 24 qui demeure utile (0,74 million d’euros) ;
– l’ajustement de la dotation à la société « Audiovisuel extérieur de la France » pour tenir compte du moratoire décidé par le Gouvernement et préparer le nouveau projet d’organisation de la société (0,15 million d’euros).
g) L’ouverture de 910,4 millions d’euros d’autorisations d’engagement pour financer deux opérations immobilières
Le présent projet de loi de finances rectificative envisage le financement de deux importantes opérations immobilières, donnant lieu à des ouvertures de crédits en autorisations d’engagement seulement, à savoir :
– 370 millions d’euros destinés à permettre la signature d’un protocole locatif avec la Société de valorisation foncière et immobilière (SOVAFIM) qui se chargera de la restructuration de l’ensemble immobilier « Ségur-Fontenoy », sis avenue de Ségur à Paris (75007). Ce site serait ainsi destiné à accueillir, à partir de 2016, la majeure partie des services du Premier Ministre (SPM) ainsi que plusieurs autorités administratives indépendantes œuvrant dans le secteur de la protection des droits et libertés.
Selon l’avis favorable du Conseil de l’immobilier de l’État du 28 février 2012, cette opération immobilière permettrait de regrouper 22 structures actuellement réparties sur 22 sites différents, dont les services administratifs des SPM, deux cabinets ministériels, le Contrôleur Budgétaire et Comptable Ministériel (CBCM) des SPM et plusieurs AAI actuellement hébergées dans le parc privé à des conditions d’occupation (en moyenne 17,2 m² SUN (14)/agent) et des coûts de location (jusqu’à 707 euros/m²) supérieurs aux normes de la politique immobilière de l’État (12 m² SUN/agent et 400 euros/m²/an) ;
– 542 millions d’euros destinés à permettre la prise à bail d’un nouvel immeuble sur le site de La Défense, sous forme de location avec option d’achat, dans le cadre de la mise en œuvre du projet immobilier de regroupement des services de l’administration centrale des ministères de l’égalité des territoires et du logement, du développement durable et de l’énergie. Conformément aux modalités de consommation des AE dans le cas d’un bail locatif de durée déterminée, il s’agit de la somme des loyers et des charges annexes au bail en euros courants sur la durée ferme du bail (soit treize ans et demi). Le flux de CP correspondant en euros courants sera étalé sur 13,5 ans.
Le coût de l’opération immobilière de regroupement des services centraux des ministères de l’égalité des territoires et de l’écologie est à mettre en regard du coût généré par le maintien des occupations actuelles. Cette comparaison fait apparaître que la réalisation de ce projet de regroupement permettrait de dégager des économies d’au moins 10 millions d’euros par an dès 2015 par rapport au coût locatif de l’année 2012 et d’environ 20 millions d’euros à horizon 2017 par rapport à l’évolution tendancielle des coûts en cas de poursuite dans les implantations actuelles.
Les annulations de crédits brutes et nettes sur le budget général proposées à l’article 5 et à l’état B du présent projet de loi atteignent 2,69 milliards d’euros en AE et 1,87 milliard d’euros en CP.
Les annulations d’autorisations d’engagement portent sur 19 des 32 missions et sur 29 des 126 programmes du budget général mais ne représentent que 0,7 % des crédits initiaux. À noter qu’aucune annulation n’est proposée au titre des remboursements et dégrèvements.
ANNULATIONS D’AE PAR MISSION DU BUDGET GÉNÉRAL
(en millions d’euros)
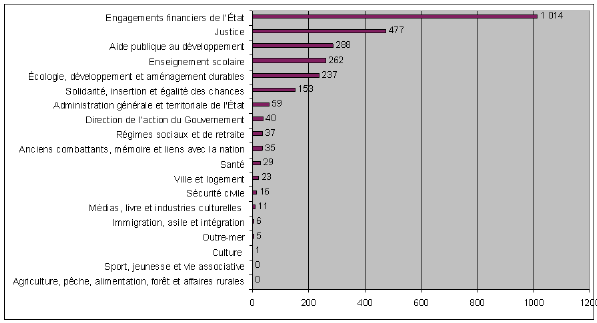
Les annulations de crédits de paiement portent sur 17 des 32 missions et sur 29 des 126 programmes du budget général mais ne représentent que 1,03 % des crédits initiaux. À noter qu’aucune annulation n’est proposée au titre des remboursements et dégrèvements.
ANNULATIONS DE CRÉDITS DE PAIEMENT PAR MISSION DU BUDGET GÉNÉRAL
(en millions d’euros)
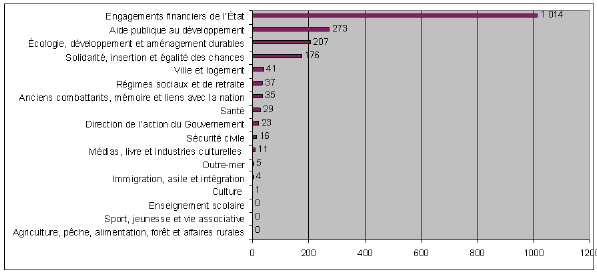
Outre l’annulation de 1,014 milliard d’euros en AE et CP sur le programme Charge de la dette et trésorerie de l’État commentée précédemment, le présent projet annule 1,67 milliard d’euros en AE et 860,2 millions d’euros en CP.
Conformément au principe d’auto-assurance, le Gouvernement s’est efforcé de compenser les ouvertures de crédits par des annulations de crédits au sein de la même mission, et de viser en priorité les crédits mis en réserve. Ainsi, le montant global des annulations de crédits au titre du projet de loi de finances rectificative sur la réserve de précaution est estimé à 583 millions d’euros en AE et à 605 millions d’euros en CP, soit 35 % des AE annulées et 75,5 % des CP annulés.
Le Rapporteur général relève notamment :
– une annulation de 237 millions d’euros en AE et 207 millions d’euros en CP sur la mission Écologie, développement et aménagement durables, qui permet de compenser partiellement l’ouverture de 542 millions d’euros en AE en faveur du regroupement immobilier des services du ministère. Les annulations de crédits de paiement portent sur des crédits non consommés ou sur des crédits devenus sans emploi (dont 60 millions d’euros sur la subvention à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France en raison de recettes d’amendes de radars automatiques supérieures à la prévision initiale) ;
– une annulation de 177 millions d’euros en CP sur le programme Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances pour financer l’ouverture de 314 millions d’euros en faveur de l’AAH sur le programme Handicap et dépendance. Cette annulation porte sur les crédits du Fonds national des solidarités actives, dont les besoins s’avèrent, comme les années précédentes, inférieurs à la prévision ;
– une annulation de 41 millions d’euros sur les réserves de précaution des programmes Développement et amélioration de l’offre de logement et Politique de la ville pour financer partiellement les ouvertures de crédits de 316 millions d’euros sur la mission Ville et logement ;
– une annulation de 39 millions d’euros d’AE et de 23 millions d’euros de CP devenus sans emploi sur les programmes de la mission Direction de l’action du Gouvernement, qui permet de compenser partiellement l’ouverture de 370 millions d’euros d’AE en vue du regroupement immobilier des services du Premier ministre, et de financer les ouvertures de crédits sur des programmes d’autres missions du budget général ;
– une annulation de 37 millions d’euros en AE et CP sur le programme Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres, qui permet non seulement de financer l’ouverture de 19 millions d’euros de crédits sur le titre 2 du programme Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers, et de contribuer au financement d’autres ouvertures de crédits sur d’autres missions ;
– une annulation de 11 millions d’euros en AE et CP sur le programme Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique de la mission Médias, livres et industries culturelles, qui permet de compenser totalement l’ouverture de 8,5 millions d’euros en AE et CP au titre de l’AEF et de contribuer partiellement au financement des ouvertures de crédits sur d’autres missions. Cette annulation repose sur des crédits devenus sans emploi (6 millions d’euros) et sur une sous-consommation des crédits du GIP France Télé numérique, d’environ 5 millions d’euros (moindre sollicitation du fonds d’aide, économies sur les dépenses de fonctionnement et moindre coût des campagnes de communication relatives à l’extinction du signal) ;
– une annulation de 5 millions d’euros sur les programmes de la mission Outre-mer sur la « ligne budgétaire unique » compte tenu de la prévision d’exécution et de l’état d’avancement des opérations financées qui permet de gager, à due concurrence, l’ouverture de crédits sur le programme Emploi outre-mer au titre du dérapage de la compensation des exonérations de charges sociales ;
– une annulation de 4 millions d’euros sur le programme Intégration et accès à la nationalité française pour compenser, pour une part limitée, l’ouverture de 83 millions d’euros sur la mission Immigration, asile et intégration.
Le solde des autres annulations de crédits – soit 355 millions d’euros en CP – est porté par des missions pour lesquelles aucune ouverture de crédits n’est proposée dans le présent collectif, dont les principales sont :
– la mission Aide publique au développement, qui subit une annulation de 287 millions d’euros en AE et 273 millions d’euros en CP en raison d’appels de fonds moins importants que prévus adressés au ministère des affaires étrangères par les principales organisations internationales (notamment l’Union européenne au titre du Fonds européen de développement) ;
– la mission Santé, et en particulier le programme Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins qui connaît une annulation de 29 millions d’euros en AE et CP devenus sans emplois (24 millions d’euros) et d’une révision à la baisse de la subvention pour charge de service public de certains opérateurs disposant d’un fonds de roulement significatif (4,5 millions d’euros) ;
– la mission Sécurité civile compte tenu d’une annulation de 16 millions d’euros en AE et CP de crédits mis en réserve du programme Coordination des moyens de secours ;
– enfin, la mission Justice contribue à gager les ouvertures d’AE pour le financement des projets immobiliers de l’État compte tenu d’une annulation de 476 millions d’euros d’AE du fait de l’abandon de contrats de partenariats public-privé pour la construction de nouvelles prisons.
La régulation budgétaire, fondée sur la mise en réserve de crédits en début de gestion, en application du 4° bis de l’article 51 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, a connu en 2012 une évolution particulière par rapport aux années précédentes.
Il faut rappeler que le précédent Gouvernement avait augmenté le taux de mise en réserve pour 2012 en procédant, en début d’année, à la mise en réserve, sur chaque programme, de 0,5 % des crédits de paiement et autorisations d’engagement ouverts sur le titre des dépenses de personnel et de 6 % sur les autres titres, au lieu de 5 % en 2011. Cette mesure avait eu pour effet de majorer la réserve de précaution de 1 milliard d’euros par rapport à 2011.
Néanmoins, cette marge de manœuvre, destinée à faire face à des aléas nouveaux en gestion, a été immédiatement consommée par le précédent Gouvernement à l’occasion de la loi de finances rectificative du 14 mars 2012, qui a procédé à une annulation « sèche » de 1,2 milliard d’euros sur la réserve ainsi qu’à un redéploiement de 0,4 milliard d’euros en faveur de la politique de l’emploi.
Compte tenu de l’audit réalisé par la Cour des comptes faisant état d’un risque en exécution sur la dépense de l’État hors charge de la dette et de pensions estimé entre 1,2 milliard d’euros et 2,0 milliards d’euros, dû en partie à des hypothèses optimistes de construction du budget initial, le Gouvernement a décidé, d’une part, de maintenir la réserve initiale jusqu’à la fin de gestion et, d’autre part, d’aller plus loin en l’augmentant de 1,5 milliard d’euros à l’occasion de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012. La répartition par mission et par programme du « surgel » de crédits réalisé par le Gouvernement a été modulée afin de tenir compte des capacités contributives de chacun des programmes. L’on peut rappeler à cet égard que certains programmes sont exonérés, en totalité ou partiellement, pour l’un des motifs suivants : levée de la mise en réserve pouvant être considérée comme inéluctable au sens de la définition de l’exposé général des motifs du projet de loi de finances pour 2012(15) ; risque en exécution 2012 déjà identifié ; programme faisant l’objet d’ouvertures nettes de crédits dans le présent projet de loi de finances rectificative.
En 2012, le montant des mises en réserve de crédits initiaux s’est donc élevé à 8,17 milliards d’euros en AE et à 7,91 milliards d’euros en CP.
En outre, dans le cadre de la reconduction du « Fonds État exemplaire » et du « Fond Handicap » en 2012, chaque ministère a alimenté le montant de la réserve initiale pour atteindre, au total, 125 millions d’euros (ces crédits devaient être dégelés en fonction des performances respectives des ministères en matière environnementale et du taux d’emploi des personnes handicapées).
Le montant des mises en réserve de crédits initiaux apparaît cependant théorique, dans la mesure où il a été diminué dès le début de l’exercice de 995 millions d’euros en AE et 1,2 milliard d’euros en CP pour tenir compte de deux décisions :
– le financement des différentes ouvertures de crédits par amendement au projet de loi de finances pour 2012 en seconde délibération (26 millions d’euros en AE et 253 millions d’euros en CP) ;
– le dégel de 969 millions d’euros de crédits au bénéfice de certaines subventions pour charges de service public qui, bien qu’imputées sur le titre 3, financent in fine des charges de personnels employés par des opérateurs de l’État (16).
Par conséquent, le montant réel de la mise en réserve initiale en 2012 s’élevait à 7,3 milliards d’euros en AE et 6,8 milliards d’euros en CP (contre 6,3 milliards d’euros en AE et 5,8 milliards d’euros en CP en 2011).
Depuis le 16 août 2012, le Gouvernement a limité les dégels aux seules dépenses inéluctables pour un montant de 161 millions d’euros en AE et 280 millions d’euros en CP. Il en résulte que, comme le montre le tableau récapitulatif ci-après, au 15 novembre 2012, la réserve de précaution s’élevait à 6,4 milliards d’euros en AE et à 6,04 milliards d’euros en CP.
Après les annulations prévues par le décret d’avance et le projet de loi de finances rectificative de fin d’année, la réserve disponible pour dégel et consommation des crédits s’élèverait donc à 4,86 milliards d’euros en AE et 4,3 milliards d’euros en CP.
ÉVOLUTION DE LA MISE EN RÉSERVE EN 2012 (AU 15 NOVEMBRE 2012)
(en millions d’euros) | |||||
Titre 2 |
Hors titre 2 |
T2+HT2 | |||
AE |
CP |
AE |
CP | ||
Mise en réserve théorique |
590 |
7 583 |
7 326 |
8 173 |
7 916 |
Surgel FEE (fonds d’État exemplaire) et handicap |
0 |
125 |
125 |
125 |
125 |
Autres ajustements |
0 |
– 26 |
– 253 |
– 26 |
– 253 |
Dégels au titre de la masse salariale opérateurs |
0 |
– 969 |
– 969 |
– 969 |
– 969 |
Mise en réserve initiale |
590 |
6 713 |
6 229 |
7 303 |
6 819 |
Mouvements intervenus sur la mise en réserve |
– 93 |
254 |
373 |
161 |
280 |
Annulations LFR I |
0 |
– 1 064 |
– 1 055 |
– 1 064 |
– 1 055 |
Annulations LFR II |
0 |
– 3 |
– 3 |
– 3 |
– 3 |
Mise en réserve au 15/11/2012 |
497 |
5 900 |
5 544 |
6 397 |
6 041 |
Annulations prévues en DA |
– 10 |
– 939 |
– 1 120 |
– 949 |
– 1 130 |
Mise en réserve prévue après DA |
487 |
4 961 |
4 424 |
5 448 |
4 911 |
Annulations prévues en LFR III |
0 |
– 583 |
– 605 |
– 583 |
– 605 |
Mise en réserve prévue après LFR III |
487 |
4 378 |
3 819 |
4 865 |
4 306 |
Source : Direction du budget.
L’article 6 et l’état C du présent projet de loi de finances rectificative tire les conséquences, sur le compte de concours financiers Participations financières de l’État, de l’ouverture de 2,58 milliards d’euros de crédits en AE et en CP sur le budget général, pour permettre à l’État d’opérer la recapitalisation de la banque Dexia.
En prenant en compte les ouvertures et annulations de crédits proposées dans le prochain décret d’avance, les deux lois de finances rectificatives ainsi que les modifications proposées par le présent projet de loi, il apparaît que, par rapport à la loi de finances initiale, les crédits nets du budget général seraient majorés de 15,4 milliards d’euros en autorisations d’engagement et de 5,6 milliards d’euros en crédits de paiement en 2012 contre moins d’un milliard d’euros en AE et CP en 2011.
Cela représente plus de quatre fois le montant des ouvertures nettes de crédits en cours de gestion 2011. Toutefois, l’essentiel de ces variations de crédits résulte du financement de dépenses exceptionnelles liées à la dotation de la France en faveur du mécanisme européen de stabilité, d’une part, et à la recapitalisation de Dexia, d’autre part : en dehors de ces dépenses exceptionnelles, les crédits de paiement nets du budget général ont été réduits de 3,5 milliards d’euros en AE et CP en 2012.
Les missions dont les crédits de paiement seraient les plus fortement majorés, en valeur absolue, par rapport à la loi de finances initiale, seraient les missions Économie (+ 16,78 %), Engagements financiers de l’État (+ 13,17 %), Immigration, asile et intégration (+ 12,4 %), et Ville et logement (+ 3,35 %).
À l’inverse, les plus fortes diminutions en valeur absolue concerneraient les missions Politiques des territoires (– 14,8 %), Aide publique au développement (– 8,9 %), Sport, jeunesse et vie associative (– 6,72 %), Écologie, développement et environnement durable (– 4,9 %), Direction de l’action du Gouvernement
(– 4,43 %), Santé (– 3,9 %), Sécurité civile (– 3,8 %).
On peut également relever que quelques – rares – programmes n’ont connu, à ce stade, aucune modification de leurs crédits en 2011. Il s’agit de programmes sur lesquels aucune marge de manœuvre n’a, semble-t-il, pu être dégagée (Presse, crédits de la mission Pouvoirs publics à l’exclusion de la dotation Présidence de la République, Régime de retraite et de sécurité sociale des marins, Formations supérieures et recherche universitaire, Majoration des rentes, Appel en garanties).
À titre de synthèse, les deux tableaux ci-après récapitulent l’ensemble des mouvements effectués en cours de gestion au titre des lois de finances rectificatives déjà intervenues en 2012, ainsi que les mouvements proposés dans le présent projet de loi et dans le projet de décret d’avance notifié à la commission des Finances le 20 novembre 2012.
OUVERTURES ET ANNULATIONS D’AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT EN 2012 |
(hors fonds de concours, en millions d’euros) Loi de finances initiale Mouvements en LFR I et II PLFR novembre Décret d'avance Montant final des crédits Ouvertures Annulations associées Variation nette des crédits Ouvertures Annulations associées Variation nette des crédits Ouvertures Annulations associées Variation nette des crédits Budget général AE brutes du budget général 380 746 17 220 3 219 +14 000 10 298 2 694 +7 604 +1 501 +1 501 +0 402 351 Remboursements et dégrèvements 85 438 483 342 +141 6 033 0 +6 033 +0 +0 +0 91 612 AE nettes du budget général 295 308 16 737 2 877 +13 860 4 265 2 694 +1 571 +1 501 +1 501 +0 310 739 Budgets annexes 2 234 4 4 +0
+0 +0 +0 +0 2 234 Comptes spéciaux 167 108 12 431 8 859 3 572 2 585 0 2 585 60 60 0 173 265 Crédits des CAS (1) 63 953 8 588 4 866 +3 722 0 0 +0 +60 +60 +0 67 675 Crédits des CCF (2) 103 155 3 843 3 993 -150 2 585 0 +2 585 +0 +0 +0 105 590 OUVERTURES ET ANNULATIONS DE CRÉDITS DE PAIEMENT EN 2012 (hors fonds de concours, en millions d’euros) Loi de finances initiale Mouvements en LFR I et II PLFR novembre Décret d'avance Montant final des crédits Ouvertures Annulations associées Variation nette des crédits Ouvertures Annulations associées Variation nette des crédits Ouvertures Annulations associées Variation nette des crédits Budget général CP bruts du budget général 376 152 7 433 3 219 +4 214 9 408 1 874 +7 534 +1 310 +1 310 +0 387 899 Remboursements et dégrèvements 85 438 483 342 +141 6 033 0 +6 033 +0 +0 +0 91 612 CP nets du budget général 290 714 6 951 2 877 +4 073 3 375 1 874 +1 501 +1 310 +1 310 +0 296 288 Budgets annexes 2 227 6 6 +0 0 0 +0 +0 +0 +0 2 227 Comptes spéciaux 170 998 12 432 12 737 -305 2 585 0 2 585 60 60 0 173 278 Crédits des CAS (1) 64 053 8 589 4 866 +3 722 2 585 0 +2 585 +60 +60 +0 70 360 Crédits des CCF (2) 106 945 3 843 7 870 -4 027 0 0 +0 +0 +0 +0 102 918 (a) Lois de finances rectificatives du 14 mars 2012 et du 16 août 2012 et décret d’avance notifié le 20 novembre 2012. (1) CAS : comptes d’affectation spéciale (2) CCF : comptes de concours financiers |
La loi de finances initiale pour 2012 anticipait un montant de recettes fiscales nettes de 274,9 milliards d’euros. Compte tenu des révisions successives à la baisse prévues par les deux premières lois de finances rectificative et par le présent projet de loi, ce montant prévisionnel est désormais fixé à 270,1 milliards d’euros, soit une moins-value de 4,8 milliards d’euros par rapport à la prévision initiale.
Le tableau suivant récapitule les réévaluations successives de la prévision de recettes fiscales nettes pour 2012.
LA PRÉVISION DE RECETTES FISCALES NETTES
(en milliards d‘euros)
LFI |
LFR |
LFR |
Révisé de septembre* |
PLFR novembre ** |
Montant PLFR novembre |
Écart PLFR novembre –LFI | |
Recettes fiscales nettes |
274,9 |
– 1,6 |
– 0,9 |
– 2,1 |
– 0,2 |
270,1 |
– 4,8 |
dont IS net |
44,9 |
– 1,8 |
– 2,4 |
– 0,4 *** |
0 |
40,3 |
– 4,6 |
dont TVA nette |
137,8 |
– 0,8 |
– 1,4 |
+ 1 *** |
0 |
136,7 |
– 1,1 |
Source : lois de finances initiale et rectificatives pour 2012 ; présent projet de loi.
* Prévision révisée pour 2012, présentée lors du dépôt du projet de loi de finances pour 2013.
** Variation par rapport à la prévision révisée associée au PLF pour 2013.
*** Réévaluations dues à des modifications de traitements comptables entraînés par le passage à Chorus.
Cette moins-value de 4,8 milliards d’euros est principalement due à une surestimation, en loi de finances initiale, des prévisions de produit d’impôt sur les sociétés (IS) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Prévu initialement à 44,9 milliards d’euros, le rendement de l’impôt sur les sociétés net atteindrait 40,3 milliards d’euros selon la prévision du présent projet de loi, soit une moins-value de 4,6 milliards d’euros.
Cette réévaluation s’est d’abord faite dans la première loi de finances rectificative, avec un réhaussement de 1,8 milliard d’euros tirant les conséquences d’un cinquième acompte d’IS, versé au mois de décembre 2011, moins important qu’escompté. La deuxième loi de finances rectificative s’est fondée sur le produit de la régularisation de l’impôt, en avril, pour revoir à la baisse sa prévision de produit, de 2,4 milliards d’euros.
Après prise en compte des modifications de traitements comptables entraînés par Chorus, la prévision d’impôt sur les sociétés net s’établit en fin d’année à 40,3 milliards d’euros.
Cette estimation repose sur un montant prévisionnel de cinquième acompte de 1,1 milliard d’euros. Ce montant est inférieur à celui de 1,4 milliard d’euros constaté fin 2011, alors que les établissements financiers alors avaient passé d’importantes provisions sur leurs titres d’État grec du fait du plan de restructuration décidé à l’automne 2011 et qu’ils avaient ainsi minoré leurs versements de plusieurs centaines de millions d’euros. Le Gouvernement prévoyant un cinquième acompte inférieur à celui de l’an dernier, son estimation paraît donc potentiellement prudente.
Il convient de remarquer que, si le produit de l’IS s’élevait effectivement à 40,3 milliards d’euros en 2012, il serait inférieur au montant de 40,7 milliards d’euros constaté en 2001 alors que, entre 2001 et 2012, la progression du PIB serait de l’ordre de 36 %. En conséquence, la part de l’IS dans le PIB serait de 2 % en 2012 quand elle atteignait 2,7 % en 2001.
Fixé initialement à 137,8 milliards d’euros, le produit prévisionnel de la taxe sur la valeur ajoutée nette s’établit désormais à 136,7 milliards d’euros - 135,7 milliards d’euros hors modifications comptables, soit une moins-value de 2,2 milliards d’euros.
Comme l’IS, la TVA a d’abord été revue à la baisse en LFR de mars, pour 0,8 milliard d’euros, pour tenir compte d’une exécution 2011 moins élevée que prévu. Les résultats des premiers mois d’exécution de l’année 2012 ont conduit à ce que son estimation soit revue à la baisse de 1,4 milliard d’euros en LFR de juillet.
Depuis la LFR de juillet, la prévision de TVA a été revue uniquement pour prendre en compte le manque à gagner lié à la baisse temporaire de la TICPE sur les carburants – soit 0,06 milliard d’euros – ainsi que l’impact de la modification des traitements comptables entraînée par le passage à Chorus – 1 milliard d’euros.
La prévision du présent projet de loi se fonde donc sur les mêmes hypothèses de croissance de l’assiette que celles déterminées en LFR de juillet. Pour mémoire, deux hypothèses sont indiquées par l’annexe relative à l’évaluation des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2013 :
– une hausse de l’assiette taxable de 2,2 %, inférieure à 2011, en raison notamment du fléchissement de l’investissement et d’une consommation des ménages plus dynamique que le PIB mais ralentie par la faible évolution des salaires réels en raison de la dégradation du marché du travail ;
– une élasticité de la TVA nette budgétaire aux emplois taxables de 0,7, donc inférieure à l’unité, qui serait en ligne avec les recouvrements observés.
Ces moins-values par rapport à la prévision initiale ont été en grande partie compensées par les mesures nouvelles prévues par la LFR de juillet dernier, dont le rendement serait proche de 5,5 milliards d’euros en 2012. Rappelons que ces mesures avaient non seulement pour objet d’entamer le rééquilibrage du système fiscal mais également de dégager les ressources requises pour assurer la compensation de ces moins-values en recettes et garantir le respect de l’objectif de déficit public pour 2012.
2.– Une quasi-stabilité des recettes du budget général par rapport à la prévision révisée de septembre dernier
● La prévision de recettes fiscales nettes est identique à la prévision révisée associée au projet de loi de finances pour 2013, à une différence près – une réévaluation à la baisse de 0,2 milliard d’euros du produit de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) en raison de l’anticipation d’une moindre consommation de carburants.
Par rapport à la prévision de la dernière loi de finances rectificative, l’estimation des recettes fiscales nettes ressort en repli de 2,4 milliards d’euros.
Le tableau suivant rappelle ces évaluations successives.
PRÉVISIONS DE RECETTES FISCALES NETTES POUR 2012
(en milliards d’euros)
LFR 2 |
Révisé |
PLFR 3 | |
Recettes fiscales nettes |
272,5 |
270,3 |
270,1 |
Impôt sur le revenu net |
60,0 |
59,0 |
59,0 |
Impôt sur les sociétés net |
40,7 |
40,7 |
40,7 |
TICPE |
14,1 |
13,6 |
13,4 |
Taxe sur la valeur ajoutée nette |
135,7 |
135,6 |
135,6 |
Autres recettes fiscales nettes |
22,0 |
21,4 |
21,4 |
Source : exposé des motifs du présent projet de loi.
La prévision révisée des principales recettes fiscales est analysée dans le tome II du rapport du Rapporteur général relatif au projet de loi de finances pour 2013.
Le Rapporteur général souhaite toutefois apporter un éclairage sur la modification de la prévision de rendement de l’impôt de solidarité sur la fortune et du coût du bouclier fiscal.
La révision à la baisse de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ne doit pas faire l’objet d’une erreur d’interprétation.
La prévision d’ISF est revue à la baisse de 462 millions d’euros par rapport à la dernière loi de finances rectificative. Selon les informations recueillies par le Rapporteur général, cette estimation est fondée sur l’extrapolation à l’ensemble des contribuables des recouvrements réalisés, au 15 juin, auprès des contribuables dont le patrimoine est inférieur à 3 millions d’euros.
Cette réévaluation à la baisse de l’ISF ne traduit donc pas un rendement moindre qu’escompté de la contribution exceptionnelle prévue par la dernière loi de finances rectificative. Le produit de cette contribution, versée au 15 novembre, serait encore inconnu.
Le Rapporteur général insiste sur le fait que les mesures adoptées depuis le début de la XIVe législature ont eu pour effet de renforcer le produit de l’ISF. La deuxième loi de finances rectificative pour 2012 a ainsi prévu la suppression du bouclier fiscal et l’instauration de la contribution exceptionnelle. Le projet de loi de finances pour 2013 réforme, pour sa part, son barème en accentuant sa progressivité.
L’analyse du rendement de l’ISF sous la XIIIe législature requiert la déduction du montant du bouclier fiscal, qui est un dispositif indissociable de cet impôt et destiné à en réduire le poids pour les plus fortunés. Le produit ainsi minoré de l’ISF ressort à un niveau nettement inférieur à celui anticipé sur les deux premières années de la XIVe législature. Les « pics » de produit d’ISF sous la XIIIème législature sont, en outre, à relativiser car ils ont été dus :
– en 2008, à la montée en charge encore incomplète du bouclier fiscal dont le coût était encore limité à 0,4 milliard d’euros ;
– en 2010 et 2011, aux recettes, en grande partie temporaires, tirées de la cellule de régularisation.
Le tableau suivant illustre ce constat.
PRODUIT DE L’IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE
(en milliards d’euros)
Rendement sous la XIII° législature * |
Rendement sous la XIV° législature | |||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 ** |
2012 |
2013 |
3,7 |
2,9 |
3,8 |
3,5 |
2,9 |
5,2 |
4,1 |
Source : pour les années 2008 à 2011 : situations mensuelles des dépenses et des recettes au 31 décembre de l’année concernée : pour les années 2012 et 2013 : loi de finances initiale pour 2012, présent projet de loi, projet de loi de finances pour 2013.
* Produit d’ISF déduction faite du bouclier fiscal.
** Prévision de la première loi de finances rectificative pour 2012.
Par ailleurs, la prévision de bouclier fiscal est revue à la hausse, de 162 millions d’euros à 450 millions d’euros. Cette réévaluation peut conduire à tirer deux conclusions.
D’une part, la prévision initiale de 162 millions d’euros conditionnait l’équilibre financier de la réforme de l’ISF du printemps 2011. Dès lors que cette estimation est revue à la hausse, on peut affirmer que, toutes choses égales par ailleurs, la réforme de l’imposition du patrimoine adoptée par la précédente majorité a été partiellement financée par l’endettement alors que le précédent Gouvernement affirmait qu’elle était entièrement gagée.
D’autre part, cette sous-estimation en prévision initiale paraît particulièrement surprenante pour une dépense dont la prévisibilité était notoire. Il ressort des éléments transmis au Rapporteur général que le niveau très bas de cette prévision initiale supposait :
– soit que la part du « millésime 2012 » (17) du bouclier fiscal, auto-imputée sur l’ISF versé en 2011, ait été sensiblement surévaluée (18). Une telle erreur de prévision aurait dû être constatée dès le début de l’année 2012 et corrigée par la loi de finances rectificative de mars 2012 ;
– soit que la prévision pour 2012 n’intégrait pas les montants versés au titre des millésimes antérieurs à 2012, dont le montant, sur les années précédentes, était généralement de l’ordre de 0,2 à 0,3 milliard d’euros. Dans une telle hypothèse, l’erreur de prévision serait grossière.
Au final, la révision du coût du bouclier fiscal prévue par le présent projet de loi semble prouver que le précédent Gouvernement a délibérément faussé la prévision initiale de cette dépense afin de ne pas faire apparaître le déséquilibre financier de la réforme de l’ISF du printemps 2011.
À noter enfin la prévision, dans le présent projet de loi, d’un produit de 250 millions d’euros de taxe sur les achats de viande, qui correspondrait à des restes à recouvrer.
● La prévision des recettes non fiscales n’est pas modifiée par rapport à la prévision révisée associée au projet de loi de finances pour 2013 et s’établit à 14,1 milliards d’euros.
Cette estimation ressort en baisse de 1,4 milliard d’euros par rapport à la prévision de la dernière loi de finances rectificative. Cette moins-value s’explique par le versement en titres, et non en numéraire comme prévu initialement, des dividendes de GDF-Suez et du Fonds stratégique d’investissement. Si un tel mode de versement vient minorer les recettes en comptabilité budgétaire, il est, en revanche, sans impact sur le déficit public. L’opération est assimilée à une opération patrimoniale, qui enrichit l’actif de l’État et doit être comptabilisée en recettes selon les conventions de la comptabilité nationale.
Trois lignes de recettes non fiscales appellent une attention particulière dans le présent projet de loi.
En premier lieu, les intérêts des prêts à des banques et des États étrangers (ligne 2401) sont revus en baisse de 331 millions d’euros par rapport à la prévision de la dernière loi de finances rectificative. Cette moins-value serait due à des opérations de refinancement de la dette de la Côte d’Ivoire et du Soudan, dont le contenu ou la date de réalisation ont été modifiés par rapport à ce qui était prévu initialement.
En deuxième lieu, le solde de trésorerie du compte de l’État auprès de Natixis est mobilisé à hauteur de 100 millions d’euros, soit un niveau inférieur de 220 millions d’euros mobilisés par la loi de finances rectificative de fin d’année 2011. Ce prélèvement serait calculé sur l’année en cours, ce qui expliquerait le fait qu’il ne soit anticipé qu’en fin d’année, au moment où il est plus aisé d’anticiper le bénéfice de l’année.
Enfin, reprenant la prévision révisée de septembre dernier, les produits tirés de la garantie de l’État sont revus à la hausse, à 322 millions d’euros, pour prendre en compte les revenus tirés de la garantie accordée à Dexia. Cette prévision n’intègre pas la diminution de 90 points de base à 5 points de base de la rémunération de la garantie, annoncée le 8 novembre dernier. Cette baisse de la rémunération n’entrerait en vigueur qu’en fin d’année et n’aurait qu’un impact marginal sur les recettes perçues par l’État en 2012.
Par rapport à la prévision révisée de septembre dernier, la prévision de solde de l’État du présent projet de loi ressort en dégradation de 2,6 milliards d’euros en raison de la recapitalisation de Dexia et s’établit à 86,1 milliards d’euros.
Déduction faite de cet élément exceptionnel, la prévision est stable en raison d’une économie prévisionnelle supplémentaire de 0,4 milliard d’euros sur la charge de la dette, qui compenserait une moins-value de 0,2 milliard d’euros sur la TICPE et un surcoût de même ordre sur le prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales.
Le tome II du rapport du Rapporteur général sur le projet de loi de finances pour 2013 présente les différents facteurs expliquant la variation de la prévision de solde.
● Le Rapporteur général observe que la prévision de 86,1 milliards d’euros intègre des éléments exceptionnels d’un montant substantiel et que ces éléments doivent en être déduits pour apprécier le niveau du déficit de l’État.
Comme l’illustre le tableau suivant, la prévision de solde pour 2012 a varié sensiblement en cours d’année en raison de ces opérations exceptionnelles.
LA PRÉVISION DE SOLDE DE L’ÉTAT
(en milliards d’euros)
LFI |
LFR 1 |
LFR 2 |
Révisé |
PLFR 3 * | |
Solde de l’État |
– 78,7 |
– 84,8 |
– 81,1 |
– 83,4 |
– 86,1 |
dont prêts à la Grèce |
3,9 |
4,4 |
0 |
0 |
0 |
dont dotation au MES |
0 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
dont recapitalisation de Dexia |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,6 |
Solde de l’État hors éléments exceptionnels |
– 74,8 |
– 73,9 |
– 74,6 |
– 76,9 |
– 77 |
Source : lois de finances pour 2013 et présent projet de loi.
* Variation par rapport au révisé.
Déduction faite de ces éléments exceptionnels, la prévision de solde de l’État en comptabilité budgétaire a été progressivement revue en baisse au cours de l’année pour atteindre un écart de 2,2 milliards d’euros avec la prévision initiale.
La surestimation des recettes fiscales nettes et, plus particulièrement, de l’IS et de la TVA, qui a été présentée plus haut, constitue le principal facteur expliquant cette dégradation du solde en exécution. Elle a été compensée par deux éléments principaux, d’une part, l’anticipation d’une économie de 2,5 milliards d’euros sur la charge de la dette, d’autre part, les mesures nouvelles prévues par la LFR de juillet, dont le rendement dépasserait 5 milliards d’euros.
● Prévu à 86,1 milliards d’euros en comptabilité budgétaire, la prévision de solde de l’État en comptabilité nationale est incertaine du fait d’une interrogation sur le traitement de la recapitalisation de Dexia par Eurostat – cette dépense devant être réalisée avant le 31 décembre de 2012 et devant donc être rattachée à l’année 2012.
Si Dexia devait être considérée comme une structure de défaisance, le versement que l’État réalise à son profit ne serait pas considéré comme relevant d’une opération patrimoniale et d’une logique d’investissement avisé. Le Gouvernement fait valoir que Dexia demeure soumise aux règles prudentielles, qui garantissent sa bonne gestion, et ne peut donc pas être assimilée à une telle structure.
Dans l’hypothèse où Eurostat suivrait le Gouvernement, le solde de l’État en comptabilité nationale s’établirait à 75 milliards d’euros. Le tableau suivant précise les modalités de calcul du solde de l’État en comptabilité nationale.
LE SOLDE DE L’ÉTAT EN COMPTABILITÉ NATIONALE *
(en milliards d’euros)
Solde en comptabilité budgétaire |
– 86,1 |
Dotation au MES |
6,5 |
Recapitalisation de Dexia * |
2,6 |
Primes et décotes à l'émission |
2,2 |
Dividendes en titres |
1,4 |
Dépenses matériels militaires |
1 |
Culot d'émission |
– 0,5 |
Intérêts courus non échus |
– 0,5 |
Prêts et remises de dettes aux États étrangers |
– 0,6 |
Intérêts reversés par la Banque de France à la Grèce |
– 0,6 |
Autres |
– 0,4 |
Solde de l’État en comptabilité nationale |
– 75 |
Source : d’après ministère de l’Économie et des finances.
* Hypothèse d’un traitement de la recapitalisation de Dexia en opération patrimoniale.
La prévision de solde des autres sous-secteurs d’administration publique n’est pas modifiée par rapport à la prévision révisée de septembre dernier. Le tableau suivant rappelle la prévision initiale et la prévision associée au présent projet de loi.
LA PRÉVISION DE SOLDE PUBLIC
(en milliards d’euros)
PLF 2012 |
PLFR 3 | |
État |
– 74,4 |
– 75 |
ODAC |
– 3,7 |
– 4,8 |
APUL |
– 3,9 |
– 2,1 |
ASSO |
– 8,7 |
– 10,4 |
TOUTES APU |
– 90,7 |
– 92,3 |
Source : d’après ministère de l’Économie et des finances.
Le déficit prévisionnel des organismes divers d’administration centrale (ODAC), à 4,8 milliards d’euros, est plus important que l’estimation initiale de 3,7 milliards d’euros. Cette révision à la hausse serait la conséquence de l’exécution 2011. Le rebasage concernerait le solde des Universités, dont le déficit en 2011 se serait avéré plus important que prévu, à hauteur de 0,8 milliard d’euros. La révision du solde pour 2012 s’expliquerait également par le fait que l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) aurait dégagé un excédent non anticipé en 2011 et consommé en 2012, ce qui viendrait dégrader le solde de 0,3 milliard d’euros.
La prévision de solde des administrations publiques locales (APUL) a été revue, en début d’année, en baisse de près de 2 milliards d’euros en raison d’une exécution 2011 meilleure que prévu. Il importe de rappeler la difficulté à réaliser une prévision fiable du solde des APUL, y compris en fin d’année, du fait du manque d’informations fiables. La Cour des comptes (19) a ainsi estimé que, s’agissant des collectivités territoriales, « les restitutions infra-annuelles qui pourraient être effectuées présenteraient un degré de fiabilité très relatif ».
Pour mémoire, le programme de stabilité présenté an avril dernier par le précédent Gouvernement prévoyait l’équilibre des APUL en 2012. Une telle prévision était probablement trop optimiste comme le prouve la révision à la hausse, de + 1,5 % à 5,3 %, de la croissance prévisionnelle des dépenses d’investissement local.
Enfin, la prévision de déficit des administrations de sécurité sociale (ASSO) est supérieure à celle faite en PLF pour 2012 en raison de la dégradation de la conjoncture qui limite la croissance de la masse salariale – croissance de 2,5 % contre 3,7 % initialement prévue – et se traduit en sens contraire par des dépenses d’indemnisation chômage plus importantes que prévu. Cet effet a été pris en compte dès la LFR de mars.
Ces évolutions seraient en partie compensées par deux éléments pris en compte dans la prévision révisée de septembre dernier, à savoir un ONDAM inférieur de 0,9 milliard d’euros à la prévision initiale et une charge de la dette qui bénéficierait de taux d’intérêt plus faibles qu’anticipé.
*
* *
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Compensation des transferts de compétences aux départements et aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure
de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)
Texte du projet de loi :
I.– 1° Il est prélevé en 2012 au département du Bas-Rhin, en application des articles L. 3113-1 à L. 3113-4 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 22 978 euros correspondant à l’ajustement, au titre des années 2008 à 2012, de la compensation au titre de la prise en charge des dépenses d’investissement et des frais de fonctionnement liées au transfert du Canal de la Bruche ainsi que des dépenses de fonctionnement des services en charge du domaine hydraulique transférés en 2011 ;
2° Il est prélevé en 2012 aux départements de la Savoie, de la Guadeloupe et de La Réunion, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 21 369 euros correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier 2011 ;
3° Il est versé en 2012 au département de la Haute-Savoie, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 8 191 euros correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier 2011 ;
4° Il est prélevé en 2012 aux départements de la Côte-d’Or, des Côtes-d’Armor, de la Creuse, de la Dordogne et de l’Eure, en application des articles 18 et 65 de la loi du 13 août 2004 précitée, un montant de 6 831 euros au titre de l’ajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses d’action sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à l’exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d’intérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement ;
5° Il est versé en 2012 aux départements des Hautes-Alpes, de l’Aveyron, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, du Doubs, de la Drôme, du Finistère, de la Gironde et de Loir-et-Cher, en application des articles 18 et 65 de la loi du 13 août 2004 précitée, un montant de 8 708 euros au titre de l’ajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses d’action sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à l’exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d’intérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement.
II.– Les diminutions opérées en application des 1°, 2° et 4° du I sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau figurant au III.
Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 3° et 5° du I sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils sont répartis conformément à la colonne B du tableau figurant au III.
III.– Les ajustements mentionnés au I sont répartis conformément au tableau suivant :
DIMINUTION |
MONTANT |
TOTAL | |
Ain |
|
|
0 |
Aisne |
|
|
0 |
Allier |
|
|
0 |
Alpes-de-Haute-Provence |
|
|
0 |
Hautes-Alpes |
|
270 |
270 |
Alpes-Maritimes |
|
|
0 |
Ardèche |
|
|
0 |
Ardennes |
|
|
0 |
Ariège |
|
|
0 |
Aube |
|
|
0 |
Aude |
|
|
0 |
Aveyron |
|
680 |
680 |
Bouches-du-Rhône |
|
|
0 |
Calvados |
|
|
0 |
Cantal |
|
|
0 |
Charente |
|
|
0 |
Charente-Maritime |
|
|
0 |
Cher |
|
|
0 |
Corrèze |
|
|
0 |
Corse-du-Sud |
|
2 618 |
2 618 |
Haute-Corse |
|
1 712 |
1 712 |
Côte-d’Or |
– 1 894 |
|
– 1 894 |
Côtes-d’Armor |
– 2 524 |
|
– 2 524 |
Creuse |
– 724 |
|
– 724 |
Dordogne |
– 1 096 |
|
– 1 096 |
Doubs |
|
1 216 |
1 216 |
Drôme |
|
1 096 |
1 096 |
Eure |
– 593 |
|
– 593 |
Eure-et-Loir |
|
|
0 |
Finistère |
|
404 |
404 |
Gard |
|
|
0 |
Haute-Garonne |
|
|
0 |
Gers |
|
|
0 |
Gironde |
|
580 |
580 |
Hérault |
|
|
0 |
Ille-et-Vilaine |
|
|
0 |
Indre |
|
|
0 |
Indre-et-Loire |
|
|
0 |
Isère |
|
|
0 |
Jura |
|
|
0 |
Landes |
|
|
0 |
Loir-et-Cher |
|
132 |
132 |
Loire |
|
|
0 |
Haute-Loire |
|
|
0 |
Loire-Atlantique |
|
|
0 |
Loiret |
|
|
0 |
Lot |
|
|
0 |
Lot-et-Garonne |
|
|
0 |
Lozère |
|
|
0 |
Maine-et-Loire |
|
|
0 |
Manche |
|
|
0 |
Marne |
|
|
0 |
Haute-Marne |
|
|
0 |
Mayenne |
|
|
0 |
Meurthe-et-Moselle |
|
|
0 |
Meuse |
|
|
0 |
Morbihan |
|
|
0 |
Moselle |
|
|
0 |
Nièvre |
|
|
0 |
Nord |
|
|
0 |
Oise |
|
|
0 |
Orne |
|
|
0 |
Pas-de-Calais |
|
|
0 |
Puy-de-Dôme |
|
|
0 |
Pyrénées-Atlantiques |
|
|
0 |
Hautes-Pyrénées |
|
|
0 |
Pyrénées-Orientales |
|
|
0 |
Bas-Rhin |
–22 978 |
|
– 22 978 |
Haut-Rhin |
|
|
0 |
Rhône |
|
|
0 |
Haute-Saône |
|
|
0 |
Saône-et-Loire |
|
|
0 |
Sarthe |
|
|
0 |
Savoie |
– 8 191 |
|
– 8 191 |
Haute-Savoie |
|
8 191 |
8 191 |
Paris |
|
|
0 |
Seine-Maritime |
|
|
0 |
Seine-et-Marne |
|
|
0 |
Yvelines |
|
|
0 |
Deux-Sèvres |
|
|
0 |
Somme |
|
|
0 |
Tarn |
|
|
0 |
Tarn-et-Garonne |
|
|
0 |
Var |
|
|
0 |
Vaucluse |
|
|
0 |
Vendée |
|
|
0 |
Vienne |
|
|
0 |
Haute-Vienne |
|
|
0 |
Vosges |
|
|
0 |
Yonne |
|
|
0 |
Territoire-de-Belfort |
|
|
0 |
Essonne |
|
|
0 |
Hauts-de-Seine |
|
|
0 |
Seine-Saint-Denis |
|
|
0 |
Val-de-Marne |
|
|
0 |
Val-d’Oise |
|
|
0 |
Guadeloupe |
– 4 408 |
|
– 4 408 |
Martinique |
|
|
0 |
Guyane |
|
|
0 |
La Réunion |
– 8 770 |
|
– 8 770 |
Total |
– 51 178 |
16 899 |
– 34 279 |
IV.– Il est versé en 2012 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Picardie, Provence-Alpes Côte-d’Azur et Rhône-Alpes, en application de l’article 95 de la loi du 13 août 2004 précitée, un montant de 1 220 000 euros au titre de la compensation, au titre des années 2007 à 2012, des charges afférentes aux agents associatifs participant à l’exercice de la compétence transférée relative à l’inventaire général du patrimoine culturel.
V.– Le montant correspondant au versement prévu au IV est prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Il est réparti conformément au tableau suivant :
RÉGION |
MONTANT TOTAL |
Alsace. |
261 429 |
Aquitaine. |
43 571 |
Auvergne. |
87 143 |
Bourgogne |
0 |
Bretagne |
217 857 |
Centre |
0 |
Champagne-Ardenne |
0 |
Corse |
0 |
Franche-Comté |
0 |
Île-de-France |
130 714 |
Languedoc-Roussillon |
0 |
Limousin |
0 |
Lorraine |
0 |
Midi-Pyrénées |
0 |
Nord-Pas-de-Calais |
174 286 |
Basse-Normandie |
0 |
Haute-Normandie |
43 571 |
Pays-de-Loire |
0 |
Picardie |
174 286 |
Poitou-Charentes |
0 |
Provence-Alpes-Côte-d’Azur |
43 571 |
Rhône-Alpes |
43 571 |
TOTAL |
1 220 000 |
Observations et décision de la Commission :
Comme l’article 22 du projet de loi de finances pour 2013, le présent article procède à plusieurs ajustements liés à la compensation de transferts de charges aux départements et aux régions opérée par l’attribution d’une partie du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TICPE).
La compensation financière des transferts de compétences est calculée sur la base des dépenses consacrées par l’État à ces compétences au cours de la période précédant le transfert.
L’application du principe de concomitance nécessite que chaque compensation soit fixée en deux temps par les lois de finances, afin de protéger au mieux les collectivités territoriales.
Ainsi, l’année précédant le transfert, la loi de finances initiale doit provisionner une somme correspondant à l’évaluation des charges transférées, sur la base du dernier état connu des dépenses que consacrait l’État aux compétences transférées.
L’année du transfert, voire, le cas échéant, l’année suivant celle du transfert, une loi de finances rectificative doit corriger la compensation allouée aux collectivités locales afin de tenir compte de leur droit à compensation arrêté sur la base des montants définitifs des dépenses consacrées par l’État aux compétences transférées. Cet ajustement doit également être répercuté sur le droit à compensation par la loi de finances initiale de l’année suivante, afin d’éviter la répétition annuelle de l’écart et de sa correction.
Les parts de TICPE (exprimées en valeur absolue) attribuées aux départements sont modifiées, par les alinéas 1 à 9 (I à III) de cet article, afin de tenir compte :
– d’une diminution des dépenses du conseil général du Bas-Rhin liées au transfert du canal de la Bruche, soit un gain pour l’État de 22 978 euros ; (1)
– d’une diminution des dépenses assumées par trois départements et des coûts assumés par un département au titre du transfert des services des parcs, représentant un gain global en recettes pour l’État de 13 178 euros mais in fine un coût pour le budget général du fait de la majoration consécutive de la dotation globale de décentralisation financée par crédits budgétaires ; (2)
– d’une diminution des dépenses assumées par cinq départements et des coûts assumés par neuf autres au titre du transfert des routes départementales, des routes nationales d’intérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement, représentant un coût global pour l’État de 1 877 euros. (3)
La cession du canal de la Bruche s’inscrit dans le cadre du transfert des voies d’eau réalisé au profit de plusieurs collectivités d’Alsace à compter du 1er janvier 2008. Les ajustements opérés dans le présent projet de loi de finances rectificative visent à reprendre le trop perçu par le département du Bas-Rhin qui a reçu depuis 2008 une compensation supérieure aux charges transférées.
Il apparaît en effet que la compensation des dépenses d’investissement et de fonctionnement versée par l’État de 2010 à 2012 intégrait, au-delà des dépenses relatives aux ouvrages hydrauliques, dues dès le transfert de la compétence, les dépenses de fonctionnement des services.
Sur cette période, le conseil général du Bas-Rhin a perçu 219 000 euros (73 000 euros depuis 2010) de subvention du ministère de l’environnement plus 190 078 euros (95 039 euros de TICPE depuis la LFI 2011), soit 409 078 euros, alors qu’il aurait dû se voir verser 386 100 euros (droit à compensation de 77 220 euros dû depuis 2008), d’où un ajustement non pérenne de + 22 978 euros.
2.– Des ajustements relatifs aux transferts de personnels de l’État relevant des services des parcs de l’équipement
L’article 13 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers a prévu que les agents non titulaires de l’État qui exercent leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré deviennent agents non titulaires de la fonction publique territoriale à la date de transfert du parc. La prise en charge de ces agents par les collectivités bénéficiaires du transfert fait l’objet, depuis le 1er janvier 2011, d’une compensation financière par l’État.
Il s’agit de corriger des inversions de bénéficiaires :
– le département de la Savoie se voit retirer 8 191 euros, dont il a bénéficié à tort au détriment de la Haute-Savoie ;
– des sommes de 4 408 euros et 8 770 euros sont reprises respectivement aux départements de Guadeloupe et de la Réunion, avant d’être allouées aux régions de Guadeloupe et de la Réunion sous forme de dotation globale de décentralisation (DGD) puisque les régions d’outre-mer ne perçoivent pas de TICPE.
3.– Des ajustements sont également prévus s’agissant du transfert des routes départementales, des routes nationales d’intérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dite Acte II de la décentralisation a opéré des transferts de compétences dans des domaines aussi variés que l’entretien des routes départementales et des routes nationales d’intérêt local (article 18) ou la gestion des fonds de solidarité pour le logement (article 65). Outre ces transferts de compétences, elle a organisé des garanties pour les agents concernés (maintien des avantages statutaires, délai d’option de deux ans) comme pour les collectivités bénéficiaires (clause de sauvegarde garantissant la compensation des emplois dits « disparus »).
Dans le silence de la loi de 2004, c’est la Commission consultative d’évaluation des charges (CCEC) qui a déterminé les modalités de compensation des dépenses liées à ces transferts de compétences. Le principe de la compensation des dépenses d’action sociale (20) en complément des dépenses de rémunération pour chaque agent ayant opté a ainsi été affirmé.
Les corrections opérées sont de faible montant :
– un montant global de 6 831 euros est repris aux départements de la Côte-d’Or (1 894 euros), des Côtes-d’Armor (2 524 euros), de la Creuse (724 euros), de la Dordogne (1 096 euros) et de l’Eure (593 euros) ;
– en sens inverse, une somme de 8 708 euros est versée aux départements des Hautes-Alpes (270 euros), de l’Aveyron (680 euros), de la Corse-du-Sud (2 618 euros), de la Haute-Corse (1 712 euros), du Doubs (1 216 euros), de la Drôme (1 096 euros), du Finistère (404 euros), de la Gironde (580 euros) et du Loir-et-Cher (132 euros).
Les alinéas 7 à 12 (IV et V) du présent article modifient les fractions de TICPE affectées aux régions, afin de tenir compte de la nouvelle mesure de compensation au titre de la prise en charge des agents d’associations qui participaient à l’inventaire général du patrimoine culturel préalablement au transfert de cette compétence aux régions (+ 1 220 000 euros).
Dans le cadre du transfert des services de l’inventaire général du patrimoine culturel, les représentants des régions au sein de la Commission consultative d'évaluation des charges (CCEC) ont sollicité la compensation de la prise en charge des agents d’associations qui participaient, préalablement au transfert de 2005, à cet inventaire. Selon les informations recueillies par le Rapporteur général, leur contrat serait susceptible d’être requalifié par le juge en contrat de droit public ; ces emplois n’avaient pas été intégrés dans le périmètre des services ayant fait l’objet du transfert et de la compensation.
Lors de la séance de la CCEC du 6 décembre 2011, le ministère de la Culture et de la communication s’est engagé à compenser le coût de ces agents avant de conduire au premier semestre 2012 une concertation avec l’Association des régions de France sur les modalités de leur « valorisation ».
Lors de la séance de la CCEC du 27 juin 2012, la section des régions a accepté la proposition présentée par le ministère, consistant à compenser les vingt-huit postes d’agents associatifs recensés dans dix régions à compter de 2013, à hauteur de 35 000 euros par agent (soit au total 980 000 euros) et à hauteur de 30 000 euros par agent pour le rattrapage correspondant à la période 2007-2012 (soit 5 040 000 euros, échelonnés sur 5 ans).
La première tranche de ce rattrapage est inscrite pour 2012 au présent article, en première partie du présent projet de loi de finances rectificative, tandis que l'article 22 du projet de loi de finances pour 2013 a prévu une compensation de 980 000 euros pour l’année 2013.
*
* *
La Commission adopte l’article premier sans modification.
*
* *
Compensation à la collectivité de Mayotte des charges résultant
de la mise en place du revenu de solidarité active (RSA)
Texte du projet de loi :
Pour 2012, les valeurs de fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévues au II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont fixées comme suit :
1° Pour les valeurs inférieures mentionnées au troisième alinéa : 0,003 euro par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et 0,002 euro par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120°C ;
2° Pour les valeurs supérieures mentionnées au quatrième alinéa : 0,008 euro par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et 0,006 euro par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120°C.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article revient sur les modalités de compensation à la collectivité de Mayotte des charges liées à la mise en œuvre du revenu de solidarité active (RSA) depuis le 1er janvier 2012.
Cette compensation prend la forme de l’affectation d’une part du produit de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques).
I.– LA MISE EN œUVRE DU RSA À MAYOTTE
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2012
Depuis le 31 mars 2011, Mayotte est devenu le 101ème département français et le 5ème département d’outre-mer. Les modalités du processus de départementalisation de Mayotte ont été précisées par la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010.
● Conformément à cette loi, complétée par l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 et le décret n° 2011-2097 du 30 décembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active (RSA) au département de Mayotte, le RSA a été mis en place à Mayotte depuis le 1er janvier 2012.
Le barème retenu pour le « RSA socle » et le « RSA chapeau » (21) correspond à peu près au quart des montants en vigueur en métropole et dans les autres départements d’outre-mer. Ce barème sera ensuite régulièrement revalorisé, sur une période de 20 à 25 ans, en vue d’une convergence vers le montant de droit commun.
À l'instar des autres départements, seule la partie RSA « socle » fait l’objet d'une compensation par l'État et ce, uniquement pour son montant forfaitaire puisque le montant forfaitaire majoré (soit le RSA socle majoré) correspondant à l'ancienne API, ainsi que le RSA « jeunes » ne sont pas applicables en 2012.
LA MÉTHODE D’ÉVALUATION DU NOMBRE DE FOYERS BÉNÉFICIAIRES En 2012, le montant de la compensation provisionnelle a été fondé sur la base d’une fourchette d’estimation du nombre de bénéficiaires du RSA socle à Mayotte. Deux hypothèses de calcul ont été retenues : – une hypothèse haute fondée sur les données de l’INSEE pour 2007 ; – une hypothèse basse prenant en compte le nombre de bénéficiaires des prestations familiales à Mayotte, c'est-à-dire les foyers avec au moins un enfant. Dans le cadre de l’hypothèse haute, un effet volume a été appliqué afin de prendre en compte la croissance démographique intervenue entre 2007 et 2012, tout en excluant la population étrangère en situation irrégulière et en appliquant un critère de ressources donnant droit au dispositif. Selon cette première méthode, 18 400 foyers auraient pu bénéficier du RSA à Mayotte à compter de 2012. L’hypothèse basse reposait quant à elle sur les données de la CNAF selon laquelle 17 273 foyers mahorais percevaient une prestation familiale en décembre 2010. L’application d’un critère de ressources et, en sens contraire, l’ajout d’un certain nombre de contribuables sans enfants potentiellement éligibles ont conduit à considérer que 13 600 foyers pouvaient bénéficier du RSA en 2012. En appliquant le barème du RSA et en prenant en compte le forfait logement et la déduction des allocations familiales pour un certain nombre de foyers, le coût net en année pleine se situait, compte tenu des hypothèses formulées, entre 21 millions d’euros et 27 millions d’euros. Toutefois, en raison de la montée en charge du dispositif dont on pouvait estimer qu’elle serait progressive – avec une prévision de versement du RSA à un tiers des bénéficiaires en début d’année, relevée à 100 % en fin d’année –, le montant de compensation en 2012 avait été finalement fixé entre 11,6 millions d’euros pour l’hypothèse basse et 15,7 millions d’euros pour l’hypothèse haute. |
● L’ordonnance du 24 novembre 2011 avait prévu que la compensation à Mayotte des dépenses du RSA soit calculée pour l'année 2012 sur la base d’un montant provisionnel, lui-même fondé sur une estimation du nombre de foyers susceptibles de bénéficier du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 2626-2 du code de l’action sociale et des familles (le RSA « socle »). Le montant de cette compensation est majoré de 6,34 % pour le financement des actions destinées à permettre l’insertion des bénéficiaires du RSA ainsi que des dépenses de structure correspondantes.
Sur la base d'une évaluation du nombre de ménages bénéficiaires, la dépense de RSA à Mayotte avait été évaluée pour 2012 entre 11,6 millions d’euros et 15,7 millions d’euros (cf. encadré supra).
II.– LES MODALITÉS DE COMPENSATION DU RSA À MAYOTTE EN 2012
Afin de compenser les charges résultant de cette création de compétences pour Mayotte, la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a prévu un dispositif de transfert d’une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) – devenue taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) – comparable au dispositif de compensation des charges liées au RMI et au RSA mis en place pour les autres départements et placé, comme lui, sous le contrôle de la commission consultative d'évaluation des charges (CCEC) mentionné à l'article L. 1711-3 du code général des collectivités territoriales.
● L’article 39 de la loi de finances initiale pour 2012 a défini une « fourchette » de fractions de tarif de la TICPE et confié aux ministres de l’Intérieur et du Budget le soin de fixer par arrêté interministériel la fraction effectivement transférée, évaluée au plus juste par rapport aux charges supportées par le Département de Mayotte.
La fraction de tarif plancher a été fixée à 0,030 euro par hectolitre de super carburants sans plomb et 0,021 euro par hectolitre de gazole présentant un point éclair inférieur à 120°C. La fraction de tarif plafond a été arrêtée à 0,041 euro par hectolitre pour les super carburants sans plomb et à 0,029 euro pour le gazole présentant un point éclair inférieur à 120°C.
Par un arrêté du 26 janvier 2012, cette fraction a été limitée pour 2012 aux valeurs plancher de la fourchette (soit 0,030 euro par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0,021 euro par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120°), correspondant à une compensation provisionnelle de 11,6 millions d'euros.
● Toutefois, l'évolution des dépenses constatées sur les dix premiers mois de l'année a démontré que la montée en charge du RSA à Mayotte est beaucoup plus lente que cela avait été envisagé : les dépenses cumulées atteignaient à peine 1,82 million d'euros au début du mois de novembre 2012. Selon les informations recueillies par le Rapporteur général, beaucoup de foyers qui pourraient bénéficier du RSA ignorent, voire renoncent à engager les démarches nécessaires à son versement.
Sur le plan financier, les dépenses totales pour 2012 s'établiront à un niveau très inférieur à celui de la compensation qu'autorise la fourchette basse de fractions de TICPE fixées en loi de finances initiale. Cette surestimation des dépenses à compenser emporte deux mesures correctrices :
– afin d'éviter que cette situation se répète en 2013, l'article 24 du projet de loi de finances pour 2013 a élargi la fourchette de compensation, pour l’année 2013 ;
– pour l'année 2012, le présent article, placé en première partie du projet de loi de finances rectificative, abaisse à 0,003/0,002 euro et 0,008/0,006 euro par hectolitre les deux fourchettes des fractions de TICPE, afin de permettre au pouvoir réglementaire de déterminer par voie d'arrêté modificatif le montant exact de la compensation qui sera due au département de Mayotte.
*
* *
La Commission adopte l’article 2 sans modification.
*
* *
Régularisation des montants dus au titre des fonds départementaux
de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP)
Texte du projet de loi :
Pour 2012, le montant prévu au I de l’article 1648 A du code général des impôts est fixé à 423 291 955 euros.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article majore de 4,829 millions d’euros les transferts financiers de l’État aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), par rapport au montant voté pour 2012.
Cette mesure est pérennisée en 2013 par l’article 24 du projet de loi de finances pour 2013.
I.– L’EXISTENCE DES FONDS DÉPARTEMENTAUX DE PÉRÉQUATION N’A PAS ÉTÉ REMISE EN CAUSE PAR LA SUPPRESSION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
Les fonds départementaux de la taxe professionnelle (FDPTP) ont été créés par la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975, en même temps que la taxe professionnelle. En effet, l'inégale répartition des bases de taxe professionnelle sur le territoire était considérée comme l’une des premières causes d’inégalité de richesse entre collectivités.
● Avant la réforme de la taxe professionnelle en 2010, les FDPTP, régis par les articles 1648 A et 1648 AA (désormais abrogé) du code général des impôts, étaient alimentés par deux types de ressources (22) : l'écrêtement des bases excédentaires et un prélèvement sur les ressources des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Les reversements des ressources des FDPTP étaient opérés en faveur de trois types de collectivités :
– tout d'abord, les collectivités écrêtées, qui bénéficiaient d'un « retour prioritaire » sur les ressources du fonds ;
– les communes « concernées », c'est-à-dire celles situées à proximité de l'établissement exceptionnel écrêté ou accueillant ses salariés et subissant donc un préjudice du fait de cet établissement ;
– enfin, les communes ou EPCI dits « défavorisés » par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges. Une grande liberté était laissée à chaque conseil général pour la répartition de cette part.
● La loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) a rendu obsolète le mécanisme d'alimentation des FDPTP qui s’appuyait sur les bases de taxe professionnelle, sans pour autant supprimer les fonds eux-mêmes. À titre conservatoire, l’article 78 de la loi avait prévu de faire bénéficier les FDPTP de la garantie de ressources sur les montants de taxe professionnelle qui étaient écrêtés à leur profit, mais qui n’étaient pas reversées aux collectivités d’implantation (bénéficiaires d’un « retour prioritaire ») ou aux communes dites « concernées » (23).
Seuls les montants correspondant aux « structures défavorisées », par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l’importance de leurs charges (communes et EPCI), étaient maintenus. Cette garantie au profit des FDPTP s’est traduite par un prélèvement spécifique sur les recettes de l’État (la dotation de garantie des reversements des FDPTP), évalué par l’article 25 du projet de loi de finances pour 2013 à 430 millions d'euros (qui minore d’autant la DCRTP).
Dans ce schéma, qui a perduré jusqu’à aujourd’hui, la répartition entre départements a continué à être opérée sur la base des versements effectués en 2009 et les conseils généraux ont conservé une large marge d'appréciation pour distribuer ces sommes.
● Dans un premier temps, l’article 46 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010), corrigé par l’article 84 de la loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010), a prolongé pour un an le statu quo.
Procédant à une réécriture complète des articles 1648 A et 1648 AC du code général des impôts, il a également gelé le montant global attribué aux FDPTP et gelé son niveau pour 2011 sur la base des versements effectués en 2009, tout en sécurisant le financement des deux FCNA (fonds de compensation des nuisances aéroportuaires, adossés aux FDPTP). Les FDPTP et les FCNA ont donc perçu, en 2011, des dotations figées au niveau des montants antérieurement perçus par eux.
L’article 42 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) a marqué une deuxième étape en opérant trois modifications :
– la pérennisation des dotations versées par l’État aux FDPTP et au FCNA, « à compter de 2012 », qui s’accompagne de la fixation dans la loi de leurs montants globaux ;
– la limitation du bénéfice de la dotation aux FDPTP existants en 2011 ;
– la minoration, à raison de 31,3 millions d’euros par rapport à 2011 du montant de la dotation versée aux FDPTP, au titre de la contribution de 200 millions d’euros des collectivités territoriales en faveur du redressement des finances publiques.
II.– LA DOTATION DE GARANTIE VERSÉE AUX FDPTP NE FAIT L’OBJET, EN 2012 COMME EN 2013, QUE DE RÉGULARISATIONS MINIMES
Il n’est pas proposé par le présent article de revenir sur le gel à son niveau 2011 du montant attribué aux FDPTP, mais de corriger les conséquences des erreurs constatées dans la prise en compte des versements de 2009 qui servent aujourd’hui de base au calcul. Un amendement au projet de loi de finances pour 2012, adopté à l’initiative du Gouvernement, opérait déjà une régularisation semblable (38 millions d’euros de minoration, mais 6,7 millions d’euros d’ajustement positif).
L’alinéa unique du présent article porte à 423 291 955 euros le montant de la dotation de l’État versée au FDPTP, contre 418 462 372 euros en loi de finances initiale (+ 1,15 %).
Comme déjà évoqué, une disposition symétrique a été insérée dans le projet de loi de finances pour 2013, et déjà débattue à l’Assemblée nationale, afin de permettre d’opérer la même régularisation sur le prochain exercice (2013).
La limitation du bénéfice de la dotation aux seuls fonds de péréquation existants en 2011 n’est en revanche pas remise en cause.
*
* *
La Commission adopte l’article 3 sans modification.
*
* *
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation
des emplois
Texte du projet de loi :
I.– Pour 2012, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(en millions d’euros) | |||
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
3 711 |
7 534 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
6 033 |
6 033 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
– 2 322 |
1 501 |
|
Recettes non fiscales |
– 1 371 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
– 3 693 |
||
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
220 |
||
Montants nets pour le budget général |
-3 913 |
1 501 |
– 5 414 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|||
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
– 3 913 |
1 501 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes |
|||
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
|||
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
2 585 |
2 585 |
0 |
Comptes de concours financiers |
400 |
400 | |
Comptes de commerce (solde) |
|||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|||
Solde pour les comptes spéciaux |
400 | ||
Solde général |
– 5 014 | ||
II.– Pour 2012 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(en milliards d’euros) | |
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à long terme |
55,5 |
Amortissement de la dette à moyen terme |
42,4 |
Amortissement de dettes reprises par l’État |
1,3 |
Déficit budgétaire |
86,1 |
Total |
185,3 |
Ressources de financement |
|
Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et |
178,0 |
Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique |
- |
Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
– 10 |
Variation des dépôts des correspondants |
3,2 |
Variation du compte de Trésor |
2,4 |
Autres ressources de trésorerie |
11,7 |
Total |
185,3 |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III.– Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État fixé pour 2012 par la loi
n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 demeure inchangé.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article retrace l’incidence sur l’équilibre budgétaire du présent projet de loi de finances rectificative. Sur le fond, les déterminants de cet équilibre, qui trouvent leur traduction dans le tableau d’équilibre du I du présent article, sont analysés dans l’exposé général du présent rapport.
La dégradation du solde budgétaire de 5,014 milliard d’euros par rapport à la dernière loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012 majore d’autant le besoin de financement de l’État pour le porter à 86,1 milliards d’euros.
Cette amélioration du solde budgétaire entraîne en conséquence, au 1° du II du présent article, une nouvelle actualisation du tableau de financement pour 2012 (24) mais le plafond de variation de la dette négociable de l’État resterait inchangé, à 80,1 milliards d’euros, au 2° du II du présent article.
Enfin, le plafond des autorisations d’emplois rémunérés par l’État mentionné au III du présent article reste également inchangé à 1 936 014 ETPT.
L’ensemble de ces éléments est commenté dans l’exposé général du présent rapport.
*
* *
M. Charles de Courson. Aux termes de l’amendement déposé par le Gouvernement après l’article 24, il semble que les entreprises pourront faire figurer dans leur bilan au 31 décembre 2013 la créance représentative du crédit d’impôt. Cette mesure aurait donc un impact sur le budget de 2013…
M. le rapporteur général. Je rappelle que nous examinons ce matin l’article d’équilibre pour 2012 ! Cela étant, le CICE n’aura pas d’impact sur le budget de 2013. Comme le Gouvernement nous l’expliquera cet après-midi, les entreprises concernées auront la possibilité de se faire préfinancer ce crédit d’impôt en souscrivant un emprunt de trésorerie, soit auprès des banques avec caution d’OSÉO, soit directement auprès de ce dernier organisme, pour un montant déterminé à l’aide d’un simulateur de calcul qui sera mis à leur disposition.
Dès lors que l’assiette du crédit d’impôt est constituée par une partie des salaires versés en 2013, le montant exact de ce crédit ne pourra pas être connu avant la fin de 2013 et, comme tout impôt, sera imputé sur les comptes de l’entreprise pour 2013. Il n’y aura donc pas de conséquences pour 2012, ni pour 2013 s’agissant du budget de l’État.
La Commission adopte l’article 4 sans modification.
Elle adopte ensuite la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2012 sans modification.
*
* *
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. - CRÉDITS DES MISSIONS
Budget général : ouvertures et annulations de crédits
Texte du projet de loi :
I.– Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement à 10 298 208 280 euros et à 9 408 176 057 euros, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.
II.– Il est annulé pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 2 693 831 280 euros et à 1 874 252 492 euros, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article tend à ouvrir et à annuler des crédits sur le budget général, selon la répartition donnée à l’état B annexé au présent projet de loi de finances rectificative. Ces ouvertures et annulations sont commentées dans l’exposé général du présent rapport.
*
* *
La Commission adopte l’article 5 sans modification.
*
* *
Comptes spéciaux : ouverture de crédits
Texte du projet de loi :
Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 2 585 000 000 euros, conformément à la répartition par programme donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article tend à ouvrir et à annuler des crédits sur les comptes spéciaux, selon la répartition donnée à l’état C annexé au présent projet de loi de finances rectificative. Ces ouvertures et annulations sont commentées dans l’exposé général du présent rapport.
*
* *
La Commission adopte l’article 6 sans modification.
*
* *
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
Renforcement de la lutte contre les fraudes patrimoniales les plus graves
Texte du projet de loi :
I.– Après l'article 754 B du code général des impôts, il est inséré un article 755 ainsi rédigé :
« Art. 755.– Les avoirs inscrits sur un compte ou un contrat d’assurance-vie étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d’expiration des délais prévus à l’article L. 23 C précité, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777.
« Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs du compte ou du contrat d’assurance-vie au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications prévue à l’article L. 23 C précité, diminuée de la valeur des avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition ont été justifiées. »
II.– Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A.– Après l’article L. 10, il est inséré un article L. 10-0 A ainsi rédigé :
« Art. L. 10-0 A.– L’administration peut demander communication auprès de tiers des relevés de compte du contribuable, afin d’examiner l’ensemble des relevés de compte du contribuable sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou à l’article 1649 AA du code général des impôts n’ont pas été respectées, sans que cet examen constitue le début d’une procédure de vérification de comptabilité ou d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle.
« Ces relevés de compte ne peuvent être opposés au contribuable pour l’établissement de l’impôt sur le revenu que dans le cadre d’une des deux procédures de contrôle précitées. »
B.– La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 16 est complétée par les mots suivants : « , notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers à hauteur d’au moins 200 000 € ».
C.– En première partie, titre II, chapitre premier, section II, le II est complété par un D intitulé : "Contrôle des comptes financiers et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis hors de France " qui comprend un article L. 23 C ainsi rédigé :
« Art. L. 23 C.– Lorsque l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou à l'article 1649 AA du code général des impôts n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’administration peut demander, indépendamment d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d'acquisition des avoirs mentionnés sur le compte ou le contrat d’assurance-vie.
« Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d’informations ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. »
D.– En première partie, titre II, chapitre premier, section V, le I est complété par un C intitulé : « En cas de défaut de justifications de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs à l’étranger » qui comprend un article L. 71 ainsi rédigé :
« Art. L. 71.– En l’absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d’informations ou de justifications prévues à l’article L. 23 C dans les délais prévus audit article, la personne est taxée d’office dans les conditions prévues à l’article 755 du code général des impôts.
« La décision de mettre en œuvre cette taxation d’office est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’État, qui vise à cet effet la notification prévue à l’article L. 76. »
III.– Les I et II s’appliquent aux demandes adressées par l’administration à compter du 1er janvier 2013.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article vise à renforcer les dispositifs juridiques permettant à l’administration fiscale de lutter contre certaines fraudes concernant le patrimoine des ménages. Il comprend deux séries de dispositions : d’une part, il renforce les moyens de contrôle et de sanction des avoirs non déclarés détenus à l’étranger ; d’autre part, il permet de mieux appréhender, de manière générale, les revenus non déclarés.
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2013.
La levée du contrôle des changes le 1er janvier 1990 s'est traduite, pour les personnes physiques résidant en France, par la possibilité de transférer librement des capitaux à l'étranger et d'y détenir des avoirs. Afin que cette levée ne constitue pas une source d'évasion fiscale, la loi de finances pour 1990 a institué une obligation de déclaration de la détention de comptes à l'étranger. L’article 1649 A du code général des impôts prévoit cette obligation déclarative des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger par les personnes physiques et certaines personnes morales, domiciliées ou établies en France (25).
Un fichier dénommé EVAFISC a été créé par un arrêté du 25 novembre 2009 pour répertorier les comptes bancaires détenus hors de France par des personnes physiques ou morales domiciliées en France. Géré par la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF), ce fichier permet de recenser et de centraliser les informations laissant présumer la détention de comptes bancaires hors de France, afin de mener des actions de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite d’infractions pénales. Pour cela, outre l’identité des personnes, EVAFISC recense les comptes bancaires concernés avec le montant des soldes et des virements. Ces données peuvent être recueillies par interrogation des établissements bancaires, notamment à partir d’une analyse des transactions réalisées en France au moyen de cartes bancaires étrangères, ou être reprises depuis d’autres fichiers fiscaux. EVAFISC comporte aujourd’hui plus de 95 000 informations sur des comptes bancaires permettant de présumer la détention d’avoirs non déclarés à l’étranger.
Par ailleurs, l'article 1649 AA du code général des impôts prévoit que les personnes physiques domiciliées fiscalement en France qui souscrivent des contrats d'assurance-vie auprès d'organismes établis hors de France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références et dates d'effet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectuées.
Si ces deux types d’obligations déclaratives ne sont pas respectés, il existe plusieurs sanctions applicables :
– d’une part, une amende spécifique mise à la charge du déclarant défaillant, dont le montant par compte non déclaré est de 1 500 euros (ou 10 000 euros dans le cas où le compte est détenu dans un État ou territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires). La première loi de finances rectificative pour 2012 a renforcé cette amende en prévoyant qu’elle s'élève à 5 % du solde créditeur de chaque compte non déclaré lorsque le total des soldes créditeurs des comptes non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 euros ;
– d’autre part, les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables soumis à l'impôt sur le revenu. En application de l'article 1758 du code général des impôts, ces rappels d'impôt sont soumis à une majoration de 40 % (jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-220 QPC du 10 février 2012), à l'intérêt de retard et aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.
Depuis la dernière loi de finances rectificative pour 2011, l'article L. 169 du livre des procédures fiscales fixe à dix ans, au lieu de trois dans le droit commun, le délai de reprise à l’impôt sur le revenu en cas de non-respect des obligations déclaratives au titre de l'ensemble des avoirs détenus à l'étranger. Toutefois, cette extension du délai de reprise ne s'applique pas en cas de non-respect de l'obligation déclarative relative à l'ouverture, l'utilisation ou la clôture de comptes à l'étranger, lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger est inférieur à 50 000 euros au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite.
Afin d’assurer une plus grande effectivité de ces procédures de contrôle et de sanction des avoirs détenus à l’étranger, tant sur des comptes bancaires que sur des contrats d’assurance-vie, le présent article prévoit deux séries de dispositions, l’une au titre du contrôle fiscal, l’autre au titre de l’imposition d’office.
Au titre du contrôle fiscal, il est ouvert la possibilité pour l’administration de demander communication à des tiers (les établissements bancaires français, ainsi que les administrations fiscales étrangères dans le cadre de l’assistance administrative internationale) l’ensemble des relevés de compte du contribuable qui n’aurait pas déclaré ses comptes ou contrats d’assurance-vie étrangers, sur le fondement d’un nouveau droit à communication prévu par l’article L. 10 A du livre des procédures fiscales, créé par le A du II du présent article.
En application de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, l’administration peut toujours demander au contribuable les renseignements, justifications ou éclaircissements qui lui paraissent utiles pour asseoir et contrôler l'impôt, mais le contribuable n’est pas tenu de répondre à une telle demande et un tel refus n’emporte aucune conséquence ou sanction.
Dans le cadre d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) prévu par l’article L. 12, l’administration peut engager toutes les démarches qui tendent à recueillir, pour les besoins de la vérification de la cohérence entre les revenus déclarés et la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et le train de vie du contribuable, des informations ou des documents, soit auprès du contribuable lui-même, soit auprès de tiers. L’article L. 47 du même livre des procédures fiscales (LPF) prévoit explicitement que l’avis envoyé au contribuable avant l’engagement d’un ESFP peut comporter une demande de relevés de comptes. Mais, dès lors que l’ESFP ne revêt aucun caractère contraignant pour le contribuable, celui-ci n'est pas légalement tenu de fournir les documents ou renseignements demandés lors de cette vérification. L’article L. 12 prévoit toutefois que, si le contribuable n’a pas lui-même fourni dans un délai de deux mois ses relevés de compte à l’administration, cette dernière dispose des délais supplémentaires nécessaires pour les obtenir en usant de son droit de communication auprès des tiers.
L’administration dispose en effet d’un tel droit de communication auprès des banques, soit en vertu de l'article L. 85 du LPF qui fait obligation aux entreprises industrielles ou commerciales de communiquer à la demande de l'administration fiscale les livres dont la tenue est prescrite par le code de commerce ainsi que tous documents annexes, notamment les comptes privés des particuliers, soit en vertu de l'article L. 83 du LPF qui prévoit que les entreprises soumises au contrôle de l'autorité administrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents des impôts qui leur demandent communication des documents de service qu'elles détiennent. Par ailleurs, l’article L. 96 A du LPF prévoit que les établissements bancaires doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, la date et le montant des transferts de fonds vers l'étranger réalisés par les personnes physiques, les associations et les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, ainsi que l'identité de l'auteur et du bénéficiaire de ces transferts et les références des comptes concernés. On rappellera enfin qu’en application de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les documents sur lesquels peut s’exercer le droit de communication doivent être conservés pendant six ans.
Lorsque l'administration a réuni des éléments permettant de présumer que le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger, elle peut aussi mettre en œuvre l'assistance administrative prévue par les conventions fiscales internationales. Le délai d'exercice de l'ESFP est alors aussi prorogé pour permettre à l'administration de recevoir les renseignements demandés aux autorités fiscales étrangères – ce qui prend du temps...
L’intérêt de la nouvelle procédure prévue par le présent article est de rationaliser et d’optimiser le contrôle fiscal : l’administration pourra désormais demander communication des relevés de compte à des tiers dès qu’elle peut prouver que le contribuable n’a pas respecté ses obligations déclaratives de comptes ou de contrats d’assurance-vie à l’étranger. Elle ne sera alors tenue à aucun délai pour procéder à l’analyse des comptes communiqués. Sa demande pourra porter sur toutes les années au cours desquelles les obligations déclaratives n’ont pas été respectées, ainsi que sur l’ensemble des comptes concernés. L’administration ne poursuivra la procédure, en engageant un contrôle fiscal externe, que si la situation fiscale du contribuable ainsi analysée au préalable l’exige. Ce souci de rationalisation des moyens de l’administration et de meilleure programmation des contrôles s’explique par le fait que 18 % des ESFP engagés n’aboutissent pas à des propositions de rectification.
Il est expressément mentionné que l’exercice de ce droit de communication ne constitue pas l’engagement d’un ESFP (ou d’une vérification de comptabilité pour un professionnel), afin de se prémunir contre toute interprétation jurisprudentielle qui requalifierait la demande de communication de l’ensemble des relevés bancaires du contribuable en une procédure de contrôle externe, exigeant le respect d’un certain formalisme et enserrée dans des délais fixés par le livre des procédures fiscales. Cette précision est apportée en raison de la lecture a contrario, faite par l’administration, d’une décision du Conseil d’État statuant au contentieux du 15 février 2002 (n° 217394, Schmitt). Dans cette décision, le Conseil d’État a jugé que des démarches entreprises par l'administration fiscale pour obtenir d'un pays étranger, en application des clauses d’assistance administrative d’une convention fiscale bilatérale, la communication de la copie des relevés de l'un des comptes bancaires du contribuable ne sont pas de nature à constituer un contrôle de la cohérence du revenu global déclaré avec l'ensemble des revenus dont l'intéressé a disposé, tels qu'ils peuvent être évalués à partir du patrimoine, de la situation de trésorerie ou du train de vie, seul de nature à caractériser un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle.
Il y a toutefois peu de risque que la demande de communication des relevés de tous les comptes, et non d’un seul comme dans le cas précité, suffise pour autant à caractériser un ESFP puisqu’en tout état de cause, l’administration ne pourra utiliser les relevés que dans le cadre d’un ESFP, après avoir procédé à une analyse d’ensemble. Le Conseil d’État a d’ailleurs déjà jugé que l’exercice du droit de communication constitue une procédure distincte de l'ESFP (23 mars 1992, n° 76586, Weber) et que l’administration peut dès lors valablement exercer ce droit sans avoir au préalable adressé au contribuable un avis de vérification (1er décembre 2004, n° 258774, ministre c/Jallet).
Les droits du contribuable sont en effet préservés puisqu’une procédure de rectification ne pourra être engagée à son encontre qu’après engagement d’un ESFP (ou d’une vérification de comptabilité) si l’administration entend se prévaloir des relevés de compte qu’elle a obtenus et exploités. Dans le cadre de ces procédures contradictoires, le contribuable pourra alors discuter avec l’administration de la pertinence de son analyse et apporter tout élément de nature à justifier l’origine des fonds figurant sur des comptes non déclarés.
En complément de ce nouveau droit de communication, dont l’exercice peut aboutir à l’engagement d’un ESFP et à une rectification contradictoire à son issue, le présent article instaure également une procédure d’imposition d’office lorsque les obligations déclaratives relatives aux comptes et contrats d’assurance-vie à l’étranger n’ont pas été respectées. Il s’agit toutefois d’une procédure particulière qui permet de garantir les droits du contribuable concerné : quand bien même la procédure n’est pas définie a priori comme contradictoire (puisqu’il est expressément mentionné qu’elle ne constitue pas un ESFP), le contribuable dispose de délais suffisants pour apporter à l’administration les justifications appropriées permettant de faire échec, le cas échéant, à l’imposition d’office.
Le nouvel article L. 23 C du livre des procédures fiscales, introduit par le C du II du présent article, prévoit qu’en cas de non-respect des obligations déclaratives au titre d’une année sur les dix précédentes, l’administration peut demander au contribuable concerné de fournir, dans un délai de soixante jours, les justifications de l’origine des fonds figurant sur les comptes bancaires ou contrats d’assurance-vie non déclarés. Si le contribuable répond et que l’administration estime certains éléments de cette réponse insuffisants, cette dernière peut adresser au contribuable une mise en demeure de préciser ces éléments dans un délai supplémentaire de trente jours.
Après cet échange entre l’administration et le contribuable, la nouvelle procédure d’imposition d’office proprement dite peut être engagée sur le fondement du nouvel article L. 71 du livre des procédures fiscales, introduit par le D du II du présent article. Les conditions de l’engagement de cette procédure sont l’absence de réponse du contribuable dans les délais impartis (de soixante ou quatre-vingt-dix jours), ou une réponse insuffisante dans ces mêmes délais. La décision d’engagement de la procédure doit être prise par un agent de catégorie A, détenant un grade dont le niveau minimum sera fixé par décret en Conseil d’État (qui sera donc un supérieur hiérarchique de l’inspecteur-vérificateur), comme pour la procédure de taxation forfaitaire en fonction des éléments de train de vie prévue par l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. Les bases d’imposition et leurs modalités de détermination doivent être notifiées au contribuable dans un délai de trente jours avant la mise en recouvrement de l’imposition, selon la procédure de droit commun prévue en matière de taxation d’office par l’article L. 76 du livre des procédures fiscales. Cette notification interrompt le délai de prescription.
La base de l’imposition d’office est déterminée par le nouvel article 755 du code général des impôts, créé par le I du présent article au sein du paragraphe relatif aux présomptions de propriété concernant le champ d’application des droits de mutation à titre gratuit.
L’ensemble des avoirs détenus sur les comptes bancaires et contrats d’assurance-vie détenus à l’étranger et non déclarés sont réputés constituer un patrimoine acquis à titre gratuit, qui sera taxé au taux le plus élevé existant pour les droits de mutation, soit 60 % (le taux applicable entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes). L’application de ce taux correspond à une présomption d’origine inconnue des fonds en cause, donc hors lignée familiale. Le contribuable concerné conserve toutefois la possibilité d’apporter la preuve contraire devant le juge de l’impôt, en établissant l’origine de ces fonds. Tant que la donation ou le don manuel n’ont pas été révélés à l'administration par le bénéficiaire de la mutation, le droit de reprise de l’administration n’est pas prescrit. Il n’y a donc aucune difficulté à rendre exigible en l’espèce les droits de mutation à la date d’expiration des délais de réponse laissés au contribuable, qui peut révéler l’origine de ses avoirs lors de la phase préalable contradictoire.
L’assiette taxable est constituée par la valeur la plus élevée des avoirs du compte ou du contrat au cours des dix années précédant l’envoi de la demande de justification. L’administration pourra connaître ce montant grâce à l’exercice préalable de son nouveau droit de communication en la matière, ou par toute autre procédure de contrôle (y compris suite à une enquête judiciaire pour fraude fiscale). La valeur des avoirs dont l’origine aura été justifiée vient en déduction de l’assiette taxable.
En plus des flux de revenus vers ou depuis l’étranger, qui peuvent déjà être imposés à l’impôt sur le revenu, l’administration disposera donc désormais de la possibilité de taxer le stock qui demeure sur des comptes ou contrats non déclarés à l’étranger et dont les flux qui en sont à l’origine n’auront pas pu être appréhendés au préalable, du fait d’une dissimulation par le contribuable concerné. Une fois qu’il aura été ainsi identifié, le stock pourra aussi être taxé chaque année au titre de l’ISF.
L'article L. 16 du livre des procédures fiscales prévoit qu'en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et, dans certains cas précisément mentionnés dans la loi, des justifications sous la forme de production de documents. Il en est notamment ainsi lorsque l'administration a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir un revenu plus important que le revenu déclaré. En cas d'absence ou d'insuffisance de réponse à la demande de justifications formulée sur ce fondement par l’administration, le contribuable s’expose soit à la taxation d'office au titre de revenus d'origine injustifiée (article L. 69), soit à l'évaluation d'office des bases de l'impôt pour défaut de déclaration s’il admet s'être livré à une activité occulte (article L. 73). Dans la suite éventuelle de la procédure au niveau contentieux, la charge de la preuve est inversée en faveur de l’administration.
L'abondant contentieux généré par les contrôles opérés sur le fondement de l'article L. 16 a permis au juge de l'impôt de retenir trois catégories d’indices permettant à l'administration de présumer l'existence de revenus dissimulés : le constat de dépenses sans rapport avec les revenus déclarés ; l'existence d'un solde inexpliqué de la balance personnelle de trésorerie ; la constatation d'un écart au moins égal au double entre les revenus déclarés et les sommes portées au crédit des comptes bancaires du contribuable. En ce qui concerne ce troisième indice, la « règle du double » a été posée, comme garantie offerte au contribuable, par une décision du Conseil d’État statuant au contentieux du 22 janvier 1982 (n° 23454). Le caractère strict de l’application de cette règle a été rappelé par une décision du Conseil d’État statuant au contentieux du 5 mars 1999 (n° 164412, Bancarel), qui a jugé insuffisant pour permettre à l'administration de mettre en œuvre la procédure de demande de justifications un écart de 1,96 entre les crédits bancaires recensés et les revenus déclarés. Le Conseil d'État semble avoir retenu une telle interprétation stricte pour assurer une application uniforme de la règle prétorienne qu'il a lui-même établie.
Dans le chapitre consacré à la lutte contre la fraude de son rapport public 2012, la Cour des comptes a toutefois constaté que l’application de cette règle du double « bénéficie indubitablement aux plus hauts revenus, bien davantage en tout cas que ne le ferait l’appréhension de l’écart entre les crédits et les revenus déclarés s’il était exprimé en valeur absolue ». C’est pourquoi le B du II du présent article propose de modifier l’article L. 16 du livre des procédures fiscales afin de mentionner explicitement dans la loi la règle du double et de la compléter par la possibilité nouvelle offerte à l’administration fiscale de formuler une demande de justifications lorsqu’elle constate un écart entre les crédits bancaires et les revenus déclarés d’un montant supérieur ou égal à 200 000 euros en valeur absolue.
Avec l’application actuelle de la règle du double, si l’administration constate un écart de 500 000 euros entre des revenus déclarés de 1 million d'euros et les crédits bancaires du contribuable concerné, elle ne peut pas de ce seul fait lui demander de fournir des justifications. Désormais, avec le nouveau seuil de 200 000 euros, une telle demande de justifications pourra être adressée au contribuable.
On rappellera que, dans une décision du 22 juin 2011 (n° 347813, Kargaci), le Conseil d’État statuant au contentieux a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’application de la règle du double en estimant que « la circonstance que ce seuil soit apprécié en valeur relative, loin de créer une différence de traitement entre contribuables, permet au contraire d'assurer le respect du principe d'égalité ». L’extension du pouvoir de contrôle de l’administration réalisée par le présent article ne devrait pas fragiliser l’actuelle règle du double, puisque celle-ci est maintenue et complétée par une autre disposition qui, par la référence à un montant assez élevé en valeur absolue, permet de limiter l’effet de seuil résultant de la prise en compte de la seule valeur relative des revenus, laquelle avantage aujourd’hui les contribuables dont les revenus sont les plus élevés.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement CF 52 du rapporteur général.
M. le rapporteur général. Dans le droit en vigueur, il est possible de taxer d'office les flux de revenus à destination ou en provenance de l'étranger sur des comptes non déclarés dès que l'administration en a connaissance, sans qu'elle soit tenue d'engager une procédure de contrôle contradictoire. Cet amendement vise à maintenir cette possibilité de taxation d'office, même lorsque l'administration aura eu connaissance de ces flux de revenus non déclarés en exerçant le nouveau droit de communication auprès des banques que lui ouvre le présent article.
La Commission adopte cet amendement (Amendement n° 11).
La Commission est ensuite saisie de l’amendement CF 51 du rapporteur général.
M. le rapporteur général. L’un des objets de l’article 7 est de durcir la « règle du double » qui permet au fisc de demander des justifications à un contribuable dès lors que ses revenus constatés représentent au moins le double de ses revenus déclarés : il dispose que l’administration fiscale pourra intervenir dès lors que la différence atteindra 200 000 euros. L’amendement tend à ramener ce montant à 150 000 euros. Cette disposition, certes plus sévère, reste néanmoins raisonnable.
M. Charles de Courson. La règle dite du double restant en vigueur, est-il bien justifié de conserver ce deuxième seuil, qu’il soit fixé à 200 000 ou 150 000 euros ? Ne vaudrait-il pas mieux se contenter d’un seuil unique, ramené par exemple à une fois et demie le revenu déclaré ?
M. le rapporteur général. Nous n’avons pas voulu toucher à cette règle du double, qui est conforme à une jurisprudence constante du Conseil d’État et qui a l’avantage de s’appliquer lorsque le revenu déclaré est inférieur au seuil fixé en valeur absolue. Ainsi, pour un revenu déclaré de 100 000 euros, elle continuera à s’appliquer à partir de 100 000 euros d’avoirs non déclarés.
M. le président Gilles Carrez. Le « ou » de l’article est alternatif, et non cumulatif.
M. Olivier Carré. Il est amusant de constater que l’exposé sommaire de l’amendement se réfère encore à un montant en francs.
M. le rapporteur général. Il est déjà difficile de discuter les amendements : épargnons-nous un débat sur les exposés sommaires.
La Commission adopte l’amendement (Amendement n° 12).
Puis la Commission examine l’amendement CF 50 du rapporteur général.
M. le rapporteur général. L’amendement tend à harmoniser à dix ans tous les délais de reprise en cas de non-déclaration de comptes à l’étranger.
M. le président Gilles Carrez. Je crois me souvenir que c’est à l’initiative de Mme Valérie Pécresse alors qu’elle était ministre du Budget que le délai de reprise à l’impôt sur le revenu a été porté à dix ans dans le cas de ces opérations suspectes. Il me semble aussi que nous nous étions alors demandés s’il ne fallait pas adopter le même délai pour l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et les droits d’enregistrement. Il y aurait donc continuité dans la lutte contre la fraude.
Mme Valérie Pécresse. Vous avez bonne mémoire ! Mais M. le rapporteur général assume-t-il cette continuité ?
M. Charles de Courson. Tous les délais seront-ils désormais harmonisés en cas de non-déclaration ?
M. le rapporteur général. Oui. Tous les délais de reprise seront harmonisés à dix ans, pour tous les impôts en cas de comptes à l’étranger non déclarés.
La Commission adopte l’amendement (Amendement n° 13).
Elle adopte ensuite l’article 7 ainsi modifié.
Article additionnel après l’article 7
Extension de la compétence de la commission départementale de conciliation de Paris aux biens situés à l’étranger
La Commission est saisie de l’amendement CF 45 du rapporteur général, portant article additionnel après l’article 7.
M. le rapporteur général. Les éventuels litiges portant sur l’estimation d’un bien entrant dans le calcul de l’ISF ou soumis à droits d’enregistrement sont traités par une commission départementale de conciliation. Aujourd'hui, aucune commission n'est territorialement compétente pour les biens situés à l'étranger. Il est proposé que cette compétence soit attribuée à la commission de Paris, ce qui permettra un contrôle effectif des déclarations tout en garantissant aux contribuables concernés le bénéfice d’une procédure de conciliation.
M. Charles de Courson. Ces commissions de conciliation fonctionnent-elles bien ?
M. le rapporteur général. Je l’ignore. Je vous propose de poser la question aux services concernés.
La Commission adopte l’amendement (Amendement n° 14).
*
* *
Article additionnel après l’article 7
Harmonisation du délai de reprise en cas de fraude révélée devant les Tribunaux
La Commission est ensuite saisie de l’amendement CF 47 du rapporteur général, portant article additionnel après l’article 7.
M. le rapporteur général. Dans le même souci d’harmonisation qu’avec l’amendement adopté à l’article 7, cet amendement tend à porter pour tous les impôts de trois ans à dix ans le délai de reprise en cas de fraude révélée devant les tribunaux.
M. Charles de Courson. Il est fréquent que les faits de fraude fiscale révélés dans le cadre d’un contentieux ne soient pas transmis au fisc ou qu’ils ne le soient qu’après qu’ils ont été prescrits. Vous êtes-vous rapproché de la commission des Lois ou du ministère de la Justice pour régler ce problème ?
M. le rapporteur général. C’est précisément pour tenir compte de ces problèmes de transmission qu’il est proposé d’allonger les délais.
M. Charles de Courson. Ne faudrait-il pas compléter l’amendement en faisant obligation aux juges de transmettre ces faits ?
M. le rapporteur général. Cette obligation existe, même s’il peut arriver qu’elle ne soit pas respectée.
La Commission adopte l’amendement (Amendement n° 15).
*
* *
Adaptation des procédures de lutte contre les fraudes les plus graves
Texte du projet de loi :
Modernisation de la procédure de droit de visite et de saisie par la création de dispositions spécifiques aux perquisitions informatiques.
I.– L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « des taxes sur le chiffre d’affaires » ;
b) Après les mots : « susceptibles d’être détenus » sont insérés les mots : « , ou d’être accessibles ou disponibles, » ;
2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.– Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.
« Les agents de l’administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de réalisation de la visite pour procéder à l’accès aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogeable sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.
« À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de l’administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.
« L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.
« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour procéder à l’accès à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu.
« Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. » ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les informations recueillies » sont insérés les mots : « , y compris celles qui procèdent des traitements mentionnés au troisième alinéa, » ;
b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au présent article, l’administration communique au contribuable, au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76, sous forme dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début d’une procédure de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées. »
II.– L’article L. 74 du même livre est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également au contrôle du contribuable mentionné au I de l’article L. 16 B lorsque l’administration a constaté dans les conditions prévues au IV bis du même article, dans les locaux occupés par ce contribuable, ou par son représentant en droit ou en fait s’il s’agit d’une personne morale, la situation d’obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie ».
III.– Après l’article 1735 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1735 quater ainsi rédigé :
« Art. 1735 quater.– L’obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au IV bis de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est passible d’une amende égale à :
« – 10 000 euros ou 5 % des droits rappelés, si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable mentionné au I de ce même article ;
« – 1 500 euros dans les autres cas, portée à 10 000 euros lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait du contribuable mentionné au I de cet article. »
Élargissement de la procédure de flagrance fiscale.
IV.– L’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la période en cours pour laquelle » sont remplacés par les mots : « des périodes pour lesquelles » ;
b) Au a du 3°, les mots : « d'opérations commerciales sans facture et non comptabilisées » sont remplacés par les mots : « d'achats, de ventes ou de prestations non comptabilisés » ;
c) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° pour les contribuables qui poursuivent une activité professionnelle, l’absence réitérée du respect de l'obligation déclarative prévue au 2 de l'article 287 du code général des impôts, » ;
d) À l'avant-dernier alinéa, après les mots : « ainsi que par le contribuable », sont insérés les mots : « , hormis les cas dans lesquels l'infraction mentionnée à l'article 1746 du code général des impôts a été constatée » ;
2° Après le I bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« I ter.– Lorsqu'une infraction mentionnée au 4° du I a été constatée par des agents de contrôle autres que ceux de l’administration des impôts et que ces derniers en ont été informés dans les conditions prévues aux articles L. 82 C ou L. 101, ils peuvent, dans le cadre de l'une des procédures énumérées au premier alinéa d’I, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance fiscale de la nature de celle mentionnée à ce même alinéa, dresser à l’encontre du contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.
« Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable, hormis les cas dans lesquels l'infraction visée à l'article 1746 du code général des impôts a été constatée. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable. » ;
3° Au II, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures ».
4° Au dernier alinéa du V, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures ».
V.– Le I de l’article L. 252 B du même livre est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des saisies conservatoires » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d’exécution » ;
2° Au deuxième alinéa du 1°, les mots : « hors taxes réalisé au titre de l’année ou de l’exercice en cours » sont remplacés par les mots : « ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque année ou exercice » ;
3° Au 2°, les mots : « de l’année ou de l’exercice en cours » sont remplacés par les mots : « de chaque année ou exercice » ;
4° Au 3°, les mots : « de la période en cours » sont remplacés par les mots : « de chaque période » ;
5° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Pour l’amende mentionnée à l’article 1740 B du code général des impôts, le montant de cette amende. » ;
6° Au premier alinéa du II, les mots : « de saisies conservatoires » sont remplacés par les mots : « des mesures conservatoires » et les mots : « ces saisies » sont remplacés par les mots : « ces mesures » ;
7° Au quatrième alinéa du II, les mots : « des saisies » sont remplacés par les mots : « des mesures conservatoires » et les mots : « la mainlevée immédiate de ces saisies » sont remplacés par les mots : « leur mainlevée immédiate » ;
8° Au III, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures » .
VI.– L'article 1740 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « et I bis » sont remplacés par les mots : « à I ter » ;
2° Le deuxième alinéa du I est complété par la phrase suivante :
« Il est également porté à 10 000 euros si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la quatrième tranche du barème de l’impôt sur le revenu fixé au I de l’article 197. » ;
3° Le troisième alinéa d’I est complété par la phrase suivante :
« Il est également porté à 20 000 euros si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la cinquième tranche du barème de l’impôt sur le revenu fixé au I de l’article 197. » ;
4° Au II, les mots : « et I bis » sont remplacés par les mots : « à I ter ».
Élargissement du champ de la procédure judiciaire d’enquête fiscale.
VII.– 1° Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
a) À l’article L. 188 B, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
b) Après le sixième alinéa de l'article L. 228, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;
« 5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration. » ;
2° Au second alinéa du I de l’article 28-2 du code de procédure pénale, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 5°».
Observations et décision de la Commission :
Afin de renforcer la lutte contre les fraudes fiscales les plus graves, le présent article prévoit trois séries de mesures visant à :
– adapter la procédure de visite et de saisie fiscales aux nouvelles technologies, notamment utilisées par les entreprises (I) ;
– moderniser la procédure de flagrance fiscale utilisée dans les cas de fraude particulièrement graves, que cette forme soit liée à l’activité professionnelle normale du contribuable ou à des activités illicites, et élargir son champ d’application (II) ;
– étendre la procédure judiciaire d’enquête fiscale à certaines fraudes fiscales complexes visant à l’évasion fiscale (III).
I.– LA PROCÉDURE DE VISITE ET DE SAISIE
La procédure de visite et de saisie, mise en œuvre à l’initiative de l’autorité judiciaire, donne la possibilité, sous certaines conditions, à l’administration fiscale de réaliser des contrôles et de saisir les documents qui lui seront utiles pour apprécier le caractère frauduleux du comportement de certains contribuables en matière d’impôts professionnels.
En vertu de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF), la procédure de visite et de saisie est mise en œuvre « lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée ».
Cette présomption, fondée sur des éléments qui doivent être réunis par l’administration, doit porter sur des infractions limitativement énumérées par l’article L. 16 B précité, soit :
– la réalisation d’achat ou de ventes sans facture ;
– l’utilisation ou la délivrance de factures ou de documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ;
– l’omission volontaire de passer ou de faire passer des écritures ;
– le fait de passer ou faire passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (CGI).
Dans le cas d’une telle présomption, l’autorité judiciaire peut autoriser les agents de l’administration des impôts ayant au moins le grade d’inspecteur (26) et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques à « rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus »(27).
Si de tels documents sont trouvés lors de la visite, ils peuvent être saisis, quel qu’en soit le support.
Toutes les opérations réalisées au cours de la visite et de la saisie des pièces recherchées par les agents de l’administration fiscale sont placées sous le contrôle du juge des libertés et de la détention qui signe l’ordonnance donnant le droit de visite. Celui-ci doit justifier sa décision par l’indication des éléments de faits et de droit retenus pour établir la présomption de comportements frauduleux et peut se rendre sur les lieux visités, s’il estime utile.
Par ailleurs, le juge compétent désigne un officier de police judiciaire qui assiste à l’ensemble des opérations et le tient informé de leur déroulement.
La visite ne peut intervenir qu’entre six heures et vingt et une heures et doit être effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou à défaut de deux témoins qui ne sont pas soumis à l’autorité de l’officier de police judiciaire ou de l’administration fiscale présents.
Au cours de la visite, les agents des impôts :
– notifient l’ordonnance verbalement et sur place à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit une copie intégrale ;
– recueillent des informations concernant les agissements du contribuable, avec son consentement ;
– consignent l’ensemble des opérations réalisées, les constatations effectuées, les renseignements et justifications obtenus de la part du contribuable et les autres informations demandées le cas échéant dans un procès-verbal dressé sur le champ ;
– dressent, le cas échéant, un inventaire des pièces saisies, annexé au procès-verbal ;
– placent sous scellés les pièces et documents saisis, en cas de difficultés à en dresser l’inventaire.
Le procès-verbal et l’inventaire, signés par les agents de l’administration des impôts, l’officier de police judiciaire et l’occupant des lieux ou son représentant s’il y consent, sont adressés au juge qui a autorisé la visite, tandis qu’une copie est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également envoyée, s’il n’est pas l’occupant des lieux, au contribuable dont le comportement a suscité la présomption de fraude à l’origine de la visite.
Par ailleurs, les documents saisis doivent être restitués au contribuable dans un délai de six mois, sauf en cas d’engagement de poursuites pénales (28).
Le procès-verbal et l’inventaire mentionnent le délai et la voie de recours dont peut bénéficier l’occupant des lieux ou, le cas échéant, l’auteur de la fraude présumée (29).
L’administration ne peut opposer les informations qu’elle a obtenues qu’après restitution des pièces saisies et mise en œuvre de la procédure d’examen contradictoire de la situation fiscale du contribuable prévue à l’article L. 47 du LPF.
Toutefois, si ces pièces n’ont pu être restituées du fait du contribuable, les informations recueillies sont opposables après la mise en œuvre de la procédure d’examen contradictoire mentionnée ci-dessus et à la condition que l’administration informe le contribuable de la teneur et de l’origine des informations collectées dans les pièces qu’elle n’a pu lui restituer en application de l’article L. 76 C du même livre.
En cohérence avec les objectifs poursuivis par cette procédure en matière de lutte contre la fraude fiscale, le présent article prévoit son élargissement à l’ensemble des taxes sur le chiffre d’affaires (à l’instar de la taxe sur les huiles ou de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles) alors qu’auparavant seuls l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices et la TVA étaient concernés.
Par ailleurs, le champ des documents susceptibles d’être saisis est étendu : s’ajoutent aux documents détenus sur le lieu de la visite, les documents accessibles ou disponibles depuis ce lieu. Il s’agit de répondre aux problèmes auxquels est confrontée l’administration lorsque le lieu où se déroule la visite n’est pas celui où sont stockées les informations recherchées (par exemple, en cas de serveurs de stockage de données à distance, en fort développement).
2.– L’extension des moyens d’intervention de l’administration fiscale en cas d’obstacle à l’accès aux informations contenues sur un support informatique
Si la saisie de supports informatiques est possible en l’état du droit, les obstacles que peuvent opposer les propriétaires de ces supports à l’accès aux données qu’ils contiennent peuvent être préjudiciables à l’intervention de l’administration, qui ne dispose pas toujours des moyens matériels pour les lever.
Le présent article prévoit plusieurs dispositions permettant de renforcer les pouvoirs de l’administration lorsque de tels comportements sont constatés :
– une mention de l’obstacle fait à l’administration est portée au procès-verbal ;
– les agents des services fiscaux procèdent à la copie du support et le placent sous scellés ;
– ils disposent alors de quinze jours pour parvenir à accéder à ces informations (par exemple, en « cassant » les codes d’accès), ce délai étant prorogeable sur autorisation du juge des libertés et de la détention.
L’occupant des lieux ou son représentant est alors avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés et à la lecture des pièces saisies qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.
Un procès-verbal décrit les opérations réalisées pour procéder à l’accès aux pièces et documents et un inventaire des pièces saisies lui est annexé le cas échéant. Il porte la signature des agents de l’administration fiscale, de l’officier de police judiciaire et de l’occupant des lieux ou de son représentant s’il y consent. Dans le cas contraire, une mention le signalant est portée au procès-verbal.
Les supports et documents saisis sont restitués de façon concomitante.
La procédure d’évaluation d’office est étendue par le présent article aux cas où l’administration constate, dans les locaux occupés par le contribuable, ou par son représentant en droit ou en fait s’il s’agit d’une personne morale, des obstacles à l’accès à des informations contenues sur des supports informatiques.
Cette procédure, prévue à l’article L. 74 du LPF, permet d’évaluer d’office les bases d’imposition à retenir lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.
En cas d’obstacle à l’accès aux informations contenues sur un support informatique, une amende spécifique, codifiée dans un nouvel article 1735 quater du code général des impôts, trouvera désormais à s’appliquer pour un montant égal à :
– 10 000 euros ou 5 % des droits rappelés, si ce dernier montant est plus élevé, lorsque l’obstacle est constaté dans les locaux du contribuable soupçonné d’avoir fraudé ;
– 10 000 euros si cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de ce contribuable ;
– 1 500 euros dans les autres cas (par exemple, la constatation d’un tel comportement lors d’une visite dans les locaux d’un fournisseur de la société contrôlée).
d) L’opposabilité des pièces saisies dans le cadre d’opérations de vérification de comptabilité ultérieure
L’administration pourra désormais opposer au contribuable les informations recueillies sur les supports informatiques saisis dans le cadre d’une vérification de comptabilité ultérieure. Le contribuable sera informé, au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification du montant de son imposition, de la nature et du résultat des traitements informatiques réalisés sur ces supports qui contribuent aux rehaussements proposés, sans que ces traitements ne constituent en eux-mêmes le début d’une procédure de vérification de comptabilité. Le contribuable pourrait également être informé des noms et adresses administratives des services par qui, et sous le contrôle desquels, les opérations ont été réalisées.
La procédure de la flagrance fiscale, introduite par l’article 15 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 et codifiée à l’article L. 16-0 BA du LPF, déroge au droit commun du contrôle fiscal en ce qu’elle permet d’exercer un contrôle en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de taxe sur le chiffre d’affaires alors qu’aucune obligation déclarative n’est échue, et d’effectuer des saisies conservatoires. Le contribuable peut toutefois en contester la régularité devant le juge des référés.
La procédure de flagrance fiscale est subordonnée à la réunion de quatre conditions cumulatives :
– le contribuable contrôlé doit se livrer à une activité professionnelle ;
– l’administration doit constater au moins un fait caractérisant la fraude ;
– cette constatation doit être établie au titre de la période en cours pour laquelle aucune obligation déclarative n’est échue (30) ;
– les circonstances doivent être susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance fiscale (31).
Le recours à la procédure de flagrance fiscale ne peut intervenir que dans le cadre des procédures de recherche et de contrôle sur place expressément mentionnées à l’article L. 16-0 BA suivantes :
– les procédures de visite et de saisie mentionnées à l’article L. 16 B ;
– les procédures de contrôle des opérations réalisées ou facturées par les redevables de la TVA placés sous le régime simplifié d’imposition prévues à l’article L. 16 D ;
– le droit d’enquête prévu par l’article L. 80 F ;
– les procédures de contrôle inopiné prévues à l’article L. 47.
Les principales procédures de mise en œuvre de la flagrance fiscale
● Le droit de visite et de saisie permet à l’administration de rechercher la preuve de l’agissement frauduleux lorsqu’il existe des présomptions à l’égard d’un contribuable qui ne remplirait pas ses obligations déclaratives. Ces visites doivent être autorisées par le juge des libertés et de la détention, et les saisies s’effectuent sous son autorité et son contrôle.
● Le droit d’enquête est exercé par les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur afin d’identifier les manquements aux règles de facturation en matière de TVA.
● Le contrôle inopiné est limité à des opérations de constatations matérielles (inventaires de stocks, inventaire de valeur en caisse, existence et état des documents comptables).
La mise en œuvre de la flagrance fiscale n’est possible que si des agents de l’administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur constatent, pour un contribuable exerçant une activité professionnelle et au titre de la période en cours pour laquelle les obligations déclaratives en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de TVA ne sont pas échues, l’un des faits suivants :
– l’exercice d’une activité que le contribuable n’a pas fait connaître à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (c’est-à-dire en cas d’activité occulte), sauf s’il a satisfait, au titre d’une période antérieure, à l’une de ses obligations fiscales déclaratives ;
– la délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou de factures afférentes à des livraisons de biens au titre desquelles la taxe sur la valeur ajoutée ne peut faire l’objet d’aucune déduction (montage de type « carrousel » de TVA) ou la comptabilisation de telles factures reçues ;
– lorsqu’ils sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante, soit la réitération d’opérations commerciales sans facture et non comptabilisées, soit l’utilisation d’un logiciel de comptabilité ou de caisse aux fins d’omettre des opérations ou d’enregistrer des opérations fictives ;
– le recours au travail dissimulé.
En application de l’article 19 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, la procédure de flagrance fiscale s’applique également dans le cas de contrôle portant sur des activités illicites.
Les agents de l’administration fiscale peuvent recourir à cette procédure à la suite d’informations délivrées par le ministère public à l’occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles (article L. 82 C du LPF) ou par l’autorité judiciaire dans le cas où elle disposerait d’une indication de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale (article L. 101 du même code), ainsi que dans le cadre de l’échange d’informations entre les services fiscaux et les forces de l’ordre (article L. 135 L du même code).
Par ailleurs, la flagrance fiscale ne s’appliquera aux cas de fraudes liées à des activités lucratives non déclarées qu’après l’ouverture :
– d’une enquête menée à la suite de la constatation d’un crime ou d’un flagrant délit (article 53 du code de procédure pénale) ;
– d’une enquête préliminaire menée par des officiers de police judiciaire (article 75 du même code) ;
– d’une instruction préparatoire obligatoire ou facultative (article 79 du même code).
La flagrance fiscale ne peut être mise en œuvre que si, dans les circonstances de fait, l’administration apporte la preuve d’un risque pesant sur le recouvrement de la créance due (par exemple, dans le cas de sociétés éphémères, du fait de l’organisation de son insolvabilité par le contribuable).
Si les trois conditions cumulatives présentées ci-dessus sont réunies, les agents de l’administration peuvent dresser à l’encontre du contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale, qu’ils signent et font signer au contribuable sauf si celui-ci refuse. Dans ce dernier cas, ce refus est mentionné au procès-verbal.
Une copie du procès-verbal est notifiée au contribuable.
L’établissement du procès-verbal et sa notification permettent au comptable public de procéder à des saisies conservatoires sans autorisation préalable du juge (32) à hauteur d’un montant représentatif des impôts afférents à la période en cours (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés ou TVA) (33). Pour établir ce montant, l’administration fiscale peut utiliser les informations recueillies dans le cadre des visites et des saisies à domicile, du droit d’enquête et du droit de communication. Cette mesure permet d’assurer l’efficacité du recouvrement et de prévenir toute intention du contribuable d’organiser son insolvabilité. Les saisies conservatoires perdurent jusqu’à l’échéance déclarative. Par la suite, soit le contribuable procède au paiement des impositions dues au titre de l’exercice, ce qui entraîne la mainlevée de ces saisies, soit le contribuable n’acquitte pas l’impôt dû et les saisies sont converties en saisies-attributions dans les conditions de droit commun.
Ces saisies ne peuvent porter que sur des droits corporels, incorporels ou des créances, à l’exclusion des immeubles, des fonds de commerce et des parts d’associés.
On notera qu’en cas d’application de la procédure de flagrance fiscale lors d’un contrôle portant sur des activités illicites, le calcul du montant des saisies conservatoires est égal au montant des revenus déterminés au regard de la valeur vénale des biens objet du trafic ou ayant servi à sa réalisation.
L’article 1740 B du code général des impôts institue un régime spécifique d'amendes en cas de flagrance fiscale :
– le montant de l'amende s'élève à 5 000 euros ;
– ce montant est porté à 10 000 euros si le chiffre d'affaires hors taxes ou le montant des recettes brutes dépasse les limites prévues pour l'application des régimes de micro-imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou du forfait agricole ;
– ce montant est porté à 20 000 euros si, à la date du constat de flagrance fiscale, le chiffre d'affaires hors taxes ou le montant des recettes brutes excède les limites du régime simplifié d'imposition en matière de TVA ou de bénéfice agricole.
Les amendes dues au titre de la flagrance fiscale ne sont pas exclusives de l'application d'autres sanctions et amendes.
Si la procédure de flagrance fiscale est lourde de conséquences (possibilité d’effectuer des saisies conservatoires, droit de reprise sur dix années, etc.), elle est toutefois encadrée par les réelles garanties dont bénéficie le contribuable. Dans un délai de huit jours à compter de la réception des procès-verbaux, celui-ci peut notamment ouvrir deux recours cumulatifs en référé, l’un contre le procès-verbal de flagrance fiscale et l’autre contre le procès-verbal de mise en œuvre des saisies conservatoires. Le juge des référés doit se prononcer dans un délai très bref (quinze jours), notamment pour apprécier le caractère sérieux du doute portant sur la régularité de la procédure.
Comme précisé précédemment, la flagrance fiscale concerne uniquement la période en cours, c’est-à-dire pour laquelle aucune obligation déclarative n’est encore échue.
Or, la fraude peut s’étendre ou concerner un exercice clos pour lequel l’obligation déclarative n’est pas échue. Dans cette hypothèse, l’administration ne peut pas recourir à la procédure de flagrance fiscale, même si l’obligation déclarative n’est pas échue.
Par ailleurs, le fait de limiter la procédure de flagrance fiscale à l’exercice en cours a pour conséquence de faire porter les contrôles sur des périodes relativement courtes, ce qui peut rendre plus difficile la collecte de documents prouvant la fraude.
En conséquence, le présent article propose d’étendre la flagrance fiscale à l’ensemble de la période pour laquelle l’obligation déclarative n’est pas échue, que l’exercice auquel se rapporte cette déclaration soit clos ou non.
Le présent article précise les termes relatifs au champ des fraudes donnant lieu à l’application de la procédure de flagrance fiscale, qui pouvaient apparaître comme trop restrictifs pour que l’administration puisse mener à bien ses contrôles.
Il est ainsi proposé de préciser que, dans le cadre de la réitération d’opérations sciemment non comptabilisées et de nature à priver la comptabilité de sa valeur probante, ces opérations sont prises en compte quelle que soit leur nature (commerciale ou non).
3.– L’extension de la flagrance fiscale en cas de réitération du non-respect de ses obligations déclaratives en matière de TVA par le contribuable
Cette extension est limitée aux cas les plus frauduleux, soit en l’absence réitérée de déclarations de TVA par des redevables soumis au régime réel normal d’imposition, qui sont tenus de déposer une déclaration chaque mois.
4.– L’extension de la flagrance fiscale aux constats de travail dissimulé opérés par d’autres administrations que l’administration fiscale
Le présent article prévoit que, lorsqu’une infraction relative au recours au travail dissimulé prévue à l’article L. 82221-1 du code du travail est constatée par des agents autres que ceux de l’administration des impôts et que ces derniers en ont été informés en application du droit de communication prévu aux articles L. 82 C et L. 101 du LPF, ils peuvent recourir à la procédure de flagrance fiscale.
Cette disposition permettra de lutter plus efficacement contre les fraudes liées à ce type d’activité, souvent constatée par les services de police et de gendarmerie, par l’inspection du travail ou les corps de contrôle des services de recouvrement des cotisations sociales (URSSAF).
Les saisies conservatoires sont étendues aux sûretés judiciaires que constituent les garanties prises sur des immeubles, des fonds de commerce et des parts d’associés, afin de mieux assurer le recouvrement de la créance par l’administration.
b) La majoration du montant de ces saisies par le montant de l’amende prévue en cas de flagrance fiscale
Afin de sécuriser le recouvrement de l’amende appliquée en cas de flagrance fiscale, son montant est ajouté au montant des impôts à recouvrer permettant de déterminer les saisies à effectuer.
L’amende prévue en cas de recours à la procédure de flagrance fiscale est majorée si cette procédure intervient dans le cadre d’activités illicites de façon à atteindre :
– 10 000 euros si le revenu imposable évalué par l’administration excède le seuil de la quatrième tranche du barème progressif de l’impôt sur le revenu mentionné à l’article 197 du code général des impôts, soit 26 420 euros ;
– 20 000 euros si ce revenu excède le seuil de la cinquième tranche du même barème progressif, soit 70 830 euros.
III.– LA PROCÉDURE JUDICIAIRE D’ENQUÊTE FISCALE
L'article 23 de la loi n° 2009-1674 de finances rectificative pour 2009 du 30 décembre 2009, adopté à l’initiative de la commission des Finances de l’Assemblée nationale, a institué une procédure judiciaire d'enquête fiscale visant à renforcer les moyens de l’administration en matière de répression pénale de la fraude fiscale (34).
Cette procédure repose sur l’octroi à des agents des services fiscaux de pouvoir de police judiciaire afin de conduire des enquêtes dans le cas des fraudes fiscales les plus graves.
La procédure d’enquête judiciaire prévue à l’article L. 228 du LPF ne peut être mise en œuvre que si trois conditions cumulatives sont réunies :
– l’existence de présomptions caractérisées d’une infraction fiscale ;
– une infraction fiscale reposant sur l’un des comportements ou moyens mentionnés expressément par l’article ;
– un risque de dépérissement des preuves.
La présomption est caractérisée lorsque des indices suffisants corroborent l’existence de la fraude, sans qu’il soit néanmoins possible, au regard des preuves accumulées, de mettre directement en œuvre des poursuites. Les montages pour échapper à l’impôt pouvant se révéler extrêmement complexes, un travail préalable conséquent et étayé doit avoir été réalisé pour retenir l’existence d’une telle présomption.
b) Les cas de fraude visés par la procédure d’enquête judiciaire
L’article L. 228 précité mentionne expressément les trois cas de fraude au titre desquels peut être appliquée la procédure d’enquête judiciaire. Il s’agit toujours de fraudes complexes réalisées au moyen de :
– l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un État ou territoire qui n'a pas conclu avec la France, depuis au moins trois ans au moment des faits, de convention d'assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale française ;
– l'interposition, dans un État ou territoire mentionné précédemment, de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable ;
– l’usage de faux.
Le risque de dépérissement des preuves est pris en compte afin de limiter toute altération ou perte, au détriment de l’administration, des éléments pouvant établir la réalité de la fraude.
d) La saisie de la Commission des infractions fiscales dans des conditions dérogatoires du droit commun
Dans les conditions de droit commun, l’administration peut saisir le parquet d’une plainte tendant à l’application de sanctions pénales en matière fiscale, après avis conforme de la Commission des infractions fiscales.
Avant de rendre cet avis, la Commission examine l’affaire qui lui est transmise par l’administration fiscale et invite le contribuable à lui communiquer toute information utile dans un délai de trente jours.
Dans le cas de la présomption d’une fraude complexe et du risque d’un dépérissement des preuves, une exception est prévue par l’article L. 228 de sorte que le contribuable ne soit pas informé de la saisine, ni de l’avis rendu par la Commission. En effet, en matière de contentieux fiscal, la réactivité de l’administration, puis des services judiciaires, est décisive pour aboutir à des sanctions effectives.
À l’issue de l’examen de l’affaire, la Commission des infractions fiscales rend un avis sur l’existence d’une présomption, qui cependant ne lie pas le ministre.
Les compétences des nouveaux officiers fiscaux judiciaires sont très encadrées. Les agents des services fiscaux de catégorie A et B, désignés dans un cadre strict (arrêté des ministres de la justice et du budget, pris après avis conforme de la Commission des infractions fiscales), sont habilités personnellement par le procureur général près la cour d’appel du siège de leur fonction. Ils sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d’instruction. Ils sont compétents, sur l’ensemble du territoire, pour rechercher ou constater un cas de fraude fiscale complexe reposant sur l’usage de faux (fausse identité, faux documents…) ou sur le recours à des comptes détenus directement ou indirectement dans des États non coopératifs en matière de renseignements fiscaux. Ils sont également compétents pour rechercher et constater les infractions connexes aux délits de fraude fiscale (35). Dans le cadre de ces enquêtes, ils ne peuvent toutefois réaliser que des actes limitativement énumérés.
Dans la conduite de leur enquête, ces officiers bénéficient également de conditions dérogatoires au droit commun, de nature à garantir un contexte favorable à l’établissement de preuves (notamment, la prorogation du délai de reprise, la dérogation à l’interdiction de renouveler un contrôle fiscal et l’absence de limitation de la durée de contrôle sur place).
Par ailleurs, ils ne peuvent exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus dans le cadre de l’enquête dont ils sont saisis par l’autorité judiciaire, ni effectuer une enquête judiciaire sur des faits dont ils auraient eu à connaître dans le cadre d’une précédente procédure de contrôle fiscal.
Cette nouvelle procédure est entrée en vigueur au 1er janvier 2010, mais sa mise en œuvre effective est intervenue à la suite de la publication du décret n° 2010-1318 du 4 novembre 2010 portant création d’une brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, qui décline l’ensemble de ses missions, soit :
– animer et coordonner à l'échelon national et au plan opérationnel, les investigations de police judiciaire et les recherches entrant dans son domaine de compétence ;
– effectuer ou poursuivre à l'étranger les recherches liées aux infractions dont elle a à connaître ;
– centraliser les informations relatives à cette forme de délinquance ;
– fournir une assistance documentaire et analytique, à leur demande, aux services de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
Le décret précise que la brigade est composée à la fois d’officiers de police judiciaire et d’officiers fiscaux de police judiciaire.
Le présent article vise à étendre le périmètre de la procédure judiciaire d’enquête fiscale à deux nouveaux cas de fraudes fiscales complexes résultant :
– d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger,
– de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration.
En effet, ces cas de fraudes, très difficilement appréhendables par les procédures de recherche et de contrôle de droit commun du fait du caractère éphémère et de la complexité des montages mis en œuvre, pourront utilement faire l’objet des procédures d’enquête judiciaire menées par la brigade de répression de la délinquance fiscale qui dispose des moyens adéquats pour collecter les preuves nécessaires à l’application des sanctions pénales.
*
* *
La Commission examine l’amendement CF 42 du rapporteur général.
M. le rapporteur général. Le Gouvernement propose que l’amende encourue par les contribuables ayant fait l’objet d’une procédure de flagrance fiscale au titre d’activités illicites soit majorée si leurs revenus, estimés par l’administration fiscale dans le cadre de cette procédure, sont supérieurs aux seuils de la quatrième et de la cinquième tranche de barème. Logiquement, la création d’une nouvelle tranche du barème dans le projet de loi de finances pour 2013 devrait conduire à celle d’une nouvelle tranche d’amende.
La Commission adopte l’amendement (Amendement n° 17).
Elle adopte ensuite l’article 8 ainsi modifié.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement CF 21 du président Gilles Carrez, portant article additionnel après l’article 8.
M. le président Gilles Carrez. Les contentieux fiscaux donnent lieu à deux procédures : l’une administrative, destinée à apprécier s’il y a eu fraude, et l’autre pénale. Lorsque les conclusions de la juridiction administrative et de la juridiction judiciaire diffèrent, le Tribunal des conflits est saisi. Or cette saisine n’a pas toujours lieu et il se produit des situations absurdes, comme celle d’un contribuable qui vient d’être condamné par la chambre criminelle de la Cour de cassation à deux ans d’emprisonnement ferme pour fraude fiscale, alors que le juge administratif avait décidé qu’il n’y avait pas eu de fraude fiscale.
L’amendement tend à ce que les sanctions pénales ne soient pas applicables lorsque le juge administratif a établi par une décision définitive que l’impôt n’est pas dû. Il s’agit là du respect des droits élémentaires des citoyens.
M. le rapporteur général. Je ne suis pas favorable à votre amendement. Une intention frauduleuse peut être établie en droit pénal, alors que des questions de procédure peuvent amener le juge administratif à décharger le contribuable de certaines impositions. Les procédures pénale et fiscale ont des objets distincts : la première doit statuer sur la responsabilité pénale du contribuable, tandis que la seconde doit permettre de statuer sur le montant de la dette fiscale. Les plaintes tendant à l’application des sanctions pénales en matière d’impôts directs, de TVA, de droits d’enregistrement, de taxe sur la publicité et de droit de timbre sont déposées par l’administration sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales.
M. Charles de Courson. Notre président pose un vrai problème, mais je ne suis pas sûr que la solution qu’il propose soit adaptée. Le cas qu’il évoque est certes choquant mais comment se fait-il que le Tribunal des conflits n’ait pas été saisi ?
M. le président Gilles Carrez. Il semble que, dans certains cas, ce soit impossible.
M. Charles de Courson. Ce tribunal ayant pour mission de trancher en cas de différence d’interprétation entre les deux ordres de juridiction, il faudrait plutôt un amendement visant à lever les obstacles à sa saisine.
M. le rapporteur général. Ce tribunal est saisi sur les conflits de compétence, et donc sur des questions de procédure. Les cas individuels de décisions divergentes entre ordres judiciaires ne lui sont pas soumis.
M. Olivier Carré. Il est parfaitement justifié de durcir les dispositifs de lutte contre la fraude, mais il nous faut veiller aussi à préserver les droits fondamentaux des contribuables.
M. le président Gilles Carrez. Depuis plusieurs années, d’un commun accord, nous durcissons la lutte contre la fraude fiscale. Mais des cas comme celui que j’évoquais risquent de saper la confiance des contribuables envers l’État. Comment, en effet, expliquer à nos concitoyens que l’on peut être condamné à une peine de prison alors que l’on n’a pas fraudé le fisc, puisque la juridiction administrative en a définitivement jugé ainsi ? Ayons le courage de le reconnaître : les textes législatifs ne sont pas toujours clairs et l’interprétation qu’en livrent les textes réglementaires donne à réfléchir. Mon rapport d’information annuel en tant que Rapporteur général sur l’application de la loi fiscale l’a montré au cours des dernières années : nombreux sont les textes d’application non publiés ou manifestement contraires à l’intention du législateur.
Mme Sandrine Mazetier. Votre majorité n’a pas eu les mêmes scrupules à inverser l’ordre d’intervention du juge judiciaire et du juge administratif dans le contentieux des étrangers, ce qui a permis de prononcer de nombreuses mesures d’éloignement du territoire sans que le juge des libertés et de la détention ait pu statuer sur la légalité de la privation de liberté. C’était même l’objectif quasi explicite de la réforme.
M. le président Gilles Carrez. On ne justifie pas une injustice par une autre, voyons !
Mme Sandrine Mazetier. Ensuite, je suis surprise que l’on envisage de remettre en cause l’indépendance des deux ordres de juridiction et d’instaurer une prééminence du juge administratif sur le juge judiciaire, et ce par un simple amendement en commission des finances, fût-il déposé par son président.
Je m’étonne enfin que l’on puisse condamner quelqu’un qui n’a rien fait à une peine privative de liberté. Le juge qui a prononcé la peine ne s’est sans doute pas totalement désintéressé de ce que cette personne avait pu faire en matière fiscale.
M. le président Gilles Carrez. Il ne s’y connaissait peut-être pas en fiscalité !
M. Henri Emmanuelli. Depuis plusieurs années, loin de régresser, la fraude fiscale est en forte hausse. Son montant dépasse peut-être même aujourd’hui celui des déficits budgétaires courants que nous avons pu connaître. Les cabinets d’avocats spécialisés en optimisation fiscale se sont développés au niveau national et international. Face à eux, l’administration est de moins en moins bien armée. Olivier Carré a laissé entendre que nous persécuterions le contribuable. Ce n’est pas vrai. N’oublions pas que la fraude fiscale est un délit pénal dans bien d’autres pays ; voyez la législation et les méthodes américaines en la matière. Je ne voterai donc pas cet amendement.
M. Patrick Ollier. Je suis tout à fait d’accord avec M. Emmanuelli pour combattre la fraude fiscale, mais il s’agit ici de dénouer une situation qui confine à l’absurde. Il n’est pas question d’établir la priorité d’un ordre de juridiction sur un autre, mais de faire en sorte que la fraude soit réellement constatée avant qu’une condamnation puisse être prononcée. Cet amendement de bon sens, qui n’a rien de politique, devrait donc être adopté.
M. Henri Emmanuelli. Le cas cité est rarissime !
M. Patrick Ollier. Raison de plus pour voter un amendement qui ne produira peut-être ses effets qu’une fois par an.
M. Éric Woerth. Cet amendement est en effet marqué au coin du bon sens. Au cours des cinq dernières années, nous avons tous pris des mesures visant à lutter plus efficacement contre la fraude fiscale et sociale, dotant l’administration fiscale de pouvoirs et d’outils nouveaux pour faire face aux infractions nationales et internationales. Pourtant, nos concitoyens ont le sentiment que nous ne faisons rien contre la fraude fiscale. Ce problème nous concerne tous, quelle que soit notre appartenance politique. Nous devons montrer que, conformément aux principes de l’État de droit, l’administration dispose des moyens juridiques, financiers et humains d’agir. Or la condamnation au pénal d’un contribuable de bonne foi qui n’est, selon la justice administrative, redevable d’aucun impôt nourrit une incompréhension qui nuit à la lutte contre la véritable fraude.
M. Dominique Lefebvre. Le groupe SRC ne votera pas l’amendement, pour au moins deux raisons. Premièrement, une telle disposition ne doit pas paraître priver la lutte contre la fraude fiscale de l’une de ses armes. Deuxièmement, sans connaître en détail le partage des compétences entre les juges administratif et judiciaire en matière de contentieux fiscal, sans rien savoir du cas d’espèce, j’observe que c’est la chambre criminelle de la Cour de cassation, plus haute instance judiciaire, qui s’est prononcée ici. Quoi qu’il en soit, si l’on doit toucher à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, ce ne saurait être sur un coin de table en commission des finances. Mieux vaudrait, monsieur le président, retirer votre amendement afin d’approfondir ces questions en lien avec la commission des Lois.
M. Christophe Caresche. Sans me prononcer quant au fond, je m’interroge sur la qualité juridique de l’amendement. Comment pourrait-on ne pas appliquer des sanctions qui ont été décidées par une juridiction judiciaire ? En outre, ne risque-t-on pas de remettre en question l’indépendance du juge ?
Mme Arlette Grosskost. Le juge dit le droit, même s’il dispose d’une marge d’interprétation. Nous sommes le législateur, et non une chambre d’enregistrement de la jurisprudence. Ce n’est pas à nous d’interpréter les dires du magistrat.
M. Henri Emmanuelli. Ce n’est pas ce qu’a dit M. Caresche.
M. Charles de Courson. À mon sens, nous ne pouvons pas voter l’amendement en l’état. En effet, il est privé d’effet dans tous les cas où le juge pénal se prononce avant la décision définitive du juge administratif, car l’on ne peut pas revenir sur une décision de justice. Le véritable problème, comme l’indique d’ailleurs l’exposé des motifs, est le champ de compétence du Tribunal des conflits. C’est en étendant ce champ que l’on trouvera une issue à ce type d’affaire, dans le respect de l’indépendance de la magistrature.
M. le président Gilles Carrez. Je suis sensible aux arguments de MM. Lefebvre et de Courson. Les relations complexes entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif sont en effet à l’arrière-plan de cet amendement. Cela étant, le problème reste entier.
M. Henri Emmanuelli. La Cour de cassation s’est prononcée !
M. le président Gilles Carrez. Oui, mais après que le juge administratif a rendu sa décision définitive.
Je suis disposé à retirer mon amendement pour le redéposer au titre de l’article 88, afin de connaître la position du Gouvernement à ce sujet et ses éventuelles propositions. Mais la médiatisation de ce cas pourrait discréditer notre lutte contre la fraude fiscale aux yeux de nos concitoyens.
L’amendement est retiré.
La Commission en vient à l’amendement CF 23 de M. Éric Woerth.
M. Éric Woerth. Aux termes de cet amendement, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l’exil fiscal qui sera joint au projet de loi de finances chaque année. Sur ce sujet qui nous intéresse tous depuis longtemps, on lit tout et n’importe quoi et les chiffres les plus divers circulent. Le Gouvernement peut seul nous éclairer, malgré la difficulté de l’exercice.
M. le président Gilles Carrez. Je suis cosignataire de cet amendement. La question suscite des rumeurs incessantes, de plus en plus folles, dans la presse et dans différents milieux, dont celui des notaires et des avocats fiscalistes. Au nom de l’intérêt général, il faut y mettre fin en clarifiant la situation. J’ai donc envoyé au ministre un questionnaire qui s’appuie notamment sur le suivi des déclarations d’ISF et surtout, de celles des plus-values latentes au titre de l’exit tax que nous avons instaurée en 2011. Le quitus fiscal ayant été supprimé il y a plusieurs années, nous devons nous doter d’un appareil statistique. Voilà pourquoi je suis également favorable à un rapport.
M. le rapporteur général. Je vous félicite, monsieur le président, d’avoir écrit au ministre pour lui demander des informations – j’aurais pu en faire autant compte tenu des pouvoirs des rapporteurs généraux des commissions des Finances – et j’espère que vous nous communiquerez ses réponses.
M. le président Gilles Carrez. Bien sûr !
M. le rapporteur général. Quant aux rumeurs, certains de ceux qui les alimentent ne seraient-ils pas parmi nous ?
En somme, monsieur le président, vous demandez un « jaune » supplémentaire alors que la LOLF vous fournit déjà en tant que président de la Commission les moyens d’obtenir les informations que vous demandez. Vous précisez en outre vouloir disposer d’« éléments d’appréciation de l’attractivité fiscale de la France ». Mais notre rôle est de faire les lois qui déterminent notre fiscalité, laissant chacun libre d’apprécier ensuite, en ses grade et qualité, l’attractivité fiscale de notre pays.
Avis défavorable.
M. Pascal Terrasse. Nous voulons tous la même chose : la vérité sur les exilés fiscaux – sans oublier ceux qui rejoignent notre territoire national pour des raisons fiscales, par exemple depuis Jersey à la suite des dispositions prises par différents États, comme me le disait tout récemment le directeur de l’autorité financière de l’île. Éric Woerth a raison de vouloir la vérité sur l’exil fiscal et notre président d’interroger le Gouvernement à ce sujet, mais, comme l’a dit le rapporteur général, ce n’est pas en ajoutant un article au projet de loi de finances rectificative qu’ils parviendront à leurs fins. Lorsqu’il aura obtenu tous les renseignements nécessaires, notre président devrait plutôt organiser un débat annuel sur le sujet au sein de notre Commission ; ce serait préférable à un amendement « bavard », si vous me permettez l’expression.
M. le président Gilles Carrez. Monsieur Terrasse, je vous signale que le rapport demandé porte non seulement sur les départs, mais également sur les retours.
Il ne faudrait pas donner l’impression que le Gouvernement, voire la majorité, ne voit pas où est le problème, car sur ce sujet qui intéresse beaucoup tous nos concitoyens, le déni serait la pire attitude à adopter. En s’efforçant d’y voir clair, notre Commission est tout à fait dans son rôle. Voilà pourquoi j’ai envoyé le questionnaire sous mon autorité de président, comptant bien proposer à la Commission de poursuivre ce travail. Voilà également pourquoi nous demandons au Gouvernement un rapport annuel.
M. Jean-François Lamour. Je suis tout à fait d’accord avec le président. En évoquant le déficit d’informations sur les entrées et les départs de contribuables ainsi que l’existence de rumeurs, le rapporteur général et M. Terrasse reconnaissent du reste implicitement l’utilité d’un tel rapport. C’est en obtenant chaque année du Gouvernement des chiffres dont nous pourrons débattre que nous établirons la vérité. La demande est d’autant plus équilibrée qu’elle s’étend à ceux qui, en venant sur notre territoire, en confirment l’attractivité fiscale. En outre, repris chaque année, l’exercice permettra de dégager une tendance.
M. Éric Woerth. La position du rapporteur général est un peu surprenante. Sur ce sujet sans cesse débattu, il s’agit de clarifier la situation, non d’obtenir un énième « jaune ». Du reste, lorsque vous étiez dans l’opposition, vous ne manquiez pas de demander des rapports, que la majorité acceptait quasi systématiquement. Pourquoi, en effet, ne pas chercher à travailler dans de meilleures conditions ? Pourquoi ne pas tordre le cou aux rumeurs ? Mais pour y parvenir, il nous faut des données. À chacun d’en tirer ensuite les conséquences politiques qu’il voudra ! La fiscalité, l’attractivité fiscale du territoire, le patriotisme fiscal, enjeux essentiels pour l’avenir qui sont débattus publiquement, doivent l’être à la lumière d’éléments fournis par le Gouvernement, dont la teneur et le mode de calcul soient indiscutables. Il ne suffit pas que le président de la commission des Finances demande ponctuellement tel ou tel document ; les données devraient être sur la place publique.
M. Charles de Courson. Je suis favorable à cet amendement. Il nous a fallu plusieurs mois, voire plusieurs années pour obtenir, à propos de l’ISF du moins, une estimation du nombre de départs et de retours. Reste le problème de ceux qui sont partis pour ne pas être assujettis à cet impôt.
M. le président Gilles Carrez. L’exit tax permet d’en savoir plus.
M. Charles de Courson. Si nos collègues sont indisposés par le dernier membre de phrase – « avoir des éléments d’appréciation de l’attractivité fiscale de la France » –, je propose de le supprimer par un sous-amendement.
Lorsque l’on nous demande combien de Français sont partis pour échapper à l’ISF, nous ne sommes pas en mesure de répondre. Et combien reviennent ? Les chiffres qui nous ont été fournis font état d’environ 800 départs et de 300 à 400 retours, mais quelles en sont les causes ? Nous avons besoin de ces données.
M. le président Gilles Carrez. L’ISF fait l’objet d’une déclaration annuelle. Aujourd’hui, nous ne connaissons pas encore les mouvements correspondant à l’année 2010, alors qu’il serait normal de disposer aujourd’hui, fin novembre 2012, des données pour 2011. Je suis donc favorable au sous-amendement de M. de Courson.
Soyons raisonnables : pourquoi pas un « jaune » sur les départs et retours pour raisons fiscales ? Notre majorité avait bien accepté en son temps un « jaune » sur la lutte contre le changement climatique !
M. le rapporteur général. Je suis défavorable à votre amendement, monsieur le président, même sous-amendé par M. de Courson. Savez-vous, mes chers collègues, qu’il existe depuis 2009 un « jaune » sur la fraude fiscale ? Qui en a fait état au cours des derniers débats ? Personne ! Depuis que je siège ici, je n’en ai jamais entendu parler. Faut-il vraiment en demander un de plus ? Vous faites valoir que celui qui existe n’est pas exploitable. Ce qui implique le cas échéant que l’on demande un nouveau rapport, puis un rapport considéré comme exploitable, puis des modifications, etc.
Le Gouvernement vous a récemment fourni les données précises relatives aux niches fiscales que vous lui aviez demandées.
M. le président Gilles Carrez. Ce qui vous a aidé, monsieur le rapporteur général, à soumettre les SOFICA au plafond !
M. le rapporteur général. Je ne vous reproche pas d’avoir formulé cette demande, monsieur le président. Je vous ai d’ailleurs remercié d’avoir adressé au Gouvernement un questionnaire sur l’exil fiscal – pour ne pas dire la fraude. Simplement, vous pouvez avoir tous les chiffres que vous souhaitez, même s’il peut être nécessaire de s’y reprendre à deux fois, ce qui n’a rien de nouveau. Continuons ainsi. Pourquoi un rapport de plus ?
M. Éric Woerth. Monsieur le rapporteur général, vous n’êtes pas comptable du surcroît de travail que notre amendement va demander au Gouvernement : vous êtes le Parlement, non le porte-parole du Gouvernement en son sein ! Il est bien naturel que la commission des Finances puisse obtenir des données, qu’il nous appartient d’exploiter ensuite ou non. Sur un sujet aussi important, l’on ne peut se contenter de dire qu’un rapport de plus ne servira à rien – à moins d’avoir intérêt à faire obstacle à la transparence, ce qui serait très regrettable.
M. Alain Fauré. Monsieur le président, je regrette que votre amendement ait été présenté à la presse comme un carton rouge adressé au Gouvernement. Si vous n’en aviez pas fait état à l’extérieur de cette manière provocatrice, nous aurions pu envisager de le voter.
La Commission rejette l’amendement.
*
* *
Lutte contre la fraude TVA sur la vente de véhicules d’occasion
Texte du projet de loi :
I.– Après le 4 bis de l’article 283 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4 ter. L’assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de véhicules terrestres à moteur et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de cette livraison ou de toute livraison antérieure des mêmes véhicules ne pouvait pas bénéficier du régime prévu à l’article 297 A est solidairement tenu d’acquitter la taxe frauduleusement éludée avec tout assujetti partie à cette livraison ou à toute livraison antérieure des mêmes véhicules. »
II.– Le I est applicable aux livraisons effectuées à compter du 1er janvier 2013.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article vise à améliorer les moyens de lutter contre la fraude importante qui se développe depuis plusieurs années sur le marché intra-communautaire des véhicules d’occasion. Cette fraude s’appuie sur une utilisation abusive du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. L’objectif recherché par les opérateurs est d’imposer à la TVA, en France, la revente d’un véhicule non pas sur le prix de vente total, mais sur la marge bénéficiaire.
Les opérations portant sur les véhicules d'occasion sont en principe soumises au régime général des objets d'occasion.
Aux termes de l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts (CGI), sont considérés comme biens d'occasion les biens meubles corporels ayant déjà fait l'objet d'une utilisation mais susceptibles de réemploi, en l'état ou après réparation, quels que soient, pour les véhicules, leur kilométrage ou la date de leur première mise en circulation. Toutefois, l'article 298 sexies du CGI donne une définition spéciale des moyens de transport neufs en matière d'échanges intracommunautaires. Corrélativement, dans le cas de livraisons ou d'acquisitions intracommunautaires, sont considérés comme des véhicules automobiles d'occasion les véhicules qui sont livrés plus de six mois après leur première mise en service et qui ont parcouru plus de 6 000 kilomètres.
Pour les livraisons intracommunautaires de véhicules d’occasion, la TVA est en principe exigible sur la marge, conformément à l’article 297 A du CGI, sauf si le bien livré a déjà ouvert droit à déduction.
La fraude considérée ici vise à céder à des particuliers des véhicules, souvent haut de gamme, taxés indûment sur la marge et ne supportant donc que peu de TVA. Dans le cas le plus fréquent, le véhicule, vendu par un loueur professionnel à l’étranger, a déjà ouvert droit à déduction.
Les organisations professionnelles représentatives des entreprises du commerce automobile dénoncent depuis plusieurs années cette pratique à la fois frauduleuse et anti-concurrentielle, qui minore fortement le prix des véhicules.
Le schéma de fraude généralement rencontré est décrit comme suit dans l’évaluation préalable annexée au présent article.
Un négociant français achète des véhicules d’occasion auprès d’un fournisseur établi dans un État membre qui délivre une facture indiquant l’application du régime de la marge. Or ce fournisseur, qui n’a pas d’autre rôle que celui de société écran, a lui-même acquis le véhicule auprès d’un négociant établi dans un autre pays de l’Union selon le régime général de TVA, c’est-à-dire en payant et en récupérant la TVA sur la totalité du prix. Dans ce cas, le fournisseur ne peut pas normalement appliquer le régime de TVA sur la marge et il doit facturer la TVA sur la totalité du prix. Le véhicule, souvent issu d’un parc de loueur automobile, est lui directement livré de ce pays en France sans transiter par le pays de la société écran. Comme pour les schémas « carrousélistes », la fraude tend à se sophistiquer par l’interposition supplémentaire d’une ou deux structures écrans en France destinées à protéger le négociant final, généralement un concessionnaire, principal bénéficiaire de la fraude. |
S’il est difficile de chiffrer les pertes de recettes pour les finances publiques, la TVA éludée s’élève probablement à quelques centaines de millions d’euros.
Le Conseil d’État (36) autorise la remise en cause du régime d’imposition sur la marge si ce régime n’était pas applicable et si l’administration fiscale peut démontrer que l’acquéreur savait, ou ne pouvait ignorer, que son fournisseur n’était lui-même pas autorisé à appliquer ce régime d’imposition.
Le présent article prévoit de rendre solidaire du paiement de la taxe frauduleusement éludée l’assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de véhicules terrestres à moteur et qui savait, ou ne pouvait ignorer, que tout ou partie de cette livraison ou de toute livraison antérieure des mêmes véhicules ne pouvait pas bénéficier du régime de la marge. Il complète en ce sens l’article 283 du CGI, qui fixe les exceptions au principe selon lequel la TVA doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables.
Cette mesure devrait améliorer le recouvrement de la TVA, puisque le premier acquéreur français du véhicule, auprès duquel l’administration remet en général en cause le bénéfice du régime de la TVA sur la marge, est souvent sans consistance économique et insolvable.
Elle s’appliquerait aux livraisons effectuées à compter du 1er janvier 2013.
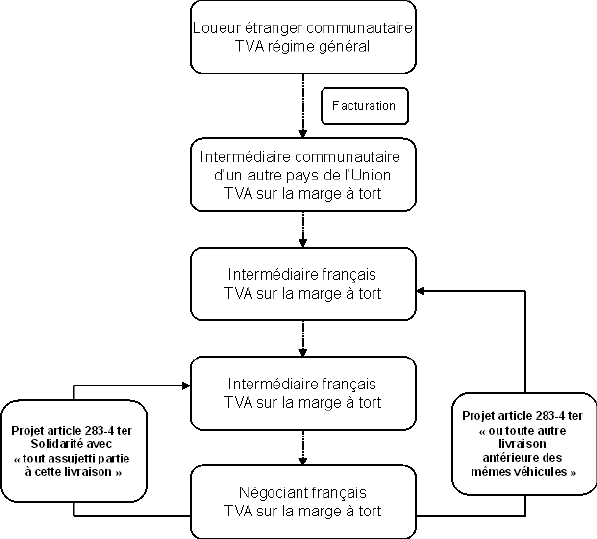
Source : ministère du Budget.
Une disposition similaire est déjà prévue par le 4 bis de l’article 283 du CGI, qui prévoit une solidarité entre les différents acteurs de la chaîne de déduction en cas de fraude de type carrousel. Toutefois, elle ne s’applique pas pour les fraudes sur les véhicules d’occasion car elle suppose le non reversement d’une TVA facturée par un fournisseur. Or, dans le schéma de fraude au régime de TVA sur la marge, le premier acquéreur n’est pas défaillant puisqu’il a en règle générale acquitté la TVA, mais sur la marge.
Le présent article reprend l’obligation, issue de la jurisprudence, pour l’administration de démontrer que l’assujetti solidairement tenu au paiement de la taxe éludée savait ou ne pouvait ignorer que son fournisseur n’était pas autorisé à appliquer le régime de la TVA sur la marge.
Cette condition limite la portée de la réforme, mais est nécessaire au regard du droit communautaire, qui voit dans toute règle de solidarité une atteinte à la neutralité économique de la TVA. Conformément au principe de personnalité des peines, la solidarité porte sur le paiement de la taxe mais pas sur les pénalités.
*
* *
La Commission adopte l’article 9 sans modification.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement CF 37 de M. Marc Le Fur, portant article additionnel après l’article 9.
Mme Marie-Christine Dalloz. Il s’agit d’harmoniser les taux de TVA applicables à un produit que nombre de nos concitoyens jugent de première nécessité : le café, le « petit café ». Alors que 14 millions de boissons chaudes sont préparées et consommées chaque jour, il y a lieu de s’étonner de la disparité entre le taux de 5,5 % applicable à l’achat du café ou de la poudre à café et la taxation à 7 % du café préparé dans un estaminet.
M. le rapporteur général. Je suis évidemment défavorable à cet amendement, dont l’exposé sommaire est édifiant.
L’un des amendements du Gouvernement que nous examinerons cet après-midi porte sur la modification des taux de TVA et engage quelque six milliards d’euros. Nous devrons le sous-amender, notamment pour tenir compte du fait qu’une part de la TVA est affectée aux recettes de la sécurité sociale, des effets de la mesure sur les collectivités territoriales, et pour moduler les taux sur certains produits ou services. Or je doute qu’il soit possible de le faire avant l’examen du texte en séance publique, prévu lundi. Puisque les modifications des taux de TVA ne s’appliqueront qu’à compter du 1er janvier 2014, nous pourrons attendre un prochain collectif et, au plus tard, le projet de loi de finances initiale pour 2014 pour en reparler s’agissant du café, du logement social, de la restauration, de l’assainissement, des transports publics, etc. Je ne souhaite pas que nous légiférions en quelques jours sur ces importantes questions qui appellent une analyse précise et chiffrée. Nous sommes assez souvent contraints de travailler en très peu de temps sur des sujets majeurs pour nous abstenir de le faire lorsque cela est possible.
M. le président Gilles Carrez. Je soutiens pleinement cette position. J’étais rapporteur général lorsque la TVA sur certains produits a été portée de 5,5 à 7 %, dans le cadre du collectif budgétaire de décembre 2011, et je peux témoigner de l’extrême complexité des problèmes de coordination avec la loi de financement de la sécurité sociale, ainsi que d’harmonisation de la fiscalité sur un même type de produits. Nous devrons y travailler au cours de l’année 2013, par exemple, en effet, à l’occasion d’un prochain collectif.
Mme Karine Berger. Je partage l’analyse du rapporteur général : il est impossible dans le délai proposé à la commission des Finances et à l’Assemblée nationale d’entrer dans le détail des mesures – pourtant de portée considérable – inscrites dans ce collectif.
Toutefois, dans certains secteurs touchés par la hausse de TVA envisagée, l’horizon temporel des contrats conclus par les entreprises peut être éloigné. C’est le cas, en particulier, des décisions de construction de logements sociaux, qui doivent intégrer les prévisions de rentabilité à long terme.
Le raisonnement du rapporteur général et du président vaut pour la très grande majorité des secteurs. Il faudra néanmoins tenir compte, dès 2013, des mises en chantier déjà décidées, qui connaissent d’ailleurs des difficultés.
M. le président Gilles Carrez. C’est ce que rappelait très justement notre collègue Jean-Louis Dumont lors de l’examen du collectif de décembre 2011.
M. le rapporteur général. S’agissant des mises en chantier déjà décidées, le Gouvernement a prévu des mesures transitoires, qui répondent à la préoccupation légitime de Mme Berger.
M. Dominique Lefebvre. Nous devons rejeter cet amendement pour les raisons indiquées par le rapporteur général. Le Gouvernement engage une réforme en profondeur de la TVA. En fixant les trois taux à 5 %, 10 % et 20 %, il simplifie et modernise son architecture. Les mesures ponctuelles telles que celle prévue par cet amendement – sur le cas typique d’un produit qui n’est pas taxé de la même manière selon qu’il est acheté en magasin ou consommé dans d’autres conditions – n’iraient pas dans le sens de la cohérence.
En outre, la hausse de la TVA vise à financer le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Compte tenu de la situation des finances publiques, nous ne pouvons et ne pourrons réformer la TVA qu’à rendement constant. Après l’adoption des amendements du Gouvernement, nous prendrons le temps nécessaire pour procéder à des réajustements entre les différents taux de TVA en respectant cette condition.
Mme Marie-Christine Dalloz. J’entends bien l’argumentation du rapporteur général. Je me propose de faire de l’amendement CF 37 un sous-amendement à l’amendement correspondant du Gouvernement après l’article 24.
M. le président Gilles Carrez. Il devrait en effet être possible de le présenter sous cette forme.
L’amendement CF 37 est retiré.
*
* *
Marquage obligatoire et traçabilité des produits du tabac. Consolidation
du dispositif des « coups d’achat » sur Internet
Texte du projet de loi :
I.– Le code général des impôts est modifié comme suit :
A.– Après l'article 564 undecies, il est inséré un article 564 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 564 duodecies.– 1. Les paquets, cartouches et tous conditionnements de cigarettes sont, lors de leur importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation, revêtus d'une marque d'identification unique, sécurisée et indélébile, qui permet de garantir leur authentification et leur traçabilité ainsi que d'accéder à des informations relatives aux mouvements de ces cigarettes.
« Les informations mentionnées au premier alinéa sont contenues dans des traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par et aux frais des personnes se livrant aux activités mentionnées au premier alinéa. Ces traitements, lorsqu'ils sont établis en France, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes responsables de ces traitements ont l'obligation d’informer les personnes concernées par lesdits traitements.
« 2. Toute personne responsable du traitement mentionné au 1 est tenue de s'assurer de la fiabilité des informations afin d'établir le lien entre le produit revêtu de la marque et lesdites informations.
« 3. Les informations mentionnées au second alinéa du 1 sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur intégration dans le traitement.
« 4. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d'apposition de la marque d'identification unique et détermine les catégories de données faisant l'objet du traitement informatique ».
B.– À l'article 1825, le mot : « prévues » est remplacé par le mot : « mentionnées » et les mots : « de huit jours » sont remplacés par les mots : « ne pouvant excéder trois mois ».
II.– Au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, après le chapitre I quater, il est inséré un chapitre I quinquies ainsi rédigé :
« Chapitre I quinquies. – Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des produits du tabac
« Art. L 80 N.- 1. Pour rechercher et constater les infractions prévues par le code général des impôts en matière de tabac, les agents de l'administration des douanes de catégorie A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus par l'article 564 duodecies du code général des impôts, au moyen de la marque d'identification unique, sécurisée et indélébile mentionnée à cet article.
« Les frais occasionnés par l'accès à ces traitements sont à la charge des personnes responsables de ces traitements se livrant aux activités mentionnées au premier alinéa de l'article 564 duodecies du code général des impôts.
« En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation mentionnée au deuxième alinéa est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction.
« 2. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d'accès aux données mentionnées au 1, par les agents de l'administration des douanes mentionnés au 1. »
III.– Le code des douanes est ainsi modifié :
A.– À l'article 67 bis-1 :
1° Au premier alinéa, après les mots : « aux seules fins de constater l'infraction », sont insérés les mots :
« d'importation, d'exportation ou » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« 3° Lorsque l'infraction est commise par un moyen de communication électronique, faire usage d'une identité d'emprunt en vue de l'acquisition des produits stupéfiants.
« Dans ce cadre, les agents des douanes habilités peuvent également :
« a) Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques,
« b) Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de l'infraction,
« c) Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de l'infraction ainsi que les comptes bancaires utilisés.
« L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'acquisition, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération. » ;
3° Après le quatrième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
« La révélation de l'identité d'emprunt des agents des douanes ayant effectué l'acquisition est passible des peines prévues au V de l'article 67 bis du présent code. » ;
4° Au dernier alinéa après les mots : « aux fins de constatation de l'infraction », sont insérés les mots : « d'importation, d'exportation ou » et après les mots : « de détention de », sont insérés les mots : « tabac manufacturé et de ».
B.– Après le chapitre IV du titre II, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis.– Consultation des traitements automatisés de données aux fins de contrôles douaniers.
« Art. 67 quinquies.– Pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code en matière de tabac, les agents de l'administration des douanes ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus par l'article 564 duodecies du code général des impôts, dans les conditions prévues par l'article L. 80 N du livre des procédures fiscales.
« En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation des informations mentionnées au premier alinéa est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction ».
Observations et décision de la Commission :
Le présent article a pour objet de renforcer les moyens de lutte contre le commerce illégal de produits du tabac.
Pour ce faire, trois types de mesures sont proposés :
– l’instauration d’un système de marquage des paquets de cigarettes, permettant d’en assurer la traçabilité ;
– le renforcement des moyens juridiques des agents des douanes réalisant des « coups d’achat » sur Internet, notamment en leur permettant d’utiliser une identité d’emprunt ;
– l’allongement de huit jours à trois mois de la durée de fermeture des établissements dans lesquels a été constatée une infraction à la législation sur le tabac.
L’impact sur les ressources publiques, qui devrait être positif, n’est toutefois pas chiffrable.
L’article 15 de la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte anti-tabac (entrée en vigueur le 27 février 2005) stipule que « chaque Partie adopte et applique des mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures efficaces pour faire en sorte que tous les paquets et cartouches de produits du tabac et toutes les formes de conditionnement extérieur de ces produits comportent une marque pour aider les Parties à déterminer l’origine des produits du tabac et, conformément à la législation nationale et aux accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents, pour aider les Parties à déterminer le point où intervient le détournement et à surveiller, suivre et contrôler le mouvement des produits du tabac et leur statut en droit ».
Chaque État partie envisage à cette fin « la mise en place d’un régime pratique permettant de suivre et de retrouver la trace des produits de manière à rendre le système de distribution plus sûr et de contribuer aux enquêtes sur le commerce illicite ».
Un protocole additionnel à cette convention a été adopté le 12 novembre dernier à Séoul ; selon les termes du communiqué de presse de l’OMS (37), ce protocole « engage les pays à instaurer un système mondial de suivi et de traçabilité, mesure cruciale pour réduire le commerce illicite des produits du tabac ».
Anticipant un processus de ratification dont elle ne précise pas le calendrier, l’évaluation préalable annexée au présent article indique que celui-ci a notamment « pour objet la mise en œuvre de la convention-cadre précitée et le [sic] protocole qui sera ratifié par la France ». Le protocole sera ouvert à la signature à compter de janvier prochain.
Cette mise en œuvre appelle la création d’un nouvel article dans le code général des impôts (CGI), ainsi que d’un nouveau chapitre dans le livre des procédures fiscales (LPF) comme dans le code des douanes.
Le A du I du présent article introduit dans le CGI un nouvel article 564 duodecies, qui prévoit un système de repérage et de traçabilité des cigarettes. Selon l’exposé des motifs, un tel système devrait « permettre aux autorités de surveiller les mouvements des produits du tabac fabriqués légalement [et] de repérer les produits contrefaits ».
● Le 1 de ce nouvel article définit le champ, les modalités et les objectifs du marquage (alinéas 3 et 4). Doivent être marqués « les paquets, cartouches et tous conditionnements de cigarettes », c’est-à-dire l’emballage des cigarettes ou des paquets, et non les cigarettes elles-mêmes. Les conditionnements évoqués par le texte sont en fait les cartons contenant les paquets et les cartouches, eux-mêmes marqués. Par commodité, le terme « paquets » sera employé ci-après pour désigner toutes les formes de conditionnement.
● Le marquage a lieu lors de l’importation, de l’introduction, de l’exportation, de l’expédition ou de la commercialisation des paquets. Il faut rappeler ici que les termes « introduction » et « expédition » désignent respectivement l’importation et l’exportation d’un produit au sein de l’Union européenne. Cela signifie donc que tout paquet de cigarettes entrant en France, en sortant ou y étant commercialisé doit être marqué ; l’ensemble des paquets circulant sur le territoire est concerné.
● La marque d’identification des paquets doit être « unique, sécurisée et indélébile ». Aucun des termes employés ne pose de difficultés de définition, mais il aurait été utile que l’évaluation préalable fournisse des exemples concrets de marques d’identification répondant à ces critères. Il a été indiqué au Rapporteur général que la marque prendra la forme d’un code apposé sur les paquets.
● La marque doit permettre :
– de garantir l’authentification et la traçabilité des paquets ;
– d’accéder à des informations relatives aux mouvements des cigarettes.
Le premier objectif assigné à la marque ne soulève pas d’interrogation particulière. Il n’aurait pas été inutile que l’évaluation préalable prenne la peine de préciser le second. Selon les informations transmises au Rapporteur général, le code apposé sur les paquets permettra de retracer la « vie » des cigarettes depuis leur fabrication ou leur entrée sur le territoire français, jusqu’à leur première sortie du territoire. La liste des informations est en réalité déjà fixée, par l’article 8 du protocole précité (cf. encadré ci-dessous).
Informations relatives aux mouvements des cigarettes auxquelles la marque d’identification doit permettre d’accéder (4.1 de l’article 8 du protocole)
a) La date et le lieu de fabrication
b) L’unité de fabrication
c) La machine utilisée pour fabriquer les produits du tabac
d) L’équipe de production ou l’heure de fabrication
e) Le nom du premier acheteur qui n’est pas affilié au fabricant, le numéro de facture, le numéro de commande et l’état de paiement
f) Le marché sur lequel le produit est destiné à être vendu au détail
g) La description du produit
h) L’entreposage et l’expédition du produit, le cas échéant
i) L’identité de tout acheteur ultérieur connu
j) L’itinéraire prévu, la date d’expédition, la destination, le point de départ et le destinataire
● Il est précisé que les informations relatives aux mouvements des paquets de cigarettes « sont contenues (38) dans des traitements automatisés de données à caractère personnel » (alinéa 4).
L’article 2 de la loi dite « Informatique et libertés » (39) définit le traitement de données à caractère personnel comme « toute opération ou tout ensemble d’opération portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction ».
Le même article définit la donnée à caractère personnel comme « toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ».
Considérer les informations relatives aux mouvements de paquets de cigarettes comme des données à caractère personnel présuppose que ces mouvements font intervenir des personnes physiques identifiables. Il en résulte que la marque d’identification devra permettre d’identifier les individus opérant les mouvements des paquets de cigarettes. En cas d’expédition d’une palette de cartouches d’une société A située en France vers une société B située en Allemagne, la marque doit permettre de savoir qui, au sein de la société A a expédié la palette.
● Il est précisé que les traitements automatisés sont mis en œuvre par et aux frais des personnes se livrant aux activités d’importation, introduction, exportation, expédition et commercialisation des paquets de cigarettes. Le texte ne précise pas qui doit apposer la marque d’identification, l’obligation de marquage pesant en réalité sur le produit : un produit marqué peut circuler sur le territoire, quelle que soit la personne qui a procédé au marquage ; un produit non marqué ne le peut pas.
● Le texte indique que lorsque les traitements automatisés sont établis en France, ils sont soumis aux dispositions de la loi Informatique et libertés. Les garanties offertes par cette loi aux personnes physiques ne s’appliqueraient donc pas – ce qui est conforme au principe général de territorialité de la loi – aux traitements établis hors de France.
● Le texte indique en revanche que les personnes responsables des traitements ont l’obligation d’informer les personnes concernées par les traitements.
Dans le silence du texte, il est permis de penser que le responsable est défini comme à l’article 3 de la loi Informatique et libertés : « Le responsable d'un traitement de données à caractère personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à ce traitement, la personne, l'autorité publique, le service ou l'organisme qui détermine ses finalités et ses moyens ».
● Ce responsable doit en tout état de cause « s’assurer de la fiabilité des informations afin d’établir le lien entre le produit revêtu de la marque et lesdites informations » (2 du nouvel article – alinéa 5). L’exposé des motifs indique sobrement à ce sujet qu’« un traitement informatisé des données sera tenu par les professionnels du secteur. […] Le responsable du traitement doit pouvoir assurer la fiabilité des informations qu’il contient, grâce à un système de contrôle interne ».
Si l’on essaie d’illustrer cette disposition qui demeure imprécise, elle semble signifier que le dirigeant de la société A précédemment évoquée doit être en mesure de garantir, donc de vérifier, que l’indication d’un mouvement de la palette de cigarettes expédiée en Allemagne – recueillie au moyen du traitement automatisé mis en place par lui – correspond bien à la réalité.
● Le délai de conservation des informations sur les mouvements des paquets ne peut excéder trois ans ; il est décompté au moment de leur intégration dans le traitement automatisé (3 du nouvel article – alinéa 6).
● Le 4 du nouvel article (alinéa 7) prévoit qu’un décret en Conseil d’État (pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (40)) « fixe les conditions d’apposition de la marque d’identification unique et détermine les catégories de données faisant l’objet du traitement informatique ».
La notion de « traitement informatique » n’étant pas préalablement employée dans le texte, il faut sans nul doute entendre par là les traitements automatisés de données. Les « catégories de données » seront celles mentionnées à l’article 8 du protocole.
L’évaluation préalable indique qu’« un cahier des charges concernant ce marquage a été élaboré avec les acteurs du secteur du tabac », et que le décret en Conseil d’État « devra prévoir un délai de deux ans pour l’application de l’authentification des cigarettes et un délai de cinq ans pour l’application pour la traçabilité des cigarettes ».
Le II du présent article introduit un chapitre I quinquies dans le LPF, composé d’un article unique L. 80 N.
● Ce nouvel article prévoit en son 1 que les agents des douanes de catégorie A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements automatisés de données prévues par le nouvel article 564 duodecies du CGI (alinéa 11). Le texte précise que l’accès aux informations se fait « au moyen de la marque d’identification unique, sécurisée et indélébile ».
L’accès aux informations par les agents des douanes doit avoir pour objet de rechercher et constater les infractions prévues par le code général des impôts « en matière de tabac ».
● Il est précisé que les frais occasionnés par l’accès aux traitements de données automatisés sont à la charge des personnes responsables (alinéa 12). Selon les informations recueillies par le Rapporteur général, les frais en question sont ceux afférents à la constitution d’une interface d’accès pour l’administration.
● Lorsque la consultation des informations contenues dans le traitement de données permet de constater une infraction, il est prévu d’annexer le résultat de la consultation au procès-verbal. C’est ce qui doit être compris de la formulation de l’alinéa 13.
● Le 2 du nouvel article L. 80 N (alinéa 14) prévoit utilement qu’un décret en Conseil d’État (pris après avis de la CNIL) fixe les modalités d’accès « aux données mentionnées au 1 » ; le terme « données » n’étant pas employé au 1, il faut comprendre qu’il s’agit des informations contenues dans les traitements automatisés.
Le B du III du présent article introduit dans le code des douanes un nouveau chapitre IV bis, composé d’un article unique 67 quinquies.
Il s’agit quasiment d’un article de coordination, qui permet à l’ensemble des agents des douanes (et, vraisemblablement du fait d’une erreur de rédaction, pas seulement aux agents de catégorie A et B) d’accéder aux informations contenues dans les traitements automatisés prévus à l’article 564 duodecies du CGI, afin de rechercher et constater les infractions prévues par le code des douanes « en matière de tabac ».
L’accès se fait dans les conditions prévues à l’article L. 80 N du LPF (alinéa 31). La précision relative à la consignation des résultats de la consultation sur le procès-verbal est donc formulée dans les mêmes termes (alinéa 32).
II.– LE RENFORCEMENT DES MOYENS JURIDIQUES À DISPOSITION DES DOUANES EN CAS DE « COUP D’ACHAT »
L’article 67 bis-1 du code des douanes permet à des agents habilités par le ministre chargé des douanes d’être déchargés de toute responsabilité pénale lorsqu’ils se livrent à certaines activités illicites aux fins « de constater l’infraction de détention de produits stupéfiants, d’en identifier les auteurs et d’effectuer les saisies ». Soumis à autorisation du procureur de la République, les actes en question consistent :
– à acquérir des produits stupéfiants (1° de l’article 67 bis-1) ;
– à mettre des moyens à disposition de personnes se livrant à l’infraction, afin de leur permettre d’acquérir des produits stupéfiants (2°).
Cette technique dite de « coup d’achat » est également permise afin de constater l’infraction de détention de marchandises contrefaites.
Le A du III du présent article étend le champ de ce dispositif, dans une perspective de « consolidation des pouvoirs mis en œuvre par le service spécialisé "Cyberdouane" » (exposé des motifs). Les modifications proposées entreront en vigueur à la promulgation de la présente loi de finances.
● Le 1° du A (alinéas 17 et 18) étend le mécanisme du coup d’achat aux actes réalisés afin de constater les infractions d’importation et d’exportation des produits stupéfiants, au-delà de la seule infraction de détention.
● Le 4° (alinéa 28) procède à la même extension s’agissant des marchandises contrefaites.
Il élargit en outre le dispositif, au-delà des marchandises contrefaites, au tabac manufacturé. L’intention du texte est de permettre de réaliser des coups d’achat de tabac non contrefait mais importé, exporté ou détenu illégalement. L’évaluation préalable justifie ainsi la mesure par « l’augmentation de la vente de cigarettes authentiques en ligne ». Mais du fait de la rédaction proposée, le dernier alinéa de l’article 67 bis-1 consacrerait une « infraction d’importation, d’exportation ou de détention de tabac manufacturé », ce qui pourrait être lu comme l’instauration d’une prohibition générale du tabac dans notre pays.
● Le 2° ajoute un troisième cas d’exonération de responsabilité pénale (en plus de l’acquisition de produits stupéfiants et de la mise à disposition de moyens en vue de cette acquisition) : utiliser une identité d’emprunt en vue d’acquérir des produits stupéfiants « lorsque l’infraction est commise par un moyen de communication électronique » (3° nouveau de l’article 67 bis-1 – alinéa 20).
Il va sans dire qu’un moyen de communication, aussi sophistiqué soit-il, ne saurait par sa propre volonté se rendre coupable d’une quelconque infraction. Il faut donc en déduire que l’intention du Gouvernement consiste à viser les cas où l’infraction est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique. Dans ce cas, les agents des douanes pourront utiliser une identité d’emprunt pour acquérir des produits stupéfiants.
● Le texte autorise également les agents des douanes à utiliser un pseudonyme électronique pour participer à des échanges électroniques (alinéa 22), à être en contact avec les potentiels auteurs d’infraction (alinéa 23), à collecter des données sur ces auteurs et sur les comptes bancaires utilisés (alinéa 24).
Il faut comprendre de la rédaction retenue que ces possibilités sont ouvertes uniquement lorsque l’infraction est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique. L’alinéa 21, qui commande les trois alinéas suivants, prévoit le recours aux possibilités qu’ils ouvrent « dans ce cadre », le cadre en question étant celui du nouveau 3°. Il est donc explicitement prévu que, pour préparer un achat de produits illicites via Internet, les agents des douanes puissent utiliser un pseudonyme ; c’est déjà le cas en pratique, fort heureusement pour la sécurité des agents concernés. L’apport juridique de ces alinéas est donc limité.
● Le 2° du A du III du présent article étend l’exonération de responsabilité pénale aux personnes requises par les agents des douanes pour procéder à l’acquisition (alinéa 25). L’évaluation préalable indique que les personnes requises pourraient être « par exemple, des banques ou des services postaux qui par leur concours permettent aux agents habilités de procéder aux opérations de coups d’achat ». L’exonération de responsabilité des personnes requises est déjà prévue dans le cadre du régime de l’infiltration douanière, prévu à l’article 67 bis du code des douanes.
● Le 3° punit « la révélation de l’identité d’emprunt des agents des douanes ayant effectué l’acquisition » (alinéa 27). La seule référence à une identité d’emprunt étant celle introduite par le 2°, il faut en déduire que seule la révélation de l’identité d’un agent réalisant un coup d’achat en ligne serait répréhensible.
Les peines sont définies par référence au V de l’article 67 bis, qui prévoit au minimum cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende en cas de révélation de l’identité d’un agent des douanes infiltré.
III.– L’ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS DANS LESQUELS EST CONSTATÉE UNE FRAUDE À LA LÉGISLATION SUR LES TABACS
En application de l’article 1825 du CGI, les préfets peuvent prendre, sur proposition du directeur régional des douanes (41), un arrêté de fermeture, pour huit jours, d’un établissement dans lequel a été constatée la fabrication ou la modification illégale d’alcool, la détention ou la vente frauduleuse de métaux précieux, ainsi que la fabrication, la détention, la vente ou le transport frauduleux de tabac (42).
L’évaluation préalable indique que la mise en œuvre de cette disposition « a mis en lumière le caractère insuffisamment dissuasif de la durée de fermeture ».
Le B du II (alinéa 8) prévoit donc, outre une opportune modification rédactionnelle, de porter la durée de fermeture de huit jours à un maximum de trois mois. L’intention est clairement d’allonger la durée de fermeture. Il faut cependant relever qu’il sera désormais possible, le cas échéant, à l’administration de décider d’une durée de fermeture plus brève que le « forfait » actuel de huit jours.
Dans le silence du texte, la modification proposée entre en vigueur à la promulgation de la loi.
*
* *
La Commission adopte l’article 10 sans modification.
*
* *
Présentation obligatoire de la comptabilité sous forme dématérialisée
dans le cadre d’une vérification de comptabilité
Texte du projet de loi :
I.– Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A.– Au I de l'article L. 47 A :
1° À la première phrase :
a. Les mots : « peut satisfaire » sont remplacés par le mot : « satisfait » ;
b. Après les mots : « en remettant » sont insérés les mots : « au début des opérations de contrôle » ;
2° Après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s’applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du même code, et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. » ;
3° Les deuxième et troisième phrases constituent un troisième alinéa ;
4° À la troisième phrase, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « , à la demande de ce dernier ».
B.– Au début du III de l’article L. 52, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1. En cas de mise en œuvre du I de l’article L. 47 A, le délai de trois mois prévu au présent I est suspendu jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l’administration. »
C.– Au second alinéa de l’article L. 74, les mots : « au II », sont remplacés par les mots : « aux I et II ».
II.– Après l'article 1729 C du code général des impôts, il est inséré une division ainsi rédigée :
« 2 bis. Infraction à l'obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée
« Art. 1729 D.– Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales est passible d’une amende de 1 500 euros par exercice ou par année soumis à contrôle ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, et compte tenu de la gravité des manquements, d’un montant pouvant atteindre, selon le cas, 5 pour mille du chiffre d’affaires déclaré en l’absence de rehaussement ou du chiffre d’affaires rehaussé, par exercice soumis à contrôle, ou 5 pour mille du montant des recettes brutes déclarées en l’absence de rehaussement ou de leur montant rehaussé, par année soumise à contrôle. »
III.– Le présent article s’applique aux contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé après le 1er janvier 2014.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article propose de rendre obligatoire, à compter de 2014, en cas de contrôle fiscal d’une entreprise, la présentation par celle-ci de ses documents comptables sous forme dématérialisée lorsqu’elle tient sa comptabilité sous cette forme. Cette présentation est aujourd’hui possible, mais les entreprises sont en droit de la refuser. L’objectif est de rendre plus fluides les opérations de contrôle. L’impact sur les recettes du budget de l’État, par principe favorable, n’est toutefois pas chiffrable.
● L’article L. 13 du livre des procédures fiscales (LPF) dispose que « les agents de l’administration des impôts vérifient sur place […] la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ».
Le I de l’article L. 47 A du LPF, créé par la loi de finances rectificative pour 2007 (43), donne la possibilité aux entreprises (44) qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés de satisfaire à leur obligation de représentation des documents comptables sous forme dématérialisée, c’est-à-dire en mettant à la disposition de l’administration fiscale des fichiers informatiques et non plus de très épaisses liasses papier. Il a été indiqué au Rapporteur général que 40 % des quelque 48 000 vérifications de comptabilité annuelles sont réalisées ainsi.
L’obligation de représentation des documents comptables est prévue par l’article 54 du code général des impôts (CGI) : les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ou au régime réel des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) (45) sont tenues « de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables […] de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration » fiscale.
Les documents pouvant être transmis par voie dématérialisée sont les copies des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général (articles décrivant les modalités de tenue de la comptabilité en partie double).
La transmission sous forme dématérialisée doit répondre à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’article A. 47 A-1 du LPF, issu de cet arrêté, définit de manière précise les normes à respecter (46).
Après s’être assurée de la concordance entre les données comptables et les déclarations fiscales – le cas échéant en procédant à des tris, classements et calculs –, l’administration restitue les copies des fichiers à l’entreprise, sans pouvoir en conserver de double.
Le II de l’article L. 47 A du LPF prévoit que lorsque les agents de l’administration fiscale envisagent des traitements informatiques des copies des fichiers transmis, ils en informent l’entreprise qui peut choisir :
– soit de laisser les agents de l’administration effectuer les vérifications sur son propre matériel informatique ;
– soit d’effectuer elle-même les traitements nécessaires à la vérification ;
– soit de mettre les copies à disposition des agents de l’administration, afin qu’ils procèdent aux vérifications sur un matériel autre que le sien.
● Une entreprise qui tient sa comptabilité sur support informatique n’est pas tenue d’en mettre une copie sous cette forme à disposition des agents de l’administration, puisqu’il s’agit pour elle d’une simple faculté. Le refus parfois opposé par les entreprises (quelques centaines par an) constitue selon le Gouvernement un obstacle au bon déroulement du contrôle fiscal. L’évaluation préalable annexée au présent article indique en effet que « le volume des documents présentés sous format papier peut empêcher de fait la réalisation du contrôle de manière efficace dans les délais légaux par l’administration ».
Disposer des données informatisées permettrait, selon la même source, de réduire « le temps consacré à la lecture, au tri, au classement des écritures comptables […] au profit d’investigations plus approfondies, et au profit d’une meilleure qualité du débat oral et contradictoire ».
Le présent article transforme en obligation la présentation des données comptables sous forme dématérialisée, pour les contribuables dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés (alinéa 4).
Il est précisé que la copie des fichiers devrait être remise au début des opérations de contrôle (alinéa 5). En application du I de l’article L. 52 du LPF, la durée d’une vérification de comptabilité ne peut en principe excéder trois mois ; il convient donc d’éviter que le délai de cette transmission réduise le temps utile de contrôle si l’entreprise contrôlée ne fournit pas au début des opérations de contrôle, comme elle devra le faire, les copies des fichiers. Aussi, il est prévu de suspendre le délai de trois mois en cas de mise en œuvre du I de l’article L. 47 A (alinéa 11).
Dans un souci de simplification des relations entre l’administration fiscale et le contribuable, il est également prévu que la restitution des copies des fichiers, aujourd’hui automatique, soit demain opérée par l’administration à la demande du contribuable (alinéa 9). Le droit existant interdit à l’administration de conserver un double de ces copies, et il n’est pas proposé de modification sur ce point : cela signifie qu’à l’avenir, l’administration devra spontanément – et en principe immédiatement – procéder à la destruction des copies de fichiers dont la restitution ne serait pas réclamée par les contribuables.
2.– Une obligation étendue à la quasi-totalité des contribuables soumis à une vérification de comptabilité
Partant du constat que « la majorité des entreprises imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles pouvant faire l’objet d’une vérification de comptabilité tiennent aujourd’hui leur comptabilité à l’aide d’un logiciel comptable » (47), le Gouvernement propose d’étendre cette nouvelle obligation au-delà des seules entreprises relevant de l’IS ou du régime réel des BIC. Seraient désormais concernés tous les contribuables soumis à l’obligation de présenter des documents comptables et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés (alinéa 7) (48).
Le présent article prévoit que l’opposition à la mise en œuvre du contrôle par un refus de présentation dématérialisée entraînera, en application de l’article L. 74 du LPF, la réévaluation d’office des bases d’imposition (alinéa 12).
Il est en outre créé une infraction à l’obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée, au sein d’une division nouvelle du CGI, composée d’un unique article 1729 D (alinéas 14 et 15).
Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du LPF serait ainsi sanctionné :
– en l’absence de rehaussement, d’une amende pouvant atteindre
5 pour mille du chiffre d’affaires (49) déclaré, par exercice (50) soumis à contrôle ;
– en cas de rehaussement, d’une amende pouvant atteindre 5 pour mille du chiffre d’affaires rehaussé, par exercice soumis à contrôle ;
– en tout état de cause, d’une amende minimale de 1 500 euros par exercice soumis à contrôle, payable par les entreprises dont le chiffre d’affaires est nul ou dont la fraction de 5 pour mille du chiffre d’affaire est inférieure à 1 500 euros.
L’administration fiscale déterminera, sous l’un ou l’autre des plafonds
de 5 pour mille, le taux de l’amende en fonction de la gravité des manquements à l’obligation de présentation dématérialisée. Cette marge d’appréciation de la sanction, apparemment dictée par un souci de proportionnalité, pourrait toutefois poser des difficultés d’application. Le soin de définir l’échelle de la gravité des manquements est en l’espèce laissé à la discrétion de l’administration, alors que le texte prévoit que c’est le défaut de présentation qui entraîne l’amende. En l’absence de toute précision, il ne paraît pas évident de caractériser la plus ou moins grande gravité du défaut de présentation dématérialisée des comptes.
L’entrée en vigueur du dispositif proposé par le présent article est prévue, par son III (alinéa 16), avec une année de décalage, c’est-à-dire pour les contrôles dont les avis de vérification seront adressés aux contribuables après le 1er janvier 2014.
Ce délai d’un an entre le vote de la loi et l’entrée en vigueur du dispositif devrait permettre à l’administration fiscale de préciser par arrêté (51) les normes des fichiers de données fiscales. Il a été indiqué au Rapporteur général que ces normes seront définies de sorte à correspondre aux supports informatiques les plus couramment utilisés par les entreprises.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement CF 49 du rapporteur général.
M. le rapporteur général. L’article 11 vise à obliger les entreprises qui tiennent leur comptabilité au moyen d’un système informatisé à présenter leurs comptes sous forme dématérialisée dans le cadre d’un contrôle fiscal. Il prévoit, en cas de défaut de présentation selon ces modalités, une amende, qui peut être modulée.
Or on voit mal selon quels critères l’administration fiscale pourrait apprécier la gravité d’un défaut de présentation. De deux choses l’une : soit l’entreprise présente ses comptes, soit elle ne le fait pas. Je propose donc de supprimer la possibilité de moduler l’amende. Cela ne va pas à l’encontre – nous nous en sommes assurés – du principe de proportionnalité des peines.
La Commission adopte l’amendement (Amendement n° 16).
Puis elle adopte l’article 11 ainsi modifié.
*
* *
Modification des modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de la cession à titre onéreux d’usufruit temporaire
Texte du projet de loi :
I.– L’article 13 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. 1° Pour l’application du 3 et par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l’imposition des plus-values, le produit résultant de la cession à titre onéreux d’un usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenu à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé.
« Lorsque l’usufruit temporaire cédé porte sur des biens ou droits procurant ou susceptibles de procurer des revenus relevant de différentes catégories, le produit résultant de la cession de cet usufruit temporaire ou, le cas échéant, sa valeur vénale, est imposable dans chacune de ces catégories à proportion du rapport entre, d’une part, la valeur vénale des biens ou droits dont les revenus se rattachent à la même catégorie et, d’autre part, la valeur vénale totale des biens ou droits sur lesquels porte l’usufruit temporaire cédé.
« 2° Pour l’application du 1° et à défaut de pouvoir déterminer, au jour de la cession, une catégorie de revenu, le produit résultant de la cession de l’usufruit temporaire ou, le cas échéant, sa valeur vénale, est imposé :
« a) Dans la catégorie des revenus fonciers, sans qu’il puisse être fait application des dispositions du II de l’article 15, lorsque l’usufruit temporaire cédé est relatif à un bien immobilier ou à des parts de sociétés, groupements ou organismes, quelle qu’en soit la forme, non soumis à l’impôt sur les sociétés et à prépondérance immobilière au sens des articles 150 UB ou 244 bis A ;
« b) Dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, lorsque l'usufruit temporaire cédé est relatif à des valeurs mobilières, droits sociaux, titres ou droits s'y rapportant, ou à des titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, mentionnés à l’article 150-0 A ;
« c) Dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dans les autres cas. »
II.– Le I est applicable aux cessions à titre onéreux d'un usufruit temporaire intervenues à compter du 14 novembre 2012.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article vise à empêcher un schéma d’optimisation fiscale dit de cession d’usufruit temporaire, au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. À cette fin, il substitue à l’actuel régime d’imposition de la plus-value constatée en cas de cession à titre onéreux d’un usufruit temporaire, un régime d’imposition des revenus correspondants.
Afin d’éviter tout effet d’aubaine, ces dispositions entrent en vigueur le jour de la délibération du conseil des ministres sur le présent projet, soit le 14 novembre 2012, pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2012 et devant être payé en 2013.
Le démembrement de propriété peut classiquement faciliter la gestion patrimoniale et permettre de bénéficier d’avantages fiscaux, par la séparation entre la nue-propriété et l’usufruit. L’usufruit est défini par l’article 578 du code civil comme « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ». Il s’agit d’un droit réel qui peut porter sur tout bien. Lorsqu’il n’est pas établi automatiquement par la loi dans certaines situations (notamment pour les successions), l’usufruit peut être établi par une convention à l’initiative du propriétaire du bien. L’usufruitier dispose de deux attributs du bien : d’une part, l’usus, c'est-à-dire un pouvoir de jouissance et un droit d’usage du bien, à charge d'en assurer sa conservation ; d’autre part, le fructus, à savoir le bénéfice des produits perçus du fait de la jouissance du bien. Le nu-propriétaire conserve l’abusus, soit le droit de disposer du bien, mais il ne peut pas vendre seul la pleine propriété du bien grevé d’usufruit. Il est aussi tenu de maintenir le bien en l’état, donc de supporter le cas échéant les charges extraordinaires, telles que les grosses réparations portant sur un bien immobilier.
L’usufruit est par essence un droit temporaire : selon les articles 617 et suivants du code civil, il cesse notamment, soit au décès de l’usufruitier personne physique, soit au plus tard après trente ans si l’usufruitier est une personne morale, soit à l'expiration du temps pour lequel il a été accordé. Une fois l'usufruit éteint, le nu-propriétaire redevient plein propriétaire. Lorsqu’il est fait référence à un usufruit temporaire, cela correspond à un usufruit déterminé pour une durée à terme fixe lors de sa constitution même.
L’usufruit peut notamment porter sur un bien immobilier, auquel cas il donne droit à percevoir des loyers, ou sur des valeurs mobilières, produisant dividendes ou intérêts perçus par l’usufruitier, ou sur un fonds de commerce, permettant à l’usufruitier de percevoir des revenus professionnels. En cédant l’usufruit du bien, le propriétaire transforme un flux de revenus futurs et aléatoires en un capital immédiat et liquide (qu’il pourra par ailleurs faire fructifier) : c’est pourquoi le prix de cession de l’usufruit est déterminé en fonction d’une valeur économique calculée sur la base de l’actualisation des revenus à percevoir sur la durée de l’usufruit. Une fois cette valeur économique calculée au titre de la pleine propriété du bien, le II de l’article 669 du code général des impôts prévoit que « l'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier ».
Au titre de l’impôt sur le revenu, la cession de l’usufruit est considérée comme une plus-value. Cette plus-value est taxée en fonction de la nature du bien démembré : plus-value mobilière, immobilière ou professionnelle. Il faut toutefois signaler que, par un arrêt du 12 juin 2012 (n° 11LY01293, ministre c/ Glas) qui fait l'objet d'un pourvoi en instance devant le Conseil d'État, la cour administrative d’appel de Lyon a jugé que la cession de l'usufruit temporaire d’un fonds libéral par une entreprise détentrice de sa pleine propriété devait être regardée non comme génératrice d'une plus-value d'actif, mais comme entraînant la perception d'un produit d'exploitation.
Le montage d’optimisation fiscale fréquemment mis en œuvre résulte de la différence entre l’imposition d’une plus-value et celle d’un revenu : taxer en une fois la plus-value de cession de l’usufruit est plus avantageux, du point de vue du contribuable, que taxer les flux de revenus qui auraient été procurés par le bien pendant une durée équivalente à celle de l’usufruit. En effet, d’une part, la valeur de l’usufruit est plus faible que celle du bien en pleine propriété, ce qui réduit le montant de la plus-value taxable (du fait que le prix d’acquisition du bien n’est retenu qu’à hauteur de la valeur de l’usufruit déterminée selon le barème, fonction de l’âge de l’usufruitier, prévu par le I de l’article 669 du code général des impôts) ; d’autre part, il existe des taux forfaitaires et des abattements pour durée de détention, pouvant par exemple aboutir à une exonération totale de la plus-value immobilière après trente ans de détention. Même avec le nouveau régime d’imposition des plus-values mobilières prévu par l’article 6 du projet de loi de finances pour 2013, la cession d’un usufruit temporaire peut demeurer avantageuse, du fait du maintien d’un taux forfaitaire dans certains cas ou de l’application d’abattements pour durée de détention aux plus-values mobilières. En transformant des revenus futurs fiscalisés en une plus-value le plus souvent totalement exonérée, la cession d’usufruit temporaire permet au contribuable avisé de réaliser une opération particulièrement rentable, fiscalement parlant.
Il est proposé de requalifier le produit de la cession d’un usufruit temporaire dans la catégorie de revenu sous-jacent, tant pour l’impôt sur le revenu que pour les prélèvements sociaux. Il s’agit en quelque sorte de généraliser et de légaliser le critère retenu par la cour administrative d’appel de Lyon dans son arrêt précité : le produit de la cession sera désormais imposé au titre de la catégorie de revenu à laquelle se rattachent les fruits susceptibles d’être procurés par le bien sûr lequel porte l’usufruit temporaire.
Le présent article propose, dans cette perspective, d’insérer une nouvelle règle d’assiette à l’article 13 du code général des impôts, qui définit de manière générale le revenu imposable au titre de l’impôt sur le revenu.
Cette nouvelle règle d’assiette comporterait trois éléments :
1. La définition de l’imposition des cessions d’usufruit temporaire par dérogation aux règles concernant les plus-values, en retenant soit le prix de cession, soit la valeur vénale de l’usufruit si elle est supérieure. L’administration disposera ainsi d’un fondement légal pour rectifier la base d’imposition en cas de sous-évaluation manifeste du prix de cession. Sont concernés tous les contribuables à l’impôt sur le revenu, directement ou par transparence fiscale au travers de sociétés de personnes. Dès lors que les règles d’imposition aux prélèvements sociaux pour les revenus du capital sont « décalquées » automatiquement de celles applicables pour le calcul de l’impôt sur le revenu, le changement du régime d’imposition s’appliquera de plano pour les prélèvements sociaux ;
2. Une règle de prorata, lorsque l’usufruit est susceptible de procurer des revenus se rattachant à plusieurs catégories de revenus. L’imposition se fera dans chaque catégorie de revenus à due proportion du rapport entre la valeur de l’usufruit par catégorie et sa valeur totale ;
3. Une présomption de répartition de la valeur de l’usufruit temporaire entre catégorie de revenus, si l’acte de cession ne permet pas de réaliser une répartition réelle :
– lorsque l’usufruit temporaire cédé est relatif à un bien immobilier ou à des parts de société à prépondérance immobilière (par exemple une société civile immobilière – SCI), le produit résultant de la cession de l’usufruit est réputé constituer un revenu foncier, sans chercher notamment à savoir si, le cas échéant, il pourrait s’agir d’une location en meublé non professionnelle relevant des BIC. Les charges relatives à ce bien sont déductibles (notamment, le cas échéant, les intérêts d’un emprunt en cours s’il existe d’autres revenus fonciers). Afin d’éviter tout risque de détournement, il est prévu que le produit soit taxé quand bien même, malgré la cession de l’usufruit, le propriétaire se réserverait la jouissance du bien ;
– lorsque l’usufruit temporaire cédé est relatif à des valeurs mobilières, le produit résultant de la cession de l’usufruit est réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers ;
– par défaut, dans tous les autres cas, le produit résultant de la cession de l’usufruit est réputé constituer un bénéfice non commercial (BNC).
Il convient de souligner que ce nouveau régime d’imposition ne concerne que les cessions d’usufruit temporaire.
En sont donc exclues les cessions d’usufruit viager, dont la durée n’est pas prédéterminée. L’article 617 du code civil distingue ces deux types d’usufruit.
Les donations d’usufruit temporaire, très utilisées dans le cadre familial pour aider notamment les enfants à financer leurs études (avec des avantages fiscaux du fait que les descendants supportent a priori une fiscalité moins lourde que leurs ascendants plus aisés à ce stade de leur vie respective) ne sont pas non plus impactées.
L’usufruit locatif social (ULS), tel qu’organisé par les articles L. 253-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, n’est pas plus concerné lorsqu’il s’agit d’une acquisition séparée ab initio de la nue-propriété par un investisseur privé et de l’usufruit de logements par des bailleurs, notamment sociaux.
Enfin, les nouvelles règles d’assiette concernant la cession d’usufruit temporaire ne sont pas exclusives de la possibilité demeurant pour l’administration de remettre en cause, sur le fondement de la procédure de répression des abus de droit, des montages à but exclusivement fiscal utilisant cet outil de gestion patrimoniale. On peut penser au cas de la cession d’un tel usufruit à une société contrôlée par le cédant, qui emprunterait pour financer l’acquisition de l’usufruit et annulerait l’impôt sur les sociétés portant sur les revenus retirés de l’usufruit du fait de l’amortissement de l’usufruit dans son bilan et de la déduction des charges financières de l’emprunt ainsi contracté (52).
On rappellera pour conclure que la cession temporaire d’usufruit permet également d’optimiser la situation fiscale du cédant au regard de l’ISF, d’une part, parce que les biens grevés d’un usufruit sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier (s’il est redevable de cet impôt) à hauteur de sa valeur en pleine propriété, et, d’autre part, parce que le cédant ne perçoit plus de revenus afférents au bien dont il demeure nu-propriétaire pendant la durée de l’usufruit, ce qui facilite de son point de vue l’application du mécanisme de plafonnement de l’ISF en fonction de ses revenus, ainsi opportunément minorés.
*
* *
La Commission examine l’amendement CF 14 de M. Philippe Vigier.
M. Charles de Courson. L’article 12 vise à remettre en cause le régime des cessions d’usufruit temporaire à titre onéreux, qui a pu être utilisé à des fins d’optimisation fiscale.
Nous sommes favorables à la suppression de la cession d’usufruit par un chef d’entreprise à une société qu’il a créée à cet effet, le bien immobilier étant loué à la société opérationnelle ou à un tiers. Cette pratique s’apparente en effet à une cession à soi-même pour échapper à l’impôt.
Toutefois, à un moment où il est question d’alléger les charges des entreprises pour renforcer leur compétitivité, il ne faudrait pas supprimer un dispositif sain qui répond à leurs intérêts, au motif que quelques montages de cette nature existent. Une cession d’usufruit sur un bien détenu depuis plus de trente ans sans plus-value demeure une hypothèse d’école.
L’amendement CF 14 permettrait de ne pas soumettre au même traitement les cessions d’usufruit temporaire justifiées et celles qui relèvent de l’optimisation fiscale.
M. le rapporteur général. Avis défavorable.
L’article 12 ne vise pas seulement à lutter contre les abus, mais il instaure également une nouvelle règle d’assiette pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Les cessions d’usufruit temporaire bénéficient d’un avantage fiscal excessif à nos yeux : le dispositif permet au cédant de percevoir un capital immédiatement disponible tout en réduisant le montant de son impôt sur le revenu et de son impôt de solidarité sur la fortune. Dans un souci de rééquilibrage, il nous paraît juste de soumettre le produit des cessions au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Cela ne remettra d’ailleurs pas en cause l’intérêt de ces opérations : leur régime fiscal demeurera favorable, même s’il le sera moins qu’auparavant.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine à l’amendement CF 24 de M. Hervé Mariton.
M. Hervé Mariton. L’intention du Gouvernement est bonne et nous partageons son objectif de lutte contre la fraude. Cependant, le dispositif qu’il propose à cette fin n’est pas équilibré. Les conséquences pour les contribuables ont été mal analysées et risquent de se révéler excessives. Je propose, avec cet amendement, une réponse mieux adaptée.
M. le président Gilles Carrez. Comme l’a indiqué le rapporteur général, il s’agit moins avec cet article d’un dispositif de lutte contre la fraude que d’un changement – radical – de règle fiscale. J’appelle l’attention des membres de la Commission sur ses conséquences – majeures – pour certaines entreprises. Il convient de l’examiner de manière approfondie. Je souhaite éviter une situation analogue à celle que nous avons connue, lors de l’examen de l’article 6 du projet de loi de finances pour 2013, sur le régime fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières.
M. le rapporteur général. Sont visées, non pas les entreprises, mais les particuliers. Le régime fiscal actuel, très favorable, permet aux contribuables de réaliser d’importantes économies d’impôt à travers certains montages. M. Mariton n’a pas vraiment présenté d’argument pour défendre son amendement.
M. Olivier Carré. Premièrement, certains dispositifs constituent la contrepartie d’une fiscalité déjà lourde dans son ensemble – sans parler des mesures récentes. M. Carrez l’a souvent souligné par le passé.
Deuxièmement, le régime fiscal des cessions d’usufruit temporaire est utilisé en matière de logement social…
M. le rapporteur général. Il est aussi utilisé pour échapper à l’impôt de solidarité sur la fortune.
M. Olivier Carré. Ce n’est pas une raison pour cesser de réaliser des logements sociaux dans ces conditions, même s’il n’y en a actuellement que quelques milliers.
M. le président Gilles Carrez. Nous parlons de 6 000 logements sociaux en démembrement de propriété.
M. le rapporteur général. Le dispositif n’est pas remis en question pour les logements sociaux. L’usufruit locatif social n’est pas dans le champ d’application de l’article.
M. Olivier Carré. La remarque de Mme Berger était tout à fait juste. Les mesures fiscales affectent le rendement net – par nature déjà faible en raison de la modicité des loyers – des projets d’investissement en matière de logement social. Le dispositif actuel a sa raison d’être : il permet d’orienter l’épargne vers ces projets. Si vous souhaitez le supprimer, il faut le dire clairement. Cela déstabilisera une partie – certes modeste – du secteur de la construction de logements sociaux, que nous souhaitons pourtant tous favoriser.
M. Hervé Mariton. Pour être général, mon propos n’en était pas moins exact : sous couvert de lutte contre la fraude et les abus, le Gouvernement modifie en réalité les modalités de calcul de l’impôt, alors même qu’il se prévalait de ne pas avoir introduit de mesures fiscales nouvelles dans ce collectif. Le dispositif actuel a sa raison d’être, il n’est pas injuste en tant que tel. Vous allez supprimer, sans aucun accompagnement, des mécanismes qui ont leur utilité. En outre, c’est une mesure destinée à rapporter de l’argent au budget de l’État.
M. le président Gilles Carrez. Le sujet est important. Nous ne contestons pas la nécessité de limiter ce type de montage, mais cette mesure beaucoup trop générale va les interdire.
M. le rapporteur général. Nous ne les interdisons pas !
M. le président Gilles Carrez. En outre, cette mesure représente un alourdissement important de la fiscalité, alors même que le ministre, lorsqu’il nous a présenté ce collectif, nous avait indiqué qu’il ne comportait aucune augmentation d’impôt nouvelle. C’est même la première phrase qu’il avait prononcée.
M. le rapporteur général. Tout d’abord, l’article 12 concerne non pas les donations – dont on sait pourtant l’usage qui peut en être fait pour échapper à l’impôt de solidarité sur la fortune –, mais uniquement les cessions.
De plus, le logement social n’est pas touché, dans la mesure, je le répète, où la nouvelle règle ne concerne pas les investissements initiaux dans la construction.
Enfin, les mesures de lutte contre les abus ont en effet vocation à rapporter de l’argent au budget de l’État ou de lui en faire moins perdre. Nous en convenons volontiers. Le Gouvernement a d’ailleurs prévu un milliard d’euros de recettes fiscales nettes supplémentaires en 2013 au titre de la lutte contre la fraude.
M. Hervé Mariton. Nous proposons non pas de supprimer la mesure, mais de mieux la cibler. Nous ne nions ni l’existence d’abus, ni la nécessité de légiférer. Nous proposons de recentrer le dispositif sur un abus de droit identifiable qu’il convient d’empêcher : le cas où le contribuable cède l’usufruit de son bien immobilier à une société qu’il contrôle. Si la mesure est profitable au budget de l’État, tant mieux. Mais nous ne voulons pas aller au-delà de la lutte contre l’abus de droit, qui demeure sanctionnable en tant que tel.
M. Charles de Courson. Quel est le rendement de cette mesure ? En a-t-on mesuré l’impact économique ?
M. le rapporteur général. J’ai interrogé le Gouvernement sur le premier point, mais n’ai pas obtenu de réponse : par nature, les pratiques abusives ou frauduleuses ne sont généralement pas quantifiables. Les recettes supplémentaires au titre de la lutte contre la fraude ont été évaluées à un milliard d’euros – chiffre que j’estime, à titre personnel, peut-être ambitieux. L’ensemble des mesures de ce collectif y contribueront, mais je ne suis pas en mesure de vous dire dans quelle proportion respective.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 12 sans modification.
*
* *
Application aux plus-values d’apport de titres réalisées par les personnes physiques d’un report d’imposition optionnel en lieu et place du sursis d’imposition en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur
Texte du projet de loi :
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.– Au premier alinéa de l’article 150-0 B, les mots : « Les dispositions de l’article 150-0 A » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 150-0 B ter, les dispositions de l’article 150-0 A ».
B.– Après l’article 150-0 B bis, il est inséré un article 150-0 B ter ainsi rédigé :
« Art. 150-0 B ter.– I.– L’imposition de la plus-value réalisée directement ou par personne interposée dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent peut, si les conditions prévues au II sont remplies, être reportée lorsque le contribuable en fait expressément la demande et mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170. À défaut d’option pour le report, la plus-value est imposée dans les conditions de l’article 150-0 A.
« Les apports avec soulte demeurent soumis aux dispositions de l’article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
« Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :
« 1° De la transmission, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;
« 2° De la transmission, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport des titres réinvestit le produit de leur cession, dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’apport et à hauteur de 50 % du montant de ce produit, dans le financement d’une activité commerciale, artisanale, libérale, agricole ou financière à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une société répondant aux conditions du b du 3° du II de l’article 150-0 D bis ;
« 3° De la transmission, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;
« 4° Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.
« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la plus-value dans les conditions prévues à l’article 150-0-A, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des titres.
« II.– Le report d’imposition est en outre subordonné aux conditions suivantes :
« 1° L’apport de titres est réalisé en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« 2° La société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l’issue de celui-ci. Pour l’application de cette condition, un contribuable est considéré comme contrôlant une société :
« a. Lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue directement ou indirectement par le contribuable ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« b. Ou lorsqu’il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires ;
« c. Ou lorsqu’il y exerce en fait le pouvoir de décision.
« Le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsqu’il dispose directement ou indirectement d’une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
« Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu’ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
« 3° Les titres apportés ne font pas l’objet d’un engagement de conservation prévu aux articles 787 B ou 787 C dans les conditions prévues par ces articles.
« III.– Lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport ou les titres des groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes l’objet d’un apport, l’imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut être reportée, dans les mêmes conditions, si le contribuable en fait expressément la demande et mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170.
« Il est mis fin au report initial en cas de transmission, de rachat, de remboursement ou d’annulation des nouveaux titres reçus en échange ou en cas de survenance d’un des événements mentionnés aux 1° à 4° du I, lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport ou les titres des groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes l’objet d’un échange bénéficiant du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B ou d’un apport soumis au report d’imposition prévu au I.
« IV.– En cas de survenance d’un des événements prévus aux 1° à 4° du I et au 2e alinéa du III, il est mis fin au report d’imposition de la plus-value dans la proportion des titres cédés, transmis, rachetés, remboursés ou annulés.
« V.– Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. »
C.– L’article 167 bis est ainsi modifié :
1° Au II, après la référence : « 150-0 B bis » est ajoutée la référence : « , 150-0 B ter » ;
2° Au a du 1 du VII, les mots : « l’article 150-0 D bis s’applique » sont remplacés par les mots : « les reports d’imposition prévus aux articles 150-0 B ter et 150-0 D bis s’appliquent » ;
3° Après le e du 1 du VII, il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f. La transmission, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres ou droits reçus en rémunération de l’apport ou des titres ou droits apportés ou des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés conformément à l’article 150-0 B ter, pour l’impôt afférent aux plus-values de cession reporté en application dudit article. » ;
D.– Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, avant les mots : « du I de l’article 150-0 D bis » sont insérés les mots : « de l’article 150-0 B ter et ».
II.– Le I est applicable aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article vise à remettre en cause un schéma d’optimisation fiscale dit d’apport-cession, au titre de la taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers à l’impôt sur le revenu. À cette fin, il substitue à l’actuel régime de sursis d’imposition applicable en cas d’apport un régime de report d’imposition sous condition de remploi.
Afin d’éviter tout effet d’aubaine, il est proposé que ces dispositions entrent en vigueur le jour de la délibération du conseil des ministres sur le présent projet, soit le 14 novembre 2012.
Le législateur a pris en compte la situation particulière des contribuables qui réalisent des plus-values à l'occasion d'un échange de titres ou d'un apport. En effet, ces opérations ne dégagent pas de liquidités au moment de leur réalisation mais facilitent les restructurations d’entreprises nécessaires à la vie économique. Par dérogation à la règle selon laquelle le fait générateur de l'imposition d'une plus-value est constitué au cours de l'année de la réalisation de celle-ci, la loi prévoit dans ce cas que la plus-value n’est imposée que l'année au cours de laquelle les titres reçus en échange seront eux-mêmes cédés.
Les plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2000 à l'occasion de certaines opérations d'échanges de titres bénéficient d'un sursis d'imposition. Ce régime de sursis a été institué par la loi de finances pour 2000 à la place du régime de report d’imposition qui s’appliquait depuis 1991 pour les échanges de titres réalisés à l'occasion d'une offre publique, d'une fusion, d'une scission ou d'un apport en société (et qui continue d’ailleurs à s’appliquer pour les plus-values qui étaient en situation de report d'imposition au 1er janvier 2000).
En cas de sursis d'imposition, l'opération d’échange est considérée comme présentant un caractère intercalaire et n'est donc pas prise en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année de l'échange des titres. Le sursis d'imposition s'applique de plein droit, sans que le contribuable ait à en faire la demande ni qu’il ait à déclarer la plus-value d'échange non constatée. Toutefois, il n’y a pas d'exonération définitive de cette plus-value puisqu’ultérieurement, lors de la cession des titres reçus en échange ou lorsque ces titres sont rachetés, remboursés ou annulés, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange.
L’article 150-0 B du code général des impôts qui prévoit ce sursis d’imposition concerne les opérations d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux résultant d'une offre publique (d'échange, d'achat, de rachat ou de retrait), d'une fusion, d'une scission, de l'absorption d'un fonds commun de placement (FCP) par une société d'investissement à capital variable (SICAV), d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, d’une conversion, d’une division ou d’un regroupement. Le montant de la soulte éventuellement reçue par le contribuable lors de l’échange ne doit toutefois pas excéder 10 % de la valeur nominale des titres reçus pour que le sursis d’imposition soit applicable.
Ce régime peut donc s'appliquer en cas d'apport de valeurs mobilières ou de droits sociaux à une société de capitaux ou assimilée soumise à l'impôt sur les sociétés (de plein droit ou sur option, sans en être exonérée totalement ou partiellement de façon permanente). Les titres remis en contrepartie de l'apport doivent, d'une part, être des valeurs mobilières ou des droits sociaux représentatifs d'une quotité du capital de la société bénéficiaire de l'apport ou constituer des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital de cette société (obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions) et, d'autre part, être émis à l'occasion de l'opération d'apport.
Un montage fréquemment utilisé à des fins d’optimisation fiscale consiste à céder des titres initialement détenus par une personne physique juste après leur apport à une société contrôlée par ce contribuable. L’administration fiscale a systématiquement pourchassé ce type de montage, d’abord sous le régime de report applicable jusqu’en 2000 puis sous le régime de sursis. Elle considère en effet que le placement en report ou en sursis d'imposition d'une plus-value réalisée par un contribuable lors de l'apport de titres à une société qu'il contrôle, suivi de leur cession par cette société, est un montage constitutif d'un abus de droit. Le contribuable aurait en effet normalement pu céder directement les titres à un acquéreur puis réinvestir lui-même le produit de cette cession sans procéder à l'opération d'apport, qui a pour seul but d’échapper au paiement immédiat de l’impôt sur la plus-value.
SCHÉMA DE L’APPORT-CESSION
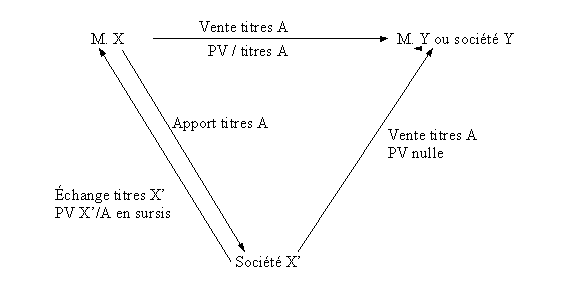
Le Conseil d’État statuant au contentieux a développé une jurisprudence précisant les cas dans lesquels l’administration peut être fondée à invoquer l’abus de droit dans le cadre d’opérations d’apport-cession, et donc à remettre en cause le régime de faveur décrit ci-dessus. Au titre de l’ancien régime de report applicable jusqu’en 2000, il a jugé légal le bénéfice de ce régime dès lors que le réinvestissement économique du produit de la cession est avéré (8 octobre 2010, n° 301934, Bazire ; 11 février 2011, n° 314950, Picoux) et qu’il a été effectué dans le délai nécessaire qu'impliquaient l'importance et la nature de l'investissement réalisé (8 octobre 2010, n° 313139, ministre c/ Bauchart). En revanche, il en a remis en cause le bénéfice lorsque les sommes réinvesties ne représentaient pas une part significative du produit de la cession des titres (4 % du produit de la cession réinvestis et 60 % affectés à des avances en compte courant qui ont un caractère patrimonial, dans une décision du 3 février 2011, n° 329839, ministre c/ Conseil ; 15 % du produit de la cession réinvestis et 41 % affectés à des avances en compte courant, dans une décision du 24 août 2011, n° 316928, Ciavatta). Il y a aussi abus de droit lorsque le produit de la cession, affecté à des investissements immobiliers réalisés par une SCI à caractère patrimonial bénéficiaire de l'apport, peut être appréhendé par le contribuable porteur de parts de la SCI bénéficiaire de l’apport et qu’il contrôle (24 août 2011, n° 314579, Moreau et Girault), ou lorsque le contribuable, apporteur des titres, récupère des liquidités à l'occasion de la réduction ultérieure du capital de la société bénéficiaire de l'apport, par voie de remboursement partiel aux associés du montant de leurs parts (8 octobre 2010, n° 321361, Four).
Statuant pour la première fois sur le régime de sursis applicable depuis 2000 dans une décision du 27 juillet 2012 (n° 327295, Berjot), le Conseil d’État a jugé qu’en dépit du caractère automatique du sursis, un montage d’apport-cession peut aussi être considéré comme constitutif d'un abus de droit. Il a alors appliqué les mêmes critères que ceux qu’il a dégagés pour les apports ouvrant droit à un report d'imposition : l’administration est fondée à se prévaloir de la procédure de répression des abus de droit dès lors que l'opération d'apport, dont l'intérêt fiscal consiste à différer l'imposition de la plus-value, permet à l'apporteur de disposer des liquidités obtenues lors de la cession tout en restant détenteur des titres et que le produit de la cession n'est pas effectivement réinvesti dans une activité économique.
Compte tenu du durcissement de l’imposition des plus-values prévu par l’article 6 du projet de loi de finances pour 2013, les tentatives d’y échapper risquent de se multiplier, notamment au travers d’opérations d’apport-cession. Eu égard à la difficulté pratique de mise en œuvre pour l’administration, du caractère traumatisant pour les contribuables, de la longueur de la procédure et de l’incertitude contentieuse qui caractérisent la répression des abus de droit, le Gouvernement propose de définir un nouveau régime légal de report d’imposition spécifique aux montages d’apport-cession, et à cette occasion de transposer dans la loi les critères retenus par la jurisprudence pour caractériser les opérations qui auront le droit de bénéficier de ce régime.
Pour autant, la définition législative des apports-cessions pouvant bénéficier d’un régime de faveur n’a pas seulement un caractère répressif, mais elle vise aussi à sécuriser les investisseurs eux-mêmes : les critères retenus seront désormais objectifs et clairement affichés dans la loi, sans devoir attendre la prise de position du juge sur chaque espèce, bien après la réalisation des réinvestissements.
Le nouveau régime de report d’imposition est codifié au sein d’un nouvel article 150-0 B bis du code général des impôts, créé par le B du I du présent article.
En cas de report d'imposition, la plus-value est normalement constatée au titre de l'année de l'échange des titres mais son imposition est différée au moment où s'opérera la cession des titres reçus lors de l'échange. La cession ultérieure des titres reçus en échange entraîne l'expiration du report, de sorte que la plus-value en report est immédiatement mise en recouvrement et une nouvelle imposition est établie sur la différence entre le prix de cession et le prix ou la valeur du titre lors de l'échange.
Le champ d’application de ce nouveau régime ne concerne que l’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés et contrôlée par le contribuable. Il est donc plus restreint, tant que l’actuel régime de sursis que l’ancien régime de report. L’articulation du nouveau report avec l’actuel sursis est réalisée par le A du I du présent article, qui modifie l’article 150-0 B du code général des impôts relatif au sursis en indiquant que le sursis ne s’applique que « sous réserve » de l’application du report. Comme le rappelle le guide de légistique mis en ligne sur le site officiel www.legifrance.gouv.fr, la locution « sous réserve » indique l'ordre de prééminence entre deux dispositions en conflit : la disposition ne joue que lorsque le texte réservé ne trouve pas à s'appliquer. Cela signifie que, si le contribuable réalise un apport à une société soumise à l’impôt sur les sociétés qu’il contrôle, il ne peut plus bénéficier du régime du sursis et relève exclusivement du régime du report. Il peut alors demander le bénéfice du report, mais s’il ne le fait pas, il est immédiatement imposé sur la plus-value d’échange. En revanche, s’il effectue un apport à une société qu’il ne contrôle pas, il demeure dans le champ d’application de l’actuel régime de sursis.
Le nouveau régime de report ne concerne pas les titres qui font l’objet d’un engagement de conservation (pacte Dutreil) pour pérenniser l’actionnariat familial dans le cadre des transmissions patrimoniales. Les opérations d’apport-cession réalisées avec ces titres peuvent donc continuer à bénéficier du régime de sursis de droit. L’exonération de 75 % des droits de mutation à titre gratuit prévue par les articles 787 B et 787 C du code général des impôts pour ces titres peut être remise en cause dans certains cas de cession et d’apport qui ne respectent pas les engagements collectif et individuel de conservation, mais il n’existe dans le droit en vigueur aucun régime de faveur spécifique concernant l’imposition des plus-values au titre des pactes Dutreil.
Le report d’imposition concerne non seulement l’impôt sur le revenu, mais aussi les prélèvements sociaux. En effet, du fait de l’apport de titres, le contribuable ne perçoit aucune liquidité en contrepartie qui lui permettrait de s’acquitter de l’impôt dû. Le système est différent pour le report d’imposition prévu par l’article 150-0 D bis qui n’emporte pas report des prélèvements sociaux, en application expresse du e ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Pour ce report en effet, il y a cession avant remploi et donc des liquidités disponibles pour s’acquitter des prélèvements sociaux dès l’année de la cession.
L'application du nouveau report d'imposition est subordonnée au respect de quatre conditions.
1. Le contribuable doit demander expressément le bénéfice du report (à la différence du régime de sursis, qui est de droit). Cette demande doit être réitérée lorsque les titres remis en échange après un premier apport font eux-mêmes l’objet d’un nouvel apport.
La demande de report devra être formulée au moment de la souscription de la déclaration des revenus de l'année de l'échange. Le D du I du présent article modifie pour coordination en ce sens l’article 170 du code général des impôts.
À cet égard, dans une décision du 13 juillet 2011 (n° 338463, Labbé), le Conseil d’État statuant au contentieux a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'obligation pour le contribuable de formuler une demande et de la réitérer à l'occasion d'un nouvel échange afin de bénéficier du régime de report applicable jusqu’en 2000, en estimant « que cette obligation a pour objet de permettre un contrôle de la plus-value placée par le contribuable en report d'imposition » et « que les conséquences attachées à l'omission d'une telle formalité, qui se traduisent par la taxation immédiate de la plus-value précédemment réalisée, ne revêtent pas le caractère d'une sanction mais se bornent à faire application du régime de droit commun ». Il n’y a donc pas de méconnaissance du droit de propriété garanti par l'article XVII de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.
2. Le montant de la soulte éventuelle ne doit pas excéder 10 % de la valeur nominale des titres reçus en échange de l’apport, comme dans le régime de sursis.
3. L’apport doit bénéficier à une société soumise à l’impôt sur les sociétés établie en France ou, s’il est réalisé dans un État de l'Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, à une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés. Le même régime d’extraterritorialité s’applique pour le régime de sursis.
4. La société bénéficiaire de l’apport doit être contrôlée par le contribuable qui apporte les titres. Ce critère légal de contrôle répond au critère jurisprudentiel d’appréhension potentielle par le contribuable des liquidités disponibles dans la société après l’opération d’apport-cession. Il est proposé pour l’essentiel de transposer les critères de contrôle d’une société par une autre tels que retenus par le code de commerce. Cette condition doit être appréciée à la date de l’apport, en tenant compte des nouveaux droits détenus dans la société en cause suite à cet apport. Trois critères alternatifs sont prévus :
– la détention de la majorité des droits de vote, directement ou avec le cercle familial du contribuable,
– l’exercice de la majorité des droits de vote en vertu d’un pacte d’actionnaires,
– l’exercice d’un pouvoir de décision de fait, avec deux cas de présomption : d’une part, lorsque le contribuable dispose directement ou indirectement d’au moins 33,33 % des droits de vote (c'est-à-dire qu’il dispose d’une minorité de blocage – on observera toutefois que le code de commerce retient 40 %) sans qu’aucun autre actionnaire ne détienne une participation supérieure ; d’autre part, lorsque le contribuable détermine les décisions prises en assemblée générale en agissant de concert avec une autre personne.
Définition du contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce « I.– Une société est considérée, pour l'application des sections II et IV du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : « 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; « 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; « 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; « 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. « II.– Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. « III.– Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. » |
Les plus-values d'échange en report deviennent imposables au titre de l'année de réalisation de l'événement entraînant l'expiration du report. Le taux d'imposition applicable est celui en vigueur au cours de l'année d'expiration du report. Comme pour tout régime de report, l’intérêt de retard s’applique (au taux de 4,8 % par an, tel que prévu par l’article 1727 du code général des impôts) à partir de la date de l’apport des titres. L’application de l’intérêt de retard a pour effet de compenser le préjudice résultant, pour le budget de l’État, de l’écoulement du temps depuis le calcul initial de la plus-value, dont le montant nominal subit chaque année l’inflation. Le contribuable aura aussi pu placer le montant d’impôt qu’il n’aura pas encore payé au titre de la plus-value d’échange du fait du report.
Cinq événements sont susceptibles de mettre fin au report. Ils sont prévus au I du nouvel article 150-0 B ter pour les quatre premiers, et au dernier alinéa du III du même article pour le cinquième.
1. La transmission, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres reçus en échange entraînent l'expiration du report d'imposition de la plus-value d'échange et, par conséquent, l'imposition immédiate de cette plus-value.
La notion de transmission retenue pour mettre fin au report est très large : elle comprend non seulement les transmissions à titre onéreux (vente, apport, échange), comme dans le régime de sursis, mais elle concerne aussi les transmissions à titre gratuit (succession et donation) des titres reçus en échange. Il s’agit d’une dérogation à la règle générale d’exonération définitive (« purge ») de la plus-value dont l'imposition a été reportée en cas de mutation à titre gratuit (une autre dérogation, spécifique pour certaines donations, est aussi prévue par l’article 14 du présent projet). Une telle dérogation s’est toutefois déjà appliquée pour les plus-values d'échange de titres réalisés avant le 1er janvier 1988 en report sur le fondement de l'ancien article 160 du code général des impôts. Elle est aussi prévue pour la remise en cause du report d’imposition prévu par l’article 150-0 D bis, lorsque la durée de détention des titres après remploi (soit cinq ans) n’est de ce fait pas respectée.
Lorsque les titres reçus en échange sont des actions ou des droits sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et que cette société procède à un remboursement d'apports ou de primes d'émission, ce remboursement entraîne l'expiration du report d'imposition. De même, l'annulation des titres reçus en échange, à la suite notamment d'une réduction du capital ou de la dissolution de la société émettrice de ces titres, entraîne l'expiration du report d'imposition l'année au titre de laquelle l'annulation intervient.
Si la transmission, le rachat, le remboursement ou l’annulation ne portent que sur une partie des titres reçus en échange, seule la fraction correspondante de la plus-value initialement reportée est imposée. Le surplus continue à bénéficier du report, en application du IV du nouvel article 150-0 B ter.
2. La transmission, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres apportés sont aussi susceptibles d’entraîner l'expiration du report d'imposition de la plus-value d'échange.
Le bénéfice du report d'imposition peut toutefois être maintenu à la condition que le produit de la cession soit réinvesti par la société bénéficiaire de l’apport qui, comme on l’a vu précédemment, est contrôlée par le contribuable. Ce critère légal de remploi traduit le critère jurisprudentiel de réinvestissement effectif d’une part substantielle du produit de la cession dans une activité économique. L’État se doit en effet de réserver le bénéfice du régime de faveur aux seules opérations d’apport-cession qui sont favorables à l’investissement et au développement de l’économie.
Le produit de la cession des titres ou droits doit être investi, dans un délai de cinq ans après l’apport (53) et à hauteur de 50 % du montant de la plus-value :
– soit dans le financement d’une activité commerciale, artisanale, libérale, agricole ou financière (pourquoi pas industrielle aussi ?), c'est-à-dire une activité opérationnelle qui ne soit pas de gestion patrimoniale,
– soit dans la souscription au capital initial ou dans l'augmentation de capital d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui exerce elle-même une activité opérationnelle ou qui est une holding dont l’objet social exclusif est de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles. Cette condition portant sur la nature de l’activité de la société de remploi doit s'apprécier de manière continue pendant les huit années précédant la cession des titres, ce qui est incompatible avec une souscription au capital initial d’une société nouvellement créée. La société bénéficiaire du remploi doit aussi avoir son siège social dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (soit l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein). Il n’est pas prévu de pouvoir remployer le produit de la cession pour acquérir des titres de sociétés déjà existantes, hors augmentation de capital.
On observera qu’il existe d’autres régimes légaux de report d’imposition sous condition de remploi. Il faut ici faire référence au dispositif général de report d’imposition des plus-values mobilières prévu par l’article 150-0 D bis du code général des impôts et modifié par l’article 6 du projet de loi de finances pour 2013 : il concerne les cessions de titres réalisées depuis le 1er janvier 2011 dont le produit de la cession est réinvesti dans la souscription au capital d'une société. Au-delà du report, la plus-value peut même être intégralement exonérée si certaines conditions sont remplies. Le taux de remploi retenu dans le nouveau dispositif prévu par le présent article est le même que celui retenu par le projet de loi de finances pour 2013 adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 20 novembre dernier pour le régime général. Il est toutefois plus exigeant que celui retenu par le comité de l’abus de droit dans son avis n° 2011-17 du 2 février 2012, qui a estimé qu’un réinvestissement est substantiel lorsqu’il représente 39 % du produit de la cession.
Régime du report d'imposition sous condition de remploi de l’article 150-0 D bis Droit en vigueur : Conditions à respecter pour bénéficier du report de la plus-value (PV) : – avoir détenu les titres pendant 8 ans en continu, – avoir détenu (avec le cercle familial) 10 % du capital, – titres d’une société opérationnelle soumise à l’IS. Conditions à respecter pour bénéficier de l’exonération de la PV reportée : – remploi dans les 3 ans de 80 % du montant de la PV, – remploi dans une société opérationnelle soumise à l’IS, – détention d’au moins 5 % du capital lors du remploi, – conservation des titres pendant au moins 5 ans. Nouvelles conditions à compter du 1er janvier 2013 (article 6 du PLF (54) ) : Part à remployer : diminuée de 80 % à 50 %. Délai de remploi : diminué de 3 ans à 2 ans. Exonération de la PV non plus totale mais limitée à la part remployée. |
Par ailleurs, il subsiste aussi un régime de report d’imposition pour les cessions de titres réalisées avant le 1er janvier 2006 dont le produit est réinvesti dans les fonds propres d'une société non cotée. Le réinvestissement pouvait porter sur une partie seulement du prix de cession ; dans ce cas, le montant de la plus-value susceptible de bénéficier du report d'imposition était déterminé selon le rapport existant entre le montant réinvesti et le prix de cession.
3. La transmission, le rachat, le remboursement ou l’annulation, soit des droits du contribuable dans les sociétés ou groupements interposés qui ont réalisé l'opération d'apport, soit des titres reçus en échange par la société ou le groupement interposés, mettent fin au report d'imposition, comme s’il n’y avait pas de chaîne de participations.
Il s’agit ainsi de tenir compte de l’éventuelle interposition de sociétés civiles de portefeuille.
4. Le transfert du domicile fiscal hors de France met aussi fin au report. Le C du I du présent article modifie par coordination l’article 167 bis du code général des impôts afin de tenir compte, pour le calcul de l’exit tax, de la plus-value précédemment reportée qui devient imposable à ce titre.
5. La transmission, le rachat, le remboursement ou l’annulation des nouveaux titres reçus en échange entraînent l'expiration du report initial. Les titres reçus en échange après un premier apport peuvent en effet eux-mêmes faire l’objet d’un échange, bénéficiant d’un sursis d’imposition, ou d’un nouvel apport, lui aussi soumis à report.
On peut se demander si le nouveau régime de report est compatible avec le droit de l’Union européenne.
En effet, dans un arrêt du 12 avril 2012, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé le régime de report d'imposition applicable avant 2000 incompatible avec les objectifs de la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990. La cour a en effet estimé qu’en vertu de l'article 8 de cette directive, l'attribution, à l'occasion d'un échange d'actions, de titres d'une société à un associé de la société apporteuse en échange de titres représentatifs du capital social de cette dernière société ne doit, par elle-même, entraîner aucune imposition sur le revenu et que seul peut être imposé le profit résultant de la cession ultérieure des titres reçus. Selon la cour, le régime du report d'imposition est contraire à cette directive dans la mesure où il a pour effet de liquider la plus-value réalisée à la date de l'échange et, le cas échéant, à défaut pour le contribuable d'en demander le bénéfice qui n’est qu’optionnel, de l'imposer au titre de l'année de réalisation de l'échange.
Un pourvoi en cassation a été introduit contre cet arrêt par le ministre de l’Économie et des finances. On ne dispose donc pas encore à ce stade d’une position du juge administratif suprême sur la compatibilité d’un régime de report avec le droit de l’Union européenne. On peut toutefois observer que l’analyse de la cour repose sur la prémisse que le report ne remet pas en cause le principe même de l’imposition. Or, les dispositions du code général des impôts qui permettent au contribuable réalisant une plus-value à l'occasion d'un échange de droits sociaux résultant d'une opération d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés d'obtenir le report de l'imposition de cette plus-value n'ont pas pour effet de différer le paiement d'une imposition qui aurait été établie au titre de l'année de réalisation de la plus-value, mais seulement de permettre, par dérogation à la règle suivant laquelle le fait générateur de l'imposition d'une plus-value est constitué au cours de l'année de sa réalisation, de la rattacher à l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report d'imposition. Sans fait générateur, il n’y a pas d’imposition.
De ce point de vue, l’institution d’un nouveau régime de report d’imposition en cas d’apport ne paraît pas manifestement contraire à l’article 8 de la directive. Conformément au 1 de cet article, la plus-value d’échange n’est pas taxée en elle-même. En revanche, en application du 2 de cet article, elle peut être taxée ultérieurement, lors de la cession des titres reçus. Le sixième considérant de la directive mentionne d’ailleurs expressément la possibilité d’instituer un régime de report d’imposition. On peut seulement se demander si le caractère optionnel du report ne pourrait pas être regardé comme constituant une restriction à la neutralisation de la fiscalité au titre d’une opération intercalaire. En vertu de l’adage nemo auditur, le contribuable ne saurait pourtant se prévaloir du non-exercice d’une option pour invoquer une incompatibilité avec le droit de l’Union alors que l’État lui permet de bénéficier d’un report d’imposition.
Article 8 de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents « 1. L'attribution, à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou d'un échange d'actions, de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire ou acquérante à un associé de la société apporteuse ou acquise, en échange de titres représentatifs du capital social de cette dernière société, ne doit, par elle-même, entraîner aucune imposition sur le revenu, les bénéfices ou les plus-values de cet associé. « 2. Les États membres subordonnent l'application du paragraphe 1 à la condition que l'associé n'attribue pas aux titres reçus en échange une valeur fiscale plus élevée que celle que les titres échangés avaient immédiatement avant la fusion, la scission ou l'échange d'actions. « L'application du paragraphe 1 n'empêche pas les États membres d'imposer le profit résultant de la cession ultérieure des titres reçus de la même manière que le profit qui résulte de la cession des titres existant avant l'acquisition. « Par « valeur fiscale », on entend la valeur qui servirait de base pour le calcul éventuel d'un profit ou d'une perte entrant en compte pour l'assiette d'un impôt frappant le revenu, les bénéfices ou les plus-values de l'associé de la société. « 3. Dans le cas où un associé est autorisé, conformément à la législation de l'État membre de sa résidence, à opter pour un traitement fiscal différent de celui défini au paragraphe 2, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux titres représentatifs pour lesquels cet associé aura exercé son droit d'option. « 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne font pas obstacle à la prise en compte, pour la taxation de l'associé, de la soulte en espèces qui lui est éventuellement attribuée à l'occasion de la fusion, de la scission ou de l'échange d'actions. » |
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement CF 55 du rapporteur général.
M. le rapporteur général. En cas d’apport-cession, l’article 13 prévoit qu’on puisse bénéficier d’un report d’imposition à condition de réinvestir le produit de la cession dans une société dans un certain délai. Aux termes du texte gouvernemental, il faut réinvestir dans un délai de cinq ans après l’apport, mais le bénéfice du report est perdu si la cession a lieu plus de cinq ans après l’apport, même en cas de réinvestissement : cela paraît incohérent. Je propose donc de décomposer en deux périodes le délai de cinq ans : l’obligation de réinvestissement ne concernerait que les cessions intervenant dans un délai de trois ans après l’apport, en suite de quoi l’on disposerait de deux ans pour investir. Cela permet de mieux viser les montages abusifs sans pénaliser les restructurations d’entreprise, auxquelles l’apport-cession peut être utile.
M. le président Gilles Carrez. Cet amendement semble aller dans le bon sens.
M. Charles de Courson. Si la cession intervient après trois ans, il n’y aura plus d’obligation de réinvestissement, dites-vous – mais pas non plus d’exonération ?
M. le rapporteur général. Dans ce cas, le bénéfice du report demeure. Si la cession intervient avant trois ans, il ne prend fin que si le produit de la cession n’est pas réinvesti au cours des deux ans qui suivent.
La Commission adopte l’amendement (Amendement n° 233).
Puis elle en vient à l’amendement CF 57 du rapporteur général.
M. le rapporteur général. Il s’agit de préciser que le réinvestissement doit aussi pouvoir se faire dans une activité industrielle.
La Commission adopte l’amendement (Amendement n° 232).
Elle examine ensuite l’amendement CF 58 du rapporteur général.
M. le rapporteur général. Il s’agit également d’un amendement de précision qui assouplit le dispositif de réinvestissement. Une disposition similaire a été adoptée à l’article 6 du projet de loi de finances sur 2013. Il s’agit de pouvoir réinvestir, le cas échéant, dans plusieurs sociétés.
La Commission adopte l’amendement (Amendement n° 230).
Puis elle examine l’amendement CF 56 du rapporteur général.
M. le rapporteur général. Dans le texte qui nous est soumis, le mécanisme d’encadrement des apports-cessions ne concerne pas les pactes Dutreil. Or ceux-ci n’emportent aujourd’hui d’avantages fiscaux que pour l’ISF et les droits de mutation, à l’exclusion des plus-values. Il n’y a donc pas lieu de favoriser ces pactes par rapport au droit commun en matière de plus-values, mais bien de maintenir le seul régime de faveur existant, conformément aux engagements qui ont été souscrits.
M. Charles de Courson. Je suis perplexe. Si l’on instaure un régime fiscal, il doit être cohérent. Si je comprends bien, les pactes Dutreil continueraient de bénéficier de l’abattement de 75 %, mais non des avantages sur les plus-values ?
M. le président Gilles Carrez. Non : à l’heure actuelle, les pactes Dutreil ont des conséquences sur les droits de succession et de donation et l’ISF, mais pas sur les plus-values.
M. Charles de Courson. Le texte gouvernemental me paraissait plus logique. Si l’on durcit le régime fiscal applicable aux plus-values – fût-ce pour atténuer ensuite la mesure, comme cela a été fait –, il faut maintenir les dispositions applicables aux pactes Dutreil.
M. le rapporteur général. L’imposition des plus-values des valeurs mobilières a été modifiée par le projet de loi de finances pour 2013. Il n’y a aucune raison de réserver un traitement différent aux plus-values réalisées dans le cadre des pactes Dutreil.
M. Charles de Courson. Il faut soutenir la position du Gouvernement si l’on veut préserver le capitalisme familial et éviter que les entreprises familiales ne soient toutes vendues à de grands groupes, ce qui nuirait au dynamisme du pays. Pour cette raison, je suis défavorable à l’amendement.
M. le président Gilles Carrez. Aujourd’hui, un actionnaire lié par un pacte Dutreil qui en sort pour vendre afin de réaliser une plus-value ne bénéficie d’aucune exonération d’impôt sur celle-ci puisque l’abattement de 75 % est limité aux droits de succession et de donation ainsi qu’à l’ISF. Mais qu’en est-il lorsqu’un associé A cède des titres à son associé B au sein du pacte ? Si je ne me trompe, la plus-value ainsi réalisée sera elle aussi assujettie à l’impôt.
M. Charles de Courson. Puisque l’on a durci le régime applicable aux plus-values, je maintiens qu’il faut en exonérer les pactes Dutreil pour les maintenir aussi longtemps que possible et les encourager.
M. le président Gilles Carrez. Je suis plutôt d’accord avec le rapporteur général. Les pactes incitent à l’actionnariat stable, que l’on favorise encore davantage en décourageant les cessions.
La Commission adopte l’amendement (Amendement n° 231).
Elle examine ensuite l’amendement CF 53 du rapporteur général.
M. le rapporteur général. Cet amendement précise la manière dont il faut apprécier l’exigence d’exercice d’une activité opérationnelle pour les sociétés nouvelles.
M. Charles de Courson. Comment faisait-on avant ?
M. le rapporteur général. Moins bien !
La Commission adopte l’amendement (Amendement n° 229).
Puis elle adopte l’article 13 ainsi modifié.
*
* *
Prévention des schémas d’optimisation fiscale
dits de « donation-cession » de titres de sociétés
Texte du projet de loi :
I.– L’article 150-0 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 bis est ainsi rédigé :
« 1 bis. – En cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A, dans un délai de deux ans suivant leur acquisition par voie de donation ou de don manuel :
« a) Le prix d’acquisition des valeurs, titres ou droits concernés à retenir par le cédant pour la détermination du gain net de cession de ces valeurs, titres ou droits est leur prix ou leur valeur d’acquisition par le donateur augmenté des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit, ou, si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la transmission ;
« b) La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou droits par le donateur ;
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux valeurs, titres ou droits qui ont fait l’objet d’une donation dans les conditions prévues aux articles 787 B ou 787 C.
« Pour l’application de ces dispositions, lorsque les valeurs, titres ou droits concernés ont fait l’objet de donations ou dons manuels successifs dans un délai de deux ans précédant leur cession, le prix d’acquisition des valeurs, titres ou droits à retenir est le prix ou la valeur d’acquisition par le premier donateur, ou si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la première donation ou du premier don manuel intervenu dans le délai de deux ans précité. La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou droits par le premier donateur.
« Lorsque, dans le délai de deux ans, les valeurs, titres ou droits reçus par donation ou par don manuel font l’objet d’un apport pour lequel le contribuable a opté pour le régime du report prévu à l’article 150-0 B ter, le montant de la plus-value en report est calculé selon les règles fixées aux trois premiers alinéas du présent 1 bis. Si les valeurs, titres ou droits apportés sont conservés par la société bénéficiaire de l’apport jusqu’à l’expiration du délai de deux ans, le montant de la plus-value en report est recalculé à partir de la valeur d’acquisition retenue pour la détermination des droits de mutation au titre de la donation considérée.
« Les dispositions du présent 1 bis ne s’appliquent pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de l’un des époux soumis à une imposition commune » ;
2° Le 9 est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les valeurs, titres ou droits remis à l’échange ont été acquis par voie de donation ou de don manuel, et que la vente ultérieure intervient moins de deux ans après ladite donation, le prix d’acquisition à retenir des valeurs, titres ou droits concernés est le prix ou la valeur d’acquisition par le donateur augmenté des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit, ou si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou droits par le donateur. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341 4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de l’un des époux soumis à une imposition commune.» ;
II.– Le premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette valeur est déterminée, lors d’un transfert de domicile fiscal hors de France intervenant dans un délai de deux ans suivant l’acquisition par voie de donation ou de don manuel des droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au premier alinéa du 1 du présent I, dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 150-0 D. »
III.– Les I et II sont applicables aux donations et dons manuels réalisés à compter du 14 novembre 2012.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article vise à remettre en cause un schéma d’optimisation fiscale dit de donation-cession, au titre de la taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers à l’impôt sur le revenu. À cette fin, il substitue à l’actuel régime de non-imposition de la plus-value latente en cas de transmission à titre gratuit des titres à l’origine de cette plus-value, un régime dérogatoire d’imposition de cette plus-value dans le chef du bénéficiaire lorsque les titres ont été acquis par donation puis cédés dans un délai inférieur à deux ans.
Afin d’éviter tout effet d’aubaine, ces dispositions entrent en vigueur le jour de la délibération du conseil des ministres sur le présent projet, soit le 14 novembre 2012.
1.– Le régime d’imposition des plus-values applicable en cas de transmission à titre gratuit de titres
En application du 1 de l’article 150-0 A du code général des impôts, seules sont en principe susceptibles de générer des plus-values imposables les cessions à titre onéreux. Celles-ci s'entendent des opérations emportant transfert à titre onéreux de la propriété des titres (vente, échange, apport...). Elles peuvent être réalisées de gré à gré entre deux personnes physiques (cessions directes) ou sur un marché réglementé.
A contrario, les mutations à titre gratuit n'entraînent en principe aucune taxation au titre des plus-values. Ces transmissions ne sont en effet pas susceptibles de dégager un gain pour le contribuable qui se dessaisit des titres qu’il possède. Dès lors, la transmission à titre gratuit des titres a pour conséquence l'exonération (on pourrait dire par purge) de la plus-value latente. Il n’y a aucune taxation à l’impôt sur le revenu de la plus-value constatée sur les titres depuis leur acquisition par le contribuable. La transmission des titres emporte transmission concomitante de leur valeur réelle à la date de la mutation. Les droits de mutation à titre gratuit (DMTG) taxent cette transmission de valeur. Le bénéficiaire de la transmission, qui doit acquitter ces droits, voit ensuite les titres entrer dans son patrimoine avec une valeur actualisée.
Un montage d’optimisation fiscale fréquemment utilisé consiste à faire précéder la cession des titres d'une donation. Ce type de montage permet ainsi de neutraliser la taxation des plus-values : la plus-value due avant la transmission est purgée par la donation (55), et la cession qui intervient juste après la donation ne génère aucune plus-value puisque le prix de cession est alors égal à la valeur des titres transmis.
SCHÉMA DE LA DONATION-CESSION
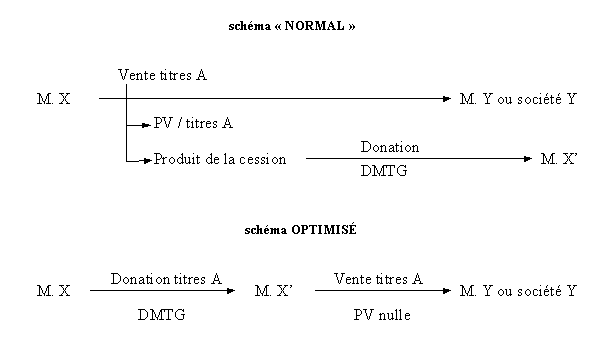
L’administration poursuit assez systématiquement ces opérations de donation-cession sur le terrain de l’abus de droit. On ne peut toutefois citer à ce stade que deux décisions du Conseil d’État statuant au contentieux sur ce type de montages. Elles témoignent de la difficulté pour l’administration d’obtenir gain de cause sur ce fondement : il lui faut en effet pouvoir démontrer la fictivité de la donation pour caractériser un abus de droit. Or cela lui est très malaisé compte tenu de la grande liberté qu’offre le droit civil en matière d’organisation des transmissions.
Dans une décision du 27 juillet 2012 (n° 327295, Berjot), le Conseil d'État a sanctionné le caractère fictif d’une donation avec réserve d'usufruit suivie d’une cession des titres. Il a en effet considéré que le produit de la cession était en fait appréhendé par les donateurs, les donataires n'ayant pas reçu la quote-part du produit correspondant à leurs droits attachés à la nue-propriété des titres. En revanche, dans une décision du 30 décembre 2011 (n° 330940, Motte-Sauvage), le Conseil d’État a estimé qu’une donation-partage de titres placés en report d'imposition, suivie de la cession immédiate de ces titres par les donataires à une société civile familiale contrôlée par les donateurs, ne présentait pas un caractère fictif constitutif d'un abus de droit, alors même que l'acte de donation était assorti de clauses restrictives des droits des donataires, dès lors que l'intention libérale des donateurs n'était pas remise en cause par ces clauses et qu'il y a bien eu dépouillement immédiat et irrévocable des titres en faveur des donataires. Les donateurs ne se sont pas réapproprié les sommes issues de la vente des titres, ces sommes ayant été versées dans leur intégralité sur des comptes bancaires ouverts au nom de chacun des enfants. La rapidité avec laquelle est intervenue la donation est en tout état de cause sans incidence.
L’administration a aussi pu tenter de remettre en cause la valeur des titres retenue pour la donation, la pratique d’optimisation consistant à porter cette valeur à un montant équivalent au prix de la cession qui va intervenir juste après la donation. Mais elle se heurte alors au 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts qui précise qu’en cas de transmission à titre gratuit, le prix d’acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value en cas de cession postérieure à la donation est la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Dans une décision du 12 octobre 2011 (n° 324717, Rastier), le Conseil d’État a ainsi jugé que l’administration ne peut écarter la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation – que cette valeur procède d'une déclaration du contribuable au titre des droits d'enregistrement ou, le cas échéant, d'une rectification de cette déclaration par l'administration elle-même selon les procédures prévues en matière de droits de mutation – qu'en établissant que cette valeur est dépourvue de toute signification.
Face à ces difficultés, le Gouvernement propose d’instaurer un nouveau régime légal d’imposition des plus-values, spécifique au cas des donations-cessions. S’agissant d’un régime objectif d’imposition, il ne sera plus nécessaire de tenter d’établir l'intention des contribuables d'échapper à l'imposition. L’instauration d’un tel système anti-optimisation fiscale est d’autant plus nécessaire que le durcissement de l’imposition des plus-values prévu par l’article 6 du projet de loi de finances pour 2013 risque de démultiplier les tentatives d’y échapper, notamment au travers d’opérations de donation-cession.
Le nouveau régime d’imposition est inséré au sein de l’article 150-0 D du code général des impôts qui détermine le mode de calcul des plus-values imposables à l’impôt sur le revenu. Le 1° du I du présent article rétablit un 1 bis au sein de l’article 150-0 D afin de prévoir le mode de taxation des donations-cessions.
Le principe de taxation retenu consiste à faire peser sur le donataire une taxation de la plus-value – qui a en principe été purgée par la donation – lorsqu’il cède les titres reçus dans un délai inférieur à deux ans après leur transmission. Ce choix a été fait car, si la donation n’est pas fictive, la décision de cession relève du seul donataire, qui doit donc en assumer les conséquences fiscales. Par ailleurs, si l’imposition reposait sur le donateur, la plus-value serait imposable alors même que sa transmission à titre gratuit ne procure aucune liquidité au contribuable pour s’acquitter de l’impôt correspondant, le produit de la cession revenant au donataire. En revanche, ce système aboutit à faire peser sur le donataire une imposition correspondant à une valorisation des titres intervenue alors qu’ils figuraient dans le patrimoine du donateur.
Il faut souligner que ce régime spécifique d’imposition ne concerne que les donations et dons manuels. En cas de succession (par principe imprévisible dans sa date et donc insusceptible de permettre la mise en place d’un schéma d’optimisation fiscale a priori), le principe de la purge de la plus-value par la transmission opérée à titre gratuit demeure.
Le mécanisme spécifique d’imposition n’est déclenché qu’en cas de cession des titres reçus dans un délai de deux ans suivant leur acquisition. Après l’expiration de ce délai, le régime de droit commun de purge de la plus-value retrouve à s’appliquer. Il ne risque plus en effet d’y avoir d’optimisation puisque les titres acquis à titre gratuit auront pu prendre de la valeur avant leur cession et une plus-value normalement taxable aura donc pu réapparaître.
Afin de rattraper la valeur des titres avant la donation, il est prévu de retenir comme prix d’acquisition, non pas la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation, mais le prix pour lequel le bien a été acquis (à titre gratuit ou onéreux) par le donateur. Afin d’éviter une double imposition pour le donataire, il est cependant prévu d’ajouter à ce prix le montant des droits de mutation payés lors de la transmission correspondant à ces titres. Pour qu’il n’y ait pas non plus d’effet d’aubaine à rebours, il sera cependant de nouveau fait référence à la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation si la somme du prix d’acquisition initial et des droits de mutation payés est supérieure à la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Ce cas peut se produire notamment en cas de moins-value constatée avant la donation : si un titre acquis 100 est donné à 50 puis vendu à 60 dans le droit en vigueur, une plus-value de 10 est taxée ; il ne faudrait pas qu’avec le nouveau système de taxation, la plus-value post-cession soit absorbée par la moins-value latente ante-cession.
Pour l’application des abattements pour durée de détention (notamment ceux qui ont été introduits par l’article 6 du projet de loi de finances pour 2013 tel qu’adopté en première lecture à l’Assemblée nationale : 20 % entre deux et quatre ans, 30 % entre quatre et six ans, 40 % au-delà de six ans), le point de départ retenu est, dans tous les cas (quelle que soit la valeur retenue pour les titres), celui de l’acquisition par le donateur.
Ces modalités de calcul du prix d’acquisition et de la durée de détention sont adaptées pour tenir compte de quatre situations particulières :
a) en cas de donations successives dans le délai de deux ans, il sera toujours fait référence aux valeur et durée retenues pour le premier donateur en application de ce nouveau régime d’imposition ;
b) en cas d’apport des titres reçus et de bénéfice du nouveau régime de report d’imposition créé par l’article 13 du présent projet (pour contrer les montages d’apport-cession), il sera aussi fait référence aux valeur et durée retenues en application du nouveau régime d’imposition des donations-cessions pour le calcul de la plus-value en report pendant une période de deux ans ;
c) en cas d’échange des titres reçus et de bénéfice du régime de sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B, il sera également fait référence aux valeur et durée retenues en application du nouveau régime d’imposition des donations-cessions pour le calcul de la plus-value en sursis pendant une période de deux ans. Cette disposition est insérée au 9 de l’article 150-0 D du code général des impôts par le 2° du I du présent article ;
d) en cas de transfert du domicile fiscal hors de France dans un délai de deux ans après une donation de titres, il sera tenu compte pour le calcul de l’exit tax de la valeur et de la durée retenues en application du nouveau régime d’imposition des donations-cessions. Le II du présent article modifie en ce sens l’article 167 bis du code général des impôts relatif à l’exit tax.
Ce régime spécifique d’imposition ne s’appliquera pas dans deux cas :
– pour les titres qui font l’objet d’un engagement de conservation (pacte Dutreil) afin de pérenniser l’actionnariat familial dans le cadre des transmissions patrimoniales. Les opérations de donation-cession réalisées avec ces titres peuvent donc continuer à bénéficier du régime de purge de la plus-value. En effet, l’exonération de 75 % des droits de mutation à titre gratuit prévue par les articles 787 B et 787 C du code général des impôts pour ces titres peut déjà être remise en cause dans certains cas de cession et d’apport ne respectant pas les engagements collectif et individuel de conservation ;
– en cas d’accident de la vie concernant le donataire ou son conjoint (56), si le bénéficiaire de la donation est obligé involontairement de céder les titres reçus dans un délai inférieur à deux ans. Il en sera ainsi suite à un décès, suite à une invalidité grave ne permettant pas d'exercer une activité rémunérée (invalidité dite de deuxième catégorie – invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque – ou de troisième catégorie – invalide qui, étant absolument incapable d'exercer une profession, est en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie), ou suite à un licenciement.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement CF 61 du rapporteur général.
M. le rapporteur général. Cet article vise les montages d’optimisation qui consistent à revendre immédiatement après avoir reçu une donation. Dans une première version du texte, le Gouvernement avait prévu un délai de trois ans, ramené à deux ans après le passage en Conseil d’État. Je propose de le ramener à un an et demi, ce qui me paraît plus raisonnable, mais pas à un an comme dans un amendement déposé par M. Hervé Mariton.
La Commission adopte l’amendement (Amendement n° 228).
Elle examine ensuite l’amendement CF 59 du rapporteur général.
M. le rapporteur général. Le texte mentionne les personnes mariées mais non les pacsés. L’amendement remédie à cet oubli.
La Commission adopte l’amendement (Amendement n° 227).
Puis elle adopte l’article 14 ainsi modifié.
*
* *
Article additionnel après l’article 14
Suppression de la retenue à la source sur les intérêts de placements antérieurs à 1987
La Commission est saisie de l’amendement CF 48 du rapporteur général.
M. le rapporteur général. Un amendement similaire avait été adopté par la Commission lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2013, puis retiré en séance à la demande du Gouvernement afin de préciser plusieurs aspects techniques, ce qui a été fait.
L’article 5 du projet de loi de finances unifie les prélèvements applicables aux produits de placement à revenu fixe, mais il maintient l’application de la retenue à la source aux placements d’avant 1987, ce qui peut poser des problèmes de gestion. L’amendement propose d’intégrer la retenue à la source sur les intérêts de placements d’avant 1987 au prélèvement applicable sur les intérêts de placements d’après 1987. Il s’agit d’une mesure de simplification et de clarification.
La Commission adopte l’amendement (Amendement n° 226).
*
* *
Article additionnel après l’article 14
Allongement du délai global d’investissement des FCPI et des FIP au titre de l’avantage consenti à l’ISF
Puis la Commission examine l’amendement CF 46 du rapporteur général.
M. le rapporteur général. Il s’agit d’un amendement de coordination avec le projet de loi de finances pour 2013. Comme celui-ci l’a fait pour la réduction d’impôt en faveur de l’investissement dans les PME – c’est le dispositif « Madelin » –, et comme le demandaient les acteurs du secteur, il porte le délai global d’investissement des FCPI et des FIP de 16 à 24 mois au titre de l’exonération d’ISF en cas d’investissement dans les PME.
La Commission adopte l’amendement (Amendement n° 225).
*
* *
Puis elle en vient à l’amendement CF 19 de M. de Courson.
M. Charles de Courson. Il s’agit d’harmoniser le plafond d’exonération d’ISF au titre de l’investissement dans les PME – 45 000 euros – et celui qui s’applique à l’impôt sur le revenu – 18 000 euros –, soit par le haut, soit en optant pour un moyen terme de 20 000 à 22 000 euros afin d’annuler le coût de la mesure. En effet, la disparité est curieuse dès lors que l’on peut choisir de faire porter l’exonération, soit sur l’ISF, soit sur l’impôt sur le revenu. L’on pourrait également procéder à une harmonisation des taux de l’exonération, qui sont de 18 % dans le dispositif Madelin applicable à l’impôt sur le revenu, mais de 50 % dans le cas de l’ISF – soit 30 % en réalité, car cela porte sur les 60 % éligibles du montant investi.
M. le rapporteur général. Avis défavorable à cet amendement qui ne concerne en fait que l’ISF et que l’on retrouve régulièrement, ce qui montre que certaines personnes savent se faire entendre. Les FCPI ne fonctionnent pas très bien. Nous devrons y réfléchir. Je ne suis pas certain qu’il faille leur accorder une aide fiscale supplémentaire, d’autant que l’opportunité fiscale l’emporte souvent – quoique pas toujours – sur l’intérêt économique.
La Commission rejette l’amendement.
*
* *
Harmonisation des délais de réclamation applicables en matière fiscale
et de réparation des préjudices subis
Texte du projet de loi :
I.– Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'article L. 190 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– Après les mots : « droits à déduction » sont insérés les mots : « ou à la restitution d'impositions indues » ;
– Il est complété par les mots : « , révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;
c) Au cinquième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » ;
2° Après l'article L. 190, il est inséré un article L. 190 A ainsi rédigé :
« Art. L. 190 A. – L'action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l'impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l’existence de la créance a été révélée au demandeur. »
II.– Le code des douanes est ainsi modifié :
1° le premier alinéa du 1 de l’article 352 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l’administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitutions de marchandises, à l’exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaires, sont présentées à l’administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° À l'article 352 ter, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » et le second alinéa est supprimé ;
3° Après l'article 352 ter, il est inséré un article 352 quater ainsi rédigé :
« Art. 352 quater. – L'action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans l'assiette, le contrôle et le recouvrement de l'impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l'existence de la créance a été révélée au demandeur. »
III.– 1° Le 1° du I et le 2° du II s'appliquent aux réclamations et demandes fondées sur une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux prononcés à compter du 1er janvier 2013 ;
2° Le 2° du I et le 3° du II s’appliquent aux actions en réparation relatives à des créances dont l’existence a été révélée au demandeur à compter du 1er janvier 2013.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article vise à harmoniser les délais de réclamation en matière fiscale et de réparation des préjudices subis par les contribuables en cas de contentieux fiscal, que ce contentieux résulte de la non-conformité de la règle de droit appliquée à une règle de droit supérieure ou de l’action des services fiscaux et douaniers.
I.– LES RÈGLES EN VIGUEUR EN MATIÈRE DE DÉLAIS DE RÉCLAMATION ET DE RÉPARATION DES PRÉJUDICES SUBIS
En application de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF), les réclamations présentées par les contribuables à l’administration fiscale relatives aux « impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration » sont du ressort de la juridiction contentieuse lorsque ces réclamations « tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ».
Il en est de même dans deux cas particuliers :
– si l’objet de la réclamation est d’obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire ;
– si la réclamation se fonde sur la non-conformité de la règle de droit appliquée à une règle de droit supérieure.
Les réclamations présentées visent donc à obtenir soit la décharge ou la réduction d’une fraction ou de la totalité de l’imposition mise en recouvrement par voie de rôle ou d'avis de mise en recouvrement, soit la restitution de sommes acquittées, soit l'exercice d'un droit à déduction qui n’aurait pas été respecté.
Les contribuables peuvent ainsi adresser une réclamation au service administratif en charge des impôts, des contributions, droits ou taxes auxquels ils sont assujettis. L’administration dispose alors d’un délai de six mois pour leur répondre, à l’échéance duquel les contribuables peuvent décider de saisir la juridiction contentieuse compétente (57).
Les contribuables doivent présenter leur réclamation dans les délais prévus par la loi, sous peine que la réclamation soit considérée comme irrecevable. La date prise en compte pour apprécier le respect de cette condition est celle de l’envoi de la réclamation par le contribuable, le cachet de la poste faisant foi.
La réclamation ne peut ainsi être prise en compte si elle a été envoyée après l’expiration du délai légal (58).
Elle ne peut l’être également si son envoi précède la date à compter de laquelle s’apprécie le délai légal (59).
Par ailleurs, les délais de présentation des réclamations diffèrent selon les impôts concernés. Ils sont fixés par voie réglementaire (articles R 196-1 à R 196-6 du livre des procédures fiscales), sauf dans le cas des taxes et autres impositions recouvrées par l’administration des douanes pour lesquelles l’article 352 du code des douanes prévoit explicitement le délai à respecter.
● Les délais applicables aux réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et leurs taxes annexes
Les réclamations doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
– de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
– du versement de l'impôt contesté ;
– de la réalisation de l'événement (60) qui motive la réclamation.
Le schéma ci-dessous permet d’illustrer ce délai de droit commun :
Mise en recouvrement de |
Art. R 196-1 a |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||||||||
1/01 |
31/12 |
1/01 |
31/12 |
1/01 |
31/12 |
1/01 |
31/12 |
1/01 |
31/12 |
|||||||
Source : Instruction fiscale 10 août 2006, 13 O-1-06
Toutefois, des dérogations spécifiques prévoient que ce délai peut être ramené, si cela est plus favorable au contribuable, au 31 décembre de l'année suivant celle :
– de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition tenant compte des erreurs de celui adressé précédemment ;
– au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés ;
– au cours de laquelle le contribuable a eu une connaissance certaine que les cotisations d'impôts établies l’étaient à tort ou faisaient double emploi.
● Les délais applicables aux réclamations relatives aux impôts directs locaux et à leurs taxes annexes
En matière d’impôts locaux, les délais de présentation des réclamations à l’administration courent jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu soit la mise en recouvrement, soit la réalisation d’un événement motivant la réclamation, ou suivant celle au cours de laquelle le contribuable a eu une connaissance certaine qu’une erreur existait dans l’établissement du montant de son imposition.
Mise en recouvrement de |
Art. R 196-2 a |
|||||||||||||||
|
Paiement de l’impôt |
|||||||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|||||||||||||
1/01 |
31/12 |
1/01 |
31/12 |
1/01 |
31/12 |
1/01 |
31/12 |
|||||||||
● Le délai applicable en cas de reprise ou de rectification de l’imposition du contribuable
Un délai spécial est prévu dans le cas où le contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification, de façon que ce dernier dispose d’un délai égal à celui de l’administration fiscale pour présenter ses propres réclamations. Ce délai spécial correspond ainsi au délai général de reprise de trois ans, qui peut être porté à dix ans dans certains cas de fraude grave (61).
Il expire donc selon le cas au 31 décembre de la troisième ou de la dixième année suivant celle au cours de laquelle l’administration a adressé la proposition de rectification au contribuable.
Dans le cas de procédures particulières, l’article L. 190 précité précise que la réclamation peut être présentée à l’administration à compter de :
– la réception de la réponse faite aux observations du contribuable par l’administration, prévue dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
– un délai de 30 jours après réception de la notification prévue en cas d’imposition d’office mentionnée à l'article L. 76 du même livre ;
– la notification de l'avis rendu par la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en cas de saisine de cette dernière.
● Le délai applicable en cas de non-conformité de la règle de droit appliquée à une règle supérieure révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux
La non-conformité de la règle de droit appliquée au regard d’une règle supérieure peut être constatée de plusieurs manières et donner droit, à ce titre, à des délais de réclamation différents.
Dans le cas où la non-conformité est constatée en l’absence de décision juridictionnelle ou d’avis rendu au contentieux, les délais de réclamation de droit commun, qui varient selon les impositions concernées, s’appliquent. La modification de la règle de droit en vue de rétablir sa conformité avec des règles de droit supérieures n’est donc pas susceptible d’ouvrir droit à un nouveau délai de réclamation. Par ailleurs, la période prise en compte pour le calcul du montant de la restitution est fixée à deux années seulement avant celle au cours de laquelle la règle de droit a été modifiée.
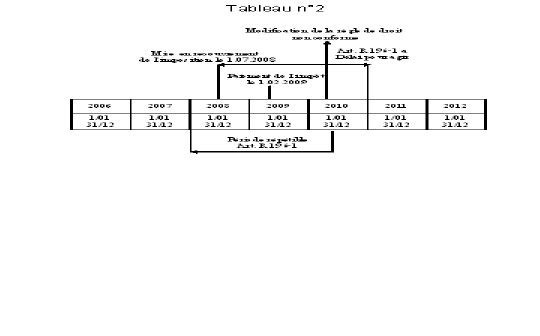
Au contraire, dans le cas où la non-conformité est révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, un nouveau délai de réclamation est ouvert. L’article L. 190 précité prévoit ainsi que le contribuable peut adresser des réclamations à l’administration fiscale, dans un délai de deux années suivant celle au cours de laquelle la décision est intervenue, au titre des impositions indûment versées pendant une période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu. Les impositions acquittées au cours des années précédentes ne peuvent en revanche faire l’objet d’une action en restitution.
Le schéma ci-dessous illustre cette disposition :
Mise en recouvrement de |
Décision juridictionnelle |
|||||||||||||||
Paiement de l’impôt |
Art. R 196-1 a | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 | ||||||||||
1/01 |
31/12 |
1/01 |
31/12 |
1/01 |
31/12 |
1/01 |
31/12 |
1/01 |
31/12 |
1/01 |
31/12 |
1/01 |
31/12 | |||
|
|
|||||||||||||||
Source : Instruction fiscale 10 août 2006, 13 O-1-06
Pour l’application de cette disposition, le même article précise que ces décisions et avis recouvrent :
– les décisions du Conseil d'État ;
– les arrêts de la Cour de cassation ;
– les arrêts du Tribunal des conflits ;
– les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l’Union européenne depuis le 1er décembre 2009, se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle.
● Le délai applicable aux demandes de restitutions adressées à l’administration des douanes
En application de l’article 352 du code des douanes, les contribuables qui souhaitent présenter à l’administration des douanes une demande en restitution « de droits et de marchandises et paiement de loyers » disposent d’un délai de trois années après le paiement des montants concernés, au-delà duquel les créances que l’administration détient à leur encontre sont prescrites à son profit.
Par ailleurs, si la demande de restitution trouve son fondement dans le défaut de validité du texte fondant la perception de la taxe recouvrée par les services des douanes et que ce défaut est révélé par une décision juridictionnelle, cette demande ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle la décision est intervenue. L’action en restitution ne peut donc viser les années antérieures à cette période.
2.– Les délais encadrant les recours en indemnités
Si le contribuable estime devoir être dédommagé du préjudice subi du fait de l'action des services fiscaux, il peut engager une procédure appuyée sur le droit commun de la responsabilité de la puissance publique.
Sa demande de dommages et intérêts doit alors être présentée avant que ne soient prescrites les créances que détient l’administration à son encontre. Cette prescription intervient, conformément aux dispositions des articles 1, 2 et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics, au titre des « créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
Par conséquent, la demande du contribuable doit intervenir avant l’expiration de ce délai (62).
Par ailleurs, si le préjudice subi est lié à la non-conformité de la règle appliquée à la règle de droit supérieure révélée par une décision juridictionnelle, l’action en réparation de ce préjudice ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision est intervenue, en application des dispositions prévues à l’article L. 190 du livre des procédures fiscales.
Ainsi, dans le cas d'une décision juridictionnelle rendue au cours de l'année 2012, l’action en réparation doit être introduite avant le 31 décembre 2016 et ne peut porter que sur des faits intervenus après le 1er janvier 2009.
Ces dispositions s’appliquent également aux taxes recouvrées par l’administration des douanes, en l’absence de disposition spécifique au régime indemnitaire dans le code des douanes.
II.– LES MESURES D’HARMONISATION DES RÈGLES EN VIGUEUR PROPOSÉES PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le présent article prévoit que l’ensemble des règles relatives à ces délais soit à l’avenir prévu par voie réglementaire (la détermination des délais mentionnés à l’article 352 du code des douanes est donc renvoyée à un décret en Conseil d’État).
Le délai de réclamation de droit commun de deux années suivant celle de la mise en recouvrement de l’impôt devrait donc s’appliquer à l’ensemble des réclamations présentées par les contribuables en matière fiscale (hormis les réclamations portant sur les impôts locaux et les délais spécifiques prévus en cas de redressement du contribuable par exemple).
Le délai de trois années prévu par l’article 352 du code des douanes ne devrait donc plus s’appliquer.
Par ailleurs, les délais des demandes en restitution des impositions indûment versées du fait de la non-conformité de la règle de droit appliquée à une règle de droit supérieure seraient, en application du présent article, identiques à ceux applicables aux demandes de décharge ou de réduction d’impôt, ou d’exercice de droits à déduction.
Si la rédaction proposée renvoie la détermination de ces délais à des décrets en Conseil d’État, ceux-ci devraient reprendre les délais de droit commun existant en matière de réclamation et de demande de restitution, soit dans les deux cas, un délai de deux années à compter de la date de mise en recouvrement.
Enfin, il est proposé de supprimer la réouverture des délais dont bénéficiaient les contribuables à la suite d’une décision de justice relevant la non-conformité de la règle appliquée à une règle de droit supérieure. Par conséquent, le délai applicable sera celui de droit commun, plus contraignant, de deux années suivant celle de la mise en recouvrement de l’impôt.
2.– Réduction de la période de restitution en cas de non-conformité de la règle appliquée à la règle de droit supérieure révélée par une décision de justice
La période prise en compte pour le droit à restitution des impositions indûment versées en cas de non-conformité de la règle de droit appliquée à la règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle, sera diminuée d’une année afin que sa durée soit identique à celle applicable en cas de modification au même motif, mais en l’absence de décision de justice.
En effet, ainsi qu’il a été décrit précédemment, le droit en vigueur prévoyait un régime de restitution plus favorable si une décision de justice était à l’origine de la modification de la règle de droit appliquée.
3.– Réduction de la période prise en compte en cas d’action en réparation ou de demande de dommages et intérêts
L’action en réparation du préjudice que le contribuable estime avoir subi du fait de la non-conformité de la règle appliquée à la règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts qu’il présente au titre de la faute commise par les services administratifs dans la détermination du montant de l’impôt ne portera plus que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année (au lieu de la troisième année) précédant celle au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance de l’existence d’une créance de l’État à son profit.
Les dispositions du présent article s’appliqueront aux réclamations et demandes fondées sur une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux prononcés à compter du 1er janvier 2013.
Elles s’appliqueront aux actions en réparation relatives aux créances portées à la connaissance du contribuable à compter de cette même date.
*
* *
La Commission adopte l’article 15 sans modification.
*
* *
Après l’article 15
La Commission est saisie de l’amendement CF 5 de M. Lefebvre.
M. Dominique Lefebvre. À l’heure actuelle, un dispositif spécifique permet à l’INSEE, notamment, d’accéder sous certaines conditions à des informations nominatives susceptibles de nourrir ses études, alors que les autres chercheurs ne bénéficient d’aucune dérogation au secret fiscal. Aux fins de transparence, nous proposons de leur étendre cet accès tout en assurant la protection des données fiscales par un filtrage confié au comité du secret statistique, chargé de vérifier que la demande est justifiée par une recherche scientifique.
M. le président Gilles Carrez. Qui sont ces « chercheurs extérieurs » ?
M. Dominique Lefebvre. Les universitaires, par exemple.
Mme Marie-Christine Dalloz. Et les chercheurs du CNRS ?
M. le rapporteur général. Avis favorable à cet amendement, qui assortit la transparence, salutaire, de toutes les garanties nécessaires.
Mme Karine Berger. Je suis très gênée : pour la première fois depuis mon élection, je me sens en porte-à-faux par rapport à mes collègues de la commission et au rapporteur général. Le principe du secret statistique suppose que l’on ne puisse déduire des chiffres l’identité des personnes, car quelle que soit la bonne foi des demandeurs, l’on ne peut exclure que les informations délivrées soient utilisées à d’autres fins que la recherche. À titre personnel, mes chers collègues, je vous déconseille vivement d’adopter cet amendement. L’INSEE, que je connais bien, ne dispose pas d’un accès automatique à ces informations et je n’ai jamais pu y consulter les données individuelles d’un particulier ou d’une entreprise, ce qui est tout à fait normal car cela suppose que des conditions extrêmement strictes soient réunies.
M. Charles de Courson. Cet amendement offrirait aux chercheurs – certes encadrés – un accès aux dossiers individuels qui est refusé aux membres de la Commission des finances, à l’exception de son rapporteur général et de son président, tenus au secret fiscal. Ensuite, comme Mme Berger, je redoute l’utilisation qui pourrait être faite des fichiers, même sans identification nominative. Qu’adviendra-t-il d’eux au terme des recherches ? Seront-ils détruits ?
M. Pierre-Alain Muet. Il ne peut s’agir que de dossiers individuels anonymisés. Peut-être conviendrait-il de retirer l’amendement pour le redéposer dans une rédaction plus précise, car il est essentiel que les travaux scientifiques puissent s’appuyer sur des données individuelles.
M. Olivier Carré. L’anonymat est possible lorsque plusieurs centaines d’individus sont concernés, mais les études les plus intéressantes portent souvent sur des échantillons plus réduits. Comment les cent plus gros patrimoines se sont-ils construits au cours des cinquante dernières années ? Voilà un beau problème d’économie ; mais les données qui permettent de le traiter pourraient être exploitées de manière contraire aux règles de déontologie.
M. le président Gilles Carrez. Monsieur Lefebvre, acceptez-vous de retirer votre amendement pour le redéposer au titre de l’article 88 ?
M. Dominique Lefebvre. Oui. J’insisterai sur l’importance de la recherche scientifique en la matière – dont l’INSEE ne devrait pas avoir le monopole. La protection des données nominatives est assurée dans la rédaction actuelle de l’amendement par une procédure très stricte.
L’amendement est retiré.
*
* *
Précisions des modalités d’imposition en cas de transfert de siège
ou d’établissement stable hors de France
Texte du projet de loi :
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.– Le 2 de l’article 221 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'étranger » sont remplacés par les mots : « dans un État étranger autre qu’un État membre de l’Union européenne ou qu’un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le transfert de siège ou d'un établissement s’effectue dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée et qu’il s'accompagne du transfert d'éléments d'actifs, l'impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l’actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d’imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs :
« a) Soit pour la totalité de son montant ;
« b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. Le solde des fractions dues en application de la phrase précédente peut être versé à tout moment, en une seule fois, avant l’expiration de ce délai.
« L'impôt devient immédiatement exigible lorsqu'intervient, dans le délai de cinq ans, la cession des actifs ou leur transfert dans un autre État que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent 2 ou la dissolution de la société ou le non-respect de l'une des échéances de paiement.
« La société adresse chaque année au service des impôts des non résidents un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values latentes sur les éléments de l'actif immobilisé transférés, mentionnées au quatrième alinéa. »
B.– Après le g du I de l’article 1763, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« h) L’état mentionné au septième alinéa du 2 de l’article 221. »
II.– Le I s’applique aux transferts réalisés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2012.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article a pour objet de tirer les conséquences de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne. Dans deux arrêts assez récents, celle-ci a estimé que les mécanismes d’exit tax ayant pour effet d’imposer de manière immédiate les plus-values latentes sur les actifs d’une société transférés d’un État de l’Union européenne vers un autre portent une atteinte disproportionnée au principe de liberté d’établissement, consacré par l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Ces deux arrêts ne concernaient pas la législation française, mais les législations néerlandaise et portugaise. Le code général des impôts prévoit cependant, selon des modalités au demeurant peu claires, un dispositif identique. Afin d’éviter une condamnation ultérieure de la France au titre de ce dispositif, le Gouvernement entend par le présent article offrir aux entreprises concernées la possibilité de fractionner le paiement de leur impôt, l’option en faveur d’un paiement différé étant considérée par la Cour comme une condition de conformité de l’exit tax au droit de l’Union européenne.
En application du 2 de l’article 221 du code général des impôts (CGI), le transfert à l’étranger du siège ou d’un établissement d’une entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés (IS) entraîne – à l’instar de la dissolution de la société ou de la création d’une personne morale nouvelle – les conséquences fiscales de la cessation d’entreprise. Il en résulte que les bénéfices qui n’ont pas encore été imposés le sont immédiatement, par une forme d’exit tax, afin d’assurer au Trésor public le recouvrement de l’impôt, qui pourrait à défaut être menacé par la disparition de l’entreprise.
Afin de mettre la législation française en conformité avec le droit de l’Union européenne (63), l’article 34 de la loi de finances pour 2005 (64) a prévu une exception au principe de taxation immédiate des bénéfices en cas de transfert à l’étranger.
Le dernier alinéa du 2 de l’article 221 dispose en effet que « le transfert de siège dans un autre État membre de la Communauté européenne, qu’il s’accompagne ou non de la perte de la personnalité juridique en France, n’emporte pas les conséquences de la cessation d’entreprise ».
L’évaluation préalable annexée au présent article indique que « cette exception au principe de la cessation d’entreprise ne s’applique que dans la mesure où le transfert de siège d’une société française dans un autre État membre ne s’accompagne pas du transfert total des actifs ».
Le transfert total des actifs entraîne donc, en l’état du droit en vigueur, l’imposition immédiate :
– des bénéfices d’exploitation dégagés depuis la date d’ouverture de l’exercice en cours ;
– des bénéfices en sursis d’imposition (notamment les provisions constituées en franchise d’impôt et les plus-values issues de fusions antérieures) ;
– des plus-values latentes afférentes aux éléments d’actif immobilisé (65).
Même en cas de transfert partiel, la taxation immédiate des actifs transférés est possible (à l’exclusion, donc, des actifs maintenus au bilan d’un établissement stable français (66)) : l’évaluation préalable indique que dans ce cas, « seules les plus-values latentes afférentes aux éléments d’actif immobilisé transférés sont immédiatement taxables ». Les bénéfices d’exploitation et les bénéfices en sursis d’imposition restent en effet taxables en France du fait du maintien d’un établissement stable.
Ces « exceptions à l’exception » ne sont toutefois pas expressément prévues par l’article 221 du CGI. Dans leurs commentaires précités de l’article 17 du projet de loi de finances pour 2005, les Rapporteurs généraux d’alors indiquaient que seraient seules soumises à taxation immédiate, en cas de transfert de siège au sein de l’Union, « les plus-values afférentes aux actifs réellement transférés dans le pays d’accueil ou cédés lors du transfert de siège ».
Selon certains commentateurs, la possibilité d’imposer les plus-values latentes résulte de « la simple application du droit commun […]. Une simple sortie de bilan constitue en effet une "cession" rendant exigible l’impôt de plus-values […]. Il en va ainsi d’un transfert d’actif d’un bilan français vers un bilan étranger. À strictement parler, c’est donc la sortie des actifs hors de France qui constitue l’événement imposable, et non le transfert du siège à l’étranger qui, en tant que tel, n’emporte pas cessation d’entreprise » (67). Le même auteur indique que la position selon laquelle les plus-values latentes sont imposables lors du transfert d’actifs « est défendue par l’administration fiscale et figure dans un projet d’instruction, qui n’a jamais été publié » (68). Cette affirmation n’a pas été démentie auprès du Rapporteur général.
Il lui a en revanche été confirmé que la taxation immédiate des bénéfices d’exploitation et des bénéfices en report en cas de transfert total des actifs résulte de l’application des dispositions de droit commun (2 de l’article 221), qui assimilent un tel transfert à la disparition du sujet fiscal, rendant nécessaire l’établissement de l’impôt sine die.
B.– UN MÉCANISME REMIS EN CAUSE PAR LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE
● La taxation immédiate des plus-values latentes en cas de transfert d’actifs au sein de l’Union européenne a récemment été remise en cause par la jurisprudence. La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a en effet jugé que le régime de taxation néerlandais – similaire au nôtre – portait une atteinte disproportionnée au principe de liberté d’établissement posé par l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (29 novembre 2011, National Grind Indus BV, affaire C-371/10).
Cette décision s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle tracée par l’arrêt Lasteyrie du Saillant du 11 mars 2004 (affaire C-9/02), dans lequel la même Cour a déclaré contraire à la liberté d’établissement l’exit tax qui frappait, en application de l’article 167 bis du CGI, les plus-values latentes sur les droits sociaux des personnes physiques transférant leur domicile fiscal hors de France.
● La législation néerlandaise considérée prévoit l’imposition immédiate des plus-values latentes afférentes aux actifs transférés à l’occasion d’un transfert du siège d’une société de droit néerlandais vers un autre État membre de l’Union européenne (UE). Les plus-values latentes n’étant pas imposées à l’occasion du transfert du siège d’une même société à l’intérieur du territoire néerlandais, mais uniquement lors de leur éventuelle réalisation (donc lorsqu’elles ne sont plus latentes), la législation nationale crée un désavantage de trésorerie au détriment de la société dont le siège est transféré dans un autre État. La Cour a jugé qu’en ce sens, elle est constitutive d’une restriction à la liberté d’établissement.
● Par application d’une jurisprudence constante, une restriction à la liberté d’établissement peut cependant être admise si elle se justifie par des raisons impérieuses d’intérêt général et qu’elle n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés, en vertu du principe de proportionnalité
(CJUE, 13 décembre 2005, Marks & Spencer, affaire C-446/03).
Le même arrêt reconnaît la préservation du pouvoir d’imposition entre les États membres comme un objectif légitime, pouvant justifier une restriction à la liberté d’établissement. La Cour a en conséquence jugé que le transfert du siège d’une entreprise dans un autre État membre ne contraint pas l’État d’origine à renoncer à imposer une plus-value née avant le transfert (12 décembre 2006, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, affaire C-374/04).
La Cour a ainsi jugé que le pouvoir d’imposition de la plus-value latente par l’État d’origine au moment du transfert ne porte pas, en tant que tel, une atteinte disproportionnée au principe de liberté d’établissement tel que posé par l’article 49 du traité.
● Comme le relève l’avocat général dans ses conclusions, « il est considérablement plus difficile d’évaluer si le recouvrement immédiat de la dette fiscale est, lui aussi, compatible avec le principe de proportionnalité » (69).
La Cour a posé comme postulat de bon sens que « le recouvrement de la dette fiscale au moment de la réalisation effective, dans l’État membre d’accueil, de l’actif pour lequel une plus-value a été constatée par les autorités de l’État membre d’origine à l’occasion du transfert […] tend à éviter les problèmes de trésorerie que le recouvrement immédiat de l’imposition due sur les plus-values latentes pourrait générer » (70). Mais la Cour a reconnu, comme l’avocat général, que le suivi des actifs transférés – indispensable si la taxation des plus-values latentes doit intervenir au moment de la cession de l’actif – pourrait générer pour l’entreprise une charge administrative constituant « une entrave à la liberté d’établissement qui ne serait pas nécessairement moins attentatoire à cette liberté que le recouvrement immédiat de la dette fiscale » (71).
En conséquence, seul un dispositif optionnel a été jugé par la Cour conforme au principe de proportionnalité, dans les termes suivants : « une réglementation nationale offrant le choix à la société qui transfère […] entre, d’une part, le paiement immédiat du montant de l’imposition, qui crée un désavantage en matière de trésorerie pour cette société mais la dispense de charges administratives ultérieures, et, d’autre part, le paiement différé du montant de ladite imposition, […] qui est nécessairement accompagné d’une charge administrative pour la société concernée, liée au suivi des actifs transférés, constituerait une mesure qui, tout en étant propre à garantir la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres, serait moins attentatoire à la liberté d’établissement que la mesure en cause au principal » (à savoir l’imposition nécessairement immédiate des plus-values latentes) 72).
● La Cour a eu l’occasion de confirmer la jurisprudence ainsi bâtie dans un arrêt Commission contre Portugal du 6 septembre 2012 (affaire C-38/10). Elle en a étendu la portée à l’imposition des plus-values latentes afférentes au transfert des actifs d’un établissement stable d’un État membre vers un autre État membre (sans que ce transfert s’accompagne nécessairement du transfert du siège).
Dans ses conclusions, l’avocat général a proposé de reconnaître une autre alternative à la taxation immédiate en cas de transfert d’actifs, en plus du paiement différé de l’impôt : « offrir également aux sociétés le choix d’échelonner le paiement de la dette fiscale, […] par exemple lors d’échéances annuelles ou en fonction de la réalisation des plus-values, [peut] constituer une mesure adéquate et proportionnée à l’objectif de préservation de la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres » (73).
● L’exit tax française, qui impose automatiquement les plus-values latentes au moment de leur transfert, serait donc vraisemblablement jugée contraire au droit de l’Union en cas de contentieux.
L’évaluation préalable annexée au présent article indique que « la Commission a d’ailleurs d’ores et déjà adressé une lettre à la France le 17 avril 2012 l’interrogeant sur son régime de taxation immédiate prévu au 2 de l’article 221 du code général des impôts ».
En l’absence de modification législative, la France devrait appliquer pleinement l’exception prévue au dernier alinéa du 2 de l’article 221 du CGI, et conséquemment exonérer d’impôt sur les sociétés les transferts d’actifs au sein de l’Union européenne. Le manque à gagner potentiel n’est pas chiffrable. L’objectif du présent article est de mettre le droit français en conformité avec les prescriptions de la CJUE, afin de permettre, sans risque juridique, la taxation de ces transferts.
Il est proposé de distinguer clairement, au sein du 2 de l’article 221 du CGI, le régime applicable aux transferts de siège ou d’établissement hors de l’Union européenne du régime applicable au transfert d’éléments d’actifs en son sein.
Il y a lieu de préciser à cet égard que le régime applicable aux transferts au sein de l’UE sera également applicable aux transferts dans un État partie à l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France :
– une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
– et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, ayant une portée similaire à celle prévue par la directive régissant cette matière pour les États membres de l’UE (74).
Il faut rappeler que l’article 31 de l’Accord sur l’Espace économique européen proscrit, au sein de cet espace, les restrictions à la liberté d’établissement. La Cour de l’Association européenne de libre-échange a récemment rendu un arrêt dont les conclusions sont proches de celles des arrêts précités de la CJUE (3 octobre 2012, Arcade Drilling AS v Staten v/Skatt Vest, affaire E-15/11).
La modification apportée au premier alinéa du 2 de l’article 221 (alinéa 3) a pour effet de réserver le mécanisme de taxation immédiate, en cas de transfert du siège ou d’un établissement de la société hors de France, aux transferts réalisés dans un État hors UE ou hors EEE (à condition que la France ait signé avec ce dernier les deux conventions précédemment évoquées).
Pour les transferts dans les États membres de l’UE ou de l’EEE (avec lesquels la France a signé les conventions précitées), un nouveau dispositif est prévu, qui se substitue à l’actuel dernier alinéa du 2 de l’article 221.
● Le premier mérite de ce dispositif est de prévoir explicitement, à une place pertinente dans le code général des impôts, que ces transferts ne sont pas intégralement et systématiquement exonérés d’IS. Comme cela a été rappelé, le mécanisme actuel de taxation n’apparaît pas clairement à la lecture du 2 de l’article 221, dont le dernier alinéa dispose que « le transfert de siège dans autre État membre de la Communauté européenne (75), qu’il s’accompagne ou non de la perte de la personnalité juridique en France, n’emporte pas les conséquences de la cessation d’activité ».
● Le fait générateur de la taxation est précisé : conformément aux interprétations qui pouvaient être faites du droit existant (cf. supra), il est confirmé que l’imposition n’est déclenchée que lorsque le transfert de siège ou d’un établissement « s’accompagne du transfert d’éléments d’actifs » (alinéa 5).
Il est explicitement prévu que le transfert du siège ou d’un établissement accompagné du transfert d’éléments d’actifs entraînera le paiement de l’IS au titre :
– des plus-values latentes constatées sur les éléments de l’actif immobilisé transféré ;
– des plus-values en report ou en sursis d’imposition.
On rappellera pour mémoire que dans le régime du sursis, la plus-value n’est ni constatée ni imposée au moment de la cession, la charge fiscale latente étant transférée au cessionnaire, qui devra payer l’impôt lorsque le sursis prendra fin, c’est-à-dire en cas de revente de l’actif concerné. Le sursis s’applique notamment en cas de fusion, pour les plus-values sur les immobilisations non amortissables. Dans le régime du report, la plus-value est constatée au moment de la cession, mais non imposée. Lorsque le report prend fin (le plus souvent à la revente de l’actif), la plus-value est imposée dans le chef du cédant.
Les bénéfices d’exploitation restent soumis au droit commun décrit supra (imposition immédiate en cas de transfert total des actifs).
● L’impôt est dû dans les deux mois suivant le transfert des actifs.
● Mais, et c’est là le principal apport du présent article, le montant d’impôt dû à l’expiration de ce délai de deux mois est variable. La société peut – elle le doit aujourd’hui –régler en une seule fois sa cotisation d’impôt (alinéa 6). Elle peut également, « sur demande expresse », ne régler qu’un cinquième de cette cotisation (alinéa 7). Le solde doit en principe être acquitté « par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes ».
Exemple : soit une entreprise redevable de l’IS en France qui transfère son siège et ses actifs en Allemagne au 1er janvier de l’année N. L’administration fiscale constate une plus-value latente sur les actifs, ayant pour effet de mettre à la charge de l’entreprise une exit tax d’un montant de 100. Au 1er mars de la même année, cette entreprise peut s’acquitter de la totalité de ce montant, ou bien demander à n’en payer qu’un cinquième. Si l’entreprise choisit cette seconde option, elle devra s’acquitter d’un montant de 20 au 1er mars de l’année N, puis d’un montant égal au plus tard le 1er mars de chacune des années N+1 à N+4.
Après le premier versement, l’entreprise peut toutefois choisir de verser le solde à tout moment, en une seule fois.
L’exposé des motifs indique qu’« un paiement fractionné de l’imposition sur plusieurs années, à l’instar de ce que prévoient les législations suédoise et allemande, permet de concilier la liberté d’établissement et l’objectif de juste répartition de la matière imposable entre États membres ». La Commission a retiré une procédure en manquement engagée contre la Suède après que celle-ci a introduit une option en faveur du paiement fractionné. Par ailleurs, une réponse explicite de la Cour sera apportée au sujet de la conformité de la législation allemande au traité, une question préjudicielle lui ayant été posée par un tribunal.
La législation française serait ainsi mise en conformité avec la jurisprudence de la CJUE. À l’appui de cette thèse, l’évaluation préalable indique que « dans le cas où l’option pour le paiement échelonné est exercée, les sociétés pourront ainsi bénéficier d’une trésorerie supplémentaire ».
Cette affirmation n’est pas contestable. Il faut cependant relever que l’arrêt National Grind Indus BV semble considérer que la perte de trésorerie subie par une entreprise immédiatement taxée au titre d’une plus-value latente en cas de transfert de siège résulte surtout du fait que la taxation intervient avant la réalisation de la plus-value.
Dans le dispositif proposé par le présent article, l’entreprise choisissant de ne pas procéder au paiement immédiat de son impôt doit néanmoins s’en acquitter, au moins pour partie, avant la revente éventuelle de l’actif. Le Gouvernement considère que l’option en faveur d’un paiement fractionné répond à l’exigence de la Cour, dont l’arrêt évoque expressément un paiement « différé » (76). Les conclusions de l’avocat général sur l’arrêt Commission contre Portugal, qui n’ont pas été démenties par la Cour, confortent, à cet égard, l’option retenue par le Gouvernement.
● L’article prévoit en son alinéa 8 l’interruption du paiement fractionné, au profit d’un paiement immédiat du solde, lorsque, dans le délai de cinq ans, intervient l’un des événements suivants :
– la cession des actifs ;
– leur transfert dans un autre État, hors UE ou EEE (77) ;
– la dissolution de la société ;
– le non-respect de l’une des échéances de paiement.
● L’option en faveur du paiement fractionné nécessite le suivi des actifs transférés, par exemple pour procéder au recouvrement du solde en cas de cession desdits actifs pendant la période de cinq ans. C’est pourquoi l’alinéa 9 prévoit que la société adresse chaque année au service des impôts des non résidents un état de suivi des plus-values latentes sur les éléments de l’actif immobilisé transférés.
● L’alinéa 11 prévoit l’adjonction de cet état de suivi à la liste des documents dont, en application de l’article 1763 du CGI, le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet entraîne l’application d’une amende égale à 5 % des sommes omises (5 % de la plus-value en l’espèce).
B.– L’ENTRÉE EN VIGUEUR ET L’EFFET BUDGÉTAIRE
● Le II du présent article (alinéa 12) prévoit une entrée en vigueur permettant son application aux transferts réalisés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2012.
● L’impact des dispositions de cet article sur le budget de l’État n’est pas chiffré par l’évaluation préalable. Deux effets peuvent toutefois être distingués :
– l’État pourrait enregistrer une perte de trésorerie, puisque les montants d’impôts encaissés aujourd’hui en une seule fois seraient susceptibles de l’être demain sur une période de cinq ans ;
– la sécurisation juridique du dispositif permettra le maintien d’un dispositif de taxation, en évitant sa censure par la CJUE.
*
* *
La Commission adopte l’article 16 sans modification.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement CF 22 de Mme Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Cet amendement invite à réfléchir à la différence entre la taxation du capital productif et celle du capital non productif de nos entreprises. La dépense fiscale liée au mécénat d’entreprise ne cesse de croître : de 570 millions en 2011, elle passe à 800 millions selon l’évaluation du Gouvernement pour 2013. Au nom de l’objectif de maîtrise de nos finances publiques, nous proposons par conséquent de ramener la réduction d’impôt de 60 à 50 % du montant du don en fixant le plafond de dépenses retenues à 1 ‰ du chiffre d’affaires total, hors taxes de l’entreprise mécène, contre 5 ‰ aujourd’hui.
M. le président Gilles Carrez. J’ai cosigné cet amendement, car depuis la loi sur le mécénat de 2003, la dépense s’est envolée. L’entreprise bénéficie non seulement d’une réduction de 60 % de l’IS, mais aussi, bien souvent, d’autres avantages, dont des entrées gratuites au musée, qui peuvent porter le taux de subvention à 80 % ! Le principe est louable, mais le taux excessif. Le crédit d’impôt compétitivité est plus défendable. En adoptant l’amendement, nous ferions la preuve de notre détermination à préserver la recette de l’IS.
M. le rapporteur général. Avis défavorable. Après avoir chanté les louanges de la stabilité fiscale, Mme Dalloz propose de modifier une disposition que l’Inspection générale des finances a jugée efficace, ce qui est rare. Cette évaluation, ainsi que d’autres arbitrages, nous ont dissuadés d’y toucher il y a quelques mois : nous avons préféré durcir d’autres dispositifs.
M. Marc Goua. Je partage l’avis du rapporteur général. Dans la France profonde, le mécénat d’entreprise est essentiel à la vie culturelle. Si les montants sont globalement très élevés, il n’en va pas de même des dons de chaque entreprise. Le double cliquet actuel – pourcentage du montant global et pourcentage du chiffre d’affaires – me paraît suffisant.
M. Pierre-Alain Muet. Je souscris pleinement aux propos de M. Goua : tout comme les dons, dont nous débattrons bientôt, qui soutiennent les associations de bénévoles œuvrant dans le domaine social, cette dépense fiscale est indispensable aux activités culturelles. Il serait beaucoup plus coûteux de la remplacer par une subvention de l’État. Ce raisonnement a conduit l’Inspection générale des finances à l’évaluer positivement. Ce n’est pas le moment de la modifier.
M. le président Gilles Carrez. Il convient pourtant de maîtriser cette dépense fiscale, créée en 2003. Songez que le budget consolidé du ministère de la Culture – crédits budgétaires, dépenses fiscales et subventions aux opérateurs – est passé de 6 milliards d’euros en 2004 à plus de 8 milliards en 2012, soit une augmentation de près de 50 % ! Or nous devons impérativement redresser nos finances publiques. Je ne défends pas ici un point de vue partisan, mais l’intérêt général.
M. le rapporteur général. Lors de la séance des questions au Gouvernement, un député d’opposition nous a accusés de massacrer la culture…
M. le président Gilles Carrez. J’ai applaudi la réponse du ministre.
M. le rapporteur général. Vous devez, chers collègues de l’opposition, cesser de tenir des discours contradictoires : vous ne pouvez pas à la fois insister sur la stabilité fiscale, nous accuser de massacrer la culture et nous reprocher de maintenir le régime fiscal favorable au mécénat. Il a été envisagé, au plus haut niveau de l’État, de le remettre en cause. Cependant, des arbitrages ont été rendus : il a été décidé de faire porter l’effort sur d’autres dispositifs afin de préserver cette dépense fiscale, certes plutôt coûteuse, mais jugée efficace. Nous assumons ce choix.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle en vient à l’amendement CF 4 de M. Thomas Thévenoud.
M. Thomas Thévenoud. Cet amendement, que j’ai déposé avec Carole Delga, vise à proroger de deux ans le crédit d’impôt en faveur des métiers d’arts - CIMA –, qui arrive à expiration le 31 décembre 2012. Cette disposition avait été approuvée par notre Commission lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2013. Toutefois, la mise en œuvre de ce crédit d’impôt donne lieu à des contentieux en augmentation sensible et, lors de la séance publique, le ministre délégué chargé du budget avait, tout en se déclarant favorable à la prorogation du dispositif, jugé nécessaire de réfléchir à son champ d’application, notamment à la notion de « conception » en matière d’artisanat d’art. Or ce travail n’a pas été mené à bien. Je souhaite donc que la Commission adopte cet amendement, afin que le Gouvernement s’engage dans cette réflexion et propose une rédaction plus précise des dispositions en cause. Ce crédit d’impôt est très utile aux artisans d’art, tant dans les villes qu’en milieu rural. Il convient de défendre leur savoir-faire et la qualité française.
M. le rapporteur général. Cet amendement avait été adopté par notre Commission et le Gouvernement avait promis de l’examiner avec bienveillance. Cependant, en séance publique, il a émis un avis défavorable, en précisant qu’il proposerait une disposition dans le cadre du collectif que nous examinons, ce qu’il n’a pas fait. Je suis très embarrassé : selon mes informations, cet amendement pourrait connaître le même sort que le précédent. Je suis donc réservé sur l’idée de le reprendre au nom de la Commission.
M. Thomas Thévenoud. Le ministre délégué avait clairement affiché sa volonté de prolonger le dispositif et un engagement a été pris au plus haut niveau de l’État. De contacts avec le ministère de l’économie et des finances, je comprends que le temps aurait manqué pour réfléchir au champ d’application et trouver la rédaction idoine. Je souhaite que la Commission adopte cet amendement, afin que le Gouvernement réitère son engagement et mobilise les services compétents.
M. le rapporteur général. Je vous suggère de retirer cet amendement et de le redéposer pour la réunion qui se tiendra au titre de l’article 88 du Règlement, de sorte que le débat puisse avoir lieu en séance publique, mais je ne souhaite pas que la Commission l’adopte à nouveau en prenant le risque d’affaiblir sa position.
L’amendement CF 4 est retiré.
*
* *
Ajustements consécutifs notamment à la suppression de la taxe professionnelle et à la mise en œuvre des schémas départementaux
de coopération intercommunale
Texte du projet de loi :
I.– Cotisation foncière des entreprises : cotisation minimum
A.– Le troisième alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts est supprimé.
B.– Le I de l’article 1647 D du même code est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa du 1, les mots : « celui mentionné au premier alinéa du 2 » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés aux a et b du 2 » ;
2° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. À défaut de délibération pour l'une des deux premières catégories de redevable définie au 1, le montant de la base minimum qui est applicable est égal :
« a. Pour les communes existantes au 31 décembre 2012 et les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ou au I de l’article 1609 quinquies C à la même date : au montant de la base minimum applicable sur leur territoire au titre de l’année 2012 ;
« b. Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2013, pour celles rattachées à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ou au I de l’article 1609 quinquies C à compter de la même date ainsi que pour les établissements publics soumis à l’un de ces régimes pour la première fois à compter de cette date à la suite d’une création, d’une fusion ou d’un changement de régime fiscal :
« – l’année au cours de laquelle cette opération produit ses effets au plan fiscal : au montant applicable l’année précédente sur le territoire de chacune des communes ou établissements publics de coopération intercommunale concernés ;
« – les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum au titre de la même année.
« c. Lorsque le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises déterminée dans les conditions définies au présent 2 est supérieur aux plafonds définis au 1, pour les deux premières catégories de redevables ou pour l'une d'entre elles seulement, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, réduire le montant de la base minimum. » ;
3° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu à l’article 1609 nonies C ou du I de l’article 1609 quinquies C, le montant de la base minimum applicable l’année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal, est égal à celui applicable l’année précédente sur le territoire de chacune des communes ou établissements publics de coopération intercommunale concernés.
« L’année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération intercommunale qui, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et au 1 du I du présent article, fixent, pour chacune des deux premières catégories de contribuables définies au 1 ou pour l’une d’entre elles seulement, le montant de la base minimum, peuvent, par une délibération prise dans les mêmes conditions, décider d’appliquer, pour la catégorie de contribuables concernée, des bases minimum différentes selon le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunaux préexistants pendant une période maximale de 5 ans.
« Les écarts entre, d’une part, les bases minimum appliquées sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale l’année au cours de laquelle l’opération a pour la première fois produit ses effets au plan fiscal et, d’autre part, celle qu’il a fixée sont réduits par fractions égales sur la durée qu’il a retenue.
« La procédure de convergence définie aux deux alinéas précédents n’est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale et celle qu’il a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport s’apprécie séparément pour chacune des deux premières catégories de contribuables définies au 1.
« Le dispositif de convergence prévu au présent 2 bis s’applique également en cas de création d’une commune nouvelle et en cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 nonies C ou du I de l’article 1609 quinquies C. »
C.– Les dispositions des A et B s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.
II.– Mesures relatives aux taux d’imposition
Report de la date limite de vote des taux des impôts directs locaux
A.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas du II de l’article 1522 bis, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;
2° Au second alinéa de l’article 1638-00 bis, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;
3° Le I de l’article 1639 A est ainsi modifié :
a. Au premier alinéa, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;
b. Au deuxième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars » et les mots : « ou généraux concernés par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril et, pour les conseils régionaux, du 31 mars au 30 avril. » sont remplacés par les mots : « , généraux ou régionaux concernés par ce renouvellement, du 15 avril au 30 avril. » ;
c. Au troisième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».
B.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 1612-1, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;
2° L’article L. 1612-2 est ainsi modifié :
a. Au premier alinéa, les dates : « 31 mars » et « 15 avril » sont respectivement remplacées par les dates : « 15 avril » et « 30 avril » ;
b. Au troisième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».
C.– Les A et B s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.
Modalités de détermination du taux maximum de cotisation foncière des entreprises pouvant être voté par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique en 2012 et 2013
D.– Le A du VI de l’article 1640 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux de référence définis au V ainsi que les dispositions du deuxième alinéa du présent A sont également retenus pour l’application en 2012 du premier alinéa du 3° du II de l’article 1636 B decies et pour l’application en 2013 du second alinéa du même 3°. »
III.– Mesure relative à la valeur locative des ports de plaisance
A.– L’article 1501 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III.– La valeur locative des postes d’amarrage dans les ports de plaisance à la date de la révision est fixée selon le tarif suivant :
« 110 euros pour les ports maritimes de la Méditerranée ;
« 80 euros pour les autres ports maritimes ;
« 55 euros pour les ports non maritimes.
« Pour chaque port, ce tarif peut être, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A, minoré ou majoré de 20 % ou 40 % en fonction des services et des équipements offerts.
« Les modalités d’application de cette modulation sont fixées par décret en Conseil d’État. »
B.– Le A s’applique à compter des impositions dues au titre de 2014.
IV.– Report de la date limite d’option pour le régime de la fiscalité professionnelle unique
A.– 1° Après la première phrase du second alinéa du IV de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, pour les établissements publics nouvellement créés, cette décision peut être prise jusqu’au 15 janvier de l’année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. » ;
2° L’article 1638-0 bis du même code est ainsi modifié :
a. Au premier alinéa du I et du II, les mots : « le 31 décembre de l’année de la fusion » sont remplacés par les mots : « le 15 janvier de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet » ;
b. Le premier alinéa du I et le premier alinéa du II sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Cette délibération ne peut être rapportée pendant la période d’unification des taux prévue au III de l’article 1609 nonies C. »
B.– Le A s’applique à compter du 1er janvier 2013.
V.– Mesure relative aux garanties de ressources versées aux collectivités territoriales dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale
A.– L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le D du IV du 1.1 est complété par un alinéa c ainsi rédigé :
« c. Lorsqu'à la suite de la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les conditions prévues aux a et b du présent D est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;
2° Le E du IV du 1.1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'à la suite du retrait d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les conditions prévues aux a et b du D du présent IV est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;
3° Le D du IV du 2.1. est ainsi modifié :
a. Au premier alinéa, avant les mots : « En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale, », est ajouté la référence : « a. » ;
b. Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« b. Lorsqu'à la suite de la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du présent D est versée au profit de cet établissement public.
« Lorsqu'à la suite de la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du présent D est mis à la charge de cet établissement public.» ;
4° Le E du IV du 2.1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'à la suite du retrait d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du présent IV est versée au profit de cet établissement public.
« Lorsqu'à la suite du retrait d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du présent IV est mis à la charge de cet établissement public. »
B.– L’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 3 du I bis, après les mots : « prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 » sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion de la fraction calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ;
2° Après le 3 du I bis, il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l'établissement public de coopération intercommunale, de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et b du D du IV du même 1.1. » ;
3° Après le I bis, il est ajouté un I ter ainsi rédigé :
« I ter.– Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l'établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la part calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. »
C.– Les A et B s’appliquent, à compter du 1er janvier 2013, aux communes devenues membres d’un établissement public de coopération intercommunale à la suite d’une fusion d’établissement public de coopération intercommunale ou d’un rattachement devenus effectifs à compter du 1er janvier 2012.
VI.– Mesures techniques diverses
Mesure de coordination liée à la réforme des établissements publics fonciers de l’État
A.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1607 bis est ainsi modifié :
a. Au premier alinéa, les mots : « aux articles L.324-1 et suivants » sont remplacés par les mots « à l’article L.324-1 » ;
b. A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « au troisième ou quatrième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° L’article 1607 ter est ainsi modifié :
a. Au premier alinéa, les mots : « au b de » sont remplacés par le mot : « à » ;
b. Il est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement selon les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l’article 1607 bis. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1609 F, les mots : « des articles L. 321-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 321-1 » ;
4° Le I de l’article 1636 B octies est ainsi modifié :
a. Les mots : « à l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme et au b de l’article L. 321-1 du même code » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme » ;
b. Les mots : « de l’établissement public foncier de Normandie, de l’établissement public foncier de Lorraine, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur » sont remplacés par les mots : « de l'établissement public d'aménagement de la Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique » ;
5° Au premier alinéa de l’article 1636 C, les mots : « aux articles L. 324-1 et suivants du code de l’urbanisme et au b de l’article L. 321-1 du même code, de l’établissement public foncier de Normandie, de l’établissement public foncier de Lorraine et de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme ».
Corrections d’erreurs rédactionnelles
B.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :
a. Au VIII, les mots : « taxe sur les fournitures d’électricité » sont remplacés par les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité » ;
b. Au IX, les mots : « Les communautés urbaines » sont remplacés par les mots : « Les métropoles, les communautés urbaines » ;
2° Au quatrième alinéa du IV de l’article 1519 I, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
3° Au dernier alinéa du I de l’article 1522 bis, la référence : « 1638 B undecies» est remplacée par la référence : « 1636 B undecies » ;
4° Au troisième alinéa du I de l’article 1639 A ter, les mots : « du 1 du II » sont remplacés par les mots : « du I et du 1 du II ».
VII.– Mesures relatives à la taxe sur les surfaces commerciales
Aménagement des règles d’assiette et de liquidation de la TASCOM
A.– L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ne sont pas considérés comme magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités. Lorsque ces établissements réalisent à titre accessoire des ventes à des consommateurs pour un usage domestique, ces ventes constituent des ventes au détail qui doivent être soumises à la taxe dans les conditions de droit commun.» ;
2° Après le 4ème alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existante au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition pour les établissements existant à cette date. » ;
3° À la première phrase du dix-septième alinéa, après les mots : « les professions dont l’exercice » sont ajoutés les mots : « à titre principal ».
Harmonisation de la modulation de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) en cas de modification de la carte intercommunale
B.– Après le sixième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant, sont maintenues pour la première année d’existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale.
« L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion doit se prononcer avant le 1er octobre de sa première année d’existence sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire.
« L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année de la fusion.
« À défaut de délibérations prises dans le délai défini aux deux précédents alinéas, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement imposable, lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistants à la fusion ne bénéficiaient pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion étaient substitués aux communes pour la perception de la taxe et que, la première année de la fusion, s’appliquaient par défaut sur le territoire de chacun de ces établissements publics de coopération intercommunale préexistants des coefficients décidés antérieurement à la fusion en application des dispositions du septième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l’année suivante sur l’ensemble du territoire de l’établissement public issu de la fusion est égal au plus faible des coefficients des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
« En cas de rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41-1 et L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant, sont maintenues pour la première année du changement de périmètre.
« Dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale doit délibérer avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble du territoire.
« Lorsqu’il a subi une modification de son périmètre dans les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents, l’établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre.
« À défaut de délibérations prises dans le délai défini aux deux alinéas précédents, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement imposable, lorsqu’elles étaient membres, avant le changement de périmètre, d’un établissement public de coopération intercommunale ne bénéficiant pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque des communes étaient membres, avant le changement de périmètre, d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception de la taxe et que, la première année de la modification du périmètre intercommunal, s’appliquait par défaut sur le territoire de chacune de ces communes des coefficients décidés antérieurement au changement de périmètre intercommunal en application des dispositions du onzième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l’année suivante sur l’ensemble du territoire de l’établissement public ayant accueilli ces communes est égal au plus faible des coefficients applicables avant la modification du périmètre.
« En cas de création d’une commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues par les articles L. 2113-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante, sont maintenues pour la première année d’existence de la commune nouvelle.
« En vue de l’application aux montants de la taxe, calculés conformément à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, du coefficient multiplicateur dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas du présent 1.2.4.1, les deuxième et troisième années d'existence de la commune nouvelle, les écarts de coefficients des communes préexistantes sont réduits de moitié la première année et supprimés la seconde, jusqu’à application d’un coefficient unique, lorsque le rapport entre le coefficient le moins élevé et le coefficient le plus élevé est inférieur à 90 %. Lorsque le rapport est supérieur ou égal à 90 %, l’organe délibérant de la commune nouvelle peut appliquer un coefficient unique dès la deuxième année existence de la commune nouvelle. Le coefficient unique doit être fixé, par délibération adoptée à la majorité simple dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, dès la première année d’existence de la commune nouvelle. »
C.– 1° Les dispositions du A s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2013 ;
2° Les dispositions du B s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
VIII.– Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d'assurance
A.– Le tableau du III de l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par le tableau suivant :
Département |
POURCENTAGE |
AIN |
0,8752 |
AISNE |
0,7007 |
ALLIER |
0,9608 |
ALPES DE HTE-PROVENCE |
0,3243 |
HAUTES-ALPES |
0,2399 |
ALPES MARITIMES |
1,3572 |
ARDÈCHE |
0,8651 |
ARDENNES |
0,6232 |
ARIÈGE |
0,4224 |
AUBE |
0,4559 |
AUDE |
0,9190 |
AVEYRON |
0,6030 |
BOUCHES-DU-RHÔNE |
3,4201 |
CALVADOS |
– |
CANTAL |
0,3443 |
CHARENTE |
0,8859 |
CHARENTE-MARITIME |
0,7138 |
CHER |
0,4934 |
CORRÈZE |
0,5341 |
CÔTE-D’OR |
0,3445 |
CÔTES-D’ARMOR |
1,3468 |
CREUSE |
0,2724 |
DORDOGNE |
0,7025 |
DOUBS |
1,2350 |
DROME |
1,2769 |
EURE |
0,5411 |
EURE-ET-LOIR |
0,5818 |
FINISTÈRE |
1,5412 |
CORSE DU SUD |
0,6021 |
HAUTE-CORSE |
0,4464 |
GARD |
1,6035 |
HAUTE-GARONNE |
2,1950 |
GERS |
0,5195 |
GIRONDE |
1,9662 |
HÉRAULT |
1,8837 |
ILLE-ET-VILAINE |
1,8976 |
INDRE |
0,3177 |
INDRE-ET-LOIRE |
0,4331 |
ISÈRE |
3,1910 |
JURA |
0,6026 |
LANDES |
0,8946 |
LOIR-ET-CHER |
0,4500 |
LOIRE |
1,7232 |
HAUTE-LOIRE |
0,5454 |
LOIRE-ATLANTIQUE |
1,6897 |
LOIRET |
– |
LOT |
0,3451 |
LOT-ET-GARONNE |
0,6332 |
LOZÈRE |
0,0832 |
MAINE-ET-LOIRE |
0,4726 |
MANCHE |
1,0275 |
MARNE |
– |
HAUTE-MARNE |
0,3307 |
MAYENNE |
0,5574 |
MEURTHE-ET-MOSELLE |
1,6947 |
MEUSE |
0,4232 |
MORBIHAN |
1,0252 |
MOSELLE |
1,3705 |
NIÈVRE |
0,6953 |
NORD |
5,0669 |
OISE |
1,4902 |
ORNE |
0,3756 |
PAS-DE-CALAIS |
3,7614 |
PUY-DE-DÔME |
0,9247 |
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES |
1,1146 |
HAUTES-PYRÉNÉES |
0,6927 |
PYRÉNÉES-ORIENTALES |
1,1454 |
BAS-RHIN |
1,9801 |
HAUT-RHIN |
1,9846 |
RHÔNE |
– |
HAUTE-SAÔNE |
0,4070 |
SAÔNE-ET-LOIRE |
1,0027 |
SARTHE |
1,0215 |
SAVOIE |
0,9315 |
HAUTE-SAVOIE |
1,2086 |
PARIS |
– |
SEINE-MARITIME |
2,1056 |
SEINE-ET-MARNE |
1,6614 |
YVELINES |
– |
DEUX-SÈVRES |
0,5709 |
SOMME |
1,4725 |
TARN |
0,9037 |
TARN-ET-GARONNE |
0,5577 |
VAR |
1,4186 |
VAUCLUSE |
1,3654 |
VENDÉE |
1,5125 |
VIENNE |
0,5181 |
HAUTE-VIENNE |
0,6849 |
VOSGES |
1,2880 |
YONNE |
0,5715 |
TERRITOIRE-DE-BELFORT |
0,2680 |
ESSONNE |
2,3569 |
HAUTS-DE-SEINE |
– |
SEINE-SAINT-DENIS |
3,3714 |
VAL-DE-MARNE |
1,8873 |
VAL-D’OISE |
1,0123 |
GUADELOUPE |
0,5616 |
MARTINIQUE |
0,2296 |
GUYANE |
0,3743 |
RÉUNION |
– |
B.– Les dispositions du A s’appliquent à compter du 1er janvier 2012.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article rassemble des dispositions tout à fait hétéroclites, entre lesquelles on peine à trouver un dénominateur commun sinon de traiter – plus ou moins directement – de fiscalité locale.
En dépit du sous-titre retenu par le présent projet de loi, les 123 alinéas de cet article ne se contentent pas de tirer d’énièmes conséquences de la réforme de la fiscalité professionnelle locale ou de prédire toutes les nouvelles configurations possibles avec la recomposition de la carte intercommunale. Elles prévoient également des modifications – de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), de la fiscalité des ports ou de la taxe spéciale d’équipement perçue par les établissements publics fonciers – qui, pour techniques qu’elles puissent paraître, auraient sans doute mérité un traitement séparé.
I.– DE NOUVELLES CONSÉQUENCES À TIRER DE LA RÉFORME DE LA FISCALITÉ PROFESSIONNELLE LOCALE
En application de l’article 1447 du code général des impôts (CGI), une cotisation foncière des entreprises (CFE) est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Cet impôt a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière, dont les redevables ont disposé pour les besoins de leur activité professionnelle.
Le produit de la CFE est intégralement affecté au bloc communal. En 2011, il avait atteint 6,294 milliards d’euros, dont 1,461 milliard d’euros pour les communes et 4,833 milliards d’euros pour les EPCI. Le rendement de la cotisation minimum de CFE peut, en ordre de grandeur, être estimé à 670 millions d’euros pour 2011 hors frais de gestion.
Lorsque la valeur locative de leurs biens passibles d’une taxe foncière est très faible ou nulle, les redevables de la CFE sont assujettis à une cotisation minimale, comme cela était déjà le cas avec la taxe professionnelle (TP) avant sa suppression. Cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI, dans les conditions prévues par l’article 1647 D du CGI. La cotisation minimale est alors le produit de la base minimum par le taux de CFE applicable à l’ensemble des redevables installés sur le territoire de la commune ou de l’EPCI (par exemple, pour une entreprise réalisant un chiffre d’affaire supérieur à 100 000 euros, la cotisation minimale est égale à 3 000 euros x 20 % = 600 euros à acquitter).
Cotisation minimum de CFE et redevables
réalisant un faible montant de CA
La plupart des redevables de la CFE réalisant de faibles montants de chiffre d'affaires ou de recettes sont imposés sur une base minimum (prévue à l'article 1647 D du CGI), qui se substitue à la base réelle du principal établissement lorsque celle-ci est inférieure. La disparition des équipements et biens mobiliers de l'assiette a eu pour conséquence une augmentation mécanique du nombre de redevables concernés de 1,15 million d'entreprises avant réforme à 2,07 millions après réforme.
Les modalités de détermination du montant de la base minimum qui existaient sous l'empire de la taxe professionnelle (TP) ont été modifiées. Désormais, cette base est fixée par la commune ou l’EPCI :
– entre 206 euros et 2 065 euros pour les redevables réalisant moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires ;
– entre 206 euros et 6 102 euros pour les autres redevables.
En l'absence de délibération fixant le montant de la base minimum depuis le ler janvier 2010, celui-ci est égal au montant de la base minimum de TP appliqué en 2009. Il dépend alors de la taxe d’habitation théorique de l'année précédente d'un logement de référence retenu par l'organe délibérant de la commune ou de l'EPCI ou, à défaut de décision, d'un logement dont la valeur locative est égale aux deux tiers de la valeur locative moyenne des habitations de la commune ou de l'intercommunalité.
Les communes et les EPCI peuvent par ailleurs, comme auparavant en matière de TP, réduire de moitié au plus le montant de la base minimum pour les redevables n'exerçant leur activité qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année.
Certaines bases minimums fixées au titre des armées 2010 et 2011 suivant ces nouvelles modalités ont cependant conduit à mettre à la charge de nombreux redevables réalisant de faibles montants de chiffre d'affaires ou de recettes un montant de CFE disproportionné au regard de leurs capacités contributives. C'est pourquoi la dernière loi de finances rectificative pour 2011 a instauré la possibilité, pour les communes et les EPCI :
– de diminuer à leur convenance le montant de la base minimum lorsque celui-ci, toujours égal au montant de la base minimum de TP appliqué en 2009, est supérieur aux plafonds légaux ;
– de réduire de moitié au plus le montant de la base minimum pour les redevables réalisant moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires.
La CFE minimum demeure toutefois mal adaptée aux facultés contributives des redevables les plus modestes en raison de son caractère forfaitaire et de son exclusion du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.
Par ailleurs, nombre de redevables imposés sur la base minimum de CFE ont pu subir, en 2010 et 2011, une augmentation de leur cotisation en raison de la hausse mécanique de certains taux syndicaux de CFE à la suite de la réforme de la TP. Afin d'annuler les effets de cette hausse, un dégrèvement temporaire de CFE, applicable sur demande au titre des années 2010 et 2011, a été instauré par la première loi de finances rectificative pour 2011. Les redevables concernés ont jusqu'au 31 décembre 2012 pour demander ce dégrèvement auprès de leur service des impôts.
Source : Rapport du Gouvernement au Parlement sur les conséquences de la réforme de la fiscalité directe locale induite par la suppression de la taxe professionnelle, novembre 2012.
Il est proposé, aux alinéas 3 à 17 du présent article, de préciser les modalités de fixation d’une cotisation minimum de CFE dans le cas particulier d’un rapprochement entre deux ou plusieurs EPCI.
En effet, aucune modalité particulière de fixation de la cotisation minimum de CFE n’est, en l’état actuel du droit, prévue pour les EPCI qui, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, feraient pour la première fois application du régime de la fiscalité professionnelle unique ou de celui de la fiscalité professionnelle de zone. Cette lacune est d’autant plus étonnante que le législateur avait prévu un mécanisme de lissage des taux de CFE dans ce type de circonstances.
Si les montants de base minimum votés semblent, dans leur grande majorité, varier entre 500 et 2 000 euros, chacun aura pu constater ces dernières semaines que certaines collectivités avaient délibéré pour retenir des montants plus importants, proches des maxima autorisés par la loi, au risque de faire peser sur les redevables concernés une augmentation très importante de CFE. Afin d’éviter de nouveaux ressauts de fiscalité, consécutif cette fois aux recompositions de la carte intercommunale, il paraît judicieux de prévoir un régime de fixation spécifique :
– en cas de création/fusion/changement de régime fiscal, la base minimum dans le nouvel EPCI faisant application des régimes de fiscalité professionnelle unique ou de zone, est égale, la première année, à celle qui était applicable sur le territoire de chaque commune ou de chaque EPCI préexistant ;
– l’EPCI résultant d’une fusion doit délibérer au cours de cette première année (et au plus tard le 1er octobre) sur le montant de la cotisation minimale applicable à l’une ou l’autre des deux catégories d’entreprises visées par l’article 1647 D (plus ou moins de 100 000 euros de chiffre d’affaires), en conservant la possibilité par une délibération séparée de fixer, à titre transitoire, des bases minimales différentes sur les territoires de certaines communes ou de certains EPCI préexistants, pendant cinq ans au maximum, sous réserve de réduire l’écart chaque année par fraction sur la durée choisie.
Cette procédure de convergence n’est toutefois pas applicable lorsque la différence entre la base minimum la plus basse et la base minimum la plus élevée (ie. leur rapport entre ces deux bases minimums extrêmes dépasse 80%).
Le régime applicable, à défaut de délibération, est également revu. Ce n’est plus le montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009 qui sert de référence, mais le montant de la base minimum de CFE applicable en 2012. Cette modification permet de régler la situation des EPCI nouvellement créés qui ne délibéreraient pas immédiatement (et pour lesquels continueraient à s’appliquer les bases minimums de chaque commune ou de chaque EPCI préexistants), tout en conservant une référence inchangée pour les communes isolées ou les EPCI ne connaissant pas de changement de périmètre.
S’il reconnaît la pertinence de ces différentes mesures techniques, le Rapporteur général observe que ni la question de la modification rétroactive des délibérations des collectivités fixant la base minimum de CFE pour l’année 2012, ni celle de la prolongation en 2012 du dégrèvement des auto-entrepreneurs ne sont réglées par le présent article, alors même qu’elles ont fait l’objet d’annonces précises par le Gouvernement. Des dispositifs spécifiques devront donc être ajoutés, sous la forme d’amendements.
● Les modalités de détermination du taux maximum de CFE pouvant être voté par une EPCI à FPU sont précisées afin d’éviter, sur la base de la rédaction actuelle, le vote de taux beaucoup plus élevés pour 2012 et 2013.
Le II de l’article 1636 B decies du code général des impôts plafonne le taux de CFE pouvant être voté par un EPCI à fiscalité professionnelle unique, à fiscalité professionnelle de zone ou à fiscalité éolienne unique.
Par rapport au taux voté au titre de l'année précédente, le taux de CFE peut augmenter dans une proportion au plus égale à l’augmentation d’un taux de référence qui correspond :
– soit au taux moyen pondéré de taxe d’habitation des communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de cette taxe ;
– soit, si son augmentation est moindre, au taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières des communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes, pour l'année d'imposition.
Les taux maximum de la CFE 2012 des EPCI à fiscalité professionnelle unique, fiscalité professionnelle de zone ou fiscalité éolienne unique dépendent donc de l’évolution des taux votés par leurs communes entre 2010 et 2011 ou, à défaut de variation, entre 2009 et 2010. De même, les taux maximum de la CFE 2013 de ces EPCI dépendront de l’évolution des taux votés par leurs communes membres entre 2011 et 2012 ou, à défaut de variation entre ces deux années, entre 2010 et 2011.
Cela signifie que, pour les taux maximum de CFE 2012 et 2013 de ces EPCI, aucune règle particulière n’a été prévue afin de neutraliser l’augmentation des taux résultant des transferts opérés par la réforme de la fiscalité professionnelle locale (part départementale de taxe d’habitation « redescendue » aux communes et frais de gestion perçus par l’État).
EXEMPLE DES RISQUES D’AUGMENTATION DES TAUX DE CFE Soit un EPCI à fiscalité professionnelle unique. Le taux moyen pondéré (TMP) de la taxe d'habitation et le TMP de la taxe d'habitation et des taxes foncières de ses communes membres n'ont pas varié entre 2011 et 2012. Le taux maximum de CFE qu'il peut voter en 2013 est donc calculé à partir de la variation de ces TMP entre 2010 et 2011 (3° du II de l'article 1636 B decies du CGI). En 2012, l'EPCI à FPU a voté un taux de CFE de 23,5%. La variation des TMP entre 2010 et 2011 est de 45%. Cette hausse très importante est due à l’évolution du taux de la taxe d’habitation consécutive à la suppression de la taxe professionnelle : le taux de taxe d'habitation est en effet « rebasé » pour tenir compte du transfert de la part départementale et d'une partie des frais de gestion auparavant perçus par l'Etat. En l’état du droit, le taux maximum de CFE 2013 atteint 34,1%. Avec la modification législative envisagée, qui neutralise l’effet du rebasage sur la variation de taux de TH, la variation du TMP de TH entre 2010 et 2011 n’atteint plus que 0,6%. Ainsi le taux maximum de CFE 2013 est limité à 23,64%. |
Source :Direction de lé législation fiscale
Afin d’y remédier et d’éviter des ressauts d’imposition, les alinéas 35 et 36 s’appuient sur une disposition existant pour la détermination des taux en 2011 : il s’agit du A du VI de l’article 1640 C qui dispose que, pour l’application, au titre de 2011, de certaines règles de lien entre les taux, les taux de 2010 sont calculés à partir de ceux qui auraient été appliqués si la réforme avait été mise en œuvre dès 2010.
● Par ailleurs, il est prévu de reporter la date limite d’option pour le régime de fiscalité professionnelle unique afin de permettre aux EPCI issus de la recomposition de la carte intercommunale d’opter pour ce régime dès la première année.
Cette date, pour l’heure fixée au 31 décembre d’une année pour être applicable l’année suivante, est repoussée au 15 janvier de l’année au cours de laquelle l’EPCI souhaite opter pour le régime de fiscalité professionnelle unique.
C.– L’ADAPTATION DES MÉCANISMES DE GARANTIE DE RESSOURCES AUX RECOMPOSITIONS DE LA CARTE INTERCOMMUNALE
Les mécanismes de garantie de ressources de la réforme de la fiscalité professionnelle locale (fonds national de garantie individuelles des ressources, FNGIR, et dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, DCRTP) font l’objet d’un complément important afin de prendre en compte le cas des communes qui changeraient d’EPCI de rattachement à l’occasion des recompositions de la carte intercommunale.
Le D du IV du 2.1 de l’article 78 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) prévoit, en l’état actuel du droit, qu’en cas de dissolution d’un EPCI, le montant du prélèvement sur ressources ou du reversement opéré au titre du FNGIR est réparti entre ses communes membres. De surcroît, le E du même paragraphe comporte des dispositions similaires en cas de retrait d’une commune d’un EPCI donné.
Dans ces conditions, une commune membre d’un EPCI, qui, initialement, n’était pas prélevée au titre du FNGIR et qui s’est retirée de cet établissement public (ou en cas de dissolution de l’EPCI de rattachement), peut devoir supporter sur son budget propre une quote-part du prélèvement intercommunal. Dans le cas inverse, elle bénéficie d’une fraction de reversement au titre de la garantie individuelle des ressources, voire d’une part de la recette de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle initialement dévolue au budget intercommunal. Dans les deux cas de figure, la commune concernée bénéficie d’une sorte de bonus/malus de départ, puisqu’elle emporte avec elle une part de la garantie individuelle des ressources (ou de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, le cas échéant) au prorata de ses ressources comparées avec celles de l’EPCI de départ.
Après avoir adhéré à un nouvel EPCI ayant opté pour le régime de fiscalité professionnelle unique, la commune continue de subir la charge liée à la quote-part de prélèvement de la garantie individuelle des ressources, sans pouvoir la répercuter au niveau intercommunal, alors que s’opère de plein droit le transfert des produits de la fiscalité professionnelle dans les conditions prévues au I et au I bis de l’article 1609 nonies C du CGI.
Afin de combler ce vide juridique, les alinéas 55 à 74 du présent article organisent le transfert automatique à l’EPCI d’accueil de la part de prélèvement de la garantie individuelle de ressource subie par une commune à la suite d’un retrait ou de la dissolution de l’établissement public de coopération intercommunal de départ. Il est également proposé de garantir le même mécanisme de transfert pour la quote-part de DCRTP intercommunale et la fraction de reversement de la garantie individuelle de ressource intercommunale rétrocédée à la commune.
II.– LES AUTRES MESURES RELATIVES À LA FISCALITÉ DIRECTE LOCALE
● La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) fait l’objet d’un réaménagement d’ampleur limitée.
L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés a instauré une taxe assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. Le seuil d’assujettissement à la taxe est fixé à 400 m² et sont seuls redevables les commerçants dont le chiffre d’affaires annuel est au moins égal à 460 000 euros.
L’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a transféré, à compter de 2011, le produit de la TASCOM aux communes ainsi qu’aux EPCI à fiscalité professionnelle unique ou de zone sur le territoire desquels sont situés les établissements imposables. Il a également prévu le transfert du recouvrement et du contrôle de cette taxe à la direction générale des finances publiques (DGFiP). La taxe était auparavant recouvrée et gérée par la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI).
Trois points font l’objet de précisions apportées par le présent article, à compter des impositions 2013 :
– la notion de vente au détail est complétée par les alinéas 101 et 102, afin d’éviter des redressements de commerçants de gros, s’appuyant sur une lecture trop littérale du dispositif actuel : seraient désormais expressément exclus du champ de la taxe les établissements de commerce de gros, sauf en ce qui concerne les ventes qu’il pourraient réaliser, à titre accessoire, au profit de consommateurs pour un usage domestique ;
– les modalités de calcul de la taxe en cas de changement de surface en cours d’année sont durcies par les alinéas 103 et 104, qui précisent que la surface à retenir est celle existante au 31 décembre de l’année précédente ; il n’y aurait donc plus lieu d’opérer comme aujourd’hui un calcul prorata temporis ;
– enfin, l’alinéa 105 du présent article précise les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire des professions requérant des surfaces de vente anormalement élevées – concessionnaires de véhicules automobiles ou d’engins agricoles, marchands de matériaux de construction,… – désormais réservé aux professionnels exerçant ce type d’activité à titre principal.
● Les modalités d’harmonisation de la TASCOM sont précisées en cas de fusion de communes, d’EPCI, ou encore en cas de rattachement de communes à un nouvel EPCI.
Cette année, pour la première fois, les collectivités avaient la possibilité de moduler le montant de la TASCOM à la hausse ou à la baisse en appliquant un coefficient multiplicateur, conformément à l’article 77 de la loi de finances pour 2010 : le coefficient multiplicateur devait être compris entre 0,95 et 1,05 pour la première année, mais les limites de cette fourchette pourraient être progressivement portées à 0,8 et 1,2.
Toutefois, aucune disposition n’encadrait la perception et la modulation de cette taxe en cas de modification de la carte communale ou intercommunale. Les alinéas 107 à 117 (B du VII) comblent cette lacune en prévoyant que :
Pendant la première année :
– en cas de fusion de deux EPCI ou plus, quels que soient leurs régimes fiscaux, la TASCOM est perçue dans les conditions qui prévalaient auparavant sur le territoire de chaque commune ou de chaque EPCI préexistant ;
– l’EPCI résultant d’une fusion doit délibérer au cours de cette première année (et au plus tard le 1er octobre) sur le régime applicable à la TASCOM, étant entendu qu’est ouverte aux EPCI n’ayant pas opté pour le régime de la fiscalité professionnelle unique la possibilité de se substituer tout de même aux communes pour percevoir la TASCOM, sur délibérations concordantes ;
A partir de la deuxième année :
– à défaut de délibérations concordantes, le produit de la TASCOM reste acquis à la commune, si, avant la fusion, aucun EPCI à fiscalité professionnelle unique ou de zone n’était substitué à elle pour percevoir la taxe ou, dans le cas contraire, au nouvel EPCI issu de la fusion, sur la base du plus faible des coefficients auparavant en vigueur.
Les mêmes dispositions sont applicables en cas de rattachement volontaire d’une commune.
En revanche, un régime spécifique est prévu pour les deuxième et troisième années d’existence d’une commune nouvelle : lorsque le rapport entre les coefficients minimum et maximum pratiqués par les communes ou EPCI préexistants n’excède pas 90 %, un processus de convergence des taux est prévu par l’alinéa 117. Sinon, un nouveau coefficient doit être fixé à la majorité simple pour permettre, à compter de la deuxième année, la perception de la TASCOM.
A défaut de réunir cette majorité, la commune nouvelle est réputée avoir renoncé à son pouvoir de modulation des coefficients multiplicateurs de la TASCOM. Cependant, le seul effet de cette abstention serait d’entraîner une absence d’application d’un coefficient multiplicateur. La commune nouvelle continuerait donc à percevoir la taxe, avec un coefficient égal à 1.
Les alinéas 20 à 33 (A du II) repoussent du 31 mars au 15 avril la date limite de vote par les conseils municipaux ainsi que les organes délibérants des EPCI, des départements et des régions du budget primitif et des taux de fiscalité directe locale. L’année du renouvellement des organes délibérants, la date limite pour adopter le budget primitif est également reportée de quinze jours, pour être fixée au 30 avril.
L’article 31 de la première loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-354 du 14 mars 2012) avait déjà prévu, pour l’exercice en cours, un report ponctuel, comme du reste en 2010 et en 2011. Ce report était motivé par le retard prévisible de la notification des états 1259 comportant les bases prévisionnelles des quatre taxes. La notification des dotations de solidarité et de péréquation, avait également été retardée, compte tenu des difficultés rencontrées pour le recensement des attributions de compensation, désormais retenues dans le calcul du potentiel fiscal des communes
Il est proposé, par le présent article, de pérenniser ce nouveau calendrier.
Le Rapporteur général estime que ces reports systématiques, depuis 2010, de la date limite de vote des budgets locaux traduisent les difficultés persistantes rencontrées par l'administration pour mettre en œuvre la réforme de la taxe professionnelle. Il faut espérer que le nouveau calendrier proposé permette aux élus locaux de débattre de leurs budgets avec une visibilité suffisante sur le montant des recettes fiscales de leurs collectivités.
Les ports de plaisance sont, par principe, imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), comme l’a confirmé la jurisprudence administrative (décision du Conseil d’État du 26 juin 1989, Société d’économie mixte de gestion Port Vauban). Dès lors qu’elles sont productives de revenus, ces installations (les postes d’amarrage, y compris dans la partie privée d’un port située par exemple au pied d’une marina) ne peuvent pas bénéficier de l'exonération prévue au 1° de l'article 1382 du code général des impôts quand bien même elles appartiennent au domaine public maritime de l’État.
Le redevable de la TFPB est le propriétaire des installations portuaires, à savoir l’État lorsque leur exploitation a été concédée et que le contrat de concession prévoit leur retour gratuit en fin de concession (CE, 16 novembre 1988, Commune d’Arcachon).
La valeur locative est déterminée par la voie d’appréciation directe prévue au 3° de l’article 1498, qui consiste, lorsque les autres moyens font défaut, à procéder à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale. Jusqu’à présent, pour déterminer cette valeur vénale, l’administration fiscale retenait comme valeur locative du poste d’amarrage un montant forfaitaire par poste d’amarrage, correspondant à la valeur moyenne observée dans les ports de la même zone.
Faisant droit au pourvoi de la commune du Grau-du-Roi, le Conseil d’État, statuant en cassation, a remis en cause l’utilisation par l’administration fiscale de montants forfaitaires, calculés par référence aux tarifs pratiqués dans les autres ports de la mer Méditerranée, pour déterminer la valeur locative des installations du port de plaisance de Port-Camargue.
EXTRAIT DE LA DÉCISION DU CONSEIL D’ÉTAT DU 5 MAI 2010, COMMUNE DU GRAU-DU-ROI « Considérant… que le régime d’exonération prévu par la décision ministérielle du 11 août 1942, que la documentation administrative de base référencée 6 C-121 du 15 décembre 1988 ne fait que rappeler sans en modifier le champ d’application, s’applique uniquement aux ports autonomes et aux chambres de commerce lorsqu’ils sont susceptibles d’être imposés au titre d’installations dont ils sont propriétaires ; que la commune n’est donc pas fondée à se prévaloir de cette tolérance administrative, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le redevable légal des impositions litigieuses était l’État. Considérant que la commune du Grau du Roi, qui ne critique pas le recours à la méthode d’évaluation par voie d’appréciation directe prévue au 3° de l’article 1498 du CGI mais conteste l’évaluation de la valeur locative, est fondée à soutenir que l’administration ne pouvait, pour déterminer cette valeur, retenir comme valeur locative du poste d’amarrage un montant forfaitaire de 700 F, correspondant à la valeur moyenne observée dans les ports de la mer Méditerranée… » EXTRAIT DE LA DÉCISION DU CONSEIL D’ÉTAT DU 20 DECEMBRE 2011, COMMUNE DU GRAU-DU-ROI « Sur la détermination de la valeur locative des terrains et des installations du port : Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au même code : Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation ; qu'aux termes de l'article 324 AC de la même annexe III : En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause . / La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien ; … Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté qu'il ne peut être recouru aux méthodes d'évaluation prévues par le premier alinéa de l'article 324 AC de l'annexe III ; Considérant, en deuxième lieu, que le ministre n'est pas fondé à déterminer la valeur de reconstruction de l'immeuble au 1er janvier 1970 sur la seule base du coût moyen unitaire de construction d'un poste d'amarrage dans les ports de plaisance tel qu'il ressortirait de diverses études portant sur divers ports de plaisance, dès lors que cette méthode n'est pas conforme aux dispositions de l'article 324 AC de l'annexe III et qu'en outre elle ne prend pas en compte les spécificités de Port-Camargue ; Considérant, en troisième lieu, que la valeur locative doit être déterminée, comme le soutient la COMMUNE DU GRAU-DU-ROI, par application du second alinéa de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts, en ajoutant à la valeur vénale du terrain la valeur de reconstruction de l'immeuble au 1er janvier 1970, diminuée d'un abattement représentatif de sa vétusté et de sa dépréciation ; qu'il doit être ensuite appliqué, pour l'obtention de la valeur locative, un taux d'intérêt à cette valeur vénale ; » |
En conséquence, afin de conforter la méthode utilisée par les services fiscaux, les alinéas 38 à 44 inscrivent dans la loi (à l’article 1501 du code général des impôts) le principe d’une évaluation forfaitaire et fixe trois tarifs applicables à raison de :
– 110 euros pour les ports maritimes de Méditerranée ;
– 80 euros pour les autres ports maritimes ;
– 55 euros pour les ports non maritimes.
L’entrée en vigueur de cette modification est toutefois reportée au 1er janvier 2014. Le Gouvernement estime ce délai nécessaire pour procéder aux évaluations.
III.– DIVERSES DISPOSITIONS D’ACTUALISATION ET DE COORDINATION
A.– L’ACTUALISATION DE LA CLÉ DE RÉPARTITION DE LA FRACTION DE LA TAXE SUR LES CONVENTIONS D’ASSURANCE (TSCA) AFFECTÉE AUX DÉPARTEMENTS
L'article 991 du code général des impôts soumet les conventions d'assurance conclues avec une société ou une compagnie d'assurance à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA), dès lors que le risque est situé en France. Plusieurs exceptions sont toutefois ménagées par les articles 995, 998, 999 et 1000, au profit de conventions assez diverses : conventions de réassurance, contrats d'assurance sur la vie, assurances de crédits à l'exportation et contrats d'assurance dépendance, notamment.
Le tarif, fixé par l'article 1001 du même code, varie de 7 à 30 % selon le risque qu'assure la convention. La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous les accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.
Jusqu’en 2010, les départements bénéficiaient seulement d'une fraction du produit de la TSCA au titre de la compensation des transferts de compétences résultant de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Dans le cadre de la suppression de la taxe professionnelle par la loi de finances pour 2010, les départements bénéficient, depuis 2011, de l'intégralité du produit de la TSCA.
La répartition de ce produit entre les départements est réglée par un tableau figurant à l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales. Les pourcentages par départements ont été initialement déterminés, par l’article 77 de la loi de finances pour 2010, « à partir des simulations de gains et pertes disponibles [lors de l’élaboration de la réforme de 2010], c’est-à-dire relatives à 2008 » (78). L’article 108 de la loi de finances pour 2011 a opéré une première mise à jour de ces pourcentages, à partir de données plus récentes mais relatives à l’exercice 2009.
Compte tenu de l’obsolescence de celles-ci, il est proposé par les alinéas 120 à 123 du présent article de procéder à une nouvelle mise à jour sur la base des dernières données disponibles, déjà utilisées pour recalculer la DCRTP et de la garantie individuelle des ressources conformément à l’article 44 de la dernière loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-1978 du 28 décembre 2011).
Cette nouvelle clé de répartition entrerait en vigueur dès la publication de la présente loi et s’appliquerait rétroactivement aux calculs opérés en 2012 qui tenaient déjà compte des dernières données.
B.– LES DISPOSITIONS DE COORDINATION LIÉES À LA RÉFORME DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS DE L’ÉTAT
L’ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 a profondément transformé le cadre juridique régissant les onze établissements publics d’aménagement (EPA) (79), les treize établissements publics fonciers de l’État (EPF) (80) et l’Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), qui ont la charge de constituer des réserves foncières en amont de la phase de réalisation d’un projet d'aménagement public.
Elle n’a en revanche pas modifié le régime des autres organismes voisins, à savoir :
– les seize établissements publics fonciers locaux (81) (mentionnés aux articles L 324-1 et suivants du code de l'urbanisme), créés à l’initiative des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des communes, qui agissent sur le territoire de leurs membres,
– l’établissement public d’aménagement de Guyane (article 1609 D du code général des impôts),
– les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe (article 1609 C) et en Martinique (article 1609 D),
– l'établissement public Société du Grand Paris (article 1609 G).
Ces quatre catégories d’organismes perçoivent, comme les EPF de l’État, le produit de la taxe spéciale d’équipement.
La réforme précitée relative aux EPA et EPF poursuivait plusieurs objectifs : elle visait notamment à préciser les compétences de chacune de ces deux catégories d’établissements, à rénover leur mode de gouvernance en affirmant le rôle de l’État et à sécuriser leur intervention au regard, notamment, du droit de la concurrence.
● L’ordonnance de 2011 précitée a notamment remplacé le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme par un nouveau chapitre divisé en trois sections, dont la première rassemble les articles L. 321-1 à 321-13 relatifs aux EPF.
Par coordination, les alinéas 77 à 84 (1° et 2° du A du VI) du présent article adaptent l’articulation et les renvois opérés par les articles 1607 bis et 1607 ter du code général des impôts, qui définissent le régime de perception de la taxe spéciale d'équipement et de partage de son produit entre EPF locaux et EPF de l’État. L’alinéa 85 opère le même type de modification s’agissant de la taxe spéciale d'équipement spécifiquement perçue par l’EPF de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
L’ORDONNANCE DU 8 SEPTEMBRE 2011 RELATIVE AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS DE L'ÉTAT ET AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS D'AMÉNAGEMENT Le cadre juridique applicable aux établissements publics d’aménagement (EPA) et aux établissements publics fonciers (EPF) d’État a été rénové. L’ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 et son décret d’application n° 2011-1900 du 20 décembre 2011 définissent les nouvelles dispositions régissant ces établissements, codifiées aux articles L. 321-1 à L. 321-28 et R. 321-1 à R. 321-22 du code de l’urbanisme. ● Des compétences précisées Pour les EPA L’objet des EPA recouvre l’aménagement et le développement durable de territoires présentant un caractère d’intérêt national. En plus de leur mission d’aménagement, le renouvellement urbain et le développement économique du territoire sont ajoutés explicitement au rang de leurs missions principales. À titre accessoire, ils peuvent également exercer toutes missions présentant un caractère complémentaire et directement utiles aux missions principales, y compris en menant sur autorisation ministérielle des interventions en dehors de leur périmètre. Pour les EPF Les conditions de création des EPF sont précisées et le champ de leur contribution aux politiques publiques est défini. À noter que les interventions en matière de préservation des espaces naturels et agricoles sont à exercer « à titre subsidiaire ». La compétence des EPF est recentrée sur le portage foncier. Les EPF qui n’avaient pas changé leurs statuts devront cesser les activités relevant de l’aménagement. Les EPF ont toujours vocation à porter des terrains en vue de leur aménagement ultérieur, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Cependant une ouverture est apportée, pour permettre le portage de biens immobiliers, en évoquant aussi une « utilisation ultérieure de ces terrains ». Il est enfin précisé que « les biens acquis par les EPF ont vocation à être cédés », les EPF n’ayant pas vocation à acheter et conserver des terrains dans un but de pure protection. ● Affirmation du rôle de l’Etat dans une gouvernance rénovée Composition du conseil d’administration (CA) Le CA des EPF est toujours composé au moins pour moitié de représentants des collectivités territoriales, mais l’État y sera désormais systématiquement représenté. De même, les régions et les départements sont membres de droit du CA. Les chambres consulaires n’ont plus de voix délibérative, mais le décret constitutif de l’établissement peut prévoir la possibilité de les y inviter de manière permanente. Implication de l’Etat dans les documents d’orientation Les EPA devront se doter d’un Projet Stratégique et Opérationnel (PSO), qui comporte des orientations stratégiques et opérationnelles de long terme et d’un programme prévisionnel d’aménagement (PPA), à moyen terme. Le Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI) des EPF, comme le PSO des EPA, tient compte désormais des orientations stratégiques de l’État notifiées par le ministre en charge de l’urbanisme. Le préfet chargé du contrôle s’assure de leur prise en compte. ● De nouveaux outils opérationnels La possibilité pour les établissements de créer des filiales et d’acquérir des participations dans des sociétés, groupements, ou organismes, dont l’objet concourt à la réalisation de leurs missions, est désormais généralisée. ● Simplification des consultations des collectivités pour les EPF Désormais, lors des consultations menées pour la création d’un EPF ou pour l’évolution de son décret, seuls les EPCI à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme seront consultés, ainsi que les communes de 20 000 habitants et plus qui ne sont pas membres de ces établissements. Pour les EPA sont consultés tous les EPCI à fiscalité propre, sans précision de leur compétence. |
Source : Ministère de l'Écologie, du développement durable, des transports et du développement
● Les alinéas 88 et 89 (b du 4° et 5° du A du VI) opèrent une modification, certes technique, mais qui dépasse la simple coordination. Ils suppriment en effet les mentions des EPF de Lorraine, Normandie et PACA dans les articles 1636 B octies et 1636 C du code général des impôts relatifs à la répartition de la taxe spéciale d’équipement. Ces EPF d’État disposaient, en effet, de statuts particuliers et se distinguaient de la catégorie générale définie aux articles L. 321-1 et suivants ; cette spécificité avait d’ailleurs conduit à prévoir un fondement législatif spécifique pour chacun d’eux, leur permettant de percevoir la taxe spéciale d’équipement (TSE).
Lesdits EPF n’ont toutefois pas disparu ; les modifications proposées tirent en réalité les conséquences de l’évolution de leurs statuts, dans le cadre de l’ordonnance de 2011, qui permettent désormais de les faire relever des dispositions de droit commun en matière de TSE, prévues à l’article 1607 ter. L’article 128 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) n’avait pas opéré différemment lorsque l’EPF du Nord-Pas-de-Calais avait aligné son statut sur le droit commun.
Le Rapporteur général relève que, à l’inverse de 2006, le présent article ne supprime pas les accroches spécifiques dans le code général des impôts (articles 1608, 1609 et 1609 F) qui permettent à ces établissements particuliers de voter un plafond individuel de TSE ; dans le régime de droit commun, un tel plafond n'existe en effet pas.
TAXES SPÉCIALES D’ÉQUIPEMENT PERÇUES AU PROFIT DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS Ces taxes sont assimilées aux impôts locaux. Elles sont perçues au profit : •des établissements publics fonciers locaux mentionnés aux articles L.324-1 et suivants du code de l’urbanisme (article 1607 bis) ; •des établissements publics fonciers de l’État mentionnés au b de l’article L 321-1 du code de l’urbanisme (article 1607 ter) ; •de l’établissement public foncier de Normandie (article 1608) ; •de l’établissement public foncier de Lorraine (article 1609) ; •de l’établissement public d’aménagement de la Guyane (article 1609 B) ; •de l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe (article 1609 C) ; •de l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique (article 1609 D) ; •de l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur (article 1609 F). Pour les deux types d’établissements publics fonciers visés aux articles 1607 bis et 1607 ter, le produit de la taxe est arrêté chaque année par l’assemblée générale de l’établissement dans la limite d’un plafond fixé à 20 euros par habitant situé dans son périmètre. Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l’article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l’établissement public. Pour les autres établissements publics fonciers, le montant de la taxe est arrêté chaque année par le conseil d’administration de l’établissement public dans les limites d’un plafond fixé pour chaque établissement par la loi et avant le 31 décembre de l’année précédant celle de l’imposition. Le produit global ainsi voté est réparti entre les quatre taxes directes locales au prorata des recettes comprises dans les rôles généraux de l’année précédente que chacune de ces taxes a procurées à l’ensemble des communes et des groupements compris dans le ressort de chacun des établissements publics. Pour 2012, le produit de la taxe s’est élevé à 442 millions d’euros pour l’ensemble des établissements publics. |
Le présent article constitue également un véhicule commode pour procéder à diverses corrections d’erreurs rédactionnelles, détaillées aux alinéas 90 à 97 (B du VI).
L’évaluation préalable annexée au présent article commente (82), avec une précision aussi clinique que peu coutumière, chacune de ces corrections. On retiendra :
– la suppression à l’article 1519 I du code général des impôts (créant une taxe additionnelle à la TFPNB sur les carrières, les pièces d’eau et les chemins de fer), introduit par le Gouvernement via l’article 108 de la loi de finances pour 2010, de la référence à une disposition que ce dernier article avait lui-même supprimée ;
– la suppression à l’article 1522 bis (traitant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères) d’une référence qui n’existe pas, fruit sans doute d’une erreur d’un de nos collègues sous la précédente législature ;
– l’ajout à l’article 1639 A ter d’une référence aux EPCI à fiscalité éolienne unique en plus des EPCI à fiscalité professionnelle unique ;
– la substitution, dans l’article 1379-0 bis, à la référence à la taxe sur les fournitures d’électricité de celle à la taxe sur la consommation finale d’électricité, qui l’a remplacée ;
– l’ajout, dans le même article, d’une référence aux métropoles sans laquelle ces dernières seraient privées de la faculté d’instaurer une taxe de balayage des trottoirs et des chaussées.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement CF 43 du rapporteur général.
M. le rapporteur général. Les amendements CF 43 et CF 44 visent à régler les problèmes relatifs à la cotisation minimale de la cotisation foncière des entreprises – CFE. Plusieurs collectivités territoriales, soit volontairement, soit par manque d’information, avaient fixé des bases d’imposition élevées pour le calcul des cotisations minimales. En conséquence, des entreprises sont aujourd’hui redevables de sommes jugées excessives.
Je propose de reprendre dans ce collectif la mesure envisagée par le Sénat – qui, je vous l’annonce au passage, vient de rejeter en première lecture le projet de loi de finances pour 2013. Il s’agit de proroger au 21 janvier 2013 le délai pendant lequel les collectivités qui le souhaitent peuvent revenir sur les délibérations qu’elles ont adoptées pour les exercices 2012 et 2013 et qu’elles jugent parfois elles-mêmes inopportunes.
M. le président Gilles Carrez. Comment cela se passera-t-il pour l’année 2012 ? Les collectivités pourront-elles adopter des délibérations dont l’effet serait rétroactif ?
M. le rapporteur général. Ce point est réglé par l’amendement CF 44, qui viendra après cet article 17 : les collectivités concernées pourront décider, par une délibération adoptée avant le 21 janvier 2013, de prendre en charge tout ou partie du montant de l’augmentation subie en 2012 par l’ensemble des entreprises assujetties à la cotisation minimale. Le montant pris en charge sera imputé sur la cotisation due au titre de l’année 2012, ce qui allégera d’autant la charge fiscale des redevables, qui n’auront pas à faire d’avance. Ainsi il reviendra non pas à l’État, mais aux collectivités de supporter le coût de cette prise en charge, dont les modalités seront fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.
M. le président Gilles Carrez. Quelle sera la procédure pour l’année 2012, dès lors que les entreprises se seront déjà acquittées du paiement de la CFE ? Il s’agira a priori non pas d’un dégrèvement, mais d’un remboursement d’une partie des sommes déjà perçues par les collectivités ?
M. le rapporteur général. Je le répète : les modalités comptables de cette prise en charge seront fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.
M. le président Gilles Carrez. Quoi qu’il en soit, le dispositif va dans le bon sens. Il permet aux collectivités de revenir sur leurs délibérations, y compris pour l’année 2012. Certaines n’ont pas mesuré les conséquences de leurs décisions.
L’élargissement de la fourchette des valeurs locatives a été une demande constante et unanime de toutes les associations d’élus locaux, notamment de l’Association des maires de France et de l’Association des maires de grandes villes de France. Les collectivités ont voulu qu’on leur redonne de la « matière fiscale ». Dès lors, elles ont été autorisées à fixer des bases d’imposition dans une fourchette allant de 200 à 2 000 euros, et jusqu’à 6 000 euros pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 100 000 euros. Certains élus ont néanmoins préféré ne pas adopter de délibération pour conserver le système antérieur, comme cela était possible.
Mme Christine Pirès Beaune. C’est une bombe à retardement que les entreprises découvrent aujourd’hui. La cotisation de certaines PME a été triplée, voire quadruplée.
M. le président Gilles Carrez. La bombe a été posée par les exécutifs locaux. Il est trop facile d’accuser systématiquement l’État.
Mme Christine Pirès Beaune. Je ne le fais nullement. C’est néanmoins une mauvaise réforme, menée à bien sans que l’on dispose de toutes les simulations nécessaires. Que cela nous serve d’exemple !
Sur le plan comptable, il serait logique que les sommes prises en charge par les collectivités constituent un acompte sur la cotisation due par les entreprises au titre de l’année 2013.
M. Henri Emmanuelli. Plusieurs maires m’ont dit ne pas avoir modifié le taux de la CFE ; c’est la base d’imposition qui aurait évolué.
M. Charles de Courson. C’est ce que font croire beaucoup d’élus qui ont pourtant adopté des délibérations en ce sens. Jusqu’en 2009, la cotisation minimale était fixée par l’administration fiscale. Nous avons ensuite donné aux collectivités la possibilité de la modifier, en adoptant une base d’imposition située dans une fourchette entre 200 et 2 000 euros, élargie ensuite à 6 000 euros pour les grandes entreprises. De nombreux élus, qui anticipaient une chute du produit de la taxe professionnelle, ont décidé de relever le niveau de la cotisation minimale. S’ils ne l’avaient pas fait, l’assiette serait restée stable.
En outre, les collectivités pouvaient demander des simulations à l’administration fiscale.
M. Henri Emmanuelli. Certaines de celles qui l’ont fait ne les ont jamais obtenues.
Mme Christine Pirès Beaune. Tout à fait.
M. Charles de Courson. Je les ai obtenues pour la commune dont je suis maire.
Les deux amendements du rapporteur général vont dans le bon sens. Je crains néanmoins que les montants pris en charge par les collectivités ne soient parfois plus élevés que la cotisation due par les entreprises au titre de l’année 2013.
M. le président Gilles Carrez. Dans ce cas, l’acompte – qui serait en effet la procédure la plus logique – serait étalé sur plusieurs années.
M. Dominique Lefebvre. Nous avons fait le tour de la question. Nous devons adopter les amendements du rapporteur général, qui règlent bien le problème posé. Il appartient aux collectivités qui ont modifié la base d’imposition de délibérer de nouveau.
M. Olivier Carré. A-t-il été envisagé de plafonner la CFE à 3 % de la valeur ajoutée des entreprises et de la soumettre ainsi à la règle générale ?
M. le rapporteur général. Non.
La Commission adopte l’amendement (Amendement n° 224).
Puis elle adopte l’article 17 ainsi modifié.
*
* *
La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 17.
*
* *
Article additionnel après l’article 17
Ouverture d’une faculté de prise en charge par les collectivités territoriales de tout ou partie de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012
La Commission adopte d’abord l’amendement CF 44 du rapporteur général (Amendement n° 223).
En conséquence, les amendements CF 9 et CF 10 de M. Charles de Courson deviennent sans objet.
*
* *
La Commission en vient à l’amendement CF 11 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Nous ne sommes pas revenus sur le mécanisme de la cotisation minimale, de sorte que nous laissons encore la porte ouverte à des augmentations considérables. Ne faudrait-il pas limiter les hausses, par exemple à 15 % par an, ce qui obligerait les collectivités à les étaler ?
Aux termes de mon amendement, le Gouvernement remettrait au Parlement un rapport sur le mode de calcul de la CFE.
Les amendements CF 43 et CF 44 que nous avons adoptés éteignent les incendies, mais ne résolvent pas le problème de manière durable.
M. le rapporteur général. Avis défavorable.
Deux rapports ont été publiés récemment sur la réforme de la fiscalité locale induite par la suppression de la taxe professionnelle : celui du sénateur Charles Guené et celui remis par le Gouvernement au Parlement le 6 novembre 2012. Il est inutile d’en prévoir un de plus. Nous devrions plutôt suggérer au Gouvernement de travailler à une réforme concertée dans le cadre du Comité des finances locales.
L’amendement CF 11 est retiré.
*
* *
Article additionnel après l’article 17
Modification des modalités de révision des attributions de compensation versées par certains EPCI à fiscalité propre
La Commission est saisie de l’amendement CF 6 de Mme Carole Delga.
M. Laurent Baumel. Cet amendement vise à empêcher que les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la contribution économique territoriale unique ne révisent à la baisse, par une décision prise à la majorité qualifiée, l’attribution de compensation versée à la commune centre ou à une commune de taille importante. Il avait déjà été présenté lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2013.
M. le rapporteur général. Il avait été accepté par la Commission lors de la réunion tenue au titre de l’article 88 du Règlement, mais n’avait pas été défendu par ses auteurs en séance publique.
Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement (Amendement n° 222).
*
* *
Puis la Commission examine l’amendement CF 27 du président Gilles Carrez.
M. le président Gilles Carrez. Cet amendement vise à déduire de la surface imposable au titre de la taxe d’aménagement – TA – les aires de stationnement souterraines des immeubles collectifs d’habitation dont la construction a été imposée par des plans locaux d’urbanisme. Le remplacement de la taxe locale d’équipement – TLE – par la taxe d’aménagement devait se faire à pression fiscale constante. Or cela n’a pas été le cas : ces aires de stationnement ont été intégrées à l’assiette de la TA, alors qu’elles ne l’étaient pas à celle de la TLE.
Cet amendement avait été approuvé par notre Commission lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2013, dans le cadre de la réunion organisée au titre de l’article 88 du Règlement. Je l’ai ensuite retiré à la demande du ministre, qui souhaitait l’examiner de manière plus approfondie. Je le présente à nouveau et je disposerai en séance d’éléments d’évaluation précis, que j’ai sollicités directement auprès du ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie.
M. le rapporteur général. La situation est la même que pour l’amendement CF 4. Je vous suggère, monsieur le président, de retirer cet amendement et de le présenter à nouveau pour la réunion qui se tiendra au titre de l’article 88. Le débat aura lieu en séance publique.
L’amendement CF 27 est retiré.
*
* *
Modification du droit de licence dû par les débitants de tabacs
Texte du projet de loi :
I.– Au huitième alinéa de l'article 568 du code général des impôts, le pourcentage : « 20,84 % » est remplacé par le pourcentage : « 20,60 % ».
II.– Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article a pour objet d’augmenter la rémunération des débitants de tabac, conformément aux engagements pris par l’État dans le contrat d’avenir 2012-2016. Les buralistes sont rémunérés au moyen d’une remise consentie par les fabricants sur le prix de vente au détail des cigarettes. Afin de porter le taux net de cette remise de 6,6 à 6,7 %, il est nécessaire de diminuer le taux du droit de licence dont s’acquittent les débitants, compte tenu des modalités – complexes – de détermination de leur rémunération.
En France, l’administration détient le monopole de la vente au détail de tabac. Les débitants de tabac, qui procèdent concrètement à la vente, sont donc des « préposés » de l’administration, aux termes du premier alinéa de l’article 568 du code général des impôts (CGI). Lorsque leur chiffre d’affaires réalisé sur la vente de tabac dépasse un certain seuil, les débitants sont soumis à un droit de licence, contrepartie de l’autorisation de vente qui leur est donnée. L’article 568 précité a fixé ce seuil à 157 650 euros pour la France continentale et à 118 238 euros pour la Corse.
Le droit de licence est assis sur la remise devant être consentie aux débitants par les fournisseurs. Le 3° du I de l’article 570 du CGI oblige en effet tout fournisseur de tabac à « consentir à chaque débitant une remise sont les taux sont fixés par arrêté [et qui] comprend l’ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ».
Cette remise constitue la rémunération des débitants de tabac. Dès lors que le prix de vente au détail des produits du tabac est fixé par voie réglementaire (83), un écart doit exister entre ce prix de vente et celui auquel les débitants se procurent les produits auprès des fournisseurs, l’exercice de la profession de débitant de tabac n’étant évidemment pas bénévole.
Le taux de la remise varie selon la nature des produits du tabac ; il est de 8,54 % du prix d’achat pour les produits autres que les cigares et cigarillos, en application de l’arrêté du 26 décembre 2007 (84).
Ce taux est celui de la remise « brute ». Afin d’obtenir la remise « nette », il faut en retirer un précompte de 1,94 %, composé :
– d’une part, du droit de licence de ces produits. Il est de 20,84 % de la remise, soit 1,78 % du prix de vente au détail (85). Le taux de 20,84 % est fixé par l’article 568 précité ;
– d’autre part, de la cotisation au régime d’allocation viagère des débitants de tabac (RAVGDT), fixée pour les mêmes produits à 1,876 % de la remise brute (article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 (86)). Cette cotisation est donc de 0,16 % (87).
Le taux de remise nette est donc de 6,6 % (88).
Le précompte de 1,94 % est versé par le fournisseur à l’administration, qui reverse aux débitants les sommes précomptées au titre du droit de licence, à hauteur du seuil d’exonération. Ce reversement est dénommé « complément de remise ».
Les fortes hausses des prix du tabac de 2003 et 2004 ont généré des difficultés pour les buralistes, notamment dans les zones frontalières. Ces difficultés ont justifié la signature de « contrats d’avenir » entre l’État et la Confédération des buralistes.
Le troisième contrat d’avenir en faveur des débitants de tabac, qui couvre la période 2012-2016, a été signé le 22 septembre 2011 par Mme Valérie Pécresse, alors ministre du Budget. Il prévoit une augmentation de la remise nette sur les produits du tabac (hors cigares et cigarillos) de 0,4 point sur la période, ainsi répartie : + 0,1 en 2012, 2013 et 2014, puis + 0,05 en 2015 et 2016.
Le taux de la remise nette a donc été porté de 6,5 à 6,6 % par l’article 67 de la dernière loi de finances rectificative pour 2011 (89). En suivant le même schéma, le présent article propose de porter ce taux à 6,7 %.
Le taux de la remise nette n’est défini ni par la loi ni par le règlement. Il est la résultante d’un calcul dont les termes sont en revanche définis juridiquement.
En conséquence, l’augmentation du taux de la remise nette implique :
– soit une augmentation du taux de la remise brute (fixé par arrêté) ;
– soit une diminution de la fraction de cette remise brute affectée aux organismes de sécurité sociale (qu’il s’agisse du droit de licence fixé par la loi ou de la cotisation au RAVGDT fixée par décret).
C’est la première option qui a été choisie, l’évaluation préalable annexée au présent article indiquant que « pour 2013, la remise brute imposée aux fabricants sera de 8,64 % ». Cette augmentation nécessitera donc une modification de l’arrêté précité du 26 décembre 2007.
L’adoption d’une telle hausse sans aucune coordination législative aurait cependant pour effet d’augmenter le précompte au titre du droit de licence. En effet, le taux de ce droit (20,84 %) viendrait frapper une assiette plus large (8,64 % à l’avenir contre 8,54 % aujourd’hui). En conséquence, la remise nette n’atteindrait pas 6,7 %, mais seulement 6,68 % (90).
Pour que la remise nette soit bien de 6,7 %, il convient donc de diminuer le taux du droit de licence, de 20,84 à 20,6 % (91).
Le I du présent article apporte donc cette modification à l’article 568 du CGI (alinéa 1).
Il faut remarquer que l’augmentation du taux de la remise brute a également pour effet spontané d’accroître la cotisation au RAVGDT, de 0,16 % à 0,162 % (92). Il a été indiqué au Rapporteur général qu’afin de maintenir constant le taux de cotisation, la formule de calcul sera modifiée par décret, ramenant ainsi la cotisation à 1,852 % de la remise brute (93).
Le II prévoit l’entrée en vigueur du nouveau taux du droit de licence au 1er janvier 2013 (alinéa 2).
La mesure proposée est neutre pour les administrations publiques, l’amélioration de la rémunération des débitants de tabac pesant sur les seuls fabricants, dont la marge sera réduite du montant de l’augmentation de la remise brute.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement CF 33 de M. Éric Alauzet.
M. Éric Alauzet. La présentation de cet amendement de suppression de l’article vise à obtenir du rapporteur général une explication précise des éléments qui ont conduit à diminuer le taux du droit de licence dû par les débitants de tabacs.
M. le rapporteur général. Je suggère que vous retiriez votre amendement, monsieur Alauzet. Son exposé sommaire laisse entendre que l’article 18 tendrait à diminuer la fiscalité sur le tabac. Or il n’en est rien.
La rémunération des débitants de tabacs, dite « remise nette », dépend de la remise brute et du taux du droit de licence. Conformément au contrat d’avenir conclu entre les buralistes et les gouvernements successifs, le taux de la remise nette doit être augmenté de 0,1 point par an pendant la durée du contrat. Pour respecter cet engagement, le taux du droit de licence doit être abaissé dans la proportion prévue à l’article 18.
L’amendement CF 33 est retiré.
La Commission adopte l’article 18 sans modification.
*
* *
Extension des dispenses de caution pour les petits opérateurs
en matière d’alcool et de boissons alcooliques
Texte du projet de loi :
Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent être dispensés de caution :
« 1° En matière de production, de transformation et de détention, les récoltants, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs ;
« 2° En matière de circulation, les petits récoltants de vin, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans les limites et conditions fixées par décret ;
« 3° Dans les limites et conditions fixées par décret, les opérateurs qui détiennent et expédient les produits mentionnés au 1° du I. »
Observations et décision de la Commission :
L’article proposé a pour but d’étendre la dispense de caution de droits d’accises, accordée aux récoltants en matière de détention et d’expédition d’alcool et de boissons alcooliques, aux négociants et aux producteurs non récoltants.
Toute personne qui produit ou transforme des alcools, vins, produits intermédiaires ou bières soumis à accises, ou qui détient de tels produits destinés à l’expédition ou la revente, doit exercer son activité comme entrepositaire agréé, conformément à l’article 302 G du code des impôts (CGI). La production ou la transformation, la réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente de ces produits sont effectués en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits, ou sous le couvert du document d’accompagnement mentionné au I de l'article 302 M du CGI.
Les droits d’accises sont exigibles lors de la mise à la consommation de ces produits.
Les produits concernés sont les suivants :
– alcools soumis au droit de consommation prévu par l’article 403 du CGI ;
– produits intermédiaires (notamment les vins doux naturels et les vins de liqueur) soumis au droit de consommation prévu par l'article 402 bis ;
– vins, cidres, poirés, hydromels et jus de raisin légèrement fermentés soumis au droit de circulation prévu à l'article 438 ;
– boissons « premix » soumises à la cotisation perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, prévue à l'article 1613 bis ;
– bières soumises au droit spécifique prévu à l'article 520 A et à la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale.
Parmi les obligations à remplir pour obtenir le statut d’entrepositaire agréé figure celle de tenir une « comptabilité matières » et de fournir une caution solidaire.
Des dispenses de caution sont toutefois déjà possibles dans plusieurs cas.
Le V de l’article 302 G du CGI prévoit deux dispenses :
– en matière de production, de transformation et de détention, pour les récoltants, dont les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs ;
– en matière de circulation, les petits récoltants de vin y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans des limites et conditions fixées par décret.
Les négociants, et les producteurs non récoltants, ne peuvent bénéficier de ces dispenses de cautions.
L’article 111-0 D de l’annexe III du CGI précise que cette dispense s’applique aux producteurs de vin qui, cumulativement, et en moyenne calculée sur une période de trois ans, produisent moins de 1 000 hectolitres de vin par an et expédient en régime de suspension de droits moins de 1 000 hectolitres de vin par an. La période de trois ans s'entend des trois années d'activité de vin écoulées à la date du dépôt de la déclaration annuelle de récolte prévue par l'article 407 du code général des impôts. Lorsque cette période est inférieure à trois ans, aucune dispense de caution ne peut être accordée. Ces dispositions transposent des seuils prévus par l'article 40.3 de la directive 2008/118/CE relative au régime général d’accise, 22 du règlement n° 436/2009 sur le secteur vitivinicole.
Par ailleurs, le III de l’article 302 D du CGI prévoit une dispense de caution dans les limites et conditions fixées par décret pour garantir le paiement des droits d’accises dus lors de la mise à la consommation des alcools. L’ensemble des entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G peut bénéficier de cette dispense.
L’article 111-0 B de l’annexe III du CGI précise que les entrepositaires agréés bénéficient de cette dispense de caution à condition que les droits d'accise dont ils sont redevables n'excèdent pas, en valeur annuelle, deux fois et demi le montant du droit de consommation fixé au 2° du I de l'article 403 du même code, soit 4 150 euros. Cette valeur annuelle s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables réalisées par les entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés au cours des deux dernières années civiles.
Le présent article vise à mettre en cohérence les règles relatives à ces dispenses de caution.
Si les alinéas 1 à 4 sont rédactionnels, l’alinéa 5 du présent article modifie le V de l’article 302 G du CGI pour étendre aux négociants et aux producteurs non récoltants la dispense de caution déjà prévue pour les récoltants et brasseurs, en matière de détention et d’expédition des alcools.
Un décret précisera que seuls sont concernés les « petits » opérateurs, pour les expéditions nationales.
Elle concerne environ 1 500 à 2 000 petits négociants (non récoltants), qui ont le statut d'entrepositaires agréés et détiennent des alcools et des boissons alcooliques dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises dont ils sont titulaires.
Il s’agit donc d’une mesure de cohérence administrative.
Le coût de la caution est faible, mais la simplification est réelle pour les entreprises comme pour les agents des douanes.
*
* *
La Commission adopte l’article 19 sans modification.
*
* *
Extension de la dispense de caution des taxes dues lors de l’importation
et en matière de régimes économiques douaniers.
Texte du projet de loi :
Le code des douanes est ainsi modifié :
A.– À l'article 114 :
1° Au 1 bis :
a) Le premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« La taxe sur la valeur ajoutée et les taxes assimilées sont dispensées de l'obligation susvisée. » ;
b) Les a) et b) sont abrogés ;
2° Au 1 ter, les mots : « Les conditions de l'octroi et de l'abrogation de la dispense mentionnée au premier alinéa du 1 bis sont » sont remplacés par les mots : « La présentation d'une caution peut toutefois être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ».
B.– À l'article 120 :
1° Au 3 :
a) Le premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« La taxe sur la valeur ajoutée et les taxes assimilées sont dispensées de l'obligation susvisée. » ;
b) Les a) et b) du 3 sont abrogés ;
2° Le sixième alinéa est supprimé ;
3° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4° « La présentation d'une caution peut toutefois être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ».
Observations et décision de la Commission :
Le présent article étend la dispense de caution des taxes dues à l’importation comme dans le cadre de régimes économiques douaniers. Ces mesures de simplification des procédures douanières, d’application immédiate, devraient concerner entre 1 000 et 1 500 sociétés importatrices, PME et entreprises nouvellement créées.
Une dispense de caution peut être accordée sous conditions aux entreprises importatrices qui bénéficient d’un report de paiement de la TVA et des taxes assimilées (crédit d’enlèvement), conformément à l’article 114 du code des douanes. De même, elles peuvent être dispensées de constituer une caution des marchandises ou de consigner la TVA (acquit-à-caution) dans le cadre du régime économique suspensif douanier, conformément à l’article 120 du même code.
Cette dispense de caution ne porte toutefois que sur la TVA et pas sur les taxes assimilées à la TVA.
Cette situation résulte d’un allègement progressif du coût des formalités douanières pour les importateurs. La direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) a autorisé depuis 2004 les opérateurs à acquitter la TVA sur les importations en une seule fois, le 25 du mois, ce qui permet de supprimer les coûts de trésorerie liés au portage de la TVA. La réduction du coût moyen de trésorerie qui en résulte est estimée à 30,50 euros par conteneur d’une valeur hors taxes de 152 000 euros.
Depuis 2006, le report de paiement de la TVA sur les importations n’est plus systématiquement subordonné à la présentation d’une caution. Cette dispense doit être demandée à l’administration, et elle est subordonnée au respect de certaines obligations. Dans le cadre du report de paiement de la TVA due, les conditions de dispense de caution sont prévues par l'article 114 du code des douanes complété par le décret n° 2006-741 du 27 juin 2006, et pour le placement sous régime économique suspensif douanier par l'article 120 du code des douanes complété par le décret n° 2011-1103 du 12 septembre 2011. Les entreprises doivent satisfaire à certaines obligations comptables, ne pas faire l’objet d’une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Enfin, la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 a étendu la dispense de cautionnement à l’ensemble des régimes douaniers suspensifs de droits. Dans la mesure où ces droits sont constitués à plus de 80 % par la TVA, la dispense de caution doit conduire à diviser le montant des sommes à garantir par cinq.
Dans sa communication à la commission des Finances de l’Assemblée nationale sur la gestion et le contrôle de la TVA, en mars 2012, la Cour des comptes estimait que plus de 85 % des entreprises avaient obtenu cette dispense de caution, parvenant à une réduction du coût de trésorerie de 20,90 euros pour un conteneur.
La DGDDI estime qu’aujourd’hui 80 % des marchandises en valeur font l’objet d’un décautionnement. Selon la Cour des comptes, les critiques sur les surcoûts du dispositif tiennent avant tout à la méconnaissance de ces réformes : toutes les PME qui y ont droit n’en bénéficient pas.
Le présent article propose d’étendre la dispense de caution à l’ensemble des entreprises, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une demande. Les conditions actuellement prévues sont supprimées. Cette suppression des conditions préalables à la dispense de caution devrait permettre un allègement des procédures, au bénéfice des opérateurs du commerce extérieur.
Cette généralisation de la dispense de caution porte sur l’article 114 (alinéas 2 à 6) pour le crédit d’enlèvement, ainsi que sur l’article 120 du code des douanes (alinéas 9 à 13) pour l’acquit-à-caution.
Le projet de loi (alinéas 7 et 15 du présent article) prévoit cependant la possibilité pour le comptable des douanes d’exiger la présentation d’une caution des personnes qui font l’objet d’une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, d’une procédure de redressement ou d’une procédure de liquidation judiciaire. Au contrôle ex ante effectué par l’administration des douanes se substitue ainsi un contrôle ex post des entreprises qui bénéficient toutes, par principe, de la dispense de caution de TVA.
La dispense de caution pour le paiement de la TVA à l’importation, telle qu’elle existe aujourd’hui constitue une procédure d’une certaine lourdeur, pour les opérateurs comme pour l’administration. De plus, cette dispense ne concerne pas les taxes assimilées qui restent souvent les seules à cautionner. Or les montants de ces taxes assimilées sont limités (avec un produit total de 25 millions d’euros, et un coût de la caution de l’ordre de 5 % des taxes dues), et le coût administratif du cautionnement pour les opérateurs apparaît disproportionné par rapport aux enjeux.
Les alinéas 5 et 11 étendent les dispenses de caution aux taxes assimilées à la TVA. Le comptable des douanes peut toutefois exiger la présentation d’une caution dans les mêmes conditions que pour la TVA.
Taxes assimilées à la TVA A– Taxes perçues à l'import par la DGDDI (et par la DGFIP en régime intérieur) – taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine (article 1609 vicies du CGI) ; – taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression et une taxe sur l'édition des ouvrages de librairie (article 1609 undecies à quindecies du CGI) ; B– Taxes perçues à l'import par la DGDDI (et par l'affectataire en régime intérieur) ● Taxes prévues par l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (anciennes taxes parafiscales) : – taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du bois ; – taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure ; – taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie ainsi que des arts de la table ; – taxe pour le développement des industries de l’habillement ; – taxe pour le développement des industries des matériaux de construction. ● Taxe au profit de FranceAgrimer (article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003). |
*
* *
La commission examine l’amendement CF 18 de M. Charles de Courson offrant aux entreprises une option leur permettant de payer la TVA à l’importation auprès de la DGFIP plutôt qu’auprès des douanes.
M. Charles de Courson. À la demande de la Commission, j’ai retravaillé ce dispositif de perception de la TVA à l’importation pour rendre la procédure française plus compétitive.
M. Christian Eckert, rapporteur général. Je suis défavorable à l’amendement, puisqu’il est satisfait par l’article 20 qui prévoit notamment de rendre la dispense de caution automatique en ne la conditionnant plus au respect de certaines obligations.
M. Charles de Courson. Je propose également un transfert du paiement de la TVA de la DGDDI vers la DGFIP.
M. le rapporteur général. Certes l’article 20 ne vous donne pas satisfaction sur ce point mais il me semble préférable de traiter directement les règles de cautionnement plutôt que de modifier l’administration de recouvrement.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’article 20 sans modification.
*
* *
Modification des dispositions relatives à la taxe poids lourds alsacienne (TPLA) et à la taxe poids lourds nationale (TPLN)
Texte du projet de loi :
I.– Le code des douanes est modifié comme suit :
A.– Le premier alinéa de l’article 271 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 s'entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes et demie ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à trois tonnes et demie. »
B.– Au cinquième alinéa du 1 de l'article 275, les mots : « ou du nombre d'essieux », « respectivement » et « ou la catégorie » sont supprimés.
C.– À l’article 278 :
1° Après le premier alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
« À titre dérogatoire, la taxe est acquittée par anticipation par la société habilitée fournissant un service de télépéage dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « d'abattements sur » sont remplacés par les mots : « d'une réduction sur le montant de », les mots : « règles d'abattement » sont remplacés par le mot : « réductions » et les mots : « chaque année » sont supprimés.
D.– Au quatrième alinéa de l’article 282 dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d’État ».
E.– L'article 283 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 283.– Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés à l’article 281, ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est constitutif d’une infraction.
« Le fait de faire usage d’un appareil, dispositif ou produit de même nature est constitutif d’une infraction.
« Indépendamment des sanctions prévues à l’article 413, cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. »
F.– Au quatrième alinéa de l’article 283 bis dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, le mot : « 283 » est remplacé par le mot : « 413 ».
G.– À l’article 285 septies :
1° Le premier alinéa du 3 du I est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 1 s'entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à douze tonnes ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à douze tonnes. » ;
2° Au quatrième alinéa du 2 du IV, les mots : « ou du nombre d'essieux », « respectivement » et « ou la catégorie » sont supprimés ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a. Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, la taxe est acquittée par anticipation par la société habilitée fournissant un service de télépéage dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d’État. » ;
b. Après le 1, est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le redevable ayant passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage bénéficie, dans la limite fixée par la directive n° 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 précitée, d'une réduction sur le montant de la taxe due, afin de tenir compte de l'économie de gestion résultant de ce contrat. Les réductions applicables sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. » ;
4° Le VII est ainsi modifié :
a. Au quatrième alinéa du 2, les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d’État » ;
b. Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés au 2, ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est constitutif d’une infraction.
« Le fait de faire usage d’un appareil, dispositif ou produit de même nature est constitutif d’une infraction.
« Indépendamment des sanctions prévues à l’article 413, cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. » ;
c. Au quatrième alinéa du 4, les mots : « au 3 du présent VII » sont remplacés par les mots : « à l’article 413 ».
H.– Au 2 de l'article 358 du même code, après les mots : « bureau des douanes » sont insérés les mots :
« , le service spécialisé ».
I.– Il est rétabli un article 413 ainsi rédigé :
« Art. 413.– Sans préjudice des dispositions de l’article 282 et du 2 du VII de l’article 285 septies, est passible d’une amende maximale de 750 euros toute infraction aux dispositions légales et réglementaires régissant la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises prévue aux articles 269 à 283 quinquies et la taxe prévue à l’article 285 septies. »
II.– L’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
A.– Le C du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. »
B.– Le C du II est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. » ;
2° Au 2, les mots : « de la date d’entrée en vigueur de la taxe prévue au A » sont remplacés par les mots : « de la date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe mentionnée au 1 ».
III.– Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article apporte diverses modifications aux éco-taxes poids lourds alsacienne et nationale, dans la perspective de leur mise en œuvre mi-2013.
800 000 véhicules de transport de marchandises, dont 600 000 véhicules immatriculés en France, entreront dans le champ d’une éco-taxe poids lourds, à compter de 2013, lorsque leurs conducteurs emprunteront 15 000 kilomètres de réseau routier non concédé (10 000 km de réseau national et 5 000 km de réseau local).
La taxe est exigible lors du franchissement d’un point de contrôle et due, à proportion de la longueur de voirie dont l’utilisation est taxée à un taux kilométrique modulé en fonction de la catégorie du véhicule, de sa classe d’émission (selon les normes dites « Euro » qui fixent les limites maximales de rejets polluants pour les véhicules roulants) et du niveau de congestion de la section de tarification.
La taxe est due, solidairement, par le propriétaire, le locataire, le sous-locataire, le conducteur ou tout utilisateur du véhicule. Elle est liquidée à partir des informations collectées au moyen d’un équipement électronique dont les véhicules doivent disposer. Le transporteur est censé soit avoir souscrit à un service de télépéage, soit constituer une avance sur taxe préalablement à l’emprunt du réseau taxable.
L’ensemble du dispositif repose sur le recours à un prestataire privé qui a notamment vocation à gérer le réseau d’appareils de contrôle, à collecter les données ainsi produites (y compris la constatation d’un manquement), à les analyser, à liquider la taxe due et à imprimer et envoyer au redevable la notification de celle-ci. Le Gouvernement a signé, le 20 octobre 2011, un contrat de partenariat public-privé (PPP) à cet effet avec le consortium Ecomouv (filiale d’Autostrade per l’Italia à hauteur de 70 % et de ses partenaires français SFR, SNCF, Steria et Thales à hauteur de 30 %).
La détermination du montant de la taxe est encadrée par la directive 2006/38 CE dite « Eurovignette », qui fixe les règles de calcul des plafonds pour les redevances kilométriques dont relève l’éco-taxe poids lourds nationale. Les évaluations réalisées dans ce cadre conduisent à un montant maximal de 15 à 16 centimes d’euros environ.
La justification première de mise en place de l’éco-taxe étant de recouvrer auprès des utilisateurs du réseau routier les coûts qu’ils engendrent pour la collectivité sans les payer directement, le taux de référence a été calculé sur la base des études de couverture des coûts d’usage du réseau routier, qui conduisent à retenir un taux moyen de 12 centimes d’euros.
Selon la direction générale des Douanes et des droits indirects (DGDDI), sur la base de ce taux et des résultats des simulations de trafic effectuées, la mise en œuvre du contrat de PPP permettrait la collecte de 1 188 millions d’euros par an de produit de la taxe brute.
Les recettes nettes affectées à l’Agence de financement des infrastructures de transport (AFITF) sont évaluées à 751 millions d’euros par an. Les collectivités territoriales bénéficieraient de 155 millions d’euros par an de recettes nettes de taxe perçue sur leur réseau.
ÉVALUATION DES RECETTES DE TPLN EN 2014
Recettes brutes : 1 188 millions d’euros | ||
|
Dotation nette pour les collectivités territoriales : 155 M€ |
Recettes brutes pour l’AFITF : 1 033 M€ | |
Équivalent du loyer de PPP versé par l’AFITF au MEDDE : 236 M€ TVA : 46 M€ |
Recettes nettes pour l’AFITF : 751 M€ | |
Frais de gestion : 234 M€ pour l’AFITF et 48 M€ pour les collectivités territoriales | ||
Source : DGDDI.
La rémunération du titulaire du contrat de partenariat sera versée dès la réalisation complète du dispositif de perception et de contrôle de l'éco-taxe poids lourds nationale. Cette rémunération pourra être modulée en fonction de l’atteinte d’objectifs de performance déterminés par l'État au cours du dialogue compétitif. Ainsi, la rémunération d’Ecomouv n’est pas fonction du trafic.
Créée par l’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances initiale pour 2009, les dispositions relatives à l’éco-taxe poids lourds ont été modifiées depuis par quatre autres lois. Le présent article constitue ainsi la sixième retouche d’un dispositif qui n’est pas encore entré en vigueur.
Depuis le 1er janvier 2005, l’Allemagne taxe les poids lourds à raison du nombre de kilomètres qu’ils parcourent. Il en est résulté un report de trafic en Alsace. C’est pourquoi à l’initiative de M. Yves Bur, la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports a prévu, à titre expérimental, l’instauration, en Alsace, d’une taxe similaire à la taxe allemande.
Conformément aux conclusions du Grenelle de l’environnement, il a été décidé, avant d’avoir pu mener à bien cette expérimentation, de généraliser la taxe et d’ajouter des critères supplémentaires de modulation de son assiette et de son tarif (selon la catégorie du véhicule, sa classe d’émission et le degré de congestion des voies qu’il emprunte).
La loi de finances pour 2009 a refondu le dispositif de la taxe antérieure, la taxe poids lourds alsacienne (TPLA), et prévu la création d’une taxe différente de portée nationale, la TPLN. L’objectif était une application de la TPLA au plus tard au 31 décembre 2010 et une application de la TPLN au plus tard au 31 décembre 2011, la TPLA étant supprimée au bénéfice de la TPLN à compter de l’application de cette dernière.
Le dispositif a été modifié par l’article 32 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 puis par la quatrième loi de finances rectificative pour 2010, et l’an dernier par l’article 53 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2011.
Il s’est agi en 2009 d’apporter des précisions aux dispositifs de collecte et de contrôle afin de les sécuriser juridiquement et de garantir la perception optimale de la TPLA et de la TPLN ; en 2010, de sécuriser la collecte et le contrôle, de clarifier la répartition des tâches entre l’État et le prestataire et de garantir les droits des redevables. En 2011, la réforme a notamment consisté :
– à distinguer les manquements, constatés par le prestataire privé (cas dans lesquels seule la taxe serait due) des infractions, constatées par les services compétents de l’État (douanes, police et gendarmerie nationales et contrôle des transports terrestres) et réprimées par une amende de 750 euros ;
– à affecter à l’AFITF la retenue opérée par l’État sur le produit de la taxe affecté aux collectivités territoriales au titre des coûts de gestion ;
– à prévoir une possibilité d’immobilisation des véhicules en cas de manquement ;
– à étendre le champ des personnes tenues à une obligation de secret professionnel.
II.– LES MODIFICATIONS PROPOSÉES
La présente réforme vise à :
– préciser la définition des véhicules assujettis, pour permettre de taxer des véhicules tractant plusieurs remorques et exclure les véhicules dont le PTAC (94) est inférieur à 3,5 tonnes mais dont le PTRA dépasse ce seuil si l’on prend en compte les remorques ;
– supprimer l’exigence de justification du nombre d’essieux, lors de l’enregistrement du véhicule ;
– améliorer le recouvrement de la taxe en cas de disparition de la société habilité de télépéage ;
– prévoir une réduction de taxe pour inciter les redevables à souscrire un contrat avec une société de télépéage ;
– interdire les avertisseurs de dispositifs de contrôle ;
– désigner le tribunal compétent pour les litiges portant sur des demandes de restitution ;
– décaler les dates d’entrée en vigueur de la TPLA et de la TPLN.
Simultanément au dépôt du présent projet de loi, le ministre des transports annonçait que les modalités de la répercussion de la TPL, fixées par un décret du 4 mai 2012, seraient revues. Le nouveau mécanisme de répercussion serait forfaitaire. Le principe d’une répercussion intégrale du coût de la taxe sur les chargeurs est prévu par l’article L. 3222-3 du code des transports, qui pourrait être modifié par une prochaine loi sur les transports.
Le présent article apporte plusieurs clarifications à la définition des véhicules assujettis. Selon l’article 271 du code des douanes, les véhicules de transport de marchandises soumis à la TPLN s'entendent des véhicules seuls ou tractant une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC), ou le poids total roulant autorisé (PTRA) s'il s'agit d'ensembles articulés, est supérieur à trois tonnes et demie. Ce seuil est porté à douze tonnes pour la TPLA par l’article 285 septies du même code. Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises les véhicules d'intérêt général prioritaires et les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire, ainsi que les véhicules militaires.
Cette rédaction pose plusieurs problèmes :
– elle ne permet pas de taxer un véhicule tractant plusieurs remorques ;
– la notion d’ensemble articulé n’est pas définie dans le code de la route ;
– la rédaction introduit un risque de confusion pour les véhicules dont le PTAC est inférieur à 3,5 tonnes : seuls, ils ne sont pas assujettis ; articulés à une remorque, ils deviennent assujettis si le PTRA de l’ensemble dépasse 3,5 tonnes pour la TPLN et 12 tonnes pour la TPLA ;
– le droit actuel ne permet pas de déterminer la situation d’un véhicule tractant une remorque dans le cas où le véhicule remorqué est agricole ou industriel.
Le présent article apporte les solutions suivantes.
Le A du I du présent article (alinéas 2 et 3) propose une nouvelle rédaction pour le premier alinéa de l’article 271 du code des douanes, supprimant la référence à un ensemble articulé, ainsi que la limitation à une seule remorque et précisant les véhicules auxquels s’applique le seuil de 3,5 tonnes, pour l’application de la TPLN.
Les véhicules de transport de marchandise soumis à la TLPN seront désormais :
– les véhicules dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;
– les ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un PTAC supérieur à 3,5 tonnes.
Les ensembles de véhicules sont définis par l’article R. 311-1 du code de la route.
Article R. 311-1 du code de la route Remorque : véhicule non automoteur sur roues, destiné à être tracté par un autre véhicule Ensembles de véhicules : 1. Train double : ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ; 2. Train routier : ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ; Véhicule articulé : ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque. |
Le 1°du G du I du présent article (alinéas 16 et 17) apporte les mêmes modifications à l’article 285 septies du code des douanes, relatif à la TPLA, le seuil pertinent étant cette fois de 12 tonnes et non de 3,5 tonnes.
Ces clarifications sont conformes à la conception d’origine du projet. Elles sont tout sauf anecdotiques, dans la mesure où la rédaction actuelle conduirait à taxer non pas 800 000 véhicules, nombre sur lequel sont construites toutes les hypothèses économiques et financières de la taxe et du contrat de partenariat, mais plus du double.
Les règles de liquidation sont prévues par le 2 du V de l’article 285 septies du code des douanes pour la TPLA et par l’article 276 du même code pour la TPLN. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée à partir des informations collectées automatiquement au moyen de l'équipement électronique embarqué mentionné au 1 du V du même article, des informations déclarées lors de l'enregistrement du véhicule et des données paramétrées dans l'équipement électronique embarqué.
Les informations collectées au moyen des équipements électroniques embarqués, mis en œuvre dans une chaîne de collecte homologuée, font foi jusqu'à preuve du contraire.
C’est pourquoi, en cas de défaut de justification, au moment de l’enregistrement par le redevable, de la classe d'émission Euro ou du nombre d'essieux du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant respectivement la classe ou la catégorie à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.
Cette disposition pose problème, dans la mesure où le nombre d’essieux du véhicule ne fait pas l’objet d’une justification du redevable au moment de l’enregistrement : il est paramétré par le conducteur dans l’équipement électronique embarqué en fonction de la configuration du véhicule.
Le 2° du G du II du présent article (alinéa 18) modifie donc le 2 du IV de l’article 285 septies pour limiter cette sanction au défaut de justification de la classe d'émission Euro. Le B du I du présent article (alinéa 4) opère la même modification pour la TPLN, au 1 de l’article 275 du code des douanes.
L’exactitude du paramétrage du nombre d’essieux sera vérifiée lors des contrôles routiers.
C.– PAIEMENT PAR LES SOCIÉTÉS HABILITÉES FOURNISSANT UN SERVICE DE TÉLÉPÉAGE EN CAS DE LIQUIDATION ANTICIPÉE DU MONTANT DE LA TAXE
Lorsque les redevables ont souscrit un abonnement aux services d’une société habilitée fournissant un service de télépéage, la taxe est liquidée et communiquée à cette société au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l’ensemble des trajets taxables réalisés le mois précédent par les redevables abonnés de la taxe.
À titre dérogatoire, la taxe est liquidée et communiquée par anticipation dans les cas et selon des modalités définis par décret en Conseil d'État : ainsi, en cas de cessation d’activité ou de défaillance d’une société habilitée fournissant un service de télépéage, il serait possible de liquider la taxe dès le constat de l’événement et de limiter ainsi le risque encouru sur le recouvrement des sommes dues. Toutefois, le code des douanes en vigueur ne prévoit pas de paiement anticipé dans ce cas, privant sensiblement de portée la disposition.
Ainsi le a du 3° du G du I du présent article (alinéas 20 et 21) introduit-il au VI de l’article 285 septies du code des douanes pour la TPLA un nouvel alinéa prévoyant des règles de paiement anticipé lorsque la taxe a été liquidée et communiquée par anticipation, à titre dérogatoire, à une société habilité fournissant un service de télépéage. La durée de détention des fonds par cette société est réduite à dix jours après la liquidation du montant de la taxe. Le recouvrement devrait en être amélioré.
Le 1° du C du I du présent article (alinéas 6 et 7) introduit à l’article 278 du code des douanes une modification similaire pour la TPLN.
D.– RÉDUCTION DU MONTANT DE TPLA POUR LES REDEVABLES AYANT PASSÉ UN CONTRAT AVEC UNE SOCIÉTÉ DE TÉLÉPÉAGE
La directive Eurovignette n°1999/62/CE du 17 juin 1999 prévoit un abattement ou une réduction du montant du péage pour les redevables ayant passé un contrat avec une société habilitée fournissant un service de télépéage, afin d’inciter les redevables à souscrire de tels abonnements, compte tenu de l’économie de gestion qu’ils permettent. Le code des douanes prévoit aujourd’hui un abattement s’agissant de la TPLN, mais rien de tel n’est prévu pour la TPLA.
Le 2° du C du I du présent article (alinéa 8) modifie l’article 278 du code des douanes relatif à la TPLN, substituant une réduction à l’abattement. Alors que les règles d’abattement doivent actuellement être fixées chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget, l’alinéa 8 supprime également la condition de révision annuelle de ces règles.
Le b du 3° du G du I du présent article (alinéas 22 et 23) complète le VI de l’article 285 septies du code des douanes relatif à la TPLA par un 1 bis ouvrant au redevable ayant passé un contrat avec une société de télépéage le bénéfice d’une réduction analogue sur le montant de la taxe due, afin de tenir compte de l’économie de gestion résultant du contrat. Comme pour la TPLN, les réductions applicables sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
La réduction est préférée à l’abattement, compte tenu du découpage du réseau en sections de tarification et des conditions de liquidation de la taxe, à partir de l'enregistrement automatique des éléments nécessaires à chaque franchissement d'un point de tarification. La modification législative sera d’autant plus utile que les systèmes informatiques ont déjà été élaborés sur la base d’une réduction et non d’un abattement.
L’emploi du pluriel réserve la possibilité de moduler des réductions d’ampleur différente selon les catégories d’abonnements. Cette possibilité ne devrait pas être utilisée dans l’immédiat. Sous réserve de l’approbation de la Commission européenne, la réduction devrait être fixée par arrêté à 10 %.
Le conducteur est responsable du bon paramétrage du nombre d’essieux sur l’équipement électronique embarqué et du bon fonctionnement de celui-ci.
Afin de garantir le recouvrement de la taxe et la sécurité routière en évitant aux conducteurs la tentation de manipuler l’élément embarqué en conduisant, le Gouvernement propose l’interdiction totale de tout avertisseur de dispositifs de contrôle.
Cette interdiction est d’autant plus importante que la charge de la preuve pèse sur l’administration : il est précisé à plusieurs reprises dans le code des douanes, et notamment à l’article 276 pour les règles de liquidation de la taxe, que les informations collectées au moyen des équipements électroniques embarqués, mis en œuvre dans une chaîne de collecte homologuée, font foi jusqu'à preuve du contraire.
Trois catégories de dispositifs sont concernées :
– les équipements et systèmes indiquant l’emplacement des dispositifs de contrôle automatique, y compris par mémorisation de ces emplacements dans les navigateurs utilisant un système de positionnement par satellite ;
– des systèmes empêchant le bon fonctionnement des dispositifs de contrôle ;
– des systèmes permettant de se soustraire au contrôle automatique.
Le E du I du présent article (alinéas 10 à 13) propose une nouvelle rédaction, applicable à compter du 1er janvier 2013, pour l’article 283 du code des douanes relatif à la TLPN.
Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés à l’article 281, ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est constitutif d’une infraction. Le texte proposé ne limite pas l’interdiction de la détention ou du transport de ces avertisseurs aux personnes se trouvant à bord d’un véhicule assujetti à la taxe : l’interdiction est générale.
Le fait de faire usage d’un appareil, dispositif ou produit de même nature est également constitutif d’une infraction.
Cet appareil, ce dispositif ou produit est susceptible d’être saisi. Lorsqu’il est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, soumis ou non à la taxe, ce véhicule peut également être saisi. Cette hypothèse vise le cas où l’avertisseur ne serait pas facilement détachable du véhicule.
Ces dispositions reprennent exactement celles de l’article R. 413-15 du code de la route, qui s’appliquent aux avertisseurs de radars.
Ces infractions sont sanctionnées, outre la saisie de l’appareil, par une amende de 750 euros prévue par l’article 413 du code des douanes. Cette amende correspond au plafond des contraventions de la quatrième classe, qui sont de nature réglementaire. Aucune peine complémentaire n’est prévue, contrairement aux dispositions du code de la route applicables aux utilisateurs d’avertisseurs de radars.
Le b du 4° du G du I du présent article (alinéas 26 à 29) procède aux mêmes modifications s’agissant de la TPLA.
À compter du 1er janvier 2013, l’article 282 du code des douanes qualifie de manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe et définit les règles applicables en pareil cas. Lorsqu'il est constaté un manquement, le redevable fait l'objet d'une taxation forfaitaire égale au produit du taux kilométrique défini à l'article 275 par une distance forfaitaire de 500 kilomètres ou d'une taxation au réel, lorsque les éléments de liquidation sont connus. Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel est doublé en cas d'existence d'un autre manquement au cours des trente derniers jours.
Le montant de la taxation forfaitaire est communiqué au redevable selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. Elle est exigible dès sa communication au redevable. À compter du 1er janvier 2013, la taxe forfaitaire due au titre de l'article 282 sera affectée à l’AFITF.
Sans préjudice des dispositions de l'article 282, tout manquement est passible d'une amende maximale de 750 euros, conformément à l’article 283. L’article 281 qualifie de manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe. Le manquement est constaté par le prestataire Ecomouv, tandis que les infractions sont constatées par les forces de l’ordre.
Considérant que tous les autres textes d’application des dispositions relatives aux droits et à l’information des redevables de la TPL sont prévus par décret en Conseil d’État, le Gouvernement souhaite remonter les règles relatives aux modalités de communication au redevable du montant de la taxation prévue en cas de manquement dans la hiérarchie des normes au niveau d’un décret en Conseil d’État.
C’est ce que prévoit le d du I du présent article (alinéa 9) qui modifie en ce sens l’article 282 pour la TPLN, tandis que le 4° du G du I (alinéa 25) opère la même modification à l’article 282 septies pour la TPLA.
2.– Mise en conformité de la codification des infractions avec le système informatique de la chancellerie
Alors que l’ensemble des dispositions répressives du code des douanes est rassemblé dans un chapitre spécifique, la sanction des infractions aux règles applicables à la TPLN et à la TPLA figure dans les articles relatifs aux caractéristiques de la taxation.
Le Gouvernement indique que cette situation empêche la prise en compte de ces infractions par les bases de données informatiques du ministère de la Justice. Le présent article opère donc le déplacement de ces dispositions dans le code des douanes.
Le I du I du présent article (alinéas 33 et 34) rétablit en conséquence un article 413 dans le chapitre du code des douanes consacré aux dispositions répressives. La rédaction proposée reprend les dispositions de l’actuel article 283 et du 3 du VII de l’article 285 septies, supprimées par le présent article et punissant de 750 euros d’amende toute infraction aux dispositions légales et réglementaires régissant la TPLN et la TPLA.
En conséquence, le F du I et le c du 4° du G du I du présent article (alinéas 14 et 30), modifient les mentions de cette amende aux articles 283 bis et 285 septies du code des douanes pour faire référence à l’article 413.
L’article 358 du code des douanes fixe les règles de compétences ratione loci des tribunaux compétents en matière de douane. Il distingue trois sortes d’instances.
Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction.
Les litiges relatifs à la créance, aux demandes en restitution formulées en application de l'article 352 du code des douanes et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie sont portés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane ou la direction régionale des douanes où la créance a été constatée.
Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances.
Le H du I du présent article (alinéas 30 et 31) prévoit que les litiges relatifs aux créances et aux demandes de restitutions de droits puissent être également portés devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le service spécialisé qui a constaté la créance. En l’espèce, en matière de taxe poids lourds, les demandes en restitution seront traitées par un service national spécialisé des douanes, situé à Metz.
L’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 prévoit dans sa rédaction actuelle que ses dispositions relatives aux caractéristiques de la TPLA entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget et au plus tard le 31 décembre 2010, cette date étant décalée au 31 décembre 2011 pour ce qui concerne la TPLN.
Ces dispositions ne sont pas pour autant en vigueur, conformément à l’article 1 du code civil qui dispose que l'entrée en vigueur de celles des dispositions législatives dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
Sans supprimer ces dispositions devenues caduques, le II du présent article (alinéas 37 et 40) prévoit que la date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte des TPLA et TPLN est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. Aucune date butoir n’est fixée, et la notion de mise en œuvre ne paraît pas très précise. La définition du dispositif technique gagnerait également à être précisée.
Parallèlement, le C du II de l’article 153 précité prévoit l’abrogation de l’article 285 septies du code des douanes, relatif à la TPLA, à compter de la date de mise en œuvre du dispositif technique de collecte de la TPLN et non plus de la d'entrée en vigueur de la TPLN.
L’alinéa 41 substitue comme date d’abrogation celle de la mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la TPLN.
Les clauses du contrat de partenariat entre l’État et le consortium Ecomouv prévoient que le dispositif de collecte et de contrôle soit opérationnel pour la TPLA au plus tard à compter du 20 avril 2013 et pour la TPLN au plus tard à compter du 20 juillet 2013.
Le III du présent article (alinéa 42) prévoit que ses dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2013, à l’exception de celles relatives à la date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe, d’application immédiate.
*
* *
La Commission examine l’amendement CF 34 de M. Éric Alauzet prévoyant un doublement de l’amende en cas d’infraction aux règles relatives à la taxe poids lourds. Après l’avis défavorable du rapporteur général, l’amendement est retiré.
La Commission adopte l’article 21 sans modification.
*
* *
La Commission rejette l’amendement CF 15 de M. Charles de Courson, appliquant à compter du 1er janvier 2015 la taxe générale sur les activités polluantes aux sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique.
Elle examine l’amendement CF 16 de M. Charles de Courson exonérant de TGAP les incinérateurs répondant à certaines normes d’efficacité énergétique.
M. le rapporteur général. Le dispositif proposé n’est pas conforme au droit communautaire. Par ailleurs, des réductions de taxe sont d’ores et déjà prévues pour certains incinérateurs.
L’amendement est retiré.
La commission examine l’amendement CF 17 de M. Charles de Courson prévoyant une exonération totale de TGAP pour les déchets contenant de l’amiante lié à des matériaux de construction inertes.
M. Charles de Courson. Il s’agit de régler un problème d’interprétation, une circulaire des douanes en date du 26 juin dernier étant revenue sur l’exonération souhaitée par le législateur.
M. le rapporteur général. Je suis défavorable à l’amendement qui va au-delà du problème qu’il entend régler. Jusqu’en juin 2012, certains déchets dangereux étaient exonérés de TGAP de façon à alléger le coût du traitement et faciliter ainsi leur élimination. L’exonération pouvait être totale dans les installations spécialisées dans le traitement de ces déchets ou partielle pour les autres installations. Une décision de la Cour de justice de décembre 2011 a obligé la France à modifier la nomenclature des déchets amiantés et, partant, le régime d’exonération dont bénéficiaient ceux contenant de l’amiante lié à des matériaux de construction inerte. La circulaire des douanes n’a fait que tirer les conséquences de cette décision. L’amendement propose une exonération totale.
L’amendement est retiré.
*
* *
Article additionnel après l’article 21
Modification de certaines modalités de calcul de la contribution au service public de l’électricité
La Commission examine l’amendement CF 8 de M. Marc Goua permettant d’intégrer dans les charges compensées par la CSPE (contribution au service public de l’électricité) toutes les actions contribuant à la baisse du coût de revient de l’électricité dans les zones non interconnectées.
M. Marc Goua. Le dispositif proposé vise à baisser le coût de l’électricité dans les outre-mer et en Corse en leur permettant de diversifier leurs sources d’approvisionnement.
M. le rapporteur général. Je suis favorable à cet amendement qui devrait induire des économies de CSPE à terme.
M. le président Gilles Carrez. Vous attirez l’attention dans votre exposé sommaire sur les possibilités d’achat à moindre coût dans des pays tiers. C’est particulièrement vrai pour le carburant : aux Antilles et en Guyane, par exemple, il serait souhaitable de pouvoir s’approvisionner au Vénézuela ou à Trinidad où le prix de l’essence est notoirement plus bas. De ce point de vue, l’amendement CF 2 non soutenu de M. Jean-Claude Fruteau qui prévoit de reporter au 1er janvier 2016 l’application de la TGAP sur les carburants outre-mer est justifié car il y a un risque de renchérissement très important de l’essence en cas d’application immédiate. Il faut se souvenir que les troubles de novembre/décembre 2008 en Guyane, qui se sont étendus en janvier 2099 à la Guadeloupe et à la Martinique, sont nés de ce problème de prix à la pompe.
M. Marc Goua. Des achats à des pays tiers seraient susceptibles de faire baisser les prix. D’une entrevue que j’ai eue ce matin avec des responsables de Shell, j’ai retenu que la société est en train d’explorer des gisements du côté de la Guyane qui pourraient être aussi importants que ceux du Ghana et que les réserves de pétrole, contrairement à une idée communément admise, sont immenses. Les recettes tirées de l’exploitation au large de la Guyane pourraient être en partie affectées au développement des énergies renouvelables.
M. le rapporteur général. S’agissant du prix des carburants outre-mer, je rappelle que le rapport de 2009 de Jérôme Cahuzac et Patrick Ollier soulevait la question de l’incompatibilité des normes des carburants des pays tiers avec les véhicules des départements concernés, rendant de fait l’importation impossible. Je suis également favorable au report suggéré par notre collègue Fruteau.
M. Charles de Courson. Où en sont les recherches et les projets sur les bio-carburants produits notamment à partir du sucre de canne ?
M. le président Gilles Carrez. La difficulté soulevée par le rapport de MM. Cahuzac et Ollier aurait pu être résolue par une négociation avec Bruxelles puisqu’il s’agit essentiellement d’une règle d’assurance ayant trait au fonctionnement des moteurs.
M. Charles de Courson. J’ai pu vérifier qu’Air France par exemple s’approvisionne à Trinidad ; ce problème de normes peut être apparemment surmonté.
Après que le rapporteur général et le président ont souhaité que le dispositif proposé par M. Fruteau puisse être examiné en article 88 par la Commission, celle-ci adopte l’amendement CF 8 (Amendement n° 221) .
*
* *
Transposition de la directive 2010/45/UE du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation
Texte du projet de loi :
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.– Au b du III de l’article 256, après les mots : « à faire l'objet » sont insérés les mots : « d’expertises ou ».
B.– Au 1 bis de l’article 266, les mots : « déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu » sont remplacés par les mots : « publié par la Banque centrale européenne, ».
C.– À l’article 269 :
1° Le 1 est complété par un a quinquies ainsi rédigé :
« a quinquies. pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l’article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d’un mois civil, à l’expiration de chaque mois civil ; »
2° Au premier alinéa du d du 2, après les mots : « acquisitions intracommunautaires » sont insérés les mots : « et pour les livraisons et les transferts exonérés en application du I de l’article 262 ter ».
D.– Avant l’article 289, il est inséré un article 289-0 ainsi rédigé :
« Art. 289-0.– 1. Les règles de facturation prévues par l’article 289 s’appliquent aux opérations réputées situées en France en application des articles 258 à 259 D, à l’exclusion de celles qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans un autre État membre, ou qui y dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle, et pour lesquelles l’acquéreur ou le preneur établi en France est redevable de la taxe, sauf si l’assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte.
« 2. Elles s’appliquent également aux opérations dont le lieu d’imposition n’est pas situé en France qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en France ou qui y dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle :
« – lorsque l’acquéreur ou le preneur établi dans un autre État membre est redevable de la taxe, sauf si l’assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte ;
« – ou lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans l’Union européenne en application du titre V de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006. »
E.– À l’article 289 :
1° Le I est ainsi modifié :
a. Le c du 1 est complété par les mots : «, à l’exception des livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies ; »
b. Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Les factures peuvent être matériellement émises par le client ou par un tiers lorsque l’assujetti leur donne mandat à cet effet. Sous réserve de son acceptation par l’assujetti, chaque facture est alors émise en son nom et pour son compte.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités particulières d’application du premier alinéa lorsque le mandataire est établi dans un pays avec lequel il n’existe aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;
c. Le 3 est ainsi modifié :
– le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies et pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application de l’article 196 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la facture est émise au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel s’est produit le fait générateur. » ;
– il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées au profit d’un même acquéreur ou preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours d’un même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois. » ;
d. Au 5, les mots : « l’article 289 bis » sont supprimés ;
e. Le second alinéa du 5 est supprimé.
2° À la première phrase du II, les mots : « la facture » sont remplacés par les mots : « les factures » ;
3° Au premier alinéa du IV, après les mots : « à payer » sont insérés les mots : « ou à régulariser » ;
4° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.– L'authenticité de l’origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu’à la fin de sa période de conservation. » ;
5° L’article 289 est complété par un VI et un VII ainsi rédigés :
« VI.– Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu’elle soit. Elles tiennent lieu de facture d'origine pour l'application de l'article 286 et du présent article. Leur transmission et mise à disposition sont soumises à l'acceptation du destinataire.
« VII.– Pour satisfaire aux conditions prévues au V, l’assujetti peut émettre ou recevoir des factures :
« 1° Soit sous forme électronique en recourant à toute solution technique autre que celles prévues aux 2° et 3°, ou sous forme papier, dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l’entreprise et permettent d’établir une piste d'audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement ;
« 2° Soit en recourant à la procédure de signature électronique avancée définie au a du 2 de l’article 233 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation. Un décret précise les conditions d'émission, de signature et de stockage de ces factures ;
« 3° Soit sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, dans les conditions précisées par décret. »
F.– L’article 289 bis est abrogé.
II.– Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A.– Après l’article L. 13 CA, sont insérés les articles L. 13 D et L. 13 E ainsi rédigés :
« Art. L. 13 D.– Les agents de l’administration des impôts s’assurent que les contrôles prévus au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts garantissent l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures émises ou reçues par le contribuable.
« À cette fin, ils vérifient l’ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou système d’information constitutifs de ces contrôles ainsi que la documentation décrivant leurs modalités de réalisation.
« Si ces contrôles sont effectués sous forme électronique, les contribuables sont tenus de les présenter sous cette forme. Les agents de l’administration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support.
« Art. L. 13 E.– En cas d’impossibilité d’effectuer la vérification prévue à l’article L. 13 D ou si les contrôles mentionnés au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts ne permettent pas d’assurer l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures, ces dernières ne sont pas considérées comme factures d’origine, sans préjudice des dispositions du 3 de l’article 283 du même code. »
B.– À l’article L. 80 F :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également, lorsque l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures sont assurées par les contrôles prévus au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts, accéder à l’ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou système d’information constitutifs de ces contrôles et à la documentation décrivant leurs modalités de réalisation. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « À cette fin » sont remplacés par les mots : « Aux fins des deux alinéas précédents » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a. Les mots : « Ils peuvent obtenir ou prendre copie, par tous moyens et sur tous supports » sont remplacés par les mots : « Les agents de l'administration peuvent obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support » ;
b. Il est complété par les dispositions suivantes :
« Si les contrôles prévus au 1° du VII de l’article 289 du même code sont effectués sous forme électronique, les assujettis sont tenus de le présenter sous cette forme. Les agents de l’administration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support. »
C.– Après l'article L. 80 F, il est inséré un article L. 80 FA ainsi rédigé :
« Art. L. 80 FA.– Les agents de l'administration peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices, et, s'il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission, pour contrôler la conformité du fonctionnement du système de télétransmission des factures et de la procédure de signature électronique aux conditions fixées par décret.
« Lors de l'intervention mentionnée au premier alinéa, l'administration remet au contribuable, ou à son représentant, un avis d'intervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission des factures ou de procédure de signature électronique.
« En cas d'impossibilité de procéder aux contrôles mentionnés au premier alinéa ou de manquement aux conditions fixées par décret, les agents de l'administration en dressent procès-verbal. Dans les trente jours de la notification de ce procès-verbal, le contribuable peut formuler ses observations, apporter des justifications ou procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système. Au-delà de ce délai et en l'absence de justification ou de régularisation, les factures électroniques ne sont plus considérées comme documents tenant lieu de factures d'origine.
« L'intervention, opérée par des agents de l'administration ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A. Les procès-verbaux établis en application du présent article ne sont opposables au contribuable qu'au regard de la conformité du système de télétransmission des factures et de la procédure de signature électronique aux conditions fixées par décret. »
D.– Le premier alinéa du I de l’article L. 102 B est complété par les dispositions suivantes :
« Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d’information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant le même délai. »
E.– À l’article L. 102 C :
1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de garantir le respect des exigences mentionnées au V de l’article 289 du code général des impôts, les factures doivent être stockées sous la forme originelle, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été transmises ou mises à disposition. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu’un droit d'accès en ligne immédiat, le téléchargement et l'utilisation » sont remplacés par les mots : « ou n’ayant pas un droit d'accès en ligne immédiat, de téléchargement et d'utilisation » ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° Au cinquième alinéa, après les mots : « sur le territoire français » sont insérés les mots : « ou sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou dans un pays lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle » ;
5° Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À des fins de contrôle, les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne ont un droit d’accès par voie électronique, de téléchargement et d’utilisation des factures émises ou reçues, stockées sur le territoire français par ou pour le compte d’un assujetti qui est redevable de la taxe sur le chiffre d’affaires dans ces États membres ou qui y est établi. »
III.– Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article a pour objet de transposer en droit interne la directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en ce qui concerne les règles de facturation. Cette directive poursuit un triple objectif d’harmonisation des règles de facturation des différents États membres de l’Union européenne, à assurer un traitement identique des factures papier et des factures électroniques, et à étendre le recours à la facture dématérialisée tout en conservant son efficacité à la procédure de contrôle des règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la TVA.
I.– LES DIRECTIVES EUROPÉENNES SUR LA FACTURATION
EN MATIÈRE DE TVA
Le principal texte législatif de l'Union européenne concernant la facturation en matière de TVA est la directive 2001/115/CE), qui modifie la sixième directive TVA et qui devait être mise en œuvre dans le droit national avant le 1er janvier 2004. Les règles de facturation en matière de TVA sont désormais incorporées dans la directive TVA 2006/112/CE. Cette directive prévoit :
– une liste de dix mentions générales obligatoires devant figurer sur chaque facture et de quatre éléments d'information supplémentaires qui peuvent être requis dans des circonstances particulières ;
– des dispositions simplifiées pour les petites entreprises et les factures portant sur de faibles montants ;
– l'obligation, pour les autorités fiscales des États membres, de reconnaître la validité des factures électroniques, sans système de notification ou d'autorisation, à la condition que l'authenticité de l'origine et l'intégrité des données soient garanties par l'utilisation de signatures électroniques ou du système d'échange électronique de données EDI ;
– la possibilité, dans certaines circonstances, de sous-traiter les opérations de facturation à un tiers ou au client ;
– le libre choix du lieu et de la méthode de stockage des factures et l'autorisation du stockage électronique, y compris du stockage en ligne dans un État membre autre que celui où l'entreprise concernée est établie.
Une deuxième directive sur la facturation en matière de TVA a été adoptée le 13 juillet 2010. Cette directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA en ce qui concerne les règles de facturation s’applique à compter du 1er janvier 2013. Elle a pour objet d'accroître le recours à la facturation électronique, de réduire les charges pour les entreprises, de soutenir les PME et d'aider les États membres à lutter contre la fraude. Elle simplifie, modernise et harmonise les règles de la TVA en matière de facturation. En particulier, elle supprime les dispositions actuelles de la directive TVA qui font obstacle à la facturation électronique, en traitant les factures papier et les factures électroniques de la même manière et en libéralisant le choix des technologies admises. Elle s'inscrit également dans la stratégie de la Commission européenne destinée à renforcer l'efficacité de la lutte contre la fraude à la TVA.
Aux termes des dispositions des articles 289 V et 289 bis du code général des impôts (CGI), les factures peuvent être transmises par voie électronique sous réserve de l’acceptation du destinataire et dès lors que l’authenticité de leur origine et l’intégrité de leur contenu sont garanties. La loi précise que les factures électroniques ne peuvent être adressées qu’en recourant à deux moyens techniques sécurisés :
– en les transmettant sous la forme d’un message structuré (échange de données informatisées, EDI) ;
– en recourant à la signature électronique, fondée sur un certificat délivré par un prestataire de service de certification dûment habilité.
Les signatures électroniques permettent à toute personne obtenant des données sur un réseau électronique de déterminer l'origine de ces données et de vérifier si elles n'ont pas été modifiées. L'EDI est un système sécurisé de transmission d'informations par voie électronique qui est utilisé par les entreprises
Les règles de stockage des factures électroniques, aux articles L. 102 C et R. 102 C-1 du livre des procédures fiscales (LPF), précisent que les assujettis ne peuvent pas stocker ces factures dans un pays non lié à la France par une convention prévoyant l’assistance mutuelle et le droit d’accès en ligne immédiat, de téléchargement et d’utilisation de l’ensemble des données concernées.
II.– LES MODIFICATIONS PROPOSÉES AUX RÈGLES GÉNÉRALES
DE FACTURATION
Le considérant 2 de la directive 2010/45/UE rappelle que la tenue de registres devant « permettre aux États membres de contrôler les biens qui sont transportés temporairement d'un État membre à un autre, il convient de préciser que les registres doivent inclure des données détaillées relatives aux expertises réalisées sur des biens transportés temporairement entre États membres. De plus, il y a lieu que les transferts de biens réalisés vers un autre État membre à des fins d'expertise ne soient pas considérés comme des livraisons de biens aux fins de la TVA ».
Les opérations entrant dans le champ de la TVA sont précisées par l’article 256 du CGI. Le A du I du présent article (alinéa 2) modifie le III de cet article pour prévoir que le transport entre plusieurs États membres de biens destinés à faire l’objet d’une expertise n’est pas considéré comme un transfert, et n’est donc pas assimilé à une livraison de bien imposable à la TVA. Cette exception à la définition légale des transferts de biens ne vaut que si les biens sont ensuite réexpédiés ou transportés en France à destination de l’assujetti.
Le B du I (alinéa 3) prévoit que lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition sont exprimés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux publié par la BCE (Banque centrale européenne) et non plus par la Banque de France.
Le C du I (alinéas 5 et 6) précise la définition du fait générateur pour les livraisons et transferts, mentionnés au I de l’article 262 ter du CGI, de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre État membre. S’ils sont effectués de manière continue pendant une période de plus d’un mois civil, le fait générateur se produit à l’expiration de chaque mois civil, conformément au considérant 3 de la directive 2010/45/UE.
L’alinéa 7 précise la date d’exigibilité des livraisons et transferts exonérés de TVA en application du I de l’article 262 ter du CGI, à savoir les livraisons de biens expédiés ou transportés vers le territoire d'un autre État membre de l’Union européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. Bien qu’exonérés, ces livraisons et transferts ouvrent droit à déduction. Leur montant doit figurer sur les déclarations de chiffre d’affaires.
L’exigibilité intervient alors le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur. Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, si celle-ci précède la date d'exigibilité prévue et s'il ne s'agit pas d'une facture d'acompte.
Les factures représentent une composante essentielle du système de TVA, puisqu’elles constituent des éléments probants grâce auxquels l’acheteur peut déduire la TVA qu’il a acquittée. Le considérant 5 de la directive 2010/45/UE indique qu’« afin d’offrir aux entreprises la sécurité juridique quant à leurs obligations en matière de facturation, il y a lieu de désigner clairement l’État membre dont les règles de facturation s’appliquent ».
Les règles de facturation françaises sont prévues par l’article 289 du CGI.
Principales règles de facturation prévues par l’article 289 du CGI : I.– 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ; b. Pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et II de l'article 298 sexies ; c. Pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des opérations visées aux a et b ne soit effectuée ; d. Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité. 2. Les factures peuvent être matériellement émises, au nom et pour le compte de l'assujetti, par le client ou par un tiers lorsque cet assujetti leur donne expressément mandat à cet effet. Le mandat de facturation ainsi établi doit notamment prévoir que l'assujetti conserve l'entière responsabilité de ses obligations en matière de facturation et de ses conséquences au regard de la taxe sur la valeur ajoutée. 3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services. Elle peut toutefois être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées entre l'assujetti et son client au titre du même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois. Le différé de facturation ne peut en aucun cas avoir pour effet de retarder la déclaration de la taxe exigible au titre des opérations facturées. 4. L'assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises. 5. Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en application de cet article ou de l'article 289 bis, et qui fait référence à la facture initiale de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Il doit comporter l'ensemble des mentions prévues au II. Un décret en Conseil d'État détermine et fixe les conditions et modalités d'application du présent I. II.– Un décret en Conseil d'État fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. (…) V.– Les factures peuvent, sous réserve de l'acceptation du destinataire, être transmises par voie électronique dès lors que l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une signature électronique. Les factures ainsi transmises tiennent lieu de facture d'origine pour l'application de l'article 286 et du présent article. Les conditions d'émission de ces factures, de leur signature électronique et leurs modalités de stockage sont fixées par décret. Lorsqu'elles se présentent sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, les factures doivent être émises dans les conditions précisées à l'article 289 bis. |
Le D du I du présent article (alinéas 8 à 12) prévoit que les règles de facturation, prévues par l’article 289 précité du CGI, s’appliquent aux opérations réputées situées en France ou réalisées par un assujetti dont le siège de l’activité est en France. Le E du I (alinéas 13 à 35) apporte par ailleurs une série de modifications à cet article 289 du CGI.
En l’espèce, le D du I insère un nouvel article 289-0 dans le CGI, avant l’article 289 relatif aux obligations des redevables en matière de factures.
Deux cas sont distingués : celui des opérations réputées situées en France et celui des opérations dont le lieu d’imposition n’est pas situé en France.
La directive 2010/45/UE prévoit que les règles applicables en matière de facturation sont celles de l’État membre dans lequel l’opération est située.
Si l’opération donne lieu à autoliquidation de la taxe par le client et que celui-ci n’établit pas lui-même la facture, ou si l’opération est située hors de l’Union européenne, les règles applicables sont celles de l’État d’établissement du fournisseur ou du prestataire.
L’alinéa 9 prévoit ainsi l’application des règles de facturation, prévues par l’article 289, aux opérations réputées situées en France du fait des règles de territorialité des opérations imposables à la TVA, fixées par les articles 258 à 259 D du même code.
Une exception est prévue pour les opérations qui remplissent deux conditions cumulatives :
– elles sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans un autre État membre, ou qui y dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
– l’acquéreur ou le preneur établi en France est redevable de la taxe pour ces opérations, sauf si l’assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte.
L’alinéa 10 prévoit également l’application des règles de facturation prévues par l’article 289 du CGI aux opérations :
– réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en France, ou qui y dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle,
– lorsque l’acquéreur ou le preneur établi dans un autre État membre est redevable de la taxe, sauf si l’assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte ;
– ou lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans l’UE en application du titre V de la directive n° 2006/112/CE.
Les alinéas 14 et 15 suppriment l’obligation de facture pour les acomptes versés pour le paiement de livraisons de biens exonérées de TVA en application du I de l’article 262 ter (livraisons intracommunautaires) et de l’article 298 sexies (livraisons de moyens de transport neuf) du CGI.
Les alinéas 16 à 18 modifient les règles relatives au mandat de facturation. Les factures peuvent aujourd’hui être matériellement émises, au nom et pour le compte de l'assujetti, par le client ou par un tiers lorsque cet assujetti leur donne expressément mandat à cet effet.
Conformément à la directive transposée, le présent article prévoit que le mandat de facturation ne doit plus être expressément accepté. La condition que le mandat de facturation ainsi établi prévoie que l'assujetti conserve l'entière responsabilité de ses obligations en matière de facturation et de ses conséquences au regard de la TVA est supprimée.
En revanche, l’assujetti doit accepter chaque facture émise en son nom et pour son compte.
Les modalités d’application de ces dispositions, lorsque le mandataire est établi dans un pays avec lequel il n’existe aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE et par le règlement (UE) n° 904/2010 sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.
Les alinéas 19 à 23 adaptent les règles relatives à la date de facturation pour certaines livraisons de bien exonérées. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services.
Le présent article maintient la possibilité d’établir une facture de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes, réalisées au profit d’un même acquéreur ou preneur, pour lesquelles la taxe devient exigible au cours d’un même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois. Il supprime toutefois la précision actuelle interdisant que le différé de facturation ait pour effet de retarder la déclaration de la taxe exigible au titre des opérations facturées.
Par ailleurs, il prévoit que pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies et pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application de l’article 196 de la directive TVA n° 2006/112/CE, la facture est émise au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel s’est produit le fait générateur.
L’alinéa 25 supprime l’exigence d’un décret en Conseil d’État pour préciser les modalités d’application de l’obligation de facturation.
Conformément à l’alinéa 26, un décret en Conseil d'État fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer non plus sur la facture mais sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la TVA.
L’alinéa 27 étend au montant de taxe à régulariser, et non plus seulement à payer, l’obligation d’être déterminé en euros en utilisant le mécanisme de conversion prévu au 1 bis de l'article 266 du CGI (cf. supra).
III.– L’EXTENSION DES MODALITÉS DE FACTURATION ÉLECTRONIQUE
ET DE SON CONTRÔLE
Les alinéas 28 et 29 élargissent les modalités de la facturation électronique.
L’article 217 de la directive TVA 2006/112/CE, dans sa rédaction issue de la directive 2010/45/UE relative aux règles de facturation, définit la facture électronique comme « une facture qui contient les informations exigées dans la présente directive, qui a été émise et reçue sous une forme électronique quelle qu’elle soit ». Pour qu’une facture puisse être considérée comme électronique au sens de la directive TVA, elle doit être non seulement émise, mais aussi reçue sous cette forme. Cette définition est nécessaire pour l’application de l’article 232 de la directive TVA, qui soumet l’utilisation d’une telle facture à l’acceptation du destinataire, et pour celle de l’article 247 de la même directive, relatif aux obligations de stockage des factures sous leur forme originale.
Les règles actuelles encadrant la facturation électronique figurent au V de l’article 289 du CGI. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les factures peuvent, sous réserve de l'acceptation du destinataire, être transmises par voie électronique dès lors que l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une signature électronique. Les factures ainsi transmises tiennent lieu de facture d'origine pour l'application des articles 286 et 289. Les conditions d'émission de ces factures, de leur signature électronique et leurs modalités de stockage sont fixées par décret.
Lorsqu'elles se présentent sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, les factures doivent être émises dans les conditions précisées à l'article 289 bis du CGI.
Les exigences posées par la directive pour que des factures électroniques soient admissibles sont maintenues par la nouvelle rédaction du V de l’article 289 du CGI : l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurée.
Il est précisé que cette triple exigence est valable à compter de l’émission de la facture et jusqu’à la fin de sa période de conservation (alinéa 29).
Conformément à la directive TVA 2006/112/CE, l’accord du destinataire est également requis pour la mise à disposition des factures par voie électronique (alinéa 31).
Le V de l’article 289 du CGI ne reconnaît aujourd’hui que deux solutions techniques : la signature électronique et les messages structurés (ou échanges de données informatisées, EDI). L’alinéa 31 complète l’article 289 par un VI qui admet toutes les formes électroniques de facture, pourvu qu’elles soient conformes aux exigences précitées. Les différentes possibilités sont déclinées dans un nouveau VII.
Les dispositions actuelles relatives à la signature électronique et aux messages structurés sont reprises par les alinéas 34 et 35. L’alinéa 33 admet toute autre solution technique dès lors que des contrôles « documentés et permanents » sont mis en place par l’entreprise et permettent d’« établir une piste d’audit fiable » entre la facture, émise ou reçue et la livraison de bien ou la prestation de services qui en est le fondement. Sont ainsi repris les termes mêmes de la directive 2010/45/UE.
L’alinéa 36, et par coordination l’alinéa 24, abrogent l’article 289 bis du CGI, qui réserve la reconnaissance comme factures d'origine, pour l’application des articles 286 et 289 aux factures transmises par voie électronique sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque.
Les exigences relatives au délai de conservation des informations émises sur les factures et au droit d’accès inopiné de l’administration dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices, prévues par l’actuel article 289 bis sont transférées dans le livre des procédures fiscales, et étendues aux autres formes de facturation électronique, par le II du présent article.
Parallèlement à la libéralisation de la facturation électronique, le présent article adapte les modalités du contrôle par l’administration du respect des règles de facturation, complétant ainsi la transposition de la directive 2010/45/UE.
Le A du II insère dans le chapitre du livre des procédures fiscales consacré au droit de contrôle de l’administration, deux nouveaux articles L. 13 D et L. 13 E.
L’article L. 13 D, proposé par les alinéas 39 à 41, vise à ce que les agents de l’administration des impôts s’assurent que l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures émises ou reçues par le contribuable soient garanties par les contrôles prévus au 1° du VII (nouveau) de l’article 289 du CGI. Il s’agit des « contrôles documentés et permanents » mis en place par l’entreprise pour permettre d’« établir une piste d’audit fiable entre la facture et la livraison de biens ou la prestation de service qui en est le fondement ».
Les agents de l’administration des impôts vérifient l’ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou système d’information constitutifs de ces contrôles internes à l’entreprise, ainsi que la documentation décrivant leurs modalités de réalisation.
Si ces contrôles sont effectués sous forme électronique, les contribuables sont tenus de présenter sous cette forme les éléments demandés. Les agents de l’administration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support.
L’article L. 13 E, proposé par l’alinéa 42, sanctionne l’impossibilité d’effectuer la vérification prévue à l’article L. 13 D : les factures concernées ne seront alors pas considérées comme factures d’origine.
Il en irait de même si les contrôles internes mentionnés au 1° du VII de l’article 289 du CGI ne permettaient pas d’assurer l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du 3 de l’article 283 du CGI, en vertu duquel toute personne qui mentionne la TVA sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.
Le B du II du présent article modifie l’article L. 80 F du livre des procédures fiscales. Celui-ci précise les conditions dans lesquelles s’exerce le droit d’enquête des agents des impôts lorsqu’ils recherchent les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la TVA.
Les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.
L’alinéa 45 complète ces dispositions pour le cas où l’entreprise assure les contrôles prévus au 1° du VII (nouveau) de l’article 289 du CGI. Il permet aux agents des impôts d’accéder à l’ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou système d’information constitutifs de ces contrôles et à la documentation décrivant leurs modalités de réalisation.
L’alinéa 46 étend à cette hypothèse le droit dont disposent déjà les agents des impôts d’avoir accès de 8 heures à 20 heures et durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts. Ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.
La portée des alinéas 47 et 48 est moins claire. Le troisième alinéa de l’article L. 80 F du LPF permet aux agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur d’obtenir ou prendre copie, par tous moyens et sur tous supports, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation.
L’alinéa 48 apporte, d’une part, une modification rédactionnelle, remplaçant les mots : « par tous moyens et sur tous supports » par les mots : « par tout moyen et sur tout support ». D’autre part, il remplace la mention des « agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur » par une simple référence aux « agents de l’administration ».
Ce changement se répercute sur l’alinéa suivant qui permet aux agents de recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition.
Les alinéas 49 et 50 permettent aux agents de l’administration, si les contrôles internes à l’entreprise sont effectués sous forme électronique, d’obtenir sous cette forme les éléments demandés. Les agents de l’administration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support.
Le C du présent article insère dans le chapitre du LPF consacré au droit d’enquête des agents des impôts un nouvel article L. 80 FA, créant un droit d’intervention inopinée dans certains locaux professionnels. Il reprend les dispositions qui figurent actuellement à l’article 289 bis du CGI pour les factures transmises sous la forme d'un message structuré, en l’étendant à l’ensemble des factures électroniques.
L’alinéa 52 ouvre ce droit aux agents de l’administration, sans le réserver à ceux d’entre eux qui ont moins le grade de contrôleur.
Les locaux visés sont ceux :
– des professionnels des entreprises émettrices et réceptrices des factures ;
– des prestataires de services de télétransmission.
Ce droit d’accès a pour objet de permettre le contrôle de la conformité du fonctionnement du système de télétransmission des factures et de la procédure de signature électronique aux conditions fixées par décret.
Les alinéas 53 et 54 fixent les garanties du contribuable, qui reçoit, lors d’une intervention inopinée, un avis d’intervention précisant les opérations techniques envisagées.
En cas d’impossibilité pour les agents de l’administration de procéder à cette intervention, ou s’ils constatent des manquements aux obligations prévues par décret, ils dressent un procès-verbal. Le contribuable dispose alors de trente jours pour présenter des observations ou régulariser les conditions de fonctionnement du système de facturation dématérialisée. Au-delà de ce délai, les factures électroniques ne sont plus considérées comme documents tenant lieu de factures d’origine.
L’alinéa 55 précise que cette procédure ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du LPF. Ainsi, les procès-verbaux établis en application du nouvel article L. 80 FA ne sont opposables au contribuable qu’au regard de la conformité du système de facturation électronique aux conditions prévues par décret.
Le D du II du présent article (alinéas 56 et 57) prévoit l’obligation de conserver pendant six ans les informations, documents, données, traitements informatiques ou systèmes d’information constitutifs des contrôles internes des entreprises prévus par le VII (nouveau) de l’article 289 du CGI.
Ce délai est déjà applicable à la conservation des livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration, conformément à l’article L. 102 B du LPF.
Enfin, le E du II du présent article modifie l’article L. 102 C du LPF, qui précise les modalités de ces obligations de stockage.
Il est actuellement prévu que les factures émises par les assujettis ou, en leur nom et pour leur compte, par leur client ou par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'ils ont reçues, doivent être stockées sur le territoire français, lorsque ce stockage n'est pas effectué par voie électronique garantissant un accès immédiat, complet et en ligne aux données concernées.
L’alinéa 60 prévoit que pour garantir le respect des exigences mentionnées au V de l’article 289 du CGI (c'est-à-dire l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture), les factures doivent être stockées sous la forme originelle, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été transmises ou mises à disposition. La directive 2010/45/UE impose de traiter de façon identique les factures papier et les factures électroniques.
Les assujettis ne peuvent actuellement stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays qui n’est pas lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle ainsi qu'un droit d'accès en ligne immédiat, le téléchargement et l'utilisation de l'ensemble des données concernées. L’alinéa 61 maintient ces conditions.
Les alinéas 62, 64 et 65 modifient les conditions dans lesquelles les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne ont un droit d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation des factures stockées sur le territoire français par ou pour le compte d'un assujetti.
L’article L. 102 C du LPF vise actuellement les assujettis relevant de la juridiction de ces États membres. Seront désormais concernés les assujettis établis ou redevables de la TVA dans ces États membres. L’encadrement de ce droit d’accès par les limites fixées par la réglementation de l'État d'établissement de l'assujetti est supprimé.
L’alinéa 63 étend aux assujettis stockant leurs factures sur le territoire d’un autre État membre de l’UE ou dans un pays lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle l’obligation de s’assurer que l'administration a, à des fins de contrôle, un accès en ligne permettant le téléchargement et l'utilisation des données stockées. Cette obligation est aujourd’hui limitée aux assujettis stockant leurs factures par voie électronique sur le territoire français.
*
* *
La Commission adopte l’article 22 sans modification.
*
* *
Mise en conformité avec le droit communautaire de diverses dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA)
Texte du projet de loi :
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.– À l'article 271 :
1° Au b du 1 du II, le mot : « perçue » est remplacé par le mot : « due » ;
2° Au 1° du a et aux b et d du V, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
B.– Le 3° de l’article 278 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; ».
C.– À l'article 286 ter :
1° Au 2°, avant les mots : « toute personne visée à l’article 286 bis » sont insérés les mots : « tout assujetti ou personne morale non assujettie qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au I de l’article 256 bis ou au I de l’article 298 sexies, » ;
2° Au 5°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
D.– À l'article 289 A :
1° Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
2° Le second alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
« 1° Aux personnes établies dans un État non membre de l'Union européenne avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces États est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;
« 2° Aux personnes non établies dans l’Union européenne qui réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l’article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou des livraisons de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles la taxe est due en France par l’acquéreur conformément aux dispositions du 2 quinquies de l’article 283. »
E.– 1° Au premier alinéa de l'article 1003, les mots : « , les courtiers et tous autres intermédiaires, désignés à l’article 1002, » sont remplacés par les mots : « établis en France, dans un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen agissant en France en libre prestation de services » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1004, les mots : « , en outre, » sont supprimés.
F.– 1° Le a du 2° du 3 du I de l’article 257 est abrogé ;
2° L’article 1002 est abrogé ;
3° L'article 278 ter est abrogé.
II.– Au premier alinéa de l’article L. 89 du livre des procédures fiscales, les mots : « , les polices ou copies de police ainsi que le répertoire des opérations prévu à l’article 1002 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ainsi que les polices ou copies de polices ».
III.– Les B et 3° du F du I s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2013.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article prévoit diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, concernant : le taux de TVA applicable à la filière équine (I), le régime des ventes d’immeubles à construire (II), la suppression de formalités réservées à des opérateurs économiques étrangers (III), l’ouverture du droit à déduction de la TVA due à l’importation et l’identification des assujettis à la TVA qui réalisent des acquisitions intracommunautaires (IV).
Les dispositions relatives à la filière équine s’appliqueront aux opérations dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier 2013. Les autres dispositions sont d’application immédiate.
I.– OPÉRATIONS RELATIVES À LA FILIÈRE ÉQUINE
Le présent article modifie le taux de TVA applicable à plusieurs opérations relatives à la filière équine, tirant ainsi les conséquences de l’arrêt C 596/10 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en date du 8 mars 2012. La Cour a jugé en l’espèce qu'en appliquant le taux réduit de TVA aux opérations relatives aux chevaux qui ne sont pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en application des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA.
Plusieurs taux réduits sont applicables aux opérations relatives à la filière équine, sur quatre fondements différents.
Le 3° de l’article 278 bis du CGI (code général des impôts) dispose que la TVA est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon générale portant sur les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation.
L’article 281 sexies du CGI prévoit que la TVA est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes d’animaux vivants de boucherie et de charcuterie, à des personnes non assujetties à cette taxe.
Ce taux « super réduit » est en vigueur depuis le 1er juillet 1986 : il fait partie des taux particuliers dont l’article 110 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA autorise le maintien, lorsqu’ils étaient en vigueur au 1er janvier 1991. La liste des animaux de boucherie est fixée par l’article 65 A de l’annexe III du CGI. Selon la documentation administrative DB 3 I-1326, cette disposition s’applique aussi aux « ventes d’équidés de grande valeur » qui ne sont a priori pas destinés à la boucherie.
L’article 278 ter du CGI soumet au taux réduit de 7 % les sommes, visées au 4° du III de l'article 257 du même code, attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs avec les chevaux dont ils sont propriétaires.
Devançant l’arrêt du 8 mars 2012, alors que les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Autriche avaient été condamnés pour manquement en 2011, l’article 13 de la loi n° 2011-1978 de finances rectificative pour 2011 a donné un nouveau fondement au taux réduit de TVA pour la filière équine, non plus au titre de l’agroalimentaire, mais des activités sportives. C’est la première fois que la possibilité d’appliquer un taux réduit aux activités sportives était utilisée en France.
Le b sexies de l’article 279 du CGI soumet ainsi au taux de 7 % les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet.
Selon l’instruction 3 C-1-12 du 8 février 2012, relèvent du taux réduit de 7 % les activités suivantes des établissements équestres :
– les activités d’enseignement, d’animation et d’encadrement de l’équitation telles que définies à l’article L. 212-1 du code du sport ;
– le droit d’utilisation des installations à caractère sportif des centres équestres (manège, carrière, écurie et équipements sportifs recensés en application de l’article L. 312-2 du code du sport).
Sont donc exclus du champ d’application du b sexies de l’article 279 du CGI les gains de courses, les saillies, la vente des animaux, le débourrage et les prises en pensions d’animaux qui ne sont pas utilisés dans le cadre de l’enseignement.
Dans son arrêt du 8 mars 2012 précité, la CJUE a jugé que « les États membres peuvent appliquer, au titre du point 11 de l’annexe III de la directive TVA, un taux réduit de TVA aux opérations relatives aux chevaux, pour les activités de culture, de sylviculture ou de pêche, dans la mesure où elles constituent des livraisons ou des prestations de services destinées à être utilisées dans la production agricole ».
Le B du I du présent article (alinéas 5 et 6) complète le 3° de l’article 278 bis du CGI pour exclure l’application du taux de 7 % aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole.
La Cour de justice a estimé que la France appliquait à tort le taux de 2,10 % aux ventes de chevaux vivants à des personnes non assujetties à cette taxe, lorsque ces chevaux ne sont pas destinés à une utilisation de boucherie et de charcuterie et, en particulier, lorsqu’il s’agit de chevaux de course, de compétition d’agrément et de manège.
Les conséquences de cette décision ne nécessitent pas de modification législative, mais impliquent une évolution de la doctrine fiscale, qui avait étendu le bénéfice du taux super réduit à ce type de transaction.
Au paragraphe 55 de l’arrêt précité, la Cour a jugé que « toutes les opérations liées aux courses de chevaux ainsi que les activités des centres équestres relèvent de la compétition, du sport, des loisirs ou du tourisme et non d’une utilisation de chevaux dans la production agricole au sens » du point 11 de l’annexe III de la directive 2006/112/CE. En conséquence, les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs avec les chevaux dont ils sont propriétaires ne peuvent bénéficier de l’application du taux réduit de la TVA.
Le 3° du F du I du présent article (alinéa 20) abroge l’article 278 ter du CGI, soumettant ainsi ces sommes au taux normal de TVA.
La Cour de justice de l'Union européenne ne s'étant pas prononcée sur les dispositions du b sexies de l’article 279, celles-ci ne sont pas modifiées par le présent article. Toutefois, les points 13 et 14 de l’annexe III de la directive visent, s’agissant d’activités sportives, « le droit d'admission aux manifestations sportives et le droit d'utilisation d'installations sportives ». On ne peut exclure que la Commission européenne engage une nouvelle action si elle devait estimer que les chevaux ne constituent pas une installation sportive.
ÉVOLUTION DES TAUX DE TVA APPLICABLES À LA FILIÈRE ÉQUINE
PRÉVUE PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Biens et services soumis à la TVA |
Article du CGI |
Taux actuel |
Taux prévu |
Produits d'origine agricole n'ayant subi aucune transformation : opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole |
278 bis |
7 % |
7 % |
Produits d'origine agricole n'ayant subi aucune transformation : opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole |
278 bis |
7 % |
19,6 % |
Sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires |
257, 278 ter |
7 % |
19,6 % |
Ventes de chevaux vivants de boucherie faites à des personnes non assujetties à la TVA |
281 sexies |
2,1 % |
2,1 % |
Ventes à des personnes non assujetties à la TVA d’équidés vivants (chevaux de compétition, course, manèges) |
281 sexies |
2,1 % |
19,6 % |
Prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet |
279 (b sexies) |
7 % |
7 % |
L'article 12 de la directive TVA n° 2006/112/CE précitée offre aux États membres la possibilité de considérer comme assujetti quiconque réalise une livraison d'immeuble neuf ou de terrain à bâtir, fût-elle unique. Le 2° du 3 du I de l’article 257 du CGI met en œuvre cette faculté en soumettant à la TVA la livraison, hors d'une activité économique, d'un immeuble neuf lorsque le cédant avait acquis au préalable l'immeuble cédé comme immeuble à construire.
Sont visées les livraisons (ventes, apports en société...) d'immeubles qui ont été acquis en tant qu'immeuble à construire, en vertu d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) ou d'un contrat de vente à terme.
La vente en l'état futur d'achèvement, définie par l’article L. 261-3 du code de la construction et de l’habitation, est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux.
La vente à terme, définie par l’article L. 261-2 du code de la construction et de l’habitation, est le contrat par lequel le vendeur s'engage à livrer l'immeuble à son achèvement, et l'acheteur à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. Le transfert de propriété s'opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble ; il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente.
L'administration admet que la cession de son contrat avant l'achèvement de l'immeuble par un non assujetti soit soumise à la TVA, conformément à l’instruction fiscale 3 A-9-10. Cette instruction prévoit également que la cession par un particulier d'un immeuble acquis comme neuf, mais après achèvement, n'est pas soumise à la TVA, même si elle intervient dans les cinq ans de l'achèvement ou que l'immeuble a été acquis auprès d'un cédant qui l'avait lui-même acquis au préalable comme immeuble à construire.
La cession d'un immeuble à construire avant l'expiration du délai de cinq ans suivant son achèvement est soumise à la TVA au taux normal sur le prix de cession augmenté des charges.
La mutation doit donner lieu à déclaration et le paiement de la TVA intervient au moment de son dépôt.
La cession de l'immeuble étant soumise à la TVA, le cédant dispose, en application des principes généraux de la TVA, d'un droit à déduction de la TVA ayant grevé les dépenses correspondantes. Conformément à l'article 271 du CGI, l’assujetti occasionnel n'exerce effectivement son droit à déduction qu'au moment de la livraison du bien qu'il cède. La déduction porte :
– sur l'intégralité de la taxe supportée lors de l'acquisition initiale, sous réserve que cette taxe ait été mentionnée dans les appels de fonds,
– et sur celle ayant grevé le coût des divers éléments constitutifs du prix de cession, notamment d'éventuelles dépenses d'amélioration durable de l'immeuble.
Un particulier qui cède un contrat d'immeuble à construire avant l'achèvement de l'immeuble peut déduire la taxe supportée sur les appels de fonds déjà payés dès lors qu'il soumet la cession à la TVA.
Par un arrêt du 15 septembre 2011 sur les affaires C 180/10 « Slaby » et C 181/10 « Kuc », la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la livraison d’un immeuble confère la qualité d’assujetti au cédant indépendamment du caractère permanent de l’opération ou de l’exercice d’une activité économique, pour autant que cette livraison ne constitue pas le simple exercice du droit de propriété par son propriétaire.
La Cour estime qu’une livraison n’entre pas dans le cadre de la gestion privée lorsque le cédant entreprend des « démarches actives de commercialisation foncière en mobilisant des moyens similaires à ceux déployés par un assujetti au sens de l’article 9 de la directive TVA ».
Dès lors, l’article 257 du CGI, en ce qu’il prévoit l’assujettissement systématique des personnes physiques ou morales au titre de la cession de leurs immeubles neufs, y compris lorsque cette cession s’inscrit dans le cadre de leur gestion patrimoniale, n’est pas conforme à la directive TVA.
Le F du I du présent article (alinéa 18) abroge en conséquence le a du 2° du 3 du I de l’article 257. Les livraisons d’immeubles neufs acquis comme immeubles à construire par le cédant n’agissant pas en qualité d’assujetti ne seront désormais plus soumises à la TVA.
III.– SUPPRESSION DE FORMALITÉS RÉSERVÉES À DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ÉTRANGERS
L’article 289 A du CGI prévoit que les assujettis à la TVA établis hors de l’Union européenne doivent désigner un représentant fiscal qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives leur incombant et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à leur place. À défaut, la taxe est payée par le destinataire de l’opération.
Ceux qui réalisent uniquement certaines opérations en suspension de taxe ou pour lesquelles l’acquéreur est le redevable de la taxe sont dispensés de cette obligation.
Depuis le 1er janvier 2002, l’article 204 de la directive TVA limite l’obligation de désigner un représentant fiscal aux seuls assujettis établis dans un pays avec lequel il n’existe pas d’instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à ceux prévus par le droit communautaire (directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et règlement n° 904/2010 du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA).
Dans le cas où il existe un instrument juridique de cette nature relatif à l’échange de renseignements et à l’assistance au recouvrement, les États membres ne peuvent obliger l’assujetti non communautaire à désigner un représentant fiscal, mais seulement lui en proposer la faculté.
Lors de la transposition en droit interne de ces dispositions, aucun instrument juridique de cette nature n’existait avec les pays non membres de l’Union européenne. Depuis, un instrument juridique d’assistance mutuelle répondant aux conditions précitées a été mis en place avec plusieurs États tiers, tels que l’Australie, l’Azerbaïdjan et la Suisse.
Par un courrier du 23 septembre 2011, la Commission européenne a invité le Gouvernement à présenter ses observations sur ce point. Le Gouvernement s’est engagé à mettre le droit français en conformité avec l’article 204 de la directive TVA en vigueur.
Le 2° du D du I du présent article (alinéas 12 à 15) complète en ce sens le second alinéa du I de l’article 289 A du CGI pour dispenser de l’obligation de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France, les personnes établies dans un État non membre de l'Union européenne avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du et par le règlement (UE) n° 904/2010 précités. La liste de ces États sera fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
Les articles 1002 à 1004 du CGI prévoient des obligations particulières à l'égard des redevables de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances (TSCA). Les intéressés sont ainsi astreints au dépôt d'une déclaration d'existence et, pour certains d'entre eux, à la tenue d'un répertoire et à la désignation d'un représentant en France. En vertu des dispositions de l'article 1003 du CGI, les sociétés et compagnies d'assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires, désignés à l'article 1002 du CGI, sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de faire, auprès du service des impôts dont dépend leur siège social ou établissement, une déclaration énonçant la nature de ces opérations ainsi que le nom du directeur de la société ou du chef de l'établissement.
L'obligation de dépôt d'une déclaration d'existence incombe :
– à toutes les entreprises d'assurances quelle que soit la branche qu'elles exploitent (compagnies mutuelles ou à primes fixes, sociétés, assureurs particuliers, caisses départementales, etc.) à l'exception toutefois des sociétés d'assurances mutuelles agricoles régies par la loi du 4 juillet 1900 ;
– aux courtiers et autres intermédiaires qui, résidant en France, prêtent habituellement ou occasionnellement leur entremise pour les opérations d'assurances conclues avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable.
En vertu de l'article 1002 du CGI, les courtiers et autres intermédiaires qui, résidant en France, prêtent habituellement ou occasionnellement leur entremise pour les opérations d'assurances conclues avec des assureurs étrangers établis dans l'Espace économique européen (EEE) n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, sont tenus de disposer d’un répertoire non sujet au timbre, mais coté, paraphé et visé, soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le juge du tribunal d'instance, sur lequel ils consignent, jour par jour, par ordre de date et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les opérations passées par leur entremise.
À la fin de chaque trimestre, le courtier ou intermédiaire établit un relevé du répertoire concernant le trimestre entier et dépose ce relevé à l'appui du versement de la taxe.
Afin d'assurer le recouvrement de la TSCA, la législation française impose enfin aux assureurs étrangers établis en dehors de l'EEE n'ayant en France ni établissement, ni succursale, ni agence mais opérant sur le territoire par le biais de courtiers ou d'intermédiaires :
– une déclaration d'existence (article 1003 du CGI) ;
– la désignation d'un représentant fiscal responsable du paiement de la taxe (article 1004 du CGI).
L’arrêt de la CJUE du 5 juillet 2007 « Commission c/Royaume de Belgique » (affaire C 522/04) indique que les prestations de services en matière d’assurances constituent des services au sens de l’article 50 du Traité instituant la Communauté européenne et que l’article 49 CE s’oppose à l’application de toute réglementation nationale qui, sans justification objective, entrave la possibilité pour un prestataire de services d’exercer effectivement cette liberté et a pour effet de rendre la prestation de services entre États membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un État membre ou s’avère de nature à prohiber ou à gêner davantage les activités du prestataire établi dans un autre État membre, où il fournit légalement des services analogues.
Toutefois, de telles mesures peuvent être admises si elles poursuivent un objectif légitime compatible avec le traité, sont justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, et sont efficaces et proportionnées. Les taxes sur les primes d’assurance faisant l’objet d’une assistance mutuelle pour leur recouvrement prévue par le droit communautaire, la Cour a jugé que l’obligation de désigner un représentant n’était pas nécessaire pour atteindre l’objectif tenant à la nécessité d’assurer le paiement de la taxe annuelle sur les contrats d’assurance.
L’article 72 de la loi de finances rectificative pour 2009 a assuré une transposition partielle de cette décision :
– en supprimant l’obligation de désigner un représentant fiscal faite aux entreprises établies dans un État membre de l'espace économique européen (EEE) agissant en libre prestation de services en France,
– et en limitant aux seuls assureurs étrangers établis en dehors de l'EEE l'obligation de faire agréer par le service des impôts un représentant français personnellement responsable du paiement de la taxe et des pénalités éventuelles.
Le présent article achève cette transposition :
– en abrogeant l’article 1002 qui impose la tenue d’un répertoire aux intermédiaires prêtant leur entremise pour les opérations d'assurances conclues avec des assureurs étrangers établis dans l’EEE (alinéas 19 et 21) ;
– en supprimant pour ces mêmes intermédiaires l’obligation qui leur est faite à l’article 1003 de déposer une déclaration d’existence (alinéa 16) ;
L’obligation de dépôt d’une déclaration d’existence est également supprimée pour les assureurs établis hors de l’EEE (alinéas 16 et 17), pour lesquels l’obligation de désigner un représentant fiscal est en revanche maintenue.
IV.– MISES EN CONFORMITÉ TECHNIQUES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans un arrêt du 29 mars 2012, que l’article 17 de la sixième directive TVA 77/388/CE du 17 mai 1977 ne permettait pas à un État membre de subordonner le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation au paiement effectif préalable de la TVA par le redevable, lorsqu’il est également titulaire du droit à déduction. En conséquence, le présent article ouvre le droit à déduction de la TVA due à l’importation, et plus seulement de la TVA perçue.
L’importation de marchandises constitue une opération imposable à la TVA en vertu du I de l’article 291 du CGI, sous réserve des exonérations prévues aux II et III du même article. La taxe est perçue au comptant, au moment de l’importation, comme en matière de douane, conformément à l’article 1695 du CGI.
Selon l’article 271 du CGI, la TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. La taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est celle qui est perçue à l'importation.
Dans sa question préjudicielle, le Conseil d’État demandait à la CJUE si, compte tenu des risques de fraude, l’article 17 de la sixième directive permettait à un État membre de subordonner le droit à déduction de la TVA à l’importation au paiement effectif de cette taxe par le redevable, lorsque le redevable de la TVA à l’importation et le titulaire du droit à déduction correspondant sont, comme en France, la même personne.
S’appuyant sur le libellé même de l’article 17 précité, aux termes duquel les assujettis sont en droit de déduire la TVA «due ou acquittée» pour les biens qui leur sont ou leur seront livrés, la CJUE a jugé dans l’arrêt 2012/C 151/08 que la sixième directive prévoit clairement que le droit à déduction de la taxe dont bénéficie l’assujetti porte non seulement sur la TVA qu’il a acquittée, mais aussi sur la TVA due, c’est-à-dire celle qui doit encore être payée.
La Cour souligne que cette interprétation est conforme aux objectifs de la sixième directive dès lors qu’elle permet d’assurer que le droit à déduction, qui ne peut en principe être limité, reste une partie intégrante du mécanisme de la TVA et peut continuer à s’exercer immédiatement pour la totalité des taxes ayant grevé les opérations effectuées en amont, et qu’elle est la plus apte à garantir le respect du principe de neutralité fiscale de la TVA.
Il incombe à celui qui demande la déduction de la TVA d’établir que les conditions pour en bénéficier sont remplies et l’administration fiscale, si elle constate que le droit à déduction a été exercé de manière frauduleuse, est habilitée à demander a posteriori, avec effet rétroactif, le remboursement des sommes déduites. Il appartient, par ailleurs, au juge national de refuser le bénéfice du droit à déduction s’il est établi, au vu d’éléments objectifs du dossier, que ce droit est invoqué.
Le A du I du présent article (alinéas 2 et 3) vise donc à mettre en conformité la déduction de la TVA à l’importation avec le droit communautaire tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne.
L’identification, en tant que tels, des assujettis à la TVA qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de biens, pour les besoins de leurs activités économiques situées en France, ne repose sur aucune base légale : le présent article propose de lui en conférer une. La portée concrète de la mesure est limitée, ces assujettis étant déjà identifiés sur d’autres fondements juridiques.
L’article 214 de la directive TVA 2006/112/CE impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que soient identifiées par un numéro individuel les personnes suivantes :
a) tout assujetti, à l'exception de ceux visés à l'article 9, paragraphe 2 de la directive, qui effectue sur leur territoire respectif des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la TVA est due uniquement par le preneur ou le destinataire conformément aux articles 194 à 197 et à l'article 199 : ces dispositions sont transposées par le 1° de l’article 286 ter du CGI ;
b) tout assujetti, ou personne morale non assujettie, qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la TVA conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), ou qui a exercé l'option prévue à l'article 3, paragraphe 3, lui permettant de soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires ; la transposition de cet alinéa est incomplète (cf. infra) ;
c) tout assujetti qui effectue sur leur territoire respectif des acquisitions intracommunautaires de biens pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et qu'il effectue en dehors de ce territoire : ces dispositions sont transposées par le 3° de l’article 286 ter du CGI ;
d) tout assujetti qui reçoit, sur leur territoire respectif, des prestations de services pour lesquelles il est redevable de la TVA en vertu de l’article 196 : ces dispositions sont transposées par le 4° de l’article 286 ter du CGI ;
e) tout assujetti qui est établi sur leur territoire respectif et qui effectue, sur le territoire d’un autre État membre, des prestations de services pour lesquelles seul le preneur est redevable de la TVA en vertu de l’article 196 : ces dispositions sont transposées par le 5° de l’article 286 ter du CGI.
Les États membres peuvent ne pas identifier certains assujettis qui effectuent des opérations à titre occasionnel.
Le 2° de l’article 286 ter du CGI ne prévoit expressément d’identification par un numéro individuel que pour les personnes qui ne remplissent plus les conditions qui leur permettent de ne pas être soumises à la TVA ou qui demandent à acquitter la TVA sur leurs acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels à titre onéreux. Il ne prévoit pas d’identification pour les personnes qui effectuent de plein droit de telles acquisitions intracommunautaires de biens pour les besoins de leurs activités économiques situées en France.
Le C du I du présent article (alinéas 7 et 8) comble cette lacune. Cette mesure est sans conséquence sur l’activité des entreprises, puisque cette identification résulte d’une pratique administrative constante depuis 1992, mais elle lui donne une base légale.
*
* *
La Commission adopte l’article 23 sans modification.
La Commission examine l’amendement CF 20 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Il s’agit de tirer les conséquences fiscales de la réorganisation des chambres consulaires opérée par la loi du 23 juillet 2010 portant réforme du réseau consulaire. Le Gouvernement, nous a-t-on dit, serait favorable à une exonération de cette taxe sur les salaires s’agissant des personnels enseignants ; l’amendement prévoit la même disposition pour les salaires des personnels administratifs.
M. le rapporteur général. En effet, les rémunérations des personnels transférés des CCIT vers les CCIR ne sont plus exonérées de la taxe sur les salaires. Le Gouvernement souhaite faire savoir par une lettre du ministre son intention d’exonérer de cette taxe les salaires des personnels enseignants. Il serait problématique d’aller au-delà : la portée de cet amendement est trop large. Actuellement, l’article 231 du CGI exonère de taxe sur les salaires les personnels des établissements d’enseignement supérieur qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'État d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat. Ne pourriez-vous pas, cher collègue, retirer cet amendement au profit d’une version plus resserrée que vous déposeriez lors de la réunion que nous tiendrons en application de l’article 88 du Règlement, afin d’obtenir une réponse du ministre en séance ? Il ne semble pas souhaitable d’aller au-delà.
M. Charles de Courson. Dans ce cas, Monsieur le rapporteur général, seriez-vous favorable à un tel amendement qui exonérerait de la taxe sur les salaires à la fois les personnels enseignants et les personnels administratifs affectés aux missions d’enseignement ?
M. le rapporteur général. Ma préférence va à une instruction ou à une lettre du ministre plutôt qu’à un dispositif législatif qui risquerait de susciter des contentieux de la part d’établissements d’enseignement non gérés par des chambres de commerce et d’industrie.
M. Charles de Courson. Je redéposerai néanmoins un tel amendement pour la séance publique.
L’amendement CF 20 est retiré.
*
* *
Départementalisation de Mayotte
Texte du projet de loi :
I.– Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour rendre applicables à Mayotte, avec les adaptations tenant compte des intérêts propres à ce territoire dans l’ensemble des intérêts de la République et de la situation particulière de Mayotte, les législations fiscales et douanières en vigueur en métropole et dans les départements et régions d’outre mer.
II.– Un projet de loi de ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le 15 décembre 2013.
Observations et décision de la Commission :
Cet article habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances afin d’adapter la législation fiscale et douanière applicable en métropole ou dans les autres départements d’outre-mer aux spécificités du nouveau département de Mayotte.
La départementalisation emporte logiquement l’applicabilité de plein droit des lois et règlements à Mayotte (95). Toutefois, l’entrée en vigueur du code général des impôts et du code des douanes a été repoussée au 1er janvier 2014. À cette date, les possibilités d’adaptation de la législation prévues par l’article LO.6161-22 du code général des collectivités territoriales (résultant de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer) cesseront d’être applicables.
Dans l’intervalle, il est proposé de permettre au Gouvernement d’adapter, avant leur entrée en vigueur, certaines dispositions législatives fiscales et douanières afin que soient mieux prises en compte les spécificités de Mayotte. Selon les informations recueillies par le Rapporteur général, seraient notamment concernés :
– les modalités d’entrée en vigueur en 2014 des règles de droit commun de l’impôt sur les revenus de 2013, qui mettront fin au régime d’imposition à la source des salaires jusqu’à présent applicable ;
– la mise en place d’un octroi de mer, comme il en existe en Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion et en Guyane ;
– éventuellement, un régime provisoire de TVA à taux zéro, comme il existe en Guyane.
L’alinéa 1 fixe à neuf mois la durée de l’habilitation, à compter de la promulgation du présent projet de loi de finances rectificative, c’est-à-dire avant la fin septembre 2013.
Conformément à l’article 38 de la Constitution, les ordonnances prises sur le fondement de cette habilitation deviendront caduques si un projet de loi de ratification n’est pas déposé avant la date prévue par l’alinéa 2, c’est-à-dire le 15 décembre 2013.
*
* *
La Commission adopte l’article 24 sans modification.
*
* *
La Commission examine l’amendement n° 4 du Gouvernement.
Il fait l’objet des sous-amendements CF 79 rectifié de M. Charles de Courson, CF 70 de M. Pierre-Alain Muet, CF 60 de M. Pascal Cherki, CF 71 de M. Christian Eckert, CF 74 de M. Pierre-Alain Muet, CF 63 et 64 de Mme Eva Sas, CF 80 rectifié de M. Charles de Courson, CF 62 de M. Régis Juanico et CF 81 et 73 de M. Pierre-Alain Muet.
La Commission examine d’abord le sous-amendement CF 79 rectifié de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Alors que l’amendement du Gouvernement ne concerne que les entreprises employant des salariés, le sous-amendement CF 79 rectifié propose de faire bénéficier du CICE (crédit d’impôt emploi compétitivité) les travailleurs indépendants, dont l’absence de prise en compte risque de ne pas être compatible avec le principe d’égalité ; le risque d’une annulation par le Conseil constitutionnel me semble réel.
M. le président Gilles Carrez. J’ai pourtant trouvé la réponse du ministre très convaincante.
M. le rapporteur général. Monsieur de Courson, il y a quelques mois, la majorité dont vous faisiez partie n’avait pourtant pas jugé utile d’étendre la diminution des cotisations d’allocations familiales aux travailleurs indépendants assujettis au RSI. Le Conseil constitutionnel n’avait pas trouvé à y redire.
Par ailleurs, le ministre a exposé que cette disposition avait pour vocation de favoriser les embauches. Or, les travailleurs indépendants n’ont pas vocation à embaucher. La différence de traitement se justifie donc au regard de l’objet du CICE.
Enfin, le coût du dispositif que vous proposez est supérieur à 1 milliard d'euros. L’enveloppe du financement prévu pour le CICE ne permet pas cette extension. Avis défavorable.
La Commission rejette le sous-amendement CF 79 rectifié.
Elle examine ensuite le sous-amendement CF 70 de M. Pierre-Alain Muet.
M. Pierre-Alain Muet. Puisqu’il prévoit de laisser à la négociation sociale la gouvernance du crédit d’impôt, le législateur doit préciser son objet. C’est ce que prévoit ce sous-amendement.
M. le rapporteur général. Avis favorable, d’autant plus que je fais partie des cosignataires !
M. Charles de Courson. La question est d’une extrême difficulté. Vous n’arriverez jamais à prévoir toutes les possibilités. Et quelle est la sanction en cas de débordement du champ prévu ?
M. le président Gilles Carrez. La mention « notamment » est essentielle.
M. Dominique Lefebvre. Le sous-amendement est nécessaire pour éviter que le CICE soit détourné de son objet.
M. Jean-Marc Germain. Trois démarches sont possibles. La première est celle d’allègements de charges sous conditions. La deuxième est celle de la conditionnalité ; c’est celle qui a été adoptée pour le contrat de génération, où des allègements de charges sont consentis en échange de la création d’emplois au profit des jeunes et des seniors. La troisième est celle du fléchage. Elle consiste à indiquer l’objet du dispositif : ainsi, ne sont pas éligibles au CICE les charges destinées à financer des hausses des profits ou des rémunérations. Outre ce fléchage, est mis en place non pas un contrôle de nature fiscale par les agents de l’État – il en faudrait trop – mais un contrôle social exercé par les acteurs de l’entreprise. Le dispositif instaure donc la transparence et un contrôle social, auxquels pourrait s’ajouter l’an prochain, après débat, un mécanisme de sanction.
Ce dispositif original est particulièrement adapté à l’objectif recherché, qui est de permettre à chaque entreprise de trouver les outils de compétitivité les mieux adaptés, embauches ou achats de machines par exemple.
M. Nicolas Sansu. Face à la situation de l’industrie, nous n’avons pas le droit de ne rien faire. Je comprends donc la volonté de nos collègues socialistes de formuler des critères. Cependant, un dispositif qui prévoit d’emblée un crédit de 20 milliards d'euros au seul profit des entreprises ne me semble pas un signe positif pour les salariés. Si une négociation est possible au sein des 10 % d’entreprises qui disposent d’un comité d’entreprise, les salariés des autres entreprises n’auront plus que la prière.
La Commission adopte le sous-amendement CF 70 (Amendement n° 220).
La Commission est saisie du sous-amendement CF 60 de M. Pascal Cherki.
M. Pascal Cherki. Mon collègue évoquait une prière, je veux croire au miracle sur ce sous-amendement. Le Gouvernement nous a indiqué que face à l’urgence de la situation en matière de chômage, il est nécessaire de donner un bol d’air aux entreprises. Je ne peux qu’adhérer à cette démarche et je veux même la renforcer.
Lors de sa présentation, le ministre a reconnu que le dispositif est indifférencié, ce qui me semble problématique. Toutes les entreprises n’ont pas besoin de cette aide ; je pense notamment aux banques. Dans un contexte de restriction de la ressource publique, il nous faut concentrer nos actions.
Ce sous-amendement est donc de bon sens et vise à exclure les sociétés cotées du bénéfice du crédit d’impôt.
M. le rapporteur général. Je comprends les intentions de notre collègue mais la voie qu’il retient n’est pas la bonne. Le critère de cotation n’est pas opérant et ne vous permet d’ailleurs pas d’atteindre votre objectif. Certaines grandes entreprises bénéficiaires du crédit d’impôt ne sont pas cotées, comme par exemple dans le secteur de la grande distribution.
Comme Louis Gallois, j’ai tendance à penser que nous ne concentrons pas assez le crédit d’impôt sur le secteur industriel. Or les grandes entreprises industrielles sont souvent cotées et votre sous-amendement les écarterait du bénéfice de la mesure.
J’ajoute enfin que votre proposition peut poser un problème juridique au regard du principe d’égalité devant les charges publiques.
Votre critère n’étant pas opérant et ne permettant pas d’atteindre votre objectif, je ne peux donc qu’être défavorable à votre sous-amendement.
M. Pierre-Alain Muet. Au nom du groupe SRC, je suis opposé à ce sous-amendement. Le crédit d’impôt vise à renforcer la compétitivité qui nécessite une alliance des grands groupes, des PME et des ETI. Exclure automatiquement les grandes entreprises va à l’encontre de cet objectif. Je ne comprends pas la logique de notre collègue et nous voterons donc contre son sous-amendement.
M. Dominique Lefebvre. La mise en place des nouvelles règles prudentielles vise à faciliter l’accès des entreprises aux marchés. Je crois que ce sous-amendement serait en contradiction avec cet objectif.
Par ailleurs nous avons déposé un autre sous-amendement qui évite que le crédit d’impôt ne soit utilisé pour augmenter les dividendes distribués aux actionnaires. Les revenus du capital ne doivent pas primer le réinvestissement.
M. Pascal Cherki. Je ne suis pas certain que le crédit d’impôt vise à faciliter l’accès des entreprises aux marchés. Mon amendement a un but politique : je veux cibler les bénéficiaires et écarter les entreprises du CAC 40. Les sociétés qui font des profits hors de notre territoire ne doivent pas profiter du crédit d’impôt. J’entends les arguments du rapporteur général mais si seuls des obstacles juridiques s’opposent à l’adoption de mon sous-amendement, je ne peux que vous inviter à le modifier pour le rendre applicable.
M. le président Gilles Carrez. Il y a 20 ans avec le plan textile, nous avons essayé de créer un régime différencié selon les secteurs. Ce système a été jugé contraire aux règles de la concurrence ; il tombait également sous le coup des règles applicables aux aides d’État. Cette jurisprudence est ancienne et constante. La seule possibilité est d’instaurer une différenciation assise sur le chiffre d’affaires. Il n’y pas d’autre alternative.
M. Nicolas Sansu. Le problème me paraît majeur. Si on ne peut pas différencier par secteur, précisons tout de même le dispositif en ce qui concerne l’utilisation des bénéfices. Le crédit d’impôt ne doit profiter qu’au seul appareil productif.
M. Éric Alauzet. En l’état, je soutiendrai ce sous-amendement car il me semble souligner le bon usage que l’on doit faire de ce dispositif. Je doute effectivement que les entreprises du CAC 40 en aient véritablement besoin. Je reconnais toutefois qu’il faut certainement affiner le critère retenu.
M. Olivier Carré. Après les déclarations du ministre, je suis surpris de la défiance de nos collègues vis-à-vis des instances qui vont contrôler ce crédit d’impôt. Vous méfiez-vous à ce point des syndicats ?
M. Laurent Grandguillaume. J’invite Pascal Cherki à défendre avec la même conviction les amendements que nous avions déposés sur l’extension de l’assiette de la taxe sur les transactions financières car les entreprises du CAC 40 auraient été directement concernées.
Je crois que la modification qu’il propose induirait une distorsion trop forte et ferait peser un risque sur l’ensemble du dispositif.
J’ajoute que nous accordons bien évidemment toute notre confiance aux syndicats et aux entrepreneurs. Cela ne supprime d’ailleurs en rien le contrôle a posteriori que nous pourrons exercer.
M. le rapporteur général. Comme l’a rappelé le président Carrez, une différenciation par secteur d’activité pose des problèmes juridiques, notamment au regard de la qualification d’aide d’État. Le Gouvernement a choisi une solution simple, claire et juridiquement imparable. Dès lors, je ne peux pas retenir le critère proposé par notre collègue.
Jean-Marc Germain l’a rappelé, ce qui compte c’est l’architecture d’ensemble du dispositif. Nous ne prévoyons certes pas de mécanisme de sanction mais c’est parce que nous faisons confiance aux instances d’auto-surveillance. Il y aura par ailleurs une évaluation par des comités prévus par un autre sous-amendement. J’ajoute que notre commission pourra se saisir de ces questions autant que de besoin. Si des abus apparaissaient, il serait alors temps de les corriger, mais inutile d’anticiper.
La Commission rejette le sous-amendement CF 60 puis elle examine le sous-amendement CF 71.
M. le rapporteur général. Ce sous-amendement précise ce que le crédit d’impôt ne doit pas financer. Il n’est pas question qu’il serve à augmenter les dividendes ou la rémunération des dirigeants. Sur ce sujet, je crois beaucoup à la force de l’évaluation et du contrôle interne.
M. le président Gilles Carrez. Je partage l’esprit de ce sous-amendement mais je m’interroge sur sa mise en œuvre. Comment allez-vous déterminer qu’une hausse des dividendes est le fait du crédit d’impôt ? Comme il est général, toutes les entreprises vont en bénéficier, y compris celles qui auraient vu leurs bénéfices s’accroître même sans lui. Reviendra-t-il aux services fiscaux de faire cette évaluation ?
M. le rapporteur général. Le sous-amendement CF 74 prévoit que dans la présentation de ses comptes, l’entreprise doit indiquer en annexe comment les sommes du crédit d’impôt ont été utilisées. Le dispositif est souple mais clair dans le principe. L’administration fiscale n’interviendra pas puisque nous avons écarté toute sanction. Le comité d’entreprise en sera informé, ce qui me semble suffisant.
M. Charles de Courson. Ce sous-amendement est absolument inapplicable. Avec ce dispositif, on va supposer que toute hausse des bénéfices est le fruit du crédit d’impôt. Par ailleurs l’entreprise pourra déclarer ce qu’elle veut sans aucun contrôle. Vous créez une véritable usine à gaz !
Quant à la rémunération des dirigeants, une hausse même de 100 000 euros restera une évolution dérisoire par rapport au montant du crédit d’impôt dans une grande entreprise.
M. Pierre-Alain Muet. La logique n’est pas celle d’un contrôle, encore moins d’un contrôle fiscal. Bien que ce ne soit pas dans la culture de notre pays, il reviendra aux partenaires sociaux d’apprécier l’utilisation du crédit d’impôt. Il s’agit donc de donner des lignes directrices pour la négociation sociale : le crédit d’impôt ne doit pas servir à augmenter les dividendes versés ni les rémunérations des dirigeants d’entreprise.
M. Charles de Courson. Dans ce cas, il fallait soumettre le bénéfice du crédit d’impôt à la conclusion d’un accord avec les partenaires sociaux, mais ce n’est pas ce que vous faites : le crédit préexiste à la négociation.
M. Olivier Carré. Je ne pense pas que la difficulté vienne de la négociation sociale : je crois que les partenaires sociaux parviendront sans peine à un accord. En revanche, il faut se préoccuper de la jurisprudence qui va se construire lors de contrôles fiscaux. Quoi qu’on en dise, l’administration fiscale cherchera à s’assurer du bien-fondé de la créance constituée par le crédit d’impôt. Dans ce contexte, des critères de gestion trop rigides pourraient avoir des effets pervers.
Prenons l’exemple d’une entreprise dont les bénéfices décroissent d’une année sur l’autre. Celle-ci peut tout de même se trouver dans l’obligation de verser des dividendes pour rembourser les financements apportés et stabiliser l’actionnariat. Dans cette situation, le crédit d’impôt pourrait donc valablement servir à financer les dividendes. Mais avec les critères de gestion que l’on cherche à imposer, l’administration fiscale pourrait trouver matière à s’opposer au versement du crédit d’impôt.
M. Jean-Marc Germain. Ce débat est au cœur de la régulation que l’on veut inventer. Cette régulation me paraît essentielle, parce que la valeur ajoutée produite dans notre pays depuis 20 ans s’est envolée à 90 % en dividendes, en rémunérations extravagantes et en parachutes dorés, alors que, dans le même temps, les salaires stagnaient. Il s’agit donc de mettre en place un contrat de confiance ; pour cela, il faut préciser ce sur quoi on s’engage. Le mécanisme est le suivant : les sommes versées au titre du crédit d’impôt sont ciblées sur des objectifs déterminés ; il revient ensuite à l’entreprise de prouver leur utilisation à bon escient. Les salariés seront associés à ce mécanisme par le dialogue social mené par le ministre du Travail.
M. Nicolas Sansu. J’admire la confiance de notre collègue Jean-Marc Germain, mais je trouve que l’on laisse beaucoup de choses à la négociation. On voit que le crédit d’impôt recherche est parfois dévoyé. Il est donc dangereux de ne pas prévoir de sanctions : il faudrait annuler le versement du crédit d’impôt si l’entreprise ne respecte pas un ensemble de conditions.
Mme Éva Sas. Je soutiens ce sous-amendement qui va dans le même sens que le CF 63 que nous avons déposé et que nous retirerons si celui du rapporteur général est adopté. Nous sommes d’accord sur le principe : le crédit d’impôt ne doit pas servir à augmenter les dividendes et les rémunérations des dirigeants. Ayant travaillé comme expert auprès des comités d’entreprise, je sais que ces derniers auront les moyens de vérifier l’utilisation du crédit d’impôt. Je pense toutefois, comme M. Sansu, que la question des sanctions doit être posée.
M. le rapporteur général. Puisque l’on compare le crédit d’impôt recherche et le crédit d’impôt compétitivité, je voudrais dire un mot à ce sujet. La montée en puissance du crédit d’impôt recherche a pris du temps : il était fondé sur des critères complexes, parfois taxés d’usine à gaz, parfois dévoyés. Son appropriation par les entrepreneurs a été progressive, à mesure que le Parlement en corrigeait les défauts de jeunesse.
La Commission adopte le sous-amendement CF 71 (Amendement n° 219).
Elle examine et adopte ensuite, sur l’avis favorable du Rapporteur général, le sous-amendement CF 74 de M. Pierre-Alain Muet (Amendement n° 218).
Le sous-amendement CF 63 de Mme Éva Sas est retiré.
La Commission examine le sous-amendement CF 64 de Mme Éva Sas.
Mme Éva Sas. Le crédit d’impôt tel qu’il est prévu par l’amendement du Gouvernement n’est pas assez ciblé : il convient de favoriser les PME, qui créent beaucoup d’emplois et ont des difficultés à se développer, en prévoyant un taux de crédit plus important pour elles.
M. le rapporteur général. On comprend le sens de ce sous-amendement et l’on peut en partager la motivation. Toutefois on ne sait pas précisément ce qu’il coûte. Par ailleurs, le Président de la République a pris l’engagement d’une différenciation des taux de l’impôt sur les sociétés en fonction de la taille des entreprises ; nous aurons donc l’occasion de revenir sur la problématique des PME. Pour ces différentes raisons, je suis défavorable à votre sous-amendement.
La Commission rejette le sous-amendement CF 64.
La Commission examine ensuite le sous-amendement CF 80 rectifié de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Il s’agit de revenir sur un défaut dans la rédaction du texte, qui laisse penser que les salariés du domaine agricole sont exclus du bénéfice du crédit d’impôt.
M. le rapporteur général. Votre sous-amendement supprime une condition pour bénéficier du crédit d’impôt, pour les personnes physiques associées à des sociétés ou groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés. Le texte prévoit que ces personnes soient actives dans l’entreprise ; vous supprimez dans votre sous-amendement cette obligation. J’y suis donc défavorable. Je dois pourtant reconnaître qu’il y aura potentiellement quelques problèmes sur certains sujets comme les coopératives agricoles, pour lesquels il faudra, d’ici l’examen du texte en séance, prévoir des sous-amendements.
La Commission rejette le sous-amendement CF 80 rectifié.
La Commission examine ensuite le sous-amendement CF 82 rectifié de M. Charles de Courson et le sous-amendement CF 62 du Rapporteur général.
M. Charles de Courson. Le crédit d’impôt ne concerne que les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés ou sur le revenu ; les autres s’en trouvent donc exclues par le choix même de la technique. Cela pose un problème d’équité sur lequel mon sous-amendement veut revenir, en ouvrant la possibilité d’imputer le crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires. Je me suis rendu compte que cela ne permettait pas de couvrir l’intégralité des entreprises, mais les autres dispositifs que j’avais envisagés n’étaient pas recevables. Il faudra pourtant trouver une solution, ne serait-ce que pour des raisons de constitutionnalité : comment justifier le fait qu’entre deux entreprises ayant la même activité, l’une puisse bénéficier du crédit d’impôt et l’autre pas ?
M. le rapporteur général. Les grands esprits se rencontrent, M. de Courson, puisque votre sous-amendement n° 82 Rect est en partie satisfait par le sous-amendement n° 62, déposé par MM. Juanico, Goua, Grandguillaume et moi-même. Nous souhaitons en effet régler un problème d’équité fiscale dans certains secteurs en particulier, notamment le secteur médico-social et le secteur associatif qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, et qui ne peuvent, de ce fait, être éligibles au CICE.
Je prends un exemple : dans le projet de loi du Gouvernement, les cliniques et hôpitaux privés sont éligibles au CICE alors que les hôpitaux publics, qui rendent un service au moins équivalent, n’y sont pas éligibles. Il faut donc trouver des contreparties pour assurer l’équité fiscale entre ces établissements. Il y a deux solutions envisageables : la première consisterait à neutraliser le bénéfice du CICE en faveur des établissements du secteur médico-social privé en réduisant les remboursements des soins qu’ils prodiguent. C’est l’orientation du Gouvernement, semble-t-il. La seconde consiste à étendre l’avantage reçu par le secteur privé au secteur public et associatif à travers un crédit d’impôt au titre de la taxe sur les salaires. Toutefois, le Gouvernement semble réticent au regard du coût de cette mesure évaluée à 1,5 milliard d’euros environ.
À titre conservatoire, je vous propose d’adopter le sous-amendement n° 62 rédigé par mes collègues et moi-même, car il est plus complet que le sous-amendement n° 82, étant précisé qu’une autre solution pourrait être trouvée d’ici la séance en accord avec le Gouvernement.
Mme Christine Pires-Beaune. Il y a un autre avantage à voter votre sous-amendement plutôt qu’à retenir la solution envisagée par le Gouvernement. Ce crédit d’impôt favoriserait en effet l’emploi et son coût serait partiellement compensé par l’augmentation de la TVA sur les services à la personne.
M. Olivier Carré. Pouvez-vous me préciser ce que vise l’article 244 quater C mentionné dans votre amendement ?
M. le rapporteur général. L’article 244 quater C est l’article qui crée le CICE.
Suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, la Commission rejette le sous-amendement CF 82 Rect.
La Commission adopte le sous-amendement CF 62 (Amendement n° 217).
La Commission examine ensuite le sous-amendement CF 81 présenté par M. Jean-Marc Germain.
M. Jean-Marc Germain. Cet amendement pose le principe selon lequel, après concertation avec les partenaires sociaux, une loi pourra fixer les conditions d’information du Parlement et des institutions représentatives du personnel ainsi que les modalités de contrôle de l’utilisation du CICE. Il convient néanmoins de procéder à une petite rectification à la fin de la phrase pour remplacer les mots « des entreprises » par les mots « de l’entreprise », le contrôle devant bien entendu être réalisé au sein de chaque entreprise pour vérifier que le crédit d’impôt a effectivement concouru à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise.
M. Hervé Mariton. Je formulerai une observation et poserai une question : tout d’abord, il me paraît étrange d’écrire, dans une loi, l’expression « une loi pourra fixer …» ; Ensuite, quelle est la capacité de contrôle des partenaires sociaux sur l’utilisation du CICE par l’entreprise ?
M. le président Gilles Carrez. Je précise tout de suite que pour être déclaré recevable, l’amendement ne pouvait retenir une formule impérative s’imposant au Gouvernement et devait également nécessairement viser l’information du Parlement.
M. Jean-Marc Germain. Je souhaite rappeler à M. Mariton qui n’a pas suivi nos débats depuis le début que cet amendement s’inscrit dans un ensemble plus large permettant aux partenaires sociaux d’exercer leur capacité de contrôle : un fléchage des dépenses susceptibles d’être financées ou non par le CICE, une obligation de transparence dans l’usage du CICE de l’entreprise au travers de ses comptes annuels, et le présent amendement qui instaure un dispositif de contrôle, dont les modalités seront définies par la négociation entre les partenaires sociaux.
M. le président Gilles Carrez. Je confirme ce qu’a dit M. Germain, cet amendement est la suite logique des amendements n° 70, 71 et 74 que nous avons examinés longuement il y a environ 45 minutes.
Suivant l’avis favorable du Rapporteur général, la Commission adopte le sous-amendement CF 81 ainsi rectifié (Amendement n° 216).
La Commission examine le sous-amendement n° CF 73 présenté par M. Pierre-Alain Muet.
M. Pierre-Alain Muet. Cet amendement propose de créer un comité national de suivi de la mise en œuvre du CICE, tripartite – État, représentants des salariés et des employeurs – qui se déclinerait au niveau régional pour contrôler la façon dont a été utilisé le CICE par les entreprises bénéficiaires.
Suivant l’avis favorable du Rapporteur général, la Commission adopte le sous-amendement CF 73 (Amendement n° 215).
Mme Éva Sas. Je voterai contre l’amendement n° 4 car malgré tous les efforts déployés par les députés de la majorité pour combler les insuffisances de l’amendement du Gouvernement, que je salue, j’estime cependant que les avancées demeurent insuffisantes. Il n’y a en réalité aucune conditionnalité attachée à l’octroi du CICE, qui n’est ni plus ni moins qu’un cadeau offert aux entreprises.
Suivant l’avis favorable du Rapporteur général, la Commission accepte l’amendement n° 4 du Gouvernement ainsi sous-amendé.
M. le président Gilles Carrez. L’amendement CF 30 est retiré.
M. de Courson. Juste un mot pour dire à mes collègues socialistes que je tiens à leur disposition les éléments démontrant que la répartition de la valeur ajoutée ne s’est pas déformée en France depuis 10 ans.
La commission est saisie de l’amendement n° 5 du Gouvernement.
Elle examine les sous-amendements CF 76 et CF 77 de M. de Courson et CF 75 rect de M. Carrez.
M. Charles de Courson. Il faut être plus juste et faire porter l’intégralité de la hausse de TVA proposée sur le taux normal pour ne pas augmenter le taux intermédiaire. Il s’agit d’un problème économique fondamental. Les produits importés seront ainsi taxés.
M. le président Gilles Carrez. Il faut effectivement rééquilibrer le financement du CICE en relevant l’augmentation du taux normal proposé par le Gouvernement pour mettre à contribution plus spécifiquement les produits importés. Il faut désinciter les consommateurs à recourir aux produits offerts par les entreprises étrangères. La TVA aussi participe au renforcement de la compétitivité de notre économie.
M. le rapporteur général. Le premier amendement de M. de Courson est surfinancé de près d’un milliard d’euros ! Cela démontre qu’il faut être très prudent lorsqu’on veut toucher à la TVA. Une discussion, produit par produit et branche par branche, doit avoir lieu, tout en maintenant l’équilibre d’ensemble du dispositif. C’est pourquoi je serai défavorable à tous les sous-amendements sur la TVA et je n’en proposerai pas moi-même, justement parce que c’est très important. Nous avons toute l’année à venir pour en discuter, on ne peut entrer dans ce débat maintenant, dans la précipitation, il faut se donner du temps pour y réfléchir ensemble. Le seul impératif est de donner de la visibilité économique pour les opérations, – notamment dans la construction –, qui dépendent du taux de TVA applicable.
La commission rejette les trois sous-amendements.
Elle examine ensuite les sous-amendements CF 65 à CF 68 de Mme Sas et le sous-amendement CF 69 de M. Alauzet.
M. Éric Alauzet. Tous ces sous-amendements concernent des sujets extrêmement sensibles : avoir un toit, de l’eau, éliminer ses déchets,... On est très proche des besoins primaires. Le crédit d’impôt ne prend déjà pas en compte la dimension écologique, il ne faudrait pas que les dépenses impactées par son financement ne tiennent pas compte non plus de l’enjeu environnemental. Les 600 millions d'euros que représente le surcoût de la hausse de la TVA dans le secteur du logement sont plus importants que les 500 millions d'euros prévus en faveur de la politique du logement dans le projet de loi de finances pour 2013. On sait bien aussi, au niveau local, que toute augmentation, même faible, sur le sujet du traitement des déchets est très sensible.
Mme Éva Sas. On ne peut pas vouloir faire de la France un pays de l’excellence environnementale en matière de transports, comme l’a annoncé le Président de la République, et augmenter la TVA sur des secteurs qui doivent contribuer à la mise en œuvre de la transition écologique pour l’économie de demain.
M. le rapporteur général. La TVA, c’est 150 milliards d'euros. Certes, plusieurs centaines de millions d’euros pour certains secteurs, c’est beaucoup, mais il faut rapporter cela au sujet global du financement de l’économie. Il y a sans aucun doute des équilibres à préserver sur certains secteurs, notamment le logement social, avec donc des compensations à trouver sur d’autres secteurs. Le Gouvernement semble d’ailleurs plus ouvert sur la question de la TVA que sur le CICE, profitons-en pour y travailler sereinement ensemble d’ici l’année prochaine.
M. Marc Goua. L’annonce d’une hausse de la TVA seulement en 2014 aura un effet bénéfique pour la consommation et donc l’économie en 2013. Il faut seulement garantir une visibilité suffisante pour les entreprises concernées.
M. Hervé Mariton. Nous avions utilisé le même argument pour défendre la TVA anti-délocalisations ! On peut être d’accord avec le rapporteur général pour dire qu’il ne faut pas bricoler maintenant sur la TVA, mais pourrait-on savoir sur quels secteurs en particulier la réflexion doit porter ?
M. le président Gilles Carrez. On peut aussi demander si un ajustement des taux eux-mêmes est aussi possible.
M. Dominique Lefebvre. Il faut saluer la démarche du Gouvernement qui propose un plan de financement du crédit d’impôt : moitié sur les dépenses, moitié sur les recettes, et sur cette deuxième moitié, un tiers de fiscalité écologique et deux-tiers de TVA. L’impact de la hausse de TVA sur les contribuables doit être mesuré pour ouvrir une discussion globale sur la question au cours de l’année 2013.
Mme Éva Sas. C’est très bien de parler d’équilibre global, mais si on conditionne le crédit d’impôt, il y aura moins besoin de TVA ! L’impact de la hausse annoncée de la TVA sur certains secteurs doit être évalué d’un point de vue environnemental.
La commission rejette les cinq sous-amendements.
Puis elle examine les sous-amendements CF 83 et CF 84 de M. de Courson.
M. Charles de Courson. Le crédit d’impôt bénéficiera-t-il aux jeunes agriculteurs ? Qu’en sera-t-il pour les associés de sociétés de personnes translucides lorsqu’ils ne participent pas à l’exploitation ?
M. Christian Eckert, rapporteur général. Ces sous-amendements concernent le crédit d’impôt, ils n’ont pas de rapport avec l’amendement n° 5, et l’amendement n° 4 a déjà été examiné.
Les sous-amendements CF 83 et CF 84 sont retirés.
La commission accepte l’amendement n° 5.
*
* *
Modification de certaines redevances perçues par les agences
et offices de l’eau
Texte du projet de loi :
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au IV de l'article L. 213-10-3 :
a) La première phrase est remplacée par la phrase suivante :
« La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l'exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le recouvrement de la redevance est assuré en phase amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. ».
2° La dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 213-10-6 est remplacée par la phrase suivante :
« Le recouvrement de la redevance est assuré en phase amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. ».
3° À L’article L. 213-10-8 :
a) Au I, les mots : « Toute personne qui, dans le cadre d’une activité professionnelle ne relevant pas du II de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, » sont remplacés par les mots : « Les personnes, à l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L. 254-1 ou du II de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent » et les mots : « est assujettie » sont remplacés par les mots : « sont assujetties » ;
b) Au second alinéa du 3° du IV, les mots : « Les distributeurs mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « Les distributeurs de produits phytopharmaceutiques ».
4° Le second alinéa de l’article L. 213-19 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l’office de l’eau.
« L’office de l’eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire. ».
Observations et décision de la Commission :
Le présent article propose de modifier les dispositions relatives aux redevances perçues par les agences et offices de l’eau en vue :
– de simplifier le régime de recouvrement des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte perçues sur la facture d’eau ;
– de clarifier les dispositions relatives à la taxe pour pollutions diffuses ;
– d’aligner la procédure de réclamation des contribuables auprès des offices de l’eau en outre-mer sur la procédure applicable en France métropolitaine.
A.– LA SIMPLIFICATION DU RÉGIME DE PERCEPTION ET DE RECOUVREMENT DES REDEVANCES POUR POLLUTION DE L’EAU ET POUR MODERNISATION DES RÉSEAUX DE COLLECTE
La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA), codifiée aux articles L. 213-10 et suivants du code de l’environnement, a réformé le dispositif des redevances perçues par les agences de l'eau. Elle a défini les règles d'assiette de ces redevances et des plafonds pour leurs taux, ainsi que les critères de modulation de ces taux(96). Il en résulte que :
– la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique est acquittée par tous les abonnés au service d’eau potable (autre que ceux acquittant la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique) ou au service d’assainissement. Elle est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service d’eau potable (article L. 213-10-3) ;
– la redevance pour modernisation des réseaux de collecte d’origine domestique est acquittée par les usagers payant la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique et la redevance d’assainissement. Elle est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service assurant la facturation de la redevance d’assainissement (article L. 213-10-6), lequel peut être le service d’eau potable ou le service d’assainissement.
L’article 131 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 a complété ces dispositions en précisant que :
– le recouvrement de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique est réalisé par l’exploitant du service d’eau potable (article L. 213-10-3) ;
– le recouvrement de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte d’origine domestique est réalisé par le service d’assainissement (article L. 213-10-6).
Or, selon l’évaluation préalable annexée au présent article, les services d’assainissement du bassin hydrographique Rhin-Meuse rencontrent une difficulté : ils ne peuvent pas assurer le recouvrement de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique lorsqu’ils facturent le service d’eau potable à l’assujetti (environ 10 communes). De la même manière, les services de l’eau ne peuvent pas assurer le recouvrement de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte lorsqu’ils facturent le service d’eau potable à l’assujetti.
En outre, l’article R. 2224-19-7 du code général des collectivités territoriales précise que, à l'exclusion des procédures contentieuses, le recouvrement des redevances de consommation d’eau et d'assainissement collectif et non collectif, peut être confié à un même organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture. Par conséquent, l’interlocuteur de l’agence de l’eau change selon que l’on se trouve en phase amiable et en phase contentieuse, ce qui crée des difficultés pour réaliser les contrôles par les agences de l’eau sur les assiettes et le montant des redevances perçues.
Pour résoudre ces difficultés, le 1° et le 2° du présent article proposent une solution simple :
– d’une part, ces deux redevances seront perçues par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service assurant la facturation de chacune de ces redevances (service de l’eau ou service d’assainissement) ;
– d’autre part, le recouvrement de chacune de ces deux redevances, en phase amiable comme en phase contentieuse, sera assuré auprès de l’assujetti, par le service assurant la facturation de la dite redevance.
Par conséquent, les services d’assainissement du bassin hydrographique Rhin-Meuse pourront recouvrer la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique lorsqu’ils facturent eux-mêmes le service d’eau potable à l’assujetti, qu’ils se trouvent en phase amiable ou contentieuse.
De manière générale, cette réforme permettra de réduire le nombre d’interlocuteurs publics de l’agence de l’eau et de simplifier le dispositif à l’égard des assujettis.
Il est prévu que les services « redevances » des agences de l’eau présentent un retour d’expérience sur cette réforme au ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie dans le cadre du groupe de travail national « redevances » qui se tient deux fois par an.
Ces dispositions ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des départements français, métropolitains et ultramarins (dont Mayotte) ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, rattaché à la circonscription administrative de l’agence de l’eau de Seine-Normandie.
B.– LA CLARIFICATION DU CHAMP D’APPLICATION ET DES OBLIGATIONS D’INFORMATIONS AFFÉRENTES À LA REDEVANCE POUR POLLUTIONS DIFFUSES
La redevance pour pollutions diffuses est assise sur les quantités de substances classées contenues dans les produits phytopharmaceutiques utilisés en France (97).
Elle vise à appliquer le principe pollueur-payeur à ces produits, de manière à inciter à atteindre l’état convenable des eaux imposé par la directive cadre sur l’eau (98) et à la réduction de leur consommation en vue d’une préservation plus générale de l’environnement et de la santé publique, dans le cadre du plan gouvernemental « Ecophyto 2018 » (99). La recette de cette redevance s’élève à environ 81,9 millions d’euros au titre de l’activité 2011, dont 41 millions d’euros sont affectés au financement du « plan Ecophyto 2018 ».
Le régime de la redevance pour pollution diffuse est notamment encadré par l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement (assujettis, assiette, taux) depuis la LEMA.
Ce dispositif a été successivement modifié par la loi de finances rectificative pour 2010 (100) puis par la loi de finances pour 2012 qui a redéfini la clef de répartition du produit de la redevance pour pollutions diffuses affectée à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (pour le financement du « plan Ecophyto 2018 ») et aux agences de l’eau.
Néanmoins, la loi de finances rectificative pour 2010 qui a modifié le régime de recouvrement de cette taxe pose certains problèmes : elle laisse penser que les jardiniers amateurs achetant ces produits n’y sont pas soumis contrairement aux distributeurs de ces produits ; elle crée une double taxation de ces produits (lors de leur achat par le distributeur et lors de leur achat par le consommateur final) ; enfin, elle n’établit pas clairement à qui incombe l’obligation de transmettre au consommateur final le montant de la redevance correspondant à ses achats sur la facture qu’il acquitte.
Pour remédier à ces difficultés, le 3° du présent article propose :
– d’une part, de modifier le champ des assujettis à la redevance pour pollutions diffuses : les producteurs et distributeurs de produits phytopharmaceutiques seraient ainsi exclus du champ de la redevance. En revanche, les acquéreurs de produits phytopharmaceutiques à des fins domestiques seraient intégrés dans le champ de la même redevance (point a) du 3°). Cette mesure vise à lever l’ambiguïté qui pouvait laisser entendre que les jardiniers amateurs n’étaient pas redevables de la redevance pour pollution diffuse. En sus, la double taxation des produits phytopharmaceutiques est supprimée, les producteurs et distributeurs n’y étant pas (producteurs) ou plus (distributeurs) assujettis ;
– d’autre part, de préciser que tout distributeur de produits phytopharmaceutiques, à l’exception des produits portant la mention « emploi autorisé dans les jardins », doit faire apparaître sur sa facture, le montant de la redevance dont doivent s’acquitter les acquéreurs de produits phytopharmaceutiques à des fins domestiques (point b) du 3°).
Cette disposition a vocation à s’appliquer à l’ensemble des départements français, métropolitains et ultramarins (dont Mayotte), ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, rattaché à la circonscription administrative de l’agence de l’eau de Seine-Normandie.
C.– L’ALIGNEMENT DU DROIT DE RÉCLAMATION DES REDEVABLES DES OFFICES DE L’EAU D’OUTRE-MER SUR LE DROIT APPLICABLE EN MÉTROPOLE
Les offices de l'eau sont des établissements publics locaux, créés dans les départements de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et de La Réunion en application de la loi n° 2000–1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, pour faciliter la gestion intégrée de l'eau par la connaissance, l'information, l'appui technique aux collectivités et le financement d'actions et de travaux. Pour contribuer à ces actions, ils perçoivent des redevances sur les utilisations de l'eau, comme le font les agences de l'eau en métropole.
L’article L. 213-19 du code de l’environnement, introduit par la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003, permet néanmoins aux offices de l’eau d’outre-mer de prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas dues et d’accorder des remises totales ou partielles de redevances et pénalités sur demande motivée du redevable, sans autre condition.
En métropole, la procédure est plus encadrée et dépend de la nature de la réclamation (contestation ou impossibilité financière). Ainsi, le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l’office de l’eau. En outre, l’agence de l’eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le 4° du présent article propose d’aligner la procédure de réclamation applicable en outre-mer sur le régime juridique applicable en métropole.
*
* *
La Commission adopte l’article 25 sans modification.
*
* *
Taxe relative aux produits phytopharmaceutiques, à leurs adjuvants, aux matières fertilisantes et supports de culture affectée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)
Texte du projet de loi :
L’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.– Il est créé une taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et aux matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l'article L. 255-1 du même code, pour chaque demande adressée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, et relative :
« 1° À l'approbation ou au renouvellement d’approbation d'une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste ;
« 2° À l’évaluation de données nouvelles susceptibles de modifier l’approbation ou le renouvellement d’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste ;
« 3° À l’évaluation relative à l’origine, au site de fabrication, à la modification du procédé de fabrication ou des spécifications d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste ;
« 4° À l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou à l'homologation d’une matière fertilisante ou d’un support de culture ; à l'extension d'usage d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant déjà autorisé ; à la modification d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une homologation précédemment obtenues ;
« 5° Au renouvellement d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou à l'homologation d’une matière fertilisante ou d’un support de culture déjà autorisés ;
« 6° Au réexamen d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant à la suite du renouvellement de l’approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes qu'il contient ;
« 7° À l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, ou à l'homologation d’une matière fertilisante ou d’un support de culture de composition identique à un produit phytopharmaceutique, un adjuvant, une matière fertilisante ou un support de culture déjà autorisé en France ;
« 8° À l'autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant déjà autorisé dans un autre État membre de l'Union européenne, et contenant uniquement des substances actives approuvées ;
« 9° À l'homologation d'un produit, ou d'un ensemble de produits, déclaré identique à un produit ou un ensemble de produits déjà homologué ou bénéficiant d'une autorisation officielle dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 10° À l’obtention d’un permis de commerce parallèle permettant l'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant provenant d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il est autorisé, et identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant autorisé en France ; à la modification ou au renouvellement de ce permis ;
« 11° À l’obtention d’un permis d’expérimentation d’un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ; à l’autorisation de distribution pour expérimentation d’une matière fertilisante ou d’un support de culture ; à la modification ou au renouvellement d’un tel permis ou d’une telle autorisation ;
« 12° À l'inscription d'un mélange extemporané sur la liste publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture ;
« 13° À la fixation ou à la modification d’une limite maximale de résidus dans les denrées pour une substance active approuvée ;
« 14° À l’introduction sur le territoire national d'une matière fertilisante, ou d’un support de culture, en provenance d'un autre État membre de l’Union européenne partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »
2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.– Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget en tenant compte de la nature de la demande et de la complexité de l'évaluation. Ce tarif est fixé :
« 1° Pour les demandes mentionnées au 1° du I dans la limite d’un plafond de 150 000 euros pour les demandes de renouvellement et de 250 000 euros pour les autres demandes ;
« 2° Pour les demandes mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 10° du I dans la limite d'un plafond de 50 000 euros ;
« 3° Pour les demandes mentionnées aux 7°, 8°, 9°, et 12° du I dans la limite d'un plafond de 25 000 euros ;
« 4° Pour les demandes mentionnées aux 11°, 13° et 14° du I dans la limite d'un plafond de 5 000 euros. ».
Observations et décision de la Commission :
Le présent article vise à modifier l’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 de façon à adapter la taxe prévue par cet article aux évolutions de la réglementation communautaire et de l’expertise scientifique.
Il est ainsi proposé de :
– mettre en cohérence les termes utilisés par la réglementation communautaire et les dispositions législatives internes ;
– tirer les conséquences des modifications de la réglementation communautaire en adaptant l’assiette de la taxe et les catégories des demandes qui y sont assujetties ;
– réformer à cette occasion les modalités de calcul de la taxe.
La taxe relative aux produits pharmaceutiques et à leurs adjuvants a été introduite à la suite du plan interministériel de réduction des risques liés aux pesticides prévu pour la période 2006-2009, dont l’un des objectifs était d’améliorer les conditions de mise sur le marché de ces produits.
Si une taxe d’homologation, prélevée à l’occasion du dépôt des demandes, existait précédemment, son montant était très faible et ne permettait pas d’assurer le financement par les industriels d’une expertise efficace des produits proposés dans des délais raisonnables.
Les résultats de l’expertise n’étaient en effet délivrés qu’à l’issue d’un délai de trois ans en moyenne, au lieu d’un an comme cela était recommandé par les instances communautaires.
La loi de finances pour 2007 précitée a proposé en conséquence l’introduction d’une nouvelle taxe affectée à l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) dont les montants ont été calculés de façon à financer la prise en charge du coût de l’évaluation par cette agence.
La taxe perçue par l’AFSSA (devenue ANSES le 1er juillet 2010 à l’issue d’une fusion avec l’AFSSET, cf. encadré infra) porte sur l’ensemble des demandes relatives aux produits pharmaceutiques et à leurs adjuvants, ainsi qu’aux matières fertilisantes et supports de culture.
Présentation des produits visés par la taxe
● Les produits phytopharmaceutiques
Selon la définition qu’en donne l’ANSES présentée ci-après, « les produits phytopharmaceutiques sont des préparations destinées à protéger les végétaux et les produits de culture » et sont assimilés à des pesticides.
Ils se composent notamment d’une ou de plusieurs substances actives (soit des substances ou micro-organismes exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux (101)).
● Les matières fertilisantes et les supports de culture :
Les matières fertilisantes tendent à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, ainsi que les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols.
Il s’agit donc principalement d’engrais.
Les supports de culture sont utilisés comme milieu de culture. Il s’agit par exemple de tourbe, de terreau ou de laine de roche.
Ces produits doivent suivre certaines procédures avant de pouvoir être commercialisés.
Ainsi, s’agissant des produits phytopharmaceutiques, pouvant engendrer des risques sanitaires et environnementaux, la réglementation communautaire est très stricte (102), notamment en termes d’évaluation. Cette évaluation se décompose en deux étapes.
Une première évaluation est réalisée sur les substances actives au niveau européen et une seconde évaluation est menée au niveau des États, répartis par zones géographiques, afin d’étudier les risques potentiels liés à l’introduction ou à la prorogation de l’autorisation des produits phytopharmaceutiques qui sont composés de ces substances.
En ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture, leur mise sur le marché n’est possible qu’avec une homologation délivrée après qu’une évaluation a été réalisée afin de s’assurer de l’innocuité de ces produits dans des conditions normales d’utilisation.
Ces évaluations sont réalisées en France par l’ANSES qui, pour les financer, perçoit la taxe acquittée par les industriels souhaitant commercialiser leurs produits.
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail (ANSES)
Cette agence, créée le 1er juillet 2010 par l’ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010, résulte de la fusion de deux agences sanitaires qui coexistaient précédemment : l'Afssa (Agence française de sécurité sanitaire des aliments) et l'Afsset (Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail). Par ailleurs, elle intègre également le Laboratoire national de protection des végétaux (LSV) depuis le 1er janvier 2011.
Si le champ de ses compétences est étendu, sa principale mission consiste à réaliser une expertise scientifique indépendante permettant l'élaboration de politiques de protection de la santé et l’évaluation des risques sanitaires dans ses domaines de compétence, que cette évaluation soit prévue ou non par le droit communautaire.
Le montant de ses dépenses est estimé à 132,7 millions d’euros en 2012 (dont 84,5 millions d’euros de charges de personnel), tandis que ses recettes prévisionnelles devraient être d’un montant équivalent et se répartir comme suit :
– 95,3 millions d’euros de dotations budgétaires (dont 65 millions en provenance du ministère de l’Agriculture) ;
– 18,6 millions d’euros de recettes fiscales (dont 9,6 millions d’euros au titre de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques) ;
– 18,6 millions d’euros d’autres subventions et ressources propres.
La taxe repose sur chacune des demandes :
– d'inscription d'une nouvelle substance active sur la liste communautaire des substances actives ;
– d’autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou d'homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture, d'extension de l’usage d'un produit déjà autorisé, de modification d'autorisation de mise sur le marché ou d'homologation ;
– de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché d’un produit déjà autorisé ou de réexamen d'un produit suite à l'inscription des substances actives, qu'il contient, sur la liste communautaire des substances actives ;
– d'autorisation de mise sur le marché d'un produit identique à un produit déjà autorisé en France ;
– d'autorisation de mise sur le marché d'un produit déjà autorisé dans un autre État membre de l'Union européenne et contenant uniquement des substances actives inscrites sur la liste communautaire des substances actives ;
– d'homologation d'un produit ou d'un ensemble de produits déclaré identique à un produit ou un ensemble de produits déjà homologué ou bénéficiant d'une autorisation officielle dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
– d’autorisation de mise sur le marché permettant l'introduction sur le territoire national d'un produit provenant d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il est autorisé et identique à un produit autorisé en France ou concernant une origine nécessitant une comparaison avec le produit autorisé en France ;
– d’examen d'une nouvelle origine de la substance active ;
– d’autorisation de distribution pour expérimentation ;
– d’inscription d'un mélange extemporané (103) sur la liste publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture et de la pêche.
Le barème de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget et tient compte de la nature de la demande et de la complexité de l’évaluation qui doit être réalisée. L’arrêté le plus récent est l’arrêté du 16 avril 2012 fixant le barème de la taxe fiscale perçue par l’ANSES, décliné par type de demande.
Toutefois, c’est la loi qui précise expressément les limites dans lesquelles ces tarifs réglementaires doivent s’inscrire selon la nature de la demande effectuée. Ces limites sont rappelées dans le tableau ci-après :
Produits |
Tarifs appliqués au titre de l’évaluation |
Inscription d’une nouvelle substance active |
40 000 € < Tarif < 200 000 € |
- Autorisation de mise sur le marché d’un produit, - Extension ou modification de cette autorisation, - Comparaison de deux produits autorisés pour l’un en France et pour l’autre dans un État membre de l’Espace économique européen. |
Tarif ≤ 40 000 € |
- Autorisation d’un produit identique à un produit déjà autorisé en France ou dans un autre État membre de l’UE, - Homologation d’un produit identique à un autre produit déjà homologué dans un autre État membre ou partie de l’EEE - Inscription d’un mélange extemporané |
Tarif ≤ 15 000 € |
- Examen d’une nouvelle substance active ; - Autorisation de distribution pour expérimentation |
Tarif ≤ 4 500 € |
L’article 130 de la loi de finances pour 2007 précitée prévoit que le recouvrement de la taxe est assuré par l’agent comptable de l’ANSES, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
II.– LES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le présent article modifie le droit en vigueur de sorte à prendre en compte les récents apports de la réglementation communautaire relatifs aux produits phytopharmaceutique et à réformer les plafonds des tarifs applicables selon la nature des demandes adressées à l’ANSES.
Le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques a abrogé la directive 91/4141/CEE qui constituait le texte de référence relatif à ces produits. Ce règlement fait partie du « Paquet pesticide » adopté en octobre 2009.
Il a notamment actualisé les critères d’approbation des substances actives et d’autorisation de mise sur le marché. Entré en vigueur le 14 juin 2011, ce règlement rend nécessaire la modification des textes en vigueur en droit interne.
Au-delà des modifications de nature rédactionnelle qui conduisent à la réécriture d’un certain nombre d’alinéas de l’article 130 précité en vigueur, il convient également de réviser le périmètre de l’assiette de la taxe afin de prendre en compte les nouveaux types de demandes qui peuvent être adressées à l’ANSES.
Sont ainsi ajoutées à la liste de demandes, présentée précédemment, les demandes relatives :
– à l’approbation d’un phytoprotecteur (104) ou d’un synergiste (105) ;
– à l’évaluation de données nouvelles susceptibles de modifier les approbations en cours des substances actives, des phytoprotecteurs ou des synergistes ;
– à l’évaluation relative à l’origine, au site de fabrication, à la modification du procédé de fabrication ou des spécifications des substances actives, des phytoprotecteurs ou des synergistes ;
– au réexamen d’un produit suite au renouvellement de l’approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes qu’il contient ;
– à la fixation ou à la modification d’une limite maximale de résidus dans les denrées pour une substance active approuvée ;
– à l’introduction sur le territoire national d’une matière fertilisante, ou d’un support de culture, en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Le présent article tend à relever les tarifs applicables au titre des différentes demandes qui peuvent être adressées à l’ANSES, de façon à prendre en compte l’évolution du coût de l’expertise et de l’intégration dans le processus de recherche des avancées scientifiques sur le sujet. Ces tarifs seront désormais retenus dans les limites suivantes :
Produits |
Tarifs appliqués au titre de l’évaluation |
Approbation ou renouvellement d’approbation d’une nouvelle substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste. |
Tarif ≤ 250 000 € pour les demandes d’approbation (soit + 50 000 €) Tarif ≤ 150 000 € pour les renouvellements d’approbation |
– Évaluation de données susceptibles de modifier une approbation de substance active ; – Évaluation relative à l’origine ou aux spécificités d’une substance active ; – Autorisation de mise sur le marché d’un produit ; – Renouvellement, extension ou modification de cette autorisation ; – Réexamen d’un produit à la suite du renouvellement de l’approbation d’une substance active ; – Permis de commerce parallèle permettant l’introduction d’un produit provenant d’un État membre de l’Espace économique européen et identique à un produit autorisé en France. |
Tarif ≤ 50 000 € (soit + 10 000 €) |
– Autorisation d’un produit identique à un produit déjà autorisé en France ou dans un autre État membre de l’UE ; – Homologation d’un produit identique à un autre produit déjà homologué dans un autre État membre ou partie de l’EEE ; – Inscription d’un mélange extemporané. |
Tarif ≤ 25 000 € (soit + 10 000 €) |
– Permis d’expérimentation d’un produit ; – Fixation de la limite maximale de résidus dans les denrées d’une substance active approuvée ; – Introduction d’une matière fertilisante en provenance d’un État faisant partie de l’EEE. |
Tarif ≤ 5 000 € (soit + 500 €) |
Par ailleurs, l’évaluation préalable annexée au présent article indique que la suppression du montant plancher auparavant prévu en cas d’introduction d’une nouvelle substance active ne devrait s’appliquer qu’ « en cas de demande d’approbation de substances actives de type phéromone ou végétale ou micro-organisme ou de substance de base n’ayant pas subi de transformation chimique ou considérée comme à faible risque ».
Cette précision, qui devrait se traduire par la fixation de tarifs inférieurs à 40 000 euros pour ce type de substances et supérieurs à ce montant pour les autres dans le cadre d’un arrêté à venir, a pour objet de favoriser les demandes d’évaluation relatives aux substances ayant un faible impact pour l’environnement et la santé publique et de favoriser ainsi leur développement.
*
* *
À l’invitation du Rapporteur général, l’amendement CF 35 de M. Éric Alauzet, tendant à réintroduire des montants planchers de la taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à en augmenter les montants plafonds, est retiré.
La Commission adopte l’article 26 sans modification.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement CF-3 de M. Laurent Baumel.
M. Laurent Baumel. Il s’agit de rehausser les taux minimal et maximal de la contribution des assurances affectée au financement de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP).
M. le rapporteur général. Les recettes de l’ACP, que le Gouvernement n’a pas accepté que nous plafonnions, sont plutôt dynamiques. Il ne paraît donc pas opportun d’en prévoir l’augmentation. Même si la mise en place d’une réglementation prudentielle au niveau européen pourrait augmenter la charge de travail de l’ACP, il est sage d’attendre, avant d’agir, les rapports du Gouvernement sur la situation de l’ACP, d’une part, et sur les taxes affectées aux opérateurs, d’autre part. Cet amendement pourrait donc être utilement redéposé à l’occasion du prochain projet de loi bancaire par exemple.
M. Laurent Baumel. Le calendrier d’examen de ce texte est trop tardif pour que je retire cet amendement. Je vous rappelle au demeurant qu’il s’agit seulement de fixer une fourchette, qui ne lie pas le Gouvernement pour la fixation du taux.
M. Christian Eckert, rapporteur général. Le plancher de taux serait triplé et son plafond doublé, cela parait excessif.
M. le président Gilles Carrez. Je soutiens le rapporteur général.
M. Hervé Mariton. Nous avons eu sous la précédente législature, notamment à l’initiative du président Didier Migaud, un débat sur la contribution du secteur financier au rétablissement des finances publiques. Si l’on peut légitimement considérer qu’il faudrait que cette contribution soit plus significative, il ne me semble pas justifié d’en affecter la totalité du produit à un organisme qui n’en a pas manifestement besoin.
M. Charles de Courson. M. Baumel connaît-il le niveau des rémunérations pratiquées par l’ACP ?
L’amendement est rejeté.
*
* *
Réforme du financement de la revalorisation des rentes
Texte du projet de loi :
I.– Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article L. 421-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à compter de l’exercice 2003 » sont remplacés par les mots : « pour les rentes allouées au titre des accidents survenus avant le 1er janvier 2013 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La gestion de cette mission par le fonds fait l’objet d’une comptabilité séparée des autres missions, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ;
2° Après l’article L. 421-6, il est inséré un article L. 421-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421–6–1.– Il est instauré une contribution, à la charge des assurés, affectée au fonds de garantie pour le financement de la mission prévue au IV de l’article L. 421-1. Cette contribution est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu’ils versent aux entreprises d’assurance pour l’assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur tout le territoire de la France métropolitaine, des départements d’outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Un décret fixe son montant dans la limite de 2 % de ces primes ou cotisations. Cette contribution s’applique aux primes émises à compter du 1er juillet 2013. ».
II.– L’article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots « , dans les cas prévus au IV de cet article » ;
2° Le deuxième et le troisième alinéas sont supprimés.
III.– La loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur est ainsi modifiée :
1° À l’article 1er, les mots : « L. 455 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « L. 434-17 du code la sécurité sociale » ;
2° Le second alinéa de l’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d’assurance sont gérées et financées par le fonds de garantie prévu à l’article L. 421-1 du code des assurances, dans les cas prévus au IV de cet article ».
Observations et décision de la Commission :
Lorsque les victimes d’un préjudice corporel à la suite d’un accident de la circulation par un véhicule à moteur sont indemnisées sous forme de rente, elles bénéficient d’un mécanisme de revalorisation indexé sur l’inflation depuis 1951 (106).
Si la rente initiale est versée par l’assureur, sa revalorisation est financée depuis l’origine sur fonds publics, du fait des difficultés qu’avaient autrefois les assureurs pour se couvrir contre le risque d’inflation. La loi de sécurité financière de 2003 a transféré cette charge du budget de l’État vers le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) alors excédentaire, sans contrepartie financière de l’État. Or, cette charge, de 127 millions d’euros en 2011 (dont 36 millions d’euros d’indemnités à verser et 91 millions d’euros de provisions à constituer), pour 9 000 rentes majorées, a fortement dégradé l’équilibre du FGAO (– 443 millions d’euros de fonds propres).
Le présent article propose donc de garantir la pérennité financière du FGAO pour lui permettre d’assurer ses missions fondamentales grâce à deux mesures :
– la création d’une taxe affectée au FGAO pour assurer le financement de la charge de revalorisation du stock des 9 000 rentes versées aux victimes d’accidents causés par des véhicules à moteur avant le 1er janvier 2013 ;
– le transfert au secteur des assurances du financement de la charge de revalorisation sur l’inflation sur le flux des nouvelles rentes versées en raison d’accidents survenus à compter du 1er janvier 2013.
I.– LES MISSIONS DU FGAO ET LE MÉCANISME DE REVALORISATION
DES RENTES EN VIGUEUR
L’instauration d’un Fonds de garantie automobile (FGA), personne morale de droit privé chargée d’une mission d’intérêt général, est antérieure à la mise en place de l'obligation d'assurance elle-même. C'est en effet dès 1951 que le législateur français a mis en place une structure chargée de payer les indemnités allouées aux victimes d'accidents corporels causés par des véhicules terrestres à moteur dont les conducteurs demeuraient inconnus, insolvables ou non assurés, tout en prévoyant une revalorisation à l’inflation des rentes allouées (107).
Le modèle était économiquement intenable et le déficit du Fonds atteignit 6 millions de francs en 1957, de sorte qu’il parut indispensable de le doubler d'une assurance obligatoire de responsabilité civile, instituée par la loi du 27 février 1958 (108). Le législateur s'était en effet, dès 1951, réservé la possibilité de mettre en place cette obligation puisque le Fonds de garantie avait été institué « sans préjudice des dispositions qui pourraient être ultérieurement prises dans le cadre d'un système d'assurances obligatoires ».
Par la suite, le champ d'intervention du Fonds a progressivement été étendu par plusieurs dispositions législatives :
– la loi du 11 juillet 1966 (109) a étendu l’intervention du FGA en ce qui concerne l’indemnisation des dommages corporels causés par un acte de chasse ;
– la loi du 30 novembre 1966 (110) relative aux contrats d'assurance a, d'une part, étendu la compétence du Fonds à certains dommages matériels résultant d'un accident de la circulation alors que, jusque-là, seuls les dommages corporels donnaient lieu à indemnisation ; d'autre part, elle a permis la mise en cause du Fonds en cas de retrait d'agrément de l'assureur du responsable ;
– la loi du 21 décembre 1972 (111) relative à la garantie du risque de responsabilité civile en matière de circulation de certains véhicules terrestres à moteur a étendu l'obligation d'assurance et le champ d'intervention du Fonds aux accidents survenus dans un État de la Communauté européenne ;
– la loi du 27 décembre 1974 (112) a élargi le champ de la revalorisation des rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur ;
– la loi du 7 juin 1977 (113) a considérablement étendu les compétences du Fonds, en prévoyant, dans son article 40, la prise en charge des victimes d'accidents corporels résultant « de la circulation sur le sol » et survenant dans un lieu ouvert à la circulation publique, sans aucune mention d'un véhicule terrestre à moteur. Il est ainsi devenu possible de mobiliser le Fonds pour des accidents impliquant des piétons, des rollers, des bicyclettes, des skieurs, des trottinettes ;
– la loi dite Badinter du 5 juillet 1985 (114) a rendu applicable au Fonds la procédure d'offre et les délais d’indemnisation imposés aux assureurs en matière automobile.
Une chambre mixte de la Cour de cassation a encore étendu, par deux arrêts du 28 mai 1990, la compétence du Fonds aux victimes « d'un accident survenu dans des lieux ouverts à la circulation publique […] lorsque l'accident a été causé en tout ou en partie par un animal ou une chose appartenant à un tiers ou sous sa garde, et dans la mesure de sa responsabilité. » (115).
Enfin, la loi du 1er août 2003 (116) a étendu la compétence du Fonds de Garantie, renommé Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), aux cas suivants : défaillances d'entreprises d'assurances obligatoires ; dommages causés par des animaux qui n'ont pas de propriétaire ou dont le propriétaire demeure inconnu ou n'est pas assuré ; dommages aux biens résultant d'accidents de la circulation sur le sol non causés par des véhicules terrestres à moteur ; et gestion et financement des majorations des rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.
L’ensemble de ces dispositions est désormais codifié aux articles L. 421-1 et suivants du code des assurances.
La gestion et le financement des majorations des rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur constituent en l’espèce une mission annexe du FGAO. Or, le « stock » de rentes à revaloriser a considérablement augmenté ces dernières années, passant de 7 500 rentes à 9 000 rentes en 2012 (+ 20 %). Le montant annuel moyen des rentes est de 30 000 euros. Elles sont versées jusqu’au décès du bénéficiaire (soit jusqu’à plus de 40 ans après l’accident). En outre, l'indemnisation des « accidents corporels lourds », dossiers qui se chiffrent généralement en millions d'euros, intervient le plus souvent sous forme de rentes (50 % des cas contre 20 % en 2002), dans l’intérêt des victimes, qui ne peuvent bien souvent pas vivre sans l'assistance – coûteuse – d'une tierce personne.
La part des dépenses liées à la revalorisation des rentes dans l’ensemble des dépenses du FGAO est devenue très importante alors même qu’aucune contribution affectée n’a été mise en place pour lui permettre d’assumer cette mission. En 2012, le FGAO doit ainsi verser un montant de l’ordre de 40 millions d’euros au titre de la revalorisation de l’inflation des rentes servies par les assureurs, (soit en moyenne 4 000 euros par rente, qui ne correspondent pas à une année d’inflation mais à l’inflation accumulée depuis la constitution de la rente). Le fonds provisionne chaque année plus de 80 millions d’euros supplémentaires pour assurer le paiement des revalorisations futures. Les missions premières du FGAO, et au premier chef l’indemnisation des victimes de conducteurs non assurés, entraînent quant à elle une charge d’environ 160 millions d’euros. Ces montants sont à rapporter aux 170 millions d’euros de ressources annuelles totales du fonds.
La charge de revalorisation des rentes obère donc la situation financière du FGAO, au détriment de sa capacité à assurer ses autres missions. Pour faire face à cette difficulté, plusieurs options étaient envisageables : maintenir le statu quo (et poursuivre la dégradation financière du FGAO), supprimer l’indexation des rentes (option non mentionnée dans l’évaluation préalable), ou transférer la charge de revalorisation des rentes futures à verser au marché de l’assurance et augmenter les ressources du FGAO pour lui permettre de financer la revalorisation du stock de rentes qu’il gère déjà.
II.– LA RÉFORME PROPOSÉE POUR GARANTIR LA PÉRENNITÉ FINANCIÈRE DU FGAO ET LA REVALORISATION DES RENTES À L’INFLATION
La réforme a pour objectif de garantir le financement de la revalorisation des rentes à compter de 2013 au travers de deux mesures :
– d’une part, un transfert au marché de l’assurance de la charge à venir au titre de la revalorisation des nouvelles rentes versées au titre d’accidents intervenus à compter du 1er janvier 2013 ;
– d’autre part, la création d’une ressource nouvelle affectée au financement de la charge incombant toujours au FGAO au titre de la revalorisation du stock des rentes constituées ou en cours de constitution jusqu’au 1er janvier 2013.
Le Rapporteur général estime qu’il s’agit d’une réforme courageuse, qui aurait dû être mise en œuvre dès la constatation de la dégradation financière du FGAO à compter de 2008, ce qui aurait permis de limiter la répercussion de cette charge sur les assurés, laquelle sera comprise entre 3,5 et 7 euros par contrat de responsabilité civile en 2013 selon le comportement commercial des assureurs, suivant qu’ils prendront tout ou partie de cette charge sur leur marge.
A.– LE TRANSFERT AU MARCHÉ DE L’ASSURANCE DE LA CHARGE DE REVALORISATION DES RENTES POUR LES ACCIDENTS SURVENANT À COMPTER DU 1ER JANVIER 2013
Le a) du 1° du I modifie le IV de l’article L. 421-1 du code des assurances pour limiter la mission du FGAO, consistant à gérer et à financer la revalorisation des rentes allouées en réparation d’un préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, aux seules rentes allouées au titre des accidents survenus avant le 1er janvier 2013 (le « stock »). Le b) du 1° précise que, désormais, la gestion de cette mission par le fonds fera l’objet d’une comptabilité séparée selon des modalités fixées par arrêté ministériel.
A contrario, cela signifie que cette mission pèsera sur les assureurs, pour les rentes qui seront allouées en réparation d’un préjudice causé par un accident de ce type à compter du 1er janvier 2013 (le « flux »). Selon l’évaluation préalable annexée au présent article, à terme, entre 650 et 1 300 rentes pourraient être constituées annuellement, étant précisé que la durée moyenne de constitution d’une rente est de 5 ans à compter de la survenance de l’accident (117). Il s’ensuit que les premières dépenses d’indemnisation des compagnies d’assurances au titre de la revalorisation des rentes qui leur auront été transférées ne devraient intervenir qu’à compter de 2018.
Le transfert de la charge à venir aura néanmoins un impact sur les entreprises d’assurance et sur les assurés dès 2013. En effet, les sociétés d’assurance devront provisionner le paiement des rentes futures qui seront allouées conformément aux règles prudentielles en vigueur, c'est-à-dire dès l’année de survenance de l’accident, sur la base des majorations liées aux revalorisations constatées l’année n, et projetées pour le futur (années n+…) - règles auxquelles le FGAO n’est pas soumis (118).
À ce jour, la profession des assureurs a donné son accord de principe au transfert de la charge de revalorisation des nouvelles rentes constituées en raison d’accidents survenant à compter du 1er janvier 2013. Toutefois, elle s’inquiète des conséquences de ce transfert sur les modalités de provisionnement de cette nouvelle charge et leurs conséquences sur les primes des assurés.
Selon la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA), toutes choses égales par ailleurs, sur la base d’une hypothèse d'inflation de 2 % provisionnée par les assureurs, l'impact immédiat, l’année du transfert (2013), serait de 4,3 % des primes RC (responsabilité civile), soit 5,9 euros (119), si les assureurs décidaient de répercuter la totalité du coût engendré par cette nouvelle charge sur les assurés. Selon le Gouvernement, la fourchette d’augmentation serait plutôt comprise entre 1,7 à 2,5 % des primes RC, soit une augmentation de 2,5 à 4 euros par contrat en 2013 (120).
Le Rapporteur général estime néanmoins que le marché des assurances RC est très concurrentiel (150 assureurs, chiffre d’affaires global égal à 7 milliards d’euros par an). S’il ne fait pas de doute que les primes RC pourraient augmenter en 2013, le montant de cette augmentation dépendra du comportement commercial de chaque société d’assurance, certaines d’entre elles pouvant décider d’absorber en tout ou partie cette nouvelle charge dans le cadre d’une stratégie de conquête de nouveaux clients ou de conservation de leur portefeuille de clients.
La FFSA indique également qu’en l’absence de tout plafonnement de la revalorisation, l’apparition d’une hyperinflation n’est pas exclue et constitue un risque financier important qu’il faut provisionner. Sa répercussion sur les assurés pourrait être lourde : selon l’évaluation qu’elle a transmise au Rapporteur général, toutes choses égales par ailleurs, si, lors d'une année, l'inflation est supérieure d'un point à celle prévue au moment du provisionnement, les assureurs devront récupérer 250 millions d’euros sur les assurés, ce qui représente 3,7 % de hausse des primes RC (5,1 euros).
Toutefois, votre Rapporteur général estime que ce risque paraît surestimé. D’une part, en vertu des traités européens, la Banque centrale européenne (BCE) a pour mission de veiller à la stabilité des prix et se fixe un objectif d’inflation de moyen terme inférieur à 2 %. Or, cet objectif de moyen terme a toujours été respecté depuis sa création en 1998. Le remettre en cause serait douter de la crédibilité de la BCE à assumer cette mission pour laquelle elle n’a jamais failli.
D’autre part, l’évaluation préalable de l’article mentionne que la mise en œuvre technique de la valorisation de cette nouvelle charge par les sociétés d’assurances est en cours de discussion avec l’Autorité des normes comptables et l’Autorité de contrôle prudentiel. Ces discussions détermineront les modifications réglementaires nécessaires, le cas échéant : il pourrait ainsi être envisagé de définir par voie réglementaire la référence pertinente pour le provisionnement des rentes, en lien avec l’objectif d’inflation de moyen terme de la Banque centrale européenne. La définition des modalités comptables devrait donc lever les incertitudes sur les modalités de calcul des provisions et limiter également la charge supportée in fine par les assurés.
B.– LA CRÉATION D’UNE CONTRIBUTION AFFECTÉE AU FGAO POUR ASSUMER LA REVALORISATION DES RENTES POUR LES ACCIDENTS SURVENUS AVANT LE 1ER JANVIER 2013
Le 2° du I du présent article instaure une nouvelle contribution, à la charge des assurés, affectée au fonds de garantie pour lui permettre d’assurer, dans des conditions financières soutenables, le financement de la revalorisation du stock de rentes allouées en réparation d’un préjudice survenu du fait d’un accident causé avant le 1er janvier 2013.
Cette contribution serait assise sur toutes les primes ou cotisations nettes versées aux entreprises d’assurance pour l’assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur tout le territoire de la France (hors Polynésie Française et Nouvelle-Calédonie).
Elle serait perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance mais recouvrée mensuellement par le FGAO.
Un décret fixera son montant dans la limite de 2 % de ces primes ou cotisations. Selon les informations transmises au Rapporteur général, le taux permettant au FGAO d’assumer cette mission dans des conditions financières soutenables serait de 0,8 %, soit une augmentation certaine de la prime RC de 1,1 euro par an. L’application de ce taux devrait accroître les recettes du FGAO de 60 millions d’euros en année pleine. Toutefois, dans la mesure où cette contribution ne s’appliquera qu’aux primes émises à compter du 1er juillet 2013, la recette attendue pour 2013 serait d’environ 20 millions d’euros (121).
Grâce à la réforme proposée par le présent article, la gestion en extinction de la revalorisation du stock de rentes par le FGAO ne devrait plus représenter qu’un coût de 50 millions d’euros à l’horizon 2050 (contre 160 millions d’euros en l’absence de réforme), chiffre qui devrait décroître avec le temps jusqu’à extinction totale. Le FGAO pourra donc continuer à exercer ses missions principales tandis que les victimes d’accidents de la route bénéficieront toujours de la revalorisation annuelle à l’inflation de la rente qui leur est versée.
Pour conclure, les II et III du présent article tirent les conséquences légistiques du I en modifiant l’article 3 de la loi du 24 mai 1951 ainsi que les dispositions de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 précitées.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement CF 41 du rapporteur général.
M. Christian Eckert, rapporteur général. L’article 27 prévoit notamment la création d’une contribution affectée au Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages (FGAO), pour l’aider à assumer sa mission de revalorisation, au niveau de l’inflation, des rentes versées aux victimes d’accidents causés par des véhicules à moteur avant le 1er janvier 2013. La contribution serait assise sur les primes des contrats de responsabilité civile et son taux serait fixé par décret dans la limite de 2 %.
Il s’avère qu’une prime de 0,8 % suffirait à couvrir les besoins de financement du FGAO pendant plusieurs années. L’amendement propose donc de ramener le plafond de 2 % à 1 %.
La Commission adopte l’amendement (Amendement n° 36).
Puis elle adopte l’article 27 ainsi modifié.
*
* *
Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2013
Texte du projet de loi :
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2013, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 5 milliards d’euros.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article a pour objet d’autoriser l’octroi de la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic en 2013, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 7 milliards d’euros.
La crise économique a provoqué une hausse des dépenses d’indemnisation versées par l’Unédic et une diminution des ressources perçues par l’organisme et assises sur la masse salariale. En conséquence, comme l’illustrent les graphiques suivants, le solde de l’Unédic s’est fortement dégradé depuis 2009 et resterait négatif en 2012 et 2013. Il en résulte une augmentation constante de l’endettement net de l’organisme.
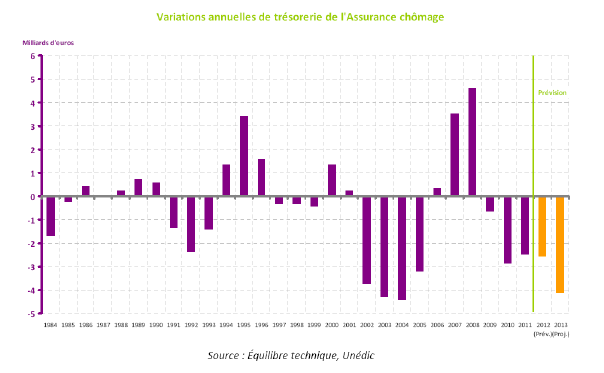
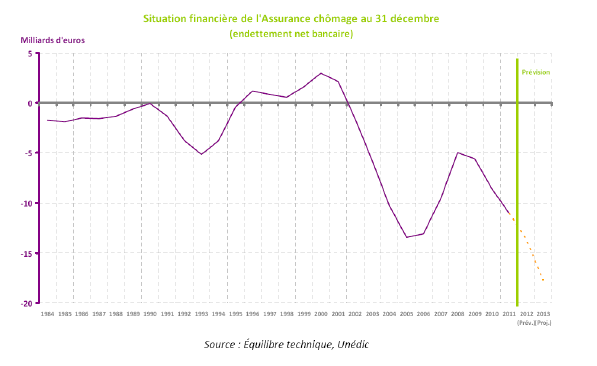
Après 2,5 milliards d’euros en 2011, le déficit de l’Unédic s’établirait à 2,6 milliards d’euros en 2012 puis 4,1 milliards d’euros en 2013. Cette augmentation s’explique par l’anticipation d’un ralentissement de la croissance de la masse salariale, à 2,4 % en 2012 et 1,5 % en 2013, et d’une accélération de l’augmentation du nombre de personnes indemnisées, de l’ordre de 72 000 en 2012, qui devrait être suivie d’une stabilisation en 2013.
En conséquence, la situation financière nette de l’Unédic poursuivrait sa dégradation en 2012 pour atteindre – 13,6 milliards d’euros avant – 17,7 milliards d’euros en 2013. Un tel niveau serait sans précédent dans l’histoire de l’Unédic.
Pour faire face à ses engagements, le conseil d’administration de l’Unédic a, le 26 juin 2009, décidé la mise en place d’un programme de financement composé d’un double volet.
D’une part, l’Unédic a décidé d’un programme d’émissions d’obligations pour lever des financements de moyen terme, dont le plafond a été relevé de 12 milliards d’euros à 14 milliards d’euros et qui doit assurer 51 % du financement du déficit et des tombées de dettes.
Au 23 novembre 2012, l’encours total des obligations émises par l’Unédic dans le cadre de ce programme s’établit à 11,25 milliards d’euros, dont 7,25 milliards garantis par l’État. Le tableau ci-après présente les caractéristiques des émissions obligataires réalisées par l’Unédic.
ÉMISSIONS OBLIGATAIRES DE L’UNÉDIC
Montant * |
Taux d'intérêt |
Maturité |
Garantie de l'État |
4 |
2,125 % |
déc-12 |
Non |
0,25 |
1,37 % |
avr-12 |
Oui |
1,5 |
2,375 % |
mars-14 |
Oui |
2,5 |
1,75 % |
févr-15 |
Oui |
1 |
2,125 % |
avr-17 |
Oui |
1 |
2,125 % |
juin-18 |
Oui |
1 |
3 % |
avr-19 |
Oui |
Source : d’après Unédic.
* En milliards d’euros
L’octroi de la garantie de l’État pour les émissions réalisées en 2011 et en 2012 a été autorisé respectivement par l’article 97 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et par l’article 85 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
D’autre part, l’Unédic a lancé un programme d’émissions de billets de trésorerie pour assurer son financement à court terme, dont le montant a été relevé de 6 milliards d’euros à 12 milliards d’euros et qui doit assurer 49 % du financement de son déficit et des tombées de dettes. Le programme de billets de trésorerie permet aussi à l’Unédic de lever le complément de ressources à court terme dont elle a besoin.
Les instruments de financement ainsi mis en place permettront à l’Unédic de couvrir les besoins relatifs à l’année 2012, lesquels peuvent se résumer ainsi :
– refinancement de l’emprunt obligataire émis en décembre 2009 pour 4 milliards d’euros ;
– couverture du déficit de l’année, prévu à hauteur de 2,6 milliards d’euros.
Concernant l’exercice 2013, les prévisions anticipent un résultat de l’assurance chômage qui resterait négatif, et donnerait lieu à une consommation de trésorerie de l’ordre de 4 milliards d’euros. L’endettement net atteindrait ainsi près de 18 milliards d’euros en fin d’année. Ses modalités de financement – support, rémunération et maturité –seront à préciser en fonction de la situation des marchés financiers.
Le présent article a pour objet d’empêcher l’application des dispositions de l’article L. 213-15 du code monétaire et financier à l’association « loi 1901 » qu’est l’Unédic.
Dans le but de protéger les épargnants, cet article définit les conditions des émissions d’obligations réalisées par les associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901. Il prévoit que, dans l’hypothèse où les déficits accumulés par une association ont conduit à réduire de moitié ou plus ses fonds propres par rapport au montant atteint à la fin de l’exercice précédant une émission d’obligations, l’association doit, dans un délai de deux ans, reconstituer ses fonds propres. À défaut, elle perd le droit d’émettre des obligations et tout porteur de titres déjà émis peut en demander le remboursement anticipé.
L’Unédic a procédé, en 2009, à une émission d’obligations non garanties par l’État. Entre la fin de l’exercice précédant cette émission – l’exercice 2008 – et le 31 décembre 2010, ses fonds propres sont passés de – 4,7 milliards d’euros à - 9,5 milliards d’euros, soit une dégradation de – 102 %. Par ailleurs, l’Unédic est dans l’incapacité de reconstituer ses fonds propres. En conséquence, l’organisme pourrait se voir appliquer les dispositions de l’article L. 213-15 du code monétaire et financier.
Cependant, la loi de finances rectificative pour 2004 (122) prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux émissions d’emprunt réalisées par l’Unédic avec la garantie de l’État. L’octroi de la garantie de l’État prévue au présent article permet donc d’exclure les financements levés en 2013 du champ d’application de l’article L. 213-15 du code monétaire et financier.
La garantie prévue par le présent article permettrait également à l’assurance chômage de profiter d’une diminution de plusieurs points de base de son coût de financement et de conserver la confiance des prêteurs.
Il importe, en effet, de remarquer que la situation financière nette de l’Unédic pourrait être négative de plus de 20 milliards d’euros à fin 2014 – un tel montant représentant plus de 60 % de ses produits annuels. La question de la soutenabilité de la dette de l’Unédic pourrait donc être posée dans un avenir rapproché. L’octroi de la garantie de l’État permet de rassurer les prêteurs sur ce point.
Le présent article a pour objet d’autoriser l’octroi de la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic en 2013, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 7 milliards d’euros.
Sous le plafond de 7 milliards d’euros prévu par le présent article, l’Unédic pourra :
– refinancer une tombée de dette obligataire de 0,25 milliard d’euros, prévue en avril 2013 ;
– financer le déficit de 4 milliards d’euros, prévu en 2013 ;
– le cas échéant, faire face à des besoins de financement imprévus.
À ce stade, l’Unédic prévoit d’émettre, en 2013, pour 5 milliards d’euros d’obligations garanties par l’État.
Comme indiqué plus haut, la loi a déjà autorisé l’octroi de la garantie pour les emprunts contractés en 2011, pour un montant maximal de 7,5 milliards d’euros, et pour les emprunts contractés en 2012, pour un montant maximal de 7 milliards d’euros. Le montant des obligations émises par l’Unédic et garanties par l’État s’établit à 7,25 milliards d’euros au 23 novembre 2012.
Compte tenu de l’accumulation des dettes de l’assurance chômage, qui conduit à s’interroger sur la soutenabilité de son endettement, il n’est pas à exclure que l’État soit appelé à jouer un rôle en la matière, dans l’avenir.
*
* *
La Commission adopte l’article 28 sans modification.
*
* *
Révision du régime de la garantie de l’État accordée à Dexia en 2011
Texte du projet de loi :
I.– Le I de l’article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :
1° Au a), après les mots : « d’investisseurs institutionnels » sont ajoutés les mots : « ou d’autres investisseurs qualifiés au sens de la réglementation qui leur est applicable, y compris les filiales directes ou indirectes de Dexia SA ou de Dexia Crédit Local SA » ;
2° La première phrase du quatrième alinéa devient un alinéa et est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « garantie » sont ajoutés les mots : « porte sur le principal, les intérêts, frais et accessoires des financements, obligations et titres de créances garantis. Elle » ;
b) Le montant : « 32,85 milliards » est remplacé par le montant : « 38,76 milliards » ;
c) Après les mots : « milliards d'euros » sont ajoutés les mots : « en principal. Les financements, obligations ou titres de créances bénéficient de la garantie de l’État si, à la date de leur émission ou souscription ou, s’agissant des titres mentionnés au b), à la date à laquelle la garantie de l’État est accordée, le montant en principal de l’encours garanti par l’État au titre du présent I n’excède pas le montant mentionné ci-dessus, en tenant compte, pour les financements, obligations ou titres de créances libellés en dollars des États-Unis d’Amérique, dollars canadiens, livres sterling, yen ou francs suisses de la contrevaleur en euros, à cette date, de leur encours en principal. » ;
3° Après cette phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants en principal garantis par l'État au titre du présent I, appréciés à la date de chaque émission ou souscription ou de chaque série d’émissions ou souscriptions concomitantes, ne peuvent être supérieurs à 45,59 % de la somme des montants d’encours en principal des financements, obligations ou titres de créance levés ou émis par les sociétés concernées à compter de la date de publication de la présente loi et garantis par l’État, le Royaume de Belgique et le Grand Duché de Luxembourg, conjointement ou non. » ;
4° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du b), qui devient un alinéa, après les mots : « s’exercera » sont ajoutés les mots : « , sauf dispositions contraires des conventions conclues par le ministre chargé de l’économie mentionnées au III du présent article, » et le pourcentage : « 36,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 45,59 % ».
II.– Les dispositions des 1° et a) et c) du 2° du I du présent article s’appliquent à toute garantie accordée par le ministre chargé de l’économie en application des I et III de l’article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 antérieurement à la date de publication de la présente loi.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article a pour objet principal de revoir à la hausse, de 32,85 milliards d’euros à 38,76 milliards d’euros, le plafond de la garantie de financement accordée à Dexia et prévue par la loi de finances rectificative de novembre 2011 (123).
À titre subsidiaire, cet article prévoit plusieurs ajustements du régime de cette garantie, destinés à faciliter le refinancement de Dexia.
Le 8 novembre dernier, la France et la Belgique se sont accordées sur :
– une recapitalisation de 5,5 milliards d’euros, répartie à hauteur de 53 % – soit 2,915 milliards d’euros – pour la Belgique et 47 % – soit 2,585 milliards d’euros – pour la France, qui fait l’objet d’une ouverture de crédits à due concurrence à l’état B du présent projet de loi ;
– un relèvement de la quote-part de la France, de 36,5 % à 45,6 %, dans la garantie de financement prévue par la loi de finances rectificative de novembre 2011, qui est l’objet principal du présent article.
Après une première recapitalisation réalisée à l’automne 2008 (124), au moment du premier plan de sauvetage de l’établissement, la France et la Belgique se sont accordées, le 8 novembre dernier, sur une deuxième recapitalisation d’un montant total de 5,5 milliards d’euros, dont 2,585 milliards d’euros pour la France.
La recapitalisation est partagée entre la Belgique et la France, qui en supportent respectivement 53 % et 47 % du montant. La part de la France est revue à la baisse par rapport à la part de 50 % qu’elle avait assumée au moment de la recapitalisation de 2008. Cette nouvelle répartition, qui permet de réaliser une économie de 165 millions d’euros, s’explique par la révision de la quote-part respective de la France et de la Belgique dans la garantie de financement – qui fait l’objet d’un développement infra.
En l’absence de recapitalisation, Dexia SA constaterait, au 31 décembre 2012, que la valeur de ses fonds propres est inférieure à la moitié de son capital social, ce qui entraînerait l’application de l’article L. 223-42 du code du commerce, et le cas échéant, la dissolution de la société. Une telle issue conduirait à l’appel des garanties de financement des États – soit un coût potentiel de l’ordre de 26,4 milliards d’euros pour le budget de l’État – et à une déstabilisation de l’ensemble du système financier de la zone euro.
Pour mémoire, le montant des fonds propres de Dexia SA au 1er janvier 2012 s’établissait à 2,8 milliards d’euros, soit un niveau légèrement supérieur à celui de la moitié de son capital social – 2,4 milliards d’euros. Compte tenu de l’anticipation de nouvelles pertes en 2012, ce seuil serait franchi, à la baisse, en l’absence de recapitalisation.
La recapitalisation décidée par la France et la Belgique le 8 novembre dernier est la conséquence directe de la perte de 16,4 milliards d’euros constatée en 2011, qui a conduit à un effondrement des fonds propres de Dexia SA – de 19,2 milliards d’euros au 31 décembre 2010 à 2,8 milliards d’euros au 31 décembre 2011.
Cette lourde perte était due à deux éléments principaux.
D’une part, la mise en œuvre du plan de démantèlement décidé à l’automne dernier a conduit à la réalisation de cessions de filiales (125) avec d’importantes moins-values. Ces moins-values ont été d’autant plus élevées que certaines cessions ont été réalisées, du fait de la pression d’un État, dans des conditions qui ne protégeaient pas de manière optimale les intérêts financiers de Dexia.
Il importe de remarquer que ces cessions étaient requises, dans le cadre du plan de démantèlement, pour permettre la diminution de l’actif de Dexia et donc ses besoins de financement. Le total du bilan du groupe devrait ainsi atteindre environ 250 milliards d’euros à fin 2013, en ligne avec les prévisions faites à l’automne dernier.
D’autre part, Dexia SA a dû provisionner la totalité de sa participation de 5 milliards d’euros dans l’une des dernières filiales qui demeureront, en l’espèce Dexia Crédit Local (DCL). La valeur de cette participation ne pourrait plus être justifiée car DCL ne serait plus en mesure de produire les flux de trésorerie qui font sa valeur. Compte tenu du coût de son financement et du rendement attendu des actifs qu’elle détient, DCL ne serait, en effet, plus en capacité de produire des résultats dans les années qui viennent.
À ces deux principaux éléments, s’ajoutent deux autres opérations qui ont conduit à amputer les fonds propres de Dexia en 2011.
En premier lieu, au premier semestre 2011, alors que l’établissement tentait encore de rééquilibrer sa structure financière dans la perspective d’un maintien de son activité, il avait cédé un portefeuille d’actifs de mauvaise qualité – portefeuille dit « Financial products » – en acceptant une moins-value de 1,9 milliard d’euros.
En second lieu, le plan de restructuration de la dette de l’État grec a conduit le groupe à constater des provisions sur ces titres pour 1,9 milliard d’euros.
Le tableau ci-après recense les principaux éléments qui ont conduit à la diminution accélérée des fonds propres de Dexia SA.
ÉVALUATION DES FONDS PROPRES DE DEXIA SA
(en milliards d’euros)
Fonds propres au 1er janvier 2011 |
19,2 |
Provision sur la participation dans DCL |
–5,9 |
Moins-value sur la cession de DBB |
–3,7 |
Cession du portefeuille « Financial products » |
–1,9 |
Restructuration dette grecque |
–1,9 |
Moins-value sur la cession de DIL |
–1,3 |
Autres éléments exceptionnels |
–1,7 |
Fonds propres au 31 décembre 2012 |
2,8 |
Résultat net du premier semestre 2012 |
–1,2 |
Fonds propres au 31 décembre 2012 |
< 2,4 |
Source : d’après rapport annuel et communiqués de presse.
Selon les informations transmises au Rapporteur général, le montant de la recapitalisation aurait été fixé de façon à faire face aux fluctuations de la valeur de l’actif de DCL, qui, pour des raisons comptables, peut varier de plusieurs centaines de millions d’euros d’un trimestre à l’autre.
Selon le Gouvernement, cette recapitalisation permettrait également d’absorber les pertes prévues dans les années à venir. Ces pertes seraient principalement dues à une rentabilité structurellement négative de l’établissement – les revenus tirés des actifs résiduels – ne couvrant pas ses frais de fonctionnement et de financement ainsi qu’à d’éventuelles provisions sur les actifs de mauvaise qualité.
Dans l’hypothèse où le résultat du second semestre 2012 serait de même niveau que celui du premier, Dexia constaterait une perte de l’ordre de 2,4 milliards d’euros en fin d’année. Ses fonds propres, après recapitalisation, atteindraient 5,5 milliards d’euros, laissant une marge de sécurité de 3,1 milliards d’euros par rapport au seuil de 50 % du capital social.
Selon le Gouvernement, cette recapitalisation devrait suffire à absorber les pertes prévues dans les années à venir sous plusieurs hypothèses, notamment celle d’une résolution progressive de la crise de la zone euro. Dexia serait, en effet, particulièrement exposé aux risques souverains et sub-souverains italiens et espagnols, via ses filiales Crediop et Sabadell, dont l’actif total serait de l’ordre de 50 milliards d’euros.
Le profil de rentabilité de l’établissement serait, en outre, renforcé par la diminution de 90 points de base à 5 points de base du coût de la garantie de financement des États. La Commission européenne ayant estimé que Dexia n’était plus partie prenante au sein du marché des services financiers, elle a accepté que la rémunération de la garantie ne soit plus fixée au prix de marché. L’économie pour Dexia pourrait atteindre près de 700 millions d’euros par an en régime de croisière, la perte de recettes pour le budget de l’État étant de l’ordre de 300 millions d’euros.
Il importe néanmoins de remarquer que Dexia garde à son bilan un portefeuille d’actifs financiers – principalement obligations et produits dérivés – pour environ 100 milliards d’euros, dont une part non négligeable de plusieurs milliards d’euros serait classée en catégorie spéculative. Le constat de moins-values sur ces titres conduirait à aggraver les pertes de l’établissement et à accroître le risque d’une nouvelle recapitalisation.
La recapitalisation fait l’objet, dans le présent projet de loi, d’une ouverture de crédits de 2,585 milliards d’euros sur un nouveau programme Recapitalisation de Dexia de la mission Engagements financiers de l’État, qui seront versés sur le compte d’affectation spéciale Participations financières de l’État. Depuis ce compte, une dotation en capital d’un montant identique sera versée à la société de prises de participation de l’État (SPPE) pour qu’elle soit en mesure de souscrire à l’augmentation de capital de Dexia SA.
Ces crédits seront consommés entre la date d’entrée en vigueur du présent projet de loi et le 31 décembre. L’opération doit impérativement être réalisée avant le 31 décembre 2012 pour qu’en fin d’exercice, le niveau des fonds propres ne soit pas inférieur à la moitié du capital social.
La comptabilisation de cette dépense dans le solde public est encore incertaine. Elle en sera exclue si Eurostat estime que l’État agit en investisseur avisé.
Le 8 novembre dernier, la France et la Belgique se sont accordées sur une nouvelle clé de répartition de la garantie de financement prévue par la loi de finances rectificative de novembre 2011.
La part de la France passerait de 36,5 % à 45,59 % quand celle de la Belgique diminuerait de 60,5 % à 51,41 % – la part du Luxembourg restant stable à 3 %.
Compte tenu de la diminution de 90 milliards d’euros à 85 milliards d’euros du montant total de la garantie (126), la part de la France passerait, comme le prévoit le b) du 2° du I du présent article, de 32,85 milliards d’euros à 38,76 milliards d’euros en principal.
Après cet accord, l’engagement envers Dexia au titre de cette deuxième garantie de financement reste, par rapport à son PIB, nettement plus élevé que celui de la France – près de 12 % du PIB contre moins de 2 % du PIB pour la France.
La révision de la part de la France dans la garantie est la contrepartie de la diminution de sa part dans la recapitalisation, décrite plus haut. En échange d’une exposition plus importante sur la garantie de financement, la France bénéficie d’une économie de 165 millions d’euros sur la recapitalisation.
Surtout, il semble que le risque financier réside davantage, pour les États, dans une nouvelle recapitalisation que dans un très hypothétique appel en garantie. Un appel en garantie serait inacceptable pour les États, notamment pour la Belgique qui est exposée sur un montant représentant plus de 10 % de son PIB. Une telle hypothèse paraît d’autant moins envisageable qu’un défaut de Dexia pourrait être encore porteur de risque systémique pour le système financier de la zone euro. En revanche, comme indiqué plus haut, il n’est pas à exclure que de nouvelles recapitalisations soient nécessaires à l’avenir pour combler de nouvelles pertes. Dans une telle hypothèse, la quote-part de 47 % de la France est préférable à la quote-part, retenue en 2008, de 50 %.
Il est toutefois à noter que le traitement, en comptabilité nationale, de la dette garantie par les États n’a pas encore été précisé par Eurostat. Dans l’hypothèse où Dexia était considéré comme une structure de défaisance, la totalité de sa dette garantie serait consolidée en dette publique brute, à concurrence de la quote-part de chaque État dans la garantie – soit un montant de près de 2 % du PIB en ce qui concerne la France.
Le Gouvernement fait toutefois valoir que Dexia demeure un établissement de crédit soumis à la réglementation prudentielle et, à ce titre, ne saurait être qualifié de structure de défaisance.
Aux termes du II, les trois premières modifications du régime de la garantie de financement, prévues par le présent article, s’appliquent de manière rétroactive à l’ensemble des émissions obligataires garanties par l’État et réalisées depuis l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative de novembre 2011.
En premier lieu, le 1° du I étend le champ de la garantie aux financements levés par les sociétés Dexia SA et Dexia Crédit Local SA :
– auprès d’« investisseurs qualifiés », qui s’ajoutent aux investisseurs institutionnels mentionnés par la LFR de 2011 pour adapter le régime de la garantie aux qualifications juridiques retenues dans d’autres pays de l’Union européenne et à l’étranger ;
– auprès des filiales directes ou indirectes de Dexia SA et Dexia Crédit local – les « émissions intra-groupes ». Ces filiales auraient ainsi à leur bilan des titres garantis par les États, qui pourront leur servir de collatéral afin de lever des fonds auprès de tiers.
En deuxième lieu, le b) du 2° du I précise que la garantie porte sur le principal, les intérêts, frais et accessoires des financements garantis. Cette définition du champ de la garantie est usuelle.
En troisième lieu, le c) du 2° du I précise les modalités de prise en compte des émissions réalisées en devises. Pour apprécier si une émission garantie par l’État ne va pas conduire au dépassement du plafond de la garantie, le montant des émissions réalisées en devises est apprécié selon le cours de change en vigueur à la date de réalisation de l’émission à réaliser. Une telle précision semble d’autant plus importante que les émissions en devises ont pu représenter, en 2009 et 2010, jusqu’à 45 % du montant total des financements garantis.
Une dernière modification vaut pour les émissions qui seront réalisées dans l’avenir.
Le 3° ouvre ainsi la possibilité de garantir la totalité d’une émission dès lors que, sur l’ensemble des financements garantis, la quote-part de l’État demeure égale à 45,59 %. Une telle disposition a pour objet de limiter les coûts de financement de Dexia, qui peuvent être accrus du fait de la complexité engendrée par le fait qu’une émission obligataire de Dexia fait normalement l’objet d’une triple garantie. Il semble en effet que la complexité résultant de la triple garantie octroyée aux financements explique paradoxalement le fait que les coûts de financement de Dexia soient légèrement supérieurs à ceux de la Belgique.
*
* *
La Commission examine l’amendement CF 39 du rapporteur général.
M. le rapporteur général. Il s’agit de prévoir la présence d’un député et d’un sénateur au conseil d’administration de Dexia Crédit Local, à qui l’État accorde une garantie de près de 39 milliards d’euros. Les parlementaires seraient désignés par les commissions des Finances en qualité de censeurs et n’auraient pas voix délibérative.
M. Hervé Mariton. Bien que je sois favorable au cumul des mandats, je ne suis pas convaincu qu’il soit opportun que des parlementaires, qui peuvent également être élus locaux, siègent au conseil d’administration de Dexia.
Sur la forme de l’amendement, est-il juste de mentionner les commissions permanentes chargées des finances ? L’amendement prévoit par ailleurs que les parlementaires soient désignés par la commission, et non par le président ou le bureau. Cela suppose-t-il un vote ?
M. le rapporteur général. La notion de commission permanente est correcte. La désignation par la commission est prévue par le règlement de l’Assemblée.
M. le président Gilles Carrez. Je m’interroge également sur la présence de parlementaires au sein du conseil d’administration d’entreprises. L’expérience a montré que les parlementaires peuvent se trouver alors en porte-à-faux. M. de Courson pourra le confirmer.
M. Charles de Courson. La présence de parlementaires au conseil d’administration d’une entreprise publique doit être évitée. Mais il s’agit ici en l’espèce d’une sorte de structure de défaisance, sur laquelle il serait utile que nous soyons bien renseignés. Je suis d’ailleurs à la disposition de la commission pour présenter les décisions importantes que devra prochainement prendre l’Établissement public de financement et de restructuration (EPFR).
Mme Valérie Rabault. L’article prévoit d’augmenter le montant de la garantie de 6 milliards d’euros. Comment cela s’inscrit-il dans le cadre des décisions prises au niveau européen ?
M. le rapporteur général. En contrepartie, la part de la France dans la recapitalisation diminue de 50 % à 47 %, soit une économie de 165 millions d’euros.
Mme Karine Berger. Ces 6 milliards sont-ils pris en compte dans le calcul de la dette « maastrichtienne » ?
M. Christian Eckert, rapporteur général. Le fait que Dexia soit encore soumise à la réglementation prudentielle laisse croire que ces 6 milliards ne sont pas consolidés dans la dette « maastrichtienne ».
Mme Valérie Rabault. Je crois me souvenir que la Cour des comptes a évoqué en juillet dernier un rapport sur Dexia. Où en est-on ?
M. le président Gilles Carrez. La Commission n’a pas reçu communication d’un tel rapport.
L’amendement est adopté (Amendement n° 214).
Puis la Commission adopte l’article 29 ainsi modifié.
*
* *
Amélioration du financement des exportations
Texte du projet de loi :
I.– La garantie de l'État peut être accordée, en totalité ou en partie, à la Compagnie française d’assurance du commerce extérieur :
1° Pour sa garantie couvrant les risques de non-paiement relatifs au financement d’exportations d’avions civils de plus de dix tonnes au décollage et d’hélicoptères civils de plus d’une tonne au décollage.
Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du financement. Elle peut être accordée :
a) Aux fournisseurs de l’aéronef ou à leurs filiales ;
b) Aux établissements de crédit et établissements financiers de droit français ou étranger ;
c) Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;
d) Aux organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ;
e) À titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d’investisseurs à l’émission d’obligations en vue du financement d’opérations d’exportation, ainsi qu’aux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat ou pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l'entité ayant procédé à leur émission.
2° Pour sa garantie couvrant les risques de change sur la valeur résiduelle d’aéronefs civils acquis à crédit dans le cadre d’une opération d’exportation sans la garantie visée au 1° du présent article ou l’assurance mentionnée au a) du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances. Cette opération ne peut bénéficier d’aucune autre garantie de la Compagnie française d’assurance du commerce extérieur.
Ces garanties peuvent être accordées :
a) Aux établissements de crédit et aux établissements financiers de droit français ou étranger ;
b) Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;
c) À titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d’investisseurs à l’émission d’obligations en vue du financement d’opérations d’exportation, ainsi qu’aux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat.
3° Pour sa garantie couvrant les risques de non-paiement au titre de contrats conclus en vue du refinancement d’opérations assurées au titre du a) du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances.
Cette garantie ne peut couvrir que le risque de non-paiement d’établissements de l’Union européenne dont l’échelon de qualité de crédit est supérieur ou égal à 3 à la date d'octroi de la garantie, cet échelon de qualité de crédit étant celui défini par la réglementation fixant, à la date de publication de la présente loi, les exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, ou dont la qualité de crédit est équivalente à cet échelon selon une réglementation postérieure.
Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du refinancement. En cas de défaillance de l’établissement de crédit ayant consenti la créance couverte par l’assurance-crédit à l’exportation, le droit au bénéfice de l’indemnisation au titre de cette assurance-crédit est délégué à l’établissement bénéficiaire de la garantie de refinancement, sans que ce droit puisse subir le concours d’un autre créancier de rang supérieur quelles que soient la loi applicable à ces créances et la loi du pays de résidence des créanciers, des tiers ou des débiteurs et nonobstant toute clause contraire des contrats régissant ces créances.
Cette garantie peut être accordée :
a) Aux établissements de crédit, aux établissements financiers de droit français ou étranger ;
b) Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;
c) Aux organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ;
d) À titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société ayant son siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques ayant procédé auprès d’investisseurs à l’émission d’obligations en vue du financement d’opérations d’exportation, ainsi qu’aux personnes morales de droit français ou relevant du droit d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat, pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l'entité ayant procédé à leur émission.
Les garanties mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont accordées par le ministre chargé de l’Économie après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur instituée par l'article 15 de la loi
n° 49-874 du 5 juillet 1949.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
II.– Le code des assurances est ainsi modifié :
1° À l’article L. 432-4, les mots : « de l’article L. 432-2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 432-2 et de l’article □□ de la loi n° 2012-□□□□ du □□ décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 » ;
2° Après l’article L. 432-4, il est inséré un article L. 432-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-5. - La garantie de l'État peut également être accordée à la Compagnie française du commerce extérieur dans les conditions fixées à l’article □□ de la loi n° 2012-□□□□ du □□ décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 » ;
3° Le b) du 1° de l'article L. 432-2 est abrogé à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’article □□ de la loi n° 2012-□□□□ du □□ décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et au plus tard le 1er janvier 2014.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article propose de compléter le dispositif d’assurance-crédit, géré, pour le compte de l’État, par la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (Coface), afin d’améliorer le financement de l’aide à l’export de produits fabriqués en France à travers :
– deux mesures relatives au secteur des aéronefs civils : l’extension de la garantie pure et inconditionnelle, jusqu’alors réservée aux gros porteurs Airbus, aux aéronefs de plus de dix tonnes et aux hélicoptères de plus d’une tonne au décollage, d’une part, et la création d’une garantie sur la valeur résiduelle de change des aéronefs français acquis à crédit, d’autre part. Ces deux garanties sont exclusives l’une de l’autre ;
– une mesure bénéficiant à l’ensemble des exportations françaises à l’exclusion des aéronefs civils : la création d’une garantie de refinancement d’opérations d’exportations déjà couvertes par une assurance-crédit.
Le présent article constitue ainsi la première mesure de mise en œuvre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi (décision n° 15) annoncé par le Premier ministre à l'issue du Conseil des ministres du 7 novembre 2012 (127) pour soutenir les exportations françaises en améliorant leurs conditions de financement par le secteur privé, dans le prolongement du rapport présenté le 5 novembre dernier par M. Louis Gallois (128).
I.– LE FINANCEMENT DE L’AIDE À L’EXPORT PAR L’ASSURANCE-CRÉDIT
Pour soutenir leurs exportations, la plupart des pays de l’OCDE ont mis en place des garanties publiques sur les crédits à l’exportation octroyés par les banques privées en faveur des entreprises exportatrices.
La garantie ainsi apportée peut consister à couvrir l’exportateur (assurance-crédit fournisseur (129)) ou sa banque (assurance-crédit acheteur (130)) contre le risque de défaut de remboursement d’un crédit à l’exportation octroyé à l’acheteur (l’importateur).
Ce mécanisme aide les entreprises à développer leurs activités quand les banques privées considèrent qu’il est trop risqué pour elles d’intervenir seules, soit en raison des risques inhérents au pays de destination (risque politique sur le pays de l’acheteur (131) ou risque d’événement catastrophique (132)) soit en raison de la nature des concours (volume financier, durée d’emprunt, etc.) qui laisse planer un risque de non-paiement de la part de l’acheteur.
Un accord multilatéral, communément dénommé « l’Arrangement OCDE (133) », négocié entre les membres de l’Organisation (134), fixe depuis 1978 les lignes directrices en matière de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, afin d’éliminer les distorsions entre les échanges. Il est régulièrement adapté pour tenir compte des évolutions de l’économie mondiale et des échanges commerciaux internationaux.
Compte tenu des caractéristiques techniques et financières particulières à certains secteurs, le régime applicable aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public a été fixé dans des accords séparés, appelés « Accords sectoriels ». Ceux-ci concernent les domaines des navires, des centrales nucléaires, des aéronefs civils et de l’environnement et font l’objet des annexes I à IV de l’Arrangement OCDE précité.
2.– L’assurance-crédit publique en France : un des instruments de la boîte à outils en faveur du financement de l’export
En France, la Coface, agence spécialisée dans l’assurance-crédit et filiale de Natixis, exerce à la fois des activités pour son compte propre et pour le compte de l’État à travers la gestion des garanties publiques.
Institué par la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à certaines dispositions d’ordre économique et financier (articles 16 et 17), le régime d’octroi de garanties publiques par la Coface est régi par les articles L. 432-1 à L. 432-4 du code des assurances. Outre le dispositif d’assurance-crédit qui fait l’objet du présent article, la Coface gère d’autres produits destinés à soutenir les entreprises françaises à l’exportation : l’assurance-prospection (prise en charge des coûts de prospection de nouveaux marchés internationaux), la garantie des investissements à l’étranger (pour protéger les exportateurs du risque politique), l’assurance des cautions et des préfinancements (pour faciliter la mise en place de tels outils) et la garantie contre le risque de change (pour exporter en devises sans subir le risque de change).
Afin de répondre au mieux aux nombreux risques encourus par l’exportateur durant les différentes phases du déroulement de son contrat d’exportation ou par les banques qui mettent en place les schémas de financement, l’assurance-crédit publique – appelée « crédit-export » à la Coface – garantit l’exportateur ou la banque finançant l’opération d’exportation contre les risques en période de fabrication (risque d’interruption de marché et/ou de non-paiement) et/ou le risque de non-remboursement du crédit. L’assuré peut aussi choisir de faire garantir le risque « politique » seul, le risque « commercial » seul ou les deux risques associés. Le taux de couverture, appelé quotité garantie, est généralement fixé à 95 %. Il peut être réduit au cas par cas.
Régi par le 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances, le dispositif d’assurance-crédit a d’abord été complété par l’article 83 de la loi de finances rectificative pour 2001 qui a introduit une garantie pure (100 % du crédit) et inconditionnelle (quelle que soit la nature du défaut de l’importateur ou du risque constaté) – dite GPI – au profit des exportations d’avions gros porteurs Airbus, à l’image du soutien public dont bénéficiait déjà le constructeur américain Boeing de la part de ses autorités nationales (135). La GPI est en effet beaucoup plus protectrice que le régime de l’assurance-crédit qui ne donne droit à indemnisation que sous certaines conditions et qui est soumise à certaines restrictions : le montant assuré ne représente que 95 % du montant du crédit à l’exportation ; l’indemnisation ne peut être accordée qu’à l’expiration d’un délai constitutif du sinistre (90 jours) et l’assurance ne couvre pas tous les risques : sont exclus le risque fiscal (impositions non prévues dans le contrat), le risque de documentation (rédaction ambiguë des conventions de prêts), ou encore le risque juridique et le risque de change.
Le régime de l’assurance-crédit a également été modifié par l’article 121 de la loi de finances rectificative pour 2008 qui a étendu son champ aux « opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l’économie française à l’étranger » (136). Concrètement, il s’agissait d’étendre la garantie à des projets qui ne comportent pas ou peu d’exportations françaises mais qui sont pour autant très importants pour l’économie française (sécurisation des approvisionnements en ressources énergétiques et en matières premières).
Depuis 1995, l’assurance-crédit présente un solde excédentaire et ne suscite donc pas de dépense budgétaire contrairement à d’autres garanties publiques. En effet, les produits perçus par la Coface continuent de dépasser les indemnités versées, à tel point que les excédents dégagés, bien qu’en baisse régulière depuis 2007, permettent à l’État de mettre la compagnie à contribution pour abonder ses propres ressources (400 millions d’euros prélevés en 2013, contre 850 millions d’euros en 2010 et 2,5 milliards d’euros en 2008).
RÉSULTATS DE L’ASSURANCE-CRÉDIT COFACE 2002-2011
(en milliards d’euros)
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 | |
Primes |
299,0 |
241,0 |
216,0 |
155,0 |
206,0 |
159,0 |
144,4 |
176,6 |
380,1 |
318,5 |
Indemnités |
(925,0) |
(485,0) |
(384,0) |
(254,0) |
(87,0) |
(31,0) |
(25,0) |
(0,7) |
(15,2) |
(280,9) |
Récupérations |
1 122,0 |
1 420,0 |
1 676,0 |
2 826,0 |
5 383,0 |
1 332,0 |
2 306,9 |
974,3 |
500,4 |
428,6 |
Convention financière |
(37,0) |
(37,0) |
(33,0) |
(36,0) |
(35,0) |
(36,0) |
(36,8) |
(33,5) |
(34) |
(28,7) |
Résultat financier |
150,0 |
57,0 |
55,0 |
57,0 |
90,0 |
217,0 |
209,0 |
57,7 |
32,4 |
44 |
Divers autres |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
13,0 |
30,0 |
26,0 |
(280,7) |
(137,9) |
(33,6) |
31,7 |
Résultat |
609,0 |
1 200,0 |
1 534,0 |
2 761,0 |
5 587,0 |
1 667,0 |
2 317,8 |
1 036,5 |
898,0 |
513,2 |
Source : réponse au questionnaire budgétaire sur la mission Engagements financiers de l’État, PLF 2013.
NB. Données négatives entre parenthèses.
En 2011, la Coface a délivré 179 polices d’assurance-crédit sur contrats conclus, pour 12,4 milliards d’euros. Ce montant est en augmentation par rapport à 2008 mais en baisse depuis l’année record de 2009 (20 milliards d'euros sur 290 contrats conclus). Au 30 septembre 2012, 123 promesses sur contrats conclus avaient été délivrées pour un montant de 7,6 milliards d'euros.
Comme le souligne le Pacte pour la compétitivité de l’industrie française proposé par M. Louis Gallois, Commissaire général à l’investissement, au Premier ministre le 5 novembre dernier, la progression des exportations est une priorité nationale au vu des médiocres résultats des dix dernières années : globalement, le solde de la balance commerciale est passé d’un excédent de 3,5 milliards d’euros en 2002 à un déficit de 71,2 milliards d’euros (soit 3,5 points de PIB), en 2011. La balance hors énergie était de + 25,5 milliards d’euros en 2002, elle était de
– 25,4 milliards d’euros, en 2011.
Parmi les solutions simples et rapides à mettre en place, ce Pacte propose notamment l’alignement des conditions de crédit et des garanties export, en volume, quotité et taux, sur le meilleur niveau constaté dans les pays avancés, et la création d’un « prêteur direct » public afin d’enrayer le resserrement des conditions de crédits bancaires et de rattraper notre retard de compétitivité (6ème proposition) (137).
Les outils de garantie existants connaissent aujourd’hui des limites du fait des difficultés des marchés du financement bancaire à long terme. En raison des règles prudentielles définies par l’accord dit Bâle III, les banques des pays de l’OCDE sont contraintes de réduire la taille de leur bilan, ce qui conduit à une diminution des volumes de prêts et un renchérissement des financements de long terme des projets les plus importants.
En particulier, sur les marchés libellés en dollars – comme le marché aéronautique – les banques européennes et françaises, en particulier, se trouvent dans une situation de plus en plus contrainte pour accéder aux liquidités en dollars : en effet, elles ne possèdent pas ou peu de dépôts en dollars et doivent donc emprunter des dollars sur le marché interbancaire auprès d’autres établissements disposant de réserves en dollars. Or, ces établissements, appelés « Money market funds », ont restreint leurs prêts en dollars au profit des banques françaises ou ont relevé leur rémunération, renchérissant le coût du crédit. Enfin, le marché des swaps euro/dollar connaît également un rétrécissement, notamment sur les maturités de moyen et long terme (au-delà de 8 ans).
Les difficultés d’accès aux crédits bancaires et le renchérissement du financement des exportations sont corroborés par l’augmentation constante de l’encours de la garantie publique octroyée en France, comme dans le reste de l’OCDE, depuis l’éclatement de la crise financière, dans la mesure où le financement privé n’est plus compétitif par rapport au financement reposant sur le soutien public. Alors qu’il était resté relativement stable entre 2006 et 2008, l’encours de l’assurance-crédit géré par la Coface a fortement progressé, passant de 42 milliards d’euros en 2008 à 64 milliards d’euros fin 2011 (+ 51 %), pour pallier les difficultés d’accès au marché dans un environnement incertain.
ENCOURS GARANTIS PAR L’ASSURANCE-CRÉDIT COFACE DEPUIS 2004
(en millions d’euros)
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 | |
Assurance-crédit |
51 540 |
50 357 |
42 956 |
42 111 |
42 401 |
52 918 |
59 459 |
64 170 |
dont moyen terme |
49 482 |
48 702 |
42 475 |
41 774 |
42 134 |
52 683 |
59 159 |
63 872 |
dont court terme |
2 058 |
1 655 |
482 |
337 |
267 |
235 |
300 |
298 |
Source : réponse au questionnaire budgétaire sur la mission Engagements financiers de l’État, PLF 2013.
En outre, en 2011, le nombre de déclarations de menaces de sinistres a progressé de 52 % (138) et le montant des indemnités versées au titre de l’assurance-crédit a atteint 280 millions d’euros contre 15 millions d’euros en 2010, démontrant les difficultés croissantes rencontrées par les exportateurs ou leur banque face au risque de non-paiement des importateurs.
3.– La perte de compétitivité des instruments de financement du crédit-export face à la concurrence européenne et internationale
Face à ces difficultés de refinancement auprès du secteur privé, qui affectent tous les secteurs d’activité et en particulier ceux qui exportent en dollars, plusieurs États, notamment dans les pays du G8, ont mis en place de nouvelles procédures de soutien financier aux exportations ou réactivé des dispositifs de soutien public existants.
Ainsi, les principaux pays exportateurs de l’OCDE (États-Unis, Japon, Canada, Allemagne, Italie, etc.) disposent de prêteurs (ou de refinanceurs) publics directs proposant des financements généralement moins coûteux que ceux dont bénéficient les exportateurs français auprès des banques privées. En pratique, le prêteur public accorde lui-même un prêt à l’importateur à un taux d’intérêt plus compétitif qu’un prêt équivalent octroyé par une banque privée couverte par une police d’assurance-crédit donnant lieu au versement d’une prime supplémentaire. Hormis l’Italie qui a mis en place ce dispositif récemment (via la Caisse des Dépôts italienne), ces mécanismes existent depuis plusieurs années dans les autres pays et ont été particulièrement utilisés pour soutenir les exportations dans les années récentes.
Par ailleurs, l’Allemagne, qui dispose depuis une trentaine d’années d’une garantie de refinancement des banques ayant accordé un crédit-export, l’a modernisée en 2011 pour fluidifier l’accès aux liquidités bancaires. De la même manière, les Pays-Bas ont créé en 2009 une garantie de refinancement équivalente qui a, elle aussi, été modernisée en 2012, pour mieux soutenir les exportations néerlandaises.
S’il n’existe pas d’évaluation publique de l’efficacité de ces nouveaux instruments dans les pays concernés depuis leur introduction, plusieurs exemples récents de contrats perdus par des exportateurs français ont montré la compétitivité de ces instruments par rapport aux financements français.
Ainsi, l’entreprise STX a perdu en juillet 2011 un appel d’offres pour la construction de deux paquebots, notamment du fait de financements exports plus coûteux que ceux de son concurrent finlandais proposant un prêt direct.
De la même manière, alors que la société franco-italienne, ATR, représentait 70 % des parts de marché des turbopropulseurs (avions de 40 à 70 places réalisant des trajets d’environ 500 km) au premier semestre 2011 contre 30 % pour son concurrent, Bombardier, ce résultat s’est totalement inversé au premier semestre 2012. En effet, Bombardier a pu s’adresser à l’équivalent de la Coface au Canada – Export Development Canada (EDC) (139) – qui est lui-même prêteur direct. Or, selon les informations transmises au Rapporteur général, EDC a proposé des prêts à un taux inférieur de 100 à 150 points de base aux prêts bancaires français couverts par une assurance-crédit au premier semestre 2012, ce qui représentait sur la durée du prêt près de 9 % du prix de l’appareil acheté par la compagnie aérienne importatrice.
Afin de rester dans la course, le Gouvernement propose donc de s’inspirer de ces dispositifs étrangers pour rénover le financement du crédit-export.
Le Rapporteur général se félicite par ailleurs que le Comité de contrôle et d’évaluation des politiques publiques de l’Assemblée nationale ait décidé le 18 octobre 2012 de réaliser une évaluation du soutien public aux exportations.
II.– LA MODERNISATION DU FINANCEMENT DE L’AIDE À L’EXPORT
PAR L’ASSURANCE-CRÉDIT
Le présent article propose d’introduire un nouvel article L. 432-5 dans le code des assurances, de façon à créer trois nouvelles garanties en faveur des sociétés exportatrices françaises, dont deux concernent exclusivement le secteur des aéronefs civils et la troisième l’ensemble des secteurs économiques à l’exclusion, a contrario, du secteur des aéronefs civils.
Il faut en effet rappeler que le secteur aéronautique représente près de 10 % des exportations françaises(140). Or, en 2011, la croissance des exportations a sensiblement diminué (+ 8,6 %, après + 14,0 % en 2010) car les livraisons aéronautiques et automobiles, qui avaient « emmené » la reprise en 2010, ont ralenti, tandis que les ventes pharmaceutiques enregistraient un repli inédit.
En revanche, l’année 2011 a été marquée par la croissance des exportations dans le secteur agroalimentaire, avec en tête les céréales et les boissons. D’une manière générale, les ventes de produits de l’industrie du luxe (notamment sacs à main, parfums et cosmétiques) ont affiché également un fort dynamisme. Enfin, la croissance soutenue des exportations de biens intermédiaires (chimie, métallurgie) a surtout traduit des effets prix liés à la hausse du cours du pétrole et des matières premières industrielles.
L’amélioration du financement des opérations d’exportations françaises constitue donc un enjeu fondamental, en particulier dans le secteur aéronautique.
Le 1° du I du présent article propose d’introduire une nouvelle garantie de l’État accordée, en totalité ou en partie, à la Coface, « couvrant les risques de non-paiement relatifs à des opérations de financement d’exportations d’avions civils de plus de dix tonnes au décollage et d’hélicoptères civils de plus d’une tonne au décollage. Cette garantie couvre le principal, intérêts et accessoires du financement. »
En vertu de cette disposition, le champ de la garantie pure et inconditionnelle à première demande (GPI) en cas de non-paiement de l’importateur, actuellement réservée aux avions gros porteurs Airbus, serait étendu aux avions civils de plus de 10 tonnes et aux hélicoptères civils de plus d’une tonne au décollage. Concrètement, sont potentiellement concernés les aéronefs civils suivants : ATR 42 et 72, Superjet 100, Dassault série Falcon, et Eurocopter (de Colibri EC120 à SuperPuma EC225).
Ainsi que le Rapporteur général l’a expliqué précédemment, la GPI est beaucoup plus protectrice que le régime de l’assurance-crédit. Autonome et irrévocable, elle couvre le risque de non-paiement du débiteur ainsi que les risques juridiques et fiscaux (risques de documentation, de validation du schéma de sûretés, de structure, de déqualification fiscale, prime dite « make whole » (141)). Elle vise le principal du financement, mais aussi les commissions bancaires et les intérêts au taux du contrat (sans pénalité) jusqu’à la date d’indemnisation.
Elle est conditionnée au versement par l’assuré d’une prime finançable par majoration du principal et/ou par supplément du taux de financement dans les conditions prévues par l’annexe sectorielle aéronautique de l’Arrangement OCDE qui fixe notamment des niveaux minima de primes selon le risque du débiteur.
Les points a) à e) du 1° arrêtent une liste limitative des bénéficiaires potentiels de l’extension de la GPI aux aéronefs, recouvrant :
– a) les fournisseurs et leurs filiales (Airbus, EADS, ATR, Safran, Thalès, et Dassault aviation à ce jour) ;
– b) c) et d) les établissements de crédits, les établissements financiers, les entreprises, mutuelles et institutions d’assurance et de réassurance, mais aussi les organismes mentionnés à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier (142), de droit français et étranger, agréés par la Coface après « stress tests » ;
– et e) à titre exceptionnel, pour tenir compte des pratiques de la concurrence, toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d’investisseurs à l’émission d’obligations en vue du financement d’opérations d’exportation, ainsi que les personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat ou pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l'entité ayant procédé à leur émission.
Ce dernier cas concernerait par exemple une compagnie aérienne, telle qu’Emirates Airlines, qui, pour importer un aéronef civil fabriqué en France, crée une société dédiée (une « special purpose company »), chargée de lever un financement correspondant au prix de l’aéronef sur le marché par le biais d’émissions obligataires, ce qui lui permet ensuite de l’acheter (à ATR ou Airbus par exemple), puis de le louer à la compagnie aérienne Emirates, afin de rémunérer les détenteurs de titres émis. L’intérêt de la GPI dans ce type de montage tient à ce que, si la compagnie aérienne importatrice fait défaut, les détenteurs de titres demeureront rémunérés et l’exportateur aura été payé.
Cet outil de financement n’a jamais été utilisé en France pour acquérir des gros porteurs Airbus à la date de rédaction du présent rapport (143). En revanche, l’assureur-crédit américain Exim en délivre de plus en plus pour les livraisons de Boeing (40 à 50 % des exportations de Boeing en 2012). Le concurrent canadien d’ATR bénéficie de prêts directs qui sont tout aussi compétitifs.
L’idée du Gouvernement est de couvrir de telles émissions dans la mesure où la concurrence bénéficie de conditions comparables ; le cas échéant, le bénéfice du e) pourrait donc être fortement restreint lors de l’examen des dossiers par la Commission interministérielle des garanties et crédits au commerce extérieur si la concurrence étrangère n’était pas avérée. En effet, ces émissions obligataires représentent un risque plus élevé de classement dans le champ des dettes des administrations publiques que les assurances traditionnelles de la Coface, notamment dans le cas où elles deviendraient le quotidien de l’activité de Coface (ce qui n’est pas le cas aujourd’hui).
Avec l’extension de la GPI à tous les avions civils de plus de dix tonnes et aux hélicoptères civils de plus d’une tonne au décollage, le législateur supprime le risque de non-paiement du prêt par l’importateur envers l’exportateur ou sa banque, son caractère inconditionnel permettant plus facilement son transfert qu’une assurance-crédit classique, par exemple par titrisation du prêt.
En outre, dans le domaine aéronautique, la GPI est un produit distribué par un plus grand nombre de banques que l’assurance-crédit classique. La concurrence accrue entre les établissements de crédit devrait donc améliorer la compétitivité des financements privés et par conséquent l’offre des exportateurs français.
Enfin, le risque budgétaire lié à un éventuel appel en garantie paraît modéré. En effet, depuis la mise en place de la GPI pour Airbus en 2001, il n’y a jamais eu de défaut et l’on a même pu observer une baisse de la sinistralité. En outre, la négociation des contrats par la Coface permet de limiter le risque juridique supplémentaire. Enfin, la garantie inconditionnelle à première demande n’est étendue qu’à des actifs récupérables et liquides, c’est-à-dire des actifs qui peuvent être revendus en cas de sinistre, de sorte que la perte occasionnée demeurerait limitée, le cas échéant.
Le 2° du I du présent article propose d’introduire une nouvelle garantie « couvrant les risques de change sur la valeur résiduelle d’aéronefs civils acquis à crédit dans le cadre d’une opération d’exportation sans la garantie visée au 1° du présent article ou l’assurance visée au a) du 1° de l’article L. 432-2. Cette exportation ne pourra bénéficier d’aucune autre garantie de la Coface. »
Cet article propose de créer une garantie de change sur la valeur résiduelle qui pourrait être délivrée par la Coface pour le compte de l’État à une banque qui financerait en euros l’acquisition d’un aéronef civil à une compagnie étrangère.
Cette garantie ne peut être cumulée avec aucune autre garantie, qu’il s’agisse de la GPI ou d’une assurance-crédit classique. Il convient néanmoins de souligner que si près d’un tiers des livraisons d’Airbus sont actuellement couvertes par la GPI, les deux tiers restants sont financés par le marché sans garanties publiques. Par conséquent, les banques prêteuses pourraient être intéressées par cette nouvelle garantie.
L’objectif de cette nouvelle garantie est avant tout de remédier à la difficulté que rencontrent les banques françaises pour obtenir des liquidités en dollars alors que le marché aéronautique est presque exclusivement libellé dans cette devise.
Rappelons que lorsqu’une banque française accepte de financer un avion Airbus à travers un prêt accordé à un importateur étranger, ce prêt est libellé en dollars, le remboursement est réalisé en dollars, et si l’importateur fait défaut, la banque dispose d’une hypothèque sur l’avion, qui lui permet de le revendre à un prix libellé en dollars et compenser ainsi tout ou partie de ses pertes.
À l’inverse, si la banque accordait un prêt libellé en euros pour acquérir le même avion à un prix libellé en dollars et que l’importateur faisait défaut, elle ne pourrait le revendre qu’à un prix libellé en dollars et se trouverait exposée à un risque de change, si la valeur du dollar en euros a baissé entre le moment de l’octroi du prêt en euros et le moment de la revente de l’avion en dollars. La présente garantie vise donc à couvrir la banque qui aurait prêté en euros en compensant la perte euro/dollar sur la valeur résiduelle de l’avion. Concrètement la garantie ne jouerait que si la revente de l’avion ne permettait pas de couvrir le capital restant dû à la banque prêteuse.
Les points a) à c) du 2° du I précisent la liste des bénéficiaires de cette nouvelle garantie, que sont :
– a) et b) : les établissements de crédits et les établissements financiers ainsi que les entreprises, mutuelles et institutions d’assurance et de réassurance, de droit français ou étranger ;
– et c) : à titre exceptionnel, toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d’investisseurs à l’émission d’obligations en vue du financement d’opérations d’exportation, ainsi qu’aux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat.
Sont donc a contrario exclus de ce dispositif de garantie les fournisseurs d’aéronefs ainsi que les organismes mentionnés à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier, à l’inverse de la GPI.
La crise ayant conduit à un renchérissement de l’accès des banques européennes aux liquidités en dollars, le développement du financement en euros des exportations aurait un impact positif pour les exportateurs français, car leurs clients auraient accès à des sources de financement plus larges à moindre coût.
En outre, l’utilisation croissante de l’euro dans les financements aéronautiques limiterait également à terme le risque du portefeuille de la Coface, aujourd’hui dominé par le dollar.
Sur le plan budgétaire, le risque apparaît circonscrit. L’octroi de la garantie serait assorti d’une nouvelle prime (dont la tarification dépendra de la maturité, du profil de remboursement, de la volatilité des taux de change, des « taux forward » (144)), et du risque de crédit de la compagnie aérienne acquéreuse). En outre, le risque d’appel en garantie semble limité par le fait qu’elle ne joue que dans la limite de l’encours restant dû. Le Gouvernement espère donc que les primes pourront couvrir, à tout le moins, les éventuels appels en garantie, voire contribuer au résultat positif de la Coface.
c) Les conditions de mise en œuvre
Les dispositifs de soutien au commerce extérieur s’appuient sur la part française des fabrications. Or les appareils Airbus et ATR sont produits en coopération internationale, Airbus essentiellement avec l’Allemagne et le Royaume-Uni, et ATR avec l’Italie. La mise en œuvre de cette nouvelle garantie de change suppose donc l’accord des partenaires allemands, britanniques et italiens, le but étant pour la France de ne pas délivrer seule la garantie, pour ne pas prendre le risque de devoir couvrir une part étrangère trop importante.
Sa mise en œuvre serait notifiée dans le cadre de l’Arrangement OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et ne nécessiterait pas de réviser l’annexe III précitée. Le Gouvernement espère parvenir à un tel accord dans le courant de l’année 2013.
B.– L’INTRODUCTION D’UNE GARANTIE PUBLIQUE SUR LE REFINANCEMENT DES BANQUES AYANT ACCORDÉ UN CRÉDIT EXPORT
Le 3° du I du présent article propose d’introduire une nouvelle garantie « couvrant les risques de non-paiement au titre de contrats conclus en vue du refinancement d’opérations assurées au titre du a) du 1° de l’article L. 432-2. ».
Concrètement, ce dispositif vise à garantir, pour une opération donnée, l’établissement refinançant la banque ayant accordé un crédit-export à l’acheteur étranger d’exportations françaises (hors secteur aéronautique). Une telle garantie, qui existe déjà en Allemagne et aux Pays-Bas notamment, permet de diversifier les sources de financement des crédits-export afin d’en abaisser leurs coûts. Les banques françaises ont indiqué au Gouvernement qu’elles pourraient ainsi gagner jusqu’à 50 points de base et les répercuter sur leurs clients.
Cette nouvelle garantie est utile car l’établissement bancaire ayant accordé le crédit-export peut se trouver, à un moment ou à un autre, dans une situation de manque de liquidités : grâce à ce nouvel outil, cet établissement pourra demander à un autre établissement, une entreprise d’assurance par exemple, de lui fournir les dites liquidités en contrepartie d’une garantie de refinancement accordée par la Coface. En pratique, la société d’assurance paiera une prime mais la refacturera à la banque qu’elle refinance en contrepartie des liquidités apportées.
Les points a) à d) du 3° du I donnent une liste limitative des bénéficiaires potentiels de cette nouvelle garantie, que sont :
– a) et c) : les établissements de crédits, les établissements financiers, les entreprises, mutuelles et institutions d’assurance et de réassurance de droit français ou étranger, et les organismes mentionnés à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier ;
– et d) : à titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence comme pour les deux autres nouvelles garanties précédemment évoquées, à toute société ayant son siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’OCDE ayant procédé auprès d’investisseurs à l’émission d’obligations en vue du financement d’opérations d’exportation, ainsi qu’aux personnes morales de droit français ou relevant du droit d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’OCDE agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat, pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l'entité ayant procédé à leur émission.
Le présent article précise toutefois que cette garantie de refinancement concerne le risque de non-paiement des seuls établissements de l’Union Européenne présentant, à la date d'octroi de la garantie, une qualité de crédit supérieure ou égale à 3 au sens de l’arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement. À titre d’exemple, cette « qualité de crédit » correspond à une notation à long terme allant de AAA à BBB – par les agences de notation Standard and Poors/Fitch. Les principales banques dans le domaine des crédits-export, à la fois françaises (BNP Paribas –A+/A+, Société générale – A/A+, Natixis A/A+, Crédit Agricole CIB A/A+) et européennes respectent cette condition.
Le présent article prévoit que la garantie de refinancement couvre 100 % du crédit acheteur en principal et intérêts de refinancement (sans limite de marge) et l’éventuelle prime « make whole ». Elle prend la forme d’un droit direct à indemnisation de la part de la Coface, permettant ainsi à l’investisseur de ne pas subir le concours d’un autre créancier de rang supérieur.
La mise en place d’une telle garantie de refinancement permettra de faciliter le refinancement des crédits-export assurés par la COFACE et diversifierait les sources de financement des exportations françaises en permettant le refinancement par des investisseurs qui ne souhaitent pas prendre de risque sur l’entité ayant accordé un crédit-export ou sur un acheteur étranger.
En outre, en garantissant à la fois le crédit à l’emprunteur étranger (assurance-crédit) et le refinancement de l’assuré qui a octroyé le crédit (garantie de refinancement), la Coface sera en mesure de connaître les marges effectuées par les banques sur ces produits et de vérifier si elles répercutent sur leurs clients l’effet de cette garantie. Aussi, dans le cas où l’octroi de la garantie de refinancement ne permettrait pas d’abaisser le coût de financement de l’exportation française par rapport à la seule assurance-crédit, c’est-à-dire dans le cas où les marges des banques devaient dépasser un niveau raisonnable, l’État pourrait notamment suspendre le dispositif pour les établissements concernés.
Sur le plan budgétaire, l’octroi de cette garantie s’assortirait du versement d’une prime de la part de l’investisseur bénéficiaire, dont le montant dépendra de la maturité et du risque de la banque prêteuse, ces critères restant à préciser. Sur la part bénéficiant déjà d’une assurance-crédit (95 %), en cas de défaut de l’établissement ayant accordé le crédit-export au titre du refinancement, l’État disposerait de sûretés additionnelles sur l’assuré et sur le débiteur étranger. Sur la part ne bénéficiant pas de l’assurance-crédit (5 %), le risque additionnel est pris par l’État. Il est toutefois limité, car il ne se réaliserait qu’en cas de double défaut de l’établissement ayant accordé le crédit-export et de l’emprunteur étranger.
III.– LES CONDITIONS DE MISE EN œUVRE ET L’IMPACT ATTENDU
DU PRÉSENT ARTICLE
La mise en œuvre du présent article suppose l’adoption de plusieurs décrets d’application dont le détail est précisé dans l’évaluation préalable annexée au présent article.
À l’instar des autres garanties publiques gérées par la Coface, ces nouvelles garanties seraient accordées sur autorisation du ministre chargé de l’Économie après avis de la Commission des garanties et du crédit au commerce extérieur instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949, commission au sein de laquelle sont représentés le directeur général du Trésor (qui la préside), le directeur du budget, le ministère des Affaires étrangères, les directeurs des administrations en charge des secteurs industriels concernés par les dossiers examinés, la Coface, et Natixis « Affaires Institutionnelles » lorsqu’une stabilisation du taux d’intérêt est également envisagée.
L’ensemble des mesures envisagées vise à renforcer la compétitivité du financement des exportations, en faisant bénéficier les exportateurs français de dispositifs de financement dont disposent déjà la plupart de leurs concurrents (à l’exception de la garantie de change sur la valeur résiduelle). Un impact positif est donc attendu sur le volume des exportations françaises, susceptible de générer ainsi des bénéfices supplémentaires pour les entreprises tournées vers l’international. Les critères d’attribution des garanties de la COFACE tiennent compte de la part française des matériels exportés, c’est-à-dire de leurs retombées économiques sur le territoire.
Chaque année, le soutien financier public aux exportations concerne entre 60 000 et 250 000 emplois en France. Le renforcement du dispositif de soutien public aux exportations est susceptible d’augmenter le volume des exportations et donc de maintenir ou créer des emplois dans le secteur privé exposé à l’international, notamment industriel.
Les banques européennes sont également susceptibles de bénéficier de ces mesures, par la facilitation du refinancement des opérations et par le développement de financements en euros pour lesquels elles sont plus susceptibles d’être plus compétitives que les banques n’appartenant pas à la zone euro.
S’agissant de l’État, l’extension de régimes de garanties existants emporte nécessairement un risque financier supplémentaire, rémunéré par une prime. Cependant, le coût demeure nul en l’absence d’appel en garantie, le solde des opérations effectuées par la Coface pour le compte de l’État étant d’ailleurs positif chaque année depuis 1996. En outre, il a déjà été démontré que pour chacune des garanties proposées, le risque budgétaire est limité.
Néanmoins, ces mesures vont impliquer la mise en place de nouveaux instruments de soutiens publics gérés par la Coface, lesquels nécessiteront la signature d’avenants à la convention de gestion État-Coface. L’élargissement du périmètre des missions confiées à la compagnie sera, le cas échéant, assorti d’un complément de rémunération de cette dernière. L’assurance-crédit étant une procédure bénéficiaire, l’impact budgétaire du présent article sera une légère baisse de la recette non fiscale correspondante. S’agissant de la charge administrative, le flux d’activité de la Coface pourra croître sensiblement, en fonction de l’attractivité du nouveau dispositif auprès des exportateurs français.
*
* *
Mme Karine Berger. Bien qu’il n’y ait pas d’amendement à cet article 30, je souhaiterais avoir des informations sur son contenu. J’ai cru comprendre qu’il permet de garantir des risques de change. Les risques afférents sont-ils évalués ? Ils peuvent être colossaux.
M. le rapporteur général. Cet article prévoit trois dispositions.
Tout d’abord, il procède à une extension de la garantie pure et inconditionnelle à première demande (actuellement réservée aux avions gros porteurs) aux avions de plus de 10 tonnes et aux hélicoptères de plus d’une tonne au décollage.
Il crée ensuite une garantie de change sur la valeur résiduelle de l’aéronef pour pallier la difficulté des banques françaises et européennes à accéder à des liquidités en dollars alors que le marché aéronautique est quasi exclusivement libellé dans cette monnaie.
Il crée enfin une garantie de refinancement des exportations dans les secteurs autres que l’aéronautique. Il s’agit concrètement de l’octroi d’une garantie à une personne morale refinançant une banque ayant accordé un crédit-export à un importateur étranger pour des produits fabriqués en France.
Il s’agit d’une importante mesure du pacte de compétitivité proposé par le Gouvernement.
Mme Valérie Rabault. Dispose-t-on d’une esquisse d’évaluation du risque d’appel à ces garanties ?
M. Dominique Lefebvre. Quelle est l’évaluation de la prime de risque qui serait payée au moment de l’appel de la garantie ? S’il n’y a pas de coût budgétaire, il nous faut connaître l’équilibre du système.
Mme Karine Berger. La partie relative à la couverture du refinancement de banque porte-t-elle bien sur des financements de plus de douze mois ? à defaut il y aurait un vrai problème de droit de la concurrence.
M. Hervé Mariton. Nos collègues ont raison, il nous faut des simulations.
M. le rapporteur général. S’agissant de la garantie pure et inconditionnelle qui est celle qui était déjà en place, il n’y a jamais eu de défaut, les primes ont toujours été encaissées par le passé. Pour les garanties nouvelles, on ne peut en connaître le montant. Nous espérons avoir plus d’informations d’ici la séance. La garantie de change ne porte que sur l’écart entre le coût de la défaillance d’un client et le produit de la revente d’un avion. Vous trouverez des précisions dans mon rapport.
Mme Karine Berger. Sauf si une monnaie n’est plus convertible. Je connais des cas dramatiques.
M. le rapporteur général. On est seulement sur de l’euro/dollar.
M. Charles de Courson. Par le passé, nous avons toujours pu trouver de nouveaux acquéreurs pour les avions à revendre. La nouveauté, c’est la garantie de change sur la valeur résiduelle. Le risque euro/dollar a évolué…
Mme Valérie Rabault. Entre 0,8 et 1,5…
M. le rapporteur général. La faible liquidité en dollars constitue un autre problème ; le coût est moindre pour les prêts en euros. Le risque n’est pas considérable, et l’intérêt économique de la mesure proposée, évident.
Suivant l’avis favorable du rapporteur général, la Commission adopte l’article 30 sans modification.
*
* *
Octroi de la garantie de l’État à la société Banque PSA Finance,
filiale de la société Peugeot S.A.
Texte du projet de loi :
I.– Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l’État aux titres de créance émis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 par la société Banque PSA Finance, filiale de la société Peugeot SA. Cette garantie porte sur le principal, les intérêts, frais et accessoires des titres de créance garantis et est accordée pour un encours en principal d’un montant total maximal de 7 milliards d’euros.
II.– Une convention entre l’État, la société Peugeot S.A. et la société Banque PSA Finance fixe notamment les modalités selon lesquelles la garantie mentionnée au I peut être appelée, les contreparties de la garantie, ses conditions tarifaires ainsi que les éventuelles sûretés conférées à l'État en contrepartie de la garantie.
III.– Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article a pour objet d’autoriser l’octroi de la garantie de l’État aux émissions de titres de créances réalisées par Banque PSA Finance, filiale bancaire de Peugeot SA, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, pour un montant maximal en principal de 7 milliards d’euros.
Rappelons que le 5° du II de l’article 34 de la LOLF prévoit que l’autorisation d’octroi de garanties de l’État ainsi que la définition de leur régime relèvent du domaine exclusif des lois de finances.
Contrôlée à 100 % par Peugeot S.A., Banque PSA est un établissement de crédit qui assume une double mission.
D’une part, elle accorde aux clients de Peugeot des crédits, dont la maturité est généralement de trois ans, en vue de leur permettre de financer leur achat de véhicule. Cette activité représente 62 % des encours totaux de l’établissement et concerne 28 % des véhicules vendus par le groupe.
D’autre part, elle finance, par des prêts d’une maturité inférieure à un an, le bas de bilan (notamment les stocks) des concessionnaires du groupe, pour un encours représentant 26 % des encours totaux de l’établissement.
Sa première mission de financement des ventes des véhicules du groupe en fait un élément clé pour la rentabilité du groupe PSA. Comme de nombreux constructeurs automobiles, Peugeot dégage les marges les plus importantes, non pas sur les ventes de véhicules, mais sur le financement placé pour permettre ces ventes et sur les services financiers associés – assurances, extensions de garantie, contrats d’entretien des véhicules.
La disparition ou la cession de Banque PSA compromettrait gravement le profil de rentabilité du groupe et constituerait un obstacle particulièrement important vers le retour aux bénéfices, qui conditionne la survie, à long terme, du constructeur automobile.
La structure financière de Banque PSA est solide, avec un ratio « TIER 1 » de 14,75 %. Les fonds propres prudentiels consolidés de la banque étant constitués exclusivement de capitaux propres ordinaires, la modification des modalités de calcul de ce ratio, prévue par les normes dites de « Bâle III », ne devrait pas avoir d’impact significatif pour l’établissement.
Par ailleurs, comme l’illustre le bilan simplifié ci-dessous, les prêts que Banque PSA accorde sont financés par des passifs de même maturité – généralement trois ans pour le crédit à la consommation et moins d’un an pour les prêts aux concessionnaires.
BILAN SIMPLIFIÉ PAR MATURITÉ DES ACTIFS
(en milliards d’euros)
Actif |
Passif |
||
Financement clientèle |
10,9 |
3,4 |
Capitaux propres |
Autres actifs non financiers |
0,2 |
7 |
Dettes (maturité supérieure à un an) |
Total actif de moyen et long terme |
11,1 |
10,4 |
Total ressources de moyen et long terme |
Financement clientèle |
7,1 |
12,5 |
Dettes à taux variables |
Financement réseau |
6,2 |
2 |
Dettes à taux fixes couvertes |
Autres actifs financiers |
2,7 |
0,9 |
Autres passifs financiers |
Autres actifs |
1 |
2,3 |
Autres passifs |
Total actif de court terme |
17 |
17,7 |
Total passif de court terme |
TOTAL ACTIF |
28,1 |
28,1 |
TOTAL PASSIF |
Source : d’après document de référence
L’établissement semble d’autant moins exposé au risque d’illiquidité qu’il serait en mesure de maintenir son refinancement pour, au moins, 12 mois par titrisation ou mobilisation de créances auprès de la Banque centrale européenne.
L’actif de Banque PSA semble être de qualité, avec un taux de créances douteuses de 1,79 %, qui, selon un analyste de crédit, serait moins élevé et moins volatile que par les sociétés comparables. Par ailleurs, les prêts accordés sont garantis par les véhicules qu’ils financent, ce qui réduit le risque de pertes sur les crédits octroyés.
Le niveau de rentabilité de Banque PSA est satisfaisant, avec un bénéfice de 201 millions d’euros au premier semestre 2012, en hausse de 22 millions d’euros sur un an quand l’activité automobile du groupe affiche un résultat opérationnel courant négatif de 662 millions d’euros.
Si les fondamentaux de Banque PSA sont sains, la qualité de sa signature est étroitement liée à la situation financière globale du groupe Peugeot.
En effet, l’établissement de crédit, dit « captif », dépend entièrement de Peugeot pour l’ensemble de son activité qui est fondée, directement ou indirectement, sur les ventes de véhicules du groupe. Par ailleurs, il peut être appelé à verser des dividendes exceptionnels, comme cela a été fait en avril dernier, qui pourraient dégrader sa structure financière.
Dans ces conditions, il est logique que la notation de Banque PSA soit intimement liée à celle du groupe Peugeot. En pratique, sa notation ne peut être supérieure de plus de deux crans à celle du groupe du fait des contraintes méthodologiques des agences de notation.
Or, compte tenu de ses difficultés financières (145), le groupe Peugeot a vu sa notation dégradée, aboutissant à ce que Banque PSA soit menacée d’être classée en catégorie spéculative.
Dans une telle hypothèse, il est probable que la filiale de Peugeot ne serait plus en mesure de lever des fonds sur les marchés financiers, sur lesquels elle obtiendrait plus de 60 % de son financement externe. Cette fermeture brutale de sa principale source de refinancement serait quasiment certaine en ce qui concerne le financement de court terme car les investisseurs seraient, sur ces types de financement, particulièrement sensibles aux notations des émetteurs. Or, Banque PSA doit refinancer pour 2,4 milliards d’euros de certificats de dépôts et 1,4 milliard d’euros de papier commercial.
Dans l’hypothèse d’une fermeture des marchés financiers, Banque PSA serait probablement conduit, à terme, à une situation de défaut, aboutissant à sa liquidation ou, le cas échéant, à sa reprise par un autre établissement de crédit.
B.– UNE GARANTIE QUI DOIT ÊTRE DISTINGUÉE DES INTERVENTIONS MENÉES AU PROFIT DU SECTEUR BANCAIRE DEPUIS 2008
Depuis le début de la crise financière à l’automne 2008, l’État a été conduit à intervenir, en deux vagues successives, afin de stabiliser le secteur bancaire. Les objectifs poursuivis par ces interventions ont été la stabilisation du système financier et la préservation de conditions normales de financement de l’économie.
À l’automne 2008 et au premier semestre 2009, sur la base des dispositions de l’article 6 de la première loi de finances rectificative pour 2008 (146), l’État a mené trois types d’actions destinées à écarter tout risque systémique – c’est-à-dire le risque d’effondrement global du système financier – et à garantir un financement normal de l’économie.
En premier lieu, la société de prises de participations de l’État (SPPE), société détenue à 100 % par l’État, a injecté du capital, sous forme de titres super-subordonnés ou d’actions de préférence, dans le capital des établissements bancaires français pour un montant total de 20,75 milliards d’euros. Hormis Dexia, la totalité des établissements de crédit bénéficiaires de cette intervention ont remboursé les fonds apportés par l’État.
En deuxième lieu, la société de financement de l’économie française (SFEF), société détenue à hauteur d’un tiers par l’État et de deux tiers par les établissements de crédit, a assuré le refinancement de ces établissements dans un contexte de forte perturbation du marché interbancaire. Émettant des obligations garanties par l’État, elle a eu pour fonction de prêter aux banques les fonds ainsi levés afin de garantir leur refinancement. La SFEF n’accorde plus de prêts depuis la fin de l’année 2009. Elle garde à son bilan un endettement de l’ordre de 21,3 milliards d’euros (147), qui serait entièrement remboursé en octobre 2014.
Enfin, une intervention spécifique a été menée en faveur de Dexia par la France, la Belgique et le Luxembourg. Compte tenu de son importance systémique, la banque franco-belge a ainsi bénéficié d’une garantie de financement, dont la quote-part de la France s’établissait, en 2008, à 36,5 %. Le montant résiduel des encours couverts par cette garantie s’élève à 19,8 milliards d’euros au 1er novembre 2012 – avec une part de la France de 7,2 milliards d’euros. Par ailleurs, une contre-garantie de la France et de la Belgique a porté sur les actifs de la filiale américaine de Dexia, FSA Asset Management – cette contre-garantie ayant toutefois cessé de produire ses effets du fait de la cession de cette filiale.
Depuis l’automne 2011, de nouvelles tensions sur le marché interbancaire ainsi que la perspective de la mise en œuvre des nouvelles normes de Bâle III ont fragilisé certains établissements bancaires et justifié de nouvelles interventions de l’État.
D’une part, une nouvelle garantie de financement a été accordée à Dexia par la troisième loi de finances rectificative pour 2011 pour un montant de 32,85 milliards d’euros – ce montant étant revu à 38,76 milliards d’euros par l’article 29 du présent projet de loi. Les déséquilibres financiers de la banque franco-belge n’ayant été que partiellement atténués depuis 2008, Dexia était à nouveau confronté à la fermeture du marché interbancaire. Dans l’incapacité de se refinancer, l’établissement faisait donc courir un risque à l’ensemble du système financier de la zone euro. La nouvelle garantie octroyée par la France, la Belgique et le Luxembourg a eu pour effet d’écarter un tel risque et s’est accompagnée d’un plan de démantèlement du groupe. Ce plan a justifié l’octroi, par la France, d’une garantie d’un montant de 10 milliards d’euros sur les actifs de Dexia Municipal Agency, filiale spécialisée dans le crédit aux collectivités territoriales – cette garantie conditionnant la reprise de l’activité par la Caisse des dépôts et la Banque postale.
D’autre part, l’article 66 du projet de loi de finances pour 2013 prévoit l’octroi d’une garantie de financement bénéficiant au Crédit immobilier de France. Cet établissement se trouvant dans l’incapacité de se refinancer, l’État est intervenu pour éviter son défaut, qui aurait eu des conséquences sur les fonds propres des banques créancières et donc sur leur capacité à financer l’économie.
En définitive, depuis 2008, l’ensemble des interventions menées par l’État en faveur du secteur bancaire poursuivait deux objectifs : assurer la stabilité du système financier et garantir des conditions normales de financement de l’économie.
Aux termes du présent article, l’État accorderait à la filiale de crédit de Peugeot une garantie temporaire sur ses refinancements. L’intervention proposée poursuit certes un objectif de préservation du système financier puisqu’un défaut de cet établissement aurait des conséquences sur ses créanciers. Son objet dépasse toutefois le cadre financier dans la mesure où la garantie proposée permettrait de sauvegarder un groupe industriel occupant une place centrale au sein d’un secteur d’activité prépondérant pour l’économie française.
Toutefois, l’intervention proposée par le Gouvernement se distingue des actions menées précédemment par son objectif de préservation d’un groupe industriel privé qui occupe une place importante au sein d’un secteur d’activité stratégique, duquel dépend un nombre important d’emplois.
Engagé dans un plan de restructuration destiné à rétablir ses marges, le groupe Peugeot voit, comme indiqué plus haut, ses bénéfices dépendre pour une part substantielle de ceux de sa filiale de crédit. En d’autres termes, le retour à bonne fortune du groupe Peugeot serait sans doute difficile à réaliser si sa filiale de crédit venait à disparaître.
En définitive, à la différence des interventions menées jusqu’alors au profit du secteur bancaire, l’intervention prévue par le présent article a pour objectif principal la préservation de l’emploi au sein d’un secteur d’activité jouant un rôle important pour la compétitivité de l’économie, et non la sauvegarde du système financier.
Le I du présent article définit le régime de la garantie.
Celle-ci porterait sur les seuls titres de créance émis par la société Banque PSA Finance. Seraient donc exclus les prêts accordés par les banques à cette société ainsi que tout financement levé par une autre société du groupe Peugeot.
La garantie concernerait uniquement les titres émis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016. Selon les informations recueillies par le Rapporteur général, cette durée est liée au plan de restructuration mené par le groupe PSA, qui devrait permettre de rétablir la rentabilité du groupe sous trois ans. Si les effets escomptés du plan sont effectivement constatés, il est probable que la notation du groupe soit revue à la hausse et que Banque PSA puisse retrouver un accès aux marchés financiers.
Selon les informations transmises au Rapporteur général, les titres garantis ne devraient pas avoir une maturité supérieure à trois ans puisque les prêts accordés par Banque PSA sont généralement de cette durée. Si tel est effectivement le cas, la garantie ne produirait plus d’effet après 2019.
Le plafond de la garantie serait fixé à 7 milliards d’euros en principal. Il semble qu’un montant de 5 milliards d’euros d’émissions obligataires devrait être garanti entre 2013 et 2015, auquel s’ajouterait un montant supplémentaire de 2 milliards d’euros en 2016. La garantie porterait sur le principal, les intérêts, frais et accessoires des titres de créances garantis.
La garantie serait accordée à titre onéreux. La rémunération de l’État n’est, à ce stade, pas déterminée mais, conformément au droit communautaire de la concurrence, elle devrait être fixée aux conditions de marché.
Selon l’évaluation préalable annexée au projet de loi, « le montant des recettes (perçues par l’État du fait de l’octroi de la garantie) devrait d’élever à environ 400 millions d’euros sur la période 2013-2019, dans l’hypothèse d’une garantie de 7 milliards d’euros. » Sur cette base, la rémunération de la garantie serait un peu inférieure à 50 points de base. Le Gouvernement a annoncé que la recette ainsi perçue serait affectée au financement d’un fonds pour la filière automobile.
La question de la conformité du dispositif au droit communautaire de la concurrence sera examinée par la Commission européenne. Sur ce point, trois éléments seront probablement mis en avant par le Gouvernement pour contester une éventuelle qualification en aide d’État induisant une distorsion de concurrence :
– la garantie ainsi octroyée est accompagnée d’un plan de restructuration du groupe PSA, qui doit permettre au groupe de retrouver un profil de rentabilité lui permettant de garantir sa viabilité à long terme ;
– la garantie serait tarifée aux conditions de marché ;
– les prêteurs privés s’engageraient également aux côtés de l’État, comme cela est décrit plus bas.
L’octroi de la garantie prévue au présent article implique un engagement financier de l’État. Contrairement à des soutiens financiers de nature similaire accordés sous la précédente législature, cette garantie serait accordée sous réserve de contreparties apportées tant par le groupe Peugeot que par les banques créancières.
Le II prévoit le principe d’une convention entre l’État, Banque PSA et Peugeot SA qui fixerait notamment des contreparties au soutien financier de l’État, qui porteraient sur :
– la mise en place d'un comité de suivi de la garantie, comprenant des représentants de l'État, de la direction de PSA et un administrateur indépendant. Ce comité devrait permettre de suivre de façon régulière l’évolution de la situation du groupe et de sa filiale bancaire et ses perspectives d’évolution. Ce comité devrait notamment donner son accord à toute opération affectant le contrôle ou le périmètre du groupe et de ses principales filiales, ainsi qu’aux évolutions significatives de leurs activités ;
– le renouvellement de la composition de son conseil de surveillance à l’occasion de la prochaine assemblée générale ;
– la nomination, en lien étroit avec l’État, d’un administrateur indépendant, qui serait membre du comité stratégique ;
– la nomination d'un représentant des salariés en tant qu'administrateur, qui devrait être décidée par l’assemblée générale prévue au printemps prochain ;
– l’interdiction de verser des dividendes ainsi que le respect du principe de modération des rémunérations des dirigeants.
Les contreparties demandées au groupe PSA ont pour objet de répondre à certaines causes, identifiées par le rapport de M. Emmanuel Sartorius, ingénieur général des Mines, expliquant les difficultés financières du constructeur.
D’une part, il existe d’importantes marges de progression dans la gouvernance de Peugeot. Il semble que le caractère familial de l’actionnariat n’ait pas facilité l’adoption des décisions stratégiques des organes de gouvernance. Le renouvellement du conseil de surveillance et la nomination d’un administrateur indépendant devraient contribuer à améliorer le fonctionnement des organes sociaux de l’entreprise.
Par ailleurs, le rapport de M. Sartorius identifie les carences du dialogue social comme un obstacle important au maintien de la confiance des salariés dans la direction. La nomination d’un administrateur représentant des salariés devrait permettre d’assurer une information complète du personnel et de préciser la vision de l’avenir du groupe.
D’autre part, l’interdiction du versement des dividendes constitue une mesure particulièrement bienvenue pour préserver la structure financière du groupe et ne pas entamer ses capacités à investir et à se moderniser.
Comme le montre le rapport de M. Sartorius, le groupe Peugeot a mené une politique particulièrement généreuse de rémunération des actionnaires. Le graphique ci-après illustre le fait que, entre 1999 et 2011, l’entreprise a distribué des dividendes pour un montant total de 2,9 milliards d’euros et mené des programmes de rachats d’action pour 3,1 milliards d’euros. Le rapport constate que cette politique a permis aux actionnaires historiques de remonter au capital du groupe.
M. Sartorius souligne le caractère discutable de la rémunération, de près de 450 millions d’euros, servie aux actionnaires en 2011. Il estime qu’« avec le recul, la mise en œuvre de la décision de l’assemblée générale d’avril 2011 de consacrer près de 450 millions d’euros à la distribution de dividendes et au rachat d’actions paraît inopportune à plusieurs titres. Tout d’abord, elle traduit un manque d’anticipation du retournement du marché qui était alors en train de se produire. Ensuite, elle a privé le groupe de ressources financières commensurables aux plans d’économie qu’il a dû mettre en œuvre fin 2011 et 2012 » – le plan d’économie portant sur un milliard d’euros.
DIVIDENDES ET RACHATS D’ACTIONS DE PSA (1997-2011)
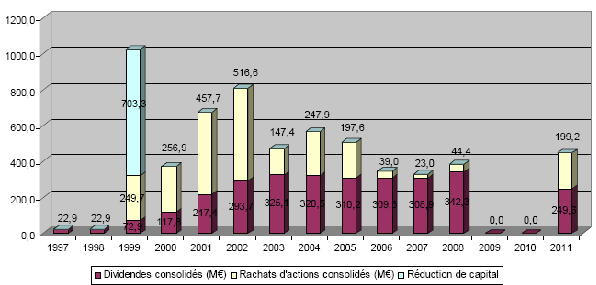
Source : rapport de M. Emmanuel Sartorius au ministre du Redressement productif.
Il semble que l’une des causes expliquant les difficultés du groupe Peugeot tient à ses modalités de gouvernance et aux difficultés que peut poser le caractère familial de son actionnariat. Dans ces conditions, il est logique que les contreparties demandées portent essentiellement sur la composition du conseil de surveillance.
Les banques créancières devraient s’engager à maintenir un volume de financement qui serait de l’ordre de 11,5 milliards d’euros, dont 1 milliard d’euros de liquidités supplémentaires – ce montant restant à confirmer.
Selon un analyste de crédit, la plupart des principales lignes de crédit auraient été renouvelées et renégociées, avec de possibles réductions sur la période 2013-2015. Les nouvelles conditions associées à ces renouvellements de lignes de crédit – obligations de respect de certains ratios financiers, cas d’une nouvelle dégradation de la notation... – n’ont pas été publiées.
En s’engageant au profit de Banque PSA, l’État s’expose financièrement à un éventuel défaut de cette filiale.
Une telle hypothèse paraît hautement improbable en raison de la qualité des fondamentaux financiers de l’établissement de crédit. Dans l’hypothèse d’une mise en extinction de la société, qui constitue le pire des scénarios, Banque PSA continuerait à percevoir les remboursements et les intérêts des prêts qu’elle a octroyés, ce qui lui permettrait de rembourser ses dettes sans que la garantie de l’État ne soit appelée.
Dans l’hypothèse d’une cession de la société, qui serait un autre scénario négatif, l’État serait délié, selon le projet de convention de garantie, des engagements pris en faveur de la société.
Enfin, comme le prévoit le II du présent article, la convention de garantie pourrait prévoir des sûretés au profit de l’État.
Au total, le risque financier pris par l’État apparaît limité et doit être mis au regard des coûts engendrés par un défaut de la société, une fragilisation durable du groupe Peugeot et son impact sur l’emploi et la croissance de l’ensemble de l’économie.
Le III prévoit une information annuelle du Parlement sur la mise en œuvre du présent article.
Une telle information devra prévoir une présentation détaillée de la situation financière de Banque PSA et de l’ensemble du groupe Peugeot. Elle devra également présenter les caractéristiques des obligations garanties – maturité, taux d’intérêt...
Cette information devra également préciser l’ensemble des éléments qui, à ce stade, n’ont pas été portés à la connaissance du Parlement – part exacte de l’engagement des banques créancières, rémunération de la garantie, recettes attendues du fait de cette garantie... – ainsi qu’une présentation de la mise en œuvre des engagements pris par Peugeot en contrepartie du soutien apporté par l’État.
*
* *
La Commission examine l’amendement CF 40 du rapporteur général.
M. le rapporteur général. L’amendement décrit le contenu de l’information attendue dans le rapport du Gouvernement au Parlement sur la garantie apportée à PSA Finance. Il est anormal que la convention entre l’État et l’entreprise ne nous ait pas été transmise.
La Commission adopte l’amendement (Amendement n° 213) et l’article 31 ainsi modifié.
*
* *
Puis elle adopte le projet de loi de finances rectificative pour 2012 ainsi modifié.
*
* *
TABLEAU COMPARATIF
Le tableau comparatif, les amendements examinés
par la Commission ainsi que l’annexe sont consultables dans la version PDF