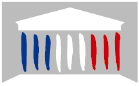N° 767
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 février 2013.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LE PROJET DE LOI d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République,
PAR M. Yves DURAND,
Député.
——
Voir le numéro :
Assemblée nationale : 653.
LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION 9
INTRODUCTION 13
I.- UNE ÉCOLE DÉSTABILISÉE EN PROFONDEUR 15
A. UNE ÉCOLE CONFRONTÉE AU DÉFI DE L’HÉTÉROGÉNÉITÉ DE SES ÉLÈVES 15
1. Une organisation scolaire peu adaptée aux besoins des élèves fragiles 16
2. Des résultats en plus en plus dégradés 17
a) Une part croissante d’élèves en difficulté 18
b) Une école qui transforme les inégalités sociales en inégalités scolaires 24
c) Un échec scolaire massif 25
B. UNE ÉCOLE QUI ALLOUE AU PRIMAIRE UNE PART DES DÉPENSES PAR ÉLÈVE TRÈS INFÉRIEURE À LA MOYENNE EUROPÉENNE 27
C. UNE ÉCOLE AUX RYTHMES PÉNALISANTS 30
1. Des rythmes scolaires déconnectés des besoins des élèves 31
a) Une année scolaire excessivement courte dans le primaire 31
b) Une semaine de quatre jours contraire aux intérêts des élèves-enfants 33
2. Des journées chargées mais probablement peu efficaces 35
D. UNE ÉCOLE QUI ORIENTE PAR L’EXCLUSION 38
1. Un processus qui déprécie les élèves rencontrant des difficultés scolaires et, au-delà, la voie professionnelle 39
2. Des mesures ponctuelles d’amélioration des dispositifs d’information et d’orientation adoptées en 2006 et 2009 40
II.- UNE ÉCOLE GRAVEMENT AFFAIBLIE QUI AVAIT ATTEINT SES LIMITES SOUS L’EFFET DES RÉDUCTIONS MASSIVES D’EMPLOIS 43
1. Des moyens d’enseignement laminés 44
2. Une scolarisation à deux ans devenue étique 50
3. Des dispositifs d’aide peu opérationnels 53
C. UNE FORMATION PROFESSIONNELLE DES MAÎTRES SACRIFIÉE SUR L’AUTEL BUDGÉTAIRE 57
1. Une sous-professionnalisation résultant des suppressions de postes permises par la « mastérisation » 57
a) La formation des maîtres : une compétence progressivement déléguée des IUFM aux universités 57
b) Les « dessous » de la mastérisation : une entrée dans le métier d’enseignant devenue hasardeuse pour économiser 9 000 postes 59
c) Une dernière estocade contre le principe de l’alternance de la formation heureusement parée par l’approche des élections 65
2. Une réforme qui a provoqué une crise aiguë du recrutement en 2011 66
3. Des mesures correctives prises pour les enseignants-stagiaires de l’année 2012-2013 68
III.- UNE REFONDATION DE L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE QUI EST ATTENDUE, NÉCESSAIRE ET AMBITIEUSE 71
A. UNE RÉFORME PRÉPARÉE SELON UNE MÉTHODE EXEMPLAIRE, INNOVANTE ET EFFICACE 71
1. L’association étroite des parties prenantes au processus 72
a) La concertation sur la refondation de l’école, un modèle de démocratie participative 72
b) Un dialogue social nourri au cours de l’élaboration du projet de loi, et même après 74
2. La nécessité d’aller vite 76
3. Des mesures constituant un véritable appel à la jeunesse adoptées préalablement à l’examen du présent projet de loi 77
a) Les mesures d’urgence du collectif budgétaire d’août 2012 77
b) Les emplois d’avenir professeur 78
c) Le budget 2013 79
B. UN PROJET DE LOI D’ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION QUI AGIT SUR LES « FONDATIONS » ET LES « FONDAMENTAUX » DE L’ÉCOLE 82
1. Des objectifs chiffrés pour élever le niveau des élèves 83
2. Une programmation des moyens conforme aux engagements 88
3. Des orientations pour la refondation 95
a) Former au métier d’enseignant 96
b) Développer l’école numérique 96
c) Rénover les enseignements et les apprentissages 97
d) Mettre les niveaux d’enseignement et les temps éducatifs au service de la réussite de tous les élèves 102
f) Renforcer l’innovation et le pilotage du système éducatif 109
g) Rendre l’école plus juste et plus ouverte 111
4. Un échéancier volontariste 115
TRAVAUX DE LA COMMISSION 119
I.- AUDITION DU MINISTRE 119
II.- DISCUSSION GÉNÉRALE 141
III.- EXAMEN DES ARTICLES 167
Article 1er : Approbation du rapport annexé présentant les objectifs de la politique d’éducation 167
TITRE 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 243
Article 2 : Modification des livres Ier, II et IV du code de l’éducation 243
Chapitre Ier : Les principes et missions de l’éducation 243
Section I : Les principes de l’éducation 243
Avant l’article 3 243
Article 3 : Réaffirmation de l’objectif de transmission des valeurs de la République 244
Article 4 : Formation à l’exercice de la citoyenneté dans la société de l’information et de la communication 250
Article 4 bis (nouveau) : Promotion de la santé 264
Après l’article 4 265
Article 5 : Développement de la scolarisation des moins de trois ans 266
Après l’article 5 273
Section 2 : L’éducation artistique et culturelle 276
Article 6 : Éducation artistique et culturelle 276
Après l’article 6 287
Article 6 bis (nouveau) : Contribution de l’éducation physique et sportive à l’éducation à la santé et à la sécurité 288
Après l’article 6 288
Section 3 : Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture 289
Avant l’article 7 289
Article 7 : Redéfinition du socle commun de connaissances et de compétences 289
Article 8 : Droit à une formation qualifiante 300
Après l’article 8 307
Article 9 : Développement du sens moral et de l’esprit critique 308
Section 4 : Le service public du numérique éducatif 310
Avant l’article 10 310
Article 10 : Création d’un service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance 310
Après l’article 10 321
Chapitre II : L’administration de l’éducation 323
Section 1 : Les relations avec les collectivités territoriales 323
Avant l’article 11 323
Article 11 : Coordination 324
Article 12 : Dépenses pédagogiques à la charge de l’État 325
Après l’article 12 328
Avant l’article 13 329
Article 13 : Dépenses informatiques à la charge des départements 329
Article 14 : Dépenses informatiques à la charge des régions 332
Après l’article 14 333
Article 14 bis (nouveau) : Utilisation des locaux et équipements scolaires des collèges en dehors du temps scolaire 334
Article 15 : Utilisation des locaux et équipements scolaires des lycées et établissements régionaux d’enseignement adapté 335
Après l’article 15 337
Article 16 : Élaboration et mise en œuvre par la région du service public régional de la formation professionnelle 338
Article 17 : Coordination 341
Article 18 : Élaboration et mise en œuvre de la carte régionale des formations professionnelles initiales 342
Article 18 bis (nouveau) : Introduction des langues et cultures régionales dans le champ des activités éducatives, culturelles ou sportives complémentaires 346
Article 19 : Coordination dans le code général des collectivités territoriales 347
Après l’article 19 347
Section 2 : Le Conseil supérieur des programmes 348
Article 20 : Création du Conseil supérieur des programmes 348
Section 3 : Le Conseil national d’évaluation du système éducatif 362
Article 21 : Création du Conseil national d’évaluation du système éducatif 362
Après l’article 21 377
Chapitre III : Le contenu des enseignements scolaires 377
Article 22 : Modification du livre III du code de l’éducation 377
Section 1 : Dispositions communes 377
Article 23 : Organisation de la scolarité en cycles 377
Article 24 : Objectifs des programmes 381
Article 25 : Dispositifs d’aide à la maîtrise du socle commun 383
Article 25 bis (nouveau) : Appréciation de l’acquisition des connaissances et des compétences 386
Article 25 ter (nouveau) : Parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde professionnel 387
Section 2 : La formation à l’utilisation des outils numériques 391
Article 26 : Formation à l’utilisation des outils numériques 391
Section 3 : L’enseignement des langues vivantes étrangères 393
Article 27 : Enseignement obligatoire d’une langue vivante étrangère au début de la scolarité élémentaire 393
Article 27 bis (nouveau) : Invitation à intégrer les langues et cultures régionales dans l’enseignement 398
Section 4 : L’enseignement moral et civique 399
Section 5 : L’enseignement du premier degré 403
Article 29 : Cycles de l’école maternelle et élémentaire 403
Après l’article 29 404
Article 30 : Redéfinition des missions de l’école maternelle 405
Après l’article 30 410
Article 30 bis (nouveau) : Rapport annuel sur la situation des écoles maternelles 410
Article 31 : Redéfinition des missions de l’école élémentaire 411
Article 31 bis (nouveau) : Approches pédagogiques spécifiques pour les élèves issus de milieu principalement créolophone 422
Après l’article 31 422
Section 6 : Les enseignements du collège 423
Article 32 : Abrogation des cycles d’enseignement du collège 423
Article 32 bis (nouveau) : Continuum école élémentaire-collège 423
Article 33 : Définition de l’enseignement dispensé en collège 424
Article 34 : Suppression des dispositifs d’alternance pendant les deux dernières années de collège 430
Article 35 : Introduction d’une éducation aux médias numériques dans les collèges 434
Article 36 : Conditions d’attribution du brevet 435
Après l’article 36 438
Section 7 : Le baccalauréat 438
Section 8 : La formation en alternance 442
Article 38 : Suppression de l’« apprentissage junior » et limitation du « DIMA » aux élèves d’au moins quinze ans 442
Après l’article 38 448
Chapitre IV : Dispositions relatives aux écoles et établissements d’enseignement scolaire 448
Article 39 : Modification du livre IV du code de l’éducation 448
Section 1 : Les relations entre l’école et le collège 449
Avant l’article 40 449
Article 40 : Cadre pour la coopération école-collège 449
Article 40 bis (nouveau) : Relations des établissements scolaires avec leur environnement 458
Section 2 : Les écoles 459
Article 41 : Le conseil d’école 459
Section 3 : Les établissements publics locaux d’enseignement 467
Article 42 : Représentation de la collectivité de rattachement au sein du conseil d’administration des EPLE 467
Article 43 : Signature du contrat d’objectifs des EPLE 473
Après l’article 43 474
Section 4 : Les groupements d’établissements 475
Section 5 : Dispositions applicables aux établissements d’enseignement privés sous contrat 478
Article 45 : Application aux établissements privés sous contrat 478
Chapitre V : Les activités périscolaires 480
Article 46 : Mise en place du contrat éducatif territorial 480
Article 47 : Fonds d’aide aux communes pour la mise en place de la réforme des rythmes scolaires 488
Après l’article 47 496
Chapitre VI : Les écoles supérieures du professorat et de l’éducation 497
Article 48 : Coordination 497
Article 49 : Formation des personnels enseignants et d’éducation par les ESPE 498
Article 50 : Le statut de composante universitaire des ESPE 517
Article 51 : Création, missions et organisation des ESPE 518
Article 52 : Affectation aux ESPE des biens des IUFM 543
Article 53 : Coordination 544
Article 54 : Modification du code de la recherche 544
Après l’article 54 545
TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES 545
Article 55 : Élargissement du champ de l’exception pédagogique 545
Article 56 : Habilitation à prendre par ordonnance des mesures en matière contentieuse et disciplinaire 550
Article 57 : Modalités de création et d’installation des ESPE 556
Article 58 : Modalités d’application à Mayotte 560
Article 59 : Modalités d’application à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis et Futuna 562
Article 60 (nouveau) : Comité de suivi 563
ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 565
LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES Au rapport annexé (article 1er) : Les amendements adoptés par la Commission tendent à : – indiquer que la devise de la République et le drapeau tricolore doivent être apposés sur la façade de tout établissement scolaire et que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 doit être apposée dans tous les établissements scolaires publics et privés sous contrat ; – affirmer qu’il est impératif d’étudier les modalités de mise en œuvre d’un système de pré-recrutement des personnels enseignants dès la licence ; – préciser que les 7 000 postes consacrés au dispositif « plus de maîtres que de classes » pourront aussi renforcer les réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) et que les spécificités des missions et du fonctionnement des réseaux seront réexaminées et s’intégreront dans une logique de complémentarité avec l’ensemble des dispositifs d’aide ; – souligner qu’à l’occasion du renforcement ciblé de l’encadrement pédagogique des écoles, une attention particulière sera portée aux territoires ruraux et de montagne et que lors de l’élaboration de la carte scolaire, les autorités académiques auront un devoir d’information et de concertation avec les exécutifs locaux ; – lier la réforme des rythmes scolaires à l’interdiction effective des devoirs écrits à la maison pour les élèves du premier degré ; – affirmer que la durée de l’année scolaire devra évoluer afin de correspondre au mieux aux rythmes de vie et d’apprentissage des élèves ; – prévoir que le Conseil supérieur des programmes doit articuler ses réflexions non seulement par grand domaine disciplinaire mais par cycle ; – préciser que les pratiques pédagogiques différenciées induites par le collège unique doivent favoriser l’épanouissement personnel et la construction de l’autonomie intellectuelle des élèves et que les marges de manœuvres accordées à ce type d’établissement doivent permettre des expérimentations pédagogiques, soumises à évaluation, et du travail transversal et pluridisciplinaire ; – mentionner le rôle des conseillers d’orientation-psychologues ; – reconnaître la spécificité de l’enseignement de l’expression écrite ou orale et de la lecture en français dans les départements, les collectivités et les territoires ultramarins ; – préciser que, dans les académies concernées, l’apprentissage complémentaire d’une langue régionale sera favorisé, que le bilinguisme français-langue régionale sera encouragé dès l’école maternelle et que les activités éducatives et complémentaires organisées par les collectivités territoriales peuvent porter sur la connaissance des langues et cultures régionales ; – prévoir que le parcours d’éducation artistique et culturelle doit être l’occasion de mettre en place des pratiques pédagogiques co-construites ; – introduire un nouveau chapitre consacré à l’éducation à l’environnement, centré sur la sensibilisation aux comportements écoresponsables et aux savoir-faire permettant de préserver notre planète ; – encourager l’introduction et la généralisation de l’alimentation biologique et locale dans la restauration collective ; – définir les missions et le contenu du service public du numérique éducatif et préciser que l’offre de ressources numériques ne peut se développer au détriment des heures d’enseignement et doit être déployée dans le respect strict des programmes scolaires ; – indiquer que les cofinancements prévus par les programmes gouvernementaux en faveur du déploiement du haut débit sont notamment mobilisés pour raccorder de façon systématique les établissements scolaires ; – prévoir que les équipes éducatives sont sensibilisées et formées à la prévention des pratiques des « jeux dangereux » ; – souligner le rôle de partenaire essentiel de l’école du secteur associatif ainsi que du mouvement d’éducation populaire. Aux autres articles du projet de loi : – La Commission a supprimé l’article 3 qui visait à préciser les valeurs de la République que l’école fait partager aux élèves. – Elle a adopté un nouvel article 4 bis tendant à prévoir que l’éducation à la santé est une composante du droit à l’éducation et constitue un service gratuit et obligatoire. Par ailleurs, elle a précisé que : – la formation scolaire favorise la connaissance du patrimoine artistique et culturel et participe au développement de la créativité, en ajoutant que l’éducation artistique et culturelle comprend un parcours pour tous les élèves (article 6) ; – les éléments du socle commun de connaissances, de compétences et de culture sont fixés après avis du Conseil supérieur des programmes (article 7) ; – le droit à l’instruction a pour objet de partager les valeurs de la République (article 9). – À l’article 10, la Commission a redéfini le service public de l’enseignement numérique, en le transformant en service public du numérique éducatif, organisé dans le cadre du service public de l’enseignement et contribuant aux objectifs de celui-ci. – Elle a adopté un nouvel article tendant à permettre aux présidents de conseils généraux d’autoriser, dans un cadre conventionnel, l’utilisation des locaux des collèges par des entreprises, des organismes de formation pour les besoins de formation et, pour les besoins de l’éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques artistiques et culturelles, par des associations (article 14 bis). – Elle a en outre prévu que les autorités académiques mettent en œuvre les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire en fonction des moyens disponibles et conformément au classement par ordre de priorité établi par la convention signée entre l’État et la région (article 18). – En ce qui concerne le Conseil supérieur des programmes (CSP) et le Conseil national d’évaluation du système éducatif (CNE), la Commission a renforcé leur indépendance et précisé que ces instances sont composées selon le principe de parité entre les femmes et les hommes et que les parlementaires qui en sont membres sont désignés par les commissions compétentes en matière d’éducation de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elle a ajouté que le CSP peut émettre des avis, en étendant son pouvoir de proposition à l’introduction du numérique dans les méthodes pédagogiques. Quant au CNE, elle a prévu qu’il puisse émettre des recommandations au regard des résultats des évaluations internationales et que la durée du mandat de ses membres soit allongée de cinq à six ans (articles 20 et 21). – La Commission a précisé que le directeur de l’établissement d’enseignement doit informer dans les plus brefs délais les parents des dispositifs d’aide mis en œuvre par l’équipe pédagogique à des fins de maîtrise du socle commun (article 25). – Elle a adopté un article additionnel tendant à indiquer que le droit au conseil en orientation et en information s’exerce dans le cadre d’un parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde professionnel pour tous les élèves (article 25 ter). – Elle a adopté un article additionnel pour prévoir que les enseignants sont invités à intégrer les langues et cultures régionales dans leur enseignement afin de favoriser leur transmission (article 27 bis). – À l’article 30, la Commission a précisé que la formation dispensée dans les écoles maternelles développe l’estime de soi et qu’elle est adaptée aux besoins des élèves en situation de handicap. Elle a adopté un article additionnel indiquant que le gouvernement effectue un état des lieux annuel de la situation des écoles maternelles (article 30 bis). – S’agissant de la formation dispensée dans les écoles élémentaires, la Commission a précisé qu’elle dispense les éléments d’une culture historique et géographique et qu’elle assure les conditions d’une éducation à l’égalité de genre (article 31). – Elle a ajouté que dans les académies d’outre-mer, des approches pédagogiques spécifiques sont prévues dans l’enseignement de l’expression orale ou écrite et de lecture au profit des élèves issus de milieu principalement créolophone (article 31 bis). – La Commission a adopté un article additionnel tendant à prévoir que la formation dispensée dans les collèges se fait dans la continuité de l’école primaire et dans le cadre de l’acquisition progressive du socle commun de connaissances, de compétences et de culture (article 32 bis). Elle a précisé par ailleurs que les enseignements complémentaires qui peuvent être proposés en 3ème visent à favoriser l’acquisition du socle commun (article 33). Elle a également maintenu le principe selon lequel le diplôme national du brevet doit attester la maîtrise du socle commun (article 36). – En ce qui concerne le baccalauréat, elle a supprimé à l’article 37 la disposition prévoyant que le contrôle des connaissances et des compétences s’effectue discipline par discipline. – La Commission a précisé que la participation des parents au conseil d’école se fait par le biais de l’élection de leurs représentants (article 41). – La Commission a modifié sur plusieurs points les articles 49 et 51 consacrés aux écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) afin que ces écoles : * préparent les futurs enseignants et personnels d’éducation aux enjeux du socle commun et à ceux de la formation tout au long de la vie ; * organisent des formations de sensibilisation à l’égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations ; * prennent en compte, pour délivrer leurs enseignements, les technologies de l’information et de la communication et forment les étudiants et les enseignants à l’usage pédagogique des ressources numériques ; * assurent leurs missions avec d’autres établissements publics d’enseignement supérieurs partenaires. – À l’article 57, elle a précisé que les agents qui exercent leurs fonctions dans les instituts universitaires de formation des maîtres, à la date de leur dissolution, sont appelés à exercer dans les écoles supérieures du professorat et de l’éducation, sous réserve de leur accord. – Enfin, la Commission a adopté un nouvel article tendant à créer un comité de suivi chargé d’évaluer l’application de la loi et comprenant notamment deux députés et deux sénateurs (article 60). |
Le 9 février 2012, à Orléans, dans un grand discours sur l’école et la nation, François Hollande déclarait qu’il n’y aurait pas de reprise économique durable pour la France sans investissement dans son école. À cette occasion, il définissait, pour la première fois, la « priorité éducative » qui constitue, avec la jeunesse, le grand dessein de cette législature.
Cette ambition résulte d’une analyse des difficultés que rencontre notre pays : son redressement, dans la justice, doit être non seulement assuré, mais il faut aussi que ce mouvement réponde à la crise d’avenir qui affecte la société. Dès lors, pour se relancer, la France est invitée à se tourner, comme elle l’a fait à d’autres moments clefs de son histoire, vers l’école, qui fonde son identité républicaine.
C’est sur la base de ce constat qu’a été menée, l’été dernier, une grande concertation sur les leviers de la refondation de l’école. Celle-ci a débouché sur un rapport, remis le 9 octobre 2012 au Président de la République, et l’ouverture, avec les partenaires de l’éducation nationale, d’intenses consultations qui, pour certaines d’entre elles, annoncent de nouveaux chantiers et prolongeront ainsi cet exercice inédit.
Dès le 23 janvier 2013, notre Assemblée a été saisie du présent projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République qui, s’il constitue l’acte majeur de la politique éducative du quinquennat, n’épuise pas pour autant toutes les mesures devant y concourir.
Ainsi que le précise le rapport de la concertation, « il ne s’agit ni de se contenter d’aménager l’existant ni de mettre à bas tout l’édifice. Refonder ne signifie pas refondre à partir d’une tabula rasa, mais réexaminer pour donner du sens en se ressourçant sur des valeurs ».
L’entreprise est donc à la fois modeste et extrêmement ambitieuse. Elle repose sur trois grandes orientations :
– la priorité au primaire, soit une révolution copernicienne dans un système éducatif qui, depuis trop longtemps, marche sur la tête. Alors qu’en 2005, pour la première fois, la nation a fixé, avec le socle commun de connaissances et de compétences, une obligation de résultats à la scolarité obligatoire, nous privilégions les lycées généraux au détriment de l’école maternelle et élémentaire. Cette erreur d’arbitrage conduit un grand nombre d’élèves à un échec presque programmé ;
– la formation des enseignants, qui sera non seulement restaurée, mais repensée, grâce aux écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE). Celles-ci permettront de dépasser l’opposition entre la transmission des savoirs et les savoirs de la transmission – car il faut en finir avec les discours de salon sur les vertus d’un âge d’or éducatif dans lequel des millions d’élèves n’accédaient ni au brevet ni au baccalauréat – pour transformer l’acte d’enseignement dans les classes et faire vivre, sur tout le territoire, l’école de la République aujourd’hui fracturée ;
– les rythmes scolaires, enfin. Certes, ceux-ci relèvent du pouvoir réglementaire, comme une très grande partie des mesures de la refondation. Mais alors que toutes les parties prenantes, en 2010 et en 2011, ont préconisé, sur le sujet, des solutions convergentes, rien n’a bougé – jusqu’au décret du 24 janvier 2013 instituant une nouvelle semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. C’est un acte de courage, qui est critiqué parce qu’il responsabilise les équipes pédagogiques et les communes. À lui seul, il est la preuve que la refondation ne se paiera pas de mots, mais se traduira par des choix qui, derrière les moyens et les postes, sont tous d’ordre qualitatif.
L’examen du présent projet de loi en Commission des affaires culturelles et de l’éducation a été précédé par l’organisation, devant celle-ci, de trois auditions et tables rondes (sur la priorité au primaire et à la petite enfance, l’orientation scolaire et la formation des enseignants), ainsi que par les 37 auditions du rapporteur, qui ont permis d’entendre, au total, pendant plus de 44 heures, 118 personnes.
Le texte et le débat parlementaire suscitent de fortes attentes, qui ne devront pas être déçues. Au-delà, il conviendra de veiller à la mise en application de la refondation en s’assurant que ses mesures d’exécution, réglementaires et budgétaires, seront conformes aux engagements pris devant la représentation nationale. Dans les deux cas, l’idéologie ne pourra pas être de mise, puisque nous débattrons de l’école – le patrimoine de ceux qui n’ont rien.
I.- UNE ÉCOLE DÉSTABILISÉE EN PROFONDEUR
L’école française ne va pas bien. Alors qu’elle s’est « massifiée », en conduisant, à partir des années 1980, des classes d’âge entières au collège et près de 80 % d’entre elles au baccalauréat (77,5 % d’une génération en 2012), elle ne s’est pas réellement démocratisée.
En effet, malgré l’implication personnelle des enseignants auprès des élèves en difficulté, notre école semble taillée « sur mesure » pour certaines catégories d’enfants et d’adolescents, tandis que les autres suivent, en souffrant, une scolarité heurtée, redoublent, sont orientés vers les filières les moins prestigieuses ou quittent le système scolaire sans diplôme ou qualification.
En dépit de ce constat aujourd’hui largement partagé, et peu de temps après que le législateur eut fixé en 2005, avec le socle commun de connaissances et de compétences, un objectif de réussite de tous les élèves, les ressources de l’éducation nationale ont été, durant le précédent quinquennat, gravement affaiblies. La conjonction de ces deux phénomènes – l’un, ancien, qui suppose de revoir l’organisation de l’école et la formation des maîtres pour accompagner au mieux les élèves les plus fragiles ; l’autre, récent, qui a aggravé les effets du premier – a de ce fait profondément déstabilisé le système éducatif.
A. UNE ÉCOLE CONFRONTÉE AU DÉFI DE L’HÉTÉROGÉNÉITÉ DE SES ÉLÈVES
La conquête historique qu’a été l’accès des enfants issus des couches populaires au collège, puis au lycée et au baccalauréat, se heurte, depuis plus de trente ans, à la démocratisation limitée d’un système éducatif qui, par ses contenus d’enseignement et ses méthodes, ne favorise qu’un certain type d’élève. Un seul chiffre permet d’illustrer cette « démocratisation ségrégative » selon l’expression du sociologue, Pierre Merle (1) : 25 % des jeunes étaient en 2009 en série générale S, soit exactement la proportion d’une classe d’âge allant au lycée à la fin des années 1970, juste avant que la réforme du collège unique ne produise ses effets… (2).
Cette école est clairement à la peine face à l’hétérogénéité de ses élèves. Elle se caractérise en effet par un « fond de classe étoffé » (3), dont les effectifs grossissent d’année en année, et sa très forte « capacité » à transformer les inégalités sociales en inégalités scolaires.
1. Une organisation scolaire peu adaptée aux besoins des élèves fragiles
« Une école juste ne peut se borner à sélectionner ceux qui ont le plus de mérite, elle doit aussi se soucier du sort des vaincus » (4). Cette maxime de M. François Dubet permet de pointer du doigt la principale faiblesse de notre système éducatif : celui-ci ne sait pas traiter la difficulté scolaire.
Durant la XIIIe législature, ce constat d’impuissance a été présenté à la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, en ces termes, par le président de la 3ème chambre de la Cour des comptes, M. Jean Picq : « Notre système sélectionne ; il ne sait pas porter le plus grand nombre à la réussite. Ainsi, notre élite est de grande qualité, mais insuffisante et il y a beaucoup trop de laissés pour compte » (5).
Cette incapacité à atteindre l’objectif de la réussite pour tous résulte en partie d’une approche « élitiste » de l’enseignement, très ancienne, à laquelle beaucoup de familles et d’enseignants restent attachés. Centrée sur le cours magistral et le discours argumentatif, cette conception se nourrit de l’illusion selon laquelle le lycée d’enseignement général de centre-ville constitue « l’horizon indépassable » des parcours scolaires. En caricaturant, on pourrait dire qu’au sein de l’éducation nationale, une grande partie de son organisation – ses moyens budgétaires comme l’approche hypothético-déductive de l’enseignement dispensé dans le second degré – se rapporte à ce type d’établissement, peu adapté à la prise en compte de l’hétérogénéité des élèves.
Ainsi que le constate la Cour des comptes dans son rapport sur L’Éducation nationale face à l’objectif de la réussite de tous les élèves, « alors que le code de l’éducation, dès son premier article, affirme que "le service public d’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves", ce postulat ne se vérifie pas dans les faits. Dans son organisation actuelle, l’enseignement scolaire reste encore principalement fondé sur un modèle qui était adapté à une période où seule une minorité d’une classe d’âge – 20 % en 1970 – suivait tout le parcours de l’enseignement scolaire et obtenait le baccalauréat. Il tend, de ce fait, à privilégier les élèves sans difficultés particulières, c’est-à-dire ceux qui seront bacheliers à la sortie du système scolaire et poursuivront des études supérieures, soit seulement un peu plus de la moitié de chaque classe d’âge ».
La Cour ajoute que « le mode d’enseignement traditionnel, dispensé de façon uniforme par un enseignant délivrant un cours devant un groupe considéré comme scolairement homogène, n’est pas adapté à un système qui fixe des objectifs de réussite pour tous les élèves, quelle que soit l’hétérogénéité de leurs profils individuels » (6).
Cette réticence à prendre en compte la diversité des besoins des élèves explique d’ailleurs la « révolution manquée » du collège unique. Au lieu d’avoir été pensé comme le premier maillon d’un parcours scolaire construit sur la durée, permettant d’assurer la continuité des apprentissages avec l’école élémentaire et ainsi de mieux accompagner les élèves fragiles, il a été conçu, selon M. Jean-Paul Delayahe, alors inspecteur général de l’éducation nationale, devenu depuis directeur général de l’enseignement scolaire, comme la « propédeutique du lycée d’enseignement général ». Dès lors, si l’intégration, lors des années 1980, des élèves du primaire dans ce « petit lycée » s’apparente, de façon rétrospective, à une forme de miracle scolaire, il n’en reste pas moins que pour 15 % à 20 % des collégiens, « le système a atteint ses limites et il est en train d’imploser » (7).
Enfin, cette relative « indifférence » à l’hétérogénéité des besoins a une traduction budgétaire : les moyens d’enseignement attribués par le ministère de l’éducation nationale ne sont pas corrélés aux difficultés scolaires constatées dans les établissements. La Cour des comptes a d’ailleurs adressé, à ce sujet, un référé au ministre, qui constate que des établissements confrontés à un échec scolaire important peuvent être moins bien dotés que des établissements ayant des taux de réussite plus élevés (8).
Le président de la 3ème chambre de la Cour, M. Patrick Lefas, a ainsi confirmé devant la Commission des affaires culturelles et de l’éducation que le système d’allocation des moyens, qui a été élaboré en 2000, ne part pas des besoins des élèves analysés sur le terrain, contrairement à ce qui se passe dans de nombreux pays, comme le Canada, les Pays-Bas ou le Land de Berlin en Allemagne : « le processus d’allocation entre les académies reste fondé sur une analyse des facteurs externes au système scolaire, tels que les catégories socioprofessionnelles et la prédominance ou pas de zones rurales. Des établissements rencontrant des difficultés similaires mais situés dans deux académies différentes seront donc traités de manière différente en fonction de l’allocation reçue par l’académie, au détriment des élèves les plus en difficulté. Non seulement le système est inéquitable, mais il est inefficace » (9).
2. Des résultats en plus en plus dégradés
Particulièrement bien attestée sur le plan statistique, la frontière qui sépare les élèves pour qui l’école française est l’une des meilleures au monde de ceux pour qui elle est l’une des plus mauvaises conforte les inégalités sociales et nourrit les sorties sans diplôme ou qualification du système éducatif.
Ainsi, tous les indicateurs sont, objectivement, « au rouge ». En effet, le système éducatif se caractérise, depuis au moins dix ans, par une forme d’inertie dans la dégradation, tandis que les résultats de nos élèves sont, parmi tous les pays de l’OCDE, ceux les plus corrélés à l’origine sociale.
a) Une part croissante d’élèves en difficulté
● Un système scolaire « fracturé » malgré le socle commun
Malgré le socle commun de connaissances et de compétences, qui définit depuis 2005 ce à quoi chaque élève a droit, une fracture scolaire s’est instaurée dans notre pays.
Certes, il convient de garder à l’esprit que le socle commun a été trop tardivement adopté pour avoir une prise efficace sur le fossé qui tend à séparer les « bons » élèves des autres. Celui-ci est devenu apparent au milieu des années 1990, grâce aux études de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère de l’éducation nationale. Le socle commun, quant à lui, n’a été institué que dix ans après, par la loi du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École, alors même qu’il vise à garantir à chaque élève l’acquisition des savoirs et savoir-faire indispensables à l’accomplissement, avec succès, de sa scolarité et à l’exercice de la citoyenneté.
En outre, depuis son instauration, ce nouveau principe d’organisation des enseignements a été défendu avec une intensité très variable par les ministres en charge de l’éducation nationale. Aussi son articulation avec les programmes d’enseignement laisse-t-elle beaucoup à désirer. De plus, cet outil n’a été doté de son volet opérationnel et méthodologique qu’en 2010, soit cinq ans après son adoption par le Parlement. Il ne donne d’ailleurs pas satisfaction pour autant. En particulier, le livret personnel de compétences, tel que défini par l’arrêté du 14 juin 2010, est inutilement complexe, son souci de précision trop poussé pouvant, selon le Haut conseil de l’éducation, donner le sentiment « d’une parcellisation extrême des compétences et d’une approche… mécanique » (10).
Trop récent, peu voire très peu approprié par l’institution scolaire, le socle n’a pas encore produit ses effets sur les disparités scolaires grevant notre système éducatif. Or, depuis la publication des résultats de l’évaluation internationale PISA (Programme for International Student Assessment), celles-ci sont désormais apparentes aux yeux des familles.
Conduite tous les trois ans par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), cette enquête permet de mesurer et de comparer les compétences des élèves de 15 ans dans trois domaines : la compréhension de l’écrit, la culture mathématique et la culture scientifique. En fonction de leurs résultats, les élèves sont répartis en 7 niveaux de compétences, deux niveaux ayant été ajoutés en 2009 pour affiner les hauts et bas niveaux.
Dans le cas de la France, les évaluations montrent que, depuis dix ans, l’écart entre les élèves suivant une scolarité normale (60 % de la population scolaire) et les élèves en difficulté (40 % de la population scolaire) ne cesse de progresser.
On observe ainsi un accroissement régulier de la population des élèves rattachée aux faibles niveaux de compétences : en 2009, les élèves des bas niveaux – inférieurs au niveau 2 – représentent 19,7 % contre 15,2 % en 2000, soit une hausse de 30 %, ce qui est considérable. Alors que les élèves situés en bas du tableau sont de plus en plus nombreux, une partie des autres appartiennent, tout aussi clairement, à « l’élite scolaire » telle qu’établie par l’enquête de l’OCDE : la performance des élèves français de 15 ans dits « à l’heure », car ils n’ont pas redoublé et fréquentent une classe de seconde générale et technologique, est en effet comparable aux meilleurs scores obtenus à PISA 2009 (11).
Pourcentage d’élèves selon le niveau de compétences en compréhension de l’écrit aux évaluations PISA (2000 et 2009)
Niveau inférieur à 1 |
Niveau 1 |
Niveau 2 |
Niveau 3 |
Niveau 4 |
Niveau 5 | |||
France 2009 |
4,2 |
11 |
22 |
30,6 |
23,7 |
8,5 | ||
OCDE 2000 |
6 |
11,9 |
21,7 |
28,7 |
22,3 |
9,5 | ||
Niveau inférieur à 1b |
Niveau 1b |
Niveau 1a |
Niveau 2 |
Niveau 3 |
Niveau 4 |
Niveau 5 |
Niveau 6 | |
France 2009 |
2,3 |
5,6 |
11,8 |
21,1 |
27,2 |
22,4 |
8,5 |
1,1 |
OCDE 2009 |
1,1 |
4,6 |
13,1 |
24 |
28,9 |
20,7 |
6,8 |
0,8 |
NB : En 2009, le niveau 1 est devenu 1a et le niveau inférieur à 1 a été scindé en niveau 1b et niveau inférieur à 1b ; le niveau 5 a été scindé en niveau 5 et niveau 6.
Source : ministère de l’éducation nationale, note d’information n° 10-24, décembre 2010.
● Une école primaire défaillante pour 40 % de ses élèves
Les résultats de notre système éducatif sont donc médiocres, à commencer par ceux de l’école primaire. Or, ainsi que l’a rappelé l’Institut Montaigne dans sa contribution à la concertation sur la refondation de l’école, « si l’école primaire dysfonctionne, c’est la scolarité tout entière qui devient une entreprise impossible : il n’est en effet pas possible d’apprendre "autre chose" si l’on est incapable de lire, d’écrire, de former un raisonnement simple » (12).
Selon le Haut conseil de l’éducation, chaque année, quatre écoliers sur dix, soit environ 300 000 élèves, sortent du CM2 avec de « graves lacunes ». Près de 200 000 d’entre eux ont des acquis « fragiles et insuffisants » en lecture, écriture et calcul et plus de 100 000 n’ont pas la maîtrise des compétences de base dans ces domaines, des lacunes qui « empêcheront ces élèves de poursuivre une scolarité normale au collège » (13).
De même pour M. Laurent Bigorgne, de l’Institut Montaigne, alors que notre élite scolaire, mesurée par l’évaluation PISA, plafonne à 8 %, contre 12 % à 17 % dans certains pays membres de l’OCDE, 40 % des enfants qui entrent en classe de 6ème ont des lacunes graves – celles-ci étant de surcroît, pour 15 % d’entre eux, « quasiment irrémédiables » (14).
En outre, du point de vue des comparaisons internationales, la dernière enquête PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), présentée le 11 décembre 2012, fait état d’une baisse continue des performances en lecture des élèves de CM1. Le score de la France est en effet passé de 525 points en 2001 à 520 points en 2011 et se situe, désormais, très en dessous de la moyenne européenne (534).
Surtout, l’enquête montre une diminution très significative des performances pour la compréhension des textes informatifs (- 13 points), ainsi qu’une « surreprésentation de nos élèves dans la catégorie des élèves en difficulté et, inversement, une sous-représentation des élèves qui s’en sortent mieux » (15). Ainsi 32 % des enfants français se rangent dans le quart des élèves européens les plus faibles et seulement 5 % de nos élèves parviennent au score de 625 points, qui marque une compréhension approfondie des textes. Les élèves français sont, de surcroît, par manque de confiance en eux, toujours les plus nombreux à s’abstenir de répondre et aussi les plus nombreux à ne pas terminer les épreuves.
● Un collège qui aggrave leurs difficultés
Avec un « stock » de 300 000 élèves qui entrent sans les bases au collège, les résultats de ce niveau d’enseignement ne peuvent qu’être préoccupants.
En outre, celui-ci aggrave la situation des élèves en difficulté. Ainsi que l’a souligné le rapport de notre ancien collègue M. Jacques Grosperrin, citant à ce propos l’historien Antoine Prost, « le collège n’a aucun effet de remédiation : il ne répare pas les insuffisances des élèves du primaire ; il les creuse » (16).
Ce phénomène est parfaitement mis en évidence par les indicateurs mesurant les compétences de base en fin d’école primaire et de collège. Si en mars 2012, en fin de CM2, la proportion d’élèves qui maîtrisaient ces compétences en français était de 90 % dans l’enseignement public, hors éducation prioritaire, celle-ci n’atteignait que 75,4 % en fin de 3ème (17).
Par ailleurs, l’évolution dans le temps des indicateurs associés aux lois de finances et aux lois de règlement pour les élèves des établissements les plus défavorisés (18) témoigne d’une dégradation des performances scolaires de ces jeunes en fin de 3ème. La proportion de ces élèves maîtrisant les compétences de base en français est ainsi passée de 55 % en juin 2007 à 47 % en juin 2011 (19).
Les constats qualitatifs sur la maîtrise du français par les collégiens faits par les inspections générales de l’éducation nationale à l’occasion de leur travail sur les dispositifs d’aide aux élèves sont encore plus éloquents : « La maîtrise de la langue française reste bel et bien une pierre d’achoppement dans tous les collèges visités, en particulier dans l’éducation prioritaire. Il apparaît qu’un grand nombre d’élèves n’ont qu’un niveau de "survie" en langue française, niveau insuffisant pour suivre avec profit des enseignements disciplinaires. Les "taiseux" constituent, selon les enseignants rencontrés, parfois la majorité dans les classes. Ils s’enferment dans le silence parce qu’ils n’ont pas "les mots pour le dire" et qu’ils ne sont pas suffisamment accompagnés pour les acquérir » (20).
● Une hausse marquée du nombre d’élèves en difficulté face à l’écrit
Depuis une dizaine d’années, la proportion d’élèves en difficulté face à l’écrit a considérablement augmenté. Ce phénomène est retracé dans une synthèse établie par les statisticiens de la DEPP et publiée par l’INSEE en 2011.
Sont analysés, dans ce cadre, les résultats de six évaluations :
– une évaluation issue du dispositif « CEDRE » ou cycle d’évaluations disciplinaires réalisées sur échantillons (mesurant les compétences générales en 3ème ou CG) ;
– deux comparaisons dites « historiques », c’est-à-dire de plus long terme, à dix et vingt ans d’intervalle en fin de primaire (LEC, « Lire, écrire, compter » en 1987, 1997 et 2007) et en début de 6ème (SPEC6 ou étude spécifique des difficultés de lecture à l’entrée en 6ème en 1997 et en 2007) ;
– et, enfin, deux évaluations internationales, PISA et PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study qui a mesuré les performances en lecture en fin de CM1 en 2001 et 2006).
Au total, la proportion d’élèves en difficulté face à l’écrit concernerait, aujourd’hui, près d’un élève sur cinq. Le graphique ci-dessous illustre cette évolution, significative pour la majorité des évaluations examinées.
Ainsi, en fin d’école, « le pourcentage d’élèves faibles en compréhension de l’écrit a presque doublé de 1997 à 2007, passant de 11,0 % à 21,4 %, selon les résultats de l’évaluation LEC », tandis que dans le second degré, « les conclusions des évaluations PISA et CEDRE CG sont convergentes : la part des élèves les plus en difficulté a augmenté de manière significative : de 15,2 % à 19,8 % pour la première, et de 15,0 % à 17,9 % pour la seconde » (21).
Évolution de la part des élèves en difficulté face à l’écrit
(en %)
Source : « France, portrait social », édition 2011, INSEE.
Nota : « Élèves en difficulté » = SPEC6 : élèves de 6ème en difficulté de lecture ; LEC : élèves de CM2 dans les faibles niveaux (référence : 1er décile en 1987) ; PIRLS : élèves de CM1 sous l’« Intermediate Benchmark » ; PISA : élèves de 15 ans dans les groupes inférieurs au niveau 2 ; CEDRE CG = élèves de fin de 3ème générale dans les groupes inférieurs au niveau 2.
L’accroissement du pourcentage des élèves en difficulté concerne tout particulièrement les collèges de l’éducation prioritaire, comme l’indique la figure ci-dessous.
En effet, selon l’évaluation SPEC6, la part des élèves en difficulté de lecture à l’entrée de la 6ème dans ces collèges a augmenté de 20,9 % à 31,3 % de 1997 à 2007.
La comparaison des résultats de l’évaluation CEDRE « compétences générales » entre 2003 et 2009 est tout aussi préoccupante : « la proportion d’élèves dans les niveaux de performances les plus faibles (inférieurs au niveau 2) dans le secteur de l’éducation prioritaire a augmenté de 7,7 points entre les deux cycles d’évaluation, passant de 24,9 % en 2003 à 32,6 % en 2009. En comparaison, la part des élèves faibles n’a augmenté que de 2,9 points dans les collèges du secteur public hors éducation prioritaire et elle est restée stable dans le secteur privé. En 2009, près d’un tiers des élèves de fin de 3ème sont ainsi en difficulté dans le secteur de l’éducation prioritaire, contre 17,7 % dans les collèges publics hors éducation prioritaire et 8,5 % dans les établissements privés » (22).
Évolution des difficultés selon le secteur et les zones d’éducation
(en %)
![]()
![]()
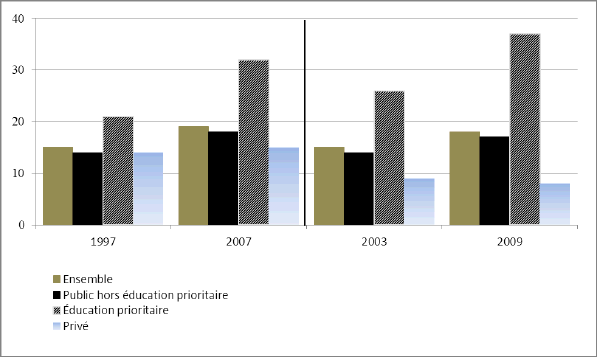
Source : « France, portrait social », édition 2011, INSEE.
Enfin, ces difficultés sont encore plus prégnantes dans les outre-mer, ainsi que le rappelle le rapport de la concertation sur la refondation de l’école. Le pourcentage des jeunes en difficulté de lecture repéré lors des Journées défense et citoyenneté est en effet alarmant : autour de 30 % pour la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, 50 % en Guyane et 70 % à Mayotte (23).
b) Une école qui transforme les inégalités sociales en inégalités scolaires
L’enquête PISA permet non seulement de « classer » les élèves français sur une échelle internationale, mais aussi d’analyser l’équité de notre système éducatif par rapport à celui des autres pays de l’OCDE, grâce à des indicateurs mesurant le lien entre les performances des élèves et leur milieu social.
Or, ce lien se renforce depuis une dizaine d’années, le statut économique, social et culturel des parents expliquant une plus grande part de la variation des scores des élèves français qu’en moyenne dans l’ensemble des pays de l’OCDE. Ainsi que l’a souligné la ministre déléguée en charge de la réussite éducative, Mme George Pau-Langevin, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2013, « l’anomalie de notre système éducatif tient au fait que nous sommes, parmi les pays de l’OCDE, un de ceux où les catégories sociales sont le plus nettement corrélées avec les résultats des enfants » (24).
En moyenne, dans les pays de l’OCDE, la progression d’une unité de l’indice PISA de statut économique, social et culturel entraîne un écart de performance de 38 points. En France, cet écart est de 51 points ; il est donc supérieur de plus de 30 % à la moyenne de l’OCDE. Notre pays est d’ailleurs, avec la Nouvelle-Zélande, celui où ce différentiel est le plus important (25).
En outre, comme cet écart n’était, en 2000, « que » de 44 points, on peut affirmer qu’en France, depuis une dizaine d’années, les inégalités sociales et les disparités scolaires se sont accrues.
La France, pays de la réussite scolaire prédestinée
Ainsi que l’a observé, en 2010, le président de la 3ème chambre de la Cour des comptes, M. Jean Picq, la France est bien « le pays de la prédestination sociale, où la réussite scolaire est la plus fortement corrélée aux origines sociales ». Il a rappelé, à cet égard, que « plus de trois quarts (78,4 %) des élèves provenant de catégories sociales favorisées obtiennent un baccalauréat général, contre seulement moins d’un cinquième (18 %) des élèves d’origine sociale défavorisée. Quant aux bacheliers qui entrent dans les classes préparatoires aux grandes écoles, 55 % ont un père cadre, chef d’entreprise, professeur ou membre d’une profession libérale. Cette proportion est trois fois et demie plus importante que leur part dans la cohorte des élèves de 6ème, tandis que celle des enfants d’origine ouvrière est quatre fois moins importante » (26).
De même, selon le chercheur Georges Fotinos, notre système éducatif se caractériserait par des « filières de scolarité ». Il constate ainsi que :
– 13,2 % des élèves, soit près de 100 000 élèves, sont en retard de scolarité lors de l’entrée en 6ème. Selon les professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) des parents, ils se répartissent en fils ou filles d’inactifs (29 %), d’ouvriers (18 %), de cadres (4 %), et d’enseignants (3 %) ;
– en 2011, un peu plus de 96 000 élèves de collèges étaient scolarisés en SEGPA (section d’enseignement général et professionnel et adapté), sur des critères fortement sociaux (PCS des parents d’élèves : 0,3 % d’enseignants, 2 % de professions libérales et de cadres, 70 % d’ouvriers, d’inactifs ou de chômeurs et 14 % d’employés) ;
– en 2011, 1,4 million d’élèves étaient scolarisés dans les lycées d’enseignement général et technologique et près de 700 000 en lycée professionnel. 76 % des premiers étaient des enfants de cadres et professions intellectuelles supérieures contre 9 % d’enfants d’ouvriers. 41 % des seconds étaient des enfants d’ouvriers contre 9,4 % d’enfants de cadres et de professions intellectuelles supérieures (27).
En réalité, notre école se caractérise par le fait qu’elle ne donne que très rarement une « deuxième chance » aux élèves fragiles, que leurs difficultés et leurs origines familiales ou sociales tendent à enfermer dans une spirale d’échecs ou d’orientations subies. En effet, pour le ministre de l’éducation nationale, M. Vincent Peillon, « les destins scolaires se nouent très tôt et, avec eux, des destins non seulement sociaux mais tout simplement humains – cela va jusqu’à influer sur l’espérance de vie » (28).
Du point de vue de l’équité scolaire, notre pays, dans lequel les mairies affichent la devise « Liberté, Égalité, Fraternité », est dans la situation la plus défavorable qui soit.
Véritable scandale pour la République, l’échec scolaire, c’est-à-dire, selon les définitions internationales, l’ensemble des jeunes qui sortent sans diplôme ou qualification de l’enseignement secondaire, représente près d’un jeune sur cinq. Chaque année, selon la ministre déléguée, chargée de la réussite éducative, Mme George Pau-Langevin, ce phénomène concerne 135 000 à 150 000 jeunes.
Même si la faiblesse des effectifs interrogés affaiblit leur précision, deux indicateurs permettent de mesurer, aujourd’hui, la proportion de ces jeunes :
– d’une part, les « sortants peu diplômés », leur nombre étant calculé par le ministère de l’éducation nationale à partir des Enquêtes emploi de l’INSEE. Il s’agit des jeunes qui ont quitté leurs études initiales depuis plus d’un an et qui sont sortis non diplômés ou diplômés, au plus, du brevet des collèges. En moyenne, sur 2008, 2009 et 2010, leur nombre était égal à 122 000, représentant ainsi 17 % des jeunes ayant terminé leur formation initiale (29) ;
– d’autre part, les « sortants précoces » ou « décrocheurs ». Âgés de 18 à 24 ans, ces jeunes n’ont pas suivi de formation au cours des quatre dernières semaines précédant l’enquête et n’ont pas terminé avec succès un enseignement secondaire du second cycle : ils n’ont ni CAP, ni BEP, ni diplôme plus élevé. En 2011, leur part était de 11,9 % (contre 13,5 % dans l’Europe à 27), alors que l’Union européenne vise un pourcentage de sorties précoces inférieur à 10 % pour 2020, notre pays ayant, pour sa part, fixé l’objectif à 9,5 %. Or, depuis près de dix ans, ce pourcentage est relativement stable, puisqu’il représentait, en 2003, 12,3 % des jeunes considérés. Enfin, par rapport à ses partenaires européens, si la France se situe à un niveau inférieur à celui du Royaume-Uni (15 %) et proche de l’Allemagne (12 %), elle fait moins bien que la Finlande (10 %) ou les Pays-Bas (9 %) (30).
Il y a lieu de noter que ce dernier indicateur a remplacé celui des jeunes âgés de 18 à 24 ans n’ayant pas obtenu de diplôme de second cycle, lequel était encore moins flatteur pour notre pays. En effet, en 2008, ces « jeunes sans diplôme » représentaient 17 % de la population de l’ensemble de la population âgée de 20 à 24 ans, soit 140 000 individus.
On observera par ailleurs qu’en 2010, selon les statistiques recueillies par les établissements d’enseignement secondaire, les flux d’élèves sortants avant une classe terminale s’élevaient, en métropole, à 72 000 jeunes. Parmi eux, 28 000 avaient arrêté l’école après une classe du premier cycle ou une première année de CAP ou de BEP, 9 000 avaient abandonné leurs études après une classe de 2nde ou de 1ère générale ou technologique, 18 000 après une classe de 2nde professionnelle et 18 000 après une classe de 1ère professionnelle. Ensemble, ces jeunes représentaient 9,7 % des sortants de l’enseignement secondaire.
Selon le directeur de l’Institut Montaigne, M. Laurent Bigorgne, ces données traduisent une « accoutumance » de notre pays à « l’insupportable », à l’opposé de l’attitude des pays nordiques. En effet, « si de nombreux facteurs expliquent les excellents résultats que connaissent, en matière scolaire, certains pays du nord de l’Europe – par exemple le fait que le finnois est une langue plutôt facile à apprendre –, il en est un qui me paraît décisif : dans ces pays, relativement peu peuplés, on considère que "laisser tomber" un élève revient à se priver d’un talent et d’une contribution à la productivité, à l’attractivité, à la cohésion sociale du pays. L’idée de voir 20 % de la population scolaire sortir de l’école sans rien à l’âge de 16 ans est, là-bas, inacceptable – c’est un "luxe" que l’on ne peut tout simplement pas se permettre. Au contraire, en France, on s’est accoutumé, en matière scolaire, à un niveau de douleur insupportable, non seulement pour ceux qui la vivent, mais aussi pour la nation dans son ensemble » (31).
B. UNE ÉCOLE QUI ALLOUE AU PRIMAIRE UNE PART DES DÉPENSES PAR ÉLÈVE TRÈS INFÉRIEURE À LA MOYENNE EUROPÉENNE
Le « décrochage » des acquis des élèves est corrélé au déséquilibre qui affecte, depuis des décennies, l’allocation des moyens à l’école.
En effet, pour lutter contre ces mauvais résultats et faire émerger une élite scolaire plus étoffée, la stimulation des capacités cognitives et des compétences langagières des plus jeunes enfants devrait être érigée en priorité budgétaire.
L’exemple du programme « PARLER » (Parler, Apprendre, Réfléchir, Lire Ensemble pour Réussir) montre d’ailleurs qu’il faut intervenir le plus tôt possible, la maîtrise en grande section, CP et CE1 des compétences de base pour réussir sa scolarité par la suite étant effectivement fondamentale.
Le programme PARLER selon l’Institut Montaigne (32)
Mis en place par le docteur Michel Zorman, ce programme a été appliqué dans les zones d’éducation prioritaire (ZEP) de l’académie de Grenoble en fin de maternelle et au début de l’école élémentaire dans huit classes entre 2005 et 2008. Il a permis de réduire l’échec scolaire par deux par rapport aux classes témoins, tandis que la proportion d’élèves en grande difficulté scolaire, qui était extrêmement élevée, a été réduite de 25 % à 12 %. Quant aux bons élèves, leur nombre a doublé en volume dans l’échantillon.
Ces résultats sont fondés sur vingt ans de recherches en psychologie cognitive, inspirées de la plus grande synthèse de la recherche mondiale sur les compétences clés à développer chez l’enfant, menée par le National Institute of Child Health and Human Development à la demande du Congrès américain.
Le programme « PARLER » montre ainsi que les recherches donnent toujours les mêmes résultats sur :
– les compétences à travailler de façon prioritaire, à savoir la phonologie, le code alphabétique et la compréhension des textes ;
– la façon de travailler la plus performante, à savoir une approche structurée et le travail en petits groupes de niveaux homogènes.
Or, au lieu d’investir massivement dans l’enseignement primaire, la France dépense beaucoup plus pour ses lycéens. Ainsi, aux prix 2011, la dépense moyenne par élève dans le premier degré s’élevait à 5 870 euros, contre 11 470 euros dans le second cycle général et technologique (33).
En 2011 toujours, quand la nation dépensait 100 euros pour un élève de l’élémentaire, elle consacrait 96 euros pour un élève du préélémentaire, mais 141 euros pour un collégien, 196 euros pour un lycéen et 197 euros pour un étudiant (34).
Ce « contresens » éducatif et budgétaire est ancien et a été présenté dans ces termes par M. Laurent Bigorgne, alors directeur général adjoint de l’Institut Montaigne : « Nous n’allons pas faire mine de découvrir que l’enseignement primaire est depuis plusieurs décennies le grand sacrifié des politiques publiques de l’éducation. Il n’est jamais la préoccupation réelle des recteurs, et on se contente assez bien que les arbitrages – notamment budgétaires – aient été rendus des années durant au profit du secondaire. Certes, nous sommes dans la moyenne de l’OCDE pour les dépenses d’éducation, mais nous avons sans doute le lycée le plus cher et le premier degré le plus cheap, et ce depuis longtemps » (35).
Du point de vue des comparaisons internationales, ainsi que le montre le tableau ci-après, avec une dépense annuelle moyenne par élève dans le primaire s’élevant à 6 373 dollars en 2009, la France se situe nettement en dessous de la moyenne de l’OCDE (7 179 dollars) et très nettement en dessous de celle des pays européens membres de cette organisation (7 762 dollars).
Au total, la France se situe, par rapport à la moyenne de l’OCDE, à un niveau de dépenses annuelles par élève inférieur de 5 % pour l’école maternelle et de 15 % pour l’école primaire, mais en revanche supérieur de 10 % pour le collège et, surtout, de 26 % pour le lycée.
Si l’on prend en compte les dépenses cumulées sur la durée des études secondaires, en moyenne, pour l’OCDE, ces dépenses s’établissent à 63 163 dollars parité pouvoir d’achat (PPA). Avec une dépense cumulée supérieure de 19 % à la moyenne de l’OCDE, la France (74 874 dollars PPA) figure « parmi les pays qui dépensent le plus pour la scolarité d’un élève du secondaire », tandis qu’avec 31 866 dollars PPA de dépenses cumulées sur la durée d’études d’un élève du primaire, la France se situe sensiblement en dessous de la moyenne de l’OCDE (- 30 %) (36).
Dépenses moyennes annuelles des établissements par élève (2009)
(En équivalents USD convertis sur la base des parités de pouvoir d’achat pour le PIB)
Préprimaire |
Primaire |
Secondaire | |||
collège |
lycée |
ensemble | |||
France |
6 185 |
6 373 |
9 111 |
12 809 |
10 696 |
Finlande |
5 553 |
7 368 |
11 338 |
7 739 |
8 947 |
Allemagne |
7 862 |
6 619 |
8 130 |
11 287 |
9 285 |
Italie (1) |
7 948 |
8 669 |
9 165 |
9 076 |
9 112 |
Japon |
5 103 |
7 729 |
8 985 |
9 527 |
9 256 |
Corée |
6 047 |
6 658 |
7 536 |
11 300 |
9 399 |
Pays-Bas |
7 437 |
7 917 |
11 708 |
11 880 |
11 793 |
Espagne |
6 946 |
7 446 |
9 484 |
11 265 |
10 111 |
Suède |
6 549 |
9 382 |
9 642 |
10 375 |
10 050 |
Royaume-Uni |
6 493 |
9 088 |
10 124 |
9 929 |
10 013 |
États-Unis |
8 396 |
11 109 |
12 247 |
12 873 |
12 550 |
Moyenne OCDE |
6 670 |
7 719 |
8 854 |
9 755 |
9 312 |
Moyenne UE21 |
6 807 |
7 762 |
9 369 |
9 666 |
9 513 |
(1) Établissements publics uniquement (enseignement supérieur excepté)
Source : Regards sur l’éducation 2012, OCDE, septembre 2012.
On suivra donc sur ce sujet la Cour des comptes qui, dans son rapport sur l’éducation nationale et la réussite des élèves, juge « inexplicable que la France soit un des pays de l’OCDE où l’école primaire reçoit le moins de financements publics par rapport au lycée, alors que c’est précisément à ce niveau qu’il convient de commencer à lutter contre les carences scolaires les plus graves » (37).
La faiblesse des financements consacrés au primaire se traduit par celle du taux d’encadrement de ce niveau d’enseignement, qui, en France, contrairement à ce que pourrait laisser penser le nombre moyen d’élèves moyen par classe, est, comme l’a rappelé le directeur général de l’enseignement scolaire au ministère de l’éducation nationale, M. Jean-Paul Delahaye, « l’un des plus faibles des pays de l’OCDE » (38).
Selon cette organisation, en effet, on comptait, en 2010, dans notre pays, 18,7 élèves par enseignant, c’est-à-dire sans compter les personnels non enseignants, de type « auxiliaires d’éducation », un ratio très supérieur à celui de la moyenne de l’OCDE (15,8), ainsi qu’à celui de la moyenne des 21 pays européens membres de cette organisation (14,3). En 2010, ce niveau nous plaçait plutôt du côté de la moyenne du G20 (19,4), qui regroupe les grands pays développés et émergents comme la Russie (19,2) (39).
De plus, en raison des suppressions de postes massives décidées par la précédente majorité, ce taux aura encore certainement baissé en 2011, comme le montrera la prochaine édition des Regards sur l’éducation de l’OCDE.
Outre qu’elle est inefficiente au regard de l’objectif d’amélioration des performances de notre système éducatif, l’allocation actuelle des moyens entre l’école primaire et le secondaire tend, enfin, à conforter le caractère inéquitable de l’orientation scolaire.
En effet, celle-ci, au collège et au lycée, dépend étroitement du niveau initial des élèves à l’école primaire, ainsi que l’a constaté le Haut conseil de l’éducation. Par conséquent, un parcours scolaire qui débute « mal », au sein d’un environnement pédagogique doté de moyens insuffisants, ne débouche que très rarement vers un baccalauréat général ou technologique, le sésame d’une entrée réussie dans l’enseignement supérieur…
Une mécanique d’orientation-exclusion se déclenchant dès l’école primaire
selon le Haut conseil de l’éducation
Dans son bilan annuel 2007, le Haut conseil de l’éducation a relevé que les élèves obtiennent des résultats très contrastés à l’issue du primaire : « 60 % ont des résultats acceptables ou satisfaisants ; 25 % ont des acquis fragiles ; 15 % connaissent des difficultés sévères ou très sévères. Or, dans les mises à jour, en 2007, de la situation scolaire d’un panel d’élèves entrés ensemble en 6ème, et ayant tous quitté l’enseignement secondaire, on retrouve à peu près trois groupes du même ordre : 64 % ont un baccalauréat général, technologique ou professionnel ; 20 % ont un diplôme de niveau CAP-BEP ou ont atteint une classe terminale de lycée ; 16 % ont quitté le système éducatif sans qualification ni diplôme. Ainsi, jusqu’à la fin de la scolarité secondaire, l’orientation entérine très largement une répartition hiérarchisée des élèves déterminée dès l’école élémentaire ».
Source : « L’orientation scolaire », Haut conseil de l’éducation, Bilan des résultats de l’École – 2008. Les caractères gras sont de l’original.
C. UNE ÉCOLE AUX RYTHMES PÉNALISANTS
La relative « indifférence » de l’école à l’hétérogénéité des élèves se vérifie aussi dans l’organisation du temps scolaire. En effet, celle-ci, selon la Cour des comptes, « n’est pas prioritairement conçue en fonction des élèves », alors que leurs rythmes d’apprentissage sont variables (40).
Les élèves français sont donc astreints à une charge de travail parmi les plus élevées au monde, qui les épuise sans pour autant améliorer leurs résultats.
1. Des rythmes scolaires déconnectés des besoins des élèves
Au sein de l’OCDE, la France est le pays qui a l’année scolaire la plus courte – 144 jours officiels dans le primaire – et l’une des journées les plus longues. Le temps scolaire est donc à la fois concentré et rigide, ce cadre ne laissant quasiment aucune place aux aménagements qui permettraient de tenir compte des rythmes d’apprentissage hétérogènes des élèves.
a) Une année scolaire excessivement courte dans le primaire
Avec 140 jours d’école effectifs dans le primaire et 178 jours dans le secondaire, la France reste parmi les pays développés dont la scolarité est la plus concentrée sur l’année.
En effet, la moyenne des pays européens membres de l’OCDE est, comme l’indique le tableau ci-dessous, de 185 jours dans le primaire et de 182 jours dans le secondaire.
Organisation du temps de travail des enseignants (2010)
Nombre de semaines et de jours d’enseignement dans les établissements publics
Nombre de semaines d’enseignement |
Nombre de jours d’enseignement | |||||
Primaire |
Premier cycle du secondaire |
Deuxième cycle du secondaire |
Primaire |
Premier cycle du secondaire |
Deuxième cycle du secondaire | |
Autriche |
38 |
38 |
38 |
180 |
180 |
180 |
Belgique (Fr.) |
38 |
38 |
38 |
183 |
183 |
183 |
Danemark (1) |
42 |
42 |
42 |
200 |
200 |
200 |
Angleterre (1) |
38 |
38 |
38 |
190 |
190 |
190 |
Finlande |
38 |
38 |
38 |
189 |
189 |
189 |
France |
36 |
36 |
36 |
144 |
m* |
m* |
Allemagne |
40 |
40 |
40 |
193 |
193 |
193 |
Japon |
40 |
40 |
40 |
201 |
201 |
198 |
Corée |
40 |
40 |
40 |
220 |
220 |
220 |
Moyenne OCDE |
38 |
38 |
38 |
187 |
185 |
183 |
Moyenne UE21 |
38 |
38 |
38 |
185 |
182 |
182 |
(1) Temps réel d’enseignement et de travail m* : donnée manquante
Source : « Regards sur l’éducation 2012 », OCDE, septembre 2012.
Or cette singularité a été accentuée ces dernières années, plusieurs pays membres de l’OCDE, européens ou asiatiques, ayant, depuis 2003, procédé à un allongement de leur calendrier scolaire pour atteindre 38 à 40 semaines. C’est notamment le cas de la Pologne (+ 1 semaine), de la République tchèque (+ 2 semaines), de la Corée (+ 3 semaines), de l’Italie et du Japon (+ 5 semaines) (41).
En outre, l’année scolaire est mal organisée, ainsi que l’ont établi plusieurs rapports, en particulier celui de l’Académie nationale de médecine, celui de la mission d’information de notre Commission sur les rythmes de vie scolaire et celui du comité de pilotage de la Conférence nationale des rythmes scolaires de 2010-2011 (42).
En raison de l’organisation des examens du secondaire, le mois de juin est « amputé » d’un grand nombre de cours, tandis que le premier trimestre est inutilement long, le mois de novembre étant la période de l’année où, selon le chrono-psychologue François Testu, les enfants sont les plus vulnérables en raison du changement de saison (43).
Par ailleurs, l’équilibre sept semaines de travail/deux semaines de vacances qui permet, selon les chrono-biologistes, d’alterner de manière optimale les séquences de travail et de repos n’est pas respecté du fait des préoccupations des professionnels du tourisme (44).
À cet égard, le rapporteur se félicite que le ministre de l’éducation nationale ait décidé, dès 28 juin 2012, de modifier le calendrier scolaire afin de porter à deux semaines pleines – au lieu de dix jours – la durée des vacances de la Toussaint (45).
Enfin, cette année si courte entraîne mécaniquement, comme on le verra plus loin, des journées et des semaines scolaires longues, c’est-à-dire caractérisées par une charge horaire moyenne, quotidienne et hebdomadaire, élevée.
b) Une semaine de quatre jours contraire aux intérêts des élèves-enfants
Menée par M. Xavier Darcos, alors ministre de l’éducation nationale, la réforme de l’enseignement primaire de 2008 s’est traduite par la suppression des cours le samedi matin et une réduction de la durée hebdomadaire de l’enseignement de 26 heures à 24 heures, celui-ci étant organisé sur quatre jours (46).
L’historien Antoine Prost l’a qualifiée de « Munich pédagogique » (47), un jugement sévère que corroborent les témoignages recueillis par la mission d’information de notre Commission sur les rythmes de vie scolaire et le comité de pilotage de la Conférence nationale sur les rythmes scolaires.
Ce dernier a notamment constaté que cette semaine de quatre jours « fait l’unanimité dans la description de ses inconvénients : fatigue des élèves et resserrement des enseignements » (48).
La semaine de quatre jours est en effet inadaptée du point de vue des intérêts de l’enfant comme de l’élève.
En premier lieu, cette organisation du temps scolaire est synonyme de fatigue et de problèmes de concentration pour les élèves. Selon certains chercheurs, elle va même jusqu’à entraîner la désynchronisation des rythmes biologiques de l’enfant.
En effet, pour le chrono-psychologue François Testu, la rythmicité journalière classique, qui voit le niveau de vigilance des élèves progresser du début jusqu’à la fin de la matinée, s’abaisser après le déjeuner et progresser au cours de l’après-midi, disparaît pour laisser place à une rythmicité inversée, observable chez certains enfants le lundi, voire jusqu’au mardi midi, et s’accompagne d’une baisse du niveau des performances psychotechniques.
Le rapport de la mission d’information de notre Commission sur les rythmes de vie scolaire en concluait que « si le lundi et le mardi sont « perdus », il ne reste que deux jours scolaires utiles. Si tel était le cas, l’année scolaire française, déjà si singulière, en Europe, par le caractère concentré des jours d’enseignement, en serait donc d’autant plus réduite. En effet, 36 semaines d’enseignement fois 2 jours, au lieu de 4, font 72 jours d’enseignement au lieu de 144, le nombre de jours officiel… » (3).
En deuxième lieu, du point de vue de l’enseignement, le temps manque pour couvrir les programmes, ce qui était prévisible, tandis que la répartition des disciplines dans les emplois du temps devient problématique (certaines d’entre elles risquant notamment de disparaître, comme les enseignements artistiques, ainsi que le notait, dès 2000, l’inspection générale de l’éducation nationale).
Toutefois, il y a pire que ces inconvénients déjà bien réels : selon M. Antoine Prost, la réduction du temps de travail des élèves, « par son ampleur et ses modalités, handicape durablement les apprentissages élémentaires » et a, de ce fait, « organisé l’échec scolaire » (49).
En dernier lieu, dans les écoles de l’éducation prioritaire, la semaine de quatre jours a des effets négatifs encore plus accentués. En effet, dans les « quartiers », la libération du temps n’est pas nécessairement synonyme d’épanouissement, d’éveil ou d’intégration, mais peut, au contraire, accroître les différences entre les milieux culturels et sociaux, en laissant à leur sort les élèves appartenant à des milieux défavorisés.
Selon M. François Testu, en elle-même, cette organisation du temps scolaire « ne génère pas des inégalités, mais elle les creuse à tous les niveaux : attention, vigilance, performances scolaires, sommeil, etc. » (50). De même, l’inspection générale de l’éducation nationale constatait, il y a treize ans, que « les réserves les plus vives sur la poursuite de l’expérience de la semaine de quatre jours sont exprimées par les enseignants exerçant en cours préparatoire et/ou en réseau d’éducation prioritaire, c’est-à-dire auprès des enfants les plus fragiles » (51).
Outre qu’elle constitue une aberration scolaire, force est de constater que, sur le plan des comparaisons internationales, la semaine de 4 jours constitue, au sein des pays développés, une exception française. En effet, elle n’est en vigueur que dans l’enseignement primaire de notre pays.
Certes, aucune enquête ne permet de comparer l’organisation de la semaine ou de la journée scolaire dans les pays développés. Cependant, l’extrapolation des données de l’OCDE, en divisant le nombre de jours d’école par le nombre de semaines scolaires, conduit à dégager ce que le ministère de l’éducation nationale appelle un « modèle dominant », celui d’une « semaine scolaire de cinq jours pleins ». Au‐dessous de cette moyenne, la semaine de 4,5 jours est seulement pratiquée en Belgique et, en France, dans le secondaire (52).
2. Des journées chargées mais probablement peu efficaces
Si l’année scolaire française est concentrée sur un nombre de jours limité, le volume horaire annuel des élèves français est l’un des plus lourds des pays de l’OCDE, ainsi que le montre le tableau ci-après.
En extrapolant les données recueillies par cette organisation, la charge quotidienne moyenne des enseignements serait en effet, dans ces pays, de quatre heures en primaire et d’un peu moins de cinq heures dans le secondaire (horaire total/nombre de jours) – chiffres à comparer avec les six heures de l’école primaire française. Comme le souligne Mme Agnès Cavet, il en résulte une journée des écoliers, des collégiens et des lycéens français « plus dense et plus chargée que celle de la plupart des autres élèves dans le monde » (53).
Temps d’instruction obligatoire dans les établissements publics (2010)
Nombre annuel moyen d’heures d’instruction obligatoires
De 7 à 8 ans |
De 9 à 11 ans |
De 12 à 14 ans |
À 15 ans (programme typique) | |
Autriche |
690 |
766 |
914 |
1 005 |
Belgique (Fr.) (1) |
840 |
840 |
960 |
m* |
Danemark |
701 |
813 |
900 |
930 |
Angleterre |
893 |
899 |
925 |
950 |
Finlande |
608 |
640 |
777 |
856 |
France |
847 |
847 |
971 |
1 042 |
Allemagne |
641 |
793 |
887 |
933 |
Japon |
735 |
800 |
877 |
m |
Corée |
612 |
703 |
859 |
1 020 |
Moyenne OCDE |
774 |
821 |
899 |
920 |
Moyenne UE21 |
750 |
800 |
877 |
907 |
(1) La tranche d’âge « De 12 à 14 ans » comprend uniquement les élèves âgés de 12 et 13 ans
* : donnée manquante
Source : « Regards sur l’éducation 2012 », OCDE, septembre 2012.
● Dans le primaire
De toute évidence, la journée de six heures de l’école primaire – 5 heures 30 d’enseignement et 30 minutes de récréation – ne tient pas compte des capacités de vigilance et d’attention des enfants.
Selon les chercheurs, celles-ci vont de 4 heures à 4 heures 30, étant précisé que ces jeunes élèves arrivent fatigués à l’école et que leurs facultés n’augmentent que progressivement à partir de 9 heures pour connaître un premier pic vers 10-11 heures, puis diminuer, en début d’après-midi, jusqu’à 14 heures et retrouver un pic vers 15-16 heures.
Selon les témoignages recueillis par la mission d’information de notre Commission sur les rythmes de vie scolaire, on n’observe même plus, pour les enfants issus de milieux défavorisés, de temps fort d’attention l’après-midi, période au cours de laquelle ils « décrochent » et attendent, avec impatience, d’être « libérés » à 16 heures 30 : la situation de ces élèves s’apparente, selon M. Hubert Montagner, à de la « maltraitance » (54).
Or, la non prise en compte par le temps scolaire de ces données pourtant fondamentales a été singulièrement accentuée par la mise en place des deux heures hebdomadaires d’aide personnalisée destinée aux élèves en difficulté.
Cette aide est en effet dispensée lors de plages horaires qui sont toutes, d’une manière ou d’une autre, problématiques au regard des intérêts des enfants :
– séances avant la matinée de classe (le plus souvent de 30 minutes, parfois de 40 ou 45 minutes), alors que les élèves débutent leur journée scolaire en étant fatigués ;
– séances inscrites dans le temps de la pause méridienne avant ou après le repas (durée de 30 à 50 minutes), ce qui revient à séparer, pendant ces moments d’échange, les élèves en difficulté de leurs camarades ;
– séances du soir souvent, en parallèle avec d’autres offres d’activités dans l’école ou à l’extérieur (de 30 minutes à 1 heure 15), cette formule ajoutant à la fatigue suscitée par une journée déjà bien longue.
En outre, d’un point de vue pédagogique, cette palette d’options ne garantit en rien que des choix optimaux sont opérés par rapport à l’âge des élèves. Ainsi, selon les observations des inspections générales de l’éducation nationale, « les durées jugées idéales sont différentes pour les enfants de l’école maternelle et les élèves du cycle 3 : la demi-heure qui convient aux plus jeunes paraît trop courte au cycle 3 et, inversement, le temps jugé pertinent au cycle 3 (45 minutes environ) est trop long pour les petits » (55).
● Dans le secondaire
Selon les calculs du ministère de l’éducation nationale, dans les pays de l’OCDE, en extrapolant les données de cette organisation (horaire total/nombre de semaines), la charge hebdomadaire moyenne des enseignements serait de 26 heures dans le secondaire.
Les collèges et les lycées français se caractérisent donc par des horaires particulièrement lourds :
– au collège, la durée hebdomadaire est égale, selon les arrêtés de 1996, 2002, 2004 et 2006, à 28 heures 30 auxquelles s’ajoutent 3 heures d’enseignement facultatif et les 2 heures d’accompagnement éducatif mis en place par le précédent gouvernement, ce dernier temps ne bénéficiant qu’à des élèves volontaires. Ce total, déjà considérable, se traduit de surcroît par des emplois du temps « décousus », qui aggravent la fatigue des enfants ;
– au lycée, la durée hebdomadaire des cours varie entre 30 et 40 heures, les réformes successives ayant multiplié, dans les lycées généraux, les matières, les options et les modules. Ainsi que le souligne la Cour des comptes, « les grilles horaires sont en moyenne supérieures de 10 à 20 % à celles qui sont pratiquées dans la plupart des pays européens, cet écart pouvant aller jusqu’à 20 à 30 % si l’on compare les horaires maxima », conduisant les lycéens français à avoir une charge de travail hebdomadaire souvent excessive (56).
Il est vrai aussi que, dans ce degré d’enseignement, les horaires sont largement déterminés, ainsi que l’a constaté la mission d’information de notre Commission sur les rythmes de vie scolaire, par « le poids des différentes disciplines dans les grilles hebdomadaires d’enseignement, la journée et la semaine des élèves s’organisant ainsi autour d’un "alignement" – pas toujours cohérent – de cours d’une heure ». En conséquence, les emplois du temps des collégiens et des lycéens « ne peuvent être établis sur des bases plus compatibles avec un rythme qui favoriserait, d’abord et avant tout, les apprentissages des élèves » (57).
C’est aussi l’avis de la Cour des comptes qui observe que « les emplois du temps sont établis par les chefs d’établissement en tenant compte des normes nationales qui déterminent un volume horaire annuel pour chacune des disciplines enseignées. Ce cadre national annuel laisse en théorie une marge de manœuvre dans la répartition des enseignements tout au long de l’année. Mais, en pratique, c’est la logique hebdomadaire qui prévaut, sans véritable modulation en cours d’année, avec parfois une variation d’une heure une semaine sur deux, mais répartie de manière identique tout au long des trimestres… En outre, le poids des heures obligatoires, imposé par les arrêtés ministériels fixant les programmes nationaux dans chaque discipline, et la définition hebdomadaire du service des enseignants limitent fortement les possibilités d’adaptation locale en fonction des besoins des élèves » (1).
● Un temps scolaire probablement peu performant
Ces journées chargées sont-elles « productives » au regard des apprentissages scolaires ? Rien n’est moins sûr. Certes, la mission d’information sur les rythmes de vie scolaire, citant à ce sujet les analyses d’un expert de l’OCDE, M. Éric Charbonnier, a constaté qu’« il n’y a pas de corrélation forte » entre le temps scolaire et les performances d’un système éducatif (2).
Dans le même temps, force est de constater, aux côtés de la Cour des comptes, que les pays qui obtiennent les meilleurs résultats dans les évaluations des enquêtes PISA ont une durée cumulée d’enseignement plus faible que celle de la France : Finlande : - 33 % ; Corée : - 29 % ; Suède : - 29 % ; Japon : - 21 %…(1).
En réalité, s’il devait y avoir une corrélation entre les piètres performances de l’école française et ses journées « chargées », elle devrait être probablement recherchée dans l’incapacité de l’éducation nationale à conjuguer, en raison de ce carcan horaire, les différents « temps » de l’élève, entre travail collectif (en classe entière et en petits groupes), travail individuel et activités péri-éducatives.
D. UNE ÉCOLE QUI ORIENTE PAR L’EXCLUSION
Le processus d’orientation est marqué par des problèmes de fond : une perception trop fréquente de l’orientation comme « une sanction des résultats scolaires, et non, conformément aux orientations affichées par l’éducation nationale, comme la construction du choix d’un parcours de formation », une contradiction entre l’affirmation par l’éducation nationale de « l’égale valeur » des trois voies de formation et la « valorisation de fait des voies générale et technologique » et une orientation vers la voie professionnelle « fréquemment décidée par défaut pour les élèves les moins bien notés » (58).
Ce constat de la Cour des comptes met en lumière le caractère injuste et stigmatisant de l’orientation scolaire telle qu’elle est pratiquée dans notre pays. Génératrice d’anxiété et d’irritation, voire de souffrance et de colère, elle conduit à dévaloriser les filières professionnelles, celles-ci étant associées, par les élèves et leurs parents, à la sanction de l’échec scolaire.
Les mesures précédemment mises en œuvre pour corriger ce processus par une meilleure information des élèves et un repérage précoce des « décrocheurs » s’avèrent néanmoins trop récentes et pas assez « systémiques ».
1. Un processus qui déprécie les élèves rencontrant des difficultés scolaires et, au-delà, la voie professionnelle
Les familles sont confrontées à un système de formation très hiérarchisé, au sommet duquel est placée la voie générale du lycée, et au sein duquel, selon un rapport de 2008 du Haut conseil de l’éducation, « l’orientation tend à procéder par exclusions successives vers des voies ou des filières moins considérées » (59).
En effet, l’orientation au collège et au lycée se fondant essentiellement sur les résultats scolaires obtenus par les élèves dans des savoirs abstraits, fruits de l’enseignement des matières dites « générales », elle se fait, d’après la Cour des comptes, « par l’échec et non en vue d’une réussite » (60), même si le poids de la « contrainte territoriale » dans ce processus doit être relevé. Les élèves qui échouent ou présentent des faiblesses dans ces disciplines sont donc écartés de la 2nde générale, pour être affectés en lycée professionnel.
L’orientation scolaire selon la Cour des comptes
Si l’orientation se fait souvent par l’échec, elle dépend aussi de l’offre scolaire existante, les différences de parcours observées entre les académies étant très nettes : « dans certaines académies, 1 élève sur 3 est orienté dans la voie professionnelle en fin de troisième, alors que dans d’autres, cette proportion n’est que de 1 sur 5 ». Ainsi, dans l’académie de Lille, une offre de formation « très importante » en voie professionnelle a eu pour effet « de limiter le nombre d’élèves susceptibles de réussir dans l’enseignement supérieur ». L’orientation reflète aussi une très forte inégalité sociale : « un enfant d’ouvrier non qualifié a cinq fois moins de probabilités d’obtenir un baccalauréat général qu’un enfant de cadre, mais en revanche neuf fois plus de n’avoir aucun diplôme » (61).
L’enseignement professionnel occupe ainsi, dans notre système éducatif, une place très dévalorisée qui explique en partie l’absentéisme et le décrochage qu’il connaît, au quotidien, dans ses établissements. Quel paradoxe lorsque l’on rappelle que la voie professionnelle a été conçue pour offrir des débouchés rapides à ses diplômés !
Cette situation est d’autant plus injuste et absurde que la décision d’orientation s’appuie sur des notes et des moyennes de notes dont les insuffisances, en termes d’évaluation des compétences des élèves, ont été démontrées depuis longtemps.
En outre, l’élève orienté en lycée professionnel se voit souvent appliquer une « double peine » : ce dernier, en raison du contingentement des places par spécialité professionnelle, est non seulement orienté vers une filière non désirée, mais affecté dans une spécialité qui ne l’intéresse pas ou qui ne correspond pas à ses aptitudes ou qui le contraint à quitter son secteur géographique.
Enfin, ce mode d’orientation est mal ressenti par les élèves comme par leurs parents. Dans une étude récente, le chercheur Georges Fotinos indique qu’en 2011, près de 60 000 familles ont été concernées par une décision contraire à leur demande de poursuite de scolarité de leur enfant et que plus d’une sur quatre a fait appel pour un taux de succès de 30 %.
Au regard des près de 3 millions d’élèves scolarisés aux niveaux « d’orientation » concernés (passage en 2nde générale ou « techno », passage en 2nde « pro » et passage en 1ère générale ou « techno »), ce phénomène apparaît marginal, mais son « impact au niveau des acteurs et usagers du système éducatif est considérable », car il développe « un sentiment de défiance et parfois d’agressivité de la part des parents et dans une moindre mesure des enseignants » (62).
2. Des mesures ponctuelles d’amélioration des dispositifs d’information et d’orientation adoptées en 2006 et 2009
Pour lutter contre ce sentiment d’injustice, l’attractivité de la voie professionnelle devrait être renforcée. Celle-ci devrait être perçue pour ce qu’elle est, c’est-à-dire la garantie d’une formation qualifiante et d’une insertion rapide dans le monde de l’entreprise. Sans oublier le fait qu’elle peut aussi jouer un rôle de promotion sociale en étant la première étape d’un parcours débouchant sur un diplôme « bac + 3 » – à savoir la licence professionnelle – construit entre l’université et les entreprises d’un bassin d’emploi.
Cela suppose de donner une information « lisible » sur les diplômes et les emplois à toutes les familles, c’est-à-dire bien au-delà des milieux aisés qui détiennent aujourd’hui les codes leur permettant de s’orienter dans les univers variés des formations du secondaire, du supérieur et des métiers.
C’est pourquoi a été créé, face à l’extraordinaire complexité du système d’accueil et d’information relatif à l’orientation – une vingtaine de structures intervenant à l’échelle de chaque région –, un poste de délégué interministériel en 2006.
Placé auprès des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de l’emploi, du travail et de l’insertion professionnelle des jeunes, il est chargé de coordonner l’action de l’État dans les domaines de l’information sur les métiers et le monde de l’entreprise, de l’orientation scolaire et dans les établissements d’enseignement supérieur, de la préparation à l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes.
Par ailleurs, la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle a prévu la mise en place d’un « service public de l’orientation tout au long de la vie », organisé pour « garantir à toute personne l’accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l’accès à des services de conseil et d’accompagnement en orientation de qualité et organisés en réseaux » (article L. 6111-3 du code du travail).
Ce droit à l’information, au conseil et à l’accompagnement « en matière d’orientation professionnelle » (article L. 6111-3 du code du travail) est décliné en deux modalités :
– un service dématérialisé, gratuit et accessible (www.orientation-pour-tous.fr), ouvert le 6 décembre 2011 ;
– la création de « lieux uniques ». Ainsi, aux termes de l’article L. 6111-5 du code du travail, ces organismes proposent dans un « lieu unique à toute personne un ensemble de services » lui permettant de « disposer d’une information exhaustive et objective sur les métiers, les compétences et les qualifications nécessaires pour les exercer, les dispositifs de formation et de certification, ainsi que les organismes de formation et les labels de qualité dont ceux-ci bénéficient » et de « bénéficier de conseils personnalisés afin de pouvoir choisir en connaissance de cause un métier, une formation ou une certification adapté à ses aspirations, à ses aptitudes et aux perspectives professionnelles » liées aux besoins de l’économie et de la société. Le décret du 4 mai 2011 a créé à cet effet une labellisation « orientation pour tous » que les services publics concernés (pôle emploi, missions locales, centre d’information et d’orientation, etc.) peuvent obtenir, dès lorsqu’ils s’organisent sur un territoire pour offrir aux personnes les sollicitant informations et conseils sur les formations et les métiers.
Parallèlement, la réforme du lycée menée par le précédent gouvernement a institué un accompagnement personnalisé de deux heures, auquel a droit chaque élève et qui doit comprendre des actions de soutien, d’approfondissement, d’aide méthodologique et d’orientation pour favoriser la maîtrise progressive par l’élève de son parcours de formation et d’orientation.
Le caractère relativement récent de ces mesures ne permet pas encore d’en tirer un réel bilan. Cependant, ainsi que l’a souligné le Conseil économique, social et environnemental, (CESE) « la question essentielle de l’orientation ne peut se limiter à la désignation d’un délégué interministériel et à la labellisation d’organismes ». (63).
Quant à l’accompagnement personnalisé, l’inspection générale de l’éducation nationale considère que sa composante « orientation » « reste le parent désespérément pauvre du dispositif » alors qu’il s’agit d’un élément décisif de la qualité des parcours scolaires des élèves (64).
Il conviendra donc, dans le cadre de l’« acte III de la décentralisation », de traiter de manière structurelle ce problème, en instituant un service public territorialisé de l’orientation pour mettre en réseau les différents dispositifs et répondre ainsi plus efficacement aux besoins des différents publics.
II.- UNE ÉCOLE GRAVEMENT AFFAIBLIE QUI AVAIT ATTEINT SES LIMITES SOUS L’EFFET DES RÉDUCTIONS MASSIVES D’EMPLOIS
Chacun sait que l’éducation nationale a été, au cours du précédent quinquennat, la principale victime de l’application de la règle dite du non remplacement d’« un poste sur deux » fonctionnaires partant à la retraite. Cette contrainte budgétaire sur les postes a été amplifiée par une politique éducative schizophrène.
Un héritier de Vidal de La Blache qui s’efforcerait de peindre le « tableau » de l’éducation nationale au sortir de ce quinquennat serait donc amené à tracer les contours d’un paysage parsemé de ruines.
Comme l’a dit, avec force, le Président de la République le 9 octobre dernier, en clôture de la concertation sur la refondation de l’école, cette dernière a non seulement subi des réformes « qui l’ont davantage accablée que confortée », mais a été « tellement amoindrie dans ses budgets, asséchée dans ses recrutements, affaiblie dans ses prérogatives, qu’elle a forcément affronté avec de plus en plus de difficultés les missions qui lui ont été confiées ».
A. UNE POLITIQUE ÉDUCATIVE SCHIZOPHRÉNIQUE
D’après le Grand Robert de la langue française, la schizophrénie est une psychose caractérisée par une « désagrégation psychique », qui se traduit par « l’ambivalence » des pensées et des sentiments, une « conduite paradoxale » et la « perte du contact avec la réalité ».
Cette définition s’applique parfaitement à la politique éducative conduite lors du précédent quinquennat.
Celle-ci a en effet multiplié les injonctions contradictoires – par exemple, la volonté affichée de « personnaliser » l’enseignement pour mieux prendre en charge la difficulté scolaire, concomitante à la suppression des postes des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté et de l’année de formation des enseignants stagiaires – et irréalisables – ainsi, la volonté d’offrir de nouveaux services aux familles, que contredit la mise en place de « coquilles vides » telles que l’aide personnalisée et l’accompagnement éducatif (65).
Ce constat clinique rejoint celui du comité de pilotage de la concertation sur la refondation de l’école : « les écarts entre les principes affichés et les réformes présentées sont devenus légion : affichage du souhait de renforcer la formation des enseignants mais destruction de son organisation au travers de la réforme de la "mastérisation" ; discours sur l’allongement du temps de scolarisation avec l’opération de "reconquête du mois de juin" mais réduction du nombre de demi-journées d’école au primaire en 2008 (66) ; introduction d’un socle commun sans souci d’articulation et de compatibilité avec les programmes existants » .
Le comité va jusqu’à dénoncer une « fabrication de l’action publique anarchique » qui, en accumulant les dysfonctionnements sur le terrain, a démobilisé et démoralisé les personnels (67).
Par conséquent, alors que le précédent gouvernement voulait rapprocher les Français de leur école, jamais les relations entre la nation et l’enseignement n’ont été aussi distendues.
B. UNE OFFRE D’ENSEIGNEMENT ATTAQUÉE DE FRONT
Les développements qui suivent ont pour objet de présenter, de manière synthétique, un bilan quantitatif et qualitatif de la politique éducative mise en œuvre par le précédent gouvernement. Le rapporteur évoquera, à cet effet, le schéma d’emplois réalisé sur la période 2007-2012, la « déscolarisation » des enfants de deux ans et les dispositifs de soutien aux élèves en difficulté. La suppression – aux effets désastreux – de l’année de formation en alternance des lauréats des concours enseignants fera l’objet d’un chapitre distinct.
1. Des moyens d’enseignement laminés
Entre 2007 et 2012, les suppressions de postes se sont succédé, en s’amplifiant avec les derniers budgets approuvés par l’ancienne majorité, sans être toutefois corrélées à une stratégie éducative. De fait, comme l’a établi un rapport d’information de Mme Brigitte Gonthier-Maurin, sénatrice, la politique financière du précédent gouvernement est entrée en « contradiction avec les enjeux éducatifs essentiels de notre pays » (68).
● Le bilan « brut » : - 74 432 emplois de 2007 jusqu’à l’été 2012
Entre 2007 et 2011, 60 432 emplois dits équivalents temps plein (ETP) ont été supprimés dans le périmètre de la mission « Enseignement scolaire », dont 56 208 ETP d’enseignants.
Sur les deux programmes correspondant à l’enseignement public des premier et second degrés, près de 39 200 postes d’enseignants (hors enseignants stagiaires) ont été supprimés entre les rentrées 2007 et 2012, avant la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.
En loi de finances initiale pour 2012, 14 000 suppressions étaient prévues, ce qui portait le total des retraits d’emplois sur la période 2007-2012 à 74 432 ETP, dont 69 808 ETP d’enseignants.
Cependant, grâce au collectif budgétaire d’août 2012, 4 326 emplois ont été créés à la rentrée scolaire 2012, auxquels s’ajoutent les 8 781 emplois prévus par la loi de finances initiale pour 2013.
Au total, si l’on se tient strictement à la période 2007-2012, sans inclure le budget « refondateur » de l’année 2013, qui sera commenté plus loin, l’évolution des emplois, pour chaque année, et sur chaque programme, est reprise dans le tableau ci-après.
Évolution du schéma d’emplois (ETP) du ministère de l’éducation nationale (2007-2012)
2007 |
2008 |
2009 |
2010 | |||||||||||||
Programmes |
Enseignants |
Stagiaires ens. |
Autres |
Total |
Enseignants |
Stagiaires ens. |
Autres |
Total |
Enseignants |
Stagiaires ens. |
Autres |
Total |
Enseignants |
Stagiaires ens. |
Autres |
Total |
Ens. privé |
– 742 |
– 742 |
– 1 424 |
– 155 |
– 1 579 |
– 1 100 |
– 350 |
– 1 450 |
261 |
– 1 797 |
– 1 536 | |||||
Premier degré public |
– 181 |
650 |
469 |
95 |
– 390 |
4 |
– 291 |
1 695 |
– 3 630 |
54 |
– 1 881 |
5 147 |
– 9 765 |
– 4 648 | ||
Second degré public |
– 5 861 |
– 40 |
– 26 |
– 5 927 |
– 8 146 |
– 1 273 |
– 407 |
– 9 826 |
– 5 521 |
– 326 |
– 184 |
– 6 031 |
576 |
– 7 504 |
– 56 |
– 6 984 |
Soutien |
– 341 |
– 341 |
– 798 |
– 798 |
– 522 |
– 522 |
– 559 |
– 559 | ||||||||
Vie de l’élève |
– 32 |
52 |
20 |
– 51 |
– 51 |
– 105 |
– 105 |
– 196 |
– 628 |
– 824 | ||||||
Total |
– 6 784 |
578 |
– 315 |
– 6 521 |
– 9 475 |
– 1 818 |
– 1 252 |
– 12 545 |
– 4 926 |
– 4 306 |
– 757 |
– 9 989 |
5 984 |
– 19 292 |
– 1 243 |
– 14 551 |
2011 |
2012 (LFI) |
2012 (LFR) |
Total 2007-2012 hors LFR |
Total 2007-2012 y compris LFR | |||||||
Programmes |
Enseignants |
Autres |
Total |
Enseignants |
Autres |
Total |
Enseignants |
Autres |
Total |
||
Ens. privé |
– 1 430 |
– 1 430 |
– 1 350 |
– 1 350 |
226 |
226 |
– 8 087 |
– 7 861 | |||
Premier degré public |
– 8 635 |
– 8 635 |
– 5 700 |
– 5 700 |
1 000 |
1 000 |
– 20 686 |
– 19 686 | |||
Second degré public |
– 6 104 |
– 192 |
– 6 296 |
– 6 550 |
– 165 |
– 6 715 |
1 500 |
1 500 |
– 41 779 |
– 40 279 | |
Soutien |
– 335 |
– 335 |
0 |
0 |
– 2 555 |
– 2 555 | |||||
Vie de l’élève |
– 130 |
– 130 |
– 235 |
– 235 |
100 |
1 500 |
1 600 |
– 1 325 |
275 | ||
Total |
– 16 169 |
– 657 |
– 16 826 |
– 13 600 |
– 400 |
– 14 000 |
2 826 |
1 500 |
4 326 |
– 74 432 |
– 70 106 |
Stagiaires ens. : enseignants stagiaires
Source : ministère de l’éducation nationale.
● Le bilan des mesures de carte scolaire adoptées de 2008 à 2012
À la demande du rapporteur, le ministère de l’éducation nationale a procédé à une analyse exhaustive des mesures de carte scolaire, à partir des données issues des enquêtes de rentrée portant sur les effectifs d’élèves réellement scolarisés et sur l’utilisation effective des moyens implantés dans les académies.
On commencera par le second degré, dont le bilan est « linéaire ». Les suppressions de postes d’enseignants opérées en académie ont été les suivantes : - 3 404 emplois à la rentrée 2008, - 5 506 emplois à la rentrée 2009, 0 à la rentrée 2010, cette « année blanche » étant celle de la suppression des emplois d’enseignants stagiaires mise en œuvre dans le cadre de la réforme dite de la mastérisation, - 4 800 à la rentrée 2011 et - 5 550 à la rentrée 2012 (avant l’adoption du collectif budgétaire de l’été 2012).
En ce qui concerne le premier degré, les résultats sont contrastés, mais les rentrées « généreuses » des années 2008 et 2009, qui ont connu des créations de postes, ne suffisent pas, et de loin, à contrebalancer les choix ultérieurs du précédent gouvernement.
– À la rentrée 2008, la loi de finances pour 2008 a prévu 700 emplois supplémentaires. Par ailleurs, l’analyse du mouvement global issu des cartes scolaires départementales montre que le solde des emplois affectés aux ouvertures de classes (4 864) excédait celui correspondant aux fermetures de classes (4 527).
– À la rentrée 2009, le caractère schizophrénique de la politique menée lors du précédent quinquennat se révèle, mais de manière encore détournée si l’on peut dire.
D’une part, la loi de finances pour 2009 a créé, au titre de l’évolution démographique, 500 postes supplémentaires d’enseignants du premier degré à cette rentrée.
D’autre part, sans que ce choix ait été étayé par un bilan de l’action pédagogique des maîtres dits « E » et « G » affectés dans les réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED), le ministre de l’éducation nationale a décidé de « sédentariser » un certain nombre d’entre eux. Il était donc prévu d’affecter 1 500 maîtres spécialisés dans les classes, tandis que 1 500 autres maîtres devaient intervenir en surnuméraire dans les écoles où se concentraient les difficultés. Ce schéma n’a, en réalité, que partiellement été réalisé, avec environ 2 000 réaffectations en classes et 1 300 affectations en surnuméraire.
Au total, si le solde des emplois affectés aux classes a été, lors de la rentrée 2009, encore positif (+ 780), celui-ci s’est inscrit dans un contexte où, hormis les moyens destinés aux décharges des directeurs d’école ou aux conseillers pédagogiques, les principales actions étaient en retrait (remplacement : - 472 emplois ; adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés ou ASH, hors classes spécialisées : - 2 200 ; situations diverses : - 452).
– À la rentrée 2010, la schizophrénie de la politique éducative du précédent gouvernement éclate au grand jour.
D’une part, l’évolution du schéma d’emplois a comporté la création de 2 182 emplois d’enseignants (notamment pour tenir compte de la variation de la démographie scolaire en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer, en Polynésie et à Mayotte et de la compensation des décharges de service des directeurs d’école à 4 classes auparavant assurée par les professeurs stagiaires).
D’autre part, 9 182 emplois de stagiaires ont été supprimés à la suite de la « mastérisation » des recrutements, cette mesure ayant eu, comme on le verra plus loin, des effets très négatifs.
Par ailleurs, en dépit de la hausse des effectifs d’élèves, les créations d’emplois destinées aux ouvertures de classes ont été assez limitées (solde des ouvertures/fermetures de classes de + 373,25 emplois), tandis que les moyens consacrés au remplacement des maîtres absents ont diminué de 366,5 emplois.
– À la rentrée 2011, l’école primaire a subi pour la première fois l’effet des « leviers d’efficience » utilisés par les rectorats, dont le plus sollicité a été l’augmentation de la taille des classes, y compris dans l’éducation prioritaire. Ainsi le contingent des 3 367 emplois à supprimer a été réparti de la manière suivante : - 2 606 emplois d’enseignants du premier degré, - 673 intervenants extérieurs de langue et - 88 assistants étrangers de langue.
Le mouvement global des emplois d’enseignants du premier degré, dans ce contexte, a mis en évidence des soldes négatifs dans toutes les actions du programme « Enseignement public du premier degré ». Les suppressions ont concerné majoritairement les classes (- 1 442) et ensuite, à parts égales, les emplois affectés au remplacement (- 343,25) et ceux relevant des besoins éducatifs particuliers hors la classe, autrement dit des RASED (- 347,25).
– À la rentrée 2012, l’école primaire a connu deux phases bien distinctes.
Ÿ Une phase « ancien régime », d’abord, placée sous le signe des « leviers d’efficience », avec 5 700 suppressions d’emplois prévues, soit 600 suppressions concernant les moyens alloués au recrutement des étudiants en deuxième année de master (M2) et 5 100 suppressions concernant les moyens d’enseignement au sens large (4 150 emplois d’enseignants en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, 60 emplois d’enseignants dans les collectivités d’outre-mer, 890 emplois d’assistants et d’intervenants de langue).
Sur les 4 150 suppressions d’emplois d’enseignants envisagées, il est apparu, selon les données recueillies auprès des services académiques, qu’environ 700 pourraient porter sur les classes (17 %), 750 sur le remplacement (18 %), près de 2 000 – soit 1 948,50 – sur les RASED (48 %), les autres retraits affectant, notamment, les réseaux d’animation et de conseil pédagogiques ou l’éducation prioritaire.
Ÿ Dans un deuxième temps, en juin 2012, le nouveau gouvernement a considéré que des mesures d’urgence s’imposaient pour éviter une trop forte dégradation des conditions d’enseignement. Les moyens supplémentaires (création de 1 000 emplois de professeurs des écoles) dégagés dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2012 ont donc eu pour objectif d’ajuster la carte scolaire 2012 en ciblant les situations les plus critiques.
Ces moyens nouveaux ont ainsi permis d’ouvrir ou de maintenir ouvertes 670 classes (40 % en zones rurales et 25 % en zones d’éducation prioritaire), le reliquat d’emplois bénéficiant essentiellement au remplacement des maîtres absents ou aux RASED.
Sur l’ensemble de la période, la plupart des suppressions ont plutôt porté, comme l’a précisé le ministre de l’éducation nationale, M. Vincent Peillon, sur des postes qui n’étaient pas « devant élèves », appelés communément postes « hors classe ». Ainsi, entre juin 2008 et juin 2012, les moyens mobilisables pour les remplacements sont passés de 10 791 à 7 405, soit une baisse de 30 %. Ce sont aussi 30 % des postes de RASED qui ont été supprimés (69).
Les tensions actuellement constatées dans nombre de départements résultent donc de ces choix « spécieux », car moins visibles que des fermetures de classe. Leur impact n’en reste pas moins important, en particulier dans des départements ruraux ou très peuplés, comme par exemple celui de la Seine Saint-Denis où le potentiel de remplacement a été, selon le ministre, « liquidé » (1).
Ce constat est confirmé par les récents travaux de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR) faisant état de la raréfaction des viviers de remplacement, notamment dans le second degré, malgré les solutions palliatives – fortement médiatisées, mais à effet très limité – mises en œuvre par le précédent gouvernement.
La problématique des viviers de remplacement dans le second degré
S’agissant du recours aux contractuels en CDD et vacataires, les académies y ont eu recours plus souvent que précédemment, mais les viviers apparaissent comme épuisés : « Toutes les tentatives engagées depuis le début de l’année scolaire 2010-2011 pour les élargir n’ont eu qu’un effet limité, malgré les réels efforts des services et des chefs d’établissement. La situation peut se révéler particulièrement tendue dans les zones géographiques éloignées des centres universitaires. Dans ces cas, une fois les quelques titulaires sur zone de remplacement (TZR) mobilisés (souvent affectés à l’année sur des congés longs), les services académiques, tout comme les chefs d’établissement, ne parviennent pas aisément à trouver une personne de nature à satisfaire à la suppléance à réaliser ».
S’agissant de la coopération avec Pôle Emploi, elle « donne des résultats surtout pour les enseignements professionnels ou technologiques, mais peu pour les enseignements généraux. L’appel à des enseignants retraités a été organisé partout mais n’a nulle part produit les effets espérés : dans chaque académie, les candidats se comptent à l’unité ; très peu ont accepté de réaliser une suppléance, leurs contraintes d’organisation et de déplacement étant généralement incompatibles avec les propositions faites ».
Source : « Le remplacement des enseignants absents », inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, rapport n° 2011-056, juin 2011.
● Une dégradation du taux d’encadrement pédagogique entre 2007-2012
Même en ciblant les postes « hors classe », la politique du « un sur deux » a conduit à une dégradation du taux d’encadrement pédagogique, ainsi que l’attestent les données du ministère de l’éducation nationale.
En effet, le nombre d’élèves par enseignant a augmenté sensiblement entre 2007 et 2012 (prévisions). Il est passé ainsi :
– pour le premier degré public, de 18,2 à 18,59 entre 2007 et 2012 ;
– pour le second degré public, de 11,48 en 2007 à 12,05 en 2012.
Entre les rentrées 2007 et 2011, les effectifs d’élèves de l’enseignement public ont augmenté de 24 730 (+ 16 700 élèves dans le premier degré public et + 8 030 dans le second degré). Or, sur la même période, le nombre d’enseignants a diminué de 14 359 ETP, dont 13 795 dans le second degré. En intégrant les prévisions 2012, les effectifs d’élèves du secteur public auront augmenté de 13 230 entre 2007 et 2012 et, dans le même temps, la diminution du nombre d’enseignants aura été de 24 332 ETP dont - 5 812 dans le premier degré public et - 18 520 dans le second degré public.
2. Une scolarisation à deux ans devenue étique
Parmi les rapports de l’inspection générale de l’éducation nationale et de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche « cachés » par le précédent gouvernement, celui consacré à l’école maternelle pointe très justement le fait que la scolarisation des très jeunes enfants constitue une « variable d’ajustement plutôt qu’une politique » (70).
Il est vrai que les règles prévues par le code de l’éducation en la matière – l’accueil de ces enfants ne constituant pas une obligation pour l’institution scolaire –, laissent la place à beaucoup de souplesse (71).
Le rapport précité, s’appuyant sur de précédents travaux de l’inspection générale de l’éducation nationale, analyse en ces termes le flou subsistant dans ces règles : « L’ambiguïté de ces textes est triple : d’une part, aucun texte de nature réglementaire ne confirme (ni n’infirme) la possibilité d’accueillir des enfants atteignant deux ans en cours d’année ; d’autre part, aucun texte de même nature ne précise le sens de l’expression « dans la limite des places disponibles » ; enfin, aucun texte n’indique la date (d’inscription ou d’admission) à laquelle doivent être pris en compte, notamment pour la carte scolaire, les enfants admis entre la rentrée scolaire et le 31 décembre. Rien n’a été clarifié depuis ».
Les conditions étaient donc réunies pour que la déscolarisation des enfants de deux ans soit utilisée, depuis dix ans, comme un instrument d’économies souple et, en quelque, sorte invisible. Au cours du précédent quinquennat, l’application de la règle du « un sur deux » à l’éducation nationale a même trouvé dans cette politique un terrain d’action privilégié. Cette mesure a d’ailleurs constitué l’un des leviers d’économies en effectifs ou « leviers d’efficience » utilisé par le ministère de l’éducation nationale pour la préparation des budgets 2011 et 2012.
La réduction des effectifs d’élèves âgés de deux ans a donc été continue. À la rentrée 2011, leur taux de scolarisation était de 11,6 % – contre 34 % en 2001 -, leur effectif étant désormais inférieur à 100 000 alors qu’il était proche de 260 000 il y a dix ans (72).
Taux de scolarisation des enfants de 2 ans
(en %)
France métropolitaine + DOM | ||||||||||
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
34,0 |
31,7 |
29,2 |
25,9 |
24,5 |
22,9 |
20,9 |
18,1 |
15,2 |
13,6 |
11,6 |
Source : ministère de l’éducation nationale.
Dans les écoles de l’éducation prioritaire, le taux de scolarisation des enfants de deux ans a fortement diminué. Pour des raisons techniques, le ministère de l’éducation nationale n’a pas pu indiquer son évolution depuis 2007 (73). En revanche, la DEPP a fourni une estimation des résultats pour les années 1999 et 2011, figurant dans les tableaux ci-dessous et mettant en évidence l’ampleur d’une baisse qui, sur le terrain, peut être constatée depuis un certain nombre d’années.
Estimation du taux de scolarisation des enfants de 2 ans en éducation prioritaire
Zone |
1999 |
2011 |
Écart |
ÉCLAIR * |
32,8 |
17,6 |
- 15,2 |
Hors ÉCLAIR * |
32,6 |
11,2 |
- 21,4 |
* Écoles, collèges et lycées pour l’ambition, l’innovation et la réussite
Zone |
1999 |
2011 |
Écart |
RRS * |
36,1 |
17,7 |
- 18,4 |
Hors RRS * |
32,2 |
10,8 |
- 21,4 |
*Réseau de réussite scolaire
Source : ministère de l’éducation nationale, septembre 2012
Au regard de ces évolutions, on peut considérer, comme Mme Brigitte Gonthier-Maurin, sénatrice, que « ce gisement d’économies faciles était presque asséché » à la rentrée 2011 – à l’exception de quelques départements où cette question demeure sensible comme dans le Nord ou le Finistère et où environ 40 % des enfants de deux ans sont encore scolarisés (74).
Pourtant, les effets d’une scolarisation précoce sont très clairement positifs comme l’indiquent plusieurs études qui, selon M. Bruno Suchaut, directeur de l’Institut de recherche en éducation (IREDU) de l’université de Bourgogne, « vont dans le même sens ». La synthèse que ce dernier a faite, en 2008, de ces recherches est reprise ci-dessous.
L’étude récente de Mme Linda Ben Ali confirme, pour l’essentiel, ce constat en montrant que « s’ils ne se distinguent pas en termes de compétences, les élèves scolarisés à deux ans ont un meilleur parcours scolaire que ceux scolarisés à trois ans : ils sont 7 % à entrer en 6ème avec une année d’avance (contre 3 % des élèves scolarisés à trois ans) et seulement 15 % à avoir pris une année de retard (contre 16 % des élèves scolarisés à trois ans) ».
Cependant, cette corrélation s’explique en partie par le fait que les élèves scolarisés à deux ans sont souvent nés en début d’année et sont donc moins soumis au redoublement que ceux nés au dernier trimestre (75).
Des recherches convergentes sur les effets positifs d’une scolarisation précoce
« La fréquentation de l’école maternelle procure un avantage pour la suite de la scolarité, tant sur le plan des acquisitions, qu’en termes de carrière scolaire en réduisant la probabilité de redoubler une classe, et notamment le cours préparatoire. Les effets étant d’autant plus positifs que la scolarisation en maternelle a été longue. Quand on compare la scolarité élémentaire des enfants ayant fréquenté l’école maternelle à l’âge de 2 ans à celle d’autres élèves qui n’ont été scolarisés qu’à l’âge de 3 ans, plusieurs constats peuvent être faits sur la base de recherches conduites à plusieurs années d’intervalle et utilisant une méthodologie semblable (analyses permettant de raisonner "toutes choses égales par ailleurs"). La première recherche effectuée au début des années 90 (Jarousse, Mingat, Richard, 1992) relève un impact positif sur les acquisitions scolaires des élèves mesurées par des tests standardisés en français et en mathématiques. Cette même recherche met en évidence le caractère durable de ces effets puisqu’ils sont encore visibles jusqu’à la fin de l’école élémentaire.
Des études plus récentes conduites par le ministère de l’éducation nationale, à partir d’un large panel d’élèves, établissent des conclusions également positives quant à la scolarisation précoce. Les enfants entrés à l’école maternelle à l’âge de deux ans présentent un risque de redoubler l’école primaire légèrement inférieur à celui des enfants scolarisés plus tardivement (Caille, 2001). Les enfants entrés en maternelle à deux ans présentent bien, en moyenne, des performances supérieures à ceux dont la scolarité a débuté à trois ans, même si cet avantage à tendance à s’estomper au cours de la scolarité élémentaire (Caille, Rosenwald, 2006). »
Source : Bruno Suchaut, « Le rôle de l’école maternelle dans les apprentissages et la scolarité des élèves », conférence pour l’Association générale des écoles et classes maternelles publiques, 30 janvier 2008.
Le rapporteur se réjouit donc que le ministre de l’éducation nationale, M. Vincent Peillon, dès sa première audition par notre Commission des affaires culturelles et de l’éducation, ait affirmé que la France devait « rendre sa spécificité à l’école maternelle et lui redonner des moyens, notamment pour accueillir les moins de trois ans dans les zones particulièrement tendues puisque c’est là que c’est le plus efficace » (76).
3. Des dispositifs d’aide peu opérationnels
Tout au long du précédent quinquennat, les ministres de l’éducation nationale ont multiplié les initiatives visant à aider ou à accompagner les élèves en difficulté :
– instituée à l’occasion de la réforme de l’école primaire de 2008, l’aide personnalisée de deux heures hebdomadaires était destinée aux élèves rencontrant des difficultés en français et en mathématiques. Plus d’un million d’élèves, soit près de 20 % de l’effectif total, en ont bénéficié chaque année jusqu’à sa suppression par le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’aménagement du temps scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires ;
– organisés pour la première fois à la rentrée 2008, les stages de remise à niveau se déroulent durant les vacances scolaires, sur trois périodes de l’année, et apportent une aide complémentaire en français et en mathématiques à partir de la classe de CM1. D’une durée de 15 heures, ils ont concerné 259 000 écoliers de l’enseignement public aux vacances du printemps et de l’été 2012 ;
– ciblé sur les « orphelins de 16 heures », l’accompagnement éducatif, qui a été étendu progressivement, à partir de la rentrée 2007, aux écoles élémentaires publiques de l’éducation prioritaire, puis aux collèges publics, permet aux élèves volontaires de bénéficier, deux heures par jour et quatre jours par semaine, d’une aide aux devoirs et aux leçons ou d’activités sportives, culturelles, artistiques et de langues vivantes. En 2011-2012, le nombre d’écoliers de l’éducation prioritaire et de collégiens bénéficiaires était respectivement égal à 160 902 et 731 831 ;
– mis en place, à partir de la rentrée 2010, dans le cadre de la réforme du lycée d’enseignement général et technologique, l’accompagnement personnalisé, d’une durée de deux heures par semaine, bénéficie à tous les élèves, ce temps pouvant être librement utilisé par les établissements, par exemple à des fins d’orientation ou d’aide méthodologique ;
– pour mémoire, les programmes personnalisés de réussite éducative (PPRE), institués par la loi du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École, visent à aider les élèves susceptibles de ne pas atteindre la maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences. Ils ont bénéficié, en 2011-2012, en primaire, à 14,48 % des élèves de l’éducation prioritaire et à 7,47 % des élèves hors éducation prioritaire.
Cette accumulation de dispositifs est, certes, impressionnante, mais équivaut-elle à une politique cohérente et efficace de prise en charge de la difficulté scolaire ? On peut en douter car elle obéit en réalité à une stratégie que l’on pourrait qualifier de « contournement », poursuivie depuis plusieurs décennies par le ministère de l’éducation nationale et mise en lumière par les inspections générales en ces termes : « L’évolution de ces trente dernières années pourrait suggérer que les responsables ministériels sont passés de la volonté de modifier les pratiques au sein de la classe, par la "pédagogie différenciée", à la volonté d’obtenir ces changements au sein de dispositifs spécifiques, avec l’espoir que ceux-ci auraient un effet bénéfique sur les pratiques ordinaires. Les constats ne vont guère dans le sens de cet espoir. Si l’on veut réformer les pratiques pédagogiques, c’est bien le cœur de la classe qu’il faut viser » (77).
En somme, les mesures adoptées par le précédent gouvernement ont été moins novatrices qu’elles ne semblaient l’être et ont relevé, pour l’essentiel, d’une politique d’affichage.
Elles n’ont d’ailleurs pas permis de rompre avec l’approche quelque peu « uniforme » de l’enseignement qui caractérise l’éducation nationale et rend si difficile, aujourd’hui, la prise en compte de l’hétérogénéité des élèves. Ainsi, l’accompagnement éducatif de deux heures, présenté par le précédent gouvernement comme étant l’élément central de la réforme du lycée, a été évoqué en ces termes par M. Jean Picq, alors le président de la 3ème chambre de la Cour des comptes : « nous observons qu’(il) octroie le même nombre d’heures d’accompagnement aux lycées prestigieux et à ceux qui ont un taux de réussite au bac inférieur à 60 %… Le ministère a reconnu qu’il n’était pas capable de prévoir si ce dispositif serait d’une quelconque utilité ou bien s’il se transformerait en simple prolongement des enseignements disciplinaires ou en permanence où les élèves feraient leurs devoirs » (78).
Les réserves de la Cour étaient fondées. En effet, selon les travaux des inspections générales, sur 120 séquences d’accompagnement observées dans des lycées, de novembre à décembre 2011, près du quart, seulement, présentaient un niveau de personnalisation satisfaisant. Certaines séquences ont en outre été qualifiées de « dérives », par exemple lorsqu’elles ne sont que des cours plus ou moins déguisés, parfois en classe entière. Aussi le constat qui domine est-il « que l’on traite de façon assez indifférenciée les élèves, sans leur apporter un accompagnement adapté à leurs besoins réels ». Plus grave encore, certains ateliers d’accompagnement sont intitulés, ce qui ne manque pas d’être inquiétant, « gestion du stress », « coaching », « relaxation », voire même « sophrologie », les inspections générales rappelant à cet égard que « rémunérer un intervenant privé, qui a inévitablement des objectifs de recrutement pour son activité commerciale, comme cela a été constaté dans un lycée, est une dérive évidente » (79).
Par ailleurs, les effectifs d’élèves concernés par ces aides ont quelque chose de dérisoire par rapport aux besoins à couvrir. Ainsi que le souligne le rapport de la Cour des comptes sur l’éducation nationale et la réussite des élèves, « la proportion de collégiens bénéficiant de PPRE est trois fois inférieure à la proportion de sorties du système scolaire sans diplôme, ni qualification », tandis que « seul un élève sur quatre relevant de l’éducation prioritaire peut bénéficier de mesures d’accompagnement éducatif, alors que ce dispositif devrait être prioritairement développé dans ce secteur » (80). En forçant quelque peu le trait, la mise en œuvre de ces aides s’est apparentée à un cautère sur une jambe de bois…
Enfin, sur le plan qualitatif, ces aides, celles mises en place en 2007-2012, tout comme les plus anciennes, ne permettent pas de lutter efficacement contre la difficulté scolaire. Ce constat d’impuissance a été établi par les inspections générales, dans un rapport rendu public le 26 mai 2012.
Les dispositifs d’aide à l’école, au collège et au lycée
Dans le premier degré
« – Pour l’aide personnalisée, le caractère uniforme des moyens consacrés (deux heures hebdomadaires dans toutes les écoles) induit des inégalités de traitement significatives : des élèves légèrement en difficulté bénéficient dans certaines écoles d’une aide lourde alors qu’ailleurs des élèves ayant des difficultés avérées reçoivent une aide légère et discontinue.
– Les élèves les plus en difficulté – surtout au cycle 3 – sont peu pris en charge au motif que les formats d’aide sont plus efficaces pour d’autres (aide personnalisée, stages de remise à niveau) ou parce que les ressources ne permettent pas de le faire à tous les niveaux (RASED).
– Le temps réel de l’aide aux élèves est souvent inférieur aux attentes et rarement contrôlé ».
Dans le second degré
L’ensemble des dispositifs d’aide prévus par la réglementation est mobilisé, mais ce « tout » tient souvent « d’un empilement dont la cohérence est peu visible ».
Par ailleurs, « les points d’alerte suivants méritent attention et appellent des régulations :
– Les élèves les plus en difficulté sont inégalement pris en charge et les solutions qu’on leur propose seraient à redéfinir.
– Le contenu réel de l’aide aux élèves est souvent inférieur aux besoins et rarement contrôlé.
– L’aide et l’accompagnement sont déconnectés du cours habituel et ne sont pas intégrés à une stratégie globale de suivi de l’élève dans ses apprentissages ».
Source : « Observation et évaluation de l’ensemble des dispositifs d’aide individualisée et d’accompagnement à l’école, au collège et au lycée », inspection générale de l’éducation nationale et inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, rapport n° 2010-114, octobre 2010.
Au total, ces processus de remédiation souffrent de faiblesses structurelles, ainsi résumées par le ministre de l’éducation nationale, M. Vincent Peillon : ils « interviennent une fois la difficulté apparue » et sont « assez coûteux, relativement inefficaces et parfois stigmatisants pour les élèves » (81).
Il est vrai que l’efficacité très limitée de ces dispositifs s’explique aussi par l’insuffisance du savoir-faire des enseignants en matière d’aide aux élèves en difficulté. En effet, leur formation ne les prépare pas à diagnostiquer les situations de blocage ou d’échec et à proposer des stratégies d’apprentissage adaptées.
Par conséquent, pour reprendre les observations des inspections générales sur ce point, « trop souvent, et surtout dans le second degré, les enseignants, ignorants des mécanismes de l’apprentissage scolaire, reproduisent en « aide » ce qu’ils font habituellement en cours, faisant le choix de méthodes qui ne sont adaptées qu’à une minorité des élèves dont ils ont la responsabilité ; mêmes choix, mêmes effets : on fait du surplace » (82).
Ce manque de formation à la prise en charge de la difficulté scolaire a été aggravé par la suppression de la politique de « professionnalisation » des enseignants débutants résultant de la réforme de la formation des maîtres de 2010.
C. UNE FORMATION PROFESSIONNELLE DES MAÎTRES SACRIFIÉE SUR L’AUTEL BUDGÉTAIRE
En application d’un arbitrage motivé par des considérations strictement budgétaires, la formation initiale des lauréats des concours de recrutement, qui était mise en œuvre depuis 1991 par les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM), a été sacrifiée. En contribuant à diminuer l’attractivité du métier d’enseignant, ce choix s’est traduit par la chute, brutale, du nombre de candidats aux épreuves.
1. Une sous-professionnalisation résultant des suppressions de postes permises par la « mastérisation »
a) La formation des maîtres : une compétence progressivement déléguée des IUFM aux universités
La formation des maîtres a longtemps été une « affaire de l’État », ce que reflétait le statut des IUFM. Ceux-ci ont en effet été créés par la loi « Jospin » du 10 juillet 1989 sous la forme d’établissements publics administratifs, dont le conseil d’administration était présidé par le recteur.
La critique des IUFM est alors rapidement devenue un « marronnier » de la littérature, savante ou non, consacrée à l’éducation nationale. Ces « citadelles du pédagogisme », que beaucoup d’essayistes vouent aux gémonies, ont-elles pourtant démérité ? Certes, les instituts ont été mis en cause dès leurs premiers pas – en particulier par les rapports du sénateur André Gouteyron (1992) et de l’historien André Kaspi (1993). Certes, la « formation générale » (pédagogie, psychologie de l’enfant et de l’adolescent, etc.) qu’ils dispensent est parfois dépréciée par les enseignants stagiaires eux-mêmes, notamment en raison de son caractère trop abstrait et donc peu « opérationnel ».
Pour autant, les IUFM ne peuvent être tenus pour les seuls responsables des dysfonctionnements du système de formation initiale et de recrutement des enseignants. Leur « échec » – ce terme étant trop expéditif, car il masque de vraies réussites – s’explique en réalité par des facteurs exogènes, d’ordre historique et culturel, brièvement rappelés ci-après.
Bref bilan qualitatif des IUFM
Aux yeux du législateur, les IUFM avaient vocation à unifier l’ensemble de formation des maîtres – enseignement primaire, enseignement secondaire, enseignement technique et professionnel – de chaque académie. L’enjeu était considérable dans la mesure où, comme le rappelle Emmanuel Fraisse, professeur de littérature à l’Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3, la « bipartition » du système d’enseignement qui caractérisait la IIIe République – d’un côté l’école communale et ses instituteurs, de l’autre les lycées et ses professeurs –, s’est longtemps traduite par des « systèmes pratiquement étanches », chacun ayant son propre mode de formation des maîtres. Or, dans les faits, ainsi que le souligne cet observateur, « la division de la formation professionnelle par ordres d’enseignement à laquelle les IUFM entendaient remédier s’est perpétuée. La formation professionnelle d’une année succédant aux épreuves théoriques des différents concours est pour l’essentiel restée centrée sur le degré d’enseignement concerné et n’a offert que très peu d’éléments de tronc commun ». D’ailleurs, alors que dans la plupart des cas, les futurs professeurs du second degré préparaient le CAPES à l’université, une très grande partie de ceux du premier degré préparaient pendant une année les concours de professeur des écoles dans les IUFM eux-mêmes (83).
En outre, ainsi que l’a observé notre ancien collègue M. Jacques Grosperrin dans son rapport d’information sur la mastérisation, peut-on accuser les instituts « de ne pas préparer les futurs professeurs à enseigner devant des classes hétérogènes lorsque le concours évalue, pour l’essentiel, des connaissances académiques ? » (84). En réalité, le principal problème auquel est confronté le système de formation et de recrutement des enseignants est le défaut d’articulation entre ses volets théorique et pratique, celui-ci étant accentué par le caractère excessivement « disciplinaire » des concours de recrutement.
Depuis lors, sous l’impulsion de la loi « Fillon » du 23 avril 2005, qui a transformé les IUFM en écoles internes de leur université de rattachement, puis de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, qui a accru l’autonomie des établissements d’enseignement supérieur, la compétence de la formation des maîtres a été, dans les faits, déléguée aux universités.
L’État reste néanmoins présent : s’il ne prescrit plus le contenu de la formation, afin de respecter l’autonomie des universités, il en fixe le cadre en arrêtant, depuis 2006 et conformément à l’article L. 625-1 du code de l’éducation, un cahier des charges sous la double signature du ministre de l’éducation nationale et de celui de l’enseignement supérieur et de la recherche. Tel était l’objet du cahier des charges du 19 décembre 2006, abrogé par l’arrêté du 12 mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les professeurs pour l’exercice de leur métier, texte qui a été remplacé dans des conditions qui seront évoquées plus loin.
En outre, en portant le niveau de recrutement des enseignants à bac + 5, la réforme de la mastérisation a parachevé l’« universitarisation » de leur formation, un mouvement engagé, parmi les pays européens, depuis plus de trente ans. Cette évolution de leur qualification universitaire était d’ailleurs souhaitée par la grande majorité des acteurs du système éducatif, à commencer par la Conférence des directeurs d’IUFM, qui a appelé, en novembre 2011, les candidats à l’élection présidentielle de 2012 à confier – clairement – à l’université, « qui est le lieu de production et de transmission des savoirs et a pour mission l’insertion professionnelle de ses étudiants », la formation des enseignants des premier et second degrés « dans toutes ses dimensions, académiques, professionnelles et de recherche » (85).
De ce fait, la mastérisation de la formation et du recrutement ne manquera pas d’avoir des effets positifs, qui ont été évoqués par notre collègue Mme Françoise Dumas à l’occasion de l’examen du projet de loi portant création des emplois d’avenir. En particulier, cette mesure permet à la France de rejoindre le nombre croissant de pays membres de l’OCDE qui imposent un niveau de diplôme équivalent au master pour exercer dans l’enseignement – c’est notamment le cas de la Finlande pour ses écoles fondamentales qui scolarisent les enfants âgés de 7 à 16 ans –, de répondre à l’élévation du niveau général d’études de la population, de mieux reconnaître la complexité du métier de professeur et, enfin, d’adosser la formation des maîtres à la recherche (86).
Le précédent gouvernement a toutefois pêché par omission en omettant de doter l’université des structures aptes à prendre en charge la nouvelle mission qui lui avait été confiée. Pour ce faire, il aurait fallu s’appuyer sur les IUFM, devenus, depuis 2010, l’opérateur principal des formations conduisant aux métiers de l’enseignement, tout en les transformant en écoles professionnalisantes.
Cette voie, qui aurait été ambitieuse, n’a pas été choisie. Il est vrai aussi que la mastérisation poursuivait d’autres objectifs que la refondation du système de formation et de recrutement des maîtres.
b) Les « dessous » de la mastérisation : une entrée dans le métier d’enseignant devenue hasardeuse pour économiser 9 000 postes
● Une entrée dans le métier préjudiciable aux enseignants et aux élèves
Ÿ Décidée en 2008 et mise en œuvre en 2010, la mastérisation a conduit à confier aux universités la responsabilité de la formation initiale des enseignants, comme c’est déjà le cas pour les médecins et les juristes. Dans le même temps – c’est le revers de la médaille, qui entache de manière irréversible la réforme –, ses modalités d’application conduisaient à supprimer la formation professionnelle initiale des enseignants.
Cette réforme a en effet mis fin à l’ancien modèle de formation, lequel était centré sur les IUFM. Reposant sur une année de stage suivant la réussite au concours, au cours de laquelle les enseignants non titulaires étaient initiés en IUFM à la pratique de l’enseignement pendant les deux tiers de leur service, celui-ci, malgré toutes ses imperfections, permettait aux enseignants de se familiariser avec les problématiques de la pédagogie. Ainsi, cette année de stage, organisée selon le principe de l’alternance de la formation posé à l’article L. 625-1 du code de l’éducation, garantissait – en principe du moins – à chaque lauréat du concours une entrée relativement sereine dans le métier.
Le système de formation et de recrutement mis en place à la rentrée 2010 se caractérise, à l’inverse, par une prise de fonction plutôt brutale, à peine atténuée par une succession bancale de formations, avant et après le concours :
– la formation initiale des enseignants est assurée par les universités qui ont mis en place à cet effet, au-delà des masters « disciplinaires » habituels, des masters préparant les étudiants au concours de l’enseignement, dits masters « métiers de l’enseignement ».
Sur ce point, la Cour des comptes a relevé, en 2012, des insuffisances dans l’élaboration des maquettes de ces diplômes : « Un arrêté du 12 mai 2010 énumère dix compétences extrêmement générales que doivent acquérir les futurs enseignants (« maîtriser la langue française », « concevoir et mettre en œuvre son enseignement », « organiser le travail de la classe », etc.). Cependant les universités s’appuient le plus souvent, soit sur leurs unités de formation et de recherche disciplinaires, soit sur les instituts universitaires de formation des maîtres, en reprenant parfois les maquettes utilisées par ces derniers dans le système antérieur, qui pourtant ne donnait pas satisfaction » (87) ;
– les lauréats des concours de recrutement sont désormais affectés directement en école ou en établissement scolaire, avec une obligation de service à temps complet, du moins, comme on le verra plus loin, jusqu’à la rentrée 2012 ;
– la formation professionnelle des enseignants est assurée
– théoriquement – sous la forme de stages, destinés aux étudiants en master et organisés avant les concours, et – pratiquement – sous la forme d’une « formation continuée », c’est-à-dire après les concours, pendant la première année de fonction des enseignants stagiaires, par le recours à des stages massés ou filés et à un « compagnonnage » assuré par des tuteurs.
Ÿ Ce dernier point mérite d’être développé, car il a conduit à confier la responsabilité de classes à de jeunes lauréats des concours de recrutement qui peuvent n’avoir jamais vu d’élèves au cours de leur formation initiale. En effet, créés en 2010, les stages d’observation et de pratique accompagnée en première année de master et les stages en responsabilité de deuxième année, qui ne représentaient, ensemble et au maximum, que 12 semaines, n’étaient pas obligatoires. En outre, ceux de deuxième année se « télescopaient » avec la préparation des épreuves des concours, le stage en responsabilité étant ainsi organisé après la publication des résultats de l’admissibilité au CAPES. Enfin, comme les épreuves des concours ne valorisaient pas les périodes de stage, les étudiants pouvaient être tentés de se détourner du volet « professionnel » de la formation pour concentrer leur préparation sur son volet académique.
Au vu de ces éléments, le président de la Commission du débat national sur l’avenir de l’école de 2003-2004, Claude Thélot, a considéré, devant la mission d’information de notre Commission sur la mastérisation, que la réforme avait entraîné « une sous-professionnalisation de la formation » (88). Le jugement du Conseil économique, social et environnemental est tout aussi sévère, son rapport sur les inégalités à l’école estimant qu’« au moment où l’ensemble du système éducatif devrait être mobilisé pour la mise en œuvre du socle commun, la formation des nouveaux enseignants apparaît plus désorganisée que jamais », la formation professionnelle proprement dite semblant « disparaître ou au moins ne constituer que le parent pauvre » (89).
Ÿ Aussi diplomatiques soient-elles, les appréciations portées sur l’année de mise en œuvre de la réforme par les inspections générales de l’éducation nationale sont peu flatteuses pour le précédent gouvernement (90). D’ailleurs, le rapport qui en fait état n’a pas été rendu public avant l’élection présidentielle – et pour cause ! En effet, l’organisation et le déroulement des stages en responsabilité, qui intervenaient, rappelons-le, en deuxième année de master (M2), ont fait apparaître, au cours de l’année 2010-2011, quatre types de dysfonctionnements :
1° Une impréparation insuffisante de certains étudiants qui ont éprouvé des difficultés à assumer la prise en charge des classes lors du début de leur stage en responsabilité. Certaines situations, présentées comme étant « limitées » en nombre, ont même conduit à des abandons ou à des situations de retrait, comme par exemple à Strasbourg pour 10 étudiants sur 269 dans le second degré.
2° Une absence de compréhension entre université et employeur – ce dernier étant entendu comme les écoles et établissements accueillant les étudiants stagiaires – au sujet des conditions d’accès aux stages en responsabilité.
Selon les inspections générales, les équilibres ont été « parfois difficiles à trouver entre d’une part les options variées des universités, voire des UFR, sur le statut des stages en responsabilité (obligatoires pour tous les étudiants inscrits dans les masters enseignement, ou seulement conseillés aux seuls admissibles, voire fortement déconseillés dans certaines préparations aux concours du second degré au nom de la priorité à donner aux études théoriques ou à la préparation à l’oral du concours…) et d’autre part, les conditions et contraintes propres à l’employeur (qu’il s’agisse de la limitation de l’accès au stage en responsabilité aux seuls admissibles pour des raisons pédagogiques et financières, ou, à l’inverse, du besoin de disposer d’un nombre suffisant d’étudiants volontaires pour assurer la suppléance des fonctionnaires stagiaires en formation) ».
Les inspections générales estiment que ces difficultés ont trouvé « progressivement » des solutions au cours de l’année 2011-2012. Cependant, il ne semble pas qu’un tel optimisme puisse être de mise lorsque l’on lit le rapport de la mission d’information du Sénat sur le métier d’enseignant. Ce document tend en effet à montrer que, l’année dernière, les rectorats et les universités ne s’étaient pas encore pleinement investis dans l’organisation et la valorisation des stages.
L’offre de stages proposée aux étudiants se destinant à l’enseignement
– Les contacts entre les rectorats, qui organisent les stages, avec les universités sont trop faibles « comme si l’institution formatrice était déchargée de l’aspect professionnel du futur métier, uniquement confié au futur employeur ».
– Les académies dans lesquelles des stages en responsabilité sont offerts, grâce à la bonne entente des universités et des recteurs, à tous les étudiants de M2, qu’ils soient admissibles ou pas, sont peu nombreuses : il s’agit des académies de Grenoble, de Lyon et de Montpellier.
– La place accordée par les universités aux stages est elle-même extrêmement variable : « de nombreuses universités tendent à limiter l’obligation du stage en responsabilité aux seuls admissibles. D’autres refusent d’inscrire des stages en responsabilité dans leurs maquettes de master comme les universités Bordeaux 3 ou Toulouse 3. Certaines le rendent optionnel parmi d’autres types de stages possibles comme l’université Paris Est-Créteil. Certaines autres qui appartiennent à la même académie valorisent diversement le stage dans le master, par exemple le stage en responsabilité est valorisé par 15 crédits ECTS par l’université de Poitiers et par 6 ECTS par celle de La Rochelle. On rencontre aussi le cas d’universités comme celle de Nancy-Metz qui n’encouragent pas leurs étudiants à faire ces stages en considérant que leur durée, réduite à peau de chagrin, ne correspond pas aux standards de durée des stages dans les masters professionnalisants, comme à Nancy-Metz ».
Source : « Le métier d’enseignant au cœur d’une ambition émancipatrice », Sénat, rapport d’information de la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication présenté par Mme Brigitte Gonthier-Maurin, n° 601, 19 juin 2012.
3° Un choix des lieux des stages proposés aux étudiants et des activités effectuées par les étudiants remplaçant des professeurs pouvant être sources de tensions. D’une part, l’option consistant à coupler le déroulement du stage en responsabilité des étudiants de M2 et le remplacement des professeurs stagiaires partant en formation continuée s’est vite heurtée à d’importantes difficultés d’organisation et à un « constat de faible pertinence pédagogique » : dans ce cas, en effet, la formation complémentaire des enseignants stagiaires intervenait trop tardivement, ceux-ci étant contraints d’abandonner leur classe en plein second trimestre. D’autre part, les académies qui ont fait le choix de rechercher des lieux de stage dans des établissements peu éloignés des centres universitaires et disposant d’équipes pédagogiques expérimentées se sont « souvent trouvées confrontées à des fortes réticences des professeurs pour laisser leurs classes à des étudiants ».
4° Une demande de stage très faible chez les étudiants préparant les concours du second degré. Ce phénomène, qui résulte sans doute de l’effet de télescopage, déjà mentionné, entre les dates du stage et celles des épreuves des concours, s’est traduit par une sous-consommation des moyens prévus pour indemniser les étudiants effectuant un stage en « responsabilité » dans ce degré d’enseignement, celle-ci atteignant des « niveaux considérables » et concernant toutes les académies. À titre d’exemple, l’académie de Créteil, dont les moyens ont été prévus pour 1 660 étudiants, s’est retrouvée avec seulement 144 étudiants en responsabilité à payer. L’académie de Lille, dont les moyens étaient calculés pour 6 semaines de stage pour 1 092 étudiants, n’a pu mettre en place que 3 semaines de stage pour 392 étudiants.
Les enquêtes effectuées par les syndicats sur la situation des enseignants stagiaires mettent en évidence le manque de préparation professionnelle résultant de la réforme. À titre d’illustration, deux ans après sa mise en application, à la rentrée 2012, 41 % des professeurs de lycée et de collège stagiaires déclaraient ne pas avoir fait de stage en deuxième année de master avant le concours (91).
Au total, à partir de la rentrée 2010, l’entrée dans le métier des lauréats des concours s’est effectuée dans d’exécrables conditions, d’autant que le précédent ministre de l’éducation n’aura pris aucune mesure contraignante pour empêcher l’affectation des jeunes enseignants sur des postes difficiles.
Ainsi, en septembre 2010, 13,5 % des professeurs des écoles stagiaires et 13,8 % des stagiaires du second degré ont été affectés en éducation prioritaire (18,4 % et 13,2 % à la rentrée 2011). De même, lors de la première année d’application de la réforme, de nombreux enseignants ont été affectés dans plusieurs établissements (18,9 % des stagiaires à Grenoble ou 16,5 % à Lyon) ou niveaux (26 % des professeurs des écoles sur deux niveaux, 13 % sur trois niveaux).
Comme l’a observé, avec force, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, Mme Geneviève Fioraso : « On a ainsi envoyé de jeunes enseignants sans aucune formation pratique dans les classes à multiples niveaux de territoires très ruraux ou dans des quartiers relevant de la politique de la ville, avec des tuteurs parfois très éloignés et incapables de s’acquitter de leur tâche, les poussant ainsi à l’échec programmé et au découragement, voire à la dépression » (92).
Plus largement, on peut estimer que de telles conditions d’entrée dans le métier ont porté préjudice à la nation. Elles ont conduit en effet à décrédibiliser l’école et les enseignants auprès des familles, qui attendent du service public de l’éducation qu’il soit le maître d’œuvre de la réussite scolaire de leurs enfants.
● Une économie de 9 500 emplois à courte vue
Cette situation est d’autant moins acceptable qu’elle résulte d’une décision budgétaire à courte vue : la mastérisation a en effet « facilité » la préparation du budget 2010 en permettant de ne pas retirer des emplois à temps complet des écoles et des établissements, grâce à la suppression des postes d’enseignant stagiaires effectuant un service à temps partiel au titre de leur année de formation initiale.
Comme l’a rappelé la Cour des comptes dans son rapport public annuel 2012, « dans le plafond d’emplois ministériel fixé par la loi de finances pour 2011, cette réforme s’est traduite par la suppression de 18 202 postes d’enseignants stagiaires des instituts universitaires de formation des maîtres. Toutefois, le plafond d’emplois a dû intégrer également la création simultanée de 2 802 emplois de titulaires pour compenser cette perte de potentiel d’enseignement et de 5 833 emplois d’étudiants de deuxième année de master effectuant des stages en responsabilité devant les élèves. Au total, il en est résulté une suppression de 9 567 équivalents temps plein travaillé (ETPT). Exprimée en euros, la suppression des postes d’enseignants stagiaires des instituts universitaires de formation des maîtres s’est traduite par une économie de 707 millions d’euros en 2011 » (93).
Il faut dénoncer ici l’extraordinaire désinvolture dont a fait preuve le précédent gouvernement : ses choix « comptables », qui ont représenté quelques milliers d’unités en moins dans le plafond d’emplois du ministère de l’éducation nationale, se traduisent depuis la rentrée 2010 par l’arrivée dans les classes de professeurs pouvant être totalement inexpérimentés sur le plan de la pédagogie alors qu’ils ont la responsabilité des dizaines de milliers d’élèves.
Le ministre de l’éducation nationale, M. Vincent Peillon, a d’ailleurs relevé le fait que cette décision n’est pas assumée par ses auteurs et a indiqué devant notre Commission des affaires culturelles et de l’éducation ne pas entendre « le ministre qui a supprimé la formation des enseignants (…) On ne se bouscule pas pour défendre cette décision ! Personne n’assume, sauf peut-être Bercy, mais enfin il n’y avait certainement pas de pilotage pédagogique quand – cas unique au monde – on a décidé de supprimer la formation des enseignants dans notre pays » (94).
c) Une dernière estocade contre le principe de l’alternance de la formation heureusement parée par l’approche des élections
Il faut se réjouir que l’approche des élections présidentielle et législatives de 2012 ait interrompu l’examen d’une proposition de loi visant à réformer le cadre institutionnel de la formation des maîtres, curieusement déposée à la quasi fin des travaux de la précédente législature et qui a été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, le 15 février 2012.
En effet, sous couvert de procéder à un toilettage des articles du code de l’éducation relatifs au rôle des IUFM, ce texte visait à supprimer, d’une part, le principe selon lequel la formation des maîtres fait alterner des périodes de formation pratique et théorique et, d’autre part, la compétence des instituts dans la conduite de la formation professionnelle initiale des personnels enseignants (95).
Son but réel était donc de « sanctuariser » la suppression de l’année de formation en alternance des enseignants stagiaires, et de conforter ainsi les choix budgétaires qui ont « paramétré » la réforme de la mastérisation.
Par ailleurs, ce texte, fort opportunément, permettait de contrecarrer une décision du Conseil d’État du 28 novembre 2011 annulant, pour des motifs de forme – le ministre de l’éducation nationale ayant abrogé un texte établi conjointement avec le ministre de l’enseignement supérieur –, une partie de l’arrêté du 12 mai 2010 portant cahier des charges de la formation des maîtres.
Cet arrêt conduisait en effet à faire « revivre » le précédent arrêté de 2006, qui fixait les obligations de service des enseignants stagiaires effectuant leur année de formation en alternance en IUFM. Autrement dit, l’ancien modèle de formation, supprimé en 2010, aurait dû être remis en place à la date d’effet de l’arrêt.
Cette date ayant été fixée au 31 juillet 2012 par un nouvel arrêt du Conseil d’État, les ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, pour éviter que les enseignants stagiaires ne soient « plongés » dans l’insécurité juridique, ont adopté le 15 juin 2002 un arrêté fixant le cahier des charges de la formation respectant l’exigence de signature interministérielle posée par le législateur (96).
On notera qu’entretemps, au début de l’année 2012, plus de 300 recours avaient été déposés devant le juge administratif par le Syndicat national des enseignements de second degré pour demander le paiement des heures de travail faites « en trop », au regard des règles fixées par l’arrêté de 2006, par les enseignants stagiaires de l’année 2011-2012.
2. Une réforme qui a provoqué une crise aiguë du recrutement en 2011
Le master comptant 300 000 élèves de moins que la licence, le relèvement du niveau de diplôme requis pour se présenter au concours a entraîné une baisse du vivier potentiel de candidats.
À ce premier effet, « mécanique », s’en ajoutent d’autres, liés au contexte exécrable créé par les choix budgétaires du précédent gouvernement.
Ainsi que l’a souligné notre collègue Mme Françoise Dumas à l’occasion de l’examen pour avis du projet de loi portant création des emplois d’avenir, « conjuguée à la réduction des postes mis au concours par le précédent gouvernement, la mastérisation et son cortège d’ombres, en particulier les conditions déplorables d’entrée dans le métier qui en résultaient, du moins jusqu’à l’adoption des mesures correctives du collectif budgétaire, a eu un impact quantitatif très important (…) soit une diminution de moitié du nombre d’inscrits aux concours de professeur des écoles entre 2008 et 2012 et une diminution de 40 % des inscrits au CAPES sur la même période (…). La session 2011 constitue, à cet égard, une « année noire », avec une baisse, forte et généralisée, du nombre des inscrits : – 46 % pour les concours externes du premier degré et – 24 % pour les concours externes du second degré. En outre, en lettres, mathématiques et anglais, tous les postes offerts n’ont pu être pourvus dans ces disciplines. Or, il s’agit de la première session pour laquelle on constate un tel déficit ! » (97).
Inscrits aux concours externes des 1er et 2nd degrés
Sessions 2008 à 2012
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | ||
CRPE |
Externe |
80 777 |
73 371 |
66 461 |
35 646 |
37 161 |
Externe spécial |
596 |
560 |
571 |
295 |
323 | |
3e concours |
8 978 |
6 710 |
6 892 |
5 822 |
3 941 | |
Total CRPE |
90 351 |
80 641 |
73 924 |
41 763 |
41 425 | |
2nd degré |
Agrégation |
21 959 |
19 535 |
20 131 |
19 761 |
21 694 |
CAPES |
40 028 |
34 497 |
33 502 |
24 223 |
24 136 | |
CAPET |
4 591 |
4 167 |
4 499 |
2 984 |
3 486 | |
CAPLP |
15 868 |
14 681 |
14 822 |
9 913 |
10 483 | |
CPE |
9 949 |
8 930 |
7 669 |
3 862 |
5 187 | |
COP |
1 354 |
1 082 |
1 388 |
1 530 |
1 398 | |
Total 2nd degré |
93 749 |
82 892 |
82 011 |
62 273 |
66 384 |
Nota : CPRE = concours de recrutement de professeurs des écoles, CAPES = certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré, CAPET = certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique, CAPLP = certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel, CPE = conseiller principal d’éducation, COP = conseiller d’orientation-psychologue
Source : Avis n° 147 de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale sur le projet de loi portant création des emplois d’avenir, 4 septembre 2012, données fournies par le ministère de l’éducation nationale.
Par ailleurs, la déperdition, habituelle, entre les inscriptions et les présences effectives aux épreuves s’est accentuée en 2011, ainsi que le montre le tableau ci-après.
Il en est résulté, selon la Cour des comptes, une « évolution préoccupante » du taux de sélectivité des concours du second degré (98). En effet, si ce taux a été maintenu dans le premier degré, par le seul fait de la baisse drastique du nombre de postes offerts, c’est loin d’être le cas dans le second degré : le ratio entre le nombre de candidats présents aux épreuves écrites et le nombre de postes ouverts au CAPES, qui était de 7,6 en 1999, n’était plus que de 4,1 en 2010 et de 2,6 en 2011. En mathématiques, ce ratio est passé, de la session 2010 à la session 2011, de 3,2 à 1,4 et en lettres modernes, de 3,7 à 1,9 (99).
Candidats présents aux concours externes publics
des 1er et 2nd degrés des sessions 2010 à 2012
Concours |
Présents |
Évolution | |||
2010 |
2011 |
2012 |
2010/2011 |
2011/2012 | |
CRPE |
|||||
externe |
34 952 |
16 273 |
17 385 |
– 53,44 % |
6,83 % |
externe spécial |
324 |
138 |
185 |
– 57,41 % |
34,06 % |
3ème concours |
2 244 |
1 725 |
1 050 |
– 23,13 % |
– 39,13 % |
Total CE1 |
37 520 |
18 136 |
18 620 |
– 51,66 % |
2,67 % |
Agrégation externe |
|||||
Histoire |
1 154 |
561 |
644 |
– 51,3 |
14,80 % |
Anglais |
895 |
766 |
879 |
– 14,41 % |
14,75 % |
Lettres classiques |
196 |
143 |
180 |
– 27,04 % |
25,87 % |
Lettres modernes |
644 |
495 |
598 |
– 23,14 % |
20,81 % |
Mathématiques |
1 335 |
1 217 |
1 323 |
– 8,84 % |
8,71 % |
Philosophie |
539 |
442 |
464 |
– 18,00 % |
4,98 % |
Sciences physiques (option chimie) |
260 |
240 |
258 |
– 7,69 % |
7,50 % |
Capes externe |
|||||
Histoire-géographie |
3 484 |
2 179 |
2 115 |
– 37,46 % |
– 2,94 % |
Anglais |
2 947 |
1 679 |
1 686 |
– 43,03 % |
0,42 % |
Lettres classiques |
299 |
119 |
108 |
– 60,20 % |
– 9,24 % |
Lettres modernes |
2 648 |
1 523 |
1 411 |
– 42,48 % |
– 7,35 % |
Mathématiques |
2 771 |
1 319 |
1 502 |
– 52,40 % |
13,87 % |
Philosophie |
712 |
479 |
538 |
– 32,72 % |
12,32 % |
Physique-chimie / sciences physiques et chimie |
1 641 |
814 |
904 |
– 50,40 % |
11,06 % |
Nota : CRPE : concours de recrutement de professeurs des écoles
Source : ministère de l’éducation nationale, 18 octobre 2012.
3. Des mesures correctives prises pour les enseignants-stagiaires de l’année 2012-2013
Dans l’attente du rétablissement de l’année de stage des professeurs et de la mise sur pied des écoles supérieures du professorat et de l’éducation, qui seront effectifs à la rentrée 2013, le maintien d’un dispositif de formation « continuée » ou complémentaire s’adressant aux enseignants stagiaires s’imposait.
Le ministre de l’éducation nationale, M. Vincent Peillon, a dû en effet sacrifier au principe de réalité, faute de pouvoir réformer rapidement l’ensemble des modalités de recrutement arrêtées dans le cadre de la mastérisation.
S’agissant des enseignants stagiaires du second degré en poste en 2012-2013, le ministre a toutefois mis fin à leur service à temps complet qui les obligeait à suivre les actions de formation « continuée » en plus de leurs obligations réglementaires de service. Des académies avaient certes accordé, depuis la mise en application, en 2010, du nouveau « modèle » d’entrée dans le métier, des décharges aux stagiaires pour qu’ils puissent partir en formation, mais toutes ne l’ont pas fait et lorsque c’était le cas, les modalités d’organisation retenues étaient très différentes d’un point du territoire à l’autre.
Ces situations inégales en matière de temps de travail ont cessé à la rentrée 2012, car les enseignants du second degré bénéficient désormais d’une formation complémentaire, « décomptée » de leurs obligations réglementaires de service, grâce à une décharge de 3 heures (100). Devant revêtir un caractère transitoire, cette mesure permet de dégager dans leur emploi du temps une journée par semaine réservée à leur formation, 36 journées de formation leur étant ainsi offertes.
Quant au contenu de la formation, celle-ci étant assurée par les corps d’inspection, des formateurs académiques et des universitaires, dans le cadre de conventions conclues entre les rectorats et les universités, l’arrêté du 15 juin 2012 fixant le cahier des charges de la formation des professeurs précise qu’elle « se compose d’une part, d’un dispositif d’accueil, d’aide à la prise de fonction, puis d’accompagnement et de tutorat tout au long de l’année et, d’autre part, de cycles ou de sessions de formation pédagogique et didactique ».
Il y a lieu de noter que la session 2013 a été marquée par ce que notre collègue Mme Françoise Dumas a appelé un « renouveau des vocations », lié aux choix budgétaires du gouvernement et de la nouvelle majorité (101).
Ainsi, en ce qui concerne l’agrégation et le CAPES, on relève une hausse très significative du nombre d’inscrits (+ 10,2 % pour ces deux concours soit près de 5 000 inscrits supplémentaires), cette croissance touchant notamment les disciplines les plus déficitaires depuis deux sessions : mathématiques (+ 16,1 %) et lettres (+ 12 %). De son côté, le nombre d’inscrits au concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) a augmenté de 2,5 %, ce qui constitue la première hausse de la session depuis 2010.
La tendance s’amplifie aux concours 2014 : tous concours de l’enseignement public confondus, les inscriptions ont progressé de plus de 46%, soit environ 44 000 candidats supplémentaires.
Pour le premier degré, l’augmentation du nombre d’inscrits aux concours dépasse 57 % avec plus de 67 000 inscrits, contre 42 600 à la session précédente. Les concours du second degré enregistrent également une hausse de près de 37% avec plus de 70 500 inscrits, contre 51 600 pour la session 2013. De son côté, L’enseignement privé connaît également une progression, passant de 7 400 à 9 000 inscrits pour le premier degré et de 9 700 à 11 600 inscrits pour le second degré.
III.- UNE REFONDATION DE L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE QUI EST ATTENDUE, NÉCESSAIRE ET AMBITIEUSE
À l’occasion de la campagne présidentielle de 2012, François Hollande s’est engagé à faire de l’éducation un marqueur de sa démarche de transformation de la France. En donnant la priorité absolue à cette politique publique consubstantielle au pacte républicain, et en dépit d’une conjoncture difficile, il s’est fait l’écho d’une attente très forte de nos concitoyens.
Beaucoup n’ont retenu du programme du candidat que la promesse d’un recrutement net, sur la durée du quinquennat, de 60 000 personnels dans l’enseignement. C’est là faire peu de cas d’une vision bien plus aboutie de la modernisation à engager. La « refondation » de l’école de la République, puisque telle est l’ambition de l’exécutif et de sa majorité parlementaire, emporte bien plus de conséquences concrètes que des recrutements supplémentaires, même si ceux-ci sont indispensables à son succès. Elle passe aussi par une révision des parcours et des rythmes scolaires, une modernisation de la pédagogie et une appropriation du numérique.
Parce que la réussite de l’école à l’égard des générations nouvelles conditionne à bien des égards le « vivre-ensemble », refonder l’école doit permettre de refonder et de revivifier la République. C’est dire l’importance qu’un tel sujet doit revêtir pour la représentation nationale.
A. UNE RÉFORME PRÉPARÉE SELON UNE MÉTHODE EXEMPLAIRE, INNOVANTE ET EFFICACE
Symbole fort s’il en est, à peine installé, le nouvel exécutif a lancé une concertation d’un genre nouveau pour dégager des constats et des solutions partagés par la plupart des parties prenantes à la vie de l’école (enseignants, parents d’élèves, élus, société civile, etc.). L’enjeu, rien de moins, consistait à poser les bases solides d’une réforme « refondatrice ». Pour avoir participé activement à ce travail, le rapporteur est bien placé pour juger de l’appréciation très positive et de l’intérêt qu’il a suscité.
Le présent projet de loi d’orientation et de programmation, s’il traduit des choix de l’exécutif, s’inscrit dans le droit fil des propositions qui ont émergé de la concertation sur la refondation de l’école. Le Parlement est donc à présent saisi d’un texte qui bénéficie d’un large soutien tant le gouvernement s’est attaché à écouter et à tenir compte des points de vue de ceux qui seront appelés à faire vivre au quotidien tous les changements souhaités. Rarement une réforme de cette envergure – car au-delà de l’étape législative, il y a sa déclinaison réglementaire et les chantiers connexes de la refondation – n’a été autant été préparée en amont : cela doit être souligné.
1. L’association étroite des parties prenantes au processus
La concertation sur la refondation de l’école publique s’est déroulée du 5 juillet au 5 octobre 2012, date à laquelle son comité de pilotage de quatre membres a rendu public un rapport esquissant un bilan et des pistes de réformes structurelles. Cette phase d’écoute et de dialogue a été suivie des premiers arbitrages de l’exécutif, présentés par le Président de la République dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne le 9 octobre, puis par le gouvernement devant le Conseil supérieur de l’éducation, le 11 octobre. S’est ensuite engagé, sur ces bases, un dialogue avec les organisations syndicales et les élus, afin de finaliser les détails de la réforme dont le Parlement est appelé à débattre maintenant.
Signe que le changement est bel et bien à l’œuvre depuis le 6 mai 2012, alors que la précédente majorité parlementaire se gargarisait de « coproduire » à un rythme effréné et sans réelle cohérence les réformes émanant de l’exécutif, il convient de souligner que le processus de refondation de l’école voulue par le Président de la République associe pleinement les acteurs directement impliqués sur le terrain au dialogue engagé par les pouvoirs publics. C’est là le gage d’une réforme bien accueillie, acceptée et donc in fine efficace.
a) La concertation sur la refondation de l’école, un modèle de démocratie participative
La méthode retenue pour préparer les changements de l’école au cours des années qui viennent est inédite dans l’histoire de la République. Certes, d’autres réformes importantes touchant à l’éducation nationale ont elles aussi été accompagnées de réflexions d’experts et d’acteurs de l’école, mais jamais elles n’ont autant été inspirées par un panel aussi large de parties prenantes.
Pour mémoire, en effet, la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École, dite « Fillon », a certes été précédée par les travaux d’une commission nationale du débat pour l’avenir de l’école, installée le 15 septembre 2003 et présidée par M. Claude Thélot. Composée de membres désignés intuitu personae, cette commission avait conduit quelque 26 000 réunions dans 15 000 sites, et remis une synthèse des débats le 6 avril 2004 (102). Par la suite, le 12 octobre 2004, elle avait remis au Premier ministre un rapport (103), censé éclairer le gouvernement d’alors dans ses choix. Il n’en fut rien. Comme l’a souligné M. Claude Lelièvre, dans un billet paru sur le site internet Le café pédagogique : « Le rapport avait été rédigé en toute indépendance du ministère. Et la loi d’orientation va être rédigée en toute indépendance du rapport de la commission » (104).
Quant à la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation, dite « Jospin », la consultation nationale n’est intervenue qu’après sa promulgation. Une trentaine de colloques régionaux et un colloque national se sont effectivement tenus six mois plus tard, faisant de l’exercice une sorte d’États généraux de l’enseignement.
La grande différence de la concertation sur la refondation de l’école avec ces précédents, au demeurant assez anciens, réside dans le fait qu’elle a réellement servi à bâtir les orientations de la réforme dont les grandes lignes sont soumises au Parlement. Naturellement, elle se distingue aussi par l’ampleur de son objet et par ses modalités.
L’ambition de « refonder » l’école peut sans doute paraître présomptueuse. Elle est cependant bien réelle car nos concitoyens ne supportent plus de voir ce pilier de la République, auquel ils sont si profondément attachés, abîmé par le manque de moyens, le manque de considération et les changements imposés en dépit du bon sens. Il est grand temps de lui accorder la priorité car comme l’a souligné le Président de la République dans son discours du 9 octobre 2012 à la Sorbonne : « Tout commence par l’école. Elle est le lieu-même où se prépare la France de demain. Faire progresser l’école, c’est faire avancer la France ».
Les modalités selon lesquelles la concertation a été conduite ne sont pas non plus très communes. À bien des égards, il est même permis de parler de précédent unique de démocratie participative. Plus que la formule du comité de pilotage composé de quatre personnalités aux profils complémentaires (un maître de conférences en sociologie, un inspecteur général de l’éducation nationale, une journaliste éditorialiste et un président de région) synthétisant la réflexion menée par quatre groupes de travail thématiques (sur la réussite scolaire pour tous, les élèves au cœur de la refondation, un système éducatif juste et efficace et des personnels formés et reconnus), c’est l’interactivité des débats, à travers les contributions déposées sur un site internet dédié et des initiatives décentralisées au niveau des régions, et l’étroite implication de tous les acteurs (représentants des personnels éducatifs, parents d’élèves, associations de jeunesse et d’éducation populaire, élus) qui ont forgé la singularité et l’exemplarité de la démarche.
Au cours de 300 heures d’ateliers, quelque 800 personnes ont ainsi participé à ces travaux. De même, des réunions publiques ont été menées dans plus de 120 villes. Quant au site internet, 175 000 visiteurs uniques l’ont consulté, 24 000 réponses étant apportées à la question de la semaine et 8 200 contributions étant déposées.
Cette concertation a créé un réel engouement citoyen. Son succès rend d’autant plus forte la portée des préconisations du rapport du comité de pilotage, publié le 5 octobre 2012 et remis solennellement au Président de la République le 9 octobre suivant. Il n’y a rien d’étonnant, dès lors, à ce que l’exécutif s’en soit fortement inspiré pour fixer les grandes lignes de la réforme.
b) Un dialogue social nourri au cours de l’élaboration du projet de loi, et même après
Rompant avec la fâcheuse habitude prise par l’exécutif pendant la décennie passée, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault ne s’est pas contenté de solliciter, en amont, l’avis de tous les acteurs concernés par la réforme de l’éducation nationale ; il s’est aussi évertué à les consulter sur les orientations retenues pour celle-ci, de manière à rendre les arbitrages les plus consensuels possibles.
Une fois les premières grandes lignes du projet de loi d’orientation et de programmation fixées par l’exécutif et présentées au Conseil supérieur de l’éducation, le ministre de l’éducation nationale et la ministre déléguée chargée de la réussite éducative, dès le 15 octobre, ont reçu les organisations représentatives des personnels, les associations d’élus, les associations de parents d’élèves, les mouvements d’éducation populaire ainsi que les mouvements lycéens et étudiants. Ce dialogue a permis d’exposer plus en détail les premiers choix arrêtés, notamment en vue de la rentrée de 2013, et d’écouter les points de vue réciproques sur ces orientations.
Un dialogue interministériel s’est également noué puisque, fait inédit, pas moins de 23 ministres ont été officiellement associés au processus.
Comme il s’y était engagé, le gouvernement a tenu compte du fruit de tous ces échanges au moment de finaliser son texte. Alors que les annonces initiales de l’exécutif avaient laissé entendre un examen de la réforme au Parlement avant la fin de l’année 2012, il n’est d’ailleurs pas anodin que plusieurs semaines aient finalement été laissées au dialogue postérieur à la concertation.
Ainsi, le 5 décembre 2012, le ministre de l’éducation nationale a présenté l’avant-projet de loi aux syndicats d’enseignants. Le 7 décembre, il a adressé une lettre à tous les personnels afin de leur présenter les objectifs et le contenu de ce texte.
Par ailleurs, lors de son cheminement institutionnel, l’avant-projet de loi a recueilli les avis favorables de quatre instances consultatives :
– d’abord, celui du Conseil supérieur de l’éducation (CSE), qui représente les personnels, les usagers et les partenaires de l’école. Le 14 décembre 2012, il a soutenu le projet de loi par une large majorité (41 voix pour, 9 contre et 16 abstentions), ce qui témoigne d’une réelle adhésion de la communauté éducative aux priorités de la refondation. Inversement, le 19 décembre 2004, cette instance s’était largement prononcée contre l’avant-projet de loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école (39 voix contre, 9 absentions et 4 voix pour) ;
– ensuite, celui du Haut conseil de l’éducation, saisi le 6 décembre 2012 par le ministre de l’éducation nationale. Son avis du 11 janvier 2013 relève que le texte « rejoint ses préconisations sur un grand nombre de points, en particulier la priorité accordée à l’école primaire et la spécificité de la maternelle, la réaffirmation du socle commun comme fondement de la scolarité obligatoire, la mise en place d’une liaison solide école primaire-collège, la création des Écoles supérieures du professorat et de l’éducation » ;
– celui du comité technique ministériel (CTM) de l’éducation nationale, où ne siègent que les syndicats de personnels. L’avant-projet de loi y a recueilli 5 voix pour et 3 contre, 6 abstentions ayant été enregistrées ;
– enfin, celui du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Selon ce dernier, les grands objectifs du texte « correspondent » à ce que préconisait son avis « Les inégalités à l’école » de septembre 2011 : donner la priorité à l’enseignement primaire, restaurer la formation initiale des enseignants, articuler la politique d’éducation prioritaire et la politique de la ville et mettre véritablement en œuvre, et de façon cohérente, le socle commun de connaissances et de compétences. Le CESE a par ailleurs approuvé que l’avant-projet de loi « veuille également réformer les rythmes scolaires, instaurer une éducation civique et morale, renforcer le travail de l’école avec ses partenaires ». Cet avis très favorable a été adopté le 16 janvier 2013 en recueillant 161 voix pour, 1 contre et 29 abstentions.
On observera pour conclure que le souci de l’écoute, de la concertation et de la préparation du changement ne s’est pas éteint avec l’adoption du projet de loi par le conseil des ministres le 23 janvier 2013. Il présidera à d’autres chantiers qui émailleront, au cours du quinquennat, l’œuvre de refondation de l’école.
En attestent, notamment, le lancement de nouvelles concertations sur :
– le lycée et son articulation avec l’enseignement supérieur ;
– l’évolution des métiers. Dans sa Lettre à tous les personnels datée du 7 décembre 2012, le ministre de l’éducation nationale a annoncé l’engagement d’une réflexion sur les métiers de l’enseignement et de l’éducation : les missions des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED), des directeurs d’école et des chefs d’établissement ou encore la diversification des carrières des enseignants. Ce doit être l’occasion de reconnaître l’importance des concertations et des « regards croisés » des différentes professionnels – enseignants spécialisés, conseillers d’orientation-psychologues, psychologues scolaires, par exemple – qui, par leurs interventions, concourent à la réussite et au bien-être des élèves ;
– la refonte du système d’allocation des moyens d’enseignement entre les académies et les établissements, afin, selon les termes employés par ce courrier, de « donner véritablement plus à ceux qui ont moins ».
De manière plus générale, cette attention permanente accordée au dialogue tranche avec la pratique du quinquennat précédent, qui consistait le plus souvent à imposer les changements d’en haut sans tenir compte du point de vue des principaux intéressés.
On se rappellera, à cet égard, l’épisode révélateur de la réforme de l’évaluation des enseignants par le décret n° 2012-702 du 7 mai 2012, paru au lendemain du second tour de l’élection présidentielle. Conférant aux chefs d’établissement le soin de mener un entretien professionnel tous les trois ans en lieu et place de la double notation administrative et pédagogique, ce texte avait été pris en total mépris des réserves des organisations représentatives des personnels ; il a fort opportunément été abrogé, depuis, par le décret n° 2012-999 du 27 août 2012.
À l’éducation nationale, plus qu’ailleurs, réformer sans associer les principaux acteurs est voué à l’échec. La refondation de l’école ne pouvait donc se faire autrement que selon la méthode privilégiée depuis l’alternance de 2012.
Avec l’examen par notre Assemblée du présent projet de loi d’orientation et de programmation s’ouvre une étape décisive. La représentation nationale doit tout à la fois répondre aux attentes de nos concitoyens à l’égard de cette refondation scolaire et aux préoccupations des élus locaux, qui seront d’indispensables relais dans sa mise en œuvre.
Le gouvernement a souhaité que la discussion au sein de chaque assemblée ait lieu assez rapidement, sans pour autant renoncer à des conditions satisfaisantes de débat : à titre d’illustration, plus d’un mois se sera écoulé entre le dépôt du texte, le 23 janvier 2013, et son inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, en mars 2013. La raison tient à la nécessité d’adopter la loi suffisamment tôt pour permettre son entrée en vigueur et la parution du volet réglementaire qui l’accompagnera avant la rentrée de septembre 2013, au cours de laquelle plusieurs innovations majeures doivent voir le jour.
C’est le cas, au premier chef, des recrutements d’enseignants et de personnels supplémentaires, dont le budget 2013 a certes prévu la première annuité, mais dont l’inscription dans une perspective de moyen terme sera le gage d’une confiance renouvelée pour les principaux acteurs de l’éducation nationale. La programmation des effectifs, à plus forte raison dans une conjoncture budgétaire difficile, marque en effet l’engagement de l’État dans la durée et solennise la priorité accordée par l’exécutif à la restauration des moyens de l’école.
Il en va de même pour les écoles supérieures du professorat et de l’éducation qui, pour porter leurs fruits dans les meilleurs délais, doivent accueillir dès l’année scolaire prochaine les futurs professeurs et personnels de l’éducation nationale. Il serait à cet égard tout à fait paradoxal, alors que le budget pour 2013 a prévu des modalités de recrutement tenant compte de ce dispositif, que les futurs enseignants – et, par extension, les élèves – ne puissent en bénéficier en temps et en heure.
L’enjeu est enfin le même pour la mise en place d’instances indépendantes chargées de l’élaboration des programmes et de l’évaluation, pour le développement de l’école numérique ou pour l’accroissement des possibilités d’innovation des équipes pédagogiques au sein des établissements.
Alors qu’ils ont clairement adhéré au projet présidentiel de reconstruire l’école, les Français ne comprendraient pas que ce chantier prioritaire prenne du retard. De ce point de vue, la majorité parlementaire ne peut que partager pleinement l’ambition et les préoccupations de l’exécutif s’agissant de la mise en œuvre de la réforme.
Naturellement, comme en toute chose, vitesse ne saurait être confondue avec précipitation. Le gouvernement a néanmoins soigneusement évité cet écueil et le débat parlementaire qui s’ouvre donnera l’occasion à la représentation nationale de procéder aux ajustements qui s’avéreraient judicieux, voire nécessaires.
3. Des mesures constituant un véritable appel à la jeunesse adoptées préalablement à l’examen du présent projet de loi
Ainsi que cela a déjà été souligné, la refondation de l’école ne se limitera pas à l’adoption du présent projet de loi. En aval, elle inspirera d’autres réformes, qui seront élaborées et mises en œuvre sous la présente mandature. En amont, elle a été amorcée par l’adoption de mesures financières et législatives, intervenant au moment même où se déroulait la concertation sur la réorientation de notre système éducatif.
Ces initiatives, dont les premières ont été approuvées dès l’été dernier par le parlement, ont non seulement marqué une rupture par rapport à la politique menée sous le précédent quinquennat, mais constitué un véritable appel à la jeunesse de notre pays. En effet, elles témoignent de la volonté de faire du professorat une voie d’avenir et de promotion sociale.
a) Les mesures d’urgence du collectif budgétaire d’août 2012
De manière exceptionnelle, à quelques semaines de la rentrée scolaire, le premier collectif budgétaire adopté par la présente majorité, à savoir la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, a dégagé de nouveaux moyens pour l’éducation nationale. Ainsi, l’école était érigée en priorité de l’action publique, tandis qu’un message positif était délivré aux étudiants sur la politique de recrutement de ce ministère.
Ce texte a permis en effet la création de plus de 4 300 emplois, dont 1 000 emplois de professeurs des écoles. Ces derniers ont été répartis de façon à régler les situations les plus tendues, en particulier pour ouvrir des classes (ou éviter les fermetures de classe initialement prévues), 669,5 emplois ayant été consacrés à cet effet, dont 271,5 dans les zones rurales et 165,5 dans les écoles de l’éducation prioritaire, améliorer le remplacement (181,5 emplois) et renforcer les dispositifs à destination des élèves en difficulté.
Des moyens ont été également débloqués dans le second degré, avec la création de 50 postes de professeurs pour l’enseignement technique agricole, de 100 postes de conseillers principaux d’éducation, ces personnels jouant un rôle de premier plan dans le quotidien des établissements, et de 280 postes de professeurs certifiés.
Dans le même temps, afin de créer, dans les établissements, un climat propice aux apprentissages, le collectif budgétaire a prévu le recrutement de 16 000 contractuels, soit 2 000 assistants d’éducation pour assurer principalement des fonctions de surveillance, 500 assistants de prévention et de sécurité affectés dans les établissements les plus exposés aux incivilités et aux violences, 1 500 emplois d’auxiliaires de vie scolaire-individuels pour accompagner les élèves handicapés et 12 000 contrats uniques d’insertion sur des fonctions d’aide à ces élèves, d’assistance administrative aux directeurs d’école et de vie scolaire dans les établissements publics du second degré.
Enfin, ainsi que cela a déjà été indiqué, des mesures d’aménagement de service et des formations spécifiques destinées aux enseignants stagiaires recrutés en septembre 2012 ont été financées par ce collectif budgétaire. En particulier, dans l’enseignement public du second degré, une décharge de service de trois heures hebdomadaires a été accordée aux 9 000 (environ) enseignants concernés, le coût de cette mesure étant évaluée à environ 1 500 équivalents temps plein (105).
b) Les emplois d’avenir professeur
Entrée en vigueur le 1er janvier 2013, la loi du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir met en œuvre un dispositif de promotion sociale et d’aide à l’insertion professionnelle dans les métiers du professorat.
Dans ce cadre, les emplois d’avenir professeur visent à attirer les étudiants issus de milieux modestes vers les métiers de l’enseignement en leur proposant une entrée progressive dans le métier, ainsi qu’une aide financière leur permettant de faire face à l’allongement de la durée des études dû à la mastérisation.
Cette réforme comporte en effet un « risque d’éviction des étudiants boursiers allant à l’encontre de notre tradition républicaine », la proportion de ces jeunes inscrits en cursus de master étant estimée à 33 %, contre 44 % en licence (106).
Le dispositif est ciblé en faveur de 18 000 étudiants boursiers d’ici 2015, dont 6 000 en 2013, ces jeunes devant être inscrits en deuxième année de licence, principal public cible, en troisième année de licence ou en première année de master, et avoir moins de 25 ans. Certains d’entre eux bénéficient, aux termes de l’article L. 5134-20 du code du travail, d’une « priorité d’accès » aux emplois d’avenir professeur dès lorsqu’ils :
– effectuent leurs études « dans une académie ou une discipline connaissant des besoins particuliers de recrutement » ;
– et ont résidé au moins deux ans dans une zone urbaine sensible, dans une zone de revitalisation rurale, dans un département d’outre-mer, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre et Miquelon ou ont effectué deux années d’études secondaires dans un établissement situé dans l’une de ces zones ou dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire.
En contrepartie d’un engagement à se présenter à un concours de recrutement d’enseignants de l’éducation nationale, les étudiants concernés sont, dès la deuxième année de licence et pendant trois ans, initiés à l’enseignement, en effectuant un certain nombre d’heures de mission – douze en moyenne – dans des écoles et des établissements du second degré, et bénéficient de trois types de revenus :
– la rémunération des heures de service effectuées, dans le cadre du contrat d’avenir professeur, au service de l’éducation nationale. Financée conjointement par le ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministère de l’éducation nationale, cette rémunération est de l’ordre de 400 euros par mois ;
– les bourses de service public. Cette nouvelle aide est allouée à chaque titulaire d’un emploi d’avenir professeur, en échange d’un engagement à préparer un concours de recrutement de personnels enseignants et à s’y présenter. Le montant de ces bourses de service public s’élève à 2 604 euros par an, soit 217 euros par mois ;
– les bourses sur critères sociaux perçues par les titulaires des emplois d’avenir.
Ces trois revenus étant cumulables, les jeunes concernés doivent percevoir un revenu net « cible » emploi d’avenir d’environ 900 euros en moyenne mensuelle, variant selon l’échelon de bourse du bénéficiaire.
Au sens fort de l’expression, le budget 2013 est un budget de « rupture », qui s’inscrit à rebours des arbitrages financiers ayant présidé aux évolutions du nombre de postes offerts aux concours des sessions 2007 à 2012.
Évolution du nombre de postes offerts aux concours externes publics
(sessions 2007 à 2012)
Postes | |||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
Externe |
10 275 |
9 331 |
6 577 |
6 575 |
2 914 |
4 601 | |
Externe spécial |
140 |
129 |
133 |
133 |
86 |
102 | |
Troisième concours |
485 |
414 |
290 |
290 |
100 |
200 | |
Total CE1 |
10 900 |
9 874 |
7 000 |
6 998 |
3 100 |
4 903 | |
Agrégation |
1 443 |
1 245 |
1 245 |
1 232 |
1 170 |
1 248 | |
CAPES |
6 040 |
5 062 |
5 095 |
5 006 |
4 881 |
4 847 | |
CAPEPS |
400 |
400 |
400 |
450 |
560 |
600 | |
CAPET |
276 |
242 |
242 |
242 |
270 |
191 | |
PLP |
1 436 |
1 288 |
1 318 |
1 318 |
1 343 |
1 357 | |
CPE |
200 |
200 |
200 |
250 |
275 |
245 | |
COP |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 | |
TOTAL CE2 |
9 952 |
8 600 |
8 600 |
8 600 |
8 600 |
8 600 | |
TOTAL CE1+CE2 |
20 852 |
18 474 |
15 600 |
15 598 |
11 700 |
13 503 | |
Source : ministère de l’éducation nationale. CE1 : concours externes du premier degré, CE2 : concours externes du second degré
La loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 traduit en effet l’arrêt total des suppressions d’emplois au ministère de l’éducation nationale, tout en amorçant la réforme de la formation professionnelle initiale des enseignants. Son schéma d’emplois prévoit donc le remplacement de tous les départs définitifs d’enseignants en 2013 et le rétablissement de l’année de stage en alternance des lauréats des concours.
● Les concours 2013
22 100 postes sont ouverts aux concours externes 2013, dont 20 000 pour l’enseignement public, soit 80 % de plus par rapport à la session 2012. Ils sont ouverts aux étudiants en deuxième année de master et aux candidats déjà titulaires d’un diplôme de master ou d’un grade équivalent, les épreuves d’admissibilité s’étant déroulées en novembre 2012. Les étudiants qui seront admis aux épreuves orales de juin 2013 seront affectés et en poste à la rentrée 2013 et bénéficieront d’une décharge d’au moins 3 heures permettant un accompagnement renforcé de la prise de poste.
Postes ouverts aux concours 2013
Public |
Privé | |
1er degré |
9 000 |
1 000 |
2ème degré |
11 000 |
1 100 |
Source : ministère de l’éducation nationale
● Les concours 2014
L’année 2013 verra l’organisation – exceptionnelle – d’un deuxième concours, dont les épreuves d’admissibilité se dérouleront en juillet 2013 et d’admission en juin 2014, l’affectation et la prise de poste des lauréats devant avoir lieu à la rentrée 2014.
Cette session débutant de manière anticipée et ouverte aux étudiants de première année de master (107) permettra de rétablir l’année de formation initiale professionnelle supprimée en 2010.
En effet, les admissibles débuteront leur formation dans les écoles supérieures du professorat et de l’éducation, qui ouvriront leurs portes en septembre 2013, et se verront proposer un contrat leur permettant d’effectuer un stage en responsabilité sous la forme d’un tiers-temps de service, rémunéré à hauteur d’un mi-temps (108).
Postes ouverts aux concours 2014
Public |
Privé | |
1er degré |
8 500 |
900 |
2ème degré |
10 750 |
1 200 |
Source : ministère de l’éducation nationale
● Les nouveaux moyens d’enseignement de la rentrée 2013
La loi de finances initiale pour 2013 prévoit la création de 10 215 équivalents temps plein ou ETP (4 569 pour le primaire et 5 646 pour le secondaire) qui correspondent aux contrats rémunérés à mi-temps qui seront proposés aux étudiants admissibles suite aux épreuves écrites de juin 2013.
Comme ces étudiants effectueront, entre septembre 2013 et les épreuves d’admission se déroulant en juin 2014, un tiers-temps de service d’enseignement, sur le terrain, ces contrats permettront de créer 6 770 ETP d’enseignement, ainsi répartis :
– 3 006 ETP supplémentaires dans le primaire, dont un tiers pour répondre à l’augmentation du nombre d’enfants scolarisés (30 328 élèves de plus étant attendus à la rentrée 2013 par rapport à la rentrée 2012). Les deux autres tiers – soit 2 000 emplois – permettront de mettre en œuvre deux dispositifs prioritaires de la refondation de l’école : l’accueil des enfants de moins de trois ans dans les secteurs les plus défavorisés et la mise en place du dispositif « plus de maîtres que de classes » ;
– 3 764 ETP supplémentaires dans le second degré, dont près de 2 500 permettront de faire face à la hausse des effectifs scolaires (29 825 élèves de plus étant attendus à la rentrée 2013) et de renforcer le remplacement. 1 300 postes seront consacrés à l’amélioration de l’encadrement et de l’organisation pédagogique dans les collèges et lycées professionnels, en particulier dans les plus défavorisés d’entre eux.
Au total, à la rentrée 2013, l’ensemble des académies verront leur taux d’encadrement amélioré ou préservé.
B. UN PROJET DE LOI D’ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION QUI AGIT SUR LES « FONDATIONS » ET LES « FONDAMENTAUX » DE L’ÉCOLE
La refondation de l’école est une priorité à la fois budgétaire et politique : elle doit être en mesure de traduire, dans la durée, le changement d’orientation que doit opérer le redressement dans la justice. L’investissement dans l’éducation constitue, en effet, la meilleure réponse possible aux grands enjeux que sont, pour la France et sa jeunesse, le redressement économique, la cohésion nationale et la promesse républicaine.
Le présent projet de loi d’orientation et de programmation constitue, à cet égard, une étape fondamentale, décisive, de cette stratégie, mais ce texte, aussi ambitieux soit-il, ne pourra pas, à lui seul, concrétiser la « priorité éducative » définie par la Président de la République.
Ainsi, son volet réglementaire et le suivi – vigilant – de la mise en application de l’ensemble des mesures – financières ou administratives – devant concourir à la refondation de l’école seront tout aussi décisifs. Autrement dit, les éléments constitutifs de la nouvelle politique éducative ne figureront pas tous dans la future loi, à commencer par la réforme des rythmes scolaires.
Cette précaution « méthodologique » ayant été rappelée, on peut toutefois considérer que le présent projet de loi constituera le pivot de la refondation, en donnant de nouvelles bases et lignes directrices à l’enseignement scolaire. C’est la raison pour laquelle celui-ci, une fois adopté, se présentera sous la forme d’une loi d’orientation et de programmation, ces deux termes étant en effet indissociables :
– le premier terme se réfère aux orientations de la refondation de l’école, c’est-à-dire aux principaux objectifs de la politique éducative du quinquennat. Ceux-ci sont présentés, formellement, dans le rapport annexé au présent projet de loi et feront l’objet d’un débat devant la représentation nationale, puisque l’approbation de ce document-cadre constitue l’objet de l’article 1er ;
– le second terme traduit la sanctuarisation et la programmation, sur la durée du quinquennat, des nouveaux moyens accordés à l’éducation nationale.
Quels seront donc, en quelques mots, avant de les détailler, les leviers de la refondation ? On suivra ici la réponse, lumineuse, de M. Claude Lelièvre, historien de l’éducation, pour qui cette ambition doit d’abord et avant tout être comprise « comme la priorité enfin donnée aux "fondations" (c’est-à-dire à l’école maternelle et à l’école élémentaire, puis au collège) et à ce qui est jugé "fondamental" (à savoir la qualité et la formation professionnelle des enseignants, l’attention privilégiée aux élèves "fragiles") » (109).
L’enseignement et la pédagogie se situent donc au cœur de la refondation, ceux-ci devant être renforcés pour assurer la réussite de tous les élèves.
Les développements qui suivent visent à présenter ces orientations, telles que déclinées par le rapport annexé et les articles du projet de loi s’y rattachant.
1. Des objectifs chiffrés pour élever le niveau des élèves
« Moins il y a de cancres, plus il y a d’excellents élèves » : selon les sociologues Christian Baudelot et Roger Establet, les données issues des enquêtes PISA de l’OCDE établissent « de façon irréfutable » que les efforts pour doter tous les élèves d’une formation initiale de grande qualité « conditionnent le nombre et le niveau des meilleurs » (110).
Il faut donc se féliciter que le rapport annexé définisse des objectifs de nature pédagogique, la refondation de l’école devant permettre, en priorité, une élévation générale du niveau de tous les élèves.
Pour l’essentiel, ces objectifs s’inspirent des indicateurs figurant dans les projets et rapports annuels de performances annexés aux lois de finances et aux lois de règlement. Ils sont toutefois beaucoup plus ambitieux que ceux retenus par ces documents, leur horizon étant celui de la refondation, qui porte sur l’ensemble du quinquennat, et non celui de la programmation pluriannuelle (2013-2015) des crédits de la mission budgétaire « Enseignement scolaire ».
C’est la raison pour laquelle tous les efforts devront être déployés sur cette période, qu’ils soient nouveaux ou non.
Ces objectifs sont au nombre de sept, la plupart étant regroupés deux par deux :
Ÿ Faire en sorte que tous les élèves maîtrisent les compétences de base en français (lecture, écriture, compréhension et vocabulaire) et les compétences en mathématiques (nombres, calcul et géométrie) en fin de CE1 et que tous les élèves maîtrisent les instruments fondamentaux de la connaissance en fin d’école élémentaire (CM2).
Ces objectifs s’appuient sur ceux fixés à l’école élémentaire par les projets annuels de performances de la mission « Enseignement scolaire », leur évaluation étant assurée par le suivi de l’indicateur 1.1 relatif à la proportion d’élèves maîtrisant en fin de CE1 les compétences du palier 1 du socle commun et de l’indicateur 1.2 relatif à la proportion d’élèves maîtrisant en fin de CM2 les compétences du palier 2 du socle commun.
Extraits du dernier projet annuel de performances (PAP) de la mission, les tableaux ci-dessous permettent de rappeler le bilan de l’école primaire en la matière et de mettre ainsi en évidence le chemin qu’il lui reste à parcourir. On observera que, s’agissant de la proportion d’élèves maîtrisant la langue française (1ère compétence du socle commun) et les principaux éléments de mathématiques (2ème compétence du socle), aucune cible n’a été fixée par le PAP dans la mesure où une nouvelle méthodologie d’évaluation de ces acquis doit être élaborée pour 2013. En effet, une fiabilisation de la méthode de calcul des sous-indicateurs pour chacune des compétences du socle commun est en cours avec l’aide de la DEPP : les sept compétences du socle seront donc redéfinies pour inclure la notion de culture.
Proportion d’élèves maîtrisant en fin de CE1 les compétences du palier 1
du socle commun (indicateur 1.1)
(en %)
2010 |
2011 |
2012 |
2015 | |
1ère compétence : « maîtrise de la langue française » |
73,7 |
77,4 |
78 |
non disponible |
3ème compétence : « principaux éléments de mathématiques » |
76,7 |
77,8 |
80 |
non disponible |
Champ : enseignement public, France métropolitaine + DOM.
Source : projet annuel de performances de la mission Enseignement scolaire (PLF 2013)
Quant au deuxième objectif, qui concerne la fin du CM2, la lecture de l’indicateur correspondant du PAP constitue, à elle seule, un plaidoyer pour la refondation de l’école, afin qu’elle permette à 100 % des élèves de maîtriser, avant l’entrée au collège, les instruments fondamentaux de la connaissance, c’est-à-dire, selon les précisions communiquées par le ministère de l’éducation nationale, les compétences constituant le socle commun à ses différents paliers (CE1 ou CM2).
Proportion d’élèves maîtrisant en fin de CM2 les compétences du socle commun (palier 2)
(en %)
2010 réalisation |
2011 réalisation |
2012 prévision PAP 2012 |
2012 prévision actualisée |
2015 | |
Compétence 1 : « maîtrise de la langue française » |
86 (± 4,2) |
78,7 (± 2,9) |
87 |
79,5 |
82 |
Compétence 2 : « pratique d’une langue vivante étrangère » |
83,5 (± 5,2) |
78,3 (± 5,4) |
86 |
63 |
66 |
Compétence 3 : « principaux éléments de mathématiques et culture scientifique et technologique » |
77,6 (± 4,6) |
70,8 (± 3,1) |
87 |
72,5 |
76 |
Compétence 4 : « brevet informatique et internet école » |
90,5 (± 5,3) |
93,6 (± 3,1) |
89 |
90 |
92 |
Compétence 5 : « culture humaniste » |
81,8 (± 5,8) |
87,5 (± 3,5) |
81 |
81 |
83 |
Compétence 6 : « compétences sociales et civiques » |
91,6 (± 5,3) |
93,8 (± 2,1) |
94 |
94 |
95 |
Compétence 7 : « autonomie et initiative » |
89,6 (± 3,9) |
90,5 (± 2,6) |
91 |
91 |
93 |
Champ : enseignements public et privé jusqu’en 2010, public seulement pour les compétences 1 à 3 à partir de 2011, France métropolitaine + DOM, ce qui interdit toute comparaison, pour les compétences 1 à 3, entre les valeurs 2010 et 2011.
Source : projet annuel de performances de la mission Enseignement scolaire (PLF 2013)
Ÿ Réduire à moins de 10 % l’écart de maîtrise des compétences en fin de CM2 entre les élèves de l’éducation prioritaire et les élèves hors éducation prioritaire.
Cet objectif, qui vise à affermir la promesse républicaine d’égalité à l’égard des écoles primaires les moins favorisées, est tout aussi ambitieux au regard de l’état des lieux et de la cible établis par l’indicateur correspondant du dernier projet annuel de performances, tous deux repris dans le tableau ci-après.
On rappellera toutefois que le « paysage » de l’éducation prioritaire a connu, à la rentrée 2011, la disparition des « réseaux ambition réussite » (RAR) et la généralisation du programme « ÉCLAIR » (écoles, collèges et lycées pour l’ambition, l’innovation et la réussite »).
Cependant, les résultats obtenus par les établissements « ÉCLAIR » confirment les conclusions du bilan de l’éducation prioritaire publié par la direction générale de l’enseignement scolaire en 2010 (111). L’objectif d’équité en matière de maîtrise des acquis scolaires fondamentaux reste à atteindre, puisque l’indicateur 2.1 évalue à une vingtaine de points l’écart, entre ÉCLAIR et hors éducation prioritaire, des pourcentages d’élèves de CM2 maîtrisant cette compétence.
Écarts des pourcentages d’élèves maîtrisant en fin de CM2, les compétences 1 et 3 du socle commun (palier 2) entre écoles de l’éducation prioritaire (EP) et hors EP
Unité |
2010 |
2011 |
2012 |
2015 | |
1. Écart ÉCLAIR – hors EP en langue française |
écart |
n.d |
- 21,6 (± 5,4) |
- 20,5 |
- 17,5 |
1. Écart ÉCLAIR – hors EP pour les principaux éléments de mathématiques, culture scientifique et technologique |
écart |
n.d |
- 28,8 (± 6,1) |
- 27 |
- 24 |
3. Écart RRS – hors EP en langue française |
écart |
n.d |
- 17,1 (± 5) |
- 16 |
- 13 |
4. Écart RRS – hors EP pour les principaux éléments de mathématiques, culture scientifique et technologique |
écart |
n.d |
- 23,89 (± 5,1) |
- 23 |
- 20 |
5. Pour information : pourcentage d’élèves maîtrisant la langue française en ÉCLAIR |
% |
n.d |
- 59,9 (± 4,6) |
s.o |
s.o |
Champ : Enseignement public, France métropolitaine + DOM. Nota : Le programme ÉCLAIR a remplacé à la rentrée scolaire 2011 les réseaux « ambition réussite » (RAR), regroupant les écoles les plus défavorisées. Les autres écoles relevant de l’éducation prioritaire sont classées « RSS » ou réseaux de réussite scolaire.
Source : Projet annuel de performances de la mission Enseignement scolaire (PLF 2013)
Ÿ Réduire par deux la proportion des élèves qui sortent du système scolaire sans qualification et amener tous les élèves à maîtriser le socle commun de connaissances, de compétences et de culture à l’issue de la scolarité obligatoire.
Ces deux objectifs sont évidemment complémentaires.
D’une part, il ne peut y avoir de scolarité obligatoire réussie sans maîtrise, à la fin de la troisième, le diplôme national du brevet l’attestant, du socle commun. Celle-ci est en effet indispensable pour pouvoir vivre une vie normale de citoyen, de salarié, de fonctionnaire ou d’entrepreneur. L’acquisition du socle commun par 100 % des élèves constitue donc un impératif, qui rejoint d’ailleurs l’objectif fixé par le législateur en 2005 et repris à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation (« La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition du socle commun »).
Cette obligation de résultat souligne toute l’urgence qu’il y a à refonder l’école car, pour l’heure, celle-ci ne parvient, selon les indicateurs annexés aux lois de finances, qu’à amener 75,4 % des élèves de troisième à maîtriser la compétence 1 du socle, c’est-à-dire la langue française (112).
D’autre part, le second objectif vise à réduire drastiquement les sorties de jeunes âgés de 18 à 24 ans sans CAP, ni BEP, ni diplôme plus élevé et qui ne poursuivent ni études, ni formation (soit 11,9 % des jeunes en 2011). Il se rapporte à un indicateur créé au projet annuel de performances en 2012 pour tenir compte de la stratégie « Europe 2020 » et de la cible de 10 % fixée, à cette échéance, par l’Union européenne. Il est cependant beaucoup plus ambitieux que la cible de 9,5 % retenue par notre pays, dans le cadre européen, car il revient, en pratique, à réduire la proportion des jeunes sans qualification à moins de 6 %.
De son côté, le Conseil économique, social et environnemental a estimé qu’une école de la réussite pour tous devrait plutôt se donner un objectif de « zéro sortie sans diplôme ». Ce dernier a donc indiqué qu’il ne peut que « regretter que les ambitions de la refondation ne visent pas à terme l’éradication de l’échec scolaire » en ajoutant qu’on « ne peut résolument pas se satisfaire d’un taux d’échec scolaire relatif qui mènerait à oublier que derrière chaque échec scolaire, c’est un destin personnel qui se joue » (113).
Ÿ Réaffirmer les objectifs de conduire plus de 80 % d’une classe d’âge au baccalauréat et 50 % d’une classe d’âge à un diplôme de l’enseignement supérieur.
On rappellera que les engagements aux termes desquels « la nation fixe au système éducatif l’objectif de garantir que 100 % des élèves aient acquis au terme de leur formation scolaire un diplôme ou une qualification reconnue, d’assurer que 80 % d’une classe d’âge accèdent au niveau du baccalauréat, de conduire 50 % de l’ensemble d'une classe d’âge à un diplôme de l’enseignement supérieur », faisaient partie du projet de rapport annexé à la loi du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École. Ils ont finalement été supprimés de ce texte à la suite d’une décision du Conseil constitutionnel (114).
Quant aux performances de notre système éducatif au regard de ces objectifs, elles restent décevantes : le taux d’accès au baccalauréat n’était en 2011, que de 71,6 %, tandis que le pourcentage d’une classe d’âge titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur n’était, en 2010, que de 46,8 %. Il y a lieu de noter que ce dernier résultat est obtenu avec la contribution des brevets de technicien supérieur (BTS), des IUT et des écoles « professionnalisantes » (ingénieurs, formations paramédicales et sociales, etc.), tandis que des pays comme la Finlande ou la Pologne dépassent la barre des 50 % (115).
Ÿ Le rapport annexé au présent projet de loi précise que ces objectifs doivent engager l’école dans sa « globalité ». Plus précisément, il indique que l’ensemble de la communauté éducative (enseignants, personnels d’éducation, d’encadrement, administratifs, médico-sociaux et de service, élèves, parents, associations, collectivités territoriales, etc.) et l’ensemble des composantes du système éducatif (enseignement du premier, du second degré et du supérieur, enseignement général, technologique et professionnel, enseignement technique agricole, enseignement public et privé, universités et écoles supérieures du professorat et de l’éducation, administrations centrales et académiques, etc.) doivent se mobiliser pour leur réalisation.
2. Une programmation des moyens conforme aux engagements
Ainsi que l’affirme, sans ambiguïté, le rapport annexé, « la refondation de l’école consiste d’abord à réinvestir dans les moyens humains qui sont mis à son service ». Il en tire les conséquences, en indiquant, dans la phrase suivante, que la création de 60 000 emplois dans l’enseignement est programmée sur la durée de la législature.
Sur ce total, 54 000 emplois seront créés au ministère de l’éducation nationale, 5 000 au ministère de l’enseignement supérieur et 1 000 au ministère de l’agriculture.
● Le faux débat « quantitatif vs qualitatif »
Ce levier essentiel de la refondation est très critiqué par l’opposition, pour qui toute politique éducative devrait être centrée sur des objectifs et des moyens qualitatifs. Cet argument, parfaitement défendable sur le fond, présente néanmoins une faille sérieuse : une telle politique ne peut que se faire qu’avec des personnels correctement formés. Or, et c’est là un curieux paradoxe, qui a déjà été soulevé par le rapporteur, la préparation au métier d’enseignant a été totalement désorganisée – et pour des raisons strictement budgétaires – sous le précédent quinquennat.
Aussi faut-il s’assurer, avant même de penser à faire du « qualitatif », que les futurs enseignants bénéficieront d’une formation pédagogique solide – ce qui implique de créer les postes qui seront le support d’un tel dispositif. De manière corollaire, puisque le nouveau modèle de formation ne pourra pas produire, dans l’immédiat, tous ses effets dans les classes, il faut bien, en attendant, affecter de nouveaux moyens dans les établissements et les niveaux jugés prioritaires.
La refondation implique donc des postes supplémentaires – non par idéologie ou goût du contre-pied, surtout au vu de l’état de nos finances publiques – mais pour des raisons purement pragmatiques, qui devraient faire consensus.
Certains mettent toutefois en avant le fait qu’il suffirait de jouer sur l’effet « chef d’établissement » pour diffuser de nouvelles pratiques pédagogiques, en considérant notamment qu’une réforme des missions des directeurs d’école et la création d’établissements publics du primaire ou du socle commun permettraient à notre système éducatif d’améliorer ses performances.
Mais suffit-il de définir une nouvelle catégorie d’établissement public pour être efficace sur le plan de la pédagogie ? Probablement pas, et c’est la raison pour laquelle cette réforme n’a pas été faite il y a cinq ans, dix ans ou vingt ans.
De même, le règlement du problème lancinant du statut du directeur d’école constitue-t-il le sésame de la réussite scolaire pour tous ? On peut aussi en douter. Le directeur de l’Institut Montaigne, M. Laurent Bigorgne, a d’ailleurs indiqué devant la Commission des affaires culturelles et de l’éducation qu’il se « méfie d’une réforme qui conduirait à créer des emplois non enseignants dans les écoles, alors que c’est le personnel enseignant qui est la clé de la réussite » (116).
En réalité, c’est sur « l’effet maître » qu’il faut jouer en premier, et dans des établissements ciblés, avant de jouer sur les structures ou de compter sur le charisme de l’autorité hiérarchique.
Comme l’a rappelé, avec force, le ministre de l’éducation nationale, M. Vincent Peillon, « l’intérêt des élèves, dans l’immédiat, ce sont des enjeux pédagogiques. Comment peut-on nous accuser de faire du quantitatif quand notre première préoccupation est de renforcer l’effet-maître, dont toutes les études soulignent l’influence essentielle sur la réussite scolaire ? » (117).
Pour illustrer ces propos, il convient de reproduire ici le graphique établi par deux chercheurs américains, William L. Sanders et James C. River, qui fait référence.
L’influence de la qualité des enseignants sur les résultats scolaires
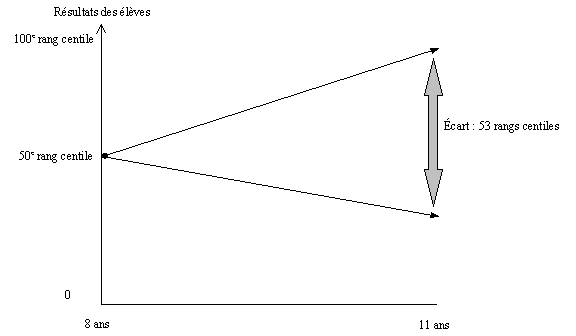

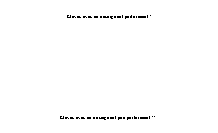
Nota : L’analyse des tests scolaires de l’État du Tennessee indique que la qualité des enseignants influence les résultats des élèves plus que tout autre variable. En moyenne, deux élèves de niveau identique verront, selon le professeur qui leur est attribué, leurs résultats diverger de plus de 50 rangs centiles à l’issue d’une période de trois ans.
* Compris dans les 20 % d’enseignants les plus performants.
** Compris dans les 20 % d’enseignants les moins performants.
Source : William L. Sanders et James C. Rivers, « Cumulative and Residual Effects on Teachers and Future Academic Achievement », 1996, cité par Michael Barber et Mona Mourshed, « Les clefs du succès des systèmes scolaires les plus performants », McKinsey & Company, septembre 2007.
● Une programmation stratégique
Outre que le fait que les 54 000 postes qu’il est prévu de créer dans l’éducation nationale sont la condition nécessaire – mais non suffisante – à la mise en œuvre d’une politique éducative assurant la réussite de tous les élèves, leur programmation répond à des arbitrages qualitatifs bien compris.
Elle est en outre conforme à la « feuille de route » déclinée et précisée par le discours sur l’école et la nation de M. François Hollande du 9 février 2012, la Lettre à tous les personnels de l’éducation nationale du 26 juin 2012 des ministres chargés de l’éducation nationale et de la réussite éducative et le discours de clôture de la concertation sur l’école prononcé par le Président de la République le 9 octobre 2012.
Ø Le rétablissement d’une formation professionnelle pour les enseignants
● 26 000 postes seront consacrés au rétablissement d’une véritable formation professionnelle pour les enseignants, qui correspondra à une année de stage, rémunérée et effectuée en alternance, car se déroulant à la fois au sein de l’université, dans les futures écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE), et sur le terrain, au contact des élèves.
Les 26 000 stagiaires qu’il est prévu de recruter dans ce cadre effectueront un demi-service d’enseignement, ce qui représente un apport de 13 000 moyens nouveaux devant les élèves.
Plus précisément, ces 26 000 emplois permettront d’asseoir, à compter de la rentrée 2014, sur des emplois de fonctionnaires stagiaires, les lauréats des concours de recrutement qui seront ouverts en 2014, aux étudiants en fin de première année de master (M1). Pendant leur année de stage (2014-2015), les intéressés seront inscrits à l’ESPE en deuxième année de master (M2), en vue de l’obtention de ce diplôme, et accompliront, en parallèle, dans le cadre de leur formation un service d’enseignement correspondant à un stage en responsabilité.
L’estimation du nombre d’emplois de fonctionnaires stagiaires créés à ce titre a été réalisée à partir, d’une part, d’une prévision des départs d’enseignants titulaires et, d’autre part, du nombre d’emplois d’enseignants titulaires qu’il est prévu créer sur la période. Une fois titularisés, ces stagiaires ont en effet vocation à occuper les postes vacants, libérés par des départs d’enseignants (de l’ordre de 22 000, chaque année, dans l’enseignement public et privé) ou créés sur cette période.
Le ministère de l’éducation nationale précise qu’au-delà de ces 22 000 créations de postes, dédiées au rétablissement de l’année de stage pour assurer la formation les jeunes enseignants qui compenseront les départs en retraite, il sera nécessaire de créer des places de stagiaires pour accueillir les étudiants qui pourvoiront des postes nouveaux.
Il ajoute que la répartition des emplois de stagiaires préalables à la création d’emplois de titulaires sera conforme à un objectif de deux-tiers en faveur du premier degré et un tiers pour le second degré. Cependant, la répartition exacte sera ajustée chaque année en loi de finances compte tenu des départs en retraite et des créations d’emplois d’enseignants titulaires.
Ce seront, au total, plus de 150 000 personnels enseignants, d’éducation et d’orientation qui devraient être recrutés sur la période 2013-2017 afin d’assurer le remplacement des départs d’enseignants titulaires, et de pourvoir les emplois créés par les lois de finances de 2013 à 2017.
● À ces emplois s’ajoutera la création de 1 000 postes d’enseignants chargés d’assurer la formation initiale et continue des enseignants dans les ESPE, en complément des moyens qui seront dégagés dans les universités.
La restauration de la formation initiale des maîtres s’accompagnera donc de l’attribution de moyens supplémentaires pour les formateurs, ces deux mesures étant corrélées. La refondation pédagogique de l’école est à ce prix, le caractère élevé de celui-ci ne s’expliquant que par l’héritage laissé par la réforme dite de la mastérisation.
Ø La priorité accordée à l’école primaire
Pour passer de la démocratisation de l’accès à l’éducation à celle de la réussite, il faudra également investir de nouveaux moyens dans le premier degré. Le rapport annexé prévoit donc que deux tiers des 21 000 postes d’enseignants titulaires qui seront créés pendant le quinquennat seront destinés aux écoles, soit 14 000 postes.
Ces nouveaux moyens se répartiront de la manière suivante :
– En premier lieu, 3 000 postes seront créés pour développer l’accueil des enfants de moins de trois ans, en particulier dans les zones d’éducation prioritaire ou dans les territoires ruraux isolés les moins bien pourvus, ainsi que dans les départements et régions d’outre-mer. Le ministère de l’éducation a publié à cet effet une circulaire, en date du 18 décembre 2012 (118).
L’enjeu que constitue la scolarisation précoce dans ces territoires est évidemment considérable, même si cette entreprise risque de se heurter à des difficultés. Ainsi que l’a observé le directeur général de l’enseignement scolaire, M. Jean-Paul Delahaye, « se posera d’abord la question des moyens, en particulier dans des zones comme la Seine-Saint-Denis où l’on partira d’un taux de scolarisation très bas – inférieur à 1 %. Mais il y a autre chose : cette offre de scolarisation précoce ne rencontre pas toujours la demande des parents, notamment dans les milieux défavorisés. Il faudra donc susciter cette demande en allant à la rencontre des familles pour leur démontrer qu’une scolarisation avant l’âge de trois ans est facteur de réussite pour l’enfant » (119) .
– En deuxième lieu, 7 000 postes seront créés pour faire évoluer les pratiques pédagogiques, notamment par le recours au dispositif « plus de maîtres que de classes », qui permettra de concentrer les nouveaux moyens là où ils seront les plus efficaces – raison pour laquelle le directeur de l’Institut Montaigne, M. Laurent Bigorgne, a indiqué qu’il approuve « totalement » cet objectif (2).
En effet, l’arrivée d’un maître supplémentaire facilitera l’identification des élèves en difficulté et permettra de mieux leur venir en aide. En intervenant plus particulièrement au tout début de la scolarité élémentaire, il pourra accompagner les organisations pédagogiques innovantes, pour agir au plus près des élèves concernés. Ainsi que l’a précisé M. Jean-Paul Delahaye, le directeur général de l’enseignement scolaire, « il ne s’agira pas d’un coordonnateur comme en sont utilement dotés les établissements du programme ÉCLAIR – écoles, collèges et lycées pour l’ambition, l’innovation et la réussite –, où ils sont chargés d’élaborer des projets et de nouer des contacts avec les différents partenaires de l’école. Ce sera un professionnel aguerri, volontaire, recruté sur profil – on ne peut affecter un maître de plus dans ces écoles simplement au barème, car il devra disposer de compétences avérées ; un maître soumis aux mêmes obligations de service que ses collègues, et investi de la même dignité. Il ne s’agira donc pas d’un factotum ! Ainsi, dans une école comptant dix classes, on ne parlera pas de "dix maîtres plus un", mais bien de onze » (2).
L’objectif, ainsi que le précise le rapport annexé, est d’aider les élèves dans l’acquisition des apprentissages indispensables à une scolarité réussie, en intervenant principalement et prioritairement dans la classe, les modalités de cette action devant être définies en équipe, en fonction des contextes et des besoins des élèves que les maîtres connaissent précisément.
Le rapporteur pense que, dans de telles conditions, le principe du « onze pour dix » (onze professeurs pour dix classes) devrait agir, effectivement, comme un levier en faveur du changement, sa finalité devant être pédagogique et non de « confort », dans le but d’alléger les classes. C’est pourquoi il doit être intégré dans le projet d’école et dans un contrat éducatif et pédagogique liant l’école et les autorités académiques.
Le mode d’emploi du dispositif « plus de maîtres que de classes » selon la circulaire n° 2008-2012 du 28 décembre 2012 (120)
– Les écoles prioritairement concernées sont celles de l’éducation prioritaire, mais aussi des écoles repérées localement présentant des besoins similaires. Ces écoles peuvent par ailleurs bénéficier de l’affectation d’un maître supplémentaire même si elles disposent déjà de personnels surnuméraires.
– Le recours à ce dispositif est formalisé dans un projet rédigé par l’équipe pédagogique, sous l’autorité du directeur d’école, et validé par l’inspecteur de l’éducation nationale (IEN) chargé de la circonscription. Ce projet est inscrit dans le projet d’école comme une réponse à la difficulté scolaire et fait l’objet d’une présentation en conseil d’école.
– Diverses formes d’interventions pédagogiques peuvent être choisies dont la co-intervention dans la classe avec le maître titulaire ou la prise en charge de groupes d’élèves en fonction de leurs besoins. Le dispositif « plus de maîtres que de classes » peut également favoriser la mise en œuvre de modes d’organisation pédagogique en équipes qui diffèrent de l’organisation en classes, en cohérence avec l’esprit des cycles.
– L’affectation d’un maître supplémentaire se fait dans une école ou un nombre limité d’écoles relevant d’un ou plusieurs groupes scolaires d’un même secteur de collège, sur la base du projet porté par l’équipe pédagogique. Les postes seront identifiés au mouvement intradépartemental et les directeurs académiques des services de l’éducation nationale (DASEN) veilleront, lors de l’affectation, à la cohérence entre les nominations et les conditions du poste sollicité. Les enseignants affectés à ces écoles ainsi que les équipes pédagogiques des écoles concernées bénéficieront d’une formation préalable.
– Les DASEN dressent la liste des écoles dans lesquelles le dispositif « plus de maîtres que de classes » est implanté. Par ailleurs, celui-ci « ne se substitue pas aux aides spécialisées, qui gardent toute leur pertinence pour les élèves en grande difficulté ».
Ainsi que cela a déjà été indiqué, le budget 2013 de l’enseignement scolaire permettra d’affecter 2 000 emplois à ces deux dispositifs prioritaires de la refondation.
– Enfin, 4 000 postes seront créés pour faire face aux évolutions démographiques attendues. Ces postes serviront également à procéder à des rééquilibrages territoriaux et à améliorer le remplacement dans les zones ayant le plus souffert des suppressions d’emplois décidées ces cinq dernières années.
Ø La prise en compte des besoins du second degré
Le second degré ne sera pas oublié avec la création de 7 000 postes d’enseignants titulaires, soit :
– 4 000 postes dans les collèges en difficulté et les lycées professionnels pour mettre en place des dispositifs pédagogiques adaptés à l’hétérogénéité des publics et des parcours favorisant la réussite de tous les élèves et lutter ainsi contre le décrochage scolaire ;
– 3 000 postes pour tenir compte des évolutions démographiques et procéder à un rééquilibrage de la répartition des moyens humains dans les collèges et les lycées.
Ø La vie scolaire
6 000 emplois supplémentaires sont par ailleurs prévus pour répondre aux besoins suscités par l’accueil des élèves en situation de handicap, la prévention et la sécurité, le suivi médical et social des élèves et l’amélioration du pilotage des établissements et des services académiques.
● Au total, un effort exceptionnel mais ciblé
Le rapport annexé indique que d’ici la fin du quinquennat, 150 000 recrutements auront été effectués par la voie des concours externes d’enseignants publics et privés, ce chiffre constituant une prévision fondée sur l’estimation des départs en retraite sur la période. Le chiffre exact des ouvertures de postes prévues chaque année sera donc fixé en tenant compte de l’actualisation des départs en retraite constatés.
Le tableau ci-après permet de récapituler la programmation des emplois supplémentaires qu’il est prévu d’affecter à l’éducation nationale et de démontrer que celle-ci est effectivement construite selon une logique qualitative, celles des « fondations » et des « fondamentaux ».
Répartition des emplois devant être créés à l’éducation nationale
Réforme de la formation initiale |
27 000 |
Enseignants stagiaires |
26 000 |
Enseignants titulaires |
21 000 |
dont premier degré (public et privé) |
14 000 |
dont second degré (public et privé) |
7 000 |
Accompagnement des élèves en situation de handicap, CPE, personnels administratifs, médico-sociaux, vie scolaire |
|
Total |
54 000 |
Source : rapport annexé au projet de loi.
Certes, la répartition précise de ces emplois supplémentaires lors des différentes rentrées scolaires sera définie par les lois de finances successives. Mais il doit être clair pour tous que la représentation nationale aura à cœur de veiller à la cohérence des budgets de l’enseignement des premier et second degrés par rapport aux engagements contenus dans le rapport annexé.
On rappellera cependant que la programmation des 54 000 emplois mentionnés par le rapport annexé a d’ores et déjà fait l’objet d’une première traduction dans la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 et dans la loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
Elle s’articule en outre avec la loi du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques, les mesures de création d’emplois prévues sur la période 2013-2015 ayant été prises en compte pour le calcul des moyens de l’enseignement scolaire prévus à l’article 11 de cette loi, soit 45,69 milliards d’euros en 2013, puis 46,10 milliards d’euros en 2014 et, enfin, 46,58 milliards d’euros pour 2015 (en crédits de paiement).
3. Des orientations pour la refondation
Le présent projet de loi d’orientation et de programmation s’articule autour de cinq grands axes : la formation initiale et continue des maîtres, le numérique, la rénovation des enseignements et la progressivité des apprentissages et, enfin, le dialogue avec les partenaires et les instances d’évaluation.
Pour faciliter leur présentation, le rapporteur a cependant choisi de regrouper les différentes thématiques que recouvrent ces grandes orientations sous six chapitres et indiquant, lorsque cela s’avère nécessaire, les articles du texte qui s’y rattachent.
a) Former au métier d’enseignant
Le premier enjeu de la refondation est d’ordre qualitatif. La refondation ne peut être en effet qu’une refondation pédagogique, la qualité d’un système éducatif reposant sur celle des enseignants.
La réforme de la formation initiale des enseignants sera donc fondée sur une entrée progressive dans le métier, conçue comme un « continuum » qui intégrera des éléments de préprofessionnalisation dès la licence et se conclura par l’acquisition d’un master professionnel.
Pour l’organiser, le présent projet de loi d’orientation et de refondation prévoit la création d’écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) qui formeront les enseignants de l’école maternelle à l’université, ainsi que les personnels d’éducation (articles 49 et 51).
Remplaçant les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM), ces structures auront le statut d’écoles internes aux universités, tout en bénéficiant d’un budget propre. Par ailleurs, bien qu’étant des composantes d’établissements autonomes, elles seront fortement encadrées par l’État : les ministres compétents arrêteront le cadre national des formations liées aux métiers du professorat et de l’éducation et accréditeront les ESPE pour la durée du contrat pluriannuel liant l’État à chaque université.
Selon le rapport annexé, ces écoles, qui accueilleront leurs premiers étudiants en septembre 2013, auront pour objectif, parmi d’autres, de développer une culture commune à tous les enseignants, ainsi qu’une recherche partenariale interuniversitaire. Elles associeront à leur fonctionnement les établissements d’enseignement et les praticiens du milieu scolaire.
b) Développer l’école numérique
Les enjeux d’un tel enseignement étant évidemment cruciaux, le présent projet de loi pose le principe d’une éducation numérique pour tous les élèves, de l’école au lycée (article 26). Cette formation devra comporter notamment une pratique raisonnée des outils d’information et de communication et de l’usage des ressources numériques.
Le projet de loi prévoit en outre la création d’un service public de l’enseignement numérique et de l’enseignement à distance (article 10), qui aura une triple mission :
– prolonger l’offre des enseignements dispensés dans les établissements et faciliter la mise en œuvre d’une pédagogie différenciée ;
– mettre à destination des enseignants des ressources pédagogiques, des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec leur famille, ainsi que des contenus et des services destinés à leur formation initiale et continue. Le rapport annexé au présent projet de loi indique que, dans ce but, un réseau social professionnel leur offrira une plateforme d’échange et de mutualisation, tandis que les écoles supérieures du professorat et de l’éducation devront intégrer dans la formation, initiale et continue, des personnels les enjeux et les usages pédagogiques du numérique ;
– assurer l’instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés en établissement.
La formulation retenue par le projet de loi paraît cependant inadaptée, dans la mesure où le numérique doit être un levier de transformation pédagogique et non une fin en soi.
Afin d’encourager l’usage de ces nouveaux outils, le code de la propriété intellectuelle sera modifié pour élargir le champ de l’exception pédagogique (article 55).
Enfin, le projet de loi précise qu’au collège, l’initiation économique et sociale et l’initiation technologique incluront une éducation aux médias numériques (article 35).
c) Rénover les enseignements et les apprentissages
Le contenu des enseignements et la progressivité des apprentissages seront placés au cœur de la refondation pédagogique. Leur rénovation impliquera par conséquent l’adoption de mesures variées mais complémentaires.
● Un Conseil supérieur des programmes garant de la transparence de leur élaboration et de leur cohérence
La refondation pédagogique de l’école et la mise en œuvre plus affirmée du socle commun imposeront de revoir les programmes d’enseignement selon des modalités nouvelles. En effet, la suppression du Conseil national des programmes par loi du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École a constitué une « erreur manifeste d’appréciation » puisque l’absence d’une instance identifiée et collective de supervision de ces outils d’apprentissage alimente un soupçon quasi permanent sur leur validité et leur légitimité.
Pour combler ce vide, un Conseil supérieur des programmes sera placé auprès du ministre de l’éducation nationale pour offrir les garanties d’expertise scientifique, d’indépendance et de transparence nécessaires à leur élaboration. Il formulera des propositions sur la conception générale des enseignements, le contenu du socle commun et des programmes et leur articulation avec les cycles, ainsi que sur la nature des examens conduisant aux diplômes de l’enseignement second degré et l’évolution des différents baccalauréats. Enfin, il donnera un avis sur la nature et le contenu des épreuves de recrutement d’enseignants des premier et second degrés (article 20 du présent projet de loi).
Cette dernière compétence constitue une nouveauté par rapport aux instances mises en place par la loi du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ou la loi du 23 avril 2005 sur l’avenir de l’École. Elle est fondamentale, car elle apportera les cautions nécessaires à l’élaboration d’une réforme, indispensable mais très délicate, des concours afin de les « professionnaliser ».
● Un socle commun sanctuarisé et clarifié
Le socle commun actuel est trop « lourd », trop « dense », ce qui a rendu sa mise en œuvre excessivement complexe. Sa conception et ses composantes seront donc réexaminées par le conseil supérieur des programmes. Par ailleurs, le projet de loi prévoit de le rebaptiser « socle commun de connaissances, de compétences et de culture », ce dernier terme constituant un ajout essentiel (article 7).
● Une progressivité des apprentissages mieux assurée de la maternelle au collège
Des cycles d’apprentissage ont été institués par la loi du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation (article L. 321-1 du code de l’éducation), ceux du premier degré se subdivisant de la manière suivante : le cycle 1 ou cycle des apprentissages premiers, correspondant aux petite et moyenne sections de l’école maternelle, le cycle 2 ou cycle des apprentissages fondamentaux, qui englobe la grande section de maternelle, le cours préparatoire (CP) et le cours élémentaire première année (CE1), et, enfin, le cycle 3 ou cycle des approfondissements, constitué des classes du cours élémentaire deuxième année (CE2) et des cours moyens première et deuxième année (CM1 et CM2).
Ces cycles étant pluriannuels, ils devraient rendre possible une gestion équilibrée des rythmes d’apprentissage des élèves et améliorer ainsi leurs résultats. Or ils ne sont guère appliqués, ainsi que l’ont constaté plusieurs rapports, dont celui consacré par Haut conseil de l’éducation à l’école primaire : « en dépit des textes officiels, l’organisation en cycles reste en général un trompe-l’œil, et les familles, dans leur grande majorité, n’ont pas conscience de son existence : on continue de penser les progressions par année et non par cycle, sans coordination entre les maîtres responsables des différentes classes d’un même cycle, sans continuité entre les apprentissages d’une année sur l’autre » (121).
La politique des cycles sera donc relancée, tandis que la liaison école collège – le passage, aujourd’hui non préparé, du maître unique de l’enseignement primaire aux professeurs « de discipline » de la 6ème pouvant mettre en difficulté les élèves fragiles et compromettre ainsi l’acquisition du socle commun – sera assurée. Pour atteindre ce double objectif, le rapport annexé prévoit :
– la mise en place d’un cycle unique à l’école maternelle ;
– la création d’un cycle associant le CM2 et la 6ème ;
– la définition d’un cadre juridique permettant à chaque collège et aux écoles relevant de son secteur de déterminer, conjointement, des modalités de coopération et d’échanges. Celles-ci devront en outre être inscrites dans le projet des écoles concernées et le projet d’établissement du collège. Le présent projet de loi prévoit d’instituer, à cette fin, un conseil école-collège, chargé de proposer des enseignements et de projets pédagogiques communs (article 40) ;
– la poursuite progressive de la baisse du nombre de redoublements, le système scolaire français semblant affectionner cette « méthode pédagogique » alors que toutes les études internationales démontrent son inefficacité. M. Éric Charbonnier, analyste à la direction de l’éducation de l’OCDE, a ainsi observé que même si la pratique tend à diminuer depuis trente ans, 38 % des élèves français âgés de quinze ans ont redoublé au moins une fois au cours de leur scolarité, tandis que dans les pays de l’OCDE, la moyenne est de 13 %. Or, selon cet expert, « les pays les mieux placés dans les résultats de l’enquête PISA sont, en général, ceux qui ont adopté des méthodes destinées à réduire le redoublement, méthodes fondées sur l’individualisation de l’enseignement, sur le soutien scolaire et sur la prise en compte des difficultés des élèves » (122). En outre, le redoublement coûte cher – 2 milliards d’euros selon les estimations du ministère de l’éducation nationale –, soit, comme l’a rappelé la Cour des comptes, le double du coût de l’éducation prioritaire (123).
Taux de redoublement dans l’enseignement primaire public
(en %)
2010 |
2011 |
2015 | |
En CP |
3,5 |
3,4 |
2 |
En CE1 |
4,4 |
4 |
2 |
En CE2 |
1,8 |
1,6 |
0,5 |
En CM1 |
1,3 |
1,1 |
0,5 |
En CM2 |
1,6 |
1,5 |
1 |
Source : rapport annuel de performances 2013 de la mission Enseignement scolaire.
Taux de redoublement dans l’enseignement secondaire public
(en %)
2009 |
2011 |
2013 | |
En Sixième |
3,4 |
2,8 |
1 |
En Cinquième |
1,9 |
1,5 |
0,5 |
En Quatrième |
2,7 |
2,1 |
1 |
En Troisième |
4,2 |
3,7 |
2 |
En Seconde générale et technologique |
10,1 |
8,8 |
6,5 |
Source : rapport annuel de performances 2013 de la mission Enseignement scolaire
● Une scolarité enrichie
Trois nouveaux contenus d’enseignements, qui devront faire l’objet de propositions du Conseil supérieur des programmes, seront mis en place dans le cadre de la scolarité obligatoire :
– un enseignement moral et civique afin de faire partager les valeurs de la République (article 28), dont les modalités devront être précisées pour être mises en œuvre à la rentrée 2015 ;
– une éducation artistique et culturelle (article 6), afin de réduire les inégalités d’accès à la culture. Ce parcours devra s’appuyer sur les apports conjugués de l’école et de ses partenaires – collectivités territoriales, institutions culturelles et associations ;
– un enseignement en langue vivante dès le cours préparatoire (article 27), à compte de la rentrée scolaire 2015, afin d’améliorer les résultats des élèves français en langue vivante, qui sont particulièrement alarmants.
● De nouvelles modalités d’évaluation
Selon le rapport annexé, les modalités de notation des élèves devront évoluer pour éviter une notation sanction, à faible valeur pédagogique, et privilégier une évaluation positive, simple et lisible par les familles.
Concrètement, cela revient à lutter contre une « notation-tri » qui, selon le chercheur en didactique André Antibi, fonctionne comme un « concours déguisé » et n’est pas étrangère à la place qu’occupe la France dans le classement établi par l’OCDE sur la qualité de vie à l’école (vingt-deuxième sur vingt-cinq pays) (124). Dans ce but, une note du Centre d’analyse stratégique sur le bien-être des élèves propose de valoriser les efforts des élèves lors de la notation, en observant que les systèmes où les contrôles types sont diffusés en amont aux élèves et font l’objet de séances de questions/réponses avec l’enseignant sont particulièrement propices à l’acquisition des connaissances. De plus, « donner le droit de se reprendre à la suite d’une évaluation insatisfaisante permet de briser le sentiment d’incapacité en reconnaissant que les difficultés et les erreurs font partie du processus d’apprentissage », les lycées finlandais permettant ainsi à leurs élèves de repasser les évaluations (qui ont lieu toutes les sept semaines) s’ils ne s’estiment pas satisfaits du niveau obtenu (125).
Aussi les modalités de l’évaluation seront-elles diversifiées, tandis que le livret personnel de compétences, qui atteste l’acquisition du socle commun, mais est perçu, par de nombreux enseignants et parents d’élèves, à juste titre d’ailleurs, comme une « usine à cases », sera réformé.
Le ministère de l’éducation nationale précise que les groupes de réflexion travaillant actuellement sur le sujet considèrent que l’évaluation chiffrée, qui reste une référence pour les élèves, les familles et les enseignants, doit devenir « plus éclairante et positive » et qu’évaluer n’est pas faire un relevé des échecs ou des manques, mais « mettre en valeur les acquis et permettre à l’élève de mesurer ses progrès et de se projeter vers de nouvelles connaissances et compétences ».
Par ailleurs, le présent projet loi prévoit de fixer par décret les conditions d’attribution du diplôme national du brevet (DNB), l’actualisation du socle commun impliquant de repenser le rôle de ce diplôme (article 36). Il attribue en outre de nouvelles missions à l’examen du baccalauréat (article 37).
d) Mettre les niveaux d’enseignement et les temps éducatifs au service de la réussite de tous les élèves
Les priorités des différents niveaux d’enseignement seront redéfinies, tout comme les rythmes scolaires seront réformés, en commençant par ceux du primaire.
● Une école maternelle confortée
Les 15 % d’élèves en grande difficulté à l’entrée de la 6ème l’étaient déjà au cours préparatoire. Il faut donc faire de l’école maternelle la priorité des priorités, d’autant que l’éducation de la petite enfance est, selon les travaux du prix Nobel d’économie James Hackman le plus rentable des investissements dans le système éducatif, en particulier pour les enfants défavorisés.
En effet, comme le montre le graphique ci-après, les retours sur investissements y sont supérieurs à ceux réalisés dans les autres niveaux d’enseignement.
C’est pourquoi le présent projet de loi prévoit de généraliser l’accueil des enfants de moins de trois ans dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à cette scolarisation précoce (article 5). Le rapport annexé précise que cet accueil sera privilégié dans les secteurs de l’éducation prioritaire, dans les secteurs ruraux isolés et dans les départements et régions d’outre-mer et qu’il devra s’appuyer sur une meilleure formation des enseignants du préélémentaire.
Retours sur investissement selon les différents niveaux du système éducatif
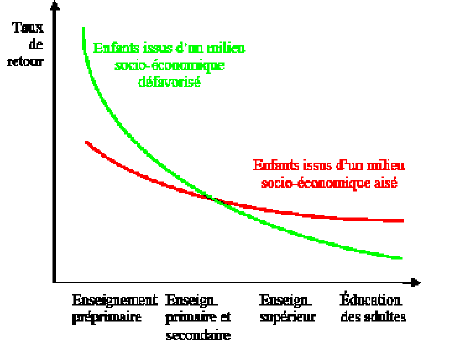
Source : communication de la Commission européenne COM (2011) 66 « Éducation et accueil de la petite enfance : permettre aux enfants de se préparer au mieux au monde de demain », 2011.
Les missions de l’école maternelle seront en outre redéfinies (article 30 du présent projet de loi), cette clarification devant intervenir en outre par la création d’un cycle unique, regroupant les petite, moyenne et grande sections. Cette mesure, qui donnera – enfin devrait-on dire – à l’école des « tout petits » une identité pédagogique, prendra effet à la rentrée 2014.
Par ailleurs, au-delà des écoles maternelles, deux grandes mesures, citées par le rapport annexé, permettront d’améliorer l’encadrement pédagogique des élèves du primaire :
– d’une part, la mise en œuvre du dispositif, déjà évoqué, « plus de maîtres que de classes » ;
– d’autre part, une évolution des missions et du fonctionnement des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED), afin de concevoir des relations et des complémentarités dans l’ensemble des dispositifs de soutien mis en œuvre dans les écoles.
● Un collège unique consolidé
L’article 4 de la loi « Haby » du 4 juillet 1975 a fixé un grand objectif au collège unique : « Tous les enfants reçoivent dans les collèges une formation secondaire. Celle-ci succède sans discontinuité à la formation primaire en vue de donner aux élèves une culture accordée à la société de leur temps ».
Pourtant, celui-ci ne s’est jamais concrétisé, le collège unique étant, depuis près de quarante ans, un faux collège « pour tous » et un vrai « petit lycée ». Par conséquent, la pédagogie différenciée qui y est pratiquée consiste, le plus souvent, à séparer les élèves à besoins éducatifs particuliers des autres, en recourant à des dispositifs ou classes spécifiques – comme l’option de découverte professionnelle « six heures » ou le dispositif d’initiation aux métiers en alternance (DIMA).
À rebours de cet héritage, qu’il convient de liquider, le rapport annexé réaffirme le principe du collège unique – celui-ci devant être organisé autour d’un tronc commun, qui autorise des pratiques pédagogiques différenciées – à la fois « comme élément clé de l’acquisition, par tous, du socle commun et comme un creuset du vivre ensemble ».
Ce choix doit être défendu, non seulement pour des raisons morales mais aussi pour des raisons d’efficacité, les vertus du tronc commun étant avérées. En effet, les systèmes scolaires disposant d’un tronc commun long et pratiquant un enseignement individualisé sont, selon les recherches de Mme Nathalie Mons, l’un des quatre membres du comité de pilotage de la concertation sur la refondation de l’école, ceux qui réussissent « le tour de force de limiter le nombre d’élèves en grande difficulté tout en produisant une élite scolaire conséquente », ce modèle d’école parvenant même « à fabriquer de l’égalité sociale ».
Pratiqué par des pays tels que la Suède, la Norvège, la Finlande, la Corée ou le Japon, cette « intégration individualisée » est le seul modèle « à la fois performant et égalisateur » (126).
Aussi les dispositifs « d’éviction » précoce seront-ils remis en cause, le projet de loi supprimant à cet effet « l’apprentissage junior » et le DIMA ouvert aux élèves de moins de quinze ans (article 38). Réservé aux jeunes ayant moins de quinze ans ou ayant terminé le collège et donc pouvant avoir moins de quatorze ans révolus (127), ce dernier dispositif a d’ailleurs été suspendu, par voie de circulaire, à la rentrée 2012.
En revanche, des enseignements complémentaires au tronc commun, comprenant éventuellement des stages contrôlés par l’État, pourront être proposés, mais seulement en classe de 3ème (article 33).
De même, la découverte des métiers et du monde du travail ne sera plus une option de « découverte professionnelle » réservée aux seuls élèves s’orientant vers l’enseignement professionnel. En effet, un nouveau « parcours de découverte du monde économique et professionnel » sera instauré à partir de la rentrée 2015 pour s’adresser à tous les élèves et trouver ainsi sa place dans le tronc commun de formation de la 6ème à la 3ème. Au-delà, ce parcours pourra se prolonger au lycée.
● Un lycée de la réussite pour tous
Le lycée assurera une continuité entre le socle commun de connaissances, de compétences et de culture et les formations supérieures de type licences (bac + 3), sections de technicien supérieur (STS), instituts universitaires de technologie (IUT) ou classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE).
L’enseignement professionnel, qui connaît un pourcentage très important de jeunes en situation de décrochage scolaire – soit un tiers des décrocheurs –, sera valorisé par l’adoption de mesures structurelles :
– tous les élèves qui s’engageront dans un cursus de baccalauréat professionnel en trois ans devront obtenir au minimum un diplôme de niveau V (CAP, ou un brevet d’études professionnelles – BEP – quand il n’existe pas de CAP dans la branche professionnelle concernée) avant leur sortie (article 8) ;
– l’accès aux cycles supérieurs courts (STS et IUT) devra être facilité pour tous les bacheliers professionnels titulaires d’une mention, qui devront être accompagnés dans cette scolarité ;
– la carte des formations sera modernisée, tandis que des « campus des métiers », offrant une gamme de formations – professionnelles, technologiques et générales – dans un champ professionnel spécifique seront mis en place pour accueillir différentes modalités de formation (sous statut scolaire, en apprentissage, en formation continue, etc.), organiser des poursuites d’études et offrir des conditions d’hébergement et de vie sociale.
Quant au lycée d’enseignement général et technologique, qui est, ainsi que le rappelle le rapport annexé, « l’un des plus coûteux et des plus denses au monde », il a fait l’objet d’une réforme entrée en application en 2010, qui s’est notamment traduite par la mise en place d’une 2nde de détermination. Celle-ci est cependant restée largement théorique, alors que, selon un premier bilan dressé par les inspections générales, « la hiérarchie entre les séries est toujours aussi présente et l’objectif de rééquilibrage est encore très lointain » (128). Ce niveau d’enseignement fera donc l’objet d’adaptations substantielles à partir de 2014 (recours à des pratiques pédagogiques innovantes, aide à l’orientation, rééquilibrage des séries, etc.).
● De nouveaux rythmes pour l’élève-enfant
Conformément aux conclusions de nombreux rapports, dont celui de la mission d’information de notre Commission sur les rythmes de vie scolaire, ceux du premier degré seront réformés à la rentrée 2013.
Avant de présenter ce nouveau cadre, le rapporteur tient à rappeler les propositions formulées en 2010 par la mission d’information. D’une part, celle-ci s’est prononcée en faveur d’une semaine de quatre jours et demie – organisée en neuf demi-journées, en mobilisant le mercredi ou le samedi matin, – ou de cinq jours. D’autre part, elle a défendu le principe d’une journée scolaire réduite et mieux articulée aux activités péri-éducatives, un plafond d’heures d’enseignement devant être fixé à cet effet, ainsi que celui de l’intégration de l’aide personnalisée au sein même de la classe, tout en soulignant l’intérêt que présenterait de l’institution, après celle-ci, d’études dirigées (129).
Ces propositions ayant été adoptées – à l’unanimité – par la mission d’information, le rapporteur considère que la réforme décidée par le gouvernement devrait recueillir un large consensus à l’Assemblée nationale, les mesures annoncées ou décidées ressemblant fort à celles suggérées, il y a moins de trois ans, par les députés.
La réforme prévoit en effet le retour à une semaine de 4 jours et demi, soit neuf demi-journées de classe, la mise en œuvre de cette mesure pouvant être étalée jusqu’à la rentrée 2014. La matinée d’enseignement supplémentaire prendra place le mercredi, sauf dérogation sollicitée auprès des autorités académiques. Du point de vue des enfants – le seul qui compte –, l’intérêt d’une telle mesure est considérable : l’ajout de 3 heures de classe le mercredi matin permettra en effet d’alléger les autres journées en moyenne de 45 minutes.
Selon le rapport annexé, cette nouvelle organisation de la semaine scolaire contribuera à améliorer l’efficacité des apprentissages en allégeant les journées de classe, en assurant une aide au travail personnel dans le temps scolaire et pour tous les enfants et en offrant, après le temps de classe, des activités pédagogiques complémentaires à des petits groupes d’élèves.
Aux termes de l’article 3 du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’aménagement du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, qui fixe les modalités d’application de cette réforme, la journée et la semaine scolaires devront obéir aux principes suivants :
– 24 heures d’enseignement hebdomadaires pour tous les élèves, réparties sur neuf demi-journées, à savoir les lundis, les mardis, les jeudis et les vendredis, toute la journée, et le mercredi matin ;
– une durée maximale de la journée d’enseignement fixée à 5 heures 30, avec une demi-journée supplémentaire n’excédant pas 3 heures 30, la pause méridienne ne devant pas être supérieure à 1 heure 30 (article D. 521-10 du code de l’éducation).
Des « activités pédagogiques complémentaires », organisées par groupes restreints d’élèves, s’ajouteront aux 24 heures d’enseignement hebdomadaire. Il pourra s’agir soit d’une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, soit d’une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d’école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial qui devra assurer la complémentarité entre les activités périscolaires et les enseignements. L’organisation générale de ces aides sera arrêtée par l’inspecteur de l’éducation nationale (IEN) de la circonscription, sur proposition du conseil des maîtres, les dispositions arrêtées étant inscrites dans le projet d’école. En conséquence, l’aide personnalisée, mise en place en 2008, sera supprimée (article D. 521-13 du code de l’éducation).
Le mode d’emploi de la réforme des rythmes scolaires selon le décret du 24 janvier 2013
● Un cadre national qui laisse une réelle liberté d’initiative aux communes et aux écoles
« Le local propose, l’État approuve ». Tel est en effet l’équilibre proposé par le décret du 24 janvier 2013 qui permettra de concilier la prise en compte des situations locales et le respect d’un cadre national, dont le respect sera assuré, sur le terrain, par le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN).
– Selon l’article 4 du décret, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peut, avant le 31 mars 2013, et non le 1er mars comme initialement prévu, faire part au DASEN de son souhait de reporter l’application de la réforme à la rentrée 2014 pour les écoles de la commune ou des communes membres de l’EPCI.
– Le conseil d’école intéressé ou la commune ou l’EPCI intéressé a la possibilité de présenter un projet d’organisation de la semaine scolaire au DASEN, après avoir recueilli préalablement l’avis de l’IEN chargé de la circonscription d’enseignement. Lorsque le DASEN arrête cette organisation, il le fait après examen du projet qui lui a été transmis et avis du maire ou du président de l’EPCI (réputé acquis en l’absence de notification au DASEN dans un délai de quinze jours à compter de la saisine).
● Un département qui doit être consulté
– Le département concerné, compétent en matière d’organisation et de financement du transport scolaire, doit être saisi par le maire ou le président de l’EPCI de leur souhait de reporter l’application de la réforme. S’il ne s’est pas prononcé sur cet aménagement transitoire dans un délai de 20 jours, son avis est réputé favorable.
– Le DASEN doit également consulter le conseil départemental de l’éducation national et le département avant de fixer les heures de d’entrée et de sortie de chaque école.
● Un garant du cadre national et de l’intérêt général, le DASEN
– Les projets d’organisation du temps scolaire sont transmis au DASEN, qui se prononce en s’assurant du respect des principes fixés au plan national, de la compatibilité du projet avec l’intérêt du service et, le cas échéant, de sa cohérence avec le projet éducatif territorial. Le DASEN s’assure également du fait que cette organisation ne porte pas atteinte à l’exercice de la liberté de l’instruction religieuse mentionnée à l’article L. 141-2 du code de l’éducation. Il se prononce également sur les dérogations au cadre national – par exemple la mobilisation du samedi matin au lieu du mercredi et l’augmentation de la durée d’enseignement de 5 heures 30 par jour et de 3 heures 30 par demi-journée – en s’assurant que celles-ci sont justifiées par les particularités du projet éducatif territorial et qu’elles présentent des garanties pédagogiques suffisantes (article D. 521-12 du code de l’éducation).
– Dans tous les cas de figure, le DASEN, agissant sur délégation du recteur d’académie, est compétent pour décider de l’aménagement du temps scolaire dans les écoles. C’est donc lui qui fixe l’organisation de la semaine, sur la base des projets qui lui sont transmis par les conseils d’école, les maires ou les présidents d’EPCI, après consultation du département et en s’appuyant sur l’avis formulé par l’IEN de la circonscription. Enfin, la décision qu’il ou elle prend ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. Sur ce dernier point, la circulaire n° 2013-017 du 6 février 2013 relative à l’organisation du temps scolaire dans le premier degré permet une souplesse d’adaptation, une commune, un EPCI ou un conseil d’école pouvant éventuellement demander au DASEN une modification de l’organisation du temps scolaire avant la fin de la période des trois ans, dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire.
● Deux silences
Le décret ne dit mot de l’heure de sortie de l’école, alors que tant la lettre du Premier ministre du 18 décembre 2012 que celle du ministre de l’éducation nationale du 24 janvier 2013 aux maires indiquent vouloir la maintenir à 16 heures 30, voire à « au moins 16 heures 30 ». Pourtant, la première version de ce texte avait confirmé cette règle. Ce silence peut encourager certaines communes à « rogner » la durée du temps éducatif qu’elles devraient prendre en charge.
Par ailleurs, le décret n’a pas affirmé la gratuité de ces 3 heures, alors qu’elles doivent être organisées en complémentarité avec le temps scolaire.
Mais il est vrai que les collectivités territoriales s’administrent librement, selon l’article 72 de la Constitution, et que l’imposition de telles règles se serait heurtée à cet obstacle juridique de taille… D’ailleurs, la circulaire du 6 février 2013 précise que les projets d’organisation du temps scolaire peuvent faire varier non seulement l’amplitude de la journée dans les limites fixées par le décret, mais aussi les horaires d’entrée et de sortie des écoles et la durée de la pause méridienne au-delà d’1 heure 30.
Le raccourcissement du nombre d’heures d’enseignement quotidien aura d’importantes conséquences sur les communes puisque, pour ne pas pénaliser les familles par une sortie prématurée des enfants l’après-midi, elles devront organiser des activités à caractère éducatif entre la fin de la classe et l’heure de sortie normale. Une partie de ce « temps éducatif » sera assurée par les enseignants, mais les communes auront la responsabilité de la plus lourde part, soit environ trois heures par semaine.
Aussi le Président de la République a-t-il annoncé le 22 novembre 2012, à l’occasion du congrès des maires, la mise en place dès la rentrée 2013 d’un fonds spécifique d’aide aux communes pour les accompagner, lorsque leur situation le justifie, dans la mise en œuvre cette réforme. La création de ce fonds fait l’objet d’un article spécifique du présent projet de loi (article 47).
Dans un courrier daté du 18 décembre 2012 et adressé aux présidents d’associations d’élus locaux, le Premier ministre, M. Jean-Marc Ayrault, a également répondu aux préoccupations des maires en matière d’encadrement des élèves, en demandant aux ministères concernés de préparer, à titre provisoire, un décret assouplissant le taux d’encadrement en centre de loisirs – fixé aujourd’hui à un animateur pour huit mineurs de moins de six ans et à un animateur pour douze mineurs de plus de six ans –, à condition toutefois que ce dispositif soit encadré par un projet éducatif territorial validé par les autorités académiques.
Le nouvel aménagement du temps scolaire suscite toutefois de nombreuses interrogations, voire inquiétudes, qui peinent à être apaisées. Cet état d’esprit reflète celui d’une société qui, selon le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, Mme Monique Sassier, est atomisée et n’a plus d’attentes collectives.
Dès lors, toute mesure à caractère général peine à trouver son public et tend même à susciter des réactions passionnées, car le changement est alors vécu comme « subi ». C’est donc un contexte psychologique et social d’ensemble qui explique l’accueil quelque peu désenchanté d’une réforme faite aux noms des élèves et des enfants.
Par ailleurs, la réforme ne sera pas sans effet sur l’organisation du travail des enseignants du premier degré – et au-delà sur leurs conditions de vie. Cet aspect a été pris en compte par le ministère de l’éducation nationale qui a réaménagé les heures de service non consacrées à l’enseignement devant tous les élèves devant la classe, lesquelles sont, depuis 2008, annualisées sous la forme d’un forfait de 108 heures (130).
Ce geste pourrait être complété, dans un avenir proche, et en lien avec une concertation sur les missions des personnels de l’éducation nationale, par l’instauration d’une indemnité spécifique pour les professeurs des écoles, ces enseignants ne percevant, contrairement à leurs collègues du second degré, aucune rémunération complémentaire de ce type – les heures supplémentaires, de surcroît, n’existant pas dans le premier degré.
Cependant, au final, cette réforme doit se faire, car, elle agira, ainsi que le souligne le rapport annexé, comme un levier pour faire évoluer le fonctionnement de l’école autour d’un projet éducatif territorial et mieux articuler les temps éducatifs et les temps péri-éducatifs.
Ce souhait rejoint celui formulé par la mission d’information de notre Commission sur les rythmes de vie scolaire dont le rapport préconisait de trouver « un nouvel équilibre entre temps scolaire et temps périscolaire au service d’une "école ouverte" » (131).
« Pour le reste », le rapport annexé précise que l’année scolaire, dont on connaît les déséquilibres, restera fixée à 36 semaines, mais qu’elle pourra évoluer « dans les prochaines années ».
Le rapporteur estime, à cet égard, que la réflexion sur les temps de l’élève devra nécessairement s’étendre au collège et au lycée. On ne peut pas en effet se limiter à constater, après comparaison avec les pays équivalents au nôtre, que les lycéens français sont ceux qui ont les horaires les plus chargés. Une réforme des rythmes scolaires devra donc aussi avoir lieu dans le secondaire, dès lors que sa visée sera pédagogique : il ne s’agit pas de réduire le temps de présence des élèves dans les établissements, mais de modifier la répartition de ce temps entre travail personnel, éventuellement accompagné, heures de cours et activités péri-éducatives.
f) Renforcer l’innovation et le pilotage du système éducatif
La refondation pédagogique suppose de faire confiance aux équipes éducatives, tout en modifiant en profondeur l’évaluation du système scolaire.
● L’innovation
L’autonomie mal comprise, c’est le « laisser-faire » face à la compétition des établissements réputés et des établissements défavorisés. C’est aussi le pari que des « chefs », disposant de pouvoirs renforcés pour diriger les établissements d’enseignement, pourront, comme par magie, impulser une réforme des pratiques pédagogiques. On l’aura compris : dans un cas comme dans l’autre, cette autonomie est une illusion, dangereuse ou naïve.
La seule autonomie qui vaille est celle qui permet à une équipe de définir, collectivement, les moyens de réussite de tous les élèves. C’est d’ailleurs ainsi que l’entend la Cour des comptes qui, dans son rapport de mai 2010, a préconisé que les « équipes pédagogiques, composées par les responsables d’établissement et les enseignants » puissent « déterminer les modalités de répartition des moyens d’enseignement et d’accompagnement personnalisé » des élèves en difficulté (132).
Le rapport annexé au présent projet de loi fait aussi le pari de l’utilisation « raisonnée » de l’autonomie. Il considère, à juste titre, qu’une politique de réussite éducative pour tous doit s’accompagner de marges de manœuvre en matière de pédagogie, afin de donner aux équipes locales la possibilité de choisir et de diversifier les démarches.
Le dispositif « plus de maîtres que de classes » constituera, à cet égard, l’un des terrains d’élection de cette approche fondée sur la confiance. En se concrétisant, celle-ci pourra ainsi mettre fin à l’organisation « Grenello-centrée » de l’éducation nationale, qui est inefficace, car en décidant de tout, le ministère se réfère à une école parfaitement homogène qui n’existe pas, mais qui avantage, de fait, les bons élèves.
À juste titre, le rapport annexé considère que ce nouveau levier impliquera de placer la concertation et la collégialité au cœur des établissements. Cela supposera de s’engager, de manière résolue, mais concertée avec les personnels, dans le chantier de l’évolution des métiers de l’enseignement.
Faire confiance au terrain n’exclut pas de s’appuyer, au niveau central, sur un nouvel acteur, afin de diffuser et de promouvoir toutes les connaissances utiles dans le domaine pédagogique et éducatif. La création d’un Institut des hautes études de l’éducation nationale est donc annoncée par le rapport annexé.
Le ministère de l’éducation nationale indique que le ministre a confié à M. Jean-Michel Blanquer, recteur, ancien directeur général de l’enseignement scolaire, la préparation d’un rapport, qui doit être rendu au plus tard le 30 mars 2013, sur la création de cet organisme et faire des propositions sur son statut juridique, son fonctionnement et sa gouvernance.
● L’évaluation
Le présent projet de loi d’orientation et de programmation prévoit de créer un Conseil national d’évaluation du système éducatif (article 21), qui apportera, avec toutes les garanties d’indépendance et d’expertise requises, une aide à la décision politique et aux réformes. Sa mise en place répondra donc à une exigence démocratique.
Ayant dans son champ d’investigation toutes les composantes de l’enseignement scolaire, l’organisation du système éducatif et ses résultats, cette instance remplacera le Haut conseil de l’éducation, mis en place par la loi du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École.
Il aura pour mission de réaliser des évaluations, de se prononcer sur les méthodes utilisées et de donner un avis sur les évaluations internationales.
g) Rendre l’école plus juste et plus ouverte
La refondation pédagogique devra s’accompagner d’une refondation pour la réussite éducative de tous les élèves, qui impliquera de lutter contre les inégalités scolaires et le décrochage, d’améliorer le climat et la vie scolaires et de renforcer les relations de l’école avec les partenaires incontournables que sont les collectivités territoriales et les parents des élèves.
● Une éducation prioritaire et une carte scolaire équitables et efficaces
Selon le rapport annexé, la refondation de l’éducation prioritaire, une politique mise en œuvre depuis 1981, nécessitera :
– une évolution de l’organisation en zonage, qui devra être mieux coordonnée au niveau interministériel, notamment avec la réforme de la géographie prioritaire de la politique de la ville. En effet, l’articulation entre le volet éducatif de cette politique et l’éducation prioritaire est insatisfaisante, la Cour des comptes ayant estimé, à ce sujet, que « leur efficience était menacée par un empilement continu d’actions non évaluées » (133) ;
– le réexamen de la question de la labellisation, les zones d’éducation prioritaire (ZEP) et leurs avatars successifs, les réseaux ambition réussite et de réussite scolaire – RAR et RRS – de 2006 et les écoles, collèges et lycées pour l’ambition, l’innovation et la réussite (ÉCLAIR) de 2011 n’ayant pas su éviter le piège de la stigmatisation ;
– une différenciation accrue des moyens en fonction des spécificités territoriales, sociales et scolaires de chacun des établissements ;
– une amélioration des conditions de travail, afin de stabiliser les équipes éducatives, cet objectif constituant un enjeu crucial pour les établissements des zones défavorisées.
Parallèlement, le retour à une sectorisation ou à d’autres modalités de régulation favorisant la mixité scolaire et sociale sera examiné, expérimenté et mis en œuvre.
En effet, même soumis à des critères, l’assouplissement de la carte scolaire décidé à la rentrée 2007 – l’exécutif ayant ensuite, et fort heureusement, renoncé à la suppression de ce dispositif –, a aggravé la ségrégation scolaire et spatiale, les rapports faits sur le sujet ayant tous constaté l’échec de cette mesure (134).
À titre d’illustration, en 2010, une fois les dérogations accordées, 75 collèges ont perdu plus du quart de leurs effectifs de sixième du seul fait de cette réforme, dont 34 labellisés « ambition réussite » (RAR). Ils étaient 72 dans ce cas en 2008 et 96 en 2009. Or, ces collèges se sont trouvés, selon le ministère de l’éducation nationale, « dans une situation d’évitement qui obère leur fonctionnement ». En ce qui concerne les collèges ECLAIR, 31 % d’entre eux voient plus du quart des élèves devant entrer en sixième demander une dérogation pour éviter l’établissement. Toutefois, compte tenu des taux de satisfaction moindres, le pourcentage de ces collèges perdant effectivement plus du quart de leur effectif de sixième est de l’ordre de 11 %, ce qui représente tout de même une trentaine de collèges.
Enfin, le rapport annexé reconnaît que l’internat scolaire est un mode de scolarisation qui favorise la réussite scolaire, tout en considérant que cette solution ne doit pas se limiter à quelques structures « d’élite », mais proposer l’excellence scolaire et éducative à tous les élèves accueillis.
● Vers une orientation et une insertion professionnelle choisies
Le rapport annexé indique que dès le collège, tous les élèves devront recevoir les éléments qui leur permettront de faire un choix éclairé pour la poursuite des études au terme de leur scolarité obligatoire.
Il s’agit de faire de l’orientation un choix « réfléchi et positif », notamment grâce au parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel qui sera mis en place à la rentrée 2015. Celui-ci sera proposé à chaque élève, dans le cadre du tronc commun de formation de la sixième à la troisième, associera les parents et sera organisé sous la responsabilité des chefs d’établissement, avec le concours des équipes éducatives et des conseillers d’orientation psychologues. Ainsi, il ne se limitera plus à une option de « découverte professionnelle » proposée uniquement aux élèves destinés à l’enseignement professionnel.
Deux autres mesures, également évoquées par le rapport annexé, permettront de favoriser des parcours choisis – et non plus subis :
– la multiplication d’initiatives partenariales de type témoignages de professionnels ou visites et stages de découverte des métiers et de l’entreprise ;
– une collaboration accrue entre l’État et les régions afin de renforcer le service public de l’orientation mis en place par la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie. Ce sera l’un des objectifs de l’« acte III » de la décentralisation.
Parallèlement, la région se verra confier une compétence cruciale pour accompagner les évolutions professionnelles et rénover le système d’orientation et d’insertion professionnelle. En effet, elle définira et mettra en œuvre la politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes sans emploi ou à la recherche d’une nouvelle orientation professionnelle (article 16 du présent projet de loi). Dans le même esprit, l’exercice des compétences et des prérogatives respectives de l’État et des régions dans l’établissement de a carte des formations professionnelles initiales sera davantage concerté (article 18).
● Un décrochage scolaire combattu
Ainsi que cela a déjà été indiqué, le rapport annexé fixe comme objectif en matière de décrochage la division par deux du nombre de sortants sans diplôme.
Trois mesures seront adoptées à cette fin :
– dans les collèges et les lycées professionnels à taux de décrochage particulièrement élevé, un référent aura en charge la prévention du décrochage, le suivi des élèves décrocheurs, la relation avec les parents et le suivi de l’aide au retour en formation des jeunes décrocheurs de l’établissement, en vue de l’obtention d’un diplôme national ou d’un titre professionnel de niveau V ;
– par ailleurs, tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficiera d’une durée complémentaire de formation qualifiante qu’il pourra utiliser dans des conditions fixées par décret (article 8 du présent projet de loi) ;
– enfin, l’État et les régions noueront des partenariats pour établir des objectifs conjoints de réduction du nombre de jeunes sortant de formation initiale ou présents sur le marché du travail sans qualification et pour définir les modalités d’atteinte de ces objectifs. Ces partenariats seront élaborés avec les comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle (CCREFP) et signés par le président de région, le recteur et le préfet.
Sur le second point, le ministère de l’éducation nationale précise que le pacte régional pour la réussite éducative et professionnelle des jeunes, issu de la « feuille de route » établi à la suite de la conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012, est un moyen de formaliser ces partenariats. Il constitue par ailleurs une déclinaison du contrat de plan régional pour le développement des formations professionnelles, signé par le président de région, le recteur et le préfet, qui a pour objet d’établir « des objectifs conjoints et chiffrés de réduction du nombre de jeunes sortant de formation initiale, ainsi que de ceux présents sur le marché du travail, sans qualification ».
● Une école contribuant à l’apprentissage de la citoyenneté et au bien-être des élèves
Le présent projet de loi et le rapport annexé définissent plusieurs mesures et orientations destinées à offrir aux élèves un cadre protecteur et à améliorer leur bien-être :
– l’introduction d’un objectif de développement du sens moral et du sens critique de l’élève et la mise en œuvre, déjà mentionnée, d’un enseignement moral et civique (article 28 du projet de loi) ;
– l’amélioration de la formation des personnels chargés de l’accompagnement humain des élèves handicapés. Un groupe de travail sur la professionnalisation de ces accompagnants a été installé le 16 octobre 2012 par les ministres déléguées chargées de la réussite éducative et des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, Mmes Marie-Arlette Carlotti et George Pau-Langevin, et il devra leur remettre un rapport en mars 2013. Par ailleurs, le ministère de l’éducation nationale financera des matériels pédagogiques adaptés répondant aux besoins particuliers d’enfants déficients sensoriels ou moteurs pour faciliter leur intégration en milieu ordinaire ;
– la sensibilisation des élèves, dès le plus jeune âge, à la responsabilité face aux risques sanitaires (notamment pour prévenir et réduire les conduites addictives et la souffrance psychique), à l’éducation nutritionnelle (notamment pour lutter contre l’obésité) et à l’éducation à la sexualité ;
– le développement du sport scolaire. En effet, celui-ci contribue à la santé et à la citoyenneté, tout en jouant un rôle essentiel dans l’accès des jeunes aux sports et à la vie associative. Des activités devant avoir un sens pédagogique seront donc proposées à tous les élèves volontaires, notamment dans les territoires prioritaires, tout au long de l’année, en complément des heures d’éducation physique et sportive ;
– la mobilisation de tous les moyens pédagogiques et éducatifs disponibles pour favoriser l’assiduité des élèves ;
– le renforcement des équipes pédagogiques et l’augmentation du nombre d’adultes présents dans les établissements en difficulté, afin de lutter contre les violences en milieu scolaire. La mise en place d’assistants de prévention et de sécurité à la rentrée 2012 a constitué, à cet égard, une première étape. Dans le même esprit, la formation initiale et continue des enseignants devra leur permettre de gérer les situations de tension ou de réagir face aux élèves en difficulté avec l’institution scolaire, cette politique devant être amorcée dans les écoles supérieures du professorat et de l’éducation à partir de la rentrée 2013.
● Un dialogue amélioré avec les partenaires de l’école
Des actions seront conduites au niveau des établissements pour renforcer les partenariats avec les parents et leurs associations et une attention particulière sera accordée aux parents les plus éloignés de l’institution scolaire par des dispositifs innovants et adaptés. Le rapport annexé ajoute que les familles devront être mieux associées aux projets éducatifs d’école ou d’établissement, ce que permettra la reconnaissance légale de l’existence du conseil d’école (article 41).
Sur ce sujet, le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, Mme Monique Sassier, en a appelé, devant le rapporteur, à une « école du dialogue », accueillant les familles avant que les problèmes liés à la scolarité de l’enfant ne surgissent.
Quant aux collectivités territoriales, qui financent 25 % de la dépense intérieure d’éducation et qui joueront un rôle clef dans la réforme des rythmes scolaires, en prenant en charge les activités péri-éducatives induites par la semaine de quatre jours et demi, leur statut de partenaire privilégié de l’école sera renforcé.
Plusieurs dispositions du présent projet de loi iront d’ailleurs dans ce sens.
Ainsi, la représentation de la collectivité territoriale de rattachement d’un lycée ou d’un collège sera renforcée au sein du conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement (EPLE) (article 42).
En outre, les contrats d’objectifs des EPLE, aujourd’hui conclus avec les seules autorités académiques, pourront devenir tripartites, en permettant à la collectivité de rattachement d’en être le cosignataire (article 43).
Par ailleurs, l’organisation d’activités périscolaires pourra être formalisée dans le cadre d’un projet éducatif territorial (article 46). La réforme des rythmes de l’école primaire visant à instaurer une nouvelle organisation horaire qui intègre, à côté du « scolaire », le péri-éducatif, ce projet devra être le maître d’œuvre de la continuité éducative des différents temps de l’enfant et inclure le travail avec les familles et le réseau associatif.
Le tableau ci-après permet de récapituler l’échéancier des principales mesures de la refondation de l’école, tel qu’il résulte du présent projet de loi et de son rapport annexé.
Échéancier des principales mesures de la refondation de l’école
Mesure |
Échéance prévue |
Création de 60 000 emplois dans l’enseignement : 54 000 à l’Éducation nationale, 5 000 à l’Enseignement supérieur et 1 000 à l’Agriculture. |
Le quinquennat |
Création d’un Conseil supérieur des programmes. |
Publication du décret d’application et de l’arrêté de nomination des membres |
Création d’un Conseil national d’évaluation du système éducatif. |
Idem |
Suppression des dispositifs « d’apprentissage junior » et d’initiation aux métiers en alternance (DIMA) pour les jeunes âgés de moins de quinze ans. |
Publication de la loi |
Mesures concernant les EPLE : – les contrats d’objectifs deviennent tripartites en associant, si elle le souhaite, la collectivité territoriale de rattachement ; – attribution d’un second représentant de la collectivité territoriale de rattachement au sein du conseil d’administration. |
Publication de la loi. |
Institution des projets éducatifs territoriaux, pour promouvoir des partenariats entre les établissements scolaires, les collectivités territoriales et le secteur associatif dans le domaine des activités péri-éducatives. |
Rentrée 2013 ou 2014 |
Création du conseil école-collège proposant des enseignements et des projets pédagogiques communs. |
Rentrée 2013 |
Création des écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE). |
Rentrée 2013 |
Formation initiale et continue des enseignants à la prévention de toutes les formes de discrimination, à la promotion de la mixité sociale et à l’égalité entre les femmes et les hommes. |
Rentrée 2013 |
Organisation d’un service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance. |
À partir de la rentrée 2013 |
Augmentation de l’accueil des enfants de moins de trois ans à l’école maternelle et mise en place du dispositif « plus de maîtres que de classes ». |
À partir de la rentrée 2013 |
Mise en œuvre de la semaine de quatre jours et demi dans le primaire. |
De la rentrée 2013 à la rentrée 2014 |
Montée en charge progressive du dispositif des emplois d’avenir professeurs, de 6 000 à 18 000 postes. |
De janvier 2013 à la rentrée 2015 |
Dispositif pérenne de formation professionnelle initiale pour tous les lauréats des concours. |
Rentrée 2014 |
Redéfinition des missions de l’école maternelle et création d’un cycle unique y correspondant. |
Rentrée 2014 |
Mise en place d’un nouveau cycle concernant le CM2 et la 6e. |
Rentrée 2015* |
Rééquilibrage des séries du lycée, diversification accrue de ses parcours et meilleure articulation de ses filières avec l’enseignement supérieur. |
À partir de la rentrée 2014 |
Mise en place d’un parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel, proposé à chaque élève. |
Rentrée 2015 |
Mise en place de nouveaux contenus d’enseignement pour la scolarité obligatoire après proposition du Conseil supérieur des programmes : – enseignement moral et civique ; – parcours d’éducation culturelle et artistique personnalisé tout au long de la scolarité ; – instauration d’un enseignement en langue vivante dès le cours préparatoire (CP). |
Rentrée 2015 Avant la fin du quinquennat Rentrée 2015 |
Évolution des modalités d’évaluation et de notation des élèves. |
Le quinquennat |
Refondation de l’éducation prioritaire et retour à la sectorisation de la carte scolaire. |
Le quinquennat |
Amélioration des conditions de travail des enseignants, évolution des missions des RASED, des directeurs d’école et des chefs d’établissement, reconstitution de réseaux de maîtres formateurs et diversification des carrières des enseignants. |
Le quinquennat |
Source : projet de loi et rapport annexé.
* Aucune échéance n’est fixée par le rapport annexé, mais le ministère de l’éducation nationale indique que l’entrée en vigueur des nouveaux cycles (à l’exception de celui de l’école maternelle, applicable à compter de 2014), qui suppose de repenser le socle commun et les programmes d’enseignement qui lui sont liés, est envisageable pour la rentrée 2015.
Lors de sa séance du mercredi 30 janvier 2013, la Commission des affaires culturelles et de l’éducation procède à l’audition de. M. Vincent Peillon, ministre de l’éducation nationale, sur le projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République.
M. Michel Ménard, président. Je vous prie d’excuser le président de notre Commission, M. Patrick Bloche, qui est retenu en séance publique. Nous avons le plaisir d’accueillir M. Vincent Peillon, ministre de l’éducation nationale, pour un moment très important de la législature : la présentation du projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République. En effet, nous touchons avec ce texte au cœur du grand espoir dont était porteuse l’élection du Président de la République, espoir qui a rassemblé la jeunesse et la société tout entières dans une démarche de confiance dans l’avenir de notre école.
Après les mesures d’urgence que le gouvernement a su prendre dès l’été 2012, après le signal puissant donné avec la création des emplois d’avenir professeur, c’est aujourd’hui par la refondation de l’école que se concrétisent les engagements présidentiels et votre engagement personnel, monsieur le ministre. Ce rendez-vous était attendu. Vous avez su mener la concertation avec l’ensemble des acteurs concernés tout en préservant la cohérence de votre action.
Même si le débat sur ce texte ne pourra faire abstraction de sujets d’actualité tels que la réforme des rythmes scolaires, il portera avant tout sur les piliers de la refondation : la priorité au primaire, la reconstruction de la formation des enseignants, la création d’un service public de l’enseignement numérique, la programmation budgétaire des créations de postes.
Nous avons nous-mêmes commencé à travailler sur tous ces sujets depuis la désignation de notre rapporteur, M. Yves Durand, qui mène un intense travail d’auditions. Je remercie le gouvernement de laisser le temps à l’Assemblée nationale de mener à bien ce travail dans les semaines qui viennent : c’est le gage d’un débat parlementaire approfondi, en commission comme en séance publique.
M. Vincent Peillon, ministre de l’éducation nationale. Je consacrerai mon intervention à l’exposé de la méthode et de l’esprit qui ont présidé à l’élaboration de ce projet de loi.
Nous avons choisi de faire de l’école une priorité du quinquennat, même si nous devons faire face à beaucoup d’autres urgences, et la loi de programmation est la concrétisation de cette volonté.
Elle a pour objectif de résoudre les difficultés de notre système éducatif, telles que les révèlent les évaluations, tant internationales que nationales. Ces difficultés sont de plusieurs ordres. Notre système éducatif peine à offrir une qualification à un nombre suffisant de jeunes ; le niveau de nos élèves n’est pas satisfaisant ; enfin, les inégalités s’accroissent au sein de notre école. Ces difficultés appellent une réponse collective, non seulement parce que c’est la France de demain qui est en jeu, mais aussi parce la résolution d’autres problèmes que notre pays doit affronter, tels que notre défaut de compétitivité ou de cohésion sociale, dépendra de notre capacité à améliorer la formation de nos jeunes. Cela suppose d’agir avec constance, de faire partager autant que possible nos objectifs et de les inscrire dans le long terme. Comme l’indique le terme de « refondation », il s’agit de revenir aux fondements de l’école, mais aussi de la République car, comme le Président de la République l’a souvent souligné, la refondation de l’école de la République sera également la refondation de la République par l’école.
Les évaluations auxquelles j’ai fait référence ont eu le mérite de nous permettre d’identifier les facteurs sur lesquels nous devions faire porter nos efforts, pour faire de ces points faibles nos points forts.
Premièrement, nous avons choisi de donner la priorité à l’enseignement primaire. Alors que ce choix semble aller de soi, notre pays ne l’avait pas fait jusqu’ici, ce qui explique que 15 à 25 % des élèves soient en difficulté à l’entrée au collège. La France consacre à son école primaire des moyens inférieurs à ceux qu’elle consacre au secondaire et très nettement inférieurs à ceux de la moyenne des pays de l’OCDE. Or c’est à ce niveau d’enseignement que se décident les réussites comme les difficultés ultérieures.
Cette priorité se traduira par le développement de l’accueil des enfants de moins de trois ans, ou encore par l’application du principe « Plus de maîtres que de classes », toutes mesures qui demanderont plusieurs milliers de postes supplémentaires, dont la création sur plusieurs années est d’ores et déjà programmée. Elles s’accompagneront d’une révision des programmes, de la réforme du livret personnel de compétences ou encore de l’introduction de l’apprentissage d’une langue étrangère dès l’école élémentaire et de l’instauration d’un service public du numérique.
Deuxièmement, notre projet vise à améliorer la formation des enseignants, aussi bien initiale que, dans la mesure de nos moyens, continue. Il prévoit dans ce but la création, au sein des universités, d’écoles supérieures du professorat et de l’éducation, les ESPE, les concours de recrutement intervenant à l’issue de la première année de master. Notre but est d’assurer une entrée progressive dans la profession, ce qui suppose de réviser le référentiel des métiers de l’éducation nationale et la nature des concours.
Les ESPE sont à mes yeux le premier élément de la réforme à long terme de notre système éducatif. Il nous appartient, ainsi qu’aux acteurs locaux, d’en faire l’instrument de la meilleure formation possible des enseignants, et le lieu où ils apprendront à se connaître et à travailler ensemble. L’engagement très fort des universités en faveur de cette réforme, que traduit l’accord sur la « feuille de route » que nous avons, ma collègue ministre de l’enseignement supérieur Geneviève Fioraso et moi, signée la semaine dernière avec la Conférence des présidents des universités, me rend assez optimiste en dépit de délais serrés.
Dans une situation budgétaire très tendue, ces choix impliquent de nombreuses créations de postes, sans parler de la réintroduction de l’année de stage, qui est en elle-même une forme de revalorisation du métier. J’ai néanmoins souhaité que cette réforme ait lieu dès le début du quinquennat, car il faudra du temps avant que ces écoles ne donnent le meilleur d’elles-mêmes.
Troisièmement, ce projet de loi crée un service public du numérique, qui fédérera les initiatives déjà prises, par les collectivités locales comme par mon ministère, mais en les inscrivant dans une perspective autrement plus ambitieuse. Il s’agira en effet d’un plan global, qui entraînera d’ailleurs des restructurations importantes au sein de l’administration centrale de l’éducation nationale.
Quatrièmement, le projet vise à résoudre le problème ancien de l’orientation, en particulier en instituant un service public territorialisé de l’orientation. Si je tiens en effet à ce que notre école assume sa mission d’émancipation de l’individu et de formation du citoyen – d’où la part faite à l’enseignement de la morale laïque –, elle doit aussi assumer pleinement ses responsabilités en matière d’insertion professionnelle des jeunes. C’est pourquoi nous voulons mettre en place un parcours d’orientation et d’information dès le collège : tous les élèves doivent être à égalité devant les décisions qui engagent leur avenir, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Enfin, le projet de loi nous dotera d’instruments visant à accroître la transparence et l’efficacité de notre système éducatif : ainsi le Conseil supérieur des programmes nous permettra de définir ces derniers en lien avec le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et en fonction des évaluations menées par les maîtres. Dans le même esprit, nous proposons les instruments d’une évaluation indépendante, et non partisane, des politiques éducatives.
On voit que cette loi de programmation affiche clairement ses priorités, dont la plupart me semblent pouvoir être largement partagées. De plus, elle ouvre certaines pistes que nous n’avons pas encore pu explorer jusqu’au bout, s’agissant de sujets tels que l’éducation prioritaire, la réforme du collège unique, l’articulation de la scolarité de bac - 3 à bac + 3. Sur ces points, les esprits ne sont pas encore mûrs et certaines réformes déjà engagées demandent à être évaluées – ainsi celle du lycée professionnel. Tout cela devra faire l’objet de concertations et de propositions en vue d’une nouvelle étape à franchir dans les années qui viennent. Il est clair en effet que cette loi de programmation et d’orientation n’épuise pas toutes les possibilités de réforme de notre système éducatif.
La question des rythmes scolaires, même si elle ne figure pas dans le projet de loi, est également un élément essentiel de la refondation, à côté de la priorité donnée au primaire et de la création des écoles supérieures du professorat.
Notre objectif est de proposer un nouveau contrat entre l’école et la nation et dans cette perspective, je souhaite laisser toute sa place à un débat parlementaire libre, mais rigoureux et sérieux. Comme je le dis très souvent aux enseignants, l’école n’appartient pas à l’éducation nationale, mais à tous. Or on ne parle pas assez de l’école dans notre pays, alors que nous avons besoin d’échanger et de construire un esprit commun, même sur des sujets strictement pédagogiques tels que l’organisation en cycles ou la notation.
Pour toutes ces raisons, j’attends avec impatience vos débats, qui doivent nous permettre d’enrichir ce texte et d’en faire un élément essentiel du redressement de notre pays.
M. Yves Durand, rapporteur. L’école n’ayant pas fait depuis longtemps l’objet d’une loi d’orientation et de programmation, nous ne pouvons que nous réjouir de celle-ci. À travers elle, la nation fixe à l’école les grandes orientations de son action et détermine les moyens qu’elle lui consacrera durant le quinquennat : nous sommes donc loin de l’incantation, d’autant que nous avons dès juillet voté les premiers de ces moyens dans le cadre du collectif budgétaire.
Ce texte résulte d’une concertation, lancée cet été, avec l’ensemble des acteurs de l’éducation sur des sujets qui agitent le monde éducatif depuis des années, comme le collège, l’évaluation ou les rythmes scolaires. Selon moi, c’est à ce temps de concertation qu’on doit l’absence d’opposition radicale aux orientations proposées ici, et c’est un premier motif de satisfaction.
Cependant, les auditions que nous avons déjà menées ont fait apparaître le besoin de préciser certains points de ce texte, qui a d’ailleurs vocation à être enrichi par le travail parlementaire. Je ne citerai que quelques exemples. Il faudrait ainsi renforcer l’indépendance d’organismes créés ou recréés par ce projet de loi, tels que le Conseil supérieur des programmes ou le Conseil national d’évaluation du système éducatif. Qu’il s’agisse des savoirs à enseigner ou de l’évaluation des politiques, on ne saurait en effet être juge et partie.
D’autre part, de nombreuses voix ont demandé que ce projet de loi fasse une place à l’apprentissage des langues régionales.
La création d’un cycle propre à l’enseignement maternel a été saluée, et il en est de même des mesures visant à une plus étroite collaboration entre enseignants de l’école élémentaire et enseignants du collège, véritable révolution pédagogique. Mais les modalités de ce rapprochement demandent à être précisées, tout comme les rapports entre programmes et socle commun. De même, nous devrons définir ensemble ce que doit être le collège unique, même si nous sommes d’accord pour dire qu’il ne doit pas y avoir d’orientation ni de sélection avant la fin de la troisième.
Ces précisions s’imposent pour enrichir, et non pas pour remettre en cause une réforme qui recueille l’assentiment de tous ceux que j’ai rencontrés. De ce point de vue, l’objectif de rassembler la nation autour de son école me semble tout à fait accessible.
Je voudrais pour finir soulever deux points qui se situent plutôt à l’aval du projet de loi.
Toute loi modifiant le code de l’éducation suppose de nombreux décrets d’application. Loin de moi l’idée de réitérer les erreurs du législateur de 2005, qui avait méconnu la distinction entre loi et règlement, mais il me paraîtrait souhaitable que la représentation nationale soit informée du contenu de ces décrets. Cette demande ne traduit aucune suspicion, mais la volonté de réunir toutes les conditions d’une adhésion entière à la présente loi.
Deuxièmement, loin de clore le débat sur l’école, cette loi lance une dynamique. L’école a besoin de temps – certains évoquent une durée de dix ans. Quoi qu’il en soit, nous ne pourrons éluder des questions telles que celles du lycée, de l’enseignement professionnel, de l’articulation entre le premier cycle et l’enseignement supérieur, etc. Comment organiser une seconde étape de concertation, notamment avec le Parlement, de sorte que le débat ne s’arrête pas au vote de la loi ?
M. Michel Ménard, président. En m’en excusant auprès du ministre, je suis amené à suspendre notre séance en raison de l’organisation d’un vote dans l’hémicycle.
Mme Martine Faure. C’est avec beaucoup de satisfaction et un immense espoir que nous accueillons ce projet de loi pour la refondation de l’école, qui doit nous permettre de bâtir ensemble l’école de demain. C’est une première pierre que nous posons aujourd’hui, à l’issue d’une concertation qui a duré plusieurs mois – et non quelques semaines, comme des esprits chagrins le font accroire.
Comme l’avaient déjà montré les conclusions édifiantes d’une concertation sur le temps de l’enfant organisée par votre prédécesseur Luc Chatel, les élèves français manquent de temps. Nous leur imposons un rythme d’apprentissage qui contrarie les rythmes biologiques, violence encore aggravée par la lourdeur et l’inadaptation des programmes. Ce projet de loi nous propose de donner du temps à l’élève pour apprendre, à l’enseignant pour enseigner, à l’ensemble de la communauté éducative et aux élus pour évaluer, mener des concertations, organiser et décider – sans compter le temps que vous aurez donné aux parlementaires pour en débattre.
Le texte remet l’enfant au cœur de nos préoccupations : il vise à lui assurer un parcours de réussite individualisé, associant tous les acteurs – enseignants, parents, élus, associations, monde de l’entreprise – dans le cadre du projet éducatif territorial.
Notre système éducatif doit impérativement être adapté aux mutations actuelles, notamment aux progrès vertigineux de la technologie.
Il faut dire aussi que ces dernières années, il a été ébranlé dans ses fondements, notamment par la suppression de postes d’enseignants, de personnels d’encadrement, de médecins et d’infirmiers scolaires, ainsi que par la suppression de la formation initiale et continue des enseignants. Aujourd’hui, il faut reconstruire – ce qui justifie l’emploi du terme de « refondation » – pour instaurer une gestion du temps différente, faisant coexister le temps long des apprentissages, des enseignements et de la réflexion avec la prise en compte des urgences.
La première de celles-ci est de donner la priorité à l’école maternelle et au primaire, pour lesquels vous avez déjà obtenu des moyens supplémentaires dès cette rentrée. L’école élémentaire est en effet une étape fondamentale du parcours scolaire d’un enfant, d’autant qu’on peut dès ce stade repérer des déficiences ou des troubles, pour y remédier ou en prévenir d’autres.
Rendre son rang à l’école élémentaire suppose d’accroître ses moyens financiers, mais aussi humains : c’est l’objectif « Plus de maîtres que de classes ». Il conviendra en outre de prendre rapidement et franchement le virage du numérique, de redéfinir le socle commun et d’élaborer des programmes plus adaptés, en s’appuyant sur le nouveau Conseil supérieur des programmes. Nous apprécions également votre volonté d’organiser une véritable éducation artistique et culturelle, voire sportive, et de rendre obligatoire l’apprentissage d’une langue vivante dès le cours préparatoire. La question des langues régionales me tenant particulièrement à cœur, vous me permettrez, monsieur le ministre, de vous remercier pour la réponse que vous avez faite hier en séance publique sur le sujet à notre collègue Paul Molac et de vous assurer que nous participerons au débat qui s’ouvrira au mois de mars, pour faire progresser la pratique et l’enseignement de ces langues.
Enfin, en clarifiant la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales et en mettant en place les projets éducatifs locaux, ce projet de loi favorise la coopération entre tous les partenaires de l’école.
Ce projet de loi de refondation porte donc la promesse d’une nouvelle ère pour notre système éducatif. Sa réussite dépendra en grande partie de la capacité des uns et des autres à accepter les évolutions nécessaires. Seul l’élève doit nous préoccuper. Un enfant a besoin d’avoir autour de lui des adultes capables de le guider dans ses apprentissages. Une école qui va bien, qui a une conscience claire de son périmètre d’action, de ses missions et de ses ambitions ne peut que tenir une place essentielle dans cette démarche.
N’oublions pas que l’école est une immense chance pour tous les enfants et qu’enseigner est un des plus beaux métiers. Vous nous donnez l’occasion, monsieur le ministre, de ramener la joie dans la maison école !
M. Frédéric Reiss. Je me réjouis de chaque occasion pour le Parlement de débattre de l’école, monsieur le ministre, même si nous, députés UMP, ne sommes pas convaincus par vos propos. Nous ne sommes d’ailleurs pas les seuls : j’ai le sentiment que votre projet de refondation inquiète bon nombre de nos concitoyens, enseignants, parents d’élèves, élus locaux, en un mot l’ensemble de la communauté éducative, y compris les réseaux d’éducation populaire.
Après son parcours peu glorieux devant le Conseil supérieur de l’éducation et devant la Commission consultative d’évaluation des normes, votre décret sur les rythmes scolaires a réussi à faire l’unanimité contre lui. Cette réforme, attendue depuis des décennies, est massivement rejetée, alors que les conclusions de la Conférence nationale sur les rythmes scolaires réunie par Luc Chatel et celles du rapport parlementaire de nos collègues Yves Durand et Xavier Breton avaient fait consensus. Si le fond n’est pas en cause, c’est sans doute votre méthode qui pèche. Cette réforme, au lieu de rassembler, divise le pays, et l’euphorie suscitée par vos premières annonces n’est sans doute pas étrangère à cet état de fait : ceux qui ont participé à la prétendue concertation que vous avez organisée ne se reconnaissant pas dans la copie que vous venez de rendre, leur déception est à la hauteur de leur enthousiasme initial.
Ce projet de refondation, dont fait partie la réforme des rythmes scolaires, laisse un sentiment d’impréparation. La loi du 23 avril 2005, dont on n’a pas encore mesuré tous les effets positifs, avait été précédée d’une année de débats, d’échanges et de concertation avec les partenaires sociaux sur tout le territoire. Le socle commun de compétences et de connaissances, qui était au cœur de la « loi Fillon », avait suscité l’adhésion du plus grand nombre. La priorité était que chaque élève sache lire, écrire et compter dès l’école élémentaire. Le projet de loi maintient d’ailleurs ce socle, qui devient le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Je me réjouis également du maintien des programmes personnalisés de réussite éducative, les PPRE, dont on avait pu craindre un temps la disparition. Quant au principe « Plus de maîtres que de classes », il est séduisant, mais il mérite d’être précisé.
Les mesures phares telles que la création de 60 000 postes supplémentaires en cinq ans, la priorité donnée au primaire ou la refonte de la formation initiale ne peuvent certes nous surprendre puisqu’elles avaient été annoncées par le Président de la République, mais elles suscitent de nombreuses interrogations.
La réforme des rythmes scolaires bouleverse la vie quotidienne des familles. L’article 47 du projet de loi, qui prévoit en faveur des communes et des intercommunalités une incitation financière à développer les activités périscolaires, ressemble à un chantage, et l’octroi d’un délai supplémentaire d’un mois pour prendre la décision n’est pas de nature à calmer la colère des élus locaux. Nous prenons acte de la création de ce fonds, mais les modalités de ce financement restent à préciser : il faudra veiller à ce que l’équité soit respectée, notamment entre écoles publiques et écoles privées sous contrat. Sur ce dernier point, les dispositions de l’article 45 me laissent quelque peu perplexe.
Les modalités de l’accueil en maternelle des enfants de moins de trois ans doivent de même être précisées, d’autant qu’elles auront une incidence sur le contrat d’objectifs et de gestion des caisses d’allocations familiales et sur l’accueil en jardin d’éveil. Quel en sera, en outre, l’impact sur les mesures de carte scolaire ?
Vous me permettrez d’autre part de déplorer que les langues régionales soient totalement oubliées dans ce texte et que l’article 38 annule les dispositions de la « loi Cherpion » pour le développement de l’alternance. Quant aux directeurs d’école, si l’article 41 dispose qu’ils présideront le conseil d’école, ils devront encore attendre avant de bénéficier d’un véritable statut.
J’aimerais enfin, monsieur le ministre, connaître votre position sur les expérimentations d’écoles du socle commun menées dans certaines académies.
Mme Isabelle Attard. La refondation de l’école est une priorité. L’école de la République doit être adaptée aux besoins de nos enfants et mieux les préparer aux défis de notre société. Vous pouvez compter sur le soutien des écologistes pour cette refondation : pour donner la priorité au primaire, pour recruter plus d’enseignants afin de donner corps au principe du « Plus de maîtres que de classes », pour rendre les rythmes scolaires plus respectueux des rythmes des enfants et plus propices à de nouvelles formes de pédagogie, ou encore pour développer la scolarisation des moins de trois ans dans les zones en difficulté.
Mais pour ne pas être un simple pansement, pour mériter son nom, la refondation doit être globale.
Or ce projet de réforme sous-estime l’importance des projets éducatifs territoriaux, pourtant essentiels puisqu’ils visent à mettre en cohérence les activités scolaires et périscolaires en impliquant l’ensemble des acteurs concernés. Ces projets doivent permettre une continuité entre le temps scolaire et les autres temps de l’enfant, en impliquant la communauté éducative, les parents, les collectivités territoriales mais aussi les structures associatives. Ils peuvent être très utiles pour concrétiser la réforme des rythmes scolaires et pour assurer un bon équilibre entre le cadre national et les adaptations aux spécificités locales. C’est aussi dans ce cadre que la question du rôle des collectivités territoriales en matière d’éducation pourra être le mieux posée. Pour nous, il est essentiel d’assurer à ces dernières, et pas seulement aux plus démunies, un soutien plus important et plus durable que celui qui est prévu aujourd’hui.
Il est également nécessaire de revaloriser le statut des professeurs des écoles. Quant à la réforme des rythmes scolaires, elle doit s’accompagner d’une réforme des pratiques pédagogiques, sans laquelle la refondation serait en partie manquée : il s’agit d’ouvrir l’école sur l’extérieur, de renforcer les projets collectifs impliquant d’autres acteurs, d’organiser différemment les emplois du temps pour donner vie à ces projets. Au-delà de la question des rythmes, c’est donc un droit à l’expérimentation et à l’innovation pédagogiques qu’il faut poser.
Cette question de la pédagogie ne doit pas non plus être dissociée de celle de l’évaluation, autre élément sous-estimé par le projet de réforme dans sa rédaction actuelle. La notation fait partie de ce qui doit impérativement changer : l’école ne doit pas être le lieu d’apprentissage de la compétition. La notation est vécue comme une épreuve, voire comme une sanction. Par son caractère stigmatisant, elle peut contribuer au décrochage scolaire. En Finlande, pays constamment en tête des classements internationaux en matière d’éducation, les élèves ne sont pas évalués avant l’âge de neuf ans, et ne sont notés qu’à partir de onze ans. Il faut donc repenser la totalité de notre système d’évaluation des élèves, du cours préparatoire au baccalauréat. La « notation positive » évoquée dans l’annexe du projet de loi est loin d’être suffisante.
Nous avons aussi des demandes précises en ce qui concerne la formation des enseignants. Nous souhaiterions que vous nous indiquiez quels moyens seront consacrés à leur formation continue. Nous approuvons certes votre volonté d’encourager une nouvelle façon de travailler, de nouvelles pratiques pédagogiques, d’organiser de nouveaux rythmes, mais les enseignants doivent être formés aujourd’hui, demain et tout au long de leur carrière.
Les écologistes plaident enfin pour un recrutement des enseignants à l’issue de la licence, afin que les deux années de master ne se résument pas à du bachotage mais soient réellement des années de formation. Le groupe « Reconstruire la formation des enseignants » a démontré dans une de ses études que le recrutement dès la première année de master serait moins coûteuse que le scénario jusqu’ici retenu, tout en garantissant une formation beaucoup plus efficace.
M. Rudy Salles. L’école est une priorité et sa réforme une nécessité avérée : de cela, monsieur le ministre, nous sommes convaincus tout autant que vous.
Mais vous avez poussé l’ambition jusqu’à prétendre, non seulement la réformer, mais la refonder, ce qui semble un peu excessif. La plupart de ceux qui vous ont précédé à la tête de l’éducation nationale ont ainsi voulu marquer leur passage par des réformes fondatrices, mais il faut se méfier de certaines déclarations emphatiques qui se révèlent finalement décevantes. Les familles françaises, les parents, le monde enseignant, les partenaires de l’éducation nationale, mais aussi les collectivités attendent de connaître vos intentions.
Vous avez lancé cette refondation dans l’enceinte de la Sorbonne, lieu hautement évocateur de sept cents ans d’histoire et d’excellence dans la transmission du savoir. La création de 60 000 postes d’enseignants comme la réforme des rythmes scolaires avaient de quoi séduire, et vous pensiez que votre projet recueillerait le soutien du plus grand nombre. Cela n’a pourtant pas été le cas.
Tout d’abord, la concertation que vous avez engagée n’a pas donné les résultats que vous en attendiez. Ainsi le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche a massivement rejeté le projet de loi d’orientation – par 25 voix contre 5 !
La réforme des rythmes scolaires subit le même désaveu. Sur les 32 000 parents, enseignants et élèves niçois que nous avons interrogés sur le sujet, 10 000 ont répondu ; 80 % souhaitent le maintien des horaires actuels, 86,5 % sont opposés à l’allongement de la pause méridienne, près de 69 % s’opposent au raccourcissement de la journée scolaire et 67 % ne veulent pas de la semaine de quatre jours et demi.
Sur le fond, ce texte ce caractérise par une attention toute particulière portée à l’école primaire alors que les réformes précédentes concernaient plutôt le collège et le lycée. Il vise aussi à développer l’accueil des enfants de moins de trois ans à l’école. Aussi pertinente soit-elle, notamment pour les familles les plus modestes, une telle mesure ne nécessite pas seulement de nouveaux moyens, mais aussi une nouvelle organisation pédagogique. Or le texte de loi est muet sur ce point.
Il n’était pas non plus inopportun de réformer le redoublement : on sait qu’il est inefficace et qu’un élève qui a redoublé son CP ou son CE1 a deux fois plus de risques que les autres de finir sa scolarité sans qualification. On peut également approuver votre volonté que les élèves fassent leurs devoirs dans l’établissement plutôt qu’à la maison : cela permettrait d’accompagner les enfants et de rétablir l’égalité entre les élèves. Mais il ne faudrait pas faire de ces objectifs, si importants soient-ils, des sujets de clivage. Ces dispositifs, qui avaient déjà été testés, dans le cadre des internats d’excellence par exemple, doivent être examinés avec toutes les parties prenantes, comme le prouve a contrario l’opposition unanime au décret relatif à la semaine de quatre jours et demi.
En réalité, le titre de ce projet promet plus que son contenu ne tient.
Sur bien des points, ce texte nous paraît en effet un peu tiède. Il revient peu sur la réforme du lycée engagée par votre prédécesseur – est-ce une sorte de reconnaissance du travail accompli avant vous ? Rien n’y est dit du contenu de la formation des maîtres, ni de la redéfinition des missions des enseignants. Le socle commun, qui a pourtant fait l’objet de débats nourris, n’est pas fondamentalement remis en cause : il n’est que très marginalement enrichi. Cela aussi prouve que les réformes engagées avant vous ne méritaient sans doute pas l’excès d’indignité dont on les a accablées. La question des grandes vacances est renvoyée aux calendes grecques. La formation professionnelle est absente de votre réflexion, si ce n’est pour en transférer un peu plus la charge aux régions. Sauf erreur de ma part, je n’ai vu aucune proposition s’agissant des autres personnels d’éducation, personnels d’encadrement, administratifs, médico-sociaux et de service.
Quant à votre projet d’écoles supérieures du professorat et de l’éducation, il était nécessaire. Mais on ignore quelle formation y sera prodiguée : quel en sera le contenu, et pour quelles missions ? Pouvez-vous nous garantir que les ESPE ne seront pas de nouveaux IUFM ? Nous attendons que vous nous répondiez précisément sur ce point, sans nous renvoyer aux décrets à venir.
Vous remettez en cause les trois axes selon lesquelles le système actuel s’ordonne : un programme éducatif rigoureux et centré sur des fondamentaux ; l’aide personnalisée de deux heures pour les enfants les plus en difficulté, et les évaluations. La diminution du nombre d’heures d’enseignement personnalisé, alors que vous augmentez le nombre d’enseignants, nous inquiète particulièrement. Quant aux évaluations, l’accord que vous avez trouvé avec les syndicats nous semble une cote mal taillée : elles sont maintenues à l’issue de la classe de CE1 et du CM2, mais elles ne remonteront plus à l’administration centrale. Vous vous privez ainsi d’un outil essentiel pour adapter votre propre politique.
Le rapport même sur lequel vous vous appuyez pour cette refondation apparaît à bien des égards moins approfondi que certains rapports précédents, comme le rapport Thélot sur l’avenir de l’école, publié en 2004, ou encore le rapport remis il y a deux ans par la Cour des comptes. Malgré quelques avancées, nous sommes très loin d’une véritable refondation. La grande concertation semble a posteriori n’avoir été qu’une grande mise en scène, au détriment des parties prenantes, notamment des enseignants.
Ce qui frappe finalement, sur ce sujet comme sur tous les autres, et hors la création de 60 000 postes supplémentaires qui pèsera très lourd dans le budget de l’État, c’est l’absence de cap. Nous espérons que ce qui n’a pas été réalisé pendant de longs mois de concertation le sera à l’occasion de la discussion parlementaire.
En tout cas, le groupe UDI, pour lequel l’éducation est une préoccupation majeure, sera vigilant quant à la réalisation des intentions que vous affichez et participera activement au travail législatif. Au-delà de déclarations d’intention souvent excessives, nous attendons des actes qui répondent aux attentes des élèves, de leurs familles, de la communauté enseignante et, de façon plus générale, de la société. Cette affaire mérite mieux que des mesures idéologiques dictées par le parti socialiste : elle nécessite un consensus national. Vous en êtes loin. Saurez-vous entendre les attentes et les contributions de ceux qui, sans penser forcément comme vous, aiment l’école au moins autant que vous ?
Nous auditionnions cet après-midi certaines associations, proches du parti socialiste, qui proposaient que l’on ne parle plus d’école maternelle mais d’école enfantine, afin de ne plus faire référence à la mère, conformément à la logique du projet de loi sur le mariage pour tous. J’espère, monsieur le ministre, que vous saurez résister à ce genre de proposition inadmissible !
Mme Marie-Odile Bouillé. Je souhaiterais tout d’abord féliciter le ministre et son équipe pour leur travail en faveur de la refondation de notre école.
Pour toucher tous les enfants, l’éducation artistique et culturelle doit, me semble-t-il, s’inscrire dans le temps scolaire. Les trois quarts d’heure dévolus aux activités périscolaires dans le cadre du projet éducatif territorial risquent en effet d’être trop courts pour une intervention de plasticiens ou de musiciens, par exemple. De plus, il convient que les enseignants, éventuellement avec les parents, soient parties prenantes de cette éducation. Il convient en tout cas de réfléchir à la place à lui donner dans l’organisation de la journée.
D’autre part, Mme la ministre de la culture et de la communication a lancé une concertation sur le sujet, en vue de définir un cahier des charges organisant la contribution des acteurs locaux : comment envisagez-vous de concilier ses propositions avec votre projet éducatif territorial ?
M. Patrick Hetzel. La méthode que vous avez employée, monsieur le ministre, pour élaborer ce que vous présentez comme une étape majeure de la refondation de l’école est contestable. Ce projet de loi d’orientation et de programmation pâtit d’un manque de préparation et ne mobilise pas suffisamment les travaux de recherche centrés sur la performance scolaire. La montagne accouche donc d’une souris.
Le projet contient des mesures positives s’agissant des relations entre l’école et le monde du travail : ainsi l’instauration du parcours d’information et d’orientation dès le collège. Mais, sur ces sujets, la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005 – dite « loi Fillon » – avait montré la voie.
Sur bien d’autres aspects, en revanche, ce texte repose sur une vision dépassée de l’éducation. En supprimant les dispositifs d’apprentissage junior et ceux qui étaient issus de la loi pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels du 28 juillet 2011 – dite « loi Cherpion » –, vous méconnaissez ce qu’ils avaient apporté à des élèves en désarroi, qui avaient souvent retrouvé de la motivation à apprendre. Vous avez cédé à une tentation démagogique alors que vous auriez dû vous en tenir à une rigueur pédagogique. Comptez-vous prendre en compte la réalité de notre système scolaire et cesser de détricoter sans proposer ?
M. Pierre Léautey. Le terme de refondation traduit une grande ambition que confirme le contenu de ce projet de loi. L’école doit prendre en charge les enfants en difficulté, de plus en plus nombreux, afin de permettre la réussite de tous. La rupture par rapport aux politiques passées est audacieuse, en particulier avec la priorité donnée au primaire, niveau auquel tout se décide. L’accueil des enfants dès le plus jeune âge et le principe consistant à avoir plus de maîtres que de classes représentent autant d’avancées, gages concrets d’une plus grande efficacité. Comment voyez-vous précisément les évolutions à imprimer à la formation des enseignants afin d’accompagner ces progrès ?
Le développement d’une école exigeante et égalitaire est le fil conducteur de cette réforme. Sur ce principe, nous pouvons tous nous accorder, mais comment concevez-vous sa mise en œuvre, forcément plus délicate ? Dans quelle mesure les spécificités territoriales seront-elles prises en compte, par exemple ?
M. Paul Molac. Professeur dans un collège rural il y a encore six mois, j’ai pu mesurer, monsieur Salles, les effets d’une politique consistant à réduire le nombre des postes et à supprimer la formation professionnelle des enseignants. Rétablir cette formation en faisant en sorte que toute une année de master puisse y être consacrée est donc une excellente chose. De même, la scolarisation des enfants dès l’âge de deux ans et la priorité donnée au primaire.
Les chronobiologistes et les enseignants sont en faveur de la semaine de quatre jours et demi. Mais, tout en approuvant cette réforme des rythmes, on ne peut ignorer l’inquiétude des maires, qui auront à résoudre des questions d’équipement, de transport et d’encadrement. Il faut donc régler ces problèmes de financement.
Enfin, à côté du programme commun à tous, il serait bon qu’une part des enseignements soit adaptée aux spécificités locales. À ce titre, comme plusieurs de mes collègues, j’insiste pour qu’une place soit faite aux langues régionales.
Mme Dominique Nachury. Ne faudrait-il pas créer, monsieur le ministre, une passerelle entre les structures d’accueil des enfants de moins de trois ans et l’école maternelle, pour mettre fin à un cloisonnement néfaste ?
Pensez-vous que les méthodes alternatives d’apprentissage et d’enseignement passent uniquement par un développement du numérique à l’école ?
Enfin, si l’on reconnaît en paroles la nécessité de respecter la singularité de chaque élève en s’adaptant à son rythme de progression, comment cela se peut-il se traduire dans les faits ?
M. Jean-Pierre Le Roch. Monsieur le ministre, la majorité vous sait gré d’avoir si bien défendu une véritable politique éducative, venant après dix années d’une politique purement comptable.
Au cours de cette décennie, le taux de scolarisation des enfants de deux ans est tombé de 34 % à 12 %. Or cette scolarisation précoce contribue fortement à leur réussite ultérieure, surtout lorsqu’ils sont issus de familles défavorisées. Que prévoit concrètement le projet de loi pour la favoriser ?
Les équipes éducatives et certains élus locaux ont exprimé leur inquiétude face à l’absence de mention explicite des langues régionales. Le Président de la République s’est pourtant engagé à ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et beaucoup de conseils régionaux ont signé avec les rectorats des conventions cadres pluriannuelles pour le développement de l’offre d’enseignement en la matière. Ne pourrait-on remédier à cette lacune du texte ?
Mme Julie Sommaruga. Après dix ans de casse, ce projet de loi répond aux objectifs d’une école plus juste et plus exigeante tout en mettant fort à propos l’accent sur le primaire.
La refondation de l’éducation prioritaire est également annoncée : quelle forme prendra-t-elle ? La carte des ZEP sera-t-elle redessinée ? Des moyens supplémentaires leur seront-ils alloués ? Les conditions de travail des enseignants de ces écoles seront-elles adaptées pour leur permettre, en étant déchargés de quelques heures de classe, de rencontrer les familles et de développer le travail en équipe – à l’intérieur des établissements comme entre les écoles et les collèges de ces zones ? Dans cette perspective, la pérennisation de la prime ÉCLAIR n’apparaît guère pertinente.
Les réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) jouent un rôle indispensable. Quel sera leur nombre à l’avenir et quelle évolution leurs missions vont-elles connaître ?
Enfin, de quels moyens disposera l’enseignement spécialisé pour accueillir dans de bonnes conditions les enfants porteurs d’un handicap ?
M. Claude de Ganay. Quelles mesures et quels moyens comptez-vous mettre en œuvre pour prévenir et combattre la violence en milieu scolaire ? Rien dans ce projet de loi et dans le rapport qui lui est annexé ne concerne cet important sujet, qui fera l’objet d’une proposition de loi dont j’ai été nommé rapporteur.
M. Vincent Feltesse. Monsieur le ministre, dans vos rêves, à quoi ressemblerait l’enseignement dans une classe numérique d’ici cinq à dix ans ? Pourquoi, dans ce domaine où tout bouge très vite, ne faites-vous aucune part à l’expérimentation ? Enfin, puisque d’importants investissements sont prévus en faveur du numérique en ligne, n’avez-vous pas envisagé de vous rapprocher de votre collègue chargée de la francophonie, maintenant que l’équipement informatique s’est considérablement développé dans tous ces pays ?
M. Patrice Verchère. Si faire entrer l’école dans l’ère du numérique est indispensable, encore faut-il que les communes, en particulier les plus rurales, en aient les moyens. Le précédent gouvernement avait lancé à cette fin l’opération « Écoles numériques rurales », mais il reste encore des écoles à équiper. Envisagez-vous, monsieur le ministre, de prolonger ce plan ?
Le passage à quatre journées et demie de classe constitue probablement une évolution souhaitable qu’il ne m’appartient pas de juger. En revanche, cette réforme n’est pas financée, car le budget alloué – 250 millions d’euros – ne semble pas suffisant pour couvrir les coûts que les collectivités locales devront engager pour animer les activités périscolaires. En outre, en milieu rural, il sera difficile de trouver des personnes qualifiées pour s’occuper des classes une heure par jour. Partagez-vous ce constat et comment comptez-vous répondre à cette difficulté ?
M. Pascal Deguilhem. Monsieur Salles, il aurait fallu déployer la même énergie à défendre l’école lorsque vous apparteniez à la majorité !
Notre préoccupation commune est l’échec scolaire et il nous faut mettre en place les meilleurs outils de remédiation. Parmi ceux-ci, le recrutement des enseignants soulève la question de l’attrait des concours, notamment dans les disciplines les plus déficitaires. Avez-vous des chiffres à nous communiquer à ce sujet, monsieur le ministre ? Les candidats sont-ils en nombre suffisant ?
Les disparités de l’état de santé et des résultats scolaires des élèves résultent souvent des inégalités sociales. Le rapport annexé souligne la nécessité de « promouvoir la santé » et de « développer le sport scolaire », mais comment ces orientations se traduiront-elles concrètement ?
En milieu rural diffus, le principe « Plus de maîtres que de classes » est-il bien le plus pertinent ? Ne vaudrait-il pas mieux privilégier les RASED pour lutter contre les difficultés scolaires individuelles ?
M. Mathieu Hanotin. Ce texte instaure un cycle facilitant le passage entre le CM2 et la 6e. Il s’agit d’une bonne initiative à condition qu’il ne s’agisse pas seulement de faire visiter leur futur collège aux enfants du primaire, mais bien d’organiser la transition entre l’enseignement transversal dispensé dans le premier cycle et l’approche plus académique du second.
Pour ce qui est de l’éducation prioritaire, il me semble que nous devrions marquer davantage notre volonté d’aller vers une individualisation des moyens. Si la pertinence d’objectifs globaux ne peut faire question, de la souplesse est nécessaire pour s’adapter aux caractéristiques locales. Par exemple, il n’est pas besoin partout de psychologues ou de maîtres formateurs du primaire mais, ici ou là, leur présence peut être utile. De même, dans certains collèges, le recrutement sur profil, qu’il serait donc dommage de supprimer.
Mme Maud Olivier. Je me réjouis de l’installation, par les ministères de l’éducation nationale et des droits des femmes, d’un comité de pilotage chargé de définir les modalités de mise en œuvre du programme « ABCD de l’égalité ». Inscrit dans le plan interministériel intitulé « Une troisième génération des droits des femmes : vers une société de l’égalité réelle », ce programme vise à faire prendre conscience aux enseignants de la prégnance des stéréotypes liés au sexe, qui engendrent des inégalités dans le parcours scolaire, puis professionnel. Les maîtres sont ainsi invités à conduire des actions permettant aux enfants de faire l’apprentissage de l’égalité entre filles et garçons. Les études de genre ont montré que la distribution des rôles entre femmes et hommes résulte d’une construction sociale et non d’un déterminisme biologique. Monsieur le ministre, comment comptez-vous introduire cette notion de genre dans la formation des enseignants ?
D’autre part, avez-vous l’intention de créer un statut pour les assistants de vie scolaire, soumis à une forte précarité ?
M. Michel Herbillon. Votre prédécesseur, monsieur le ministre, avait lancé une vaste concertation sur la question des rythmes scolaires. Les représentants des enseignants et des parents avaient alors pris position. Puis, en 2010, nos collègues Xavier Breton et Yves Durand ont rédigé un rapport sur le sujet, dans lequel ils étaient parvenus à des conclusions communes. Comment expliquez-vous dès lors que votre projet suscite tant d’oppositions ? En effet, les associations de parents d’élèves, la presque totalité des syndicats et les enseignants – qui ont conduit une grève très suivie à Paris – demandent soit l’abandon de cette réforme, soit son report à 2014. Ce front ne révèle-t-il pas un problème de méthode ?
D’autre part, malgré la dotation de 250 millions d’euros, au reste temporaire, les communes n’ont pas les moyens de supporter le coût de cette réforme. Comment comptez-vous les aider à l’assumer ?
M. Jean-Jacques Cottel. Il était nécessaire de s’attaquer à la refondation de l’école et la notation positive en constitue une mesure importante.
Vous prévoyez avec raison de créer des postes supplémentaires, mais les maîtres spécialisés qui exercent dans les RASED et dans les sections d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), ou qui occupent des fonctions spécifiques dans les écoles primaires, en bénéficieront-ils ou non ? Allez-vous rétablir leur formation ?
Les élus locaux sont disposés à mettre en place les nouveaux rythmes scolaires mais les communes qui ne pourraient le faire dès la prochaine rentrée et qui reporteraient donc la mesure à la rentrée de 2014 ne pourraient-elles, elles aussi, bénéficier d’un soutien financier ?
M. Xavier Breton. Nous aurions dû nous retrouver, monsieur le ministre, sur ce projet de refondation de l’école. Cependant, nos analyses sur les insuffisances du système éducatif divergent. Vous et votre majorité vous focalisez sur le quinquennat précédent alors que l’échec d’aujourd’hui résulte de choix effectués tout au long des vingt-cinq ou trente dernières années.
J’approuve certaines mesures de ce projet comme la priorité donnée au primaire, la création d’un lien entre l’école et le collège, ou encore la volonté d’organiser une évaluation indépendante, pour laquelle le nouveau Conseil national d’évaluation du système éducatif aurait d’ailleurs tout intérêt à s’appuyer sur les universités.
Mais, comme Yves Durand et moi l’avions souligné, la modification des rythmes scolaires exige une concertation approfondie, une estimation de son coût et une réflexion centrée, non sur l’organisation de la semaine, mais sur celle de l’année. Ces trois éléments manquent en l’espèce. D’autre part, l’enseignement privé sous contrat sera-t-il soumis à cette réforme et selon quelles modalités ?
Enfin, nous sommes favorables à l’affirmation d’une morale à l’école. Si elle est laïque, celle-ci ne doit toutefois enseigner que les valeurs républicaines partagées par l’ensemble des Français. L’égalité entre les hommes et les femmes uniquement envisagée sous l’angle de l’idéologie du genre n’entre pas dans cette catégorie. Quant au concept même de laïcité, nous voudrions être sûrs qu’on l’appréhende dans un esprit consensuel, d’ouverture et de tolérance.
M. Jean Jacques Vlody. Le Gouvernement a consenti de vrais efforts pour les régions qui manquent le plus d’enseignants. Ainsi l’académie de La Réunion qui a perdu 220 postes au cours des cinq dernières années bénéficiera de 247 créations à la prochaine rentrée.
La question des langues et des cultures régionales est particulièrement sensible dans les territoires d’outre-mer. Il y a lieu de renforcer leur enseignement dans le cadre scolaire. Il n’y aura pas de refondation de l’école dans ces régions sans la reconnaissance de leurs spécificités linguistiques. À cet égard, l’apprentissage du français en milieu créolophone constitue un défi, d’autant plus difficile à relever qu’il n’est pas tenu compte du cas de l’enfant ne parlant pas français au moment de son entrée dans le système éducatif. Approuveriez-vous, monsieur le ministre, la création, au sein des écoles supérieures du professorat et de l’éducation, d’un programme de formation des enseignants à la spécificité linguistique de ces territoires ?
Mme Martine Martinel. Monsieur Breton, la laïcité et l’égalité entre les hommes et les femmes ne peuvent être remises en cause en classe. Ces principes s’imposent à tous et ceux qui ne les partagent pas doivent s’interroger. Il ne faudrait pas que l’école devienne le lieu où l’on veut tout changer sans opérer le moindre changement, ni que le débat sur les rythmes scolaires nous éloigne de l’examen du présent projet.
La création des ESPE vise à favoriser « le développement d’une culture commune (…) à l’ensemble de la communauté éducative ». Quel sens accordez-vous, monsieur le ministre, à ce concept de culture commune ?
Mme Marion Maréchal-Le Pen. Je vous rejoins, monsieur le ministre, sur l’importance du primaire, même si, avant d’être initiés à l’anglais, les élèves devraient y apprendre le français. Plus largement, vous êtes-vous posé la question des méthodes d’enseignement ? À leur entrée en 6e, de plus en plus d’enfants ne maîtrisent pas la lecture à cause de la méthode globale. Ne pourrait-on pas réintroduire la méthode syllabique, qui avait fait ses preuves et qui a été sacrifiée sur l’autel du pédagogisme ?
M. Michel Ménard, président. Cette réforme sera sans doute difficile à mettre en place et le statu quo aurait été plus confortable. Néanmoins, il est indispensable de la conduire à son terme.
La formation pédagogique des enseignants a été supprimée en 2009. Réintroduite, quelle place occupera-t-elle dans les ESPE ?
Les RASED bénéficieront-ils de recrutements et quelles missions leur seront dévolues ?
Mme Françoise Dumas. La refondation de l’école nécessite la mobilisation durable de chacun, dans un esprit d’ouverture, d’unité et de laïcité. Après cette loi, un vrai dialogue s’imposera entre tous ceux qui contribuent, à un titre ou un autre, à l’éducation de nos enfants, à leur enrichissement culturel et à leur épanouissement physique. Dans ce cadre, il conviendra de garantir l’égal accès de tous les enfants aux dispositifs éducatifs les plus innovants et de veiller à associer les parents les plus éloignés de l’institution scolaire. Pouvez-vous nous préciser, monsieur le ministre, les grands axes de ce partenariat et nous assurer qu’il reposera sur les valeurs de laïcité et de neutralité du service public ? C’est à cette condition en effet qu’il favorisera l’éducation à la pensée et à la liberté de conscience.
M. le ministre. On ne peut prétendre travailler avec le Parlement sans l’écouter et soyez assurés que je respecte les positions de chacun. Le dialogue doit exclure la caricature. Mais il exige aussi du gouvernement qu’il précise sa méthode.
Le terme de refondation, auquel je tiens, n’est pas comme on l’a dit la marque d’un excès d’ambition mais, au contraire, celle d’une démarche empreinte de beaucoup d’humilité. Il ne s’agit en aucun cas de traiter de tous les sujets relatifs à l’école – notamment pas de certains, que vous avez évoqués mais qui ne relèvent pas de la loi – mais de tirer les leçons du passé : si bonnes qu’aient été les intentions, beaucoup de réformes n’ont pas porté de fruits parce que les fondements du système éducatif n’avaient pas été rénovés au préalable. Là est l’essentiel sur lequel on peut ensuite bâtir. C’est pourquoi il faut donner la priorité au primaire dont tous s’accordent à reconnaître les faiblesses structurelles.
Ce constat n’est ni nouveau, ni partisan et l’on a déjà essayé de résoudre ces difficultés. Notre atout est de disposer aujourd’hui, grâce au Président de la République, des moyens et du temps nécessaires pour corriger les effets d’un sous-investissement qui se lisent notamment dans le classement des pays de l’OCDE : la France y figure au dernier rang pour le taux d’encadrement dans le primaire. Nous sommes en outre l’unique pays avancé à avoir supprimé la formation des maîtres et le seul au monde à organiser l’année scolaire sur 144 jours seulement, au prix de journées surchargées pour les élèves. Enfin, notre système éducatif est caractérisé par une partition excessive entre le primaire et le secondaire : les méthodes, l’organisation du temps de travail y sont différentes – jusqu’aux syndicats qui portent des visions distinctes ! De tout cela, il n’y a pas de quoi être fier ! Voilà pourquoi nous devons commencer par assainir ce fondement de notre système éducatif – commencer par le commencement, en divisant les difficultés en autant de parcelles qu’il faut pour les résoudre.
En ce qui concerne l’accueil des moins de trois ans, une circulaire a été publiée et vous avez donc pu voir dans quel esprit nous le concevions. Il est surtout utile là où les populations sont le plus en difficulté. Nous pouvons l’organiser en nous appuyant sur ce qui existe déjà, par exemple sur les classes passerelles ou sur les expérimentations menées ici ou là, mais il nous faut aussi former les personnels : souvenons-nous qu’il y a vingt ans, les écoles normales dispensaient aux futurs maîtres de maternelle un enseignement spécifique d’au moins soixante-dix heures, de sorte qu’ils étaient parfaitement au fait des besoins de l’enfant à chaque étape de son développement intellectuel et moteur. Tout cela a été supprimé. Nous allons le rétablir.
Le dispositif « Plus de maîtres que de classes », expérimenté dans plusieurs régions, se révèle très efficace. Certains souhaiteraient réduire de moitié l’effectif des classes, mais il faut savoir que le réduire d’une seule unité obligerait à créer 10 000 postes. Un législateur responsable ne saurait donc se résoudre à une telle décision. En revanche, nous pouvons nous en remettre à une disposition qui a été expérimentée et évaluée dans notre pays et qui est pratiquée dans cette Finlande dont le modèle est si souvent invoqué. Mettre deux enseignants dans une classe permet de faire évoluer la pédagogie et le métier d’enseignant tout en favorisant le travail d’équipe, et cela donne des résultats !
Nous ne supprimerons pas l’école du socle, nous ferons mieux : nous généraliserons l’institution du conseil pédagogique et nous créerons un cycle à cheval sur le primaire et le secondaire. Les syndicats ont accepté cette mesure que beaucoup souhaitaient.
Après la priorité donnée au primaire, les ESPE constitueront le deuxième pilier de la refondation. Leur mission sera de garantir la compétence disciplinaire des enseignants, ce qui est essentiel, mais aussi de leur offrir les outils leur permettant de gérer des situations complexes. Quant à l’égalité des sexes, c’est une exigence fondamentale. Notre pays souffre à cet égard, y compris par rapport à l’Espagne, d’un retard dommageable, sensible notamment dans les disciplines scientifiques. Nous souffrons là de stéréotypes que les chefs d’entreprise jugent pénalisants pour l’économie. Les enseignants doivent donc être formés à les combattre.
Nous nous préoccupons également des violences à l’école, monsieur de Ganay : nous avons même inventé un métier, celui des assistants de prévention et de sécurité, que nous allons maintenant nous attacher à conforter en assurant leur place au sein de la communauté éducative. Nous avons également créé – ce à quoi il est curieux qu’on n’ait jamais songé – une délégation ministérielle chargée de la prévention et de la lutte contre les violences en milieu scolaire, qui nous permettra d’être mieux informés de ces phénomènes pour former les personnels à y faire face et pour définir des plans de gestion de crise. L’urgence s’en faisait sentir même dans le primaire, où les maîtres se disent confrontés à des enfants de plus en plus turbulents.
Enfin, le troisième pilier de notre projet réside dans la réforme des rythmes scolaires. Vous vous interrogez à ce propos sur ma méthode : eh bien, c’est celle que dicte l’intérêt général sur un sujet où le diagnostic était consensuel. Le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) a certes émis un vote négatif sur le projet de décret, mais il a fait de même sur toutes les propositions de réforme de mes prédécesseurs. En revanche, la Commission consultative d’évaluation des normes s’est prononcée favorablement, par huit voix contre deux. Il est vrai que le front du refus était étendu au sein du CSE, entre les parents d’élèves qui souhaitaient réduire immédiatement la journée d’école à cinq heures dans une année de 38 semaines, et les enseignants qui réclamaient une légitime revalorisation salariale. Cependant, le vote négatif résulte avant tout d’abstentions et aucune contre-proposition n’a été formulée. Cette réforme se fera donc, mais nous devons la mener de la façon la plus intelligente possible car elle est difficile : en effet, elle ne consiste pas simplement à ajouter une demi-journée dans la semaine, elle conduit également à modifier l’organisation de la journée elle-même, ce qui ne s’est jamais fait jusqu’ici dans notre pays mais qui est nécessaire même si cela pose des problèmes aux collectivités.
La consultation préalable à l’élaboration de ce projet a été très large, et c’est d’ailleurs ce qui explique la publication tardive du décret, contre laquelle protestent certains élus – les mêmes qui ont demandé cette concertation et ont contribué par leurs demandes à ce qu’elle se prolonge. L’opposition des collectivités n’est d’ailleurs pas homogène, ce qui est compréhensible étant donné leur diversité. Nous essaierons de tenir compte au mieux de tout ce qui nous a été dit par les uns et par les autres, mais vient un moment où il faut avancer ! Très nombreuses sont du reste les villes qui ont décidé de s’engager dans la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires.
Je suis conscient que cette réforme exigera un effort certain, de la part des élus comme des professeurs, tant elle oblige à rompre avec des habitudes. La principale révolution sera celle du dialogue. Entre les professeurs, au premier chef, qui doivent apprendre à se connaître et à se respecter à quelque niveau qu’ils enseignent et quels que soient leur discipline et leur statut, afin de faire émerger une culture commune. Les enseignants de maternelle ou du primaire ne sont en rien inférieurs à ceux des universités. Il n’est pas question non plus d’ériger une barrière entre eux et ceux qui auront à prendre en charge les enfants après 15 heures 45 : il faut qu’ils se parlent. C’est à quoi travailleront les ESPE, écoles supérieures du professorat « et de l’éducation ».
Si je vous disais que tout sera formidable dès 2013 et qu’aucun problème d’encadrement ne se posera, je ne serais qu’un marchand d’illusions. Mais il est des circonstances où il faut, non reculer devant les difficultés, mais chercher résolument des solutions. Ainsi en ce qui concerne le financement. Les 250 millions d’euros que coûteront les trois heures du mercredi matin seront couverts par le budget de l’éducation nationale. Les collectivités ne verront donc pas leur charge s’alourdir en assumant celle des quatre séquences de 45 minutes. Cependant, il est vrai qu’il y aura là un morcellement qui imposera des contraintes et il est probable que ces séquences concerneront davantage d’enfants. Dès lors, il est normal que l’État accorde une aide. Assorti d’un mécanisme de péréquation sans précédent, le fonds que nous avons prévu à cet effet permettra de corriger les fortes inégalités d’offre éducative et péri-éducative qui existent aujourd’hui entre les communes et dont vous pouvez avoir une idée en vous reportant à l’étude d’impact du ministère de l’intérieur. Il complétera l’effort conduit en faveur des zones les plus en difficulté, y compris rurales, sur lesquelles seront concentrés le premier millier de postes qui vont être crées.
Le même souci de combattre les inégalités territoriales inspire d’ailleurs notre action en faveur de l’accès à internet. Le plan « Écoles numériques rurales » est certes bien construit et bien doté, mais il n’a pas permis de combler le retard pris dans l’équipement des écoles primaires. Pour assurer le raccordement au haut débit des établissements situés en zone rurale, nous avons par conséquent demandé et obtenu 150 millions d’euros pris dans l’enveloppe du Fonds européen de développement régional (FEDER) et nous avons signé une convention avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC). De plus, nous avons passé un accord avec le Commissaire général à l’investissement, M. Louis Gallois, pour développer une filière française du logiciel pédagogique, secteur dans lequel les pays anglo-saxons jouissent d’une large avance. Afin que ces investissements dans le numérique ne soient pas consentis en vain, les ESPE se chargeront de l’indispensable formation, initiale et continue, des enseignants.
Sur tous ces points, je le répète, le constat des difficultés, qu’elles soient celles du système actuel ou celles qu’il faudra surmonter pour l’améliorer, doit nous pousser à une action résolue.
Qu’est-ce qu’une morale laïque ? C’est une morale non confessionnelle, qui ne repose pas sur le fondement d’une Révélation. Elle doit rassembler, et non diviser. Autrefois, ce concept était compris de tous. Si l’on veut faire de la laïcité un nouveau dogme, on la dévoie, car elle repose précisément sur le contraire : sur l’esprit critique. Quant à la morale, qu’on confond trop souvent dans nos programmes avec le droit, elle renvoie à la notion d’obligation. La République s’est d’ailleurs construite sur le refus de séparer morale et politique. De la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen au refus de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en passant par l’affaire Dreyfus, il existe une continuité d’actes supérieurs aux lois. Tous les enfants savaient cela mais comme ce n’est plus le cas, cela doit être de nouveau enseigné et j’ai installé une mission chargée de l’organiser. Vous disposerez de ses conclusions pour vos débats.
La droite a supprimé l’apprentissage avant 16 ans en 2008, le jugeant inopérant. Elle l’a remplacé par un dispositif d’alternance qui s’adressait aux jeunes de 14 et 15 ans, mais la dernière évaluation dont celui-ci a fait l’objet a montré que n’y étaient entrés que quarante élèves de 14 ans, dans deux académies seulement. Il est donc supprimé pour cette classe d’âge, mais conservé pour les adolescents âgés de 15 ans, à condition qu’ils maîtrisent le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. En effet, on ne peut pas être à la fois partisan du socle, promu par la loi Fillon, et affirmer que, pour certains enfants, son acquisition est accessoire.
Le parcours éducatif d’information et d’orientation est une nouveauté dont l’enjeu est considérable pour notre système éducatif. Déjà introduit dans les premiers cycles universitaires, il doit maintenant être généralisé, notamment au collège.
L’éducation artistique sera, à l’école primaire, intégrée dans le temps scolaire – au même titre que la langue vivante, qui ne sera pas nécessairement l’anglais, madame Maréchal-Le Pen –, afin d’en garantir l’accès à tous. Cela n’exclut pas qu’elle puisse être présente aussi au sein des activités péri-éducatives : il reviendra aux collectivités d’en décider, dans le cadre du projet éducatif territorial dont je précise qu’il pourra ne pas être limité à des séquences de trois quarts d’heure.
Au total, ce projet de loi n’a pas pour objectif de tout embrasser. Il fixe des objectifs simples : refondation du primaire et de la formation des enseignants, et réforme des rythmes scolaires. C’est seulement une fois que les bases de notre système auront ainsi été consolidées que nous pourrons aborder d’autres sujets – éducation prioritaire, réforme du collège, etc. – pour réfléchir à d’autres améliorations.
Je suis convaincu toutefois qu’un débat parlementaire constructif peut nous permettre d’enrichir ce texte. Nous pourrons par exemple y aborder la question des langues régionales, mentionnée par beaucoup – mais je fais observer que le code de l’éducation autorise déjà à les enseigner, disposition à laquelle je ne touche pas : il ne s’agirait que de rajouter. Afin de permettre au pouvoir législatif d’exercer en totale liberté sa faculté d’amendement, je n’assisterai pas à vos débats en commission. Je m’engage, par ailleurs, à accepter les amendements, d’où qu’ils viennent, dès lors qu’ils concourront aux objectifs que nous avons fixés. En dépit des caricatures inhérentes au débat politique, l’enjeu de la refondation de l’école dépasse les clivages partisans. En nous confrontant à des sujets qui n’ont pas été traités jusqu’ici et qui méritent de l’être, nous portons l’ambition de la simplicité et du courage.
La Commission des affaires culturelles et de l’éducation examine le projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République lors de sa séance du mercredi 20 février 2013.
M. le président Patrick Bloche. L’examen du projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, que nous entamons ce matin, ouvre une période de travail particulièrement intense pour notre Commission comme pour le Gouvernement, puisque nous allons délibérer sur une réforme cruciale pour l’avenir des plus jeunes de nos concitoyennes et concitoyens.
Nous nous sommes cependant préparés de longue main à cette course de fond, puisque nous avons consacré de nombreux débats et tables rondes aux principaux sujets traités dans ce projet de loi, tels que la priorité au primaire, les problèmes d’orientation ou encore la rénovation de la formation des enseignants. Parallèlement, notre rapporteur a mené un travail de longue haleine en conduisant toute une série d’auditions au bénéfice de l’ensemble des membres de notre Commission. Qu’il me soit permis, en votre nom à toutes et à tous, de le remercier pour son investissement personnel.
Notre réunion d’aujourd’hui sera consacrée à la discussion générale du projet de loi, l’examen des articles étant programmé à la semaine prochaine. Le délai de dépôt des amendements sera clos samedi prochain à treize heures. J’appelle tout particulièrement votre attention sur le fait que l’article 89 du Règlement de l’Assemblée nationale – aux termes duquel, conformément à l’article 40 de la Constitution, les amendements reçus par la Commission seront déclarés irrecevables s’ils entraînent la création ou l’aggravation d’une charge publique – s’appliquera, non seulement aux amendements proposés au projet de loi, mais également à ceux qui porteront sur le rapport annexé.
Je vous rappelle enfin que le ministre de l’éducation nationale, M. Vincent Peillon, a choisi de ne pas participer à nos travaux afin que la Commission puisse délibérer en toute indépendance. Je le remercie de cette décision, qui consacre le fait que c’est ici que la loi s’élabore.
M. Yves Durand, rapporteur. Comme vous l’avez dit, monsieur le président, la présente discussion générale n’est qu’une étape dans un long cheminement, notre Commission ayant déjà consacré de nombreuses discussions, auditions et tables rondes aux points essentiels de ce projet de loi. Cela me permet de limiter ce propos liminaire à l’exposé de la raison d’être et des grands principes de ce projet de loi.
C’est la première fois depuis bien longtemps que notre école fait l’objet d’une loi à la fois d’orientation et de programmation. Et c’est cette caractéristique qui explique la présence d’un rapport annexé donnant la répartition des moyens consacrés à l’action gouvernementale en faveur de l’éducation, conformément à notre engagement d’en faire une des priorités du quinquennat.
Si ce texte vise à la « refondation » de notre système éducatif, c’est qu’une simple réforme ne suffirait pas à remédier aux dysfonctionnements actuels. Quand chaque année 150 000 jeunes restent sans qualification à l’issue de leur parcours scolaire et sont ainsi voués au chômage et aux périls qu’il entraîne, c’est le système éducatif dans son ensemble qui est en cause, et non les enseignants, qui font ce qu’ils peuvent avec ce qu’ils ont. À rebours de sa vocation, qui est de les réduire, l’école républicaine reproduit les inégalités et, pis, les aggrave : je ne détaillerai pas ici un diagnostic qui a été posé dans maintes études internationales comme dans maints rapports nationaux, tels ceux de la Cour des comptes.
Il fallait donc, non se borner à réformer l’école, mais bien la refonder en sorte qu’elle retrouve les missions, les principes fondateurs et le « souffle » de l’école républicaine. Il fallait recréer des fondations sur lesquelles bâtir ensuite un système cohérent. Cette loi ne vise donc pas à accomplir, mais à commencer la reconstruction de l’école : elle lance une dynamique, elle ne la clôt pas.
C’est la raison pour laquelle ce texte n’embrasse pas tout le champ éducatif. Certains d’entre vous s’en sont inquiétés, notant qu’il traite peu du collège et du lycée, notamment du lycée professionnel, mais c’est précisément un parti pris de ce projet de loi que de donner la priorité au premier degré, afin d’enclencher une dynamique qui s’étendra dans un deuxième temps aux autres degrés d’enseignement.
Quant aux principes, ce projet de loi comporte une nouveauté absolue : c’est la première réforme de l’éducation nationale qui aborde le système éducatif par la pédagogie, et non par les structures. Elle ne vise pas en effet à aménager telle ou telle filière, tels ou tels horaires : son objectif est une véritable transformation de la pédagogie, parce que c’est celle-ci qui est au centre de l’acte éducatif.
Cette réforme se distingue également en ce qu’elle fait de l’école maternelle et surtout de l’école primaire sa priorité. C’est en effet là que tout commence, là que les savoirs fondamentaux, tels que lire, écrire, compter, doivent être acquis. Or trop d’élèves aujourd’hui ne les maîtrisent pas à l’entrée au collège, et sont de ce fait voués à l’échec scolaire – ce qui conduit certains à remettre en cause l’existence même du collège unique, alors que le projet de loi en réaffirme la nécessité car le mal vient de plus loin. C’est aussi au niveau de l’école primaire que les inégalités se créent.
Il est plus efficace de prévenir l’échec et le décrochage scolaires que de tenter d’y remédier a posteriori. C’est donc, je le redis, parce que ces maux s’enracinent dans l’école primaire que le projet de loi vise à concentrer les efforts sur ce niveau d’enseignement, en ce qui concerne tant la pédagogie que les moyens.
L’objectif d’avoir « plus de maîtres que de classes » là où cela est nécessaire du point de vue culturel et social illustre ce double choix de concentrer les efforts sur le primaire et de réformer les méthodes d’enseignement. Comme nous le disait le nouveau directeur général de l’enseignement scolaire, M. Jean-Paul Delahaye, il ne s’agit pas d’accorder aux écoles un maître supplémentaire, mais de créer les conditions d’une véritable révolution pédagogique : de permettre le travail en petits groupes, l’éclatement des classes, voire celui des emplois du temps, la liberté pédagogique, en un mot une transformation profonde du travail des enseignants, qui favorisera la réussite des élèves grâce à la personnalisation des parcours pédagogiques.
Encore faut-il que les enseignants y soient préparés par une formation adéquate, et nous abordons là la deuxième priorité, voire le cœur même du projet de loi : la formation des maîtres. Comme chacun sait, la mise en place de la mastérisation a entraîné la suppression de fait de la formation professionnelle des maîtres, au détriment de la réussite des élèves. La priorité est de restaurer cette formation. Il ne s’agit de recréer ni les écoles normales ni les IUFM, qui ont fait leur temps et sont incapables de répondre aux besoins actuels de formation. C’est pourquoi il nous est proposé de créer des écoles supérieures du professorat et de l’éducation, les ESPE. Le choix de nommer ces établissements « écoles » n’est pas indifférent : il signifie que, même s’ils sont créés au sein des universités, ils doivent préserver leur identité propre d’écoles professionnelles. C’est la première fois à ma connaissance qu’est instituée, en plus de la formation universitaire, une formation professionnalisante des maîtres, à travers un tronc commun d’enseignements. Cette dimension sera d’ailleurs présente dès la préparation du recrutement : une sensibilisation au métier d’enseignant est prévue dès la troisième année de licence, dans l’esprit qui a déjà présidé à la création des emplois d’avenir professeur.
Deuxième caractéristique, il s’agira d’écoles du professorat « et de l’éducation » : cela signifie qu’elles seront chargées de la formation, non pas seulement des enseignants, mais de toutes les professions éducatives – éducateurs, formateurs, etc. Nous considérons en effet que l’éducation n’est pas le fait de la seule école et qu’elle constitue un métier dont relèvent des professions diverses.
Le projet de loi fait de la continuité éducative sa troisième priorité. En cela, il ne fait que tirer les conséquences de la « loi Jospin » de 1989 et de la « loi Fillon » de 2005 : il consacre le respect du rythme d’acquisition des enfants en réaffirmant la politique des cycles ; il confirme le principe selon lequel l’enseignement obligatoire doit se solder par l’acquisition d’un socle commun qu’il élargit en « socle commun de connaissances, de compétences et de culture ». L’acquisition de ce socle commun suppose une continuité éducative entre l’école élémentaire et le collège, ce que certains appellent « l’école du socle ». Ce principe se traduit dans le projet de loi par l’instauration d’un cycle commun entre le CM2 et la 6ème, par la création de structures communes au collège et à l’école élémentaire et par la mise en place d’apprentissages communs aux enseignants de ces deux degrés. Il reviendra au futur Conseil supérieur des programmes – remplaçant le Conseil national des programmes supprimé par la loi de 2005 – de revoir l’organisation des programmes dans la perspective de cette continuité. Le futur Conseil national d’évaluation du système éducatif aura, quant à lui, la charge d’évaluer ces politiques.
S’agissant enfin de l’enseignement numérique, ce projet de loi n’en fait pas la panacée, la solution de tous les problèmes de notre système éducatif. Il lui donne sa place, toute sa place, mais rien que sa place : celle d’un levier pour la transformation de la pédagogie et, dès lors, il ne saurait en aucun cas se substituer au service public de l’éducation.
Je voudrais affirmer en conclusion le caractère véritablement refondateur de ce projet de loi, même si, hormis le rapport annexé qui pose les grandes orientations, il ne semble apporter que des modifications purement techniques au code de l’éducation. En effet, ce texte vise à transformer l’acte éducatif qui est au cœur même de l’école. Mais il s’agit aussi, par là même, d’un texte dynamique qui jette les bases d’une vaste transformation de l’ensemble du système scolaire. De ce fait, il propose à la fois des réponses d’urgence et des pistes pour l’avenir.
Mme Martine Faure. Je tiens à vous remercier, monsieur le rapporteur, pour le sérieux et la profondeur de votre rapport, sans concession mais chargé d’espoir, et nourri par les nombreuses auditions que vous avez conduites. Je veux également saluer le courage et la détermination du gouvernement, de M. Vincent Peillon en particulier, qui entreprend à travers ce projet de loi d’orientation et de programmation d’ouvrir notre école à toutes les transformations et à toutes les réussites.
Depuis plus de dix ans, les ministres successifs de l’éducation nationale s’étaient enfermés dans une vision strictement comptable de l’école, contribuant ainsi, par leur absence de vision et par leur refus de répondre aux difficultés, au découragement de l’ensemble de la communauté éducative, dont nous devons aujourd’hui reconquérir la confiance.
Élevé par le Président de la République au rang de priorité de la nation, l’objectif de ce texte est la réussite de tous les élèves. Il constitue une étape décisive de la refondation de la maison École, de la maternelle à l’université. Aussi long, aussi difficile, voire aussi douloureux que soit le chemin à parcourir, il était urgent de commencer à le tracer. Pour cela, on s’est appuyé sur une large concertation : enseignants, représentants des parents d’élèves et des lycéens, collectivités territoriales, parlementaires, chercheurs, universitaires ont été associés à l’élaboration de ce texte.
Je me réjouis particulièrement de la priorité qui y a été donnée à l’école primaire, car il était essentiel de redonner ses missions au premier degré. L’école maternelle doit redevenir le lieu où tous les enfants bénéficient des mêmes conditions d’accueil et de préapprentissage. Quant à l’objectif « plus de maîtres que de classes », il permettra de renouveler les méthodes pédagogiques. Les passerelles que ce texte jette entre le primaire et le collège sont tout aussi fondamentales – et, tout en préservant la spécificité de la maternelle, il faudra assurer avec la même exigence la transition avec l’école primaire. D’autre part, le recrutement de 60 000 enseignants assurera l’encadrement nécessaire à un enseignement de qualité : quoi qu’on ait dit, on ne peut enseigner à trente élèves comme on le fait à vingt-deux ou à vingt-quatre.
S’agissant des enseignants, les ESPE doivent être le lieu de leur formation professionnelle commune, qu’ils soient appelés à enseigner dans le primaire, dans le secondaire, à l’université ou dans les filières professionnelles. Il est urgent par ailleurs de restaurer une véritable formation continue des maîtres, d’autant que ceux-ci sont tout disposés à fournir les efforts nécessaires pour renouveler des conceptions pédagogiques qui ont parfois vieilli.
Le numérique doit devenir un outil essentiel de la réforme pédagogique, même si, comme vous l’avez souligné, monsieur le rapporteur, il n’a pas vocation à se substituer à l’enseignant.
Il faut également mettre tout en œuvre pour que chaque élève puisse acquérir un socle commun de connaissances, de compétences et de culture lui permettant d’aller au bout de ses possibles.
Cette refondation prendra du temps, mais cette première étape est essentielle pour la construction de l’école de demain, une école juste pour tous et exigeante pour chacun, selon l’expression de Vincent Peillon, une école assurant l’égalité des chances de tous les élèves et faisant confiance à ses équipes pédagogiques.
Sans ignorer les difficultés que nous aurons à surmonter, s’agissant d’apporter une solution collective à des besoins individuels, voire individualistes, nous pouvons cependant tous nous retrouver autour de ce projet. D’ores et déjà, l’engagement du gouvernement et de sa majorité a permis de mettre l’école au premier plan des préoccupations : on parle enfin dans notre pays de nos enfants et de l’avenir de notre société ! J’espère que le sujet restera au cœur de nos débats tout au long de l’examen de ce texte et au-delà.
M. Xavier Breton. On ne peut que se féliciter, monsieur le président, de votre décision de consacrer toute cette séance à la discussion générale. Je voudrais également vous remercier, monsieur le rapporteur, pour le sérieux et la cohérence de votre travail : étant donné les attentes suscitées par ce projet de loi de refondation de l’école, il était essentiel que nous puissions entamer ce débat dans les meilleures conditions.
Le groupe UMP a choisi de mettre en exergue trois constats et de juger ce projet au regard des trois exigences qui en découlent.
Premier constat : on a tellement demandé à l’école au cours des dernières décennies, comme s’il lui incombait de pallier toutes les insuffisances de la société et de la famille, que la communauté éducative est totalement déboussolée et incapable d’assurer sa vocation première, comme le prouve le creusement des inégalités. La première nécessité est donc de recentrer l’école autour de priorités.
Deuxièmement, notre système éducatif souffre d’un excès de centralisation qui tend à étouffer les initiatives. Il est incapable de prendre en compte la diversité des élèves, d’accorder une autonomie suffisante aux établissements et de faire confiance aux enseignants, alors même que l’« effet maître » est primordial dans la réussite éducative. Il faut accorder plus de liberté aux acteurs, valoriser la diversité des élèves et prendre en compte les différences sociales et territoriales.
Troisième constat : l’école n’est plus, depuis des décennies, portée par une ambition partagée par l’ensemble de la nation : elle est devenue un sujet de clivage plutôt que d’unité, d’où l’incapacité à mener des réformes quelles qu’elles soient.
Au regard de ces trois constats, notre analyse du projet de loi nous conduit à marquer des points d’accord et des points de désaccord, mais surtout à poser des points d’interrogation.
Tout d’abord, un certain nombre d’éléments de ce texte nous font craindre que nous n’allions pas vers le nécessaire recentrage de l’école. L’ajout du mot « culture » tend à brouiller la définition du socle commun de connaissances et de compétences issu de la « loi Fillon », qui faisait pourtant l’unanimité. La place donnée à l’éducation artistique et culturelle et à l’apprentissage d’une langue étrangère dès le cours préparatoire ne va pas non plus dans le sens d’un recentrage de l’école autour de sa mission de transmission des acquis fondamentaux. De même, si nous sommes favorables au développement de l’accueil des enfants de moins de trois ans dans les zones où celui-ci est nécessaire, sa généralisation n’a pas forcément le caractère prioritaire que lui assigne le projet de loi.
Ce défaut de recentrage se traduit également par un certain manque d’exigence. Ainsi le texte propose de remplacer l’évaluation annuelle de la progression des élèves à l’école primaire par une évaluation « régulière » sans qu’on sache ce que recouvre ce mot. De même, on s’interroge sur l’évaluation « positive », censée se substituer à la « notation sanction » : n’est-ce pas s’exposer au risque d’un renoncement à toute exigence à l’égard de l’enfant ?
Deuxièmement, ce texte risque d’accroître la rigidité d’un système éducatif qui a besoin au contraire d’une plus grande liberté. Ainsi, la composition des futurs Conseil supérieur des programmes et Conseil national d’évaluation du système éducatif ne garantit en rien leur indépendance vis-à-vis du ministère de l’éducation nationale. D’autre part, si nous sommes pour le développement du numérique à l’école, l’organisation d’un service public de l’enseignement numérique ne nous semble pas susceptible de favoriser la liberté pédagogique dans ce domaine. Nous partageons en outre l’inquiétude que nous avons ressentie chez le rapporteur : celle de voir ce service public entrer en concurrence avec celui de l’éducation.
La réaffirmation du principe du collège unique est un autre facteur de rigidité et d’uniformité, d’autant qu’on supprime par ailleurs les dispositifs de préapprentissage institués par la « loi Cherpion ».
S’agissant de l’école primaire, nous regrettons que le texte ne propose aucune avancée vers un statut du directeur d’école, qui contribuerait pourtant à assouplir la gestion de notre système éducatif. Quant à l’école maternelle, elle risque de se refermer sur elle-même si nous votons la création d’un cycle spécifique, projet quelque peu paradoxal au moment où on cherche à rapprocher l’école et le collège.
L’approche purement quantitative du recrutement des enseignants risque également de constituer une rigidité supplémentaire, alors que le problème réside bien plutôt dans la qualité de ce recrutement, en raison de conditions de travail qu’il faudrait dès lors chercher à améliorer pour rendre le métier plus attractif. Or nous ne trouvons dans le projet de loi rien qui aille en ce sens.
Même l’inscription dans la loi des projets éducatifs territoriaux est grosse de risques d’uniformisation dans l’hypothèse d’une mise en œuvre centralisée de ces projets.
Enfin, le projet de loi ne va pas dans le sens d’une ambition nationale partagée pour notre école. Certes, nous pouvons faire nôtre le constat qui le fonde, celui d’un système éducatif qui fonctionne mal, et ce depuis plusieurs décennies, comme vous le reconnaissez dans votre rapport – et, dès lors, focaliser ses critiques sur la politique menée au cours des cinq ou dix dernières années, comme le fait le ministre de l’éducation nationale, ne me semble pas le bon moyen de faire partager son ambition en faveur de notre école. Nous pouvons également approuver les quatre objectifs mentionnés dans l’exposé des motifs. Nous nous interrogeons en revanche sur les modalités de leur mise en œuvre. Ainsi, si nous sommes d’accord pour fonder notre système éducatif sur les valeurs de la République, il faudra s’assurer que nous avons la même conception de ces valeurs, s’agissant par exemple de l’égalité entre les sexes ou de la laïcité.
On voit qu’il reste beaucoup de questions en suspens. Si nous ne parvenons pas à y apporter des réponses communes, nous manquerons l’occasion d’opérer une véritable refondation de notre école. Ne répétons pas l’erreur commise avec la réforme des rythmes scolaires !
Mme Barbara Pompili. La refondation de l’école est une priorité urgente, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve notre système scolaire. Ainsi la dernière enquête PISA montre qu’aujourd’hui, en France, l’origine sociale reste le facteur déterminant de la réussite scolaire. Nous sommes loin, trop loin du modèle de l’école de la République, garante de l’égalité des droits sans condition d’origine ou de moyens !
Pour renouer avec ses missions, l’école a donc besoin d’une refondation digne de ce nom. Ce constat est partagé par la majorité des acteurs du monde de l’éducation, comme il ressort des nombreuses auditions auxquelles j’ai participé – dont certaines organisées par vous, monsieur le rapporteur, et je tiens à ce propos à saluer le sérieux et la rigueur avec lesquels vous avez mené vos travaux. Représentants des syndicats et des associations, professionnels : tous m’ont fait part de la nécessité de réformer en profondeur l’école, car la situation n’a cessé de se dégrader depuis dix ans, avec une mastérisation qui a détruit toute formation digne de ce nom – pour ne pas parler du décret de 2008 sur les rythmes scolaires.
Mme Isabelle Attard et moi-même l’avons dit ici à plusieurs reprises : les écologistes soutiennent cette volonté de refondation, en particulier la priorité donnée à l’école primaire. Et parce que nous souhaitons une refondation globale et ambitieuse, à la hauteur des attentes qui se sont exprimées, nous proposerons des amendements en vue d’améliorer ce projet de loi, en espérant qu’ils rencontreront un écho favorable.
Tout d’abord, nous souhaitons aller plus loin dans la définition des projets éducatifs territoriaux. En effet, ceux-ci joueront un rôle central dans la réforme des rythmes, dans le développement de l’innovation pédagogique et des expérimentations et dans la recherche d’un nécessaire équilibre entre le cadre national et l’adaptation aux spécificités locales.
Ces projets éducatifs territoriaux doivent organiser une continuité éducative entre le temps scolaire et les autres temps de l’enfant. Ils doivent ainsi assurer la cohérence entre activités scolaires et activités périscolaires, en impliquant l’ensemble des acteurs concernés : communauté éducative, parents, associations – dans lesquelles il faudrait comprendre celles qui s’occupent du handicap – et, bien sûr, collectivités territoriales car c’est aussi dans le cadre d’une « co-construction » des projets que leur rôle doit être appréhendé, étant entendu qu’il conviendrait de réfléchir à la pérennisation et au renforcement du dispositif de péréquation.
Ensuite, nous souhaitons que la refondation permette des évolutions pédagogiques. Les projets éducatifs territoriaux et la réforme des rythmes ouvrent à cet égard le champ des possibles. Alors soyons audacieux, sortons du carcan conservateur ! Il s’agit d’ouvrir l’école sur l’extérieur, à d’autres acteurs, en revoyant les emplois du temps de manière à donner vie à des projets collectifs. La réforme des rythmes doit susciter une réforme des pratiques. Dans cet esprit, nous déposerons des amendements posant un droit à l’expérimentation et à l’innovation pédagogique et visant à ouvrir les établissements aux associations, en particulier aux associations d’éducation populaire.
Enfin, nous appelons de nos vœux une gouvernance plus ouverte. Il faudrait en particulier y donner plus de place aux élèves et à leurs parents.
Pour ce qui est de la pédagogie, nous prônons une révision profonde du système de notation, l’interdiction de la notation chiffrée à l’école primaire et, à tout le moins, l’instauration d’une notation positive par la suite. L’école ne doit pas être le lieu d’apprentissage de la compétition.
De façon plus globale, il convient de repenser la totalité du système d’évaluation des élèves, du cours préparatoire au baccalauréat. En effet, les modalités d’examen sont elles aussi à revoir. Comment peut-on encore raisonnablement considérer qu’un 12 sur 20 en mathématiques « rattrape » un 8 sur 20 en français ?
Au-delà des connaissances, il faut aussi s’intéresser aux compétences. Dans la mesure où un parcours culturel et artistique est prévu, pourquoi ne pas s’appuyer sur l’enseignement moral et civique pour créer aussi un parcours citoyen ? Et pourquoi pas un parcours professionnel, pour chaque élève ? Nous proposerons plusieurs amendements en ce sens, concernant aussi bien le brevet que le bac.
Vous ne serez pas surpris, d’autre part, que nous souhaitions faire du redoublement une réelle exception.
Je tiens à insister sur la nécessité d’aller plus loin aussi dans la scolarisation des élèves handicapés. Parler d’accueil et d’accompagnement ne suffit plus. Nous demanderons une meilleure adaptation des locaux, davantage de personnels dédiés et une formation plus poussée des équipes pédagogiques et des enseignants.
Enfin, concernant la formation des enseignants, nous avons exprimé à plusieurs reprises des demandes précises : davantage de moyens pour la formation continue, qui est le véritable levier de la refondation de l’école ; un concours en troisième année de licence afin que les deux années de master soient réellement consacrées à la formation ; un prérecrutement digne de ce nom. Les emplois d’avenir professeur et l’organisation envisagée actuellement nous paraissent en effet perfectibles.
Vous le constatez, les pistes que nous proposons d’explorer sont nombreuses, et nous sommes impatients d’entrer dans le cœur du débat.
Je terminerai par un petit mot à l’intention de mes collègues de l’opposition. J’ai appris que, la semaine dernière, certains d’entre vous s’étaient émus de mon absence à la fin de la discussion de la proposition de la loi visant à prévenir la violence en milieu scolaire. J’ai été touchée par cette marque d’attention mais, comme M. le président de la Commission vous l’a précisé, j’étais tenue par mes obligations de présidente de groupe. Rassurez-vous toutefois : la coprésidence que nous avons instaurée avec M. François de Rugy nous permettra de mieux nous organiser. Je serai ainsi pleinement disponible pour prendre toute ma part dans ce débat essentiel !
M. Rudy Salles. Je tiens tout d’abord à féliciter le rapporteur pour le travail qu’il a accompli afin de préparer l’examen de ce projet de loi.
Globalement, nous sommes d’accord sur les constats, qu’il s’agisse de la dégradation des résultats et des acquis de nos élèves dans les comparaisons internationales ou de l’aggravation constante des inégalités scolaires et territoriales, et nous partageons votre souhait de combattre le décrochage scolaire. Soulignons toutefois que le phénomène n’est pas récent, contrairement à ce qu’affirme Mme Martine Faure : il s’étale sur au moins trente ans. Il n’y a pas non plus ici de députés qui n’aimeraient pas l’école – nous l’aimons tous – et les gouvernements successifs ont tous fait des efforts et connu des succès et des échecs. Il en sera de même de l’actuel ministre de l’éducation nationale, comme je le lui ai d’ailleurs dit. Alors, gardons-nous de toute caricature si nous voulons travailler sérieusement sur ce sujet très important.
Quatre grands points me semblent faire consensus : la priorité donnée au primaire pour prévenir au plus tôt les difficultés ; la formation des enseignants et des personnels d’éducation, avec une entrée progressive des premiers dans le métier ; une formation de l’élève qui aille au-delà de la seule instruction pour englober l’enseignement moral et civique ainsi que l’éducation artistique et culturelle ; l’instauration, enfin, d’un parcours d’orientation débutant le plus précocement possible, afin d’éviter une orientation « subie ».
En revanche, j’exprimerai une réserve de fond : cette réforme ne tient pas suffisamment compte de l’environnement des élèves, qui a évolué au fil des décennies et influencé leur comportement. Le rapport reste muet sur ces transformations profondes – fragilisation des structures familiales et des relations intergénérationnelles, importance croissante des dispositifs périscolaires, règne du consumérisme et du zapping médiatique…
Je formulerai aussi des critiques.
Certes, malgré le flou du dispositif, nous pouvons saluer la réforme de la formation initiale des enseignants, mais rien de concret ne permet de crédibiliser certaines déclarations d’intention quant aux moyens dont disposeront les ESPE et quant à la formation continue de ces maîtres.
S’agissant du numérique, nous regrettons l’absence de toute référence à une formation critique des jeunes aux médias et à l’information. La focalisation sur les seuls apports fonctionnels du numérique, à la fois comme outil et comme ressource, me semble un peu dangereuse. Le texte souffre à cet égard d’une vision quasi industrielle, sans finalité culturelle ni citoyenne.
D’autre part, il ne traite pas de l’éducation prioritaire ni de la mixité sociale, sinon de façon incidente. Mais il fait référence à l’enseignement « moral ». Attention à ce que ce ne soit pas un enseignement « doctrinal » ! (Exclamations parmi les commissaires SRC). Vos réactions montrent que vous avez compris de quoi il est question…
L’aide personnalisée est remplacée par un temps d’activité pédagogique complémentaire, en petits groupes et hors temps scolaire. Aucun cadrage national n’en fixe les modalités. Rien non plus sur la violence à l’école ni sur les moyens d’assurer un cadre serein aux élèves – mais, de cela, nous parlerons dans l’hémicycle quand y viendra en discussion la proposition de loi de M. Claude de Ganay.
Certaines mesures ne figurent pas dans ce projet de loi alors qu’elles avaient été abordées dans le cadre de la concertation. Ainsi rien n’est prévu en matière de décentralisation des centres d’orientation ou de carte scolaire. On peut aussi s’interroger sur la place faite aux collectivités territoriales dans la mise en œuvre de cette réforme, d’autant que pas un mot n’est dit sur celle des rythmes scolaires, qui a réussi à fédérer beaucoup de monde contre elle. Quelles aides spécifiques seront allouées aux collectivités ? Quelle concertation ? Quelles modalités d’association des acteurs de terrain ? Selon quel calendrier ? Nous l’ignorons !
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, les interrogations du groupe UDI à propos de ce texte. Nous attendons des réponses, si possible assorties de dates et de chiffres.
M. Thierry Braillard. Selon le rapport annexé, la promesse républicaine serait de « permettre la réussite de tous ». Nous pensons plutôt que la promesse républicaine est de faire de l’école le vecteur essentiel de la mobilité sociale : de permettre à chacun de devenir ce qu’il souhaite être – ce qui n’est pas tout à fait la même chose.
Pour nous, investir dans l’éducation, c’est investir dans la jeunesse, dans notre avenir. Ce ne sont pas que des mots. Et avant d’apprécier ce projet de loi, il nous semble opportun de dresser un bilan – à cet égard, j’apprécie l’honnêteté de nos collègues de l’opposition qui reconnaissent qu’il est extrêmement négatif.
L’effort éducatif de la nation a baissé de 15 % entre 2000 et 2011, passant de 7,5 % à 6,5 % du PIB. Et au-delà d’un manque criant de moyens, tout un système s’est désorganisé. Le rapport de notre collègue Yves Durand est à cet égard implacable. L’école n’a pas su répondre aux défis de l’hétérogénéité de ses élèves, continuant à privilégier ceux qui ne rencontraient pas de difficultés particulières et laissant se creuser inexorablement le fossé entre eux et les autres. Elle se trouve ainsi à l’origine même de la fracture sociale et de la fracture spatiale.
Que 140 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans qualification ni diplôme est intolérable. Déjà, quatre écoliers sur dix arrivent en 6ème avec de graves lacunes ; au lieu de résorber leurs difficultés, le collège les renforcera.
L’école primaire a vu ses moyens réduits : quand la nation dépense 100 euros pour un élève de l’enseignement élémentaire, elle en dépense 141 pour un collégien et 196 pour un lycéen.
Le rapport nous rappelle aussi combien les rythmes scolaires sont insatisfaisants : avec 24 heures de classe sur quatre jours seulement, nos élèves ont les horaires plus lourds de tous les pays de l’OCDE, ce qui entraîne fatigue et manque de concentration. Si l’on se souvient que cette organisation a été imposée en 2008 sans concertation, comment admettre les leçons qu’on veut aujourd’hui nous donner sur la réforme de ces mêmes rythmes scolaires ?
L’école oriente mal : malgré la réforme de novembre 2009, la voie professionnelle reste stigmatisée. Elle manque aussi cruellement de moyens humains, ayant été privée de 74 432 emplois entre 2007 et l’été 2012. Si l’on ajoute à cela les difficultés d’accueil des plus petits et la formation critiquable dispensée par les IUFM, on ne peut que se réjouir de ce projet de loi de refondation !
Il vise à donner de nouvelles fondations à une institution qui en a bien besoin. Le groupe RRDP estime que son économie générale est à la hauteur de cette ambition. Aussi, monsieur le rapporteur, durant les débats, vous nous aurez la plupart du temps à vos côtés.
Vous nous aurez à vos côtés parce que vous accordez des moyens à l’école : des recrutements, mais surtout une formation repensée et réorganisée ; parce que vous donnez la priorité au primaire, dont vous entendez réformer les rythmes et le contenu des enseignements ; parce que vous prenez en compte le numérique ; parce que vous prévoyez de rénover le système d’orientation et d’insertion professionnelle.
Notre groupe compte, pour sa part, insister sur plusieurs points.
Tout d’abord sur l’exigence de la coéducation, pour résorber l’échec scolaire. Le projet éducatif territorial est un bon outil, mais il faut aller au-delà et créer les conditions du dialogue entre les différents acteurs, dont les parents.
Ensuite, sur le rôle important des collectivités territoriales, qui sont responsables de l’homogénéité des établissements scolaires sur le territoire, ainsi que du numérique. C’est d’ailleurs pourquoi, monsieur le président, je renouvelle le souhait que nous invitions Mme Fleur Pellerin : en effet, s’il est bon de vouloir introduire le numérique dans les écoles, encore faut-il que le haut débit, sinon le très haut débit, soit accessible partout. Or notre pays compte encore trop de zones blanches.
Nous insisterons aussi sur l’utilité d’un enseignement moral et civique, sur la reconnaissance de la spécificité de l’école maternelle et sur l’apport du conseil école-collège. Enfin, et surtout, à la suite du rapporteur, sur la nécessité de « rendre l’école plus juste et plus ouverte ». Cela suppose de lutter contre la ségrégation et de faire plus d’efforts encore en faveur de la mixité sociale, de renforcer les moyens de l’école, de recréer les postes de RASED supprimés et de développer les écoles ouvertes.
En conclusion, ce sera à nous, durant le débat parlementaire, d’œuvrer à la réussite des ambitions que porte ce projet de loi, pour plus d’égalité, de justice et de démocratie.
M. le président Patrick Bloche. Il va de soi que nous serons amenés à auditionner Mme Fleur Pellerin.
M. Jean-Pierre Le Roch. Le 9 février 2012 à Orléans, dans un grand discours sur l’école et la nation, François Hollande déclarait qu’il n’y aurait pas de reprise économique durable pour la France sans investissement dans son école. Il définissait ainsi pour la première fois la priorité qui constitue le grand dessein de cette législature.
La mission républicaine de l’école a été mise à mal par la gestion arithmétique et comptable dont elle était l’objet ces dernières années – et non ces dernières décennies : rappelons que le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux s’est traduit dans ce secteur par la suppression de 60 000 équivalents temps plein entre 2007 et 2012, d’où l’impossibilité d’assurer cette mission et l’accroissement des inégalités entre les élèves.
La grande concertation lancée par le ministère a permis de poser clairement le diagnostic et de définir les priorités auxquelles le présent projet de loi vise à répondre.
Première priorité : l’enseignement primaire, qui avait été sacrifié ces dernières années. Le nombre des enfants de moins de trois ans accueillis à l’école a diminué ; 300 000 élèves du CM2 présentent de graves lacunes à l’entrée en collège ; les dépenses annuelles par élève sont inférieures de 5 %, pour l’école maternelle, et de 15 %, pour l’école primaire, au niveau moyen constaté dans les pays de l’OCDE.
Deuxième priorité : la formation des enseignants. Elle sera restaurée grâce à la création des écoles supérieures du professorat et de l’éducation.
Troisième priorité : la réforme des rythmes scolaires, pour le bien-être des enfants.
Enfin, dernière priorité, la résorption de la fracture qui traverse l’école républicaine contribuera à la réussite de l’ensemble des élèves, quels que soient leur origine sociale et leur lieu de scolarisation.
M. Patrick Hetzel. Il faut reconnaître l’importance du travail réalisé par notre rapporteur, même si l’on ne partage pas l’ensemble de ses analyses.
Cela étant, je m’élève contre l’affirmation selon laquelle le gouvernement précédent aurait imposé la semaine de classe de quatre jours. Ce n’est qu’une rumeur, relayée par la presse. L’objectif de Xavier Darcos n’était que de supprimer les cours du samedi matin, les conseils d’école ayant tout loisir d’opter entre une semaine de quatre jours et une semaine de quatre jours et demi. C’est d’ailleurs ce dernier choix qui a été fait à Périgueux, où l’on a rétabli les cours du mercredi matin.
On prétend également que le gouvernement précédent aurait supprimé la formation des enseignants : c’est faire peu de cas de celle qui était dispensée par les universités, dans le cadre des masters !
Mais revenons à ce projet. L’article 55 vise à favoriser l’utilisation des ressources numériques sans que soit jamais soulevée la question de la liberté pédagogique. Or l’article 10 organise un service public de l’enseignement numérique dont la création pourrait déboucher sur un véritable monopole d’État et devenir « liberticide ».
Cette disposition peut d’autant plus inquiéter qu’elle est de nature à favoriser un phénomène qui se développe depuis une bonne trentaine d’années, notamment dans le primaire, et dont je m’étonne que vous ne le preniez nulle part en compte : je veux parler du « zapping pédagogique » qui, selon certains spécialistes, contribue à la dégradation de la performance scolaire dans la mesure où il prive du cadre de référence donné par le manuel.
Sur ces deux points, ni le projet de loi, ni le rapport n’apportent des réponses. J’espère donc que nous pourrons y revenir au cours du débat.
Mme Colette Langlade. J’insisterai pour ma part sur deux des qualités de ce projet de loi : sa lisibilité et son caractère ambitieux.
Comme notre rapporteur l’a souligné, la priorité sera clairement donnée à l’école maternelle et à l’école primaire. Le collège et le lycée, y compris le lycée professionnel, en bénéficieront ensuite, grâce à un niveau de culture et de compétences, sanctionné par le baccalauréat, qui ouvrira à tous les jeunes l’accès aux études supérieures et à un projet professionnel.
S’agissant spécifiquement de l’enseignement professionnel, j’ai relevé l’expression très positive de « campus des métiers » et je me peux que me réjouir de la suppression, par l’article 38, du dispositif d’initiation aux métiers de l’alternance (DIMA) institué pour les jeunes de moins de quinze ans par la « loi Cherpion » du 28 juillet 2011.
La valorisation de l’enseignement professionnel est de nature à éviter le décrochage scolaire. Y contribueront la modernisation de la carte des formations, en partenariat avec le rectorat et surtout avec les partenaires sociaux et avec les collectivités territoriales, et le dialogue obligatoire avec les comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle, afin de mieux adapter les formations aux spécificités des territoires et des différentes filières, et de développer ainsi des métiers au service du redressement productif.
Ce projet de loi est donc ambitieux et il répond aussi à une attente de longue date en ce qu’il suit une chaîne logique : formation, orientation, développement économique, aménagement du territoire, recherche et innovation, pour favoriser l’emploi.
M. Benoist Apparu. Bien sûr, monsieur le rapporteur, je ne peux que vous féliciter pour l’excellent travail que vous avez fourni ces dernières semaines. Reste que nous sommes en désaccord sur plusieurs points.
Premièrement, selon vous, il s’agirait d’un texte de « refondation ». Mais sur quelles fondations s’appuie le système éducatif français, sinon sur le statut des personnels et sur celui des établissements ? Or ce projet ne touche ni à l’un, ni à l’autre. Ce n’est qu’un « ripolinage », un coup de pinceau passé sur le système scolaire. Les experts sont d’ailleurs unanimes pour estimer qu’il n’y a rien dans ce texte. Sincèrement, nous attendions autre chose !
Deuxièmement, vous affirmez que la priorité a été accordée à l’enseignement primaire. On peut se demander comment. En effet, dans ce projet de loi, vous ne tirez aucune conséquence de l’écart que vous avez constaté entre primaire et lycée quant au niveau des investissements dont ils bénéficient respectivement. Vous n’inversez pas la tendance.
Vous écrivez que la suppression des IUFM et la mastérisation ont « économisé » quelque 9 000 postes. Or la création des ESPE devrait en coûter 27 000, de sorte que je comprends mal votre calcul, à moins que ces 27 000 créations ne soient étalées sur cinq ans. Mais si tel devait être le cas, vous ne seriez pas près de respecter la promesse de François Hollande, qui est de créer 60 000 postes dans l’éducation nationale… Pourriez-vous nous expliquer ce qu’il en est ?
D’autre part, il y a deux jours, est parue une circulaire qui ramène le temps de service des professeurs des écoles de 27 à 26 heures par semaine. Cela fait 320 000 heures par an – puisqu’il y a 320 000 professeurs des écoles – soit 12 000 équivalents temps plein. Comment pouvez-vous accepter qu’on fasse à ces enseignants un tel cadeau sans rien leur demander en contrepartie, si ce n’est leur accord pour la réforme des rythmes scolaires ? J’ai du mal à comprendre que vous ne dénonciez pas un tel scandale !
Enfin, à vous entendre, vous et le ministre, les résultats catastrophiques relevés par les enquêtes PISA s’expliqueraient par les suppressions de postes dans le primaire et par la suppression des IUFM. Mais ces enquêtes ont été réalisées en 2009 sur des cohortes d’enfants de quinze ans, qui étaient donc entrés en CP en 1999 et 2000. Comment des décisions prises dix ans après pourraient-elles expliquer leurs mauvais résultats ?
M. Pierre Léautey. Je voudrais moi aussi saluer la qualité du rapport de notre collègue Yves Durand. On y sent toute la passion qu’il a pour l’école de la République !
Grâce à un état des lieux clair, précis, sans faux-fuyant, qui démontre objectivement et de façon méthodique l’échec des réformes passées, il met en perspective ce projet de refondation de l’école qui vise à lutter efficacement contre l’échec scolaire grâce à la priorité donnée à l’école maternelle et à l’école primaire, où l’échec scolaire prend son origine.
Ce projet n’est pas une déclaration d’intentions. Pour relever ce grand défi au service de la jeunesse, les moyens sont au rendez-vous : accueil des enfants de moins de trois ans ; objectif « plus de maîtres que de classes » ; développement organisé du numérique pour éviter la fracture numérique ; remise en chantier de la formation des enseignants sacrifiée par le précédent gouvernement alors même qu’elle conditionne l’efficacité de notre système éducatif.
Toutes ces dispositions sont à la fois pertinentes et urgentes pour combattre l’échec à l’école, qui transforme les inégalités sociales en inégalités scolaires. Il n’est pas acceptable de laisser nos résultats se dégrader d’année en année, comme cela ressort du rapport : depuis dix ans, l’écart entre les élèves suivant une scolarité normale et les élèves en difficulté – aujourd’hui 40 % de la population scolaire – ne cesse de se creuser et 150 000 d’entre eux quittent chaque année le système éducatif sans diplôme et sans qualification, de sorte qu’ils auront beaucoup de mal à s’insérer dans la vie professionnelle.
Ce projet de loi répond donc aux attentes de la jeunesse et complète les lois déjà votées concernant, notamment, les emplois d’avenir et les contrats de génération. Sur ce volet spécifique de la réforme de l’école, il faut aller vite si nous voulons donner à notre jeunesse les moyens de sa réussite.
Mme Isabelle Attard. MM. Xavier Breton et Patrick Hetzel s’inquiètent de la liberté qui sera laissée aux enseignants en matière de pédagogie, mais plusieurs articles de ce projet de loi autoriseront à expérimenter en ce domaine. D’autre part, je rappelle que les maîtres n’ont jamais été incités à s’engager dans cette voie – surtout ces dernières années – et que l’obligation qui leur est faite, par l’inspection, de suivre strictement et rigoureusement un programme bien défini limite singulièrement leur liberté. L’encouragement qu’ils trouveront dans ce projet est donc bienvenu et de nature à valoriser leur travail. Ils ont d’ailleurs hâte de se lancer dans ces expérimentations, ayant l’intuition qu’elles peuvent contribuer à résorber l’échec scolaire. J’aimerais savoir, monsieur le rapporteur, si vos auditions ont été l’occasion de suggestions à ce propos.
Je ferai enfin remarquer à M. Benoist Apparu que la dernière place qui nous échoit dans la récente enquête PISA ne nous est pas imputable. Certes, il y a bien plus de dix ans que notre système éducatif s’essouffle. Mais nous sommes tous d’accord pour constater que la situation s’est aggravée au cours des dix dernières années.
M. Michel Ménard. Monsieur Hetzel, la suppression des cours le samedi matin ne s’est pas accompagnée d’une incitation à les reporter au mercredi matin. Ce choix n’a eu lieu qu’à l’initiative d’équipes pédagogiques et de municipalités qui voulaient expérimenter des rythmes différents.
Nous n’avons jamais dit qu’il n’y avait plus de formation des enseignants. Effectivement, ceux-ci sont recrutés à bac+5 ! Je n’ai d’ailleurs jamais entendu de parents d’élèves se plaindre qu’un professeur ne maîtrise pas sa discipline. Mais qu’un professeur ne maîtrise pas sa classe ou ne sache pas faire progresser ses élèves, cela, je l’ai entendu souvent dénoncer et c’est dû à un manque de formation pédagogique.
Monsieur Apparu, notre priorité n’est pas le statut des enseignants ou l’état des bâtiments, mais les enfants et leur réussite. Et cette réforme est nécessaire parce que ceux-ci sont trop nombreux à connaître l’échec scolaire – près de 20 % selon la dernière étude, et la proportion a crû ces dix dernières années.
Il s’agit d’une réforme ambitieuse et exigeante, qui implique de reconstruire la formation des maîtres et qui obligera ceux-ci à travailler en équipe. Elle conduira à une mobilisation de tous les acteurs, à quelque titre que ce soit, du système éducatif : enseignants, parents, personnels municipaux, acteurs associatifs et de l’éducation populaire, collectivités, etc. L’entreprise peut apparaître difficile mais n’oublions pas l’objectif, qui est d’assurer la réussite des élèves.
Nous commençons par l’enseignement primaire, qui est à la base de tout. Pour autant, ce projet de loi traite de tout le parcours de la maternelle à l’université. En effet, il est nécessaire d’intervenir sur les différents niveaux de l’enseignement. Celui-ci bénéficiera d’autre part de 60 000 emplois au cours du quinquennat, ce qui constitue de la part de l’État un effort qu’il convient de saluer.
Un travail de concertation a été engagé depuis des mois, avant même l’élection présidentielle. Il s’est poursuivi l’été dernier avec les ateliers sur la refondation de l’école mis en place par M. Vincent Peillon. Nous abordons maintenant une deuxième phase de concertation, au niveau local. Je souhaite que les enseignants, les parents d’élèves et les collectivités locales se saisissent de la possibilité qui leur est ainsi donnée d’élaborer un projet éducatif de territoire, pour assurer la réussite des élèves. C’est en tout cas l’objectif commun que nous allons poursuivre.
M. Guénhaël Huet. Je souhaite que cette refondation de l’école de la République se réalise dans de meilleures conditions que la réforme des rythmes scolaires ! Cela étant, nous faisons nôtres les objectifs visés par ce projet de loi – maîtrise des compétences de base, réduction de l’écart entre les élèves, division par deux de la proportion d’élèves sortant du système scolaire sans qualification… – et nous saluons la forte priorité accordée à l’école primaire.
Il est seulement assez étrange d’affirmer cette priorité en oubliant le rôle joué par les communes dans ce domaine. Aucun article n’aborde le sujet alors que deux – les articles 13 et 14 – traitent du rôle respectif des départements et des régions.
Je suis assez réservé sur l’objectif affiché d’amener 80 % d’une classe d’âge au baccalauréat et 50 % à un diplôme de l’enseignement supérieur. Certes, les diplômes sont nécessaires mais ne transformons pas la culture du diplôme en mythe du diplôme. Celui-ci est loin aujourd’hui de garantir une bonne insertion professionnelle.
Quant à la scolarisation des enfants de deux ans, un certain nombre de spécialistes de la pédagogie sont très réservés à son propos et, personnellement, je ne suis pas sûr qu’il faille la généraliser. Il existe d’autres formes de socialisation que l’école pour ces jeunes enfants. Une concertation plus approfondie avec les collectivités locales permettrait peut-être de faire la part des choses en laissant aux communes le soin de prendre en charge les enfants de deux à trois ans, l’État prenant ensuite le relais, via l’éducation nationale.
La question de l’orientation, abordée dans l’exposé des motifs, ne fait cependant l’objet d’aucune disposition. On sait pourtant que les centres d’information et d’orientation (CIO) sont des outils particulièrement désuets. J’aimerais que l’on s’interroge sur leur place et sur leur rôle.
Enfin, monsieur le rapporteur, comment justifiez-vous l’absence totale, dans ce texte, de référence à l’éducation sportive ?
M. Hervé Féron. S’agissant de la formation des enseignants, ce projet marque des avancées incontestables.
Historiquement, les écoles normales constituent la référence pour la formation des instituteurs, ces « hussards noirs de la République » : formation longue commencée dès la classe de 2nde jusqu’à la réforme de 1969, et de deux années au minimum ; formation d’élite assurant un véritable recrutement populaire ; formation bien structurée – à la fois didactique et pratique – et éminemment structurante, suscitant un véritable esprit de corps, une vocation forte, et assortie d’une vraie reconnaissance sociale.
Si leurs successeurs, les IUFM, ont pu être critiqués pour le manque de densité de certains de leurs enseignements et pour l’oubli de matières comme les sciences cognitives ou la psychologie de l’enfant, ils ont eu le grand mérite d’unifier la formation des enseignants. C’est ce que nous souhaitons recréer avec les écoles supérieures du professorat et de l’éducation. Il s’agit en effet de rétablir ce que la précédente majorité a détruit en supprimant la formation initiale des enseignants, dénigrement ultime d’une profession dont dépend pourtant l’avenir de la jeunesse et du pays, et en érodant l’ensemble des dispositifs de formation continue.
Aujourd’hui, dans un souci de professionnalisation et de valorisation de ces métiers, nous maintenons le niveau de recrutement des enseignants à bac+5, la mastérisation ayant parachevé l’« universitarisation » de leur formation. Nous répondons ainsi à un souhait de l’ensemble des acteurs de l’éducation.
Pour autant, nous n’oublions pas que la mastérisation a aussi rendu l’entrée dans le métier plus hasardeuse pour de nombreux étudiants candidats au professorat, en permettant une économie de 9 000 postes. C’est pourquoi, à l’inverse de la réforme Fillon de 2005 pour laquelle, incontestablement, les moyens manquaient, nous faisons, parallèlement, le choix d’une autre politique. Nous créerons 26 000 postes qui seront consacrés au rétablissement d’une véritable formation professionnelle, grâce à une année de stage rémunéré, effectuée en alternance au sein de l’université, dans les ESPE, et sur le terrain, au contact des élèves, dans le cadre d’un stage en responsabilité. Mais il faudra veiller à rétablir également la formation continue des personnels enseignants, ce qui correspond à une très forte attente de leur part.
Je voudrais pour finir soumettre une idée qui pourrait être concrétisée à moyens constants : bien des professionnels chevronnés préféreraient, à une formation sous forme de stage avec tuteur, un échange de bonnes pratiques. Pourquoi ne pas favoriser, dans les futures ESPE ou dans les établissements, des réunions mensuelles de professeurs d’une même discipline et d’un même bassin, pour faciliter les transitions, pour remotiver et pour dynamiser leurs enseignements ? Il conviendra en tout cas de ne pas négliger la formation continue des enseignants, mise à mal au cours de ces dernières années.
Mme Julie Sommaruga. Étant donné la situation excellemment décrite par notre rapporteur, il n’était que temps de consacrer à notre système éducatif un projet de loi à la hauteur de ses besoins et de ses attentes, un texte ambitieux, volontaire, courageux, susceptible de lui donner un nouveau souffle après dix ans de casse de l’éducation nationale par la droite.
M. Benoist Apparu. Ça manquait !
Mme Julia Sommaruga. C’est une réalité, et les exemples ne manquent pas : suppression de 80 000 postes, mise à mal de la formation des maîtres, accroissement des inégalités territoriales avec la suppression de la carte scolaire, fragilisation du système d’orientation, généralisation d’une semaine de quatre jours contraire à l’intérêt des enfants…
C’est une politique totalement opposée que souhaite mener le gouvernement, dont la principale préoccupation est la réussite de tous les élèves.
M. Benoist Apparu prétend qu’il n’y a rien dans ce texte. N’est-ce rien que de donner la priorité au primaire pour lutter dès la racine contre les inégalités scolaires, de développer la scolarisation des moins de trois ans, de rétablir la formation des maîtres, de généraliser les projets éducatifs territoriaux, de réformer les rythmes scolaires, de créer un service public de l’enseignement numérique, de lutter contre le décrochage scolaire, de prévoir plus de maîtres que de classes, etc. ? Au contraire, ce projet de loi est riche de dispositions volontaristes.
En outre, toutes ces orientations sont en adéquation avec les promesses de campagne du Président de la République. L’objectif du gouvernement est clairement affiché : faire une école juste pour tous et exigeante pour chacun, en la replaçant au cœur du pacte social pour la réussite de tous. Pour cela, nous lui redonnons tous les moyens nécessaires, en particulier les moyens humains, indispensables non seulement pour réduire les inégalités, mais aussi pour améliorer le climat scolaire et pour assumer notre ambition en matière d’éducation.
Ce projet de loi qui donne le départ à la refondation de l’école prélude à d’autres chantiers, à d’autres réflexions. Il me semble à cet égard nécessaire d’insister sur le travail à mener en faveur de l’enseignement prioritaire – les établissements concernés doivent devenir des lieux d’expérimentation, des lieux d’excellence –, de l’accompagnement de la parentalité ou des partenariats avec le monde associatif.
M. Jean Jacques Vlody. Ce beau projet de loi est un projet fondateur, sans doute la première grande réforme de la législature. Après une longue phase de concertation et de consultations préalables, nous sommes enfin entrés dans le travail concret avec un texte qui ne se borne pas à apporter des changements à la marge, mais qui tend à dessiner l’école de demain : une école où les enfants aiment à se rendre, où ils prennent le goût du savoir ; une école qui motive plus qu’elle ne sanctionne, à la fois bienveillante et exigeante, et qui réunit autour d’elle tous les acteurs de la communauté éducative.
Le terme « refondation » est tout à fait approprié dans un tel contexte, et il est dès lors normal que des oppositions, des incompréhensions se fassent jour. Nous le voyons aujourd’hui avec la réforme des rythmes scolaires, qui déchaîne les passions. Il en sera de même pour d’autres chantiers : c’est le propre des grandes réformes structurelles que de rencontrer de telles difficultés.
Notre mission, en tant que parlementaires, est par conséquent d’expliquer et de soutenir une réforme courageuse qui va dans le sens de l’intérêt général. Au sein de cette Commission, nous devrons avoir une démarche constructive, en nous donnant le temps nécessaire pour enrichir le projet, avec un seul objectif : conforter les nombreuses avancées qu’il contient et l’améliorer quand il le faut.
De nombreux amendements, que je soutiendrai, vont dans le sens d’un renforcement de notre système éducatif. Pour ma part, je me suis concentré sur deux questions propres à la France d’outre-mer, dont je suis un élu.
La première concerne la variété linguistique de ces territoires. Si celle-ci représente une richesse, elle peut aussi, faute d’être suffisamment prise en compte dans les processus pédagogiques, être à l’origine de difficultés dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture ou dans l’expression orale de langue française, accroissant les risques d’illettrisme ou d’échec scolaire. L’éducation nationale doit reconnaître cette réalité du bilinguisme et favoriser le développement de méthodes pédagogiques adaptées, en en faisant l’objet d’un module de formation initiale et continue dans les ESPE d’outre-mer.
Deuxièmement, il n’est plus acceptable que la dimension ultramarine de la France soit absente de l’enseignement de notre histoire. L’ensemble des élèves de notre République doit pouvoir en prendre conscience.
Je souhaite donc que le nouveau contrat pour l’école prenne en compte ces deux exigences.
Mme Marie-Odile Bouillé. J’ai été particulièrement ravie de découvrir dès les premières pages du projet de loi des dispositions introduisant l’éducation artistique et culturelle tout au long de la scolarité de l’enfant, sur le temps scolaire comme sur le temps périscolaire. Il s’agit d’un véritable parcours dont les modalités seront fixées conjointement par deux ministres, celui de l’éducation nationale et celui de la culture – une telle collaboration, peu fréquente, est déjà en soi une excellente chose.
L’objectif est bien sûr de réduire les inégalités et de favoriser l’égal accès de tous les jeunes, tout au long de leur scolarité, à l’art et à la culture.
L’étude d’impact souligne la grande variété des actions déjà menées en ce domaine par le ministère de l’éducation nationale et rappelle les partenariats forts qu’il a noués avec les directions régionales des affaires culturelles – DRAC –, avec les collectivités locales et avec les institutions culturelles, que ces partenariats prennent la forme de conventions ou de comités de pilotage associant rectorat, région et DRAC. Elle indique aussi que le ministère de la culture s’engage à augmenter ses crédits d’intervention de 15 millions d’euros sur trois ans. Je m’interroge toutefois en ce qui concerne les collectivités territoriales, que l’on ne saurait obliger à quoi que ce soit : auront-elles la volonté et les moyens d’accompagner ce parcours artistique et culturel des élèves dans le cadre des projets éducatifs territoriaux ?
M. Luc Belot. Les félicitations sont souvent de rigueur à l’adresse d’un rapporteur, mais elles sont particulièrement justifiées s’agissant d’Yves Durand. Le projet de loi et l’ambition qu’il porte méritaient au demeurant un rapport de cette qualité.
Les premiers échanges – je pense notamment aux interventions de Mme Martine Faure et de M. Xavier Breton – semblent annoncer un débat de qualité. Et en dépit des désaccords que nous pouvons avoir avec M. Xavier Breton, je salue le caractère constructif de ses propos. Je ne peux toutefois en dire autant de ceux de M. Rudy Salles.
Il faut rappeler que le décret de 2008 sur les rythmes scolaires a été publié le 15 mai pour une application dès la rentrée de septembre. Ceux qui réclament plus de temps, plus de concertation et un report de la réforme de ces rythmes à 2014 devraient bien s’en souvenir !
D’autre part, s’il est vrai que le décret laissait la possibilité de faire classe le mercredi matin, ce n’était qu’à titre purement dérogatoire et après avoir pris trois avis différents assortis d’autant de votes. Les conditions posées étaient très difficiles à réunir : je le sais pour avoir obtenu une telle dérogation à Angers. Les communes appliquant la semaine de quatre jours et demi font d’ailleurs figure d’exceptions.
Non seulement le débat sur les rythmes scolaires n’a rien de nouveau, puisqu’il y a longtemps – et heureusement ! – que les acteurs de la communauté éducative s’en sont saisis, mais les expériences réalisées en ce domaine permettent de tirer des enseignements très riches.
Quant au texte évoqué par M. Benoist Apparu, même s’il n’a pas encore été publié au Bulletin officiel de l’éducation nationale, nous en connaissons en partie le contenu. Or, contrairement à ce que dit notre collègue, il ne change rien au nombre d’heures de service, qui reste fixé à 936 heures, soit 864 heures d’enseignement et 108 heures consacrées à la coordination et à la formation – et, demain, aux activités pédagogiques complémentaires. Il est donc totalement erroné d’affirmer que des heures d’enseignement seront supprimées.
Enfin, j’ai particulièrement apprécié la manière dont le rapporteur a présenté le numérique comme un nouvel outil au service de la pédagogie, qu’il permettra d’adapter aux différents publics scolaires. L’examen des amendements et celui du texte en séance publique devraient permettre d’apporter tous les compléments utiles à la réalisation de cette ambition majeure.
Mme Martine Martinel. Je ne peux que m’associer aux éloges adressés au rapporteur.
Nos collègues de l’opposition, par myopie ou mauvaise foi, semblent faire une lecture sélective du projet de loi, dont ils tentent de minimiser la portée en invoquant à tout propos la réforme des rythmes scolaires. Ils se disent tous épris de l’école, mais quand M. Benoist Apparu affirme que ce texte ne changera rien, on a le sentiment qu’il souhaite en fait que rien ne change, afin de pouvoir confirmer que tout va mal en ce domaine.
Quant aux enquêtes PISA qui, jusqu’à présent, étaient le mètre étalon pour l’évaluation du système scolaire, elles semblent ne plus avoir aucune signification pour eux depuis qu’ils sont dans l’opposition.
M. Benoist Apparu. Nous n’avons jamais dit cela !
Mme Martine Martinel. M. Patrick Hetzel qui, à la suite de certains experts, fait du développement du numérique une des causes de l’échec scolaire, semble suggérer que son entrée à l’école aurait pour corollaire l’abandon de l’usage des manuels. Mais rien, dans le projet de loi ni dans le rapport annexé, ne permet une telle conclusion. Au contraire, le numérique est présenté comme un outil d’accompagnement pédagogique.
Le rapport annexé évoque par ailleurs la formation du citoyen. Quelle place ce sujet prendra-t-il dans la scolarité, et ce dès l’école primaire ?
M. le rapporteur. Je vous remercie pour la qualité de vos interventions, qui toutes expriment une volonté d’enrichir le texte. Le débat sur les amendements s’annonce donc particulièrement intéressant.
Je vous remercie également pour les félicitations que vous m’avez accordées. Je souhaite y associer l’équipe de la Commission, qui a fait un travail remarquable, notamment au cours des nombreuses auditions que nous avons conduites.
Une grande partie de vos interrogations trouvera une réponse lors de l’examen des amendements, et je souhaite ici m’en tenir aux points les plus importants.
C’est à dessein que je n’ai pas évoqué les rythmes scolaires dans mon propos introductif. Tout d’abord, il ne me paraissait pas utile d’en rajouter sur un sujet dont on parle déjà beaucoup. Ensuite, si les rythmes scolaires sont un élément fondamental de la réforme, celle-ci ne s’y réduit pas.
Sur le sujet, le rapport d’information que M. Xavier Breton et moi-même avons cosigné en 2010 montre que tout le monde est d’accord : nous étions en effet parvenus aux mêmes diagnostics et aux mêmes conclusions. Le problème réside dans la mise en œuvre, qui relève du pouvoir réglementaire. À cet égard, et contrairement à ce qu’affirme M. Rudy Salles, le décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires est très précis.
M. Xavier Breton s’est interrogé sur l’ajout du mot « culture » à l’expression : « socle commun de connaissances et de compétences ». Nous pensons en effet que la culture fait partie du socle dont l’école doit doter les élèves, car elle contribue à la formation de leur personnalité. Une école ne pourrait viser la réussite pour tous et l’égalité devant le savoir et la connaissance si elle excluait de ce socle commun la formation artistique et culturelle.
Nous avons d’ailleurs eu ce débat lors de l’examen de la loi de 2005. Le socle commun doit-il être une sorte de « SMIC culturel et éducatif », ou bien la base permettant à chacun « d’aller au bout de ses possibles », comme l’a dit l’une d’entre vous ? C’est cette dernière conception qui est la nôtre. Il reviendra donc au Conseil supérieur des programmes de donner forme concrète à ce parcours culturel évoqué par Mme Marie-Odile Bouillé.
Il en est de même de l’apprentissage d’une langue étrangère dès le début de la scolarité obligatoire, que l’on retrouve dans tous les pays connaissant le succès en matière d’éducation. De nombreux spécialistes l’ont constaté : plus tôt on commence l’étude d’une langue étrangère, mieux c’est. En outre, l’apprentissage de l’anglais – car il s’agit bien de cette langue, de moins en moins étrangère –, nécessaire si nous voulons faire de nos enfants des citoyens du monde, n’entre nullement en concurrence avec celui du français : les deux enseignements se renforcent mutuellement.
J’en viens à l’accueil des enfants de moins de trois ans dans les écoles maternelles, qu’il ne faut pas confondre avec la scolarisation obligatoire. À six ans, un élève doit entrer à l’école primaire mais, auparavant, la scolarisation ne peut être que progressive. Si un enfant de deux ans est suffisamment mûr, sur le plan psychologique et même physique, pour intégrer le corps social que constitue l’école maternelle, alors il doit en avoir le droit.
Nous considérons par ailleurs que l’école maternelle doit être une école à part entière – ce qui répond à la question sur la transition entre la grande section et le cours préparatoire –, dotée d’une pédagogie propre et d’objectifs spécifiques en matière de développement de la personnalité ou de socialisation. Elle n’est pas une propédeutique de l’école élémentaire.
Dans l’article 23 du projet de loi, l’adjectif « régulière » ne s’applique pas à l’évaluation, monsieur Breton, mais à la progression des enseignements au sein de chaque cycle. L’évaluation, elle, peut avoir lieu à n’importe quel moment et donc se faire annuellement. En revanche, je suis d’accord avec vous pour dire qu’elle doit être indépendante. C’est d’ailleurs l’esprit de la loi et nous verrons, lors de l’examen des amendements, s’il faut l’inscrire dans sa lettre.
À propos du service public de l’enseignement numérique, j’ai déjà exprimé mes propres interrogations. Nous sommes tous d’accord, je pense, pour juger qu’il s’agit d’un levier, d’un accompagnement absolument nécessaire à la transformation pédagogique, mais qu’il ne doit en aucun cas être livré à des intérêts privés pour devenir un marché – comme le risque en existe déjà. Et, comme vous aussi, nous refusons qu’il vienne « verrouiller » le contenu de l’enseignement lui-même. C’est pourquoi cet enseignement numérique doit faire partie intégrante des sujets soumis à la réflexion du Conseil supérieur des programmes, comme outil pédagogique et comme objet de connaissance.
Je ne reviens pas sur le débat relatif au collège unique. Il s’agit d’une véritable opposition entre nous, mettant en jeu la conception que nous avons de la scolarité obligatoire et de la continuité éducative. Cette question mérite que nous en débattions en séance publique.
Il est pour le moins excessif d’affirmer que le texte ne comprend aucune disposition sur les conditions de travail des enseignants. En effet, lorsque l’ancienne majorité a supprimé, bien qu’elle s’en défende, la formation professionnelle des enseignants – je ne parle pas de leur formation universitaire, monsieur Hetzel –, elle a sérieusement dégradé leurs conditions de travail. Le seul rétablissement d’une telle formation va donc, pour eux, dans le sens d’une amélioration de ces conditions.
Le projet de loi, monsieur Apparu, ne touche en effet ni au statut des enseignants, ni à celui des établissements. C’est toute la différence entre ce que j’appelle les réformes « bricolage » et une démarche commençant par la pédagogie : plutôt que d’entreprendre une énième réforme des statuts, nous avons souhaité changer ce qui touche à l’essentiel, c’est-à-dire à la réussite des élèves, aux élèves eux-mêmes plutôt qu’aux autres acteurs de l’école. Pour ma part, j’estime que ce n’est pas parce que l’on ne touche pas à la structure, c’est-à-dire au statut des enseignants et à celui des établissements, que l’on ne fait rien. Au contraire, nous modifions ce qui fait l’essence de l’école, la transmission des savoirs et des savoir-faire, et donc la pédagogie.
Ce qu’ont dit les orateurs de la majorité au sujet des projets éducatifs territoriaux est tout à fait juste : leur contenu reste à préciser. Mais ils constituent, avec la réforme des rythmes scolaires, un extraordinaire moyen de lutter contre les inégalités devant la culture et la connaissance. Dans la mesure où les collectivités territoriales ont la responsabilité de mettre en œuvre ces deux mesures, certains affirment qu’il en résultera une aggravation des inégalités, mais c’est exactement l’inverse ! D’autant que l’inégalité existe déjà, tant l’implication de la collectivité dans les activités périscolaires diffère d’un lieu à l’autre : le rapport est d’environ un à douze. La réforme des rythmes et les projets éducatifs territoriaux – dont la mise en œuvre sera soutenue par l’État via un fonds d’amorçage – va justement inciter les communes les moins impliquées à accroître leur participation. C’est donc un facteur d’égalité. La réflexion doit toutefois se poursuivre sur les moyens d’aider les collectivités sans pour autant porter atteinte au principe de leur libre administration.
Mme Colette Langlade a souligné avec raison l’importance de la filière professionnelle. C’est un argument supplémentaire en faveur de la priorité donnée à l’école primaire et à l’école maternelle. En effet, pour que l’orientation vers la voie professionnelle soit choisie, et non subie comme elle l’est aujourd’hui, pour qu’elle devienne une voie d’excellence, ce qu’elle mérite, il faut en finir avec le déséquilibre qui caractérise la situation des élèves arrivant en sixième : les bases de l’enseignement primaire, notamment en matière de lecture et en mathématiques, doivent être acquises.
Selon certains, nous aurions fait des « cadeaux » aux professeurs des écoles. Connaissant la situation de ces derniers, s’agissant du salaire comme des conditions de travail, c’est un terme qu’il vaudrait mieux éviter : n’oublions pas qu’ils sont recrutés au même niveau de diplôme que les enseignants du secondaire – ce qui est une bonne chose –, mais qu’ils ne perçoivent pas les mêmes rémunérations. Quoi qu’il en soit, ils n’ont obtenu aucune réduction du nombre d’heures d’enseignement : ils seront toujours vingt-quatre heures par semaine devant les élèves. La seule modification concerne la répartition des fameuses 108 heures annualisées.
Enfin, s’agissant des rythmes scolaires, et quels que soient les arguments présentés par l’opposition, le décret du 15 mai 2008 a bien eu pour effet de ramener brutalement à quatre jours la semaine d’un écolier. Et c’est bien la semaine des quatre jours qui a été appliquée dans la très grande majorité des communes – à l’exception de quelques-unes qui ont obtenu des dérogations –, ce qui a entraîné une véritable catastrophe pédagogique. Il est donc inutile d’invoquer une incidente dans le corps d’une circulaire pour chercher à justifier l’injustifiable.
Telles sont, mes chers collègues, les réponses partielles – mais non partiales – que je souhaitais vous apporter. Lors de l’examen des amendements, mercredi prochain, je ne doute pas que nous connaîtrons une ambiance de travail aussi sérieuse qu’aujourd’hui.
La Commission des affaires culturelles et de l’éducation examine les articles du projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République lors de ses séances des mercredi 27 et jeudi 28 février 2013.
M. le président Patrick Bloche. Après avoir procédé, la semaine dernière, à la discussion générale sur le projet de loi, la Commission aborde, ce mercredi 27 février matin, la discussion des articles.
Nous poursuivrons nos travaux cet après-midi mais non ce soir, car nos collègues de l’UMP, qui ont beaucoup de talent, ont préféré nous mobiliser dans l’hémicycle pour une séance de questions au ministre de l’éducation nationale. De ce fait, j’ai prévu une autre séance de travail demain matin.
Afin de faire respecter les dispositions de l’article 40 de la Constitution, et après avoir consulté la Commission des finances, soixante et onze amendements ont été déclarés irrecevables puisqu’ils aggravaient la charge publique. Pour le reste, 622 amendements sont toujours en discussion.
M. Frédéric Reiss. N’est-il pas normal de profiter de la disponibilité du ministre pour procéder à une séance de questions ?
M. le président Patrick Bloche. Mais si ! C’est pourquoi j’ai salué votre talent.
La Commission entame l’examen des articles.
Article 1er
Approbation du rapport annexé présentant les objectifs de la politique d’éducation
Cet article a pour objet l’approbation du rapport annexé au présent projet de loi, qui présente « la programmation des moyens et les orientations de la refondation de l’école de la République ».
Le contenu de ce document ayant été synthétisé dans l’exposé général du présent rapport, ne seront commentés, ici, que l’intérêt et le cadre juridique d’une telle procédure, qui n’a rien d’exceptionnel.
Le recours au rapport annexé permet au gouvernement de détailler, dans un document débattu devant la représentation nationale, qui peut l’amender, les objectifs, ainsi que les moyens et leur « doctrine d’emploi », de tel ou tel domaine de l’action publique. Ainsi, dans le cas d’espèce, son approbation formalisera, de manière solennelle, les engagements pris conjointement par le gouvernement et le Parlement en matière d’éducation.
Par ailleurs, l’exercice n’est pas nouveau, en particulier dans ce domaine de l’éducation. En effet, le législateur a déjà débattu de rapports annexés lors de l’élaboration des lois du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation (loi « Jospin ») et du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École (loi « Fillon »).
Néanmoins, la possibilité pour le Parlement de délibérer sur un rapport annexé est désormais strictement encadrée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui sanctionne les dispositions non normatives des textes législatifs en vertu du principe selon lequel « la loi a pour vocation d’énoncer des règles et doit par suite être revêtue d’une portée normative » (décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004).
Pour autant, le Conseil constitutionnel a jugé que le grief tiré du défaut de portée normative ne saurait être opposé aux orientations présentées dans un rapport annexé à une loi dès lors qu’il s’agit de mettre en œuvre les dispositions de l’article 34 de la Constitution relatives aux lois de programmation (décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011).
Ces lois de programmation, qui se sont substituées aux anciennes lois de programme lors de la révision constitutionnelle de 2008, « déterminent les objectifs de l’action de l’État ». Depuis la révision de 2008, elles peuvent intervenir dans tous les domaines, et non plus uniquement dans le champ de « l’action économique et sociale » aux termes de l’ancienne rédaction de l’article 34. Le précédent gouvernement en a d’ailleurs largement usé en matière de sécurité ou de politique pénale (135).
Le présent article et le rapport annexé permettant incontestablement de « déterminer » les « objectifs de l’État » en matière d’éducation, et d’en programmer les moyens, nul doute qu’il s’agisse en l’espèce d’une mise en œuvre de l’article 34 de la Constitution.
La qualité de loi de programmation du présent projet de loi emporte une autre conséquence de nature constitutionnelle tenant à la procédure de consultation du Conseil économique, social et environnemental (CESE) préalablement à la délibération du Parlement.
En effet, selon l’article 70 de la Constitution, « tout plan ou projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental » est soumis pour avis au CESE. Cette obligation s’étend au rapport annexé. En 2005, l’omission de cette formalité, que le Conseil constitutionnel a jugée substantielle, avait d’ailleurs conduit à la déclaration de non-conformité à la Constitution de l’article de la loi « Fillon » approuvant le rapport qui lui était annexé (décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005).
S’agissant du présent projet de loi, le gouvernement s’est attaché à consulter le Conseil économique, social et environnemental en le saisissant dès le 20 décembre 2012. Lors de sa séance plénière du 16 janvier 2013, ce dernier a rendu un avis favorable sur l’avant-projet de loi.
À l’initiative du rapporteur, la Commission a modifié la rédaction du présent article afin que celui-ci reprenne le titre exact du rapport annexé. Elle a par ailleurs apporté de nombreuses modifications au rapport annexé lui-même.
*
La Commission examine l’amendement AC 138 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Nous proposons de supprimer l’article, considérant que le rapport annexé n’est pas du niveau législatif.
M. Yves Durand, rapporteur. Avis défavorable. En 2005, le Conseil constitutionnel a considéré qu’un rapport annexé avait sa place dans la « loi Fillon ».
M. Xavier Breton. La réponse est strictement juridique. Dans le cas présent, nous nous interrogeons sur l’opportunité d’intégrer au projet de loi un rapport annexé, dont la rédaction, tour à tour redondante et contradictoire, prête à confusion.
M. Patrick Hetzel. La discussion du texte serait grandement facilitée si l’on supprimait l’article 1er ! Au reste, l’argument du rapporteur ne tient pas : quand le Conseil constitutionnel avait approuvé l’intégration du rapport annexé à la « loi Fillon », le groupe socialiste avait protesté de manière véhémente. Faut-il vous rappeler vos arguments d’alors ?
M. le président Patrick Bloche. Même s’il est tentant d’adopter un amendement qui en ferait tomber cent soixante-neuf autres, je suis convaincu par la position du rapporteur.
M. le rapporteur. Le rapport a son utilité : il ouvre des pistes qui se concrétisent dans le texte et définit des orientations pour la suite. Je suis donc juridiquement et politiquement défavorable à l’amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AC 28 du rapporteur.
M. le président Patrick Bloche. Nous en venons aux amendements portant sur le rapport annexé.
La Commission examine l’amendement AC 256 de M. Benoist Apparu.
M. Benoist Apparu. Nous proposons de substituer au rapport annexé, que nous jugeons vide de sens et faible de contenu, un autre rapport qui reflète notre vision de la refondation de l’école. Nous préconisons de jouer sur deux leviers : le statut des enseignants et celui des établissements.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Votre projet de rapport annexé repose sur une autre logique que le nôtre, ce qui le rend hors sujet par rapport au texte. C’est par la pédagogie et non par les statuts que nous proposons de refonder l’école.
M. Claude Goasguen. Le rapport annexé à l’article 1er devrait figurer dans l’exposé des motifs. Si vous optez pour un exposé des motifs politique, ce qui est votre droit, ne vous plaignez pas que l’opposition use du sien pour proposer sa propre vision du problème. Quoi qu’il en soit, nous saisirons le Conseil constitutionnel pour savoir si un article 1er peut abriter un texte de cette nature.
M. Benoist Apparu. Il ne peut y avoir de hors sujet, dès lors qu’il s’agit de redessiner la vision politique de l’école pour les dix prochaines années. Par ailleurs, je récuse l’artifice qui consiste à opposer l’approche statutaire et l’approche pédagogique. S’appuyer sur le statut des établissements ou des enseignants est en soi une révolution pédagogique.
M. Frédéric Reiss. En général, une loi d’orientation et de programmation a vocation à durer quinze ans. Ce fut le cas pour la « loi Jospin », et celle de M. Fillon s’applique depuis déjà huit ans. Dans le présent projet de loi, les articles qui concernent les moyens ne dépassent pas la durée de la législature, preuve qu’il vous manque une vision à moyen et à long terme, pour faire baisser de manière significative le nombre d’élèves en difficulté lors de leur entrée en sixième.
Mme Annie Genevard. La rédaction de l’amendement est d’une grande qualité. En outre, celui-ci envisage l’autonomie des établissements, dont un document paru sous l’égide du ministère montre qu’elle améliore les performances de l’école.
M. le rapporteur. Je ne nie pas la qualité tant littéraire qu’idéologique du rapport proposé par M. Benoist Apparu, mais sa logique ne correspond pas à celle du projet de loi.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement AC 341 de M. Gérald Darmanin.
Mme Virginie Duby-Muller. Nous regrettons que le mot « physique » ne figure pas dans l’alinéa 4, alors que, selon plusieurs études, les enfants les plus performants sur le plan cognitif, en matière d’attention, de concentration et de réflexion, font régulièrement du sport.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Le sport est mentionné dans le projet de loi ainsi que dans les alinéas 221, 222 et 223 du rapport annexé. Il n’y a donc pas lieu de modifier l’alinéa 4.
M. Guénhaël Huet. C’est faux : le sport n’est pas mentionné dans le texte. Comment un projet de loi préparé en concertation avec nombre d’organismes peut-il à ce point mépriser les activités sportives, qui font partie intégrante de la pédagogie ?
M. Thierry Braillard. Je partage en partie l’avis de M. Guénhaël Huet, mais le mot « social » recouvre les activités sportives. Nous proposerons ultérieurement des ajouts plus précis et plus opportuns.
M. Pascal Deguilhem. Les alinéas déjà cités du rapport annexé portent sur le sport scolaire, auquel le ministre a redonné, dès la rentrée, des moyens que le précédent gouvernement avait supprimés.
M. le rapporteur. Que nos collègues se rassurent : le projet de loi prendra place dans le code de l’éducation, qui mentionne explicitement le sport.
La Commission rejette l’amendement.
Elle aborde ensuite l’amendement AC 278 de M. Benoist Apparu.
M. Benoist Apparu. Une loi ne doit pas relever de la politique politicienne. Il est déplacé d’écrire dans ce texte que les problèmes de l’école ne se posent que depuis dix ans. J’admets qu’ils ont perduré, mais n’imaginons pas qu’il existait avant 2002 un temps béni pour l’école de la République !
M. le rapporteur. Avis défavorable. Tenons-nous en aux faits : les enquêtes nationales ou internationales pointent depuis dix ans une cassure nette dans la réussite scolaire et une augmentation de l’échec scolaire. En interprétant cette précision de manière uniquement électorale, vous avouez vos propres turpitudes.
M. Benoist Apparu. Au lieu d’analyser sérieusement et objectivement les difficultés qui se posent à l’école depuis des années, ce qui pourrait déboucher sur un travail utile et intéressant, vous vous focalisez à tort sur les seules difficultés apparues depuis dix ans seulement.
La dernière enquête PISA (Programme for International Student Assessment), qui pointait, en 2009, les failles de notre système éducatif, a été réalisée sur des élèves de quinze ans, entrés au CP en 1999-2000, quand M. Jospin était Premier ministre et M. Lang ministre de l’éducation nationale. Les précédentes, de 2006 et de 2003, portent sur des élèves entrés au CP au début des années quatre-vingt-dix. N’écrivons pas dans la loi que toutes les difficultés de l’école ne remontent pas à plus de dix ans : ce serait une supercherie politique.
Mme Annie Genevard. Je rappelle qu’en vingt ans, il y a eu en moyenne un professeur en plus pour douze élèves en moins.
M. Xavier Breton. L’amendement est symbolique. On peut apprécier d’une manière ou d’une autre le bilan des derniers mandats, mais ce serait un très mauvais signal que de le politiser, puisque l’état de notre système éducatif est le fruit d’un cycle d’une trentaine d’années. Le premier test PISA remonte à 2000. Nous ne disposons donc pas de chiffres plus anciens.
M. Michel Herbillon. Si j’apprécie la courtoisie du rapporteur, qui tranche avec l’insolence, voire le mépris montré par le ministre dans l’hémicycle, sa réponse ne me convainc pas. Qui peut croire que la référence à une période de dix ans soit innocente ? Il est regrettable que le texte commence par cette provocation. Je propose un sous-amendement visant à remplacer « dix ans » par « de longues années », voire par« dix-sept ans, à l’exception de la période irénique comprise entre 1997 et 2002, au cours de laquelle M. Jospin était Premier ministre ».
M. Claude Goasguen. Avec l’alinéa 7 du rapport annexé, vous allez au-delà de la confusion entre l’exposé des motifs et le dispositif : vous inaugurez un principe juridique dangereux. En indiquant le moment où les difficultés ont, selon vous, commencé, vous fixez une date pour le début de l’application de la loi. Tel n’était pas le cas dans le rapport annexé à la loi Fillon de 2005. En effet, que signifiera, dans cinq ans, la phrase « les difficultés sont nées il y a une dizaine d’années » ? Sur le plan juridique, la loi n’est pas bornée dans le temps : elle est faite pour l’éternité. À défaut, nous allons désormais adopter des lois provisoires.
Vous confondez la rédaction d’un rapport annexé avec celle d’une protestation politique. Un rapport annexé contient en principe des éléments techniques. Tel n’est pas le cas de cet alinéa.
D’autant que la période précédente – notamment les ministères de MM. Jospin, Allègre et Lang – n’a pas été particulièrement heureuse pour l’éducation nationale. Rappelez-vous le temps où aucune évaluation n’était réalisée ! D’ailleurs, avec ce texte, vous faites preuve d’une mauvaise foi caractérisée en la matière : comme l’évaluation révélait les problèmes, vous la remettez en cause et tout ira forcément mieux ! Votre attitude n’est pas seulement politicienne, elle est inédite en matière d’élaboration de la loi.
M. Rudy Salles. Je suis d’accord avec M. Benoist Apparu : les problèmes de l’éducation nationale s’inscrivent dans le temps long. Les études réalisées portent sur les quinze ou vingt dernières années : la référence à « une dizaine d’années » est donc dépourvue de sens. Je soutiens la proposition de M. Michel Herbillon consistant à la remplacer par « de nombreuses années ». Cela redonnerait de la crédibilité à ce projet de loi. Contrairement à ce que prétend la majorité, tous les groupes politiques s’intéressent à l’école. Nous souhaitons apporter notre contribution et faire un travail sérieux.
M. Thierry Braillard. M. Benoist Apparu l’a lui-même écrit dans son amendement AC 256 qui visait à récrire le rapport annexé : l’application de la loi de 2005 a été un « demi-échec ». Or cela fait près de dix ans que cette loi a été adoptée. Nous sommes donc bien d’accord : les problèmes de l’école se sont accrus depuis une dizaine d’années.
M. Guénhaël Huet. Je rappelle le titre du texte : « projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République ». Si les mots ont un sens, c’est un acte politique fort. Sur un sujet aussi important, sans doute l’un de plus sérieux sur lequel notre assemblée est amenée à se prononcer, nous devrions pouvoir partir d’un constat sinon objectif, du moins impartial. La sagesse voudrait que nous nous accordions sur l’amendement de synthèse de M. Michel Herbillon : la formule « depuis de nombreuses années » n’insulterait personne. Alors que nous entamons ce débat, vous feriez preuve, chers collègues de la majorité, d’une certaine ouverture et de votre volonté de débattre avec l’opposition. Ce projet de loi nous concerne tous et dépasse les querelles de chapelles et les idéologies.
Mme Martine Faure. L’alinéa 7 est précédé de l’alinéa 6, qui indique notamment que « depuis près de vingt ans, notre école ne progresse plus ». Vous faites preuve de mauvaise foi, chers collègues de l’opposition, dans la manière dont vous interprétez ces alinéas.
M. Michel Herbillon. La formule « depuis de nombreuses années » ne devrait poser de problème à personne. Nous en convenons tous : l’école n’a pas commencé à se dégrader il y a dix ans. À moins que vous ne souhaitiez imposer une vérité qui ne correspond en rien à la réalité ! Vous feriez preuve d’ouverture, monsieur le rapporteur, monsieur le président, en acceptant ce sous-amendement.
M. le rapporteur. Je ne pensais pas que le rapport annexé poserait autant de problèmes. Il me semble que vous les créez, chers collègues de l’opposition. L’alinéa 7 énonce simplement un fait que tout le monde reconnaît : le nombre d’élèves en difficulté face à l’écrit en 6ème s’est accru depuis une dizaine d’années. Nous ne disons nullement que cela tient à la politique menée par les gouvernements de l’époque. Nous pourrions d’ailleurs être encore plus précis : toutes les enquêtes, tant nationales qu’internationales, montrent que cette augmentation a été encore plus forte depuis cinq ans.
Ne voyez pas malice là où il n’y en a pas ! Évitons ce genre de débats. Je maintiens mon avis défavorable.
M. Patrick Hetzel. Le rapporteur le dit lui-même : évitons ce genre de débats. Toute la difficulté tient au fait que le rapport annexé est de nature non pas législative, mais politique, à l’instar d’un exposé des motifs. La meilleure solution aurait été de supprimer l’article 1er, comme je le proposais avec l’amendement AC 138. Nous nous serions simplifié le travail.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement AC 307 de M. Benoist Apparu.
M. Benoist Apparu. Cet amendement vise à préciser dans le rapport annexé que le taux de 80 % d’une classe d’âge au niveau du baccalauréat a été atteint pour la première fois en 2012. Cet objectif politique avait été fixé par M. Chevènement. Le symbole est important.
M. le rapporteur. Si tel était le cas, je m’en féliciterais. Mais il convient d’être très prudent : ce taux n’a été atteint qu’une année donnée, de manière tout à fait conjoncturelle. En 2012, des cohortes plus nombreuses sont arrivées au niveau du baccalauréat en grande partie en raison d’un effet mécanique de la réforme des lycées, qui a réduit de quatre à trois ans la durée des cursus menant au baccalauréat professionnel. Cela ne signifie pas que l’objectif est rempli de manière durable. Votre raisonnement est un peu fallacieux. Avis défavorable.
M. Frédéric Reiss. L’argumentation développée par M. le rapporteur n’est pas satisfaisante. En 2012, non seulement plus de 80 % de la classe d’âge a atteint le niveau du baccalauréat, mais 77,5 % ont obtenu le diplôme du baccalauréat. Cette progression doit en effet beaucoup à la forte hausse du taux d’accès au baccalauréat professionnel, conséquence de la réforme des lycées. Néanmoins, nous avons réalisé de nets progrès au regard des objectifs de M. Chevènement, qui ont été confirmés dans la loi de 2005.
Mme Annie Genevard. Pourquoi cette réalité serait-elle moins pertinente que celle énoncée par l’alinéa 7 ? Pourquoi la référence temporelle à l’année 2012 serait-elle moins valable que celle des dix dernières années ? Nous comprenons mal une telle différence de traitement.
Mme Brigitte Bourguignon. Votre argumentation contredit celle que vous avez développée pour défendre l’amendement précédent : dans un cas, vous refusez la référence aux dates ; dans l’autre, vous souhaitez mettre en avant une date qui vous convient davantage.
M. Xavier Breton. Si l’amendement précédent avait été adopté, nous aurions probablement retiré celui-ci.
C’est un fait avéré : 80 % de la classe d’âge a atteint le niveau du baccalauréat en 2012. Au nom de quoi refuse-t-on de le mentionner ? Il n’est pas honnête de trier les faits en ne retenant que ceux qui vous arrangent. Cela pose un vrai problème d’objectivité. Vous transformez ce projet de loi en tract électoral !
En outre, la participation du ministre de l’éducation nationale à nos débats aurait permis des échanges plus libres. Il ne faudrait pas que M. le rapporteur se fasse le porte-parole du ministre et refuse toute modification du texte ! Réintroduisons de la liberté et de l’audace dans notre discussion.
M. Claude Goasguen. Personne n’est dupe : vous inscrivez dans le texte les arguments politiques qui vous arrangent et rejetez les autres. En matière d’élaboration de la loi, c’est une méthode originale et nouvelle !
Vous nous servez un mauvais discours de préau d’école ! Vous affirmez que l’accès de plus de 80 % d’une classe d’âge au niveau du baccalauréat en 2012 relève de la conjoncture, mais que les difficultés de l’éducation nationale constituent, elles, un fait objectif. Comment pouvez-vous, M. le rapporteur – vous qui, comme moi, connaissez bien l’éducation nationale –, tenir de tels raisonnements ?
M. Guénhaël Huet. Il existe non pas une contradiction, mais un lien logique entre cet amendement et le précédent : nous nous contentons, dans les deux cas, de constater des faits. S’agissant de l’amendement précédent, chacun sait que les difficultés de l’école sont bien antérieures à la dernière décennie. Avec cet amendement-ci, nous relevons simplement que le taux de 80 % d’une classe d’âge au niveau du baccalauréat a été « atteint pour la première fois en 2012 ». Il est difficile d’être plus mesuré, précis, factuel. Il ne s’agit pas d’idéologie, mais de faits. Je ne comprends pas pourquoi M. le rapporteur s’oppose à ce simple constat. L’accepter, monsieur le président, nous éviterait de prolonger nos débats.
M. Michel Françaix. À la différence de M. Claude Goasguen, je ne connais rien à l’éducation nationale et j’aimerais donc en apprendre un peu plus. Aussi, évitons de débattre pendant des heures d’aspects formels, inutiles et dépassés, et concentrons-nous sur le fond ! Nous y gagnerions tous.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement rédactionnel AC 60 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit de l’intitulé exact du diplôme national du brevet.
M. Patrick Hetzel. Les spécialistes de l’éducation nationale le savent : il convient d’employer non pas le terme usuel « brevet des collèges », mais la dénomination technique « diplôme national du brevet ». Il est très surprenant qu’un texte provenant du ministère de l’éducation nationale et validé au cours de plusieurs réunions interministérielles comporte une telle erreur. Cela révèle l’amateurisme du gouvernement et le peu de respect qu’il a pour le Parlement.
M. le rapporteur. Je rectifie la rédaction proposée par le ministre : cela montre bien que je ne suis pas son porte-parole ! En revanche, je soutiens pleinement, quant au fond, ce projet de loi essentiel pour l’avenir de l’école.
M. Xavier Breton. J’en donne acte à M. le rapporteur. Je souhaite néanmoins qu’il s’affranchisse du texte sur d’autres points que les aspects purement rédactionnels.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine l’amendement AC 361 de Mme Martine Carrillon-Couvreur.
M. Hervé Féron. Il s’agit d’introduire la notion d’école « inclusive » à l’alinéa 15 du rapport annexé. Il convient de donner un nouvel élan aux politiques d’inclusion et de définir leur contenu. Le mot « inclusive » témoigne d’une nouvelle ambition : faire en sorte que chaque enfant soit effectivement accompagné au sein de l’école.
M. le rapporteur. Avis favorable.
Mme Marie-George Buffet. Je soutiens cet amendement, qui précise notre ambition pour l’école. Dans la suite de nos débats, il conviendra de soulever la question du statut des personnels chargé de l’accompagnement de certains enfants. Ils souffrent aujourd’hui d’une grande précarité. Nous avons besoin de personnels bien formés, qui bénéficient d’un véritable déroulement de carrière et d’une validation de leurs acquis.
Mme Annie Genevard. L’emploi du terme « inclusif » relève d’une sorte de mode langagière. Cette précision n’apporte rien, selon moi, à la notion de justice : une école juste est une école capable d’intégrer des enfants handicapés. Cet ajout affaiblirait davantage le propos qu’il ne l’enrichirait.
M. Xavier Breton. Nous débattons là d’un point important : les objectifs fixés à l’école par la nation. La présentation des auteurs de l’amendement est succincte : au-delà des bonnes intentions, que veut dire le mot « inclusif » ? Où cette volonté d’inclusion se retrouve-t-elle dans le texte ? Il ne faut pas se contenter d’un affichage.
M. Patrick Hetzel. Je ne comprends pas cette formulation, qui relève davantage de la novlangue que d’une terminologie juridique rigoureuse. Les auteurs de l’amendement peuvent-ils en préciser le sens ? Nous pourrons peut-être alors trouver le terme qui convient.
M. Frédéric Reiss. J’ai également du mal à comprendre cette rédaction. J’y insiste : l’école n’a jamais fait autant de progrès que depuis dix ans en matière de scolarisation des enfants handicapés. Ces enfants sont aujourd’hui scolarisés en milieu ordinaire et cela se passe très bien. Je suis néanmoins d’accord avec Mme Marie-George Buffet : des difficultés demeurent en ce qui concerne le statut des personnels d’accompagnement.
M. Paul Salen. D’après le dictionnaire, l’adjectif « inclusif » signifie « qui comprend en soi ». Les auteurs de l’amendement peuvent-ils préciser leurs intentions ? Peut-être soutiendrons-nous alors cet amendement.
M. Guénhaël Huet. Même remarque. Une loi n’est pas seulement un exercice de rhétorique parlementaire : elle s’adresse à des destinataires. Que signifie « une école la fois juste et inclusive pour tous et exigeante pour chacun » ? Comment cette formule – générale et vaporeuse – sera-t-elle reçue par l’opinion publique et par les destinataires de la loi ? Nous allons être assaillis de questions. Les auteurs de l’amendement devraient nous fournir davantage d’explications.
M. Hervé Féron. Il n’est pas étonnant que nos collègues de l’UMP éprouvent des difficultés à comprendre notre amendement, qui manifeste notre volonté de promouvoir l’égalité des chances et de faire en sorte que chacun trouve sa place – toute sa place – au sein de l’école. Ce n’est pas toujours le cas et il convenait donc d’apporter cette précision. Je ne partage pas l’avis de M. Frédéric Reiss au sujet des progrès accomplis : dans certains territoires, les conditions de scolarisation des enfants handicapés se sont dégradées au cours des dix – et plus particulièrement des cinq – dernières années.
Mme Barbara Pompili. Plusieurs collègues du groupe UMP, membres du groupe d’études sur l’intégration des personnes handicapées, ont cosigné un amendement à l’article 3 dans lequel il est aussi fait référence à l’école inclusive : peut-être pourraient-ils, chers collègues de l’opposition, vous expliquer le sens de cette expression.
M. Xavier Breton. J’ai cosigné l’amendement dont vous parlez, madame Pompili, car il a toute sa place à l’article 3. L’article 1er, lui, définit les objectifs généraux : quel est le sens précis, dans ce contexte, du mot « inclusive » ?
Mme Annie Genevard. Personne ne conteste le fait que l’école doit accueillir les enfants atteints de handicap. Nous nous interrogeons seulement sur le choix d’un terme et sur sa place dans le texte.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AC 84 de M. Frédéric Reiss.
M. Frédéric Reiss. Compte tenu de l’évolution technologique et informatique, la loi du 23 avril 2005 avait instauré le principe d’un socle commun de connaissances et de compétences. Aux termes de l’article 7 du présent texte, « la scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition » de ce socle. Je propose donc de remplacer, à l’alinéa 17 du rapport annexé, l’expression « tous les élèves » par l’expression « chaque élève ».
M. le rapporteur. Sans vouloir m’attarder sur des questions sémantiques, je comprends le sens de cet amendement, dont on voit bien qu’il traduit un débat entre deux conceptions de l’école : la première repose sur une individualisation qui passe par la sélection ; la seconde, qui est la nôtre, est d’assurer la réussite de tous les élèves, quelles que soient leurs origines, leurs difficultés ou leurs histoires individuelles. Avis défavorable.
M. Xavier Breton. La massification de la scolarisation a été l’une des réussites du XXe siècle ; pour notre système éducatif, l’enjeu est désormais la personnalisation. L’amendement traduit bien cet objectif ; au surplus, l’article 7 évoque lui aussi la réussite de « chaque élève » : en ce sens, il s’agit d’un amendement de cohérence. Vous ne pouvez, sans débats, rejeter tous les amendements de l’opposition et adopter tous ceux de la majorité.
Mme Julie Sommaruga. J’approuve les arguments du rapporteur. Comment en appeler à l’individualisation après avoir supprimé, pendant des années, des postes dans l’éducation nationale ? De ce point de vue, chers collègues de l’opposition, votre amendement n’a aucune cohérence.
Mme Annie Genevard. En vingt ans, madame Sommaruga, le nombre d’élèves par professeur a diminué.
Lorsque M. Frédéric Mitterrand, alors ministre de la culture et de la communication, a lancé son programme dit de « culture pour chacun », on lui a objecté qu’il valait mieux parler de « culture pour tous ». Il y a là plus qu’une nuance sémantique : l’objectif de l’individualisation est qu’aucun élève ne sorte de l’école sans qualification et sans maîtriser les savoirs fondamentaux. Il impose donc une forme de responsabilité vis-à-vis de chaque enfant, responsabilité que l’expression « pour tous » a précisément tendance à diluer.
M. Patrick Hetzel. Nous sommes en effet au cœur du sujet.
L’amendement revient à fixer un objectif de résultat, car nous devons être en mesure d’évaluer le système éducatif ; mais comment le faire sans apprécier la réussite de chaque élève ? C’est d’ailleurs l’objectif affiché du gouvernement à travers ce texte. L’amendement est donc de cohérence.
M. Frédéric Reiss. Au vu de la rédaction de l’article 7, que j’ai rappelée, je suis étonné par l’avis défavorable du rapporteur.
M. Guénhaël Huet. Si chacun ne réussit pas, comment tous pourraient-ils le faire ? Je ne vois pas où est la contradiction. Faites preuve d’un peu d’ouverture, monsieur le rapporteur : votre obstination, surtout si elle devait témoigner d’idéologies réactionnaires et dépassées, ne me semble pas de bon aloi. Si vous n’acceptez pas l’amendement, allez au moins au bout de votre logique en refusant le soutien et l’évaluation individualisés.
M. le président Patrick Bloche. Nous n’en sommes qu’au neuvième amendement sur 622 : il est peut-être un peu tôt pour juger de l’esprit d’ouverture du rapporteur…
M. Claude Goasguen. Je souhaite venir en aide au rapporteur.
Si l’expression dont nous débattons figurait dans l’exposé des motifs, elle serait sans conséquence. Mais un texte de loi doit être irréprochable sur le plan du droit. De ce point de vue, le choix entre « tous » et « chacun » est d’importance : le premier terme suppose une obligation de résultats ; le second, une obligation de moyens et de résultats. La solution la plus prudente me semble donc de réserver le terme de « chacun » à l’exposé des motifs et celui de « tous » au texte de la loi ; faute de quoi, des parents pourraient attaquer l’éducation nationale en justice au motif qu’elle n’a pas donné à leur enfant les moyens de maîtriser telles ou telles connaissances.
M. Pascal Deguilhem. Ce débat me rappelle celui de la poule et de l’œuf. Le terme « chacun » figure explicitement dans les alinéas suivants. La somme des réussites individuelles constituant la réussite collective, la rédaction actuelle me semble tout à fait adaptée.
Mme Sophie Dessus. Cette discussion est quelque peu ubuesque. Ne peut-on écrire « pour tous et pour chacun », puis passer à l’amendement suivant ?
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AC 305 de M. Benoist Apparu.
M. Benoist Apparu. L’amendement est défendu.
M. le rapporteur. L’amendement est sympathique ; mais tenons-nous en à des ambitions réalistes. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle rejette également, suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement AC 85 de M. Frédéric Reiss.
Puis elle examine l’amendement AC 306 de M. Benoist Apparu.
M. Benoist Apparu. Il convient de maintenir l’objectif des 80 % d’une classe d’âge au baccalauréat, dès lors qu’il a été atteint.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 280 de M. Benoist Apparu.
M. Benoist Apparu. Une loi ne doit pas être bavarde, il faut le rappeler. En l’occurrence, celle-ci l’est. Je propose donc de supprimer les alinéas 22 à 25, selon lesquels l’ensemble de la communauté éducative doit se mobiliser pour atteindre les objectifs fixés par la loi.
M. le rapporteur. Cet amendement touche à la substance du projet de loi. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AC 362 de Mme Sylvie Tolmont.
Mme Sylvie Tolmont. Je défendrai également, par cette intervention, l’amendement AC 363.
La qualité de l’information et de l’orientation est l’une des conditions de la réussite des élèves. Or le choix de l’orientation est un parcours du combattant pour eux, mais aussi pour leurs familles et les enseignants qui assurent cette mission. Il me paraît important, dans ces conditions, de rappeler le rôle central des conseillers d’orientation psychologues et de les inclure dans la communauté éducative. Ainsi, ils participeraient à l’accompagnement des mesures de refondation de l’école, comme le précise l’amendement AC 363.
M. le rapporteur. Je suis favorable à chacun de ces deux amendements.
M. Patrick Hetzel. Pourquoi, monsieur le rapporteur, le ministère avait-il oublié les conseillers d’orientation psychologues ? Une telle omission montre à tout le moins que le texte a été rédigé dans la précipitation.
La Commission adopte successivement les amendements AC 362 et AC 363.
Puis elle examine les amendements identiques AC 279 de M. Benoist Apparu et AC 86 de M. Frédéric Reiss.
M. Benoist Apparu. La formule utilisée à l’alinéa 23 figure déjà, presque terme pour terme, à l’alinéa 15 : cela me semble beaucoup, pour une loi qui n’est pas censée être bavarde.
M. Frédéric Reiss. Pour l’amendement AC 86, l’argument est le même. Mon amendement AC 87 est de cohérence rédactionnelle.
M. le rapporteur. Dans l’esprit d’ouverture qui me caractérise, je suis favorable à ces deux amendements.
La Commission adopte les amendements.
Puis elle adopte, suivant l’avis favorable du rapporteur, l’amendement AC 87 de M. Frédéric Reiss.
Elle examine ensuite l’amendement AC 188 de M. Frédéric Reiss.
M. Frédéric Reiss. Le gouvernement souhaite rendre le métier d’enseignant plus attractif pour les jeunes. Dans ce contexte, une réécriture de l’alinéa 26 me paraît souhaitable, afin que le statut des enseignants prenne en compte « tout le travail d’accompagnement des élèves, leur formation, en particulier dans le 1er degré, ainsi que la revalorisation du métier ».
M. le rapporteur. Je partage la préoccupation dont témoigne cet amendement, d’autant qu’une réflexion sur le métier et le statut d’enseignant s’impose. Néanmoins, celle-ci n’est pas directement liée au texte dont nous débattons : le gouvernement s’y attellera, mais elle sera forcément longue et difficile. Avis défavorable.
M. Benoist Apparu. Il faut s’interroger sur le contenu de ce projet de loi dit de « refondation », dont le rapporteur nous dit qu’il exclut des sujets aussi importants que le statut des enseignants – lequel, à en croire le ministre, fera prochainement l’objet d’une réflexion. Une loi d’orientation et de programmation n’a-t-elle pas pour objectif de tracer les perspectives pour les dix – ou quatre – années à venir ? Les objectifs de la nation et du gouvernement qui figurent dans le rapport annexé ne doivent-ils pas inclure le plus grand nombre de sujets ?
Dans l’introduction du rapport annexé, le rapporteur explique que la politique éducative du gouvernement ne se résume pas à ce projet de loi, puisqu’elle fera l’objet de dispositions réglementaires ; aussi le rapport annexé en vient-il à énumérer l’ensemble des sujets exclus du projet de loi.
Si un tel amendement n’a pas sa place dans le texte, c’est que celui-ci n’est pas un projet de loi d’orientation.
M. Xavier Breton. On peut en effet s’interroger sur la portée de ce projet de loi de refondation si de tels sujets n’y sont pas évoqués, alors même que son exposé des motifs indique que les conditions de travail des enseignants doivent être revalorisées. La seule référence à cet objectif se trouve à l’alinéa 26 du rapport annexé, qui annonce « la mise en place d’une formation initiale professionnalisante pour les personnels avec les écoles supérieures du professorat et de l’éducation ».
Si le chantier de la revalorisation du statut des enseignants s’engage, une loi d’orientation et de programmation doit en faire état ; faute de quoi elle apparaîtrait ambiguë et hypocrite.
M. Mathieu Hanotin. Que changerait la réécriture proposée ? Sans doute pas le statut des enseignants, puisque l’amendement prévoit que l’effort portera « notamment » sur ce point, ce qui n’est donc pas exclusif ; en outre, il préconise de « réinvestir dans les moyens humains de manière qualitative ». L’aspect quantitatif, lui, semble exclu : vous devriez au moins assumer cette position.
M. Patrick Hetzel. Cet amendement n’a pas du tout l’esprit qu’on vient de lui prêter : il se termine par une référence à la « revalorisation du métier », question centrale pour la refondation de l’école. Je rappelle que le statut et les missions des enseignants sont définis par un décret des années cinquante. Je m’étonne donc que ces points ne soient guère développés dans le projet de loi.
M. Guénhaël Huet. Fixer des objectifs dans une loi d’orientation, qui par définition porte sur les années à venir, me semble être la moindre des choses – ou alors il faut avouer qu’elle n’a aucune ambition, comme cela semble être le cas. Quant aux moyens, ils relèvent des projets de loi de finances. Loin d’être gênants, les principes énoncés dans l’amendement renforceraient donc la portée du texte.
Mme Marie-George Buffet. Revaloriser le métier d’enseignant exige de revenir à une formation professionnelle, abandonnée par la précédente majorité, de donner aux enseignants les moyens de travailler correctement en créant suffisamment de postes pour que chaque classe ait un professeur – et au besoin un remplaçant –, mais également d’augmenter les salaires. À cet égard, le discours de l’opposition ne peut qu’étonner, les mêmes personnes s’étant offusquées de la suppression du jour de carence pour les fonctionnaires.
M. le rapporteur. Les inscriptions aux concours de recrutement des enseignants augmentent cette année de plus 46 %. Cette progression sans précédent montre que ces jeunes étudiants perçoivent notre volonté de revaloriser la profession. En leur donnant une formation, on leur offre – pour la première fois depuis quelques années – les moyens de réussir dans leur métier d’enseignant.
Quant au statut d’enseignant, il fera l’objet d’un débat collectif qu’il faudra mener à partir de la réflexion engagée dans le rapport annexé.
M. Patrick Hetzel. Si l’on peut se féliciter de cette augmentation des inscriptions, n’oublions pas qu’elle est notamment due à la modification des conditions d’accès au concours ; corrigée de cet effet, elle n’atteint pas les objectifs fixés par M. le ministre. Par ailleurs, elle n’atténue en rien la difficulté du métier.
L’amendement est rejeté.
La Commission examine l’amendement AC 88 de M. Frédéric Reiss.
M. Frédéric Reiss. La rédaction de l’alinéa 27 m’apparaît très négative, présentant les échecs scolaires comme une fatalité. Je propose d’insister plutôt sur leur prévention.
M. le rapporteur. Favorable.
L’amendement est adopté.
La Commission est saisie de l’amendement AC 445 de M. Mathieu Hanotin.
M. Mathieu Hanotin. Il s’agit de rappeler, après l’alinéa 27, l’importance de la transition progressive entre l’école primaire et le collège.
M. le rapporteur. Cet amendement, juste dans le fond, me paraît satisfait par les alinéas 9 et 94 du rapport annexé. Je demande donc à M. Hanotin de le retirer.
L’amendement est retiré.
La Commission examine les amendements identiques AC 446 et AC 364 de M. Mathieu Hanotin.
M. Mathieu Hanotin. Ces amendements proposent de tirer les conséquences de l’étude de la Cour des comptes de juillet 2012 en ajoutant, à l’alinéa 29, la notion de « rééquilibrage des moyens attribués en faveur des territoires en difficulté », tant urbains que ruraux.
La Commission est saisie du sous-amendement AC 697 du rapporteur à l’amendement AC 364 de M. Mathieu Hanotin.
M. le rapporteur. Le terme de rééquilibrage me paraît imprécis. Je propose de parler plutôt d’« affectation prioritaire des moyens attribués en faveur des territoires en difficulté ».
M. Rudy Salles. Les « territoires en difficulté » ne constituent pas une notion juridique. Comment adjuger des moyens prioritaires sur un critère aussi vague ?
M. Benoist Apparu. Qu’est-ce, en effet, qu’un « territoire en difficulté » ?
M. Mathieu Hanotin. Mes chers collègues, le rapport de la Cour des comptes définit parfaitement cette notion. Monsieur le rapporteur, j’accepte votre sous-amendement.
Mme Brigitte Bourguignon. Afin d’assurer une véritable continuité territoriale, cet amendement devrait tenir compte de la charte des services publics en milieu rural, qui prévoit que le projet de fermeture de classe soit anticipé deux ans avant sa mise en œuvre. Je l’avais d’ailleurs sollicité par amendement, avec mes collègues Sylvie Pichot et Serge Bardy.
M. le rapporteur. Madame Bourguignon, je partage votre préoccupation ; nous en discuterons à l’occasion de mon amendement sur la carte scolaire, qui reprend la même idée.
M. Rudy Salles. Monsieur le rapporteur, pouvez-vous répondre à notre question relative à la définition des territoires en difficulté ?
M. le rapporteur. Monsieur Salles, si vous voulez voir un territoire en difficulté, je vous invite à vous rendre en Seine-Saint-Denis.
M. le président Patrick Bloche. Je rappelle que le rapport annexé n’a pas un caractère normatif.
M. Xavier Breton. Qu’est-ce alors qu’un territoire qui n’est pas en difficulté ?
M. le rapporteur. Monsieur Breton, visitez donc certaines communes des Hauts-de-Seine.
La Commission adopte le sous-amendement.
Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement AC 364 sous-amendé.
En conséquence, l’amendement AC 446 tombe.
La Commission examine l’amendement rédactionnel AC 696 du rapporteur.
M. Frédéric Reiss. L’amendement suivant – AC 89 – corrige l’imperfection rédactionnelle que le rapporteur a voulu supprimer afin d’éviter toute ambiguïté.
M. le rapporteur. Mon amendement satisfait donc le vôtre.
L’amendement est adopté.
En conséquence, l’amendement AC 89 tombe.
La Commission est saisie de l’amendement AC 90 de M. Frédéric Reiss.
M. Frédéric Reiss. Le mot « refonder », à l’alinéa 32, n’ajoute rien à l’objectif légitime d’amélioration du climat scolaire pour une école sereine et citoyenne. Je propose de le supprimer.
M. le rapporteur. Défavorable. Répéter ce mot n’est pas outrecuidant dans une loi de refondation de l’école.
L’amendement est rejeté.
La Commission examine l’amendement AC 189 de M. Frédéric Reiss.
M. Frédéric Reiss. Il s’agit de supprimer l’alinéa 33. Il est, en effet, d’usage de ne modifier les lois d’orientation sur l’école que tous les dix à quinze ans. Les syndicats que nous avons auditionnés nous ont dit souffrir d’être ballottés d’une réforme à l’autre sans avoir le temps d’appliquer la loi précédente.
M. le rapporteur. Défavorable.
L’amendement est rejeté.
La Commission est saisie de l’amendement AC 310 de M. Benoist Apparu.
M. Benoist Apparu. Si l’on modifie en profondeur l’organisation des enseignements, il semble important de « renforcer les évaluations nationales des résultats et des progrès des élèves ».
M. le rapporteur. Défavorable. Nous ne sommes pas contre l’évaluation, mais pour une évaluation efficace et juste. À côté des évaluations nationales ou internationales – effectuées par des organismes nationaux ou internationaux, à l’image des programmes Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) ou Programme for International Student Assessment (PISA) –, les évaluations individuelles doivent également remonter au niveau national, mais autrement que par le passé.
L’amendement est rejeté.
La Commission examine les amendements AC 282 de M. Benoist Apparu et AC 190 de M. Frédéric Reiss, pouvant faire l’objet d’une présentation commune.
M. Benoist Apparu. Cet amendement – premier d’une série – vise à supprimer les alinéas 34 à 52, soit toute la programmation des moyens nouveaux que vous voulez engager. Nous sommes, en effet, opposés au recrutement de 60 000 enseignants – pierre angulaire de votre projet –, lancé par le ministre à la suite des engagements pris par le Président de la République pendant la campagne de la primaire socialiste.
Si nous assumons les décisions prises entre 2007 et 2012, c’est qu’il n’a jamais été démontré que la qualité et la performance d’un système éducatif dépendaient du nombre d’enseignants. La France dépense, en effet, plus que la moyenne des pays de l’OCDE pour son système scolaire – de la maternelle au lycée ; en revanche, nous consacrons comparativement bien plus de moyens au lycée qu’au primaire. La dépense globale en faveur de l’éducation est donc suffisante, et il n’est nul besoin de recruter massivement des enseignants. Il faut simplement mieux répartir nos moyens entre la maternelle et le primaire d’un côté, et le lycée de l’autre. Nous pouvons donc réduire le nombre de postes, comme nous l’avons fait entre 2007 et 2012, sans pour autant porter atteinte aux résultats de notre système éducatif.
Parallèlement à la diminution du nombre d’enseignants, celui des élèves a également chuté. Grâce à ce phénomène démographique naturel, le taux d’encadrement – nombre d’élèves par classe – est resté constant durant les dix dernières années. Les documents annuels « L’état de l’école » en attestent ; il suffit d’appliquer la règle de trois – un basique de l’arithmétique – pour s’apercevoir que si le nombre d’élèves baisse, la diminution du nombre d’enseignants ne dégrade en rien les conditions de l’enseignement.
Si l’on tient à évoquer le temps béni d’avant 2002, rappelons qu’il y a aujourd’hui en France plus d’enseignants que dans les années 1990, pour 500 000 élèves de moins. Le système scolaire était-il donc, à cette époque, désastreux ? Assumez alors cette position – et votre action pendant cette période – ou bien reconnaissez que la solution ne réside pas dans le recrutement massif des enseignants.
Sous la précédente législature, vous ne cessiez de critiquer notre politique de non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux. Mais avez-vous calculé ce que représente, pour les autres ministères, l’engagement du Président de la République de créer 60 000 postes dans l’éducation nationale et 5 000 dans la justice, la gendarmerie et la police ? Puisque le nombre global de fonctionnaires ne doit pas augmenter, ils subiront une pression bien plus considérable encore, avec un non-remplacement de deux postes sur trois. Assumez-le et dites à l’ensemble des fonctionnaires hors éducation nationale que vous leur infligerez une saignée sans précédent.
M. le rapporteur. Monsieur Apparu, les engagements de François Hollande avaient été clairement énoncés pendant la campagne électorale et approuvés par les Français lors des élections présidentielle et législatives.
L’augmentation des moyens – nécessaire, mais non suffisante – n’épuise pas la portée de la réforme qui vise une véritable transformation pédagogique, comme en attestent les articles portant sur la priorité à donner au primaire et à l’école maternelle, la liaison entre l’école et le collège ou la réaffirmation du collège unique. Mais si les moyens ne peuvent pas tout, ils ont leur importance. Un récent rapport de l’OCDE montre clairement que c’est l’école élémentaire qui connaît l’encadrement le plus faible ; nous souhaitons en faire une priorité, mais refusons de déshabiller pour cela un enseignement secondaire – collège ou lycée, et notamment la filière professionnelle – qui souffre également d’un manque criant de moyens. L’investissement dans l’école constitue un engagement du Président de la République, comme de tous ceux qui composent l’actuelle majorité et ont été élus sur ce programme. Un effort particulier en faveur de l’éducation est donc nécessaire, et puisque les effectifs de la fonction publique doivent rester à un niveau constant, nous en assumons les conséquences.
Monsieur Apparu, lorsque nous avons mené ensemble la mission sur la réforme du lycée, nous étions parvenus à la conclusion qu’elle ne pouvait pas se faire à moyens constants, notamment pour la voie professionnelle, grande sacrifiée du second cycle de l’enseignement secondaire. Là où vous aviez fait le choix de priver l’école des moyens supplémentaires, nous faisons celui d’en faire l’outil de sa refondation. Vous assumez vos choix, nous assumons les nôtres : comme vous l’avez souligné, il s’agit d’un clivage politique majeur entre nous. Je suis défavorable à cet amendement.
Mme Marie-George Buffet. Ces créations de postes visent à corriger la situation que vous avez créée – notamment au sein du corps de remplaçants ou dans le fonctionnement des Réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) – et à accompagner des ambitions nouvelles pour l’école. Ouvrir la maternelle aux moins de trois ans nécessite ainsi de créer 3 000 postes sur la durée du quinquennat ; assurer la formation initiale et continue des enseignants, plus de 1 000 postes ; disposer de plus de maîtres que de classes – condition d’un travail pédagogique en équipe et d’un bon accompagnement –, 7 000 postes nouveaux. Ces créations ne procèdent pas d’une volonté a priori, mais cherchent à nous donner les moyens de ces nouvelles ambitions ; elles sont donc pleinement justifiées.
M. Luc Belot. Nous nous devons d’être précis, monsieur Apparu ; et, comme la semaine dernière, je me vois dans l’obligation de corriger vos propos.
Vous faites en effet une confusion entre le taux d’encadrement et le nombre d’élèves par classe. Il ne s’agit pas que d’une question de mots : ce sont deux visions politiques qui s’opposent. La droite ne considère que l’enseignement devant la classe. Or, si c’est un élément essentiel, ce n’est pas le seul : quand vous empêchez les enfants de moins de trois ans d’aller à l’école, le nombre d’élèves en classe diminue ! De même, quand on réduit les décharges pour les directions d’école ou pour les postes à projet, quand on supprime les remplaçants et les RASED, quand on manque de médecins scolaires, d’infirmières et de psychologues, le nombre d’élèves par classe ne change pas, mais le taux d’encadrement devient catastrophique !
Notre ambition pour l’école vise bien à améliorer le taux d’encadrement, pour la réussite de nos enfants.
M. Frédéric Reiss. Pourtant les chiffres sont têtus : par rapport à 1989, date de la « loi Jospin », il y a 500 000 élèves en moins et 30 000 postes en plus !
Le rapporteur se réfère à l’OCDE pour les taux d’encadrement ; je m’y référerai aussi pour présenter l’amendement AC 190. En France, le niveau de salaire des enseignants en début et en milieu de carrière est nettement inférieur à la moyenne des pays de l’OCDE. La révision générale des politiques publiques (RGPP) permettait de donner du pouvoir d’achat aux enseignants, puisque la moitié des économies réalisées leur étaient reversées sous forme de salaire. En revanche, la création de 60 000 nouveaux postes obérerait toute amélioration qualitative du système – qui passe notamment par un redéploiement des moyens entre le premier et le second degré.
M. Guénhaël Huet. Ce débat est significatif de la confusion engendrée par ce projet de loi qui, en dépit de son nom, est à bien des égards une coquille vide. On y note des oublis, comme le sport ; Patrick Hetzel et le rapporteur ont pointé des imprécisions ou imperfections, notamment dans la rédaction, qui donnent à penser que le projet a été préparé à la hâte. Un projet d’orientation et de refondation aurait dû être davantage mûri.
À ce projet est annexé un rapport volumineux, qui a soulevé des interrogations concernant sa nature législative ou non. Le rapporteur y a répondu en se référant à une décision du Conseil constitutionnel. Dont acte. Il reste que le dispositif est déséquilibré : d’un côté, un texte de loi renfermant des déclarations d’intention généralistes, avec beaucoup d’oublis, de l’autre un rapport annexé comportant des objectifs chiffrés en termes d’effectifs et de moyens budgétaires. Ce projet de loi claudique – et cela ne cessera de poser des difficultés pour son examen, en commission comme dans l’hémicycle.
Benoist Apparu a fait une démonstration imparable. Après, on peut discuter sur le détail et vouloir distinguer le nombre d’élèves par classe et le taux d’encadrement, mais ce qu’il a dit est incontestable ; d’ailleurs, vous ne l’avez pas contesté.
M. Luc Belot. Il me semblait pourtant l’avoir fait !
M. Guénhaël Huet. Ce projet de loi ayant été mal préparé par le gouvernement, son examen provoque des bévues, des imprécisions, des incompréhensions, qui pourraient être réglées si le rapporteur faisait preuve d’une plus grande ouverture d’esprit, au lieu de rester arc-bouté sur ses positionnements idéologiques. En l’occurrence, ces paragraphes ne sont pas d’une grande utilité.
M. le président Patrick Bloche. Il me semble cependant que le rapporteur a le droit d’émettre un avis défavorable à un amendement tendant à supprimer dix-neuf alinéas relatifs aux moyens humains affectés à l’éducation nationale…
M. Mathieu Hanotin. Comparaison n’est pas raison, monsieur Apparu ! Vous comparez les réalités d’aujourd’hui avec celles d’il y a vingt à trente ans, mais combien y avait-il d’élèves par classe à l’époque ? Quel était alors l’état des lycées technologiques et professionnels ? De nouvelles filières n’ont-elles pas été créées ? Les territoires n’ont-ils pas évolué ? Faudrait-il se contenter de trois quarts ou de quatre cinquièmes de professeur dans les territoires ruraux ? Faudrait-il fermer systématiquement les classes en dessous d’un certain seuil ?
Monsieur Reiss, vous n’avez pas augmenté les salaires des enseignants pendant dix ans : ils ont été gelés. La seule manière que vous ayez trouvée pour accroître leur pouvoir d’achat, c’est de leur faire faire des heures supplémentaires. Mais tout travail mérite salaire : que des heures supplémentaires soient payées me semble la moindre des choses ! Certes, il convient d’aller vers une revalorisation des salaires des professeurs ; mais, comme disait Mendès-France, gouverner, c’est choisir – et vu l’état dans lequel se trouve notre pays, nous avons choisi de répondre à la problématique du chiffre.
Puisque vous le voulez, soyons précis : en Seine-Saint-Denis, le lundi 12 février, 212 classes de primaire étaient sans enseignant, parce que la totalité des moyens de remplacement avaient déjà été mobilisés. Voilà la réalité des chiffres, et c’est à cette réalité-là que répond le projet de loi !
M. le président Patrick Bloche. Merci, monsieur Hanotin, de nous avoir précisé ce qu’est « un territoire en difficulté ».
M. Michel Herbillon. Monsieur le rapporteur, les engagements présidentiels ne sont pas les Tables de la Loi ! Ils peuvent être discutés – surtout quand ils sont discutables, comme c’est le cas avec la création de ces 60 000 postes. D’ailleurs, j’observe que d’autres engagements ont été remis en cause par leur propre auteur : ainsi, ceux concernant la croissance, la réduction des déficits, la baisse du chômage, le traité européen ou la TVA.
Monsieur Hanotin, vous oubliez les revalorisations des salaires en début de carrière ! D’autre part, si beaucoup d’enseignants ont fait des heures supplémentaires, c’est parce qu’elles étaient défiscalisées. Depuis que ce régime a été modifié, on observe une moindre propension à en faire ; sous le gouvernement de gauche, le net à payer des enseignants n’est plus tout à fait le même…
M. le rapporteur. Vous avez bien raison, monsieur Reiss, les chiffres sont têtus. Et si l’on consulte le rapport de l’OCDE de 2012 – qui porte sur des données de 2010 –, on constate un net décalage entre la France et l’ensemble de l’Union européenne en nombre d’élèves par enseignant : respectivement, 21,5 élèves contre 13,4 dans l’enseignement pré-élémentaire, 18,7 contre 14,3 dans l’élémentaire et 15 contre 11,7 au collège – où il existe donc de vrais besoins, contrairement à ce que prétend M. Apparu. Quant à la taille moyenne des classes, elle est, dans le primaire, de 22,7 élèves en France contre 19,8 dans l’ensemble de l’Union européenne, et, au collège, de 24,5 élèves contre 21,8. Le rééquilibrage n’est donc pas de mise. Avis défavorable sur les deux amendements.
La Commission rejette successivement les amendements AC 282 et AC 190.
Elle examine ensuite l’amendement AC 281 de M. Benoist Apparu.
M. Benoist Apparu. Cet amendement tend à s’assurer que la répartition des postes se fera dans le respect de la parité entre l’enseignement public et l’enseignement privé.
M. le rapporteur. Cela va sans dire : la loi l’impose déjà ! Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Mme Sandrine Doucet. Permettez-moi de signaler que l’amendement AC 596 de Mme Annie Genevard, qui n’a pas été défendu, faisait référence aux « territoires les plus en difficulté » ; sa présentation nous aurait permis d’en connaître la définition…
La Commission est saisie de l’amendement AC 92 de M. Frédéric Reiss.
M. Frédéric Reiss. Je défendrai ensemble les amendements AC 92, AC 93 et AC 94, qui visent à fondre en un seul les alinéas 39, 43 et 46, qui disent exactement la même chose – d’autant plus qu’à l’alinéa 51, un tableau reproduit encore les mêmes chiffres… Ce n’est plus du bavardage, mais du matraquage !
M. le rapporteur. Avis défavorable : pourquoi nous reprocher d’être trop précis dans la programmation des moyens ?
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AC 283 de M. Benoist Apparu.
M. Benoist Apparu. Je présenterai en même temps les amendements AC 660 et 661, car ils vont tous les trois ensemble.
Puisque nous nous accordons sur la nécessité de donner la priorité à l’école primaire, il conviendrait de réserver à celle-ci les 21 000 nouveaux postes devant élèves. Dans le secondaire, entre le surinvestissement dans le lycée – le projet de loi lui-même estime que le lycée français est « coûteux » ! – et la relative faiblesse de l’encadrement au collège par rapport aux autres pays de l’Union européenne, les répartitions de postes devraient pouvoir s’effectuer à moyens constants.
D’autre part, j’attends avec impatience vos amendements visant à rétablir les RASED – et les avis que le rapporteur et le gouvernement donneront sur eux : je pense que cela nous fera sourire…
Monsieur le rapporteur, puisque vous vous faites l’apôtre de la précision, j’en souhaiterais à l’alinéa 51 : pour aboutir au total de 54 000 postes, quel sera le volume des recrutements année budgétaire par année budgétaire ? Une loi « de programmation » devrait à tout le moins programmer ; ce n’est pas le cas !
Enfin, je renouvelle une question que j’avais déjà posée lors de la discussion générale – sans que j’obtienne de réponse. Si, comme vous l’écrivez dans votre rapport, la suppression des instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) avait fait disparaître 8 000 postes, pourquoi prévoir 26 000 postes pour la création des écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) ? Votre méthode de calcul m’échappe !
M. le rapporteur. Monsieur Apparu, je me félicite que vous considériez que les 60 000 créations de postes sont nécessaires ! Quant à la répartition que vous suggérez, elle ne correspond pas à la réalité des besoins – nous transmettrons votre proposition aux enseignants du secondaire dont les classes sont surchargées. Pour le collège, je vous ai déjà communiqué les chiffres de l’OCDE ; quant au lycée, s’il est coûteux, ce n’est pas nécessairement en nombre de postes : les lycées professionnels, notamment, ont besoin de moyens supplémentaires. La refondation de l’école n’oublie pas le second degré, même si elle donne la priorité au premier degré.
Oui, il s’agit bien d’une loi de programmation, qui fixe des objectifs en nombre de postes à créer durant la législature et la mandature du Président de la République – ce à quoi nous nous étions engagés et ce pour quoi nous avons été élus. Il nous appartiendra ensuite d’inscrire dans chaque loi de finances la répartition annuelle de cette programmation ; c’est d’ailleurs ce qui est « précisé » à l’alinéa 50. Avis défavorable, donc.
La Commission rejette l’amendement AC 283.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 365 de M. Michel Pouzol.
M. Michel Pouzol. Les RASED ont été malmenés ces dernières années ; leur utilité est pourtant reconnue par tous les acteurs de l’éducation. Ils font partie de ces personnes qui, sans être en classe devant les élèves, assurent un encadrement général. Cet amendement tend à renforcer ce dispositif.
M. le rapporteur. Avis favorable : les RASED, qui ont été remis en cause par le précédent gouvernement, jouent un rôle essentiel dans l’aide aux enfants en difficulté. C’est amendement vient à point.
M. le président Patrick Bloche. Merci, monsieur le rapporteur, de donner un avis favorable à cet amendement qui vise à illustrer le principe du « plus de maîtres que de classes ».
La Commission adopte l’amendement.
Puis, suivant les avis défavorables du rapporteur, elle rejette successivement l’amendement AC 93 de M. Frédéric Reiss, les amendements AC 660 et AC 661 de M. Benoist Apparu, et l’amendement AC 94 de M. Frédéric Reiss.
La Commission en vient à l’amendement AC 171 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. C’est en tant que présidente du groupe d’études sur le handicap que je présente cet amendement, qui a été cosigné par les collègues, de tous bords politiques, membres du groupe d’études. S’inscrivant dans la continuité de la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap de 2005, il tend à garantir l’accessibilité des enseignements aux personnes en situation de handicap.
Même si l’on note un certain progrès depuis 2005, avec une augmentation de 33 % du nombre d’enfants handicapés, au moins 20 000 enfants restent aujourd’hui sans solution de scolarisation, sans compter tous ceux qui, accueillis à temps partiel, ne bénéficient pas d’une scolarité satisfaisante.
Puisque nous souhaitons construire une école inclusive, dans laquelle chaque enfant serait pris en compte suivant ses besoins, il ne nous semble plus adapté de dire que les élèves en situation de handicap doivent être « accueillis » ou « accompagnés » à l’école, car cela revient à ne pas les considérer comme des élèves normaux. L’école doit leur fournir une éducation adaptée à leur besoin, et non pas simplement un lieu où ils passeront quelques heures par semaine.
L’objet de cet amendement – ainsi que des amendements AC 662, AC 663, AC 664 et AC 665, qui seront examinés ultérieurement – est donc de remplacer les termes d’« accueil » et d’« accompagnement » par celui de « scolarisation ».
M. le président Patrick Bloche. La liste des signataires de cet amendement est le signe d’une belle unanimité !
M. le rapporteur. Avis favorable, bien entendu.
La Commission adopte l’amendement.
La Commission est saisie des amendements AC 286 et 285 de M. Benoist Apparu, faisant l’objet d’une présentation commune.
M. Benoist Apparu. Un débat sur le rôle que la nation souhaite attribuer aux enseignants est indispensable dans le cadre de l’examen de ce projet de loi. En effet, lorsque le décret de 1950 a défini le temps de travail des enseignants en termes d’heures-matière, 50 % d’une classe d’âge avait accès au collège et 15 % au lycée : les établissements scolaires étaient très sélectifs, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Il convient donc d’adapter le rôle des enseignants à l’hétérogénéité croissante des élèves et de distinguer l’enseignement des matières et l’accompagnement des élèves.
M. le rapporteur. Ces amendements sont satisfaits par la création du Conseil supérieur des programmes, qui rétablit le Conseil national des programmes supprimé par la loi de 2005. Ce Conseil, au sein duquel siégeront des parlementaires – députés et sénateurs –, sera chargé d’une réflexion sur les champs disciplinaires et sur la conception même du métier d’enseignant. Il ne faut ni précipiter ni figer ce débat de fond. Avant de se demander qui doit enseigner et comment le faire, il faut d’abord s’interroger sur les savoirs.
Si donc ces amendements étaient maintenus, j’émettrais un avis défavorable.
M. Patrick Hetzel. Vous ne vous êtes pas prononcé, monsieur le rapporteur, sur l’annualisation du temps de travail des enseignants, proposée par l’amendement AC 286. Si l’objet du texte est bien une « refondation », il faut aller au bout de la démarche.
M. le rapporteur. Si nous votions cet amendement, l’annualisation du temps de travail des enseignants deviendrait la règle. La question mérite peut-être d’être posée, mais nous ne pouvons pas y répondre sans concertation. Mon avis est donc vraiment défavorable.
M. Patrick Hetzel. Si l’on en croit votre raisonnement, le projet de loi lui-même est précipité. Il conviendrait donc d’attendre l’issue de cette concertation, faute de quoi il ne s’agira pas d’un texte de « refondation ». C’est une question de cohérence, et c’est précisément aussi la question de fond que vous refusez d’aborder. Je comprends que vous soyez gêné par un texte qui va trop loin ou pas assez.
M. Benoist Apparu. L’exposé des motifs du texte qui nous est soumis rappelle que son élaboration a été précédée de six mois de concertations approfondies à l’échelle nationale, auxquelles le rapporteur et moi-même avons du reste participé. Vous vous réclamez aujourd’hui de cette concertation à propos des rythmes scolaires, mais vous la récusez sur les autres sujets. Si le texte est une loi de « refondation », il faut évoquer tous les sujets. Si on ne les évoque pas, il ne s’agit pas d’une refondation.
M. le rapporteur. Depuis le décret de 1950, vous n’avez pas fait grand-chose pour poser le problème de la définition du métier d’enseignant. Nous gouvernons, quant à nous, depuis neuf mois : laissez-nous le temps d’aller au fond du sujet, dans l’intérêt du monde enseignant et de l’école.
La Commission rejette successivement ces deux amendements.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 367 de M. Vincent Feltesse.
M. Vincent Feltesse. L’amendement tend à préciser que, notamment dans la formation initiale et continue des enseignants, les ressources numériques doivent être intégrées dans la pratique pédagogique.
M. le rapporteur. Avis favorable.
La Commission adopte cet amendement.
Puis elle examine l’amendement AC 366 de M. Luc Belot.
M. Luc Belot. L’amendement tend à assurer, dans la formation initiale comme dans la formation continue, une meilleure préparation des enseignants au dépistage des troubles du comportement et du langage, tels que la dyslexie, la dysorthographie, la dysphasie, la dyspraxie, la dyscalculie ou l’hyperactivité.
M. le rapporteur. Avis favorable.
Mme Claudine Schmid. Ne conviendrait-il pas de supprimer le mot « notamment » ?
M. le rapporteur. Ce mot évite, au contraire, de figer la liste.
La Commission adopte cet amendement.
Elle est alors saisie de l’amendement AC 368 de M. Jean Jacques Vlody, faisant l’objet du sous-amendement AC 698 du rapporteur.
M. Jean Jacques Vlody. L’amendement AC 368 vise à inscrire dans la formation des enseignants la prise en compte des spécificités du bilinguisme dans les espaces créolophones.
M. le rapporteur. Le sous-amendement AC 698 tend à préciser que la mesure proposée s’applique, plus largement, « dans les territoires ultramarins ».
M. Jean Jacques Vlody. Il conviendrait alors de rectifier ce sous-amendement dans le sens d’une plus grande précision en remplaçant les termes « territoires ultramarins » par ceux de « départements, collectivités et territoires ultramarins », qui tiennent compte des différents statuts de ces territoires.
M. le rapporteur. Je souscris tout à fait à cette précision.
Mme Marie-George Buffet. Je soutiens cet amendement et associe à cette démarche Mme Huguette Bello, qui soulignait, lors des questions orales sans débat, les difficultés d’apprentissage que provoque la non-prise en compte de la langue créole. Il importe que tous les enseignants en soient alertés et qu’ils soient formés à cette prise en compte.
M. Paul Molac. Il n’est pas sans importance de conserver la référence à la spécificité créolophone. En effet, la situation du créole s’apparente à celle des langues d’oïl, proches du français et que leurs locuteurs n’identifient pas toujours comme distinctes. Du reste, on a longtemps reproché à ces locuteurs de parler, non pas le créole – ou, en Bretagne, le gallo –, mais un mauvais français, avec les conséquences que cela peut induire en termes d’image de soi. Cette situation appelle une pédagogie différente de celle qui s’applique par exemple pour les langues polynésiennes, très clairement différentes du français.
M. le rapporteur. Cette observation est tout à fait fondée, mais il me semble d’autant plus préférable de ne pas figer une liste et d’exprimer une disposition générale. Votre préoccupation monsieur Molac, me semble satisfaite par le point d’équilibre que nous avons atteint.
La Commission adopte successivement le sous-amendement AC 698 rectifié et l’amendement AC 368 modifié par ce sous-amendement.
Elle adopte ensuite, sur l’avis favorable du rapporteur, l’amendement AC 662 de Mme Barbara Pompili.
Puis elle examine l’amendement AC 542 de Mme Barbara Pompili.
Mme Isabelle Attard. L’amendement tend à insister sur la formation qui devra être dispensée aux enseignants assumant la fonction de professeur principal, en prévoyant qu’une réflexion sera menée en concertation avec les acteurs concernés pour la reconnaissance du statut et que cette formation comprendra un module relatif aux relations avec les familles et les représentants des parents d’élèves.
Le professeur principal a en effet un rôle essentiel : il est l’animateur de l’équipe pédagogique de la classe, assure l’interface avec les familles et doit accompagner l’élève dans sa scolarité, l’aidant également à prendre des décisions d’orientation. Ce rôle essentiel se traduit souvent par une surcharge de travail et ne fait pas l’objet d’une formation adéquate.
Le statut du professeur principal devrait donc être revu et élaboré, avec une décharge partielle de cours lui permettant de se consacrer pleinement à ses missions, voire un bureau dédié.
M. le rapporteur. L’amendement est satisfait, car le rôle essentiel du professeur principal figure dans le référentiel de compétences élaboré par le ministère et approuvé unanimement par les représentants du personnel. Quant à la création d’un statut particulier au sein de la profession enseignante, elle ne relève pas de cette loi de refondation. Avis défavorable, donc.
M. Thierry Braillard. L’amendement est excellent. La spécificité du professeur principal mérite d’être mise en lumière.
Mme Julie Sommaruga. J’entends l’argument du rapporteur. Il faut néanmoins mettre en valeur l’importance du rôle du professeur principal, en particulier lors du passage du CM2 en 6ème, où se produisent à la fois un décrochage scolaire et un décrochage des parents.
M. Mathieu Hanotin. L’amendement n’est pas assez complet. Il faut en effet repenser le rôle du professeur principal, notamment lors de la transition entre le CM2 et la 6ème, car la transversalité est nécessaire lors du passage de l’enseignement polyvalent à l’enseignement monovalent et il faut un animateur d’équipe. Ce sont là des missions qui pourront être dévolues au professeur principal.
M. le rapporteur. La préoccupation dont procède l’amendement est tout à fait justifiée et a d’ailleurs fait l’objet d’un long travail dans le cadre du référentiel de compétences.
Madame Attard, je vous propose de retirer l’amendement, de le retravailler et de le présenter à nouveau en vue de l’examen du texte en séance publique.
M. Benoist Apparu. Je m’étonne qu’on nous ait répondu tout à l’heure que le statut de l’enseignant n’avait pas à être débattu dans le cadre de l’examen de ce projet de loi, mais que le statut du professeur principal y trouve sa place.
M. le rapporteur. J’ai au contraire pris soin de distinguer entre le rôle du professeur principal, qui figure dans le référentiel de compétences et dont j’ai suggéré que nous étudiions la possibilité de l’inscrire dans la loi, et son statut, qui n’a pas à y figurer. Vous m’avez mal entendu, parce que mal écouté.
Mme Isabelle Attard. J’espère que la question liée au professeur principal permettra d’amorcer la réflexion nécessaire sur le statut des cadres intermédiaires de l’éducation nationale.
Je suis donc prête à retirer l’amendement au bénéfice des dispositions figurant dans le référentiel de compétences, en me réservant de le présenter à nouveau lors de l’examen en séance publique si ces dispositions ne me paraissaient pas satisfaisantes.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement AC 95 de M. Frédéric Reiss.
M. Frédéric Reiss. Le ministre doit préciser par décret le devenir des étudiants ayant bénéficié des emplois d’avenir professeur (EAP) mais qui ont échoué au concours.
M. le rapporteur. Je félicite M. Reiss de se soucier des EAP mais ces étudiants relèvent du droit commun dès lors que le dispositif constitue une aide qui leur est apportée en contrepartie de l’engagement de passer un concours face auquel tous les étudiants, quels qu’ils soient, sont à égalité. Procéder autrement et présenter deux types de candidats à un concours de la fonction publique serait anticonstitutionnel. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AC 589 de Mme Marie-George Buffet.
Mme Marie-George Buffet. Il est impératif d’étudier les modalités de mise en œuvre d’un véritable système de pré-recrutement des enseignants dès la licence. À plusieurs reprises, le ministre a d’ailleurs lui-même assuré que cela était nécessaire afin de restaurer le vivier de recrutement et d’accroître la diversité sociale du corps enseignant.
L’alinéa 59 porte sur les EAP – lesquels doivent monter en puissance puisqu’ils passeront de 4 000 à 6 000 – mais ces derniers ne constituent pas néanmoins un pré-recrutement tel que les syndicats et un certain nombre d’entre nous l’entendent depuis des années.
M. le rapporteur. Les EAP constituent une forme de pré-recrutement mais, au sens strict, ils n’en sont pas un. Je suis donc favorable à l’idée d’étudier les modalités de mise en place d’un véritable pré-recrutement, avec toutes les conséquences que cela peut avoir.
La Commission adopte l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement AC 543 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. Cet amendement aurait pu faire l’objet d’une discussion commune avec le précédent puisqu’il vise à étudier la généralisation du pré-recrutement au-delà des EAP afin de répondre à la crise du recrutement que nous connaissons et qui, malgré une légère embellie, demeure forte, notamment dans l’académie de Créteil ou dans des disciplines comme les lettres ou les mathématiques.
Le pré-recrutement peut permettre notamment à des élèves issus de milieux défavorisés de réussir leurs études supérieures en leur en donnant les moyens. Le vivier de recrutement, en outre, en sera élargi.
J’ajoute que le pré-recrutement n’aurait d’autre contrepartie que l’engagement à passer le concours, ce qui n’est actuellement pas le cas puisque les emplois d’avenir doivent travailler.
Même si les conditions ne sont sans doute pas encore toutes remplies pour mettre en place un tel dispositif, nous proposons d’en discuter.
M. le président Patrick Bloche. Ces amendements n’ont pas fait l’objet d’une discussion commune parce que l’un propose la remise d’une étude et, l’autre, celle d’un rapport.
M. le rapporteur. Cet amendement est doublement satisfait, et par l’adoption de l’amendement précédent, et par un amendement que je proposerai visant à créer un comité de suivi de l’application de la loi qui tiendra compte de l’ensemble des thèmes soulevés à travers les différentes propositions de remises de rapport. Je vous propose donc de le retirer.
Mme Barbara Pompili. Dès lors qu’il a en effet été satisfait par l’adoption de l’amendement précédent, je le retire.
L’amendement AC 543 est retiré.
La Commission examine les amendements AC 544 et AC 545 de Mme Barbara Pompili pouvant l’objet d’une présentation commune.
Mme Barbara Pompili. Dans la même logique que les amendements précédents, l’amendement AC 544 vise à ce qu’un rapport soit remis au Parlement concernant l’élargissement des voies d’accès aux concours d’enseignants – outre le troisième concours pour les personnes qui ont déjà exercé une activité professionnelle d’au moins cinq ans – afin d’augmenter le nombre de places proposées qui, aujourd’hui, sont de 8 000 environ au concours de professeur des écoles contre 300 au troisième concours. Les étudiants titulaires de masters autres que ceux qui sont habituellement concernés et les professionnels qui feraient valoir une validation des acquis de l’expérience (VAE) doivent bénéficier de concours spécifiques.
L’amendement AC 545 demande quant à lui qu’un rapport soit remis sur la mise en place des ESPE afin d’étudier de possibles améliorations du dispositif et, notamment, le positionnement du concours dans la formation, le groupe Re-construire la formation des enseignants (GRFDE) ayant démontré que placer le concours en fin de troisième année de licence (L3) et non de première année de master (M1), comme le gouvernement l’a décidé, serait bénéfique pour les étudiants – qui disposeraient ainsi de deux années pleines de formation –, pour les élèves – qui auraient devant eux des enseignants entrant peu à peu dans leur métier au lieu d’y être « jetés » –, et serait moins cher ou, à tout le moins, d’un coût équivalent pour les finances publiques. Ce concours en L3 ouvrirait la voie à une formation en trois ans : deux années de master avec une entrée progressive dans le métier, et une année de fonctionnaire stagiaire pour parfaire la formation avant une titularisation définitive.
Nous prenons acte que cette option n’a pas été retenue mais elle pourrait être étudiée.
M. le rapporteur. Ces deux rapports se justifient mais, comme je l’ai déjà dit, le comité de suivi de l’application de la loi satisfera les deux préoccupations qu’ils expriment. Je vous propose donc de retirer ces amendements.
Mme Barbara Pompili. Nos demandes étant assez précises et comme nous n’avons pas encore étudié votre amendement, monsieur le rapporteur, Mme Attard et moi-même les maintenons.
M. le président Patrick Bloche. La demande de rapports au Parlement se justifie plus dans un texte de loi en tant que tel que dans un rapport annexé.
M. le rapporteur. D’où, précisément, la création dans la loi d’un comité de suivi. Je renouvelle donc ma demande de retrait.
Mme Barbara Pompili. Vous m’encouragez donc à préciser dans l’amendement que vous proposerez les demandes que nous venons de formuler ?
M. le rapporteur. Si vous voulez.
M. le président Patrick Bloche. Le dépôt d’amendements en vue de la séance, ainsi que de sous-amendements, offre en effet bien des possibilités.
Mme Barbara Pompili. Dans ces conditions, nous retirons les amendements.
Les amendements AC 544 et AC 545 sont retirés.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AC 61 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AC 369 de M. Jean-Pierre Le Roch.
M. Jean-Pierre Le Roch. Un rapport annuel doit faire état du suivi statistique du parcours des étudiants intégrant les ESPE. Deux récents rapports, en effet, ont respectivement mis en évidence l’absence de connaissance de ces parcours et fait part du souhait de mieux connaître ces carrières, en particulier s’agissant des étudiants issus de filières scientifiques.
M. le rapporteur. Je vous propose de retirer votre amendement, dont nous discuterons du fond lors de l’examen de la création du comité de suivi, lequel devrait permettre de mener ce type d’analyses. Si vous jugez toutefois que tel n’est pas le cas, vous pourrez le redéposer afin qu’il soit discuté en séance publique.
M. Jean-Pierre Le Roch. Soit.
L’amendement est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 313 de M. Benoist Apparu.
Elle adopte l’amendement rédactionnel AC 652 du rapporteur.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 315 de M. Benoist Apparu.
Elle en vient à l’amendement AC 546 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. Le futur Conseil supérieur des programmes doit articuler ses réflexions non seulement par grand domaine disciplinaire, mais aussi par cycle, afin de garantir une forte cohérence interne entre les connaissances, les compétences et les apprentissages à chaque cycle.
Les programmes de 2008 ne sont pas assez articulés entre eux ni avec le socle commun. Les terminologies sont parfois différentes entre disciplines. Pour désigner les mêmes objets, on n’utilise pas les mêmes termes de grammaire en français et en anglais. Par ailleurs, il arrive que l’étude d’un même objet soit abordée à des moments différents en biologie et en physique.
Pour assurer une articulation plus étroite entre les programmes et le socle commun, il convient que le futur Conseil supérieur des programmes travaille sur leur cohérence, notamment sur le vocabulaire utilisé, les notions abordées, ainsi que les compétences et les capacités à mobiliser.
M. Yves Durand, rapporteur. Avis favorable.
M. Frédéric Reiss. Je soutiens l’amendement, bien que la précision qu’il apporte figure également dans l’alinéa 72 du rapport annexé.
La Commission adopte l’amendement.
Elle aborde l’amendement AC 284 de M. Benoist Apparu.
M. Benoist Apparu. L’alinéa 71 prévoit que le Conseil supérieur des programmes donne un avis sur la nature et le contenu des épreuves de recrutement d’enseignants du premier et du second degré, et sur la conception générale de leur formation au sein des écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE). Comment pourra-t-il émettre un avis alors que celles-ci doivent ouvrir à la rentrée 2013 ?
M. le rapporteur. Avis défavorable. Le problème est réel, mais ponctuel. La loi n’est pas faite uniquement pour la rentrée 2013.
M. Benoist Apparu. Quel horizon vise-t-elle ? J’imagine qu’une fois définie, la formation des étudiants dans les ESPE ne changera pas chaque année.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel AC 62 du rapporteur.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement AC 96 de M. Frédéric Reiss.
La Commission examine l’amendement AC 370 de M. Luc Belot.
M. Luc Belot. En pratique, les enseignants oublient souvent que, aux termes d’une circulaire du 29 décembre 1956, ils peuvent demander aux écoliers d’apprendre des leçons, mais non de faire des devoirs à la maison, puisque le travail chez soi aggrave les inégalités socioculturelles. Nous proposons que le travail personnel des enfants soit encadré et qu’il ne soit pas réalisé à leur domicile.
M. le rapporteur. Avis défavorable, même si je partage votre analyse. Ne créons pas de carcan qui entraverait la liberté pédagogique des enseignants ! D’ailleurs, aux termes de la circulaire du 29 décembre 1956, des parents peuvent parfaitement faire apprendre une récitation à leur enfant : « aucun devoir écrit, soit obligatoire, soit facultatif, ne sera demandé aux élèves hors de la classe. […] Libérés des devoirs du soir, les enfants de sept à onze ans pourront consacrer plus aisément le temps nécessaire à l’étude des leçons. » En revanche, je défendrai un amendement visant à décourager les enseignants de demander aux élèves d’effectuer chez eux des devoirs écrits.
Mme Annie Genevard. Il existe un système aussi efficace qu’équitable : faire surveiller des études par les enseignants rémunérés par les communes. Malheureusement, celles-ci devront y renoncer si elles doivent financer des activités pour tous les élèves entre quinze heures quarante-cinq et seize heures trente.
M. Thierry Braillard. M. Luc Belot et le rapporteur ont tous les deux raisons : peut-être faut-il récrire l’amendement en vue de la séance publique. La nouvelle rédaction devra ménager la liberté pédagogique de l’enseignant.
M. Luc Belot. Je retire l’amendement, que je me propose de retravailler.
Toutes les communes que j’accompagne dans leur projet éducatif de territoire ont le souci d’inscrire le travail personnel de l’enfant dans un cadre collectif, qu’il soit scolaire ou périscolaire, encadré par les enseignants ou par des personnels en lien avec eux.
L’amendement est retiré.
La Commission en vient à l’amendement AC 447 de M. Mathieu Hanotin.
M. Mathieu Hanotin. Notre système de notation est discriminant, puisque la réussite des uns se détermine par l’échec des autres. Des expériences visant à évaluer les élèves au moyen d’un contrat de confiance donnent de bien meilleurs résultats.
M. le rapporteur. Je comprends mal la rédaction de l’amendement, que je vous suggère de retirer. Pour ma part, je ne pense pas que la réussite des uns se détermine par l’échec des autres.
Mme Annie Genevard. Ce n’est pas en supprimant l’évaluation qu’on fera progresser les élèves ni qu’on garantira la maîtrise d’un socle commun indispensable à la poursuite des études. Par ailleurs, je ne sais pas ce qu’est une « évaluation positive, simple et lisible ».
M. Mathieu Hanotin. Je n’ai pas inventé cette formule, qui figure dans le texte. Quant à l’évaluation, il n’est pas question de la supprimer. Je constate seulement que, dans les classes, le contrôle, purement discriminant, n’apporte rien sur le plan pédagogique. Cherche-t-on à piéger l’élève ou à l’évaluer ? Je vous renvoie aux travaux du professeur André Antibi, qui propose d’évaluer les connaissances au moyen d’un contrat de confiance. Dans toutes les classes de France, un tiers des élèves sont considérés comme bons, un tiers comme moyens et un tiers comme mauvais. C’est pourquoi j’ai dit que la réussite des uns se mesure à l’échec des autres, mais je pense qu’il faut casser cette idée, notamment dans l’esprit des évaluateurs.
Je retire l’amendement.
L’amendement est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 287 de M. Benoist Apparu.
Elle aborde l’amendement AC 231 de M. Thierry Braillard.
M. Thierry Braillard. Je propose une nouvelle rédaction. Le texte mentionne les « valeurs de la laïcité », mais celle-ci n’est-elle pas une valeur en soi, qui promeut la neutralité de l’État et la liberté de croyance ?
M. le rapporteur. Je suis favorable à l’amendement, qui se réfère à la morale laïque. Ces termes parlent d’eux-mêmes.
M. Frédéric Reiss. Le rapport annexé comme le corps du projet de loi se réfèrent à la morale, au civisme et à la laïcité. C’est assez clair pour qu’on apprenne le respect aux enfants sans invoquer la notion de morale laïque, qui me dérange.
M. Patrick Hetzel. D’ailleurs, qu’est-ce que la morale laïque ? Nous sommes quelques-uns à nous le demander…
Mme Marion Maréchal-Le Pen. Dans l’étude d’impact, je lis que votre projet est de « former des citoyens éclairés, porteurs de valeurs telles que la dignité de l’homme » et « l’égalité entre les femmes et les hommes », ce que j’approuve. Plus bas, il est question d’un « apprentissage du respect mutuel entre les élèves sans distinction liée au genre ». On voit poindre la théorie du genre. Enfin, il est question de « la primauté de la raison et du refus des dogmes ». Qu’entendez-vous par là ? Voilà un terrain glissant, qu’il est difficile d’envisager de manière objective.
Mme Annie Genevard. Je regrette que l’expression de « morale laïque » réduise la morale à la laïcité, alors que le terme a un sens plus vaste.
M. Xavier Breton. Vous écrivez dans l’exposé des motifs qu’il « est difficile d’enseigner les valeurs de la laïcité », alors que la morale laïque s’imposerait d’elle-même. Mais pourquoi les valeurs de laïcité ne s’enseigneraient-elles pas ? Et pourquoi vouloir imposer une morale sans discussion ?
M. le président Patrick Bloche. Vous pourrez le demander au ministre, qui s’est approprié l’expression de « morale laïque ».
La Commission adopte l’amendement AC 231.
De ce fait, l’amendement AC 371 de Mme Julie Sommaruga n’a plus d’objet.
La Commission est saisie de l’amendement AC 372 de Mme Françoise Dumas.
Mme Françoise Dumas. L’amendement est symbolique : il tend à ce que la devise de la République soit apposée sur la façade de tout établissement scolaire. Nous témoignerons ainsi de notre attachement à l’enseignement moral et civique, qui invite à respecter la personne, son origine comme ses différences, ainsi que l’égalité entre les hommes et les femmes.
M. le rapporteur. Avis favorable.
M. Thierry Braillard. Nous soutenons l’amendement. Nous proposons même de compléter l’alinéa par les mots : « La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 doit être apposée dans tous les établissements scolaires publics et privés sous contrat. » M. Chatel avait envoyé à tous les établissements une circulaire allant dans ce sens, qui n’a pas été suivie d’effet.
M. Rudy Salles. Je propose un autre sous-amendement visant à ajouter après « la devise de la République » les mots : « et le drapeau tricolore ». De ce fait, il faudra substituer aux mots « doit être apposé », les mots « doivent être apposés ».
M. Patrick Hetzel. L’amendement AC 372 respecte-t-il les dispositions de l’article 40 de la Constitution ?
M. le président Patrick Bloche. La Commission des finances a été consultée. Il est vrai que si nous ajoutons à l’inscription sur la façade, la Déclaration des droits de l’homme et le drapeau tricolore, nous risquons d’alourdir la facture…
M. Benoist Apparu. Quelle est la portée précise de l’amendement ? Que signifie « apposé sur la façade » ? S’agit-il d’un petit panneau ou d’une inscription imposante comme sur le fronton des mairies ?
Mme Annie Genevard. Premièrement, la décision que nous nous apprêtons à prendre emporte certaines conséquences pratiques. Pour conserver une allure convenable, un drapeau déployé en permanence doit être changé en moyenne tous les six mois. Actuellement, dans ma commune, je ne fais pavoiser les établissements scolaires qu’à l’occasion des fêtes patriotiques. En outre, pour apposer la devise de la République, il sera nécessaire d’adapter certains bâtiments à caractère patrimonial. Tout cela va induire des coûts.
Deuxièmement, quant au fond, notre devise républicaine rappelle les principes fondamentaux de notre Constitution et a évidemment sa place sur un certain nombre de bâtiments publics. Mais qu’en est-il des établissements scolaires ? Les écoles sont-elles avant tout des lieux de liberté ? Même s’il n’est bien sûr nullement question d’asservir les élèves, l’exercice de la liberté individuelle est-il la première chose qu’on leur demande ?
Plusieurs commissaires membres du groupe SRC. La liberté dans une école, c’est la liberté de penser !
Mme Annie Genevard. À ce moment-là, il convient d’ajouter dans le texte, lorsqu’il y est question d’enseignement de la morale et de la laïcité, le principe de neutralité politique.
M. Xavier Breton. Apposer la devise de la République sur la façade des écoles ne pose pas de problème en soi. Cependant, le débat va plus loin : vous allez rechercher, avec ce texte, un clivage sur les valeurs de la République. Vous n’allez pas vous contenter du triptyque « Liberté, Égalité, Fraternité », mais ajouter, par exemple, l’égalité entre les hommes et les femmes ou la laïcité. Nous partageons bien sûr les valeurs de la République, mais il n’est pas nécessaire, de notre point de vue, de les détailler dans un texte, sauf si l’on veut créer des divisions.
En outre, l’école est-elle uniquement républicaine ? N’y a-t-il droit de cité, au sein de l’école, que pour la République ? Je pose ici la question de la place des familles. Pour certains, il y a égalité parfaite entre l’école et la République. Telle n’est pas ma conception : j’estime que les familles préexistent à l’État et à la République et qu’elles ont toute leur place au sein de l’école. Je ne voudrais pas que l’imposition de la devise républicaine signifie une exclusion des familles. Nous devons avoir un débat : dans ce texte, parle-t-on d’école de la nation – la nation comprend tant les familles que la communauté formée par la République – ou parle-t-on, comme je le crains, d’une école strictement républicaine ? Ce sont là des visions divergentes.
M. le président Patrick Bloche. Je rappelle l’article 2 de la Constitution : « La langue de la République est le français. L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L’hymne national est la “Marseillaise”. La devise de la République est “Liberté, Égalité, Fraternité”. Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. »
L’amendement proposé s’inscrit parfaitement dans le cadre de cet article. Il n’y a pas lieu de s’engager dans des débats qui dépassent l’examen du présent projet de loi.
À ce stade, tel est l’amendement qui résulte de nos discussions : « La devise de la République et le drapeau tricolore doivent être apposés sur la façade de tout établissement scolaire. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 doit être apposée dans tous les établissements scolaires publics et privés sous contrat. »
M. le rapporteur. Compte tenu du rappel de l’article 2 de la Constitution, j’émets un avis favorable à l’amendement ainsi rectifié.
Mme Annie Genevard. Ne pourrait-on pas laisser une certaine liberté aux établissements scolaires, en leur permettant d’apposer la devise de la République et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen non pas sur la façade, mais à l’intérieur du bâtiment ? Quant au drapeau, pourrait-il être déployé non pas en permanence, mais seulement à l’occasion des célébrations officielles ou patriotiques ?
M. le président Patrick Bloche. Le drapeau et la devise devront être apposés sur la façade des établissements scolaires. Tel n’est pas le cas, en revanche, de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. J’invite la Commission à se prononcer sur l’amendement rectifié et suggère aux collègues qui souhaiteraient des précisions supplémentaires de proposer des amendements en vue de la séance publique.
M. Xavier Breton. L’article 3 du projet de loi détaille les valeurs de la République et y fait notamment figurer l’égale dignité de tous les êtres humains. Lorsque nous examinerons cet article, nous en tiendrons-nous au contenu de l’article 2 de la Constitution ? Accepterez-vous nos amendements de suppression ? Si tel n’est pas le cas, nous aurons des positions divergentes.
M. le rapporteur. Je proposerai la suppression de l’article 3.
M. le président Patrick Bloche. Les valeurs de la République sont distinctes de sa devise. Il convient de ne pas les confondre.
La Commission adopte l’amendement AC 372 ainsi rectifié.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 289 de M. Benoist Apparu.
Elle examine ensuite, en présentation commune, les amendements AC 232, AC 233 et AC 234 de M. Thierry Braillard.
M. Thierry Braillard. L’éducation artistique et culturelle est évidemment importante, mais l’éducation physique et sportive doit également avoir toute sa place dans le développement personnel et collectif des élèves. C’est pourquoi je propose de mentionner le sport aux côtés de l’art et de la culture.
M. le rapporteur. Les activités sportives et les activités artistiques et culturelles relèvent de modalités très différentes. La mention du sport ne serait pas à sa place à cet endroit du texte. Je suis défavorable à ces trois amendements.
M. Thierry Braillard. Le présent projet de loi traite uniquement des activités sportives qui peuvent être proposées aux élèves en dehors du temps scolaire. Il accorde donc une importance limitée au sport. Pourtant, la ministre des sports vient de lancer une grande réflexion visant à renforcer le lien entre les activités des associations sportives et l’enseignement du sport à l’école.
M. Xavier Breton. Je suis d’accord avec l’esprit des amendements de M. Braillard. Nous allons créer un déséquilibre entre les activités artistiques et culturelles – qu’il convient en effet de développer – et le sport – qui est un peu négligé dans ce texte.
Mme Isabelle Attard. Comme l’a indiqué M. le rapporteur, il ne serait pas cohérent d’insérer des mentions concernant le sport dans les paragraphes relatifs au parcours d’éducation artistique et culturel. Cela ne revient nullement à minimiser l’importance du sport dans l’éducation, dont nous sommes tous conscients.
Mme Martine Faure. Les alinéas 221 et suivants du rapport annexé traitent bien, d’une part, de l’enseignement du sport à l’école et, d’autre part, des activités sportives proposées aux élèves volontaires en dehors du temps scolaire.
M. le rapporteur. Pour répondre à la préoccupation de M. Braillard sans pour autant remettre en cause la cohérence du parcours d’éducation artistique et culturelle, j’émets finalement un avis favorable à l’amendement AC 233. Je maintiens en revanche mon avis défavorable sur les amendements AC 232 et AC 234.
M. Thierry Braillard. Je retire ces deux amendements.
Les amendements AC 232 et AC 234 sont retirés.
La Commission adopte l’amendement AC 233.
Elle est saisie de l’amendement AC 595 de Mme Annie Genevard.
Mme Annie Genevard. Si l’on veut donner ses chances à l’éducation artistique et culturelle, il convient qu’elle soit considérée par les enfants et par leurs parents non pas comme une activité annexe, mais comme un ensemble de disciplines à part entière. C’est pourquoi je propose que ces disciplines soient intégrées parmi les matières dans lesquelles les élèves sont évalués. Pour autant, il n’est pas nécessaire qu’elles deviennent des matières discriminantes et la forme de l’évaluation sera déterminée par l’enseignant.
De nombreux ministres de l’éducation nationale – notamment MM. Savary, Lang, Fillon et Darcos – ont pris des initiatives en faveur de l’éducation artistique et culturelle, considérant à juste titre qu’il s’agissait d’un enseignement fondamental. Mais, en l’absence d’évaluation des élèves, ces disciplines n’ont jamais vraiment émergé.
M. le rapporteur. La préoccupation légitime de Mme Annie Genevard est déjà satisfaite : les élèves sont obligatoirement évalués dans les disciplines qui relèvent du parcours d’éducation artistique et culturelle. Avis défavorable.
Mme Annie Genevard. Vous venez, monsieur le rapporteur, d’accepter une redondance concernant l’éducation sportive, pour mieux souligner son importance. De même, il me paraîtrait utile de rappeler l’exigence d’une évaluation dans les disciplines artistiques et culturelles. Je maintiens donc mon amendement.
M. le rapporteur. La comparaison avec l’amendement précédemment adopté n’est pas fondée. L’existence d’un parcours d’éducation artistique et culturelle implique nécessairement que les élèves sont évalués.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement AC 547 de Mme Barbara Pompili.
Mme Isabelle Attard. Nous souhaitons préciser que le parcours d’éducation artistique et culturelle « doit être l’occasion de mettre en place des pratiques pédagogiques co-construites, innovantes et actives, envisageant aussi l’art comme vecteur de connaissances ».
Nous constatons avec satisfaction que la notion de parcours semble être acceptée par tous. Ce parcours doit s’inscrire dans toute la durée de la scolarité de l’élève et dans l’ensemble des temps éducatifs : scolaire, périscolaire et extrascolaire. Il doit être une suite cohérente et articulée de découvertes et d’expériences artistiques et culturelles.
Si le cahier des charges de ce parcours est fixé au niveau national, sa mise en œuvre devra se faire, selon nous, au niveau local, à travers les projets éducatifs territoriaux. D’où l’importance de la relation entre collectivités territoriales, acteurs périscolaires et équipes éducatives.
Ce parcours pourrait inclure les activités suivantes : réalisation d’œuvres artistiques, classes de découvertes, sorties culturelles, implication dans un groupe de musique ou de théâtre. En outre, les élèves pourraient participer à l’apposition de la devise de la République sur la façade de leur école, et ce serait là l’occasion de laisser libre cours à la créativité des équipes enseignantes.
M. le rapporteur. Avis favorable.
Mme Annie Genevard. J’ai mis en place, depuis quinze ans, un partenariat artistique et culturel avec les écoles de ma ville. Il s’agit d’une formation qui s’inscrit dans les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. Mais la réforme des rythmes scolaires va me contraindre à des choix budgétaires.
Notre collègue vient de mentionner la participation des collectivités territoriales à la mise en œuvre des parcours d’éducation artistique et culturelle. Je crains cependant que de nombreuses communes n’en aient plus les moyens, bien que la loi le préconise. Je le regrette infiniment.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite, en présentation commune, les amendements AC 704 du rapporteur, AC 590 de Mme Marie-George Buffet et AC 357 de M. Paul Molac.
M. le rapporteur. L’amendement AC 704 vise à souligner l’importance de la précocité de l’exposition à une langue vivante et de son apprentissage, tant pour une langue régionale que pour une langue étrangère.
Mme Marie-George Buffet. Je me félicite que l’apprentissage des langues régionales figure dans le rapport annexé au projet de loi. La rédaction que je propose ou celle de M. Paul Molac me paraissent néanmoins plus satisfaisantes que celle du rapporteur. Je souhaiterais éviter l’emploi des parenthèses.
M. Paul Molac. Le rapporteur propose d’introduire l’enseignement des langues régionales dans le rapport annexé, et je l’en remercie. Cet enseignement prend de l’importance dans notre pays : aujourd’hui, environ 50 000 élèves bénéficient d’un enseignement bilingue en français et en langue régionale dès la maternelle. Certains inspecteurs de l’éducation nationale attendaient cette reconnaissance dans les textes.
Ceci étant, je préconise d’employer la conjonction « et » plutôt que « ou » : l’enseignement d’une langue étrangère n’exclut pas celui d’une langue régionale, et inversement. Dans certaines écoles appliquant des méthodes pédagogiques innovantes, l’enseignement de la langue régionale commence dès le début de la maternelle et celui de la langue étrangère dès la grande section.
M. Frédéric Reiss. J’ai une préférence pour la rédaction proposée par Mme Marie-George Buffet.
Je comprends la nécessité d’un certain affichage, mais je rappelle les textes existants. L’article L. 312-10 du code de l’éducation issu de la loi du 23 avril 2005 dispose qu’« un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l’État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage ».
En outre, l’article L. 312-11 du même code prévoit que « les maîtres sont autorisés à recourir aux langues régionales dans les écoles primaires et maternelles chaque fois qu’ils peuvent en tirer profit pour leur enseignement, notamment pour l’étude de la langue française ».
M. Patrick Hetzel. Comme vient de l’indiquer M. Frédéric Reiss, certaines dispositions existent déjà dans le code de l’éducation. Je préfère également la formulation proposée par Mme Marie-George Buffet.
M. le rapporteur. Il est à mon sens préférable d’associer langues étrangères et régionales dans un même alinéa, tout en remplaçant les parenthèses par des virgules, ainsi que le mot « ou » par le mot « et », selon les suggestions de Mme Marie-George Buffet.
M. Patrick Hetzel. L’intérêt de l’amendement de Mme Marie-George Buffet est d’évoquer les langues régionales dans un alinéa spécifique et d’insister sur leur statut de langue vivante. Dans ma région, par exemple, plus de la moitié de la population parle encore l’alsacien.
M. Paul Molac. De plus, monsieur Hetzel, les transfrontaliers alsaciens travaillent souvent à Bâle ou en Allemagne.
Jusqu’à présent, les langues étrangères ont été mieux traitées que les langues régionales, qui pourtant font partie du patrimoine français. Associer les unes et les autres dans une même phrase permettrait d’abolir toute hiérarchie entre elles. C’est pourquoi je retire mon amendement pour me rallier à celui du rapporteur.
L’amendement AC 357 est retiré.
Mme Marie-George Buffet. Je suis réticente à mettre les langues régionales et les langues étrangères sur le même plan, même si mon amendement n’implique aucune hiérarchie entre elles.
M. le président Patrick Bloche. Plutôt que d’écrire deux fois la même phrase, pour les langues étrangères puis les langues régionales, mieux vaut rédiger l’alinéa 88 dans les termes suivants : « La précocité de l’exposition et de l’apprentissage en langue vivante, étrangère et régionale, est un facteur avéré de progrès en la matière. »
Mme Marie-George Buffet. J’en suis d’accord, et retire mon amendement.
L’amendement AC 590 est retiré.
M. Frédéric Reiss. Pour la rédaction que vous venez de proposer, monsieur le président, la conjonction « ou » est préférable.
M. Patrick Hetzel. L’exposé sommaire de l’amendement AC 590 insiste sur le fait que les langues régionales sont un « patrimoine à transmettre ». Cette précision me semble importante.
M. le président Patrick Bloche. Deux des trois amendements dont nous venons de parler précisent que seules les langues vivantes sont visées – j’en suis désolé pour les amateurs de grec et de latin.
Mme Julie Sommaruga. La conjonction « ou », monsieur Reiss, suggère que l’on peut choisir d’enseigner une langue régionale plutôt qu’une langue étrangère. Or, si l’apprentissage des langues régionales est un plus pour la culture personnelle et la préservation du patrimoine, il n’a pas la même portée que l’apprentissage des langues étrangères, indispensable, notamment, pour l’avenir professionnel des enfants. Il me semble donc essentiel de s’en tenir à la version du président.
La Commission adopte l’amendement AC 704 ainsi rectifié.
Puis elle examine l’amendement AC 288 de M. Benoist Apparu.
M. Benoist Apparu. Je propose de substituer aux mots « langue vivante », le mot : « anglais » à l’alinéa 89. Cette langue étant devenue un outil de communication indispensable, il me paraît important que tous les élèves la maîtrisent. Un tel acquis favoriserait d’ailleurs, j’en suis intimement convaincu, l’apprentissage d’autres langues vivantes au collège.
M. le rapporteur. Aujourd’hui, 90 % des élèves choisissent l’anglais comme première langue vivante, la plupart des autres optant souvent pour l’allemand, dont il faut absolument défendre l’apprentissage. Avis défavorable.
M. Frédéric Reiss. Nous sommes d’accord avec l’idée que tous les élèves doivent maîtriser l’anglais. L’apprentissage de cette langue serait d’ailleurs lui aussi facilité par celui d’une autre langue vivante, étrangère ou régionale. L’objectif est que tous les élèves soient trilingues.
M. Patrick Hetzel. Nous sommes attachés à l’apprentissage d’une langue étrangère dès le plus jeune âge ; mais limiter cet objectif à l’anglais poserait des problèmes en Alsace, où l’allemand est beaucoup enseigné. Comme le rappelait M. Frédéric Reiss, cela facilite d’ailleurs l’apprentissage de l’anglais lui-même. Les recherches en science cognitive montrent que l’essentiel est d’apprendre une autre langue dès le plus jeune âge, quelle qu’elle soit.
M. Michel Ménard. Lors du cinquantième anniversaire de l’amitié franco-allemande, nous avons réaffirmé la volonté de renforcer les échanges entre nos deux pays. Un tel amendement enverrait donc un mauvais signal, même si la première langue, à défaut d’être l’anglais, ne doit pas forcément être l’allemand non plus.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, l’amendement AC 705 du rapporteur et les amendements identiques AC 373 de Mme Martine Faure et AC 358 de M. Paul Molac et l’amendement AC 591 de Mme Marie-George Buffet.
M. le rapporteur. L’amendement AC 705 vise à compléter l’alinéa 89 par une phrase ainsi rédigée : « Dans les académies concernées, et à la demande des familles, cet enseignement en langue vivante étrangère pourra être complété par l’apprentissage d’une langue régionale. » Cet amendement, qui prend en compte les éventuels souhaits des familles, ne serait pas redondant avec les précédents.
Mme Martine Faure. Je propose pour ma part de compléter l’alinéa par la phrase suivante : « Dans les académies concernées, l’apprentissage complémentaire d’une langue régionale sera favorisé et l’enseignement bilingue français-langue régionale sera encouragé dès la maternelle. » Les enfants baignant dans une langue régionale pratiquée au sein de leurs familles ont acquis une gymnastique du bilinguisme qui leur a facilité l’apprentissage d’une troisième langue.
M. Paul Molac. L’enseignement bilingue dans le primaire présente l’avantage de n’entraîner aucun coût supplémentaire, puisqu’il est assuré soit par un même maître, soit par deux maîtres à mi-temps pour chacune des langues. Ce type d’enseignement, efficace sur le plan pédagogique, existe dans l’école publique depuis la circulaire Savary de 1982.
Mme Marie-George Buffet. L’enseignement bilingue français-langue régionale dès la maternelle me semble être une source de réussite scolaire, comme on l’a par exemple rappelé ce matin avec le créole.
M. le rapporteur. L’enseignement bilingue « dès la maternelle » serait contradictoire avec d’autres dispositions du texte, aux termes desquelles la maternelle n’est plus une école préélémentaire. Si les amendements étaient rectifiés en conséquence, j’émettrais un avis favorable.
M. Mathieu Hanotin. La cohérence impose que l’on encourage l’apprentissage des langues régionales comme celui des langues étrangères dès le début de la scolarité obligatoire, ce qui n’exclut pas, bien entendu, les initiatives relevant de la liberté pédagogique.
M. Frédéric Reiss. En Alsace, l’enseignement bilingue français-langue régionale commence dès la maternelle, en moyenne voire en petite section, et il donne d’excellents résultats. L’apprentissage de la langue régionale, au demeurant, n’a pas grand-chose à voir avec celui d’une langue étrangère. Comme l’a rappelé M. Paul Molac, il n’implique pas de coûts supplémentaires puisqu’il est souvent assuré par un maître, selon une répartition horaire paritaire – treize heures pour chaque langue, devenues douze depuis la réforme Darcos.
M. Patrick Hetzel. Cet enseignement bilingue dès la maternelle – et jusqu’au lycée – est en effet répandu dans nos communes. Il a donné des résultats en Alsace et en Moselle, si bien que l’on a progressivement voulu le diffuser. Les trois amendements identiques ne nous semblent donc pas poser de problèmes particuliers.
Mme Annie Genevard. Je suis d’accord avec M. Mathieu Hanotin : nous devons, par cohérence, encourager également l’apprentissage des langues étrangères dès la maternelle.
Mme Martine Faure. S’il convient à mes yeux de conserver l’expression « dès la maternelle », on peut, pour lever la difficulté qu’évoquait le rapporteur, trouver un synonyme au terme d’« enseignement » – « sensibilisation » ou « pratique », par exemple.
M. Paul Molac. De fait, il ne s’agit pas d’« apprendre » une langue aux élèves de maternelle, mais de les en imprégner, au sein de classes qui comportent plusieurs niveaux. L’assimilation se fait donc de façon progressive, et elle rend possible l’enseignement de certaines matières dans la langue régionale dès le cours préparatoire.
Mme Marie-George Buffet. Si l’on peut discuter du terme d’« enseignement » de la langue régionale, la référence à un apprentissage dès la maternelle doit être maintenue, car c’est à cet âge que les enfants peuvent s’imprégner d’une langue.
Le rapporteur a rappelé la position du ministre, qui souhaite revoir les programmes et les objectifs de la maternelle. Je suis personnellement favorable à la maternelle obligatoire à partir de trois ans, même si, en l’occurrence, je reste ouverte à l’éventuel remplacement du mot « enseignement » par un autre terme.
M. le rapporteur. Je suis sensible aux arguments développés au sujet de la maternelle ; mais, pour remédier au problème que j’indiquais, je vous propose de remplacer le mot « enseignement » par le mot « pratique ». Les amendements identiques seraient donc ainsi rédigés : « Dans les académies concernées, l’apprentissage complémentaire d’une langue régionale sera favorisé et la pratique bilingue français-langue régionale sera encouragée dès la maternelle. » Une référence aux langues étrangères me semble difficile, madame Genevard, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent « dans les académies concernées ».
M. Mathieu Hanotin. Cette rédaction va dans le bon sens. Il y a en effet une vraie différence, y compris en matière de recrutement des enseignants, entre « l’apprentissage complémentaire d’une langue régionale » et l’enseignement bilingue.
M. Frédéric Reiss. L’analyse de M. Paul Molac est très juste. L’article L. 312-11 du code de l’éducation se réfère explicitement aux écoles maternelles : supprimer une telle référence constituerait donc une régression. Je suis par ailleurs favorable à ce que l’on encourage la pratique des langues étrangères comme des langues régionales, à condition que les moyens humains soient suffisants.
M. Jean-Jacques Vlody. Dans les académies ultramarines, les enseignants seront formés à ces pratiques. La référence à l’école maternelle me semble par ailleurs indispensable ; au reste, le système dont nous parlons existe déjà, à titre expérimental, dans les classes passerelles, où les langues régionales – en l’occurrence, le créole dans les outre-mer – sont enseignées en même temps que le français.
Mme Barbara Pompili. Le terme d’« enseignement » ne me gêne pas davantage que Mme Marie-George Buffet : ce point annonce d’ailleurs un débat intéressant sur la place et le rôle de l’école maternelle. Pourquoi, en l’occurrence, ne pas remplacer l’expression « la pratique bilingue » par les mots : « le bilinguisme » ?
M. le président Patrick Bloche. La rédaction serait donc la suivante : « Dans les académies concernées, l’apprentissage complémentaire d’une langue régionale sera favorisé et le bilinguisme français-langue régionale sera encouragé dès la maternelle. »
M. le rapporteur. Je suis favorable à cette rédaction, et retire mon amendement AC 705.
L’amendement AC 705 est retiré.
La Commission adopte les amendements identiques AC 373 et AC 358 ainsi rectifiés, l’amendement AC 591 devenant sans objet.
Puis elle examine les amendements AC 592 de Mme Marie-George Buffet et AC 359 de M. Paul Molac, pouvant faire l’objet d’une présentation commune.
Mme Marie-George Buffet. Mon amendement est défendu.
M. Paul Molac. Prix Nobel de littérature en 1904, Frédéric Mistral a écrit Mireille en langue occitane. Par souci de cohérence, il faudrait mentionner les langues régionales.
M. le rapporteur. Avis favorable à l’amendement AC 592.
L’amendement AC 359 est retiré.
L’amendement AC 592 est adopté.
La Commission est saisie de l’amendement AC 702 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit de préciser les modalités d’application de l’apprentissage des langues régionales.
L’amendement est adopté.
La Commission étudie l’amendement AC 448 de M. Mathieu Hanotin.
M. Mathieu Hanotin. Cet amendement vise à favoriser le développement des séjours à l’étranger, qui constituent un apport essentiel dans l’apprentissage d’une langue.
M. le rapporteur. Je suis favorable à cet amendement, car il précise qu’encourager les séjours est « souhaitable » ; il n’est pas question de les rendre obligatoires.
L’amendement est adopté.
La Commission examine l’amendement AC 548 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. Nous souhaitons introduire, après l’alinéa 90, le thème de l’éducation à l’environnement. Dès les années 1970, les conférences mondiales sur l’environnement en évoquent la nécessité, mais cet enseignement n’a pas encore trouvé sa place au sein de l’école. Indispensable pour faire évoluer les mentalités et les comportements, cette éducation devrait prendre la forme d’un parcours pluridisciplinaire liant discours et pratiques, et proposant, tout au long de la scolarité, une vision systémique des problèmes environnementaux. Cette base réflexive devrait susciter des débats prenant appui sur les expériences concrètes des élèves.
M. le rapporteur. Si l’on ouvre la liste des sujets à enseigner – qui relève de la compétence du Conseil supérieur des programmes –, celle-ci risque de se révéler interminable. Mon avis est favorable parce que la disposition figurera dans l’annexe, mais avec cette réserve orale.
Mme Annie Genevard. L’éducation à l’environnement n’est-elle pas déjà effective dans de nombreuses écoles ? Ne figure-t-elle pas dans la loi de 2005 ? Je ne crois pas que le terrain soit vierge.
M. Thierry Braillard. Il est regrettable que l’amendement spécifie quatre thèmes parmi tous ceux qui existent. La formule « tels que la qualité de l’air, les changements climatiques, la gestion des ressources ou la préservation de la biodiversité » dresse une liste restrictive ; en rester aux « grands enjeux environnementaux » serait préférable.
Mme Barbara Pompili. Ne pourrait-on pas remplacer « tels que » par « notamment », pour ouvrir le champ des possibles ?
Mme Julie Sommaruga. Madame Genevard, l’éducation à l’environnement n’existe pas partout. Certaines collectivités font l’effort de mettre en place cet enseignement dans les écoles primaires, mais ailleurs, par manque de moyens ou de motivation, ce n’est pas le cas. L’inscrire dans la loi encouragera à le faire.
M. le président Patrick Bloche. Plutôt que « tels que » ou « notamment », je suggère d’opter pour « comme », qui introduit une illustration non restrictive : « Cette éducation doit d’une part viser à nourrir la réflexion des élèves sur les grands enjeux environnementaux comme la qualité de l’air, les changements climatiques, la gestion des ressources ou la préservation de la biodiversité ».
Mme Barbara Pompili. C’était notre rédaction d’origine ; nous sommes donc parfaitement d’accord.
La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AC 63 du rapporteur.
Elle en vient ensuite à l’amendement AC 97 de M. Frédéric Reiss.
M. Frédéric Reiss. Cet amendement propose de supprimer l’alinéa 93 afin de garder la définition des cycles datant de la loi d’orientation de 1989, avec notamment, à l’école maternelle, le cycle des apprentissages premiers pour les élèves de la petite et de la moyenne section et le cycle des apprentissages fondamentaux pour ceux de la grande section, du CP et du CE1. On peut d’ailleurs se demander à quelle définition renvoie l’amendement AC 546 de Barbara Pompili relatif à l’alinéa 69, que nous avons adopté, qui cherchait à articuler cycles et socle commun. Le gain de l’alinéa 93 serait la création d’un cycle associant le CM2 et la classe de 6ème ; or, la continuité entre ces deux classes figure déjà dans la « loi Haby » de 1975. Cette nouvelle définition du cycle n’apporte donc rien de nouveau ; c’est pourquoi je propose d’en rester à la rédaction actuelle.
M. le rapporteur. Défavorable.
Mme Annie Genevard. Il est contradictoire de vouloir à la fois établir un pont entre l’école primaire et le collège, et supprimer celui entre l’école maternelle et l’école primaire. Réduire l’école maternelle à un seul cycle, c’est en signer la clôture.
L’amendement est rejeté.
La Commission est saisie de l’amendement AC 449 de M. Mathieu Hanotin, faisant l’objet d’un sous-amendement AC 700 du rapporteur.
M. Mathieu Hanotin. Il s’agit de lutter contre les transitions brutales d’un cycle à l’autre. La rupture la plus violente en termes de mode d’apprentissage se situe entre le CM2 et la 6ème, où l’on passe d’un enseignement transversal à des enseignements académiques. À ce titre, elle entraîne l’échec scolaire de nombreux élèves, notamment les plus en difficulté. Il faut rendre ce passage de l’enseignant polyvalent aux enseignants monovalents davantage progressif, afin de préparer au brevet et à l’enseignement du lycée.
M. le rapporteur. Je propose de remplacer les trois dernières phrases par la phrase suivante : « Le passage de l’école au collège doit être appréhendé de manière progressive ». Je serai favorable à l’amendement sous-amendé.
M. Frédéric Reiss. Mon amendement AC 97 participait du même esprit. Dans certaines académies – dans les zones urbaines sensibles ou les territoires ruraux difficiles –, on expérimente aujourd’hui les écoles du socle ; en toute logique, des enseignants qualifiés pour le second degré devraient pouvoir enseigner dans le premier degré, et inversement.
La Commission adopte le sous-amendement AC 700.
Puis elle adopte l’amendement AC 449 sous-amendé.
Elle en vient à l’amendement AC 374 de M. Luc Belot.
M. Luc Belot. Toutes les études, tant nationales qu’européennes, montrent que le redoublement est inefficace, les pays qui ne l’utilisent pas ayant souvent des résultats scolaires supérieurs aux nôtres. Par ailleurs, cette pratique coûte 2 à 3 milliards d’euros par an ! Ma proposition – sans doute excessive – de l’interdire doit être mise sur le compte de l’agacement ; les moyens supplémentaires mis à la disposition du système éducatif devraient, en effet, pour partie pallier les difficultés des élèves. Je retire donc mon amendement afin d’en retravailler la rédaction avant la séance publique.
L’amendement est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement AC 597 de Mme Annie Genevard.
Mme Annie Genevard. À l’alinéa 95, après le mot « redoublements », je suggère d’ajouter : « par une individualisation des méthodes d’enseignement et un accompagnement personnalisé de l’élève. La formation initiale et continue des maîtres doit consacrer à cet objectif prioritaire une large part ».
Il s’agit de lutter contre l’échec scolaire. En effet, on parle depuis longtemps de la nécessité de réduire le redoublement, car l’efficacité de cette pratique très coûteuse – en 2010, la Cour des comptes a chiffré la dépense à 2 milliards d’euros – n’est pas démontrée. Mais décréter cette nécessité ne résout pas le problème des élèves qui arrivent en classe supérieure en situation de fragilité. Il est indispensable de mettre en place un enseignement personnalisé se concentrant sur les progrès de l’élève : je regrette que le texte proposé ne le mentionne pas.
M. le rapporteur. Avis défavorable, non sur le fond, mais parce que cette rédaction de l’alinéa 95 supprimerait l’explication donnée à la volonté de réduction du nombre de redoublements – « car il s’agit d’une pratique coûteuse plus développée en France que dans les autres pays et dont l’efficacité pédagogique n’est pas probante » –, qui me paraît essentielle.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle étudie l’amendement AC 375 de Mme Anne-Lise Dufour-Tonini.
Mme Anne-Lise Dufour-Tonini. Nous proposons de compléter ainsi l’alinéa 95 : « Dans le cadre de la programmation des connaissances, compétences et méthodes attendues en fin de cycle et non plus en fin d’année scolaire, le redoublement d’une année scolaire doit être exceptionnel ». Sans l’interdire – puisque certains élèves malades ou victimes d’aléas impondérables peuvent manquer six ou huit mois de classes –, il faut rendre le redoublement exceptionnel : « Le maintien d’un élève dans un cycle pour une année supplémentaire doit s’appuyer sur un constat de déficit grave dans les attendus d’un élève en fin de cycle. Le maintien dans un cycle est proposé par l’équipe pédagogique du cycle, soumis à l’avis du psychologue scolaire et à la validation des parents ou des responsables légaux. »
M. le rapporteur. Le problème du redoublement représente un vrai sujet de débat. Je vous propose de retirer votre amendement pour le rédiger à nouveau – peut-être avec Luc Belot – en vue d’une discussion de fond dans l’hémicycle.
Mme Annie Genevard. Je note une différence de traitement entre mon amendement et celui de mes collègues !
Nous sommes d’accord sur le constat, ce qui devrait nous encourager à trouver les modalités d’un consensus ; mais il ne suffit pas de déclarer que les redoublements doivent être réduits, il faut également proposer des méthodes pour parvenir à cet objectif. L’intérêt de mon amendement – tout comme de celui de Mme Anne-Lise Dufour-Tonini – réside dans les solutions concrètes envisagées.
Mme Anne-Lise Dufour-Tonini. M’en remettant à la sagesse du rapporteur, je retire mon amendement pour le retravailler avec mes collègues et en déposer un nouveau, en vue de la séance publique.
L’amendement est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement AC 703 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit de prévoir que lors de l’élaboration de la carte scolaire, les autorités académiques auront un devoir d’information et de concertation avec les exécutifs locaux des collectivités territoriales concernées.
Mme Brigitte Bourguignon. Je suis ravie de découvrir cet amendement, même si je l’aurais souhaité plus précis. Celui que j’avais rédigé avec plusieurs collègues visait à imposer un délai de prévision de deux ans aux fermetures et aux ouvertures de classes dans les territoires ruraux.
Mme Annie Genevard. L’attention particulière portée aux territoires ruraux et de montagne ne peut que me satisfaire. Pourtant, les suppressions de classes s’y sont poursuivies ; Mme Marie-Christine Dalloz en a ainsi été témoin dans le massif du Jura. Dire les choses est salutaire ; mais mettre les politiques en adéquation avec les mots l’est davantage encore.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AC 376 de M. Michel Pouzol.
Mme Martine Faure. Il s’agit, à l’alinéa 111, de préciser que les spécificités des missions et du fonctionnement des réseaux d’aides spécialisés aux élèves en difficultés (RASED) seront garanties et s’intégreront dans une logique de complémentarité avec l’ensemble des dispositifs d’aide.
M. le rapporteur. Je propose de remplacer « seront garanties » par « seront réexaminées ». Le rapport annexé souligne, en effet, que les RASED s’intégreront dans la politique d’aide globale, dont le projet d’avoir plus de maîtres que de classes. Dans certains endroits, le RASED pourra ainsi être inséré au sein d’un dispositif plus efficace. Parler de « garanties » fige les choses, alors que, s’il faut garantir la mission des RASED, celle-ci ne passe pas forcément par leur forme actuelle. Il est d’ailleurs contradictoire d’affirmer, d’une part, que les spécificités des missions et du fonctionnement des RASED « seront garanties », et, d’autre part, qu’elles « s’intégreront dans une logique de complémentarité avec l’ensemble des dispositifs d’aide », cette intégration supposant une capacité d’évolution que le mot « garanties » risque d’interdire. Je donnerai un avis favorable si l’amendement est ainsi rectifié.
M. Thierry Braillard. Je suis d’accord avec le rapporteur. En revanche, on pourrait peut-être insérer une parenthèse dans le texte de l’amendement pour développer le sigle « RASED ».
M. le président Patrick Bloche. C’est spécifié de manière explicite dans le rapport annexé, mais nous pouvons en effet le rappeler.
Mme Barbara Pompili. Notre amendement AC 549, qui doit être examiné après celui-ci, va dans le sens des propos du rapporteur. Nous proposons en effet de remettre un rapport pour étudier les conditions du renforcement des effectifs des RASED et la pérennisation de leurs missions.
M. Xavier Breton. L’évolution des RASED doit pouvoir être envisagée. Dans l’avis budgétaire que notre ancien collègue, M. Gérard Gaudron, et moi-même y avions consacré lors de la précédente législature, nous montrions que leurs missions n’avaient pas été remises en cause depuis des années, jusqu’à ce que les décisions budgétaires y obligent. L’efficacité des RASED recueillait pourtant des appréciations contrastées sur l’ensemble du territoire ; la proposition du rapporteur me semble donc aller dans le bon sens, car, si un dispositif d’accompagnement est nécessaire, il faut pouvoir l’adapter et non le figer en l’état.
M. le président Patrick Bloche. La partie du rapport annexé dont il est question est consacrée à l’évolution des missions des RASED ; il s’agit donc de s’inscrire dans une perspective dynamique.
M. Frédéric Reiss. Je suis d’accord avec le rapporteur : il convient de réfléchir à l’articulation entre le dispositif RASED et celui du « plus de maîtres que de classes ». Les deux heures personnalisées introduites par la réforme Darcos permettaient le traitement de la difficulté scolaire par le maître lui-même. Les maîtres E et G, quant à eux, font partie d’une équipe éducative ; leur intervention peut se justifier dans des écoles comportant un certain nombre de classes, mais c’est moins évident s’ils se déplacent une heure par semaine pour quelques élèves. Une rédaction plus souple serait préférable.
Mme Martine Faure. Il paraît néanmoins nécessaire de conserver l’idée que l’action des RASED est appelée à se poursuivre. Une évaluation n’apporte aucune garantie pour la suite.
M. le rapporteur. Il est proposé de réexaminer « les spécificités des missions et du fonctionnement des RASED », non les RASED eux-mêmes !
M. le président Patrick Bloche. Et je rappelle que nous avons déjà adopté un amendement de M. Michel Pouzol tendant à garantir l’existence des RASED.
Mme Martine Faure. J’en conviens.
M. le rapporteur. Quant à l’amendement AC 549 de Mme Pompili, il est satisfait par anticipation, puisque cela rentrera dans le cadre des attributions du comité de suivi.
Mme Barbara Pompili. Dans ce cas, je le retire et j’en proposerai un autre ultérieurement.
La Commission adopte l’amendement AC 376 rectifié.
L’amendement AC 549 est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement AC 292 de M. Benoist Apparu.
Mme Annie Genevard. Cet amendement traite d’un sujet d’actualité, puisqu’il tend à supprimer les alinéas concernant la réforme des rythmes scolaires. En effet, si nous souscrivons à l’idée que la semaine de quatre jours et demi est souhaitable pour l’équilibre des élèves, en revanche nous estimons que le gouvernement a engagé cette réforme de manière catastrophique, en réussissant à coaliser contre elle tant de collectivités locales…
M. Stéphane Travert. Mais non !
Mme Annie Genevard. Mais si : on verra combien de communes s’y engageront dès la rentrée 2013 !
M. Stéphane Travert. Elles ne sont pas contraintes de le faire dès 2013 !
Mme Annie Genevard. Elles n’ont pas la possibilité matérielle de la mettre en œuvre, et je ne suis pas certaine qu’une année supplémentaire y suffira !
Actuellement, les directeurs académiques des services de l’éducation nationale (DASEN) s’évertuent à montrer comment on peut s’accommoder des nouveaux rythmes scolaires pour changer un minimum de choses. Cela signifie que l’objectif est de bousculer le moins possible l’organisation de la journée scolaire.
Matériellement, on ne pourra pas lâcher les enfants à quatre heures moins le quart ; il faudra bien s’occuper d’eux jusqu’à quatre heures et demie. Comment fera-t-on dans une région frontalière comme la mienne, où il est déjà difficile de trouver une nounou ? Comment les collectivités arriveront-elles à augmenter leur masse salariale de près de 5 % ? Et comment ralliera-t-on les enseignants à une réforme dont ils ne veulent pas en ces termes ? Tout cela manque de préparation !
M. le rapporteur. Avis défavorable.
M. Frédéric Reiss. Cette réforme des rythmes scolaires est en effet d’une impréparation totale. On se trouve dans une situation insensée : alors que le ministre peut s’appuyer sur le travail de la Conférence nationale sur les rythmes scolaires et sur le rapport rédigé par MM. Yves Durand et Xavier Breton lors de la précédente législature, il arrive à se mettre tout le monde à dos !
Les gens ne sont pas forcément opposés à la semaine de quatre jours et demi, mais, pour la rendre effective à la rentrée 2013, une enveloppe de 250 millions d’euros ne suffira pas. Les élus locaux, qui sont des personnes responsables, ne veulent pas d’une fausse solution !
M. Xavier Breton. La mise en œuvre de la réforme provoque des interrogations, des inquiétudes, voire des blocages sur tout le territoire. Vous ne pouvez pas répondre : « Circulez, il n’y a rien à voir » ! Il faut envoyer un message, soit par la suppression pure et simple de ces alinéas, soit par le biais d’amendements tenant compte des difficultés actuelles.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AC 293 de M. Benoist Apparu.
Mme Annie Genevard. Il s’agit d’un amendement de repli, qui vise à repousser l’application de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014 sur l’ensemble du territoire national.
M. le rapporteur. Avis défavorable : certaines communes se sont déjà organisées pour la rentrée 2013.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AC 64 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AC 550 de Mme Barbara Pompili.
Mme Isabelle Attard. Cet amendement tend à rendre effective l’interdiction formelle des devoirs à la maison pour les élèves du premier degré, qui est officielle depuis une circulaire de 1956, confirmée par une autre circulaire de 1994.
Malgré ces injonctions, l’interdiction n’a jamais été appliquée. De nombreuses études ont pourtant démontré que les devoirs à la maison ne contribuaient pas à attirer les élèves vers le savoir et qu’ils sont un facteur d’aggravation des inégalités scolaires, en offrant aux bons élèves la possibilité d’avancer plus vite sans permettre à ceux en difficulté de combler leur retard. Cela est aggravé par le fait que les familles ne sont pas égales dans la façon dont elles accompagnent leurs enfants dans leurs devoirs : celles appartenant à des milieux culturels élevés apportent une aide plus adaptée aux demandes de l’école que ceux appartenant à des milieux culturels défavorisés. Il convient d’en finir définitivement avec les devoirs à la maison et de trouver de nouvelles méthodes pédagogiques permettant à tous les élèves de parfaire leurs apprentissages.
Nous savons que les parents sont souvent réticents à une suppression des devoirs, mais cela aura de l’effet si elle est faite en liaison avec eux et en les associant à la vie scolaire.
M. le rapporteur. Si les auteurs de l’amendement acceptaient de se conformer aux circulaires citées en ajoutant « écrits » après « devoirs », je serais favorable à l’amendement ainsi rectifié.
Mme Isabelle Attard. Nous en sommes d’accord.
M. Xavier Breton. Peut-être faudrait-il s’interroger aussi sur les raisons de ce non-respect des circulaires… S’il faut faire attention à ne pas creuser les inégalités, je sais d’expérience que les devoirs écrits peuvent avoir un intérêt, notamment lorsqu’ils sont proposés sous une forme collective, car cela permet à des élèves issus de milieux différents de travailler ensemble et d’avoir accès aux mêmes ressources. Vous, vous prônez un nivellement par le bas ; attention à ne pas avoir une approche idéologique de ces questions !
M. Mathieu Hanotin. M. Luc Belot a présenté tout à l’heure un amendement sur le même sujet. Peut-être serait-il intéressant de réfléchir à une rédaction commune ?
M. le président Patrick Bloche. Je pense qu’il serait préférable d’en rester à la rectification du rapporteur…
Mme Annie Genevard. Il faut rappeler la liberté pédagogique des enseignants. Ils connaissent mieux que quiconque leurs élèves, leurs limites et les possibilités que ceux-ci ont de progresser à travers des devoirs écrits, qu’ils soient faits à la maison ou ailleurs. Ne cherchez pas à tout réglementer ! Qu’un enseignant se voie interdit par la loi de donner à ses élèves un devoir écrit, collectif ou individuel, me paraît outrancier.
M. Luc Belot. C’est pourtant le cas depuis 1956 !
Mme Annie Genevard. Alors, demandons-nous pourquoi ce n’est pas respecté !
Notre collègue prétend que ce serait le cas si c’était fait en liaison avec les parents. Or, les milieux défavorisés, qui seraient d’après vous pénalisés par les devoirs à la maison, sont précisément ceux où le soutien familial est le plus faible. Comment surmontez-vous cette contradiction ?
Mme Isabelle Attard. Il faut expliquer aux parents que les devoirs doivent être faits dans le temps scolaire, et non à la maison. Les devoirs à la maison sont une cause d’inégalité scolaire.
Ce que dit M. Xavier Breton est juste, mais le travail en groupe n’est pas du travail à la maison ; il peut avoir lieu dans le temps périscolaire ou au sein d’associations de bénévoles. L’école ne retrouvera son rôle d’ascenseur social que lorsque les inégalités générées par les devoirs à la maison seront cassées. Ceux qui, comme moi, aident d’autres élèves que leurs enfants à faire leurs devoirs savent qu’il existe pour certains parents des marches infranchissables. Si l’on ne redonne pas la responsabilité des devoirs écrits à l’école, on aggravera encore des inégalités déjà considérables.
La Commission adopte l’amendement AC 550 rectifié.
Elle en vient à l’amendement AC 294 de M. Benoist Apparu.
Mme Annie Genevard. Cet amendement tend à supprimer l’alinéa 120, qui prouve que la réforme des rythmes scolaires, mal préparée, est de surcroît incomplète, puisqu’elle ne modifie pas le nombre de semaines travaillées. Or la France a l’année scolaire la plus courte d’Europe et la journée scolaire la plus longue.
M. le rapporteur. Je me félicite que Mme Annie Genevard soit favorable à la proposition du ministre de raccourcir les vacances d’été ! Avis défavorable, néanmoins.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement AC 551 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. Je suis d’accord avec Mme Annie Genevard : la réforme des rythmes scolaires est incomplète. Il convient d’engager également un débat sur la durée de l’année scolaire ; à cette fin, notre amendement tend à remplacer, à l’alinéa 120, « pourra » par « devra ».
M. le rapporteur. Avis favorable.
M. Xavier Breton. Je suis d’accord avec la seconde partie de l’amendement : il importe de rappeler que la question des rythmes scolaires a pour principal enjeu l’intérêt de l’enfant.
En revanche, il me semble difficile de préjuger aujourd’hui d’une évolution de la durée de l’année scolaire – bien que j’y sois personnellement favorable. Il se peut en effet que la concertation sur le sujet arrive à la conclusion que le système actuel est le meilleur. Il serait préférable de conserver le texte en l’état.
Mme Annie Genevard. Cette explication dira à Mme Barbara Pompili la différence entre son amendement et le mien.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AC 450 de M. Mathieu Hanotin.
M. Mathieu Hanotin. Il est nécessaire de définir les facteurs d’échec scolaire au collège : la structure du collège, son manque de transversalité et de polyvalence, l’organisation académique et disciplinaire des enseignements qui provoque une rupture trop grande avec le CM2 – d’où l’intérêt d’instituer un conseil école-collège, comme le prévoit le projet de loi.
M. le rapporteur. Si je partage votre préoccupation, la rédaction de l’amendement peut prêter à confusion. L’organisation académique et disciplinaire des enseignements, quand elle est figée, est effectivement à revoir – ce sera le rôle du Conseil supérieur des programmes –, mais ce n’est pas la seule cause d’échec scolaire au collège ; en outre, il est délicat d’opposer comme vous le faites un degré d’enseignement à un autre. Je vous suggère donc de retirer votre amendement ; à défaut, j’y donnerais un avis défavorable.
M. Mathieu Hanotin. Je ne dis pas qu’il s’agit de la seule cause d’échec scolaire ! Toutefois, j’accepte de retirer mon amendement.
L’amendement est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 100 de M. Frédéric Reiss.
La Commission en vient à l’amendement AC 379 de Mme Anne-Lise Dufour-Tonini.
M. Michel Ménard. Cet amendement tend à remplacer, dans la dernière phrase de l’alinéa 124, le verbe « autorise » par le verbe « nécessite », et prévoit que les pratiques différenciées sont adaptées aux besoins des élèves.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement AC 378 de M. Mathieu Hanotin, qui fait l’objet du sous-amendement AC 699 du rapporteur.
M. Mathieu Hanotin. L’amendement AC 378 est un amendement collectif visant à favoriser l’épanouissement personnel et l’autonomie intellectuelle des élèves, notamment par une prise en charge spécifique des élèves en grande difficulté scolaire.
M. le rapporteur. Le sous-amendement AC 699 est rédactionnel.
Mme Annie Genevard. Ces amendements reconnaissent qu’il est nécessaire de mettre en place des pratiques différenciées pour les élèves en difficulté. Je ne vois pas pourquoi ils seraient adoptés puisque mon amendement visant à introduire les notions d’individualisation des méthodes d’enseignement et d’accompagnement personnalisé de l’élève a été rejeté !
Mme Michèle Fournier-Armand. Il faudrait de toute façon corriger la première phrase ; la formulation correcte serait : « Celles-ci doivent favoriser l’épanouissement personnel et la construction de l’autonomie intellectuelle des élèves ».
M. le président Patrick Bloche. On aboutirait donc au texte suivant : « Compléter l’alinéa 124 de cet article par un alinéa ainsi rédigé : “Celles-ci doivent favoriser l’épanouissement personnel et la construction de l’autonomie intellectuelle des élèves. Elles permettent la prise en charge spécifique des élèves, notamment de ceux en grande difficulté scolaire. Ces pratiques différenciées s’enrichissent de toutes les innovations et initiatives pédagogiques des équipes enseignantes.” »
L’auteur de l’amendement est-il d’accord avec ces modifications ?
M. Mathieu Hanotin. Oui.
M. le rapporteur. J’y suis également favorable.
La Commission adopte le sous-amendement AC 699 du rapporteur.
Puis elle adopte l’amendement AC 378 ainsi rectifié et sous-amendé.
La Commission est saisie des amendements identiques AC 295 de M. Benoist Apparu et AC 101 de M. Frédéric Reiss.
Mme Annie Genevard. Supprimer les orientations précoces est manifestement une erreur.
M. Frédéric Reiss. L’amendement tend à supprimer l’alinéa 125, qui remet en cause la « loi Cherpion » de 2011 relative à la formation en alternance pour les élèves de 4ème et de 3ème. Il s’agissait là d’une bonne solution pour les élèves souhaitant se diriger vers une nouvelle voie, qui pouvait du reste être une voie d’excellence.
M. le rapporteur. Avis tout à fait défavorable. Ces amendements révèlent une différence de conception qui devra faire l’objet d’un débat en séance publique. L’orientation précoce – qui est en fait une sélection – est une erreur socialement pénalisante. Dans tous les systèmes éducatifs efficaces, l’orientation est tardive – c’est-à-dire postérieure à l’âge de la fin de scolarité obligatoire –, ce qui n’empêche pas le recours à des pédagogies adaptées aux différents élèves. Je rappelle en outre que le pré-apprentissage pour les jeunes d’au moins quinze ans, qui concerne environ 7 000 jeunes par an, n’est pas remis en cause.
Le texte du projet de loi témoigne d’une volonté de maintenir le collège unique. Il y a du reste une contradiction flagrante entre l’ambition d’assurer à tous les élèves l’acquisition du socle commun de compétences, de connaissances et de culture et l’éjection d’une partie d’entre eux avant la fin du collège.
La Commission rejette ces amendements.
Puis elle examine l’amendement AC 451 de M. Mathieu Hanotin.
M. Mathieu Hanotin. L’amendement tend à préciser que le travail en équipe et les projets de classe permettront une plus grande transversalité.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte cet amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 552 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. Je défendrai également l’amendement AC 553, qui porte sur le même thème. Ces deux amendements visent à favoriser l’expérimentation – dans les collèges pour l’amendement AC 552 et dans les lycées pour l’amendement AC 553.
En effet, le droit à l’expérimentation prévu par l’article L. 401-1 du code de l’éducation, ne s’applique aujourd’hui qu’au projet d’école et est en outre soumis à autorisation académique. Il importe de renforcer ce droit pour faire évoluer les pratiques et transformer l’école.
Cette mesure pourrait inciter les échelons intermédiaires, comme les inspecteurs, à accompagner les équipes dans la conduite de ces projets et à les inscrire dans le temps et dans l’espace. Il convient donc d’augmenter la marge de manœuvre des enseignants et des équipes pédagogiques, sur la base du volontariat.
Les expérimentations déjà mises en œuvre sont plutôt heureuses. Elles favorisent l’intelligence collective et produisent des résultats attractifs pour les autres établissements. Le collège Clisthène, à Bordeaux, en est un bon exemple. On y applique des principes consistant notamment à adapter l’emploi du temps aux rythmes biologiques et psychologiques de l’enfant, à faire de l’élève l’acteur de son parcours et, plus généralement, à repenser les temps scolaires avec des temps disciplinaires et interdisciplinaires. Les jeunes peuvent parler de leur expérience et débattre, participer à des ateliers artistiques, travailler en petits groupes et disposer de plages longues permettant d’organiser des activités d’apprentissage plus variées.
M. le rapporteur. Avis favorable, sous réserve de préciser que les expérimentations doivent faire l’objet d’une évaluation.
Mme Julie Sommaruga. L’expression de « regroupements d’élèves en fonction de leurs besoins » appelle une explication. Une telle différenciation peut relever d’une stigmatisation ordinairement liée à l’échec scolaire. Depuis quelques années, le recours à la pédagogie différenciée et à des activités décrochées permet à certains élèves de s’en sortir.
Mme Marie-George Buffet. J’appuie l’intervention de Mme Julie Sommaruga. L’expression qu’elle relève n’est pas adaptée.
M. Frédéric Reiss. L’article 34 de la loi du 23 avril 2005 a déjà permis de procéder, au collège et à l’école primaire, à des expérimentations d’une durée de cinq ans qui, comme l’a souligné le rapporteur, doivent être évaluées. Les évaluations réalisées ont d’ailleurs fait l’objet d’un rapport du Haut Conseil de l’éducation en date du 29 novembre 2011. L’amendement n’apporte donc rien de nouveau à un dispositif qui fonctionne.
Mme Barbara Pompili. Afin d’éviter toute confusion, j’accepte de supprimer du texte de mon amendement les mots « en fonction de leurs besoins ». Je suis également prête à intégrer l’ajout proposé par le rapporteur.
La Commission adopte cet amendement ainsi rectifié.
Puis elle examine l’amendement AC 452 de M. Mathieu Hanotin.
M. Mathieu Hanotin. Compte tenu de l’adoption de l’amendement précédent, je retire celui-ci.
L’amendement est retiré.
La Commission est alors saisie de l’amendement AC 553 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. Il y aurait lieu de procéder pour cet amendement, qui tend à favoriser l’expérimentation au lycée, à la même suppression et au même ajout que pour l’amendement AC 552.
La Commission adopte cet amendement ainsi rectifié.
Elle examine ensuite l’amendement AC 311 de M. Benoist Apparu.
Mme Annie Genevard. L’amendement propose d’ajouter à l’alinéa 131 une mention du baccalauréat professionnel, diplôme d’insertion qui a fait ses preuves. La voie professionnelle doit être valorisée comme voie spécifique d’accès au baccalauréat.
M. le rapporteur. Il faut certes valoriser la voie professionnelle, mais cet amendement, qui met en lumière le baccalauréat en omettant le certificat d’aptitude professionnelle (CAP), est un peu déséquilibré. Avis défavorable.
Mme Sylvie Tolmont. Qu’est-ce qu’un « diplôme d’insertion » ?
Mme Annie Genevard. Monsieur le rapporteur, rien n’interdit de mentionner le CAP, mais il s’agit plutôt de pousser les élèves à élever leur exigence en matière de niveau de diplôme. Engager le plus grand nombre d’élèves sur la voie du baccalauréat professionnel n’implique aucun mépris à l’égard du CAP.
Quant au « diplôme d’insertion », l’expression parle d’elle-même.
M. le rapporteur. Je maintiens mon avis défavorable.
La Commission rejette cet amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel AC 65 du rapporteur.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement AC 296 de M. Benoist Apparu.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AC 66 du rapporteur.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement AC 308 de M. Benoist Apparu.
Puis elle examine l’amendement AC 309 de M. Benoist Apparu.
M. Benoist Apparu. Cet amendement tend à intégrer dans l’examen du baccalauréat une partie de contrôle continu. Dans un texte de « refondation » destiné à définir notre vision de l’éducation pour les dix ans qui viennent, nous devons prendre position quant à cet examen sacro-saint dans la symbolique française.
M. le rapporteur. L’article L. 331-1 du code de l’éducation dispose que, « en vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, éventuellement en les combinant, des résultats d’examens terminaux, des résultats des contrôles en cours de formation, des résultats du contrôle continu des connaissances, et de la validation des acquis de l’expérience ». Cela semble répondre en grande partie à votre proposition.
Par ailleurs, la loi de refondation est une loi dynamique qui, si elle est principalement consacrée à l’école primaire, donne néanmoins certaines orientations pour le collège, réaffirmant notamment le collège unique, et ouvre l’indispensable réflexion sur le « bac -3, bac +3 », laquelle implique nécessairement une réflexion sur le baccalauréat.
Avis défavorable, donc.
M. Benoist Apparu. Après m’avoir répondu que l’amendement était déjà satisfait par la loi existante et qu’il était donc inutile, vous soulignez que le projet de loi qui nous est soumis réaffirme le collège unique, lui aussi déjà inscrit dans le droit : il y a dans ce raisonnement une certaine contradiction.
Si la loi de refondation est une loi « dynamique », l’introduction du contrôle continu serait un message important que le législateur adresserait à la communauté éducative. Elle obligerait en outre le ministère à engager la réforme du baccalauréat, dont on parle depuis longtemps, mais qui n’a jamais été faite.
Mme Isabelle Attard. Une modification du baccalauréat est attendue par le corps enseignant comme par les élèves et par les parents. Nous ne pourrons pas en faire l’économie.
La Commission rejette cet amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement AC 312 de M. Benoist Apparu.
M. Benoist Apparu. La notion même de service public entraîne des obligations, comme celle de continuité. La création d’un service public de l’enseignement numérique créerait ainsi une opposabilité devant les tribunaux français. Il importe donc d’affirmer que le seul service public est celui de l’éducation nationale, quitte à trouver une autre terminologie pour le service que vous prévoyez de créer.
M. le rapporteur. Il s’agit d’ouvrir à tous un droit égal d’accès au numérique – et c’est en cela que l’on peut parler de service public, mais le seul service public est assurément celui de l’éducation nationale, dont le service de l’enseignement numérique ne saurait s’émanciper et auquel il ne saurait se substituer.
Votre amendement est trop sec et j’émets un avis défavorable, mais je proposerai moi-même des amendements tendant à éviter que le service public du numérique ne devienne un concurrent ou un substitut au service public de l’éducation.
M. Benoist Apparu. Je retire donc mon amendement.
L’amendement est retiré.
La Commission examine les amendements AC 716, AC 717 et AC 718 du rapporteur, ainsi que les amendements AC 598 de Mme Annie Genevard et AC 166 de M. Patrick Hetzel, faisant l’objet d’une présentation commune.
M. le rapporteur. L’amendement AC 716 tend à remplacer la notion de « service public de l’enseignement numérique » par celle de « service public du numérique éducatif », exprimant ainsi qu’il ne saurait y avoir de concurrence avec le service public de l’éducation nationale tout en affirmant la nécessité d’un service public qui assure l’égalité d’accès aux droits.
L’amendement AC 717 tend à préciser que « l’école doit s’adapter et accompagner ces évolutions en créant, au sein du service public de l’éducation et afin de contribuer à l’exercice de ses missions, un service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance ».
Quant à l’amendement AC 718, il ajoute que « l’offre de ressources numériques ne peut se développer au détriment des heures d’enseignement et doit être mise en service dans le respect strict de programmes scolaires et des obligations d’accueil de tous les élèves », soulignant qu’un service public du numérique ne saurait se substituer au service public d’éducation.
Ces trois amendements répondent donc très exactement à la même préoccupation.
M. Frédéric Reiss. Ces amendements ne sont pas anodins. Il semble que l’État veuille prendre en main la production des ressources numériques éducative, qui ferait en quelque sorte l’objet d’une nationalisation empêchant le développement d’un marché pour lequel plusieurs éditeurs ont déjà commencé à travailler. C’est, à terme, la liberté pédagogique des enseignants qui serait menacée.
L’éducation nationale associe les éditeurs et les auteurs de contenus numériques éducatifs à son projet de développement numérique, dans le respect de tous. Il faut veiller à la diversité des offres et à la protection de la création intellectuelle en la matière.
M. le rapporteur. La création du service public, qui vise à assurer l’égalité d’accès, n’est pas monopolistique et n’est nullement contradictoire avec l’existence d’une concurrence. Ainsi, la création en 2005 du service public de l’enseignement à distance n’a aucunement tué la libre concurrence. Nous avons du reste répondu aux préoccupations des éditeurs, que nous avons auditionnés.
M. Benoist Apparu. Une première question est celle de la définition même d’un service public. Si la création d’un service public répond, selon vous, à la volonté d’assurer à tous l’accès à un service, quelle obligation créera à l’État ce droit opposable dans les territoires ruraux qui ne sont desservis ni par la fibre ni par l’ADSL, et qui, ne bénéficiant que d’un débit de 512 kilobits par seconde, n’auront pas accès à ces ressources numériques ?
Par ailleurs, quel objectif le ministère poursuit-il en créant ce service ? Entend-il créer des contenus ou en diffuser ?
Mme Annie Genevard. Nous sommes préoccupés par l’avenir de l’industrie privée de production d’outils pédagogiques numériques. L’enjeu économique que représente cette filière est en effet considérable puisqu’elle a consacré plus de 25 millions d’euros à la recherche : dans le contexte que nous connaissons, nous n’avons pas le droit de contribuer à fragiliser cette filière par la loi.
La pédagogie numérique est porteuse d’avenir et chacun doit pouvoir effectivement y accéder, mais ce dernier point relève seulement de considérations techniques quand la production des contenus, elle, relève de la liberté pédagogique. Si un producteur de contenus d’État doit exister, alors, il faut le dire, car cela ne peut que nourrir des interrogations sur la liberté des enseignants.
En outre, comment pouvez-vous garantir que l’industrie privée ne sera pas pénalisée ? Je vous invite à accepter notre amendement AC 598 qui, sans compromettre l’esprit de la loi, assure à cette filière la possibilité de continuer à produire des contenus.
M. Xavier Breton. L’amendement AC 166 est identique.
Le secteur du numérique éducatif se développe et les enjeux sont nombreux en termes pédagogiques, certes, mais aussi de création d’activités et de rayonnement. Nous devons donc prendre garde à ne pas brider les possibilités d’émergence des entreprises. À cette fin, il importe de déterminer les limites du service public du numérique éducatif de manière à ce qu’aucun monopole ne brime les initiatives privées.
M. Vincent Feltesse. Quelle sera la nature de l’éducation numérique dans les mois et les années à venir lorsque l’on sait que les producteurs de tablettes réfléchissent à la possibilité d’en vendre au prix de 100 euros environ et que dans un, deux ou quatre ans, les enfants seront vraisemblablement tous équipés de ces outils ?
Quels seront les contenus, sachant que quatre émetteurs différents sont possibles : le service public numérique, les éditeurs scolaires classiques, les professeurs eux-mêmes, mais aussi de grandes sociétés privées comme Amazon ou Apple qui peuvent produire des contenus peu onéreux, puis se constituer en monopoles ?
L’amendement AC 380, que je défendrai tout à l’heure, propose la mise en place d’une « labellisation » des contenus qui laisse leur part aux éditeurs privés tout en interdisant l’accès à certains entrants. S’il n’est pas adopté, je crains que les contenus ne soient produits par les grands groupes privés qui disposent d’une avance technologique.
Mme Annie Genevard. La fragilisation des maisons d’édition françaises ouvre également la porte aux majors.
M. Vincent Feltesse. Mon amendement vise précisément à protéger ces maisons.
M. le rapporteur. Avis défavorable aux amendements AC 598 et AC 166.
Mes amendements visent à défendre deux principes : faire en sorte que le numérique soit essentiellement un outil au service de la révolution pédagogique qui est au centre de cette loi ; ne pas laisser le numérique scolaire au seul marché qui se constituerait ainsi en une manière de cheval de Troie pour des intérêts totalement privés.
Le service public de l’enseignement numérique n’impliquant pas un monopole, je le répète, la concurrence sera effective.
La Commission adopte successivement les amendements AC 716, AC 717 et AC 718.
Elle rejette ensuite successivement les amendements AC 166 et AC 598.
Elle adopte l’amendement rédactionnel AC 629 du rapporteur.
La Commission est ensuite saisie de l’amendement AC 380 de M. Vincent Feltesse.
M. Vincent Feltesse. Comment préserver une filière d’édition numérique pédagogique française de qualité ? L’amendement dispose que les opérateurs de l’éducation nationale étendent aux supports pédagogiques numériques leur dispositif d’agrément des supports pédagogiques papier. Cette position me semble équilibrée.
M. le rapporteur. Je suis très favorable à cet amendement, sauf que le dispositif d’agrément des supports pédagogiques papiers n’existe pas.
M. Vincent Feltesse. Je ne méconnais pas cette difficulté, mais j’avoue ne pas avoir trouvé la bonne solution. Le Syndicat national des éditeurs nous a quant à lui proposé des amendements que j’ai jugés un peu trop contraignants.
M. le rapporteur. Je vous propose de retirer votre amendement et de le revoir avant la séance publique.
M. Vincent Feltesse. Soit.
L’amendement AC 380 est retiré.
M. Benoist Apparu. M. le rapporteur a raison : il n’existe pas d’agrément, en l’état, pour les supports papiers.
En outre, comment la nouvelle rédaction pourra-t-elle proposer un agrément pour les supports numériques alors que l’agrément pour les supports papiers ne sera toujours pas effectif ? Qu’en sera-t-il, de surcroît, de la liberté pédagogique des enseignants ?
Apple et Amazon investissent dans l’enseignement numérique avec des moyens qui n’ont rien à voir avec les 25 millions d’euros engagés par les éditeurs de livres scolaires. Le décalage sera donc extraordinaire entre les propositions éventuelles des majors du numérique et ce qu’il sera possible de faire en interne, y compris au niveau de l’État. Le Centre national de documentation pédagogique (CNDP) et le Centre national d’enseignement à distance (CNED) auront bien du mal à supporter une telle concurrence !
J’ai le sentiment que nous ne sommes pas suffisamment au clair sur l’action à conduire dans un domaine aussi complexe.
M. le rapporteur. Nous sommes en tout cas d’accord sur le constat que vous avez dressé.
M. Benoist Apparu. Enfin, il me semblerait astucieux de nous saisir spécifiquement de cette question du numérique puisque notre commission est compétente en la matière.
M. le président Patrick Bloche. En effet. Nous disposons également de la compétence sur la question des droits d’auteur et de la propriété intellectuelle qui relevait naguère de la Commission des lois.
Mme Isabelle Attard. S’agissant des droits d’auteur, des amendements traitant de l’exception pédagogique viendront en discussion. Les problématiques liées aux supports papiers et numériques sont ardues et les exceptions, voire les doubles exceptions, nombreuses. Nous devrons impérativement y réfléchir.
M. le président Patrick Bloche. La question de l’exception pédagogique relève de l’article 55.
Mme Annie Genevard. L’alinéa 155 du rapport annexé dispose que le développement de ressources et de services pédagogiques sera assuré notamment par la mobilisation des opérateurs de l’éducation nationale comme le CNDP et le CNED. Voilà objectivement de quoi nourrir les craintes de l’édition privée ! Je veux bien qu’il soit question de nouveaux travaux et de nouvelles auditions, mais cet alinéa soulève déjà un problème. Si nous ne protégeons pas nos propres filières économiques et la liberté pédagogique des enseignants, qui le fera ? La mise en place d’une source pédagogique unique d’État ne laisse pas d’interroger. Il n’est pas possible de laisser le texte tel quel.
M. le président Patrick Bloche. Je vous rappelle, d’une part, que M. Vincent Feltesse a retiré son amendement – mais il est vrai que ces sujets sont capitaux – et que nos constats et objectifs convergent. Nous sommes en effet soucieux de faire en sorte qu’aucun géant de l’internet ne s’approprie toutes les potentialités offertes par les supports pédagogiques numériques.
La Commission examine les amendements identiques AC 167 de M. Patrick Hetzel et AC 599 de Mme Annie Genevard.
M. Xavier Breton. Nous regrettons que Mme Fleur Pellerin, ministre chargée de l’économie numérique, n’ait pas été auditionnée. Le problème dont nous débattons concerne d’ailleurs plusieurs commissions et ministères.
La procédure d’agrément est un peu trop rigide. Elle n’est en effet pas souhaitable pour les supports papiers – nous avions rédigé un rapport lors de la précédente législature à l’occasion de la polémique sur les manuels de sciences de la vie et de la terre en classe de 1ère préconisant de préserver la liberté éditoriale –, mais il est néanmoins important de trouver des règles. Aussi l’amendement AC 167 vise-t-il à limiter le champ d’intervention du service public de l’enseignement numérique et à préserver le respect des règles de concurrence.
Mme Annie Genevard. L’édition papier, essentiellement le fait de sociétés privées, est aujourd’hui diverse. Pourquoi n’appliquerait-on pas les mêmes règles pour les supports pédagogiques numériques ? Pourquoi un traitement différent ?
Il ne me semble pas pertinent de confier une telle mission au CNDP et au CNED : ce serait économiquement dangereux pour les entreprises de la filière.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
Je répète que l’existence d’un service public n’implique pas l’absence de toute concurrence, mais que la limitation systématique du service public des ressources numériques ouvrirait des perspectives qui ne sont pas acceptables dans le domaine éducatif.
La Commission rejette les amendements.
Elle étudie ensuite les amendements identiques AC 168 de M. Patrick Hetzel et AC 600 de Mme Annie Genevard.
M. Xavier Breton. La publication des ressources pédagogiques doit être réalisée en respectant le droit d’auteur, quelles que soient les formes de diffusion.
Mme Annie Genevard. L’amendement AC 600 est défendu.
M. le rapporteur. Le texte respectant strictement la loi, je ne peux qu’être défavorable à ces deux amendements.
La Commission rejette les deux amendements.
Elle examine l’amendement AC 453 de M. Mathieu Hanotin.
M. Mathieu Hanotin. Je propose de préciser à la fin de l’alinéa 163 que les plans de formation devront permettre à chaque établissement scolaire d’avoir deux référents numériques formés afin d’assurer une véritable « continuité » numérique, en particulier dans les collèges et les lycées où, lorsqu’un professeur s’en va, c’est bien souvent l’ensemble du projet numérique de l’établissement qui vacille.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Cela n’entre pas dans le cadre de la loi.
M. Mathieu Hanotin. Il serait en tout cas possible d’en faire un objectif tant la question de la formation des enseignants est importante.
M. le rapporteur. Cela relève du cahier des charges et des référentiels de formation des enseignants, mais pas d’un texte de loi.
M. Mathieu Hanotin. Je retire mon amendement.
L’amendement AC 453 est retiré.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AC 630 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AC 381 de M. Vincent Feltesse.
M. Vincent Feltesse. Le Président de la République s’est engagé à ce que le très haut débit soit déployé sur l’ensemble du territoire d’ici à 2020. Or, lorsqu’elle arrive au sein de nos collectivités locales, la fibre n’est pas systématiquement tirée jusqu’aux établissements scolaires, ce qui n’impliquerait pourtant pas toujours un surcoût. Nous proposons que, désormais, elle le soit.
M. le rapporteur. Avis favorable, puisque l’examen de sa recevabilité financière n’a pas censuré cet amendement.
M. le président Patrick Bloche. Les cofinancements étant déjà prévus dans le texte du projet de loi, la charge publique n’en est pas alourdie.
Mme Isabelle Attard. Je profite de cet amendement pour revenir sur notre proposition de loi relative au principe de précaution pour les risques résultant des ondes électromagnétiques du 31 janvier dernier. Oui au très haut débit et au développement de la connexion filaire dans les écoles, mais prenons garde au Wifi et à la 4G dans les écoles primaires ainsi qu’à ce que nous écrirons à l’avenir dans la loi.
M. Thierry Braillard. Je ne voterai pas cet amendement qui met la charrue avant les bœufs.
Le plan relatif au très haut débit a été adopté par l’ancienne majorité et inclut des « zones amies » dans lesquelles interviennent les opérateurs privés pour amener la fibre à l’habitant. Mme la ministre Fleur Pellerin, en outre, a annoncé qu’un nouveau plan serait proposé. Ces cofinancements doivent également être adaptés à la loi sur la décentralisation que nous discuterons bientôt.
Je n’imagine pas que les départements cofinancent l’arrivée de la fibre dans les écoles primaires et que les communes en fassent de même pour les collèges. Certaines régions ont mis en place de tels dispositifs pour les lycées et les établissements d’enseignement supérieur, mais elles les ont financés elles-mêmes.
Cet amendement n’est donc pas adapté au plan prévu, l’engagement du Président de la République n’étant par ailleurs pas encore complètement arrêté, et il soulève un problème s’agissant des compétences des différentes collectivités territoriales dans le cadre des lois de décentralisation.
M. le président Patrick Bloche. Je rappelle que M. Braillard est adjoint au maire de Lyon, dont nous connaissons l’indépendance.
M. Vincent Feltesse. On évoquait autrefois l’esprit girondin ; maintenant, il est question de l’esprit lyonnais !
M. le président Patrick Bloche. Et nous nous exprimons en français, non en langues régionales !
La Commission adopte l’amendement AC 381.
La Commission est saisie de l’amendement AC 382 de M. Michel Ménard.
M. Michel Ménard. Cet amendement vise à préciser que l’information délivrée en matière d’orientation s’attachera particulièrement à lutter contre les représentations préconçues et sexuées des métiers.
En effet, l’idée qu’il existe des « métiers d’homme » et des « métiers de femme » reste solidement ancrée dans les mentalités et contribue à ce que l’orientation ne soit pas toujours choisie, mais au contraire subie.
M. Yves Durand, rapporteur. Avis défavorable car l’amendement est satisfait par le texte.
M. Michel Ménard. Je fais confiance au rapporteur et retire mon amendement.
L’amendement est retiré.
La Commission en vient à l’amendement AC 383 de Mme Anne-Lise Dufour-Tonini.
Mme Martine Faure. Conformément au texte national d’orientation pédagogique qui précise que « l’option facultative de découverte professionnelle (3 heures hebdomadaires) vise à proposer aux élèves des classes de troisième du collège une approche du monde professionnel pour une découverte des métiers, du milieu professionnel et de l’environnement économique et social » et qu’elle « doit être proposée à tout élève », sans prédétermination de l’orientation post-3ème, cette option ne doit pas être « proposée uniquement aux élèves destinés à l’enseignement professionnel », mots que nous souhaitons en conséquence supprimer à l’alinéa 179.
M. le rapporteur. Je partage cette préoccupation mais je me demande si l’amendement n’est pas déjà satisfait par le texte même du rapport annexé. Je vous suggère de le retirer afin que nous étudiions la question. Vous pourrez le redéposer, le cas échéant, en vue de la séance publique.
Mme Martine Faure. D’accord.
L’amendement est retiré.
La Commission examine ensuite les amendements identiques AC 333 de Mme Sandrine Mazetier et AC 384 de Mme Sylvie Tolmont.
M. Hervé Féron. Ces amendements visent à insérer après l’alinéa 180 un alinéa précisant que le conseiller d’orientation-psychologue assure et coordonne l’organisation de l’information des élèves sur la connaissance de soi, des métiers et des formations en lien avec les équipes éducatives.
M. le rapporteur. Les amendements sont satisfaits par l’alinéa 22 du rapport annexé et par l’amendement AC 362, que la Commission a déjà adopté.
M. le président Patrick Bloche. Leurs auteurs accepteraient-ils de les retirer ?
Mme Sylvie Tolmont. Ce serait dommage. L’amendement AC 362, que j’ai présenté précédemment, réintroduisait les conseillers d’orientation-psychologues dans la liste des membres de la communauté éducative, tandis que ces amendements précisent leur rôle, qui ne saurait se limiter à un simple concours et devrait au contraire être central. En tant que spécialistes et dans la mesure où ils sont extérieurs à l’établissement, ils sont à même de porter sur les élèves un regard plus neutre, plus détaché de leurs résultats scolaires.
M. Frédéric Reiss. Je partage l’avis du rapporteur. Il ne faut pas oublier le rôle éminent que joue en la matière le professeur principal, dont la Commission a d’ailleurs déjà précisé les missions. Ces amendements me semblent donc redondants.
Mme Sylvie Tolmont. Bien qu’il ait en effet un rôle éminent en matière d’orientation, le professeur principal ne reçoit pas de formation spécifique pour le remplir. Puisque notre pays forme des professionnels de l’orientation, reconnaissons-leur au moins un rôle central sur cette question !
M. le rapporteur. Je demande néanmoins le retrait. Nous pourrons réfléchir à une formulation avant la réunion que nous tiendrons au titre de l’article 88 du Règlement, mais je ne pense pas qu’il soit du ressort de la loi de préciser le rôle de chaque profession au sein de l’éducation nationale.
Mme Sylvie Tolmont. Je retire mon amendement, mais avec tristesse. Il ne s’agit pas de n’importe quelle fonction. L’objectif du projet étant, entre autres, d’améliorer l’orientation des élèves, il me semble important de réaffirmer le rôle des conseillers d’orientation-psychologues.
Les amendements sont retirés.
La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel AC 67 du rapporteur.
Elle en vient à l’amendement AC 385 de M. Luc Belot.
M. Vincent Feltesse. Cet amendement vise à introduire plus d’égalité entre les différents métiers de l’enseignement en permettant aux enseignants exerçant dans les établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA) d’avoir le même statut que ceux qui exercent dans les lycées généraux et professionnels.
M. le rapporteur. Je vous demande de retirer cet amendement le temps que nous vérifiions si tel n’est pas déjà le cas. Dans l’hypothèse inverse, l’amendement aurait toute sa place et nous le discuterions dans le cadre de la réunion de Commission dite de l’article 88.
M. Vincent Feltesse. Soit.
L’amendement est retiré.
La Commission est saisie des amendements identiques AC 386 de Mme Martine Carillon-Couvreur et AC 663 de Mme Barbara Pompili.
Mme Martine Faure. Il s’agit de remplacer l’expression : « Accueillir les élèves en situation de handicap » par : « Scolariser les élèves en situation de handicap ».
Mme Barbara Pompili. Ce sont des amendements de conséquence.
M. le rapporteur. Avis favorable.
La Commission adopte les amendements identiques.
Elle examine ensuite l’amendement AC 172 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. Cet amendement est présenté au nom du groupe d’études sur l’intégration des personnes handicapées. Afin de garantir la scolarisation des élèves en situation de handicap dans de bonnes conditions, une formation spécifique des personnels enseignants et non enseignants est indispensable.
M. le rapporteur. L’amendement est satisfait par les dispositions du référentiel de compétences.
Mme Barbara Pompili. Nous allons étudier ces dispositions ; pour l’instant, nous retirons l’amendement.
L’amendement est retiré.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement de conséquence AC 664 de Mme Barbara Pompili.
Elle examine ensuite l’amendement AC 388 de Mme Martine Faure.
Mme Martine Faure. Comme l’amendement AC 172 de Mme Barbara Pompili, cet amendement traite de la formation des enseignants à l’accueil des enfants en situation de handicap. Je le retire pour étudier les dispositions du référentiel de formation.
L’amendement est retiré.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement de conséquence AC 665 de Mme Barbara Pompili.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AC 653 et AC 654 du rapporteur.
Elle en vient à l’amendement AC 389 de Mme Maud Olivier.
Mme Martine Faure. Cet amendement demande que les équipes éducatives soient sensibilisées aux pratiques dites de « jeux dangereux », notamment les pratiques de non-oxygénation et les jeux d’attaque. Il prévoit également que les élèves suivent au moins une séance de sensibilisation dans les écoles primaires et au collège.
M. le rapporteur. Avis favorable.
M. Xavier Breton. Qu’entendez-vous par « jeux d’attaque » ? Ne pourrait-on y comprendre le rugby, par exemple ?
M. le président Patrick Bloche. Je propose de ne viser spécifiquement que les pratiques de non-oxygénation parmi ces « jeux dangereux ».
Mme Martine Faure. Je suis d’accord.
La Commission adopte l’amendement AC 389 ainsi rectifié.
Elle examine ensuite l’amendement AC 555 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. Le Grenelle de l’environnement avait fixé l’objectif d’introduire 20 % de nourriture provenant de l’agriculture biologique dans la restauration collective. On est très loin de l’avoir atteint. Cet amendement rappelle donc qu’il convient d’encourager l’introduction et la généralisation de l’alimentation biologique et d’origine locale dans les cantines.
M. le rapporteur. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Elle en vient à l’amendement AC 390 de Mme Martine Faure.
M. Hervé Féron. L’enseignement moral et civique doit comprendre un volet sur le fonctionnement de nos institutions.
M. le rapporteur. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AC 391 de Mme Valérie Corre.
Mme Valérie Corre. Le projet de loi ouvrant plus largement l’école à ses différents partenaires, nous voulons par cet amendement favoriser un dialogue équilibré entre tous les acteurs de l’éducation, tels que notre amendement les énumère.
M. le rapporteur. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement AC 392 du même auteur.
Mme Valérie Corre. Cet amendement vise à mieux reconnaître la place des parents en mettant en exergue la notion de « co-éducation ».
M. le rapporteur. Avis favorable.
M. Frédéric Reiss. L’éducation commence dans les familles. Je suis opposé à cette promotion de la « co-éducation », qui revient parfois à dédouaner les parents en présupposant que l’école peut remplir leur rôle à leur place.
M. le président Patrick Bloche. Ce concept figure déjà dans le rapport annexé. L’amendement ne fait que le reprendre et le préciser.
Mme Valérie Corre. Je suis d’accord avec M. Frédéric Reiss. C’est bien pourquoi l’amendement vise à promouvoir le rôle des parents comme premiers acteurs de l’éducation des enfants.
M. Xavier Breton. Pourquoi la loi prévoirait-elle une « participation accrue des parents à l’action éducative » alors que cette participation est première ? L’amendement est ambigu : il insiste sur la « co-éducation » mais sous-entend que les parents n’en font pas assez. Si le problème se situe au sein de la famille, ce n’est pas un texte sur l’école qui le résoudra. Quant à l’école, ce sont les enseignants qui y ont une place première. Bref, je partage les réticences de M. Frédéric Reiss à l’égard de cet amendement.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AC 393 du même auteur.
Mme Valérie Corre. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le rapporteur. Il est satisfait par l’article D. 111-11 du code de l’éducation, qui prévoit cette possibilité de médiation presque dans les mêmes termes.
L’amendement est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement AC 377 de Mme Julie Sommaruga.
Mme Julie Sommaruga. Après l’entrée en 6ème, on constate que le lien entre l’école et les familles se rompt. Les parents ont du mal à accompagner la scolarité de leurs enfants, ce qui est particulièrement préjudiciable aux élèves en situation de décrochage. Cet amendement vise à favoriser le lien entre les familles et le collège en prévoyant l’organisation, au sein des établissements, de débats, de groupes de parole ou d’activités thématiques destinés aux parents.
M. le rapporteur. Avis favorable.
M. Rudy Salles. On est plus dans le catalogue que dans la loi !
M. Frédéric Reiss. Le texte comporte déjà beaucoup de dispositions visant à articuler le CM2 et la 6ème. Évitons de rendre la loi bavarde !
M. Xavier Breton. Ce rapport annexé est un inventaire à la Prévert. Faut-il inscrire dans la loi tout ce que font déjà les équipes pédagogiques ? Il y a là un problème de méthode.
M. le rapporteur. Les observations de mes collègues de l’opposition ne sont pas sans pertinence. Je demande à Mme Sommaruga de retirer son amendement afin d’examiner comment le rédiger de manière plus « incisive ».
Mme Julie Sommaruga. Si on n’inscrit pas dans la loi cette possibilité d’ouvrir les collèges aux parents, beaucoup d’établissements leur resteront fermés. Or il faut des contacts réguliers, en particulier, entre les parents, les coordinateurs des réseaux « ambition réussite » des zones d’éducation prioritaire et les associations.
M. le président Patrick Bloche. Peut-être pourriez-vous retirer cet amendement et le déposer de nouveau en vue de la séance publique ? Il sera ainsi discuté dans l’hémicycle et le ministre pourra, le cas échéant, s’engager à inciter par voie de circulaire les principaux de collège à ouvrir leur établissement aux parents.
Mme Julie Sommaruga. Je retire l’amendement.
L’amendement est retiré.
La Commission en vient à l’amendement AC 556 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. Si l’on veut que tous les acteurs s’impliquent dans la réforme de l’école, il faut donner enfin un statut aux parents d’élèves délégués. Par exemple, ils n’ont pas aujourd’hui accès à des formations qui les aideraient à prendre toute leur place dans le système éducatif.
M. le rapporteur. C’est une préoccupation légitime, portée du reste par les fédérations de parents d’élèves. Néanmoins, la création d’un statut nouveau aurait des conséquences sur le code du travail, qui devrait prévoir des heures de congé pour l’exercice de ce mandat. L’amendement n’étant pas applicable en l’état actuel de la législation du travail, je vous suggère de le retirer, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.
M. Rudy Salles. Bien que je comprenne le point de vue de Mme Barbara Pompili, je me rangerai à la position du rapporteur.
M. Frédéric Reiss. Lorsque je lui ai posé la question du statut des enseignants à l’occasion de la séance de « questions cribles » dans l’hémicycle, le ministre m’a répondu qu’il fallait refonder l’école avant de se préoccuper des portes, des fenêtres ou du toit. Je suis donc très surpris par cet amendement.
Mme Barbara Pompili. Je vous ferai observer, monsieur Reiss, que les enseignants ont déjà un statut, ce qui n’est pas le cas des délégués des parents d’élèves ! Cela dit, j’entends les réserves du rapporteur et je lui propose donc une autre rédaction : « Un véritable statut des parents d’élèves délégués devra être étudié » ou « sera étudié ». Au cas où elle n’aurait pas son agrément, je retirerai l’amendement pour le redéposer en séance.
M. le président Patrick Bloche. Le retrait me semble préférable.
Mme Sandrine Doucet. L’amendement est en partie satisfait. Des dispositions permettent déjà aux parents d’élèves salariés du privé de demander une autorisation d’absence pour participer à un conseil de classe.
Mme Barbara Pompili. Mais cette autorisation dépend du bon vouloir de leur employeur !
L’amendement est retiré.
La Commission étudie l’amendement AC 394 de Mme Brigitte Bourguignon.
Mme Brigitte Bourguignon. Pour préparer convenablement la carte scolaire du premier degré, il est souhaitable que les exécutifs locaux, les préfectures et les inspections soient informés, deux ans à l’avance, de l’ouverture ou de la fermeture de classes. La disposition figure certes dans la charte sur l’organisation de l’offre des services publics, mais elle n’a jamais été respectée, ce qui place les élus ruraux et de montagne dans l’embarras, faute de prévisibilité. Le ministre, que j’ai interrogé, s’est montré ouvert à ma proposition.
M. le rapporteur. L’amendement est satisfait par l’amendement AC 703 que nous avons adopté précédemment.
Mme Brigitte Bourguignon. Lequel n’impose rien, puisqu’il ne comporte pas de délai…
M. le président Patrick Bloche. S’il s’agit d’introduire un délai, mieux vaut retirer l’amendement AC 394 et envisager de compléter le texte adopté par la Commission en vue de la séance publique.
Mme Brigitte Bourguignon. C’est ce que j’ai tenté, sans être entendue !
M. Rudy Salles. Il sera extrêmement difficile de respecter un délai de deux ans. Comment anticiper, par exemple, les déménagements ?
M. le rapporteur. Compte tenu de la réponse du ministre dans l’hémicycle et de l’adoption de l’amendement AC 703, je pense moi aussi que nous pourrions y revenir en séance.
M. Xavier Breton. M. Rudy Salles a raison : il est très difficile d’anticiper la mobilité des particuliers. Le plus souvent, c’est seulement le jour de la rentrée qu’on connaît précisément le nombre des élèves. Il arrive ainsi qu’il faille rouvrir une classe qu’on avait fermée l’année précédente. La rédaction devra donc préciser que le délai est fixé à titre indicatif.
M. le président Patrick Bloche. Je rappelle que le rapport annexé ne crée pas d’obligation en tant que telle.
L’amendement est retiré.
La Commission en vient à l’amendement AC 235 de M. Thierry Braillard.
M. Thierry Braillard. Je souhaite souligner le rôle important des associations sportives et culturelles, ainsi que du mouvement d’éducation populaire.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 1er modifié, ainsi que le rapport annexé, ainsi modifié.
*
TITRE 1ER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2
Modification des livres Ier, II et IV du code de l’éducation
Cet article a pour seul objet de préciser que les livres Ier, II et IV du code de l’éducation – relatifs aux principes et à l’administration de l’éducation – sont modifiés conformément aux dispositions du présent titre du projet de loi.
*
La Commission adopte l’article sans modification.
Chapitre Ier
Les principes et missions de l’éducation
Section I
Les principes de l’éducation
La Commission est saisie de l’amendement AC 720 de M. Rudy Salles.
M. Rudy Salles. Chaque année, 140 000 jeunes sortent du système scolaire sans diplôme : 20 % à 25 % de la jeunesse française sont ainsi sacrifiés. Nous proposons qu’aucun enfant ne quitte le système scolaire sans un diplôme national.
M. le rapporteur. Avis défavorable. L’amendement est purement déclaratif.
M. Rudy Salles. Tout comme l’engagement d’amener 80 % d’une classe d’âge au baccalauréat. Nous y sommes pourtant parvenus…
M. le rapporteur. Ne rajoutons pas aux missions du système éducatif !
M. Michel Ménard. Le projet de loi vise à améliorer l’efficacité de l’école et à réduire l’échec scolaire, mais il me semble trop ambitieux, sinon irréaliste de prévoir qu’aucun enfant ne quittera le système scolaire sans diplôme.
M. Thierry Braillard. La rédaction de l’amendement semble bien péremptoire, surtout quand on considère la situation actuelle. Mieux vaudrait mettre la phrase au conditionnel et ajouter après les mots « un diplôme national », les mots : « ou une formation qualifiante ».
M. Rudy Salles. Je propose de supprimer la deuxième phrase de l’amendement et de compléter la première par les mots : « , l’objectif à atteindre étant qu’aucun enfant ne quitte le système scolaire sans diplôme. » Nous fixerions ainsi un cap, ce qui est conforme au rôle d’une loi d’orientation.
M. le rapporteur. Aux termes du quatrième alinéa de l’article 8 du projet de loi, « Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d’une durée complémentaire de formation qualifiante qu’il peut utiliser dans des conditions fixées par décret. » Cette disposition est préférable à l’amendement, puisqu’elle propose une solution pour remédier à l’éventuelle absence de diplôme.
Je suggère par conséquent de retirer purement et simplement votre proposition.
M. Rudy Salles. Je la maintiens.
La Commission rejette l’amendement.
Article 3
Réaffirmation de l’objectif de transmission des valeurs de la République
Outre la réussite scolaire de tous les élèves, l’objectif de la refondation est de redonner à l’école son rôle de transmission des valeurs de la République. À cet effet le présent article propose de modifier l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui fixe comme mission fondamentale à l’école de faire partager aux élèves les valeurs de la République, afin de préciser que ces valeurs sont notamment « l’égale dignité de tous les êtres humains, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité et la laïcité, qui repose sur le respect de valeurs communes et la liberté de conscience. »
Si les intentions du présent article sont louables, l’introduction d’un inventaire non exhaustif des valeurs de la République au frontispice du code de l’éducation n’apparaît ni souhaitable ni pertinente.
Alors que l’objectif, compréhensible, est de mettre l’accent sur des valeurs susceptibles de rassembler, le présent article pourrait avoir l’effet inverse en déplaçant le débat sur le terrain des valeurs de la République, ce qui n’est évidemment pas l’objet de la refondation de l’école.
1. La nécessaire réaffirmation de l’objectif de transmission des valeurs de la République
L’école, en France, se veut un lieu d’instruction, de formation intellectuelle et de transmission des valeurs, autant que de préparation à la vie sociale et professionnelle.
Cette définition de l’école à la française ne relève pas de l’évidence. C’est même un projet politique qui continue à être singulier au regard d’expériences étrangères, notamment des modèles libéraux.
Comme l’indique l’étude d’impact du projet de loi, « la transmission des valeurs de la République doit permettre aux élèves d’acquérir des principes indispensables au développement d’une attitude respectueuse des règles du " vivre ensemble " fondées sur des valeurs communes. »
Cette mission est donc fondamentale pour l’apprentissage de la vie sociale, à commencer par la vie à l’école. Il s’agit de créer les conditions d’une amélioration du climat scolaire afin de donner à tous un cadre propice aux apprentissages.
En effet, le rapport de la concertation pour la refondation de l’école d’octobre 2012 souligne à juste titre que « l’école française, en son sein comme dans son rapport avec ses partenaires du monde extérieur (collectivités territoriales, associations, entreprises), a encore du mal à gérer les différences de tous ordres : diversités culturelles et religieuses résultant de l’intégration de populations immigrées, bien sûr, mais aussi situations de handicap, normes sociales divergentes, ou encore hétérogénéité des pratiques professionnelles. C’est, trop souvent, davantage sur le mode de la cohabitation conflictuelle que du partage et de l’enrichissement mutuel que se vit à l’École le rapport à l’autre. »(136)
Ce rapport observe également qu’« aux premières heures de la IIIe République, (…) chaque enfant – mais aussi chaque enseignant – fut sommé d’abandonner sa culture régionale, familiale ou étrangère et sa singularité aux portes des établissements scolaires qui ne toléraient pas l’écart à l’égard de la norme. Qu’on le déplore ou non, cette posture de l’institution scolaire n’est plus envisageable dans la société du XXIe siècle. Il s’agit désormais de construire, comme l’atelier "citoyenneté et vie scolaire" l’a appelé, un "pluralisme raisonnable", dans le cadre d’un ensemble de valeurs communes, fortes et structurantes, références centrales de la communauté nationale – au premier rang desquelles figure la laïcité. Cette question est d’ailleurs l’objet de la mission sur la morale laïque mise en place par le ministère. »(1)
Ajoutons à la liste des différences que l’école a encore du mal à gérer le rapport entre les hommes et les femmes.
L’égalité des filles et des garçons constitue une obligation légale et une mission fondamentale pour l’éducation nationale. Si les écoles et les établissements sont devenus mixtes dans les années 1970, trop de disparités subsistent dans les parcours scolaires des filles et des garçons. Une véritable éducation à l’égalité apparaît plus que jamais nécessaire à l’évolution des mentalités.
C’est un fait : les filles réussissent mieux que les garçons. Dès l’école primaire, elles obtiennent de meilleurs résultats scolaires. Elles redoublent moins et leur taux de réussite tant au diplôme national du brevet qu’au baccalauréat est plus élevé. 71 % des filles ont le baccalauréat, contre 61 % des garçons.
Cependant, si les filles entrent brillamment dans le métier d’élèves, les orientations choisies ne sont pas à la hauteur de ces résultats scolaires. Très tôt, des stéréotypes se forgent et tendent à enfermer chaque sexe dans des rôles préétablis. Filles et garçons continuent à se conformer à ce qui est reconnu comme leur « domaine respectif de compétences » socioprofessionnelles.
Ainsi, à la fin du collège, quels que soient leur milieu social d’origine ou leur réussite scolaire, les filles s’orientent-elles plus vers l’enseignement général et technologique que vers l’enseignement professionnel (et très rarement dans les sections industrielles). Dans l’enseignement général et technologique, elles délaissent plus facilement les filières scientifiques et techniques. Elles ne représentent ainsi que 46 % des élèves de la filière générale scientifique même si leur taux de réussite dans cette filière dépasse celui des garçons. Elles choisissent aussi plus généralement des options différentes des garçons.
Après le baccalauréat, dans les classes préparatoires aux grandes écoles, 75 % des élèves des filières littéraires sont des filles, pour 30 % des élèves scientifiques. Seulement 26 % des diplômes d’ingénieurs sont délivrés à des femmes.
Les différences d’orientation entre filles et garçons ont des conséquences sur leur insertion dans l’emploi. Aujourd’hui, la moitié des femmes en emploi est regroupée dans seulement douze familles professionnelles, contre vingt pour la moitié des hommes en emploi.
Notons que la persistance des choix sexués est d’ailleurs autant le fait des garçons que des filles : ils anticipent des rôles adultes en fonction de représentations stéréotypées.
Les garçons sont également victimes des représentations stéréotypées. Pour trop de garçons l’identité masculine se construit dans le rejet de la valeur « trop féminisée » de la réussite scolaire. Comme le soulignait la sociologue de l’éducation Marie Duru-Bellat, dans un article intitulé « École de garçons et école de filles » publié dans la revue Diversité en 2004, les garçons sont trop souvent confrontés à un dilemme absurde : apparaître « viril » ou être un bon élève… Ainsi les garçons fournissent-ils les plus grosses cohortes des victimes du décrochage scolaire.
Enfin, garçons et filles ne s’avèrent pas égaux face à certaines formes de violence dans l’institution scolaire. Basée sur le respect de l’autre sexe, l’éducation à l’égalité implique aussi la prévention des comportements et violences sexistes.
2. Une proposition louable sur le fond mais contestable sur la forme
Le gouvernement propose de placer au cœur de la refondation plusieurs valeurs qui apparaissent particulièrement fondamentales et créatrices de lien dans la société contemporaine.
● Une proposition louable sur le fond
Le projet de loi prévoit de mettre en avant une approche plus morale et philosophique de l’égalité par l’introduction de la notion d’égale dignité de tous les êtres humains.
La notion d’égale dignité constitue le fondement de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 dont l’article premier dispose que « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Le droit traduit ainsi l’idée selon laquelle il y a au cœur de l’homme « quelque chose » qu’aucun pouvoir ne peut dominer ou abolir
Aux termes de l’article 28 du présent projet de loi, « l’école, notamment grâce à un enseignement moral et civique, fait acquérir aux élèves le respect de la personne, de ses origines et de ses différences. » Il ne s’agit donc pas d’abandonner ses origines, sa culture régionale, familiale ou étrangère et sa singularité aux portes des établissements scolaires. « L’égalité, ce n’est pas vous êtes tous pareils, mais vous pouvez être tous vous-mêmes, différents, mais reconnus dans l’égalité de vos dignités respectives. C’est une égalité au service de l’émancipation et de la liberté »(137), a ainsi précisé le ministre de l’éducation nationale, M. Vincent Peillon.
L’égalité entre les femmes et les hommes est également mise en avant parce qu’elle constitue un combat qui reste à mener, singulièrement au sein de l’école. L’inscrire dans le premier article du code de l’éducation correspond à une volonté politique de prendre en compte plus fortement l’éducation à l’égalité entre hommes et femmes dans les objectifs de l’école. Le gouvernement souhaite ainsi donner une nouvelle impulsion, dès le plus jeune âge, à l’éducation au respect mutuel.
Devrait notamment contribuer à cet objectif l’enseignement moral et civique que l’article 28 du présent projet de loi tend à créer et dont il est précisé qu’il devra faire acquérir aux élèves « le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes. »
Par ailleurs, l’intégration de modules de formation à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la formation initiale des professeurs, qui s’inscrit dans les objectifs de la création par le présent projet de loi des écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE), doit également permettre d’agir contre les stéréotypes que l’école participe à véhiculer sans que les acteurs éducatifs en aient toujours conscience.
Les travaux de la sociologue Marie Duru-Bellat (138) ont en effet montré que les filles sont en moyenne moins souvent interrogées que les garçons, et les enseignants passent aussi moins de temps à réagir à leurs interventions et à attendre leur réponse. Les enseignants exprimeraient malgré eux des attentes différentes envers les garçons et les filles (par exemple propreté des copies et qualités de lectrice pour les filles, justesse des raisonnements pour les garçons). Le fait de devoir maintenir la discipline pourrait aussi conduire à porter une plus grande attention aux garçons, et à considérer davantage les filles comme un groupe.
Une plus grande compréhension et prise en compte des effets de ces stéréotypes sexués doit aider les enseignants à agir pour que les élèves, quel que soit leur sexe, ne soient restreints ni dans leurs intérêts pour certains domaines de la connaissance ni dans leur confiance en eux.
En ce qui concerne la solidarité, elle a été délibérément préférée à celle de fraternité, qui figure dans la devise de notre République.
Selon les informations fournies au rapporteur, le terme de solidarité a été choisi car il suppose davantage une action volontaire qu’un sentiment. Dans le processus d’apprentissage des élèves, il renvoie à la volonté de développer la coopération entre élèves et leur engagement concret dans des actions éducatives.
Ainsi que l’indique le rapport de la concertation sur la refondation de l’école, « de nouvelles formes de solidarité horizontale interpersonnelle fondées sur l’échange, l’entraide, la coopération, le respect de l’autre doivent être mobilisées pour construire du lien social, éviter les frictions, et amener chacun à se ranger aux références qui fondent le bien commun. Dans l’enceinte de l’école, cela doit notamment se traduire par la multiplication des dispositifs permettant de créer des relations interpersonnelles horizontales entre tous les acteurs de l’école (travail de groupe sur projet chez les élèves, tutorat entre élèves, échanges d’expérience entre enseignants, développement de collaborations entre l’éducation nationale et ses partenaires extérieurs, collectivités territoriales, parents…). »(139)
Enfin, le présent article place la laïcité au cœur de la refondation. Cette disposition répond à la volonté du ministre de l’éducation nationale de rappeler le lien consubstantiel qui existe entre l’école et la laïcité, lien déjà établi par Condorcet en 1792.
Mais il s’agit aussi, en particulier à travers l’enseignement moral et civique, de promouvoir une approche positive de la laïcité. C’est pourquoi le présent article fait référence à la laïcité en tant qu’elle « repose sur le respect de valeurs communes et la liberté de conscience ».
L’article L. 141-6 du code de l’éducation dispose que « Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique. » Cet article met en avant les seules dimensions de neutralité et de tolérance de la laïcité.
Or, comme le rappelle justement le ministre de l’éducation nationale (140), « les fondateurs de la laïcité la concevaient comme une religion, c’est à dire quelque chose qui relie les hommes, mais une religion sans dogme, une religion sans église, une religion sans orthodoxie qui n’est pas la laïcité comme laïcisme dont Ferdinand Buisson disait qu’elle est une orthodoxie à rebours. On ne peut pas être intégriste de la laïcité puisqu'on est contre tous les intégrismes. »
Ce lien doit se vivre quotidiennement au sein des écoles et des établissements, et il est indispensable que les membres de la communauté éducative comprennent bien que la laïcité ne s’oppose pas aux religions, mais aussi qu’elle permet de vivre ensemble, quels que soient les choix personnels politiques, philosophiques ou religieux, autour de valeurs qui sont celles du respect des principes fondamentaux des droits de l’homme.
● Un dispositif contestable sur la forme
Si l’on peut comprendre l’intention du gouvernement, qui est de mettre en avant plusieurs valeurs particulièrement créatrices de lien pour la société actuelle, il n’apparaît pas pertinent de dresser dans le code de l’éducation une liste non exhaustive des valeurs de la République, choix qui pourrait susciter plus de débat que de consensus.
Il n’appartient d’ailleurs pas à une loi sur l’école de tenter de définir les valeurs de la République, ni de les hiérarchiser, pas plus qu’il ne lui appartient de tenter de fournir une définition succincte de la laïcité, notion complexe et multidimensionnelle qui résulte d’une législation et d’une jurisprudence riches et évolutives.
C’est pourquoi, à l’initiative notamment du rapporteur, la Commission a adopté un amendement de suppression du présent article.
*
La Commission examine les trois amendements identiques AC 711 du rapporteur, AC 272 de M. Benoist Apparu et AC 103 de M. Frédéric Reiss.
M. le rapporteur. L’amendement AC 711 tend à supprimer l’article 3. Il n’y a pas lieu de proposer une liste des valeurs républicaines.
M. Benoist Apparu. Même argumentation pour l’amendement AC 272.
M. Frédéric Reiss. Si nous commençons un tel catalogue, nous n’en finirons pas. Il faudrait par exemple ajouter le respect dû à la personne, quelle qu’elle soit.
M. Xavier Breton. Je regrette de n’avoir pas pu cosigner l’amendement AC 711, dont l’exposé des motifs est particulièrement bien rédigé.
M. Malek Boutih. Au-delà de sa mission d’enseignement, l’école construit l’identité de notre pays et l’appartenance à notre nation. J’avais rédigé un amendement visant à rappeler qu’elle doit aussi assurer la mixité sexuelle, sociale et ethnique, enjeux dont l’actualité montre toute l’importance. Je regrette donc qu’on renonce à rappeler certains principes propres à la définition, aux enjeux et aux missions de l’école républicaine.
La Commission adopte les amendements et l’article 3 est ainsi supprimé.
En conséquence, les amendements AC 273 de M. Benoist Apparu, AC 722 de M. Rudy Salles, AC 396 de M. Malek Boutih, AC 104 de M. Frédéric Reiss, AC 199 et AC 198 de M. Thierry Braillard, AC 721 de M. Rudy Salles, AC 174 de Mme Barbara Pompili, AC 347 de M. Paul Molac et AC 342 de M. Gérald Darmanin tombent.
Article 4
Formation à l’exercice de la citoyenneté dans la société de l’information
et de la communication
Le présent projet de loi porte un intérêt tout particulier au numérique. Le présent article tire les conséquences de l’impact majeur des nouveaux médias sur l’exercice de la citoyenneté. Il est proposé de compléter le deuxième alinéa de l’article L. 111-2, deuxième article du code de l’éducation nationale, relatif aux objectifs de la formation scolaire afin de préciser qu’« elle développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté dans la société de l’information et de la communication ».
On soulignera que l’impact du numérique sur l’exercice et l’apprentissage de la citoyenneté a été analysé en détail par le rapport de la mission d’information commune à la Commission des lois et à la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de notre Assemblée, « Révolution numérique et droits de l’individu : pour un citoyen libre et informé ». (141)
Internet a pris une importance considérable dans la vie des enfants et des adolescents et ce, en moins de dix ans, voire moins de trois ans pour les réseaux sociaux. Les blogs, les chats, les réseaux sociaux, les jeux en ligne, la recherche d’information en ligne, la diffusion et le visionnage de vidéos sur les sites de partage sont autant de nouvelles pratiques qui s’ajoutent à une consommation de contenus audiovisuels de plus en plus délinéarisée, qu’il s’agisse de vidéo à la demande ou de télévision de rattrapage.
Financée par le programme Safer Internet de la Commission européenne, une enquête sociologique basée sur un échantillon de 25 140 internautes de 9 à 16 ans a été réalisée au cours du printemps et de l’été 2010 par le réseau scientifique européen EU Kids Online, avec la coordination de la London School of Economics. Des équipes de chercheurs de 25 pays y ont contribué, dont le CNRS pour la France.
Les statistiques de cette enquête à grande échelle montrent avant tout qu’internet fait partie intégrante du quotidien des enfants européens : 93 % des jeunes de 9 à 16 ans se connectent au moins une fois par semaine et 60 % tous les jours ou presque.
L’âge de la première connexion est précoce et tend encore à baisser dans l’ensemble des pays. Un tiers des internautes européens de 9-10 ans se connectent tous les jours, comme 80 % des 15-16 ans. Utilisé surtout à la maison (87 %) et à l’école (63 %), internet est également accessible aux enfants dans leur chambre à coucher (49 %) et par l’intermédiaire d’un terminal portable (33 %).
Dans leur grande majorité les 9-16 ans utilisent internet pour leur travail scolaire (85 %), pour jouer (83 %), pour regarder des clips vidéo (76 %) et pour la messagerie instantanée (62 %).
Près de 60 % d’entre eux ont un profil sur un réseau social : 26 % des 9-10 ans, 49 % des 11-12 ans, 73 % des 13-14 ans et 82 % des 15-16 ans. En outre, 26 % des jeunes Européens ont un profil public, c’est-à-dire accessible à tout le monde.
● Des opportunités nouvelles
Ces nouveaux usages apportent aux nouvelles générations des opportunités nouvelles d’information, de loisirs, de création, de communication, d’ouverture, qui peuvent être extrêmement positives.
Internet constitue incontestablement un vecteur d’accès à des sources sans cesse plus riches et nombreuses d’informations pour tous. Il offre également à chacun la possibilité de s’exprimer, à travers notamment les réseaux sociaux.
De nombreux psychiatres et psychologues insistent sur le rôle des technologies numériques comme outil de socialisation douce particulièrement adapté à l’adolescence et vecteur non pas d’isolement mais de liens communautaires.
Plus fondamentalement, le numérique redéfinit de façon radicale les modes d’accès au savoir et à la culture : à des relations verticales entre leurs détenteurs et leurs destinataires se substituent des relations horizontales où chacun devient potentiellement émetteur et récepteur de données. La démocratisation de l’accès à la connaissance, à l’information et à la culture qui en résulte est comparable, voire supérieure, par son ampleur, aux ruptures qui ont marqué diverses périodes historiques : la Renaissance avec le développement de l’imprimerie ou les Lumières et le XIXe siècle avec le développement de la presse écrite.
La société engendrée par ce nouveau saut technologique a été abondamment étudiée par les philosophes et les sociologues, du fait des changements de conception du monde, voire des modes de pensée, qu’elle induit et de la « décentralisation des savoirs » qu’elle implique.
Que ce soit pour sélectionner l’information (à travers les bases de données numérisées ou les moteurs de recherche), acquérir les connaissances (avec les cours magistraux et les bibliothèques en ligne) ou pour les formaliser (au travers des logiciels de traitement de texte ou de présentation), l’apport des technologies numériques à la construction du savoir au cours des processus d’apprentissage est aujourd’hui incontournable.
De nombreuses études scientifiques, menées en France et à l’étranger ont montré les apports du numérique dans l’éducation, à tous les niveaux, école, collège et lycée.
Le développement des usages du numérique dans les pratiques pédagogiques représenterait une véritable opportunité d’amélioration des résultats des élèves, les technologies de l’information et de la communication pour l’éducation (TICE) constituant en particulier des outils d’individualisation de la pédagogie, à destination des enseignants, des élèves, des parents, et plus largement de l’ensemble de la communauté éducative.
Le rapport de la mission parlementaire de M. Jean-Michel Fourgous sur la modernisation de l’école par le numérique de février 2010 mettait en avant les nombreux effets positifs des TICE sur l’apprentissage des élèves : possibilité d’interactivité, de dédramatisation de l’erreur aboutissant à une augmentation de la motivation ; augmentation de l’envie d’apprendre ; plus grande concentration ; persévérance dans les efforts effectués ; augmentation de la confiance en soi, de la participation en cours, de la collaboration entre élèves ; compréhension plus importante et plus rapide ; meilleure mémorisation ; amélioration des résultats scolaires.
Quant au rapport de l’OCDE sur le dépouillement des tests PISA réalisés en 2006, il met en évidence une corrélation entre les moindres résultats scolaires et l’absence d’ordinateur et d’internet à domicile, ou plus précisément entre la performance scolaire et la fréquence d’utilisation de l’informatique au domicile.
● Des menaces nouvelles
Internet est capable, comme toute autre technique, du meilleur comme du pire.
En étant le plus puissant instrument de communication jamais inventé par l’homme, internet peut aussi se révéler un redoutable outil de désinformation. En multipliant les espaces de conversations, le « Web 2.0 » est, plus que les autres médias, un lieu d’où partent et se diffusent des informations fabriquées.
Parallèlement les technologies numériques donnent une nouvelle dimension à des problématiques déjà présentes pour les médias traditionnels : l’exposition aux contenus choquants, pornographiques, de très grande violence, l’impact sur la socialisation et la concentration, notamment en milieu scolaire, les phénomènes de pratiques excessives et d’addiction, la profusion d’informations de toute sorte qui peut être dangereuse si elle ne s’accompagne pas de la capacité de distanciation et de l’esprit critique.
À cela s’ajoutent des problématiques nouvelles, notamment la divulgation massive de données à caractère personnel et leur possible utilisation par des tiers, ou encore le respect de la législation, concernant notamment les droits d’auteur et la vie privée. Enfin, le développement des usages du numérique auprès des jeunes s’accompagne d’une indépendance croissante des enfants vis-à-vis des parents dans leur consommation de médias : internet est un terrain plus difficile à restreindre et beaucoup de parents se sentent dépassés.
S’agissant des risques liés à l’usage d’internet, l’enquête précitée, financée par le programme Safer Internet, distinguait différentes catégories : la pornographie, le harcèlement, la réception de messages à caractère sexuel, les contacts avec des inconnus, la lecture de contenus dangereux et le détournement de données personnelles.
Plus de 40 % des internautes âgés de 9 à 16 ans ont été exposés à au moins un de ces risques et le pourcentage augmente avec l’âge : 14 % des 9-10 ans, 33 % des 11-12 ans, 49 % des 13-14 ans et 63 % des 15-16 ans.
Les mineurs sont particulièrement concernés par la problématique de la vie privée et des données personnelles dans la mesure où ils exposent presque naturellement leur vie intime sur les réseaux sociaux sans être toujours conscients des conséquences que cela peut entraîner. Pour les jeunes, Facebook est devenu un enjeu de sociabilité et de construction de l’identité dont les bénéfices seraient plus importants que les risques encourus. Les adolescents auraient plus fondamentalement une conception de leur vie privée différente de celle de leurs aînés, qui n’ont pas grandi avec Internet.
Se pose de manière urgente la question de l’usage qui sera fait dans quelques années des informations indélébiles qui se seront accumulées sur les enfants d’aujourd’hui. En quelques années, Facebook a révolutionné les écoles et les collèges. Qu’en sera-t-il dans quinze ans ? Toutes les informations que les jeunes auront diffusées resteront accessibles et seront à disposition, par exemple, des recruteurs.
La construction du rapport des enfants à la citoyenneté et au respect de la loi est un autre enjeu très important dans l’univers numérique. L’apparente anonymisation de l’accès à Internet peut véhiculer des illusions, comme la virtualité des actes, un certain sentiment d’impunité, que ce soit concernant le respect de la dignité des personnes, le respect de la vie privée ou celui des droits d’auteurs.
Sur internet, les plus jeunes ne savent pas qu’ils agissent mal, à la différence des délinquants dans la vie réelle. Facebook appartient au monde du virtuel ; en conséquence, tout paraissant virtuel, y sont tenus des propos qui ne l’auraient jamais été dans le monde réel.
Or il est important que les enfants et les adolescents comprennent qu’il n’y a pas d’impunité sur internet, et qu’il existe un cadre légal qui doit être respecté, que les injures, la diffamation, les atteintes à la vie privée et à la confidentialité constituent des fautes pénales.
● De nouvelles missions pour l’éducation nationale
À l’heure où les outils numériques sont omniprésents dans la société, dans les relations sociales et dans le monde de l’entreprise, l’acquisition des compétences numériques est déterminante pour une insertion sociale et professionnelle réussie.
Donner toutes les cartes au futur citoyen pour s’intégrer dans la société du numérique et de l’information est devenu une mission essentielle de l’éducation : la multiplication des échanges et des sources d’information implique une éducation à l’usage responsable de l’internet et des technologies de l’information et de la communication.
Apprendre qu’un blog et un réseau social peuvent être un espace public, que les mots et les images qui y sont diffusés peuvent avoir des conséquences qui ne sont pas virtuelles, apprendre comment retirer une référence, une photo, apprendre qu’il n’y a pas d’impunité pour les insultes, la diffamation sont autant de compétences nouvelles que les enfants doivent acquérir pour pouvoir évoluer sereinement sur Internet.
Le développement des usages d’internet nécessite tout d’abord une éducation à la fiabilité et à la hiérarchisation des sources, des données, des informations et une compréhension, ou à tout le moins, une analyse critique, des principes régissant le référencement par les moteurs de recherche.
Il y a là un enjeu d’égalité dans l’accès à la connaissance : disposer d’une information sans avoir les outils pour la comprendre conduit toujours à l’échec. C’est pourquoi cette éducation est absolument primordiale pour la formation de citoyens capables d’exercer leur libre arbitre et de participer activement à la démocratie. De plus en plus, les enseignants demandent à leurs élèves de faire des recherches sur internet ; il est nécessaire de leur en fournir les règles. Cette dimension de l’éducation aux médias doit être portée par l’école républicaine.
Faute d’éducation du citoyen au numérique, il pourrait en effet se produire, outre la fracture numérique, une fracture d’usage entre ceux qui maîtriseraient les nouvelles technologies et en retireraient un bénéfice social, culturel ou professionnel et ceux qui n’en maîtriseraient que l’aspect ludique de consommation.
La protection des données personnelles et la gestion de la vie privée à l’ère numérique exigent une connaissance approfondie des risques, des droits et des devoirs en la matière.
Ajoutons que beaucoup de questions sont posées et que des études sont à mener pour mieux appréhender les effets de ces nouvelles modalités d’apprentissage, d’information et de travail sur le fonctionnement même de l’intelligence et sur les procédures cognitives (mode de perception et de représentation, raisonnement, mémoire…).
Il semblerait, plus globalement, que les enfants et adolescents ne soient plus ce qu’ils étaient. Les technologies de l’information et de la communication changent nos manières de penser et d’agir, d’où un impact fort sur l’école, en termes de rapport au savoir, à l’autorité, à l’évaluation. Les « digital natives », indigènes de l’univers numérique dans lequel ils sont nés et avec lequel ils ont grandi, auraient des attentes et des compétences différentes de celles de leurs aînés.
Selon M. Daniel Andler, philosophe, spécialiste des sciences cognitives, fondateur de COMPAS, un « think tank » de l’École normale supérieure réunissant chercheurs et professeurs de toutes les disciplines ainsi que quelques industriels pour réfléchir aux pédagogies du futur, la génération numérique s’éloigne de plus en plus d’un apprentissage dogmatique, combinant mémorisation pure et logique d’entraînement et de récompense. En revanche, « les jeunes adoptent volontiers des processus d’apprentissage fondés sur la déconstruction/reconstruction des savoirs, sur l’interactivité des méthodes et des points de vue… un peu sur le modèle des jeux vidéo, qui permettent de passer au niveau 1, puis au niveau 2, etc. en essayant différentes clés, quitte à aller dénicher la solution sur des sites spécialisés. Ils ont intégré le fait qu’on peut apprendre en se trompant, qu’on peut recycler à son profit les expériences d’autrui. » (142) Il s’ensuit que ce n’est plus le savoir lui-même qui est essentiel, mais bien l’habileté à trier et à décoder l’information proposée en ligne. La posture encyclopédiste, qui a tant marqué la culture scolaire française traditionnelle, est, dès lors, dépassée. Tout autant que d’apprendre, l’objectif est désormais d’apprendre à apprendre.
Ces mutations doivent inévitablement pousser l’école et la pédagogie à se transformer. Pour que l’école de demain soit une réussite, les spécialistes s’accordent à penser qu’il faut une réforme holistique c’est-à-dire globale – qui implique le rapport entre le professeur et l’élève, la pédagogie, les technologies, l’organisation du temps, de l’espace, etc.
2. La formation aux usages responsables : des réalisations modestes, malgré l’enjeu reconnu et les intentions affichées
● Un fossé important entre les objectifs et la pratique
Avec le brevet information et internet, le B2i, créé en 2000, la France fait partie des rares pays à prévoir, dans le cadre du cursus scolaire, un passage obligatoire permettant d’aborder les usages de l’internet.
Le décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 relatif au socle commun de connaissances et de compétences fait figurer explicitement l’éducation aux médias parmi les objectifs fondamentaux officiellement assignés au système éducatif, notamment en ce qui concerne les piliers 4 et 6 du socle (« la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication », d’une part, et « les compétences sociales et civiques », d’autre part). Chaque élève doit donc théoriquement apprendre à faire un usage responsable des technologies de l’information et de la communication.
Depuis 2008, l’acquisition du B2i est même nécessaire à l’obtention, en fin de 3ème, du diplôme national du brevet (DNB).
Cependant fin 2010, s’il apparaissait que le B2i s’était progressivement généralisé au collège, il était encore peu connu du public et les enseignants semblaient peu concernés par la réflexion sur ses contenus. À l’école primaire, si le B2i était officiellement intégré aux programmes depuis 2002, toutes les écoles ne le mettaient pas encore en œuvre et en juin 2008, un peu moins de 30 % des élèves sortants de CM2 avaient obtenu le B2i. (143)
Plus du tiers des enseignants déclaraient ne pas avoir les compétences pour contribuer aux acquisitions des élèves demandées dans le cadre du B2i et le socle commun des compétences n’était pas vraiment mis en application dans les établissements. (1)
Par ailleurs, le B2i devait être adapté pour tenir compte de l’évolution des technologies et des usages et intégrer davantage la dimension sociale, éthique et citoyenne.
Selon un rapport d’août 2007 sur l’éducation aux médias de l’inspection générale de l’éducation nationale et de l’inspection générale de l’administration, de l’éducation nationale et de la recherche, alors même que les programmes recommandaient assez largement d’introduire les médias dans les pratiques de classe, comme supports pédagogiques, comme outils d’apprentissage ou comme objets d’étude, les instructions passaient souvent inaperçues et restaient lettre morte. Le rapport mettait en évidence des obstacles structurels et des résistances culturelles multiples : des objectifs mal définis, un champ vaste et confus, une formation des enseignants insuffisante et des horaires d’enseignement rigoureusement contraints.
Selon ce même rapport, l’éducation aux médias était donc restée, majoritairement, « une affaire de militants », reposant sur des moyens non stabilisés.
Le CLEMI (Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information) participe également à l’éducation aux médias dans les établissements. Cet organe est en effet chargé, en partenariat avec le ministère de l’éducation nationale, de l’éducation aux médias dans le système éducatif et a pour objectif d’apprendre aux élèves une pratique citoyenne des médias. Il constitue, au sein du ministère de l’éducation nationale, une structure organisée en réseau qui comprend vingt enseignants travaillant au niveau national et des coordonnateurs nommés par les recteurs. Ces derniers ont pour fonction de constituer des équipes d’enseignants chargés d’actions de formation qui s’adressent à tous les niveaux scolaires et à toutes les disciplines. Tous les enseignants, quels que soient leur niveau et leur discipline peuvent venir se former au CLEMI qui forme ainsi depuis vingt-cinq ans environ 30 000 enseignants chaque année. Le travail du CLEMI est cependant loin de concerner la majorité des établissements.
Partant de ce constat, le plan de développement des usages du numérique à l’école, lancé en novembre 2010, se fixait les objectifs suivants : « pour accompagner les élèves dans leur appropriation de la société numérique, l’éducation nationale doit former les citoyens numériques de demain, en transmettant les valeurs civiques dans la société de l’information. Au-delà de la formation technique, le Brevet informatique et internet, qui valide les compétences numériques acquises par les élèves, accordera dès la rentrée 2011 plus d’importance à l’apprentissage de l’usage responsable de l’internet. Les équipes pédagogiques et les élèves pourront s’appuyer dès le début 2011 sur un portail de ressources pédagogiques sur ce thème. »
En outre, la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques a complété l’article L. 312-15 du code de l’éducation par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre de l’enseignement d’éducation civique, les élèves sont formés afin de développer une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l’information disponible et d’acquérir un comportement responsable dans l’utilisation des outils interactifs, lors de leur usage des services de communication au public en ligne. Ils sont informés des moyens de maîtriser leur image publique, des dangers de l’exposition de soi et d’autrui, des droits d’opposition, de suppression, d’accès et de rectification prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que des missions de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). »
En ce qui concerne la formation des enseignants, la réalité n’est pas non plus à la hauteur des ambitions. D’après les textes, tous les enseignants réussissant les concours de recrutement devraient être titulaires du certificat informatique et internet (C2i) niveau 2 enseignants. Tous, en effet, devraient être capables de contribuer aux formations B2i école, B2i collège ou B2i lycée. Les contenus de ces formations font une place satisfaisante aux usages raisonnés du numérique et à la problématique « Informatique et Libertés ». Comme pour le B2i des élèves, c’est plutôt la mise en œuvre qui pose problème.
Dans le cadre du plan de développement des usages du numérique à l’école, l’accompagnement des enseignants et leur formation ont donc été considérés comme un facteur clé de succès. Dans chaque établissement, sur la base du volontariat, un professeur responsable du numérique pédagogique devait être désigné, afin de conseiller le chef d’établissement dans la définition et la mise en œuvre de la politique numérique et dans l’identification des besoins de formation de ses collègues et leur réalisation. « Ce plan de formation au plus près de l’établissement sera complémentaire des formations académiques aux usages du numérique et aux formations en ligne », pouvait-on lire dans le plan.
● Les résultats décevants du plan de développement des usages du numérique à l’école
Le rapport de l’inspection générale de l’éducation nationale (IGEN) de septembre 2012 consacré au Suivi de la mise en œuvre du plan de développement des usages du numérique à l’école est particulièrement accablant.
Selon ce rapport, le cinquième axe du plan de développement des usages du numérique à l’école (DUNE), « former les élèves à un usage « responsable » et « citoyen » des technologies de l’information et de la communication » est trop souvent considéré comme mineur. Il représente pourtant un enjeu considérable, d’une part parce qu’il concerne la formation de plus de douze millions d’élèves, d’autre part parce que la maîtrise du numérique dans les apprentissages et des responsabilités qu’implique son usage constituent une problématique complexe.
Pour l’IGEN, celle-ci est le plus souvent abordée sous son aspect le plus évident : les dangers de l’internet, la protection de la vie privée et l’éducation aux droits et devoirs liés aux usages des technologies de l’information et de la communication. Or, « L’usage responsable du numérique est infiniment plus complexe : la modification fondamentale qu’il introduit dans l’accès au savoir implique pour l’école un travail important portant sur :
« – l’acquisition des fondamentaux et des références de base qui permettent une approche critique de l’information ;
« – les clefs d’entrée à l’internet, les critères de discrimination et de validation ;
« – la maîtrise des nouvelles logiques de contiguïté des savoirs. »
Le rapport déplore que cette tâche soit jusqu’ici trop largement déléguée à des acteurs spécifiques : les professeurs documentalistes et le CLEMI.
Il apparaît donc nécessaire, pour assumer une formation plus totale à l’usage responsable du numérique, d’impliquer tous les enseignants.
Le plan prévoyait la mise en place, dès la rentrée 2011, de dispositifs nationaux de sensibilisation aux usages responsables de l’internet et de formation des élèves. Un portail « Internet responsable » a été lancé avec deux objectifs principaux :
– la protection des données personnelles et de la vie privée ;
– la lutte contre le piratage des œuvres.
Il a fait l’objet d’une convention signée le 18 novembre 2010 avec le Centre national de documentation pédagogique (CNDP). Comme l’indique le rapport de l’IGEN, « Pour respecter la date d’ouverture fixée, le travail a été mené assez rapidement au cours des vacances scolaires d’été 2011, sans réunion des groupes de réflexion. Le site, ouvert à l’automne 2011 sur EDUSCOL, présente quelques défauts d’ergonomie et des lacunes fonctionnelles, auxquelles la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) a entrepris de remédier, notamment en prévoyant de réunir des groupes de travail dès le début de l’année 2012. Le défaut majeur du site est sans doute qu’il reste destiné, dans sa forme, son organisation et ses objectifs, aux cadres de l’éducation, aux juristes et aux enseignants. Il ne touche pas directement le public des élèves et des parents. Il n’est pas sûr à cet égard qu’un seul et même site puisse répondre aux attentes de deux publics très différents. »
Le plan prévoyait également un important travail en 2010-2011 de révision des référentiels de compétences du B2i « écoles » et du B2i « collèges », afin de mieux prendre en compte les pratiques numériques des élèves et de mieux accompagner leur formation civique. Ce travail a été réalisé sous l’égide de la DGESCO et soumis à la CNIL.
Les nouveaux référentiels ont été mis à disposition sur EDUSCOL à la mi-décembre 2011. Ils sont en phase avec la compétence 4 du socle commun, la validation du B2i valant désormais (dans le cadre du livret de compétences de l’élève) validation de cette compétence.
On constatait néanmoins, fin décembre 2011 et début janvier 2012, que les validations se faisaient encore sur les référentiels anciens, d’autant plus que l’outil informatique de validation des compétences du B2i, OBII, qu’il était prévu de généraliser à la rentrée 2011, demeure encore uniquement en expérimentation dans quatre académies.
Surtout, l’évolution du B2i lui-même n’a pas fait l’objet d’un effort significatif de formation auprès des enseignants chargés de le valider.
3. Le dispositif proposé par le projet de loi
Le présent article traduit la prise de conscience de l’importance capitale des technologies numériques sur le mode d’exercice de la citoyenneté.
La formation à l’exercice de la citoyenneté à l’ère numérique est d’autant plus indispensable que les moyens d’action des pouvoirs publics sur les contenus circulant sur internet et les grands acteurs de l’internet tels que Google ou Facebook sont particulièrement limités. Il s’ensuit que l’action préventive constitue aujourd’hui le principal levier d’action des gouvernements pour protéger les individus face aux dangers du numérique.
La formation des élèves aux enjeux de la citoyenneté à l’ère numérique sera donc au cœur de l’enseignement moral et civique que l’article 28 du présent projet de loi tend à créer.
Par ailleurs, le présent projet de loi comporte des dispositions consacrées à la formation à l’utilisation des outils numériques. L’article 26 propose de préciser que la formation à l’utilisation des outils et des ressources numériques est dispensée progressivement à l’école, au collège et au lycée et que cette formation « comporte en particulier une sensibilisation aux droits et devoirs liés à l’usage de l’internet et des réseaux, notamment à la protection de la vie privée et au respect de la propriété intellectuelle. »
Il conviendra à cet égard de veiller à l’articulation entre cette sensibilisation et l’éducation aux médias numériques qui sera dispensée à travers l’enseignement moral et civique.
Comme il a été précédemment, la mise en œuvre du B2i a pâti de la mauvaise articulation entre le socle commun de connaissances et de compétences et les enseignements. Les compétences du B2i devraient désormais être mieux intégrées dans les programmes compte tenu du travail de redéfinition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture d’une part, et du contenu des programmes scolaires d’autre part.
Surtout, le présent projet de loi entend remédier à l’un des maillons faibles du dispositif, à savoir la formation des enseignants.
La formation à un usage citoyen des technologies numériques devrait enfin impliquer l’ensemble des enseignants puisqu’aux termes de l’article 51 du présent projet de loi, les futures écoles supérieures du professorat et de l’éducation auront notamment pour mission de former les enseignants à l’usage du numérique.
*
La Commission a adopté, au présent article, un amendement tendant à compléter le deuxième alinéa de l’article L. 111-2 du code de l’éducation, relatif aux objectifs de la formation scolaire, afin de préciser qu’« elle favorise l’esprit d’initiative. »
*
La Commission examine l’amendement AC 139 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. Il est dommage de réduire notre société à n’être qu’une société de l’information et de la communication. Nous suggérons de parler plutôt de la « société contemporaine ».
M. le rapporteur. Avis défavorable. L’amendement étant satisfait par les articles L. 121-1 et L. 131-1-1 du code de l’éducation, qui font référence à l’exercice de la citoyenneté, je vous suggère de le retirer.
M. Xavier Breton. Soit.
L’amendement est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement AC 238 de M. Guénhaël Huet.
Mme Claudine Schmid. Comme presque tous ceux que j’ai déposés, cet amendement met l’accent sur la formation professionnelle et sur l’apprentissage. En séance publique, le ministre a rappelé qu’il était favorable au doublement du nombre de places en apprentissage, que préconise le rapport Gallois.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Je vous suggère de retirer l’amendement, car il est lui aussi satisfait par l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation qui pose le droit de l’enfant à une éducation « lui permettant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté. »
Mme Claudine Schmid. Je maintiens ma proposition : ce qui va sans dire va mieux en le disant. La France a encore des progrès à faire pour développer l’apprentissage.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient aux amendements identiques AC 122 de Mme Claudine Schmid et AC 723 de M. Rudy Salles.
Mme Claudine Schmid. Dans le droit fil du précédent, l’amendement AC 122 vise à inscrire le développement de l’esprit d’entreprendre parmi les objectifs de la formation scolaire. On apprendra ainsi aux élèves à être plus indépendants.
M. Rudy Salles. L’amendement AC 723 vise à encourager le décloisonnement des parcours de formation et à insister sur l’esprit d’entreprendre, qu’il faut instiller dans les esprits dès l’école.
M. le rapporteur. Je vous propose de retirer ces amendements, puisque le septième pilier du socle commun de connaissances, de compétences et de culture met en avant l’autonomie et l’initiative.
M. Benoist Apparu. L’argument ne tient pas puisque, dans quelques instants, nous supprimerons de la loi la définition du socle, qui sera renvoyée à un décret.
M. Frédéric Reiss. Même objection.
M. le rapporteur. Compte tenu de ces remarques, je propose de rectifier les amendements en substituant à l’expression « esprit d’entreprendre », légèrement ambiguë, celle d’« esprit d’initiative », de portée plus générale.
Mme Claudine Schmid. Sans doute trop générale, et je regrette qu’on s’éloigne ainsi de toute référence à l’insertion professionnelle. Mais j’accepte la rectification.
M. Rudy Salles. J’y souscris moi aussi.
Mme Marie-George Buffet. Je ne voterai pas l’amendement.
La Commission adopte les amendements rectifiés.
Elle est saisie de l’amendement AC 459 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. La formation scolaire doit être conçue comme la première étape d’une formation tout au long de la vie. Il faut poser ce principe dès le début du texte.
M. le rapporteur. J’en suis d’accord, mais je vous propose plutôt de remplacer, dans l’article L. 111-2 du code de l’éducation, la phrase : « Elle constitue la base de l’éducation permanente. » par la phrase : « Elle prépare à l’éducation et à la formation tout au long de la vie. », qui me paraît plus claire.
Mme Barbara Pompili. Soit !
M. Thierry Braillard. N’est-il pas hors sujet de parler de la formation tout au long de la vie alors que nous traitons de l’école ?
M. Xavier Breton. Je comprends cette réticence. En outre, il est curieux de présenter la formation scolaire comme la première étape d’une formation tout au long de la vie, puisqu’il existe une étape réellement primordiale : l’éducation donnée par la famille.
Mme Isabelle Attard. Cette éducation familiale n’est ni la première ni la dernière étape de la formation. Elle intervient parallèlement à celle que dispense l’éducation nationale. C’est pourquoi on parle de co-éducation.
Si je propose d’insister dès la période scolaire sur la formation tout au long de la vie, c’est en pensant à tous ceux qui quittent le système sans aucune qualification et qu’on espère voir « raccrocher » un jour en reprenant une formation.
M. Frédéric Reiss. Nous nous égarons. Cette discussion n’apporte rien au projet de loi.
M. Benoist Apparu. La formation tout au long de la vie est un enjeu fondamental. Dans la société française actuelle, notre vie professionnelle est trop conditionnée par notre diplôme initial. Dans le système américain, en revanche, on progresse beaucoup plus facilement tout au long de la vie.
Cependant, l’amendement trouverait mieux sa place à l’article 8, consacré à la formation continue.
Mme Michèle Fournier-Armand. L’école ne se réduit pas à la formation : elle sert aussi à se construire.
Mme Barbara Pompili. Il est évident que l’école ne se réduit pas à de la formation professionnelle, mais je souscris pleinement à la remarque de M. Benoist Apparu. La refondation de l’école doit prendre en compte le fait que, dans le système actuel, on porte son diplôme – ou plutôt son absence de diplôme – comme une croix durant toute sa vie professionnelle. Il faut revoir le système éducatif pour permettre une éducation tout au long de la vie et l’affirmation de cette exigence me semble avoir sa place dans cette section du texte qui évoque les principes de l’éducation.
Sans doute la rédaction peut-elle être améliorée. Je propose donc de retirer l’amendement pour le déposer à nouveau lors de l’examen du texte en séance publique, afin que nous puissions avoir un débat sur cette question essentielle.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte alors l’article 4 modifié.
Article 4 bis (nouveau)
Promotion de la santé
Le chapitre II du titre premier de la première partie du code de l’éducation est relatif aux « dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés. » La Commission a adopté un amendement tendant à renommer ce chapitre « Engagement de l’école en faveur des enfants ou adolescents handicapés et de la santé » et à y insérer un nouvel article L. 112-1 A du code de l’éducation
Si l’on peut recenser un grand nombre de textes officiels relatifs aux questions de santé à l’école, il convient d’assurer la cohérence de la politique de santé à l’école afin d’assurer une meilleure lisibilité des principales missions dévolues à l’école en ce domaine.
Le nouvel article L. 112-1 A du code de l’éducation introduit par l’amendement indique que « la promotion de la santé est une composante du droit à l’éducation et constitue un service gratuit et obligatoire dont les élèves bénéficient dans tous les établissements. » Il précise que la promotion de la santé « a pour finalité de favoriser la réussite scolaire de l’élève tout au long de son parcours scolaire et de le soutenir dans la construction de son projet de vie personnelle, scolaire, professionnelle et son insertion socioprofessionnelle. Elle contribue à réduire les inégalités de santé par le développement des démarches de prévention. »
Cette disposition constitue la traduction législative des conclusions du rapport d’évaluation du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) de notre Assemblée sur la médecine scolaire, et du rapport de suivi de ses préconisations, qui, sur la base des travaux de la Cour des comptes venus en appui de ceux du CEC, ont mis en évidence « la nécessité d’inscrire dans la loi la place de la santé à l’école, afin de faire de la promotion de cette dernière une composante du droit à l’éducation et de définir clairement le contenu de cette mission de l’école. » (144)
Comme l’indique l’exposé sommaire de l’amendement, l’approche de la santé à l’école doit prendre en compte l’ensemble des interrogations relatives à la santé, en incluant par exemple la question des rythmes scolaires ou celle des relations individuelles au sein des établissements.
*
La Commission est saisie de l’amendement AC 398 de Mme Martine Pinville, portant article additionnel après l’article 4.
Mme Martine Faure. Cet amendement reprend les conclusions du rapport d’évaluation du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) de notre Assemblée sur la médecine scolaire. Il tend à rédiger comme suit l'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de l'éducation : « Engagement de l'école en faveur des enfants ou adolescents handicapés et de la santé » et à insérer avant l'article L. 112-1 du même code un article L. 112-1A ainsi rédigé : « Art. L. 112-1A – La promotion de la santé est une composante du droit à l’éducation et constitue un service gratuit et obligatoire dont les élèves bénéficient dans tous les établissements. Elle a pour finalité de favoriser la réussite scolaire de l’élève tout au long de son parcours scolaire et de le soutenir dans la construction de son projet de vie personnelle, scolaire, professionnelle et son insertion socioprofessionnelle. Elle contribue à réduire les inégalités de santé par le développement des démarches de prévention. »
M. le rapporteur. Avis favorable.
M. Xavier Breton. Cette mesure est en effet l’une des préconisations du rapport rédigé par Mme Martine Pinville et notre ancien collègue M. Gérard Gaudron durant la précédente législature.
La Commission adopte l’amendement.
La Commission est saisie de l’amendement AC 400 de M. Michel Ménard, portant article additionnel après l’article 4.
M. Michel Ménard. La loi du 11 février 2005 a favorisé le développement rapide de la scolarisation en milieu ordinaire des enfants et adolescents en situation de handicap. Le projet de loi que nous examinons poursuit l'effort en insistant sur la nécessité d’améliorer la qualité de cette prise en charge. Ainsi, le rapport annexé indique que, « face à l’augmentation rapide et continue des demandes et des prescriptions, il convient de mettre en place une approche plus qualitative et notamment de partager des outils de gestion, de suivi et de prospective pour ajuster les réponses apportées à la situation des élèves ».
Or, à l'heure actuelle, seuls les parents peuvent saisir la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) pour demander en cours d'année une révision des notifications de l’accompagnement de l'enfant handicapé. Cet accompagnement peut freiner le développement de l’autonomie de l’enfant et l’équipe éducative considère parfois que la prescription devrait être révisée en cours d’année.
L’amendement tend donc à rédiger comme suit l’alinéa 3 de l'article L. 112-2-1 du code de l'éducation : « Elles peuvent, après avoir consulté et recueilli l'avis de ses parents ou de son représentant légal, proposer à la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles toute révision de l'orientation d'un enfant ou d'un adolescent et des notifications concernant son accompagnement qu'elles jugeraient utile, y compris en cours d'année scolaire ».
M. le rapporteur. Cette préoccupation est légitime, mais l’adoption de cette disposition pourrait, s’agissant de la saisine des MDPH, bouleverser l’équilibre trouvé entre les familles, les équipes éducatives et l’éducation nationale. Une expertise des conséquences qu’aurait cette mesure s’impose et je propose donc que l’amendement soit retiré, pour être éventuellement remanié et présenté à nouveau en vue de l’examen du texte en séance publique, en fonction des résultats de cette expertise.
M. Michel Ménard. Cet amendement résulte des auditions que j’ai tenues l’an dernier sur le sujet, en tant que rapporteur pour avis du budget de l’enseignement scolaire. Je le retire néanmoins.
L’amendement est retiré.
Article 5
Développement de la scolarisation des moins de trois ans
Si aucun article du présent projet de loi ne concerne spécifiquement l’éducation prioritaire, cette question essentielle n’est pas absente du projet. Parce qu’il est prouvé que la scolarisation précoce contribue fortement à l’amélioration des trajectoires des élèves des milieux défavorisés, il est proposé de la développer en priorité dans les écoles situées dans un environnement social difficile.
Il est en effet plus facile et moins coûteux de surmonter une difficulté dès son apparition plutôt que d’attendre qu’elle ait pris de l’ampleur. Le prix Nobel d’économie James Hackman a d’ailleurs démontré que l’investissement dans l’éducation des tout-petits, en particulier lorsqu’ils sont issus de milieux défavorisés, est le plus rentable des investissements que l’on puisse faire dans le système éducatif.
1. La situation actuelle
L’article L. 113-1 du code de l’éducation prévoit déjà la possibilité d’accueil en maternelle des enfants dès l’âge de deux ans, en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé.
Cependant comme le montre le rapport de 2011 de l’inspection générale de l’éducation nationale et de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche sur l’école maternelle, la scolarisation des très jeunes enfants a constitué une « variable d’ajustement plutôt qu’une politique ».
Comme il a été indiqué dans l’exposé général, ce rapport pointe l’imprécision des règles posées par le code de l’éducation en la matière (145) : « L’ambiguïté de ces textes est triple : d’une part, aucun texte de nature réglementaire ne confirme (ni n’infirme) la possibilité d’accueillir des enfants atteignant deux ans en cours d’année ; d’autre part, aucun texte de même nature ne précise le sens de l’expression « dans la limite des places disponibles » ; enfin, aucun texte n’indique la date (d’inscription ou d’admission) à laquelle doivent être pris en compte, notamment pour la carte scolaire, les enfants admis entre la rentrée scolaire et le 31 décembre. Rien n’a été clarifié depuis. » (146)
La scolarisation des enfants de moins de trois ans s’est donc développée en fonction des usages régionaux et des moyens disponibles.
Or, une suppression massive de postes au cours des cinq dernières années a diminué fortement les capacités d’accueil et conduit à porter la scolarisation des enfants de moins de trois ans de 34,7 % en 2002 à 11,2 % en 2012.
2. Les modifications proposées par le projet de loi
Le présent article tend à modifier l’article L. 113-1 du code de l’éducation pour réaffirmer la priorité que constitue l’accueil des enfants de deux ans dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d’outre-mer.
Précision importante, le texte prévoit que cet accueil est assuré dans des conditions éducatives et pédagogiques définies par voie réglementaire.
Surtout, le projet de loi prévoit de mettre des moyens au service de cet objectif, qui, selon les informations recueillies par le rapporteur, doit être mis en œuvre progressivement sur la durée de la législature.
● Des moyens au service de cette politique
Le rapport annexé au projet de loi prévoit d’affecter 3 000 postes à la scolarisation des moins de trois ans. De nouveaux effectifs y seront consacrés dès la rentrée 2013.
La direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère de l’éducation nationale a en effet estimé à 2 400 postes supplémentaires la création d’une classe d’enfants de deux ans par école classée « éducation prioritaire ». Il convient également de tenir compte des zones de revitalisation rurale, ce qui porte à 3 000 postes l’estimation de cette mesure.
L’objectif n’est pas de scolariser l’ensemble de cette classe d’âge : ces 3 000 postes pourraient permettre de porter le taux aux alentours de 19 % sur la législature.
Le dispositif législatif et réglementaire n’impose pas un accueil systématique des moins de trois ans mais le permet. Dans les secteurs socialement défavorisés, il s’avère que les parents n’exercent que marginalement ce droit. Les enfants de nationalité étrangère ou de parents immigrés entrent d’ailleurs moins fréquemment que les autres à l’école maternelle à deux ans.
L’enjeu que constitue la scolarisation précoce dans ces territoires et pour ces populations est évidemment considérable. Comme l’a observé le directeur général de l’enseignement scolaire, M. Jean-Paul Delahaye, devant la Commission des affaires culturelles et de l’éducation, « se posera d’abord la question des moyens, en particulier dans des zones comme la Seine-Saint-Denis où l’on partira d’un taux de scolarisation très bas – inférieur à 1 %. » Il conviendra par conséquent de veiller à ce que les affectations nouvelles aillent bien en priorité là où les besoins sont les plus pressants, comme l’indique la loi actuelle non modifiée à cet égard, en tenant compte des besoins et des spécificités des zones rurales et de l’outre-mer.
« Mais il y a autre chose : cette offre de scolarisation précoce ne rencontre pas toujours la demande des parents, notamment dans les milieux défavorisés. Il faudra donc susciter cette demande en allant à la rencontre des familles pour leur démontrer qu’une scolarisation avant l’âge de trois ans est facteur de réussite pour l’enfant » (147) .
● Une définition précise des conditions de mise en œuvre
La scolarisation d’un enfant avant ses trois ans est une chance pour lui et sa famille lorsqu’elle correspond à ses besoins et se déroule dans des conditions adaptées. On ne peut scolariser ces enfants de la même façon que leurs aînés et le projet dispose à juste titre, ce qui est nouveau, que cette scolarisation doit se faire dans des conditions éducatives et pédagogiques particulières, précisées par le ministre de l’éducation nationale.
Cette intention doit se traduire concrètement aussi bien dans l’architecture et le matériel de ces classes que dans la formation initiale ou continue des personnels qui y interviendront.
La circulaire n° 2012-202 du 18 décembre 2012 est venue, avant même l’examen du présent projet de loi, définir les conditions d’accueil des enfants de moins de trois ans.
La réussite du projet nécessite l’implication forte des collectivités territoriales concernées. C’est pourquoi, pour garantir une répartition efficace des moyens en fonction besoins identifiés, les directeurs académiques des services de l’éducation nationale (DASEN) engageront des discussions avec les collectivités territoriales situées dans les secteurs concernés pour s’assurer que les conditions d’accueil soient à la mesure des besoins spécifiques des tout-petits.
S’agissant des modalités d’accueil, la circulaire précise que les projets d’accueil et de scolarisation d’enfants de moins de trois ans peuvent présenter des formes variées répondant aux besoins et aux ressources locales :
– un accueil et une scolarisation dans une classe de l’école maternelle, spécifique et adaptée aux besoins des jeunes enfants, dont le projet doit être explicitement accepté par la municipalité en raison des contraintes qu’il impose (présence régulière d’un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), aménagement de l’espace, matériel et jeux adaptés au jeune âge des enfants, rythmes spécifiques, etc.) ;
– un accueil et une scolarisation dans des classes de l’école maternelle comportant un ou plusieurs autres niveaux. Cette solution présente l’avantage de la stimulation apportée par les pairs, mais constitue un cadre moins favorable à une prise en compte des besoins des jeunes enfants ;
– enfin, un accueil en milieu mixte, associant services de la petite enfance et école, permet d’offrir du temps scolaire dans des dispositifs conçus localement. Un tel projet, élaboré conjointement par l’éducation nationale et les collectivités territoriales, doit garantir la complémentarité des ressources apportées par chaque partenaire dans une cohérence éducative au service du parcours de l’élève.
La circulaire insiste sur l’attention particulière qui doit être accordée à la relation avec les parents.
La prise en compte des rythmes spécifiques adaptés à ces très jeunes élèves est également souhaitée. Les horaires d’entrée et de sortie, le matin et l’après-midi, peuvent ainsi faire l’objet de dispositions particulières. Cette souplesse est cependant soumise à l’impératif que le temps de présence de chaque enfant demeure significatif.
La qualité de la prise en charge éducative des enfants de moins de trois ans est largement dépendante des collaborations qui s’établissent entre les collectivités territoriales, l’éducation nationale et les autres services ayant en charge la petite enfance, tels que les caisses d’allocations familiales (CAF), les services de la protection maternelle et infantile (PMI), etc.
Comme l’indique l’étude d’impact du présent projet de loi, « les communes, qui prennent en charge les emplois d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), seront libres de financer des emplois supplémentaires permettant d’assister le personnel enseignant pour l’accueil de ces enfants, notamment par redéploiement des personnels prenant en charge ces enfants dans le cadre de crèches. En effet, le taux d’encadrement en crèche est beaucoup plus exigeant qu’en maternelle : un adulte pour 5 enfants pour les enfants qui ne marchent pas et un adulte pour 8 enfants qui marchent. » En maternelle, il n’est pas prévu de taux d’encadrement spécifique par les ATSEM. L’article R. 412-127 du code des communes prévoit que « toute classe maternelle doit bénéficier des services d’un agent communal occupant l’emploi d’agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines », ce qui équivaut à un ATSEM pour 25 à 30 élèves par classe.
S’agissant du pilotage, les inspecteurs de l’éducation nationale (IEN) sont les pilotes naturels des projets locaux, avec les directeurs des écoles maternelles concernées. Ils sont garants de la nécessaire concertation avec les collectivités territoriales et évaluent la pertinence et l’efficacité des dispositifs.
Les recteurs et les DASEN doivent s’assurer des moyens nécessaires au développement des projets qu’ils déterminent comme prioritaires en fonction de leur implantation.
Les DASEN dressent la liste des écoles dans lesquelles des dispositifs de scolarisation des enfants de moins de trois ans sont implantés.
Les enseignants souhaitant postuler doivent être dans une démarche volontaire d’adhésion au projet de l’école. Les DASEN veilleront lors de l’affectation à la cohérence entre les nominations et les conditions du poste sollicité. Les professeurs affectés recevront une formation complémentaire associant, autant que nécessaire, les personnels territoriaux.
Une série de séminaires interacadémiques, inscrits dans le programme national de formation, rassemblera, dans le courant du premier semestre 2013, les cadres académiques et les inspecteurs de l’éducation nationale chargés de mission sur la maternelle.
● Les modifications apportées par la Commission
La Commission a adopté plusieurs amendements à cet article :
– un amendement tendant à préciser que les enfants sont accueillis dans des conditions éducatives et pédagogiques « visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif » ;
– un amendement tendant à préciser que l’accueil des enfants de moins de trois ans est organisé « après un dialogue avec la famille de l’enfant » ;
– et un amendement tendant à substituer l’expression « territoires ultramarins » à celle de « régions d’outre-mer » afin de viser l’ensemble des collectivités et territoires d’outre-mer.
*
La Commission est saisie des amendements identiques AC 258 de M. Benoist Apparu, AC 140 de M. Patrick Hetzel et AC 105 de M. Frédéric Reiss, tendant à la suppression de l’article 5.
M. Benoist Apparu. En réservant l’accueil des enfants de moins de trois ans aux enfants des zones prioritaires, l’article 5 ne respecte pas pleinement l’engagement 37 pris par le candidat François Hollande, qui déclarait « Je ferai en sorte que les enfants de moins de trois ans puissent être accueillis en maternelle » !
M. Xavier Breton. La scolarisation des enfants de moins de trois ans peut donner aux enfants des milieux défavorisés une chance d’entendre parler français lorsque ce n’est pas le cas dans sa famille ou dans son quartier, mais la généralisation de cette scolarisation divise les pédopsychiatres. En outre, la demande sociale qui s’exprime en ce sens procède surtout du souci de disposer d’un mode de garde gratuit. Est-ce bien là le rôle de l’école ?
Cette scolarisation précoce doit faire l’objet d’un débat. J’entends bien que le ministre y voit le moyen d’arracher les enfants à un certain déterminisme, mais, pour notre part, nous considérons la famille non comme un instrument de ce déterminisme, mais comme un lieu d’épanouissement. D’où l’amendement AC 140.
M. Frédéric Reiss. Le sujet est loin d’être consensuel : si la scolarisation précoce est bénéfique pour certains enfants, elle ne l’est pas pour tous.
D’autre part, la rédaction de l’article 5 n’apporte rien de neuf par rapport à la loi de 2005 qui, à la suite de celle de 1989, demandait qu’on accorde une attention particulière à la scolarisation des enfants de moins de trois ans dans les territoires défavorisés.
M. le rapporteur. Cette question fera certainement l’objet de débats en séance publique, car nous défendons manifestement des conceptions irréductibles l’une à l’autre. Cela posé, il est faux de dire que l’article 5 n’ajoute rien au droit existant, car il précise que les enfants de deux ans peuvent être accueillis « dans des conditions éducatives et pédagogiques précisées par le ministre chargé de l’éducation nationale ». Cette précision, s’ajoutant au souci de faire de l’école maternelle une école à part entière, dans le cadre d’un cycle spécifique, confirme bien que nous défendons là une conception nouvelle de la scolarisation précoce.
Je suis donc défavorable à ces amendements de suppression.
Mme Marie-George Buffet. J’avais déposé deux amendements, qui n’ont pas été retenus et que je retravaillerai pour les présenter à nouveau lors de l’examen du texte en séance publique, afin de souligner que la maternelle est une école à part entière et que les bénéfices de la scolarisation à deux ans ne concernent pas seulement les enfants dont les parents ne parlent pas français.
Le premier tendait à remplacer les mots : « peuvent être accueillis » par les mots : « sont accueillis » et à préciser que les conditions pédagogiques devaient comprendre « une pédagogie adaptée à leur âge, notamment concernant les moyens matériels et humains, le taux d’encadrement en classe, l’enseignement dispensé, ainsi que l’adaptation de la journée d’école au rythme du très jeune enfant ».
Mon autre amendement, qui prenait acte du fait que le taux de scolarisation en maternelle à cet âge dépasse largement 90 %, visait à rendre obligatoire la scolarisation des enfants de trois ans.
La Commission rejette les amendements de suppression.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 141 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. L’amendement demande que l’accueil des enfants de deux ans soit organisé en priorité dans les écoles scolarisant des enfants issus de catégories socioprofessionnelles défavorisées, en écartant ainsi des critères purement géographiques qui pourraient conduire à la constitution de ghettos scolaires.
M. le rapporteur. On voit réapparaître ici le débat classique opposant le zonage et la prise en compte des individus. L’amendement remet en cause notre conception de l’éducation prioritaire : il ne doit pas s’agir d’une politique limitée à l’école et visant des personnes ou des catégories déterminées, mais d’une politique globale et concertée, traitant de tout ce qui relève de l’aménagement du territoire et mobilisant à ce titre aussi bien les ministères de la ville et des transports, par exemple, que celui de l’éducation nationale. Avis défavorable.
M. Xavier Breton. Ce débat fait en effet écho à celui qui porte sur la politique de la ville. Il faut sortir d’une logique « cartographique » pour prendre en compte les situations personnelles : au-delà des politiques d’aménagement du territoire, ce sont les politiques sociales qui sont ici en jeu.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine alors l’amendement AC 239 de M. Guénhaël Huet.
Mme Claudine Schmid. La scolarisation à deux ans est un peu trop précoce. D’autres formules d’accueil sont plus adaptées à cet âge et plus favorables pour les parents, notamment pour ce qui est des horaires et des vacances scolaires.
D’autre part, en disposant que « les enfants peuvent être accueillis », le texte de l’article 5 donne aux parents une certitude là où la loi en vigueur, prenant en compte les difficultés pratiques, se borne à énoncer que « tout enfant doit pouvoir être accueilli ».
M. le rapporteur. Même avis que précédemment, pour les mêmes raisons.
La Commission rejette l’amendement.
Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement de précision AC 724 de M. Rudy Salles.
Elle examine ensuite l’amendement AC 725 de M. Rudy Salles.
M. Rudy Salles. La scolarisation précoce doit être subordonnée à une analyse partagée entre l’équipe pédagogique et les parents, dans l’esprit de dialogue que nous avons évoqué ce matin.
M. le rapporteur. Avis favorable, bien que cette disposition relève davantage d’une circulaire que de la loi.
La Commission adopte l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 236 de M. Thierry Braillard.
M. Thierry Braillard. Je souhaite compléter la liste des zones prioritaires en y ajoutant les collectivités d’outre-mer.
M. le rapporteur. Avis favorable, sous réserve de parler plutôt des « territoires ultramarins ».
M. Thierry Braillard. J’accepte.
La Commission adopte l’amendement rectifié.
Elle adopte ensuite l’article 5 modifié.
La Commission est saisie de plusieurs amendements, portant articles additionnels après l’article 5 et, d’abord, de l’amendement AC 460 de Mme Barbara Pompili.
Mme Isabelle Attard. Dans l’esprit de la Convention internationale des droits de l’enfant et dans un souci d’éducation à la démocratie et à la citoyenneté, l’amendement élargit aux élèves du primaire la liberté d’expression actuellement garantie aux seuls collégiens et lycéens. Ce souci est en cohérence avec la réflexion que nous avons menée sur l’éducation morale et civique, car la liberté d’expression donne un contenu plus concret à ce parcours citoyen. Cette liberté doit, bien entendu, être adaptée au degré de maturité et à l’âge des enfants.
M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait dans la mesure où l’un des objectifs majeurs assignés à l’école est le développement de l’esprit critique, ce qui suppose la liberté d’expression. Mais inscrire celle-ci dans le texte de la loi pourrait servir de justification à des comportements contraires à la mission même de l’école. Un élève pourrait ainsi contester en pleine classe le traitement d’une partie du programme d’histoire – voire le fait même d’aborder telle question du programme. Il est des possibilités qui doivent être encadrées. Avis défavorable, donc.
Mme Isabelle Attard. Le terme de « liberté d’expression » figure déjà dans la loi pour le collège et le lycée. L’amendement vise, je le répète, à étendre cette liberté à l’école primaire, compte tenu de l’âge et de la maturité des enfants. Quant à l’idée d’« encadrer » la liberté d’expression, elle ne me séduit guère. Si vous jugez cependant que cet amendement n’a pas sa place ici, je le retirerai.
M. Rudy Salles. La liberté d’expression est certes un principe républicain, qui figure en outre dans le projet de loi. Je partage cependant les craintes du rapporteur quant aux conséquences que pourrait avoir l’application de ce principe, à l’inverse même de ce qu’il implique.
M. Thierry Braillard. Le législateur a posé des limites à la liberté d’expression, excluant notamment la faculté de porter atteinte à la liberté d’enseignement et de critiquer ouvertement le professeur. Une circulaire a précisé le champ de cette liberté dans les collèges et, de façon beaucoup plus libérale, dans les lycées. Le droit en vigueur me semble sur ce point assez bien fait.
Mme Isabelle Attard. Tout bien considéré, je maintiens l’amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 175 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. Cet amendement est présenté par plusieurs membres du groupe d’études sur l’intégration des personnes handicapées. Les auxiliaires de vie scolaire et, plus généralement, les accompagnants des élèves en situation de handicap souffrent d’un manque de reconnaissance, de formation et de perspectives d’évolution de carrière. Leur rémunération est insuffisante et ils ne sont en outre pas assez nombreux, car 11 000 enfants en situation de handicap n’ont pu bénéficier de ce service. L’amendement demande qu’un rapport soit remis au Parlement sur les évolutions possibles du statut et du recrutement de ces personnels, afin notamment d’améliorer leur formation et de pérenniser l’accompagnement des élèves handicapés.
M. le rapporteur. La Conférence nationale du handicap (CNH) est chargée d’un rapport sur ce point. L’amendement étant satisfait, j’invite ses auteurs à le retirer ; faute de quoi j’y serais défavorable.
M. Xavier Breton. La question des perspectives d’emploi est importante, même si les contraintes budgétaires imposent que l’on ne promette pas l’impossible. Il serait utile que notre Commission discute du rapport de la CNH afin que le Parlement soit associé au débat.
M. le rapporteur. Un groupe de travail interministériel est également chargé d’un rapport sur cette question. Nous pourrons bien entendu, lors de l’examen en séance, demander à y être associés.
Mme Barbara Pompili. Cette solution me paraît sage. Je retire donc mon amendement, pour le redéposer en séance afin de demander au gouvernement qu’il nous associe à ces travaux.
M. Thierry Braillard. Il faut veiller à ce que cette solution ne se traduise pas par une demande de rapport au Parlement.
L’amendement est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement AC 176 de Mme Barbara Pompili.
M. Xavier Breton. Cet amendement participe de la même logique que le précédent : nous souhaitons que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l’accessibilité des bâtiments. En ce domaine, on le sait, les contraintes sont nombreuses ; aussi souhaitons-nous participer à la réflexion.
M. le rapporteur. L’avis et le commentaire sont les mêmes que pour l’amendement précédent.
Mme Barbara Pompili. Dans la même optique que précédemment, je retire cet amendement, ainsi que l’amendement AC 177, pour les représenter en séance.
Les amendements AC 176 et AC 177 sont retirés.
La Commission en vient à l’examen de l’amendement AC 401 de Mme Martine Pinville.
Mme Martine Faure. Cet amendement étant satisfait par d’autres, je le retire.
L’amendement est retiré.
Section 2
L’éducation artistique et culturelle
Article 6
Éducation artistique et culturelle
Le présent article propose de remplacer l’article L. 121-6 du code de l’éducation relatif aux enseignements artistiques par une série de dispositions ayant pour but de mettre en place une véritable éducation artistique et culturelle tout au long de la scolarité des élèves. Il est proposé d’adopter une approche globale qui couvre l’ensemble des enseignements mais aussi les actions éducatives qui les complètent sur les temps scolaire et périscolaire.
L’objectif du gouvernement est de permettre à tous les jeunes, sur tous les territoires, d’accéder à l’art et à la culture de la petite enfance à l’université.
Le parcours d’éducation artistique et culturelle comprendra trois volets complémentaires : les enseignements (dont l’histoire des arts), la pratique artistique et la rencontre avec des œuvres et des artistes. C’est une démarche partenariale, qui implique tous les espaces et temps de vie des jeunes et qui concerne l’État et les collectivités territoriales, les réseaux associatifs culturels comme ceux de la jeunesse et de l’éducation populaire, les structures culturelles et les artistes.
1. La situation actuelle : une multitude d’initiatives insuffisamment articulées et qui n’atteignent pas tous les jeunes
Les initiatives et les réalisations existantes sont multiples, souvent remarquables, impliquant d’ores et déjà tous les acteurs de l’éducation artistique et culturelle, depuis l’école jusqu’aux musées, aux théâtres, aux cinémas, aux conservatoires. Mais d’importantes inégalités territoriales, sociales et familiales persistent.
● Un besoin de définition et de clarification
La rédaction actuelle de l’article L. 121-6 du code de l’éducation limite l’acquisition de la culture artistique et le développement de la pratique artistique à l’école aux seuls enseignements pendant le temps scolaire :
« Les enseignements artistiques contribuent à l’épanouissement des aptitudes individuelles et à l’égalité d’accès à la culture. Ils favorisent la connaissance du patrimoine culturel ainsi que sa conservation et participent au développement de la création et des techniques d'expression artistiques.
« Ils portent sur l’histoire de l’art et sur la théorie et la pratique des disciplines artistiques, en particulier de la musique instrumentale et vocale, des arts plastiques, de l'architecture, du théâtre, du cinéma, de l’expression audiovisuelle, des arts du cirque, des arts du spectacle, de la danse et des arts appliqués.
« Les enseignements artistiques font partie intégrante de la formation scolaire primaire et secondaire. Ils font également l’objet d’enseignements spécialisés et d’un enseignement supérieur. »
Dès l’école maternelle, les élèves font leurs premières expériences dans le domaine « percevoir, sentir, imaginer, créer » : ils découvrent des instruments, des matériaux, des gestes graphiques ou encore des œuvres de référence.
Tous les élèves suivent des enseignements artistiques obligatoires : arts visuels et éducation musicale à l’école primaire (enseignement fondé essentiellement sur des pratiques) ; arts plastiques et éducation musicale au collège.
De plus, un enseignement d’histoire des arts est dispensé à tous les niveaux depuis 2009.
Le lycée est le temps de la diversification des parcours et d’une spécialisation progressive pour ceux qui le souhaitent vers le champ artistique et culturel ; l’éducation artistique et culturelle reçue par chaque lycéen est très variable en fonction de ses choix d’orientation.
Durant toute la scolarité des élèves, des actions éducatives portant sur le champ artistique et culturel, dans le cadre des enseignements ou dans le temps périscolaire, peuvent compléter, nourrir, enrichir les apports des enseignements. Ces actions éducatives prennent appui sur des dispositifs nationaux ou académiques d’éducation artistique et culturelle.
Cependant, s’il existe déjà beaucoup d’actions, à l’école et en dehors de l’école, des actions souvent remarquables, elles ne sont pas assez lisibles et ne touchent pas tous les jeunes.
Les enseignements dispensés ne permettent pas de couvrir l’ensemble des grandes formes d’expression artistique, et l’équilibre entre pratiques, connaissances et rencontres avec les œuvres, les lieux ou les professionnels de l’art n’est pas toujours satisfaisant. En outre, les dispositifs nationaux d’éducation artistique et culturelle ne touchent qu’une partie limitée de la population scolaire (environ 15 % des élèves chaque année).
Le rapport présenté en janvier 2013 au nom du comité de consultation sur l’éducation artistique et culturelle, présidé par Mme Marie Desplechin, fait apparaître un besoin de définition et de clarification.
● Des moyens budgétaires en diminution
Les moyens budgétaires de l’État ont connu une diminution depuis une dizaine d’années. Les crédits du ministère de l’éducation nationale et, dans une moindre mesure, ceux du ministère de la culture ont été réduits au cours des dernières années. Comme l’indique le rapport précité, « à l’effet des choix politique se sont ajoutés des arbitrages internes aux échelons déconcentrés de l’État, confrontés à la nécessité de mettre en œuvre plusieurs priorités dans un contexte budgétaire contraint. Cette évolution a contribué à faire douter de la réelle volonté de faire progresser l’éducation artistique et culturelle. »
● De grandes inégalités dans l’accès à l’éducation artistique et culturelle
L’accès à l’éducation artistique et culturelle à l’école est encore bien trop variable et inégal d’un élève à l’autre en fonction des politiques académiques, des différences en matière d’équipements et d’offre culturelle entre les territoires, des établissements fréquentés, des équipes pédagogiques.
Ces inégalités s’ajoutent aux différences et aux inégalités socio-culturelles et économiques entre les familles, que l’école ne parvient pas à compenser.
Certaines zones accusent un retard important, zones rurales et quartiers défavorisés notamment.
Beaucoup d’acteurs déplorent une insuffisante coordination sur le terrain des initiatives et des actions et tous situent la réponse dans une approche territoriale renforcée et un partenariat entre l’État et les collectivités territoriales.
● Un suivi inexistant
Enfin, l’éducation artistique et culturelle souffre d’un défaut de suivi et d’évaluation.
La loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 sur l’école, dite loi « Fillon » a créé un haut conseil de l’éducation artistique et culturelle chargé de suivre la mise en œuvre des mesures administratives et financières relatives au développement de l’éducation artistique et culturelle. Ce haut conseil comprend notamment des représentants de l’État et des collectivités territoriales et des personnalités du monde artistique ; il est présidé conjointement par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé de l’éducation. La loi précise qu’il établit et publie chaque année un rapport sur son activité et sur l’état de l’éducation artistique et culturelle.
Une visite du site internet de cette instance permet de constater que sa dernière actualité remonte au 6 décembre 2011, avec l’organisation d’un séminaire. Surtout, depuis sa création en novembre 2005, le haut conseil n’a rendu que deux rapports annuels rendant compte de son activité en 2006 et 2007. Aucun rapport sur l’état de l’éducation artistique et culturelle n’a été rendu à ce jour…
2. Une nouvelle ambition pour l’éducation artistique et culturelle
Il s’agit de faire de l’éducation artistique et culturelle un objectif de formation majeur à l’école pour développer la créativité, la curiosité intellectuelle, la sensibilité et le jugement esthétiques des élèves. Cette ambition se retrouve dans la consécration de la culture comme composante du socle, à côté des connaissances et des compétences.
Cette éducation doit permettre à tous les élèves d’avoir une pratique dans des domaines artistiques diversifiés, d’acquérir une culture artistique large, de découvrir régulièrement des œuvres, des artistes, des lieux et des professionnels des arts et de la culture.
La mise en œuvre de cette ambition impose de privilégier les territoires les plus éloignés de l’offre culturelle, en particulier les zones urbaines sensibles et les zones rurales.
● Le dispositif du projet de loi
Le 1° du II du présent article propose de substituer la notion d’éducation artistique et culturelle à celle d’enseignements artistiques. La notion d’éducation artistique et culturelle est plus large puisqu’elle permet, toujours pendant le temps scolaire, d’associer tous les acteurs (ministères en charge de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de l’agriculture, de la culture, des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, collectivités territoriales, associations). Il s’agit donc d’un concept recouvrant l’ensemble des enseignements, fondements de cette éducation, mais également les actions éducatives qui les complètent.
Le I du présent article est une disposition de coordination. Il vise, par cohérence, à substituer l’expression « éducation artistique et culturelle » à l’expression « enseignements artistiques » dans l’article L. 121-1 du code de l’éducation.
Le 2° du II du présent article tend à préciser que l’éducation artistique et culturelle favorise la connaissance du patrimoine artistique et culturel, mais aussi, et c’est une nouveauté par rapport à la rédaction actuelle de l’article L. 121-6, la création contemporaine.
Au-delà de l’acquisition de connaissances, l’accent est mis sur « le développement de la créativité et des pratiques artistiques ». Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 121-6 évoque « la création et les techniques d’expression artistique ».
L’éducation artistique et culturelle comprendra des enseignements artistiques (3° du II du présent article) qui, comme le précise le deuxième alinéa de l’article L. 121-6, dont la rédaction n’est pas modifiée, portent notamment « sur l’histoire de l’art et sur la théorie et la pratique des disciplines artistiques, en particulier de la musique instrumentale et vocale, des arts plastiques, de l’architecture, du théâtre, du cinéma, de l’expression audiovisuelle, des arts du cirque, des arts du spectacle, de la danse et des arts appliqués. »
L’éducation artistique et culturelle n’est pas un enseignement, mais les enseignements dispensés à l’école, notamment les enseignements artistiques et l’histoire des arts, mais aussi les lettres ou l’histoire, en constituent le fondement. Le futur conseil supérieur des programmes contribuera donc à la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle en coordonnant la réécriture progressive des programmes d’enseignement, de l’école primaire au lycée.
La mise en place du « parcours d’éducation artistique et culturelle », prévue par le 2° du II du présent article doit favoriser l’égal accès de tous à l’éducation artistique et culturelle, en la renforçant et en la rendant plus cohérente au sein de l’école.
L’organisation d’un parcours en éducation artistique et culturelle tout au long de la scolarité des élèves doit en outre permettre de mettre en cohérence les enseignements et les partenariats, de les enrichir, de les diversifier, notamment dans une perspective de complémentarité entre les temps scolaires et périscolaires.
Comme le précise le 2° du II du présent article, les modalités de ce parcours seront définies conjointement par les ministres chargés de l’éducation nationale et de la culture.
Selon les informations transmises au rapporteur, le parcours d’éducation artistique et culturelle se définit comme un itinéraire que suit chaque élève dans les domaines des arts et de la culture artistique, de l’école primaire à la fin du lycée.
Au fil de ce parcours et de sa scolarité, l’élève :
– fait l’expérience de pratiques artistiques de plus en plus riches, employant des techniques expressives d’un niveau de technicité croissant, accédant à une plus grande autonomie dans sa démarche créative ;
– acquiert des repères culturels de plus en plus complexes, dans des domaines artistiques variés ;
– se familiarise avec les œuvres d’art pour devenir un spectateur averti et critique, dont les goûts et le jugement se précisent et s’affinent ;
– découvre peu à peu l’économie de l’art, les différents secteurs d’activité et métiers qui la constituent.
Ce parcours doit être continu, progressif et cohérent, particulièrement :
– au sein d’un même établissement, entre les différents enseignements et actions éducatives qui contribuent à la formation artistique et culturelle des élèves ;
– entre les degrés : école primaire, collège, lycée.
Selon les informations transmises au rapporteur, sa mise en place nécessite un travail en profondeur sur les enseignements – tant sur les contenus que sur les modalités pédagogiques de leur mise en œuvre (qui doit favoriser la démarche de projet et le recours au partenariat notamment) –, la réorganisation des réseaux du ministère, de manière à donner un appui fort à l’organisation des parcours et aux enseignements, des actions de formation des personnels, et l’utilisation des ressources numériques en faveur de l’éducation artistique et culturelle.
Comme l’indique le rapport du comité de consultation sur l’éducation artistique et culturelle, la réforme des rythmes scolaires est pour de nombreux élus, une opportunité historique pour faire une meilleure place à l’éducation artistique et culturelle. Elle offre en effet de nouvelles possibilités pour que l’organisation du temps des enfants ménage des séquences consacrées à une activité culturelle, en lien avec l’environnement de l’école.
En outre, à la suite des préconisations du rapport de la concertation, le ministère de l’éducation nationale a confirmé son souhait de repenser l’organisation hebdomadaire des enseignements obligatoires de musique et d’arts plastiques au collège. « Une offre d’assouplissement de l’actuelle organisation offrirait par exemple des opportunités de regroupements d’heures afin que ces enseignements puissent se développer dans un environnement culturel plus riche. »
Enfin, l’enseignement de l’histoire des arts, après une refonte de ses objectifs et de son organisation, encouragera à la fréquentation des lieux culturels et des œuvres. Le portail de l’histoire des arts, avec ses ressources numériques géolocalisées, devra continuer à venir en appui des démarches des enseignants.
● Les moyens
Pour le ministère de l’éducation nationale, l’objectif est de clarifier et de mieux encadrer l’éducation culturelle et artistique et donc de mieux utiliser les moyens qui y sont consacrés par le ministère de l’éducation nationale.
Ainsi que le précise l’étude d’impact du projet de loi, « le ministère de l’éducation nationale consacre d’ores et déjà un effort important puisqu’aux 17 000 professeurs de musique et d’arts plastiques du second degré s’ajoutent près de 1 400 emplois dans les académies (délégués académiques à l’action culturelle, décharges pour les chorales…) et les départements (coordonnateurs, conseillers pédagogiques…) soit 18 400 emplois équivalents temps plein (ETP). S’y ajoutent des référents culture dans les lycées. »
On constate une importante variété d’actions et des partenariats avec les directions régionales des affaires culturelles (DRAC), les collectivités territoriales et les institutions culturelles qui prennent la forme de conventions, de comités de pilotage associant rectorat, région et DRAC.
Cependant, comme il a été indiqué précédemment les projets restent inégaux, et on constate de manière générale une absence d’évaluation de leurs résultats.
Si l’objectif est de mieux utiliser les moyens existants, l’étude d’impact précise néanmoins qu’en fonction des évolutions attendues, « une partie des 60 000 postes créés sur le quinquennat pourra être mobilisée en faveur de l’éducation artistique et culturelle. »
De son côté, le ministère de la culture et de la communication a prévu d’augmenter ses crédits d’intervention pour la première fois depuis de nombreuses années : aux 30 millions d’euros consacrés annuellement à l’éducation artistique et culturelle, il est prévu d’ajouter 2,5 millions d’euros en 2013, 5 millions d’euros en 2014, 7,5 millions d’euros en 2015 (soit 15 millions d’euros sur trois ans).
En ce qui concerne les collectivités territoriales, aucune obligation ne leur est imposée. Les collectivités territoriales qui souhaiteront renforcer leur politique d’éducation artistique et culturelle, pourront, si elles le souhaitent, accompagner la mise en œuvre territoriale du parcours artistique et culturel des élèves.
Néanmoins, la réussite de cette nouvelle ambition implique une concertation accrue de tous les acteurs. En effet, pour une mise en place efficace de la généralisation du parcours culturel, une mise en synergie des actions de tous les partenaires est absolument requise. Cela impliquera nécessairement une coordination des budgets.
● Le pilotage
L’étape clé pour la mise en œuvre du parcours sera l’installation des instances stratégiques académiques pour l’éducation artistique et culturelle, sous la forme de comités d’organisation et de pilotage régional de l’éducation artistique et culturelle (COPRÉAC).
Ces COPRÉAC réunissent l’ensemble des partenaires (les représentants en région des ministères en charge de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la culture, de la jeunesse, de l’agriculture, ainsi que les collectivités territoriales). Ils définissent, en fonction des spécificités territoriales, les axes stratégiques pour une mise en place opérationnelle, coordonnée et progressive du parcours d’éducation artistique et culturelle, en portant une attention particulière aux publics sociologiquement ou géographiquement éloignés des arts et de la culture. Selon les informations transmises au rapporteur, ces instances stratégiques peuvent être en place dès la rentrée 2013.
L’objectif de promotion de l’égal accès à l’éducation artistique et culturel doit être une préoccupation majeure.
Le parcours d’éducation artistique et culturelle s’appuie de façon explicite sur les enseignements qui sont, par leur caractère obligatoire, porteurs d’égalité.
Cependant, si l’ambition d’offrir un égal accès à la culture à tous est nationale, son pilotage opérationnel se fait de façon efficace au niveau territorial.
C’est pourquoi il revient au COPRÉAC, dans le cadre de ses missions principales, d’identifier les territoires sociologiquement ou géographiquement éloignés des arts et de la culture. Ainsi il pourra intégrer, dans ses axes stratégiques, une politique adaptée à ces territoires.
Par ailleurs, une des missions fondamentales de l’instance stratégique académique (COPRÉAC) est de veiller au maillage territorial. Privilégiant une logique d’aménagement du territoire, le COPRÉAC favorisera mutualisation et synergie des moyens humains et financiers pour réduire les inégalités.
Enfin, le recours au vecteur numérique, dans le cadre d’un plan plus large sur le numérique à l’école, aidera à toucher plus d’élèves.
Selon les informations transmises au rapporteur, la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle commencera dès la rentrée scolaire 2013, et sera progressive, au fil :
– de la réécriture des programmes d’enseignement, une fois le conseil supérieur des programmes installé ;
– de la structuration de l’offre de formation des personnels, initiale et continue, en fonction de ces nouveaux axes, dans les écoles supérieures du professorat et de l’éducation et dans les plans académiques de formation.
Elle dépendra aussi de l’état de l’éducation artistique et culturelle dans chaque territoire, qui est très variable d’une académie à l’autre (certaines étant avancées plus que d’autres dans la structuration de l’éducation artistique et culturelle conçue comme un parcours).
● Les modifications adoptées par la Commission
La Commission a adopté un amendement tendant à préciser que :
– l’éducation artistique et culturelle comprend un parcours pour tous les élèves, « y compris les élèves en situation de handicap » ;
– ce parcours inclut des activités scolaires et des activités éducatives complémentaires ;
– sa mise en œuvre doit s’effectuer localement, notamment à travers les projets éducatifs territoriaux ;
– le parcours d’éducation artistique et culturelle est pris en compte dans la validation des diplômes.
La Commission a également adopté un amendement tendant à préciser que le parcours d’éducation artistique et culturelle est assuré par des enseignants de l’éducation nationale auxquels peuvent être associés des acteurs du monde culturel et artistique et du monde associatif.
Enfin le présent article, dans sa version initiale, supprimait le dernier alinéa de l’article L. 121-6 du code de l’éducation, qui dispose que « les enseignements artistiques font partie intégrante de la formation scolaire primaire et secondaire. Ils font également l’objet d’enseignements spécialisés et d’un enseignement supérieur. » Afin de ne pas réduire la portée de l’obligation du système éducatif d’assurer des enseignements artistiques, la Commission a adopté, à l’initiative du rapporteur, un amendement tendant à rétablir cet alinéa.
*
La Commission est saisie de l’amendement AC 259 de M. Benoist Apparu, tendant à la suppression de l’article.
M. Benoist Apparu. Le contenu du texte, bien maigre, est de surcroît très redondant par rapport au droit existant. L’article 6 en est la parfaite illustration. Les alinéas 82 à 85 du rapport annexé me semblent amplement suffisants pour satisfaire la volonté d’affichage du gouvernement en matière d’éducation artistique et culturelle. Évitons les lois bavardes.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite les amendements identiques AC 343 de M. Gérald Darmanin et AC 241 de M. Guénhaël Huet.
M. Rudy Salles. L’amendement AC 343 est défendu.
Mme Claudine Schmid. Je retire l’amendement AC 241, ainsi que les amendements AC 242, AC 666 et AC 667.
Les amendements AC 241, AC 242, AC 666 et AC 667 sont retirés.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 343.
Puis elle examine l’amendement AC 349 de M. Paul Molac.
M. Paul Molac. La rédaction de l’article L. 121-1 du code de l’éducation ne me semble pas très claire. Il dispose en effet que « Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur (…) dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. » Un « pays » pouvant désigner une région géographique comme la Thiérache ou le Gévaudan par exemple, je propose de parler plutôt « de la région où se trouve l’établissement scolaire, de la France ». Cette rédaction ouverte permettrait d’ailleurs de viser les régions au sens administratif ou historique.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Même si j’en comprends l’esprit, l’amendement risque de régionaliser des enseignements qui relèvent par définition de l’éducation nationale.
M. Paul Molac. Lorsque j’enseignais l’histoire, je partais souvent d’exemples locaux pour traiter le programme.
M. le rapporteur. Cette méthode est de bonne pédagogie, mais elle ne saurait constituer une obligation légale. Je vous invite donc à retirer votre amendement.
L’amendement est retiré.
La Commission en vient à l’examen de l’amendement AC 561 de Mme Marie-George Buffet.
Mme Marie-George Buffet. Mon intervention vaudra également défense de l’amendement AC 560. L’enseignement artistique doit être pleinement intégré aux programmes du primaire et du secondaire, et non « déporté » vers le périscolaire. Celui-ci peut évidemment avoir un contenu artistique, mais ne saurait être qu’un complément.
M. le rapporteur. Mon amendement AC 712, qui viendra en discussion tout à l’heure, témoigne de la même préoccupation puisqu’il vise à maintenir le dernier alinéa de l’article L. 121-6, que le gouvernement entendait supprimer et aux termes duquel « les enseignements artistiques font partie intégrante de la formation scolaire primaire et secondaire. Ils font également l’objet d’enseignements spécialisés et d’un enseignement supérieur ». S’il est adopté, l’amendement AC 561 sera satisfait ; j’invite donc Mme Marie-George Buffet à le retirer.
Mme Marie-George Buffet. Je le retire, ainsi que l’amendement AC 560.
Les amendements AC 561 et AC 560 sont retirés.
La Commission examine l’amendement AC 461 de Mme Barbara Pompili.
Mme Isabelle Attard. La notion de « parcours » artistique et culturel, depuis la maternelle jusqu’à la terminale, me semble plus appropriée que celle d’« enseignements ».
D’autre part, même si les grandes orientations sont définies au niveau national, elles doivent être déclinées localement grâce aux projets éducatifs territoriaux.
L’amendement permet enfin de prendre en compte les élèves en situation de handicap.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AC 463 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. Nous proposons que des intervenants extérieurs, par exemple issus du monde associatif, soient associés à l’enseignement artistique et culturel. Une telle ouverture de l’école à la société sera source de vraie richesse.
D’autre part, il convient d’ajouter la photographie à la liste des matières enseignées, à côté du cinéma.
M. le rapporteur. S’agissant de la photographie, nous avons déjà souligné les dangers de toute liste. Je suis en revanche favorable à l’ouverture de l’enseignement aux acteurs du monde culturel et artistique. Si l’amendement était rectifié en conséquence, j’émettrais un avis favorable.
M. Xavier Breton. Tout inventaire à la Prévert est par définition non limitatif, en effet.
Quant au second point, les acteurs du monde culturel et artistique doivent-ils être mis sur le même plan que les enseignants de l’éducation nationale ? Je propose plutôt la rédaction suivante : « Il est assuré par des enseignants de l’éducation nationale auxquels peuvent être associés des acteurs du monde culturel et artistique […]. »
Mme Barbara Pompili. J’accepte les deux rectifications proposées, même si je me réserve le droit de renouveler en séance ma proposition d’ajouter la photographie à l’énumération qui figure déjà dans le texte.
M. le président Patrick Bloche. En ce cas, je cosignerai votre amendement.
La Commission adopte l’amendement rectifié.
Puis elle examine les amendements identiques AC 712 du rapporteur et AC 106 de M. Frédéric Reiss.
M. le rapporteur. J’ai déjà présenté cet amendement, qui tend à supprimer l’alinéa 6 de l’article.
M. Xavier Breton. L’amendement AC 106 est défendu.
La Commission adopte ces amendements.
En conséquence, l’amendement AC 107 de M. Frédéric Reiss tombe.
La Commission adopte l’article 6 modifié.
La Commission en vient aux amendements portant articles additionnels après l’article 6.
Elle examine d’abord l’amendement AC 350 de M. Paul Molac.
M. Paul Molac. Le Conseil d’État a rendu une décision à caractère pédagogique en limitant l’enseignement en langue régionale à 50 % du temps scolaire, retoquant par la même occasion la circulaire de 1967 qui autorisait, pour autant que le corps enseignant et les parents d’élèves en fussent d’accord, une plus large exposition des enfants à la langue régionale – le plus souvent en maternelle –, quitte à rétablir ensuite un enseignement paritaire, voire à l’avantage du français. Proposant ici de revenir sur cette décision, je précise que la mesure serait applicable « sous réserve de garantir la pleine maîtrise de la langue française », cette maîtrise demeurant bien entendu l’objectif principal. Mais je m’empresse d’ajouter que, dans les écoles associatives où le temps d’enseignement en français est inférieur à 50 %, les élèves ont obtenu aux tests d’évaluation, y compris en langue française, des résultats supérieurs à la moyenne.
M. le rapporteur. Avis défavorable. La jurisprudence du Conseil d’État, comme vous l’avez rappelé, limite l’enseignement en langue régionale à 50 % du temps d’enseignement.
M. Paul Molac. Ne peut-on revenir sur cette jurisprudence ?
M. le président Patrick Bloche. En modifiant la Constitution ? Un autre jour, peut-être, car nous sommes un peu pressés… (Sourires.)
M. Paul Molac. Il ne s’agit pas d’une décision du Conseil constitutionnel, monsieur le président, mais du Conseil d’État. Je me permets donc d’insister.
La Commission rejette l’amendement.
Article 6 bis (nouveau)
Contribution de l’éducation physique et sportive
à l’éducation à la santé et à la sécurité
La Commission a adopté un amendement tendant à compléter l’article L. 121-5 du code de l’éducation relatif à l’éducation physique et sportive afin de préciser que cette dernière contribue à l’éducation à la santé et à la sécurité.
*
La Commission examine l’amendement AC 344 de M. Gérald Darmanin.
M. Rudy Salles. Il s’agit d’ajouter, après les mots « à la lutte contre l’échec scolaire », les mots : «, à l’éducation à la santé et à la sécurité ».
Les activités physiques et sportives aident l’élève à mieux connaître son corps et à gérer l’espace et les obstacles. Cet enseignement contribue ainsi à l’éducation à la santé et à la sécurité, notamment en apprenant à l’élève à gérer sa prise de risque et à apprécier les conséquences de ses choix dans des environnements variés.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
La Commission est ensuite saisie des amendements identiques AC 123 de Mme Claudine Schmid et AC 727 de M. Rudy Salles.
Mme Claudine Schmid. Je souhaite que les élèves reçoivent une éducation à l’entrepreneuriat au cours de leur cursus. Il me semble en effet important de les sensibiliser à l’esprit d’entreprise, d’autant que certains y ont moins accès que d’autres en raison de leur situation sociale. Un tel enseignement est aussi de nature à favoriser la confiance en soi.
M. Rudy Salles. Il faut en effet sensibiliser les jeunes à l’esprit d’entreprise : cela contribuerait à développer leur créativité, leur esprit d’initiative, leur confiance en eux dans ce qu’ils entreprennent et les inciterait à des comportements socialement responsables. La Commission européenne accorde d’ailleurs une attention particulière à l’apprentissage de l’esprit d’entreprise, depuis l’école primaire jusqu’à l’université.
M. le rapporteur. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que celles précédemment développées.
Mme Claudine Schmid. Cet avis ne va pas dans le sens des propos tenus par le ministre dans l’hémicycle. L’adaptation à la vie professionnelle suppose un apprentissage.
La Commission rejette ces amendements.
Section 3
Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture
La Commission est saisie de l’amendement AC 726 de M. Rudy Salles portant article additionnel avant l’article 7.
M. Rudy Salles. Je propose de rédiger l’intitulé de la section 3 de la façon suivante : « Le socle commun de connaissances et de compétence ».
Dans la mesure où le contenu du socle n’est pas formellement défini par le projet de loi, rien ne justifie l’adjonction du mot « culture ».
M. le rapporteur. Avis défavorable : la culture a tout sa place à l’école. Les humanités, notamment, font partie du socle commun.
M. Xavier Breton. Je suis d’accord avec M. Rudy Salles. La culture faisant déjà partie du socle, il n’y a aucune raison de la mentionner à part dans le titre, au risque de diluer. Mieux vaut réfléchir au contenu du socle et aux moyens d’assurer son assimilation.
La Commission rejette l’amendement.
Article 7
Redéfinition du socle commun de connaissances et de compétences
Le présent article tend à modifier l’article L. 122-1-1 qui définit le socle commun de connaissances et de compétences. Comme l’indique l’exposé des motifs, « il s’agit de poser les bases d’une réflexion sur le contenu du socle en reformulant sa définition ».
1. La situation actuelle : un principe ambitieux qui ne s’est guère traduit dans les faits
L’article L. 122-1-1 du code de l’éducation, issue de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École, dite « loi Fillon », impose à notre système éducatif un objectif : garantir à tous les élèves la maîtrise du « socle commun de connaissances et de compétences » à la fin de la scolarité obligatoire.
Cet objectif se retrouve dans la plupart des pays développés, l’Union européenne ayant défini en novembre 2005 un cadre européen des « compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie » qui doivent permettre « l’épanouissement et le développement personnels, la citoyenneté active, l’intégration sociale et l’emploi ». Le but est que chacun, lorsqu’il quitte l’école, dispose de ressources intellectuelles pérennes et soit capable de les utiliser à bon escient.
Si le socle est défini en termes de compétences, c’est afin de mettre l’accent sur la capacité des élèves à mobiliser leurs acquis, à l’école comme dans la vie. Les compétences ne s’opposent pas aux connaissances, mais combinent connaissances, capacités et attitudes. Les résultats des évaluations internationales (PISA) montrent la difficulté des jeunes Français à mobiliser les connaissances et les compétences acquises à l’école pour résoudre des problèmes rencontrés en situations authentiques de la vie ordinaire. Dans le cas des langues vivantes étrangères par exemple, apprendre la grammaire et le vocabulaire sans apprendre à mobiliser ces savoirs en situation de communication effective, écrite ou orale, n’implique pas qu’on a atteint un niveau satisfaisant dans la pratique d’une langue, comme de nombreuses générations en ont fait l’expérience.
Le socle commun était censé fonder les objectifs des programmes et être la base de toute formation ultérieure, comme l’indique l’article L. 122-1-1. Ainsi, le socle commun a-t-il été présenté par le ministère comme « un acte refondateur de notre système éducatif », et son importance, entre autres comme levier contre l’échec scolaire, est régulièrement soulignée. Il devait également constituer une chance de redonner un véritable contenu aux cycles, c’est-à-dire à une organisation pluriannuelle de l’enseignement, dont la mise en place est restée largement théorique depuis 1989.
Le socle s’organise actuellement en sept compétences : la maîtrise de la langue française, la pratique d’une langue étrangère, les compétences de base en mathématiques et la culture scientifique et technologique, la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication, la culture humaniste, les compétences sociales et civiques et l’autonomie et l’initiative des élèves.
Si le socle commun existe depuis 2005 dans le code de l’éducation, sa traduction concrète, dans le quotidien des classes, s’est heurtée à de nombreux obstacles.
Le décret du 11 juillet 2006 relatif au socle commun, pris en application de la loi du 23 avril 2005 a tenté de donner une définition (essentiellement négative) du socle qui n’était guère éclairante sur son articulation avec l’enseignement obligatoire : « l’enseignement obligatoire ne se réduit pas au socle commun. Bien que désormais il en constitue le fondement, le socle ne se substitue pas aux programmes de l’école primaire et du collège ; il n’en est pas non plus le condensé »…
Dans son rapport de 2011 sur la mise en œuvre du socle, le Haut conseil de l’éducation observe que « l’effort d’adaptation des programmes aux exigences du socle a été accompli pour l’école primaire. Des pages “socle commun” sont clairement repérables à la fin des programmes de chaque cycle de l’école élémentaire publiés au B.O. hors-série n° 3 du 19 juin 2008 ; elles indiquent les éléments de compétence dont la maîtrise est alors attendue. »
Dans le cas du collège, la prise en compte du socle est en revanche très variable selon les disciplines.
Enfin, l’article 32 de la loi du 23 avril 2005 prévoit que la maîtrise du socle commun est attestée par le diplôme national du brevet (DNB), dont les sujets portent sur les programmes. Jusqu’à la session 2010, les seules compétences exigibles étaient la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication (avec le B2i, brevet informatique et internet) et la pratique d’une langue vivante étrangère. Depuis la session 2011, la maîtrise de toutes les compétences du socle commun est obligatoire pour obtenir le DNB. Néanmoins, l’articulation entre, d’une part, la réussite à un examen reposant sur la moyenne des notes obtenues aux épreuves finales et au contrôle en cours de formation dans les différentes disciplines et, d’autre part, l’attestation de la maîtrise de compétences non compensables entre elles demeure problématique.
L’approche par compétences devait entraîner une modification de l’évaluation des élèves. C’est ce qui a conduit à la conception du « livret personnel de compétences » (LPC), dont l’objectif, depuis les premiers textes de 2007, est de permettre à l’élève, à ses parents et aux enseignants, de suivre la validation progressive des compétences du socle commun. Pour chacun des trois paliers de maîtrise du socle, le livret recense, pour chaque compétence, des « items », c’est-à-dire des éléments de compétences attendus à chaque palier. Utilisé dans les écoles primaires depuis 2008, il a été généralisé à tous les collèges à la rentrée 2010 ; après plusieurs expérimentations, sa forme a été unifiée en 2010.
Le socle a suscité chez les enseignants autant d’incompréhension que de lassitude, l’attestation de maîtrise cristallisant les inquiétudes, voire les oppositions. Les personnels sont souvent demandeurs d’un mode d’emploi du socle, d’outils d’ordre pédagogique pour les aider à faire maîtriser le socle commun par tous les élèves. Or ces outils n’ont été réalisés que pour la seule compétence 3 (les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique) à partir de 2009.
Le principe du socle commun a suscité de nombreuses critiques et résistances internes et externes au monde éducatif.
Il marquerait pour certains un abaissement des exigences et un appauvrissement culturel. Il a souvent été, à tort, identifié au simple « lire, écrire, compter et raisonner » de l’école primaire. L’accent mis sur les « fondamentaux » – expression parlante mais ambiguë – a d’ailleurs pu entretenir la confusion. La maîtrise de ces fondamentaux de l’école primaire est certes indispensable pour l’acquisition du socle commun, mais le socle commun va bien au-delà : il comporte sept compétences et sa maîtrise ne peut être acquise que progressivement jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire. De plus, il ne peut y avoir de compensation entre les compétences qui le constituent : toutes doivent être acquises, car elles sont complémentaires et aussi nécessaires les unes que les autres.
Les indications partielles dont on dispose donnent à penser que le nombre d’élèves maîtrisant la totalité du socle à la fin de la troisième est très éloigné de celui de l’ensemble d’une classe d’âge. On ne saurait donc, de bonne foi, accuser le socle commun de manquer d’ambition.
D’autres pensent que le socle nuirait à l’excellence en tirant les meilleurs vers le bas, empêchant ainsi l’éclosion d’une élite. C’est oublier, d’une part, que le socle ne vise pas seulement à élever le niveau des élèves les plus faibles, mais aussi à combler les lacunes que l’on constate en trop grand nombre même chez les élèves qui réussissent. Les comparaisons internationales montrent au demeurant que les pays où l’élite scolaire est la plus importante sont aussi ceux qui ont réussi à réduire le plus la proportion d’élèves faibles.
D’autres contestent l’approche par compétences au motif qu’elle conduirait à un émiettement des savoirs, voire asservirait l’école aux besoins immédiats des employeurs. C’est ignorer que le socle met un accent très fort sur la culture scientifique et technologique, sur la culture humaniste, et sur le dialogue entre disciplines.
Enfin, le socle commun est souvent assimilé au seul « livret personnel de compétences », considéré par les enseignants comme une « usine à cases » et peu compréhensible par les élèves et leurs parents. La réforme constituée par le socle commun a en effet été en partie vidée de son sens en se réduisant largement à l’introduction de cette usine à cases sans articulation avec les programmes. Or, la validation de la maîtrise du socle ne doit être qu’un aboutissement, et l’acquisition des compétences du socle devrait avant tout être une question d’enseignement.
2. Le dispositif proposé : relancer le socle pour refonder l’école
Comme l’indique le rapport de la concertation pour la refondation de l’école, malgré les difficultés rencontrées dans la conception et la mise en œuvre du socle commun, un consensus a émergé sur la nécessité de définir un ensemble de compétences et de connaissances obligatoires pour tous.
Le présent article renvoie la définition du socle à un décret. Ce renvoi doit permettre de rendre cette définition plus évolutive et de donner de la souplesse à ce qui en manquait jusque-là. Rappelons que la définition du socle retenue par la loi du 23 avril 2005 a fait l’objet de vifs débats, dès son adoption. Le décret précité de 2006 a dû ajouter deux piliers par rapport à la rédaction actuelle de l’article L. 122-1-1 qui ne comporte que cinq piliers.
Il convient de souligner que la redéfinition du socle n’est qu’un élément d’une réforme globale qui s’accompagne d’une révision des programmes, des cycles, de l’évaluation et du soutien aux élèves en difficulté.
Ce socle commun doit enfin devenir le principe organisateur de l’enseignement obligatoire. Il est donc essentiel de faire évoluer les programmes parallèlement et de redéfinir le mode de validation, à l’issue de la scolarité obligatoire, de la réalité des acquis des élèves. Une réforme du diplôme national du brevet s’imposera donc. Le deuxième alinéa de l’article L. 122-1-1, dans la rédaction proposée par le présent article, précise, comme c’est le cas actuellement, que l’acquisition du socle commun par les élèves fait l’objet d’une évaluation qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité.
Les dispositions proposées engendrent donc la rédaction de nouveaux programmes, mission dont le conseil supérieur des programmes (CSP) dont la création est proposée par l’article 20 du présent projet de loi sera la pièce maîtresse.
La garantie effective de tous les moyens nécessaires à l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture doit avoir un effet favorable sur l’ensemble des lacunes du système actuel : améliorer les résultats des élèves, réduire les sorties sans qualification et les écarts de réussite entre les élèves de l’éducation prioritaire et les élèves hors éducation prioritaire.
Comme l’indique l’étude d’impact du projet de loi, « la garantie de l’acquisition du socle par tous les élèves sera favorisée par une révision de la conception et des composantes du socle, par l’évolution des modalités de notation des élèves et par la mise en place d’aides spécifiques pour les élèves en difficulté. »
Le principe des cycles est réaffirmé à l’article L. 311-1 du code de l’éducation par l’article 23 du présent projet de loi. La fixation de leur nombre et de leur durée, qui n’est pas du domaine législatif, est renvoyée à un décret, ce qui devrait permettre d’assurer là encore une plus grande souplesse et une plus grande cohérence entre les programmes, le socle commun et l’organisation de la scolarité obligatoire des élèves.
La modification de l’article L. 311-3 proposée par l’article 24 du présent projet de loi vise à favoriser l’articulation des programmes avec le socle commun de connaissances, de compétences et de culture en précisant que les programmes définissent les compétences attendues de chaque élève.
Par rapport à la rédaction actuelle, le nouvel article L. 122-1-1 insiste bien sur la transversalité du socle et son articulation avec les programmes, en indiquant que l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité contribue à son acquisition.
Le 3° du présent article tend à supprimer, le dernier alinéa de l’actuel article L. 122-1-1 du code de l’éducation, qui précise que « parallèlement à l’acquisition du socle commun, d’autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire ». Le présent article opère donc ici une mise en cohérence absolument salutaire. L’une des grandes limites de l’actuel socle est en effet, que l’enseignement semblait composé de deux domaines : celui du socle et celui des disciplines ; que le premier devait s’ajouter aux secondes, pouvant ainsi laisser penser que le socle avait un contenu disciplinaire propre « à côté » d’autres contenus disciplinaires, « parallèles ». Le texte de l’article donne une meilleure visibilité à l’ensemble : c’est au travers des diverses disciplines que chacun doit acquérir les compétences attendues, ce qui impose de mettre rapidement en cohérence les programmes.
L’articulation des cycles, des programmes et des dispositifs d’aide doit évidemment permettre une meilleure progressivité dans l’organisation du socle commun et une réduction des taux de redoublement à l’école et au collège.
La progressivité de l’acquisition du socle est d’ailleurs soulignée. Concevoir de façon progressive les apprentissages est en effet essentiel pour permettre la réussite de chaque élève, ces derniers progressant en effet chacun à son rythme, en fonction aussi bien de leur personnalité propre que des événements qui peuvent survenir dans leur vie et leur entourage. Le système scolaire actuel raisonne trop en termes de programmes annuels, de progressions annuelles, ce qui souvent ne laisse comme seule possibilité que le redoublement quand un élève n’a pas atteint le niveau requis en fin d’année.
Élément essentiel de la redéfinition du socle, la notion de culture vient s’ajouter à celles de connaissances et de compétences. Comme il a été indiqué précédemment, la notion de culture (scientifique et technique et humaniste) n’est pas absente de la définition actuelle du socle. Toutefois, pour éviter une interprétation utilitariste du socle qui négligerait sa dimension culturelle, il apparaît nécessaire de revenir sur la distinction opérée par la loi entre connaissances et compétences. L’intégration de la culture comme élément constitutif du socle trouvera notamment une traduction concrète dans la mise en œuvre d’un ambitieux parcours d’éducation artistique et culturelle (article 6 du présent projet de loi).
Il est également proposé de préciser que l’acquisition du socle est indispensable « pour se préparer à l’exercice de la citoyenneté ». Cette ambition se traduira notamment par la mise en place d’un enseignement moral et civique.
Pour exister dans les faits, une réforme de cette ampleur exige une stratégie d’accompagnement, élaborée en tenant compte des préoccupations et des réticences des acteurs. Le travail de légitimation du socle commun est indispensable ; il est à mener auprès de tous les personnels de l’éducation nationale et des parents.
La formation initiale et continue des professeurs doit également ouvrir à des méthodes d’enseignement et d’évaluation permettant d’intégrer à la pratique quotidienne les exigences liées au socle commun, à savoir la maîtrise par la totalité des élèves de compétences solides, reposant sur des connaissances disciplinaires.
Assurer la cohérence des textes, des discours et des pratiques est un impératif pour la réussite d’une réforme. À cet égard un « pilotage ferme » de la mise en œuvre du socle sera nécessaire. On constate en effet que l’institution et ses représentants à tous les niveaux, notamment les corps d’inspection, n’ont pas toujours tenu un discours cohérent et mobilisateur afin de créer une vraie dynamique et de garantir la mise en œuvre coordonnée et efficace de cette innovation. Des consignes claires ont manqué concernant la validation de chaque pilier, pour éviter sur le terrain des pratiques très disparates d’une école ou d’un collège à l’autre, voire d’une classe à l’autre, qui font courir le risque d’attester la maîtrise d’un socle qui ne serait plus vraiment « commun ».
*
La Commission a adopté un amendement tendant à préciser que les éléments du socle commun et les modalités de son acquisition progressive seront fixés par décret « après avis du Conseil supérieur des programmes. » Cette proposition avait été formulée par le Conseil économique social et environnemental (CESE) dans son avis sur l’avant-projet de loi. Le Conseil supérieur des programmes doit jouer un rôle clé dans l’élaboration des programmes et leur articulation avec le socle. Il est donc tout à fait souhaitable qu’il formule un avis sur le décret qui définira les éléments du socle et les modalités de leur acquisition.
*
La Commission est saisie des amendements identiques AC 191 de M. Frédéric Reiss, AC 260 de M. Benoist Apparu et AC 142 de M. Patrick Hetzel, tendant à la suppression de l’article.
M. Frédéric Reiss. Le socle commun de connaissances et de compétences est une innovation majeure de la loi du 23 avril 2005. Nous sommes attachés à l’enseignement de la culture mais, en l’occurrence, la redéfinition est renvoyée à un décret. Nous souhaitons maintenir le socle et ses éléments constituants tels qu’ils avaient été définis en 2005, à savoir la maîtrise de la langue française, la maîtrise des principaux éléments de mathématiques, le développement d’une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté, la pratique d’au moins une langue vivante étrangère et la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication. Le Haut conseil de l’éducation avait d’ailleurs estimé que l’acquisition du socle ainsi compris était de « l’intérêt des élèves ».
M. Benoist Apparu. L’article 7 retire au Parlement le pouvoir de définir le contenu du socle, pour le transférer au gouvernement. S’il est normal que les spécialistes du ministère de l’éducation nationale rédigent les programmes, il me semble tout aussi normal que la représentation nationale définisse les connaissances et les compétences devant être acquises au terme de la scolarité obligatoire. Il me semblerait grave que notre Commission accepte un recul sur ce point.
M. Xavier Breton. Je souscris pleinement à ces observations. S’il appartient à l’exécutif d’assurer la mise en œuvre du socle commun, nous enverrions un très mauvais signal en lui abandonnant la définition de celui-ci, d’autant que l’éducation nationale est un peu fermée sur elle-même. De ce point de vue, la loi de 2005 avait été l’occasion d’un dialogue. Il serait dommage aujourd’hui de nous prononcer pour l’existence d’un socle commun dont nous ne pourrions fixer les grandes orientations.
M. le rapporteur. En 2005, la discussion sur le socle nous avait longuement occupés en séance. À l’époque, j’étais tout à fait favorable à ce que le Parlement en fixe le contenu mais, au fil du temps, il m’est apparu que cette méthode avait eu deux inconvénients majeurs. Le premier est l’empilement consécutif à l’intervention, par ailleurs tout à fait légitime, de différentes catégories de personnels. Nous avions ainsi dû répondre aux préoccupations des professeurs d’éducation physique et sportive et d’autres encore, si bien que l’idée même du socle, transformé en liste, s’en était trouvée dénaturée.
Deuxième inconvénient : inscrire la définition précise du socle dans la loi aboutit à le figer alors qu’il doit pouvoir s’adapter à l’évolution des savoirs et des techniques, notamment des techniques d’information et de communication. En effet, pour le modifier, il faudrait une nouvelle intervention du législateur.
Il est de notre compétence de déterminer l’objectif du socle, mais mieux vaut recourir au décret pour en fixer la définition si l’on veut éviter les inconvénients majeurs dont nous avons pâti en 2005. D’ailleurs, sitôt voté par le Parlement, le socle avait dû être remanié par le Haut Conseil de l’éducation (HCE) – ce qui soulevait au demeurant un problème de compétence. En introduisant plus de souplesse, l’article 7 tire les leçons de cette expérience ; c’est pourquoi je suis contre les amendements de suppression.
M. Benoist Apparu. Vous invoquez le danger du lobbying qui conduirait à une énumération à la Prévert des matières à enseigner, mais pensez-vous que l’élaboration d’un décret sera à l’abri de ce danger ? Quant au risque de figer le socle, vous vous appuyez sur le fait qu’en 2005, le HCE avait dû revenir sur le texte voté par le Parlement. Mais le principe même d’une loi n’est-il pas de figer les choses en attendant qu’une autre loi les change ? Certes, les connaissances évoluent et il n’appartient pas au Parlement de fixer les programmes, qui doivent suivre les changements de la société. En revanche, il doit déterminer ce que la nation attend de l’école ; à ce titre, redéfinir régulièrement – tous les quatre, cinq ou six ans – le contenu du socle me paraît sain.
M. Xavier Breton. L’effet d’empilement constaté par le rapporteur est dommageable, et il faut avoir le courage politique – qui a peut-être fait défaut en 2005 – de fixer les priorités sans élargir sans cesse la définition du socle, comme le font les amendements présentés aujourd’hui.
S’il n’est pas souhaitable de figer le socle, il faut éviter qu’il ne varie d’une année sur l’autre, car il doit dessiner une perspective de cinq à dix ans. Le faire réviser par le Parlement n’interdit pas les évolutions, mais impose simplement un rythme de travail législatif qui soit adapté.
M. Frédéric Reiss. Nous sommes heureux et fiers que l’existence de ce socle – auquel l’avènement de l’ère du numérique donne une importance capitale – soit confirmée. Il a certes évolué au fil du temps, le ministre Gilles de Robien lui ayant ajouté deux piliers supplémentaires, mais réécrire les programmes du primaire sans tenir compte de son esprit fut une erreur.
La tâche d’articuler le socle et l’enseignement est une des compétences du Conseil supérieur des programmes mais la définition elle-même du socle devrait, à mon sens, revenir au Parlement. Il n’est pas logique de la renvoyer à un décret alors même qu’on ne se prive pas dans d’autres domaines de faire des catalogues à la Prévert des dispositions à prendre.
La Commission rejette les amendements de suppression.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement AC 261 de M. Benoist Apparu.
Puis, elle examine l’amendement AC 108 de M. Frédéric Reiss.
M. Frédéric Reiss. Il s’agit d’un amendement de repli. Je propose de réécrire le début de l’alinéa 3 ainsi : « La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève de savoir s’exprimer, lire, écrire et compter et, à la fin de l’école élémentaire, lui garantir les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances… ».
M. le rapporteur. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine l’amendement AC 345 de M. Gérald Darmanin.
M. Rudy Salles. À l’alinéa 3, après le mot « compétences », il conviendrait d’ajouter les mots : « y compris motrices ».
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement AC 143 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. À l’alinéa 3, nous souhaitons supprimer la référence à la « culture », celle-ci étant englobée dans le concept de connaissances.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
La Commission examine en discussion commune les amendements AC 728 de M. Rudy Salles et AC 124 de Mme Claudine Schmid.
M. Rudy Salles. La proportion d’élèves de collège en grande difficulté s’est accrue de 30 % au cours des dernières années. Il faut donc préciser que la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture est « obligatoire » et non « indispensable ».
Mme Claudine Schmid. Le mot « indispensable » n’est pas assez fort ; pourquoi ne pas écrire « nécessaire » ?
M. le rapporteur. Avis défavorable. « Indispensable » me semble bien plus fort qu’« obligatoire » ou « nécessaire ».
La Commission rejette successivement les amendements AC 728 et AC 124.
Elle est saisie de l’amendement AC 402 de M. Vincent Feltesse.
Mme Martine Faure. Nous proposons d’ajouter que les enjeux de la société de l’information et de la communication sont inscrits dans le socle commun.
M. le rapporteur. L’article 4 du projet de loi prévoit déjà que la formation scolaire « développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté dans la société de l’information et de la communication ».
L’amendement est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement AC 729 de M. Rudy Salles.
M. Rudy Salles. Le projet de loi ne cite pas les piliers du socle, au risque de les faire disparaître. L’amendement propose donc de substituer à la dernière phrase de l’alinéa 3 les phrases suivantes : « Le socle s’organise en trois grandes catégories : la maîtrise de la langue française, les principaux éléments de culture scientifique et de mathématiques, les humanités. Ses contenus et ses modalités d’acquisition progressive sont fixés par décret. »
M. le rapporteur. Même avis défavorable et même argumentation que tout à l’heure.
La Commission rejette l’amendement.
La Commission examine les amendements AC 464 et AC 465 de Mme Barbara Pompili, pouvant faire l’objet d’une présentation commune.
Mme Barbara Pompili. L’amendement AC 464 procède de l’idée que le socle, fondamental pour l’école primaire et pour le collège, ne saurait se construire uniquement par voie de décret. Il doit faire l’objet d’un débat plus ouvert ; nous demandons donc que le Conseil supérieur des programmes joue un rôle important dans son élaboration, donnant un avis préalable à toutes les décisions du ministre.
D’autre part, alors que l’article L. 122-1-1 du code du travail ne reprenait que cinq des huit compétences clés définies dans les recommandations du Parlement européen et du Conseil, nous considérons qu’elles doivent toutes être mentionnées : « la compétence numérique », « apprendre à apprendre » ou « les compétences sociales et civiques » s’inscrivent pleinement dans l’esprit de cette loi de refondation. L’amendement AC 465 propose par conséquent que les éléments du socle commun « se réfèrent aux recommandations du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 ».
M. le rapporteur. Je suis favorable à l’amendement AC 464, mais non à l’amendement AC 465, qui nous ferait retomber dans le travers de la liste.
M. Benoist Apparu. Il est surprenant que le groupe écologiste ne trouve rien à redire lorsqu’on retire au Parlement français le droit de définir le socle, tout en se référant, pour orienter cette définition, au Parlement européen.
Mme Barbara Pompili. Je maintiendrai le second amendement. Il ne prive pas le Parlement français de ses prérogatives : la France faisant partie de l’Union, nous pouvons prendre en considération les recommandations du Parlement européen. Il ne grossit pas plus le nombre de listes, puisque celle-ci existe déjà.
La Commission adopte l’amendement AC 464.
Puis elle rejette l’amendement AC 465.
La Commission examine l’amendement AC 466 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. Cet amendement est important puisqu’il inscrit dans la loi le droit à l’expérimentation pédagogique, élément essentiel pour faire évoluer les pratiques et transformer l’école.
M. le rapporteur. L’amendement est satisfait : ce droit est déjà reconnu par l’article L. 401-1 du code de l’éducation.
M. Frédéric Reiss. Le socle représente la partie la plus importante de l’enseignement, et non un lieu d’expérimentation.
Mme Barbara Pompili. Je retire l’amendement mais en me réservant de le redéposer s’il n’était pas réellement satisfait.
L’amendement est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 243 de M. Guénhaël Huet.
Puis, elle étudie l’amendement AC 730 de M. François Rochebloine.
M. Rudy Salles. Il s’agit de préciser que les élèves éprouvant des difficultés dans l’acquisition du socle commun reçoivent des aides spécifiques de la communauté enseignante et éducative et bénéficient de dispositifs adaptés. Le succès du socle suppose qu’il puisse devenir réellement universel ; dès lors, tous les moyens pédagogiques doivent être mis en œuvre pour soutenir les enfants en difficulté.
M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par l’article 25 du projet de loi, que nous examinerons ultérieurement et qui renforce les dispositifs d’aide.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’article 7 modifié.
Article 8
Droit à une formation qualifiante
Le présent article propose d’inscrire dans la loi l’obligation pour l’État d’accorder à tout jeune n’ayant pas obtenu au moins un diplôme ou un titre inscrit au niveau V du répertoire national de la certification professionnelle une durée complémentaire de formation lui permettant d’atteindre ce niveau.
1. La situation actuelle
Comme le souligne le rapport de concertation pour la refondation de l’école, « alors que l’institution scolaire accueille davantage d’élèves, les conduit de plus en plus aux diplômes, le fait de ne pas avoir été adoubé par elle devient un handicap professionnel et social majeur. Le diplôme est devenu un "brevet de normalité". Dans une France que certains ont pu décrire comme une "société pédagogique", jamais les diplômes délivrés par l’École n’ont été aussi importants en termes d’insertion professionnelle et sociale, et, réciproquement, jamais les jeunes sans diplôme n’ont été aussi fragilisés. Pour ce public très défavorisé, les conséquences négatives en termes d’insertion professionnelle de l’absence de diplôme ont été à la fois croissantes dans le temps et sont aujourd’hui, en France, supérieures à celles existant dans d’autres pays de l’OCDE. De plus, ce handicap social persiste, dans la trajectoire d’insertion professionnelle, plus longtemps dans notre pays qu’ailleurs dans l’OCDE. » (148)
Les dispositifs de seconde chance n’ont été mis en place que de façon ponctuelle, le plus souvent à l’initiative d’associations et des collectivités territoriales et sans coordination nationale. Cette offre éducative parallèle propose aujourd’hui quelques milliers de places alors que 140 000 jeunes sont chaque année recensés comme décrocheurs.
Selon l’étude d’impact du projet de loi, si aucune action n’est menée, le nombre d’élèves ayant décroché augmentera de 140 000 décrocheurs de plus par an.
Le code de l’éducation définit aux articles L. 122-2, L. 313-7 et L. 313-8 les compétences de l’État dans la lutte contre le décrochage scolaire.
L’article L. 122-2 du code de l’éducation fonde le droit au retour en formation initiale (ou éducation récurrente). Il dispose que « tout élève qui, à l’issue de la scolarité obligatoire, n’a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d’atteindre un tel niveau ».
Ce droit est ouvert, sans limite d’âge, à toute personne ayant connu une brève période professionnelle ou un abandon passager. Il est réservé aux personnes souhaitant reprendre des études à temps plein dans un collège, un lycée professionnel ou un lycée (sections de techniciens supérieurs comprises).
La personne souhaitant revenir en formation initiale après une interruption d’études doit, au préalable, préciser son projet personnel. Pour ce faire, elle bénéficie des informations et de l’aide personnalisée d’un conseiller d’orientation psychologue. Les candidats sont accueillis dans les centres d’information et d’orientation (CIO) afin de constituer un dossier qui évalue avec l’intéressé(e), l’opportunité de la démarche entreprise, les motivations, les conditions et les moyens utilisables pour réaliser le projet.
Ce bilan est transmis, en fonction de l’admission demandée, à l'instance chargée d’examiner la candidature (à la direction académique). L’affectation est ensuite prononcée en fonction des places disponibles.
Dans les faits, ce droit à l’éducation récurrente en classe « ordinaire » est très peu appliqué car il se heurte aux contraintes liées à la carte des formations. De plus, dans les procédures académiques d’affectation, la priorité est légitimement donnée aux montées pédagogiques et au redoublement qui restreignent fortement les possibilités réelles d’affectation.
En ce qui concerne les élèves encore sous la responsabilité de leur établissement d’origine mais qui n’ont pas obtenu le niveau requis (échec à l’examen, absentéisme, décrochage), la mission générale d’insertion (MGI) les prend en charge avec des dispositifs spécifiques et adaptés à leurs besoins (action de remobilisation ou action diplômante).
Enfin, s’agissant des publics les plus éloignés, qui sont en rupture avec les apprentissages, leur repérage et leur prise en charge par les plates-formes de suivi et d’appui aux décrocheurs (dispositif interministériel) permet de les accompagner vers différentes solutions : formation professionnelle régionale, écoles de la seconde chance, GRETA (structures de l’éducation nationale qui organisent des formations pour adultes dans la plupart des métiers), missions locales…
La situation actuelle se caractérise par l’obligation, introduite dans l’article L. 313-7 du code de l’éducation, d’identifier les jeunes qui sont dans cette situation et de transmettre leurs coordonnées aux personnes désignées par les préfets de département.
Cet article prévoit en effet que chaque établissement d’enseignement du second degré et chaque centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage transmet à des personnes et organismes désignés par le représentant de l’État dans le département ainsi qu’à la mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n’ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie réglementaire.
L’introduction de cet article dans le code de l’éducation, consécutive à la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, ne s’était néanmoins pas traduite par l’introduction d’un droit à la poursuite d’étude visant à atteindre un niveau de qualification défini.
Ainsi, même si les jeunes concernés se voient offrir des solutions (insertion dans un dispositif relevant de la mission générale d’insertion de l’éducation nationale par exemple, dispositifs proposés par les conseils régionaux, école de la deuxième chance, formations professionnalisantes), cela ne relève pas de d’une obligation légale.
2. Le dispositif proposé par le projet de loi
La lutte contre le décrochage constitue l’un des objectifs majeurs de la refondation. Le rapport annexé au projet de loi fixe l’objectif « de diviser par deux le nombre des sortants sans diplôme ». Le présent article constitue un levier essentiel au service de cet objectif.
● La création d’un véritable droit au retour en formation initiale pour les jeunes n’ayant pas obtenu de diplôme ou de certification
La rédaction actuelle de l’article L. 122-2 est insuffisamment précise.
Le 1° du présent article tend à le modifier afin de préciser que le droit au retour en formation initiale concerne « tout élève qui, à l’issue de sa scolarité obligatoire, n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au premier niveau du répertoire national des certifications professionnelles ».
Comme l’indique l’avis du Conseil économique, social et environnemental sur l’avant-projet de loi, « s’il ne s’agit pas d’une obligation de réussite, à laquelle on ne peut astreindre le système éducatif, c’est là un renforcement substantiel de l’obligation de moyen qui lui incombe. »
L’objectif est beaucoup plus précis puisqu’un diplôme national ou un titre professionnel certifie la possession de compétences professionnelles reconnues.
Le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) est aujourd’hui le cadre de référence pour l’ensemble des certifications à caractère professionnel ; il « contribue à faciliter l’accès à l'emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle. Il permet de tenir à la disposition des personnes et des entreprises une information constamment mise à jour sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle (..). Les certifications enregistrées dans le répertoire sont reconnues sur l'ensemble du territoire national » (article R. 335-12 du code de l’éducation).
Selon les informations transmises au rapporteur, la référence à un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au RNCP permet de viser un diplôme ou un titre « professionnel », reconnu le plus souvent dans les conventions collectives des branches professionnelles. Il s’agit par exemple d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP).
Le 2° du présent article propose d’introduire un droit pour tout jeune sortant ou sorti du système éducatif sans diplôme de bénéficier d’une durée complémentaire de formation qualifiante, qu’il peut utiliser dans des conditions fixées par décret.
Selon les informations transmises au rapporteur, sont visés les jeunes de 16 ans (âge de la scolarité obligatoire) à 24 ans, n’ayant par exemple pas obtenu le diplôme sanctionnant la formation dans laquelle ils s’étaient engagés.
La rédaction de l’article vise à la fois les jeunes « sortant » du système éducatif, qui en fin d’année scolaire n’ont pas obtenu de diplôme et se retrouvent à la rentrée sans solution mais aussi les jeunes « sortis » qui ont interrompu leur cursus.
Selon les informations dont dispose le rapporteur, pour les jeunes sortant de la voie professionnelle, l’expression « sans diplôme » signifie sans CAP, BEP, ni baccalauréat professionnel.
Pour les jeunes sortant des voies générale ou technologique, l’expression « sans diplôme » signifie sans baccalauréat général ou technologique. Le diplôme national du brevet (DNB) ne fait pas partie de cette catégorie : un jeune sortant du système éducatif titulaire du seul DNB est donc considéré comme « sans diplôme ».
En ce qui concerne la notion de « formation qualifiante », le terme n’a pas de définition juridique précise. Il s’agit de la durée complémentaire de formation nécessaire pour acquérir un diplôme national ou titre professionnel inscrit au RNCP tel qu’évoqué au 1° du présent article.
Quant à la notion de « durée complémentaire », elle correspond à celle, propre à chaque jeune, permettant d’atteindre le niveau de qualification visé. Cela pourra donc aller de quelques heures, pour une jeune qui aurait échoué à un diplôme mais qui conserverait le bénéfice de certaines matières, à plusieurs années pour un jeune reprenant un cursus en seconde professionnelle, générale ou technologique.
Les modalités précises d’application du droit complémentaire à une formation devront être définies par voie réglementaire et à l’issue de discussions avec les partenaires sociaux.
● Les modalités de mise en œuvre de ce droit
Selon l’étude d’impact du projet de loi, en 2011, 12 % des jeunes âgés de 18 à 24 ans sont des sortants précoces, ce qui représente un total d’environ 680 000 jeunes.
Plusieurs mesures seront mises en œuvre pour l’application du droit au retour en formation.
Dans les collèges et les lycées professionnels à taux de décrochage particulièrement élevé, un référent aura en charge la prévention du décrochage, le suivi des élèves décrocheurs, la relation avec les parents et le suivi de l’aide au retour en formation des jeunes décrocheurs de l’établissement.
En outre, le territoire national comporte aujourd’hui 360 plates-formes d’appui et de suivi des décrocheurs, pilotées par des coordonnateurs nommés par les préfets de département. Ces coordonnateurs sont destinataires des listes de jeunes identifiés par le « système interministériel d’échange d’information » (SIEI) créé à la suite de la loi précitée du 24 novembre 2009.
Dorénavant, dans le cadre de ces 360 plates-formes d’appui et de suivi, il devra être obligatoirement proposé aux jeunes des solutions permettant d’atteindre le diplôme défini par le présent article.
Le réseau des plates-formes d’appui et de suivi des décrocheurs assurera la mise en œuvre du droit au retour en formation en lien avec les dispositifs et les structures existantes.
Par exemple, en ce qui concerne l’éducation nationale, selon les informations fournies au rapporteur, une organisation en « réseaux objectif formation-emploi » (ROFE) est en train de se constituer, qui permettra de mobiliser des places disponibles dans les formations professionnelles ou dans les formations générales et technologiques.
Ces réseaux permettront de mieux structurer les réponses de l’éducation nationale proposées dans le cadre des plates-formes de suivi et d’appui aux jeunes décrocheurs.
Ils interviendront en complémentarité avec les autres réseaux de partenaires sollicités dans le cadre des plates-formes de suivi et d’appui aux jeunes décrocheurs (missions locales, régions, GRETA, centres de formation d’apprentis…).
Ils ont pour objectif de développer les mesures de compensation proposée au sein de l’éducation nationale et d’en renforcer la lisibilité. Ils permettent de recenser toutes les solutions existantes et favorisent la mutualisation des bonnes pratiques à l’intérieur des dispositifs.
La responsabilité du réseau sera confiée notamment à un personnel de direction nommé par le recteur. Les personnels de la MGI interviennent en appui de ce dispositif par une activité de conseil, d’expertise et d’ingénierie de formation.
Pour cela, elles pourront s’appuyer sur l’utilisation des places disponibles et déjà financées (estimées à 40 000 en lycée professionnel) mais également sur le développement de structures innovantes (micro lycées, lycées de la nouvelle chance, collèges et lycées élitaires pour tous, pôles innovants lycéens).
Enfin, des offres de parcours de formation en partenariat avec le ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative et l’Agence du service civique permettront également un retour sous statut scolaire.
Outre le fonctionnement des plates-formes qui permet de toucher l’ensemble des jeunes « décrocheurs », un dispositif d’information et de « géolocalisation des solutions de formation » est en cours de mise en place avec l’ONISEP.
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre des ROFE, un volet de communication est prévu afin de sensibiliser les jeunes et les acteurs concernés lors d’opérations telles que « la semaine de la persévérance scolaire ».
Des dispositifs combinés, associant par exemple l’Agence du service civique et l’éducation nationale, sont susceptibles également d’encourager les jeunes à bénéficier de ce droit.
● Les moyens mobilisables
S’agissant du ministère de l’éducation nationale, l’étude d’impact indique qu’il est proposé de mobiliser les dispositifs existants, et notamment les places laissées vacantes dans les établissements d’enseignement professionnel par des élèves en cours de scolarité. Ces places vacantes, qui sont déjà financées, « sont estimées à 13 000 places en post 3ème (2nde professionnelle, première année de CAP) et à 40 000 pour l’ensemble du cycle professionnel. »
« Au-delà de ces places vacantes, le ministère de l’éducation nationale pourra mobiliser des moyens pour améliorer les capacités d’accueil pour les élèves les plus fragiles et pour sécuriser les parcours en quatre ans (CAP-Bac Pro).
« Ces mesures sont de nature à accueillir des décrocheurs et à réduire les sorties sans qualification. Elles seront financées dans le cadre des créations de postes prévues dans le cadre du quinquennat en faveur du second degré. »
En complément, l’étude d’impact précise que le fonds social européen (FSE) a notamment servi à soutenir la mise en place des plates-formes de suivi et d’appui aux décrocheurs à hauteur de 2,6 millions d’euros. « Il pourrait dans l’avenir servir de co-financement pour des actions de formation destinées au public cible ».
En outre, « la mission générale d’insertion (MGI) organise des actions de prise en charge par groupe de jeunes, sur une période allant de quelques semaines à plusieurs mois. Cela représente un budget annuel de 52 millions d’euros. Les actions existantes recouvrent des actions à temps partiel (sur plusieurs semaines), des actions à temps plein (jusqu’à 6 mois) et des actions de remobilisation/médiation.
« Les actions menées au titre de la MGI dans les établissements d’enseignement secondaire (EPLE) permettent à ces derniers de collecter des fonds correspondant à un certain pourcentage de la taxe d’apprentissage due par les entreprises.
« Pour l’année 2010/2011, 35 713 jeunes ont bénéficié de ce type d’action. »
Enfin, l’étude d’impact mentionne les dispositifs relevant de la formation professionnelle et des régions : fonds régionaux de lutte contre le décrochage, dispositifs de formation régionaux, apprentissage.
*
La Commission est saisie de l’amendement AC 562 de Mme Marie-George Buffet.
Mme Marie-George Buffet. L’amendement est de clarification rédactionnelle.
M. le rapporteur. « Niveau V » est une dénomination d’origine réglementaire et nous pourrions en rester à l’expression « premier niveau », strictement synonyme. Cela étant, avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 8 modifié.
La Commission examine l’amendement AC 471 de Mme Barbara Pompili, portant article additionnel après l’article 8.
Mme Barbara Pompili. Cet amendement dispose que « les élèves élaborent leur projet d’orientation scolaire et professionnelle dans le cadre d’un parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde professionnel ». Ce parcours doit devenir l’outil principal d’orientation de l’élève, et celui-ci être placé au cœur de la décision.
M. le rapporteur. L’importance de l’orientation est rappelée dans le rapport annexé. Quant au rôle de l’élève dans son orientation, il relève du domaine réglementaire et non législatif. L’amendement est donc satisfait.
Mme Barbara Pompili. Nous y reprenions des dispositions de l’avant-projet de loi.
M. le rapporteur. Dispositions qui ont été retirées par le Conseil d’État parce que relevant du domaine réglementaire, et transférées à l’annexe – qui, sans avoir valeur normative, a néanmoins valeur législative.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement AC 472 de Mme Barbara Pompili portant article additionnel après l’article 8.
Mme Barbara Pompili. Cet amendement participait du même esprit, demandant que l’élève soit accompagné dans son parcours.
L’amendement est retiré.
Article 9
Développement du sens moral et de l’esprit critique
La modification proposée par le présent article porte sur l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation qui est consacré à la définition du droit de l’enfant à l’instruction. Il est proposé d’y introduire un objectif de développement du sens moral et de l’esprit critique là où la rédaction actuelle a une approche fondée principalement sur l’acquisition des connaissances et des instruments du savoir.
Le présent projet de loi d’orientation et de programmation porte en effet un projet éducatif qui ne se limite pas, pour nos élèves, à l’acquisition de connaissances. Il porte aussi l’ambition d’une école qui contribue à la formation de futurs citoyens respectueux des différences, tolérants, solidaires, éclairés et responsables. Elle fait comprendre et acquérir aux élèves le respect de la personne, de ses origines, et de ses différences.
Cette affirmation se traduit par l’introduction, proposée par l’article 28 du présent projet de loi, d’un enseignement moral et civique dans la formation des élèves.
S’agissant de la notion de sens moral, comme le ministre de l’éducation national l’a précisé devant la Commission des affaires culturelles et de l’éducation, « c’est une morale non confessionnelle, qui ne repose pas sur le fondement d’une révélation. Elle doit rassembler, et non diviser. Autrefois, ce concept était compris de tous […] La République s’est d’ailleurs construite sur le refus de séparer morale et politique. De la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen au refus de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en passant par l’affaire Dreyfus, il existe une continuité d’actes supérieurs aux lois. Tous les enfants savaient cela mais comme ce n’est plus le cas, cela doit être de nouveau enseigné et j’ai installé une mission chargée de l’organiser. »(149)
Quant au développement du sens critique, il constitue aujourd’hui comme en 1791, l’un des objectifs fondamentaux de l’instruction, un outil majeur d’émancipation. Selon Condorcet : « Le but de l’instruction n’est pas de faire admirer aux hommes une législation toute faite, mais de les rendre capables de l’apprécier et de la corriger. Il ne s’agit pas de soumettre chaque génération aux opinions comme à la volonté de celle qui la précède, mais de les éclairer de plus en plus, afin que chacun devienne de plus en plus digne de se gouverner par sa propre raison. » (150)
*
La Commission a adopté un amendement tendant à supprimer la référence au « sens moral » pour lui substituer la notion, moins subjective, de « partage des valeurs de la République. »
*
La Commission est saisie des amendements AC 200 de M. Thierry Braillard et AC 109 de M. Frédéric Reiss, pouvant faire l’objet d’une discussion commune.
M. Thierry Braillard. Je retire l’amendement AC 200.
M. Frédéric Reiss. Le respect de la liberté d’opinion est inscrit dans la Constitution ; notre amendement introduit dans l’article 9 la notion de respect des choix éducatifs des parents, premiers éducateurs de leur enfant.
M. le rapporteur. Avis tout à fait défavorable. Le principe de laïcité garantit le respect de la liberté des parents. En revanche, inscrire dans la loi le respect des choix éducatifs des parents donnerait à ces derniers la possibilité de refuser un programme d’histoire ou de sciences naturelles au prétexte qu’il irait contre leurs choix idéologiques, politiques ou religieux. En tant que parlementaire et enseignant, je trouve cela inacceptable.
M. Frédéric Reiss. On peut garantir aux parents le droit de choisir librement l’école de leurs enfants, dans un esprit de laïcité.
L’amendement AC 200 est retiré.
La Commission rejette l’amendement AC 109.
La Commission examine les amendements AC 192 et AC 564 de Mme Marie-George Buffet, pouvant faire l’objet d’une présentation commune.
Mme Marie-George Buffet. Ces deux amendements se complètent. La notion de « sens moral » est sujette à interprétation ; je propose donc de la remplacer par celle de partage des valeurs de la République.
M. le rapporteur. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement AC 192.
En conséquence, l’amendement AC 201 de M. Thierry Braillard tombe.
Puis la Commission adopte l’amendement AC 564.
La Commission est saisie de l’amendement AC 346 de M. Gérald Darmanin.
M. Rudy Salles. Attaché à la condition physique des élèves, je souhaite la mentionner à l’article 9.
M. le rapporteur. Même argumentation que lors de l’examen de l’article 1er. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 9 modifié.
Section 4
Le service public du numérique éducatif
La Commission examine l’amendement AC 719 du rapporteur.
M. le rapporteur. Sans reprendre l’explication déjà donnée, je propose de remplacer dans l’intitulé de la section « Le service public de l’enseignement numérique » par « Le service public du numérique éducatif ».
M. Frédéric Reiss. Nous réitérons nos réserves à l’égard de cette modification.
La Commission adopte l’amendement.
Article 10
Création d’un service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance
Afin de créer un « service public de l’enseignement numérique et de l’enseignement à distance », le présent article tend à remplacer les dispositions de l’article L. 131-2 du code de l’éducation relatif au service public de l’enseignement à distance, organisé notamment pour assurer l’instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou un établissement scolaire,
1. La situation actuelle : le bilan accablant de la mise en œuvre du plan de développement des usages numériques à l’école
● Un plan qui répondait à un besoin important de développement des usages pédagogiques du numérique et d’accès aux ressources numériques
Le rapport global sur les technologies de l’information et de la communication publié en 2011 par le forum économique mondial place la France au vingt-neuvième rang sur 138 nations en ce qui concerne la formation des enfants et des adolescents à l’utilisation des outils numériques. Cependant, du point de vue de l’équipement matériel, la France se place à la septième, huitième et neuvième position européenne, respectivement pour ses collèges, écoles et lycées. Le problème principal est donc celui de l’utilisation de ces matériels. Par ailleurs, seuls 5 % des enseignants français utilisent quotidiennement le numérique pour mettre leurs élèves en activité, ce qui s’explique notamment par un problème d’accès à des ressources pédagogiques numériques et un manque de formation.
Cette situation n’est pas satisfaisante. Elle conduit tout d’abord les collectivités territoriales, l’État et les acteurs économiques à s’interroger sur leurs investissements dans l’éducation numérique, alors que ces investissements sont considérés comme nécessaires pour assurer l’insertion sociale et professionnelle des élèves par la majorité des citoyens français.
Le risque à plus long terme est que le système éducatif français stagne en termes de résultats alors que nos voisins européens, Finlande, Danemark par exemple, et nos partenaires internationaux, comme la Corée du Sud ou le Qatar, investissent dans l’éducation numérique et améliorent leurs résultats dans les classements internationaux. Des études et des comparaisons internationales montrent pourtant que le numérique, introduit de manière pertinente dans le système éducatif, est bénéfique pour la scolarité des élèves.
Si les programmes recommandent assez largement d’introduire les outils numériques dans les pratiques de classe, comme supports pédagogiques, comme outils d’apprentissage ou comme objets d’étude, comme le soulignaient en juin 2011 MM. Patrick Bloche et Patrick Verchère, corapporteurs de la mission commune à la Commission des lois et à la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de notre Assemblée sur la révolution numérique et les droits de l’individu, « ce qui émerge des différents coups de sonde dans les établissements scolaires, c’est le sentiment que la culture numérique et les retombées qu’elle devrait avoir sur l’organisation et les contenus des apprentissages n’y sont pas assez sérieusement prises en compte. Un même constat avait pu être fait naguère pour la culture de l’image, mais l’enjeu était, somme toute, moins essentiel. »(151)
Il semblerait que l’on essaie très généralement de faire rentrer des modèles anciens dans des formes nouvelles. Le plus souvent le numérique n’est utilisé que comme un nouveau support – souvent plus commode, certes – pour véhiculer le cours magistral ou pour décalquer l’organisation pédagogique traditionnelle. Ceci reste vrai pour les usages du tableau blanc interactif, bien qu’il soit présenté comme une révolution pédagogique, pour les manuels numériques et pour le cahier de texte numérique, même si ce dernier remporte un certain succès auprès des parents pour des raisons souvent ambiguës (en tant qu’outil de surveillance des enseignants par les parents et par l’inspection). Cela vaut également pour les usages qui sont faits le plus souvent des environnements numériques de travail (ENT) alors que ceux-ci devaient ouvrir des perspectives très novatrices dans l’organisation de la scolarité.
Face à ce constat, le précédent gouvernement a présenté, le 25 novembre 2010, un plan de développement des usages du numérique à l’école (plan DUNE) dont la finalité était d’accélérer de façon significative pour les années à venir l’usage pédagogique des outils numériques.
Cinq axes prioritaires ont été définis :
– faciliter l’accès à des ressources numériques de qualité ;
– former et accompagner les enseignants pour l’usage du numérique afin de favoriser l’évolution des pratiques pédagogiques ;
– généraliser les services numériques et les ENT ;
– relancer le partenariat avec les collectivités territoriales ;
– former les élèves à un usage « responsable » et « citoyen » des technologies de l’information et de la communication.
Ce plan répondait à une attente et devait combler un déficit : après plusieurs initiatives centrées sur les équipements, un dispositif visant le développement des usages pédagogiques et l’accès aux ressources numériques était le bienvenu. Il pouvait se fonder sur l’expérience acquise dans les plans précédents. Prévu pour une période de trois ans, il devait permettre les anticipations nécessaires à un véritable partenariat avec les collectivités territoriales, à un changement des pratiques, à l’émergence d’un marché viable pour les ressources pédagogiques numériques.
● Les constats accablants dressés par l’inspection générale de l’éducation nationale sur la mise en œuvre de ce plan
L’inspection générale de l’éducation nationale (IGEN) a rendu en septembre 2012 un rapport consacré au Suivi de la mise en œuvre du plan de développement des usages du numérique à l’école dont les constats sont sans appel.
L’IGEN indique tout d’abord que les conditions de pilotage national de ce plan n’ont pas permis que ses objectifs soient atteints, en tout cas au début de l’été 2012.
La lenteur des arbitrages en a retardé le démarrage. Le transfert, dans la même période, des services en charge du numérique pédagogique du service des technologies et des systèmes d’information (STSI) du secrétariat général du ministère de l’éducation à la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO), le partage des responsabilités entre plusieurs bureaux, l’absence d’organisation en « mode projet » ont rendu difficile une coordination efficace.
Les contraintes financières, limitant le budget à 30 millions d’euros pour les trois ans, alors que le plan « école numérique rurale » (ENR) en avait mobilisé 67, ont conduit à restreindre les ambitions.
La concertation trop tardive avec les représentants des collectivités territoriales n’a pas permis de conclure les conventions-cadres nationales qui auraient facilité le développement des partenariats locaux, alors même que le couplage du plan avec le développent des ENT imposait un effort financier des collectivités et que l’État ne parvenait pas à dégager, au démarrage, des moyens pour la formation de ses personnels, condition posée par la plupart des collectivités.
Une large place a été faite en revanche à la concertation avec les éditeurs, mais leurs exigences en matière de commercialisation des ressources ont conduit à un dispositif peu satisfaisant pour les enseignants, tant en ce qui concerne l’accès aux ressources qu’en matière de financement.
Le déploiement du dispositif dans les académies s’est opéré en deux phases, alors qu’initialement il en était annoncé trois. Chacune a concerné un groupe d’académies (13 pour la première et les 17 autres pour la seconde) ; 20 millions d’euros ont été engagés et une incertitude subsiste sur une éventuelle troisième phase. Le choix des académies de la première vague s’est fait à la suite d’un appel à projets, procédure dont la mise en œuvre est apparue contestable et qui ne paraissait pas s’imposer dès lors que toutes les académies devaient être dotées, selon des modalités identiques sur l’ensemble du territoire : cette procédure a eu pour effet de retarder de plusieurs mois la mise à disposition des ressources. Le lancement d’un nouvel appel à projets pour la seconde phase manquait encore plus de rationalité.
Le dispositif s’est révélé très déséquilibré.
Le développement de l’accès aux ressources numériques a mobilisé l’essentiel des énergies et 80 % des financements.
Un dispositif original a été mis en place : un catalogue de référencement de toutes les ressources numériques proposées par les éditeurs dit « catalogue chèque ressources » (CCR), géré par le Centre national de documentation pédagogique (CNDP). Les établissements attributaires ont été dotés d’un « droit de tirage » sur ces ressources (allant de 500 euros pour une école à 2 500 euros pour un grand lycée), certaines académies ayant dû négocier un peu de souplesse pour tenir compte de particularités locales. Mais sa durée de vie est limitée à celle du plan, à savoir trois ans.
En outre, l’IGEN dénonce les conditions posées par les éditeurs qui ont créé de lourdes contraintes. Ni les collectivités territoriales, ni les établissements eux-mêmes ne peuvent abonder le montant alloué pour acquérir les ressources figurant au CCR. Ce catalogue, dans sa première version a été structuré par maison d’édition, ce qui rend difficile la recherche par discipline et par niveau, ou par thème. Il ne comporte en outre aucune appréciation qualitative. Les portails, élaborés par le ministère pour certaines disciplines, qui recensent notamment les ressources gratuites ou celles produites par le réseau du CNDP, n’ont pas pu y être intégrés et ne sont accessibles que sur EDUSCOL. Le portail unique de référencement de l’ensemble des ressources pédagogiques initialement prévu n’a donc pas pu voir le jour.
L’IGEN relève que les produits proposés (une majorité de « manuels numériques ») correspondent peu aux attentes des enseignants, en particulier dans le premier degré, et aux usages qu’ils privilégient dans leurs classes. La relative faiblesse du niveau des commandes au mois de juin 2012 atteste d’un faible intérêt de leur part. L’ergonomie du catalogue a été améliorée pour la seconde phase, mais il est trop tôt pour évaluer l’impact des modifications apportées.
Ajoutons à cela que l’accompagnement des enseignants n’est pas encore opérationnel. L’IGEN observe que les corps d’inspection sont impliqués de façon très inégale ; ils interviennent en tout cas très rarement dans le choix des ressources, se conformant ainsi à la demande fortement exprimée par les éditeurs et relayée par la DGESCO. Beaucoup n’ont pas reçu de formation à l’usage de ces ressources et certains doivent encore être convaincus. Comme le souligne l’IGEN, certains centres régionaux (CRDP) ou départementaux de documentation pédagogique (CDDP) ont néanmoins pris un peu plus de liberté et s’efforcent d’informer au mieux les enseignants sur l’intérêt des différentes ressources, notamment pour le premier degré.
Les professeurs référents pour les usages pédagogiques du numérique, une des innovations pertinentes du plan, se mettent en place mais difficilement.
Leurs missions ne sont pas assez clairement définies. Mais plus grave encore, alors qu’ils sont présentés comme les formateurs de leurs collègues, les formations spécifiques dont ils auraient dû eux-mêmes bénéficier en priorité ne sont pas encore en place et les CRDP et CDDP, qui devaient y contribuer, ont été peu mobilisés à cet effet. Les conditions de leur indemnisation méritent par ailleurs, selon l’IGEN, d’être revues et clarifiées.
Pour la formation des enseignants, aucun dispositif spécifique n’était prévu dans la première phase ; elle s’est poursuivie dans le cadre préétabli des plans académiques de formation existants, qui ont parfois été infléchis mais sans s’inscrire dans une stratégie de conduite du changement.
Un financement de 4 millions d’euros est prévu pour la seconde phase mais chaque académie construit son propre dispositif et l’accent n’est pas mis systématiquement sur la formation des professeurs référents. La plateforme collaborative de formation à distance Pairform@nce n’a pour l’instant que peu contribué à ce dispositif.
La généralisation des ENT, présentée aux académies, dans les deux appels à projets successifs, comme une condition pour bénéficier du plan DUNE (mais, dans les faits, par toujours respectée), s’est révélée être un frein à son déploiement : là où ils existent, les ENT sont en général peu utilisés par les enseignants, sauf pour la vie scolaire ; ils leur préfèrent d’autres services numériques et utilisent d’autres procédures d’identification ou de protection…
Dans l’état actuel des réseaux, les débits sont en effet jugés le plus souvent insuffisants, les connexions aléatoires et les procédures d’identification dissuasives pour un usage collectif.
Les ENT mobilisent pourtant une grande part des financements des collectivités locales, qui pourraient les utiliser autrement en faveur du numérique. En outre, la généralisation de l’usage pédagogique des ENT supposerait des investissements massifs dans les réseaux, que toutes les collectivités ne peuvent pas envisager, notamment en ce qui concerne les écoles primaires. Les fournisseurs de ressources, dans la première phase au moins, avaient considéré que les ENT étaient les seuls outils permettant d’identifier précisément les utilisateurs de leurs produits, d’analyser donc précisément la demande tout en garantissant le respect des droits des auteurs et des éditeurs ; mais beaucoup d’acteurs estiment que d’autres solutions sont envisageables pour garantir ces droits.
Les partenariats avec les collectivités locales ne se sont pas développés comme espéré. Tout au plus a-t-on pu enregistrer des déclarations d’intention en matière de développement des ENT. Les collectivités attendaient surtout un engagement fort de l’État en faveur de la formation des enseignants, car leur préoccupation légitime est que les investissements qu’ils consentent dans les matériels, les réseaux, les ENT se traduisent par une évolution des pratiques pédagogiques. De ce point de vue, la première phase du plan les a déçues et il n’est pas encore possible de dire si elles seront sensibles à l’existence d’un volet « formation » dans la deuxième phase.
Il est trop tôt pour tenter d’apprécier les effets du plan sur les pratiques pédagogique puisque, dans les académies de la première vague, le volume le plus important de commandes a été passé au mois de juin et, pour la seconde, les établissements ne recevront la notification des moyens qui leur sont attribués qu’à la rentrée.
Néanmoins, les observations faites dans les classes permettent de constater que les enseignants, peu attirés par les manuels numériques (principale ressource proposée sur le CCR), privilégient les ressources ouvertes et interactives moins présentes sur le catalogue national et disponibles plutôt sur les portails disciplinaires.
Elles confirment aussi que l’ENT, dans ses conditions de mise en œuvre actuelle, ne favorise pas les pratiques pédagogiques innovantes, mais que les outils de mobilité (ordinateurs individuels portables, baladeurs numériques et surtout tablettes) sont les véritables vecteurs de l’innovation pédagogique par l’interactivité qu’ils rendent possible, alors qu’ils semblent avoir été négligés par l’institution, si l’on excepte quelques expérimentations. »
2. Le dispositif proposé par le projet de loi
Le présent article tend à remplacer les dispositions de l’article L. 131-2 du code de l’éducation, relatif au service public de l’enseignement à distance en faveur des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans un établissement scolaire, afin de créer un « service public de l’enseignement numérique et de l’enseignement à distance ».
Ce service public a notamment pour mission :
- de mettre à la disposition des écoles et des établissements d’enseignement des services numériques permettant de prolonger l’offre des enseignements qui y sont dispensés et faciliter la mise en œuvre d’une aide personnalisée aux élèves (1° de l’article L. 131-2). Le numérique offre en effet de nombreuses possibilités de personnaliser les parcours d’apprentissage et le suivi des élèves ;
- et de proposer aux enseignants des ressources pédagogiques pour leur enseignement, des contenus et services destinés à leur formation initiale et continue ainsi que des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec les familles (2° de l’article L. 131-2).
Enfin, le 3° de l’article L. 131-2 correspond à l’actuel service public de l’enseignement à distance, qui pourra bénéficier des ressources numériques développées dans le cadre de ce nouveau service public.
De grands chantiers ont, dès à présent, été engagés pour développer de nouveaux services :
- à destination des élèves : un service public d’aide personnalisée aux élèves en difficulté (30 000 élèves concernés dès la rentrée scolaire 2013) et un service d’accompagnement à l’apprentissage des langues pour les élèves du primaire (l’anglais dès 2013) développés avec le Centre national d’enseignement à distance (CNED) ; deux offres d’orientation réalisées par l’Office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP), la première accessible aux élèves en situation de handicap sur les téléphones mobiles incluant un ordinateur de poche, la seconde pour les jeunes en situation de décrochage scolaire ;
- à destination des enseignants : une offre de ressources pédagogiques culturelles et scientifiques, gratuite pour les enseignants et les élèves, réalisée en partenariat avec les ministères concernés et leurs établissements nationaux ainsi que la mise en ligne, avec possibilité de réutilisation, des sujets de concours et d’examen de l’enseignement public ;
- à destination de la communauté éducative : un service en direction des parents pour les aider à suivre la progression de leurs enfants dans l’apprentissage de la lecture, conçu par le CNDP.
Le gouvernement a annoncé qu’un appel à proposition serait prochainement lancé dans le cadre des investissements d’avenir pour soutenir la production de ressources éducatives dans le domaine des apprentissages fondamentaux.
Par ailleurs, la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre d’un nouveau partenariat avec le ministère de l’éducation nationale, devrait soutenir l’équipement et la connexion au très haut débit des écoles dans un souci d’attractivité et d’égalité des territoires. Les fonds européens (Feder) devraient également mobilisés pour le développement du numérique éducatif.
Comme l’indique l’étude d’impact du projet de loi, les opérateurs de l’enseignement scolaire (CNED, CNDP et dans une moindre mesure l’ONISEP) seront très fortement mobilisés pour la mise en œuvre de la stratégie numérique du ministère de l’éducation nationale. Cette stratégie devra impliquer une profonde transformation de leur activité et une refonte de grande ampleur de leur organisation.
Il est très important de souligner que la création d’un service public de l’enseignement numérique vise à garantir que certaines activités, productions soient réalisées dans le cadre de l’intérêt général et par conséquent des objectifs et priorités définies par le ministère de l’éducation nationale.
La création d’un tel service n’est pas contradictoire avec l’existence d’une concurrence sur le périmètre que recouvre ce service public. En effet, le gouvernement n’entend évidemment pas conférer de droits exclusifs à ce service public, conformément aux règles européennes en matière de droit de la concurrence. Cette question s’est posée en 2005 lors de la création du service public de l’enseignement à distance et depuis lors, l’existence d’entreprises privées intervenant par exemple dans le champ de l’enseignement à distance n’a pas été empêchée. S’il est bien évident que le ministère de l’éducation s’adressera aux opérateurs publics dont les missions couvrent déjà ce champ d’intervention, la création de ce service public n’exclut absolument pas la participation d’opérateurs privés à l’exécution de sa mission.
En outre, comme il est précisé dans l’étude d’impact, afin d’éviter qu’il soit reproché à l’opérateur public de ne pas respecter les règles de la concurrence, il sera procédé à une sectorisation de ses activités, afin que le financement des activités considérées n’intègre pas des aides qui lui sont accordées au titre de ses activités non concurrentielles.
3. Une formulation inadaptée
Comme il a été indiqué précédemment, les études montrent que le numérique, introduit de manière pertinente dans le système éducatif, peut être très bénéfique pour les élèves. C’est pourquoi il est capital de ne pas l’introduire selon des modalités inadaptées, susceptibles de susciter l’incompréhension ou le rejet.
Alors que le numérique doit être un outil, un levier de transformation pédagogique, qui doit irriguer l’ensemble du service public de l’enseignement, le texte en fait de facto une fin en soi, un service public autonome, susceptible de concurrencer le service public de l’enseignement, voire de s’y substituer.
Si le texte parle bien de mettre à disposition des enseignants des ressources pédagogiques et, à disposition des élèves, des services permettant de « prolonger l’offre des enseignements dispensés dans les établissements », le terme d’enseignement numérique pourrait laisser penser que ce nouveau service public n’est pas pleinement intégré dans le service public de l’enseignement, ce qui serait un contresens sur ce que doivent être la place et le rôle du numérique à l’école.
Afin de lever toute ambiguïté sur ce point, la Commission a adopté, à l’initiative du rapporteur, plusieurs amendements tendant à rebaptiser ce service public « service public du numérique éducatif », d’une part, et à préciser que ce service public est créé « au sein du service public de l’enseignement afin de contribuer à ses missions », d’autre part.
La Commission a également adopté quatre amendements tendant à préciser :
– que le service public du numérique éducatif a pour objet de diversifier les modalités d’enseignement (1° du présent article);
– qu’il propose aux enseignants « une offre diversifiée » de ressources pédagogiques et des contenus et services « contribuant à » leur formation initiale (2° du présent article) ;
– et qu’il favorise « les projets innovants visant à développer progressivement le numérique à l’école » (4° du présent article).
*
La Commission adopte l’amendement de précision AC 632 du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement AC 731 de M. Rudy Salles.
M. Rudy Salles. Ce qu’il s’agit d’organiser ici n’est pas un simple service technique, mais une véritable mission de service public ; il faut donc procéder à une approche ouverte des évolutions du numérique et mettre en place une veille attentive pour en prévenir les dérives.
M. le rapporteur. Nous en avons déjà débattu. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
La Commission étudie l’amendement AC 714 du rapporteur.
M. le rapporteur. C’est un amendement de conséquence.
La Commission adopte l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement AC 161 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. Il convient d’être précis quand on définit les missions d’un nouveau service public. La loi pourra par la suite étendre ou restreindre son champ d’action, mais il nous paraît dangereux, surtout à la lumière des débats que nous avons eus, de conserver l’adverbe « notamment ».
M. le rapporteur. Avis défavorable : un service public doit pouvoir s’adapter à la situation.
M. Xavier Breton. Le principe d’adaptabilité vaut pour les modalités de mise en œuvre du service public, non pour la définition de ses objectifs !
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite à l’amendement AC 733 de M. Rudy Salles.
M. Rudy Salles. Mon amendement tend à insérer, à l’alinéa 2, après les mots « est organisé », les mots : « et piloté par une commission nationale du service public de l’enseignement numérique regroupant des représentants du ministère de l’éducation nationale, des collectivités territoriales, des usagers et des parents d’élèves. ». On parle d’autre chose que d’organisation technique et industrielle !
M. le rapporteur. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement AC 202 de M. Thierry Braillard. En conséquence, les amendements identiques AC 110 et AC 668 de M. Frédéric Reiss tombent, de même que les amendements AC 473 et AC 178 de Mme Barbara Pompili.
La Commission en vient aux amendements identiques AC 111 et AC 193 de M. Frédéric Reiss.
M. Frédéric Reiss. L’enseignement numérique peut apporter beaucoup à l’école, nous en sommes conscients, mais nous sommes aussi conscients des difficultés qu’il soulève – et dont nous avons débattu précédemment. C’est pourquoi nous jugeons utile de préciser que l’offre en ressources pédagogiques numériques doit être diversifiée.
M. le rapporteur. Avis favorable : il faut éviter tout monopole.
La Commission adopte les amendements identiques.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AC 715 du rapporteur.
Elle examine l’amendement AC 474 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. Cet amendement vise à favoriser l’usage de logiciels libres et de formats ouverts pour les ressources pédagogiques et les services et contenus numériques. La mise en place du service public de l’enseignement numérique doit en effet s’accompagner d’une réflexion sur les outils mis à la disposition des élèves et des personnels. Or celle-ci resterait incomplète si elle était conduite à travers le prisme des logiciels « propriétaires », qui excluent une utilisation interactive. Au contraire, les logiciels libres et les formats ouverts facilitent le libre accès aux savoirs et la mutualisation des contenus.
M. le rapporteur. Avis défavorable : l’amendement est satisfait par le rapport annexé.
Mme Barbara Pompili. Si c’est le cas, je le retire.
L’amendement est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement AC 732 de M. Rudy Salles.
M. Rudy Salles. Il s’agit de garantir la mobilisation optimale de l’outil numérique aux enfants éloignés des bancs de l’école et connaissant des difficultés d’apprentissage.
M. le rapporteur. Avis défavorable : cela ne relève pas de la loi.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AC 403 de M. Vincent Feltesse.
Mme Sandrine Doucet. Les pratiques numériques étant en renouvellement constant, il convient d’encourager l’intégration des nouvelles techniques dans le cycle pédagogique et de permettre aux écoles de développer les projets numériques progressivement, en fonction des innovations et de leurs moyens.
M. le rapporteur. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
L’amendement AC 565 de Mme Marie-George Buffet est retiré.
La Commission adopte l’article 10 modifié.
La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 10.
Elle examine d’abord l’amendement AC 404 de M. Vincent Feltesse.
Mme Martine Faure. Il s’agit de prévoir, à l’article L. 401-1 du code de l’éducation, que le projet d’école ou d’établissement contient notamment un plan de développement du numérique et que celui-ci fait l’objet d’une actualisation annuelle.
M. le rapporteur. Avis défavorable : cela relève, non de la loi, mais du décret.
Mme Martine Faure. Permettez-moi d’insister : tout évoluant très vite dans le domaine du numérique, il me semble important d’inscrire dans la loi la nécessité d’une actualisation régulière du plan de développement du numérique.
M. le rapporteur. Je comprends votre intention, mais cet amendement soulève une difficulté juridique. C’est pourquoi je vous suggère de le retirer afin que nous puissions examiner comment concilier l’article L. 401-1 du code de l’éducation, relatif au projet d’école ou d’établissement, et votre proposition.
Mme Martine Faure. C’est entendu.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement AC 244 de M. Guénhaël Huet.
Mme Claudine Schmid. Eu égard à l’innocence des enfants en la matière, il convient de parfaire l’éducation numérique en y incluant un volet prévention et gestion de l’image numérique.
M. le rapporteur. L’amendement est satisfait par l’article 26 du présent projet de loi : je vous suggère donc de le retirer.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement AC 245 de M. Guénhaël Huet.
Mme Claudine Schmid. Il s’agit d’appliquer un principe de précaution pour garantir la sécurité des enfants dans le nouvel environnement numérique.
M. le rapporteur. C’est un principe de précaution qui n’a pas de portée normative et ne me semble pas avoir sa place dans ce texte, car il ne concerne pas uniquement l’école. Je vous suggère de retirer votre amendement et d’évoquer la question en séance plénière ; à défaut, j’y donnerai un avis défavorable.
Mme Claudine Schmid. L’amendement ne porte pourtant que sur les établissements scolaires ! S’il n’est pas à la bonne place, cherchons-en une autre – si on ne le fait pas en commission, je ne vois pas pourquoi on trouverait une solution dans l’hémicycle.
M. le rapporteur. Je reste sur ma position : votre amendement traite d’un problème général de protection, non d’une question spécifiquement scolaire.
Mme Barbara Pompili. Il s’agit quand même un sujet important, et la sécurité des enfants me semble relever de la loi ! L’article 10 favorisant le développement de l’utilisation d’un nouvel outil, l’enseignement numérique, il ne me paraît pas aberrant d’aborder cette question à cet endroit du texte. Nous présenterons d’ailleurs probablement des amendements en ce sens en séance.
M. le président Patrick Bloche. De toute évidence, cette proposition répond à certaines de nos préoccupations. Néanmoins, dans la mesure où il s’agit de l’expression par le Parlement d’une intention, il serait plus logique qu’elle fasse l’objet d’un amendement au rapport annexé.
Mme Julie Sommaruga. C’est exactement la proposition que je voulais faire, monsieur le président. Cette proposition répond en effet à une véritable préoccupation : il faut impérativement s’en saisir.
M. Benoist Apparu. Si l’on transfère dans le rapport annexé tout ce qui n’a pas de portée normative, je crains qu’il ne reste pas grand-chose du texte de loi…
M. le président Patrick Bloche. Au terme de cette discussion, acceptez-vous de retirer votre amendement, madame Schmid ?
Mme Claudine Schmid. Monsieur le rapporteur, si cet amendement portait sur le rapport annexé, obtiendrait-il un avis favorable en séance plénière ?
M. le rapporteur. Je ne puis me prononcer avant de le connaître !
L’amendement AC 245 est retiré.
La Commission en vient à l’amendement AC 162 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. Cet amendement prévoit la remise au Parlement d’un rapport faisant le bilan du développement de l’éducation au numérique à l’école. Il importe en effet de suivre attentivement les premiers pas du nouveau service public, notamment en ce qui concerne ses effets en matière de concurrence et de développement économique de la filière.
M. le rapporteur. Avis défavorable : votre amendement sera satisfait par la création du comité de suivi que je vais proposer, ainsi que par la mission spécifique sur la filière numérique confiée à l’Inspection générale de l’éducation nationale.
M. Xavier Breton. Dans ce cas, je retire l’amendement.
L’amendement est retiré.
Chapitre II
L’administration de l’éducation
Section 1
Les relations avec les collectivités territoriales
La Commission est saisie de trois amendements portant articles additionnels avant l’article 11.
Elle examine d’abord l’amendement AC 734 de M. Rudy Salles.
M. Rudy Salles. Si l’État a bien entendu vocation à définir et lancer les politiques nationales liées à l’éducation, la déclinaison de ces programmes et les expérimentations dans les territoires doivent faire l’objet d’un partenariat constant. Tel est l’objet du présent amendement.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AC 340 de M. Hervé Pellois.
M. Paul Molac. Faute d’accord du département, certaines communes de plus de 10 000 habitants ne disposent pas d’un collège public, alors que des collèges privés y ont des annexes. Notre amendement vise à remédier à cette situation.
M. le rapporteur. La question mérite en effet d’être soulevée. Cependant, votre amendement pose un problème juridique, car il touche à la libre administration des collectivités territoriales. En conséquence, je vous propose de le retirer et de travailler à une nouvelle rédaction, de manière à pouvoir en débattre en séance.
M. Paul Molac. C’est entendu.
L’amendement AC 340 est retiré, de même que l’amendement AC 339 de M. Hervé Pellois.
Le présent article modifie l’article L. 211-2 du code de l’éducation afin de prendre en compte les nouvelles dispositions des articles L. 214-13 et L. 214-13-1 que les articles 17 et 18 du présent projet de loi tendent à introduire.
*
La Commission est saisie de l’amendement AC 566 de Mme Marie-George Buffet, tendant à supprimer l’article.
Mme Marie-George Buffet. M. le ministre de l’éducation nationale a annoncé que la question des lycées, notamment professionnels, serait traitée ultérieurement. Il a cependant déclaré vouloir promouvoir une nouvelle vision du lycée professionnel ; il s’est ainsi prononcé en faveur d’un renforcement de l’enseignement général en son sein et il a dit réfléchir à un lycée unique où se retrouveraient différentes filières. Il s’agit de perspectives fort intéressantes pour une future loi.
Or l’article 11 fige les choses, en accordant aux régions un pouvoir important, notamment en ce qui concerne la création des filières. Je veux bien qu’il s’agisse d’un texte de loi « dynamique », mais le lycée professionnel doit rester sous la responsabilité pleine et entière de l’éducation nationale, y compris pour le choix des filières – ce qui n’empêchera pas de travailler en liaison avec les collectivités territoriales.
M. le rapporteur. Le problème, c’est qu’il existe une double compétence : la loi de décentralisation donne aux régions compétence pour la carte des formations cependant que les autorités académiques sont chargées de gérer les moyens mis à la disposition des lycées, notamment professionnels. Il faut donc arriver à concilier la compétence régionale et le principe d’unité de l’éducation nationale. Quand il y a accord, la question ne se pose pas ; c’est en cas de désaccord qu’il y a difficulté : il faut savoir à qui attribuer la compétence ultime en matière de moyens.
Pour lever cette difficulté, je proposerai, à l’article 18, un amendement visant à compléter l’alinéa 5 par une phrase ainsi rédigée : « Les autorités académiques mettent en œuvre les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire en fonction des moyens disponibles et conformément au classement par ordre de priorité mentionné au deuxième alinéa du présent article. »
En d’autres termes, la région, dans le cadre de ses compétences, définira des priorités, mais ce sont les autorités académiques qui mettront en œuvre les ouvertures et les fermetures de sections, en tenant compte de ces priorités mais sans que celles-ci s’imposent à l’État.
Une telle rédaction me paraît à la fois être plus précise que la vôtre, respecter les compétences issues de la loi de décentralisation et répondre à votre préoccupation. Je vous suggère donc de retirer votre amendement.
Mme Marie-George Buffet. Votre proposition donne en effet un certain nombre de garanties qui ne se trouvent pas dans le projet de loi en l’état. Je retire donc mon amendement, mais j’en présenterai un autre en séance plénière afin que la question du lycée professionnel et de son avenir fasse l’objet d’un débat dans l’hémicycle.
L’amendement AC 566 est retiré.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements AC 144 de M. Patrick Hetzel et AC 203 de M. Thierry Braillard.
M. Xavier Breton. L’amendement AC 144 vise à solliciter l’avis du conseil économique, social et environnemental régional (CESER) sur le programme prévisionnel des investissements.
M. Thierry Braillard. L’amendement AC 203 est défendu.
M. le rapporteur. L’amendement AC 144 est satisfait, puisque le conseil économique, social et environnemental régional a un rôle consultatif auprès de la région.
M. Xavier Breton. La consultation du CESER est obligatoire ?
M. le rapporteur. Oui.
M. Xavier Breton. Dans ce cas, je retire l’amendement.
M. le rapporteur. Même avis défavorable sur l’amendement AC 203 : les départements sont déjà associés à l’élaboration de l’arrêté fixant la structure des établissements.
M. Thierry Braillard. Je fais confiance au rapporteur et je retire moi aussi mon amendement.
Les amendements AC 144 et AC 203 sont retirés.
La Commission adopte l’article 11 sans modification.
Article 12
Dépenses pédagogiques à la charge de l’État
Cet article propose de modifier le 5° de l’article L. 211-8 du code de l’éducation en vue d’actualiser le contenu les dépenses pédagogiques à la charge de l’État. Ces dernières comprendront désormais d’une part des dépenses liées au numérique éducatif – « des services et des ressources numériques à caractère pédagogique des collèges, des lycées et des établissements d’éducation spéciale » –, et d’autre part la fourniture de manuels scolaires et de documents à caractère pédagogique à usage collectif.
1. Les dépenses à caractère pédagogique liées au numérique
Le présent article vise principalement, en relation avec les articles 13 et 14, à clarifier la répartition entre l’État et les collectivités territoriales des compétences relatives à la maintenance des équipements et des logiciels informatiques dans les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale.
Dans sa rédaction actuelle, le texte du 5° de l’article L. 211-8 renvoie à des mesures réglementaires le soin de fixer la liste des dépenses pédagogiques des collèges, des lycées et des établissements d’éducation spéciale. Ces mesures font l’objet des articles D. 211-14 et D. 211-15 du code de l’éducation, qui concernent respectivement les dépenses d’investissement et celles de fonctionnement.
Les dépenses pédagogiques d’investissement à la charge de l’État sont, aux termes de l’article D. 211-14, « les dépenses relatives au premier équipement en matériel des établissements réalisées dans le cadre d’un programme d’intérêt national et correspondant à l’introduction des nouvelles technologies ou à la fourniture de matériels spécialisés indispensables à la rénovation des enseignements » ; les dépenses pédagogiques de fonctionnement inscrites à l’article D. 211-15 incluent « la maintenance des matériels acquis par l’État en application de l’article D. 211-14 ».
Comme le rappelle l’étude d’impact du projet de loi, ces dispositions ont été prises dans le cadre des lois de décentralisation de 1983, lorsqu’avec l’apparition des nouvelles technologies, l’apport de l’État a été décisif pour financer le premier équipement informatique des établissements scolaires. Un plan national, le « plan informatique pour tous » (IPT) mis en œuvre à la rentrée de septembre 1985, a ainsi permis d’installer plus de 120 000 machines dans 50 000 établissements scolaires, de former 110 000 enseignants et d’initier 11 millions d’élèves à l’outil informatique. L’État a mis le matériel informatique à la disposition des collectivités à titre gratuit pendant trois ans (pendant lesquels il remboursait le crédit-bail qui lui permettait de financer le plan) ; au terme de ces trois ans, l’État devenu propriétaire a proposé aux collectivités un transfert de propriété à titre gratuit du matériel informatique, les collectivités en assumant le coût de fonctionnement (essentiellement l’électricité consommée) et l’entretien courant après la première année de fonctionnement.
Selon les précisions fournies par le ministère de l’éducation nationale, ces dispositions réglementaires ont à présent épuisé leurs effets puisque leur portée était limitée à la mise en œuvre du plan national d’introduction des premiers équipements informatiques dans les établissements scolaires.
Elles n’impliquent donc pas que toutes les dépenses relatives à l’acquisition des équipements informatiques et à la maintenance de ces équipements ont le caractère de dépenses pédagogiques. On peut, au contraire, déduire de l’article L. 213-2 du code de l’éducation, qui confère au département la compétence sur les collèges, que les dépenses d’équipement et de maintenance informatique de ces derniers sont à la charge de cette collectivité, et de l’article L. 214-6, qui reconnaît à la région la compétence sur les lycées, que les dépenses d’équipement et de maintenance informatique de ces derniers incombent à cette collectivité.
Le rapporteur tient néanmoins à indiquer qu’une analyse divergente des obligations de l’État en la matière a été produite par les organisations représentatives des départements et des régions. Ainsi, s’appuyant sur la jurisprudence du Conseil d’État (152), l’Association des régions de France (ARF) considère qu’ayant conservé l’exclusivité des compétences pédagogiques dans le domaine de l’éducation, l’État a donc la charge de l’ensemble des dépenses directement pédagogiques – c’est-à-dire celles correspondant aux ressources mises à disposition des élèves dans le cadre d’activités d’enseignement – dans les établissements scolaires.
Dans cette optique, ces dépenses incluent celles liées aux équipements informatiques à usage pédagogique et à l’entretien de ces équipements, en dépit de la mention du seul « premier équipement en matière de nouvelles technologies » figurant à l’article D. 211-14. De fait, le ministère de l’éducation nationale et les rectorats ont, depuis le « plan informatique pour tous » et jusqu’à ces dernières années, contribué à l’acquisition d’équipements informatiques dans les établissements scolaires.
La question posée à l’égard du présent article, ainsi que des articles 13 et 14, par les départements et les régions concerne donc l’éventualité d’un transfert de compétences qui serait effectué sous couvert d’une définition législative des dépenses informatiques mises à la charge de l’État. Un tel transfert nécessiterait une compensation financière en vertu de l’article 72-2 de la Constitution.
2. Les autres dépenses à caractère pédagogique
Le texte initial du projet de loi disposait qu’outre le numérique éducatif, les dépenses à la charge de l’État comprennent « la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d'éducation spéciale et des documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées professionnels ».
Ces dispositions reprennent les termes du a) du 1° de l’article D. 211-15 du code de l’éducation, sans toutefois mentionner la phrase contenue dans la disposition réglementaire énonçant clairement que l’État à la charge des dépenses pédagogiques des « lycées ».
La suppression de cette mention pouvant être interprétée comme renvoyant aux collectivités territoriales la charge de ces dépenses pédagogiques, la Commission, à l’initiative du rapporteur, a adopté un amendement qui lève toute ambiguïté en prévoyant que restent à la charge de l’État « des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale etc… ».
*
La Commission est saisie de l’amendement AC 657 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement propose de clarifier la répartition des dépenses à caractère pédagogique entre l’État et les collectivités territoriales.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 12 ainsi modifié.
La Commission est saisie de deux amendements portant articles additionnels après l’article 12.
Elle examine d’abord l’amendement AC 352 de M. Paul Molac.
M. Paul Molac. Cet amendement vise à créer un quatrième cas dérogatoire dans lequel une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire mais inscrits dans une autre commune : celui où les parents souhaitent inscrire leur enfant dans un établissement scolaire proposant un enseignement de la langue régionale.
Jusqu’en 2005, l’administration a considéré, de fait, que la commune était tenue de participer financièrement à la scolarisation d’un enfant dans ce cas de figure. Mais la pratique a changé à partir de cette date à la suite d’une question écrite posée par un député. Le ministère de l’éducation nationale indique bien que ces classes ont une vocation intercommunale, mais la loi ne le précise pas.
Cette situation est source de tensions entre les communes, d’une part, et entre les familles et les communes, d’autre part. Ainsi, certains maires refusent d’accueillir les enfants résidant dans d’autres communes parce que ces dernières n’envisagent pas de payer le forfait scolaire. D’autres refusent que les enfants résidant dans leur commune s’inscrivent dans d’autres communes, bien que leur école ne propose pas d’enseignement de la langue régionale. D’autres, enfin, refusent l’inscription des enfants dans une classe bilingue publique d’une commune voisine, au motif que l’enseignement de la langue régionale est proposé par un établissement scolaire privé de leur commune.
Dans certains cas, il est possible de contester la décision du maire devant le tribunal administratif, dans la mesure où une commune est tenue d’accepter l’inscription des enfants âgés de plus de trois ans dès lors qu’elle dispose de places disponibles. C’est cependant une procédure complexe.
La règle de bon sens que je propose d’instituer permettrait de pacifier la situation. Elle répond à l’attente de plusieurs maires.
Je mentionne également le cas d’une commune rurale qui est parvenue à sauver son école en transformant l’unique classe qui restait en classe bilingue, après l’adoption de la « circulaire Savary » en 1982. L’école compte aujourd’hui deux classes et la commune souhaiterait rénover les locaux, mais les communes voisines refusent de participer au financement des travaux. Quant aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), ils prennent rarement en charge de telles opérations. Nous n’avons pas trouvé, à ce stade, de solution.
M. le rapporteur. L’enseignement de la langue régionale n’étant pas obligatoire, il n’est pas possible de le mettre à la charge des communes. Dans l’état actuel du droit, nous ne pouvons pas inscrire une telle disposition dans la loi. Je vous suggère de retirer votre amendement et de soulever le problème en séance publique. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.
M. Paul Molac. Je retire mon amendement et le déposerai à nouveau en vue de la discussion en séance publique.
L’amendement AC 352 est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 246 de M. Guénhaël Huet portant article additionnel avant l’article 13.
Article 13
Dépenses informatiques à la charge des départements
En cohérence avec l’article 12, qui concerne les dépenses à caractère pédagogique à la charge de l’État et avec l’article 14, qui décrit celles assumées par la région, le présent article vise à clarifier le partage des compétences entre l’État et les conseils généraux en matière d’acquisition, de renouvellement et surtout de maintenance des infrastructures et des équipements numériques dans les collèges.
1. Une clarification nécessaire des compétences partagées entre l’État et les collectivités territoriales
Comme il a été indiqué précédemment, l’État, dans le cadre du plan « informatique pour tous » mis en œuvre en 1985, a financé l’acquisition et la maintenance du premier équipement informatique des établissements scolaires, conformément aux articles D. 211-14 et D. 211-15 du code de l’éducation.
Les collectivités locales ont renouvelé leurs équipements et en assurent la maintenance, qu’il s’agisse de celle du réseau administratif ou du réseau pédagogique, étant précisé que, dans de nombreux cas, ces réseaux sont articulés et interconnectés. Pour ce faire, elles recourent à des marchés de maintenance souvent conclus dans le cadre des marchés d’achats des matériels, ou à du personnel technique. De son côté, l’État finance, dans le cadre de l’assistance pédagogique, des décharges partielles de service aux enseignants ou à des personnels d’éducation, lesquels interviennent également pour la maintenance en assurant un relais local pour les collectivités.
Ainsi, comme le relevait en 2011 le rapport du gouvernement au Parlement concernant « les effets de la décentralisation sur le fonctionnement du système éducatif » (153), « la maintenance informatique apparaît à certaines collectivités comme une « zone grise » assurée conjointement entre l’État, responsable des matériels à finalité pédagogique et les départements et les régions, détenteurs d’une compétence de principe pour le fonctionnement matériel des établissements publics locaux d’enseignement. S’ensuit une intervention conjointe des équipes territoriales et des équipes académiques. »
2. Le dispositif proposé par le projet de loi
Le présent article modifie le premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’éducation pour attribuer explicitement la responsabilité de la maintenance des « matériels informatiques et [des] logiciels prévus pour leur mise en service » équipant les collèges au département, au titre de sa compétence de principe sur le fonctionnement de ces établissements.
La maintenance porte sur l’infrastructure et les équipements – le « hard-ware » –, c’est-à-dire sur tous les éléments passifs et actifs du câblage des bâtiments, les serveurs, les postes de travail (ordinateurs fixes et mobiles, terminaux) et les périphériques (imprimantes, tableaux numériques interactifs etc…).
Mais elle concerne également les logiciels (« software »), qui sont de deux types : d’une part, les « logiciels systèmes », prévus pour la mise en service des infrastructures et des équipements et généralement inclus dans le matériel ; d’autre part ceux qui sont « nécessaires à l’enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative » ; cette définition très large permet d’englober les espaces numériques de travail (ENT), les logiciels de gestion des réseaux locaux ainsi que les passerelles locales vers internet via les réseaux des opérateurs de télécommunications.
Il aboutit donc à confier la charge de l’informatique de l’EPLE dans sa totalité, matériel et logiciel, à la collectivité territoriale de rattachement. L’État conservera la responsabilité des services et des ressources pédagogiques liées à ses compétences régaliennes(154), et continuera, ainsi que le rapporteur en a eu la confirmation, à financer des décharges partielles de service aux enseignants ou à des personnels d’éducation pour assurer, dans les établissements scolaires, la maintenance et l’assistance dans le domaine pédagogique.
Si en première approche, la frontière tracée par le texte est claire puisque la responsabilité de la maintenance et de l’assistance est attachée au type de logiciel ou de ressources numériques et incombe à l’État pour ceux ayant un caractère pédagogique, le risque existe que la clarification des compétences soit peu effective dans sa mise en œuvre concrète.
De fait, la limite entre l’assistance technique et l’assistance pédagogique, qui ne relève pas de la collectivité, peut s’avérer difficile à déterminer. Au surplus, si la maintenance par les collectivités territoriales des infrastructures et des équipements qu’elles ont choisis et acquis ne soulève pas de difficulté particulière, il n’en va pas de même pour les logiciels, et en particulier les logiciels de gestion des réseaux locaux qui sont pour la plupart développés et gérés par des services et des personnels de l’éducation nationale. Afin de faire face à ces situations, les collectivités devront nouer des partenariats avec les services académiques afin d’assurer conjointement dans un premier temps, la maintenance de ces logiciels.
Enfin, le rapporteur tient à relever les inquiétudes de l’Association des départements de France quant à d’éventuelles charges nouvelles. De la même manière que pour l’article 12, la question posée est celle du périmètre de la responsabilité de l’État s’agissant des équipements informatiques à usage pédagogique, de la maintenance de ces derniers et de l’assistance aux utilisateurs.
*
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AC 1 du rapporteur.
Puis elle est saisie de l’amendement AC 205 de M. Thierry Braillard.
M. le rapporteur. Avis défavorable : l’amendement est dépourvu de contenu normatif.
L’amendement AC 205 est retiré.
La Commission adopte l’article 13 modifié.
Article 14
Dépenses informatiques à la charge des régions
Cet article vise à clarifier, en relation avec les articles 12 et 13, le partage des responsabilités assumées par l’État et les collectivités territoriales dans le domaine du numérique éducatif. Il modifie le premier alinéa de l’article L. 214-6 du code de l’éducation afin de confier explicitement à la région l’acquisition et la maintenance des « matériels informatiques » équipant les lycées, ainsi que des « logiciels prévus pour leur mise en service », au titre de sa compétence de principe sur le fonctionnement de ces établissements.
Dans le cadre de leur responsabilité en matière d’équipement des lycées, les régions ont investi ces dernières années des moyens financiers et humains importants dans la maintenance technique des équipements et réseaux informatiques, et parfois dans l’assistance aux usagers, souvent afin de compenser le désengagement de l’État. 16 régions consacrent ainsi 555 emplois équivalents temps plein (ETP) à la maintenance informatique des équipements des lycées, alors que 15 rectorats n’y consacrent que 360 ETP.
C’est pourquoi l’Association des régions de France a proposé en juillet dernier que soit clairement transférée aux régions, sous réserve de compensation financière et de transfert des personnels, la maintenance technique des équipements et des réseaux informatiques des lycées (155) qui, de son point de vue, relève normalement de la responsabilité de l’État sur le fondement du « bloc de compétences » reconnu à ce dernier en matière d’éducation par la jurisprudence du Conseil d’État.
Le présent article, ainsi que les articles 12 et 13, qui ne laissent à la charge de l’État que « la fourniture des services et des ressources numériques à caractère pédagogique » ainsi que la maintenance et l’assistance qui s’y rattachent, ne satisfont pas, de ce point de vue, les demandes des régions qui évoquent un transfert sans contrepartie des compétences de l’État vers les collectivités territoriales.
Le rapporteur considère quant à lui que le développement du numérique éducatif implique un partenariat État-régions dans le domaine de la maintenance et de l’assistance informatique.
L’État consacre actuellement de 750 à 1 000 postes de maintenance et d’assistance pour l’ensemble des collèges et des lycées, alors que, selon M. François Bonneau, vice-président de l’ARF en charge de l’éducation, les besoins sont estimés à un poste pour trois établissements. Selon l’ARF, les régions ne pourront pas répondre à l’ambition du ministère de l’éducation nationale de développer le numérique éducatif et assumer la pleine responsabilité de la maintenance et de l’assistance sans un apport de l’État, qui sans couvrir la totalité des besoins, constituerait un « geste » en direction des collectivités territoriales.
Ces dernières ont d’ailleurs engagé depuis plusieurs années avec le ministère de l’éducation nationale des partenariats de maintenance et d’assistance informatique dans les EPLE prévoyant que chacun portera ses efforts prioritairement sur les fonctions relevant de ses missions premières, l’accompagnement des utilisateurs dans leurs usages des technologies de l’information et de la communication pour l’éducation (TICE) pour le ministère, la maintenance et l'accompagnement technique pour les collectivités territoriales. C’est le cas, par exemple, pour l’académie de Poitiers, qui a passé des accords avec la région Poitou-Charentes, et avec les départements de la Charente, de la Vienne et des Deux-Sèvres ; pour l’académie de Strasbourg avec la région Alsace ou pour l’académie de Nantes avec la région Pays-de-la-Loire et le département de Loire-Atlantique ainsi que pour les académies d’Aix-Marseille et de Nice avec la région PACA et les départements des Bouches-du-Rhône et du Var. Il serait souhaitable que ces partenariats se développent, notamment en Champagne-Ardennes, Île-de-France et Midi-Pyrénées, où les besoins en maintenance –assistance, jusqu’à présent uniquement couverts par l’État, s’accroissent. (156)
*
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AC 2 du rapporteur.
L’amendement AC 206 de M. Thierry Braillard est retiré.
La Commission adopte l’article 14 modifié.
La Commission est saisie de l’amendement AC 735 de M. Yves Jégo portant article additionnel après l’article 14.
M. Rudy Salles. Cet amendement vise à favoriser l’ouverture des locaux scolaires.
M. le rapporteur. Cette préoccupation est déjà satisfaite par les articles L. 212-15 et L. 216-1 du code de l’éducation.
L’amendement est retiré.
Article 14 bis (nouveau)
Utilisation des locaux et équipements scolaires des collèges en dehors du temps scolaire
La Commission a adopté un amendement insérant cet article qui propose de créer un article L. 213-3-1 du code de l’éducation afin de permettre au président du conseil général d’autoriser, en dehors des heures consacrées à la formation initiale et continue, l’utilisation par des entreprises ou des organismes de formation des locaux et des équipements scolaires des collèges.
Il présente une portée différente de celle des actuels articles L. 216-1 et L. 551-1 du code de l’éducation qui permettent aux départements d’organiser, dans les établissements scolaires dont ils ont la responsabilité et pendant les heures d’ouverture de ces derniers, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires, ou d’apporter leur concours à l’organisation d’activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation.
Il vise en effet à optimiser et à valoriser le parc immobilier et les équipements scolaires des départements, en étendant le principe de leur mise à disposition à des utilisations visant à répondre à des besoins de formation, selon des mêmes modalités similaires à celles définies à l’article 15 du projet de loi pour les lycées et établissements régionaux d’enseignement adapté qui relèvent de la compétence des régions. De la même façon qu’à l’article 15, cette utilisation des locaux des collèges est également ouverte aux associations pour les besoins de l’éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques.
*
La Commission en vient à l’amendement AC 476 de Mme Barbara Pompili portant article additionnel après l’article 14.
Mme Barbara Pompili. À l’instar de ce que prévoit l’article 15 du présent projet de loi pour les lycées, cet amendement vise à donner la possibilité aux présidents de conseils généraux d’autoriser l’utilisation des locaux et des équipements des collèges, notamment pour les besoins de la formation initiale et continue, de l’éducation populaire et de la vie associative.
M. le rapporteur. Avis favorable.
Mme Julie Sommaruga. Si nous nous prononçons en faveur de l’ouverture des collèges pour les besoins de l’éducation populaire et de la vie associative, je ne comprends pas pourquoi la Commission a rejeté tout à l’heure mon amendement qui visait à ouvrir les collèges aux activités permettant de maintenir le lien avec les parents.
M. le rapporteur. Je suggère que ce débat soit poursuivi lors de l’examen du texte en séance publique.
La Commission adopte l’amendement.
Article 15
Utilisation des locaux et équipements scolaires des lycées et établissements régionaux d’enseignement adapté
Cet article propose de créer un article L. 214-6-2 1 du code de l’éducation afin de permettre au président du conseil régional d’autoriser, en dehors des heures consacrées à la formation initiale et continue, l’utilisation par des entreprises ou des organismes de formation des locaux et des équipements scolaires des lycées et établissements régionaux d’enseignement adapté.
Il convient de rappeler que l’utilisation des locaux et équipement scolaires par des personnes physiques ou morales de droit public ou privé en dehors du temps scolaire est d’ores et déjà prévue par le code de l’éducation.
Ainsi, l’article L. 212-15 met en place un dispositif de proximité visant à favoriser le développement de la vie associative locale en autorisant le maire à utiliser l’ensemble des locaux scolaires implantés sur le territoire de sa commune pour l’organisation d’activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif sans but lucratif.
Par ailleurs, l’article 216-1 permet à la commune, au département ou à la région d’organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d’ouverture, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires.
Le dispositif proposé par l’article L. 214-6-2 nouveau est tout autre, dans son esprit et sa finalité. Il s’agit ici de permettre aux régions, dotées depuis les lois de décentralisation du 2 mars 1982 et du 13 août 2004 de compétences étendues en matière de développement économique, d’apprentissage et de formation professionnelle, et qui ont par ailleurs la charge des lycées et établissements régionaux d’enseignement adapté, de retirer un avantage financier des investissements massifs qu’elles ont réalisés dans ces établissements, notamment en matière informatique, en autorisant l’utilisation à titre payant des équipements pour des activités de formation professionnelle.
Les modalités envisagées pour cette utilisation sont les suivantes :
– L’autorisation est donnée « sous sa responsabilité » par le président du conseil régional ou, pour la Corse, le président du conseil exécutif.
– Le conseil d’administration de l’établissement est consulté et si la région n’est pas propriétaire des bâtiments, elle doit demander l’accord de la collectivité propriétaire.
– Les locaux et les équipements scolaires mis à disposition, sont ceux des lycées et établissements régionaux d’enseignement adapté qui sont dotés d’équipements de haut niveau, notamment informatiques, nécessaires aux activités de formation professionnelle.
– Les périodes d’utilisation sont « les heures ou les périodes au cours desquelles [les locaux] ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale ou continue ». Il convient de rappeler à cet égard que le champ de la formation initiale et continue a été précisé par la circulaire du 22 mars 1985 relative à la mise en œuvre du transfert de compétences en matière d’enseignement public et à l’utilisation des locaux scolaires par le maire. Il couvre les heures de classe ou de cours, les actions de formation continue, les activités directement liées aux activités d'enseignement, ou qui en constituent un prolongement. (157)
– Les activités « doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux » ainsi qu’« avec le fonctionnement normal du service ». Les deux premières exigences reprennent celles figurant au premier alinéa de l’article L. 212-15 du code de l’éducation ; la troisième vise à rappeler que ce sont les besoins du service public d’enseignement qui priment en matière d’utilisation des locaux et équipements des établissements scolaires et qu’ils ne se limitent pas aux activités d’enseignement ou autres destinées aux élèves, mais comprennent également les activités administratives, d’entretien de l’établissement, de concertation pédagogique, etc… Le rapporteur a noté à ce sujet l’attachement des organisations représentatives des personnels à cette précision, étant indiqué qu’elles sont unanimement réservées sur l’utilisation des locaux et équipements des établissements scolaires par des personnes extérieures aux établissements.
– Les utilisateurs sont les entreprises ou les organismes de formation.
– L’autorisation est conditionnée par la conclusion d'une convention entre le représentant de la région – ou de la collectivité territoriale de Corse –, celui de l'établissement et l'organisateur. Outre les dispositions relatives aux modalités d'utilisation des locaux, cette convention précise « les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels. » Il s’agit ainsi de définir de façon très pragmatique les responsabilités de l’organisateur, par exemple en ce qui concerne la remise en ordre des locaux et équipements qu’il a utilisés, leur nettoyage, la fermeture des locaux, l’extinction des éclairages, etc…
– La mise à disposition des locaux est payante : la convention précise « les conditions financières de l’utilisation des biens dans le respect des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques ». Il est ici fait référence aux dispositions du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques qui fixent les principes relatifs à l’occupation du domaine public et, notamment en ce qui concerne les conditions financières de l’utilisation des locaux scolaires, à l’article L. 2125-1 qui prévoit que cette occupation donne lieu à redevance.
Dans son avis sur l’avant-projet de loi, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) observe que « le bon sens peut effectivement trouver normal que des locaux inutilisés durant un certain nombre de périodes de l’année scolaire puissent être affectés à d’autres activités : c’est là le signe d’une bonne gestion des équipements publics. Pour autant, il ne faudrait pas que la tentation soit grande pour un certain nombre de régions de “rentabiliser à tout prix” leurs installations. » Le rapporteur partage également le sentiment du CESE selon lequel « à l’évidence cela ne doit pas porter préjudice à l’organisation des enseignements. » (158)
*
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AC 3 du rapporteur.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement l’amendement AC 262 de M. Benoist Apparu et l’amendement AC 669 de Mme Barbara Pompili.
Elle en vient à l’amendement AC 475 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. Aux termes de cet amendement, le président du conseil régional pourrait autoriser l’utilisation des locaux et des équipements des lycées non seulement par des entreprises ou des organismes de formation, mais également par des associations, pour les besoins de l’éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques.
M. le rapporteur. Avis favorable, par cohérence.
M. Mathieu Hanotin. J’avais l’intention de déposer un amendement analogue. Je suis donc très favorable à celui-ci.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 15 modifié.
La Commission est saisie de l’amendement AC 477 de Mme Barbara Pompili, portant article additionnel après l’article 15.
Mme Barbara Pompili. Aux termes de cet amendement, à l’instar de ce que nous avons prévu pour les collèges et les lycées, le maire ou le président de l’EPCI pourrait autoriser l’utilisation des locaux et des équipements des écoles par des entreprises, des organismes de formation ou des associations.
M. le rapporteur. Avis favorable.
Mme Marie-George Buffet. Je suis d’accord sur le principe. Cependant, les maires mettent déjà les salles des écoles à la disposition des associations. En outre, cette disposition relève-t-elle vraiment de la loi ?
M. Mathieu Hanotin. Je souscris aux propos de Mme Marie-George Buffet.
Il existe une différence fondamentale entre les écoles, d’une part, et les collèges et les lycées, d’autre part : les seconds sont des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE).
Dans le cas d’une école, la responsabilité civile et pénale est assumée par le maire, qui peut donc décider librement de la mise à disposition des locaux.
Dans le cas d’un EPLE, en vertu de la loi de 1985, la responsabilité civile et pénale est assumée par le chef d’établissement. C’est pourquoi nous avons dû modifier la loi pour donner la possibilité aux présidents de conseils généraux et régionaux d’autoriser l’utilisation des locaux des collèges et des lycées, respectivement.
Mme Barbara Pompili. Je suis sensible à ces arguments. Je retire mon amendement, quitte à le déposer à nouveau en vue de la discussion en séance publique.
L’amendement AC 477 est retiré.
Article 16
Élaboration et mise en œuvre par la région du service public régional de la formation professionnelle
Le présent article tend à affirmer la compétence de la région pour arrêter la carte des formations professionnelles initiales du territoire régional.
1. Le droit existant
Les compétences des régions en matière de formation professionnelle concernent à la fois la planification des formations, la construction, l’entretien et le fonctionnement des lycées, ainsi que la définition et la coresponsabilité de la mise en œuvre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles.
Ce contrat, défini à l’article L. 214-13 du code de l’éducation, « a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et d’assurer un développement cohérent de l’ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières de formation. »
Il détermine les objectifs communs aux différents acteurs sur le territoire régional, notamment en termes de filières de formation professionnelle initiale et continue, sur la base d’une analyse des besoins en termes d’emplois et de compétences par bassin d’emploi.
Aux termes de l’article L. 214-13, « le contrat de plan régional est élaboré par la région au sein du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle sur la base des documents d’orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l’État dans la région, l’autorité académique et les organisations d’employeurs et de salariés. »
Il est cosigné par le président de la région, le représentant de l’Etat dans la région et l’autorité académique et établi après chaque renouvellement du conseil régional.
En application du IV de l’article L. 214-13, le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles se décline en conventions annuelles d’application. Ces conventions précisent, pour l’État et la région, la programmation et le financement des actions de formation professionnelle destinées aux jeunes et aux adultes. Elles sont mises en œuvre par l’État et la région dans l’exercice de leurs compétences respectives.
Dans les établissements d’enseignement du second degré (mais aussi les lycées agricoles et les établissements relevant du ministère chargé des sports), ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent, par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Sur ce point, le IV de l’article L. 213-4 prévoit qu’à défaut d’accord, les autorités de l’État prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l’éducation.
L’État, pour sa part, prend en charge les personnels d’enseignement des établissements du second degré et arrête leur structure pédagogique générale (article L. 211-2) en tenant compte du schéma prévisionnel des formations établi par la région. La liste annuelle des opérations de construction ou d’extension des établissements que l’État s’engage à doter de personnels est établie par le représentant de l’État en tenant compte du programme prévisionnel des investissements.
2. Les modifications proposées par le projet de loi
Le présent article propose de modifier l’article L. 214-12 du code de l’éducation qui affirme la compétence de la région pour la définition et la mise en œuvre de la politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes sans emploi ou à la recherche d’une nouvelle orientation professionnelle.
Il est proposé de réaffirmer dans l’article L. 214-12 que la région élabore le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles. Comme il a été indiqué précédemment, cette disposition est déjà prévue par le IV de l’article L. 214-13.
Enfin, et c’est là l’élément essentiel du dispositif prévu par les articles 16, 17 et 18 du présent projet de loi, il est proposé de préciser que la région arrête la carte des formations professionnelles initiales du territoire régional définie et élaborée dans les conditions prévues par le nouvel article L. 214-13-1 du code de l’éducation, que l’article 18 du présent projet de loi tend à créer. En l’état actuel du droit en effet, sur ce point, à défaut d’accord entre les parties, les autorités de l’État prennent les décisions nécessaires à la continuité du service public de l’éducation.
Le présent article supprime incidemment plusieurs dispositions que le rapporteur proposera de rétablir par amendement. L’article L. 214-12 précise en effet que la région « organise sur son territoire le réseau des centres et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de l’expérience et contribue à assurer l’assistance aux candidats à la validation des acquis de l’expérience.
« Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d’apprentissage et de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes aux différentes filières de formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d'acquérir une des qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1 du code du travail.
« Elle assure l’accueil en formation de la population résidant sur son territoire, ou dans une autre région. Dans ce dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en charge de la formation par les régions concernées. »
*
La Commission adopte l’amendement de précision AC 713 du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement AC 736 de M. Rudy Salles.
M. Rudy Salles. Cet amendement vise à assurer la cohérence de l’offre de formation à l’échelle régionale et organise, à cette fin, la concertation entre les principaux acteurs régionaux de la formation.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Les amendements AC 147 et AC 670 de M. Patrick Hetzel sont retirés.
La Commission est saisie de l’amendement AC 207 de M. Thierry Braillard.
M. Thierry Braillard. Avec cet amendement, je souhaite insister sur l’importance des dispositifs d’orientation.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
L’amendement AC 207 est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement AC 112 de M. Frédéric Reiss.
M. Frédéric Reiss. Nous souhaitons maintenir les compétences de la région en matière de validation des acquis de l’expérience.
M. le rapporteur. Votre préoccupation est satisfaite par l’amendement AC 713 que nous venons d’adopter : l’alinéa correspondant de l’article L. 214-15 du code de l’éducation a été rétabli.
L’amendement AC 112 est retiré.
La Commission adopte l’article 16 modifié.
Le présent article tend à supprimer les trois premières phrases du troisième alinéa du IV de l’article L. 214-13 du code de l’éducation qui précisent les modalités d’élaboration de la carte des formations professionnelles initiales dans le cadre de la convention annuelle précitée. Il est proposé de remplacer ces dispositions par un nouvel article L. 213-3-1 que l’article 18 tend à créer.
*
Mme Marie-George Buffet. Il s’agit d’un amendement de suppression de l’article, justifié comme mon précédent amendement AC 566 par un souci d’équilibre entre l’État et les régions dans la détermination de la carte des formations professionnelles.
M. le rapporteur. Je vous renvoie à la réponse que je vous ai faite à propos de l’article 11.
L’amendement AC 567 est retiré.
La Commission examine les amendements identiques AC 125 de Mme Claudine Schmid et AC 737 de M. Rudy Salles.
Mme Claudine Schmid. L’article L. 214-13 du code de l’éducation précise que le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles (CPRDF) engage les parties représentées au sein du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle, notamment les partenaires sociaux. Il serait donc logique que les conventions d’application du CPRDF soient signées par le président de la commission paritaire régionale interprofessionnelle de l’emploi, en sa qualité de représentant des partenaires sociaux.
M. Rudy Salles. L’amendement est défendu.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Le conseil régional adopte le CPRDF après consultation du comité de coordination régionale de l’emploi et de la formation professionnelle et du conseil économique et social régional. L’augmentation du nombre de parties alourdirait considérablement la procédure.
Mme Claudine Schmid. Je ne demande pas à augmenter le nombre de parties représentées, mais à ce que les parties engagées par le CPRDF – qui sont déjà représentées – puissent en signer les conventions d’application.
M. le président Patrick Bloche. Je suggère que ce débat soit poursuivi lors de l’examen du texte en séance publique.
La Commission rejette les amendements identiques AC 125 et AC 737.
Puis elle adopte l’article 17 sans modification.
Article 18
Élaboration et mise en œuvre de la carte régionale des formations professionnelles initiales
Le présent article vise à renforcer la concertation entre l’État et les régions s’agissant des décisions d’ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale dans les établissements d’enseignement du second degré.
Ces dispositions constituent la traduction législative d’une « déclaration commune » signée le 12 septembre 2012 à l’Élysée par le Président de la République et l’Association des régions de France (ARF), et dans laquelle l’État et les régions ont pris des engagements réciproques qui concernent notamment l’emploi, l’orientation et la formation.
Dans le huitième engagement, les régions et l’État s’engagent à « diviser par deux en cinq ans le nombre de jeunes entrant sur le marché du travail sans qualification ». Pour cela, « les régions renforceront leurs interventions pour lutter contre toutes les formes de « décrochage », en pilotant l’évolution de la carte des formations, en mobilisant les différentes voies de formation professionnelle dont l’alternance, et en modernisant le service public de l’orientation que les régions ont vocation à coordonner et animer. »
Compte tenu de ces engagements, le présent article tend à clarifier les rôles respectifs de l’État et des régions dans le pilotage de l’évolution de la carte des formations professionnelles initiales.
1. Les problèmes posés par le droit actuel
S’agissant du choix des ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale, les rôles respectifs de l’État et de la région méritent d’être révisés afin de garantir les conditions d’une concertation satisfaisante.
En effet, comme il a été indiqué précédemment, la rédaction actuelle de l’article L. 214-13 du code de l’éducation prévoit la possibilité pour les autorités de l’État, en cas de désaccord, de prendre seules la décision finale concernant les ouvertures et fermetures de formation dans ces établissements.
Ce droit pour l’État de prendre des décisions unilatérales est source de difficultés pour la mise en œuvre des plans régionaux de développement des formations professionnelles.
Cette disposition partait d’une intention compréhensible : prévoir les cas de désaccord à l’issue du dialogue entre l’État, notamment le recteur, et la région. En réalité, elle a conduit les autorités académiques, ainsi assurées d’avoir le dernier mot, de se passer du dialogue avec la région.
De fait, la plupart des régions ne signent plus les conventions annuelles, refusant d’être placées par l’État devant le fait accompli.
Ainsi, selon les informations transmises par l’ARF, fin 2011, dans le cadre de la préparation de la rentrée 2012, plus de la moitié des régions n’auraient-elles pas été consultées par le rectorat pour les ouvertures et les fermetures de sections en lycée professionnel.
En raison de nombreuses fermetures de sections, des investissements réalisés pour ces lycées professionnels, parfois récemment, par les régions, en accord avec le rectorat ou à sa demande, sont devenus inutiles (ateliers, équipements, parfois des lycées entiers). Selon l’ARF, dans les rares cas d’ouvertures de sections, le rectorat aurait parfois demandé au dernier moment à la région de financer en urgence des équipements et travaux nécessaires.
Par ailleurs, le droit actuel ne garantit pas la complémentarité des politiques d’apprentissage et de formation professionnelle initiale sous statut scolaire. En effet alors que la carte des formations en apprentissage relève des régions, celle des formations des lycées professionnels relève in fine des recteurs, ce qui n’est pas un gage de cohérence de l’ensemble.
Les décisions étant prises de manière unilatérale par le rectorat pour les lycées professionnels, l’apprentissage est le seul levier dont les régions disposent pour essayer de mettre en adéquation la formation avec le développement économique et l’aménagement du territoire, deux autres de leurs compétences
Du fait des suppressions massives de postes en lycée professionnel ces dernières années, les régions n’ont pu que déplorer les fermetures de sections ou rouvrir des formations équivalentes en apprentissage, lorsqu’elles estimaient que celles-ci offraient des débouchés aux jeunes ou répondaient à des besoins identifiés dans certains secteurs utiles au développement économique des territoires.
La politique en matière d’offre et de carte des formations en apprentissage doit pourtant être étroitement articulée à celle menée dans l’enseignement professionnel public, afin d’offrir des solutions adaptées aux besoins des jeunes et des territoires.
C’est à cette situation que le nouvel article L. 214-13-1 du code de l’éducation entend remédier.
2. Le dispositif proposé : créer les conditions d’une concertation renforcée entre l’État et les régions
Le nouvel article L. 214-13-1 distingue deux phases dans le processus d’élaboration de la carte des formations.
Dans une première phase (alinéa premier du nouvel article L. 214-13-1), la région recense, par ordre de priorité, les ouvertures et les fermetures qu’elle estime nécessaires, tandis que les autorités académiques établissent également un état des besoins de formation professionnelle initiale.
Dans une deuxième phase (deuxième alinéa du nouvel article L. 214-13-1), la région et les autorités académiques signent la convention annuelle d’application qui classe par ordre de priorité les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale, en fonction des moyens disponibles. Il appartiendra au recteur d’indiquer celles des évolutions proposées par la région que les moyens d’enseignement dont il dispose permettront de prendre en compte.
En application du troisième alinéa du nouvel article L. 214-13-1, la carte complète des formations professionnelles initiales (incluant les sections maintenues, nouvelles et fermées) sera arrêtée par la région conformément aux choix retenus dans la convention signée avec l’État et conformément aux décisions d’ouverture et de fermeture de formations par l’apprentissage qu’elle aura prises.
Ainsi les régions seront-elles en mesure d’assurer une mise en cohérence des cartes des formations professionnelles initiales et de l’apprentissage.
Enfin, en application du quatrième alinéa du nouvel article L. 214-13-1, la carte régionale des formations professionnelles initiales sera, comme c’est le cas actuellement, mise en œuvre par l’État et la région dans l’exercice de leurs compétences respectives.
Comme l’indique l’étude d’impact du projet de loi, il n’est pas nécessaire de prévoir de texte réglementaire d’application de ces dispositions. En revanche, cette nouvelle procédure concernant également les établissements relevant du code rural et de la pêche, il conviendra de consulter les ministères de tutelle de ces établissements pour l’établissement de la nouvelle procédure.
Un rapport annuel sur l’évolution de la carte des formations professionnelles sera établi par chaque région et communiqué au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie qui en effectuera la synthèse nationale.
La région étant déjà chef de file du développement économique et de l’innovation sur son territoire, la place plus grande accordée à la concertation avec les régions permettra de mieux articuler l’offre de formation avec les besoins économiques exprimés par les représentants régionaux des différents secteurs professionnels. Il ne s’agit pas d’asservir la formation professionnelle à une vision de proximité mais de faire en sorte que la formation professionnelle initiale soit mieux articulée avec les évolutions anticipées de l’emploi, sur les plans à la fois national et régional.
Dans le dispositif proposé, ni l’État, ni la région n’ont le dernier mot. La nouvelle rédaction oblige les deux parties à se mettre d’accord.
Le rapporteur souhaite cependant attirer fortement l’attention sur un point : le rôle de l’État doit rester essentiel pour garantir la diversité de l’offre de formation dans chaque région, son adéquation avec les perspectives nationales, pour éviter des exigences de mobilité abusives s’imposant aux jeunes, et pour faire en sorte que l’offre de formation ne soit pas le résultat d’une simple adaptation avec l’emploi local. La convention annuelle indiquée plus haut est à cet égard un outil indispensable pour maintenir un équilibre entre les territoires.
Pour plus de clarté, la Commission a adopté, à l’initiative du rapporteur, un amendement tendant à préciser que les autorités académiques mettent en œuvre les ouvertures et fermetures de sections de formations professionnelle initiale sous statut scolaire en fonction des moyens disponibles et conformément au classement par ordre de priorité mentionné au deuxième alinéa du présent article.
*
Les amendements AC 568, AC 569, AC 671, AC 570 et AC 571 de Mme Marie-George Buffet sont retirés.
La Commission adopte l’amendement de précision AC 633 du rapporteur, les amendements AC 126 de Mme Claudine Schmid, AC 738 de M. Rudy Salles et AC 405 de M. Michel Ménard devenant sans objet.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 739 de M. Rudy Salles.
Les amendements AC 672 et AC 673 de Mme Marie-George Buffet sont retirés.
La Commission adopte l’amendement de clarification AC 634 du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement AC 635 du rapporteur.
M. le rapporteur. J’ai déjà présenté, lors de l’examen de l’article 11, cet amendement qui, je le rappelle néanmoins, prévoit que les autorités académiques mettent en œuvre les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire en fonction des moyens disponibles et conformément au classement par ordre de priorité mentionné au deuxième alinéa du nouvel article L. 214-13-1 du code de l’éducation créé par l’article 18 du projet de loi.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 18 modifié.
Article 18 bis (nouveau)
Introduction des langues et cultures régionales dans le champ des activités éducatives, culturelles ou sportives complémentaires
La Commission a adopté, à l’initiative du rapporteur, un amendement tendant à préciser, dans l’article L. 216-1 du code de l’éducation, relatif aux activités éducatives, culturelles ou sportives que les communes, départements et régions peuvent organiser dans les établissements scolaires pendant leurs heures d’ouverture, que ces activités peuvent porter sur la connaissance des langues et cultures régionales.
*
La Commission est saisie de l’amendement AC 701 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 18.
M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de synthèse sur la question des langues et des cultures régionales. Je l’ai déjà évoqué.
La Commission adopte l’amendement.
Article 19
Coordination dans le code général des collectivités territoriales
Par souci de cohérence, le projet de loi propose de modifier l’article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales pour renforcer la concertation entre les représentants de l’État et les conseils régionaux dans l’élaboration des structures pédagogiques des établissements du second degré et pour indiquer que la liste des constructions ou extensions d’établissements que l’État s’engage à doter en personnel est établie en fonction du programme prévisionnel d’investissement mais aussi des engagements conclus dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles.
*
Les amendements AC 572 et AC 573 de Mme Marie-George Buffet sont retirés.
La Commission adopte l’article 19 sans modification.
La Commission est saisie de l’amendement AC 406 de M. Jean-Jacques Urvoas, portant article additionnel après l’article 19.
Mme Lucette Lousteau. Cet amendement concerne les activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires que peuvent organiser les collectivités territoriales en vertu de l’article L. 216-1 du code de l’éducation. Nous souhaitons que ces activités, qui s’inscrivent dans le temps scolaire, ne soient plus facultatives pour les enfants. Nous proposons, notamment à cette fin, une nouvelle rédaction de l’article L. 216-1.
M. le rapporteur. Ces dispositions seraient contraires au principe de libre administration des collectivités territoriales. Les activités complémentaires visées à l’article L. 216-1 sont organisées sous la responsabilité de ces dernières : une loi ne peut pas les rendre obligatoires.
L’amendement AC 406 est retiré.
Section 2
Le Conseil supérieur des programmes
Article 20
Création du Conseil supérieur des programmes
Cet article vise à insérer dans le code de l’éducation un nouveau chapitre instituant un Conseil supérieur des programmes, en supprimant par voie de conséquence le Haut conseil de l’éducation. Il permettra de donner suite à l’une des préconisations du rapport de la concertation sur l’école, à savoir la création d’une instance chargée de proposer et de coordonner le socle commun et les programmes à des fins de « pilotage pédagogique national » (159).
1. Une instance de « légitimation » indispensable pour faire évoluer les outils de formation des élèves
Dès lors que la rénovation du contenu des enseignements est placée au cœur de la refondation de l’école qui se veut, d’abord, une refondation pédagogique, cette politique doit s’appuyer, en matière de programmes scolaires, sur une instance de proposition indépendante, dotée d’une forte légitimité.
À l’heure actuelle, cette instance fait défaut, le législateur ayant supprimé, en 2005, le Conseil national des programmes institué par la loi du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation (loi « Jospin »).
Depuis lors, selon le constat de notre collègue M. Xavier Breton, « la procédure d’élaboration des programmes est peu transparente et se déroule quasiment en "circuit fermé", au sein du monde de l’éducation nationale », le ministre s’appuyant, pour gagner du temps, « sur "son" inspection générale, tandis que les différentes phases de consultation se succèdent dans des délais resserrés » (160).
La procédure d’élaboration des programmes scolaires
– La révision d’un programme intervient, en moyenne, tous les cinq ans, lorsqu’intervient la réforme d’un niveau d’enseignement. Ainsi, entre 2007 et 2012, les programmes de l’école, du collège et du lycée ont été tous modifiés.
– La loi lui ayant confié la définition, par des arrêtés, du « contenu des formations » (article L. 311-2 du code de l’éducation), c’est le ministre de l’éducation nationale qui prend la décision de lancer la révision des programmes, en adressant, à cet effet, une lettre de cadrage au directeur général de l’enseignement scolaire. Le décret du 17 mai 2006 fixant l’organisation de l’administration centrale des ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche précise en effet que c’est la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) qui « élabore la politique éducative et pédagogique, ainsi que les programmes d’enseignement des écoles, des collèges, des lycées et des lycées professionnels ».
– La rédaction du nouveau programme est alors confiée à un groupe d’experts, sous la présidence d’un universitaire ou d’un inspecteur général de l’éducation nationale nommé par le ministre. Les membres de ce groupe sont choisis pour leur compétence professionnelle par le président du groupe, en accord avec la DGESCO. Il s’agit très majoritairement d’inspecteurs généraux et d’inspecteurs pédagogiques régionaux.
– Des consultations sont organisées au cours de la phase d’élaboration du programme, mais elles n’associent, dans un premier temps, que les syndicats et les associations de professeurs spécialistes de la discipline concernée. La consultation ne devient publique que dans un second temps, tout en ne concernant qu’un public averti, avec la mise en ligne du projet de programme pendant quelques semaines sur le site Éduscol, ce qui permet aux enseignants de faire part de leurs observations.
– Au terme de ces différentes étapes et avant la signature par le ministre de l’arrêté portant publication au Bulletin officiel de l’éducation nationale, le projet de programme entre dans une phase de consultation institutionnelle, qui nécessite le recueil de l’avis du Conseil supérieur de l’éducation (CSE), composé de 97 membres, dont 19 représentants des usagers. L’intervention de cet organisme est, cependant, purement formelle : juridiquement, le ministre n’est pas tenu de suivre ses avis ; pratiquement, le Conseil ne dispose pas toujours du temps nécessaire pour étudier les projets, dont chacun comprend pourtant des dizaines de pages.
À l’inverse, le défunt Conseil national des programmes (CNP) permettait de concilier expertise, transparence et légitimité en dissociant la rédaction de ces outils de formation de leur validation par une autorité indépendante, qui émettait des avis conformes sur les projets qui lui étaient soumis.
Aujourd’hui, cette fonction de légitimation ne saurait être exercée par le Haut conseil de l’éducation (HCE) institué par la loi « Fillon » de 2005, dans la mesure où le HCE n’a qu’un pouvoir consultatif en matière de programmes et n’a été que rarement saisi de cette question.
En effet, cet organisme « émet un avis et formule des propositions » à la demande du ministre de l’éducation nationale sur les questions relatives aux programmes (article L. 230-2 du code de l’éducation). Or, depuis son installation, le HCE a fait un usage modéré de cette faculté, puisqu’il n’a publié, en tout et pour tout, qu’un avis sur les projets de programmes de l’école primaire (le 19 mai 2008) et des « observations préalables » sur la révision des programmes du lycée général et technologique (10 décembre 2009).
C’est donc à juste titre que l’étude d’impact du présent projet de loi rappelle que le HCE « n’est pas considéré comme garant d’une procédure valide pour l’élaboration des programmes », et ce bien qu’une partie des attributions du CNP lui ait été transférée.
2. Le dispositif proposé par le projet de loi
Le présent article prévoit :
– de supprimer le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code de l’éducation consacré au Haut conseil de l’éducation ;
– d’insérer dans ce même titre, après le chapitre Ier relatif au Conseil supérieur de l’éducation (CSE), un chapitre Ierbis intitulé : « Le Conseil supérieur des programmes ». Ce nouveau chapitre comprendra quatre articles, le premier fixant la composition du conseil (article L. 231-14 nouveau), les deux suivants ses missions (articles L. 231-15 et L. 231-16 nouveaux), le dernier article renvoyant à un décret le soin de préciser son fonctionnement (article L. 231-17 nouveau).
Ainsi, le présent article permettra de distinguer, de manière plus saine et opérationnelle, deux fonctions : d’une part, la participation à l’élaboration des programmes, d’autre part l’évaluation de ces mêmes programmes – laquelle peut porter sur leur pertinence. Ces compétences sont actuellement exercées par le HCE et ce mélange des genres a certainement rendu difficile le « positionnement » de cet organe au sein du monde de l’éducation, malgré la qualité de ses rapports.
Ainsi que l’a souligné l’historien Claude Lelièvre devant le rapporteur, la mise en place simultanée d’un Conseil supérieur des programmes et d’un Conseil national d’évaluation du système éducatif (institué pour sa part à l’article 21 du présent projet de loi) permettra de distinguer le « prescripteur » de « l’évaluateur » de l’enseignement scolaire. Cette double création constituera, de ce fait, une innovation « considérable » pour notre école, car, depuis l’institution de l’inspection des lycées par Napoléon, ces deux missions sont entremêlées.
a) Une instance resserrée qui accorde la première place au Parlement et aux personnalités qualifiées
L’article L. 231-14 nouveau du code de l’éducation propose que le Conseil supérieur des programmes (CSP) soit placé auprès du ministre chargé de l’éducation nationale et comprenne seize membres, désignés pour cinq ans, soit :
– deux députés et deux sénateurs, la présence de parlementaires au sein de l’instance chargée de piloter les programmes de formation des élèves constituant un gage de solennité et une caution démocratique. En outre, comme on le verra plus loin, les assemblées bénéficieront d’une représentation numérique identique au sein du Conseil national d’évaluation du système éducatif ;
– deux membres du Conseil économique, social et environnemental, désignés par le président de cette institution, afin d’assurer, par ce biais, la représentation de la société civile au sein d’une instance qui, par ses propositions, contribuera à définir l’avenir de l’école ;
– dix personnalités qualifiées. Leur poids au sein de la nouvelle instance, supérieur à 60 % de ses effectifs, offrira au CSP les garanties scientifiques et pédagogiques nécessaires à toute évolution des paramètres clefs d’un système éducatif que sont les programmes d’enseignement et les concours de recrutement des enseignants. Ainsi, la nouvelle instance pourra être indépendante, tant à l’égard de l’administration centrale que de l’inspection générale. Par ailleurs, elle sera en mesure de favoriser un débat sur les savoirs, qui aille au-delà des logiques disciplinaires, et de faciliter les relations de l’école avec le monde de l’université et de la recherche.
On observera que le Conseil national des programmes institué par la loi « Jospin » de 1989 comprenait, de son côté, pas moins de vingt-deux membres, mais aucun représentant du Parlement. En 2002, il comptait dans ses rangs un professeur des écoles, quatre professeurs agrégés ou certifiés, un professeur de chaire supérieure, quatre inspecteurs généraux, dix professeurs des universités et deux chercheurs du CNRS.
b) Une instance respectueuse des prérogatives du ministre
Le futur CSP ne sera pas un CNP bis. Son champ d’intervention sera, comme on le verra plus loin, à la fois plus large et plus cohérent que celui du conseil installé en 1990, dont la compétence était strictement limitée aux programmes. En outre, ses pouvoirs ne seront pas les mêmes, un choix qui doit être explicité et qui répond à des considérations de principe.
Le CNP « version 1990 », compte tenu des avis conformes qu’il rendait, disposait des moyens de s’ériger en véritable contre-pouvoir – ce qui est presque arrivé en raison de la forte personnalité de l’un de ses présidents – vis-à-vis du ministre de l’éducation nationale.
Le fonctionnement du Conseil national des programmes (CNP)
Placé directement auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, le CNP était un organisme indépendant dont les avis, déclarations ou rapports étaient rendus publics aux termes de l’article 6 de la loi du 10 juillet 1989.
Le décret du 23 février 1990 qui en a précisé le fonctionnement définissait ainsi son rôle : les projets de programmes étaient élaborés par des groupes d’experts pour les programmes scolaires (GEPS) et, en ce qui concerne l’enseignement technologique et professionnel, par des commissions professionnelles consultatives (CPC), les uns et les autres « placés auprès des directions compétentes » du ministère de l’éducation nationale, tandis que le CNP était « consulté sur les conclusions des travaux de ces groupes » et donnait son avis sur la composition des GEPS.
À partir des orientations générales fixées par le ministre de l’éducation nationale, le CNP adressait aux présidents des GEPS des lettres de cadrage définissant les principaux axes des nouveaux programmes. Des consultations régulières étaient ensuite organisées entre le CNP et les GEPS pendant la phase d’élaboration. À l’issue de cette première phase, le CNP émettait un avis sur les projets de programmes qui lui étaient soumis. En cas de désaccord ou d’avis négatif, le CNP pouvait demander aux GEPS des amendements ou proposer lui-même des modifications, voire élaborer un nouveau projet. Au final, seuls les programmes ayant reçu un avis favorable du CNP étaient présentés au Conseil supérieur de l’éducation.
Pourtant, depuis 1975, le législateur a confié au ministre la définition du contenu des formations (article L. 311-2 du code de l’éducation). En effet, il est sain que, dans une démocratie, ce soit une autorité politique, un ministre de la République, membre d’un gouvernement dont le Premier ministre est responsable devant le Parlement, qui exerce cette compétence fondamentale pour l’éducation des futurs citoyens.
Pour tenir compte de cette exigence, l’article L. 231-15 nouveau du code de l’éducation ne prévoit de confier au Conseil supérieur des programmes qu’un pouvoir de proposition étendu, mais qui, bien utilisé, pourra accompagner la refondation pédagogique de l’école.
c) Un pouvoir de proposition étendu qui pourra être un vrai levier pour la refondation pédagogique de l’école
Pour l’essentiel, le CSP formulera des propositions sur les contenus d’enseignement, les modes de certification des connaissances des élèves et les modalités de formation et de recrutement des enseignants, ce qui permettra d’accroître la cohérence et les synergies entre ces aspects – aujourd’hui peu convergents – des politiques éducatives.
C’est l’exercice de cette compétence qui conduira le CSP à faire part de ses recommandations sur les nouveaux contenus dont la mise en place est prévue par le projet de loi et son rapport annexé : l’enseignement moral et civique, le parcours d’éducation artistique et culturelle et l’apprentissage d’une langue vivante dès le cours préparatoire.
● Les programmes et le socle commun
Le droit d’initiative et d’expression du conseil s’exercera sur les domaines suivants :
– la conception générale des enseignements dispensés aux élèves des écoles, des collèges et des lycées. Cette question constitue l’un des principaux aspects de la refondation d’un système éducatif dont le lycée est resté le « centre de gravité », ce qui se traduit par des programmes du collège qui ne se réfèrent pas à ceux du primaire mais à ceux du second cycle de l’enseignement secondaire. Le CSP pourra ainsi s’en saisir afin d’impulser une conception unifiée de l’enseignement scolaire ;
– le contenu du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires, et leur articulation en cycles.
Ici, chacun de ces termes a son importance. Leur combinaison vise à permettre au Conseil supérieur des programmes d’établir, par ses préconisations, les corrélations entre des instruments – les programmes, le socle commun et les cycles – qui, pour l’heure, sont faiblement, voire quasiment pas, articulés. Il reviendra donc au CSP de veiller à l’amélioration des cohérences des principaux outils de formation des élèves, qu’elles soient verticales (au niveau des cycles et des programmes d’enseignement) ou horizontales (au niveau du socle commun et de la conception générale des enseignements, ceux-ci devant ouvrir la voie à plus d’interdisciplinarité).
S’agissant en particulier de la cohérence entre le socle commun et les programmes, la situation actuelle se caractérise par la présence plus que résiduelle du premier dans les seconds. C’est surtout vrai au collège, pour des raisons essentiellement « culturelles », ainsi que l’a constaté, en 2010, une mission d’information de notre Commission, en s’appuyant sur les analyses de l’historien et ancien recteur Philippe Joutard.
Selon le rapport de cette mission, « le chemin à parcourir vers des programmes réellement adossés au socle commun risque d’être encore long, car certaines disciplines – les sciences – sont plus "allantes" que les autres. Devant la mission, M. Philippe Joutard, historien, a parfaitement mis en évidence les différentes approches entre les disciplines scientifiques et les disciplines dites culturelles, qui a pour effet de retarder l’assimilation du socle commun par l’ensemble des programmes. Selon lui, les programmes des disciplines scientifiques – mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre et technologie – montrent clairement comment ces disciplines participent à l’acquisition des compétences 1 – la maîtrise de la langue française –, 4 – la maîtrise des technologies de l’information et de la communication –, et 2 – la pratique d’une langue vivante étrangère (mais en partie seulement). À l’inverse, pour les "humanités" – le français, les langues vivantes étrangères et le latin-grec – ainsi que pour l’histoire, la géographie et l’éducation civique, on ne constate pas un tel effort. Les programmes correspondants ignorent la notion des thèmes de convergence, tandis que le socle commun n’y fait que des apparitions – parfois dans le chapeau introductif d’un programme qui explique ensuite en quoi celui-ci est plus important » (161).
Il est vrai aussi que, jusqu’à présent, l’élaboration des programmes du premier cycle du second degré s’est référée à ceux du lycée général, qui eux-mêmes s’inspirent des savoirs universitaires d’excellence. Le futur Conseil supérieur des programmes aura donc un grand rôle à jouer vis-à-vis du collège, car il pourra donner une identité propre aux enseignements qui y sont dispensés, en lien avec le socle commun.
De même, il y a peu de place pour l’interdisciplinarité au collège alors que ce niveau d’enseignement devrait accueillir des champs disciplinaires plus larges, qui intéresseraient davantage les élèves aux contenus et favoriseraient une plus grande continuité entre le primaire et le premier cycle du secondaire. Le CSP devrait être le bras armé d’une telle politique en suivant la voie empruntée avec succès par l’enseignement intégré de sciences et technologie (EIT) expérimenté depuis 2006 en partenariat avec l’Académie des sciences.
L’expérimentation de l’« enseignement intégré de science et de technologie » (EIST)
L’expérimentation de l’« enseignement intégré de science et de technologie » (EIST) est mise en œuvre dans le cadre de l’article 34 de la loi du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École.
L’EIST consiste à associer en classes de 6ème et de 5ème les disciplines scientifiques expérimentales (sciences physiques et chimiques et sciences de la vie et de la terre) à la technologie.
En classe de 6ème, l’horaire hebdomadaire « traditionnel » est d’1 heure 30 dans chacune des deux matières au programme, à savoir la technologie et les sciences de la vie et de la terre (SVT). Il passe, dans le cadre de l’EIST, à 3 heures 30 par élève, composé d’1 heure 30 de technologie, d’1 heure 30 de SVT auxquelles est ajoutée 0,5 heure de sciences physiques et chimiques, discipline non enseignée en classe de 6ème. En classe de 5ème, le volume horaire n’est pas modifié par rapport au volume horaire officiel, soit 4,5 heures.
Les modalités de mise en œuvre sont les suivantes : les élèves de deux classes de 6ème ou de 5ème sont répartis en trois groupes identiques en nombre d’élèves. Chaque groupe reçoit 3,5 heures d’enseignement de « sciences et technologie » pour la 6ème et 4,5 heures pour la 5ème intégrant les trois disciplines. Ce cours, construit à partir des thèmes de convergence des programmes disciplinaires, est assuré par un seul enseignant tout au long de l’année. Par ailleurs, l’organisation du service des enseignants volontaires participant à cet enseignement n’est pas modifiée.
Enfin, les problèmes actuels de « cohabitation » entre le socle commun et les programmes devraient, à terme, inciter le conseil supérieur des programmes à proposer des solutions permettant de dépasser cette double injonction. En matière de transmission des savoirs, l’acquisition du socle devrait être la première ambition de l’école.
● Les examens et les concours
Le Conseil supérieur des programmes pourra également exercer son pouvoir de proposition dans deux domaines constituant, pour l’essentiel, de vraies « nouveautés » par rapport au champ de compétences du Haut conseil de l’éducation et du défunt Conseil national des programmes :
– la nature et le contenu des épreuves des examens conduisant aux diplômes nationaux de l’enseignement du second degré. Le CSP devra donc se pencher sur l’évolution du diplôme national du brevet et son articulation avec la validation du socle commun, ainsi que sur l’évolution des différents baccalauréats, général, technologique et professionnel ;
– la nature et le contenu des épreuves des concours de recrutement d’enseignants des premier et second degrés, la conception générale de la formation des enseignants et les grands objectifs de formation à atteindre. On rappellera qu’en la matière, la compétence du HCE se limite actuellement à émettre des avis et à formuler des propositions, à la demande du ministre, sur les « questions relatives à » la formation des enseignants.
On ne saurait trop insister sur l’importance, décisive pour l’avenir de notre système éducatif, de ces dispositions.
À condition que le Conseil supérieur des programmes bénéficie d’une réelle légitimité, celui-ci pourra suggérer des évolutions utiles en ce qui concerne le brevet et la prise en compte, par celui-ci, du socle commun et les différents baccalauréats. En effet, on ne pourra modifier, en profondeur, l’enseignement secondaire et son organisation excessivement disciplinaire qu’en révisant les modalités d’obtention des diplômes qui en constituent le « couronnement » et qui pilotent, de ce fait, son offre de formation.
De même, le Conseil supérieur des programmes pourra assister utilement les ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche dans l’élaboration du cadre national des formations dispensées par les masters liés aux métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation et d’une maquette des concours de recrutement des enseignants fondés, tous deux, sur une plus grande prise en compte des qualités professionnelles des candidats et le développement de leurs savoir-faire pédagogiques. La réussite de la refondation pédagogique étant conditionnée par les modalités de formation et de recrutement des maîtres, la nouvelle instance aura une carte essentielle à jouer en la matière.
Sur ce point, le Conseil économique, social et environnemental a toutefois estimé, dans son avis sur l’avant-projet de loi, que la notion de « contenu » des épreuves des concours de recrutement nécessiterait d’être précisée, le Conseil supérieur des programmes pouvant difficilement se prononcer sur chacune d’entre elle (162). En réalité, les dispositions proposées n’ont pas pour objet, selon le ministère de l’éducation nationale, de rendre le nouvel organisme garant de la validité de chaque épreuve ou sujet de concours ou d’examen, mais de l’amener à définir, grâce à son pouvoir de proposition, les principes permettant de mettre en place un système d’évaluation correspondant aux objectifs de la formation, celle des élèves comme celle des professeurs.
d) Une information étendue et régulière du Parlement
L’article L. 231-16 nouveau du code de l’éducation prévoit que le Conseil supérieur des programmes établira un rapport annuel sur ses travaux et les suites qui leur ont été données, rapport remis au ministre chargé de l’éducation.
Ces dispositions devraient permettre à la nouvelle instance de « peser » face à l’exécutif et de jouer tout son rôle dans la refondation de notre école.
En effet, on peut parier que ce droit de suite donné aux propositions du conseil aura pour conséquence d’« obliger » quelque peu le ministre en ce qui concerne la rénovation des contenus d’enseignement et des modalités de formation et de recrutement des enseignants. De fait, comment ce dernier pourrait-il mettre en place une instance de pilotage pour, ensuite, s’affranchir de ses propositions, au risque de voir celui-ci faire état du manque de considération accordée à son travail ? En réalité, la refondation pédagogique ne pourra avoir lieu que si l’exécutif et le Conseil supérieur des programmes acceptent pleinement le rôle « d’aiguillon » que ce dernier doit jouer en la matière.
En outre, comme le rapport établi par le CSP sera transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et que ses avis et propositions seront rendus publics, on peut penser que les responsables politiques et administratifs de l’éducation nationale seront d’autant plus « enclins » à tenir compte de ses recommandations.
Par ailleurs, la transmission de ce rapport au Parlement sera l’occasion pour lui de s’emparer, de manière plus régulière qu’aujourd’hui, des questions liées aux objectifs de la formation des élèves et des enseignants. Les assemblées pourront ainsi assumer leurs responsabilités dans ces deux domaines, qui sont éminentes, mais doivent être bien comprises. En effet, pour ne prendre que l’exemple des programmes d’histoire, au lieu de porter des jugements péremptoires sur le « comment on enseigne telle question sensible » – par exemple, la colonisation, ce type d’intervention hors du domaine législatif étant anticonstitutionnel –, le parlement pourra débattre, fort opportunément, sur une problématique qui, elle, relève de son ressort : l’enseignement de cette discipline doit-il être une histoire de France, de l’Europe ou du monde ?
e) L’organisation et le fonctionnement du CSP
● Des modalités fixées par décret
L’article L. 231-17 nouveau du code de l’éducation propose que l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur des programmes soient précisés par décret. Sa mise en place prendra donc effet dès la publication de ce décret et de l’arrêté de nomination de ses membres. Selon l’étude d’impact jointe au projet de loi, cet arrêté respectera le principe de parité entre les femmes et les hommes.
C’est déjà un décret simple (n° 2005-999 du 29 août 2005) qui régit actuellement le Haut conseil de l’éducation (HCE). Il y a lieu de noter que ce texte prévoit qu’afin de présenter le bilan annuel des résultats du système éducatif, le HCE est assisté d’un « comité consultatif ».
Présidé par le président du Haut conseil, qui le réunit, cet organe est composé de personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre de l’éducation nationale et choisies parmi des représentants des organisations syndicales et professionnelles, de parents d’élèves, d’élèves, des associations et de toutes autres personnes ayant une activité dans les domaines qui sont de sa compétence (article D. 230-5 du code de l’éducation).
Il serait souhaitable qu’après la suppression du HCE, ce comité ait un successeur, ce qui permettrait de faciliter la consultation du monde de l’éducation. Celui-ci pourrait être d’ailleurs placé utilement auprès des deux conseils que le projet de loi prévoit de créer, c’est-à-dire le Conseil supérieur des programmes et le Conseil national d’évaluation du système éducatif.
● Un coût budgétaire limité
L’étude d’impact indique que, à l’instar du conseil national d’évaluation du système éducatif, le financement du fonctionnement du Conseil supérieur des programmes se fera « principalement par redéploiement des économies générées par la suppression du Haut conseil à l’éducation », pour lequel le ministère dépense aujourd’hui 500 000 euros chaque année.
3. Les améliorations apportées par la Commission
La Commission a précisé que le Conseil supérieur des programmes devra travailler en toute indépendance, afin qu’il puisse exercer ses missions dans la transparence et sans soupçon de « collusion » avec le pouvoir en place.
Elle a en outre amélioré les modalités de désignation de ses membres :
– d’une part, en prévoyant, à l’initiative du rapporteur, que les deux députés et deux sénateurs membres du conseil seront désignés, respectivement, par les commissions compétentes en matière d’éducation de l’Assemblée nationale et du Sénat. En effet, la rédaction initiale de l’alinéa 6 de l’article 20 précisait les modes de désignation des représentants du Conseil économique, social et environnemental et des personnalités qualifiées au Conseil supérieur des programmes, sans indiquer celui des parlementaires ;
– d’autre part, en intégrant l’objectif constitutionnel d’égal accès des femmes et des hommes à toutes les fonctions par l’adoption d’une disposition prévoyant que le conseil sera composé selon le principe de parité.
Enfin, la Commission a élargi le champ d’intervention du Conseil supérieur des programmes. Cette instance pourra non seulement formuler des propositions, mais aussi émettre des avis. Sa compétence a été de surcroît étendue à la conception générale de la formation continue des enseignants et à l’introduction du numérique dans les méthodes pédagogiques et la construction des savoirs, ce dernier ajout résultant d’une initiative du rapporteur.
*
La Commission est saisie de l’amendement AC 148 de M. Patrick Hetzel.
M. Frédéric Reiss. Cet article créant le Conseil supérieur des programmes (CSP) doit être supprimé et le Haut conseil de l’éducation maintenu en raison de son indépendance.
M. le rapporteur. Avis défavorable, même si le Haut conseil a correctement accompli son travail. L’institution du CSP et du Conseil national d’évaluation du système éducatif permettra de poursuivre l’œuvre engagée.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine les amendements identiques AC 113 et AC 194 de M. Frédéric Reiss.
M. Frédéric Reiss. Plutôt que la création du CSP, nous souhaitons permettre la saisine du Haut conseil de l’éducation par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.
Elle examine ensuite l’amendement AC 478 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. Il convient de substituer au mot « programmes » les mots « contenus éducatifs ». Si nous sommes très satisfaits de la création du CSP et si tous les programmes doivent être revus, cette instance ne doit cependant pas se focaliser sur les seuls programmes scolaires. Il faudrait plutôt promouvoir une vision plus globale des contenus éducatifs en veillant notamment à leur bonne articulation avec le socle de connaissances.
Les programmes doivent également être pensés dans une logique englobant la totalité du temps éducatif : temps scolaire, périscolaire et extrascolaire.
M. le rapporteur. Le CSP n’aura compétence que sur ce qui est obligatoirement enseigné dans le cadre strictement scolaire, et non sur les activités périscolaires même si celles-ci ont bien évidemment un contenu éducatif. Avis défavorable.
Je vous invite à retirer votre amendement qui soulève certes un vrai problème mais qui ne le règle pas de façon satisfaisante.
Mme Barbara Pompili. Je le retire, mais je rappelle que le CSP traite également du socle commun, champ qui outrepasse celui des programmes stricto sensu.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement AC 479 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. Le CSP doit travailler en toute indépendance.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 408 de Mme Martine Faure.
Mme Lucette Lousteau. Il convient d’introduire le principe de parité entre les hommes et les femmes dans l’ensemble des instances chargées de la refondation de l’école.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
La Commission examine les amendements AC 574, AC 706 et AC 707 de Mme Marie-George Buffet, pouvant faire l’objet d’une présentation commune.
Mme Marie-George Buffet. Il nous semble nécessaire d’associer un plus grand nombre d’enseignants à la réflexion sur les programmes, celle-ci devant tenir compte de la pratique et du temps nécessaire à l’appropriation pédagogique par les professionnels qui doivent la mettre en œuvre.
M. le rapporteur. Avis défavorable car il ne convient pas d’accroître le nombre de membres du CSP si l’on veut qu’il puisse travailler correctement. D’autre part, les enseignants pourraient se faire entendre dans le cadre d’un comité consultatif installé auprès du conseil.
Je vous invite à retirer vos amendements, quitte à les représenter en vue de la séance publique de sorte que le ministre puisse ensuite préciser ses intentions.
Mme Marie-George Buffet. Je ferai ainsi.
Les amendements sont retirés.
La Commission examine en discussion commune les amendements AC 210 de M. Thierry Braillard et AC 659 du rapporteur.
M. Thierry Braillard. Mon amendement est en faveur de la parité mais, cette fois, entre les personnalités qualifiées et les représentants du Sénat, de l'Assemblée nationale et du Conseil économique, social et environnemental.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
Mon amendement vise quant à lui à préciser la procédure de désignation des parlementaires, celle-ci étant confiée aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat en matière d’éducation. Monsieur le président, vous ne pouvez qu’y être favorable !
M. le président Patrick Bloche. Absolument !
M. Xavier Breton. Nous soutenons l’amendement de M. Thierry Braillard car la représentation paritaire nous semble importante, les personnalités qualifiées désignées par le ministre de l’éducation nationale ne devant pas être majoritaires au sein du CSP.
M. le rapporteur. Le CSP étant chargé de se prononcer sur les programmes, il me semble essentiel qu’il compte en son sein une majorité de « spécialistes » de ces questions même si des représentants de la nation doivent bien évidemment en faire partie. Il en va de son efficacité
L’amendement AC 210 est retiré.
La Commission adopte l’amendement AC 659.
La Commission examine les amendements AC 740 de M. Rudy Salles, AC 480 de Mme Barbara Pompili, AC 211 de M. Thierry Braillard et AC 179 de Mme Barbara Pompili, pouvant faire l’objet d’une présentation commune.
M. Rudy Salles. Par l’amendement AC 740, nous proposons que les dix personnalités qualifiées soient désignées par cette autorité collégiale, représentant les personnels, les usagers et les partenaires de l’État dans l’action éducative, qu’est le Conseil supérieur de l’éducation.
Mme Barbara Pompili. L’amendement AC 480 vise à ce que ces personnalités qualifiées soient désignées après avis des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. En outre, ce collège doit être composé pour moitié d’enseignants en activité et pour moitié de personnes issues de la société civile et des milieux artistiques et culturels.
M. Thierry Braillard. Parmi les dix personnalités qualifiées nommées par le ministre, l’une d’entre elles au moins doit être spécialisée dans les questions de prise en compte des différents handicaps. Tel est le sens de l’amendement AC 211.
Mme Barbara Pompili. L’amendement AC 179 va dans le même sens en proposant que soient représentés parmi les personnalités qualifiées les parents des enfants en situation de handicap. L’adaptation des contenus étant nécessaire, cette disposition s’impose.
M. le rapporteur. Avis défavorable à l’ensemble de ces amendements, qui relèvent du règlement et non de la loi.
M. Braillard et Mme Pompili peuvent éventuellement retirer les leurs et les redéposer en vue de la séance publique pour que le ministre, le cas échéant, s’engage sur une circulaire.
M. Thierry Braillard. Je retire l’amendement AC 211.
L’amendement AC 211 est retiré.
Mme Barbara Pompili. Je retire également l’amendement AC 179 compte tenu de ce que vient de dire M. le rapporteur et je le redéposerai donc.
Je maintiens en revanche l’amendement AC 480 mais, pour tenir compte des remarques de M. le rapporteur, je suis prête à le scinder en ne gardant pour l’heure que la première phrase, la seconde donnant matière à un autre amendement que je présenterai pour la séance publique.
M. le rapporteur. Mon avis demeure identique sur cet amendement ainsi réduit : les nominations seraient dans ce cas politiques, fût-ce au sens noble, alors que le CSP ne doit pas être prisonnier de telle ou telle majorité. Son travail, de surcroît, est d’ordre technique.
Mme Barbara Pompili. Le ministre sera de toute façon soupçonné de procéder à des désignations politiques, mais il pourrait en aller différemment si ces dernières résultaient d’un débat parlementaire.
L’amendement AC 179 est retiré.
La Commission rejette successivement les amendements AC 740 et AC 480.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AC 636 du rapporteur.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements AC 637 du rapporteur et AC 575 de Mme Marie-George Buffet.
M. le rapporteur. L’amendement AC 637 vise à inclure dans les missions du CSP la formulation de propositions sur l’introduction du numérique dans les méthodes pédagogiques et dans la construction des savoirs.
Mme Marie-George Buffet. L’amendement AC 575 ayant le même objectif, je le retire – même si je le trouve plus complet ! – en faveur de celui du rapporteur.
L’amendement AC 575 est retiré.
La Commission adopte l’amendement AC 637.
Elle examine ensuite l’amendement AC 212 de M. Thierry Braillard.
M. Thierry Braillard. Il convient d’adapter les programmes aux élèves atteints d’un handicap.
M. le rapporteur. Cela ne relève pas de la loi.
L’amendement AC 212 est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 481 de Mme Barbara Pompili.
Elle examine ensuite l’amendement AC 576 de Mme Marie-George Buffet.
Mme Marie-George Buffet. Je souhaite que le CSP formule des propositions sur la conception générale de la formation « initiale et continue » des enseignants.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement AC 247 de M. Guénhaël Huet.
Elle examine l’amendement AC 577 de Mme Marie-George Buffet.
Mme Marie-George Buffet. Je demande que le CSP formule des projets de programmes et soit organisé, d’autre part, en groupes techniques incluant des représentants des divers ordres d’enseignement.
M. le rapporteur. Avis défavorable : tout cela relève du règlement.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AC 29 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 20 modifié.
Section 3
Le Conseil national d’évaluation du système éducatif
Article 21
Création du Conseil national d’évaluation du système éducatif
Cet article vise à insérer au titre IV du livre II du code de l’éducation un nouveau chapitre instituant un Conseil national d’évaluation du système éducatif.
1. La nécessité de créer un « évaluateur » du système éducatif qui dispose d’une vision d’ensemble de son fonctionnement et de son efficacité
Représentant le premier budget de l’État, l’enseignement scolaire doit être, comme toute politique publique, évalué de manière rigoureuse et régulière. Du point de vue de la nation, c’est une exigence à la fois démocratique et économique, qui doit être d’autant plus satisfaite que l’école est en difficulté.
Pourtant, dans notre pays, la question de l’évaluation est polémique, tant elle a été, pour reprendre le terme du rapport de la concertation, « dévoyée » (163).
Il n’est qu’à prendre l’exemple de la méthodologie des évaluations des acquis des élèves à l’école primaire, sévèrement critiquée par le Haut conseil de l’éducation (HCE) lui-même. Le protocole des évaluations de CE1 mis en place par le précédent gouvernement prévoyait que tous les enseignants faisaient passer les évaluations à leurs propres élèves et les corrigeaient, les résultats étant ensuite agrégés au niveau national pour en tirer des indicateurs globaux.
Or, selon le HCE, « il n’est pas de bonne méthode de confondre deux types d’évaluation : d’une part les évaluations dans la classe dont l’enseignant a régulièrement besoin pour adapter son enseignement en fonction des acquis de ses élèves, d’autre part une évaluation nationale destinée au pilotage du système éducatif. Cette confusion est manifeste en ce qui concerne les évaluations de CE1, ainsi que l’attestent les finalités multiples avancées par le ministère de l’éducation nationale ». Le HCE en a conclu que ces évaluations « ne peuvent servir de support à l’élaboration rigoureuse d’un indicateur de pilotage du système éducatif relatif aux acquis » (164).
De même, les indicateurs annuels fournis au Parlement à l’appui des projets de loi de finances et de loi de règlement ne sont pas satisfaisants – ils sont d’ailleurs en cours de révision. À titre d’illustration, le HCE a mis en lumière le fait que les proportions d’élèves maîtrisant les « compétences de base » en français et en mathématiques, en fin d’école primaire et de collège, « ne sont pas à même de nous renseigner réellement sur le degré de maîtrise du socle commun par les élèves ». En particulier, ces indicateurs se limitent à une compétence et demie sur les sept que comporte le socle, tandis que « la forme de l’évaluation – questionnaire à choix multiple (QCM) – ne permet pas de prendre en compte des capacités aussi essentielles que l’expression écrite ou orale en français, ou la construction de figures géométriques en mathématiques » (1).
Plus généralement, les instances d’évaluation de notre système éducatif sont, aujourd’hui, soit non indépendantes, soit « externalisées », soit mobilisées par d’autres missions, ce qui n’est évidemment guère satisfaisant :
– non indépendantes. En effet, le décret n° 2006-572 du 17 mai 2006 fixant l’organisation de l’administration centrale des ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche confie à la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) la conception et la mise en œuvre, à la demande des autres directions, d’un programme d’évaluations, d’enquêtes et d’études sur tous les aspects du système éducatif et de recherche. Ce service doit assurer, par ailleurs, la cohérence de la mesure de la performance aux niveaux national et territorial et calculer les indicateurs de performance que les directions et les services déconcentrés mettent en œuvre dans les programmes budgétaires ;
– externalisées. À l’heure actuelle, ce sont, dans une large mesure, les évaluations de l’OCDE, c’est-à-dire PISA, et les enquêtes de la Cour des comptes sur l’éducation nationale (165)qui, aux yeux des médias et du public, permettent de diagnostiquer les performances de l’école. Peut-on cependant s’appuyer sur les seuls travaux, publiés tous les trois ans, d’une organisation internationale pour piloter notre système éducatif ? Cette question vaut aussi pour les rapports – remarquables – de la Cour des comptes, car cet organe de contrôle n’a pas pour seule mission d’assurer l’évaluation du ministère de l’éducation nationale.
La situation est d’autant plus paradoxale qu’il existe des indicateurs nationaux, peu connus, mais rigoureux pour mesurer les acquis des élèves au regard des objectifs fixés par les programmes disciplinaires : le cycle des évaluations disciplinaires réalisées sur échantillon (CEDRE), ce dispositif ayant été mis en place en 2003 ;
– mobilisées par d’autres missions. C’est le défaut du HCE qui exerce son « droit de regard » consultatif sur l’élaboration des programmes, sur les résultats du système éducatif et sur la formation des enseignants. C’est trop pour lui permettre de se consacrer pleinement à la fonction d’évaluation, le Haut conseil s’étant d’ailleurs substitué à deux organismes, le Conseil national des programmes institué par la loi du 10 juillet 1989 et le Haut conseil de l’évaluation de l’école, créé par un décret du 27 octobre 2000 et supprimé par un décret du 13 juillet 2004. Ce dernier organisme avait d’ailleurs noté, il y a près de huit ans mais ce constat reste valable, que « les travaux d’évaluation du système éducatif français, dont certains sont novateurs et particulièrement intéressants, ne s’inscrivent pas vraiment dans un dispositif d’évaluation d’ensemble du système et ne sont pas suffisamment utilisés pour son orientation » (166).
L’activité du Haut conseil de l’éducation (HCE)
Cet organisme consultatif a été institué par l’article 14 de la loi du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École (loi « Fillon »). À la demande du ministre chargé de l’éducation nationale, il peut émettre un avis et formuler des propositions sur la pédagogie, les programmes, les modes d’évaluation des connaissances des élèves, l’organisation et les résultats du système éducatif et la formation des enseignants (article L. 230-2 du code de l’éducation). Depuis son institution, le 8 novembre 2005, il a rendu six avis (dont le dernier porte sur l’avant-projet de loi d’orientation et de programmation) et trois recommandations (sur le socle commun, la « maîtrise du corps » et le socle, la formation des maîtres).
Par ailleurs, le HCE remet au Président de la République un bilan annuel, rendu public et transmis au Parlement, des résultats du système éducatif (article L. 230-2 du code) ainsi que des expérimentations menées sur le terrain (article D. 230-5 du code). À ce titre, il a publié sept rapports (sur l’école primaire en 2007 ; sur l’orientation scolaire en 2008 ; sur l’enseignement professionnel en 2010 ; sur le collège en 2010 ; sur les indicateurs relatifs aux acquis et la mise en œuvre du socle commun en 2011 ; sur les grands enjeux du système éducatif en 2012) et deux notes au ministre de l’éducation nationale (sur les expérimentations réalisées sur le fondement de l’article 34 de la loi du 23 avril 2005 et sur le numérique à l’école).
À titre de comparaison, le défunt Haut conseil de l’évaluation de l’école, qui était chargé de donner un avis sur le programme annuel des évaluations conduites par le ministère de l’éducation nationale et d’établir, chaque année, un rapport sur l’état de l’évaluation du système éducatif, a publié 19 avis et 19 rapports entre janvier 2001 et octobre 2005.
Ces observations plaident en faveur de la création d’une instance d’évaluation indépendante qui puisse disposer, ainsi que le précise le rapport annexé au projet de loi, à la fois d’une « vision globale du fonctionnement et de l’efficacité du système éducatif » et de l’indépendance et de l’expertise nécessaires pour apporter une aide à la décision politique et à la mise en œuvre de réformes éducatives.
2. Le dispositif proposé par le projet de loi
Le I du présent article prévoit d’insérer, au titre IV du livre II du code de l’éducation, un chapitre Ier bis consacré au conseil national d’évaluation du système éducatif (CNE). Ainsi, ce nouveau chapitre fera suite au chapitre Ier relatif à l’exercice des missions d’inspection et d’évaluation.
a) Une mission d’évaluation approfondie de l’enseignement scolaire et des modalités de saisine novatrices
● La mission d’évaluation
Le CNE aura pour ambition de rendre lisible et transparent l’ensemble du processus d’évaluation. De cette manière, il sera le bras armé de l’État en ce qui concerne le « contrôle et l’évaluation des politiques éducatives », la loi ayant précisé qu’il « assume » ces missions « en vue assurer la cohérence d’ensemble du système éducatif » (article L. 211-1 du code de l’éducation).
Aux termes de l’article L. 241-12 nouveau du code, le nouvel organisme sera chargé d’évaluer « l’organisation et les résultats de l’enseignement scolaire ».
Son champ d’investigation couvrira donc toutes les composantes de cet enseignement : l’enseignement public du premier degré, l’enseignement public du second degré et l’enseignement privé sous contrat du premier et du second degré. Selon les précisions apportées par le ministère de l’éducation nationale, il pourra inclure aussi l’enseignement technique agricole et l’apprentissage, dès lors que les évaluations du conseil porteront sur les parcours des jeunes et les diplômes acquis.
En outre, comme il évaluera « l’organisation et les résultats » de cet enseignement, ses investigations s’étendront, de fait, aux politiques éducatives elles-mêmes, ce qui permettra à la nation de juger de la pertinence des orientations de la refondation.
● Les modalités de saisine
On rappellera qu’à l’heure actuelle le HCE n’émet que des avis ou des recommandations, à la demande du ministre de l’éducation nationale, sur les modes d’évaluation des connaissances des élèves, et publie un bilan annuel, remis au Président de la République, sur les résultats obtenus par le système éducatif.
À l’inverse, le CNE non seulement réalisera ou fera réaliser – à l’instar du HCE, il pourra demander des études à des experts – des évaluations, mais ses travaux pourront être diligentés à son initiative ou à la demande des ministres compétents ou des présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Le CNE bénéficiera ainsi de modalités de saisine améliorées par rapport au HCE :
– il pourra en effet « s’autosaisir », alors que le HCE ne peut actuellement choisir que le thème du bilan annuel remis au Président de la République ;
– le ministre de l’éducation nationale ne sera pas, au sein du gouvernement, le seul « commanditaire » du nouvel organisme. Des évaluations pourront en effet lui être demandées par « d’autres ministres disposant de compétences en matière d’éducation » – par exemple, le ministre chargé de l’agriculture – et par le ministre chargé de la politique de la ville. Sur ce dernier point, chacun conviendra que le volet éducatif de la politique de la ville – qui représente plus de 150 millions d’euros et repose, entre autres, sur les « projets de réussite éducative » en zone urbaine sensible (ZUS) et le programme « Ville Vie Vacances » – est suffisamment important pour justifier la saisine du CNE par le ministre compétent ;
– enfin, des évaluations pourront être également réalisées à la demande du président de l’Assemblée nationale et du président du Sénat. Il est en effet logique que les assemblées, qui représentent la nation et ses territoires et adoptent chaque année les crédits de l’enseignement scolaire, puissent s’appuyer sur l’expertise du CNE pour mener à bien, dans le domaine de l’éducation, leur mission constitutionnelle de contrôle de l’action du gouvernement.
Grâce à ce dispositif, l’évaluation de l’école ne pourra plus se faire isolément, à la convenance du seul ministre de l’éducation nationale – ce qui constituera une réelle avancée pour les usagers du service public de l’éducation.
b) Un champ d’investigation cohérent
Le champ d’investigation du Conseil national d’évaluation ne se limitera pas à sa compétence « générale » d’évaluation de l’organisation et des résultats de l’enseignement scolaire.
En effet, indépendamment de toute saisine par une autorité extérieure, il sera également chargé de :
– se prononcer sur les méthodologies et les outils des évaluations conduites par le ministère de l’éducation nationale. On observera qu’en la matière, les compétences actuelles du HCE se limitent « aux modes d’évaluations des connaissances des élèves » – sans se référer explicitement à la manière dont celles-ci sont choisies, construites et utilisées.
On rappellera en outre que le HCE ne rend des avis ou des recommandations sur ce sujet qu’à la demande du ministre chargé de l’éducation nationale.
Enfin, si le ministère dispose d’une direction chargée de l’information statistique, il est important, comme le souligne l’avis du Conseil économique, social et environnemental, qu’elle puisse « travailler à la fois au service de la politique publique mise en œuvre par le ministre mais en toute indépendance quant à la conduite de ses enquêtes et à la publication des résultats » (167), ce que permettra l’installation du nouvel organisme ;
– donner un avis sur les résultats des évaluations des systèmes éducatifs conduites dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux. Cette disposition ne vise pas à contester les travaux effectués dans un cadre « extranational » mais, au contraire, à ancrer leurs apports dans notre politique d’évaluation et à enrichir ainsi le débat public sur la qualité de notre école. D’ailleurs, le Haut conseil de l’évaluation de l’école (2000-2005) comptait parmi ses missions l’« expertise des évaluations externes du système éducatif » (article 2 du décret n° 2000-1060 du 27 octobre 2000).
Selon les précisions apportées par le ministère de l’éducation nationale, les évaluations visées par cette disposition sont PISA, le programme PIRLS (compétences de lecture en fin de CM1), l’enquête européenne sur les compétences en langues (SurveyLang) et les évaluations du type Trends in International Mathematics and Science (TIMS) ou Teaching And Learning International Survey (TALIS). Seront également concernées les comparaisons internationales sur les grands indicateurs des systèmes éducatifs, comme par exemple la dépense intérieure d’éducation ou les niveaux de diplômes des jeunes.
c) Une composition solennelle, élargie et donnant toute leur place aux compétences scientifiques
En son temps, le Haut conseil de l’évaluation de l’école comprenait trente-cinq membres, dont un député et un sénateur, un maire, un conseiller général et un conseiller régional, trois représentants des parents d’élèves, six représentants des enseignants, un représentant d’une association éducative complémentaire de l’enseignement public et douze personnalités qualifiées, françaises ou étrangères, choisies pour leurs compétences en matière d’évaluation et d’éducation.
Le Haut conseil de l’éducation ne comprend, lui, que neuf membres désignés pour six ans, trois étant désignés par le Président de la République, deux par le président de l’Assemblée nationale, deux par le président du Sénat et deux par le président du Conseil économique, social et environnemental en dehors des membres de ces assemblées, le législateur n’ayant pas exigé de ces personnalités qu’elles aient une compétence reconnue en matière d’évaluation (article L. 230-1 du code de l’éducation).
Par rapport à l’existant, le présent article permettra de donner au Conseil national d’évaluation du système éducatif une plus grande caution démocratique et scientifique. Par ailleurs, la composition solennelle de cet organisme lui apportera l’indépendance et l’autorité nécessaires à l’exercice des missions qui lui seront confiées.
Dans ce double but, l’article L. 241-13 nouveau du code de l’éducation prévoit de donner au conseil une composition à la fois large et équilibrée. Le CNE comprendra, au total, quatorze membres, soit :
– deux députés et deux sénateurs, la présence de membres du Parlement devant formaliser l’importance que celui-ci attache aux enjeux de l’évaluation de l’enseignement scolaire ;
– deux membres du Conseil économique, social et environnemental, désignés par le président de ce Conseil. Leur présence se justifie eu égard au rôle de représentation de la société civile qui est reconnu à cette institution ;
– et huit personnalités, qui représenteront ainsi plus de la moitié des membres du conseil, choisies pour « leurs compétences en matière d’évaluation ou dans le domaine éducatif » par le ministre chargé de l’éducation nationale. Cette dernière disposition est évidemment fondamentale, car elle devra conduire le ministre à désigner des experts dont la mission sera de fournir aux acteurs de l’école une évaluation scientifique incontestable et incontestée, indispensable pour être reconnue et utilisée.
Enfin, la durée du mandat des membres sera limitée à cinq ans, un rythme de renouvellement équivalent à celui proposé pour le Conseil supérieur des programmes.
d) Un fonctionnement qui sera transparent et préservera l’évaluation des expérimentations
● Une exigence de publicité des travaux du conseil
● Chaque année, le Conseil national d’évaluation devra remettre un rapport sur ses travaux au ministre chargé de l’éducation nationale. Ce rapport sera transmis ensuite au Parlement (article L. 241-14 nouveau du code de l’éducation).
Il y a lieu de noter que les exigences de publicité et de communication formulées à l’égard du Haut conseil de l’évaluation de l’école, supprimé en 2004, ne s’étendait pas au Parlement – le président de cet organisme devait seulement présenter un rapport annuel sur l’état de l’évaluation du système éducatif au Conseil supérieur de l’éducation. En revanche, le document présenté à cette occasion devait faire état de « l’impact des recommandations de ses précédents rapports ».
● Par ailleurs, le rapport annuel sur les travaux du CNE, ainsi que ses avis, seront rendus publics.
L’information du Parlement en matière d’évaluation de notre système éducatif sera ainsi considérablement renforcée. Celle-ci ne repose, pour l’heure, que sur des apports internes ou externes qui présentent, à des degrés divers, certaines limites :
– les indicateurs des projets annuels de performances (PAP) annexés aux lois de finances et des rapports annuels de performances (RAP) annexés aux lois de règlement, dont on a vu que leur méthodologie est aujourd’hui remise en cause ;
– le bilan de l’école dressé par le Haut conseil de l’éducation, qui n’est publié qu’une fois par an ;
– enfin, les rapports des inspections générales de l’éducation nationale et de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche – à la condition toutefois que les ministres compétents les rendent publics… Le précédent gouvernement avait adopté en la matière une stratégie, inacceptable, de « black-out ».
● Une organisation et un fonctionnement précisés par décret
L’organisation et le fonctionnement du conseil seront précisés par décret (article L. 241-15 nouveau du code de l’éducation). À cet égard, il serait souhaitable qu’un comité consultatif, composé de personnalités qualifiées et choisies notamment parmi les représentants des personnels et des parents d’élèves, puisse assister la nouvelle instance, ainsi que le futur Conseil supérieur des programmes.
● Une mission d’évaluation des expérimentations préservée
Les II du présent article tire les conséquences de la création du Conseil national d’évaluation en procédant à une substitution au dernier alinéa de l’article L. 401-1 du code de l’éducation.
La modification proposée aura pour effet de confier l’évaluation de la réalisation d’expérimentations dans les écoles et les établissements au Conseil national d’évaluation et non plus au Haut conseil de l’éducation. Elle permettra ainsi de préserver le principe d’un bilan annuel de ces initiatives, posé par la loi du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École.
On rappellera qu’aux termes de l’article L. 401-1 du code de l’éducation, sous réserve de l’autorisation préalable des autorités académiques, ces dispositifs peuvent porter, dans le cadre du projet d’école ou d’établissement, sur l’enseignement des disciplines, l’interdisciplinarité et l’organisation pédagogique, et ce pendant une durée de cinq ans.
La base Expérithèque du ministère de l’éducation nationale recensait ainsi 1 770 innovations et expérimentations à la date du 27 juillet 2012, le nombre d’innovations et d’expérimentations ayant été multiplié par plus de 4 depuis l’année scolaire 2006-2007. En outre, l’analyse thématique de ces politiques permet de rendre compte :
– de la forte augmentation des actions développant des « approches transversales » (autour du socle ou des technologies de l’information et de la communication) ou menées autour de l’interdisciplinarité ;
– du développement des actions liées à l’individualisation des parcours – cette thématique étant présente dans plus de la moitié des actions ;
– d’un accroissement des actions concernant l’aménagement du temps scolaire.
À ce jour, cependant, un seul bilan de ces initiatives a été rendu public par le HCE (168).
● Un coût budgétaire limité
L’étude d’impact indique que le coût de la création du Conseil national d’évaluation du système éducatif a vocation à être financé par le redéploiement des économies générées par la suppression du HCE. Le budget de ce dernier représente un montant de 500 000 euros qui permettra, en principe, de financer les dépenses de masse salariale et de fonctionnement courant du nouvel organisme, auxquelles s’ajouteront les dépenses liées aux rémunérations des chargés de mission. Par ailleurs, une partie des études découlant des propositions du conseil national d’évaluation pourra être réalisée par les services de la DEPP.
3. Les améliorations apportées par la Commission
À l’instar de ce qu’elle a prévu pour le Conseil supérieur des programmes, la Commission a précisé que le Conseil national d’évaluation du système éducatif devra travailler « en toute indépendance ». Cette exigence sera confortée par l’allongement de la durée du mandat de ses membres de cinq à six ans – suite à l’adoption d’un amendement du rapporteur –, sur le modèle des autorités administratives indépendantes comme le CSA.
En outre, de même que pour son homologue en charge des programmes, la composition du CNE devra respecter le principe de parité entre les femmes et les hommes et les deux députés et deux sénateurs membres devront être désignés, respectivement, par les commissions compétentes en matière d’éducation des deux assemblées.
Enfin, à l’initiative du rapporteur, la compétence du CNE en ce qui concerne les évaluations internationales a été étendue, puisqu’il pourra émettre des recommandations au regard de leurs résultats.
*
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 213 de M. Thierry Braillard, tendant à la suppression de l’article.
Elle rejette de même l’amendement AC 195 de M. Frédéric Reiss tendant à une nouvelle rédaction de l’article. L’amendement AC 214 de M. Thierry Braillard est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 742 de M. Rudy Salles.
Elle est saisie de l’amendement AC 164 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. Le Conseil national d’évaluation doit être chargé d’évaluer, outre l’organisation et les résultats de l’enseignement scolaire, les moyens alloués aux dépenses pédagogiques de manière à assister le ministre de l’éducation nationale dans sa mission de garant de l’égalité d’accès aux ressources pédagogiques des élèves sur l’ensemble du territoire.
M. le rapporteur. Un tel travail relève des Commissions des finances du Parlement ainsi que de la Cour des Comptes.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement AC 482 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. Tout comme le CSP, le Conseil national d’évaluation doit être indépendant.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
Elle examine les amendements AC 30 du rapporteur et AC 150 de M. Patrick Hetzel, pouvant faire l’objet d’une présentation commune.
M. le rapporteur. L’amendement AC 30 est rédactionnel.
M. Xavier Breton. Parce que le Parlement doit pouvoir jouer pleinement son rôle, il convient que des demandes d’évaluation puissent également être formulées par un tiers des députés ou des sénateurs.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
La Commission adopte l’amendement AC 30.
Elle rejette l’amendement AC 150.
La Commission examine l’amendement AC 578 de Mme Marie-George Buffet.
Mme Marie-George Buffet. Il s’agit de préciser les missions du Conseil national d’évaluation.
M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par un texte qu’il ne convient pas de surcroît d’alourdir. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
L’amendement AC 215 de M. Thierry Braillard est retiré.
La Commission examine en discussion commune les amendements identiques AC 127 de Mme Claudine Schmid et AC 743 de M. Rudy Salles, ainsi que l’amendement AC 695 du rapporteur.
Mme Claudine Schmid. Il me semble préférable d’écrire que le conseil « émet des préconisations », formule à connotation active, plutôt qu’il « donne un avis », à connotation plus passive.
M. Rudy Salles. L’amendement AC 743 est ainsi défendu.
M. le rapporteur. Avis défavorable à ces amendements qui sont satisfaits par mon amendement AC 695.
Mme Claudine Schmid. Y a-t-il une telle différence entre « émettre des recommandations », comme vous le proposez, et « émettre des préconisations » que vous ne puissiez accepter nos amendements ?
M. le rapporteur. Ce n’est pas la même chose.
Mme Claudine Schmid. Je maintiens donc mon amendement.
M. Rudy Salles. Par solidarité, je maintiens également le mien.
La Commission rejette les amendements AC 127 et AC 743.
Elle adopte l’amendement AC 695.
La Commission est saisie des amendements identiques AC 128 de Mme Claudine Schmid et AC 744 de M. Rudy Salles.
Mme Claudine Schmid. Je laisse à M. Salles le soin de présenter ces amendements.
M. Rudy Salles. Le pilotage du système éducatif et l’efficacité de son fonctionnement doivent s’appuyer sur les résultats des évaluations d’abord dans les établissements, au plus près de l’action éducative. Il convient donc de compléter les missions de l’instance d’évaluation afin d’aboutir à un tel objectif.
M. le rapporteur. L’évaluation des établissements ne relève pas du Conseil, mais de l’inspection.
La Commission rejette les amendements identiques.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 741 de M. Rudy Salles.
Elle examine l’amendement AC 483 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. Le Conseil doit pouvoir également évaluer les évaluations, notamment le livret personnel de compétences qui n’a pas été établi correctement et doit faire l’objet d’un bilan approfondi.
M. le rapporteur. Votre amendement, qui est mal rédigé, contraindrait le Conseil à s’immiscer dans la pédagogie des enseignants, ce qui va à l’encontre du principe de la liberté pédagogique. Avis défavorable.
Mme Barbara Pompili. Si je précise qu’il donne simplement son avis ?
M. le rapporteur. Le mien ne changerait pas.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie, en discussion commune, des amendements AC 114 de M. Frédéric Reiss et AC 745 de M. Rudy Salles.
M. Xavier Breton. Dans la rédaction actuelle, la composition du conseil national d’évaluation du système éducatif ne répond pas au souci de parité défendu tout à l’heure par M. Thierry Braillard. Pour y remédier, nous proposons par l’amendement AC 114 de ramener à douze le nombre de ses membres, soit quatre parlementaires, deux membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et seulement six personnalités qualifiées.
D’autre part, afin de garantir l’indépendance du conseil, l’amendement prévoit aussi que ces personnalités seront nommées, non plus par le ministère de l’éducation nationale, mais par le président de l’Assemblée nationale, par le président du Sénat et par le président du CESE.
M. Rudy Salles. Pour les mêmes raisons, l’amendement AC 745 propose que le conseil soit composé de vingt-six membres désignés pour cinq ans.
M. le rapporteur. Avis défavorable. J’ai déjà exposé mes arguments au sujet de la composition paritaire parlementaires-personnalités qualifiées.
La Commission rejette successivement les amendements AC 114 et AC 745.
Elle en vient à l’amendement AC 409 de Mme Martine Faure.
Mme Lucette Lousteau. Cet amendement a le même objet que l’amendement AC 408 : instaurer la parité entre hommes et femmes dans toutes les instances créées ou réformées par ce texte.
M. le rapporteur. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AC 708 de Mme Marie-George Buffet.
Mme Marie-George Buffet. Il tend également à modifier la composition du Conseil national d’évaluation du système éducatif.
M. le rapporteur. En faisant passer le nombre de ses membres de quatorze à vingt-sept ! N’est-ce pas excessif ? Je vous suggère de retirer cet amendement.
L’amendement AC 708 est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement AC 638 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il est proposé par cet amendement d’allonger d’un an le mandat des membres du Conseil national d’évaluation du système éducatif, de manière à ce que sa durée ne corresponde pas à celle d’un mandat législatif ou présidentiel. C’est une garantie d’indépendance.
M. Xavier Breton. Avec vous, l’indépendance est à géométrie variable !
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement de coordination AC 639, également du rapporteur.
Suivant l’avis défavorable de ce dernier, elle rejette l’amendement AC 709 de Mme Marie-George Buffet.
Elle en vient à l’examen des amendements AC 484 et AC 677 de Mme Barbara Pompili, pouvant faire l’objet d’une présentation commune.
Mme Barbara Pompili. Ces amendements visent à ouvrir le collège des personnalités qualifiées à des personnes choisies pour leurs compétences dans le domaine artistique et culturel. Pour aborder les questions d’éducation dans toute leur complexité, le conseil doit être pluriel.
M. le rapporteur. Je crains que cette ouverture ne conduise à diluer la mission du conseil, qui est d’évaluer les politiques scolaires. Pour que le dispositif soit efficace, il faut qu’il soit ciblé. La préoccupation exprimée est sympathique mais je suis défavorable aux deux amendements.
La Commission rejette successivement les amendements AC 484 et AC 677.
Elle est ensuite saisie, en discussion commune, des amendements AC 410 de Mme Valérie Corre et AC 180 de Mme Barbara Pompili.
Mme Valérie Corre. L’amendement AC 410 vise à assurer la représentation des parents d’élèves au sein du Conseil national d’évaluation du système éducatif.
Mme Barbara Pompili. Dans le même esprit, il est proposé par l’amendement AC 180 qu’au moins un membre du conseil représente les associations de parents d’enfants en situation de handicap.
M. le rapporteur. Ces dispositions relèvent du décret. Je vous propose de retirer ces amendements et de les présenter à nouveau en séance publique, de manière à amener le ministre à s’engager à ce qu’un comité consultatif comprenant notamment des représentants des parents soit placé auprès des deux conseils.
Les amendements AC 410 et AC 180 sont retirés.
La Commission examine l’amendement AC 485 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. Il est proposé par cet amendement que les personnalités qualifiées soient nommées sur proposition de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale et de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat.
M. le rapporteur. Avis défavorable pour les mêmes raisons que précédemment.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement AC 710 de Mme Marie-George Buffet.
Mme Marie-George Buffet. Cet amendement vise à assurer la présence, au sein du conseil, de représentants des parents d’élèves et de représentants des personnels de l’enseignement public. Comme la disposition relève en effet du décret, je le retire pour le soutenir à nouveau en séance publique et obtenir des engagements de la part du ministre.
L’amendement AC 710 est retiré.
La Commission examine ensuite l’amendement AC 411 de M. Vincent Feltesse.
Mme Martine Faure. Pour réaffirmer l’ambition du projet de loi en matière de numérique, nous proposons d’indiquer que le Conseil national d’évaluation du système éducatif accorde une attention particulière au développement du numérique à l’école. Il s’agit, par ailleurs, de prévoir à l’article L. 401-1 du code de l’éducation que c’est « en lien » avec ce conseil que le projet d’école ou d’établissement peut prévoir des expérimentations.
M. le rapporteur. L’amendement est satisfait par les dispositions adoptées au sujet du Conseil supérieur des programmes, qui devra faire des propositions sur l’introduction du numérique dans la pédagogie.
Mme Martine Faure. Il me semble préférable d’écrire que le conseil accorde une attention « particulière » à la question, non seulement pour marquer l’importance de l’inclusion du numérique dans les pratiques pédagogiques, mais aussi pour que l’on prenne toutes les précautions nécessaires à cet égard.
M. le président Patrick Bloche. Il n’est jamais inutile, me semble-t-il, de rappeler la priorité que constitue le numérique.
M. le rapporteur. Je me range à vos arguments. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte également l’amendement rédactionnel AC 31 du rapporteur.
Suivant l’avis défavorable de ce dernier, elle rejette l’amendement AC 746 de M. Rudy Salles.
Puis elle adopte l’article 21 modifié.
La Commission est saisie des amendements AC 486 et AC 487 de Mme Barbara Pompili portant articles additionnels après l’article 21.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement ces amendements.
Chapitre III
Le contenu des enseignements scolaires
Article 22
Modification du livre III du code de l’éducation
Cet article a pour seul objet de préciser que le livre III du code de l’éducation – relatif à l’organisation des enseignements scolaires – est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre du projet de loi.
*
La Commission adopte l’article 22 sans modification.
Section 1
Dispositions communes
Article 23
Organisation de la scolarité en cycles
Cet article vise à modifier l’article L. 311-1 du code de l’éducation, relatif à l’organisation de la scolarité en cycles, afin de permettre au gouvernement de redonner un contenu à cette notion et d’assurer, de cette manière, une réelle progressivité des apprentissages entre les différents niveaux d’enseignement.
1. Des cycles aujourd’hui peu effectifs
Les cycles ont été mis en place, il y a plus de vingt ans, par la loi du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation (loi « Jospin »). Issu de l’article 4 de cette loi, l’article L. 311-1 du code de l’éducation dispose que « la scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression annuelle ainsi que des critères d'évaluation ». Il précise que « pour assurer l’égalité et la réussite des élèves », l’enseignement « est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité ».
Les cycles de l’enseignement scolaire
– À l’école maternelle : cycle des apprentissages premiers (petite et moyenne sections) ;
– à l’école primaire : cycle des apprentissages fondamentaux (grande section-CP et CE1) et cycle des approfondissements (CE2, CM1 et CM2) ;
– au collège : cycle d’adaptation (6ème), cycle central (5ème et 4ème) et cycle d’orientation (3ème) ;
– au lycée général et technologique : 2nde de détermination et cycle terminal (1ère et terminale).
Ainsi que cela a été souligné dans l’exposé général du présent rapport, la mise en place des cycles n’a jamais été effective. Il est vrai aussi que la disposition de l’article L. 311-1 du code indiquant que les cycles sont mis en œuvre par des programmes comportant une « progression annuelle » contredit l’objectif de la mise en place d’apprentissages étalés sur la durée du cycle et donc plus adaptés aux rythmes d’acquisition des élèves.
Autrement dit, la « règle de l’annualité » qui prévaut dans l’organisation des enseignements n’aide guère à la modulation des programmes et de la pédagogie.
Ce « verrou » pédagogique contribue en outre à retarder la diffusion, dans les classes, du socle commun, qui, lui, se réfère très clairement à la notion de progressivité des apprentissages. L’annexe du décret du 11 juillet 2006, qui définit cet outil de formation, dispose en effet que celui-ci « s’acquiert progressivement de l’école maternelle à la fin de la scolarité obligatoire » et qu’en conséquence, les écoles et les collèges doivent organiser un accompagnement adapté des élèves « afin de prendre en compte (leurs) différents rythmes d’acquisition ».
2. Le dispositif proposé par le projet de loi
Le présent article propose que les programmes nationaux de formation prévoient une progression « régulière » et non plus « annuelle ».
Ainsi, l’organisation des enseignements en fonction d’une progression annuelle restera possible, mais elle ne pourra plus servir de principe directeur aux programmes. De cette manière, l’adaptation de l’enseignement à l’hétérogénéité des besoins des élèves pourra être facilitée.
En outre, avant le second l’alinéa de l’article L. 311-1 du code de l’éducation, relatif à l’adaptation de l’enseignement à la diversité des élèves, qu’il n’est pas prévu de modifier, le présent article propose d’ajouter une disposition précisant que le nombre des cycles par niveau d’enseignement, ainsi que leur durée, seront fixés par décret.
Le ministre de l’éducation nationale pourra ainsi relancer la politique des cycles, conformément aux engagements contenus dans le rapport annexé.
Ce document indique en en effet que leur nombre et leur durée seront « réexaminés tout au long de la scolarité obligatoire à partir de deux objectifs principaux » : l’unité retrouvée de l’école maternelle, qui constituera un cycle à elle seule, et une meilleure continuité pédagogique entre l’école et le collège, qui sera assurée par la création d’un cycle associant les classes de CM2 et de 6ème.
Le ministre de l’éducation nationale, dans sa Lettre à tous les personnels du 6 décembre 2012, a ajouté que la « refonte » des cycles permettra, à partir de la rentrée 2014, « une réelle progressivité des apprentissages et le développement d’alternatives au redoublement ».
Aux yeux du rapporteur, cette « refonte » devra être ambitieuse et, par conséquent, ne rien s’interdire. Elle impliquera d’étudier divers scénarios, à l’aune d’un enseignement scolaire conçu et organisé en fonction des élèves : cycle CM2-6ème suivi d’un cycle se concluant en 4ème par la validation du socle commun ; cycle 3ème-2nde, qui serait celui de la différenciation « de masse » des parcours d’élèves ; ou alors, cycles CP-CE2, CM1-6ème et 5ème-3ème permettant de structurer l’école élémentaire et le collège autour de « blocs » de trois ans.
*
La Commission est saisie de l’amendement AC 440 de M. Mathieu Hanotin.
M. Mathieu Hanotin. Cet amendement vise à faire ressortir la logique de l’école du socle commun, qui va du cours préparatoire à la 3ème, et à clarifier ainsi l’organisation de l’ensemble de la scolarité par degrés et par cycles.
M. Yves Durand, rapporteur. L’amendement me semble satisfait par le projet de loi lui-même, qui est suffisamment précis.
M. Mathieu Hanotin. Partiellement satisfait. Je le retire néanmoins.
L’amendement est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ensuite l’amendement AC 490 de Mme Barbara Pompili.
Elle examine ensuite l’amendement AC 115 de M. Frédéric Reiss.
M. Benoist Apparu. Alors que la définition des cycles qui composent la scolarité relevait jusqu’à présent du domaine législatif, le projet de loi la « dégrade » au niveau réglementaire en laissant au gouvernement le soin de la fixer par décret. C’est d’autant plus regrettable que les lois sur l’éducation sont rares – tout au plus une par législature ! – et que la matière éducative est déjà très fortement réglementaire et très peu législative. L’article 7 nous prive de nos compétences pour ce qui est du socle commun, l’article 23 le fait pour les cycles scolaires. Il est dommage que le Parlement n’ait pas son mot à dire sur des sujets aussi importants !
M. le rapporteur. Pour les mêmes raisons que s’agissant du socle, avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement AC 488 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. Nous saluons la volonté du gouvernement de relancer la politique des cycles créée par la « loi Jospin ». Il est cependant dommage que l’intention de créer un cycle unique en maternelle et un cycle associant le CM2 et la classe de 6ème n’apparaisse que dans le rapport annexé. Nous proposons d’inscrire ces deux principes dans le corps de la loi.
M. le rapporteur. Même avis que pour l’amendement AC 115. La détermination des cycles est du domaine du décret. Comme vous l’avez indiqué, le rapport annexé fait état d’un cycle de maternelle et d’un cycle commun pour le CM2 et la 6ème. Cela suffit largement pour fixer l’orientation.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AC 489 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. Comme je subodore l’avis du rapporteur, je retire cet amendement pour le présenter à nouveau en séance, mais cette fois-ci sur le rapport annexé.
L’amendement est retiré.
La Commission en vient à l’amendement AC 216 de M. Thierry Braillard.
M. Thierry Braillard. Je subodore également l’avis du rapporteur. Mais l’amendement est défendu.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 23 sans modification.
Article 24
Objectifs des programmes
Cet article vise à modifier l’article L. 311-1 du code de l’éducation relatif aux programmes scolaires afin d’enrichir la définition des objectifs de ces outils essentiels de la scolarité.
Dans sa rédaction actuelle, la première phrase de cet article dispose que les « programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées ».
La rédaction proposée prévoit que les programmes, en plus des connaissances et des méthodes de travail à assimiler, définiront les « compétences attendues ».
Cette nouvelle mention permettra de réparer un oubli fâcheux de la loi du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École qui n’a pas établi de lien entre l’acquisition des compétences du socle commun, qu’elle a institué, et les programmes.
À l’inverse, le décret du 11 juillet 2006 relatif au socle commun consacre à cet aspect de la formation d’importants développements, en indiquant par exemple que chaque grande compétence est conçue « comme une combinaison de connaissances fondamentales pour notre temps, de capacités à les mettre en œuvre dans des situations variées, mais aussi d’attitudes indispensables tout au long de la vie ».
Parallèlement à l’ajout d’une référence aux « compétences attendues », le présent article propose de supprimer l’adjectif « essentielles », employé par le code de l’éducation pour qualifier les connaissances qui doivent être acquises. Celles-ci doivent en effet revêtir une égale importance dès lors qu’elles figurent dans un programme : il ne saurait y avoir de connaissances « inessentielles ».
Au total, le présent article permettra de mettre en œuvre l’un des postulats mis en avant par le rapport du comité de pilotage de la concertation sur la refondation de l’école, selon lequel « tout autant que d’apprendre, l’objectif est désormais d’apprendre à apprendre » (169).
Enfin, il convient de noter que le présent article ne modifiera pas la disposition de l’article L. 311-3 du code de l’éducation, issue de la loi du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation et indiquant que les programmes constituent le « cadre national » au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements « en prenant en compte les rythmes d’apprentissage de chaque élève ».
Ces précisions constituent en effet autant de garanties pour les usagers du service public de l’éducation qui complètent et renforcent deux autres principes posés par le législateur :
– d’une part, celui selon lequel le service public de l’éducation est « organisé en fonction des élèves », conformément à l’article L. 111-1 du code de l’éducation ;
– d’autre part, celui de la liberté pédagogique des professeurs reconnue à l’article L. 912-1-1 du code, lequel précise toutefois qu’elle doit s’exercer dans le cadre national défini par les programmes.
La Commission a modifié le présent article pour préciser que les compétences, qui sont présentées, dans le projet de loi initial, comme étant « attendues », doivent être « acquises », à l’instar de ce qui est prévu pour les connaissances.
*
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 747 de M. Rudy Salles.
Elle examine ensuite l’amendement AC 491 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. Il s’agit de préciser que les compétences doivent être non pas « attendues », mais « acquises » au même titre que les connaissances.
M. le rapporteur. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement AC 492 de Mme Barbara Pompili.
Puis elle adopte l’article 24 modifié.
Article 25
Dispositifs d’aide à la maîtrise du socle commun
Cet article vise à modifier le cadre juridique du programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) défini à l’article L. 311-3-1 du code de l’éducation, afin d’élargir la palette des aides mises en œuvre au profit des élèves susceptibles de rencontrer des difficultés dans l’acquisition du socle commun.
La loi du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École tend à faire du PPRE la réponse unique à toute difficulté dans la maîtrise des connaissances et des compétences du socle, leur acquisition, de l’école primaire à la fin de la scolarité obligatoire, étant progressive et validée aux trois moments clefs que sont le CE1, le CM2 et la 3ème.
En effet, aux termes de l’article L. 311-3-1 du code de l’éducation, lorsqu’il apparaît qu’un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d’un cycle, le directeur d’école ou le chef d’établissement propose, à tout moment de la scolarité obligatoire, aux parents de l’élève (ou à son responsable légal), de mettre en place un PPRE.
Le PPRE, un programme formalisé selon la circulaire n° 2006-138 du 25 août 2006
– Pour chaque élève concerné, « un document clairement organisé présente le plan coordonné d’actions que constitue le PPRE ».
– Rédigé par les enseignants, ce document précise « la situation de l’élève, les objectifs de fin de cycle sur lesquels seront basés les bilans individuels, les objectifs à court terme liés à l’action d’aide identifiée, le descriptif de cette action ainsi que les indicateurs d’évaluation qui y sont associés, l’échéancier des aides et des bilans intermédiaires et, enfin, les points de vue de l’enfant et de sa famille ».
– Ce document devra présenter l’ensemble des informations mentionnées ci-dessus. Conçu en principe pour être lisible par tous, il est signé par l’élève et sa famille.
Cependant, dans les faits, le PPRE ne joue pas le rôle que lui a été confié par la loi, son « public » restant très en deçà des 20 % d’élèves, environ, qui ne maîtrisent pas les compétences en langue française et en mathématiques. On rappellera en effet qu’en 2011-2012 :
– dans les écoles publiques du premier degré, seulement 7,47 % des élèves hors éducation prioritaire (dont 68,37 % parmi les élèves redoublants) et 14,48 % des élèves en éducation prioritaire (dont 65,77 % de redoublants) en ont bénéficié (total : 8,65 % des élèves) ;
– dans les collèges de l’enseignement public, seulement 6,5 % des élèves hors éducation prioritaire et 12,3 % des élèves en éducation prioritaire en ont bénéficié (total : 7,6 % des élèves).
De fait, sur le terrain, le PPRE a été « dilué » au sein des différents dispositifs d’aide mis en œuvre dans les écoles et les collèges, ainsi que l’a établi un rapport récent des inspections générales de l’éducation nationale.
Dans le premier degré, l’aide personnalisée mise en place par la réforme de l’école primaire de 2008 tend à faire diminuer le nombre de PPRE. Toutefois, ceux-ci peuvent être parfois imposés par les inspecteurs de circonscription lorsqu’il y a plusieurs prises en charge pour un élève (aide personnalisée combinée à une aide spécialisée). Mais ils sont alors davantage utilisés comme un « outil au service de la coordination ».
Quant aux collèges, même lorsque les PPRE existent, « l’acception est très diversifiée et souvent déconnectée dans l’esprit de ceux qui les pratiquent de leur finalité première ; il n’a été fait qu’exceptionnellement référence, dans les échanges, au socle commun de connaissances et de compétences auquel la loi, dès sa définition initiale, les rattache » (170).
L’« étiolement » du PPRE souligne l’intérêt qu’il y aurait à diversifier les modes de prise en charge de la difficulté scolaire. C’est d’ailleurs tout l’enjeu du développement de la pédagogie différenciée, laquelle, selon le président du Haut conseil de l’éducation, M. Bruno Racine, doit amener « au minimum, l’enseignant (…) à varier les dispositifs : supports, outils (en recourant à l’ordinateur, aux TICE, qui offrent un autre statut à l’erreur et modifient la relation professeur-élève), questions posées, aide… ; il va élargir la palette de ce qui est proposé à tous les élèves, faire varier successivement les outils, les approches, les activités pour que chaque élève trouve ce qui lui convient le mieux » (171).
En outre, la rédaction actuelle de l’article L. 311-3-1 présente le PPRE comme étant une solution obligatoire, mais soumise à l’accord des parents, une condition qui peut être « bloquante ». À cet égard, l’étude d’impact met en avant le fait que cette procédure est « parfois perçue par les enseignants comme trop formalisée ». En effet, cette exigence paraît incompréhensible dès lors que l’on considère que l’éducation nationale n’a pas à se soumettre – au nom de quoi d’ailleurs ? – à un régime d’autorisation lorsqu’elle doit exercer sa mission de remédiation auprès d’un élève en difficulté.
Le présent article propose donc d’introduire plus de souplesse dans la mise en œuvre de l’aide apportée aux élèves en difficulté, sans sacrifier pour autant le cadre d’intervention que peut constituer le PPRE :
– l’élément « déclencheur » continuera d’être l’apparition du risque qu’un élève ne maîtrise pas les connaissances et les compétences indispensables à la fin d’un cycle, et ce à tout moment de la scolarité obligatoire. Le point de départ prévu par le législateur en 2005 est donc préservé, l’acquisition du socle commun devant rester le pivot de la scolarité ;
– en revanche, la prise en charge de l’élève obéira à une autre logique que celle prévue par l’article L. 311-3-1 du code. Ainsi, le directeur d’école ou le chef d’établissement ne devra plus proposer aux parents de l’élève un seul outil – le PPRE –, mais les équipes pédagogiques devront mettre en place des dispositifs d’aide. Celles-ci devront donc examiner les options disponibles, définir une réponse adaptée et l’appliquer, dans des conditions toutefois « fixées par le ministre de l’éducation nationale ». Cette dernière disposition servira de garde-fou en matière pédagogique : l’initiative ne doit pas être confondue avec le « laisser-faire », surtout lorsque la politique éducative se fixe des objectifs chiffrés en matière de réussite scolaire ;
– enfin, ces aides pourront prendre la forme d’un PPRE. L’outil mis en place par le législateur en 2005 sera préservé, même s’il devient facultatif et a plutôt vocation à « fédérer » les modalités d’intervention arrêtées par l’équipe pédagogique. En effet, le PPRE garde tout son intérêt dès lors qu’il faut mettre en place un ensemble d’aides coordonnées, impliquant différents intervenants.
La Commission a modifié le présent article pour prévoir, en toute logique, que le directeur de l’école ou le chef d’établissement informe, dans les plus brefs délais, les parents ou le responsable légal de l’enfant de la mise en place de ces aides.
*
La Commission est saisie de l’amendement AC 268 de M. Benoist Apparu, tendant à supprimer l’article 25.
M. Benoist Apparu. Chacun reconnaît la nécessité de disposer d’un encadrement intermédiaire au sein de l’éducation nationale. Dans le système actuel, il n’y a pas d’intermédiaires entre le recteur et les établissements alors qu’il y en a beaucoup entre le ministre et le recteur. L’article 25 fait en outre disparaître le rôle – pourtant modeste – de chef d’équipe pédagogique joué par le chef d’établissement. C’est une erreur.
M. le rapporteur. L’équipe pédagogique est composée du chef d’établissement et des enseignants. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AC 32 du rapporteur.
Puis elle est saisie, en discussion commune, des amendements AC 217 de M. Thierry Braillard et AC 493 de Mme Barbara Pompili.
M. Thierry Braillard. Il s’agit d’acter le rôle des parents, en lien avec l’équipe pédagogique, lorsque l’élève est en difficulté.
Mme Barbara Pompili. Mon amendement va dans le même sens.
M. le rapporteur. Avis défavorable aux deux amendements. Prévoir un accord préalable des parents risque de bloquer le dispositif.
Mme Barbara Pompili. Nous en reparlerons.
La Commission rejette successivement les amendements.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement AC 748 de M. Francis Hillmeyer.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement AC 494 de Mme Barbara Pompili.
Elle examine ensuite l’amendement AC 579 de Mme Marie-George Buffet.
Mme Marie-George Buffet. Les parents doivent à tout le moins être informés de la mise en place du dispositif personnalisé.
M. le rapporteur. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 25 modifié.
Article 25 bis (nouveau)
Appréciation de l’acquisition des connaissances et des compétences
L’article L. 311-7 du code de l’éducation prévoit que durant la scolarité, l’appréciation des aptitudes et de l’acquisition des connaissances s’exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d’établissement.
Cette rédaction fait référence aux aptitudes et non aux compétences, le terme consacré par le socle commun, et ignore la notion de la progressivité des apprentissages.
Adopté à l’initiative du rapporteur, le présent article prévoit une nouvelle rédaction de ces dispositions, conforme aux attendus de la refondation pédagogique. Ainsi, le contrôle continu devra permettre l’appréciation de l’acquisition progressive des connaissances et des compétences.
*
La Commission examine, en présentation commune, les amendements AC 467 de Mme Barbara Pompili, AC 640 du rapporteur, AC 397 de Mme Martine Carrillon-Couvreur et AC 469 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. L’amendement AC 467 est défendu.
M. le rapporteur. L’amendement AC 640 est rédactionnel.
Mme Martine Faure. L’amendement AC 397, qui vise à renforcer l’accompagnement des personnes concernées par des besoins particuliers et à promouvoir des mécanismes tendant à rendre effectif le principe d’égalité devant les services publics de l’école, complète les dispositifs élaborés pour permettre aux élèves de mieux réussir.
Mme Barbara Pompili. L’amendement AC 469 vise à ce que le redoublement ne soit plus proposé, bien qu’il puisse toujours être demandé par les familles. Pour faire progresser les élèves, il faut trouver une autre solution que ce système qui a coûté 2 milliards d’euros en 2009.
M. le rapporteur. Avis défavorable à l’amendement AC 467.
Quant à l’amendement AC 397, je propose qu’il soit retiré et retravaillé, afin d’éviter toute confusion avec le projet d’accueil individualisé.
Mme Martine Faure. Je retire l’amendement, dont je proposerai une autre rédaction en vue de la séance publique.
L’amendement AC 397 est retiré.
M. le rapporteur. Avis défavorable à l’amendement AC 469.
La Commission rejette l’amendement AC 467.
Elle adopte l’amendement AC 640.
Elle rejette l’amendement AC 469.
Article 25 ter (nouveau)
Parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde professionnel
La Commission a adopté un amendement insérant cet article qui propose une nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’éducation afin de prévoir que le droit au conseil en orientation et à l’information sur les enseignements, inscrit au premier alinéa, « s’exerce grâce à la mise en place, tout au long du second degré, d’un parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde professionnel pour tous les élèves. Les choix d’orientations et de formations sont de la responsabilité des élèves et de leurs parents ou leur représentant légal. » En outre, il modifie la première phrase du troisième alinéa du même article pour préciser que les élèves élaborent « et déterminent leur orientation » scolaire et professionnelle.
L’orientation des élèves ne figurait pas dans la rédaction initiale du projet de loi, si ce n’est dans le rapport annexé, alors qu’elle constitue un problème récurrent du système éducatif français et demeure pour de nombreux jeunes une source d’échecs voire de sortie sans qualification.
Malgré les priorités assignées au système éducatif – assurer à 100% des jeunes un diplôme ou une qualification reconnue, conduire 80% d’une classe d’âge au niveau du baccalauréat et 50% de l’ensemble d’une classe d’âge à un diplôme de l’enseignement supérieur –, environ 120 000 jeunes de 16 ans et plus sortent en effet chaque année précocement du système scolaire sans diplôme ou avec le brevet des collèges.
Aussi, l’orientation en fin de classe de 3ème, entendue à la fois comme le processus de répartition des élèves dans les différentes filières, l’affectation dans un établissement et l’aide à la construction d’un parcours tout au long de la scolarité revêt-elle une importance primordiale, puisqu'elle conditionne très fortement l’avenir scolaire et la capacité d’insertion professionnelle des élèves.
Les différents rapports et études produits sur cette question aboutissent aux mêmes constats (172).
1. L’orientation apparait souvent comme le résultat d’exclusions successives plus que comme le résultat de choix éclairés
La valorisation par le système éducatif des savoirs abstraits a pour conséquence la hiérarchisation de fait des filières générale, technologique et professionnelle et la sélection des élèves en fonction de leurs résultats scolaires dans ces savoirs, les moins performants – souvent les moins favorisés socialement – étant dirigés vers la voie professionnelle, qui privilégie une approche plus expérimentale. La sélection entre les différentes filières étant, en outre, conditionnée par l’offre de formation sur chaque territoire, les élèves n’auront pas, à compétence et souhaits équivalents, les mêmes possibilités d’orientation et de formation selon les académies. Par ailleurs, les élèves exclus des voies générale et technologique pourront être, en lycée professionnel, affectés dans une spécialité ne correspondant pas à leurs vœux ou à leurs aptitudes, en raison du contingentement des places par spécialité. Or, les changements de filière dans le second cycle sont très difficiles, l’offre territoriale de formation étant rigide, et les fermetures de filières, rares, même en l’absence de débouchés professionnels.
Comme le résume le rapport annexé au projet de loi, il s’agit donc «de faire de l’orientation, quelle qu’elle soit, un choix réfléchi et positif, et non une étape où l’élève est passif, déterminée uniquement par ses résultats au collège et les stéréotypes de genre ».
2. L’information sur les métiers et les filières et l’accompagnement des élèves dans l’élaboration de leur projet scolaire et professionnel répondent très imparfaitement aux besoins.
Les nombreux dispositifs d’orientation chargés d’apporter un appui aux élèves – conseillers d’orientation-psychologues (près de 3800 COPSY sur le territoire national), centres d’information et d’orientation (567 CIO), service public de l’orientation mis en place en 2010, Onisep, éditeur public diffusant une information sur les formations et les cursus de 600 métiers – constituent un labyrinthe peu compréhensible et peu accessible, en particulier pour les jeunes des familles défavorisées, les plus éloignées du système éducatif.
Par ailleurs, la communauté éducative – enseignants et conseillers d’orientation-psychologues – n’a pas la formation adéquate pour exercer pleinement sa mission. Le Haut conseil de l’éducation comme la Cour des comptes déplorent l’absence d’une formation initiale et continue des enseignants concernant l’information des élèves sur les filières de formation aux différents métiers, alors que les textes leur attribuent une responsabilité particulière en matière d’orientation. Quant aux conseillers d’orientation, « du fait de leur formation et de leur recrutement, ils s’intéressent plus à la dimension psychologique, qui est l’essentiel de leur métier, qu’à l’orientation et la connaissance des métiers. » (173) Soulignant que les missions, déjà vastes, de ces derniers se sont accrues au fil des circulaires et des nouveautés pédagogiques, le Haut conseil préconise d’élaborer un référentiel de compétences et de diversifier les profils. (174)
Plus généralement, enfin, le processus d’orientation demeure complexe. Les options et les voies sélectives (classes internationales, européennes, à horaires aménagés musique et danse…) sont mal connues des familles défavorisées ; les classes de niveau, bien qu’interdites, existent dans un établissement sur deux par le biais des options. De même, les dispositifs de gestion des élèves en difficulté mis en place depuis 1975 sont devenus le plus souvent des voies de pré-orientation, telles les sections d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) dont les élèves sortent très souvent sans qualification ; les 3ème d’insertion ou d’alternance perdurent.
Les options de « découverte professionnelle » en 3ème s’adressent aux collégiens que l’on pense orienter (découverte en trois heures – DP3) ou accueillent ceux destinés à l’enseignement professionnel par choix ou en raison de leurs difficultés scolaires (découverte en six heures – DP6). Quant au « parcours de découverte des métiers et des formations » (PDMF), généralisé en 2009 pour tous les élèves à partir de la 5ème et jusqu’en terminale, il n’a pas encore produit les effets escomptés.
3. La mise en place d’un « parcours »
Pour pallier ces insuffisances, la nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’éducation se base sur les intentions d’ores et déjà affichées par le ministre de l’éducation nationale. Elle propose que le parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde professionnel soit prévu dans le cursus de l’ensemble des élèves du second degré. Il s’agit de permettre à chacun de se familiariser progressivement « tout au long du second degré » avec le monde professionnel par une première approche du marché du travail, des professions et des métiers, du rôle et du fonctionnement des entreprises ainsi que des modalités et des perspectives d’insertion professionnelles.
Comme l’indique le rapport annexé, « la découverte des métiers et du monde du travail ne peut plus être une option de "découverte professionnelle" réservée aux seuls élèves s’orientant vers l’enseignement professionnel. » Parallèlement, l’article 34 du projet de loi supprime les dispositifs d’orientation précoce en classe de 4ème – « apprentissage junior » et « dispositif d’initiation aux métiers en alternance ».
Mis en place à partir de la rentrée 2015, le parcours s’adressera à tous les collégiens et fera partie du tronc commun de formation de la 6ème à la 3ème et se prolongera au lycée.
En renforçant « l’éducation à l’orientation », ce parcours place donc l’orientation au cœur du cursus scolaire et responsabilise les élèves en leur permettant « d’élaborer et de déterminer leur orientation scolaire et professionnelle » avec l’aide des parents et de l’ensemble de la communauté éducative. La réalisation du parcours suppose également une collaboration renforcée des établissements avec leurs différents partenaires, notamment locaux. Comme le préconisait le Conseil économique, social et environnemental dans son avis relatif à « l’emploi des jeunes » (175), il est nécessaire de coordonner l’ensemble des acteurs de l’orientation sur un même territoire et d’inciter les branches, les chambres consulaires et les secteurs professionnels à développer des partenariats avec les écoles et les universités, les jeunes devant être accompagnés et conseillés à toutes les étapes de leurs choix menant au marché du travail.
Les régions devraient être davantage associées au dispositif puisqu’elles sont au plus près des offres de formation et des opportunités d’emploi des territoires, pilotent déjà des plates-formes régionales d’insertion et de lutte contre le décrochage, et sont au cœur des missions d’information et d’accompagnement des jeunes. Une « déclaration commune » formulée le 12 septembre 2012 par le Président de la République et l’Association des régions de France (ARF) prévoit ainsi qu’en vue de réduire le nombre de jeunes entrant sur le marché du travail sans qualification, les régions renforceront leurs interventions pour lutter contre toutes les formes de « décrochage » en pilotant l'évolution de la carte des formations et en modernisant le service public de l'orientation qu’elles ont vocation à coordonner et animer.
*
La Commission examine l’amendement AC 470 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. Défendu.
M. le rapporteur. Avis favorable, même si la précision ne relève pas réellement du domaine législatif.
La Commission adopte l’amendement.
Section 2
La formation à l’utilisation des outils numériques
Article 26
Formation à l’utilisation des outils numériques
Le présent article tend à remplacer la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’éducation, qui est consacrée aux « enseignements de technologie et d’informatique », par une section consacrée à « la formation à l’utilisation des instruments et des ressources numériques ».
1. La situation actuelle
À l’école, au collège et au lycée, le brevet informatique et internet (B2i) répond à la nécessité de dispenser à chaque futur citoyen la formation qui, à terme, lui permettra de faire une utilisation raisonnée des technologies de l’information et de la communication. Cette formation permet également de percevoir les possibilités et les limites des traitements informatisés, de faire preuve d'esprit critique face aux résultats de ces traitements. Elle donne aussi des moyens d’identifier les contraintes juridiques et sociales dans lesquelles s'inscrivent ces utilisations.
Le B2i n’est pas un examen mais une « attestation de compétences ». Cinq domaines de compétences sont évalués. Ils sont présentés dans des référentiels pour chaque niveau : s’approprier un environnement informatique de travail ; adopter une attitude responsable ; créer, produire, traiter et exploiter des données ; s’informer et se documenter ; communiquer, échanger.
Les évolutions d’internet et le développement des usages pédagogiques du numérique ont conduit à la rénovation des référentiels de compétences du B2i école et du B2i collège en janvier 2012 afin de mieux préparer les élèves à un usage responsable de ces technologies. La rénovation du B2i des lycées devrait être présentée lors d’un prochain Conseil supérieur de l’éducation.
Les enseignements nécessaires à l’acquisition des compétences du B2i ont vocation à être apportés par tous les enseignants, quelle que soit leur discipline. Il revient au chef d’établissement et à l’équipe pédagogique de l’établissement de répartir entre les différentes disciplines les formations données afin de faire acquérir par les élèves l’ensemble des compétences indiquées dans le B2i. Les validations des différentes compétences sont ensuite effectuées par les enseignants qui ont assuré l’enseignement des compétences correspondantes.
Tous les nouveaux enseignants reçoivent depuis cinq ans une formation professionnelle destinée à maîtriser un usage pédagogique des outils et ressources numériques. Cette formation est certifiée (C2i2e, ou certificat informatique et internet, niveau 2).
L’éducation aux médias et au numérique repose certes sur les compétences du B2i, mais elle est aussi portée par des enseignements disciplinaires spécifiques, notamment par les professeurs de lettres (maîtrise de la langue à tous les niveaux, du cours préparatoire au lycée) et par les enseignants en charge de l’éducation à la citoyenneté, notamment au lycée à travers les enseignements en éducation civique, juridique et sociale (ECJS). Elle doit également être présente les programmes disciplinaires.
S’agissant de la situation actuelle et des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du B2i, la formation des enseignants et l’éducation aux médias en général, le rapporteur renvoie au commentaire de l’article 4 du présent projet de loi.
2. Les modifications proposées par le projet de loi
Il est proposé de remplacer l’article L. 312-9 du code de l’éducation par des dispositions précisant que cette formation est dispensée progressivement de l’école au lycée, et comporte notamment une sensibilisation aux droits et devoirs liés à l’usage de ces instruments et ressources. Cette sensibilisation porte notamment sur la protection de la vie privée et le respect de la propriété intellectuelle.
Comme l’indique l’exposé des motifs, « cette formation s’insère dans les programmes d’enseignement et peut faire l’objet d’enseignements spécifiques. »
La notion de formation à l’utilisation des ressources numériques se substitue donc à celle d’initiation à la technologie et à l’usage de l’informatique.
L’apprentissage dédié aux sciences du numérique existe en classe de technologie au collège et en terminale scientifique, avec l’option « informatique et sciences du numériques » créée récemment. Il est prévu d’étendre cette option aux autres classes terminales des lycées généraux, de renforcer la place des sciences du numérique en technologie et de réfléchir à de premiers apprentissages de ces domaines dans le premier degré.
Les écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) que le présent projet de loi tend à créer devront quant à elles assurer la formation au numérique des futurs professeurs.
S’agissant de la formation continue, les services académiques mettent en œuvre des formations au numérique tant sur les thématiques relevant des B2i que sur les usages disciplinaires du numérique. Un important effort de formation au numérique demeure nécessaire et la stratégie numérique ministérielle, annoncée le 13 décembre dernier, fait de cette question un axe essentiel des mesures proposées.
*
La Commission examine l’amendement AC 413 de M. Vincent Feltesse.
Mme Julie Sommaruga. L’amendement tend à mettre en place, dans chaque école, une charte signée par tous les membres de la communauté éducative, sur les droits et devoirs liés à l’utilisation d’internet et des contenus numériques dans les pratiques pédagogiques.
M. le rapporteur. Avis défavorable. L’amendement est satisfait par les articles R. 511-1 et suivants du code de l’éducation.
Mme Julie Sommaruga. Je le retire.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’article 26 sans modification.
Section 3
L’enseignement des langues vivantes étrangères
Article 27
Enseignement obligatoire d’une langue vivante étrangère au début de la scolarité élémentaire
Cet article vise à rendre obligatoire un enseignement de langue vivante étrangère dès le début de la scolarité obligatoire, c’est-à-dire dès le cours préparatoire (CP). Il prévoit d’ajouter, à cet effet, une nouvelle section relative à l’enseignement de ces langues au sein du chapitre II – concernant les dispositions propres à certaines matières d’enseignement – du titre Ier du livre II du code de l’éducation.
1. Une France en décrochage par rapport aux « standards » européens
Grâce au Cadre européen commun de référence pour les langues, élaboré par le Conseil de l’Europe et adopté en 2005, la France et ses partenaires disposent désormais d’un référentiel commun pour identifier et évaluer les cinq compétences qui marquent la maîtrise d’une langue : compréhension et expression écrites, compréhension et expression orales, interaction orale.
Plus connu sous son acronyme, le CECRL, ce cadre établit une échelle de compétence langagière globale qui comprend trois niveaux généraux, subdivisés en six niveaux communs :
– Niveau A : utilisateur élémentaire (= scolarité obligatoire), subdivisé en niveau introductif ou de découverte (A1) et intermédiaire ou usuel (A2) ;
– Niveau B : utilisateur indépendant (= lycée), subdivisé en niveau seuil (B1) et avancé ou indépendant (B2) ;
– Niveau C : utilisateur expérimenté, subdivisé en C1 (autonome) et C2 (maîtrise).
Ce « standard » a été pris en compte par la France, pour les programmes scolaires et les dispositifs d’évaluation. Ainsi, à la fin de l’école élémentaire, les élèves doivent avoir acquis le niveau A1 du CECRL, c’est-à-dire être capables de communiquer simplement avec un interlocuteur qui parle distinctement. La maîtrise du niveau A2 est ensuite exigée pour la validation du socle commun à la fin de la scolarité obligatoire, ce niveau correspondant aux programmes officiels de la fin de la 5ème. Enfin, à partir de la session 2013 du baccalauréat, l’évaluation des langues vivantes 1 et 2 à cet examen prendra en compte les compétences écrites et orales des élèves dans la logique du CECRL.
Or, ainsi que le souligne le rapport annexé au projet de loi, par rapport à ces exigences, les acquis des élèves français sont « particulièrement alarmants ». En effet, selon la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère de l’éducation nationale, leurs résultats à la dernière enquête européenne montrent que, pour la compréhension de l’oral, « seuls 26 % des élèves maîtrisent au moins le niveau A2 en anglais et 26,7 % en espagnol ». Ces chiffres s’élèvent respectivement à 22,8 % et 30,4 % des élèves en compréhension de l’écrit et à 38,8 % et 27,1 % en expression écrite. La proportion d’élèves de niveau pré-A1 est donc très importante et s’échelonne de 23,7 % à 40,5 % des élèves en anglais et de 17,9 % à 24,3 % des élèves en espagnol, selon les activités langagières.
Cet état des lieux est confirmé par les évaluations nationales. En mai 2010, la DEPP a évalué les compétences en langue vivantes étrangères des élèves en fin de collège dans le cadre du dispositif CEDRE. Ce travail visait surtout le niveau A2, mais contenait aussi des items de niveau A1 et B1. Selon la DEPP, même s’il est difficile de comparer les deux enquêtes, qui ne reposent pas sur les mêmes protocoles ni la même méthodologie, il est possible de dessiner des tendances. Or, les deux évaluations montrent « la faiblesse du niveau général des élèves en langues, avec une forte proportion d’élèves aux plus bas niveaux de l’échelle et plus particulièrement en compréhension de l’oral (59,6 % des élèves en compréhension de l’oral et 49,7 % en compréhension de l’écrit se situent dans les groupes 0, 1 et 2 de l’échelle CEDRE en anglais) » (176).
Face à ce constat préoccupant, il est admis que la précocité de l’exposition des élèves aux langues étrangères et de leur apprentissage est un facteur avéré de progrès. Il existe en conséquence un consensus sur le fait que l’enseignement de ces langues, qui constitue un atout dans un monde globalisé, doit être rendu obligatoire et surtout débuter plus tôt.
En effet, ce dernier, d’une durée de 54 heures (177), ne relève aujourd’hui que d’une mesure réglementaire et ne commence qu’à partir du CE1.
En outre, si cet enseignement progresse à l’école élémentaire, force est de constater, à partir des données du ministère de l’éducation nationale, que sa diffusion reste très variable selon les classes, ainsi que l’indique le tableau ci-dessous.
Enfin, on observera que dans la plupart des pays européens l’apprentissage des langues vivantes commence de plus en plus tôt. C’est ce qu’a constaté le rapport, à l’accueil consensuel, du Comité stratégique des langues présenté à M. Luc Chatel, alors ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse : « la publication Chiffres clés de l’enseignement des langues en Europe du réseau Eurydice montre d’ailleurs que, presque partout, l’enseignement obligatoire d’une langue étrangère débute de fait au cours de la scolarité primaire, en moyenne aux alentours de 8-10 ans, mais plus tôt encore dans certains pays : dès trois ans par exemple en Espagne et dans la Belgique germanophone. Les spécialistes de neurosciences affirment en effet que jusqu’à sept ans, les enfants peuvent parfaitement assimiler les sonorités et la phonologie de systèmes linguistiques différents » (178).
Élèves bénéficiant d’un enseignement de langue vivante étrangère (LVE)
(en 2010-2011 et 2011-2012)
Enseignement des LVE |
% d’élèves de l’enseignement public bénéficiant d’un enseignement de LVE |
% d’élèves de l’enseignement privé sous contrat bénéficiant d’un enseignement de LVE | ||
2010-2011 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2011-2012 | |
Au cycle 3 |
99,2 % |
99,1 % |
96,5 % |
97,5 % |
En CE1 |
87 % |
92,1 % |
89,7 % |
91,6 % |
En CP |
59,4 % |
67,4 % |
57 % |
63,9 % |
Source : ministère de l’éducation nationale.
2. Le dispositif proposé par le projet de loi
Avant de présenter le dispositif proposé par le gouvernement, on rappellera que le code de l’éducation contient d’ores et déjà une série de dispositions concernant l’enseignement de certaines disciplines : l’éducation physique et sportive (articles L. 312-1 à L. 312-4), les enseignements artistiques (articles L. 312-5 à 8), les enseignements de technologie et d’informatique (article L. 312-9), l’enseignement de la langue des signes (L. 312-9-1), l’enseignement des langues et cultures régionales (L. 312-10 à L. 312-11-1), l’enseignement de la défense (L. 312-12), les enseignements de la sécurité (L. 312-13 à L. 312-13-1), l’enseignement des problèmes démographiques (L. 312-14) et l’enseignement d’éducation civique (L. 312-15). S’y ajoutent l’éducation à la santé et à la sexualité (L. 312-16 à L. 312-17-2) et la prévention et l’information sur les toxicomanies (L. 312-8).
Ces articles sont répartis dans les dix sections du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’éducation, qui regroupent les dispositions propres à certaines matières d’enseignement.
Le I du présent article propose d’insérer une section 3 ter, relative à l’enseignement des langues vivantes étrangères, après la section 3 bis de ce chapitre, relative à l’enseignement de la langue des signes.
La refonte des contenus d’enseignement prévue par le rapport annexé au présent projet de loi trouve ici une traduction juridique, qui met l’accent sur la maîtrise nécessaire des langues vivantes. Le nouvel article L. 312-9-2 du code de l’éducation rendra ainsi obligatoire un enseignement en langue vivante étrangère dès le début de la scolarité obligatoire, qui correspond à la classe du cours préparatoire (CP).
Cet enseignement ne sera pas une initiation ou une formation au contenu souple, mais un véritable cours, puisqu’il devra bénéficier, selon le ministère de l’éducation nationale, à tout élève, dans le cadre de l’horaire normal de l’école élémentaire.
Le II du présent article indique que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à la rentrée scolaire 2015.
L’étude d’impact précise que cette mesure ne nécessitera pas de prévoir le recrutement de nouveaux professeurs, mais qu’en revanche, un effort devra être réalisé en matière de formation continue et initiale des professeurs des écoles :
– d’une part, cet enseignement fera partie intégrante des programmes de CP, étant précisé qu’en 2010-2011, plus de 95 % des maîtres assuraient déjà l’enseignement d’une langue vivante à l’école primaire ;
– d’autre part, des maîtres itinérants spécialisés en langues vivantes pourront également intervenir dans les écoles élémentaires, de même que des assistants étrangers de langue vivante, qui sont majoritairement des étudiants inscrits à l’université recrutés dans le cadre de programmes d’échanges bilatéraux et qui exercent environ douze heures par semaine.
*
La Commission est saisie de l’amendement AC 152 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. Je le retire.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement AC 269 de M. Benoist Apparu.
M. Benoist Apparu. En l’absence de mes collègues alsaciens, je fais une nouvelle tentative pour rendre l’apprentissage de l’anglais obligatoire.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AC 33 du rapporteur.
Elle en vient à l’amendement AC 218 de M. Thierry Braillard.
M. Thierry Braillard. Je propose que l’enseignement des langues étrangères s’inscrive dans le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) promu par le Conseil de l’Europe.
M. le rapporteur. Avis défavorable. L’amendement est satisfait par l’article D. 122-1 du code de l’éducation.
M. Thierry Braillard. Je le retire, sous réserve de vérification.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AC 34 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 27 modifié.
Article 27 bis (nouveau)
Invitation à intégrer les langues et cultures régionales dans l’enseignement
La Commission a adopté un amendement insérant cet article qui modifie l’article L. 312-11 du code de l’éducation aux termes duquel les maîtres sont autorisés à recourir aux langues régionales dans les écoles primaires et maternelles chaque fois qu’ils peuvent en tirer profit pour leur enseignement, notamment pour l’étude de la langue française.
L’article L. 312-11 est modifié afin d’inviter les professeurs à intégrer les langues et cultures régionales dans leur enseignement et, de cette manière, d’en favoriser la transmission et de les mettre à profit pour l’acquisition du socle commun, notamment pour l’étude de la langue française.
*
La Commission examine, en présentation commune, les amendements identiques AC 415 de Mme Martine Faure et AC 353 de M. Paul Molac, ainsi que l’amendement AC 582 de Mme Marie-George Buffet.
Mme Martine Faure. L’amendement AC 415 vise à inviter les professeurs à intégrer les langues et cultures régionales dans leur enseignement afin d’en favoriser la transmission et de les mettre à profit pour l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, notamment pour l’étude de la langue française.
Mme Barbara Pompili. L’amendement AC 353 est défendu.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Les amendements sont satisfaits par l’amendement AC 701 précédemment adopté portant article additionnel après l’article 18. Je suggère leur retrait.
Mme Martine Faure. L’amendement AC 701 porte seulement sur les langues régionales. Culture et langue ne sont pas synonymes !
Mme Barbara Pompili. Je partage cet avis : les deux notions sont liées, mais ne recoupent pas la même réalité.
Mme Marie-George Buffet. L’amendement AC 582 vise à affirmer dans la loi l’utilité des langues et des cultures régionales, qui ne sont mentionnées que dans le rapport annexé.
M. le rapporteur. Sans ouvrir un long débat sur langue et culture, il serait bon de réécrire ces amendements.
Mme Martine Faure. À mon sens, l’amendement AC 415 n’a pas à être réécrit.
Mme Barbara Pompili. Je maintiens l’amendement AC 353.
Mme Marie-George Buffet. Je maintiens également l’amendement AC 582.
M. le rapporteur. Sur le rapport entre langue et culture, comme sur la place des langues et des cultures régionales, il sera bon que le gouvernement précise sa position.
La Commission adopte les amendements AC 415 et AC 353.
M. le président Patrick Bloche. Je constate que, formellement, l’amendement AC 582 tombe mais qu’il est satisfait par l’adoption des amendements AC 415 et AC 353.
Section 4
L’enseignement moral et civique
Article 28
Enseignement moral et civique
Le présent article modifie les articles L. 311-4 et L. 312-5 du code de l’éducation, ainsi que l’intitulé de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre III du même code, en vue de substituer aux cours d’instruction civique qu’ils prévoient un enseignement moral et civique.
1. Le développement du libre arbitre
Comparé à l’objet assigné aux cours d’instruction civique par l’actuelle rédaction de l’article L. 311-4 – « inculquer aux élèves le respect de l’individu, de ses origines et de ses différences », l’enseignement moral et civique couvre un périmètre plus large. Il s’agit désormais de faire comprendre et acquérir aux élèves non seulement le « respect de la personne » – notion plus actuelle dans le débat public que celle de « respect de l’individu » –, de ses origines et de ses différences, mais aussi l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que les valeurs de la laïcité.
Comme l’indiquent M. Vincent Peillon, ministre de l’éducation nationale, et Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, « l'égalité entre les femmes et les hommes est aujourd'hui une valeur et une promesse de la République, en même temps qu'un objectif fondamental de l'institution scolaire. L'égalité en droit, la mixité scolaire n'ont pas suffi à abolir la différence de regard porté sur les filles et les garçons, la construction sexuée des parcours scolaires ni les violences sexistes à l'école » (179). L’école reproduit encore trop souvent des stéréotypes de genre qui peuvent avoir des conséquences lourdes et directes sur les parcours scolaires, puis professionnels, des jeunes. C’est pourquoi il importe de « déconditionner » les mentalités grâce à une éducation qui transmette dès les premières années la culture de l’égalité entre les sexes.
L’acquisition et la compréhension des valeurs de la laïcité doivent, quant à elles, permettre à chaque élève de s’émanciper. En effet, les valeurs de la laïcité ne se résument pas à la tolérance, ni à des règles de coexistence ; selon le ministre de l’éducation, « le point de départ de la laïcité, c’est le respect absolu de la liberté de conscience. Pour donner la liberté de choix, il faut être capable d’arracher l’élève à tous les déterminismes, familial, social, intellectuel… La laïcité consiste à faire un effort pour raisonner ». Une charte de la laïcité sera élaborée dans les mois à venir, à l’image de celle diffusée depuis 2007 dans les services publics ; elle « devra notamment s'attacher, par des définitions simples et courtes, à expliciter les notions de laïcité, de République, de citoyenneté de manière compréhensible pour les élèves » (180). Cette charte devra être affichée dans chaque établissement et pourra être jointe aux règlements intérieurs.
2. La construction du citoyen
Le présent article propose également de remplacer la première phrase de l’article L. 312-15 du code de l’éducation par deux phrases.
– La première définit le but de l’enseignement moral et civique au regard des objectifs du droit de l’enfant à l’instruction énoncés à l’article L. 131-1-1 : amener les élèves à être des citoyens responsables et libres, à se forger un sens critique et à adopter un comportement réfléchi. Cet énoncé appelle deux observations.
Tout d’abord, l’enseignement moral et civique s’inscrit ainsi clairement dans la tradition républicaine puisque la formation du citoyen, destinée principalement à construire une identité nationale, constituait le cœur de l’école de la République. Certes, le contenu, les objectifs et la forme de cet enseignement ont considérablement varié depuis la fin du XIXe siècle. L’« instruction morale et civique » telle qu’elle était définie dans les programmes de 1883, et qui était fortement liée d’une part, à une instruction morale, et d’autre part, à l’histoire et à la géographie, a été profondément remise en cause dans les années soixante.
Les changements considérables de la société – avec la fin des guerres coloniales, l’entrée dans la consommation de masse, la construction européenne, la libéralisation des mœurs etc… – ont fait passer au premier plan les dimensions sociales et économiques de la vie française au détriment de la dimension politique du lien collectif. En 1969, l’instruction civique a disparu comme discipline autonome dans l’enseignement primaire pour être fondue dans les activités d’éveil. Une évolution analogue a eu lieu dans l’enseignement secondaire où la réforme « Haby » a instauré en 1975 en lieu et place de l’instruction civique un « enseignement d’initiation à la vie économique et sociale ».
Mais la prise de conscience des difficultés d’intégration dans la société d’une jeunesse diverse culturellement a eu comme conséquence la réintroduction en 1985 à l’école primaire et au collège d’une « éducation civique », qui privilégie l’étude des institutions et des valeurs républicaines, tandis qu’est créé en 1999 pour les lycéens un programme d’« éducation civique, juridique et sociale » (ECJS).
Cet énoncé traduit, par ailleurs, la conception du ministre de l’éducation nationale, selon lequel « la République porte une exigence de raison et de justice. La capacité de raisonner, de critiquer et de douter, tout cela doit s’apprendre à l’école ». Comme le souligne le rapport de la concertation « Refondons l’école de la République », pour exercer de manière lucide et raisonnée la part de souveraineté qui lui est dévolue, le citoyen doit avoir appris à s’informer sur des sujets politiques, à juger du point de vue de l’intérêt général, à avoir le souci du bien commun, de la justice et de l’égalité, à argumenter et à débattre.
– La seconde phrase dispose que l’enseignement moral et civique comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République, à la connaissance et au respect des droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un engagement international et à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Il s’agit d’une reprise, appliquée à l’enseignement moral et civique, de la formulation de la première phrase de l’article L. 312-15 du code de l’éducation, qui concernait l’éducation civique.
L’objectif est toutefois d’unifier cet enseignement « à tous les stades de la scolarité » et d’en faire une discipline à part entière. En effet, à l’école primaire, bien qu’instituée dans un programme, l’instruction civique et morale s’enseigne rarement seule ; elle est liée aux apprentissages fondamentaux, à l’enseignement de l’histoire-géographie, aux premières démarches scientifiques ; au collège, à raison d’une heure hebdomadaire par niveau, l’éducation civique est enseignée essentiellement par les professeurs d’histoire et de géographie ; au lycée, les programmes d’éducation civique, juridique et sociale sont enseignés à raison de deux heures par quinzaine par des professeurs volontaires, de différentes spécialités (en pratique, des professeurs d’histoire et de géographie, ainsi que de sciences économiques et sociales) ; les trois dénominations différentes – instruction civique et morale à l’école primaire, éducation civique, au collège, éducation civique, juridique et sociale au lycée – prouvent, d’ailleurs, le manque de cohérence qui caractérise cet apprentissage.
De plus, comme le relève le ministre de l’éducation nationale, « si les créneaux horaires réservés à l’instruction civique et morale sont souvent utilisés par les enseignants pour rattraper le retard sur d’autres points du programme, c’est que la matière n’est pas ou peu évaluée (181); si les professeurs ne sont pas formés pour l’enseigner, cela ne sert à rien. »
C’est pourquoi M. Vincent Peillon a nommé, le 12 octobre 2012, une mission chargée de réfléchir à la définition et au contenu de l’enseignement moral et civique avec un triple objectif : qu’il y ait une cohérence depuis le primaire jusqu’à la terminale ; que l’enseignement soit évalué ; qu’il trouve un véritable espace. Composée de M. Alain Bergounioux, inspecteur général de l’éducation nationale, de Mme Laurence Loeffel, universitaire et de M. Rémy Schwartz, conseiller d’État, la mission doit rendre ses conclusions à la fin du mois de mars 2013. Le conseil supérieur des programmes sera alors saisi, afin que cette discipline soit inscrite aux programmes de la rentrée 2015. La formation pour l’enseigner pourra alors être dispensée au sein des écoles supérieures du professorat et de l’éducation mises en place en 2013.
*
La Commission aborde l’amendement AC 495 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. Il est dommage de réduire à un enseignement l’éducation à la citoyenneté, qui relève de la formation globale de l’individu.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Contrairement à vous, je préfère au terme d’éducation celui d’enseignement, qui suppose un programme, une progression et une évaluation. Nous devons faire de cette matière une véritable discipline, si nous voulons qu’elle soit prise au sérieux.
La Commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement AC 250 de M. Guénhaël Huet.
Puis elle examine, en présentation commune, les amendements AC 496 et AC 678 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. L’éducation morale et civique doit être envisagée dans une approche interdisciplinaire, au moyen de pratiques coopératives.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Je trouve gênant de noyer cet enseignement spécifique dans l’interdisciplinarité.
Mme Barbara Pompili. L’éducation morale et civique est par excellence interdisciplinaire, puisqu’elle fait appel à des connaissances historiques, sociologiques et politiques, ainsi qu’à l’expérience de la démocratie et de la citoyenneté.
Mme Julie Sommaruga. Je pense, comme le rapporteur, que l’enseignement moral et laïc est une discipline en soi, même s’il vise à l’acquisition de compétences transversales.
Mme Barbara Pompili. C’est un débat de fond. Nous tenons à ce que les disciplines ne soient plus cloisonnées. En attendant d’en discuter en séance publique, je retire les amendements.
Les amendements sont retirés.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements AC 497 et AC 498 de Mme Barbara Pompili.
Elle adopte successivement les amendements de cohérence AC 4, AC 5 et AC 6 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 28 modifié.
La Commission examine l’amendement AC 153 de M. Patrick Hetzel portant article additionnel après l’article 28.
M. Xavier Breton. L’orientation et les formations proposées aux élèves doivent tenir compte non seulement de leurs aspirations et de leurs aptitudes, mais aussi des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l’économie et de l’aménagement des territoires.
M. le rapporteur. Avis défavorable. La précision figure au mot près à l’article L. 313-1 du code de l’éducation, relatif à l’information et à l’orientation.
M. Xavier Breton. Je retire l’amendement, sous réserve de vérification.
L’amendement est retiré.
Section 5
L’enseignement du premier degré
Article 29
Cycles de l’école maternelle et élémentaire
Cet article vise à abroger l’article L. 321-1 du code de l’éducation qui dispose que la scolarité de l’école maternelle à la fin de l’école élémentaire comporte trois cycles. Il permettra de tirer les conséquences de l’article 23 du présent projet de loi qui propose un cadre juridique pour repenser le nombre et la durée des cycles par niveau d’enseignement, ceux-ci devant être fixés par décret. On rappellera que cette orientation se traduira notamment par la mise en place d’un cycle unique à l’école maternelle et d’un nouveau cycle CM2-6ème.
La Commission adopte l’article 29 sans modification.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements AC 330 et AC 331 de Mme Sandrine Mazetier.
Mme Julie Sommaruga. Ces amendements tendent à remplacer l’expression « école maternelle » par celle de « première école » ou d’« école pré-élémentaire ». En effet, le terme usuel ne plaide pas pour l’égalité des sexes et dévalorise le rôle des enseignants dont le métier, très difficile, ne consiste pas à changer les couches des élèves, selon la formule de M. Darcos.
M. le rapporteur. Défavorable. Il ne me semble pas utile de changer un terme qui n’a rien de choquant.
M. Rudy Salles. J’appuie la position du rapporteur. L’école maternelle est une institution et presque un symbole. On parle couramment de « la maternelle ». Il n’y a pas lieu de changer ce terme.
M. Xavier Breton. La position du rapporteur relève du bon sens.
Mme Marie-George Buffet. Invoquer le bon sens ou la tradition ne suffit pas. Pendant des décennies, on a parlé des droits de l’homme, ce qui réduisait la visibilité des femmes. On dit aujourd’hui « droits des êtres humains ». L’expression « école maternelle » établit un lien implicite entre la femme et le premier âge. Même si ces amendements sont dérangeants, ils sont justes sur le fond.
Mme Barbara Pompili. J’ai déposé sur l’article 30 un amendement AC 500 visant à substituer à l’expression d’école maternelle, datée et décalée par rapport à nos objectifs, celle d’école première.
La Commission rejette successivement les amendements.
Elle en vient à l’amendement AC 416 de Mme Anne-Lise Dufour-Tonini.
Mme Martine Faure. Nous proposons d’instituer, dans chaque secteur de recrutement d’une école élémentaire, un conseil pédagogique préélémentaire-élémentaire, qui favorisera la continuité pédagogique entre les niveaux scolaires et appréhendera la difficulté scolaire, ainsi que le suivi des élèves en difficulté. Sa composition et son fonctionnement seront fixés par décret.
Il est nécessaire d’accorder une attention particulière au passage de la maternelle à l’école élémentaire qui, comme celui de l’école élémentaire au collège, est fragilisant.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Un des points forts du texte est de faire de la maternelle une école à part entière, déconnectée de l’école élémentaire. Il n’y a donc pas lieu de créer un organisme pour rétablir un lien entre elles.
M. Xavier Breton. Je ne suis pas convaincu de l’opportunité d’instaurer une coupure entre la maternelle et l’école élémentaire. L’amendement pointe une réelle difficulté : faut-il séparer ou réunir les deux écoles ?
Mme Martine Faure. L’amendement est sans doute mal écrit. On doit faire de la maternelle un cycle à part entière, tout en favorisant le passage entre la maternelle et le primaire.
M. Mathieu Hanotin. La création de ce conseil ne me semble pas la bonne solution, car elle risque de créer des lourdeurs bureaucratiques.
M. le rapporteur. La « continuité pédagogique » évoquée par l’amendement tend à recréer un cycle unissant la grande section de maternelle et le CP, ce qui est incohérent avec le dispositif mis en place par le texte. Je suggère donc le retrait de l’amendement afin que sa rédaction puisse être revue.
Mme Martine Faure. Je le retire donc.
L’amendement est retiré.
Article 30
Redéfinition des missions de l’école maternelle
Cet article vise à enrichir les missions de l’école maternelle, définies à l’article L. 321-2 du code de l’éducation, afin de souligner que la formation dispensée à ce niveau sera centrée sur le développement de l’enfant, dans toutes ses dimensions.
1. Une école « première » qui perd peu à peu le sens de sa mission
« École première » selon la belle expression de M. Philippe Meirieu, l’école maternelle a un rôle clef à jouer dans la stimulation des capacités et des compétences sur lesquelles reposent tous les apprentissages et, par conséquent, dans la compensation des inégalités sociales.
Dans le même temps, cette école accueille de très jeunes enfants, dont le développement intellectuel dépend étroitement de leur développement affectif. Ce dernier ne doit donc pas être « bousculé » par l’introduction trop précoce des apprentissages scolaires.
Or, force est de constater que l’école maternelle française peine à concilier ces deux exigences.
● Un bilan inégal en ce qui concerne la langue et le langage
Les programmes de l’école maternelle de juin 2008 accordent la priorité au langage oral et écrit, dans la production (expression orale et production d’écrits) et la réception (écoute et compréhension du langage présenté par le maître), ainsi qu’au travail sur la langue, la structuration de la syntaxe et l’enrichissement du lexique. Cette priorité a même été rehaussée avec le plan de prévention de l’illettrisme mis en place par le précédent gouvernement à la rentrée 2010.
Dans la pratique, selon les inspections générales de l’éducation nationale, le bilan de l’application de cette priorité reste inégal. De fait, la pédagogie de l’oral présente, entre les enquêtes effectuées en 1999 et 2011, « toujours autant de faiblesses et les mêmes difficultés ». À titre d’illustration, les inspections générales ont observé que « dans les classes, il est indéniable qu’il y a du langage, mais le volume et le temps de parole des enfants sont parfois peu élevés, surtout dans les écoles qui accueillent massivement des élèves de milieux défavorisés », en ajoutant que « partout l’on observe peu d’activités structurées, peu ou pas d’interventions didactiques explicites » : ainsi, on suscite le langage par une « grêle de questions magistrales », l’objectif étant quantitatif, tandis que l’on observe peu d’échanges entre les enfants et que l’enseignement de l’oral n’est ni programmé ni organisé.
Quant à la production d’écrit, la classe maternelle est souvent « envahie d’écrits divers mais les enfants voient rarement écrire les adultes à l’école » alors qu’il serait nécessaire de rendre visible le travail mental d’élaboration nécessaire à la construction d’un texte en le pratiquant devant eux (182).
● Une école qui ne doit pas oublier qu’elle accueille des « tout-petits »
Bien que les particularités de l’école maternelle soient affirmées par les textes, ses méthodes d’apprentissage et d’évaluation, en particulier celles de la grande section (GS), « s’alignent » souvent sur celles de l’école élémentaire (183).
Pourtant le législateur a pris soin, dès la loi du 11 juillet 1975 relative à l’éducation, de prévoir que la formation dispensée dans les classes et écoles maternelles doit favoriser « l’éveil de la personnalité des enfants » sans « rendre obligatoire l’apprentissage précoce de la lecture ou de l’écriture » (article L. 321-2 du code de l’éducation). Le rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale, M. Jacques Legendre, avait d’ailleurs mis en garde le gouvernement de l’époque contre le risque « majeur » qu’il y aurait à « oublier le caractère véritablement préscolaire de la maternelle pour vouloir y multiplier les apprentissages précoces » (184).
Malgré ces précautions, l’école maternelle à la française devient « scolaire » trop vite, trop tôt – dans un contraste frappant avec la Finlande. On rappellera que, dans ce pays, les enfants commencent normalement à apprendre à lire qu’à partir de 7 ans. Auparavant, le jardin d’enfant (1 à 6 ans) et l’éducation préscolaire (6 à 7 ans) cherchent, avant tout, à éveiller les aptitudes des enfants, leur curiosité, leur habileté : « chaque jour est consacré à une discipline (musique, sport, activités manuelles ou artistiques, langue maternelle, maths), mais c’est seulement le matin que les enfants s’y initient, de façon toujours très attractive », l’après-midi étant réservé au jeu (185).
Devant la Commission des affaires culturelles et de l’éducation, M. Jean-Paul Delahaye, le directeur général de l’enseignement scolaire, a mis en lumière les effets de la « primarisation » de l’école des tout-petits : « nous avons une tendance culturelle à « primariser » l’école maternelle – en particulier au cours de la dernière année, celle de la grande section –, à anticiper les apprentissages alors qu’il faudrait, au contraire, les rendre beaucoup plus progressifs. Ce faisant, on exerce très précocement une pression presque insupportable sur certains élèves, on les met en difficulté, puis, très vite, on les identifie comme élèves en difficulté. Or nous ne savons pas, dans notre pays, réparer les difficultés ni compenser l’impact des inégalités sociales sur le parcours scolaire, de sorte que l’on ne parvient jamais à rétablir la situation de ces élèves » (186).
C’est pourquoi les inspections générales ont préconisé, dans un rapport « caché » par le précédent gouvernement, d’inverser la logique actuelle afin de penser le cursus de l’école maternelle « selon une approche progressive qui s’accorde au développement de l’enfant et le stimule, en partant du plus jeune âge, et non selon une conception régressive qui met l’école maternelle au service de l’école élémentaire en la conduisant à adopter prématurément la forme scolaire » (187).
L’ensemble de ces constats ont inspiré les orientations définies par le rapport annexé au présent projet de loi. Comme cela a déjà été indiqué, il prévoit la mise en place, dès la rentrée 2014, d’un cycle unique à l’école maternelle afin de redonner à celle-ci son unité pédagogique, et met l’accent sur :
– la préparation progressive des enfants aux apprentissages fondamentaux de l’école élémentaire ;
– une meilleure formation des enseignants, appuyée sur un partenariat avec les collectivités compétentes, en vue d’améliorer l’accueil matériel, éducatif et pédagogique des très jeunes enfants. Sur ce dernier point, en effet, on observe une perte de professionnalisme chez certains maîtres, qui n’ont pas été préparés à l’enseignement en maternelle. Or, l’école maternelle correspond à un type de scolarisation particulier : il faut donc apprendre à y enseigner, ce que l’on ne fait plus.
2. La clarification proposée par le projet de loi
Le présent article propose de remplacer la première phrase de l’article L. 321-2 du code de l’éducation, relatif aux classes et écoles maternelles, par de nouvelles dispositions afin de procéder à un rééquilibrage des missions éducatives et pédagogiques de la maternelle.
Les modifications prévues permettront ainsi de redonner à la maternelle une identité propre, centrée sur le développement de l’enfant ainsi que sur son épanouissement affectif.
La formation qui y sera dispensée devra donc répondre à plusieurs grands objectifs qui constitueront un ensemble équilibré et cohérent, entre conciliation du caractère préscolaire et scolaire de ce niveau d’enseignement et apprentissage de la vie en société.
En tenant compte de la modification proposée par le présent article et des dispositions de l’article L. 321-2 laissées inchangées, ces objectifs seront au nombre de quatre :
– l’éveil de la personnalité de l’enfant, son développement dans toutes ses dimensions (« sensoriel, moteur, cognitif et social »), et, enfin, son épanouissement affectif. Cette triple mission, qui est indissociable de l’accueil et de la scolarisation de très jeunes enfants, n’a jusqu’ici jamais été reconnue par le législateur. Ce dernier a seulement précisé, avec la loi du 4 juillet 1975 relative à l’éducation, que l’école maternelle « favorise l’éveil de la personnalité de l’enfant » ;
– la prévention des difficultés scolaires, le dépistage des handicaps et la compensation les inégalités ;
– une mission éducative comportant une première approche des outils de base de la connaissance et la préparation des enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l’école élémentaire ;
– l’apprentissage des principes de la vie en société.
Ces trois derniers objectifs ont été posés ou reprécisés par la loi du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école.
Par ailleurs, la réécriture proposée de l’article L. 321-1 du code aura pour effet de supprimer les dispositions de la première phrase indiquant que l’école maternelle favorise l’éveil de la personnalité « sans rendre obligatoire l’apprentissage précoce de la lecture ou de l’écriture ». Cette modification doit être saluée, car, ainsi que l’a constaté le Conseil économique, social et environnemental, le principe posé en 1975 relevait plus de la « prétérition que de l’interdit » (188).
Au total, le présent article constitue une base solide pour affirmer l’identité pédagogique de l’école maternelle. Aux yeux du rapporteur, celle-ci doit avoir un double fondement :
– afin de rétablir l’égalité des chances, l’école maternelle, qui, selon l’étude d’impact du projet de loi, « ne réalise que trop imparfaitement son rôle de réduction des écarts de niveau entre les élèves », devrait initier et exercer les enfants à l’usage des différents moyens d’expression. La maîtrise de l’expression, en particulier du langage, pourrait être ainsi placée au cœur de sa mission scolaire ;
– la préparation progressive des élèves des classes maternelles aux apprentissages fondamentaux dispensés à l’école primaire devrait tenir compte des besoins affectifs des enfants concernés et reposer sur des approches éducatives permettant de développer la confiance en soi et l’envie d’apprendre. Par conséquent, la pédagogie de l’enseignement préélémentaire devrait être toute d’encouragement et accorder une plus grande place au jeu.
La Commission a adopté deux amendements de fond à cet article pour préciser que la formation dispensée dans les écoles maternelles :
– d’une part, favorise l’estime de soi et des autres ;
– d’autre part, est adaptée aux élèves en situation de handicap pour permettre leur scolarisation.
*
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 500 de Mme Barbara Pompili.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 417 de Mme Julie Sommaruga.
Mme Julie Sommaruga. Il importe que les enfants puissent acquérir l’estime et le respect d’eux-mêmes et des autres.
M. le rapporteur. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AC 181 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. Cet amendement est déposé par des membres du groupe d’études sur l’intégration des personnes handicapées. La maternelle étant une école comme les autres, elle doit être elle aussi inclusive et chaque enfant, y compris lorsqu’il est en situation de handicap, doit être pris en compte selon ses besoins.
M. le rapporteur. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite l’article 30 modifié.
L’amendement AC 418 de Mme Anne-Lise Dufour-Tonini, portant article additionnel après l’article 30, est retiré.
Article 30 bis (nouveau)
Rapport annuel sur la situation des écoles maternelles
Compte tenu du rôle clef de l’école maternelle dans la lutte contre les inégalités et des engagements pris par le ministre de l’éducation nationale en matière de scolarisation des enfants de moins de trois ans, la Commission a adopté un amendement insérant cet article qui vise à assurer l’information du Parlement sur cette question essentielle.
Ainsi, le gouvernement, en lien avec les inspecteurs d’académie, devra effectuer un état des lieux annuel de la situation des écoles maternelles, qui sera communiqué sous forme de rapport aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il devra également remettre à ces commissions un rapport annuel spécifique sur la scolarisation des enfants de deux ans à trois ans.
*
La Commission est saisie de l’amendement AC 584 de Mme Marie-George Buffet.
Mme Marie-George Buffet. Mes amendements tendant à instaurer l’obligation de scolarisation à l’école maternelle n’ayant pu être discutés, celui-ci vise à prendre date pour une réflexion plus approfondie sur la maternelle.
M. le rapporteur. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Article 31
Redéfinition des missions de l’école élémentaire
Cet article vise à redéfinir les missions de l’école élémentaire, précisées à l’article L. 321-3 du code de l’éducation, en enrichissant la notion d’« instruments fondamentaux de connaissance » et en confortant son rôle d’éducation, aux côtés des familles, dans les domaines de la morale et du civisme.
1. L’école primaire, qui ne fonctionne pas pour la moitié de ses élèves, est enfin élevée au rang de priorité
Ainsi que cela a déjà été indiqué dans l’exposé général du présent rapport, quatre élèves sur dix sont en difficulté en fin de primaire, puisque 60 % d’entre eux, seulement, atteignent, à la fin du CM2, le niveau de connaissances attendu en français et en calcul. De plus, pour les 15 % d’élèves éprouvant de très sérieuses difficultés, leurs lacunes « rendent impossibles aussi bien un réel parcours scolaire au collège qu’une formation qualifiante » selon le verdict rendu en 2007 par le Haut conseil de l’éducation (189).
La nation s’est pourtant engagée, en 2005, à donner à chaque enfant les moyens de maîtriser le socle commun au terme de la scolarité obligatoire, l’école élémentaire ayant un rôle essentiel à jouer dans la réalisation de cet objectif.
En ce qui concerne la contribution, décisive, de ce niveau d’enseignement au parcours des élèves, les travaux de M. Bruno Suchaut, directeur de l’Institut de recherche en éducation (Irédu-CNRS) ont permis de dresser une cartographie des compétences des élèves de l’école élémentaire et de repérer ainsi celles qui apparaissent essentielles à la réussite scolaire. Certaines d’entre elles sont en effet « particulièrement prédictives » du niveau global d’acquisition des élèves. Ainsi, selon ce chercheur, « à l’entrée au CE2 et à l’entrée en 6ème, il apparaît qu’un nombre limité de compétences suffit à expliquer la quasi-totalité des écarts de performances entre les élèves. Au niveau du CE2, les compétences les plus prédictives du niveau global des élèves et centrales dans les mécanismes d’apprentissage se regroupent dans trois grands domaines : le calcul mental, les capacités attentionnelles et l’orthographe. Ces ensembles de compétences peuvent donc être considérés comme primordiaux dans les acquisitions des élèves » (190).
Ainsi que le souligne le dernier rapport du Haut conseil de l’éducation, ces éléments doivent conduire la nation à accorder « une attention toute particulière à son école primaire, notamment au premier cycle de la scolarité obligatoire », c’est-à-dire à celui des approfondissements : « les lacunes dans les apprentissages de ces années-là ont des répercussions négatives sur toute la scolarité ultérieure, car les retards pris sont très difficiles à rattraper » (191).
Cette attention « toute particulière » a trouvé, dans le présent projet de loi et son rapport annexé, une double traduction qu’il convient de saluer :
– une traduction budgétaire avec l’affectation aux écoles des deux tiers de postes d’enseignants titulaires devant être créés sur la durée du quinquennat, soit 14 000 emplois dont la moitié seront consacrés au renforcement de l’encadrement pédagogique dans les zones difficiles, notamment par le recours au dispositif « plus de maîtres que de classes ». Aux termes de la circulaire n° 2012-201 du 18 décembre 2012, l’objectif de l’équipe d’enseignants ainsi constituée est de conduire chaque élève à la maîtrise du socle commun, son action étant « prioritairement centrée sur l’acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance (expression orale et écrite, mathématiques) et de la méthodologie du travail scolaire » ;
– une traduction juridique avec le présent article qui se propose de clarifier et d’enrichir les missions de l’école élémentaire. Avec des programmes trop chargés, celle-ci reste en effet excessivement centrée sur la transmission des connaissances alors qu’elle doit contribuer plus fortement à l’acquisition des compétences.
2. Le dispositif proposé par le projet de loi
Le présent article propose de modifier l’article L. 321-3 du code de l’éducation relatif à la formation dispensée dans les écoles élémentaires dans un double but. Il s’agit :
– d’une part, d’enrichir les contenus d’enseignements dispensés à ce stade de la scolarité, ceux-ci étant restés centrés sur l’acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance ;
– d’autre part, de conforter sa mission d’éducation morale et civique, tout en donnant une expression plus claire à la notion de « coéducation » avec les parents.
Avant de présenter ces modifications, on observera que le présent article prévoit de procéder à une substitution de référence afin de tenir compte de la suppression des trois cycles de l’école maternelle et élémentaire proposée par l’article 29 du projet de loi. Quant à la disposition de l’article L. 321-3 du code qui précise que cette formation suscite le développement de l’intelligence, de la sensibilité artistique, des aptitudes manuelles, physiques et sportives, le présent article ne prévoit pas de la modifier.
a) Des connaissances et des compétences de base enrichies
● Une définition des instruments fondamentaux de la connaissance utilement complétée
La mission prioritaire de l’école élémentaire, qui, d’un point de vue formel, vient en tête des objectifs fixés à ce niveau d’enseignement par l’article L. 321-3 du code de l’éducation, est l’acquisition des « instruments fondamentaux de la connaissance », une notion introduite par la loi du 4 juillet 1975 relative à l’éducation.
Ceux-ci continueront d’occuper la première place dans la rédaction proposée par le présent article, mais il est prévu d’enrichir leur définition : la résolution de problèmes s’ajoutera à l’expression orale et écrite – la disposition actuelle faisant seulement référence à l’expression écrite ou orale –, à la lecture et au calcul.
La modification proposée permettra de mettre l’accent sur une compétence essentielle pour la réussite de la scolarité au collège. En effet, selon le chercheur Bruno Suchaut, les « capacités attentionnelles (des élèves) sont liées aux compétences en calcul mental qui elles-mêmes vont déterminer les futures acquisitions des élèves en numération et calcul à l’entrée au collège et, de façon indirecte, les compétences en compréhension », ce dernier domaine étant « central » pour expliquer la réussite ou l’échec des élèves à l’entrée du second degré (192). L’Académie des sciences, de son côté, dans un avis adopté en 2006, avait souligné toute l’importance des objectifs qui consistent à donner à l’enfant un « socle solide d’automatismes » dans le domaine du calcul et à « maintenir constamment ces calculs en liaison avec leur sens quantitatif » (193).
● Une référence à la culture scientifique et technique
La formation dispensée à l’école élémentaire devra par ailleurs comporter « les éléments d’une culture scientifique et technique ».
Cette notion est en effet curieusement absente de la définition des missions de l’enseignement élémentaire alors que la culture scientifique et technologique constitue, depuis 2006, l’un des piliers du socle commun. On citera, à ce sujet, l’annexe du code de l’éducation définissant le socle, qui souligne que « les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectif de comprendre et de décrire le monde réel, celui de la nature, celui construit par l’Homme ainsi que les changements induits par l’activité humaine. Leur étude contribue à faire comprendre aux élèves la distinction entre faits et hypothèses vérifiables d’une part, opinions et croyances d’autre part. Pour atteindre ces buts, l’observation, le questionnement, la manipulation et l’expérimentation sont essentiels, et cela dès l’école primaire, dans l’esprit de l’opération « La main à la pâte » qui donne le goût des sciences et des techniques dès le plus jeune âge » (194).
Cet ajout permettra de souligner l’importance de la culture scientifique et technique qui, tout comme la culture humaniste, permet de « préparer l’exercice de la citoyenneté », l’un des objectifs assignés au socle commun (article L. 122-1-1 du code de l’éducation). Le goût pour les sciences se cultivant tôt, il donnera ainsi une impulsion à l’enseignement des sciences expérimentales et de la technologie – au sujet duquel l’Académie des sciences a exprimé ses inquiétudes, en soulignant que « l’effort engagé par La main à la pâte depuis 1996 est loin d’être parvenu à son terme, environ une moitié encore des classes primaires françaises ne respectant sans doute pas les obligations d’enseignement de ces sciences, obérant par là même la qualité de leurs études au collège » (195).
Dans le même temps, l’expression : « éléments de la culture scientifique et technique » se justifie par la place relativement modeste de cet enseignement – dont la durée annuelle est de 78 heures (196)– dans les apprentissages à l’école élémentaire. Celui-ci est en effet introduit progressivement dans le cursus des élèves, puis se renforce au collège à partir des fondements acquis au primaire grâce à trois disciplines constituées, les sciences de la vie et de la terre (SVT), la technologie et la physique-chimie.
b) La reconnaissance de nouveaux contenus d’enseignement
Au titre de ses missions, l’école élémentaire devra mettre en œuvre de nouveaux contenus de formation, à savoir l’éducation artistique et musicale et une première langue vivante étrangère, dont le cadre de référence est complété par d’autres articles du présent projet de loi.
● L’éducation aux arts
Aujourd’hui, l’école élémentaire est tenue d’offrir une « initiation aux arts plastiques et musicaux ». Le présent article prévoit d’aller plus loin, en proposant que ce niveau d’enseignement offrira une « éducation » à ces arts.
La cohérence et la finalité pédagogique de cette formation y gagneront. On rappellera en effet qu’à l’école primaire, cette éducation repose aujourd’hui sur des dispositifs variés : les enseignements et les pratiques artistiques (arts visuels et éducation musicale) – les programmes de 2008 attribuant à celles-ci et à l’histoire des arts 78 heures annuelles (197) – et les classes à horaires aménagés, qui proposent, du CE1 à la 3ème, aux élèves volontaires, un enseignement artistique renforcé en musique, danse ou théâtre.
En outre, la reconnaissance plus affirmée de cette dimension de la formation facilitera la mise en œuvre, au début de la scolarité obligatoire, donc du CP, du parcours d’éducation artistique et culturelle prévu par l’article 6 du présent projet de loi.
● L’enseignement d’une langue vivante étrangère
Par ailleurs, le présent article prévoit d’accorder, au sein du cursus de l’école élémentaire, une plus grande importance à la formation en langue vivante étrangère. Celle-ci deviendra en effet un « enseignement » alors que le code se réfère aujourd’hui à la notion, plus floue, d’apprentissage. Ses modalités sont précisées par l’article 27 du présent projet de loi.
● Une mission de formation aux médias
L’utilisation des médias constituant un véritable enjeu de société et de citoyenneté, l’école doit s’emparer de ces outils pour être en mesure de poursuivre ses missions traditionnelles d’instruction et d’éducation. Si elle ne le faisait pas, elle risquerait de devenir obsolète aux yeux d’enfants pour qui les écrans exercent, aujourd’hui, une influence culturelle et éducative bien supérieure, trop parfois, à celle de nombreux enseignants.
L’éducation aux médias constitue donc un « impératif démocratique » selon l’expression de M. Laurent Gervereau, directeur du Dictionnaire mondial de l’image. Cependant, cette éducation doit être définie non pas comme un enseignement – ce qui, compte tenu du poids et de la structuration des disciplines actuelles, serait irréaliste – mais comme une démarche visant, selon les inspections générales de l’éducation nationale, à permettre à l’élève « de connaître, de lire, de comprendre et d’apprécier les représentations et les messages issus de différents types de médias auxquels il est quotidiennement confronté, de s’y orienter et d’utiliser de manière pertinente, critique et réfléchie ces grands supports de diffusion et les contenus qu’ils véhiculent » (198).
Or, jusqu’à présent, la loi n’a jamais assigné une telle ambition à l’école. Il est vrai aussi que les efforts déployés par l’institution scolaire pour sensibiliser les élèves aux enjeux de cette problématique se heurtent à de nombreux obstacles, à commencer par le « mur » culturel qui sépare traditionnellement l’école de la vie quotidienne.
De surcroît, les politiques menées en la matière sont portées par une structure légère, le Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information (CLEMI). Ce dernier est chargé de l’éducation aux médias dans l’ensemble du système éducatif, son objet étant de « promouvoir, tant au plan national que dans les académies, notamment par des actions de formation, l’utilisation pluraliste des moyens d’information dans l’enseignement, afin de favoriser une meilleure compréhension par les élèves du monde qui les entoure tout en développant leur sens critique » (décret n° 93-718 du 25 mars 1993). Placé sous la tutelle du ministère de l’éducation nationale, le CLEMI est rattaché au Centre national de documentation pédagogique (CNDP), dont il constitue aujourd’hui un « service », et travaille sur la base d’une convention passée avec la direction générale de l’enseignement scolaire du ministère de l’éducation nationale.
En prévoyant que la formation dispensée en école élémentaire « contribue à la compréhension et à un usage autonome et responsable des médias », le présent article posera donc un défi « organisationnel » à l’éducation nationale, qui devra être relevé. Et il ne pourra l’être qu’à condition de jouer à fond la « carte » de l’interdisciplinarité.
● Une mission d’éducation morale et civique confortée
Le présent article propose de clarifier le rôle de l’école élémentaire en matière d’éducation morale et civique et de donner une expression plus claire au partenariat avec la famille dans ce domaine fondamental.
Outre que les modifications proposées tiendront compte de la mise en place d’un enseignement moral et civique prévu par l’article 28 du présent projet de loi, elles permettront d’améliorer la rédaction, aujourd’hui peu satisfaisante, des dispositions de l’article L. 321-3 du code de l’éducation consacrées à cet aspect de la formation.
En premier lieu, ces dispositions sont faussement ambitieuses. Le second alinéa de l’article L. 321-3 se réfère à un « enseignement d’éducation civique ». Cette formulation fait l’impasse sur l’éducation morale, alors qu’elle est prévue par les textes réglementaires, tandis qu’elle laisse croire que cette formation, promue au rang « d’enseignement », constitue une « discipline » à part entière. Or, rien n’est moins vrai puisque les programmes de l’école élémentaire consacrent 78 heures, pêle-mêle, à l’histoire-géographie-instruction morale et civique. Et l’affirmation, par la circulaire n° 2011-131 du 25 août 2011, que « l’instruction civique et morale constitue un enseignement à part entière » n’y a rien changé.
De manière plus pragmatique, le présent article propose que l’école primaire « assure conjointement avec la famille l’éducation morale et civique ». Ainsi, cette disposition permettra de donner à cette formation un statut plus adapté à la place réelle qu’elle occupe dans l’enseignement élémentaire, tout en reconnaissant, et de manière beaucoup plus complète, le rôle joué, en la matière, par la famille.
C’est d’ailleurs là le deuxième reproche qui peut être fait au second alinéa de l’actuel article L. 321-3 du code. En effet, celui-ci reconnaît le rôle de la famille dans le domaine de la morale, tout en l’ignorant dans le domaine civique. Pourtant, l’initiation à l’apprentissage de la citoyenneté se fait, le plus souvent, au sein de la famille, où l’enfant entend parler, pour la première fois, des échéances électorales ou des grands débats publics. En outre, l’éducation civique et l’éducation morale ne peuvent être dissociées, à l’école comme dans la vie de tous les jours, ces termes constituant les deux pôles du « vivre ensemble ».
Troisième et ultime reproche : l’article L. 321-3 du code n’établit pas de lien entre l’éducation civique, la citoyenneté et les valeurs de la République. Sa rédaction actuelle se contente en effet d’indiquer que cet « enseignement » comporte « obligatoirement » l’apprentissage de l’hymne national et de son histoire, ce qui est un peu court.
C’est pourquoi le présent article prévoit de compléter ces dispositions en prévoyant que l’éducation morale et civique comprendra « obligatoirement » l’apprentissage des valeurs et symboles de la République, notamment de l’hymne national et de son histoire.
Il propose en outre de lier cette formation à l’exercice de la citoyenneté – la formation dispensée à l’école élémentaire devant « permettre l’exercice » de celle-ci –, autant d’ajouts qui ne sont nullement superfétatoires :
– la référence aux « valeurs de la République » permettra de consacrer l’apprentissage, dans les classes, des éléments constitutifs de l’idéal républicain, qui est un idéal universaliste. Les valeurs de la République ont en effet pour fondement la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, reprises dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958. La devise républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité » s’appuie sur cette déclaration en la résumant en trois grands principes. À ce premier ensemble, il convient d’ajouter, bien entendu, la laïcité consacrée par le premier article de la Constitution de 1958 qui la place au deuxième rang des principes fondateurs de la République : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale » ;
– la référence aux symboles de la République consacrera l’apprentissage des attributs de la souveraineté républicaine, tels que l’article 2 de la Constitution les définit : « L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L’hymne national est La Marseillaise. La devise de la République est Liberté, Égalité, Fraternité. Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». D’autres symboles, qui ne sont pas gravés dans le marbre constitutionnel, mais qui « incarnent », au vrai sens du terme, la République, en particulier Marianne et la fête nationale du 14 juillet, qui célèbre la liberté et la lutte contre toutes les formes d’oppression et d’arbitraire, pourront être également présentés en classe.
On notera que selon une enquête du réseau européen d’information sur les systèmes éducatifs Eurydice publiée en 2012, vingt pays sur les trente-quatre étudiés enseignent « l’éducation à la citoyenneté » comme une matière obligatoire et séparée, généralement à partir de l’enseignement secondaire : par exemple, l’Angleterre et le Pays de Galles, la Norvège, la Finlande et la Pologne. D’autres commencent dès le primaire : le Portugal, l’Espagne, la France, l’Estonie, la Bulgarie, la Grèce et Malte, étant précisé que la France et le Portugal « partagent la palme de l’éducation précoce », puisqu’elle commence dès l’âge de six ans (199).
3. Les améliorations apportées par la Commission
À l’initiative du rapporteur, la Commission a précisé que la formation dispensée dans les écoles primaires devra aussi dispenser les éléments d’une culture historique et géographique, la rédaction actuelle ne faisant référence qu’à la culture scientifique et technique. Ces deux disciplines, qui permettent aux jeunes élèves d’acquérir tout à la fois le sens de la continuité et de la rupture, de l’identité et de l’altérité, se verront ainsi consacrées comme étant des piliers de la scolarité élémentaire et, par voie de conséquence, du socle commun.
La Commission a également ajouté que la formation élémentaire devra assurer une éducation aux conditions de l’égalité de genre. Selon les auteurs de l’amendement, cette disposition a pour but d’intégrer dans cette formation « une éducation à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la déconstruction des stéréotypes sexués ».
Enfin, la Commission a précisé que l’éducation morale et civique devra comprendre l’apprentissage de l’hymne européen et de son histoire.
*
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 750 de M. Jean-Louis Borloo.
Elle est ensuite saisie des amendements identiques AC 35 du rapporteur et AC 117 de M. Frédéric Reiss.
M. le rapporteur. Remplacer les mots : « résolution des problèmes » par les mots : « résolution de problèmes » n’est pas qu’une correction rédactionnelle.
M. Xavier Breton. Je souscris à cette observation.
La Commission adopte les amendements.
Elle examine ensuite l’amendement AC 129 de Mme Claudine Schmid.
Mme Claudine Schmid. L’amendement tend à compléter la liste des formations qui assurent l’acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance, en y intégrant l’esprit d’entreprendre et la démarche expérimentale.
M. le rapporteur. Pour les mêmes raisons que précédemment, avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 751 de M. Rudy Salles.
M. Rudy Salles. Cet amendement est de cohérence.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements AC 641 du rapporteur et AC 752 de M. Rudy Salles.
M. le rapporteur. L’amendement AC 641 tend à rappeler l’importance de l’histoire et de la géographie dans la formation dispensée par l’école primaire.
M. Rudy Salles. Je retire l’amendement AC 752 et me rallie à l’amendement AC 641.
L’amendement AC 752 est retiré.
La Commission adopte l’amendement AC 641.
Elle examine ensuite les amendements identiques AC 419 de Mme Martine Faure et AC 355 de M. Paul Molac.
Mme Martine Faure. L’amendement AC 419 a pour objet de préciser que la formation dispensée dans les écoles élémentaires contribue à la connaissance et à la transmission des langues régionales.
Mme Barbara Pompili. L’amendement AC 335 est identique.
M. le rapporteur. Si cet amendement était adopté, l’enseignement qu’il prescrit s’appliquerait à l’ensemble du territoire national, ce qui est en contradiction avec l’esprit même de l’enseignement des langues régionales. Je ne peux donc qu’exprimer un avis défavorable.
Mme Barbara Pompili. La France est riche de ses cultures régionales et il est bon que les jeunes Français les connaissent. Bien évidemment, le dispositif s’appliquera plus fortement dans les régions où des langues régionales sont fortement implantées.
M. le rapporteur. Prenons garde de ne pas surcharger des programmes dont nous reconnaissons nous-mêmes qu’ils sont déjà trop lourds.
Mme Martine Faure. L’amendement prévoit que la formation contribue à la connaissance des langues régionales, ce qui n’implique pas d’obligation.
M. le président Patrick Bloche. Cette disposition a toutefois une valeur normative.
M. le rapporteur. Compte tenu de l’imprécision qui entoure les conséquences de cet amendement, je suggère son retrait, afin que sa rédaction puisse être retravaillée.
Mme Martine Faure. Je retire donc l’amendement AC 419.
Mme Barbara Pompili. Et moi l’amendement AC 355.
Les amendements AC 419 et AC 355 sont retirés.
La Commission est ensuite saisie de l’amendement AC 420 de M. Vincent Feltesse.
Mme Martine Martinel. Cet amendement tend à compléter la disposition selon laquelle la formation primaire « contribue à la compréhension et à un usage autonome et responsable des médias » en précisant que ces médias sont « notamment numériques ». Cela répond à l’ambition numérique portée par le projet de loi.
M. le rapporteur. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AC 421 de Mme Martine Faure.
Mme Julie Sommaruga. Cet amendement a pour objet l’intégration dans la formation dispensée dans les écoles élémentaires d’une éducation à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la déconstruction des stéréotypes sexués. Il s’agit de substituer à des catégories telles que le « sexe » ou la « différence sexuelle », qui renvoient à la biologie, le concept de « genre », qui montre que les différences entre les hommes et les femmes ne sont pas fondées sur la nature, mais sont historiquement construites et socialement reproduites.
M. le rapporteur. Avis favorable.
M. Xavier Breton. Comme en témoigne la proposition de résolution demandant une commission d’enquête, cosignée par Mme Virginie Duby-Muller et par moi-même, nous reconnaissons aux études de genre un grand intérêt. Le problème commence quand on bascule dans une théorie qui dénie toute importance au biologique. J’appelle donc le rapporteur à une grande vigilance : il convient de ne pas introduire dans notre législation cette idéologie du « gender ».
Mme Virginie Duby-Muller. Il nous faut être vigilants face à une terminologie qui véhicule une idéologie, dont nous avons eu tout à l’heure un aperçu avec la proposition de changer le nom de l’école maternelle.
Mme Martine Martinel. Il ne s’agit nullement de nier la biologie. La théorie du genre est déjà ancienne et n’est pas une idéologie propre à renverser toutes les valeurs de la société.
Mme Marie-George Buffet. Quelle idéologie véhiculerait donc la théorie du genre ? Elle se borne à dire que des hommes et des femmes ne se retrouvent pas dans leur état biologique et se construisent autrement. Ce n’est que le constat d’un vécu, qu’il faut prendre en compte. Nous demandons l’égalité des genres.
Mme Lucette Lousteau. On observe de plus en plus souvent, et chez des enfants de plus en plus jeunes, des attitudes qui trouvent leur origine dans une confrontation de genre. Pour lutter contre ce phénomène, il faut éduquer les enfants le plus tôt possible à cette réalité de genre.
Mme Martine Faure. L’amendement a pour objet d’insister sur l’égalité des genres.
M. Xavier Breton. Madame Lousteau, qu’entendez-vous concrètement par « confrontation de genre » ?
M. le président Patrick Bloche. Mme Lousteau n’est pas obligée de répondre. Nous n’allons pas entrer dans une discussion sur la théorie du genre.
M. le rapporteur. J’émets, je le répète, un avis favorable. Cet amendement n’impose aucune idéologie ; il se borne à constater un fait. L’école doit apprendre aux enfants à comprendre la société dans laquelle ils sont appelés à vivre et à devenir des êtres et des citoyens responsables.
La Commission adopte l’amendement.
Elle est alors saisie de l’amendement AC 501 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. Dès lors que l’on précise que le drapeau et l’hymne national figurent au programme de l’éducation morale et civique, il faut y ajouter l’hymne européen, car l’éducation doit s’inscrire dans une dimension européenne indispensable pour l’éducation des futurs citoyens européens. Du reste, un hymne intitulé Ode à la joie n’est-il pas un vrai programme d’éducation ?
M. le président Patrick Bloche. Nous partageons votre opinion.
M. le rapporteur. Avis tout à fait favorable.
M. Rudy Salles. Je me réjouis de cette proposition.
M. le rapporteur. Il conviendrait toutefois d’apporter à l’amendement une légère correction grammaticale. Les mots à insérer sont les suivants : « , de l’hymne européen et de leur histoire ».
La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.
Elle adopte ensuite l’article 31 modifié.
Article 31 bis (nouveau)
Approches pédagogiques spécifiques pour les élèves issus de milieu principalement créolophone
Le présent article, inséré par un amendement adopté par la Commission, propose d’ajouter un alinéa à l’article L. 321-4 du code de l’éducation qui regroupe une série de dispositions consacrées aux aménagements particuliers et aux actions de soutien désignés à certains publics d’élèves.
Il s’agit de préciser que dans les académies d’outre-mer, des approches pédagogiques spécifiques seront prévues dans l’enseignement de l’expression orale ou écrite et de la lecture au profit des élèves issus de milieu principalement créolophone.
Si la culture de ces élèves constitue une richesse, ces derniers peuvent éprouver des difficultés au moment de l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et de l’expression orale en langue française, qui expliquent, du moins en partie, le taux élevé d’illettrisme outre-mer. Aussi, afin de lutter efficacement contre l’échec scolaire et d’améliorer la maîtrise du français, l’éducation nationale doit-elle reconnaître cette réalité et favoriser le développement de méthodes pédagogiques adaptées.
*
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AC 422 de M. Jean Jacques Vlody, portant article additionnel après l’article 31 et prévoyant que dans les académies d’outre-mer, des approches pédagogiques spécifiques sont prévues dans l’enseignement de l’expression orale ou écrite et de la lecture au profit des élèves issus de milieu principalement créolophone.
La Commission est saisie de l’amendement AC 130 de Mme Claudine Schmid.
Mme Claudine Schmid. L’orientation ne relève pas de la seule psychologie et la référence aux « conseillers d’orientation », que propose l’amendement, permet de ne pas restreindre cette mission aux seuls « conseillers d’orientation psychologues ».
M. le rapporteur. Le projet de loi que nous examinons n’a pas vocation à modifier le statut des conseillers d’orientation psychologues – ni, du reste, aucun autre statut des personnels de l’éducation nationale. L’amendement n’est donc pas recevable.
Mme Claudine Schmid. Je le retire donc.
L’amendement est retiré.
Section 6
Les enseignements du collège
Article 32
Abrogation des cycles d’enseignement du collège
Le présent article prévoit d’abroger l’article L. 332-1 du code de l’éducation qui fixe à trois le nombre de cycles structurant l’enseignement dispensé dans les collèges. Il fait écho à l’article 32 du présent projet de loi, qui propose aussi de supprimer les trois cycles de l’école primaire, le gouvernement devant redonner un contenu à ces cycles par la voie réglementaire.
*
La Commission adopte l’article 32 sans modification.
Article 32 bis (nouveau)
Continuum école élémentaire-collège
La Commission a adopté un amendement insérant cet article qui modifie l’article L. 332-2 du code de l’éducation. La rédaction actuelle de cet article est décalée par rapport à l’objectif d’un collège effectivement adossé au socle commun. Elle prévoit en effet que tous les enfants y reçoivent une « formation secondaire », celle-ci succédant « sans discontinuité à la formation primaire » en vue de donner aux élèves une culture accordée à la société de leur temps.
L’idée de continuité est bien présente, mais elle ne s’appuie pas sur le socle, un oubli regrettable, qu’il convient de réparer. En outre, on sait combien de la formation secondaire dispensée au collège est conçue en fonction de son aval, c’est-à-dire du lycée.
Adopté à l’initiative du rapporteur, le présent article prévoit donc que la scolarité au collège devra se référer au socle et s’inscrire plus clairement dans un continuum de formation avec l’école élémentaire.
*
La Commission est saisie de l’amendement AC 642 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 32.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser que dans la continuité de l’école primaire et dans le cadre de l’acquisition progressive du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, tous les enfants reçoivent dans les collèges une formation secondaire accordée à la société de leur temps.
M. Mathieu Hanotin. Qu’entendez-vous par « formation secondaire » ?
M. le rapporteur. Cette expression, qui correspond à la formulation du code de l’éducation, désigne le collège et le lycée.
M. Xavier Breton. Quelle est l’utilité de cette insertion ?
Mme Marie-George Buffet. Que signifie l’expression : « accordée à la société de leur temps » ?
M. le président Patrick Bloche. L’important me semble être le début de la phrase.
M. le rapporteur. En effet, la deuxième partie de la phrase reprend strictement les formulations employées dans le code de l’éducation, tandis que le début souligne la continuité entre l’école primaire et le collège pour l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. C’est là un objectif majeur de la loi, que je souhaite préciser et renforcer.
M. Mathieu Hanotin. Je suis très favorable à cet amendement. La rédaction du code de l’éducation mériterait cependant d’être précisée pour ce qui est de la « formation secondaire accordée à la société de leur temps ».
M. le rapporteur. La phrase visée serait suivie, dans l’article L. 332-2, par la phrase suivante : « Elle repose sur un équilibre des disciplines intellectuelles, artistiques, manuelles, physiques et sportives et permet de révéler les aptitudes et les goûts. » Cette formation est donc clairement définie.
M. Xavier Breton. Je comprends la continuité avec l’école primaire et l’articulation avec le socle. Cependant, cet amendement entend-il aussi réaffirmer le principe du collège unique ?
M. le rapporteur. Oui, bien entendu.
La Commission adopte l’amendement.
Article 33
Définition de l’enseignement dispensé en collège
Cet article vise à modifier l’article L. 332-4 du code de l’éducation relatif à l’enseignement dispensé en collège, dans un double but. D’une part, le principe du collège unique sera réaffirmé afin d’éviter toute orientation précoce des élèves. D’autre part, la mise en place d’enseignements complémentaires, permettant des parcours pédagogiques différenciés, restera possible. Les dispositions proposées sont étroitement corrélées à celles des articles 34 et 38 du présent projet de loi qui tendent à supprimer les dispositifs ou classes « d’éviction précoce » des élèves en difficulté.
1. La nécessité de réaffirmer le principe du collège unique
Le collège unique est une fiction ou, tout au plus, une appellation qui ne correspond à rien. Celui-ci est en effet devenu, au fil des années, une pure façade : les enseignements communs n’ont jamais concerné tous les élèves, car nombre d’entre eux, sous prétexte de gérer l’hétérogénéité des classes, en sont exclus pour être orientés, précocement, dès la quatrième, vers des filières spécialisées ou des dispositifs extrascolaires.
Ainsi, en dernière année de collège, environ 13 % des élèves ne sont pas scolarisés en troisième générale, mais dans de multiples « structures annexes » qui constituent de fait, pour la plupart d’entre elles, selon le jugement du Haut conseil de l’éducation, des « filières de relégation » (200) .
Parmi celles qui ont existé ou subsistent encore, on peut citer les quatrièmes d’aide et de soutien, les troisièmes d’insertion, les quatrièmes et troisièmes « technologiques », le module de découverte professionnelle de six heures en troisième, ainsi que les dispositifs de préapprentissage ou de formation en alternance (classes préparatoires à l’apprentissage ou CLIPA qui disparaissent à partir de 1991, classes d’initiation préprofessionnelle en alternance créées en 1994 et dispositif d’initiation aux métiers en alternance ou DIMA qui sera évoqué dans le commentaire de l’article 38 du présent projet de loi).
Cette politique, très ancienne, va évidemment à l’encontre de la démarche postulée par le socle commun. En effet, ainsi que l’a souligné, en 2010, le rapport d’information de notre Commission sur le collège, « dès lors que le législateur exige que le collège mène, via l’obligation de maîtriser le socle commun, l’ensemble d’une génération aux mêmes compétences de base, le débat sur le collège unique devrait être considéré comme clos. Cette analyse est renforcée par le fait qu’étant lié à la scolarité obligatoire, le socle commun permet d’appréhender le collège comme faisant partie de celle-ci, ce qui constitue, selon M. Claude Lelièvre, historien, une première dans l’histoire de l’enseignement. S’opère ainsi un changement de perspective sur le collège : ce niveau d’enseignement ne doit plus être conçu pour quelques élèves, en fonction de son « aval », le lycée général, mais pour tous ; il est lui en effet demandé de délivrer « ce bien fondamental qu’est l’instruction obligatoire » (201).
La stratégie « ségrégative » actuellement appliquée est en outre contre-productive sur le plan des performances scolaires. Les recherches de Mme Mathalie Mons montrent ainsi que le modèle de « l’intégration uniforme », mis en œuvre par la France et d’autre pays (Italie ou Grèce), qui associe un tronc commun à des outils de gestion de l’hétérogénéité qui visent à « homogénéiser » le public scolaire dans chaque classe – comme, par exemple, le redoublement ou la sortie des élèves les plus faibles du système éducatif, sans qu’ils aient terminé le parcours unique qui leur était assigné –, se caractérise par les scores globaux de l’OCDE les plus faibles. En effet, cette famille « éducative » engendre « un nombre important d’élèves faibles sans pour autant produire une élite scolaire » (202).
Enfin, l’affaiblissement du collège unique pose à la société française un défi moral et social. En effet, ce phénomène doit tous nous conduire à nous poser la question formulée en 2006 par M. Jean-Paul Delahaye, qui exerçait alors les fonctions d’inspecteur général de l’éducation nationale : « quelle société construirons-nous si nous ne sommes pas capables de faire vivre ensemble les futurs citoyens dans une école moyenne en mesure de donner aux uns et aux autres un même socle commun d’instruction et d’éducation ? » (203).
Pour toutes ces raisons, il faut réaffirmer, ainsi que le souligne le rapport annexé au projet de loi, « le principe du collège unique à la fois comme élément clé de l’acquisition, par tous, du socle commun et comme creuset du vivre ensemble ».
2. Le dispositif proposé par le projet de loi
Prises dans leur ensemble, les modifications proposées par le présent article permettront de concrétiser la grande idée qui animait les fondateurs du collège unique au moment de l’adoption, en 1975, de la loi « Haby » : ces derniers n’ont pas pensé à un enseignement complètement identique pour tous, mais seulement à un « tronc commun » au sens propre du terme. Autrement dit, pour reprendre l’explication donnée par M. Jean-Paul Delahaye, il ne faut pas « oublier cette évidence, pourtant perdue de vue très rapidement après 1975, si l’on suit cette métaphore arboricole, que l’arbre, c’est-à-dire le collège, ne se résume pas à son tronc mais, qu’en principe, un arbre est composé d’un tronc et de branches qui peuvent être sensiblement différentes les unes des autres » (204).
Le principe du tronc commun doit donc être consolidé, tout en admettant des parcours différenciés pour tenir compte de l’hétérogénéité des publics d’élèves. Ou pour reprendre les termes de l’étude d’impact du présent projet de loi : « le tronc commun assure l’égalité devant les enseignements fondamentaux, tandis que des enseignements complémentaires permettent de prendre en compte les spécificités des élèves ».
Dans ce but, la disposition selon laquelle les collèges dispensent « un enseignement commun réparti sur quatre niveaux successifs », formulée par la loi « Haby » du 4 juillet 1975 et reprise à la première phrase de l’article L. 332-3 du code de l’éducation, ne sera pas modifiée par le présent article.
En revanche, les dispositions suivantes de l’article L. 332-3 du code seront profondément remaniées.
Le code prévoit aujourd’hui que les deux derniers niveaux d’enseignement du collège peuvent également comporter des enseignements complémentaires dont certains préparent à une formation professionnelle. Ces formations peuvent ainsi comprendre des stages contrôlés par l’État et accomplis auprès de professionnels agréés. En termes concrets, le législateur a permis que des enseignements puissent préparer certains élèves à une formation professionnelle dès la classe de 4ème, soit dès l’âge de treize ans, ce qui revient à les enfermer très tôt les dans une filière.
Même si l’article L. 332-3 du code précise que la scolarité correspondant à ces deux niveaux comporte « obligatoirement l’enseignement commun », il permet, de fait, l’« exfiltration », des élèves concernés du parcours unique. En outre, comme cette formation peut être, en vertu de cet article, accomplie dans des classes rattachées à un établissement de formation professionnelle, cela revient, dans les faits, à affecter ces élèves dans une structure séparée.
● Pour éviter toute relégation précoce, le présent article propose d’adosser au « tronc commun » de formation des enseignements complémentaires, qui ne pourront être proposés qu’au cours de la dernière année de scolarité au collège.
Le caractère complémentaire de ces enseignements, déjà affirmé par la rédaction en vigueur de l’article L. 332-3 du code de l’éducation, constituera une garantie pour les élèves : en effet, ces formations ne devront pas constituer un « à côté » de l’enseignement commun, susceptible un jour de se transformer en « sous-filière ».
Autrement dit, il ne faudra pas, après l’adoption de la loi, que se remettent en place, au niveau du collège, des options qui conduiront à pré-orienter vers le lycée général ou le lycée professionnel ou à constituer, sans l’afficher, des classes de niveau. À cet égard, le ministère de l’éducation nationale a précisé que ces enseignements se présenteront sous la forme de « modules » s’ajoutant au tronc commun, l’ensemble devant contribuer « effectivement » à l’acquisition du socle commun.
● Le présent article propose d’ajouter que ces enseignements pourront être proposés « notamment » pour préparer des élèves à une formation professionnelle.
Cette disposition permettra ainsi de ne pas fermer la porte de l’initiation au monde économique et professionnel aux élèves désireux d’en avoir une première approche, tout en restant dans un cadre strictement scolaire. En même temps, le recours à l’adverbe « notamment » rendra possible la mise en place de parcours différenciés pour d’autres fins.
● Dans le même temps, le présent article propose d’indiquer que ces enseignements seront organisés seulement à partir de la dernière année de collège – la 3ème – et non plus à partir de la 4ème. Cette disposition est évidemment fondamentale, car en différant d’une année scolaire la possibilité de proposer de tels dispositifs, elle tend à sanctuariser le principe d’un enseignement unique pour tous ceux qui sont âgés de 11 à 14 ans : les collégiens pourront enfin bénéficier d’une scolarité « commune », au sens premier du terme, lors des trois premières années de ce niveau d’enseignement qui, de cette manière, ne pourra plus pratiquer de « tri sélectif ».
● Enfin, les enseignements complémentaires préparant des élèves à une formation professionnelle pourront comporter des stages contrôlés par l’État et accomplis auprès de professionnels agréés.
Cette double condition, qui constitue une exigence de qualité, est déjà posée par l’article L. 332-3 du code.
Par ailleurs, le présent article prévoit de préciser que les lycées professionnels pourront être associés à cette préparation, ce qui permettra à ces établissements d’y apporter leur savoir-faire et leurs plateaux techniques. En outre, la rédaction proposée aura pour effet de supprimer la disposition permettant que la scolarité correspondant aux classes de 4ème et de 3ème puisse être accomplie « dans des classes préparatoires rattachées à un établissement de formation professionnelle ». Ainsi, en aucun cas, ces enseignements ne pourront se transformer en classe « d’éviction » des élèves en difficulté vers la filière professionnelle.
3. Les améliorations apportées par la Commission
Au total, l’ensemble de ces dispositions, combinées aux articles 34 et 38 du présent projet de loi, permettront de conforter la mise en place d’un collège « unique » pour tous les élèves.
On peut cependant regretter que le présent article, à des fins de « réassurance » par rapport à cette grande ambition, n’ait pas prévu que les enseignements complémentaires au « tronc commun » puissent être proposés à tous les élèves – et non à « des élèves » – pour favoriser l’acquisition du socle commun.
En outre, la rédaction proposée est peu claire, car elle tend à laisser penser que ces enseignements complémentaires ne peuvent être proposés qu’en 3ème. Il serait plus logique de prévoir que ces enseignements pourraient être offerts à tous les élèves et à tous les niveaux du collège dès lorsqu’ils viseraient à favoriser l’acquisition du socle commun. Ce ne serait donc qu’en dernière année de collège que ces enseignements pourraient préparer « les élèves » – et non plus des élèves – à une formation professionnelle et comporter des stages contrôlés par l’État. Ainsi, le principe d’un tronc commun « long » serait nettement inscrit dans la loi, en écartant le risque de la reconstitution de filières.
La Commission a donc modifié, à l’initiative du rapporteur, le présent article afin de satisfaire à l’ensemble de ces observations.
*
La Commission est saisie de deux amendements identiques, AC 154 de M. Patrick Hetzel et AC 169 de Mme Claudine Schmid, tendant à la suppression de l’article.
M. Xavier Breton. L’amendement AC 154 est défendu.
Mme Claudine Schmid. L’amendement AC 169 est de cohérence avec mon amendement de suppression de l’article 38, lequel vise à supprimer un article du code qui dispose que les élèves ayant atteint l’âge de quatorze ans peuvent être admis […] à suivre une formation alternée, dénommée « formation d’apprenti junior ».
M. le rapporteur. Par cohérence avec ce que nous venons de voter, je suis totalement défavorable à ces amendements.
La Commission rejette les amendements.
Puis elle examine l’amendement AC 643 du rapporteur.
M. le rapporteur. Les enseignements complémentaires s’adressent à tous les élèves, et non à certains d’entre eux ; faute de quoi ils pourraient devenir des filières de relégation, ce qui serait tout à fait contraire à la réaffirmation du collège unique et du socle commun.
M. Mathieu Hanotin. La dernière phrase de l’amendement laisse entendre que les stages sont réservés aux élèves en formation professionnelle en classe de troisième. Ce point ne contredit-il pas un amendement que nous avons voté, selon lequel ces stages doivent être ouverts à l’ensemble des élèves de troisième ?
Mme Julie Sommaruga. Je suis moi aussi gênée par la fin de cet amendement. J’avais déposé un amendement similaire, afin de préciser que les enseignements complémentaires concernent « tous les élèves », et non « des élèves ». En plus d’éviter toute stigmatisation, nous valoriserions ainsi la filière professionnalisante.
Mme Barbara Pompili. J’ai moi aussi déposé des amendements qui tomberont si celui du rapporteur est adopté. Je me réjouis que de telles possibilités soient offertes à tous les élèves, même si je défendrai un amendement en séance afin de clarifier la question des stages, et de compléter la formation professionnelle par une éducation technique, culturelle ou artistique.
M. le rapporteur. Les stages de formation professionnelle, contrôlés par l’État, n’ont rien à voir avec les stages juniors en entreprise : ils sont proposés lors de la dernière année du collège et ouverts à tous. Faire de cette formation une filière de relégation serait contraire, je le répète, à la réaffirmation du collège unique et à l’esprit de l’article 33.
M. le président Patrick Bloche. Ne pourrions-nous voter l’amendement du rapporteur, quitte à amender le texte de la Commission en séance ?
M. le rapporteur. Le collège unique, rappelons-le, n’est pas synonyme de collège uniforme. Au-delà du socle commun, des voies pédagogiques peuvent être ouvertes, parmi lesquelles la voie professionnelle qui, loin de traduire une orientation précoce imposée, permet à tous les élèves qui le souhaitent – et non seulement aux plus mauvais d’entre eux, puisque telle est souvent, hélas, la réalité aujourd’hui – d’acquérir le socle commun selon d’autres modalités pédagogiques. Nous refusons donc à la fois la sélection précoce et l’idée que la voie professionnelle serait une filière de relégation. Tel est le sens de mon amendement.
M. Mathieu Hanotin. Je me retrouve pleinement dans ces remarques, mais je ne lis pas l’amendement de la même façon que son auteur : l’expression « dans ce cas » laisse supposer que les stages sont réservés aux seuls élèves en formation professionnelle. Le statut de ces stages mérite à mon avis d’être mieux défini, notamment par rapport aux stages de découverte professionnelle.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, les amendements AC 423 de Mme Julie Sommaruga, AC 327 de Mme Sandrine Mazetier, AC 679 et AC 502 de Mme Barbara Pompili, AC 683 de Mme Sandrine Mazetier, AC 680 de Mme Barbara Pompili, AC 684 de Mme Sandrine Mazetier, AC 681 et AC 682 de Mme Barbara Pompili, et AC 424 de Mme Martine Faure tombent.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ensuite l’amendement AC 503 de Mme Barbara Pompili.
Puis elle adopte l’article 33 modifié.
Article 34
Suppression des dispositifs d’alternance pendant les deux dernières années de collège
Cet article, qui est étroitement corrélé à la réaffirmation du principe du collège unique, vise à supprimer la possibilité, prévue au quatrième alinéa de l’article L. 332-4 du code de l’éducation, de déroger à la scolarité de « droit commun » durant les deux dernières années de collège.
1. Des parcours spécifiques qui anticipent l’orientation en fin de 3ème
● Des aménagements bien particuliers
Depuis la suppression en 1994 du palier d’orientation à la fin de 5ème, les élèves ne se déterminent théoriquement en matière d’orientation qu’en fin de classe de 3ème. Cependant, ainsi que l’a observé la Cour des comptes dans son enquête sur l’orientation scolaire, des dispositifs particuliers au sein du collège continuent de conditionner « fortement l’avenir des jeunes qui y sont affectés » (205).
Le quatrième alinéa de l’article L. 332-4 du code de l’éducation prévoit en effet que des « aménagements particuliers » permettent, durant les deux dernières années de collège et dans le cadre de dispositifs d’alternance personnalisés, « une découverte approfondie des métiers et des formations ainsi qu’une première formation professionnelle ».
Il précise que ces aménagements comprennent notamment le suivi de stages dans les conditions définies à l’article L. 332-3 (stages contrôlés par l’État et accomplis auprès de professionnels agréés), ainsi que de stages dans des centres de formation d’apprentis (CFA) et des sections d’apprentissage.
Dans leur rédaction actuelle, ces dispositions sont issues de l’article 17 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, dite loi « Cherpion ». Selon le député auteur de la proposition de loi qui en est à l’origine, elles ouvrent la possibilité, pour l’éducation nationale, de créer des sections « que l’on pourrait appeler « études métiers » en 4ème et 3ème, comme il existe, par exemple, des sections « sports études » : tout en continuant à suivre le tronc commun des collèges, des jeunes pourraient y réaliser des stages chez des employeurs agréés et en centre de formation d’apprentis » (206).
Ce dispositif, qui a été mis en œuvre par le décret n° 2012-222 du 15 février 2012, a été, dans les faits, précisé par deux circulaires publiées au Bulletin officiel de l’éducation nationale :
– la circulaire n° 2011-127 du 26 août 2011 constate que, pour certains collégiens, « l’alternance peut être envisagée dès la 4ème ». Elle se propose donc de « donner un cadre national aux différents types de dispositifs, en alternant la formation générale et la découverte des métiers, qui peuvent être proposés aux élèves de quatrième ». L’offre de découverte des métiers peut être modulée, avec le choix entre un dispositif léger, le « module d’alternance » qui n’excède pas un total de 90 heures sur l’année scolaire, et un dispositif renforcé, l’« atelier de découverte des métiers et des formations » qui peut représenter jusqu’à 180 heures de découverte des métiers et des formations dans l’année, concentrées sur une période de quatre à sept semaines et impliquant donc une sortie momentanée de la classe.
– la circulaire n° 2011-128 du 26 août 2011 vise à définir un « cadre national applicable à la classe de 3ème préparatoire aux formations professionnelles ou 3ème "prépa-pro" », laquelle peut comporter un maximum de 216 heures de « séquences de découverte professionnelle », avec des « séances de découverte des parcours et des formations » (en lycée professionnel, centre de formation d’apprentis, etc.), une « initiation aux activités professionnelles » et des « périodes en milieu professionnel ».
● Des élèves aux effectifs relativement limités mais fortement orientés
S’agissant de classes spécifiques, les effectifs d’élèves concernés par ces aménagements de scolarité sont relativement limités. Le ministère de l’éducation nationale compte en effet :
– pour les classes de 3ème DP6, qui subsistent dans un nombre limité d’académies, 3 207 élèves dans l’enseignement public et 1 000 élèves dans l’enseignement privé ;
– pour les classes de 3ème prépa-pro, qui ont remplacé les classes de découverte professionnelle « six heures » ou 3ème DP6 dans la plupart des académies, 21 511 élèves dans le public et 8 999 élèves dans le privé.
On observera qu’aux yeux du précédent gouvernement, la 3ème « prépa-pro » avait vocation à se substituer, à terme, à la classe de 3ème DP6. Elle a fait l’objet, en 2011, d’une expérimentation dans certains établissements et devait être généralisée à la rentrée 2012. Cependant, était-ce pour le mieux ? On peut en doute à partir du moment où le nouveau dispositif, comme le premier, aurait eu pour effet de pré-orienter de jeunes adolescents dans des conditions qui étaient loin d’être satisfaisantes.
S’agissant des classes de DP6, les constats de la Cour des comptes sont d’ailleurs éloquents, à commencer par leur implantation, fréquente, dans les lycées professionnels. Celle-ci peut en effet peut soulever des difficultés : en particulier, les équipes éducatives du second cycle « ne sont pas nécessairement préparées à s’occuper d’élèves moins âgés ; ceux-ci sont normalement soumis au régime scolaire des collèges (interdiction de sortie de l’établissement entre les cours par exemple) ; ils ont enfin besoin de beaucoup plus d’attention et de soutien de la part des enseignants ». En outre, si la DP6 est située dans un lycée professionnel, les élèves « sont conduits à souhaiter y rester pour leur orientation post-troisième ». C’est pourquoi certains collèges refusent d’envoyer dans ce dispositif leurs élèves parce qu’ils considèrent que ce sont, selon une expression entendue au cours de l’enquête de la Cour, des « classes-dépotoirs » (207).
Quand un élève quitte le collège pour entrer en « pré-quelque chose », même si tous les textes du monde affirment qu’il peut y revenir pour suivre la scolarité de « droit commun », il y a peu de chances, en réalité, qu’il y retourne.
2. Le dispositif proposé par le projet de loi
Dès lors que le principe du collège unique est réaffirmé, il convient de remettre en cause tout dispositif qui, de manière précoce, détourne les élèves de l’objectif de maîtrise du socle commun et les enferme dans une filière.
En conséquence, le présent article propose d’abroger le quatrième alinéa de l’article L. 332-4 du code qui permet aux élèves de 4ème et de 3ème de bénéficier, dans le cadre de dispositifs d’alternance personnalisés, d’aménagements particuliers à des fins de découverte approfondie des métiers et des formations et de première formation professionnelle.
Inversement, il n’est pas prévu de modifier les autres dispositions de cet article, qui prévoient, certes, des aménagements du parcours scolaire, mais limités dans leur portée et visant des publics très spécifiques.
En effet, il convient de conserver ces dispositifs pour d’évidentes raisons d’intérêt général. Dans l’ordre retenu par l’article L. 332-4, ils permettent :
– de prévoir des aménagements particuliers et des actions de soutien prévus au profit des élèves en difficulté ;
– de dispenser un enseignement adapté pour les élèves éprouvant des difficultés graves et permanentes ;
– d’offrir des activités d’approfondissement dans les disciplines de l’enseignement commun ;
– de prévoir des aménagements appropriés au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières ;
– de prévoir des actions particulières pour l’accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
*
La Commission adopte l’article 34 sans modification.
Article 35
Introduction d’une éducation aux médias numériques dans les collèges
Cet article vise à compléter l’article L. 332-5 du code de l’éducation, qui indique que la formation dispensée à tous les élèves des collèges comprend obligatoirement une initiation technologique, afin de préciser que celle-ci inclut une éducation aux médias numériques.
À l’heure actuelle, les programmes de l’enseignement de la technologie au collège ne prévoient pas une telle formation, ceux-ci restant centrés sur les aspects matériels de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) et la validation des compétences du Brevet informatique et internet (B2i). Ils permettent toutefois, de manière indirecte, une entrée dans le domaine des médias numériques, puisqu’ils visent, entre autres, l’acquisition des connaissances, capacités et attitudes se rapportant aux « conditions d’usage » des TIC « au plan technique et éthique » (208).
Il faut aller plus loin en prévoyant que cet enseignement devra comprendre une éducation aux médias. En effet, dès lors que le numérique permet d’accéder à des sources d’information infinies et variées, mais qui peuvent être biaisées, la nation se doit de formuler une telle exigence à l’égard de l’école qui doit rester le lieu de l’apprentissage de l’esprit critique.
À l’échelon européen, cette demande a été relayée dès 2006 par la Commission européenne qui a adopté à cet effet une Charte européenne pour l’éducation aux médias. Elle a ensuite adopté une recommandation sur l’éducation aux médias dans l’environnement numérique qui invite les États membres à engager un débat sur « l’intégration de l’éducation aux médias dans les programmes scolaires obligatoires et dans l’enseignement des compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie » (209).
En outre, en proposant de dispenser cette nouvelle formation au collège, le présent article tient compte du fait que l’appétence des jeunes pour les médias numériques se développe surtout pendant les années qui correspondent à ce stade de la scolarité.
Par ailleurs, cette formation constituera la deuxième étape d’un parcours commencé au primaire, puisque l’article 31 du présent projet de loi propose que la formation dispensée dans les écoles élémentaires contribue à « la compréhension et à un usage responsable des médias, notamment numériques ». Ainsi, toute une classe d’âge pourra bénéficier de cet apprentissage, organisé sur l’ensemble de la scolarité obligatoire et de manière adaptée aux étapes de l’enfance et de l’adolescence.
Enfin, l’éducation aux médias s’intégrera dans un ensemble plus vaste, celui de la formation à l’utilisation des outils et des ressources numériques, prévue par l’article 26 du présent projet de loi et dont on rappellera qu’elle devra être dispensée progressivement de l’école au lycée.
*
La Commission adopte l’article 35 sans modification.
Article 36
Conditions d’attribution du brevet
Cet article vise à modifier l’article L. 332-6 du code de l’éducation qui définit le cadre juridique du diplôme national du brevet (DNB).
1. Le brevet : un diplôme « en souffrance » qui doit être reformé
Issues de la loi du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École, les dispositions qui déterminent les conditions actuelles d’attribution du diplôme national du brevet prévoient qu’il « atteste la maîtrise du socle commun », « intègre » les résultats de l’enseignement d’éducation physique, « prend en compte les autres enseignements suivis par les élèves selon leurs capacités et leurs intérêts » et « comporte une note de vie scolaire ».
Cette définition appelait des précisions, lesquelles ont donné naissance à la célèbre « usine à cases », le livret personnel de compétences…
En vertu des mesures réglementaires adoptées par le précédent gouvernement, cinq paramètres sont pris en compte pour l’attribution de la série générale de ce diplôme (210) :
– la maîtrise du socle commun et de ses sept compétences au palier 3, c’est-à-dire à la fin de la 3ème, validée par l’attestation délivrée depuis la rentrée 2009 par le chef d’établissement et se présentant sous la forme du livret personnel de compétences ;
– la note obtenue à l’oral d’histoire des arts ;
– les notes obtenues à l’examen du brevet, qui comporte trois épreuves écrites : français, mathématiques et histoire-géographie-éducation civique ;
– les notes de contrôle continu obtenues en cours de formation ;
– la note de vie scolaire, instituée par la loi du 23 avril 2005 et mesurant « l’assiduité de l’élève et son respect des dispositions du règlement intérieur de l’établissement » tout en prenant en compte sa participation à la vie de l’établissement (article D. 332-4-1 du code de l’éducation).
L’arrêté du 18 août 2009, modifié par celui du 4 décembre 2012, précise que le DNB est attribué aux candidats « ayant obtenu la maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences et obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 résultant de la division de la somme des notes obtenues [à l’oral de l’histoire des arts, à l’examen du brevet, au contrôle continu et à la note de vie scolaire] par le total des coefficients attribués à chacune de ces notes ».
Les mesures de simplification du livret personnel de compétences
décidées en septembre 2012
À la suite du changement de majorité intervenu au printemps 2012, le ministère de l’éducation nationale a pris des mesures énergiques « d’allégement du livret personnel de compétences » afin de simplifier le processus de validation du socle commun et de faciliter le travail des enseignants et des chefs d’établissement :
– dans le cas des élèves ne rencontrant pas de difficultés particulières, l’attribution du socle repose uniquement sur la validation des sept compétences, sans que soit exigé le renseignement des domaines et des items du livret personnel de compétences ;
– lorsqu’il s’avère que l’acquisition d’une compétence est discutée, les équipes pédagogiques ne renseignent que les domaines et non plus les items (26 domaines, pour le palier 3, contre 97 items au total) ;
– enfin, une simple attestation de validation des compétences, en une page au lieu des 25 pages du livret actuel, sera adressée aux familles (211).
Au vu de ces modalités, il n’est guère étonnant que le rapport de notre Commission sur la mise en œuvre du socle commun au collège ait jugé le DNB « bancal voire baroque » (212). De son côté, le Conseil économique, social et environnemental a noté, en septembre 2011, que le profil du diplôme « devient illisible », en ajoutant qu’il est « indispensable d’en simplifier la procédure et de le rendre plus cohérent avec l’objectif fondamental que constitue le socle » (213).
L’étude d’impact du présent projet de loi met elle aussi en lumière le fait que le DNB est devenu un diplôme « en souffrance » : « la crainte de barrer l’accès au diplôme aux élèves qui n’auraient pas validé les compétences du socle pervertit son évaluation et rend insincères les validations ; la double articulation (notes de contrôle continu et notes d’épreuves d’examen) rend peu crédible le diplôme aussi bien comme examen que comme « validation » du socle commun ; la notation de la vie scolaire, souvent mal appliquée dans les établissements, concentre les critiques de la majorité des intéressés ».
Enfin, lors de son audition par le rapporteur, le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, Mme Monique Sassier, a insisté sur le fait que le brevet n’est plus compris par les familles. Ce diplôme conjuguant deux principes – la validation des compétences et l’examen classique – constitue une « folie », qui donne lieu, ensuite, à des « lettres de rage » de la part de parents. Ainsi, dans un des exemples cités, un élève ayant eu plus de 10 de moyenne aux épreuves, au contrôle continu et en moyenne générale n’a pas obtenu son brevet – alors qu’il lui était demandé pour effectuer un petit travail d’été – au seul motif que son livret de compétences n’attestait pas une maîtrise suffisante du socle.
2. Le dispositif proposé par le projet de loi
Le présent article propose de supprimer le deuxième alinéa de l’article L. 332-6 du code de l’éducation, qui détaille les acquis devant être validés par le brevet, et de fixer par décret ses conditions d’attribution.
La modification proposée permettra de faire évoluer le diplôme national du brevet en lien avec la refonte du socle commun qui doit accompagner la refondation de l’école. En revanche, elle laissera intacte la disposition selon laquelle le brevet sanctionne la formation acquise à l’issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d’autres établissements. Ce diplôme continuera ainsi de conserver son rôle symbolique, auquel les élèves et leurs familles demeurent attachés.
Dans un deuxième temps, l’évolution annoncée du socle commun, dont les éléments constitutifs seront fixés par décret après l’adoption du projet de loi, nécessitera d’aller plus loin que le réaménagement proposé par le présent article. Le rôle du diplôme national du brevet devrait être en effet entièrement repensé. Devenu un « mini-bac », celui-ci aura-t-il encore une raison d’être lorsque la fin de la scolarité au collège aura pour finalité la validation d’un socle commun qui ne sera plus l’annexe d’un examen ?
Pour prendre date, la Commission a modifié cet article afin de préciser que le DNB, dont le cadre restera fixé par décret, devra néanmoins attester la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
*
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement l’amendement AC 504 de Mme Barbara Pompili et l’amendement AC 753 de M. Rudy Salles.
Elle examine ensuite l’amendement AC 505 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. Cet amendement vise à supprimer les mentions au brevet, dans la mesure où celui-ci sanctionne la simple acquisition du socle.
M. le rapporteur. Avis défavorable : les mentions décident de l’octroi des bourses, attribuées au mérite.
Mme Barbara Pompili. Si le brevet valide seulement une acquisition, c’est toute l’évaluation qui s’en trouve modifiée. Il conviendra d’en mesurer l’impact pour l’attribution des bourses.
M. le rapporteur. J’entends bien, mais il faudra alors revoir la rédaction de votre amendement.
Mme Barbara Pompili. Je retire mon amendement à ce stade, mais le redéposerai en séance.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement AC 644 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser que le brevet « atteste notamment la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ».
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 36 modifié.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 253 de M. Guénhaël Huet, portant article additionnel après l’article 36.
Article 37
Objectifs du baccalauréat
Cet article vise à redéfinir le rôle de l’examen du baccalauréat, tout en reconnaissant ses versions technologique et professionnelle.
Le baccalauréat est aujourd’hui défini – et encore uniquement dans sa version « générale » – par l’article L. 334-1 du code de l’éducation. Cet examen doit sanctionner une formation équilibrée et comporter, d’une part, la vérification d’un niveau de culture défini par les enseignements des lycées et, d’autre part, le contrôle des connaissances dans des enseignements suivis par l’élève en dernière année, effectué indépendamment dans chacune des disciplines.
● Le I du présent article prévoit donc de compléter le chapitre III – consacré aux dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées – du titre III du livre III du code de l’éducation par un article L. 333-4 nouveau.
1° Ce nouvel article sera relatif à « l’examen du baccalauréat général, technologique et professionnel ». En substituant à la mention du seul baccalauréat général celles des trois baccalauréats existants, le législateur renforcera l’égalité de leur statut. En 2012, la voie générale comptait 294 009 bacheliers, la voie technologique 124 831 bacheliers et la voie professionnelle 188 974 bacheliers.
2° En outre, des objectifs communs seront assignés aux trois baccalauréats.
– En premier lieu, l’examen devra sanctionner une « formation équilibrée qui permet de favoriser la poursuite d’études supérieures et l’insertion professionnelle ». La prise en compte de ces deux nouveaux objectifs par la formation dispensée en lycée devra permettre aux bacheliers de réaliser, à plus ou moins long terme, un projet d’études supérieures et un projet professionnel.
Le premier objectif est conforme à celui, rappelé par le rapport annexé, d’amener 50 % d’une classe d’âge à un diplôme de l’enseignement supérieur.
Quant au second, il permet non seulement de reconnaître la vocation d’insertion rapide sur le marché du travail du baccalauréat professionnel, mais aussi de fixer implicitement aux différents lycées qui préparent l’examen une mission d’insertion professionnelle, d’ores et déjà assignée en 2007 par le législateur au service public de l’enseignement supérieur. D’ailleurs, le décret du 30 août 1985 régissant le fonctionnement des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), qui reconnaît aux lycées une autonomie en matière pédagogique, prévoit d’ores et déjà que celle-ci porte, entre autres, sur « la préparation de l’orientation ainsi que de l’insertion sociale et professionnelle des élèves » (article R. 421-2 du code de l’éducation).
Aux yeux du rapporteur, cette mission générale de « préparation à l’aval » qu’il est proposé d’assigner à la formation dispensée au lycée devrait s’exercer dans plusieurs domaines : l’information des élèves sur les filières de formation et les besoins locaux, régionaux ou nationaux en matière d’emploi, le suivi du devenir des élèves, l’adaptation des savoir-faire à l’évolution des besoins professionnels, l’organisation de rencontres entre les jeunes en formation et les représentants des professions auxquelles ils se destinent, etc.
– En second lieu, l’examen du baccalauréat devra comporter la vérification d’un niveau de culture défini par les enseignements au lycée, ainsi que le contrôle des connaissances et des compétences dans les enseignements suivis par l’élève en dernière année.
La vérification du niveau de culture et le contrôle des connaissances – celui-ci devant être effectué indépendamment dans chacun des enseignements – sont déjà prévus par le code de l’éducation.
En revanche, le présent article propose de faire référence au « contrôle des compétences ». Ainsi, pour la première fois, le baccalauréat, qu’il soit général, technologique ou professionnel, contrôlera non seulement des connaissances, mais également des compétences. La rédaction proposée permettra ainsi d’établir un lien entre le lycée et le socle commun – qui reconnaît les compétences –, les savoir-faire et les aptitudes d’un élève n’ayant évidemment pas vocation à disparaître après la 3ème.
3° Enfin, la modification proposée favorisera l’égale dignité des trois voies d’accès au diplôme en prévoyant que le contrôle des connaissances fera partie intégrante des trois baccalauréats, y compris donc de celui qui sanctionne le cursus de la voie professionnelle. À cet égard, on notera que le règlement du baccalauréat professionnel ne prévoit pas une évaluation du niveau de connaissances, alors que, de toute évidence, les lycées concernés transmettent, eux aussi, des savoirs.
Pour de nombreux observateurs de notre système éducatif, le principe selon lequel les enseignements font l’objet, pour chacun d’entre eux, d’une épreuve spécifique à l’examen du baccalauréat conduit à perpétuer le « cloisonnement disciplinaire » de l’enseignement du lycée. Cette question sensible, qui hante depuis plus trente ans les débats sur les savoirs à enseigner dans le lycée de demain, devrait être tranchée, en l’intégrant à la réflexion sur le continuum « bac-3 et bac+3 » et en lien avec la mise en place, fort souhaitable, d’une spécialisation progressive au cours des trois années du cursus de la licence.
● Par coordination avec les modifications proposées, le II du présent article prévoit de supprimer l’article L. 334-1 du code de l’éducation. Le III propose d’en tirer les conséquences formelles sur le dernier article – c’est-à-dire le L. 333-3, relatif à la participation de professionnels aux opérations d’évaluation du baccalauréat dans les lycées comportant des enseignements artistiques – du chapitre III du titre III du livre III en l’insérant au début du chapitre IV, consacré aux enseignements conduisant au baccalauréat.
● Outre l’adoption d’amendements rédactionnels, la Commission a amélioré le dispositif proposé sur deux points essentiels :
– d’une part, en remplaçant « dernière année » par « dernier cycle », elle a permis que certaines épreuves du baccalauréat général ou technologique portent sur la classe de première, en plus de la classe terminale, et que les épreuves du baccalauréat professionnel portent sur les classes de seconde, première et terminale. En effet, au lycée professionnel, le dernier cycle couvre l’ensemble de la scolarité de ce niveau d’enseignement ;
– d’autre part, elle a supprimé la disposition prévoyant un contrôle des connaissances et des compétences « discipline par discipline ». Il convient de rappeler, à cet égard, que des épreuves interdisciplinaires existent déjà, quand les enseignements sont eux-mêmes interdisciplinaires. À moyen terme, des épreuves interdisciplinaires, portant sur des enseignements distincts, pourraient être mises en place. L’évaluation innovante de compétences transversales à plusieurs disciplines serait alors permise.
*
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AC 509 de Mme Barbara Pompili.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements AC 506 et AC 507 de Mme Barbara Pompili.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements AC 655 du rapporteur et AC 510 de Mme Barbara Pompili.
M. le rapporteur. L’amendement AC 655 est de précision.
Mme Barbara Pompili. L’amendement AC 510 a le même objet : l’expression « dernière année » doit être remplacée par celle de « cycle terminal », sans quoi les épreuves anticipées, notamment de français, ne seraient pas concernées par la mesure. Mais je retire mon amendement, pour me rallier à celui du rapporteur.
L’amendement AC 510 est retiré.
La Commission adopte l’amendement AC 655.
Elle examine ensuite les amendements identiques AC 656 du rapporteur et AC 685 de Mme Barbara Pompili.
M. le rapporteur. Le contrôle des connaissances et des compétences doit être pluridisciplinaire.
Mme Barbara Pompili. L’amendement AC 685 est défendu.
La Commission adopte les amendements.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement AC 508 de Mme Barbara Pompili.
Elle adopte ensuite successivement les amendements de précision AC 36, AC 37 et AC 38 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 37 modifié.
La Commission est saisie de l’amendement AC 271 de M. Benoist Apparu, portant article additionnel après l’article 37.
M. Benoist Apparu. Bis repetita sur le contrôle continu.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Section 8
La formation en alternance
Article 38
Suppression de l’« apprentissage junior » et limitation du « DIMA » aux élèves d’au moins quinze ans
Cet article, tout comme l’article 33 du présent projet de loi, est étroitement corrélé à la réaffirmation du principe du collège unique. Il vise à supprimer les dispositifs actuels d’apprentissage « junior » et d’initiation aux métiers en alternance (DIMA) et à réserver la formation sous statut scolaire effectuée en centre de formation des apprentis (CFA) aux jeunes de 15 ans et plus.
1. La tentation récurrente du préapprentissage
● L’apprentissage junior
Les adversaires du collège unique sont souvent des partisans de voies de formation alternatives organisées de manière précoce. Mais on compte aussi parmi ces derniers de vrais défenseurs du socle commun, qui considèrent toutefois que certains élèves, même à 14 ans, peuvent s’épanouir et découvrir leur vocation grâce à des dispositifs de préapprentissage.
Ces considérations en partie contradictoires ont conduit à la mise en place de la « formation d’apprenti junior », un dispositif encadré par la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, dite loi « Borloo » et repris à l’article L. 337-3 du code de l’éducation. L’élève, sous statut scolaire, pouvait ainsi rentrer, dès l’âge de 14 ans, dans une première année d’« apprentissage junior initial », comportant un parcours d’initiation aux métiers. La formation comprenait des enseignements généraux, technologiques et pratiques ainsi que des stages en milieu professionnel. À l’âge de quinze ans, le jeune pouvait entrer dans la seconde phase d’« apprentissage junior confirmé » par la signature d’un contrat d’apprentissage à condition qu’il soit « jugé apte à poursuivre l’acquisition par la voie de l’apprentissage du socle commun ». Cette condition constituait un rappel – bien maigre et pudique – des obligations induites par l’existence d’un tronc commun de formation.
Il convient de rappeler que la loi du 31 mars 2006 a abrogé les dispositions relatives aux classes d’initiation préprofessionnelles en alternance (CLIPA), instituées par la loi du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle, qui accueillaient, elles aussi, les élèves à partir de 14 ans.
Très contesté – y compris au sein des rangs de la précédente majorité – parce qu’il « entaillait » fortement la scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans décidée par la réforme Berthoin de 1963, l’apprentissage junior n’a pas manqué de susciter, chez les chercheurs, des interrogations sur son efficacité.
Ainsi, selon M. Gilles Moreau, sociologue, « l’effet des capitaux scolaires joue dans l’apprentissage. L’expression peut sembler paradoxale, mais l’apprentissage s’est scolarisé. En fait, la réussite d’un apprenti au diplôme, tout comme ses chances de poursuite à un niveau d’apprentissage supérieur, sont étroitement liées à son niveau scolaire à l’entrée en apprentissage : plus celui-ci est élevé, plus il a de chances de réussir son diplôme, une éventuelle poursuite à un niveau plus élevé, et donc insertion. Envoyer un jeune dans le dispositif apprenti avec un faible niveau scolaire, c’est lui infliger une double peine sociale : échec à l’école et échec probable dans l’apprentissage. L’apprentissage à 14 ans est une vision qui date des années 1960 » (214).
Le dispositif a donc été suspendu à partir de la rentrée 2007 par une décision du ministre de l’éducation nationale, conformément aux engagements du Président de la République Nicolas Sarkozy, mais il n’a été jamais abrogé.
● Les nouveaux visages du préapprentissage
L’apprentissage junior a toutefois « prospéré », sous une forme quelque peu atténuée, car visant, en priorité, les élèves volontaires âgés de 15 ans.
Trois types de dispositifs de préapprentissage pouvaient ainsi accueillir ces élèves :
– les classes préparatoires à l’apprentissage, créées par voie de circulaire en 1972 ;
– les parcours d’initiation aux métiers (PIM), constituant la première phase, effectuée sous statut scolaire, de la formation d’apprenti junior créée par l’article L. 337-3 du code de l’éducation. En 2010-2011, il restait dans ce dispositif seulement 43 élèves, dans deux académies (31 en Corse dans les centres de formation d’apprentis et 12 à Orléans-Tours en lycée professionnel). Depuis l’année 2011-2012, il n’accueillait plus d’élèves, étant remplacé par le dispositif d’initiation aux métiers en alternance (DIMA) ;
– le DIMA, formalisé par la circulaire de la rentrée scolaire 2008.
Puis la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie a permis un accueil des élèves ayant atteint l’âge de 15 ans en centre de formation (CFA) des apprentis pendant une durée maximale d’an pour découvrir des métiers en vue d’un projet d’apprentissage.
Le décret n° 2010-1780 du 31 décembre 2010 a alors consacré le DIMA. Il s’agit d’une formation en alternance, effectuée sous statut scolaire pour une durée d’un an maximum et partagée entre l’établissement de formation et des stages en milieu professionnel, pour faire découvrir aux élèves un environnement professionnel correspondant à un projet d’entrée en apprentissage. Les élèves devaient être volontaires et âgés d’au moins 15 ans à la date d’entrée en formation du DIMA. Ils devaient rester inscrits dans leurs collèges d’origine (articles D. 337-172 à D. 337-182 du code de l’éducation).
Enfin, la loi du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, dite loi « Cherpion », a étendu le dispositif aux élèves ayant accompli la scolarité du collège et modifié à cet effet l’article L. 337-3 du code de l’éducation.
Sur ce fondement, pouvait accéder au DIMA tout jeune qui souhaitait entrer en apprentissage et :
– avait au moins 15 ans, en application de la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
– ou avait terminé le collège et pouvait donc avoir moins de 14 ans révolus, en application de l’article 18 de la loi « Cherpion ».
Il convient de préciser que le jeu combiné des articles L. 337-3-1 du code de l’éducation et L. 6222-1 du code du travail fait que l’élève peut :
– soit signer un contrat d’apprentissage, sous réserve d’avoir atteint l’âge de 16 ans, d’avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire ou d’avoir suivi la formation du DIMA ;
– soit reprendre sa scolarité dans un collège ou un lycée.
Ces conditions d’entrée en apprentissage, notamment celles liées à l’âge, soulèvent deux types de difficultés parfaitement mis en lumière par l’étude d’impact du projet de loi :
– un problème quant à l’utilité du dispositif. En effet, les élèves sortant de 3ème ont davantage intérêt à s’engager directement dans la préparation d’un diplôme professionnel – CAP ou baccalauréat professionnel – qu’à suivre une année de DIMA pour, à son issue, préparer ces mêmes diplômes ;
– un risque lié à l’âge : ainsi que le relève l’étude d’impact, « sans condition d’âge pour entrer en DIMA après la 3ème, certains élèves peuvent n’avoir que 14 ans et après un an de DIMA, voire moins, devenir apprentis à 15 ans ou quelques mois avant leur anniversaire s’ils ont 15 ans avant le 31 décembre. Quant aux élèves qui entrent en DIMA à 15 ans, ils peuvent devenir apprentis très rapidement : puisqu’il est possible de quitter un DIMA « à tout moment », ils peuvent signer un contrat d’apprentissage quelques semaines, voire quelques jours, après leur entrée en DIMA ».
Pour d’évidentes raisons de principe, le gouvernement a suspendu ce dispositif dès juin 2012. D’ailleurs, celui-ci ne concernait que « très peu d’élèves », ainsi que l’a récemment constaté la Cour des comptes dans une enquête réalisée pour le compte de la Commission des finances de notre Assemblée (215).
Cette observation est corroborée par les données disponibles. Ainsi, la dernière édition des Repères et références statistiques de l’éducation nationale indique qu’en 2010-2011, 67 élèves de 14 ans ou moins, 855 élèves de 15 ans et 785 élèves de 16 ans et plus étaient inscrits au titre des DIMA et des classes relais et ateliers relais (216). Le ministère de l’éducation nationale précise qu’en 2011-2012, on comptait 6 920 élèves en DIMA dans les CFA. La plupart d’entre eux (88,3 %) étaient âgés de 15 ans, 2,1 % avaient 14 ans, 7,9 % avaient 16 ans et 17,7 % avaient plus de 16 ans.
Au vu de ces éléments statistiques, force est de constater qu’en plus de contrevenir au principe du collège unique, les dispositifs d’alternance mis en place par la précédente majorité étaient peu attractifs.
2. Le dispositif proposé par le projet de loi
● La suppression de l’apprentissage « junior »
Le I du présent article prévoit d’abroger l’article L. 337-3 du code de l’éducation qui encadre la « formation d’apprenti junior », dont on rappellera qu’elle n’est plus mise en œuvre depuis 2007.
● La suppression du DIMA dans sa forme actuelle et le retour au seul critère de l’âge, fixé à 15 ans, pour effectuer une formation en alternance en CFA
Le II propose de modifier le premier alinéa de l’article L. 337-3-1 du code de l’éducation afin de réserver la formation effectuée sous statut scolaire en centre de formation des apprentis (CFA) aux jeunes de 15 ans et plus et de prévoir que cette année de formation doit leur permettre de poursuivre l’acquisition du socle commun.
La modification proposée permettra d’abroger les dispositions de la loi « Cherpion » du 28 juillet 2011 ayant introduit le dispositif d’initiation aux métiers en alternance (DIMA) pour les jeunes « ayant accompli la scolarité du premier cycle du secondaire » et pouvant avoir par conséquent moins de 15 ans. Cette suppression permettra ainsi d’entériner la suspension du DIMA à la rentrée 2012 décidée par la Lettre à tous les personnels de l’éducation nationale du 26 juin 2012 des ministres chargés de l’éducation nationale et de la réussite éducative (217).
Quant à l’année de formation en alternance dispensée aux jeunes accueillis en CFA, son caractère scolaire sera renforcé. En effet, celle-ci continuera d’être limitée à un an maximum et effectuée sous un statut scolaire – ces conditions étant déjà prévues par l’article L. 337-3-1 du code de l’éducation –, mais le projet de loi propose de préciser qu’elle devra permettre aux élèves « de poursuivre l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ».
Cet objectif complétera celui actuellement fixé par la loi, à savoir la découverte d’un environnement professionnel correspondant à un projet d’entrée en apprentissage. Cet ajout aura pour conséquence de subordonner la formation en alternance en CFA à l’accomplissement d’une scolarité dont le pivot restera le socle commun.
● La coordination avec le code du travail
Le premier alinéa de l’article L. 6222-1 du code du travail dispose que nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est âgé de 16 ans au moins au début de l’apprentissage.
Le second alinéa ajoute, toutefois, que les jeunes âgés d’au moins 15 ans au cours de l’année civile peuvent souscrire un contrat d’apprentissage s’ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire, c’est-à-dire celle du collège, ou avoir suivi la formation en alternance – le DIMA – prévue à l’article L. 337-3-1 du code de l’éducation.
Par coordination avec les dispositions précédentes, le III prévoit de modifier le second alinéa de cet article issu de la loi « Cherpion » du 28 juillet 2011.
Les dispositions concernées posent en effet un problème de conformité avec le droit national, et plus encore européen.
En premier lieu, l’âge d’entrée dans la vie active est en principe fixé à 16 ans, cette règle étant posée par l’article L. 4153-1 du code du travail. Ensuite, l’article 1er de la directive n° 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail, prévoit que « Les États membres (…) veillent (…) à ce que l’âge minimal d’admission à l’emploi ou au travail ne soit pas inférieur à l’âge auquel cesse l’obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale ni, en tout cas, à 15 ans ».
Or, actuellement, certains élèves, en raison des dispositions combinées des articles L. 337-3-1 du code de l’éducation et L. 6222-1 du code du travail, peuvent entrer en DIMA sans condition d’âge s’ils ont accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire, puis signer, à tout moment, un contrat d’apprentissage.
Il est donc proposé de supprimer à l’article L. 6222-1 du code du travail les mots : « au cours de l’année civile », ainsi que les mots : « ou avoir suivi une formation » prévue à l’article L. 337-3-1 du code de l’éducation. Cette suppression permettra d’assurer la conformité de la loi française avec le droit européen, en mettant fin à l’apprentissage à l’âge de 14 ans et en supprimant la possibilité de devenir apprenti à 15 ans après un DIMA.
Ainsi que le précise l’étude d’impact, la formation en alternance effectuée en CFA et sous statut scolaire se limitera, dorénavant, à « une double finalité » : « la découverte d’un environnement professionnel correspondant à un projet d’entrée en apprentissage » et « la poursuite de l’acquisition du socle commun ».
● Les précisions apportées par la Commission
À l’initiative du rapporteur, la Commission a procédé à deux autres coordinations dans le code du travail, afin de tirer toutes les conséquences de la suppression des dispositifs apprentissage junior et DIMA pour les moins de quinze ans. Dans ce but, elle a abrogé, par cohérence, l’article L. 6222-20 du code du travail qui traite de la rupture du contrat d’apprentissage conclu dans le cadre de la formation d’apprenti junior mentionnée à l’article L. 337-3 du code de l’éducation. Elle a également supprimé la référence à l’article L. 6222-20 du code du travail, qu’il est prévu d’abroger, dans l’article L. 6222-21 du même code.
*
La Commission examine trois amendements identiques, AC 196 de M. Frédéric Reiss, AC 156 de M. Patrick Hetzel et AC 754 de M. Michel Zumkeller, tendant à la suppression de l’article.
M. Xavier Breton. L’article 38 abroge une loi qui a fait ses preuves avec le dispositif d’initiation aux métiers en alternance. Cela nous semble être un très mauvais signal.
M. Benoist Apparu. L’amendement AC 196 est défendu.
M. Rudy Salles. L’amendement AC 754 l’est aussi.
M. le rapporteur. Par cohérence avec l’article 33 notamment, avis défavorable.
La Commission rejette les amendements.
Puis elle adopte l’amendement de coordination AC 39 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 38 modifié.
La Commission est saisie de l’amendement AC 170 de Mme Claudine Schmid, portant article additionnel après l’article 38.
Mme Claudine Schmid. Afin de valoriser la formation professionnelle, nous proposons que les régions garantissent « un nombre suffisant de places dans les lycées d’enseignements technologiques et professionnels ». Aujourd’hui, faute de places suffisantes, des élèves sont en effet obligés de réintégrer le collège ou le lycée.
M. le rapporteur. Avis défavorable : l’amendement est satisfait par l’article 18, qui traite notamment des rapports entre les régions et l’État sur la question des moyens.
Mme Claudine Schmid. Je retire l’amendement.
L’amendement est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ensuite l’amendement AC 131 de Mme Claudine Schmid.
Chapitre IV
Dispositions relatives aux écoles et établissements d’enseignement scolaire
Article 39
Modification du livre IV du code de l’éducation
Cet article a pour objet de préciser que le livre IV du code de l’éducation, relatif aux établissements d’enseignement scolaire, sera modifié conformément aux dispositions du chapitre IV du présent projet de loi.
*
La Commission adopte l’article 39 sans modification.
Section 1
Les relations entre l’école et le collège
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AC 41 du rapporteur, sur l’intitulé de la section 1.
Article 40
Cadre pour la coopération école-collège
Cet article vise à définir un cadre de coopération entre chaque collège et les écoles de son secteur de recrutement afin d’assurer la continuité pédagogique entre le primaire et le secondaire. Il prévoit d’instituer, à cet effet, un conseil école-collège dont la composition et le fonctionnement seront précisés par décret.
1. La nécessité d’établir un cadre pour assurer la liaison école-collège et conforter ainsi le socle commun
Le socle commun devrait engager de nouvelles représentations du système éducatif, car il amène à considérer l’école primaire et le collège comme un continuum et à redessiner, de manière plus opérationnelle, les cursus scolaires.
Ainsi, grâce au socle, la rupture qui survient en 6ème entre le premier degré, où l’élève ne connaît qu’un professeur des écoles, polyvalent, et le second degré, où il est confronté à neuf ou dix enseignants « disciplinaires », devrait être effacée.
L’exigence de la réussite scolaire devrait en effet aboutir à ce qu’aucun élève ne se sente « débordé » par l’opposition entre deux cultures scolaires, dont l’enchaînement ne présente, pour lui, aucun sens : « la marche est haute pour certains enfants : il faut les aider à la franchir » (218).
Il faut donc mettre en place un cadre qui permette d’établir des liaisons pédagogiques entre l’école élémentaire et le premier cycle du secondaire. Au final, cette collaboration devra corriger ce que M. Jean-Paul Delahaye a appelé « le vice de forme initial » qui affecte ce niveau d’enseignement.
Ainsi que l’a rappelé ce dernier, la solution retenue en 1975 d’un collège « davantage conçu en fonction de son aval, le lycée, que de son amont, l’école primaire, a sans doute permis de vaincre les résistances historiques d’un enseignement secondaire qui voulait se protéger, mais elle n’a probablement pas été le choix le plus judicieux pour tous les élèves. Ainsi, la France a non seulement conçu un système qui contraint les élèves à effectuer leur parcours de scolarité obligatoire dans deux établissements successifs et radicalement différents, mais elle l’a fait en transférant dans la deuxième partie de la scolarité obligatoire un modèle d’enseignement secondaire ne pouvant convenir qu’à une partie des élèves » (219).
Ces objectifs faisant désormais partie intégrante de la refondation pédagogique, quel instrument faut-il utiliser pour y parvenir ?
Certaines initiatives parlementaires mettent en avant la solution des « écoles du socle commun » : ainsi en témoigne une proposition de loi visant à mettre en place ce type d’établissement à titre expérimental (220).
L’Assemblée nationale n’a pas eu à en débattre faute d’inscription à l’ordre du jour. Et pour cause : la création d’établissements qui signeraient, à terme, la fin de la « communale » suscite les craintes des trois acteurs incontournables d’une telle réforme que sont les enseignants des premier et second degrés, les parents et les communes.
Au surplus, la catégorie des EPLE constitue-t-elle, à titre de comparaison, une structure administrative performante sur le plan de la pédagogie ? On peut en douter, car s’ils existent depuis près de trente ans – leur fonctionnement est régi par le décret du 30 août 1985 –, ils ne sont pas parvenus à surmonter le cloisonnement disciplinaire qui les caractérise. Ainsi que l’ont rappelé en 2007 les inspections générales, « l’EPLE est le cadre d’une addition de missions d’enseignement, effectuées certes avec sérieux, mais séparément, et non pas d’une mission d’enseignement au sens large, assumée collectivement. De ce point de vue, l’EPLE apparaît fréquemment comme une collection d’individualités ; les équipes, y compris à l’intérieur d’une discipline, sont souvent plus virtuelles que réelles » (221).
Aussi faut-il faire preuve de réalisme en la matière et ne pas penser que la refondation pédagogique de l’école peut se jouer sur une réforme qui, aux yeux d’une partie significative de l’opinion publique, pourrait être interprétée comme une tentative de briser les corps enseignants du premier et du second degrés ou le statut de service municipal de l’école datant de la loi « Guizot » de 1833.
Tout au plus peut-on considérer qu’après la mise en application, dans la durée, de la loi portant refondation, c’est-à-dire dans un deuxième temps et à l’issue d’un débat conduisant à un accord entre toutes les parties prenantes, des réseaux d’écoles du socle pourraient être mis en place dans notre pays.
À cet égard, le rapporteur se félicite du caractère pragmatique de la voie choisie par le présent projet de loi, qui recèle néanmoins de réelles potentialités en ce qui concerne le rapprochement pédagogique entre le primaire et le collège.
En effet, son intérêt réside dans le fait qu’elle s’inspire d’un outil qui, à certains égards, a fait ses preuves : les réseaux « ambition réussite » ou RAR mis en place dans le cadre de la réforme de l’éducation prioritaire de 2006.
On sait que ceux-ci ont dû, en raison des injonctions du précédent gouvernement, laisser la place, à partir de 2010, au programme CLAIR, puis au programme ECLAIR, dont la valeur pédagogique est pourtant apparue « limitée » aux yeux des inspections générales. En effet, un grand nombre d’actions mises en œuvre par les établissements concernés se sont bornées à une « capitalisation des acquis pédagogiques des RAR » (222).
Or ces acquis ont été rendus possibles par une coopération étroite entre un collège et « ses » écoles, laquelle était formalisée selon les modalités suivantes :
– chaque réseau était piloté localement par un principal de collège pour le second degré, et par un inspecteur de l’éducation nationale pour le premier degré. Un comité exécutif réunissait ainsi le principal du collège, son adjoint, l’inspecteur et les directeurs des écoles et était chargé de l’élaboration, du suivi et de la régulation du contrat du réseau, permettant la définition d’objectifs partagés et le développement d’une culture commune de la maternelle au collège ;
– le projet de chaque réseau était formalisé dans un contrat « ambition réussite ». Il contenait un tableau de bord, un diagnostic axé sur les acquis des élèves, des objectifs pédagogiques, un plan d’actions et les lettres de mission des enseignants. Validé par le comité exécutif du réseau, ce contrat devenait une référence commune de travail au sein du réseau, de même qu’avec les autorités académiques. Il était discuté lors des conseils d’école, du conseil pédagogique et du conseil d’administration au collège et pouvait être amendé chaque année.
Le dispositif proposé revient à prendre appui sur ce type de démarche collaborative de terrain pour l’étendre à l’ensemble des écoles primaires et des collèges, en le rendant obligatoire.
2. Le dispositif proposé par le projet de loi
Le présent article propose d’ajouter un nouvel article L. 401-4 au titre préliminaire, relatif aux dispositions communes concernant les établissements d’enseignement scolaire, du livre IV du code de l’éducation. Il viendra après les articles L. 401-1, L. 401-2 et L. 401-3 consacrés respectivement au projet d’école ou d’établissement, au règlement intérieur et à la présentation de celui-ci aux personnes responsables de l’enfant.
a) Sa philosophie : une obligation de collaboration au service de la continuité des apprentissages et de l’acquisition du socle commun
En termes de structures, la continuité pédagogique dans la scolarité du primaire et du collège postulée par le socle commun fait aujourd’hui figure de parent pauvre. Elle est en effet encadrée par une simple circulaire du 26 août 2011 qui met en place des commissions de liaison, co-présidées par l’inspecteur de l’éducation nationale (IEN) et le principal du collège.
Composées des maîtres des classes de CM2 des écoles du secteur du collège, des professeurs principaux et des professeurs de français et de mathématiques des classes de 6ème ces instances ont pour unique mission de « définir les modalités des aides qui pourront être apportées aux élèves entre leur sortie de l’école primaire et la fin de la classe de 6ème » et de « suivre leur mise en œuvre et en évaluer les effets » (223). Enfin, selon l’étude d’impact jointe au présent projet de loi, l’application de cette circulaire, qui repose sur la seule volonté des personnels concernés, est « très disparate selon les territoires ».
Le présent article propose donc d’imposer une obligation de collaboration entre chaque collège et les écoles de son secteur de recrutement, au moyen de l’institution d’un « conseil école-collège ».
On rappellera que c’est le conseil général qui définit, en vertu de l’article L. 213-1 du code de l’éducation, les secteurs de recrutement des différents collèges publics du département. Cela détermine dans quel collège public doivent être scolarisés les élèves qui habitent dans telle zone du département. De la même manière, les écoles primaires sont sectorisées, l’article L. 212-7 du code de l’éducation disposant que « le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal ».
Toutefois, les délimitations des secteurs de recrutement des écoles et celles des secteurs des collèges peuvent ne pas être similaires. Le secteur de recrutement d’un collège peut en effet recouvrir tout ou partie du secteur de recrutement d’une ou plusieurs écoles. En conséquence, selon le ministère de l’éducation nationale, la notion d’« école du secteur du collège » s’entend « entre un collège et la ou les écoles du premier degré d’où seront originaires les élèves qui seront scolarisés en 6ème ».
Définition juridique du secteur de recrutement d’un collège
L’article L. 213-1 du code de l’éducation dispose que le conseil général arrête la localisation, la capacité d’accueil et le secteur de recrutement des collèges, après avis du conseil départemental de l’éducation nationale.
L’article D. 211-10 du même code prévoit, pour les collèges, « que le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts ». Les secteurs scolaires correspondent aux zones de desserte des collèges : « Un secteur comporte un seul collège public, sauf exception due aux conditions géographiques ».
L’article D. 211-11 précise que les collèges accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. Cette disposition définit le droit, pour les familles, à scolariser leur enfant dans le collège « de secteur ». Ainsi, les élèves qui, sauf dérogation obtenue, seront scolarisés dans un collège sont ceux qui résident dans la zone de recrutement de l’établissement.
Quant à la nature de la coopération qui devra lier un collège à « ses » écoles, celle-ci devrait avoir, aux yeux du rapporteur, une double finalité et être corrélée à une obligation de résultat :
– une finalité pédagogique, car cette coopération devra assurer la continuité des apprentissages entre l’école élémentaire et le collège et la mise en œuvre coordonnée des programmes ;
– une finalité scolaire, en contribuant à l’acquisition, par tous les élèves, du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
De cette manière, cette nouvelle instance permettra de donner suite à l’une des principales préconisations du rapport de la concertation sur la refondation de l’école, rédigée en ces termes : « faciliter les collaborations pédagogiques et les concertations communes » entre les deux niveaux d’enseignement pour « fluidifier la transition école-collège » (224).
En la matière, le comité de pilotage de la concertation est d’ailleurs allé assez loin, en proposant des services d’enseignement partagés. Ainsi, un professeur ayant en charge une classe de CM2 pourrait consacrer quelques heures de ses obligations de service à enseigner en 6ème, une possibilité qui serait ouverte, symétriquement, à son collègue du secondaire désireux d’enseigner en fin d’école élémentaire. Une telle évolution devrait être encouragée à condition qu’elle ne serve pas de paravent à une politique – qui serait, elle, indéfendable – visant à transformer les professeurs des écoles en spécialistes du traitement des difficultés d’apprentissage en première année de collège…
Le rapport annexé précise que, dans le cadre du conseil école-collège, chaque collège et les écoles relevant de son secteur « détermineront conjointement des modalités de coopérations et d’échanges », qui devront de surcroît être inscrites dans le projet d’école et le projet d’établissement. En effet, ces projets, approuvés par les organes délibérants de ces établissements, définissent leurs objectifs en termes de réussite scolaire, ainsi que leur « charte pédagogique ». Il est donc logique de penser qu’ils constitueront le support des actions destinées à renforcer les relations école-collège.
Enfin, le présent article permettra de mieux accompagner les efforts déjà fournis par les équipes pédagogiques pour améliorer, localement, la continuité entre école et collège : demi-journées d’accueil des élèves du primaire dans leur futur collège, échanges entre classes de CM2 et de 6ème, harmonisation du vocabulaire dans certaines disciplines, élaboration d’un livret numérique « liaison école-collège » pour la maîtrise de la langue française, etc.
b) Un conseil école-collège « force de proposition » et respectueux des prérogatives des organes délibérants des écoles et collège
● Un conseil qui ne sera pas « hors-sol »
Le conseil école-collège devra proposer au conseil d’administration du collège et aux conseils des écoles du secteur de recrutement de cet établissement le contenu concret de cette politique de coopération.
Les prérogatives des conseils existants seront donc préservées. La décision finale quant aux projets reviendra ainsi aux écoles et aux collèges, ce qui doit leur permettre, ainsi que l’a observé l’avis du Conseil économique, social et environnemental, « de les adapter aux publics qu’ils scolarisent et aux ressources dont ils disposent localement » dans la mesure où ces coopérations ne peuvent se faire de la même façon en milieu urbain et en milieu rural, notamment au regard, dans ce dernier cas de figure, de l’éloignement des collèges et des écoles (225).
On rappellera qu’à l’heure actuelle, les conseils d’école statuent sur la partie pédagogique du projet d’école et adoptent ce dernier (article D. 411-2 du code de l’éducation). Quant aux conseils d’administration des EPLE, ils fixent « les principes de mise en œuvre de (leur) autonomie pédagogique et éducative », qui porte sur l’organisation des classes et des groupes d’élèves, l’emploi des dotations en heures d’enseignement et l’organisation du temps scolaire, et ils adoptent les projets d’établissement (article R. 421-20 du code de l’éducation).
On soulignera par ailleurs le rôle essentiel du projet d’école et du projet d’établissement. En effet, aux termes de l’article L. 401-1 du code de l’éducation, celui-ci « définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux » et précise « les activités scolaires et périscolaires qui y concourent », ainsi que « les voies et moyens qui sont mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin ».
● Un pouvoir de proposition étendu
Le présent article précise que le conseil école-collège proposera « des enseignements et des projets pédagogiques communs » visant à l’acquisition du socle commun par les élèves.
Cette instance pourra être ainsi le pivot de collaborations professionnelles portant sur des objets professionnels précis – et non un lieu de débats philosophiques ou d’affrontements entre les deux ordres d’enseignement. C’est à ce titre que le conseil école-collège pourra se saisir des questions de la « programmation » des apprentissages – afin d’éviter les césures ou les répétitions entre les cours d’un niveau à l’autre – et de l’évaluation des acquis des élèves.
Cette disposition fondamentalement novatrice donnera corps à une autre proposition essentielle du rapport du comité de pilotage de la concertation sur l’école, qui porte sur l’organisation d’un « enseignement regroupé en champs disciplinaires à la fin de l’école primaire et au début de la scolarité au collège » afin de passer, de manière progressive, du maître unique aux professeurs spécialisés (226). Elle permettra d’atténuer les changements pédagogiques souvent mal vécus par les élèves en difficulté et de donner une impulsion décisive à l’approche interdisciplinaire postulée par le socle commun.
De son côté, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a estimé que ce travail commun, qui doit associer les personnels dans le respect des statuts, peut engendrer une « dynamique vertueuse entre les équipes éducatives des établissements concernés, pour faciliter les progressions des élèves d’un cycle à l’autre, adoucir une transition souvent rude, et parfois fatale aux élèves les plus en difficulté » (227).
C’est la raison pour laquelle il conviendrait, afin de donner du « grain à moudre » au nouveau conseil, que les collèges puissent disposer d’une réelle autonomie dans l’utilisation de leurs moyens, à l’image des lycées généraux ou technologiques qui, depuis la réforme de 2009, peuvent répartir entre un quart et un tiers de leur dotation globale horaire. Peut-être faudrait-t-il même, dans un deuxième temps, aller encore plus loin en prévoyant l’institution d’un conseil pédagogique inter-degré.
Au total, les dispositions proposées n’ont rien d’anecdotiques. Ainsi que l’a souligné le ministre de l’éducation nationale, M. Vincent Peillon, devant notre Commission (228), elles conduisent à généraliser « l’institution du conseil pédagogique », lequel est prévu au sein des seuls établissements publics locaux d’enseignement par la loi du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école.
● Un cadre de coopération qui sera précisé par décret
La composition et les modalités de fonctionnement du conseil école-collège seront fixées par décret. Ce texte pourrait notamment prévoir, ainsi que le proposait l’avant-projet de loi, qu’après l’accord du conseil d’administration et des conseils des écoles, les enseignements ou projets communs seront mis en œuvre dans les collèges sous l’autorité du chef d’établissement et dans les écoles sous la responsabilité du directeur d’école. Par ailleurs, l’animation et le pilotage de ce conseil devraient être assurés par le principal de collège, l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription ou les directeurs d’école concernés et un enseignant coordonnateur. Enfin, le conseil devrait se réunir au moins trois fois par an pour éviter qu’il ne devienne une coquille vide.
3. Les améliorations apportées par la Commission
À l’initiative du rapporteur, la Commission a adopté une disposition précisant que le conseil école-collège pourra proposer non seulement des enseignements et des projets pédagogiques communs, mais aussi des actions de coopérations, celles-ci devant faciliter ceux-là.
La Commission a également prévu que le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) pourra être commun au collège et aux écoles concernées. On rappellera que ce comité s’inscrit dans le pilotage de chaque établissement du second degré, conformément aux dispositions des articles R 421-46 et 421-47 du code de l’éducation, et qu’il constitue une instance de réflexion, d’observation et de propositions, concevant, mettant en œuvre et évaluant un projet éducatif détaillé en matière d’éducation à la citoyenneté et à la santé et de prévention de la violence.
Enfin, la Commission a précisé que, dans les zones d’éducation prioritaire, les conseils d’école-collège associent les acteurs de la politique de la ville, l’entrée en 6ème étant encore plus délicate dans ces territoires.
*
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 511 de Mme Barbara Pompili.
Puis elle adopte l’amendement de précision AC 645 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 441 de M. Mathieu Hanotin.
M. Mathieu Hanotin. Je propose d’encourager les expérimentations visant à faciliter la transition entre un enseignement polyvalent à l’école élémentaire et des enseignements monovalents à la fin du collège.
M. le rapporteur. L’article 40 institue un conseil école-collège qui permet d’organiser cette continuité de façon progressive. Cependant, votre amendement évoque « une organisation commune et intégrée » qui revient à réunir l’école élémentaire et le collège – ce qui, au demeurant, poserait bien des problèmes statutaires pour les personnels. Si la loi permet le rapprochement des deux cultures du primaire et du secondaire, elle ne les fusionne pas.
M. Benoist Apparu. L’un de mes amendements, qui visait à instituer des écoles du socle commun, n’a malheureusement pas passé le filtre de l’article 40 de la Constitution – dont l’interprétation semble parfois à géométrie variable.
La création d’un nouveau cycle, entre la fin du primaire et le début du collège, n’annonce-t-elle pas un rapprochement entre les établissements relevant de l’une et l’autre école ? Il est dommage de ne pas aller au bout de cette logique à l’occasion de ce projet de loi. À tout le moins, on aurait pu favoriser des expérimentations, qui d’ailleurs ont déjà eu lieu en Alsace.
M. Mathieu Hanotin. Je n’entendais évidemment pas, avec cet amendement, modifier l’organisation globale de l’école : le troisième alinéa de l’article L. 401-1 du code de l’éducation vise seulement l’expérimentation. Cependant, au bénéfice des arguments du rapporteur, je retire mon amendement, afin d’en déposer un autre sur le même sujet en séance.
L’amendement est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ensuite l’amendement AC 513 de Mme Barbara Pompili.
Puis elle examine l’amendement AC 277 de M. Benoist Apparu.
M. Benoist Apparu. Cet amendement, qui réaffirme ce qui relève du niveau national, allait de pair avec un autre qui définissait les conditions de l’autonomie, mais qui s’est heurté à l’article 40 de la Constitution. Il n’a plus de sens seul ; je le retire donc.
L’amendement est retiré.
La Commission examine ensuite l’amendement AC 427 de Mme Martine Faure.
Mme Martine Faure. Il s’agit de prévoir que le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté peut être commun au collège et aux écoles concernées.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AC 425 de Mme Julie Sommaruga.
Mme Julie Sommaruga. Il s’agit d’associer, dans les zones d’éducation prioritaire, les acteurs de la politique de la ville aux conseils d’école-collège.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 40 modifié.
Article 40 bis (nouveau)
Relations des établissements scolaires avec leur environnement
La Commission a adopté un amendement insérant cet article qui vise à renforcer, dans les écoles situées en zones prioritaires, des actions éducatives concrètes, permettant de favoriser l’ouverture d’esprit, la créativité, l’esprit d’initiative et de renforcer le bien-être des enfants et des adolescents.
Dans ce but, les activités et les interventions du monde associatif, culturel, scientifique et sportif peuvent non seulement jouer un rôle essentiel auprès d’un public issu d’un milieu défavorisé mais aussi valoriser les établissements victimes du phénomène d’évitement résultant de l’assouplissement de la carte scolaire.
Le présent article tend donc à modifier l’article L. 421-7 du code de l’éducation pour préciser que les établissements scolaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, social et culturel « particulièrement dans les zones d’éducation prioritaire ».
*
La Commission examine l’amendement AC 426 de Mme Julie Sommaruga portant article additionnel après l’article 40.
Mme Julie Sommaruga. Il s’agit de préciser, à l’article L. 421-7 du code de l’éducation, que les établissements scolaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social « particulièrement dans les zones d’éducation prioritaire ».
M. le rapporteur. Pourquoi dans ces zones en particulier ? Les échanges avec l’environnement doivent être organisés partout.
Mme Julie Sommaruga. C’est dans ces zones que se concentrent les difficultés scolaires et sociales. Les actions éducatives concrètes, et l’interaction avec le monde associatif, culturel, scientifique et sportif, y sont particulièrement indispensables.
M. le rapporteur. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Cet article a pour objet de modifier l’article L. 411-1 du code de l’éducation relatif aux missions des directeurs d’école et aux comités des parents d’élèves afin de donner – enfin ! – une existence légale au conseil d’école.
1. La nécessité d’un dialogue social approfondi préalable à toute réforme d’ampleur du « statut » de directeur d’école
Le statut du directeur d’école n’a pas atteint aujourd’hui son point d’équilibre. C’est une évidence, à commencer pour les intéressés eux-mêmes.
Il est vrai que le grand nombre d’écoles primaires de notre pays, tout comme la diversité de leur taille, n’ont pas été favorables à l’adoption de solutions juridiques comparables à celles qui ont vu la mise en place des EPLE – par le décret n° 85-924 du 30 août 1985 – et du statut des personnels de direction du second degré (le décret du 11 décembre 2001 a remplacé celui du 11 avril 1988).
Ainsi, dans le seul secteur de l’enseignement public, on dénombre 22,8 % d’écoles à deux classes ou moins, dont près de 4 700 écoles à classe unique (9,7 %). 40 % des écoles publiques ont par ailleurs entre trois et cinq classes.
Recruté sur une liste d’aptitude élaborée au niveau départemental, le directeur d’école est un instituteur ou un professeur des écoles qui, tout en conservant ce statut, est simplement chargé, souvent à temps partiel, de fonctions administratives et pédagogiques. Placé sous l’autorité de l’inspecteur de l’éducation nationale (IEN) chargé de la circonscription scolaire, il n’intervient ni dans l’évaluation, ni dans aucun acte de gestion des enseignants, ces attributions étant exercées par l’IEN.
Aussi le directeur d’école ne bénéficie-t-il que d’un « statut d’emploi », défini par un décret du 24 février 1989. Pourtant, ce texte lui attribue de très nombreuses tâches, dont l’énumération frappe par son « ampleur » et son « hétérogénéité », ainsi que l’a souligné notre collègue M. Frédéric Reiss dans un rapport remis au Premier ministre en 2010 : « le détail cohabite avec la globalité, l’opération de routine avec la décision stratégique, la création pédagogique avec l’exécution administrative » (229). Or, pour lui permettre d’accomplir ces missions, le directeur n’est entièrement déchargé de son service d’enseignement que dans les écoles comportant au moins 14 classes primaires ou 13 classes maternelles.
Nombre d’écoles selon le nombre de classes et le type d’école en 2011-2012
Nombre de classes |
Écoles maternelles |
Écoles élémentaires et spécialisées |
Écoles primaires |
Total |
Public |
||||
1 131 |
2 699 |
848 |
4 678 | |
2 |
2 055 |
1 712 |
2 554 |
6 321 |
3 |
3 692 |
877 |
2 660 |
7 229 |
4 |
3 273 |
1 092 |
2 169 |
6 534 |
5 |
2 422 |
1 982 |
1 667 |
6 071 |
6 à 10 |
2 957 |
7 035 |
3 541 |
13 533 |
11 à 15 |
153 |
2 287 |
780 |
3 220 |
16 et plus |
3 |
369 |
181 |
553 |
Total public |
15 686 |
18 053 |
14 400 |
48 139 |
Privé |
||||
1 |
28 |
66 |
61 |
155 |
2 |
29 |
62 |
455 |
546 |
3 |
32 |
22 |
548 |
602 |
4 |
16 |
17 |
613 |
646 |
5 |
8 |
33 |
511 |
552 |
6 à 10 |
15 |
46 |
1 739 |
1 800 |
11 à 15 |
0 |
18 |
652 |
670 |
16 et plus |
1 |
8 |
299 |
308 |
Total privé |
129 |
272 |
4 878 |
5 279 |
Ensemble |
15 815 |
18 325 |
19 278 |
53 418 |
Source : Repères et références statistiques édition 2012, ministère de l’éducation nationale, septembre 2012. Champ : France métropolitaine + DOM y compris Mayotte.
En outre, sa position administrative n’est « objectivement guère enviable » pour reprendre les termes d’un rapport rédigé par un inspecteur général de l’éducation nationale, M. Jean-Pierre Obin : « il ne dispose en fait d’aucune autorité pour assumer une réelle responsabilité pédagogique, et il dispose de peu de moyens pour assurer ses responsabilités administratives. (…) Il n’est ni franchement un pair ni vraiment un supérieur. Toujours à la recherche d’une transaction efficace entre ces deux positions, il est en outre constamment soumis à l’autorité proche des deux vrais responsables institutionnels de l’école, l’inspecteur de la circonscription, représentant l’État, et le maire de la commune, propriétaire des lieux et employeur des personnels non enseignants, deux personnages dont l’entente ne va pas toujours de soi » (230).
Les missions du directeur d’école selon le décret n° 89-122 du 24 février 1989
et ses décharges de service
● Les missions
– Le directeur d’école veille à la bonne marche de l’école et au respect de la réglementation qui lui est applicable.
– Il procède à l’admission des élèves sur production du certificat d’inscription délivré par le maire et répartit les élèves entre les classes, après avis du conseil des maîtres.
– Il répartit les moyens d’enseignement. Après avis du conseil des maîtres, il arrête le service des enseignants et fixe les modalités d’utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l’enseignement et de la formation.
– Il organise le travail des personnels communaux en service à l’école qui, pendant leur service dans les locaux scolaires, sont placés sous son autorité.
– Il organise les élections des délégués des parents d’élèves au conseil d’école ; il réunit et préside le conseil des maîtres et le conseil d’école.
– Il prend toute disposition utile pour que l’école assure sa fonction de service public. À cette fin, il organise l’accueil et la surveillance des élèves et le dialogue avec leurs familles.
– Il assure la coordination nécessaire entre les maîtres et anime l’équipe pédagogique. En outre, il aide au bon déroulement des enseignements en suscitant au sein de l’équipe pédagogique toutes initiatives destinées à améliorer l’efficacité de l’enseignement dans le cadre de la réglementation et en favorisant la bonne intégration dans cette équipe des maîtres nouvellement nommés dans l’école, des autres maîtres qui y interviennent, ainsi que la collaboration de tout autre intervenant extérieur.
– Il prend part aux actions destinées à assurer la continuité de la formation des élèves entre l’école maternelle et l’école élémentaire et entre l’école et le collège.
– Il représente l’institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales. Par ailleurs, il est l’interlocuteur des autorités locales et veille à la qualité des relations de l’école avec les parents d'élèves, le monde économique et les associations culturelles et sportives.
– Il contribue à la protection des enfants en liaison avec les services compétents. Il s’assure de la fréquentation régulière de l’école par les élèves.
● Les décharges de service
Le régime de décharge d’enseignement des directeurs d’école est défini par une note de service du 21 juin 2006 : décharge complète pour les écoles comportant au moins 14 classes primaires ou 13 classes maternelles ; demi-décharge pour les écoles de 10 à 13 classes primaires ou 9 à 12 classes maternelles ; quart de décharge pour les écoles de 4 à 9 classes primaires ou 4 à 8 classes maternelles ; l’équivalent horaire de 2 journées de décharge dans les 15 jours suivant la rentrée scolaire pour les autres écoles.
Il y a lieu de noter qu’en 2010 notre collègue M. Frédéric Reiss, dans un rapport remis au premier ministre, avait proposé les seuils suivants : 4 classes pour 25 %, 7 classes pour 50 %, 10 classes pour une décharge de 50 % pour le directeur conjuguée à un complément de décharge pour un autre enseignant de l’école (fixé à 25 %), 14 classes pour la décharge maximale du directeur, avec un complément de décharge pour un autre enseignant de l’école (fixés à 75 % pour le directeur et 25 % pour l’autre enseignant) (231).
Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que les directeurs d’école éprouvent un profond malaise professionnel – ainsi, dans une enquête publiée fin 2012, 70 % de ceux qui étaient interrogés déclarent trouver leur métier « épuisant » et « stressant » et leurs missions « pléthoriques » (232). Ce sentiment trouvera son expression la plus spectaculaire dans la « grève administrative », très suivie, de ces personnels, qui durera de la fin des années 1990 à 2006.
À partir des années 2000, la précédente majorité a cherché à faire d’eux de véritables chefs d’établissement, à l’instar des principaux de collèges et des proviseurs de lycées, sous le couvert de la mise en place, à titre expérimental, d’établissements publics du premier degré dirigés par un conseil d’administration.
Ainsi, l’article 86 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit que les établissements publics de coopération intercommunale ou plusieurs communes d’un commun accord, ou une commune, peuvent, après avis des conseils des écoles concernées et accord de l’autorité académique, mener, pour une durée maximum de cinq ans, une expérimentation tendant à créer des établissements publics d’enseignement primaire (EPEP). Faute d’accord de la part des intéressés sur les équilibres de la composition tripartite – représentants des collectivités territoriales, des enseignants et des parents – du conseil administrant les EPEP, le projet de décret d’application soumis à l’avis du Conseil supérieur de l’éducation n’a jamais eu de suite.
De même, une proposition de loi relative à la création d’établissements publics d’enseignement primaire (233) n’a jamais été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, alors que la loi de finances pour 2009 prévoyait la création de 500 emplois administratifs pour mettre en application ses dispositions – une mesure qui a disparu des budgets ultérieurs.
C’est pourquoi le présent projet de loi ne propose pas de graver « dans le marbre » un statut du directeur d’école de « plein exercice » – qu’il serait de toute façon impossible, pour des raisons budgétaires, d’accorder à tous ceux qui, en France, exercent cette fonction.
Certes, les missions des directeurs d’école devront évoluer, mais à l’issue d’une négociation approfondie avec les personnels. Pour cette raison, le rapporteur se réjouit que le ministre de l’éducation nationale, le 6 décembre 2012, ait inclus dans « l’agenda de la refondation » la réflexion sur les métiers de l’enseignement, dont celui de directeur d’école.
2. Le dispositif proposé par le projet de loi
Le présent article propose de reconnaître l’existence du conseil d’école, afin d’associer plus clairement les parents d’élèves et les communes à la vie de cet établissement d’enseignement.
● Une organisation des écoles qui est simple et encadrée essentiellement par des textes réglementaires
Comparée aux structures nombreuses et complexes cohabitant au sein des EPLE, l’organisation de l’école primaire est simple, car elle repose sur deux organes, le conseil d’école et le conseil des maîtres.
– Présidé par le directeur, le conseil d’école comporte des membres de droit : le maire de la commune ou son représentant, les maîtres de l’école, un maître du réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED), choisi par le conseil des maîtres, le délégué départemental de l’éducation nationale, et des membres élus représentant les parents d’élèves, en nombre égal à celui des classes de l’école. Il se réunit en principe au moins une fois par trimestre et l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions (article D. 411-1 du code de l’éducation). Il vote le règlement intérieur de l’école, adopte le projet d’école et donne son avis et fait des suggestions sur toutes les questions de la vie de l’école : intégration des enfants handicapés, activités périscolaires, restauration scolaire, hygiène scolaire, sécurité des enfants, etc.
– Le conseil des maîtres est l’organe de concertation et de coordination pédagogique de l’école. Il est également présidé par le directeur et se réunit aussi au moins une fois par trimestre. Il rassemble l’ensemble des enseignants. Il donne son avis sur l’organisation pédagogique de l’enseignement et élabore le projet d’école qui définit « les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux » et précise pour chaque cycle « les actions pédagogiques qui y concourent ainsi que les voies et moyens mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves » (article D. 411-7 du code de l’éducation).
Vis-à-vis des parents et des communes, le conseil d’école se situe donc au centre des relations « triangulaires » qui se nouent quotidiennement entre l’équipe pédagogique et ses partenaires extérieurs.
Les compétences du conseil d’école (article D. 411-2 du code de l’éducation)
Le conseil d’école, sur proposition du directeur de l’école :
– vote le règlement intérieur de l’école ;
– établit le projet d’organisation de la semaine scolaire ;
– donne, dans le cadre de l’élaboration du projet d’école à laquelle il est associé, tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l’école et sur toutes les questions intéressant la vie de l’école, et notamment sur :
* les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d’enseignement ;
* l’utilisation des moyens alloués à l’école ;
* les conditions de bonne intégration d’enfants handicapés ;
* les activités périscolaires ;
* la restauration scolaire ;
* l’hygiène scolaire et la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire.
Par ailleurs, le conseil d’école :
– statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d’école et adopte le projet d’école ;
– donne son accord pour l’organisation d’activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles ;
– est consulté par le maire sur l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d’ouverture de l’école.
En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d’école sur les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers et l’organisation des aides spécialisées.
● La consécration législative du conseil d’école
Alors que le conseil d’école est un organe consultatif et d’information réciproque essentiel et qu’il exerce des compétences décisionnelles fondamentales, il n’est pas reconnu par la loi.
En effet, ayant été institué par l’article 17 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990, le conseil d’école ne figure que dans la partie réglementaire du code de l’éducation aux articles D. 411-1 et 411-2.
Le présent article propose donc de lui conférer une reconnaissance d’ordre législatif. Il précise que le conseil est présidé par le directeur de l’école, qu’il réunit les représentants de la communauté éducative et qu’il donne son avis sur « les principales questions de la vie scolaire ».
Par vie scolaire, il faut comprendre, selon les précisions apportées par le ministère de l’éducation nationale, le terme « dans son acception la plus large, c’est-à-dire la vie pédagogique et éducative de l’école ».
Ces dispositions s’ajouteront à celles que le présent article, dans sa rédaction initiale, ne prévoit pas de modifier et qui précisent, d’une part, que les parents d’élèves élisent leurs représentants, qui constituent un « comité des parents », réuni périodiquement par le directeur de l’école et, d’autre part, que le représentant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale intéressé assiste de plein droit aux réunions du conseil d’école.
Enfin, la composition et les attributions du conseil d’école seront fixées par décret, lequel devrait rester proche des dispositions actuelles de l’article D. 411-2 du code de l’éducation.
Les modifications proposées par le présent article permettront une triple avancée :
– Le conseil d’école, chargé de faire vivre la cité dans l’école, bénéficiera de toute la solennité attachée à la loi. La participation des représentants des parents et des communes à ses réunions se fera en effet sur un fondement législatif et non au titre d’une simple disposition réglementaire. On rappellera en effet que le conseil d’école réunit les représentants de la communauté éducative. Or celle-ci « rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l’établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l’accomplissement de ses missions » et « réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d’élèves, les collectivités territoriales ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l’éducation » (article L. 111-3 du code de l’éducation).
– Le conseil d’école pourra donner son avis sur les « principales questions de la vie scolaire ». Aux yeux du rapporteur, cette disposition signifie que le conseil d’école pourra se prononcer sur le projet d’école, c’est-à-dire sur l’outil qui permettra, localement, de définir les modalités de mise en œuvre des objectifs pédagogiques fixés par refondation.
– Le rôle du conseil d’école est consacré au moment où y est débattue l’organisation du temps scolaire et des activités périscolaires résultant de la généralisation de la semaine de quatre jours et demi. En effet, le décret du 24 janvier 2013 relatif à l’aménagement du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires prévoit que le conseil d’école peut proposer un projet d’organisation de la semaine scolaire au directeur académique des services de l’éducation nationale, qui arrête cette organisation après examen de la proposition qui lui a été transmise et avis du maire.
La Commission a souhaité aller encore plus loin dans cette reconnaissance, en prévoyant que la participation des parents à la vie de l’établissement se fait par le biais de l’élection annuelle de leurs représentants au conseil d’école.
*
La Commission est saisie des amendements AC 428 et AC 686 de Mme Françoise Dumas, pouvant faire l’objet d’une présentation commune.
Mme Valérie Corre. L’amendement AC 428 vise à supprimer la référence au comité des parents. Cette structure – qui entre en concurrence avec le conseil d’école – représente en effet un intermédiaire sans utilité entre les parents et l’établissement.
M. le rapporteur. Avis favorable.
M. Benoist Apparu. À l’heure où l’on souhaite mieux associer les parents d’élèves à la réussite de leurs enfants, pourquoi supprimer cette structure qui leur est réservée ?
Mme Valérie Corre. Le comité des parents n’est pas le seul lieu d’expression des parents, ceux-ci étant représentés au conseil d’école. L’intérêt de supprimer cette structure est de développer une participation plus directe des parents.
M. le rapporteur. L’amendement AC 686 précise en effet : « La participation des parents se fait par le biais de l’élection de leurs représentants au conseil d’école chaque année ».
Mme Valérie Corre. C’est bien à travers le conseil d’école que les parents sont associés à la vie de l’établissement.
M. Benoist Apparu. Le deuxième amendement est superfétatoire, n’ajoutant rien à ce qui existe déjà. Supprimer une institution réservée à la représentation des parents serait une erreur.
M. Xavier Breton. Monsieur le rapporteur, comment fonctionnent aujourd’hui les comités des parents ? S’ils ne donnent pas satisfaction, pourquoi ne pas leur confier d’autres fonctions ? Les supprimer sans débat constituerait un mauvais signal à l’heure où l’on veut réaffirmer la place des parents au sein de l’école.
M. le rapporteur. Les comités des parents souffrent d’un manque de représentativité, que ces deux amendements permettent de pallier. Être élus au conseil d’école donnera aux parents la possibilité d’y représenter l’intérêt de leurs enfants et de participer de façon efficace à la vie de l’établissement.
M. Xavier Breton. Ne faudrait-il pas en débattre avec le ministre ? Plutôt que de supprimer les comités des parents sans discussion, mieux vaut vérifier si les nouvelles dispositions donnent toute leur place aux parents au sein de l’école.
La Commission adopte successivement les amendements AC 428 et AC 686.
Puis, elle adopte l’article 41 modifié.
Section 3
Les établissements publics locaux d’enseignement
Article 42
Représentation de la collectivité de rattachement au sein du conseil d’administration des EPLE
Cet article vise à modifier la composition des conseils d’administration des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) afin de renforcer la représentation de leurs collectivités territoriales de rattachement – régions et départements. Il permettra de tirer les conséquences, au niveau de ces organes décisionnels, du transfert progressif de la propriété immobilière des collèges et des lycées à ces collectivités prévu par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
1. Des conseils d’administration à la composition « décalée »
L’article L. 421-2 du code de l’éducation dispose que les représentants des collectivités territoriales au sein des conseils d’administration des EPLE sont au nombre de 3 ou de 4 selon que l’effectif du conseil est de 24 ou de 30 membres, celui-ci variant en fonction de l’importance de l’établissement.
Le législateur a ajouté que ces représentants doivent comprendre 1 représentant de la collectivité de rattachement, le cas échéant, 1 représentant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), et 1 ou plusieurs représentants de la commune siège de l’établissement.
Concrètement, en application des articles R. 421-16 et R. 421-17 du code de l’éducation, les conseils d’administration des collèges de moins de 600 élèves et des établissements régionaux d’enseignement adapté comptent 24 membres dont 3 représentants des collectivités territoriales, soit :
– 1 représentant de la collectivité de rattachement ;
– 2 représentants de la commune siège de l’établissement ou, lorsqu’il existe un groupement de communes (EPCI), 1 représentant du groupement et 1 représentant de la commune siège.
Quant aux conseils d’administration comptant 30 membres, ils comportent 4 représentants des collectivités territoriales, soit :
– 1 représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
– 3 représentants de la commune siège de l’établissement ou, lorsqu’il existe un EPCI, 1 représentant du groupement et 2 représentants de la commune siège (article R. 421-14 du code de l’éducation).
Le droit en vigueur n’attribue donc qu’un seul représentant à la collectivité territoriale de rattachement d’un EPLE – le département en ce qui concerne les collèges et la région en ce qui concerne les lycées – au sein du conseil d’administration de cet établissement.
Il en résulte, par conséquent, une relative surreprésentation des communes au sein de ces instances, leur composition n’ayant pas tenu compte du transfert progressif de la propriété immobilière des collèges et des lycées aux départements et aux régions.
En effet, c’est la propriété des locaux qui justifiait principalement la représentation « large » des communes au sein des conseils d’administration des collèges et des lycées, la règle actuelle ayant été posée par la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État.
Depuis lors, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu le transfert, obligatoire ou facultatif selon les cas, de la propriété du patrimoine des établissements scolaires du second degré aux départements et aux régions. L’article 79, repris aux articles L. 213-3 (pour les collèges) et L. 214-7 (pour les lycées) du code de l’éducation, s’applique aux bâtiments des EPLE, tandis que l’article 84, non codifié, concerne les biens immobiliers des établissements scolaires encore gérés par l’État.
En ce qui concerne les biens immobiliers des EPLE, la loi prévoit trois types de transfert de propriété :
– le transfert aux départements ou aux régions des biens immobiliers appartenant à l’État à la date du 1er janvier 2005. Ce transfert de droit ne requiert aucune demande de la collectivité, l’ensemble des biens immobiliers appartenant à l’État, y compris les terrains affectés aux EPLE, étant transféré à la collectivité de rattachement. Il s’effectue à titre gratuit et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxes ou honoraires ;
– le transfert aux départements ou aux régions des biens immobiliers appartenant à une autre collectivité : région, département, commune ou groupement de commune. Lorsqu’il est effectué à l’occasion de travaux de construction, de reconstruction ou d’extension – mais non de grosses réparations – réalisés par le département ou par la région, ce transfert est de droit, à la demande du département ou de la région de rattachement ;
– le transfert aux départements ou aux régions des biens appartenant à une autre collectivité, en dehors des travaux précédemment mentionnés. Ce transfert est facultatif et soumis à l’accord des parties concernées. Il est donc soumis à l’approbation des assemblées délibérantes des collectivités concernées, des actes de cession devant être établis avant d’être publiés à la conservation des hypothèques.
Une mise en œuvre progressive des transferts de propriété
Le champ d’application de ce transfert est immense, puisque sont concernés des milliers d’établissements scolaires, plus de 120 régions et départements, des milliers de communes et des millions de m2.
Ainsi, en 2005-2006, 7 250 ensembles immobiliers ont été recensés dans le second degré en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, dont 532 cités scolaires regroupant 1 098 établissements du second degré, occupant une surface cadastrale de plus 160 millions de m2 dont 40 millions bâtis.
Le processus d’établissement des actes de cession peut en outre se révéler extrêmement long, en raison des difficultés de recensement et d’identification des biens à transférer. Plusieurs collectivités peuvent être ainsi copropriétaires d’un même ensemble immobilier en plus de l’État et quelquefois seules des parcelles appartiennent à ce dernier, le reste étant souvent la propriété de la ville siège.
À titre d’illustration, un document de la région Centre indique que sur 95 sites répartis en 6 départements, 13 étaient la propriété de cette collectivité, 15 appartenaient en entier à l’État, 1 appartenait à un département, 2 à une communauté d’agglomération, 37 aux communes, les 27 restants étant une copropriété État/commune, État/département ou département/commune.
Évolution du régime de propriété des bâtiments 2002-2009
(en nombre de bâtiments)
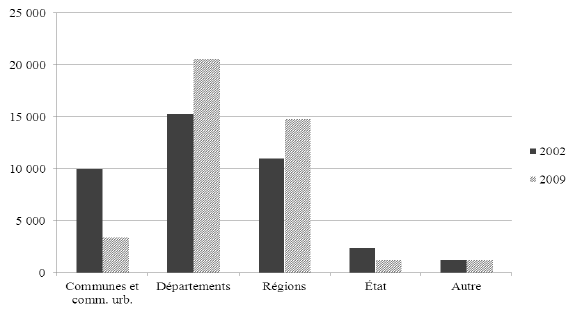
Source (encadré et graphique) : « Les effets de la décentralisation sur le fonctionnement du système éducatif », rapport du gouvernement au parlement en application de l’art. L. 211-1 du code de l’éducation (2012).
2. Le dispositif proposé par le projet de loi
Afin d’assurer au sein des conseils d’administration des collèges et des lycées une représentation des départements et des régions qui tienne compte du mouvement engagé par la loi du 13 août 2004, le présent article propose de modifier l’article L. 421-2 du code de l’éducation pour prévoir que la collectivité de rattachement d’un EPLE sera représentée par 2 membres, le nombre de représentants de la commune étant diminué à cet effet.
En revanche, la règle selon laquelle les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de 3 ou de 4 selon que l’effectif du conseil d’administration est de 24 ou de 30 membres restera inchangée.
● En conséquence, le présent article prévoit des règles de représentation des collectivités de rattachement et de la commune siège de l’établissement différentes selon que les représentants des collectivités territoriales seront au nombre de 3 ou de 4 :
– dans le premier cas de figure, ils comprendront 2 représentants de la collectivité de rattachement et 1 représentant de la commune siège de l’établissement ou, lorsqu’il existe un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), 1 représentant de la collectivité de rattachement, 1 représentant de l’EPCI et 1 représentant de la commune siège ;
– dans le second cas de figure, ils comprendront 2 représentants de la collectivité de rattachement et 2 représentants de la commune siège ou, lorsqu’il existe un EPCI, 2 représentants de la collectivité de rattachement, 1 représentant de l’établissement public et 1 représentant de la commune siège.
De cette façon, le nombre total de membres du conseil d’administration ne sera pas modifié et sa composition sera rééquilibrée au profit de la collectivité de rattachement.
● Par ailleurs, le présent article propose de tenir compte de l’existence des métropoles qui peuvent, à l’intérieur de leur périmètre, exercer les compétences du département ou de la région en matière de construction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des collèges ou des lycées, sous réserve qu’une convention soit passée à cet effet avec cette collectivité saisie d’une demande faite en ce sens par la métropole (cf. l’article L. 5217-4 du code général des collectivités territoriales issu de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales).
Dans les deux cas de figure, c’est un représentant de la métropole qui siégera au conseil d’administration des EPLE concernés en lieu et place de l’un des représentants de la collectivité territoriale de rattachement (234).
Le tableau ci-dessous permet de récapituler les différentes modalités de représentation des collectivités territoriales proposées par le présent article.
Effectifs du CA de l’EPLE |
Nombre de représentants des collectivités |
Répartition |
Répartition |
24 membres |
3 |
2 pour la région ou le département 1 pour la commune siège |
– 1 région ou département – 1 EPCI – 1 commune siège |
30 membres |
4 |
2 pour la région ou le département 2 pour la commune siège |
– 2 région ou département – 1 EPCI – 1 commune siège |
Source : d’après l’article 42 du présent projet de loi.
*
La Commission examine l’amendement AC 132 de Mme Claudine Schmid.
Mme Claudine Schmid. Cet amendement a pour objet de mettre en œuvre la proposition 22 du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, décidé par le gouvernement, qui vise à renforcer la place des entreprises au sein de l’enseignement technique et professionnel.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
Mme Claudine Schmid. Pour quelle raison ?
M. Michel Ménard. Plutôt que de renforcer leur place au sein de l’enseignement technique et professionnel, mieux vaut encourager les entreprises à proposer des stages aux élèves qui éprouvent de grandes difficultés à en trouver.
M. le rapporteur. La proposition 22 du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi s’appliquera à l’article R. 421-14 du code de l’éducation, qui dispose que le conseil d’administration des lycées et des collèges d’au moins 600 élèves comprend « une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l’administration de l’établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à cinq ». Il est donc inutile de le mentionner dans la loi.
Mme Claudine Schmid. Je maintiens mon amendement.
La Commission rejette l’amendement.
La Commission examine, en présentation commune, les amendements AC 442, AC 687 et AC 688 de M. Mathieu Hanotin, l’amendement AC 42 du rapporteur et l’amendement AC 689 de M. Mathieu Hanotin.
M. Mathieu Hanotin. Mes amendements visent à renforcer la place des collectivités au sein des conseils d’administration des établissements du second degré. Les conseils d’administration ne comptant que vingt-quatre membres – ce qui est généralement le cas pour les collèges – ne comprennent que trois représentants des collectivités. Là où il existe un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ils comptent donc un seul représentant de la collectivité de rattachement. Or, il est important qu’à la fois un élu et un membre de l’administration de cette collectivité siègent au conseil d’administration, afin que la collectivité puisse déployer pleinement sa politique et assurer la continuité du service public. Tout conseil d’administration devrait ainsi inclure quatre représentants des collectivités : deux représentants de la collectivité de rattachement, un représentant de l’EPCI et un représentant de la commune siège.
M. le rapporteur. La préoccupation est juste : la représentation des collectivités territoriales doit être à la hauteur du rôle de plus en plus important qu’elles sont amenées à jouer. Mais l’on ne saurait bouleverser sans concertation, à l’occasion d’un simple amendement, le difficile équilibre que le texte parvient à instaurer entre différents acteurs représentés dans les conseils d’administration. Je propose à M. Mathieu Hanotin de retirer ses amendements et d’organiser un débat avec toutes les parties prenantes, afin de parvenir à un nouvel accord.
M. Mathieu Hanotin. Aujourd’hui, ce sont les élus qui siègent dans les conseils d’administration, notamment dans les collèges et les lycées. Or, la multiplicité des conseils tombant le même jour rend quasiment impossible à un élu d’y assister systématiquement. Pour la continuité du service public, il est important que la collectivité responsable du financement soit toujours représentée par un membre de son administration. Tel qu’il est rédigé, le projet de loi le permet, mais pas pour tous les établissements, puisque l’alinéa 3 précise que lorsque les représentants des collectivités sont au nombre de trois, la présence d’un EPCI sur le territoire fait perdre un siège à la collectivité de rattachement. J’accepte de retirer mes amendements si l’on peut les retravailler ensemble en vue de la séance publique pour essayer de résorber cette incohérence.
M. le rapporteur. L’amendement AC 42 est rédactionnel.
Les amendements AC 442, AC 687, AC 688 et AC 689 sont retirés.
La Commission adopte l’amendement AC 42.
Puis, elle adopte l’article 42 modifié.
Article 43
Signature du contrat d’objectifs des EPLE
Cet article vise à modifier l’article L. 421-4 du code de l’éducation, relatif aux compétences des conseils d’administration des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), pour prévoir que le contrat d’objectifs d’un collège ou d’un lycée, signé avec l’autorité académique, peut être conclu avec sa collectivité territoriale de rattachement.
Pour mesurer la portée de la modification proposée, il convient de rappeler quelques éléments de contexte.
1° Le conseil d’administration d’un EPLE règle par ses délibérations les « affaires de l’établissement », qui, pour l’essentiel, relèvent de son autonomie pédagogique et éducative. À ce titre, il « fixe », dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités de l’État, les « principes de mise en œuvre » de cette autonomie et, en particulier, « les règles d’organisation de l’établissement » et se prononce sur le contrat d’objectifs qu’il conclut avec l’autorité académique (article L. 421-4 du code de l’éducation).
2° Tout comme le projet d’établissement, le contrat d’objectifs est l’outil de cette autonomie, tous deux ayant été introduits dans le code de l’éducation par la loi du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École.
Les deux instruments sont étroitement corrélés puisqu’ils doivent permettre aux EPLE de glisser du « conglomérat d’actions pédagogiques » (235) vers la construction d’une véritable stratégie d’établissement, laquelle est indispensable à toute refondation pédagogique de l’école.
La circulaire du 30 septembre 2005 qui encadre le contrat d’objectifs a d’ailleurs établi un lien « organique » entre celui-ci et le projet d’établissement. Ce texte précise en effet que le contrat « doit être établi en cohérence avec le projet d’établissement et sur la base des orientations fixées aux niveaux national et académique ; il définit les objectifs à atteindre à une échéance pluriannuelle (trois à cinq ans) sous forme d’un programme d’actions, dont la mise en œuvre peut être facilitée, voire conditionnée par un appui des services rectoraux ». Les indicateurs permettant d’apprécier la réalisation de ces objectifs sont mentionnés dans le contrat dont le projet est élaboré dans le cadre d’un dialogue avec l’autorité académique portant sur la pertinence des objectifs fixés et leurs conditions de mise en œuvre (236).
3° La collectivité de rattachement est très peu présente dans le dispositif. Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 421-4 du code de l’éducation se borne à prévoir que le conseil d’administration de l’EPLE se prononce sur le contrat conclu avec l’autorité académique « après en avoir informé la collectivité territoriale de rattachement », celle-ci devant en avoir eu communication « au moins un mois avant la réunion du conseil d’administration » (article R. 421-20 du même code).
Cette « relégation » à l’arrière-plan du département ou de la région est pour le moins surprenante dès lors que la réalisation des objectifs fixés par le contrat peut nécessiter son concours. C’est le cas, par exemple, lorsque ce contrat engage l’établissement dans l’expérimentation de ressources numériques, sans que « sa » collectivité ne lui en donne les moyens en matière d’équipements.
Pourtant, le législateur a prévu que le président du conseil général ou du conseil régional fait connaître au chef d’établissement les moyens que la collectivité de rattachement alloue au collège ou au lycée (article L. 421-23 du code de l’éducation).
Il permet également à l’établissement et au conseil général ou régional de signer une convention déterminant les modalités d’exercice de leurs compétences respectives, mais celle-ci et le contrat d’objectifs EPLE-autorité académique sont mis en œuvre de façon séparée, obligeant ainsi les collèges et les lycées à tenter de faire la synthèse d’engagements qui peuvent être contradictoires.
Le présent article propose donc de permettre la conclusion de contrats d’objectifs tripartites entre l’établissement, l’autorité académique et la collectivité territoriale de rattachement : si celle-ci souhaite en faire partie, elle pourra en être le cosignataire.
Selon l’analyse de l’étude d’impact, ce contrat pourra ainsi devenir, un véritable « pacte éducatif » destiné à « structurer le partenariat académie-collectivité de rattachement et la responsabilisation des équipes éducatives ». Dans ce but, il devra faire état des constats, des objectifs, des dispositifs et projets prévus, ainsi que des moyens accordés (humains, financiers, immobiliers, équipements, etc.) pour la mise en œuvre des principaux axes des politiques partagées en matière d’orientation, de formation, de lutte contre le décrochage, de numérique éducatif, etc.
*
La Commission adopte l’article 43 sans modification.
La Commission est saisie de l’amendement AC 514 de Mme Barbara Pompili portant article additionnel après l’article 43.
Mme Barbara Pompili. Cet amendement vise à reconnaître le statut de parent d’élève délégué.
M. le rapporteur. Avis défavorable. On peut s’accorder sur son objectif, mais eu égard aux conséquences de l’ouverture d’un nouveau droit, l’amendement n’est pas recevable.
Mme Barbara Pompili. Je le maintiens par plaisir, mais je le déposerai certainement sous forme de demande de rapport.
La Commission rejette l’amendement.
Section 4
Les groupements d’établissements
Article 44
Reconstitution des GRETA
Cet article vise à reconstituer les groupements d’établissements scolaires publics (GRETA) dont le cadre juridique, défini par l’article L. 423-1 du code de l’éducation, a été en partie supprimé par la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
1. Un statut des GRETA modifié au nom de la « simplification » du droit
Créés en 1973 et aujourd’hui au nombre de 200, les GRETA sont en réalité des groupements d’EPLE qui mutualisent leurs ressources et compétences pour mettre en œuvre des prestations de formation professionnelle à l’attention des adultes. Jusqu’en 2011, ils étaient dépourvus de personnalité juridique, chaque groupement étant adossé à un établissement support.
En abrogeant l’article L. 423-1 du code de l’éducation relatif aux groupements d’établissements scolaires publics, la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a imposé la transformation du statut de ces structures en groupement d’intérêt public (GIP) avant la fin du mois de mai 2013. Autrement dit, cette abrogation conduira, dans quelques mois, à la disparition des GRETA dans leur forme actuelle.
On rappellera que « pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue et de formation et d’insertion professionnelles », l’article L. 423-1, issu de la loi du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation (loi « Jospin »), permettait aux établissements concernés d’opter entre deux formules juridiques :
– soit en s’associant en groupements d’établissements dans des conditions fixées par décret ;
– soit en constituant, pour une durée indéterminée, un GIP.
Emprunte de ce que Pascal a appelé « l’esprit de géométrie », la loi du 17 mai 2011 a supprimé toutes les dispositions législatives qui autorisaient la création de catégories particulières de GIP en déterminant un cadre législatif général pour ce type de groupements. Ce faisant, elle a également privé les établissements publics scolaires de la possibilité de s’associer en groupements d’établissements « hors GIP » pour mener à bien leur mission de formation continue.
Certes, plusieurs rapports avaient considéré que l’absence de personnalité juridique des GRETA constituait un handicap, raison pour laquelle la formule du GIP avait été retenue. Cependant, outre le fait que la suppression des GRETA dans leur configuration traditionnelle risquait, selon certains syndicats, d’avoir pour effet de confier à des organismes privés une partie de la formation continue assurée jusqu’à présent par des professionnels de l’éducation nationale, cette mesure « simplificatrice » a entraîné de très nombreux problèmes pratiques, en termes de gestion des ressources humaines, budgétaires, comptables et organisationnels.
Sous la forme juridique prévue par la loi « Jospin » de 1989, les GRETA emploient des personnels titulaires de la fonction publique affectés sur emplois gagés ou intervenant au-delà de leurs obligations réglementaires de service et rémunérés à la vacation. Ils emploient aussi des agents contractuels.
L’article 109 de la loi du 17 mai 2011 dispose que les personnels d’un GIP comprennent des personnels mis à disposition par ses membres, d’agents relevant d’une personne morale de droit public non membre du groupement et, à titre complémentaire, de personnels propres directement recrutés par le groupement.
La transformation des GRETA en GIP aura donc pour conséquence que les personnels titulaires de l’éducation nationale ne pourront plus être affectés sur emplois gagés. Ils seront mis à disposition. Des personnels titulaires relevant d’autres personnes morales de droit public pourront également être employés par le GIP dès lors qu’ils seront placés dans une position conforme à leur statut, principalement le détachement sur contrat ou la mise à disposition. Quant aux personnels contractuels recrutés, ils seront soumis à un régime de droit public déterminé par un décret en Conseil d’État. Enfin, les conditions d’emploi des personnels seront déterminées par la convention constitutive du GIP.
Or, si ce dispositif était appliqué, les personnels contractuels des GRETA transformés en GIP deviendraient des personnels contractuels et non plus des agents de l’État. Ils ne pourraient donc pas bénéficier de la transformation de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ni de l’accès aux concours réservés, deux possibilités prévues par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire dans la fonction publique et ouvertes aux seuls personnels des GRETA rattachés à un EPLE.
Il n’est guère étonnant que, dans ces conditions, le cadre défini par la loi du 17 mai 2011 ait pu constituer une source d’anxiété pour les personnels.
2. Le dispositif proposé par le projet de loi
● Le I du présent article propose de rétablir, après l’article L. 422-3 du code de l’éducation, un article L. 423-1 disposant que pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue et de formation et d’insertion professionnelles, les établissements scolaires publics s’associent en groupements d’établissements dans des conditions définies par décret.
Ainsi les GRETA seront-ils reconstitués sous leur forme associative. Le ministère de l’éducation nationale considère toutefois que le retour pur et simple au dispositif précédent ne constitue pas une solution optimale. Par conséquent, après avoir consulté sur ce sujet les partenaires sociaux et l’Association des régions de France, il propose d’articuler les GRETA et le GIP selon des principes précisés par l’étude d’impact et repris par l’encadré ci-après.
La remise en place des GRETA « permet de conserver une présence territoriale forte de la formation continue de l’éducation nationale », ce maillage territorial étant indispensable pour répondre « aux besoins des différents publics, au plus près des besoins des territoires ».
Les GRETA adhéreront à un « GIP académique qui deviendra un interlocuteur unique pour les régions » et pourra ainsi mutualiser des fonctions essentielles à l’efficacité de la formation continue des adultes et renforcer le pilotage du réseau des GRETA au niveau académique.
Ce projet de recréation des GRETA permettra par ailleurs d’éviter les inconvénients du GIP en ce qui concerne la situation des personnels contractuels qui ne pourront pas, en cas du maintien du dispositif existant, bénéficier des dispositions de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique.
● Le II précise que les services accomplis par les agents contractuels pour le compte des GRETA régis par l’article L. 423-1 du code de l’éducation dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la loi du 17 mai 2011 seront assimilés à des services accomplis pour le compte des groupements d’établissements régis par le nouvel article L. 423-1.
Concrètement, cette disposition signifie que les personnels pourront garder le bénéfice de leurs services accomplis antérieurement à la « recréation » des GRETA. Selon le ministère de l’éducation nationale, environ 6 500 agents contractuels seront concernés par cette disposition.
● Par coordination, le III tend à supprimer l’article 120 de la loi du 17 mai 2011 qui dispose que le régime des personnels recrutés sous contrat avant que ces groupements se constituent sous forme de GIP peut être maintenu jusqu’au terme de leur contrat, dans la limite de quatre ans après la promulgation de la présente loi.
*
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AC 43 du rapporteur.
Puis, elle adopte l’article 44 modifié.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 254 de M. Guénhaël Huet portant article additionnel après l’article 44.
Section 5
Dispositions applicables aux établissements
d’enseignement privés sous contrat
Article 45
Application aux établissements privés sous contrat
Cet article vise à modifier l’article L. 442-20 du code de l’éducation, qui dresse la liste des articles du code applicables aux établissements d’enseignement privé sous contrat, afin de procéder aux substitutions ou suppressions de référence résultant des nouvelles dispositions proposées par le présent projet de loi.
*
La Commission examine l’amendement AC 443 de M. Mathieu Hanotin.
M. Mathieu Hanotin. Il s’agit de mettre en cohérence l’école privée et l’école publique en prévoyant que deux représentants de chaque collectivité compétente qui contribue aux dépenses de fonctionnement de l’école privée siègent dans son conseil d’administration. La collectivité – élus et administration – pourra ainsi contrôler la bonne utilisation de l’argent public.
M. le rapporteur. La présence de deux élus est-elle justifiée ?
M. Mathieu Hanotin. Il s’agirait d’un élu et d’un membre de l’administration.
M. le rapporteur. La France compte 5 000 écoles, 1 800 collèges, 1 000 lycées et 700 lycées professionnels privés sous contrat ; les communes parviendront-elles à désigner des élus pour les représenter dans tous les conseils d’administration ? L’intention est louable, mais l’enfer est pavé de bonnes intentions : si l’on vote cet amendement, l’obligation qu’il impliquera ne sera jamais respectée.
Mme Marie-George Buffet. M. Mathieu Hanotin avait pourtant expliqué que les élus étaient trop sollicités et qu’un membre de l’administration devait les remplacer lorsqu’ils ne pouvaient pas se rendre aux conseils des établissements publics. Passons sur l’équivalence établie ici entre un élu et un fonctionnaire ; mais si les élus peinent déjà à assurer leurs obligations dans les établissements publics, comment y arriveraient-ils dans les établissements privés ?
M. Mathieu Hanotin. Il y a eu malentendu. Aux termes de la loi actuelle, la collectivité est libre d’envoyer au conseil d’administration des établissements scolaires un élu ou un fonctionnaire, même si l’usage fait que seuls les élus ont été nommés jusque-là. Afin d’assurer une meilleure continuité du service public, l’amendement AC 689 – qui a été retiré – proposait que les conseils comprennent toujours deux représentants de la collectivité : un élu et un membre de l’administration, ce dernier pouvant remplacer l’élu qui ne peut pas siéger. De plus, un conseiller général pouvant approuver ou rejeter un projet éducatif territorial en raison de son appartenance à telle ou telle force politique, il est important de faire entendre la voix neutre de l’institution. Mes amendements cherchent à rendre le fonctionnement des établissements – tant publics que privés – cohérent avec l’esprit de l’article 42 du projet de loi qui prévoit que dans 80 % des établissements, il y aura dorénavant deux représentants de chaque collectivité, probablement un élu et un membre de l’administration.
M. Rudy Salles. L’intention est louable, mais la mesure serait inapplicable. Qui plus est, envoyer des fonctionnaires dans les conseils d’administration obligerait les collectivités à rémunérer des heures supplémentaires.
M. le président Patrick Bloche. Ce qui créerait une dépense.
M. Mathieu Hanotin. Si le rapporteur le souhaite, nous pouvons reconsidérer la question des conseils d’administration de manière globale, en débattant de tous les amendements concernés afin de parvenir à un dispositif cohérent.
M. le rapporteur. J’y suis tout à fait disposé.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’amendement de coordination AC 44 du rapporteur.
Puis, elle adopte l’article 45 modifié.
Chapitre V
Les activités périscolaires
Article 46
Mise en place du contrat éducatif territorial
Cet article a pour objet d’instituer le projet éducatif territorial, c’est-à-dire l’outil dont le cadre juridique permettra d’organiser les activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation, en lien avec la réforme des rythmes scolaires.
1. Un cadre contractuel pour assurer la continuité éducative indispensable à une réforme réussie des rythmes scolaires
● Une alternance à construire dans l’intérêt des enfants
La réforme des rythmes scolaires sera difficile à mettre en œuvre, car elle imposera de repenser l’alternance des différentes activités dans la journée.
Voici ce qu’écrivaient en 2010, sur le sujet, les rapporteurs de la mission d’information de notre Commission sur les rythmes de vie scolaire : « Une réduction de la durée de la journée scolaire ne suffirait pas à épuiser toutes les problématiques liées à organisation du temps scolaire quotidien de l’élève. Agir sur ce seul levier, c’est traiter la question sur le plan quantitatif, alors qu’elle devrait être également traitée sur le plan qualitatif. Or cette réflexion est beaucoup plus délicate à mener, car elle conduit à s’interroger sur la nature des activités qui pourraient être proposées, au cours d’une journée, aux élèves, ainsi que sur leur emplacement et leur articulation.
« De fait, le réaménagement de la journée imposerait de distinguer, au sein de celle-ci, plusieurs temps. À titre d’illustration, pour M. Paul Bron, adjoint au maire en charge de l’éducation de la ville de Grenoble, il faudrait prévoir une journée de cinq heures de classe maximum, organisée autour de trois heures de classe le matin et une heure et demie d’activités culturelles ou sportives et trente minutes de retour sur les apprentissages scolaires l’après-midi. Après la classe, la ville prendrait le relais par des activités périscolaires ».
Les rapporteurs ajoutaient que, dans ces conditions, une réduction de la durée quotidienne des classes ne pourrait être décidée « sans que soient réaménagés les différents temps – scolaire et périscolaire – de prise en charge de l’enfant », en citant, à l’appui de ce constat, les propos de plusieurs de leurs interlocuteurs, repris dans l’encadré ci-après (237).
La nouvelle journée scolaire selon quelques interlocuteurs
de la mission d’information de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation
sur les rythmes de vie scolaire (8 décembre 2010)
Selon l’analyse du Syndicat national des directeurs et directrices d’écoles catholiques, la journée de l’enfant pourrait être divisée en trois temps : un temps de « travail scolaire », un temps d’« aide personnalisée » pour les élèves en difficulté et d’« aide aux devoirs » pour les autres et, enfin, un temps d’« activités en lien avec le monde associatif ».
Aussi le nouveau découpage de la journée, quel qu’il soit, imposerait-il de repenser la part respective des activités scolaires et périscolaires, ainsi que l’espace scolaire. Pour reprendre les propos de M. Paul Bron, représentant de la Fédération des maires des grandes villes de France, s’il faut mettre en place un « temps de l’après école » structuré et utile, cela ne pourrait se faire qu’en rebâtissant non seulement les différentes périodes d’activités de la journée, mais aussi l’espace dans lequel elles sont organisées : dans l’idéal, une « maison de l’enfance » devrait être mise en place, adossée à l’école, dans laquelle interviendraient les acteurs de la ville et du tissu associatif.
Un objectif moins ambitieux, défendu par l’Union nationale des associations familiales, consisterait à faire de l’école une école « ouverte », organisant des temps d’échange avec les parents, ainsi que des temps ludiques et festifs, bref des temps d’activité non exclusivement pédagogiques, avec des « acteurs partenaires ». Installée au cœur de son territoire, cette école « ouverte » pourrait ainsi se rapprocher des familles, qui y viendraient non seulement quand elles sont convoquées – quand les choses vont mal –, mais invitées pour assister à des activités mettant en valeur les talents de leurs enfants. M. Patrice Bride, rédacteur en chef des Cahiers pédagogiques, a estimé que l’école ouverte pourrait ainsi « se donner les moyens de gérer les rythmes de l’enfant non plus à coup de sonneries mais sur du temps long ».
● L’impératif de la continuité éducative
Les obstacles à la mise en place d’une « école ouverte » organisant des activités non exclusivement pédagogiques avec des « acteurs partenaires » sont incontestablement nombreux. Pour une large part, ils résultent du « mille-feuilles » des dispositifs existants, un grand nombre de contrats étant aujourd’hui passés avec les collectivités pour organiser les activités péri et extrascolaires (projets éducatifs locaux, contrats éducatifs locaux, etc.).
Dans certains cas, on peut même observer une concurrence entre les deux politiques éducatives, celle de l’éducation nationale et celle des villes. Et ceci bien que le code de l’éducation ne reconnaisse aux collectivités territoriales que la faculté d’organiser, après approbation par le conseil d’école, des activités périscolaires « éducatives, sportives et culturelles », définies par leur caractère « facultatif » et « complémentaire » par opposition aux activités obligatoires mises en place par l’État. Le code précise ajoute, à cet égard, que les autorités locales « ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités de formation et d’enseignement fixées par l’État » (article L. 216-1).
La Cour des comptes a en outre noté, en 2008, que si le développement des actions éducatives engagées par les communes, durant le temps scolaire ou en complément de l’action de l’éducation nationale, fait souvent l’objet d’une coordination, les responsables académiques qu’elle a interrogés ont porté un jugement « nuancé sur ces partenariats, dans la mesure où la complémentarité de l’offre scolaire de l’éducation nationale et de l’offre scolaire communale ne leur paraissait pas toujours assurée » (238).
Forte de ces observations, la mission d’information de notre Commission sur les rythmes de vie scolaire a proposé de reconnaître dans la loi des « projets éducatifs locaux » afin de donner « une impulsion forte au rassemblement, autour d’une même politique éducative, de l’ensemble des partenaires éducatifs d’un même territoire, qui s’adresseraient aux mêmes publics et partageraient des objectifs convergents » (239).
Le rapporteur ne peut donc que se réjouir de l’institution par le présent article du projet de loi d’un contrat éducatif territorial qui permettra de mettre en place une offre enfin lisible et cohérente, laquelle devra former un « continuum éducatif ».
D’ailleurs, les incompréhensions ou les inquiétudes exprimées à l’occasion de la réforme des rythmes scolaires rendent encore plus nécessaire, dans une société en voie de fragmentation, la recréation, autour des établissements, de collectifs locaux conjuguant l’individuel et le partenariat. Autrement dit, le projet éducatif territorial « a du sens » pour reprendre l’expression de Mme Monique Sassier, médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.
Au total, ce cadre de collaboration locale présentera de nombreux avantages, rappelés par la circulaire du 6 février 2013 relative à l’organisation du temps scolaire dans le premier degré : « il constitue pour la commune un outil essentiel pour la mise en œuvre du volet éducatif de la réforme des rythmes scolaires ; il contribue à la lutte contre les inégalités scolaires en mettant en place des actions répondant à des besoins identifiés au niveau de chaque territoire ; il favorise la création de synergies entre les acteurs tout en respectant le domaine de compétences de chacun d’entre eux » (240).
2. Le dispositif proposé par le projet de loi
Le présent article propose de modifier le premier alinéa de l’article L. 551-1 du code de l’éducation relatif à l’organisation des activités périscolaires afin de prévoir que celle-ci pourra être formalisée dans le cadre d’un projet éducatif territorial.
● Des activités complémentaires au service public de l’éducation
En conformité avec le principe selon lequel ces activités prolongent le service public de l’éducation, le présent article, dans sa rédaction initiale, prévoit de préciser qu’elles devront être organisées « en complémentarité » avec celui-ci.
L’élaboration du projet éducatif territorial devra ainsi garantir une réelle continuité éducative entre les projets des écoles et des établissements, d’une part, et les activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire, d’autre part.
Dans le premier degré, cette exigence est prise en compte par le décret du 24 janvier 2013 relatif à l’aménagement du temps scolaire dans les écoles. Le directeur académique des services de l’éducation nationale doit s’assurer que la proposition d’organisation de la semaine scolaire qui lui est soumise est cohérente avec le projet éducatif territorial. Il peut donner son accord à une dérogation aux règles nationales fixant la répartition et la durée maximale des demi-journées lorsqu’elle est justifiée par les particularités du projet éducatif territorial.
Il reste que la notion d’activités périscolaires peut être sujette à confusion, ainsi que l’ont montré les auditions du rapporteur. En effet, elle pourrait être la source de dérives, au bout desquelles des familles se verraient demander le paiement de « prestations » ou d’un « service ». Or, ces activités, qui devront prolonger le service public de l’éducation et lui être complémentaires, devraient être, par définition, gratuites. En effet, le projet éducatif territorial, ce devrait être l’école « autrement ». Et celle-ci, doit-on le rappeler, est obligatoire et gratuite – gratuite car obligatoire.
Ce principe de bon sens sera sans doute largement mis en œuvre sur le territoire. Mais il ne pourra être formalisé sur le plan législatif ou réglementaire, car il se heurterait au principe de libre-administration des collectivités territoriales posé par l’article 72 de la Constitution.
● Un cadre de collaboration locale
Le présent article précise que le projet éducatif territorial associera notamment aux « services et établissements » relevant du ministre chargé de l’éducation nationale d’autres administrations, ainsi que des collectivités territoriales, des associations et des fondations.
Les dispositions actuelles de l’article L. 551-1 du code de l’éducation se contentent d’indiquer, en ce qui concerne la participation de l’État à ces activités, qu’elles peuvent être organisées « des administrations ».
Ainsi, par rapport au droit en vigueur, la rédaction proposée permettra de mentionner les établissements scolaires – les « cadres de référence » locaux de l’aménagement des temps de l’enfant –, ainsi que les services du ministère de l’éducation nationale qui sont les garants, locaux eux aussi, de la pertinence pédagogique des mesures. En effet, ici, les « services » ne désigneront pas ceux des directions du ministère (administration centrale), mais les services déconcentrés de l’éducation nationale, à savoir les rectorats et les directions des services départementaux.
En outre, cette formulation permettra de mettre l’accent sur le caractère « fédérateur » d’un projet « associant » les différents acteurs.
Ainsi, le projet éducatif territorial sera impulsé par la collectivité territoriale d’implantation et élaboré conjointement avec les administrations étatiques concernées (ministères de l’éducation nationale, des sports et de la jeunesse, de la culture, de la famille, de la ville, etc.), les associations, notamment celles d’éducation populaire, ainsi que les institutions culturelles et sportives, etc.
Le nouveau dispositif pourra donc s’appuyer sur les expérimentations et les partenariats liés aux différentes politiques de la ville et de la jeunesse et des sports développés à partir de 1998 et qui ont pu concerner jusqu’à 11 000 communes et 2,6 millions d’enfants.
En outre, les associations complémentaires agréées, notamment celles soutenues financièrement par le ministère, et qui sont à la tête de réseaux territoriaux, pourront contribuer à la mise en place d’activités périscolaires car elles ont développé, en complémentarité des enseignements, « une expertise et un savoir-faire dans le domaine de l'éducation à la citoyenneté, du vivre ensemble et de l’accompagnement à la scolarité » (241).
Par ailleurs, le projet éducatif territorial se présentera sous la forme d’un engagement contractuel pour les partenaires. Cette formule permettra ainsi de définir un périmètre d’action correspondant à une problématique éducative territoriale clairement identifiée. Elle aidera également les acteurs concernés à déterminer, ensemble, ce qui relève du domaine « de l’éducation partagée ».
Selon un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional, M. Yves Goepfert, cet objectif est très ambitieux, puisqu’il ne correspond « ni à l’extension du champ d’action (et/ou de compétence) de tel ou tel (école, municipalité, associations…), ni à la simple addition des interventions (et/ou compétences) de chacun. On est dans la logique systémique du 1+1=3 qui doit permettre de faire émerger de nouvelles marges de manœuvre (y compris dans la mobilisation des moyens humains et financiers), de nouvelles potentialités et de nouvelles réponses » (242).
Le cadrage du projet éducatif territorial selon le projet de circulaire interministérielle
Pendant la phase d’élaboration du projet éducatif territorial, les collectivités qui souhaiteront être accompagnées pourront bénéficier de l’aide d’un groupe d’appui départemental, mis en place par le préfet de département et la direction des services départementaux de l’éducation nationale, avec le concours éventuel d’autres services de l’État, des caisses d’allocations familiales et caisses de la mutualité sociale agricole) et du conseil général.
Ce groupe pourra associer les services compétents des collectivités et les associations dont l’expertise est reconnue dans la mise en œuvre de projets éducatifs. Cet accompagnement pourra se poursuivre pendant toute la phase d’élaboration, jusqu’à la signature du projet afin de faciliter la mise en place d’activités périscolaires ou d’adapter l’existant au futur projet éducatif territorial.
Dans un second temps, la collectivité qui aura l’initiative du projet éducatif territorial approfondira la concertation avec la direction des services départementaux de l’éducation nationale et la direction départementale de la cohésion sociale, ainsi qu’avec les autres partenaires éventuels du projet, afin de l’enrichir en tenant compte des éléments d’un cahier des charges, lequel devra notamment indiquer : l’état des lieux (activités périscolaires et extrascolaires existantes, besoins non satisfaits, atouts et contraintes) ; les publics cibles (nombre d’enfants, classes d’âge) et les modalités de leur participation ; les objectifs éducatifs et les effets attendus ; les activités proposées (en cohérence et en complémentarité entre elles et avec les projets d’école) ; les tarifs des prestations éventuellement facturées aux familles ; l’articulation avec les éventuels dispositifs existants ; les acteurs (services et associations) engagés.
Le projet sera ensuite transmis à la direction des services départementaux de l’éducation nationale et à la direction départementale de la cohésion sociale qui en organiseront conjointement l’examen.
Après examen, le projet éducatif territorial prendra la forme d’un engagement contractuel signé entre la collectivité porteuse, le préfet, le DASEN, par délégation du recteur, et les autres partenaires, auquel le conseil général pourra s’associer, notamment pour adapter les transports scolaires.
La signature par le préfet du projet éducatif territorial permettra de bénéficier des dérogations aux conditions d’encadrement, soit un animateur pour 14 mineurs au plus (au lieu de 10 prévus par l’actuelle réglementation) pour les enfants de moins de six ans et un animateur pour 18 mineurs au plus (au lieu de 14 prévus par l’actuelle réglementation) pour les enfants de six ans et plus.
Enfin, la durée maximale de cet engagement sera de trois ans.
Le rapporteur tient néanmoins à souligner qu’un danger guette les projets éducatifs territoriaux : celui de n’être que des documents-cadres, très généraux, ne précisant que la répartition des horaires entre les types d’activités et s’adressant à des élèves « génériques ». Les textes d’application du dispositif et les bonnes volontés locales devront donc faire en sorte que ce cadre permette d’appréhender les besoins de l’élève. Car qui trop embrasse mal étreint…
Par ailleurs, l’élaboration et la mise en œuvre de ce projet devraient être suivies par un « comité de pilotage » associant des représentants de l’équipe pédagogique, des parents, de la commune, des caisses d’allocations familiales et des autorités académiques. De cette manière, l’école et ses partenaires pourraient pleinement s’approprier le nouvel outil.
● Un égal accès à des activités non concurrentielles de l’école
Ces activités devront respecter la règle, d’ores et déjà posée par l’article L. 551-1 du code de l’éducation, selon laquelle celles-ci ne peuvent se substituer aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’État.
Les modifications proposées par le présent article consistent toutefois à préciser que le projet éducatif territorial – et non plus les activités périscolaires – devra viser « l’égal accès » des élèves, pendant leur temps libre, aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.
En prévoyant d’ajouter une référence aux « activités » et non plus seulement aux pratiques, le présent article permettra d’appliquer le principe de l’universalité d’accès à l’ensemble du champ périscolaire. Par exemple, dans le domaine culturel, le terme d’« activités » recouvre tout ce que les enseignants, les institutions culturelles, les associations, etc., peuvent organiser pour les élèves : visiter des musées, assister à une pièce de théâtre, rencontrer un artiste. Le terme de « pratiques » recouvre, quant à lui, les situations qui permettent à l’élève d’approcher de façon personnelle le processus de création en se confrontant lui-même à l’exercice (grâce à la pratique d’un instrument de musique ou de la photographie par exemple).
Pour marquer la nature spécifique des activités proposées aux élèves dans ce cadre, la Commission a adopté un amendement se référant aux « activités éducatives complémentaires » en lieu et place des « activités périscolaires » pouvant faire l’objet du projet éducatif territorial.
*
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 68 de M. Jean-Pierre Blazy.
La Commission est saisie de l’amendement AC 316 de Mme Sandrine Mazetier.
M. Michel Pouzol. Le projet de loi donnant davantage d’importance aux « activités périscolaires », nous proposons de les désigner par le terme plus large d’« activités éducatives complémentaires », qui correspond mieux au poids qu’elles prendront dans la journée des élèves.
M. le rapporteur. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
La Commission étudie l’amendement AC 329 de Mme Sandrine Mazetier.
M. Michel Pouzol. Il s’agirait de substituer aux mots « associant notamment aux services » les mots : « associant notamment les services ».
M. le rapporteur. Cette correction donnerait à la phrase un tout autre sens. Défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
La Commission examine l’amendement AC 429 de Mme Julie Sommaruga.
Mme Julie Sommaruga. Il s’agit de mentionner les « acteurs du milieu associatif ».
M. le rapporteur. Tel que modifié par le projet de loi, l’article L. 551-1 du code de l’éducation dispose déjà que les activités prolongeant le service public de l’éducation […] peuvent être organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial associant notamment […] des associations.
M. le président Patrick Bloche. Les acteurs du milieu associatif étant par définition les animateurs des associations, seriez-vous d’accord pour retirer cet amendement ?
Mme Julie Sommaruga. Il s’agissait de le préciser dans l’article.
M. le président Patrick Bloche. Vous pourrez représenter cet amendement en remplaçant « associations » par « acteurs du milieu associatif ».
L’amendement est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 432 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements AC 318 de Mme Sandrine Mazetier et AC 516 de Mme Barbara Pompili.
M. Michel Pouzol. L’amendement AC 318 est défendu.
Mme Barbara Pompili. Ces deux amendements, quasi identiques, tendent à préciser le rôle des projets éducatifs territoriaux.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
La Commission rejette successivement les amendements.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements AC 690 de Mme Sandrine Mazetier et AC 431 de Mme Valérie Corre.
M. Michel Pouzol. L’amendement AC 690 est défendu.
Mme Valérie Corre. L’amendement AC 431 vise à mieux définir les modalités d’organisation et de pilotage du projet éducatif territorial, en précisant qui sont les participants et les décideurs, et en mettant en place un comité de pilotage.
M. le rapporteur. J’émets un avis défavorable à l’amendement AC 690. Quant à l’amendement AC 431, je suggère que vous le retiriez et que vous le redéposiez en vue de la séance publique.
Mme Valérie Corre. J’en suis d’accord.
Les amendements sont retirés.
La Commission est saisie de l’amendement AC 182 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. Cet amendement, que je présente au nom du groupe d’études sur l’intégration des personnes handicapées, tend à intégrer les acteurs du secteur du handicap aux projets éducatifs territoriaux.
M. le rapporteur. Avis défavorable : cela est déjà prévu par la circulaire relative à l’organisation du temps scolaire, qui met en place le projet éducatif territorial.
Mme Barbara Pompili. Pourrez-vous nous la transmettre quand elle aura été publiée ?
M. le président Patrick Bloche. Elle l’est déjà : vous pouvez en prendre connaissance dans le Bulletin Officiel.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’article 46 modifié.
Article 47
Fonds d’aide aux communes pour la mise en place de la réforme des rythmes scolaires
Cet article vise à instituer un fonds spécifique d’aide aux communes pour la mise en place de la réforme des rythmes scolaires dans le primaire.
1. Un fonds spécifique pour lancer la réforme des rythmes scolaires
● Un effort demandé aux collectivités territoriales qui doit être mis en perspective
La réforme des rythmes a parfois suscité des réactions passionnées, qui, il est vrai, sont l’apanage de la société française. Mais elle n’a pas pour autant suscité un « front du rejet », en particulier parmi les communes. En effet, au-delà des communiqués de presse, elles sont dans un esprit qui consiste à « jouer le jeu ». Il y a lieu de noter, à cet égard, que saisie par le ministère de l’éducation nationale, la commission consultative d’évaluation des normes (CCEN), instituée au sein du comité des finances locales pour examiner les projets de loi « concernant les collectivités territoriales » (article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales), a rendu, le 18 janvier 2013, un avis favorable sur le présent projet de loi (8 voix pour et 2 contre).
Au vu de leur situation spécifique, il n’en reste pas moins que les communes devront être fortement épaulées par l’État pour la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. Cet appui devra comporter plusieurs dimensions :
– une dimension pédagogique, qui implique un travail d’explication et de « compagnonnage » de la part du ministère de l’éducation nationale. À cet égard, le Guide pratique pour les élus publié le 4 février 2013 devrait être en mesure d’apaiser certaines craintes, notamment en rappelant que, comme aujourd’hui, l’organisation de la cantine le mercredi relèvera de la compétence des communes, la restauration scolaire ou l’organisation d’activités périscolaires ne faisant pas partie en effet des obligations que la loi confère à ces collectivités ;
– une dimension administrative, car la nouvelle organisation de la semaine scolaire ne saurait se transformer en carcan. C’est le sens de la circulaire du 6 février 2013 du ministère de l’éducation nationale qui permet à une commune ou à un EPCI, dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire, de demander un réaménagement du temps scolaire avant la fin de la période de trois ans qui définit la « durée de vie » normale de l’organisation arrêtée par le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) ;
– une dimension financière, enfin, qui doit être correctement appréhendée puisque le temps éducatif confié aux communes est, en termes de durée, identique à la demi-journée qu’elles assuraient le mercredi. En effet, il convient de rappeler que les communes n’auront plus la charge du mercredi matin, celle-ci étant couverte par le budget de l’éducation nationale. En outre, ces collectivités territoriales ne verront pas nécessairement leur charge s’alourdir en assumant celle des quatre séquences de 45 minutes dont elles auront la responsabilité. Cependant, il est vrai que le nouveau dispositif entraînera un certain morcellement des activités, qui imposera des contraintes, tandis que les activités périscolaires concerneront probablement davantage d’enfants. Dès lors, il est normal que l’État accorde une aide.
● Les principes guidant le fonctionnement du fonds d’aide
Le 20 novembre 2012, dans son intervention devant le congrès des maires de France, le Président de la République constatait que, pour certaines communes, cette réforme constituera une « charge supplémentaire ». Aussi indiquait-il avoir demandé au gouvernement de mettre en place, dès la prochaine rentrée scolaire, un fonds spécifique de 250 millions d’euros pour accompagner « les collectivités qui, les premières, lorsqu’elles sont dans une situation qui le justifie, mettront en œuvre cette réforme ».
Puis, dans un courrier daté du 18 décembre 2012 et adressé aux présidents d’associations d’élus locaux, le Premier ministre, M. Jean-Marc Ayrault, reconnaissait que les nouvelles modalités d’organisation du temps scolaire « préoccupent les communes quant à leurs capacités à faire face à leur responsabilité en termes de ressources humaines et financières ». C’est pourquoi il confirmait qu’en application des orientations définies par le Président de la République, un fonds spécifique d’aide aux communes pour la mise en place de la réforme des rythmes scolaires sera effectivement créé pour la rentrée scolaire 2013, son cadre juridique devant être fixé par le présent projet de loi.
Le fonds reposera sur deux types d’aide :
– Une aide forfaitaire de 50 euros par élève pour les communes qui entreront dès 2013 dans la réforme
Toutes les communes se verront allouer une dotation de 50 euros par élève dès lors qu’elles auront décidé de mettre en œuvre les nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2013.
À l’inverse, afin d’inciter le plus grand nombre de communes à entrer rapidement dans la réforme, les collectivités qui ne mettront en œuvre la semaine de quatre jours et demi qu’à la rentrée 2014 devront demander une dérogation et ne pourront pas bénéficier de l’aide forfaitaire.
– Une majoration de 40 euros pour les communes les plus en difficulté qui pourra être prolongée
Les communes urbaines ou rurales les plus en difficulté bénéficieront de 40 euros supplémentaires par élève. Au total, c’est donc une aide de 90 euros par élève qui sera versée à ces communes – c’est-à-dire aux communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) « cible » ou à la dotation de solidarité rurale (DSR) « cible » – pour l’année scolaire 2013-2014.
En outre, la partie majorée de l’aide sera prolongée pour l’année scolaire 2014-2015 et s’élèvera à 45 euros par élève, en demeurant réservée aux communes éligibles à la « DSU cible » ou à la « DSR cible ». Par conséquent, les communes qui ont le moins de ressources et qui auront dû, notamment pour cette raison, procéder au report de la réforme à la rentrée 2014, pourront toujours bénéficier de cette aide complémentaire.
2. Le dispositif proposé par le projet de loi
Le présent article propose de fixer le cadre juridique de ce fonds qui sera doté d’« au moins 250 millions d’euros », comme le rappelle l’étude d’impact jointe au présent projet de loi. Il permettra d’inciter et d’aider les communes à mettre en œuvre, dès 2013, la semaine scolaire organisée en neuf demi-journées.
Il aura également pour objectif de garantir la prise en charge de tous les enfants jusqu’à 16 h 30 au moins. En effet, ainsi que le précise l’étude d’impact, la part forfaitaire du fonds « permettra de faciliter le redéploiement et l’enrichissement des activités périscolaires déjà existantes (et, notamment, de celles organisées actuellement le mercredi matin) » et favorisera « le développement de nouvelles activités pour les enfants et synergies entre les offres des différentes communes ».
● Un fonds spécifique à la durée de vie limitée
Institué en faveur des communes et des EPCI, lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles leur ont été transférées, ce fonds sera chargé, aux termes du premier alinéa du présent article, « de contribuer au développement d’une offre d’activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat, dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ».
L’étude d’impact du présent projet de loi précise que les élèves du public et du privé sous contrat seront comptabilisés dans le calcul des dotations et qu’en conséquence, les écoles privées sous contrat seront éligibles au fonds.
La durée de vie de ce dispositif sera limitée aux années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 : comme cela a déjà été souligné, celui-ci est conçu comme un outil puissant d’incitation à la mise en œuvre, dès la prochaine rentrée, du nouvel aménagement de la journée et de la semaine.
● Des aides comportant deux parts
Les aides apportées par le fonds seront calculées en fonction du nombre d’élèves éligibles scolarisés dans la commune ou les communes membres de l’EPCI.
Ici, le terme « éligibles » doit être compris comme désignant les élèves dont l’école sera passée à 9 demi-journées, c’est-à-dire les élèves qui seront pris en compte pour le calcul de l’attribution des aides. L’absence de cette précision pourrait laisser entendre que l’ensemble des élèves scolarisés dans la commune seront pris en compte dans ce calcul, ce qui ne sera pas le cas puisqu’au sein d’une même commune, certaines écoles pourront passer à 9 demi-journées et non les autres.
Les aides concernées comporteront deux parts :
– un montant forfaitaire par élève versé aux communes et aux EPCI dont les écoles organisent les enseignements sur neuf demi-journées à la rentrée scolaire 2013. Afin de faire jouer plein l’effet « levier » du fonds, le versement de ce montant ne pourra être renouvelé au titre de l’année 2014-2015 ;
– une majoration forfaitaire par élève réservée à trois types de communes.
Cette majoration sera accordée :
● aux communes mentionnées au 1° de l’article L. 2334-18-4 du code général des collectivités territoriales. Il s’agit des 250 premières communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges qui bénéficient, en plus de leur attribution de droit commun, d’une « DSU cible » ;
● aux communes mentionnées à l’article L. 2334-22-1 du même code. Il s’agit des dix mille premières communes de moins de 10 000 habitants, parmi celles éligibles au moins à l’une des deux premières fractions de la DSR, qui se voient attribuer la troisième fraction de cette dotation ou DSR « cible ». On rappellera que la DSR se divise désormais en trois fractions : aux deux fractions « bourg-centre » et « péréquation » existantes, s’ajoute la DSR « cible » destinée à concentrer les accroissements de DSR sur les communes de métropole de moins de 10 000 habitants les plus défavorisées ;
● aux communes des départements d’outre-mer bénéficiant de la quote-part de la dotation d’aménagement prévue au quatrième alinéa de l’article L. 2334-13 du même code. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant de la dotation d’aménagement le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement de population, entre la population des communes d’outre-mer (départements d’outre-mer, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et collectivité départementale de Mayotte) et celle de l’ensemble des communes de métropole et d’outre-mer.
Pour obtenir le nombre des communes potentiellement concernées par la majoration, il convient donc de croiser la liste des communes bénéficiaires des différentes dotations avec celle des communes disposant d’au moins une école publique ou privée sous contrat. On arrive ainsi aux données suivantes, qui ont été établies par le ministère de l’éducation nationale à partir des communes bénéficiaires de ces dotations au titre de l’année civile 2012 :
– 250 communes de plus de 10 000 habitants bénéficient de la DSU « cible » et sont toutes dotées au moins d’une école publique ou privée sous contrat. 30 communes de 5 000 à 10 000 habitants sont également dans ce cas de figure ;
– parmi les 10 000 communes bénéficiant de la DSR « cible », 6 659 sont dotées au moins d’une école publique ou privée sous contrat ;
– les 129 communes des départements d’outre-mer sont bénéficiaires de la dotation d’aménagement.
Le présent article prévoit de reconduire le versement de cette majoration au titre de l’année 2014-2015 pour les communes dont les écoles organiseront les enseignements sur neuf demi-journées dès la rentrée scolaire 2013. Quant aux communes dont les écoles appliqueront la réforme à compter de la rentrée 2014, elles ne bénéficieront de la majoration qu’au titre de l’année scolaire 2014-2015.
● Le fonctionnement et le financement du fonds
La gestion du fond sera confiée, pour le compte de l’État, à l’Agence de services et de paiement (ASP), un établissement public administratif créé par l’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 et qui assure la gestion administrative et financière d’aides publiques dans des secteurs très variés – de l’agriculture à la solidarité et à l’intégration.
Le cadre d’application du présent article sera fixé par un décret en Conseil d’État, qui précisera notamment les modalités d’attribution du fonds. Quant aux modalités de financement et de versement, elles seront prévues dans une prochaine loi de finances.
*
La Commission est saisie de l’amendement AC 275 de M. Benoist Apparu, tendant à supprimer l’article.
M. Benoist Apparu. La réforme des rythmes scolaires n’est pas prête ; elle est contestée par les parents, par les enseignants et par les collectivités locales. Il serait judicieux de l’ajourner, d’autant plus qu’avec les nouvelles annonces du ministre, on frise le ridicule : après la réforme de la journée scolaire et celle de la semaine scolaire, on nous annonce pour 2015 la réforme de l’année scolaire, avec deux semaines de cours en plus. Cela représentant 54 heures supplémentaires de travail pour chaque enseignant, il nous en coûtera 750 millions d’euros. De deux choses l’une : soit Bercy débloquera cette somme – ce dont je doute –, soit on diminuera la durée de la journée scolaire, autrement dit on défera la réforme que l’on est en train de faire. Il eût mieux valu préparer une réforme globale ! C’est pourquoi il me semble impératif d’ajourner la réforme et d’attendre qu’elle soit complète et financée pour l’engager.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
M. Benoist Apparu. Mais encore ? Il est normal de vouloir accélérer les débats, monsieur le rapporteur, mais la réforme des rythmes scolaires n’est pas un sujet insignifiant ! Le ministre nous a dit lors de la séance de questions cribles qu’il s’agissait, avec la priorité au primaire et la création des écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE), d’une des trois fondations de ce texte. J’eusse aimé que vous nous indiquiez pourquoi vous êtes défavorable à cet amendement et que vous répondiez à la question posée : comment fera-t-on pour financer la réforme de l’année scolaire ?
M. le président Patrick Bloche. M. le ministre de l’éducation nationale a déjà été interrogé à plusieurs reprises, en séance plénière lors des questions au gouvernement, et encore lors de la séance de questions cribles. Par ailleurs, la réforme des rythmes éducatifs est d’ordre réglementaire. Le fait qu’elle ne fasse pas l’objet d’une longue discussion dans le cadre de l’examen d’un projet de loi qui ne comprend pas de dispositions spécifiques sur le sujet ne me semble pas choquant !
M. Benoist Apparu. Le projet de loi crée un fonds d’aide aux communes pour permettre sa mise en place !
M. le président Patrick Bloche. Le texte de loi tire les conséquences de la réforme, mais, sur le fond, celle-ci relève d’un décret qui a déjà été publié.
M. le rapporteur. Si j’ai été si rapide dans ma réponse, c’est que l’amendement portant sur la suppression de l’article 47, qui crée un fonds d’aide aux communes, je pensais que mon avis se comprenait aisément. Mais nous allons écrire à tous les maires de France que M. Benoist Apparu veut supprimer ce fonds !
M. Émeric Bréhier. Monsieur Apparu, à travers cet amendement, vous vous interrogez sur la pertinence du rythme de la réforme des rythmes scolaires. C’est votre droit, mais si nous adoptions votre amendement, la seule conséquence sur la rentrée 2013 serait la suppression du fonds d’aide aux communes, et non la remise en cause de la réforme des rythmes scolaire telle qu’elle est prévue par le décret du 24 janvier dernier !
Comme vous vous plaisez à le répéter, nous sommes ici pour faire la loi sérieusement ; le rapporteur doit donc donner son avis sur votre amendement, qui tend à la suppression du fonds, et non sur ce que sous-entend votre proposition. Bien entendu, nous n’allons pas écrire à l’ensemble des maires que vous souhaitez la suppression de ce fonds – ce n’est à l’évidence pas le cas –, mais admettez que l’on puisse trouver quelque peu paradoxal l’objet de votre amendement !
M. Benoist Apparu. Certes, nous discutons actuellement du fonds d’aide aux communes, mais, il y a quelques heures encore, nous discutions du rapport annexé, dans lequel la réforme des rythmes scolaires est présentée très clairement. Cette réforme fait donc bien partie de ce texte, et il est légitime que, pour marquer notre désapprobation, nous proposions de supprimer l’article 47.
M. Xavier Breton. D’ailleurs, l’exposé sommaire le précise : il s’agit de supprimer le fonds d’aide, non pas en laissant la réforme en l’état, mais en l’ajournant. La réforme des rythmes scolaires n’est pas prête : les nombreuses réactions parmi les collectivités locales, les enseignants et les parents d’élèves le montrent bien !
M. le président Patrick Bloche. Je ne crois pas qu’il y ait d’ambiguïté : les membres de l’UMP veulent marquer leur opposition à la réforme des rythmes éducatifs en déposant un amendement de suppression de l’article 47, qui est le seul article du projet de loi relatif à cette réforme.
M. Michel Françaix. Il n’est pas en effet illogique que vous vouliez supprimer ce que nous sommes en train de faire, de même qu’il n’est pas illogique que le rapporteur vous réponde qu’il ne partage pas votre position, sans qu’il ait besoin de développer.
M. Benoist Apparu. Je le répète : le ministre a présenté cette réforme comme l’un des trois piliers de la refondation de l’école dont nous discutons actuellement. Il me semblerait donc normal que le rapporteur apporte une réponse à la question de savoir si l’on dépensera, en 2015, 750 millions d’euros ou s’il faudra défaire la réforme qui est en cours. S’il ne veut pas la donner, dont acte, mais je le regretterais.
M. le président Patrick Bloche. Ne nous échauffons pas, chers collègues : je vous rappelle que M. Yves Durand est le rapporteur de notre commission pour l’examen d’un projet de loi, et non le porte-parole du ministre !
M. Benoist Apparu. C’est bien dommage !
M. le président Patrick Bloche. Peut-être, mais c’est ainsi. Et le ministre a souhaité ne pas assister aux travaux de notre Commission afin de nous laisser délibérer en toute indépendance. De ce fait, nous le retrouverons à partir du lundi 11 mars à 16 heures. Il pourra alors répondre directement à MM. Benoist Apparu et Xavier Breton, ainsi qu’à tous ceux qui interviendront sur l’article 47 pour aborder la question de la réforme des rythmes éducatifs. Que le rapporteur ait émis un avis défavorable à cet amendement ne traduit que la cohérence de son travail.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AC 462 de Mme Sandrine Mazetier.
M. Michel Pouzol. Il s’agit de faire référence au projet éducatif territorial.
M. le rapporteur. Avis défavorable : le projet éducatif territorial n’étant pas obligatoire, il ne faut pas lier le bénéfice du fonds à son existence.
L’amendement est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 691 de Mme Sandrine Mazetier.
Elle examine ensuite l’amendement AC 692 de Mme Sandrine Mazetier.
M. Michel Pouzol. Il s’agit de remplacer l’obligation faite d’une répartition très rigide de la semaine scolaire sur neuf demi-journées par celle d’une organisation sur au moins quatre jours et demi, ce qui permettra une souplesse plus grande et ne mettra pas dans l’illégalité des projets engagés depuis plus de dix ans.
M. le rapporteur. L’initiative est louable, mais il serait pénalisant pour les communes de la lier au fonds d’aide.
L’amendement est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 237 de M. Thierry Braillard.
Les amendements AC 693 et AC 694 de Mme Sandrine Mazetier sont retirés.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AC 45 du rapporteur.
L’amendement AC 518 de Mme Barbara Pompili est retiré.
La Commission adopte l’article 47 modifié.
La Commission est saisie de deux amendements portant articles additionnels après l’article 47.
Elle examine d’abord l’amendement AC 133 de Mme Claudine Schmid.
Mme Claudine Schmid. Au-delà de l’obligation prévue à l’article L. 612-1 du code de l’éducation sur la communication des statistiques comportant notamment des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes, il convient de s’assurer que les étudiants peuvent disposer des éléments en amont de leur orientation dans une formation supérieure.
M. le rapporteur. L’amendement est satisfait par l’article du code de l’éducation que vous venez de citer, puisque celui-ci prévoit que « les établissements rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes » : les étudiants peuvent donc en prendre connaissance.
Mme Claudine Schmid. Certes, mais il serait bon qu’on les leur transmette pour qu’ils fassent leur choix.
M. le rapporteur. Cela relève d’une circulaire, non de la loi. Si vous ne retirez pas votre amendement, je serai contraint de lui donner un avis défavorable.
Mme Claudine Schmid. Je veux bien le retirer, mais il faudrait faire quelque chose !
M. le président Patrick Bloche. Je vous suggère d’écrire à M. Vincent Peillon pour le lui demander.
L’amendement est retiré.
La Commission examine ensuite l’amendement AC 197 de M. Frédéric Reiss.
M. Xavier Breton. La réforme des rythmes scolaires pose de nombreux problèmes. C’est pourquoi nous demandons au gouvernement de remettre au Parlement, avant le 1er février 2014, un rapport faisant le bilan de cette réforme en termes d’augmentation des budgets de fonctionnement des communes. Cela permettra d’ajuster le montant du fonds créé à l’article 47 aux besoins réels des communes.
M. le rapporteur. Avis défavorable : il s’agira d’une des tâches du comité de suivi que je vous propose de créer.
La Commission rejette l’amendement.
Chapitre VI
Les écoles supérieures du professorat et de l’éducation
Le présent article a pour objet de préciser que les livres du code de l’éducation relatifs à l’organisation des enseignements supérieurs (VI), aux établissements d’enseignement supérieur (VII) et aux personnels (IX) seront modifiés conformément aux dispositions du chapitre VI de la loi consacrées aux écoles supérieures du professorat et de l’éducation.
*
La Commission adopte l’article 48 sans modification.
Article 49
Formation des personnels enseignants et d’éducation par les ESPE
Cet article vise à créer les écoles supérieures de l’éducation et du professorat (ESPE) qui seront chargées d’organiser la formation initiale et de participer à la formation continue des personnels enseignants et d’éducation. Avec l’article 51, relatif à l’organisation de ces écoles, il constitue, sans aucun doute, le « cœur du réacteur » d’une refondation dont l’entrée se veut pédagogique.
1. Pourquoi créer des écoles supérieures du professorat et de l’éducation ?
Ainsi que le souligne le rapport annexé au présent projet de loi, le premier enjeu de la refondation est essentiellement « qualitatif », la qualité d’un système éducatif tenant à celle de ses enseignants. Celle-ci doit reposer sur deux aspects, qui revêtent une égale importance : les compétences académiques, d’une part, et professionnelles, d’autre part.
Or, de ce point de vue, notre système de formation et de recrutement des enseignants est totalement inadapté. En effet, celui-ci est comme « obnubilé » par les concours et se désintéresse, dans une large mesure, de la préparation au métier d’enseignant.
Les ESPE et les nouveaux concours ont donc pour ambition de remédier à ce biais majeur de notre système éducatif, qui est ancien mais qui a été aggravé par la réforme dite de la mastérisation. Leur création constitue, de ce fait, une espérance, qui ne peut prendre le risque d’être déçue.
a) Ce que les ESPE ne seront pas : des IUFM « repeints »
● La formation des maîtres : un marqueur des dysfonctionnements de notre système éducatif
Historiquement, notre système éducatif a été marqué par la coupure, datant de la III° République, entre « l’école de masse » des instituteurs et les formations – élitistes – du lycée et de l’université, dispensées par les « professeurs ». Cette « bipartition » s’est trouvée très naturellement reproduite dans le système de formation des enseignants, avec la cohabitation de deux filières : celle des écoles normales et celle de l’université.
Cette ligne de fracture explique pourquoi les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM), dès leur naissance en 1991, ont « échoué à rapprocher en profondeur les logiques du premier et du second degré » (243). Pourtant, les IUFM avaient pour ambition d’unifier l’ensemble de la formation des enseignants du primaire et du secondaire « général » et « technique ». Dans les faits, cependant, ils accueillaient la très grande partie des futurs professeurs des écoles, admis à préparer pendant une année le concours en institut, tandis que les futurs professeurs de lycée et de collège préparaient les concours du CAPES et de l’agrégation dans les universités.
Cette bipartition et le prestige attaché aux deux principaux concours de l’enseignement du second degré ont probablement eu un effet d’ordre encore plus général : celui de conforter un système de formation qui, en plaçant au sommet de la hiérarchie de l’enseignement, le lycée et les savoirs universitaires d’excellence, perpétue le moule « hyper-disciplinaire » des programmes et des épreuves. C’est d’ailleurs ce qui explique la « résistance » au socle commun de l’enseignement du collège.
C’est aussi la raison pour laquelle la préparation au métier d’enseignant a toujours été, plus ou moins, perdue de vue par l’université, et ce même après que le Haut conseil de l’éducation (HCE) eut recommandé que le professeur soit un « professionnel de l’enseignement de sa ou de ses disciplines à des groupes élèves » (244).
L’Académie des sciences a elle-même reconnu cet échec en des termes dépourvus de toute ambiguïté : « consciente de l’insuffisant intérêt apporté par les universités dans les années récentes à cette mission cruciale pour la nation, elle craint le regrettable impact de ce fait sur la qualité des professeurs (…) et insiste très fortement pour que les universités autonomes prennent au sérieux cette mission de formation professionnelle, comme elles ont su le faire dans les décennies écoulées pour les professions d’ingénieur ou de médecin » (245).
Bien entendu, l’ersatz de formation professionnelle prévue par la réforme de la mastérisation de 2008 n’a pas permis de corriger ce « vice de construction » initial. Au final, en forçant le trait, on pourrait dire, aux côtés de l’économiste Éric Maurin, que devenir enseignant reste en France « une forme d’élection », notre pays étant peut être le seul du monde développé où les professeurs entrant dans la carrière « sont avant tout et principalement de bons élèves dans leur discipline » (246).
Ces derniers sont en effet recrutés sur une « maldonne fondamentale », car rien dans leur passé, ni dans leur formation, ne les prépare à enseigner, au quotidien, dans des classes hétérogènes.
Au total, ces éléments plaident en faveur d’une refonte de la formation au métier d’enseignant et de la mise en place d’ESPE qui se différencieront des IUFM sur de nombreux points.
● Des différences marquées avec les IUFM
1°Première différence : outre les enseignants – c’est-à-dire les professeurs des premier et second degrés, les professeurs documentalistes et les conseillers principaux d’éducation –, les ESPE formeront l’ensemble des personnels d’éducation, ainsi que les étudiants de licence bénéficiant d’un emploi d’avenir professeur ou encore tous ceux qui souhaiteront développer des compétences dans le domaine de l’enseignement, de l’éducation et de la formation.
Il faut s’en féliciter, car, comme le fait remarquer le Conseil économique, social et environnemental, « les futurs enseignants devront de plus en plus travailler en équipe avec d’autres professionnels du secteur de l’éducation, au sein de leur établissement ou à l’extérieur » (247).
En outre, les ESPE formeront tous les enseignants – de la maternelle à l’université. En effet, les problématiques liées aux savoirs de la transmission concernent tous les professeurs, y compris les enseignants-chercheurs, un point trop souvent négligé.
Sur ce dernier sujet, dans un rapport sur les centres d’initiation à l’enseignement supérieur qui assuraient la formation des étudiants bénéficiaires d’une allocation de recherche et se préparant aux fonctions d’enseignant-chercheur, l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche a observé que chez beaucoup d’universitaires « prévaut encore l’idée que si l’on maîtrise un savoir académique, on est capable de l’enseigner ». Or, ajoute-t-elle à juste titre, « si cela peut être vrai au niveau master ou doctorat, il est clair que cela ne l’est pas au niveau de la licence », la lutte contre le taux d’échec dans le premier cycle universitaire impliquant d’y révolutionner la pédagogie (248).
2° Deuxième différence par rapport aux IUFM : ainsi que le souligne le rapport annexé au projet de loi, les futures écoles favoriseront le développement d’une « culture commune » à tous les enseignants et à l’ensemble de la communauté éducative.
Ce rapprochement, dont les modalités seront évoquées plus loin, doit être impérativement enclenché car il conditionne, en grande partie, la refondation de l’école. En effet, il sera de nature à encourager le développement de projets transversaux et interdisciplinaires qui faciliteront les liaisons entre les différents degrés de l’enseignement, de la maternelle au premier cycle universitaire.
3° Dernière différence : à condition de prendre quelques précautions, le positionnement original des ESPE au sein de l’université, qui sera commenté plus loin, devrait conduire à « sortir » la formation initiale des enseignants de son moule hyperdisciplinaire pour lui donner sa véritable identité professionnelle, à la fois académique et pédagogique.
Ainsi, il pourra être mis fin à la guerre stérile entre « transmission des savoirs » et « savoirs de la transmission » (249), pour que les enseignants sachent, demain, transposer leurs connaissances universitaires en cours de CP, de 5ème ou de 2nde…
b) Le but : mettre en place des écoles professionnalisantes
La responsabilité de la formation reposera sur la mise en place de masters mention « Enseignement, éducation et formation » (MEEF), organisés par les composantes universitaires que seront les ESPE.
En soi, le regroupement dans cette unique mention des appellations des diplômes préparant au métier d’enseignant, « éclatées » à la suite de la réforme du gouvernement précédent, garantira une lisibilité et une homogénéité qui font aujourd’hui défaut. À ce jour, en effet, le ministère de l’enseignement supérieur est dans l’incapacité de donner le chiffre exact des masters « métiers de l’enseignement et de la formation » mis en place en 2010, la vérité étant peut-être entre une estimation haute de 59 mentions et une fourchette basse de 42 mentions.
Par ailleurs, la formation dispensée dans le cadre de ces diplômes devra suivre une « feuille de route », conclue entre l’État et la Conférence des présidents d’université le 24 janvier 2013, qui fixe, en la matière, des principes essentiels, repris dans l’encadré ci-après.
– Une entrée progressive dans le métier par des masters adossés à la recherche et ayant une vocation professionnelle affirmée ;
– L’organisation, coordonnée avec les services des rectorats, de stages en école et en établissement scolaire dans le cadre d’unités d’enseignement reposant sur une démarche d’alternance ;
– Une place particulière accordée à la recherche dans la formation des étudiants et dans l’exercice des missions des ESPE ;
– Une attention en direction des dispositifs préparant à l’enseignement scolaire du premier degré ;
– Une construction du projet pédagogique permettant de fédérer autour des équipes pédagogiques des ESPE l’ensemble des compétences nécessaires présentes dans les autres composantes des universités ainsi que chez les praticiens de l’enseignement scolaire (maîtres formateurs, enseignants, personnels d’inspection et de direction, associations partenaires de l’école) ;
– L’émergence d’une culture commune aux étudiants se destinant à l’enseignement ;
– Le développement de cursus à destination des autres métiers de l’éducation et de la formation ;
– La préparation à ces métiers dès le cursus de licence ;
– La participation des universités à la formation continue des enseignants et des autres personnels relevant des métiers de l’éducation.
Quelques-uns de ces principes méritent d’être développés.
● Une formation de haut niveau et reposant sur un continuum
Contrairement à certaines affirmations, le master « MEEF » ne sera pas un master « au rabais » du point de vue académique. Si enseigner est un métier qui s’apprend, celui-ci doit avoir une coloration disciplinaire très solide. La maîtrise de la discipline enseignée devra donc rester le socle de la formation, mais celle-ci devra être mise en perspective, ainsi que l’a recommandé le Haut conseil de l’éducation : « Les enseignements ne sont ni empilement d’informations, ni accumulation de pratiques intellectuelles, mais soutiennent la compréhension des savoirs et leurs applications. Dans cette optique, le professeur doit être à même d’offrir des explications approfondies, relier les différentes parties du cours et les champs disciplinaires, discuter dans les matières scientifiques les raisons d’être des solutions des problèmes posés, en ayant un recul épistémologique sur sa discipline » (250).
En outre, en deuxième année de master (M2), le fonctionnaire stagiaire se confrontera à la production d’un mémoire, constitutif du diplôme. Ainsi, l’initiation à la recherche que postule tout diplôme d’un niveau bac + 5 pourra s’appuyer sur ce travail réflexif, qui sera lui-même alimenté par les observations de terrain faites au cours du stage.
À condition que le mémoire soit ensuite présenté devant un jury constitué d’universitaires et de tuteurs, cette dimension « recherche » permettra à l’enseignant de transformer des compétences académiques en éléments de réflexion didactiques et en instruments d’enseignement.
Enfin, cette formation devra être conçue comme un continuum, qui, comme l’indique le rapport annexé au projet de loi, se déroulera en plusieurs temps : la formation initiale, avec une préprofessionnalisation qui débutera dès la licence et se conclura avec l’acquisition d’un master professionnalisant, et, enfin, la formation continue, indispensable « pour permettre aux enseignants de rester au contact de la recherche, des avancées dans leur discipline ainsi que des évolutions qui traversent les métiers de l’éducation et la société ».
Le rapporteur considère que la qualité de ce continuum de formation dépendra, dans une large mesure, de celle des éléments de professionnalisation institués au niveau de la licence. Cette condition devra être d’autant plus respectée que la place accordée à la pratique de l’enseignement au cours de la première année de master devra tenir compte du fait que les épreuves d’admissibilité des nouveaux concours pourraient avoir lieu en mars ou en avril, donc après six mois de formation universitaire au cours desquels il ne sera pas possible d’opérer une professionnalisation poussée.
C’est pourquoi la deuxième année de licence devrait comporter une unité d’enseignement permettant aux étudiants d’observer, pendant quinze jours par exemple, la réalité pratique du métier dans une école primaire et un établissement du secondaire. Un tel dispositif, qui aiderait les étudiants à choisir entre les deux niveaux d’enseignement, devrait être complété, en troisième année de licence, par une unité d’enseignement centrée sur le questionnement didactique de la discipline ou l’approfondissement, pour les futurs professeurs des écoles, des matières qui ne seraient pas encore maîtrisées.
● Une formation intégrée et comportant un tronc commun
Le cursus des masters « MEEF » devra être intégré, c’est-à-dire ne pas dissocier les compétences académiques et professionnelles des futurs personnels enseignants et d’éducation.
L’alternance de la formation devra donc permettre la construction des « blocs de compétences » qui ont été identifiés par le rapport du groupe de travail animé en 2009 par M. Daniel Filâtre, alors président de l’Université de Toulouse 2-Le Mirail, un travail dont les conclusions n’avaient pas été suivies par le précédent gouvernement. En effet, pour reprendre l’analyse développée dans ce document, la « logique de l’intégration conduit bien évidemment à exiger la maîtrise des savoirs à enseigner, à développer une approche épistémologique de la ou des disciplines et à adosser la formation à la recherche. La mise en perspective des savoirs, la réflexion relative aux processus de transmission à l’œuvre dans l’enseignement, constituent bien des compétences professionnelles difficilement séparables des compétences disciplinaires.
« Au total, quatre blocs de compétences peuvent donc être définis :
« – le premier vise la maîtrise des savoirs, connaissances et savoirs faire spécifiques nécessaires à l’enseignement de la discipline ;
« – le deuxième, qui renvoie aux savoirs didactiques, vise à la maîtrise des éléments (principes, méthodes, outils) intervenant dans leur transmission ;
« – le troisième est relatif à la maîtrise des compétences disciplinaires et méthodologiques nécessaires à l’évolution et l’approfondissement des compétences enseignantes. La démarche de recherche constitue une dimension essentielle de ce bloc ;
« – le quatrième vise les savoirs et compétences nécessaires à une claire perception de l’environnement institutionnel et social dans lequel s’inscrivent les missions de l’enseignant » (251).
La pondération de ces différents éléments au cours des deux années du master devra être la plus fine possible. En particulier, l’enseignement académique devra peser nettement plus lourd que la didactique en première année, car la réussite au concours suppose la maîtrise de contenus disciplinaires, tandis que la proportion devra être inverse en deuxième année.
Parallèlement à cet objectif, la formation devra favoriser un certain équilibre entre l’acquisition d’un tronc commun, nécessaire au rapprochement des cultures professionnelles des premier et second degré et de l’enseignement scolaire avec l’enseignement supérieur, et la spécialisation, celle-ci ne devant pas intervenir trop tôt. Ce point capital sera développé dans le commentaire de l’article 51 du présent projet de loi.
● Une formation pilotée par des « référentiels métiers »
La formation s’appuiera sur les référentiels « métiers » arrêtés par l’employeur, c’est-à-dire le ministère de l’éducation nationale. Actuellement en cours de publication, ceux-ci doivent constituer un élément fort de cadrage de la formation organisée par les ESPE.
À cet égard, le référentiel commun à tous les professeurs et personnels d’éducation vise à créer une culture partagée entre tous les professionnels de l’éducation et assigne des objectifs en matière de transmission des valeurs de la République, de maîtrise du socle commun, de gestion de la classe, de travail en équipe, etc., valant aussi bien pour les futurs enseignants que pour les universités. S’adressant à l’ensemble de la profession, il contribue ainsi à affirmer son identité.
En outre, il détaille onze grands domaines de connaissances à maîtriser au moment de la titularisation et tout au long de la carrière et, à ce titre, prend en compte la complexification du métier et, notamment, les contraintes résultant de l’hétérogénéité de la population scolaire(252).
Ce premier document est complété par un référentiel de compétences des professeurs, qui n’est pas construit autour d’un degré d’enseignement particulier mais fait référence à des compétences « intégratrices » qui se manifestent dans des actes professionnels. Surtout, il est unique, c’est-à-dire qu’il concerne l’ensemble des métiers, tout en reconnaissant la spécificité des lieux (école, collège, lycée, lycée professionnel) d’exercice (253).
Ces référentiels devront servir de guides à l’élaboration des maquettes de master « MEEF » et donner ainsi un cadre aux équipes pédagogiques des ESPE comme aux enseignants eux-mêmes, et ce aussi bien pour la formation initiale que pour la formation continue.
c) L’articulation ESPE/stage/concours
● La dimension professionnelle de la formation
La dimension professionnelle de la formation sera articulée sur les quatre semestres du master. Elle sera particulièrement prégnante lors de la dernière année de master, puisque le positionnement du nouveau concours – épreuves d’amissibilité et d’admission – à la fin de la première année conduit à organiser, pour les lauréats, une année de stage en alternance, rémunérée, au cours de laquelle ils devront compléter leur formation initiale par l’acquisition de modules.
Auparavant, en première année, outre le cursus normal du master et la préparation au concours, les étudiants auront à effectuer un stage d’observation et de pratique accompagnée de plusieurs semaines, qui sera pris en compte dans le cursus même du master. Ces futurs enseignants auront donc à la fois des tuteurs de l’éducation nationale et des tuteurs de l’université et les validations seront de même doubles.
En deuxième année, les étudiants reçus au concours deviendront, à partir de 2014, fonctionnaires stagiaires et, en alternance avec les périodes en université, assureront un temps partiel d’enseignement. Ce stage sera également intégré au cursus du master et, dans le cadre national défini conjointement par les ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche, il est prévu qu’il vaudra 20 crédits ETCS (système européen de transfert et d’accumulation de crédits). Ici encore, il y aura double tutorat mais, de manière à ne pas surcharger le jeune professeur en le soumettant à des exigences trop éloignées de part et d’autre, le ministère de l’éducation nationale envisage de recourir à une évaluation en partie commune.
Le mode d’emploi de l’année de stage
● Le dispositif transitoire
Dans l’attente du nouveau dispositif de recrutement et de formation des personnels enseignants et d’éducation, qui sera mis en œuvre à partir de la session 2014 du concours, un dispositif transitoire est prévu afin de répondre à l’objectif de professionnalisation progressive du recrutement.
Ainsi, une session de concours transitoire, pour laquelle la campagne de recrutement a été lancée, se déroule avec une phase d’admissibilité en juin 2013 et une phase d’admission en juin 2014.
Ces concours exceptionnels seront organisés selon les mêmes modalités (programmes, épreuves, nomination avec notamment la condition de détention d’un master, titularisation et classement) que les concours externes de droit commun encadrés par les statuts particuliers.
Ils se distinguent des concours de droit commun par la possibilité offerte aux candidats admissibles qui le souhaitent de bénéficier d’une expérience professionnelle dans des activités d’enseignement ou d’éducation, qui se traduira par un contrat à raison d’un tiers de service rémunéré à hauteur d’un mi-temps.
Les candidats admissibles se verront ainsi proposer, à la rentrée scolaire 2013, un contrat à durée déterminée en vertu duquel ils auront à effectuer un tiers des obligations réglementaires de service prévues pour les corps auxquels ils postulent.
Les candidats ayant satisfait aux épreuves d’admission du concours à la fin de l’année scolaire 2013-2014 seront nommés fonctionnaires stagiaires à la rentrée 2014. Ils auront vocation à être titularisés à la rentrée 2015.
● Le dispositif pérenne ou nouveau concours (admissibilité mars ou avril 2014 -admission juin 2014)
La réforme du recrutement et de la formation des personnels enseignants en vue de la première session des nouveaux concours – le futur régime de droit commun – envisage une présentation aux concours en fin de première année d’études de master. Les lauréats des concours bénéficieront ensuite du statut de fonctionnaire stagiaire durant leur deuxième année de master.
Pendant l’année de stage, les ESPE proposeront des formations aux métiers de l’éducation qui compléteront les séquences en école ou en établissement scolaire. Ces séquences (stages en responsabilité) correspondront à un service d’enseignement équivalent à un mi-temps. Les lauréats auront ainsi la qualité de fonctionnaires stagiaires et seront classés dans leur corps et rémunérés à plein temps.
Quant aux lauréats du concours, déjà titulaires d’un master, ils bénéficieront d’un parcours d’études adapté et auront accès à une formation en alternance. Ils devront compléter leur formation initiale par l’acquisition de modules centrés sur des problématiques pédagogiques.
L’ensemble des stagiaires auront vocation à être titularisés à la rentrée 2015, à la double condition d’être déclarés aptes par un jury d’évaluation à exercer le métier et d’avoir validé leur master.
● Un positionnement du concours qui n’est peut-être pas parfait mais qui a de réelles vertus
L’articulation concours-master finalement retenue est parfois critiquée, car, pour certains, elle ressemble fort à la « césure » qui, dans l’ancien modèle de formation, centré sur les IUFM, séparait l’année de préparation des épreuves de celle effectuée en alternance entre l’établissement et l’université. Pour se prémunir contre ce danger, qui est bien réel, la solution idéale consisterait, pour les adversaires du concours placé en première année de master (M1), à recruter ou pré-recruter les futurs enseignants dès la fin de la licence.
Cependant, outre le coût excessif d’un tel dispositif au vu des contraintes pesant sur les finances publiques et compte tenu de l’effort considérable que représentent pour la nation les 54 000 emplois qui seront affectés à l’enseignement scolaire – dont 27 000 consacrés à la réforme de la formation initiale –, la solution retenue par le gouvernement présente de réels avantages.
1° En premier lieu, elle tient compte de l’exigence d’excellence disciplinaire postulée par le métier d’enseignant. En effet, une entrée dans le métier, même à temps partiel, dès la fin de la licence conduirait à remettre en cause l’élévation du niveau de qualification universitaire des enseignants résultant de la mastérisation – le seul point positif de la réforme décidée en 2008.
En outre, cette formule reviendrait en pratique à faire reposer le volet académique du recrutement sur les seuls cursus et diplôme de licence qui connaissent un taux d’échec préoccupant, lié à « un problème de spécialisation trop précoce », selon le rapport de M. Jean-Yves Le Déaut remis à l’issue des Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche (254). En plaçant ainsi le curseur du recrutement trop en amont, elle ferait prendre un risque considérable, celui de déprécier le concours aussi bien que la formation.
2° En deuxième lieu, le concours en fin de M1 évite de surcharger le programme pédagogique de la deuxième année de master par rapport au stage.
3° Enfin, elle permet de mieux gérer les flux d’étudiants en deuxième année de master en facilitant la réorientation des étudiants non admissibles, ce qui constitue un point fort, sur les plans tant humain que social. Cette souplesse est à mettre en lien avec la nature et le champ des masters « MEEF ».
En effet, selon l’étude d’impact du projet de loi, la « structure en Y » induite par l’organisation du concours lors de la première année de master « permet d’inclure un cursus ciblant les métiers d’enseignant au sein du ministère de l’éducation nationale dans une problématique plus large des métiers de l’éducation et de la formation, offrant ainsi plus de débouchés aux étudiants. Elle offre également plus de possibilités de poursuite d’études élargies pour les candidats non admissibles qui souhaiteraient se réorienter ». À l’inverse, un concours en fin de licence « enfermerait » trop tôt les lauréats dans un parcours de formation avant même qu’ils aient effectué, sur le terrain, les stages de pratique accompagnée leur permettant de conforter ou non leur vocation.
Il reste que cette solution, qui permet de « libérer » la dernière année de formation du poids du concours, peut conduire à une première année de master axée sur le bachotage et le disciplinaire. Là est le vrai risque, comme l’a d’ailleurs pointé le Conseil économique, social et environnemental : cette solution conduit à « fortement hypothéquer une véritable formation professionnelle durant les deux années du master. En effet, l’année de M1 sera à nouveau tout entière orientée vers la préparation du concours, lequel risque d’être fortement disciplinaire comme aujourd’hui, faute de pouvoir vraiment tester des compétences professionnelles au bout d’un an et de quelques stages. Quant à la deuxième année de master, le concours étant obtenu, il est probable que les étudiants se consacreront de façon privilégiée à la formation professionnelle au détriment de la formation disciplinaire et de la recherche. Autrement dit, comme le pensent aujourd’hui la plupart des acteurs, cette orientation couperait en deux la formation du master et obérerait fortement le caractère intégré d’un cursus alliant enseignements théoriques et pratiques, stages, formation disciplinaire et professionnelle » (255).
Ce risque ne pourra être écarté que si les épreuves des concours sont « professionnalisées ». Aussi la solution du recrutement en M1, qui est souvent présentée comme étant la moins mauvaise, ne peut-elle devenir une bonne solution qu’avec la mise en place de concours entièrement repensés et tenant effectivement compte du fait que le master a vocation à garantir le niveau de formation des enseignants, à la fois théorique et professionnel.
Or, c’est précisément cette voie qui a été choisie, semble-t-il, par le ministère de l’éducation nationale.
● Le nouveau concours de recrutement
Le concours ne servira plus à valider ce qui l’aura déjà été par l’université au travers des différentes épreuves organisées au cours de la première année de master. Dans le même temps, ainsi que l’a précisé M. Jean-Yves Capul, sous-directeur des programmes d’enseignement et de la formation des enseignants au ministère de l’éducation nationale, devant notre Commission, « il est indispensable d’avoir la maîtrise complète de contenus disciplinaires pour en assurer la pédagogie »(256).
Pour répondre à ce double objectif, la maquette du concours devrait comprendre les épreuves suivantes :
– une des deux épreuves de l’écrit consistera en l’exploitation d’un dossier documentaire devant démontrer « la capacité à mobiliser les savoirs disciplinaires et didactiques dans le but de présenter un raisonnement pédagogique contextualisé » par rapport à une situation et à un public scolaire donnés : il s’agit donc d’une épreuve qui, tout en n’étant pas entièrement académique comme par le passé, exigera une bonne maîtrise des savoirs disciplinaires en même temps qu’une maîtrise des conditions de leur transposition à un public d’élèves. Ainsi, on peut penser que sera testée, non la connaissance de la grammaire universitaire, mais la capacité d’enseigner la grammaire à des collégiens ;
– par ailleurs, les deux épreuves orales prendront « la forme d’une mise en situation professionnelle, mettant en jeu la capacité d’engager la construction d’une séquence pédagogique dont le candidat devra justifier, face au jury, les choix didactiques et pédagogiques qu'il a effectués » et celle d’un « entretien à partir d’un dossier destiné à montrer l’aptitude au dialogue, mais également (…) une première approche épistémologique de la discipline et de ses enjeux, la capacité à se projeter dans le métier futur, par exemple à partir des réponses aux questions et aux situations proposées par le jury ».
Le lien sera donc constant entre l’appréciation du savoir disciplinaire et celle des aptitudes professionnelles, mais ces dernières seront d’autant mieux prises en considération que les coefficients des épreuves orales, qui permettront mieux que l’écrit d’en juger, pèseront pour deux tiers dans le total.
De même, à l’issue de l’année de stage, la procédure de titularisation permettra à l’employeur, c’est-à-dire à l’État, de vérifier que le stagiaire aura obtenu sa deuxième année de master (M2) et de s’assurer, par le biais du jury d’examen de qualification professionnelle, que les compétences acquises à l’occasion du travail effectué en responsabilité dans la classe, avec les observations des tuteurs, seront suffisantes pour commencer à exercer.
Enfin, le rapporteur tient à souligner que sur ce sujet, complexe et crucial, M. Gilles Roussel, président de la commission de la formation de la Conférence des présidents d’université (CPU), a donné quitus au gouvernement. Ainsi, le contenu de ce concours « a considérablement évolué afin de permettre une véritable formation intégrée, sans rupture entre la formation à la discipline, la préparation du concours et la préparation à l’exercice du métier. Désormais, ce n’est plus le concours, mais le master qui valide les compétences. La CPU se félicite de ce signe de confiance du ministère de l’éducation nationale vis-à-vis de l’université » (257).
d) L’impact budgétaire du nouveau dispositif
● L’année de stage
Le rétablissement de l’année de stage rémunérée, même réorganisée autour des ESPE, implique la création d’emplois d’enseignants stagiaires. L’étude d’impact jointe au projet de loi précise qu’à la rentrée 2014, « ce sont près de 20 000 emplois de stagiaires pour les premier et second degrés publics qui seront ouverts, la perspective pour la rentrée 2016 étant d’environ 28 000 emplois de stagiaires (public et privé) ». Quant au dispositif transitoire applicable dès la rentrée 2013, on rappellera qu’il représentera 11 476 équivalents temps plein ou ETP (public et privé) et permettra aux étudiants concernés de bénéficier de contrats à mi-temps pour un service d’enseignement limité à un tiers de service d’enseignement d’un titulaire.
● Les moyens des écoles
Selon l’étude d’impact, l’appréciation des moyens des ESPE doit prendre en considération deux dimensions : d’une part, l’évolution des effectifs étudiants inscrits dans les cursus et, d’autre part, les besoins en potentiel d’enseignement des nouvelles maquettes de formation en cours d’élaboration, lesquelles comprendront, au cours de la seconde année de master, un tiers-temps de service.
1° En ce qui concerne les effectifs des masters « MEEF », l’étude d’impact prévoit une hausse du nombre d’étudiants inscrits dans ces nouveaux masters alors que, depuis 2008, les structures universitaires préparant des masters « métiers de l’enseignement » ont perdu 40 % de leurs effectifs. Cette hausse devrait, en outre, se conjuguer avec celle, globale, des effectifs étudiants au niveau master – soit + 11,7 % de 2011 à 2021 selon les prévisions – sous l’effet de la mise en œuvre d’une politique d’entrée progressive dans le métier dès la licence et de la politique attractive de recrutement mise en œuvre par le ministère de l’éducation nationale.
2° En ce qui concerne les besoins en potentiel d’enseignement, l’étude d’impact considère que « la préservation des moyens dont a bénéficié l’université au cours des dernières années, ainsi que les efforts de productivité et les réorganisations, permettent d’envisager la création des ESPE à coût constant pour l’État ». En effet, pour l’essentiel, les moyens de ces écoles proviendront :
– d’un redéploiement de ceux des différentes composantes universitaires partenaires de l’ESPE, dont les IUFM. Selon les premiers constats d’une mission conduite par les deux inspections générales, ces composantes font partie de celles qui ont subi une baisse de leurs moyens moins forte que la baisse de leurs effectifs ;
– des 1 000 postes d’enseignants chargés de la formation initiale et continue des maîtres et des personnels d’éducation prévus par la programmation budgétaire. Pour la constitution de leur potentiel d’enseignement, les ESPE pourront en outre bénéficier du service de nombreux praticiens – enseignants, maîtres formateurs, conseillers pédagogiques, personnels de direction et d’inspection, etc.
Compte tenu de ces observations, l’étude d’impact conclut qu’« à moyen terme, dans une hypothèse d’augmentation progressive des effectifs étudiants inscrits dans les formations organisées par les ESPE par rapport aux anciennes formations de master organisées par les IUFM, et compte tenu de l’appréciation actuelle qu’il peut être fait de l’interprétation que feront les ESPE des référentiels qui encadreront la formation des enseignants, le potentiel mobilisable par l’Université en heures enseignants apparaît suffisant en première approche ».
Cette longue phrase, quelque peu entortillée, ne permet pas de fournir au Parlement une estimation chiffrée à l’euro ou à l’équivalent temps plein, près du coût budgétaire du nouveau dispositif de formation. Mais il est vrai qu’il est difficile de tracer des prévisions lorsque la « matière » – les étudiants ayant la vocation de l’enseignement – est aujourd’hui peu suivie sur le plan statistique, tandis que les modalités de la formation seront revues d’une année sur l’autre.
Les effectifs d’étudiants préparant les concours d’enseignement
– L’analyse des inscriptions en IUFM est possible jusqu’en 2009-2010, date à laquelle, les instituts, à l’exception de ceux des Antilles-Guyane, ont intégré les universités en tant qu’écoles internes. Ainsi, le nombre d’étudiants en première année est passé de 44 773 en 2007 à 41 508 en 2009, soit une diminution de 13 % sur deux ans.
– À partir de 2010, il est possible de repérer les étudiants inscrits dans les masters dits d’enseignement et de formation (MEF). En revanche, il est impossible de recenser les étudiants inscrits dans les parcours préparant aux métiers de l’enseignement au sein de masters « classiques » à vocation plus large, l’enquête SISE du ministère de l’enseignement supérieur ne descendant pas jusqu’au niveau du parcours ou de l’option. Les chiffres ne sont donc pas exhaustifs. Ainsi, en 2010-2011, on estimait à 42 500 les étudiants inscrits en 2010-2011 (hors les inscrits en master classique non MEF et les étudiants préparant à nouveau le concours inscrits en diplôme universitaire).
À partir de 2011-2012, les masters spécifiques MEF sont repérés. Le nombre d’étudiants se destinant à l’enseignement représentait donc un total de 41 300 étudiants répartis ainsi :
– masters enseignement 1ère et 2nde année : 34 406 étudiants répartis entre 15 869 étudiants en M1 et 18 537 étudiants en M2 ;
– préparations professeur des écoles (cas particulier du Pacifique) : 134 étudiants ;
– préparations au concours (dont agrégation) : 6 791 étudiants.
2. Le dispositif proposé par le projet de loi
Le présent article tend à remplacer les dispositions du chapitre V du titre II du livre VI du code de l’éducation – consacré à « la formation des maîtres » – par un nouveau chapitre intitulé « formation des personnels enseignants et d’éducation ». Il comprend deux paragraphes, le premier d’entre eux proposant de réécrire l’article L. 625-1 du code de l’éducation relatif aux instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM), le second de procéder à une coordination à l’article L. 611-1 afin de supprimer la référence à ces instituts.
a) Des ESPE qui « organisent » et « participent »
● La double mission des écoles
Les ESPE assureront une double mission :
– organiser la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d’éducation ;
– participer à leur formation continue.
Selon le ministère de l’éducation nationale, ces termes sont adaptés car ils correspondent aux deux positionnements des ESPE : d’un côté, une position d’« opérateur monopolistique » pour la formation initiale des enseignants, de l’autre, une position d’opérateur privilégié pour la formation continue.
Sur le premier point, les ESPE auront un double rôle :
– d’abord un rôle d’organisation, puisque leurs formations seront assurées par des équipes pédagogiques relevant des diverses composantes concernées des établissements publics d’enseignement supérieur de l’académie et associant des professionnels intervenant en milieu scolaire ;
– ensuite, elles seront aussi opératrices de ces formations, en utilisant leurs ressources propres de formation, qui correspondront principalement, à la rentrée 2013, à celles des actuels IUFM.
Sur le second point, les ESPE n’auront pas vocation à être le seul opérateur de formation continue qui pourra être mobilisé par le ministère de l’éducation nationale.
En effet, cette politique, pilotée par les recteurs, continuera d’être organisée par les services académiques eux-mêmes, notamment lorsque sont mises en place des formations dites de proximité (au sein d’un établissement ou d’un bassin, pour une équipe d’enseignants, ou au sein d’une circonscription). Cependant, selon les précisions apportées par le ministère de l’éducation nationale, d’autres opérateurs que les écoles pourront être sollicités par les académies, qu’il s’agisse d’établissements d’enseignement supérieur (grandes écoles) qui proposent des formations très spécialisées ou même d’organismes privés.
Ainsi, les ESPE ne seront pas les opérateurs exclusifs de la formation continue pour répondre aux plans académiques de formation, mais en deviendront les opérateurs privilégiés. En outre, comme pour la formation initiale, lorsqu’elles répondront aux « commandes » des académies, les écoles seront amenées à associer différentes composantes des universités partenaires, tout en faisant appel à leurs ressources internes. C’est pourquoi les rectorats et les ESPE devront travailler ensemble à la mise en œuvre d’une offre de formation qui réponde aux besoins des académies et puisse satisfaire les enseignants qui suivent les modules spécialisés.
La mise en place des ESPE sera donc l’occasion de relancer la politique de formation continue des personnels enseignants. En effet, l’école de la République ne peut plus se payer le luxe de voir se perpétuer le fiasco actuel. Elle a trop souffert des hésitations du ministère sur le rôle des IUFM en la matière. Ainsi, la loi du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation précisait qu’ils participent à la formation continue des personnels enseignants mais, dans les faits, ils sont « largement sortis du jeu », les recteurs et les corps d’inspection ayant repris la main.
À ce premier constat, établi en 2010 par les inspections générales dans un rapport non rendu public par le précédent gouvernement, s’ajoute celui d’un dispositif qui est le « parent pauvre » de l’éducation nationale. Avec une enveloppe de 15 millions d’euros par an seulement pour le premier degré entre 1998-2009 et une réduction d’un tiers des moyens pour le second degré, la formation continue a joué « le rôle de variable d’ajustement dans les arbitrages budgétaires de manière diffuse, sans véritable opposition des acteurs » (258).
La loi de finances pour 2013 s’inscrit, hélas, dans cette continuité, en affectant seulement 12,95 millions d’euros à la formation continue dans le premier degré et 20,68 millions à celle dans le second degré, même s’il faut rappeler que ce texte permet d’ouvrir plus de 40 000 postes aux concours. Il faut espérer qu’au cours des prochains exercices, des moyens plus substantiels seront débloqués pour « refonder » la formation continue des enseignants.
● Des ENS non concurrencées
Le présent article précise que les ESPE exerceront leur mission de formation initiale et continue « sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures » (ENS).
Le ministère de l’éducation nationale n’a pas souhaité que la mise en place des ESPE vienne modifier les missions dévolues aux ENS, car celles-ci présentent la particularité d’accueillir, sur concours, des élèves préparant, à leur tour, soit l’agrégation, soit une thèse, soit un autre concours de la fonction publique.
Nonobstant l’exception prévue par le présent article, il sera tout à fait loisible à une ESPE, dans le cadre de conventions entre établissements et à l’instar de ce qui déjà prévu pour les diplômes co-habilités – par exemple avec l’ENS de Lyon – d’associer une école normale à un projet de site.
Les écoles normales supérieures (ENS)
Ces écoles, à l’instar des universités, font partie de la catégorie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Leurs décrets statutaires (du 26 août 1987 pour l’ENS Ulm, du 5 janvier 2011 pour l’ENS de Cachan et du 7 mai 2012 pour l’ENS de Lyon) prévoient des règles d’organisation et de fonctionnement particulières, conformément à l’article L. 716-1 du code de l’éducation.
Si elles couvrent l’ensemble des champs disciplinaires offerts par les universités, elles ont pour mission de préparer, par une formation disciplinaire et scientifique de haut niveau, des élèves recrutés sur concours qui se destinent prioritairement aux carrières de l’enseignement supérieur et de la recherche. Elles accueillent, dans ce but, des élèves normaliens, ainsi que des étudiants préparant un master et des doctorants. Dans leur grande majorité, les élèves poursuivent leurs études vers une formation doctorale dans le cadre de formations dispensées en co-accréditation avec les universités partenaires.
b) Un cadrage national de la formation
La publication de « référentiels métiers » identifiant les compétences requises au niveau de l’exercice professionnel doit être conjuguée à celle d’un cadre national pour les formations aux métiers de l’enseignant, de l’éducation et de la formation (MEEF), qui fixe les conditions qui permettent de construire ces compétences.
La formation des maîtres étant une « affaire d’État », ce cadre doit être prescriptif, même s’il doit respecter l’autonomie pédagogique des établissements dont les ESPE seront des composantes.
À cet égard, l’article L. 625-1 du code de l’éducation, introduit par la loi du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École, a posé le principe d’un tel cadrage, en disposant que la formation dispensée dans les IUFM « répond à un cahier des charges fixé par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale après avis du haut conseil de l’éducation ».
Il est proposé de maintenir ce principe, en l’adaptant au nouveau système de formation et de recrutement : ainsi les ministres arrêteront « le cadre national des formations liées aux métiers du professorat du premier et du second degrés et de l’éducation ».
La rédaction proposée appelle les commentaires suivants :
– elle réaffirme le principe d’une « co-construction » du cadre de référence des formations, les ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur devant le rédiger à « quatre mains » ;
– ce cadre s’appliquera à l’éventail des masters « MEEF », puisqu’il concernera aussi bien les métiers du professorat que ceux de l’éducation. Les ESPE assureront donc, dans le cadre de ces masters, la préparation à l’ensemble des métiers du professorat (y compris donc les professeurs documentalistes), ainsi qu’aux métiers de conseiller principal d’éducation. Le ministère de l’éducation nationale a précisé que les conseillers d’orientation-psychologues et les auxiliaires de vie scolaire en sont, pour le moment, exclus, au moins au titre de la formation initiale ;
– le cadre national de la formation retenu par la loi sera plus large que le cahier des charges actuel. En effet, selon le ministère, il sera complété par trois autres documents : les référentiels de compétences des professeurs et des personnels d’éducation ; le cadre et les programmes des futurs concours liés à la nouvelle formation ; le cahier des charges de l’accréditation des futures ESPE.
c) Une formation marchant sur trois jambes
Le présent article précise que la formation organisée par les ESPE inclura des enseignements pratiques, des enseignements théoriques et un ou plusieurs stages.
On retrouve, dans la combinaison de ces trois éléments, l’essentiel des recommandations du Haut conseil de l’éducation sur la formation des maîtres : « La formation doit s’effectuer en alternance, à l’université et dans les établissements scolaires, et elle doit être partout à la fois pratique et théorique. Des savoirs déconnectés de la pratique sont peu utiles pour la formation, et, symétriquement, les situations rencontrées sur le terrain ne sont pleinement formatrices que si elles sont analysées individuellement et collectivement à l’aide d’outils conceptuels. Il est donc essentiel que les formateurs en université soient en contact réel avec le terrain, et qu’ils travaillent ensemble à partir des situations rencontrées dans les classes » (259).
On retrouve également dans cette disposition le principe de l’alternance de la formation, que l’ancienne majorité a voulu supprimer avant la fin de la précédente législature (260). La mission des ESPE sera d’assurer une « véritable » alternance, c’est-à-dire de lier vraiment l’expérience pratique de la conduite d’une classe, avec le soutien d’un enseignant chevronné, et le soubassement que procurera l’enseignement universitaire, enrichi de l’apport de la recherche.
Par ailleurs, la formulation ouverte proposée par le présent article pour le nombre de stages – « un ou plusieurs stages » – s’explique par le fait que le ministère de l’éducation nationale n’a pas voulu préjuger, en posant d’emblée le principe d’un chiffre supérieur à un, de l’organisation qui sera privilégiée par les académies et les ESPE. Plusieurs situations pourront en effet être privilégiées, compte tenu du parcours antérieur des étudiants candidats ou des lauréats des concours, selon qu’ils disposent d’un master première année ou seconde année, dans la spécialité « MEEF » ou non, etc.
d) Des ESPE accueillant un public diversifié
Le présent article propose d’ajouter qu’en plus de leur mission générale d’organisation de la formation initiale des enseignants, les ESPE accueilleront aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles organisées par les autorités académiques.
Cette disposition vise les activités de formation continue qui pourront être organisées par les ESPE. Par ailleurs, la rédaction proposée permettra d’englober toutes les catégories de personnel exerçant dans les écoles et les établissements, sans se limiter aux seuls professeurs, professeurs-documentalistes et conseillers principaux d’éducation (CPE). Selon le ministère de l’éducation nationale, cette formulation rendra possible un élargissement du spectre des catégories de personnels accueillies dans les ESPE au titre de la formation continue. De cette manière, il sera possible d’organiser des formations ponctuelles pour les cadres d’une académie, par exemple à l’occasion d’une réforme pédagogique, ou pour d’autres types de publics ciblés comme les assistants pédagogiques ou les emplois d’avenir professeurs.
*
La Commission est saisie de l’amendement AC 755 de M. Rudy Salles.
M. Rudy Salles. Mon amendement vise à ce que l’ensemble des personnels composant les équipes des établissements scolaires puissent bénéficier d’une formation, initiale ou continue, dans le cadre des écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE).
M. le rapporteur. Ce sera le cas.
M. Rudy Salles. Alors, je le retire.
L’amendement AC 755 est retiré, de même que l’amendement AC 519 de Mme Barbara Pompili.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 756 de M. Rudy Salles.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AC 646 du rapporteur.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement AC 224 de M. Thierry Braillard.
La Commission en vient à l’amendement AC 225 de M. Thierry Braillard.
M. Thierry Braillard. Cet amendement s’intéresse au cas des enfants intellectuellement précoces : actuellement, il n’est rien fait pour eux.
M. le rapporteur. Avis défavorable : on ne va pas mentionner tous les modules de formation dans la loi !
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’article 49 modifié.
Article 50
Le statut de composante universitaire des ESPE
Le présent article tend à compléter l’article L. 713-1 du code de l’éducation, relatif aux composantes de l’université, afin de préciser que ce type d’établissement public d’enseignement supérieur peut comporter une école supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE).
Aujourd’hui, le code de l’éducation ne reconnaît que six types de composantes : les unités de formation et de recherche (UFR), les départements, les laboratoires et centres de recherche, les écoles ou les instituts. Les trois premières structures sont créées par délibération du conseil d’administration de l’université, après avis de son conseil scientifique, tandis que les deux dernières sont créées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d’administration de l’université et du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).
L’article L. 713-1 du code de l’éducation précise que ces composantes déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d’administration de l’université, et leurs structures internes. En outre, le président de l’université doit les associer à la préparation et à la mise en œuvre du contrat pluriannuel d’établissement qui lie ce dernier à l’État. Enfin, les composantes disposent, au sein même de l’université, d’une autonomie reconnue par la loi et qui s’incarne dans des conseils élus. Tel est le cas des UFR, qui sont non seulement administrées par un conseil élu, mais sont dirigées par un directeur, élu par ce même conseil (L. 713-3 du code de l’éducation).
Grâce au présent article, cette autonomie statutaire bénéficiera également aux ESPE, selon des modalités qui tiendront compte de leur spécificité et seront précisées par les articles L. 721-1 à L. 721-3 nouveaux proposés par l’article 51 du projet de loi.
*
La Commission adopte l’article 50 sans modification.
Article 51
Création, missions et organisation des ESPE
Cet article a pour objet de préciser les modalités de création et d’accréditation des écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE), ainsi que leurs missions, leur organisation et leur fonctionnement.
1. Des écoles d’un type nouveau
Les ESPE bénéficieront d’un statut adapté à leurs missions. D’une part, les écoles les exerceront dans un cadre arrêté conjointement par les ministres de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche. D’autre part, elles constitueront un nouveau type de composante universitaire (ou de département d’un établissement public de coopération scientifique – EPCS), dérogatoire au droit commun en ce qui concerne leur modalité de création et leur gestion.
a) Un statut adaptable au paysage universitaire local
Pour tenir compte des différences dans l’organisation et le paysage de l’enseignement supérieur selon les territoires, les ESPE seront constituées au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) ou au sein d’un pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) ayant adopté le statut d’établissement public de coopération scientifique (EPCS).
S’agissant du nombre d’écoles, l’objectif des ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche est de mettre en place 32 ESPE, soit une par académie. Ce maillage académique devra être effectivement mis en œuvre, mais il impliquera, dans certains sites, de réels efforts de coordination entre les différentes structures « formatrices ».
Ainsi, la région Île de France comptera trois ESPE, tandis que le reste des ESPE se partageront entre des sites mono et pluri-universitaires. Toutefois, dans les premiers (cas de l’académie de Limoges qui ne comporte qu’une seule université), comme dans les seconds (cas de l’académie de Lyon qui comporte 4 universités : les universités Claude Bernard Lyon 1, Lumières Lyon 2, Jean Moulin Lyon 3 et l’Université Jean Monnet Saint-Étienne), il n’y aura bien qu’une seule ESPE.
● Une structure partenariale
Les ESPE seront le fruit d’une collaboration étroite entre les deux ministères compétents. C’est le défaut d’une telle collaboration qui a rendu si difficile la mise en place d’un système efficace de formation des enseignants, tant en 1989, avec les IUFM, qu’en 2008 avec la réforme dite de la mastérisation.
Cette collaboration se traduira par :
– l’élaboration conjointe du cadre national des formations liées aux métiers du professorat et de l’éducation (prévue par l’article 49 du présent projet de loi) ;
– l’accréditation conjointe des écoles à l’issue d’une évaluation par les deux ministères, les modalités de cette procédure devant être définies dans un cahier des charges national ;
– la nomination du directeur de l’école par arrêté conjoint.
À cette collaboration au niveau national s’ajouteront les coopérations locales, nouées par les ESPE au sein de leur académie de rattachement. Ces écoles devront travailler en étroite relation avec les composantes « disciplinaires » des universités, ainsi qu’avec les établissements d’enseignement – écoles, collèges et lycées – accueillant des stagiaires.
b) Des écoles soumises à une procédure d’accréditation
Les ESPE seront accréditées conjointement par le ministère de l’éducation nationale et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, à l’issue d’une évaluation et pour une période ne pouvant excéder la durée du contrat liant l’État à l’établissement.
● Un dispositif d’accréditation qui a vocation à être généralisé dans l’enseignement supérieur
Les écoles inaugureront un dispositif dont la généralisation à l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur est attendue dans le cadre de la réforme préparée par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
En effet, le système actuel, fondé sur l’habilitation de la maquette de diplôme présentée par une université au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), ne permet pas toujours, en raison de son « formalisme », de juger de la qualité scientifique et pédagogique du projet d’établissement présenté par une équipe d’enseignants et de professionnels.
● Un dispositif critiqué mais qui a vocation à limiter la concurrence entre les établissements
La procédure d’accréditation est toutefois critiquée en ce qu’elle emportera habilitation de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopération scientifique ou des établissements d’enseignement supérieur publics partenaires à délivrer le diplôme national de master dans les domaines des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (master MEEF). Cette contestation a, dans une large mesure, motivé le rejet de l’avant-projet de loi de refondation de l’école par le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche le 8 janvier 2013 (25 voix contre et 5 pour) (261).
Selon ses opposants, ce dispositif aura pour effet de remettre en cause le principe de l’habilitation des diplômes par l’État et, au-delà, celui selon lequel « l’État a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires » (article L. 613-1 du code de l’éducation). Ce dernier date du Premier Empire (décret du 17 mars 1808) et a été repris par la loi du 18 mars 1880 sur la liberté de l’enseignement supérieur, qui réservait la collation des grades aux facultés et aux jurys de l’État. Il a été érigé en principe fondamental reconnu par les lois de la République par le Conseil d’État dans un avis rendu en 1984 sur la loi dite « Savary ».
Ce monopole a toujours été maintenu, mais il a fait l’objet d’aménagements, depuis plusieurs années, notamment au moment de la création du diplôme de master. Ainsi, l’arrêté du 25 avril 2002 créant ce diplôme national, qui confère le grade sanctionnant les masters « recherche » et les masters « professionnels », a autorisé les grandes écoles à demander l’habilitation à délivrer le diplôme national de master pour leurs projets de masters.
Par la suite, l’arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale, qui prévoit que ces écoles sont accréditées, après une évaluation nationale, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, dispose que « l’accréditation d’une école doctorale habilite l’établissement auquel elle appartient ou les établissements faisant l’objet d’une accréditation conjointe à délivrer le diplôme national de doctorat » (article 13).
L’accréditation détermine ainsi l’habilitation d’un établissement à délivrer le diplôme de docteur, une procédure que le présent article propose d’appliquer aux ESPE.
Outre le fait qu’elle est appelée à devenir la norme dans l’enseignement supérieur, l’accréditation aura une vertu majeure, celle de limiter les risques de concurrence entre les structures assurant aujourd’hui la formation des enseignants – les IUFM et les unités de formation et de recherche (UFR) n’ayant pas toujours coordonné, par le passé, leur offre de formation.
Ainsi, le dispositif proposé par le présent article permettra de veiller à la cohérence de ces formations, en lien avec les attentes de l’employeur – l’Éducation nationale – en ce qui concerne la carte des formations, la qualité des équipes de formateurs et le suivi des étudiants et de leur insertion professionnelle.
2. Le risque de la coquille vide ou moyennement pleine
L’étude d’impact du projet de loi indique que les ESPE auront un « rôle global de pilotage et de maîtrise d’ouvrage de la formation des enseignants, initiale et continue » et pourront également agir « en qualité de maître d’œuvre ».
Elle ajoute que « pour mener à bien leur mission, les ESPE font également appel à des maîtres d’œuvre au sein des universités et établissements associés à l’ESPE, ainsi qu’aux services académiques ». Le principe d’organisation des nouvelles écoles du professorat est bien d’être un projet partenarial entre toutes les universités de l’académie. Le projet pédagogique de ESPE sera donc conçu ab initio, en rassemblant l’ensemble des établissements partenaires puisque ceux-ci seront associés, dès le départ, à la mise en place et à la répartition des unités d’enseignements des masters « MEEF ».
Or, dans leur grande majorité, les écoles seront constituées au sein des universités. Universités aujourd’hui présidées par de vrais pilotes – les présidents –, disposant d’un « budget global » et qui se voient dotées par l’État de moyens calculés, pour l’essentiel, en fonction du nombre d’étudiants. En outre, la répartition de ces moyens est effectuée selon un système d’allocation, appelé « SYMPA », qui induit la concurrence entre les établissements.
Par conséquent, il n’est pas exclu que, dans certains sites, des stratégies d’établissement aboutiront à faire des ESPE une sorte de « paravent » vaguement fédéral des acteurs – pour l’essentiel, les unités de formation et de recherche disciplinaires (UFR) – qui, hier déjà, « préparaient » les étudiants au professorat de lycée et de collège dans des conditions qui n’étaient pas toujours optimales.
Bref, plus ça change, plus c’est la même chose, à part le fait que les IUFM disparaîtront pour de bon. Dans une version un peu moins pessimiste, l’offre de formation du projet porté par l’ESPE se présentera comme le cumul de l’offre existante des différentes composantes des établissements partenaires.
Pour ne pas décevoir les espérances que suscite la création des ESPE, ces composantes devront s’intégrer, sur tout le territoire, dans une logique d’école – et non de simple donneur d’ordres.
Des assurances devront donc être données sur ce sujet essentiel pour éviter qu’au final, les écoles ne se transforment en simple maillon entre l’employeur et les UFR pilotant les masters « MEEF ». Autrement dit, aux yeux du rapporteur, les ESPE devront être de vraies écoles, avec un « esprit d’école », s’appuyant sur des outils identifiés.
Pour cela, les écoles devront être, au minimum, en mesure de suivre les cohortes des étudiants se destinant aux métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation et de préparer leur insertion professionnelle. Pour le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, ce devra d’ailleurs être l’un des objectifs de l’accréditation que de contrôler que les ESPE auront bien une « traçabilité » de « leurs » étudiants.
L’exercice de cette mission ne pourra pas, cependant, se traduire par l’inscription des étudiants dans les écoles. Les composantes d’une université ne peuvent en effet exercer une telle prérogative qui appartient en propre aux établissements publics d’enseignement supérieur. En revanche, le mot école devant avoir un sens, il faudra prévoir une inscription pédagogique des étudiants au sein des ESPE.
3. Le dispositif proposé par le projet de loi
Le présent article propose de remplacer l’intitulé du titre II du livre VII du code de l’éducation, consacré aux « Établissements de formation des maîtres », par une série de dispositions regroupées sous le titre « Écoles supérieures du professorat et de l’éducation » : les articles L. 721-1, L. 721-2 et L. 721-3 nouveaux précisent ainsi le statut des ESPE, leurs modalités de création et d’accréditation, leurs missions et leur organisation.
a) Création et accréditation des ESPE (article L. 721-1 nouveau)
● Deux « berceaux » possibles pour les ESPE
Les ESPE seront constituées soit au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), une catégorie juridique d’établissements qui comprend les universités, soit au sein d’un établissement public de coopération scientifique.
Dans le premier cas, elles auront le statut d’une composante universitaire, telle que définie à l’article L. 713-1 du code de l’éducation.
Dans le second cas, elles feront partie d’un pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES). Ainsi que le précise l’étude d’impact du projet de loi, si la solution retenue est celle d’un département d’un PRES constitué sous la forme d’un établissement public de coopération scientifique, l’école disposera des mêmes prérogatives et des mêmes règles de fonctionnement que sa « consœur » constituée au sein d’une université.
On rappellera que les PRES permettent à plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d’enseignement supérieur et de recherche « de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens, notamment en matière de recherche (…) afin de conduire ensemble des projets d’intérêt commun » (article L. 344-1 du code de la recherche). Ainsi, cette structure, qui est créée par une convention entre les établissements et les organismes fondateurs, dispose « naturellement » de la souplesse nécessaire pour organiser le rapprochement entre les écoles et universités d’un même site ou d’un large bassin. C’est ce qui explique son succès puisqu’on comptait, en septembre 2012, 26 PRES regroupant près de 60 universités et plus de 60 autres types d’établissements (écoles d’ingénieurs ou de commerce, grands établissements, centres hospitaliers, instituts d’études politiques, etc.).
Les PRES peuvent en outre revêtir quatre formes, de la plus intégrée à la moins structurée, les trois premières étant dotées de la personnalité morale : l’établissement public de coopération scientifique (EPCS), la fondation de coopération scientifique, le groupement d’intérêt public (GIP) et l’association. À ce jour, sur les 26 PRES existants, 23 ont été constitués sous la forme d’un EPCS.
L’établissement public de coopération scientifique (EPCS)
● Le statut
L’EPCS assure la mise en commun des moyens et des activités que les établissements et organismes fondateurs et associés consacrent au PRES. À ce titre, la loi reconnaît explicitement sa compétence en matière de mise en place et de gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés participant au pôle, de coordination des activités des écoles doctorales, de la valorisation des activités de recherche menées en commun et de promotion internationale du pôle (article L. 344-4 du code de la recherche). D’autres compétences peuvent cependant s’ajouter selon la volonté des membres.
Le projet de création et les statuts d’un EPCS sont adoptés par l’ensemble des membres fondateurs et des membres associés qui ont vocation à y participer. L’EPCS est ensuite créé par décret qui en approuve les statuts, lesquels organisent les missions et le mode de fonctionnement de l’établissement, avec notamment les règles de représentation des membres associés et les règles de majorité.
L’EPCS est administré par un conseil d’administration qui détermine la politique de l’établissement, approuve son budget et en contrôle l’exécution. Son président, élu par le conseil d’administration en son sein, dirige l’établissement. Le recteur assiste ou se fait représenter aux séances du conseil et les décisions à caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après lui avoir été transmises.
Depuis la loi n° 2010-1536 du 13 décembre 2010, les EPCS peuvent être habilités à délivrer des diplômes nationaux dans les mêmes conditions que les établissements publics d’enseignement supérieur, c’est-à-dire par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et après avis du CNESER. Ce texte a également permis aux EPCS de se voir confier, par l’État, la maîtrise d’ouvrage de constructions universitaires.
● Les 23 EPCS
Université de Bordeaux ; Clermont Université ; Université Lille Nord de France ; Université de Lyon ; Université de Lorraine ; Université Nantes Angers Le Mans ; Université de Toulouse ; Université européenne de Bretagne ; ParisTech ; Université Paris Est ; UniverSud Paris ; PRES Limousin Poitou-Charentes ; Université de Grenoble ; PRES Sud de France ; Université Sorbonne Paris-Cité ; Centre - Val de Loire Université ; Sorbonne Universités ; Normandie Université ; Université du Grand Ouest parisien Université fédérale européenne Champagne Ardenne Picardie ; Collegium Ile-de-France ; Campus Condorcet ; PSL formation.
● La création et l’accréditation des écoles
● Les ESPE seront créées sur proposition du conseil d’administration de l’établissement – EPSCP ou EPCS – et accréditées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale, après avis du CNESER. Les modalités de cette accréditation seront définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale.
L’accord conclu le 24 janvier 2013 entre les ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche, d’une part, et la Conférence des présidents d’université, d’autre part, fixe au 12 mai prochain la date limite de retour des dossiers de projets d’accréditation des écoles.
● Cette accréditation ne vaudra que pour la durée du contrat liant l’État à l’établissement, mais elle pourra être renouvelée pour la même durée, après une évaluation nationale, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale, après avis du CNESER.
Le « couplage » contrat-accréditation n’appelle que deux commentaires :
– d’une part, le projet de chaque ESPE étant fortement lié au projet de son site, il est normal que la durée de l’accréditation soit liée à celle du projet de site, celui-ci étant formalisé par le ou les contrats ;
– d’autre part, ce lien est déjà prévu par l’arrêté du 7 août 2006 relatif aux formations doctorales, son article 6 disposant en effet que les écoles doctorales sont accréditées « dans le cadre du ou des contrats d’établissement, lorsqu’ils existent, et au maximum pour la durée des contrats ».
La contractualisation des liens État-établissements d’enseignement supérieur
C’est l’article 17 de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et aux responsabilités des universités qui a, pour la première fois, consacré le caractère obligatoire des contrats pluriannuels entre l’État et les établissements d’enseignement supérieur, la loi « Savary » du 26 janvier 1984 ayant inauguré cette politique.
En outre, de quadriennal, le contrat est devenu, en 2011, quinquennal et la contractualisation s’opère désormais en cinq vagues composées en moyenne de 30 établissements. Un cycle complet de négociation entre les établissements d’enseignement supérieur et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, ouvert en juillet 2009, s’est d’ailleurs achevé avec la signature, en mars 2012, des contrats de la vague B (2012-2016), laquelle concerne près de cinquante établissements. Trois contrats de PRES sont en cours d’élaboration dans cette vague : Université de Nantes-Angers-Le Mans ou UNAM (3 universités et l’École Centrale de Nantes), Université du Centre Val de Loire ou CVL (Orléans, Tours, ENSI de Bourges, ENI Val de Loire et ENS Nature et Paysage de Blois) et Université Européenne de Bretagne ou UEB (Brest, Bretagne Sud, Rennes 1, Rennes 2, IEP de Rennes, INSA de Rennes et ENS de chimie de Rennes) (262).
Le ministère de l’éducation nationale indique que sur la base d’une ESPE par académie, il y aura 4 ESPE dans la vague A et 6 dans la vague B et qu’au total, il y aura un peu plus une trentaine d’écoles réparties sur 5 vagues.
● Enfin, l’accréditation aura un rôle crucial à jouer dans le contrôle de la qualité de la politique de formation et de recherche mise en œuvre dans le cadre du projet d’école. En effet, selon l’étude d’impact, cette procédure permettra de s’assurer de :
– la capacité de l’ESPE à agir en maître d’ouvrage délégué d’une politique de formation des enseignants tant en formation initiale que continue, ainsi que par le recours à la validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
– la cohérence de la convention d’objectifs et de moyens avec les établissements partenaires en regard des missions confiées à l’ESPE ;
– la capacité de l’ESPE à agir en acteur de la recherche et à mobiliser les résultats de la recherche dans sa réflexion sur les contenus de formation.
● L’habilitation « déléguée »
Ainsi que cela a déjà été indiqué, l’accréditation de l’école emportera l’habilitation de l’EPSCP ou de l’EPCS ou des établissements d’enseignement supérieur publics partenaires mentionnés à l’article L. 721-2 nouveau du code de l’éducation, à délivrer le diplôme national de master dans les domaines des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF).
La notion de diplôme national sera donc maintenue, mais la décision d’accréditation, qui, on l’a vu au début du commentaire du présent article, sera plus globale dans son analyse, emportera les actes réglementaires d’habilitation à délivrer ce type de diplôme.
L’étude d’impact commente cette disposition en indiquant que « l’accréditation de l’ESPE, comme c’est le cas pour les écoles doctorales, induit les habilitations, pour les établissements partenaires de l’ESPE, à délivrer les diplômes de master dans le cadre d’une politique nationale de l’offre de formation ».
En effet, dans son approche, comme cela a déjà été indiqué, ce processus s’apparentera à celui des écoles doctorales où la décision d’accréditation d’une école de ce type emporte les habilitations à délivrer le doctorat pour tous les établissements partenaires du projet d’école doctorale.
Toutefois, l’accréditation d’une ESPE sera ciblée, c’est-à-dire qu’elle concernera certains secteurs (sciences, lettres, etc.) ou niveaux d’enseignement (professeur des écoles, professeur de lycée et de collège ou professeur de lycée professionnel). Autrement dit, toutes les ESPE ne seront pas accréditées pour organiser la formation à tel ou tel enseignement, celui d’italien par exemple.
En outre, si le principe retenu pour l’accréditation des ESPE sera similaire à celui mis en œuvre pour les écoles doctorales, il s’en démarquera dans les critères qui fonderont la décision d’accréditation. Ces modalités seront en effet réunies au sein d’un cahier des charges arrêté conjointement par les ministres en charge de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale. Ce dispositif, parmi d’autres, atteste le fait que la formation des maîtres restera bien l’affaire de l’État.
La procédure d’habilitation proposée par le gouvernement appelle d’autres remarques concernant sa nature publique et spécialisée :
– l’habilitation « déléguée » sera strictement bornée, puisqu’elle bénéficiera aux seuls établissements d’enseignement supérieur publics mentionnés par le présent article ;
– en outre, cette habilitation concernera surtout des établissements publics – les universités dans l’écrasante majorité des cas – d’ores et déjà habilités par l’État à délivrer des masters. À ce jour, compte tenu de l’état d’avancement de l’élaboration des dossiers d’accréditation, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche indique qu’il n’y a pas de cas où un PRES serait in fine le seul établissement d’un site donné habilité à délivrer le diplôme ;
– enfin, l’accréditation emportant habilitation « d’autres établissements d’enseignement supérieurs publics partenaires » sera de facto limitée dans son champ d’application. Ne seront en effet concernés que les établissements publics qui proposeront collectivement le projet d’ESPE.
Si l’on prend l’exemple de l’académie de Lyon, qui accueille quatre universités, ce devrait être le cas de tous ces établissements. Il sera également possible, selon les territoires, que d’autres établissements d’enseignement supérieur publics souhaitent apporter leur contribution à ce projet et soient donc partenaires : ainsi, sur le site de Lyon, ce pourrait être le cas de l’ENS de cette ville, notamment en raison de la présence, au sein de cet établissement, de l’Institut français d’éducation, très en pointe en matière de recherche pédagogique. De même, le Centre national d’enseignement à distance, le CNED, qui est établissement public à caractère administratif, pourrait être concerné par la procédure.
La formation des enseignants dans l’enseignement catholique
Cette formation repose sur les 7 masters « Métiers de l’enseignement et de la formation » (MEF) mis en place par les cinq universités ou instituts catholiques (Lille, Paris, Toulouse, Lyon et Bretagne Sud). Ces établissements sont « hors accréditation », cette procédure ne concernant que l’enseignement public. Actuellement, ils sont également « hors co-habilitation », un dispositif qui permet à des établissements partenaires de délivrer un seul et même diplôme.
Cette situation s’explique par le fait que la législation ne permet pas d’habiliter les établissements d’enseignement supérieur privés à délivrer des diplômes nationaux, l’article L 613-1 du code de l’éducation réservant à l’État le monopole de la collation des grades et des titres universitaires.
Certes, l’article L 613-7 institue un régime spécial « d’obtention de diplômes nationaux par les étudiants des établissements supérieurs privés », qui se matérialise par une convention entre un établissement privé et un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel permettant aux étudiants du premier, de passer devant un jury constitué par le second, les contrôles nécessaires à l’obtention d’un diplôme national.
Cependant, pour l’heure, les masters MEF de l’enseignement catholique n’en bénéficient pas, les diplômes de ses établissements étant validés par la procédure du jury rectoral. Celle-ci s’appuie, en grande partie, sur une note de service du 22 juillet 1987 qui demande aux recteurs de « veiller, à ce que les programmes et les modalités de contrôle des connaissances soient conformes à la réglementation établie sur le plan national ». Composé en majorité d’enseignants d’établissements d’enseignement supérieur publics, le jury établit les sujets d’examen portant sur le programme qui lui a été soumis et prononce la sanction des études des candidats.
b) Missions des ESPE (article L. 721-2 nouveau)
● Les actions de formation initiale et continue
Le « cœur de métier » des ESPE sera constitué de deux missions :
– l’organisation des actions de formation initiale des étudiants se destinant aux métiers du professorat et de l’éducation et des personnels enseignants et d’éducation stagiaires dans le cadre des orientations définies par l’État. À ce titre, les écoles auront vocation à être l’interlocuteur universitaire de référence du ministère de l’éducation nationale dans leur territoire et le lieu naturel d’interaction avec les écoles primaires, les établissements du second degré et les services académiques pour la mise en œuvre des stages et de l’alternance de la formation ;
– l’organisation des formations de préparation aux concours de recrutement dans les métiers du professorat et de l’éducation. Les concours préparés au sein des écoles seront donc le concours de recrutement de professeur des écoles, pour le premier degré, et le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (CAPES), le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique (CAPET), le certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel (CAPLP) et le concours de conseiller principal d’éducation (CPE) pour le second degré.
● Le tronc commun de formation
Le présent article précise que les actions de formation initiale à destination des étudiants et des personnels stagiaires comporteront « des enseignements communs et des enseignements spécifiques en fonction des métiers, des disciplines et des niveaux d’enseignement ».
C’est pourquoi, selon les éléments de réponse fournis au rapporteur, le cadre national des formations arrêté par les ministres de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur soulignera, dès ses dispositions générales préalables, l’importance qu’il y a à délivrer une culture commune à l’ensemble des enseignants et personnels d’éducation. Il précisera à cet effet un certain nombre de domaines que toutes les ESPE devront proposer aux étudiants se destinant aux métiers de l’enseignement et de l’éducation (connaissance des processus d’apprentissage, prise en compte de la diversité des publics, méthodes de différenciation pédagogique, processus d’orientation des élèves, méthodes d’évaluation dans la classe, conduite de classe, etc.).
Les enseignements dispensés au titre des ESPE s’articuleront donc autour de quatre composantes principales :
– des enseignements disciplinaires ;
– un tronc commun, reposant sur une approche générale de la pédagogie et de la didactique et des enseignements relatifs à la vie de l’établissement. Devant notre Commission, M. Jean-Yves Capul, sous-directeur à la direction générale de l’enseignement scolaire du ministère de l’éducation nationale, a indiqué que ces éléments de culture commune recouvriront « notamment les valeurs de la République, en particulier la laïcité, la logique du socle commun et de l’approche par compétences, les mécanismes d’apprentissage, la gestion de classe, l’adossement à la recherche, le travail en équipe, etc. », afin d’accroître ainsi « l’homogénéité et la cohérence des formations proposées aux enseignants et aux corps de l’éducation nationale » (263) ;
– une spécialisation en fonction du métier choisi par l’étudiant, plus particulièrement au cours de l’année de master 2 ;
– des enseignements orientés vers la pratique professionnelle, principalement pendant l’année de master 2, avec des séances permettant de se familiariser aux situations et activités de classe, et des stages en établissement scolaire, qui seront, dans un premier temps, des stages d’observation, puis de pratique accompagnée et, enfin, en responsabilité.
On rappellera que la dimension professionnelle de la formation, qui a déjà été évoquée dans le commentaire de l’article 49 du présent projet de loi, sera articulée sur les quatre semestres du master afin de permettre aux étudiants de bénéficier d’une entrée progressive dans le métier. Or, ainsi que le fait observer l’étude d’impact, ce mode de formation en alternance est largement mis en œuvre dans l’enseignement supérieur au niveau du master, les équipes universitaires disposant, en la matière, d’une expérience « capitalisable ». Il faudra toutefois s’assurer que le temps du stage en alternance, combiné à la préparation des cours par l’enseignant stagiaire, sera conciliable avec la préparation du diplôme.
● Les autres missions confiées aux écoles
Le présent article propose de confier d’autres missions aux ESPE, ce qui permettra de conforter leur rôle de pilotage et de maîtrise d’ouvrage déléguée de la formation initiale et continue des enseignants et personnels d’éducation.
Ces missions seront les suivantes :
– la participation à la formation initiale et continue des personnels enseignants-chercheurs et enseignants de l’enseignement supérieur ;
– la possibilité de conduire des actions de formation aux autres métiers de la formation et de l’éducation ;
– la participation à la recherche et à des actions de coopération internationale.
Ces dispositions appellent les commentaires suivants :
1° Les ESPE n’auront pas vocation à être le seul lieu de formation des enseignants-chercheurs. En effet, il existe déjà au sein des écoles doctorales des formations permettant aux doctorants, dont le projet professionnel est de devenir enseignant-chercheur, de trouver un appui à ce projet (tant sur la connaissance du métier que sur le volet formation à la pédagogie).
En outre, les enseignants-chercheurs en poste peuvent avoir recours à d’autres « formateurs », tels que les services de formation continue ou les services universitaires de pédagogie (SUP) des établissements d’enseignement supérieur. Par conséquent, dans ce domaine, le vrai enjeu sera de favoriser une meilleure coordination de l’ensemble de ces acteurs au profit d’une véritable politique de site à destination des futurs et actuels enseignants-chercheurs.
2° Les ESPE n’auront pas pour seule mission la formation en lien avec les métiers offerts par concours au sein de l’éducation nationale. En effet, ces écoles offriront à l’ensemble des étudiants – et notamment à ceux qui ne réussiront pas le concours – d’autres débouchés, par exemple dans le secteur de la formation, que ce soit au sein des collectivités territoriales ou dans les entreprises (formation de formateurs, éducateur, responsable de programmes de formation, etc.). Ainsi, elles permettront à tous les diplômés des masters « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » de trouver une insertion professionnelle de qualité.
3°La formation dispensée dans le cadre des ESPE s’appuiera sur une activité d’initiation à la recherche. Celle-ci est évidemment indispensable, car elle permet à l’étudiant de se sensibiliser à la démarche scientifique dans son champ disciplinaire et de relier ainsi des savoirs scientifiques aux pratiques professionnelles (sciences de l’éducation, sciences cognitives, etc.). Cette dimension devra être, comme le précise l’étude d’impact, « conçue en interaction avec l’observation et l’analyse des pratiques professionnelles ».
● Une mission supplémentaire d’encouragement à l’innovation
Le présent article dispose que les ESPE devront assurer, dans le cadre de leurs missions, le développement et la promotion de méthodes pédagogiques innovantes et former les enseignants à l’usage du numérique.
Ces écoles piloteront donc une formation qui devra mettre l’accent sur la pédagogie, « l’effet-maître » étant déterminant pour la réussite des élèves, en particulier les plus fragiles d’entre eux. C’est ce qu’a rappelé l’Institut Montaigne dans sa contribution à la concertation sur la refondation de l’école : « La recherche a montré qu’il était possible d’améliorer fortement le niveau des élèves en repensant les pédagogies utilisées. L’ « effet-maître » qui s’explique en grande partie par les choix réalisés par l’enseignant en matière de pédagogie et par son comportement en classe est identifié comme le facteur dominant du niveau des élèves : plus de 20 % de la progression d’un élève sur une année sont liés à son enseignant. Le travail sur la pédagogie est également un très bon moyen d’offrir à tous les élèves les mêmes chances de réussir. Ce sont surtout les élèves les plus faibles qui décrochent avec des professeurs moins performants, alors qu’ils réussissent presque aussi bien que les meilleurs élèves avec des enseignants performants » (264).
● Des relations contractualisées avec les partenaires
● Le présent article précise que les ESPE devront assurer leurs missions avec les autres composantes de l’établissement de rattachement et d’autres établissements d’enseignement supérieur, les services académiques et les établissements scolaires, dans le cadre de conventions conclues avec eux. Elles pourront aussi associer à leur action des professionnels intervenant dans le milieu scolaire.
L’étude d’impact précise, à cet égard, que l’ensemble des relations entre les ESPE et leurs partenaires devra donner lieu à une convention d’objectifs et de moyens unique, engageant toutes les parties, convention qui devra figurer dans le dossier d’accréditation.
Le bon fonctionnement de ce cadre coopératif sera donc déterminant pour la qualité des « aller-retour » entre l’ESPE et les écoles, les collèges et les lycées où les étudiants et les lauréats des concours effectueront leurs différents stages. Ces échanges devront permettre de conforter les enseignements disciplinaires, leur didactique et le « faire classe ».
● Par ailleurs, le dispositif proposé prévoit que les ESPE pourront associer à leur action des professionnels de la formation. L’intervention de praticiens des métiers visés par les étudiants et les stagiaires est en effet éminemment souhaitable. Cependant, afin d’en assurer la plus-value, il est indispensable que les professionnels concernés soient en contact réel avec ces métiers et, donc, qu’ils soient enseignants, maîtres formateurs, éducateurs, inspecteurs, etc.
Aussi, pour attirer des formateurs de terrain, et les meilleurs d’entre eux, le cadre universitaire devra-t-il devenir plus attractif à leur égard. L’université devrait donc reconnaître le certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur ou de professeur des écoles maître formateur, le CAFIPEMF, afin que ses titulaires puissent y enseigner – à cette fin, le relèvement de leur qualification par le recours à la validation des acquis de l’expérience (VAE) devrait être envisagé.
Parallèlement, la fonction de maître formateur pourrait être créée dans le second degré, tandis que l’élaboration d’un statut ou à tout le moins d’une charte de l’« établissement d’application » pour les écoles, collèges et lycées accueillant des stagiaires, étudiants ou fonctionnaires, devrait être à l’ordre du jour. Enfin, les conseillers pédagogiques, qui ne disposent pas, à la différence des professeurs des écoles maîtres formateurs, d’une décharge de service pour exercer leur activité de formation, devraient, idéalement, se voir accorder une telle mesure, même si celle-ci aurait un certain coût.
Au final, trois catégories de formateurs devront travailler ensemble dans les ESPE : les enseignants-chercheurs de l’enseignement supérieur, les professeurs des ex-IUFM, mais aussi les professionnels de terrain. C’est leur addition, leur coopération, qui devra permettre un regard « croisé » et favoriser le va-et-vient entre théorie et pratique, l’une nourrissant l’autre.
● Le présent article vise d’autres établissements que les établissements d’enseignement supérieur publics : d’une part, les établissements scolaires, d’autre part, les établissements d’enseignement supérieur sans autre précision, c’est-à-dire privés. Les services du ministère de l’éducation nationale justifient cette rédaction par le fait « qu’on peut envisager que, pour les métiers liés aux formations professionnelles (concours de recrutement de professeur de lycée professionnel), il puisse se tisser un partenariat avec les écoles d’ingénieur du site, voire des lycées technologiques ou professionnels. Des établissements privés pourraient ainsi apporter une contribution sans pour autant pouvoir délivrer le diplôme national qui est réservé aux établissements d’enseignement supérieur publics ».
c) Organisation des ESPE (article L. 721-3 nouveau)
Aux termes du I de la rédaction proposée de l’article L. 721-3 nouveau du code de l’éducation, les ESPE seront administrées par un conseil et dirigées par un directeur. Elles comprendront également un conseil d’orientation scientifique et pédagogique.
● Le conseil de l’école
– Effectifs du conseil de l’école
Le conseil de l’école ne pourra dépasser trente membres. Il comprendra des représentants des enseignants, qui seront en nombre au moins égal à celui des représentants des autres personnels et des usagers, et 30 à 50 % de personnalités extérieures. En outre, au moins la moitié des représentants des enseignants seront des enseignants-chercheurs.
En ce qui concerne le plafond d’effectifs proposé, on observera qu’il est plus restrictif que celui prévu par le décret n° 90-867 du 28 septembre 1990 qui a fixé les règles d’organisation et de fonctionnement des IUFM et a limité à quarante le nombre des membres des conseils d’administration de ces instituts.
Par ailleurs, les dispositions proposées s’inspirent de celles applicables aux autres composantes de l’université :
– les unités de formation et de recherche (UFR) sont en effet administrées par un conseil élu. L’effectif de ce conseil ne peut dépasser quarante membres et comprend des personnalités extérieures dans une proportion de 20 à 50 %. Dans tous les cas, les personnels enseignants doivent être en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants (article L. 713-3 du code de l’éducation) ;
– les instituts – dont les instituts universitaires de technologie (IUT) – et les écoles sont aussi administrés par un conseil élu. On retrouve, pour ces composantes, la règle selon laquelle l’effectif maximal du conseil est de quarante membres, mais, dans leur cas, cet organe comprend de 30 à 50 % de personnalités extérieures, un pourcentage identique à celui proposé pour les conseils des ESPE. Le principe selon lequel les personnels d’enseignement y sont en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants s’applique également à ces composantes (article L. 713-9 du code de l’éducation).
La proportion de personnalités extérieures proposée est donc celle applicable aux IUT. Ce choix paraît logique dans la mesure où les ESPE porteront une offre très ciblée, dont la vocation sera principalement l’insertion professionnelle immédiate. Ainsi composé, le conseil de ces écoles pourra tenir compte de cette finalité : en cela, les ESPE seront proches des IUT.
Quant à la « double règle » réservant la moitié des sièges aux représentants des enseignants, la moitié d’entre eux au moins devant être des représentants d’enseignants-chercheurs, elle est conforme à ce qui est en vigueur dans les composantes relevant de l’article L. 713-9 du code de l’éducation. La présence « paritaire » des enseignants-chercheurs avec les autres enseignants est en effet souvent considérée comme la garantie d’un lien avec la recherche. Or, au-delà de l’organisation des actions de formation, les ESPE participeront à la recherche.
– Des modalités d’élection des représentants des personnels fixées par décret
Le présent article précise qu’un décret fixera les règles relatives à la composition et au fonctionnement du conseil de l’école et du conseil d’orientation scientifique et pédagogique, en particulier les modalités de représentation des personnels, des personnes participant à des actions de formation organisées par l’école ainsi que de celles qui en bénéficient.
C’est donc par la voie réglementaire que seront précisées les conditions de constitution du corps électoral de l’ESPE. Si l’on se réfère aux règles traditionnelles de fonctionnement des composantes universitaires, ce corps électoral comprend, généralement, les personnels statutairement affectés à la composante et l’ensemble des personnes qui interviennent dans la formation pour un nombre jugé significatif d’heures d’enseignement. Les règles d’éligibilité seront, quant à elles, fixées par un arrêté.
– Durée du mandat
Les membres du conseil de l’école et du conseil d’orientation scientifique et pédagogique seront désignés pour la durée de l’accréditation, c’est-à-dire pour cinq ans, à l’exception des représentants des usagers qui sont désignés pour une durée moindre fixée par décret.
Ainsi, la durée des mandats des représentants des personnels sera alignée sur la durée classique des membres des conseils des composantes universitaires (quatre ou cinq ans). Dans le même temps, c’est la première fois qu’il est proposé de lier le début et la durée d’un mandat à celui d’un contrat d’établissement. Cependant, une telle disposition est justifiée, car elle permettra de faire coïncider le projet pédagogique des ESPE, qui s’inscrira dans le cadre des contrats d’établissement, et l’engagement des personnels dans les conseils.
Par ailleurs, les usagers n’ayant pas vocation à garder le statut d’étudiant sur une telle durée, il est d’usage, dans toutes les instances de l’enseignement supérieur, de prévoir pour eux un mandat réduit de un ou deux ans. Ainsi, ce seront des représentants « réellement » usagers de chaque ESPE qui seront élus au conseil de l’école.
Le directeur sera également nommé pour la durée de l’accréditation par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale, sur proposition du conseil de l’école, cette règle s’inspirant des dispositions de l’arrêté du 7 août 2006 relatif aux formations doctorales.
– Les personnalités extérieures
Le présent article prévoit que le recteur de l’académie désigne certaines des personnalités extérieures et que le président du conseil est élu parmi ces personnalités extérieures. Il s’agit d’une novation qui n’a pas manqué d’être critiquée.
Il est vrai que cette « main du recteur » paraît en porte-à-faux avec l’esprit de plusieurs autres dispositions qui tendent à formaliser la collaboration « paritaire » entre les ministères de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale (accréditation conjointe de l’école et nomination conjointe de son directeur).
En réalité, il faut y voir la volonté de marquer le fait que les personnalités extérieures et les présidents des conseils des écoles auront comme mission essentielle de veiller à la compatibilité de la politique de formation des ESPE avec les attentes de l’employeur, c’est-à-dire de l’éducation nationale.
– Les pouvoirs du conseil d’école
En vertu du II de l’article L. 721-3 nouveau du code de l’éducation, les conseils administrant les ESPE exerceront les compétences suivantes :
– ils adopteront les règles relatives aux examens et les modalités de contrôle des connaissances ;
– ils adopteront le budget de l’école et approuveront les contrats pour les affaires intéressant l’école ;
– ils soumettront aux conseils d’administration des EPSCP ou des EPCS la répartition des emplois et seront consultés sur les recrutements.
À titre de comparaison, on rappellera que les conseils d’administration des universités votent le budget de ces établissements, adoptent les règles relatives aux examens, approuvent les accords et les conventions signés par les présidents et fixent la répartition des emplois qui leur sont alloués par les ministres compétents (article L. 712-3 du code). Les dispositions proposées s’en inspirent, tout en les adaptant au fait que les ESPE s’inséreront dans un ensemble plus large, celui d’un EPSCP ou d’un PRES, qui dispose, dans le cas des universités, de compétences décisionnelles, notamment en matière de gestion des ressources humaines et financières.
C’est la raison pour laquelle les ESPE n’approuveront pas de rapport d’activité ou de contrat d’établissement, autant de compétences attribuées aux conseils d’administration des universités au titre de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et aux responsabilités des universités (LRU).
● Le directeur de l’école
En application du III de l’article L. 721-3 nouveau du code de l’éducation, les pouvoirs des directeurs des ESPE seront étendus, mais respectueux du positionnement des écoles au sein de leur « établissement-mère » ou du partenariat associant différents établissements publics :
– les directeurs prépareront les délibérations du conseil et en assureront l’exécution. Ils auront autorité sur l’ensemble des personnels. Ces trois compétences seront identiques à celles actuellement attribuées par l’article L. 713-9 du code aux directeurs des instituts et écoles faisant partie des universités, notamment ceux des instituts universitaires de technologie (IUT). Par conséquent, l’autorité du directeur de l’ESPE devra s’inscrire dans le cadre général des prérogatives du président de l’université, à l’image de ce qui existe déjà pour les autres composantes ;
– ils auront qualité pour signer, au nom de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) ou de l’établissement public de coopération scientifique (EPCS), les conventions relatives à l’organisation des enseignements. Toutefois, ces instruments ne pourront être exécutés qu’après avoir été approuvés par le président de l’EPSCP ou de l’EPCS et votées par le conseil d’administration de l’établissement ;
– enfin, les directeurs proposeront une liste de membres des jurys d’examen au président de l’EPSCP ou de l’EPCS pour les formations soumises à examen dispensées dans les ESPE et, le cas échéant, aux présidents des établissements partenaires.
Cette dernière disposition est motivée par le fait que l’école sera chargée de la mise en place d’une offre de formation assurée par l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur publics partenaires, c’est-à-dire les universités de l’académie. Il est donc logique que la fonction de directeur de l’école implique la mise en cohérence de la composition des jurys des examens liés à cette formation. Cette compétence est particulièrement importante dans le cas des sites pluri-universitaires, car, par exemple, lorsque les universités d’une académie délivreront le diplôme de master, il y aura, formellement, un jury par établissement pour traiter les étudiants inscrits dans chaque établissement.
Quant à la possibilité offerte au directeur d’un ESPE de signer les conventions relatives à l’organisation des enseignements, elle s’inspire des dispositions organisant les unités de formation et de recherche (UFR) de médecine, de pharmacie et d’odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations – dispositions reprises aux articles L. 713-4 à 713-8 du code de l’éducation.
Ces conventions régiront donc les accords entre les partenaires des ESPE. Elles définiront de cette manière, quand cela sera nécessaire, les engagements des uns et des autres, comme c’est déjà le cas pour certaines écoles doctorales ou quand des masters sont co-habilités.
● Le conseil d’orientation scientifique et pédagogique
Le IV de l’article L. 721-3 nouveau du code de l’éducation précise que le conseil d’orientation scientifique et pédagogique de l’ESPE contribuera à la réflexion sur les grandes orientations relatives à la politique partenariale et aux activités de formation et de recherche de l’école.
Comme toute formation, celle des enseignants devra être constamment remise en question pour tenir compte des avancées de la recherche et de l’évaluation. Le conseil d’orientation scientifique et pédagogique sera donc le lieu privilégié de cette réflexion sur « l’ingénierie » de la formation et jouera ainsi, d’une certaine manière, le rôle des conseils de perfectionnement des filières professionnelles.
d) Le budget des ESPE
Le V de l’article L. 721-3 nouveau du code de l’éducation prévoit que les écoles disposeront d’un budget propre au sein du budget de l’EPSCP ou de l’EPCS.
À première vue, le dispositif proposé ressemble à celui dont bénéficient, en application de l’article L. 713-9 du code de l’éducation, les écoles et instituts faisant partie des universités, dont les instituts universitaires de technologie (IUT). D’une part, le directeur de l’institut est ordonnateur des recettes et des dépenses ; d’autre part, les instituts et les écoles « disposent, pour tenir compte des exigences de leur développement, de l’autonomie financière », les ministres compétents pouvant « leur affecter directement des crédits et des emplois attribués à l’université ».
L’autonomie de ces composantes repose donc sur le « fléchage » des crédits attribués à ces composantes par le ministère chargé de l’enseignement supérieur. Cependant, l’attribution, aux universités qui accèdent à l’autonomie renforcée prévue par la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (« LRU »), d’un budget global dans lequel les moyens ne sont plus pré-affectés a conduit à mettre fin à cette pratique et à encourager le « grignotage » des crédits des IUT par certains présidents d’université.
Ainsi qu’a pu le constater notre collègue Mme Françoise Guégot en 2009, « l’autonomie de gestion des IUT, qui s’appuie sur un article du code de l’éducation, formellement intouché par la loi « LRU », ne peut plus s’appuyer sur ce qui était, sans doute, son véritable socle, à savoir le fléchage des moyens, rendu impossible par le budget global. Une « brèche » étant ouverte dans le statut dérogatoire des IUT, certains responsables d’université s’y sont engouffrés » (265).
C’est cette dérive qu’il convient, à tout prix, d’éviter afin que les ESPE ne se transforment en coquille vide. D’où l’importance de la notion de « budget propre » dont bénéficieront les ESPE – à la différence des écoles et instituts faisant partie des universités, qui jouissent d’une « autonomie financière ».
Ce budget propre sera certes intégré au budget de l’établissement dont l’école fera partie, mais les ministres compétents pourront lui affecter directement des crédits et des emplois attribués à l’établissement. Le directeur de l’école sera en outre ordonnateur des recettes et des dépenses. Enfin, le budget de l’école sera approuvé par le conseil d’administration de l’établissement, qui pourra l’arrêter lorsqu’il n’est pas adopté par le conseil de l’école ou n’est pas voté en équilibre réel.
Ainsi, les ESPE, comme toute composante universitaire, disposeront d’un budget propre qui sera intégré au budget de l’établissement public au sein duquel l’école sera constituée. Par conséquent, dans la pratique, il n’y aura pas d’autonomie financière des écoles en ce sens qu’elles bénéficieront, pour leur activité, des nombreux apports indirects des différentes universités partenaires ou du rectorat. En particulier, les ESPE ne pourront pas avoir un budget leur permettant d’assumer la totalité des frais d’infrastructure, mais elles pourront s’appuyer sur les services communs des établissements partenaires.
Toutefois, les ESPE, contrairement aux IUT, mettront en œuvre un projet de site. Leur budget propre ne sera donc qu’une partie du « budget du projet » qu’elles porteront.
Par exemple, dans un site pluri-universitaire, une ESPE composante de l’université X bénéficiera, pour conduire son projet, de l’apport de personnels de l’ensemble des EPSCP partenaires, apport qui sera valorisé dans le budget du projet de l’école, mais ne sera pas intégré au budget de cette composante de l’université X. La comparaison avec les IUT trouve, ici, ses limites.
Pour toutes ces raisons, l’identité d’école des ESPE doit s’appuyer sur leur budget de projet, qui doit être reconnu. Ainsi, cet outil, qui retracera l’ensemble des moyens mobilisés sur un site au titre de la formation initiale et continue des étudiants et des personnels enseignants et d’éducation, stagiaires ou titulaires, pourra être présenté devant le conseil de l’école, par le directeur de la nouvelle composante.
4. Les améliorations apportées par la Commission
● En ce qui concerne les missions des ESPE, la Commission a d’abord précisé, à l’initiative du rapporteur, que les enseignements communs visent à permettre l’acquisition d’une culture professionnelle partagée. Autrement dit, le « tronc commun » de la formation initiale devra être conçu en fonction d’une perspective allant au-delà de la facilitation « technique » de la prise de poste, qui sera celle du rapprochement des cultures professionnelles des deux degrés de l’enseignement scolaire.
Elle a ensuite ajouté deux nouvelles missions aux écoles :
– d’une part, l’organisation de formations de sensibilisation à l’égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations. Cette mission a été confiée aux IUFM par la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, un texte d’origine parlementaire qui résulte des travaux de la mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, présidée et rapportée en 2008-2009, respectivement, par Mme Danielle Bousquet et M. Guy Geoffroy ;
– d’autre part, la préparation des futurs enseignants et personnels d’éducation aux enjeux du socle commun et à ceux de la formation tout au long de la vie. Il est en effet indispensable que les missions des écoles se réfèrent à l’outil structurant de la scolarité obligatoire, qui doit faire partie de « l’ADN » des personnels de l’éducation nationale, et qu’elles sensibilisent les futurs enseignants au fait que ce métier peut-être synonyme de deuxième carrière et d’évolution professionnelle.
● Puis la Commission, sur proposition du rapporteur, a adopté une disposition indiquant que les écoles prennent en compte, pour délivrer leurs enseignements, les technologies de l’information et de la communication et forment les étudiants et les enseignants à l’usage pédagogique des outils et ressources numériques.
● Enfin, comme cela a déjà été souligné, le présent article prévoit que l’accréditation des ESPE entraîne l’habilitation des universités ou des PRES au sein desquels sont constituées les écoles ou des établissements d’enseignement supérieurs publics partenaires de l’école à délivrer les masters « MEEF ». Il précise par ailleurs que les ESPE assurent leurs missions avec les composantes de l’université de rattachement ou d’autres établissements d’enseignement supérieur – qui peuvent donc être publics ou privés, le texte n’étant pas assez précis à ce sujet. La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur indiquant sans ambiguïté que les établissements partenaires d’une école sont des établissements publics d’enseignement supérieur.
*
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AC 46 et AC 47 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AC 647 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit de préciser que les enseignements communs dispensés au cours des actions de formation initiale des ESPE permettent l’acquisition d’une culture professionnelle partagée.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine l’amendement AC 523 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. Cet amendement vise à souligner que la formation des enseignants repose sur deux piliers : les enseignements disciplinaires et didactiques, mais aussi les enseignements en pédagogie et en sciences de l’éducation.
M. le rapporteur. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
La Commission est saisie de l’amendement AC 183 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. L’amendement est défendu.
M. le rapporteur. Ces précisions ne relèvent pas du domaine de la loi. Elles ont vocation à figurer dans le cahier des charges de la formation des maîtres. Avis défavorable.
L’amendement est retiré.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AC 526 de Mme Barbara Pompili.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement AC 527 de Mme Barbara Pompili.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte ensuite successivement l’amendement AC 525 de Mme Barbara Pompili et l’amendement AC 438 de Mme Martine Martinel.
Puis elle en vient à l’amendement AC 134 de Mme Claudine Schmid.
Mme Claudine Schmid. Cet amendement vise à favoriser la relation entre le monde éducatif et le monde professionnel. Il prévoit que les ESPE organisent des actions de formation et de sensibilisation permettant aux enseignants d’améliorer leur connaissance du monde économique et professionnel, afin de les préparer à exercer leur mission d’orientation auprès des élèves. Il est indispensable que cette sensibilisation intervienne dès la formation initiale des enseignants.
M. le rapporteur. Avis défavorable. La loi n’a pas à se substituer au cahier des charges de la formation des maîtres, où ces prescriptions ont vocation à figurer.
Mme Claudine Schmid. Nous n’avons aucune certitude qu’elles y figureront bien. Je maintiens mon amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement AC 226 de M. Thierry Braillard.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AC 48 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AC 648 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser que les ESPE prennent en compte, pour délivrer leur enseignement, les technologies de l’information et de la communication, et forment les enseignants à l’usage pédagogique des outils et ressources numériques. C’est la conséquence de l’article 10 du présent projet de loi, que nous avons adopté.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle en vient à l’amendement AC 529 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. Il est défendu.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Ces éléments ont vocation, là encore, à figurer dans le cahier des charges de la formation des maîtres.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements de précision AC 49, AC 649 et AC 650 du rapporteur.
En conséquence de l’adoption de l’amendement AC 650, les amendements AC 135 et AC 136 de Mme Claudine Schmid deviennent sans objet.
La Commission est saisie de l’amendement AC 530 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. Il est défendu.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Ces précisions ont vocation, une fois de plus, à figurer dans le cahier des charges de la formation des maîtres. Il n’est pas nécessaire de les inscrire dans la loi.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AC 436 de Mme Sandrine Doucet.
M. Michel Ménard. Cet amendement vise à préciser que les ESPE « assurent leurs missions dans les territoires où exercent les futurs enseignants qu’elles forment, en lien avec les collectivités territoriales et les services de l’éducation nationale ». Il convient d’assurer une répartition homogène des ESPE, dans une logique d’aménagement du territoire.
M. le rapporteur. C’est le modèle des anciennes écoles normales : on enseignait dans le département où on avait été formé. Je comprends votre préoccupation, mais cette règle serait difficile à appliquer. Elle entraverait la mobilité géographique et risquerait de pénaliser certains jeunes enseignants au moment de leur première affectation. Avis défavorable.
L’amendement est retiré.
La Commission en vient à l’amendement AC 437 de Mme Martine Faure.
Mme Valérie Corre. Aux termes de cet amendement, les conseils prévus à l’article L. 721-3 du code de l’éducation – le conseil chargé d’administrer l’ESPE et le conseil d’orientation scientifique et pédagogique – devraient être composés selon le principe de parité entre les hommes et les femmes.
M. le rapporteur. C’est un excellent principe, mais quasi inapplicable en l’espèce. Autant nous pouvons imposer la parité dans les conseils nationaux – nous l’avons fait pour le Conseil supérieur des programmes et le Conseil national d’évaluation du système éducatif –, autant elle serait très difficile à mettre en œuvre dans les conseils internes aux ESPE. Leur composition doit aussi tenir compte des domaines de compétence. Si l’on poussait la logique jusqu’au bout, il faudrait même étendre la parité aux conseils d’école. Je vous invite à retirer votre amendement.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AC 50 du rapporteur.
Puis elle est saisie de l’amendement AC 531 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. Cet amendement prévoit que les ESPE disposent de leur propre budget, afin qu’elles conservent leur autonomie par rapport à leur université de rattachement.
M. le rapporteur. C’est un point très important. L’ESPE sera certes une composante de l’université, mais elle sera une école, non pas un centre ou un institut. Il est souhaitable que s’y développe un esprit d’école. Cela passe en effet par l’autonomie budgétaire. Je souhaite que nous en débattions en séance publique et que le ministre de l’éducation nationale prenne des engagements à ce sujet. Je déposerai donc, pour notre prochaine réunion de Commission au titre de l’article 88 du Règlement, un amendement qui devrait satisfaire votre préoccupation. Je vous invite à retirer le vôtre.
M. Benoist Apparu. La Conférence des présidences d’universités et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche apprécieront cet amendement. Nous risquons de susciter des demandes reconventionnelles de la part des instituts universitaires de technologie (IUT), qui demanderont également à disposer de leur propre budget. Vous sapez le principe même de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités !
Mme Barbara Pompili. Je retire cet amendement et le déposerai à nouveau pour que nous ayons ce débat en séance publique.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement AC 159 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. Aux termes de cet amendement, le conseil chargé d’administrer l’ESPE devrait comprendre non pas seulement 30 à 50 % de personnalités extérieures comme cela est prévu, mais 50 %. Il est en effet nécessaire que le nombre de celles-ci soit significatif pour assurer la bonne marche de ces écoles.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Toutes les composantes des universités – les ESPE en sont une – sont administrées par des conseils qui comprennent 30 à 50 % de personnalités extérieures. Seuls les IUT font exception à cette règle.
L’amendement est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 532 de Mme Barbara Pompili.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AC 51 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 184 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. L’amendement est défendu.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Votre amendement détaille la composition des conseils chargés d’administrer les ESPE, ce qui n’est pas illégitime, mais n’est pas du niveau de la loi.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement de précision AC 52 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AC 160 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. Aux termes de cet amendement, le directeur de l’ESPE serait nommé sur proposition non seulement du conseil de l’école, mais aussi du président de l’université à laquelle l’école est rattachée.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements de précision AC 53, AC 54, AC 55 et AC 56 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 51 modifié.
Article 52
Affectation aux ESPE des biens des IUFM
Cet article a un double objet : procéder à plusieurs coordinations dans le code de l’éducation et préciser la date d’affectation des biens meubles et immeubles des IUFM aux futures écoles supérieures du professorat et de l’éducation.
Le I prévoit de compléter l’intitulé du chapitre II du titre II du livre VII du code de l’éducation – relatif aux droits et obligations de l’État concernant les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) – par une référence aux écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE).
Le III propose de compléter l’article L. 722-1 du même code, relatif aux biens des IUFM, par un alinéa prévoyant qu’à compter du 1er septembre 2013, ces biens seront affectés aux écoles supérieures du professorat et de l’éducation.
Cet article dispose en effet que, pour l’accomplissement des missions de formation définies à l’article L. 721-1, les biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à leurs écoles annexes sont affectés aux IUFM.
Les autres paragraphes proposent de procéder à différentes coordinations afin de :
– remplacer aux articles L. 722-1 et L. 722-16, respectivement consacrés aux biens des IUFM et à la possibilité pour le président du conseil général d’utiliser, après avis du conseil d’administration de l’institut, les locaux concernés pour l’organisation d’activités à caractère éducatif, sportif ou culturel, la référence « L. 721-1 » par la référence « L. 721-2 », ce dernier article devant définir les missions des ESPE (II) ;
– remplacer à l’article L. 722-16 la mention du conseil d’administration des IUFM par celle du conseil de l’ESPE (IV) ;
– de substituer à l’article L. 722-17 relatif à la prise en charge par la collectivité territoriale de Corse des biens meubles et immeubles affectés aux IUFM la référence à ces instituts par une référence aux ESPE (V).
*
La Commission adopte successivement l’amendement de précision AC 57 et l’amendement de conséquence AC 58 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 52 modifié.
Cet article vise à remplacer, au sein de l’article L. 932-3 du code de l’éducation relatif à la formation des enseignants des établissements d’enseignement technologique, la mention d’institut universitaire de formation des maîtres par celle d’école supérieure du professorat et de l’éducation.
*
La Commission adopte l’article 53 sans modification.
Article 54
Modification du code de la recherche
Le présent article a pour objet de procéder à plusieurs modifications dans le code de la recherche pour tirer les conséquences de la création des ESPE. Il est ainsi proposé d’ajouter la formation des personnels enseignants et d’éducation aux missions des établissements publics de coopération scientifique (EPCS) définies à l’article L. 344-4 lorsqu’ils comprennent une ESPE et de supprimer une référence aux instituts de formation des maîtres à l’article L. 312-1.
Par ailleurs, le présent article propose de mentionner dans le code de la recherche la nouvelle possibilité, pour un EPCS, de comprendre une ESPE, en modifiant à cet effet l’article L. 344-1 relatif aux pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES).
On rappellera qu’aux termes de cet article, plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d’enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, y compris les centres hospitaliers universitaires, et dont au moins un EPSCP, peuvent décider de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens, notamment en matière de recherche, dans un PRES afin de conduire ensemble des projets d’intérêt commun. Par ailleurs, ces pôles peuvent être dotés de la personnalité morale, notamment sous la forme d’un groupement d’intérêt public ou d’un EPCS.
La possibilité prévue par le présent projet de loi de créer des ESPE sous la forme de la composante d’un EPCS nécessite par conséquent d’élargir les missions de cet établissement qui gère un PRES, lequel n’a reçu de la loi aucune compétence en matière de formation des enseignants.
Dans cet esprit, le présent article propose de modifier l’article L. 344-4 du code de la recherche, relatif aux missions qui peuvent être assurées par un EPCS, afin d’ajouter aux quatre compétences reconnues actuellement (la gestion des équipements partagés entre les membres, la coordination des activités des écoles doctorales, la valorisation des activités de recherche et la promotion internationale du pôle), la formation des personnels enseignants et d’éducation lorsque cet établissement comprend une ESPE.
*
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AC 59 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 54 modifié.
La Commission est saisie de deux amendements portant articles additionnels après l’article 54.
Elle examine d’abord l’amendement AC 533 de Mme Barbara Pompili.
Mme Barbara Pompili. Il est défendu.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Tout fonctionnaire bénéficie d’un droit individuel à la formation.
La Commission rejette l’amendement.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement AC 534 de Mme Barbara Pompili.
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 55
Élargissement du champ de l’exception pédagogique
Le présent article a pour objet de simplifier l’application de l’« exception pédagogique » prévue par l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle (CPI) qui permet, contre rémunération forfaitaire, la représentation ou la reproduction d’extraits d’œuvres de l’esprit à des fins d’utilisation dans le cadre de l’enseignement sans avoir à demander préalablement l’autorisation aux auteurs ou aux ayants droit.
1. Le droit actuel
La loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins dans la société de l’information (loi « DADVSI »), prise pour la transposition de la directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001, a institué une exception au droit d’auteur et aux droits voisins spécifique aux activités d’enseignement et de recherche.
Aux termes du e) du 3° de l’article L. 122-5 du CPI, cette exception concerne « la représentation ou la reproduction d’extraits d’œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l’utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie. »
Il existe donc de nombreuses exceptions à l’exception. Sont ainsi exclues les œuvres conçues à des fins pédagogiques, les partitions de musique et les œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit.
Ce texte ne suffisant pas à lui seul, c’est sur le mode conventionnel que les parties se sont accordées, d’une part, pour définir les modalités d’application de l’exception et, d’autre part, pour autoriser d’éventuels usages supplémentaires excédant son champ.
Trois accords sont actuellement en vigueur avec les sociétés de gestion concernées :
- un accord du 1er février 2012, signé pour la période 2012-2013, qui concerne l’utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche. Cet accord a été conclu avec le centre français d’exploitation du droit de copie (CFC), la société des arts visuels associés (AVA) et la SEAM (société des éditeurs et des auteurs de musique) ;
- un accord du 4 décembre 2009, reconduit pour la période 2012-2014, avec la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) pour l’interprétation vivante d’œuvres musicales, l’utilisation d’enregistrements sonores d’œuvres musicales et l’utilisation de vidéos de musique ;
- et un accord du 4 décembre 2009, reconduit pour la période 2012-2014, signé avec la société des producteurs de cinéma et de télévision pour l’utilisation d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles (PROCIREP).
Le régime de l’exception combinée à ces accords est particulièrement complexe à appréhender et à mettre en œuvre par les enseignants. Elle impose de tenir compte du genre artistique et du support de l’œuvre dont l’utilisation est envisagée.
À titre d’exemple, les enseignants ne peuvent utiliser que des extraits d’œuvres, étant précisé que cela correspond à cinq pages consécutives pour les livres, mais à seulement quatre pages pour les manuels… Et ceci ne vaut qu’à la condition que ces quatre ou cinq pages ne représentent pas plus de 5 % de l’œuvre dont ils sont extraits et pas plus de 20 % du support pédagogique dans lequel ils sont incorporés… On mesure donc la complexité du travail de vérification pour un enseignant.
Par ailleurs, pour chaque œuvre utilisée, les professeurs sont censés vérifier si les titulaires de droits concernés sont bien membres des sociétés de gestion collective signataires des accords. Cela vaut pour un livre, mais aussi pour chaque image, photographie, illustration figurant dans ce livre, ce qui nécessite des vérifications extrait par extrait. Ainsi, le texte de l’accord conclu avec le CFC, l’AVA et la SEAM est-il en grande partie inapplicable pour l’activité pédagogique.
Toutes ces difficultés de mise en œuvre de l’exception et de ses accords d’application représentent une entrave évidente au développement des usages du numérique dans les écoles et les établissements scolaires
Un enseignant ne peut utiliser avec ses élèves ou ses étudiants que des œuvres éditées sur support papier, sauf pour les images qui peuvent être « nativement numériques ». Les seuls fichiers numériques autorisés sont ceux qui, pour un extrait d’œuvre par exemple, résultent d’un scannage ou d’une nouvelle saisie par l’enseignant lui-même. Il lui est par exemple impossible d’utiliser la version numérique d’un roman contemporain.
Si les outils numériques présents aujourd’hui dans les classes (de la capture d’écran sur tout ordinateur au tableau numérique interactif) permettent à tout enseignant de capturer-copier-coller tout ou partie d’un document numérique très facilement, l’usage en classe de ces ressources n’entre pas dans le cadre légal.
Les accords n’indiquent pas si l’enseignant peut constituer légalement son support de préparation de cours sur son ordinateur personnel, s’il peut envoyer un support d’activité pédagogique ou un corrigé par courriel aux élèves, ni si les élèves peuvent intégrer les éléments sur leur propre matériel, l’emporter à la maison sur une clé USB pour garder une trace personnelle de l’activité pédagogique.
Il convient de noter que si la directive 2001/29/CE du 22 mai 2011 sur le droit d’auteur dans la société de l’information a tenté d’harmoniser le régime des exceptions au droit d’auteur, notamment l’exception pédagogique, le droit français est le plus restrictif d’Europe en la matière.
De nombreuses réglementations européennes (en Allemagne par exemple) ignorent la distinction entre les différents supports (papier, numérique) pour les œuvres écrites, à condition que leur utilisation soit réservée aux seuls élèves et aux enseignants.
2. Les modifications proposées par le projet de loi
L’élargissement de l’exception pédagogique fait partie des pistes importantes d’adaptation du droit d’auteur avancées par la mission présidée par M. Pierre Lescure sur l’acte II de l’exception culturelle dans son bilan d’étape.
Le présent article, par une modification de l’article L 122-5 du CPI, se limite à proposer, d’une part, d’élargir l’exception pédagogique aux sujets d’examen et de concours organisés dans le prolongement des enseignements et, d’autre part, de permettre aux enseignants d’utiliser des extraits d’œuvres disponibles via une édition numérique de l’écrit.
Le 1° tend ainsi à supprimer la référence aux « œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit ». Outre que leur définition pose problème, leur exclusion interdit l’utilisation de fichiers numériques intégrant tout ou partie d’une œuvre. Comme il a été indiqué précédemment, les seuls fichiers numériques autorisés sont ceux qui, pour un extrait d’œuvre par exemple, résultent d’un scannage ou d’une nouvelle saisie par l’enseignant, ce qui n’apparaît guère pertinent.
Il convient d’ailleurs de noter qu’avec le développement continu des offres numériques, toutes les œuvres écrites vont être progressivement mises en format numérique si bien que les limitations prévues conduiront rapidement à vider de sa substance la loi sur l’exception pédagogique.
Il est donc proposé la suppression de l’exception à l’exception pédagogique en faveur des œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit (ORENE). L’usage de ces publications écrites numériques s’inscrira dans le cadre défini par l’article L. 122-5 du CPI et par les accords sectoriels susmentionnés, qui devront venir repréciser les contours de la notion d’extrait dès lors notamment que ces œuvres sous format numérique ne sont pas toujours paginées.
Est en revanche maintenue l’exception que représentent les « œuvres conçues à des fins pédagogiques » (manuels scolaires notamment, de façon à éviter leur usage en classe, avec un tableau blanc interactif notamment, lorsque les droits n’ont pas été acquis).
Le 3° du présent article tend à étendre l’exception pédagogique à l’élaboration et à la diffusion de sujets d’examen ou de concours organisés dans la prolongation des enseignements. Est ici visée la mise en ligne des sujets d’examens et de concours organisés dans la prolongation des enseignements.
L’utilisation d’extraits d’œuvres pour les évaluations en classe et les sujets d’examen et de concours lors des épreuves elles-mêmes bénéficient déjà de l’exception pédagogique. Il est proposé d’étendre cette exception aux extraits d’œuvres figurant dans les sujets posés aux examens et aux concours de façon à pouvoir mettre en ligne ces sujets au bénéfice des parents et des élèves. La loi actuelle ne permet en effet pas cette diffusion car cet usage ne constitue pas une illustration d’activités d’enseignement.
Le 2° du présent article constitue une mesure de coordination rédactionnelle.
Il importe de rappeler que l’usage des ressources écrites numériques se fera non seulement dans le cadre fixé par l’exception pédagogique et les accords sectoriels, mais aussi sur la base de l’offre numérique de programmes développée par les éditeurs. La mise en œuvre de l’exception pédagogique est en effet sans préjudice des offres numériques proposées sur Internet par les éditeurs scolaires et universitaires et dont les conditions d’usage doivent continuer à être définies de manière contractuelle en application de l’article L. 331-8 du CPI.
Outre que cette mesure permettra de faciliter les usages du numérique en classe et le développement de l’éducation artistique et culturelle, on peut s’attendre à l’avenir à un recul de la pratique des photocopies au profit d’un usage plus important des ressources numériques. Comme l’indique l’étude d’impact, « cette diminution des photocopies devrait être source d’économies pour l’État (qui verse une redevance de 7,7 millions d’euros par an à ce titre pour les écoles), pour les établissements scolaires (qui versent 7,5 millions d’euros par an au titre des droits de reprographie) et pour les collectivités qui financent les photocopies (dépenses de papier, d’encre, de machines). »
En termes de surcoûts, ces mesures concernant l’exception pédagogique seront marginales. L’insertion d’extraits de texte est déjà négociée quand il se présente sous forme « papier » et le numérique, s’il en simplifie l’usage, n’en modifie pas la volumétrie sur laquelle les redevances sont calculées. D’autre part, le volume d’extraits de textes et d’images utilisé pour les examens est somme toute très limité ; ce volet de la mesure vise surtout la simplification de leur communication.
*
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 165 de M. Patrick Hetzel tendant à supprimer l’article.
Puis elle examine les amendements AC 535, AC 536, AC 537, AC 538, AC 539, AC 540 et AC 541 de Mme Isabelle Attard.
Mme Barbara Pompili. Je retire ces amendements ; Mme Isabelle Attard les défendra en séance publique.
Les amendements AC 535 à AC 541 sont retirés.
La Commission adopte l’article 55 sans modification.
Article 56
Habilitation à prendre par ordonnance des mesures
en matière contentieuse et disciplinaire
Cet article vise à habiliter le gouvernement à prendre par ordonnance, en application de l’article 38 de la Constitution, des mesures supprimant les compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l’éducation, des conseils académiques de l’éducation nationale et de la commission des titres de l’ingénieur.
1. Le droit actuel
L’étude d’impact développe de manière particulièrement claire et précise les objectifs de cette mesure.
● Les compétences contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l’éducation nationale
En application de l’article L. 234-3 du code de l’éducation, les conseils académiques de l’éducation nationale (CAEN) disposent, outre leurs attributions consultatives définies au niveau réglementaire par les articles R. 234-9 et suivants du même code, de compétences contentieuses et disciplinaires.
Les compétences disciplinaires des CAEN sont prévues par les 1°, 2° et 3° de l’article L. 234-3 du code de l’éducation :
– les CAEN peuvent prononcer des sanctions à l’encontre des personnes attachées à l’enseignement ou à la surveillance des établissements d’enseignement privés du premier et du second degré. Les motifs justifiant une saisine de la formation contentieuse et disciplinaire du CAEN par l’autorité académique sont limitativement énumérées par l’article L. 914-6 : la faute grave dans l’exercice des fonctions, l’inconduite ou l’immoralité, un enseignement dispensé contraire à la morale et aux lois. La décision prise par le CAEN peut aller jusqu’à l’interdiction d’enseigner à titre définitif ;
- les CAEN sont également compétents pour sanctionner les manquements aux dispositions, posées au niveau réglementaire par les articles R. 131-2 à R. 131-9 du même code, relatives au contrôle de la fréquentation et de l’assiduité scolaires. L’enseignant ou le directeur d’un établissement d’enseignement privé qui, en dépit d’un avertissement écrit du directeur académique des services de l’éducation nationale, ne s’est pas conformé à ces dispositions, peut être déféré devant la formation contentieuse et disciplinaire du CAEN et faire l’objet d’une sanction qui peut aller, en cas de récidive, jusqu’à l’interdiction d’exercer sa profession ;
- enfin, la troisième catégorie de compétences proprement disciplinaires octroyées par le législateur aux CAEN concerne les membres de l’enseignement privé à distance. L’article L. 444-9 du code de l’éducation confère au CAEN compétence pour statuer disciplinairement sur les faits dont il est saisi par le recteur à la suite d’une inspection et pour prononcer, le cas échéant, pour une durée inférieure ou égale à un an, l’interdiction de diriger et d’enseigner ainsi que la fermeture de l’établissement.
Les CAEN disposent également de compétences en matière de police administrative, prévues par le 4° de l’article L. 234-3 du code de l’éducation, qui s’apparentent davantage à des compétences juridictionnelles.
Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré ainsi que les établissements d’enseignement technique privés sont soumis à un régime de déclaration préalable défini aux articles L. 441-1 et suivants du même code. Ce sont les autorités administratives (selon les cas, le maire, le directeur académique des services de l’éducation nationale, le recteur, le préfet ou le procureur de la République) qui sont destinataires de cette déclaration. C’est à elles qu’il revient de s’opposer, le cas échéant, à l’ouverture de l’établissement. La formation contentieuse et disciplinaire du CAEN est saisie de la décision d’opposition qu’elle peut confirmer ou infirmer.
Les motifs susceptibles de fonder une décision d’opposition sont limitativement énoncés par la loi : ils tiennent principalement à des considérations d’ordre public, entendues au sens large, les textes mentionnant l’hygiène et les bonnes mœurs. En outre, pour les établissements d’enseignement technique, l’opposition peut être fondée sur le fait qu’il résulterait des programmes de l’enseignement dispensé que l’établissement n’a en réalité pas le caractère d’un établissement d’enseignement technique.
Lorsqu’ils font usage des compétences prévues à l’article L. 234-3 du code de l’éducation, les CAEN siègent dans la formation prévue par l’article L. 234-2 du même code. Cette formation est également compétente pour donner son avis dans les quatre cas mentionnés à l’article L. 234-6.
● Les compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l’éducation
Le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) est quant à lui compétent, en vertu du 1° de l’article L. 231-6 du code de l’éducation, pour se prononcer en appel sur les recours formés contre les décisions des CAEN prises en application de l’article L. 234-3 susmentionné.
● La commission contentieuse de la commission des titres d’ingénieur
Les compétences juridictionnelles de la commission des titres d’ingénieur (CTI) concernées par le présent article sont relatives à l’autorisation des écoles techniques privées à délivrer des titres d’ingénieurs et au retrait de ces autorisations (articles L. 642-4 et L. 642-6 du code de l’éducation).
2. Les difficultés posées par le droit actuel
L’existence d’une procédure contentieuse et disciplinaire devant le CAEN ne revêt, sur le plan juridique, aucune nécessité. Elles sont un exemple de l’héritage des débuts de la IIIe République, féconde en matière de juridictions administratives spécialisées.
L’idée qui a présidé à la création de telles instances spécifiques était d’instituer, de façon générale, un régime de responsabilité disciplinaire dérogatoire du droit commun pour les enseignants. Cependant, les compétences disciplinaires et juridictionnelles de ce type de juridictions spécialisées se sont progressivement réduites. Elles l’ont été de manière substantielle en particulier lorsque les décrets du 4 juillet 1972 ont sorti de leur champ des enseignants des établissements publics, depuis lors soumis au droit commun de la fonction publique. Désormais, on voit difficilement en quoi les missions en cause requerraient, davantage que les autres, l’existence d’instances juridictionnelles ad hoc.
Outre que la procédure actuelle paraît relativement datée, elle présente de surcroît l’inconvénient d’être une source évidente de complexité.
Il n’est en effet pas toujours évident pour les intéressés de savoir quelle est l’autorité compétente, surtout lorsque, comme c’est le cas dans le domaine de l’éducation, il existe une pluralité d’instances spécifiques, qui exercent des compétences très proches de celles qu’exercent les autorités administratives en matière disciplinaire ou les juridictions de droit commun en matière de contrôle de légalité des actes.
De façon plus générale, le partage, souvent peu lisible, des compétences entre différentes autorités peut conduire les membres des instances spécialisées à se réunir pour prendre acte du fait qu’elles ont été saisies à tort...
Ce fut le cas en 2006 lorsque le CAEN de Lyon eut à statuer sur l’opposition à l’ouverture du collège-lycée Al Kindi à Décines. Le CSE, saisi en appel de la décision du CAEN, a estimé que l’instance juridictionnelle spécialisée n’était pas compétente pour connaître du motif d’opposition retenu – à savoir le fait que l’auteur de la déclaration préalable n’était pas la personne qui devait assurer la responsabilité effective de la direction de l‘établissement – les dispositions de l’article L. 441-7 du code de l’éducation devant être interprétées strictement et ne reconnaissant la compétence des CAEN que pour une opposition fondée sur des motifs tirés de l’intérêt des bonnes mœurs ou de l’hygiène (CSE, 8 novembre 2006, BOEN n° 1 du 4 janvier 2007).
Le cas du lycée Al Kindi illustre la complexité du partage des rôles entre le CAEN, compétent pour le jugement des oppositions fondées sur l’hygiène et les bonnes mœurs, et la juridiction administrative de droit commun, compétente pour connaître des litiges relatifs au caractère complet et régulier de la déclaration.
Par ailleurs, aucune spécificité technique de nature à échapper à la sagacité du juge administratif de droit commun, évidemment coutumier du contentieux des sanctions disciplinaires et administratives et des mesures de police, ne légitime le maintien des trois juridictions spécialisées que sont les CAEN, le CSE et la CTI réunis en formation contentieuse et disciplinaire.
Enfin, on peut s’interroger, eu égard au renforcement des exigences posées en la matière par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), sur la fragilité juridique du dispositif actuel dans lequel le recteur est à la fois l’autorité de saisine du CAEN et son président, au regard des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un arrêt du 11 septembre 2009, Dubus S.A. contre France (n° 5242/04), la CEDH a durci ses exigences dans le domaine très proche de l’auto-saisine des instances disciplinaires de type juridictionnel. Depuis cet arrêt, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État ont infléchi leur jurisprudence dans le sens d’une plus grande exigence. Ainsi, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire au principe d’impartialité la possibilité pour le juge des enfants de renvoyer un mineur devant le tribunal pour enfants et de présider cette juridiction de jugement (décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011). De même, dans une décision récente du 22 décembre 2011, n° 323612, le Conseil d’État a jugé que la circonstance que les mêmes personnes se prononcent sur la décision de poursuivre, d’une part, et sur la sanction, d’autre part, est de nature à faire naître un doute sérieux sur l’impartialité de cette autorité.
Par ailleurs, le ministère de l’éducation nationale, à l’instar des autres départements ministériels, a initié depuis quelques années un mouvement tendant à supprimer les juridictions administratives spécialisées relevant de son domaine de compétences, en transformant les procédures juridictionnelles devant des commissions spécialisées en procédures administratives, et en les soumettant au contrôle de droit commun de la juridiction administrative.
À titre d’exemple, on peut citer la suppression des commissions spéciales de la taxe d’apprentissage par l’article 26 de l’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l’harmonisation et l’aménagement du régime des pénalités, ou la suppression des compétences juridictionnelles du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) en matière de fraude au baccalauréat par le décret n° 2012-640 du 3 mai 2012 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat.
Ainsi, tous ces éléments militent en faveur de la suppression des compétences contentieuses et disciplinaires des CAEN, présidés et saisis par lui dans la plupart des cas et, par voie de conséquence, des compétences d’appel du CSE sur les décisions du CAEN.
3. Le dispositif proposé par le projet de loi
Dans le prolongement de cette évolution, il est proposé d’habiliter le gouvernement à supprimer, par voie d’ordonnance :
– les compétences juridictionnelles du conseil supérieur de l’éducation (CSE) prévues à la section 2 du chapitre I du titre III du livre deuxième du code de l’éducation (1° du présent article) ;
– et, par voie de conséquence, celles des conseils académiques de l’éducation nationale (CAEN) et de la commission des titres d’ingénieurs (CTI) prévues respectivement à l’article L. 234-3 et aux articles L. 642-4 et L. 642-6 du même code, dont les décisions sont susceptibles d’appel devant le CSE (2° du présent article).
Les 1° et 2° du présent article habilitent également le gouvernement à prévoir les dispositifs qui se substitueront à ceux ainsi supprimés.
Le recours à une habilitation législative pour autoriser le gouvernement à prendre ces mesures par voie d’ordonnance est justifié par le caractère très technique de cette réforme. Le gouvernement disposera d’un an pour prendre cette ordonnance. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Selon les informations transmises au rapporteur, les modalités de la réforme, en ce qui concerne notamment les dispositifs qui se substitueront à ceux actuellement existants, ne sont pas encore toutes précisément déterminées. Les éléments précisés ci-dessous sont donc susceptibles d’être modifiées de manière marginale lors de la rédaction de l’ordonnance.
En l’état actuel de ses intentions, le gouvernement envisage de confier les attributions disciplinaires aujourd’hui dévolues aux CAEN (1°, 2° et 3° de l’article L. 234-3 du code de l’éducation) au recteur d’académie, qui pourrait prendre sa décision après avis du CAEN réuni dans la formation restreinte prévue à l’article L. 234-2.
Il en va de même pour l’interdiction de diriger ou d’enseigner décidée à l’encontre d’un membre de l’enseignement privé à distance, voire pour la décision de fermeture d’un établissement
On substituerait ainsi une procédure administrative à une procédure juridictionnelle, comme cela a été fait au cours du XXe siècle pour les enseignants du public et les maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat.
L’objet de la réforme envisagée par le gouvernement n’est pas de modifier la procédure de déclaration préalable et la possibilité de s’y opposer dont disposent les autorités administratives. Les conditions d’ouverture des établissements resteront les mêmes qu’avant la réforme.
En revanche, le gouvernement souhaite rendre la décision d’opposition à l’ouverture d’un établissement privé directement contestable devant la juridiction de droit commun, en l’espèce la juridiction administrative, et non plus devant la juridiction spécialisée que constitue le CAEN siégeant en formation contentieuse et disciplinaire.
En vertu de la règle du privilège du préalable, la décision d’opposition à ouverture prise par l’autorité administrative est directement applicable et empêche l’ouverture de l’établissement, sous peine d’application à l’intéressé des peines prévues aux articles L. 441-4 et suivants du code de l’éducation, et ce quand bien même cette décision d’opposition serait contestée par l’intéressé devant le juge.
La suppression des compétences contentieuses des CAEN et du CSE en matière d’opposition à l’ouverture des établissements privés n’aura donc pas pour conséquence de faciliter l’installation des établissements privés.
Le CAEN donne actuellement un avis sur le relèvement des exclusions, déchéances et incapacités. Là encore, au stade du projet du gouvernement, cette décision pourrait être prise par le recteur d’académie.
En ce qui concerne les décisions qui seront prises par le recteur en matière disciplinaire (compétences pour l’instant prévues au 1°, 2° et 3° de l’article L. 234-3), au lieu d’être contestables devant le CSE comme c’était jusqu’alors le cas des décisions prononcées par le CAEN (article L. 234-5 du code de l’éducation), elles seront directement contestables devant la juridiction administrative.
Le ministère de l’éducation nationale a mené une étude préalable dont il ressort que les CAEN qui exercent actuellement les attributions disciplinaires prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 234-3 du code de l’éducation n’ont prononcé aucune décision disciplinaire au cours des années 2009 à 2012. Le transfert des compétences disciplinaires des CAEN à une autorité administrative telle que le recteur, s’il apparaît opportun, ne devrait donc pas, dans les faits, avoir d’impact sur l’activité des services des rectorats.
La suppression des attributions de police administrative (4° de l’article L. 234-3) aujourd’hui exercées par les CAEN aura pour conséquence de rendre les décisions d’opposition à l’ouverture des établissements privés directement contestables devant les juridictions administratives de droit commun.
Là encore, il ressort de l’étude préalable menée par le ministère de l’éducation nationale auprès des 27 CAEN métropolitains et d’outre-mer et du conseil inter académique de l’éducation nationale des académies de Paris, Créteil et Versailles que ces 28 instances ont eu à connaître, entre 2009 et 2012, de sept décisions d’opposition à l’ouverture d’établissements privés, qui concernent essentiellement le premier degré. Seules deux décisions des CAEN ont ensuite fait l’objet d’un appel devant le CSE.
Le ministère de l’éducation ne dispose pas de chiffres relatifs à l’activité de la CTI ou aux déchéances et oppositions relevées par le CSE, mais tout laisse penser que ceux-ci sont, comme pour les CAEN, de très faible importance.
La suppression des compétences contentieuses et disciplinaires des CAEN, de la CTI et du CSE ne constituera donc pas un accroissement de charge substantiel pour les juridictions administratives.
À cet égard, il convient de préciser que le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CSTACAA), saisi par le ministère de l’éducation nationale du projet de suppression des compétences contentieuses et disciplinaires des CAEN et du CSE inscrit dans une précédente version du projet de loi, s’est déclaré favorable à l’universalité des compétences des juridictions administratives de droit commun et a relevé qu’« aucun impact significatif ne peut être anticipé sur l’activité des tribunaux administratifs et, a fortiori, des cours administratives d’appel » du fait de la réforme envisagée par le ministère.
*
La Commission adopte l’article 56 sans modification.
Article 57
Modalités de création et d’installation des ESPE
Cet article fixe les modalités du remplacement des instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) par les écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE), celles de la mise en place des conseils et de la direction de ces dernières, ainsi que la durée de leur accréditation.
1. La date de création des ESPE
Le présent article prévoit que les ESPE sont « créées et accréditées au 1er septembre 2013 ».
Ce calendrier resserré de mise en place des ESPE a suscité des réserves de la part du Conseil économique, social et environnemental. Dans l’avis qu’il a rendu sur l’avant-projet de loi, le CESE souligne ainsi que « nombre d’universitaires qui ont déjà dû modifier hâtivement en 2010 les maquettes des masters pour les adapter à la réforme demandent du temps pour pouvoir procéder dans de bonnes conditions aux nouvelles modifications induites par la loi : il conviendrait de réfléchir à une mise en œuvre progressive et concertée qui articule à la fois la nécessité de revenir sur une réforme négative et celle de prendre le temps de construire une formation et un recrutement de qualité répondant aux besoins des métiers de l’éducation » (266).
Par ailleurs, la disparité des configurations locales risque de compliquer l’installation effective des écoles. Lors de son audition par le rapporteur, M. Patrick Demougin, directeur de la Conférence des directeurs d'IUFM, a indiqué que « s’il n’y a qu’une université dans l’académie, la situation est simple, il s’agira d’un transfert de l’IUFM vers l’ESPE. Mais dans les situations plus complexes, avec plusieurs universités, on pourra voir naître une ESPE sur les cendres de l’IUFM existant, ou alors dans une autre université ou encore dans le cadre d’un pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES). »
Selon les informations recueillies par le rapporteur, un accompagnement de tous les sites a été organisé avec la participation des directions des deux ministères concernées par la création des ESPE – direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle (DGESIP), direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO) et direction générale des ressources humaines (DGRH) – afin que la réflexion avance dans des délais compatibles avec la mise en place des ESPE au 1er septembre 2013. Des points réguliers sont faits avec les chefs de projet et des visites de sites sont effectuées chaque semaine. Sur les sites complexes, les deux ministères ont été particulièrement attentifs à ce que le choix de l’affectation de l’ESPE, composante universitaire, ne soit pas un élément bloquant dans l’élaboration du projet et en aucun cas un enjeu de pouvoir local. Le choix de rattachement de l’ESPE doit être déterminé en fonction du projet afin d’en optimiser la mise en œuvre.
Lors de son audition par la Commission des affaires culturelles et de l’éducation, M. Vincent Peillon a justifié la création rapide des ESPE par le fait qu’« il faudra du temps avant que ces écoles ne donnent le meilleur d’elles-mêmes » (267). Le processus conduisant à l’accréditation conjointe par le ministère de l’éducation et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a débuté en janvier 2013, la date limite de retour des dossiers de projets d’accréditation des ESPÉ étant fixée au 12 mai. Par ailleurs, le gouvernement a conclu le 24 janvier 2013 avec M. Jean-Loup Salzmann, président de la Conférence des présidents d’université (CPU), un accord « permettant d’engager la meilleure coopération possible » pour la mise en place des ESPE.
2. La transition des IUFM vers les ESPE
Le présent article prévoit logiquement que les IUFM restent en place « jusqu’à la date de création des écoles supérieures du professorat et de l’éducation », l’article L. 625-1 du code de l’éducation – qui confie la formation des maîtres aux IUFM – et l’article L. 721-3 – qui fixe les missions et l’organisation des IUFM – continuant à s’appliquer « dans leur rédaction antérieure à la présente loi ». Les décrets portant création des IUFM au sein des universités demeurent également applicables jusqu’à cette date.
À l’organisation de cette transition est liée la question du devenir des personnels et des locaux des IUFM, qui n’est pas évoquée dans le projet de loi.
Devant la Commission des affaires culturelles et de l’éducation, M. Gilles Roussel, président de la commission de la formation et de l’insertion professionnelle de la CPU, a souligné que « si l’on demande de pérenniser les équipes IUFM dans les ESPE, c’est pour pérenniser un potentiel de formation qui a été réduit ces dernières années. Il est exclu de trier entre les personnels ; les universités doivent les intégrer tous dans les ESPE, où ils ont toute leur place ».
C’est pourquoi, à l’initiative du rapporteur, la Commission a adopté un amendement prévoyant que les agents exerçant leurs fonctions dans les IUFM sont appelés, à la date de dissolution des IUFM, à exercer dans les ESPE, dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables et sous réserve de leur accord.
Quant aux locaux des IUFM, qui ont fait l’objet de conventions entre l’État et les départements depuis 1990, M. Roussel a observé que « les universités seront portées, pour des raisons d’économie et pour simplifier leur gestion, à fermer toutes les antennes locales pour tout regrouper sur leur emprise. D’un autre côté, elles sont également conscientes de leurs missions au service des territoires et des populations : elles doivent contribuer à une élévation générale du niveau de formation et, de ce point de vue, utiliser les locaux des IUFM pourrait être un atout… Mais elles n’ont pas aujourd’hui les moyens de cette territorialisation de la formation et si on veut qu’elles assument cette mission, il faudra donc les leur donner » (268) .
3. La mise en place des conseils
Ces conseils, prévus à l’article 51 qui modifie l’article L. 721-3 du code de l’éducation, sont le conseil d’école et le conseil d’orientation scientifique et pédagogique.
Le présent article fixe à « trois mois à compter de la date de la création de l’école » le délai dans lequel ils sont « installés dans les conditions fixées par l’article L. 721-3 du code de l’éducation », c’est-à-dire lorsque l’ensemble de leurs membres ont été désignés selon les modalités fixées par le décret prévu à l’article 51. Il précise, par ailleurs, qu’avant l’expiration du délai de trois mois, « les conseils siègent valablement sans les représentants des personnels, des personnes participant à des actions de formation organisées par l’école ainsi que celles qui en bénéficient ».
Selon les informations recueillies par le rapporteur, il s’agit de permettre à un conseil incomplètement constitué de prendre certaines décisions importantes comme l’adoption d’un budget de fonctionnement provisoire, destiné à faire face aux premiers engagements, ainsi que les modalités de partenariat avec les unités de formation et de recherche (UFR) des universités et les écoles internes associées au fonctionnement de l’ESPE. Au demeurant, durant ces trois mois, aucune décision concernant les ressources humaines et les divers engagements pluriannuels ne seront adoptés dans l’urgence.
4. Les autres dispositions
● Le présent article prévoit que le directeur est désigné « dès que le conseil d’école est installé dans les conditions fixées par l’article L. 721-3 du code de l’éducation » par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale, pour la durée de l’accréditation et sur proposition du conseil d’école. Pendant la phase transitoire de trois mois après la création de l’école et avant l’installation du conseil d’école, la direction est assurée par un administrateur provisoire nommé par le recteur sur proposition du président de l’établissement de rattachement.
Selon les précisions fournies au rapporteur, sera désignée comme administrateur une personnalité interne à l’établissement ayant vocation à devenir directeur, et pour laquelle le mandat provisoire servira en quelque sorte de période probatoire. L’administrateur disposera des mêmes droits que le futur directeur afin que la composante universitaire puisse avoir un fonctionnement administratif correct.
● Enfin, le présent article aménage la durée de la première accréditation fixée par l’article 51 en prévoyant que lorsque la durée du contrat pluriannuel liant l’État à l’établissement de rattachement est inférieure à un an, l’accréditation est donnée jusqu’au terme du contrat suivant. Cette disposition évite aux ESPE d’avoir à engager, peu de temps après leur création, une nouvelle procédure de demande d’accréditation.
*
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AC 7 du rapporteur.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements AC 658 du rapporteur et AC 439 de Mme Martine Martinel.
M. le rapporteur. L’amendement AC 658 vise à prévoir que les agents qui exercent leurs fonctions dans les IUFM, à la date de leur dissolution, sont appelés à exercer dans les ESPE, dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables et sous réserve de leur accord. Il s’agit de sécuriser la situation des personnels des IUFM.
M. Michel Pouzol. L’amendement AC 439 vise, quant à lui, à préciser que les personnels des IUFM sont intégrés comme personnels des ESPE à compter de la date de leur création et qu’un droit d’option leur est accordé. L’objectif est le même.
M. le président Patrick Bloche. Je propose de conserver l’amendement du rapporteur et suggère aux membres du groupe SRC de retirer le leur.
M. Michel Pouzol. Nous le retirons en effet.
L’amendement AC 439 est retiré.
La Commission adopte l’amendement AC 658.
Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel AC 27, l’amendement de cohérence AC 8 et les amendements rédactionnels AC 9, AC 10 et AC 11 du rapporteur.
La Commission adopte l’article 57 modifié.
Article 58
Modalités d’application à Mayotte
Cet article qui prévoit les modalités de mise en œuvre à Mayotte de la loi de refondation de l’école s’inscrit dans le cadre de l’article 73 de la Constitution relatif à l’application de plein droit aux régions et aux départements d’outre-mer (dont fait partie Mayotte depuis 2011) des lois et règlements, nonobstant des adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Le I énumère les dispositions de la loi qui ne sont pas applicables à Mayotte. Il s’agit de celles contenues dans les articles 5 – accueil des enfants dès l’âge de deux ans dans les classes ou les écoles maternelles –, 15 – autorisation donnée par le président du conseil régional à des entreprises ou des organismes de formation d’utiliser les locaux et les équipements des lycées et des établissements d’enseignement adapté en dehors du temps scolaire –, 49 à 51 – formation des personnels enseignants et d’éducation, mission et organisation des écoles supérieures du professorat et de l’éducation –, 53, 54 et 57 – remplacement des instituts universitaires de formation des maîtres par les écoles supérieures du professorat et de l’éducation et modalités de création et d’installation de ces écoles.
Il convient de préciser que l’article 5 modifie le dernier alinéa de l’article L. 113-1 du code de l’éducation, lequel est applicable à Mayotte à la rentrée scolaire 2014 en vertu de l’article L. 162-2-1 de ce même code. Comme le relève l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, le maintien et éventuellement les modalités de l’adaptation doivent être à nouveau discutées.
En ce qui concerne la formation des personnels enseignants et d’éducation et la mise en place des écoles supérieures du professorat et de l’éducation (articles 49 à 51, 53, 54 et 57), il convient de rappeler que Mayotte ne dispose plus d’institut de formation des maîtres, l’article 19 de la loi n° 2010-1487 du 17 décembre 2010 relative au département de Mayotte ayant abrogé à compter du 1er septembre 2012 l’article L. 972-3 du code de l’éducation qui créait cet IFM, établissement public local à caractère administratif spécifique, distinct des IUFM existants sur le reste du territoire français.
Comme le souligne l’étude d’impact, il n’est pas nécessaire de modifier les articles du code de l’éducation (269) qui énumèrent les articles dont l’application est exclue à Mayotte, puisque le projet de loi ne vise que des articles qui sont déjà cités dans les articles L. 162-2-1, L. 262-1, L. 492-1, L. 682-2 et L. 772-1.
Le II prévoit que le gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance, les mesures de nature législative nécessaires pour étendre, voire adapter à Mayotte les dispositions qui n’y sont pas applicables et pour tenir compte dans le plan du code de l’éducation de la création du département de Mayotte.
Conformément aux conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, la demande d’habilitation contenue dans le présent article fixe la durée de l'habilitation – en l’espèce « un an suivant la promulgation de la loi » – et le délai de ratification – « au plus tard six mois à compter de la publication de cette ordonnance » –, les ordonnances devenant en effet caduques si un projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.
Dans son avis du 16 janvier 2013 concernant l’avant-projet de loi, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) regrette l’imprécision de cette disposition. Le CESE considère en effet que si des difficultés techniques ou juridiques peuvent se poser dans l’application de certains dispositifs et donc conduire le gouvernement à différer l’application et agir par voie d’ordonnance, ce dernier devrait s’engager à prendre toutes les mesures nécessaires préalables à l’application de plein droit, avec un calendrier et des délais définis.
*
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AC 12 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 58 modifié.
Article 59
Modalités d’application à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis et Futuna
Cet article, qui se conforme aux dispositions de l’article 74-1 de la Constitution, autorise le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures législatives destinées à étendre ou à adapter la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 (dont font partie la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna), ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie.
Comme l’observe l’étude d’impact qui accompagne le projet de loi, le choix de la procédure des ordonnances prévue à l’article 38 de la Constitution semble la meilleure solution en l’espèce ; plutôt que d’inscrire dans un projet de loi susceptible d’évoluer au cours des navettes parlementaires des mesures spécifiques à l’outre-mer, il est préférable d’étendre et d’adapter à ces territoires les dispositions du texte de loi.
En effet, compte tenu des modifications substantielles proposées par le projet de loi à plusieurs codes – éducation, recherche, propriété intellectuelle et travail –, de la complexité de la répartition des compétences entre l’État et les collectivités d’outre-mer et de la diversités de leurs domaines d’intervention en matière d’éducation, la transposition des mesures à l’outre-mer exigera un examen minutieux qui ne pourra s’effectuer que lorsque le texte sera stabilisé. Il en est de même pour les consultations préalables aux mesures d’adaptation qui sont prévues par les statuts des collectivités d’outre-mer.
Conformément aux conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le présent article précise la durée de l’habilitation – en l’espèce « un an suivant la promulgation de la loi » – et le délai dans lequel le projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement – « au plus tard six mois à compter de la publication de cette ordonnance ».
Il convient de relever que le présent article ne concerne pas Saint-Barthélemy et Saint-Martin qui sont pourtant deux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et dotées de l’autonomie. En effet, les dispositions qui leur sont applicables relèvent du principe de l’identité législative : en l’absence de dispositions expresses d’exclusion ou de dispositions particulières d’adaptation, les lois leur sont applicables sans qu’il soit nécessaire de le prévoir, ainsi que cela ressort des statuts de ces collectivités tels qu’ils résultent des lois organiques qui les ont fixés et qui sont codifiés dans le code général des collectivités territoriales (270).
*
La Commission adopte successivement l’amendement de cohérence AC 13 et l’amendement rédactionnel AC 14 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 59 modifié.
Article 60 (nouveau)
Comité de suivi
Issu d’un amendement adopté par la Commission à l’initiative du rapporteur, le présent article prévoit d’instituer un comité de suivi, chargé d’évaluer chaque année l’application de la loi. Institué par décret, ce comité comprendra notamment deux représentants, dont un titulaire et un suppléant, de chaque assemblée et transmettra, chaque année, un rapport sur ses travaux au parlement.
Un texte aussi essentiel pour l’avenir notre pays que le projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République doit être en effet évalué, dans son application et ses incidences, chaque année, en y associant le parlement. Le comité visé par le présent article permettra en outre à la représentation nationale de s’assurer que les engagements formalisés dans le rapport annexé ont été bien respectés.
*
La Commission est saisie de l’amendement AC 651 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 59.
M. le rapporteur. Nous avons évoqué la création d’un comité de suivi à plusieurs reprises au cours de nos débats.
Je propose d’insérer, après l’article 59, l’article suivant : « Un décret institue un comité de suivi chargé d’évaluer l’application de la présente loi. Ce comité comprend notamment deux députés et deux sénateurs, dont respectivement un titulaire et un suppléant, désignés par les commissions compétentes en matière d’éducation de leurs assemblées respectives. Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux. »
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.
*
En conséquence, la Commission des affaires culturelles et de l’éducation demande à l’Assemblée nationale d’adopter le présent projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
(par ordre chronologique)
Ø Société des agrégés de l’Université – Mme Blanche Schmitt-Lochmann, présidente, et M. Bertrand Vieille, membre du bureau
Ø Syndicat général de l’éducation nationale-CFDT (SGEN-CFDT) – M. Frédéric Sève, secrétaire général, Mme Chantal Demonque et M. Franck Loureiro, secrétaires nationaux
Ø Audition commune réunissant :
– la Conférence des doyens et directeurs d’unités de formation et de recherche (UFR) de lettres, langues, arts, sciences humaines et sociales (CDUL) : Mme Françoise Dubosquet, présidente, et M. Thierry Revol, vice-président, doyen de l’UFR Lettres, université de Strasbourg, et
– la Conférence des doyens et directeurs d’UFR scientifiques (CDUS) : M. Jean-Marc Broto, président, et Mme Marie Claude Millot, membre du bureau, doyenne de la faculté des sciences de l’université de Créteil
– Conférence de sciences et techniques des activités sportives (C3D STAPS) : M. Paul Delamarche, président
Ø Audition commune réunissant :
– le Syndicat national des personnels de direction de l’éducation nationale de l’Union nationale des syndicats autonome (SNPDEN-UNSA) : M. Cédric Carraro, secrétaire permanent, M. Philippe Tournier, secrétaire général, M. Michel Richard, secrétaire général adjoint, et Mme Claire Bourhis, secrétaire nationale commission pédagogie, et
- le Syndicat des enseignants de l’Union nationale des syndicats autonome (SE-UNSA) : Mme Claire Krepper, secrétaire nationale, secteur éducation
Ø Syndicat national de l’enseignement supérieur (SNESUP-FSU) – M. Stéphane Tassel, secrétaire général, et Mme Gisèle Jean, co-responsable du secteur formation des enseignants
Ø Fédération autonome de l’éducation nationale (FAEN) – M. Pascal Cazier, secrétaire national, et M. Marc Geniez, secrétaire général
Ø Audition commune réunissant :
– la Fédération autonome de l’éducation nationale (FAEN) : M. Pascal Cazier, secrétaire national, et M. Marc Geniez, secrétaire général, et
– le Syndicat de l’inspection de l’éducation nationale (UNSA Education) : M. Roumagnac, secrétaire général, M. Francis Bougault, secrétaire général adjoint pour le secteur 2nd degré et M. Franck Montuelle, secrétaire général adjoint secteur 1er degré.
Ø Association générale des enseignements des écoles et classes maternelle publiques (AGEEM) – Mme Isabelle Racoffier, présidente
Ø Union nationale des associations familiales (UNAF) – Mme Claire Ménard, attachée parlementaire, M. Rémy Guilleux, administrateur de l’UNAF en charge de l’éducation-jeunesse et Mme Patricia Humann, coordinatrice pôle éducation
Ø Table ronde réunissant :
– la Fédération des parents d’élèves de l’école publique : Mme Valérie Marty, présidente,
– l’Association des parents d’élèves de l’enseignement libre national : Mme Caroline Saliou, présidente, et M. Christophe Abraham, et
– l’Union nationale des associations autonomes de parents d’élèves (U.N.A.A.P.E.) : Mme Sophie Fontaine, présidente, et M. Yannick Caron, secrétaire général adjoint
Ø Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques (FCPE) – M. Jean-Jacques Hazan, président
Ø Confédération syndicale de l’éducation nationale (CSEN) – M. François Portzer, président du SNALC, M. Jean-Remi Girard, membre du SNALC, M. Pierre Favre, membre du SNE, M. Ange Martinez, membre du SNE, et M. Driss Aheda, Sup Autonome/csen
Ø Syndicat national unitaire des instituteurs, des professeurs des écoles et des professeurs d’enseignement général de collège – FSU (SNUipp-FSU) – M. Sébastien Sihr, secrétaire général
Ø Audition commune réunissant :
– le CRAP-Cahiers Pédagogiques : M. Philippe Watrelot, président, M. Patrice Bride, rédacteur en chef de la revue, et M. Philippe Pradel, membre du bureau, et
– Éducation et devenir : Mme Marie-Claude Cortial, présidente, Mme Françoise Sturbaut, vice-présidente, et M. Sylvain Ladent, secrétaire général
Ø Conférences des directeurs d’IUFM – M. Patrick Demougin, président, et M. Pierre Statius, 1er vice-président de la Conférence des direct
Ø Fédération nationale de l’enseignement, de la culture et de la formation professionnelle (FNEC FP-FO) – M. Hubert Raguin, secrétaire général, M. Christian Lage, secrétaire fédéral, secrétaire général du SNETAA-FO, M. Norbert Trichard, secrétaire fédéral, secrétaire général du SNUDI-FO, M. Jean-Christophe Vaysette, secrétaire national du SN-FO-LC, et M. Jean-Jacques Courtiau, secrétaire général-adjoint d’ID-FO
Ø Audition commune réunissant :
– l’Union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP) : M. Jean-Michel Sautreau, président, et Mme Véronique Moreira, vice-présidente, et
– l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) : M. Laurent Petrynka, président
Ø La ligue de l’enseignement – M. Eric Favey, secrétaire général adjoint de la ligue, délégué à l’éducation, et M. Jean-Paul Albert, président de la Ligue de l’enseignement Basse-Normandie
Ø Audition commune réunissant :
– le Syndicat national des enseignements du second degré-FSU
(SNES-FSU) : Mme Frédérique Rolet, co-secrétaire générale, et
– le Syndicat national de l’éducation physique de l’enseignement public FSU (SNEP-FSU) : M. Serge Chabrol, secrétaire général
Ø Table ronde réunissant :
– la Fédération nationale des associations de maîtres (FNAME) : Mme Thérèse Auzou-Caillemet, présidente, M. Marc Loret, et Mme Servane Cuypers,
– la Fédération nationale des associations de rééducateur de l’éducation nationale (FNAREN) : Mme Maryse Charnet, présidente, et Mme Lydie Morales, secrétaire fédérale,
– l’Association française des psychologues de l’éducation nationale (AFPEN) : Mme Véronique le Mezec, présidente, et M. Daniel Tramoni, vice-président
Ø Ministère de l’éducation nationale - Direction de l’enseignement scolaire – M. Jean-Paul Delahaye, directeur général, et M. Xavier Turion, chef de service, adjoint au directeur général
Ø Mme Monique Sassier, Médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur
Ø Conseil économique, social et environnemental – M. Xavier Nau et M. Patrick Guyot, administrateur de la section éducation, culture et communication
Ø Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche – Mme Simone Bonnafous, directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle, et M. Jean-Michel Jolion, professeur des universités, chef du service de la stratégie de l’enseignement supérieur
Ø M. Claude Lelièvre, historien de l’éducation
Ø Table ronde réunissant :
– le ministère de l’éducation nationale : M. Jean-Yves Capul, sous-directeur des programmes d’enseignement, de la formation des enseignants et du développement numérique,
– le Conseil national du numérique (CNNum) : M. Benoît Thieulin, président, et M. Bernard Stiegler, membre du CNN,
– le Syndicat national de l'édition (SNE) : Mme Sylvie Marcé, vice-présidente et présidente des éditions Belin, Mme Catherine Lucet, présidente de EDITIS, Pôle éducation et référence, et Mme Pascale Gélébart, chargée de mission au Groupe éducation, et
– le Groupement des éditeurs et diffuseurs d’éducatif multimédia (GEDEM) : Mme Michèle Barrière, présidente, et M. Alain Laurent, vice-président
Ø Association des maires de France –M. Pierre-Alain Roiron, maire de Langeais (président de la Commission Education et culture de l’AMF) et M. Pierre-Yves Jardel, maire d’Orbais-l’Abbaye (rapporteur de cette commission), M. Sébastien Ferriby, chargé d’études éducation et culture, et M. Alexandre Touzet, Chargé de mission relations avec le Parlement
Ø M. Philippe Meirieu, professeur en sciences de l’éducation, vice-président du conseil régional de Rhône-Alpes
Ø Association des régions de France (ARF) – M. François Bonneau, président de la Région Centre et vice-président de l’ARF en charge de l’éducation, et M. Laurent Brisset, conseiller éducation
Ø Secrétariat général de l’enseignement catholique (SGEC) – M. Éric de Labarre, secrétaire général, et M. Pierre Marsollier, délégué général aux relations politiques
Ø Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) – Mme Martine Carrillon-Couvreur, présidente
Ø Conférence des présidents d’universités (CPU) – M. Gilles Roussel, président de la Commission formation, président de l’université de Marne-la-Vallée
Ø Haut conseil de l’éducation – M. Bruno Racine, président, et M. Pierre Maurel, secrétaire général
Ø Union nationale des syndicats de l’Éducation nationale (UNSEN) – CGT Éduc’action – M. Patrick Désiré, secrétaire général et M. Samuel Serre, secrétaire national, responsable des secteurs lycée et vie scolaire
Ø Association des départements de France – Mme Colombe Brossel, vice-présidente du Conseil de Paris, Mme Cécile Fougère-Cazalé, directrice de cabinet de Mme Brossel, Mme Catherine Bertin, chef du service éducation culture jeunes et Europe, Mme Mélanie Courivaud, conseillère technique, et Mme Marylène Jouvien, chargée des relations avec le Parlement
1 () « La démocratisation de l’enseignement entre égalisation et illusions », in « Sociologie du système éducatif. Les inégalités scolaires », sous la direction de Marie Duru-Bellat et Agnès Van Zanten, PUF, 2009.
2 () Pourcentage cité par M. Richard Descoings dans ses « Préconisations sur la réforme du lycée », rapport remis au ministre de l’éducation nationale le 2 juin 2009.
3 () « L’élitisme républicain. L’école française à l’épreuve des comparaisons internationales », Christian Baudelot et Roger Establet, La République des idées, Seuil, mars 2009.
4 () « L’école des chances. Qu’est-ce qu’une école juste ? », La République des idées, Seuil, octobre 2004.
5 () Audition du mercredi 16 juin 2010.
6 () Rapport public thématique, mai 2010.
7 () « Le collège unique, pour quoi faire ? Les élèves en difficulté au cœur de la question », Jean-Paul Delahaye, Retz, 2006.
8 () Référé sur « l’égalité des chances et la répartition des moyens dans l’enseignement scolaire » du 11 juillet 2012.
9 () Audition du 12 décembre 2012.
10 () « Mise en œuvre du socle commun », Bilan des résultats de l’École – 2011, décembre 2011.
11 () « L’évolution des acquis des élèves de 15 ans en compréhension de l’écrit. Premiers résultats de l’évaluation internationale PISA », note d’information n° 10.24, ministère de l’éducation nationale, décembre 2010.
12 () « Contribution à la concertation sur l’école : priorité au primaire », note de l’Institut Montaigne, juillet 2012.
13 () « L’école primaire » Bilan des résultats de l’École – 2007, août 2007.
14 () Audition du 29 septembre 2010 de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale (XIIIe législature).
15 () Intervention de M. Jean-Paul Delahaye, directeur général de l’enseignement scolaire au ministère de l’éducation nationale, à la table ronde du 5 décembre 2012 organisée par la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale sur la priorité à accorder au primaire et à la petite enfance
16 () « Un socle pour consolider le collège unique », rapport d’information de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation, n° 2446, 4 avril 2010 (Assemblée nationale – XIIIe législature).
17 () « L’état de l’École édition 2012 », n° 22, ministère de l’éducation nationale, octobre 2012.(
18 () Collèges des « réseaux ambition réussite » (RAR), labellisés ÉCLAIR à partir de 2010
19 () « Éducation prioritaire », fiche thématique n° 6 de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère de l’éducation nationale pour la concertation sur la refondation de l’école (été 2012).
20 () « Observation et évaluation de l’ensemble des dispositifs d’aide individualisée et d’accompagnement à l’école, au collège et au lycée », inspection générale de l’éducation nationale et inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, rapport n° 2010-114, octobre 2010.
21 () « L’évolution du nombre d’élèves en difficulté face à l’écrit depuis une dizaine d’années », Jeanne-Marie Daussin, Saskia Kespaik, Thierry Rocher in « France, portrait social », édition 2011, INSEE.
22 () « L’évolution du nombre d’élèves en difficulté face à l’écrit depuis une dizaine d’années », article précité.
23 () « Refondons l’École de la République », le rapport de la concertation, remis le 5 octobre 2012 au ministre de l’éducation nationale.
24 () Audition du 24 octobre 2012 de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale.
25 () « Regards sur l’éducation 2011 », OCDE, septembre 2011.
26 () Audition du 16 juin 2010 de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale (XIIIe législature).
27 () « L’exclusion scolaire en France : un système "performant". Inégalités scolaires : France 23ème sur 24 (UNICEF/OCDE) », étude présentée à la 3ème journée nationale de l’écoute SOS Amitié, 13 novembre 2012.
28 () Audition du 11 juillet 2012 de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale.
29 () « Sortants sans diplôme et sortants précoces – Deux estimations du faible niveau d’études des jeunes », note d’information n° 12.15, ministère de l’éducation nationale, septembre 2012.
30 () « L’état de l’École édition 2012 », ouvrage précité.
31 () Table ronde du 5 décembre 2012 organisée par la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale sur la priorité à l’école primaire et à la petite enfance.
32 () « Contribution à la concertation sur l’école : priorité au primaire », note de l’Institut Montaigne, juillet 2012.
33 () « L’état de l’École édition 2012 » ouvrage précité.
34 () « La dépense par élève ou étudiant en France et dans l’OCDE », note d’information n° 12.29, ministère de l’éducation nationale, décembre 2012.
35 () Audition de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale du 29 septembre 2010 (XIIIe législature).
36 () Note d’information n° 12.29 précitée.
37 () « L’Éducation nationale face à l’objectif de la réussite de tous les élèves », rapport précité.
38 () Table ronde 5 décembre 2012 organisée par la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale sur la priorité à l’école primaire et à la petite enfance.
39 () « Regards sur l’éducation 2012 », OCDE, septembre 2012.
40 () « L’Éducation nationale face à l’objectif de la réussite de tous les élèves », rapport précité.
41 () « Rythmes scolaires : pour une dynamique nouvelle des temps éducatifs », Agnès Cavet, Dossier d’actualité n° 60 de la veille scientifique et technologique de l’Institut national de recherche pédagogique, février 2011.
42 () « Aménagement du temps scolaire et santé de l’enfant », rapport présenté par MM. Yvan Touitou et Pierre Bégué (janvier 2010), « Quels rythmes pour l’École ? », rapport d’information de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation présenté par MM. Xavier Breton et Yves Durand, n° 3028, 8 décembre 2010 (Assemblée nationale – XIIIe législature) et « Des rythmes plus équilibrés pour la réussite de tous », rapport d’orientation sur les rythmes scolaires (juillet 2011).
43 () Audition du 6 mai 2010 par la mission d’information de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation sur les rythmes de vie scolaire (Assemblée nationale, XIIIe législature).
44 () Ces professionnels sont attachés aux trois zones de départ en vacances d’hiver et de Pâques qui entraînent des déséquilibres dans la durée de travail des élèves (entre six à huit semaines selon la période) pour une zone donnée.
45 () Celles-ci ont débuté le samedi 27 octobre et se sont terminées le lundi 12 novembre 2012.
46 () À titre dérogatoire, ces 24 heures d’enseignement peuvent être répartis sur neuf demi-journées – le mercredi matin étant scolarisé –, cette organisation devant être approuvée par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale. Cette situation concerne environ 3 % des écoles.
47 () Le Monde du 29 mai 2008.
48 () Rapport d’information n° 3028 (Assemblée nationale, XIIIe législature) précité.
49 () « La réduction du temps de travail des élèves est un formidable gâchis », Le Monde, 30 mai 2012.
50 () Audition du 6 mai 2010 par la mission d’information de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation sur les rythmes de vie scolaire (Assemblée nationale, XIIIe législature).
51 () « L’aménagement des rythmes à l’école primaire », janvier 2000.
52 () « Rythmes scolaires : éléments de comparaison internationale », ministère de l’éducation nationale, Concertation sur la refondation de l’école, 11 septembre 2012.
53 () « Rythmes scolaires : pour un dynamique nouvelle des temps éducatifs », article précité.
54 () Rapport d’information n° 3028 (Assemblée nationale, XIIIe législature) précité.
55 () Rapport n° 2010-114 précité.
56 () « L’Éducation nationale face à l’objectif de la réussite de tous les élèves », rapport précité.
57 () Rapport d’information n° 3028 (Assemblée nationale, XIIIe législature) précité.
58 () « L’orientation à la fin du collège : la diversité des destins scolaires selon les académies », communication de la Cour des comptes à la Commission des finances de l’Assemblée nationale, septembre 2012
59 () « L’orientation scolaire », Bilan des résultats de l’École – 2008, septembre 2008.
60 () « L’Éducation nationale face à l’objectif de la réussite de tous les élèves », rapport précité.
61 () « L’Éducation nationale face à l’objectif de la réussite de tous les élèves » et « L’orientation à la fin du collège : la diversité des destins scolaires selon les académies », rapports précités.
62 () « Famille et école : des chiffres inquiétants », colloque « École – Famille – Cité : la valeur des liens », 23 et 24 octobre 2012.
63 () « L’emploi des jeunes », Avis du Conseil économique, social et environnemental, séance du 26 septembre 2012.
64 () « Observations sur les établissements et la vie scolaire en 2011-2012 », rapport n° 2012-136, novembre 2012.
65 () « Refondons l’École de la République », le rapport de la concertation, 9 octobre 2012.
66 () Le nouveau calendrier de la session du baccalauréat résultant du dispositif dit de la « reconquête du mois de juin » s’est traduit par un gain effectif limité à une à deux semaines de cours.
67 () « Refondons l’École de la République », le rapport de la concertation, 9 octobre 2012.
68 () « Le métier d’enseignant au cœur d’une ambition émancipatrice », rapport d’information de la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, n° 601, 19 juin 2012.
69 () Audition du 24 octobre 2012 de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale.
70 () « L’école maternelle », inspection générale de l’éducation nationale et inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, rapport n° 2011-108, octobre 2011.
71 () Aux termes de l’article D. 113-1 du code de l’éducation, les enfants qui ont atteint l’âge de trois ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu’à la rentrée scolaire de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire. L’accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé.
72 () 259 633 précisément.
73 () Le ministère rappelle qu’en raison de la grève administrative des directeurs d’école, déclenchée à la rentrée 1999, les effectifs scolarisés d’enfants à deux ans ne peuvent, sur la période 2002-2011, être connus avec certitude, mais seulement estimés. Par ailleurs, les zones de l’éducation prioritaire ayant évolué entre 1999 et 2011, les taux ont été calculés à ces deux dates en fonction des classements « RRS » et « ÉCLAIR ».
74 () Sénat, rapport d’information n° 601 précité.
75 () « La scolarisation à deux ans », Éducation & formations n° 82, décembre 2012.
76 () Audition du 11 juillet 2012.
77 () Rapport n° 2010-114 précité.
78 () Audition par la Commission des affaires culturelles et de l’éducation le 16 juin 2010 (Assemblée nationale, XIIIe législature).
79 () « Suivi de la mise en œuvre de la réforme du lycée d’enseignement général et technologique », inspection générale de l’éducation nationale et inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, rapport n° 2012-003, janvier 2012.
80 () « L’Éducation nationale face à l’objectif de la réussite de tous les élèves », rapport précité.
81 () Audition de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale du 11 juillet 2012.
82 () Rapport n° 2010-114 précité.
83 () « Regards sur la formation des maîtres en France », Revue internationale d’éducation – Sèvres, n° 55 (décembre 2010).
84 () « Mieux former les enseignants », rapport d’information de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation, n° 4033, 7 décembre 2011 (Assemblée nationale – XIIIe législature).
85 () « Pour une formation universitaire professionnelle des enseignants », 22 propositions de la Conférence des directeurs d’IUFM à destination des candidats à l’élection présidentielle de 2012, novembre 2011.
86 () Avis n° 147 de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale sur le projet de loi portant création des emplois d’avenir, 4 septembre 2012.
87 () Rapport public annuel 2012, février 2012.
88 () Audition du 10 mai 2011, « Mieux former les enseignants », rapport d’information n° 4033 (Assemblée nationale, XIIIe législature) précité.
89 () « Les inégalités à l’école », rapport présenté par M. Xavier Nau le 13 septembre 2011.
90 () « Mise en œuvre de la réforme de la formation des enseignants », inspection générale de l’éducation nationale et inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, rapport n° 2011-093, juillet 2011
91 () Enquête en ligne menée par le Syndicat national des enseignements du second degré (SNES) en octobre 2012 à laquelle plus de 400 stagiaires ont répondu.
92 () Audition de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale du 24 juillet 2012.
93 () Chapitre « La formation initiale et le recrutement des enseignants », rapport public annuel, février 2012.
94 () Audition de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale du 11 juillet 2012.
95 () Texte adopté n° 855, issu de la proposition de loi n° 4151 (Assemblée nationale, XIIIe législature) relative à la modification de certaines dispositions encadrant la formation des maîtres déposée le 10 janvier 2012.
96 () Arrêté du 15 juin 2012 fixant le cahier des charges de la formation des professeurs, documentalistes et conseillers principaux d’éducation.
97 () Avis n° 147 de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, 4 septembre 2012.
98 () Rapport public annuel 2012 précité.
99 () Cf. données issues de l’avis n° 772 présenté par Mme Françoise Cartron, sénatrice, au nom de la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, sur le projet de loi portant création des emplois d’avenir (20 septembre 2012) et du rapport du comité de pilotage de la concertation sur la refondation de l’école (5 octobre 2012).
100 () Circulaire n° 2012-104 du 3 juillet 2012, Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale n° 27 du 5 juillet 2012.
101 () Avis n° 147 précité.
102 () « Les Français et leur école : le miroir du débat », Dunod, 2004.
103 () « Pour la réussite de tous les élèves : rapport de la commission du débat national sur l’avenir de l’école », octobre 2004, Documentation française.
104 () « Une concertation sans précédent », Claude Lelièvre, Le café pédagogique, 2 juillet 2012.
105 () Pour l’enseignement privé des premier et second degrés, 3,468 millions d’euros en crédits de paiement ont été consacrés à la mobilisation de maîtres délégués remplaçant les professeurs des écoles nouvellement recrutés pendant leur formation et à la mise en place d’une décharge de formation pour les professeurs de lycée et collège néo-titulaires. Le coût de cette dernière mesure est évalué à 128 équivalents temps plein, tandis que l’absence de titulaires remplaçants dans le premier degré nécessite la création de 98 équivalents temps plein contractuels.
106 () Avis n° 147 précité.
107 () Principalement, mais les étudiants de M2 et les personnes titulaires d’un diplôme équivalent pourront aussi se présenter aux épreuves d’admissibilité.
108 () Soit 6 heures dans le second degré et trois demi-journées dans le premier degré.
109 () « Orientation et programmation pour un changement de cap », 10 décembre 2012 (blog de M. Lelièvre).
110 () « L’élitisme républicain. L’école française à l’épreuve des comparaisons internationales », ouvrage précité.
111 () « Bilan national des réseaux "ambition réussite" », ministère de l’éducation nationale, juin 2010.
112 () En 2011 selon le rapport annuel de performances 2013 de la mission « Enseignement scolaire ».
113 () Avis sur l’avant-projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, 16 janvier 2013.
114 () Dans sa décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005, le Conseil constitutionnel a constaté l’omission d’une formalité substantielle, à savoir la consultation du Conseil économique et social, devenu depuis le Conseil économique, social et environnemental, applicable aux projets de loi de programme conformément à l’article 70 de la Constitution. Il a en conséquence déclaré contraire à la Constitution l’article approuvant le rapport annexé, disposition relevant d’une loi de programme.
115 () Selon les projets annuels de performances 2013 des missions « Enseignement scolaire » et « Recherche et enseignement supérieur ».
116 () Table ronde du 5 décembre 2012 organisée par la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale sur la priorité à accorder au primaire et à la petite enfance.
117 () Audition de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale du 24 octobre 2012.
118 () Bulletin officiel de l’éducation nationale n° 3 du 15 janvier 2013.
119 () Table ronde du 5 décembre 2012 organisée par la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale sur la priorité à accorder au primaire et à la petite enfance.
120 () Bulletin officiel de l’éducation nationale n° 3 du 15 janvier 2013.
121 () « L’école primaire », Bilan des résultats de l’École – septembre 2007.
122 () Table ronde du 5 décembre 2012 organisée par la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale sur la priorité à accorder au primaire et à la petite enfance.
123 () « L’Éducation nationale face à l’objectif de la réussite de tous les élèves », rapport précité.
124 () « Assurer le bien-être des enfants », OCDE, 2009. La qualité de vie scolaire comprend deux indicateurs couvrant la tranche d’âge allant de 11 à 15 ans et reposant sur des données collectées en 2005-2006 : le premier rend compte des brimades physiques et psychologiques et le second rend compte des enfants qui déclarent aimer l’école.
125 () « Favoriser le bien-être des élèves, condition de la réussite éducative », Sarah Sauneron, note d’analyse n° 313, janvier 2013.
126 () « Les nouvelles politiques éducatives. La France fait-elle les bon choix ? », PUF, 2007.
127 () En application de la loi du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et de la sécurisation des parcours professionnels dite loi « Cherpion ».
128 () Rapport n° 2012-003 précité.
129 () Rapport d’information n° 3028 (Assemblée nationale, XIIIe législature) précité.
130 () Circulaire n° 2013-019 du 4 février 2013 parue au Bulletin officiel n° 8 du 21 février 2013.
131 () Rapport d’information n° 3028 (Assemblée nationale, XIIIe législature) précité.
132 () « L’Éducation nationale face à l’objectif de la réussite de tous les élèves », rapport précité.
133 () « Enquête sur l’articulation entre les dispositifs de la politique de la ville et de l’éducation nationale dans les quartiers sensibles », Communication de la Cour des comptes à la Commission des finances du Sénat, annexée au rapport d’information n° 81 de MM. Philippe Dallier et Gérard Longuet, sénateurs, 3 novembre 2009.
134 () En particulier le « Rapport d’évaluation de l’assouplissement de la carte scolaire » de l’École d’économie de Paris – Cepremap, commandé par le ministère de l’éducation nationale (janvier 2012), et le rapport d’information n° 617 de la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat « Réguler la carte scolaire : pour une politique ambitieuse de mixité sociale » (27 juin 2012).
135 () Cf. notamment la loi du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure et la loi du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines.
136 () « Refondons l’École de la République », le rapport de la concertation, 9 octobre 2012.
137 () Débat avec des journalistes de Mediapart, 19 octobre 2012
138 () « Ce que la mixité fait aux élèves », Revue de l’OFCE n°114, juillet 2010.
139 () « Refondons l’École de la République », rapport précité.
140 () débat avec des journalistes de Mediapart, 19 octobre 2012.
141 () Rapport d’information sur les droits de l’individu dans la société numérique présenté par MM. Patrick Bloche et Patrice Verchère, n° 3560 (XIIIe législature), 22 juin 2011.
142 () « Bienvenue à l’école du futur », RSLN, mars 2008.
143 () Source : enquête ETIC 2008-2009.
144 () « Une médecine scolaire renforcée et rénovée au service de l’enfant », rapport présenté par M. Gérard Gaudron et Mme Martine Pinville, n° 3968 (XIIIe législature), 17 novembre 2011.
145 () Aux termes de l’article D. 113-1 du code de l’éducation, les enfants qui ont atteint l’âge de trois ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu’à la rentrée scolaire de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire. L’accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé.
146 () « L’école maternelle », inspection générale de l’éducation nationale et inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, rapport n° 2011-108, octobre 2011.
147 () Table ronde du 5 décembre 2012 organisée par la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale sur la priorité à accorder au primaire et à la petite enfance.
148 () « Refondons l’École de la République », rapport précité.
149 () Audition du 30 janvier 2013.
150 () « Sur l’instruction publique », dans Œuvres, édition Firmin Didot, 1847.
151 () Rapport d’information n° 3560 (Assemblée nationale, XIIIe législature) précité.
152 () Cf. notamment CE, avis, 25 mai 1999, req. n° 363340.
153 () « Les effets de la décentralisation sur le fonctionnement du système éducatif – état des lieux et éléments d’analyse 2005-2010 » – rapport du gouvernement au Parlement, décembre 2011.
154 () « À quoi les régions et les départements doivent-ils s’attendre dans le domaine du numérique ? » - M. Serge Pouts-Lajus, Éducation et territoires, 11 décembre 2012.
155 () Cf. « Les régions au cœur du nouvel acte de décentralisation »– Association des Régions de France – juillet 2012.
156 () Il serait ainsi nécessaire de mettre en œuvre 130 à 150 postes de maintenance-assistance pour les 400 lycées que compte l’Île-de France.
157 ()Activités directement liées aux activités d'enseignement, ou qui en constituent un prolongement : réunions des différents conseils : d’administration, de classe, des maîtres ; réunion des équipes pédagogiques ; réunions syndicales organisées dans le cadre du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; réunions tenues par les associations locales de parents d'élèves qui participent à la vie de l'établissement ; réunions d'information sur les métiers qui se déroulent dans les établissements du second degré au titre de l'orientation scolaire et professionnelle, réunions consacrées aux prêts et bourses de livres.
158 () Avis précité, 16 janvier 2013.
159 () « Refondons l’École de la République », rapport précité.
160 () Communication de M. Xavier Breton sur les manuels scolaires et rapport d’information de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation, n° 4225, 23 janvier 2012 (Assemblée nationale – XIIIe législature).
161 () Rapport d’information n° 2446 (Assemblée nationale, XIIIe législature) précité.
162 () Avis précité du 16 janvier 2013.
163 () « Refondons l’École de la République », rapport précité.
164 () « Les indicateurs relatifs aux acquis des élèves », Bilan des résultats de l’École – 2011, septembre 2011. Depuis la rentrée 2012, les résultats des évaluations de CE1 et de CM2 ne sont pas centralisés, mais collectés à l’échelle des écoles, et seulement à ce niveau.
165 () Sur l’objectif de la réussite de tous les élèves (rapport thématique en 2010), la répartition des moyens entre les établissements (référé de juillet 2012), l’orientation en fin de troisième (septembre 2012). Un rapport thématique sur la gestion des personnels devrait être publié en mai 2013.
166 () « La France et les évaluations internationales des acquis des élèves », avis n° 16, mai 2005.
167 () Avis sur l’avant-projet de loi, 16 janvier 2013.
168 () « Les expérimentations réalisées dans le cadre des projets d’école ou d’établissement », 29 novembre 2011.
169 () « Refondons l’École de la République », rapport précité.
170 () Rapport n° 2010-114 précité.
171 () « Socle commun et compétences : des enjeux nouveaux ? Réflexions dans la perspective de l’individualisation des parcours scolaires » Administration et Éducation, n° 114, juin 2007.
172 () Cf. notamment : « L’orientation scolaire », Bilan des résultats de l’École – 2008, rapport du Haut conseil de l’Education ; « L’orientation à la fin du collège : la diversité des destins scolaires selon les académies » - communication de la Cour des comptes à la Commission des finances de l’Assemblée nationale, septembre 2012.
173 () Audition de M. Patrick Lefas, président de la 3ème chambre de la Cour des comptes, par la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, 12 décembre 2012.
174 () « L’orientation scolaire », Bilan des résultats de l’École – 2008, rapport précité.
175 () « L’emploi des jeunes », avis du Conseil économique, social et environnemental, 26 septembre 2012.
176 () « Les compétences en langues étrangères des élèves en fin de scolarité obligatoire », note d’information n° 12.11, juin 2011. L’enquête en question est l’Étude européenne des compétences en langues, pilotée par la Commission européenne, à laquelle la France a participé en mars 2011.
177 () Arrêté du 9 juin 2008 publié au Bulletin officiel hors-série n° 3 du 19 juin 2008.
178 () « Apprendre les langues Apprendre le monde », rapport présenté au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative par le Comité stratégique des langues présidé par Mme Suzy Halimi, janvier 2012.
179 () « Pour plus d’égalité entre filles et garçons à l’école », lemonde.fr – idées, 25 septembre 2012.
180 () Entretien au Journal du dimanche, 1er septembre 2012.
181 () Seul l’enseignement de l’éducation civique au collège fait l’objet d’une évaluation à l’occasion du diplôme national du brevet.
182 () Rapport n° 2011-108 précité.
183 () « L’école primaire », Haut conseil de l’éducation, Bilan des résultats de l’École – 2007.
184 () Journal officiel, débats de l’Assemblée nationale, séance du 17 juin 1975.
185 () « L’éducation en Finlande. Les secrets d’une étonnante réussite », par Paul Robert, principal de collège (2009).
186 () Table ronde du 5 décembre 2012 de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale sur la priorité à accorder à l’école primaire et à la petite enfance.
187 () Rapport n° 2011-108 précité.
188 () Avis précité sur l’avant-projet de loi, 16 janvier 2013.
189 () « L’école primaire », Bilan des résultats de l’École – 2007.
190 () « Le rôle de l’école maternelle dans les apprentissages et la scolarité des élèves », article précité.
191 () Bilan des résultats de l’École – 2012, rapport précité.
192 () « Le rôle de l’école maternelle dans les apprentissages et la scolarité des élèves », article précité.
193 () Avis de l’Académie des sciences sur la refondation de l’enseignement approuvé le 22 septembre 2012.
194 () Annexe à la section I du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’éducation.
195 () Avis précité du 22 septembre 2012.
196 () Pour les classes de CE2, CM1 et CM2 aux termes de l’arrêté du 9 juin 2008 définissant les horaires de l’école élémentaire.
197 () L’enseignement annuel d’histoire des arts est de 20 heures et concerne l’ensemble des disciplines.
198 () « L’éducation aux médias. Enjeux, état des lieux, perspectives », inspection générale de l’éducation nationale et inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, rapport n° 2007-083, août 2007.
199 () « Citizenship Education in Europe », enquête publiée en juin 2012 et commentée dans « L’éducation à la citoyenneté en Europe », Éducation & formations n° 82, décembre 2012.
200 () « Le collège », Bilan des résultats de l’École – 2010, octobre 2010.
201 () « Un socle pour consolider le collège unique », rapport d’information n° 2446 précité (Assemblée nationale, XIIIe législature).
202 () « Les nouvelles politiques éducatives. La France fait-elle les bons choix ? », ouvrage précité.
203 () « Le collège unique pour quoi faire ? Les élèves en difficulté au cœur de la question », ouvrage précité. Dans cet écrit, les termes d’école moyenne désignent le collège
204 () « Les difficultés du collège unique : la France toujours à la recherche de son école moyenne », Revue française d’éducation comparée n° 3, septembre 2008.
205 () « L’orientation scolaire à la fin du collège : la diversité des destins scolaires selon les académies », rapport précité.
206 () Rapport n° 3519 présenté par M. Gérard Cherpion au nom de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, 8 juin 2011 (XIIIe législature).
207 () « L’orientation scolaire à la fin du collège : la diversité des destins scolaires selon les académies », rapport précité.
208 () Programmes du collège - Programmes de l’enseignement technologique, Bulletin officiel spécial n° 6 du 28 août 2008.
209 () Recommandation du 20 août 2009 de la Commission européenne sur l’éducation aux médias dans l’environnement numérique pour une industrie de l’audiovisuel et du contenu plus compétitive et une société de la connaissance intégratrice (2009/625/CE).
210 () Aux termes d’un arrêté du 4 décembre 2012, le DNB comportera, à partir de la session 2013, une série générale et une série professionnelle.
211 () Note de service du 24 septembre 2012, Bulletin officiel n° 35 du 27 septembre 2012. Les conditions de validation du socle commun dans le cadre du diplôme national du brevet ne seront pas modifiées pour la session 2013.
212 () « Un socle pour consolider le collège unique », rapport d’information n° 2446 (Assemblée nationale, XIIIe législature) précité.
213 () « Les inégalités scolaires à l’école », rapport précité.
214 () Café pédagogique du 13 janvier 2005.
215 () « L’orientation scolaire à la fin du collège : la diversité des destins scolaires selon les académies », rapport précité.
216 () Repères et références statistiques, édition 2012.
217 () Bulletin officiel n° 26 du 26 juin 2012.
218 () « Refondons l’École de la République », rapport précité de la concertation.
219 () « Les difficultés du collège unique : la France toujours à la recherche de son école moyenne », article précité.
220 () Proposition de loi n° 3170 présentée par MM. Frédéric Reiss, Dominique Le Mèner et Jacques Grosperrin et Mme Claude Greff, députés, 15 février 2011 (Assemblée nationale, XIIIe législature).
221 () « Rapport annuel des inspections générales 2007 », inspection générale de l’éducation nationale et inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, 2008.
222 () « Élargissement du programme CLAIR au programme ECLAIR », inspection générale de l’éducation nationale et inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, rapport n° 2012-076, juillet 2012.
223 () Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale n° 31 du 1er septembre 2011.
224 () « Refondons l’École de la République », rapport précité.
225 () Avis précité sur l’avant-projet de loi, 16 janvier 2013.
226 () « Refondons l’École de la République », rapport précité.
227 () Avis précité sur l’avant-projet de loi, 16 janvier 2013.
228 () Audition du 30 janvier 2013.
229 () « Quelle direction pour l’école du XXIe siècle ? », rapport à monsieur le Premier ministre, septembre 2010.
230 () « Améliorer la direction des établissements scolaires. Rapport national de base de la France », présenté dans le cadre de l’activité de l’OCDE, mai 2007.
231 () « Quelle direction pour l’école du XXIe siècle ? », rapport précité. Selon les calculs de M. Reiss, cette mesure représenterait un coût estimé entre 2 300 et 2 700 emplois.
232 () Enquête effectuée par le syndicat SE-UNSA auprès de 7 500 directeurs parue le 18 octobre 2012
233 () Proposition de loi n° 1188 présentée par MM. Benoist Apparu, Guy Geoffroy et Frédéric Reiss (13 novembre 2008).
234 () On rappellera que l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales dispose que la métropole est un EPCI regroupant « plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave et qui s’associent au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire » et que peuvent ainsi obtenir le statut de métropole les EPCI qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500 000 habitants.
235 () Selon l’expression d’un inspecteur d’académie, cité par le Rapport annuel 2007 de l’inspection générale de l’éducation nationale et de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale.
236 () Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale n° 36 du 6 octobre 2005.
237 () Rapport d’information n° 3028 précité (Assemblée nationale, XIIIe législature).
238 () « Les communes et l’école de la République », rapport public thématique, décembre 2008.
239 () Rapport d’information n° 3028 (Assemblée nationale, XIIIe législature) précité.
240 () Bulletin officiel n° 6 du 7 février 2013.
241 () Circulaire du 6 février 2013 relative à l’organisation du temps scolaire dans le premier degré parue dans le Bulletin officiel de l’éducation nationale n° 6 du 7 février 2013.
242 () « Projet éducatif local, loi d’orientation et fonds d’amorçage de 250 millions d’euros », tribune publiée par le Café pédagogique le 27 novembre 2012.
243 () « La formation des maîtres : débats et perspectives », Alain Boissinot, Revue international d’éducation-Sèvres n° 55, décembre 2010.
244 () « Recommandations pour la formation des maîtres », 31 octobre 2006.
245 () Avis précité sur la refondation de l’enseignement, septembre 2012.
246 () « La nouvelle question scolaire. Les bénéfices de la démocratisation », 2007.
247 () Avis précité sur l’avant-projet de loi.
248 () « Les centres d’initiation à l’enseignement supérieur » rapport n° 2009-55, juin 2009.
249 () Selon l’expression de M. Jean-Michel Jolion, ancien président du comité de suivi du master.
250 () Avis sur le projet d’arrêté fixant le cahier des charges de la formation des professeurs, des documentalistes et conseillers principaux d’éducation, 13 juin 2012.
251 () « Principes et recommandations pour une réforme réussie de la formation des maîtres », rapport remis aux ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale, 17 juillet 2009.
252 () Faire partager les valeurs de la République ; inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif ; connaître les élèves et les processus d’apprentissage ; prendre en compte la diversité des élèves ; accompagner les élèves dans leur parcours de formation ; agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques ; utiliser une langue vivante étrangère ; coopérer au sein d’une équipe ; contribuer à l’action de la communauté éducative ; coopérer avec les partenaires de l’école ; s’engager dans une démarche de développement professionnel.
253 () S’y ajoute le référentiel des compétences spécifiques à la conseillère principale d’éducation ou au conseiller principal d’éducation.
254 () « Refonder l’université Dynamiser la recherche. Mieux coopérer pour réussir », rapport remis au Premier ministre le 14 janvier 2013.
255 () Avis précité du 16 janvier 2013.
256 () Table ronde du 6 février 2013 organisée par la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale sur la formation des enseignants.
257 () Table ronde organisée le 6 février 2013 par la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale sur la formation des enseignants.
258 () « Évaluation de la politique de formation continue des enseignants des premier et second degrés (sur la période 1998-2009) », inspection générale de l’éducation nationale et inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, rapport n° 2010-111, octobre 2010.
259 () Avis précité du 13 juin 2012.
260 () Les péripéties de la proposition de loi relative à la modification de certaines dispositions encadrant la formation la formation des maîtres, adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale le 15 février 2012, ont été commentées dans l’exposé général du présent rapport.
261 () Après avoir été amendé, le projet a suscité une opposition moins forte (19 voix contre et 10 pour).
262 () La vague A couvre la période 2011-2015, la C la période 2013-2017 et la E la période 2015-2019.
263 () Table ronde du 6 février 2013 organisée par la Commission des affaires culturelles et de l’éducation sur la formation des enseignants.
264 () Contribution précitée, juillet 2012.
265 () Avis n° 1968, tome 8, au nom de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation (Assemblée nationale, XIIIe législature) sur les crédits relatifs à l’enseignement supérieur et à la vie étudiante du projet de loi de finances pour 2010, 14 octobre 2009.
266 () Avis précité, 16 janvier 2013.
267 () Audition du 30 janvier 2013.
268 () Table ronde du 6 février 2013 organisée par la Commission des affaires culturelles et de l’éducation sur la formation des enseignants.
269 () C'est-à-dire les articles L. 162-2-1, L. 262-1, L. 492-1, L. 682-2 et L. 772-1.
270 () Le statut de Saint-Barthélemy est fixé aux articles L.O. 6211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; celui de Saint-Martin est déterminé par les articles L.O. 6311-1 et suivants du CGCT.