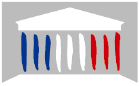N° 847
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 mars 2013.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI relatif à la sécurisation de l’emploi,
(procédure accélérée)
PAR M. Jean-Marc GERMAIN,
Député.
——
TOME I
Rapport
——
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 774, 837 et 839.
A. UN MARCHÉ DU TRAVAIL ENTRE PRÉCARITÉ DE L’EMPLOI ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 13
B. LES PARTENAIRES SOCIAUX DÉSORMAIS PLEINEMENT ASSOCIÉS À L’ÉLABORATION DE LA NORME SOCIALE 15
1. La procédure de consultation des partenaires sociaux en amont des projets et propositions de loi 16
2. Un projet de loi constitutionnel pour reconnaître dans notre loi fondamentale ce rôle accru des partenaires sociaux 17
II.- UN ACCORD « LARGE » 17
A. UN DES RARES ACCORDS NATIONAUX INTERPROFESSIONNELS MULTIDIMENTIONNELS SUR L’EMPLOI ET LE MARCHÉ DU TRAVAIL 17
B. L’ACCORD VU PAR SES SIGNATAIRES 20
C. LE PRÉSENT PROJET DE LOI 23
TRAVAUX DE LA COMMISSION 27
EXAMEN DES ARTICLES 27
Article 1er (art. L. 911-7, L. 911-8 et L. 912-1 du code de la sécurité sociale ; loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989) Généralisation de la couverture complémentaire collective « santé » pour les salariés et amélioration de la portabilité des couvertures « santé » et « prévoyance » des demandeurs d’emploi 27
Article 2 (art. L. 6111-1 et L. 6314-3 [nouveau] du code du travail) Création du compte personnel de formation et du conseil en évolution professionnelle 86
Article 3(art. L. 1222-12 à L. 1222-15 [nouveaux] du code du travail) Création d’une période de mobilité volontaire sécurisée 119
Article 4 (art. L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-7-1 à L. 2323-7-3 [nouveaux], L. 2325-35, L. 2325-42-1 [nouveau], L. 2332-1, L. 2323-26-1 à L. 2323-26-3 [nouveaux], L. 2313-7-1 [nouveau], L. 4616-1 à L. 4616-5 [nouveaux], et L. 4614-3 du code du travail) Réforme des règles de consultation et de recours à l’expertise des institutions représentatives du personnel 133
Article 5 (art. L. 225-27-1 et L. 225-28-1 [nouveaux], L. 225-29 à L. 225-34, L. 225-34-1 et L. 225-79-1 [nouveaux], L. 225-80 et L. 226-4-2 à L. 226-4-4 [nouveaux] du code du commerce ; art. L. 2323-65 du code du travail) Représentation des salariés au conseil d’administration ou de surveillance 171
Article 6 (art. L. 5422-2-1 [nouveau] du code du travail ; art. 43 de la loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels) Amélioration des droits à nouvelle indemnisation chômage des salariés et renforcement de l’accompagnement des demandeurs d’emploi 193
Article 7 (art. L. 5422-12 du code du travail) Majoration de la cotisation d’assurance chômage sur les contrats courts 215
Article 8 (art. L. 2241-13, L. 3123-8, L. 3123-14, L. 3123-14-1 à L. 3123-14-4 [nouveaux], L. 3123-16, L. 3123-17, L. 3123-19 et art. L. 3123-25 du code du travail) Encadrement du travail à temps partiel 238
Article 9(art. L. 2242-15, L. 2242-16, L. 2323-33 et L. 2323-35 du code du travail) Extension du périmètre de la négociation triennale obligatoire sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 266
Article 10 (art. L. 2242-21 à L. 2242-23 [nouveaux] du code du travail) Mobilité interne 276
Article 11 (art. L. 3232-2, L. 3232-5, L. 5122-1 à L. 5122-4, et L.5428-1 du code du travail et art. L. 242-10 du code de la sécurité sociale) Refonte du dispositif d’indemnisation de l’activité partielle 299
Article 12 (art. L. 5125-1 à L. 5125-6 [nouveaux] du code du travail) Accords de maintien de l’emploi 319
Article 13(art. L. 1233-22 à L. 1233-24, L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 [nouveaux], L. 1233-30, L. 1233-33à L. 1233-36, L. 1233-39 à L. 1233-41, L. 1233-45-1 [nouveau], L. 1233-47, L. 1233-50, L. 1233-52 à L. 1233-57, L. 1233-57-1 à L. 1233-57-8 [nouveaux], L. 1233-58, L. 1233-63, L. 1233-90-1 [nouveau], L. 1235-7, L. 1235-7-1 [nouveau], L. 1235-10, L. 1235-1,L. 1235-16, L. 2323-15, L. 2325-35, L. 2325-37, L. 3253-8, L. 3253-13, L. 4614-12-1 et L. 4614-12-2 [nouveaux] du code du travail ; art. L. 631-17, L. 631-19, L. 641-4 et L. 642-5 du code de commerce) Réforme de la procédure de licenciement collectif pour motif économique 345
Article 14(art. L. 1233-90-1 [nouveau] et L. 2325-37 du code du travail) Création d’une obligation de recherche d’un repreneur en cas de fermeture d’établissement 379
Article 15(art. L. 1233-5, L. 1233-71 et L. 1233-72-1 du code du travail) Précision des critères d’ordre des licenciements économiques et allongement de la durée du congé de reclassement 385
Article 16(art. L. 1235-1, L. 1471-1 [nouveau], L. 3245-1 du code du travail ; art. 80 duodecies du code général des impôts) Développement de la conciliation prud’homale et réforme des délais de prescription 389
Article 17(art. L. 2314-2, L. 2322-2 et L. 2324-3 du code du travail) Aménagement de la mise en place des institutions représentatives du personnel en cas de franchissement des seuils d’effectif 397
Article 18 Expérimentation du contrat à durée indéterminée intermittent 400
Article 19 Habilitation du Gouvernement à modifier par voie d’ordonnance le code du travail application à Mayotte 405
TABLEAU COMPARATIF 409
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 511
Notre pays est confronté à la plus grande crise qu’il ait sans doute connue en temps de paix. La crise est dure avec un taux de chômage au plus haut, des emplois précaires qui se sont multipliés et des fins de mois de plus en plus difficiles à boucler atteignant aussi désormais les classes moyennes, et des entreprises françaises fragilisées dans la mondialisation.
La crise est dure, mais aussi particulièrement dure à affronter, dans notre pays comme dans les autres pays développés, car contrairement à d’autres périodes de notre histoire, ces difficultés des ménages et des entreprises se cumulent avec celles des États, fortement endettés et donc aux marges de manœuvre limitées. Elle est particulièrement difficile à affronter aussi parce qu’elle est profonde, à la fois économique, sociale, écologique et planétaire.
Dans cette situation, le Président de la République et son gouvernement ont engagé une bataille sur trois fronts, avec des mesures d’urgence comme des réformes de structure.
– Le front européen, tout d’abord, pour relancer la croissance car c’est à ce niveau-là qu’elle se joue. Nos économies européennes sont à ce point imbriquées que tenter de relancer seuls notre économie ne serait guère plus efficace que de tenter d’écoper la mer avec un seau.
C’est la raison d’être du « paquet croissance » négocié de haute lutte par le Président de la République lors du sommet européen de juin 2012. Ce sont les négociations récentes pour un budget européen préservé. C’est un rythme de réduction des déficits budgétaires suffisamment étalé dans le temps pour ne pas porter atteinte à la croissance. C’est une Banque centrale européenne et un Mécanisme européen de stabilité qui apportent aux banques et aux États les liquidités dont elles ont besoin pour fonctionner.
– Le deuxième front, c’est la compétitivité pour redonner à la France sa place dans la mondialisation. En 2002, la balance commerciale française était excédentaire, aujourd’hui, elle accuse un déficit commercial de plus de 70 milliards d’euros.
La compétitivité, c’est remettre la finance au service des entreprises : c’est l’objet de la loi créant la Banque publique d’investissement et de la loi bancaire adoptées récemment, de la future loi sur la mobilisation de l’épargne des Français au service de l’économie et de la dernière loi de finances, avec le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), qui donne des moyens sans précédent aux entreprises – 20 milliards d’euros par an –, non pas pour baisser leurs prix de production, ce serait une course sans fin illusoire, mais pour leur permettre d’investir dans la recherche, dans l’innovation, dans la formation et d’embaucher.
– Le troisième front, c’est celui du marché du travail. Il faut agir sur l’embauche, c’est ce qui est fait avec les deux lois déjà votées sur les 150 000 emplois d’avenir et les 500 000 contrats de génération pour aider les jeunes et les seniors – qui sont les premières victimes du chômage –, mais aussi sur la sécurisation des emplois : c’est l’objet du présent projet de loi.
*
À cette fin, sur le fondement des grands principes posés lors de la Grande conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012, le Gouvernement a adressé aux partenaires sociaux au début du mois de septembre 2012 un document d’orientation définissant quatre domaines qu’il souhaitait soumettre à leur négociation dans le cadre de la sécurisation de l’emploi : la lutte contre la précarité du marché du travail, la progression dans l’anticipation des évolutions de l’activité, de l’emploi et des compétences, l’amélioration des dispositifs de maintien de l’emploi face aux aléas conjoncturels ainsi que l’amélioration des procédures de licenciements collectifs.
Après quatre mois de négociations, un accord national interprofessionnel a été signé le 11 janvier 2013 par les trois organisations représentatives des employeurs et trois des cinq organisations syndicales représentatives des salariés, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC. Selon les résultats de représentativité rendus publics le 29 mars, ces trois syndicats de salariés représentent 51,15 % des suffrages recueillis par les organisations habilitées à négocier au plan interprofessionnel, c’est-à-dire ayant franchi le seuil des 8 %.
Le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi, qui est aujourd’hui soumis à la représentation nationale, en est le prolongement. Il traduit la nouvelle articulation souhaitée par le Président de la République entre la démocratie sociale et la démocratie politique qui a donné lieu à un projet de loi constitutionnelle relatif à la démocratie sociale, adopté par le Conseil des ministres le 13 mars 2013. Sa philosophie développée dans son exposé des motifs se résume ainsi : la négociation sociale précède et inspire les lois sociales. Le législateur reste souverain, mais les évolutions législatives en matière sociale, sauf urgence, doivent être précédées d’une phase de consultation et, si les partenaires sociaux le veulent, d’une négociation.
C’est au fond une sorte de valse à trois temps : le premier est celui du gouvernement qui fixe les objectifs comme cela a été le cas avec la feuille de route de septembre 2012 ; le second est celui des partenaires sociaux qui négocient sur ce fondement, comme ils l’ont fait entre octobre et jusqu’au 11 janvier 2013 ; le troisième est celui du Parlement.
*
Votre rapporteur considère que ces trois étapes doivent être d’égale importance. Repartir de zéro serait un non-sens : rien ne justifie d’ignorer le fruit de quatre mois de travail intense des partenaires sociaux auquel ont contribué y compris les organisations non signataires, qui sont restées jusqu’au bout à la table des négociations même si in fine elles ne se reconnaissent pas dans l’accord. Beaucoup des dispositions qui sont contenues dans ce texte concernent le cœur du fonctionnement des entreprises, et il est fondamental pour la représentation nationale de prendre en compte ce que proposent ceux qui en sont les premiers acteurs, les représentants des salariés et des employeurs.
Nous limiter toutefois à un travail de scribe qui consisterait à simplement codifier ce qui a été écrit par les signataires ne serait pas plus conforme au mandat que nous ont donné nos électeurs : celui de faire la loi au nom du peuple, porteurs de l’intérêt général et fidèles aux convictions et aux engagements que chacun d’entre nous a pris devant ses électeurs.
Jouer pleinement notre rôle de législateur est d’autant plus légitime que, d’une part, nombre des dispositions de cet accord dépassent le champ de l’entreprise –la création d’une couverture santé complémentaire obligatoire ou d’un compte personnel de formation universel, le rôle de l’État dans la protection des salariés, celui du juge dans le règlement des contentieux….– et que d’autre part, contrairement à l’accord sur les contrats de générations, deux organisations de syndicats de salariés ne l’ont pas signé.
Être loyal vis-à-vis des signataires – car sinon nous porterions un coup fatal à la négociation collective interprofessionnelle pour de longues années –, mais à l’écoute des non-signataires et aussi de tous ceux qui au-delà seront concernés, pour améliorer ce qui peut l’être, voilà ce qui a guidé votre rapporteur dans les travaux préparatoires qu’il a conduit. C’est un chemin de crête sans doute étroit, mais il existe et il permet d’avancer loin dès lors qu’on le fait avec méthode.
– Avancer avec méthode, c’est d’abord écouter. C’est la raison pour laquelle de très nombreuses auditions ont été organisées. Les organisations patronales et syndicales ont été ainsi auditionnées à cinq reprises chacune : par votre rapporteur pendant les négociations, après la conclusion de l’accord, après l’avant-projet de loi, après le projet de loi, et de manière collective par la commission des affaires sociales.
– Avancer avec méthode, c’est comprendre. Afin que chacun puisse se faire une idée très précise de la portée de chacune des dispositions du projet de loi, et de ses effets possibles sur l’emploi, sur la réduction de la précarité, sur les droits des salariés, sur la compétitivité des entreprises, de très nombreux spécialistes, experts, administrations ont été auditionnés, et tous les débats qui sont apparus sont retracés dans ce rapport, sans rien éluder des débats qui existent et des questions qui se posent.
– Avancer avec méthode, c’est enfin respecter. Respecter les signataires dans leur choix de signer cet accord ; respecter les non-signataires dans leur choix de ne pas le faire ; respecter les parlementaires dans la plénitude de leur droit d’amendement. L’intelligence est collective. Cela a conduit votre rapporteur, en liaison avec le gouvernement, à consulter en permanence les partenaires sociaux, signataires comme non signataires, dans son travail d’amendement du texte. Beaucoup de questions qui avaient pu être soulevées ont pu être réglées lors de notre travail en commission, d’autres pourront l’être lors du débat dans l’hémicyle avec les amendements complémentaires qui sont proposés, d’autres encore le seront dans le temps, par un suivi et une évaluation très précises, et le cas échéant un droit de suite pour corriger ce qui n’a pas fonctionné comme espéré.
L’objectif est qu’in fine, l’efficacité dans la lutte contre le chômage, dans la protection des salariés et de leur qualité de vie, et pour la performance des entreprises, soit au rendez-vous.
*
Mis bout à bout, la vingtaine d’articles du projet de loi dessinent trois évolutions profondes du marché du travail de notre pays.
– La première, c’est retour de l’État, à l’appui des salariés et de la négociation sociale, comme garant dans la prévention des licenciements économiques.
Une refonte profonde de la procédure en la matière est en effet engagée. Aujourd’hui, la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi s’opère de manière unilatérale à l’initiative de l’employeur ; elle sera demain soumise soit à l’accord des salariés à travers leurs organisations syndicales – un accord majoritaire –, soit à défaut à une homologation de l’administration. Il s’agit là de la traduction concrète de l’engagement n° 35 de François Hollande : renchérir le coût des licenciements en fonction des moyens des entreprises, en vue de les dissuader le plus possible. L’administration sera à cet effet dotée d’un nouveau pouvoir : celui de refuser un plan social qui ne serait pas suffisamment protecteur pour les salariés.
L’objectif est clair : comme l’a souligné le ministre du travail lors de son audition, il s’agit de mettre résolument fin à la préférence française pour le licenciement au profit de toutes les solutions qui permettent de les éviter. C’est ainsi que parallèlement à cette nouvelle procédure, le projet de loi procède à une refonte du dispositif de chômage partiel qui est rendu plus efficace et plus facilement et rapidement mobilisable par les entreprises confrontées à des aléas conjoncturels. Il crée également la possibilité de conclure des accords de maintien de l’emploi, qui sont également une forme d’activité partielle, mais négociée et assortie de protections, de garanties, et d’une contribution des dirigeants actionnaires aux efforts.
C’est ce choix qui a principalement permis à l’Allemagne de mieux s’en sortir que d’autres pendant la crise de 2008 sans augmentation sensible du chômage : ainsi par exemple, au plus fort de la crise en 2009, 1 600 000 salariés allemands étaient en activité partielle quand, la même année, seulement 200 000 salariés français l’étaient.
Contrairement à ce qui est parfois avancé, ce texte ne porte pas en lui la mise en place en France de la flexi-sécurité. La flexi-sécurité aurait consisté à faciliter les licenciements tout en indemnisant mieux les chômeurs. Elle repose sur un théorème absurde – et démenti par les faits – selon lequel « les licenciements d’aujourd’hui feraient les emplois de demain ». Cela supposerait en outre d’augmenter considérablement les moyens de l’assurance chômage, ce qui est hors de portée compte tenu de la situation financière de la France.
C’est un autre choix qui a été fait, que l’on pourrait qualifier de la sécuri-sécurité : il rend plus difficile la flexibilité externe – plans sociaux limités, taxation des contrats à durée déterminée, encadrement des temps partiels – au profit des redéploiements internes aux entreprises, en donnant des pouvoirs et des moyens nouveaux à la négociation collective, avec l’État comme garant. C’est l’intérêt des salariés, qui gardent leur emploi, mais aussi des entreprises qui conservent en leur sein leurs compétences.
– La deuxième évolution profonde, c’est une participation accrue des salariés à la définition des stratégies d’entreprise.
L’objectif est simple : anticiper, saisir à temps les opportunités et gérer les difficultés avant qu’il ne soit trop tard, et cela, en associant fortement les salariés. La mise en place d’une représentation des salariés au conseil d’administration des très grandes entreprises, de plus de 5 000 salariés, en constitue indéniablement la mesure emblématique qui constituait un engagement fort de François Hollande (engagement n° 55). Mais cette vision commune et concertée s’incarne également dans la nouvelle participation des salariés, à travers leurs représentants, à la stratégie de l’entreprise, avec la création de deux consultations annuelles supplémentaires sur les orientations stratégiques de l’entreprise et son utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi, un recours élargi à l’expertise, une obligation de négocier désormais les grandes orientations du plan de formation, la mise en place d’une base de données stratégiques accessible en permanence aux représentants du personnel.
– Enfin, ce projet de loi apporte de nouveaux jalons constitutifs d’une véritable sécurité sociale professionnelle.
Les salariés sont désormais amenés à changer beaucoup plus souvent d’entreprise que par le passé, que cette situation soit choisie ou subie. Dès lors, il nous faut aller vers un modèle social où les droits acquis dans une entreprise puissent être conservés lorsque l’on en change, des droits attachés au salarié tout au long de sa vie professionnelle et non plus à l’entreprise qui l’emploie à un moment donné.
Que ce soit en matière de santé – avec la généralisation de la couverture complémentaire santé à l’ensemble des salariés et la mise en place d’un mécanisme de portabilité des droits pour les salariés qui quittent l’entreprise -, en matière de formation – avec la création d’un compte personnel de formation destiné à suivre toute personne de son entrée sur le marché du travail à son arrivée à la retraite – ou encore en matière de couverture chômage – avec la mise en place de droits rechargeables à l’assurance chômage –, l’approche qui est privilégiée est bien celle de la reconnaissance de droits aux individus en tant que salariés, mais également pendant leurs périodes d’inactivité, de chômage ou de formation.
Au-delà de ces droits « portables », ce texte vise aussi à améliorer les transitions en encadrant par la négociation collective les mobilités demandées aux salariés à l’intérieur des entreprises, en créant une mobilité externe sécurisée qui permet de tenter une expérience professionnelle dans une autre entreprise avec un droit au retour si cela ne se passe pas comme prévu mais également en obligeant les entreprises qui veulent fermer un établissement à rechercher des repreneurs.
* *
*
I.- LA SITUATION DÉGRADÉE DU MARCHÉ DU TRAVAIL APPELLE DES MESURES FORTES
Si la crise économique qui frappe la France a entraîné une accélération des destructions d’emplois, la situation du marché du travail apparaît structurellement dégradée, générant précarité de l’emploi et des conditions de travail. Conformément à l’objectif présidentiel d’inversion de la courbe du chômage et à la priorité d’action pour l’emploi, après de nombreux textes visant à redresser économiquement et financièrement notre pays, après les lois portant création des emplois d’avenir et des contrats de génération, le présent projet de loi propose de nouvelles mesures fortes pour améliorer en profondeur le fonctionnement du marché du travail de notre pays. Depuis la Grande conférence sociale de l’été dernier, les partenaires sociaux ont engagé, à l’initiative du Gouvernement, de nombreuses négociations les associant au processus d’élaboration du droit du travail.
La situation du marché du travail français est marquée par une précarité croissante de l’emploi, caractérisée par l’augmentation du taux de chômage depuis mars 2008 et un recours accru aux contrats temporaires, ainsi que par un développement des formes atypiques de travail, telles que le temps partiel ou les horaires décalés.
Le taux de chômage, qui avait fortement été réduit dans les années 1997-2002 et fluctué ensuite pendant les cinq années qui ont suivi, a repris sa progression il y a cinq ans pour atteindre un niveau historiquement élevé. Il touche 10,6 % de la population active au dernier trimestre 2012.
Source : Insee, Séries longues sur le marché du travail.
Les taux de chômage de longue durée et de très longue durée ont également augmenté sur cette période : en 2011, 3,7 % des actifs sont en recherche d’emploi depuis plus d’un an, soit une augmentation d’un point par rapport à 2008, et 1,8 % depuis plus de deux ans, soit une augmentation de 0,5 point. En février 2013, l’ancienneté moyenne des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi s’élève à 482 jours.
La précarité de l’emploi sur le marché du travail français s’étend aux formes de celui-ci, et l’on constate un accroissement significatif du recours aux contrats temporaires. Ainsi, en 2011, près de 9,5 % des salariés se trouvent en contrat à durée déterminée (CDD) et 16,8 millions de contrats d’intérim ont été conclus, concernant 3,2 % des salariés. Depuis le milieu des années 1990, cette dernière forme d’emploi a connu une croissance notable. Les contrats temporaires constituent désormais des modes banals de recrutement par les entreprises.
Source : DARES Analyses, « L’intérim en 2011 », juin 2012.
Enfin, le nombre de stages en milieu professionnel est estimé à environ 1,6 million par an, selon le rapport sur l’emploi des jeunes du Conseil économique, social et environnemental de septembre 2012. Leur développement s’explique par la diffusion de la pratique de l’alternance dans les cursus universitaires, mais également par les difficultés d’insertion des jeunes sur le marché du travail, qui acceptent des stages à défaut de trouver un emploi pérenne.
L’évolution des conditions de travail des salariés français se caractérise aussi par une précarité accrue, qu’il s’agisse de la durée du travail ou des horaires atypiques. En 2011, près 18,7 % des salariés travaillent à temps partiel, dont 28,7 % des salariés en contrat à durée déterminée (CDD) contre 16,5 % des salariés en contrat à durée indéterminée (CDI), ce qui donne une première mesure du cumul des contraintes que subissent les salariés précaires.
En 2012, par rapport à la moyenne des pays de l’Union européenne, on observe que le recours aux CDD apparaît plus important sur le marché du travail en France, alors que le temps partiel y est moins répandu, bien que le temps partiel « subi » y soit plus important.
Source : Insee, « France, portrait social », Édition 2012.
Les horaires atypiques ont également connu une forte progression. Ainsi, en 2011, près de 29 % des salariés ont travaillé le dimanche de manière habituelle ou occasionnelle, contre 20 % en 1990.
Face à cette situation dégradée du marché du travail, le Gouvernement a fait du développement de l’emploi sa priorité d’action, et a invité les partenaires sociaux à se mobiliser. Ces derniers ont ouvert de nombreuses négociations suite à la Grande conférence sociale, dont deux d’entre elles ont d’ores et déjà abouti : celle sur les contrats de générations, conclue par un accord unanime et traduite depuis dans la loi ; celle sur la sécurisation de l’emploi qui a abouti à l’accord transversal du 11 janvier dernier. D’autres sont en cours, notamment celle sur la qualité de vie au travail et l’égalité entre les femmes et les hommes qui devrait aboutir au premier semestre 2013. Une nouvelle conférence sociale est programmée en juillet pour fixer le programme de travail des douze mois qui suivront. Les partenaires sociaux sont donc, désormais, pleinement associés à l’élaboration de la norme sociale.
La loi de modernisation du dialogue social du 31 janvier 2007 a créé une obligation de consultation préalable des partenaires sociaux, placée en tête du code du travail, à son article L. 1. Ainsi, lorsque le gouvernement envisage une réforme qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle, il doit d’abord organiser une concertation des partenaires sociaux, en commençant par leur communiquer un document d’orientation.
S’ils décident d’ouvrir une négociation, les partenaires sociaux doivent indiquer au Gouvernement le délai qu’ils estiment nécessaire pour tenter de parvenir à un accord. Au vu des résultats de cette négociation et de la concertation, le gouvernement élabore, ensuite, un projet de loi qu’il doit soumettre pour avis, selon le cas, à la Commission nationale de la négociation collective, au Comité supérieur de l’emploi ou au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Afin d’associer également les partenaires sociaux à l’élaboration des propositions de lois, les assemblées parlementaires se sont dotées de protocoles prévoyant des procédures de consultation préalable similaires. Ainsi, la Conférence des Présidents de l’Assemblée nationale a adopté le 16 février 2010 un protocole (1) organisant la concertation des partenaires sociaux avant l’inscription effective à l’ordre du jour d’une proposition de loi, dont le contenu entre dans le champ de la loi de modernisation du dialogue social.
Aujourd’hui, lorsque l’inscription à l’ordre du jour d’une telle proposition de loi est envisagée, le président de la commission des affaires sociales doit en être informé. Il transmet alors ce texte aux partenaires sociaux, afin qu’ils lui fassent part, sous quinze jours, de leurs observations et de leur intention d’ouvrir une négociation. Si tel est le cas, il doit leur accorder un délai raisonnable pour conduire cette négociation, lorsque l’ensemble des organisations syndicales et d’employeurs consultées l’a demandé. Il n’y est pas tenu lorsqu’elles ne sont pas unanimes.
2. Un projet de loi constitutionnel pour reconnaître dans notre loi fondamentale ce rôle accru des partenaires sociaux
Depuis sa création, la procédure de consultation a été mise en œuvre quatorze fois au titre de la loi de modernisation du dialogue social, et quatre fois sur le fondement du protocole expérimental de l’Assemblée nationale. Depuis la Grande conférence sociale, les partenaires sociaux, comme cela a été dit, ont été invités à ouvrir plusieurs négociations, relatives aux contrats de génération et à la sécurisation de l’emploi, qui ont abouti à deux accords nationaux interprofessionnels, ainsi qu’à la qualité de vie au travail, une négociation toujours en cours.
La mise en œuvre de cette procédure apparaît donc soutenue. Afin de consacrer cette reconnaissance du rôle essentiel des partenaires sociaux et de marquer une nouvelle étape d’approfondissement de la démocratie sociale, le Gouvernement a déposé, en mars 2013, un projet de révision constitutionnelle visant à inscrire cette procédure dans notre loi fondamentale.
L’accord conclu le 11 janvier porte sur l’emploi dans sa globalité, contrairement à la plupart des accords nationaux interprofessionnels conclus au fil des années, qui sont le plus souvent sectoriels ou thématiques. Rares sont les deux autres négociations portant sur un spectre aussi large qui ont abouti dans notre histoire sociale.
A. UN DES RARES ACCORDS NATIONAUX INTERPROFESSIONNELS MULTIDIMENTIONNELS SUR L’EMPLOI ET LE MARCHÉ DU TRAVAIL
L’accord national interprofessionnel du 31 décembre 1958, qui crée le régime d’assurance chômage et en confie la gestion à des instances paritaires, l’Unédic et les Assédic, constitue le texte fondateur de la négociation interprofessionnelle sur l’emploi.
En réalité, les premiers pas du dialogue social interprofessionnel sur l’emploi se matérialisent dans des accords qui portent de manière isolée sur des champs spécifiques, qu’il s’agisse donc du premier accord déjà évoqué de 1958, ou encore de la création de l’Association pour l’emploi des cadres (APEC) par l’accord du 18 novembre 1966 ou de l’indemnisation du chômage partiel par l’accord du 23 février 1968.
Les événements de mai 1968 relancent le dialogue social de manière plus large : si, en matière de réduction de la durée du travail, ce sont essentiellement des accords de branche qui aboutissent à cette époque, la négociation interprofessionnelle débouche néanmoins, en 1969 et 1970, sur deux accords portant respectivement sur la « sécurité de l’emploi » et « la formation et le perfectionnement professionnels » :
– le premier, signé le 10 février 1969, crée des « commissions paritaires de l’emploi » dans chaque branche, et, dans le cadre du projet de licenciement collectif, définit d’une part les modalités de la consultation du comité d’entreprise, et fixe d’autre part des obligations de reclassement ou de réembauche.
– le second, signé le 9 juillet 1970, est considéré comme fondateur du système français de formation professionnelle continue. Il fonde la légitimité des partenaires sociaux à régir le dispositif de formation continue et crée un droit individuel pour le salarié : le congé individuel de formation. Il prévoit le recours à la formation pour les salariés menacés de licenciement. Il est repris par la loi du 16 juillet 1971 qui prévoit les modalités de financement du système de formation professionnelle continue.
Jusqu’au début des années 1980, le dialogue social est ensuite clairement marginalisé.
Avec l’apparition du phénomène de chômage de masse, une nouvelle série de négociations interprofessionnelles et multidimensionnelles sur l’emploi s’ouvre en 1984 à l’initiative du patronat : elles portent autant sur les mutations technologiques, la durée et l’aménagement du temps de travail, le temps partiel, les contrats à durée déterminée et le travail temporaire, que sur les procédures de licenciement et la question des seuils d’effectifs. Ces négociations se soldent, comme on le sait, par un échec, et conduisent à obérer pour plusieurs années le dialogue social au niveau interprofessionnel et à opérer un retour de celui-ci au niveau de l’entreprise. Une des raisons parfois mise en avant par certains de cet échec est d’avoir voulu de faire de la négociation une négociation non fractionnable.
Ce n’est qu’en 1988-1989 que des négociations interprofessionnelles sont relancées autour de la « modernisation des entreprises » ; la recherche d’un accord global indivisible est d’emblée abandonnée. Au final, sur les cinq thématiques soumises à la négociation, quatre aboutissent : la première à travers l’accord national interprofessionnel du 23 septembre 1988 sur les mutations technologiques, la deuxième par l’accord du 21 mars 1989 sur l’aménagement du temps de travail ; la troisième, relative à l’amélioration des conditions de travail, se matérialise dans l’accord du 20 octobre 1989, tandis que la quatrième aboutit à l’accord du 23 novembre 1989 sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Seule la négociation sur la mobilité géographique et professionnelle échoue. Les quatre accords signés se donnent davantage comme des préconisations adressées aux pouvoirs publics ainsi que des orientations données aux branches pour une négociation à leur niveau.
De nouvelles négociations sur l’emploi, et notamment l’emploi des jeunes, sont initiées en 1995 : comme en 1988, la formule retenu consiste à rechercher des accords formellement distincts dont chacun couvrirait un champ spécifique. Cette négociation débouche sur la conclusion de quatre accords : un accord sur l’insertion professionnelle des jeunes le 23 juin 1995, qui obtient notamment des aides financières publiques pour réduire le coût salarial de l’embauche des jeunes ; un accord sur les « préretraites contre l’embauche », signé le 6 septembre 1995 et qui initie une politique de cessations anticipées d’activité ; un accord sur l’emploi conclu le 31 octobre 1995, qui porte essentiellement sur un échange de contreparties entre aménagement et réduction du temps de travail ; et enfin, un accord signé le même jour qui porte sur l’articulation entre les différents niveaux de négociation et aménage des procédures dérogatoires de négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.
Une nouvelle vague de négociation de vaste ampleur sur l’emploi est amorcée en 2000-2001 sous la thématique générale de la « refondation sociale ». Elle a initialement porté sur quatre thématiques – l’approfondissement de la négociation collective ; l’assurance chômage, la lutte contre la précarité et l’insertion des jeunes ; la santé au travail et la prévention des risques ; et enfin, l’évolution des régimes de retraite complémentaire. Par la suite, quatre thématiques complémentaires doivent relayer le premier « round » de négociations : l’adaptation de la formation professionnelle ; l’égalité professionnelle ; la place et le rôle de l’encadrement ; et enfin, la protection sociale. Sur ces huit sujets, trois font l’objet d’un accord final, qui se matérialise respectivement dans l’accord du 14 juin 2000 sur l’assurance chômage, l’accord sur la santé au travail du 19 décembre 2000, et l’accord sur les retraites complémentaires du 10 février 2001. S’agissant de la formation professionnelle, c’est le 20 septembre 2003 que sera signé l’accord sur la formation tout au long de la vie, qui crée le droit individuel à la formation (DIF) de vingt heures par an pour chaque salarié ainsi que le contrat de professionnalisation.
Enfin, le dernier accord national interprofessionnel multidimensionnel sur l’emploi a été signé le 11 janvier 2008 : il porte sur la « modernisation du marché du travail ». Il comporte de nombreuses mesures relatives notamment à l’allongement de la période d’essai qui est soumise à des accords de branche étendus, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), le développement de la mobilité professionnelle et géographique, l’accès à la portabilité des droits à la complémentaire santé et à la prévoyance ou encore la sécurisation du portage salarial. Il prévoit également la création du dispositif de la rupture conventionnelle ou encore l’expérimentation du contrat de projet destiné à des ingénieurs et des cadres (2).
Depuis 1958, le dialogue social avance, on le voit, par à-coups, et selon deux types de modalités :
– la première, qui consiste à négocier sur un ensemble de thématiques interdépendantes liées à l’emploi, dans l’objectif d’obtenir un équilibre final grâce à des concessions mutuelles portant sur des domaines différents ; cette voie crée les conditions d’un débat sur les enjeux du marché du travail et de l’emploi dans leur globalité mais s’est révélée souvent plus difficile à faire aboutir dans sa totalité, comme le montre l’échec de la négociation de 1984.
– la seconde, qui consiste à engager une négociation sur une thématique précise ou, dans le cadre d’un dialogue global, à séparer les sujets les uns des autres. Cette voie a l’avantage de permettre d’aboutir plus facilement à un accord, elle a en revanche l’inconvénient de morceler le traitement de questions qui sont très liées.
L’accord national interprofessionnel conclu le 11 janvier 2013 s’inscrit dans la continuité des accords relatifs à l’emploi à ambition multidimensionnelle. Il en constitue à ce titre un moment important, par l’ampleur des thématiques dont il traite.
Conclu le 11 janvier 2013 après quatre mois de négociations, l’accord national interprofessionnel « pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels des salariés » s’articule autour de cinq grands titres :
– la création de nouveaux droits pour les salariés afin de sécuriser les parcours professionnels ;
– le renforcement de l’information des salariés sur les perspectives et les choix stratégiques de l’entreprise pour renforcer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
– les moyens donnés aux entreprises pour s’adapter aux problèmes conjoncturels et préserver l’emploi ;
– le développement de l’emploi par l’adaptation du contrat de travail à l’activité économique de l’entreprise ;
– et enfin, la rationalisation des procédures de contentieux judiciaire.
Le renforcement de la sécurité de l’emploi passe en effet en premier lieu par la protection et l’accompagnement des salariés dans leurs parcours professionnels, en particulier des plus fragiles d’entre eux. Il s’agit du premier volet de l’accord.
De ce point de vue, l’accord du 11 janvier vise à la consolidation ou l’amélioration de certains outils en faveur des salariés, qu’il s’agisse de la portabilité des droits à la couverture complémentaire et à la couverture prévoyance pour les anciens salariés (article 2) ou encore de celle des droits à la formation (article 5), mais également du développement de la préparation opérationnelle à l’emploi (POE). Il instaure également des règles entièrement nouvelles, comme le principe de la majoration des cotisations d’assurance chômage sur les contrats courts (article 4), la généralisation de la couverture complémentaire santé à l’ensemble des salariés (article 1er) ou encore l’instauration d’un droit à une mobilité externe sécurisée pour les salariés. Il modifie les règles en vigueur pour mieux couvrir les demandeurs d’emploi, par la création des droits rechargeables à l’assurance chômage (article 3). Enfin, de nouvelles règles sont fixées pour encadrer le travail à temps partiel (article 11).
On le voit, si certains de ces droits sont exclusivement destinés aux salariés, tels la mobilité volontaire sécurisée, certaines dispositions s’adressent aussi aux demandeurs d’emploi, à travers la portabilité des droits à la protection sociale mais surtout par le biais des droits rechargeables à l’assurance chômage et parfois aussi, aux ayant-droits de salariés comme la couverture complémentaire santé. Le compte personnel de formation est quant à lui entièrement transversal, puisqu’il a vocation à s’adresser à tout primo-entrant sur le marché du travail et à l’accompagner jusqu’à son départ à la retraite. Deux mesures – l’encadrement du temps partiel et la surcotisation d’assurance chômage sur les contrats à durée déterminée (CDD) – s’adressent enfin spécifiquement aux salariés les plus vulnérables, ceux qui enchaînent les contrats courts d’une part, et les salariés en sous-emploi, autrement dit, à temps partiel « subi », d’autre part.
Le deuxième volet de l’accord souhaite favoriser l’anticipation et le partage de l’information au sein des entreprises. L’article 12 de l’accord instaure à cet effet une information et une consultation permanentes, au fil de l’eau, des institutions représentatives du personnel, à travers la mise en place d’une « base de données » unique qui doit constituer le socle du partage d’information au sein de l’entreprise. Ce renforcement de l’information et de la capacité des salariés à intervenir sur la stratégie de l’entreprise passe également par la mise en place d’un mécanisme de représentation des salariés au conseil d’administration dans les entreprises de plus de 5 000 salariés (article 13). L’article 14 de l’accord propose également de mieux articuler la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) avec le plan de formation de l’entreprise. Parce qu’elle doit être articulée avec cette gestion anticipée, l’accord place également sous ce chapitre le volet relatif à la négociation sur l’organisation de la mobilité interne à l’entreprise (article 15). Afin de tenir compte de la situation particulière des petites entreprises, il entend également leur donner un délai lorsque celle-ci franchissent un seuil d’effectifs pour répondre à leurs obligations s’agissant de la mise en place des institutions représentatives du personnel en leur sein (article 17).
Le troisième volet entend renforcer la capacité des entreprises à s’adapter aux évolutions conjoncturelles, afin de préserver l’activité et l’emploi. De ce point de vue, trois mesures sont actées : la possibilité de négocier des accords transitoires de maintien de l’emploi dans les entreprises confrontées à de graves difficultés conjoncturelles (article 18) ; la refonte du dispositif de chômage partiel pour améliorer son efficacité et faciliter son recours par les entreprises en difficulté (article 19) ; et enfin, la refonte de la procédure de licenciement collectif pour motif économique (article 20).
Le quatrième volet de l’accord recouvre une unique mesure d’adaptation de la forme du contrat de travail aux caractéristiques de l’activité économique, par le biais de l’expérimentation du recours direct, dans certains secteurs d’activité, au contrat de travail intermittent, aujourd’hui conditionné à son encadrement par un accord collectif.
Enfin, le cinquième et dernier volet de l’accord traite des procédures de contentieux judiciaire : pour ce faire, l’article 23 prévoit que le critère de la compétence professionnelle est expressément prévu comme étant un critère privilégié de fixation de l’ordre des licenciements, conformément à la jurisprudence. L’article 25 porte sur la procédure de conciliation prud’homale, par la fixation d’un barème d’indemnisation de référence. Enfin, l’article 26 de l’accord réduit les délais de prescription en matière de contestation relative à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail.
L’accord du 11 janvier prend ainsi le parti du renvoi à d’autres négociations, sur deux plans.
● En premier lieu, certaines mesures dont le principe est posé sont renvoyées pour leur application à des négociations ultérieures. Ainsi de la généralisation de la couverture complémentaire santé, qui sera principalement mise en œuvre par accords collectifs de branche ou, subsidiairement, par accords d’entreprise ; ou encore de la mise en place des droits rechargeables à l’assurance chômage ou de la majoration des cotisations chômage sur les contrats courts, qui ont vocation à être instaurés dans le cadre de la renégociation de la convention d’assurance chômage qui doit avoir lieu au seconde semestre 2013.
La création d’un compte personnel de formation est quant à elle renvoyée non pas à une négociation ultérieure, mais à une concertation entre les partenaires sociaux, l’État, l’ensemble des acteurs dans le champ de la formation, mais également les régions, qui ont vocation à intervenir largement dans ce dispositif. À cet égard, deux réformes législatives doivent intervenir pour pouvoir aménager un tel compte personnel de formation : la réforme de la décentralisation d’une part, la réforme de la formation professionnelle d’autre part.
● La négociation est également privilégiée au cœur même des mesures souhaitées par l’accord du 11 janvier. Ainsi, face au constat de grandes difficultés économiques dans une entreprise, c’est la voie de la négociation qui est recherchée pour maintenir les emplois, et permettre aux entreprises de passer un cap difficile sans recourir à des licenciements. Ainsi encore, c’est le rôle essentiel de la négociation d’entreprise qui est réaffirmé pour organiser la mobilité interne à l’entreprise. Afin de permettre un meilleur encadrement du temps partiel, c’est encore la négociation, de branche cette fois, qui est privilégiée pour adapter les nouvelles règles, en particulier la mise en place d’une durée minimale hebdomadaire de travail de vingt-quatre heures. Enfin, et c’est sans doute l’une des grandes innovations de cet accord, la voie de la négociation sera désormais également recherchée dans le cadre de la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Les salariés se voient aujourd’hui imposer un plan de licenciement collectif sans disposer d’autre pouvoir que celui de l’information et de la consultation des institutions représentatives du personnel : la démarche promue par l’accord du 11 janvier est inverse, puisqu’elle souhaite donner un rôle aux salariés, à travers leurs représentants, dans la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi, celui-ci pouvant même faire l’objet d’un accord éventuel avec les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
Le gouvernement souligne, dans l’exposé des motifs, avoir associé pleinement « toutes les organisations à la préparation du projet de loi, dans un double esprit : loyauté envers l’accord et les signataires ; transparence et écoute vis-à-vis de tous. ».
Il précise que le projet de loi « sur tous les points où l’accord était ambigu, imprécis ou incomplet, voire comportait des contradictions, a retenu des options claires. Le gouvernement a opéré des choix, en écoutant les partenaires sociaux bien sûr, mais en l’absence de convergence, en retenant l’option qui lui a paru la plus juste, la plus efficace au regard des objectifs du projet de loi
– sécuriser l’emploi et les parcours professionnels – et la plus conforme à l’intérêt général. ».
C’est ainsi en effet que votre rapporteur considère que des améliorations décisives ont été apportées.
– La plus importante porte sur le nouveau rôle de l’État à travers l’homologation. L’espoir de certains était sans doute d’en faire une simple formalité administrative. La réalité du projet de loi est tout autre, et rejoint le souhait des organisations de salariés, signataires comme non signataires.
Comme cela a été dit, le projet de loi donne à l’État des pouvoirs très importants qui lui permettront de peser de manière décisive pour éviter tous les licenciements qui pourront l’être et exiger des entreprises des efforts proportionnés aux moyens dont dispose le groupe auquel elles appartiennent le cas échéant. En renfonçant le rôle de l’État à travers l’homologation, on renforce aussi celui des syndicats dans les négociations de plan sociaux. L’État intervenant à défaut d’accord, les pouvoirs qui lui sont donnés seront de fait aussi dans les mains des organisations de salariés. Concrètement, par ce choix essentiel qui est fait – et sur ce point l’accord ne disait rien –, l’employeur devra rechercher soit l’accord majoritaire des salariés, soit de l’administration, sur son plan de sauvegarde de l’emploi.
– Le projet de loi renforce aussi les protections des salariés en cas d’application qui leur serait faite d’un accord d’entreprise portant sur la mobilité : le projet de loi prévoit qu’ils bénéficieront de toutes les protections liées au motif économique, alors que le motif personnel avait été retenu par l’accord. Ce choix s’appuie sur la volonté de conformer notre droit national à la directive 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), mais correspond aussi à une demande qui avait été faite avec insistance par les organisations syndicales de salariés non signataires de l’accord.
– On pourrait citer également de nombreuses autres améliorations, qui lèvent autant d’inquiétudes soulevées par certains à la lecture de l’accord : le maintien de la possibilité de désigner des organismes de branches pour assurer la couverture complémentaire santé des salariés et sa généralisation effective à toutes les entreprises même les plus petites, un champ large retenu pour les entreprises devant ouvrir leur conseil d’administration à des administrateurs salariés et des modes d’élections qui permettent soit aux organisations syndicales soit au délégués du personnel de présenter leurs candidats, des exceptions à la réduction des délais de prescription à des cas où cela pourrait porter préjudice aux salariés (harcèlement, dommages corporels)….
Votre rapporteur souhaite que les débats parlementaires s’inscrivent dans un même esprit et permettent de nouvelles avancées décisives.
Du point de vue de sa structure, le projet de loi suit le cheminement de l’accord. Ainsi, le projet de loi s’articule autour de quatre chapitres – au lieu des cinq titres de l’accord.
Le premier regroupe l’ensemble des nouveaux droits créés au bénéfice des salariés, avec les droits individuels – généralisation de la couverture complémentaire santé et extension de la portabilité des droits (article 1er), compte personnel de formation et conseil en évolution professionnelle (article 2), et mobilité externe sécurisée (article 3) –, les droits collectifs d’autre part, avec l’amélioration de l’information et des procédure de consultation des institutions représentatives du personnel (article 4) et la représentation des salariés dans les conseils d’administration (article 5). Contrairement à l’accord, ces deux dernières dispositions figurent donc dans la partie relative aux nouveaux droits consentis aux salariés.
Le deuxième chapitre regroupe les mesures de lutte contre la précarité de l’emploi et dans l’accès à l’emploi, à travers les dispositifs de droits rechargeables à l’assurance chômage (article 6), la majoration des cotisations d’assurance chômage sur les contrats courts (article 7) et l’encadrement du temps partiel (article 8). Ces trois mesures figuraient dans l’accord au rang des nouveaux droits : leur regroupement au sein d’un chapitre spécifique apparaît néanmoins tout à fait justifié.
Le troisième chapitre vise à favoriser l’anticipation négociée des mutations économiques, pour développer les compétences, maintenir l’emploi et encadrer les licenciements économiques.
Les deux dispositions autour de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) sont réunies au sein de la première section : la recherche d’une meilleure articulation de la GPEC avec une série d’autres négociations ou actions menées dans l’entreprise d’une part (article 9), la négociation organisant la mobilité interne à l’entreprise d’autre part (article 10). On notera que l’accord a placé ces deux outils dans le chapitre consacré à l’information des salariés.
La deuxième section renforce les dispositifs de maintien de l’emploi dans l’entreprise en cas de difficulté économique conjoncturelle : elle recouvre le nouveau régime d’activité partielle (article 11) ainsi que les accords de maintien de l’emploi (article 12).
Enfin, la troisième section recouvre la refonte des procédures de licenciements économiques collectifs (article 13), la création d’une obligation de recherche d’un repreneur lors de la fermeture d’un établissement (article 14), l’ordre des licenciements et l’allongement du congé de reclassement (article 15).
Le dernier chapitre du projet de loi regroupe l’ensemble des autres dispositions donnant lieu à transposition législative, qu’il s’agisse de la procédure de conciliation prud’homale (article 16), des délais accordés aux entreprises en cas de franchissement des seuils (article 17) et enfin, de l’expérimentation du recours direct au contrat de travail intermittent (article 18), qui figurait de manière isolée dans un titre de l’accord.
Enfin, l’article 19 habilite le Gouvernement à procéder par ordonnance pour rendre le texte applicable à Mayotte.
Certaines mesures, on l’a dit, n’ont pas nécessité de traduction législative. En particulier :
– la mise en œuvre de l’article 6 de l’accord du 11 janvier, qui prévoit l’assouplissement des conditions d’accès des salariés de moins de 30 ans en contrat à durée déterminée (CDD) au congé individuel de formation (CIF), passe par la modification des dispositions réglementaires afférentes. L’article R. 6322-20 du code du travail réserve en effet le congé individuel à une ancienneté de vingt-quatre mois au cours des cinq dernières années, dont quatre mois en CDD au cours des douze derniers mois. Un décret ne maintiendra que la seule deuxième condition pour les publics concernés.
– l’article 9 de l’accord souhaite donner un rôle d’initiative aux organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) ayant conclu une convention avec Pôle emploi dans le cadre du dispositif de la préparation opérationnelle à l’emploi (POE) : il s’agit de leur permettre de proposer aux entreprises qui ont des offres d’emploi disponibles d’utiliser ce dispositif d’accompagnement des demandeurs d’emploi. Les modalités de mise en œuvre seront négociées entre les organismes collecteurs et Pôle emploi.
– Les mesures d’amélioration de l’accès au logement des primo-entrants sur le marché du travail, des salariés en contrat court et des salariés en mobilité professionnelle, prévue par l’article 10, passe par la mobilisation d’une partie des fonds d’Action Logement. Si ces mesures d’ordre strictement financier n’ont logiquement pas de traduction législative, il pourrait néanmoins être utile de préciser que ces trois catégories de publics prioritaires sont également prises en compte comme étant prioritaires par les commissions d’information et d’aide au logement des salariés des comités d’entreprise, ces commissions jouant en effet un rôle pour faciliter l’accès au logement, à la propriété et à la location des salariés.
– Enfin, l’article 24 de l’accord prévoit l’éventuelle mise en place d’un groupe de travail sur la sécurité juridique des relations de travail : d’après l’accord, il s’agit de répondre à l’insécurité juridique constatée lorsque « des irrégularités de forme sont assimilées à des irrégularités de fond ». Les partenaires sociaux conviennent que leurs futurs travaux sur cette question s’appuieront sur le concours des pouvoirs publics. Aucune disposition de mise en œuvre n’a donc lieu d’être prévue à ce sujet.
La Commission des affaires sociales examine, sur le rapport de M. Jean-Marc Germain, le présent projet de loi, au cours de ses séances des mardi 26 et mercredi 27 mars 2013.
Article 1er
(art. L. 911-7, L. 911-8 et L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989)
Généralisation de la couverture complémentaire collective « santé » pour les salariés et amélioration de la portabilité des couvertures « santé » et « prévoyance » des demandeurs d’emploi
Conformément à l’article 1er de l’accord du 11 janvier, le présent article prévoit la généralisation de la couverture complémentaire collective « santé » pour l’ensemble des salariés, l’amélioration de la portabilité des couvertures « santé » et « prévoyance » des demandeurs d’emploi, ainsi que l’obligation des branches professionnelles d’engager une négociation destinée à mettre en place une couverture « prévoyance ». La généralisation de la couverture complémentaire santé collective doit intervenir au 1er janvier 2016 : à cette date, l’ensemble des salariés devront être couverts.
Le projet de loi privilégie la conclusion d’accords de branche, en créant pour les branches professionnelles une obligation d’ouvrir des négociations à ce titre avant le 1er juin 2013. Ce n’est que de manière subsidiaire, en l’absence d’accords de branche, que les entreprises non couvertes prendront le relais en négociant à leur niveau, entre le 1er juillet 2014 et le 1er janvier 2016. À défaut, à cette date, les entreprises devront faire bénéficier, de manière unilatérale, leurs salariés d’une couverture complémentaire santé minimale.
Parallèlement, et conformément toujours aux souhaits des partenaires sociaux, le présent article propose de généraliser à l’ensemble des salariés et d’étendre de neuf à douze mois le mécanisme de portabilité des droits aux couvertures « santé » et « prévoyance » des salariés licenciés.
Les enjeux d’une telle généralisation de la couverture complémentaire « santé » sont importants. Les objectifs poursuivis sont en effet ceux de l’accès de tous les salariés à une couverture complémentaire, mais également d’un meilleur accès et d’un accès facilité à une telle couverture. Le choix d’une couverture collective obligatoire emportera des conséquences en termes de répartition de la couverture entre l’assurance individuelle et l’assurance collective. Une telle mesure comporte également un coût, important, puisqu’un certain nombre d’avantage fiscaux et sociaux sont aujourd’hui attachés aux contrats collectifs obligatoires, alors qu’ils ne bénéficient pas aux garanties souscrites dans le cadre de l’assurance complémentaire individuelle.
A. LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ D’ENTREPRISE : ÉTAT DES LIEUX ET ENJEUX DE LA GÉNÉRALISATION
1. La situation actuelle de la couverture complémentaire santé
D’après les comptes nationaux de la santé, en 2010, 77 % de la dépense de soins et de biens médicaux étaient pris en charge par l’assurance maladie obligatoire et 14 % de cette dépense étaient pris en charge par une complémentaire santé. Cette même année, plus de 95 % de la population française bénéficiait d’une couverture complémentaire santé, alors qu’au début des années 1980, seulement deux tiers des Français disposaient d’une telle couverture.
● La part respective de l’individuel et du collectif
Parmi les plus de 95 % de Français couverts par une complémentaire santé, 56 % sont en 2009 couverts par une complémentaire individuelle et 44 % par une complémentaire collective (3).
S’agissant des seuls salariés, 2,3 % d’entre eux ne sont actuellement couverts par aucune complémentaire santé, soit de l’ordre de 400 000 salariés, sur un total de 18 millions de salariés. Le tableau suivant récapitule la situation des seuls salariés au regard de leur couverture complémentaire santé.
Nombre de salariés |
Pourcentage | |
Salariés non couverts par une complémentaire santé |
414 000 |
2,3 |
Salariés couverts par une complémentaire individuelle |
3 250 043 |
18,1 |
Salariés couverts par la complémentaire de leur conjoint fonctionnaire |
664 063 |
3,7 |
Salariés couverts par une complémentaire collective d’entreprise |
13 206 600 |
75,9 |
– en tant qu’assuré |
11 757 828 |
65,3 |
– en tant qu’ayant droit |
1 914 065 |
10,6 |
Total des salariés |
18 000 000 |
100 |
Source : Direction de la sécurité sociale.
● Les caractéristiques de la couverture complémentaire collective obligatoire
La couverture complémentaire santé collective d’entreprise couvrirait au total 25 millions de personnes en tenant compte de l’ensemble des ayants droit, y compris donc les conjoints et les enfants. Si, historiquement, les garanties collectives de frais de soins de santé relevaient très majoritairement des accords d’entreprise, alors que les conventions collectives nationales de branches professionnelles instituaient essentiellement des régimes de « prévoyance lourde » (décès, incapacité de travail, invalidité), un relatif renversement de tendance a pu être observé depuis 2003-2004, à la faveur :
– de la « loi Fillon » du 21 août 2003 qui a réservé le bénéfice des exonérations de charges aux complémentaires « santé » collectives obligatoires ;
– et de la loi du 13 août 2004 portant réforme de l’assurance maladie surtout, qui a conditionné ces exonérations aux contrats dits « responsables » (cf. supra).
En 2009, 44 % des établissements français déclarent proposer une complémentaire « santé » à tout ou partie de leurs salariés (4) : c’est le cas de 93 % des entreprises de plus de 250 salariés, de 79 % des entreprises entre 50 et 250 salariés, de 49 % des entreprises de 10 à 50 salariés et de seulement 33 % des TPE de moins de 10 salariés.
Parmi les 56 % d’entreprises qui ne proposent pas de couverture complémentaire « santé » à leurs salariés, 28 % invoquent la trop petite taille de la structure pour l’assumer. Le principal critère de choix du contrat est le bon rapport qualité / prix (31 %) ; pour 15 % des entreprises, le contrat est imposé par la convention collective ou l’accord de branche, tandis que 15 % choisissent leur organisme parce qu’il est le même que celui qui couvre la prévoyance. S’il n’a pas été possible d’identifier l’organisme gestionnaire pour l’ensemble des entreprises, lorsque cela a été possible, il s’avère que 51 % des entreprises ont opté pour une mutuelle, 25 % pour une institution de prévoyance et 24 % pour une société d’assurance.
En 2009 toujours, près des trois quarts (72 %) des entreprises proposant une complémentaire « santé » à leurs salariés le font sur la base d’un accord d’établissement ou d’entreprise, contre 20 % seulement sur la base d’un accord de branche ou de la convention collective qui leur est applicable (5).
S’agissant des accords de branches, d’après l’étude d’impact associée au présent projet de loi, seules 34 des 145 plus grandes branches en termes d’effectifs proposent une couverture complémentaire « santé » à leurs salariés. Au total, 64 branches (sur un total d’environ 240) proposent une couverture complémentaire « santé » aux salariés de leurs secteurs, soit de l’ordre de 3,5 millions de salariés. Seuls 5 % de ces régimes de branche couvrent les seuls cadres, les 95 % restants couvrant l’ensemble des salariés.
En moyenne, parmi les 34 branches professionnelles qui comptent plus de 10 000 salariés et qui ont mis en place un régime de prise en charge complémentaire des frais de santé, la cotisation totale s’élève en moyenne à 443 euros par an, soit 37 euros par mois. Dans 80 % de ces branches, l’employeur assume la charge de plus de la moitié du financement de la couverture.
La couverture collective d’entreprise est aujourd’hui inéquitablement répartie entre les salariés : en effet, seuls 58 % des ouvriers non qualifiés et 53 % des employés du commerce sont couverts par un contrat collectif, contre 76 % des cadres. D’après l’étude d’impact associée au présent projet de loi, la couverture des salariés à temps partiel est également plus faible que celle des salariés à temps complet, respectivement 51 % et 68 %, et celle des salariés en contrat à durée déterminée est plus faible que celle des salariés en contrat en durée indéterminée, respectivement 25 % contre 66 %.
Le cas des PME/TPE
Pourquoi privilégier des accords de branche ? En particulier pour assurer une meilleure couverture complémentaire des TPE/PME, la couverture complémentaire « santé » collective négociée au niveau de l’entreprise étant souvent pointée du doigt comme étant l’apanage des grandes ou très grandes entreprises, en raison des coûts d’adhésion et des tarifs potentiellement plus élevés auxquels s’exposent les petites entreprises.
Certaines des branches couvertes par un accord instituant un régime de complémentaire « santé » recouvrent des secteurs composés de très petites structures de type commerce ou artisanat et où les salaires moyens pratiqués sont modestes : c’est le cas de la boulangerie artisanale, de la coiffure, de la poissonnerie, de la pharmacie d’officine, de la charcuterie de détail, des fleuristes ou encore du secteur des hôtels, cafés et restaurants, ce dernier secteur comptant 500 000 salariés.
D’après une étude réalisée en juillet 2012 par le Crédoc sur l’équipement des TPE/PME en complémentaire « santé » (6), 74 % des entreprises de moins de 250 salariés ont mis en place une couverture complémentaire « santé » en leur sein, qui dans huit cas sur dix, est obligatoire. Dans 80 % des TPE/PME concernées, elle couvre tous les salariés, cadres comme non cadres et dans 90 % d’entre elles, elle s’étend aux ayants droit (conjoint, famille), sans surcoût dans la moitié des cas. Au total, 94 % des entreprises qui ont mis en place une telle couverture participent à son financement, à hauteur en moyenne de 53 % de son coût total. Enfin, dans six cas sur dix, la couverture complémentaire « santé » est mise en place par décision prise au sein de l’entreprise et non par obligation conventionnelle.
D’après les données de la DREES, en 2009, 41,4 % des bénéficiaires d’un contrat collectif étaient couverts par une institution de prévoyance, 38,5 % par une mutuelle et 20,2 % par une société d’assurance.
Parmi les 64 branches qui proposent aujourd’hui une couverture complémentaire « santé » à leurs salariés, on estime à 80 % le nombre d’entre elles qui ont défini des garanties sur le fondement d’une clause de prescription de l’organisme assureur. Dans un cas sur quatre, cette clause de prescription serait assortie d’une clause de migration. Parmi les branches couvertes par un accord comportant une clause de prescription figurent : la coiffure, les poissonniers-détaillants, les intermittents, l’habillement, les hôtels-cafés-restaurants, notamment. Ce sont donc souvent des branches qui couvrent de petites, voire très petites entreprises, avec des salariés globalement faiblement rémunérés.
2. Le cadre juridique
La protection sociale complémentaire en entreprise recouvre aujourd’hui deux volets : la prévoyance et la retraite. Les garanties complémentaire « santé » relèvent de la première catégorie : l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale définit en effet les garanties collectives complémentaires des salariés comme incluant « les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ».
Les couvertures complémentaires « santé » collectives sont soumises aux règles générales applicables en matière de protection sociale complémentaire, figurant aux articles L. 911-1 à L. 914-4 du code de la sécurité sociale, aux dispositions du code du travail s’agissant de la négociation collective et des accords collectifs qui les encadrent, ainsi qu’aux dispositions spécifiques aux opérations de prévoyance prévues par la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
Conformément à l’ensemble des autres garanties collectives complémentaires (garantie décès, incapacité de travail, invalidité ou retraite), aux termes de l’article L. 911-1, une couverture complémentaire « santé » collective est instituée soit par voie de convention ou d’accord collectif, soit par la ratification à la majorité des salariés intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit enfin, par décision unilatérale de l’employeur remise par écrit à chacun des salariés intéressés. Toutefois, dans ce dernier cas, l’article 11 de la loi du 31 décembre 1989 prévoit expressément la possibilité pour le salarié déjà présent dans l’entreprise de refuser d’adhérer au système de prévoyance mis en place par l’employeur.
Une couverture complémentaire « santé » collective peut donc être facultative pour l’entreprise, mais elle peut également lui être imposée par une convention ou un accord collectif interprofessionnel, de branche ou professionnel. En cas de régime s’imposant obligatoirement à l’entreprise, l’employeur est responsable de la bonne exécution de son obligation.
Ainsi, des accords de branche par exemple peuvent être conclus qui vont s’imposer aux entreprises en relevant. Mais plusieurs cas de figure coexistent :
– l’accord peut se borner à fixer un niveau de financement à consacrer à des garanties librement choisies par l’entreprise ;
– l’accord peut définir des garanties en laissant à l’entreprise le choix des moyens.
– l’accord peut également mettre en place un véritable régime, en fixant prestations et cotisations et en désignant un organisme assureur chargé de mutualiser les risques pour l’ensemble des entreprises de la branche professionnelle.
Un accord de branche ou professionnel instaurant une mutualisation des risques s’applique obligatoirement à l’entreprise qui en relève, celle-ci se contentant d’adhérer à l’organisme qu’il désigne (article L. 912-1). Conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail qui renvoie à cette disposition spécifique du code de la sécurité sociale, la convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement ne peut pas déroger aux garanties collectives prévues par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel instaurant une mutualisation des risques. Qui plus est, lorsqu’une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel prévoyant une mutualisation des risques et organisant la couverture auprès d’un ou plusieurs organismes assureurs vient à s’appliquer à une entreprise déjà couverte par un contrat avec un organisme assureur différent pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, celle-ci doit adapter son système en conséquence (article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui lui-même renvoie à l’article L. 2253-2 du code du travail), ce qui lui impose de changer d’organisme assureur, comme en a jugé la Cour de cassation en octobre 2007.
En tout état de cause, l’acte juridique qui institue la protection complémentaire « santé » dans l’entreprise, – qu’il s’agisse d’un accord (d’entreprise, professionnel, de branche ou interprofessionnel), d’un accord ratifié ou d’une décision unilatérale de l’employeur –, définit les garanties accordées et les modalités de financement et de gestion du régime.
Lorsqu’il comporte une clause de prescription du ou des organismes assureurs garantissant la couverture des risques, il doit également inclure une clause de réexamen du choix du ou des organismes désignés, ainsi que des modalités d’organisation de la mutualisation des risques lorsqu’il s’agit d’un accord de branche ou interprofessionnel. La périodicité de ce réexamen ne peut excéder cinq ans (articles L. 912-1 et L. 912-2) (7).
En outre, le comité d’entreprise est obligatoirement informé et consulté préalablement à la mise en place dans l’entreprise d’un régime de protection sociale complémentaire ou à la modification de ce dernier.
Aux termes de l’article 1er de la loi de 1989 précité précitée, la gestion d’une complémentaire « santé » collective est confiée à l’un des trois types d’organismes habilités : sociétés d’assurance, institutions de prévoyance ou mutuelles. Les premières sont régies par le code des assurances, les deuxièmes par le code de la sécurité sociale et les troisièmes par le code de la mutualité.
3. Les avantages fiscaux et sociaux attachés aux contrats collectifs
L’ensemble des avantages fiscaux et sociaux attachés aux contrats collectifs complémentaires « santé » sont conditionnés à leur caractère obligatoire (8) et à leur conformité à la définition des contrats dits « responsables ».
En effet, depuis la loi portant réforme de l’assurance maladie d’août 2004, les contrats complémentaires « santé » doivent, pour bénéficier de l’exonération fiscale et sociale, respecter un certain nombre d’obligations et d’interdictions de prise en charge. Il s’agit de la condition de ce que l’on appelle désormais communément les contrats « responsables et solidaires ».
Les contrats « responsables »
L’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale réserve le bénéfice de l’exemption de l’assiette des cotisations sociales aux contrats qui :
– ne prennent pas en charge la participation forfaitaire de 1 euro sur les consultations, les actes médicaux et les actes de biologie médicale, pas plus que la franchise annuelle de 0,5 euro par boîte de médicaments, 0,5 euro par acte paramédical pratiqué hors de l’hôpital et 2 euros par recours au transport sanitaire, sauf transport d’urgence ;
– excluent la prise en charge de la majoration de participation des assurés en cas de non-respect du parcours de soins, et qui est égale à 20 % du ticket modérateur dans la limite de 5 euros par acte pour les actes supérieurs à 25 euros, ainsi que les dépassements d’honoraires sur les actes cliniques et techniques des spécialistes consultés hors parcours de soins à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques ;
– prennent en charge au moins 30 % du tarif opposable des consultations du médecin traitant, au moins 30 % des médicaments à vignette blanche (remboursés à 65 % par l’assurance maladie obligatoire), au moins 35 % du tarif de base de l’assurance maladie obligatoire pour les frais d’analyses ou de laboratoire, ainsi que 100 % du ticket modérateur d’au moins deux prestations de prévention à choisir sur la liste établie par le ministère chargé de la santé.
● Pour l’entreprise et pour les salariés :
S’agissant de l’employeur :
– les règles générales applicables à la déductibilité de certaines charges du bénéfice imposable permettent aux entreprises de déduire l’ensemble des cotisations ou primes (contribution salariale et patronale) versées aux régimes de prévoyance complémentaire de leur résultat imposable.
– aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les seules contributions des employeurs sont exemptes de l’assiette des cotisations sociales dans la limite de 6 % du plafond annuel, soit 2 221,92 euros en 2013, et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations, le bénéfice total ne pouvant excéder 12 % du plafond, soit 4 443,84 euros en 2013. D’après les données fournies par l’annexe 5 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, l’assiette exemptée en 2011 représente 12,7 milliards d’euros au titre de la prévoyance complémentaire.
Néanmoins, depuis le 1er janvier 2012, les contributions patronales aux régimes de prévoyance complémentaire sont soumises au forfait social, à hauteur de 8 % pour la part exonérée de cotisations sociales, sauf lorsqu’elles sont versées au bénéfice de salariés, anciens salariés de leurs ayants droit par des employeurs de moins de 10 salariés.
Le bénéfice de l’exemption de l’assiette des cotisations sociales est réservé, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 21 août 20003 portant réforme des retraites, aux régimes de protection sociale complémentaire à caractère « collectif » et « obligatoire ».
S’agissant du salarié, aux termes du 4° du II de l’article 156 du code général des impôts, l’ensemble des cotisations (incluant les versements de l’employeur) versées dans le cadre d’un régime de prévoyance obligatoire sont admises en déduction pour l’établissement de l’assiette de l’impôt sur le revenu, dans la limite de 7 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 2 592,24 euros en 2013 et 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ne puisse excéder 3 % de huit fois le plafond, soit un montant maximal déductible de 8 887,68 euros en 2013. (Cet avantage ne s’applique pas aux contrats facultatifs, sauf pour le cas du maintien, pour neuf mois, des garanties au profit des anciens salariés au chômage).
● Pour les organismes gestionnaires :
Pour la gestion de leur protection sociale complémentaire, les entreprises doivent s’adresser à l’un des trois types d’organismes habilités sur ce marché : sociétés d’assurance, institutions de prévoyance ou mutuelles. Lorsqu’il s’agit de contrats souscrits auprès d’une société d’assurance, on parle de contrats d’assurance de groupe, qui sont, aux termes du 1° de l’article 998 du code général des impôts, exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances, à condition que moins de 20 % de la prime ou de la cotisation globale soit affectée au remboursement de soins de santé (ce qui ne concerne donc théoriquement pas les contrats complémentaire « santé »).
En outre, les contrats d’assurance maladie complémentaires collectifs et obligatoires sont soumis à la taxe sur les conventions d’assurances au taux de 7 % depuis le 1er octobre 2011 (contre 3,5 % auparavant) à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale déjà cité.
On notera que les cotisations d’assurance maladie complémentaire sont également soumises à une taxe de solidarité additionnelle de 6,27 % au profit du Fonds pour le financement de la couverture maladie universelle complémentaire (Fonds CMU).
*
* *
Dans son rapport annuel sur la sécurité sociale de 2011, la Cour des comptes estimait entre 1,6 et 1,75 milliard d’euros la perte de recettes pour la sécurité sociale liée à l’exemption de l’assiette des cotisations des primes versées au titre des contrats collectifs obligatoires, et entre 575 et 661 millions d’euros la dépense fiscale résultant de l’exemption de l’assiette de l’impôt sur le revenu de la cotisation pour les salariés. Elle n’a pas chiffré le coût résultant de la déductibilité du résultat imposable de la cotisation versée par l’employeur, celle-ci pouvant être considérée comme une modalité de calcul de l’impôt. Au total, ce sont donc entre 2,18 et 2,41 milliards d’euros de pertes de recettes fiscales et sociales qui sont générées par ce dispositif d’exonérations. Ces montants sont même portés entre 2,9 et 4 milliards d’euros en tenant compte des exonérations de contributions sociales dont bénéficient par ailleurs ces contrats (au titre par exemple, de la retraite complémentaire et de l’assurance chômage), si l’on neutralise donc toujours la dépense fiscale au titre du bénéfice imposable de l’entreprise.
4. Les enjeux de la généralisation de la couverture complémentaire santé d’entreprise
Les dispositions prévues par l’accord du 11 janvier, dont la traduction législative est portée par l’article 1er du présent projet, doivent permettre de couvrir les 414 000 salariés qui ne disposeraient à l’heure actuelle d’aucune couverture complémentaire. Ces nouvelles garanties permettront également de couvrir leurs potentiels ayants-droit. Au-delà, l’affiliation obligatoire des salariés à une couverture collective d’entreprise va générer un transfert des salariés aujourd’hui couverts par une assurance individuelle vers la couverture collective d’entreprise. Ensuite, les salariés qui ont aujourd’hui accès à la couverture collective de leur conjoint fonctionnaire vont vraisemblablement également être amenés à basculer dans le régime de la couverture collective obligatoire d’entreprise. Enfin, on peut faire l’hypothèse qu’un certain nombre de salariés aujourd’hui ayants droit de la couverture complémentaire de leur conjoint salarié deviendront directement assurés auprès de leur propre entreprise.
Au total, le déport vers l’assurance complémentaire collective d’entreprise organisé par la généralisation de la couverture d’entreprise pourrait concerner entre 24 % et 34,7 % des salariés. Cette dernière hypothèse est haute, puisqu’elle repose sur le postulat du basculement de l’ensemble des salariés ayants droit d’un conjoint salarié vers leur propre couverture d’entreprise. Autrement dit, entre 4,32 et 6,25 millions de salariés pourraient être concernés par l’extension du champ de la couverture complémentaire santé d’entreprise.
Le transfert vers l’assurance collective obligatoire d’une partie des salariés aujourd’hui couverts par une assurance individuelle présente un certain nombre d’avantages ; il est aussi générateur d’un coût important pour la collectivité.
● Du point de vue du coût pour l’assuré de la couverture complémentaire « santé », toutes choses égales par ailleurs, les contrats collectifs coûtent 6 euros de moins par personne et par mois que les contrats individuels, hors prise en compte des avantages liés pour les couvertures collectives, à la prise en charge d’une partie de la prime par l’employeur et à la déduction par le salarié de l’ensemble des cotisations versées de son revenu imposable (9). En outre, toujours d’après la même étude, les garanties proposées sont souvent plus larges en collectif qu’en individuel.
● La couverture collective présente également l’avantage de permettre une mutualisation des risques, à une échelle particulièrement large lorsque cette couverture est assurée au niveau de la branche : en effet, l’affiliation d’un grand nombre de salariés au sein d’un secteur d’activité permet de réduire les effets d’anti-sélection bien connus sur le marché de l’assurance ; en outre, les branches disposent d’une masse critique suffisante pour obtenir des conditions de garanties que ne peuvent négocier à leur niveau des entreprises, a fortiori les plus petites d’entre elles, et encore moins un individu isolé. Plus le champ de la couverture est large, comme c’est le cas d’une couverture de branche, plus la mutualisation des risques est donc importante.
Enfin, la logique de couverture « santé » de branche est cohérente si l’on considère la spécificité des métiers : l’exemple souvent donné en la matière est celui de la boulangerie, dont l’accord de branche organisant la couverture complémentaire « santé » permet de développer des actions particulières de prévention spécifiques dans deux domaines, l’asthme et la carie dentaire, deux pathologies particulièrement présentes dans ces métiers. On pourrait a contrario considérer que des secteurs présentant une dangerosité particulière ou une exposition à certains risques spécifiques fassent l’objet de tarifications spécifiques à ce titre, ce qui alourdirait le coût de la couverture par rapport à d’autres filières professionnelles : cela reste néanmoins vrai aussi à l’échelle d’une entreprise dont les salariés seraient exposés à des risques particuliers.
● La généralisation de la couverture complémentaire pour les salariés et le transfert qu’elle entraîne vers une couverture collective d’une partie des salariés aujourd’hui couverts par une assurance complémentaire individuelle génère un coût important pour les finances publiques, en raison, on l’a vu, des avantages fiscaux et sociaux associés à ces contrats.
D’après l’étude d’impact associée au projet de loi, le coût pour la sécurité sociale de la généralisation de la protection sociale complémentaire collective aux salariés serait compris entre 300 et 430 millions d’euros, selon l’hypothèse d’extension considérée (soit 24 % des salariés, soit 34,7 % des salariés), au titre des exonérations de cotisations sociales. Le mécanisme de portabilité des droits sur douze mois se traduirait quant à lui par un coût supplémentaire compris entre 75 et 110 millions d’euros pour la sécurité sociale.
S’agissant de l’État, le manque à gagner s’établirait entre 1,175 milliard d’euros et 1,56 milliard d’euros au titre de la déduction des cotisations versées de l’assiette de l’impôt sur le revenu qui bénéficie au salarié et de la déduction de l’assiette de l’impôt sur les sociétés qui bénéficie à l’employeur.
Au total, les pertes de recettes pour les finances publiques sont estimées entre 1,5 et 2,1 milliards d’euros.
B. LA GÉNÉRALISATION DE LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ D’ENTREPRISE PRÉVUE PAR L’ARTICLE 1ER
Pour assurer la généralisation de la couverture complémentaire collective « santé », la négociation d’accords de branche est privilégiée par le projet de loi ; ce n’est qu’en l’absence de tels accords qu’une négociation d’entreprise prendra ensuite le relais. À l’échéance du 1er janvier 2016, en l’absence d’accord de branche ou d’entreprise, l’obligation de couverture devenant effective, les entreprises seront tenues de mettre en œuvre une telle couverture par voie unilatérale.
1. Par défaut, la mise en place d’une couverture complémentaire collective a minima à compter du 1er janvier 2016
Le 1° du II de l’article complète le chapitre premier du titre premier du livre IX du code de la sécurité sociale. Il s’agit des dispositions du code consacrées à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non-salariés et aux institutions à caractère paritaire, en l’occurrence de la détermination des garanties complémentaires des salariés en matière de protection sociale.
Un nouvel article L. 911-7 prévoit l’obligation pour les entreprises qui ne seraient pas couvertes à la date du 1er janvier 2016 par un accord de branche ou d’entreprise organisant une couverture complémentaire « santé » collective et obligatoire dont les garanties seraient aussi favorables que celles prévues par ce même article, d’offrir une telle couverture à leurs salariés par voie unilatérale.
Autrement dit, la couverture complémentaire minimale définie par l’article L. 911-7 devra obligatoirement être mise en œuvre au 1er janvier 2016 au sein des entreprises qui ne seraient pas couvertes par un accord de branche et n’auraient pas réussi à faire aboutir la négociation d’un accord à leur niveau ou encore des entreprises dépourvues de délégué syndical dans l’hypothèse toujours où aucun accord de branche ne serait intervenu à cette date. Elle aura également potentiellement vocation à s’appliquer à des entreprises couvertes par une complémentaire dont les garanties sont inférieures à celles désormais requises, que ces garanties soient prévues par accord de branche ou d’entreprise. Dans l’hypothèse où une entreprise serait déjà couverte par le biais d’une décision unilatérale de l’employeur, il conviendra de vérifier si la couverture en question est au moins aussi favorable que la nouvelle couverture minimale prévue par l’article L. 911-7 : dans le cas contraire, l’employeur sera en tout état de cause tenu d’adapter cette couverture en conséquence.
La mise en œuvre de manière unilatérale par décision de l’employeur est d’ores et déjà prévue en matière de garanties complémentaires offertes aux salariés (article L. 911-1) : il s’agit d’une des modalités de droit commun de la mise en œuvre de telles garanties dans l’entreprise.
Toutefois, le texte précise bien que cette mise en œuvre unilatérale par décision de l’employeur se fait dans le respect des dispositions de l’article 11 de la loi de 1989 précitée : or, cet article dispose qu’un système de garanties collectives mis en place par décision unilatérale de l’employeur ne peut s’imposer à un salarié déjà présent dans l’entreprise.
Cette possibilité pour un salarié de refuser la mise en œuvre de la couverture complémentaire « santé » peut s’apparenter à une entorse à l’objectif de la généralisation de la couverture complémentaire collective portée par le présent article. Toutefois, une telle clause d’ « opting out » constitue une garantie pour le salarié, qui ne peut se voir imposer par décision unilatérale de l’employeur la mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire se traduisant par de nouvelles cotisations à sa charge. Tel n’est pas le cas des salariés entrés dans l’entreprise postérieurement à la mise en place de ce régime, qui y adhèrent lors de leur embauche en toute connaissance de cause.
On notera que l’obligation imposée à l’employeur d’assurer la couverture minimale définie à l’article L. 911-7 ne concerne que ses seuls salariés : il n’est nullement fait référence à ses potentiels ayants droit (conjoint, enfants). Néanmoins, en pratique, des garanties pourront être instituées pour prévoir l’ouverture de droits pour le conjoint ou la famille du salarié couvert, ce qui est aujourd’hui d’ores et déjà très souvent le cas.
L’article L. 911-7 précise ensuite le futur contenu du « panier minimal de soins » qui sera exigé dans le cadre de la couverture complémentaire collective qui s’imposera aux entreprises au 1er janvier 2016. Celle-ci comprend obligatoirement la prise en charge totale ou partielle :
– du ticket modérateur laissé à la charge du patient mentionné au I de l’article L. 322-2, pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires au titre des soins de ville et des soins hospitaliers (1° de l’article L. 911-7) ;
– du forfait journalier hospitalier mentionné à l’article L. 174-4 (2° de l’article L. 911-7) ;
– ainsi que des dépassements d’honoraires pratiqués pour certains soins dentaires et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement (3° de l’article L. 911-7).
Pour mémoire, l’accord national interprofessionnel prévoyait que le panier de soins minimal couvrirait 100 % de la base de remboursement des consultations, actes techniques et pharmacie en ville et à l’hôpital, le forfait journalier hospitalier, 125 % de la base de remboursement des prothèses dentaires et un forfait optique de 100 euros par an.
Un décret déterminera le niveau de prise en charge de ces dépenses et la liste des dispositifs médicaux visés.
Au cours des travaux menés par votre rapporteur, la question de l’étendue du « panier de soins » minimal a été très largement abordée, de nombreux interlocuteurs faisant valoir que la couverture proposée se situait en deçà du niveau de couverture actuel de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUc). D’après les informations dont dispose votre rapporteur, le décret définira les taux de prise en charge pour chacune des catégories de la manière suivante, mise en regard du « panier de soins » de la CMUc.
Catégories de dépenses médicales |
Niveau de la prise en charge |
Panier de soins CMUc |
Soins de ville |
Au moins 100 % de la base de remboursement |
100 % de la base de remboursement |
Hospitalisation |
Au moins 100 % de la base de remboursement |
100 % de la base de remboursement |
Médicaments |
100 % pour l’ensemble des médicaments |
100 % de la base de remboursement |
-dont vignettes blanches | ||
-dont vignettes bleues | ||
-dont vignettes oranges | ||
Forfait journalier hospitalier |
Prise en charge complète |
Prise en charge complète |
Optique |
100 % de la base de remboursement + Forfait de 100 € par an au-delà |
Jusqu’à 137 € |
Dentaire |
125 % de la base de remboursement |
Jusqu’à 300 % de la base de remboursement (y compris le ticket modérateur) |
Audioprothèse |
100 % de la base de remboursement |
443 € par appareil |
Source : Direction de la sécurité sociale
La comparaison avec le panier de soins de la CMUc a toutefois des limites : en effet, les bénéficiaires de la CMUc se voient appliquer les tarifs opposables par les professionnels de santé, et ne s’exposent donc pas au paiement de dépassements d’honoraires par exemple. En outre, le panier de soins minimal ne couvre pas obligatoirement la famille du salarié, contrairement à la CMUc qui couvre également les ayants droit de l’assuré.
Ce décret fixera également les catégories de salariés pouvant être dispensés d’affiliation eu égard à la nature et aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. L’accord du 11 janvier précise sur ce point que les contrats de couverture complémentaire santé devront respecter les dispositions des articles R. 242-1-1 à R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, en particulier les conditions requises par ces contrats pour bénéficier de la reconnaissance de contrats collectifs, que ne remettent pas en cause un certain nombre de dispenses d’affiliation expressément prévues par l’article R. 242-1-6. D’après les informations dont dispose votre rapporteur, le décret a vocation à reprendre les catégories de salariés définies à l’article R. 242-1-6 : il s’agit donc des cas de dispenses d’affiliation de droit commun.
Le texte précise que l’employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture. On rappellera qu’aujourd’hui, dans le cadre des complémentaires « santé » collectives et obligatoires d’entreprise, l’employeur prend en charge en moyenne 54 % du financement de la couverture.
À partir du moment où est fixée une obligation pour les entreprises d’offrir à leurs salariés une couverture complémentaire « santé » qui a elle-même vocation à être collective et obligatoire, se pose la question de l’éventuelle résiliation du contrat par l’organisme assureur et de l’éventuelle suspension du paiement des prestations dans l’hypothèse où l’employeur ne s’acquitterait pas de ses cotisations. On notera à cet égard que le cinquième alinéa de l’article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, qui concerne les institutions de prévoyance, prévoit qu’aucune suspension de garantie, de dénonciation de l’adhésion d’une entreprise ou de résiliation du contrat n’est possible dans le cas d’une couverture organisée par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel.
Or, cette obligation n’existe que pour les seules institutions de prévoyance et non pour les assurances et les mutuelles : votre rapporteur s’interroge donc sur l’opportunité d’étendre à ces deux catégories d’organismes assureurs les obligations existantes pour les institutions de prévoyance, dans l’objectif de garantir la cohérence de la nouvelle obligation de couverture pesant sur les entreprises.
2. Une priorité donnée à la négociation d’accords de branche
Le A du I du présent article impose aux branches d’entamer, avant le 1er juin 2013, une négociation visant à garantir une couverture complémentaire « santé » collective aux salariés des entreprises qui en relèvent. Cette négociation doit être obligatoirement menée dans les branches où les salariés soit ne bénéficient d’aucune couverture complémentaire, soit bénéficient d’une couverture moins favorable que celle instituée par le nouvel article L. 911-7. Cette couverture doit être effective au 1er janvier 2016.
D’après les informations transmises à votre rapporteur, concrètement, les branches qui n’ont pas antérieurement conclu de convention ou d’accord instituant une telle couverture sont clairement dans l’obligation d’ouvrir des négociations. Pour celles qui ont d’ores et déjà conclu une telle convention ou un tel accord, une évaluation de la couverture proposée au regard de la couverture minimale nouvellement imposée devra être réalisée préalablement, afin que la branche puisse déterminer si elle doit ou non remettre son ouvrage sur le métier.
Contrairement aux obligations de négociation actuellement existantes au niveau des branches, la négociation de branche prévue pour la généralisation de la couverture complémentaire « santé » ne sera pas périodique.
On remarquera que la mention générique retenue pour parler de la couverture complémentaire « santé » est bien celle retenue par le code de la sécurité sociale, autrement dit une couverture en matière de remboursements complémentaires de « frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ».
La couverture prévue est « collective » et « à adhésion obligatoire » : ces deux critères sont fixés par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012. Le caractère collectif et obligatoire de la couverture est, on l’a vu, une condition pour bénéficier du régime fiscal et social favorable déjà cité. La qualification de régime collectif suppose que les garanties prévues bénéficient à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux (article R. 242-1-1 à R. 242-1-5). Le critère de régime obligatoire implique quant à lui que l’ensemble des salariés de l’entreprise ou tous ceux relevant de la ou des catégories entrant dans son champ doivent obligatoirement être affiliés, avec toutefois un certain nombre de dérogations sous la forme de dispenses d’affiliation.
Le caractère collectif et obligatoire de la couverture complémentaire
● S’agissant du caractère collectif des garanties :
Aux termes de l’article R. 242-1-1, les garanties prévues peuvent ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés, pour autant que ces catégories couvrent tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
Les critères permettant de déterminer une catégorie de salariés sont les suivants :
– l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres ;
– les tranches de rémunération fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite Agirc et Arrco ;
– l’appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels ;
– le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords susmentionnés ;
– et enfin, l’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession.
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou de l’ancienneté du salarié.
L’article R. 242-1-2 prévoit toutefois qu’une condition d’ancienneté de six mois puisse être exigée pour le bénéfice d’une couverture complémentaire « santé » (douze mois pour les autres risques). Le caractère collectif de la couverture complémentaire « santé » n’est pas remis en cause dès lors que certaines prestations sont réservées aux cadres, sous réserve que l’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficient d’une couverture complémentaire à ce titre.
Théoriquement, la participation de l’employeur doit être fixée selon un taux et un montant uniformes pour l’ensemble des salariés ou pour les salariés d’une même catégorie. La reconnaissance du caractère collectif d’un contrat complémentaire « santé » ne fait toutefois pas obstacle à la possibilité pour l’employeur de prendre en charge l’intégralité des contributions des salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que l’absence d’une telle prise en charge conduirait ces salariés à s’acquitter d’une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération brute (article R. 242-1-4).
De même, l’employeur est susceptible de majorer sa contribution en cas de surcotisation effectuée par les salariés choisissant de souscrire à des garanties supplémentaires, sans que cela ne remette en cause le caractère collectif de la couverture (article R. 242-1-5).
● S’agissant du caractère obligatoire des garanties :
La reconnaissance de la qualité d’obligatoire d’une couverture complémentaire « santé » collective ne fait pas obstacle à l’existence de dispenses d’affiliation pour les salariés suivants (article R. 242-1-6) :
– les salariés déjà présents dans l’entreprise lorsque le régime est mis en place par décision unilatérale de l’employeur ;
– sous certaines conditions, les salariés en CDD, les apprentis et les salariés à temps partiel. Dans ce cas, la couverture doit résulter d’une convention, d’un accord collectif ou d’un projet d’accord de l’employeur ratifié à la majorité des intéressés. En l’occurrence, pour ces salariés dont le contrat est d’au moins un an, la dispense d’adhésion n’est possible que si et dans la mesure où ils justifient par ailleurs d’une couverture complémentaire santé individuelle ; pour les salariés à temps partiel et les apprentis, une dérogation peut aussi être prévue dans le cas où leur adhésion leur coûterait plus de 10 % de leur rémunération brute.
– des dispenses d’affiliation peuvent également être prévues pour les salariés bénéficiaires de la CMUc ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire « santé » (ACS) ou couverts par une complémentaire individuelle au moment de la mise en place de la couverture collective d’entreprise ou au moment de leur embauche. Dans ces cas, la dispense d’affiliation ne peut, en tout état de cause, jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Le A du I fixe également le contenu, obligatoire ou facultatif, de la négociation qui s’impose aux branches professionnelles, qui fait l’objet des 1° au 5° du A du I.
– Le 1° prévoit que la négociation porte obligatoirement sur la définition du contenu et du niveau des garanties, ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés. Sur ce dernier point, les conditions posées au nouvel article L. 911-7 concernant la mise en place d’une couverture complémentaire « santé » collective d’entreprise au plus tard au 1er janvier 2016, incluraient le plancher de 50 % du financement par l’employeur. En effet, les entreprises dont les salariés ne bénéficieront pas à cette date d’une couverture complémentaire santé au moins aussi favorable que celle mentionnée à cet article, devront en tout état de cause s’y conformer. Autrement dit, les accords de branche auront bien entendu tout intérêt à respecter par avance les conditions fixées au nouvel article L. 911-7, sous peine d’être amenées à renégocier très rapidement leur couverture avant le 1er janvier 2016.
La fixation du contenu et du niveau des garanties est un élément central de la négociation de ce type d’accords, bien que dans les faits, les accords de branche puissent aujourd’hui se borner à fixer un niveau général de financement à consacrer à des garanties qui seront librement choisies par chaque entreprise.
– Le 2° précise que la négociation doit obligatoirement déterminer les modalités de choix de l’assureur. Le texte précise que les parties examinent « en particulier les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître l’objectif de couverture effective de l’ensemble des salariés des entreprises de la branche ». La négociation doit ainsi permettre de déterminer si une entière liberté de choix est laissée aux entreprises relevant de la branche, si des recommandations d’un ou de plusieurs organismes seront émises par la branche à l’attention des entreprises ou si, troisième option, une clause de prescription – parfois appelée de désignation – est retenue au niveau de la branche, qui s’impose dès lors à l’ensemble des entreprises qui en relèvent. On pourrait ainsi concevoir que des choix différents soient effectués en fonction des caractéristiques des entreprises de la branche (taille des entreprises, type de métier ou de secteur d’activité, exposition à des risques particuliers). En tout état de cause, la négociation doit, dans l’hypothèse où une liberté de choix serait laissée aux entreprises, déterminer les conditions dans lesquelles celle-ci s’exerce ainsi que ses éventuelles limites. Il s’agirait donc en tout état de cause d’une liberté encadrée. La rédaction choisie laisse clairement entendre que les clauses de recommandation ou de prescription sont privilégiées (10).
– Le 3° recouvre la faculté pour les branches négociatrices de fixer, « le cas échéant », les modalités de financement de l’objectif de solidarité (notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs). Il s’agit de la possibilité pour les branches de prévoir le financement de certaines actions spécifiques de « solidarité », qu’il s’agisse par exemple du développement d’actions de prévention auprès des salariés de leur secteur d’activité ou encore du maintien des droits à la couverture complémentaire pour les salariés quittant l’entreprise, dans le cas d’un départ à la retraite ou d’un licenciement.
Cette dimension n’est pas obligatoire, mais elle est évidemment plus porteuse de sens au niveau de la branche que de l’entreprise.
– Le 4° prévoit que la négociation définit les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés peut justifier des dispenses d’affiliation. On peut s’interroger sur la latitude dont disposeront les branches à cet égard : ces cas devront-ils être déterminés dans le respect des dispositions de l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale ? Dans le cadre de l’amélioration du dispositif de portabilité des droits, la question des dispenses d’affiliation est loin d’être anecdotique, le salarié déclinant la couverture que lui offre son entreprise au motif qu’il est couvert par ailleurs en tant qu’ayant droit de son conjoint doit avoir conscience qu’il renonce par là même au maintien d’une couverture complémentaire s’il se retrouve au chômage.
S’agissant des modalités d’affiliation des salariés à temps partiel, le texte ne prévoit aucune règle particulière. Ces salariés sont affiliés dans les règles de droit commun, avec les mêmes tarifs et les mêmes garanties que celles qui prévalent pour les salariés à temps plein. En effet, la protection sociale complémentaire d’entreprise est indépendante de la durée de travail du salarié. En revanche, les spécificités du travail à temps partiel soulèvent deux interrogations : d’une part, celui du coût plus important que revêt cette couverture pour ces salariés et qui justifie, on l’a vu, la possibilité de leur dispense d’affiliation dès lors qu’il représenterait plus de 10 % de leur rémunération brute. Cette exclusion potentielle des salariés à temps partiel – et des apprentis, d’ailleurs – du bénéfice de la couverture complémentaire pose problème au regard de l’objectif de généralisation. D’autre part, se pose la question des modalités d’affiliation des salariés à temps partiel pluri-actifs : un salarié ayant plusieurs employeurs a vraisemblablement vocation à être couvert par la complémentaire proposée par l’entreprise dans laquelle il effectue le volume horaire le plus important, et à se voir dispenser d’affiliation, à sa demande, à la couverture offerte par son second employeur.
– Enfin, le 5° dispose que la négociation doit fixer le délai, au minimum de dix-huit mois mais ne pouvant aller au-delà du 1er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles. À cet égard, les modalités retenues dans le choix des organismes assureurs seront déterminantes : en effet, dans le cas d’un accord de branche comportant une clause de prescription, la couverture est considérée comme étant constituée par cet accord de branche, l’entreprise se contentant d’adhérer à l’organisme qu’elle désigne. Les délais de mise en conformité des entreprises seront nécessairement plus longs dans l’hypothèse d’une totale liberté de choix laissée aux entreprises : on conçoit qu’une TPE devant couvrir ses salariés conformément à un niveau de garanties et à des conditions tarifaires éventuellement prédéterminées par l’accord de branche, aura besoin de beaucoup plus de temps pour conclure son contrat complémentaire « santé » collectif. Dans le cas d’un accord de branche recommandant un ou plusieurs organismes, les délais dans lesquels les entreprises pourront se mettre en conformité pourront être plus courts, bien que chaque entreprise devra toutefois logiquement s’informer auprès de ces organismes et éventuellement d’organismes tiers des conditions tarifaires et des garanties qu’ils pourraient offrir à l’entreprise, avant de fixer son choix sur un organisme recommandé ou non par la branche.
3. Une négociation d’entreprise prévue de manière subsidiaire
Le B du I prévoit qu’à compter du 1er juillet 2014 et avant le 1er janvier 2016, dans les entreprises pourvues d’un délégué syndical et non couvertes soit par un accord de branche, soit par un accord d’entreprise, soit par une décision unilatérale de l’employeur prévoyant une couverture complémentaire « santé » au moins aussi favorable aux conditions fixées par le nouvel article L. 911-7 et applicable au plus tard le 1er janvier 2016, l’employeur doit obligatoirement engager une négociation sur ce thème.
Plusieurs observations doivent être formulées sur cette négociation d’entreprise.
● En premier lieu, cette négociation n’est applicable qu’aux entreprises où a été désigné un délégué syndical, ce qui exclut de facto de nombreuses petites entreprises (11). Rappelons qu’un délégué syndical ne peut en principe être désigné que dans une entreprise de 50 salariés ou plus : dans les entreprises de moins de 50 salariés, un délégué du personnel peut néanmoins être désigné comme délégué syndical. Si l’exclusion de l’obligation de négociation des entreprises non dotées d’un délégué syndical est logique à partir du moment où cette négociation s’articule avec la négociation annuelle obligatoire déjà existante en matière de protection maladie prévue à l’article L. 2242-11 (12), on peut toutefois s’interroger sur la mise en œuvre de telles négociations dans les nombreuses petites entreprises où n’existe pas de délégué syndical. On pourrait en effet craindre que, en l’absence d’accord de branche, les petites entreprises soient finalement automatiquement amenées à mettre en œuvre la couverture complémentaire collective minimale prévue à l’article L. 911-7 à l’échéance du 1er janvier 2016.
Toutefois, l’obligation de négociation collective dans les seules entreprises pourvues de délégué syndical constitue la voie de droit commun fixée par le code du travail. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, des modalités facultatives de négociation existent : ces entreprises gardent donc, a priori, la possibilité de négocier un accord d’entreprise sur ce sujet selon les procédures prévues à l’article L. 2232-21 avec les représentants élus des salariés et à l’article L. 2232-24 avec un ou plusieurs salariés mandatés, sans qu’il soit d’ailleurs nécessaire d’aménager spécifiquement cette procédure, qui reste de droit commun, pour la négociation d’entreprise relative à la mise en place d’une couverture complémentaire « santé ».
● Ensuite, les entreprises tenues de négocier sont celles qui, outre la présence d’un délégué syndical, ne sont couvertes ni par un accord de branche, ni par un accord d’entreprise, ni par une décision unilatérale du chef d’entreprise : or, l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, qui aménage les modalités de la mise en œuvre de garanties collectives pour les salariés en matière de protection sociale complémentaire, prévoit, outre ces cas de figure, celui de « la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise ». Votre rapporteur juge qu’une clarification du texte mérite d’être apportée sur ce point. De la même manière, et cette fois en aval de la négociation de branche et d’entreprise, en cas d’échec de la négociation, doit-on considérer que l’entreprise peut recourir à ces deux autres modalités de mise en œuvre d’une couverture collective obligatoire pour ses salariés, à savoir par la ratification d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise ou par décision unilatérale de ce dernier ou l’échec de la négociation d’entreprise signifie-t-il que la mise en œuvre de la couverture complémentaire collective se fera automatiquement par voie unilatérale au 1er janvier 2016, sur la base des garanties minimales prévues au nouvel article L. 911-7 ?
● S’agissant du calendrier imparti aux entreprises pour négocier sur la mise en place d’une couverture complémentaire santé, une articulation devra impérativement être réalisée avec les branches dont elles relèvent : en effet, les entreprises ne lanceront dans les faits des négociations que si leur branche n’en a pas initié ou si la négociation de branche n’a pas permis de déboucher sur un accord au 30 juin 2014. Il existe donc deux cas de figure :
– soit la branche est d’ores et déjà couverte par un accord garantissant une couverture complémentaire plus avantageuse que celle prévue par le texte : dans ce cas, les entreprises de son secteur sont considérées comme satisfaisant déjà aux conditions mises en place, et aucune négociation, ni de branche, ni d’entreprise, n’a lieu d’être ;
– soit la branche n’est pas couverte par un tel accord ou est couverte par un accord dont les garanties sont inférieures à celles prévues par le texte : dans ce cas, la branche sera tenue d’engager une négociation avant le 1er juin 2013. Par conséquent, l’entreprise devra nécessairement être informée de l’aboutissement de cette négociation à la date du 1er juillet 2014, afin qu’elle puisse le cas échéant, en cas d’échec de la négociation, entamer ses propres négociations à son niveau. Dans l’hypothèse où une branche professionnelle serait toujours en cours de négociation au 1er juillet 2014, les entreprises de son secteur devront tout de même engager des négociations à leur niveau.
Concrètement, les entreprises seront informées de l’évolution des négociations de la branche par le biais des organisations professionnelles représentatives.
● Ensuite, la question se pose de savoir selon quelles modalités une entreprise déjà couverte doit évaluer la qualité des garanties qu’elle propose à ses salariés à l’aune de la couverture minimale instituée par l’article L. 911-7. Cette question vaut d’ailleurs tout autant au niveau de la branche. Suffit-il qu’en globalité, les garanties proposées soient plus nombreuses à être plus favorables que celles prévues dans le « panier de soins » minimal ? Faut-il, au contraire, que chaque type de remboursement de dépenses de santé soit comparé avec celui prévu dans le cadre de la couverture minimale ? D’après les informations transmises à votre rapporteur, la seconde interprétation est celle qui doit prévaloir : autrement dit, il suffirait par exemple que le remboursement des frais d’optique garanti dans le cadre d’une couverture d’entreprise soit inférieur à celui prévu dans le cadre de la couverture minimale, et cela quand bien même tous les remboursements d’autres dépenses seraient supérieurs, pour que l’entreprise soit obligée de renégocier son régime d’assurance complémentaire santé. Si cette lecture doit prévaloir, il convient néanmoins qu’elle soit clairement énoncée par le texte.
● La négociation d’entreprise, s’il y a lieu, se déroule dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4, qui correspondent aux modalités de droit commun de la négociation annuelle obligatoire en entreprise, et au deuxième alinéa de l’article L. 2242-11 du code du travail, qui concerne la négociation annuelle obligatoire d’entreprise sur la mise en place d’un régime de prévoyance maladie dans les entreprises non couvertes.
Les modalités de la négociation obligatoire en entreprise
La négociation obligatoire en entreprise est aujourd’hui annuelle ou triennale. Le renvoi, pour la négociation d’une couverture complémentaire collective en entreprise, aux règles applicables à la négociation annuelle obligatoire en entreprise peut donc sembler étonnant pour une négociation qui n’a pas vocation à être périodique : ce renvoi permet toutefois d’encadrer la procédure de négociation prévue, quand bien même celle-ci ne serait pas réitérée, en garantissant, entre autres, le caractère loyal et sérieux de la négociation, l’établissement d’un procès-verbal de désaccord en cas d’échec de la négociation, etc.
Pour rappel, les thèmes devant être abordés chaque année dans toute entreprise pourvue de délégués syndicaux sont : l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les salaires et la durée du travail, le régime de prévoyance maladie, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale et enfin, les travailleurs handicapés.
L’article L. 2242-1 précise que la négociation doit être engagée, au moins une fois par an, par l’employeur. À défaut d’une initiative de l’employeur depuis plus de douze mois depuis le début de la dernière négociation, celle-ci doit obligatoirement être engagée si un syndicat représentatif de salariés en fait la demande. À réception d’une telle demande, l’employeur doit transmettre celle-ci aux autres organisations représentatives dans un délai de huit jours et convoquer les parties à la négociation annuelle dans un délai de quinze jours.
Aux termes de l’article L. 2242-2, la première réunion doit permettre de fixer le lieu et le calendrier des réunions ultérieures, ainsi que les informations que l’employeur remettra aux membres des délégations syndicales
L’article L. 2242-3 précise que tant que la négociation est en cours, l’employeur ne peut pas prendre de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés dans les matières sur lesquelles porte la négociation, sauf si l’urgence le justifie. Enfin, l’article L. 2242-4 dispose qu’en cas d’échec de la négociation, un procès-verbal de désaccord est établi, dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal donne lieu à dépôt à l’initiative de la partie la plus diligente.
4. Les modalités de la désignation du ou des organismes assureurs et ses conséquences
Le dispositif retenu par l’article 1er concernant le choix du ou des organismes assureurs est équilibré : en effet, comme on l’a vu, les branches fixeront elles-mêmes les modalités de choix de l’assureur.
Trois options sont de ce point de vue ouvertes aux branches :
– Une liberté entière peut être laissée aux entreprises de recourir à l’organisme de leur choix pour assurer la couverture d’après le contenu et le niveau des garanties que l’accord de branche aura par ailleurs définis.
– L’accord de branche peut comporter des recommandations d’un ou de plusieurs organismes, parmi lesquels les entreprises pourront exercer leur choix.
Dans ces deux premiers cas, le texte prévoit que l’accord de branche doit examiner « les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître l’objectif de couverture effective de l’ensemble des salariés des entreprises de la branche » : autrement dit, même si une liberté entière est laissée aux entreprises, cette liberté sera encadrée ; dans le second cas, la recommandation d’un ou de plusieurs organismes se donne précisément comme un moyen d’assurer la couverture effective de l’ensemble des salariés.
– Enfin, l’accord de branche peut inclure une clause de prescription, s’imposant à l’ensemble des entreprises qui en relèvent.
La question des modalités de désignation des organismes assureurs s’est posée à de nombreuses reprises dans le cadre des auditions menées par votre rapporteur : elle a suscité de nombreux débats, de nombreuses interrogations et quelques crispations. Sans prétendre retracer de manière exhaustive l’ensemble des points de vue qui ont été exprimés et des questions qui ont été soulevées, il semble nécessaire de restituer les principaux enjeux et problématiques qu’elle recouvre.
● La première problématique concerne la traduction par le projet de loi des termes de l’accord du 11 janvier: il a pu être reproché au Gouvernement de n’avoir sur ce point pas respecté le souhait des partenaires sociaux. Rappelons le texte de l’accord : « les partenaires sociaux de la branche laisseront aux entreprises la liberté de retenir le ou les organismes assureurs de leur choix. Toutefois, ils pourront, s’ils le souhaitent, recommander aux entreprises de s’adresser à un ou plusieurs organismes assureurs ou institutions pouvant garantir cette couverture après mise en œuvre d’une procédure transparente de mise en concurrence. Les accords de branche pourront définir, quels que soient les organismes éventuellement recommandés, les contributions dédiées au financement de l’objectif de solidarité, notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs. ». Les signataires divergent sur l’interprétation de ces trois phrases : certains déduisent de la première phrase une interdiction des clauses de désignation, d’autres estiment au contraire que la dernière les autorise. À partir du moment où les trois options restent sur la table de l’ensemble des branches qui seront tenues d’engager des négociations avant le 1er juin 2013, que le projet de loi aménage les conditions d’une mise en concurrence préalable des organismes assureurs, il est bien difficile de dire si le texte de loi est conforme ou non à l’accord.
● Le deuxième enjeu est celui de la mutualisation des risques, dont l’importance est encore accrue avec le mécanisme de portabilité que le projet de loi propose de renforcer. Il pose la question de l’éventuelle clause de prescription que pourront comporter les accords de branche organisant la couverture complémentaire « santé » collective.
La clause de prescription figure à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Cet article dispose que lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels prévoient une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture auprès d’un ou plusieurs organismes assureurs, les entreprises relevant de son champ d’application y adhèrent alors obligatoirement : dès lors, ces accords doivent également obligatoirement comporter une clause fixant les conditions et la périodicité du réexamen des modalités d’organisation de la mutualisation des risques, cette périodicité ne pouvant excéder cinq ans. Lorsqu’un tel accord s’applique à une entreprise déjà couverte par un autre organisme pour les mêmes risques et à un niveau de garantie équivalent, les dispositions de l’article L. 2253-2 s ’appliquent : autrement dit, les stipulations de l’accord de niveau supérieur priment (il s’agit de ce que l’on appelle la « clause de migration »).
Dès lors que le projet de loi prévoit, au même titre que l’accord du 11 janvier d’ailleurs, que l’accord de branche peut, « le cas échéant », fixer « les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l’objectif de solidarité, notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs », on peut s’interroger sur la possibilité pour les branches qui souhaiteraient fixer de telles modalités de ne pas recourir à une clause de prescription : autrement dit, la poursuite d’un objectif de solidarité est-elle possible sans une mutualisation des risques, c’est-à-dire sans recourir à un ou plusieurs organismes déterminés ayant vocation à couvrir l’ensemble des entreprises de la branche ?
Il va de soi que la mise en œuvre de droits non contributifs, au premier rang desquels figure sans aucun doute la mise en place d’un mécanisme de portabilité des droits en faveur des anciens salariés, mais également celle d’une politique de prévention ou encore de mesures d’action sociale, passe plus facilement par une mutualisation générale des fonds auprès d’un nombre restreint d’organismes, voire auprès d’un organisme unique. Si la possibilité pour un organisme assureur de mettre en place de telles mesures au niveau d’une seule entreprise ne peut être exclue, il n’en demeure pas moins qu’une telle mutualisation a d’autant plus de sens au niveau de la branche.
La question de la licéité de la clause de prescription
L’article 101 du traité de fonctionnement de l’Union européenne prohibe les ententes entre entreprises susceptibles de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur. Les garanties de prévoyance qui reposent sur une clause de prescription ne sont pas considérées comme faussant la libre-concurrence, et ce, à un double titre : elles sont issues d’un accord négocié par les partenaires sociaux d’une part, elles ont pour objet l’amélioration des conditions de travail d’autre part. En outre, il ne s’agit pas non plus d’une clause constitutive d’un potentiel abus de position de dominante (article 102 du même traité), si et dans la mesure où la garantie de prévoyance mise en place poursuit un objectif de solidarité, ce qui induit que l’opérateur assume une mission d’intérêt général économique au profit des partenaires sociaux (Cour de justice de l’Union européenne, arrêts Albany et autres du 21 septembre 1999, de Woulde du 21 septembre 2000 et AG2R Prévoyance c/ Beaudout Père et Fils SARL du 3 mars 2011).
Dans ce dernier arrêt, la Cour rappelle que « les accords conclus dans le cadre de négociations collectives entre partenaires sociaux destinés à améliorer les conditions d’emploi et de travail doivent être considérés, en raison de leur nature et de leur objet, comme ne relevant pas de l’article 101 [du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne] » et que la réglementation communautaire ne s’oppose donc pas « à la décision des pouvoirs publics de rendre obligatoire, à la demande des organisations représentatives des employeurs et des salariés d’un secteur d’activité déterminé, un accord issu de négociations collectives qui prévoit l’affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé pour l’ensemble des entreprises du secteur concerné, sans possibilité de dispense. ».
Une chose est la reconnaissance par la jurisprudence communautaire de la licéité des clauses de prescription en matière de couverture complémentaire « santé » obligatoire et collective ; une autre est la question de la constitutionnalité de l’interdiction d’une telle clause de prescription.
L’interdiction de la clause de prescription serait-elle contraire aux principes fondamentaux ? D’aucuns prétendent que la suppression de la clause de prescription serait contraire à l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1958, aux termes duquel « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises », ainsi qu’au droit à la négociation collective consacré au niveau communautaire tant par la Charte des droits sociaux de 1989 que par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de décembre 2000, et donc, par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Ainsi, l’interdiction d’une clause de prescription reviendrait à limiter de manière excessive la liberté contractuelle des partenaires sociaux, en les empêchant de mettre en place une couverture mutualisée et la poursuite d’un objectif de solidarité.
Si l’existence de la clause de prescription ne semble donc pas constituer un obstacle rédhibitoire à la liberté économique, s’agissant de la mise en place d’une couverture complémentaire « santé » collective et obligatoire, elle reste et doit bien rester une exception au principe de la libre concurrence, justifiée par l’existence d’un objectif d’intérêt général et de solidarité suffisant. C’est pourquoi le projet de loi prévoit d’encadrer la procédure de désignation ou de recommandation du ou des organismes assureurs lorsque l’une de ces deux options sera privilégiée au détriment de la troisième (le libre choix laissé aux entreprises) : ainsi, le 2° du II de l’article complète l’article L. 912-1 pour préciser que lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels prévoient une mutualisation des risques qui passe alors par l’adhésion obligatoire des entreprises entrant dans leur champ, ou lorsqu’ils recommandent, sans valeur contraignante, aux entreprises d’adhérer à un ou plusieurs organismes, une procédure de mise en concurrence préalable doit être respectée, dans des conditions de transparence et selon des modalités prévues par décret.
L’étude d’impact associée au présent projet précise, sur ce point, que compte tenu de l’objet des accords en question, il n’a pas été question de les soumettre aux procédures d’appels d’offres régis par le code des marchés publics. Les signataires de l’accord du 11 janvier ont décidé de constituer un groupe de travail paritaire chargé de définir, dans un délai de trois mois, « les conditions et les modalités d’une procédure transparente de mise en concurrence, tant lors de la mise en place de la couverture que lors du réexamen périodique du ou des organismes assureurs désignés ou recommandés ». Le décret a vocation à reprendre les éléments de conclusion de ce groupe paritaire ; d’après l’étude d’impact, les principales règles de procédure pourraient concerner :
– le respect d’une publicité préalable obligatoire en amont de la négociation d’un accord ou de renouvellement d’un accord ;
– des modalités destinées à garantir un consentement éclairé des partenaires sociaux lors de la désignation ou recommandation, avec la mise en place de formations techniques ou encore le recours à des experts, etc. ;
– l’édiction de règles spécifiques destinées à prévenir les conflits d’intérêts (celui par exemple de partenaires sociaux exerçant un mandat ou ayant un lieu avec l’un des organismes assureurs candidat) ;
– et enfin, la définition des modalités de suivi du régime en cours d’exécution du contrat (par la mise en place d’un comité de suivi et d’obligations d’information de la part de l’assureur).
Votre rapporteur considère que cet encadrement du recours aux clauses de prescription ou de recommandation est bienvenu et permettra d’ailleurs de renforcer leur légitimité. Un tel encadrement répond en effet aux recommandations émises par le juge communautaire au juge national s’agissant des conditions de désignation d’un organisme assureur par les partenaires sociaux d’une branche professionnelle : la Cour de justice recommande en effet d’analyser les circonstances dans lesquelles l’organisme assureur a été désigné ; la marge de négociation dont cet organisme a pu disposer quant aux modalités de son engagement ; et enfin, les répercussions de ces éléments sur le mode de fonctionnement du régime dans son ensemble. Une sécurisation et une meilleure transparence de l’organisation des conditions de désignation des organismes assureurs semblaient donc indispensables.
● Une troisième question concerne le cas des entreprises qui n’acquitteraient pas ou plus leurs cotisations (en raison de difficultés financières importantes par exemple). L’article L. 932-9 du code de la sécurité sociale prévoit, en cas de défaut de paiement de la cotisation, l’obligation, pour une institution de prévoyance qui couvre une entreprise sur le fondement d’une convention de branche, de maintenir la garantie, et interdit toute possibilité de dénoncer l’adhésion de l’entreprise ou de procéder à la résiliation du contrat. Or, de telles contraintes ne s’appliquent ni aux organismes d’assurance régis par le code des assurances, ni aux mutuelles régies par le code de la mutualité. Il s’agit pourtant d’une garantie essentielle dans le cadre d’une couverture collective d’entreprise.
C. L’AMÉLIORATION DE LA PORTABILITÉ DE LA COUVERTURE « SANTÉ » ET « PRÉVOYANCE » POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI
Le mécanisme de la portabilité des droits relatifs à la protection sociale complémentaire des salariés a été institué par l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail. L’accord a fixé le principe du maintien du bénéfice des garanties des couvertures complémentaires « santé » et « prévoyance » aux salariés en cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, pour une période minimale de trois mois et dans la limite d’une durée égale à un tiers de leur droit à indemnisation, soit huit mois.
Il a ensuite été modifié par avenant le 18 mai 2009 : la période minimale d’indemnisation a été supprimée ; en revanche, le maintien de la couverture est prévu pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail, apprécié en mois entiers, et la durée maximale de l’indemnisation est fixée à neuf mois.
L’accord précisait les modalités de financement de cette portabilité, qui devait être assuré soit conjointement par l’ancien employeur et l’ancien salarié dans les conditions applicables aux salariés de l’entreprise, soit par un système de mutualisation défini par accord collectif, ce qui signifie en pratique que l’ancien salarié est couvert à titre gratuit. Un mode spécifique de collecte des cotisations de l’ancien salarié pouvait toutefois, dans le premier cas, être envisagé, par exemple, l’appel en totalité par l’employeur au moment de la rupture du contrat, avec, le cas échéant, en cas de reprise d’un emploi avant la fin de la période de portabilité, une possibilité pour l’ancien salarié de se voir rembourser le trop versé.
L’accord du 11 janvier 2008 tel que modifié par avenant prévoit également que le salarié peut renoncer à la portabilité de ses droits, cette démarche devant être écrite et réalisée dans les dix jours suivant la rupture du contrat, et que le non-paiement par l’ancien salarié de sa quote-part de financement de ces garanties, à la date d’échéance des cotisations, libère l’ancien employeur de toute obligation et entraîne la perte des garanties pour la période restant à courir.
Un bilan de ce dispositif ainsi que des systèmes de mutualisation mis en œuvre pour assurer le financement de la portabilité était prévu par l’avenant à l’accord : aucun bilan n’a toutefois à ce jour été réalisé sur la mise en œuvre de ce dispositif, ce que l’on ne peut que regretter à l’heure de son incorporation dans le corpus législatif. Les seules données dont a pu disposer votre rapporteur sont issues des estimations réalisées dans le cadre des négociations de l’accord national interprofessionnel, et qui chiffrent le surcoût représenté par la portabilité à neuf mois à 18,5 % du coût de la couverture totale à la charge des salariés et des employeurs.
Le 1° du II du présent article insère un nouvel article L. 911-8 dans le code de la sécurité sociale, qui donne une valeur législative au mécanisme de la portabilité des droits à la couverture complémentaire « santé » et « prévoyance » au profit des anciens salariés, ce qui a pour premier effet de rendre la portabilité applicable aux secteurs qui en étaient exclus par l’accord de 2008 et son avenant.
En effet, si ceux-ci ont bien fait l’objet d’arrêtés d’extension (respectivement les arrêtés du 23 juillet 2008 et du 7 octobre 2009), les articles L. 2261-15 et L. 2261-16 du code du travail précisent que l’extension d’un accord interprofessionnel n’a pour effet que de le rendre applicable aux employeurs entrant dans leur champ d’application professionnel et territorial, autrement dit, l’extension n’a eu pour effet que de rendre l’accord applicable aux branches au sein desquelles il existe une ou plusieurs organisations patronales représentatives adhérentes au MEDEF, à l’UPA ou la CGPME, qui sont les trois organisations signataires de cet accord et de son avenant (13).
Le dispositif ne s’applique donc à ce jour que dans les secteurs de l’industrie, du commerce, des services et de la construction. L’inscription dans la loi du principe de la portabilité permet donc concrètement d’étendre celui-ci aux secteurs d’activité dans lesquels d’autres organisations patronales sont représentatives qui n’adhèrent pas aux organisations représentatives au niveau national, c’est-à-dire principalement le secteur de l’économie sociale et solidaire, les professions libérales et le secteur agricole.
Ensuite, le premier alinéa du nouvel article L. 911-8 reprend bien le cadre applicable à cette portabilité tel qu’il avait été défini dans l’accord de 2008 modifié par avenant : la portabilité des droits ne s’applique qu’aux anciens salariés dont la rupture du contrat n’est pas consécutive à une faute lourde et qui sont pris en charge par le régime d’assurance chômage. Votre rapporteur s’interroge sur la limitation du dispositif aux cas de rupture de contrat, qui conduisent, de facto, à exclure du bénéfice de la portabilité les salariés dont le contrat à durée déterminée arrive à échéance à son terme : dans la mesure où une telle exclusion n’apparaît pas avoir été souhaitée par les partenaires sociaux, il conviendrait de modifier le texte sur ce point.
En outre, l’exclusion des salariés licenciés pour faute lourde du bénéfice de la portabilité ne constitue-t-elle pas une sorte de double-peine, problématique juridiquement autant que difficile à justifier sur le plan éthique ? Cette exclusion a toutefois clairement été souhaitée par les partenaires sociaux, qui l’avaient incluse dans la rédaction de l’accord de 2008.
Le premier alinéa de l’article précise enfin que le maintien de cette couverture bénéficie bien à l’ancien salarié « à titre gratuit » : le projet de loi reprend ici ce qui constituait l’une des modalités de financement de la portabilité, par le biais d’une mutualisation, à l’exclusion de l’autre, c’est-à-dire la répartition du financement entre l’employeur et l’ancien salarié, dans les conditions qui prévalaient antérieurement. Il s’agit d’un point important, qui confirme la nécessité pour les contrats organisant la couverture complémentaire de bien prévoir un mécanisme de mutualisation des risques, ne serait-ce qu’à ce titre. Pour mémoire, entre 2009 et 2012, 58 % des conventions collectives de branche portant sur la complémentaire « santé » ont signé un avenant sur la portabilité des garanties des anciens salariés : 70 % avaient choisi de mutualiser son financement.
L’article procède ensuite à une énumération des conditions de cette portabilité : là encore, il s’agit d’une stricte reprise des conditions déjà prévues par l’accord de 2008, à l’exception majeure de la durée maximale d’indemnisation qui est donc portée de neuf à douze mois.
Plus précisément, le 1° du nouvel article L. 911-8 prévoit le maintien des garanties « santé » et « prévoyance » à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, et sans pouvoir excéder douze mois.
La limitation du bénéfice de la portabilité aux chômeurs indemnisés par l’assurance chômage peut poser question : en effet, il peut sembler inéquitable qu’un demandeur d’emploi en fin de droits qui bascule à l’allocation de solidarité spécifique (ASS), perde à cette occasion ses droits en matière de protection complémentaire, ce qui pourrait en quelque sorte s’apparenter à une double peine. Cette limitation est en réalité liée à la volonté de ne pas ouvrir le bénéfice de la portabilité pendant un an à un salarié qui n’aurait par exemple travaillé que quelques semaines chez un employeur et qui bénéficierait ensuite d’un maintien de ses droits pendant un an, alors même qu’il n’aurait en réalité cotisé au titre de ces garanties que pendant une très courte durée. Toutefois, dans la pratique, le bénéfice des couvertures « prévoyance » et « santé » est généralement soumis à une condition d’ancienneté, l’article R. 242-1-2 prévoyant, on l’a vu, qu’une condition d’ancienneté de six mois puisse être exigée pour le bénéfice d’une couverture complémentaire « santé » et de douze mois pour les autres risques. La plupart des accords prévoient aujourd’hui une telle condition. Autrement dit, un salarié dont le contrat serait rompu après trois semaines d’activité ne pourrait de toute manière pas bénéficier de la portabilité de droits auxquels il ne pouvait en tout état de cause pas encore prétendre au sein même de l’entreprise.
La limitation du bénéfice de la portabilité à la durée du dernier contrat de travail appréciée en mois entiers a, pour sa part, pour objet de neutraliser les mécanismes de reprise de droits et de réadmission qui permettent aujourd’hui à un demandeur d’emploi de faire valoir tout ou partie de ses droits ouverts au titre d’une période d’activité antérieure (14). En effet, dans la mesure où le financement de la portabilité est assuré par le dernier employeur, il ne saurait être question de faire peser sur lui le poids d’une extension de la durée des garanties au titre d’un contrat de travail antérieur. Cette précision est d’autant plus importante que l’article 6 du présent projet de loi pose le principe de la mise en place de droits rechargeables à l’assurance chômage, qui vont encore davantage décorréler les droits à indemnisation de la durée du contrat de travail – et donc de cotisation – directement antérieure.
Le 2° du nouvel article L. 911-8 subordonne le bénéfice du maintien de ces garanties à l’ouverture des droits à couverture complémentaire chez le dernier employeur : a contrario, il convient en effet de ne pas faire peser sur un employeur précédent le coût du maintien de droits à complémentaire ouverts lors d’une période d’activité antérieure.
Le 3° du nouvel article L. 911-8 précise que les garanties maintenues au bénéfice des anciens salariés sont celles en vigueur dans l’entreprise, autrement dit, l’employeur ne peut réduire ni le contenu ni le niveau des garanties offertes.
Le 4° dispose que le maintien des garanties relatives à la protection complémentaire « santé » et « prévoyance » ne peut avoir pour effet de porter les indemnités perçues par l’ancien salarié à un niveau supérieur au montant des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période. Cette précision vaut en particulier pour les garanties au titre de l’incapacité temporaire ou de l’invalidité, qui peut conduire au versement d’une rente : dans ce cas de figure, on peut en effet légitimement considérer que cette indemnisation n’a pas vocation à s’additionner aux allocations chômage.
Enfin, le 5° impose aux anciens salariés de justifier auprès de leur ancien employeur, tant à l’ouverture qu’au cours de la période de maintien du droit, du respect des conditions exigées par le nouvel article L. 911-7 pour le bénéfice de la portabilité. L’avenant à l’accord de 2008 précisait sur ce point que l’ancien salarié doit fournir à l’ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, de même qu’il est tenu d’informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations chômage si celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties.
Le III du présent article procède à l’harmonisation d’un certain nombre de dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques avec la mise en place de la portabilité.
Le 1° du III étend tout d’abord aux anciens salariés bénéficiaires du mécanisme de la portabilité les dispositions des articles 2 et 5 de cette loi :
– l’article 2 concerne l’obligation de prise en charge par l’organisme assureur des suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention d’assurance ou à l’adhésion audit contrat ou à ladite convention. Cette obligation est logiquement étendue aux bénéficiaires du mécanisme de portabilité.
– l’article 5 précise les obligations incombant à l’organisme assureur complémentaire en cas de résiliation ou de non renouvellement du contrat ou de la convention, en particulier le délai de préavis applicable en l’espèce, ainsi que les modalités et les conditions tarifaires d’un maintien de cette couverture à la demande des salariés concernés dès lors qu’ils en font la demande avant la fin du délai de préavis, le maintien de cette couverture ne pouvant impliquer de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux. Dans la mesure où les employeurs auront désormais l’obligation de couvrir collectivement tous leurs salariés en matière de santé, ces dispositions ne concerneront en réalité plus que les risques couverts au titre de la prévoyance. Toutefois, le mécanisme de la portabilité concernant autant le risque maladie que les autres risques, il est souhaitable qu’un ancien salarié puisse se voir proposer le maintien de la couverture prévoyance sans condition de période probatoire, d’examen ou de questionnaire médicaux, dans le cas où la résiliation du contrat « prévoyance » collectif se produirait pendant la période de portabilité.
Le 2° du III procède à l’articulation des dispositions de l’article 4 de la loi de 1989 avec le nouveau dispositif de portabilité : cet article régit la sortie des contrats complémentaires pour les anciens salariés, qu’il s’agisse de salariés licenciés, de salariés partant en retraite ou de bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité. Actuellement, dans ces cas de « sortie » des salariés de l’entreprise, il est prévu que le contrat ou la convention organisant la couverture complémentaire doit prévoir les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels le maintien de la couverture leur est garanti sans condition de durée, de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux. Or, ces conditions doivent être offertes au salarié sortant de l’entreprise sous réserve qu’il en fasse la demande dans les six mois suivant la rupture du contrat de travail.
À partir du moment où est mis en place un mécanisme de portabilité des droits pouvant conduire à étendre les garanties complémentaires santé et prévoyance jusqu’à un an après la rupture du contrat, il convient donc logiquement de permettre un déplacement d’un an du curseur, afin que les modalités d’une couverture ultérieure dans de nouvelles conditions (15) puissent bien s’appliquer à l’issue du dispositif de portabilité. Le 2° prévoit donc que la demande de maintien de la garantie dans de nouvelles conditions doit bien être adressée par le salarié dans les six mois suivant la rupture de son contrat de travail ou, le cas échéant, avant l’expiration de la période pendant laquelle il bénéficie de la portabilité de ses droits, soit au maximum un an.
Le VI de l’article prévoit l’entrée en vigueur différée du dispositif de portabilité des droits à la protection sociale complémentaire pour les demandeurs d’emploi prévu au nouvel article L. 911-8 : le 1° prévoit qu’il s’appliquera à compter du 1er juin 2014 s’agissant de la protection complémentaire « santé » ; le 2° fixe au 1er juin 2015 l’entrée en vigueur du mécanisme de portabilité s’agissant des garanties relatives à la prévoyance. Ce décalage dans le temps de l’application de la portabilité a été souhaitée par les partenaires sociaux, en particulier pour permettre d’en étaler le coût.
On peut néanmoins s’interroger sur la pertinence d’un tel décalage dans le temps de l’application de la portabilité des droits à la protection sociale complémentaire pour les anciens salariés : ainsi, un salarié licencié à l’été 2014 pourra-t-il bénéficier de la portabilité de ses droits en matière de complémentaire « santé », mais non pour la couverture des risques décès et incapacité de travail. Un tel hiatus pose question à votre rapporteur.
Le V du présent article pose enfin le principe d’une obligation de négociation des branches dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective obligatoire « prévoyance » au niveau de la branche ou de l’entreprise, avant l’échéance du 1er janvier 2016.
Les modifications restantes opérées par le texte, et prévues au IV de l’article ne concernent que des éléments de coordination :
– le 3° du IV complète l’article relatif au contenu des conventions de branche susceptibles d’être soumises à extension, en ajoutant après la mention des modalités d’accès à un régime de prévoyance maladie celle d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. On peut d’ailleurs s’interroger à cet égard sur la notion de régime, dont on peut douter qu’elle soit la plus appropriée dans ce cadre ;
– les 1° et 2° du IV concernent la négociation annuelle obligatoire en entreprise en matière de prévoyance maladie : l’intitulé « Régime de prévoyance maladie » est remplacé par l’intitulé « Protection sociale complémentaire des salariés », tandis qu’à l’article L. 2242-11, la négociation annuelle obligatoire portera désormais sur la protection prévoyance en général, en cas d’absence de couverture, et sur le volet complémentaire « santé », en cas d’absence d’une couverture aussi favorable que celle mise en place dans le cadre de la garantie minimale prévue à compter du 1er janvier 2016.
*
* *
Lors de son examen du projet de loi, votre commission a adopté les principales modifications suivantes au texte de l’article 1er :
S’agissant des accords de branches devant organiser la mise en place d’une couverture complémentaire santé collective au sein des entreprises de leur secteur, elle a, à l’initiative des commissaires du groupe socialiste, précisé que les conditions dans lesquelles les branches définissent les modalités de leur couverture complémentaire collective tiennent compte, outre de l’objectif de couverture effective de l’ensemble des salariés, de l’objectif d’accès universel à la santé. Elle a également souhaité rappeler, en adoptant deux amendements identiques de votre rapporteur et des commissaires du groupe UDI, que les cas de dispenses d’affiliation pouvant être prévus par accord de branche sont toujours définis à l’initiative du salarié, conformément aux règles qui s’appliquent aujourd’hui en la matière.
S’agissant de la mise en place de la couverture collective au niveau de l’entreprise, elle a, à l’initiative de votre rapporteur, précisé, au niveau de l’entreprise, que la couverture collective complémentaire peut également être aménagée par un projet d’accord du chef d’entreprise ratifié à la majorité des intéressés, comme le prévoit bien aujourd’hui l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Elle a en outre adopté un amendement du groupe socialiste prévoyant une information du salarié dans l’hypothèse où la complémentaire d’entreprise serait mise en œuvre par le biais d’une décision unilatérale de l’employeur.
S’agissant de la portabilité des garanties santé complémentaires à destination des anciens salariés, votre commission a souhaité, sur proposition des commissaires du groupe socialiste, assortir ce droit de l’obligation pour l’employeur de signaler le maintien de ces garanties dans le cadre du certificat de travail qu’il délivre au salarié au moment de l’expiration du contrat.
Concernant la procédure de mise en concurrence préalable à la désignation d’un ou de plusieurs organismes assureurs, votre commission a adopté, à l’initiative de MM. Vercamer et Richard, un amendement précisant que celle-ci s’opérait dans des conditions garantissant l’impartialité et l’égalité de traitement entre les candidats. Votre commission a en outre adopté un amendement de M. Tian et de Mme Boyer prévoyant que cette mise en concurrence serait également effectuée lors de chaque réexamen des modalités d’organisation de la mutualisation des risques.
Enfin, votre commission a, à l’initiative des commissaires du groupe socialiste, complété l’article de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 qui traite des modalités selon lesquelles les garanties complémentaires peuvent être maintenues pour les anciens salariés, en précisant que l’offre de maintien de la couverture est adressée dans le mois suivant la rupture du contrat de travail ou du décès de l’assuré s’il s’agit d’une assurance décès.
*
La Commission est saisie d’un amendement AS 129 de Mme Jacqueline Fraysse, tendant à la suppression de l’article.
Mme Jacqueline Fraysse. Chacun connaît l’attachement de notre groupe au système de protection sociale comme à la protection complémentaire. Cependant, la mesure prévue par l’article nous semble constituer une monnaie d’échange contre d’autres dispositions qui seraient d’authentiques reculs sociaux ; de surcroît, même si elle a été montée en épingle, elle ne concerne que la faible minorité de salariés qui ne bénéficient pas encore d’une couverture complémentaire. Elle serait enfin un recul au regard de la vocation universelle du régime de sécurité sociale de base.
Sur le fond, une telle mesure ne s’appliquera qu’au 1er janvier 2016, alors que d’autres dispositions du texte, graves pour les salariés, seront d’application immédiate. Cette mesure est par ailleurs soumise à un accord de branche, en l’absence duquel l’employeur pourra décider unilatéralement du choix de l’organisme de couverture complémentaire. Il est évident, dans ces conditions, que la couverture complémentaire se limitera au socle minimal de qualité prévu, lequel, je le rappelle, inclut seulement le forfait hospitalier et les soins dentaires – même les lunettes n’en font pas partie.
M. le rapporteur. Avis défavorable. L’article 1er constitue une sorte d’« Obamacare » pour les complémentaires, puisqu’il obligera toutes les entreprises à affilier leurs salariés à ces organismes. Le dispositif repose sur un juste équilibre : si le choix n’est pas fait par les branches, qui pourront désigner ou recommander un ou plusieurs organismes, il le sera par les entreprises. Cette avancée majeure, qui mobilisera les ressources publiques comme celles des entreprises – à hauteur d’environ 1 milliard d’euros –, permettra à quelque 400 000 salariés d’accéder à une couverture complémentaire et à 3,6 millions d’autres de bénéficier d’une mutuelle collective, laquelle les protégera mieux que leur mutuelle individuelle tout en étant trois fois moins coûteuse.
Si le délai d’application a été fixé au 1er janvier 2016, madame Fraysse, c’est parce que la loi laissera un an aux branches pour négocier un accord, avant, le cas échéant, que les entreprises ne prennent le relais. Il est donc impossible d’aller plus vite. J’ajoute que de ces négociations dépendront les mutuelles qui s’imposeront aux salariés : il faut donc qu’elles aient lieu dans de bonnes conditions. Le délai initialement prévu, en tout état de cause, était de deux ans plus tardif : il a été ramené au 1er janvier 2016 sur la demande pressante des syndicats.
M. Jean-Pierre Door. L’article 1er soulève quelques interrogations de notre part, mais l’amendement de Jacqueline Fraysse est motivé par le souci de supprimer les complémentaires santé, selon le refrain communiste bien connu. Je rappelle que près de 95 % des Français bénéficient d’une couverture complémentaire, via un contrat collectif ou individuel. Nous ne pouvons donc que nous opposer à cet amendement.
Mme la présidente Catherine Lemorton. S’agissant de la position de nos collègues communistes, monsieur Door, je parlerai non pas de « refrain », mais de convictions.
M. Francis Vercamer. Le groupe UDI s’oppose lui aussi à cet amendement, l’extension des complémentaires santé représentant à ses yeux une avancée sociale importante. Néanmoins, l’article 1er ne transcrit pas l’accord national interprofessionnel de manière fidèle ; aussi proposerons-nous de le faire à travers certains de nos amendements.
Notre second motif d’inquiétude tient à ce que ceux de nos compatriotes qui ont le plus besoin d’une couverture complémentaire – les demandeurs d’emploi et certains travailleurs non salariés, par exemple – ne sont pas concernés par la mesure.
M. Christian Paul. La généralisation des complémentaires santé, non seulement à tous les salariés mais à tous les Français, est une avancée à laquelle nous entendons œuvrer jusqu’à la fin de la présente législature ; elle correspond d’ailleurs à un engagement que le Président de la République a rappelé devant le congrès de la Mutualité française en octobre 2012. Le choix des organismes et le contenu des couvertures sont évidemment des conditions essentielles, mais un tel objectif engage aussi la reconquête, par le régime obligatoire, de domaines délaissés au cours des dernières années.
J’ajoute, madame Fraysse, que le groupe SRC proposera d’amender cet article afin que les protections complémentaires visées relèvent de la catégorie des contrats solidaires et responsables.
M. Denis Jacquat. Les parlementaires d’Alsace et de Moselle ont été très surpris que le régime de protection sociale spécifique à ces territoires soit ignoré lors des négociations de l’accord du 11 janvier. Ce régime inclut en effet une couverture complémentaire obligatoire, dont bénéficient tous les salariés et les ayants droit. Pourquoi ce point n’a-t-il pas été évoqué en son temps ? Qu’en est-il par ailleurs des ayants droit, qui ne sont pas tout à fait couverts par le dispositif prévu ?
M. André Chassaigne. Les militants du Front de gauche et notamment du parti communiste, qui pour certains d’entre eux se sont investis toute leur vie dans les activités mutuelles, seront heureux d’apprendre qu’ils sont opposés aux couvertures complémentaires santé ! En politique comme au théâtre, parfois, la mesure est dans la démesure…
Au-delà des effets d’annonce, la prise en charge minimale prévue n’atteindra même pas, rappelons-le, le niveau de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUc).
Par ailleurs, même si le projet de loi marque un progrès par rapport à l’accord du 11 janvier – qui constituait, aux dires de certains, le « bingo » pour les assureurs –, la mise en concurrence entre les prestataires, séduisante sur le papier, favorisera les assureurs privés par rapport au secteur mutualiste, porteur d’autres valeurs.
M. Gérard Cherpion. L’extension des complémentaires santé est un indéniable progrès social. Cependant, il ne s’agit en rien d’une généralisation puisque les chômeurs ou les retraités, par exemple, ne seront pas concernés.
Ma seconde réserve porte sur la méthode, qui a motivé le dépôt d’amendements de notre part.
M. Michel Liebgott. Je souscris aux propos de Denis Jacquat, que j’invite à s’associer à un amendement que je défendrai en séance avec d’autres collègues d’Alsace et de Moselle. Compte tenu de la complexité du problème, sur lequel il faudra sans doute revenir dans le cadre du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, il nous a en effet paru préférable de procéder en deux étapes : la première consiste à faire reconnaître, dans le présent texte, la spécificité du régime d’Alsace-Moselle – c’est là tout le sens, d’ailleurs, du travail d’amendement parlementaire. Cette spécificité, au demeurant, valide l’accord du 11 janvier lui-même, puisque le régime d’Alsace-Moselle inclut la couverture complémentaire, même s’il conviendra d’évaluer les avantages et les inconvénients des deux systèmes respectifs, s’agissant par exemple des retraités – non pris en compte par l’accord du 11 janvier – ou de la participation des employeurs.
M. Hervé Morin. Cette mesure représente environ 2 milliards d’euros de dépense fiscale : comment le Gouvernement entend-il la financer ?
M. Christophe Cavard. Le 1er janvier 2016 correspond à un délai maximal, si aucune convention de branche ou aucun accord professionnel n’a été signé jusqu’à cette date. On peut donc espérer que le dialogue social, dont chacun salue les vertus, permette de vraies avancées et s’impose dans la plupart des cas. Nos amendements tendent à faciliter cette solution.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Mon homologue de la commission des finances, Gilles Carrez, m’a interrogée sur le coût de la mesure. J’ai donc saisi M. Sapin, M. Moscovici et Mme Touraine de cette question. Le ministère de l’économie et des finances et celui du budget m’ont adressé ce matin la réponse suivante :
« L’étude d’impact du projet de loi a estimé la perte de recettes entre 1,5 et 2,1 milliards d’euros à terme pour l’ensemble des administrations publiques.
« Cet effet est bien intégré dans les prévisions de recettes réalisées en vue du programme de stabilité et il le sera également dans l’ensemble des prévisions de recettes ultérieures.
« J’attire toutefois votre attention sur le fait que le chiffre indiqué par l’étude d’impact désigne une perte de recettes à terme. Or cette perte de recettes montera graduellement en charge, à mesure d’une part que la couverture complémentaire se généralisera conformément au calendrier prévu par le projet de loi, et d’autre part que la participation de l’employeur à la complémentaire se substituera à d’autres éléments de rémunération. Pour ces raisons, l’effet à terme de ces dispositions ne sera pas atteint intégralement en 2017.
« Concernant la compensation de cette perte de recettes à la sécurité sociale, l’analyse du Gouvernement est que ces dispositions ne relèvent pas du champ de l’obligation organique de compensation à la sécurité sociale des mesures dérogatoires définie par l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.
« En effet, [cet article] confie aux lois de financement de la sécurité sociale le monopole des créations ou modifications des mesures de réduction ou d’exonération. Les dispositions de l’article 1er n’ont pour effet ni de créer une mesure de réduction ou d’exonération puisque la participation de l’employeur est déjà exemptée, ni de modifier cette mesure car le régime social de ces sommes est inchangé. L’article 1er conduit les employeurs à davantage recourir à une mesure qui existe déjà et dont le régime est inchangé : on ne peut donc considérer qu’il relève du champ de l’article LO 111-3.
« Si elles ne donnent pas lieu à une compensation ainsi comprise, ces dispositions s’insèrent toutefois dans une trajectoire de finances publiques contrainte dont elles ne remettent pas en cause les objectifs de réduction des déficits et de niveau des prélèvements obligatoires. Les mesures qui seront adoptées pour assurer le respect de cette trajectoire tiendront donc compte de l’effet de ces dispositions sur les finances publiques. »
M. le rapporteur. Même si le Parlement reste souverain, j’ai eu pour principe de consulter les partenaires sociaux sur chacun de mes amendements. Ce principe vaut pour l’amendement dont Michel Liebgott a parlé ; aussi l’ai-je invité à le retirer à ce stade, pour le redéposer en séance.
L’un des débats soulevés lors des auditions est l’impact de la disposition dont nous parlons sur le marché de l’assurance. Le changement induit est important, puisque 4 millions de contrats individuels deviendront, d’une manière ou d’une autre, des contrats collectifs. Le secteur mutualiste, les instituts de prévoyance et certains grands groupes d’assurance sont mieux à même de répondre à cette demande.
En revanche, les représentants des mutuelles ont considéré que l’impact sera plutôt neutre sur leurs activités. Outre que ces organismes sont à même de se positionner s’agissant des contrats de branche, ils disposent d’opportunités en dehors de tels accords.
Un problème se pose, certes, mais pour les courtiers d’assurances, lesquels sont surtout inquiets de perdre une partie d’un marché potentiel de 4 millions de contrats supplémentaires.
Sur 52 branches couvertes, 44 le sont par des instituts de prévoyance, 7 par des mutuelles et une – une demie, même – par des contrats d’assurances. Les sociétés d’assurance réassurant en général ces contrats-là, un marché s’ouvre également devant elles. Dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants, le groupe ACCOR, qui a pour actionnaire AXA, avait choisi ce dernier en tant qu’assureur complémentaire santé, lequel a accepté de rentrer dans une mutuelle de branche qui sera désormais prise en charge par KLESIA, AXA réassurant KLESIA.
Il serait absurde de nier que l’impact de la réforme sera important sur le marché de l’assurance. Quoi qu’il en soit, je soutiens l’objectif visant à laisser les différentes branches opérer autant de mutualisations que possible. Si tel n’est pas le cas, les salariés des TPE et des PME devront attendre des lustres avant de bénéficier de couvertures dignes de ce nom.
Ce qui est en train de se mettre en place, finalement, est un peu comparable à ce qui s’est passé en matière de retraites complémentaires avec des couvertures de branches puis une mutualisation entre les branches. Je souhaite qu’il en soit également ainsi, à long terme, pour le système de complémentaires santé.
Christian Paul l’a rappelé : notre objectif et celui du Président de la République est de faire en sorte que toute la population soit couverte par une complémentaire santé. Sans la négociation sociale qui a eu lieu, nous n’aurions sans doute pas pris le problème de cette façon, mais nous n’aurions pas non plus obtenu une participation des employeurs à hauteur de 1 milliard d’euros.
Il est important de parvenir à couvrir les 4 millions de personnes qui ne le sont pas et, à cette fin, de mobiliser les moyens publics. Il conviendra également de faire en sorte que les mutuelles coûtent moins cher en favorisant les salariés les plus modestes puisque les coûts sont fixes et non proportionnels aux salaires.
Enfin, il est faux de prétendre que les chômeurs ne seront pas concernés puisqu’ils bénéficieront de la portabilité, laquelle passe d’ailleurs de neuf à douze mois. Je proposerai de surcroît un amendement visant à ce que celle-ci ne soit pas limitée aux seuls chômeurs indemnisés. Selon les estimations, son coût représente 18 % du système de mutualisation du financement.
M. Gérard Bapt. Madame la présidente, pourriez-vous nous communiquer la lettre que vous avez reçue aujourd’hui concernant l’impact financier de ces mesures ? En tant que rapporteur sur l’équilibre des comptes, j’ai cru comprendre que les conditions fiscales et sociales des contrats collectifs ne changeraient pas et que la charge supplémentaire de 1,5 à 2 milliards dans les deux ou trois prochaines années serait en quelque sorte compensée par d’autres mesures dont je ne sais si elles consisteront en prélèvements ou en recettes.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Je me suis inquiétée, ce matin, de ne pas avoir reçu de réponse puisque je me doutais que je serais interpellée à propos de la lettre du président de la Commission des finances. J’ai finalement reçu le mail que je vous ai lu. Son contenu figurera dans le compte rendu de cette réunion.
M. Hervé Morin. Cette réponse est absconse. Nous ne savons pas si l’équilibre des comptes sera maintenu puisque nous ignorons, comme l’a dit Gérard Bapt, s’il sera procédé à des prélèvements supplémentaires ou à des économies. Dans ce dernier cas, quels secteurs seront concernés ?
En outre, qui financera la portabilité de la complémentaire santé ? Le régime d’assurance chômage, la dernière entreprise dans laquelle le salarié a travaillé, les allocations chômage ? Nous avons besoin de le savoir.
M. Dominique Tian. Le passage de la portabilité de neuf à douze mois induisant de surcroît un coût supplémentaire, je suppose que ce sera l’assurance chômage qui paiera.
M. le rapporteur. La portabilité des droits sera assurée soit par les entreprises dans un cadre mutualisé à travers la cotisation instaurée par l’accord de branche, soit par la dernière entreprise employeuse. Des questions très concrètes se posent d’ailleurs en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, mais nous aurons l’occasion d’en débattre plus tard.
J’ajoute que les mutuelles imposent des conditions d’ancienneté afin d’éviter que les contrats courts ne rentrent automatiquement dans le dispositif.
S’agissant des finances publiques, le ministre a été très clair. Ces coûts sont inclus dans les prévisions des comptes sociaux où figurent les objectifs de recettes et de dépenses pour l’assurance maladie ainsi que les objectifs de recettes fiscales pour l’État.
De plus, ces dépenses ont été incluses dans la précédente programmation notifiée à Bruxelles et elles le seront dans la suivante.
La notification de nos comptes publics à la Commission européenne, en revanche, ne comprend jamais, vous le savez bien, aucun détail sur la ventilation des dépenses et des pertes de recettes par types de recettes.
M. Céleste Lett. Suite aux propos de Michel Liebgott et Denis Jacquat sur le régime en vigueur en Alsace-Moselle, je rappelle que les parlementaires alsaciens et mosellans se sont rencontrés et ont souhaité déposer un amendement dont j’ai émis l’idée qu’il soit repris par le Gouvernement. Alors que certaines déclarations ont un peu inquiété les Alsaciens-Mosellans, cela constituerait un signe fort.
Mme la présidente Catherine Lemorton. J’ai bien entendu le souci des parlementaires de l’opposition et de M. le rapporteur Gérard Bapt. Dès que la lettre me sera officiellement envoyée, je la mettrai à votre disposition.
La Commission rejette l’amendement AS 129.
Elle examine ensuite les amendements AS 206 et AS 207 de M. Christophe Cavard pouvant faire l’objet d’une présentation commune.
M. Christophe Cavard. Il importe de tenir compte de ce public très spécifique que sont les stagiaires. Nous avons entendu leurs représentants mais, également, le ministre, lequel nous a expliqué qu’il tenait à travailler à l’amélioration des contrats et, en particulier des plus courts d’entre eux.
L’employeur ne doit donc pas pouvoir se dédouaner de ses obligations vis-à-vis non seulement des salariés, mais aussi des stagiaires. Nous voulons éviter que les stagiaires deviennent une solution de repli pour les employeurs. Nous souhaitons donc que ces derniers soient pris en compte soit par le biais de dispositifs propres à l’entreprise, soit par un complément qui pourrait leur être délivré dans le cadre de leur mutuelle étudiante.
J’ajoute qu’en raison de leur statut, les stagiaires ont une couverture santé qui n’est pas toujours optimale.
M. le rapporteur. La question des stages est en effet fondamentale, l’accord du 11 janvier visant d’ailleurs à réduire la proportion des emplois ou des situations précaires.
La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche travaillant à un texte destiné notamment à traiter les problèmes soulevés par les stages et dans lequel il sera également question des mutuelles étudiantes, cela relèverait un peu du « bricolage » que de nous saisir d’ores et déjà de ce sujet.
Sans doute conviendrait-il de mettre un peu d’ordre dans des formations de troisième cycle un peu factices servant de support à des stages que les entreprises jugent favorablement parce qu’ils sont adossés à une formation. De telles formations ne devraient pas être habilitées par l’État.
En outre, ces très longs stages, quasiment post-scolaires, se substituent aux stages courts dont les étudiants ont besoin. Nous avons tous rencontré des jeunes en L1, L2, L3 ou M1, qui n’arrivent pas à trouver de stages pourtant indispensables à la validation de leur formation. Nous devons donc encadrer ou interdire les stages post-scolaires et favoriser les stages plus brefs, utiles dans les cursus scolaires pour découvrir le monde de l’entreprise.
Avis défavorable.
M. Christophe Cavard. L’amendement AS 207 a le même objectif, mais il concerne les apprentis.
M. Dominique Dord. Je partage partiellement le point de vue du rapporteur, mais je n’ai pas l’impression que la question des stages ait été incluse dans le champ de la réflexion des partenaires sociaux.
En outre, les conséquences fiscales de la réforme constituent déjà un important défi.
Enfin, si l’on tient à ce que les entreprises ne proposent plus de stages aux jeunes étudiants qui éprouvent déjà bien des difficultés à en trouver, agissons ainsi !
Cet amendement ne doit donc pas être adopté.
M. Élie Aboud. Humainement, il n’est pas possible de s’opposer à cet amendement et nous ne pouvons qu’être sensibles à son objectif. Néanmoins, ne freinerait-il pas, in fine, le recrutement des stagiaires ?
J’ignore quel est le pourcentage des étudiants qui, aujourd’hui, ne disposent pas d’une mutuelle santé.
Enfin, tous les stagiaires ont-ils le statut d’étudiant ?
Mme la présidente Catherine Lemorton. Ce sont 23 % à 25 % des étudiants qui ne disposent pas d’une mutuelle.
M. Élie Aboud. Une véritable réflexion sur la santé dans le monde estudiantin s’impose donc.
M. le rapporteur. Les apprentis étant salariés, ils seront éligibles à la complémentaire santé obligatoire. L’amendement AS 207 est donc satisfait.
J’ajoute que 2 % des salariés ne sont pas couverts. Si le problème de l’accès aux mutuelles est bien réel, ce que vous proposez n’est pas la bonne façon de le résoudre.
Les partenaires sociaux n’ont pas inclus la question des stages dans les négociations, considérant qu’elle concerne aussi bien le monde du travail que celui de l’enseignement supérieur.
Soit la taxation des CDD favorise les CDI, soit elle accroît la précarité à travers la multiplication des stages. Nous pourrions travailler sur ce problème mais il est complexe ; des solutions législatives ont d’ailleurs été proposées sans qu’elles aient pour autant fait l’objet de décrets d’application. Il convient donc de reprendre cette question dans sa globalité et c’est précisément ce qu’a fait la ministre de l’enseignement supérieur en présentant récemment quinze mesures visant à lutter contre les stages abusifs.
M. Christophe Cavard. Nous aussi nous sommes sur le terrain et nous constatons que si certaines entreprises jouent le jeu des stages, d’autres sont tentées par les effets d’aubaine. Mon amendement visait à soulever le problème. À l’instar des organismes représentant les stagiaires, nous serons attentifs à ce que fera le Gouvernement à cet égard.
Je retire l’amendement AS 207.
L’amendement AS 207 est retiré.
La Commission rejette l’amendement AS 206.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS 370 du rapporteur.
La Commission examine l’amendement AS 3 de M. Jean-Charles Taugourdeau.
M. Jean-Charles Taugourdeau. Les modalités de choix de l’assureur doivent s’effectuer, dans le respect du dialogue social, au niveau de chaque entreprise. Tel est l’objet de cet amendement.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la possibilité d’une clause de désignation au niveau des branches et je ne peux qu’y être défavorable.
Le texte préserve la liberté : clause de désignation, recommandation ou liberté de choix au niveau des branches. Il s’agit là d’un bon équilibre.
La Commission rejette l’amendement AS 3.
L’amendement AS 4 de M. Guillaume Larrivé n’est pas défendu.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 101 de M. Gérard Cherpion.
M. Jean-Pierre Door. La clause de désignation avait disparu de l’accord du 11 janvier avant que d’être réintroduite – on se doute par qui – afin d’imposer un processus monopolistique, car elle favorise plutôt certains groupes assurantiels et, en particulier, les instituts de prévoyance, au détriment des groupes mutualistes et des assurances privées.
La puissance juridique de cette clause représente un risque majeur : le déclin pur et simple, irréversible, du mouvement mutualiste. Les assurances privées, quant à elles, peuvent perdre de 15 000 à 30 000 emplois comme de nombreux courtiers nous l’ont fait savoir.
J’ai saisi à ce propos Michel Sapin et j’ai relu la fabuleuse réponse qu’il m’a faite en se livrant à un véritable gymkhana : « Oui, peut-être bien, c’est vrai… On a mis la clause, on l’a retirée, on l’a remise mais peut-être que l’on ne la mettra pas, peut-être que chacun sera libre… ».
Lors des auditions, les représentants de syndicats de salariés ont tous considéré que cette clause était inutile à l’exception d’un seul… qui est un peu juge et partie, ce qui ressemble fort à un conflit d’intérêts.
Parce que la liberté de choix de l’entreprise nous semble essentielle, nous demandons la suppression de l’alinéa 4 de l’article 1er. La position du groupe UMP sur ce texte dépendra en grande partie de ce que deviendra cette clause de désignation qui a été subrepticement introduite dans le projet de loi où elle n’a rien à y faire.
M. Bernard Perrut. Alors que l’on évoque souvent la protection des consommateurs et des salariés et que l’on considère la libre concurrence comme bénéfique à la recherche de la meilleure garantie et du meilleur prix, je me pose une question : pourquoi ériger en principe l’absence de concurrence en favorisant les monopoles de fait ?
Ce sont 2 500 à 3 000 emplois qui sont directement menacés. Cette clause de désignation constitue une forme de déni et de dénaturation du principe même de l’assurance puisque la mutualisation est bien plus large, et donc bien plus protectrice, tant dans le cadre de contrats individuels que dans celui, plus restreint, d’un accord de branche.
L’exclusion des populations les moins favorisées comme les retraités, les chômeurs de longue durée ou les jeunes sans emploi ne peut nous laisser indifférents.
Il s’agit aussi d’une atteinte à la liberté contractuelle d’autant moins justifiée qu’il n’a jamais été prouvé que les clauses de désignation permettent d’organiser une couverture des salariés plus satisfaisante que les autres systèmes.
La consécration d’organisations nationales le plus souvent parisiennes et, en tout cas, très éloignées des réalités des entreprises au sein de nos territoires, ne va pas forcément rapprocher ces dernières et leurs salariés de ces grandes structures.
Enfin, il existe un risque d’opacité et de moindre responsabilisation dès lors que les accords sont signés loin des entreprises.
Je souhaite le retrait de la clause de désignation ainsi qu’une information complète des décideurs économiques et politiques sur la non-pertinence économique et sociale de tels mécanismes.
En revanche, un mécanisme à deux étages pourrait éventuellement être envisagé avec un accord de branche fixant l’objectif de protection à mettre en œuvre au niveau de chaque entreprise, chacune choisissant ensuite les règles de la négociation collective en vigueur ainsi que l’organisme assureur qui serait le plus apte à protéger les salariés et qui serait le plus proche d’eux.
Mme Fanélie Carrey-Conte. Je m’étonne de voir aujourd’hui Jean-Pierre Door défendre ainsi le mouvement mutualiste à l’égard duquel il se montrait si dur et critique, il n’y a pas si longtemps que cela, lors de l’examen de la proposition de loi sur les réseaux de soins !
Bien des choses ont été dites sur ces clauses de désignation qui suscitent des craintes, certes, mais aussi des approbations autour de deux arguments principaux : la question de l’égalité entre salariés au niveau de la branche et la volonté de ne pas laisser les TPE et les PME négocier seules face aux organismes complémentaires.
Le texte reprend ce qui existe aujourd’hui : ni systématisation ni obligation, mais possibilité de clauses de désignation ou de clauses de recommandation d’un ou de plusieurs organismes, voire, liberté entière au niveau de la branche.
En outre, dans le cadre de clauses de désignation existantes, plusieurs organismes complémentaires ont pu être désignés. Ce qui compte c’est donc non pas d’être ou non favorable à de telles clauses, mais de s’intéresser aux conditions des appels d’offres, de veiller à en renforcer la transparence ainsi qu’à la possibilité, pour les petites mutuelles, d’y répondre.
En l’occurrence, le texte est équilibré et l’essentiel du débat sur l’article 1er doit porter sur l’accès aux complémentaires santé pour l’ensemble de nos concitoyens.
M. Dominique Tian. Cette clause de désignation est également source de fragilité juridique dans la mesure où elle n’était pas prévue dans l’accord. C’est le ministre du travail qui l’a réintroduite de façon autoritaire, si bien que le MEDEF a indiqué il y a quelques jours qu’il n’aurait pas signé l’accord dans ces conditions.
La disposition n’est pas le fruit de la négociation et cela pose un vrai problème politique : l’accord du 11 janvier n’est plus viable puisqu’une des principales organisations signataires ne se reconnaît pas dans ce projet de loi.
Il faut donc revenir sur cet alinéa, dont le contenu est de toute façon néfaste aux entreprises et à l’ensemble du mouvement mutualiste.
M. Christophe Cavard. C’est au contraire une avancée importante par rapport à l’accord. Dans la séquence parlementaire du débat, nous devons nous engager pour toutes les parties concernées. C’est pourquoi nous sommes attentifs à écouter tout le monde. Au demeurant, aucun choix n’est imposé : seule une possibilité est ajoutée. C’est la négociation qui déterminera quel est le dispositif adopté.
À Dominique Tian, qui semble se faire le porte-parole de certains, je rappelle qu’il s’agit d’un débat politique. On sait que les assurances privées ont poussé le MEDEF à maintenir sa position en matière de complémentaire santé. Je trouve normal, pour ma part, que l’on ouvre les possibilités. Les assurances privées n’ont pas à dicter la façon dont on doit effectuer ces choix.
Le débat se poursuivra bien entendu dans l’hémicycle : c’est pour cela qu’il y a une opposition et une majorité !
M. Dominique Dord. Nos collègues de la majorité ne prennent pas le sujet par le bon bout. Ce n’est nullement une question d’idéologie, et je vois mal en quoi cette modalité technique voulue par certains constituerait une avancée.
Ma ligne de conduite sera constante tout au long du débat : nous devons nous efforcer de rester au plus près de l’accord du 11 janvier. Dès lors que l’on déroge à ce principe, on fragilise l’adoption du texte par l’Assemblée nationale. C’est particulièrement dommage s’agissant d’une mesure somme toute technique dans laquelle le MEDEF a indiqué qu’il ne se reconnaissait pas.
En outre, l’alinéa met sur le même plan les différentes options. On aurait pu au moins donner la priorité à la liberté de choix, en faisant venir ensuite la recommandation, puis, à défaut, la désignation.
Enfin, l’étude d’impact ne fait pas la moindre référence au risque que cette clause fait courir aux différents métiers. Notre objectif n’est quand même pas de fragiliser 20 000 à 30 000 emplois dans le secteur de l’assurance !
M. Francis Vercamer. Tout l’accord, rien que l’accord, professe le Gouvernement. Or il y est écrit que « les partenaires sociaux de la branche laisseront aux entreprises la liberté de retenir le ou les organismes de leur choix ». Le projet de loi, lui, renvoie les modalités de ce choix à la négociation de branche. Il y a donc bien une clause de désignation, là où l’accord n’introduit qu’une clause de recommandation en précisant que « toutefois, ils pourront, s’ils le souhaitent, recommander aux entreprises de s’adresser à un ou plusieurs organismes assureurs ou institutions ».
C’est pourquoi mon amendement AS 49 propose une réécriture de l’alinéa 4 conforme à l’accord du 11 janvier.
Le Premier ministre a souhaité tout à l’heure, lors des questions d’actualité, que l’on ne modifie pas un accord qu’il juge équilibré. Revenons-en donc à son texte, cela arrangera tout le monde !
Mme la présidente Catherine Lemorton. Le Premier ministre est trop respectueux des prérogatives du Parlement pour lui imposer quoi que ce soit.
M. Gérard Cherpion. Alors que l’accord du 11 janvier ne comporte aucune clause de désignation, le projet de loi renvoie à la négociation les « modalités de choix de l’assureur ». L’exposé des motifs mentionne d’ailleurs explicitement le cas « où une branche choisirait d’identifier un ou plusieurs organismes, sous la forme d’une désignation s’imposant à ses entreprises ».
Pourquoi cet ajout alors que le texte de l’accord du 11 janvier se suffisait à lui-même ? De toute façon, à défaut d’accord de branche signé avant le 1er juillet 2014, les entreprises pourront négocier elles-mêmes à ce sujet.
M. Jean-Charles Taugourdeau. Il est louable de vouloir défendre les salariés des petites entreprises, mais en l’espèce vous êtes dans l’illusion. Les organismes de prévoyance étaient 80 en 2001, ils sont 47 aujourd’hui et dans cinq ans il n’y en aura plus que 10. Quelle latitude cela laissera-t-il aux petites filières pour négocier les tarifs ?
M. Jean-Pierre Door. Si le droit au contrat collectif constitue un réel progrès, il ne doit pas être soumis à un monopole. Le rapporteur ne peut nier qu’une clause de désignation est possible puisque l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale en fait mention.
Je vous renvoie aux propos de M. Étienne Caniard, président de la Mutualité française : « Nous regrettons le fait que la traduction législative ne soit pas le reflet exact du texte qui a été signé par les partenaires sociaux. » La clause que le texte réintroduit n’est pas bonne pour l’avenir du mouvement mutualiste, que je défends également. Le monopole du choix des assureurs est une erreur fondamentale. Si cet amendement était repoussé, il nous serait difficile de soutenir l’ensemble du projet de loi.
M. Gérard Sébaoun. Pour avoir assisté à l’audition des représentants de l’UPA et du MEDEF, je sais bien qu’il y a deux discours. Le MEDEF, par le biais de la Fédération française des sociétés d’assurance, a manifestement arraché cette signature, tandis que le président de l’UPA a clairement indiqué qu’il était favorable aux clauses de désignation. Il n’y a donc pas que la CGT !
Le texte du Gouvernement vise à rétablir un équilibre qui n’était plus dans l’accord du 11 janvier après que le MEDEF eut tordu le bras de l’UPA au moment de la signature. C’est pourquoi j’invite mes collègues à repousser l’amendement.
M. Olivier Faure. Mes collègues de l’UMP devraient relire l’accord. Les parties signataires ont en effet décidé de constituer un groupe de travail paritaire dont l’objet sera « de définir, dans un délai de trois mois, les conditions et les modalités d’une procédure transparente de mise en concurrence, tant lors de la mise en place de la couverture “remboursements complémentaires frais de santé” que lors du réexamen périodique du ou des organismes assureurs désignés ou recommandés ».
M. Francis Vercamer. Ce n’est pas l’accord !
M. Olivier Faure. Voyez la note au bas de la page 1. Si vous voulez respecter l’accord, lisez-le jusqu’au bout !
M. le rapporteur. S’agissant du prétendu mauvais coup porté au secteur mutualiste, le président de la Mutualité française a affirmé à notre Commission que l’impact de l’accord ne serait ni positif ni négatif : le secteur mutualiste est capable de répondre aussi bien à des clauses de désignation ou de recommandation qu’à des entreprises individuellement.
Les interrogations de M. Caniard portent plutôt sur la prise en compte du modèle régional de la mutualité. Selon lui, il faudrait pouvoir adapter le panier de soins suivant les régions. Une prise en charge à 150 % pour dépassements d’honoraires peut se justifier en région parisienne, mais elle risque d’avoir des effets inflationnistes dans les régions où la moyenne des dépassements n’est que de 120 %.
Sur le fond, nous pensons que le niveau le plus élevé est le plus favorable à la mutualisation. Il s’agit bien d’une différence d’appréciation politique, monsieur Door. Si l’assurance est passée entreprise par entreprise, on aboutira à des disparités de tarifs, donc à une inégalité dans l’accès à un droit essentiel.
Nous souhaitons nous aussi la mise en concurrence des organismes. Le groupe SRC déposera d’ailleurs des amendements en ce sens. Mais il considère qu’une branche est à même de gérer paritairement la complémentaire santé qui lui est applicable. Ce modèle ne nous gêne pas, même dans le cas où l’on adopterait un système de même type que celui de l’assurance chômage.
Pour ce qui est de l’accord, il faut reconnaître qu’il dit tout et son contraire. Dans une première phrase, il affirme la liberté de choix ; dans une deuxième il ouvre la possibilité d’une recommandation et, dans une troisième, il est énoncé que « les accords de branche pourront définir, quels que soient les organismes éventuellement recommandés, les contributions dédiées au financement de l’objectif de solidarité, notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs ».
Il ne vous a pas échappé que, la veille de la conclusion de l’accord, deux des trois organisations patronales signataires ont provoqué un clash sur la question et ont obtenu une modification de l’obligation faite par l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale d’assurer toutes les entreprises en cas de mutualisation et de prévoir une clause de désignation à cet effet. La vérité est que les organisations patronales n’ont pas réussi s’entendre sur ce point.
M. Francis Vercamer. Elles ont pourtant signé l’accord !
M. le rapporteur. Oui, mais elles ont signé trois phrases contradictoires entre elles. Le ministre, pour sa part, a fait un choix clair, et nous souhaitons comme lui qu’il y ait, autant que possible, des organismes uniques au niveau des branches afin de permettre une meilleure mutualisation. Pour une petite entreprise ayant trois salariés de plus de 55 ans, le coût d’affiliation serait le double de celui de la même entreprise ayant trois jeunes salariés. Le dispositif proposé vise à assurer une égalité dans l’accès et à permettre des actions de prévention.
Enfin, je n’accepte pas que l’on parle de conflit d’intérêts au sujet de l’UPA. Vous savez bien qu’il n’est pas réaliste de laisser les petites entreprises se débrouiller seules pour trouver une complémentaire. Tous les secteurs comprenant des petites entreprises auront besoin, au moins en partie, de l’accès à la mutualisation. C’est un enjeu essentiel pour l’égalité des droits entre salariés des petites entreprises et salariés des grandes entreprises, et c’est pour cette raison que l’UPA défend la possibilité de clauses de désignation. Évitez de caricaturer ce choix ! Les instituts de prévoyance sont aussi respectables que les autres structures.
Que l’UMP conditionne son vote du projet de loi à cet élément relève de sa responsabilité. Pour notre part, nous sommes convaincus que nous œuvrons à l’intérêt collectif en procédant ainsi.
Avis défavorable.
M. Jean-Pierre Door. Si j’ai parlé de conflit d’intérêts, c’est que le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie a inscrit auprès de tous les boulangers de France un institut de prévoyance alors qu’il est membre du conseil d’administration dudit institut. On ne peut être juge et partie !
M. le rapporteur. C’est méconnaître le fait que les instituts de prévoyance sont des structures gérées par les partenaires sociaux de la branche. Est-il interdit à un maire d’accorder des subventions à un centre social au motif qu’il siège à son conseil d’administration ?
En outre, nous renforcerons par voie d’amendement les règles de transparence auxquelles ces organismes sont soumis. Celles-ci prévoient notamment que les choix sont faits par des personnalités indépendantes des dirigeants de la branche.
La Commission rejette l’amendement AS 101.
Elle en vient à l’amendement AS 49 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. Les propos du rapporteur ne sont pas tout à fait conformes aux conclusions de la commission d’enquête Perruchot, dont j’étais membre et dont le rapport n’a malheureusement pas été publié.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AS 49.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement AS 32 de M. Dominique Tian.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS 371 du rapporteur.
La Commission est saisie de l’amendement AS 242 de M. Philippe Noguès.
M. Philippe Noguès. Cet amendement de précision vise à rappeler aux négociateurs l’objectif majeur que constitue l’accès universel à la santé, la couverture de tous les salariés par une mutuelle n’étant qu’un moyen d’y parvenir.
M. le rapporteur. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement AS 242.
Elle examine ensuite, en présentation commune, les amendements AS 33 à AS 36 de M. Dominique Tian.
M. Dominique Tian. Les « améliorations » de la majorité, selon l’aveu de Christophe Cavard, nous éloignent de plus en plus de ce que l’exposé des motifs appelle pourtant « l’accord qui inspire la présente loi ».
Le rapporteur va plus loin quand il affirme que l’accord est mal écrit.
M. le rapporteur. Je n’ai pas dit cela !
M. Dominique Tian. Il indique de plus que le groupe SRC introduira ultérieurement des amendements. Doit-on entendre qu’il le fera lors de la réunion qui se tiendra en application de l’article 88 du règlement ? À quoi sert-il que la Commission siège maintenant si elle ne connaît pas la teneur de ces amendements sortis à la dernière minute ? Notre débat est tronqué !
Mme la présidente Catherine Lemorton. Votre remarque n’est pas recevable. Dans tout examen en commission, une deuxième salve de dépôts d’amendements est prévue avant la séance publique.
M. le rapporteur. Pour certains amendements que j’indiquerai au fil de l’eau, j’ai souhaité consulter les partenaires sociaux avant de les soumettre à la Commission – en tout état de cause avant la fin de la semaine.
M. Dominique Tian. C’est très discourtois à l’égard des membres de la Commission et de très mauvaise méthode. Dites-nous au moins de quoi traitent ces amendements et quelles modifications ils apportent au texte.
M. Christian Paul. La vraie politesse est celle du règlement de l’Assemblée nationale, monsieur Tian. Un texte de cette importance exige bien évidemment des allers et retours et des consultations avec les partenaires sociaux et le Gouvernement. Certains amendements sont prêts pour l’examen en Commission aujourd’hui, d’autres le seront pour la réunion prévue à l’article 88. Le député expérimenté que vous êtes sait parfaitement que tous les gouvernements et toutes les majorités procèdent ainsi. Si vous voulez renoncer à utiliser l’article 88, libre à vous, mais nous entendons pour notre part que le règlement soit appliqué.
M. le rapporteur. Avis défavorable sur les quatre amendements. Nous souhaitons que le système soit mutualisé au maximum. La migration vers l’organisme désigné doit donc faire partie du dispositif d’ensemble.
La Commission rejette successivement les amendements AS 33 à AS 36.
Elle en vient aux amendements identiques AS 292 du rapporteur et AS 53 de M. Francis Vercamer.
M. le rapporteur. Il s’agit de préciser que les cas de dispense d’affiliation ne pourront être prévus qu’à l’initiative du salarié.
M. Francis Vercamer. J’ai présenté le même amendement.
La Commission adopte les amendements AS 292 et AS 53.
Puis elle examine l’amendement AS 52 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. Le contenu minimal des accords collectifs doit être précisé en ce qui concerne les cas de dispense d’affiliation qui devrait être possible en raison des caractéristiques du contrat de travail, ou bien au bénéfice acquis d’une couverture maladie complémentaire plus avantageuse.
M. le rapporteur. Défavorable. Les dispenses d’affiliation seront prévues par voie réglementaire.
La Commission rejette l’amendement AS 52.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS 372 et AS 373 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AS 293 du rapporteur.
M. le rapporteur. L’entreprise n’est tenue de négocier que si elle n’est couverte ni par un accord de branche ou d’entreprise, ni par une décision unilatérale de l’employeur, ni par un projet d’accord ratifié à la majorité des intéressés, qui constitue aujourd’hui la troisième voie possible pour organiser la couverture complémentaire des salariés en entreprise, prévue explicitement par l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
À défaut de cette précision, une entreprise déjà couverte par ce biais dans le cadre d’un contrat offrant des garanties supérieures à la couverture minimale devrait néanmoins engager une nouvelle négociation sur ce thème.
La Commission adopte l’amendement AS 293.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS 374 du rapporteur.
Puis elle est saisie de l’amendement AS 208 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Nous avons déjà débattu de notre souhait de voir les stagiaires cités dans cet article ; je n’y reviens pas.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AS 208.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS 375 du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement AS 243 de M. Michel Lefait.
M. Gérard Sébaoun. Les salariés concernés doivent être informés du dispositif relatif à la couverture minimale prévu à l’article L. 911.7 du code de la sécurité sociale.
M. Dominique Tian. Cette précision est inutile : les salariés sont informés puisqu’il y a des négociations. Je trouve presque humiliant pour ces derniers que l’on veuille ainsi leur tenir la main.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Peut-être certains employeurs ne donnent-ils pas clairement toutes les informations !
M. le rapporteur. Favorable. Monsieur Tian, nous ne devons pas vivre dans le même monde. Vous devriez retourner dans une entreprise voir si les salariés sont informés de tous leurs droits.
La Commission adopte l’amendement AS 243.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS 376 et AS 377 du rapporteur.
La Commission examine ensuite l’amendement AS 47 de Mme Bérengère Poletti.
M. Dominique Tian. Cet amendement vise à préciser que, pour les salariés du secteur des services à la personne accomplissant moins de vingt-quatre heures de travail par semaine, le financement par l’employeur sera établi sur une base horaire. Un décret déterminera les modalités de calcul.
M. le rapporteur. Défavorable. Il y a bien un problème avec les salariés ayant plusieurs employeurs, mais l’amendement reste muet sur la couverture à laquelle ils auraient accès et sur la participation respective de ces divers employeurs.
Pour ma part, j’avais pensé que le salarié pourrait choisir l’organisme complémentaire de son choix parmi ceux auxquels ses employeurs lui donnent accès – ces derniers contribuant tous. Le Gouvernement semble plutôt favorable à une mutualisation : chaque employeur prendrait en charge son salarié, ce qui peut poser un problème aux petits employeurs. Aucune solution n’étant satisfaisante, il faut travailler sur le sujet afin d’éviter que les salariés n’adhèrent pas à la complémentaire obligatoire parce qu’elle serait trop coûteuse au regard de leur salaire. Je vous suggère de retirer votre amendement afin que nous puissions résoudre ce problème dans les meilleurs délais.
M. Gérard Cherpion. Les salariés en question risquent de passer au travers des mailles du filet. Une participation pourrait être envisagée sous forme contributive afin de garantir l’accès à une mutuelle aux salariés ayant plusieurs employeurs.
M. le rapporteur. Dans ce cas, l’organisme de branche serait une solution adaptée dans la mesure où cela pourrait donner lieu à une cotisation proportionnelle au salaire et la loi des grands nombres s’appliquerait.
M. Dominique Tian. L’activité du salarié peut aussi concerner plusieurs branches.
Je remercie le rapporteur de reconnaître qu’il s’agit d’un vrai sujet. S’il parvient à trouver une solution d’ici à la réunion de l’article 88, nous pourrions être amenés à voter son amendement. Mais, en attendant, je maintiens le nôtre !
La Commission rejette l’amendement AS 47.
Puis elle examine l’amendement AS 4 de M. Jean-Charles Taugourdeau.
M. Jean-Charles Taugourdeau. Afin de ne pas alourdir les charges pesant déjà sur les entreprises, il est proposé d’envisager un financement de la complémentaire santé en fonction des moyens de l’entreprise, en accord avec les représentants syndicaux.
Nous remettons en cause non pas les institutions de prévoyance, mais plutôt le système que vous mettez en place. Lorsque l’on rétrécit le choix à outrance, il n’y a plus vraiment de liberté de choix. Alors qu’il n’y a plus que cinq grandes banques en France, les entreprises trouvent-elles plus facilement des financements ? Il n’y a que quelques grands groupes d’assurance ; les entreprises et les particuliers s’assurent-ils plus facilement ? Quand il n’y aura plus qu’une dizaine d’institutions de prévoyance, sera-t-il plus aisé de financer sa complémentaire santé ? La réponse est non. Aujourd’hui, la vraie liberté est possible avec les cabinets de courtage en assurance que vous êtes en train de tuer !
M. le rapporteur. Pour ma part, je crois à la sécurité sociale. Dans ce domaine, j’estime que la dépense collective est plus efficace que la dépense privée. Je rappelle que si les dépenses de santé représentent 10 % du PIB en France, contre 15 % aux États-Unis, selon l’avis général, notre pays propose un meilleur système de soins. Nous avons sur ces questions des divergences de fond.
Les syndicats ont obtenu lors de la négociation qu’à défaut d’accord l’employeur « assure au minimum la moitié du financement » de la couverture alors qu’une version antérieure prévoyait une participation maximale de 50 %. En l’espèce, la nécessité de respecter l’accord du 11 janvier me semble rejoindre l’intérêt général.
M. Jean-Charles Taugourdeau. J’espère que demain le privé produira encore assez de richesses pour financer tout cela ! À ce sujet, je m’étonne que la Commission des affaires économiques n’ait même pas été saisie pour avis d’un texte portant sur la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi. C’est grave !
Mme la présidente Catherine Lemorton. L’accord du 11 janvier porte sur le code du travail et la sécurisation de l’emploi !
M. le rapporteur. Tous les députés membres de toutes les commissions pouvaient déposer des amendements et pourront le faire d’ici la séance publique.
La Commission rejette l’amendement AS 4.
Elle examine ensuite l’amendement AS 2 de M. Jean-Pierre Door.
M. Bernard Perrut. Il est proposé d’instaurer un mécanisme alternatif pour les très petites entreprises, celles de moins de dix salariés, sous la forme d’un « chèque-santé ».
Les employeurs seraient conduits à participer de façon forfaitaire à l’acquisition d’une garantie individuelle en santé de leurs employés. Les salariés pourraient ainsi continuer à adhérer à la mutuelle de leur choix en souscrivant la couverture la plus adaptée, et les très petites entreprises contribueraient à « solvabiliser » l’acquisition d’une complémentaire par leurs salariés.
M. le rapporteur. Défavorable. Cette solution, en totale contradiction avec l’esprit de l’article 1er, renvoie le problème à l’entreprise et supprime la mutualisation alors même que les représentants des petites entreprises, comme l’UPA et la CGPME, estiment que des organismes complémentaires, si possible de branche, leur apporteront les meilleures garanties en matière de prix et en termes d’actions de prévention.
M. Christian Paul. Les amendements de l’opposition visent manifestement à détricoter, voire à défigurer l’accord du 11 janvier, ce qui est d’autant plus paradoxal que Jean-Pierre Door nous a annoncé que l’UMP conditionnerait son vote au respect de l’accord.
Je constate par ailleurs que les altérations proposées vont toujours dans le même sens : la diminution des droits des salariés. Votre stratégie est décidément très intéressante !
M. Dominique Dord. Monsieur Paul, nous n’avons pas la même lecture de l’amendement qui vise, selon moi, non pas à revenir sur les termes de l’accord, mais plutôt à proposer une modalité complémentaire.
M. Gérard Cherpion. L’accord du 11 janvier prévoit bien qu’à défaut d’accord de branche signé avant le 1er juillet 2014, ce sera au tour des entreprises de négocier sur ces sujets. Cet amendement, qui vise à protéger les salariés, s’appliquerait donc après 2014.
M. le rapporteur. In fine, l’amendement risque de faire obstacle à la mutualisation en prévoyant une mesure de contribution à l’achat d’une mutuelle : un chèque individuel plutôt qu’une assurance collective.
La Commission rejette l’amendement AS 2.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS 378 à AS 384 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 244 de M. Michel Lefait.
M. Gérard Sébaoun. Cet amendement vise à ajouter, après l’alinéa 24 de l’article 1er, un alinéa précisant que l’employeur doit signaler dans le certificat de travail le maintien des garanties décès, maternité, incapacité…
M. le rapporteur. Favorable. Il me semble très important que les salariés soient informés de leurs nouveaux droits.
La Commission adopte l’amendement AS 244.
Puis elle examine l’amendement AS 50 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. Il s’agit de s’assurer que la procédure de mise en concurrence s’applique pour le choix de l’organisme assureur.
M. le rapporteur. Monsieur Vercamer, je vous propose de retirer votre amendement au profit de l’amendement AS 37 de M. Dominique Tian, qui est placé plus loin.
M. Francis Vercamer. Je le retire et je cosigne celui de mon collègue.
L’amendement AS 50 est retiré.
La commission est saisie l’amendement AS 102 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. L’article 1er organise la mise en place de la généralisation de la complémentaire santé pour les salariés, mais alors qu’au cours de la négociation de l’accord du 11 janvier, les partenaires sociaux avaient privilégié la liberté de choisir l’entreprise assurantielle, le projet de loi introduit une disposition contraire au principe de liberté de choix. Ne pas laisser cette liberté aux entreprises peut donner lieu à un abus de position dominante de certaines institutions. Cet amendement vise en conséquence à supprimer toute référence à une clause de désignation qui dénature l’accord du 11 janvier.
M. le rapporteur. Défavorable. Nous faisons confiance aux branches pour prendre les meilleures décisions pour les entreprises et les salariés concernés : soit la désignation, soit la recommandation, soit la liberté de choix.
La Commission rejette l’amendement AS 102.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS 385 du rapporteur.
Elle en vient ensuite à l’amendement AS 54 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. Les principes d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats doivent s’appliquer dans le cadre des procédures de mise en concurrence préalable par les branches. Il faut mettre en œuvre la « loi Sapin ».
M. le rapporteur. L’argument est puissant : favorable !
La Commission adopte l’amendement AS 54.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 37 de M. Dominique Tian.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement AS 38 de M. Dominique Tian.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS 386 du rapporteur.
La Commission examine l’amendement AS 245 de Mme Fanélie Carrey-Conte.
Mme Fanélie Carrey-Conte. L’article 4 de la loi du 31 décembre 1989 prévoit, que, sous certaines conditions, les anciens salariés peuvent continuer à bénéficier de la couverture santé de leur entreprise. Cet amendement vise à renforcer les droits des retraités en encadrant plus strictement les obligations de l’organisme complémentaire, en particulier en matière d’information.
M. le rapporteur. Favorable. Je propose toutefois une rectification rédactionnelle. Au troisième alinéa de l’amendement, il me semble préférable d’écrire « L’organisme doit avoir adressé la proposition de couverture à ces anciens salariés au plus tard… » De la même façon, au cinquième alinéa, je suggère de déplacer les mots « à ces personnes » : « L’organisme doit avoir adressé la proposition de couverture à ces personnes… »
Mme Fanélie Carrey-Conte. J’accepte cette rectification.
La Commission adopte l’amendement AS 245 ainsi rectifié.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS 387 et AS 388 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AS 51 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. En l’état, le code des assurances ne permet pas aux sociétés d’assurance de contribuer aux actions de solidarité ce qui les empêche de répondre aux appels d’offres relatifs à la complémentaire santé. Cet amendement vise donc à rétablir une véritable concurrence.
M. le rapporteur. L’expertise de cet amendement est en cours. Autant nous approuvons sa première partie – qui permet le maintien de la complémentaire santé par les mutuelles et les organismes d’assurance en l’absence de versements de l’entreprise –, autant nous sommes défavorables à sa seconde partie qui est contraire à d’autres dispositions du code des assurances.
Si vous voulez bien retirer votre amendement, je proposerai une solution concernant sa première partie d’ici à la réunion de la commission au titre de l’article 88.
M. Francis Vercamer. Pouvez-vous être plus précis ?
M. le rapporteur. Je suis défavorable à la seconde partie de votre amendement que je ne reprendrai donc pas, mais je déposerai un amendement reprenant la première partie en l’étendant aux mutuelles.
L’amendement AS 51 est retiré.
La Commission examine l’amendement AS 39 de M. Dominique Tian.
Mme Valérie Boyer. La transparence des actions des organisations syndicales est liée à la transparence de leur financement qui a fait l’objet de nombreux rapports, dont le récent « rapport Perruchot », issu de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur le financement des syndicats.
Le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi met l’accent sur la nécessaire transparence des recommandations ou des désignations des organismes assureurs par ces mêmes organisations syndicales. Dans ce cadre, la transparence sur le financement des syndicats est intimement liée à l’objectif de la loi.
Pour renforcer les conditions de transparence indispensables au bon déroulement de la procédure de mise en concurrence visée à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire d’imposer aux organismes paritaires de nouvelles règles comptables.
M. le rapporteur. J’ai beau lire et relire l’accord du 11 janvier, je ne vois pas que l’on y traite de cette question. Cet amendement me paraît être hors de notre sujet.
Cela dit, je reste surpris par l’insistance de l’opposition à vouloir montrer du doigt les organisations syndicales.
M. Jean-Charles Taugourdeau. Vous nous reprochez, chers collègues de la majorité, notre insistance sur la transparence en matière de financement des syndicats. Nous pourrions vous reprocher celle que vous mettez à démontrer, depuis le début de la séance, que les chefs d’entreprise cherchent systématiquement à duper les salariés.
En outre, il convient de le savoir : les syndicats font partie des « œuvres sociales » auxquelles les institutions de prévoyance sont habilitées à faire des dons.
M. Gérard Bapt. L’exigence de transparence exprimée par Dominique Tian et Valérie Boyer avec les amendements AS 38 et AS 39 devrait rejoindre nos préoccupations. Ainsi, nous nous sommes battus, au sein de cette commission, pour imposer la transparence dans les relations entre l’industrie pharmaceutique et les chefs de services hospitaliers. Je vous suggère, monsieur le rapporteur, de proposer un amendement sur cette question.
Mme Valérie Boyer. Quel consensus remarquable ! Notre commission a en effet adopté de nombreux textes relatifs à la transparence, notamment dans le domaine du médicament. Il serait dommage de ne pas persévérer dans cette voie.
M. le rapporteur. Pour ma part, j’ai déjà exprimé mon avis. La stigmatisation des organisations syndicales – à travers celle de leurs institutions de prévoyance ou de toute autre manière – n’a pas sa place dans le présent projet de loi.
En outre, je n’accepte pas vos propos, monsieur Taugourdeau : personne ici n’a émis la moindre critique à l’égard des chefs d’entreprises, bien au contraire. C’est avec les entreprises que nous voulons redresser le pays.
Mme Valérie Boyer. Nous n’avons pas d’arrière-pensées : notre demande de transparence n’a rien de stigmatisante ; elle va au contraire dans le sens de la clarification. Nous devrions tous pouvoir nous retrouver sur cette proposition.
M. Christian Paul. Cet amendement est évidemment stigmatisant et révélateur de vos obsessions. Surtout, il s’agit d’un cavalier : il n’a rien à voir avec l’accord du 11 janvier.
M. Dominique Tian. Que faites-vous des affaires en cours devant la justice ?
M. Christian Paul. Nous pourrions parler de nombreuses autres affaires. Votre diversion est lamentable. La situation de l’emploi devrait pourtant vous inciter à vous concentrer sur le présent texte.
M. André Chassaigne. Cet amendement est en effet révélateur de vos obsessions concernant les organisations syndicales, chers collègues de l’opposition. Vous devriez pourtant commencer par balayer devant votre porte en vous intéressant aux organisations syndicales que vous soutenez : nous avons vu ce qu’il en a été avec l’UIMM. Surtout, vous n’avez rien fait au cours des dix dernières années pour lutter contre l’évasion fiscale. Nous n’avons donc pas de leçons de morale à recevoir.
La Commission rejette l’amendement AS 39.
Puis elle examine l’amendement AS 95 de Mme Marie-Françoise Bechtel.
M. Christian Hutin. Les institutions de prévoyance, les mutuelles et les assurances ont vocation à recueillir des sommes considérables. Or la gestion de ces fonds ne fera l’objet d’aucun contrôle externe. Pourtant, les risques de mauvaise gestion existent toujours – notamment en cas de titrisation – et de telles opérations pourraient se révéler très préjudiciables aux droits des salariés.
C’est pourquoi, nous proposons que dans le cadre des pouvoirs par le code monétaire et financier, l’Autorité de contrôle prudentiel vérifie notamment que leurs opérations de placement sur les marchés financiers sont dépourvues de risque et permettent la préservation à titre permanent des droits des salariés ayant souscrit l’assurance complémentaire.
M. Gérard Bapt. Cette proposition ne découle pas directement du texte de l’accord du 11 janvier, mais répond à la préoccupation que j’ai exprimée lors de ma précédente intervention.
Toutefois, l’amendement ne concerne que les assurances et les mutuelles, dont la gestion est déjà contrôlée, notamment par l’Inspection générale des affaires sociales et la Cour des comptes au titre, respectivement, du code des assurances et du code de la mutualité. En revanche, les institutions de prévoyance, qui vont pourtant acquérir une place beaucoup plus importante sur le marché des complémentaires santé, ne relèvent d’aucun des deux codes précités et ne sont contrôlées par personne : elles sont simplement soumises à des règles prudentielles.
Certains d’entre nous sont réticents à imposer la transparence, car nous manifesterions ainsi notre suspicion. Néanmoins, nous devrions pouvoir nous entendre en ce qui concerne les institutions de prévoyance : s’agissant d’organismes paritaires, l’exigence de transparence s’adresserait tant aux syndicats d’employeurs qu’aux syndicats de salariés.
M. le rapporteur. Gérard Bapt a très bien expliqué le problème : l’amendement concerne non pas les institutions de prévoyance, mais les assurances et les mutuelles, pour lesquelles un tel contrôle existe déjà. En effet, l’Autorité de contrôle prudentiel a compétence pour vérifier que les opérations de placement réalisées par ces dernières sont dépourvues de risque. Je vous suggère donc, monsieur Hutin, de retirer votre amendement afin, le cas échéant, de le compléter.
M. Christian Hutin. Je retire cet amendement et en déposerai ultérieurement un autre qui concernera les institutions de prévoyance.
L’amendement AS 95 est retiré.
La Commission adopte l’article 1ermodifié.
Article 2
(art. L. 6111-1 et L. 6314-3 [nouveau] du code du travail)
Création du compte personnel de formation et du conseil en évolution professionnelle
Les dispositions relatives à la formation professionnelle figurant dans l’accord national interprofessionnel du 11 janvier traduisent l’importance croissante que les partenaires sociaux accordent à l’objectif de sécuriser les parcours professionnels au moyen d’une formation adaptée à l’évolution de l’environnement professionnel et aux parcours personnels.
Créé par le présent article, le compte personnel de formation est un droit individuel d’initiative de formation, ouvert à tous les actifs et défini en fonction de leurs besoins. Ce droit individuel se voit assorti de garanties collectives au nombre desquelles figure un dispositif d’accompagnement, le conseil en évolution professionnelle, également créé par le présent article.
En outre l’article 9 du projet de loi reprend le lien, établi à l’article 14 de l’accord du 11 janvier, entre la négociation obligatoire de la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) et le plan de formation.
I.- LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Sur la base de l’article 5 de l’accord du 11 janvier, le I. du présent article complète l’article L. 6111-1 du code du travail par un nouvel alinéa qui instaure, pour chaque actif, un « compte personnel de formation ».
L’accord indique que la création de ce compte vise à « franchir une étape supplémentaire en matière de portabilité des droits à la formation » et que le « compte est mobilisé par la personne lorsqu’elle accède à une formation à titre individuel, qu’elle soit salariée ou demandeur d’emploi. »
Le compte personnel de formation n’a pas vocation à devenir le seul instrument de formation professionnelle. Il ne régira pas les formations à l’initiative de l’employeur, par exemple, relevant du plan de formation mentionné à l’article L. 6312-1du code du travail.
Le compte est un nouveau mode d’accès aux formations qui sont à l’initiative du salarié ou de personnes qui cherchent à acquérir de nouvelles qualifications. Destiné à tous les actifs, il vise à transcender les barrières statutaires, de moins en moins adaptées au regard du caractère de plus en plus discontinu des parcours professionnels.
La transposition envisagée par le présent article fait figurer le compte personnel de formation dans un article prévoyant les principes généraux de la formation professionnelle, au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail. Ainsi, le compte personnel de formation vise à concrétiser l’objectif, assigné à la formation professionnelle par le premier alinéa du même article, de permettre « à chaque personne, indépendamment de son statut (…) de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle ».
Le compte personnel de formation se voit donc investi d’une double mission d’amélioration des droits existants, afin de les rendre pleinement accessibles, et de formation professionnelle des personnes en fonction de leurs besoins et aux moments où l’acquisition de nouvelles qualifications est le plus nécessaire.
Si le compte personnel de formation remplit conjointement ces objectifs, il contribuera à transformer le système français de formation professionnelle afin de passer d’une obligation collective de dépense à un droit d’accès pour chacun à une formation adaptée. Il s’agit d’instaurer un véritable régime assurance formation, interprofessionnel, dans un but de sécurisation du parcours professionnel de l’ensemble des actifs.
A. LES PARTENAIRES SOCIAUX ONT CRÉÉ, POUR L’ENSEMBLE DES ACTIFS, UN NOUVEAU DROIT D’INITIATIVE DE FORMATION
1. Le compte personnel est l’aboutissement d’objectifs anciens et de constats partagés
En matière de formation professionnelle, les objectifs assignés par les partenaires sociaux le 11 janvier 2013 rejoignent les choix figurant dans les différents accords depuis celui du 20 septembre 2003 relatif à l’accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle : ce dernier prévoyait déjà d’associer un droit d’initiative individuelle de formation et un dispositif d’accompagnement.
Le compte personnel de formation (CPF) proposé en 2013 prend la suite du droit individuel à la formation (DIF) créé en 2003 qui visait à donner au salarié un instrument de maîtrise de son parcours professionnel en lui permettant de disposer, tout au long de la vie professionnelle, d’un crédit d’heures de formation, utilisable à son initiative, avec l’accord de l’employeur. En 2003, l’entretien professionnel était envisagé comme un dispositif d’accompagnement lié au DIF ; aujourd’hui le conseil en évolution professionnelle a vocation à accompagner l’utilisateur du compte personnel de formation (16).
Les insuffisances constatées au cours des dix dernières années invitent à créer de nouveaux instruments : contrairement au DIF, le compte personnel de formation est ouvert par l’alinéa 2 du présent article à « chaque personne, indépendamment de son statut, dès son entrée sur le marché du travail » et « il est intégralement transférable en cas de changement ou de perte d’emploi ».
Si, aux côtés du système de formation initiale, le système de formation professionnelle français a contribué, depuis 1971, à ramener la part des travailleurs sans qualification de 70 % à 25 %, au fil des accords nationaux interprofessionnels, une continuité de vue s’est dégagée qui a identifié de nouveaux objectifs auxquels les dispositifs existants répondent imparfaitement.
La création d’un compte personnel de formation attribué à chaque actif constituerait une voie importante d’amélioration à plusieurs titres.
a) Garantir d’autonomie en matière de formation
Les signataires de l’accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 indiquaient se donner « pour objectif de permettre à chaque salarié d’être acteur de son évolution professionnelle ». Il en découle que les droits d’initiative de formation détenus par le salarié doivent être utilisés à sa seule initiative ; le salarié doit disposer d’une pleine liberté de décision et l’accès à ces droits doit être simple. Il faut un accompagnement pour utiliser les droits acquis, mais il ne saurait entraîner leur utilisation sans l’accord du salarié.
b) Sécuriser les parcours professionnels
L’accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 relatif à l’accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie professionnelle constate que « dans une économie de plus en plus ouverte sur le monde (…) le renouvellement accéléré des techniques de production et de distribution des biens et des services sollicite toujours davantage l’initiative et la compétence de chacun des salariés ; leurs aspirations à une meilleure maîtrise de leur évolution professionnelle nécessitent de renouveler les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue. » Un compte personnel mobilisable lors des transitions professionnelles, voulues ou subies, répond à cet objectif.
Dès lors, les distinctions s’estompent entre formation des salariés et formation des demandeurs d’emploi. Les dépenses de formation des chômeurs s’élèvent à 3,9 milliards d’euros en 2010 en hausse de 3 % par rapport à 2009. C’est, avec l’accompagnement des jeunes en insertion, le seul public bénéficiaire dont la dépense de formation augmente : au-delà de l’effet de flux lié à la hausse du chômage, la nécessité de former un grand nombre de demandeurs d’emploi provient de carences de formation, constituées en amont, qui ne sont repérées qu’au stade de l’accompagnement par Pôle emploi. Le droit d’initiative de formation des salariés en emploi, indissociable d’un droit à accompagnement, vise donc à accroître leurs compétences pour faciliter les transitions professionnelles et rendre moins aigu le besoin de formation en cas d’épisodes de chômage.
c) Réduire les inégalités constituées au moment de la formation initiale
Les articles 4-1 de l’accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 et 1-4-3 de l’accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 indiquent que « dans un souci d’équité, les salariés qui ont arrêté leur formation initiale avant ou au terme de premier cycle de l’enseignement supérieur, et en priorité ceux qui n’ont pas obtenu de qualification professionnelle reconnue, et qui souhaitent poursuivre ultérieurement des études en vue d’une promotion sociale, devraient avoir accès à une ou des formation(s) qualifiante(s) ou diplômante(s) d’une durée totale maximale d’un an, mise(s) en œuvre notamment dans le cadre du congé individuel de formation. »
d) Améliorer les voies d’accès à la formation
S’il ne figure pas en tant que tel dans les accords nationaux interprofessionnels adoptés depuis dix ans, le constat est largement partagé de la complexité croissante d’un système de formation professionnelle marqué par le cloisonnement des publics et des financements.
L’ensemble des dépenses de formation n’a pas vocation à être utilisé au travers d’un compte personnel, mais la possession d’un tel compte doit favoriser l’initiative de formation d’un d’actif amené, dans son parcours professionnel, à être tour à tour un salarié du secteur privé, un agent public ou un demandeur d’emploi et qui, à son entrée dans la vie active, a pu bénéficier des formations destinées aux apprentis et aux jeunes en insertion professionnelle.
En 2010, les actifs occupés (incluant les agents du secteur public) sont destinataires de 62 % des 31,51 milliards d’euros représentant l’ensemble des dépenses consacrées à la formation professionnelle. 84 % des 12,9 milliards d’euros de dépenses destinées aux actifs occupés du secteur privé proviennent des entreprises et sont pour moitié mutualisés par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA et OPACIF). L’État complète les dépenses de formation des actifs occupés du secteur privé à hauteur de 870 millions d’euros en 2010 et les régions pour 420 millions d’euros.
Les dépenses de l’employeur proviennent principalement de l’obligation «d’adaptation des salariés à leur poste de travail (et de) maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations » figurant à l’article L. 6321-1 du code du travail. Cet article fonde également les droits à formation à l’initiative du salarié « notamment dans le cadre du congé individuel de formation » (CIF) et à formation à l’initiative du salarié avec l’accord de son employeur « dans le cadre du droit individuel à la formation » (DIF).
À cette aune, les sommes mobilisées par les dispositifs de formation dans lesquels le salarié dispose d’une initiative sont modestes : les organismes paritaires collecteurs agréés ont dépensé 276 millions d’euros en 2010 au titre du DIF et les OPACIF ont collecté 1 milliard d’euros en moyenne au titre du CIF chaque année depuis trois ans. Les deux principaux dispositifs qui permettent au salarié de manifester son initiative dans le choix de s’engager dans une formation représentent donc 12 % des dépenses de formation destinées aux actifs occupés du secteur privé.
L’effet des dépenses de formations à l’initiative des salariés au regard des inégalités de répartition de l’ensemble des dépenses de formation est ambigu. Elles semblent accroître les inégalités en fonction du niveau d’études et de diplôme : un non diplômé sur dix déclare avoir suivi une formation au cours des douze derniers mois, contre trois sur dix déjà diplômés du supérieur. L’appétence à la formation est en effet plus forte pour les salariés initialement mieux formés.
Mais lorsque le DIF est utilisé dans une entreprise, quel que soit le secteur professionnel, les inégalités d’accès à la formation professionnelle se réduisent. Selon une étude de 2008 du Céreq (17), au regard d’un taux d’accès moyen des salariés à la formation de 41 %, tous secteurs confondus, ce taux était de 54 % dans les entreprises ayant accepté le recours au DIF et de 29 % dans celles n’y ayant pas eu recours. Ce différentiel était plus important dans les secteurs où l’accès à la formation est moindre. Ainsi, dans le secteur de l’habillement : pour un taux moyen de 22 %, l’accès des salariés à la formation varie de 38 % à 15 % selon que l’entreprise a accepté le recours au DIF ou non. Le bénéfice du DIF est plus fort dans les entreprises de petite taille ou pour les salariés, ouvriers ou employés dont le taux d’accès, d’une manière générale, est plus faible. Il semble donc que dans les secteurs où représentants du personnel sont moins susceptibles de pouvoir négocier un effort de formation de la part de l’employeur, les outils à l’initiative du salarié ont un effet de levier qui incite l’employeur à accroître ses propres efforts.
En tout état de cause, on ne peut pas fixer en tant que tel un objectif de dépenses de formation à l’initiative du salarié : une formation reste liée à un projet. Celui-ci ne peut exister sans un accompagnement fondé sur une analyse des perspectives professionnelles et des transitions professionnelles qui peuvent inclure une phase de recherche d’emploi.
En conséquence, l’approche statutaire atteint vite ses limites. Les dépenses de formation à destination des demandeurs d’emploi relèvent en premier lieu de Pôle emploi, à hauteur de 43 %, puis des régions pour 28 % et de l’État pour 23 %. Mais entre le salariat et le chômage, il s’agit surtout de cibler la formation au moment le plus pertinent. Le compte personnel de formation peut offrir de nouvelles marges d’initiative tant dans les phases d’emploi que dans les phases de recherche d’emploi.
Dépense des financeurs finaux par public bénéficiaire, en 2010
(en milliards d’euros)
Apprentis |
Jeunes en insertion professionnel |
Demandeurs d’emploi |
Actifs occupés du privé |
Agents publics |
Total | |
Entreprises |
1,12 |
1,06 |
0,07 |
10,89 |
- |
13,14 |
État |
2,27 |
0,76 |
0,84 |
0,87 |
2,92 |
7,66 |
Régions |
2,08 |
0,84 |
1,11 |
0,42 |
0,19 |
4,64 |
Autres collectivités territoriales |
0,04 |
- |
- |
0,01 |
2,41 |
2,46 |
Autres administrations publiques et Unédic-Pôle emploi |
0,11 |
- |
1,68 |
0,03 |
0,66 |
2,48 |
Ménages |
0,21 |
- |
0,24 |
0,68 |
- |
1,13 |
Total |
5,83 |
2,66 |
3,94 |
12,90 |
6,18 |
31,51 |
Lecture : en 2010, l’État a dépensé 2,27 milliards d’euros pour les apprentis, 0,76 milliard pour les jeunes en insertion professionnelle (alternance, accompagnement…), 0,84 milliard pour les demandeurs d’emploi et 0,87 milliard pour la formation continue des salariés du privé, etc. (Champ : France entière).
Source : Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares).
2. Le compte personnel peut pallier les limites du droit individuel à la formation
La loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie a ouvert le droit individuel à la formation (DIF) permettant à tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée de bénéficier de vingt heures de formation par an. Les droits acquis annuellement sont cumulés pendant six ans, le droit individuel à la formation restant plafonné ensuite à 120 heures. Les droits des salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée et des salariés intérimaires sont proratisés. À la différence du compte individuel de formation (CIF), pour lequel l’employeur peut seulement demander un report du congé, la mise en œuvre du droit individuel à la formation nécessite l’accord de l’employeur sur l’action de formation envisagée.
L’article 5 de l’accord du 11 janvier a doté le compte personnel de formation des principales caractéristiques du DIF. Il prévoit ainsi que « les heures acquises et non utilisées à ce jour au titre du DIF par le salarié sont réputées acquises au titre du compte personnel de formation (et que) le compte est plafonné à 120 heures ». De la même façon que pour le DIF « le salarié peut mobiliser son compte personnel avec l’accord de l’employeur ». L’article 5 prévoit que « les droits acquis par le salarié au titre du compte le sont à raison de 20 heures par an pour les salariés à temps plein ».
Il y a donc largement transfert de l’existant : le compte personnel de formation présente les caractéristiques d’un décompte en heures, d’une acquisition annuelle liée à l’ancienneté et de l’accord d’un financeur, l’employeur au premier titre, pour sa mise en œuvre. Mais les principes qui ont vocation à régir le compte personnel de formation, qui sera le réceptacle du DIF, vont améliorer ce dernier.
a) Le compte personnel de formation peut lever les obstacles à la transférabilité du DIF
Le présent article précise que le compte personnel de formation est « intégralement transférable ». L’accord du 11 janvier prévoit que « lorsque des dispositions conventionnelles plus favorables à l’accumulation des heures du DIF existent, elles s’appliquent automatiquement au compte personnel de formation ». Il indique également que « la transférabilité n’emporte pas monétisation des heures. Les droits acquis demeurent comptabilisés en heures, quel que soit le coût horaire de la formation ».
Le compte personnel de formation doit donc pallier les insuffisances du DIF dans les phases de transitions professionnelles. Les situations de conservation du DIF en cas de changement d’employeur ont initialement dépendu d’un mécanisme de transférabilité prévu par la loi du 4 mai 2004 qui était une autorisation pour le salarié d’utiliser ses droits acquis pendant le préavis. Parallèlement de nombreux accords de branches et d’entreprises ont prévu des mécanismes de transférabilité permettant la conservation du droit en cas de changement d’entreprise d’un même groupe ou d’une même branche. L’accord du 11 janvier propose donc de conserver les mécanismes de transférabilité prévus par ces conventions.
Puis, dans la lignée de l’accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009, l’article 6 de la loi du 24 novembre 2009 a instauré un nouveau mécanisme dit de « portabilité » : applicable à toute rupture ou arrivée à terme de contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage, à l’exception du licenciement pour faute lourde, il permet de conserver et de faire valoir les droits à DIF résiduels, soit pendant la période de chômage consécutive, soit pendant deux ans chez un nouvel employeur. L’employeur doit porter sur le certificat de travail du salarié le montant des droits DIF qu’il a acquis et l’organisme paritaire collecteur agréé qui devra les valoriser. Cette valorisation est mutualisée ; elle est à la charge soit de l’organisme collecteur du dernier employeur, si le salarié est chômeur, soit de celui de son nouvel employeur.
Le demandeur d’emploi peut demander d’utiliser ses droits prioritairement pendant la période d’indemnisation et après avis du référent de Pôle emploi ; auprès du nouvel employeur, la demande doit être formulée dans les deux ans suivant l’embauche ; il faut l’accord de l’employeur mais en cas de refus, l’organisme collecteur peut refuser la demande d’utilisation du DIF si elle juge qu’elle ne relève pas des priorités de la branche. Au vu du rôle des branches professionnelles, la portabilité par les salariés envisageant des mobilités interbranches est fragilisée par la dimension insuffisamment interprofessionnelle du dispositif.
La transférabilité ou la portabilité emportent provisionnement comptable. Dans son avis n° 2004-F du 13 octobre 2004, le Conseil national de la comptabilité a limité le provisionnement du DIF par les entreprises aux deux situations de désaccord entre l’employeur et le salarié sur le choix de la formation et de licenciement ou démission du salarié. Les coûts doivent donner lieu à constatation d’un passif, dans le premier cas parce que l’action de formation ne relève pas du champ des décisions de gestion de l’entreprise ; dans le second cas parce qu’elle ne peut être rattachée à l’activité future du salarié dans l’entreprise.
Dans tous les cas, la portabilité est limitée aux « sommes correspondantes au nombre d’heures acquises » dont la valorisation forfaitaire, fixée par décret, est de 9,15 euros.
En 2010, 21 007 DIF portables ont été financés, pour une prise en charge moyenne de 760 euros et une durée moyenne de 72 heures, dont 78 % durant plus de vingt heures. Si depuis la naissance de la portabilité du DIF, le nombre de demandes adressées aux organismes collecteurs a été multiplié par six, elles proviennent à 83 % des demandeurs d’emploi.
Ceci illustre, en creux, l’insuffisante portabilité dans les cas de mobilité professionnelle sans épisode de chômage, puisque la majorité des démissions n’ouvrent pas droit à portabilité du DIF. Pôle emploi participe en retour au financement du DIF portable : c’est un des cas de figure de versement complémentaire de l’aide individuelle à la formation qui peut atteindre 1 500 euros (18). En 2012, 15 600 aides ont été versées pour un montant total de 13,8 millions d’euros.
Le compte personnel de formation étant défini par la loi comme « intégralement transférable », il a vocation à supprimer l’ensemble des limites résultant des anciens dispositifs de transférabilité ou de portabilité du DIF, principalement les dispositions figurant aux articles L. 6323-17 à L. 6323-19 du code du travail. La transférabilité devra logiquement s’étendre à tous les cas de rupture du contrat de travail et le délai de deux ans pour mobiliser le DIF en cas de changement d’employeur devra être supprimé. Enfin, la transférabilité des droits tirés du DIF devrait être prévue pour les cas de passage entre secteurs public et privé.
Une estimation du coût potentiel de la transférabilité
L’estimation du coût potentiel de la transférabilité du compte personnel de formation peut se fonder sur une évaluation menée par la Cour des comptes en 2008 du coût annuel potentiel de la portabilité du DIF.
Les salariés en contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d’ancienneté et ayant donc acquis des droits au titre du DIF étaient environ 12 millions et le taux de rotation de 13 % : environ 1,57 million de personnes pouvaient ainsi faire valoir leurs droits chaque année.
Sur la base d’un résidu de droits à valoriser égal en moyenne à une année d’accumulation, soit 20 heures, la valorisation forfaitaire horaire de 9,15 euros permettait d’établir un montant de dépenses de 287 millions. Cette estimation ne tenait pas compte des montants, alors faibles, entraînés par la portabilité des DIF liés aux fins de contrats à durée déterminée. Cette simulation prenait en compte l’ensemble des démissions, deux fois plus nombreuses que les licenciements mais ne donnant accès à la portabilité du DIF que dans le cas de démissions légitimes au sens de l’assurance chômage. Elles entrent toutes en compte dans les cas de transférabilité du compte personnel de formation.
Le montant de 16 millions d’euros effectivement déboursés par les organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la portabilité du DIF en 2010 représente 5,5 % du montant de l’estimation menée par la Cour, ce qui illustre bien la faible portabilité du DIF.
b) Le faible usage du DIF montre qu’un outil plus accessible est nécessaire
Après dix années de montée en charge, le dispositif plafonné à six années cumulées devrait pouvoir être utilisé en tout état de cause par 1/6ème de ses bénéficiaires, soit au moins 16 % des salariés. Or le taux d’accès au DIF en 2010 est de 6,5 % des salariés couvrant 25 % des entreprises. La durée moyenne des formations est stable autour de vingt heures. Les salariés n’ont donc pas eu tendance en règle générale à capitaliser leurs droits pour réaliser une action d’une durée plus importante.
Les organismes paritaires collecteurs agréés ont mobilisé 276 millions d’euros pour financer 475 000 DIF dont 294 000 qualifiés de prioritaires et 181 000 de non prioritaires. En 2010, 473 327 stagiaires ont bénéficié d’un DIF, en baisse de 6 % par rapport à 2009. La part des entreprises utilisatrice du DIF a cessé de croître : le nombre des entreprises utilisatrices en 2009 qui ne le sont plus en 2010 dépasse le nombre de celles qui deviennent utilisatrices en 2010, alors qu’elles ne l’étaient pas l’année précédente.
Face à ces limites d’usage manifestes, la création d’un compte personnel de formation dont la gestion sera extérieure à l’entreprise garantira l’égalité des salariés en matière d’information et de gestion des droits, ce qui devrait accroître leurs possibilités d’utilisation. L’accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 avait d’ailleurs fixé l’objectif de mise en place d’un groupe de travail sur le DIF et le CIF, qui devait proposer des modalités de gestion externalisée du DIF, incluant la gestion administrative et financière, afin de faciliter la mise en œuvre notamment dans les TPE-PME. Si ces travaux n’ont pas abouti, le compte personnel permettra bien une gestion externalisée et améliorée du DIF visant à en faciliter l’accès.
c) Le plafond de 120 heures nécessite d’articuler le DIF avec d’autres droits à formation
Un des principaux motifs de la faible utilisation du DIF semble provenir du fait que 20 heures ou 120 heures de formation sont peu exploitables par le salarié. Les plus qualifiés sont aussi les mieux à même de s’approprier de petits modules de formation au fil de l’eau (dont des cours de langue ou de développement personnel) alors que les moins qualifiés n’en sont pas demandeurs.
Le DIF est limité à 20 heures annuelles alors qu’une formation qualifiante lourde représente 600 à 1 000 heures, soit cinquante années de capitalisation. Votre rapporteur regrette que l’accord du 11 janvier mentionne, pour le compte personnel de formation, un plafond de 120 heures. Cette mesure ne figure cependant pas au présent article du projet de loi.
Une ambiguïté des termes de l’article 5 de l’accord du 11 janvier doit d’ailleurs être relevée : il est indiqué que « les heures acquises et non utilisées à ce jour au titre du DIF par le salarié sont réputées acquises au titre du compte personnel de formation ». Cette formulation ne précise pas si les heures ainsi acquises au titre du compte figurent toujours dans les droits à DIF ou si un transfert s’opère, plafonné à 120 heures, mais permettant d’acquérir, après transfert, de nouveaux droits dans le cadre du DIF.
Le compte personnel de formation est certes le réceptacle des droits au DIF, réservé au salarié, mais puisqu’il est universel, il a vocation à accueillir d’autres droits, dont certains permettent l’accès à des formations longues. En facilitant l’articulation des droits du DIF, même plafonnés à 120 heures, avec d’autres droits à formation, le compte personnel pourra favoriser l’accès des salariés détenteurs d’un DIF à des formations actuellement hors de portée.
3. Le compte personnel peut favoriser l’accès à des formations qualifiantes
Divers dispositifs de formation sont d’une durée plus longue que le DIF, plafonné à 120 heures. Ils permettent d’accéder à des qualifications et sont des outils adaptés de sécurisation des parcours professionnels. Par contraste avec la faible diffusion du DIF, ces dispositifs connaissent un usage croissant. Le compte personnel de formation pourrait permettre à son titulaire de mobiliser différentes sources de droits à formation ou de financements afin d’accéder à ces dispositifs qualifiants.
À titre d’exemple les périodes de professionnalisation prévues à l’article L. 6324-1 connaissent un fort développement, 373 148 salariés en ayant bénéficié en 2011. Elles ne sont pas à l’initiative du salarié car elles permettent à l’employeur de répondre à son obligation de maintien de l’employabilité mais la formation est individualisée et souvent longue. Dans 11,26 % des cas (soit 42 022 périodes), la durée moyenne a été égale à 342 heures de formation pour une prise en charge moyenne par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) de 4 324 euros.
En matière de retour à l’emploi, la préparation opérationnelle à l’emploi (POE) ou le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) comportent des périodes de formation longues, précédées d’un diagnostic des besoins en qualification du demandeur d’emploi au vu de son environnement socioéconomique et d’une définition d’un parcours de retour à l’emploi qui dure jusqu’à un an.
L’exemple principal est fourni par le congé individuel de formation (CIF), créé par la loi du 16 juillet 1971 suite à l’accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970. L’article L 6322-1 du code du travail indique qu’il « a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation (qui) doivent (lui) permettre (par exemple) d’accéder à un niveau supérieur de qualification (ou) de changer d’activité ou de profession ». Un million de salariés ont suivi un CIF depuis 1982. Il a pleinement joué un rôle de « seconde chance » soit au titre d’une formation différée, soit dans le cadre d’une transition professionnelle.
Les organismes paritaires collecteurs agréés des contributions des entreprises au titre du CIF (OPACIF), dont les Fongecif, gèrent des réseaux d’accueil des salariés porteurs de projets de CIF et fournissent une aide à l’établissement du projet professionnel. Ils ne financent que des formations diplômantes. Les enveloppes financières sont définies par âge et niveau de qualification. En 2010, plus de 35 000 dossiers ont été acceptés au titre du CIF-CDI et 9 500 au titre du CIF-CDD et intérim, pour des enveloppes financières totales dépassant le milliard d’euros. Si le taux moyen d’acceptation des candidatures est de 50 %, il est de 20 % pour les plus qualifiés et atteint 70 % pour les moins formés.
Nombre de refus de candidatures sont liés à des contraintes de financement. La faculté pour le salarié candidat à un CIF d’abonder celui-ci de ses droits du DIF n’est pas autorisée par la loi. Des responsables de Fongecif et du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels auditionnés par votre rapporteur ont cependant indiqué que des modalités encadrées d’abondement des droits issus du DIF en cas de recours au CIF auraient des effets importants sur le nombre des bénéficiaires : la baisse du coût unitaire de chaque CIF pourrait être rapide, sans mobiliser outre mesure les droits à DIF.
La seule disposition légale qui rapproche le DIF du CIF concerne l’accès prioritaire à ce dernier, sous conditions, pour le salarié qui se serait trouvé pendant deux années consécutives en désaccord avec son employeur sur le choix de l’action de formation au titre du DIF (article L. 6323-12 du code du travail). Par ailleurs, si les actions de formation du CIF doivent s’accomplir en tout ou partie pendant le temps de travail, auquel est assimilée la durée du congé rémunéré, l’article 10 de la loi du 24 novembre 2009 a atténué cette contrainte et permet aux OPACIF de prendre en charge des formations hors temps de travail (tels que des « cours du soir ») pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise. La durée minimale de ces formations a été fixée à 120 heures par un décret du 18 janvier 2010. Le plancher des durées de formation que peuvent financer les OPACIF correspond donc au plafond des droits à DIF financés par les OPCA. Le compte personnel de formation doit permettre de transcender ces formes de cloisonnements.
L’incidence d’un congé individuel de formation sur les parcours professionnels
Une étude du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (19) a mesuré l’impact du congé individuel de formation sur l’évolution professionnelle de ses bénéficiaires. Elle illustre la valeur ajoutée d’une formation qualifiante longue fondée sur une bonne analyse des compétences initiales et des perspectives professionnelles du demandeur.
Il en ressort que le CIF s’adresse prioritairement aux salariés faiblement qualifiés : 82 % des bénéficiaires sont ouvriers ou employés ; 28 % sont de niveaux V et V bis (soit, dans la classification des niveaux de formation, les BEP ou CAP ou la sortie un an avant l’année terminale du second cycle court); 29 % sont de niveau IV (équivalent au baccalauréat ou au brevet professionnel).
Les personnes ayant bénéficié d’un CIF après un contrat à durée déterminée (CIF CDD) ou dans le cadre d’un contrat de travail temporaire (CIF Intérim) accèdent en proportion importante à un contrat à durée indéterminée un an après leur formation. Malgré le durcissement du contexte économique, la part des bénéficiaires (CIF CDD et Intérim) en emploi se maintient à un niveau très élevé (79 %). 69 % occupent une fonction en lien avec la formation suivie un an après la fin du CIF. 93 % des formations suivies se concluent par un examen : diplôme, titre, certification. Parmi les bénéficiaires d’un CIF terminé en 2010, 52 % avaient changé de catégorie socioprofessionnelle, 70 % de profession, 65 % de responsabilités et 54 % de secteur d’activité. 60 % avait changé d’entreprise.
4. Le compte personnel peut être un outil de formation initiale différée
Inséré dans l’article du code du travail qui proclame le droit pour chaque personne de « progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle », le compte personnel de formation dont «chaque personne dispose, indépendamment de son statut, dès son entrée sur le marché du travail » est logiquement créé pour les 140 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire sans diplôme ni qualification. En 2011, 12 % des jeunes âgés de 18 à 24 ans sont des sortants précoces, représentant un total d’environ 680 000 jeunes.
Le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 dispose que « la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à la formation professionnelle» ; appréhendée « tout au long de la vie » cette dernière comporte les acquis de la formation initiale et ceux de la formation continue. La garantie constitutionnelle d’égalité conduirait donc à donner plus en matière de formation continue aux personnes qui ont quitté l’école sans qualification.
Le compte personnel de formation pourrait être le support d’un droit différencié en faveur des jeunes peu qualifiés à la sortie du système scolaire et leur permettrait de disposer de crédits d’heures de formation inversement proportionnels à la durée de leur formation initiale. Il conviendrait dans ce cas de calibrer la créance, au regard par exemple de la précocité du décrochage.
L’article 25 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels prévoyait ainsi la remise par le Gouvernement d’un rapport relatif aux modalités de mise en œuvre d’un chèque formation fondé sur un crédit individuel de formation inversement proportionnel au niveau de diplôme obtenu. Ce rapport n’a pas été déposé au Parlement.
En tout état de cause, l’absence de qualification initiale est la première cause de faiblesse de formation professionnelle tout au long de la vie. Ceux qui ont connu le plus d’échec dans leur formation initiale ont, sans accompagnement, le moins d’appétence pour une formation ultérieure. Selon les résultats d’une étude McKinsey présentés à votre rapporteur par le directeur de l’Association de formation professionnelle des adultes (AFPA), 2,2 millions d’actifs ne seraient pas en mesure de suivre un stage de pré-qualification faute de prérequis. Ce constat conforte les analyses relatives à l’illettrisme, absence ou perte de la maîtrise de la lecture, de l’écriture et du calcul par des personnes qui ont bénéficié d’apprentissages initiaux. La contribution du compte personnel de formation à une prise en charge des « décrocheurs » contribuerait à la poursuite du mouvement de montée en qualification des classes d’âge qu’a connu la société française depuis un demi-siècle.
B. LE LÉGISLATEUR DOIT PRÉCISER LE CONTENU DE CE DROIT ET SES CONDITIONS DE MISE EN œUVRE
1. Fixer dans la loi des principes d’utilisation du compte
Selon l’alinéa 2 du présent article « afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose, indépendamment de son statut, dès son entrée sur le marché du travail, d’un compte personnel de formation, individuel et intégralement transférable en cas de changement ou de perte d’emploi ». Le projet de loi reprend donc les « grandes propriétés » du compte définies par l’accord du 11 janvier : le compte est universel ; il est individuel ; il est intégralement transférable.
Mais le présent article ne transcrit pas dans la loi certains des principes dont l’accord prévoit pourtant qu’ils régissent le compte. Le compte étant universel, le législateur doit en définir les principes pour l’ensemble des actifs, y compris ceux qui ne seront pas couverts par le champ des accords au terme des négociations de sa mise en œuvre.
Trois caractéristiques principales du compte personnel de formation doivent être soulignées.
a) L’usage du compte conjugue liberté et accompagnement
Puisqu’il vise à renforcer les droits de la personne dans son parcours professionnel, le compte ne saurait être utilisé sans l’accord de son titulaire. Mais il n’y pas de droit à dépense de formation : la primauté revient au projet de qualification, qui conditionne le versement de fonds publics et l’utilisation du compte personnel de formation.
Le compte permet au salarié d’être à l’initiative d’une formation. Cette initiative doit être pleinement informée. L’appellation de « compte personnel » est bienvenue car l’usage, s’il est individuel, doit être personnalisé, taillé sur mesure en fonction des parcours professionnels. Le lien est établi entre l’existence d’un droit et l’accompagnement de son titulaire, comme le montre la création conjointe du conseil en évolution professionnelle.
Comme dans le cadre du DIF, l’utilisation du compte ne relève ni d’un droit de consommation du titulaire, ni d’une prescription par l’employeur, mais d’un accord. Il y a bien liberté de choix mais à partir d’une offre encadrée. Le compte ne peut être utilisé qu’avec l’accord exprès de son titulaire, mais les choix de formation doivent s’inscrire dans les priorités fixées aux niveaux national, régional, de branche et interprofessionnel. Ceci représente, en pratique, une liberté de choix accrue dans la plupart des cas : le refus de l’employeur pourrait être tempéré si la demande de formation correspond à un accord de branche ou à la priorité d’une autorité publique, par exemple.
b) La compte est transférable sans monétisation
L’article 5 de l’accord du 11 janvier précise que « la transférabilité n’emporte pas monétisation des heures. Les droits acquis demeurent comptabilisés en heures, quel que soit le coût horaire de la formation ». Ces principes d’utilisation sont actuellement inapplicables au DIF en raison des dispositions actuelles régissant sa portabilité (aux articles L. 6323-17 et L. 6323-18 du code du travail) qui prévoient le transfert de « la somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire ».
Afin de garantir leur pleine transférabilité, les droits acquis doivent être établis en heure de formation qui représente une garantie d’utilisation pour le titulaire du compte. Ces heures n’ont certes pas la même valeur selon les formations, les plus coûteuses requérant par exemple l’utilisation de machines. Une équivalence générale sur une base horaire permet ainsi d’opérer une redistribution entre types de formations.
c) Le compte peut être abondé par l’employeur et les pouvoirs publics
Puisque le compte personnel de formation vise à sécuriser les parcours professionnels, il doit pouvoir être abondé par les pouvoirs publics en charge des politiques de formation et d’emploi. Il doit également pouvoir être abondé par l’employeur, qui a l’obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi.
Dans la logique du droit à formation initiale différée, ces abondements pourraient aller prioritairement aux personnes sans qualification ou être définis en fonction du niveau de qualification cible qui n’a pas été atteint. D’autres publics prioritaires pourraient être identifiés, tels les personnes en reconversion résidant dans des bassins d’emploi où le taux de chômage est élevé, ou les personnes dont le besoin de qualification est avéré ou encore les personnes en projet de création d’activité…
Si des abondements monétaires sont envisagés, un comité des financeurs pourra fixer les principes généraux des modalités de conversion en heures, en fonction des formations et des qualifications.
Enfin, les abondements devraient permettre aux collectivités locales, principalement aux régions, d’intervenir en fonction de leurs priorités. Actuellement, les abondements ponctuels envisageables sont en fait peu développés : ainsi des chèques formation des conseils régionaux établis en pratique à titre subsidiaire. Les dossiers de demande d’aide répondent à des critères définis par chaque région ; ils font le plus souvent l’objet d’une prescription préalable par Pôle emploi ou une mission locale. L’aide régionale est en général plafonnée en montant et durée ; la prise en charge des coûts pédagogiques atteint en moyenne 3 000 euros, et les bénéficiaires pouvant être rémunérés en tant que stagiaires de la formation professionnelle. Selon les données d’une enquête à laquelle avaient, en juin 2012, répondu douze régions, les bénéficiaires sont peu nombreux : 6 700 en une année, variant selon les régions de moins de 30 à plus de 1 000.
L’existence du compte personnel de formation devrait inciter les financeurs publics à doter cet outil aux moments opportuns, par exemple dans les situations d’inflexion des parcours professionnels.
2. Engager la concertation et faire émerger une assurance formation
L’accord du 11 janvier indique que « le financement du compte personnel de formation fait l’objet d’une concertation avec l’État et les régions (que) sa mise en place est conditionnée à un accord sur ses modalités de financement entre les partenaires sociaux, les régions et l’État, qui engageront une concertation sur ce sujet dans les plus brefs délais ».
Le renvoi à la négociation des différents financeurs est légitime au regard des interrogations concernant le calibrage du dispositif. Les seuls salariés représentent environ 15 millions de personnes en équivalents temps plein. Chaque personne alimentant son compte à raison d’au moins 20 heures par an, le compte serait alimenté, au minimum par 300 millions d’heures de formation. Puisque le compte est universel, il devra couvrir le « hors champ », les demandeurs d’emploi, et le secteur public ce qui représenterait 500 millions d’heures de formation. Mais une approche par thésaurisation ne semble pas pertinente : les droits ne sont calculés qu’au moment de la demande de formation, la créance est théorique le reste du temps. Un besoin important de formation se fait sentir en cas de rupture professionnelle et de requalification. Le droit n’est d’ailleurs pleinement constitué qu’au terme de l’élaboration d’un projet de formation.
Mais puisque le compte est le réceptacle de droits existants, des financements nouveaux ne sont sollicités que pour ce qui concerne les coûts de gestion du dispositif ou les différents abondements. L’accord sur les modalités de financement est donc indissociable de la définition des responsabilités respectives. L’accord du 11 janvier indique d’ailleurs que « les partenaires sociaux adapteront les dispositions conventionnelles interprofessionnelles en vigueur, impactées par le présent article. »
Votre rapporteur propose d’arrêter dès le présent projet de loi certains contours du compte personnel de formation. La contribution des régions au financement des politiques de formation et à leur structuration territoriale dépendra des dispositions du prochain projet de loi de décentralisation mais peut d’ores et déjà être cernée. Sans attendre un projet de loi de réforme de la formation professionnelle, votre rapporteur souhaite donc que s’engage sans tarder une négociation sur le financement et la gestion du compte, quadripartite, rassemblant les représentants des salariés et des employeurs, les régions et l’État.
Une gestion interprofessionnelle du compte personnel de formation semble particulièrement légitime, de la même manière que le risque de perte d’emploi est géré par les partenaires sociaux dans le cadre de l’assurance chômage.
Quels que soient les statuts, aux plans national, interbranche et interprofessionnel, une assurance formation, gérée par les partenaires sociaux, doit permettre de rendre le droit effectif lorsque le risque se réalise : aux moments du parcours professionnel où l’action de formation qualifiante permet sa sécurisation. Une gestion interprofessionnelle du compte personnel de formation est par ailleurs indispensable pour en garantir la transférabilité : le droit sera transféré quelles que soient les modalités pratiques de transitions professionnelles, d’une entreprise à l’autre, d’une branche à l’autre, de l’emploi à une période de chômage etc...
L’émergence de cette assurance interprofessionnelle n’entraîne en aucune façon un désengagement des employeurs : ni au titre du financement, ni au titre du plan de formation. Les « grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise » feront d’ailleurs l’objet d’une négociation dans le cadre de la gestion prévisionnelle négociée des emplois et des compétences, prévue à l’article 9 du projet de loi. Rendre plus effectif un droit d’initiative du salarié en matière de formation, adapté à ses besoins, n’exonère en rien l’employeur de ses obligations en matière de maintien de l’employabilité du salarié.
La tenue unique de ce compte représentera également une garantie de bonne information et de connaissance par chacun de ses droits à la formation professionnelle tout au long de la vie. Universel et individuel, le compte peut difficilement être tenu par des institutions publiques dont le périmètre ne recouvre pas l’ensemble du territoire national, telles les régions, ou par des organismes paritaires qui ne concernent pas l’ensemble des actifs, comme les organismes paritaires collecteurs agréés.
La structure chargée de tenir le compte doit être rompue à la gestion d’un volume considérable de droits individuels, à l’image de l’Agence de services et de paiement (ASP). L’opérateur central devrait assurer la tenue et le suivi des comptes individuels de chaque personne, donc à terme de 28 millions d’actifs. Il devrait être mesure de gérer les abondements. Chaque titulaire du compte disposerait, seul, d’un accès à la base de données mais il pourrait le partager avec le conseil en évolution professionnelle lors de l’élaboration de son projet de formation. Le coût d’un tel dispositif variera selon son périmètre et les modalités d’accès aux données par les titulaires. En tout état de cause, un rassemblement des droits acquis au titre du DIF dans le cadre du compte est rendu possible par simple transferts des informations de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) qui deviendra la déclaration sociale nominative (DSN) à partir de 2016.
Une autorité prescriptrice pourrait définir des règles, à l’image du rôle de l’Unédic dans le cadre du régime d’assurance chômage. Mais les crédits de la formation continueront de relever de la responsabilité de chaque financeur.
II.- LE CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
Sur la base de l’article 16 de l’accord du 11 janvier, le II du présent article insère au chapitre IV du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail, relatif au droit à l’information, à l’orientation et à la qualification professionnelles, un article L. 6314-3 qui ouvre droit, pour tout salarié, à un conseil en évolution professionnelle, mis en œuvre au niveau local dans le cadre du service public de l’orientation. Il vise à répondre au besoin d’accompagnement des personnes dans l’élaboration de leur parcours professionnel.
Le II retranscrit fidèlement les différentes missions envisagées par les partenaires sociaux à l’article 16 de l’accord du 11 janvier.
Ce faisant, il offre une garantie d’effectivité de l’accès aux droits tirés du compte personnel de formation. L’accompagnement proposé par le conseil en évolution professionnelle est indissociable du droit d’initiative renforcé par le compte personnel de formation.
A. LA GARANTIE COLLECTIVE DE L’EXERCICE DES DROITS CRÉÉS PAR LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
1. Une demande ancienne des partenaires sociaux
En créant un conseil en évolution professionnelle, les partenaires sociaux renouvellent le constat ancien tirés des limites, au regard des intentions initiales, du bilan de compétences créé par la loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi.
Le bilan de compétences se voulait la traduction d’un véritable droit à l’orientation professionnelle. Les actions aujourd’hui codifiées à l’article L. 6313-10 du code du travail «doivent permettre à des travailleurs d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation ». Si le bilan de compétence vise à définir un projet professionnel, la loi ne précise pas que ce dernier passe par l’examen des besoins de la personne, au regard de son parcours professionnel et de l’évolution des qualifications et des métiers au sein d’un environnement socio-économique. Seule est explicitement prévue l’analyse des motivations et compétences personnelles. Le bilan de compétence a donc souvent une forte dimension psychologisante.
Tout au long de la décennie 2000, les différents accords nationaux interprofessionnels relatifs à la formation ont tenté de pallier ces carences en proposant, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise, de nouveaux dispositifs d’information et de bilan mieux adapté à l’objectif de sécurisation des parcours.
L’accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 visait par exemple à « permettre à chaque salarié d’être acteur de son évolution professionnelle grâce aux entretiens professionnels dont il bénéficie ou aux actions de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience auxquelles il participe ». Cet accord souhaite qu’un « passeport formation et les travaux de l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications de sa branche professionnelle (permettent) à chaque salarié d’être en mesure d’élaborer et de mettre en œuvre un projet professionnel qui tienne compte non seulement des besoins en qualification de son entreprise ou, plus généralement, de ceux du monde économique, mais aussi de sa propre ambition de développer ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles ».
2. Les premières réponses n’ont pas été concluantes
À ces demandes, le législateur n’a apporté que des réponses imparfaites.
La création d’un bilan d’étape professionnel a été demandée par les accords du 11 août 2008 relatif à la modernisation du marché du travail et du 14 novembre 2008 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les partenaires sociaux envisageaient un bilan nettement distinct de l’entretien annuel d’évaluation qui ne serait pas nécessairement réalisé dans l’entreprise, et en tout état de cause, pas par la hiérarchie directe de l’intéressé. La faculté d’effectuer l’entretien dans l’entreprise était dictée par un objectif de simplicité et de limitation du coût.
L’article 12 de la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie a défini ce bilan d’étape professionnel, à l’article L. 6315-1 du code du travail, comme « un diagnostic réalisé en commun par le salarié et son employeur (devant) permettre au salarié d’évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences et à son employeur de déterminer les objectifs de formation du salarié ». L’entretien est réservé aux salariés disposant de deux ans d’ancienneté et sa périodicité est fixée à cinq ans.
La loi en a renvoyé les conditions d’application à la négociation collective : celle-ci n’a pas abouti. Il semble en effet contradictoire d’assigner un objectif de sécurisation des parcours à un dispositif dont la condition d’ancienneté écarte les salariés en contrat à durée déterminée. On voit mal en quoi l’employeur peut accompagner des trajectoires aux lignes brisées qui s’effectuent dans de nombreuses entreprises et empruntent successivement des statuts différents. L’information sur l’environnement professionnel et les perspectives de formation et d’emploi au regard du parcours et des compétences ne peut être fournie exclusivement à l’intérieur de l’entreprise. Des instances neutres au regard de la relation de travail sont nécessaires.
En complément du bilan d’étape professionnel, le même article 12 de la loi du 24 novembre 2009 prévoit la création d’un « passeport orientation-formation», « mis à disposition de toute personne » et qui serait notamment alimenté par les conclusions du bilan d’étape professionnel. Ce passeport doit recenser les diplômes de la formation initiale et les éléments de la formation continue : expérience professionnelle, actions de formation, qualifications obtenues, etc. Une disjonction plus nette avec l’entreprise est établie, la loi interdisant au recruteur de demander la présentation du passeport à un candidat.
Ce dispositif n’a pas pu entrer en vigueur. La loi renvoie à un décret en Conseil d’État. Un projet de décret a bien été présenté qui définissait le passeport orientation et formation comme « un portefeuille personnel et coordonné de documents recensant les compétences et qualifications » et précisait que « le passeport orientation formation constitue la propriété de son titulaire qui le constitue et décide en toute liberté de son usage». Il a reçu en avril 2010 un avis négatif de la section sociale du Conseil d’État, qui a constaté l’absence de définition d’une autorité administrative chargée de l’établir, d’encadrer la liberté de son utilisation ou de valider les éléments qui y seraient inscrits.
Plutôt que d’apporter un service au salarié confronté à la perspective d’évolutions professionnelle et au besoin de mieux connaître son environnement professionnel et ses compétences, il était donc institué un nouveau document administratif mais dépourvu des garanties qui s’y attachent. Ce dispositif a donc constitué une impasse.
Il ne subsiste plus aujourd’hui du projet initial qu’un site internet, financé par les partenaires sociaux, présentant un modèle de document que chacun est libre d’imprimer pour y indiquer sa propre perception de son expérience et de ses compétences(20). Le document distingue des compétences sociales, organisationnelles, techniques, informatiques, artistiques ou linguistiques… Aucun accompagnement n’est proposé.
La loi du 24 novembre 2009 précitée a apporté une dernière réponse partielle en créant un délégué à l’information et à l’orientation aux articles L. 6123-3 à -5 du code du travail.
Ce dernier est chargé de mettre en place « un service dématérialisé gratuit et accessible à toute personne » défini à l’article L. 6111-4 permettant de « disposer d’une première information et d’un premier conseil personnalisé en matière d’orientation et de formation professionnelles » et « d’être orienté vers les structures susceptibles de lui fournir les informations et les conseils nécessaires à sa bonne orientation professionnelle ».
Son financement a été renvoyé à une convention entre l’État, le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) et les régions. Les conventions conclues entre l’État et le fonds paritaire ont effectivement affecté des financements au nouveau service dématérialisé, à hauteur de 5 millions d’euros. Les accords couvrent la mise en œuvre, l’hébergement et la maintenance d’un site internet, le fonctionnement d’une plateforme téléphonique et des prestations d’information du grand public. Ils ont permis la mise en place du site internet www.orientation-pour-tous.fr où l’utilisateur trouve des descriptions de métiers et des outils de recherche de formation ou de lieux d’information en matière d’orientation. Il s’agit en grande partie d’une optimisation de l’existant car le maître d’œuvre de ce site est Centre INFFO, association créée par décret en 1976, et qui proposait déjà sur internet, depuis 2006, un « portail national de l’orientation et la formation » donnant accès à des fiches descriptives de métiers et à des offres de formation.
Ces différentes mesures sont donc bien loin de répondre à l’objectif d’accompagnement de l’individu dans son évolution professionnelle.
3. Un conseil sur l’environnement professionnel et les formations
Les partenaires sociaux ont identifié de façon croissante le besoin d’aide du salarié pour connaître les évolutions de son environnement professionnel et les opportunités d’emploi et de formations présentes sur le territoire. Votre rapporteur souscrit pleinement à cette analyse : le droit à la connaissance de l’évolution des métiers conditionne la maîtrise par le salarié d’un parcours de formation et de son évolution professionnelle.
Le conseil en évolution professionnelle doit disposer de diagnostics locaux des activités, des emplois et des besoins en compétences, à l’image de l’accompagnement renforcé mené par le service public de l’emploi dans le cadre des cellules de reclassement ou du contrat de sécurisation professionnelle.
Il s’agit donc d’un conseil en opportunités professionnelles et de formation. Loin d’une simple analyse des compétences du bénéficiaire qui, pour de nombreux salariés, pourrait être redondante avec les dispositifs existants dans les entreprises, les partenaires sociaux ont envisagé « une offre de service d’accompagnement claire, lisible et de proximité (…) visant l’évolution et la sécurisation professionnelle ». Le conseil en évolution doit donc être en mesure de répondre à des demandes formulées aux moments clés des parcours professionnels, lorsque le besoin d’une information sur les métiers et les qualifications est le plus aiguë.
L’article 16 de l’accord du 11 janvier a proposé que cet accompagnement soit réalisé grâce à « la coordination des opérateurs publics et paritaires existants sur l’orientation, la formation et l’emploi » et que « l’articulation avec les pouvoirs publics et les dispositifs tels que le service public de l’orientation, (soit) discutée avec l’ensemble des interlocuteurs concernés, notamment dans le cadre du débat sur la décentralisation ».
L’alinéa 4 du présent article prévoit d’ores et déjà la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle « au niveau local dans le cadre du service public de l’orientation prévu à l’article L. 6111-3 » qui dispose que « toute personne dispose du droit à être informée, conseillée et accompagnée en matière d’orientation professionnelle » et que « le service public de l’orientation tout au long de la vie est organisé pour garantir à toute personne l’accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l’accès à des services de conseil et d’accompagnement en orientation de qualité et organisés en réseaux. »
La création de ce service au niveau local, hors de l’entreprise, répond à la demande des partenaires sociaux car il favorisera notamment l’accès des salariés des TPE et PME que l’accord du 11 janvier identifie comme les plus dépourvus actuellement de cette forme de conseil. Si l’accord et le projet de loi réservent le conseil en évolution professionnelle aux seuls salariés, la mise en œuvre par le service public de l’orientation garantit, dans les faits, l’accès aux mêmes informations par l’ensemble des actifs.
Les alinéas 5 à 8 du présent article retranscrivent les différentes missions du conseil envisagées par les partenaires sociaux.
La première composante du service figure à l’alinéa 5 : le droit « d’être informé sur son environnement professionnel et l’évolution des métiers sur le territoire ». Le conseil se situe bien dans une logique de parcours et de mobilité. L’identification du cadre dans lequel s’inscrit le parcours professionnel du salarié et la définition d’un projet d’évolution professionnelle sont donc les préalables à une offre de formation, ce qui est une garantie d’efficacité, au final, de la dépense de formation. C’est en lien avec cette analyse territoriale des évolutions professionnelles qu’est exercée la mission, figurant à l’alinéa 7, « d’identifier les offres d’emploi adaptées (aux) compétences (du salarié) ».
Aux alinéas 6 et 8 figurent les missions de ce conseil permettant aux salariés « de mieux connaître ses compétences, de les valoriser et d’identifier les compétences utiles à acquérir pour poursuivre son parcours professionnel », ainsi que d’ « être informé des différents dispositifs qu’il peut mobiliser pour consolider son parcours professionnel ».
Il s’agit donc d’une aide à la lecture de l’offre de formation au regard du parcours du salarié. Le conseil doit être capable d’orienter vers les services de formation en fonction des situations personnelles.
Le projet de loi ne fait pas figurer explicitement la mission d’accompagnement dans la mobilisation du compte personnel de formation. Or tout projet de formation doit être financé et l’individu n’est acteur de son parcours de formation que dans la mesure où il connaît ses droits. Le conseil en évolution professionnelle doit donc fournir une première aide à l’analyse des droits acquis au titre du compte, des droits mobilisables à l’avenir et des abondements éventuels à solliciter.
Il en irait ainsi pour le conseil en évolution professionnelle de la même façon que pour les conseillers de Pôle emploi qui informent à la fois sur les mesures d’accompagnement vers les qualifications et l’emploi fournies par le service public de l’emploi et sur les règles en matière d’indemnisation du chômage ou d’activité réduite relevant du régime d’assurance chômage, l’effectivité des premières étant indissociable des secondes.
L’alinéa 9 précise que l’obligation d’informer le salarié de la possibilité de recourir à cet accompagnement relève « notamment de l’employeur » ce qui rend effectif, au bénéfice de tout salarié, le « droit à l’information sur l’existence de ce service et sur les possibilités d’y accéder » explicitement prévu par les partenaires sociaux à l’article 16 de l’accord du 11 janvier. Le projet de loi ne définit cependant pas précisément cette obligation nouvelle de l’employeur, ni les conditions d’information des instances représentatives du personnel à ce titre.
Afin « d’assurer l’effectivité de ce droit au conseil à l’évolution professionnelle » les partenaires sociaux ont envisagé « la possibilité (pour le salarié) d’utiliser son compte personnel de formation pour accéder à ce conseil en évolution professionnel ». L’alinéa 10 retranscrit cette stipulation en prévoyant que « le compte personnel de formation peut être mobilisé par le salarié pour bénéficier de cet accompagnement ».
Votre rapporteur s’interroge cependant sur l’opportunité de prévoir une possibilité de mobiliser le compte personnel de formation qui risquerait fort de se transformer en obligation. Cette possibilité suppose que le conseil en évolution professionnelle entre dans les catégories d’actions de formation définies aux articles L. 6313-1 et suivants du code du travail. Or l’accès à une action de formation pour laquelle le compte est mobilisé donne lieu à accord soit de l’employeur soit d’un organisme de financement de la formation, ce qui semble contradictoire tant avec l’objectif d’informer le salarié sur son environnement professionnel à l’extérieur de l’entreprise qu’avec celui d’orienter vers des formations moins en fonction des statuts ou des circuits de financement qu’en fonction des parcours professionnels.
Le rattachement prévu au premier alinéa au service public de l’orientation invite au demeurant à définir un service gratuit de première intention. La frontière entre gratuité garantie par le service public et usage du compte personnel de formation dépend du niveau de l’accompagnement : le compte ne saurait être débité lors de la première étape d’accompagnement personnalisée qui vise à rendre plus efficace l’utilisation ultérieure des droits à formation. Il s’agit précisément du nouveau droit instauré par le projet de loi.
B. UNE NOUVELLE COMPOSANTE DU SERVICE PUBLIC DE L’ORIENTATION TOUT AU LONG DE LA VIE
1. Une mise en œuvre organisée par les régions
L’instauration du conseil en évolution professionnelle dans le cadre d’un service public organisé localement est une garantie de libre accès pour les salariés.
Les prestations de ce service public reposent actuellement sur un réseau d’opérateurs souvent spécialisés par publics : les scolaires et jeunes à la sortie de l’école sont très majoritaires aux côtés des jeunes primo entrants sur le marché du travail. L’article L. 6123-3 du code du travail prévoit que le délégué à l’information et à l’orientation établit des normes de qualité, évalue les politiques nationale et régionales d’information et d’orientation scolaire et professionnelle et apporte son appui à la mise en œuvre et à la coordination des politiques d’information et d’orientation aux niveaux régional et local. Des sites bénéficient de la labellisation « Orientation pour tous ».
Les modalités d’accompagnement des jeunes par les missions locales donnent quelques indications sur les contours du conseil en évolution professionnelle. C’est seulement après avoir contribué à la définition d’un parcours d’insertion professionnelle que les missions locales proposent des actions de formation, figurant dans le programme régional de formation.
Le projet de loi de décentralisation va définir une nouvelle structuration du service public de l’orientation professionnelle et de l’emploi et devrait confirmer le rôle de chef de file de la région en la matière. Un comité de coordination régionale de l’emploi et de la formation professionnelle coprésidé par le préfet et le président du conseil régional serait compétent à la fois en matière d’emploi et de formation, ce qui renforcera l’approche fondée sur les besoins et la sécurisation des parcours au regard de l’évolution de l’environnement professionnel.
Les contours du rôle de coordination des régions sont à définir, notamment les modalités de choix des intervenants en charge du conseil en évolution professionnelle. Des cahiers des charges communs pourraient formaliser les principes de l’accompagnement. Les régions pourront labelliser les réseaux. L’organisation au niveau régional donnera lieu à une grande diversité de configurations notamment au vu de ce qui existe déjà : cités des métiers, espace d’accueil des Fongecif, maisons de l’emploi, structures expérimentales locales… La mise en cohérence du réseau permettra de gagner en efficacité et de fusionner des dispositifs redondants, le cas échéant.
Les régions ne contribuent aujourd’hui que très marginalement à des formations à l’initiative du salarié sous forme de « chèques formation » qui pourraient, s’ils étaient développés, abonder le compte personnel et vers l’utilisation desquels le conseil en évolution professionnelle pourrait orienter le salarié. Les régions jouent surtout un rôle de prescription et d’achat de formation. Le catalogue des formations du programme régional structure actuellement les offres et il semble que le futur projet de loi de décentralisation augmentera la place de la région dans la commande publique de formation. Il prévoirait en outre, concernant les demandeurs d’emploi, que la région établira des cahiers des charges communs et participera à des groupements de commande avec Pôle emploi.
Les régions exerceront donc concomitamment des compétences renforcées en matière d’achat de formation et de structuration des réseaux de conseil en évolution professionnelle. Ce dernier deviendra ainsi un levier d’amélioration de l’offre de formation : l’analyse du besoin de formation en fonction de chaque personne est porteuse d’efficacité. Les régions pourront mieux adapter la carte de formation aux besoins repérés grâce aux organismes assurant le conseil en évolution professionnelle.
2. La contribution des organismes gérés par les partenaires sociaux
L’article 16 de l’accord du 11 janvier mentionne explicitement l’action des « opérateurs paritaires qui participent aux réseaux d’accueil des publics salariés, notamment les Fongecif et l’APEC ». La contribution des réseaux d’accueil de salariés gérés par des opérateurs paritaires sera en effet déterminante.
Un bon exemple est fourni par l’accompagnement par les Fongecif des salariés porteurs d’un projet individuel de formation. Cette mission se fonde sur l’article 2-15 de l’accord national interprofessionnel de 2003 qui dispose que « chaque salarié qui souhaite élaborer un projet professionnel individuel peut bénéficier de l’aide du Fongecif dont il relève ». Le service comporte « un accompagnement dans le choix de son orientation professionnelle, une information sur les dispositifs de formation, de validation des acquis de l’expérience et de bilan de compétence, un appui à l’élaboration de son projet. » Le conseil est personnalisé: le temps d’accompagnement est fixé en fonction du degré d’autonomie des personnes ; la gamme des prestations mobilisées va de l’entretien individuel à la réunion collective ou au libre accès dans un espace projet, à l’image de celui décrit à votre rapporteur par les responsables du Fongecif Ile de France, qui accueille environ 80 000 salariés par an. Le programme distingue une étape d’aide au choix du projet professionnel individuel et une étape d’appui à l’élaboration du projet professionnel qui définit les besoins de formation.
L’accord du 11 janvier ne cite pas les organismes paritaires collecteurs agréés qui semblent parfois se positionner en conseils des entreprises, alors que les Fongecif accueillent les salariés. Mais la gestion des organismes collecteurs est paritaire et les fonds collectés auprès des entreprises concernent la formation des salariés. La participation des partenaires sociaux à la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle gagnera à associer l’ensemble des acteurs.
*
* *
La commission des affaires sociales a adopté un amendement des commissaires du groupe UDI précisant que les missions du conseil en évolution professionnelle visent « prioritairement un objectif de qualification ».
*
La Commission est saisie de l’amendement AS 130 de Mme Jacqueline Fraysse tendant à supprimer l’article.
M. André Chassaigne. L’article 2 apparaît, à certains égards, attrayant : il renvoie à la sécurité emploi-formation ou à la sécurité sociale professionnelle. Cependant, il doit être précisé sur plusieurs points.
Premièrement, que recouvre le « service public de l’orientation prévu à l’article L 6111-3 du code du travail » mentionné à l’alinéa 4 ? S’agit-t-il du service public de l’orientation dans sa version ancienne, tel qu’il existe encore dans certains bassins d’emploi ? Ou bien de celui qui a été instauré l’année dernière et qui regroupe, de manière plus centralisée et mutualisée, les actions de Pôle emploi, des centres d’information et d’orientation (CIO) et des missions locales, ainsi que, le cas échéant, celles qui sont menées dans le cadre des plans locaux d’insertion ?
Ces différents organismes devront se mobiliser pour étudier le parcours professionnel de chaque demandeur et suivre leur compte personnel de formation. Si cela ne posera sans doute guère de problème à Pôle emploi et aux centres d’information et d’orientation dans la mesure où ils reçoivent des financements de l’État, tel ne sera pas nécessairement le cas pour les missions locales, dont nous connaissons bien les difficultés. En outre, dans le cadre de l’acte III de la décentralisation, il est envisagé de confier le pilotage du service public de l’orientation aux régions. D’une manière générale, il est difficile d’approuver l’article 2 si les financements correspondants – notamment les éventuelles dotations aux missions locales ou les transferts aux régions – ne sont pas prévus.
Deuxièmement, qu’entend-on exactement par compte personnel de formation ? S’agit-il d’une réserve d’heures de formation à laquelle le salarié pourra recourir, tout au long de sa vie active, afin de s’adapter aux évolutions technologiques, de rechercher un nouvel emploi ou encore de bénéficier d’un accompagnement ciblé après un accident de parcours ? Ce compte revêt-il également une dimension financière ?
Troisièmement, malgré les bénéfices qu’il en retirera en termes d’adéquation du personnel à l’emploi, l’employeur ne semble contribuer en rien au financement du dispositif : c’est à l’État, aux collectivités territoriales, voire au salarié lui-même, qu’il reviendra d’assurer celui-ci.
M. Jean-Patrick Gille. Je ne suis pas convaincu par cette argumentation. L’ensemble des partenaires sociaux, signataires ou non de l’accord du 11 janvier, sont favorables à l’instauration d’un compte personnel de formation, à tout le moins dans son principe. Ainsi, M. Lepaon a rappelé que l’idée était défendue par la CGT depuis 2003.
Cet instrument vise à répondre à l’objectif fixé par les partenaires sociaux dans l’accord national interprofessionnel de 2003 et repris dans la loi de 2009 : la formation professionnelle tout au long de la vie doit permettre à chaque salarié de « progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle ».
Il s’agira d’un compte individuel, universel – il a vocation à concerner non seulement les 16 millions de salariés du secteur privé représentés par les syndicats qui ont participé à la négociation de l’accord du 11 janvier, mais l’ensemble des salariés français – et intégralement transférable en cas de changement ou de perte d’emploi. À ces trois caractéristiques pourrait s’en ajouter une quatrième, si l’on suit les recommandations du Centre national de la formation professionnelle tout au long de la vie : ce compte pourrait devenir un outil de formation initiale différée et être, à ce titre, abondé par la puissance publique dès son ouverture pour ceux qui entrent sur le marché du travail sans qualification.
Nous devrions tous nous retrouver sur ce dispositif. Une question se pose cependant : convient-il d’en décrire plus précisément le fonctionnement dès maintenant ? Ne devrions-nous pas, au minimum, lancer une négociation entre les partenaires sociaux, l’État et les régions ?
Les réponses aux interrogations d’André Chassaigne sur le service public de l’orientation se trouvent dans le code du travail. Quant à la prochaine loi de décentralisation, elle ira probablement dans le sens d’une régionalisation des compétences en matière de formation professionnelle.
Je suis donc opposé à l’amendement de suppression : inscrivons une fois pour toutes le compte personnel de formation dans la loi.
Mme Monique Iborra. Je ne comprends pas que l’on puisse s’opposer à l’instauration du compte personnel de formation, alors même que nous avons besoin de salariés plus qualifiés. Malgré les lois successives et les transferts de compétences – certes incomplets – intervenus en la matière, la formation professionnelle n’a pas atteint, en France, le niveau requis, par comparaison avec d’autres pays. En particulier, l’accès à la formation professionnelle demeure très inégalitaire.
Cependant, nous devons aller plus loin que l’affirmation du principe selon lequel chacun dispose d’un compte personnel de formation. La prochaine loi de décentralisation et la future loi relative à la formation professionnelle apporteront chacune des précisions. Nous devons, d’une part, renforcer les compétences des régions en matière de formation professionnelle et, d’autre part, lancer une réflexion associant les partenaires sociaux, l’État et les régions.
M. le rapporteur. Je suis très surpris de votre position, monsieur Chassaigne : la création d’un tel compte est un objectif de longue date de votre groupe politique, comme d’ailleurs du groupe socialiste.
L’instauration d’un financement obligatoire de la formation professionnelle par l’employeur en 1974 – le « 1 % formation » – a constitué un progrès, mais le système a vite atteint ses limites : les formations dispensées dans ce cadre bénéficiaient plutôt à ceux qui étaient déjà les plus formés. Avec le compte personnel de formation, nous passerons d’une obligation collective de dépenser pour la formation des salariés à une obligation individuelle de dépenser pour la formation de chacun. C’est un moyen d’établir une égalité non seulement formelle, mais réelle. C’est pourquoi nous sommes nombreux à le défendre, particulièrement à gauche.
Le droit individuel à la formation (DIF) était une première étape dans cette voie. Cependant, ce dispositif n’a été utilisé que par un salarié sur cinq, car il a souffert de ses contradictions internes : il devait favoriser la montée en qualification des salariés, mais il a été plafonné à 120 heures, ce qui est insuffisant pour une formation qualifiante. Il conviendra de porter ce droit individuel au-delà de ce plafond et de poser, à cet égard, la question d’une participation financière des entreprises.
À ce stade, l’accord du 11 janvier ne tranche pas la question et sanctuarise même le plafond de 120 heures. En revanche, le compte personnel de formation permettra de rassembler l’ensemble des contributions de l’État, des régions et des entreprises. En accumulant ainsi des droits, les intéressés pourront avoir accès à des formations qualifiantes.
Deuxièmement, les modalités d’utilisation du compte doivent encore être précisées par une loi, que je souhaite voir adoptée rapidement. Nous en avons déjà une vision assez claire et un principe ressort clairement des auditions que j’ai menées : c’est in fine le salarié qui devra décider de sa formation. L’expérience montre en effet qu’une formation qui est imposée à un salarié ou dans laquelle il ne s’implique pas se solde généralement par un échec. En revanche, un vrai débat demeure, y compris au sein du groupe SRC : certains plaident pour que le salarié ait l’entière liberté de choisir sa formation ; d’autres – c’est mon cas – pour qu’il exprime son choix parmi plusieurs formations figurant dans une sorte de catalogue national défini par les partenaires sociaux. Cela garantirait que la formation réponde aux besoins économiques de notre pays, ce qui est également dans l’intérêt des salariés : ils s’attendent en effet à ce que les formations qu’ils suivent leur permettent d’accéder à un emploi ou de progresser sur le plan professionnel.
Troisièmement, le service public de l’orientation mentionné à l’article 2 correspond à la mission de l’ensemble des organismes qui concourent à l’accompagnement des demandeurs d’emploi : Pôle emploi, les missions locales, mais aussi un certain nombre d’organismes paritaires. S’agissant de la loi de décentralisation, je plaide pour que l’on confie aux régions le soin d’organiser ce système d’orientation professionnelle. Celles-ci n’auront nullement vocation à se substituer aux organismes existants – auquel cas vous auriez raison, monsieur Chassaigne, de pointer du doigt un transfert de charge financière sur les budgets régionaux –, mais elles devront s’assurer que tout salarié et tout demandeur d’emploi peut bénéficier d’un accueil en la matière. En revanche, la gestion des droits au titre du compte personnel de formation devrait revenir aux partenaires sociaux au niveau interprofessionnel. Un accord pourrait se dessiner entre l’État, les régions et les partenaires sociaux sur un tel partage des rôles. Des précisions seront apportées progressivement dans le cadre des discussions qu’engagera le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
J’émets un avis défavorable sur votre amendement, monsieur Chassaigne, et vous suggère de le retirer.
M. Dominique Dord. Quel bonheur d’assister à ce tête-à-tête entre le parti socialiste et le parti communiste ! Malgré tous vos efforts, vous ne parviendrez pas, monsieur le rapporteur, à convaincre André Chassaigne : même si les stipulations de l’accord du 11 janvier créent, pour certaines, des droits que le parti communiste réclame depuis des années pour les salariés, elles sont nécessairement mauvaises à ses yeux dès lors que le MEDEF les a approuvées. Le parti communiste ne peut pas accepter un accord signé par le patronat et certains syndicats : c’est, de son point de vue, la lutte des classes qui doit prévaloir !
Pour notre part, nous avons pris dans le passé plusieurs mesures en matière de formation professionnelle, dont le droit individuel à la formation. Le compte personnel de formation est un bon dispositif, dont le contenu demande cependant à être précisé.
C’est lors de la seconde phase, quand il s’agira de préciser le mode opératoire, que les écueils bien connus auxquels nous sommes depuis longtemps confrontés en matière de formation vont resurgir. J’espère que les choses vont bien fonctionner, mais nous attendons tout de même avec impatience les textes visant à mettre ce dispositif en application.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Je vous rappelle, mon cher collègue, que le groupe GDR a voté en faveur des contrats de génération, qui résultaient d’un accord entre organisations patronales et de salariés.
M. André Chassaigne. Dominique Dord s’est fait plaisir, mais ses propos sont caricaturaux à l’excès. Contrairement à ce qu’il imagine, nous entretenons, sur le terrain, de nombreux liens avec les chefs d’entreprise et le milieu économique. La semaine dernière, je me suis ainsi fait une joie de me rendre dans une entreprise privée pour signer le premier contrat de génération de ma circonscription. Quand les dispositions vont dans le bon sens, nous ne nous contentons pas de les voter ; nous veillons aussi à ce qu’elles trouvent au plan local des relais efficaces, au bénéfice des personnes en attente d’emploi.
Avant tout, monsieur le rapporteur, je vous remercie pour la précision de votre réponse, qui permettra d’alimenter le débat en séance publique. Quant aux affirmations de Jean-Patrick Gille, nous les vérifierons auprès des organisations syndicales concernées.
Bien entendu, nous sommes favorables au principe même du compte personnel de formation. Mais deux raisons me conduisent à maintenir cet amendement de suppression.
Tout d’abord, au cours de mes deux mandats de député, j’ai souvent entendu mes collègues socialistes, alors dans l’opposition, exprimer leur méfiance à l’égard de dispositions pour lesquelles aucun financement n’est prévu. Elles risquent en effet de se traduire par un transfert de charges financières vers les collectivités territoriales, voire les associations – les missions locales, par exemple.
Ensuite, comme le disent les paysans auvergnats, il ne faut jamais acheter un âne dans un sac. Or c’est ce que j’aurais l’impression de faire en votant cet article.
M. Gérard Cherpion. J’ai du mal à comprendre la volonté d’André Chassaigne de supprimer une disposition qui répond à des besoins réels.
Le dispositif prévu par la loi – qui comprend déjà une première pierre : le droit individuel à la formation – est encore très insuffisant, il est vrai. D’ailleurs, lors de la dernière réunion du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, il n’a pas fait l’unanimité, y compris au sein des représentants des régions.
Par ailleurs, en matière d’orientation, les régions devraient jouer un rôle de coordination des institutions existantes.
Depuis très longtemps, nous travaillons en faveur de la création d’un compte de formation géré par le salarié dans un cadre défini par les partenaires sociaux. À cet égard, l’article 2 est intéressant. On pourrait le voter à condition qu’il fasse explicitement référence à une négociation interprofessionnelle, laquelle devrait se tenir dans un délai raisonnable – de six mois, par exemple.
M. Francis Vercamer. Bien entendu, l’UDI ne votera pas l’amendement, car nous sommes favorables au développement de la formation.
Nous proposons depuis longtemps la création d’un « chèque formation » dont le montant serait inversement proportionnel à l’importance de la formation initiale : cela permettrait aux personnes peu qualifiées de rattraper leur retard. À cet égard, on peut regretter de voir, dans ce texte, tous les salariés logés à la même enseigne, quel que soit leur degré de qualification.
Cela étant, le dispositif proposé constitue tout de même une avancée.
M. le rapporteur. Nous souhaitons également, monsieur Cherpion, qu’une négociation entre partenaires sociaux ait lieu le plus rapidement possible.
La Commission rejette l’amendement AS 130.
Elle examine ensuite l’amendement AS 209 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. L’État, les régions et les partenaires sociaux doivent engager une concertation sur le financement du compte personnel de formation avant le 1er janvier 2014. Tel est l’objet de cet amendement.
Par ailleurs, le groupe Écolo veillera à ce que ce compte soit aussi, pour les salariés, un outil permettant de quitter un secteur en perte d’emplois et de se réorienter vers une filière émergente. De ce point de vue, la région constitue un échelon essentiel.
M. le rapporteur. Je le répète, je suis favorable à l’idée de fixer un délai précis pour la négociation. Mais en l’occurrence, le 1er janvier 2014 me paraît une date trop éloignée. En outre, il convient de préciser ce qui se passera si la négociation n’aboutit pas : c’est un moyen d’exercer une – gentille – pression. Je proposerai, en vue de la séance publique, un amendement dans ce sens.
M. Christophe Cavard. Je m’en réjouis, et je retire donc celui-ci.
L’amendement AS 209 est retiré.
La Commission examine l’amendement AS 210 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Il s’agit de rétablir une disposition figurant à l’article 5 de l’accord du 11 janvier, mais qui a disparu dans le texte du projet de loi.
M. le rapporteur. Là encore, la date d’effet, le 1er janvier 2015, me semble trop éloignée. En outre, il paraît nécessaire de préciser ce que signifie l’accès étendu du compte de formation « aux personnes sorties du système de formation initiale sans qualification ». En effet, selon les termes de l’article 2, le compte est déjà accessible à tous. L’idée est en fait celle que défendait récemment le Président de la République : l’État abonderait les comptes des jeunes sortis précocement du système scolaire.
M. Christophe Cavard. Raccourcir le délai d’application ne peut qu’aller dans le bon sens. Mais je rappelle les termes de l’accord du 11 janvier : « Une personne sortie du système de formation initiale sans qualification peut bénéficier, avant son premier emploi, d’un compte personnel de formation pris en charge financièrement par les pouvoirs publics. » Or l’article 2 prévoit que le compte est créé au moment de l’entrée sur le marché du travail.
Mme Véronique Louwagie. La formulation de l’amendement me paraît restrictive. Il serait préférable d’écrire : « le compte de formation est étendu à tous, y compris les personnes sorties du système de formation initiale sans qualification ».
M. Jean-Patrick Gille. Les partenaires sociaux ont voulu d’abord se préoccuper des salariés du secteur privé, dont, d’une certaine façon, ils gèrent les intérêts. Mais pour être universel, le compte de formation devrait aussi concerner d’autres personnes, comme les salariés du public, voire les travailleurs indépendants. De même, s’il est d’abord destiné aux personnes ayant un emploi, l’idée se fait peu à peu jour que les « décrocheurs » et les personnes sans qualification devraient également pouvoir y accéder. Cela reviendrait soit à leur accorder un crédit avant même le premier emploi, soit à créditer leur compte d’un niveau plus important, ce qui ne peut, dans les deux cas, que relever de la puissance publique. Tel est le sens de l’alinéa cité par Christophe Cavard.
M. Francis Vercamer. Nous voterons l’amendement, car il rétablit une disposition présente dans l’accord du 11 janvier.
M. le rapporteur. Je le répète, une rédaction plus adéquate devrait opter pour une date plus proche et prévoir que l’État peut abonder un compte personnel de formation. Je demande donc le retrait de l’amendement.
M. Christophe Cavard. Je retire cet amendement et nous proposerons une nouvelle rédaction susceptible de recueillir l’unanimité.
L’amendement AS 210 est retiré.
La Commission examine l’amendement AS 55 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. Le conseil en évolution professionnelle doit viser prioritairement la qualification.
M. le rapporteur. C’est en effet son objectif. Mais le préciser ici serait redondant dans la mesure où le code du travail, un peu plus haut, rappelle que tout travailleur doit pouvoir progresser au cours de sa carrière d’au moins un niveau de qualification.
M. Jean-Patrick Gille. L’accord du 11 janvier ne précise pas si le conseil en évolution professionnelle doit servir à progresser dans sa carrière ou à changer de métier. L’amendement tendrait à privilégier le premier objectif, et en ce sens, j’y serais plutôt favorable. Mais le texte qu’il propose entre en contradiction avec le septième alinéa de l’article 2, en vertu duquel le conseil en évolution professionnelle doit permettre « d’identifier les offres d’emploi adaptées aux compétences du salarié ». En toute logique, il faudrait donc supprimer cette dernière phrase.
M. le rapporteur. Les propos de Jean-Patrick Gille nous placent devant un dilemme : faut-il, comme le groupe UMP nous l’enjoint, respecter strictement le texte de l’accord du 11 janvier ? L’article 16 précise en effet que le conseil en évolution professionnelle vise « l’évolution et la sécurisation professionnelle ». Mais la rédaction proposée par Francis Vercamer a l’avantage de donner une ambition accrue à ce nouveau conseil. J’y suis donc favorable.
M. Gérard Cherpion. Je voterai également l’amendement.
La Commission adopte l’amendement AS 55.
Elle examine ensuite l’amendement AS 56 de M. Francis Vercamer.
M. Arnaud Richard. L’amendement précise que l’accompagnement est notamment mis en œuvre, au niveau local, par les maisons de l’emploi, les missions locales, les plans locaux pour l’insertion et l’emploi – PLIE – et l’ensemble des institutions qui, au sein du service public de l’emploi, concourent à la formation professionnelle.
M. le rapporteur. C’est ce qu’affirme déjà le texte, puisque le service public de l’orientation, prévu à l’article L. 6111-3 du code du travail, inclut les missions locales, les maisons de l’emploi, les PLIE, les permanences d’accueil, d’information et d’orientation – PAIO –, etc. En outre, votre amendement cite certaines structures, mais pas toutes – je pense notamment à Pôle emploi ou Cap emploi – ce qui poserait un problème de lisibilité de la loi.
Mme Monique Iborra. Les différents organismes participant au service public de l’emploi forment un tel maquis que l’on ne sait plus qui fait quoi. Ce n’est pas Dominique Dord, président d’une mission d’information sur le sujet, qui me contredira sur ce point. Or le moins que l’on puisse dire est que cet amendement ne va pas dans le sens d’une clarification. Les maisons de l’emploi sont réparties inégalement sur le territoire, et les missions locales ont déjà beaucoup à faire. Leur confier le conseil en évolution professionnelle sans aucune concertation ni organisation au niveau national et régional risque d’alimenter la confusion.
Le mieux serait de définir précisément, dans le cadre de la loi sur la décentralisation, le périmètre du service public de l’orientation et celui du service public de l’emploi.
M. Jean-Patrick Gille. Soit l’amendement n’apporte pas grand-chose, soit il conduit implicitement à redéfinir le service public de l’orientation.
Une question se pose cependant au sujet du conseil en évolution professionnelle. Le fait que celui-ci soit porté par le service public signifie-t-il qu’il est proposé à titre gratuit, ou faudra-t-il débiter son compte personnel pour en bénéficier, comme semblent l’indiquer le texte de l’accord du 11 janvier et celui du projet de loi ?
M. Arnaud Richard. Je veux bien retirer l’amendement, mais la réaction de mes collègues montre qu’il pose un vrai problème dont nous devrons débattre soit dans l’hémicycle, soit lors de l’examen de la loi de décentralisation.
M. le rapporteur. Il me semble souhaitable de maintenir la définition actuelle du service public de l’emploi afin de pouvoir travailler sur une base claire dans le cadre de l’examen de la loi de décentralisation.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Je rappelle que notre commission sera saisie pour avis de ce projet de loi.
L’amendement AS 56 est retiré.
La Commission adopte l’article 2 modifié.
Article 3
(art. L. 1222-12 à L. 1222-15 [nouveaux] du code du travail)
Création d’une période de mobilité volontaire sécurisée
Le présent article vise à créer une période de mobilité volontaire sécurisée, nouveau droit individuel du salarié, qui doit lui permettre d’enrichir son parcours professionnel, par la découverte d’une autre entreprise, sans qu’il ne soit tenu de rompre son contrat de travail. Il constitue la déclinaison législative de l’article 7 de l’accord du 11 janvier.
I.- LES CONGÉS PERMETTANT AUJOURD’HUI
UNE MOBILITÉ EXTERNE DU SALARIÉ
Le code du travail prévoit aujourd’hui quatre congés à vocation professionnelle, offrant la possibilité aux salariés de quitter temporairement leur entreprise sans rompre leur contrat de travail. Il s’agit du congé sabbatique, du congé pour création ou reprise d’entreprise, du congé de solidarité internationale et du congé individuel de formation (CIF).
A. DES CONGÉS À OBJET VARIABLE, COURTS ET CONDITIONNÉS
Ces congés répondent à des objectifs professionnels variés mais précis, tels que la création ou la reprise d’entreprise, l’obtention d’un niveau de qualification supérieur dans le cas du congé individuel de formation, ou l’exercice d’une mission humanitaire à l’étranger pour le congé de solidarité internationale. Seul le congé sabbatique, congé pour convenances personnelles, permet au salarié de réaliser l’activité de son choix, qu’elle soit salariée ou non.
Ils présentent des durées très courtes : un an renouvelable au plus pour le congé de création ou reprise d’entreprise, un an pour le congé individuel de formation, onze mois pour le congé sabbatique et six mois pour le congé de solidarité internationale. Ces congés obéissent tous, de plus, à des conditions d’ancienneté dans l’entreprise plus ou moins longues, de trente-six mois pour le congé sabbatique à six mois pour le congé de solidarité internationale.
Certains ne peuvent être refusés au salarié dans les entreprises d’au moins 200 salariés, comme le congé sabbatique et le congé pour création ou reprise d’entreprise, mais l’employeur conserve la possibilité d’en différer le point de départ, dans une limite de six à neuf mois. En revanche, le congé de solidarité internationale et le congé individuel de formation ne sont pas de droit, et l’employeur peut en refuser le bénéfice au salarié, s’il estime, après avis des représentants du personnel, que son absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise. Le salarié peut, toutefois, saisir le conseil de prud’hommes pour contester cette décision.
Dans le cas du congé sabbatique, du congé pour création ou reprise d’entreprise et du congé de solidarité internationale, les représentants du personnel doivent, de plus, être informés chaque semestre des demandes formées par les salariés et de la suite qui leur a été donnée.
B. LE STATUT DU SALARIÉ PENDANT LA SUSPENSION DU CONTRAT
S’ils sont pris sous la forme d’un congé total, ces congés provoquent la suspension du contrat de travail. Le contrat n’étant pas rompu, le salarié demeure pris en compte pour le calcul des effectifs de l’entreprise d’origine et bénéficie, en cas de procédure de licenciement ou de transfert de société, des protections légales et conventionnelles. Il reste électeur et éligible aux élections professionnelles, et, le cas échéant, conserve ses mandats de représentant du personnel ou de délégué syndical. La durée du congé ne se trouve pas nécessairement, en revanche, prise en compte pour le calcul des droits à ancienneté du salarié. C’est le cas pour le congé individuel de formation et le congé de solidarité internationale, mais ni pour le congé sabbatique ni pour le congé de création ou reprise d’entreprise.
Selon les informations transmises par le ministère du travail, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas d’incidence sur l’affiliation aux régimes de protection sociale : le salarié demeure couvert par l’assurance maladie, dans son régime professionnel, pour les prestations en nature. S’agissant des prestations en espèces en cas de maladie, elles ne seront versées qu’en cas de perte de gains, c’est-à-dire uniquement si le salarié exerce une activité pour le compte d’un autre employeur.
À cet égard, le salarié ne se trouve pas dégagé de toute obligation envers son employeur. S’il peut effectivement, notamment dans le cadre du congé sabbatique, exercer une activité dans une autre entreprise, il doit respecter, selon la jurisprudence, une obligation de loyauté et de non-concurrence à l’égard de son employeur d’origine. Dans un arrêt du 30 mars 2005, la chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi jugé que « pendant les périodes de suspension de son contrat de travail, le salarié reste tenu envers son employeur d’une obligation de loyauté ».
C. LE RETOUR DU SALARIÉ DANS L’ENTREPRISE
À l’issue de ces différents congés, le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Il ne peut invoquer aucun droit de retour avant terme, de même que l’employeur ne peut le rappeler. Un accord peut, toutefois, intervenir entre les parties pour permettre un retour anticipé du salarié.
II.- LA CRÉATION D’UNE PÉRIODE DE MOBILITÉ VOLONTAIRE SÉCURISÉE
Le présent article propose de créer une période de mobilité volontaire sécurisée, en complément des congés aujourd’hui prévus par le code du travail, en s’inspirant des principes arrêtés par l’article 7 de l’accord du 11 janvier. Il crée, à cet effet, une nouvelle section dans le code du travail, comportant quatre articles.
A. LA NATURE ET L’OBJET DE LA PÉRIODE DE MOBILITÉ
Le nouvel article L. 1222-12 définit, tout d’abord, la nature de la période de mobilité volontaire sécurisée, qui constitue une suspension de l’exécution du contrat de travail, puis son objet : permettre au salarié « d’exercer une activité dans une autre entreprise ». Il peut s’agir de l’activité de son choix, à défaut de restriction. Ce nouvel article traduit donc fidèlement les dispositions de l’accord du 11 janvier, qui lui octroie cette même nature et lui assigne l’objectif de favoriser la découverte d’un métier, quel qu’il soit.
Par rapport aux congés existants, la période de mobilité offre donc la même liberté au salarié que le congé sabbatique, mais sans comporter de limitation de principe de sa durée, ce qui permet au salarié de pouvoir bénéficier d’une expérience suffisamment longue pour être professionnellement utile. Le nombre de mobilités que peut accomplir un salarié ne se trouve pas non plus limité.
B. LES CONDITIONS DU BÉNÉFICE DE LA PÉRIODE DE MOBILITÉ
Le nouvel article L. 1222-12 énonce, ensuite, les conditions d’accès à la période de mobilité, en reprenant celles déterminées par l’accord du 11 janvier.
S’agissant du champ du dispositif, la période de mobilité est ouverte aux salariés des entreprises et des groupes d’au moins 300 salariés. Cette condition n’est applicable qu’à l’entreprise d’origine, le salarié pouvant effectuer sa mobilité dans une entreprise de dimension inférieure. Pour prétendre à la période de mobilité, le salarié doit, de plus, justifier d’une ancienneté minimale de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, dans l’entreprise.
Si le salarié se trouve à l’initiative de la demande de mobilité, l’employeur ne pouvant la lui imposer, sa mise en œuvre est subordonnée à l’accord de ce dernier, sans qu’il ait à justifier d’un motif précis de refus, mais dans le respect des dispositions légales relatives aux discriminations par exemple.
Néanmoins, si l’employeur oppose deux refus successifs à la demande de mobilité, l’accès au congé individuel de formation sera alors de droit pour le salarié, sans que ne puissent lui être opposées ni les dispositions de l’article L. 6322-7, prévoyant le report de ce congé si 2 % des salariés sont déjà absents à ce titre, ni la durée d’ancienneté exigée. En revanche, l’employeur pourra en refuser le bénéfice au salarié, s’il estime, après avis des représentants du personnel, que son absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise. À cet égard, le nouvel article L. 1222-12 précise les stipulations de l’accord du 11 janvier qui indique que, après deux refus de l’employeur, le salarié jouit d’un « accès privilégié » au congé individuel de formation.
C. UNE SUSPENSION NÉGOCIÉE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La période de mobilité constitue une suspension négociée du contrat de travail, conformément aux dispositions de l’accord du 11 janvier, qui impose la définition de ses modalités par avenant.
Le nouvel article L. 1222-13 conditionne, donc, la mise en œuvre de la période de mobilité à la conclusion d’un avenant au contrat de travail, qui doit en déterminer « l’objet, la durée, la date de prise d’effet et le terme ». Les parties peuvent ainsi donner la forme de leur choix à la période de mobilité. D’un commun accord, elles peuvent en modifier les contours en complétant l’avenant, y compris en cours de mobilité, si, par exemple, le salarié souhaite prolonger son expérience ou changer d’entreprise d’accueil.
La période de mobilité entraînant la suspension du contrat de travail, les règles de droit commun s’appliquent en la matière.
Le salarié demeure inclus dans les effectifs de son entreprise d’origine, y reste électeur et éligible, y conserve ses mandats, bénéficie de la même protection en cas de licenciement économique ou de transfert de société, et demeure tenu d’une obligation de loyauté. Il ne perd, en aucun cas, ses droits accumulés à congé payé, qu’il peut prendre avant son départ en mobilité, percevoir sous forme d’une indemnité compensatrice, ou reporter s’il le souhaite avec l’accord de l’employeur. Si l’avenant le prévoit, la durée de la mobilité peut être prise en compte pour le calcul de son ancienneté.
S’il en remplit les conditions légales, le salarié se trouve également décompté dans les effectifs de l’entreprise d’accueil, y devient électeur et éligible, et peut acquérir un mandat représentatif. La convention collective lui est applicable, ainsi que les protections en cas de licenciement ou de transfert d’entreprise. Il est, de plus, assujetti au régime de sécurité sociale dont dépend cette entreprise.
D. LES MODALITÉS DE RETOUR DU SALARIÉ
Les modalités de retour du salarié proposées par le présent article correspondent aux orientations arrêtées par l’accord du 11 janvier, qu’il s’agisse de la cessation de la mobilité avant ou au terme fixé par l’avenant et du droit de retrouver son emploi.
● Les conditions d’un retour anticipé
Le nouvel article L. 1222-13 dispose que l’avenant doit prévoir « les situations et modalités d’un retour anticipé du salarié ». Il peut, par exemple, mettre en place une période probatoire, au terme de laquelle le salarié peut revenir dans son entreprise, si la mobilité ne lui convient pas.
Ce retour anticipé « reste dans tous les cas possible à tout moment avec l’accord de l’employeur ». En dehors des cas visés par l’avenant, si le salarié cesse sa période de mobilité avant terme, il ne bénéficie donc pas d’un droit de retour automatique, mais doit obtenir l’accord de l’employeur. À l’inverse, l’employeur ne peut imposer au salarié un retour avant terme. À cet égard, le régime de la période de mobilité apparaît similaire à celui des congés existants aujourd’hui.
Le régime du retour anticipé retenu par ce nouvel article semble donc plus protecteur du salarié, que celui envisagé par l’accord du 11 janvier, qui stipule que l’avenant « peut » en prévoir les modalités, le retour anticipé du salarié n’intervenant sinon « que du commun accord des parties ». En effet, le nouvel article impose la fixation des conditions de retour anticipé dans l’avenant, avant le départ du salarié en mobilité, afin de sécuriser la situation de ce dernier.
S’agissant des droits éventuels du salarié et de l’assurance chômage, la question de leur ouverture relève de la négociation relative à la convention Unédic, mais votre rapporteur s’interroge sur la nécessité d’habiliter les partenaires sociaux à négocier sur cette question.
● Le droit de retrouver son emploi
Le nouvel article L. 1222-14 indique, ensuite, qu’« à son retour dans l’entreprise d’origine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une qualification et d’une rémunération au moins équivalentes ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification ».
Cette garantie de retrouver son emploi ou un emploi similaire s’applique au retour du salarié tant au terme de la période de mobilité que de manière anticipée. Si l’employeur ne la respecte pas, le salarié pourra agir devant le conseil de prud’hommes. Par ailleurs, dans le cas où le salarié serait réintégré sur un emploi similaire, il ne perdra le bénéfice personnel de sa classification, si cet emploi correspond à une classification inférieure.
● La possibilité de ne pas réintégrer l’entreprise
Au terme de la période de mobilité, le salarié peut décider de ne pas reprendre son poste dans son entreprise d’origine.
Le nouvel article L. 1222-13 impose, à cet égard, que l’avenant fixe « le délai dans lequel le salarié doit informer par écrit l’employeur de son choix éventuel de ne pas réintégrer l’entreprise ». Ce délai de prévenance doit être respecté par le salarié.
Le nouvel article L. 1222-15 prévoit alors que « le contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu » et que « cette rupture constitue une démission qui n’est soumise à aucun préavis autre que celui prévu par l’avenant », les conditions de droit commun s’appliquant pour le reste. En revanche, si le salarié choisit de démissionner avant le terme de la période de mobilité, le préavis doit, en principe, être exécuté, mais les parties peuvent en convenir autrement.
*
* *
Lors de son examen du projet de loi, votre commission a adopté les principales modifications suivantes au texte de l’article 3 :
Afin d’assurer l’information des représentants du personnel sur la mise en œuvre des périodes de mobilité volontaire sécurisée dans l’entreprise, votre commission a adopté un amendement du rapporteur imposant à l’employeur de communiquer semestriellement au comité d’entreprise la liste des demandes de périodes de mobilité avec l’indication de la suite qui leur a été donnée.
Votre commission a, ensuite, choisi d’encadrer davantage les conditions de retour anticipé du salarié, en adoptant un amendement du rapporteur prévoyant que, dans tous les cas, celui-ci doit « intervenir dans un délai raisonnable ».
*
La Commission est saisie de l’amendement AS 131 de Mme Jacqueline Fraysse tendant à supprimer l’article 3.
M. André Chassaigne. Ce n’est pas par crispation idéologique que nous souhaitons supprimer l’article 3 – encore que ! – ; c’est parce que le système proposé, la mobilité volontaire sécurisée, nous semble en retrait par rapport aux dispositions existantes du code du travail.
En effet, un salarié peut aujourd’hui demander un congé sabbatique d’une durée maximale de onze mois, congé que l’employeur, après deux refus, est obligé d’accepter. Il en résulte une suspension du contrat de travail et de ses obligations, même si le salarié est soumis, pendant son congé, à un devoir de loyauté à l’égard de son employeur.
À la différence du congé sabbatique, ouvert à tous, l’accès à la mobilité volontaire sécurisée est restreint, puisque celle-ci ne concerne que les entreprises de plus de 300 salariés. En outre, après deux refus successifs, l’employeur n’est pas contraint d’accepter la mobilité ; la seule conséquence est un accès de droit, pour le salarié, au congé individuel de formation.
Bien sûr, la mobilité volontaire sécurisée n’a pas le même objectif que le congé sabbatique, puisqu’elle vise à exercer une activité dans une autre entreprise. On comprend l’intention : permettre à un salarié d’exercer un autre emploi lorsque son entreprise subit une baisse d’activité. Nous aurons l’occasion d’y revenir en séance publique.
Pour autant, monsieur le rapporteur, l’article 3, dans son état actuel, appelle indiscutablement des éclaircissements de votre part.
M. le rapporteur. En plus des mobilités volontaires non sécurisées qui existent déjà, l’article 3 vise à créer un nouveau droit assorti de protections. Il permettra au salarié d’aller travailler dans une entreprise en suspendant son contrat de travail, tout en bénéficiant, sous certaines conditions, d’un droit au retour.
Il faut avoir travaillé trente-six mois dans une entreprise pour bénéficier d’un congé sabbatique, qui ne peut dépasser onze mois – ce qui est peu, puisqu’il faut généralement deux ans pour réussir une expérience professionnelle nouvelle. Le dispositif que nous proposons est plus protecteur. Veillons toutefois à ne pas l’assortir de contraintes qui dissuaderaient les entreprises d’y recourir. L’équilibre que nous avons trouvé me semble acceptable.
Restent à régler deux problèmes qui se poseront en cas de rupture involontaire avec l’entreprise d’accueil.
Le premier concerne le délai du retour dans l’entreprise de départ. Par amendement, nous avons proposé de le fixer à six mois, mais on nous a répondu que c’était à la fois trop court et trop long, une entreprise d’une certaine taille étant capable d’assurer un retour en trois mois, tandis qu’une PME aurait besoin de plus de temps. Peut-être faut-il orienter le dispositif sans l’insérer dans un délai.
Le second problème concerne le droit à l’assurance chômage durant cette période. Les partenaires sociaux avec lesquels nous avons discuté ont l’intention, lors de la révision de la convention d’assurance chômage, d’ouvrir ce droit aux salariés qui n’en bénéficient plus, dès lors que leur contrat de travail avec l’entreprise de départ a été suspendu.
M. Denys Robiliard. Sur au moins deux points, la mobilité volontaire sécurisée diffère du congé sabbatique ou du congé pour création ou reprise d’entreprise : sa durée n’est pas fixée, et elle offre au salarié la possibilité de réintégrer l’entreprise d’origine de façon anticipée.
M. Dominique Dord. Contrairement à André Chassaigne, je considère que l’article repose sur une idée intéressante, tant pour une entreprise qui connaîtrait une baisse d’activité provisoire que pour un salarié qui voudrait prendre l’initiative d’une mobilité. Nous ne voyons aucune raison de nous y opposer, pour peu que les modalités d’application nous donnent satisfaction. Nous examinerons donc l’avenant avec attention.
M. Gérard Cherpion. On ne peut pas comparer la mobilité volontaire sécurisée au congé sabbatique dont il est question aux articles L. 3141-91 à L. 3141-104 du code du travail. Pour bénéficier d’un congé sabbatique, le salarié doit avoir acquis une certaine ancienneté et vouloir réaliser un projet personnel. Par ailleurs, la durée de ce congé est comprise entre six et onze mois. Le système proposé n’est pas encadré de la même manière. En outre, il présente un intérêt pour toutes les entreprises qui connaîtraient des difficultés momentanées. C’est pourquoi je ne voterai pas l’amendement.
Mme Véronique Louwagie. L’article 3 propose une disposition qui s’ajoutera au congé sabbatique. Ce sera une véritable opportunité pour les salariés qui voudraient changer de parcours, d’entreprise, d’emploi ou de statut, ce qui n’est jamais facile. Je ne comprends donc pas pourquoi certains veulent supprimer un tel dispositif. On peut tout au plus vouloir l’encadrer, par exemple en augmentant le seuil à partir duquel il s’appliquera, tant il sera difficile à mettre en œuvre pour les entreprises dont l’effectif n’est pas considérable.
M. Jean-Charles Taugourdeau. On nous a souvent signalé que les seuils sociaux ou fiscaux constituaient un obstacle à la compétitivité. Ce sont des obstacles à franchir, ce qui explique la pénurie d’entreprises de taille intermédiaire. Je vous proposerai donc de modifier par amendement le seuil de 300 salariés prévu par cet article.
La Commission rejette l’amendement AS 131.
La Commission examine l’amendement AS 5 de M. Jean-Charles Taugourdeau.
M. Jean-Charles Taugourdeau. Je présenterai tout d’abord l’amendement AS 5, qui tend à supprimer toute notion de seuil et à appliquer le dispositif à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Les seuils, fiscaux ou sociaux, sont à la source des problèmes de compétitivité des entreprises. J’observe du reste que ce sont là des contraintes imposées aux entreprises, mais pas aux collectivités.
M. le rapporteur. Le seuil de 300 salariés ne crée pas de contrainte supplémentaire et répond à la préoccupation d’assurer le droit au retour. Plus l’entreprise est petite, plus il est difficile de retrouver un poste et, sous ce seuil, la mobilité ne fonctionnerait pas bien. Rien n’empêche cependant d’utiliser d’autres dispositifs dans les entreprises de petite taille Avis défavorable, donc.
La Commission rejette cet amendement AS 5.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 6 de M. Jean-Charles Taugourdeau.
M. Jean-Charles Taugourdeau. L’amendement AS 6 propose de fixer le seuil à 10 salariés. Sa fixation par le projet de loi à 300 salariés montre bien que l’accord du 11 janvier est destiné aux grosses entreprises – et, de fait, le retour du salarié en mobilité est difficile à envisager dans une entreprise de moins de 10 salariés.
Comme le précédent et comme les quatre prochains que je présenterai rapidement, cet amendement vise à mettre en lumière l’absurdité de ces seuils. Lors de l’examen du texte en séance publique, la semaine prochaine, je prendrai le temps d’exposer en détail l’ensemble de ces amendements.
M. le rapporteur. À l’article 17, vous pourrez vous féliciter du lissage du seuil pour la mise en place des instances représentative du personnel. Avis défavorable pour les mêmes raisons que précédemment.
La Commission rejette l’amendement AS 6.
Elle examine alors l’amendement AS 7 de M. Jean-Charles Taugourdeau.
M. Jean-Charles Taugourdeau. L’article 18 évoque les entreprises de plus de 1 000 salariés. L’amendement AS 7 se limite à proposer un seuil de 20 salariés.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement AS 7.
Puis elle rejette successivement, sur avis défavorable du rapporteur, les amendements AS 8, AS 9 et AS 10 de M. Jean-Charles Taugourdeau.
Elle est saisie de l’amendement AS 211 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. L’amendement tend à encadrer la disposition de mobilité externe par un accord d’entreprise.
M. le rapporteur. Le dispositif est déjà encadré par la loi, qui est plus protectrice qu’un accord d’entreprise. Avis défavorable.
M. Christophe Cavard. Il s’agit d’éviter que certaines entreprises puissent exercer des pressions pour utiliser le dispositif comme un moyen de gestion des ressources humaines.
Mme Véronique Louwagie. Pourquoi recourir à un accord d’entreprise pour des décisions à caractère individuel ? Un tel dispositif serait plus réducteur et dommageable aux salariés.
M. Denys Robiliard. Je souscris à l’analyse de Véronique Louwagie.
La Commission rejette l’amendement AS 211.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS 389 du rapporteur.
Puis elle est saisie des amendements AS 294 du rapporteur et AS 246 de M. Denys Robiliard, pouvant faire l’objet d’une discussion commune.
M. le rapporteur. L’amendement AS 294 vise à sécuriser encore la mobilité en évitant notamment que des salariés ayant choisi la mobilité ne subissent, si cette dernière ne se passe pas bien, plusieurs mois de suspension de contrat de travail. La notion de « délai raisonnable » introduite par l’amendement peut avoir un sens différent selon la taille de l’entreprise. Elle signifie en tout cas que le délai sera défini au plus près du terrain, au besoin sous le contrôle du juge.
M. Denys Robiliard. Je retire l’amendement AS 246, qui a le même objet.
M. Hervé Morin. L’amendement se borne à répéter la jurisprudence de la Cour de cassation, qui repose sur les notions de bonne foi et de délai raisonnable.
Mme Véronique Louwagie. La notion de « délai raisonnable » est très imprécise. De quel délai s’agit-il ?
M. Dominique Dord. Cet amendement est à double tranchant, car il est susceptible d’une lecture moins favorable pour le salarié si celui-ci a fait le choix de s’éloigner de l’entreprise.
M. Gérard Cherpion. L’expression « délai raisonnable » n’a guère de signification juridique. Par ailleurs, l’article L. 1222-12 dispose que le contrat de travail est suspendu pendant le temps où le salarié exerce une activité dans une autre entreprise : comment suspendre un contrat tout en appliquant l’avenant à ce contrat organisant la mobilité ?
M. le rapporteur. C’est précisément là le problème que nous nous efforçons de résoudre. L’amendement prescrit que l’employeur doit faire tout son possible pour réduire le délai et il revient au juge, le cas échéant, de déterminer si ce délai est « raisonnable ». La mobilité étant organisée par la loi, il faut donc qualifier ce qui est admissible dans les clauses contractuelles. Il est en tout cas contradictoire de nous reprocher à la fois l’imprécision de l’expression et le fait qu’elle figure déjà dans la jurisprudence.
M. Hervé Morin. Il n’est pas exact de présenter la notion de délai raisonnable comme dépendant de la taille de l’entreprise, car ce délai peut s’apprécier différemment pour certaines fonctions très précises dans de grands groupes – il est plus facile de retrouver un poste pour un cariste que pour un ingénieur. La notion de délai raisonnable repose donc aussi sur des éléments économiques et sur les fonctions. Ne compliquez pas une mobilité qui sera déjà assez difficile à mettre en œuvre.
M. le rapporteur. La rédaction proposée permettra aux parties de juger cas par cas, selon que le replacement sera plus ou moins facile, s’il est « raisonnable » de fixer des délais plus longs. Si nous convenons ici que l’employeur doit réduire au maximum les délais, nos débats éclaireront l’application du dispositif sur le terrain.
M. Denys Robiliard. Le contrat de travail est suspendu durant la période de mobilité volontaire sécurisée, et non pas durant la période d’activité du salarié dans l’autre entreprise – car, si tel était le cas, l’employeur aurait obligation de reprendre le salarié dès que l’autre emploi prendrait fin, ce qui pourrait se révéler difficile.
Par ailleurs, il s’agit ici de préciser ce qui doit figurer dans l’avenant organisant la période de mobilité volontaire sécurisée. Le délai raisonnable pourra être adapté en fonction de la nature de l’entreprise et du poste, et cela sous le contrôle du juge. Cette notion, qui figure dans la Convention européenne des droits de l’homme, est bien connue et s’applique déjà en France.
La Commission adopte l’amendement AS 294.
L’amendement AS 246 est retiré.
La Commission est alors saisie de l’amendement AS 181 de Mme Jacqueline Fraysse.
M. André Chassaigne. L’amendement vise à donner des garanties supplémentaires au salarié en cas de perte involontaire d’emploi dans l’entreprise d’accueil.
M. le rapporteur. L’amendement AS 294 qui vient d’être adopté répond à cette préoccupation. Avis défavorable.
M. André Chassaigne. Je retire donc l’amendement, tout en me réservant de le présenter à nouveau, si besoin, après avoir analysé plus précisément l’amendement AS 294.
L’amendement AS 181 est retiré.
La Commission examine alors l’amendement AS 128 de M. Thierry Braillard.
M. Jean-Noël Carpentier. L’amendement tend à faciliter le retour du salarié au terme de la période de mobilité volontaire, en particulier en cas de rupture de contrat.
M. le rapporteur. Cet amendement risque de réduire la protection du salarié.
M. Jean-Noël Carpentier. Je retire donc cet amendement afin de pouvoir en préciser l’exposé des motifs.
L’amendement AS 128 est retiré.
Puis la Commission est saisie de l’amendement AS 182 de Mme Jacqueline Fraysse.
M. André Chassaigne. Cet amendement tend à éviter des dérives. Une mobilité volontaire sécurisée pourrait en effet être suggérée à un ou plusieurs salariés en anticipation de suppressions de postes, afin d’éviter à l’employeur de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). De nombreuses ruptures conventionnelles du contrat de travail sont en effet un habillage permettant d’éviter les mesures accompagnant des licenciements pour motif économique.
La Cour de cassation a déjà rappelé à l’ordre des entreprises qui utilisaient le plan de départ volontaire pour tenter d’échapper à leur obligation de mettre en place un plan de reclassement alors que des suppressions de poste étaient prévues.
Si un plan de sauvegarde de l’emploi est mis en place durant la période de mobilité volontaire sécurisée, le salarié, même s’il choisit de ne pas revenir à l’issue de sa période de mobilité, doit pouvoir bénéficier des mesures du plan, car sa mobilité évitera à l’entreprise de rechercher des solutions de reclassement interne ou externe.
M. le rapporteur. Cet amendement est superfétatoire.
L’amendement AS 182 est retiré.
La Commission examine l’amendement AS 247 de M. Michel Lefait.
M. Denys Robiliard. Cet amendement vise à préciser que le salarié peut faire connaître sa décision à l’employeur à tout moment au cours de sa mobilité.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 247.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 148 de Mme Jacqueline Fraysse.
M. André Chassaigne. Il s’agit là encore d’apporter une garantie supplémentaire au salarié.
M. le rapporteur. Votre amendement est totalement contraire au dispositif qui a été négocié par les partenaires sociaux puisque, par principe, la rupture du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnité en cas de réussite de la mobilité. Si on adoptait votre proposition, nul employeur ne recourrait à la mobilité sécurisée et les salariés en mobilité ne bénéficieraient d’aucune protection.
M. André Chassaigne. Votre argumentation serait valable si la mobilité sécurisée était toujours le choix du salarié. Or c’est bien mal connaître le monde de l’entreprise que d’ignorer que certaines mobilités « volontaires » seront en réalité imposées par l’employeur.
M. Dominique Dord. Je partage évidemment entièrement l’analyse du rapporteur : il serait complètement absurde de verser des indemnités de licenciement à un salarié qui choisit de ne pas réintégrer son entreprise d’origine. Le monde de l’entreprise a un peu changé depuis la dernière fois que vous y avez mis les pieds, monsieur Chassaigne.
M. Jean-Charles Taugourdeau. On croirait à vous entendre, monsieur Chassaigne, que les chefs d’entreprise sont animés des pires intentions à l’égard de leurs salariés. Pourtant, la meilleure façon de sécuriser l’emploi d’un salarié, c’est de faire en sorte qu’il ait toujours du travail.
M. André Chassaigne. Mes propos ne sont pas une mise en cause de l’ensemble du patronat : je connais moi aussi des chefs d’entreprise dont le comportement envers leurs salariés est conforme à l’éthique. Vous ne pouvez pas nier cependant que certains salariés se retrouvent dans des situations inacceptables : il vous arrive tout autant qu’à moi de voir dans votre permanence des salariés victimes d’un licenciement abusif. Il ne s’agit pas de diaboliser qui que ce soit : mon seul objectif est de poser des garde-fous pour protéger les salariés des dérives auxquelles ce texte est susceptible de donner lieu.
M. Gérard Cherpion. Cet article instituant une mobilité volontaire sécurisée, et en particulier son neuvième alinéa, est la transcription pure et simple de la volonté des signataires de l’accord du 11 janvier. Je ne nie pas que ce texte puisse donner lieu à des dérives, d’un côté comme de l’autre, mais nous légiférons en général, et non pour les cas particuliers.
M. le rapporteur. Le parti socialiste aussi connaît le monde de l’entreprise. Nous ne sommes pas des « bisounours » : de même que deux tiers des salariés ayant signé une rupture conventionnelle ne souhaitaient pas quitter leur entreprise, il est probable que certaines mobilités « volontaires » seront en réalité imposées. De telles mobilités sont déjà organisées dans les grandes entreprises, chez France Télécom par exemple. L’objectif de cet article de loi est de les encadrer en précisant leurs modalités, telles que les conditions du retour du salarié dans son entreprise d’origine. Par ailleurs, mon amendement AS 295, que nous allons examiner bientôt, vise à permettre aux représentants du personnel de vérifier la réalité du volontariat en instaurant une information semestrielle du comité d’entreprise sur les mobilités volontaires au sein de l’entreprise.
Ce débat a déjà opposé les syndicats signataires de l’accord à ceux qui ont refusé de le signer. Je n’accepte pas qu’on puisse dire d’un accord signé par le deuxième syndicat de salariés de ce pays est un accord du MEDEF, de même que je refuse toute caricature des positions de la CGT. Notre rôle de parlementaires est de dépasser ce débat en proposant des solutions concrètes qui protègent les salariés sans entraver le fonctionnement des entreprises.
La Commission rejette l’amendement AS 148.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS 390 du rapporteur.
La Commission est saisie de l’amendement AS 295 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement a été défendu à l’instant.
La Commission adopte l’amendement AS 295.
La Commission adopte ensuite l’article 3 modifié.
Article 4
(art. L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-7-1 à L. 2323-7-3 [nouveaux], L. 2325-35, L. 2325-42-1 [nouveau], L. 2332-1, L. 2323-26-1 à L. 2323-26-3 [nouveaux], L. 2313-7-1 [nouveau], L. 4616-1 à L. 4616-5 [nouveaux], et L. 4614-3 du code du travail)
Réforme des règles de consultation et de recours à l’expertise
des institutions représentatives du personnel
Le présent article porte réforme des règles de consultation et de recours à l’expertise des institutions représentatives du personnel. Il renforce, tout d’abord, leurs pouvoirs, en créant deux nouvelles consultations relatives aux orientations stratégiques et à l’utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), et en imposant aux entreprises l’élaboration d’une base de données unique qui leur est accessible.
Il aménage, ensuite, la procédure de consultation du comité d’entreprise, puis encadre les délais de mission des experts. Enfin, il ouvre la possibilité de mettre en place une instance temporaire de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), chargée de réaliser une expertise unifiée en cas de projet concernant plusieurs établissements.
Il constitue la déclinaison législative de l’article 12 de l’accord du 11 janvier.
I.- LA CRÉATION DE DEUX NOUVELLES CONSULTATIONS
DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Le présent article crée, tout d’abord, deux nouvelles obligations de consultation des représentants du personnel. La première porte sur les orientations stratégiques de l’entreprise et vise le comité d’entreprise. La seconde traite de l’utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) et s’applique à la fois au comité d’entreprise et aux délégués du personnel.
A. LA CONSULTATION SUR LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Malgré des attributions économiques développées, le comité d’entreprise ne dispose pas actuellement d’un pouvoir de consultation sur la stratégie de l’entreprise. La nouvelle obligation proposée complétera donc utilement ses prérogatives.
1. L’absence de consultation propre à la stratégie de l’entreprise
Le comité d’entreprise jouit, aujourd’hui d’attributions consultatives variées en matière économique, périodiques ou ponctuelles. D’une manière générale, l’employeur est tenu de le consulter sur toute question intéressant la marche de l’entreprise, notamment s’il s’agit de mesures affectant le volume des emplois. Il doit également, chaque année, lui communiquer les documents comptables et financiers de l’entreprise, avant de les présenter à l’organe de gouvernance, et l’informer sur la situation économique de la société et ses perspectives. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, cette information donne lieu à un avis.
Si, à travers ces informations et consultations, le comité d’entreprise se trouve conduit à débattre de la stratégie de l’entreprise, celle-ci ne donne pas lieu, en soi, à un avis du comité, qui lui permette, en particulier, de formuler des propositions alternatives.
Face à ce constat, le présent article vise à étendre les attributions du comité d’entreprise, afin de l’associer pleinement au processus de définition des orientations stratégiques des sociétés. À cet effet, le III crée un nouvel article L. 2323-71, qui impose la consultation annuelle du comité d’entreprise sur ces orientations.
2. Le champ et les modalités de la consultation
Le nouvel article L. 2323-71 précise, tout d’abord, le champ de cette consultation, qui doit porter sur :
– les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de son administration ou de sa surveillance ;
– leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, le recours à la sous-traitance, à l’intérim et à des contrats temporaires.
Il offre, ensuite, au comité d’entreprise, un pouvoir de proposition renforcé. Celui-ci émet un avis sur les orientations présentées par l’employeur, et peut présenter des options alternatives. L’avis du comité doit être transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de la société, qui arrête alors définitivement ces orientations. Le comité se voit communiquer cette délibération. En vertu des règles générales de consultation du comité d’entreprise, l’employeur doit apporter une réponse motivée à cet avis.
Pour préparer la consultation sur les orientations stratégiques et ses éventuelles propositions alternatives, le comité d’entreprise pourra, de plus, s’appuyer sur la nouvelle base de données unique, décrite ci-dessous.
Le VI du présent article impose, par ailleurs, la transmission au comité de groupe, des différents avis rendu dans le cadre de cette nouvelle consultation, en complétant l’article L. 2332-1 par un alinéa en ce sens.
3. Une traduction fidèle de l’accord national interprofessionnel
Le champ et les modalités de consultation retenus par le nouvel article traduisent donc fidèlement les dispositions de l’accord du 11 janvier. Celui-ci stipule, en effet, que cette consultation doit permettre :
– une présentation pédagogique par l’employeur des options stratégiques possibles et de ses conséquences en termes d’évolution de l’activité, des métiers impactés, des compétences requises, de l’emploi, du recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires ou à de nouveaux partenariats ;
– un débat entre l’employeur et les représentants du personnel sur les perspectives présentées ;
– un avis des représentants du personnel, commentant les options proposées et formulant, le cas échéant, une option alternative ;
– une réponse argumentée de l’employeur à cet avis ;
– la transmission de cet avis au conseil d’administration, qui en délibère, puis la communication de cette délibération au comité d’entreprise.
4. Une faculté supplémentaire de recours à l’expertise
Le nouvel article L. 2323-71 offre, enfin, la faculté au comité de recourir à l’assistance d’un expert-comptable, en vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise. Il s’agit d’un nouveau droit du comité. Conformément aux stipulations de l’accord du 11 janvier, le financement de ce nouveau cas de recours fait l’objet d’une répartition entre l’employeur et le comité d’entreprise, qui y contribue à hauteur de 20 % sur son budget de fonctionnement. Toutefois, un accord entre l’employeur et la majorité des membres élus du comité peut en décider autrement.
Le 1° du V opère une mesure de coordination pour ajouter ce nouveau cas de recours à la liste des cas de recours prévue à l’article L. 2325-35.
B. LA CONSULTATION SUR LE CRÉDIT D’IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI
Poursuivant le renforcement des attributions des représentants du personnel, le présent article instaure une deuxième consultation obligatoire, portant sur l’utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE). À cette fin, le VII crée un nouveau paragraphe du code du travail comportant trois articles.
1. Les modalités de consultation du comité d’entreprise
Le nouvel article L. 2323-26-1 définit les modalités de cette consultation. Il impose, en préalable, à l’employeur de retracer dans la base de données unique les sommes reçues par l’entreprise au titre du crédit d’impôt compétitivité emploi. Il précise, ensuite, que le comité d’entreprise doit être informé et consulté sur leur utilisation avant le 1er juillet de chaque année. Il ouvre, enfin, la possibilité de joindre cette consultation, à celle sur les orientations stratégiques, pour une présentation globale de la situation de l’entreprise.
2. Le pouvoir de contrôle et d’alerte du comité d’entreprise
Au titre de ce droit de regard, les nouveaux articles L. 2323-26-2 et L. 2323-26-3 accordent au comité d’entreprise un pouvoir de contrôle et d’alerte, qui se déroule en deux temps.
● La demande d’explications et le rapport du comité
Dans un premier temps, lorsque le comité d’entreprise constate que tout ou partie du crédit d’impôt n’a pas été utilisé conformément aux prescriptions légales, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications. En effet, l’article 244 quater C du code général des impôts assigne des finalités précises à ce crédit d’impôt, à savoir financer l’amélioration de la compétitivité, au travers d’efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution du fonds de roulement.
La demande d’explication est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité. Si ce dernier n’obtient pas de réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci confirme l’utilisation non conforme du crédit, il établit un rapport, qui doit être transmis à l’employeur et au comité de suivi régional du crédit d’impôt, qui adresse, à son tour, une synthèse annuelle au comité national de suivi.
● La saisine de l’organe de gouvernance
Dans un second temps, au vu de ce rapport, le comité peut décider, à la majorité des membres présents, de saisir de ses conclusions le conseil d’administration ou de surveillance dans les sociétés qui en sont dotées, ou d’en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d’intérêt économique.
Dans les sociétés pourvues d’un conseil d’administration ou de surveillance, la demande d’explication sur l’utilisation du crédit d’impôt est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance de l’instance. La réponse de l’employeur doit être motivée et adressée au comité d’entreprise. Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d’intérêt économique, lorsque le comité d’entreprise a décidé d’informer les associés ou les membres de l’utilisation du crédit d’impôt, le gérant ou les administrateurs leur communiquent son rapport.
3. Une obligation applicable aux délégués du personnel
S’agissant d’un dispositif de soutien ouvert à toutes les entreprises, le présent article étend l’obligation de consultation sur l’utilisation du crédit d’impôt aux délégués du personnel. À cette fin, le VIII crée un nouvel article L. 2313-7-1 qui prévoit que, dans les entreprises de moins de 50 salariés, les délégués du personnel sont informés et consultés sur les conditions d’utilisation du crédit d’impôt dans les mêmes conditions et avec les mêmes pouvoirs que le comité d’entreprise.
4. L’évaluation du droit de saisine des représentants
Afin de mesurer l’impact de ce nouveau droit des représentants du personnel, le IX du présent article impose au Gouvernement de présenter au Parlement, avant le 31 décembre 2016, un rapport sur la mise en œuvre de l’exercice du droit de saisine des comités d’entreprise et des délégués du personnel sur l’utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi.
II.- LA MISE EN PLACE D’UNE BASE DE DONNÉES UNIQUE
Pour permettre le plein déploiement des nouvelles obligations de consultation, le présent article impose la mise en place d’une base de données unique sur l’entreprise, ayant vocation à leur servir de support. À cet effet, le III crée deux nouveaux articles qui définissent le contenu de la base de données, ses conditions d’accès, et son articulation avec les obligations de transmission de documents.
A. LE CONTENU DE LA BASE DE DONNÉES UNIQUE
Le nouvel article L. 2323-7-2 détermine, tout d’abord, le contenu de la base de données unique, dont les informations doivent porter sur les thèmes suivants : l’investissement social, matériel et immatériel, les fonds propres et l’endettement, les rétributions des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l’entreprise, notamment les aides publiques et les crédits d’impôts, la sous-traitance, et, le cas échéant, les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. Le nouvel article retient donc les mêmes thèmes que l’accord du 11 janvier.
À l’initiative des commissaires du groupe socialiste et du rapporteur, votre commission a remplacé le terme « rétributions », par l’expression « l’ensemble des éléments de la rémunération » des salariés et des dirigeants, afin de garantir l’exhaustivité des informations mises à disposition dans la base.
S’agissant de la définition du contenu même des informations, il prévoit qu’elle est arrêtée par décret en Conseil d’État et peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés. De plus, un accord de branche, de groupe ou d’entreprise peut l’adapter en fonction de l’organisation et du domaine d’activité de la société. Ces dispositions relatives à la modulation du contenu de la base reflètent, également, les stipulations de l’accord du 11 janvier.
En revanche, le cadre temporel de six ans retenu par le nouvel article apparaît plus ambitieux que celui de trois ans envisagé par l’accord. Il impose, ainsi, que les informations contenues dans la base portent sur l’année en cours, les deux années précédentes et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. L’employeur a, en outre, l’obligation de mettre régulièrement ces données à jour.
B. L’ACCÈS À LA BASE DE DONNÉES UNIQUE
Le nouvel article L. 2323-7-2 définit, ensuite, les conditions d’accès à la base de données unique. Celle-ci doit être accessible, en permanence, aux membres du comité d’entreprise, du comité central d’entreprise et aux délégués syndicaux. En contrepartie, ceux-ci sont tenus d’une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
Le nouvel article reprend donc les dispositions de l’actuel article L. 2325-5, qui prévoit que, de manière générale, les membres du comité d’entreprise et les représentants syndicaux sont soumis à une obligation de discrétion à l’égard de cette catégorie d’informations.
C. L’ARTICULATION AVEC LES OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DE DOCUMENTS
Le nouvel article L. 2323-7-3 organise l’articulation de la création de la base de données unique, avec les obligations actuelles de transmission d’informations de l’employeur. Il énonce ainsi que les éléments d’information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au comité d’entreprise, doivent être mis à sa disposition dans la base de données. Cette mise à disposition vaut communication des documents au comité, dans des conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’État. S’agissant des rapports et informations liés à une consultation ponctuelle, ils devront continuer d’être envoyés au-delà de leur intégration à la base.
Ces règles correspondent à celles fixées par l’accord du 11 janvier, qui stipule que l’insertion des informations à la base de données se substitue à la transmission des rapports, sans remettre en cause les attributions des représentants du personnel.
D. L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF
Le IV du présent article prévoit, enfin, les modalités d’entrée en vigueur du dispositif : la base de données doit être mise en place dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, et de deux ans, dans les entreprises de moins de 300 salariés. Les dispositions relatives à l’articulation des informations contenues dans la base de données avec la communication de documents au comité d’entreprise, entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, au 31 décembre 2016
III.- LES NOUVELLES RÈGLES PROCÉDURALES DE CONSULTATION
ET DE RECOURS À L’EXPERTISE
S’agissant des attributions du comité d’entreprise, si le présent article les accroît sur le fond, il en modifie également, sur la forme, les modalités d’exercice, suivant les orientations arrêtées par l’accord du 11 janvier. En effet, tirant les conséquences de l’instauration d’une obligation de mettre en place une base de données unique et exhaustive, ce dernier prévoit un encadrement des délais de consultation du comité d’entreprise, tout en lui accordant un nouveau droit d’action en référé, et de ceux de réalisation des expertises. Le présent article propose la déclinaison législative de ces dispositions.
A. LA FIXATION DE DÉLAIS DE CONSULTATION DU COMITÉ D’ENTREPRISE
Le I modifie, tout d’abord, l’article L. 2323-3, qui indique que, dans le cadre de ses attributions consultatives, définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, le comité d’entreprise émet des avis et vœux, auxquels l’employeur doit répondre de manière motivée. Le I complète cet article par trois alinéas énonçant les quatre règles suivantes :
– le comité d’entreprise dispose d’un délai d’examen suffisant, ce droit prévu aujourd’hui à l’article L. 2323-4 y étant supprimé par le 1° du II ;
– sauf dispositions législatives spécifiques, un accord entre l’employeur et la majorité des membres élus titulaires du comité d’entreprise ou le cas échéant du comité central d’entreprise, ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État, fixe les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise sont rendus, dans le cadre de ses attributions consultatives précitées, ainsi que de celles relatives au bilan social, au droit d’expression des salariés et au dépassement du contingent d’heures supplémentaires ;
– ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d’entreprise d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises ;
– à l’expiration de ces délais, le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté.
Ces dispositions reprennent celles arrêtées par l’accord du 11 janvier, qui pose le principe de la fixation d’un délai d’avis du comité d’entreprise, soit par accord entre l’employeur et le comité, soit par le code du travail. Il affirme également que ce délai doit être suffisant pour permettre aux représentants du personnel d’obtenir les réponses à leurs questions, les nouveaux alinéas fixant ce délai minimal à quinze jours. Il stipule, enfin, que l’absence d’avis du comité dans ce délai vaut avis négatif.
B. UN NOUVEAU DROIT D’ACTION EN RÉFÉRÉ
Le 2° du II accorde, ensuite, un nouveau droit de recours en référé au comité d’entreprise pendant la procédure de consultation, quelle qu’en soit la matière, en complétant par deux alinéas, l’article L. 2323-4, qui prévoit aujourd’hui que, pour formuler ses avis, le comité doit disposer d’informations précises et écrites de la part de l’employeur.
Aux termes de ces nouveaux alinéas, les membres élus du comité pourront, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir en référé le président du tribunal de grande instance, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Ce dernier devra statuer dans un délai de huit jours, le recours en référé n’ayant pas pour effet de prolonger le délai d’avis du comité. Cependant, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations, le juge pourra décider sa prolongation. Conformément aux règles de procédure civile de droit commun, il pourra en décider dès sa saisine.
C. L’ENCADREMENT DES DÉLAIS D’EXPERTISE
Suivant les orientations de l’accord du 11 janvier et du fait de la fixation de délais d’avis du comité d’entreprise, le 2° du V crée une nouvelle section comportant un article L. 2325-42-1 unique, portant un principe d’encadrement des délais de l’expertise.
Selon ce nouvel article, l’expert doit, tout d’abord, remettre son rapport dans un délai fixé, soit par accord entre l’employeur et la majorité des membres élus titulaires du comité d’entreprise, soit, à défaut, par décret en Conseil d’État. Ce délai ne peut être prorogé que par commun accord de l’employeur et du comité. Au sein du délai de mission établi, l’échange de vues et d’informations entre l’expert et l’employeur se trouve, ensuite, lui-même encadré dans un délai déterminé par décret en Conseil d’État.
IV.- LA CRÉATION D’UNE INSTANCE DE COORDINATION DES COMITÉS D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR LA RÉALISATION D’EXPERTISES COMMUNES
Le présent article ouvre, enfin, la possibilité de mettre en place une instance ad hoc de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), afin de permettre la réalisation d’une expertise unifiée et globale sur des projets concernant plusieurs établissements d’une entreprise.
Le X crée, à cet effet, un nouveau chapitre dans le titre du code du travail consacré à ces comités, qui comporte cinq articles.
A. LES CONDITIONS DE MISE EN PLACE DE L’INSTANCE
Le nouvel article L. 4616-1 énonce, tout d’abord, les conditions de mise en place de l’instance de coordination. Celle-ci intervient à l’initiative de l’employeur, en cas de projet commun à plusieurs établissements, requérant la consultation de leur CHSCT, au titre de :
– l’article L. 4612-8, imposant la consultation du CHSCT avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
– l’article L. 4612-9, imposant la consultation du CHSCT sur l’introduction de nouvelles technologies et sur ses conséquences sur la santé et la sécurité des travailleurs ;
– l’article L. 4612-10, imposant la consultation du CHSCT sur les plans d’adaptation établis lors de la mise en œuvre de mutations technologiques importantes et rapides ;
– l’article L. 4612-13, indiquant que le CHSCT se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par l’employeur, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel.
Ces articles recouvrent l’ensemble des consultations ponctuelles obligatoires du CHSCT, pouvant dépasser le cadre d’un établissement.
B. UN OBJET LIMITÉ ET TEMPORAIRE
Le nouvel article L. 4616-1 assigne un objet précis à l’instance de coordination : « organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé ». Il s’agit donc d’une instance temporaire, qui a vocation à disparaître une fois sa mission réalisée. Ce nouvel article lui ouvre, toutefois, la possibilité de formuler un avis dans le cadre de la consultation pour laquelle elle a été mise en place.
Il indique, ensuite, que l’expertise doit être réalisée dans les conditions de droit commun prévues pour le CHSCT, l’expert devant être désigné lors de la première réunion de l’instance. Le nouvel article L. 4616-3 prévoit, cependant, que ce dernier doit rendre son rapport dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, conformément aux stipulations de l’accord du 11 janvier et aux nouvelles dispositions prévues pour le comité d’entreprise. Lorsque l’instance choisit de se prononcer, celle-ci doit également émettre son avis dans un délai déterminé par décret. À défaut d’avis à l’expiration de ce dernier, l’instance sera réputée avoir été consultée.
C. LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DE L’INSTANCE
Le nouvel article L. 4616-2 définit la composition de l’instance de coordination, qui comprend :
– l’employeur ou son représentant ;
– un représentant de chaque CHSCT concerné, désigné en son sein par la délégation du personnel ;
– les personnes, territorialement compétentes pour l’établissement dans lequel se réunit l’instance de coordination, suivantes : le médecin du travail, l’inspecteur du travail, l’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, des responsables spécialisés sur des secteurs professionnels.
S’agissant du fonctionnement de l’instance, le nouvel article L. 4616-4 opère un renvoi aux dispositions de droit commun des CHSCT pouvant s’appliquer au cadre de l’instance. Le nouvel article L. 4616-5 prévoit, toutefois, qu’un accord d’entreprise peut arrêter des modalités particulières de composition et de fonctionnement, notamment si un nombre important de CHSCT est concerné.
S’agissant des moyens mis à la disposition des délégués des CHSCT siégeant à l’instance, le XI complète l’article L. 4614-3 pour qu’il permette une augmentation des heures de délégation dans ce cas.
D. L’ARTICULATION AVEC LES COMITÉS DES ÉTABLISSEMENTS
Le présent article prévoit, enfin, le dispositif d’articulation entre l’instance de coordination et les CHSCT des établissements. Le nouvel article L. 4616-3 impose la transmission du rapport de l’expert et, le cas échéant, de l’avis de l’instance, aux CHSCT, qui ne se trouvent pas privés de leur droit d’information. En revanche, le nouvel article L. 4616-5 indique qu’un accord d’entreprise peut décider la substitution de la consultation des CHCST, par celle de l’instance.
À l’initiative des commissaires socialistes et du rapporteur, votre commission a réaffirmé le principe selon lequel, en cas de mise en place d’une instance de coordination, les CHSCT continuent de rendre un avis en s’appuyant sur le rapport de l’expert unique et sur l’avis de l’instance de coordination.
*
* *
Lors de son examen du projet de loi, votre commission a adopté plusieurs modifications au texte de l’article 4.
À l’initiative du rapporteur, votre commission a :
– étendu le champ de la nouvelle consultation du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques, au recours aux stages ;
– limité la contribution de principe de 20 % du comité d’entreprise au financement de la nouvelle expertise sur les orientations stratégiques, au « tiers de son budget annuel », afin de tenir compte de la situation des nombreux comités dotés de faibles subventions de fonctionnement ;
– renforcé le dispositif de contrôle parlementaire de l’utilisation du CICE, en avançant la date de remise du rapport du Gouvernement sur le droit de saisine des représentants du personnel, au 30 juin 2015, et en imposant au Gouvernement de transmettre ensuite, chaque année, un rapport d’évaluation de ce nouveau droit au Parlement.
À l’initiative des commissaires du groupe socialiste et du rapporteur, votre commission a :
– remplacé le terme « rétributions », par l’expression « l’ensemble des éléments de la rémunération » des salariés et des dirigeants, afin de garantir l’exhaustivité des informations mises à disposition dans la base de données unique ;
– précisé que la mise à disposition des informations dans la base de données ne valait communication de celles-ci, que si les informations transmises étaient actualisées ;
– limité les possibilités d’adaptation par accord collectif du contenu des informations intégrées dans la base de données : ce contenu ne pourra se trouver qu’« enrichi » par l’accord – le groupe GDR s’étant associé à cette initiative ;
– souligné le caractère « temporaire » de l’instance de coordination des CHSCT, en adoptant un amendement lui adjoignant cette qualification ;
– réaffirmé le principe selon lequel, en cas de mise en place d’une instance de coordination, les CHSCT continuent de rendre un avis en s’appuyant sur le rapport de l’expert unique et sur l’avis de l’instance de coordination.
À l’initiative des commissaires du groupe RRDP et du rapporteur, votre commission a élargi l’accès à la base de données aux délégués personnel, dans les entreprises de plus de cinquante salariés dépourvues de comité d’entreprise.
À l’initiative du groupe GDR et du rapporteur, votre commission a imposé que le délai d’avis du comité d’entreprise soit fixé, le cas échéant, en fonction de l’information et de la consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). À l’initiative du groupe UDI, elle a précisé que l’absence d’avis du comité d’entreprise dans ces délais vaut « avis négatif », afin d’inscrire dans la loi la règle prévue par l’accord national interprofessionnel.
Enfin, à l’initiative des commissaires socialistes et du rapporteur, votre commission a apporté deux modifications à la composition de l’instance de coordination, en prévoyant que celle-ci comprend :
– trois représentants de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné par le projet, désignés en leur sein par la délégation du personnel en présence d’au plus sept comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou deux représentants de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en présence de sept à quinze comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et un au-delà de quinze comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
– les personnes qualifiées précitées territorialement compétentes pour l’établissement dans lequel se réunit l’instance de coordination s’il est concerné par le projet et, sinon, celles territorialement compétentes pour l’établissement concerné le plus proche du lieu de réunion.
Ces modifications visent à permettre la prise en compte de la diversité de représentation qui peut exister au sein chaque CHSCT, et s’assurer que les personnes qualifiées qui siégeront à l’instance de coordination disposent d’une connaissance réelle du ou des établissements concernés par le projet. Votre commission a, ensuite, précisé que seuls l’employeur et les délégués des CHSCT ont « voix délibératives ».
*
La Commission est saisie de l’amendement AS 132 de suppression de l’article de Mme Jacqueline Fraysse.
M. André Chassaigne. Nous proposons la suppression de l’article 4, qui constitue une régression par rapport à l’état actuel du droit.
Premier recul, cet article met à la charge du comité d’entreprise le financement des expertises sur les orientations stratégiques de l’entreprise à hauteur de 20 % de leur coût, alors que ce type d’expertise est d’ordinaire entièrement pris en charge par l’employeur. Cette nouvelle obligation aura pour effet d’interdire ces expertises aux comités d’entreprise dépourvus de moyens financiers suffisants.
Deuxièmement, si l’article impose l’obligation d’informer le comité d’entreprise de l’utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi, il ne précise pas les moyens dont celui-ci dispose pour garantir une bonne utilisation de celui-ci.
Troisièmement, l’article prévoit que, dans les entreprises comptant plusieurs comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, CHSCT, concernés par un même projet, une instance unique de coordination de ces comités pourra être mise en place pour recourir à une expertise unique, alors que l’état du droit autorise aujourd’hui une expertise sur chaque site, les problèmes pouvant considérablement varier d’un site à un autre au sein d’une même entreprise.
M. le rapporteur. L’article dont vous proposez la suppression est essentiel dans la perspective de l’article 5, qui prévoit la participation de représentants des salariés aux conseils d’administration des grandes entreprises, puisqu’il vise à associer les salariés aux orientations stratégiques de l’entreprise, en organisant de nouvelles modalités d’information et de consultation des salariés sur ces décisions. Cette association des salariés à la stratégie de l’entreprise constitue pour elle la meilleure protection dans la compétition internationale.
Le cofinancement de l’expertise prévu par l’article ne concerne pas les expertises aujourd’hui prévues par le code du travail, qui restent intégralement à la charge de l’entreprise, mais celles qui seront demandées en application de la nouvelle loi. Il est vrai qu’il est apparu au cours de nos auditions que le budget des plus petites structures ne leur permettrait pas de financer ces 20 % : c’est la raison pour laquelle nous vous proposerons un amendement limitant la contribution du comité d’entreprise à un tiers de son budget. J’ajoute que les deux autres nouvelles possibilités d’expertises prévues par le projet de loi seront entièrement à la charge de l’entreprise. Sur ce plan n’y a donc aucun recul, mais au contraire un progrès, même si pouvez le juger insuffisant. Il faut souligner par ailleurs que l’état du droit laisse certaines expertises intégralement à la charge du comité d’entreprise dès lors qu’elles ne sont pas obligatoires.
S’agissant du crédit d’impôt compétitivité emploi, nous avions, lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative, demandé que les représentants du personnel puissent vérifier qu’il servait bien à favoriser la recherche et l’emploi, et non à rémunérer les actionnaires ou les cadres dirigeants. C’est précisément l’objectif que poursuit cet article en créant l’obligation d’informer et de consulter le comité d’entreprise sur cette dépense fiscale considérable, en mettant en place un droit d’alerte dans le cadre d’une instance régionale créée à cet effet. Il reste à décider s’il revient à une future loi des finances de prévoir les conséquences d’une utilisation du crédit d’impôt non conforme aux objectifs, comme le souhaite le Gouvernement, ou si celle-ci doit être sanctionnée par l’administration fiscale.
Enfin, si l’idée d’une expertise commune aux comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail des sites concernés par un projet de restructuration n’a rien de scandaleux, nous vous proposerons des amendements visant à préciser que chaque site pourra être consulté sur le fondement des conclusions de cette expertise, conformément à ce que je crois être l’intention des signataires de l’accord.
Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à la suppression de cet article.
M. Denys Robiliard. Rationalisant l’accès permanent des représentants des salariés à l’information sur les orientations stratégiques de l’entreprise, l’article 4 constitue indéniablement un progrès.
Par ailleurs, quand une entreprise compte plusieurs comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail concernés par un même projet, je ne vois pas l’intérêt de permettre à chaque comité de conduire sa propre expertise.
Enfin il est inexact de dire qu’aujourd’hui les experts-comptables choisis par le comité d’entreprise sont intégralement rémunérés par l’employeur. Selon l’état actuel du droit en effet, c’est le comité d’entreprise qui rémunère en principe les experts-comptables qu’il choisit, hormis dans les cas où la loi prévoit sa rémunération par l’employeur.
Voilà pourquoi le groupe socialiste ne soutiendra pas la demande de suppression de cet article.
M. André Chassaigne. Cet article constitue indiscutablement un recul, d’autant que l’accord du 11 janvier a réduit le champ d’investigation des experts-comptables désignés par le comité d’entreprise, en définissant de façon limitative les éléments d’information à produire et les modalités de recours à l’expertise.
M. le rapporteur. Vous ne pouvez pas dire qu’il y a un recul en matière d’expertise alors que les expertises prévues dans le cadre des procédures actuelles d’information et de consultation obligatoires du comité d’entreprise continueront à être intégralement prises en charge par l’entreprise. En outre, le texte introduit trois nouvelles possibilités d’expertise, dont deux sont entièrement financées par l’entreprise.
Quant au champ d’investigation de la nouvelle expertise, il ne se substitue pas aux obligations d’information actuelles, l’intention des signataires de l’accord étant au contraire d’accroître les prérogatives des représentants du personnel en la matière. Il est vrai cependant que certains cabinets d’experts-comptables partagent vos inquiétudes à ce sujet, mais je propose que nous revenions sur ce point au moment de l’examen de l’article 13.
La Commission rejette l’amendement AS 132.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS 391 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AS 248 de M. Denys Robiliard.
M. Denys Robiliard. Il s’agit d’un amendement de nature quasi rédactionnelle. En effet, la majorité du comité d’entreprise ne peut pas disposer des pouvoirs qui sont ceux du comité lui-même. Cette précision juridique permet de souligner que cet accord lie le comité à l’employeur.
M. le rapporteur. Denys Robiliard m’a convaincu de la pertinence de ses arguments.
La Commission adopte l’amendement AS 248.
La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS 392 du rapporteur.
La Commission est saisie de l’amendement AS 87 de M. Hervé Morin.
M. Hervé Morin. Cet amendement propose de préciser que les délais de consultation des comités d’entreprise courent « à compter de la remise des documents » : cela permettrait d’éviter manœuvres dilatoires et complications diverses.
M. le rapporteur. Je comprends votre souci, et j’ai un temps pensé proposer un amendement similaire. Mais le Gouvernement m’a indiqué que le décret fixera ces points de départs de façon plus complexe et plus précise que ce que vous proposez. De plus, il faudra aussi prendre en considération la nécessité de consulter le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il paraît donc pertinent de renvoyer au décret, qui précisera ces détails – ce qui est évidemment indispensable.
Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement AS 87.
Puis elle examine l’amendement AS 183 de Mme Jacqueline Fraysse.
M. André Chassaigne. Cet amendement vise à s’assurer que les délais entre l’information et la consultation seront suffisants, en précisant que le délai de quinze jours mentionné par le projet de loi court « entre la première réunion de présentation du projet et la réunion de consultation ». Cette procédure, réservée par nature aux sujets importants, exige en effet que se succèdent une phase d’information, au cours de laquelle l’employeur fournit des explications et remet des documents, une phase d’appropriation et de questionnement par le comité d’entreprise, et enfin une phase de réponse aux questions et propositions du comité d’entreprise.
M. le rapporteur. Vous auriez presque pu cosigner cet amendement avec Hervé Morin, puisque vous partagez son souci de préciser le point de départ des délais.
M. André Chassaigne. Hervé Morin et moi ne sommes pas du même côté de la barricade !
M. le rapporteur. Je vous renverrai néanmoins de la même façon au décret. Il existe des situations très différentes les unes des autres : le décret précisera donc les délais de façon sophistiquée, en fixant non seulement les délais minimaux mais aussi les points de départ, ce qui m’a été confirmé par le ministère. Sur le principe, nous sommes d’accord, mais je suis défavorable à l’inscription de ces précisions dans la loi.
M. André Chassaigne. Vous êtes décidé à nous faire acheter un âne dans un sac !
Mme Véronique Louwagie. Les références à ce futur décret sont nombreuses dans le texte : au-delà de la question des délais, que contiendra-t-il ?
M. le rapporteur. Je n’en dispose pas. Mais la précision essentielle est bien inscrite dans la loi, qui dispose que ces délais « doivent permettre au comité d’entreprise d’exercer utilement sa compétence ». Nous interrogerons le ministre dans l’hémicycle sur le contenu du décret : cela nous permettra d’ôter le sac et de voir la tête de l’âne !
La Commission rejette l’amendement AS 183.
Elle examine ensuite l’amendement AS 184 de Mme Jacqueline Fraysse.
M. André Chassaigne. Il s’agit de prendre en considération les délais nécessaires à l’information et à la consultation du ou des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
M. Hervé Morin. Il y a un sujet que l’accord du 11 janvier n’a malheureusement pas abordé : c’est le chevauchement, de plus en plus important, des CHSCT et des comités d’entreprise. Les premiers ont été dotés de nouvelles compétences, qui recoupent celles du comité d’entreprise.
Il me paraîtrait au contraire utile de les recentrer sur leur rôle initial, qui concernait l’hygiène, la santé et la sécurité, et de laisser les comités d’entreprise s’occuper de l’organisation du travail et des conditions de travail. Aujourd’hui, les deux organes sont systématiquement consultés, ce qui implique des délais supplémentaires, la Cour de cassation ayant ordonné que le comité d’entreprise ne se prononce qu’après l’avis des CHSCT.
Ces deux instances – qui sont d’ailleurs souvent, mais pas toujours, composées des mêmes personnes – se chevauchent, ce qui complique considérablement le dialogue social et donc la signature d’accords collectifs.
Pour mettre fin à cette situation, un amendement UDI proposera, tout à l’heure, que le CHSCT fasse désormais partie du comité d’entreprise, qu’il en devienne une composante.
M. le rapporteur. Monsieur Morin, je suis très défavorable à ce que vous proposez, qui reviendrait en quelque sorte à supprimer les lois Auroux. Le CHSCT dispose de compétences en matière d’hygiène et de sécurité qui lui sont propres ; à l’inverse du comité d’entreprise, il exerce sur l’employeur un pouvoir contraignant. Sur certaines questions, il ne peut être saisi que par le comité d’entreprise.
Pour en revenir au texte, pour un plan de licenciements par exemple, l’accord du 11 janvier prévoit que toutes les étapes de la procédure se déroulent dans le délai – de deux à quatre mois – prévu entre la première réunion, qui marquera le début de la procédure, et la dernière réunion du comité d’entreprise. L’accord prévoit un délai beaucoup plus long que les délais actuels pour que la procédure puisse – sauf entrave, mauvaise foi ou procédure de suspension – être entièrement contenue dans ce temps. On pourrait en débattre, mais c’est ce qui résulte de l’accord, et cela devrait être un changement par rapport à la situation actuelle. Les délais prévus paraissent d’ailleurs trop courts à certains.
Monsieur Chassaigne, je suis d’accord avec vous sur le fond, mais je vous propose de rectifier votre amendement. Nous pourrions rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : « , et permettre, le cas échéant, l’information et la consultation du ou des CHSCT ».
Ainsi, les délais prendront en considération, le cas échéant, la consultation des CHSCT. Le décret en tiendra compte, le ministère me l’a confirmé.
M. André Chassaigne. J’accepte très volontiers cette rectification.
Monsieur Morin, votre intervention était pétrie de conservatisme ; je n’en suis pas surpris, mais je le regrette. Jean Auroux lui-même me disait l’an dernier au cours d’un débat que les lois qui portent son nom, et qui ont été une formidable avancée, n’ont guère évolué depuis trente ans, et qu’aujourd’hui, il est vraiment indispensable de donner un nouveau coup de pouce à la démocratie sociale : face aux difficultés que rencontrent les entreprises aujourd’hui, il ne faut pas réduire les droits et les pouvoirs des salariés, mais au contraire les élargir !
Lors des débats du Grenelle de l’environnement – vous étiez encore ministre, je crois – il y avait eu un échange sur l’évolution des CHSCT, qui devaient pouvoir intervenir plus largement sur les questions environnementales : les salariés sont en effet les mieux placés pour constater les éventuels dommages à l’environnement, comme pour évaluer les effets de certains produits sur leur santé.
Ne réduisons donc surtout pas les pouvoirs de cette avancée sociale extraordinaire que sont les CHSCT ! Il leur faut au contraire plus d’expertise, de formation, de technicité.
M. Hervé Morin. Loin de moi l’idée de supprimer les CHSCT ; mais je propose d’en faire par exemple une sorte de commission qui appartiendrait au comité d’entreprise. L’autre solution serait, conformément d’ailleurs aux lois Auroux, de les recentrer sur leur rôle en matière de santé et de sécurité.
Sous l’influence de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, ils sont aujourd’hui consultés sur tout ce qui relève de l’organisation du travail et des conditions de travail. Cela va bien au-delà des plans sociaux : sans cette consultation systématique, il y a un risque d’annulation des accords.
Ainsi, lorsqu’il y a dans une entreprise un accord sur les entretiens annuels d’évaluation, le comité d’entreprise est consulté, mais le CHSCT l’est aussi, au motif que ces entretiens pourraient constituer pour les salariés une source de stress.
Encore une fois, cette double consultation complique le dialogue social. Ne voyez donc pas dans mes propos du conservatisme, mais bien une volonté d’efficacité.
M. Gérard Sébaoun. À l’intérieur des CHSCT, nous avons en effet vu apparaître de plus en plus souvent les questions d’organisation du travail, car une mauvaise organisation peut engendrer pour les salariés des risques psychosociaux.
Il y a quelquefois sur les conditions de travail un dialogue, mais souvent, c’est vrai, une opposition entre représentants des salariés et employeur. Aujourd’hui, les salariés peuvent aborder les questions de conditions de travail et des organisations du travail, au sein des CHSCT, puisqu’une mauvaise organisation peut avoir des effets délétères sur la santé. Nous en avons connu suffisamment d’exemples fâcheux ces dernières années.
M. Gérard Cherpion. Cette discussion montre toute la complexité du système : les délais sont nombreux, très courts, et ils se chevauchent…
Il paraît bien difficile de nous prononcer sans connaître le décret : nous allons ce soir voter quelque chose qui n’a pas de sens.
M. le rapporteur. La loi fixe des délais qui ont paru raisonnables. Il faut bien voir que le texte propose un renversement de la logique actuelle, où les procédures s’emboîtent plus ou moins bien les unes avec les autres. Nous y reviendrons d’ailleurs plus longuement à l’article 13, où je proposerai notamment de fractionner les délais. La préoccupation est toujours la même : la discussion doit pouvoir se dérouler, l’expertise s’affiner, et tout cela dans des délais plus serrés qu’ils ne l’étaient.
Mais, grâce à ce changement de logique, un délai de deux mois suffira désormais pour faire les choses de façon utile et intelligente.
M. Gérard Cherpion. Le délai est de quinze jours, dit le texte, ou en tout cas il ne peut pas être inférieur à quinze jours. Nous ne parlons pas ici seulement de licenciements !
M. le rapporteur. Les comités d’entreprise sont en particulier consultés lors de la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
M. Gérard Cherpion. Mais pas seulement.
M. le rapporteur. Non, bien sûr, d’où les nombreuses précisions qui seront apportées par le décret. Mais les délais préfix, ou les expertises dans des délais très courts, sont des procédures qui seront par nature réservées aux moments où elles sont nécessaires : ce serait inutile pour une expertise des comptes annuels de l’entreprise, par exemple. C’est pourquoi j’insiste sur la procédure de plan social : la logique du texte est de fixer des délais relativement longs, mais à l’intérieur desquelles toutes les consultations doivent se faire.
Mais je relaierai votre demande auprès du ministre, qui pourra peut-être nous communiquer les grandes orientations du décret dès notre débat dans l’hémicycle.
La Commission adopte l’amendement AS 184 ainsi rectifié.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 57 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. L’accord du 11 janvier précisait que l’absence d’avis des institutions représentatives du personnel valait avis négatif ; dans le projet de loi, elles sont seulement réputées avoir été consultées. Cet amendement vise à rétablir cette précision.
M. le rapporteur. Je ne suis pas sûr qu’elle ait des conséquences majeures, puisque le texte oblige seulement à consulter le comité d’entreprise, mais pourquoi pas ? Je m’en remets à la sagesse de la Commission.
M. Denys Robiliard. Je soutiens pour ma part l’amendement de Francis Vercamer.
La Commission adopte l’amendement AS 57.
Elle examine ensuite l’amendement AS 185 de Mme Jacqueline Fraysse.
M. André Chassaigne. Monsieur le rapporteur, vous nous dites depuis le début de notre discussion que c’est là un accord qui nous veut du bien. Il permettrait notamment de sécuriser les délais de consultation des instances représentatives du personnel.
Cet amendement vise à apporter quelque cohérence à ce nouveau dispositif et à vérifier si votre bienveillance est tout à fait justifiée : il précise que le comité d’entreprise n’est réputé avoir été consulté à l’expiration des délais que sous réserve que l’employeur lui ait fourni toutes les informations nécessaires à sa parfaite compréhension du projet et qu’il ait répondu de manière motivée à ses observations.
De nos consultations avec les organisations syndicales – termes que je préfère à ceux de « partenaires sociaux » – il ressort qu’il est en réalité souvent impossible de rendre un avis dans un délai raisonnable, car le comité d’entreprise ne dispose pas de toutes les informations nécessaires : pour les obtenir, et donc pouvoir faire des observations pertinentes, il faut interroger l’employeur de façon répétée, ce qui prend du temps.
M. le rapporteur. Votre intention est louable, et j’y suis tout à fait sensible. Toutefois, le texte prévoit une procédure différente : c’est le juge, saisi en urgence, qui peut obtenir du chef d’entreprise tous les documents nécessaires.
N’oublions pas les nouveaux pouvoirs accordés lors d’un plan social à l’administration du travail, mais aussi au juge administratif et au juge judiciaire. De plus, si les informations ne sont pas transmises, la procédure pourrait être in fine annulée.
Cette procédure n’est pas celle que vous proposez, mais elle répond néanmoins, me semble-t-il, à votre préoccupation.
M. André Chassaigne. Je ne crois pas, monsieur le rapporteur, mais je ferai expertiser votre réponse.
Je vous signale d’ailleurs – ce sera le sujet de l’amendement suivant – qu’il ressort également de nos consultations que demander à un juge de statuer en huit jours sur ces problèmes ne paraît pas très sérieux.
M. Dominique Tian. L’amendement d’André Chassaigne est tout à fait subjectif. Vous parlez de « parfaite compréhension ». Et si l’interlocuteur ne comprend rien à rien ? Cela peut arriver, vous savez, et même chez des syndicalistes !
M. André Chassaigne. Continuez comme cela, monsieur Tian, vous nous donnez des cartouches !
M. le rapporteur. Sur les propos de Dominique Tian, j’ai un avis, mais il vaut mieux que je le garde pour moi.
Sur l’amendement, avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement AS 185.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ensuite l’amendement AS 149 de Mme Jacqueline Fraysse.
La Commission examine ensuite l’amendement AS 186 de Mme Jacqueline Fraysse.
M. André Chassaigne. L’alinéa 9 traite du cas où, faute d’informations suffisantes, le comité ne peut rendre son avis en toute connaissance de cause : le juge peut alors décider la prolongation du délai, mais sa saisine n’a pas pour effet de prolonger ce dernier. Si le comité n’a connaissance qu’au bout de dix jours du refus par l’employeur de remettre les documents sollicités, le juge, même en statuant en huit jours, ne pourra donner sa réponse avant la fin du délai de consultation, qui peut être de quinze jours : dix plus huit font bien dix-huit.
M. le rapporteur. Avis défavorable. L’alinéa 9, dans sa deuxième phrase, dispose qu’« en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires […], le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L. 2323-3 ».
Vous suggériez que le délai de huit jours était insuffisant pour les juges. Il est vrai que la justice judiciaire est un peu « embolisée », mais elle est capable de traiter des contentieux rapidement : récemment, lors d’un contentieux relatif à une crémation, en quinze jours ont été rendus un jugement en première instance, un jugement en appel, un jugement en cassation et un second jugement en appel.
M. André Chassaigne. Comment, monsieur le rapporteur, prolonger un délai déjà expiré ?
M. le rapporteur. Le juge peut, dès sa saisine, prolonger le délai : tous les juristes consultés nous l’ont confirmé.
M. André Chassaigne. J’espère que votre réponse n’est pas un « coup de bluff » ! Je vous fais confiance, mais je vérifierai ce point et maintiens donc mon amendement.
M. le rapporteur. Il n’y a aucun bluff de ma part, monsieur Chassaigne : j’avais d’ailleurs envisagé le même amendement, avant de me raviser au bénéfice de vérifications juridiques.
La Commission rejette l’amendement AS 186.
Puis elle examine l’amendement AS 214 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. À l’alinéa 11, nous proposons d’insérer, après les mots : « l’évolution des métiers et des compétences », les mots : « l’environnement, la dépendance aux énergies fossiles ».
Nous trouverions normal que soient pris en compte les enjeux environnementaux, notamment la dépendance aux énergies fossiles, à travers laquelle nous faisons aussi référence à la question des coûts et des « circuits courts ».
M. le rapporteur. Cet amendement se combine avec un autre, relatif à l’alinéa 22. Il propose d’associer les salariés, à travers leur information et leur consultation, à la mutation écologique des entreprises. De fait, l’écologie ne relève pas de la seule action publique : elle se joue aussi au quotidien, pour les particuliers comme pour les entreprises.
Cependant, je vous invite à retirer votre amendement pour en revoir la rédaction d’ici à l’examen en séance, afin de mieux l’insérer dans cet alinéa qui énumère un grand nombre de thèmes.
M. Élie Aboud. Pourquoi, soit dit au passage et sans esprit de provocation, se limiter aux énergies fossiles ?
M. Christophe Cavard. Nous sommes prêts à élargir la consultation à beaucoup d’autres sujets environnementaux, monsieur Aboud. Reste que les énergies fossiles sont essentielles au regard des enjeux de mutation écologique et des questions de coûts, que les entreprises subissent de plein fouet.
Quoi qu’il en soit, au bénéfice de l’accord de principe du rapporteur, je retire l’amendement à ce stade afin d’en revoir la rédaction.
L’amendement AS 214 est retiré.
La Commission examine l’amendement AS 296 du rapporteur.
M. le rapporteur. Une réflexion plus globale est nécessaire sur les stages, au sujet desquels s’accumulent des mesures sans réelle efficacité. Je pense qu’il serait utile que le comité d’entreprise soit consulté aussi sur cette question, comme sur celle des contrats temporaires.
M. Gérard Cherpion. Le code du travail prévoit déjà une obligation d’information sur les stages : l’amendement me semble donc redondant.
Mme Isabelle Le Callennec. Pourquoi ne pas étendre cette information aux contrats d’apprentissage et de formation en alternance ?
M. le rapporteur. Je ne mets pas sur le même plan, d’une part, les contrats d’apprentissage et de professionnalisation et, de l’autre, les contrats précaires tels que les contrats à durée déterminée et les contrats en intérim. Le comité sera consulté sur les contrats de travail qui contribuent à la flexibilité au sein de l’entreprise : sous-traitance, intérim et contrats temporaires ; il m’a paru utile d’y ajouter les stages. Au demeurant, monsieur Cherpion, l’obligation que vous avez rappelée vaut aussi pour les contrats temporaires. Le point dont nous parlons est au cœur de la négociation stratégique ; or, force est de constater que les stages sont aussi devenus, hélas, une forme d’emploi précaire.
M. Dominique Tian. Les stages ne sont pas des contrats de travail. J’ajoute que beaucoup de cursus scolaires ou universitaires incluent des stages obligatoires, que les étudiants ont toutes les peines du monde à trouver : évitons de leur compliquer davantage la tâche.
Mme Isabelle Le Callennec. Pourquoi l’information ne porte-t-elle pas sur les contrats de génération ?
M. André Chassaigne. La consultation du comité d’entreprise ne peut que favoriser l’accueil des stagiaires. L’amendement me semble donc opportun.
La Commission adopte l’amendement AS 296.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS 393 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 189 de Mme Jacqueline Fraysse.
M. André Chassaigne. Aux termes de l’alinéa 14, « le comité d’entreprise peut se faire assister de l’expert-comptable de son choix ». Il convient de préciser que « cette possibilité de recours […] ne se substitue pas aux autres expertises ».
M. le rapporteur. Je vous ai déjà répondu sur ce point, monsieur Chassaigne : le recours à l’expert-comptable ne se substituera pas aux autres expertises, qu’un article du code du travail énumère avant d’ajouter celle que vous mentionnez, indépendamment des autres. Votre amendement serait donc redondant avec l’alinéa 35 de l’article.
M. André Chassaigne. Je retire l’amendement.
L’amendement AS 189 est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement AS 216 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Cet amendement, dont j’espère qu’André Chassaigne l’approuvera, traduit notre inquiétude sur la contribution du comité d’entreprise, à hauteur de 20 % de son budget, au financement de l’expertise. Aussi proposons-nous donc de supprimer la dernière phrase de l’alinéa 14.
M. le rapporteur. Je vous suggère de retirer votre amendement, pour vous rallier à mon amendement AS 297, qui propose de limiter la contribution des petits comités d’entreprise aux expertises à hauteur de 30 % de leur budget. Cet amendement présente l’avantage d’avoir été approuvé par l’ensemble des signataires de l’accord du 11 janvier.
M. Christophe Cavard. Notre amendement tend à supprimer la référence à la contribution du comité d’entreprise : par principe, je le maintiens, malgré l’avancée potentielle que représenterait la proposition du rapporteur.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AS 216.
Elle examine ensuite l’amendement AS 217 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Nous proposons que l’expert-comptable soit rémunéré dans les conditions de l’article L. 2325-40, et que le comité d’entreprise puisse prendre à sa charge une part de cette rémunération, dans la limite de 20 % du coût hors taxe de l’expertise.
M. le rapporteur. Cette disposition s’appliquerait « sous réserve que le comité d’entreprise dispose d’une subvention de fonctionnement » ; en d’autres termes, elle ne vise que les comités de groupe. En attendant une éventuelle expertise sur ce point, j’émets un avis défavorable.
M. Denys Robiliard. L’employeur a l’obligation légale de verser au comité d’entreprise une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute : la rédaction de l’amendement est donc à revoir.
Par ailleurs, si le comité central de l’entreprise ne dispose pas d’un budget propre, celui-ci est abondé par les comités d’établissement : compte tenu de la taille des entreprises concernées, il n’a a priori pas de difficultés de financement.
Ces deux raisons me conduisent à désapprouver l’amendement.
La Commission rejette l’amendement AS 217.
Puis elle examine l’amendement AS 249 de M. Denys Robiliard.
M. Denys Robiliard. Cet amendement est de coordination avec un autre adopté tout à l’heure : il vise à remplacer les mots : « la majorité des membres élus du » par le mot : « le ».
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 249.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS 394 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AS 297 du rapporteur.
M. le rapporteur. J’ai déjà présenté cet amendement, qui vise à plafonner la contribution au financement des expertises par le comité d’entreprise au tiers de son budget, sachant qu’une autre répartition reste bien entendu possible.
La Commission adopte l’amendement AS 297.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements AS 113 de M. Jean-Noël Carpentier et AS 250 de M. Denys Robiliard.
M. Jean-Noël Carpentier. Nous proposons de transcrire dans la loi l’article 12 de l’accord du 11 janvier, aux termes duquel la base de données unique est « mobilisable à tout moment […] par les institutions représentatives du personnel et les délégués syndicaux ».
M. le rapporteur. Je suis plutôt favorable à l’amendement AS 250 ; quant à l’amendement AS 113, je suggère à son auteur de le modifier en faisant précéder, aux alinéas 15 et 16, les mots : « , aux délégués du personnel » par les mots : « et, à défaut ».
M. Jean-Noël Carpentier. Pourquoi cette précision ?
M. Denys Robiliard. La logique veut que l’on ouvre l’accès à la base de données à ceux qui ont besoin des informations qu’elle contient, à savoir les délégués du personnel et les membres du comité d’entreprise, bien que leurs fonctions diffèrent ; au reste, ils peuvent être tous deux remplacés par une délégation unique du personnel. En l’absence de comité d’entreprise, les délégués du personnel exercent une partie des fonctions normalement dévolues à celui-ci, notamment en matière de licenciement économique ; en ce cas, il serait logique de leur ouvrir l’accès à la base de données.
M. le rapporteur. La base de données comportera des informations stratégiques, d’où l’obligation de discrétion. Elle doit être ouverte à ceux-là seuls qui ont à prendre des décisions en fonction des informations qu’elle contient : on a émis l’idée de mettre celles-ci à la disposition de tous les salariés, par exemple sur Internet ; mais elles deviendraient alors des documents de communication de l’entreprise, y compris vis-à-vis de l’extérieur. Si l’on veut préserver leur intérêt, mieux vaut les réserver à ceux à qui elles sont vraiment utiles.
M. Jean-Noël Carpentier. Je suis d’accord pour modifier mon amendement dans le sens que vous avez indiqué, monsieur le rapporteur, même si l’on peut penser que les représentants du personnel feront circuler l’information parmi les salariés, en dépit de l’obligation de confidentialité et bien qu’ils fassent en général preuve de responsabilité.
Mme Isabelle Le Callennec. André Chassaigne, avec son amendement AS 189, faisait part de sa crainte de voir la base de données se substituer aux autres informations légalement dues par l’employeur. Ne devrait-on pas préciser qu’elle inclut l’ensemble de ces informations, pour devenir le document unique de référence ? Veillons à ne pas superposer les informations.
Par ailleurs, que signifie exactement l’expression : « accessible en permanence » ? Un seul accès par an, suivi d’une discussion, ne serait-il pas plus intéressant ? Il faut s’interroger aussi bien sur les modalités de cet accès – fichier numérisé ou document papier, par exemple – que sur ceux auxquels il sera ouvert : de ce point de vue, le texte me semble mériter clarification et simplification, d’autant que des informations relatives par exemple à la rémunération des salariés ou des dirigeants sont loin d’être neutres. La diffusion de données stratégiques comporte des risques.
M. Philippe Noguès. Je rappelle, à la suite de Jean-Noël Carpentier, que la base de données unique, aux termes de l’accord du 11 janvier, est « mobilisable à tout moment aussi bien par les institutions représentatives du personnel et les délégués syndicaux, dans le cadre de leurs attributions, que par l’employeur ».
M. le rapporteur. Une mise à jour régulière, telle qu’elle est prévue à l’alinéa 15, n’a pas grand sens : est-ce à dire qu’elle devrait intervenir dès que l’entreprise a connaissance d’une information nouvelle ? Je vous proposerai donc, par un prochain amendement, d’inscrire dans la loi que c’est la base actualisée qui doit être présentée dans le cadre d’une procédure de consultation.
Quant aux interrogations sur l’exhaustivité, l’alinéa 29 précise que « les éléments d’information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au comité d’entreprise sont mis à la disposition de ses membres dans la base de données ».
M. Arnaud Richard. Dès lors que le rapporteur est un peu contraint à demander leur avis à un certain nombre de signataires de l’accord du 11 janvier sur les amendements à venir qui ont été évoqués, pourrait-on en disposer avant la clôture du délai de dépôt ?
Mme la présidente Catherine Lemorton. Non, nous suivrons la procédure normale. C’est bien la première fois que l’on exige de disposer d’amendements dans ces conditions – et même de décrets avant qu’ils ne soient rédigés ! Ce n’est pas raisonnable.
La Commission adopte l’amendement AS 113 modifié.
En conséquence, l’amendement AS 250 devient sans objet.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS 395 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AS 215 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Nous proposons que, parmi les informations fournies dans la base de données, doivent notamment figurer la nature des contrats, le nombre de stagiaires et son ratio équivalent temps plein, ainsi que la part des salariés à temps partiel afin d’éviter des quiproquos et l’éventuelle stigmatisation d’une entreprise qui serait soupçonnée de trop utiliser ce genre de dispositifs.
M. le rapporteur. Avis défavorable mais vous serez satisfait par un amendement qui ira beaucoup plus loin et qui concerne la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), l’accord du 11 janvier ayant prévu que les contrats précaires seraient désormais pris en compte.
La Commission rejette l’amendement AS 215.
Puis, elle en vient à l’amendement AS 253 de M. Gérard Sébaoun.
M. Gérard Sébaoun. À l’alinéa 20, il serait plus clair et plus exhaustif de remplacer le mot « Rétributions » par « Ensemble des éléments de la rémunération ».
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 253.
La Commission est saisie de l’amendement AS 212 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Parmi les informations de la base de données devraient également figurer les impacts environnementaux de la production, la consommation d’énergies fossiles, la sensibilité au prix de l’énergie et à la dépendance aux importations de matières premières.
M. le rapporteur. Je suis favorable à ce très important amendement puisqu’il contribue à impliquer les salariés dans la mutation écologique des entreprises mais il serait plus adéquat non après l’alinéa 21 mais à l’alinéa 18 où il est question de divers types d’investissements, notamment matériels et immatériels, auxquels il serait possible d’adjoindre l’investissement écologique.
Je vous propose que, d’ici à la séance publique, nous travaillions ensemble à une nouvelle rédaction qui conférera encore plus de force à votre amendement.
Mme Isabelle Le Callennec. Dès lors, ne pourrait-on pas reprendre la définition de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises (RSE) ? Pourquoi répéter ce qui existe déjà, en l’occurrence pour les grandes entreprises ?
M. Christophe Cavard. Je suis d’accord avec la proposition du rapporteur.
Quant à la responsabilité sociale des entreprises, nous regarderons de près ce qu’il en est, notamment s’agissant d’un certain nombre de sujets sensibles dont je ne suis pas sûr qu’ils y soient inclus.
M. Hervé Morin. Les informations de la base de données soulèvent le problème de la confidentialité et des risques liés à l’intelligence économique. Grossièrement, tous les concurrents des entreprises françaises en connaîtront les flux financiers, les éventuels impacts environnementaux qui, potentiellement, permettraient à tel ou tel concurrent de lancer des campagnes de dénigrement sur tel ou tel sujet, les investissements matériels et immatériels, les relations avec les sous-traitants ou les transferts commerciaux et financiers.
Je comprends la raison d’être de ces bases de données permettant aux instances représentatives de faire leur travail mais il n’en reste pas moins que ce problème se pose bel et bien.
Continuons la liste de la sorte et autorisons nos concurrents à nous embêter quotidiennement !
M. le rapporteur. Les contours de la base de données ont été validés par le MEDEF…
M. Hervé Morin. Il n’a pas forcément raison.
M. le rapporteur. … et regardés de près par l’Association française des entreprises privées (AFEP).
Isabelle Le Callennec a raison de considérer qu’une articulation avec la responsabilité sociale des entreprises est nécessaire mais il faudrait également en concevoir une version actualisée qui ne doublonne pas avec la première et incluant la participation à la mutation écologique des entreprises.
M. Christophe Cavard. Je retire l’amendement AS 212 pour mieux le représenter en séance publique.
L’amendement AS 212 est retiré.
La Commission examine l’amendement AS 213 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. La liste des données devrait également préciser que les conditions de l’octroi des aides publiques et des crédits d’impôts doivent être respectées. Il en va en particulier de la transparence quant à l’utilisation de l’argent public.
M. le rapporteur. Sur le fond, je suis d’accord avec vous : les informations concernant les crédits d’impôts doivent être précises. Néanmoins, nos débats permettront de spécifier nos exigences sans alourdir le texte à cet endroit-là.
J’ajoute que l’alinéa 45 dédié au crédit d’impôt compétitivité emploi crée une procédure d’information et de consultation des salariés avec droit d’alerte à un comité régional.
Avis défavorable.
Mme Véronique Louwagie. L’article 12 de l’accord du 11 janvier précise très bien la volonté des partenaires sociaux, à laquelle il me semble important de nous tenir. La base de données comprend au moins 5 rubriques – 6 pour les groupes – et à aucun moment il n’est fait état des conditions d’octroi des crédits d’impôt et de leur respect.
À cela s’ajoute la question de la confidentialité, à laquelle il vient d’être fait allusion.
La Commission rejette l’amendement AS 213.
Elle adopte l’amendement rédactionnel AS 396 du rapporteur.
La Commission en vient ensuite aux amendements AS 188 de Mme Jacqueline Fraysse et AS 254 de M. Denys Robiliard pouvant faire l’objet d’une discussion commune.
M. André Chassaigne. L’alinéa 27 dispose que le contenu des informations peut être « adapté » par un accord de branche ou d’entreprise, or, cette modification pouvant fort bien intervenir dans un sens défavorable, je propose qu’il soit plutôt « complété ».
M. Denys Robiliard. J’ai quant à moi préféré le mot « enrichi ».
M. le rapporteur. Sur ce point majeur de l’accord du 11 janvier, je vous invite à vous rallier à ce dernier amendement, monsieur Chassaigne, que j’ai moi-même cosigné.
À ce propos, je vous précise que je ne suis ni un « ANIbéat » ni un « ANIbêta ».
Mme Isabelle Le Callennec. Cet alinéa dispose que le contenu de ces informations est déterminé par un décret et peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés.
Avez-vous discuté avec les auteurs du décret à venir quant à la liste des informations contenues dans la base de données des entreprises qui comptent moins de 300 salariés ? La situation n’est pas la même en effet si l’on dispose ou non d’un service des ressources humaines, lequel peut mettre à jour régulièrement ces informations. Le décret en tiendra-t-il donc compte ?
M. Francis Vercamer. Je propose de sous-amender l’amendement en précisant « adapté ou enrichi » car les deux possibilités sont envisageables en fonction des entreprises. Par exemple, des éléments peuvent être retirés si des problèmes stratégiques risquent de se poser.
M. le rapporteur. Je suis favorable au maintien de la rédaction proposée par l’amendement AS 254.
M. André Chassaigne. Je le co-signe tant le mot « enrichi » confère une dimension qualitative supérieure à « complété » et je retire donc l’amendement AS 188.
L’amendement AS 188 est retiré.
La Commission adopte l’amendement AS 254.
Puis elle examine l’amendement AS 59 de M. Francis Vercamer.
M. Arnaud Richard. Cette base de données, qui n’est pas une nouveauté puisqu’elle comptait déjà parmi les éléments de négociation de la loi sur la modernisation du dialogue social, devra être opérationnelle un an après l’adoption de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires nécessaires à son application.
Au-delà de la question de la confidentialité, qui nous semble très importante, se pose la question des modalités de mise à jour des informations et, en particulier, de sa périodicité.
Enfin, sans doute conviendra-t-il de donner de nouveaux moyens aux comités d’entreprise pour la prise en charge de l’ensemble de ces charges nouvelles.
M. le rapporteur. L’alinéa 15 dispose que la base de données doit être régulièrement mise à jour.
En outre, l’amendement AS 255 concernant l’alinéa 29 sur lequel nous débattrons bientôt indique que la mise à disposition des informations doit être actualisée dès lors qu’une procédure d’information et de consultation est déclenchée.
Un tel dispositif devrait permettre d’éviter l’alourdissement des conditions que la loi impose à l’accord collectif.
Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement AS 59.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 150 de M. Chassaigne.
M. André Chassaigne. Le rapporteur a répété plusieurs fois que… le texte ne devait pas se répéter. Or, je suis surpris qu’il n’ait pas déposé un amendement identique au mien visant à supprimer l’alinéa 28 selon lequel les membres du comité d’entreprise sont tenus à une obligation de discrétion puisque cela figure déjà dans le code du travail.
M. le rapporteur. Je reconnais bien là l’habileté d’André Chassaigne mais permettez-moi de vérifier d’ici à la séance publique « ce qui se cache sous le sac ». Vous avez en partie raison mais je souhaite vérifier qu’il n’y ait pas d’ambiguïté avant de conclure à une éventuelle redondance.
De plus, une directive européenne sur les obligations de confidentialité attachées aux informations stratégiques des entreprises nous imposera peut-être de préciser nos intentions, étant entendu que l’obligation susmentionnée est plus faible que ladite obligation de confidentialité puisqu’elle permet de protéger a minima les informations sans remettre en cause les prérogatives des représentants du personnel.
Avis défavorable.
Mme Isabelle Le Callennec. Quitte à réécrire le texte, allons jusqu’au bout et exigeons une totale confidentialité, voire, un devoir de réserve.
M. Denys Robiliard. L’argument d’André Chassaigne n’est pas absolument pertinent dès lors que l’article L. 2325-5 du code du travail porte sur les membres du comité d’entreprise et les représentants syndicaux aux comités d’entreprise mais pas sur les délégués syndicaux. Le texte qu’il voudrait supprimer a une portée plus large que cet article.
Cela dit, nous aurions sans doute intérêt à procéder à la modification de ce dernier plutôt que d’inclure une disposition du même ordre à un autre endroit.
M. le rapporteur. Nous procèderons aux vérifications nécessaires d’ici à la séance publique. Si la solution de Denys Robiliard se révèle pertinente, ce qui est fort probable compte tendu de ses hautes compétences en matière de droit social, nous travaillerons en ce sens-là.
M. André Chassaigne. Dans l’attente de votre haute expertise, je retire donc l’amendement.
L’amendement AS 150 est retiré.
La Commission examine l’amendement AS 60 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. Nous proposons de remplacer le mot « discrétion » par celui de « confidentialité », qui est plus fort et qui se trouve dans l’accord du 11 janvier.
M. le rapporteur. Avis défavorable. L’obligation de discrétion est une notion récurrente dans le code du travail. Il n’est pas question de l’affaiblir ou de la renforcer mais, en l’occurrence, de conserver un bon équilibre entre la protection des données et le droit des salariés.
La Commission rejette l’amendement AS 60.
Elle en vient ensuite l’amendement AS 86 de M. Hervé Morin.
M. Hervé Morin. Nous savons fort bien, monsieur le rapporteur, que les données prétendument soumises à des obligations de discrétion, la plupart du temps, y échappent. En 24 heures, tout est en général sur la place publique.
Donnons donc un peu de sens et de force à la loi en indiquant qu’il s’agit d’une obligation sérieuse qui doit être respectée et que les fuites intempestives et non contrôlées doivent être évitées !
M. le rapporteur. L’alinéa 28 fait état des « informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur ». Celles qui portent atteinte au secret des affaires en font bien évidemment partie.
Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement AS 86.
Puis elle examine l’amendement AS 255 de M. Denys Robiliard.
M. Denys Robiliard. Dès lors que les informations de la base de données vaudront rapport et information qui doivent être transmis au comité d’entreprise, l’obligation de leur actualisation doit être précisée.
M. le rapporteur. Nous avons évoqué cet amendement à plusieurs reprises et le voilà enfin. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement AS 255.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 187 de M. Chassaigne.
M. André Chassaigne. Il s’agit de prévoir les modalités de mise à disposition ou d’accès aux modifications de la base de données pour les membres du comité d’entreprise.
M. le rapporteur. Les amendements que nous avons adoptés permettent de répondre à votre préoccupation. À chaque procédure d’information-consultation, la base sera actualisée. La mise à jour, de surcroît, sera régulière et la base contiendra toutes les informations pertinentes chaque fois qu’elles seront nécessaires. Ce bon équilibre pratique évitera des situations où la non-actualisation d’une base ferait l’objet de reproches pour des motifs qui n’intéresseraient pas les salariés.
Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement AS 187.
Puis la Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS 397 et AS 398 du rapporteur.
Elle en vient à l’amendement AS 256 de M. Denys Robiliard.
M. Denys Robiliard. C’est un amendement de coordination avec plusieurs amendements déjà adoptés.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 256.
Elle examine ensuite l’amendement AS 190 de Mme Jacqueline Fraysse.
M. André Chassaigne. Il est défendu.
M. le rapporteur. Le décret précisera la date de début de la mission de l’expert. Avis défavorable comme précédemment.
La Commission rejette l’amendement AS 190.
Elle en vient à l’amendement AS 58 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. L’amendement tend à supprimer le paragraphe 9 consacré au crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), dont les dispositions ne figurent pas dans l’accord du 11 janvier et sont redondantes avec l’alinéa 23.
M. le rapporteur. Nous avons ardemment souhaité ces dispositions lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative. Le crédit d’impôt compétitivité emploi n’est pas conditionné à des critères prédéfinis, mais seulement à un fléchage des sommes vers la recherche et l’innovation, et à l’interdiction de financer par ce moyen des hausses de dividendes ou de rémunération des dirigeants. Le contrôle par les salariés de l’utilisation des sommes est une forme de contrôle moderne.
Nous souhaiterions d’ailleurs aller plus loin dans ces dispositions essentielles, afin que l’administration fiscale puisse tirer des conséquences en cas de non-respect ou de mauvaise utilisation.
M. Denys Robiliard. L’accord du 11 janvier ne mentionne pas expressément le crédit d’impôt compétitivité emploi mais il évoque bien, page 12, les crédits d’impôt en général.
La Commission rejette l’amendement AS 58.
Elle examine ensuite l’amendement AS 98 de M. Christian Hutin.
M. Christian Hutin. Il s’agit de préciser que le comité d’entreprise peut demander toute information complémentaire utile dans le cadre de la consultation sur le crédit d’impôt compétitivité emploi. L’information du comité d’entreprise est en effet utile pour garantir la bonne utilisation des sommes et pour éviter d’éventuels abus.
M. le rapporteur. C’est le droit commun pour toutes les procédures d’information-consultation. Au reste, l’alinéa 47 prévoit que le comité d’entreprise peut demander à l’employeur de lui fournir des explications lorsqu’il existe un doute sur l’utilisation réelle du crédit d’impôt compétitivité emploi.
L’amendement me semble donc redondant. Son adoption risque, en outre de jeter le trouble : on s’interrogera sur l’absence de dispositions spécifiques ailleurs, alors qu’il s’agit, je le répète, de la procédure habituelle.
M. Christian Hutin. Je retire l’amendement, quitte à le présenter de nouveau en séance publique afin d’évoquer les éventuels dévoiements du crédit d’impôt compétitivité emploi.
L’amendement AS 98 est retiré.
Puis la Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS 399 et AS 400 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AS 257 de M. Denys Robiliard.
M. Denys Robiliard. Il s’agit d’un amendement de coordination avec un amendement à l’alinéa 51 qui n’a pas encore été déposé. Je le retire.
L’amendement AS 257 est retiré.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS 401 du rapporteur.
Elle en vient à l’amendement AS 151 de Mme Jacqueline Fraysse.
M. André Chassaigne. Dans le projet de loi, le comité d’entreprise peut seulement constater des anomalies dans l’utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi et, le cas échéant, protester et alerter. Nous proposons qu’il puisse également saisir le tribunal administratif d’une requête visant à ordonner le remboursement par l’entreprise des sommes reçues.
M. le rapporteur. Je comprends d’autant mieux votre préoccupation que j’ai moi-même défendu l’idée d’un contrôle de l’utilisation de ces sommes. Cela dit, avant de saisir le tribunal administratif, il faut saisir le comité de suivi régional. Les services de l’État, notamment l’administration du travail et les services fiscaux, y seront représentés. La procédure proposée me semble un peu rapide. Avis défavorable.
M. André Chassaigne. Où ce comité régional de suivi est-il mentionné ?
M. le rapporteur. À l’alinéa 50. Il réunit les administrations compétentes de l’État et les partenaires sociaux.
Mme Isabelle Le Callennec. Pourrions-nous avoir une liste précise ?
Par ailleurs, l’alinéa 50 ne dit rien de ce que fera le comité de suivi régional, hormis la remise d’une synthèse annuelle au comité national de suivi – dont nous aimerions aussi, par parenthèse, connaître la composition.
M. André Chassaigne. Mon amendement précise bien que la saisine du tribunal peut avoir lieu « en cas d’absence de réponse suffisante de l’employeur à l’issue des réunions des organes visés par les alinéas précédents du présent article ». Donc il prend en compte le comité de suivi régional.
M. le rapporteur. À ma connaissance, c’est l’administration fiscale et non le tribunal administratif qui peut demander le reversement des sommes en cause.
En créant par la loi de finances rectificative pour 2012 les comités de suivi régionaux, le Gouvernement voulait mettre en place un dispositif qui suive de près les éventuelles mauvaises utilisations du crédit d’impôt compétitivité emploi afin de faire évoluer la législation dans les lois de finances ultérieures. Il n’est pas dans les compétences de ces structures de demander le reversement de ces sommes.
Nous poursuivrons ce débat dans l’hémicycle.
La Commission rejette l’amendement AS 151.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS 402 du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement AS 298 du même auteur.
M. le rapporteur. Il s’agit d’avancer du 31 décembre 2016 au 30 juin 2015 la remise au Parlement du rapport sur l’exercice du droit de saisine des comités d’entreprise en matière d’utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi. Il ne faut pas attendre la fin du quinquennat pour corriger, le cas échéant, ce qui n’aurait pas fonctionné dans le dispositif. Dès la préparation de la loi de finances pour 2016, nous devons disposer d’un rapport d’étape qui nous permettra d’exercer un suivi très serré et de corriger par la loi les éventuels effets d’aubaine.
La Commission adopte l’amendement AS 298.
Elle adopte également l’amendement rédactionnel AS 403 du rapporteur.
Elle examine l’amendement AS 258 de Mme Fanélie Carrey-Conte.
Mme Fanélie Carrey-Conte. Il s’agit de préciser que l’instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n’a pas vocation à être permanente.
M. le rapporteur. Cela répond à la préoccupation, exprimée par André Chassaigne, de conserver aux CHSCT l’intégralité de leurs responsabilités. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement AS 258.
Elle en vient aux amendements AS 96 de M. Christian Hutin et AS 299 du rapporteur, pouvant être soumis à une discussion commune.
M. Christian Hutin. L’alinéa 64 prévoit un seul représentant par comité dans l’instance de coordination. Je propose que ce nombre soit porté à deux ou à trois selon le nombre de comités concernés.
Cela permettra d’améliorer le fonctionnement de l’instance de coordination, de mieux prendre en compte la diversité des sites de certaines entreprises – Dunkerque et Florange pour ArcelorMittal, par exemple – et d’assurer la représentation des petits établissements.
En outre, l’article R. 4613-1 du code du travail précise qu’avec un effectif compris en 50 et 199 salariés, la délégation du personnel comprend trois salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres. Dans le dispositif proposé par le projet de loi, la représentation de ces catégories devient difficile.
M. le rapporteur. Mon amendement va dans le même sens mais je propose plutôt de modifier le vôtre, monsieur Hutin, en ajoutant qu’au-delà de quinze CHSCT, il n’y aura plus qu’un représentant par comité. Il ne faut pas que l’instance de coordination devienne pléthorique.
M. Christian Hutin. D’accord.
La Commission adopte l’amendement AS 96 modifié.
En conséquence, l’amendement AS 299 devient sans objet.
La Commission est saisie de l’amendement AS 259 de M. Gérard Sébaoun.
M. Gérard Sébaoun. Aux termes de l’alinéa 65, l’instance de coordination comprendra différentes personnalités territorialement compétentes pour l’établissement dans lequel elle se réunit. Cette référence au lieu de la réunion n’a guère de sens car rien n’interdit qu’on y étudie les difficultés d’un établissement éloigné. C’est pourquoi nous proposons que les personnalités qualifiées soient territorialement compétentes pour l’établissement où se tient la réunion s’il est concerné par le projet, et, dans le cas contraire, pour l’établissement concerné le plus proche du lieu de réunion.
M. le rapporteur. Avis favorable.
M. Hervé Morin. Quelles seraient les conséquences du non-respect de cette disposition ?
M. Gérard Sébaoun. Ces personnalités qualifiées sont invitées. Elles n’ont pas obligation à être présentes. À ma connaissance, il n’y a donc pas de conséquences légales.
Pour le reste, il est préférable que ce soient le médecin du travail et l’inspecteur du travail les plus intéressés au sujet débattu qui siègent.
La Commission adopte l’amendement AS 259.
Elle en vient à l’amendement AS 260 de Mme Pascale Boistard.
Mme Fanélie Carrey-Conte. Il s’agit de préciser que seuls l’employeur et les représentants des CHSCT auront voix délibérative au sein de l’instance de coordination.
M. le rapporteur. Avis favorable. Cette clarification est bienvenue.
La Commission adopte l’amendement AS 260.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS 404 et AS 405 du rapporteur.
Elle examine l’amendement AS 300 du même auteur.
M. le rapporteur. Après l’expertise commune rendue par plusieurs CHSCT concernés par un même projet, il nous semble indispensable que chaque comité rende individuellement son avis puisque les réorganisations concerneront les salariés de chaque établissement. Ainsi, il ne sera possible en aucun cas que le dispositif proposé se substitue à la consultation d’un CHSCT.
La Commission adopte l’amendement AS 300.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS 406 et AS 407 du même auteur.
Elle est saisie de l’amendement AS 97 de M. Christian Hutin.
M. Christian Hutin. L’alinéa 11 prévoit une consultation annuelle obligatoire du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Cet amendement propose de faire de même pour le CHSCT, à l’importance duquel je crois, contrairement à Hervé Morin.
M. le rapporteur. La négociation sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle que les partenaires sociaux ont engagée portera notamment sur le rôle du CHSCT. L’amendement soulève un vrai problème. Il est à noter cependant que le comité d’entreprise est aujourd’hui habilité à demander la consultation du CHSCT dès lors que les orientations stratégiques pourraient avoir des conséquences sur les conditions de travail.
Nous poursuivrons le débat lorsque nous serons saisis du texte issu de cette négociation qui devrait aboutir avant l’été. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement AS 97.
Puis elle adopte l’article 4 ainsi modifié.
Après l’article 4
La Commission est saisie, en présentation commune, des amendements AS 90 et AS 88 de M. Hervé Morin, portant articles additionnels après l’article 4.
M. Hervé Morin. L’objectif de ces amendements est de rationaliser le dispositif d’information-consultation du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. J’ai expliqué comment le système actuel provoque des doublons en matière d’information, d’expertise et de contentieux.
L’amendement AS 90 propose que le CHSCT devienne une commission du comité d’entreprise, l’amendement AS 88 propose d’en revenir à l’essence des lois Auroux en réattribuant au comité d’entreprise les compétences qui ont été progressivement confiées au CHSCT par la jurisprudence de la Cour de cassation.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
La Commission rejette successivement les amendements AS 90 et AS 88.
Article 5
(art. L. 225-27-1 et L. 225-28-1 [nouveaux], L. 225-29 à L. 225-34, L. 225-34-1 et L. 225-79-1 [nouveaux], L. 225-80 et L. 226-4-2 à L. 226-4-4 [nouveaux]
du code du commerce ; art. L. 2323-65 du code du travail)
Représentation des salariés au conseil d’administration ou de surveillance
Le présent article vise à imposer l’obligation de représentation des salariés au conseil d’administration ou de surveillance des grandes entreprises implantées en France, afin d’accroître leur participation à la gouvernance de ces sociétés. Il constitue la déclinaison législative de l’article 13 de l’accord du 11 janvier.
I.- LA REPRÉSENTATION ACTUELLE DES SALARIÉS
DANS LES ORGANES DE GOUVERNANCE
La représentation des salariés dans les organes de gouvernance des entreprises prend, aujourd’hui, cinq formes. Il s’agit, tout d’abord, d’une faculté offerte à l’ensemble des entreprises dotées d’un conseil d’administration ou de surveillance, si elles souhaitent la mettre en œuvre. Il s’agit, ensuite, d’une obligation en ce qui concerne la représentation des salariés actionnaires, ainsi que pour les entreprises du secteur public et, dans certains cas, les sociétés européennes. Enfin, des délégués du comité d’entreprise ont la possibilité de siéger, avec voix consultative, dans ces instances.
A. LES CAS DE REPRÉSENTATION FACULTATIVE DES SALARIÉS
Le code de commerce offre la possibilité aux entreprises d’organiser la représentation de leurs salariés au conseil d’administration, en vertu de l’article L. 225-27, ou au conseil de surveillance, en vertu de l’article L. 225-79.
1. Des représentants élus
Aux termes de ces articles, les statuts des sociétés peuvent prévoir que leurs organes de gouvernance comprennent des représentants élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social se trouve en France.
Le nombre de ces représentants ne peut ni excéder le tiers du nombre des autres membres, ni être supérieur à quatre. Toutefois, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, jusqu’à cinq représentants peuvent participer au conseil d’administration.
Le bénéfice de ce mandat représentatif obéit à deux conditions : les salariés intéressés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la société ou l’une de ses filiales, correspondant à un emploi effectif et conclu au moins deux ans avant la date de nomination. Le bénéfice du droit de vote est accordé à tout salarié de la société et, le cas échéant, de ses filiales, dont le contrat de travail a été signé au moins trois mois avant l’élection.
S’agissant, ensuite, du processus électoral, les candidats ou listes de candidats peuvent être présentés soit par des organisations syndicales représentatives, soit par le vingtième des électeurs ou, si le nombre de ceux-ci est supérieur à deux mille, par cent d’entre eux. Si, dans tous les cas, le vote doit être secret, les modes de scrutin varient en fonction du nombre de sièges à pourvoir. En effet, quand le nombre des représentants élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les ingénieurs et cadres doivent disposer au moins d’un siège. Lorsqu’un seul siège doit être pourvu, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours, et, dans les autres cas, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. En cas de vacance du mandat, postérieure à l’élection, le siège sera pourvu soit par le remplaçant, soit par le candidat suivant sur la liste.
Enfin, les contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales doivent être portées devant le juge d’instance, qui statue en dernier ressort à l’instar des règles prévues pour les élections professionnelles.
2. Des membres de plein droit au statut protecteur
Les représentants des salariés constituent des membres de plein droit de l’organe auquel ils appartiennent : ils disposent des mêmes pouvoirs et responsabilités que les autres membres.
Cette équivalence de droits et de responsabilités explique l’incompatibilité de ce mandat, avec ceux de délégué syndical, de membre du comité d’entreprise, de délégué du personnel ou de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les règles relatives à la durée du mandat des représentants des salariés sont, par ailleurs, semblables à celles des autres membres : celle-ci doit être déterminée par les statuts, sans excéder six ans, en principe renouvelables.
Concernant le dédommagement de leur activité au conseil, les représentants des salariés peuvent se voir alloués des jetons de présence par l’assemblée générale, à l’instar des autres membres. Ils sont, enfin, tenus à la même obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel.
Cependant, du fait de la particularité de leur situation, ils jouissent d’un statut protecteur. Tout d’abord, les représentants en exercice ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail et ne peuvent subir aucune réduction de rémunération. Ils peuvent, de plus, bénéficier d’un stage de formation économique, financière et juridique, au titre de l’article L. 3341-2 du code du travail.
Enfin, leur révocation obéit à des motifs et conditions stricts : celle-ci ne peut intervenir que pour faute dans l’exercice de leur mandat, par décision en référé du président du tribunal de grande instance, à la demande de la majorité des autres membres du conseil. Pour comparaison, ces derniers sont, par contre, révocables ad nutum. Cette protection du mandat s’étend, en quelque sorte, au contrat de travail, dont la rupture ne peut être prononcée qu’en référé par le bureau de jugement du conseil des prud’hommes.
B. LES CAS DE REPRÉSENTATION OBLIGATOIRE DES SALARIÉS
Outre la faculté ouverte à toute société d’organiser l’élection de salariés aux organes de gouvernance, le droit français prévoit quatre cas de représentation obligatoire de nature différente.
1. La représentation des salariés actionnaires
Le code de commerce impose la représentation des salariés actionnaires au conseil d’administration ou de surveillance, dès lors que ceux-ci détiennent plus de 3 % du capital social.
Ces représentants sont élus par l’assemblée générale, dans des conditions fixées par les statuts, sur proposition des salariés et anciens salariés actionnaires. Peuvent prétendre à ce mandat, les salariés actionnaires ou, le cas échéant, les salariés membres du conseil de surveillance d’un fonds commun de placement d’entreprise détenant des actions de la société. Une fois en fonction, le statut de ces représentants est identique à celui des membres non-salariés des organes de gouvernance.
L’obligation de représentation du personnel actionnaire se trouve assortie d’une sanction : si l’assemblée générale ne se réunit pas dans un délai de dix-huit mois à compter du franchissement du seuil de 3 %, tout salarié actionnaire peut saisir en référé le président du tribunal de commerce, pour qu’il enjoigne au conseil de la convoquer. Toutefois, il existe aujourd’hui un mécanisme de substitution de représentation. En effet, les sociétés dont l’organe de gouvernance comprend des membres élus par le personnel ne sont pas tenues d’organiser l’élection de représentants des salariés actionnaires.
2. La représentation des salariés des entreprises publiques
Dans les entreprises publiques ou anciennement publiques, les lois du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations imposent l’élection de représentants des salariés au conseil d’administration ou de surveillance.
● Les règles prévues par la loi du 26 juillet 1983
Dans les sociétés soumises aux dispositions de la loi du 26 juillet 1983, le nombre obligatoire de représentants des salariés varie entre deux et six. Leurs conditions d’éligibilité et d’élection, ainsi que l’étendue de leurs pouvoirs sont semblables à celles du droit commun, mais leur statut obéit à des règles propres. Leur mandat dure cinq ans, et ses modalités d’exercice apparaissent plus protectrices. En effet, la loi leur accorde un droit à formation spécifique : l’organe de gouvernance doit arrêter un programme de formation à la gestion des entreprises destiné aux représentants des salariés nouvellement élus, à la charge de l’entreprise. Il doit être consulté, de plus, avant toute modification substantielle du contrat de travail de ces représentants.
Au-delà, l’article L. 2411-17 du code du travail leur accorde surtout le statut de salariés protégés, dont le licenciement ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour les anciens représentants des salariés pendant les six premiers mois suivant la cessation de leur mandat, ainsi que pour les candidats et anciens candidats pendant les trois mois suivant le dépôt des candidatures.
● Les règles prévues par la loi du 6 août 1986
Aux termes de la loi du 6 août 1986, les conseils d’administration ou de surveillance des sociétés privatisées au titre de la loi du 19 juillet 1993, doivent comprendre deux représentants des salariés et un représentant du personnel actionnaire, s’ils comptent moins de quinze membres, et, trois représentants des salariés et un représentant du personnel actionnaire, dans le cas contraire. Dans les entreprises privatisées au titre de la loi du 2 juillet 1986, l’organe de gouvernance comporte, au moins, un représentant des salariés ou du personnel actionnaire, s’il compte moins de quinze membres, et deux dans les autres cas. L’élection et le statut de ces représentants sont régis, pour le reste, par les règles de droit commun prévues par le code de commerce.
3. La participation des salariés dans les sociétés européennes
Dans les sociétés européennes implantées en France, à défaut d’accord collectif, le code du travail impose la participation des salariés au conseil d’administration ou de surveillance sous deux formes alternatives :
– dans le cas d’une société européenne constituée par transformation, s’il existait un système de participation des salariés avant l’immatriculation, il continue de s’appliquer ;
– dans les autres cas de constitution d’une société européenne, les modalités de participation des salariés sont déterminées après examen des différents systèmes nationaux en vigueur avant l’immatriculation.
Dans les deux cas, la participation des salariés ne recouvre pas nécessairement, selon le code du travail, l’élection de représentants à l’organe de gouvernance mais peut consister en un droit de recommandation ou d’opposition à la désignation de ses membres.
4. La participation de délégués du comité d’entreprise
Au-delà des mécanismes facultatifs ou obligatoires de représentation des salariés aux conseils d’administration ou de surveillance, le code du travail accorde le droit à des délégués désignés par le comité d’entreprise d’assister avec voix consultative à l’ensemble des séances de ces instances. Ces délégués sont au nombre de deux ou quatre, en fonction des collèges électoraux définis dans l’entreprise. Lorsque des représentants élus par les salariés siègent à l’organe de gouvernance, un seul délégué peut exercer cette prérogative.
Ils ont accès aux mêmes documents que les membres du conseil d’administration ou de surveillance et peuvent soumettre des propositions, auxquelles il doit être répondu de manière motivée. Ils ont également la faculté d’assister aux assemblées générales, et d’être entendus à leur demande, lors de toutes les délibérations requérant l’unanimité des associés.
C. UNE PRATIQUE PEU RÉPANDUE DANS LES ENTREPRISES PRIVÉES
D’après les informations transmises par le Gouvernement, il existe peu de données disponibles évaluant la mise en œuvre de la possibilité ou de l’obligation d’organiser la participation de représentants des salariés aux organes de gouvernance. Une étude de la documentation française (21) indique, toutefois, que 160 sociétés disposaient, en 2008, de représentants des salariés avec voix délibérative, en dehors des représentants du personnel actionnaire : 61 % de ces sociétés étaient des entreprises publiques, 34 % des entreprises privatisées et 5 % des sociétés privées.
Cette répartition démontre que très peu d’entreprises non soumises à une obligation de représentation des salariés choisissent de la mettre en place, bien que le code de commerce leur en offre la faculté.
II.- LA CRÉATION D’UNE OBLIGATION DE REPRÉSENTATION
DES SALARIÉS DANS LES ORGANES DE GOUVERNANCE
Face à ce constat, le présent article vise à créer une obligation de représentation des salariés dans les organes de gouvernance des grandes entreprises implantées en France, en s’inspirant des orientations arrêtées par l’article 13 de l’accord du 11 janvier. Selon l’étude d’impact, cette mesure s’appliquerait à près de 200 sociétés, couvrant 4 millions de salariés, soit un salarié du secteur privé sur quatre.
À cette fin, les 1° du I, II et III créent trois nouveaux articles du code de commerce, qui imposent une obligation identique de représentation des salariés au conseil d’administration des sociétés anonymes (nouvel article L. 225-27-1), au conseil de surveillance de ces mêmes sociétés (nouvel article L. 225-79-2), et à celui des sociétés en commandite par actions (nouvel article L. 226-4-2).
A. LE CHAMP DE L’OBLIGATION DE REPRÉSENTATION
Le I de ces trois nouveaux articles définit, tout d’abord, le champ de l’obligation de représentation, qui s’applique aux sociétés :
– dont le siège social est situé en France, la loi française ne pouvant régir des sociétés établies à l’étranger ;
– qui emploient, à la clôture de chacun des deux derniers exercices, au moins 5 000 salariés permanents dans la société et ses filiales directes ou indirectes situées sur le territoire français, ou au moins 10 000 salariés permanents dans la société et ses filiales directes ou indirectes situées sur le territoire français et à l’étranger ;
– qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise, c’est-à-dire comptent plus de 50 salariés.
Les seuils d’effectifs retenus correspondent donc à ceux stipulés par l’accord du 11 janvier. La limitation aux sociétés tenues d’instituer un comité d’entreprise, écarte du champ de l’obligation les sociétés holding comprenant très peu de salariés, dont les filiales se verront, en revanche, soumises à la nouvelle obligation.
Le I des trois nouveaux articles prévoit, également, l’articulation de l’application de cette nouvelle obligation entre une société et ses filiales. N’y seront pas tenues les filiales d’une société soumise à la nouvelle obligation. En revanche, y seront tenues les filiales en remplissant les critères, même si leur société de tête n’y est pas soumise.
B. LE NOMBRE DE REPRÉSENTANTS
Le II des trois nouveaux articles fixe, ensuite, le nombre des représentants des salariés devant participer aux organes de gouvernance, qui s’élève à deux dans les organes comprenant plus de douze membres, et à un dans les autres cas, conformément aux dispositions de l’accord du 11 janvier. Ces représentants ne seront pas pris en compte pour le calcul des nombres minimal et maximal de membres de ces instances, ni pour l’application des règles relatives à la parité, comme c’est le cas aujourd’hui pour les représentants élus du personnel.
Selon le V des trois nouveaux articles, pourront prétendre à la désignation à l’organe de gouvernance les salariés titulaires d’un contrat de travail depuis deux ans et correspondant à un emploi effectif. Cette condition d’ancienneté ne sera toutefois pas exigée si la société est constituée depuis moins de deux ans.
C. LES OPTIONS DE DÉSIGNATION
Le III des trois nouveaux articles précise, ensuite, les modalités de désignation du ou des représentants des salariés. Les statuts devront retenir l’une des options suivantes :
– l’organisation d’une élection auprès des salariés dans les conditions fixées au nouvel article L. 225-28-1, présenté ci-dessous ;
– la désignation par, selon le cas, le comité de groupe, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise ;
– la désignation par l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections professionnelles, lorsqu’un seul représentant doit être désigné, ou par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages à ces élections, lorsque deux administrateurs doivent être désignés ;
– lorsque deux représentants doivent être désignés, la désignation du premier selon l’une des trois modalités précitées, et du second par le comité d’entreprise européen, s’il existe, et, pour les sociétés européennes, par le comité de la société européenne ou l’organe de représentation des salariés. Dans ce dernier cas, les statuts pourraient prévoir la désignation d’un salarié étranger à l’organe de gouvernance.
D. LES MODALITÉS DE L’ÉLECTION
Si les statuts retiennent l’option de l’élection, celle-ci devra se dérouler selon des modalités définies par les nouveaux articles L. 225-28-1, s’agissant du conseil d’administration des sociétés anonymes, créé par le 2° du I, et L. 226-4-2, s’agissant du conseil de surveillance des sociétés en commandite par actions, créé par le 2° du III. S’agissant du conseil de surveillance des sociétés anonymes, le 2° du II complète l’article L. 225-80 pour qu’il opère par renvoi à ces dispositions.
Sur le fond, les modalités retenues pour l’élection apparaissent similaires à celles aujourd’hui en vigueur dans les cas de représentation facultative. En effet, peuvent y participer tous les salariés de la société et de ses filiales établies en France, titulaires d’un contrat de travail depuis trois mois. Les candidats ou listes de candidats doivent être présentés par une organisation syndicale représentative. Lorsqu’un seul siège doit être pourvu, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours, et, dans les autres cas, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. En cas d’égalité des voix, sont déclarés élus les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien. Quel que soit le mode de scrutin, le vote est secret. Sans pouvoir déroger à ces prescriptions légales, les statuts fixeront les autres modalités de l’élection, notamment son organisation pratique.
À l’instar des règles actuelles, les contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le juge d’instance qui statue en dernier ressort.
E. LE REMPLACEMENT EN CAS DE VACANCE
Le 9° du I prévoit les conditions de remplacement des représentants en cas de vacance, quelle qu’en soit la cause. Il crée un nouvel article L. 225-34-1, qui énonce que le siège vacant doit être pourvu par le suppléant du représentant, lorsque l’élection a eu lieu au scrutin majoritaire à deux tours, ou par le candidat suivant sur la liste, lorsque l’élection a eu lieu au scrutin de liste. Si la vacance concerne un représentant désigné, une nouvelle procédure de désignation doit être mise en œuvre. Dans les deux cas, le mandat du nouveau représentant prend fin à l’arrivée du terme initialement prévu.
Le 2° du II complète l’article L. 225-80, pour rendre ces règles applicables, par renvoi, aux représentants des salariés au conseil de surveillance des sociétés anonymes, et le 8° du I opère une coordination législative.
F. LE STATUT DES REPRÉSENTANTS
Le présent article étend aux nouveaux représentants désignés le statut actuellement prévu pour les représentants élus aux organes de gouvernance des entreprises privées, en procédant aux coordinations nécessaires. Les nouveaux représentants se voient donc appliquer les règles relatives :
– à la durée de six ans renouvelables du mandat et à la nullité de toute nomination intervenue en violation des dispositions légales (3° du I) ;
– à l’incompatibilité avec les mandats syndicaux ou représentatifs du personnel (4° du I) ;
– au maintien du contrat de travail et de la rémunération (5° du I) ;
– aux conditions restrictives de révocation (6° du I) et de rupture du contrat de travail (7° du I).
S’agissant des représentants aux conseils de surveillance des sociétés en commandite par action, le 3° du III crée un nouvel article L. 226-4-4 qui opère un renvoi aux dispositions applicables aux représentants aux organes de gouvernance des sociétés anonymes.
G. UNE OBLIGATION SANCTIONNÉE
Le présent article assortit d’une sanction la nouvelle obligation de représentation des salariés, prévue au IV des trois nouveaux articles créés par les 1° du I, II et III. En effet, si l’assemblée générale ou l’assemblée des commanditaires ne procède pas aux modifications statutaires nécessaires à la mise en œuvre de cette obligation, dans un délai de six mois à compter de la clôture du second exercice où la société remplit le critère d’effectif, les représentants sont désignés par voie d’élection. Celle-ci doit se tenir, au plus tard, six mois après le rejet des modifications en assemblée extraordinaire ou après la réunion sur les comptes du second exercice clos en assemblée ordinaire.
H. LA SITUATION DES SOCIÉTÉS AYANT ORGANISÉ UNE REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Concernant les sociétés anonymes, le VI de ces nouveaux articles règle la situation des sociétés ayant organisé une représentation des salariés à l’organe de gouvernance, qu’elles y soient tenues par la loi, dans le cas des entreprises publiques, ou qu’elles aient souhaité la mettre en œuvre en utilisant la faculté offerte par le code de commerce. Ces sociétés ne seront pas soumises à la nouvelle obligation, dès lors que le nombre actuel de représentants correspond aux prescriptions légales. Dans le cas contraire, elles doivent procéder à une nouvelle désignation de l’ensemble des représentants selon les modalités décrites.
Par ailleurs, le IV du présent article opère les coordinations nécessaires aux articles du code du travail relatifs à la participation d’un délégué du comité d’entreprise aux organes de gouvernance.
I. L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF
Le V du présent article prévoit, enfin, les règles d’entrée en vigueur du dispositif : la désignation des nouveaux représentants devra intervenir dans les vingt-six mois de la promulgation de la loi, conformément au délai fixé par l’accord du 11 janvier.
*
* *
Lors de son examen du projet de loi, à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission des lois et du rapporteur, votre commission a amélioré et complété le statut des nouveaux représentants des salariés aux conseils d’administration et de surveillance :
– en leur conférant le statut de salariés protégés, dont la rupture du contrat de travail requiert l’autorisation de l’inspection du travail ;
– en imposant à l’employeur de donner aux administrateurs élus par les salariés ou désignés le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, dans la limite d’une durée fixée par décret et permettant à l’administrateur d’exercer utilement sa compétence ;
– en actualisant le champ des incompatibilités statutaires, en y incluant le mandat de membre des institutions représentatives de sociétés européennes, du fait de l’octroi à celles-ci d’une possibilité de désignation d’un représentant des salariés.
*
M. Jean-Michel Clément, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République. L’article 5 consacre la participation des salariés dans l’organe de gouvernance de tête qui définit la stratégie de l’entreprise. Il vise à donner consistance à un principe dont sont convenues les organisations signataires de l’accord du 11 janvier.
Il consacre aussi un accroissement de la place des administrateurs représentant les salariés par rapport aux dispositifs existants, notamment ceux qui sont issus de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, des lois de privatisation de 1986 et de 1993 et de certains articles du code de commerce applicables aux entreprises dont plus de 3 % du capital est détenu par des salariés.
Le dispositif n’est donc pas totalement nouveau, d’autant que certaines sociétés l’ont expressément prévu dans leurs statuts.
Il a été évoqué, on le sait, dans le rapport Gallois, mais aussi lors des auditions menées par la mission d’information sur la transparence de la gouvernance des grandes entreprises, crée par la Commission des Lois, où plusieurs grands patrons nous ont dit souhaiter la présence de représentants des salariés dans les conseils d’administration et les conseils de surveillance.
L’article 5 pose le principe d’un statut d’administrateur de plein exercice pour les salariés et l’assortit de règles protectrices permettant l’exercice de ces fonctions. La voix de ces administrateurs est juridiquement égale à celle des autres administrateurs en matière de prise de décision, et leurs devoirs sont les mêmes. Le souhait des organisations syndicales est que le statut d’administrateur salarié ne soit pas hybride.
La commission des lois a adopté ce matin des amendements de précision et émis un avis favorable à l’adoption de l’article 5. Nous déposerons de nouveaux amendements de précision concernant l’entrée en vigueur du dispositif en séance publique, de manière que le texte soit appliqué sans équivoque et sans retard.
Cela étant, seules 200 entreprises sont actuellement visées. Je pense comme le rapporteur qu’il est possible d’élargir le champ du dispositif.
La Commission est saisie de l’amendement AS 133 de Mme Jacqueline Fraysse, tendant à supprimer l’article 5.
M. André Chassaigne. Défendu.
M. le rapporteur. Avis défavorable. L’entrée des représentants des salariés aux conseils d’administration des grandes entreprises constitue une avancée importante. À titre personnel, je souhaiterais que l’on aille jusqu’à quatre administrateurs dans la limite d’un tiers, conformément aux préconisations du rapport Gallois, et que l’on abaisse le seuil d’application de ce dispositif à 1 000 salariés.
Lors de son audition, M. Bernasconi a estimé que le texte actuel, avec deux représentants des salariés pour les conseils d’administration de plus de douze membres et une application aux seules entreprises de plus de 5 000 salariés, n’était qu’une étape. Pour une fois, je propose d’aller plus vite que le MEDEF !
Le débat se poursuivra dans l’hémicycle car je n’ai pas encore recueilli un avis entièrement favorable de la part des signataires de l’accord du 11 janvier et ne puis donc vous présenter d’amendement en ce sens.
La Commission rejette l’amendement AS 133.
Elle examine ensuite l’amendement AS 99 de M. Christian Hutin.
M. Christian Hutin. Le champ des entreprises concernées serait considérablement élargi si nous abaissions le seuil de 5 000 à 50 salariés, seuil retenu pour la création d’un comité d’entreprise.
M. le rapporteur. À regret, défavorable.
Cher collègue, votre amendement pèche par ambition, ce qui n’est pas un défaut mais plutôt une qualité. Si je souhaite, à titre personnel, que le seuil soit rapidement abaissé, votre proposition n’est pas compatible avec l’accord du 11 janvier.
La commission rejette l’amendement AS 99.
Elle est saisie de l’amendement AS 152 de Mme Jacqueline Fraysse.
M. André Chassaigne. La proposition de Christian Hutin était radicale ; la mienne, modérée, vise à abaisser le seuil à 1 000 salariés.
M. le rapporteur. Défavorable, mais du bout des lèvres, vous l’avez compris.
M. André Chassaigne. Monsieur le rapporteur, pourquoi ce blocage à l’égard du développement de la démocratie sociale ?
M. le rapporteur. Monsieur Chassaigne, je n’ai pas de blocage mais une règle de conduite : j’avance sur le chemin de crête dessiné par l’accord tel qu’il a été signé. À titre personnel, je soutiens votre amendement, mais son adoption nous éloignerait de la route que je me suis fixée.
Je souhaite que les esprits évoluent, notamment au sein du patronat financier car les auditions ont clairement montré que le patronat industriel était déjà convaincu.
M. Jean-Noël Carpentier. Le rapporteur n’a pas abandonné l’idée d’abaisser le seuil prévu à l’article 5 ; peut-être pourrions-nous l’aider dans ses négociations en votant en faveur des amendements qui nous sont soumis malgré la demande de rejet qu’il se trouve dans l’obligation de formuler ?
La Commission rejette l’amendement AS 152.
Elle en vient à l’amendement AS 236 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Une société doit être soumise à l’obligation relative aux administrateurs représentants les salariés même lorsqu’elle est la filiale d’une société elle-même soumise à cette obligation.
M. le rapporteur. Mollement défavorable. L’idée est bonne, mais elle s’écarte à nouveau de mon chemin de crête.
La commission rejette l’amendement AS 236.
Elle est saisie de l’amendement AS 153 de Mme Jacqueline Fraysse.
M. André Chassaigne. Beaucoup d’entre vous, quels que soient les bancs sur lesquels ils siègent, ont montré dans leurs engagements passés leur intérêt pour l’appropriation collective des biens de production. Nous proposons que le nombre d’administrateurs salariés soit égal au tiers du nombre total d’administrateurs. Cette mesure constituerait une avancée considérable et une véritable esquisse de transformation sociale.
M. le rapporteur. À titre personnel, je suis très favorable à cette disposition qui reprend une proposition du rapport Gallois. Lors de son audition, M. Jean-Louis Beffa, président d’honneur de Saint-Gobain, nous a expliqué qu’un tel dispositif joue un rôle majeur pour préserver les emplois de production en Allemagne.
Le sujet est fondamental, il y a urgence, et nous devrions avancer, mais certains signataires de l’accord sont résolument opposés à une telle évolution. Il nous reste quelques jours pour les faire changer d’avis. En l’état, avec un immense regret, j’émets un avis défavorable.
M. André Chassaigne. Nous n’avons décidément pas la même conception du travail parlementaire : pour moi, le Parlement écrit la loi, et nous ne sommes pas des copistes !
M. Christian Paul. Le groupe socialiste a fait le choix d’avancer en améliorant le texte à chacune des étapes du processus législatif. Nous le faisons en commission ; nous le ferons en séance en déposant des amendements qui résulteront de la poursuite des consultations et des négociations. En respectant cette ligne de conduite, le rapporteur mène les débats avec sérieux, loyauté et transparence. La messe n’est donc pas encore dite, monsieur Chassaigne, ne désespérez pas !
M. Gérard Cherpion. Un conseil d’administration de douze membres compte obligatoirement six personnes extérieures à l’entreprise. Si un tiers du nombre total des sièges doit être réservé aux administrateurs salariés, ces derniers seront quatre, et vous n’aurez plus que deux représentants de l’entreprise au sein du conseil d’administration !
M. Christian Paul. Parce que les salariés ne représentent pas l’entreprise ?
M. Gérard Cherpion. Les représentants des actionnaires ne seront plus que deux. Il faut maintenir un équilibre dans un premier temps, quitte à le moduler ultérieurement.
M. Francis Vercamer. Les idées d’André Chassaigne sont sans doute excellentes pour le parti communiste ; je suis moins certain qu’elles le soient pour les entreprises françaises. Les sites industriels quittent déjà notre pays en nombre ; il ne faudrait pas que nous fassions fuir les sièges sociaux en adoptant des dispositions sans concertation préalable. Allons-y doucement ! L’administration des entreprises ne se réforme pas sur un coin de table en commission des affaires sociales.
M. André Chassaigne. M. Gallois n’est pas membre du PCF !
M. le rapporteur. La question n’arrive pas sur la table au détour de cet amendement.
Monsieur Cherpion, le nombre d’administrateurs représentant les salariés ne s’impute pas à l’effectif des administrateurs représentant l’entreprise : ces nouveaux sièges d’administrateurs créés par l’accord viennent s’ajouter à ceux qui existent déjà.
Monsieur Chassaigne, le Parlement doit jouer pleinement son rôle : je n’ai jamais prétendu qu’il ne fallait pas amender le projet de loi. J’appartiens à une majorité soutenant un Président de la République qui fait du dialogue social et de la négociation un moyen du redressement du pays. Fidèle à cette ligne, j’emprunte un chemin de crête afin d’éviter qu’à l’issue de nos travaux les signataires de l’accord du 11 janvier puissent penser qu’ils ont été trahis. Nous aurions échoué si les partenaires sociaux refusaient demain de revenir à la table des négociations.
Chers collègues, nous traversons une crise, et nous n’avons pas un temps infini devant nous. Les plus grands patrons de notre industrie estiment que la question est essentielle, et que notre avenir dans la mondialisation dépend aussi des rapports entre salariés et patrons : nous ne pouvons pas réagir par une politique des petits pas.
M. Hervé Morin. N’oublions pas que l’accord du 11 janvier doit être décliné secteur par secteur ! Si nous allons trop loin aujourd’hui, la partie qui se sentirait flouée risque d’empêcher la mise en œuvre de l’accord en procédant à des manœuvres dilatoires lors des négociations par branche. Il y a encore plusieurs marches à gravir !
M. le rapporteur. Tout est en effet une question d’équilibre. Il reste qu’il y a urgence, et qu’il serait préférable de monter les marches quatre par quatre plutôt qu’une à une.
La Commission rejette l’amendement AS 153.
Elle examine, en présentation commune, les amendements AS 237 et AS 238 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Nous sommes tous d’accord pour respecter l’équilibre de l’accord du 11 janvier. Nous n’y portons pas atteinte en augmentant le nombre d’administrateurs salariés. En attendant que le rapporteur puisse nous proposer de meilleures solutions, je suggère d’adopter l’amendement AS 238 qui porte ce nombre à deux pour les conseils d’administration comportant au plus douze membres, et l’amendement AS 237 qui le porte à trois lorsque ce conseil compte plus de douze sièges.
M. le rapporteur. À nouveau, je ne peux qu’être défavorable à ces amendements.
Selon l’accord du 11 janvier, lorsque le conseil d’administration compte deux administrateurs représentant les salariés, l’un est désigné par le comité d’entreprise européen. En restant dans l’esprit de l’accord, nous pourrions parvenir au même résultat que l’amendement de M. Christophe Cavard, si nous proposions la désignation de cet administrateur « européen » en plus de deux administrateurs « nationaux ».
M. le rapporteur pour avis. Douze pays européens ont déjà adopté des dispositifs assurant une représentation des salariés dans les organes de gestion des entreprises.
En 2009, lors des travaux de la mission d’information de la commission des lois sur les rémunérations des dirigeants, l’évocation de la présence des salariés dans les organes de gouvernance des entreprises provoquait des cris d’orfraie. Quatre ans plus tard, le discours est totalement différent : tous les patrons que nous avons entendus se disent prêts à accueillir des salariés au sein des conseils d’administration. Cette évolution s’inscrit dans celle plus globale de la gouvernance des entreprises.
M. Jean-Noël Carpentier. L’idée de démocratie dans l’entreprise est dans l’air du temps, et les amendements de Christophe Cavard ne bouleverseraient pas la gouvernance des entreprises. Je suggère que nous les votions, ce qui aidera sans doute le rapporteur dans ses négociations.
M. Francis Vercamer. Je m’étonne que les représentants d’un parti politique qui souhaite constitutionaliser dès juillet prochain le dialogue social s’évertuent comme vous le faites à détricoter l’accord du 11 janvier.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Monsieur Vercamer, vous avez le droit de penser le contraire, mais je ne crois pas que, jusqu’à maintenant, nous ayons vraiment dénaturé cet accord.
La Commission rejette successivement les amendements AS 237 et AS 238.
Elle est saisie de l’amendement AS 91 de M. Hervé Morin.
M. Hervé Morin. Les administrateurs salariés doivent tous être élus par les salariés. Il ne saurait y avoir d’autre légitimité que celle de cette élection.
M. le rapporteur. Défavorable. Cela dit, cet amendement qui prévoit une élection par les salariés travaillant sur le territoire français rendrait logique la désignation par le comité d’entreprise européen de l’administrateur supplémentaire que j’évoquais en réponse aux amendements de Christophe Cavard. Il semble, monsieur Morin, que nous pourrions faire cause commune.
Monsieur Vercamer, avec le soutien parfois peiné de mon groupe, je me contente d’affirmer que nous souhaitons aller plus loin, mais que nous le ferons en dialoguant avec les partenaires sociaux. Convenez tout de même que la représentation nationale serait légitime si elle décidait souverainement que trois administrateurs représentant les salariés pourraient siéger au conseil d’administration plutôt que deux – ce qui permettrait aux trois grandes organisations syndicales d’être partie prenante, même si FO n’y est pas favorable ! À vrai dire, si nous décidions d’aller jusque-là, je serais choqué que les partenaires sociaux nous dénient le droit de modifier ce point sur l’ensemble de l’accord.
La Commission rejette l’amendement AS 91.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte successivement les amendements de précision AS 408 à AS 413 du rapporteur pour avis.
Puis elle est saisie de l’amendement AS 114 de M. Jean-Noël Carpentier.
M. Jean-Noël Carpentier. Il convient de s’assurer que les administrateurs représentant les salariés au conseil d’administration puissent exercer leur mission en toute indépendance. Nous proposons qu’ils bénéficient, à cette fin, du statut de salarié protégé prévu à l’article L 2411-1 du code du travail.
M. le rapporteur. Je suis favorable à votre amendement sur le principe. Une question se pose cependant : est-il préférable de faire bénéficier les administrateurs de la protection qui est prévue par le code du travail pour les délégués du personnel et les délégués syndicaux ou de celle qui est prévue par le code de commerce ? J’ai auditionné des salariés qui exercent déjà de telles fonctions. Ce sont, pour la grande majorité, d’anciens délégués syndicaux ou délégués du personnel qui ont vocation à le redevenir. La plupart d’entre eux sont d’ailleurs favorables à une limitation du nombre de mandats d’administrateur. Dès lors, il semble plus logique que les administrateurs représentant les salariés conservent la protection qui est prévue par le code du travail, plutôt que de se voir attribuer celle qui est prévue par le code du commerce. Tel est le sens de mon amendement AS 429, que nous examinerons ultérieurement. Il traite à la fois le cas des nouveaux administrateurs qui seront élus ou désignés en vertu du présent article et celui des salariés qui exercent déjà de telles fonctions à titre facultatif. Je vous invite à retirer votre amendement.
M. Jean-Noël Carpentier. Je retire mon amendement. Dominique Orliac et moi-même souhaitons cosigner l’amendement du rapporteur.
M. le rapporteur. Bien sûr.
L’amendement AS 114 est retiré.
La Commission en vient à l’amendement de précision AS 414 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à préciser que le présent article ne s’applique ni aux entreprises du secteur public ni aux entreprises privatisées dès lors que leur conseil d’administration comprend déjà, en application respectivement de la loi du 26 juillet 1983 et de la loi du 6 août 1986, un nombre d’administrateurs représentant les salariés au moins égal à celui qui est prévu par le présent texte.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 414.
Puis elle examine l’amendement de précision AS 415 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à préciser que les modes d’élection ou de désignation prévus par le présent article ne s’imposent aux entreprises du secteur public et aux entreprises privatisées précitées que dans la mesure où leur conseil d’administration ne comprend pas déjà le nombre voulu d’administrateurs représentant les salariés.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 415.
Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement de coordination AS 416 du rapporteur pour avis.
L’amendement AS 11 de M. Jean-Charles Taugourdeau n’est pas défendu.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 417 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à actualiser le champ des incompatibilités : le mandat d’administrateur élu ou désigné par les salariés doit être incompatible avec celui de membre d’un organe de concertation assimilable, dans les sociétés européennes, à une institution représentative du personnel.
M. le rapporteur. Avis favorable. C’est une précision très utile.
La Commission adopte l’amendement AS 417.
Puis elle examine de l’amendement AS 418 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Les administrateurs élus ou désignés par les salariés doivent disposer du temps nécessaire à l’exercice de leur mandat. L’amendement vise à leur appliquer une règle similaire à celle qui est prévue à l’article L. 2325-6 du code du travail pour les représentants syndicaux au comité d’entreprise : « l’employeur laisse le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, dans la limite d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois ».
M. le rapporteur. Nous avons deux possibilités : soit étendre les dispositions prévues par le code de commerce pour les salariés qui exercent un mandat d’administrateur à titre facultatif, soit leur faire bénéficier des heures de délégation prévues par le code du travail pour les représentants syndicaux. Le rapporteur pour avis privilégie la première solution et je me range à sa position.
En revanche, la durée de vingt heures par mois paraît très faible au regard des besoins exprimés par les administrateurs représentant les salariés que j’ai auditionnés. Certains d’entre eux évoquent même une charge équivalent à un mi-temps dans les très grandes entreprises. Je suis favorable à ce que la durée maximale soit fixée, comme vous le suggérez, par décret, mais je propose de remplacer le chiffre de vingt heures proposé par une durée « permettant à l’administrateur d’exercer utilement sa compétence ». Nous évitons ainsi de trancher ici la question du nombre d’heures, tout en encadrant le pouvoir réglementaire.
M. Gérard Cherpion. La règle d’incompatibilité entre le mandat d’administrateur et ceux de délégués du personnel, de délégué syndical, de membre du comité d’entreprise et de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail n’a pas été reprise dans le projet de loi.
M. le rapporteur. Si, c’est bien le cas : aux termes des alinéas 30 et suivants de l’article 5, le renvoi adéquat est inséré dans l’article L. 225-30 du code de commerce qui fixe cette règle.
La Commission adopte l’amendement AS 418 ainsi rectifié.
Puis elle en vient à l’amendement AS 419 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à inscrire dans la loi le droit des administrateurs élus ou désignés par les salariés à une formation qui leur permette d’exercer pleinement leur mandat.
M. le rapporteur. Je suis favorable sur le fond. Cependant, j’ai discuté de la question avec le Gouvernement et il me paraîtrait plus simple de renvoyer à des dispositifs de droit commun. Je vous propose, monsieur le rapporteur pour avis, de retirer votre amendement, afin d’en proposer une nouvelle rédaction en vue de la discussion en séance publique.
M. le rapporteur pour avis. Je le retire.
L’amendement AS 419 est retiré.
La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel AS 420, l’amendement de cohérence AS 421 et l’amendement de précision AS 422 du rapporteur pour avis.
Puis elle est saisie de l’amendement AS 423 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Je retire mon amendement afin d’en proposer, le cas échéant, une nouvelle rédaction.
L’amendement AS 423 est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements AS 154 à AS 157, tous de M. André Chassaigne.
Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte successivement l’amendement de cohérence AS 424 et les amendements de coordination AS 425 et AS 426, tous du rapporteur pour avis.
Elle examine ensuite l’amendement de précision AS 427 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Je retire cet amendement afin de le clarifier et de le déposer à nouveau, le cas échéant, en vue de la séance publique.
L’amendement AS 427 est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement AS 429 du rapporteur.
M. le rapporteur. C’est l’amendement que j’évoquais tout à l’heure, visant à étendre les protections du code de commerce aux représentants des salariés aux conseils d’administration
M. Francis Vercamer. Mon amendement AS 61 prévoyait des dispositions analogues. Je le retire, mais certains d’entre nous souhaitent cosigner l’amendement du rapporteur.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Je mets aux voix l’amendement AS 429 du rapporteur, cosigné par Dominique Orliac, Jean-Noël Carpentier, Francis Vercamer, Arnaud Richard et Denys Robiliard.
La Commission adopte l’amendement AS 429.
L’amendement AS 61 est retiré.
La Commission en vient à l’amendement AS 428 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à dissiper toute incertitude quant aux procédures devant être menées à bien en application de l’article 5 au plus tard le premier jour du vingt-sixième mois suivant la publication du présent projet de loi : il s’agit soit de l’élection directe par les salariés, soit d’une des trois procédures de désignation.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 428.
Elle examine ensuite l’amendement AS 261 de M. Denys Robiliard.
M. le rapporteur. Il est satisfait par l’amendement AS 418 rectifié que nous avons adopté précédemment.
L’amendement AS 261 est retiré.
La Commission adopte l’article 5 modifié.
Après l’article 5
L’amendement AS 84 de M. Hervé Morin n’est pas défendu.
La Commission est saisie de l’amendement AS 85 de M. Hervé Morin, tendant à introduire un article additionnel après l’article 5.
M. Francis Vercamer. Cet amendement vise à interdire aux entreprises de recourir à des stagiaires pour faire face à un surcroît d’activité.
M. le rapporteur. Avis défavorable, non pas sur le fond de l’amendement, mais parce que le sujet qu’il aborde mérite une réflexion plus globale. Les stages doivent rester accessibles aux étudiants et, en même temps, ne pas se substituer à de vrais contrats de travail.
M. Hervé Morin. Il faut rappeler ici la réalité de certains stages qui permettent d’embaucher du personnel supplémentaire dans des périodes d’activité accrue. Il suffit, pour s’en aviser, de se rendre au moment de Noël dans certains magasins des Champs-Élysées… Des centaines d’offres d’emploi, comportant des fiches de poste, des définitions de fonctions, des horaires de travail, se déguisent en propositions de stages. Il faut mettre fin à cette dérive et interdire qu’un stagiaire effectue le même travail qu’un salarié normal tout en coûtant moins cher à l’employeur. Rien ne nous empêche, quelle que soit la nécessité d’une « réflexion globale », d’inscrire d’ores et déjà un tel principe dans la loi.
M. le rapporteur. Des universités, généralement privées, créent des formations quasi factices dans le seul dessein de permettre à des étudiants déjà diplômés d’obtenir des stages qui, de fait, se substituent à de vrais contrats de travail. Mais les mesures que nous adoptons ne doivent pas entraîner d’effet négatif sur les stages en entreprise que, trop souvent, les jeunes ont du mal à décrocher dans leur cursus de formation. Il faut donc parvenir à une régulation des formations et des conventions de stage afférentes, ce qui pose la question de la responsabilité de l’enseignement supérieur. On pourrait aussi imaginer un dispositif interdisant aux titulaires d’un certain niveau de diplôme d’effectuer certains types de stages, sauf pour terminer une formation longue.
M. Gérard Cherpion. Il me paraît excessif de prétendre que des instituts privés ne créent certaines formations qu’en vue de stages. J’approuve néanmoins cet amendement, car un stage de formation ne doit pas servir à répondre à un surcroît momentané d’activité. J’ai connu le cas d’une grande banque française qui souhaitait conserver un stagiaire à son poste au-delà de la durée prévue et prétendait ne pas pouvoir le faire. Pourquoi ne pas lui proposer un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ?
M. le rapporteur. Je suis d’accord avec vous, mais le sujet est trop vaste pour qu’on le traite par le seul biais du présent projet de loi.
M. Jean-Pierre Door. Un stagiaire ne peut pas servir de variable d’ajustement aux aléas du niveau de l’activité de l’entreprise. Pourquoi ne pas adopter dès aujourd’hui cet amendement ? Je sens que notre rapporteur en a envie…
M. Hervé Morin. Voyez donc, dans tels magasins d’électro-ménager, certaines offres dites de stages, qui sont en réalité des offres d’emploi. La seule chose qui change, c’est la couleur de la blouse ! Cela complique d’ailleurs souvent les relations sociales entre stagiaires et titulaires des mêmes emplois. Je déposerai donc probablement, en vue de la séance publique, un amendement prévoyant que les stagiaires doivent figurer dans le tableau des effectifs de l’entreprise.
Je ne comprends pas pourquoi il serait impossible de préciser dans la loi que le stagiaire n’est pas un employé intérimaire ou en CDD. On nous présente parfois comme des conservateurs liés au patronat, et la majorité parlementaire refuserait notre proposition !
M. Dominique Dord. Je suis opposé à cet amendement, dont l’objet ne figure pas dans l’accord du 11 janvier et qui me paraît trop important pour être traité à la va-vite. Il existe certes une zone de flou entre les stages offerts aux étudiants et certains emplois à temps partiel. Mais il est très profitable pour des jeunes en cours de formation de pouvoir vivre une expérience en entreprise qui leur servira quand ils se présenteront sur le marché du travail.
M. Christophe Cavard. La démarche qui fonde cet amendement est louable, visant un objectif que nous partageons tous : éviter, à travers les stages, certains effets d’aubaine dont peuvent abuser certains employeurs. Mais, quand nous avons évoqué hier la nécessité de données prévisionnelles et de planification sur les stages en entreprise, notamment dans le cadre des accords de branche, ceux qui défendent le présent amendement se sont alors montrés très réservés. Je le soutiendrai néanmoins.
M. Hervé Morin. Ce n’est pas du tout la même chose !
M. le rapporteur. Il paraît que nous sommes tous d’accord, mais je relève un désaccord au sein de l’opposition.
Il est vrai que les partenaires sociaux n’ont pas discuté de la question, car ils considèrent qu’elle relève à la fois du monde de l’enseignement supérieur et de celui du travail. Mais ils ne considéreraient pas comme illégitime que nous légiférions en la matière.
Les abus dénoncés par Hervé Morin sont exacts. Il existe des conventions de stages conclues postérieurement à l’obtention d’un diplôme et correspondant aux formations que j’ai brocardées tout à l’heure.
J’insiste donc sur la nécessité d’une régulation des stages, par voie législative ou autre, qui permettrait de supprimer des pratiques fallacieuses. Mais on ne saurait interdire qu’un surcroît temporaire d’activité soit couvert par le recours à des stagiaires étudiants, qui acquerront ainsi une connaissance du monde de l’entreprise, par exemple dans un poste n’exigeant pas de qualification particulière.
Et pourquoi ne pas viser aussi, dans cet amendement, les remplacements de congés de longue durée ?
Nous avons déjà adopté un amendement prévoyant que les stages seraient désormais intégrés dans les procédures d’information et de consultation des instances de représentation du personnel sur la stratégie des entreprises.
Je souhaite que ce sujet soit également abordé par les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences lorsqu’il sera question des emplois précaires. Car je crois beaucoup au contrôle social et à la discussion en entreprise pour faire le tri entre le souhaitable et l’abusif.
M. Dominique Dord. Il faut bien distinguer les stages de fin d’études, ultérieurs à une formation, mais antérieurs à l’obtention d’un diplôme, et les stages effectués postérieurement à celui-ci.
La Commission rejette l’amendement AS 85.
Puis elle examine l’amendement AS 83 de M. Hervé Morin.
M. Hervé Morin. La rigidité du droit du travail a débouché sur une précarisation de l’emploi salarié en France. Aujourd’hui 90 % des embauches se font en CDD de moins de trois mois. C’est pourquoi, dans la ligne des rapports publiés sur la question, notamment par le Conseil d’analyse économique, nous proposons d’instituer un contrat de travail unique sécurisant progressivement le parcours professionnel du salarié et intégrant une formule de bonus-malus portant sur les cotisations d’assurance chômage de l’entreprise en fonction de sa gestion des ressources humaines.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Vous venez de dénoncer certains types de stages et vous voulez maintenant transformer en stagiaires les titulaires de contrat de travail à durée indéterminée (CDI). Je reconnais que je caricature un peu votre amendement.
Notre priorité consiste à favoriser les CDI et non à les vider des protections qu’ils offrent aux salariés.
La question du contrat unique a, d’une certaine façon, déjà été discutée par les partenaires sociaux en vue de la conclusion de l’accord du 11 janvier.
Quant à l’idée de moduler les cotisations d’assurance chômage en fonction de la durée du CDI, elle se trouve déjà satisfaite en partie. On pourra toujours discuter ensuite de son champ d’application.
La Commission rejette l’amendement AS 83.
Article 6
(art. L. 5422-2-1 [nouveau] du code du travail ; art. 43 de la loi n°2011-893
du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance
et la sécurisation des parcours professionnels)
Amélioration des droits à nouvelle indemnisation chômage des salariés et renforcement de l’accompagnement des demandeurs d’emploi
Le présent article prévoit deux mesures visant à sécuriser le parcours professionnel des demandeurs d’emplois indemnisés par le régime d’assurance chômage.
Sur la base de l’article 3 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, le I du présent article insère dans le code du travail un article L. 5422-2-1 afin de permettre aux chômeurs qui retrouvent un emploi puis reviennent au chômage de cumuler, en tout ou partie, avec les nouveaux droits acquis, les droits à indemnisation non consommés lors de la première période de chômage. Il s’agit à la fois d’améliorer les droits à indemnisation des salariés précaires alternant des périodes d’emploi et d’indemnisation et de supprimer tout effet désincitatif à une reprise d’emploi.
Sur la base de l’article 8 de l’accord du 11 janvier, le II du présent article autorise les partenaires sociaux à accorder une aide financière aux chômeurs bénéficiaires de l’accompagnement en contrat de sécurisation professionnelle expérimental destinés à des personnes en fin de contrat à durée déterminée. Il s’agit d’inciter ces derniers à s’engager dans une formation relevant de leur accompagnement même si sa durée dépasse la fin de leurs droits à chômage.
I.- LA CRÉATION DE « DROITS RECHARGEABLES »
À L’ASSURANCE CHÔMAGE
À l’article 3 de l’accord national interprofessionnel, les signataires de l’accord national interprofessionnel ont rappelé que « le régime d’assurance chômage contribue à la sécurisation des parcours des salariés, tant en leur assurant un revenu de remplacement qu’en leur permettant de bénéficier des dispositifs d’accompagnement destinés à accéder à des emplois durables ». La sécurisation des parcours professionnels est donc tributaire de la couverture des demandeurs d’emploi indemnisables par l’assurance chômage, définie comme le rapport entre le nombre de chômeurs indemnisés et le nombre total de demandeurs d’emploi.
Le taux de couverture des demandeurs d’emploi par le régime d’assurance chômage rend compte de la portée de celui-ci. Lorsqu’il est faible, une part importante des demandeurs d’emploi ne sont pas ou plus indemnisés par l’aide au retour à l’emploi (ARE) qui représente plus de 90 % des allocations versées par l’Unédic. Les demandeurs d’emploi non indemnisés bénéficient alors, soit d’un revenu de solidarité versé de façon complémentaire par le régime d’assurance tel l’allocation spécifique de solidarité (ASS), soit d’un minimum social attribué par les autorités publiques, tel le revenu de solidarité active (RSA).
Le dispositif des « droits rechargeables » vise à améliorer le taux de couverture du régime d’assurance chômage en créant de nouveaux droits à indemnisation pour des salariés actuellement indemnisés de manière insatisfaisante.
A. UN NOUVEL OUTIL D’AMÉLIORATION DE LA COUVERTURE DES SALARIÉS LES PLUS PRÉCAIRES PAR LE RÉGIME D’ASSURANCE CHÔMAGE
La part des chômeurs indemnisée par le régime d’assurance diminue si les conditions d’ouverture de droits sont restrictives, si le montant des droits accordé est mal adapté à des profils d’activité défavorables ou si la durée d’indemnisation du demandeur d’emploi est inférieure à sa durée de chômage.
Un demandeur d’emploi qui a cotisé au régime d’assurance peut ainsi se retrouver rapidement en fin de droits si les conditions d’affiliation minimale sont trop restrictives, entraînant un épuisement rapide de ses droits à indemnisation. La définition des règles du régime d’assurance chômage doit donc veiller à réduire les disparités de droits découlant des conditions d’activité professionnelle antérieures. Il s’agit par exemple d’éviter que les profils de carrière les plus heurtés soient mal indemnisés par l’assurance chômage, alors qu’ils sont les plus vulnérables dans les situations de retournements de conjoncture.
1. La poursuite d’un objectif d’amélioration de la couverture des demandeurs d’emploi par le régime d’assurance chômage
Face à la montée du chômage récurrent, les partenaires sociaux ont cherché, au fil des conventions Unédic, à rendre un plus grand nombre de salariés éligibles à une prise en charge par l’assurance chômage, en utilisant comme leviers les grands paramètres du régime: la durée minimale d’affiliation a été raccourcie et la période de référence lors de laquelle l’activité antérieure est appréciée a été allongée. En contrepartie la couverture du chômage de longue durée a progressivement été réduite, sa prise en charge étant transférée aux revenus minimaux relevant des collectivités publiques. Le périmètre de l’assurance s’est donc déplacé du chômage long vers le chômage récurrent ou de transition.
Comme le montre le schéma ci-après, le seuil d’entrée en assurance chômage a été abaissé au fil des conventions Unédic depuis 1992. La période de référence est ainsi passée de huit à vingt-huit mois entre 1992 et 2000.
Seuil d’entrée en assurance chômage dans les conventions Unédic successives.
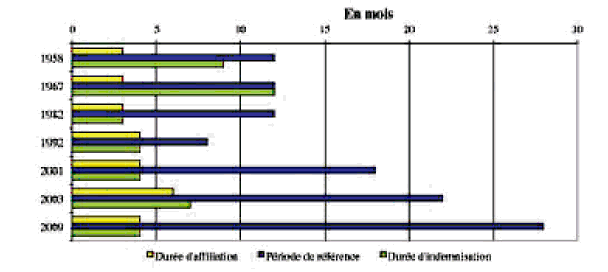
Source : Centre d’analyse stratégique
La convention d’assurance chômage du 19 février 2009 a marqué une nouvelle étape : un système de filières définissant les droits différents à indemnisation a été remplacé par le principe « un jour cotisé, un jour indemnisé » et la durée minimale d’affiliation a été réduite de six à quatre mois.
Selon la Cour des comptes, en 2011, sur un potentiel indemnisable de 4,5 millions de demandeurs d’emploi seuls 2 millions sont indemnisés par le régime d’assurance chômage. En 2011, 54,1 % des chômeurs sont indemnisés, 44,8 % par le régime d’assurance, 9,2 % par le régime de solidarité.
La proportion de demandeurs d’emploi indemnisés par le régime d’assurance chômage a continûment baissé depuis 2009, passant de 48,5 % en 2009 à 47,3 % en 2010 et à 44,8 % en 2011. La réforme de 2009 n’a donc pas pu absorber les effets de la dégradation du marché du travail, imputables à l’importance de la dégradation conjoncturelle et à la faiblesse du nombre des retours à l’emploi.
Le tableau suivant retrace l’évolution depuis 2009.
Évolution des taux de couverture entre 2009 et 2011
En milliers et en % |
2009 |
2010 |
2011 |
variation |
Potentiel indemnisable |
4 417 |
4 517 |
4 566 |
+3,4% |
Demandeurs d’emploi indemnisés par le régime d’assurance chômage |
2 145 |
2 136 |
2 047 |
-4,6% |
Demandeurs d’emploi indemnisés par le régime de solidarité |
416 |
434 |
422 |
+1,4% |
Total des demandeurs d’emploi indemnisés |
2 561 |
2 570 |
2 469 |
-3,5% |
Demandeurs d’emploi non indemnisés |
1 856 |
1 957 |
2 096 |
+12,9% |
Proportion de demandeurs d’emploi indemnisés par le régime d’assurance chômage |
48,5 |
47,3 |
44,8 |
-3,7 points |
Proportion de demandeurs d’emploi indemnisés par le régime de solidarité |
9,4 |
9,6 |
9,2 |
-0,2 point |
Proportion de demandeurs d’emploi indemnisés |
58 |
56,9 |
54,1 |
-3,9 points |
Source : Pôle emploi et Cour des comptes
Une comparaison au plan européen montre pourtant que l’accès au régime d’assurance chômage est aisé en France: la durée d’affiliation est la plus courte et elle s’établit sur une période de référence comparativement longue. La durée minimale d’indemnisation est égale à la durée de cotisation mais ne peut dépasser une durée de 24 mois, ou de 36 mois pour les salariés âgés de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail. La période de référence n’est plus longue qu’au Danemark et en Espagne. En Europe, l’accès à l’indemnisation du chômage est ouvert aux salariés après douze mois de cotisations en moyenne contre quatre mois en France et six mois aux Pays-Bas. La durée d’indemnisation est le plus souvent inférieure à la durée d’affiliation, sauf au Luxembourg, mais dans la limite de 12 mois.
Pour les mêmes motifs qui inspirent l’accord du 11 janvier, la crise économique a conduit de nombreux pays européens à rechercher une amélioration de la couverture des demandeurs d’emploi par le régime d’assurance chômage. Ainsi, en Allemagne, depuis le 1er janvier 2008, la durée d’indemnisation est déterminée en fonction de la période d’affiliation établie sur les cinq années précédentes, au lieu de trois antérieurement. En Belgique, la réforme de l’assurance chômage entrée en vigueur le 1er novembre 2012 allonge la période de référence pour la condition d’affiliation minimale qui passe de 18 à 21 mois pour les moins de 36 ans, de 27 à 33 mois pour les personnes âgées de 36 à 49 ans et de 36 à 42 mois pour les plus de 50 ans. Au Portugal, la durée de la période minimum d’affiliation est abaissée, passant de 450 à 360 jours au cours des 24 mois précédant la perte d’emploi.
Dans son rapport public thématique de janvier 2013 sur le marché du travail, la Cour des comptes a relevé que le système français d’indemnisation chômage présente cependant l’éventail des durées d’indemnisation le plus important : de quatre mois pour la durée minimale à 24 ou 36 mois pour la durée maximale. Les salariés les plus précaires bénéficient de durées d’indemnisation relativement plus brèves que les salariés aux profils d’affiliation complets pour lesquels le régime offre un taux de remplacement des revenus et une durée d’indemnisation plus favorables. Le régime français d’assurance chômage garantit un haut niveau de remplacement du revenu mais le réserve dans la durée aux chômeurs ayant les références d’emploi les plus longues : la perte de droits à indemnisation chômage non utilisés antérieurement y contribue.
2. La succession de périodes de chômage et d’emploi n’est pas suffisamment prise en compte à l’ouverture de nouveaux droits
L’ouverture de droits à l’assurance chômage en cas de perte d’emploi peut se traduire par une admission, qui est une première ouverture de droit pour un individu inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
Cependant, selon la DARES (22), 55 % des personnes entrées à l’allocation de retour à l’emploi (ARE) entre octobre 2010 et septembre 2011 ont connu un droit à indemnisation antérieur. La majorité d’entre eux (42 % des entrants) n’avaient pas entièrement consommé leur droit à leur sortie. Leur durée d’indemnisation a été de sept mois (214 jours) en moyenne au cours des trois dernières années. La durée médiane entre les deux épisodes d’indemnisation chômage est de sept mois.
Lorsqu’il y a eu épisode antérieur de chômage, trois cas de figure se présentent :
– la nouvelle admission : le travailleur privé d’emploi précédemment pris en charge par l’assurance chômage ne dispose plus d’aucun reliquat de droits ;
– la reprise : le travailleur privé d’emploi bénéficie de la reprise du versement du reliquat de droits non épuisé lors d’une précédente période d’indemnisation ;
– la réadmission : le travailleur privé d’emploi précédemment pris en charge par l’assurance chômage et disposant d’un reliquat de droit se voit ouvrir une nouvelle période d’indemnisation.
L’admission ou nouvelle admission: dans près de la moitié des entrées au régime d’assurance chômage, les règles de l’admission sont appliquées. Pour 13 % de l’ensemble des entrants ayant connu un droit à indemnisation antérieur, il y a nouvelle admission, une réadmission sans reliquat. Les intéressés ont logiquement été indemnisés plus longtemps en moyenne au cours des trois dernières années (7,5 mois, soit 232 jours), mais sur des périodes plus anciennes. Pour la moitié d’entre eux, le droit précédent a été fermé depuis plus de vingt mois, période qui a permis de reconstituer un nouveau droit à indemnisation.
La reprise de droits permet à l’allocataire qui a repris un emploi en cours d’indemnisation alors qu’il n’avait pas épuisé ses droits, de les retrouver à l’issue de la reprise d’emploi. La reprise est donc un décalage du droit antérieur dans le temps qui est simplement suspendu lors de la conclusion d’un contrat de travail. En cas de reprise, la nouvelle période de travail pourra être ultérieurement prise en compte dans le calcul de l’affiliation et permettre une nouvelle ouverture de droits au bénéfice de l’intéressé.
La réadmission concerne les allocataires dont l’emploi retrouvé en cours d’indemnisation dure au moins 122 jours et permet donc l’ouverture d’un nouveau droit. Dans ce cas, il est procédé à une « pesée » des droits consistant à comparer le reliquat de l’ancien droit avec le capital lié au nouveau droit. Le droit finalement retenu correspond au plus élevé des deux capitaux. Le montant journalier le plus élevé est versé. La durée d’indemnisation est calculée en divisant le capital retenu par le montant journalier.
Si le demandeur d’emploi est assuré de retrouver un droit au moins équivalent à celui qu’il avait au moment de reprendre un emploi, les périodes d’activité qui sont à l’origine du réexamen ou qui sont postérieures à l’ouverture du droit précédent ne sont plus prises en compte pour une réadmission ultérieure. La période d’emploi reprise ne peut donc pas être utilisée pour générer de nouveaux droits.
Pour environ 270 000 entrées en moyenne chaque mois en 2010, la répartition des modalités d’établissement des droits à chômage s’établit donc comme suit :
ENTRÉES
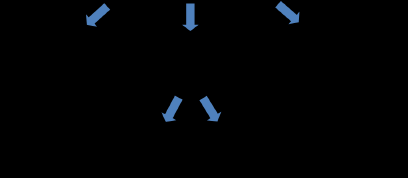
Près de 60 000 demandeurs d’emplois font ainsi chaque mois l’objet de la procédure de réadmission, soit près de 700 000 personnes par an.
L’étude d’impact annexée au projet de loi indique que les personnes pour lesquelles le nouveau capital est sélectionné ont sept mois de reliquat et ont travaillé quatorze mois, en moyenne. Les personnes que la procédure de réadmission conduit à réutiliser le capital précédent avaient seize mois de reliquat au moment de leur sortie et ont travaillé neuf mois, en moyenne.
Pour des salariés qui ont repris un emploi avant la fin de leurs précédents droits à chômage et qui l’ont conservé assez longtemps pour ouvrir de nouveaux droits à chômage, il en résulte une diminution des droits à l’assurance chômage au titre soit du reliquat du capital précédent soit du nouveau capital. Si le reliquat est plus élevé, le dernier emploi occupé n’aura pas été créateur de droit, malgré une durée de cotisation supérieure à quatre mois. Si le nouveau capital est plus élevé, les droits non utilisés de l’épisode d’indemnisation antérieur sont perdus.
Par l’accord du 11 janvier, les partenaires sociaux ont en conséquence demandé une modification des règles actuellement applicables à ces situations afin d’améliorer le taux de remplacement des revenus et la durée d’indemnisation des assurés qui ont connu des phases successives d’emploi et d’indemnisation du chômage.
Il convient de relever que la portée défavorable de la réadmission est atténuée, à la marge, par le fait que le délai d’attente qui reporte la prise en charge de sept jours (article 22 du règlement général) ne s’applique pas en cas de réadmission intervenant dans un délai de douze mois à compter de la précédente admission.
La réglementation d’assurance chômage prévoit par ailleurs plusieurs situations pour lesquelles il n’est pas procédé à une réadmission d’office bien que la condition d’affiliation minimale de 122 jours soit satisfaite.
En cas de reprise d’activité à temps plein et de perte de ce nouvel emploi, une reprise de droits est opérée systématiquement si la première fin de contrat est intervenue à 58 ans ou postérieurement.
Pour les salariés intermittents et intérimaires auxquels sont appliquées les règles de l’annexe IV au règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, en cas de reprise puis de cessation d’emploi en cours d’indemnisation, une reprise des droits est systématiquement prononcée même si l’affiliation résultant de cet emploi est suffisante. Ceci permet d’éviter qu’un reliquat important n’annule les droits occasionnés par une succession de courtes périodes de reprise d’activité.
Enfin les règles de réadmission sont aménagées dans le cadre du dispositif de l’activité réduite qui permet aux allocataires de reprendre ou de conserver une activité professionnelle présentant un caractère occasionnel ou réduit, en conservant tout ou partie de leurs allocations. En cas de perte de l’activité reprise avant la fin d’un délai de quinze mois, le versement de l’allocation de retour à l’emploi est poursuivi sur la base du droit initial. Une réadmission peut également intervenir sur demande de l’allocataire, lorsque l’activité a été exercée au moins 122 jours. En cas de perte de l’activité conservée, la poursuite du versement de l’allocation ou la réadmission sur demande du demandeur d’emploi sont possibles. En pratique, tant que les allocataires demeurent inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi, les règles de l’activité réduite sont appliquées, quelles que soient la durée et l’intensité de l’activité exercée, ce qui neutralise l’application des règles de la réadmission tant que l’intéressé ne demande pas à en bénéficier. Une telle limitation du champ d’application des règles de réadmission concerne un nombre croissant d’allocataires. Le nombre de personnes déclarant une activité réduite a été en effet multiplié par onze entre 1991 et 2009, ce qui a porté la part des allocataires en activité réduite de 5,2 % à 38,2 % de l’ensemble. L’augmentation récente du chômage a accentué cette tendance, le nombre de bénéficiaires en activité réduite passant de 880 000 en 2009 à 1,1 million en 2011.
Les pertes de droits à indemnisation chômage du fait de la réadmission sont donc désormais concentrées sur des populations qui alternent malgré elles des périodes d’emploi et d’indemnisation et dont il convient de sécuriser la reprise d’emploi.
3. Les droits à indemnisation chômage non utilisés sont plus souvent perdus par les salariés jeunes ou en CDD
Les données de l’Unédic relatives à la structure par âge des entrées en réadmission montrent que la comparaison de capital est opérée dans 37 % des cas pour des demandeurs d’emploi âgés de 25 à 35 ans, dans 27 % des cas entre 35 et 45 ans.
Comme le montre le schéma ci-après, les demandeurs d’emplois de moins de 45 ans totalisent 78 % des cas de réadmission avec comparaison de capital. Le résultat de la comparaison de capital ne varie cependant pas en fonction de l’âge.
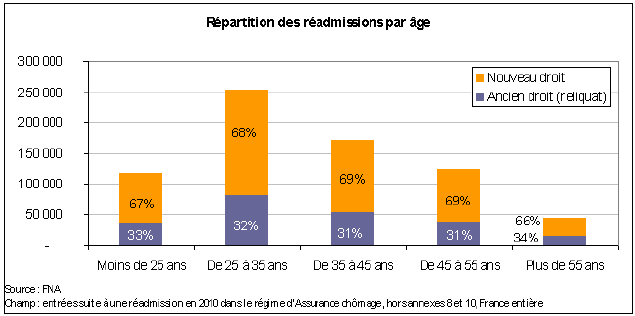
Les mêmes données, illustrées par le schéma ci-après, indiquent que l’essentiel des réadmissions concerne des anciens salariés en CDD.
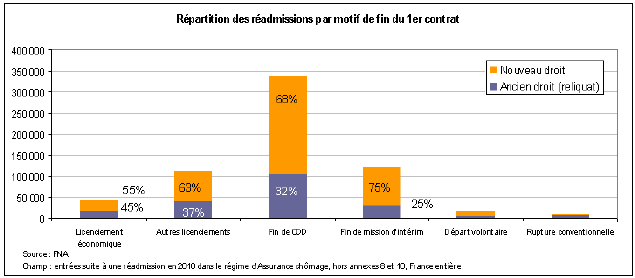
Si 38,7 % des entrées à l’assurance chômage en 2011 ont lieu suite à la fin d’un CDD contre 32 % pour les licenciements, la part des CDD parmi les réadmissions est trois fois plus importante que pour les licenciements. Les règles actuelles en cas de réadmission renforcent donc les inégalités d’indemnisation qui existent aujourd’hui entre les salariés privés d’emploi selon la nature de leur contrat de travail.
En conséquence, les plus gros contingents d’allocataires faisant l’objet d’une réadmission disposent de reliquats d’une durée inférieure à 6 mois et de nouveaux droits à indemnisation inférieurs à 12 mois.
Les pertes de droits à indemnisation se concentrent donc sur les actifs les plus jeunes que la fragilisation croissante des parcours professionnels amène à se trouver successivement en emploi et au chômage. Or les phénomènes de récurrence du chômage s’accroissent. Selon l’enquête emploi de l’INSEE, les situations dans lesquelles un actif occupé a connu trois années consécutives de chômage ou d’emploi précaire sont passées de 4 % en 1982 à 12 % en 2010.
L’amélioration de la situation des demandeurs d’emploi qui ont connu une première admission dans les 28 mois précédents entre ainsi pleinement dans la vocation assurantielle de l’Unédic. Pour un régime d’assurance obligatoire, la mutualisation des risques vise en effet à redistribuer une partie des ressources entre actifs comme entre entreprises, suivant le secteur, la taille, la profession, la qualification, l’âge ou le type de contrat.
B. LES PARTENAIRES SOCIAUX VONT FIXER LE PÉRIMÈTRE DE CE NOUVEAU DROIT
1. Un nouveau droit instauré par le législateur
Le régime de protection sociale contre la privation involontaire d’emploi a été créé, à l’initiative de l’État, par une convention des représentants des organisations d’employeurs et de salariés représentatives aux niveaux national et interprofessionnel le 31 décembre 1958. Cette source conventionnelle de l’assurance chômage a été maintenue par le législateur, l’article L. 5422-20 du code du travail délimitant le champ d’intervention des partenaires sociaux. Les accords conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés prévoient les mesures d’application des dispositions fixées dans le code du travail et font l’objet d’un agrément ministériel. La dernière convention d’assurance chômage du 6 mai 2011 s’applique jusqu’au 31 décembre 2013.
L’introduction des « droits rechargeables » dans la convention d’assurance chômage modifie le mécanisme de reprise des droits et de réadmission tel qu’il est actuellement prévu par l’article 9 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage.
Jusqu’à présent, le mécanisme de la réadmission n’était pas prévu par la loi. L’article L. 5422-2 du code du travail qui prévoit que « l’allocation d’assurance est accordée pour une durée limitée qui tient compte (…) des conditions d’activité professionnelle antérieure » est en effet la base législative de la seule fixation de la durée d’indemnisation en fonction de la durée d’activité figurant à l’article 11 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011.
Le principe de la comparaison des droits, sur lequel repose actuellement la réadmission en présence d’un reliquat de droit est prévu à l’article R. 5422-2 du code du travail qui dispose que « lorsque l’intéressé n’a pas épuisé les droits à l’allocation d’assurance qui lui ont été précédemment octroyés et qu’il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée minimale d’indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits et du montant journalier de l’allocation d’assurance mentionné les plus élevés, selon des modalités définies dans l’accord relatif à l’assurance chômage ». Cette disposition provient de l’ancien article R. 351-1 issu du décret du 21 février 2006 relatif aux durées d’indemnisation des demandeurs d’emploi par le régime d’assurance chômage et modifiant le code du travail.
Alors qu’actuellement un dispositif réglementaire conduit à priver les assurés de l’Unédic d’une partie des droits qu’ils devraient pouvoir retirer de leur parcours professionnel, le nouvel article L. 5422-2-1 va consacrer au plan législatif le principe selon lequel tout ou partie des droits non épuisés à indemnisation chômage devra être pris en compte dans le calcul du nouveau droit.
2. Sécuriser la reprise d’un emploi
Le mécanisme actuel de réadmission pénalise un demandeur d’emploi indemnisé par l’assurance chômage qui accepterait une offre d’emploi dont il redouterait qu’elle occasionne un nouvel épisode de chômage après quelques mois d’activité.
Quand le reliquat de droits à chômage est élevé, le nouvel emploi, s’il est perdu après quatre mois, ne fournit aucun nouveau droit à indemnisation. Alors que huit recrutements sur dix s’effectuent aujourd’hui en CDD, que les fins de CDD représentent les trois quarts des sorties de contrats et que les trois quarts des CDD arrivés à terme en 2011 ont duré six mois ou moins, l’effet désincitatif d’un tel mécanisme sur la reprise d’activité de chômeurs encore éloignés de la fin de droits ne saurait être négligeable. Les « droits rechargeables » sécuriseront les salariés qui choisissent de reprendre un emploi même à durée déterminée afin de ne pas rester trop longtemps éloigné de l’emploi.
Simultanément, l’amélioration de la durée et du niveau de l’indemnisation après « recharge » de droits a des effets positifs, soulignés par les différents travaux de recherche économique sur les liens entre indemnisation de la perte d’emploi et efficacité du marché du travail. Ils soulignent qu’une garantie d’assurance chômage favorise l’appariement entre l’offre et la demande de travail, soutient la recherche d’emploi et améliore la distribution des salaires ainsi que la productivité moyenne des emplois (23).
En étendant de façon plus importante la couverture du régime d’assurance chômage aux salariés aux parcours professionnels les plus heurtés, l’Unédic va satisfaire un objectif majeur des politiques de l’emploi : renforcer l’employabilité des publics les plus exposés à la précarité sur le marché du travail.
3. L’évaluation du coût pour le régime d’assurance chômage
Comme il a été indiqué, près d’un tiers des entrées en indemnisation, concernant plus de 700 000 allocataires, induit une perte de droits potentiels à indemnisation par rapport aux périodes cotisées. La masse de droits potentiels à indemnisation annulés par cette procédure est estimée, pour l’année 2010, à 6,6 milliards d’euros. Mais ces montants estimés ne correspondent pas à des dépenses prévues ou évitées, car la somme de la durée acquise et de la durée éliminée peut dépasser les durées règlementaires maximales actuellement fixées à 24 ou 36 mois.
Si une partie des droits éliminés aujourd’hui devient réutilisable, il convient d’établir si le cumul autorise de dépasser la durée maximale des droits. D’après les données transmises à votre rapporteur par l’Unédic, en conservant les durées plafond actuelles, l’assiette maximale possible après écrêtement serait de 3,6 milliards d’euros.
De même les allocataires ne demeurent pas tous sans emploi jusqu’à la fin de leurs droits à chômage. L’application du taux moyen d’utilisation des droits aboutit à un coût de 2 milliards d’euros.
Si, en moyenne, les chômeurs indemnisés sortis du régime d’assurance chômage au cours de l’année 2011 ont utilisé 61 % de l’intégralité de leur droit, ce taux n’est pas stable et varie selon l’âge et la durée du droit potentiel. La part du droit consommée s’élève à 65 % chez les plus de 50 ans. Elle est la plus élevée quand la durée de droit potentiel est inférieure à douze mois (85 % pour les moins de 50 ans qui disposent de quatre à huit mois d’indemnisation par exemple).
L’évaluation de l’incidence financière de la mesure doit donc prendre en compte les effets éventuels sur les comportements, difficiles à cerner. Le coût peut être fortement atténué par l’attractivité de la reprise d’emploi et ses effets sur la sécurisation des parcours, se traduisant par une baisse des entrées dans le régime d’assurance chômage. Mais en cas de persistance d’un niveau de chômage élevé, une part importante des droits supplémentaires sera consommé en tout état de cause.
Les effets dans le temps dépendent également du niveau de l’allocation journalière retenu. Le mécanisme actuel de réadmission retient l’allocation journalière la plus élevée ce qui a pour effet de réduire la durée totale de versement. L’allocation journalière pourrait également être calculée sur l’ensemble des droits. Son montant serait alors inférieur à celui du premier épisode d’indemnisation dans les cas où l’emploi repris a ouvert droit à une allocation journalière moins élevée.
Par ailleurs, si l’application rétroactive de ce dispositif aux demandeurs d’emploi en cours d’indemnisation leur est favorable dans une période de chômage accru, elle semble difficile à mettre en œuvre et peut comporter le risque de générer des indus.
Selon un chiffrage réalisé par l’Unédic à la demande de Force Ouvrière, le coût serait de 750 millions d’euros si, lors de la réadmission, le capital le plus élevé est retenu avec ajout de 50 % du capital le plus faible. La loi autorise en effet « la prise en compte en tout ou partie » des droits à l’allocation d’assurance non épuisés.
Un repère du même ordre est fourni par l’Unédic à partir du montant des capitaux non retenus lors de la réadmission d’allocataires arrivant ultérieurement en fin de droit et donc amenés à utiliser des droits supplémentaires, s’ils sont créés.
Enfin la montée en charge sera progressive : les responsables de l’Unédic ont indiqué à votre rapporteur que la modification des règles de réadmission opérera son plein effet au terme de quatre ou cinq années de mise en œuvre, contre deux à trois ans en cas de modification des durées d’indemnisation ou d’affiliation.
4. L’incidence de la négociation de la convention Unédic
Le coût de la mesure dépendra donc des paramètres fixés par les mesures d’application du principe des « droits rechargeables ». Celles-ci relèvent des partenaires sociaux en vertu de l’article L. 5422-20 du code du travail, auquel renvoie le présent article.
Les négociations seront menées dans le cadre du « groupe de travail paritaire politique » prévu par l’accord national interprofessionnel du 25 mars 2011 relatif à l’indemnisation du chômage. Les règles figureront dans la convention d’assurance chômage qui entrera en vigueur début 2014.
Les conditions de mise en œuvre de ce droit dépendent donc également de la situation financière du régime d’assurance chômage, l’article 3 de l’accord du 11 janvier indiquant que les droits rechargeables ne devront pas conduire à « aggraver le déséquilibre financier du régime d’assurance chômage ».
Selon la dernière prévision d’équilibre, le déficit de l’Unédic en 2013 s’élèverait à 5 milliards d’euros. Les déficits cumulés atteindraient 18,6 milliards d’euros. Avec une « dette » représentant sept mois de recettes, le régime d’assurance chômage dépassera donc le sommet historique de six mois de recettes atteint par ce ratio en 2005. Votre rapporteur souligne cependant que la garantie, en loi de finances, à hauteur de 5 milliards d’euros, des émissions obligataires de l’Unédic permet de couvrir l’ensemble des besoins de financement.
Si l’article L. 5422-12 du code du travail dispose que « les taux des contributions et de l’allocation sont calculés de manière à garantir l’équilibre financier du régime » celui-ci doit s’apprécier sur toute la durée du cycle économique. La baisse d’activité explique le creusement du déficit de l’assurance chômage puisque le régime doit alors indemniser un plus grand nombre de chômeurs, plus longtemps.
L’Unédic joue ainsi un rôle contracyclique important. Les allocations chômage sont, avec la TVA et la fiscalité des sociétés, les principaux « stabilisateurs automatiques », en raison à la fois de leur effet multiplicateur et de leur sensibilité à la conjoncture. Une étude de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) (24) de 2009, a estimé l’impact sur la dégradation du solde financier de l’Unédic d’un choc négatif d’un point de PIB à 4,7 % la première année et 7,8 % la seconde année.
Votre rapporteur considère donc qu’il importe d’éviter que la dégradation conjoncturelle des comptes n’oriente défavorablement la prochaine négociation de la convention Unédic : l’introduction des droits rechargeables ne doit pas avoir pour corollaire une réduction des droits des autres chômeurs ni en terme de montants des indemnités, ni en terme de durée. Le régime d’assurance chômage a parfois suivi par le passé une logique procyclique de réduction des droits des chômeurs en phase de récession ou de dépenses nouvelles en phases de croissance, ce qui a limité ses effets stabilisateurs sur l’activité. A contrario, l’instauration des « droits rechargeables » en période de faible croissance renforcera le rôle contracyclique du régime d’assurance chômage, ce qui sera favorable à la reprise. Conformément à l’esprit du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG), votre rapporteur considère qu’il convient d’apprécier le solde de l’Unédic structurellement, sur la durée du cycle économique et par conséquent de laisser le régime d’assurance chômage jouer pleinement son rôle de stabilisation économique et de protection pleine et entière des chômeurs sur la durée.
Situation financière cumulée du Régime d’assurance chômage (RAC) 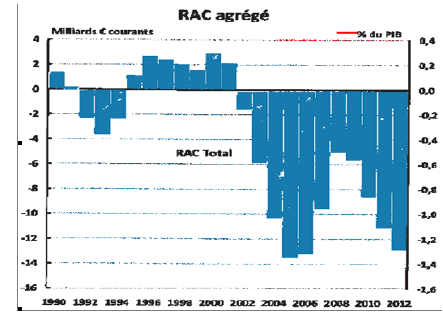
Source : Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle
Comme l’indique le graphique ci-dessus, depuis plus de dix ans l’Unédic n’a pas pu résorber son déficit cumulé. Il s’agit bien des effets des dix années de stagnation avec lesquels rompt l’action résolue de redressement de l’emploi et de la production engagée par le Gouvernement et à laquelle va contribuer la loi sur la sécurisation de l’emploi.
L’amélioration des comptes de l’Unédic dépend entièrement de la baisse du chômage. Elle ne saurait être opérée au détriment de droits des chômeurs.
II.- UN SUPPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION POUR FORMATION LORS DE L’ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ D’ANCIENS SALARIÉS EN CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE
Le II du présent article modifie l’article 43 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels en permettant aux accords conclus entre partenaires sociaux de prévoir une incitation financière dans le cadre de l’accompagnement dans le parcours de retour à l’emploi des publics relevant du dispositif d’accompagnement en contrat de sécurisation professionnelle expérimental destinés à des personnes en fin de contrat à durée déterminée».
A. LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ DE PÔLE EMPLOI ONT ÉTÉ ÉLARGIS À CERTAINS DEMANDEURS D’EMPLOI EN FIN DE CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE OU DE MISSION D’INTERIM
1. Le contrat de sécurisation professionnelle a unifié différents dispositifs expérimentaux d’accompagnement de salariés licenciés pour motif économique
L’article 41 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et de la sécurisation des parcours professionnels a créé le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), applicable dans certains bassins d’emploi, fruit de la fusion de la convention de reclassement personnalisé (CRP) et du contrat de transition professionnelle (CTP).
La convention de reclassement personnalisée avait été créée par les partenaires sociaux par l’accord national interprofessionnel du 5 avril 2005, sur habilitation législative (ancien article L. 321-4-2 du code du travail). Jusqu’à septembre 2011, l’entreprise de moins de 1 000 salariés était tenue de proposer une telle convention au salarié dont elle envisageait le licenciement économique, s’il ne pouvait pas bénéficier d’un congé de reclassement. La signature d’une convention de reclassement personnalisée valait rupture du contrat avec l’ancien employeur et renonciation au préavis et permettait une prise en charge pendant neuf mois initialement, puis douze mois à partir de 2009. Une allocation spécifique de reclassement égale à 80 % du salaire brut était versée aux salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté.
Le contrat de transition professionnelle, créé par l’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 sur habilitation de l’article 32 la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l’emploi et sur les droits et devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, avait le même public cible que la convention de reclassement personnalisée. Le bénéficiaire était pris en charge pendant douze mois par une structure spécifique, filiale de l’Association française pour la formation des adultes (AFPA). Il bénéficiait du versement d’une allocation spécifique de reclassement égale à 80 % du salaire brut sans condition d’ancienneté. L’expérimentation a porté sur sept bassins d’emploi à l’origine, et en a atteint 32 en 2010.
L’évaluation de ces deux dispositifs, notamment par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) en 2010 a conduit les partenaires sociaux à consacrer la création d’un dispositif d’appui et d’accompagnement personnalisé des salariés confrontés aux conséquences des mutations économiques pour mieux sécuriser leur parcours professionnel et accélérer leur reclassement : c’est l’accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 relatif au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui a abouti à la loi n° 2011-893 du 13 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi Cherpion ».
Le contrat de sécurisation professionnelle cible donc les entreprises de moins de 1 000 salariés ou en dépôt de bilan et permet un accompagnement du signataire pendant douze mois maximum. Une allocation spécifique de reclassement égale à 80 % du salaire brut est versée aux salariés ayant au moins un an d’ancienneté, les autres salariés recevant le montant de l’allocation de retour à l’emploi. Le bénéficiaire dispose d’un droit à indemnité différentielle de reclassement s’il reprend une activité moins bien rémunérée que son emploi précédent.
Dans son rapport de janvier 2013 sur les politiques en matière d’emploi, la Cour des comptes a souligné les limites des dispositifs existants, le taux de reprise d’emploi n’étant que de 48 % douze mois après un contrat de transition professionnelle en 2009 par exemple. La Cour recommande de dépasser une logique de statut et de comparer les méthodes d’accompagnement spécifiques avec celles du dispositif de droit commun, le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE).
Dans les dispositifs spécifiques comme dans les dispositifs de droit commun, la qualité de l’accompagnement repose en effet sur la capacité à établir un diagnostic sur le parcours professionnel et sur le niveau d’engagement dans une formation qualifiante donc d’une durée élevée. Elle nécessite une forte disponibilité de la part des conseillers de Pôle emploi : le portefeuille de bénéficiaires du CSP par conseiller a donc été limité, et Pôle emploi s’est assigné un objectif comparable pour les publics les plus éloignés de l’emploi.
2. L’expérimentation des mesures d’accompagnement du contrat de sécurisation professionnelle à des demandeurs d’emploi en fin de contrat à durée déterminée ou de mission d’intérim
Dans un but de dépassement de l’approche par statut, l’article 43 de la « loi Cherpion » a ouvert aux partenaires sociaux la faculté d’expérimenter l’extension de l’accompagnement en contrat de sécurisation professionnelle à des travailleurs en fin de contrat à durée déterminée, de mission de travail temporaire ou de chantier au sens de l’article L. 1236-8 du code du travail.
La loi ouvre seulement la faculté d’expérimenter des « modalités particulières d’accompagnement » qui « peuvent notamment comprendre les mesures mentionnées à l’article L. 1233-65 du code du travail relatif au contrat de sécurisation professionnelle ». Il s’agit d’une phase de prébilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel qui tient compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché du travail ; le parcours comprend des mesures d’appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.
Le public n’est pas donc éligible à l’allocation spécifique de reclassement mais indemnisé au titre de ses droits à l’aide au retour à l’emploi (ARE).
En janvier 2012, quinze bassins d’emploi ont été sélectionnés, rendant 9 000 demandeurs d’emploi éligibles(25). L’expérimentation a été élargie à quinze bassins supplémentaires en mai 2012. À ce jour, on décompte environ 6 000 adhésions dans 38 bassins d’emplois répartis dans 19 régions. 57 % concernent des fins de CDD et 42 % des fins de contrats en intérim.
B. UNE AIDE FINANCIÈRE POUR RÉTRIBUER UNE FORMATION QUALIFIANTE PERMETTANT L’ACCÈS PÉRENNE À UN EMPLOI
1. Le contrat de sécurisation professionnelle – contrat à durée déterminée prévoit une offre de formation qualifiante dont les coûts sont mutualisés.
Les coûts du dispositif comportent les mesures d’accompagnement, financées par l’Unédic et l’État, notamment au moyen de l’aide individuelle à la formation (AIF) créée par Pôle emploi en avril 2010 et aménagée en octobre 2011. Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) participe au financement dans le cadre de projets de formations également éligibles au Fonds social européen (FSE).
Sur le fondement de l’article 3.3 de la convention cadre 2013-2015 qui le lie à la tutelle, le fonds paritaire vient ainsi de lancer un appel à projet d’actions de qualification et de requalification des salariés et demandeurs d’emploi concernent exclusivement les personnes accompagnées en contrat de sécurisation professionnelle ayant perdu leur emploi suite à l’échéance d’un CDD, d’une mission de travail temporaire ou d’un chantier dans certains bassins d’emploi. Cet appel à projet s’adresse aux organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) qui mettent en œuvre des formations longues : Fonds d’assurance formation du travail temporaire (FAFTT), OPCA Constructys et Fongecif.
Le pilotage par le fonds paritaire garantit l’ajustement du dispositif au plan national, l’homogénéité de traitement des bénéficiaires, l’adéquation du parcours de sécurisation avec la situation du marché du travail au niveau infrarégional et fournit une information et des procédures homogènes auprès de l’ensemble des acteurs et institutions impliqués dans le dispositif, à tous les échelons territoriaux.
Les ressources mobilisées par les Fongecif sont celles collectées au titre de la contribution au financement du congé individuel de formation des salariés en CDD. Les OPCA mobilisent les ressources collectées au titre des contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.
Les représentants de Pôle emploi ont, en outre, indiqué à votre rapporteur avoir identifié des pistes de synergies entre les cellules de reclassements relevant de la responsabilité des entreprises dans le cadre des plans de sauvegarde de l’emploi et les interventions de Pôle emploi dans le cadre du projet de sécurisation professionnelle. Une meilleure articulation de dispositifs qui interviennent parfois concomitamment dans les mêmes bassins d’emploi pourrait être envisagée, sous forme d’échange de service et de projets communs.
2. Lever l’obstacle de la faible indemnisation des stagiaires.
Depuis la convention d’assurance chômage de 2001, les demandeurs d’emploi indemnisés qui entreprennent une action de formation validée par Pôle emploi, bénéficient du maintien de leur allocation durant cette formation. Ce principe a été reconduit dans les conventions d’assurance chômage successives. Ainsi, en application de l’article 4 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 6 mai 2011, les demandeurs d’emploi qui accomplissent une action de formation dans le cadre de leur projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) continuent à percevoir leur allocation d’assurance chômage. Cette allocation est alors dénommée « aide au retour à l’emploi-formation » (AREF).
En 2011, le Gouvernement et le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) ont décidé de créer un nouveau dispositif, la rémunération de fin de formation (R2F), destinée à assurer un revenu de remplacement aux demandeurs d’emploi suivant une formation dont la durée excède celle de leurs droits à indemnisation au titre de l’assurance chômage. La formation doit être qualifiante et concerner un métier en tension. Le montant attribué dans le cadre de la rémunération de fin de formation est versé dans la limite de 652 euros par mois. Cette aide est cofinancée par l’État et le fonds paritaire pour un montant total de 160 millions d’euros. Pôle emploi a enregistré des entrées à partir du mois de mai 2011, et a versé 12 millions d’euros aux bénéficiaires en 2011. Ce dispositif a été reconduit en 2012. Le coût de la mise en œuvre de la rémunération de fin de formation au titre des formations prescrites en 2011 et 2012 s’élèverait à 96 millions d’euros (26).
Selon les informations fournies à votre rapporteur par Pôle emploi, parmi les bénéficiaires du dispositif, il n’y a eu que 462 entrées en formation, soit moins de 8 % de ses adhérents. Ce faible pourcentage concerne par ailleurs une proportion relativement faible du public éligible, puisque seuls un tiers des personnes auxquelles l’accompagnement est proposé s’y engagent.
Selon l’étude d’impact jointe au projet de loi, 57 % des bénéficiaires disposent de droits à indemnisation chômage inférieurs à douze mois. Au vu de durées d’indemnisation par le régime d’assurance-chômage relativement courtes, les formations qualifiantes peuvent se prolonger au-delà des droits à assurance chômage.
Le versement d’une prime de 1 000 euros au septième mois d’accompagnement est envisagé par l’article 8 de l’accord du 11 janvier. Compte tenu des délais d’entrée en formation, le versement serait donc opéré au moment de la fin des droits à assurance chômage de la plupart des anciens salariés en CDD. Ajoutée aux montants de la rémunération de fin de formation (R2F), cette indemnisation complémentaire permettrait aux adhérents d’achever leur formation dans de bonnes conditions.
Elle répond donc pleinement à la mission du régime d’assurance chômage de financement du « capital humain », pendant les périodes de recherche d’emploi, afin de sécuriser les parcours professionnels.
*
* *
Sur proposition du rapporteur, la commission des affaires sociales a apporté au présent article une modification rédactionnelle.
*
La Commission examine l’amendement AS 134 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Nous proposons la suppression de l’article 6, car, si nous approuvons la disposition permettant aux salariés de conserver les droits non consommés au cours d’une période de chômage, nous savons aussi que le patronat a précisé que cela ne devait pas aggraver le déséquilibre financier de l’assurance chômage et que les entreprises n’apporteraient aucune contribution financière supplémentaire. Autrement dit, ce nouveau droit s’inscrirait au détriment des autres demandeurs d’emploi.
En outre, pour en bénéficier, il faudrait avoir travaillé suffisamment longtemps. Or, en 2011 et en 2012, 80 % des nouveaux contrats de travail étaient des contrats à durée déterminée de courte durée n’ouvrant aucun droit.
Il s’agit donc d’un leurre, voire d’un recul social.
M. le rapporteur. Avis défavorable, même si je comprends la préoccupation qui vient d’être exprimée.
Le régime d’assurance chômage accuse un déficit annuel de 5 milliards d’euros et de 18 milliards cumulés. Mais il doit, en période de crise, jouer son rôle de stabilisateur automatique et de protection des plus fragiles. C’est pourquoi, à un moment où les durées observées de retour à l’emploi s’allongent jusqu’à trois ans, je suis, comme les partenaires sociaux, résolument opposé à une réduction de l’indemnisation du chômage. D’autant qu’il existe une perspective de retour à l’équilibre financier du régime.
La mesure proposée par l’article 6 va-t-elle aggraver le déficit ? Une simulation réalisée à la demande de Force ouvrière sur la base de la moitié des droits rechargeables en estime le coût direct à environ 750 millions d’euros. Mais elle permettra de sécuriser chacun dans sa reprise d’emploi et présentera donc un gain indirect pour l’assurance chômage. On peut penser qu’elle s’équilibrera d’elle-même sur le plan financier.
Au-delà, la question plus générale consiste à savoir que faire du déficit de l’Unédic. Faut-il le laisser filer pendant la crise ou prendre des mesures de compensation ? La discussion se poursuivra.
Mme Isabelle Le Callennec. L’alinéa 2 de l’article 6 dispose que les droits à l’allocation d’assurance non épuisés sont pris en compte « en tout ou partie » dans le calcul de la durée et du montant des droits. Qu’est-ce qui détermine ce partage ?
M. le rapporteur. L’alinéa 2 est ainsi rédigé parce que les partenaires sociaux n’ont pas tranché la question de la proportion des droits rechargeables. La réponse dépendra aussi des contributions évoquées par Jacqueline Fraysse et du gain indirect généré par la mesure. L’estimation de 750 millions d’euros se fonde sur une hypothèse de 50 % de droits rechargeables. Ainsi, dans le cas d’un reliquat de douze mois, avec un CDD de quatre mois, six mois de droits s’ajouteront aux droits acquis au titre de celui-ci.
M. Jean-Patrick Gille. Il me semble que l’exposé des motifs méconnaît un peu le dispositif proposé. L’idée de droits rechargeables vise à inciter à la reprise d’emploi, quand des chômeurs hésitent à travailler de nouveau, notamment en CDD, afin de ne pas perdre de droits. On ne peut donc prédire quel sera l’impact concret de la mesure, d’où son enjeu économique et son aléa financier.
M. Francis Vercamer. Un certain nombre de chômeurs hésitent en effet à reprendre un emploi en CDD de peur de perdre des droits. Cet article 6 me semble donc constituer une bonne incitation au travail et je salue les partenaires sociaux d’avoir avancé sur ce point. On ne peut en prédire l’incidence, mais il est important que l’expérimentation se déroule.
La Commission rejette l’amendement AS 134.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS 317 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AS 103 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. Lors de la négociation sur la convention d’assurance chômage, en septembre prochain, les partenaires sociaux devront veiller à ce que les dispositions de l’article 6 ne conduisent pas à aggraver le déséquilibre financier du système, qui connaît déjà un déficit cumulé d’environ 18 milliards d’euros. Or il est possible d’agir à enveloppe constante : dans la mesure où la mise en place des droits rechargeables va faciliter l’accès à l’emploi, on peut s’attendre à ce qu’elle entraîne une économie susceptible de compenser en partie son coût, évalué à environ 750 millions d’euros par Force ouvrière.
Par ailleurs, l’expression « en tout ou partie » me semble poser problème, car elle ouvre la porte à des droits non entièrement rechargeables. En raison de l’insécurité juridique qu’elle représente pour les personnes concernées, on risque de produire l’effet inverse de celui attendu.
Enfin, monsieur le rapporteur, la réadmission des droits, déjà prévue par les textes existants, sera-t-elle encore possible ?
M. le rapporteur. En matière d’indemnisation, la loi pose les grands principes, mais les règles sont toutes fixées par le régime d’assurance chômage, et leur publicité est la même que pour les dispositions prises par l’État. Formellement, d’ailleurs, l’accord interprofessionnel donne lieu à un décret de validation du ministre, dont le pouvoir réglementaire est délégué aux partenaires sociaux. Votre remarque sur la sécurité juridique vaut donc pour l’ensemble du dispositif de l’assurance chômage. Il appartient aux partenaires sociaux de décider si les droits doivent être entièrement rechargeables ou seulement en partie. Je ne serais pas hostile à ce qu’ils le soient systématiquement à 100 %, mais une telle disposition serait contraire à l’accord du 11 janvier.
Quant à l’amendement lui-même, j’y suis défavorable, car j’estime qu’il ne faut pas enserrer la négociation dans des contraintes trop étroites. En outre, la montée en charge du dispositif étant progressive, il ne coûtera pas 750 millions d’euros dès le 1er janvier 2014. L’accumulation des droits s’étalant sur plusieurs années, nous aurons le temps de vérifier si le système fonctionne à l’équilibre.
Je le répète : soit nous laissons le régime d’assurance chômage jouer son rôle de stabilisateur, soit nous décidons d’augmenter les cotisations, mais je suis totalement défavorable à l’idée de réduire le montant ou la durée des indemnisations.
M. Denys Robiliard. L’amendement proposé cherche à poser des contraintes à la négociation entre partenaires sociaux. Il est donc contradictoire avec la volonté exprimée par nos collègues de suivre presque aveuglément l’accord du 11 janvier.
Mme Véronique Louwagie. L’amendement ne fait que traduire la volonté des partenaires sociaux, clairement exprimée à l’article 3 de l’accord du 11 janvier, de ne pas aggraver le déséquilibre financier de l’assurance chômage. Contrairement à ce qu’affirmait Jacqueline Fraysse il y a quelques instants, ce n’est pas seulement le patronat, mais tous les signataires de l’accord qui se sont engagés sur cette question cruciale.
Mme Jacqueline Fraysse. J’ai surtout souligné la volonté préoccupante du patronat de ne pas engager de moyens nouveaux.
M. le rapporteur. J’ajoute qu’un des principaux syndicats signataires de l’accord a exclu expressément toute évolution des droits à indemnisation.
Le système de la réadmission, monsieur Cherpion, permet aujourd’hui à un demandeur d’emploi de bénéficier de la meilleure indemnisation, soit au titre de l’emploi qu’il vient de quitter, soit à celui d’un emploi précédent. Non seulement il est conservé, mais il est amélioré : les anciens droits non consommés et les nouveaux droits acquis pourront se cumuler en tout ou en partie.
La commission rejette l’amendement AS 103.
Puis elle adopte l’article 6 modifié.
Article 7
(art. L. 5422-12 du code du travail)
Majoration de la cotisation d’assurance chômage sur les contrats courts
C’est sur la base du constat d’une segmentation accrue du marché du travail – avec d’un côté, la stabilité et l’inscription dans la durée des contrats à durée indéterminée (CDI) et de l’autre, la précarité et l’instabilité des contrats atypiques – que les partenaires sociaux se sont penchés sur la question de la modulation des taux de cotisation d’assurance chômage en fonction de la nature du contrat.
A. UN DÉVELOPPEMENT DES CONTRATS COURTS QUI A CONTRIBUÉ À LA DUALISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL ET DONT LE COÛT POUR LA COLLECTIVITÉ EST IMPORTANT
1. La place actuelle des contrats courts
Que recouvrent réellement les contrats dits « atypiques » ? L’INSEE parle de « formes particulières d’emploi » pour renvoyer aux contrats à durée déterminée (CDD), aux missions d’intérim, aux contrats aidés et aux contrats en alternance, par opposition aux CDI.
Historiquement, l’explosion du recours au CDD, figure emblématique du contrat atypique, se situe au milieu des années 1980 : la part des CDD et des contrats saisonniers dans l’emploi total est ainsi passée de 3,6 % en 1984 à 6,2 % en 1989, puis à 8,1 % en 1997, et enfin, à 8,5 % en 2010 (27). Globalement toutefois, la proportion des salariés en CDD est stable depuis le milieu des années 1990. C’est pourquoi on ne peut pas réellement parler d’un accroissement de la précarité des contrats de travail, mais bien d’un approfondissement de la dualisation du marché du travail.
En effet, d’après l’INSEE, 76,4 % des salariés en France sont aujourd’hui titulaires d’un contrat à durée indéterminée (CDI) : c’est le cas de près de 80 % des salariés entre 25 et 49 ans en 2011, mais de seulement 47,5 % des jeunes salariés de 15 à 24 ans. La part des salariés en CDD, y compris en contrat aidé, représente 8,4 % en 2011 : les jeunes salariés de 15 à 24 ans sont 27 % à être en CDD, contre 7,6 % des salariés de 25 à 49 ans et 4,5 % des salariés de plus de 50 ans. On remarquera également que 15,7 % des jeunes salariés de moins de 24 ans sont en apprentissage et que 7,1 % d’entre eux sont intérimaires. Au total, la proportion de salariés français en contrat court (CDD, intérim, apprentissage) atteint un peu moins de 12 % en 2011. Du point de vue de la répartition par sexe, on remarque également que les femmes sont plus nombreuses à être en CDD : 10,4 % contre 6,6 % des hommes (28). Au total, en 2011, 2 191 000 salariés sont en CDD ou en contrat saisonnier, contre 19 727 000 salariés en CDI.
En France, huit recrutements sur dix se font aujourd’hui en CDD. Le recours au CDD est plus répandu dans les entreprises de plus de 50 salariés, puisque la part des embauches en CDD y représente 80,9 % contre 77,4 % dans les entreprises de moins de 10 salariés et 74,6 % dans les entreprises de 10 à 50 salariés. Les embauches en CDD sont particulièrement fréquentes dans le secteur tertiaire, puisqu’elles représentent 80,3 % des embauches contre 65 % dans l’industrie et 59 % dans la construction.
Les fins de CDD représentent les trois quarts des sorties de contrats, loin devant les démissions et les licenciements. Les trois quarts des CDD arrivés à terme en 2011 ont duré six mois ou moins ; quant aux CDD de plus d’un mois terminés en 2011, ils ont été signés pour près de 85 % d’entre eux dans le tertiaire, pour un peu moins de 10 % dans l’industrie et pour 5,7 % dans la construction. En outre, les durées des CDD sont particulièrement courtes dans le secteur tertiaire : la moitié des CDD arrivés à terme en 2011 dans ce secteur ont duré un ou deux mois (29).
Dans les faits, si la proportion globale des CDD est relativement stable depuis le milieu des années 1990, autour de 8 à 8,5 %, on constate une très forte croissance des contrats de moins d’un mois (+ 88 % entre 2000 et 2010) et notamment des CDD de moins d’une semaine (+ 120 % sur la même période). A contrario, les embauches de plus d’un mois (CDD de plus d’un mois et CDI) diminuent de 1,7 % sur cette même période (30). Cette forte augmentation de la part des CDD de très courte durée est principalement à mettre au compte du secteur tertiaire, et plus particulièrement des secteurs autorisés par la loi à recourir à des CDD d’usage, dont le régime est dérogatoire, puisqu’ils ne comportent ni durée maximale, ni délai de carence entre deux CDD, ni indemnité de précarité : en effet, l’ACOSS montre que les secteurs d’activité habilités à recourir à des CDD d’usage regrouperaient au moins 57 % des déclarations uniques d’embauche de moins d’un mois, alors qu’ils ne représentent que 12 % de l’emploi salarié au total.
En 2010, par exemple, les recrutements en CDD de moins d’un mois représentent plus de 95 % de l’ensemble des recrutements dans le secteur des activités récréatives et du spectacle, de la production cinématographique, de l’audiovisuel et de la manutention portuaire. L’analyse de l’ACOSS permet de mettre en évidence que les 19,4 millions de déclarations d’embauche en 2010 ont concerné environ 6,5 millions de personnes, soit en moyenne trois contrats par personne embauchée dans l’année ; un peu moins de 2 % des personnes embauchées le sont au moins vingt fois dans l’année. Les embauches récurrentes sont ainsi très élevées dans les secteurs faisant appel aux intermittents du spectacle (activités créatives, spectacles, production cinématographique, audiovisuel), et plus généralement dans les secteurs qui recourent à des CDD d’usage, tels que la manutention portuaire ou encore le déménagement.
L’ACOSS explique la progression des recrutements en CDD d’usage de courte durée par une évolution jurisprudentielle qui a contribué à réduire le risque de requalification de ces contrats en CDI : en effet, dans plusieurs arrêts rendus en 2003, la chambre sociale de la Cour de cassation a décidé que le juge n’avait plus à vérifier le caractère par nature temporaire de l’emploi dès lors que l’entreprise appartenait bien à l’un des secteurs habilités à recourir aux CDD d’usage et qu’il s’agissait bien d’un emploi pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir à un CDI. Un revirement de jurisprudence est néanmoins intervenu en 2008 à ce sujet : dans deux arrêts rendus le 23 janvier, la Cour de cassation, se fondant sur le droit communautaire, a précisé que des contrats successifs peuvent être conclus avec le même salarié à condition que cela soit justifié par des raisons objectives, qui s’entendent d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.
Le recours aux contrats précaires représente un coût important pour le régime d’allocation chômage : en effet, les fins de CDD et de missions d’intérim de moins de douze mois représentent, entre octobre 2010 et septembre 2011, 23 % du total des allocataires de l’assurance chômage, soit un peu moins de 520 000 personnes. Ils représentent donc une part non négligeable des dépenses d’assurance chômage, leur durée d’indemnisation moyenne à la sortie étant de six mois, pour un équivalent d’allocation mensuel de l’ordre de 1 110 euros. La dépense mensuelle d’indemnisation pour l’assurance chômage de ces publics représente 460 millions d’euros, soit 20 % des dépenses totales d’assurance chômage (31), alors même que les contributions versées pour ces contrats ne représentent que 8 % des contributions totales, d’après l’étude d’impact associée au présent projet de loi. La faible durée moyenne de ces contrats conduit également à peser davantage sur les régimes de solidarité nationale (allocation de solidarité spécifique ou revenu de solidarité active), dans la mesure où ces demandeurs d’emploi bénéficient souvent mécaniquement de durées d’indemnisation plus courtes par l’assurance chômage.
Le cas particulier de l’intérim
Le secteur du travail intérimaire regroupe environ 576 000 salariés en 2011. Cette même année, 2,1 millions de personnes ont signé 16,8 millions de contrats de mission : 54 % d’entre elles ont réalisé au moins quatre missions dans l’année et 22 % n’en ont effectué qu’une seule. La durée moyenne des missions a augmenté d’une demi-semaine environ, pour s’établir à 1,8 semaine. En moyenne, les intérimaires sont en mission 2,6 mois dans l’année, et un intérimaire sur deux a été en mission moins de 1,6 mois dans l’année (32).
Les principaux secteurs ayant recours au travail temporaire sont l’industrie, avec 45 % du volume total de travail temporaire, 261 000 intérimaires employés en équivalent emplois à temps plein en 2011, et 6,4 millions de contrats d’intérim signés cette année-là ; mais également la construction, qui a recouru à 117 600 intérimaire en équivalent temps plein en 2011, soit 20 % du volume total de travail temporaire, et conclu 2,3 millions de contrats d’intérim ; et enfin, le secteur tertiaire, qui a employé 195 000 intérimaires en 2011 en équivalent temps plein, soit 34 % du volume total de travail temporaire, et conclu 8 millions de contrats.
Selon les dernières données connues, au troisième trimestre 2012, 516 400 salariés sont intérimaires, soit un net recul de près de 60 000 postes sur une année (33). Les salariés intérimaires représentent en 2011 2,1 % de l’ensemble de l’emploi salarié. Si la part représentée par l’intérim dans l’emploi salarié a progressé dans les trente dernières années, cette progression est restée contenue : en effet, la part de l’emploi intérimaire est passée de 0,4 % de l’emploi en 1983 à 1 % en 1995 ; elle a atteint les 2,1 % en 2005.
2. Le cadre juridique du contrat à durée déterminée
Le code du travail (articles L. 1241-1 à L. 1248-11) encadre théoriquement rigoureusement le recours au CDD, qui ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
1° Celui-ci ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, en l’occurrence dans le cadre du remplacement d’un salarié absent ou passé provisoirement à temps partiel, de l’attente de la prise de fonction d’un nouveau salarié ou de la suppression définitive du poste d’un salarié ayant définitivement quitté l’entreprise – il s’agit des CDD dits « de remplacement » -, dans le cadre de l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ou encore pour l’exécution de travaux saisonniers.
2° En outre, certains emplois par nature temporaire sont de manière constante occupés par des personnes embauchées en CDD : il s’agit des secteurs d’activité définis à l’article D. 1242-1 du code du travail (exploitations forestières, réparation navale, déménagement, hôtellerie et restauration, centres de loisirs et de vacances, sport professionnel, spectacles, action culturelle, audiovisuel, production cinématographique, édition phonographique, enseignement, information, activités d’enquête et de sondage, entreposage et stockage de la viande, bâtiment et travaux publics pour les chantiers à l’étranger ; activités de coopération, d’assistance technique, d’ingénierie et de recherche à l’étranger ; activités d’insertion par l’activité économique exercées par les associations intermédiaires, recrutement de travailleurs pour les mettre à la disposition de personnes physiques dans le cadre des services à la personne ; recherche scientifique réalisée dans le cadre d’une convention internationale, d’un arrangement administratif international pris en application d’une telle convention ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ; et, enfin, pour les activités foraines). Dans l’ensemble de ces secteurs d’activité, on parle de « CDD d’usage ».
3° Enfin, dans certains cas particuliers, comme par exemple pour l’exécution de travaux urgents, l’organisation de mesures de sauvetage, la réparation du matériel, des installations ou des bâtiments d’une entreprise qui présenteraient un danger pour les personnes, ou encore pour la réalisation de travaux de vendanges, il est également possible de recourir à un CDD.
On notera également que de nombreux contrats aidés peuvent être conclus sous la forme de CDD, comme par exemple les contrats de professionnalisation ou les contrats uniques d’insertion.
La durée légale d’un CDD varie en fonction de la nature du recours à cette forme de contrat : cette durée est le plus souvent fixée à dix-huit mois, renouvellement compris, par exemple pour le remplacement d’un salarié absent ou encore un accroissement temporaire d’activité ; mais elle peut être portée à vingt-quatre mois lorsque le contrat est exécuté à l’étranger, en cas de départ définitif d’un salarié avant suppression de son poste ou encore en cas de commande exceptionnelle à l’exportation ; elle est en revanche ramenée à neuf mois dans l’attente de l’entrée en service effectif d’un salarié en CDI ou pour la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Cette durée est même ramenée à trois mois pour les contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité dans un établissement ayant procédé à un licenciement économique. Aucune durée maximale n’est en revanche imposée pour les CDD d’usage ou les CDD saisonniers.
Le CDD peut également être sans terme précis dans le cas du remplacement d’un salarié absent, dans l’attente de l’entrée en service effectif d’un salarié en CDI (à condition toutefois de respecter la durée maximale légale de neuf mois), pour des emplois saisonniers ou encore pour des emplois pour lesquels il est d’usage de ne pas recourir au CDI. Dans tous ces cas, le contrat doit fixer une durée minimale.
On notera que la durée des CDD au titre des contrats aidés dépend de chaque type de dispositif.
Un délai minimal doit être respecté entre deux CDD : ce délai est du tiers de la durée totale du contrat précédent, renouvellement inclus, pour un CDD de plus de 14 jours ; et de la moitié de la durée totale du contrat précédent, renouvellement inclus, pour les CDD de moins de 14 jours. Ce délai ne s’applique pas aux emplois saisonniers, aux CDD d’usage, aux travaux urgents, aux contrats aidés, en cas de rupture anticipée du salarié ou de refus de celui-ci de renouveler son contrat, ni en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ou en cas de remplacement d’un chef d’entreprise.
En outre, à l’échéance du CDD, la poursuite de la relation contractuelle avec le même salarié la place juridiquement sous le régime du CDI (article L. 1243-11) ; des CDD successifs peuvent toutefois être conclus avec un même salarié pour un remplacement, pour les emplois saisonniers ou les emplois d’usage.
Le contrat de travail d’un salarié embauché en CDD est obligatoirement écrit et doit comporter la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée et peut dès lors faire l’objet d’une requalification par le conseil des prud’hommes. Le contrat doit notamment comporter le nom et la qualification de la personne remplacée (s’il s’agit d’un CDD de remplacement), la date de fin de contrat et, le cas échéant, une clause de renouvellement, ou la durée minimale pour les contrats à terme incertain. Il doit également préciser, entre autres, le poste de travail, le montant de la rémunération et ses différentes composantes. Une période d’essai peut être prévue, limitée, sauf dispositions conventionnelles contraires, à un jour par semaine dans la limite de quinze jours pour les contrats inférieurs à six mois ; et un mois maximum pour les contrats supérieurs à six mois : dans ce cas, elle est également expressément mentionnée au contrat.
Parce que les règles relatives au licenciement ne s’appliquent pas aux salariés embauchés en CDD – le contrat cessant de plein droit à l’échéance du terme ou, a priori, au-delà de la durée minimale s’il est sans terme précis –, des contreparties sont prévues pour le salarié sous la forme du versement d’une indemnité de fin de contrat, appelée « prime de précarité » et qui est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié (article L. 1243-8). Cette indemnité ne s’applique pas dans le cas d’un CDD saisonnier, d’un CDD d’usage, d’un contrat aidé ou encore dans le cas du refus d’un salarié de conclure un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi équivalent assorti de la même rémunération. Elle n’est logiquement pas due non plus en cas de conclusion d’un CDI à la suite du CDD.
B. LE PRINCIPE D’UNE MODULATION DES TAUX DE COTISATION D’ASSURANCE CHÔMAGE
L’accord du 11 janvier pose le principe d’une majoration de la cotisation patronale d’assurance chômage pour les CDD inférieurs à trois mois ; cette majoration est fonction du motif de recours à ce type de contrat. Il prévoit également une exonération temporaire de cotisations patronales d’assurance chômage pour l’embauche en CDI d’un jeune de moins de 26 ans.
La convention d’assurance chômage du 6 mai 2011, qui s’applique jusqu’au 31 décembre 2013, fixe un taux de cotisation uniforme pour l’ensemble des salariés relevant du régime général de l’assurance chômage, décomposé en une part employeur et une part salarié. La convention actuellement applicable fixe à 4 % le taux de la cotisation patronale à l’assurance chômage, dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 36 372 euros en 2012 (taux qui prévaut depuis 2004, avec une exception pour la convention de 2006, modifiée par avenant en 2007, et qui avait porté ce taux à 4,04 % jusqu’en 2009).
L’encadrement législatif du régime d’assurance chômage figure aux articles L. 5422-1 à L. 5422-24 du code du travail, les contributions au financement du régime figurant aux articles L. 5422-9 à L. 5422-12.
Le taux des cotisations patronales n’a en réalité jamais été modulé en fonction de la nature du contrat. Toutefois, un régime de contribution spécifique a déjà été aménagé par voie législative, en l’occurrence, concernant les intermittents du spectacle (article L. 5422-6) : on rappellera à cet égard que le taux de cotisation d’assurance chômage est, pour ces professions, fixé à 10,80 %, dont 7 % à la charge de l’employeur et 3,80 % à la charge du salarié.
De la même manière que ce régime spécifique est aménagé par la loi, la mise en place d’une modulation des cotisations sur la base d’autres critères que la profession nécessite donc une disposition législative.
1. Une modulation qui doit être négociée dans le cadre de la future convention d’assurance chômage
L’article 4 de l’accord du 11 janvier fixe le cadre qui sera applicable aux cotisations patronales d’assurance chômage pour les contrats courts.
a) Une majoration de la cotisation patronale pour les contrats courts
L’accord prévoit qu’à compter du 1er juillet 2013, un avenant à la convention d’assurance chômage fixera le taux de la cotisation employeur au régime pour les CDD (hors contrats d’apprentissage et contrats d’intérim) :
– à 7 % pour les CDD inférieurs à un mois ;
– à 5,5 % pour les CDD entre un et trois mois ;
– à 4,5 % pour les CDD inférieurs à trois mois dans certains secteurs d’activité dans lesquels il est d’usage de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois (ex : spectacle, déménagement, hôtellerie, restauration, enseignement, secteur de l’insertion par l’activité économique, etc., définis à l’article D. 1242-1), autrement dit pour les CDD d’usage.
Les emplois saisonniers et les CDD conclus pour le remplacement d’un salarié ou d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle, commerciale ou agricole ou d’un professionnel libéral, ne sont pas concernés par ces taux.
Ces taux ne s’appliquent pas davantage en cas d’embauche du salarié en CDI à l’issue de son CDD.
S’agissant du calendrier retenu, on remarquera que si les dispositions relatives à la majoration de la cotisation d’assurance chômage des contrats courts doivent entrer en vigueur au 1er juillet 2013, il est vraisemblable que la négociation relative à la nouvelle convention d’assurance chômage ne sera pas aboutie. Il s’agira donc bien a priori de deux négociations distinctes, la renégociation de la convention d’assurance chômage dans sa globalité ne devant intervenir que dans un second temps.
b) Une exonération temporaire de la cotisation patronale pour l’embauche d’un jeune en CDI
L’article 4 de l’accord prévoit également que l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans en CDI doit donner lieu à exonération de cotisation patronale d’assurance chômage pendant trois mois, cette durée étant portée à quatre mois pour les entreprises de moins de 50 salariés. Cette exonération n’est valable que si le contrat se poursuit au-delà de la période d’essai.
Votre rapporteur estime souhaitable que les partenaires sociaux encadrent le bénéfice de cette exonération au cours de leur négociation de l’avenant à la convention d’assurance chômage : il ne serait en effet pas légitime que cette exonération puisse bénéficier à un employeur qui romprait le contrat du jeune en question dès la fin de l’exonération. Certes, l’accord national interprofessionnel exclut du bénéfice de l’exonération les embauches pour lesquelles le contrat ne se poursuivrait pas au-delà de la période d’essai du salarié : il conviendrait d’aller plus loin, dans la mesure où la période d’essai peut, en toute rigueur, être inférieur à trois ou quatre mois, durée maximale fixée pour bénéficier de l’exonération.
On notera qu’il s’agit d’un dispositif véritablement exceptionnel : sauf à de très rares exceptions par le passé, il n’existe aucune exonération de cotisations chômage. Les exonérations de cotisations, qu’elles soient générales ou ciblées, excluent toujours les contributions chômage de leur champ.
2. Le chiffrage de l’impact financier de la modulation des cotisations d’assurance chômage sur les contrats courts
La majoration de la cotisation patronale d’assurance chômage sur les contrats courts d’une part, l’exonération temporaire de cotisation patronale pour l’embauche en CDI d’un jeune de moins de 26 ans d’autre part, constituerait une double mesure qui serait in fine neutre pour l’Unédic : les recettes attendues de l’une, estimées entre 130 et 150 millions d’euros seraient annulées par le coût de l’autre, estimé entre 120 et 160 millions d’euros.
a) Le gain attendu de la majoration de la cotisation d’assurance chômage sur les contrats courts
Au total, la majoration des taux de cotisation prévue par l’article 4 de l’accord sur les contrats courts permettrait de générer un rendement en termes de recettes d’assurance chômage de l’ordre de 130 à 150 millions d’euros.
Les simulations relatives aux nouvelles recettes générées par cette majoration de cotisation doivent être manipulées avec précaution : en effet, si l’embauche d’un salarié en CDD donne lieu à déclaration, l’administration ne dispose pas des éléments précis de répartition entre les différents motifs de recours au CDD. En recoupant deux séries de données, – une extraction des déclarations annuelles de données sociales (DADS) d’une part, celles fournies par les déclarations uniques d’embauche (DUE) d’autre part –, les estimations évoluent entre 138 et 141 millions d’euros de recettes supplémentaires nettes pour l’Unédic.
● En effet, sur la base de la première série de données, qui ne permet toutefois pas de distinguer les motifs de recours au CDD, l’assiette sur laquelle repose l’estimation correspond à la masse salariale 2010 de l’ensemble des CDD, en excluant les contrats d’apprentissage et les contrats aidés, mais en incluant les CDD saisonniers, les contrats conclus pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, ainsi que les contrats qui sont transformés en CDI à l’issue du CDD.
Cette assiette comprend également les intermittents du spectacle, bien que l’accord ne les ait pas expressément inclus dans le champ de la majoration. Les CDD conclus dans le cadre de ces activités correspondent généralement à des CDD d’usage, pour lesquels l’accord prévoit une majoration de 0,5 % de la cotisation d’assurance chômage (34).
Le tableau suivant retrace les recettes supplémentaires attendues de la majoration des cotisations sur les contrats courts d’après la première série de données.
Première simulation de la majoration des cotisations
applicable aux contrats courts
(en millions d’euros)
Durée/type des contrats |
Masse salariale |
Cotisations actuelles |
Cotisations article 4 | |
Surcotisation |
Montant | |||
Moins d’un mois |
2 058,8 |
131,8 |
+3 |
193,5 |
De un à trois mois |
4 300 |
275,2 |
+1,5 |
339,7 |
Plus de trois mois |
19 701,8 |
1 260,9 |
- |
1 260,9 |
Intermittents du spectacle |
2 240,7 |
242 |
+0,5 |
253,2 |
Total des CDD (hors contrats aidés et contrats d’apprentissage) |
28 301,3 |
1 909,9 |
2 047,3 | |
Gain |
+137,5 | |||
Contrats aidés / d’apprentissage |
9 675 |
619,2 |
619,2 | |
Total |
37 976,3 |
2 529,1 |
2 666,5 | |
Source : Unédic.
● La deuxième série de données permet d’émettre des hypothèses sur le nombre des CDD d’usage : dans les secteurs qui en relèvent mais qui n’ont pas exclusivement recours à ce type de CDD, 8,2 millions de déclarations uniques d’embauche ont été enregistrées en 2010. Un retraitement des données permet d’estimer à 1,7 million le nombre de déclarations de CDD d’usage en 2010, hors intermittents du spectacle.
Le tableau suivant retrace les recettes supplémentaires attendues de la majoration des cotisations sur les contrats courts d’après la seconde série de données.
Seconde simulation de la majoration des cotisations
applicable aux contrats courts
(en millions d’euros)
Durée/type des contrats |
Masse salariale |
Cotisations actuelles |
Cotisations article 4 | |
Surcotisation |
Montant | |||
Moins d’un mois |
2 282 |
146 |
+3 % |
214,5 |
De un à trois mois |
3 824,6 |
244,8 |
+1,5 % |
302,1 |
Plus de trois mois |
15 993,9 |
1 023,6 |
- |
1 023,6 |
Total des CDD « ordinaires » |
22 100,5 |
1 414,4 |
1 540,3 | |
Moins de trois mois |
819,7 |
52,5 |
+0,5 % |
56,6 |
Plus de trois mois |
3 140,4 |
201 |
201 | |
Intermittents du spectacle |
2 240,7 |
242 |
+0,5 % |
253,2 |
Total des CDD d’usage |
6 200,8 |
495,4 |
510,7 | |
Total des CDD (hors contrats aidée et apprentissage) |
28 301,3 |
1 909,9 |
2 051 | |
Gain |
+141,1 | |||
Contrats aidés / apprentissage |
9 675 |
619,2 |
619,2 | |
Total |
37 976,3 |
2 529,1 |
2 670,2 | |
Source : Unédic
b) La perte de recettes occasionnée par l’exonération de cotisation patronale d’assurance chômage pour l’embauche d’un jeune en CDI
S’agissant de l’exonération de cotisation chômage pendant trois mois (ou quatre pour les entreprises de moins de 50 salariés) pour l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans en CDI, trois séries de données sont exploitables : les déclarations de mouvements de main-d’œuvre (DMMO), les déclarations annuelles de données sociales (DADS) et les déclarations uniques d’embauche (DUE).
Sur la base d’une estimation de 916 400 entrées en CDI de jeunes de moins de 26 ans en 2010, et l’hypothèse moyenne d’une interruption de 20 % des CDI avant la fin de la période d’essai, le nombre de jeunes embauchés en CDI serait de 733 100. Pour un salaire annuel brut moyen de l’ordre de 20 000 euros et une répartition de ces embauches de jeunes entre les structures de moins de 50 salariés et de plus de 50 salariés (sur la base d’une répartition moyenne de 67 % dans les entreprises de moins de 50 salariés et 33 % dans celles de plus de 50), le montant de l’exonération atteindrait un peu moins de 180 millions d’euros. Cette simulation peut apparaître comme surévaluée car les déclarations uniques d’embauche ne donnent pas systématiquement lieu à embauche effective.
Une deuxième simulation faite à partir des déclarations des mouvements de main-d’œuvre (DMMO) et du taux d’entrée en CDI, par taille d’entreprise, appliqués aux moins de 26 ans, conduit à estimer le coût de la mesure respectivement entre 120 et 160 millions d’euros.
Une troisième simulation, reposant uniquement que les données annuelles de données sociales (DADS), permet de mieux appréhender la masse salariale, mais apparaît plus fragile s’agissant de l’identification des entrées de jeunes en CDI : d’après cette simulation, le coût de l’exonération pourrait avoisiner 166 millions d’euros.
C. LA TRADUCTION LÉGISLATIVE
Le dispositif législatif aménageant les conclusions de l’accord est logiquement très limité : en effet, le contenu de son article 4, – qui expose les différents taux majorés ayant vocation à s’appliquer aux CDD en fonction de leur durée et du motif de recours à ces contrats, ainsi que l’exonération de cotisations prévue pour l’embauche en CDI d’un jeune –, doit faire l’objet d’un avenant à la convention d’assurance chômage. L’aménagement de ces mesures n’est donc pas du ressort du législateur.
Le présent article se contente de compléter l’article L. 5422-12 du code du travail, – qui prévoit que les taux des contributions et de l’allocation d’assurance chômage sont calculés de manière à garantir l’équilibre financier du régime –, par un nouvel alinéa qui dispose que les accords conclus par les partenaires sociaux gestionnaires du régime d’allocation chômage « peuvent majorer ou minorer les taux des contributions en fonction de la nature du contrat de travail, de sa durée, du motif de recours à ce type de contrat, de l’âge du salarié ou de la taille de l’entreprise ».
Les critères fixés permettent donc aux partenaires sociaux de réserver un traitement différencié, en termes de contributions au régime d’assurance chômage, aux contrats de travail en fonction de leur nature (CDI ou CDD), de leur durée (CDD de moins de moins d’un mois, d’un à trois mois ou de plus de trois mois), du motif de recours à ce type de contrat (pour un emploi d’usage, un emploi saisonnier, le remplacement d’un salarié absent, etc.), de l’âge du salarié (pour l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans) ou de la taille de l’entreprise (une entreprise de moins de 50 salariés ou de plus de 50 salariés).
La notion de « minoration » des taux des contributions peut permettre d’aménager une exonération de cotisations, celle-ci revenant à réduire à zéro le taux de cette contribution.
Le principe d’une telle modulation doit permettre de lutter contre la précarité excessive du marché du travail, en créant, comme l’indique l’étude d’impact, une incitation financière à la conclusion d’un CDI ou d’un CDD long plutôt que d’un contrat court, mais également en demandant un surcroît de participation de la part des employeurs et des secteurs qui, par leurs pratiques ou leurs spécificités, coûtent en proportion plus cher au régime d’assurance chômage.
Cet objectif est louable et répond à un souhait légitime. La nature des mesures proposées appelle néanmoins plusieurs réflexions :
– La première question concerne l’exclusion du champ de la majoration de cotisations de certains CDD en fonction du motif de recours à ce type de contrat. Si l’exclusion des CDD de remplacement apparaît logique, on peut s’interroger sur le motif de l’exclusion des CDD saisonniers de cette surcotisation, dès lors que les CDD conclus dans le cadre de l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise seront eux assujettis au taux majoré. Si la raison en est qu’un CDD saisonnier s’apparente davantage à un besoin structurel et permanent, car récurrent, la logique aurait, dans ce cas, pu conduire à classer les CDD saisonniers dans la même catégorie que les CDD d’usage, pour lesquels le taux de cotisation est porté à 4,5 %.
– La deuxième question concerne l’application ou non de la majoration de cotisations aux intermittents du spectacle. En effet, si les simulations financières fournies aux partenaires sociaux au cours des négociations intégraient bien les CDD conclus avec les intermittents du spectacle, dans la mesure où il s’agit quasi exclusivement de CDD d’usage, force est de constater que l’accord ne les mentionne pas expressément, voire les exclut de facto de la majoration prévue. En effet, le taux afférent aux CDD d’usage est porté, on l’a dit, à 4,5 % : or, les cotisations chômage des intermittents du spectacle font l’objet d’un taux spécifique, qui est déjà de 10,80 %, dont 7 % pour l’employeur. Ils ne figurent donc pas dans cette catégorie dans la lettre de l’accord.
– Troisième interrogation, l’accord exclut également du champ de la majoration des cotisations d’assurance chômage les contrats de travail temporaire, en prévoyant pour ce secteur, des dispositions spécifiques qui doivent faire l’objet de négociations dans la branche. On peut se demander dans quelle mesure l’exclusion de l’intérim de la majoration des cotisations ne va pas conduire à un effet de « déport » du flux des CDD vers les missions d’intérim, en particulier pour les contrats très courts, de moins d’un mois, qui s’établissent à 13,2 millions de contrats en 2011, sur un total de CDD de 17,3 millions.
En contrepartie de l’exclusion du secteur de l’intérim du champ de la majoration des cotisations d’assurance chômage, l’accord a prévu des dispositions particulières le concernant.
Il a ainsi prévu que la branche du travail temporaire doit mettre en place, par accord collectif et dans un délai de six mois, un CDI pour les salariés de son secteur : un accord de branche doit en effet intervenir pour fixer les conditions d’emploi et de rémunération des intérimaires en CDI, ainsi que les conditions de rapprochement des intérimaires en CDD à temps partiel des objectifs visés par ailleurs par l’accord en matière de temps partiel.
La négociation d’un accord de branche sur la mise en place d’un CDI intérimaire
Prévue par l’accord du 11 janvier, la négociation d’un accord de branche dans le secteur du travail temporaire, destinée à mettre en place un CDI intérimaire, devait en théorie s’ouvrir le 1er mars dernier : la négociation doit en effet aboutir avant le 11 juillet prochain, l’accord ayant consenti un délai de six mois pour la conduite de cette négociation et ayant précisé qu’en l’absence d’accord de branche au moment de l’ouverture de la prochaine négociation sur l’assurance chômage, un réexamen des conditions de la sécurisation des parcours professionnels des intérimaires s’imposerait.
Le présent projet de loi ne comporte assez logiquement aucune traduction juridique sur ce point : en effet, ce n’est qu’en fonction de l’issue de la négociation qu’un éventuel aménagement des dispositions législatives destinées à encadrer le CDI intérimaire devra intervenir.
Le support juridique du CDI intérimaire existe déjà dans certains pays européens, en particulier aux Pays-Bas, en Allemagne et en Italie. Il concerne 5 à 7 % des intérimaires néerlandais, alors qu’en Allemagne, il a été transformé en CDD en raison des déviances qui ont caractérisé le dispositif. En Italie, le CDI intérimaire est relativement récent.
En France, le dispositif juridique du « temps partagé » pourrait constituer le socle d’un CDI intérimaire : le choix a toutefois été privilégié par le secteur de créer un dispositif propre par voie d’accord. En tout état de cause, selon les informations recueillies auprès des acteurs de la branche, le CDI intérimaire ne serait pas obligatoire, mais seulement optionnel : il pourrait être lié à l’ancienneté dans le secteur, comme c’est le cas par exemple aux Pays-Bas. On constate en effet que 20 % des intérimaires le sont par choix : le dispositif du CDI intérimaire leur serait apparemment dédié. Il leur permettrait de bénéficier de la sécurité juridique de ce contrat, tout en leur permettant de continuer à pouvoir travailler auprès de plusieurs employeurs. Juridiquement, le salarié intérimaire en CDI ferait l’objet de mises à disposition successives auprès de différents employeurs. Il incombera au secteur – en l’occurrence, à l’agence d’intérim – de financer les intermissions : en effet, il n’est pas question que l’assurance chômage soit sollicitée dans ce cadre. La branche fournira également un effort supplémentaire en matière de formation professionnelle. Le niveau de rémunération du salarié intérimaire en intermission devra être négocié, mais on peut assez naturellement concevoir qu’il soit équivalent au salaire de référence perçu chez le dernier employeur.
S’agissant du financement de la jonction entre différentes missions, un dispositif de lissage devrait être envisagé, qui ne saurait bien entendu aux yeux de votre rapporteur se faire au détriment du salarié, autrement dit qui ne peut que correspondre à une forme d’avance.
Le passage de la forme du CDD au CDI pour ces salariés intérimaires conduira les agences d’intérim à ne plus devoir acquitter la prime de précarité de 10 % : cette économie serait utilisée pour permettre de financer les intermissions des salariés concernés.
On remarquera que le secteur lance, en parallèle de la négociation sur la mise en place d’un CDI intérimaire, une négociation sur la sécurisation du parcours professionnel des intérimaires qui resteront en CDD : l’objectif est d’augmenter leur durée d’emploi et de favoriser leur insertion durable dans l’emploi.
En l’absence d’accord de branche conclu à l’échéance de la mi-juillet, une intégration des missions d’intérim dans le champ des contrats assujettis à une majoration des cotisations patronales d’assurance chômage ne saurait donc être écartée.
Sans vouloir aucunement remettre en cause le choix qui a été fait par les partenaires sociaux de privilégier la voie de la majoration de cotisations chômage en fonction de la durée des CDD et du motif de recours à ce type de contrat, on peut rappeler que deux autres options ont déjà fait l’objet d’un certain nombre d’études.
La première recouvre la mise en place d’une cotisation d’assurance chômage dégressive avec l’ancienneté du contrat (35). Cette proposition concerne tous les types de contrats, quelle que soit leur nature (CDI ou CDD). Le taux de contribution à l’assurance chômage passerait de plus de 10 % pour un contrat d’un jour à 7,3 % le premier mois, pour se réduire à 3,6 % à partir du douzième mois contre un taux fixe actuel de 6,4 %.
La seconde recouvre la mise en place d’une contribution variable d’assurance chômage en fonction du taux de recours à des emplois précaires. Ce dispositif représenterait une sorte de bonus-malus de l’ampleur du recours à des contrats précaires (CDD, intérim). Il aurait vocation à tenir compte de la taille de l’entreprise, quitte à éventuellement exonérer de toute majoration de la cotisation patronale d’assurance chômage les très petites entreprises de moins de 10 salariés. Sur la base d’un taux de cotisation compris dans une fourchette de 5,4 % à 10 % en fonction du taux de recours aux contrats précaires, avec un taux pivot de 20 % dans les entreprises de moins de 10 salariés (ou en conservant le taux de 6,4 % actuel), de 15 % dans les entreprises de 10 à 200 salariés et de 11 % dans les entreprises de plus de 200 salariés, le rendement supplémentaire en termes de recettes d’assurance chômage serait de 5 milliards d’euros et atteindrait 3,7 milliards d’euros dans l’hypothèse d’une exclusion des entreprises de moins de 10 salariés.
Votre rapporteur estime qu’il conviendra de suivre de près le dispositif proposé et, le cas échéant, de soumettre à la négociation un approfondissement du dispositif si son efficacité devait être insuffisante.
*
* *
La Commission n’a apporté aucune modification à cet article.
*
La Commission est saisie de l’amendement AS 135 de Mme Jacqueline Fraysse.
M. André Chassaigne. L’article 7 est emblématique de la philosophie générale du texte, dans la mesure où il renvoie à des accords ultérieurs l’application de ses dispositions. La limitation de l’usage des contrats à durée déterminée (CDD) est donc purement hypothétique, puisqu’elle dépendra du bon vouloir du patronat.
La même démarche inspire de nombreux articles du projet de loi : alors que les dispositions défavorables aux salariés sont immédiatement applicables, celles qui pourraient éventuellement se traduire par des avancées sont systématiquement conditionnées à des négociations ultérieures.
Par ailleurs, l’accord du 11 janvier ne prévoyant aucune mesure véritablement dissuasive, nous doutons fortement que ces dispositions se traduisent par une réduction du nombre de contrats de courte durée.
Enfin, non seulement le patronat ne veut pas mettre d’argent supplémentaire dans le système d’assurance chômage, comme l’a rappelé Jacqueline Fraysse, mais il cherche à en économiser. En effet, alors que la surcotisation des contrats courts aura un coût de 110 millions d’euros pour les entreprises, la contrepartie accordée, c’est-à-dire l’exonération de cotisation pour l’embauche en contrat à durée indéterminée (CDI) d’un jeune de moins de 26 ans, représentera pour elles une économie de 145 millions d’euros, soit un gain net potentiel pour le patronat de 35 millions d’euros. Le tour est joué !
M. le rapporteur. Bien que différée, l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 7 va venir très rapidement, puisque les partenaires sociaux ont prévu de modifier les taux de cotisation avant l’été.
S’agissant des conséquences financières de la mesure, le coût de l’exonération pour l’embauche en CDI de jeunes de moins de 26 ans est plus facile à évaluer que le produit de la taxation des emplois précaires, faute de données statistiques précises : mais on peut estimer que le premier sera compris entre 120 à 160 millions d’euros, et le deuxième entre 130 et 150 millions d’euros. Dans le pire des cas, les dispositions de cet article se traduiraient donc par un déficit, relativement modeste, de 20 millions d’euros. Nous ne sommes pas loin de l’équilibre.
De toute façon, dans un système de bonus-malus – car c’est bien de cela qu’il s’agit –, il ne faut pas rechercher l’équilibre à chaque instant. Au contraire, plus la mesure rencontre le succès, plus le déséquilibre s’aggrave. Dans l’hypothèse où les entreprises renonceraient totalement aux CDD, la taxe sur les contrats courts ne produirait plus rien. Pour autant, réclameriez-vous la suppression d’une exonération qui aurait ainsi montré son efficacité ? Vous avez d’ailleurs voté en faveur des contrats de génération, qui prévoient une aide de 2 000 euros pendant trois ans pour l’embauche d’un jeune, soit beaucoup plus que les quelques dizaines d’euros d’exonération dont il est question ici.
Le dispositif prévu par l’article 7 est donc un bon dispositif. Certes, on peut se demander s’il va assez loin, dans la mesure où il ne s’applique pas à certains types d’emploi précaire, comme les CDD de plus de trois mois, les contrats saisonniers ou les CDD d’usage. Mais une négociation va s’ouvrir : si les partenaires sociaux constatent que le système prévu ne conduit pas à freiner le recours aux contrats de courte durée, ils pourront soumettre ces contrats au même système de taxation. Je vous invite donc, monsieur le député, à reconsidérer votre position sur l’article 7, car celui-ci constitue un pas dans le bon sens.
M. Dominique Dord. L’article 7 fixe un principe dont la mise en œuvre est renvoyée à une négociation future. Non seulement une telle démarche n’a rien de nouveau, mais elle est plutôt saine. Certes, le texte ne règle pas tous les problèmes, mais il répond à un objectif que nous partageons tous : mettre un terme à la multiplication des contrats courts. À cet égard, la modulation des taux de cotisation me paraît une bonne chose.
M. Denys Robiliard. Alors que l’article 4 de l’accord du 11 janvier ne concerne que les CDD, l’article 7 est de portée beaucoup plus générale et pourrait parfaitement s’appliquer à d’autres formes de contrat temporaire.
Le principe posé par l’article va en effet dans le bon sens, même s’il reste à voir ce qu’en feront les partenaires sociaux. Cela étant, il serait peut-être utile de réfléchir à un mécanisme permettant de s’assurer que le bonus ne sera pas supérieur au malus.
M. Francis Vercamer. Le groupe UDI est favorable à la modulation des cotisations selon les secteurs, à la condition, bien sûr, que l’équilibre des comptes sociaux soit préservé. Mais le fait de renvoyer la mise en œuvre du dispositif à des accords entre organisations représentatives d’employeurs et de salariés pose un problème, dans la mesure où certains secteurs ne sont aujourd’hui pas représentés dans ce type de négociations. C’est le cas en particulier du secteur de l’économie sociale et solidaire, notamment des services à la personne, éternels oubliés du dialogue social. Nous proposerons donc plusieurs amendements destinés à prendre en compte les spécificités de ce secteur.
M. Christophe Cavard. Il faut bien le reconnaître, les dispositions de l’article 7 constituent une avancée importante et répondent à des revendications anciennes. Il est temps, en effet, de mettre un terme à la croissance exponentielle du nombre de contrats de travail de courte durée. Mais, alors que l’accord du 11 janvier fixait d’ores et déjà les taux de cotisation applicables en fonction de la durée du contrat, le projet de loi se contente de fixer le principe d’une modulation.
Comme l’a dit Denys Robiliard, il conviendra de veiller, avec les partenaires sociaux, à ce que le montant des dépenses liées à l’application de cet article ne dépasse pas celui des recettes.
Par ailleurs, et tout en laissant toute sa place au dialogue social, nous devrons nous montrer vigilants et faire en sorte que l’objectif recherché par l’article 7 s’applique également à l’intérim.
Nous voterons cependant cet article, même si ses dispositions doivent être encore améliorées.
M. André Chassaigne. Denys Robiliard n’a fait que conforter mes arguments en soulignant que non seulement le patronat allait s’en sortir gagnant, mais il aurait pratiquement la garantie de voir ses gains dépasser largement ses pertes. D’une manière générale, d’ailleurs, ce projet de loi privilégie systématiquement les intérêts du patronat par rapport à ceux des salariés.
La Commission rejette l’amendement AS 135.
Elle examine ensuite l’amendement AS 159 de Mme Jacqueline Fraysse.
M. André Chassaigne. J’essaie de vous aider à faire évoluer ce texte dans un sens plus social. Un moyen simple consisterait à supprimer, dans le deuxième alinéa, les mots : « ou minorer ». Comment, en effet, peut-on envisager de nouvelles minorations des contributions patronales, alors que les aides votées en novembre s’élèvent à 20 milliards d’euros, et qu’elles viennent s’ajouter aux dizaines de milliards d’euros d’exonérations de cotisations déjà appliquées ?
M. le rapporteur. Le dispositif des contrats de génération, en faveur duquel vous avez voté, prévoit une aide financière de 2 000 euros par mois pendant trois ans, soit 6 000 euros. Tandis que l’exonération voulue par les partenaires sociaux pour inciter les entreprises à recourir à des embauches en CDI ne représente que 40 euros par mois pendant trois mois, c’est-à-dire 120 euros. Ce n’est pas du tout le même ordre de grandeur.
Il reste que cette mesure représente un signal fort envoyé aux entreprises, afin de les inciter à recourir prioritairement aux CDI et, à l’inverse, à limiter le recours au CDD, qui frappe plus particulièrement les jeunes.
Je pourrais à la rigueur concevoir que les dispositions de l’article 7 n’aillent pas suffisamment loin à vos yeux et que vous cherchiez à les améliorer, comme vous avez voulu le faire pour l’article 5. Mais votre opposition au principe même d’un bonus-malus est incompréhensible. Pour les socialistes, il s’agit en tout cas d’une revendication très ancienne, devenue l’engagement no 25 du candidat François Hollande. Nous sommes donc très satisfaits de lui voir trouver une première concrétisation avec l’appui du MEDEF.
Je rappelle que la surcotisation des contrats courts s’appliquera dès le 1er juillet 2013, sans même attendre la renégociation de la convention d’assurance chômage. Aucune nouvelle négociation n’est d’ailleurs nécessaire, dans la mesure où l’accord du 11 janvier a déjà fixé précisément les taux applicables à chaque type de contrat de travail. Le ministère travaille à limiter les complications administratives qui en résulteront pour les entreprises.
J’espère donc, monsieur Chassaigne, que vous allez, d’ici à l’examen du texte en séance publique, reconsidérer votre position sur l’article 7, comme j’ai senti que vous étiez prêt à le faire à propos de l’article 2 et du compte personnel de formation.
Mme Isabelle Le Callennec. La taxation des contrats courts a déjà fait couler beaucoup d’encre. Auditionnés par la Commission, les représentants des partenaires sociaux ont rappelé leur volonté de faire des CDI la norme et des CDD l’exception. L’objectif de cet article est donc de faire la chasse à l’usage abusif des CDD.
À cet égard, l’accord du 11 janvier va très loin puisque, comme vous venez de le rappeler, monsieur le rapporteur, il fixe déjà les taux de cotisation applicables aux différents types de contrat. Je suis donc surprise par le caractère très général de la rédaction de l’article 7, qui contraste avec la précision des dispositions, issues de la négociation, auxquelles il est censé donner une traduction concrète.
M. Jean-Patrick Gille. En fait, l’article 7, comme d’ailleurs le précédent, va plus loin que ce que proposait l’accord du 11 janvier en posant un principe susceptible de changer profondément le fonctionnement de l’assurance chômage. Alors que l’article 6 permet aux partenaires sociaux de créer des droits rechargeables à l’indemnisation, l’article 7 leur donne la possibilité – attendue depuis longtemps – de moduler le montant des cotisations en fonction de la qualité du contrat de travail, les CDD à temps partiel étant plus mis à contribution que les CDI à temps plein. Il appartient désormais aux partenaires sociaux de négocier l’application de ce principe. Ils l’ont d’ailleurs déjà fait en partie en prévoyant d’appliquer dès le mois de juillet une surcotisation sur les contrats de courte durée.
De toute façon, certains contrats particuliers, comme les CDD d’usage régis par les annexes 8 et 10 du régime général de l’assurance chômage, et qui concernent plus particulièrement les intermittents du spectacle, font déjà l’objet d’une modulation semblable, puisqu’ils se voient appliquer un taux de cotisation de 10,8 % au lieu de 6,4 %.
M. Christophe Cavard. Nous partageons votre objectif, monsieur Chassaigne. Même si 80 % des salariés sont en CDI, le nombre des contrats courts, voire très courts, a explosé depuis quelques années, et il faut mettre un terme à ce mouvement. Aussi l’idée du système de bonus-malus s’est-elle imposée. La notion de modulation est bien dans l’esprit de l’accord : il faut des incitations pour revenir à la norme, constituée par le CDI, et taxer les contrats courts.
M. le rapporteur. Selon le principe qui régit l’assurance chômage, après que les partenaires sociaux ont négocié dans un cadre défini, un décret ministériel donne valeur réglementaire à leur accord, pour peu qu’il soit conforme aux principes définis en amont. La question est de savoir si la loi n’impose pas l’unicité de la cotisation : en d’autres termes, est-il possible de faire varier les taux en fonction de certains critères.
L’article permet en effet d’aller plus loin que l’accord du 11 janvier. Il autorise les partenaires à inclure les intérimaires dans la taxation, par exemple en cas d’échec de la négociation sur l’intérim. Nous avons eu cette discussion lors de la transposition de la loi. Alors que le MEDEF ne souhaitait pas qu’on étende la taxation à l’intérim, le ministre a décidé d’autoriser une modulation très large, afin d’allonger le plus possible les contrats. L’accord du Conseil d’État était nécessaire pour prévenir le risque d’inconstitutionnalité. On évitera les ruptures brutales induites par des effets de seuil ou l’existence de contrats différents alors qu’ils répondraient à la même logique. L’habilitation était nécessaire pour que l’accord fixant des taux différenciés soit agréé par le ministre. Politiquement, elle offre une grande liberté aux partenaires sociaux pour améliorer le dispositif.
Cette étape est positive, monsieur Chassaigne, et je me réjouirais que nous la franchissions ensemble. Avant la séance publique, nous aurons le temps de prévoir un suivi de l’évolution de ces contrats. S’il s’avérait que les CDD de moins de trois mois disparaissent au profit de CDD de trois ou quatre mois, les partenaires sociaux devraient renégocier. Alors que, depuis quinze ans, le nombre de salariés intérimaires varie, selon la conjoncture, entre 500 000 et 600 000, celui des CDD a augmenté depuis vingt ans, et celui des CDD très courts a explosé depuis dix ans. C’est d’abord à ceux-ci que s’attaque l’accord du 11 janvier.
Mme Isabelle Le Callennec. Plusieurs organisations syndicales ont reconnu que les CDD permettent aux entreprises d’embaucher, quand elles doivent faire face à un surcroît de travail, ce qui est fréquent dans l’industrie. C’est pourquoi l’intérim a été exclu de la taxation des CDD. Le vrai problème est celui des CDD d’usage : certaines sociétés, comme les cabinets d’études, ne signent que des contrats courts, sans égard pour le fait que les salariés concernés pourraient signer des contrats plus longs. Le problème est-il traité par l’article 7 ?
M. le rapporteur. Le problème est abordé dans la loi et dans l’accord du 11 janvier, qui prévoit de taxer ces contrats courts à 4,5 % au lieu de 4 %. Pour ma part, je ne les considère pas comme une fatalité. On pourrait imaginer, par exemple, que les sociétés de sondage recourent à des sous-traitants, qui procureraient des emplois stables, à temps plein, aux salariés travaillant pour plusieurs instituts. Nul ne remet en cause les règles d’usage prévues par le code du travail, surtout si un CDD est légitime, mais, si nous ne trouvons pas de meilleure organisation, il ne faut pas s’étonner que les CDD représentent 14 % des contrats, ni qu’ils soient le mode d’entrée systématique dans l’emploi, avec un taux de rotation très fort.
La Commission rejette l’amendement AS 159.
Elle adopte l’amendement rédactionnel AS 320 du rapporteur.
Elle étudie l’amendement AS 62 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. Lorsqu’ils négocient un accord, les organisations nationales oublient les secteurs qu’ils ne représentent pas, tel celui des services à la personne, pourtant très créateur d’emplois. Pour redonner de l’élan à ce secteur, qui vient d’être frappé par la suppression de la déclaration au forfait et la réduction de l’avantage fiscal dont il bénéficiait, je propose de lui conserver un régime particulier. L’exonération des contributions concernerait 4 millions de particuliers employeurs, qui ne sont pas nécessairement fortunés : parfois, ce sont simplement des personnes âgées qui cherchent à rester chez elles ou des parents qui recourent à une assistante maternelle.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Adopter l’amendement reviendrait à créer une exonération nouvelle sans même consulter les partenaires sociaux. Nous avons déjà eu ce débat lors de l’examen de la loi de finances, qui a prévu des mesures spécifiques. Il n’y a pas lieu d’y revenir.
M. Dominique Tian. Le rapporteur nous a assuré qu’il déposerait des amendements avant la réunion qui se tiendra au titre de l’article 88. Nous serons très attentifs à la manière dont il améliorera le texte sur ce point, qui pose un réel problème.
M. Francis Vercamer. Je regrette que le Gouvernement n’ait pas intégré dans le projet de loi le cas des particuliers employeurs, qui figurait dans l’accord du 11 janvier.
La Commission rejette l’amendement AS 62.
Elle en vient à l’amendement AS 63 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. L’amendement propose le même type de mesure pour les associations chargées de missions d’insertion auprès des collectivités territoriales ou des entreprises. Si elles recourent à des CDD, c’est dans un objectif d’insertion. Il n’y a donc pas lieu de renchérir leurs coûts, généralement financés par de l’argent public.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Charger la barque de l’assurance chômage ne fera qu’aggraver le problème dont nous avons longuement débattu à l’article 1er.
M. Gérard Sebaoun. L’idée de l’amendement est bonne, mais je me range à l’argument du rapporteur.
M. Christophe Cavard. Il ne s’agit pas de sanctionner les associations qui jouent le jeu de l’insertion, mais le débat est ouvert en leur sein pour déterminer quelle doit être la durée d’un CDD. En ne privilégiant pas des contrats trop courts, elles iraient dans le sens d’un meilleur accompagnement social et professionnel.
M. Francis Vercamer. Je rappelle les termes de l’amendement : « Ils peuvent prévoir une exonération ». Nous voulons seulement appeler l’attention des partenaires sociaux sur ces métiers.
La Commission rejette l’amendement AS 63.
L’amendement AS 26 de Mme Valérie Boyer n’est pas défendu.
Elle aborde l’amendement AS 40 de Mme Bérengère Poletti.
Mme Bérengère Poletti. Nombre d’établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale veulent engager des professionnels retraités, qui souhaitent reprendre une activité pour s’assurer un complément de ressources. Cette main-d’œuvre expérimentée est nécessaire pour certains métiers en tension : kinésithérapeutes, infirmiers ou aides-soignants. Leur recrutement permettrait en outre de former des jeunes. C’est pourquoi il faut prévoir pour ces salariés une forme de CDD spécifique.
M. le rapporteur. Le cumul emploi-retraite m’inspire une forte réticence. Je comprends que certains retraités veuillent compléter un faible revenu, mais il est aberrant qu’on puisse percevoir en même temps une retraite de 6 000 euros et un salaire de 8 000. Quoi qu’il en soit, dans les cas que vous évoquez, rien n’interdit de recruter des retraités par CDI. Il n’est nul besoin de créer un dispositif spécifique.
M. Arnaud Robinet. Je trouve bon qu’une personne apte à rendre des services puisse s’assurer un complément de rémunération après avoir liquidé sa retraite. N’oublions pas qu’à partir du 1er avril, le pouvoir d’achat des retraités diminuera, puisqu’ils seront soumis à la contribution additionnelle de 0,3 % appliquée aux pensions, et frappés par l’indexation partielle des retraites complémentaires. Souhaitons que le Gouvernement ne s’engage pas sur cette piste lorsqu’il abordera la réforme des retraites du régime général.
La Commission rejette l’amendement AS 40.
Elle adopte l’article 7 modifié.
Après l’article 7
La Commission examine l’amendement AS 158 de Mme Jacqueline Fraysse, portant article additionnel après l’article 7.
Mme Jacqueline Fraysse. L’amendement tend à taxer les contrats courts, dont l’explosion représente un véritable drame.
M. le rapporteur. Avis défavorable, mais je me réjouis que, après avoir voulu supprimer l’article 7, vous tentiez de l’améliorer.
Mme Jacqueline Fraysse. Nous souhaitons être constructifs…
M. le rapporteur. Pour réduire le nombre des contrats courts, il est plus dissuasif de faire évoluer le taux de cotisation acquitté par l’employeur, que de doubler le montant de la prime de précarité.
M. Dominique Tian. Les principaux utilisateurs de ce type de contrat sont l’éducation nationale, la SNCF et les hôpitaux publics. Si, par mégarde, nous adoptions votre amendement, madame Fraysse, les hôpitaux seraient contraints de fermer. Vous avez déjà supprimé le jour de carence, ce qui leur coûtera 80 millions d’euros. Faites attention aux conséquences de ce que vous écrivez !
Mme Jacqueline Fraysse. Dominique Tian défend l’hôpital public : une grande mutation vient de se produire !
La Commission rejette l’amendement AS 158.
Elle examine ensuite l’amendement AS 121 de M. Joël Giraud.
M. Jean-Noël Carpentier. Il s’agit de sécuriser les contrats des saisonniers, en proposant, sauf motif réel et sérieux, une clause de reconduction pour la saison suivante.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Les partenaires sociaux ont négocié sur ce type de contrat. Je proposerai un autre amendement à l’article 18 afin de limiter l’expérimentation aux trois branches d’activités qu’ils ont envisagées.
La Commission rejette l’amendement AS 121.
Article 8
(art. L. 2241-13, L. 3123-8, L. 3123-14, L. 3123-14-1 à L. 3123-14-4 [nouveaux], L. 3123-16, L. 3123-17, L. 3123-19 et art. L. 3123-25 du code du travail)
Encadrement du travail à temps partiel
Le présent article traduit le souhait exprimé par les partenaires sociaux d’encadrer le temps partiel (article 11 de l’accord du 11 janvier). Le principal objectif de cet encadrement est de lutter contre le temps partiel « subi ».
Il s’agit principalement de fixer une durée minimale de travail à temps partiel sur la base d’une référence hebdomadaire de vingt-quatre heures, tout en aménageant des dérogations à cette règle qui doivent permettre au salarié de cumuler plusieurs activités par une répartition régulière de ses horaires de travail.
Une majoration de salaire de 10 % dès la première heure complémentaire est également prévue, un accord de branche pouvant toutefois prévoir une majoration de moins de 25 % pour les heures complémentaires effectuées entre le 1/10ème et le tiers de la durée prévue au contrat. Un dispositif spécifique de « complément d’heures » est également institué : il pourra être prévu par un accord de branche étendu.
Enfin, l’ensemble des branches dont au moins un tiers de l’effectif occupe un emploi à temps partiel devront lancer des négociations dans les trois mois suivant la promulgation de la loi.
A. LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU TRAVAIL À TEMPS PARTIEL EN FRANCE EN 2011
En 2011, 18,7 % des salariés travaillent à temps partiel, soit 4,2 millions de personnes : huit salariés à temps partiel sur dix sont des femmes et 31 % des femmes salariées sont à temps partiel, contre 7 % des hommes. La proportion des femmes à temps partiel est très liée au nombre des enfants à charge et à leur âge : ainsi, 45 % des femmes ayant au moins trois enfants à charge travaillent à temps partiel, cette proportion atteignant même 56 % pour les femmes dont le benjamin a entre 3 et 5 ans.
La durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel est de 23,2 heures par semaine, contre 39,6 heures pour les salariés à temps complet. et près de 40 % d’entre eux ont une quotité de travail inférieure ou égale à un mi-temps. Le temps partiel subi est estimé à un tiers des salariés travaillant à temps partiel.
C’est dans le secteur tertiaire que le travail à temps partiel est le plus largement diffusé : il y représente en effet 22 % des emplois. Ce secteur regroupe 92 % des salariés à temps partiel, qui sont particulièrement nombreux dans l’hébergement et la restauration, l’éducation, la santé et l’action sociale, le commerce, les aides à domicile et les services domestiques. Ces secteurs représentent aussi la plus grande part du travail à temps partiel féminin.
Il existe une grande variabilité des modalités d’organisation hebdomadaire du temps partiel : si, dans les activités financières, prédomine les durées hebdomadaires longues sur moins de cinq jours (correspondant donc souvent à un temps partiel choisi pour assurer la grande des enfants le mercredi), la prédominance de durées hebdomadaires longues sur au moins cinq jours est davantage liée dans la grande distribution à la flexibilité organisationnelle des entreprises. Dans les secteurs des activités immobilières et des activités de nettoyage en entreprise, c’est le modèle de temps partiel court sur au moins cinq jours qui qui prédomine, tandis que dans l’hébergement et la restauration, coexistent des durées hebdomadaires courtes sur peu de jours et des durées hebdomadaires longues sur cinq jours ou plus.
Le tableau suivant récapitule les raisons principales du temps partiel d’après les déclarations des salariés.
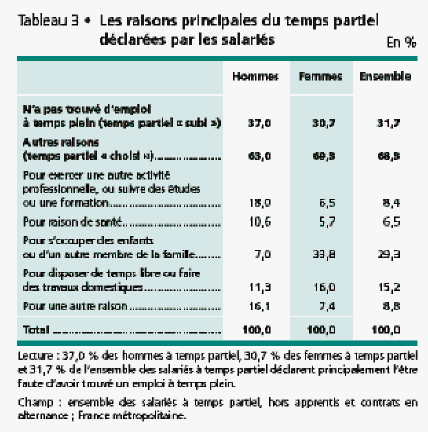
Source : DARES Analyses, n° 005, janvier 2013
La proportion de salariés à temps partiel « subi » est donc de l’ordre de 6 % de l’ensemble des salariés. Ces salariés travaillent plus fréquemment au moins cinq jours par semaine : c’est le cas de 48 % d’entre eux, contre 36 % pour l’ensemble des salariés à temps partiel. 28 % ont des durées hebdomadaires longues et 20 % d’entre eux travaillent peu sur une grande amplitude hebdomadaire. Les salariés à temps partiel ont plus souvent des horaires variables d’une semaine à l’autre que les salariés à temps complet : c’est le cas de 30 % des salariés à temps partiel « subi » et de 25 % des salariés à temps partiel « choisi », contre 22 % des salariés à temps complet. Ces éléments permettent de mettre en évidence la problématique spécifique liée à l’impossibilité en pratique pour un certain nombre de salariés à temps partiel « subi », de trouver une activité complémentaire. Selon la DARES, 31,7 % des temps partiels seraient « subis », 37 % pour les hommes, 30,7 % pour les femmes.
Le temps partiel « subi » se double d’une seconde difficulté, celle des caractéristiques propres à ces salariés. Si le temps partiel concerne souvent des jeunes (27 % d’entre eux) et des seniors (25 % d’entre eux), le temps partiel « subi » est plus répandu chez les jeunes : 48 % des jeunes à temps partiel subissent cette situation, alors qu’elle est choisie pour 76 % des seniors. Le temps partiel concerne aussi davantage des personnes dont le niveau de qualification est faible : ainsi, 25 % des salariés sans diplôme sont à temps partiel, et 64 % des salariés se déclarant en temps partiel « subi » ont un diplôme de niveau inférieur au baccalauréat. Enfin, les chefs de famille monoparentale sont surreprésentés parmi les salariés à temps partiel « subi », et les couples avec des enfants parmi les personnes à temps partiel « choisi ».
Les personnes à temps partiel « subi » occupent plus souvent des emplois moins qualifiés : 63 % sont employés, dont 29 % employés des services directs à la personne, et 11 % sont ouvriers non qualifiés. Si les conditions d’emploi des personnes à temps partiel « choisi » sont assez similaires à celles prévalant pour les salariés à temps plein, les personnes en temps partiel « subi » sont davantage exposées à la précarité : 29 % sont en CDD, 9 % en contrat aidé (contre respectivement 11 % et 2 % pour les personnes en temps partiel « choisi »). Ils sont également davantage exposés au chômage, puisqu’ils sont cinq fois plus nombreux que les salariés en temps partiel « choisi » à avoir connu au moins un épisode de chômage au cours de l’année précédente. Enfin, ils accèdent moins souvent à une formation que les autres salariés.
En 2011, la moitié des salariés à temps partiel déclaraient percevoir un salaire mensuel net inférieur à 850 euros. La rémunération moyenne est encore inférieure pour les personnes à temps partiel « subi », la moitié d’entre elles ayant déclaré percevoir moins de 719 euros. La faiblesse de leur salaire horaire (11,20 euros de l’heure contre 14,80 euros de l’heure pour les salariés à temps complet) est principalement liée au fait qu’ils occupent plus souvent des emplois faiblement qualifiés (professions du nettoyage, aide à domicile, commerce).
Enfin, 16 % des salariés à temps partiel ont plusieurs emplois : près de 11 % exercent le même métier chez plusieurs employeurs, tandis que 6 % exercent des métiers divers. La multi-activité permet aux salariés qui la pratiquent de porter leur revenu mensuel moyen de 791 euros dans leur emploi principal à 1 230 euros en tenant compte de l’ensemble des emplois : ils travaillent au total en moyenne 27 heures par semaine, dont 19,8 heures chez leur employeur principal. La multi-activité est plus répandue chez les employés des services directs aux particuliers (35 %), mais concerne également les agents de nettoyage en entreprise (18 %), ainsi que les salariés des arts, spectacles et activités récréatives (26 %). Les salariés multi-actifs sont plus nombreux à être en temps partiel « subi » (21 % contre seulement 14 % des personnes en temps partiel « choisi ») (36).
B. LE CADRE JURIDIQUE ACTUEL DU TEMPS PARTIEL
Il n’existe pas aujourd’hui d’horaire minimal légal de travail, bien qu’une durée minimale puisse tout à fait être prévue par convention collective. Ainsi, dans le secteur de la grande distribution, un accord de branche a fixé un tel socle minimal de vingt-cinq heures par semaine, tandis que des accords d’entreprise sont allés jusqu’à porter cette durée à trente heures.
Le recours au temps partiel peut se faire dans une entreprise même en l’absence d’accord collectif – qu’il s’agisse d’une convention collective, d’un accord de branche étendu, d’un accord d’entreprise ou encore d’un accord établissement –, sous réserve de la consultation des représentants du personnel ou, en leur absence, d’en avoir informé l’inspecteur du travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient d’un horaire individualisé, leur durée de travail pouvant être répartie sur la semaine, le mois ou encore sur une partie de l’année si l’entreprise est couverte par un accord collectif d’aménagement de la durée du travail sur tout ou partie de l’année (cf. infra).
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est obligatoirement écrit et doit mentionner la qualification, les éléments de la rémunération, mais également préciser, selon le cas, la durée hebdomadaire de travail et la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine ou la durée mensuelle de travail et la répartition des heures entre les semaines du mois, les conditions de la modification de cette répartition, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié, ainsi que les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires (article L. 3123-14).
Toute modification de la répartition hebdomadaire ou mensuelle du temps de travail doit être notifiée au salarié sept jours ouvrés entiers à l’avance ; cette durée peut être ramenée à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement, moyennant des contreparties en faveur du salarié (articles L. 3123-21 et L. 3123-22).
Les horaires de travail à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures. Toutefois, il est possible de déroger à ce régime des coupures par convention, accord collectif de branche étendu ou agréé ou convention ou accord d’entreprise ou d’établissement le prévoyant, soit expressément, soit par la fixation des amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l’activité exercée (article L. 3123-16).
Les salariés à temps partiel peuvent, on l’a dit, être amenés à effectuer des heures complémentaires, sous réserve d’en avoir été informés trois jours au moins à l’avance. Le régime des heures complémentaires est soumis à une double limite :
– d’une part, le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur à 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat, cette limite pouvant toutefois être portée jusqu’au tiers de cette durée par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement. Dans ce dernier cas, le volant d’heures complémentaires effectuées entre le 1/10ème et le tiers de la durée prévue au contrat est majoré de 25 % (articles L. 3123-17 à L. 3123-20) ;
– d’autre part, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée totale de travail du salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement (deuxième alinéa de l’article L. 3123-17).
Aux termes de l’article L. 3123-15, l’utilisation régulière d’heures complémentaires sur une période d’au moins douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d’une période de quinze semaines, entraîne l’obligation pour l’employeur de modifier le contrat de travail pour y inscrire la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué. Une telle modification du contrat suppose que cet horaire moyen réellement effectué soit supérieur d’au moins deux heures par semaine (ou son équivalent mensuel) à l’horaire prévu au contrat, qu’un préavis de sept jours soit respecté et que le salarié ne refuse pas cette modification.
Le régime spécifique de l’aménagement du temps partiel
sur tout ou partie de l’année
● Le régime applicable depuis la loi du 20 août 2008 (article L. 3122-2)
Il s’agit d’une déclinaison du régime unique d’aménagement du temps de travail, créé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, et qui remplace les anciens dispositifs relatifs au temps partiel modulé : ce dispositif est codifié à l’article L. 3122-2 du code du travail.
Ce régime permet de faire varier, dans certaines limites, la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle du salarié fixée dans son contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Ce régime doit avoir été prévu par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ou par accord de branche. Cette convention ou accord doit fixer les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail (à défaut de précision, celui-ci est fixé à sept jours) ; les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail ; ainsi que les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
L’article L. 3122-6 précise que la mise en œuvre du travail à temps partiel annualisé ne constitue pas une modification du contrat de travail, et ne nécessite donc pas l’accord exprès du salarié.
Le salarié doit bénéficier des mêmes règles sur le nombre limité de coupures quotidiennes que le salarié à temps partiel de droit commun. Un lissage de la rémunération sur l’année est possible, les modalités de calcul de la rémunération mensuelle devant être prévue par l’accord collectif (article L. 3122-5)
Le régime applicable aux heures complémentaires est identique à celui qui prévaut pour le temps partiel classique, mais le nombre de ces heures est estimé à la fin de la période de référence.
● Le temps partiel modulé antérieur à la loi de 2008
Les accords de modulation du temps partiel conclus avant le 22 août 2008 restent en vigueur : ce dispositif permettait de faire varier à la hausse comme à la baisse, sur tout ou partie de l’année, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat à condition que sur un an cette durée n’excède pas en moyenne la durée prévue au contrat. Il est soumis à la conclusion d’une convention ou d’un accord collectif de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement.
C. L’ENCADREMENT DU TEMPS PARTIEL PROPOSÉ PAR L’ARTICLE 8
1. La mise en place d’un socle minimal de vingt-quatre heures hebdomadaires, avec des possibilités de dérogation
Les nouvelles dispositions d’encadrement du temps partiel s’insèrent dans la section qui lui est aujourd’hui déjà consacrée (section première du chapitre III du titre II du livre 1er de la troisième partie du code, titre consacré à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires).
Autrement dit, l’encadrement du temps partiel que propose le présent article ne se substitue pas aux dispositions existantes le concernant : les règles aujourd’hui applicables en matière de temps partiel continueront donc a priori d’être applicables, sauf ajustements ou modifications spécifiquement prévus ici.
On notera également que les salariés en contrat de travail intermittent, n’étant pas soumis au régime juridique des salariés à temps partiel, ne sont pas concernés par les nouvelles dispositions.
Le III de l’article insère quatre nouveaux articles L. 3123-14-1 à L. 3123-14-4, qui fixent de nouvelles règles d’encadrement du temps partiel, sans préjudice des règles existantes.
a) Le principe : un socle minimal de vingt-quatre heures
Le nouvel article L. 3123-14-1fixe à vingt-quatre heures la durée minimale hebdomadaire de travail d’un salarié à temps partiel. La durée de référence de travail d’un salarié à temps partiel est en effet soit hebdomadaire, soit mensuelle ; elle peut également, dans le seul cadre d’application d’un accord d’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année (article L. 3122-2) correspondre à à la période prévue par l’accord, soit tout ou partie de l’année. C’est pourquoi le nouvel article précise que le socle minimal de travail à temps partiel est fixé à vingt-quatre heures par semaine ou à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent annuel ou infra-annuel de cette durée en cas d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.
Ce socle minimal n’est toutefois pas applicable aux salariés âgés de moins de 26 ans, dans la mesure où ceux-ci poursuivent leurs études. Il serait en effet regrettable que des jeunes exerçant une activité salariée d’appoint en complément de leurs études et pour les financer, se retrouvent privés de la possibilité d’obtenir de tels petits « jobs ».
Le VIII de l’article prévoit que ce socle minimal s’appliquera à compter du 1er janvier 2014 : à compter de cette date, tous les nouveaux contrats à temps partiel nouvellement conclus devront respecter cette durée minimale de vingt-quatre heures. Son entrée en vigueur est seulement différée pour les contrats en cours à la date du 1er janvier 2014 : en effet, le socle minimal ne s’appliquera à eux qu’à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, la durée minimale est applicable à la demande du salarié – en l’absence d’accord de branche dérogatoire –, sauf en cas de refus de l’employeur pour des raisons liées à l’activité économique de l’entreprise.
b) Des possibilités de dérogations encadrées
● La possibilité de déroger au socle minimal de vingt-quatre heures
Le III introduit les articles L. 3123-14-2 à L. 3123-14-4, qui aménagent les possibilités de déroger au socle minimal de vingt-quatre heures défini à l’article L. 3123-14-1.
Il ne sera en effet possible d’y déroger que dans deux cas de figure :
– à la demande écrite et motivée du salarié (c’est l’objet de l’article L. 3123-14-2), pour deux raisons alternatives : soit pour faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre un temps plein ou au moins une durée de vingt-quatre heures hebdomadaires. Il s’agit là de ménager l’espace suffisant à la pratique du temps partiel « choisi » : en effet, un salarié peut souhaiter travailler moins de vingt-quatre heures par semaine, pour assumer des charges de famille (enfants ou aînés) par exemple. L’encadrement du temps partiel n’a aucunement pour vocation de limiter le travail à temps partiel des personnes pour lesquelles cette configuration d’emploi leur paraît la plus adaptée à leur vie personnelle. Il s’agit toutefois le plus possible de permettre à des salariés à temps partiel de faible durée de ne pas être en quelque sorte l’otage de cette activité limitée et de compléter leur activité, s’ils le souhaitent : c’est pourquoi il est également prévu que le salarié puisse demander à ce que sa durée de travail soit inférieure à vingt-quatre heures si cela lui permet de cumuler plusieurs activités et d’atteindre grâce à ce cumul plus des deux tiers d’un temps plein, voire un temps plein.
En l’occurrence, un salarié qui serait employé à temps partiel pour une durée hebdomadaire de dix-huit heures (en raison de l’existence d’un accord de branche dérogatoire dans le secteur d’activité dans lequel il exerce) peut souhaiter compléter son activité : il doit dans ce cas pouvoir solliciter d’un éventuel nouvel employeur une durée de travail hebdomadaire inférieure à vingt-quatre heures, mais d’au moins six heures, ce qui le porterait à une durée hebdomadaire de vingt-quatre heures et jusqu’à dix-sept heures, ce qui l’amènerait à effectuer au total une durée égale à un temps plein.
A contrario, ce même salarié qui exerce son activité chez son premier employeur pendant dix-huit heures par semaine ne pourrait demander à exercer un second emploi pour une durée de seulement trois heures complémentaires par semaine : ce faisant, il n’atteindrait pas une activité d’au moins vingt-quatre heures par semaine. Il s’agit par là d’éviter au maximum les emplois à temps très partiel, de quelques heures par semaine, qui sont les moins structurants pour les salariés concernés.
– sur le fondement d’une convention ou d’un accord de branche, qui peut fixer une durée hebdomadaire de travail inférieure à vingt-quatre heures, à condition d’apporter des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités lui permettant d’atteindre une durée au moins égale à vingt-quatre heures ou à un temps plein. Il s’agit donc d’un accord de branche « dérogatoire » aux vingt-quatre heures. On notera qu’une durée minimale hebdomadaire doit vraisemblablement et en tout état de cause être fixée par l’accord. La dérogation est encadrée : l’accord doit prévoir les conditions permettant aux salariés à temps partiel d’être soumis à des horaires réguliers ou leur permettant de compléter leur activité à hauteur de vingt-quatre heures et jusqu’à un temps plein.
À ces deux conditions alternatives s’ajoute une condition supplémentaire, prévue à l’article L. 3123-14-4 : dans les deux cas, que la durée inférieure à vingt-quatre heures soit issue de la demande expresse du salarié ou de la conclusion d’un accord de branche fixant une durée inférieure, cette durée inférieure ne peut prévaloir qu’à la condition que les horaires de travail du salarié soient regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Les modalités de regroupement des horaires peuvent être déterminées par accord de branche ou d’entreprise : vraisemblablement, un accord de branche qui fixera une durée minimale inférieure à vingt-quatre heures hebdomadaires précisera également selon quelles modalités doit s’opérer le regroupement des heures effectuées par les salariés à temps partiel. A contrario, lorsque la fixation d’une durée inférieure se fait à la demande du salarié, il est plus vraisemblable qu’un accord d’entreprise soit conclu pour préciser ces modalités.
● Le régime des coupures
Le IV du présent article modifie l’article L. 3123-16 relatif au régime des coupures : cet article pose le principe selon lequel la journée de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être organisée avec plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures. Cette règle peut être écartée par une convention ou un accord de branche étendu (ou par un accord de branche agréé en application de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles), mais également par accord d’entreprise ou d’établissement :
– « soit expressément » ;
– « soit en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l’activité exercée ».
Le IV propose de supprimer l’obligation d’un accord de branche étendu pour déroger au régime de droit commun des coupures : désormais, un accord de branche simple pourra le faire.
2. Le régime des heures complémentaires et des compléments d’heures
a) Le nouveau régime applicable aux heures complémentaires
Le régime actuel des heures complémentaires est prévu aux articles L. 3123-17 à L. 3123-19 : toute heure effectuée au-delà de l’horaire prévu au contrat est une heure complémentaire. Le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours de la même semaine ou du même mois ne peut être supérieur à 1/10ème de la durée prévue au contrat, cette limite pouvant être portée à un tiers par accord collectif de branche étendu, ou encore par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le salarié doit être informé trois jours à l’avance des heures complémentaires qu’il aura à effectuer. Les heures complémentaires sont rémunérées au taux normal : elles ne donnent lieu ni à majoration a priori, ni à repos compensateur. Si la durée fixée est supérieure à 1/10ème de l’horaire prévu au contrat, les heures au-delà sont rémunérées 25 % de plus. On notera que dans ce système, le recours au mécanisme des heures supplémentaires est impossible.
Le V modifie la sous-section relative aux heures complémentaires, en complétant tout d’abord, par son 1°, l’article L. 3123-17 pour prévoir une majoration des heures complémentaires dès la première heure, à hauteur de 10 % du salaire. Son 2° complète pour sa part l’article L. 3123-19 relatif à la majoration de 25 % du salaire des heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10ème de la durée prévue au contrat, en prévoyant la possibilité de déroger à ce taux de majoration par convention ou accord de branche seulement pour prévoir un taux inférieur, mais qui doit obligatoirement excéder un plancher de 10 % de majoration.
Au total, le nouveau régime applicable au temps partiel comportera donc une majoration des heures complémentaires dès la première heure à hauteur de 10 % et jusqu’au 1/10ème de la durée prévue au contrat ; au-delà, la majoration pourra être inférieure à 25 %, ce qu’elle ne peut être aujourd’hui, mais au minimum de 10 % si un accord de branche le prévoit. Le projet de loi prévoit donc une valorisation des premières heures complémentaires, au possible détriment des heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10ème. Dans l’ensemble, ce système apparaît globalement favorable aux salariés à temps partiel qui effectuent des heures complémentaires, dans la mesure ils pourront désormais voir leur salaire majoré à ce titre dès lors qu’ils en effectuent.
Un salarié à temps partiel dont la durée de travail prévue au contrat est de vingt heures par semaine ne bénéficie aujourd’hui d’aucune majoration de salaire pour ses heures complémentaires effectuées dans la limite de deux heures (soit 10 % de la durée prévue à son contrat). S’il effectue quatre heures complémentaires, les deux premières heures lui sont payées à hauteur de son salaire normal, les deux suivantes lui étant rémunérées 25 % de plus. Dans le nouveau régime, ce même salarié bénéficiera d’une majoration de 10 % de son salaire sur ses deux premières heures complémentaires ; les deux heures suivantes seront majorées au minimum de 10 %.
L’articulation des articles L. 3123-18 et L. 3123-19 conduit à la situation suivante : le recours à des heures complémentaires au-delà du 1/10ème de la durée prévue au contrat et jusqu’au tiers de celle-ci peut être autorisé par accord de branche, mais également par accord d’entreprise. En revanche, seul un accord de branche pourra demain prévoir une majoration de ces heures inférieure à 25 % (mais supérieure à 10 %) : autrement dit, une entreprise qui aménage un système de recours aux heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée de travail de ses salariés à temps partiel devra continuer à payer ces heures au-delà du 1/10ème à hauteur de 25 %, seul un accord de branche pouvant prévoir une majoration inférieure.
On notera que le VIII de l’article prévoit que la majoration de 10 % des heures complémentaires effectuées dès la première heure entre en vigueur au 1er janvier 2014, au même titre que le socle minimal de vingt-quatre heures pour les nouveaux contrats qui seront conclus à compter de cette date.
En revanche, aucune entrée en vigueur différée n’est prévue pour la possibilité de déroger par accord de branche à la règle de la majoration de 25 % des heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10ème de la durée prévue au contrat : cette disposition a donc vocation à entrer en vigueur dès la promulgation de la loi. Si elle ne trouvera à s’appliquer que dès lors qu’un accord de branche aura été conclu, il n’en demeure pas moins que théoriquement jusqu’au 1er janvier 2014, il n’y aura pas de majoration de 10 % des heures complémentaires dès la première heure, mais avec toutefois la possibilité que la majoration des heures effectuées au-delà du 1/10ème ne soit que de 10 % et non de 25 % comme c’est le cas aujourd’hui.
b) La création d’un dispositif de compléments d’heures par avenant
Le VI complète la section première consacrée au travail à temps partiel, par une sous-section 8, créant un dispositif de compléments d’heures par avenant au contrat de travail : c’est l’objet du nouvel article L. 3123-25. Cet article dispose qu’une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité d’augmenter temporairement la durée du travail prévue au contrat par avenant.
On notera que ce régime suppose donc que l’accord de branche ait fait l’objet d’une extension par arrêté du ministre chargé du travail, conformément à l’article L. 2261-15 du code du travail.
En conséquence, le VII propose de compléter l’article L. 3123-14 relatif au contrat de travail du salarié à temps partiel pour préciser qu’un avenant au contrat portant complément d’heures mentionne les modalités selon lesquelles ce complément est effectué, autrement dit et a minima la durée pendant laquelle il s’applique et le nombre d’heures concernées. Le cas échéant, cet avenant devra également préciser la nouvelle répartition des heures entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, dans la mesure où il s’agit d’une des clauses obligatoires du contrat de travail à temps partiel.
Le régime du complément d’heures est dérogatoire au régime des heures complémentaires : dans le cadre de ce complément d’heures, les heures effectuées par le salarié ne donnent lieu à aucune majoration, dans la mesure où ce complément se substitue temporairement à la durée prévue au contrat. En revanche, toute heure complémentaire effectuée au-delà du complément d’heures fixé par l’avenant donne lieu au paiement d’une majoration d’au moins 25 %.
S’agissant du régime actuel applicable aux heures complémentaires, la jurisprudence considère que toutes les heures effectuées par le salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat, qu’elles soient imposées par l’employeur ou qu’elles soient prévues par avenant au contrat de travail en application d’un accord collectif, sont des heures complémentaires (Cass. soc., 7 décembre 2010). Autrement dit, rigoureusement, même dans le cas d’un avenant fixant un volant d’heures complémentaires à effectuer par le salarié pendant une période donnée, les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat tombent sous le régime des heures complémentaires.
Dans le cadre du « complément d’heures » par avenant au contrat de travail, ce ne sera plus le cas : en effet, le nouvel article L. 3123-25 dispose que la convention ou l’accord de branche « peut prévoir la majoration des heures effectuées dans le cadre de cet avenant », ces heures n’étant plus considérées comme des heures complémentaires, mais comme la nouvelle durée prévue au contrat pendant une période donnée (c’est l’objet du b) du nouvel article).
L’accord de branche relatif aux compléments d’heures doit également déterminer le nombre maximum d’avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné (c’est l’objet du a) du nouvel article). On remarquera qu’aucune limite temporelle n’est fixée à ces avenants : un avenant au contrat pourra donc augmenter « temporairement » la durée de travail, que ce soit d’une demi-heure ou de quatre heures par semaine ou plus, cette augmentation pouvant s’appliquer pour deux semaines, un mois ou six mois.
On peut concevoir qu’un salarié à qui son employeur propose d’augmenter sa durée de travail pendant plusieurs mois soit, logiquement, favorable à une telle augmentation, malgré une faible ou une absence de majoration heures complémentaires. Mais, si l’employeur peut procéder à des modifications successives de son contrat de travail à huit reprises dans l’année, on peut s’interroger sur les limites de ce dispositif, qui s’inscrit pourtant dans une démarche d’ensemble censée permettre aux salariés à temps partiel de compléter leur activité ou de rechercher un emploi complémentaire. Certes, à partir du moment où c’est une augmentation de sa durée de travail que prévoit l’avenant, on peut plaider que ce régime va dans le sens d’une plus forte activité des salariés à temps partiel : mais votre rapporteur s’interroge sur le fait qu’aucun plancher n’est fixé en matière d’augmentation de la durée du travail pour ces avenants, même s’il est vrai que, du fait que ce régime du complément d’heures nécessite la conclusion d’un accord de branche, on peut penser que ces questions pourraient se régler dans la négociation de branche. À tout le moins, un suivi précis de ces accords devra être mis en place pour surveiller cette question.
Enfin, l’accord de branche détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d’heures, autrement dit, les conditions dans lesquelles est aménagée la priorité d’accès à un emploi à un temps plein dont bénéficient les salariés à temps partiel en vertu de l’article L. 3123-8.
Rien n’interdit que le dispositif des compléments d’heures puisse permettre au salarié d’atteindre temporairement la durée légale du travail, auquel cas son contrat est assimilable à un contrat à temps plein le temps de la durée de l’avenant.
3. La négociation obligatoire d’un accord de branche lorsqu’un tiers de l’effectif est à temps partiel
Le I de l’article insère une nouvelle section 5, intitulée « Temps partiel » dans le chapitre du code du travail consacré à la négociation obligatoire de branche et professionnelle (chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie), pour instaurer une nouvelle obligation de négociation au niveau des branches, consacrée au temps partiel. Cette négociation n’est pas périodique, contrairement aux autres négociations obligatoires aujourd’hui existantes, qui sont soit annuelles (sur les salaires), soit triennales (par exemple, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes), soit quinquennales (comme la négociation sur les classifications). Comme pour l’obligation de négociation prévue à l’article 1er du présent projet, il s’agit donc d’une obligation de négociation ad hoc, qui doit être menée une fois pour toutes.
On remarquera que cette obligation de négociation n’est pas générale : elle ne s’impose pas à l’ensemble des branches, mais seulement à celles dont « au moins un tiers de leur effectif occupe un emploi à temps partiel ». D’après les informations communiquées à votre rapporteur, les données de la DARES permettent d’identifier celles des branches qui sont concernées : les services de la direction générale du travail ont d’ores et déjà pris attache avec ces branches pour les informer de la nouvelle obligation qui va s’imposer à elles.
Au total, 31 branches de plus de 5 000 salariés totalisent un effectif à temps partiel d’au moins un tiers de l’effectif salarié total (37). Toutes ces branches disposent d’ores et déjà d’un accord relatif au temps partiel. Parmi elles, seules quatre branches ont fixé une durée minimale : deux d’entre elles ont fixé une durée minimale inférieure au nouveau socle fixé par le présent article – la restauration rapide (22 heures) et la propreté (43 heures 33 mensuelles), les deux autres ont fixé une durée minimale supérieure – les cafétérias (25 heures) et les commerces de détail à prédominance alimentaire (25 heures). Toutes branches confondues, moins d’une dizaine d’entre elles ont fixé une durée minimale, par exemple, la branche des hôtels-cafés-restaurants avec 24 heures hebdomadaires ou encore la parfumerie (avec 20 heures hebdomadaires).
BRANCHES DE PLUS DE 5 000 SALARIÉS STRUCTURELLEMENT CONCERNÉES PAR LE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL EN 2010
Convention collective (Code IDCC) |
Effectif salarié au 31/12/2010 |
Part de salariés à temps partiel | |
Ensemble des conventions collectives de branche |
15 249 400 |
21,1 | |
02372 |
Entreprises de distribution directe |
25 100 |
79,9 |
02683 |
Portage de presse |
8 600 |
75,3 |
01031 |
Associations Familles rurales |
6 400 |
68,4 |
01501 |
Restauration rapide |
138 800 |
66,4 |
03043 |
Entreprises de propreté et services associés |
360 500 |
60,3 |
02408 |
Ets enseignement privé |
58 700 |
59,1 |
02691 |
Enseignement privé hors contrat |
12 200 |
57,7 |
02060 |
Cafétérias |
19 800 |
57,4 |
02511 |
Sport |
59 900 |
51,2 |
01875 |
Cabinets et cliniques vétérinaires |
13 700 |
50,2 |
01043 |
Gardiens concierges employés d’immeubles |
79 200 |
47,8 |
01147 |
Cabinets médicaux |
82 200 |
47,7 |
00468 |
Succursales du commerce de détail en chaussure |
20 600 |
47,7 |
01619 |
Cabinets dentaires |
36 900 |
45,2 |
01516 |
Organismes de formation |
74 800 |
45,0 |
01307 |
Exploitations cinématographiques |
10 200 |
44,1 |
00675 |
Succursales de vente au détail d’habillement |
95 200 |
42,0 |
01285 |
Entreprises artistiques et culturelles |
24 300 |
41,2 |
01996 |
Pharmacie d’officine |
119 100 |
40,5 |
02642 |
Production audiovisuelle |
5 800 |
38,3 |
01505 |
Commerce de détail fruits légumes épicerie |
63 400 |
35,6 |
01314 |
Succursale d’alimentation gérants |
5 200 |
35,3 |
00897 |
Services interentreprises de médecine du travail |
15 200 |
34,8 |
02216 |
Commerce détail et gros à prédominance alimentaire |
652 200 |
34,7 |
01483 |
Commerce de détail habillement textiles |
78 600 |
33,5 |
02336 |
Foyers et services pour jeunes travailleurs |
5 500 |
32,6 |
01000 |
Cabinets d’avocats |
33 100 |
32,3 |
00959 |
Laboratoires d’analyses médicales |
42 800 |
31,7 |
00733 |
Détaillants en chaussure |
10 100 |
31,6 |
02156 |
Grands Magasins et magasins Populaires |
39 900 |
30,8 |
01801 |
Assistance |
9 100 |
30,4 |
La nouvelle obligation de négociation prévue par le nouvel article L. 2241-13 porte « sur les modalités d’organisation du temps partiel ». L’objet de la négociation est précisé au second alinéa de cet article ; il est en effet prévu qu’elle porte « notamment » sur :
– la durée minimale d’activité hebdomadaire ou mensuelle ;
– le nombre et la durée des périodes d’interruption d’activité ;
– le délai de prévenance préalable à la modification des horaires ;
– et enfin, la rémunération des heures complémentaires.
L’idée portée par cette nouvelle obligation de négocier est de faire en sorte que les branches dans lesquelles le recours au temps partiel est important se saisissent du sujet, pour proposer des règles d’encadrement en amont : il s’agit bien d’une démarche de responsabilisation des principaux secteurs d’activité pourvoyeurs d’activité à temps partiel.
Le IX de l’article prévoit que ces branches doivent ouvrir cette négociation dans les trois mois suivant la promulgation de la loi.
Les branches concernées auront donc pleinement conscience du nouveau régime légal d’encadrement du temps partiel qui a vocation à entrer en vigueur au 1er janvier 2014, et en particulier de la nouvelle règle fixant la durée minimale hebdomadaire à vingt-quatre heures : elles seront donc amenées à négocier une durée inférieure dans les conditions prévues aux articles L. 3123-14-3 (sous réserve donc de mise en place de garanties de régularité des horaires ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités, mais également de regroupement des horaires de travail sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes).
Elles fixeront le nombre et la durée des périodes d’interruption, en dérogeant donc à la règle d’une interruption d’activité ou d’une interruption de deux heures au maximum, sous réserve de respecter les exigences posées par le 2° de l’article L. 3123-16, par la définition des amplitudes horaires s’imposant aux salariés et de leur répartition dans la journée, et sous réserve de contreparties spécifiques et tenant compte des exigences propres à l’activité exercée. Un accord d’entreprise ou d’établissement pourra néanmoins également continuer de déroger au régime des coupures, sous réserve qu’un accord de branche n’ait pas verrouillé cette possibilité pour l’entreprise.
Les accords de branche en question fixeront aussi le délai de prévenance préalable à la modification des horaires : celui-ci est régi par les dispositions de l’article L. 3123-21, qui précise que toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. La fixation d’un délai inférieur, au moins égal à trois jours ouvrés, continuera d’être soumise à l’existence d’un accord de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement (article L. 3123-22).
Enfin, l’accord de branche issu de la négociation obligatoire mise en place par le I fixera également la rémunération des heures complémentaires : autrement dit, il aura pour mission de fixer, à au moins 10 %, le taux de majoration des heures effectuées au-delà du 1/10ème de la durée prévue au contrat et dans la limite du tiers (article L. 3123-19 dans sa nouvelle rédaction), puisque les heures complémentaires effectuées jusqu’au 1/10ème seront désormais majorées de 10 % (article L. 3123-17 dans sa nouvelle rédaction). Enfin, on peut supposer que les accords de branche fixeront également l’éventuelle majoration des heures effectuées dans le cadre de compléments d’heures, qu’ils auront par ailleurs vocation à organiser : ces dernières règles ne pourront toutefois s’appliquer que sous réserve de l’extension de l’accord de branche en question par arrêté ministériel.
4. La question du passage à temps complet
Dans le cadre de l’accord du 11 janvier, les partenaires sociaux ont souhaité que les accords de branche destinés à encadrer le travail à temps partiel puissent mettre en place « une procédure de demande de passage à temps plein d’un salarié à temps partiel » et prévoir « la possibilité pour l’employeur de proposer des emplois à temps complet de nature différente ».
S’agissant du passage à temps complet des salariés à temps partiel, les dispositions actuelles, prévues à l’article L. 3123-8, qui concernent d’ailleurs également les salariés à temps complet qui souhaiteraient passer à temps partiel, donnent la priorité à ces salariés « pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants ».
Le II de l’article prévoit simplement qu’une convention collective ou un accord de branche peuvent prévoir la possibilité pour l’employeur de proposer un emploi à temps complet ne ressortissant pas à la catégorie professionnelle du salarié à temps partiel ou un emploi non équivalent.
Outre que le projet de loi ne transpose pas le dispositif prévu par l’accord national d’une procédure spécifique par laquelle un accord de branche pourrait aménager le passage à temps plein des salariés à temps partiel, la transposition qu’il propose du second volet semble pouvoir remettre en cause le principe actuel de la priorité des salariés à temps partiel souhaitant passer à temps plein sur un emploi équivalent ou un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle. La rédaction proposée laisse en effet suggérer que dans le cadre de cette priorité, l’employeur pourrait, sur le fondement d’une convention collective ou d’un accord de branche, ne proposer aux salariés à temps partiel que des emplois d’une catégorie professionnelle inférieure ou des emplois non équivalents. Il est évident que tel n’est pas l’intention du législateur, aussi, votre rapporteur s’interroge sur la nécessité de préciser ce point.
*
* *
Votre commission a adopté un amendement des commissaires Écolo, prévoyant que le comité d’entreprise serait consulté chaque année au titre des demandes adressées par les salariés pour déroger à la durée minimale hebdomadaire de travail de vingt-quatre heures.
La Commission examine l’amendement AS 136 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Une fois de plus, l’article 8 contient une annonce trompeuse. S’il fixe une durée minimale d’activité à temps partiel, ce qui est positif, il prévoit aussi un grand nombre de dérogations du fait des accords de branche ou à la demande du salarié, dont on sait qu’il n’est pas toujours libre de ses choix, autant d’éléments qui vident l’article de tout intérêt concret. Dès lors, mieux vaut le supprimer, d’autant qu’il instaure des discriminations entre les salariés à temps partiel et les nouveaux embauchés, ainsi qu’une différence de rémunération entre les heures complémentaires et supplémentaires, qui s’effectuera au détriment des salariés.
M. le rapporteur. Vous êtes plus royaliste que le roi. Le texte ramène à la négociation de branche les dérogations possibles à la durée minimale du temps partiel, laquelle est fixée un peu au-dessus d’un mi-temps afin d’ouvrir les droits sociaux. Dans pratiquement tous les cas, lorsque la durée est inférieure à 24 heures, l’employeur doit faire tout son possible pour fixer des horaires réguliers permettant au salarié d’avoir un autre contrat de travail s’il le souhaite.
Le temps partiel s’accompagne d’une grande précarité : selon l’INSEE, 33 % des salariés concernés indiquent que leur temps partiel est « subi » et les femmes comptent pour les cinq-sixièmes de ces temps partiels « subis ».
Les partenaires sociaux ont décidé d’avancer sur ce sujet, mis sur la table par les organisations syndicales, qui considèrent qu’elles ont obtenu des avancées importantes. On peut certes souhaiter aller plus loin, mais votre amendement est surprenant.
M. Denys Robiliard. Ce n’est pas parce qu’on pourrait mieux faire qu’on ne fait pas bien. L’article 8, qui dispose que les contrats à temps partiel ne doivent pas être inférieurs à 24 heures, représente une grande avancée, même s’il existe des possibilités de dérogation.
M. Dominique Dord. Les députés communistes auront sans doute du mal à expliquer pourquoi ils ont voté contre la création de tous les droits nouveaux prévus pour les salariés – généralisation de la couverture santé, création du compte personnel formation, mobilité sécurisée, amélioration des procédures d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, droits rechargeables, modulation des cotisations, taxation des contrats courts et, maintenant, régulation des temps partiels subis. On peut comprendre leur opposition aux articles 11 et 12, consacrés à la compétitivité, mais il faut beaucoup de mauvaise foi de la part de membres du parti communiste pour voter contre des droits qu’ils revendiquent depuis des années au motif que l’accord n’a pas été signé par la CGT ou FO.
M. Francis Vercamer. Si l’on peut comprendre le souci des partenaires sociaux de limiter la précarité au niveau général, il faut prendre garde aux cas particuliers. Comment traiter, par exemple, le cas du personnel de ménage qui travaille une heure ou deux chaque jour pour nettoyer les bureaux d’une petite entreprise ou les locaux d’un commerçant, et qui a donc plusieurs employeurs ? Ces petits travaux vont disparaître au profit de grandes entreprises qui embaucheront ces salariés, au risque de faire peser sur eux plus de pression que ne le font les commerçants. Il faut certes lutter contre la précarisation, notamment dans la grande distribution, mais pourquoi supprimer en France, au nom d’une vision généraliste du travail, ces petits métiers multi-employeurs qui, au Japon ou en Allemagne par exemple, contribuent à limiter le chômage ?
M. André Chassaigne. Je me réjouis que Dominique Dord accepte de discuter nos amendements alors que certains de ses amis voudraient établir autour des députés communistes et du Front de gauche, jugés dangereux, un cordon sanitaire.
J’ai déjà dit hier soir que le dépôt systématique d’amendements de suppression ne signifiait pas de notre part le rejet total du contenu des articles, mais qu’il entendait souligner que leur contenu précis annulait les objectifs affichés. Toutes les atteintes aux droits des salariés sont d’application immédiate, tandis que toutes les mesures susceptibles de contraindre le patronat à mettre la main à la poche ou à faire évoluer le droit du travail sont renvoyées à une négociation ultérieure. Nos amendements de suppression visent à permettre un débat.
La semaine prochaine, lors de l’examen du texte dans l’hémicycle, nous veillerons à ce que ce projet de loi fasse le moins de dégâts possible et nous efforcerons d’arracher des évolutions constructives. J’observe à ce propos que le mandat impératif est déjà en train d’évoluer – mais il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée.
M. le rapporteur. Il n’est pas exact de dire que la mise en œuvre des nouveaux droits est largement différée. Qu’il s’agisse de la taxation des CDD, qui devrait intervenir au 1er juillet 2013, de l’accord de mobilité et de l’accord de maintien dans l’emploi, ou de la généralisation de l’assurance complémentaire santé, à propos de laquelle les branches ont un an pour négocier, les délais sont rapides. Cette dernière mesure est certes renvoyée à la négociation, mais un dépassement du délai fixé se traduirait par une application automatique pour tous les salariés.
Par ailleurs, la question d’un « équilibre » ne se pose pas pour un tel accord. Monsieur Chassaigne, auriez-vous pu imaginer avant l’élection présidentielle le retour de l’État dans le contrôle des plans sociaux ? Vous souhaitez l’interdiction des licenciements boursiers, mais un texte qui les renchérit au point de dissuader d’y recourir n’est-il pas un texte de gauche ? Si j’étais représentant du MEDEF, je n’aurais pas signé un accord qui organise le retour de la puissance publique, sous une forme moderne qui n’est plus celle des autorisations administratives de licenciement de 1975 et avec des pouvoirs importants. Je vous demande de bien mesurer la portée de ces mesures avant de voter contre.
La Commission rejette l’amendement AS 136.
Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels AS 321 à AS 326 du rapporteur.
Puis elle est saisie de l’amendement AS 160 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. La fixation d’une durée minimale du travail à temps partiel correspond à une demande forte des salariés. Elle est cependant assortie de multiples dérogations renvoyées à la négociation, ce qui est d’autant plus aléatoire que le MEDEF défendra ses intérêts et appliquera le plus possible ces dérogations. L’amendement tend donc à mieux protéger les salariés en assurant une durée minimale stable qui leur permette de trouver un autre temps partiel.
M. le rapporteur. Je souhaiterais comme vous que le texte aille encore plus loin dans la protection des salariés, mais l’article 8, consacré au temps partiel, a été discuté dans les moindres détails par les partenaires sociaux et il est difficile de remettre en cause ces discussions.
M. Michel Issindou. La durée minimale de 24 heures est une protection qui mettra fin à bien des abus, notamment dans la grande distribution. L’accord, même imparfait, ouvre véritablement des droits nouveaux. La loi doit être aussi peu bavarde que possible. Faisons confiance aux partenaires sociaux, sans considérer comme inévitable que les uns écraseront les autres. La loi prévoit en effet des garde-fous, comme le retour plus ou moins déguisé de l’autorisation administrative de licenciement. Bien que le MEDEF se soit ouvertement – et sans doute trop – réjoui de l’accord du 11 janvier, celui-ci n’est pas à son seul profit et certains de ses signataires le défendent à juste titre.
Mme Isabelle Le Callennec. La dernière phrase de l’alinéa 9 indique que « cette durée minimale n’est pas applicable aux salariés âgés de moins de vingt-six ans poursuivant leurs études ». Il conviendrait de préciser comment protéger les étudiants, notamment ceux qui travaillent dans les grandes surfaces.
(Présidence de Mme Catherine Lemorton, présidente de la Commission.)
M. le rapporteur. La mention des jeunes de moins de 26 ans serait mieux placée à l’alinéa 10. Cette modification pourrait faire l’objet d’un amendement déposé en séance publique. La mesure ne leur interdit pas de travailler plus de 24 heures, mais leur offre une protection collective de branche, à laquelle ils peuvent renoncer de leur plein gré. Je consulterai les signataires pour m’assurer de leur accord sur cette modification.
M. Christophe Cavard. Les dispositions de l’article 8 représentent une avancée très importante. Il convient cependant, afin d’éviter les dérapages, d’encadrer l’annualisation du temps de travail partiel. C’est ce que nous proposerons de faire au moyen d’un amendement qui sera déposé en séance publique.
Mme Jacqueline Fraysse. Après avoir énoncé un principe qui répond à une forte revendication, l’alinéa 9 prévoit de nombreuses dérogations à ce principe. Les organisations syndicales, habituées à la négociation syndicale, nous ont signalé ce risque de voir contourner l’application de la durée minimale de 24 heures. Il faudrait supprimer cette possibilité.
M. le rapporteur. Vous êtes, plus généralement, opposée à l’annualisation du temps de travail et souhaitez que ce temps soit organisé sur la semaine. C’est cependant déjà une avancée que de fixer un plancher de 24 heures, même sur une base annuelle. Les salariés sont du reste parfois demandeurs, en particulier lorsqu’ils cumulent deux emplois saisonniers.
Le point essentiel est la régularité des horaires, qui permet de trouver un autre travail. Il est en effet insupportable de ne connaître que le vendredi son planning de la semaine suivante.
Le texte prévoit qu’un accord de branche est nécessaire pour déroger à la durée minimale de 24 heures. Or de tels accords sont difficiles à conclure, car les organisations syndicales les négocient âprement au niveau des branches. Les organisations patronales, en revanche, nous ont fait part de leur crainte de ne pas pouvoir s’organiser. Certaines entreprises parviennent cependant à le faire, comme dans la grande distribution, qui prétend pourtant que le travail partiel s’effectue uniquement entre six et huit heures du matin, mais dont 40 % des salariés travaillent plus de 24 heures. C’est aussi le cas de la presse quotidienne régionale. Nous devons donc pousser vers ces solutions nécessaires pour les salariés.
La Commission rejette l’amendement AS 160.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS 327 du rapporteur.
Les amendements AS 12 de M. Jean-Charles Taugourdeau et AS 29 de M. Guillaume Larivé ne sont pas défendus
Elle est ensuite saisie des amendements AS 45, AS 30, AS 31 et AS 46 de Mme Bérengère Poletti, AS 64 à AS 69 de M. Francis Vercamer, AS 44 et AS 48 de Mme Bérengère Poletti, AS 104 à AS 106 de M. Gérard Cherpion, pouvant faire l’objet d’une présentation commune.
Mme Bérengère Poletti. L’amendement AS 45 est un amendement général, qui vise à soustraire à l’obligation d’une durée minimale de travail de 24 heures les secteurs d’activité où la mise en œuvre de cette règle s’avérerait excessivement complexe, et risquerait d’aboutir à la disparition d’entreprise et à l’augmentation du chômage. Les amendements suivants déclinent cette disposition suivant les secteurs d’activité : l’amendement AS 30 pour le portage de presse, l’amendement AS 31 pour les entreprises et les associations d’aide à domicile, l’amendement AS 46 pour les particuliers employeurs.
M. Francis Vercamer. L’amendement AS 64 tire les conséquences du caractère aberrant de cette règle dans le secteur des services d’aide à la personne. Il en va de même pour les très petites entreprises, visées par l’amendement AS 65. Imposée aux particuliers employeurs auxquels l’amendement AS 66 est consacré, cette règle se révèle particulièrement absurde : ainsi le particulier qui cherche une personne pour aider ses enfants à faire leurs devoirs se verrait contraint de lui assurer un véritable service d’enseignant !
L’amendement AS 67 est consacré aux associations d’insertion. L’amendement AS 68 permet aux secteurs dont les modalités d’activité sont spécifiques d’échapper à la règle. Enfin l’amendement AS 69 prévoit une telle dérogation pour le secteur sanitaire, social et médico-social.
Mme Bérengère Poletti. L’amendement AS 44 dispense de cette obligation de durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires les collectivités territoriales, les groupements d’employeurs et les structures d’insertion par l’activité économique, en raison de la spécificité de leur mission. L’amendement AS 48 fait de même pour le secteur des services à la personne.
M. Bernard Perrut. Dans l’exposé des motifs du présent projet de loi, le Gouvernement exclut les salariés des particuliers employeurs de l’obligation d’une durée minimale d’activité de 24 heures hebdomadaire pour les contrats à temps partiel : cette disposition n’a pas de transcription législative. L’amendement AS 104 vise à rétablir le texte issu de l’accord du 11 janvier, qui exclut de cette limitation les salariés âgés de moins de 26 ans et poursuivant leurs études, ainsi que les salariés des particuliers employeurs. Dans un souci d’égalité et de parallélisme des formes, il prévoit également une disposition identique pour les salariés des associations et des entreprises de services à la personne puisqu’un particulier peut également faire le choix de passer par un mandataire.
M. Gérard Cherpion. L’amendement AS 105 est un amendement de repli.
Mme Véronique Louwagie. L’amendement AS 106 vise à exclure le portage de presse du champ d’application de cette règle de durée minimale de 24 heures, susceptible de mettre en péril l’emploi des 12 000 salariés de ce secteur d’activité.
M. le rapporteur. Je me réjouis de cette soudaine frénésie d’amendement qui s’est emparée des députés de l’UMP, conformément à mon souhait que nous jouions pleinement notre rôle de parlementaires. En outre, elle prouve que le dispositif est réellement contraignant pour les employeurs. J’ai reçu les représentants de la quasi-totalité des secteurs concernés par vos amendements et aucun ne m’a convaincu que les difficultés que vous évoquez ne pourraient pas être résolues dans le cadre d’accords de branche.
Quant aux particuliers employeurs, leur cas ne relève pas de cette partie du code du travail.
Pour ces raisons, je suis défavorable à vos amendements.
M. Gérard Cherpion. Si l’exposé des motifs exclut en effet les particuliers employeurs du champ d’application du dispositif, ce n’est pas le cas du projet de loi.
M. le rapporteur. Les particuliers employeurs relèvent de l’article L. 7221-2 du code du travail.
M. Jean-Patrick Gille. On ne peut à la fois subventionner le secteur de la presse écrite et nier que cette disposition constitue pour lui une vraie difficulté. Il faut qu’on trouve une solution.
La Commission rejette successivement l’ensemble des amendements.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS 328 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 71 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. Cet amendement vise à préciser qu’un salarié souhaitant revenir à une durée minimale de travail de 24 heures doit formuler sa demande par écrit.
M. le rapporteur. Rien ne s’y oppose dans l’état actuel du droit. Par ailleurs, une telle précision créerait un « a contrario » dans tous les autres cas de temps partiel.
La Commission rejette l’amendement AS 71.
Elle examine ensuite l’amendement AS 218 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Cet amendement vise à doter le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du pouvoir de vérifier la réalité des demandes de dérogations individuelles à la durée minimale de travail à temps partiel afin de parer aux risques de pressions sur les salariés.
M. le rapporteur. Je comprends votre souci, bien qu’il me semble que ce serait plutôt le rôle du comité d’entreprise. C’est pourquoi je vous propose de modifier votre amendement pour que ce soit le comité d’entreprise qui soit informé par l’employeur du nombre de demandes.
M. Christophe Cavard. Je suis très favorable à votre proposition, qui est conforme à l’objectif de l’amendement d’introduire dans le texte la faculté de saisir les instances représentatives du personnel.
La Commission adopte l’amendement AS 218 ainsi modifié.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AS 161 de Mme Jacqueline Fraysse.
Elle examine ensuite l’amendement AS 43 de M. Jean-Pierre Door.
M. Jean-Pierre Door. Cet amendement vise à introduire plus de souplesse et de flexibilité dans l’application du dispositif au secteur du service à domicile, où il n’est pas toujours loisible de regrouper les heures de travail sur des journées ou des demi-journées.
M. le rapporteur. Je ne suis pas favorable à cet amendement, contraire au principe même d’une durée minimale de 24 heures, qui vise précisément à encadrer le temps partiel. En tout état de cause, l’aménagement du principe relève d’un accord de branche.
La Commission rejette l’amendement AS 43.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 115 de M. Jean-Noël Carpentier.
M. Jean-Noël Carpentier. Cet amendement vise à limiter la possibilité de déroger à l’interdiction d’interruption de travail supérieure à deux heures. En effet, l’article L. 3123-16 du code du travail stipule que « l’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures ». Toutefois, des dérogations sont permises, soit par une convention ou un accord collectif de branche, soit par une convention ou un accord d’entreprise. Il s’agit d’éviter ces temps de pause interminables que subissent les caissières de la grande distribution, par exemple.
M. le rapporteur. Il s’agit là d’une question importante, même si elle n’a pas été évoquée en tant que telle dans le cadre de la négociation de l’accord du 11 janvier. De ce fait, le dispositif institué par l’accord se surajoute à la possibilité actuelle de déroger à la règle par un accord d’entreprise, créant ainsi un problème de cohérence interne. Je propose que vous retiriez votre amendement : nous allons soumettre ce point aux partenaires sociaux, afin de pouvoir statuer définitivement en séance publique.
M. Jean-Noël Carpentier. Je préfère le maintenir : cela ne vous empêchera pas d’en débattre avec les partenaires sociaux. Je suis persuadé que vous nous apporterez de bonnes nouvelles au moment de l’examen du texte en séance publique.
La Commission rejette l’amendement AS 115.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 239 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Sans entamer ici un débat de fond sur l’annualisation du temps de travail, nous souhaiterions que la loi prévoie que la durée minimale de travail se calcule de manière hebdomadaire ou mensuelle.
M. le rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat, et la conclusion reste la même : avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement AS 239.
Elle examine ensuite l’amendement AS 240 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. La majoration de 10 % de la rémunération dès la première heure complémentaire est une avancée incontestable, mais nous nous inquiétons de la possibilité que l’accord du 11 janvier offre à l’employeur de déroger aux règles actuelles de rémunération des heures supplémentaires, notamment à la règle de majoration de 25 % si le salarié effectue plus d’un dixième de son temps de travail en heures complémentaires. Un tel recul serait contraire à l’esprit de l’accord.
M. le rapporteur. Je ne suis pas persuadé que votre amendement constitue un progrès par rapport à l’accord du 11 janvier. Selon l’accord, en effet, jusqu’à un dixième du temps de travail, la rémunération des heures complémentaires est majorée de 10 %, alors que, dans l’état actuel du droit, seules les heures complémentaires représentant 10 à 33 % du temps de travail donnent lieu à une majoration de 25 %. Au-delà de 10 % du temps de travail, le projet de loi laisse à la négociation le soin de décider. À défaut d’accord des partenaires sociaux, ce sera 10 plus 25.
M. Christophe Cavard. L’amendement n’a rien d’impératif : il ouvre simplement la possibilité de renvoyer ce point à la négociation collective.
M. le rapporteur. Faux : il impose bien une majoration minimale de 25 %, outre que sa portée dépasse le champ de l’accord du 11 janvier.
M. Dominique Dord. Je partage l’avis du rapporteur : la disposition que vous proposez pourrait même s’avérer moins favorable aux salariés.
La Commission rejette l’amendement AS 240.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS 329 du rapporteur.
Elle est saisie de l’amendement AS 162 de Mme Jacqueline Fraysse.
M. André Chassaigne. Avec ce projet de sous-section 8 du code du travail, nous entrons dans le « dur » du dispositif. À lui seul, il justifierait la suppression de l’ensemble de l’article. On retrouve ici un dispositif que, lors de la législature précédente, toute la gauche, tous les députés socialistes, avaient rejeté. Je me souviens des envolées d’Alain Vidalies dénonçant le risque d’autoriser la flexibilisation du temps de travail par le biais de conventions ou d’accords de branche, à la suite desquels les employeurs pourraient faire varier à leur guise la durée de travail des salariés. Cela aurait, sur leur vie quotidienne, des conséquences encore plus importantes pour ceux qui sont à temps partiel ou pour les mères qui élèvent seules leurs enfants.
Avec cette sous-section 8, la modification sera continuelle, puisqu’il pourra y avoir jusqu’à huit avenants par an et par salarié. De plus, le texte remet en cause le taux de majoration des heures décomptées à partir du contrat initial.
Cette sous-section est une illustration de ce qu’il ne faut jamais faire en politique : erreur en deçà des élections, vérité au-delà ! Vous défendez aujourd’hui ce contre quoi nous avons lutté ensemble avant les élections : cela porte un coup terrible à la morale politique !
M. le rapporteur. Monsieur Chassaigne, j’ai un profond respect pour ce que vous défendez.
M. André Chassaigne. J’en prends acte.
M. le rapporteur. Cependant, je ne peux vous laisser dire que nous ne sommes pas fidèles à ce que nous avons toujours défendu. Malgré toute ma loyauté envers la majorité, je ne voterais pas ce texte si je le croyais contraire aux intérêts des salariés. Certes, comme vous, il est des points sur lesquels je souhaiterais aller plus loin ; mais la signature de l’accord par les organisations patronales renforcera sans doute, en réalité, l’application du texte.
La question des compléments d’heures est délicate. Ils existent : ce sont les salariés les plus complaisants qui obtiennent des heures en plus ; les autres n’en ont pas. Ce sont des heures de travail sans contrat : pour le patron, c’est la souplesse idéale ! C’est d’ailleurs pour cela que j’avais combattu la « loi Sarkozy » sur la défiscalisation des heures complémentaires. Les partenaires sociaux ont voulu encadrer cette pratique : en échange de la garantie d’un certain volume d’heures complémentaires, on renonce à la majoration. Aujourd’hui, en effet, dans le cadre d’une action aux prud’hommes, le juge requalifie les compléments d’heures en heures complémentaires et impose la majoration prévue par la loi.
Demandez à des salariés s’ils préfèrent des heures complémentaires ou des compléments d’heures : ils choisiront tous la seconde possibilité, car ils ont alors pendant un mois un quota d’heures assuré ; et le volume d’heures compense la majoration financière des heures complémentaires. Il y a un effet pervers : on finit par transformer des temps plus longs, voire des temps complets, en temps partiels avec compléments d’heures. C’est ce qu’il faut éviter. Pour cela, un accord de branche paraît plus protecteur, pour les salariés, qu’un accord d’entreprise, car les organisations syndicales peuvent véritablement négocier à ce niveau.
La Commission rejette l’amendement AS 162.
Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels AS 330 à AS 334 du rapporteur.
L’amendement AS 27 de Mme Valérie Boyer n’est pas défendu.
Elle examine ensuite l’amendement AS 42 de Mme Bérengère Poletti.
Mme Bérengère Poletti. Il est défendu.
M. le rapporteur. Je suis défavorable à l’amendement : le projet de loi fixe le délai minimal pour éviter les problèmes de constitutionnalité ; nous nous en tiendrons à cette date.
La Commission rejette l’amendement AS 42.
Puis elle adopte les amendements rédactionnels AS 335 et AS 336 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 70 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. Cet amendement vise à supprimer, au vingt-neuvième alinéa, le mot « économique » après le mot « activité » : l’activité économique est conjoncturelle ; la notion d’activité de l’entreprise, c’est autre chose.
M. le rapporteur. La subtilité de ce raisonnement m’échappe : je préfère donc conserver la rédaction actuelle.
La Commission rejette l’amendement AS 70.
Puis elle examine l’amendement AS 41 de Mme Bérengère Poletti.
M. Jean-Pierre Door. Certaines branches professionnelles regroupent des métiers présentant des contraintes d’activité incompatibles avec la durée minimale mentionnée à l’article L. 3121-14-1. Nous proposons que les conventions collectives ou accords de branche étendus contenant déjà des dispositions sur la durée minimale au 1er janvier 2014 ne soient pas visés par les dispositions de ce texte. Encore de la souplesse, monsieur le rapporteur !
M. le rapporteur. Pour ma part, je défends la protection des salariés plutôt que la souplesse : avis défavorable. Les avancées que permet ce texte doivent s’appliquer à toutes les branches.
La Commission rejette l’amendement AS 41.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS 337 à AS 340 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AS 219 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Il faut éviter les effets d’aubaine qui rendraient les stages particulièrement attractifs : nous proposons donc de revoir la question des charges dues pour les stagiaires.
M. le rapporteur. Je partage votre souci, mais un stage qui donnerait lieu à cotisation sociale, c’est un contrat d’apprentissage !
Il faut reconstruire complètement notre dispositif en la matière : les stages doivent être réservés aux cursus de formation courts et être effectués avant l’obtention des premiers diplômes ; il faut parallèlement développer l’apprentissage, qui donne lieu à cotisations et droits sociaux. Enfin, il faut interdire les faux stages.
La Commission rejette l’amendement AS 219.
Puis elle examine l’amendement AS 107 de M. Cherpion.
M. Gérard Cherpion. En raison du caractère spécifique de leur activité, certaines branches ou entreprises peuvent avoir conclu des accords prévoyant des durées de travail inférieures à 24 heures par semaine. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est constante : il se montre toujours attentif au respect de la liberté contractuelle et n’accepte pas, sauf dans des conditions précises, la remise en cause de dispositions conventionnelles. Nous proposons donc que les accords conclus avant la publication de cette loi et contenant une clause fixant une durée minimale de travail inférieure à 24 heures demeurent en vigueur.
Par ailleurs, monsieur le rapporteur, vous m’avez tout à l’heure, à propos des particuliers employeurs, opposé l’article L. 7221-2. Je ne crois pas que cette référence soit exacte.
M. le rapporteur. Il me semble que c’est bien cela : cet article énumère de façon exhaustive les dispositions applicables aux salariés des particuliers employeurs. C’est un statut dérogatoire. Mais je vous promets de vérifier à nouveau.
Quant à l’amendement, encore une fois, nous souhaitons vraiment de nouvelles négociations : les avancées prévues par ce texte doivent s’appliquer. Si l’accord est déjà conforme au nouveau cadre législatif, de nouvelles négociations ne sont bien sûr pas nécessaires.
La Commission rejette l’amendement AS 107.
Puis elle adopte l’article 8 modifié.
Article additionnel après l’article 8 : Rapport du Gouvernement sur les conséquences des dispositions sur le temps partiel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La Commission est saisie de l’amendement AS 291, portant article additionnel après l’article 8.
Mme Fanélie Carrey-Conte. Cet amendement vise à prévoir la remise par le Gouvernement au Parlement, avant le 1er janvier 2015, d’un rapport d’évaluation des dispositifs relatifs au temps partiel, pour en mesurer l’impact réel, notamment en termes d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 291.
Article 9
(art. L. 2242-15, L. 2242-16, L. 2323-33 et L. 2323-35 du code du travail)
Extension du périmètre de la négociation triennale obligatoire
sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Le présent article vise à étendre le périmètre de la négociation triennale obligatoire sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). Il constitue la déclinaison législative de l’article 14 de l’accord du 11 janvier.
I.- LA NÉGOCIATION ACTUELLE SUR LA GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES
Depuis 2005 (38), le code du travail impose à certaines grandes entreprises et groupes, une obligation triennale de négocier sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). Le contenu de cette négociation apparaît très varié, ce que reflètent les accords signés, bien que leur bilan qualitatif demeure mitigé.
A. UN CONTENU VARIÉ
Aux termes de l’article L. 2242-15, les entreprises et les groupes d’au moins 300 salariés ainsi que les entreprises et les groupes de dimension communautaire (39) ayant au moins un établissement de 150 salariés en France, sont tenus d’engager, tous les trois ans, une négociation portant sur :
– les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise sur la stratégie de l’entreprise, ainsi que ses effets prévisibles sur l’emploi et sur les salaires ;
– la mise en place d’un dispositif de GPEC, sur laquelle le comité d’entreprise est informé, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés.
Au-delà de ce socle obligatoire, en vertu de l’article L. 2242-16, cette négociation peut également aborder les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise en cas de licenciement économique collectif, ainsi que la qualification des catégories d’emploi menacées par les évolutions technologiques.
Enfin, au titre des articles L. 2242-19 et L. 2242-20, dans les entreprises ou groupes employant au moins 300 salariés en France, cette négociation peut aussi porter sur le contrat de génération, et doit traiter du déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.
B. UN BILAN QUANTITATIF ENCOURAGEANT
Entre 2005 et 2011, quelque 5 000 entreprises ont engagé une négociation sur la GPEC, dont 3 000 ont signé un accord, ce qui constitue un premier bilan quantitatif encourageant. On observe, d’ailleurs, un intérêt réel des entreprises pour cette négociation, puisque, entre 2008 et 2010, l’ont menée 19 % des entreprises de moins de 50 salariés et 35 % des entreprises de 50 à 299 salariés, alors que ces entreprises ne sont pas tenues de négocier.
C. UN BILAN QUALITATIF MITIGÉ
Sur le plan qualitatif, néanmoins, le bilan des accords de GPEC semble plus mitigé. En effet, selon les informations transmises par le ministère du travail, nombre d’accords n’apportent parfois qu’une réponse formelle à l’obligation de négocier, fondée sur des dispositifs auxquels le salarié a légalement droit.
De plus, si la mise en œuvre des accords se traduit par une implication croissante des salariés dans l’anticipation de l’évolution des besoins en compétences, les plans de GPEC s’inscrivent moins dans la gestion de parcours. Ainsi, au-delà du ciblage des emplois en tension ou appelés à disparaître, ceux-ci ne comportent pas de prévisions chiffrées et offrent surtout aux salariés des outils de mobilité pour des parcours qu’il leur appartient de définir.
Par ailleurs, l’articulation des actions de GPEC avec les outils de gestion des ressources humaines, comme la formation professionnelle, demeure insuffisante. En pratique, les salariés connaissent, en général, assez peu les dispositifs de GPEC de l’entreprise, notamment lorsque celle-ci a été élaborée autour de mesures techniques telles que la construction d’un référentiel des métiers.
Enfin, la mise en œuvre de la démarche de GPEC demeure souvent limitée au cadre de l’entreprise, alors que l’ensemble des sociétés appartenant à une même filière d’activité se trouvent soumises à des évolutions parallèles ou, dans le cas des entreprises sous-traitantes, liées aux décisions stratégiques de l’entreprise donneuse d’ordre.
II.- L’EXTENSION DU PÉRIMÈTRE DE NÉGOCIATION PROPOSÉE
Le présent article vise donc à remédier à ces différentes insuffisances, en se fondant sur les principes arrêtés par les partenaires sociaux à l’article 14 de l’accord du 11 janvier. Il étend, tout d’abord, le périmètre de la négociation sur la GPEC, puis opère l’articulation de ce dispositif avec la nouvelle consultation sur les orientations stratégiques créée par l’article 4 du projet de loi.
A. UN CONTENU DE NÉGOCIATION RENFORCÉ
Le présent article renforce le contenu de la négociation sur la GPEC, en imposant des thèmes obligatoires plus nombreux, en conférant un poids accru aux dispositions de l’accord, en ouvrant la possibilité de mettre en place des dispositifs de filière, et en créant une obligation de dresser un bilan à l’échéance de l’accord.
● Des thèmes obligatoires plus nombreux
Complétant la liste des thèmes énumérés à l’article L. 2242-15, le 4° du I prévoit que, désormais, la négociation sur la GPEC doit également porter sur :
– les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise prévue à l’article L. 2242-21, qui doivent, en cas d’accord, faire l’objet d’un chapitre spécifique (40) ;
– les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise ;
– les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, notamment aux contrats à durée indéterminée, aux contrats à durée déterminée et aux contrats d’intérim.
Du fait de l’introduction, parmi les thèmes de négociation obligatoires, des conditions de la mobilité interne définie aux nouveaux articles L. 2242-21 et L. 2242-22, le 3° du I restreint le champ des mesures d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés, sur lesquelles porte aujourd’hui la négociation, en précisant qu’il s’agit des mesures « autres que celles prévues dans le cadre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 ». Cette modification vise à assurer la bonne articulation des deux thèmes de négociation et préserver la spécificité du nouveau dispositif de mobilité interne.
Le périmètre élargi de la GPEC apparaît donc plus ambitieux. En particulier, il doit permettre la fixation par la négociation collective des grandes orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise, alors que la détermination de celles-ci relève aujourd’hui du pouvoir de direction de l’employeur, après avis du comité d’entreprise. Les délégués syndicaux seront donc appelés à se prononcer sur l’ensemble des dispositifs déployés dans l’entreprise en matière de formation professionnelle, y compris le plan de formation.
Ce périmètre élargi doit également permettre de transformer la GPEC en un véritable outil de lutte contre la précarité dans l’entreprise, puisque, au cours des discussions, doivent être présentées et débattues les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, et notamment aux contrats temporaires.
Enfin, il correspond au dispositif envisagé par les partenaires sociaux à l’article 14 de l’accord du 11 janvier, dont le 1/ stipule que la négociation sur la GPEC devait notamment inclure les grandes orientations du plan de formation, l’utilisation des différentes formes de contrat de travail et la mobilité interne.
● Le poids accru de l’accord de GPEC
Concernant plus précisément la formation professionnelle, le III du présent article confère un poids accru aux grandes orientations arrêtées par l’accord de GPEC, en complétant le premier alinéa de l’article L. 2323-33, qui impose la consultation annuelle du comité d’entreprise sur les orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise. Désormais, ces dernières devront être « établies en cohérence avec le contenu de l’accord » de GPEC.
Dans le même esprit, le IV modifie l’article L. 2323-35, pour qu’il prévoie que le projet de plan de formation de l’employeur soumis à l’avis du comité d’entreprise tienne compte « des grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise arrêtées, le cas échéant, par l’accord » de GPEC.
Ces dispositions constituent une reprise du 2/ de l’article 14 de l’accord du 11 janvier, qui énonce que la consultation annuelle du comité d’entreprise sur les orientations du plan de formation doit être l’occasion de s’assurer que celles-ci sont fixées en cohérence avec le dispositif de GPEC.
● Vers une GPEC de filière
En sus d’enrichir le socle obligatoire de la négociation sur la GPEC, le II introduit un nouveau thème facultatif de discussion, en complétant l’article L. 2242-16, pour qu’il prévoie que la négociation puisse désormais aussi porter « sur les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes peuvent être informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences, ainsi que sur les modalités de leur association au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ».
Il s’agit de permettre la mise en place, par la voie négociée, d’une GPEC de filière, reposant sur des dispositifs de partage d’informations et d’association des salariés des entreprises sous-traitantes aux mesures de GPEC mises en œuvre dans l’entreprise donneuse d’ordre.
Ces nouvelles dispositions constituent la déclinaison du 3/ de l’article 14 de l’accord du 11 janvier, qui stipule que les entreprises doivent mettre en place des dispositifs permettant aux sous-traitants, dont l’activité dépend principalement d’un donneur d’ordre, d’anticiper les évolutions résultant des options prises par ce dernier, et, à cet effet, s’attacher à une meilleure information entre ces catégories de sociétés par des mécanismes communs de GPEC.
Elles devraient contribuer au développement des bonnes pratiques en cours aujourd’hui en matière de GPEC territoriale. Il existe, par exemple, des pôles de mobilité régionale, financés par les entreprises adhérentes, qui proposent l’accompagnement de salariés désireux de changer de trajectoire professionnelle sur un même territoire. Ces pôles intègrent dans la GPEC d’entreprise une dimension d’employabilité à l’échelle des bassins d’emploi, au moyen de transferts et de mises à disposition de compétences entre entreprises, les conditions d’utilisation des pôles devant être définies par l’accord de GPEC de chaque entreprise.
● L’obligation de dresser un bilan de l’accord
Enfin, le dernier alinéa du 4° du I impose l’obligation de réaliser un bilan à l’échéance de l’accord de GPEC, en complétant l’article L. 2242-15 par un alinéa en ce sens. Il s’agit d’une nouveauté en matière de GPEC, qui permettra aux délégués syndicaux de bénéficier d’un suivi de la mise en œuvre des dispositions de l’accord avant d’en commencer la renégociation.
Cette obligation s’appliquera aux accords en vigueur, qui, à leur terme, devront faire l’objet d’un bilan. Ils devront, ensuite, être renégociés conformément aux nouvelles dispositions du code du travail.
B. L’ARTICULATION AVEC LA NOUVELLE CONSULTATION SUR LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Le présent article procède, enfin, à l’articulation du dispositif rénové de GPEC avec la nouvelle consultation du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques, créée par l’article 4 du projet de loi.
À cette fin, le 2° du I supprime l’actuel deuxième alinéa de l’article L. 2242-15, qui prévoit que la négociation sur la GPEC doit porter sur les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise sur la stratégie de l’entreprise, ainsi que ses effets prévisibles sur l’emploi et sur les salaires. La mise en place d’une consultation annuelle obligatoire en la matière minore, en effet, l’utilité de ces dispositions, moins protectrices car issues d’un accord triennal.
Le 1° du I lie, néanmoins, cette nouvelle consultation à la négociation sur la GPEC, en modifiant le premier alinéa de l’article L. 2242-15 pour qu’il prévoie que cette dernière s’engage « sur le fondement des orientations stratégiques de l’entreprise et de leurs conséquences », soumises à l’avis du comité d’entreprise.
*
* *
Lors de son examen du projet de loi, votre commission a adopté plusieurs modifications au texte de l’article 9.
À l’initiative des commissaires du groupe socialiste et du rapporteur, votre commission a rendu facultative la prise en compte :
– de la mobilité interne, sous sa forme nouvelle créée par l’article 10 du présent projet de loi, dans la négociation sur la GPEC, qui pourra « le cas échéant » être abordée par les négociateurs, s’ils estiment que ce dispositif présente un intérêt pour l’entreprise ;
– des résultats de la consultation du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise, en précisant que la négociation sur la GPEC pouvait s’engager « notamment » sur le fondement de celles-ci, mais que cette articulation n’est pas obligatoire.
À l’initiative des commissaires du groupe Écolo et du rapporteur, votre commission a renforcé le volet territorial et de filière de la négociation sur la GPEC, en prévoyant que celle-ci pourra porter :
– sur les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes « sont » informées de la stratégie de l’entreprise donneuse d’ordre ;
– sur les conditions dans lesquelles l’entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l’échelle du site ou du bassin d’emploi.
*
La Commission examine l’amendement AS 137 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Défendu.
M. le rapporteur. L’un des engagements du Président de la République était de donner plus de pouvoir aux salariés dans l’entreprise. Nous avons déjà, à cette fin, adopté les articles 4 et 5. L’article 9 leur offre un pouvoir encore plus grand, en faisant de la négociation sur la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) une négociation éminemment stratégique. Cela permettra bien sûr de réfléchir à l’avenir de l’entreprise dans son secteur d’activité ; mais, pour la première fois, nous donnons aux salariés un nouveau pouvoir très important : les plans de formation des entreprises devront être négociés avec eux, tous les trois ans, dans le cadre d’une réflexion sur l’utilisation du 1 % formation en fonction des opportunités ou des difficultés de l’entreprise.
La négociation portera aussi sur la nature des contrats utilisés dans l’entreprise. Je proposerai d’ailleurs d’ajouter une discussion sur les stages, afin que les représentants du personnel soient associés aux choix de l’entreprise en ce domaine.
Mme Isabelle Le Callennec. Nous croyons beaucoup à la GPEC : anticiper est une très bonne chose. Elle est ici étendue à toutes les entreprises. Or les situations peuvent être très différentes selon leur taille. Y a-t-on réfléchi ?
M. le rapporteur. Ces négociations sont obligatoires dans les entreprises de plus de 300 salariés ; en revanche, dans l’accord du 11 janvier, les partenaires sociaux avaient seulement invité les entreprises de moins de 300 salariés à négocier dans le cadre de la GPEC.
Pour les accords de mobilité, les organisations syndicales signataires souhaitent clairement que, dans les entreprises de plus de 300 salariés, on discute en même temps de mobilité et de GPEC, et que, dans les entreprises de moins de 300 salariés, si l’on discute de mobilité, on doive ouvrir une négociation plus générale sur la GPEC. Il est possible que les organisations patronales aient un sentiment un peu différent. Nous aurons l’occasion d’y revenir.
La Commission rejette l’amendement AS 137.
Puis elle examine l’amendement AS 262 de M. Philippe Noguès.
M. Philippe Noguès. Cet amendement vise à éviter toute disposition trop restrictive, en ajoutant à l’alinéa 2 l’adverbe « notamment ».
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 262.
Puis elle examine l’amendement AS 119 de Mme Jeanine Dubié.
M. Jean-Noël Carpentier. Pourquoi lier la GPEC, c’est-à-dire des accords qui peuvent être signés par des syndicats qui recueillent 30 % des suffrages, et la mobilité interne, pour laquelle il faut 50 % des suffrages ? Ne risque-t-on pas ainsi de réduire le pouvoir des salariés ? Ces discussions ne sont au demeurant pas de même nature.
L’accord du 11 janvier ne faisait pas ce lien, pourquoi est-il apparu dans le projet de loi ?
M. le rapporteur. Le lien figurait bien dans l’accord du 11 janvier.
Je ne partage pas votre souhait de dissocier les deux négociations. Une négociation sur la mobilité sera réussie si elle a lieu à froid : avec le pistolet sur la tempe, vous accepterez de faire des déplacements de quarante-cinq minutes, même si cela vous pose des problèmes effroyables ; inversement, si l’entreprise va bien, ce sont les syndicats qui seront demandeurs, et il en résultera des protections nouvelles pour les salariés. Nous sommes donc attachés à ce que des négociations sur la mobilité soient liées à une discussion de la stratégie de l’entreprise, qui comprendra aussi une négociation sur le plan de formation, sur la diminution des emplois précaires, sur la gestion des âges dans l’entreprise…
Aujourd’hui, les accords de GPEC peuvent comprendre des clauses sur la mobilité ; désormais, les négociations sur la mobilité devront nécessairement se dérouler dans le cadre de la GPEC, afin que cela se passe dans de bonnes conditions pour les salariés.
J’ajoute que les accords de GPEC n’ont pas besoin de 50 % des suffrages. Il y a des amendements pour le proposer, mais, dans le projet de loi, des organisations syndicales ayant recueilli 30 % des suffrages exprimés suffisent.
M. Jean-Noël Carpentier. Je retire l’amendement, mais je maintiens que ces deux discussions n’ont pas les mêmes répercussions sur la vie du salarié.
M. Jean-Patrick Gille. Irez-vous, monsieur le rapporteur, jusqu’à dire que la négociation sur la mobilité interne doit faire partie d’une négociation sur la GPEC, ou bien maintenez-vous deux négociations séparées ?
M. le rapporteur. Il y a bien une seule négociation.
L’amendement AS 119 est retiré.
La Commission examine ensuite l’amendement AS 263 de M. Denys Robiliard.
M. Denys Robiliard. La négociation sur la mobilité professionnelle ou géographique ne doit pas devenir obligatoire. Un amendement en ce sens sera présenté à l’article 10. Celui-ci est un amendement de cohérence.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 263.
Elle examine ensuite l’amendement AS 221 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Je me félicite de la proposition du rapporteur sur les stagiaires. Dans le même état d’esprit, nous proposons de mentionner parmi les éléments qui feront l’objet de la négociation et d’un bilan l’utilisation possible, notamment, les emplois d’avenir et les contrats de génération. Cela nous permettrait de mesurer ensemble l’efficacité de ces dispositifs.
M. le rapporteur. Même si je comprends la préoccupation qu’elle exprime, la mesure proposée relève davantage de la communication gouvernementale et de la réflexion sur l’application des politiques nationales de l’emploi que de la négociation de la GPEC.
Le groupe écologiste restera, quoi qu’il arrive, celui qui a le plus amendé le texte, avec le groupe UDI.
Mme Isabelle Le Callennec. Les informations dont nous parlons ne gagneraient-elles pas à figurer dans la base de données ? Ne pourrait-on coordonner les dispositions des deux articles visés, afin de regrouper toutes les données dans un document unique qui servirait de base aux négociations ? Je rappelle que le texte s’adresse à toutes les entreprises, y compris aux plus petites, désireuses de simplification.
M. le rapporteur. La négociation de la GPEC est un exercice un peu particulier, puisqu’elle concerne l’activité prévisionnelle triennale. Inclure ces informations dans la base de données obligerait l’entreprise à actualiser ses prévisions tous les trois mois. Même si la simplification est souhaitable, des exercices de projection spécifiques sont indispensables dans le cadre d’une négociation aussi lourde de conséquences.
M. Christophe Cavard. Nous maintenons l’amendement, d’autant que les partenaires sociaux y semblaient favorables.
La Commission rejette l’amendement AS 221.
Puis elle examine l’amendement AS 220 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Nous proposons de remplacer le mot « peuvent » par le mot « doivent », afin de rendre la mesure obligatoire.
M. le rapporteur. Je serais volontiers favorable à cet amendement, pour peu qu’il tende plutôt à remplacer les mots « peuvent être » par le mot « sont ».
M. Christophe Cavard. J’en suis d’accord.
M. Francis Vercamer. Je souscris à cet amendement : il est important que les sous-traitants soient informés de la stratégie de leur donneur d’ordre.
La Commission adopte l’amendement AS 220 ainsi rectifié.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 301 du rapporteur.
M. le rapporteur. La GPEC concernera aussi les perspectives de la filière : le groupe Renault, par exemple, pourra participer aux négociations menées par ses sous-traitants. Mon amendement vise à appliquer la même logique au niveau territorial.
Mme Isabelle Le Callennec. Il est utile d’associer les sous-traitants à la GPEC, mais cette disposition ne figure pas expressément dans le texte.
M. Francis Vercamer. La GPEC territoriale avait fait l’objet, dans un autre texte, d’amendements alors rejetés. Nous sommes bien évidemment favorables à celui-ci.
La Commission adopte l’amendement AS 301.
Puis elle adopte l’article 9 modifié.
Article 10
(art. L. 2242-21 à L. 2242-23 [nouveaux] du code du travail)
Mobilité interne
L’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 a prévu, dans son article 15, une obligation de négociation triennale d’entreprise sur l’organisation de la mobilité interne professionnelle ou géographique.
Cette négociation a vocation à s’articuler avec la négociation relative à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), obligatoire pour les entreprises ou les groupes d’au moins 300 salariés et elle-même triennale, telle que prévue à l’article L. 2242-15 du code du travail, et facultative dans les entreprises dont les effectifs sont inférieurs. L’accord insiste notamment sur l’importance pour ces entreprises de moins de 300 salariés de négocier également en la matière.
A. LE CADRE ACTUEL DE LA MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE ET PROFESSIONNELLE
1. Le lieu de travail et la mobilité géographique du salarié
● En l’absence de clause de mobilité
Tout salarié est potentiellement soumis à une obligation de mobilité, à moins que son contrat de travail ne prévoie de manière claire et précise qu’il exerce son activité dans un seul lieu déterminé. En l’absence de précision expresse, la mutation d’un salarié constitue un simple changement des conditions de travail, non subordonnée à l’accord de l’intéressé, si le nouveau lieu de travail se situe dans le même secteur géographique que son lieu de travail précédent. Ainsi, la simple mention du lieu de travail dans le contrat a valeur strictement informative, s’il n’est pas précisé que le salarié exerce son activité exclusivement dans ce lieu.
Or – et c’est donc très souvent le cas –, en l’absence de disposition expresse dans le contrat, le salarié n’a souvent aucune connaissance de l’étendue de son secteur géographique d’emploi. Si le nouveau lieu de travail se situe en revanche dans un secteur géographique différent, la mobilité demandée au salarié constitue une modification de son contrat, qui suppose donc, pour être mise en œuvre, d’avoir recueilli son accord clair et non équivoque.
Le secteur géographique fait l’objet d’une définition, logiquement très casuistique, par la jurisprudence, qui l’apprécie de manière objective, sans tenir compte a priori de ses conséquences pour le salarié (en termes de trajet supplémentaire notamment). Elle tient compte en revanche, d’une manière générale, de l’accessibilité de chacun des sites de travail et de leur desserte par les transports publics.
● En présence d’une clause de mobilité
Une clause de mobilité est définie comme la stipulation d’un contrat de travail par laquelle un salarié accepte à l’avance que son lieu de travail puisse être modifié, et d’exercer ses fonctions dans les différents établissements, agences ou succursales où l’entreprise déciderait de le muter.
Une clause de mobilité peut être prévue soit dans un contrat de travail, soit dans une convention collective.
Dans le cas où une clause de mobilité géographique est prévue par une convention collective, il n’est pas nécessaire qu’elle figure également explicitement dans le contrat de travail. Néanmoins, cette clause doit rigoureusement définir précisément sa zone géographique d’application, elle doit être prévue de manière obligatoire par la convention collective, et le salarié doit avoir été informé de son existence et mis en mesure d’en prendre connaissance ; l’information doit lui avoir été donnée lors de son embauche. Si la clause de mobilité prévue par la convention collective n’est pas assez précise, elle doit, pour pouvoir s’appliquer au salarié, être complétée par une clause contenue dans le contrat de travail. Si la clause prévue par la convention collective n’est pas obligatoire, elle ne peut s’imposer en tant que telle au contrat. Enfin, on notera que si le salarié est supposé avoir pu prendre connaissance de cette clause conventionnelle lors de son embauche, une telle clause ne saurait s’imposer aux salariés déjà présents dans l’entreprise.
Un salarié ne peut en principe se soustraire à l’application d’une clause de mobilité inscrite dans son contrat de travail, sous réserve d’un usage abusif de la clause ou d’une clause illicite. Le refus du salarié constitue un motif réel et sérieux de licenciement et peut, selon les circonstances, s’analyser en une faute grave.
Avant tout, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application : de ce fait, est nulle une clause de mobilité prévoyant que le salarié exercerait ses fonctions sur l’ensemble du territoire national, mais également dans tous pays. La Cour de cassation a également jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement d’un salarié dont la clause incluse dans le contrat prévoyait une mobilité sur l’ensemble de la zone d’activité de son employeur, celle-ci ayant été étendue à l’ensemble du territoire national.
Outre la nécessité de prédéfinir précisément le périmètre de la zone géographique, pour être valide, une clause de mobilité doit :
– être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
– être proportionnée au but recherché, compte tenu de l’emploi occupé et du travail demandé ;
– et enfin être justifiée par la nature de la tâche à accomplir.
Ces conditions de validité ont été précisées par la Cour de cassation à l’aune de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : en particulier, tout salarié est libre de choisir son domicile personnel et familial. Une restriction apportée à la liberté de choix du domicile du salarié ne peut donc être justifiée qu’à ces conditions.
Lorsque la mutation d’une salariée à 22 kilomètres de son lieu de travail s’accompagne d’une modification de ses horaires la conduisant à travailler jusqu’à 21 heures contre 19 heures auparavant, il convient de rechercher si cette nouvelle affectation est compatible avec ses obligations familiales impérieuses : il incombe à l’employeur de démontrer que l’atteinte à la vie personnelle et familiale est justifiée par la tâche à accomplir et est proportionnée au but recherché. À défaut, le refus du salarié d’appliquer la clause de mobilité est légitime.
En outre, le champ d’application d’une clause de mobilité ne peut être étendu en cours de contrat en fonction des besoins de l’entreprise.
Il a également été jugé qu’une clause de mobilité imposant une mutation dans une autre société du groupe est nulle, au motif que le principe d’exécution de bonne foi du contrat de travail interdit au salarié d’accepter par avance un changement d’employeur, une telle clause de mobilité étant trop discrétionnaire.
Enfin, l’insertion d’une clause de mobilité dans un contrat en cours ou la modification du contenu de cette clause en cours d’exécution du contrat peut être refusée par le salarié : il s’agit en effet d’une modification du contrat de travail.
2. La mobilité professionnelle
La mobilité professionnelle est plus difficile à appréhender que la mobilité géographique. L’étude d’impact associée au projet de loi fournit quelques éléments sur ce type de mobilité, en indiquant que 29 % des personnes en emploi en 1998 et qui l’étaient encore en 2003 ont changé de métier au moins une fois : 21 % ont changé de domaine professionnel et 9 % ont changé de métier en restant dans le même domaine professionnel. Elle note également que le changement de métier est plus fréquent pour les jeunes et pour les hommes. En tout état de cause, la mobilité professionnelle est plus fréquente en début de carrière.
Sur le plan juridique, dans le cadre d’une mobilité professionnelle interne à l’entreprise, il ne peut être imposé de modification de la qualification du salarié ou de la nature de ses fonctions sans recueil de son accord exprès. En revanche, l’affectation d’un salarié à une nouvelle tâche correspondant à sa qualification est possible sans l’accord du salarié : autrement dit, il s’agit d’une simple modification des conditions de travail, la nouvelle qualification ne devant pas s’accompagner d’une baisse de la rémunération ou d’une diminution des responsabilités auparavant exercées par le salarié.
B. LES NOUVELLES CONDITIONS D’ORGANISATION DE LA MOBILITÉ INTERNE PRÉVUES PAR L’ARTICLE 10
1. Les modalités de la négociation d’un accord de mobilité et le contenu de cette négociation
Le présent article complète la section relative à la négociation triennale du chapitre II, consacré à la négociation obligatoire en entreprise, du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail relative aux relations collectives du travail et en particulier à la négociation collective. Il insère une nouvelle sous-section 2, intitulée « Mobilité interne », après la sous-section relative à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et la prévention des conséquences des mutations économiques. L’articulation avec la négociation sur la GPEC apparaît donc de manière évidente.
Les modalités et le contenu de la négociation proprement dite sont respectivement précisés par les nouveaux articles L. 2242-21 et L. 2242-22.
a) Les modalités et l’objet de la négociation relative à la mobilité interne
Le nouvel article L. 2242-21 met en place une obligation de négociation triennale dans les entreprises « sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise dans le cadre de mesures collectives d’organisation sans projet de licenciement ».
On notera en premier lieu qu’en pratique, la négociation s’impose donc à toute entreprise dotée d’un délégué syndical. En outre, le rythme de cette négociation est triennal : le choix de cette périodicité est lié à la volonté de corréler cette nouvelle négociation avec celle relative à la GPEC, on l’a dit. Il s’agit en effet de la seule négociation triennale obligatoire en entreprise. C’est pourquoi le second alinéa du nouvel article L. 2242-21 prévoit que dans les entreprises et groupes d’entreprises d’au moins 300 salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes de dimension communautaire comportant au moins une entreprise ou un établissement de 150 salariés en France, les modalités de la mobilité interne s’inscrivent dans le cadre de la négociation triennale relative à la GPEC qui s’impose par ailleurs à ces entreprises.
En revanche, dans les entreprises de moins de 300 salariés, où la négociation relative à la GPEC ne s’impose pas, la nouvelle négociation relative à la mobilité interne est menée de manière autonome. Or, dans l’accord du 11 janvier 2013, les partenaires sociaux avaient souhaité inciter ces entreprises à ouvrir de telles négociations plus larges sur la GPEC. Votre rapporteur considère qu’une telle articulation facultative avec la négociation relative à la GPEC pourrait donc apparaître souhaitable, même pour les entreprises qui n’y sont pas légalement soumises.
La mobilité interne qui est l’objet de la nouvelle négociation est de deux ordres : il peut s’agir d’une mobilité professionnelle, mais également d’une mobilité géographique. Cette mobilité est bien interne à l’entreprise, ce qui impliquerait que même dans le cas où elle est menée dans le cadre d’un groupe, elle ne concernerait que les entreprises en interne au sein de ce groupe : telle n’est pourtant pas la lecture qui en est faite par l’administration, d’après les informations recueillies par votre rapporteur. La jurisprudence considère d’ailleurs qu’une clause de mobilité dans le cadre d’un groupe est nulle.
Les conditions de cette mobilité sont définies « dans le cadre de mesures collectives d’organisation sans projet de licenciement ». Cette précision est destinée à éviter que la négociation sur la mobilité prenne place dans un contexte général de restructuration de l’entreprise : autrement dit, la négociation sur la mobilité interne est une négociation « à froid », qui ne doit pas être le corollaire d’un projet plus vaste de restructuration de l’entreprise, qui prévoirait une suppression de postes ou encore des licenciements. On notera à cet égard que la formulation retenue par l’accord est différente, puisque l’accord parle de « mesures collectives d’organisation courantes dans l’entreprise, ne comportant pas de réduction d’effectifs ». Cette formulation a l’avantage d’être plus précise : en effet, à partir du moment où il est question d’organisation courante, tout projet de restructuration est écarté ; en outre, ces mesures ne doivent pas comporter de réduction d’effectifs : autrement dit, non seulement, les projets de licenciements sont exclus, mais également les plans de départs volontaires ou encore les mises en retraite anticipée. Votre rapporteur suggère donc de revenir à la formulation choisie par l’accord sur ce point.
L’adoption de mesures de mobilité interne « à chaud », dans le cadre d’un projet de restructuration lié à un contexte économique difficile pour l’entreprise, fait l’objet d’autres dispositions, spécifiquement prévues à l’article 13 du projet de loi, qui procède à la refonte de la procédure de licenciement économique. Ces mesures font l’objet de plus amples analyses dans le cadre du commentaire de l’article consacré à cette refonte.
b) Le contenu de la négociation
Le contenu obligatoire, mais non exhaustif, de cette négociation « à froid » sur les conditions de la mobilité interne est précisé par le nouvel article L. 2242-22. Ce sont en particulier trois types de dispositions qui devront faire l’objet des négociations, sous réserve d’autres thématiques qui pourraient être traitées par l’accord, le texte précisant que la négociation porte « notamment » sur ces trois types de dispositions :
– Le 1° du nouvel article L. 2242-22 précise que la négociation porte sur les mesures d’accompagnement à la mobilité, en particulier en termes de formation et d’aides à la mobilité géographique. Le premier objectif de la négociation est donc de favoriser la mobilité par la mise en place d’outils spécifiques d’accompagnement, que ce soit par des actions de formation s’agissant de la mobilité professionnelle ou par des aides dédiées pour ce qui concerne la mobilité géographique. La mise en place de ces outils montre que la mobilité est naturellement un obstacle dans l’entreprise, qu’elle doit donc, pour être favorisée, faire l’objet de mesures particulières de soutien. On peut supposer que les aides à la mobilité géographique recouvrent notamment la participation de l’employeur à d’éventuels frais de déménagement occasionnés par la mobilité d’un salarié ou à la prise en charge d’éventuels frais de transport supplémentaires liés à un éloignement plus important de son domicile.
– Le 2° prévoit que la négociation porte sur « les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique de l’emploi du salarié, elle-même précisée par l’accord ». Autrement dit, l’accord doit, en traçant deux cercles concentriques, différencier trois types d’espaces : le premier, le plus proche du centre, qui correspond au secteur géographique d’emploi du salarié ; le deuxième, qui correspond, au-delà de ce secteur géographique, à la zone dans laquelle peut être exigée une mobilité ; enfin, une troisième zone, extérieure et la plus périphérique, correspond à ce qui excède ces limites.
De fait, la notion de zone géographique de l’emploi du salarié est aujourd’hui très floue : ses contours ne sont souvent connus que par le biais de la jurisprudence relativement abondante sur ce sujet. En effet, nombre de salariés n’ont pas connaissance de la zone géographique correspondant à leur emploi, a fortiori si leur contrat n’inclut aucune clause de mobilité. De ce point de vue, sa définition par le biais d’un accord d’entreprise aura l’avantage de clarifier le périmètre du secteur géographique applicable aux salariés de l’entreprise.
Ce faisant, l’accord opère un déplacement des traditionnelles limites fixées par la jurisprudence, qui évalue, d’une part, l’étendue raisonnable de la zone géographique à l’intérieur de laquelle un employeur peut demander à un salarié d’être mobile sans que cette demande soit considérée comme une modification de son contrat de travail (il s’agit bien d’un simple changement dans les conditions de travail du salarié), et d’autre part, ce qui excède cette zone, qui correspond donc à une modification du contrat et requiert donc l’acceptation expresse du salarié pour être mise en œuvre. La définition d’un second espace de mobilité, au-delà de la zone géographique de l’emploi du salarié, conduit donc à déplacer le curseur de ce qui doit être identifié comme une modification substantielle du contrat. Rappelons en effet que le licenciement d’un salarié à la suite de son refus de se soumettre à une mobilité à l’intérieur de sa zone géographique constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, son refus pouvant même dans certains cas être considéré comme fautif ; en revanche, le licenciement d’un salarié refusant une mobilité hors de sa zone géographique d’emploi est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
– Enfin, d’après le 3°, la négociation porte également sur les mesures visant à permettre la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
On remarquera, dans un premier temps, que la notion classique à laquelle s’attache la jurisprudence est celle de « vie personnelle et familiale ». L’ajout de ce dernier terme semble donc indispensable. Sur le fond ensuite, le juge considère qu’une clause de mobilité peut en quelque sorte légitimement porter atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié si et seulement si cette atteinte est justifiée par la tâche à accomplir et est proportionnée au but recherché. Il incombe à l’employeur d’établir que l’atteinte en question est bien justifiée. Le principe ici invoqué par la jurisprudence est affirmé à l’article L. 1121-1 : il dispose que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » (dans un arrêt du 13 janvier 2009, la Cour de cassation a jugé que, en l’espèce, malgré la présence d’une clause de mobilité dans son contrat, le changement de site à une vingtaine de kilomètres de son lieu de travail antérieur conjugué à une modification des horaires de travail imposés à une salariée veuve et élevant seule deux jeunes enfants, constituent une atteinte disproportionnée à son droit au regard de ses obligations familiales impérieuses).
Le cinquième alinéa du nouvel article L. 2242-22 précise ensuite que l’accord collectif relatif à la mobilité interne ne peut entraîner de diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié : il s’agit de garanties essentielles qui sont ici apportées aux salariés. La mobilité professionnelle ou géographique dont le cadre sera fixé par la négociation ne saurait conduire à un « déclassement » du salarié, tant du point de vue de sa rémunération que de sa catégorie professionnelle. Le même alinéa prévoit que les stipulations de l’accord doivent garantir le maintien ou l’amélioration de sa qualification professionnelle : autrement dit, l’objectif est bien de permettre la progression du salarié, les actions de formation prévues par l’accord devant a minima conduire au maintien de sa qualification, et dans le meilleur des cas, à son amélioration. Ces garanties semblent essentielles au regard de la jurisprudence sur la mobilité professionnelle, qui assimile à une modification substantielle du contrat de travail toute mobilité professionnelle conduisant à une modification de la qualification ou de la nature des fonctions d’un salarié, mais également toute affectation à une tâche différente correspondant à la qualification du salarié, mais impliquant une baisse de responsabilités ou une diminution de la rémunération.
Le dernier alinéa du nouvel article L. 2242-22 prévoit enfin que l’accord collectif relatif à la mobilité interne est porté à la connaissance de l’ensemble des salariés, sans toutefois aucunement préciser les modalités de cette information : s’agit-il d’une information collective, qui doit donner lieu à un affichage dans les locaux de l’entreprise ou d’une information personnalisée de chacun des salariés concernés par le nouveau cadre fixé à la mobilité interne en entreprise ?
Si une information collective des salariés apparaît logique, une information personnalisée de chacun des salariés concernés par l’application de l’accord semble toutefois indispensable : en effet, à partir du moment où l’accord emporte des effets substantiels sur le contenu du contrat de travail lui-même, on voit mal comment l’employeur pourrait s’abstraire de porter à la connaissance de chacun des salariés le contenu précis de l’accord et ses conséquences concrètes sur le contrat de travail individuel. On notera à cet égard que lorsqu’une clause de mobilité est prévue aujourd’hui par une convention collective, elle n’est valide qu’à la condition que le salarié ait été informé de son existence et mis en mesure d’en prendre connaissance, cette information devant avoir lieu lors de l’embauche. Autrement dit, une telle clause prévue par une convention collective ne saurait valoir que pour les salariés embauchés postérieurement à sa conclusion. À tout le moins il semblerait normal que la capacité pour chaque salarié de prendre connaissance des conditions d’application de l’accord collectif à sa situation individuelle puisse être aménagée.
2. Les conséquences d’un accord relatif à la mobilité interne sur le contrat de travail
La conclusion d’un accord organisant la mobilité interne au sein d’une entreprise s’impose au contrat de travail : simplement, les clauses du contrat contraires aux stipulations de l’accord se voient suspendues. En cas de refus d’un salarié de se voir appliquer l’accord, son licenciement s’analyse comme un licenciement individuel pour motif économique.
a) La suspension des clauses du contrat de travail contraires aux stipulations de l’accord
Le nouvel article L. 2242-23 aménage les conséquences de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise relatif à la mobilité interne sur la situation de chaque salarié pris individuellement, et en particulier sur son contrat de travail. En effet, le texte précise que les stipulations de l’accord sont applicables au contrat de travail.
En premier lieu, dans quelle mesure un accord collectif peut-il modifier l’économie du contrat de travail ? Dans sa décision n° 2012-649 DC sur la loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, le Conseil constitutionnel a rappelé que le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. La remise en cause d’une clause de mobilité dans un contrat de travail ou l’application d’une telle clause à un contrat qui en est dépourvu constituerait-elle une atteinte disproportionnée à l’économie générale des conventions pour le juge constitutionnel (41) ?
Afin vraisemblablement de se prémunir contre une telle atteinte à l’intangibilité du contrat de travail, qui pourrait être jugée disproportionnée, le nouvel article précise que « les clauses du contrat de travail contraires à l’accord sont suspendues ». Le choix a donc été opéré de suspendre les clauses du contrat de travail et non de prévoir que les stipulations de l’accord se substituent aux clauses contraires contenues dans le contrat.
Dans la mesure où un accord collectif relatif à la mobilité interne s’inscrit dans un cadre triennal, cela ne signifie pas pour autant que la suspension des clauses du contrat contraires à l’accord ne vaut que pour trois ans : en effet, la négociation prévue est triennale, mais il n’y a pas à proprement parler d’échéance de l’accord, celui-ci continuant en effet de s’appliquer sauf dénonciation ou nouvel accord.
Pour un salarié dont le contrat ne comporte aucune clause de mobilité, il n’y a vraisemblablement lieu à suspendre aucune clause de son contrat : la délimitation de la zone géographique, ainsi que les limites au-delà desquelles une mobilité peut lui être imposé au-delà de cette zone, s’appliqueront a priori à lui sans effet visible sur contrat de travail individuel. En revanche, lorsqu’une telle clause est présente au contrat, celle-ci est suspendue si elle est contraire à l’accord, et cela, qu’elle soit ou non plus large que la zone délimitée par l’accord : la mobilité prévue dans l’accord prévaut sur une éventuelle clause de mobilité prévue au contrat.
b) La qualification du licenciement
Le texte prévoit que le licenciement du ou des salariés refusant l’application de l’accord à leur situation individuelle repose sur un motif économique ; il est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d’accompagnement que doit prévoir l’accord.
Sur ce point, le projet de loi ne retient pas la rédaction à laquelle ont abouti les partenaires sociaux dans l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013. En effet, d’après l’article 15 de celui-ci, le refus d’un salarié de se voir appliquer les termes de l’accord entraîne son licenciement pour motif personnel et ouvre droit « à des mesures de reclassement telles qu’un bilan de compétences ou un abondement du compte personnel de formation ». Le projet de loi retient pour sa part le cadre d’un licenciement individuel pour motif économique.
Pourquoi cette option a-t-elle finalement prévalu ? C’est d’une part en raison de la différence entre les procédures encadrant une modification pour motif économique et une modification pour motif personnel, et d’autre part, – ce qui est lié – par souci de conformité avec la directive 158 de l’organisation internationale du travail (OIT).
Dans le cadre d’un motif économique, l’employeur doit formellement proposer à chaque salarié concerné la modification envisagée par lettre recommandée avec avis de réception, en l’informant de ses nouvelles conditions d’emploi et des éventuelles mesures d’accompagnement proposées, et en lui précisant qu’il dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son refus. À défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. En revanche, dans le cas d’une modification pour motif personnel, l’information du salarié est certes obligatoire, mais elle n’est soumise à aucune condition de forme. L’employeur est néanmoins tenu de laisser au salarié un délai suffisant pour faire connaître son acceptation ou son refus, raisonnablement de quinze jours.
Le nouvel article L. 2242-23 précise enfin que le licenciement d’un salarié prononcé en cas de refus de l’application de l’accord à son contrat de travail, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique. Cette rédaction est destinée à exonérer un employeur qui serait amené à licencier plus de dix salariés ayant refusé l’application de l’accord à leur contrat des obligations lui incombant dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique, autrement dit, par la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Si l’employeur échappe à la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, les salariés licenciés sur le fondement de leur refus de l’application de l’accord bénéficieront néanmoins des « mesures d’accompagnement que doit prévoir l’accord ». Autrement dit, la négociation relative à la mobilité interne doit également porter sur les mesures spécifiques d’accompagnement qui seront prévues pour les salariés qui refuseraient le cadre de la mobilité fixé par l’accord d’entreprise. De toute évidence, la volonté est que ces mesures soient complémentaires à celles prévues pour un licenciement économique, mais peut-être faudrait-il clarifier ce point dans le débat.
Enfin, votre rapporteur souligne la latitude qui sera laissée au juge en cas de contestation de son licenciement par un salarié qui aurait refusé l’application de l’accord à son contrat de travail. En effet, le texte du projet de loi ne dit pas que le refus du salarié « constitue » un motif valable de licenciement ; le juge aura donc toujours à estimer si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, autrement dit, à exercer une appréciation sur la portée de la mobilité imposée au salarié au regard non seulement de la vie personnelle et familiale du salarié, mais également plus largement de la validité de la clause de mobilité prévue par l’accord. Si le champ des limites de la zone géographique définies par l’accord sont imprécises ou que son application aux salariés n’apparaît pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, ou proportionnée au but recherché, compte tenu de l’emploi occupé ou du travail demandé, ou encore si elle n’est pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, le juge sera fondé, du point de vue de votre rapporteur, à prononcer la nullité de cette clause, quand bien même elle trouverait son origine dans un accord collectif d’entreprise.
*
* *
Votre commission a adopté une série d’amendements à cet article, dont les principaux ont apporté les modifications suivantes :
– À l’initiative de votre rapporteur, votre commission a restreint le champ de la négociation relative à la mobilité interne dans l’entreprise aux mesures d’organisation courantes, sans projet de réduction d’effectifs, comme le prévoyait sur ce point l’accord du 11 janvier.
– Elle a également, à l’initiative de votre rapporteur, souhaité préciser ce que recouvrent les mesures d’aides à la mobilité géographique, en l’occurrence, la participation de l’employeur à d’éventuels frais de déménagement ou frais de transports supplémentaires.
– Elle a tenu, à l’initiative des commissaires du groupe socialiste, à préciser que la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié recouvrait également la vie familiale de ce dernier, conformément à la notion de « vie personnelle et familiale » usitée tant par la jurisprudence que par la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).
– Votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur, identique à un amendement des commissaires socialistes, prévoyant que l’information des salariés quant au contenu de l’accord n’était pas collective, mais personnalisée.
*
La Commission est saisie d’un amendement, AS 138 de Mme Jacqueline Fraysse, tendant à la suppression de l’article.
Mme Jacqueline Fraysse. Aux termes de l’article 10, le chef d’entreprise pourra, à la faveur d’un accord d’entreprise potentiellement minoritaire, imposer à un salarié une mobilité interne, qu’elle soit géographique ou professionnelle. S’il refuse, le salarié sera licencié à titre individuel et non pour motif économique, même si d’autres salariés sont dans le même cas : il sera donc beaucoup moins protégé. Cet article est particulièrement préoccupant.
M. le rapporteur. L’esprit du texte est d’ouvrir de nouveaux droits, tout en mettant fin à ce que M. Sapin appelait la « préférence française » pour les plans sociaux. En d’autres termes, il s’agit de rendre les licenciements plus difficiles en favorisant le chômage partiel – c’est l’objet de l’article 11 –, lequel a permis de sauver de nombreux emplois industriels en Allemagne.
Le deuxième grand volet concerne les accords de maintien de l’emploi : nous y reviendrons.
S’agissant du troisième volet, la mobilité, le fait est que les salariés sont aujourd’hui isolés face à leur employeur, d’autant que la jurisprudence les protège assez peu, même en l’absence de clause spécifique sur le contrat de travail : si celui-ci ne précise pas expressément le lieu de travail, le salarié peut se voir imposer une mobilité et, en cas de refus, être licencié pour faute. En Île-de-France, selon la jurisprudence en vigueur, un salarié est réputé mobile dans l’ensemble de la région.
Face à cette situation, les partenaires sociaux ont voulu fixer un cadre. Restait à savoir lequel. Le choix s’est porté sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), car la mobilité n’est justifiable qu’au regard de son utilité pour l’entreprise.
En second lieu, il est préférable qu’une telle négociation ait lieu « à froid » ; d’où mon amendement AS 302, par lequel je proposerai d’en revenir aux termes de l’accord du 11 janvier, qui sur ce point offre davantage de garanties aux salariés. Les organisations signataires, d’ailleurs, craignent plutôt que cette mesure ne généralise les mobilités qui, jusqu’à présent, se décident au cas par cas.
L’objet de certains de mes amendements est d’encadrer plus strictement cette négociation, notamment dans l’optique de protéger la vie personnelle des salariés au regard de la mobilité géographique. Il nous faudra aussi débattre des modalités individuelles, par exemple si un employeur souhaite faire appliquer immédiatement certaines dispositions de l’accord triennal.
Enfin, la conséquence logique de cette négociation « à froid » sur les mobilités est bien entendu d’éviter tout plan social ; tel est en tout cas l’objectif du dernier alinéa de l’article.
M. André Chassaigne. Cet article me semble d’une extrême gravité. Le refus du salarié, qui aux termes de l’accord du 11 janvier pouvait justifier un licenciement pour raisons personnelles, devient, dans le projet de loi, un motif de licenciement économique, lequel garderait un caractère individuel malgré sa portée collective. Autrement dit, un employeur échappera aux procédures collectives même s’il procède à plusieurs licenciements : ce recul majeur contrevient d’ailleurs, de ce point de vue, à une directive européenne.
Comment, dès lors, qualifier les motifs mêmes du licenciement ? Seront-ils dits « économiques », ou le refus du salarié sera-t-il assimilé à une faute grave ? Quelle sera la position du juge, et sur quoi la fondera-t-il ? Est-il normal, dans ces conditions, que la seule mesure de reclassement soit un bilan de compétences ?
M. le rapporteur. Le Conseil d’État a estimé que le licenciement pour motif personnel peut, dans le cas dont nous parlons, contrevenir à la convention 158 de l’Organisation internationale du travail, aux termes de laquelle il convient de distinguer entre les licenciements inhérents à la personne et ceux qui ne le sont pas ; or il est incontestable que nous sommes dans le second cas de figure : le refus de mobilité relève donc du licenciement économique – puisque celui-ci constitue la catégorie alternative dans le droit français.
Les licenciements économiques peuvent être individuels : c’est notamment le cas s’ils sont inférieurs à neuf par mois. Le caractère « individuel » traduit seulement l’absence de plan social.
Je rappelle que, en moyenne, 30 % des salariés changent d’emploi tous les cinq ans, et 100 % tous les quinze ans. En tout état de cause, la négociation « à froid » renforcerait la position des salariés dans la négociation ; et si dix d’entre eux refusent la mobilité, ils ne pourront faire l’objet d’un plan social. Au surplus, la dernière phrase de l’alinéa 13 précise que le licenciement économique, dans ce cas de figure, implique des mesures d’accompagnement prévues par l’accord, en plus de celles qui existent déjà.
M. Francis Vercamer. Je ne suis pas d’accord avec cette analyse, malgré l’avis du Conseil d’État dont elle s’autorise. La Cour de cassation, qui avait à se prononcer sur le même sujet dans le cadre de la « loi Aubry II », a considéré que le refus du salarié justifiait un licenciement pour motif personnel, dans la mesure où ce refus visait un accord collectif. Gardons-nous de modifier l’accord du 11 janvier par des artifices, d’autant que nous n’avons qu’entendu parler de cet avis du Conseil d’État, sans jamais l’avoir sous les yeux.
Mme Isabelle Le Callennec. Aux termes de l’article 9, la GPEC est obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés ; or la négociation sur la mobilité interne concerne toutes les entreprises.
M. le rapporteur. En effet : l’alinéa 1 de l’article vise toutes les entreprises. La GPEC est facultative pour les entreprises de moins de 300 salariés, selon le vœu des partenaires sociaux.
M. Christophe Cavard. L’article 10, qui est au cœur des débats sur ce texte, mérite des améliorations substantielles, car, tel qu’il est rédigé, il pourrait contrevenir aux objectifs mêmes de l’accord du 11 janvier. Les amendements que nous défendrons sont essentiels de ce point de vue : les dispositions relatives à la mobilité ne doivent pas occulter certains principes juridiques, à commencer par ceux que pose une directive européenne.
M. Jean-Noël Carpentier. Je veux bien croire le rapporteur sur parole, mais la rédaction de cet article soulève des interrogations, notamment sur de possibles contournements qui le rendraient très défavorable aux salariés. Sans voter l’amendement de suppression, j’espère donc que notre discussion permettra d’enrichir le texte.
La Commission rejette l’amendement AS 138.
Puis elle examine l’amendement AS 120 de M. Jean-Noël Carpentier.
M. Jean-Noël Carpentier. Je propose une rédaction plus solide, afin d’éviter des contournements qui faciliteraient les licenciements.
M. le rapporteur. Bien que je partage le souci dont il témoigne, je vous invite à retirer cet amendement, car il ne correspond pas aux termes de l’accord du 11 janvier, même si celui-ci doit être complété afin de rendre facultative la négociation sur la mobilité dans les entreprises de moins de 300 salariés. Nous pourrons, si vous le souhaitez, réfléchir à une nouvelle rédaction d’ici à l’examen en séance publique.
M. Jean-Noël Carpentier. Je maintiens l’amendement, quitte à le retirer en séance si la négociation permet des avancées.
Mme Jacqueline Fraysse. Le rapporteur objecte que l’amendement ne reprend pas les termes de l’accord du 11 janvier ; mais, je le répète, notre rôle est de légiférer, non d’avaliser cette rédaction terme pour terme.
M. le rapporteur. Je ne refuse pas les amendements, ma chère collègue ; mais je me suis fixé pour règle, pour les plus importants d’entre eux, de consulter au préalable les signataires de l’accord. C’est ce que je ferai en l’occurrence : chacun prendra ensuite ses responsabilités dans l’hémicycle.
Mme la présidente Catherine Lemorton. On ne peut que saluer cette méthode.
La Commission rejette l’amendement AS 120.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements AS 302 du rapporteur et AS 72 de M. Francis Vercamer.
M. le rapporteur. Cet amendement est l’un des plus importants de ceux que j’ai déposés. La négociation sur la mobilité doit aboutir à protéger les salariés, non à diminuer leurs droits. À cette fin, elle doit avoir lieu lorsque ces derniers sont en position de force et, donc, lorsque l’entreprise ne connaît aucune difficulté. L’employeur engage cette négociation dans le cadre de mesures collectives courantes d’organisation sans projet de réduction d’effectifs et non « sans projet de licenciement », puisqu’il convient de prendre en compte notamment les plans de départs volontaires.
M. Francis Vercamer. En effet, la formule « sans projet de licenciement » exclut les plans de départs volontaires, alors que nombre d’entreprises, parmi les plus importantes, en font avant les plans de licenciement. Il importe donc que le texte les couvre également.
M. le rapporteur. Le mot « courantes » étant très important, je vous invite à vous rallier à mon amendement.
M. Francis Vercamer. Je le cosigne et je retire l’amendement AS 72.
L’amendement AS 72 est retiré.
La Commission adopte l’amendement AS 302.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS 341 du rapporteur.
Puis elle est saisie de l’amendement AS 265 de M. Gérard Sebaoun.
M. Gérard Sebaoun. Il convient de placer les mesures d’accompagnement après celles définissant les limites de la mobilité, puisqu’elles seront en partie définies en conséquence de celles-ci.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 265.
Elle étudie ensuite l’amendement AS 163 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Les clauses protectrices prévues à partir de l’alinéa 7 – accompagnement à la mobilité, limites imposées à cette dernière, mesures permettant la conciliation entre la vie professionnelle et personnelle, etc. – doivent être effectivement appliquées. Nous proposons donc d’ajouter à l’alinéa 7 « à peine de nullité ».
M. le rapporteur. Ce n’est pas nécessaire puisqu’un accord qui ne comprendrait pas les dispositions prévues par la loi, par définition, serait nul.
Votre amendement, toutefois, a le mérite de remplacer « négociation » par « accord », mais je reste défavorable à son adoption.
Mme Jacqueline Fraysse. Chacun devrait réfléchir à cette question dès lors que nous souhaitons protéger les salariés. Mentionner « sous peine de nullité » aurait le mérite de renforcer l’application des clauses de protection.
M. le rapporteur. Dans le cadre du code du travail, par exemple, les accords sont nuls, hors certaines considérations purement formelles, lorsque les clauses obligatoires ne sont pas respectées, mais, je le répète, votre amendement a le mérite de préciser que c’est l’accord qui est porteur.
Je vous propose de rectifier votre amendement en précisant que « l’accord issu de la négociation prévue à l’article L. 2242-21 comporte notamment : ». Ainsi, tous les items suivants seront traités : la zone géographique sera désignée par l’adresse de l’entreprise ; hormis pour les commerciaux, les limites de la mobilité n’excéderont très souvent pas le site lui-même ; la conciliation de la vie professionnelle et personnelle est inscrite dans le droit international ainsi que dans le préambule de notre Constitution et, enfin, les mesures de compensation doivent être effectives. Sous cette forme-là, je pourrais accepter votre amendement.
Mme Jacqueline Fraysse. Je suis sensible au fait que vous entendiez ma préoccupation, mais je n’envisage pas de rectifier mon amendement. Je retiens en revanche votre proposition visant à rédiger un amendement alternatif pour s’assurer que l’accord tiendra bien compte des différents thèmes mentionnés. De mon côté, je réfléchirai également à une autre formulation, même si celle que j’ai retenue est en l’occurrence plus radicale.
M. Gérard Cherpion. Mentionner l’accord résultant de la négociation modifierait considérablement le texte, puisque c’est bien de la négociation qu’il s’agit, l’accord n’intervenant qu’à l’alinéa 11.
M. le rapporteur. « Pas de bras, pas de chocolat ». S’il n’y a pas d’accord, il n’y a pas de mobilité encadrée.
La Commission rejette l’amendement AS 163.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS 342 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 303 du rapporteur.
M. le rapporteur. L’aide à la mobilité doit comprendre une prise en charge partielle des frais de transport par l’employeur ou des frais de déménagement. Les partenaires sociaux sont d’accord sur ce point.
La Commission adopte l’amendement AS 303.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS 343 du rapporteur.
Puis elle est saisie de l’amendement AS 222 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Nous sommes très préoccupés par la question de la mobilité. Conformément à la jurisprudence, nous proposons de la limiter à une distance de 50 kilomètres et à une heure de trajet.
M. le rapporteur. Les partenaires sociaux n’ont pas réussi à s’entendre à ce sujet. Les versions provisoires du texte envisageaient de ne pas autoriser les mobilités qui ajouteraient plus de quarante-cinq minutes de transport par rapport au trajet actuel du salarié. Or, cette disposition étant peu protectrice, la CFTC en a demandé le retrait. Elle a également demandé un renvoi à l’accord faute de pouvoir trouver un dispositif s’appliquant à toutes les entreprises.
La loi, toutefois, ne doit-elle pas fixer une norme d’ordre public social contraignant la négociation ? J’avais quant à moi envisagé que l’accord ne s’imposerait au contrat de travail que s’il ne porte pas le temps de transport à plus d’une heure.
Une autre solution consisterait à considérer que les zones géographiques, sans être fixées par une distance kilométrique précise, doivent être conçues de manière à respecter la vie familiale et professionnelle.
Je propose que nous poursuivions ce débat dans l’hémicycle. Peut-être pourriez-vous retirer votre amendement ?
M. Christophe Cavard. Je propose d’ôter la référence à la distance et de conserver la mention du temps de trajet.
Mme Isabelle Le Callennec. En la matière, il convient de distinguer la région parisienne et la province. Les contraintes temporelles et spatiales variant beaucoup entre les bassins d’emplois. Il me semblerait dommageable d’envisager leur strict encadrement.
De plus, si les salariés raisonnent en termes de temps de trajet – ils ont du mal à concevoir des déplacements au-delà de vingt ou trente minutes de leur domicile –, ils sont surtout préoccupés par la cherté des carburants.
Enfin, que l’on discute de la question de la limite géographique dans le cadre d’un accord, soit, mais l’alinéa 10 concernant les mesures visant à permettre la conciliation de la vie professionnelle et personnelle me semble plus intéressant.
M. Gérard Sebaoun. Une heure cinq en étant assis dans le RER ou en utilisant quatre modes de transport différents, ce n’est pas la même chose ! La fixation à une heure de trajet est erronée, car les modes de transport diffèrent en fonction des régions et des types de mobilités, ce qui change tout.
M. Christophe Cavard. Je maintiens mon amendement, car il s’agit pour notre groupe d’une question très importante.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Pour nous aussi.
M. le rapporteur. Il faut bien réfléchir à ce problème.
Isabelle Le Callennec a raison de le rappeler, les coûts peuvent être très élevés. Un aller-retour quotidien de cinquante kilomètres entraîne une dépense de 350 euros de carburant par mois, ce qu’un smicard ne peut se permettre. Dans ces conditions, les salariés ne peuvent pas être mobiles !
Il est également difficile de fixer une distance, car cela pourrait modifier les conditions de vie de ceux qui vivent très près de leur lieu de travail dès lors qu’un accord collectif ferait état d’une heure de trajet.
M. Christophe Cavard. Il s’agit de ne pas dépasser une heure de trajet ! Ce peut être bien moins !
M. le rapporteur. Et l’on dira que les écologistes ont déposé un amendement considérant qu’une heure de trajet, c’est tout à fait acceptable ! Les quelques salariés qui ont deux heures trente de transport remercieront M. Cavard, mais que diront les 99 % qui vivent à cinq minutes de leur lieu de travail ?
Je plaisante sur cette grave question, mais c’est pour mieux attirer l’attention sur toutes les difficultés qu’elle soulève. Nous y avons beaucoup travaillé, mais, même au sein de notre groupe, nous sommes divisés quant à l’opportunité d’un tel encadrement.
La Commission rejette l’amendement AS 222.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS 344 et AS 345 du rapporteur.
Puis elle examine les amendements identiques AS 304 du rapporteur et AS 264 de M. Jérôme Guedj.
M. Gérard Sebaoun. L’accord sur la mobilité ne doit bouleverser ni la vie professionnelle, ni la vie personnelle, ni la vie familiale.
M. le rapporteur. Décidément, le parti socialiste devient le défenseur de la vie familiale pour tous !
Mme la présidente Catherine Lemorton. Je suis assez étonnée de cette insistance sur la vie familiale, alors que c’est la vie personnelle qui, en l’occurrence, importe.
M. Gérard Sebaoun. La vie personnelle peut être bouleversée par un enfant qui a des difficultés, mais c’est toute la vie familiale qui le sera aussi. J’entends la famille au sens le plus général : la famille quelle qu’elle soit.
Mme Jacqueline Fraysse. On peut en effet ajouter une telle mention, mais, sans autre précision, cela risque de n’être qu’une déclaration de principe.
M. le rapporteur. Cet amendement est important, notamment eu égard à la jurisprudence. Lors d’une demande de mobilité adressée à un salarié, l’employeur doit s’assurer qu’aucune personne plus mobile ne puisse occuper le poste. Le juge, quant à lui, peut annuler une mobilité demandée à une mère de famille alors qu’elle aurait pu être effectuée sans dommage par un salarié célibataire.
Il conviendrait également de reprendre d’autres éléments de la jurisprudence, dont l’idée selon laquelle la mobilité doit être conçue dans « l’intérêt supérieur de l’entreprise ». Outre le cadre collectif défini dans l’accord, la manière dont les mobilités seront ensuite déclinées doit être protectrice.
La Commission adopte les amendements AS 304 et AS 264.
Elle examine ensuite l’amendement AS 223 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Il convient de prévoir des mesures visant à compenser, en cas de changement de secteur géographique, d’éventuelles pertes de niveau de vie liées notamment à l’accès aux services publics et à l’indice des prix de l’immobilier.
M. le rapporteur. Je vous propose de déposer avec moi un amendement qui complétera celui que j’ai défendu et qui a été voté concernant les compensations financières.
M. Christophe Cavard. Je retire mon amendement et je prends acte de votre proposition.
L’amendement AS 223 est retiré.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS 346 du rapporteur.
Suite à l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement AS 229 de M. Christophe Cavard.
Puis elle examine les amendements identiques AS 305 du rapporteur et AS 268 de M. Gérard Sebaoun.
M. le rapporteur. Les accords de mobilité ne doivent pas seulement figurer sur les panneaux d’affichage des entreprises, mais chaque salarié doit en être personnellement informé afin, éventuellement, de faire valoir ses droits.
M. Gérard Sebaoun. L’amendement AS 268 est défendu.
La Commission adopte les deux amendements AS 305 et AS 268.
Elle est saisie de l’amendement AS 224 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Il importe de conditionner la mobilité interne à des accords majoritaires et, donc, à l’approbation de 50 % des représentants des salariés.
M. le rapporteur. Selon les règles de négociation définies par la loi de 2008, un accord est considéré comme majoritaire lorsqu’il est validé par 30 % de signataires et que 50 % ne s’y opposent pas. Si 50 % s’opposent à un projet de mobilité, il n’y a donc pas d’accord.
S’agissant des accords de maintien de l’emploi et des plans sociaux, la loi crée une « super majorité », pour reprendre la formule du ministre, puisqu’il faut que 50 % des votants y soient favorables.
Le débat demeure ouvert, mais il faut défendre l’idée que la négociation a lieu « à froid », qu’elle ne porte que sur la négociation courante et qu’elle se fait dans le cadre d’une GPEC sans inclure les protections prévues dans les plans sociaux ou dans les plans de maintien de l’emploi. Ce que vous proposez entraînerait une dérive du dispositif, que nous ne souhaitons pas.
A contrario, cet article a pour conséquence qu’un accord collectif s’impose au contrat de travail et qu’à ce titre la majorité de 50 % pourrait se justifier. Néanmoins, vous savez que les partenaires sociaux n’ont pas signé de proposition de ce type même si la CFDT, compte tenu du motif économique retenu dans l’alinéa 13, a fait savoir qu’elle aurait peut-être insisté pour prévoir une telle majorité.
En l’état, je suis favorable au maintien du texte tel qu’il est et donc défavorable à votre amendement.
La Commission rejette l’amendement AS 224.
Elle examine ensuite les amendements AS 164 et AS 165 de Mme Jacqueline Fraysse, pouvant faire l’objet d’une présentation commune.
Mme Jacqueline Fraysse. L’amendement AS 164 propose de supprimer l’alinéa 13 et l’amendement AS 165 de le réécrire.
Trois points nous préoccupent particulièrement : la remise en cause du contrat de travail par l’accord de mobilité, lequel s’impose, y compris suite à un vote minoritaire ; en cas de licenciement, le motif économique est acquis par avance – alors que c’est contraire aux engagements de la France sur la convention 158 de l’Organisation internationale du travail ; enfin, ce licenciement sera prononcé individuellement, même si plusieurs salariés sont dans cette situation.
La rédaction que nous proposons tend à surmonter ces difficultés.
M. le rapporteur. L’analyse du Conseil d’État, que Francis Vercamer semble remettre en cause, est pourtant partagée par de nombreux juristes auditionnés.
Dire que le licenciement « repose sur un motif économique » ne signifie pas que l’on considère qu’il existe une « cause réelle et sérieuse » : c’est au juge judiciaire qu’il appartiendra d’en décider.
Ensuite, la disposition offre toutes les protections liées au licenciement économique en matière d’indemnisation et de reclassement. Les mesures d’accompagnement issues de la négociation ne peuvent que venir en complément.
Jusqu’à neuf personnes se trouvant dans la situation évoquée sur une période d’un mois – soit cent personnes sur un an –, rien n’est changé par rapport au droit existant. Au-delà, l’accord dispense de mettre en œuvre l’article 13, c’est-à-dire de recourir à un plan social avec accord majoritaire des salariés ou homologation par l’administration.
Bref, la situation que nous visons à l’article 10 est celle d’une négociation « à froid » se déroulant dans de bonnes conditions. Le Gouvernement a cependant réintroduit dans le texte, contre le souhait des partenaires sociaux mais conformément à la convention de l’Organisation internationale du travail, la mention des protections en cas de licenciement pour motif économique.
Lorsque les syndicats non signataires que nous avons auditionnés font état de leur souhait de disposer de la menace du plan social pour peser dans les négociations, ils se réfèrent plutôt à l’article 12, c’est-à-dire aux cas où l’entreprise est confrontée à de graves difficultés conjoncturelles.
La Commission rejette successivement les deux amendements AS 164 et AS 165.
Elle est ensuite saisie des amendements AS 108 de M. Gérard Cherpion, AS 73 de M. Francis Vercamer et AS 192 de Mme Jacqueline Fraysse, pouvant être soumis à une discussion commune.
Mme Véronique Louwagie. La réécriture proposée par l’amendement AS 108 vise à conformer les dispositions du texte à l’accord du 11 janvier, dont les signataires ont prévu que le refus par un salarié d’une modification de son contrat proposée dans les conditions préalablement définies n’entraînait pas un licenciement pour motif économique mais un licenciement pour motif personnel.
En l’état, l’alinéa 13 n’est pas une traduction loyale de l’accord. Il en modifie très substantiellement la lettre et l’esprit.
J’ajoute que la rédaction de la dernière phrase de cet alinéa est obscure.
M. Francis Vercamer. L’amendement AS 73 vise également à revenir à l’accord du 11 janvier.
Quant à l’avis des juristes sur l’article, monsieur le rapporteur, nous y reviendrons en séance publique !
Mme Jacqueline Fraysse. L’amendement AS 192 vise à mettre les modalités de licenciement prévues à l’alinéa 13 en conformité avec les principes généraux du droit.
M. le rapporteur. Nous devons être loyaux à l’égard des signataires, mais notre loyauté ne nous permet pas de déroger à notre devoir de législateurs, qui est a minima de nous conformer au droit international. Avis défavorable, donc, aux amendements AS 108 et AS 73.
Bien que difficile à comprendre, la dernière phrase de l’alinéa me semble grammaticalement correcte, madame Louwagie.
L’amendement de Jacqueline Fraysse propose un renvoi à l’article L. 1233-3 du code du travail, qui définit le licenciement pour motif économique. Mais les situations visées ici ne sont pas celles où l’entreprise est en difficulté et envisage des restructurations : il s’agit seulement de garantir au salarié les protections applicables aux licenciements pour motif économique. Avis défavorable également.
La Commission rejette successivement les trois amendements AS 108, AS 73 et AS 192.
Elle en vient à l’amendement AS 226 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Nous proposons de supprimer le mot : « individuel » de l’expression « licenciement individuel pour motif économique » car cette notion ne nous semble pas conforme à la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs. Dans l’hypothèse où cent salariés refuseraient l’accord, il faudrait, en l’état, procéder à cent licenciements individuels !
M. le rapporteur. J’ai posé les termes du débat dans mon rapport. Selon certains, la directive n’est pas respectée, puisque l’on ne s’appuie pas sur la procédure d’information-consultation prévue par le code du travail ; selon d’autres – la majorité –, la négociation prévue par le texte vaut consultation au sens européen du terme, dans la mesure où elle est plus contraignante que la procédure d’information-consultation.
Au reste, la suppression du mot « individuel » revient à supprimer l’article 10, qui pose précisément les conditions à remplir pour éviter d’avoir recours à un plan social.
Avis défavorable.
M. Jean-Noël Carpentier. Je voterai cet amendement, car il met en évidence un certain flou dans la rédaction actuelle de l’article 10, ouvrant des possibilités dangereuses en matière de licenciement. J’espère que le débat en séance publique permettra de clarifier les choses. Pour de nombreux députés, cela aura une incidence en ce qui concerne le vote sur l’ensemble du texte.
La Commission rejette l’amendement AS 226.
Elle examine ensuite l’amendement AS 191 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Il s’agit de préciser les modalités de recueil de l’accord ou du refus du salarié.
M. le rapporteur. Je comprends votre préoccupation, mais je pense que nous devons travailler à une procédure spécifique. S’agissant de mobilité, il faut préciser que le salarié a droit à un entretien avec l’employeur pour faire valoir les contraintes de sa vie personnelle. Il conviendrait aussi d’introduire dans la loi des éléments de jurisprudence quant à l’intérêt démontré de l’entreprise et à l’impossibilité de demander à des salariés plus mobiles ou géographiquement plus proches d’occuper le poste visé. Comme je déposerai un amendement en ce sens, avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement AS 191.
Puis elle adopte l’article 10 modifié.
Article 11
(art. L. 3232-2, L. 3232-5, L. 5122-1 à L. 5122-4, et L.5428-1 du code du travail et
art. L. 242-10 du code de la sécurité sociale)
Refonte du dispositif d’indemnisation de l’activité partielle
Le chômage partiel est un dispositif qui permet à une entreprise confrontée à une baisse temporaire d’activité de suspendre, sans les rompre, les contrats de travail conclus avec ses salariés. Il existe en France depuis 1918, mais avait été quasiment abandonné au début des années 2000, avant sa réactivation à la faveur de la crise de 2008. Ce dispositif est constitué, depuis la fin des années 1960, d’un système de trois allocations assorties d’une exonération de cotisations sociales et d’une réduction de CSG et de CRDS.
Il représente l’un des outils de la politique de l’emploi en matière de prévention des licenciements. Lors de la dernière crise, période au cours de laquelle le dispositif a été réactivé, un mécanisme complémentaire, d’« activité partielle de longue durée » (APLD), a été mis en place, qui s’est désormais dans les faits entièrement substitué aux anciennes conventions d’activité partielle.
Ainsi, d’après les chiffres de la DARES (42), entre 2007 et 2010, près de 90 000 salariés se sont retrouvés chaque mois en chômage partiel, avec une réduction moyenne d’activité de 30 heures par mois. Sur cette période, 130 millions d’heures de chômage partiel ont été consommées, avec un pic entre le dernier trimestre 2008 et le troisième trimestre 2009. Le nombre de salariés concernés a également connu un pic au deuxième trimestre 2009 avec 270 000 salariés (220 000 salariés au premier trimestre 2009 et 260 000 salariés au troisième trimestre 2009). Le recours au dispositif s’est ensuite ralenti : en 2011, ce sont de l’ordre de 30 000 salariés qui se sont trouvés chaque mois en position de chômage partiel. Le coût du dispositif pour l’État s’est logiquement sensiblement alourdi dans le sillage de l’augmentation du recours au dispositif, puisqu’il a représenté 320 millions d’euros en 2009, soit vingt fois plus qu’en 2008, tandis que l’Unédic dépensait 43 millions d’euros en 2009 au titre de l’APLD. L’industrie est le secteur le plus utilisateur du chômage partiel : 85 % des heures consommées entre 2007 et 2010, dont 27 % pour l’automobile (11 % environ seulement dans le secteur des services).
Cette mobilisation accrue du chômage partiel pendant la crise est allée de pair avec des ajustements permanents du dispositif, qui était quasiment tombé en désuétude au début des années 2000.
Les multiples modifications qui y ont été apportées ont d’ailleurs souvent été portées par les partenaires sociaux : ceux-ci se sont particulièrement mobilisés autour de cet outil, qui a été l’objet sur la période de pas moins de cinq accords nationaux interprofessionnels (ANI) : ainsi, avant tout, dès l’accord du 15 décembre 2008, les partenaires sociaux sont revenus sur les taux d’indemnisation qui n’avaient pas évolué depuis l’accord du 21 février 1968, permettant de porter ceux-ci de 50 à 60 % dans le cadre du conventionnement avec l’État. L’accord du 8 juillet 2009 a ensuite permis d’adapter le système pour ne plus exclure les entreprises qui organisent le travail par roulement : les salariés peuvent donc depuis être placés en chômage partiel individuellement et alternativement (dès lors qu’il y a bien réduction collective de l’horaire de travail appliquée dans les mêmes conditions aux salariés exerçant la même activité). L’accord du 8 octobre 2009 a ensuite modifié l’assiette servant de base au calcul de l’allocation de chômage partiel, en l’élargissant à la rémunération brute servant au calcul de l’indemnité de congés payés ; dans le même temps, il a permis de conserver l’acquisition des droits à congés payés pour les salariés placés en activité partielle. Dans le cadre de l’accord du 13 janvier 2012, les partenaires sociaux ont également demandé la réduction à dix jours des délais d’instruction de l’administration ainsi que la suppression de l’autorisation administrative préalable pour recourir au dispositif, tout en réaffirmation l’importance de la mobilisation de la formation dans ce cadre. Enfin, l’accord du 6 février 2012 a permis la revalorisation de la participation de l’Unédic au financement du dispositif, et conduit à la réduction de la durée minimale de conventionnement à deux mois.
À la suite notamment des évaluations respectives du dispositif menées par la Cour des comptes en février 2011 et par l’Inspection générale des affaires sociales en juin 2012 (43), qui ont mis en évidence à la fois l’efficacité discutable de cet outil et surtout sa grande complexité, une refonte du dispositif de chômage partiel est proposée par le présent article.
A. LE DISPOSITIF ACTUEL
Le dispositif d’indemnisation du chômage partiel a pour objectif de compenser partiellement la perte de salaire résultant soit de la fermeture temporaire d’un établissement ou partie d’établissement, soit d’une réduction de l’horaire habituel de travail en deçà de la durée légale (article L. 5122-1 du code du travail). Le chômage partiel se compose :
– d’une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l’État ;
et en complément de cette allocation :
– soit d’une allocation conventionnelle financée par l’employeur et, le cas échéant, remboursée à l’employeur par l’État (lorsque l’entreprise a signé une convention de chômage partiel) dès lors que l’entreprise relève de l’accord national interprofessionnel du 21 février 1968 ou est couverte par un accord collectif relatif à l’indemnisation du chômage partiel. Il s’agit d’un dispositif qui n’est plus aujourd’hui ouvert qu’en cas de circonstances exceptionnelles ;
– soit d’une allocation complémentaire lorsque l’entreprise a signé une convention d’activité partielle de longue durée (APLD), financée par l’employeur, l’État et l’Unédic. Mis en place de manière provisoire en 2009, ce dispositif a été constamment reconduit depuis : il s’agit aujourd’hui du régime conventionnel de droit commun. L’APLD peut être mobilisée par une entreprise pendant un an.
Ce dispositif est complété par une garantie de rémunération mensuelle minimale (RMM) au salarié, équivalente au SMIC net (articles L. 3232-3 et L. 3232-5 du code du travail).
La réduction ou la suspension temporaire de l’activité qui permet de recourir au chômage partiel doit être imputable à la conjoncture économique, à des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise, ou à toute autre circonstance exceptionnelle (article R. 5122-1).
Le chômage partiel est a priori exclu en cas de grève, de chômage saisonnier lorsque les salariés ne travaillent pas habituellement pendant la période de l’année concernée, ainsi que pour les salariés en forfait annuel lorsqu’il s’agit d’une simple réduction de l’horaire de travail. En revanche, du fait de la conjoncture économique difficile, l’administration peut accorder le bénéfice du chômage partiel à des entreprises théoriquement exclues du dispositif : il en va ainsi des entreprises en redressement judiciaire – les entreprises en liquidation en restant néanmoins exclues –, des entreprises sous-traitantes qui rencontrent des difficultés liées à une baisse des commandes de leur donneur d’ordre, ainsi que des entreprises qui procèdent à un licenciement économique en leur sein, si et dans la mesure où les salariés concernés par les deux procédures sont clairement identifiés et distincts.
L’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat ou leur durée de travail, peuvent a priori bénéficier du chômage partiel ; c’est aussi le cas des salariés intérimaires si les salariés de l’entreprise utilisatrice sont eux-mêmes placés en chômage partiel. Les salariés placés en chômage partiel peuvent a priori cumuler un ou plusieurs emplois pendant leur indemnisation, sous réserve du respect des principes de loyauté et de non concurrence, ainsi que des règles relatives à la durée maximale du travail.
La mise en chômage partiel ne constituant pas une modification du contrat de travail, le salarié placé dans cette position n’est donc pas en droit de refuser une telle mesure. L’entreprise qui souhaite actionner ce dispositif doit toutefois consulter le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel en les informant des motifs qui l’amènent à envisager une réduction ou une suspension d’activité, le nombre de salariés concernés et la durée probable de la mesure. L’avis des institutions représentatives du personnel (IRP) est transmis à la DIRECCTE.
1. L’allocation spécifique de chômage partiel
L’allocation spécifique de chômage partiel est due pour chaque heure de travail chômée et se calcule selon un taux horaire qui s’établit depuis le 1er mars 2012 à 4,84 euros pour les entreprises de moins de 250 salariés et à 4,33 euros pour les entreprises de plus de 250 salariés. Elle est prise en charge par l’État, dans des limites qui diffèrent selon que l’on se trouve dans le cas d’une réduction d’activité ou d’une suspension temporaire d’activité :
– en cas de réduction d’activité, la prise en charge est limitée à un contingent annuel de 1 000 heures par an et par salarié ;
– en cas de suspension d’activité, le financement de l’allocation spécifique par l’État est limité à six semaines ; au-delà, les salariés basculent dans le système d’indemnisation du chômage de droit commun.
C’est en 2008-2009, à la faveur de la réactivation du dispositif de chômage partiel, que la durée d’indemnisation a été portée de six mois à un an et que le nombre maximal d’heures indemnisables est passé de 600 à 1000 heures (soit environ deux tiers de la durée annuelle du travail). Le nombre de semaines de réduction totale d’activité autorisées est également passé à cette occasion de quatre à six semaines. Enfin, le taux minimal d’indemnisation garanti au salarié a été porté de 50 à 60 % de la rémunération brute d’activité. La part du financement de l’État a enfin été revue sensiblement à la hausse, puisqu’elle est passée de moins de 30 % du SMIC brut en 2008 à un peu moins de 45 % en 2009. L’indemnité horaire minimale a été augmentée de 55 %.
2. L’allocation d’activité partielle de longue durée
Instituée par le décret n° 2009-478 du 29 avril 2009, reconduite en 2010, l’allocation d’activité partielle de longue durée (APLD) a été réactivée et aménagée par l’accord national interprofessionnel du 6 février 2012. Il s’agit désormais du dispositif complémentaire d’indemnisation du chômage partiel de droit commun, qui doit être systématiquement privilégié par rapport aux conventions de chômage partiel « classiques ».
Complémentaire de l’allocation spécifique de chômage partiel, cette allocation, prévue à l’article L. 5122-2 du code du travail, ne peut être octroyée qu’en cas de réduction d’activité pendant une longue période afin d’éviter un licenciement pour motif économique (et non pas de suspension temporaire d’activité).
L’application du dispositif est subordonnée à la conclusion d’une convention avec l’État – concrètement avec l’unité territoriale de la DIRECCTE – pour une période de trois mois renouvelable dans la limite de douze mois ; elle ne peut intervenir que si les conditions d’attribution de l’allocation spécifique sont réunies et si la convention a pour effet le maintien durable des effectifs dans l’emploi. La convention est conclue soit directement par l’entreprise, soit par adhésion à une convention-cadre conclue au niveau national, régional ou départemental entre une organisation professionnelle ou interprofessionnelle et l’État. La demande de convention d’APLD peut être formulée en même temps que la demande de prise en charge au titre de l’allocation spécifique, soit postérieurement, en cours d’activité partielle. Elle doit en tout état de cause être précédée de la consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sur les motifs économiques du recours à l’activité partielle de longue durée, sur les catégories professionnelles et les activités de l’entreprise concernées, sur le niveau et les modalités de mise en œuvre des réductions d’horaires, ainsi que sur les actions de formation susceptibles d’être engagées pendant les périodes chômées.
En contrepartie du versement de l’allocation complémentaire, l’employeur s’engage à maintenir dans l’emploi les salariés concernés pendant une période égale au double de la durée de la convention et à proposer à chaque salarié bénéficiaire un entretien individuel en vue notamment d’examiner les actions de formation qui pourraient être engagées pendant la période d’activité partielle. En cas de licenciement pour motif économique, départ en retraite dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ou mise à la retraite d’un salarié indemnisé durant cette période, l’employeur est tenu de rembourser à l’État les sommes perçues au titre de l’APLD.
Versée dans les mêmes conditions relatives au contingent d’heures indemnisables que l’allocation spécifique de chômage partiel, l’APLD garantit le versement d’une indemnité au moins égale à 75 % de la rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés, soit environ 93 % de la rémunération nette. Lorsque le salarié accepte de suivre une formation pendant les heures de chômage partiel, son allocation est portée à 100 % de sa rémunération nette de référence, cet effort financier supplémentaire restant cependant à la charge de l’employeur.
La contribution versée par l’employeur est, depuis le 1er mars 2012, prise en charge par l’Unédic à hauteur de 2,90 euros par heure chômée : le contingent des 50 premières heures, qui était à la charge de l’État, a ainsi été supprimé.
3. L’ancienne allocation conventionnelle de chômage partiel « classique », devenue marginale
En complément de l’allocation spécifique de chômage partiel versée par l’État, les salariés peuvent également bénéficier d’une allocation conventionnelle, dès lors que l’entreprise relève du champ de l’accord national interprofessionnel du 21 février 1968 (44). Cette allocation, versée par l’entreprise, peut faire l’objet d’une prise en charge partielle ou totale par l’État sous réserve de la conclusion d’une convention.
Tous les salariés bénéficiaires de l’allocation spécifique de chômage partiel peuvent a priori avoir droit à l’allocation conventionnelle, sous réserve de ne pas avoir refusé un travail de remplacement offert par l’entreprise et assorti d’une rémunération équivalente, ni d’accomplir des heures de récupération depuis la dernière période de chômage partiel.
L’allocation conventionnelle est due pour toute heure indemnisée au titre de l’allocation spécifique, dans la même limite du contingent d’heures indemnisables. Elle complète la première à hauteur de 60 % de la rémunération horaire brute servant de base au calcul de l’indemnité de congés payés, soit la rémunération totale payée au salarié sur la période de référence. L’allocation totale ne pouvant être inférieure à 6,84 euros par heure chômée, il s’ensuit que la part de l’allocation conventionnelle est au moins égale à 2 euros pour les entreprises de moins de 250 salariés et de 2,51 euros pour les entreprises de plus de 250 salariés.
Une prise en charge par l’État du montant de l’allocation conventionnelle est possible lorsque la mise au chômage partiel a pour but d’éviter ou de réduire le nombre de futurs licenciements pour motif économique : à cet effet, une convention de chômage partiel classique doit être signée entre l’entreprise et la DIRECCTE, pour une durée de six mois, renouvelable une fois. La demande de convention peut être effectuée en même temps que la demande de mise en chômage partiel, mais également postérieurement. En tout état de cause, l’employeur doit avoir préalablement consulté le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, en précisant les mesures prévues pour le redressement économique de l’entreprise.
La convention de chômage partiel « classique » ne peut intervenir que si les conditions d’attribution de l’allocation spécifique sont réunies, l’employeur devant, en contrepartie, s’engager à maintenir en emploi tout ou partie des salariés couverts par la convention et dont le licenciement était envisagé, pendant une durée au moins équivalente à celle de la convention, voire, le double de la durée de la convention. Le non-respect de cet engagement par l’employeur peut conduire l’administration à lui demander le remboursement des sommes perçues à ce titre.
Le taux de prise en charge par l’État de l’allocation conventionnelle est fonction de la gravité des difficultés constatées, de l’importance de la réduction apportée au nombre de licenciements envisagés, ainsi que des efforts de réorganisation de l’entreprise dans un but de redressement économique, notamment en matière de réduction ou de modulation concertée de la durée du travail. Ce taux ne peut excéder un plafond fixé chaque année par arrêté ministériel et qui s’établit, pour les conventions signées en 2012 :
– à 100 % en cas de catastrophe naturelle ;
– à 80 % à titre exceptionnel en cas de très graves difficultés de trésorerie de l’entreprise susceptibles de mettre sa survie en jeu, et prioritairement pour les petites entreprises.
Le tableau suivant retrace les modalités actuelles d’indemnisation dans le cadre du chômage partiel et de prise en charge par les pouvoirs publics.
Sommes versées au titre de l’activité partielle depuis le 1er janvier 2013
Rémunération versée au salarié par l’employeur |
Allocation remboursée à l’employeur par l’État ou l’Unédic | ||
Chômage partiel classique | |||
– Allocation spécifique de chômage partiel : 4,84 € pour les entreprises de moins de 250 salariés / 4,33 € pour les entreprises de plus de 250 salariés – Allocation conventionnelle de chômage partielle (cas exceptionnel ; entreprises couvertes par l’ANI de 1968) : 60 % de la rémunération horaire brute servant de calcul aux congés payés, avec un minimum de 6,84 €. Le montant mensuel de ces allocations ne peut être inférieur à la rémunération mensuelle minimale (RMM). |
Allocation spécifique de chômage partiel (État) |
4,84 € : entreprises de 1 à 250 salariés | |
4,33 € : entreprises de plus de 250 salariés | |||
Allocation complémentaire de chômage partiel (État) |
Convention à 80 % |
1,60 € ; entreprises jusqu’à 250 salariés | |
2,01 € : entreprises de plus de 250 salariés | |||
Convention à 100 % |
2 € : entreprise jusqu’à 250 salariés | ||
2,51 € : entreprises de plus de 250 salariés | |||
Dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) | |||
– Allocation spécifique de chômage partiel : 4,84 € pour les entreprises jusqu’à 250 salariés et 4,33 € au-delà – Allocation d’APLD : -75 % de la rémunération horaire brute, soit environ 93 % du salaire net avec un minimum égal à la RMM, soit 7,39 € nets de l’heure pour les salariés à temps plein ; -100 % de la rémunération quand le salarié suit une formation pendant la période chômée. |
Allocation spécifique de chômage partiel (État) |
4,84 € : entreprises jusqu’à 250 salariés | |
4,33 € : entreprises de plus de 250 salariés | |||
Allocation complémentaire de chômage partiel (Unédic) |
2,90 € quelle que soit la taille de l’entreprise | ||
Rémunération mensuelle minimale (RMM) | |||
Allocation complémentaire de RMM : complément de la rémunération mensuelle jusqu’au SMIC net, soit 1 120,45 € pour les salariés à temps plein (proratisée pour les temps partiels). |
État : 50 % de l’allocation complémentaire de RMM | ||
Source : Liaisons sociales quotidien du 11 février 2013 : « Le dossier juridique », n° 16282
B. UNE EFFICACITÉ TRÈS MITIGÉE DU DISPOSITIF ACTUEL
1. Un dispositif dont l’efficacité est relative
Comme l’a montré la Cour des comptes (45), si le nombre de bénéficiaires du chômage partiel a fortement augmenté en 2009, avec 275 000 salariés concernés au deuxième trimestre 2009 et 78 millions d’heures indemnisées au total sur l’année, ces données contrastent avec celles de l’Allemagne, qui comptait 1,53 million de bénéficiaires du chômage partiel en 2009.
La Cour a en premier lieu constaté une sous-utilisation par les entreprises du nombre d’heures autorisées par l’administration, le taux de recours effectif étant de l’ordre d’un tiers environ du total des heures autorisées. Malgré la forte revalorisation du dispositif, l’ampleur du chômage partiel est restée modeste par comparaison avec la dernière phase de récession observée en France en 1993.
La réactivité du dispositif face à la crise est en France très discutable : en effet, la part de la population concernée par le chômage partiel est passée de 0,34 % avant la crise à 0,83 % en 2009, alors que dans le même temps, en Allemagne, cette part passait de 0,08 % à 3,17 % et en Italie, de 0,64 % à 3,29 %.
D’après l’OCDE (46), les systèmes d’indemnisation du chômage partiel auraient permis de sauvegarder 221 500 emplois en Allemagne pendant la crise, 124 000 en Italie et 43 000 en Belgique, mais seulement 18 000 en France.
Malgré un degré de protection de l’emploi élevé en France, – qui devrait coïncider comme c’est généralement le cas dans les autres pays dont le modèle du marché du travail est similaire – avec un recours important au dispositif de chômage partiel –, les entreprises françaises confrontées à la crise dès 2008 n’ont pas mobilisé massivement cet outil, dans la mesure où elles disposaient, d’une part, de possibilités de flexibilité externe qu’elles ont a contrario beaucoup utilisées (le recours aux CDD et à l’intérim), et d’autre part, d’un autre outil de flexibilité qu’elles ont préféré au recours au chômage partiel, celui de l’aménagement du temps de travail, qui avait été encore assoupli par la loi de 2008.
Une autre explication du succès tout relatif de cet outil de prévention des licenciements réside dans son utilisation très concentrée sur l’industrie : or, si l’industrie représente encore 25 % de l’emploi total en Allemagne, sa part dans l’emploi n’a cessé de s’éroder en France, puisqu’il est passé de 30 % en 1989 à 20 % en 2010.
D’après la Cour toujours, les allocations françaises de chômage partiel sont globalement généreuses pour les salariés, puisqu’elles leur garantissent de 75 % de leur salaire net pour l’allocation spécifique à 90 % de leur salaire net pour l’APLD (contre 60 à 67 % du salaire net en Allemagne) ; elles sont en revanche globalement moins avantageuses pour les entreprises, dont le reste à charge évolue dans une fourchette comprise entre le quart et la moitié de l’indemnisation, alors qu’elle est limitée tout au plus à la prise en charge d’une partie des cotisations sociales en Allemagne et en Italie, et qu’elle est même entièrement assumée par la collectivité dans certains pays, comme le Belgique ou l’Espagne.
En effet, l’activité partielle consiste, pour l’employeur, à verser au salarié un revenu de remplacement correspondant à un certain niveau de la rémunération brute mensuelle horaire de celui-ci : si ce taux est fixé à 60 % du salaire brut horaire dans le cadre de l’allocation spécifique, il passe à 75 % dans le cadre de l’APLD et peut même s’établir à 100 % dans le cas où le salarié engage une formation. En contrepartie, une allocation horaire est versée à l’employeur, qui laisse donc à l’entreprise un reste à charge, que récapitule le graphique suivant.
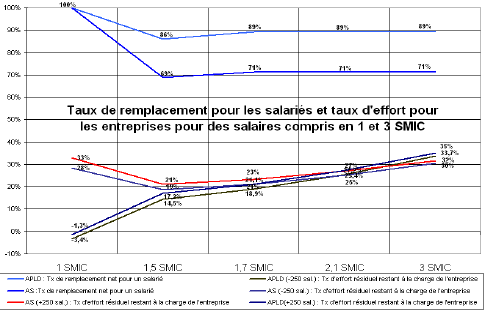
Source : Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle.
Enfin, d’après la Cour des comptes, l’une des raisons de l’insuffisance du dispositif actuel de chômage partiel réside dans sa mauvaise articulation avec la formation : hors APLD qui exige l’examen des actions de formation ou de bilan qui pourraient être engagées pendant la période d’activité partielle, la position de chômage partiel n’implique aujourd’hui aucune obligation de formation. En particulier, les heures de chômage partiel sont considérées comme « hors temps de travail », – le contrat de travail du salarié étant en effet suspendu –, ce qui, de facto, lui ferme toute possibilité de bénéficier d’une action de formation au titre du plan de formation de l’entreprise, et en particulier, d’une formation d’adaptation au poste, action de formation qui semblerait néanmoins tout à fait indiquée dans le cas des salariés en position d’activité partielle.
2. Un coût néanmoins important
D’après la Cour des comptes, le coût du dispositif de chômage partiel a été évalué à 610 millions d’euros en 2009, dont 349 millions d’euros de coût direct et 260,5 millions d’euros d’exonérations de cotisations sociales, contre 6 milliards d’euros en Allemagne la même année.
Si son ampleur en termes financiers est donc sans commune mesure avec celle de notre voisin outre-Rhin, ce coût reste néanmoins important, ce qui justifie qu’un tel dispositif ne puisse être mis en œuvre que sur autorisation préalable de l’administration, les DIRECCTE s’assurant du caractère temporaire et exceptionnel de la baisse d’activité de l’entreprise.
3. Une complexité excessive
Dans son rapport consacré à l’évaluation du chômage partiel déjà cité, l’IGAS met en évidence l’excessive complexité de cet outil : outre la construction du dispositif autour de trois étages d’allocations distincts, génératrice d’illisibilité pour les entreprises, l’indemnisation au titre du chômage partiel se fait à stricte proportion de la non-activité de nature conjoncturelle à laquelle il répond. Autrement dit, l’employeur qui a par ailleurs recours à d’autres dispositifs d’organisation ou d’aménagement du temps de travail (annualisation, aménagement du temps de travail, modulation), doit distinguer les heures relevant du chômage partiel de celles relevant de ces autres outils. Enfin, la superposition de plusieurs niveaux d’indemnisation du chômage partiel en fonction de sa durée peut conduire à des niveaux d’indemnisation différents pour les salariés et des niveaux de prise en charge différents pour les entreprises.
C. LA REFONTE DU DISPOSITIF D’INDEMNISATION DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le présent article opère une refonte du dispositif d’indemnisation du chômage partiel : sans aucunement revenir sur les critères d’éligibilité des entreprises, les conditions d’indemnisation des salariés, la refonte proposée se contente d’unifier la construction en trois étages du dispositif actuel, source de complexité, et accentue la dimension de formation de cet outil, formation qui doit en effet prioritairement bénéficier aux salariés placés en position d’activité partielle.
Le dispositif d’indemnisation du chômage partiel est actuellement codifié au chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, aux articles L. 5122-1 à L. 5122-4 : il s’agit du chapitre spécifiquement consacré aux « aides aux salariés en chômage partiel », qui participent de la panoplie des outils déployés en faveur du maintien et de la sauvegarde de l’emploi.
Le I du présent article propose avant tout de modifier l’intitulé de ce dispositif, en substituant à la notion d’aide aux salariés en chômage partiel celle d’aide aux salariés placés en activité partielle. La modification est purement syntaxique, mais est loin d’être neutre : en effet, le changement de terminologie
– parler d’activité partielle plutôt que de chômage partiel – permet de conférer au dispositif une connotation plus positive. Si la différence entre le verre à moitié plein et le verre à moitié vide est, comme chacun le sait, ténue, personne n’ignore l’importance de cette distinction sur un plan psychologique.
Le II supprime les intitulés existants des sections du chapitre consacré au dispositif de chômage partiel, en l’occurrence les sections 1 à 4, respectivement intitulées : « Allocation spécifique de chômage partiel » ; « Allocations complémentaires de chômage partiel » ; « Régime fiscal et social des allocations » et « Dispositions d’application ». Ces intitulés n’ont en effet plus de raison d’être à partir du moment où les allocations actuelles que sont l’allocation spécifique d’une part, l’allocation partielle de longue durée (APLD) d’autre part, – y compris le cas résiduel de l’allocation complémentaire versée dans le cadre du conventionnement dit « classique » –, font l’objet d’une refonte au sein d’une allocation qui sera désormais unifiée.
Le III procède à une réécriture de l’actuel article L. 5122-1 consacré à l’allocation spécifique de chômage partiel. Les 1° et 2° proposent une reformulation permettant de supprimer le renvoi à l’actuelle allocation spécifique, premier étage de droit commun du dispositif d’indemnisation, mais également la mention de chômage partiel pour la remplacer par la notion d’activité partielle. Le a) du 2° précise toutefois que le placement des salariés en activité partielle a lieu « après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative ».
Le rétablissement de l’autorisation administrative préalable
Le chômage partiel donnant lieu à un financement public, il semble légitime que l’activation de cet outil par les entreprises soit soumise à l’autorisation de l’administration.
Toutefois, la mobilisation de l’activité partielle est logiquement le fait d’entreprises qui se trouvent dans une situation difficile et qui se heurtent à des contraintes spécifiques et à une relative urgence. C’est pourquoi dans le cadre des réformes successives du dispositif qui ont été proposées après la crise de 2008 pour le rendre plus efficace, les partenaires sociaux ont, dans un premier temps, souhaité dans le cadre de l’accord national interprofessionnel du 8 juillet 2009 sur la gestion sociale des conséquences de la crise économique sur l’emploi, que l’administration puisse réduire son délai de réponse de vingt à dix jours ; puis ont, dans un second temps, dans le cadre de l’accord du 13 janvier 2012, réitéré cette demande tout en proposant la suppression de l’autorisation préalable de l’administration pour toute entreprise qui connaîtrait une dégradation forte et subite de son activité.
Dans le sillage de cette demande formulée par les partenaires sociaux, le décret n° 2012-341 du 9 mars 2012, entré en vigueur le 11 mars, a purement et simplement supprimé cette autorisation administrative, quelle que soit la situation de l’entreprise. Cette dernière pouvait donc adresser à l’administration sa demande d’indemnisation après avoir déjà placé une partie de ses salariés en chômage partiel.
Dans son rapport publié en juillet 2012, l’inspection générale des affaires sociales a toutefois mis en garde contre les risques inhérents à cette suppression, tant du point de vue de l’employeur que des pouvoirs publics :
– S’agissant de l’employeur, la suppression de l’autorisation préalable génère un risque financier potentiellement important pour une entreprise qui essuierait un refus a posteriori de l’administration. En outre, au lieu de permettre une accélération de l’activation de l’outil de maintien en emploi que constitue le chômage partiel, on pouvait craindre que les entreprises ne fassent preuve d’une frilosité accrue dans la mobilisation de cet outil, n’étant pas suffisamment assurées de leur possibilité de bénéficier à terme des aides publiques à ce titre à partir du moment où l’administration n’avait pas formellement validé leur démarche.
– S’agissant des pouvoirs publics, l’IGAS considère que la suppression de l’autorisation préalable constitue un risque non seulement juridique, avec une hausse potentielle des recours contre les refus a posteriori de l’administration ; mais également financier, avec un risque que les employeurs « assimilent le dispositif à un droit de tirage à guichet ouvert ».
C’est pourquoi le rétablissement de l’autorisation administrative préalable a rapidement été acté l’automne dernier. Afin de ne pas pénaliser les entreprises qui doivent pouvoir placer rapidement, mais en toute sécurité, tout ou partie de leurs salariés en chômage partiel, et qui seraient bloquées par les délais de traitement de l’administration, une procédure d’acceptation tacite a été mise en place : elle permet à une entreprise de procéder au placement en chômage partiel passé un délai de quinze jours ouvrés, contre vingt jours antérieurement, sans réponse des services de l’État (décret n° 2012-1271 du 19 novembre 2012).
Concrètement, l’entreprise qui souhaite recourir au chômage partiel adresse au préfet du département une demande préalable précisant les motifs de recours à ce dispositif, la période prévisible de sous-activité, le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d’entre eux, la durée du travail habituellement accomplie. Cette demande est accompagnée de l’avis préalable des institutions représentatives du personnel. En cas de décision d’acceptation expresse ou tacite, l’employeur peut ensuite adresser à la DIRECCTE une demande d’indemnisation, qui comporte des états nominatifs précisant le nombre d’heures chômées par salarié.
La formule finalement retenue pour permettre une mise en œuvre rapide de cet outil sur le terrain tout en apportant la sécurité nécessaire aux entreprises explique la mention choisie par le a).
Le c) du 2° modifie le renvoi à la perte de salaire imputable soit à la fermeture de tout ou partie de l’entreprise, soit à la réduction de l’horaire de travail, qui conditionne la demande de mise en chômage partiel : il mentionne désormais la perte de rémunération, cette notion étant plus large et recouvrant également les éventuelles primes ou avantages touchés par les salariés.
Le 2° bis insère un nouvel alinéa qui prévoit que les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement, pour peu qu’il s’agisse bien d’une réduction collective de l’horaire de travail : il s’agit ici de transposer les dispositions qui figurent aujourd’hui au troisième alinéa de l’article L. 5122-1, et qui permettent, depuis la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, d’autoriser la mise en chômage partiel dans des entreprises qui organisent le temps de travail « par roulement ».
L’ensemble des dispositions encadrant actuellement l’allocation spécifique de chômage partiel sont supprimées au profit d’un nouveau II et d’un nouveau III, qui précisent que, dans le cadre de l’activité partielle :
– les salariés reçoivent une indemnité horaire versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’État ;
– l’employeur perçoit, quant à lui, en contrepartie, une allocation financée conjointement par l’État et l’Unédic ;
– une convention entre l’État et l’Unédic doit intervenir pour déterminer les modalités de financement de cette allocation ;
– le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
– des engagements spécifiques peuvent être demandés par l’administration à l’employeur recourant au dispositif d’activité partielle, en tenant compte d’un éventuel accord collectif d’entreprise conclu sur l’activité partielle.
Plusieurs remarques doivent être formulées à ce stade.
– En premier lieu, le niveau de l’indemnité horaire versée au salarié placé en activité partielle devrait vraisemblablement être fixé par décret en Conseil d’État entre 74 % et 92 % de son salaire net antérieur, ce qui correspond au taux de remplacement aujourd’hui assuré respectivement par l’allocation de base et par l’APLD.
– Ensuite, il est prévu que l’Unédic participe, conjointement avec l’État, au financement de l’activité partielle unifiée, alors que l’assurance chômage n’assurait jusqu’alors qu’une partie du financement de l’APLD. Si la clé de répartition du financement ne devrait vraisemblablement pas changer – de l’ordre de 60 % pour l’État et de 40 % pour l’Unédic –, la mobilisation de l’Unedic dans le cadre de la totalité du dispositif pourrait occasionner un doublement du coût qu’il représente actuellement. En effet, d’après les éléments fournis dans le cadre de l’étude d’impact, l’Unédic est intervenue en 2012 pour le financement partiel de 46 % des heures chômées, soit celles qui l’ont été au titre de l’APLD. Dans l’hypothèse d’un nombre d’heures chômées équivalent en 2013, soit au total 12,5 millions d’heures, sa participation au financement pourrait donc doubler, pour s’établir au total à 36,3 millions d’euros. En revanche, la part du financement de l’État restant la même sur une assiette également inchangée, la refonte du dispositif serait au final neutre pour l’État.
Une convention entre l’État et l’Unédic doit organiser les modalités du cofinancement du dispositif. Les modalités de financement par l’Unédic de l’indemnisation au titre du chômage partiel sont déjà aujourd’hui définies dans le cadre d’une convention conclue avec l’État, qui fixe le montant de l’enveloppe annuelle dont la charge incombe à l’assurance chômage : autrement dit, un avenant à la convention est signé chaque année pour fixer ce montant. L’actuelle convention liant l’État et l’Unédic sur le dispositif d’activité partielle a été signée le 4 décembre 2009 ; le dernier avenant fixant la participation financière de l’assurance chômage date du 11 décembre 2012.
– La réforme proposée ne revient pas sur le principe d’un remboursement par la puissance publique à l’employeur de la charge de l’indemnisation des salariés placés en activité partielle. Outre le reste à charge pour l’employeur, celui-ci continuera de supporter une charge de trésorerie liée au décalage entre le paiement des indemnités aux salariés et leur remboursement partiel par l’État et l’Unédic. La réduction des délais d’autorisation administrative, avec un système d’acceptation tacite au bout de quinze jours, devrait néanmoins réduire sensiblement cette charge pour les employeurs décidant de recourir à l’activité partielle.
– Il est également précisé que le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu, cette disposition existant déjà dans le droit actuel, puisqu’elle figure actuellement au dernier alinéa de l’article L. 5122-1.
Les droits du salarié placé en activité partielle
La refonte du dispositif d’activité partielle ne modifie pas les dispositions actuelles en vigueur relatives aux droits du salarié dans le cadre du chômage partiel.
Les périodes d’activité partielle sont intégralement prises en compte pour le calcul de la durée des congés payés.
S’agissant de la participation et de l’intéressement, le calcul des primes intègre les salaires qui auraient normalement dû être perçus.
En outre, les heures chômées ne viennent pas en réduction des droits que s’ouvre le salarié au titre de l’indemnisation par l’assurance chômage, sauf en cas de chômage partiel total, pour lequel la durée d’indemnisation maximale est limitée à 182 jours. Exceptionnellement, le salaire de référence servant de base au calcul du montant de l’allocation chômage peut retenir les rémunérations perçues pendant la période précédant le chômage partiel.
L’indemnité de licenciement d’un salarié à la suite d’une période de chômage partiel est calculée sur le salaire qui aurait été versé s’il n’avait pas été placé en position d’activité partielle. De la même manière, l’indemnité de préavis est calculée sur la base du salaire correspondant à la durée légale du travail et non sur le salaire réellement perçu pendant la période de chômage partiel.
Enfin, s’agissant des droits sociaux du salarié placé en activité partielle, il convient tout d’abord de souligner que les allocations de chômage partiel ne sont pas soumises à cotisations sociales. Les heures chômées sont assimilées à des heures travaillées pour l’ouverture et le maintien des droits à l’assurance maladie ; en revanche, un salarié en maladie ne peut cumuler ses indemnités journalières et son allocation de chômage partiel. Ses droits à assurance vieillesse sont ouverts au titre de son revenu d’activité. Enfin, s’agissant de la retraite complémentaire obligatoire, les périodes de chômage partiel font l’objet d’une validation gratuite lorsqu’elles excèdent 60 heures au cours d’une même année.
Enfin, s’agissant des engagements spécifiques pouvant être requis de la part de l’employeur, il est renvoyé à un décret en Conseil d’État pour fixer les modalités de souscription de ces engagements.
On pense ici à l’obligation aujourd’hui imposée à l’employeur dans le cadre de l’APLD : en contrepartie de cette allocation complémentaire, il doit en effet s’engager à maintenir dans l’emploi les salariés concernés pendant une durée équivalente au double de la durée du conventionnement, qui est celle du versement de l’APLD ; il doit en outre organiser un entretien avec chaque salarié en vue de mettre en place des actions de formation. La Cour des comptes a notamment pointé l’actuelle absence totale d’évaluation des résultats du chômage partiel en matière de sauvegarde de l’emploi, en indiquant qu’aucun suivi du maintien en emploi des salariés aidés dans le cadre de l’APLD n’a jamais été instauré.
D’après les informations fournies à votre rapporteur, les contreparties qui pourraient être demandées aux employeurs dans le cadre du nouveau dispositif pourraient dépendre de l’importance du recours à l’activité partielle : dans l’hypothèse d’une première demande de mise en activité partielle, aucune contrepartie spécifique ne serait demandée, au-delà du maintien en emploi des salariés pendant la période d’indemnisation. Dans le cadre d’une deuxième demande, en revanche, des contreparties seraient vraisemblablement exigées de la part de l’entreprise, qui tiendraient compte d’un éventuel accord d’entreprise conclu en la matière, mais également de l’avis des institutions représentatives du personnel sur le nouveau recours au dispositif : ces contreparties pourraient être un maintien dans l’emploi des salariés pendant le double de la période d’indemnisation ; des engagements en termes de formation des salariés ou encore de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ; ou encore, la mise en place d’un plan de redressement de l’entreprise.
Le IV de l’article procède, pour sa part, à une réécriture de l’article L. 5122-2, aujourd’hui consacré aux allocations complémentaires de chômage partiel, autrement dit à l’allocation de conventionnement classique, aujourd’hui résiduelle, et à l’allocation partielle de longue durée (APLD). Il substitue à ces allocations spécifiques, vouées à être fondues dans le dispositif désormais unique de l’allocation d’activité partielle, le volet « formation » du nouvel outil.
Alors que, dans le droit existant, la mention d’une formation n’était prévue qu’à la dernière phrase de l’article L. 5122-1, – qui dispose que durant la période de chômage partiel, « les salariés peuvent suivre des actions de formation en dehors du temps de travail » –, le nouvel outil d’activité partielle sera désormais véritablement assorti d’un volet formation, auquel la nouvelle rédaction de l’article L. 5122-2 sera donc spécifiquement consacrée : celle-ci prévoit que le salarié placé en activité partielle peut bénéficier, pendant les heures chômées, de l’ensemble des actions de formation existantes, dans le cadre du plan de formation. Les actions de formation concernées sont énumérées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 : il s’agit de l’ensemble des actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle et dans le cadre du droit à l’information, à l’orientation et à la qualification professionnelle.
L’ambition de la réforme est d’inciter à la mise à profit de la période d’activité partielle pour engager des actions de formation destinées en particulier à améliorer l’adaptation au poste des salariés. Cette incitation passe par la majoration de l’indemnité versée au salarié dès lors que celui-ci s’engage dans une action de formation, ce qui est déjà le cas pour l’APLD aujourd’hui lorsqu’elle bénéficie à un salarié qui suit une formation. Rappelons en effet qu’aujourd’hui, l’APLD garantit le versement d’une indemnité au moins égale à 75 % de la rémunération brute antérieure, celle-ci étant portée à 100 % de sa rémunération nette de référence en cas de suivi d’une formation pendant les heures d’activité partielle.
Le décret n° 2012-183 du 7 février 2012 a assoupli les conditions de recours à une formation pendant les heures d’activité partielle, en prévoyant que les formations étaient désormais possibles sans limitation de durée et dans les mêmes conditions que celles relatives à la mise en œuvre du plan de formation.
Autrement dit, le IV ne fait que reprendre les dernières évolutions d’ores et déjà apportées au dispositif de chômage partiel en matière de formation, en les intégrant à un système désormais unifié et en leur donnant une valeur législative.
En l’état du texte, rien ne confirme cependant que la majoration ne reste pas à la charge de l’employeur.
Le V abroge l’article L. 5122-3 qui renvoyait au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les contreparties demandées à l’employeur pour le bénéfice de l’APLD, autrement dit, le maintien en emploi des salariés concernés par le chômage partiel pendant au moins le double de la convention APLD et l’organisation d’un entretien individuel avec chacun des salariés concernés, afin d’examiner les actions de formation pouvant être suivies (adaptation au poste, perfectionnement des compétences, bilans de compétences et validation des acquis de l’expérience – VAE –, etc.).
Le VI modifie l’article L. 5122-4 qui précise le régime social et fiscal applicable aux allocations et contributions de chômage partiel, en l’alignant sur le régime des contributions des salariés et des employeurs au système d’assurance chômage prévu à l’article L. 5422-10.
Le régime fiscal et social des allocations de chômage partiel
Actuellement, les allocations spécifiques de chômage partiel, les allocations conventionnelles, l’APLD et les allocations versées au titre de la rémunération mensuelle minimale (RMM) ont le même régime fiscal et social.
En tant qu’allocations d’indemnisation, elles ne sont pas assimilées à un salaire, mais à un revenu de remplacement : elles sont donc exonérées de cotisations sociales et de la taxe sur les salaires (ce point n’est aujourd’hui précisé que pour le reste à charge de l’employeur au titre de l’APLD, au 2° de l’article L. 5122-2) ; elles sont également exonérées du forfait social, car non assimilées à une rémunération ou un gain au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elles sont en revanche assujetties à la CSG sur les revenus de remplacement au taux réduit de 6,2 % après un abattement de 1,75 % et à la CRDS au taux de 0,5 % après abattement de 1,75 %. L’assujettissement à la CSG peut être réduit à 3,8 %, voire exonéré, en fonction des revenus et de la situation fiscale des salariés ou si le prélèvement a pour effet de réduire le montant de l’allocation en dessous du SMIC brut. L’ensemble de ces allocations sont, pour le salarié, soumises à l’impôt sur le revenu.
Dans le sillage de la refonte du dispositif qui conduit à la suppression des diverses allocations actuelles et à leur rassemblement dans une allocation unique, la rédaction choisie substitue aux actuelles « allocations et contributions de chômage partiel » l’unique référence à « l’indemnité versée au salarié ».
Le 2° du VI complète l’article relatif au régime fiscal et social applicable à l’indemnité versée au salarié, en précisant que celle-ci est « cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires ». Parallèlement, la mention de l’allocation de chômage partiel est supprimée au X : il s’agit de l’article L. 5428-1 qui affirme le caractère cessible et saisissable des allocations servies au titre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), de l’allocation de chômage partiel, de l’allocation d’assurance chômage et de l’allocation de préretraite.
Le VII modifie l’article L. 3232-5 qui concerne la rémunération mensuelle minimale (RMM), en substituant aux actuelles références aux allocations légales et conventionnelles de chômage partiel la référence à la future unique indemnité d’activité partielle.
La rémunération mensuelle minimale (RMM)
Lorsqu’un salarié a perçu, au cours d’un mois, en cumulant salaire et allocations au titre du chômage partiel, une somme totale inférieure au SMIC net, l’employeur doit lui allouer une allocation complémentaire destinée à combler l’écart entre les deux.
L’ouverture de la rémunération mensuelle minimale (RMM) est automatique et de droit : elle n’est soumise à aucune formalité ou autorisation préalable.
Elle s’applique dans toute situation de réduction d’horaire en dessous de la durée légale du travail ou d’arrêt complet d’activité au titre du chômage partiel. La rémunération mensuelle minimale ne s’applique qu’aux salariés à temps plein, à l’exclusion donc des salariés à temps partiel, des salariés temporaires et des apprentis. Elle s’établit à 1 120,45 euros par mois (7,39 euros par heure) au 1er janvier 2013. L’allocation complémentaire de rémunération mensuelle minimale est donc égale à la différence entre ce montant et l’ensemble des allocations d’activité partielle perçues par le salarié.
Une prise en charge par l’État, à hauteur de 50 % de l’allocation complémentaire de la rémunération mensuelle minimale, peut être demandée par l’employeur : le montant cumulé de ce remboursement ne peut pas, en tout état de cause, excéder la moitié de la différence entre le SMIC net et le salaire net perçu par le salarié. L’État peut néanmoins être amené à assurer la prise en charge de la totalité de l’allocation complémentaire de la rémunération mensuelle minimale dans l’hypothèse d’une entreprise en procédure de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire ou de difficultés financières particulières.
Le VIII abroge la section 4 du chapitre II du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, autrement dit, supprime la prise en charge par l’État d’une partie de l’allocation complémentaire au titre de la rémunération mensuelle minimale (article L. 3232-8).
En effet, le recours à celle-ci dans le cadre de la mise en œuvre de l’activité partielle, s’est révélé très marginal, de l’ordre de quatre à cinq cas par an, dans la mesure où, comme le précise l’étude d’impact associée au présent projet de loi, « le niveau de l’allocation est proportionnellement élevé par rapport au taux du SMIC horaire actuel » (cf. page 121).
On notera également la modification de la référence au dispositif de chômage partiel prévue à l’article L. 3232-2, dans le cadre du rapport annuel annexé au projet de loi de finances sur la mise en œuvre de la rémunération mensuelle minimale : ce rapport doit en particulier présenter le nombre de salariés bénéficiaires de l’allocation complémentaire au titre de la rémunération mensuelle minimale, ainsi que le coût qu’elle a représenté ; il doit en outre préciser le nombre de salariés bénéficiaires d’allocations au titre du chômage total et du chômage partiel. C’est donc ce dernier point qui fait l’objet d’une modification rédactionnelle, la notion d’activité partielle se substituant à celle de chômage partiel.
Enfin, le XI modifie la référence au chômage partiel à l’article L. 242-10 du code de la sécurité sociale, qui énumère les règles particulières applicables aux cotisations sociales sur les rémunérations des salariés à temps partiel. L’abattement d’assiette applicable sur les cotisations sociales pour les salariés à temps partiel ne s’applique pas aux allocations servies au titre de l’activité partielle.
Du point de vue de l’objectif de maintien de l’emploi dans un contexte de difficultés économiques conjoncturelles, on voit que le dispositif de l’activité partielle est très complémentaire de l’outil que constitueront demain les accords de maintien de l’emploi, aménagés par l’article 12 du présent projet. Votre rapporteur souhaite d’ailleurs qu’il soit explicitement prévu que l’indemnisation au titre de l’activité partielle puisse être utilisée par une entreprise en difficulté qui aurait par ailleurs procédé à une réduction de l’horaire de travail de ses salariés en contrepartie de son engagement de maintenir les emplois. Les deux dispositifs pourront donc bien coexister pendant une période de sous-emploi ou être utilisés par une entreprise de manière alternative. On peut même imaginer que les accords de maintien dans l’emploi aménagent les contreparties exigées de l’entreprise dans le cadre de la mise en œuvre de l’activité partielle.
*
* *
Lors de son examen du projet de loi, votre commission a adopté un amendement des commissaires du groupe UDI à cet article, prévoyant que dans un délai d’un an, un rapport serait remis au Parlement pour renforcer l’attractivité du dispositif d’activité partielle.
*
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AS 139 de Mme Jacqueline Fraysse, tendant à supprimer l’article 11.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS 347 à AS 357 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AS 74 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. Faute de proposer une modification du financement qui tomberait sous le coup de l’article 40 de la Constitution, l’amendement vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur le chômage partiel au regard notamment de son coût pour l’employeur. Le chômage partiel est peu utilisé en France, et il coûte beaucoup plus cher et est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre qu’en Allemagne.
M. le rapporteur. Beaucoup de rapports ont paru sur ce sujet. Je préférerais une réflexion ciblée sur les questions qui ont soulevé le plus de débats, comme la taxation des contrats à durée déterminée, la mobilité, les accords de maintien de l’emploi. Cela dit, avis favorable pour peu que vous remplaciez les mots : « chômage partiel » par les mots : « activité partielle » – sans quoi vous encourrez la sanction du ministre du travail !
M. Denys Robiliard. L’amendement donne la priorité à la question du coût pour l’employeur. Il est plus pertinent d’envisager l’activité partielle sous tous ses aspects.
M. le rapporteur. Je propose une seconde modification supprimant la référence au coût pour l’employeur.
M. Francis Vercamer. D’accord. L’objectif est de développer l’activité partielle au lieu de licencier.
La Commission adopte l’amendement AS 74 ainsi rectifié.
Puis elle adopte l’article 11 modifié.
Article 12
(art. L. 5125-1 à L. 5125-6 [nouveaux] du code du travail)
Accords de maintien de l’emploi
Les accords de maintien dans l’emploi offrent un nouveau cadre juridique spécifique aux entreprises confrontées à de graves difficultés économiques conjoncturelles, en leur permettant, par le biais du dialogue social dans l’entreprise, de conclure un accord destiné à mettre en place, pour une durée limitée à deux ans, un nouvel équilibre global entre temps de travail, salaires et emploi. Il s’agit par exemple de pouvoir temporairement diminuer les salaires et le temps de travail, afin d’éviter des licenciements économiques, des suppressions d’emploi, et pour permettre à l’entreprise de passer un « cap difficile ».
Il serait faux de dire qu’aucun cadre juridique n’existe aujourd’hui dans ce type de situations : en effet, les entreprises en difficulté (ou pas) peuvent aujourd’hui déjà conclure des accords d’aménagement du temps de travail et, ce faisant, ajuster à la baisse les salaires.
Il existe également d’autres outils à la disposition des entreprises confrontées à des difficultés économiques conjoncturelles et leur permettant de ne pas recourir au licenciement économique : chômage partiel, plans de départs volontaires, etc. L’article 11 du présent projet procède d’ailleurs, on l’a vu, à une refonte globale de l’outil que constitue l’activité partielle, afin de le rendre plus facilement mobilisable par les entreprises en difficulté.
Le régime unique d’aménagement du temps de travail
sur plusieurs semaines ou sur l’année
Créé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ce dispositif s’est substitué, sous réserve du maintien des accords conclus avant l’entrée en vigueur de la loi, aux dispositifs préexistants : modulation, cycle de travail, réduction du temps de travail sous forme de jours de repos et travail à temps partiel modulé.
Ce régime, codifié à l’article L. 3122-2 du code du travail, peut être mis en place par accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, ces premiers pouvant déroger in pejus aux stipulations d’un éventuel accord de branche. L’accord en question doit prévoir :
– les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail ;
– les limites du décompte des heures supplémentaires ;
– les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
L’accord peut faire varier la durée du travail sur l’année, une partie de l’année ou plusieurs semaines, et peut prévoir des jours de réduction du temps de travail.
Le régime applicable aux heures supplémentaires dépend de la durée de référence retenue pour l’application de l’aménagement du temps de travail : s’il s’agit de l’année, les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord (à défaut, aucune heure supplémentaire n’est décomptée en cours d’année), et en fin de période, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l’accord déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année. S’il s’agit d’une période de plusieurs semaines, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée éventuellement par l’accord (le cas échéant, aucune heure supplémentaire n’est décomptée à ce titre), et les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence fixée par l’accord déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées.
L’accord peut prévoir un lissage de la rémunération ; toutefois, les heures supplémentaires demeurent rémunérées chaque mois.
La période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés peut être différente de celle de droit commun (du 1er juin au 31 mai de l’année suivante) ; un mécanisme de report des congés jusqu’au 31 décembre de l’année suivante peut également être prévu par accord.
En l’absence d’accord collectif, un régime supplétif existe qui permet aujourd’hui à l’employeur d’organiser la durée du travail de l’entreprise ou de l’établissement sous forme de périodes de travail, chacune de quatre semaines au plus. Un programme indicatif de la variation de la durée du travail est soumis dans un premier temps par l’employeur à l’avis du comité d’entreprise ou aux délégués du personnel. Dans ce cas, la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel effectué : elle est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires, avec, le cas échéant, la rémunération des heures supplémentaires, soit les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine et au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence d’au plus quatre semaines déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées.
L’article 12 du projet introduit un nouveau chapitre 5 dans le titre II du livre premier de la cinquième partie du code du travail. Il s’agit de la partie du code consacrée à l’emploi, plus précisément, aux dispositifs en faveur de l’emploi, et en particulier aux aides au maintien et à la sauvegarde de l’emploi : les accords de maintien de l’emploi ont donc vocation à compléter les aides existantes en matière d’adaptation des salariés aux évolutions de l’emploi et des compétences, de chômage partiel (également modifié par le présent projet de loi), ainsi que de reclassement et de conversion professionnelle.
1. La situation de départ
Le texte de l’article 12 (nouvel article L. 5125-1 du code du travail) définit le contexte applicable aux éventuels futurs accords de maintien de l’emploi, invoquant l’existence d’une « grave difficulté conjoncturelle », dont le constat est établi sur la base d’un diagnostic « analysé avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise », l’accord national interprofessionnel renvoyant quant à lui à la notion de « diagnostic partagé ». L’annexe à l’article 17 incluse dans l’accord parle également de « difficultés, prévisibles ou déjà présentes, susceptibles de mettre en danger l’emploi et/ou la survie de l’entreprise » et évoque une « analyse de la situation » « partagée avec les partenaires sociaux », allant même jusqu’à prévoir une anticipation des situations qui justifient le recours aux accords de maintien de l’emploi lors des réunions trimestrielles et annuelles avec le comité d’entreprise et la communication à cette instance des données relatives à la situation économique et financière de l’entreprise. Votre rapporteur s’interroge sur cette absence du projet de loi d’une dimension de l’accord national interprofessionnel qui lui paraissait importante.
Le lien entre le contexte d’un accord de maintien de l’emploi et le motif économique
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, qui concerne le licenciement d’un salarié pour motif économique, celui-ci recouvre des difficultés économiques ou des mutations technologiques. La jurisprudence a été amenée à préciser ce que recouvrent ces deux notions : s’agissant des difficultés économiques, si le juge n’exige pas que la situation de l’entreprise soit catastrophique, il s’assure néanmoins que les difficultés rencontrées sont réelles et sérieuses et ne résultent pas d’un manquement de l’employeur. S’agissant de la notion de mutation technologique, il peut s’agir de l’introduction d’une technologie nouvelle comportant une incidence sur l’emploi, quand bien même la compétitivité de l’entreprise ne serait pas menacée.
Outre ces deux notions, le juge reconnaît également un motif économique dans la réorganisation d’une entreprise, si et dans la mesure où elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Enfin, la cessation d’activité d’une entreprise peut valoir motif économique si celle-ci est totale, définitive et ne résulte pas de la faute de l’employeur.
On ne saurait totalement séparer le contexte de « grave difficulté conjoncturelle » et la définition du motif économique tel qu’issu du code du travail : on peut toutefois estimer que la notion de « grave difficulté conjoncturelle » est beaucoup moins large que celle de « difficultés économiques ou de mutations technologiques » : elle en est en quelque sorte une sous-catégorie, limitée à des difficultés économiques et financières ponctuelles pour l’entreprise. En particulier, toute mutation technologique ayant un impact sur l’emploi ou l’environnement de l’entreprise doit être considérée comme une difficulté structurelle : elle n’entre donc pas dans le champ des potentiels accords de maintien de l’emploi.
Le deuxième alinéa du nouvel article L. 5125-1 précise également que les organisations syndicales peuvent être accompagnées d’un expert-comptable mandaté par le comité d’entreprise pour les aider dans l’analyse du diagnostic et dans la négociation. Le renvoi à l’article L. 2325-35 permet bien de faire peser sur l’entreprise la charge relative aux frais d’expertise : cet article est en effet modifié par le XXXVIII de l’article 13 du présent projet de loi, qui renvoie explicitement à l’expertise auprès du comité d’entreprise pour la préparation de la négociation d’un accord de maintien de l’emploi.
2. Les modalités de la négociation
Le II du nouvel article L. 5125-4 précise la procédure applicable à la négociation d’un accord de maintien de l’emploi.
L’accord de maintien de l’emploi est soit un accord signé par les syndicats majoritaires dans l’entreprise, soit en l’absence de délégué syndical, par un ou des représentants élus du personnel mandatés par un ou des syndicats représentatifs dans la branche ou au niveau national et interprofessionnel ; en l’absence de représentants élus du personnel, il peut être conclu par un ou des salariés mandatés par des syndicats représentatifs dans la branche ou au niveau national et interprofessionnel.
Le premier cas de figure concerne les entreprises dotées d’un délégué syndical. Pour ces entreprises, le projet de loi prévoit que l’accord de maintien de l’emploi est obligatoirement un accord majoritaire, c’est-à-dire signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. Cette règle de majorité est exorbitante du droit commun : en effet, la règle qui prévaut aujourd’hui pour les accords d’entreprise, prévue à l’article L. 2232-12 du code du travail, pose le double principe d’une signature par un ou plusieurs syndicats ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans le cadre des mêmes élections, ainsi que de l’absence d’opposition d’un ou de plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. On reviendra sur cette spécificité.
Le deuxième cas de figure concerne les entreprises dépourvues de délégué syndical et qui engagent la négociation avec un ou plusieurs représentants élus du personnel. Dans ce cas de figure, les représentants élus du personnel appelés à négocier sont « expressément mandatés à cet effet » par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par un ou plusieurs syndicats représentatifs au niveau national et interprofessionnel.
Il s’agit d’une procédure distincte de celle qui existe déjà aujourd’hui et qui permet aux entreprises dépourvues de délégué syndical de conclure un accord avec des représentants du personnel : d’une part, cette procédure est réservée aux entreprises de moins de 200 salariés ; d’autre part, la négociation est dans ce cas menée avec les représentants élus du personnel au comité d’entreprise ou la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel. Enfin, on notera que la validité d’un tel accord est en outre conditionnée à son approbation par une commission paritaire de branche. Cette procédure est prévue aux articles L. 2232-21 à L. 2232-23.
La procédure prévue avec les représentants élus du personnel pour la conclusion d’accord de maintien de l’emploi est donc une procédure sui generis, qui donne plus de poids aux organisations syndicales.
Enfin, troisième cas de figure, en l’absence de représentants élus du personnel, la négociation d’un accord de maintien de l’emploi peut être ouverte avec un ou plusieurs salariés mandatés. Dans ce cas, ce sont un ou des salariés expressément mandatés par les syndicats représentatifs dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel, qui peuvent être amenés à négocier des accords de maintien en emploi, conformément cette fois au dispositif d’ores et déjà prévu à l’article L. 2232-26 du code du travail. Autrement dit, cette option de négociation suppose bien, pour que l’accord soit validé, qu’il soit approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. La seule différence a priori qui existerait pour les accords de maintien de l’emploi serait la possibilité de mandater un ou des salariés par les syndicats au niveau national et interprofessionnel.
On notera que pour chacune des deux dernières options, l’accord du 11 janvier n’avait pas prévu de possibilité de mandatement par les organisations syndicales nationales et interprofessionnelles. Seules les organisations au niveau de la branche étaient visées. Le recours à la désignation éventuelle par une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel est en réalité destiné à tenir compte de la situation des entreprises qui n’appartiennent à aucune branche professionnelle.
Le troisième alinéa du II du nouvel article L. 5125-4 précise ensuite la condition de validité de l’accord signé par un représentant du personnel mandaté ou par un salarié mandaté, en l’occurrence l’approbation de cet accord par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
La délégation par une organisation syndicale d’un représentant élu du personnel ou d’un salarié fait l’objet, dans l’accord national interprofessionnel, d’un encadrement : il est en effet précisé que les organisations syndicales précisent les modalités des relations entretenues par le ou les mandatés dans le cadre de la négociation, la délégation ne valant que pour l’objet précis de cette négociation ; en outre, le temps consacré par le ou les mandatés à la négociation est payé comme du temps de travail, de même que le temps éventuellement consacré à ses relations avec l’organisation syndicale mandante, dans la limite de dix heures. Enfin, lorsqu’il s’agit d’un salarié non représentant élu du personnel, il bénéficie de la même protection que les représentants du personnel pendant la durée de la négociation mais également pendant toute la durée de l’accord.
Le projet de loi reprend, concernant cet encadrement :
– la disposition relative à la rémunération comme du temps de travail du temps consacré par le ou les mandatés à la négociation : ainsi, le III du nouvel article L. 5125-4 prévoit que le temps passé aux négociations de l’accord de maintien de l’emploi n’est pas imputé sur les heures de délégation prévues aux articles L. 2315-1 (pour les délégués du personnel) et L. 2325-6 (pour les représentants au comité d’entreprise). Cette précision ne vaut que pour les représentants élus du personnel.
– la durée, fixée à un maximum de dix heures par mois, de temps disponible pour l’exercice des fonctions de salarié mandaté ou de représentant élu du personnel mandaté, dans les conditions fixées par l’article L. 2232-25 (qui ne concerne que les salariés mandatés).
– la règle de protection contre le licenciement du représentant élu du personnel mandaté ou du salarié mandaté est également expressément rappelée : on peut s’interroger sur la nécessité de préciser ce point. En effet, aux termes de des articles L. 2411-1 et suivants, le licenciement d’un délégué du personnel ou d’un membre du comité d’entreprise (mais également d’un représentant syndical ou d’un représentant des salariés au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – CHSCT) est soumis à la consultation du comité d’entreprise ; en l’absence de ce dernier, l’inspecteur du travail est directement saisi : il doit en effet autoriser le licenciement. Autrement dit, même en dehors de tout mandat, le représentant élu du personnel est un salarié protégé : il le reste donc a fortiori dans le cadre de son mandat. S’agissant des salariés mandatés, l’article L. 2411-4 prévoit, au même titre que pour les délégués syndicaux, que seule l’autorisation de l’inspecteur du travail est requise, sans consultation préalable nécessaire du comité d’entreprise. Néanmoins, d’une part, comme la procédure de mandatement prévue ici diffère de la procédure de mandatement de droit commun, et que, d’autre part, les représentants du personnel sont protégés uniquement au titre de leur mandat d’élu, il est apparu souhaitable de préciser que leur protection contre le licenciement s’étendait bien au cadre du mandat prévu par le présent article.
3. Le contenu de l’accord de maintien de l’emploi
Le projet de loi définit les « termes » généraux de l’accord, en précisant d’une part que l’employeur s’engage à « maintenir les emplois pendant la durée de validité de l’accord », tandis que d’autre part, un aménagement de la durée du travail, de ses modalités d’organisation et de répartition ainsi que de la rémunération des salariés occupant ces emplois peut être prévu en contrepartie.
● Le champ de l’accord
Il convient avant tout de préciser que le champ d’application de l’accord est limité à l’entreprise ; il ne peut aucunement s’inscrire dans le cadre d’un groupe de sociétés. Par ailleurs, l’accord d’entreprise en question peut concerner tous les salariés de l’entreprise ou une partie d’entre eux seulement : dans ce second cas de figure, l’employeur s’engage à maintenir les seuls emplois concernés par l’accord, tandis que l’aménagement des conditions de travail opéré (qu’il s’agisse de la durée du travail ou de la rémunération) ne concerne que les seuls salariés occupant ces emplois. La logique à l’œuvre est la même que celle qui préside au recours au dispositif de l’activité partielle.
● La durée de l’accord
Les accords de maintien de l’emploi sont des accords « transitoires » : leur durée est déterminée ; en l’occurrence, le premier alinéa du III du nouvel article L. 5125-1 précise qu’elle ne saurait excéder deux ans, sans possibilité de renouvellement aucune. En effet, on peut raisonnablement estimer qu’au-delà de deux ans, une entreprise qui n’a pas réussi à surmonter ses difficultés conjoncturelles bascule en réalité dans des difficultés structurelles.
● Les dispositions devant être respectées par l’accord
Le I du nouvel article L. 5125-1 précise que l’accord de maintien de l’emploi peut procéder aux aménagements prévus sous réserve de respecter :
– le principe de la hiérarchie des normes en vertu duquel un accord d’entreprise ne peut déroger aux accords de niveau supérieur (accords de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels) en matière de salaires minima, de classification, de garanties collectives complémentaires et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle (article L. 2253-3) ;
– les règles régissant le temps de pause (article L. 3121-33), les durées
– quotidienne et hebdomadaire – maximales de travail (articles L. 3121-34 à L. 3121-36), les durées – quotidienne et hebdomadaire – maximales de travail de nuit (articles L. 3122-34 et L. 3122-35), le repos quotidien et hebdomadaire (articles L. 3131-1 à L. 3132-2), le 1er mai comme jour férié et chômé (article L. 3133-4), le droit aux congés payés (articles L. 3141-1 à L. 3141-3), ainsi que le SMIC (article L. 3231-2).
L’accord du 11 janvier prévoyait en effet que l’accord ne pouvait « déroger aux éléments de l’ordre public social, tels que, notamment, le SMIC, la durée légale, les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, le repos quotidien et hebdomadaire, les congés pays légaux, ainsi que la législation relative au 1er mai ». L’ensemble de ces éléments sont donc repris par le premier alinéa du nouvel article L. 5125-1, à l’exception de la disposition relative à la durée légale du travail, dont on pourrait considérer qu’il y est de manière indirecte renvoyé à travers la mention du SMIC, la fixation du SMIC horaire se faisant sur la base de la durée légale de travail. Toutefois, votre rapporteur juge ce renvoi indirect insuffisant et souhaite que la mention expresse de la durée légale du travail figure dans les principes de l’ordre public social devant être respectés par l’accord de maintien de l’emploi.
Le premier alinéa du II du nouvel article L. 5125-1 précise également que l’accord ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération des salariés lorsque celle-ci est inférieure ou égale au SMIC horaire majoré de 20 % ou lorsqu’elle est supérieure, de la ramener en deçà de ce niveau. Si l’accord du 11 janvier prévoyait bien que « l’arbitrage résultant d’un accord de maintien dans l’emploi ne peut avoir d’impact sur les salaires inférieurs à 1,2 SMIC », il restait muet sur les rémunérations supérieures qui pouvaient, du fait de l’application de l’accord, se trouver réduites à un niveau inférieur à 1,2 SMIC : il s’agit donc bien, sur ce dernier point, d’un ajout du projet de loi, que votre rapporteur approuve, cela étant, pleinement.
● La « symétrie des formes » à l’égard de la rémunération des mandataires sociaux et des actionnaires.
Évoquée par l’accord national interprofessionnel, cette « symétrie des formes » reste néanmoins très vague. Le projet de loi aménage cette disposition, en précisant que l’accord prévoit les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant des responsabilités dans le périmètre de l’accord participent aux efforts demandés aux salariés, notamment en termes de rémunération, ainsi que « des stipulations équivalentes pour la rémunération des mandataires sociaux et le versement des dividendes aux actionnaires ». Autrement dit, si l’accord devra obligatoirement comporter des mesures relatives à la rémunération des dirigeants salariés et des mandataires sociaux et aux dividendes versés aux actionnaires, aucune fourchette n’est précisée. L’accord gardera donc toute latitude pour juger de ce qui constitue une « équivalence » des efforts demandés à chacun : dans la mesure où il constituera le fruit de la négociation, on peut s’attendre à ce qu’une interdiction pendant une durée limitée du versement de dividendes ou une diminution dans les mêmes proportions que celles demandées aux salariés de la rémunération des dirigeants et des mandataires sociaux puissent toutes deux être négociées. On peut toutefois s’interroger sur l’opportunité de préciser les bornes dans lesquelles cette « symétrie des formes » doit intervenir.
Des modalités de suivi par les salariés de cette « symétrie des efforts » devraient également pouvoir être envisagées, et ce, d’autant plus que l’accord prévoyait bien la mise en place d’un suivi régulier de l’évolution de la situation économique de l’entreprise et de la mise en œuvre de l’accord par ses signataires : votre rapporteur estime qu’une information délivrée régulièrement aux institutions représentatives du personnel ou aux organisations syndicales représentatives sur l’effectivité de ces efforts est indispensable, afin de mettre les salariés en mesure de s’assurer de la mise en œuvre loyale de l’accord.
On remarquera que le nouvel article L. 5125-3 dispose que « les organes de direction de l’entreprise sont informés du contenu de l’accord (…) lors de leur première réunion suivant sa conclusion. ». Cette information destinée, d’après l’accord du 11 janvier, à « maintenir la solidarité et la motivation à l’intérieur de l’entreprise », aurait principalement pour objet de présenter au conseil d’administration et à l’assemblée générale les efforts demandés aux actionnaires et aux mandataires sociaux, dans le souci de parallélisme des formes déjà évoqué.
On notera enfin que l’accord du 11 janvier prévoyait que les négociations devraient « prendre en compte les contraintes d’ordre privé que peuvent supporter les salariés » : cette disposition n’a pas été reprise par le projet de loi, dans la mesure où elle reviendrait à fixer des critères à la négociation, et à contraindre cette dernière. Il est toutefois regrettable que cette dimension n’apparaisse pas dans le texte de loi (outre de savoir ce qu’elle aurait dès lors pu réellement recouvrir).
● La clause de retour à meilleure fortune
Le second alinéa du III du nouvel article L. 5125-1 dispose que l’accord doit prévoir les conséquences d’une amélioration de la situation économique de l’entreprise sur la situation des salariés soit à l’issue de sa période d’application, soit dans l’hypothèse d’une suspension de l’accord pendant son application.
Si le contexte de difficulté conjoncturelle se maintient pendant la durée de l’accord, à l’issue de cette durée, les salariés retrouvent la pleine application de leur contrat de travail, dont certaines stipulations avaient été suspendues par l’accord. Il y a retour à la situation initiale, ex ante, préalable à l’accord. En revanche, si la situation économique de l’entreprise s’améliore pendant la durée d’application de l’accord, ce dernier doit prévoir ce qu’il se passe, de même qu’il doit prévoir ce qu’il se passe à l’issue de l’application de l’accord, en cas de retour à meilleure fortune de l’entreprise.
Pour que ces dispositions puissent trouver une application concrète, une sorte de bilan de la situation de l’entreprise doit pouvoir être réalisé à l’arrivée à échéance de l’accord, qui doit permettre de constater une éventuelle amélioration de la situation économique de l’entreprise. En effet, autant, si la situation économique s’améliore pendant la période d’application de l’accord, la procédure de mise en cause prévue au nouvel article L. 5125-5 permettra de disposer d’une sorte de sanction juridique du constat de cette amélioration, autant ce diagnostic ne sera-t-il pas automatiquement attesté une fois que l’accord sera arrivé à son terme.
Quant à savoir ce que recouvrent ces « conséquences » de l’amélioration de la situation de l’entreprise sur la situation des salariés, on ne peut que renvoyer à l’accord du 11 janvier, qui évoquait des « garanties telles que le partage du bénéfice économique de l’accord arrivé son échéance ».
● La clause pénale
Le projet de loi prévoit, conformément à l’accord du 11 janvier, que l’accord de maintien de l’emploi comporte une clause pénale au sens de l’article 1226 du code civil, entendue donc comme une clause « par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution ». Autrement dit, il s’agit d’une clause contractuelle ayant pour but de déterminer la sanction pécuniaire applicable dans le cas où l’une des parties n’exécuterait pas ses obligations. Cette clause est donc improprement appelée « pénale » : elle n’a, dans le cas présent, vocation à concerner que les seuls engagements de l’employeur relatifs au maintien de l’emploi, le texte du projet de loi précisant qu’elle « donne lieu au versement de dommages et intérêts aux salariés lésés dont le montant et les modalités d’exécution sont fixés dans l’accord. ».
D’une part, cette clause est bien asymétrique : elle n’a logiquement lieu d’être appliquée qu’en cas de manquement de l’employeur. Le seul cas de manquement du salarié à ses engagements serait celui de son refus de se voir appliquer l’accord, cas dans lequel le texte prévoit une procédure particulière, celle du licenciement individuel pour motif économique. D’autre part, il est précisé que la clause pénale trouve à s’appliquer en cas de non-respect par l’employeur de ses « engagements de maintien de l’emploi ». Or, dans le cadre d’un tel accord de maintien de l’emploi, on peut supposer que les nouvelles conditions de durée du travail ou de rémunération du salarié aillent de pair avec d’autres contreparties que le seul maintien en emploi : en effet, un employeur pourrait par exemple s’engager, en contrepartie de l’augmentation de la durée du travail demandée aux salariés, à leur octroyer une plus grande souplesse dans leurs horaires. En cas de non-respect de cet engagement, il serait légitime que la clause pénale trouve aussi à s’appliquer, dans la mesure où un tel engagement est constitutif de l’équilibre des concessions consenties par chacune des parties.
Comme toute clause de nature contractuelle, si les parties n’exécutent pas elles-mêmes leurs obligations respectives, il appartiendrait alors au juge de rendre une décision permettant l’exécution forcée de cette clause, étant précisé que le juge a toujours à cette occasion, la faculté de moduler les sommes dues en application de cette clause si elle est « manifestement excessive ou dérisoire », aux termes de l’article 1152 du code civil.
4. Les conditions de validité de l’accord
En premier lieu, aux termes du premier alinéa du III du nouvel article L. 5125-1, la validité de l’accord est soumise à la condition que l’employeur ne procède, pendant la durée de l’accord, à aucune rupture du contrat de travail pour motif économique des salariés auxquels l’accord s’applique. Il s’agit en quelque sorte de la condition sine qua non qui justifie à la fois le recours à un tel accord « de maintien de l’emploi » et qui est constitutive de l’engagement même de l’employeur. Cette condition est déjà formulée dans la définition même de l’accord figurant au I du nouvel article L. 5125-1, la disposition ici prévue étant simplement destinée à la préciser : en effet, « maintenir les emplois » signifie donc bien que l’employeur peut toujours, pendant ce laps de temps, procéder à un licenciement pour motif personnel d’un ou de plusieurs salariés (pour faute ou pour insuffisance, par exemple), quand bien même ceux-ci seraient dans le champ de l’accord. La seule interdiction porte sur le licenciement pour motif économique des seuls salariés entrant dans le champ de l’accord : autrement dit, le licenciement économique d’un salarié n’entrant pas dans son champ reste possible, s’il s’agit d’un accord portant sur une partie seulement des salariés.
Dans le cadre des travaux menés par votre rapporteur, un certain nombre d’interlocuteurs ont pu s’interroger sur l’étendue de l’engagement de l’employeur, arguant du fait que le seul engagement de maintien des emplois laisse celui-ci libre de mettre en place un plan de départs volontaires ou de départs en retraite anticipée. Afin de se prémunir contre cette politique de flexibilité dans le cadre d’un accord dont l’objectif premier est le maintien de l’emploi, on pouvait suggérer d’adjoindre à l’engagement de maintien de l’emploi celui du maintien des effectifs, ce qui aurait contraint l’employeur qui aurait souhaité provoquer des départs volontaires à remplacer ces emplois devenus vacants. Il serait toutefois paradoxal qu’une entreprise en difficulté conjoncturelle demande des efforts à ses salariés en place alors qu’elle pourrait les éviter ou leur substituer des départs volontaires.
En second lieu, le I du nouvel article L. 5125-4 dispose que, par dérogation aux conditions de droit commun de validité des accords collectifs d’entreprise, l’accord de maintien de l’emploi doit avoir été signé « par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ». Il s’agit donc d’une condition de majorité renforcée par rapport aux dispositions de droit commun prévues à l’article L. 2232-12 : en effet, de manière générale, un accord est considéré comme majoritaire s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des mêmes élections, quel que soit le nombre de votants, et en l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. À la double condition traditionnelle 30 % des suffrages pour les signataires / absence d’opposition des syndicats majoritaires à 50 %, se substitue une seule et unique condition, plus restrictive : la signature par des syndicats majoritaires à 50 %.
Il s’agit donc bien d’une majorité renforcée qui est exigée pour qu’un accord de maintien de l’emploi puisse s’appliquer : cette condition plus drastique est liée à la spécificité de ces accords qui conduisent à une modification substantielle du contrat de travail des salariés, puisque autant la durée de travail que le niveau de la rémunération peuvent être modifiés par un tel accord.
5. Les effets de l’accord de maintien de l’emploi
Conformément aux souhaits de l’accord du 11 janvier, le projet de loi précise que les termes de l’accord s’imposent au contrat de travail, en ce sens que les dispositions du contrat de travail contraires à l’accord se trouvent suspendues pendant la durée d’application de ce dernier, mais que l’application de l’accord au contrat de travail individuel requiert l’accord individuel du salarié. Le raisonnement sous-jacent est ici que l’application au contrat de travail des dispositions de l’accord constitue une modification du contrat de travail, et non un simple changement des conditions de travail du salarié : elle est donc subordonnée à l’accord de l’intéressé.
Le IV du nouvel article L. 5125-1 précise que l’accord détermine le délai et les modalités de l’acceptation ou du refus par le salarié de l’application des stipulations de l’accord à son contrat de travail.
Autrement dit, ces modalités seront des modalités négociées : on peut s’interroger sur la nécessité d’encadrer ces modalités, dans la mesure où dans le cadre d’une modification du contrat de travail pour motif économique, le code du travail prévoit une procédure très précise de recueil de l’avis du salarié. En l’occurrence, aux termes de l’article L. 1222-6, l’employeur doit proposer à chaque salarié concerné la modification envisagée par lettre recommandée avec avis de réception, en lui précisant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. À défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée, s’il s’agit d’une modification collective (ce qui est bien le cas en l’espèce). S’il s’agit d’une modification individuelle de son contrat, un accord exprès du salarié est requis, l’employeur devant pouvoir apporter la preuve de cette acceptation.
Dans le cas d’un accord de maintien de l’emploi, c’est donc l’accord lui-même qui fixera le délai et les modalités de recueil de l’avis du salarié : autrement dit, il pourra opter pour une acceptation implicite passé un certain délai, ce qui n’est pas aujourd’hui possible en cas de modification substantielle du contrat. La différence réside néanmoins dans le fait que la notion de modification du contrat de travail concerne une modification pérenne, les parties ne pouvant exiger le retour aux conditions initiales en cas d’acceptation de la modification, ce qui n’est pas le cas de la modification constituée par l’accord de maintien de l’emploi, qui n’a d’effet que suspensif sur les clauses du contrat qui lui sont contraires.
En effet, le premier alinéa du nouvel article L. 5125-2 précise que pour les salariés qui l’acceptent, les stipulations de l’accord sont applicables à son contrat de travail, ce qui se traduit concrètement par la suspension, pendant la durée d’application de l’accord, des clauses du contrat contraires à l’accord.
A contrario, le refus du salarié de se voir appliquer l’accord de maintien de l’emploi occasionne un licenciement individuel pour motif économique. En cas de refus d’application de l’accord au contrat de travail, il s’ensuit donc une rupture du contrat, qui s’analyse en un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d’accompagnement que doit par ailleurs prévoir l’accord.
Plusieurs remarques doivent ici être formulées.
Rappelons d’abord que d’après l’article 18 de l’accord du 11 janvier, « en cas de refus du salarié des mesures prévues par l’accord, la rupture de son contrat de travail qui en résulte s’analyse en un licenciement économique dont la cause réelle et sérieuse est attestée par l’accord précité ». Sur ce point, le projet de loi s’écarte, notablement même, de la rédaction choisie par les partenaires sociaux : en réalité, la préqualification d’un licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse semble à la fois contrevenir à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit à un procès équitable, à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif au droit à un recours effectif, à l’article 24 de la Charte sociale européenne relatif au droit à la protection des travailleurs en cas de licenciement, et aux articles 8-1 et 9-1 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le licenciement, qui posent respectivement le droit au recours contre tout licenciement estimé injustifié par un travailleur et l’habilitation du juge à examiner les motifs invoqués pour justifier le licenciement. En effet, en affirmant que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse en raison de l’existence de l’accord de maintien de l’emploi, toute possibilité de recours du salarié contre son licenciement était rendue impossible.
Ensuite, l’accord de maintien de l’emploi est suscité par un contexte de difficulté économique : il est donc logique que le licenciement d’un salarié ayant refusé l’application à son contrat de travail des termes de l’accord s’analyse comme un licenciement économique. La qualification de licenciement « individuel » pour motif économique a pour effet, dans le cas d’un tel accord collectif, de dispenser l’employeur des procédures collectives. Aujourd’hui, un employeur qui licencie au moins dix salariés ayant refusé une proposition de modification de leur contrat pour motif économique doit mettre en œuvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique et établir, le cas échéant (si l’entreprise compte plus de 50 salariés), un plan de sauvegarde de l’emploi. En termes de protection du salarié, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou d’un licenciement collectif, le salarié bénéficie des mesures de reclassement incombant à l’entreprise. En revanche, si le licenciement de plus de dix salariés ayant refusé l’application de cet accord s’analyse comme une juxtaposition de licenciements individuels, cela permet à l’employeur de s’exonérer de la procédure de mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi, s’il s’agit d’une entreprise de plus de 50 salariés, de la consultation des délégués du personnel, s’il s’agit d’une entreprise de moins de 50 salariés.
Le projet de loi prévoit toutefois que le salarié licencié bénéficie des mesures d’accompagnement que doit prévoir l’accord : cela signifie que la prise en compte du potentiel refus des salariés doit être anticipée par l’accord, qui doit comporter un volet consacré à l’accompagnement des potentiels salariés licenciés en cas de refus de l’accord. Ces mesures d’accompagnement ont vraisemblablement vocation à se substituer au contenu du plan de sauvegarde de l’emploi que devrait normalement établir l’employeur en cas de licenciement de plus de dix salariés sans accord de maintien de l’emploi, obligation dont il sera dispensé dans le cadre d’un accord de maintien de l’emploi.
Lors des auditions, certains se sont interrogés sur la conformité de cette disposition avec l’article 13 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le licenciement et avec la directive 98/59/CE du 20 juillet 1998 relative aux licenciements collectifs, qui posent chacune le principe de la consultation des représentants des travailleurs préalablement à de tels licenciements. Autrement dit, dans quelle mesure la loi peut-elle imposer que la procédure de licenciement collectif ne s’applique pas au licenciement pour motif économique de plusieurs salariés, le licenciement de chacun de ces salariés pour motif économique individuel permettant à l’employeur d’échapper à la consultation des institutions représentatives du personnel ? D’autres considèrent que les éventuels licenciements consécutifs à des refus opposés par des salariés de se voir appliquer l’accord sont le résultat d’un dispositif qui a été entièrement négocié en amont : autrement dit, la place laissée aux « représentants des travailleurs », notion utilisée par la directive communautaire, est jugée par les mêmes plus large qu’elle ne l’est dans le cadre actuel d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
6. Les conditions de mise en cause de l’accord
Compte tenu de la spécificité des accords de maintien de l’emploi, qui sont étroitement liés à la situation économique de l’entreprise, une procédure de mise en cause de l’accord au cours de son application est prévue par le projet de loi, au même titre qu’elle avait d’ailleurs été prévue par l’accord du 11 janvier.
Cette procédure est exorbitante du droit commun applicable aux accords à durée déterminée (article L. 2222-4 du code du travail), pour lesquels la Cour de cassation a considéré qu’ils ne pouvaient être unilatéralement dénoncés pendant leur durée d’application.
Le nouvel article L. 5125-5 prévoit ainsi une procédure de suspension de l’accord, sur saisine du tribunal de grande instance, à la demande de l’une des parties signataires, dans deux cas de figure :
– lorsque les engagements souscrits, notamment en matière de maintien de l’emploi, ne sont pas jugés être appliqués de manière loyale et sérieuse ;
– lorsque la situation économique de l’entreprise a évolué de manière significative.
Dans le premier cas, il s’agirait d’une mise en cause de l’application de l’accord par les organisations syndicales de salariés, qui estimeraient que l’employeur ne respecte pas ses engagements relatifs au maintien en emploi des salariés, mais également, – on pourrait en tout cas le supposer –, en cas de non-respect de la symétrie des formes requise vis-à-vis des dirigeants salariés, des actionnaires et des mandataires sociaux, ou encore si l’employeur ne respecte pas l’un des engagements qu’il aurait pu prendre par ailleurs dans le cadre de l’accord, par exemple, celui du consentement à une plus grande souplesse des horaires des salariés en contrepartie d’une augmentation provisoire de leur durée de travail. Notons que c’est aussi parce que le nouvel article L. 5125-5 prévoit une possibilité de saisine du tribunal pour non-respect d’autres engagements que celui, strictement, du maintien de l’emploi, qu’il convient de préciser à l’article L. 5125-2, relatif à la clause pénale, que celle-ci trouve à s’appliquer en cas de non-respect de l’ensemble des engagements de l’employeur.
Dans le second cas de figure, la mise en cause pourrait émaner de l’employeur qui estimerait qu’une détérioration importante de la situation économique de l’entreprise ne le met plus en état de respecter ses engagements de maintien de l’emploi ; elle pourrait également émaner de l’une ou de l’autre partie en cas, au contraire, d’amélioration significative de la situation de l’entreprise, qui devrait légitimer la suspension de l’accord.
Le juge serait saisi en référé et déciderait ou non de la suspension de l’accord : en cas de suspension, il en fixerait le délai. Des éléments relatifs soit à l’application loyale de l’accord, soit à l’évolution de la situation économique de l’entreprise seraient transmis à la justice pendant ce délai, conduisant le juge, à l’expiration dudit délai, à prononcer la suspension définitive des effets de l’accord ou à en autoriser la poursuite.
L’accord du 11 janvier évoquait la notion de « résolution judiciaire » de l’accord, ce qui laissait supposer que si celle-ci était prononcée, l’accord de maintien de l’emploi était réputé n’avoir jamais existé : en effet, la résolution d’un contrat conduit à remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lui, ce qui peut potentiellement conduire l’employeur à devoir payer rétroactivement la part des salaires non payée pendant l’accord, en cas de diminution de la rémunération des salariés prévue par l’accord. Le projet de loi retient la notion de suspension définitive des effets de l’accord, n’annulant donc pas rétroactivement ses effets pour la durée écoulée.
Le nouvel article L. 5125-6 précise le régime applicable en cas de rupture du contrat de travail consécutive notamment à la décision du juge de suspendre les effets de l’accord. Tout d’abord, le texte du projet de loi ne précise pas s’il s’agit d’une rupture du contrat consécutive à la décision provisoire ou définitive du juge de suspension de l’accord.
Ce régime a vocation à s’appliquer dans le cas d’une rupture du contrat de travail « notamment » consécutive à la suspension de l’accord par décision judiciaire : autrement dit, si un salarié couvert par l’accord est licencié pendant l’application de celui-ci sans que celui-ci ne soit formellement suspendu, ce régime trouverait vraisemblablement à s’appliquer aussi.
Ainsi, le calcul des indemnités légales de préavis, des indemnités de licenciement, ainsi que des allocations chômage, se fera sur la base de la rémunération au moment de la rupture du contrat ou sur la base de la rémunération antérieure à la conclusion de l’accord si celle-ci est supérieure. Dans le cas d’un accord qui aurait conduit à une réduction des salaires, les indemnités versées aux salariés licenciés se feront donc sur la base de leur situation antérieure.
L’indemnisation d’un salarié en cas de licenciement
Le licenciement ouvre doit au versement au salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde :
– d’une indemnité légale de licenciement (à condition de justifier d’un an d’ancienneté), calculée en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, cette indemnité ne pouvant néanmoins être inférieure à 1/5ème de mois de salaire par année d’ancienneté pendant les dix premières années, puis 1/3 de mois de salaire pour chaque année suivante. L’assiette est égale au douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ou, si elle s’avère plus avantageuse, à 1/3 des trois derniers mois ;
– le cas échéant, d’une indemnité légale de préavis, en cas d’inobservation du délai de préavis par l’employeur (article L. 1234-5) : forfaitaire et proportionnelle à la durée du préavis non exécuté, elle est égale au montant de la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé pendant cette période ;
Même en cas de faute grave ou lourde, le salarié licencié a également droit, sous conditions d’une durée minimale d’affiliation, au versement des allocations chômage.
Le texte précise que le calcul des allocations chômage se fait sur la base la plus favorable. En effet, en principe, la période de référence retenue pour le calcul des allocations chômage est constituée par les douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé au salarié. Il est donc nécessaire de préciser les modalités de calcul spécifiques qui seront applicables dans le cas d’un accord de maintien de l’emploi.
Autrement dit, pour ces trois types d’indemnisation, – indemnité de préavis, indemnité de licenciement et allocation chômage –, le calcul se fera sur la base de la rémunération la plus avantageuse pour le salarié et non dans les conditions de droit commun. Dans la plupart des cas, il s’agira de la rémunération antérieure à la conclusion de l’accord qui sera a priori la plus élevée.
*
* *
Lors de son examen de cet article, votre commission a apporté les principales modifications suivantes à son dispositif :
– Elle a, à l’initiative de votre rapporteur, mentionné expressément la durée légale du travail parmi les principes de l’ordre public social que devront respecter les futurs accords de maintien de l’emploi.
– À l’initiative des commissaires du groupe socialiste, elle a adopté un amendement prévoyant que le plancher de 1,2 SMIC prévu par le texte en matière de diminution des rémunérations concernait la rémunération horaire ou mensuelle, afin d’offrir une protection particulière aux salariés à temps partiel.
– Sur proposition de votre rapporteur et des membres du groupe socialiste, votre commission a également prévu que les dirigeants salariés devaient contribuer de manière proportionnée aux efforts demandés aux autres salariés dans le cadre de l’accord.
– Votre commission a ensuite prévu que les accords de maintien de l’emploi devaient obligatoirement définir les modalités de suivi par les salariés de la mise en œuvre de l’accord.
– S’agissant de la clause pénale contenue dans l’accord, votre commission a à l’initiative des commissaire socialistes, prévu que celle-ci trouverait à s’appliquer en cas de non respect des engagements de l’employeur, qu’il s’agisse ou non de son engagement spécifique de maintien de l’emploi ou d’un autre engagement qu’il aurait pu prendre dans le cadre de cet accord.
– Votre commission a tenu à souligner, sur proposition de votre rapporteur, que le dispositif d’activité partielle pouvait bénéficier aux entreprises dans le cadre d’un accord de maintien de l’emploi.
– Elle a enfin prévu le dépôt annuel d’un rapport au Parlement sur l’évaluation des accords de maintien de l’emploi, sur proposition de M. Carpentier de Mme Orliac.
*
La Commission est saisie de l’amendement AS 140 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Les accords dits « de maintien de l’emploi » créés par l’article 12 sont défavorables aux salariés. La « flexibilité » mise en avant se fait aux dépens de ces derniers, jamais des dirigeants ou des actionnaires.
L’exigence affichée de maintien de l’emploi n’est qu’un leurre, puisque les ruptures conventionnelles et les plans de départs volontaires ne sont pas empêchés.
De plus, seuls les syndicats signataires de ces accords pourront en contester l’application. Les pouvoirs d’appréciation du juge sont une fois de plus considérablement limités.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article.
M. le rapporteur. Beaucoup de voix se sont élevées pour dénoncer dans ces accords la poursuite des accords compétitivité-emploi souhaités par Nicolas Sarkozy. C’est faux : il est bien précisé en début de chapitre qu’ils concernent les entreprises rencontrant de graves difficultés conjoncturelles.
J’en veux d’ailleurs pour preuve que le groupe UMP a déposé un amendement visant à créer des accords de maintien dans l’emploi « offensifs », dont l’objet est d’allonger la durée du travail pour augmenter prétendument la productivité.
À l’opposé, le texte permet une activité partielle négociée.
Tous les syndicats auditionnés, y compris les non-signataires, ont indiqué qu’ils passaient déjà de tels accords sur le terrain. L’article 12 leur donne un cadre rigoureux. Il limite leur durée à deux ans, écarte la possibilité de déroger aux éléments fondamentaux du code du travail – disposition qu’un de mes amendements viendra renforcer –, protège les salaires inférieurs à 1,2 SMIC, prévoit la participation des dirigeants aux efforts, la répartition des fruits d’un éventuel retour à bonne fortune ainsi que des sanctions très fortes en cas de non-respect des engagements. Et les accords ne sont valides que s’ils sont majoritaires. Vouloir aller plus loin, c’est revenir à coup sûr aux plans sociaux classiques !
Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement AS 140.
Elle examine ensuite l’amendement AS 166 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le rapporteur. Le projet de loi interdit d’abaisser les salaires inférieurs à 1,2 SMIC horaire. Je proposerai d’ailleurs de rapporter cette interdiction à 1,2 SMIC mensuel, sans quoi un mi-temps pourrait passer de 700 à 600 euros.
L’amendement vise à étendre cette interdiction aux salaires inférieurs à 1,2 fois le montant du salaire conventionnel. Cela signifie que le plancher varierait selon les branches. En subordonnant aux accords de branche l’interdiction générale de baisse des salaires dans le cadre d’un accord de maintien de l’emploi, on crée une inégalité entre les salariés. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement AS 166.
Elle est saisie de l’amendement AS 230 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. La jurisprudence nous incite à introduire, après les mots : « graves difficultés », le mot : « économiques ».
M. le rapporteur. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine l’amendement AS 231 du même auteur.
M. Christophe Cavard. Cet amendement procède du même esprit que le précédent.
M. le rapporteur. L’accord du 11 janvier parle de « diagnostic partagé » par les partenaires sociaux. La rédaction retenue pour le projet de loi vise à créer les conditions pour aboutir à ce diagnostic partagé et pour ne pas provoquer à ce propos un flou juridique qui mettrait longtemps à se dissiper.
Il est de la responsabilité de l’employeur de considérer que l’entreprise connaît de graves difficultés conjoncturelles. Et il appartiendra éventuellement au juge de considérer que tel n’était pas le cas. Bref, l’analyse dont il est question dans le texte ne vaut pas quitus vis-à-vis des salariés.
La dissymétrie ainsi créée peut paraître moins protectrice au moment de la signature de l’accord, alors qu’elle est en réalité plus protectrice pour ce qui est de ses conséquences. Votre amendement tente de la réduire. Mieux vaut pourtant s’en tenir à la rédaction du projet de loi. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement AS 231.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS 358 du rapporteur.
Elle en vient à l’amendement AS 228 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Comme les plans de sauvegarde de l’emploi, les accords de maintien de l’emploi doivent demeurer une exception.
M. le rapporteur. Nous avons là une divergence d’appréciation. Je l’ai dit, les accords de maintien de l’emploi sont une forme de chômage partiel négocié. Ils doivent donc bénéficier de la prise en charge partielle des salaires prévue dans le cadre du chômage partiel. Mon amendement AS 309 vise à assurer ce cumul des dispositifs en précisant que les accords de maintien de l’emploi sont compatibles avec l’aide relative au chômage partiel prévue à l’article L. 5122-1 du code du travail.
Le recours au chômage partiel est une décision unilatérale du chef d’entreprise. Le dispositif du texte permet au contraire de négocier les conditions dans lesquelles on met en œuvre une réduction de l’activité et des temps de travail, en l’assortissant d’une réduction des plus hauts salaires et, comme je le propose, des dividendes. Il ne faut pas séquencer les mesures.
La Commission rejette l’amendement AS 228.
La Commission examine l’amendement AS 111 de M. Jean-Noël Carpentier.
M. Jean-Noël Carpentier. Les accords de maintien de l’emploi ne doivent être mis en œuvre que lorsque la situation économique nationale est dégradée et que la prévision de croissance est inférieure à 1 % du PIB pour l’année en cours. On ne peut accepter que les salaires soient réduits alors que la conjoncture économique globale est bonne !
M. le rapporteur. Avis défavorable. Une entreprise peut rencontrer de graves difficultés conjoncturelles sans que la situation économique nationale soit dégradée. Si tel est le cas, pourquoi renoncer à encadrer par la loi des accords de maintien de l’emploi qui peuvent éviter un plan social ?
La Commission rejette l’amendement AS 111.
Elle est saisie de l’amendement AS 306 du rapporteur.
M. le rapporteur. Parmi les règles d’ordre public social que doivent respecter les accords de maintien de l’emploi, il faut faire figurer la durée légale du travail, comme le prévoyait expressément l’accord du 11 janvier.
La Commission adopte l’amendement AS 306.
Elle examine l’amendement AS 76 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. Un peu au rebours de Jean-Noël Carpentier à l’instant, nous considérons que les « graves difficultés conjoncturelles » autorisant la conclusion d’un accord de maintien de l’emploi doivent être appréciées au niveau de l’entreprise, et non à celui du secteur d’activité. On sait par exemple que, si le secteur automobile va mal aujourd’hui, ce n’est pas le cas de tous les constructeurs et rien ne justifierait donc de tels accords dans les entreprises qui restent prospères.
M. le rapporteur. La précision est superfétatoire, même si la rédaction de cet alinéa apparaît perfectible.
La Commission rejette l’amendement AS 76.
Elle en vient à l’amendement AS 232 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. L’employeur doit produire des éléments justifiant la mise en œuvre d’un accord de maintien de l’emploi.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AS 232.
Elle adopte l’amendement rédactionnel AS 359 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 270 de M. Denys Robiliard.
M. Denys Robiliard. Dans le cadre de l’accord de maintien de l’emploi, la rémunération mensuelle d’un salarié à temps partiel ne saurait diminuer dès lors que son taux horaire est inférieur à 1,2 SMIC.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 270.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS 360 du rapporteur.
Elle examine ensuite les amendements identiques AS 307 du rapporteur et AS 271 de M. Jérôme Guedj.
M. le rapporteur. Si l’amendement de Denys Robiliard assure la protection des salaires les plus bas, celui-ci garantit que les salariés percevant les rémunérations les plus élevées contribueront de manière proportionnée aux efforts demandés.
La Commission adopte les deux amendements AS 307 et AS 271.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS 361 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 167 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Il est défendu.
M. le rapporteur. Défavorable. Les amendements identiques que nous venons d’adopter vont plus loin en instaurant une progressivité de l’effort selon le salaire alors que celui de Jacqueline Fraysse se contente de prévoir que la rémunération de tous sera diminuée du même pourcentage.
La Commission rejette l’amendement AS 167.
Elle examine ensuite l’amendement AS 194 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. En cas d’accord de maintien de l’emploi, il importe que toutes les parties prenantes à l’entreprise fassent des efforts : les salariés, les dirigeants, mais aussi les actionnaires. Nous proposons donc de geler momentanément le versement des dividendes.
M. le rapporteur. Le cas des entreprises qui rencontrent de graves difficultés conjoncturelles et continuent de verser des dividendes doit tout de même être extrêmement rare.
La question du gel des dividendes a été discutée par les partenaires sociaux. Certains ont estimé qu’une réduction drastique était préférable à un gel dans la mesure où elle préservait des chances d’obtenir des financements à terme. Cela dit, des membres du groupe SRC seraient prêts à voter un tel amendement s’il ne s’écartait pas de la ligne de crête dont je parle depuis hier. Défavorable.
M. Jean-Noël Carpentier. Ces derniers mois, nous avons tous entendu parler de plans sociaux mis en place par des entreprises qui versaient néanmoins des dividendes à leurs actionnaires ou qui distribuaient des stock options – je pense au cas de Sanofi. Dans la période que nous traversons, la proposition de Jacqueline Fraysse apparaît tout à fait raisonnable.
M. Christophe Cavard. Le groupe Écologiste soutient l’amendement. Le rapporteur estime qu’il est « rare » que des dividendes soient versés par des entreprises rencontrant de graves difficultés : nous citerons lors de la séance publique plusieurs exemples qui pourraient amener à revoir cette appréciation !
La Commission rejette l’amendement AS 194.
Elle est saisie de l’amendement AS 100 de M. Christian Hutin.
M. Christian Hutin. Pour des raisons de sécurité juridique, les dispositions fixant la contribution des dirigeants salariés, des mandataires sociaux et des actionnaires aux efforts communs devraient être soumises au conseil d’administration préalablement à la signature de l’accord.
M. le rapporteur. Avis défavorable : la procédure prévue me paraît suffisante. Mais je suis prêt à examiner la question avec vous, monsieur Hutin.
La Commission rejette l’amendement AS 100.
Elle en vient à l’amendement AS 308 du rapporteur.
M. le rapporteur. Un véritable suivi est indispensable, qu’il s’agisse de la mise en œuvre de l’accord, de l’évolution de la situation économique de l’entreprise ou de la réalité des efforts consentis par les dirigeants, par les mandataires sociaux et par les actionnaires.
La Commission adopte l’amendement AS 308.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement AS 195 de Mme Jacqueline Fraysse.
Puis, elle examine l’amendement AS 77 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. Il s’agit de prévoir les modalités de renouvellement de l’accord de maintien de l’emploi si « de graves difficultés persistent à l’issue des deux ans ».
M. le rapporteur. Défavorable. Nous ne souhaitons pas que les accords de maintien de l’emploi soient reconductibles. Ils doivent seulement permettre à l’entreprise de traverser une passe difficile grâce à l’application de mesures dérogatoires et encadrées, portant notamment sur les salaires.
La Commission rejette l’amendement AS 77.
Elle en vient à l’amendement AS 75 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. L’accord doit fixer les modalités selon lesquelles sera appréciée l’amélioration de la situation économique de l’entreprise. Mon expérience de conseiller prud’homal m’a convaincu qu’en la matière, les appréciations peuvent diverger selon que l’on analyse le chiffre d’affaires ou le résultat d’une entreprise.
M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par les dispositions du projet de loi.
La Commission rejette l’amendement AS 75.
Elle examine ensuite l’amendement AS 193 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Pendant la durée d’application de l’accord, par définition limitée, l’employeur doit prendre en charge la part cotisations sociales correspondant à la baisse de rémunération du salarié, pour éviter que celui-ci ne soit lésé. C’est d’autant plus nécessaire que, si les difficultés ne se résolvaient pas et que le salarié perdait son emploi, son indemnisation serait minorée en raison de sa participation à la tentative de sauvetage de son entreprise, ce qui serait bien injuste !
M. le rapporteur. Défavorable. Des dispositions de cette sorte sont déjà prévues pour les droits à indemnisation du chômage ainsi que pour les indemnités de licenciement en cas de licenciement économique – sans cotisation supplémentaire de l’employeur.
Il est vrai que la question des droits à retraite reste posée. En la matière, même si nous sommes sensibles à votre préoccupation, il faut tenir compte du coût qu’aurait cette disposition pour les entreprises. J’ajoute qu’en l’adoptant, nous nous écarterions de l’accord du 11 janvier.
La Commission rejette l’amendement AS 193.
Elle est saisie de l’amendement AS 196 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. La loi doit fixer les modalités de recueil de l’accord ou du refus par le salarié des modifications de son contrat de travail entraînées par l’application d’un accord de maintien de l’emploi.
M. le rapporteur. Nous avons déjà traité de ce sujet à l’article 10 et ma réponse reste défavorable.
La Commission rejette l’amendement AS 196.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements AS 168 et AS 197 de Mme Jacqueline Fraysse.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements AS 169 de Mme Jacqueline Fraysse et AS 275 de M. Denys Robiliard.
Mme Jacqueline Fraysse. Aux termes de cet amendement de repli, tout acte de l’employeur contraire à son engagement de maintien de l’emploi contracté dans le cadre de l’accord est nul et de nul effet.
M. Denys Robiliard. Il n’y a pas lieu de limiter l’application de la clause pénale au manquement à l’engagement de maintenir l’emploi. Comme dans l’accord du 11 janvier, elle doit être générale et sanctionner le non-respect d’une obligation conventionnelle quelle qu’elle soit.
M. le rapporteur. Ma préférence va à l’amendement de M. Denys Robiliard grâce auquel la clause pénale couvre un champ plus large que le seul maintien de l’emploi.
Mme Jacqueline Fraysse. Je le voterai donc, après avoir voté pour le mien !
La Commission rejette l’amendement AS 169, puis elle adopte l’amendement AS 275.
Elle en vient ensuite à l’amendement AS 273 de M. Michel Lefait.
Mme Barbara Romagnan. L’accord doit prévoir les modalités d’information des salariés quant à son application et à son suivi pendant toute sa durée.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 273.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS 362 du rapporteur.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement AS 170 de Mme Jacqueline Fraysse.
Elle est saisie de l’amendement AS 225 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Quand on connaît les conséquences de l’accord de maintien de l’emploi, il semble évident que les organisations susceptibles de mandater un représentant élu du personnel doivent être majoritaires au sein de l’entreprise ou de la branche.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AS 225.
Elle examine l’amendement AS 235 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. L’amendement vise à supprimer l’alinéa 18 qui permettrait à des salariés mandatés de négocier l’accord de maintien de l’emploi lorsqu’il n’y a pas d’élus du personnel dans l’entreprise.
M. le rapporteur. Cet amendement empêcherait la négociation d’accords de maintien de l’emploi par mandatement alors qu’il nous semble qu’il faut au contraire les favoriser.
La Commission rejette l’amendement AS 235.
Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels AS 363 et AS 364 du rapporteur.
Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement rédactionnel AS 276 de M. Denys Robiliard.
Elle adopte l’amendement rédactionnel AS 365 du rapporteur.
Elle en vient à l’amendement AS 171 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Le droit de saisir le président du tribunal de grande instance pour demander la suspension d’un accord de maintien de l’emploi ne doit pas être accordé aux seuls signataires de celui-ci, mais également aux organisations syndicales non-signataires et aux salariés victimes du non-respect de l’engagement de maintien de l’emploi.
M. le rapporteur. Avis défavorable : cela reviendrait à remettre en cause le caractère majoritaire de l’accord. Quant aux salariés, ils ont toujours la possibilité de saisir le juge !
Mme Jacqueline Fraysse. Le juge porte un regard objectif sur l’accord : pourquoi empêcher les organisations non-signataires de le saisir, d’autant que les signataires peuvent être minoritaires ?
La Commission rejette l’amendement AS 171.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS 366 à AS 369 du rapporteur.
Elle est saisie de l’amendement AS 309 du rapporteur.
M. le rapporteur. Les entreprises ayant signé un accord de maintien de l’emploi doivent pouvoir bénéficier des aides liées à l’activité partielle.
La Commission adopte l’amendement AS 309.
Elle en vient à l’amendement AS 116 de M. Jean-Noël Carpentier.
M. Jean-Noël Carpentier. Nous demandons que le Gouvernement remette chaque année au Parlement un rapport évaluant le dispositif des accords de maintien de l’emploi.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 116.
Elle examine l’amendement AS 109 de M. Gérard Cherpion.
M. Gérard Cherpion. Les accords de maintien de l’emploi voulus par les partenaires sociaux ont une vocation défensive, dans un contexte de crise économique. Cet amendement vise à instituer une disposition symétrique, à vocation offensive, pour permettre la conclusion d’accords de développement de l’emploi.
En période de reprise économique, ou bien pour répondre de façon ponctuelle à une hausse du carnet de commandes, des entreprises peuvent avoir besoin de souplesse. Il faut donc leur permettre de négocier des accords pour ajuster la durée du travail à la hausse.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement aura du moins le mérite de m’aider à convaincre nos collègues communistes que les accords de maintien de l’emploi n’ont rien à voir avec les accords compétitivité-emploi voulus par le précédent Président de la République. Pour nous, monsieur Cherpion, les cas que vous évoquez peuvent être traités sans qu’il soit besoin de déroger au droit commun en matière de salaire ou de temps de travail.
M. Gérard Cherpion. Si la conjoncture se retourne, une entreprise qui a passé un accord de maintien de l’emploi peut avoir besoin de passer un accord offensif.
M. le rapporteur. Il lui suffit de réagir en mettant fin à l’accord de maintien de l’emploi de façon anticipée. Votre amendement va beaucoup plus loin puisqu’il propose un accord spécifique comportant des dérogations au code du travail.
La commission rejette l’amendement AS 109.
Elle adopte ensuite l’article 12 modifié.
(La séance, suspendue à quatorze heures, est reprise
à quatorze heures vingt-cinq.)
Les amendements AS 92 à AS 94 de M. Hervé Morin ne sont pas défendus.
Article 13
(art. L. 1233-22 à L. 1233-24, L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 [nouveaux], L. 1233-30, L. 1233-33à L. 1233-36, L. 1233-39 à L. 1233-41, L. 1233-45-1 [nouveau], L. 1233-47, L. 1233-50, L. 1233-52 à L. 1233-57, L. 1233-57-1 à L. 1233-57-8 [nouveaux], L. 1233-58, L. 1233-63, L. 1233-90-1 [nouveau], L. 1235-7, L. 1235-7-1 [nouveau], L. 1235-10, L. 1235-1,L. 1235-16, L. 2323-15, L. 2325-35, L. 2325-37, L. 3253-8, L. 3253-13, L. 4614-12-1 et L. 4614-12-2 [nouveaux] du code du travail ; art. L. 631-17, L. 631-19, L. 641-4 et L. 642-5 du code de commerce)
Réforme de la procédure de licenciement collectif pour motif économique
Le présent article porte réforme de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en se fondant sur les principes arrêtés par l’article 20 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013. Les partenaires sociaux ont souhaité créer deux nouvelles voies pour fixer la procédure de licenciement et le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi : un accord majoritaire ou un document unilatéral de l’employeur, soumis à une homologation de l’administration.
Le présent article reprend ces principes et en tire également toutes les conséquences, en renforçant les prérogatives d’intervention de l’administration dans ces procédures et en confiant les contestations relatives à ses décisions à son juge naturel, le juge administratif.
I.- UNE NOUVELLE PROCÉDURE DE LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE ENTRE VOIE NÉGOCIÉE ET HOMOLOGATION ADMINISTRATIVE
La nouvelle procédure de licenciement proposée par le présent article s’articule entre une voie négociée, autour d’un accord majoritaire, et une voie administrative, reposant sur un document élaboré par l’employeur homologué par la DIRECCTE. Ces voies ne sont pas exclusives, une partie de la procédure ou du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi pouvant être déterminée par accord et l’autre par un document de l’employeur.
A. DES ACCORDS DE MÉTHODE SUR LA PROCÉDURE
Le présent article maintient la possibilité de conclure des accords de méthode, mais en adapte le contenu, du fait de la création d’accords majoritaires portant sur l’ensemble de la procédure de licenciement.
● Le champ actuel des accords de méthode
Les accords de méthode constituent aujourd’hui la seule voie de négociation collective, au champ circonscrit, sur un projet de licenciement économique. Prévus par l’article L. 1233-21, ils permettent d’aménager « les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise » en cas de projet de licenciement économique collectif. Plus précisément, aux termes de l’article L. 1233-22, ils fixent les conditions dans lesquelles le comité d’entreprise :
– est réuni et informé de la situation économique et financière de l’entreprise ;
– peut formuler des propositions alternatives au projet à l’origine d’une restructuration, et obtenir une réponse motivée de l’employeur.
En vertu des deux derniers alinéas du même article, ces accords peuvent également organiser la mise en œuvre d’actions de mobilité professionnelle et géographique internes et, surtout, déterminer les conditions dans lesquelles l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi peut faire l’objet d’un accord et anticiper le contenu de celui-ci. Au-delà de l’organisation du déroulement de la procédure, les accords de méthode peuvent donc porter, en partie, sur des mesures de fond relatives au projet de licenciement.
Ces accords ne peuvent, toutefois, pas déroger, selon l’article L. 1233-23 : à l’obligation d’effort de formation, d’adaptation et de reclassement des salariés incombant à l’employeur, à certaines règles générales d’information et de consultation du comité d’entreprise, à la communication aux représentants du personnel des renseignements relatifs au projet de licenciement, aux règles de consultation applicables lors d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
● Une limitation du champ des accords à la procédure
Afin d’assurer leur articulation avec les nouveaux accords majoritaires, sans supprimer la possibilité de conclure des accords de méthode, le présent article restreint leur champ à la procédure. À cette fin :
– le II supprime les deux derniers alinéas de l’article L. 1233-22, qui prévoient que les accords de méthode peuvent porter sur la mobilité interne et le plan de sauvegarde de l’emploi ;
– le III abroge l’interdiction de déroger à l’obligation d’effort de formation, devenue sans objet puisque les accords de méthode rénovés n’aborderont plus les questions de fond ;
– le IV supprime le délai de contestation de douze mois des accords de méthode portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi, également devenu sans objet.
Ces accords demeureront, en revanche, soumis au droit commun des accords collectifs quant à leur conclusion et au droit d’opposition, et continueront d’être contestés devant le tribunal de grande instance dans le délai actuel de trois mois à compter de leur dépôt. Cette particularité s’explique, en partie, par le fait que ces accords peuvent être signés dans des entreprises de moins de 50 salariés, non soumises à l’obligation d’élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi et donc à la nouvelle procédure de licenciement.
S’agissant des accords de méthode en vigueur, ils resteront applicables en ce qui concerne l’aménagement de la procédure d’information et de consultation, dans le respect des nouvelles dispositions prévues par la loi. Les mesures anticipant, le cas échéant, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi n’exonéreront pas l’entreprise d’élaborer un plan conformément à la nouvelle législation.
B. DES ACCORDS MAJORITAIRES SUR LE PROJET DE LICENCIEMENT
La création d’accords majoritaires pouvant régir l’ensemble de la procédure de licenciement constitue l’une des innovations importantes du présent article, traduisant la volonté des partenaires sociaux. Au-delà des accords de méthode existants, il s’agit de permettre la mise en place d’un dialogue social structurant, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, sur les projets de licenciement économique collectif.
À cette fin, le V crée trois nouveaux articles qui établissent le régime et le contenu de ces nouveaux accords.
● La condition de majorité
Le nouvel article L. 1233-24-1 ouvre la possibilité, dans ces entreprises, de déterminer par accord collectif le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les modalités de consultation du comité d’entreprise et de mise en œuvre des licenciements. Aux termes de ce nouvel article, cet accord doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. Il s’agit donc d’un accord majoritaire, cette condition n’étant également exigée, au sein du code du travail, que pour les accords de maintien de l’emploi.
● Le contenu de l’accord
Le nouvel article L. 1233-24-2 précise, ensuite, le champ de cet accord, qui doit a minima porter sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, mais peut aussi porter aussi sur :
– les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise ;
– la pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements ;
– le calendrier des licenciements ;
– le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées ;
– les modalités de mise en œuvre des mesures d’adaptation et de reclassement.
Potentiellement, un projet de licenciement économique pourra donc se trouver entièrement organisé, tant sur le fond que sur la forme, par un accord collectif majoritaire.
● Les limitations du champ de l’accord
Le nouvel article L. 1233-24-3 définit, enfin, les limitations juridiques du champ de l’accord, qui ne peut déroger :
– à l’obligation d’effort de formation, d’adaptation et de reclassement incombant à l’employeur ;
– à l’obligation pour l’employeur de proposer aux salariés le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ou le congé de reclassement ;
– à la communication aux représentants du personnel des renseignements relatifs au projet de licenciement ;
– aux règles de consultation applicables lors d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
Le nouvel article L. 1233-24-3 reprend donc les limites d’ordre public social aujourd’hui imposées aux accords de méthode, en y ajoutant l’obligation pour l’employeur de proposer aux salariés le contrat de sécurisation professionnelle ou le congé de reclassement.
Le V insérant ces trois nouveaux articles au paragraphe régissant les accords de méthode, le I procède à la modification de l’intitulé de celui-ci pour qu’il vise désormais les deux catégories d’accords.
C. UN DOCUMENT UNILATÉRAL ENCADRÉ DE L’EMPLOYEUR
Suivant les principes arrêtés par les partenaires sociaux, en parallèle de la création des accords majoritaires, le présent article ouvre la possibilité à l’employeur d’élaborer un document unilatéral sur le projet de licenciement. Le VI crée donc un nouvel article L. 1233-24-4, au sein d’un nouveau paragraphe, qui en délimite le périmètre.
● Le périmètre du document unilatéral
Aux termes de ce nouvel article, à défaut d’accord majoritaire, un document élaboré par l’employeur, après la dernière réunion du comité d’entreprise sur le projet de licenciement envisagé, détermine le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi.
Le document unilatéral doit également préciser, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur : les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise, la pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements, le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées, et les modalités de mise en œuvre des mesures d’adaptation et de reclassement.
● Les pouvoirs restreints de l’employeur
Si le champ du document unilatéral est donc identique au champ de l’accord majoritaire, les marges de manœuvre de l’employeur sont considérablement plus restreintes. En effet, il ne peut que « préciser » ces éléments sans pouvoir déroger au droit positif, puisqu’il doit agir « dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur » selon le nouvel article. Par ailleurs, la conclusion d’un accord majoritaire demeure possible à tout moment de la procédure sur tout ou partie du projet de licenciement et du plan de sauvegarde de l’emploi.
II.- DES RÈGLES RÉNOVÉES DE CONSULTATION ET DE RECOURS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL À UN EXPERT
Le présent article rénove les règles de consultation des représentants du personnel, en s’inspirant des orientations fixées par les partenaires sociaux, et précise leurs conditions de recours à un expert, tout en leur octroyant une nouvelle possibilité en la matière.
A. LES ÉVOLUTIONS DE LA CONSULTATION DU COMITÉ D’ENTREPRISE
Les modalités de consultation du comité d’entreprise connaissent d’importantes évolutions, concernant tant ses délais et son contenu, que les pouvoirs dévolus au comité, qui sont accrus.
● La procédure actuelle de consultation du comité d’entreprise
L’article L. 1233-30 régit aujourd’hui la procédure de consultation du comité d’entreprise. Il impose, d’une part, l’obligation de consulter le comité d’entreprise sur le projet de licenciement envisagé, puis offre la possibilité de joindre à cette consultation, celle sur les projets de restructuration et de compression des effectifs, obligatoire au titre de l’article L. 2323-15.
L’article L. 1233-30 prévoit, d’autre part, les délais de consultation du comité d’entreprise. Ce dernier doit actuellement tenir deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à : 14 jours en cas de projet comprenant moins de 100 licenciements, 21 jours en cas de projet entre 100 et 249 licenciements, et 28 jours en cas de projet de 250 licenciements ou plus. Néanmoins, un accord collectif peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.
Tout en conservant son architecture en deux parties, le VII propose de profondes modifications à l’article L. 1233-30.
● Le contenu de la consultation du comité d’entreprise
S’agissant de la première partie de l’article L. 1233-30, le 1° du VII opère une clarification formelle, puis le 2° du VII détermine les règles de fond de consultation du comité d’entreprise, dont la première réunion portera désormais sur :
– l’opération projetée et ses modalités d’application, conformément aux dispositions de l’article L. 2323-15, les deux consultations obligatoires étant donc désormais juridiquement unies en cas de procédure impliquant l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi ;
– le projet de licenciement collectif, à savoir le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi, sauf si ces éléments font l’objet d’un accord majoritaire, auquel cas ils ne sont pas soumis au comité d’entreprise, afin d’assurer l’articulation entre consultation et négociation.
Du fait de l’unification des consultations obligatoires précitées, le XXXVII opère une coordination à l’article L. 2323-15, pour prévoir que l’avis du comité d’entreprise sur les projets de restructuration doit être rendu « dans les conditions et délais prévus à l’article L. 1233-30 », lorsque celle-ci est soumise à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi.
● Les délais de consultation du comité d’entreprise
S’agissant de la seconde partie de l’article L. 1233-30, le 3° du VII reprend, tout d’abord, le principe selon lequel le comité d’entreprise doit tenir au moins deux réunions, mais imposent qu’elles soient espacées d’au moins 15 jours. Les 4° à 7° du VII prévoient, ensuite, que le comité d’entreprise doit rendre ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion à :
– deux mois, lorsque le nombre de licenciements est inférieur à 100 ;
– trois mois, lorsque le nombre de licenciements est compris entre 100 et 249 ;
– quatre mois, lorsque le nombre de licenciements est égal ou supérieur à 250.
Le 8° du VII indique, ensuite, qu’un accord collectif, de méthode ou majoritaire, peut prévoir des délais différents à ceux précédemment mentionnés. Enfin, le 9° du VII pose la règle selon laquelle le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté, en l’absence d’avis rendu dans les délais indiqués.
● Le pouvoir de proposition renforcé du comité d’entreprise
Au cours de la consultation, en vertu de l’article L. 1233-33, le comité d’entreprise dispose aujourd’hui de la faculté de formuler des suggestions relatives aux mesures sociales envisagées par l’employeur, auquel ce dernier doit répondre dans le délai correspondant à l’envoi des lettres de licenciement.
Le VIII du présent article propose une nouvelle rédaction de cet article, afin d’harmoniser le délai de proposition avec celui prévu pour la consultation du comité d’entreprise, et de renforcer le pouvoir de ce dernier, qui pourra désormais émettre des « propositions alternatives au projet de restructuration », en plus des suggestions sur les mesures sociales. L’employeur sera tenu de les mettre à l’étude et d’y apporter une réponse motivée.
● L’avis du comité d’entreprise sur les mesures de mobilité interne
Autre amélioration des prérogatives du comité d’entreprise en cours de procédure, le XIV lui confère un nouveau droit d’avis en matière de mobilité interne. Il crée à cet effet un nouvel article L. 1233-45-1, au sein d’un nouveau paragraphe, qui subordonne à un avis favorable du comité la possibilité pour l’employeur de mettre en œuvre des mesures de mobilité interne avant l’expiration du délai de consultation.
À l’initiative des commissaires du groupe socialiste et du rapporteur, votre commission a préféré à la dénomination de « mesures de mobilité interne », celle de « mesures de reclassement interne », plus appropriée.
B. LE RECOURS ÉLARGI ET ADAPTÉ À L’EXPERTISE
Le présent article élargit et adapte les conditions de recours à l’expertise par les représentants du personnel, en créant un nouveau cas de recours en faveur des délégués syndicaux et en harmonisant les délais de mission accordés aux experts avec ceux de la procédure de consultation.
● Un nouveau cas de recours en faveur des délégués syndicaux
Le 1° du IX crée, tout d’abord, la possibilité pour le comité d’entreprise de mandater un expert-comptable, afin qu’il apporte son aide aux délégués syndicaux pour mener la négociation de l’accord majoritaire. Il complète en ce sens l’article L. 1233-34, qui permet aujourd’hui au comité d’entreprise de recourir à l’assistance d’un expert dans le cadre de la procédure de licenciement. En conséquence, le 2° du IX prévoit que le rapport de l’expert est remis au comité d’entreprise ainsi qu’aux organisations syndicales.
Le XXXVIII opère, ensuite, la coordination nécessaire à l’article L. 2325-35, qui énumère les cas de recours à un expert rémunéré par l’employeur, ouvert au comité d’entreprise. Il organise cet article en deux parties, dont la première est consacrée aux experts ayant pour mission d’assister le comité d’entreprise, le 1° du XXXVIII procédant à une clarification formelle. Le 2° du XXXVIII crée la seconde partie de l’article, qui prévoit que, au-delà de ses cas de recours propres, le comité d’entreprise peut mandater un expert-comptable afin qu’il assiste les organisations syndicales pour préparer les négociations d’un accord de maintien de l’emploi ou d’un accord majoritaire sur le projet de licenciement. Dans ce dernier cas, l’expert doit être le même que celui désigné dans le cadre de la procédure de licenciement.
● Les délais de mission de l’expert sur le projet de licenciement
Le X encadre, ensuite, les délais de l’expertise accomplie sur le projet de licenciement pour le compte du comité d’entreprise, dans les délais de consultation assignés à ce dernier. Il propose une nouvelle rédaction de l’article L. 1233-35, qui fixe aujourd’hui les délais de la deuxième et de la troisième réunion que doit tenir le comité d’entreprise lorsqu’il recourt à un expert. Cette nouvelle rédaction organise, tout d’abord, les délais dans lesquels intervient l’échange d’informations entre l’expert et l’employeur : l’expert dispose de 21 jours à compter de sa désignation pour présenter ses demandes d’informations à l’employeur, auxquelles ce dernier doit répondre dans un délai de quinze jours. Puis elle impose à l’expert de rendre son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration du délai de consultation du comité d’entreprise, afin que ce dernier puisse en prendre utilement connaissance.
C. L’HARMONISATION DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
Le présent article harmonise les règles relatives aux délais de consultation et au recours à l’expertise de l’ensemble des institutions représentatives du personnel, en leur appliquant les nouvelles dispositions prévues pour le comité d’entreprise.
● Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Le XXXIX étend ces dispositions au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et, le cas échéant, à l’instance de coordination des CHSCT, en créant deux articles L. 4614-12-1 et L. 4614-12-2. Ces nouveaux articles prévoient que l’expert désigné par le CHSCT ou l’instance de coordination des CHSCT doit transmettre, dans un délai de 21 jours, ses demandes d’information à l’employeur, qui lui répond dans les quinze jours, puis qu’il doit présenter son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration du délai de consultation du comité d’entreprise. Il prévoit également que le CHSCT ou l’instance de coordination sont tenues de rendre leur avis avant cette échéance, faute de quoi, à l’expiration de ce délai, ils seront réputés avoir été consultés.
● Le comité central d’entreprise
Le XI procède, ensuite, aux modifications nécessaires pour appliquer à la consultation du comité central d’entreprise, les nouvelles règles régissant celle du comité d’entreprise.
Aujourd’hui, lorsqu’il existe un comité central d’entreprise, l’article L. 1233-36 prévoit que l’employeur doit le consulter ainsi que les comités d’établissement intéressés, dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir des chefs d’établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Il précise, ensuite, que les comités d’établissement doivent tenir leurs réunions après celles du comité central, qu’elles soient au nombre de deux ou trois en cas de recours à un expert.
Afin d’harmoniser le droit applicable aux institutions représentatives du personnel, le XI supprime à cet article les références au nombre de réunions possibles, précise que celles-ci doivent se tenir dans les délais de consultation généraux fixés à l’article L. 1233-30, et opère un renvoi aux dispositions organisant le recours à l’expertise par le comité d’entreprise.
III.- LE RÔLE CENTRAL DE L’ADMINISTRATION TOUT AU LONG DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT
La réforme du rôle de l’administration, désormais central, dans les procédures de licenciement constitue l’une des innovations majeures proposée par le présent article, suivant les orientations fixées par les partenaires sociaux. Ce dernier renforce donc les prérogatives d’information et d’intervention dévolues à celle-ci.
A. LES PRÉROGATIVES D’INFORMATION DE L’ADMINISTRATION
Le présent article adapte, tout d’abord, les obligations d’information de l’administration sur le projet de licenciement, incombant à l’employeur.
Le délai de notification du projet à l’administration, fixé par l’article L. 1233-46, demeure identique : la notification doit être effectuée au plus tôt le lendemain de la première réunion de consultation du comité d’entreprise. En revanche, le XV complète cet article pour prévoir que, au plus tard à cette date, l’employeur doit indiquer son intention d’ouvrir la négociation d’un accord majoritaire. Dès lors que cette négociation est ouverte, à l’initiative du rapporteur, votre commission a imposé une obligation d’information « sans délai » de l’administration.
Le XVI abroge, ensuite, l’article L. 1233-47 qui impose l’obligation de transmettre à l’administration la liste des salariés dont le licenciement est envisagé. L’administration ne disposant pas d’éléments, à ce stade, pour contrôler l’application des critères d’ordre des licenciements, cette formalité apparaît d’un intérêt limité. Les nouveaux pouvoirs de l’administration quant au contrôle de l’accord majoritaire et du document unilatéral offrent une protection améliorée aux salariés.
Le XVII modifie, enfin, l’article L. 1233-50, qui prévoit aujourd’hui que l’employeur doit informer l’administration du recours à un expert par le comité d’entreprise. Les 1°, 2° et 4° du XVII procèdent à des modifications rédactionnelles pour supprimer les références au nombre de réunions du comité. Le 3° du XVII impose, ensuite, à l’employeur une nouvelle obligation : celle de communiquer à l’administration le rapport rendu par l’expert désigné.
B. L’ACTION DE L’ADMINISTRATION DANS LES PROCÉDURES SANS PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI
Le présent article crée une distinction des modalités d’action de l’administration, selon que la procédure de licenciement suppose ou non l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Le XVIII modifie, tout d’abord, l’intitulé du paragraphe prévoyant aujourd’hui les règles générales d’intervention de l’administration, pour qu’il porte uniquement sur le contrôle des procédures de licenciement ne comportant pas de plan de sauvegarde de l’emploi, les dispositions applicables aux autres procédures étant prévues dans un nouveau paragraphe présenté ci-dessous.
Le XX procède donc à une restriction d’objet à l’article L. 1233-53, qui définit le champ du contrôle de l’administration, afin de le limiter à ces procédures. Sur le fond, les prérogatives de contrôle de l’administration demeurent inchangées, de même que le délai de 21 jours dans lequel il doit être opéré.
À ce même paragraphe, le XIX abroge l’article L. 1233-52, qui offre aujourd’hui à l’administration la possibilité de notifier un constat de carence à l’entreprise qui ne remplit pas son obligation d’élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi. Du fait du pouvoir donné à l’administration de valider ou d’homologuer ce plan, il n’apparaît pas, en effet, utile de maintenir cet outil, le constat de carence n’ayant pas de valeur contraignante.
Le XXI abroge, ensuite, deux articles :
– l’article L. 1233-54, qui prévoit aujourd’hui les délais dont l’administration dispose pour opérer ses vérifications, qui varient entre 21 et 35 jours en fonction du nombre de licenciements, ces délais étant prévus désormais soit à l’article L. 1233-53 modifié, pour les procédures contenant un plan de sauvegarde de l’emploi, soit dans le nouveau paragraphe consacré aux autres procédures ;
– l’article L. 1233-55, qui prévoit un allongement des délais de vérifications de l’administration lorsque le comité d’entreprise recourt à un expert, devenu sans objet du fait de l’encadrement des délais d’expertise au sein des délais de consultation.
Le XXII complète, enfin, l’article L. 1233-56, pour qu’il précise que l’administration peut formuler des observations sur les mesures sociales prévues par le projet de licenciement.
C. L’ACTION DE L’ADMINISTRATION DANS LES PROCÉDURES AVEC PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI
Suivant la nouvelle distinction opérée par le présent article, le XXIII crée, ensuite, un nouveau paragraphe consacré à l’intervention de l’administration dans les procédures impliquant l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Le XXIV procède, tout d’abord, à une clarification rédactionnelle, en précisant à l’article L. 1233-57 que l’employeur doit adresser une réponse motivée aux propositions de l’administration relatives au plan de sauvegarde de l’emploi. Il s’agit de formaliser cette obligation, à laquelle, en pratique, l’employeur est tenu aujourd’hui.
Le XXV crée ensuite huit articles qui définissent les nouveaux pouvoirs d’intervention et de contrôle de l’administration dans les procédures de licenciement.
● La validation de l’accord majoritaire et l’homologation du document de l’employeur
Le nouvel article L. 1233-57-1 octroie sa nouvelle compétence de contrôle à l’administration, qui doit désormais valider l’accord majoritaire ou homologuer le document unilatéral sur le projet de licenciement.
Le nouvel article L. 1233-57-2 prévoit, tout d’abord, les règles relatives à la validation de l’accord majoritaire, que l’administration peut effectuer dès lors qu’elle s’est assurée :
– de sa conformité aux dispositions des articles qui régissent le contenu et le régime de l’accord majoritaire ;
– de la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise ;
– de la présence dans le plan de sauvegarde de l’emploi des mesures qui y sont imposées par la loi.
Le nouvel article L. 1233-57-3 énonce, ensuite, les règles régissant l’homologation du document unilatéral de l’employeur. L’administration doit vérifier la conformité de ce document aux dispositions législatives et conventionnelles relatives à son contenu obligatoire, ainsi que la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise. Elle doit également apprécier le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, en fonction des critères suivants :
– les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ;
– les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ;
– les efforts de formation et d’adaptation déployés.
Elle doit, enfin, s’assurer que l’employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle ou la mise en place du congé de reclassement.
Dans le cadre de la procédure d’homologation du document unilatéral, le contrôle de l’administration apparaît donc plus étendu et comporte, surtout, une dimension d’évaluation de la proportionnalité des efforts consentis par l’employeur dans le plan de sauvegarde de l’emploi. Aujourd’hui, ce contrôle de proportionnalité est effectué par le juge judiciaire, au titre de l’article L. 1235-10. Dans un premier temps, l’administration pourra donc s’appuyer sur la jurisprudence développée en la matière.
Au cours des auditions menées par votre rapporteur, a été débattue la question du contrôle par l’administration, et, par répercussion, par la juridiction administrative, du motif économique du licenciement. Le présent article transfère à ces dernières la compétence aujourd’hui exercée par le tribunal de grande instance, habilité à évaluer la validité de la procédure collective de licenciement, mais pas celle de son motif économique, qui relève de l’appréciation du conseil de prud’hommes, dans le cadre des litiges individuels. Le présent article reprend donc cette architecture de compétence, distinguant conformité de la procédure et conformité du motif économique. Outre que le contrôle de ce dernier par l’administration et la juridiction administrative affaiblirait le contrôle du juge prud’homal, qui se prononcerait nécessairement après, se pose la question de sa constitutionnalité, selon plusieurs juristes reçus par votre rapporteur. Dans tous les cas, votre rapporteur estime qu’il serait à tout le moins souhaitable que le gouvernement donne des instructions claires et précises à l’administration en la matière, afin que puissent être rejetés des plans fondés sur une fraude à la loi.
● Les délais d’action de l’administration et l’information des parties
Le nouvel article L. 1233-57-4 fixe les délais dont dispose l’administration pour opérer son contrôle et notifier sa décision, qui sont de huit jours pour l’accord majoritaire et de 21 jours pour le document unilatéral, à compter de leur réception. L’administration doit motiver sa décision et la transmettre à l’employeur, au comité d’entreprise et, en cas d’accord, aux organisations syndicales signataires.
Cet article pose, ensuite, le principe selon lequel le silence gardé par l’administration au terme de ces délais vaut décision d’acceptation de validation ou d’homologation. Dans ce cas, il appartient à l’employeur d’en informer les représentants du personnel et les délégués syndicaux, celui-ci étant tenu, par ailleurs, d’informer les salariés de la décision de l’administration par voie d’affichage sur le lieu de travail.
À l’initiative des commissaires socialistes et du rapporteur, votre commission a étendu l’obligation d’information des salariés aux moyens et délais de recours qui leur sont ouverts.
● Les conséquences du refus de validation ou d’homologation
Le nouvel article L. 1233-57-7 organise les conséquences du refus de validation ou d’homologation par l’administration. Dans ce cas, l’employeur, s’il souhaite reprendre son projet de licenciement, doit présenter une nouvelle demande de validation ou d’homologation, après avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le comité d’entreprise.
● La compétence territoriale de l’administration
Le nouvel article L. 1233-57-8 règle la question de la compétence territoriale de l’administration, en l’attribuant à celle du lieu de l’entreprise concernée par le projet de licenciement. Si ce dernier porte sur des établissements relevant de plusieurs administrations, il appartiendra au ministre chargé de l’emploi de désigner l’autorité compétente.
● L’intervention de l’administration en cours de procédure
En amont de la décision de validation ou d’homologation, les pouvoirs de l’administration se trouvent également renforcés en cours de procédure.
Le nouvel article L. 1233-57-5 offre, ainsi, aux représentants du personnel la possibilité nouvelle de saisir l’administration à tout moment, pour qu’elle enjoigne à l’employeur de fournir des informations ou de se conformer à des règles de procédure de nature législative ou conventionnelle. L’administration doit se prononcer sur ces demandes d’injonction dans un délai de cinq jours.
Le nouvel article L. 1233-57-6 accorde, ensuite, le pouvoir à l’administration de formuler, à tout moment, des observations sur le déroulement de la procédure et des propositions sur les mesures sociales envisagées, auxquelles l’employeur doit répondre. Les représentants du personnel et les délégués syndicaux sont informés de ces échanges.
● Le suivi de la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi
En aval de la décision de validation ou d’homologation, sont également accrues les prérogatives de l’administration pour le suivi du plan de reclassement et du plan de sauvegarde de l’emploi. L’article L. 1233-63 prévoit aujourd’hui que l’administration doit être « associée » au suivi de la mise en œuvre des mesures contenues par ces plans. Le XXX modifie cet article, pour renforcer les pouvoirs de celle-ci en imposant que :
– les avis des représentants du personnel en la matière lui soient transmis (1°) ;
– l’employeur lui fournisse un bilan de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l’emploi (2°).
IV.- UN CONTENTIEUX DU LICENCIEMENT PARTAGÉ ENTRE
JUGE ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE
Le présent article réforme en profondeur le contentieux du licenciement économique collectif, en en partageant la compétence entre le juge administratif et le juge judiciaire. Les nouveaux pouvoirs accordés à l’administration sur la procédure de licenciement, qui induisent un contrôle de ses décisions en la matière, conduisent à confier une partie du contentieux à leur juge naturel, le juge administratif. Le tribunal administratif se substitue au tribunal de grande instance, mais ni au conseil de prud’hommes ni au juge pénal. Le présent article prévoit donc l’articulation entre les attributions de ces différentes juridictions, et adapte les sanctions applicables à la nullité du licenciement, au vu de cette nouvelle architecture contentieuse.
Sur la forme, le XXXI tire la conséquence rédactionnelle de la création de cette nouvelle voie de recours, en modifiant l’intitulé de la sous-section au sein de laquelle elle est mise en place.
A. LA COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF SUR LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT
Sur le fond, le XXXIII crée un nouvel article L. 1235-7-1 qui donne compétence au juge administratif sur la procédure de licenciement.
● Le champ de la compétence exclusive du juge administratif
Le nouvel article L. 1235-7-1 définit le champ matériel de la compétence du juge administratif, qui couvre les contestations relatives : à la décision de validation ou d’homologation, à l’accord majoritaire, au document unilatéral de l’employeur, au contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, aux décisions prises par l’administration sur les demandes d’injonction. Il attribue une compétence exclusive à la juridiction administrative (sous réserve du B ci-après), en affirmant que les litiges portant sur ces matières :
– ne peuvent faire l’objet de litiges distincts ;
– relèvent de la compétence en premier ressort du tribunal administratif, « à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ».
Cet article opère donc un regroupement des motifs contentieux relatifs à la procédure de licenciement dans une action en justice unifiée autour de la compétence du juge administratif. La décision administrative de validation ou d’homologation pouvant faire grief à l’ensemble des parties prenantes, seront habilités à agir devant le tribunal administratif, tant l’employeur, que les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les salariés. Ces derniers n’auront pas à présenter une action unique, mais le tribunal administratif pourra décider de joindre les affaires.
● Un contentieux postérieur à la décision administrative
La décision administrative arrêtant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, le droit de recours ne pourra être exercé qu’à partir de sa notification, ou à l’expiration de délai de décision implicite. En cas de difficulté pendant la procédure, les représentants du personnel ou les délégués syndicaux devront s’adresser à l’administration, comme exposé ci-dessus. Ils ne pourront, donc, plus exercer de recours contentieux. Pour cette raison, le XXXII supprime la possibilité actuelle d’agir en référé en cours de procédure devant le tribunal de grande instance, prévue au premier alinéa de l’article L. 1235-7.
● Les délais d’action et de procédure contentieuse
Le nouvel article L. 1235-7-1 fixe les délais d’action et de procédure devant le juge administratif : les recours devront être présentés dans un délai de deux mois courant pour l’employeur à compter de la notification de la décision administrative, et pour les organisations syndicales et les salariés, à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance.
Le tribunal administratif devra statuer dans un délai de trois mois, sous peine de dessaisissement d’office. En effet, si, à l’issue de ce délai, il ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, le litige sera porté devant la cour administrative d’appel, qui devra elle-même statuer dans un délai de trois mois. Si à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige sera porté devant le Conseil d’État. Dans le cas où le Conseil d’État serait saisi suite à la défaillance du tribunal puis de la cour d’appel, il statuerait donc en premier et dernier ressort.
Dans un objectif de clarté de la loi, ce nouvel article précise que sont applicables les dispositions relatives au référé du livre du code de justice administrative.
B. L’ARTICULATION AVEC LES ATTRIBUTIONS DU JUGE JUDICIAIRE
La création de la nouvelle voie de recours devant la juridiction administrative ne prive pas les salariés de leur droit d’agir devant le conseil de prud’hommes, ni les représentants du personnel de saisir le juge pénal.
● La compétence du juge prud’homal pour les litiges individuels
S’agissant des contentieux individuels, les salariés conservent le droit de contester leur licenciement devant le conseil de prud’hommes, dans un délai de douze mois. Le juge prud’homal contrôlera, comme aujourd’hui, la réalité et le sérieux du motif économique, ainsi que l’application au salarié des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi, tel que les critères d’ordre des licenciements. En revanche, si le salarié souhaite contester la validité même du plan de sauvegarde de l’emploi ou la régularité de la procédure collective, il ne pourra désormais agir que devant le tribunal administratif, compétent à l’exclusion de tout autre recours.
● La compétence du juge pénal pour le délit d’entrave
Les représentants du personnel conservent également le droit de saisir le tribunal correctionnel en cas de délit d’entrave, au titre de :
– l’article L. 1238-2, qui punit d’une amende de 3 750 euros par salarié concerné, le fait de procéder à un licenciement sans consulter les représentants du personnel ;
– l’article L. 1238-5, qui punit d’une même peine le prononcé d’un licenciement en violation des règles relatives à la consultation des représentants du personnel en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
La saisine du tribunal correctionnel ne suspend pas la procédure de licenciement, puisqu’elle vise à obtenir la condamnation pénale de l’employeur ou, le cas échéant, de l’administrateur ou du liquidateur.
C. LES SANCTIONS DU LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE
La réforme du contentieux du licenciement économique, désormais partagé entre juge administratif et judiciaire, rend nécessaire l’adaptation des sanctions applicables.
● Les cas de nullité du licenciement prévus à l’article L. 1235-10
Le XXXIV modifie l’article L. 1235-10, qui énonce aujourd’hui que :
– la procédure de licenciement est nulle à défaut de présentation du plan de reclassement aux représentants du personnel, ainsi que de leur information et consultation ;
– le juge apprécie la validité du plan de sauvegarde de l’emploi au regard des moyens dont dispose l’entreprise, l’unité économique et sociale ou le groupe.
Le 1° du XXXIV supprime ces dispositions, pour prévoir que :
– tout licenciement intervenu en l’absence de décision relative à la validation ou à l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue, est nul ;
– en cas d’annulation d’une décision de validation ou d’homologation en raison d’une absence ou d’une insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, la procédure de licenciement est nulle.
Ces modifications de l’article L. 1235-10 découlent du nouveau rôle accordé à l’administration, à qui est, en particulier, transférée la responsabilité d’apprécier la proportionnalité du plan de sauvegarde de l’emploi, le juge administratif étant appelé à contrôler l’évaluation de l’administration à cet égard.
S’agissant des juridictions compétentes pour constater les nouveaux cas de nullité, le conseil de prud’hommes pourra prononcer, dans le cadre des litiges individuels, la nullité des licenciements intervenus en l’absence de décision administrative favorable ou en présence d’un refus de validation ou d’homologation. En revanche, seul le juge administratif a compétence pour annuler la décision rendue par l’administration et prononcer la nullité de la procédure.
Le 2° du XXXIV exclut, ensuite, l’application de la sanction d’annulation du licenciement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, comme aujourd’hui, pour les raisons tenant à la spécificité de celles-ci exposées ci-dessous.
● Les sanctions des cas de nullité prévus à l’article L. 1235-10
Les conséquences de la nullité du licenciement demeurent inchangées. Aux termes de l’article L. 1235-11, lorsque le juge prud’homal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, il peut soit ordonner la poursuite du contrat de travail, soit prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible.
Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant ne peut être inférieur aux douze derniers mois de salaires. Le XXXV procède à une coordination législative à cet article.
● Le régime des autres cas de nullité du licenciement
Le XXXVI règle le régime des cas de nullité non visés à l’article L. 1235-10 modifié, en rétablissant un article L. 1233-16 disposant que :
– l’annulation de la décision de validation ou d’homologation pour un motif autre que l’absence ou l’insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi donne lieu, sous réserve de l’accord des parties, à la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ;
– à défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaires, due sans préjudice de l’indemnité de licenciement.
Le juge administratif peut, en effet, annuler la décision de validation ou d’homologation pour un motif autre que l’absence ou l’insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi, tel que l’illégalité externe. Cette annulation ouvre droit à réintégration ou indemnisation. En pratique, si l’employeur ne donne pas suite de sa propre initiative à la décision du juge administratif, le salarié devra saisir le conseil de prud’hommes pour en obtenir les effets à titre individuel.
V.- DES DÉLAIS ADAPTÉS DE NOTIFICATION DE LEUR LICENCIEMENT AUX SALARIÉS
Les changements apportés à la procédure de licenciement impliquent l’adaptation des délais de notification de leur licenciement aux salariés, prévus à l’article L. 1233-39, ce à quoi procède le XII en modifiant ce dernier.
Aujourd’hui cet article énonce que, à compter de la notification du projet de licenciement à l’administration, qui intervient au plus tôt le lendemain de la première réunion du comité d’entreprise, l’employeur peut procéder à la notification de leur licenciement aux salariés dans un délai qui varie en fonction du nombre de licenciements que comprend le projet.
S’agissant des entreprises de moins de 50 salariés, le 1° et le 2° du XII précisent que le délai de notification du licenciement ne peut être inférieur à trente jours à compter de l’information de l’administration. Les règles de notification demeurent donc inchangées dans ce cas.
En revanche, s’agissant des entreprises d’au moins 50 salariés, les 3° et 4° du XII suppriment les dispositions existantes et leur substituent des délais adaptés à la nouvelle procédure de licenciement. L’article L. 1233-39 modifié prévoit ainsi, désormais, que l’employeur peut notifier aux salariés leur licenciement, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la notification de la décision administrative ou à l’expiration du délai de contrôle de l’administration. Il sanctionne la violation de ces délais par la nullité des licenciements prononcés.
Le XIII procède, ensuite, à l’abrogation de :
– l’article L. 1233-40, qui prévoit aujourd’hui une prolongation des délais de notification du licenciement, lorsque le comité d’entreprise recourt à un expert, cette disposition devenant sans objet, du fait de l’encadrement des délais d’expertise dans ceux de la consultation du comité ;
– l’article L. 1233-41, qui offre aujourd’hui la faculté à l’administration de réduire le délai de notification du licenciement en cas d’accord sur les mesures sociales du licenciement.
VI.- L’APPLICATION AMÉNAGÉE DE LA RÉFORME AUX ENTREPRISES EN REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE
Les procédures de licenciement dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire obéissent, aujourd’hui, à des conditions particulières, du fait de la situation de défaillance de ces entreprises. Le présent article leur rend applicable une partie des nouvelles règles, tout en aménageant des dérogations, notamment en matière de délais. Il porte aussi adaptation du régime de la garantie des salaires et opère les coordinations nécessaires dans le code de commerce.
● La transposition de la nouvelle procédure de licenciement
Le XXVI modifie profondément l’article L. 1233-58, qui prévoit les règles de licenciement dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire. Il organise cet article en deux parties, la première énonçant les dérogations relatives à l’ensemble des procédures de licenciement, la seconde transposant les nouvelles règles de licenciement économique collectif. Le 1° du XXVI opère une clarification formelle à cet effet.
S’agissant de la première partie de l’article, le 2° du XXVI précise que l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur doit mettre en œuvre un plan de licenciement dans les conditions des articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, relatifs à l’accord majoritaire et au document unilatéral. Puis le 3° du XXVI indique que celui-ci doit réunir et consulter les représentants du personnel, selon les modalités prévues à l’article L. 2323-15, qui régit la consultation obligatoire sur les projets de restructuration, ainsi que, dans le cas d’un licenciement impliquant l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi :
– selon le 4° du XXVI, aux I et septième alinéas du II de l’article L. 1233-30, soit la procédure de droit commun sauf en ce qui concerne les délais de consultation du comité d’entreprise et la règle selon laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté en l’absence d’avis dans ces délais ;
– et selon le 5° du XXVI, aux articles L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, qui décrivent les pouvoirs de l’administration en cours de procédure.
Le 5° du XXVI crée, ensuite, la seconde partie de l’article L. 1233-58, qui adapte les nouvelles règles de licenciement aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire. Ainsi, l’accord majoritaire et le document unilatéral sont validés ou homologués dans les conditions de droit commun, sauf en ce qui concerne les délais assignés à l’administration, ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise, à huit jours en cas de redressement judiciaire et quatre jours en cas de liquidation judiciaire. Ne s’applique pas, non plus, l’obligation d’informer les salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail.
Si l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur a interdiction de procéder aux licenciements avant la décision favorable de l’administration, les licenciements prononcés avant cette notification sont considérés comme irréguliers et ne se trouvent pas sanctionnés par la nullité comme en droit commun. En cas de décision défavorable de l’administration, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur doit consulter le comité d’entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document ou l’accord modifié et l’avis du comité d’entreprise sont transmis à l’autorité administrative, qui se prononce également dans un délai de trois jours.
Enfin, en cas de licenciement intervenu en l’absence de décision administrative ou lorsque celle-ci est annulée, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Ce licenciement n’est pas considéré comme nul, contrairement aux dispositions de droit commun, prévues à l’article L. 1235-16.
Outre les délais réduits, l’une des principales spécificités de la procédure de licenciement dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire réside donc dans la sanction par l’irrégularité de licenciements considérés, en droit commun, comme nuls. En réalité, le présent article reprend le principe actuel qui exclut l’application de cette sanction, compte tenu de la situation économique et financière dégradée de ces entreprises.
● Le champ de la garantie des salaires
Le XXVII étend, ensuite, le champ de l’assurance de garantie du paiement des salaires, défini par l’article L. 3253-8, afin que celui-ci couvre :
– les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les 21 jours, lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être établi, suivant le jugement de liquidation ou la fin du maintien d’activité autorisé par ce jugement (1°), afin que les salariés soient couverts pendant le délai d’homologation de l’administration ;
– les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord majoritaire ou un document unilatéral, dès lors qu’il a été validé ou homologué avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou liquidation judiciaire (2°) ;
– les sommes dues, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, au cours 21 jours, lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être établi, suivant le jugement de liquidation ou la fin du maintien d’activité autorisé par ce jugement (3°).
Le 4°procède à un ajustement de référence au sein de l’article L. 3253-8.
Le XXVIII modifie, ensuite, l’article L. 3253-13 pour exclure du champ de l’assurance de garantie du paiement des salaires, les sommes concourant à l’indemnisation du préjudice causé par un licenciement effectué en application :
– d’un accord collectif validé (1°) ou d’un document unilatéral homologué (2°) ;
– si cet accord a été conclu ou ce document notifié postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (3°) ou moins de dix-huit mois avant.
● Les coordinations nécessaires au code de commerce
Le XXIX procède, enfin, aux coordinations nécessaires dans le code de commerce.
Le 1° modifie l’article L. 631-17 qui régit les licenciements économiques pendant la période d’observation, pour qu’il prévoie que l’administrateur « met en œuvre le plan de licenciement dans les conditions prévues à l’article L.1233-58 du code du travail » et transmet au juge-commissaire la décision de validation ou d’homologation de l’administration.
Le 2° modifie l’article L. 631-17 relatif au plan de redressement, pour prévoir que ce dernier est arrêté par le tribunal après mise en œuvre par l’administrateur de certaines dispositions de la procédure prévue à l’article L.1233-58 du code du travail, l’administration devant se prononcer dans un délai d’un mois après le jugement.
Le 3° corrige une référence obsolète.
Le 4° modifie l’article L. 642-5 relatif au plan de cession de l’entreprise, en cas de liquidation judiciaire, pour prévoir que ce dernier ne peut être arrêté par le tribunal qu’après la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L.1233-58 du code du travail, l’administration devant se prononcer sur le projet de licenciement dans ce délai.
VII.- L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA RÉFORME
Aux termes du XL du présent article, les nouvelles dispositions du code du travail et du code de commerce s’appliqueront aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er juillet 2013, c’est-à-dire à celles dont la convocation de la première réunion du comité d’entreprise sera envoyée à partir de cette date.
*
* *
Lors de son examen du projet de loi, votre commission a adopté les principales modifications suivantes au texte de l’article 13 :
À l’initiative du rapporteur, votre commission a modifié les dispositions relatives à l’échange de vues entre l’expert et l’employeur, pour l’organiser en deux temps, sans modifier le délai global de 36 jours prévu par le projet de loi. L’expert devra adresser ses demandes sous dix jours à l’employeur, qui disposera de huit jours pour lui répondre, un second échange d’informations, sous les mêmes délais, étant désormais possible. En effet, les premiers éléments transmis par l’employeur peuvent susciter de nouvelles questions de l’expert, et il convient de prévoir la possibilité d’un second échange d’informations.
À l’initiative des commissaires du groupe socialiste et du rapporteur, votre commission a adopté un amendement visant à de garantir le principe selon lequel l’avis de l’instance de coordination n’a pas vocation à se substituer à celui des CHSCT des établissements concernés par un projet de restructuration. Puis, elle a étendu l’obligation d’information des salariés sur la décision de validation ou d’homologation de l’administration, aux moyens et délais de recours qui leur sont ouverts.
*
La Commission est saisie de l’amendement AS 141 de Mme Jacqueline Fraysse, tendant à supprimer l’article.
Mme Jacqueline Fraysse. L’article 13 est particulièrement important : il instaure un nouveau régime de licenciement collectif.
Aujourd’hui, un employeur qui licencie dix salariés ou plus est tenu d’élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) afin d’accompagner les licenciements ou de procéder à des reclassements. En application d’une disposition de la loi du 27 janvier 1993, qui résultait d’ailleurs d’un amendement déposé par le groupe communiste, le tribunal de grande instance peut prononcer la nullité de ce plan de sauvegarde s’il l’estime insuffisant, ce qui entraîne la nullité des licenciements eux-mêmes et la réintégration des salariés concernés. Depuis 1993, aucun gouvernement, même de droite, n’avait osé remettre en cause ce dispositif, mais c’est pourtant ce qu’on nous propose ici : l’employeur qui souhaiterait licencier dix salariés ou plus pourrait le faire, soit en signant un accord collectif majoritaire avec les organisations syndicales – qui codécideraient ainsi des licenciements ! –, soit en élaborant unilatéralement un plan de sauvegarde de l’emploi. Dans les deux cas, le document serait transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
Dans le cas d’un accord collectif majoritaire, la DIRECCTE disposerait seulement – c’est invraisemblable ! – de huit jours pour se prononcer, contre quinze en cas de rupture conventionnelle entre un salarié et son employeur. De plus, en contradiction avec le principe général du droit selon lequel le silence gardé par l’administration vaut décision de rejet, l’accord serait validé si la DIRECCTE ne s’y était pas opposée dans ce délai.
Nous demandons, pour toutes ces raisons, la suppression de l’article 13. Si nous ne l’obtenons pas, nous présenterons des amendements de repli pour « limiter les dégâts ».
M. le rapporteur. Je ne partage nullement, madame Fraysse, votre lecture de l’article 13. Je me réjouis au contraire du retour de l’État, qui interviendra désormais dans les procédures de licenciement collectif pour motif économique. Le présent projet de loi n’instaure pas une procédure totalement nouvelle : il prévoit que le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, qui fait aujourd’hui l’objet d’une décision de l’employeur soumise à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, sera soit déterminé par un accord collectif majoritaire, soit fixé dans un document élaboré unilatéralement par l’employeur, puis soumis à l’administration pour homologation.
La signature d’un accord majoritaire supposera dans la plupart des cas le consentement de la CGT, dans d’autres l’approbation conjointe de FO et de la CFDT. J’insiste, en outre, sur l’importance de l’homologation : elle permettra à l’administration d’exiger que les mesures d’accompagnement soient en adéquation avec les moyens du groupe.
Vous souhaitez, chers collègues du groupe GDR, interdire les licenciements boursiers. Nous souhaitons, pour notre part, renchérir leur coût au point de dissuader d’y recourir. Tel est en partie l’objet de l’article 13. J’émets dont un avis défavorable sur votre amendement de suppression.
La Commission rejette l’amendement AS 141.
L’amendement AS 78 de M. Francis Vercamer n’est pas défendu.
Puis elle examine l’amendement AS 310 du rapporteur.
M. le rapporteur. Dans le cas d’un document unilatéral élaboré par l’employeur, l’administration sera informée de l’existence du plan social au plus tard le jour de la première réunion du comité d’entreprise. Le contenu du plan social définitif sera fixé par l’employeur à l’issue de la deuxième réunion du comité d’entreprise, qui se tiendra dans un délai de deux mois après la première. L’administration disposera ensuite de vingt et un jours pour homologuer le document. Elle aura ainsi le temps de prendre connaissance du plan, d’en mesurer les conséquences, d’exiger le cas échéant des contreparties et des mesures de reclassement ou de redéploiement plus favorables pour les salariés, puis de rendre son avis définitif.
Dans le cas d’un accord, les délais fixés par le projet de loi sont moins clairs. Aux termes de mon amendement, l’administration devrait être informée sans délai de l’ouverture d’une négociation en vue de la conclusion d’un tel accord. Elle disposerait ainsi d’un délai raisonnable pour étudier son contenu et, le cas échéant, le valider.
La Commission adopte l’amendement AS 310.
Puis elle examine, en présentation commune, les amendements AS 311 à AS 313 du rapporteur.
M. le rapporteur. La législation actuelle prévoit que l’expert mandaté par le comité d’entreprise dispose de vingt et un jours pour adresser ses demandes d’information à l’entreprise, laquelle doit répondre dans les quinze jours. Au dire des experts eux-mêmes, ces deux délais apparaissent relativement longs.
Je propose, avec ces trois amendements, que l’expert puisse adresser à l’entreprise deux séries successives de questions. Il disposera, à chaque fois, de dix jours pour ce faire. L’entreprise aura, de son côté, huit jours pour répondre, mais elle sera tenue de le faire rapidement, sans attendre l’expiration du délai.
Cette nouvelle procédure, dont la durée globale demeure inchangée par rapport à la précédente, permettra d’instaurer un véritable dialogue entre l’entreprise et l’expert, qui pourra ainsi préparer plus efficacement les discussions sur le contenu du plan social.
La Commission adopte successivement les amendements AS 311 à AS 313.
Puis elle est saisie de l’amendement AS 282 de M. Denys Robiliard.
M. Denys Robiliard. Dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique, l’employeur doit pouvoir mettre en œuvre, après avis favorable du comité d’entreprise, non pas des mesures de « mobilité interne », mais des mesures de « reclassement interne ». Telle est la correction que mon amendement vise à apporter. Il convient de distinguer les deux notions.
M. le rapporteur. Avis très favorable. Cet amendement améliore la cohérence de la procédure.
La Commission adopte l’amendement AS 282.
Puis elle examine, en discussion commune, l’amendement AS 112 de M. Jean-Noël Carpentier et les amendements AS 172 et AS 173 de Mme Jacqueline Fraysse.
M. Jean-Noël Carpentier. Cet amendement revêt une importance particulière aux yeux du groupe RRDP : il reprend une proposition de loi que nous avons déposée il y a plusieurs mois et dont nous avons discuté avec le Gouvernement encore récemment. Nous tiendrons compte du sort qui lui sera réservé au moment de voter sur l’article 13 et sur l’ensemble du projet de loi.
Nous déplorons actuellement un vide juridique : la loi ne prévoit pas que l’administration vérifie, dans les procédures de licenciement collectif, l’existence d’un motif économique réel et sérieux tel qu’il est défini par l’article L. 1233-3 du code du travail. Dans plusieurs affaires, des juridictions du premier et du deuxième degrés ont prononcé la nullité de plans sociaux contestés par des salariés après avoir constaté qu’un tel motif faisait défaut. Cependant, elles n’ont pas été suivies par la Cour de cassation, qui s’est appuyée sur l’adage « pas de nullité sans texte ». Notre amendement vise à combler cette lacune.
Mme Jacqueline Fraysse. Le présent projet de loi transfère à l’autorité administrative ce qui relevait précédemment de la compétence du juge judiciaire. Cependant, l’administration n’est amenée à se prononcer que sur la qualité et le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, sans avoir vérifié au préalable l’existence d’un motif économique réel et sérieux justifiant le recours au licenciement collectif. Avec les amendements AS 172 et AS 173, nous proposons d’ajouter cette étape essentielle. Si elle constate l’existence d’un tel motif, l’administration pourra alors examiner le plan.
En outre, le document dit « unilatéral » fixant le contenu du plan ne devrait pas refléter, selon nous, le seul avis de l’employeur.
M. le rapporteur. La question soulevée par ces amendements est revenue avec force au cours des auditions que j’ai menées. Les positions ne recoupent d’ailleurs pas le clivage entre organisations syndicales et employeurs.
Plusieurs questions se posent : à quel moment l’existence d’un motif économique doit-elle être contrôlée ? Est-ce à l’administration de le faire ? Si l’administration réalise ce contrôle, comme vous le proposez, elle en ôte la possibilité au juge judiciaire, à un moment ultérieur où le salarié peut contester son licenciement. Nous sommes donc confrontés à un dilemme.
Certaines organisations syndicales non signataires de l’accord du 11 janvier préfèrent que l’administration ne se prononce pas sur l’existence d’un motif économique réel et sérieux. En effet, si elle valide la justification de l’employeur, les salariés seront moins bien protégés et risqueront de ne pas obtenir d’indemnisation – ou d’obtenir une indemnisation moindre – s’ils contestent leur licenciement devant le juge. Actuellement, l’administration ne se prononçant pas sur la validité du motif économique, le juge administratif ne le fera pas davantage et le juge judiciaire pourra, le cas échéant, constater l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement et décider une indemnisation du salarié équivalente à au moins douze mois de son salaire.
D’autres plaident au contraire pour une intervention de l’administration en amont : dans les cas où le motif économique fait défaut de manière évidente, elle pourrait alors bloquer la procédure de licenciement.
D’autre part, la question de la fraude à la loi a fait l’objet d’un débat entre les juristes que j’ai auditionnés. Pour certains, l’administration pourrait refuser d’homologuer le document unilatéral élaboré par un employeur au motif que celui-ci s’est placé à tort dans le cadre de l’article 1233-3 du code du travail, ce qui constitue une tentative de fraude à la loi. L’administration effectuerait ainsi un contrôle de l’erreur manifeste, ce qui lui permettrait d’interrompre certaines procédures, par exemple des licenciements pour d’autres motifs déguisés en licenciements économiques, lesquels peuvent être révélés par un rapport d’expert.
De plus, même dans le cas où l’administration déciderait d’homologuer le document, cela laisserait néanmoins une marge d’appréciation au juge : le fait qu’elle ne se soit pas prononcée dans le cadre du contrôle de l’erreur manifeste ou de la fraude à la loi n’empêcherait nullement ce dernier de constater l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement et de décider une indemnisation des salariés. En revanche, si nous adoptions votre amendement, monsieur Carpentier, nous le priverions de cette possibilité, du fait de la séparation des ordres de juridiction.
Avis défavorable sur ces trois amendements.
M. Hervé Morin. Je suis opposé aux procédures d’homologation et de validation. Le MEDEF estime qu’elles vont sécuriser les plans de sauvegarde de l’emploi, mais il commet là une grave erreur d’analyse.
Premièrement, rien n’empêchera les juges, monsieur le rapporteur, d’aller contre l’avis de la DIRECCTE. Le juge administratif pourra ainsi très bien considérer, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, que la DIRECCTE a commis une erreur d’appréciation en estimant que les conditions d’un licenciement économique étaient réunies. Ensuite, le juge judiciaire pourra et même devra en tirer les conséquences, compte tenu du fonctionnement de nos juridictions.
Deuxièmement, l’intervention de l’administration à travers l’homologation ou la validation va politiser les procédures de licenciement. Dès lors que les médias s’intéresseront aux difficultés économiques de tel ou tel grand groupe, la DIRECCTE se prononcera non pas sur le fond, mais en fonction de la pression politique. Le dossier sera alors géré par le cabinet du ministre du travail ou par celui du Premier ministre.
On risque, dans ces conditions, de bloquer le système, comme en matière de libération conditionnelle des criminels ayant purgé de lourdes peines : tant que les décisions de cette nature ont relevé du Garde des sceaux, aucune libération conditionnelle n’a été prononcée, même dans des cas où les risques de récidive apparaissaient très faibles ou nuls, tant la pression médiatique et politique était forte. Depuis que ces décisions ont été confiées aux magistrats, le système fonctionne.
Enfin, la DIRECCTE sera exposée même dans le cas où elle ne fera que valider un accord majoritaire signé par des organisations syndicales. Le ou les syndicats qui n’auront pas signé l’accord pourront contester la légitimité des signataires et lui reprocher de les avoir soutenus. Cela risque d’être notamment le cas lorsque des syndicats minoritaires se seront alliés pour signer un accord que le syndicat le plus représentatif au sein de l’entreprise aura refusé.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Je rappelle que la représentativité syndicale est définie par la loi.
M. Denys Robiliard. Dans l’état actuel du texte, la DIRECCTE ne se prononcera pas sur l’existence d’un motif économique réel et sérieux. En revanche, elle pourrait effectuer un contrôle non pas de l’erreur manifeste – cela reviendrait pour elle à apprécier, certes de manière minimale, le bien-fondé du licenciement économique –, mais le détournement de procédure, qui correspond, en droit administratif, à la notion plus générale de fraude à la loi. Il conviendrait alors d’adopter un amendement en ce sens.
Jacqueline Fraysse critique le caractère unilatéral du document élaboré par l’employeur pour fixer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi. Cependant, ce document continuera à être soumis à la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise avant d’être, le cas échéant, homologué par l’administration. En outre, il est nécessaire qu’il conserve sa nature d’acte unilatéral, compte tenu des implications juridiques : l’employeur est tenu par ce qu’il a promis.
Mme Jacqueline Fraysse. Nous nous interrogeons sur la mise à l’écart du juge judiciaire, qui est pourtant le mieux placé pour statuer sur la réalité du motif économique justifiant les licenciements et, le cas échéant, sur le contenu du plan de sauvegarde. Les amendements AS 172 et AS 173 sont des amendements de repli, l’article 13 remettant en cause plusieurs protections dont bénéficient actuellement les salariés.
M. Jean-Noël Carpentier. Notre proposition de loi était bien antérieure au présent projet de loi, qui modifie de manière substantielle la procédure de licenciement économique. Même si je suis sensible aux arguments que vous avez développés, monsieur le rapporteur, il demeure selon moi nécessaire que l’administration vérifie, à un moment de la procédure de licenciement, l’existence d’un motif économique réel et sérieux – c’est d’ailleurs la question qui se trouve au cœur de nombreux conflits sociaux. Un tel contrôle constituerait une protection supplémentaire pour les salariés. Je maintiens mon amendement et n’exclus pas de le présenter à nouveau, modifié, lors de la discussion en séance publique.
M. le rapporteur. Sur le plan juridique, je rejoins votre analyse, monsieur Morin : il n’y a pas d’éviction du juge. Au contraire, nous aurons deux juges au lieu d’un. Le chevauchement des deux ordres de juridiction peut certes se révéler complexe, mais le président de la chambre sociale de la Cour de cassation et le Conseil d’État, que j’ai consultés, ont considéré que plus le pouvoir de l’administration – et donc du juge administratif – sur le motif économique était large, plus celui du juge judiciaire était réduit.
Sur le plan politique, je tire néanmoins de cette analyse des conclusions inverses des vôtres. Je me réjouis de ce retour de l’État à un moment où il est encore possible d’éviter des licenciements – plutôt que de les indemniser ultérieurement. Votre gêne révèle d’ailleurs la nature éminemment politique de ce texte, qui est un texte de gauche, mais dans une acception moderne, puisqu’il prévoit la négociation d’un accord majoritaire, l’homologation n’intervenant qu’à défaut de celui-ci, et organise le retour de l’État en lui permettant de peser sur les plans sociaux, de demander d’autant plus aux groupes qu’ils ont plus de moyens, et d’éviter les licenciements chaque fois que possible. Si le ministre a parlé de mettre fin à la préférence française pour le licenciement, c’est que, dans notre pays, le licenciement collectif apparaît comme la solution la plus facile aux difficultés des entreprises alors qu’ailleurs, on privilégie des redéploiements.
Le fait que, chose peu compréhensible, le MEDEF soit favorable à cette disposition suscite une certaine méfiance à son égard dans notre camp. Mais cette méfiance n’a pas lieu d’être puisque nous assistons au contraire, comme je viens de l’expliquer, à un retour de l’État.
J’ai demandé à de hauts magistrats de l’ordre judiciaire s’il fallait s’attendre à ce que le juge administratif soit plus clément que le juge judiciaire – c’est le pari que faisait initialement le MEDEF. Ils m’ont répondu par la négative. En effet, les deux ordres de juridiction harmonisent déjà leurs décisions lorsque les juridictions administratives sont conduites à se prononcer sur le licenciement des salariés protégés licenciés dans le cadre d’un plan social. J’appelle en revanche votre attention sur une vraie différence, qui justifie que l’on approfondisse la réflexion sur le motif économique et le moment où l’on apprécie celui-ci. Trois ans plus tard, on ne peut certes plus réintégrer les salariés, mais on peut apprécier si le motif économique était sérieux ou pas. Si le juge judiciaire protège mieux, c’est parce qu’il statue à un moment où il peut démontrer, le cas échéant, qu’il n’y avait pas de difficultés économiques. Il est plus difficile d’apprécier la réalité du motif économique à chaud. Il nous faut donc bien réfléchir à ce que nous demandons à l’administration, sachant que d’une manière ou d’une autre, cela réduira le pouvoir du juge judiciaire.
Dans les procédures collectives, c’est l’administration qui s’assurera du respect des procédures, sous le contrôle du juge et dans des délais serrés. Néanmoins, le délit d’entrave restera une voie d’action devant les juridictions pénales. Vos craintes ne sont donc pas fondées.
M. Hervé Morin. Vous confondez retour de l’État et retour de la politique, monsieur le rapporteur. Les juridictions, c’est l’État ! Vous avez été membre d’un cabinet ministériel : vous savez bien qu’en cas de plan social, surtout s’il n’y pas d’accord, les parlementaires de la circonscription ou du département demanderont au ministre d’intervenir pour que la DIRECCTE ne valide pas le plan social. Cela aboutira à politiser des dossiers qui ne méritaient pas de l’être. Je maintiens que l’État est déjà présent à travers le contrôle – particulièrement tatillon – du juge judiciaire. Mais vous n’y êtes pour rien : le texte ne fait que transcrire l’accord du 11 janvier.
La Commission rejette successivement les amendements AS 112, AS 172 et AS 173.
La Commission examine l’amendement AS 174 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Les DIRECCTE n’ont pas les moyens de donner un avis sur l’accord ou sur le document complet élaboré par l’employeur dans le délai prévu à cet article. Nous proposons donc de porter celui-ci à 45 jours.
M. le rapporteur. Je vous donnerais raison si le délai de vingt et un jours s’ouvrait à compter de l’entrée en lice de l’administration, en tout cas pour les grandes entreprises. Pour prendre un exemple, analyser si les coûts de production en Turquie sont inférieurs à ce qu’ils sont en France est en effet très complexe. Il ne suffit pas de les mesurer : il faut se demander si la différence de coût salarial de 300 euros aurait l’impact que l’on dit – 1 200 euros – sur le coût de fabrication d’une voiture si la même usine moderne était implantée en France. Mais dans le cas d’une décision unilatérale homologuée, l’administration sera saisie du plan du chef d’entreprise à la première réunion du comité d’entreprise. Puis interviendra la discussion avec les délégués du personnel. Il se passera ensuite deux mois – au lieu de quatorze jours auparavant – avant la deuxième réunion du comité d’entreprise. C’est seulement après ces deux mois que s’ouvre le délai de vingt-et-un jours.
Vous dites que le ministre a transcrit l’accord du 11 janvier, monsieur Morin. Je rappelle que l’une des parties à la négociation souhaitait que l’homologation concerne la procédure quand l’autre souhaitait qu’elle concerne le contenu – ce qu’a retenu le ministre. Le délai de l’administration s’élève donc à deux mois plus vingt et un jours pour les plans sociaux de moins de 99 licenciements, et à trois mois, voire quatre, plus vingt-et-un jours pour les très grands plans sociaux. Dans le cas de Renault ou de Peugeot, l’administration disposerait de quatre mois plus vingt et un jours, délai qui lui permettrait de recourir à toutes les expertises nécessaires.
Il n’en va pas de même en ce qui concerne la procédure de validation : le délai de huit jours est en effet très court.
M. André Chassaigne. Les conditions dans lesquelles nous examinons ce texte sont tout bonnement incroyables quand on songe à son importance. Cela justifiera sans aucun doute des rappels au Règlement lors de la discussion en séance publique.
L’intérêt premier de l’article 13 semble être la rapidité de la procédure, dont il permettrait de restreindre les délais. La réalité est tout autre. Nous avons procédé à des simulations sur des entreprises actuellement soumises à des plans de sauvegarde de l’emploi, au sein desquelles s’est engagée une réflexion sur des propositions alternatives : l’application du texte en l’état bloquerait toute possibilité de les sauver par ce moyen. Elles seraient condamnées à la liquidation !
Je puis citer l’exemple de plusieurs entreprises qui ont été sauvées parce que leurs salariés ont eu le temps d’élaborer collectivement, en recourant à une expertise économique, des solutions alternatives. Ce sera vraisemblablement le cas encore pour Fralib. Cet article revient à considérer – à l’instar du patronat – que les licenciements d’aujourd’hui sont les emplois de demain, et qu’il faut donc faire vite. Plus grave, il traduit un manque de confiance dans les solutions économiques alternatives que peuvent élaborer les salariés avec l’aide des experts, des collectivités territoriales et des acteurs économiques locaux.
Les organisations syndicales que nous avons rencontrées sont effrayées par ces dispositions. Vous en faites une lecture différente, monsieur le rapporteur, mais, même si je ne conteste pas votre honnêteté intellectuelle, je ne saurais vous suivre : cet article fragilisera encore la situation des salariés et, si le MEDEF y applaudit, ce n’est pas qu’il n’y ait rien compris, bien au contraire !
Mme Catherine Lemorton, présidente. Je ne peux pas vous laisser critiquer de la sorte les conditions d’examen de ce texte. Le rapporteur a pris la peine de répondre à chaque question et chaque amendement. Nous y consacrons le temps nécessaire, mais nous devons achever notre travail au cours de cette réunion car nous avons un autre texte en discussion cet après-midi en séance publique, qui a aussi son importance.
J’ajoute, Monsieur Chassaigne, que vous avez assisté à la conférence des présidents qui a fixé le calendrier de discussion de ce texte en séance dès mardi prochain. Vous en étiez donc parfaitement informé.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AS 174.
La Commission examine l’amendement AS 175 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. J’aimerais obtenir des explications sur cet alinéa. En droit administratif, le silence de l’autorité administrative vaut rejet de la demande de validation d’un accord. Or, ici, il vaut acceptation. Je ne suis pas juriste, mais je ne comprends pas la raison de ce renversement. Le rapporteur pourrait-il donc m’éclairer sur ce point ?
M. le rapporteur. Que les choses soient claires. Pour revenir sur le point précédemment évoqué, je n’ai jamais dit que la vertu de ce texte était d’aller plus vite. J’ai simplement salué le retour de l’État dans les plans sociaux et vous ai indiqué qu’une lecture attentive du texte montrait que l’administration aurait d’avantage de temps pour opérer son contrôle. Mais je n’ai porté aucun jugement sur ce que vous disiez.
En ce qui concerne Fralib, j’attends votre démonstration. Car en l’état actuel du droit, quelle est la procédure de consultation du comité d’entreprise ? Celui-ci doit tenir au moins deux réunions séparées par un délai minimal de quatorze jours en cas de projet comprenant moins de cent licenciements. S’y ajoutent 21 jours en cas de recours du comité d’entreprise à une expertise complémentaire. Que se passe-t-il aujourd’hui ? Le chef d’entreprise ne respecte pas ces délais en raison des problèmes rencontrés avec les salariés, et non parce qu’il y aurait été contraint par le juge, qui n’a pas annulé la procédure. Ce sont les salariés qui en supportent les conséquences.
Lisez le détail de l’article 13 et appliquez-le ligne à ligne, et vous découvrirez qu’en réalité, les plans sociaux seront désormais encadrés par des délais allongés.
Tout n’est pas noir ou blanc. C’est bien de la réalité du texte dont nous devons débattre, et je n’ai pas le sentiment d’avoir éludé les questions qu’il soulève et les débats que nous avons au sein même de la majorité. Je donne un avis défavorable à cet amendement.
Mme Jacqueline Fraysse. J’aimerais que vous répondiez à la question précise que je vous ai posée.
M. le rapporteur. On peut effectivement se poser la question, mais la procédure de licenciement collectif pour motif économique se déroule sous le contrôle du juge. Il sera en mesure d’annuler la décision rendue par l’administration et de prononcer la nullité des licenciements intervenus en l’absence de décision administrative favorable ou de refus de validation ou d’homologation. Je rejoins ce que disais Hervé Morin sur ce point. La DIRECCTE devra prendre toutes ses responsabilités en matière de contrôle des licenciements.
La Commission rejette l’amendement AS 175.
La Commission examine l’amendement AS 283 de M. Denys Robiliard.
M. Denys Robiliard. Lorsqu’on informe les salariés sur une décision susceptible de faire l’objet d’un recours, il est important que cette information comporte la mention des voies et délais de recours applicables. Cet amendement vise donc à préciser que l’affichage dans les locaux de l’entreprise prévu par la loi précise ces points.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 283.
La Commission rejette ensuite l’amendement AS 198 de Mme Jacqueline Fraysse, suivant l’avis défavorable du rapporteur.
La Commission examine l’amendement AS 176 de Mme Jacqueline Fraysse.
M. André Chassaigne. Cet amendement a pour objet d’en revenir à la sanction actuelle d’un licenciement intervenu en violation des dispositions relatives au plan de sauvegarde de l’emploi. Lorsque le plan est jugé insuffisant ou inexistant, le salarié a le choix entre la réintégration et une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire brut. Rien ne justifie en effet que le transfert de compétence vers l’autorité et le juge administratif s’accompagne d’un tel recul des droits des salariés victimes de licenciements abusifs.
M. le rapporteur. Sur cet amendement, dans la mesure où nous sommes ici dans le cadre d’un règlement judiciaire, aucune indemnisation minimale n’est prévue pour le salarié. Prévoir que cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois n’a donc ici pas de sens.
M. André Chassaigne. Je constate que, si j’en crois le rapporteur, les organisations syndicales font preuve d’une véritable schizophrénie, car ce sont elles qui nous ont suggéré cette modification, dont vous jugez qu’elle est contraire aux intérêts du salarié.
M. le rapporteur. La question se pose en effet à propos de l’amendement 179 qui viendra en discussion, mais sur cet amendement, il n’y pas de véritable sujet.
La Commission rejette l’amendement AS 176.
Elle examine ensuite l’amendement AS 177 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Encore une fois nous sommes préoccupés par le choix opéré par ce texte. L’accord majoritaire porteur d’un plan de sauvegarde de l’emploi échappe en effet au contrôle du juge judiciaire, alors même qu’il s’agit d’une convention conclue entre deux personnes morales de droit privé.
M. le rapporteur. Dans la mesure où de nouveaux pouvoirs sont accordés à l’administration sur la procédure de licenciement, le contentieux doit être confié au juge administratif. Il aurait été possible de confier l’intégralité du contentieux du licenciement au juge judiciaire. Cette option n’a cependant pas été retenue. Je n’ai pas moi-même un avis tranché sur la question malgré les nombreuses auditions que nous avons menées. En tout état de cause, le juge administratif ne sera pas plus clément que le juge judiciaire et lui confier une partie du contentieux sur le licenciement devra permettre d’améliorer les délais. Du point de vue des entreprises, il est indéniable que confier un bloc de compétence unique au juge judiciaire aurait certainement été plus efficace. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement AS 177.
Puis elle examine les amendements AS 233 et AS 234 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Ces amendements visent à limiter l’intervention du juge administratif aux litiges relatifs à la décision d’homologation ou de validation. J’en profite, au nom de mon groupe, pour saluer le retour de l’administration dans le contrôle des plans sociaux.
M. le rapporteur. Il convient de maintenir la possibilité pour le juge administratif de contrôler les autres motifs contentieux relatifs à l’accord collectif, étant dit par ailleurs que le juge pénal pourra toujours être saisi en cas de délit d’entrave. J’ajoute enfin que les principes généraux du droit ne permettront jamais de dessaisir un tribunal qui estimerait qu’il se situe dans un champ d’action qui relève de sa compétence.
La Commission rejette les amendements AS 233 et AS 234.
Elle examine l’amendement AS 178 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Nous sommes surpris de cet alinéa qui prévoit que le tribunal administratif devra statuer dans un délai de trois mois, sous peine de dessaisissement d’office. En effet, si, à l’issue de ce délai, il ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, le litige sera porté devant la cour administrative d’appel, qui devra elle-même statuer dans un délai de trois mois. Si à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige sera porté devant le Conseil d’État. Dans le cas où le Conseil d’État serait saisi suite à la défaillance du tribunal puis de la cour d’appel, il statuerait donc en premier et dernier ressort. Je ne sais pas ce qu’en pensent les juristes, ce que je ne suis pas, mais si un juge saisi d’un litige ne se prononce pas, nous sommes en présence d’un déni de justice. J’ajoute que dans le pire des cas, seul le Conseil d’État pourrait être saisi. Nous proposons donc de supprimer ces dispositions.
M. le rapporteur. Si vous lisez bien cet article, vous constaterez qu’il prévoit les dessaisissements successifs que vous citez, mais que la décision du Conseil d’État, elle, n’est soumise à aucun délai. Le plus important demeure qu’un jugement soit rendu.
Mme Jacqueline Fraysse. Certes, mais tout l’intérêt de cette procédure réside dans sa rapidité. La possibilité de faire appel d’une décision vise normalement à protéger les salariés. C’est cette protection qui disparaît ici. Je m’étonne que vous ne vous offusquiez pas que seul le Conseil d’État soit saisi suite à la défaillance du tribunal et de la cour d’appel.
La Commission rejette l’amendement AS 178.
Elle examine ensuite l’amendement 179 de Mme Jacqueline Fraysse.
M. André Chassaigne. Les alinéas 164 et 165 du présent article entérinent un recul des garanties accordées aujourd’hui aux salariés. En effet, l’alinéa 164 dispose qu’en cas d’annulation de l’autorisation administrative de licenciement obtenue par l’employeur, le salarié aura droit à réintégration dans les effectifs de l’entreprise « sous réserve de l’accord des parties ». Mais comment peut-on imaginer que l’employeur sera favorable à la réintégration du salarié ? Quant à l’alinéa 165, il prévoit qu’à défaut de réintégration, une indemnité sera versée au salarié, qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire, alors que c’est douze mois actuellement. Ces deux alinéas étant en retrait par rapport au droit en vigueur, le présent amendement propose de rétablir les dispositions applicables aujourd’hui.
M. le rapporteur. Je comprends votre interrogation et j’essaierai d’avancer dans le sens que vous proposez pour l’examen du texte en séance. Il faut toutefois bien comprendre que dans la mesure où le texte prévoit une homologation par l’administration tout en conservant la possibilité pour le juge d’invalider cette décision, l’intention de l’accord était bien de prévoir une pénalisation plus faible pour l’employeur que dans le droit en vigueur. Faut-il pour autant qu’en raison d’un désaccord entre l’administration et la juridiction, la solution adoptée soit moins favorable au salarié ? Je vois bien où est le problème, je vais étudier la question. En attendant, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
M. André Chassaigne. Je sens chez le rapporteur une forme d’hésitation, donc je maintiens mon amendement et je lui propose de s’y rallier dès à présent. Il pourra toujours proposer la suppression de cette disposition en séance si, après réflexion, elle ne lui paraît pas opportune.
La Commission rejette l’amendement AS 179.
Elle examine ensuite l’amendement 287 de M. Denys Robiliard.
M. Denys Robiliard. Il s’agit d’un amendement de cohérence : l’avis des instances de coordination temporaires n’a en effet pas vocation à se substituer à l’avis des différents comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux ou d’établissement.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission adopte l’amendement AS 287 ainsi que l’amendement AS 288 de M. Denys Robiliard visant à supprimer des dispositions redondantes.
Puis, elle adopte l’article 13 modifié.
Article 14
(art. L. 1233-90-1 [nouveau] et L. 2325-37 du code du travail)
Création d’une obligation de recherche d’un repreneur
en cas de fermeture d’établissement
Le présent article vise à créer l’obligation, pour les entreprises d’au moins mille salariés, de rechercher un repreneur lorsqu’elles procèdent à la fermeture d’un établissement. Il constitue la déclinaison législative du 6/ de l’article 12 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013.
Il s’agit d’une innovation majeure, car il n’existe à ce jour aucune obligation légale en la matière pour les entreprises in bonis, qui complétera utilement l’obligation de revitalisation à laquelle celles-ci sont soumises.
I.- L’OBLIGATION ACTUELLE DE REVITALISATION DU BASSIN D’EMPLOI APRÈS UN LICENCIEMENT COLLECTIF
Aujourd’hui, aux termes de l’article L. 1233-84 du code du travail, lorsqu’elles mettent en œuvre un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l’équilibre du bassin d’emploi dans lequel elles sont implantées, les entreprises d’au moins 1 000 salariés doivent contribuer à la création d’activités et au développement des emplois, ainsi qu’atténuer les effets du licenciement sur les autres entreprises du bassin d’emploi.
Cette obligation de revitalisation prend la forme d’une convention entre l’entreprise et l’administration, qui détermine les actions de création d’activités et d’emploi envisagées, ainsi que leurs modalités de financement. Cette convention doit être conclue dans les six mois de la notification du projet de licenciement à l’administration, et prendre en considération les mesures de même nature prévues par un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ou par le plan de sauvegarde de l’emploi (47). Les actions de revitalisation sont arrêtées après consultation des collectivités territoriales intéressées, des organismes consulaires et des partenaires sociaux.
Dans le cadre de son obligation de revitalisation, l’entreprise doit verser une contribution dont le montant ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du SMIC par emploi supprimé. L’administration peut, toutefois, fixer un montant inférieur, lorsque l’entreprise se trouve dans l’incapacité d’assumer une telle charge financière. En l’absence de convention, une contribution d’un montant double doit être versée par l’entreprise au Trésor public.
En 2012, ont été conclues 127 conventions de revitalisation, principalement par des entreprises du secteur industriel, et le montant total des contributions financières s’est élevé à 41,8 millions d’euros. Parmi les actions retenues par les conventions, prédominent l’aide à l’emploi et au développement de l’activité (20,3 millions d’euros), ainsi que l’appui à la reconversion de sites (5,7 millions d’euros). Près de 10 400 créations d’emploi sont attendues, pour environ 10 750 destructions d’emplois.
Le bilan des actions de revitalisation menées ces dernières années apparaît, d’ailleurs, positif. Ainsi, les 133 conventions arrivées à échéance en 2012 ont permis la création de plus de 10 300 emplois depuis leur signature en 2009 et 2010. Elles ont donc rempli à 78 % leur objectif, qui se situait autour 13 200 créations d’emploi.
II.- L’OBLIGATION NOUVELLE DE RECHERCHE D’UN REPRENEUR AVANT LA FERMETURE D’UN SITE
Seule obligation légale de participer au développement économique d’un bassin d’emploi, l’obligation de revitalisation intervient, cependant, en aval des licenciements. Malgré ses résultats encourageants, il semble donc indispensable de mettre en place une procédure permettant d’agir en amont des suppressions d’emploi, ce que propose le présent article en créant une obligation de recherche d’un repreneur avant la fermeture d’un site. Afin de souligner leur complémentarité, ces deux obligations seront prévues à la même sous-section du code du travail, dont le I modifie, en conséquence, l’intitulé.
Le II crée un nouvel article L. 1233-90-1 du code du travail, qui impose, désormais, l’obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de licenciement collectif ayant pour conséquence la fermeture d’un établissement, et en précise les modalités. Le premier alinéa de ce nouvel article prévoit que ce processus de recherche doit débuter dès l’ouverture de la procédure d’information et consultation sur le projet de licenciement. En pratique, il commencera souvent avant, mais, juridiquement, ne deviendra opposable qu’à partir de la première réunion du comité d’entreprise.
A. LE CHAMP DES ENTREPRISES CONCERNÉES
Le premier alinéa du nouvel article L. 1233-90-1 définit également le champ des entreprises concernées par l’obligation. Il s’agit des entreprises mentionnées à l’article L. 1233-71, c’est-à-dire celles soumises à l’obligation de proposer un congé de reclassement, à savoir :
– les entreprises et les établissements d’au moins 1 000 salariés ;
– les entreprises appartenant à des groupes d’au moins 1 000 salariés ;
– les entreprises ou groupes d’entreprises de dimension communautaire d’au moins 1 000 salariés.
La référence à l’article L. 1233-71 exclut donc du champ de l’obligation les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, qui ne sont pas soumises aux dispositions relatives au congé de reclassement.
B. LE RÔLE DU COMITÉ D’ENTREPRISE
Conformément à la volonté des partenaires sociaux, le comité d’entreprise sera pleinement associé au processus de recherche d’un repreneur.
Le premier alinéa du nouvel article L. 1233-90-1 prévoit, tout d’abord, que celui-ci doit être informé sur ce processus dès l’ouverture de la procédure d’information et consultation sur le projet de licenciement collectif, c’est-à-dire lors de sa première réunion à ce sujet.
Le deuxième alinéa offre, ensuite, au comité d’entreprise la possibilité de recourir à l’assistance de l’expert-comptable désigné dans le cadre de la procédure de licenciement, afin qu’il analyse le processus de recherche d’un repreneur, sa méthodologie et son champ, qu’il apprécie les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels et qu’il étudie les projets de reprise.
L’expert-comptable ainsi mandaté bénéficiera d’importants pouvoirs. En effet, le IV du présent article lui octroie l’accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l’opération de recherche d’un repreneur, en modifiant l’article L. 2325-37 afin qu’il prévoie que l’expert-comptable jouit des mêmes prérogatives dans ce cadre que lors des opérations de concentration.
Le troisième alinéa impose, de plus, à l’employeur d’informer le comité d’entreprise des offres de reprise formalisées, sur lesquelles ce dernier peut émettre un avis, tout en prévoyant que les informations communiquées à ce titre sont réputées confidentielles. Il s’agit d’une amélioration considérable des droits des représentants du personnel, dont l’information détaillée sur les offres de reprise dépend, aujourd’hui, de la volonté de l’employeur.
Aux termes du quatrième alinéa, l’avis du comité d’entreprise sur ces offres doit être rendu dans les délais encadrant la procédure de licenciement, prévus à l’article L. 1233-30 (48). Toutefois, si une offre de reprise était présentée en fin de procédure, tant que les licenciements économiques n’ont pas été prononcés, l’employeur peut retirer ou modifier son projet de licenciement en fonction des caractéristiques de l’offre. Par ailleurs, si les licenciements ont été effectués avant la reprise du site, le repreneur peut toujours réembaucher les salariés licenciés qui le souhaiteraient, même s’ils ont bénéficié des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi et perçu des indemnités de licenciements.
Le dispositif prévu par le nouvel article L. 1233-90-1 reprend donc les principes posés par le 6/ de l’article 12 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, qui prévoit que le comité d’entreprise doit être informé dès le début du processus de recherche, consulté sur ce processus à l’aide, éventuellement, d’un expert, et informé des offres de reprise formalisées.
C. L’ARTICULATION AVEC L’OBLIGATION DE REVITALISATION
Le dernier alinéa du nouvel article L. 1233-90-1 opère l’articulation de la nouvelle procédure avec l’actuelle obligation de revitalisation, en prévoyant que les actions engagées par l’employeur au titre de l’obligation de recherche d’un repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l’entreprise et l’administration. Ces dispositions visent à assurer la complémentarité effective des deux obligations.
Au-delà, il s’agit aussi d’inciter les employeurs à mener une recherche active de repreneur, puisque les actions accomplies en la matière constitueront des éléments en faveur de l’entreprise lors de la négociation de la convention de revitalisation, si, au final, l’établissement visé ferme. En cas de négligence, l’administration pourrait décider, au contraire, de fixer une contribution financière de revitalisation élevée.
D. L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF
Le IV du présent article prévoit, enfin, les modalités d’entrée en vigueur de la nouvelle obligation de recherche d’un repreneur. Cette dernière s’appliquera aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er juillet 2013, c’est-à-dire à celles dont la convocation de la première réunion du comité d’entreprise sur le projet de licenciement envisagé est envoyée à partir de cette date.
*
* *
À l’initiative des commissaires socialistes et du rapporteur, votre commission a renforcé les droits du comité d’entreprise en lui ouvrant la possibilité de « formuler des propositions » sur les offres de reprise du site.
*
La Commission examine l’amendement AS 142 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Il est défendu.
M. le rapporteur. Pour la première fois, on introduit dans le droit positif une obligation de recherche d’un repreneur en cas de fermeture de site : j’étais très surpris que le MEDEF souscrive à cette disposition, mais je suis encore plus surpris que vous souhaitiez la supprimer. Il y a une procédure d’information et de consultation des salariés, un droit à l’expertise pour rechercher un repreneur et notre groupe travaille pour compléter ces dispositions, notamment en matière de droit du commerce.
M. André Chassaigne. L’argumentaire est le même que pour notre amendement précédent : cet article est très insuffisant, en particulier sur le plan des droits des salariés. Il ne correspond en rien à la philosophie que nous souhaitons promouvoir, au travers d’une proposition de loi que nous avons déposée et que nous allons traduire sous forme d’amendements afin d’encourager l’appropriation collective par les salariés de la recherche d’un repreneur. A contrario, cet article est placé sous le sceau de la confidentialité et ne prévoit aucune implication des salariés dans le processus.
La commission rejette l’amendement AS 142.
Puis, elle examine l’amendement AS 289 de M. Michel Lefait.
M. Denys Robiliard. Cet amendement vise à faire en sorte que le comité d’entreprise puisse non seulement émettre un avis, mais également formuler des propositions.
M. le rapporteur. Cela va dans le sens des dispositions de l’article 13 qui permettent désormais aux organisations représentatives des salariés de formuler des propositions qui doivent être examinées par l’employeur dans le cadre de la nouvelle procédure de licenciement. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement AS 289.
Elle examine ensuite l’amendement AS 79 de M. Francis Vercamer.
M. Arnaud Richard. Il s’agit d’un amendement d’appel qui vise à attirer l’attention sur la nécessité que les entreprises versent un montant substantiel pour la revitalisation des bassins d’emplois en cas de licenciement collectif affectant l’équilibre de ceux-ci.
M. Jean-Marc Germain. Je suis favorable sur le principe à cet amendement, mais cette question sera traitée dans le cadre de la discussion de la proposition de loi préparée par notre collègue François Brottes, dans laquelle ce dispositif aura plus sa place. Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement.
L’amendement AS 79 est retiré.
La Commission examine l’amendement AS 80 de M. Francis Vercamer.
M. Arnaud Richard. Une proposition de loi déposée, il y a quelques années, par Gérard Cherpion et Gaëtan Gorce prévoyait un triplement du montant de la contribution financière à verser par les entreprises : tel est l’objet du présent amendement.
Jean-Marc Germain, rapporteur. Pour le même motif que l’amendement précédent, je vous demande de retirer cet amendement.
L’amendement AS 80 est retiré.
La Commission examine ensuite l’amendement AS 81 de M. Francis Vercamer.
M. Arnaud Richard. Nous demandons un rapport du Gouvernement sur les améliorations qui doivent être envisagées dans le cadre de l’obligation de revitalisation des bassins d’emploi touchés par des licenciements collectifs.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AS 81 puis adopte l’article 14 modifié.
Article 15
(art. L. 1233-5, L. 1233-71 et L. 1233-72-1 du code du travail)
Précision des critères d’ordre des licenciements économiques et
allongement de la durée du congé de reclassement
Le présent article vise à préciser les critères d’ordre des licenciements économiques et allonger la durée du congé de reclassement. Il constitue la déclinaison législative des articles 21 et 23 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013.
I.- LA PRÉCISION DES CRITÈRES D’ORDRE
DES LICENCIEMENTS ÉCONOMIQUES
Le I du présent article porte sur les critères d’ordre des licenciements économiques, définis à l’article L. 1233-5. Cet article prévoit aujourd’hui que, à défaut d’accord collectif, l’employeur doit déterminer, après consultation des représentants du personnel, les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements. Il énonce, ensuite, que ces critères doivent notamment prendre en compte :
– les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
– l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
– la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
– les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Ces prescriptions légales ont été complétées par la jurisprudence, qui a encadré les marges de manœuvre de l’employeur. En effet, selon un arrêt du 14 janvier 1997 de la chambre sociale de la Cour de cassation, l’employeur « doit retenir, sans que cette liste soit limitative, la totalité des critères légaux » et « ne peut privilégier l’un d’entre eux qu’à la condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères ». Dans un arrêt du 2 mars 2004, la chambre sociale a réaffirmé ce second principe, en indiquant que « l’employeur peut privilégier l’un des critères retenus pour déterminer l’ordre des licenciements à condition de tenir compte de chacun d’entre eux ».
Le I du présent article vise à inscrire dans la loi cette solution jurisprudentielle, en complétant l’article L. 1233-5 par un alinéa prévoyant que « l’employeur peut privilégier un de ces critères, en particulier celui des qualités professionnelles, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus par le présent article ». Il traduit ainsi fidèlement les dispositions de l’article 23 de l’accord du 11 janvier, qui stipule que l’employeur est fondé, pour fixer l’ordre des licenciements, à privilégier la compétence professionnelle, sous réserve de tenir également compte des autres critères fixés par la loi.
Le I du présent article a donc pour seul effet d’introduire au niveau législatif, un principe déjà appliqué par les tribunaux, et ne modifie pas, en réalité, les règles aujourd’hui en cours.
En particulier, demeurent inchangées les garanties relatives à l’ordre des licenciements, offertes aux salariés par la loi et la jurisprudence. Les salariés peuvent toujours exiger de l’employeur qu’il leur indique, par écrit, les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, au titre des articles L. 1233-17 et L. 1233-43. En cas de contestation, n’est pas remise en cause l’obligation imposée par la jurisprudence à l’employeur de présenter « les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix » (49). De même, tout licenciement intervenu en violation des critères d’ordre reste considéré comme irrégulier et donne lieu à l’indemnisation du salarié concerné.
II.- L’ALLONGEMENT DE LA DURÉE DU CONGÉ DE RECLASSEMENT
Le présent article vise, ensuite, à allonger la durée du congé de reclassement, que doivent proposer les entreprises d’au moins 1 000 salariés (50), aux salariés dont elles envisagent le licenciement économique. Prévu à l’article L. 1233-71, le congé de reclassement a pour objet de permettre à ces derniers de bénéficier de formations et des prestations d’une cellule d’accompagnement de la recherche d’emploi. Il peut débuter par un bilan de compétences, afin de définir un projet professionnel et déterminer les mesures de reclassement à mettre en œuvre, l’ensemble de ces actions étant financées par l’employeur.
Aujourd’hui, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 1233-71, la durée du congé de reclassement ne peut excéder neuf mois. Le II du présent article porte cette durée maximale à douze mois, conformément à l’article 21 de l’accord du 11 janvier. Il s’agit d’harmoniser la durée maximale du congé de reclassement avec celle du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), qui doit être proposé par les entreprises de moins de 1 000 salariés, aux salariés dont elles envisagent le licenciement économique et qui poursuit le même objectif d’organiser un parcours de retour à l’emploi.
Au-delà d’actions de formation, le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail, effectuées pour le compte d’un autre employeur, dans le cadre de contrats à durée déterminée ou de travail temporaire, durant lesquelles il est suspendu. L’article L. 1233-72-1 prévoit aujourd’hui que, au terme de ces périodes de travail, le congé de reclassement reprend « sans excéder son terme initial ».
Le III du présent article propose d’ouvrir la possibilité d’un report du terme du congé, en supprimant cette mention et en complétant l’article L. 1233-72-1 par un alinéa énonçant que « l’employeur peut prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées ». En pratique, cette possibilité devra être négociée dans le plan de sauvegarde de l’emploi, et permettra de sécuriser les parcours des salariés qui choisissent d’accomplir des périodes de travail dans d’autres entreprises.
*
La Commission examine l’amendement AS 143 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Cet article est extrêmement préoccupant eu égard aux critères auxquels il renvoie pour déterminer l’ordre des licenciements. Je rappelle que dans le cadre d’un licenciement économique, le salarié n’est nullement en cause : l’employeur prend seul la décision. Le code du travail prévoit cependant qu’il doit se référer à un certain nombre de critères d’ordre social, comme les perspectives de retour à l’emploi ou les charges de famille. Or, le texte introduit désormais la notion de « qualités professionnelles » et en fait le critère à privilégier, avant même de prendre en considération les critères sociaux ! Nous considérons que ce critère n’est pas recevable car le motif du licenciement n’est pas inhérent à la personne du salarié.
M. le rapporteur. Cet article reprend stricto sensu les critères dégagés par la jurisprudence. Il s’agit d’un ensemble de critères objectifs que l’employeur peut pondérer.
Mme Jacqueline Fraysse. Il faudrait à tout le moins éviter de privilégier ce critère-là !
M. Denys Robiliard. Il ne s’agit ni plus ni moins que de la transposition de l’accord du 11 janvier, qui correspond à l’état de la jurisprudence. Par ailleurs, il sera très difficile concrètement pour les employeurs de privilégier ce critère car il doit reposer sur des éléments objectifs qui sont difficiles à démontrer.
M. Gérard Sebaoun. N’y aurait-il pas cependant une amélioration sémantique à apporter en recourant au verbe « prendre en compte » plutôt qu’au verbe « tenir compte » ?
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement AS 143 ainsi que l’amendement AS 180 de Mme Jacqueline Fraysse.
Puis, elle examine les amendements AS 127 et AS 126 de M. Thierry Braillard.
M. Jean-Noël Carpentier. Ces amendements visent à nuancer le texte.
M. le rapporteur. Je répète que cet article ne fait que reprendre la jurisprudence en vigueur. Je tiens par ailleurs à le replacer dans l’historique de la négociation : le MEDEF souhaitait initialement que l’employeur puisse se référer à un critère de « compétences professionnelles » et non de « qualités professionnelles », contrairement à ce que retient la jurisprudence aujourd’hui. Vous louiez, madame Fraysse, sur l’article 13, l’intervention du juge judiciaire et les arrêts de la Cour de cassation : vous avez ici la traduction concrète de sa jurisprudence. Pourquoi reprendre ce critère ? Parce que, dans le cadre d’un plan social, si l’employeur se réfère uniquement à des critères sociaux, tels que l’âge ou la difficulté à retrouver un emploi, il risque de perdre des salariés assumant des fonctions stratégiques indispensables à la pérennité de l’entreprise. C’est pourquoi il doit pouvoir introduire une pondération. C’est d’ailleurs dans cet esprit que ce critères est appliqué et contrôlé par le juge aujourd’hui. Avis défavorable.
La Commission rejette les amendements AS 127 et AS 126.
Puis, elle adopte l’article 15 sans modification.
Article 16
(art. L. 1235-1, L. 1471-1 [nouveau], L. 3245-1 du code du travail ;
art. 80 duodecies du code général des impôts)
Développement de la conciliation prud’homale et
réforme des délais de prescription
Le présent article vise à développer la conciliation prud’homale et porte réforme des délais de prescription. Il constitue la déclinaison législative des articles 25 et 26 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013.
I.- DÉVELOPPER LA CONCILIATION PRUD’HOMALE
La procédure prud’homale se distingue des autres procédures judiciaires par la place centrale qu’elle accorde à la conciliation. En effet, en dehors des recours en référé et de quelques demandes spécifiques, tout procès prud’homal commence par une tentative de conciliation des parties devant le bureau de conciliation, composé d’un conseiller employeur et d’un conseiller salarié. Si aucun accord n’est trouvé entre les parties ou si seul un accord partiel est conclu, l’affaire ou le reliquat du litige est alors transféré au bureau de jugement, qui comprend au moins deux conseillers employeurs et deux conseillers salariés.
En pratique, aujourd’hui, seul 7 % des affaires sont réglées lors du préalable obligatoire de conciliation. Or, cette voie permet une résolution rapide et plus apaisée des litiges, qu’il convient de favoriser.
A. LA POSSIBILITÉ DE CONCLURE UNE NOUVELLE CATÉGORIE D’ACCORD
Les partenaires sociaux ont donc choisi de lui consacrer l’article 25 de l’accord du 11 janvier. Ce dernier stipule que, en cas de contestation d’un licenciement, les parties peuvent mettre un terme définitif au litige en conciliation, au moyen du versement par l’employeur d’une indemnité forfaitaire calculée à partir de l’ancienneté du salarié, et à laquelle sont attachées les caractéristiques sociales et fiscales des dommages et intérêts. Il indique, ensuite, que cette indemnité vaut réparation de l’ensemble des préjudices découlant de la rupture du contrat de travail, et détermine les montants de l’indemnité qui varient de deux à quatorze mois de salaires. Il prévoit, enfin, que la conciliation intervenue sous cette forme a autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Le I du présent article reprend ces dispositions en complétant l’article L. 1235-1 du code du travail, qui régit les contestations relatives à l’irrégularité des licenciements. Le 1° crée deux nouveaux alinéas à cet article, qui énoncent que :
– lors de la conciliation, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer de mettre un terme au litige par un accord prévoyant le versement d’une indemnité forfaitaire, dont le montant est déterminé sur le fondement d’un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié ;
– le procès-verbal constatant cet accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail.
La conclusion d’un accord demeure donc facultative, comme c’est le cas aujourd’hui : les parties restent libres de ne pas régler leur différend en conciliation. Le barème mentionné revêt également un caractère indicatif, ni les parties, ni le bureau de conciliation n’étant tenus de le proposer. Un accord pourra ainsi être trouvé, le cas échéant, en dehors des stipulations du barème.
Toutefois, si les parties décident de conclure un accord, il emporte renonciation à toute contestation de la rupture du contrat. Ses effets sont donc identiques à ceux d’une transaction, dont l’article 2052 du code civil prévoit qu’elle a, entre les parties, « l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ». C’est déjà le cas des actuels accords et procès-verbaux de conciliation, qui ferment toute voie de recours. En revanche, l’accord n’éteint pas, par principe, les contestations portant sur d’autres griefs, en matière d’exécution du contrat de travail par exemple. Néanmoins, si ces griefs faisaient l’objet d’un accord en conciliation, aucune voie de recours ne serait ouverte, conformément au droit actuel.
Le 2° procède, ensuite, au même article, à une coordination rédactionnelle.
Enfin, suivant le principe fixé par l’accord du 11 janvier, le II du présent article modifie l’article 80 duodecies du code général des impôts, afin que l’indemnité versée lors de la conciliation ne soit pas imposable et bénéficie des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les sommes accordées aujourd’hui par le juge, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse par exemple. Elle sera donc totalement exonérée de l’impôt sur le revenu, et de cotisations sociales dès lors que son montant, cumulé avec celui de l’indemnité de licenciement, ne dépassera pas deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, fixé à 74 064 euros en 2013. Elle sera soumise aux CSG et CRDS, dans la mesure où elle conduira à dépasser le seuil d’exonération égal au montant légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement.
B. L’OBLIGATION DE MOTIVATION DES JUGEMENTS
À défaut de conciliation, la procédure prud’homale se poursuit devant le bureau de jugement. À cet égard, les partenaires sociaux ont souhaité souligner à l’article 25 de l’accord du 11 janvier que le bureau doit justifier du montant des condamnations qu’il prononce en réparation du préjudice subi.
Le 3° du I intègre cette précision à l’article L. 1235-1 du code du travail, en le complétant par un alinéa disposant que le juge « justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie ».
Cette mention constitue un rappel de l’obligation de motivation des décisions incombant à tout magistrat, y compris au juge prud’homal, aux termes de l’article 455 du code de procédure civile. Cet article prévoit que tout jugement « doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens » et « doit être motivé ».
II.- LA RÉFORME DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION
Au-delà de l’aménagement de la conciliation prud’homale, les partenaires sociaux ont souhaité une réforme des délais de prescription, dont ils ont arrêté les principes à l’article 26 de l’accord du 11 janvier. Cet article stipule que :
– sans préjudice des délais de prescription plus courts fixés par le code du travail, aucune action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail ne peut être engagée au-delà d’un délai de 24 mois, sauf en matière de discrimination ;
– les demandes portant sur les salaires se prescrivent par 36 mois si elles sont formées en cours d’exécution de contrat, le point de départ de cette période de 36 mois courant à compter de la rupture du contrat, lorsque l’action est introduite postérieurement à celle-ci.
Les partenaires sociaux se sont donc accordés pour créer un délai général de prescription des actions relatives à l’exécution et la rupture du contrat de travail, plus court que le délai de droit commun de cinq ans aujourd’hui applicable, lorsqu’aucun délai particulier n’est imposé par le code du travail. S’agissant de la prescription des réclamations sur les salaires, ils ont choisi d’en raccourcir le délai de cinq à trois ans.
Les III et IV du présent article traduisent ces dispositions dans le code du travail, tout en les encadrant.
A. UN DÉLAI DE PRESCRIPTION GÉNÉRAL DE DEUX ANS
Le III crée un nouveau titre VII relatif à la prescription des actions en justice, au sein du livre consacré à la résolution des litiges devant le conseil de prud’hommes. Ce titre comporte un nouvel article L. 1471-1 unique disposant que :
– toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ;
– ce délai de prescription ne s’applique pas aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées sur le fondement des articles L. 1132-1 (discrimination), L. 1152-1 (harcèlement moral) et L. 1153-1 (harcèlement sexuel) ;
– ce délai ne fait pas obstacle aux délais de prescription plus courts prévus par le code du travail, notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 (douze mois pour contester la rupture du contrat de travail en cas d’adhésion à un contrat sécurisation professionnelle), L. 1234-20 (six mois pour contester le solde de tout compte), L. 1235-7 (douze mois pour contester un licenciement économique) et L. 1237-14 (douze mois pour contester une rupture conventionnelle).
Par rapport aux stipulations de l’accord du 11 janvier, le nouvel article L. 1471-1 accroît donc le nombre d’exceptions à l’application du délai de deux ans, en y incluant les actions en réparation d’un dommage corporel ou sur le fondement du harcèlement moral et sexuel.
Conformément aux dispositions de droit commun prévues à l’article 2224 du code civil (51), ce nouvel article fixe le point de départ de la prescription au « jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ». Ce dernier cas vise, par exemple, le cas du salarié qui ne retire pas un courrier recommandé avec accusé de réception, et qui est alors malgré tout considéré comme ayant eu connaissance de son contenu.
B. UN DÉLAI DE PRESCRIPTION DES SALAIRES DE TROIS ANS
Le IV modifie ensuite l’article L. 3245-1 du code du travail, en s’inspirant des orientations fixées par l’accord du 11 janvier. Cet article prévoit aujourd’hui que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par « cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil ».
Le IV propose de mettre en œuvre le délai spécial voulu par les partenaires sociaux, en substituant au délai actuel, un délai de « trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
C. L’ENTRÉE EN VIGUEUR DES NOUVEAUX DÉLAIS
Le V prévoit enfin le dispositif d’entrée en vigueur des nouveaux délais de prescription. Ils seront applicables aux prescriptions en cours à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En revanche, elles n’affecteront pas les actions introduites avant l’entrée en vigueur de la loi, qui se poursuivront et seront jugées conformément à la loi ancienne, y compris en appel et en cassation.
*
La Commission examine l’amendement AS 144 de Mme Jacqueline Fraysse.
M. André Chassaigne. Cet amendement vise à supprimer l’article 15 qui, en introduisant une tarification forfaitisée de l’indemnisation du licenciement abusif, souhaitée par le patronat, porte atteinte aux missions du juge conciliateur dans le cadre des procédures prud’homales. La prise en compte du seul critère d’ancienneté pose également problème. Quant au renvoi au décret, il n’est pas suffisamment encadré. Cet article aura pour effet de corseter les décisions des conseils de prud’hommes concernant le montant des indemnités en renvoyant au barème prévu par l’accord, barème qui prévoit une indemnisation insuffisante et inférieure à celle généralement octroyée aujourd’hui. Ainsi les conseils de prud’hommes perdent la prérogative dont ils disposaient de pouvoir apprécier souverainement le montant de l’indemnité à accorder au salarié.
M. le rapporteur. Le barème qui va être fixé par décret a vocation à s’appliquer à la procédure de conciliation mais ne s’imposera pas au juge. Je vous rappelle que les partenaires sociaux étaient initialement en désaccord sur ces dispositions. Un consensus s’est néanmoins dégagé sur la nécessité de mettre en œuvre une procédure de conciliation à la fois rapide et très cadrée. C’est pourquoi il n’y aura pas d’autre critère pris en compte que celui de l’ancienneté. Par ailleurs, il ne s’agit ici que de l’indemnité liée à la rupture du contrat de travail, les autres éventuels préjudices ne sont donc pas pris en compte dans ce cadre, et cette indemnité s’ajoute aux autres indemnités légales ou conventionnelles. Certes, il y a un raccourcissement du délai de prescription, mais ce délai, fixé à deux ans à compter de la rupture du contrat de travail, a été unanimement jugé suffisant lors des auditions : au-delà, ils profiteraient plus aux avocats qu’aux parties ! Les seules difficultés qui pourraient advenir concernent les contentieux en cours de contrat de travail, mais je rappelle que 92 % des contentieux ont logiquement lieu après la rupture du contrat. Enfin, le texte fait exception pour tous les sujets - discrimination, harcèlement, dommages corporels – qui pourraient nécessiter des temps de prescription plus longs.
La commission rejette l’amendement AS 144.
Elle est saisie ensuite de l’amendement AS 241 de M. Christophe Cavard.
M. Christophe Cavard. Nous sommes dans une logique d’amélioration du texte qui, sur certains aspects, tels que l’indemnité forfaitaire et les délais de prescription, peut être considéré comme en recul par rapport au droit existant. On ne peut pas nier que sur ces aspects, le texte peut être jugé comme insuffisant ou déséquilibré, même si un des partenaires à la négociation aura sans doute du mal à entendre et à accepter des modifications sur ces points. Il appartient néanmoins aux parlementaires de travailler à améliorer le texte.
Elle examine ensuite l’amendement AS 125 de M. Thierry Braillard.
M. Jean-Noël Carpentier. Les conciliations échouent souvent du fait de l’absence du défendeur. Il faudrait inscrire dans la loi les dispositions de l’article R. 1453-1 du code du travail qui dispose que les parties comparaissent en personne.
M. le rapporteur. Il n’est pas utile et pas souhaitable d’introduire dans la loi des dispositions qui figurent déjà dans la partie réglementaire du code du travail. Avis défavorable.
Mme Catherine Lemorton, présidente. Compte tenu de ces remarques, retirez-vous votre amendement ?
M. Jean-Noël Carpentier. Non car ces dispositions ne sont pas respectées.
M. le rapporteur. Il ne serait pas cohérent que certains types de contentieux soient organisés par la loi tandis que d’autres continueraient à relever du niveau réglementaire.
La Commission rejette l’amendement AS 125.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements AS 117 de M. Jean-Noël Carpentier, AS 82 de M. Francis Vercamer et AS 202 de Mme Jacqueline Fraysse.
M. Jean-Noël Carpentier. L’amendement AS 117 est défendu.
M. Arnaud Richard. Le barème doit être indicatif, afin que le montant de l’indemnisation soit laissé à la libre appréciation du juge.
Mme Jacqueline Fraysse. L’amendement AS 202 est défendu.
M. le rapporteur. Effectivement, le barème de l’indemnité forfaitaire est facultatif, mais il n’est pas nécessaire de modifier la rédaction de l’alinéa. S’agissant de l’amendement AS 117, je préfère le mot « fondement » à l’expression « se référer ». J’ajoute que cette indemnité forfaitaire ne se substitue pas aux indemnités légalement dues à l’occasion d’un licenciement et qu’elle a la nature de dommages-intérêts. Avis défavorable aux amendements AS 117, AS 82 et AS 202.
La Commission rejette les amendements AS 117, AS 82 et AS 202.
Elle examine ensuite alors l’amendement AS 201 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Il est défendu.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement AS 201.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements AS 124 de M. Thierry Braillard et AS 314 du rapporteur.
M. Jean-Noël Carpentier. L’amendement AS 124 est défendu.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
M. Denys Robiliard. Concernant l’amendement AS 314 du rapporteur, je rappelle le principe d’unicité de l’instance : si le procès-verbal de conciliation vient mettre un terme au litige, on ne peut plus le ranimer. À vouloir trop bien faire, on risque de compliquer le travail des prud’hommes.
M. le rapporteur. Je suis sensible à cette remarque. Je retire mon amendement.
L’amendement AS 124 est retiré.
La Commission rejette l’amendement AS 124.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements AS 118 de M. Jean-Noël Carpentier et AS 204 de Mme Jacqueline Fraysse.
M. Jean-Noël Carpentier. L’amendement AS 118 est défendu.
Mme Jacqueline Fraysse. L’amendement AS 204 vise à laisser un délai suffisant aux salariés pour récupérer leurs droits. Le délai de prescription de droit commun est de cinq ans. Nous sommes défavorables à la réduction des délais de prescription prévue par le projet de loi.
M. le rapporteur. Avis défavorable à ces deux amendements. La réduction de ces délais a été acceptée par les organisations syndicales en contrepartie d’avancées sur la complémentaire santé, les congés pour formation, etc. J’ajoute que les salariés n’ont rien à gagner dans des contentieux trop longs qui augmentent les frais d’avocats. Le problème se pose cependant lorsqu’il y a des éléments difficiles à prouver.
Mme Jacqueline Fraysse. Nous ne partageons pas votre avis, et les syndicats qui nous ont alertés ne sont pas d’accord. La représentation nationale a le droit de légiférer dans un sens différent de l’accord du 11 janvier.
M. Jean-Noël Carpentier. Les syndicats n’étaient pas demandeurs de cette disposition. Je ne pense pas que nous remettions en cause l’équilibre obtenu par les partenaires sociaux en revenant sur ce délai.
La Commission rejette les amendements AS 118 et AS 204.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 203 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Il s’agit d’une précision visant à mieux protéger les salariés.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement AS 203.
Elle examine ensuite l’amendement AS 200 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Il s’agit d’un amendement de repli.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement AS 200.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 205 de Mme Jacqueline Fraysse.
M. André Chassaigne. L’amendement est défendu.
M. le rapporteur. Je n’y suis pas totalement défavorable.
M. Denys Robiliard. Il faudrait prévoir non pas une interruption du délai mais une suspension, faute de quoi le délai de deux ans recommencerait à l’issue de l’interruption.
M. le rapporteur. Je pourrai donner un avis favorable à votre amendement en séance publique, sous réserve de cette rectification. En attendant, j’émets un avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement AS 205.
Elle adopte ensuite l’article 16 sans modification.
Article 17
(art. L. 2314-2, L. 2322-2 et L. 2324-3 du code du travail)
Aménagement de la mise en place des institutions représentatives du personnel en cas de franchissement des seuils d’effectif
Le présent article vise à aménager la mise en place des institutions représentatives du personnel en cas de franchissement des seuils d’effectif. Il constitue la déclinaison législative de l’article 17 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, qui stipule que les entreprises disposent d’un délai d’un an pour mettre en œuvre les obligations liées au franchissement des seuils, à condition d’organiser l’élection des représentants du personnel sous trois mois. Le présent article reprend ces deux principes.
I.- L’ALLONGEMENT À TROIS MOIS DU DÉLAI D’ORGANISATION DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
L’obligation de mettre en place des institutions représentatives du personnel obéit, aujourd’hui, à des conditions d’effectif. Ainsi, l’article L. 2312-2 impose la mise en place de délégués du personnel, dès lors que l’effectif d’une entreprise atteint au moins 11 salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. L’article L. 2322-2 impose la constitution du comité d’entreprise, dès lors que l’effectif d’une entreprise atteint au moins 50 salariés sur une période identique. En pratique, les entreprises tiennent, chaque mois, un tableau de leurs effectifs, qui leur permet de constater le franchissement de ces seuils.
Aux termes des articles L. 2314-2 pour les délégués du personnel et L. 2324-3 pour le comité d’entreprise, il appartient alors à l’employeur d’engager le processus de mise en place de l’institution représentative concernée, en informant les salariés par voie d’affichage de l’organisation d’élections professionnelles. Le document affiché précise la date du premier tour, qui doit intervenir dans les quarante-cinq jours. Ce délai permet à l’employeur de négocier le protocole préélectoral avec les organisations syndicales.
Suivant l’article 17 de l’accord du 11 janvier et dans l’objectif d’accorder aux entreprises le temps nécessaire aux opérations préélectorales, en cas de mise en place des institutions, le présent article propose d’allonger à trois mois le délai de tenue du premier tour des élections professionnelles.
Le I complète l’article L. 2314-2, pour qu’il prévoie que lorsque l’organisation de l’élection est consécutive au franchissement du seuil de mise en place des délégués du personnel, le premier tour doit intervenir dans les quatre-vingt-dix jours de l’affichage.
Le III complète l’article L. 2324-3 par un alinéa prévoyant la même règle concernant le comité d’entreprise.
Ce délai de trois mois étant subordonné au « franchissement du seuil », il s’applique tant à la première mise en place d’une institution représentative du personnel, qu’à une nouvelle mise en place, si cette institution a disparu suite à une baisse prolongée des effectifs de l’entreprise. Dans les deux cas, la problématique demeure la même car l’ensemble du processus doit être bâti ou reconstruit. Il s’agit, de plus, d’un délai maximal, l’employeur pouvant organiser les élections avant son terme.
II.- LE POSSIBLE REPORT D’UN AN DES OBLIGATIONS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION RÉCURRENTES
DU COMITÉ D’ENTREPRISE
Le II du présent article traduit, ensuite, le second principe arrêté par l’article 17 de l’accord du 11 janvier, relatif au report des obligations liées au franchissement du seuil. Il complète, à cette fin, l’article L. 2322-2 précité, par un alinéa énonçant que l’employeur dispose d’un délai d’un an à compter de ce franchissement, pour se conformer aux « obligations récurrentes d’information et de consultation du comité d’entreprise », selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d’État. Il s’agit, là encore, d’un délai maximal, l’employeur pouvant satisfaire à ces obligations avant cette échéance.
D’après les informations transmises par le ministère du travail, ces obligations recouvrent l’ensemble des obligations d’information et de consultation périodiques du comité d’entreprise, qu’il s’agisse de consultations sur des thèmes spécifiques, tels que la formation professionnelle, ou des consultations à caractère global, sur la situation économique ou sociale de l’entreprise par exemple.
Cette faculté de report est limitée, par le présent article, aux seules attributions du comité d’entreprise, alors que le champ visé par l’accord du 11 janvier peut sembler plus large. Ces dispositions ne s’appliquent ni aux délégués du personnel, ni au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui pourront exercer l’ensemble de leurs prérogatives dès leur mise en place. Elles n’affectent, par ailleurs, ni les obligations d’information et de consultation ponctuelles du comité d’entreprise, sur un projet de restructuration par exemple, qui doivent être mises en œuvre, ni la gestion des activités sociales et culturelles par celui-ci. Enfin, conformément au droit actuel, les membres du comité d’entreprise bénéficieront du statut de salariés protégés dès leur élection, ainsi que de tous les moyens prévus par le code du travail, telles que les heures de délégation.
*
* *
À l’initiative des commissaires du groupe socialiste et du rapporteur, votre commission a souligné le caractère facultatif du report d’un an des obligations récurrentes du comité d’entreprise et le maintien des consultations ponctuelles de celui-ci, en indiquant qu’à compter du franchissement du seuil, l’entreprise disposait d’un délai d’un an pour se conformer « complètement » à ces obligations.
*
Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression AS 145 de Mme Jacqueline Fraysse, puis adopte l’amendement AS 290 de M. Denys Robiliard.
L’amendement AS 110 de M. Gérard Cherpion n’est pas défendu.
La Commission adopte ensuite l’article 17 modifié.
Article 18
Expérimentation du contrat à durée indéterminée intermittent
Le présent article autorise l’expérimentation, dans les seules entreprises de moins de 50 salariés, appartenant à trois secteurs d’activité, du recours direct au contrat de travail intermittent sans obligation de conclure préalablement un accord collectif de branche ou d’entreprise, mais après information des délégués du personnel. Il s’agit de la déclinaison de l’article 22 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013.
Le principal objectif de cette expérimentation est de s’interroger sur la nécessité de conserver le mécanisme de soumission du recours au contrat de travail intermittent à l’existence d’un accord, qu’il soit de branche étendu, d’entreprise ou d’établissement et, le cas échéant, d’assouplir son régime à l’issue de cette période expérimentale.
A. LE CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE INTERMITTENT AUJOURD’HUI
Le dispositif du contrat de travail à durée indéterminée « intermittent » existe d’ores et déjà. Toutefois, les conditions de recours à ce type de contrat sont aujourd’hui fortement encadrées : en particulier, il est soumis à l’existence d’un accord de branche étendu ou d’un accord d’entreprise.
1. Le droit existant
Le travail intermittent est défini comme comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées : aujourd’hui, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises pour lesquelles un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit, à condition que cet accord en fixe le cadre d’application et précise les emplois permanents pour lesquels ce type de contrat peut être conclu (article L. 3123-31 du code du travail).
Il se distingue du travail saisonnier, qui concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année, à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie ; mais également du travail à temps partiel, qui correspond simplement à un horaire de travail inférieur au temps plein.
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, qui doit être écrit et mentionner notamment la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée annuelle minimale de travail, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes (article L. 3123-32).
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié (article L. 3123-34). En outre, les heures accomplies, au cours d’une semaine donnée, au-delà de la durée légale hebdomadaire par le salarié intermittent sont des heures supplémentaires.
S’agissant de la rémunération, les travailleurs intermittents sont exclus du champ de la mensualisation, mais l’accord de branche, d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la rémunération qui leur est versée mensuellement est indépendante de l’horaire, par un mécanisme de lissage.
2. Le CDI intermittent dans la pratique
Comme l’expose l’étude d’impact associée au présent projet de loi, une vingtaine de conventions collectives, couvrant au total près de 400 000 salariés, prévoient d’ores et déjà la possibilité de recourir au CDI intermittent. C’est le cas en particulier dans la branche de l’immobilier, des prestataires de services du secteur tertiaire ou encore des experts comptables-commissaires aux comptes pour ce qui concerne de grandes branches (couvrant plus de 100 000 salariés). De plus petites branches autorisent également le recours à ce type de contrat, comme par exemple la pâtisserie, l’hôtellerie de plein air, les industries des jeux et jouets, l’animation ou encore l’enseignement privé hors contrat.
B. L’EXPÉRIMENTATION PRÉVUE PAR LE PROJET DE LOI
Le présent article instaure une voie dérogatoire aux dispositions de l’article L. 3123-31, qui prévoit que le recours au contrat de travail intermittent ne peut se faire que sur la base d’un accord de branche étendu, d’entreprise ou d’établissement. Le premier alinéa aménage ainsi la possibilité de recourir au contrat de travail intermittent en l’absence de convention ou d’accord collectif, mais de manière très encadrée :
– En premier lieu, il s’agit d’une expérimentation qui a vocation à se dérouler jusqu’au 31 décembre 2014, autrement dit, en tenant compte des délais vraisemblables de promulgation de la loi, pendant un an et demi. En effet, le troisième alinéa de l’article prévoit la remise au Parlement, avant cette date, d’un rapport du Gouvernement évaluant la mise en œuvre de cette expérimentation.
– Ensuite, cette expérimentation est restreinte aux seules entreprises de moins de 50 salariés.
– Cette expérimentation est également limitée à des « secteurs déterminés par arrêté du ministre chargé du travail ».
En l’occurrence, trois secteurs ont vocation à participer à cette expérimentation, qui devrait couvrir au total un peu moins de 160 000 salariés : la branche des organismes de formation (à l’exception des salariés formateurs en langues pour lesquels il existe déjà un accord collectif spécifique), pour des effectifs de l’ordre de 95 300 salariés ; la branche du commerce des articles de sport et des équipements de loisirs, pour un effectif de 54 400 salariés ; et enfin, la branche des détaillants et détaillants fabricants de confiserie, chocolaterie, biscuiterie, pour des effectifs de 10 100 salariés.
– Enfin, elle ne peut être initiée qu’après information des délégués du personnel. En effet, l’expérimentation concerne les seules entreprises de moins de 50 salariés, dont l’effectif est donc inférieur au seuil d’obligation de mise en place d’un comité d’entreprise. Dans ces petites structures, les délégués du personnel sont les seules instances représentatives du personnel : ils sont donc les destinataires naturels de toute information relative à l’entreprise. À partir du moment où est mise en place une possibilité de se soustraire à ce qui est aujourd’hui soumis à l’existence d’un accord collectif, il semble normal que soit a minima prévue l’information des institutions représentatives du personnel.
C. LE MÉCANISME DE LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
Le deuxième alinéa de l’article précise que le contrat de travail « indique que la rémunération versée mensuellement au salarié est indépendante de l’horaire réel effectué et est lissée sur l’année ».
Aux termes de l’article L. 3123-37, un mécanisme de lissage sur l’année de la rémunération peut d’ores et déjà être prévu dans le cadre du recours au CDI intermittent, dès lors qu’il est expressément prévu par l’accord collectif. La formulation de cet article est strictement reprise ici dans le cadre de l’expérimentation prévue, à la seule différence que ce mécanisme de lissage devient ici obligatoire et qu’il n’est plus une simple faculté.
En dehors de ce mécanisme de lissage, les autres dispositions applicables au CDI intermittent soumis à accord collectif seront applicables dans le cadre de cette expérimentation, en particulier les articles L. 3123-33, L. 3123-34 et L. 3123-36, qui concernent respectivement le contenu obligatoire du contrat de travail du salarié intermittent, la limitation à un tiers de la durée prévue à l’accord du nombre d’heures supplémentaires pouvant être effectuées chaque année par le salarié intermittent, et enfin, l’égalité des droits reconnus aux salariés intermittents par rapport aux salariés à temps plein ainsi que la prise en compte des périodes non travaillées dans la détermination des droits à ancienneté.
Le mécanisme de lissage de la rémunération est néanmoins à double tranchant :
– Certes, il permet au salarié d’éviter les ruptures de salaires et donc de favoriser son accès à certains droits comme le logement ou le crédit, comme le précise l’étude d’impact associée au projet de loi ;
– A contrario, il conduit également à ce que sa rémunération soit inférieure à son activité horaire pendant les périodes travaillées : autrement dit, le contrat débutant vraisemblablement par une période travaillée, le mécanisme du lissage se donne en quelque sorte comme une sorte d’avance de trésorerie consentie par le salarié intermittent à son employeur.
*
* *
Lors de son examen de cet article, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur inscrivant dans la loi les trois branches concernées par l’expérimentation prévue d’une mise en œuvre du contrat de travail intermittent en l’absence d’accord collectif.
*
La Commission examine l’amendement AS 146 de Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Les salariés relevant d’un contrat de travail intermittent alternent périodes de travail à temps plein, à temps partiel et de non-travail. Ils sont ainsi complètement à disposition de l’employeur. Nous demandons la suppression de cette disposition « assassine » qui asservit quelque peu les salariés.
M. le rapporteur. Cet article permet simplement d’expérimenter le contrat à durée indéterminée intermittent en l’absence d’accord de branche. J’ai par ailleurs déposé un amendement visant à inscrire dans la loi les trois secteurs où cette expérimentation pourra être entreprise, à savoir les organismes de formation, à l’exclusion des formateurs en langues, le commerce des articles de sport et des équipements de loisirs, et les détaillants et détaillants fabricants de confiserie, chocolaterie et biscuiterie.
Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AS 146, puis adopte l’amendement rédactionnel AS 318 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AS 316 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à inscrire dans la loi, et non pas dans un arrêté, les trois secteurs où le contrat à durée indéterminée, conformément à l’accord du 11 janvier, pourra être expérimenté.
La Commission adopte l’amendement AS 316, puis l’amendement rédactionnel AS 319 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement AS 123 de M. Joël Giraud.
M. Jean-Noël Carpentier. Il est défendu.
M. le rapporteur. Il faut saluer la grande constance avec laquelle le groupe RRDP défend le développement du tourisme, mais l’expérimentation doit être limitée aux secteurs prévus par les partenaires sociaux.
La Commission rejette l’amendement AS 123, puis adopte l’article 18 modifié.
La Commission examine l’amendement AS 122 de M. Joël Giraud.
M. Jean-Noël Carpentier. La logique de cet amendement est la même que celle du précédent : il s’agit de mettre en place une procédure destinée à sécuriser le travail des saisonniers.
M. le rapporteur. L’amendement va à l’encontre de notre volonté commune de ne pas multiplier ce type de contrats. On ne va pas créer un contrat ad hoc pour le tourisme. Pourquoi les branches concernées ne négocient-elles pas un accord ?
M. Jean-Noël Carpentier. L’objectif de Joël Giraud n’est pas le tourisme en général, mais seulement la sécurisation des contrats des saisonniers.
M. le rapporteur. Il est déjà possible de le faire par accord d’entreprise, de telle sorte que je ne comprends pas bien l’intérêt de cet amendement.
La Commission rejette l’amendement AS 12.
Puis elle examine l’amendement AS 89 de M. Hervé Morin.
M. Hervé Morin. Le Gouvernement veut inscrire dans la Constitution la capacité des corps intermédiaires d’être facteurs d’évolution du droit, mais un dialogue social nourri et fructueux requiert des syndicats patronaux représentatifs ainsi que des branches professionnelles appropriées. Or, certaines de ces 700 branches ne comptent que quelques centaines ou milliers de salariés et, faute de syndicats en situation de négocier, il est impossible d’y engager un dialogue social : il existe des branches aussi baroques que celles de la désinsectisation ou du transport aérien du bétail. Il faut donc, à l’image de ce qui a été fait pour les organismes paritaires collecteurs agréés en matière de formation professionnelle, confier aux partenaires sociaux un mandat les invitant à en réduire significativement le nombre.
M. le rapporteur. Cet amendement constitue une injonction au Gouvernement, mais il sera loisible à ses dépositaires de l’interpeller en séance publique sur cette question.
La Commission rejette l’amendement AS 89.
Article 19
Habilitation du Gouvernement à modifier par voie d’ordonnance
le code du travail application à Mayotte
Le présent article a pour objet d’habiliter le Gouvernement à modifier par voie d’ordonnance, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, le code du travail applicable à Mayotte, pour y rendre applicables et y adapter les dispositions du projet de loi.
En tant que département d’outre-mer, Mayotte se trouve soumis au principe d’identité législative. Le droit commun s’y applique automatiquement, mais il peut être adapté. Mayotte dispose en effet d’un code du travail particulier issu d’une ordonnance du 25 février 1991. Il est procédé à l’actualisation périodique de ce code plutôt qu’à l’extension des modifications législatives en matière de droit du travail. L’étude d’impact jointe au projet de loi indique que certaines dispositions du projet de loi seraient inapplicables en l’état à Mayotte. Par exemple le code du travail mahorais ne réglemente pas le travail à temps partiel et ne prévoit pas les conditions d’application aux entreprises locales des accords nationaux interprofessionnels ou de branche.
Des adaptations parfois importantes sont donc nécessaires qui n’ont pu intervenir au stade du projet de loi. Elles seront effectuées par voie d’ordonnance. Plusieurs habilitations actuellement en cours autorisent déjà le Gouvernement à moderniser le code du travail applicable à Mayotte (en particulier le 4° du I de l’article 27 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer). Mais ces habilitations ne couvrent pas le domaine du droit commercial et du régime complémentaire assuré par une couverture conventionnelle collective.
Le I du présent article autorise donc le Gouvernement « dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois » à compter de la promulgation de la loi, pour la mise en œuvre des dispositions de celle-ci, à modifier par ordonnance le code du travail applicable à Mayotte ainsi que le code de commerce et le régime de protection sociale complémentaire en vigueur localement. Le projet d’ordonnance fera l’objet de la consultation du conseil général du département de Mayotte.
L’article 38 de la Constitution énonce le régime juridique des ordonnances. Celles-ci doivent, en particulier, comporter des mesures relevant du domaine de la loi et être prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, dans un délai limité, d’un an et demi au plus dans le cas présent. En principe, les ordonnances entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent cependant caduques si un projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date prévue par la loi d’habilitation. Le II du présent article fixe cette date au « dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication ».
*
* *
La Commission n’a apporté aucune modification à cet article.
*
La Commission examine l’amendement AS 147 de Mme Jacqueline Fraysse.
M. André Chassaigne. Pourquoi un sort particulier est-il réservé à Mayotte ? La perspective de modifier par ordonnance le code du travail est assez étonnante, car j’ai encore en tête les cris d’orfraie que nous avons poussés pendant dix ans dans l’opposition à chaque fois qu’on nous parlait d’ordonnances. Cet article a donc une dimension symbolique qui n’est pas compréhensible.
Nos débats touchent maintenant à leur fin et je constate que nous avons été rejoints par des députés appartenant à des groupes de la majorité, en particulier Écolo et RRDP, dans une démarche consistant à faire évoluer le texte afin de prendre en compte les salariés et leurs droits. Je tiens à saluer ces rassemblements que nous avons pu constituer au coup par coup sur certains amendements et qui montrent qu’il existe une marge de progression. Je le dis de façon solennelle : je ne doute pas que durant le débat en séance publique, des députés du groupe SRC sauront reprendre des arguments qui ont été développés et, s’ils le souhaitent, s’associer à certains amendements que nous avons déposés en commission et qui n’ont pas été adoptés, car la défense de l’intérêt des salariés exige que ce rassemblement formé aujourd’hui autour des porte-parole de trois groupes puisse s’étendre ensuite à un nombre important d’autres députés de la majorité, en particulier socialistes.
M. Christophe Cavard. Nous ne voterons pas la suppression de l’article 19. Sur la méthode, nous avons été un certain nombre à améliorer le texte, mais il est important de rendre également hommage au rapporteur, qui a aussi contribué à ce que le texte soit significativement amélioré. Comme André Chassaigne, je pense qu’au vu de l’amélioration permanente du texte, d’abord en commission mais plus encore en séance publique, une grande partie d’entre nous en seront finalement satisfaits.
M. Jean-Noël Carpentier. Nous avons tous à l’esprit le choix que la majorité présidentielle a fait de privilégier le dialogue social et les arbitrages que nous devons rendre. Le monde du travail a ses propres contradictions, qui sont plus fortes en période de crise : il faut rendre notre économie plus compétitive et apte à faire face à la crise mais, en même temps, ne pas augmenter la précarité des salariés et maintenir leurs droits, voire essayer de les accroître. C’est la grande question posée par cet accord. Au nom du groupe RRDP, je tiens aussi à féliciter le rapporteur pour son travail et pour la manière dont il a mené nos débats, comme j’ai eu l’occasion de le constater en prenant part à quelques-unes des auditions. Il a apporté des éléments en commission et il va en apporter d’autres en séance publique, où le travail de la majorité, toutes sensibilités confondues, va se poursuivre dans l’intérêt de nos concitoyens.
M. Denys Robiliard. Même si le groupe SRC n’a pas été mentionné, je me joins à ce qui a été dit. Ces deux journées d’examen des amendements ont permis d’obtenir des améliorations, significatives pour certaines d’entre elles. Le rapporteur a en outre indiqué que des processus sont susceptibles d’aboutir la semaine prochaine, mais ils sont plus longs qu’à l’accoutumée : s’agissant de la transposition d’un accord, il est en effet nécessaire de discuter non seulement avec le Gouvernement mais aussi avec les partenaires sociaux. Le texte peut donc encore être amélioré et nous nous y emploierons dans les jours qui viennent.
M. Jean-Patrick Gille. Nous avons certes pu nous restaurer et nous reposer un peu, mais cela fait exactement 24 heures que nous sommes entrés dans cette sorte de conclave : un débat de qualité a eu lieu et, comme les autres intervenants l’ont souligné, cela tient à la qualité de sa préparation, notamment par le rapporteur. Tous se sont félicités de la méthode et nous allons voter dans le calme cette transcription de l’accord du 11 janvier. Ensuite, il ne faut pas être dupe : certains représentants des groupes n’en iront pas moins se répandre en disant qu’il n’est pas possible de voter ce texte au motif soit qu’il est inacceptable, soit qu’il s’est écarté de l’accord conclu par les partenaires sociaux. Mais les enregistrements vidéo en feront foi : cela n’a pas du tout été le sens de nos débats, à la fois politiques et techniques. Je pense que nous avons collectivement fait la démonstration que le texte pouvait être amendé et amélioré sans en modifier l’esprit, ni celui de l’accord, et que nous étions en mesure de remplir notre fonction : ni notaires, ni greffiers, ni porte-plume, mais de vrais parlementaires qui font leur travail et vont continuer à le faire en séance publique.
M. Arnaud Richard. Malgré la longueur de nos débats, je partage l’avis de mes collègues sur la qualité de ces échanges. Nous sommes très attendus sur ce texte, qui n’est pas neutre, entre démocratie sociale et démocratie représentative. Je crois que pour l’instant, nous avons tous fait œuvre de responsabilité sur ce vaste accord que nous avons essayé de ne pas dénaturer. Nous n’avons pas de réponse ou seulement des semblants de réponse sur le coût de la complémentaire santé pour les finances publiques, car le courrier adressé par le ministère de l’économie et des finances à la présidente de la Commission n’est pas pleinement convaincant, et sur les éléments financiers relatifs aux droits rechargeables. Nous serons attentifs aux résultats en matière de représentativité syndicale, dont nous disposerons la semaine prochaine lorsque nous serons en séance publique, et aux services à la personne, sur lesquels nous considérons que ce texte fait malheureusement l’impasse ; au regard du nombre d’emplois non délocalisables créés ces dernières années, ce secteur n’est peut-être pas assez défendu par les partenaires sociaux et la majorité, qui a déjà beaucoup mis à mal ce secteur, comme le Gouvernement, devraient réfléchir à nos propositions.
M. le rapporteur. Vous n’avez pas souligné que nous avons adopté des amendements en commun. Je vous remercie pour la qualité des échanges : quand nous aurons le temps de regarder le travail que nous avons fait, nous verrons qu’il est tout sauf négligeable. Nul n’espérait sans doute que nous parviendrions à une protection à 1 200 euros pour tous les salaires dans le cadre des accords de maintien de l’emploi. Nous faisons également progresser les choses de manière très substantielle en exigeant que les mobilités ne se substituent pas à des formes de plans sociaux mais portent un vrai progrès pour les salariés car elles auront été négociées dans de bonnes conditions. Il en va de même quand nous imposons la protection de la vie familiale pour définir les mobilités. Nous pourrions multiplier les exemples. En matière de droit du travail, tout est dans les détails : des amendements longuement débattus seraient totalement inexplicables pour le commun des mortels mais sont pourtant très importants. Ne dévalorisons donc pas le travail que nous avons accompli. Place, maintenant, à la séance publique : je souhaite qu’elle permette d’éclairer les Français sur la portée réelle des dispositions, sur nos certitudes mais aussi parfois sur nos doutes et sur les questions qui font débat ; si j’ai souhaité mener de nombreuses auditions, c’est afin que nous puissions remplir notre devoir d’éclairer le législateur.
La Commission rejette l’amendement AS 146.
Elle adopte l’article 19.
Puis la commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.
*
* *
En conséquence, la Commission des affaires sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi, dans le texte figurant en annexe au présent rapport.
TABLEAU COMPARATIF
___
Dispositions en vigueur ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Texte de la Commission ___ |
Projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi |
Projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi | |
Chapitre Ier |
Chapitre Ier | |
Créer de nouveaux droits pour les salariés |
Créer de nouveaux droits pour les salariés | |
Section 1 |
Section 1 | |
De nouveaux droits individuels pour la sécurisation des parcours |
De nouveaux droits individuels pour la sécurisation des parcours | |
Article 1er |
Article 1er | |
I. – A. – Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, engagent une négociation afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident au moins aussi favorable que celle fixée en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d’accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2016. |
I. – A. – …
… que la couverture minimale mentionnée à l’article L. 911-7 … … 2016. Amendement AS 370 | |
La négociation porte notamment sur : |
||
1° La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés ; |
||
2° Les modalités de choix de l’assureur. À cet effet, la négociation examine en particulier les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître l’objectif de couverture effective de l’ensemble des salariés des entreprises de la branche ; |
2° … … l’assureur. La négociation …
… méconnaître les objectifs de couverture effective de l’ensemble des salariés des entreprises de la branche et d’accès universel à la santé. Amendements AS 371 et AS 242 | |
3° Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l’objectif de solidarité, notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs ; |
||
4° Les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés peut justifier des dispenses d’affiliation ; |
4° … … d’affiliation à l’initiative du salarié ; Amendements AS 292 et AS 53 | |
5° Le délai, au moins égal à dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la convention sans pouvoir excéder le 1er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles. |
5° … … convention ou de l’accord, et expirant au plus tard le 1er janvier … … conventionnelles. Amendement AS 372 | |
B. – À compter du 1er juillet 2014 et jusqu’au 1er janvier 2016, dans les entreprises où a été désigné un délégué syndical et non couvertes par un accord de branche, un accord d’entreprise ou une décision unilatérale du chef d’entreprise prévoyant une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident au moins aussi favorable que celle fixée en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale et applicable au plus tard le 1er janvier 2016, l’employeur engage une négociation sur ce thème. |
B. – … … et qui ne sont pas couvertes selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale prévoyant par une … … favorable que la couverture minimale mentionnée à l’article … Amendements AS 373, AS 293 et AS 370 | |
Cette négociation se déroule dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 et au deuxième alinéa de l’article L. 2242-11 du code du travail. |
Cette … … prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail et au deuxième alinéa de l’article L. 2242-11 du même chapitre. Amendement AS 374 | |
Code de la sécurité sociale |
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
|
Livre IX Titre Ier Dispositions générales relatives à la Chapitre Ier Détermination des garanties |
1° Le chapitre Ier du livre IX est complété par les articles L. 911-7 et L. 911-8 ainsi rédigés : |
|
« Art. L. 911-7. – À compter du 1er janvier 2016, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements ou d’indem-nisations de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident par le biais d’un accord de branche ou d’entreprise dans des conditions au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur, dans le respect des dispositions de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. |
« Art. L. 911-7. – … … remboursements complémentaires de frais … … accident déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 dans des conditions … … 1989. Les salariés concernés sont informés de cette décision. Amendements AS 375, AS 293 et AS 243 | |
« Cette couverture minimale comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes : |
||
« 1° La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale prévue au I de l’article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ; |
||
« 2° Le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 ; |
||
« 3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dento-faciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement. |
||
« Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs mentionnés au 3° entrant dans son champ. Il fixe les catégories de salariés pouvant être dispensés de l’obligation d’affiliation eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. |
« Un … … dispositifs médicaux mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture. Il fixe … … complémentaire. Amendements AS 376 et AS 377 | |
« L’employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture. |
||
« Art. L. 911-8. – Les salariés qui sont garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes : |
« Art. L. 911-8. – Les salariés garantis … … en cas de cessation du contrat … … suivantes : Amendements AS 378 et AS 379 | |
« 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, et sans pouvoir excéder douze mois ; |
||
« 2° Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur ; |
« 2° Le bénéfice du maintien des garanties … … droits à remboursements complémentaires aient … … employeur ; Amendements AS 380 et AS 381 | |
« 3° Les garanties maintenues au bénéfice des anciens salariés sont celles en vigueur dans l’entreprise ; |
« 3° … … bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ; Amendement AS 382 | |
« 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ; |
||
« 5° Les anciens salariés justifient auprès de leur ancien employeur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien du droit, des conditions prévues au présent article. » ; |
« 5° L’ancien salarié justifie auprès de son ancien … … maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ; Amendements AS 383 et AS 384 | |
« 6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail. » ; Amendement AS 244 | ||
2° L’article L. 912-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
||
Art. L. 912-1. – Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture auprès d’un ou plusieurs organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou d’une ou plusieurs institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances, auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d’application de ces accords, ceux-ci comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d’organisation de la mutualisation des risques peuvent être réexa-minées. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans. Lorsque les accords mentionnés ci-dessus s’appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d’effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d’un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l’article L. 132-23 du code du travail sont applicables. |
||
« Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques en application du premier alinéa ou lorsqu’ils recommandent, sans valeur contraignante, aux entreprises d’adhérer pour la couverture des risques qu’ils organisent à un ou plusieurs organismes, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dans des conditions de transparence et selon des modalités prévues par décret. » |
« Lorsque … … pour les risques dont ils organisent la couverture à un ou … … de transparence, d’impartialité, et d’égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret. Cette mise en concurrence est également effectuée lors de chaque réexamen. » Amendements AS 385, AS 54 et AS 37 | |
Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 |
III. – La loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est ainsi modifiée : |
|
1° L’article 2 et l’article 5 sont complétés, pour chacun d’entre eux, par un alinéa ainsi rédigé : |
||
Art. 2. – Lorsque des salariés sont garantis collectivement, soit sur la base d’une convention ou d’un accord collectif, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par décision unilatérale de l’employeur, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, l’organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l’adhésion à ceux-ci, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration. Aucune pathologie ou affection qui ouvre droit au service des prestations en nature de l’assurance maladie du régime général de sécurité sociale ne peut être exclue du champ d’application des contrats ou conventions visés au premier alinéa dans leurs dispositions relatives au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Art. 5. – Lorsque des salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues par l’article 2 de la présente loi, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, le contrat ou la convention doit prévoir le délai de préavis applicable à sa résiliation ou à son non-renouvellement ainsi que les modalités et les conditions tarifaires selon lesquelles l’organisme peut maintenir la couverture, sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaire médicaux, au profit des salariés concernés, sous réserve qu’ils en fassent la demande avant la fin du délai de préavis. |
||
« Les dispositions du présent article sont également applicables au titre des anciens salariés garantis en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. » ; |
||
Art. 4. – Lorsque des salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article 2 de la présente loi, en vue d’obtenir le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, le contrat ou la convention doit prévoir, sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaire médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l’organisme maintient cette couverture : |
||
1° Au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ; 2° Au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès. Le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de la demande. Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret. |
2° Au 1° de l’article 4, après les mots : « dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, avant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties en application d’une convention, d’un accord ou d’une décision mentionnés à l’article 2 ». |
2° Le 1° de l’article 4 est ainsi modifié : « a) Sont ajoutés les mots : « ou, … … convention ou d’un accord collectif, de la ratification par la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise ou d’une décision unilatérale de l’employeur mentionnés à l’article 2 » Amendement AS 386 |
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : | ||
« L’organisme doit avoir adressé la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la rupture du contrat de travail. » ; | ||
3° Le 2° du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : | ||
« L’organisme doit avoir adressé la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai d’un mois à compter du décès. ». Amendement AS 245 | ||
Code du travail |
IV. – À compter du 1er juillet 2014, le code du travail est ainsi modifié : |
|
Deuxième partie Les relations collectives de travail Livre II La négocaition collective Titre IV Domaines et périodicité de la négociation obligatoire Chapitre II Négociation obligatoire en entreprise Section 2 Négociation annuelle Sous-section 3 Régime de prévoyance maladie |
° L’intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie devient : « Protection sociale complémentaire des salariés » ; |
|
Art. L. 2242-11. – Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord d’entreprise définissant les modalités d’un régime de prévoyance maladie, l’employeur engage chaque année une négociation sur ce thème. Dans ces entreprises, comportant des établissements ou groupes d’établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d’établissements. Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation prévue aux premier et deuxième alinéas porte sur l’accès aux garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. |
2° À l’article L. 2242-11, le mot : « maladie » est remplacé par les mots : « et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident » ; |
|
I. – Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau national contient des clauses portant sur la détermination des règles de négociation et de conclusion, prévues aux articles : 1° L. 2222-1 et L. 2222-2, relatifs au champ d’application territorial et professionnel ; 2° L. 2222-5 et L. 2222-6, relatifs aux modalités de renouvellement, de révision et de dénonciation ; 3° L. 2232-3 et L. 2232-9, relatifs aux garanties accordées aux salariés participant à la négociation. II. – Elle contient en outre des clauses portant sur : …………………………………………. |
||
14° Les modalités d’accès à un régime de prévoyance maladie ; 15° Les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale ; 16° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l’entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d’une ou des organisations syndicales de salariés représentatives. |
3° Au 14° du II de l’article L. 2261-22, le mot : « maladie » est remplacé par les mots : « ou un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ». |
|
V. – Avant le 1er janvier 2016, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, engagent une négociation en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de prévoyance au niveau de leur branche ou de leur entreprise d’accéder à une telle couverture. |
||
VI. – Les dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale telles qu’issues de la présente loi entrent en vigueur : |
||
1° Au titre des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 ; |
1° Au titre des garanties liées aux risques … … 2014 ; Amendement AS 387 | |
2° Au titre des garanties liées aux risque décès, ou aux risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, à compter du 1er juin 2015. |
2° Au titre des garanties liées au risque … … 2015. Amendement AS 388 | |
Article 2 |
Article 2 | |
I. – L’article L. 6111-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
||
Art. L. 6111-1. – La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise en œuvre par l’État, les régions et les partenaires sociaux. Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l’apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s’y engagent. En outre, toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle ou liée à l’exercice de responsabilités syndicales. |
||
« Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose, indépendamment de son statut, dès son entrée sur le marché du travail, d’un compte personnel de formation, individuel et intégralement transférable en cas de changement ou de perte d’emploi. » |
||
Sixième partie La formation professionnelle tout au long de la vie Livre III La formation professionnelle continue Titre Ier Dispositions générales Chapitre IV Droit à l’information, à l’orientation et à la qualification professionnelles |
II. – Au chapitre IV du titre Ier du livre III de la sixième partie du même code, après l’article L. 6314-2, il est inséré un article L. 6314-3 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 6314-3. – Tout salarié bénéficie d’un conseil en évolution professionnelle. Cet accompagnement, mis en œuvre au niveau local dans le cadre du service public de l’orientation prévu à l’article L. 6111-3, lui permet : |
« Art. L. 6314-3. – … … professionnelle visant prioritairement un objectif de qualification. Cet … … permet : Amendement AS 55 | |
« 1° D’être informé sur son environnement professionnel et l’évolution des métiers sur le territoire ; |
||
« 2° De mieux connaître ses compétences, de les valoriser et d’identifier les compétences utiles à acquérir pour poursuivre son parcours professionnel ; |
||
« 3° D’identifier les offres d’emploi adaptées à ses compétences ; |
||
« 4° D’être informé des différents dispositifs qu’il peut mobiliser pour consolider son parcours professionnel. |
||
« Chaque salarié est informé, notamment par son employeur, de la possibilité de recourir à cet accompagnement. |
||
« Le compte personnel de formation peut être mobilisé par le salarié pour bénéficier de cet accompagnement. » |
||
Article 3 |
Article 3 | |
Première partie Les relations individuelles au travail Livre II Le contrat de travail Titre II Formation et exécution du contrat de travail Chapitre II Exécution et modification du contrat de travail |
Au chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail, il est créé une section 5 ainsi rédigée : |
|
« Section 5 |
||
« Mobilité volontaire sécurisée |
||
« Art. L. 1222-12. – Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 de trois cents salariés et plus, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, peut avec l’accord de son employeur, bénéficier d’une période de mobilité volontaire sécurisée afin d’exercer une activité dans une autre entreprise, au cours de laquelle l’exécution de son contrat de travail est suspendue. |
||
« Si l’employeur oppose deux refus successifs à la demande de mobilité, l’accès au congé individuel de formation est de droit pour le salarié, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article L. 6322-7 ou la durée d’ancienneté mentionnée à l’article L. 6322-4. |
« Si … … opposées la durée d’ancienneté mentionnée à l’article L. 6322-4 ou les dispositions de l’article L. 6322-7. Amendement AS 389 | |
« Art. L. 1222-13. – La période de mobilité volontaire sécurisée est prévue par un avenant au contrat de travail, qui détermine l’objet, la durée, la date de prise d’effet et le terme de la période de mobilité, ainsi que le délai dans lequel le salarié doit informer par écrit l’employeur de son choix éventuel de ne pas réintégrer l’entreprise. |
||
« Il prévoit également les situations et modalités d’un retour anticipé du salarié, qui reste dans tous les cas possible à tout moment avec l’accord de l’employeur. |
« Il … … salarié, qui doit intervenir dans un délai raisonnable, et qui reste … … l’employeur. Amendement AS 294 | |
« Art. L. 1222-14. – À son retour dans l’entreprise d’origine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une qualification et d’une rémunération au moins équivalentes ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification. |
||
« Art. L. 1222-15. – Lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d’origine au terme de la période de mobilité, le contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu. Cette rupture constitue une démission qui n’est soumise à aucun préavis autre que celui prévu par l’avenant en application de l’article L. 1222-13. » |
« Art. L. 1222-15. – … … d’origine au cours ou au terme … … l’avenant mentionné à l’article L. 1222-13. Amendements AS 247 et AS 390 | |
« Art. L. 1222-16. – L’employeur communique semestriellement au comité d’entreprise la liste des demandes de période de mobilité volontaire sécurisée avec l’indication de la suite qui leur a été données. » Amendement AS 295 | ||
Section 2 |
Section 2 | |
De nouveaux droits collectifs en faveur de la participation des salariés |
De nouveaux droits collectifs en faveur de la participation des salariés | |
Article 4 |
Article 4 | |
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2323-3 du code du travail, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés : |
||
Art. L. 2323-3. – Dans l’exercice de ses attributions consultatives, définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, le comité d’entreprise émet des avis et voeux. |
||
« Il dispose d’un délai d’examen suffisant. |
||
« Sauf dispositions législatives spécifiques, un accord entre l’employeur et la majorité des membres élus titulaires du comité d’entreprise ou le cas échéant du comité central d’entreprise, ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État, fixe les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise sont rendus, dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, ainsi qu’aux articles L. 2323-72, L. 2281-12 et L. 3121-11. Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d’entreprise d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises. |
« Sauf dispositions législatives spéciales, un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise ou, le cas échéant, le comité central d’entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut … … articles L. 2281-12, L. 2323-72 et L. 3121-11. Ces … … soumises et, le cas échéant, de l’information et de la consultation du ou des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Amendements AS 391, AS 248, AS 392 et AS 184 | |
« À l’expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2323-4, le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté. » |
« À … … consulté et avoir rendu un avis négatif. » Amendement AS 57 | |
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces avis et voeux. |
||
II. – L’article L. 2323-4 du même code est ainsi modifié : |
||
Art. L. 2323-4. – Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d’entreprise dispose d’informations précises et écrites transmises par l’employeur, d’un délai d’examen suffisant et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations. |
1° Au premier alinéa, les mots : « , d’un délai d’examen suffisant » sont supprimés ; |
|
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
||
« Les membres élus du comité peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’em-ployeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours. |
||
« Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L. 2323-3. » |
||
Deuxième partie Les relations collectives de travail Livre III Les institutions représentatives du personnel Titre II Comité d’entreprise Chapitre III Attributions Section 1 Attributions économiques Sous-section 2 Information et consultation sur |
III. – À la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du même code, il est inséré, après l’article L. 2323-7, les articles L. 2323-7-1 à L. 2323-7-3 ainsi rédigés : |
|
« Art. L. 2323-7-1. – Chaque année, le comité d’entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, le recours à la sous-traitance, à l’intérim et à des contrats temporaires. |
« Art. L. 2323-7-1. – …
… l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Amendement AS 296 | |
« Le comité émet un avis sur ces orientations et propose, le cas échéant, des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’admi-nistration ou de la surveillance de l’entreprise qui arrête définitivement les orientations stratégiques. Le comité d’entreprise reçoit communication de cette délibération. |
||
« La base de données prévue à l’article L. 2323-7-2 est le support de préparation de cette consultation. |
« La base de données mentionnée à … … consultation. Amendement AS 393 | |
« Le comité d’entreprise peut se faire assister de l’expert-comptable de son choix en vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2325-40 et sauf accord entre l’employeur et la majorité des membres élus du comité d’entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 % au financement de cette expertise. |
« Le … … l’employeur et le comité … … fonctionnement au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel. Amendements AS 249, AS 394 et AS 297 | |
« Art. L. 2323-7-2. – Une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que l’emplo-yeur met à disposition du comité d’entreprise. |
« Art. L. 2323-7-2. – … … d’entreprise et, à défaut, des délégués du personnel. | |
« La base de données est accessible en permanence aux membres du comité d’entreprise, du comité central d’entreprise et aux délégués syndicaux. |
« La … … d’entreprise et, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux. Amendement AS 113 | |
« Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants : |
||
« 1° Investissements : investissement social (emploi, formation professionnelle, conditions de travail), investissement matériel et immatériel ; |
« 1° … … professionnelle et conditions … … immatériel ; Amendement AS 395 | |
« 2° Fonds propres et endettement ; |
||
« 3° Rétributions des salariés et dirigeants ; |
« 3° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ; Amendement AS 253 | |
« 4° Activités sociales et culturelles ; |
||
« 5° Rémunération des financeurs ; |
||
« 6° Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts ; |
||
« 7° Sous-traitance ; |
||
« 8° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. |
||
« Ces informations portent sur l’année en cours, les deux années précédentes et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. |
« Ces informations portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et … … suivantes. Amendement AS 396 | |
« Le contenu de ces informations est déterminé par un décret en Conseil d’État et peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés. Il peut être adapté par un accord de branche ou d’entreprise ou, le cas échéant, un accord de groupe en fonction de l’organisation et du domaine d’activité de l’entreprise. |
« Le … … être enrichi par … Amendement AS 254 | |
« Les membres du comité d’entreprise, du comité central d’entreprise et les délégués syndicaux ayant accès à la base de données sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur. |
||
« Art. L. 2323-7-3. – Les éléments d’information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au comité d’entreprise sont mis à la disposition de ses membres dans la base de données mentionnée à l’article L. 2323-7-2 et cette mise à disposition vaut communication des rapports et informations au comité d’entreprise, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’État. |
« Art. L. 2323-7-3. – … … disposition actualisée vaut … … d’État. Amendement AS 255 | |
« Les consultations du comité d’entreprise pour des événements ponctuels continuent de faire l’objet de l’envoi de ces informations et rapports. » |
« Les … … ces rapports et informations. » Amendement AS 397 | |
IV. – La base de données prévue à l’article L. 2323-7-2 du code du travail est mise en place dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi dans les entreprises de trois cents salariés et plus, et de deux ans dans les entreprises de moins de trois cents salariés. |
IV. – … … de la promulgation de la … … sala- Amendement AS 398 | |
Les dispositions de l’article L. 2323-7-3 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard au 31 décembre 2016. |
||
Deuxième partie Les relations collectives de travail Livre III Les institutions représentatives du personnel Titre II Comité d’entreprise Chapitre V Fonctionnement Section 7 Recours à un expert |
V. – La section 7 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée : |
|
1° À l’article L. 2325-35, après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : |
||
Art. L. 2325-35. – Le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix : 1° En vue de l’examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ; |
||
« 1° bis En vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise prévu à l’article L. 2323-7-1 ; » |
||
2° En vue de l’examen des documents mentionnés à l’article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ; 3° Dans les conditions prévues à l’article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ; 4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l’exercice du droit d’alerte économique ; 5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l’article L. 1233-30, est mise en oeuvre. |
||
2° Il est ajouté une sous-section 4 ainsi rédigée : |
||
« Sous-section 4 |
||
« Délai de l’expertise |
||
« Art. L. 2325-42-1. – L’expert-comptable ou l’expert technique mentionnés dans la présente section remettent leur rapport dans un délai fixé par un accord entre l’employeur et la majorité des membres élus titulaires du comité d’entreprise, ou, à défaut d’accord, par décret en Conseil d’État. Ce délai ne peut être prorogé que par commun accord. |
« Art. L. 2325-42-1. – … … l’employeur et le comité d’entreprise … … accord. Amendement AS 256 | |
« Un décret en Conseil d’État détermine, au sein du délai prévu au premier alinéa, le délai dans lequel l’expert désigné par le comité d’entreprise peut demander à l’employeur toutes les informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission et le délai de réponse de l’employeur à cette demande. » |
||
VI. – Le second alinéa de l’article L. 2332-1 du même code est complété par la phrase suivante : |
||
Art. L. 2332-1. – Le comité de groupe reçoit des informations sur l’activité, la situation financière, l’évolution et les prévisions d’emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu’ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant. |
||
Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l’année à venir. |
« Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l’article L. 2323-7-1 lui sont communiqués. » |
|
Deuxième partie Les relations collectives de travail Livre III Les institutions représentatives du personnel Titre II Comité d’entreprise Chapitre III Attributions Section 1 Attributions économiques Sous-section 2 Information et consultation sur l’organisation et la marche de l’entreprise |
VII. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est complétée par un paragraphe 9 ainsi rédigé : |
|
« Paragraphe 9 |
||
« Crédit d’impôt compétitivité emploi |
||
« Art. L. 2323-26-1. – Les sommes reçues par l’entreprise au titre du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts et leur utilisation sont retracées dans la base de données économiques et sociales prévue à l’article L. 2323-7-2. Le comité d’entreprise est informé et consulté, avant le 1er juillet de chaque année, sur l’utilisation par l’entreprise de ce crédit d’impôt. Cette consultation peut être organisée à l’occasion de la consultation sur les orientations stratégiques prévue à l’article L. 2323-7-1. |
||
« Art. L. 2323-26-2. – Lorsque le comité d’entreprise constate que tout ou partie du crédit d’impôt n’a pas été utilisé conformément aux dispositions prévues à l’article 244 quater C du code général des impôts, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications. |
||
« Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité d’entreprise. |
||
« Si le comité d’entreprise n’a pu obtenir de réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci confirme l’utilisation non conforme de ce crédit, il établit un rapport. |
« Si … … obtenir d’explications suffisantes de l’employeur ou si celles-ci confirment l’utilisation … … rapport. Amendement AS 399 | |
« Ce rapport est transmis à l’employeur et au comité de suivi régional créé par l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, qui adresse une synthèse annuelle au comité national de suivi. |
« Ce … … créé par le IV de l’article 66 … … suivi. Amendement AS 400 | |
« Art. L. 2323-26-3. – Au vu de ce rapport, le comité d’entreprise peut décider, à la majorité des membres présents, de saisir de ses conclusions l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d’en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d’intérêt économique. |
||
« Dans les sociétés dotées d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance, la demande d’expli-cation sur l’utilisation du crédit d’impôt est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil d’admini-stration ou du conseil de surveillance, à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l’avance. La réponse de l’employeur est motivée et adressée au comité d’entreprise. |
||
« Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d’intérêt économique, lorsque le comité d’entreprise a décidé d’informer les associés ou les membres de l’utilisation du crédit d’impôt, le gérant ou les administrateurs leur communiquent le rapport du comité d’entre-prise. |
||
« Dans les autres personnes morales, ces dispositions s’appliquent à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance. » |
« Dans les autres personnes morales, le présent article s’applique à … … surveillance. » Amendement AS 401 | |
VIII. – Après l’article L. 2313-7 du même code, il est inséré un article L. 2313-7-1 ainsi rédigé : |
||
« Art. L. 2313-7-1. – Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont informés et consultés sur les conditions d’utilisation du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts selon les modalités prévues aux articles L. 2323-26-1 à L. 2323-26-3. » |
« Art. L. 2313-7-1. – … … consultés sur l’utilisation … … L. 2323-26-3. » Amendement AS 402 | |
IX. – Avant le 31 décembre 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’exercice du droit de saisine des comités d’entreprise ou des délégués du personnel sur les conditions d’utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi, prévu par les articles L. 2323-26-2 à L. 2323-26-3 et L. 2313-7-1 du code du travail. |
IX. – Avant le 30 juin 2015, le Gouvernement présente au Parlement un premier rapport …. … sur l’utilisation … … travail. Ce rapport est ensuite actualisé au 30 juin de chaque année. Amendements AS 298 et AS 403 | |
Quatrième partie Santé et sécurité au travail Livre VI Institutions et organismes de prévention Titre Ier Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail |
X. – Le titre Ier du livre VI de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : |
|
« Chapitre VI |
||
« Instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail |
||
« Art. L. 4616-1. – Lorsque les consultations prévues aux articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements, l’employeur peut mettre en place une instance de coordination de leurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission d’organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 4614-12 et à l’article L. 4614-13, et qui peut rendre un avis au titre des articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13. |
« Art. L. 4616-1. – … … instance temporaire de coordination … … L. 4612-13. Amendement AS 258 | |
« Art. L. 4616-2. – L’instance de coordination est composée : |
||
« 1° De l’employeur ou de son représentant ; |
||
« 2° D’un représentant de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, désigné en son sein par la délégation du personnel ; |
« 2° De trois représentants de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné par le projet, désignés en leur sein par la délégation du personnel en présence d’au plus sept comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou de deux représentants de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en présence de sept à quinze comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et d’un au-delà de quinze comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; Amendement AS 96 | |
« 3° Des personnes suivantes territorialement compétentes pour l’établis-sement dans lequel se réunit l’instance de coordination : médecin du travail, inspecteur du travail, agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. |
« 3° Des personnes suivantes : médecin du travail, … … travail. Ces personnes sont celles territorialement compétentes pour l’établissement dans lequel se réunit l’instance de coordination s’il est concerné par le projet et, sinon, celles territorialement compétentes pour l’établissement concerné le plus proche du lieu de réunion. Amendement AS 259 | |
« Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative. Amendement AS 260 | ||
« Art. L. 4616-3. – L’expert mentionné à l’article L. 4616-1 est désigné lors de la première réunion de l’instance. |
« Art. L. 4616-3. – … … l’instance de coordination. Amendement AS 404 | |
« Il remet son rapport et l’instance de coordination se prononce le cas échéant dans les délais prévus par un décret en Conseil d’État. À l’expi-ration de ces délais, l’instance est réputée avoir été consultée. |
« Il … … l’instance de coordination est réputée avoir été consultée. Amendement AS 405 | |
« Le rapport de l’expert et le cas échéant l’avis de l’instance de coordination sont transmis par l’employeur aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés par le projet ayant justifié la mise en place de l’instance de coordination. |
« Le … … coordination, qui rendent leurs avis. Amendement AS 300 | |
« Art. L. 4616-4. – Les dispositions des articles L. 4614-1, L. 4614-2, L. 4614-8 et L. 4614-9 s’appliquent à l’instance de coordination. |
||
« Art. L. 4616-5. – Un accord d’entreprise peut prévoir des modalités particulières de composition et de fonctionnement de l’instance de coordination, notamment en cas d’un nombre important de comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés. Il peut prévoir que la consultation de l’instance de coordination se substitue aux consultations prévues aux articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13. » |
« Art. L. 4616-5. – … … notamment si un nombre … … travail sont concernés.Il … … L. 4612-13. » Amendements AS 406 et AS 407 | |
Art. L. 4614-3. – L’employeur laisse à chacun des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. Ce temps est au moins égal à : 1° Deux heures par mois dans les établissements employant jusqu’à 99 salariés ; 2° Cinq heures par mois dans les établissements employant de 100 à 299 salariés ; 3° Dix heures par mois dans les établissements employant de 300 à 499 salariés ; 4° Quinze heures par mois dans les établissements employant de 500 à 1 499 salariés ; 5° Vingt heures par mois dans les établissements employant au moins mille cinq cents salariés. |
||
|
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. |
XI. – Au dernier alinéa de l’article L. 4614-3 du même code, après les mots : « circonstances exceptionnelles », sont insérés les mots : « ou de participation à une instance de coordination prévue à l’article L. 4616-1 ». |
|
Code de commerce |
Article 5 |
Article 5 |
Livre II Des sociétés commerciales et des Titre II Dispositions applicables aux diverses Chapitre V Des sociétés anonymes Section 2 De la direction et de l’administration des sociétés anonymes. Sous-section 1 : Du conseil d’administration de la direction générale. |
I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée : |
|
1° Après l’article L. 225-27, il est inséré un article L. 225-27-1 ainsi rédigé : |
||
« Art. L. 225-27-1. – I. – Dans les sociétés dont le siège social est situé sur le territoire français qui emploient, à la clôture de chacun des deux derniers exercices, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales directes ou indirectes situées sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales directes ou indirectes situées sur le territoire français et à l’étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, des administrateurs représentant les salariés. |
||
« Une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa dès lors qu’elle est la filiale directe ou indirecte d’une société elle-même soumise à cette obligation. Lorsqu’une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa mais que ses filiales remplissent les conditions fixées à cet alinéa, l’obligation est applicable aux filiales. |
||
« II. – Le nombre des administrateurs représentant les salariés est égal à deux dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 est supérieur à douze et à un s’il est égal ou inférieur à douze. |
||
« Les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d’administrateurs prévus à l’article L. 225-17 ou pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-18-1. |
||
« III. – Les statuts prévoient les modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés selon l’une des modalités suivantes : |
||
« 1° L’organisation d’une élection auprès des salariés de la société et de ses filiales directes ou indirectes situées sur territoire français dans les conditions fixées à l’article L. 225-28-1 ; |
||
« 2° La désignation par, selon le cas, le comité de groupe prévu à l’article L. 2331-1 du code du travail, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise de la société mentionnée au premier alinéa ; |
« 2° … … au I du présent article ; Amendement AS 408 | |
« 3° La désignation par l’organi-sation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées à l’article L. 2122-1 du code du travail dans la société et ses filiales directes ou indirectes sur le territoire français lorsqu’un seul administrateur est désigné ou par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées ci-dessus lorsque deux administrateurs doivent être désignés ; |
||
« 4° Lorsque le nombre d’adminis-trateur à désigner est égal à deux, la désignation de l’un des administrateurs selon l’une des modalités fixées aux 1°, 2° et 3° et du second par le comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l’article L. 2351-1 du code du travail, par l’organe de représentation des salariés mentionné à l’article L. 2352-16 du code du travail, ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l’article L. 2353-1 du code du travail. |
||
« IV. – En cas de non approbation par l’assemblée générale extraordinaire des modifications statutaires nécessaires à la mise en œuvre des dispositions des cinquième à neuvième alinéas dans un délai de six mois à compter de la clôture du second exercice mentionné au premier alinéa, les administrateurs représentant les salariés sont désignés par la voie de l’élection mentionnée au sixième alinéa. |
« IV. – … … œuvre des II et III du présent article dans … … second des deux exercices mentionnés au I, les administrateurs … … mentionnée au 1° du III. Amendements AS 409, AS 410 et AS 411 | |
« L’élection a lieu au plus tard six mois après : |
||
« 1° Le refus des modifications statutaires par l’assemblée générale extraordinaire ; |
||
« 2° L’assemblée générale statuant sur les comptes du second exercice clos mentionné au premier alinéa si les modifications statutaires prévues aux cinquième à neuvième alinéas n’ont pas été soumises à l’assemblée générale extraordinaire. |
« 2° … … du second des deux exercices mentionnés au I si les modifications statutaires prévues aux II et III n’ont …
… extraordinaire. Amendements AS 412 et AS 413 | |
« V. – Les administrateurs désignés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la société ou ses filiales directes ou indirectes antérieur de deux années au moins à leur désignation et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsqu’au jour de la nomination la société est constituée depuis moins de deux ans. |
||
« VI. – Les sociétés dont le conseil d’administration comprend un ou plusieurs membres désignés en application de l’article L. 225-27, de l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ou de l’article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, ne sont pas tenues à l’obligation prévue au premier alinéa dès lors que le nombre de ces administrateurs est au moins égal au nombre prévu au troisième alinéa. Quand le nombre de ces administrateurs n’est pas égal au nombre prévu par le troisième alinéa, l’ensemble de ces administrateurs sont élus ou désignés selon les modalités prévues au présent article. » ; |
« VI. – … .... 1986 relative aux modalités des privatisations, ne sont pas soumises à l’obligation prévue aux I, II et III du présent article dès lors … … prévu au II. Quand le nombre de ces administrateurs est inférieur au nombre prévu au même II, l’ensemble … … article. » ; Amendements AS 414 et AS 415 | |
2° Après l’article L. 225-28, il est inséré un article L. 225-28-1 ainsi rédigé : |
||
« Art. L. 225-28-1. – Pour l’élection prévue au 1° de l’article L. 225-27-1, tous les salariés de la société et de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est situé sur le territoire français et dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret. |
||
« Les candidats ou listes de candidats sont présentés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du code du travail. |
||
« Lorsqu’il y a un seul siège à pourvoir pour l’ensemble du corps électoral, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de son remplaçant éventuel. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la majorité relative. |
||
« Dans les autres cas, l’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir. |
||
« En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus. |
||
« Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts. |
||
« Les contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le juge d’instance qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 2324-23 du code du travail. » ; |
||
« 2° bis Au troisième alinéa de l’article L. 225-22 du code de commerce, après le mot : « élus », sont insérés les mots : « ou désignés » ; Amendement AS 416 | ||
3° L’article L. 225-29 est ainsi modifié : |
||
Art. L. 225-29. – La durée du mandat d’administrateur élu par les salariés est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans. Le mandat est renouvelable, sauf stipulation contraire des statuts. |
a) Après les mots : « élu par les salariés», sont insérés les mots : « ou désigné selon les modalités prévues à l’article L. 225-27-1 » ; |
|
Toute nomination intervenue en violation des articles L. 225-27, L. 225-28 et du présent article est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé. |
b) Après les mots : « articles L. 225-27 », sont insérés les mots : « L. 225-27-1, » ; c) Après les mots : « L. 225-28 », sont insérés les mots : « , L. 225-28-1 » ; |
|
4° L’article L. 225-30 est ainsi modifié : |
||
Art. L. 225-30. – Le mandat d’administrateur élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical, de membre du comité d’entreprise, de délégué du personnel ou de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société. L’administrateur qui, lors de son élection, est titulaire d’un ou de plusieurs de ces mandats doit s’en démettre dans les huit jours. À défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat d’administrateur. |
a) Après les mots : « élu par les salariés », sont insérés les mots : « ou désigné selon les modalités prévues à l’article L. 225-27-1 » ; b) Après les mots : « lors de son élection », sont insérés les mots : « ou de sa désignation selon les modalités prévues à l’article L. 225-27-1 » ; |
« a bis) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le mandat d’administrateur élu ou désigné par les salariés est également incompatible avec tout mandat de membre d’un comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l’article L. 2351-1 du code du travail, de membre de l’organe de représentation des salariés mentionné à l’article L. 2352-16 du même code ou de membre d’un comité de la société européenne mentionné à l’article L. 2353-1 dudit code. » ; Amendement AS 417 |
4° bis Après l’article L. 225-30, il est inséré un article L. 225-30-1 ainsi rédigé : | ||
« Art. L. 225-30-1. – L’employeur laisse aux administrateurs élus ou désignés par les salariés en application de l’article L. 225-27-1 le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, dans la limite d’une durée fixée par décret et permettant à l’administrateur d’exercer utilement sa compétence. » ; Amendement AS 418 | ||
Art. L. 225-31. – Les administrateurs élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l’exercice de leur mandat. |
5° À l’article L. 225-31, après le mot : « élus », sont insérés les mots : « ou désignés selon les modalités prévues à l’article L. 225-27-1 » ; |
|
6° L’article L. 225-32 est ainsi modifié : |
||
Art. L. 225-32. – La rupture du contrat de travail met fin au mandat de l’administrateur élu par les salariés. |
a) Après les mots : « élu par les salariés », sont insérés les mots : « ou désigné selon les modalités prévues à l’article L. 225-27-1 » ; |
|
Les administrateurs élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans l’exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d’administration. La décision est exécutoire par provision. |
b) Après les mots : « élus par les salariés », sont insérés les mots : « ou désignés selon les modalités prévues à l’article L. 225-27-1 » ; |
|
Art. L. 225-33. – Sauf en cas de résiliation à l’initiative du salarié, la rupture du contrat de travail d’un administrateur élu par les salariés ne peut être prononcée que par le bureau de jugement du conseil des prud’hommes statuant en la forme des référés. La décision est exécutoire par provision. |
7° À l’article L. 225-33, après les mots : « élus par les salariés », sont insérés les mots : « ou désignés selon les modalités prévus à l’article L. 225-27-1 » ; |
|
Art. L. 225-34. – I. – En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, d’un siège d’administrateur élu par les salariés, le siège vacant est pourvu de la manière suivante : 1° Lorsque l’élection a eu lieu au scrutin majoritaire à deux tours, par le remplaçant ; 2° Lorsque l’élection a eu lieu au scrutin de liste, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu. II. – Le mandat de l’administrateur ainsi désigné prend fin à l’arrivée du terme normal du mandat des autres administrateurs élus par les salariés. |
8° À l’article L. 225-34, après les mots : « élus par les salariés », sont insérés les mots : « en application des articles L. 225-27 et L. 225-28 » ; |
|
9° Après l’article L. 225-34, il est inséré un article L. 225-34-1 ainsi rédigé : |
||
« Art. L. 225-34-1. – En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, d’un siège d’administrateur ou désigné selon les modalités prévues, selon le cas, à l’article L. 225-27-1 ou L. 225-79-2, le siège vacant est pourvu de la manière suivante : |
« Art. L. 225-34-1. – … … d’administrateur élu ou désigné selon les modalités prévues à l’article L. 225-27-1, le siège … … suivante : Amendements AS 420 et AS 421 | |
« 1° Lorsque l’élection a eu lieu au scrutin majoritaire à deux tours, par le remplaçant ou lorsque l’élection a eu lieu au scrutin de liste, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu ; |
||
« 2° Lorsque l’administrateur a été désigné selon les modalités prévues aux septième, huitième ou neuvième alinéas de l’article L. 225-27-1, une nouvelle procédure de désignation est engagée. |
« 2° … … aux 2° à 4° du III de l’article … … engagée. Amendement AS 422 | |
« Le mandat de l’administrateur ainsi désigné prend fin à l’arrivée du terme normal du mandat des autres administrateurs désignés selon les modalités fixées à l’article L. 225-27-1. » |
||
Livre II Des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique Titre II Dispositions applicables aux diverses sociétés commerciales Chapitre V Des sociétés anonymes Section 2 De la direction et de l’administration des sociétés anonymes. Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance. |
II. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code est ainsi modifiée : |
|
1° Après l’article L. 225-79-1, il est inséré un article L. 225-79-2 ainsi rédigé : |
||
« Art. L. 225-79-2. – I. – Dans les sociétés dont le siège social est situé sur le territoire français qui emploient, à la clôture de chacun des deux derniers exercices, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales directes ou indirectes situées sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales directes ou indirectes situées sur le territoire français et à l’étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, le conseil de surveillance comprend, outre les membres prévus aux articles L. 225-69 et L. 225-75, des membres représentant les salariés. |
||
« Une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa dès lors qu’elle est la filiale directe ou indirecte d’une société elle-même soumise à cette obligation. Lorsqu’une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa mais que ses filiales remplissent les conditions fixées à cet alinéa, l’obligation est applicable aux filiales. |
||
« II. – Le nombre des membres du conseil de surveillance représentant les salariés est égal à deux dans les sociétés dont le nombre de membres désignés selon les modalités de l’article L. 225-75 est supérieur à douze et à un s’il est égal ou supérieur à douze. |
||
« Les membres du conseil de surveillance représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal des membres du conseil de surveillance prévus à l’article L. 225-69 ou pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-69-1. |
||
« III. – Les statuts prévoient les modalités de désignation des membres représentant les salariés selon l’une des modalités suivantes : |
||
« 1° L’organisation d’une élection auprès des salariés de la société et ses filiales directes ou indirectes situées sur territoire français dans les conditions fixées à l’article L. 225-28-1 ; |
||
« 2° La désignation par, selon le cas, le comité de groupe prévu à l’article L. 2331-1 du code du travail, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise de la société mentionnée au premier alinéa ; |
« 2° … … au I du présent article ; Amendement AS 408 | |
« 3° La désignation par l’orga-nisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées à l’article L. 2122-1 du code du travail dans la société et ses filiales directes ou indirectes situées sur le territoire français lorsqu’un seul membre est désigné ou par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées ci-dessus lorsque deux membres doivent être désignés ; |
||
« 4° Lorsque le nombre de membres à désigner est égal à deux, la désignation de l’un des membres selon l’une des modalités fixées aux 1°, 2° et 3° et du second par le comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l’article L. 2351-1 du code du travail par l’organe de représentation des salariés mentionné à l’article L. 2352-16, ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l’article L. 2353-1 du code du travail. |
||
« IV. – En cas de non approbation par l’assemblée générale extraordinaire des modifications statutaires nécessaires à la mise en œuvre des dispositions des cinquième à neuvième alinéas dans un délai de six mois à compter de la clôture du second exercice mentionné au premier alinéa, les membres représentant les salariés sont désignés par la voie de l’élection mentionnée au sixième alinéa. |
« IV. – … … dispositions des II et III du présent article dans … … second des deux exercices mentionnés au I, les membres … … au 1° du III. Amendements AS 409, AS 410 et AS 411 | |
« L’élection a lieu au plus tard six mois après : |
||
« 1° Le refus des modifications statutaires par l’assemblée générale extraordinaire ; |
||
« 2° L’assemblée générale statuant sur les comptes du second exercice clos mentionné au premier alinéa si les modifications statutaires prévues aux cinquième à neuvième alinéas n’ont pas été soumises à l’assemblée générale extraordinaire. |
« 2° … … second des deux exercices mentionnés au I du présent article si les modifications statutaires prévues aux II et III n’ont … … extraordinaire. Amendements AS 412 et AS 413 | |
« V. – Les membres du conseil de surveillance désignés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la société ou ses filiales directes ou indirectes antérieur de deux années au moins à leur désignation et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsqu’au jour de la nomination la société est constituée depuis moins de deux ans. |
||
« VI. – Les sociétés dont le conseil de surveillance comprend un ou plusieurs membres désignés en application de l’article L. 225-27, de l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ou de l’article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, ne sont pas tenues à l’obligation prévue au premier alinéa dès lors que le nombre de ces membres est au moins égal au nombre prévu au troisième alinéa. Quand le nombre de ces membres n’est pas égal au nombre prévu par le troisième alinéa, l’ensemble de ces membres sont élus ou désignés selon les modalités prévues au présent article. » ; |
« VI. – … … 1986 relative aux modalités des privatisations, ne sont pas soumises à l’obligation prévue aux I, II et III du présent article dès lors que le nombre de ces administrateurs est au moins égal au nombre prévu au II. Quand le nombre de ces membres est inférieur au même II, l’ensemble … … article. » ; Amendements AS 414 et AS 415 | |
Art. L. 225-80. – Les conditions relatives à l’éligibilité, à l’électorat, à la composition des collèges, aux modalités du scrutin, aux contestations, à la durée et aux conditions d’exercice du mandat, à la révocation, à la protection du contrat de travail et au remplacement des membres du conseil de surveillance élus par les salariés sont fixées selon les règles définies aux articles L. 225-28 à L. 225-34. |
2° L’article L. 225-80 est complété par la phrase suivante : « Pour les membres du conseil de surveillance désignés en application de l’article L. 225-79-2, les conditions relatives au remplacement sont fixées selon les règles prévues à l’article L. 225-34-1. » |
|
Livre II Des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique Titre II Dispositions applicables aux diverses sociétés commerciales Chapitre VI Des sociétés en commandite par actions |
III. – Le chapitre VI du titre II du livre II du même code est ainsi modifié : |
|
1° Après l’article L. 226-4-1, il est inséré un article L. 226-4-2 ainsi rédigé : |
||
« Art. L. 226-4-2. – I. – Dans les sociétés dont le siège social est situé sur le territoire français, qui emploient, à la clôture de chacun des deux derniers exercices, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales directes ou indirectes situées sur le territoire français, ou, au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales directes ou indirectes situées sur le territoire français et à l’étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, le conseil de surveillance comprend, outre les membres du conseil de surveillance prévus à l’article L. 226-4, des membres du conseil de surveillance représentant les salariés. |
||
« Une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa dès lors qu’elle est la filiale directe ou indirecte d’une société elle-même soumise à cette obligation. Lorsqu’une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa mais que ses filiales remplissent les conditions fixées à cet alinéa, l’obligation est applicable aux filiales. |
||
« II. – Le nombre des membres représentant les salariés est égal à deux dans les sociétés dont le nombre de membres est supérieur à douze et à un s’il est égal ou inférieur à douze. |
||
« Les membres représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour l’application du premier alinéa de l’article L. 226-4-1. |
||
« III. – Les statuts prévoient les modalités de désignation des membres du conseil de surveillance représentant les salariés selon l’une des modalités suivantes : |
||
« 1° L’organisation d’une élection auprès des salariés de la société et de ses filiales directes ou indirectes situées sur territoire français dans les conditions fixées à l’article L. 226-4-3 ; |
||
« 2° La désignation par, selon le cas, le comité de groupe prévu à l’article L. 2331-1 du code du travail, le comité central d’entreprise ou le comité d’entre-prise de la société mentionnée au premier alinéa ; |
« 2° … … au I du présent article ; Amendement AS 408 | |
« 3° La désignation par l’orga-nisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées à l’article L. 2122-1 du code du travail dans la société et ses filiales directes ou indirectes sur le territoire français lorsqu’un seul membre est désigné ou par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées ci-dessus lorsque deux membres doivent être désignés ; |
||
« 4° Lorsque le nombre de membres à désigner est égal à deux, la désignation de l’un des membres selon l’une des modalités fixées au 1°, 2° et 3° et du second par le comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l’article L. 2351-1 du code du travail, par l’organe de représentation des salariés mentionné à l’article L. 2352-16 du code du travail, ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l’article L. 2353-1 du code du travail. |
||
« IV. – Lorsque les modifications statutaires nécessaires à la mise en œuvre des dispositions des cinquième à neuvième alinéas n’ont pas été adoptées dans le délai de six mois à compter de la clôture du second exercice mentionné au premier alinéa, les membres représentant les salariés sont désignés par la voie de l’élection mentionnée au sixième alinéa. |
« IV. – … … des II et III du présent article n’ont … … second des deux exercices mentionnés au I, les membres … … au 1° du III. Amendements AS 409, AS 410 et AS 411 | |
« Cette élection est organisée au plus tard : |
||
« 1° Dans les six mois de la dernière assemblée des commanditaires ou des commandités ayant refusé les modifications statutaires ; |
||
« 2° Dans le délai de six mois suivant l’approbation des comptes du second exercice clos mentionné au premier alinéa lorsque les modifications statutaires n’ont pas été approuvées par l’assemblée générale extraordinaire des commanditaires et par les commandités selon les modalités prévues à l’article L. 226-11. |
||
« V. – Les membres du conseil de surveillance désignés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la société ou ses filiales directes ou indirectes antérieur de deux années au moins à leur désignation et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsqu’au jour de la nomination la société est constituée depuis moins de deux ans. » ; |
||
2° Après l’article L. 226-4-2, il est inséré un article L. 226-4-3 ainsi rédigé : |
||
« Art. L. 226-4-3. – Pour l’élec-tion prévue au 1° de l’article L. 226-4-2, tous les salariés de la société et de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est situé sur le territoire français et dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret. |
||
« Les candidats ou listes de candidats sont présentés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du code du travail. |
||
« Lorsqu’il y a un seul siège à pourvoir pour l’ensemble du corps électoral, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de son remplaçant éventuel. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la majorité relative. |
||
« Dans les autres cas, l’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir. |
||
« En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus. |
||
« Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts. |
||
« Les contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le juge d’instance qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 2324-23 du code du travail. » ; |
Alinéa supprimé Amendement AS 424 | |
3° Après l’article L. 226-4-3, il est inséré un article L. 226-4-4 ainsi rédigé : |
||
« Art. L. 226-4-4. – Les conditions relatives à l’éligibilité, à l’électorat, à la composition des collèges, aux modalités du scrutin, aux contestations, à la durée et aux conditions d’exercice du mandat, à la révocation, à la protection du contrat de travail et au remplacement des membres du conseil de surveillance élus par les salariés sont fixées selon les règles définies aux articles L. 225-28 à L. 225-34. » |
« Art. L. 226-4-4. – … … contestations de la régularité des opérations électorales, à la durée … … à L. 225-34-1. » Amendements AS 425 et AS 426 | |
Code du travail |
IV. – L’article L. 2323-65 du code du travail est ainsi modifié : |
|
Art. L. 2323-65. – Dans les sociétés anonymes dans lesquelles le conseil d’administration ou de surveillance comprend des administrateurs ou des membres élus par les salariés au titre des articles L. 225-27 et L. 225-79 du code de commerce, la représentation du comité d’entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné par ce dernier. |
1° Après les mots : « membres élus », sont insérés les mots : « ou désignés » ; 2° Les mots : « au titre des articles L. 225-27 et L. 225-79 » sont remplacés par les mots : « L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 226-4-2 ». |
|
« IV bis. – Au premier alinéa de l’article L. 2411-17 du même code, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et des entreprises visées aux articles L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 226-4-2 du code de commerce ». Amendement AS 429 | ||
V. – La désignation des administrateurs mentionnés à l’article L. 225-27-1 du code de commerce et des membres du conseil de surveillance mentionnés aux articles L. 225-79-2 et L. 226-4-2 doit intervenir au plus tard le premier jour du vingt-sixième mois suivant la publication de la présente loi. |
V. – L’élection ou la désignation … … loi. Amendement AS 428 | |
Chapitre II |
Chapitre II | |
Lutter contre la précarité dans l’emploi et dans l’accès à l’emploi |
Lutter contre la précarité dans l’emploi et dans l’accès à l’emploi | |
Article 6 |
Article 6 | |
Cinquième partie L’emploi Livre IV Le demandeur d’emploi Titre II Indemnisation des travailleurs Chapitre II Régime d’assurance Section 1 Conditions et modalités d’attribution de l’allocation d’assurance |
I. – À la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la cinquième partie du code du travail, après l’article L. 5422-2, il est inséré un nouvel article L. 5422-2-1 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 5422-2-1. – Les droits à l’allocation d’assurance non épuisés, issus d’une période antérieure d’indem-nisation, sont pris en compte en tout ou partie dans le calcul de la durée et du montant des droits lors de l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation, dans les conditions prévues à l’article L. 5422-20. » |
« Art. L. 5422-2-1. – … … conditions définies dans les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20. » Amendement AS 317 | |
Loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels Art. 43. – Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail peut prévoir l’expérimentation de modalités particulières d’accompagnement dans le parcours de retour à l’emploi dans les bassins d’emploi qu’il détermine et pour des personnes ayant perdu leur emploi suite à l’échéance d’un contrat à durée déterminée, d’une mission de travail temporaire ou d’un chantier au sens de l’article L. 1236-8 du même code. Ces modalités peuvent notamment comprendre les mesures mentionnées à l’article L. 1233-65 du même code, des périodes de formation et des périodes de travail effectuées dans les conditions définies au 3° de l’article L. 1233-68 dudit code. Cet accord, conclu pour une durée maximale de trois ans, détermine les conditions dans lesquelles l’expérimentation est évaluée avant son terme. Cette évaluation est communiquée au Parlement. |
II. – À la première phrase de l’article 43 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, après les mots : « modalités particulières d’accompa-gnement », sont insérés les mots : « et d’incitation financière ». |
|
Code du travail |
Article 7 |
Article 7 |
L’article L. 5422-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
||
Art. L. 5422-12. – Les taux des contributions et de l’allocation sont calculés de manière à garantir l’équilibre financier du régime. |
||
« Les accords prévus à l’article L. 5422-20 peuvent majorer ou minorer les taux des contributions en fonction de la nature du contrat de travail, de sa durée, du motif de recours à ce type de contrat, de l’âge du salarié ou de la taille de l’entreprise. » |
« Les … … à un contrat d’une telle nature, de l’âge … … l’entreprise. » Amendement AS 320 | |
Article 8 |
Article 8 | |
Deuxième partie Les relations collectives de travail Livre II La négociation collective Titre IV Domaines et périodicité de la négociation obligatoire Chapitre Ier Négociation de branche et professionnelle |
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée : |
|
« Section 5 |
||
« Temps partiel |
||
« Art. L. 2241-13. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, ouvrent des négociations sur les modalités d’organisation du temps partiel dès lors qu’au moins un tiers de leur effectif occupe un emploi à temps partiel. |
« Art. L. 2241-13. – … … ouvrent une négociation sur … … tiers de l’effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel. Amendements AS 321 et AS 322 | |
« Cette négociation porte notamment sur la durée minimale d’activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes d’interruption d’activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires. » |
||
II. – L’article L. 3123-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
||
Art. L. 3123-8. – Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. |
||
« Une convention collective ou un accord de branche peuvent prévoir la possibilité pour l’employeur de proposer un emploi à temps complet ne ressortissant pas à la catégorie professionnelle du salarié à temps partiel ou un emploi non équivalent. » |
« Une … … proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent. » Amendements AS 323, AS 324 et AS 325 | |
III. – Après l’article L. 3123-14 du même code, sont insérés les articles L. 3123-14-1 à L. 3123-14-4 ainsi rédigés : |
||
« Art. L. 3123-14-1. – La durée minimale de travail du salarié employé à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou, le cas échéant, à l’équi-valent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2. Cette durée minimale n’est pas applicable aux salariés âgés de moins de vingt-six ans poursuivant leurs études. |
« Art. L. 3123-14-1. – … … salarié à temps … … conclu en application de l’article … … études. Amendements AS 326 et AS 327 | |
« Art. L. 3123-14-2. – Une durée de travail inférieure à celle prévue par l’article L. 3123-14-1 peut être fixée à la demande du salarié soit pour faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l’article L. 3123-14-1. Cette demande est écrite et motivée. |
« Art. L. 3123-14-2. – … … soit pour lui permettre de faire … … motivée. Amendement AS 328 | |
L’employeur informe chaque année le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogations individuelles définies au présent article à la durée du temps de travail prévue à l’article L. 3123-14-1. Amendement AS 218 | ||
« Art. L. 3123-14-3. – Une convention ou un accord de branche ne peut fixer une durée de travail inférieure à la durée mentionnée à l’article L. 3123-14-1 que s’il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités, afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l’article L. 3123-14-1. |
||
« Art. L. 3123-14-4. – Dans les cas prévus aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-3, il ne peut être dérogé à la durée minimale de travail mentionnée à l’article L. 3123-14-1 qu’à la condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Un accord de branche ou d’entreprise peut déterminer les modalités selon lesquelles s’opère ce regroupement. » |
||
Art. L. 3123-16. – L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures. |
||
|
Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut déroger à ces dispositions : |
IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 3123-16 du même code, les mots : « étendu, ou » sont remplacés par les mots : « le cas échéant ». |
|
1° Soit expressément ; 2° Soit en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l’activité exercée. |
||
Troisième partie Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale Livre Ier Durés de travail, repos et congés Titre II Durée du travail, répartition et aménagement des horaires Chapitre III Travail à temps partiel et travail intermittent Section 1 Travail à temps partiel Sous-section 6 Heures complémentaires |
V. – La sous-section 6 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifiée : |
|
1° À l’article L. 3123-17, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
||
Art. L. 3123-17. – Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. |
||
« Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa donne lieu à une majoration de salaire de 10 %. » ; |
||
2° L’article L. 3123-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
||
Art. L. 3123-19. – Lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %. |
||
« Une convention ou un accord de branche peut prévoir un taux de majoration différent, qui ne peut toutefois être inférieur à 10 %. » |
« Une… … peut être inférieur à 10 %. » Amendement AS 329 | |
Troisième partie Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale Livre Ier Durés de travail, repos et congés Titre II Durée du travail, répartition et aménagement des horaires Chapitre III Travail à temps partiel et travail intermittent Section 1 Travail à temps partiel |
VI. – Il est rétabli à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code une sous-section 8 ainsi rédigée : |
|
« Sous-section 8 |
||
« Compléments d’heures par avenant |
||
« Art. L. 3123-25. – Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d’augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat de travail. Par dérogation à l’article L. 3123-17, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l’avenant donnent lieu à une majoration qui ne peut être inférieure à 25 %. |
« Art. L. 3123-25. – … … prévue par le contrat. Par dérogation au dernier alinéa de l’article … … majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %. Amendements AS 330, AS 331 et AS 332 | |
« La convention ou l’accord : |
||
« a) Détermine le nombre maximum d’avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné ; |
||
« b) Peut prévoir la majoration des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ; |
« b) Peut prévoir la majoration salariale des heures… … avenant ; Amendement AS 333 | |
« c) Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d’heures. » |
||
VII. – L’article L. 3123-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
||
Art. L. 3123-14. – Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. |
||
« L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée de travail fixée par le contrat de travail. » |
« L’avenant … … le contrat. Amendement AS 334 | |
VIII. – Les dispositions de l’article L. 3123-14-1 et du troisième alinéa de l’article L. 3123-17 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Pour les contrats en cours à cette date, et jusqu’au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord conclu au titre de l’article L. 3123-14-3, la durée minimale prévue à l’article L. 3123-14-1 est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l’employeur justifié par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise. |
VIII. – Les … … contrats de travail en cours … … accord de branche conclu … … l’entreprise. Amendements AS 335 et AS 336 | |
IX. – Dans les organisations liées par une convention de branche, ou, à défaut, par des accords professionnels dont au moins un tiers de l’effectif occupe, à la date de publication de la présente loi, un emploi à temps partiel, la négociation prévue à l’article L. 2241-13 du code du travail doit être ouverte dans les trois mois suivant son entrée en vigueur. |
IX. – Dans … … l’effectif de la branche professionnelle occupe à la date de promulgation de la présente loi … … travail est ouverte … … mois à compter de la promulgation de la loi. Amendements AS 337, AS 338, AS 339 et AS 340 | |
Article 8 bis | ||
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2015, un rapport sur l’évaluation des dispositifs relatifs au temps partiel pour en mesurer l’impact réel notamment en termes d’égalité professionnelle. Amendement AS 291 | ||
Chapitre III |
Chapitre III | |
Favoriser l’anticipation négociée des mutations économiques pour développer les compétences, |
Favoriser l’anticipation négociée des mutations économiques pour développer les compétences, | |
Section 1 |
Section 1 | |
Développer la gestion prévisionnelle négociée des emplois et des compétences |
Développer la gestion prévisionnelle négociée des emplois et des compétences | |
Article 9 |
Article 9 | |
I. – L’article L. 2242-15 du code du travail est ainsi modifié : |
||
Art. L. 2242-15. – Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 d’au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l’employeur engage tous les trois ans une négociation portant sur : |
1° Au premier alinéa, après les mots : « tous les trois ans », sont insérés les mots : « , sur le fondement des orientations stratégiques de l’entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l’article L. 2323-7-1, » ; |
1° Au … … mots : « , notamment sur le fondement … … L. 2323-7-1, » ; Amendement AS 262 |
1° Les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise sur la stratégie de l’entreprise ainsi que ses effets prévisibles sur l’emploi et sur les salaires ; |
2° Le 1° est supprimé ; |
|
2° La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur laquelle le comité d’entreprise est informé, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. |
3° Le 2° devient le 1° et après les mots : « mobilité professionnelle et géographique des salariés », sont insérés les mots : « autres que celles prévues dans le cadre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 » ; |
|
4° Il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés : |
||
« 2° Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise prévue à l’article L. 2242-21, qui doivent, en cas d’accord, faire l’objet d’un chapitre spécifique ; |
« 2° Le cas échant, les conditions de … … spécifique ; Amendement AS 263 | |
« 3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise ; |
||
« 4° Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, notamment aux contrats à durée indéterminée, aux contrats à durée déterminée et aux contrats d’intérim. |
||
« Un bilan est réalisé à l’échéance de l’accord. » |
||
II. – À l’article L. 2242-16 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
||
Art. L. 2242-16. – La négociation prévue à l’article L. 2242-15 peut également porter : 1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à ce même article ; 2° Sur la qualification des catégories d’emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques. |
||
« 3° Sur les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes peuvent être informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences, ainsi que sur les modalités de leur association au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. » |
« 3° Sur … … sous-traitantes sont informées … … compétences. » Amendement AS 220 | |
4° Sur les conditions dans lesquelles l’entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l’échelle du site ou du bassin d’emploi. Amendement AS 301 | ||
III. – Le premier alinéa de l’article L. 2323-33 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : |
||
Art. L. 2323-33. – Chaque année, le comité d’entreprise est consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise en fonction des perspectives économiques et de l’évolution de l’emploi, des investissements et des technologies dans l’entreprise. |
« Ces orientations sont établies en cohérence avec le contenu de l’accord issu, le cas échéant, de la négociation mentionnée à l’article L. 2242-15, notamment avec les grandes orientations sur trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise qu’il a arrêtées. » |
|
Art. L. 2323-35. – Le projet de plan de formation tient compte des orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise dont le comité d’entreprise a eu à délibérer, du résultat des négociations prévues à l’article L. 2241-6 ainsi que, le cas échéant, du plan pour l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 1143-1. |
IV. – À l’article L. 2323-35 du même code, après le mot : « délibérer, », sont insérés les mots : « des grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise arrêtées, le cas échéant, par l’accord issu de la négociation prévue à l’article L. 2242-15 ». |
|
Article 10 |
Article 10 | |
Deuxième partie Les relations collectives de travail Livre II La négociation collective |
I. – La sous-section unique de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail devient la sous-section 1. |
|
Titre IV |
||
Domaines et périodicité de la négociation obligatoire Chapitre II Négociation obligatoire en entreprise Section 3 Négociation triennale |
II. – La section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du même code est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée : |
|
« Sous-section 2 |
||
« Mobilité interne |
||
« Art. L. 2242-21. – L’employeur engage tous les trois ans une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise dans le cadre de mesures collectives d’organisation sans projet de licenciement. |
« Art. L. 2242-21. – … … d’organisation courantes sans projet de réduction d’effectifs. Amendement AS 302 | |
« Dans les entreprises et groupes mentionnés à l’article L. 2242-15, les modalités de cette mobilité interne s’inscrivent dans le cadre de la négociation prévue au même article. |
« Dans les entreprises et les groupes d’entreprises mentionnés … … article. Amendement AS 341 | |
« Art. L. 2242-22. – La négociation prévue à l’article L. 2242-21 porte notamment sur : |
||
« 1° Les mesures d’accompagne-ment à la mobilité, en particulier en termes de formation et d’aides à la mobilité géographique ; |
« 1° Les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d’emploi du salarié, elle-même précisée par l’accord ; Amendements AS 265 et AS 344 | |
« 2° Les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique de l’emploi du salarié, elle-même précisée par l’accord ; |
« 2° Les mesures visant concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ; Amendements AS 265, AS 345 AS 264 et AS 304 | |
« 3° Les mesures visant à permettre la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. |
« 3° Les mesures d’accompa-gnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à la mobilité géographique, qui comprennent la participation de l’employeur à la prise en charge des éventuels frais de déménagement et frais de transport supplémentaires. Amendements AS 265, AS 342, AS 303 et AS 343 | |
« Les stipulations de l’accord collectif issu de la négociation mentionnée par le présent article ne peuvent avoir pour effet d’entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié et doivent garantir le maintien ou l’amélioration de sa qualification professionnelle. |
« Les … … négociation prévue à l’article L. 2242-21 ne peuvent … … professionnelle. Amendement AS 346 | |
« L’accord collectif issu de la négociation mentionnée par le présent article est porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concernés. |
« L’accord … … négociation prévue au même article L. 2242-21 est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés. Amendements AS 346, AS 305 et AS 268 | |
« Art. L. 2242-23. – Les stipulations de l’accord conclu au titre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l’accord sont suspendues. Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application de l’accord à leur contrat de travail, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d’accompagnement que doit prévoir l’accord. » |
||
Section 2 |
Section 2 | |
Encourager des voies négociées de maintien de l’emploi face aux difficultés conjoncturelles |
Encourager des voies négociées de maintien de l’emploi face aux difficultés conjoncturelles | |
Article 11 |
Article 11 | |
Cinquième partie L’emploi Livre Ier Les dispositifs en faveur de l’emploi Titre II Aides au maintien et à la sauvegarde de l’emploi Chapitre II Aides aux salariés en chômage partiel |
I. – L’intitulé du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est remplacé par l’intitulé suivant : « Aide aux salariés placés en activité partielle ». |
|
Section 1 Allocation spécifique de chômage partiel Section 2 Allocations complémentaires de chômage partiel Section 3 Régime social et fiscal des allocations Section 4 Dispositions d’application |
II. – Les titres des sections 1 à 4 du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du même code sont supprimés. |
II. – Les divisions et intitulés des sections 1 à 4 du chapitre … … supprimés. Amendement AS 347 |
III. – L’article L. 5122-1 du même code est ainsi modifié : |
||
|
Art. L. 5122-1. – Les salariés sont placés en position de chômage partiel et bénéficient d’une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l’État s’ils subissent une perte de salaire imputable : |
1° Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ; 2° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « de chômage partiel » sont remplacés par les mots : « d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, » ; b) Les mots : « et bénéficient d’une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l’État » sont supprimés ; c) Le mot : « salaire » est remplacé par le mot : « rémunération » ; |
|
- soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établis-sement ; |
||
- soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. |
||
2° bis Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
||
« En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement. » ; |
||
3° Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : |
||
L’allocation spécifique de chômage partiel est également attribuée aux salariés exerçant la même activité qui subissent la réduction collective de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail, appliquée, dans les mêmes conditions, individuellement et alternativement. Dans ce cas, les entreprises de plus de 250 salariés doivent conclure une convention d’activité partielle de longue durée prévue par le 2° de l’article L. 5122-2. |
« II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’État. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’État et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. |
|
Les salariés restent liés à leur employeur par un contrat de travail. |
« Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. |
|
La mise en chômage partiel des salariés indemnisés au titre de l’allocation spécifique de chômage partiel entraîne la suspension de l’exécution de leur contrat de travail. Durant cette période, les salariés peuvent suivre des actions de formation en dehors du temps de travail. |
« III. – L’autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l’employeur en contrepartie de l’allocation qui lui est versée, en tenant compte d’un éventuel accord collectif d’entreprise conclu sur l’activité partielle. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements. » |
« III. – L’autorité administrative peut imposer des obligations spécifiques à l’employeur … … compte des stipulations de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’activité partielle, lorsqu’un tel accord existe. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités selon lesquelles sont imposées ces obligations. Amendements AS 348, AS 349 et AS 350 |
IV. – L’article L. 5122-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : |
||
Art. L. 5122-2. – Afin d’éviter des licenciements pour motif économique touchant certaines professions dans certaines régions atteintes ou menacées d’un grave déséquilibre de l’emploi, des actions de prévention peuvent être engagées pour une durée déterminée. |
« Art. L. 5122-2. – Le salarié placé en activité partielle peut bénéficier, pendant les heures chômées, de l’ensemble des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 réalisées notamment dans le cadre du plan de formation. |
« Art. L. 5122-2. – Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l’ensemble des actions et de la formation mentionnées … … formation. Amendements AS 351, AS 352 et AS 353 |
Ces actions peuvent comporter notamment : |
« Dans ce cas, le pourcentage mentionné au II de l’article L. 5122-1 est majoré dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » |
« Dans … … conditions prévues par décret en Conseil d’État. » Amendement AS 354 |
1° La prise en charge partielle par l’État des indemnités complémentaires de chômage partiel dues aux travailleurs victimes d’une réduction d’activité au-dessous de la durée légale du travail. Cette prise en charge se fait par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels ou avec les entreprises ; |
||
2° Le versement d’allocations aux salariés subissant une réduction d’activité en dessous de la durée légale du travail pendant une période de longue durée. Ce versement intervient par voie de conventions conclues par l’État avec les organismes professionnels, interprofessionnels ou avec les entreprises. Ces allocations sont financées conjointement par l’entreprise, l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Elles sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. |
||
Art. L. 5122-3. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles les actions de prévention mentionnées à la présente section peuvent être engagées. |
V. – L’article L. 5122-3 du même code est abrogé. |
|
VI. – L’article L. 5122-4 du même code est ainsi modifié : |
||
Art. L. 5122-4. – Le régime social et fiscal applicable aux contributions mentionnées à l’article L. 5422-10 est applicable aux allocations et contributions de chômage partiel, lorsque cette indemnisation résulte d’accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux. |
1° Les mots : « aux allocations et contributions de chômage partiel, lorsque cette indemnisation résulte d’accords professionnels, ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux » sont remplacés par les mots : « à l’indemnité versée au salarié » ; |
|
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: |
||
« Cette indemnité est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. » |
||
VI bis. – Au 3° de l’article L. 3232-2 du même code, les mots : « de chômage partiel » sont remplacés par les mots : « d’activité partielle ». Amendement AS 355 | ||
VII. – L’article L. 3232-5 du même code est ainsi modifié : |
||
Art. L. 3232-5. – Lorsque, par suite d’une réduction de l’horaire de travail au-dessous de la durée légale hebdomadaire pour des causes autres que celles énumérées à l’article L. 3232-4, un salarié a perçu au cours d’un mois, à titre de salaire et d’allocations légales ou conventionnelles de chômage partiel, une somme totale inférieure à la rémunération minimale, il lui est alloué une allocation complémentaire égale à la différence entre la rémunération minimale et la somme qu’il a effectivement perçue. |
1° Au premier alinéa, les mots : « d’allocations légales ou conventionnelles de chômage partiel » sont remplacés par les mots : « d’indemnité d’activité partielle » ; |
|
Pour l’application du présent chapitre, sont assimilées aux allocations légales ou conventionnelles de chômage partiel, les indemnités pour intempéries prévues aux articles L. 5424-6 et suivants. |
2° Au second alinéa, les mots : « aux allocations légales ou conventionnelles de chômage partiel » sont remplacés par les mots : « à l’indemnité d’activité partielle ». |
|
Troisième partie Durée du salaire, salaire, intéressement, participation et épargne salariale Livre II Salaire et avantages divers Titre III Détermination du salaire Chapitre II Rémunération mensuelle minimale Section 4 Remboursement par l’État |
VIII. – La section 4 du chapitre II du titre III du livre II de la troisième partie du même code est abrogée. |
|
Art. L. 3232-8. – L’État rembourse à l’employeur une fraction de l’allocation complémentaire. |
||
Le montant cumulé de ce remboursement et de l’allocation de chômage partiel prévue à l’article L. 5122-1 ne peut excéder la moitié de la différence entre la rémunération mensuelle minimale et le salaire net perçu par un travailleur. Ce salaire correspond au nombre d’heures pendant lesquelles celui-ci a effectivement travaillé au cours du mois considéré. |
||
Art. L. 3232-2. – Le gouvernement présente chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport sur l’application du présent chapitre indiquant notamment : 1° Le nombre de salariés bénéficiaires de l’allocation complémentaire établie par l’article L. 3232-5 ; 2° Le coût du versement de l’allocation prévue au 1° pour l’année écoulée ; 3° Le nombre de bénéficiaires des allocations publiques de chômage total et des allocations publiques de chômage partiel ainsi que les mesures prises en application de l’article L. 3232-9. |
IX. – Au 3° de l’article L. 3232-2 du même code, les mots : « de chômage partiel » sont remplacés par les mots : « d’activité partielle ». |
Alinéa supprimé Amendement AS 355 |
Art. L. 5428-1. – L’allocation perçue dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, l’allocation de chômage partiel, l’allocation d’assurance et l’allocation de préretraite sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. |
X. – Au premier alinéa de l’article L. 5428-1 du même code, les mots : « l’allocation de chômage partiel, » sont supprimés. |
X. – L’article L. 5428-1 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « l’allocation de chômage partiel, » sont supprimés ; |
|
Ces prestations ainsi que l’allocation de solidarité spécifique et l’allocation temporaire d’attente sont exonérées de la taxe sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale, sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 131-2, L. 241-2, L. 242-13 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime. |
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « l’indemnité d’activité partielle, ». Amendement AS 356 | |
Les règles fixées au 5 de l’article 158 du code général des impôts sont applicables. |
||
Code de la sécurité sociale |
||
Art. L. 242-10. – Les dispositions des articles L. 242-8 et L. 242-9 ci-dessus ne sont pas applicables : |
||
1°) aux salariés ou assimilés dont l’emploi donne lieu à des taux, assiettes ou montants spécifiques de cotisations, en application du deuxième alinéa de l’article L. 241-2, des articles L. 241-3, L. 241-6 et L. 242-3 ; |
||
2°) aux salariés ou assimilés dont l’emploi régulier et simultané par plusieurs employeurs entraîne, quant au calcul des cotisations, un fractionnement entre lesdits employeurs du plafond fixé pour l’assiette des cotisations de sécurité sociale. |
||
Elles ne s’appliquent pas non plus aux personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire ni aux salariés concernés par des mesures de réduction d’horaire ouvrant droit à une indemnisation au titre du chômage partiel. |
XI. – Au dernier alinéa de l’article L. 242-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « du chômage partiel » sont remplacés par les mots : « de l’activité partielle ». |
|
Code général des impôts |
XII. – Le code général des impôts est ainsi modifié : | |
Art. 58. – …………………….. |
||
5 a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90. Les pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 10 % qui ne peut excéder 3 660 €. Ce plafond s’applique au montant total des pensions et retraites perçues par l’ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. L’abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 374 €, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s’applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 374 € est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées aux articles L. 3232-6, L. 5122-1, L. 5122-2, L. 5123-2, L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l’article 81, lorsque ces sommes sont imposables. Sous réserve de l’exonération prévue à l’article 163 bis AA, les dispositions du a sont également applicables aux sommes revenant aux salariés au titre de la participation aux résultats de l’entreprise en application du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail. |
1° Au premier alinéa du b du 5 de l’article 158, après le mot : « allocations », sont insérés les mots : « et indemnités » ; Amendement AS 357 | |
2° L’article 231 bis D est ainsi modifié : | ||
Art. 231 bis D. – Conformément aux dispositions du 2° de l’article L. 5122-2, des articles L. 5123-2 et L. 5123-5, de l’article L. 5422-10, des premier et deuxième alinéas de l’article L. 5428-1 et de l’article L. 3232-6 du code du travail, les allocations et contributions mentionnées à ces mêmes articles sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l’article 231. |
a) La référence : « du 2° » est supprimée. b) Après le mot : « allocations », il est inséré le mot : « , indemnités ». Amendement AS 357 | |
XIII. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des propositions pour renforcer l’attractivité du régime de l’activité partielle. Amendement AS 74 | ||
Code du travail |
Article 12 |
Article 12 |
Cinquième partie L’emploi Livre Ier Les dispositifs en faveur de l’emploi Titre II Aides au maintien et à la sauvegarde de l’emploi |
I. – L’intitulé du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est remplacé par l’intitulé suivant : « Maintien et sauvegarde de l’emploi ». |
|
II. – Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé : |
||
« Chapitre V |
||
« Accords de maintien de l’emploi |
||
« Art. L. 5125-1. – I. – En cas de graves difficultés conjoncturelles dont le diagnostic est analysé avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, un accord d’entreprise peut, en contrepartie de l’engagement de la part de l’employeur de maintenir les emplois pendant la durée de validité de l’accord, aménager pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 dans le respect des dispositions du premier alinéa de l’article L. 2253-3 et des articles L. 3121-33 à L. 3121-36, L. 3122-34 et L. 3122-35, L. 3131-1 à L. 3132-2, L. 3133-4, L. 3141-1 à L. 3141-3 et L. 3231-2. |
« Art. L. 5125-1. – I. – En cas de graves difficultés économiques conjoncturelles dont le diagnostic est analysé avec les organisations syndicales de salariés représentatives … articles L. 3121-10 à L. 3121-36 … … L. 3231-2. Amendements AS 230, AS 358 et AS 306 | |
« Un expert-comptable peut être mandaté par le comité d’entreprise pour accompagner les organisations syndicales dans l’analyse du diagnostic et dans la négociation dans les conditions prévues par l’article L. 2325-35. |
||
« II. – L’application des dispositions de l’accord ne peut avoir pour effet ni de diminuer la rémunération des salariés lorsque le taux horaire de celle-ci, à la date de conclusion de cet accord, est égal ou inférieur au taux horaire du SMIC majoré de 20 %, ni de porter la rémunération des autres salariés en dessous de ce seuil. |
« II. – L’application des stipulations de l’accord ne peut avoir pour effet ni de diminuer la rémunération, horaire ou mensuelle, des salariés … … ni de ramener la rémunération … … seuil. Amendements AS 359, AS 270 et AS 360 | |
« L’accord prévoit les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant des responsabilités dans le périmètre de l’accord participent aux efforts demandés aux salariés, notamment en termes de rémunération au sens de l’article L. 3221-3. Il prévoit également, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance, des stipulations équivalentes pour la rémunération des mandataires sociaux et le versement des dividendes aux actionnaires. |
« L’accord … … l’accord contribuent de manière proportionnée aux efforts demandés aux autres salariés … … actionnaires. Amendements AS 307, AS 271 et AS 361 | |
L’accord prévoit les modalités de l’organisation du suivi de l’évolution de la situation économique de l’entreprise et de la mise en œuvre de l’accord, notamment auprès des organisations syndicales de salariés représentatives signataires et des institutions représentatives du personnel. Amendement AS 308 | ||
« III. – La durée de l’accord ne peut excéder deux ans. Pendant sa durée, l’employeur ne peut procéder à aucune rupture du contrat de travail pour motif économique des salariés auxquels l’accord s’applique. |
||
« L’accord prévoit les conséquences d’une amélioration de la situation économique de l’entreprise sur la situation des salariés, à l’issue de sa période d’application ou dans l’hypothèse d’une suspension de l’accord pendant son application, pour ce motif, dans les conditions fixées à l’article L. 5125-5. |
||
« IV. – L’accord détermine le délai et les modalités de l’acceptation ou du refus par le salarié de l’application des stipulations de l’accord à son contrat de travail. |
||
« Art. L. 5125-2. – Pour les salariés qui l’acceptent, les stipulations de l’accord mentionné à l’article L. 5125-1 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l’accord sont suspendues pendant la durée d’application de celui-ci. |
||
« Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application de l’accord à leur contrat de travail, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d’accompagnement que doit prévoir l’accord. |
||
« L’accord contient une clause pénale au sens de l’article 1226 du code civil. Celle-ci s’applique lorsque l’employeur n’a pas respecté les engagements de maintien de l’emploi mentionnés à l’article L. 5125-1. Elle donne lieu au versement de dommages-intérêts aux salariés lésés, dont le montant et les modalités d’exécution sont fixés dans l’accord. |
« L’accord … … respecté ses engagements, notamment ceux de maintien … … l’accord. Amendement AS 275 | |
L’accord prévoit les modalités d’in-formation des salariés quant à son application et son suivi pendant toute sa durée Amendement AS 273 | ||
« Art. L. 5125-3. – Les organes d’administration et de surveillance de l’entreprise sont informés du contenu de l’accord mentionné à l’article L. 5125-1 lors de leur première réunion suivant sa conclusion. |
||
« Art. L. 5125-4. – I. – La validité de l’accord mentionné à l’article L. 5125-1 est subordonnée, par dérogation à l’article L. 2232-12, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. |
« Art. L. 5125-4. – I. – Par dérogation à l’article L. 2232-12, la validité de l’accord mentionné à l’article L. 5125-1 est subordonnée à sa signature … … votants. Amendement AS 362 | |
« II. – Lorsque l’entreprise est dépourvue de délégué syndical, l’accord peut être conclu par un ou plusieurs représentants élus du personnel expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. |
« II. – Lorsque … … syndicales de salariés représentatives … … interprofessionnel. Amendement AS 358 | |
« À défaut de représentants élus du personnel, l’accord peut être conclu avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, dans le respect de l’article L. 2232-26. |
« À défaut … … syndicales de salariés représentatives … … L. 2232-26. Amendement AS 358 | |
« L’accord signé par un représentant élu du personnel mandaté ou par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions déterminées par cet accord et dans le respect des principes généraux du droit électoral. |
« L’accord … … doit être approuvé … … électoral. Amendement AS 363 | |
« III. – Le temps passé aux négociations de l’accord visé au 1er alinéa du II n’est pas imputable sur les heures de délégation prévues aux articles L. 2315-1 et L. 2325-6. |
« III. – Le … … l’accord mentionné au … … L. 2325-6. Amendement AS 364 | |
« Chaque représentant élu du personnel mandaté et chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans les conditions prévues à l’article L. 2232-25. |
||
« IV. – Le représentant élu du personnel mandaté ou le salarié mandaté bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par chapitre premier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les salariés mandatés dans les conditions fixées à l’article L. 2232-24. |
« IV. – Le … … prévue par le chapitre … … L. 2232-24. Amendement AS 276 | |
« Art. L. 5125-5. – L’accord peut être suspendu par décision du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, à la demande de l’un de ses signataires lorsqu’il estime que les engagements souscrits, notamment en matière de maintien de l’emploi, ne sont pas appliqués de manière loyale et sérieuse, ou que la situation économique de l’entreprise a évolué de manière significative. |
« Art. L. 5125-5. – … … signataires, lorsque le juge estime … … significative. Amendement AS 365 | |
« Lorsque le juge décide cette suspension, il en fixe le délai. À l’issue de ce délai, à la demande des parties et au vu des éléments transmis relatifs à l’application loyale de l’accord ou à l’évolution de la situation économique de l’entreprise, il autorise, selon la même procédure, la poursuite de l’accord ou en suspend définitivement les effets. |
« Lorsque … … demande de l’une des parties … … loyale et sérieuse de l’accord … … effets. Amendements AS 366 et AS 367 | |
« Art. L. 5125-6. – En cas de rupture du contrat de travail, consécutive notamment à la décision du juge de suspendre les effets de l’accord, le calcul des indemnités légales de préavis et de licenciement ainsi que de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1, dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l’article L. 5422-20, se fait sur la base de la rémunération au moment de la rupture ou, si elle est supérieure, sur la base de la rémunération antérieure à la conclusion de l’accord. » |
« Art. L. 5125-6. – … … l’accord mentionné à l’article L. 5125-1, le calcul … … rémunération du salarié au moment … … l’accord. » Amendements AS 368 et AS 369 | |
Art. L. 5125-7. – L’allocation mentionnée à l’article L. 5122-1 est cumulable avec les dispositions prévues au présent chapitre. Amendement AS 309 | ||
III. – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant évaluation des accords de maintien de l’emploi. Amendement AS 116 | ||
Section 3 |
Section 3 | |
Renforcer l’encadrement des licenciements collectifs et instaurer une obligation de recherche de repreneur en cas de fermeture de site |
Renforcer l’encadrement des licenciements collectifs et instaurer une obligation de recherche de repreneur en cas de fermeture de site | |
Article 13 |
Article 13 | |
Première partie Les relations individuelles de travail Livre II Le contrat de travail Titre III Rupture du contrat de travail à durée indéterminée Chapitre III Licenciement pour motif économique Section 4 Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours Sous-section 1 Dispositions générales Paragraphe 1 Modalités spécifiques résultant d’un accord |
I. – L’intitulé du premier paragraphe de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est remplacé par l’intitulé suivant : « Paragraphe 1er - Possibilité d’un accord et modalités spécifiques en résultant ». |
|
Art. L. 1233-22. – L’accord prévu à l’article L. 1233-21 fixe les conditions dans lesquelles le comité d’entreprise : |
||
1° Est réuni et informé de la situation économique et financière de l’entreprise ; |
||
2° Peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l’origine d’une restructuration ayant des incidences sur l’emploi et obtenir une réponse motivée de l’employeur à ses propositions. |
||
L’accord peut organiser la mise en œuvre d’actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l’entreprise et du groupe. |
II. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 1233-22 du même code sont supprimés. |
|
Il peut déterminer les conditions dans lesquelles l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi prévu à l’article L. 1233-61 fait l’objet d’un accord et anticiper le contenu de celui-ci. |
||
Art. L. 1233-23. – L’accord prévu à l’article L. 1233-21 ne peut déroger : |
||
1° À l’obligation d’effort de formation, d’adaptation et de reclassement incombant à l’employeur prévue à l’article L. 1233-4 ; |
III. – Le 1° de l’article L. 1233-23 du même code est abrogé et les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°. |
|
2° Aux règles générales d’information et de consultation du comité d’entreprise prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ; |
||
3° À la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ; |
||
4° Aux règles de consultation applicables lors d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, prévues à l’article L. 1233-58. |
||
Art. L. 1233-24. – Toute action en contestation visant tout ou partie d’un accord prévu à l’article L. 1233-21 doit être formée, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de l’accord prévu à l’article L. 2231-6. |
||
Ce délai est porté à douze mois pour un accord qui détermine ou anticipe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi prévu à l’article L. 1233-61. |
IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 1233-24 du même code est supprimé. |
|
V. – Après l’article L. 1233-24 du même code, sont insérés les articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ainsi rédigés : |
||
« Art. L. 1233-24-1. – Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d’entreprise et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. |
« Art. L. 1233-24-1. – … votants. L’administration est informée sans délai de l’ouverture d’une négociation en vue de l’accord précité. Amendement AS 310 | |
« Art. L. 1233-24-2. – L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. |
||
« Il peut également porter sur : |
||
« 1° Les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise ; |
||
« 2° La pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements mentionnés à l’article L. 1233-5 ; |
||
« 3° Le calendrier des licenciements ; |
||
« 4° Le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées ; |
||
« 5° Les modalités de mise en œuvre des mesures d’adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. |
||
« Art. L. 1233-24-3. – L’accord prévu à l’article L. 1233-24-1 ne peut déroger : |
||
« 1° À l’obligation d’effort de formation, d’adaptation et de reclassement incombant à l’employeur en vertu des articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 ; |
||
« 2° À l’obligation pour l’employeur de proposer aux salariés le contrat de sécurisation professionnelle prévu à l’article L. 1233-65 ou le congé de reclassement prévu à l’article L. 1233-71 ; |
||
« 3° À la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ; |
||
« 4° Aux règles de consultation applicables lors d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, prévues à l’article L. 1233-58. » |
||
VI. – Il est créé, après l’article L. 1233-24-3 du même code, un paragraphe 1er bis ainsi rédigé : |
||
« Paragraphe 1er bis |
||
« Document unilatéral de l’employeur |
||
« Art. L. 1233-24-4. – À défaut d’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1, un document élaboré par l’employeur après la dernière réunion du comité d’entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. » |
||
VII. – L’article L. 1233-30 du même code est ainsi modifié : |
||
Art. L. 1233-30. – Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité d’entreprise. |
1° Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » et après le mot : « comité d’entreprise », il est ajouté le mot : « sur : » ; |
|
2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : |
||
Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise en œuvre de la procédure de consultation prévue par l’article L. 2323-15. |
« 1° L’opération projetée et ses modalités d’application conformément aux dispositions de l’article L. 2323-15 ; |
|
« 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi. |
||
« Les éléments mentionnés au 2° qui font l’objet de l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité d’entreprise prévue par le présent article. » ; |
||
|
Le comité d’entreprise tient deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à : |
3° Au troisième alinéa, qui devient le cinquième, après le mot : « tient », sont insérés les mots : « au moins » et les mots : « séparées par un délai qui ne peut être supérieur à » sont remplacés par les mots : « espacées d’au moins quinze jours » ; |
|
4° Après le troisième alinéa, qui devient le cinquième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
||
« II. – Le comité d’entreprise rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2°du I, à : » ; |
||
|
1° Quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ; |
5° Au quatrième alinéa, qui devient le septième, les mots : « quatorze jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ; |
|
|
2° Vingt-et-un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ; |
6° Au cinquième alinéa, qui devient le huitième, les mots : « vingt-et-un jours » sont remplacés par les mots : « trois mois » ; |
|
|
3° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. |
7° Au sixième alinéa, qui devient le neuvième, les mots : « vingt-huit jours » sont remplacés par les mots : « quatre mois » ; |
|
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés. |
8° Au septième alinéa, qui devient le dixième, les mots : « plus favorables aux salariés » sont remplacés par les mots : « différents » ; |
|
9° Après le septième alinéa, qui devient le dixième, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
||
« En l’absence d’avis du comité d’entreprise dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté. » |
||
Lorsqu’il n’existe pas de comité d’entreprise et qu’un procès-verbal de carence a été transmis à l’inspecteur du travail, le projet de licenciement est soumis aux délégués du personnel. |
||
VIII. – L’article L. 1233-33 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : |
||
Art. L. 1233-33. – L’employeur met à l’étude, dans les délais prévus aux articles L. 1233-39 et L. 1233-41 pour l’envoi des lettres de licenciement, les suggestions formulées par le comité d’entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur donne une réponse motivée. |
« Art. L. 1233-33. – L’emplo- |
|
IX. – L’article L. 1233-34 du même code est ainsi modifié : |
||
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
||
Art. L. 1233-34. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d’entreprise peut recourir à l’assistance d’un expert-comptable en application de l’article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l’article L. 1233-30. |
« Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l’article L. 1233-24-1. » ; |
|
L’expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l’article L. 2325-41. |
||
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
||
« Le rapport de l’expert est remis au comité d’entreprise et, le cas échéant, aux organisations syndicales. » |
||
X. – L’article L. 1233-35 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : |
||
Art. L. 1233-35. – Lorsqu’il recourt à l’assistance d’un expert-comptable, le comité d’entreprise tient une deuxième réunion au plus tôt le vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour après la première. |
« Art. L. 1233–35. – L’expert désigné par le comité d’entreprise demande à l’employeur, au plus tard dans les vingt et un jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les quinze jours. |
« Art. L. 1233–35. – … … les dix jours … … dans les huit jours. Le cas échéant, l’expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l’employeur, qui doit répondre à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande de l’expert est formulée. Amendements AS 311, AS 312 et AS 313 |
Il tient une troisième réunion dans un délai courant à compter de sa deuxième réunion. Ce délai ne peut être supérieur à : |
« L’expert présente son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 1233-30. » |
|
1° Quatorze jours lorsque le nombre de licenciements est inférieur à cent ; |
||
2° Vingt-et-un jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ; |
||
3° Vingt-huit jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. |
||
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés. |
||
XI. – L’article L. 1233-36 du même code est ainsi modifié : |
||
1° Au premier alinéa : |
||
Art. L. 1233-36. – Dans les entreprises dotées d’un comité central d’entreprise, l’employeur consulte le comité central et le ou les comités d’établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d’établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d’établissement tiennent leurs deux réunions respectivement après la première et la deuxième réunion du comité central d’entreprise tenues en application de l’article L. 1233-30. |
a) Les mots : « deux » et « respectivement » sont supprimés ; b) Les mots : « la première et la deuxième réunions » sont remplacés par le mot : « celles » ; |
|
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : |
||
« Ces réunions ont lieu dans les délais prévus par l’article L. 1233-30. » ; |
||
2° Au second alinéa : |
||
Si la désignation d’un expert-comptable est envisagée, elle est effectuée par le comité central d’entreprise, dans les conditions prévues au paragraphe 2. Dans ce cas, le ou les comités d’établissement tiennent leurs deux réunions respectivement après la deuxième et la troisième réunion du comité central d’entreprise tenues en application de l’article L. 1233-35. |
a) Après les mots : « dans les conditions », sont insérés les mots : « et les délais » ; b) Le mot : « prévues » est remplacé par le mot : « prévus » ; |
|
c) La dernière phrase est supprimée. |
||
XII. – L’article L. 1233-39 du même code est ainsi modifié : |
||
|
Art. L. 1233-39. – L’employeur notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception. |
1° Au début du premier alinéa, sont insérés les mots suivants : « Dans les entreprises de moins de 50 salariés, » ; |
|
La lettre de notification ne peut être adressée avant l’expiration d’un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l’autorité administrative. |
||
|
Ce délai ne peut être inférieur à : |
2° Au troisième alinéa, après les mots : « inférieur à », sont insérés les mots : « 30 jours » ; |
|
1° Trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ; |
3° Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés ; |
|
2° Quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ; |
||
3° Soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. |
||
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés. |
||
4° Après le septième alinéa, qui devient le quatrième, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : |
||
« Dans les entreprises de 50 salariés ou plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l’employeur notifie le licenciement selon les modalités prévues au premier alinéa, après la notification par l’autorité administrative de la décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou de la décision d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 ou à l’expiration des délais prévus à l’article L. 1233-57-4. |
||
« Il ne peut procéder, à peine de nullité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de cette décision d’homologation ou de validation ou l’expiration des délais prévus à l’article L. 1233-57-4. » |
||
Art. L. 1233-40. – Lorsque le comité d’entreprise recourt à l’assis-tance d’un expert-comptable, les délais d’envoi des lettres de licenciement prévus à l’article L. 1233-39 courent à compter du quatorzième jour suivant la notification du projet de licenciement à l’autorité administrative prévue à l’arti-cle L. 1233-46. |
XIII. – Les articles L. 1233-40 et L. 1233-41 du même code sont abrogés. |
|
Art. L. 1233-41. – L’autorité administrative peut réduire le délai de notification des licenciements aux salariés, prévu à l’article L. 1233-39, ou tout autre délai prévu par convention ou accord collectif de travail, lorsqu’un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l’article L. 1233-32, a été conclu à l’occasion du projet de licenciement ou lorsque l’entreprise applique les dispositions préexistantes d’une convention ou d’un accord collectif ayant ce même objet. |
||
Toutefois, ce délai accordé ne peut être inférieur à celui dont dispose l’autorité administrative pour effectuer les vérifications prévues à l’article L. 1233-53. |
||
Première partie Les relations individuelles de travail Livre II Le contrat de travail Titre III Rupture du contrat de travail à durée indéterminée Chapitre III Licenciement pour motif économique Section 4 Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours Sous-section 3 Procédure à l’égard des salariés |
XIV. – La sous-section 3 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé : |
|
« Paragraphe 4 |
||
« Mesures de mobilité interne |
||
« Art. L. 1233-45-1. – Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, l’employeur peut, après avis favorable du comité d’entreprise, mettre en œuvre des mesures de mobilité interne avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 1233-30. » |
« Art. L. 1233-45-1. – … … d’entreprise, proposer des mesures de reclassement interne … … L. 1233-30. Amendement AS 282 | |
Art. L. 1233-46. – L’employeur notifie à l’autorité administrative tout projet de licenciement pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours. |
XV. – Le troisième alinéa de l’article L. 1233-46 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
Lorsque l’entreprise est dotée de représentants du personnel, la notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30. |
||
XV. – Le troisième alinéa de l’article L. 1233-46 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : |
||
La notification est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l’ordre du jour et la tenue de cette réunion. |
« Au plus tard à cette date, elle indique, le cas échéant, l’intention de l’employeur d’ouvrir la négociation prévue à l’article L. 1233-24-1. » |
|
Art. L. 1233-47. – La liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise à l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. |
XVI. – L’article L. 1233-47 du même code est abrogé. |
|
XVII. – L’article L. 1233-50 du même code est ainsi modifié : |
||
Art. L. 1233-50. – Lorsque le comité d’entreprise recourt à l’assistance d’un expert-comptable, l’employeur le mentionne dans la notification du projet de licenciement faite à l’autorité administrative. Il informe cette dernière de la date de la deuxième réunion du comité d’entreprise. Il lui transmet également les modifications éventuelles du projet de licenciement à l’issue de la deuxième et de la troisième réunion. |
1° Les mots : « le mentionne dans la notification du projet de licenciement faite à » sont remplacés par les mots : « en informe » ; 2° La deuxième phrase est supprimée ; 3° Après le mot : « également », sont insérés les mots : « son rapport et » ; 4° Les mots : « à l’issue de la deuxième et de la troisième réunion » sont supprimés. |
|
Première partie Les relations individuelles de travail Livre II Le contrat de travail Titre III Rupture du contrat de travail à durée indéterminée Chapitre III Licenciement pour motif économique Section 4 Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours Sous-section 4 Information et intervention de l’autorité administrative Paragraphe 2 Intervention de l’autorité administrative |
XVIII. – L’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code est complété par les mots : « concernant les entreprises non soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi ». |
|
Art. L. 1233-52. – En l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi au sens de l’article L. 1233-61, alors que l’entreprise est soumise à cette obligation, l’autorité administrative constate et notifie cette carence à l’entreprise dès qu’elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification du projet de licenciement prévue à l’article L. 1233-46. |
XIX. – L’article L. 1233-52 du même code est abrogé. |
|
XX. – Le premier alinéa de l’article L. 1233-53 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : |
||
Art. L. 1233-53. – L’autorité administrative vérifie que : |
« Dans les entreprises de moins de cinquante salariés et les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l’autorité administrative vérifie, dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification du projet de licenciement, que : ». |
|
Art. L. 1233-54. – L’autorité administrative dispose, pour procéder aux vérifications et adresser son avis, d’un délai courant à compter de la date de notification du projet de licenciement de : |
XXI. – Les articles L. 1233-54 et L. 1233-55 du même code sont abrogés. |
|
1° Vingt-et-un jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ; |
||
2° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ; |
||
3° Trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante. |
||
Lorsqu’il existe une convention ou un accord collectif de travail, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel séparant les deux réunions de représentants du personnel, prévu à l’article L. 1233-30, augmenté de sept jours. |
||
Art. L. 1233-55. – Lorsque le comité d’entreprise recourt à l’assistance d’un expert-comptable, le délai accordé à l’autorité administrative pour effectuer les vérifications et adresser son avis court à compter du lendemain de la deuxième réunion du comité d’entreprise. Il expire au plus tard quatre jours avant l’expiration du délai d’envoi des lettres de licenciement mentionné à l’article L. 1233-39. |
||
Art. L. 1233-56. – Lorsque l’autorité administrative relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications qu’elle effectue, elle adresse à l’employeur un avis précisant la nature de l’irrégularité constatée. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. |
XXII. – À l’article L. 1233-56 du même code, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : |
|
« L’autorité administrative peut formuler des observations sur les mesures sociales prévues par l’article L. 1233-32. » |
||
L’employeur répond aux observations de l’autorité administrative et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si cette réponse intervient après le délai d’envoi des lettres de licenciement prévu à l’article L. 1233-39, celui-ci est reporté jusqu’à la date d’envoi de la réponse à l’autorité administrative. Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées aux salariés qu’à compter de cette date. |
||
XXIII. – Après l’article L. 1233-56 du même code, il est créé un paragraphe 3 ainsi intitulé : |
||
« Paragraphe 3 |
||
« Intervention de l’autorité administrative concernant les entreprises soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi ». |
||
Art. L. 1233-57. – L’autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l’emploi, en tenant compte de la situation économique de l’entreprise. |
XXIV. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1233-57 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d’entreprise. Elles sont communiquées à l’employeur et au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. |
« L’employeur adresse une réponse motivée à l’autorité administrative. » |
|
En l’absence de représentants du personnel, ces propositions ainsi que la réponse motivée de l’employeur à celles-ci, qu’il adresse à l’autorité administrative, sont portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail. |
||
XXV. – Après l’article L. 1233-57 du même code, sont insérés les articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-8 ainsi rédigés : |
||
« Art. L. 1233-57-1. – L’accord collectif majoritaire mentionné à l’article L. 1233-24-1 ou le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4 sont transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord ou homologation du document. |
||
« Art. L. 1233-57-2. – L’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 dès lors qu’elle s’est assurée : |
||
« 1° De sa conformité aux dispositions des articles L. 1233-24-1, L. 1233-24-2 et L. 1233-24-3 ; |
||
« 2° De la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise ; |
||
« 3° De la présence dans le plan de sauvegarde de l’emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63. |
||
« Art. L. 1233-57-3. – En l’abs-ence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise, et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : |
||
« 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; |
||
« 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ; |
||
« 3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. |
||
« Elle s’assure que l’employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l’article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l’article L. 1233-71. |
||
« Art. L. 1233-57-4. – L’autorité administrative notifie à l’employeur la décision de validation dans un délai de huit jours à compter de la réception de l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 et la décision d’homo-logation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4. |
||
« Elle la notifie dans les mêmes délais au comité d’entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l’autorité administrative est motivée. |
||
« Le silence gardé par l’autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa vaut décision d’acceptation de validation ou d’homologation. Dans ce cas, l’employeur transmet une copie de la demande de validation ou d’homologation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité d’entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. |
||
« La décision de validation ou d’homologation ou, à défaut, les documents mentionnés au deuxième alinéa, sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail. |
« La … … alinéa et les voies et délais de recours sont portés … … travail. Amendement AS 283 | |
« Art. L. 1233-57-5. – Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d’homologation, à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de fournir les éléments d’information souhaités relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif, est adressée à l’autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours. |
||
« Art. L. 1233-57-6. – L’admi-nistration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l’employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues par l’article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, lorsque la négociation d’un accord est engagée, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. |
||
« L’employeur répond à ces observations et adresse copie de sa réponse aux représentant du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales. |
||
« Art. L. 1233-57-7. – En cas de décision de refus de validation ou d’homologation, l’employeur, s’il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande de validation ou d’homologation après y avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le comité d’entreprise. |
||
« Art. L. 1233-57-8. – L’autorité administrative compétente pour prendre la décision d’homologation ou de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-1 est celle du lieu où l’entreprise ou l’établissement concerné par le projet de licenciement collectif est établi. Si le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence d’autorités différentes, le ministre chargé de l’emploi désigne l’autorité compétente. » |
||
XXVI. – L’article L. 1233-58 du même code est ainsi modifié : |
||
Art. L. 1233-58. – En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, réunit et consulte le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l’article L. 2323-15 ainsi qu’aux articles : |
1° Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ; 2° Au premier alinéa, les mots : « réunit et consulte le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l’article L. 2323-15 ainsi qu’aux articles : » sont remplacés par les mots : « met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 » ; |
|
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
||
« L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l’article L. 2323-15 ainsi qu’aux articles : » ; |
||
1° L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ; |
||
2° L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ; |
||
3° L. 1233-30, premier, deuxième et huitième alinéas, pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés ; |
4° Au 3°, les mots : « premier, deuxième et huitième alinéas » sont remplacés par les mots : « I et huitième alinéa du II » ; |
|
4° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l’autorité administrative ; |
||
5° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l’emploi. |
||
5° Après le 5°, il est ajouté six alinéas ainsi rédigés : |
||
« 6° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6 pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés. |
||
« II. – Pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l’article L. 1233-24-4, élaboré par l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées par les articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1233-57-4et l’article L. 1233-57-7. |
||
« Les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise, à huit jours en cas de redressement judiciaire et quatre jours en cas de liquidation judiciaire. |
||
« L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d’irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable d’homologation ou de validation, ou l’expiration des délais mentionnés au dixième alinéa. |
||
« En cas de décision défavorable de validation ou d’homologation, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur consulte le comité d’entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l’avis du comité d’entreprise, ou un avenant à l’accord collectif, sont transmis à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours. |
||
« En cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L’article L. 1235-16 ne s’applique pas. » |
||
Art. L. 3253-8. – L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre : |
XXVII. – L’article L. 3253-8 du même code est ainsi modifié : |
|
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; |
||
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : |
||
a) Pendant la période d’observation ; |
||
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; |
||
|
c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; |
1° Au c et au d du 2°, après les mots : « Dans les quinze jours », sont ajoutés les mots : « , ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être élaboré » ; |
|
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours suivant la fin de ce maintien de l’activité ; |
||
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; |
||
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé : |
||
« 4° L’assurance prévue à l’article L. 3253-6 couvre les mesures d’accom-pagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux dispositions des articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou liquidation judiciaire » ; |
||
4° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : |
||
a) Au cours de la période d’observation ; |
||
|
b) Au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ; |
3° Le 4° devient le 5° et aux b et d, après les mots : « quinze jours », sont ajoutés les mots : « , ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être élaboré » ; |
|
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ; |
||
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours suivant la fin de ce maintien de l’activité. |
||
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 4° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi. |
4° Au dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ». |
|
XXVIII. – L’article L. 3253-13 du même code est ainsi modifié : |
||
Art. L. 3253-13. – L’assurance prévue à l’article L. 3253-6 ne couvre pas les sommes qui concourent à l’indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, en application d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou de groupe ou d’une décision unilatérale de l’employeur, lorsque l’accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. |
1° Après les mots : « ou de groupe », sont insérés les mots : « , d’un accord collectif validé » ; |
|
2° Après les mots : « décision unilatérale de l’employeur », sont ajoutés les mots : « homologuée conformément à l’article L. 1233-57-3 » ; |
||
3° Après les mots : « de redressement ou de liquidation judiciaire », sont ajoutés les mots : « , ou l’accord conclu ou la décision notifiée postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ». |
||
Code de commerce |
XXIX. – Le code de commerce est ainsi modifié : |
|
1° Le second alinéa de l’article L. 631-17 est ainsi modifié : |
||
Art. L. 631-17. – Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d’observation, l’administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. |
||
Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l’administrateur consulte le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l’article L. 321-9 du code du travail et informe l’autorité administrative compétente mentionnée à l’article L. 321-8 du même code. Il joint, à l’appui de la demande qu’il adresse au juge-commissaire, l’avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l’indemnisation et le reclassement des salariés. |
a) Les mots : « l’administrateur consulte le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l’article L. 321-9 du code du travail et informe l’autorité administrative compétente mentionnée à l’article L. 321-8 du même code » sont remplacés par les mots : « l’administrateur met en œuvre le plan de licenciement dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 du code du travail » ; |
|
b) Après les mots : « reclassement des salariés », sont insérés les mots : « ainsi que la décision de l’autorité administrative prévue à l’article L. 1233-57-4 du code du travail. » ; |
||
2° L’article L. 631-19 est ainsi modifié : |
||
Art. L. 631-19. – I. – Les dispositions du chapitre VI du titre II sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. |
||
Il incombe à l’administrateur, avec le concours du débiteur, d’élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux comités de créanciers les propositions prévues au premier alinéa de l’article L. 626-30-2. Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 626-8, l’information et la consultation portent sur les mesures que l’administrateur envisage de proposer. |
||
|
II. – Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu’après que le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l’article L. 321-9 du code du travail et que l’autorité administrative compétente mentionnée à l’article L. 321-8 du même code a été informée. |
a) La première phrase du premier alinéa du II est remplacée par la phrase suivante : « II. – Le plan est arrêté par le tribunal après que la procédure prévue à l’article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre par l’administrateur, à l’exception des alinéas huit, neuf, dix et onze de cet article. » ; |
|
Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification de l’administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail. |
b) Après la première phrase du deuxième alinéa du II, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans ce délai, l’autorité administrative valide ou homologue le projet de licenciement dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du code du travail. » ; |
|
Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d’une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d’un mois après le jugement est celui dans lequel l’intention de rompre doit être manifestée. |
||
Art. L. 641-4. – Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. |
||
Il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s’agissant d’une personne morale ou d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il n’y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l’article L. 651-2. |
||
Le liquidateur exerce les missions dévolues à l’administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 624-17, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. |
||
Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l’activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail. |
3° Au dernier alinéa de l’article L. 641-4, les mots : « des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 1233-58 du code du travail » ; |
|
4° Le cinquième alinéa de l’article L. 642-5 est ainsi modifié : |
||
Art. L. 642-5. – Après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’en-semble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession. |
||
Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’un débiteur dont le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. |
||
Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous. |
||
Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l’urbanisme ne peuvent s’exercer sur un bien compris dans ce plan. |
||
Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu’après que le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l’article L. 321-9 du code du travail et l’autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l’article L. 321-8 du même code. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification du liquidateur, ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. |
a) Les mots : « le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l’article L. 321-9 du code du travail et l’autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l’article L. 321-8 du même code » sont remplacés par les mots : « la procédure prévue à l’article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre, à l’exception des alinéas huit, neuf, dix et onze de cet article » ; |
|
b) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans ce délai, l’autorité administrative valide ou homologue le projet de licenciement dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du code du travail ». |
||
Code du travail |
||
XXX. – L’article L. 1233-63 du code du travail est ainsi modifié : |
||
Art. L. 1233-63. – Le plan de sauvegarde de l’emploi détermine les modalités de suivi de la mise en œuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l’article L. 1233-61. |
||
Ce suivi fait l’objet d’une consultation régulière et détaillée du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots suivants : « dont les avis sont transmis à l’autorité administrative » ; |
|
L’autorité administrative est associée au suivi de ces mesures. |
2° Le dernier alinéa est complété par les mots suivants : « et reçoit un bilan, établi par l’employeur, de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l’emploi ». |
|
Première partie : Les relations individuelles de travail Livre II Le contrat de travail Titre III Rupture du contrat de travail à durée indéterminée Chapitre V Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement Section 2 Licenciement pour motif économique Sous-section 1 Délais de contestation |
XXXI. – L’intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre III du livre II de la première partie du même code est remplacé par l’intitulé suivant : « Sous-section 1 « Délais de contestation et voies de |
|
Art. L. 1235-7. – Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel est introduite, à peine d’irrecevabilité, dans un délai de quinze jours suivant chacune des réunions du comité d’entreprise. |
XXXII. – Le premier alinéa de l’article L. 1235-7 du même code est supprimé. |
|
Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement. |
||
XXXIII. – Après l’article L. 1235-7 du même code, il est inséré un article L. 1235-7-1 ainsi rédigé : |
||
« Art. L. 1235-7-1. – L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4. |
||
« Ces litiges relèvent de la compétence en premier ressort du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. |
||
« Le recours doit être présenté dans un délai de deux mois par l’employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d’homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément aux dispositions de l’article L. 1233-57-4. |
||
« Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si à l’issue de ce délai, il ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour administrative d’appel qui statue dans un délai de trois mois. Si à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d’État. |
||
« Les dispositions du livre V du code de justice administrative sont applicables. » |
||
XXXIV. – L’article L. 1235-10 du même code est ainsi modifié : |
||
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : |
||
Art. L. 1235-10. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l’article L. 1233-61 et s’intégrant au plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. |
« Art. L. 1235-10. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue est nul. |
|
La validité du plan de sauvegarde de l’emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou l’unité économique et sociale ou le groupe. |
« En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une absence ou d’une insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle. » ; |
|
|
Le premier alinéa n’est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires. |
2° Au dernier alinéa, les mots : « le premier alinéa n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables ». |
|
Art. L. 1235-11. – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l’établissement ou du site ou de l’absence d’emploi disponible. |
XXXV. – À l’article L. 1235-11 du même code, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas ». |
|
Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. |
||
XXXVI. – Il est rétabli un article L. 1235-16 du même code ainsi rédigé : |
||
« Art. L. 1235-16. – L’annulation de la décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l’accord des parties, à la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. |
||
« À défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. » |
||
Art. L. 2323-15. – Le comité d’entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. |
||
Il émet un avis sur l’opération projetée et ses modalités d’application. |
XXXVII. – À l’article L. 2323-15 du même code, après les mots : « modalités d’application », sont introduits les mots : « dans les conditions et délais prévus à l’article L. 1233-30, lorsqu’elle est soumise à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi ». |
|
Cet avis est transmis à l’autorité administrative. |
||
XXXVIII. – L’article L. 2325-35 du même code est ainsi modifié : |
||
Art. L. 2325-35. – Le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix : |
1° Au début de l’article, il est inséré un « I. » ; |
|
1° En vue de l’examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ; |
||
2° En vue de l’examen des documents mentionnés à l’article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ; |
||
3° Dans les conditions prévues à l’article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ; |
||
4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l’exercice du droit d’alerte économique ; |
||
5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l’article L. 1233-30, est mise en oeuvre. |
||
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
||
« II. – Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l’expert est le même que celui désigné en application du 5° du I. » |
||
XXXIX. – Après l’article L. 4614-12 du même code, sont insérés les articles L. 4614-12-1 et L. 4614-12-2 ainsi rédigés : |
||
« Art. L. 4614-12-1. – L’expert désigné par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou par l’instance de coordination prévue à l’article L. 4616-1 dans le cadre d’une consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l’article L. 2323-15 demande à l’employeur, au plus tard dans les vingt et un jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu’il juge nécessaire à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les quinze jours. |
||
« L’expert présente son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 1233-30 du code du travail. |
||
« L’avis du comité ou, le cas échéant, de l’instance de coordination est rendu avant la fin du délai prévu à l’article L. 1233-30. À l’expiration de ce délai, ils sont réputés avoir été consultés. |
« L’avis du comité et, le cas échéant, … … consultés. Amendement AS 287 | |
« Art. L. 4614-12-2. – Lorsque l’instance de coordination prévue à l’article L. 4616-1 est saisie sur un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l’article L. 2323-15, elle peut recourir à un expert, qui remet son rapport dans les délais prévus par l’article L. 1233-35. |
Alinéa supprimé Amendement AS 288 | |
« L’instance de coordination rend son avis avant la fin du délai prévu à l’article L. 1233-30. » |
Alinéa supprimé Amendement AS 288 | |
XL. – Les dispositions du code du travail et du code de commerce dans leur rédaction issue du présent article sont applicables aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er juillet 2013. |
||
Pour l’application de l’alinéa précédent, une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date d’envoi de la convocation à la première réunion du comité d’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-30. |
||
Article 14 |
||
Première partie Les relations individuelles de travail Livre II Le contrat de travail Titre III Rupture du contrat de travail à durée indéterminée Chapitre III Licenciement pour motif économique Section 6 Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement Sous-section 5 Revitalisation des bassins d’emploi |
I. – L’intitulé de la sous-section 5 de la section VI du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est remplacé par l’intitulé suivant : « Sous-section 5 - Reprise de site et revitalisation des bassins d’emploi ». |
|
II. – Cette sous-section est complétée par l’article L. 1233-90-1 ainsi rédigé : |
||
« Art. L. 1233-90-1. – Lorsqu’elle envisage un projet de licenciement collectif ayant pour conséquence la fermeture d’un établissement, l’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-71 recherche un repreneur et en informe le comité d’entreprise dès l’ouverture de la procédure d’information et consultation prévue à l’article L. 1233-30. |
||
« Le comité d’entreprise peut recourir à l’assistance de l’expert-comptable désigné le cas échéant en application de l’article L. 1233-34 pour analyser le processus de recherche d’un repreneur, sa méthodologie et son champ, pour apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels et pour analyser les projets de reprise. |
||
« Le comité d’entreprise est informé des offres de reprise formalisées. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles. Le comité d’entreprise peut émettre un avis. |
« Le … … avis et formuler des propositions. Amendement AS 289 | |
« Cet avis est rendu dans les délais prévus à l’article L. 1233-30. |
||
« Les actions engagées par l’employeur au titre de l’obligation de recherche d’un repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l’entreprise et l’autorité administrative en application des articles L. 1233-84 et suivants. » |
||
Art. L. 2325-37. – Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes. |
||
Lorsqu’il est saisi dans le cadre d’une opération de concentration prévue à l’article L. 2323-20, l’expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l’opération. |
III. – À l’article L. 2325-37 du même code, après les mots : « à l’article L. 2323–20 », sont insérés les mots : « ou dans une opération de recherche de repreneurs prévue à l’article L. 1233-90-1 ». |
|
IV. – Les dispositions du code du travail dans leur rédaction issue du présent article sont applicables aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er juillet 2013. |
||
Pour l’application de l’alinéa précédent, une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date d’envoi de la convocation à la première réunion du comité d’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-30. |
||
Article 15 |
Article 15 | |
I. – L’article L. 1233-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Sans modification | |
Art. L. 1233-5. – Lorsque l’em-ployeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
||
Ces critères prennent notamment en compte : |
||
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; |
||
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ; |
||
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; |
||
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. |
||
« L’employeur peut privilégier un de ces critères, en particulier celui des qualités professionnelles, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus par le présent article. » |
||
Art. L. 1233-71. – Dans les entreprises ou les établissements d’au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l’article L. 2331-1 et celles mentionnées à l’article L. 2341-4, dès lors qu’elles emploient au total au moins mille salariés, l’employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d’actions de formation et des prestations d’une cellule d’accom-pagnement des démarches de recherche d’emploi. |
||
La durée du congé de reclassement ne peut excéder neuf mois. |
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1233-71 du même code, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze ». |
|
Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement. Celles-ci sont mises en oeuvre pendant la période prévue au premier alinéa. |
||
L’employeur finance l’ensemble de ces actions. |
||
III. – L’article L. 1233-72-1 du même code est ainsi modifié : |
||
Art. L. 1233-72-1. – Le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l’exception des particuliers, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée tels que prévus à l’article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l’article L. 1243-13, ou de contrats de travail temporaire tels que prévus à l’article L. 1251-7. Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend, sans excéder son terme initial. |
1° Les mots : « sans excéder son terme initial » sont supprimés ; |
|
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : |
||
« L’employeur peut prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées. » |
||
Chapitre IV |
Chapitre IV | |
Dispositions diverses |
Dispositions diverses | |
Article 16 |
Article 16 | |
I. – L’article L. 1235-1 du code du travail est ainsi modifié : |
Sans modification | |
1° Il est inséré, avant le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés : |
||
« En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1 l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé sur le fondement d’un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié. |
||
« Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues par le présent chapitre. » ; |
||
|
Art. L. 1235-1. – En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. |
2° Au premier alinéa, qui devient le troisième, les mots : « En cas de litige », sont remplacés par les mots : « À défaut d’accord » ; |
|
3° Après le premier alinéa, qui devient le troisième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
||
« Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. » |
||
Si un doute subsiste, il profite au salarié. |
||
Code général des impôts |
||
Art. 80 duodecies. – 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. |
||
Ne constituent pas une rémunération imposable : |
||
|
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; |
II. – Au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, après les mots : « aux articles », sont ajoutés les mots : « L. 1235-1, ». |
|
…………………………………………. |
||
Code du travail Première partie Les relations individuelles de travail Livre IV La résolution des litiges – Le conseil de prud’hommes |
III. – Le livre IV de la première partie du code du travail est complété par un titre VII ainsi rédigé : |
|
« Titre VII |
||
« Prescriptions des actions en justice |
||
« Chapitre unique |
||
« Art. L. 1471-1. – Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. |
||
« Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées sur le fondement des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font pas obstacle aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14. » |
||
Art. L. 3245-1. – L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil. |
IV. – À l’article L. 3245-1 du même code, les mots : « se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil » sont remplacés par les mots : « se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». |
|
V. – Les dispositions du code du travail prévues par les III et IV s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. |
||
Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation. |
||
Article 17 |
Article 17 | |
I. – L’article L. 2314-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
||
Art. L. 2314-2. – L’employeur informe tous les quatre ans le personnel par affichage de l’organisation des élections. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant le jour de l’affichage, sous réserve qu’une périodicité différente n’ait pas été fixée par accord en application de l’article L. 2314-27. |
||
« Lorsque l’organisation de l’élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l’article L. 2312-2, le premier tour doit se tenir dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de l’affichage. » |
||
II. – L’article L. 2322-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
||
Art. L. 2322-2. – La mise en place d’un comité d’entreprise n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. |
||
« L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer aux obligations récurrentes d’information et de consultation du comité d’entreprise prévues par le présent code, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d’État. » |
« L’employeur … … conformer complètement aux obligations … … d’État. ». Amendement AS 290 | |
III. – L’article L. 2324-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
||
Art. L. 2324-3. – L’élection des représentants du personnel au comité d’entreprise et celle des délégués du personnel ont lieu à la même date. |
||
L’employeur informe le personnel tous les quatre ans par affichage de l’organisation des élections. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant l’affichage, sous réserve qu’une périodicité différente n’ait pas été fixée par accord en application de l’article L. 2314-27. |
||
« Lorsque l’organisation de l’élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l’article L. 2322-2, le premier tour doit se tenir dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de l’affichage. » |
||
Article 18 |
Article 18 | |
Par dérogation à l’article L. 3123-31 du code du travail et à titre expérimental, dans les entreprises occupant moins de 50 salariés dans les secteurs déterminés par arrêté du ministre chargé du travail, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus jusqu’au 31 décembre 2014 en l’absence de convention ou d’accord collectif, après information des délégués du personnel, pour pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. |
Par … … entreprises employant moins de cinquante salariés dans les secteurs des organismes de formation, à l’exclusion des formateurs en langues, du commerce des articles de sport et des équipements de loisirs, et des détaillants et détaillants- fabricants de confiserie, chocolaterie, biscuiterie, des contrats … … travaillées. Amendements AS 318 et AS 316 | |
Le contrat indique que la rémunération versée mensuellement au salarié est indépendante de l’horaire réel effectué et est lissée sur l’année. Les dispositions des articles L. 3123-33, L. 3123-34 et L. 3123-36 du même code lui sont applicables. |
||
Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expé-rimentation avant le 31 décembre 2014. |
Le Gouvernement remet au Parlement … … 2014. Amendement AS 319 | |
Article 19 |
Article 19 | |
I. – Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à modifier par ordonnance le code du travail applicable à Mayotte, le code de commerce et le régime de protection sociale complémentaire en vigueur localement afin d’y rendre applicables et d’y adapter les dispositions de la présente loi. |
Sans modification | |
II. – Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication. |
||
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
Amendement AS 2 présenté par M. Jean-Pierre Door, Mme Valérie Boyer, MM. Xavier Breton, Olivier Carré, Jean-Pierre Decool, Mme Marianne Dubois, M. Bernard Gérard, Mme Arlette Grosskost, MM. Christian Kert, Alain Marty, Bernard Perrut, Mme Bérengère Poletti, MM. Frédéric Reiss, Arnaud Robinet, Mme Sophie Rohfritsch, MM. Fernand Siré, Éric Straumann, Lionel Tardy, Dominique Tian, Jean-Pierre Vigier et Mme Marie-Jo Zimmermann
Article 1er
I.– Après l’alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :
« Art L. 911-7-1. – Par dérogation au I de l’article 1er de la loi n° .... du …. relative à la sécurisation de l’emploi, les entreprises dont les effectifs sont compris entre un et neuf salariés participent de manière forfaitaire au financement des couvertures complémentaires en matière de remboursement ou d’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident auxquelles leurs salariés souscrivent dans des conditions déterminées par décret.
II. – « Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
1° bis L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, la participation des employeurs mentionnées à l’article L. 9111-7-1 du code du travail ».
Amendement AS 3 présenté par M. Jean-Charles Taugourdeau
Article 1er
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Les modalités de choix de l’assureur s’effectuent, dans le respect du dialogue social, au niveau de chaque entreprise. ».
Amendement AS 4 présenté par M. Jean-Charles Taugourdeau
Article 1er
À l’alinéa 18, substituer aux mots : « au minimum la moitié du », les mots « , selon les possibilités financières de l’entreprise et après un échange avec les représentants syndicaux, le ».
Amendement AS 5 présenté par M. Jean-Charles Taugourdeau
Article 3
À l’alinéa 4, supprimer les mots : « de trois cents salariés et plus ».
Amendement AS 6 présenté par M. Jean-Charles Taugourdeau
Article 3
À l’alinéa 4, substituer aux mots : « et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 de trois cents salariés et plus », les mots : « d’au moins 20 salariés et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 ».
Amendement AS 7 présenté par M. Jean-Charles Taugourdeau
Article 3
À l’alinéa 4, substituer aux mots : « et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 de trois cents salariés et plus », les mots : « d’au moins 50 salariés et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 ».
Amendement AS 8 présenté par M. Jean-Charles Taugourdeau
Article 3
À l’alinéa 4, substituer aux mots : « et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 de trois cents salariés et plus », les mots : « d’au moins 150 salariés et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 ».
Amendement AS 9 présenté par M. Jean-Charles Taugourdeau
Article 3
À l’alinéa 4, substituer aux mots : « et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 de trois cents salariés et plus », les mots : « d’au moins 150 salariés et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 ».
Amendement AS 10 présenté par M. Jean-Charles Taugourdeau
Article 3
À l’alinéa 4, substituer aux mots : « et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 de trois cents salariés et plus », les mots « d’au moins 200 salariés et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 »
Amendement AS 11 présenté par M. Jean-Charles Taugourdeau
Article 5
Après le mot : « présentés », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :
« librement dès le premier tour. ».
Amendement AS 12 présenté par M. Jean-Charles Taugourdeau
Article 8
Compléter l’alinéa 9 par les mots : « , ainsi qu’aux salariés des groupements d’employeurs mentionnés à l’article L. 1253-1 du code du travail ».
Amendement AS 26 présenté par Mme Valérie Boyer
Article 7
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – L’article L. 1242-3 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Avec des salariés ayant liquidé leurs droits à la retraite, dans le cadre du dispositif de cumul emploi-retraite prévu à l’article L.161-22 du code de la sécurité sociale. »
« III. – Après l’article L. 1242-9 du code du travail, est inséré un article L. 1242-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1242-9-1. – Les contrats conclus dans les cas visés au 3° de l’article L. 1242-3 sont conclus pour une durée minimale de six mois et maximale d’un an. Ils sont renouvelables cinq fois dans la limite de cinq ans. ».
Amendement AS 27 présenté par Mme Valérie Boyer
Article 8
I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« VI bis. – Au 1° de l’article L. 3123-14 du même code, après le mot : « domicile », sont insérés les mots : « , les salariés des associations et entreprises de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale ». ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3123-22, après le mot : « domicile », sont insérés les mots : « et les associations et entreprises de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale » ».
Amendement AS 28 présenté par M. Guillaume Larrivé
Article 1er
Supprimer l’alinéa 4
Amendement AS 29 présenté par M. Guillaume Larrivé
Article 8
Compléter l’alinéa 9 par les mots : « ainsi qu’aux salariés affectés à des tâches de portage de presse ».
Amendement AS 30 présenté par Mme Bérengère Poletti, MM. Arnaud Robinet, Patrick Hetzel, Dominique Tian, Marc Le Fur, Christian Kert, Eric Straumann, Nicolas Dhuicq, Thierry Lazaro, Philippe-Armand Martin, Fernand Siré, Mmes Arlette Grosskost, Valérie Boyer, M. Martial Saddier, Mmes Geneviève Levy, Marie-Louise Fort, Marie-Jo Zimmermann, M. Paul Salen, Mme Josette Pons, MM. Jacques Lamblin, Yves Foulon, Dino Cinieri, Jean-Pierre Vigier, Jean-Marie Sermier, Jean-Pierre Decool, Alain Marty, Jean-Claude Mathis, Jean-Luc Reitzer, Mme Valérie Lacroute et M. Lionel Tardy
Article 8
À l’alinéa 9, après le mot : « applicable », insérer les mots : « aux salariés affectés à des tâches de portage de presse
Amendement AS 31 présenté par Mme Bérengère Poletti, MM. Arnaud Robinet, Patrick Hetzel, Dominique Tian, Marc Le Fur, Eric Straumann, Nicolas Dhuicq, Thierry Lazaro, Philippe-Armand Martin, Fernand Siré, Mmes Arlette Grosskost, Valérie Boyer, M. Martial Saddier, Mmes Geneviève Levy, Marie-Louise Fort, Marie-Jo Zimmermann, M. Paul Salen, Mme Josette Pons, MM. Jacques Lamblin, Yves Foulon, Dino Cinieri, Jean-Pierre Vigier, Jean-Marie Sermier, Jean-Pierre Decool, Alain Marty, Jean-Claude Mathis, Jean-Luc Reitzer, Mme Valérie Lacroute et M. Lionel Tardy
Article 8
À l’alinéa 9, après le mot : « applicable », insérer les mots : « aux salariés des associations et entreprises d’aide à domicile, ainsi qu’ ».
Amendement AS 32 présenté par M. Dominique Tian et Mme Valérie Boyer
Article 1er
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 4 :
« Dans le cadre de cette négociation, et par dérogation à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises conservent la liberté de retenir le ou les organismes assureurs de leur choix ; ».
Amendement AS 33 présenté par M. Dominique Tian et Mme Valérie Boyer
Article 1er
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les entreprises disposant à la date de la signature de l’accord de branche, ou au terme d’une période transitoire de dix-huit mois après cette date, d’une couverture au moins équivalente à celle que l’accord prévoit, ne peuvent être contraintes de rejoindre l’organisme désigné ; »
Amendement AS 34 présenté par M. Dominique Tian et Mme Valérie Boyer
Article 1er
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« En cas de désignation d’un organisme assureur, les entreprises disposent d’un délai de dix- huit mois après la date de la signature de l’accord pour mettre en place ou, le cas échéant, mettre en conformité un régime avec une couverture au moins équivalente à celle prévue par l’accord, auprès de l’organisme assureur de leur choix. Au-delà, elles sont tenues de rejoindre l’organisme désigné ; ».
Amendement AS 35 présenté par M. Dominique Tian et Mme Valérie Boyer
Article 1er
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« En cas de désignation d’un organisme assureur, les entreprises exemptées de l’obligation de rejoindre ce dernier peuvent conserver cette exemption en cas de changement d’organisme assureur à condition de disposer d’un régime au moins aussi favorable que celui défini par l’accord de branche ; ».
Amendement AS 36 présenté par M. Dominique Tian et Mme Valérie Boyer
Article 1er
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« En cas de désignation d’un organisme assureur, les entreprises en création disposent d’un délai de dix-huit mois pour se mettre en conformité auprès de l’organisme assureur de leur choix ; ».
Amendement AS 37 présenté par M. Dominique Tian et Mme Valérie Boyer
Article 1er
Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :
« Cette mise en concurrence est également effectuée lors de chaque réexamen. ».
Amendement AS 38 présenté par M. Dominique Tian et Mme Valérie Boyer
Article 1er
Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° L’article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la convention ou le contrat est souscrit dans le cadre d’une désignation ou d’une recommandation d’un organisme d’assurance conformément à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article comprend également le détail des sommes versées directement ou indirectement par l’organisme d’assurance aux organisations syndicales de la branche concernée et à leurs confédérations nationales, ainsi qu’aux sociétés qu’elles contrôlent. Un décret détermine les modalités d’application de la présente disposition. » ».
Amendement AS 39 présenté par M. Dominique Tian et Mme Valérie Boyer
Article 1er
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – L’article L. 2135-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les comptes des confédérations doivent être consolidés avec ceux de leurs unions départementales, de leurs unions régionales, de leurs fédérations professionnelles et de leurs syndicats de branche et une nomenclature comptable commune doit être établie par décret. » ».
Amendement AS 40 présenté par Mme Bérengère Poletti, MM. Arnaud Robinet, Patrick Hetzel, Dominique Tian, Marc Le Fur, Eric Straumann, Nicolas Dhuicq, Thierry Lazaro, Philippe-Armand Martin, Fernand Siré, Mme Arlette Grosskost, M. Martial Saddier, Mmes Geneviève Levy, Marie-Louise Fort, Marie-Jo Zimmermann, M. Paul Salen, Mme Josette Pons, MM. Jacques Lamblin, Yves Foulon, Dino Cinieri, Jean-Pierre Vigier, Jean-Marie Sermier, Jean-Pierre Decool, Alain Marty, Jean-Claude Mathis, Jean-Luc Reitzer, Mme Valérie Lacroute et M. Lionel Tardy
Article 7
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – L’article L. 1242-3 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Avec des salariés ayant liquidé leurs droits à la retraite, dans le cadre du dispositif de cumul emploi-retraite prévu à l’article L.161-22 du code de la sécurité sociale. »
« III. – Après l’article L. 1242-9 du code du travail, il est inséré un article L. 1242-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L.1242-9-1. – Les contrats conclus dans les cas visés au 3° de l’article L. 1242-3 sont conclus pour une durée minimale de six mois et maximale d’un an. Ils sont renouvelables cinq fois dans la limite de cinq ans. » ».
Amendement AS 41 présenté par Mme Bérengère Poletti, MM. Arnaud Robinet, Patrick Hetzel, Dominique Tian, Marc Le Fur, Eric Straumann, Nicolas Dhuicq, Thierry Lazaro, Philippe-Armand Martin, Fernand Siré, Patrice Verchere, Mme Arlette Grosskost, M. Martial Saddier, Mmes Geneviève Levy, Marie-Louise Fort, Marie-Jo Zimmermann, M. Paul Salen, Mme Josette Pons, MM. Jacques Lamblin, Yves Foulon, Dino Cinieri, Jean-Pierre Vigier, Jean-Marie Sermier, Jean-Pierre Decool, Alain Marty, Jean-Claude Mathis, Jean-Luc Reitzer, Mme Valérie Lacroute et M. Lionel Tardy
Article 8
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Les conventions collectives ou accords de branche étendus contenant déjà des dispositions sur la durée minimale au 1er janvier 2014 ne sont pas visés par les dispositions de l’article L. 3123-14-1. »
Amendement AS 42 présenté par Mme Bérengère Poletti, MM. Arnaud Robinet, Patrick Hetzel, Dominique Tian, Marc Le Fur, Eric Straumann, Nicolas Dhuicq, Thierry Lazaro, Philippe-Armand Martin, Fernand Siré, Patrice Verchere, Mme Arlette Grosskost, M. Martial Saddier, Mmes Geneviève Levy, Marie-Louise Fort, Marie-Jo Zimmermann, M. Paul Salen, Mme Josette Pons, MM. Jacques Lamblin, Yves Foulon, Dino Cinieri, Jean-Pierre Vigier, Jean-Marie Sermier, Jean-Pierre Decool, Alain Marty, Jean-Claude Mathis, Jean-Luc Reitzer, Mme Valérie Lacroute et M. Lionel Tardy
Article 8
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 29, substituer à l’année : « 2014 », l’année : « 2015 ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer à l’année : « 2016 », l’année : « 2017 ».
Amendement AS 43 présenté par Mme Bérengère Poletti, MM. Arnaud Robinet, Patrick Hetzel, Dominique Tian, Marc Le Fur, Eric Straumann, Nicolas Dhuicq, Thierry Lazaro, Philippe-Armand Martin, Fernand Siré, Patrice Verchere, Mme Arlette Grosskost, M. Martial Saddier, Mmes Geneviève Levy, Marie-Louise Fort, Marie-Jo Zimmermann, M. Paul Salen, Mme Josette Pons, MM. Jacques Lamblin, Yves Foulon, Dino Cinieri, Jean-Pierre Vigier, Jean-Marie Sermier, Jean-Pierre Decool, Alain Marty, Jean-Claude Mathis, Jean-Luc Reitzer, Mme Valérie Lacroute et M. Lionel Tardy
Article 8
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : « aux articles L. 3123-14-2 et », les mots : « à l’article ».
Amendement AS 44 présenté par Mme Bérengère Poletti, MM. Yves Censi et Jean-Charles Taugourdeau
Article 8
Compléter l’alinéa 9 par les mots : «, ainsi qu’aux salariés des collectivités territoriales, des groupements d’employeurs mentionnés à l’article L. 1253-1 et des structures d’insertion par l’activité économique mentionnés à l’article L. 5134-4, lorsqu’ils sont employés dans le cadre de contrats d’insertion spécifiques aux publics les plus fragilisés ».
Amendement AS 45 présenté par Mme Bérengère Poletti et M. Dominique Tian
Article 8
À l’alinéa 9, après le mot : « applicable », insérer les mots : « aux salariés de tous les secteurs dont la liste est fixée par décret et pour lesquels la règle des 24 heures hebdomadaires est reconnu impossible du fait de l’organisation de la semaine de travail, ou du fait qu’ils ont de multiples employeurs, ou du fait de besoins spécifiques pour de brèves périodes, ni ».
Amendement AS 46 présenté par Mme Bérengère Poletti et M. Dominique Tian
Article 8
À l’alinéa 9, après le mot : « applicable », insérer les mots : « aux salariés du secteur particuliers employeurs, ni ».
Amendement AS 47 présenté par Mme Bérengère Poletti et M. Dominique Tian
Article 1er
Compléter l’alinéa 17, par les deux phrases suivantes :
« Pour les salariés du secteur des services à la personne accomplissant moins de 24 heures de travail par semaine, le financement de l’employeur est établi sur une base horaire. Un décret détermine les modalités de calcul. ».
Amendement AS 48 présenté par Mme Bérengère Poletti et M. Dominique Tian
Article 8
Compléter l’alinéa 9 par les mots : « et aux salariés employés par les particuliers définis à l’article L. 7221-1 et par toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées à l’article D. 7231-1».
Amendement AS 49 présenté par MM. Francis Vercamer et Arnaud Richard
Article 1er
Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« 2° Les conditions d’assurance des garanties, chaque entreprise disposant de la liberté de retenir l’organisme assureur de son choix ;
« 2° bis Le cas échéant, la procédure de recommandation du ou des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques auxquels les entreprises peuvent adhérer. La procédure de recommandation doit garantir une concurrence préalable de ces organismes, dans les conditions de transparence et selon les modalités prévues par décret ; ».
Amendement AS 50 présenté par MM. Francis Vercamer et Arnaud Richard
Article 1er
I. – Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis. – Le premier alinéa de l’article L. 912-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le réexamen donne lieu, dans les conditions définies au présent article, à une nouvelle désignation ou recommandation d’un ou plusieurs des organismes visés ci-dessus. » »
II. – À l’alinéa 26, substituer aux mots : « préalable des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 », les mots : « préalablement à la désignation ou la recommandation ainsi que préalablement à chaque renouvellement de la désignation ou de la recommandation, ».
Amendement AS 51 présenté par MM. Francis Vercamer et Arnaud Richard
Article 1er
Après l’alinéa 34, insérer les quatre alinéas suivants :
« IV bis. – le code des assurances est ainsi modifié :
« Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 113-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la souscription d’un contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l’assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à sa résiliation. » ;
« 2° L’article L. 322-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises mentionnées à l’article L. 310-1 peuvent mettre en œuvre au profit de leurs assurés une action sociale qui, lorsqu’elle se traduit par l’exploitation de réalisations sociales collectives, doit être gérée par une ou plusieurs personnes morales distinctes de l’assureur. » ».
Amendement AS 52 présenté par MM. Francis Vercamer et Arnaud Richard
Article 1er
Compléter l’alinéa 6 par les mots : «, eu égard notamment à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail, ou bien au bénéfice acquis d’une couverture maladie complémentaire ».
Amendement AS 53 présenté par MM. Francis Vercamer et Arnaud Richard
Article 1er
Compléter l’alinéa 6 par les mots : « à l’initiative du salarié ».
Amendement AS 54 présenté par MM. Francis Vercamer et Arnaud Richard
Article 1er
À l’alinéa 26, après le mot : « transparence », insérer les mots : « , d’impartialité, et d’égalité de traitement entre les candidats, »
Amendement AS 55 présenté par MM. Francis Vercamer, Arnaud Richard et Hervé Morin
Article 2
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots : « visant prioritairement un objectif de qualification ».
Amendement AS 56 présenté par MM. Francis Vercamer et Arnaud Richard
Article 2
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot « local », insérer les mots : «, notamment par les maisons de l’emploi ou à défaut par les missions locales, les plans locaux pour l’insertion et l’emploi et l’ensemble des réseaux d’accompagnement socio-professionnel, »
Amendement AS 57 présenté par MM. Francis Vercamer et Arnaud Richard
Article 4
Compléter l’alinéa 4 par les mots : « et avoir rendu un avis négatif ».
Amendement AS 58 présenté par M. Francis Vercamer
Article 4
Supprimer les alinéas 43 à 57.
Amendement AS 59 présenté par MM. Francis Vercamer et Arnaud Richard
Article 4
Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :
« Cet accord détermine les modalités de mise à jour de la base de données, en particulier en termes de périodicité. ».
Amendement AS 60 présenté par MM. Francis Vercamer, Arnaud Richard et Hervé Morin
Article 4
À l’alinéa 28, substituer au mot « discrétion », le mot « confidentialité ».
Amendement AS 61 présenté par MM. Francis Vercamer et Arnaud Richard
Article 5
Après l’alinéa 90, insérer les deux alinéas suivants :
« VI bis. – Après le 12° de l’article L. 2411-1 du code du travail, est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis Représentant des salariés au conseil d’administration ou de surveillance des entreprises mentionnées aux articles L. 225-27-1, L. 225-79-2 et L. 226-4-2 du code de commerce ; »
Amendement AS 62 présenté par MM. Francis Vercamer et Arnaud Richard
Article 7
I. – Après le mot : « par », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« cinq alinéas ainsi rédigés : »
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Ils peuvent prévoir une exonération de contributions pour les particuliers employeurs, notamment :
« 1° Au contrat conclu par une personne physique pour un service rendu à son domicile ;
« 2° Au contrat conclu par une personne physique pour un emploi d’assistant maternel agréé. ».
Amendement AS 63 présenté par MM. Francis Vercamer et Arnaud Richard
Article 7
I. – Après le mot : « par », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 : « trois alinéas ainsi rédigés : »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ils peuvent prévoir une exonération de contributions pour les associations en charge de missions d’insertion. ».
Amendement AS 64 présenté par MM. Francis Vercamer, Arnaud Richard et Hervé Morin
Article 8
À la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot : « applicable », insérer les mots : « aux salariés du secteur d’activité des services à la personne et de l’aide à domicile et ».
Amendement AS 65 présenté par MM. Francis Vercamer, Arnaud Richard et Hervé Morin
Article 8
À la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot : « applicable », insérer les mots : « aux salariés des entreprises de moins de dix salariés et ».
Amendement AS 66 présenté par MM. Francis Vercamer, Arnaud Richard et Hervé Morin
Article 8
À la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot : « applicable », insérer les mots : « aux salariés des particuliers employeurs et ».
Amendement AS 67 présenté par MM. Francis Vercamer, Arnaud Richard et Hervé Morin
Article 8
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot : « applicable », insérer les mots : « aux associations en charge de missions d’insertion et ».
Amendement AS 68 présenté par MM. Francis Vercamer, Arnaud Richard et Hervé Morin
Article 8
À la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot : « applicable », insérer les mots : « aux salariés dont l’employeur est dans l’impossibilité de la mettre en œuvre compte tenu des caractéristiques de son activité et ».
Amendement AS 69 présenté par MM. Francis Vercamer, Arnaud Richard et Hervé Morin
Article 8
À la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot : « applicable », insérer les mots : « aux salariés des associations et entreprises de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale et ».
Amendement AS 70 présenté par MM. Francis Vercamer et Arnaud Richard
Article 8
À la seconde phrase de l’alinéa 29, supprimer le mot : « économique ».
Amendement AS 71 présenté par MM. Francis Vercamer et Arnaud Richard
Article 8
Compléter l’alinéa 10 par les deux phrases suivantes :
« Un salarié bénéficiant d’une durée du travail fixée dans le cadre des dispositions prévues au présent alinéa peut demander à bénéficier de la durée du travail prévue à l’article L. 3123-14-1. L’augmentation de la durée du travail est fixée dans le cadre d’un accord écrit entre l’employeur et le salarié. »
Amendement AS 72 présenté par MM. Francis Vercamer et Arnaud Richard
Article 10
À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot : « licenciement », les mots : « réduction d’effectifs ».
Amendement AS 73 présenté par MM. Francis Vercamer, Arnaud Richard et Hervé Morin
Article 10
Après la première occurrence du mot : « accord », rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 13 :
« conclu au titre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 à leur contrat de travail, leur licenciement repose sur un motif personnel. ».
Amendement AS 74 présenté par MM. Francis Vercamer, Arnaud Richard et Hervé Morin modifié à l’initiative de M. Jean-marc Germain, rapporteur
Article 11
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des propositions pour renforcer l’attractivité du régime de l’activité partielle. ».
Amendement AS 75 présenté par MM. Francis Vercamer et Arnaud Richard
Article 12
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« L’accord prévoit les modalités d’appréciation de l’amélioration de la situation économique de l’entreprise. ».
Amendement AS 76 présenté par MM. Francis Vercamer et Arnaud Richard
Article 12
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les graves difficultés conjoncturelles s’apprécient dans le champ de l’accord. ».
Amendement AS 77 présenté par MM. Francis Vercamer et Arnaud Richard
Article 12
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Dans le cas où de graves difficultés persistent à l’issue des deux ans, un nouvel accord peut être négocié, dans les six mois qui précèdent la conclusion de l’accord initial, dans les conditions définies au I et au II. »
Amendement AS 78 présenté par MM. Francis Vercamer et Arnaud Richard
Article 13
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : « peut déterminer », le mot : « détermine ».
Amendement AS 79 présenté par MM. Francis Vercamer et Arnaud Richard
Article 14
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Après le mot : « inférieur », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1233-86 du code du travail est ainsi rédigée :
« au montant total des indemnités de licenciement attribuée aux salariés. » ».
Amendement AS 80 présenté par MM. Francis Vercamer et Arnaud Richard
Article 14
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au second alinéa de l’article L. 1233-86 du code du travail, le mot : « double » est remplacé par le mot « triple » ».
Amendement AS 81 présenté par MM. Francis Vercamer et Arnaud Richard
Article 14
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport établissant un bilan des actions entreprises dans le cadre des actions de revitalisation des articles L. 1233-84 et suivants du code du travail, en précisant les améliorations qui peuvent concerner le dispositif. ».
Amendement AS 82 présenté par MM. Francis Vercamer et Arnaud Richard
Article 16
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : « est », les mots : « peut être ».
Amendement AS 83 présenté par M. Hervé Morin
Après l’article 5
Insérer l’article suivant :
I. – Le titre IV du livre II de la première partie du code du travail est abrogé.
II. – Dans le code du travail, les mots : « contrat de travail à durée indéterminée » sont remplacés par les mots : « contrat de travail unique à droits progressifs ». Les salariés dont le contrat de travail était régi par ces dispositions dépendent désormais de celles relatives au contrat de travail unique à droits progressifs définies aux III, IV, V, et VI du présent article
III. – Le contrat de travail unique à droits progressifs est conclu sans détermination de durée. Il est établi par écrit et assorti de droits progressifs dans le temps en terme d’indemnisation chômage, de protection juridique et de formation.
IV. – En cas de rupture du contrat, le salarié titulaire d’un contrat de travail unique a droit à une indemnité de licenciement suivant les conditions déterminées par l’article L. 1234-9 du code du travail.
V. – L’employeur verse une contribution aux pouvoirs publics dénommée contribution de solidarité calculée en fonction du niveau de rémunération du salarié depuis la date de signature du contrat selon un mode de calcul fixé par décret. Elle sert à financer la prise en charge des reclassements effectués par le service public de l’emploi.» »
VI. – Le montant des charges de cotisation chômage est dégressif en fonction de la durée du contrat de travail dont les modalités seront prévues par décret.
Amendement AS 84 présenté par M. Hervé Morin
Après l’article 5
Insérer l’article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils ne peuvent être réalisés post-formation. ».
Amendement AS 85 présenté par MM. Hervé Morin et Francis Vercamer
Après l’article 5
Insérer l’article suivant :
Au dernier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’éducation, après les mots : « à un poste de travail permanent », sont insérés les mots : « ou à un surcroît d’activité ».
Amendement AS 86 présenté par M. Hervé Morin
Compléter l’alinéa 28 par les mots : « ou pouvant porter atteinte au secret des affaires ».
Amendement AS 87 présenté par MM. Hervé Morin et Francis Vercamer
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot : « jours », insérer les mots : « à compter de la remise des documents ».
Amendement AS 88 présenté par M. Hervé Morin
Après l’article 4
Insérer l’article suivant :
Aux articles L. 4612-1 à L. 4742-1 du code du travail, les mots : « et de conditions de travail » sont supprimés.
Amendement AS 89 présenté par MM. Hervé Morin et Francis Vercamer
Après l’article 18
Insérer l’article suivant :
Le Gouvernement saisit les partenaires sociaux dans le cadre de l’article L. 1 du code du travail afin qu’ils procèdent dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° ……..du …….. relative à la sécurisation de l’emploi au regroupement des branches professionnelles selon des modalités fixées par décret précisant le nombre maximal de branches.
Amendement AS 90 présenté par M. Hervé Morin
Après l’article 4
Insérer l’article suivant :
Le code du travail est ainsi modifié :
I. – Le second alinéa de l’article L. 2323-27 est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « à travers le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui est sa « commission santé et sécurité spécialisée » dans les matières relevant de sa compétence » ;
2° Les deux dernières phrases sont supprimées ;
II. – À l’article L. 2323-28, les mots : « au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail », sont remplacés par les mots : « à la commission santé et sécurité du comité d’entreprise » ;
III. – Au premier alinéa de l’article L. 4611-1, les mots : « dans tout établissement », sont remplacés par les mots : « au sein de chaque comité d’entreprise » ;
IV. – Aux articles L. 4612-1 et suivants du code du travail, les mots : « le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « la commission santé et sécurité ».
Amendement AS 91 présenté par M. Hervé Morin
Article 5
I. – Après le mot : « prévoient », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« que la désignation des administrateurs représentant les salariés est organisée par une élection auprès des salariés de la société et de ses filiales directes ou indirectes situées sur le territoire français dans les conditions fixées à l’article L. 225-28 du code du travail. ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 50 et 68.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 12.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 à 43.
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 51 à 55.
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 69 à 73.
Amendement AS 92 présenté par M. Hervé Morin
Après l’article 12
Insérer l’article suivant :
L’article L. 2251-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent déroger aux articles L. 3121-1 à L. 3123-37 et R. 3121-1 à R. 3124-16. ».
Amendement AS 93 présenté par M. Hervé Morin
Après l’article 12
Insérer l’article suivant :
Le code du travail est ainsi modifié :
I. – L’article L. 2232-21 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« À l’exception des accords collectifs mentionnés à l’article L. 1233-21 et des dispositions contraires aux droits fondamentaux des salariés, les accords d’entreprises peuvent être conclus, sous réserve d’avoir été approuvés à la majorité des suffrages exprimés par la voie d’un référendum. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les accords collectifs conclus par le comité d’entreprise ou par le délégué du personnel doivent être préalablement soumis au référendum d’entreprise. » » ;
II. – L’article L. 2232-22 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « professionnelles », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée.
2° La dernière phrase du premier alinéa et les deux derniers alinéas sont supprimés.
Amendement AS 94 présenté par M. Hervé Morin
Après l’article 12
Insérer l’article suivant :
Après l’article L. 1222-8 du code du travail, il est inséré une section III bis ainsi rédigée :
« Section III bis
« Modification du contrat de travail en cas d’accords approuvés par référendum,
« Art. L. 1222-8-1. – Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux et dans les entreprises de moins de 200 salariés, dépourvues de délégués syndicaux dans l’entreprise, les représentants élus du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel, ou à défaut, les délégués du personnel, peuvent conclure des accords collectifs de travail.
« Lesdits accords, à l’exception des accords collectifs mentionnés à l’article L. 1233-21 et des dispositions contraires aux droits fondamentaux des salariés sont opposables auxdits salariés, s’ils comportent des mesures ou des dispositions entraînant des modifications au contrat de travail, sous réserve que ces accords aient été approuvés à la majorité des suffrages exprimés par la voie du référendum. »
Amendement AS 95 présenté par Mme Marie-Françoise Bechtel, MM. Jean-Luc Laurent et Christian Hutin
Article 1er
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont confiés par le III de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, l’Autorité de contrôle prudentiel vérifie notamment que les opérations de placement sur les marchés financiers faites par les mutuelles et assureurs désignés dans les conditions prévues par le présent article sont dépourvues de risque et permettent la préservation à titre permanent des droits des salariés ayant souscrit l’assurance complémentaire. »
Amendement AS 96 présenté par M. Christian Hutin, Mme Marie-Françoise Bechtel et M. Jean-Luc Laurent, modifié à l’initiative de M. Jean-Marc germain, rapporteur
Article 4
Rédiger ainsi l’alinéa 64 :
« 2° De trois représentants de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné par le projet, désignés en leur sein par la délégation du personnel en présence d’au plus sept comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou de deux représentants de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en présence de sept à quinze comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et d’un au-delà de quinze comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; »
Amendement AS 97 présenté par M. Christian Hutin, Mme Marie-Françoise Bechtel et M. Jean-Luc Laurent
Article 4
Après l’alinéa 57, insérer les deux alinéas suivants :
« IX bis. – Après l’article L. 4612-15, il est inséré un article L. 4612-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4612-15-1 – Chaque année, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’organisation de travail. » ».
Amendement AS 98 présenté par M. Christian Hutin, Mme Marie-Françoise Bechtel et M. Jean-Luc Laurent
Article 4
Compléter l’alinéa 46 par la phrase suivante :
« Le comité d’entreprise peut demander toute information complémentaire utile dans le cadre de cette consultation. » ».
Amendement AS 99 présenté par M. Christian Hutin, Mme Marie-Françoise Bechtel et M. Jean-Luc Laurent
Article 5
I. – À l’alinéa 3, substituer au nombre : « cinq mille », le nombre : « cinquante ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 46 et 64.
Amendement AS 100 présenté par M. Christian Hutin, Mme Marie-Françoise Bechtel et M. Jean-Luc Laurent
Article 12
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Dans ces deux cas, l’organe compétent est appelé à se prononcer préalablement à la conclusion de l’accord. ».
Amendement AS 101 présenté par MM. Gérard Cherpion, Jean-Pierre Door, Élie Aboud, Bernard Accoyer, Jean-Pierre Barbier, Mme Valérie Boyer, MM. Rémi Delatte, Dominique Dord, Denis Jacquat, Mme Isabelle Le Callennec, MM. Jean Leonetti, Céleste Lett, Mmes Geneviève Levy, Véronique Louwagie, MM. Gilles Lurton, Laurent Marcangeli, Pierre Morange, Bernard Perrut, Mme Bérengère Poletti, MM. Arnaud Robinet, Fernand Siré, Dominique Tian, Jean-Sébastien Vialatte, Jean-Charles Taugourdeau
Article 1er
Supprimer l’alinéa 4.
Amendement AS 102 présenté par MM. Gérard Cherpion, Jean-Pierre Door, Élie Aboud, Bernard Accoyer, Jean-Pierre Barbier, Mme Valérie Boyer, MM. Rémi Delatte, Dominique Dord, Denis Jacquat, Jean Leonetti, Céleste Lett, Mmes Geneviève Levy, Véronique Louwagie, MM. Gilles Lurton, Laurent Marcangeli, Pierre Morange, Bernard Perrut, Mme Bérengère Poletti, MM. Arnaud Robinet, Fernand Siré, Dominique Tian, Jean-Sébastien Vialatte, Jean-Charles Taugourdeau
Article 1er
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 26 :
« Les accords collectifs de branche conclus à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la sécurisation de l’emploi laissent aux entreprises la liberté de retenir le ou les organismes assureurs de leur choix. Ils peuvent, s’ils le souhaitent, recommander aux entreprises de s’adresser à un ou plusieurs organismes assureurs ou institutions pouvant garantir cette couverture après mise en concurrence … (le reste sans changement) ».
Amendement AS 103 présenté par MM. Gérard Cherpion, Élie Aboud, Bernard Accoyer, Jean-Pierre Barbier, Mme Valérie Boyer, MM. Rémi Delatte, Jean-Pierre Door, Dominique Dord, Denis Jacquat, Mme Isabelle Le Callennec, MM. Jean Leonetti, Céleste Lett, Mmes Geneviève Levy, Véronique Louwagie, MM. Gilles Lurton, Laurent Marcangeli, Pierre Morange, Bernard Perrut, Mme Bérengère Poletti, MM. Arnaud Robinet, Fernand Siré, Dominique Tian, Jean-Sébastien Vialatte, Jean-Charles Taugourdeau
Article 6
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Dans le cadre de la renégociation de l’accord national interprofessionnel du 25 mars 2011 relatif à l’indemnisation de l’assurance chômage, les partenaires sociaux s’engagent à ne pas aggraver le déséquilibre financier du régime d’assurance chômage dans l’application de l’alinéa précédent. ».
Amendement AS 104 présenté par MM. Gérard Cherpion, Élie Aboud, Bernard Accoyer, Jean-Pierre Barbier, Mme Valérie Boyer, MM. Rémi Delatte, Jean-Pierre Door, Dominique Dord, Denis Jacquat, Mme Isabelle Le Callennec, MM. Jean Leonetti, Céleste Lett, Mmes Geneviève Levy, Véronique Louwagie, MM. Gilles Lurton, Laurent Marcangeli, Pierre Morange, Bernard Perrut, Mme Bérengère Poletti, MM. Arnaud Robinet, Fernand Siré, Dominique Tian, Jean-Sébastien Vialatte, Jean-Charles Taugourdeau
Article 8
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
«, aux salariés du particulier employeur et aux salariés des associations et entreprises de services à la personne ».
Amendement AS 105 présenté par MM. Gérard Cherpion, Élie Aboud, Bernard Accoyer, Jean-Pierre Barbier, Mme Valérie Boyer, MM. Rémi Delatte, Jean-Pierre Door, Dominique Dord, Denis Jacquat, Mme Isabelle Le Callennec, MM. Jean Leonetti, Céleste Lett, Mmes Geneviève Levy, Véronique Louwagie, MM. Gilles Lurton, Laurent Marcangeli, Pierre Morange, Bernard Perrut, Mme Bérengère Poletti, MM. Arnaud Robinet, Fernand Siré, Dominique Tian, Jean-Sébastien Vialatte, Jean-Charles Taugourdeau
Article 8
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et aux salariés du particulier employeur ».
Amendement AS 106 présenté par M. Gérard Cherpion, Mme Bérengère Poletti, MM. Élie Aboud, Bernard Accoyer, Jean-Pierre Barbier, Mme Valérie Boyer, MM. Rémi Delatte, Jean-Pierre Door, Dominique Dord, Denis Jacquat, Mme Isabelle Le Callennec, MM. Jean Leonetti, Céleste Lett, Mmes Geneviève Levy, Véronique Louwagie, MM. Laurent Marcangeli, Pierre Morange, Bernard Perrut, Arnaud Robinet, Fernand Siré, Dominique Tian, Jean-Sébastien Vialatte, Jean-Charles Taugourdeau
Article 8
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ainsi qu’aux salariés affectés à des tâches de portage de presse ».
Amendement AS 107 présenté par M. Gérard Cherpion, Élie Aboud, Bernard Accoyer, Jean-Pierre Barbier, Mme Valérie Boyer, MM. Rémi Delatte, Jean-Pierre Door, Dominique Dord, Denis Jacquat, Mme Isabelle Le Callennec, MM. Jean Leonetti, Céleste Lett, Mmes Geneviève Levy, Véronique Louwagie, MM. Gilles Lurton, Laurent Marcangeli, Pierre Morange, Bernard Perrut, Mme Bérengère Poletti, MM. Arnaud Robinet, Fernand Siré, Dominique Tian, Jean-Sébastien Vialatte, Jean-Charles Taugourdeau
Article 8
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – Les accords conclus antérieurement à la publication de la présente loi et contenant une clause fixant une durée minimale de travail différente de celle prévue à l’article L. 3123-14 du code du travail restent en vigueur. ».
Amendement AS 108 présenté par M. Gérard Cherpion, Élie Aboud, Bernard Accoyer, Jean-Pierre Barbier, Mme Valérie Boyer, MM. Rémi Delatte, Jean-Pierre Door, Dominique Dord, Denis Jacquat, Jean Leonetti, Céleste Lett, Mmes Geneviève Levy, Véronique Louwagie, MM. Gilles Lurton, Laurent Marcangeli, Pierre Morange, Bernard Perrut, Mme Bérengère Poletti, MM. Arnaud Robinet, Fernand Siré, Dominique Tian, Jean-Sébastien Vialatte
Article 10
Après la première occurrence du mot : « travail, », rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 13 :
« leur licenciement est un licenciement qui ne repose pas sur un motif économique. Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. ».
Amendement AS 109 présenté par M. Gérard Cherpion, Élie Aboud, Bernard Accoyer, Jean-Pierre Barbier, Mme Valérie Boyer, MM. Rémi Delatte, Jean-Pierre Door, Dominique Dord, Denis Jacquat, Mme Isabelle Le Callennec, MM. Jean Leonetti, Céleste Lett, Mmes Geneviève Levy, Véronique Louwagie, MM. Laurent Marcangeli, Pierre Morange, Bernard Perrut, Mme Bérengère Poletti, MM. Arnaud Robinet, Fernand Siré, Dominique Tian, Jean-Sébastien Vialatte
Article 12
Compléter cet article par les seize alinéas suivants :
« III. – Le livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par un titre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Développement de l’emploi
« Art. L. 5151-1 – I. – Un accord d’entreprise peut, en contrepartie de l’engagement de la part de l’employeur de développer les emplois pendant la durée de validité de l’accord, aménager pour les salariés, la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 dans le respect des dispositions du premier alinéa de l’article L. 2253-3 et des articles L. 3121-33 à L. 3121-36, L. 3122-34 et L. 3122-35, L. 3131-1 à L. 3132-2, L. 3133-4, L. 3141-1 à L. 3141-3 et L. 3231-2.
« II. – La durée de l’accord ne peut excéder deux ans.
« III. – L’accord détermine le délai et les modalités de l’acceptation ou du refus par le salarié de l’application des stipulations de l’accord à son contrat de travail. Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application de l’accord à leur contrat de travail, leur licenciement est un licenciement qui ne repose pas sur un motif économique. Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.
« Art. L. 5151-2. – Pour les salariés qui l’acceptent, les stipulations de l’accord mentionné à l’article L. 5151 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l’accord sont suspendues pendant la durée d’application de celui-ci.
« Art. L. 5151-3. – Les organes d’administration et de surveillance de l’entreprise sont informés du contenu de l’accord mentionné à l’article L. 5151-1 lors de leur première réunion suivant sa conclusion.
« Art. L. 5151-4. – I. – La validité de l’accord mentionné à l’article L. 5151-1 est subordonnée, par dérogation à l’article L. 2232-12, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
« II. – Lorsque l’entreprise est dépourvue de délégué syndical, l’accord peut être conclu par un ou plusieurs représentants élus du personnel expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« À défaut de représentants élus du personnel, l’accord peut être conclu avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, dans le respect de l’article L. 2232-26.
« L’accord signé par un représentant élu du personnel mandaté ou par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions déterminées par cet accord et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
« III. – Le temps passé aux négociations de l’accord visé au 1er alinéa du II n’est pas imputable sur les heures de délégation prévues aux articles L. 2315-1 et L. 2325-6.
« Chaque représentant élu du personnel mandaté et chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans les conditions prévues à l’article L. 2232-25.
« IV. – Le représentant élu du personnel mandaté ou le salarié mandaté bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par chapitre premier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les salariés mandatés dans les conditions fixées à l’article L. 2232-24.
« Art. L. 5151-5. – L’accord peut être suspendu par décision du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, à la demande de l’un de ses signataires lorsqu’il estime que les engagements souscrits, notamment en matière de maintien de l’emploi, ne sont pas appliqués de manière loyale et sérieuse, ou que la situation économique de l’entreprise a évolué de manière significative.
« Lorsque le juge décide cette suspension, il en fixe le délai. À l’issue de ce délai, à la demande des parties et au vu des éléments transmis relatifs à l’application loyale de l’accord ou à l’évolution de la situation économique de l’entreprise, il autorise, selon la même procédure, la poursuite de l’accord ou en suspend définitivement les effets. » ».
Amendement AS 110 présenté par M. Gérard Cherpion, Élie Aboud, Bernard Accoyer, Jean-Pierre Barbier, Mme Valérie Boyer, MM. Rémi Delatte, Jean-Pierre Door, Dominique Dord, Denis Jacquat, Mme Isabelle Le Callennec, MM. Jean Leonetti, Céleste Lett, Mmes Geneviève Levy, Véronique Louwagie, MM. Laurent Marcangeli, Pierre Morange, Bernard Perrut, Mme Bérengère Poletti, MM. Arnaud Robinet, Fernand Siré, Dominique Tian, Jean-Sébastien Vialatte
Article 17
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – L’article L. 2312-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer aux obligations récurrentes de réunion des délégués du personnel prévues par le présent code, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d’État. » »
Amendement AS 111 présenté par M. Jean-Noël Carpentier et Mme Dominique Orliac
Article 12
À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot : « entreprise, », insérer les mots : « et si la prévision de croissance de l’Institut national de la statistique et des études économiques pour la France est inférieure à 1 % pour l’année en cours, ».
Amendement AS 112 présenté par M. Jean-Noël Carpentier et Mme Dominique Orliac
Article 13
I. – Après l’alinéa 92, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A De l’existence d’un motif économique défini par l’article L. 1233-3 ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 96, après le mot : « vérifié », insérer les mots : « l’existence d’un motif économique défini par l’article L. 1233-3, ».
Amendement AS 113 présenté par M. Jean-Noël Carpentier et Mme Dominique Orliac, modifié à l’initiative de M. Jean-Marc germain, rapporteur
Article 4
I. – Compléter l’alinéa 15 par les mots : « et, à défaut, des délégués du personnel ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, après la seconde occurrence du mot : « entreprise », insérer les mots : « et, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu’ ».
Amendement AS 114 présenté par M. Jean-Noël Carpentier et Mme Dominique Orliac
Article 5
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Les administrateurs désignés sont des salariés protégés tel que prévu à l’article L. 2411-1 du code du travail. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :
« Les membres du conseil de surveillance désignés sont des salariés protégés tel que prévu à l’article L. 2411-1 du code du travail. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :
« Les membres du conseil de surveillance désignés sont des salariés protégés tel que prévu à l’article L. 2411-1 du code du travail. »
IV. – Après l’alinéa 90, insérer les quatre alinéas suivants :
« IV bis. – L’article L. 225-33 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-33. – Sauf en cas de résiliation à l’initiative du salarié, la rupture du contrat de travail d’un administrateur élu par les salariés ne peut être prononcée.
« IV ter. – L’article L. 2411-1 du code du travail est ainsi modifié :
« Le 12° est complété par les mots : « et privé » ».
Amendement AS 115 présenté par M. Jean-Noël Carpentier et Mme Dominique Orliac
Article 8
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Au même alinéa du même article, supprimer les mots : « ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement » ».
Amendement AS 116 présenté par M. Jean-Noël Carpentier et Mme Dominique Orliac
Article 12
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Chaque année, le Gouvernement remet un rapport portant évaluation des accords de maintien de l’emploi. ».
Amendement AS 117 présenté par M. Jean-Noël Carpentier et Mme Dominique Orliac
Article 16
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « est déterminé sur le fondement d’», les mots : « peut se référer à »
Amendement AS 118 présenté par M. Jean-Noël Carpentier et Mme Dominique Orliac
Article 16
Supprimer les alinéas 9 à 17.
Amendement AS 119 présenté par Mme Jeannine Dubié, M. Jean-Noël Carpentier et Mme Dominique Orliac
Article 9
I. – À l’alinéa 5, substituer au chiffre : « quatre », le chiffre : « trois ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
Amendement AS 120 présenté par Mmes Jeannine Dubié, Dominique Orliac, et M. Jean-Noël Carpentier
Article 10
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots : « engage tous les trois ans », les mots : « peut engager ».
II. – Supprimer l’alinéa 6.
III. – Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« Art. L. 2242-24. – I. – La validité de l’accord mentionné à l’article L. 2242-21 est subordonnée, par dérogation à l’article L. 2232-12, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
« II. – Lorsque l’entreprise est dépourvue de délégué syndical, l’accord peut être conclu par un ou plusieurs représentants élus du personnel expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« À défaut de représentants élus du personnel, l’accord peut être conclu avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, dans le respect de l’article L. 2232-26.
« L’accord signé par un représentant élu du personnel mandaté ou par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions déterminées par cet accord et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
« III. – Le temps passé aux négociations de l’accord visé au 1er alinéa du II n’est pas imputable sur les heures de délégation prévues aux articles L. 2315-1 et L. 2325-6.
« Chaque représentant élu du personnel mandaté et chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans les conditions prévues à l’article L. 2232-25.
« IV. – Le représentant élu du personnel mandaté ou le salarié mandaté bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par chapitre premier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les salariés mandatés dans les conditions fixées à l’article L. 2232-24. »
Amendement AS 121 présenté par M. Joël Giraud, Mme Dominique Orliac, et M. Jean-Noël Carpentier
Après l’article 7
Insérer l’article suivant :
L’article L. 1244-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante. Le salarié doit faire savoir s’il fait acte de candidature par courrier en recommandé avec demande d’avis de réception ou remis en main propre contre décharge auprès de leur employeur au moins trois mois avant le début de la saison.
« La non-reconduction du contrat de travail à l’initiative de l’employeur est possible pour un motif réel et sérieux. Elle entraîne alors application de la procédure de convocation à un entretien préalable prévue aux articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1232-4. Cet entretien doit intervenir avant la fin de la saison. Si à la fin de cet entretien, l’employeur décide de ne pas reconduire le contrat, il en informe le saisonnier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en lui en indiquant le ou les motifs, au plus tard à la fin du contrat saisonnier. La non reconduction du contrat pour la saison suivante entraîne le versement au salarié d’une indemnité de non-reconduction au minimum égale à la prime de précarité de 10 % prévue à L. 1243-8. » ;
3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’arrêt ou la rupture de la succession des contrats saisonniers d’une saison à l’autre entraîne la caducité définitive de la reconduction. » ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois le droit à la reconduction est conservé si la succession des contrats saisonniers est suspendue pendant une ou plusieurs saisons pour cause de congé de maternité, de congé parental d’éducation, de congé individuel de formation, de congé pour la création ou la reprise d’entreprise, de congé sabbatique, et dans les conditions prévues par le code du travail. ».
Amendement AS 122 présenté par M. Joël Giraud, Mme Dominique Orliac, et M. Jean-Noël Carpentier
Après l’article 12
Insérer l’article suivant :
Le chapitre III du titre IV du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Contrat de travail intermittent
« Art. L. 1223-1. – Dans les régions touristiques à activité interrompue pendant une partie de l’année, définies par arrêté du préfet de région, les employeurs doivent proposer, pour tous les emplois dépassant douze semaines, la possibilité de signer des contrats de travail à durée indéterminée intermittents, avec alternance de périodes travaillées et non travaillées, tels que définies par les articles L. 3123-31 à L. 3123-37 du code du travail.
« Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent doit être conclu par écrit, avec fixation d’une durée annuelle contractuelle de base dans le contrat, durée que l’employeur s’engage à faire effectuer et à rémunérer.
« Cette durée annuelle de travail doit être, dans le cas où un salarié signe un seul contrat de travail à durée indéterminée intermittent, au moins de 450 heures, hors heures supplémentaires et au plus de 4/5e de la durée légale (soit pour les établissements ouvrant les jours fériés du 1er janvier, 14 juillet, 15 aout et 25 décembre, de 1435 heures) ou conventionnelle du travail. En cas de signature de plusieurs contrats de travail, il n’est pas prévu de limite basse pour le ou les autres contrats.
« Dans le contrat, il doit être explicitement stipulé que les périodes non travaillées n’ouvrent pas de droits aux assurances chômage.
« Art. L. 1223-2. – Les organisations d’employeurs sont tenues d’organiser sur le plan territorial, une négociation annuelle obligatoire avec les organisations syndicales de salariés pour examiner la mise en application locale du contrat à durée indéterminée intermittent.
« À défaut d’instance locale de dialogue social organisée par profession une commission paritaire territoriale interprofessionnelle, telle que définie à l’article L. 2234-2 du code du travail est créée par arrêté préfectoral dans les territoires concernés, pour, notamment, concourir à l’application des accords collectifs territoriaux de travail, conclus dans le cadre de l’application du présent article. Ces CPL peuvent être animées par les services extérieurs de l’État chargés du travail et de l’emploi. »
Amendement AS 123 présenté par M. Joël Giraud, Mme Dominique Orliac, et M. Jean-Noël Carpentier
Article 18
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’expérimentation prend en compte le secteur du tourisme. ».
Amendement AS 124 présenté par M. Thierry Braillard, Mme Dominique Orliac, et M. Jean-Noël Carpentier
Article 16
À l’alinéa 4, après le mot : « relatives », insérer les mots : « à l’exécution et ».
Amendement AS 125 présenté par M. Thierry Braillard, Mme Dominique Orliac, et M. Jean-Noël Carpentier
Article 16
I. – À l’alinéa 2, substituer au chiffre : « deux » le chiffre : « trois ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime apprécié par le juge. Elles peuvent se faire assister. ».
Amendement AS 126 présenté par M. Thierry Braillard, Mme Dominique Orliac, et M. Jean-Noël Carpentier
Article 16
I. – Après le mot : « par », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« les deux alinéas ainsi rédigés : ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les qualités professionnelles sont évaluées conformément aux articles L. 1222-2 à L. 1222-4. ».
Amendement AS 127 présenté par M. Thierry Braillard, Mme Dominique Orliac, et M. Jean-Noël Carpentier
Article 15
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ces critères sont appliqués dans le cadre de l’entreprise à l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie professionnelle dont relèvent les emplois supprimés. ».
Amendement AS 128 présenté par M. Thierry Braillard, Mme Dominique Orliac, et M. Jean-Noël Carpentier
Article 3
Supprimer l’alinéa 9.
Amendement AS 129 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez et Nicolas Sansu
Article 1er
Supprimer cet article.
Amendement AS 130 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez et Nicolas Sansu
Article 2
Supprimer cet article.
Amendement AS 131 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez et Nicolas Sansu
Article 3
Supprimer cet article.
Amendement AS 132 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 4
Supprimer cet article.
Amendement AS 133 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez et Nicolas Sansu
Article 5
Supprimer cet article.
Amendement AS 134 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez et Nicolas Sansu
Article 6
Supprimer cet article.
Amendement AS 135 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez et Nicolas Sansu
Article 7
Supprimer cet article.
Amendement AS 136 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez et Nicolas Sansu
Article 8
Supprimer cet article.
Amendement AS 137 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 9
Supprimer cet article.
Amendement AS 138 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 10
Supprimer cet article.
Amendement AS 139 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 11
Supprimer cet article.
Amendement AS 140 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 12
Supprimer cet article.
Amendement AS 141 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez et Nicolas Sansu
Article 13
Supprimer cet article.
Amendement AS 142 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 14
Supprimer cet article.
Amendement AS 143 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 15
Supprimer cet article.
Amendement AS 144 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 16
Supprimer cet article.
Amendement AS 145 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 17
Supprimer cet article.
Amendement AS 146 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, M. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 18
Supprimer cet article.
Amendement AS 147 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 19
Supprimer cet article.
Amendement AS 148 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 3
Après le mot « constitue », rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 9 :
« un licenciement et donne lieu au versement des indemnités de rupture calculées sur la base du salaire et de l’ancienneté acquise par le salarié au moment de son départ de l’entreprise. ».
Amendement AS 149 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 4
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 8 et l’alinéa 9.
Amendement AS 150 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 4
Supprimer l’alinéa 28.
Amendement AS 151 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 4
Après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :
« En cas d’absence de réponse suffisante de l’employeur à l’issue des réunions des organes visés par les alinéas précédents du présent article et par l’article L. 2323-26-2, ou de non-conformité de l’utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi à sa destination légale, le comité d’entreprise peut saisir le tribunal administratif d’une requête tendant à voir ordonner le remboursement par l’entreprise des sommes reçues par l’entreprise à ce titre. Il peut également en demander, en référé, la suspension du versement. ».
Amendement AS 152 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 4
I. – À l’alinéa 3, supprimer le chiffre : « cinq ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au chiffre : « dix », le chiffre : « deux ».
Amendement AS 153 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 5
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« II. – Le nombre d’administrateurs salariés est égal au tiers du nombre total d’administrateurs. ».
Amendement AS 154 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 5
I. – À l’alinéa 46, supprimer le mot : « chiffre ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au chiffre : « dix », le chiffre : « deux ».
Amendement AS 155 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 5
Rédiger ainsi l’alinéa 48 :
« II. – Le nombre d’administrateurs salariés est égal au tiers du nombre total d’administrateurs. ».
Amendement AS 156 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 5
I. – À l’alinéa 64, supprimer le chiffre : « cinq ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au chiffre : « dix », le chiffre : « deux ».
Amendement AS 157 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 5
Rédiger ainsi l’alinéa 66 :
« II. – Le nombre d’administrateurs salariés est égal au tiers du nombre total d’administrateurs. ».
Amendement AS 158 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Après l’article 7
Insérer l’article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article L. 1243-8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est doublée pour les contrats d’une durée inférieure à un mois et majorée de de 75 % pour les contrats d’une durée comprise entre un et trois mois. ».
Amendement AS 159 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 7
À l’alinéa 2, supprimer les mots : « ou minorer ».
Amendement AS 160 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 8
Après le mot : « semaine », supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 9.
Amendement AS 161 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 8
Supprimer l’alinéa 11.
Amendement AS 162 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 8
Supprimer les alinéas 19 à 26.
Amendement AS 163 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 10
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Art. L. 2242-22. – L’accord résultant de la négociation prévue à l’article L. 2242-21 prévoit, à peine de nullité : ».
Amendement AS 164 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 10
Supprimer l’alinéa 13.
Amendement AS 166 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 12
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Art. L. 5125-1. – L’application des dispositions de l’accord ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération des salariés lorsque le taux horaire de celle-ci, à la date de conclusion de cet accord, est égal ou inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance ou, s’il existe une convention collective applicable, du salaire minimum conventionnel, majoré de 20 %, ni de porter la rémunération des autres salariés en dessous de ces seuils. »
Amendement AS 167 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 12
Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots : « par une diminution de rémunération d’un même pourcentage que celle appliquée aux salariés ».
Amendement AS 168 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 12
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : « repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel », les mots : « est prononcé selon les modalités du licenciement » ».
II. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Le motif économique ne peut résulter de la seule existence de l’accord et du refus du ou des salariés. ».
Amendement AS 169 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 12
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« Tout acte de l’employeur contraire à son engagement de maintien de l’emploi contracté dans le cadre de l’accord est nul et de nul effet. ».
Amendement AS 170 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 12
Supprimer l’alinéa 17.
Amendement AS 171 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 12
Rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« L’accord peut être suspendu par décision du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, à la demande de l’un de ses signataires lorsqu’il estime que les engagements souscrits, notamment en matière de maintien de l’emploi, ne sont pas appliqués de manière loyale et sérieuse, ou que la situation économique de l’entreprise a évolué de manière significative. Le président du tribunal de grande instance peut également être saisi dans les mêmes conditions et aux mêmes fins par les organisations syndicales non signataires et les salariés victimes du non-respect de l’engagement de maintien de l’emploi. »
Amendement AS 172 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 13
Après l’alinéa 92, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A De l’existence d’un motif économique réel et sérieux ; ».
Amendement AS 173 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 13
I. – À l’alinéa 96, après le mot : « vérifié », insérer les mots : « l’existence d’un motif économique réel et sérieux de licenciement et »
II. – Après l’alinéa 100, insérer les cinq alinéas suivants :
« L’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 dès lors qu’elle s’est assurée :
« 1° De l’existence d’un motif économique réel et sérieux ;
« 2° De la conformité de l’accord aux dispositions des articles L. 1233-24-1, L. 1233-24-2 et L. 1233-24-3 ;
« 3° De la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise ;
« 4° De la présence dans le plan de sauvegarde de l’emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63. ».
Amendement AS 174 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 13
Après le mot : « validation », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 101 :
« ou d’homologation dans un délai de 45 jours à compter de la réception de l’accord ou du document complet élaboré par l’employeur. ».
Amendement AS 175 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 13
Supprimer l’alinéa 103.
Amendement AS 176 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, et Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 13
I. – Au début de l’alinéa 122, substituer aux mots : « En cas de licenciements intervenus », les mots : « Tout licenciement intervenu ».
II. – Après la seconde occurrence du mot : « homologation », rédiger ainsi la fin du même alinéa :
« est nul et ouvre droit, au choix du salarié, à la réintégration dans son emploi ou un emploi similaire ou au versement d’une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire brut. ».
Amendement AS 177 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, et Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 13
Supprimer les alinéas 152 et 153.
Amendement AS 178 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, et Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 13
Supprimer l’alinéa 155.
Amendement AS 179 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, et Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 13
I. – Après la référence : « L. 1233-57-3 », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 164 :
« donne lieu, à la réintégration du salarié dans son emploi ou un emploi similaire, avec maintien de ses avantages, ou, au choix de ce dernier, au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire brut mois. Elle est due sans préjudice de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 165.
Amendement AS 180 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, et Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 15
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Amendement AS 181 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, et Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 3
Compléter l’alinéa 7 par les mots : « si la demande résulte d’un simple choix du salarié et sans condition en cas de perte involontaire d’emploi dans l’entreprise d’accueil ».
Amendement AS 182 présenté par MM. Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, et Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 3
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Art L. 1222-15. – Si le poste du salarié n’a pas été supprimé ou modifié durant sa période de mobilité et s’il n’est pas concerné directement ou indirectement par un projet de réorganisation annoncé dans l’entreprise, cette rupture constitue une démission et n’est soumise à aucun préavis de la part de l’une ou l’autre des parties. Dans le cas contraire, si le poste a déjà été supprimé ou modifié durant la période de mobilité, ou s’il est concerné directement ou indirectement par un projet de réorganisation déjà annoncé dans l’entreprise au jour de son retour, l’ensemble des obligations légales et conventionnelles liées au licenciement pour motif économique sont applicables. ».
Amendement AS 183 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, et Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 4
À la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot : « jours », insérer les mots : « entre la première réunion de présentation du projet et la réunion de consultation ».
Amendement AS 184 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, et Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, Nicolas Sansu, modifié à l’initiative de M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 4
Compléter l’alinéa 3 par les mots : « et, le cas échéant, de l’information et de la consultation du ou des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».
Amendement AS 185 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, et Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 4
Compléter l’alinéa 4 par les mots : « , sous réserve que l’employeur lui ait fourni toutes les informations nécessaires à sa parfaite compréhension du projet et qu’il ait répondu de manière motivée à ses observations conformément aux dispositions de l’article L. 2323-4 ».
Amendement AS 186 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, et Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 4
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 9 :
« Cette saisine suspend la mise en œuvre du projet. »
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot : « décider », insérer les mots : « la reprise de la procédure et ».
Amendement AS 187 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, et Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 4
Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :
« Toute modification de la base de données est portée sans délai à la connaissance des élus du comité d’entreprise et fait l’objet d’une information du comité d’entreprise lors de la réunion suivante. »
Amendement AS 188 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, et Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 4
À la seconde phrase de l’alinéa 27, substituer au mot : « adapté », le mot : « complété ».
Amendement AS 189 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, et Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 4
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Cette possibilité de recours à l’expert-comptable ne se substitue pas aux autres expertises. »
Amendement AS 190 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, et Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 4
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 39 par les mots : « et ne commence à courir que lorsque l’employeur a remis à l’expert l’ensemble des documents nécessaires à la réalisation de sa mission »
Amendement AS 191 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, et Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 10
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Les modifications du contrat de travail nécessitées par l’accord sont soumises aux dispositions de l’article L. 1222-6 du code du travail. ».
Amendement AS 192 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, et Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 10
Après la première occurrence du mot : « économique », rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 13 :
« si les conditions de l’article 1233-3 sont réunies. ».
Amendement AS 193 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, et Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 12
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« En cas de diminution de la rémunération, l’employeur prend en charge le différentiel de cotisations sociales entre le salaire brut antérieur et celui applicable pendant la durée de validité de l’accord. ».
Amendement AS 194 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, et Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 12
À la seconde phrase de l’alinéa 8, après la dernière occurrence du mot : « le », insérer les mots : « gel du ».
Amendement AS 195 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, et Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 12
Après le mot : « économique », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« autres que celle prévue à l’article L. 5125-2. ».
Amendement AS 196 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, et Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 12
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Les modifications du contrat de travail nécessitées par l’accord sont soumises aux dispositions de l’article L. 1222-6 du code du travail. ».
Amendement AS 197 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, et Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 12
Après la première occurrence du mot : « économique », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 : « si les conditions de l’article 1233-3 sont réunies. »
Amendement AS 198 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, et Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 13
Après l’alinéa 105, insérer les deux alinéas suivants :
« Si l’autorité administrative ne fait pas droit à la demande ou y fait droit partiellement, le tribunal administratif peut être saisi dans les huit jours de la décision, implicite ou explicite, et doit statuer dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.
« La saisine du tribunal interrompt les délais de consultation du comité jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur le recours. ».
Amendement AS 200 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, et Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 16
Compléter l’alinéa 15 par les deux phrases suivantes :
« Toutefois, lorsqu’un syndicat a saisi la juridiction civile en application des dispositions des articles L. 2132-3 ou L. 2262-10, L. 2262-11 et L. 2262-12 du code du travail, le délai de prescription pour toute demande individuelle de salarié liée à l’action engagée par le syndicat est interrompu. Le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter du moment où une décision définitive intervient sur l’action syndicale engagée. »
Amendement AS 201 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 16
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Après avoir informé les parties de leurs droits et vérifié que l’accord auquel elles sont parvenues préserve les droits de chacune d’elles, le bureau de conciliation procède à son homologation ».
Amendement AS 202 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 16
Après le mot : « déterminé », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« en référence à un barème fixé par décret dont le montant ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l’application des dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles. ».
Amendement AS 203 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, et Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 16
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« Toutefois, lorsqu’un syndicat a saisi la juridiction civile en application des dispositions des articles L. 2132-3 ou L. 2262-10, L. 2262-11 et L. 2262-12 du code du travail, le délai de prescription pour toute demande individuelle de salarié liée à l’action engagée par le syndicat est interrompu.
« Le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter du moment où une décision définitive intervient sur l’action syndicale engagée. »
Amendement AS 204 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, et Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 16
Supprimer les alinéas 9 à 17.
Amendement AS 205 présenté par Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Chassaigne, François Asensi, et Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, Marc Dolez, et Nicolas Sansu
Article 16
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, interrompt, pendant le délai de deux ans prévu à l’article L. 1471-1, l’écoulement du délai prévu au premier alinéa du présent article. ».
Amendement AS 207 présenté par M. Christophe Cavard, Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumegas
Article 1er
À l’alinéa 1, après le mot : « salariés », insérer les mots : « et aux apprentis.»
Amendement AS 208 présenté par M. Christophe Cavard, Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumegas
Article 1er
I. – À l’alinéa 12, après les mots : « entreprises dont les salariés », insérer les mots : « ou les stagiaires »
II. – En conséquence, au même alinéa, après les mots : « bénéficier leurs salariés », insérer les mots : « et leurs stagiaires ».
Amendement AS 209 présenté par M. Christophe Cavard, Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumegas
Article 2
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Avant le 1er janvier 2014, l’État, les régions et les partenaires sociaux engagent une concertation sur le financement du compte personnel de formation. »
Amendement AS 210 présenté par M. Christophe Cavard, Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumegas
Article 2
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Avant le 1er janvier 2015, le compte de formation est étendu aux personnes sorties du système de formation initiale sans qualification. »
Amendement AS 211 présenté par M. Christophe Cavard, Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumegas
Article 3
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : « plus, » insérer les mots : « un accord d’entreprise peut organiser la possibilité pour ».
Amendement AS 212 présenté par M. Christophe Cavard, Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumegas
Article 4
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis. – L’impact environnemental de la production, notamment sa consommation d’énergies fossiles, sa sensibilité au prix de l’énergie et sa dépendance à l’importation de matières premières. »
Amendement AS 213 présenté par M. Christophe Cavard, Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumegas
Article 4
Compléter l’alinéa 23 par les mots : « ainsi que les conditions de leur octroi et leur respect. »
Amendement AS 214 présenté par M. Christophe Cavard, Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumegas
Article 4
À l’alinéa 11, après le mot : « compétences, », insérer les mots : « l’environnement, la dépendance aux énergies fossiles ».
Amendement AS 215 présenté par M. Christophe Cavard, Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumegas
Article 4
À l’alinéa 18, après le mot : « travail, », insérer les mots : « nature des contrats, nombre de stagiaire et son ratio équivalent temps plein, part des salariés à temps partiel, demande de dérogation individuelles au temps partiel minimum de 24 heures ».
Amendement AS 216 présenté par M. Christophe Cavard, Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumegas
Article 4
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 14.
Amendement AS 217 présenté par M. Christophe Cavard, Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumegas
Article 4
Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 14, les deux phrases suivantes :
« L’expert-comptable est rémunéré dans les conditions de l’article L. 2325-40. Toutefois, sous réserve que le comité d’entreprise dispose d’une subvention de fonctionnement, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 2325-40, un accord entre l’employeur et la majorité du comité d’entreprise peut mettre à la charge du comité une part de la rémunération de l’expert-comptable n’excédant pas 20 % du total hors taxe du coût de l’expertise. »
Amendement AS 218 présenté par M. Christophe Cavard, Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumegas, modifié à l’initiative de M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 8
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« L’employeur informe chaque année le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogations individuelles définies au présent article à la durée du temps de travail prévue à l’article L. 3123-14-1 »
Amendement AS 219 présenté par M. Christophe Cavard, Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumegas
Article 8
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – À l’article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, après la référence « b », les mots « et f » sont supprimés.
Amendement AS 220 présenté par M. Christophe Cavard, Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumegas
Article 9
À l’alinéa 11, substituer au mot : « peuvent », le mot : « doivent ».
Amendement AS 221 présenté par M. Christophe Cavard, Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumegas
Article 9
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Les perspectives de recours par l’employeur aux dispositifs publics en faveur de l’emploi et notamment aux contrats d’avenir et aux contrats de génération ».
Amendement AS 222 présenté par M. Christophe Cavard, Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumegas
Article 10
Après le mot : « au-delà », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« du secteur géographique limité par une distance de 50 kilomètres et en regard à la facilité de transport pour ne pas dépasser une heure de trajet. ».
Amendement AS 223 présenté par M. Christophe Cavard, Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumegas
Article 10
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les mesures visant à compenser, en cas de changement de secteur géographique, d’éventuelles pertes de niveau de vie liées notamment à l’accès aux services publics et à l’indice des prix de l’immobilier. »
Amendement AS 224 présenté par M. Christophe Cavard, Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumegas
Article 10
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2242-22-1. – La validité de l’accord mentionné à l’article L. 2242-21 est subordonnée, par dérogation à l’article L. 2232-12, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. »
Amendement AS 225 présenté par M. Christophe Cavard, Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumegas
Article 12
Compléter l’alinéa 17 par les deux phrases suivantes :
« Les organisations mandantes doivent avoir recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des représentants élus du personnel ou à défaut dans la branche. À défaut, les représentants des sections locales ou des unions départementales desdites organisations peuvent signer l’accord. »
Amendement AS 226 présenté par M. Christophe Cavard, Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumegas
Article 10
À la seconde phrase de l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot : « licenciement », supprimer le mot : « individuel ».
Amendement AS 228 présenté par M. Christophe Cavard, Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumegas
Article 12
À l’alinéa 5, après le mot : « entreprise », insérer les mots : « et une fois tous les moyens épuisés, notamment la réduction du temps de travail, le chômage partiel et la suppression de l’intérim, »
Amendement AS 229 présenté par M. Christophe Cavard, Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumegas
Article 10
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Avant sa signature, le projet d’accord collectif issu de la négociation mentionnée par le présent article fait l’objet d’un avis du conseil d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans le cadre de la consultation prévue à l’article L. 4612-8. »
Amendement AS 230 présenté par M. Christophe Cavard, Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumegas
Article 12
À l’alinéa 5, après le mot : « difficultés », insérer le mot : « économiques ».
Amendement AS 231 présenté par M. Christophe Cavard, Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumegas
Article 12
À l’alinéa 5, substituer aux mots : « analyse avec », les mots : « constaté par ».
Amendement AS 232 présenté par M. Christophe Cavard, Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumegas
Article 12
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Il appartient à l’employeur de produire les éléments nécessaire pour établir le diagnostic des graves difficultés économiques conjoncturelles. L’absence de transmission d’informations connues par l’employeur au moment du diagnostic entraine la nullité de l’accord ».
Amendement AS 233 présenté par M. Christophe Cavard, Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumegas
Article 12
Rédiger ainsi l’alinéa 152 :
« Art. L. 1235-7-1. – Les litiges concernant les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 ou relatifs à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4 relèvent de la compétence en premier ressort du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. »
Amendement AS 234 présenté par M. Christophe Cavard, Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumegas
Article 13
Supprimer l’alinéa 153.
Amendement AS 235 présenté par M. Christophe Cavard, Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumegas
Article 12
Supprimer l’alinéa 18.
Amendement AS 236 présenté par M. Christophe Cavard, Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumegas
Article 5
Supprimer la première phrase de l’alinéa 4.
Amendement AS 237 présenté par M. Christophe Cavard, Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumegas
Article 5
À l’alinéa 5, substituer au chiffre : « deux », le chiffre : « trois ».
Amendement AS 238 présenté par M. Christophe Cavard, Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumegas
Article 5
À l’alinéa 5, substituer au chiffre : « un », le chiffre : « deux ».
Amendement AS 239 présenté par M. Christophe Cavard, Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumegas
Article 8
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 3123-17, les mots « le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2 » sont supprimés.
II. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3123-19, les mots « le cas échéant sur la période prévue par un accord collectif sur le fondement de l’article L. 3122-2 » sont supprimés.
Amendement AS 240 présenté par M. Christophe Cavard, Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumegas
Article 8
Substituer aux alinéas 15 à 18 les cinq alinéas suivants :
« 1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 3123-17 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa donne lieu à une majoration de salaire de 10 % ».
« Si le nombre d’heures accomplies atteint un dixième du temps hebdomadaire minimal, chaque heure effectuée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %. »
« 2° L’article L. 3123-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention ou accord de branche peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut toutefois être inférieur à 10 %. Si la durée d’heures complémentaires effectuées dépasse le dixième des heures inscrites dans le contrat de travail, la convention ou l’accord peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut pas être inférieur à 25 % » ;
Amendement AS 241 présenté par M. Christophe Cavard, Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumegas
Article 16
Substituer aux alinéas 2 à 7 les cinq alinéas suivants :
« 1° Il est inséré, avant le premier alinéa, trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de litige, lors de conciliation prévue à l’article L. 1411-1 l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d’y mettre terme par accord ».
« Si le bureau de jugement constate que l’accord viole manifestement les droits du salariés, l’accord est réputé nul et le bureau de jugement automatiquement saisi. »
« L’absence d’une des parties lors de conciliation vaut saisine du bureau de jugement ».
« I bis. – L’article L. 1423-13 est complété par les mots : « différents des conseillers qui siègent au bureau de jugement ».
Amendement AS 242 présenté par M. Philippe Nogues, Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Gérard Sébaoun, Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Mme Monique Iborra, M. Denys Robiliard, Mme Barbara Romagnan et les membres du groupe SRC
Article 1er
Après le mot : « méconnaître », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« les objectifs de couverture effective de l’ensemble des salariés des entreprises de la branche et d’accès universel à la santé ».
Amendement AS 243 présenté par M. Michel Lefait, Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Gérard Sébaoun, Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Mme Monique Iborra, M. Denys Robiliard, Mme Barbara Romagnan et les membres du groupe SRC
Article 1er
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Les salariés concernés sont informés de cette décision.».
Amendement AS 244 présenté par M. Michel Lefait, Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Gérard Sébaoun, Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Mme Monique Iborra, M. Denys Robiliard, Mme Barbara Romagnan et les membres du groupe SRC
Article 1er
Après alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail. ».
Amendement AS 245 présenté par Mme Fanélie Carrey-Conte, M. Gérard Sébaoun, Mme Joëlle Huillier, MM. Philippe Nogues, Jérôme Guedj, Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Mme Monique Iborra, M. Denys Robillard, Mme Barbara Romagnan et les membres du groupe SRC modifié à l’initiative du rapporteur
Article 1er
Après alinéa 30, insérer les quatre alinéas suivants :
« b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« L’organisme doit avoir adressé la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la rupture du contrat de travail. » ;
« 3° Le 2° du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’organisme doit avoir adressé la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai d’un mois à compter du décès. » ».
Amendement AS 246 présenté par MM. Denys Robiliard, Jean Michel Clément, Mme Colette Capdevielle, M. Jean-Marc Germain, Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Gérard Sébaoun, Jean-Patrick Gille, Mmes Monique Iborra, Barbara Romagnan et les membres du groupe SRC
Article 3
Après le mot « salarié », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« doit intervenir dans un délai raisonnable et qui reste dans tous les cas possible à tout moment, avec l’accord de l’employeur si la demande résulte d’un simple choix du salarié. »
Amendement AS 247 présenté par MM. Michel Lefait, Denys Robiliard, Jean-Marc Germain, Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Gérard Sébaoun, Jean-Patrick Gille, Mmes Monique Iborra, Barbara Romagnan et les membres du groupe SRC
Article 3
À l’alinéa 9, après le mot : « origine », insérer les mots : « au cours ou ».
Amendement AS 248 présenté par MM. Denys Robiliard, Jean-Marc Germain, Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Gérard Sébaoun, Jean-Patrick Gille, Mmes Monique Iborra, Barbara Romagnan, M. Philippe Noguès et les membres du groupe SRC
Article 4
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« Sauf dispositions législatives spéciales, un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise ou, le cas échéant, le comité central d’entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut … (le reste sans changement) ».
Amendement AS 249 présenté par MM. Denys Robiliard, Jean-Marc Germain, Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Gérard Sébaoun, Jean-Patrick Gille, Mmes Monique Iborra, Barbara Romagnan, M. Philippe Noguès et les membres du groupe SRC
Article 4
À l’alinéa 14, substituer aux mots : « la majorité des membres élus du », le mot : « le ».
Amendement AS 250 présenté par MM. Denys Robiliard, Jean-Marc Germain, Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Gérard Sébaoun, Jean-Patrick Gille, Mmes Monique Iborra, Barbara Romagnan, M. Philippe Noguès et les membres du groupe SRC
Article 4
Compléter l’alinéa 15 par les mots : « et à défaut des délégués du personnel. »
Amendement AS 253 présenté par MM. Gérard Sébaoun, Denys Robiliard, Jean-Marc Germain, Mme Fanélie Carrey-Conte, M. Jean-Patrick Gille, Mmes Monique Iborra, Barbara Romagnan, M. Philippe Noguès et les membres du groupe SRC
Article 4
À l’alinéa 20, substituer au mot : « Rétributions », les mots : « Ensemble des éléments de la rémunération ».
Amendement AS 254 présenté par MM. Denys Robiliard, Jean-Michel Clément, Mme Colette Capdevielle, M. Jean-Marc Germain, Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Gérard Sébaoun, Jean-Patrick Gille, Mmes Monique Iborra, Barbara Romagnan, M. Philippe Noguès, les membres du groupe SRC et M. André Chassaigne
Article 4
À l’alinéa 27, substituer au mot : « adapté », le mot : « enrichi ».
Amendement AS 255 présenté par MM. Denys Robiliard, Jean-Marc Germain, Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Gérard Sebaoun, Jean-Patrick Gille, Mmes Monique Iborra, Barbara Romagnan, M. Philippe Noguès et les membres du groupe SRC
Article 4
À l’alinéa 29, après la seconde occurrence du mot : « disposition », insérer le mot : « actualisée ».
Amendement AS 256 présenté par MM. Denys Robiliard, Jean-Marc Germain, Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Gérard Sébaoun, Jean-Patrick Gille, Mmes Monique Iborra, Barbara Romagnan, M. Philippe Noguès et les membres du groupe SRC
Article 4
À l’alinéa 39, substituer aux mots : « la majorité des membres élus titulaires du », le mot : « le ».
Amendement AS 257 présenté par MM. Denys Robiliard, Jean-Marc Germain, Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Gérard Sébaoun, Jean-Patrick Gille, Mmes Monique Iborra, Barbara Romagnan, M. Philippe Noguès et les membres du groupe SRC
Article 4
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 53 :
« Dans les sociétés qui en sont dépourvues ou dans… (le reste sans changement) ».
Amendement AS 258 présenté par Mme Fanélie Carrey-Conte, M. Denys Robiliard, Mme Barbara Romagnan, MM. Jean-Marc Germain, Gérard Sébaoun, Jean-Patrick Gille, Mme Monique Iborra, M. Philippe Noguès et les membres du groupe SRC
Article 4
À l’alinéa 61, après le mot : « instance », insérer le mot : « temporaire ».
Amendement AS 259 présenté par MM. Gérard Sébaoun, Denys Robiliard, Jean-Marc Germain, Mme Fanélie Carrey-Conte, M. Jean-Patrick Gille, Mmes Monique Iborra, Barbara Romagnan, M. Philippe Noguès et les membres du groupe SRC
Article 4
I. – À l’alinéa 65, supprimer les mots : « territorialement compétentes pour l’établissement dans lequel se réunit l’instance de coordination »
II. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Ces personnes sont celles territorialement compétentes pour l’établissement dans lequel se réunit l’instance de coordination s’il est concerné par le projet et, sinon, celles territorialement compétentes pour l’établissement concerné le plus proche du lieu de réunion ».
Amendement AS 260 présenté par Mme Pascale Boistard, MM. Denys Robiliard, Jean-Marc Germain, Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Gérard Sébaoun, Jean-Patrick Gille, Mmes Monique Iborra, Barbara Romagnan, M. Philippe Noguès et les membres du groupe SRC
Article 4
Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :
« Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative. »
Amendement AS 261 présenté par MM. Denys Robiliard, Jean-Marc Germain, Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Gérard Sébaoun, Jean-Patrick Gille, Mmes Monique Iborra, Barbara Romagnan et les membres du groupe SRC
Article 5
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VI. – L’article L. 2325-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Aux administrateurs représentant les salariés au conseil d’administration ou de surveillance de la société » ;
« VII. – Au premier alinéa de l’article L. 2325-11 du même code, avant le mot « peuvent », sont insérés les mots : « et les administrateurs représentant les salariés au conseil d’administration ou de surveillance de la société » ».
Amendement AS 262 présenté par MM. Philippe Noguès, Denys Robiliard, Jean-Marc Germain, Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Gérard Sébaoun, Jean-Patrick Gille, Mmes Monique Iborra, Barbara Romagnan et les membres du groupe SRC
Article 9
À l’alinéa 2, avant les mots : « , sur le fondement », insérer le mot : « notamment ».
Amendement AS 263 présenté par MM. Denys Robiliard, Jean-Marc Germain, Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Gérard Sébaoun, Jean-Patrick Gille, Mmes Monique Iborra, Barbara Romagnan et les membres du groupe SRC
Article 9
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :
« 2° Le cas échéant les conditions … (le reste sans changement) ».
Amendement AS 264 présenté par MM. Jérôme Guedj, Jean-Marc Germain, Denis Robiliard, Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Gérard Sébaoun, Jean-Patrick Gille, Mmes Monique Iborra, Barbara Romagnan et les membres du groupe SRC
Article 10
Compléter l’alinéa 10 par les mots : « et familiale ».
Amendement AS 265 présenté par MM. Gérard Sébaoun, Denys Robiliard, Jean-Marc Germain, Mme Fanélie Carrey-Conte, M. Jean-Patrick Gille, Mmes Monique Iborra, Barbara Romagnan et les membres du groupe SRC
Article 10
Rédiger ainsi les alinéas 8 à 10 :
« 1° Les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique de l’emploi du salarié, elle-même précisée par l’accord ;
« 2° Les mesures visant à permettre la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;
« 3° Les mesures d’accompagnement à la mobilité, en particulier en termes de formation et d’aides à la mobilité géographique.
Amendement AS 268 présenté par MM. Gérard Sébaoun, Jean-Marc Germain, Denys Robiliard, Mme Fanélie Carrey-Conte, M. Jean-Patrick Gille, Mmes Monique Iborra, Barbara Romagnan et les membres du groupe SRC
Article 10
À l’alinéa 12, substituer aux mots : « l’ensemble », le mot : « chacun ».
Amendement AS 270 présenté par M. Denys Robiliard, Mmes Catherine Coutelle, Ségolène Neuville, M. Jean-Marc Germain, Mmes Barbara Romagnan, Fanélie Carrey-Conte, MM. Gérard Sébaoun, Jean-Patrick Gille, Mme Monique Iborra et les membres du groupe SRC
Article 12
À l’alinéa 7, après la première occurrence du mot : « rémunération », insérer les mots : « , horaire ou mensuelle, ».
Amendement AS 271 présenté par M. Jérôme Guedj, Mmes Cécile Untermaier, Anne-Yvonne Le Dain, MM. Yann Galut, Philippe Baumel, Mmes Marie-Anne Chapdelaine, M. Jean-Marc Germain, Denis Robiliard, Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Gérard Sébaoun, Jean-Patrick Gille, Mmes Monique Iborra, Barbara Romagnan et les membres du groupe SRC
Article 12
À l’alinéa 8, substituer au mot : « participent », les mots : « contribuent de manière proportionnée ».
Amendement AS 273 présenté par MM. Michel Lefait, Denys Robiliard, Jean-Marc Germain, Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Gérard Sébaoun, Jean-Patrick Gille, Mmes Monique Iborra, Barbara Romagnan et les membres du groupe SRC
Article 12
Après l’alinéa 14, insérer l’article suivant :
« L’accord prévoit les modalités d’information des salariés quant à son application et son suivi pendant toute sa durée ».
Amendement AS 275 présenté par MM. Denys Robiliard, Jean-Marc Germain, Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Gérard Sébaoun, Jean-Patrick Gille, Mmes Monique Iborra, Barbara Romagnan et les membres du groupe SRC
Article 12
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 14 :
« Celle-ci s’applique lorsque l’employeur n’a pas respecté ses engagements, notamment ceux de maintien de l’emploi mentionnés à l’article L. 5125-1 »
Amendement AS 276 présenté par MM. Denys Robiliard, Jean-Marc Germain, Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Gérard Sébaoun, Jean-Patrick Gille, Mmes Monique Iborra, Barbara Romagnan et les membres du groupe SRC
Article 12
À l’alinéa 22, après le mot : « par », insérer le mot : « le ».
Amendement AS 282 présenté par MM. Denys Robiliard, Jean-Marc Germain, Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Gérard Sébaoun, Jean-Patrick Gille, Mmes Monique Iborra, Barbara Romagnan et les membres du groupe SRC
Article 13
À l’alinéa 69, substituer aux mots : « mettre en œuvre des mesures de mobilité », les mots : « proposer des mesures de reclassement ».
Amendement AS 283 présenté par MM. Denys Robiliard, Jean-Marc Germain, Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Gérard Sébaoun, Jean-Patrick Gille, Mmes Monique Iborra, Barbara Romagnan et les membres du groupe SRC
Article 13
À l’alinéa 104, substituer au mot : « alinéa, », les mots : « alinéa et les voies et délais de recours ».
Amendement AS 287 présenté par MM. Denys Robiliard, Jean-Marc Germain, Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Gérard Sébaoun, Jean-Patrick Gille, Mmes Monique Iborra, Barbara Romagnan et les membres du groupe SRC
Article 13
À la première phrase l’alinéa 174, substituer au mot : « ou », le mot : « et ».
Amendement AS 288 présenté par MM. Denys Robiliard, Jean-Marc Germain, Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Gérard Sébaoun, Jean-Patrick Gille, Mmes Monique Iborra, Barbara Romagnan et les membres du groupe SRC
Article 13
Supprimer les alinéas 175 et 176.
Amendement AS 289 présenté par MM. Denys Robiliard, Jean-Marc Germain, Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Gérard Sébaoun, Jean-Patrick Gille, Mmes Monique Iborra, Barbara Romagnan et les membres du groupe SRC
Article 14
Compléter l’alinéa 5 par les mots : « et formuler des propositions ».
Amendement AS 290 présenté par MM. Denys Robiliard, Jean-Marc Germain, Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Gérard Sébaoun, Jean-Patrick Gille, Mmes Monique Iborra, Barbara Romagnan et les membres du groupe SRC
Article 17
À l’alinéa 4, après le mot : « conformer », insérer le mot : « complètement ».
Amendement AS 291 présenté par Mme Catherine Coutelle, M. Christophe Sirugue, Mmes Ségolène Neuville, Barbara Romagnan, Brigitte Bourguignon, Monique Orphé, Pascale Crozon, Conchita Lacuey, Édith Gueugneau, Nathalie Chabanne, Paola Zanetti, Maud Olivier, MM. Jean-Marc Germain, Denys Robiliard, Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Gérard Sébaoun, Jean-Patrick Gille, Mme Monique Iborra, et les membres du groupe SRC
Après l’article 8
Insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2015, un rapport sur l’évaluation des dispositifs relatifs au temps partiel pour en mesurer l’impact réel notamment en termes d’égalité professionnelle.
Amendement AS 292 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 1er
Compléter l’alinéa 6 par les mots : « à l’initiative du salarié. ».
Amendement AS 293 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 1er
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots : « par un accord de branche, un accord d’entreprise ou une décision unilatérale du chef d’entreprise prévoyant », les mots : « selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale prévoyant par ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots : « par le biais d’un accord de branche ou d’entreprise », les mots : « déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 ».
Amendement AS 294 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 3
À l’alinéa 7, après le mot « salarié, », insérer les mots : « qui doit intervenir dans un délai raisonnable, et ».
Amendement AS 295 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 3
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 1222-16. – L’employeur communique semestriellement au comité d’entreprise la liste des demandes de période de mobilité volontaire sécurisée avec l’indication de la suite qui leur a été données. »
Amendement AS 296 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 4
Après le mot : « intérim », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« , à des contrats temporaires et à des stages ».
Amendement AS 297 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 4
Compléter l’alinéa 14 par les mots : « , dans la limite du tiers de son budget annuel ».
Amendement AS 298 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 4
I. – À l’alinéa 57, substituer à la date : « 31 décembre 2016 », la date : « 30 juin 2015 ».
II. – Au même alinéa, avant le mot : « rapport », insérer le mot : « premier »
III. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Ce rapport est ensuite actualisé au 30 juin de chaque année. »
Amendement AS 299 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 4
I. – À l’alinéa 64, substituer aux mots : « D’un représentant », les mots suivants : « De deux représentants ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : « désigné en son », les mots suivants : « désignés en leur ».
Amendement AS 300 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 4
Compléter l’alinéa 68, par les mots : « , qui rendent leurs avis ».
Amendement AS 301 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 9
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« II. – L’article L.2242-16 du même code est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés : »
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Sur les conditions dans lesquelles l’entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l’échelle du site ou du bassin d’emploi. »
Amendement AS 302 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 10
À l’alinéa 5, après le mot : « organisation », rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« courantes sans projet de réduction d’effectifs. ».
Amendement AS 303 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 10
Après le mot : « formation », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« ainsi que d’aides à la mobilité géographique, qui comprennent la participation de l’employeur à la prise en charge des éventuels frais de déménagement et frais de transport supplémentaires. ».
Amendement AS 304 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 10
Compléter l’alinéa 10 par les mots : « et familiale ».
Amendement AS 305 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 10
À l’alinéa 12, substituer aux mots : « l’ensemble », le mot : « chacun ».
Amendement AS 306 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 12
À l’alinéa 5, substituer à la référence : « L. 3121-33 », la référence : « L. 3121-10 ».
Amendement AS 307 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 12
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot : « participent », les mots : « contribuent de manière proportionnée ».
Amendement AS 308 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 12
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« L’accord prévoit les modalités de l’organisation du suivi de l’évolution de la situation économique de l’entreprise et de la mise en œuvre de l’accord, notamment auprès des organisations syndicales de salariés représentatives signataires et des institutions représentatives du personnel. ».
Amendement AS 309 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 12
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 5125-7. – L’allocation mentionnée à l’article L. 5122-1 est cumulable avec les dispositions prévues au présent chapitre.. ».
Amendement AS 310 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 13
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« L’administration est informée sans délai de l’ouverture d’une négociation en vue de l’accord précité. ».
Amendement AS 311 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 13
À l’alinéa 46, substituer au nombre : « vingt-et-un », le chiffre : « dix ».
Amendement AS 312 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 13
À l’alinéa 46, substituer au nombre : « quinze », le chiffre : « huit ».
Amendement AS 313 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 13
Compléter l’alinéa 46 par la phrase suivante :
« Le cas échéant, l’expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l’employeur, qui doit répondre à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande de l’expert est formulée. »
Amendement AS 314 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 16
À l’alinéa 4, après les mots « relatives à la », insérer le mot : « seule ».
Amendement AS 315 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 18
Compléter l’alinéa 1 par les mots : « et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail. ».
Amendement AS 316 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 18
À l’alinéa 1, substituer aux mots : « déterminés par arrêté du ministre chargé du travail », les mots : « des organismes de formation, à l’exclusion des formateurs en langues, du commerce des articles de sport et des équipements de loisirs, et des détaillants et détaillants-fabricants de confiserie, chocolaterie, biscuiterie, ».
Amendement AS 317 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 6
Á l’alinéa 2, substituer au mot : « prévues », les mots : « définies dans les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés ».
Amendement AS 318 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 18
À l’alinéa 1, substituer au mot : « occupant », le mot : « employant ».
Amendement AS 318 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 18
À l’alinéa 3, substituer au mot : « transmet », le mot : « remet ».
Amendement AS 320 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 7
À l’alinéa 2, substituer aux mots : « ce type de contrat », les mots : « un contrat d’une telle nature ».
Amendement AS 321 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 8
À l’alinéa 4, substituer aux mots : « des négociations », les mots : « une négociation ».
Amendement AS 322 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 8
À l’alinéa 4, substituer aux mots : « leur effectif », les mots : « l’effectif de la branche professionnelle ».
Amendement AS 323 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 8
À l’alinéa 7, après le mot : « proposer », insérer les mots : « au salarié à temps partiel ».
Amendement AS 324 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 8
I. – À l’alinéa 7, substituer à la seconde occurrence du mot : « la », le mot : « sa ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : « du salarié à temps partiel ».
Amendement AS 325 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 8
À l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot : « emploi », insérer les mots : « à temps complet ».
Amendement AS 326 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 8
À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer le mot : « employé ».
Amendement AS 327 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 8
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : « sur le fondement », les mots : « en application ».
Amendement AS 328 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 8
À la première phrase de l’alinéa 10, après la première occurrence du mot : « pour », insérer les mots : « lui permettre de ».
Amendement AS 329 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 8
À l’alinéa 18, supprimer le mot : « toutefois ».
Amendement AS 330 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 8
À la fin de la première phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots : « de travail ».
Amendement AS 331 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 8
À la seconde phrase de l’alinéa 22, substituer à la première occurrence du mot : « à », les mots : « au dernier alinéa de ».
Amendement AS 332 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 8
À la seconde phrase de l’alinéa 22, après le mot : « majoration », insérer les mots : « de salaire ».
Amendement AS 333 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 8
À l’alinéa 25, après le mot : « majoration », insérer le mot : « salariale ».
Amendement AS 334 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 8
À la fin de l’alinéa 28, supprimer les mots : « de travail ».
Amendement AS 335 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 8
À la seconde phrase de l’alinéa 29, après le mot : « contrats », insérer les mots : « de travail ».
Amendement AS 336 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 8
À la seconde phrase de l’alinéa 29, après le mot : « accord », insérer les mots : « de branche ».
Amendement AS 337 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 8
À l’alinéa 30, après le mot : « effectif », insérer les mots : « de la branche professionnelle ».
Amendement AS 338 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 8
À l’alinéa 30, substituer au mot : « publication », le mot : « promulgation ».
Amendement AS 339 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 8
À l’alinéa 30, substituer aux mots : « doit être », le mot : « est ».
Amendement AS 340 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 8
Après le mot : « mois », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 30 : « à compter de la promulgation de la présente loi. ».
Amendement AS 341 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 10
À l’alinéa 6, substituer au mot : « groupes », les mots : « les groupes d’entreprises ».
Amendement AS 342 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 10
À l’alinéa 8, substituer aux mots : « en termes », les mots : « les actions ».
Amendement AS 343 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 10
À l’alinéa 8, substituer à la seconde occurrence du mot : « d’ », le mot : « les ».
Amendement AS 344 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 10
À l’alinéa 9, substituer aux mots : « de l’ », le mot : « d’ ».
Amendement AS 345 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 10
À l’alinéa 10, substituer aux mots : « permettre la conciliation entre », le mot : « concilier ».
Amendement AS 346 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 10
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots : « mentionnée par le présent article », les mots : « prévue à l’article L. 2242-21 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots : « mentionnée par le présent article », les mots : « prévue au même article L. 2242-21 ».
Amendement AS 347 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 11
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Les divisions et intitulés des sections 1 à 4 ... (le reste sans changement) ».
Amendement AS 348 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 11
À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots : « définir des engagements spécifiquement souscrits par », les mots : « imposer des obligations spécifiques à ».
Amendement AS 349 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 11
Après les mots : « en tenant compte », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 14 :
« des stipulations de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’activité partielle, lorsqu’un tel accord existe. ».
Amendement AS 350 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 11
Après les mots : « selon lesquelles sont », rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 14 :
« imposées ces obligations. ».
Amendement AS 351 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 11
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 16 :
« Art. L. 5122-2. – Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier … (le reste sans changement). ».
Amendement AS 352 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 11
À l’alinéa 16, substituer aux mots : « heures chômées », les mots : « périodes où ils ne sont pas en activité ».
Amendement AS 353 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 11
À l’alinéa 16, après les mots : « des actions », insérer les mots : « et de la formation ».
Amendement AS 354 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 11
À l’alinéa 17, substituer au mot : « fixées », le mot : « prévues ».
Amendement AS 355 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 11
I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« VI bis. – Au 3° de l’article L. 3232-2 du même code, les mots : « de chômage partiel » sont remplacés par les mots : « d’activité partielle ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.
Amendement AS 356 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 11
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« X bis. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5428-1, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « l’indemnité d’activité partielle, ».
Amendement AS 357 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 11
Après l’alinéa 29, insérer les cinq alinéas suivants :
« XII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du b du 5 de l’article 158, après le mot : « allocations », sont insérés les mots : « et indemnités » ;
« 2° L’article 231 bis D est ainsi modifié :
« a) La référence : « du 2° » est supprimée ;
« b) Après le mot : « allocations », il est inséré le mot : « , indemnités » ».
Amendement AS 358 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 12
I. – À l’alinéa 5, après le mot : « syndicales », insérer les mots : « de salariés ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux deux occurrences de ces mêmes mots aux alinéas 17 et 18.
Amendement AS 359 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 12
À l’alinéa 7, substituer au mot : « dispositions », le mot : « stipulations ».
Amendement AS 360 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 12
À l’alinéa 7, substituer au mot : « porter », le mot : « ramener ».
Amendement AS 361 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 12
À la première phrase de l’alinéa 8, après les mots : « demandés aux », insérer le mot : « autres ».
Amendement AS 362 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 12
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 16 :
« Art. L. 5125-4. I. – Par dérogation à l’article L. 2232-12, la validité de l’accord mentionné à l’article L. 5125-1 est subordonnée à sa signature ... (le reste sans changement). ».
Amendement AS 363 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 12
À l’alinéa 19, substituer aux mots : « avoir été », le mot : « être ».
Amendement AS 364 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 12
À l’alinéa 20, substituer au mot : « visé », le mot : « mentionné ».
Amendement AS 365 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 12
À l’alinéa 23, substituer au mot : « lorsqu’il », les mots : « , lorsque le juge ».
Amendement AS 366 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 12
À la seconde phrase de l’alinéa 24, substituer à la première occurrence du mot : « des », les mots : « de l’une des ».
Amendement AS 367 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 12
À la seconde phrase de l’alinéa 24, après le mot : « loyale », insérer les mots : « et sérieuse ».
Amendement AS 368 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 12
À l’alinéa 25, après la première occurrence du mot : « accord », insérer les mots : « mentionné à l’article L. 5125-1, ».
Amendement AS 369 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 12
À l’alinéa 25, après la première occurrence du mot : « rémunération », insérer les mots : « du salarié ».
Amendement AS 370 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 1er
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots : « celle fixée en application des dispositions de » les mots : « la couverture minimale mentionnée à ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8.
Amendement AS 371 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 1er
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : « À cet effet, ».
Amendement AS 372 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 1er
À l’alinéa 7, substituer aux mots : « sans pouvoir excéder », les mots : « ou de l’accord, et expirant au plus tard ».
Amendement AS 373 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 1er
À l’alinéa 8, substituer au mot : « non », les mots : « qui ne sont pas ».
Amendement AS 374 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 1er
I. – À l’alinéa 9, substituer aux références : « aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 » les mots : « à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après les mots : « L. 2242-11 du », rédiger ainsi la fin de l’alinéa : « même chapitre. ».
Amendement AS 375 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 1er
À l’alinéa 12, substituer aux mots : « ou d’indemnisations », le mot : « complémentaires ».
Amendement AS 376 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 1er
À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot : « dispositifs », insérer le mot : « médicaux ».
Amendement AS 377 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 1er
Après les mots : « entrant dans », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 17 : « le champ de cette couverture ».
Amendement AS 378 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 1er
À l’alinéa 19, supprimer les mots : « qui sont ».
Amendement AS 379 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 1er
À l’alinéa 19, substituer au mot : « rupture », le mot : « cessation ».
Amendement AS 380 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 1er
À l’alinéa 21, substituer aux mots : « de ces », les mots : « des ».
Amendement AS 381 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 1er
À l’alinéa 21, substituer aux mots : « couverture complémentaire », les mots : « remboursements complémentaires ».
Amendement AS 382 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 1er
À l’alinéa 22, substituer aux mots : « des anciens salariés », les mots : « de l’ancien salarié ».
Amendement AS 383 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 1er
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 24 :
« 5° L’ancien salarié justifie auprès de son ancien ... (le reste sans changement) ».
Amendement AS 384 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 1er
À l’alinéa 24, substituer aux mots : « du droit », les mots : « des garanties ».
Amendement AS 385 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 1er
À l’alinéa 26, substituer aux mots : « la couverture des risques qu’ils organisent », les mots : « les risques dont ils organisent la couverture ».
Amendement AS 386 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 1er
Substituer à l’alinéa 30 les deux alinéas suivants :
« 2° Le 1° de l’article 4 est ainsi modifié :
« a) Sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, avant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties en application d’une convention ou d’un accord collectif, de la ratification par la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise ou d’une décision unilatérale de l’employeur mentionnés à l’article 2 » ».
Amendement AS 387 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 1er
À l’alinéa 37, après le mot : « des », insérer les mots : « garanties liées aux ».
Amendement AS 388 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 1er
À l’alinéa 38, substituer à la première occurrence du mot : « aux », le mot : « au ».
Amendement AS 389 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 3
Après le mot : « opposées », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« la durée d’ancienneté mentionnée à l’article L. 6322-4 ou les dispositions de l’article L. 6322-7. ».
Amendement AS 390 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 3
À l’alinéa 9, substituer aux mots : « en application de », les mots : « mentionné à ».
Amendement AS 391 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 4
À l’alinéa 3, substituer au mot : « spécifiques », le mot : « spéciales ».
Amendement AS 392 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 4
À l’alinéa 3, substituer aux références : « articles L. 2323-72, L. 2281-12 », les références : « articles L. 2281-12, L. 2323-72 ».
Amendement AS 393 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 4
À l’alinéa 13, substituer au mot : « prévue », le mot : « mentionnée ».
Amendement AS 394 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 4
Après les mots : « fonctionnement, » rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 : « au financement de cette expertise à hauteur de 20 % ».
Amendement AS 395 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 4
À l’alinéa 18, substituer au mot et au signe : « professionnelle, » les mots : « professionnelle et ».
Amendement AS 396 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 4
À l’alinéa 26, substituer aux mots : « l’année en cours, les deux années précédentes », les mots : « les deux années précédentes et l’année en cours ».
Amendement AS 397 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 4
À l’alinéa 30, substituer aux mots : « informations et rapports », les mots : « rapports et informations ».
Amendement AS 398 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 4
À l’alinéa 31, substituer au mot : « publication », le mot : « promulgation ».
Amendement AS 399 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 4
À l’alinéa 49, substituer aux mots : « de réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci confirme », les mots : « d’explications suffisantes de l’employeur ou si celles-ci confirment ».
Amendement AS 400 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 4
À l’alinéa 50, après les mots : « créé par », insérer les mots : « le IV de ».
Amendement AS 401 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 4
À l’alinéa 54, substituer aux mots : « ces dispositions s’appliquent », les mots : « le présent article s’applique ».
Amendement AS 402 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 4
À l’alinéa 56, substituer aux mots : « les conditions d’utilisation du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts », les mots : « l’utilisation du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts, ».
Amendement AS 403 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 4
À l’alinéa 57, substituer aux mots : « les conditions d’utilisation », les mots : « l’utilisation ».
Amendement AS 404 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 4
À l’alinéa 66, après les mots : « l’instance », insérer les mots : « de coordination ».
Amendement AS 405 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 4
À la seconde phrase de l’alinéa 67, après les mots : « l’instance », insérer les mots : « de coordination ».
Amendement AS 406 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 4
À la première phrase de l’alinéa 70, substituer aux mots : « en cas d’un », les mots : « si un ».
Amendement AS 407 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 4
À la première phrase de l’alinéa 70, après le mot : « travail », insérer le mot : « sont ».
Amendement AS 408 présenté par M. Jean-Michel Clément, rapporteur pour avis au nom de la Commission des Lois
Article 5
I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots : « au premier alinéa », les mots : « au I du présent article »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 52 et 70.
Amendement AS 409 présenté par M. Jean-Michel Clément, rapporteur pour avis au nom de la Commission des Lois
Article 5
I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots : « cinquième à neuvième alinéas », les mots : « II et III du présent article »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 12 et 55.
Amendement AS 410 présenté par M. Jean-Michel Clément, rapporteur pour avis au nom de la Commission des Lois
Article 5
I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots : « exercice mentionné au premier alinéa », les mots « des deux exercices mentionnés au I »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 55 et 73.
Amendement AS 411 présenté par M. Jean-Michel Clément, rapporteur pour avis au nom de la Commission des Lois
Article 5
I. – À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots : « sixième alinéa », les mots : « 1° du III »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 55 et 73
Amendement AS 412 présenté par M. Jean-Michel Clément, rapporteur pour avis au nom de la Commission des Lois
Article 5
I. – À l’alinéa 15 substituer aux mots : « exercice clos mentionné au premier alinéa », les mots : « des deux exercices mentionné au I ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 58.
Amendement AS 413 présenté par M. Jean-Michel Clément, rapporteur pour avis au nom de la Commission des Lois
Article 5
I. – À l’alinéa 15 substituer aux mots : « cinquième à, neuvième alinéa », les mots : « II et III ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 58.
Amendement AS 414 présenté par M. Jean-Michel Clément, rapporteur pour avis au nom de la Commission des Lois
Article 5
I. – Après l’année : « 1986 », rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 17 :
« relative aux modalités des privatisations, ne sont pas soumises à l’obligation prévue aux I, II et III du présent article dès lors que le nombre de ces administrateurs est au moins égal au nombre prévu au II. »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 60.
Amendement AS 415 présenté par M. Jean-Michel Clément, rapporteur pour avis au nom de la Commission des Lois
Article 5
I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 17 substituer aux mots : « n’est pas égal au nombre prévu par le troisième alinéa », les mots : « est inférieur au nombre prévu au même II ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 60
Amendement AS 416 présenté par M. Jean-Michel Clément, rapporteur pour avis au nom de la Commission des Lois
Article 5
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au troisième alinéa de l’article L. 225-22 du code de commerce, après le mot : « élus », sont insérés les mots : « ou désignés ».
Amendement AS 417 présenté par M. Jean-Michel Clément, rapporteur pour avis au nom de la Commission des Lois
Article 5
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après la première phrase de l’article L. 225-30, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le mandat d’administrateur élu ou désigné par les salariés est également incompatible avec tout mandat de membre d’un comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l’article L. 2351-1 du code du travail, de membre de l’organe de représentation des salariés mentionné à l’article L. 2352-16 du même code ou de membre d’un comité de la société européenne mentionné à l’article L. 2353-1 dudit code. »
Amendement AS 418 présenté par M. Jean-Michel Clément, rapporteur pour avis au nom de la Commission des Lois modifié à l’initiative de M. Jean-Marc Germain, rapporteur
Article 5
Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis Après l’article L. 225-30, il est inséré un article L. 225-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-30-1. – L’employeur laisse aux administrateurs élus ou désignés par les salariés en application de l’article L. 225-27-1 le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, dans la limite d’une durée fixée par décret, permettant à l’administrateur d’exercer convenablement sa compétence. ».
Amendement AS 419 présenté par M. Jean-Michel Clément, rapporteur pour avis au nom de la Commission des Lois
Article 5
Après l’alinéa 32, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° bis Après l’article L. 225-30, il est inséré un article L. 225-30-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-30-2. – Les administrateurs élus ou désignés par les salariés pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 3142-13, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, soit par un des organismes mentionnés à l’article L. 3142-7. Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
« Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures consacrées à l’exercice du mandat d’administrateur en application de l’article. L. 225-30-1. Il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 3142-7 et suivants.
« Le financement de la formation économique est pris en charge par la société. »
Amendement AS 420 présenté par M. Jean-Michel Clément, rapporteur pour avis au nom de la Commission des Lois
Article 5
À l’alinéa 40, après les mots : « d’administrateur », insérer les mots : « élu ».
Amendement AS 421 présenté par M. Jean-Michel Clément, rapporteur pour avis au nom de la Commission des Lois
Article 5
À la fin de l’alinéa 40, substituer aux mots : «, selon le cas, à l’article L. 225-27-1 ou L. 225-79-2 », les mots : « à l’article L. 225-27-1, »
Amendement AS 422 présenté par M. Jean-Michel Clément, rapporteur pour avis au nom de la Commission des Lois
Article 5
À l’alinéa 42, substituer aux mots : « aux septième, huitième ou neuvième alinéas », les mots : « aux 2° à 4° du III » ;
Amendement AS 423 présenté par M. Jean-Michel Clément, rapporteur pour avis au nom de la Commission des Lois
Article 5
Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :
« Les procédures prévues aux 1° et 2° du présent article sont engagées dès la constatation de la vacance d’un siège et dans des délais compatibles avec l’objectif d’assurer la continuité de la participation des administrateurs élus ou désignés au conseil d’administration. »
Amendement AS 424 présenté par M. Jean-Michel Clément, rapporteur pour avis au nom de la Commission des Lois
Article 5
Supprimer l’alinéa 85.
Amendement AS 425 présenté par M. Jean-Michel Clément, rapporteur pour avis au nom de la Commission des Lois
Article 5
À l’alinéa 87, après le mot : « contestations », insérer les mots : « de la régularité des opérations électorales ».
Amendement AS 426 présenté par M. Jean-Michel Clément, rapporteur pour avis au nom de la Commission des Lois
Article 5
À l’alinéa 87, substituer à la référence : « L. 225-34 », la référence : « L. 225-34-1 ».
Amendement AS 427 présenté par M. Jean-Michel Clément, rapporteur pour avis au nom de la Commission des Lois
Article 5
Après l’alinéa 87, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – L’article L. 2325-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Aux administrateurs élus ou désignés par les salariés en application des articles L. 225-27-1, L. 225-79-2 et L. 226-4-2 du code de commerce. »
Amendement AS 428 présenté par M. Jean-Michel Clément, rapporteur pour avis au nom de la Commission des Lois
Article 5
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 91 :
« V. – L’élection ou la désignation ».
Amendement AS 429 présenté par M. Jean-Marc Germain, rapporteur, Mme Dominique Orliac, et MM. Jean-Noël Carpentier, Francis Vercamer et Arnaud Richard
Article 5
Après l’alinéa 90, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Au premier alinéa de l’article L. 2411-17 du même code, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et des entreprises mentionnées aux articles L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 226-4-2 du code de commerce » ».
1 () Protocole relatif à la consultation des partenaires sociaux sur les propositions de loi à caractère social relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle.
2 () Ces développements reprennent assez largement les analyses de l’ouvrage de Jacques Freyssinet : Négocier l’emploi : 50 ans de négociations interprofessionnelles sur l’emploi et la formation. Centre d’études de l’emploi, Editions Liaisons, 2010.
3 () Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), Études et résultats n° 789 : « Les contrats les plus souscrits auprès des complémentaires santé en 2009 », février 2012.
4 () Les données détaillées ci-après sont issues d’un rapport de l’institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES), n° 1890 : « L’enquête Protection sociale complémentaire d’entreprise 2009 », juillet 2012.
5 () IRDES, rapport n° 1890.
6 () Cette étude a porté sur 900 entreprises de moins de 250 salariés.
7 () On notera également qu’aucune discrimination fondée sur le sexe ne peut figurer dans cet acte juridique fondateur à peine de nullité, cette interdiction ne faisant toutefois pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme au titre de la maternité (article L. 913-1).
8 () Le bénéfice de l’exemption de l’assiette des contributions patronales est réservé, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, aux régimes de protection sociale complémentaire à caractère « collectif » (bénéficiant à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux) et « obligatoire ».
9 () DREES, Études et résultats, n° 789, février 2012.
10 () Sur ce point, voir plus loin le 4. consacré aux modalités de désignation des organismes assureurs.
11 () D’après les données issues de l’enquête RÉPONSE 2004-2005, 23 % seulement des entreprises de 20 à 49 salariés sont pourvues d’un délégué syndical, pour 49 % des entreprises de 50 à 99 salariés et 38 % pour l’ensemble des entreprises de plus de 50 salariés. Au total, 38 % des entreprises comptent un délégué syndical en leur sein.
12 () L’article L. 2242-1 du code du travail précise que la négociation annuelle obligatoire en entreprise ne concerne que les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’administration interprétant ce point comme exonérant de l’obligation de négociation les entreprises dépourvues de délégué syndical.
13 () Rappelons qu’un accord interprofessionnel non étendu ne s’applique qu’à ses signataires ou aux membres des organisations ou groupements signataires de cet accord (article L. 2262-1 du code du travail).
14 () Ces mécanismes font l’objet d’une analyse détaillée dans le cadre du commentaire de l’article 6 relatif à la mise en place de droits rechargeables à l’assurance chômage, infra.
15 () En effet, l’article 4 précise bien que dans le cadre de ce maintien ultérieur des droits, qui donnent lieu à la souscription d’un nouveau contrat, en l’occurrence forcément individuel, les tarifs applicables peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
16 () Sur le conseil en évolution professionnelle, voir II. infra
17 () Centre d’études et de recherches sur les qualifications, cité par Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, L’individu, acteur de sa qualification, état des lieux et questionnements, octobre 2012, p. 25-26
18 () Instruction Pôle emploi n° 2010-152 du 14 septembre 2010.
19 () Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels 2e évaluation post CIF, synthèse des résultats de l’enquête IPSOS sur les parcours achevés en 2010. septembre 2012.
20 () Le site internet http://www.passeportformation.eu/ est financé par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels à la demande du Comité national paritaire pour la formation professionnelle.
21 () « Les administrateurs salariés et la gouvernance d’entreprise », La Documentation Française, 2009.
22 () DARES, Analyse, n° 12 « Les demandeurs d’emploi indemnisables par le régime d’assurance chômage en 2011 », février 2013.
23 () Centre d’analyses stratégiques, Note d’analyse n°211 Missions et enjeux de l’assurance chômage : une mise en perspective internationale, janvier 2011. p. 8.
24 () Gérard Cornilleau, Mireille Elbaum, « Indemnisation du chômage, une occasion manquée face à la crise ? », .Lettre de l’OFCE n° 307, février 2009
25 () Sambre-Avesnois, Saint-Quentin, le Calaisis, le Boulonnais, Dunkerque, Douai, Roubaix-Tourcoing, Saint-Dié, Limoges, Rouen, Annonay, Brest, Rodez, Le Havre et Rennes.
26 () Annexe au projet de loi de finances pour 2013 relative à la formation professionnelle, p. 128.
27 () Source : INSEE, enquêtes Emploi
28 () Source : Institut national de la statistique et des études économiques
29 () DARES Analyses, « Les mouvements de main-d’œuvre en 2011 : une rotation élevée dans le tertiaire », n° 071, octobre 2012.
30 () Ces données sont issues de l’étude réalisée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) : ACOSS Stat n° 143, « Les déclarations d’embauche entre 2000 et 2010 : une évolution marquée par la progression des CDD de moins d’un mois », décembre 2011.
31 () Ces données sont issues d’une fiche technique publiée par l’Unédic : « Profil des allocataires de l’assurance chômage », février 2012.
32 () DARES Analyses n° 042 : « L’intérim en 2011 : croissance soutenue », juin 2012.
33 () DARES Analyses n° 098 : « L’emploi intérimaire au 3ème trimestre 2012 : la baisse se poursuit », décembre 2012.
34 () La question de savoir si les partenaires sociaux ont souhaité ou non inclure les intermittents du spectacle dans le champ de la majoration des cotisations d’assurance chômage n’est pas tranchée : en effet, en tant que relevant des CDD d’usage, ces professions seraient incluses ; toutefois, l’accord du 11 janvier fixe à 4,5 % le taux de la cotisation patronale sur ces contrats. Or, la cotisation patronale afférente aux contrats conclus avec des intermittents du spectacle est d’ores et déjà fixée à 7 %.
35 () Revue Futuribles n° 368, Bruno Coquet : « Assurance chômage et emplois précaires. Contrats courts et segmentation du marché du travail en France : le rôle paradoxal de l’assurance chômage », novembre 2010.
36 () DARES Analyses : « Le temps partiel en 2011 : des profils et des conditions d’emploi très contrastés selon que le temps partiel est « choisi » ou « subi » », n° 005, Janvier 2013.
37 () Ces données sont issues de la DARES et établies sur la base de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) de 2010.
38 () L’obligation triennale de négocier sur la GPEC a été créée par l’article 72 de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005.
39 () L’article L. 2341-1 du code du travail définit l’entreprise de dimension communautaire comme « l’entreprise ou l’organisme qui emploie au moins mille salariés dans les États membres de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen et qui comporte au moins un établissement employant au moins cent cinquante salariés dans au moins deux de ces États », et l’article L. 2341-2 du même code indique que constituent des groupes de dimension communautaire, les groupes qui satisfont à ces mêmes conditions d’effectifs et d’activité et comportent au moins une entreprise employant au moins 150 salariés dans au moins deux des États précités.
40 () Voir le commentaire de l’article 10 du projet de loi.
41 () Dans le commentaire associé à cette décision, il est précisé que « dès lors qu’il ne s’agit pas des éléments essentiels [du contrat de travail] (caractère à durée déterminée ou indéterminée, salaire…) et que la loi encadre cette atteinte (durée maximale d’un an), cette loi peut organiser ce rapport entre la convention collective et le contrat individuel de travail ».
42 () Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) Analyses n° 004 : « Le recours au chômage partiel entre 2007 et 2010 : forte augmentation de la fin 2008 à l’automne 2009, diminution ensuite », janvier 2012 ; et n° 097 : « Le chômage partiel en 2011 : stabilisation du recours au dispositif », décembre 2012.
43 () Rapport public annuel 2011 de la Cour des comptes, février 2011 et rapport de l’IGAS (RM 2012-084 P) : « Évaluation du système français d’activité partielle dans la perspective d’une simplification de son circuit administratif et financier », juin 2012.
44 () Cet accord, qui a mis en place un dispositif de conventionnement, ne concerne que les entreprises qui relèvent des organisations représentatives signataires de l’accord, autrement dit, les branches d’activité représentées au Medef.
45 () Cour des comptes, Rapport public annuel 2011 : « Le système français d’indemnisation du chômage partiel : un outil insuffisamment utilisé », février 2011.
46 () OCDE, Perspectives de l’emploi 2010
47 () Sous certaines conditions et avec l’accord de l’administration, un accord collectif peut tenir lieu de convention de revitalisation.
48 () Voir le commentaire de l’article 13.
49 () Cass. soc., 14 janvier 1997.
50 () Pour le détail du champ des entreprises d’au moins mille salariés soumises à l’obligation de proposer un congé de reclassement, voir le commentaire de l’article 14.
51 () L’article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».