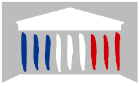N° 970
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 avril 2013.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI visant à renforcer les droits des patients en fin de vie,
PAR M. Jean LEONETTI,
Député.
——
Voir le numéro :
Assemblée nationale : 754.
A. LA LOI DU 22 AVRIL 2005 DEVRAIT PERMETTRE AUX PERSONNES EN FIN DE VIE DE MOURIR DANS LA DIGNITÉ ET SANS SOUFFRANCE 7
1. L’arrêt des traitements 8
a) L’interdiction de l’obstination déraisonnable 8
b) Le droit au refus des traitements par le patient 10
c) Le respect de la volonté des malades qui ne peuvent s’exprimer 11
2. Le soulagement de la douleur et le double effet 12
B. UNE LOI ENCORE MÉCONNUE ET INSUFFISAMMENT APPLIQUÉE 14
1. La loi de 2005 reste méconnue tant des patients que des médecins 14
2. La loi est mal appliquée, et peu respectée 16
a) Le patient n’est pas assez écouté 16
b) L’insuffisance des soins palliatifs, en particulier à domicile 17
II.- LE LÉGISLATEUR DOIT-IL ALLER PLUS LOIN ? 20
A. ANALYSE DES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES 20
3. La plupart des pays qui ont légiféré ont une législation similaire au modèle français 23
B. LES PISTES EXPLORÉES PAR DIFFÉRENTS RAPPORTS 24
1. Les pistes étudiées par le rapport Sicard et ses conclusions 25
a) Le rapport Sicard écarte la légalisation de l’euthanasie 25
b) Il étudie la question du suicide assisté, sans se prononcer en sa faveur 26
c) Il privilégie le maintien de la législation actuelle en soulignant la nécessité de renforcer l’écoute du malade 26
d) Le rapport propose une « sédation terminale » dans des cas exceptionnels 28
C. LA PRÉSENTE PROPOSITION DE LOI PERMET DE RENFORCER LA VALEUR DE LA PAROLE DU PATIENT SANS FRANCHIR L’INTERDIT DE TUER 30
1. Maintenir la solidarité de la société face à la mort 31
2. La priorité est de garantir l’application de la loi 32
a) Mieux faire connaître les dispositions législatives encadrant les décisions médicales 32
b) Développer les soins palliatifs à l’hôpital et à domicile 33
3. La présente proposition de loi s’inscrit dans la continuité des lois de 1999, 2002 et 2005 en renforçant la parole du patient 36
a) Créer un droit à la sédation en phase terminale (article 1er) 36
b) Rendre les directives anticipées opposables au médecin (article 2) 36
Article 1er (art. L. 1110-5-1 [nouveau] du code de la santé publique) : Droit à la sédation en fin de vie 53
Article 2 (art. L. 1111-11 du code de la santé publique) : Opposabilité des directives anticipées 58
TABLEAU COMPARATIF 65
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 67
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 69
ANNEXE 1 : Enquête de l’institut national d’études démographiques 74
ANNEXE 2 : Recommandations du rapport Sicard 79
ANNEXE 3 : Avis du Conseil national de l’ordre des medecins 89
ANNEXE 4 : Liste des personnes auditionnées 93
La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie a été portée par trente-deux députés réunis en mission d’information qui, à partir de points de vue très différents sur la fin de vie, sont parvenus, au bout de plusieurs mois d’auditions, à l’élaboration d’un texte consensuel qui a été adopté à l’unanimité dans les deux chambres.
Elle s’inscrit dans la continuité des lois de 1999 et 2002 relatives aux droits des patients, qui ont promu et encadré deux évolutions récentes : le développement des soins palliatifs et la reconnaissance des droits du patient.
Le débat public sur la fin de vie a souvent été rythmé par des affaires médiatiques, dans un climat passionnel, et presque toujours limité au sujet de la dépénalisation de l’euthanasie. Le sujet est en réalité beaucoup plus vaste et complexe, et les situations de fin de vie sont d’une grande diversité.
Le débat a été relancé par le Président de la République, dont l’engagement 21 était d’offrir « une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité ». Ce concept assez flou peut finalement regrouper un grand nombre de propositions, de l’accompagnement palliatif à l’euthanasie ou au suicide assisté. Cet engagement a donné lieu à la mise en place d’une commission de réflexion présidée par le professeur Didier Sicard, avec pour consigne d’aller à la rencontre des citoyens, qui a remis son rapport le 18 décembre 2012. La mission a ainsi rencontré 4 000 personnes au cours de débats publics très riches et témoignant de convictions diverses.
La commission souligne l’angoisse collective que véhicule le sujet de la fin de vie, liée à la peur de souffrir et à la crainte de voir la médecine s’approprier cet épisode essentiel de la vie. Le professeur Sicard relève un paradoxe, au cœur du débat : les gens demandent à la fois des prouesses médicales pour eux-mêmes ou leurs proches, mais sont effrayés par le « mal mourir » et le risque de survie dans des conditions jugées « indignes ».
Le rapport constate la grande méconnaissance de la loi. La moitié des personnes interrogée ne sait pas que « l’acharnement thérapeutique » est interdit par la loi. Souvent, les personnes revendiquent des possibilités qui existent déjà (l’arrêt des traitements de survie par exemple, avec soulagement de la douleur associée).
La plupart du temps, les personnes restent très marquées par les souffrances subies par un de leurs proches avant de mourir. Le rapport réitère les observations faites par la mission d’évaluation de 2008 (1), selon lesquelles la loi actuelle est mal appliquée : l’acharnement thérapeutique, ou « l’obstination déraisonnable », est toujours une réalité, les médecins restent réticents à soulager la douleur en fin de vie lorsque les doses utilisées peuvent éventuellement écourter la vie et les soins palliatifs ne sont pas toujours accessibles.
Pour le rapport Sicard, la légalisation de l’euthanasie ne peut être une réponse au fait que les soins palliatifs sont insuffisamment répandus. En effet, si la législation actuelle était correctement appliquée, la plupart des cas qui alimentent les craintes trouveraient une solution apaisée et respectueuse du patient. En effet, le code de la santé publique interdit l’obstination déraisonnable, impose au médecin de supprimer la souffrance du malade en phase terminale, si nécessaire par sédation profonde, même au risque d’abréger sa vie – ce que l’on appelle le « double effet ».
Ainsi, le rapport « souligne avec force l’exigence d’appliquer résolument les lois actuelles plutôt que d’en imaginer sans cesse de nouvelles, l’utopie de résoudre par une loi la grande complexité des situations de fin de vie et le danger de franchir la barrière de l’interdit ».
Le rapport fait aussi un certain nombre de propositions en ce qui concerne la sédation terminale et les directives anticipées.
S’inscrivant dans les recommandations du rapport Sicard, la présente proposition de loi vise à modifier la loi de 2005 sans en changer l’esprit, afin de renforcer la valeur de la parole du patient. Ainsi, l’article 1er crée un « droit à la sédation » pour les malades conscients en phase terminale dont les souffrances physiques et morales ne sont plus soulagées par les traitements administrés. Le malade peut ainsi demander à bénéficier d’une sédation profonde pour terminer sa vie en dormant, sans souffrance. La même possibilité est prévue par l’article 2 pour les personnes inconscientes qui se trouvent dans une telle situation, via leurs directives anticipées lorsqu’elles auront été rédigées sous forme de contrat avec le médecin.
Ainsi amendé, le cadre juridique bâti progressivement par les lois de 1999, 2002 et 2005 répondrait à quasiment tous les « cas » sans franchir la barrière de l’interdit de tuer, fondement de notre pacte social.
La mort est une expérience que nous ne vivons qu’au travers de celle de nos proches, ce qui rend le débat passionnel. Au-delà de nos émotions, dans ce débat éminemment complexe, où chaque témoignage fait vaciller nos certitudes, il faut concilier la solidarité envers les plus fragiles et le respect de l’autonomie de la personne. Améliorer la fin de vie en France, c’est apporter l’attention et les soins aux malades dont la parole doit être placée au cœur de l’intervention médicale. Comme le conclut le rapport Sicard, « il serait illusoire de penser que l’avenir de l’humanité se résume à l’affirmation sans limite d’une liberté individuelle, en oubliant que la personne humaine ne vit et ne s’invente que reliée à autrui et dépendante d’autrui ».
I.- UNE LOI CONSENSUELLE MAIS ENCORE MÉCONNUE
A. LA LOI DU 22 AVRIL 2005 DEVRAIT PERMETTRE AUX PERSONNES EN FIN DE VIE DE MOURIR DANS LA DIGNITÉ ET SANS SOUFFRANCE
La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie s’est inscrite dans la continuité des lois de 1999 et 2002 relatives aux droits des patients, qui ont promu et encadré deux évolutions récentes :
– le développement des soins palliatifs ;
– la reconnaissance des droits du patient, et de sa capacité de décision par rapport au corps médical.
La loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs marque la reconnaissance officielle des soins palliatifs, pratique qui se développait, portée par un mouvement militant. L’article L. 1110-10 du code de la santé publique en donne une définition : « Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. »
Cette loi crée un droit à recevoir des soins palliatifs : « Toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement » (désormais article L. 1110-9 du code de la santé publique).
Elle crée aussi le droit de refuser un traitement : « La personne malade peut s’opposer à toute investigation ou thérapeutique. »
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé renforce ce droit de refus, en précisant qu’il s’applique même si cela peut abréger la vie du patient – mais le médecin a dans ce cas l’obligation de convaincre le patient d’accepter les soins : « Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables » (art. 1111-4). L’information des proches est obligatoire en cas d’inconscience du patient : « Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. »
La loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie a été adoptée à l’unanimité dans les deux chambres, à partir d’une proposition de loi cosignée par trente-deux députés de tous bords politiques, à l’issue d’une mission d’information sur le thème de la fin de vie constituée dans le contexte de « l’affaire Humbert ».
Le titre du rapport de la mission d’information résume bien son esprit : « Respecter la vie, accepter la mort ». La loi refuse à la fois l’acharnement thérapeutique et l’euthanasie, choisissant la réponse à la souffrance du malade en fin de vie dans l’accompagnement et les soins palliatifs. Elle obéit aux règles de « non abandon » et « non souffrance », accepte le double effet des sédatifs et condamne l’obstination déraisonnable.
Elle précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent intervenir les limitations ou arrêts de traitement lorsqu’une telle décision est susceptible d’entraîner la mort de la personne malade et selon que celle-ci est ou non en mesure d’exprimer sa volonté.
La loi a été complétée par trois décrets (2) du 6 février 2006. Le décret 2006-119 est relatif aux directives anticipées, le décret 2006-120 à la procédure collégiale (modifiant le code de déontologie médicale) et le décret 2006-121 aux soins palliatifs. Le code de déontologie a été à nouveau modifié en 2010, à la suite de la mission d’évaluation de la loi mise en place en 2008, précisant qu’en cas d’arrêt des traitements de survie quand le malade est inconscient, un traitement sédatif et antalgique doit être administré. L’arrêt des traitements n’implique pas l’arrêt des soins.
Il convient de distinguer l’arrêt des traitements, qui peut être décidé lorsqu’il n’y a plus de perspective de guérison, du refus des traitements demandé par le patient.
a) L’interdiction de l’obstination déraisonnable
La loi du 22 avril 2005 a inséré dans l’article L. 1110-5 du code de la santé publique un alinéa ainsi rédigé : « Ces actes [de prévention, d’investigation ou de soins] ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10. »
Le législateur a ainsi confirmé l’interdiction de l’obstination déraisonnable, appelée communément « acharnement thérapeutique », qui figurait déjà à l’article 37 du code de déontologie médicale (3).
Cette interdiction ne concerne pas seulement les malades en fin de vie, et pose le problème de la pertinence d’actes thérapeutiques : tout ce qui est possible n’est pas forcément souhaitable.
La limite de l’obstination déraisonnable est cependant difficile à caractériser, et il est délicat de préciser à quel moment on n’administre plus le « juste soin ». La collégialité, le dialogue avec les proches et l’éventuelle référence aux directives anticipées permettent de prendre la décision.
Pour les patients qui peuvent exprimer leur volonté, la situation peut être délicate si le médecin estime que la poursuite des traitements relèverait de l’obstination déraisonnable, tandis que le malade refuse l’arrêt des traitements. Cette situation est cependant exceptionnelle. L’article L. 1111-4 du code de la santé publique dispose que « toute personne prend, avec le professionnel de santé (…) les décisions concernant sa santé » et que « le médecin doit respecter la volonté de la personne, après l’avoir informée des conséquences de ses choix ». C’est donc la volonté de la personne qui prime. En pratique, les désaccords se résolvent par le dialogue entre le médecin et le patient.
Pour les patients hors d’état d’exprimer leur volonté, le législateur a prévu une procédure particulière. Ainsi, le cinquième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique dispose : « Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. »
C’est donc le médecin qui décide de l’arrêt des traitements, en prenant en compte la volonté présumée du patient (au travers des directives anticipées ou de l’avis de la personne de confiance), après avoir respecté la procédure collégiale définie au II de l’article R. 4127-37 du code de la santé publique (article 37 du code de déontologie médicale) : « La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l’équipe de soins si elle existe et sur l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. »
La décision de limitation ou d’arrêt de traitement doit être motivée. Les avis recueillis au sein de l’équipe de soins ainsi que les motifs de la décision doivent être inscrits dans le dossier du patient. En définitive, la décision médicale prend bien en compte la volonté du patient, mais puisque celle-ci n’est que présumée, la décision finale reste celle du médecin.
La collégialité a un rôle essentiel dans le développement des bonnes pratiques médicales et hospitalières. En effet, les cas dramatiques d’euthanasie, ou, pire, d’administration de substance létale à un patient qui ne l’a pas demandé, se sont toujours réalisés dans des situations où un seul individu a pris des décisions sans confronter son jugement à celui d’autrui.
b) Le droit au refus des traitements par le patient
Le droit de refuser les traitements a été introduit par la loi du 9 juin 1999, dont l’article 1er dispose que « La personne malade peut s’opposer à toute investigation ou thérapeutique ». Il a été précisé par la loi du 4 mars 2002 à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, qui a prévu que les traitements puissent être refusés par la personne malade même si leur arrêt risque d’entraîner sa mort ou d’accélérer sa survenue. Dans ce cas, « le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables ».
Enfin, la loi du 22 avril 2005 en a renforcé la portée en indiquant à l’article L. 1111-4 que le patient avait de droit de refuser « tout » traitement.
Ce droit au refus de tout traitement ne s’applique pas qu’à la personne en fin de vie susceptible de faire l’objet d’une obstination déraisonnable de la médecine, mais à tout patient.
Si la personne n’est pas en fin de vie et est apte à exprimer un consentement, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins. Pour ce faire, il peut faire appel à un autre médecin et le patient doit réitérer sa décision après un délai raisonnable (art. 1111-4).
Le respect du consentement du malade implique à l’inverse que lorsqu’il n’est pas apte à exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance, la famille, ou un de ses proches ait été consulté (art. 1111-4).
La question de savoir si l’alimentation et l’hydratation constituent des traitements a suscité de nombreux débats. Votre rapporteur estime qu’à partir du moment où l’alimentation et l’hydratation sont administrées artificiellement, il est clair qu’elles constituent un traitement au sens des articles L. 1110-5 et L. 1111-10 du code de la santé publique. Elles peuvent constituer une obstination déraisonnable, et le médecin peut donc décider de les arrêter avec l’accord du patient ou après en avoir discuté avec la personne de confiance et les proches. Le patient est aussi en droit de demander à ce que l’on interrompe son alimentation et son hydratation artificielles, ou qu’on ne les mette pas en œuvre.
L’arrêt de ces traitements doit s’accompagner d’un renforcement des soins palliatifs adaptés afin que le patient ne souffre pas, comme l’a expliqué le professeur Régis Aubry lors de son audition.
c) Le respect de la volonté des malades qui ne peuvent s’exprimer
L’expression de la volonté des malades en fin de vie fait l’objet d’une section 2 introduite par la loi du 22 avril 2005 dans le chapitre relatif à l’information des usagers du système de santé et à l’expression de leur volonté.
Lorsque la personne est en phase terminale d’une maladie incurable, et demande l’arrêt des traitements, « le médecin respecte sa volonté après l’avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical » (art. L. 1111-10).
Pour la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, interviennent les éventuelles directives anticipées qu’il a rédigées, ou la personne de confiance qu’il a désignée.
Ainsi, l’article L. 1111-11 prévoit que « Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l’arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment ». Le médecin doit tenir compte des directives anticipées lorsqu’elles ont été rédigées moins de trois ans avant la survenue de la perte de conscience du patient.
Le décret n° 2006-119 du 6 février 2006 définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. Sur la forme, les directives anticipées sont « un document écrit, daté et signé par leur auteur dûment identifié par l’indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance » (art. R. 1111-17). Lorsque l’auteur de ces directives, bien qu’en état d’exprimer sa volonté, est dans l’impossibilité d’écrire lui-même le document, il peut demander à deux témoins, dont la personne de confiance lorsqu’elle est désignée, d’attester que le document est l’expression de sa volonté libre et éclairée.
Le mode de conservation des directives reste très souple : si l’article R. 1111-19 indique qu’en principe, « elles sont conservées dans le dossier de la personne constitué par un médecin de ville, (…) ou, en cas d’hospitalisation, dans le dossier médical », il prévoit aussi qu’elles puissent « être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance » ou à un proche, et, dans ce cas, « leur existence et les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnées, sur indication de leur auteur, dans le dossier constitué par le médecin de ville ou dans le dossier médical ».
Lorsqu’il n’y a pas de directives anticipées, c’est l’avis de la personne de confiance désignée par le patient qui prévaut sur tout autre avis non médical, c’est-à-dire sur les avis de la famille et des proches (art. L. 1111-12), dans les décisions d’intervention, d’investigation ou de traitement prises par le médecin.
L’article L. 1111-13 prévoit la procédure à suivre en cas d’arrêt des traitements sur une personne en phase terminale et inconsciente : le médecin peut décider d’arrêter un traitement « inutile, disproportionné ou n’ayant d’autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie », après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale (article R. 4127-37) et consulté la personne de confiance, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. « Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical ».
2. Le soulagement de la douleur et le double effet
L’article L. 1110-5 du code de la santé publique dispose que « Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée ». Ce droit du malade implique une obligation de moyens pour le médecin et les personnels soignants : « Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort. »
Si le soulagement de la douleur passe d’abord par les antalgiques (douleur physique) et les anxiolytiques (souffrance morale), il peut être nécessaire d’avoir recours à la sédation en cas de symptômes réfractaires. La sédation désigne une pratique qui vise à diminuer la perception d’une situation de détresse perçue comme insupportable par le malade par une diminution de la vigilance pouvant aller jusqu’à la perte de conscience du patient. Or, les médicaments sédatifs ou antalgiques peuvent avoir pour effet secondaire d’accélérer la survenue de la mort, notamment par leur effet de dépresseur respiratoire.
Dans le cas des personnes en fin de vie, le législateur a admis ce « double effet » des médicaments qui soulagent la douleur. Ce risque n’est acceptable qu’en phase avancée ou terminale d’une maladie.
L’article 2 de la loi du 22 avril 2005 a introduit à l’article L. 1110-5 une phrase ainsi rédigée : « Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. »
Le principe posé par le législateur reste celui du maintien de l’interdiction absolue de donner la mort mais ouvre la possibilité pour le médecin de prescrire certains traitements dont l’effet indirect peut accélérer la survenance du décès. En fin de vie, la qualité de vie prime sur la durée de la vie et l’intention du médecin est le soulagement du patient. Il s’agit bien d’une « sédation en phase terminale » et non d’une « sédation à but terminal ». La différence est fondamentale : l’intention est bien de soulager la souffrance physique et psychique, et non de donner la mort. Votre rapporteur souligne que l’expression d’« euthanasie passive » employée par les médias est impropre.
Comme l’a expliqué le professeur Régis Aubry lors de son audition (4), le but d’une sédation est d’atténuer une perception jugée insupportable. Selon les doses, la vigilance et même la conscience peuvent être altérées. Le médecin doit évaluer les effets de la sédation sur la personne, afin de parvenir à la bonne posologie. Dans le cas d’une sédation à but terminal, il s’agirait simplement d’augmenter progressivement la dose pour obtenir le décès du patient.
La Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP) a élaboré des recommandations de bonne pratique en matière d’usage de la sédation en phase terminale (5).
Euthanasie, suicide assisté et droit pénal « Les faits euthanasiques sont qualifiables pénalement (…) parce que l’intention criminelle ou délictueuse existe malgré le mobile compassionnel de l’auteur ou le consentement de la victime. L’intention est la volonté d’accomplir l’acte incriminé en connaissance de cause, peu importe donc le mobile de l’agent ou la psychologie de la victime. Le meurtre par pitié reste un meurtre. Le meurtre sur demande de la victime reste un meurtre. Cette pitié, cette demande n’ont pas d’influence sur la qualification juridique des faits mais évidemment beaucoup pour la répression éventuelle de ceux-ci, c’est-à-dire pour son adoucissement » (6). 1. La qualification pénale Le code pénal qualifie de meurtre « le fait de donner volontairement la mort à autrui » (art. 221-1 du code pénal). L’empoisonnement (art. 221-5) peut aussi permettre de qualifier un acte euthanasique : ainsi, le docteur Chaussoy a été poursuivi pour empoisonnement de Vincent Humbert. Si le suicide n’est pas interdit, en revanche, l’assistance au suicide peut être incriminée. L’individu ne possède pas de droit au suicide (CEDH 29 avril 2002, Diane Pretty). Ainsi, nul ne peut demander à autrui de lui donner la mort à sa place. L’assistance au suicide peut être qualifiée de provocation au suicide, ce qui est un délit (art. 223-13). Peut aussi être envisagée la qualification de non-assistance à personne en péril (art. 223-6), dès lors qu’il est prouvé que le tiers a eu connaissance des intentions suicidaires du défunt et qu’il n’a volontairement pris aucune mesure pour lui porter assistance. 2. La responsabilité pénale L’article 122-4 du code pénal dispose : « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ». Ainsi, l’article L. 1110-5 du code de la santé publique qui accepte le double effet des traitements sédatifs permet de dégager la responsabilité pénale du médecin en cas de poursuites. La circulaire du 20 octobre 2011 concernant la mise en œuvre de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie et le traitement judiciaire des affaires dites de « fin de vie » fournit aux magistrats quelques pistes et éléments de réflexion pour le traitement judiciaire de ces affaires particulièrement délicates. Elle a été élaborée en application d’une des recommandations du rapport d’évaluation de la loi du 22 avril 2005 qui préconisait que les relations entre les médecins et les magistrats soient favorisées et qu’une circulaire de politique pénale soit réalisée à l’adresse de ces derniers. |
Ainsi, si la loi du 22 avril 2005 a clairement écarté la dépénalisation de l’euthanasie, certaines de ses dispositions constituent, lorsqu’elles sont correctement appliquées, une permission de la loi, cause d’irresponsabilité pénale, permettant, dans certaines hypothèses, au médecin d’intervenir en toute légalité dans le processus de vie (par exemple en arrêtant un traitement de survie artificielle).
B. UNE LOI ENCORE MÉCONNUE ET INSUFFISAMMENT APPLIQUÉE
Les principales instances ayant émis des recommandations sur la fin de vie récemment – la commission présidée par le professeur Sicard (7), l’Observatoire national de la fin de vie (ONFV) (8), et le Conseil national de l’ordre des médecins (9) – insistent toutes sur la méconnaissance de la loi du 22 avril 2005, tant parmi les médecins que les citoyens. Cette observation avait déjà été faite par la mission d’évaluation de ladite loi en 2008 (10).
Le rapport de l’observatoire national, s’appuyant sur l’étude réalisée par l’Institut national d’études démographiques (INED), montre aussi que la loi n’est pas bien appliquée.
1. La loi de 2005 reste méconnue tant des patients que des médecins
Si la loi du 22 avril 2005 dite « Leonetti » passe pour une loi importante dans l’opinion, les enquêtes montrent que ses dispositions sont mal connues.
a) Une loi méconnue des citoyens
Depuis l’adoption de la loi il y a huit ans, les travaux parlementaires et sondages ont montré que la loi reste largement méconnue du grand public. Le rapport de la commission Sicard constate que, selon les personnes interrogées, la loi ne permettrait pas aux patients d’exiger l’arrêt ou la limitation des soins, tout comme elle n’interdirait pas l’acharnement thérapeutique, pratique pourtant interdite par la loi de 2005 sous le terme d’« obstination déraisonnable » et auparavant déjà proscrite par le code de déontologie médicale.
Dans son avis de décembre 2012 sur la fin de vie, l’Académie nationale de médecine observe que le cas des personnes réanimées et dépendantes d’assistance respiratoire et alimentaire sans espoir de récupération peut se « résoudre » par une demande d’arrêt des traitements, ce que beaucoup de personnes ignorent.
Les citoyens ont seulement retenu de la loi qu’elle avait interdit l’euthanasie – alors que l’euthanasie a toujours été proscrite, à travers l’interdiction de donner la mort volontairement à autrui (art. 221-1 du code pénal).
De plus, les différentes notions en présence dans le débat ne sont comprises que partiellement. Beaucoup de confusion existe entre les notions de suicide assisté, d’euthanasie, ou encore d’arrêt des traitements, et l’usage impropre des expressions d’« euthanasie active » et d’« euthanasie passive » y a largement contribué.
L’angoisse de la souffrance et de la dégradation physique et psychique ressort de façon constante des débats publics. Ainsi, le rapport de la commission Sicard observe que « les citoyens expriment une angoisse de mourir dans des conditions inacceptables en étant dépossédés de toute autonomie, ce qui conduit à une grande souffrance anticipée. Un certain nombre de demandes d’euthanasie semblent liées à cette angoisse ».
Le sondage TNS-Sofres réalisé à l’occasion des travaux de la commission Sicard montre que les proches des personnes en fin de vie témoignent tous d’un sentiment de responsabilité et d’impuissance face à la souffrance de leurs proches.
Cette angoisse montre que le dispositif des soins palliatifs tel qu’il existe actuellement n’est pas jugé comme une solution rassurante. Un véritable doute s’est installé sur la capacité à prendre en charge la souffrance en France.
Les directives anticipées, outil essentiel de la loi de 2005, sont méconnues et, par conséquent, peu utilisées. L’étude conjointe menée par l’INED et l’ONFV (11) montre que seulement 2,5 % des patients décédés avaient rédigé des directives anticipées. Or, dans les cas où elles ont été rédigées, elles ont été considérées comme utiles dans 72 % des situations. Cela pose la question de la connaissance de la loi par les patients, mais aussi par les professionnels de santé censés les conseiller.
b) Une loi méconnue de la majorité des soignants
Le personnel soignant estime que la loi régit prioritairement les situations de réanimation et ne la considère pas comme une loi à vocation générale.
L’enquête réalisée auprès des médecins, toutes spécialités confondues, pour le Conseil national de l’Ordre des médecins (12), montre que la loi est mal connue par 53 % des praticiens interrogés. Cette méconnaissance de la loi est à nuancer dans la mesure où les services les plus confrontés aux situations de fin de vie la connaissent très bien : c’est le cas des services de néonatalogie, de réanimation, de cancérologie ou encore de gériatrie.
Les directives anticipées sont également peu connues et utilisées des médecins. Ce point avait déjà été souligné lors de la mission d’évaluation de la loi en 2008. Or, les textes prévoient que le médecin a obligation de les prendre en compte puisqu’elles prévalent sur tout autre avis non médical dans le cas où la personne se trouve hors d’état d’exprimer sa volonté.
L’insuffisance de la formation sur les soins palliatifs et la prise en charge de la douleur pendant les études de médecine peut être en partie responsable de cette méconnaissance. Le rapport de la commission Sicard estime que 80 % des médecins n’auraient jamais suivi de formation sur la prise en charge de la douleur, que ce soit en formation initiale ou continue. Lors de son audition par votre rapporteur, le professeur Sicard a déploré l’absence de séminaire sur l’obstination déraisonnable, regrettant le désintérêt de la faculté pour ces sujets.
Cette dernière constatation va de pair avec l’omniprésence de la culture curative en France. Ainsi, « les unités de soins palliatifs apparaissent en milieu hospitalier comme les seuls lieux où la parole du malade est a priori entendue » (13). Ce « divorce entre médecine curative et médecine palliative » est une des raisons de la mauvaise application de la loi et empêche in fine le développement d’une culture palliative efficiente et satisfaisante dans l’ensemble du système hospitalier.
2. La loi est mal appliquée, et peu respectée
a) Le patient n’est pas assez écouté
La loi du 22 avril 2005 « ne change pas l’insuffisance de la communication avec le corps médical ». Ce constat a été entendu « comme une antienne » lors des débats organisés par la commission Sicard.
Pourtant, l’objet de cette loi était aussi, au-delà des dispositions juridiques, d’inviter le médecin à trouver un consensus par le dialogue humain entre lui, le malade ou ses proches et l’équipe médicale.
Les sondages et enquêtes montrent que l’acharnement thérapeutique est toujours une réalité. L’étude menée par l’INED avec l’ONFV démontre même qu’un arrêt ou une limitation de traitement n’a été effectué que dans la moitié des situations de fin de vie observées. Par ailleurs, ces décisions ne sont pas prises collégialement dans la moitié des cas, et, dans 20 % des cas, la décision d’arrêt des traitements n’a pas fait l’objet de concertation préalable avec le malade ou les proches – famille ou personne de confiance – ce qui est contraire à la loi.
Le décret du 25 janvier 2010 modifiant le code de déontologie médicale a pourtant élargi les possibilités de recours à la procédure collégiale encadrant les décisions de limitation et d’arrêt de traitement. Celle-ci peut désormais être déclenchée par la famille et les proches, notamment lorsqu’ils sont dépositaires des directives anticipées de la personne. Le même décret lève toute ambiguïté en ce qui concerne l’utilisation des traitements à visée antalgique et sédative en autorisant le médecin à les mettre en œuvre en cas d’arrêt des traitements pour les personnes cérébro-lésées dont la douleur n’est pas évaluable.
Dans sa position sur la fin de vie de février 2013, l’Académie nationale de médecine s’interroge en particulier sur l’obstination déraisonnable à l’égard des personnes très âgées. Elle recommande d’éviter le transfert en milieu hospitalier en cas d’épisode aigu, mal toléré psychologiquement. Elle déplore aussi que l’on s’efforce parfois de nourrir des personnes âgées physiquement dépendantes et inconscientes qui refusent de s’alimenter.
Par ailleurs, les euthanasies clandestines existent, mais paradoxalement moins que dans les pays ayant légalisé l’euthanasie : la mort donnée sans consentement express du malade est trois fois plus importante dans les pays ayant légalisé l’euthanasie (14). Cette situation montre que contrairement à une idée reçue, la légalisation de l’euthanasie ne supprime pas les pratiques clandestines et illégales.
b) L’insuffisance des soins palliatifs, en particulier à domicile
Le professeur Sicard souligne un paradoxe : alors que la plupart des Français souhaitent mourir chez eux plutôt qu’à l’hôpital, la mort à domicile effraie les gens, qui aux premiers signes de dégradation de l’état du patient (en particulier les personnes âgées), font hospitaliser leurs proches, cherchant une sorte de « visa » de la médecine pour mourir. De fait, la majorité des décès ont lieu à l’hôpital (15), ce qui constitue une spécificité française.
Toutefois, cette attitude n’est pas irrationnelle et s’explique en partie par les difficultés d’accès aux soins palliatifs, et la peur que les souffrances du mourant ne soient pas soulagées.
Les préconisations du rapport de la mission d’évaluation de la loi du 22 avril 2005 sur les soins palliatifs ont donné lieu à la mise en œuvre du programme de développement des soins palliatifs 2008-2012. La coordination de ce programme a été confiée à l’Observatoire national de la fin de vie (ONFV) créé par le décret du 19 février 2010.
Le rapport de l’ONFV de mars 2013 constate néanmoins que ce programme n’a pas été suivi d’une politique suffisamment forte de développement des dispositifs de prise en charge ambulatoire. La permanence des soins ambulatoire (PDSA) connaît des limites, en particulier la nuit et les week-ends dans certaines régions.
Par ailleurs, la coordination des soins n’est pas organisée. Le médecin traitant, qui devrait être le « pivot » naturel de la prise en charge de la fin de vie à domicile, est en réalité souvent démuni face à ces situations : il manque de temps et n’a pas toujours la formation adaptée pour soutenir les familles et accompagner le patient. Ainsi, dans la majorité des cas, l’hôpital apparaît comme prioritaire dans la prise en charge, surtout lorsque la pathologie dont est atteinte la personne est lourde et complexe.
Les principales recommandations Le rapport de mars 2013 constitue la première étude sur la façon dont on meurt en France. Il s’est basé sur l’enquête de l’INED précitée, mais il a surtout réalisé une large enquête de terrain de mai à juillet 2012 dans trois régions françaises pendant laquelle il a interrogé les proches et les professionnels sur le vécu de la fin de la vie mais n’a pas rencontré de patients. Elle porte en particulier sur les dernières semaines de vie des personnes qui meurent à domicile. Ses principales recommandations sont les suivantes : 1. La politique d’« aide aux aidants » – Reconnaître des droits pour les aidants o Simplifier l’accès à l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie (AJAP) o Inciter les entreprises à mettre en œuvre une politique de gestion de ressources humaines soucieuse de l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale pour les personnes souhaitant accompagner un proche en fin de vie o Permettre aux aidants de bénéficier de temps de répit o Favoriser l’accompagnement des deuils par l’entreprise et par les professionnels de santé – Donner aux professionnels de proximité le moyen d’aider les aidants o Mettre en place des formations pour apprendre à repérer l’épuisement que peut subir l’aidant o Reconnaître le rôle des professionnels de proximité dans l’accompagnement des proches après le décès – Faire connaître les aides existantes et les adapter à la fin de vie, notamment par la mise en place d’une véritable plateforme d’information en direction des aidants qui pourrait prendre la forme d’un « guichet unique d’information ». – Réduire le reste à charge des aidants o Mieux couvrir les frais liés à l’aide au domicile o Réduire les délais d’accès aux aides existantes – Mettre en place un dispositif d’entraide entre aidants 2. La politique de développement des soins palliatifs à domicile – Reconnaître la place centrale du médecin généraliste dans la prise en charge – Professionnaliser la mission de coordination des soins – Développer la formation des aides à domicile – Financer les temps de coordination nécessaires des professionnels intervenant à domicile (visites conjointes à domicile, staff hebdomadaire, participation aux réunions de concertation pluridisciplinaires) – Développer le recours à l’hospitalisation à domicile tout en évitant la surmédicalisation de la fin de vie – Aider les professionnels du domicile à anticiper les situations d’urgence et favoriser l’admission directe dans les services hospitaliers pour éviter le passage par les services d’urgence – Former les urgentistes du SAMU à la prise en charge de la fin de vie. |
Source : « Vivre la fin de sa vie chez soi », Observatoire national de la fin de vie, mars 2013.
En conclusion, force est de constater que la méconnaissance de la loi alimente l’angoisse collective face à la fin de vie et conduit un grand nombre de personnes à souhaiter une légalisation de l’euthanasie, afin de pouvoir « maîtriser » leur fin de vie face à une médecine performante mais suspectée de pratiquer l’acharnement thérapeutique, et de ne pas suffisamment écouter les malades.
Le professeur Sicard souligne que les personnes entendues ne souhaitent pas être euthanasiées – au contraire, elles redoutent le pouvoir du médecin qui pourrait décider de leur mort – mais elles veulent pouvoir donner des instructions au médecin jusqu’à la fin. Cela justifie-t-il la création d’un droit au suicide assisté, ou la légalisation de l’euthanasie ?
II.- LE LÉGISLATEUR DOIT-IL ALLER PLUS LOIN ?
L’angoisse de l’agonie et la demande de liberté de nos concitoyens face à la médecine doivent être entendues. La solution passe-t-elle par un changement de notre législation ? Votre rapporteur a souhaité étudier les législations étrangères, ainsi que différentes solutions proposées par les rapports parus récemment sur ces sujets, avant d’en tirer des conclusions.
A. ANALYSE DES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES
1. L’euthanasie en Belgique et aux Pays-Bas
La Belgique et les Pays-Bas ont adopté des législations très proches, permettant l’euthanasie. Dans les deux cas, il s’agit d’un acte accompli par un médecin, sur une personne atteinte d’une maladie incurable qui inflige une souffrance insupportable. Le souhait de mourir doit être exprimé de façon réfléchie, la demande est enregistrée dans un dossier, elle donne lieu à une concertation médicale. Enfin, il existe dans les deux cas un contrôle a posteriori par des commissions indépendantes.
Aux Pays-Bas, la loi du 12 avril 2001 autorise l’interruption de la vie et l’aide au suicide si les actes sont effectués par un médecin qui a respecté les critères définis par la loi et a préalablement signalé le cas au médecin légiste de la commune. L’article 293 du code pénal punit le fait de tuer autrui à sa demande ; il lui a été adjoint un second alinéa qui dispose que si le médecin procède à la mise à mort d’une personne à sa demande, en respectant certaines conditions de forme et de fond, les peines prévues par le code pénal ne s’appliquent pas. Le patient doit avoir plus de 16 ans. Le médecin doit informer le patient préalablement sur sa situation et doit avoir la conviction qu’il n’existe plus d’autres solutions. C’est à lui de juger la souffrance insupportable. Un second avis médical d’un médecin indépendant est également requis. En 2010, 1,7 % des décès ont eu lieu dans le cadre de la procédure d’interruption de la vie.
D’après une étude de Franck Judo (16), le fonctionnement des organes de contrôle n’est pas satisfaisant car leurs analyses sont très générales et ne se penchent pas sur des cas concrets, et les critères requis par la loi semblent être effacés au profit d’une appréciation de la « qualité de vie », notion beaucoup plus subjective que la souffrance insupportable.
En Belgique, la loi du 28 mai 2002, modifiée en 2005, a dépénalisé l’euthanasie. Cette dernière est désormais reconnue comme un droit du patient. Il s’agit d’une loi spécifique, en dehors du droit pénal, déterminant les conditions dans lesquelles un médecin peut procéder à une mise à mort qui peut être qualifiée d’euthanasie.
La souffrance insupportable est estimée par la personne elle-même, qui doit être majeure, capable et consciente au moment de formuler la demande qui doit être écrite, datée et signée. Le médecin doit s’assurer que la demande est volontaire, réfléchie, répétée et qu’elle ne résulte pas de pressions extérieures. Il doit également évoquer avec le patient les alternatives thérapeutiques existantes et se forger la conviction qu’aucune autre solution n’est envisageable.
La commission nationale d’évaluation n’est juge que du respect de la procédure et non de la pertinence de la demande.
En moyenne, un médecin généraliste pratique six euthanasies par an. La mort par euthanasie représente 2 % des morts par an en Belgique (dont 1 % a lieu après des soins palliatifs).
Il est important de noter que ces dispositifs législatifs ne sont pas « à l’équilibre ». Ainsi, le rapport Sicard indique qu’en Belgique, vingt-cinq projets d’extension des cas de figure prévus par la loi ont été proposés depuis 2002.
Dans les deux pays, les débats portent sur l’accès pour les personnes qui ne sont pas capables d’exprimer leur volonté, l’accès aux mineurs (en Belgique), la clause de conscience des médecins ou des établissements hospitaliers, la création d’un « droit à » être euthanasié. Sur ce dernier point, les médias s’émeuvent quand un médecin refuse l’euthanasie au motif qu’il estime que les conditions requises par la loi ne sont pas remplies. La légalisation de l’euthanasie doit-elle être une exception à l’interdiction de tuer, ou un droit de tout citoyen à être euthanasié ?
Enfin, l’Observatoire national de la fin de vie (ONFV) souligne que la légalisation de l’euthanasie ne permet pas de répondre à toutes les demandes individuelles. Il y aurait en Belgique beaucoup plus d’euthanasies non déclarées qu’en France.
Pour Franck Judo, les exemples belge et néerlandais montrent que la dépénalisation de l’euthanasie « risque de mettre en marche un processus dangereux, évoluant à la fois vers une extension des cas d’application de la loi et vers une distanciation vis-à-vis des critères définis par elle ». En outre, il observe que dans les deux pays précités, elle a freiné voire arrêté la réflexion déontologique : « Le législateur ayant permis l’euthanasie, il ne serait plus admissible de critiquer cette pratique, y compris dans une perspective éthique ».
2. Le suicide assisté en Suisse et dans l’Oregon
Le suicide assisté est le fait de donner les moyens à quelqu’un de se suicider. On distingue l’assistance au suicide, qui est la fourniture d’un médicament létal, du suicide assisté avec accompagnement.
a) Le suicide assisté en Suisse
La Confédération helvétique prohibe l’euthanasie (art. 114 du code pénal). Elle interdit l’aide au suicide, sauf si cette aide est réalisée sans « mobile égoïste » (art. 115). Cette décriminalisation de l’aide au suicide a été utilisée par des associations comme Exit, Dignitas ou ADMD dans les années 2000 pour organiser des suicides assistés dans deux cantons, Vaud et le Valais, qui leur ont permis d’organiser leur activité (les cantons sont compétents en matière d’organisation du système de santé).
Le Tribunal fédéral, par un arrêt de principe du 3 novembre 2006 a affirmé le droit de chacun à décider de sa propre mort. Cependant, le Tribunal a précisé que conformément aux dispositions législatives, les produits létaux ne pouvaient être délivrés que sur ordonnance.
Actuellement, seuls deux cantons, Vaud et Valais, ont mis en place une procédure de suicide assisté. À l’initiative de l’association Exit, la loi cantonale de Vaud de 1985 devrait être modifiée très prochainement pour obliger les établissements de santé et médico-sociaux à accueillir les personnes qui souhaitent recourir au suicide assisté. Pour bénéficier de cette assistance en établissement, il faut que la personne qui demande l’assistance souffre d’une maladie grave et incurable et soit capable de discernement, que sa situation soit contrôlée par une équipe soignante et enfin, que des soins palliatifs lui aient été proposés. Cette disposition encadrera de manière plus stricte le recours au suicide assisté et exclura par conséquent le recours au suicide assisté en l’absence de maladie incurable, condition qui n’était pas posée distinctement auparavant.
Un médecin fait l’ordonnance du produit létal, l’accompagnant de l’association apporte ce médicament dans le lieu choisi par la personne qui souhaite mourir, et lui laisse une minute pour confirmer sa demande. La personne absorbe elle-même la substance létale.
Les associations Exit et ADMD n’acceptent que des citoyens suisses. Dignitas accepte les étrangers mais leur demande des frais très importants (notamment pour le rapatriement du corps).
Votre rapporteur estime que ce système connaît des dérives, dont certaines ont été médiatisées. Dans 30 % des cas, les personnes n’ont pas de maladie grave et incurable ; ce sont souvent des personnes âgées lasses de vivre.
b) L’assistance au suicide dans l’Oregon
L’État de l’Oregon a opté pour l’autorisation du suicide assisté par l’Oregon’s death with dignity act de 1997, demandé par référendum fin 1994 et validé par la Cour Suprême des États-Unis en 2006, et à nouveau confirmée par un référendum en 1997.
Cette loi permet au malade en phase terminale d’une maladie évaluée comme incurable, qui entraînera la mort dans les six mois, d’obtenir la prescription par un médecin d’une médication létale pour mettre un terme à sa vie, à condition que le malade puisse s’auto-administrer le produit.
Le patient doit être âgé de plus de 18 ans, être résident de l’État de l’Oregon et être capable de prendre la décision. La demande doit être formulée de manière orale par deux fois séparées de quinze jours au minimum et confirmée par écrit par deux personnes témoins n’ayant aucun lien familial avec le patient. Le patient doit bénéficier de la possibilité de revenir sur sa volonté à tout moment.
Un second avis médical est requis, et un troisième médecin doit vérifier que le patient ne souffre pas de dépression.
À la différence de nombreuses législations sur la fin de vie, une obligation de prévenir les proches pèse sur le médecin. La loi garantit également au médecin d’exciper la clause de conscience.
La loi ne requiert pas la présence du médecin au moment de l’ingestion du produit. La loi exige malgré tout une évaluation précise du médecin après le décès. À la suite de l’acte, une information administrative est effectuée auprès de l’autorité de santé, mais aucune enquête policière ne peut être ouverte.
L’assistance au suicide concerne une soixantaine de personnes par an et on estime qu’un tiers à la moitié des malades ayant reçu une prescription de produit létal ne l’utilise pas.
3. La plupart des pays qui ont légiféré ont une législation similaire au modèle français
La plupart des États européens ont adopté une législation assez proche de la nôtre.
En Allemagne, l’euthanasie est explicitement interdite par le code pénal, pour des raisons historiques : de 1939 à 1946, les nazis établirent le Programme Euthanasie (également appelé Programme T4) qui visait à exterminer les personnes atteintes de handicap physique ou mental accueillies dans les institutions spécialisées.
La loi fondamentale prévoit le droit du libre arbitre du patient. Le Bundestag a adopté en juin 2010 une loi sur le droit des patients en fin de vie qui prévoit la possibilité pour les patients d’écrire un « testament médical » qui consiste à faire connaître par écrit son souhait de poursuivre ou non l’acharnement thérapeutique. L’avis exprimé du patient prévaut sur tout avis médical et le droit allemand pénalise toute poursuite de traitement contraire à la volonté de la personne malade.
Pour être valable, le testament doit avoir été écrit par une personne capable d’exprimer sa volonté.
La loi permet de mettre un terme au traitement hospitalier si la personne se trouve en état de coma si elle en a exprimé la volonté au préalable. Dans ce cas spécifique, l’avis du médecin ne sera pas requis.
On estime entre 8 et 10 millions le nombre d’Allemands qui auraient rédigé actuellement un testament médical. Le professeur Sicard a estimé, lors de son audition, que le modèle allemand de directives anticipées était exemplaire.
Au Royaume-Uni, l’aide au suicide est passible de quatorze ans de prison. La législation a connu une évolution en 2002 à la suite de l’arrêt Pretty de la Cour européenne des droits de l’Homme du 29 avril 2002 qui affirme le droit des patients à renoncer à un traitement et ce, même si la décision risque d’entraîner la mort.
En Argentine, le droit des malades en fin de vie est régi par la loi de muerte digna du 5 mai 2012, très proche de notre législation. Le principe de l’autonomie de la volonté permet aux patients de refuser les soins en cas de maladie « irréversible, incurable et en phase terminale » et de renoncer à l’alimentation et l’hydratation. Cette loi interdit également l’acharnement thérapeutique. Si le patient se trouve en incapacité d’exprimer sa volonté, la famille a la possibilité de demander le renoncement aux soins en son nom. La loi a fait l’objet d’un très large consensus social lors de son adoption.
En Espagne, le gouvernement Zapatero avait déposé en juin 2011 un projet de loi très proche de la loi française du 22 avril 2005, qui n’a pas pu être adopté avant le changement de majorité. L’opposition socialiste a déposé le même texte sous forme de proposition de loi en décembre 2011, mais ce dernier a été rejeté le 26 juin 2012, le parti populaire s’y étant opposé au motif que le droit actuel était suffisant et qu’il s’agissait avant tout de développer la culture palliative. Les dispositions de cette proposition de loi sont similaires à celle de notre loi de 2005, si ce n’est que la volonté du malade prime sur celle du médecin pour demander une sédation profonde en fin de vie (article 11).
B. LES PISTES EXPLORÉES PAR DIFFÉRENTS RAPPORTS
L’annonce du dépôt d’un projet de loi par le Gouvernement et l’installation d’une commission de réflexion sur la fin de vie en France ont suscité des prises de positions de la part de plusieurs institutions. Ainsi, outre les conclusions du rapport de la commission présidée par le professeur Sicard, votre rapporteur analysera l’avis du Conseil national de l’ordre des médecins, celui de l’Académie nationale de médecine ainsi qu’une procédure particulière qui a été proposée dans le passé par le Comité consultatif national d’éthique, l’exception d’euthanasie.
Au préalable, votre rapporteur tient cependant à mettre en garde contre la tentation de centrer le débat sur l’euthanasie, alors que l’enjeu essentiel réside dans l’amélioration des conditions de la fin de vie. Ainsi, dans son avis sur le rapport Sicard, la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs remarque : « la focalisation sur l’euthanasie ou le suicide assisté pourrait faire occulter les autres propositions indispensables pour répondre aux enjeux soulevés par ce rapport. Une politique focalisée sur la création de nouveaux droits ne modifiera pas significativement les conditions du vivre et du mourir lorsque l’on est atteint d’une maladie grave ».
1. Les pistes étudiées par le rapport Sicard et ses conclusions
Après avoir étudié de façon approfondie les moyens d’améliorer l’accompagnement médical et humain de la fin de vie en France, et de mieux faire appliquer dans la lettre et dans l’esprit la loi de 2005, le rapport Sicard explore des « conduites non prévues par les lois relatives aux droits des malades en fin de vie » : l’euthanasie et le suicide assisté. Il recommande néanmoins de ne pas changer la législation actuelle – tout en en donnant une interprétation contestable en ce qui concerne l’usage de la sédation en phase terminale.
a) Le rapport Sicard écarte la légalisation de l’euthanasie
Le rapport de la commission de réflexion sur la fin de vie déplore une « évolution concernant la conception de la valeur de la vie humaine » dans la société « conduisant à ce qu’une vie ne soit considérée comme valable que lorsqu’elle est " utile ", quand la personne fait, agit, produit, voire est rentable ». Les malades incurables sont-ils libres devant l’euthanasie ou enfermés dans la vision négative qu’ils pensent renvoyer à la société ?
Le rapport met en garde le législateur contre la tentation de légiférer pour autoriser l’euthanasie, concluant : « l’euthanasie engage profondément l’idée qu’une société se fait des missions de la médecine, faisant basculer celle-ci du devoir universel d’humanité de soins et d’accompagnement à une action si contestée d’un point de vue universel. La commission ne voit pas comment une disposition législative claire en faveur de l’euthanasie, prise au nom de l’individualisme, pourrait éviter ce basculement ».
Enfin, le rapport Sicard souligne que jamais une loi ne pourra répondre à toutes les situations exceptionnelles, créant une limite claire et définitive, car « tout déplacement d’un interdit crée d’autres situations limites, toujours imprévues initialement et susceptibles de demandes réitérées de nouvelles lois ».
b) Il étudie la question du suicide assisté, sans se prononcer en sa faveur
Le rapport Sicard étudie de façon approfondie la question du suicide assisté sans se prononcer en sa faveur. Il s’étonne de la fascination que ces suicides exercent sur l’opinion.
En préalable, il insiste sur le fait que cette possibilité ne peut en aucune manière constituer une solution à l’absence de soins palliatifs ou d’accompagnement du malade.
Il y voit un avantage : lorsqu’elle est organisée comme dans l’Oregon, l’assistance au suicide a l’avantage d’apporter à celui qui obtient le médicament létal le soulagement de savoir qu’il peut l’utiliser en dernier recours, sans être tenu de le faire. Ainsi, dans cet État, près d’une personne sur deux qui l’obtient ne l’utilise pas.
Cependant, le professeur Sicard a souligné lors de son audition le 3 avril dernier que souvent, le suicide assisté révolte la famille de celui qui y recourt et qu’elle ne l’accompagne pas toujours.
En tout état de cause, le rapport souligne que le recours à l’assistance au suicide n’est envisageable qu’à condition que la personne soit suffisamment autonome pour accomplir elle-même l’acte ultime – à défaut, si le geste létal est administré par quelqu’un d’autre, il s’agit d’une euthanasie.
Pour le cas où le législateur choisirait de dépénaliser l’assistance au suicide, le rapport recommande l’exigence d’un certain nombre de conditions comme la demande explicite et réitérée du malade, le constat que le malade est en fin de vie par une équipe médicale collégiale, l’assurance que le malade a préalablement accès aux possibilités de soulagement de la souffrance physique et psychique, requérir la présence d’un médecin lors de l’agonie, l’objection de conscience des médecins et pharmaciens et la centralisation de l’information sur les cas de suicide assisté par une instance nationale.
c) Il privilégie le maintien de la législation actuelle en soulignant la nécessité de renforcer l’écoute du malade
En conclusion de son rapport, la commission Sicard souligne « l’exigence d’appliquer résolument les lois actuelles plutôt que d’en imaginer sans cesse de nouvelles ». Elle rappelle l’utopie de résoudre par une loi « la grande complexité des situations de fin de vie » et le « danger de franchir la barrière de l’interdit ».
Dans cet esprit, elle émet les recommandations suivantes :
– faire un effort majeur d’appropriation de cette loi par la société et par le personnel médical, notamment par des campagnes d’information à destination des premiers et des formations à destination des seconds ;
– consacrer les financements nécessaires au développement des soins palliatifs (pas seulement en unités de soins palliatifs mais aussi en équipes mobiles et en ville) – ce qui est possible par un redéploiement des ressources « d’un curatif disproportionné » ;
– accompagner l’annonce d’une maladie grave par un projet de fin de vie en fonction des choix de la personne.
Elle recommande aussi de prendre de nouvelles dispositions réglementaires d’application des lois relatives aux droits des malades (lois de 1999, 2002 et 2005), notamment sur les conditions d’information du malade et de ses proches sur les possibilités de limitation, d’abstention ou d’arrêt des traitements, sur les possibilités d’intensification du traitement de la douleur et sur la sédation terminale.
Le rapport insiste à plusieurs reprises sur la nécessité d’une volonté politique pour porter ce changement de mentalité : « Si un nouveau regard, heurtant les conformismes et les traditions, n’est pas porté par les pouvoirs publics, il n’y a aucune possibilité que les institutions médicales elles-mêmes proposent de leur propre chef, des changements dont elles ne mesurent pas l’importance sociale pour les citoyens » (17).
La commission fait des propositions concrètes sur les directives anticipées, la formation, l’exercice professionnel, les hôpitaux et établissements médico-sociaux, le domicile, l’accompagnement, la néonatalogie. Votre rapporteur vous invite à vous reporter au détail de ces propositions en annexe du présent rapport.
La commission propose en particulier de renforcer la valeur des directives anticipées en distinguant deux procédures :
– une première consisterait en la proposition par le médecin traitant à chaque patient, y compris lorsqu’il est en bonne santé, de rédiger des directives anticipées ; le ministère de la santé devrait formaliser un document s’inspirant d’exemples étrangers (les modèles suisse et allemand sont de bons exemples) ;
– une deuxième procédure concernerait les personnes chez lesquelles une maladie grave est diagnostiquée ; un document recueillerait les volontés du malade concernant sa fin de vie, il serait également signé par le médecin, si bien qu’il constituerait une sorte de contrat.
Ces deux types de documents devraient être conservés dans un fichier national informatisé.
Ainsi, l’amélioration de la fin de vie en France passe non pas par la création de nouveaux « droits » mais par la meilleure application des lois de 1999, 2002 et 2005. Dans l’analyse qu’il fait du rapport Sicard, Patrick Verspieren (18) estime : « Sans doute, parce que ces recommandations n’ont rien de spectaculaire, elles n’ont pas fait la Une des grands médias, mais c’est à leur mise en œuvre qu’on pourra juger de l’authenticité de la volonté politique d’améliorer les conditions de la fin de vie en France. Sans une telle volonté politique, elles resteront lettre morte ».
d) Le rapport propose une « sédation terminale » dans des cas exceptionnels
Enfin, la commission Sicard fait une recommandation particulière sur la pratique de la sédation, interprétant la loi de 2005 d’une façon assez contestable.
Ainsi, elle propose l’administration d’une sédation à but terminal : « Lorsque la personne en situation de fin de vie, ou en fonction de ses directives anticipées figurant dans le dossier médical, demande expressément à interrompre tout traitement susceptible de prolonger sa vie, voire toute alimentation et hydratation, il serait cruel de la « laisser mourir » ou de la « laisser vivre », sans lui apporter la possibilité d’un geste accompli par un médecin, accélérant la survenue de la mort ».
Pour la commission, cette possibilité ne nécessiterait pas de modifier la loi et pourrait s’inscrire dans l’acceptation du double effet de la sédation prévu par la loi de 2005, à travers l’édiction de recommandations de bonnes pratiques. Votre rapporteur met en garde contre l’extension de l’interprétation de la « sédation terminale », et répète que la sédation en phase terminale prévue par l’article L. 1110-5 du code de la santé publique vise à soulager le malade, en aucun cas à le faire mourir. Si l’on devait accepter cette double intentionnalité, soulager et accélérer la mort, le risque de confusion et de dérive existerait lors de la mise en place de toute sédation profonde en phase terminale.
Cependant, du fait de la modification du troisième alinéa de l’article 37 du code de déontologie médicale (art. R. 4127-37 du code de la santé publique) en 2010 (19), qui « oblige » le médecin à mettre en place un traitement sédatif et antalgique lorsque le malade ne peut exprimer sa volonté et qu’on arrête un traitement de survie, répond de fait à la double intention de soulagement du patient (traitement sédatif et antalgique) et d’accélération du décès (arrêt des traitements de survie).
2. La proposition du conseil national de l’Ordre des médecins
Après avoir insisté sur la nécessité de promouvoir la connaissance, l’accompagnement et l’application de la loi de 2005, l’avis du conseil national de l’ordre des médecins du 8 février 2013 aborde les situations exceptionnelles, « certaines agonies prolongées » ou « des douleurs psychologiques ou physiques qui, malgré les moyens mis en œuvre, restent incontrôlables ».
Une « sédation profonde et terminale » pourrait être proposée dans ces situations exceptionnelles, dans le cadre suivant :
– situation clinique exceptionnelle – lors de son audition, le docteur Legmann, président du conseil national de l’Ordre, a pris l’exemple de la maladie de Charcot où le malade est conscient et subit une dégénérescence ;
– phase terminale d’une maladie, avec soins palliatifs instaurés ;
– requête persistante, lucide et réitérée de la personne ;
– décision prise par une formation collégiale ; le docteur Legmann, a indiqué que ce collège devrait comprendre des soignants (médecins, infirmiers) mais aussi des personnes extérieures à la médecine comme un psychologue ou un magistrat.
Il s’agirait bien d’une autorisation de mettre intentionnellement fin à la vie du patient – d’ailleurs, le conseil national de l’Ordre prévoit que le médecin puisse se récuser en excipant d’une clause de conscience. En tout état de cause, la décision de transgresser l’interdit fondamental de donner la mort à autrui ne peut, pour le conseil national de l’Ordre, être prise par un seul homme.
Cette proposition est assez proche de la proposition du rapport Sicard puisqu’il s’agit aussi d’une sédation en phase terminale et à but terminal, mais sa portée est plus large : elle ne s’adresse pas qu’aux malades auxquels on interrompt un traitement de survie. Il lui est donc proposé un encadrement plus strict.
Dans son avis du 27 janvier 2000 (20), le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a proposé une procédure « d’exception d’euthanasie » pour des cas exceptionnels. Cette proposition a été écartée par le législateur en 2005, mais il est intéressant d’y revenir dans le contexte actuel.
Il ne s’agissait pas de créer un droit à recevoir la mort, ni de remettre en cause l’interdit de meurtre, la procédure n’ayant pas pour but d’empêcher l’ouverture d’une procédure judiciaire.
Cette proposition consistait à déresponsabiliser pénalement l’auteur de l’acte euthanasique a posteriori. L’autorité judiciaire réserverait un examen particulier à l’acte d’euthanasie qui lui serait soumis, appréciant les circonstances exceptionnelles et les conditions de réalisation de l’acte (demande réitérée du malade, compassion). Le juge resterait maître de la décision.
Utiliser la technique de vérification des conditions de l’irresponsabilité éventuelle pour permission de la loi, propre à notre droit pénal, serait préférable à la création d’une véritable autorisation de tuer.
Toutefois, votre rapporteur estime que cette procédure pose, malgré tout, des problèmes très importants, car elle ne peut être considérée comme une pure exception de procédure : il s’agit bien d’une exception de fond (21).
Par ailleurs, à vouloir en faire une exception à l’appréciation du juge, elle semble extrêmement large et les critères beaucoup trop flous.
Une autre procédure d’exception, cette fois a priori, a été proposée par M. Gaëtan Gorce dans la proposition de loi n° 2049 déposée à l’Assemblée nationale en novembre 2009. Il s’agirait de créer une commission que le médecin confronté à une demande d’euthanasie pourrait saisir afin qu’elle caractérise la situation à laquelle il est confronté. Selon l’exposé des motifs de la proposition, « La commission aura pour mission de caractériser la maladie, en particulier sa gravité, de constater l’absence de traitement susceptible de permettre une guérison ou une amélioration sensible ; de s’assurer de la conscience du malade et du caractère volontaire et réitéré de sa demande ; et d’indiquer s’il existe, ou non, une issue légale à celle-ci. L’avis de la commission sera, comme il a été indiqué, inscrit au dossier médical et pourra être utilisé, en cas de contestation de la légalité d’un acte qu’aurait pu être amené à pratiquer un médecin. Elle permettra au juge de vérifier si le médecin est intervenu en « état de nécessité », ce qui lui vaudra alors excuse absolutoire ». Cette procédure pose le problème de l’absence de recours contre les avis de cette commission.
C. LA PRÉSENTE PROPOSITION DE LOI PERMET DE RENFORCER LA VALEUR DE LA PAROLE DU PATIENT SANS FRANCHIR L’INTERDIT DE TUER
La réponse au problème de savoir « comment améliorer la fin de vie en France » réside avant tout dans l’accompagnement de celle-ci, et non dans la création d’un nouveau droit permettant de l’abréger, dont la discussion doit être dissociée. Sans remettre en cause l’équilibre des lois de 1999, 2002 et 2005, la présente proposition de loi permettrait de faire prévaloir la volonté du patient, dans les cas déjà prévus par la loi.
1. Maintenir la solidarité de la société face à la mort
Le débat sur la dépénalisation de l’euthanasie et du suicide assisté met en évidence deux philosophies : l’éthique de l’autonomie et l’éthique de la solidarité. La volonté individuelle doit-elle primer sur le devoir qu’a la société de protéger la vie de ses membres ? Passer d’un droit-liberté (droit de se suicider) à un droit-créance (droit à ce que la société nous fournisse les moyens de nous suicider) ne remet-il pas en cause le pacte social qui garantit la sécurité de chacun ?
Chacun a son idée de sa propre mort, en fonction de l’expérience qu’il a pu avoir de la mort de ses proches, mais il est question ici de notre conception collective, qui doit garantir la protection des plus faibles.
Or, le risque pour les plus faibles – les malades, les personnes très âgées – est qu’ils se sentent des poids pour leur entourage et souhaitent les en libérer. La création d’un « droit à mourir dans la dignité » ne ferait que renforcer la pression déjà subie par les mourants. On peut ainsi s’interroger sur la possibilité de garantir que les demandes d’euthanasie reposent réellement sur un choix libre. En outre, la notion de dignité est ambiguë. La dignité n’est-elle pas le propre de l’homme ? Doit-elle être liée à l’image que les malades pensent renvoyer d’eux-mêmes ? Le professeur Sicard s’est inquiété, lors de son audition, de la façon dont notre société traite les mourants, comme si l’attente de la mort était gênante pour les vivants.
Le mot « euthanasie » signifie étymologiquement « mort douce », mais il y a bien une forme de violence dans le fait de supprimer les derniers moments de la vie, qui peuvent avoir un sens pour le malade et pour ses proches, si la douleur et l’angoisse sont bien prises en charge.
Analysant les législations belge et hollandaise, le professeur Sicard a estimé, lors de son audition, que les pratiques constatées n’étaient pas choquantes en elles-mêmes, mais que le caractère radical de ces actes était « aux antipodes du vivre ensemble ».
La demande d’euthanasie peut cacher un appel à l’aide lié à la souffrance subie ou à l’angoisse de la fin de vie, qui appelle un renforcement de l’accompagnement médical et humain de la personne. Par ailleurs, les désirs de mort des malades sont fluctuants. Peuvent-ils fonder un acte irréversible ?
L’euthanasie peut constituer une solution de facilité, qui évite de s’interroger sur l’accompagnement de la fin de vie. Cela peut permettre une forme d’indifférence par rapport à l’agonie.
Sa légalisation risquerait de mettre fin aux réflexions en équipe à l’hôpital, mettant en cause le long travail déjà accompli sur la fin de vie par les médecins et les personnels soignants ces dernières années.
Enfin, tout en constituant une rupture majeure de l’ordre juridique et social, la légalisation de l’euthanasie ne concernerait qu’un nombre très faible de cas de fin de vie douloureuse. Les propositions avancées par les rapports précités portent sur la phase agonique : elles peuvent permettre au médecin d’abréger les jours d’un mourant par une sédation terminale. Cependant, en réalité, les demandes d’euthanasie concernent en réalité rarement cette phase de déficience des organes qui dure généralement trois à quatre jours. Comme l’a expliqué le professeur Régis Aubry lors de son audition, l’euthanasie est généralement demandée beaucoup plus « en amont » de la maladie. Ainsi se posera toujours la question des cas que la loi n’aura pas prévus et de l’assistance au suicide qui n’est pas obligatoirement liée à la médecine.
Votre rapporteur reprend les mots employés par le professeur Sicard en conclusion de son intervention devant les députés le 3 avril dernier : « notre fin de vie est celle des autres, il faut que l’on fasse en sorte, collectivement, qu’elle soit plus douce ». Par la présente proposition de loi, votre rapporteur souhaite associer la solidarité de la société au travers de la médecine en fin de vie et renforcer l’autonomie de la personne en grande vulnérabilité, écartant toute mort donnée par un acte médical.
2. La priorité est de garantir l’application de la loi
Tant le rapport Sicard que les avis du conseil national de l’Ordre des médecins, de l’Académie nationale de médecine et de l’Observatoire national de la fin de vie font de l’application de la législation actuelle – fruit des trois grandes lois de 1999, 2002 et 2005 sur les droits des malades – la priorité des priorités.
Cette préconisation avait déjà été faite en 2008 par la mission d’évaluation de la loi de 2005, et elle est toujours d’actualité.
En effet, si la législation sur les droits des malades et la fin de vie était correctement appliquée, la plupart des cas qui alimentent l’angoisse collective et les demandes de légalisation de l’euthanasie trouveraient une issue respectueuse de la volonté des malades comme de l’éthique.
L’application de la loi suppose à la fois de mieux la faire connaître et de consacrer les moyens nécessaires au développement des soins palliatifs.
a) Mieux faire connaître les dispositions législatives encadrant les décisions médicales
Le professeur Sicard a observé que dans le milieu médical, il n’y a pas de position commune ou de réflexion générale sur la fin de vie. Le sujet est laissé aux spécialistes des soins palliatifs.
Or, jusqu’à ce jour, la loi de 2005 n’a pas fait l’objet d’un engagement majeur des ministères concernés. Votre rapporteur souhaite que le ministère de la santé organise des campagnes de communication à destination des patients comme des soignants (en particulier les médecins généralistes) sur les droits des malades, les possibilités d’accompagnement et de soins palliatifs en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et à domicile.
Sur la question de la formation initiale et continue des médecins, votre rapporteur renvoie aux propositions formulées dans le rapport de la commission Sicard.
b) Développer les soins palliatifs à l’hôpital et à domicile
Beaucoup de demandes de légalisations de l’euthanasie sont liées à l’expérience de personnes qui ont vu leurs proches mourir dans de grandes souffrances, sans avoir été soulagés, soit que les soins nécessaires n’étaient pas disponibles, soit parce que les médecins étaient réticents à administrer les médicaments ou les doses de médicaments nécessaires.
Votre rapporteur recommande de développer la formation en soins palliatifs, pour que la pratique des soins palliatifs ne soit pas l’apanage des services de soins palliatifs – tout médecin peut pratiquer des soins palliatifs, y compris sédatifs, s’il a reçu la formation adéquate et s’il dispose des protocoles appropriés.
Il faut diffuser la culture palliative dans tous les domaines de la médecine. En effet, trop souvent les médecins opposent médecine curative et médecine palliative. Le soulagement de la douleur ne doit pas intervenir seulement quand on a abandonné l’espoir de guérir mais à tout moment de la maladie si nécessaire.
Enfin, pour permettre de mourir à domicile, ce qui correspond au souhait d’une majorité de nos concitoyens, il faut permettre l’accès aux soins palliatifs à domicile et la coordination avec les généralistes.
Les recommandations de la Société française de soins palliatifs (SFAP) 1. Répondre à l’inégalité d’accès aux soins palliatifs L’égalité de l’accès à des soins palliatifs de qualité (équité territoriale, en fonction de son lieu de vie, de sa maladie, de sa situation administrative) pour tous les patients nécessite un effort important de santé publique et une définition précise des priorités. On peut retenir parmi les axes majeurs ; • Améliorer l’accès des soins palliatifs au domicile • Améliorer l’accès des soins palliatifs dans les établissements médico-sociaux (axe prioritaire) • Intégrer plus précocement la démarche palliative dans le parcours du patient Cette politique volontariste devra s’inscrire dans la continuité du comité national de suivi du développement des soins palliatifs et de l’accompagnement afin d’évaluer en permanence les avancées réalisées et permettre les réorientations nécessaires. 2. Adapter les filières de soins aux patients atteints de maladies graves en élaborant un vrai parcours de soins à leur intention En ce qui concerne les structures hospitalières, l’enjeu est « le développement absolument nécessaire d’une culture palliative et l’abolition de la frontière entre soin curatif et soin palliatif ». Le système de soins devrait se réformer avec la nécessité de « passer de logiques structurelles à des logiques fonctionnelles ». L’important est de construire « une médecine de parcours ». Il faut travailler à la cohérence du parcours de soins ; car c’est parfois plus au patient de s’adapter aux dispositifs et à l’organisation des soins que l’inverse. Il faut articuler les structures de soins palliatifs et territoires de santé par un dispositif territorial coordonné des soins palliatifs (travail en réseau) pour une meilleure complémentarité et utilisation des ressources. Il ne s’agit pas d’idéaliser cette articulation entre les structures mais de tenir également compte des réalités de terrain et des capacités de chacun des acteurs (médecin traitant, équipe mobile, réseau, services de soins infirmiers à domicile, infirmières libérales avec la nouvelle lettre clé pour la coordination…) de pouvoir jouer ce rôle de coordination. Pour mettre en œuvre cette mutation dans les hôpitaux, une mise en œuvre précoce de la démarche palliative dans le parcours de soins du patient est indispensable. Cela passe par l’intégration d’acteurs de soins palliatifs dans les consultations de suivi, les hôpitaux de jour, les réunions interdisciplinaires de cancérologie etc. 3. Améliorer les pratiques de soins par : • L’élaboration de référentiel de pratique en lien avec la Haute Autorité de santé (HAS) La commission Sicard sollicite celle-ci afin qu’elle fasse des « recommandations de bonnes pratiques en soins de support et en soins palliatifs avec la même exigence qu’en soins curatifs ». La SFAP s’inscrit depuis des années dans une telle dynamique qu’elle souhaite poursuivre. Les questions à traiter gagneraient à être définies par l’ensemble des professionnels de santé concernés par la fin de vie mais aussi par les usagers de santé et leurs représentants. • La promotion d’une démarche d’évaluation des pratiques professionnelles La qualité des soins dans les établissements de santé, les réseaux, le secteur libéral dépend de nombreux facteurs dont la qualité des pratiques professionnelles. Évaluer cette qualité doit constituer une exigence pour chaque intervenant (salarié, libéral ou bénévole). • La promotion d’une démarche d’évaluation qualitative des structures Au-delà des évaluations chiffrées et afin d’éviter un enfermement possible des structures de soins palliatifs sur elle-même, il est indispensable de mettre en œuvre une véritable évaluation qualitative de ces services en créant une dynamique d’autoévaluation qualitative dans une visée d’amélioration des pratiques sur un principe « d’audits croisés » associant des professionnels des structures de soins palliatifs et des représentants des tutelles. 4. Penser le redéploiement des ressources financières La commission Sicard préconise « un redéploiement des ressources d’un curatif disproportionné par ses excès et trop peu interrogés » La SFAP a déjà des propositions concrètes à faire dans ce sens : • Aujourd’hui, la description de l’activité palliative dans les établissements n’est que partielle. Elle ne permet pas d’avoir ni même d’approcher une véritable évaluation quantitative ou qualitative de l’activité en soins palliatifs ni une description correcte des patients. Voici quelques pistes : – réfléchir à l’utilisation de modèles de description et de valorisation déjà existants (type réanimation ou infection ostéo-articulaire) – utiliser une forme de valorisation par bonus pour un service donné ou un établissement donné en fonction d’un indicateur (type indicateur pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins de la HAS). • Le modèle actuel de financement à l’activité valorise plus les actes que la réflexion. Les hôpitaux sont essentiellement structurés sur des logiques scientifiques, curatives et financières, qui conduisent à la production d’actes médico-économiques. Or les nouveaux défis médicaux ne se réduisent pas au développement de nouvelles techniques prolongeant l’existence. Il s’agit aussi de délibérer sur la pertinence d’utiliser ou non ces techniques vu l’incertitude sur la qualité et le sens de la vie ainsi prolongée et de répondre à la crainte exprimée par les citoyens de subir un acharnement thérapeutique. – Associer par exemple un codage aux limitations et arrêts de traitements et en faire un diagnostic associé – Création d’un indicateur qualitatif pour valoriser la collégialité, l’intervention d’un tiers (équipe mobile, confrère…) Dans ce débat nécessairement public, il ne s’agira pas d’opposer une médecine curative à une médecine palliative mais de créer le lien nécessaire à ces deux approches. 5. Une vraie politique de formation médicale à la démarche palliative La commission Sicard dénonce à juste titre les lacunes constatées dans le champ de la formation médicale en soins palliatifs. Bien que des progrès soient constatés depuis quelques années, ils sont encore modestes et varient selon les facultés. On reste dans une stratégie à minima. Ainsi, dans le cadre de la réforme actuelle des études médicales, les items relatifs aux soins palliatifs demeurent très limités. Malgré les propositions répétées émanant du Collège national des enseignants en soins palliatifs (CNEFUSP), il n’existe pas de visibilité des soins palliatifs. Leur enseignement s’inscrit peu dans une continuité. Leur insertion ne se fait pas de manière transversale dans les disciplines concernées. Enfin, l’objectif n’est pas uniquement le renforcement de la formation en soins palliatifs. C’est aussi le développement d’une réflexion continue sur les pratiques médicales en s’appuyant sur les sciences humaines et sociales. La formation médicale gagnerait à s’extraire d’une focalisation excessive sur une compétence technoscientifique pour favoriser conjointement l’apprentissage des compétences relationnelles, éthiques, coopératives, nécessaires à la pratique médicale actuelle. Là encore, les propositions faites sont un appel aux responsables universitaires et politiques afin qu’ils ne se limitent pas au colmatage des carences actuelles. Les responsables pédagogiques en soins palliatifs ne pourront participer à cette mutation sans renforcement de leurs moyens et appuis politiques. |
Source : Société française d’accompagnement et de soins palliatifs, Analyse du rapport Sicard, 2013.
3. La présente proposition de loi s’inscrit dans la continuité des lois de 1999, 2002 et 2005 en renforçant la parole du patient
S’inspirant des propositions du rapport Sicard et de son propre constat sur le fait que la volonté des patients n’est pas suffisamment prise en compte par les médecins, votre rapporteur souhaite modifier deux articles de la loi de 2005, tout en restant dans l’esprit des lois actuelles.
La présente proposition de loi comporte deux articles, l’un créant un droit à la sédation en phase terminale, l’autre permettant de rendre opposables les directives anticipées au médecin sous certaines conditions.
a) Créer un droit à la sédation en phase terminale (article 1er)
L’objectif de la sédation en phase terminale ne doit pas changer : il s’agit de soulager le malade autant qu’il le souhaite, au risque d’accélérer la mort (double effet de la sédation), en particulier si la sédation est mise en place à la suite de l’arrêt d’un traitement de survie. La sédation n’est pas destinée à provoquer la mort du patient. On peut le résumer par la formule suivante : « faire dormir avant de mourir, et non pas faire dormir pour faire mourir ».
Ce qui change, c’est le droit du patient d’exiger qu’on le plonge dans une sédation profonde lorsque les conditions prévues par l’article L. 1110-5 du code de la santé publique sont réunies.
Votre rapporteur s’est également inspiré de l’article 11 du projet de loi espagnol relatif aux droits de la personne en fin de vie, déposé en 2011 par le Gouvernement Zapatero et repris sous forme de proposition de loi par l’opposition socialiste après l’alternance – ce texte est par ailleurs extrêmement proche dans son esprit et dans sa lettre de la loi du 22 avril 2005.
Cette proposition est conforme aux recommandations de la Société française de soins palliatifs.
b) Rendre les directives anticipées opposables au médecin (article 2)
Dans le même esprit, l’article 2 reprend la proposition du rapport Sicard concernant les directives anticipées. Lorsqu’elles prennent la forme d’un contrat entre le malade et le médecin, elles sont opposables au médecin, comme c’est le cas dans la législation allemande par exemple.
Lors de son audition, le professeur Régis Aubry a estimé qu’il était impensable qu’un médecin ne prenne pas en compte les directives anticipées, et que s’il devait prendre une décision qui ne s’y conforme pas, il devait le justifier par écrit. Votre rapporteur prévoit deux exceptions dans lesquelles le médecin n’est pas obligé d’accéder à la demande de sédation en phase terminale formulée dans les directives anticipées du patient inconscient : en cas d’urgence et lorsque les directives ont été rédigées dans un contexte de pathologie psychiatrique.
La mise en œuvre des directives anticipées de manière collégiale en garantit l’application conforme à la loi.
Pour une explication plus détaillée de ces propositions, votre rapporteur vous renvoie aux commentaires d’articles du présent rapport.
La Commission examine, sur le rapport de M. Jean Leonetti, la présente proposition de loi au cours de sa séance du mercredi 17 avril 2013.
Mme la présidente Catherine Lemorton. L’ordre du jour appelle l’examen de plusieurs propositions de loi, que le groupe UMP a choisi d’inscrire dans sa niche parlementaire du 25 avril prochain. Nous commençons par celle de M. Jean Leonetti visant à renforcer les droits des patients en fin de vie.
Je tiens à indiquer au préalable que, comme le souhaitait le rapporteur, j’ai donné l’autorisation pour que les auditions qu’il a organisées le 3 avril soient retransmises sur le réseau de télévision intérieure et sur le site Internet de l’Assemblée nationale, où elles peuvent encore être regardées.
Par ailleurs, je rappelle amicalement au rapporteur, qui s’est permis d’envoyer par SMS des convocations à ses auditions, que ce mode de communication n’est pas dans les usages de la Commission et doit donc être proscrit à l’avenir.
M. Jean Leonetti, rapporteur. Je vous remercie, madame la présidente, d’avoir donné cette autorisation.
En 2005, à la suite de l’affaire Humbert, nous avons voté une loi relative aux droits des malades et à la fin de vie.
Mais, en 2008, l’incompréhension d’un certain nombre de médecins vis-à-vis de l’arrêt des traitements et de l’arrêt des soins concomitant a conduit à faire plusieurs modifications, notamment de l’article 37 du code de déontologie. Désormais, lorsqu’on arrête des traitements maintenant en vie et que le malade est cérébralement dans l’incapacité de répondre, il est obligatoire de procéder à une sédation profonde avec des traitements sédatifs et antalgiques appropriés.
Puis, lors de la campagne pour l’élection présidentielle, la proposition 21 du candidat François Hollande a suscité un débat et donné lieu à diverses interprétations. Mais avant son élection comme après, ce dernier a indiqué qu’il était opposé à l’euthanasie et que sa proposition cherchait à renforcer la sécurité des malades en respectant leur dignité et en leur proposant un accompagnement médical.
Il a chargé le professeur Didier Sicard de recueillir l’avis des citoyens sur cette question. Le rapport rendu par ce dernier consiste d’abord à évaluer les diverses possibilités. Il envisage notamment d’améliorer la loi sur deux points : la sédation en phase terminale et les directives anticipées. Il évoque aussi, sans la prôner, la possibilité de recourir au suicide assisté plutôt qu’à l’euthanasie.
Il indique par ailleurs avec force qu’avant d’élaborer des lois nouvelles, il vaudrait mieux appliquer les lois en vigueur de 1999, 2002 et 2005. Il constate en effet que celles-ci sont inappliquées et mal connues du public et du corps médical.
Le Président de la République a souhaité en outre avoir l’avis du Comité consultatif national d’éthique (CCNE), qui s’est déjà prononcé plusieurs fois sur ce sujet. C’est la raison pour laquelle j’ai demandé à entendre le professeur Régis Aubry, qui, lors de son audition, a conforté la position et les propositions du professeur Sicard.
De plus, un rapport de l'Institut national d'études démographiques (INED) et de l’Observatoire national de la fin de vie a fait un état des lieux de la fin de vie en France en la comparant à celle prévalant dans d’autres pays européens, notamment ceux ayant légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté. Il comporte aussi des éléments de comparaison avec ce qui existe outre-Atlantique, dans l’Oregon.
J’ai moi-même estimé que la loi était peu efficiente sur la phase terminale de la fin de vie notamment. Une étude du docteur Édouard Ferrand disait notamment que 30 % de nos concitoyens continuent à mourir dans la souffrance, sans traitement sédatif ou antalgique visant à les calmer. L’avis du Conseil national de l’ordre des médecins de février 2013 va même plus loin en proposant la sédation comme moyen d’alléger la souffrance, mais aussi de raccourcir la vie et de diminuer la longueur de l’agonie.
La proposition de loi que je vous propose comporte deux articles, le premier sur la sédation terminale, et le second sur les directives anticipées. Il s’agit de rendre les demandes des malades opposables et de faire en sorte qu’elles ne relèvent pas du libre arbitre du médecin.
Nous savons en effet que si certains médecins mettent en place les directives anticipées ou la sédation terminale telle qu’elle est prescrite dans la présente proposition de loi, d’autres, dans certains cas, ne le font pas, par manque de formation ou en raison d’une culture médicale ancienne.
Le rapport Sicard a d’ailleurs distingué deux types de directives anticipées : celles – larges – données par des personnes bien portantes ; celles délivrées par des personnes malades qui, après un entretien avec leur médecin, passent un contrat moral sur ce qu’elles souhaitent. Ce contrat pourrait dès lors devenir opposable et mis en place par une instance collégiale qui vérifierait que les propositions contenues dans les directives sont conformes à la loi.
Nous savons également qu’une sédation en phase terminale peut parfois allonger la durée de vie, le plus souvent la diminuer ou, dans certains cas, ne pas avoir d’effet sur elle.
Or l’objectif de cette proposition de loi est de soulager le malade lorsque les moyens actuels – sédatifs, antalgiques ou soins palliatifs – n’ont pas réussi à calmer la souffrance. Il paraît en conséquence logique que celui-ci puisse demander cette sédation, qui permettrait ainsi de dormir avant de mourir, et non de faire mourir en faisant dormir.
Cette proposition de loi s’inscrit donc dans le cadre des propositions du professeur Sicard, validées par celles du Conseil national de l’ordre des médecins et l’audition de Régis Aubry, qui rapportera dans quelques jours l’avis du Comité consultatif national d’éthique sur les trois sujets sur lesquels le Président de la République a souhaité saisir ce dernier : les directives anticipées, la sédation terminale et le suicide assisté.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Avez-vous des éléments permettant de combattre l’idée reçue selon laquelle on ne pourrait pas soulager la douleur, malgré l’avancée de la pharmacologie sur les produits ?
M. le rapporteur. En phase terminale, il existe souvent un conflit entre des médecins utilisant des doses jugées suffisantes parce qu’à la limite de la toxicité théorique et des malades continuant à souffrir et confrontés aux réticences du corps médical à augmenter les doses.
La loi de 2005 a là aussi été mal comprise : en fin de vie, la qualité de la vie prime sur sa durée ; elle justifie donc un traitement approprié. On doit ainsi fixer la dose de morphine pour obtenir l’absence de douleur ou son atténuation, et non en fonction des prescriptions du dictionnaire Vidal selon le poids du malade – quelquefois celui-ci résiste d’ailleurs à des doses très importantes. Il en est de même pour la sédation, qui tend plutôt à remédier à la souffrance morale et doit être dosée de manière à faire disparaître l’angoisse, même si c’est au prix d’une diminution de la vigilance, qui peut aller jusqu’à l’endormissement ou l’anesthésie générale.
Ce droit à l’absence de douleur est le fondement de la loi de 2005, dont les deux autres piliers sont le non-abandon et le non-acharnement thérapeutique.
Mme Bernadette Laclais. Cette proposition de loi aborde un sujet particulièrement délicat, complexe et douloureux.
Si, au nom du groupe SRC, je m’interroge sur le calendrier d’examen de ce texte, j’apprécie le travail qui a été fait sous d’autres gouvernements, lequel a permis de déboucher sur le vote unanime de la loi de 2005. Je salue également les compléments apportés à celle-ci en 2008, mais aussi en 2010, avec la mise en place de l’Observatoire national de la fin de vie, la loi du 2 mars 2010 instaurant une allocation journalière d’accompagnement, les modifications des procédures de limitation ou d’arrêt des traitements, ou l’introduction de la sédation dans le code de déontologie médicale dans certains cas particuliers. De même, a été mis en place le programme de développement des soins palliatifs.
Mais les lacunes de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie sont largement mises en exergue et le débat sur le droit de mourir dans la dignité ou de choisir sa mort est régulièrement relancé dans l’opinion publique.
C’est la raison pour laquelle le Président de la République a confié au professeur Sicard la mission d’évaluer cette loi dans le cadre d’une réflexion plus globale sur la fin de vie.
Cette mission a abouti à un rapport, intitulé « Penser solidairement la fin de vie », rendu public le 18 décembre 2012. Elle constate, entre autres, que la loi de 2005 reste aujourd’hui encore imparfaitement appliquée et parfois méconnue. Elle note en particulier que le développement de la prise en charge palliative des malades en fin de vie est insuffisant. Elle met notamment en cause l’absence de formation spécifique des médecins et un trop grand cloisonnement entre les structures de soins curatifs et celles de soins palliatifs – ce qui empêche la diffusion de la culture de la prise en charge de la douleur.
Le Président de la République a ensuite saisi le Comité national consultatif d’éthique sur trois pistes d’évolution ouvertes par ce rapport : comment et dans quelles conditions recueillir et appliquer les directives anticipées concernant la fin de vie émises par une personne en pleine santé ou à l’annonce d’une maladie grave ? Selon quelles modalités et conditions strictes permettre à un malade conscient et autonome atteint d’une maladie grave et incurable d’être accompagné et assisté dans sa volonté de mettre lui-même un terme à sa vie ? Comment rendre plus dignes les derniers moments d’un patient dont les traitements ont été interrompus à la suite d’une décision prise par ce dernier, sa famille ou les soignants ?
Si cette proposition de loi fait écho à certaines attentes, elle n’aborde pas toutes les facettes de la problématique. Elle est aussi incomplète au regard du constat partagé par de nombreux acteurs sur l’insuffisance de la culture palliative et de la formation des professionnels de santé.
Si l’on peut comprendre, monsieur le rapporteur, que vous souhaitiez améliorer la loi de 2005, nous nous étonnons de la précipitation avec laquelle vous présentez ce texte – vous qui avez prôné le débat serein et approfondi, qui a abouti à la loi de 2005. Cette précipitation explique peut-être d’ailleurs les oublis que je viens d’évoquer.
Que l’on soit pour ou contre l’idée de pouvoir bénéficier d’une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité, telle est bien la question qui nous est posée par nos concitoyens et les associations. Les débats doivent avoir lieu même si chacun a le droit d’avoir un point de vue différent sur ce sujet, qui ne relève pas d’un choix politique.
Le Président de la République s’est engagé à ce qu’un projet de loi soit présenté en la matière. L’avis du Comité national consultatif d’éthique est attendu pour la mi-juin : il ne nous paraît donc pas envisageable de légiférer avant sa publication.
Pour toutes ces raisons et parce qu’une proposition de loi ne nous semble pas le véhicule législatif approprié pour une question aussi sensible et importante, alors qu’un projet de loi englobant la totalité de la problématique – y compris les questions de formation et de soins palliatifs – doit être déposé, nous ne nous associerons pas au vote de ce texte.
M. Jean-Pierre Door. Il ne faut pas prendre au premier degré les SMS envoyés par le rapporteur : il était dans l’intérêt de tous que nous puissions assister à ces auditions, sachant qu’à la même heure, il y avait d’autres débats dans d’autres salles de l’Assemblée.
Mme la présidente Catherine Lemorton. C’est une question de forme. Cela ne s’est jamais fait et ne doit pas se reproduire.
M. Jean-Pierre Door. Après l’adoption de la loi de juin 1999, qui garantissait le droit à l’accès aux soins palliatifs, et de celle du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, celle du 22 avril 2005, dite Leonetti, a défini les spécificités de la réglementation française autour de la fin de vie. Elle interdit tout acharnement thérapeutique : il faut obliger les médecins à se conformer à la volonté du patient et de la famille de mettre fin à un traitement.
Cette loi, qui respecte le double objectif de non-abandon et de non-souffrance, au cœur de la problématique de la demande de mort, affirme en effet qu’en fin de vie, la qualité de celle-ci prime sur sa durée. Elle s’est accompagnée d’un plan volontariste de développement des soins palliatifs : les unités spécialisées se sont développées et, en dix ans, on est passé de 300 à 5 000 lits.
Ce texte fondateur et équilibré est encore mal connu, ce qu’a rappelé le rapport Sicard, qui a par ailleurs démontré la nécessité de renforcer la formation du personnel soignant et l’information des citoyens sur cette loi encore trop peu appliquée.
Cette proposition de loi permet à notre groupe de réaffirmer les valeurs que nous défendons autour de cette question difficile. Il faut tout faire pour accompagner les personnes en fin de vie et soulager leur souffrance. Mais aller au-delà serait contraire à notre conception de la dignité de l’être humain et du respect de la vie, car cela reviendrait à instaurer un véritable droit à la mort.
Il convient en revanche de soulager la quasi-totalité des souffrances que peut avoir chaque patient en fin de vie. C’est la raison pour laquelle il est proposé de créer un nouveau droit pour le malade de demander une sédation. Si la définition de celle-ci fait l’objet d’un consensus dans le domaine de l’anesthésie et de la réanimation, il n’en est pas de même dans le champ de la médecine palliative : il faut donc bien différencier une sédation terminale d’une sédation en phase terminale. La décision devra être collégiale. La Société française d’accompagnement et de soins palliatifs l’a définie comme la recherche par des moyens médicaux de diminuer la vigilance, pouvant aller jusqu’à la perte de conscience.
Si cette pratique peut avoir pour effet secondaire d’accélérer la fin de vie, elle n’est pas mise en place pour cela, mais seulement pour soulager la souffrance. Il s’agit donc d’un double effet et non d’une pratique d’euthanasie.
Le rapport Sicard a montré combien les directives anticipées, qui permettraient de mieux prendre en compte la volonté du patient, sont peu utilisées dans notre pays. Il faut donc aller plus loin, comme le propose cette proposition de loi, que nous suggérons de soutenir.
Je ne comprends pas pourquoi la majorité actuelle reste au bord de la route sur ce sujet fondamental, qui intéresse toutes les familles : il n’y a pas lieu d’attendre d’autres textes, d’autant que l’encombrement législatif est important. J’invite donc à voter en faveur de cette proposition de loi.
Mme Véronique Massonneau. Je suis, au nom du groupe écologiste, profondément troublée, pour ne pas dire choquée, monsieur le rapporteur, par la façon dont vous avez conduit les auditions sur votre proposition de loi. Sur un sujet tel que celui-ci, n’avoir entendu que des intervenants corroborant votre position est inapproprié. Des avis contradictoires auraient été primordiaux. Or le seul point de vue contradictoire que nous avons pu constater est celui des médecins sur les effets des traitements à visée sédative, certains affirmant qu’ils peuvent être assimilés à une aide à mourir, d’autres réfutant cette théorie – ce qui a eu pour conséquence de jeter un trouble sur cette pratique.
S’agissant de la proposition de loi, je suis tout à fait favorable à la légalisation de l’euthanasie active et du suicide assisté.
Par mon histoire personnelle en Belgique, j’ai pu me rendre compte des bienfaits de l’autorisation de ces pratiques et de l’intérêt de disposer, grâce à l’aide active à mourir, d’un climat apaisé dans cette période douloureuse qu’est la mort.
Je ne doute pas, monsieur le rapporteur, que vous souhaitiez aussi que la fin de vie soit la meilleure possible, mais alors que vous vous situez dans la position du médecin, je me place dans celle des patients.
Le texte que vous nous proposez n’apporte rien à la loi de 2005, si ce n’est une reformulation. Les conclusions du rapport Sicard mettent en effet en avant une méconnaissance de celle-ci : vouloir mieux l’appliquer et la faire connaître ne me choque donc pas. Mais je considère que l’euthanasie active, le suicide assisté et les soins palliatifs ne sont pas contradictoires : chacune de ces pratiques apporte une réponse différente à la question de la fin de vie ; je prône la liberté de choix.
Elles sont d’ailleurs si peu contradictoires que la légalisation de l’euthanasie en Belgique n’a pas empêché l’amélioration et le développement de ces soins.
Plutôt que de se limiter à une simple explication de texte sur les traitements sédatifs, n’aurait-il pas été plus opportun de se pencher sur l’un des sujets qui posent un réel problème d’application, à savoir la personne de confiance ? J’aurais aimé voir des propositions concrètes pour clarifier son statut.
Lors de sa réception par le groupe d’amitié France-Belgique, l’ambassadeur de Belgique en France m’a confirmé hier le soulagement avec lequel la population belge a accueilli la légalisation de l’euthanasie.
Or refuser l’aide active à mourir est symbolique d’une forme de frilosité. On a pu mesurer celle-ci lors de l’examen, le 28 mars dernier, de la proposition de loi de nos collègues du groupe RRDP sur la recherche sur l’embryon, qui a suscité l’obstruction du groupe UMP. Vous aviez alors brandi l’argument selon lequel une niche parlementaire n’était pas propice pour traiter de sujets aussi importants. Est-ce à dire, monsieur le rapporteur, que la fin de vie n’est pas un sujet important ?
J’ai donc déposé plusieurs amendements permettant au moins de discuter du fond du sujet.
Je m’interroge enfin sur le calendrier d’examen de cette proposition de loi, le Gouvernement ayant annoncé un projet de loi pour cette année. Je n’ose penser que vous avez essayé de lui couper l’herbe sous le pied !
Pour toutes ces raisons, je voterai contre cette proposition de loi.
M. Bernard Perrut. Comme cela vient d’être rappelé, la loi de 2005 respecte en effet le double objectif, auquel nous sommes attachés, de non-abandon et de non-souffrance, et permet de faire en sorte que la qualité de la vie prime sur sa durée.
On peut se demander pourquoi ce texte fondateur n’est pas assez connu et si la formation du personnel médical est suffisante à cet égard.
Reste que le rapporteur, en s’appuyant sur le rapport Sicard, qui ne juge pas nécessaire de légiférer à nouveau, nous permet, au travers de sa proposition de loi, de réaffirmer nos valeurs.
Il s’agit d’un sujet difficile car on sait bien qu’il n’est pas toujours possible de soulager toutes les souffrances. Aussi est-il proposé à l’article 1er de créer ce nouveau droit pour le patient à demander une sédation.
On peut certes s’interroger sur la définition de la sédation, qui, comme cela vient d’être rappelé, fait l’objet d’approches diverses ; il y a lieu de distinguer en effet la sédation terminale de la sédation en phase terminale.
S’agissant des directives anticipées évoquées par la proposition de loi, qu’est-il prévu lorsque le malade n’est pas conscient ? Comment le médecin est-il amené à intervenir ? Dans quelle mesure lui serait-il possible de pratiquer la sédation en liaison avec les autres médecins, la famille et les personnels soignants ?
M. Gérard Sebaoun. Le malade en fin de vie entreprend une longue marche pour se réapproprier sa mort lorsque sa conscience, dûment éclairée et exprimée, le lui permet. Le législateur a cherché à l’accompagner depuis les années 1970 avec le travail d’Henri Caillavet, de Roger-Gérard Schwartzenberg en 1999, de notre rapporteur en 2005 et, plus récemment, en octobre 2009, la proposition de loi du groupe SRC sur le droit de finir sa vie dans la dignité. Je note d’ailleurs qu’à l’alinéa 2 de l’article 8 de ce texte, a été utilisé le mot tabou d’euthanasie, qui signifie en grec « la mort douce ».
Puis, comme l’a rappelé Bernadette Laclais, le Président de la République a pris des engagements dans le cadre de sa proposition 21 lors de la campagne électorale.
La présente proposition de loi ne répond pas à mon sens à la question fondamentale. Un patient incurable, victime d’un cancer, d’une maladie neurodégénérative ou vasculaire invalidante et grave, a-t-il le droit d’exiger d’être médicalement assisté pour mettre un terme à une vie devenue insupportable ? À cette question essentielle, je réponds oui.
Ce texte reprend la terminologie de la loi de 2005, à savoir l’administration d’un traitement sédatif qui peut avoir comme effet secondaire d’abréger la vie. Or je ne crois pas que la mort puisse être un effet secondaire particulier : elle est indissociable de la vie et lorsqu’un de nos semblables considère en conscience que ses souffrances sont insupportables, j’estime que le législateur a le devoir de lui apporter une réponse en permettant au couple soigné-soignant de choisir l’heure et le lieu de sa mort.
M. Rémi Delatte. Nous avons la chance d’avoir, en la personne de notre rapporteur, à la fois un grand expert de ces questions et quelqu’un de mesuré.
Depuis la loi de 2005, l’opinion des Français a évolué et leur demande s’est affinée : ils souhaitent pouvoir mourir dans la sérénité, hors de toute souffrance physique ou psychologique inutile.
Si cette loi permet globalement de répondre à leurs attentes, elle est en effet trop méconnue du corps médical et des citoyens.
La présente proposition de loi nous permet de réaffirmer notre rejet de l’euthanasie active, à l’heure où une majorité de Français attend le développement des soins palliatifs. Selon un sondage Ipsos, près de neuf Français sur dix estiment que ceux-ci permettent aux personnes gravement malades de vivre le plus sereinement possible leur fin de vie dans la dignité. Mais près de deux sur trois ont le sentiment d’être mal informés sur ces soins.
À cet égard, j’attire votre attention sur le fait que s’est achevé le programme de développement des soins palliatifs 2008-2012. Fort de 230 millions d’euros, il présente pourtant un bilan très positif.
Or il n’y a pas de nouveau plan et aucune perspective n’est ouverte par le Gouvernement pour poursuivre le développement de cette prise en charge voulue par les Français.
Par ailleurs, grâce à la reconnaissance par la Haute Autorité de santé de la définition de la sédation en phase terminale, la pratique peut évoluer. L’article 1er de la proposition de loi nous permet de reconnaître cette évolution. Ainsi, le corps médical ne se trouvera plus confronté au risque juridique que comporte cet acte médical, qui n’est pas banal et qui a un véritable retentissement sociétal.
M. Olivier Véran. La fin de vie constitue un sujet à la fois délicat et fondamental, tant nous sommes tous interpellés par la souffrance – morale ou physique – et l’agonie. Votée à l’unanimité, la loi de 2005 – qui porte votre nom, monsieur le rapporteur – a constitué une avancée, couvrant en théorie l’immense majorité des situations vécues par les malades et les professionnels du soin. En pratique pourtant, son application est loin d’être satisfaisante. En tant que neurologue et hospitalier, j’ai à plusieurs reprises fait l’expérience de l’ambivalence inhérente au décalage entre les besoins exprimés par les patients et les solutions effectivement mises en œuvre. S’il s’agit d’un problème d’information, comment peut-on y remédier tant du côté des professionnels que de celui des patients ? Sinon, comment l’expliquer ?
La question de la fin de vie, qui préoccupe la société depuis de nombreuses années, devrait bientôt faire l’objet d’un débat dans cette Assemblée, conformément au souhait du Président de la République. La douleur, l’acharnement thérapeutique, la limite du soin, les directives anticipées constituent autant de sujets qui exigent réflexion, concertation et engagement – ce qui explique la saisine du Comité consultatif national d’éthique (CCNE). C’est pourquoi, monsieur Leonetti, je m’étonne de votre empressement à présenter une proposition de loi, alors que cette question mérite une place bien plus importante dans l’agenda public. Il y a trois semaines, vous vous opposiez sur la chaîne LCP à la proposition de loi portant sur la recherche sur les cellules souches embryonnaires, arguant du fait que le Conseil consultatif national d’éthique n’avait pas été sollicité en amont. Aujourd’hui, sur un sujet aussi fondamental que la fin de vie, vous souhaitez vous passer de son avis, anticipant sur ses conclusions. Votre démarche manque de précaution, de concertation et de cohérence ; si nul ne remet en cause ni la qualité de votre travail ni votre engagement – à la fois comme professionnel du soin et comme élu –, vous ne pouvez pas monopoliser la préoccupation éthique sur cette question.
M. Laurent Marcangeli. Le sujet est, à l’évidence, sensible. S’il nous enjoint à l’humilité, c’est que le débat transcende les clivages idéologiques, chacun d’entre nous ayant sur cette question une position personnelle. C’est pourquoi Jean Leonetti pouvait espérer que l’on s’extirpe de l’habituelle opposition droite-gauche pour se livrer, comme par le passé, à un débat apaisé. Il est dommage que cette occasion soit aujourd’hui manquée, car cette proposition de loi méritait la considération des membres de la majorité.
Nous avons chacun un rapport particulier à ce sujet ; confrontés à la fin de vie d’un proche, nous avons tous souhaité, à un moment donné, que son agonie cesse. Mais pour légiférer, nous devons nous référer à notre conscience et à nos convictions spirituelles, politiques et philosophiques. C’est pourquoi, à l’instar de bien de mes collègues, je soutiens cette proposition de loi que j’ai cosignée.
Pour accompagner le malade vers sa fin inéluctable en prenant en charge les symptômes les plus pénibles, on peut compléter le dispositif existant, déjà équilibré. Légaliser l’euthanasie reviendrait en revanche à franchir les limites de l’acceptable. Donner au corps médical la possibilité d’administrer la mort me semble, en effet, contraire à notre conception de la dignité de la personne humaine et du respect de la vie.
M. Jean-Louis Roumegas. Faisant partie de ceux qui s’interrogent encore sur le périmètre de l’acceptable, j’attends les débats pour me déterminer. Il y a quelques années, j’aurais eu du mal à m’opposer à ce texte ; mais le contexte m’incite à la réflexion. Surtout, je récuse la démarche qui consiste à politiser cette question, en faisant une proposition qui sert à marquer la position du groupe UMP. C’est pourquoi je voterai contre le texte.
M. Fernand Siré. Je fais également partie des signataires de cette proposition de loi. Nous nous trouvons à un tournant de civilisation ; jadis, en effet, le médecin de famille prenait complètement en charge le malade et faisait naturellement tout ce qui est désormais inscrit dans la loi. Ce contrat moral garantissait l’accompagnement de la fin de vie, et il n’y avait nul besoin de lois pour faire ce que nous commandaient notre conscience, notre code de déontologie et notre serment, symbole de notre vocation.
Il est vrai qu’aujourd’hui, l’acharnement thérapeutique conduit beaucoup de gens à mourir à l’hôpital, couverts d’escarres. Néanmoins, même si vous faites voter une loi légalisant l’euthanasie, il sera difficile de trouver des médecins qui accepteront de donner la mort. J’ai pratiqué la médecine durant quarante ans, mais jamais je n’aurais administré un produit expressément destiné à cette fin. On n’inflige pas ce traitement aux criminels redoutables ayant massacré des enfants ; pourquoi en confierait-on la responsabilité à des médecins ? Je suis en revanche favorable à tout ce qui peut soulager le patient et lui éviter la souffrance, même si le produit utilisé pour réduire la douleur est si puissant qu’il favorise la fin de vie. C’est pourquoi je voterai pour cette proposition de loi.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Dans un débat aussi sensible, il faut mesurer ses propos, car nos concitoyens qui nous écoutent vivent peut-être en ce moment même le problème dont on débat. Si le sujet est si prégnant, c’est que chacun sera un jour confronté à la fin de vie – la sienne ou celle des proches – et nulle certitude n’est de mise quant à ce triangle des Bermudes entre la vie et la mort. C’est pourquoi les groupes évitent généralement les consignes de vote sur des lois de ce type, laissant chacun libre de voter selon sa conscience. Si le moment de débattre de cet enjeu est peut-être mal choisi, Jean Leonetti a le mérite de remettre le travail sur le métier.
M. le rapporteur. La mort concerne toujours l’autre, puisque le jour où l’on en fait soi-même l’expérience, on ne peut plus la raconter. Sur cette question, le désaccord ne procède pas des clivages entre la droite et la gauche, ni entre ceux qui croient au ciel et ceux qui n’y croient pas, mais de notre vécu. La façon dont s’est déroulée la mort d’un être aimé nous amène quelquefois à des certitudes quant à la manière de faire face à ce type de situations. En 2005 – la période de mi-mandat favorisant sans doute la sérénité du débat –, nous avons pourtant réussi à passer des certitudes individuelles à des doutes collectifs, la loi qui porte abusivement mon nom – puisqu’elle a été écrite par 32 députés – résultant de cette progression commune.
En présentant – de manière précipitée, dites-vous – ce texte, je ne souhaite opérer aucun putsch ; le Président de la République ayant chargé Didier Sicard de consulter les Français dans le cadre de la préparation d’un projet de loi sur cet enjeu, j’ai attendu ses conclusions sans critiquer sa démarche. Le rapport Sicard s’articule autour de trois thématiques fortes : les directives anticipées, la sédation en phase terminale et les démarches concernant le suicide assisté, la possibilité de franchir cette dernière étape faisant débat.
La fin de vie cristallise le conflit entre l’éthique de vulnérabilité et celle d’autonomie, la revendication de liberté de la personne s’opposant à la nécessité de protection de la vie humaine, quelquefois malgré l’individu. Il ne s’agit pas d’une opposition entre le bien et le mal, la droite et la gauche, la science et la morale, mais d’un conflit de valeurs, qui peut être résolu très différemment. Une décision du Conseil d’État stipule ainsi qu’en cas d’hémorragie grave, le médecin a raison de procéder à une transfusion sanguine s’il s’agit d’une jeune femme, témoin de Jéhovah ; mais s’il s’agit d’une personne âgée en fin de vie qui refuse cette solution, l’imposer ne ferait qu’ajouter à sa souffrance une violence psychologique. Le sujet est donc particulièrement complexe.
Si j’ai souhaité avancer aussi vite, c’est d’abord parce que je pensais qu’à l’heure actuelle, le Comité national consultatif d’éthique aurait déjà rendu son avis. Celui-ci ayant été reporté au mois de juin, et parce que je respecte l’avis du Comité, j’ai demandé à M. Régis Aubry, qui avait commencé ses travaux, de m’exposer sa position. Au fond, ma proposition retient les deux points consensuels du rapport Sicard – directives anticipées et sédation terminale – qui se situent du côté de la solidarité, laissant de côté le suicide assisté qui penche vers l’autonomie. Estimant que la recherche du dialogue constructif et du consensus imposait de procéder par étapes, j’ai souhaité aborder ce sujet, quitte à ce qu’il soit repris ultérieurement par la majorité.
Alors que dans les pays qui l’ont autorisée, l’euthanasie ne concerne que 1 à 2 % des patients en fin de vie – 1,8 % en Belgique –, les gens qui meurent mal – privés de sédation en dépit des directives anticipées, violés dans leur conscience et leur liberté – en représentent 30 %. Certes, le nombre ne constitue pas le seul critère pertinent, mais il est urgent d’avancer sur le thème de la solidarité et de réfléchir sur celui de l’autonomie. Je suis, pour ma part, opposé à la légalisation de l’euthanasie, car en France, contrairement à la Belgique ou aux Pays-Bas, les soins palliatifs ont largement précédé le débat sur l’euthanasie. Celle-ci apparaît donc contraire à notre culture médicale, et comme le suggère le rapport Sicard, s’il fallait envisager des solutions, c’est plutôt du côté du suicide assisté – donc de l’autonomie – qu’il faudrait les rechercher.
Au total, il me semblait possible d’avancer ensemble sur ces deux points. Même si cette proposition de loi est rejetée, lancer le débat et chercher collectivement des solutions m’apparaît bénéfique. Certains pays ont ainsi rendu opposables les directives anticipées ; quant à la sédation terminale, cette pratique ne va pas systématiquement de pair avec la légalisation de l’euthanasie.
Depuis 2005, la Suède, l’Argentine, le Mexique et l’Espagne ont adopté exactement la même loi que la France. Didier Sicard rappelle d’ailleurs que même si elle reste perfectible, la démarche française – qui incarne le consensus – est copiée dans le monde entier, le Benelux, avec ses 50 millions d’habitants, faisant plutôt exception au sein des 500 millions d’Européens. Les membres de la majorité devraient faire confiance aux constats d’un expert nommé par le Président de la République !
Monsieur Perrut, les patients non conscients – le nouveau-né ou le sujet dans le coma – sont incapables d’exprimer leur volonté ; mais la modification du code de déontologie de 2008 interdit de les laisser souffrir en cas d’arrêt des traitements. En effet, si l’on pensait jadis que les prématurés et les personnes plongées dans le coma n’éprouvaient pas de douleur, les IRM dynamiques ont battu cette idée en brèche. La sédation profonde garantit que le patient ne souffre pas, cette assurance rassérénant ses proches.
Gérard Sebaoun estime que l’enjeu fondamental relève du suicide assisté. En effet, si l’on suit Albert Camus : « Il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux : c’est le suicide », et répondre positivement à la question de savoir si « la vie vaut ou ne vaut pas la peine d’être vécue » exige d’agir en conséquence. Mais les problèmes certes essentiels du sens de la vie et de la mort ne doivent pas nous faire oublier que beaucoup de malades meurent mal dans notre pays ; le dispositif conçu à leur intention reste trop léger et doit être renforcé.
Monsieur Véran, l’ambivalence est toujours présente en fin de vie, marquée par la tension entre désir de mort et désir de vie, qu’évoquait Laurent Marcangeli. Selon les convictions de chacun, ce dispositif peut représenter une étape ou un aboutissement ; la proposition de loi n’a d’ailleurs pas été signée de tous les membres du groupe l’UMP, certains considérant qu’elle va trop loin. Peut-être aurons-nous réussi, dans le débat, à convaincre de nouvelles personnes de part et d’autre de l’hémicycle, afin que, même si le texte n’est pas voté, un débat apaisé vienne remplacer nos certitudes individuelles. Commencée en 2004 avec des convictions subjectives retirées de la mort d’un proche, notre mission a débouché sur un consensus parce que chacun a su dépasser son expérience personnelle pour poser la question en termes de norme universelle applicable à l’ensemble de la population.
Article 1er
(art. L. 1110-5-1 [nouveau] du code de la santé publique)
Droit à la sédation en fin de vie
Le présent article crée un droit à la sédation en phase terminale. Il permet au malade en phase terminale d’exiger une sédation profonde auprès de son médecin traitant.
1. La sédation en phase terminale
a) Définition de la sédation
Du latin « sedare » – apaiser, calmer, le terme de sédation est employé aussi bien pour désigner un traitement antalgique ou anxiolytique que l’induction d’un sommeil.
En soins palliatifs, la sédation désigne une pratique qui vise à diminuer la perception d’une situation de détresse perçue comme insupportable par le malade. Dans ses recommandations de 2009 (22), la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP) définit la sédation comme « l’utilisation de traitements médicamenteux sédatifs afin de soulager une souffrance intolérable due à des symptômes réfractaires par une réduction de l’état de conscience du patient ». Elle a pour but de soulager des souffrances physiques et psychiques (angoisse) générées par l’agonie.
La technique de la sédation ne doit donc être employée que lorsque les autres substances (antalgiques, anxiolytiques), ne suffisent pas à soulager la souffrance du patient.
Si son usage reste rare, il tend à se banaliser en phase terminale d’une maladie. La SFAP définit la phase terminale comme « la survenue de la défaillance des grandes fonctions vitales du corps » ; le décès est alors imminent et inévitable.
La société indique (23) que la sédation peut influer sur le moment de la mort, dans un sens comme dans l’autre : elle peut la précipiter mais aussi la retarder. Elle recommande son usage en phase terminale, lorsque la proximité de la mort rend prioritaire le seul traitement symptomatique. Lorsque le patient n’est pas en phase terminale mais en phase palliative, un symptôme réfractaire(24) peut être une indication de sédation intermittente ou temporaire laissant le temps au symptôme de perdre son caractère réfractaire, soit grâce au succès d’un traitement spécifique, soit par une meilleure tolérance du patient après une période de sédation.
Comme l’a expliqué le professeur Régis Aubry lors de son audition (25), en aucun cas l’objectif de la sédation ne doit être d’accélérer la mort. Les effets de la sédation doivent être évalués au moyen de « l’échelle de Rudkin » qui mesure la vigilance du patient. La sédation est réalisée en utilisant des médicaments dosés de telle façon que leurs effets puissent être réversibles : le patient est endormi mais peut être réveillé à l'arrêt de ces produits.
La SFAP indique que la sédation doit rester exceptionnelle, et que le médecin a le devoir d’informer le patient des options thérapeutiques et de leurs conséquences. « Le recours à la sédation prive le patient de ses capacités relationnelles et de son autonomie. Il est alors dans un état de totale dépendance vis-à-vis d’autrui et donc très vulnérable. Il y a donc un paradoxe majeur entre la sédation et le souci de maintenir une relation, condition essentielle de l’accompagnement ».
b) L’encadrement par la loi du double effet de la sédation
Administrés à certaines doses et compte tenu des spécificités et fragilités physiologiques des personnes en fin de vie, certains traitements sédatifs peuvent avoir pour effet secondaire d’accélérer la survenue de la mort.
La loi du 22 avril 2005 a encadré l’usage des sédatifs en phase terminale selon la doctrine du « double effet » : il est possible d’administrer un traitement qui peut avoir pour effet d’abréger la vie si c’est la seule façon de soulager un patient en phase avancée ou terminale. Le patient, la personne de confiance, ou à défaut les proches, doivent être informés.
Ainsi, le dernier alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique (26) dispose : « Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. »
Il s’agit bien d’une « sédation en phase terminale » et non d’une « sédation à but terminal ». La différence est fondamentale : l’intention est bien de soulager la souffrance physique et psychique, et non de donner la mort. Le médicament est dosé dans l’objectif d’atténuer une perception jugée insupportable. En aucun cas, l’article L. 1110-5 ne peut être interprété comme autorisant une sédation à but terminal, c’est-à-dire une euthanasie, pour laquelle il s’agit d’augmenter progressivement la dose jusqu’à faire mourir le patient.
Lors de l’examen à l’Assemblée nationale de la proposition de loi ayant abouti à la loi du 22 avril 2005, votre rapporteur expliquait que l’objectif de ces dispositions était de mettre un terme à deux pratiques scandaleuses :
– « des médecins qui utilisent la morphine comme un produit létal et qui, volontairement, alors que le malade ne souffre pas, utilisent des doses massives de morphine pour arrêter la vie ».
– « des médecins qui (…) refusent, en dépit de la souffrance du malade, de s'approcher davantage des doses toxiques et donc de passer à la dose supérieure, pour ne pas être mis en examen pour homicide ».
Dans le cas de personnes mourantes, l’utilisation de sédatifs à fortes doses peut abréger la vie de quelques minutes, quelques heures ou quelques semaines mais votre rapporteur estime qu’elle permet aussi de mieux vivre les derniers instants.
2. La nécessité de mieux écouter la parole du malade
a) La loi mal appliquée
Il ressort du rapport de la mission présidée par le Professeur Sicard que l’angoisse de la souffrance est omniprésente chez les personnes entendues par la mission. Ainsi, le rapport (27) souligne « le ressenti des citoyens qui expriment une angoisse de mourir dans des conditions inacceptables en étant dépossédés de toute autonomie, ce qui conduit à une grande souffrance anticipée ». Ajoutant, « un certain nombre de demandes d’euthanasie semblent liées à cette angoisse ».
Cette angoisse serait en partie liée au fait que les médecins n’écoutent pas assez la parole des patients. « Que ce soit le mésusage de la sédation terminale, du principe du double effet, des directives anticipées ou de la place de la personne de confiance, on ne peut que constater la quasi absence de l’expression de la volonté de la personne à propos des choix qui la concernent. Le paradoxe est que dans cette situation de fin de vie, et même dans un service de soins palliatifs, la personne peut se sentir dépossédée des dimensions essentielles de sa fin de vie. »
Aussi, dans les enseignements qu’il retient des débats publics qui ont été organisés par la mission, le rapport Sicard (28) cite-il notamment :
– « La plainte quasi obsessionnelle et constante de l’insuffisance de l’écoute des médecins à ce moment de la fin de vie, en dehors des unités de soins palliatifs, bien que même dans ces unités, certains expriment le reproche que la demande d’euthanasie peut en venir à être inentendable. »
– « La hantise d’un basculement dans des situations de fin de vie insupportables. »
– « Les soins palliatifs, perçus comme une réponse adaptée, mais vécus comme une alternative insuffisamment connue et suscitant des doutes sur leur mise en œuvre concrète et sur leur capacité à soulager les souffrances. »
Ces observations ont conduit votre rapporteur à proposer de renforcer la valeur de la parole du malade dans les décisions relatives à l’accompagnement médical de la fin de vie.
b) La création d’un droit à la sédation en phase terminale
Le présent article crée un article L. 1110-5-1 dans le code de la santé publique s’insérant à la suite de l’article L. 1110-5 qui traite notamment de l’encadrement du double effet de la sédation.
Ce nouvel article L. 1110-5-1 instaurerait un droit à la sédation au profit des malades remplissant les trois conditions suivantes :
– être « en état d’exprimer sa volonté » ;
– être « atteinte en phase terminale d’une affection grave et incurable » ;
– souffrir de douleur physique ou de souffrance psychique que les traitements et soins palliatifs ne suffisent pas à soulager.
La demande est adressée au médecin traitant. Il s’agit de permettre aux malades qui n’ont pas accès aux soins palliatifs d’obtenir une sédation de leur médecin traitant. On pense par exemple aux personnes qui vivent leur fin de vie à domicile ou en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Le principe du double effet est rappelé : le patient peut demander un traitement sédatif même s’il peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie. De même qu’à l’article L. 1110-5, il s’agit bien d’une sédation en phase terminale ayant pour but de soulager la souffrance, et non d’une sédation à but terminal. Votre rapporteur souhaite que ce dispositif soit sans ambiguïté.
L’alinéa 3 indique que « la mise en œuvre du traitement sédatif est décidée de manière collégiale ». Cela ne signifie pas que la décision revienne en dernier recours aux médecins, car ceux-ci sont obligés d’accéder à la demande du patient. Cela signifie que de telles décisions doivent être actées à plusieurs, que le médecin traitant ne doit pas être seul dans cette situation : il peut réunir un éventuel autre médecin qui suit le patient, une infirmière et d’autres soignants, la famille ou les proches, etc. L’objectif est d’assurer la transparence de la décision, qui doit être inscrite dans le dossier médical, ainsi que les conclusions de la réunion collégiale.
Si le présent article crée un droit à la sédation pour les malades en phase terminale, il rappelle qu’à l’inverse, en vertu de l’article L. 1110-5, il n’est pas admissible qu’une sédation soit imposée à un malade sans l’en avoir informé et sans avoir obtenu son accord. Lorsque le malade est inconscient, le médecin doit informer la personne de confiance ou les proches.
*
La Commission est saisie de l’amendement AS 1 de Mme Véronique Massonneau.
Mme Véronique Massonneau. Favorable à la légalisation des pratiques d’aide active à mourir, j’estime que le développement des soins palliatifs, prévu par la loi de 2005, relève d’une excellente initiative. Cependant la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui n’apporte rien de neuf. Expliciter la pratique du traitement par les sédatifs aurait pu sembler intéressant, mais les auditions n’ont fait que jeter le doute sur cette pratique et ses implications. C’est pourquoi je propose de supprimer cet article.
M. le rapporteur. Avis défavorable. L’article clarifie précisément ce qu’est la sédation. Je trouve également contradictoire de déposer des amendements tout en refusant de voter ce texte parce que vous attendez celui du Gouvernement.
Mme Véronique Massonneau. Il s’agit d’avancer sur cette question.
Mme Bernadette Laclais. Partageant la volonté d’éviter la polémique dans le cadre d’un débat serein, nous ne souhaitons mettre personne en cause. Sans refuser le dialogue, nous estimons toutefois inopportun de traiter le sujet aujourd’hui au travers d’une proposition de loi. Quelle que soit leur position sur la question, nos concitoyens attendent en effet un débat, et même s’il est bon de travailler sur un texte par étapes, la discussion doit rester globale et aborder toutes les questions que se pose l’opinion publique. Cet amendement, qui supprime l’article, correspond donc à notre position.
La Commission adopte l’amendement AS 1.
En conséquence, l’article 1er est supprimé et les amendements AS 14 et AS 15 deviennent sans objet.
Article 2
(art. L. 1111-11 du code de la santé publique)
Opposabilité des directives anticipées
Le présent article vise à rendre les directives anticipées opposables au médecin lorsqu’elles respectent certaines formes.
1. Le dispositif actuel
L’article L. 1111-11 du code de la santé publique, introduit par l’article 7 de la loi du 22 avril 2005, autorise toute personne majeure à « rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté ».
Ces directives indiquent « les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou de l’arrêt des traitements ».
Elles ne sont valables qu’à la condition de dater de moins de trois ans avant l’état d’inconscience du patient. Elles sont révocables à tout moment par le patient conscient.
Elles ne constituent pas une injonction au médecin, qui garde la responsabilité de décider de l’arrêt des traitements lorsque le patient est inconscient. L’article L. 1111-11 indique que le médecin « en tient compte pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement la concernant ». Les directives anticipées sont donc à prendre en compte parmi d’autres éléments comme le jugement porté par le médecin sur les chances de rétablissement du patient à l’issue des traitements envisagés.
Le dernier alinéa de l’article L. 1111-11 renvoie à un décret en Conseil d’État (29) la définition des conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées :
– les conditions de forme sont définies par l’article R. 1111-17 du code de la santé publique : le document doit être écrit, daté et signé par son auteur dûment identifié par ses nom, prénom, date et lieu de naissance ; lorsque l'auteur, conscient, est dans l'impossibilité d'écrire lui-même, il peut demander à deux témoins d'attester que le document est l'expression de sa volonté libre et éclairée ; le dernier alinéa de cet article précise que « le médecin peut, à la demande du patient, faire figurer en annexe de ces directives (…) une attestation constatant qu'il est en état d'exprimer librement sa volonté et qu'il lui a délivré toutes informations appropriées » ;
– les conditions de validité sont définies par l’article R. 1111-18 du même code : la période de validité de trois ans est renouvelable par simple décision de confirmation signée par leur auteur sur le document. Toute modification intervenue dans le respect des conditions prévues à l’article R. 1111-17 vaut confirmation et fait courir une nouvelle période de trois ans ; dès lors qu'elles ont été établies dans le délai de trois ans précédant soit l'état d'inconscience de la personne, ces directives demeurent valides quel que soit le moment où elles sont ultérieurement prises en compte ;
– les conditions de conservation sont prévues par l’article R. 1111-19 : elles doivent être « aisément accessibles pour le médecin », ce qui constitue plus un conseil pratique qu’une obligation ; en principe, elles doivent être conservées « dans le dossier de la personne constitué par un médecin de ville, qu'il s'agisse du médecin traitant ou d'un autre médecin choisi par elle, ou, en cas d'hospitalisation, dans le dossier médical » ; toutefois, leur auteur reste libre de les conserver chez lui ou de les remettre à sa personne de confiance, ou encore à un membre de sa famille ou un proche ; dans ce cas, leur existence doit être mentionnée dans le dossier médical ; il est précisé que toute personne admise dans un établissement de santé ou dans un établissement médico-social peut signaler l'existence de directives anticipées.
Enfin l’article R. 1111-20 précise l’étendue du devoir du médecin, en instaurant une obligation pour celui-ci de s’enquérir de l'existence éventuelle de directives anticipées – lorsqu’elles ne sont pas déjà dans le dossier médical – auprès de la personne de confiance, de la famille ou des proches ou auprès du médecin traitant ou du médecin qui lui a adressé la personne malade.
Le législateur s’est prononcé contre l’imposition d’un modèle réglementaire de directives anticipées, souhaitant préserver la liberté de la personne de formuler ses souhaits en fonction de son approche de la fin de vie et des éventuelles pathologies dont il est atteint.
Toutefois, les directives anticipées ont d’autant plus d’utilité qu’elles sont rédigées de façon précise. Dans son rapport sur la proposition de loi ayant abouti à la loi du 22 avril 2005, votre rapporteur envisageait que les directives correspondent « à une véritable planification des soins, établie après une discussion approfondie avec le médecin traitant, lorsqu'une maladie grave et incurable a été diagnostiquée : en définissant, en fonction des phases de la maladie ou de ses complications, les traitements qui peuvent être mis en œuvre et ceux qui ne doivent pas être tentés (réanimation, alimentation artificielle...) ou qui doivent être interrompus ». Dans ce cas, elles constituent une sorte de contrat moral passé avec le médecin.
Certains hôpitaux et associations proposent des modèles de directives anticipées.
2. Les directives anticipées restent peu répandues
a) Le dispositif est méconnu des citoyens
La rédaction de directives anticipées reste très rare. Ainsi, l’enquête sur « La fin de vie en France » (30) réalisée en 2012 par l’Institut national d’études démographiques (INED) avec l’Observatoire nationale de la fin de vie (ONFV) a montré que seuls 2,5 % des personnes décédées en avaient rédigé.
Pourtant, cette enquête montre que lorsque ces directives existent, les médecins déclarent qu’elles ont été un élément important pour 72 % des décisions médicales en fin de vie.
Une grande part de la population ignore la loi. Dans ses recommandations adoptées le 8 février 2013, le Conseil national de l’Ordre des médecins observe : « Les dispositions de la loi du 22 avril 2005 concernant les directives anticipées et la personne de confiance restent mal connues du public. Il convient qu’une campagne d’information soit faite. Les médecins doivent y participer. »
Mais le faible nombre de directives anticipées s’explique aussi par le désintérêt dont elles peuvent faire l’objet. Ainsi, il ressort d’une enquête réalisée par le Centre d’éthique clinique de l’hôpital Cochin, citée dans la fiche contributive n° 3 annexée au rapport Sicard, que 83 % des personnes âgées interrogées déclarent ne pas être intéressées.
b) Le médecin n’accède pas toujours à ces directives quand elles existent
Il n’existe pas de fichier national regroupant les directives anticipées comme il peut en exister pour le don d’organes, ce qui empêche leur consultation en cas d’urgence.
Ainsi, les réanimateurs des SAMU auditionnés par la mission Sicard ont indiqué qu’ils n’ont jamais connaissance des directives anticipées lorsqu’ils sont appelés en intervention, même dans le cas où les personnes sont suivies en soins palliatifs ou en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Il faudrait au moins que tout médecin puisse avoir connaissance de leur existence. En effet, si le médecin traitant est souvent au courant de l’existence de ces directives, il est rarement contacté en cas d’hospitalisation de son patient.
Le Conseil national de l’Ordre des médecins recommande que « les directives anticipées soient répertoriées dans un registre national ou sur un support accessible aux soignants membres de l’équipe de soins ».
c) La question de l’opposabilité des directives
Les directives anticipées devraient-elles s’imposer au médecin ?
Les missions parlementaires sur la fin de vie de 2004 et 2008 avaient répondu à cette question par la négative, notamment parce que leur opposabilité risquait de déresponsabiliser le médecin qui n’aurait plus à évaluer la situation et à se demander ce qui est bon pour le patient. Par ailleurs, les députés considéraient que le rapport qu’a un malade avec sa maladie se modifie avec l’évolution de celle-ci – par exemple, un patient peut s’habituer à un état qu’il imaginait insupportable antérieurement. La mission de 2008 (31) indiquait aussi que « les lignes de partage entre les traitements estimés acceptables et ceux ressentis comme inacceptables sont mouvantes ».
Refusant que les directives anticipées deviennent opposables, la mission recommandait cependant que les refus opposés aux directives anticipées soient motivés dans le dossier médical.
La mission de 2004 ayant précédé l’élaboration de la proposition de loi relative aux droits des malades et à la fin de vie indiquait que dans un quart des États membres du Conseil de l’Europe, les directives anticipées, ou les instruments équivalents, ont une force juridique contraignante (32). Cependant, ce caractère contraignant est généralement subordonné à la précision des directives. Doivent être envisagés l’état du mourant, le stade de l’agonie, les types de traitements refusés, etc.
Dans son avis du 8 février 2013, le Conseil national de l’Ordre des médecins rappelle que « les médecins et les membres de l’équipe de soins qui concourent à la prise en charge du malade doivent prendre en compte les directives anticipées et l’avis de la personne de confiance, qui traduisent, dans sa liberté, les dernières volontés conscientes du patient ». Il refuse cependant que ces directives puissent avoir le caractère d’une injonction.
Le rapport Sicard (33) relance cependant l’idée d’une opposabilité des directives anticipées.
Souhaitant que ces documents soient beaucoup plus fréquents – « Il apparaît alors évident que des directives anticipées devraient s’inscrire dans l’univers du soin comme une donnée aussi élémentaire que la possession de sa carte vitale, mais sans en faire une obligation qui tendrait à la bureaucratie » – le rapport préconise un fichier national sur le modèle de celui du don d’organes. Il recommande également la diffusion d’un modèle de document à l’image de ceux qui sont proposés en Suisse ou en Allemagne.
Si le rapport Sicard refuse que les directives anticipées telles qu’elles sont prévues par la loi puissent devenir opposables, soulignant les « fluctuations de la volonté [des malades] entre abattement et réflexe de survie », il propose cependant l’élaboration d’un deuxième document, à destination des personnes atteintes d’une maladie grave, qui, s’en être absolument opposable au médecin, serait beaucoup plus contraignant.
Ce document décrirait très précisément les différentes options thérapeutiques susceptibles d’être proposées en fin de vie. Il serait notamment « signé par le malade qui le souhaite », « rempli dans le cadre d’un dialogue avec le médecin de famille et l’équipe hospitalière – occasion ici de souligner avec force que le médecin généraliste doit être mieux accueilli dans l’univers hospitalier où il reste trop souvent considéré comme un visiteur indésirable », inséré dans le dossier médical et « inscrit dans un fichier national informatisé », « signé par le thérapeute concerné, ce qui sans en faire un caractère contraignant, en fait un caractère très engageant ».
Votre rapporteur souhaite que les directives anticipées portent non seulement sur les limitations ou arrêts de traitement, mais également sur les demandes de sédation en phase terminale. Le patient peut vouloir recevoir une sédation profonde, au risque que cela abrège ses jours. De même que l’article 1er crée un droit à la sédation en phase terminale, votre rapporteur propose que ce droit s’applique aux patients hors d’état d’exprimer leur volonté grâce aux directives anticipées.
2. Le dispositif proposé : rendre les directives anticipées opposables sous certaines conditions
Le présent article modifie l’article L. 1111-11 du code de la santé publique relatif aux directives anticipées.
a) L’extension de l’objet des directives anticipées à la sédation
L’alinéa 2 étend l’objet des directives anticipées à l’expression des souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions « de l’administration d’un traitement à visée sédative ».
En effet, le fait que le patient soit hors d’état d’exprimer sa volonté ne signifie pas qu’il ne souffre pas. Il convient donc de prévoir que le patient puisse demander dans ses directives anticipées une sédation profonde en phase terminale, acceptant par là-même le risque du « double effet » des traitements sédatifs présenté dans le commentaire de l’article 1er du présent projet de loi.
b) L’opposabilité des directives anticipées sous certaines conditions
L’alinéa 4 rend les directives anticipées opposables au médecin lorsqu’elles sont rédigées « sous la forme d’un projet de soins validé à la fois par le patient et par le médecin, et éventuellement visé par la personne de confiance ».
Cette procédure s’adresse aux personnes atteintes d’une maladie grave, dont le médecin est capable d’envisager l’évolution. Ainsi, les directives peuvent être rédigées de façon suffisamment précise pour envisager différentes situations et être véritablement applicables en cas de perte de conscience.
Par ailleurs, le document étant élaboré par le patient et le médecin, on se rapproche de l’idée d’engagement moral qui lie le médecin à son patient proposé par le rapport Sicard.
De même qu’à l’article 1er, les décisions d’arrêt des traitements ou de sédation en phase terminale prises en application des directives anticipées rédigées sous forme de projet de soins doivent être prises de manière collégiale et inscrites dans le dossier médical. Bien que le collège n’ait pas à refuser la demande contenue dans les directives anticipées, il s’agit de s’assurer qu’elles sont bien interprétées et qu’elles ont appliquées de façon transparente.
c) Les exceptions
L’alinéa 6 prévoit deux exceptions à l’opposabilité des directives anticipées rédigées sous forme de projet de soins :
– « en cas d’urgence vitale immédiate » : le médecin doit pouvoir se dégager des directives s’il estime, dans une situation d’urgence, justifié que l’on s’écarte des cas envisagés pour la phase terminale de la maladie ;
– « dans un contexte de pathologie psychiatrique » : votre rapporteur souhaite que le médecin puisse s’écarter des directives anticipées s’il estime que le patient n’était pas en pleine possession de son jugement lorsque le projet de soins a été élaboré (pendant une dépression par exemple) – ce dernier ayant pu être élaboré avec un autre médecin que lui-même.
d) La conservation des directives
L’alinéa 7 dispose que les directives anticipées du patient doivent être conservées dans son dossier médical.
Le mode de conservation des directives anticipées est jusqu’à présent encadré par l’article R. 1111-19 précité. Si celui-ci prévoit déjà qu’en principe les directives anticipées sont conservées dans le dossier médical, il permet cependant que le patient puisse les garder chez lui ou les confier à un proche. Cette liberté n’est guère envisageable dans le cas de l’opposabilité des directives anticipées, puisqu’il faut s’assurer que tout médecin amené à soigner le patient en ait connaissance. Il faudra donc prévoir un décret afin de modifier l’article R. 1111-19 pour indiquer que lorsque les directives sont rédigées sous forme de projet de soin validé par le médecin, elles doivent obligatoirement être conservées dans un dossier médical – leur auteur ne pouvant les garder avec lui, faute de quoi elles ne pourraient être opposables au médecin.
L’alinéa 7 dispose également qu’elles sont insérées dans la « carte Vitale ». Cette proposition n’étant techniquement pas possible, votre rapporteur propose que seule leur existence soit mentionnée dans la carte Vitale (amendement AS 19), ce qui permettrait au médecin qui ne connaît pas le patient qu’il est amené à traiter (aux urgences par exemple) de demander ces directives aux proches ou au médecin traitant.
*
Article 2 : Opposabilité des directives anticipées
La Commission examine l’amendement AS 2 de Mme Véronique Massonneau.
Mme Véronique Massonneau. En cohérence avec mon amendement précédent, je demande également la suppression de l’article 2, pour les mêmes raisons.
M. le rapporteur. Même avis.
La Commission adopte l’amendement AS 2.
En conséquence, l’article 2 est supprimé et les amendements AS 18 et AS 19 deviennent sans objet.
Les amendements AS 3, AS 11, AS 4, AS 5, AS 6, AS 7, AS 10, AS 8 et AS 9 de Mme Véronique Massonneau sont retirés.
Tous les articles ayant été rejetés, il n’y a pas lieu pour la Commission de procéder à un vote sur l’ensemble de la proposition de loi.
——fpfp——
En conséquence, aux termes de l’article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique aura lieu sur la base du texte initial de la proposition de loi.
TABLEAU COMPARATIF34
___
Dispositions en vigueur ___ |
Texte de la proposition de loi ___ |
Texte de la commission ___ |
Proposition de loi visant à renforcer les droits des patients en fin de vie |
||
Code de la santé publique |
Article 1er |
Aucun texte adopté |
Après l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, est inséré un article L. 1110-5-1 ainsi rédigé : |
||
« Art. L. 1110-5-1. – Toute personne en état d’exprimer sa volonté et atteinte en phase terminale d’une affection grave et incurable, dont les traitements et les soins palliatifs ne suffisent plus à soulager la douleur physique ou la souffrance psychique, est en droit de demander à son médecin traitant l’administration d’un traitement à visée sédative, y compris si ce traitement peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie selon les règles définies à l’article L. 1110-5*. |
||
« La mise en œuvre du traitement sédatif est décidée de manière collégiale. La demande formulée par le malade et les conclusions de la réunion collégiale sont inscrits dans le dossier médical. » |
||
Article 2 |
||
L’article L. 1111-11 du même code est ainsi modifié : |
||
Art. L. 1111-11. – Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l’arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment. |
I. – Après le mot : « limitation », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , de l’arrêt de traitement ou de l’administration d’un traitement à visée sédative. » |
|
II. – Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : |
||
À condition qu’elles aient été établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement la concernant. |
« Lorsque les directives anticipées sont rédigées sous la forme d’un projet de soins validé à la fois par le patient et par le médecin, et éventuellement visé par la personne de confiance, elles s’imposent au médecin. Les décisions résultant de ces directives anticipées sont prises de manière collégiale, et doivent être inscrites dans le dossier médical du patient. » |
|
III. – Après l’avant-dernier alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants : |
||
« Les directives anticipées n’ont pas d’effet contraignant en cas d’urgence vitale immédiate et dans un contexte de pathologie psychiatrique. |
||
« Les directives anticipées du patient sont insérées dans son dossier médical et sa carte Vitale. » |
||
Un décret en Conseil d'État définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. |
||
Disposition citée à l’article 1er :
Code de la santé publique - Art. L. 1110-5. – Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code.
Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.
Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
Amendement n° AS 1 présenté par Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumégas
Article 1er
Supprimer cet article.
Amendement n° AS 2 présenté par Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumégas
Article 2
Supprimer cet article.
Amendement n° AS 3 présenté par Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumégas
Après l’article 2
Insérer l’article suivant :
L’article L. 1110-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-2. – La personne malade a droit au respect de sa liberté et de sa dignité. Elle peut bénéficier, dans les conditions prévues au présent code, d’une aide active à mourir ou du suicide assisté. »
Amendement n° AS 4 présenté par Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumégas
Après l’article 2
Insérer l’article suivant :
L’article L. 1110-9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale, même en l’absence de diagnostic de décès à brève échéance, atteinte d’au moins une affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incurable, et/ou à tendance invalidante et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique constante et inapaisable qu’elle juge insupportable, peut demander à bénéficier, dans les conditions strictes prévues au présent titre, d’une aide active à mourir ou d’un suicide assisté. »
Amendement n° AS 5 présenté par Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumégas
Après l’article 2
Insérer l’article suivant :
Après l’article L. 1110-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-9-1. – Est réputée décédée de mort naturelle, en ce qui concerne les contrats où elle est partie, la personne dont la mort résulte d’une aide active à mourir ou d’un suicide assisté mise en œuvre selon les conditions et procédures prescrites par le présent code. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Amendement n° AS 6 présenté par Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumégas
Après l’article 2
Insérer l’article suivant :
Après l’article L. 1110-10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-10-1. – Lorsqu’une personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale, même en l’absence de diagnostic de décès à brève échéance, atteinte d’au moins une affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incurable et/ou à tendance invalidante et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique constante et inapaisable ou qu’elle juge insupportable, demande à son médecin le bénéfice d’une aide active à mourir ou d’un suicide assisté, celui-ci doit s’assurer de la réalité de la situation dans laquelle se trouve la personne concernée.
« Après examen du patient, étude de son dossier et, s’il y a lieu, consultation de l’équipe soignante, le médecin doit faire appel, pour l’éclairer, dans un délai maximum de 48 heures, à un autre praticien de son choix.
« Les médecins vérifient le caractère libre, éclairé, réfléchi et constant de la demande présentée, lors d’un entretien au cours duquel ils informent l’intéressé des possibilités thérapeutiques, ainsi que des solutions alternatives en matière d’accompagnement de fin de vie.
« Les médecins peuvent, s’ils le jugent souhaitable, renouveler l’entretien dans les 48 heures.
« Les médecins rendent leurs conclusions sur l’état de l’intéressé dans un délai de quatre jours au plus à compter de la demande initiale du patient.
« Lorsque les médecins constatent au moins une affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incurable et/ou à tendance invalidante et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique constante et inapaisable ou que la personne juge insupportable, et donc la situation d’impasse thérapeutique dans laquelle se trouve la personne ainsi que le caractère libre, éclairé, réfléchi et réitéré de sa demande, l’intéressé doit, s’il persiste, confirmer sa volonté, le cas échéant, en présence de la ou des personnes de confiance qu’il a désignées.
« Le médecin est tenu de respecter cette volonté.
« L’acte d’aide active à mourir, pratiqué sous le contrôle du médecin, par lui-même ou, dans le cas d’un suicide assisté, par le patient, s’il le souhaite et est en capacité de le faire, en milieu hospitalier ou au domicile du patient ou dans les locaux d’une association agréée à cet effet, ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de l’intéressé si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de celui-ci telle qu’il la conçoit pour lui-même.
« L’intéressé peut, à tout moment, et par tout moyen, révoquer sa demande.
« Les conclusions médicales et la confirmation de la demande sont versées au dossier médical. Dans un délai de huit jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l’aide active à mourir ou au suicide assisté adresse à la commission régionale de contrôle prévue à la présente section un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article ; la commission contrôle la validité du protocole. Le cas échéant, elle transmet à l’autorité judiciaire compétente. »
Amendement n° AS 7 présenté par Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumégas
Après l’article 2
Insérer l’article suivant :
L’article L. 1111-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-11. – Toute personne majeure et capable peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie. Elles sont révocables à tout moment.
« Le médecin est tenu de les respecter car elles demeurent valables sans conditions de durée.
« Dans ces directives, la personne indique ses souhaits en matière de limitation ou d’arrêt de traitement. Elle peut également indiquer dans quelles circonstances elle désire bénéficier d’une aide active à mourir, ou d’un suicide assisté, telle que régie par le présent code. Elle désigne dans ce document la ou les personnes de confiance chargées de la représenter et qui auront accès à son dossier médical. Les directives anticipées sont inscrites sur un registre national automatisé tenu par la commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de mourir dans la dignité, instituée par l’article L. 1111-14 du présent code. Toutefois cet enregistrement ne constitue pas une condition nécessaire pour la validité du document.
« En complément, un fichier national des directives anticipées géré par un organisme indépendant des autorités médicales est créé dès la promulgation de la présente loi. Une association peut être habilitée par arrêté à gérer ce fichier national. Les autorités médicales ou tous médecins ont l’obligation de consulter ce fichier dès lors qu’une personne en phase avancée ou terminale d’au moins une affection reconnue grave et incurable ou dans un état de dépendance incompatible avec sa dignité est admise dans un service hospitalier.
« La directive anticipée ainsi que le nom de la ou des personnes de confiance sont enregistrés sur la Carte Vitale des assurés sociaux. »
Amendement n° AS 8 présenté par Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumégas
Après l’article 2
Insérer l’article suivant :
Après l’article L. 1111-13 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-13-1. – Lorsqu’une personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale, même en l’absence de diagnostic de décès à brève échéance, atteinte d’au moins une affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incurable et/ou à tendance invalidation et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique constante et inapaisable ou jugée insupportable se trouve dans l’incapacité d’exprimer une demande libre et éclairée, elle peut néanmoins bénéficier d’une aide active à mourir, à la condition que cette volonté résulte de ses directives établies dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111-11 du présent code. La ou les personnes de confiance saisissent de la demande le médecin. Après examen du patient, étude de son dossier et, éventuellement, consultation de l’équipe médicale soignante assistant au quotidien l’intéressé, il fait appel pour l’éclairer à un autre praticien de son choix. Le médecin établit dans un délai de quatre jours au plus à compter de leur saisine pour avis un rapport indiquant si l’état de la personne concernée correspond aux conditions exprimées dans ses directives anticipées, auquel cas elles doivent être respectées impérativement.
« Lorsque le rapport conclut à la possibilité d’une aide active à mourir ou d’un suicide assisté, la ou les personnes de confiance doivent confirmer la volonté constante du patient. Le médecin est tenu de respecter cette volonté. L’acte d’aide active à mourir ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande.
« Dans un délai de huit jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l’aide active à mourir ou au suicide assisté adresse à la commission régionale de contrôle un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article ainsi que les directives anticipées ; la commission contrôle la validité du protocole. Le cas échéant, elle transmet à l’autorité judiciaire compétente. »
Amendement n° AS 9 présenté par Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumégas
Après l’article 2
Insérer l’article suivant :
Après l’article L. 1111-13 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-13-1. – En cas de pronostic vital engagé à très brève échéance, le médecin peut, après en avoir informé la commission régionale qui se réserve la possibilité de dépêcher auprès de lui un médecin-conseiller, ramener l’ensemble du protocole à quatre jours. »
Amendement n° AS 10 présenté par Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumégas
Après l’article 2
Insérer l’article suivant :
L’article L. 1111-12 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12. – Lorsqu’une personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale, même en l’absence de diagnostic de décès à brève échéance, atteinte d’au moins une affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incurable et/ou à tendance invalidante et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique constante et inapaisable ou jugée insupportable et hors d’état d’exprimer sa volonté a désigné une personne de confiance en l’application de l’article L. 1111-6 du présent code, l’avis de cette dernière prévaut sur tout autre avis, y compris médical, à l’exclusion des directives anticipées, dans les décisions d’investigation, d’intervention ou de traitement prises par le médecin. La personne de confiance a le même droit d’accès au dossier médical que le titulaire. »
Amendement n° AS 11 présenté par Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumégas
Après l’article 2
Insérer l’article suivant :
L’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin n’est pas tenu d’apporter son concours à la mise en œuvre de l’aide active à mourir ou du suicide assisté ; dans le cas d’un refus de sa part, il doit, dans un délai de deux jours, s’être assuré de l’accord d’un autre praticien et lui avoir transmis le dossier. »
Amendement n° AS 14 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur
Article 1er
Après le mot « définies », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « au dernier alinéa de l’article L. 1110-5 ».
Amendement n° AS 15 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur
Article 1er
À l’alinéa 3, substituer aux mots : « inscrits dans le », les mots : « inscrites dans son ».
Amendement n° AS 18 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur
Article 2
À l’alinéa 7, substituer au mot : « insérées », le mot : « conservées ».
Amendement n° AS 19 présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur
Article 2
À l’alinéa 7, substituer aux mots : « sa carte Vitale », les mots : « leur existence est renseignée dans la carte mentionnée au I de l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale ».
ANNEXE 2 :
RECOMMANDATIONS DU RAPPORT SICARD
Recommandations et réflexions du rapport au président de la République de la commission de réflexion sur la fin de vie en France, Penser solidairement la fin de vie, du 18 décembre 2012.
La recommandation première est avant tout, de donner la plus grande importance aux paroles et aux souhaits des personnes malades en fin de vie et de faire en sorte qu’elles soient entendues dans leur situation d’extrême vulnérabilité.
1. Principes généraux
– Parce qu’il est inacceptable que la loi Leonetti ne soit toujours pas appliquée après sept ans d’existence, faire un effort majeur d’appropriation de cette loi par la société et par l’ensemble des médecins et des soignants, notamment par des campagnes régulières d’information et un effort massif de formation, pour lui donner toute son efficacité.
– Réaliser une évaluation des financements et des besoins en personnel soignant nécessaires à un réel accès de tous à ces soins. Faire en sorte que ces financements soient attribués. Favoriser l’implication des accompagnants bénévoles.
– Avoir conscience que le recours aux seules unités de soins palliatifs ne pourra jamais résoudre la totalité des situations, même si ces structures devaient être en nombre plus important.
– Avoir conscience que la mort directement liée à une pratique létale ne représenterait également qu’une proportion très marginale des décès si cette pratique était légalisée, au vu des observations hors de France.
– L’inégalité majeure en termes d’accès à un accompagnement humain approprié en fin de vie, et à l’inverse le sentiment contraint d’un passage en soins palliatifs jugé comme la seule bonne réponse, peuvent être à l’origine d’une profonde angoisse de l’opinion, qui explique en partie la demande répétée d’euthanasie.
– Apporter toute l’attention requise à l’immense majorité des personnes en fin de vie, dont la situation ne relève pas des seules unités de soins palliatifs. Avoir une politique volontariste de développement de soins palliatifs à domicile avec des formules de « répit » pour les proches.
– Accompagner l’annonce d’une maladie grave par un projet spécifique de fin de vie en restant avant tout attentif aux choix de la personne.
2. Propositions concernant des conduites prévues par les lois relatives aux droits des malades en fin de vie
Pour assurer l’effectivité des textes de loi (Loi relative à l’accès aux soins palliatifs 1999, Kouchner 2002, Leonetti 2005), prendre des dispositions réglementaires concernant :
– les conditions de la délivrance d’une information précise, compréhensible, claire et appropriée au malade et à ses proches, sur la proposition d’abstention, de limitation ou d’arrêt de traitements, ou d’intensification du traitement de la douleur et des symptômes, ou de sédation terminale.
– les conditions du respect de la volonté de la personne.
– les conditions de la traçabilité des procédures retenues.
L’ensemble des propositions de la commission énoncées-dessous doivent être une priorité dans l’allocation des moyens financiers et peuvent être financées par un redéploiement des ressources d’un curatif disproportionné par ses excès et trop peu interrogé, vers une meilleure prise en charge du « prendre soin » de la fin de vie.
a) Les directives anticipées
Réaliser régulièrement une campagne d’information majeure auprès des citoyens, des médecins et des soignants sur l’importance des directives anticipées, la qualité de leur rédaction et l’effectivité de leur usage ; et sur la possibilité de désigner une personne de confiance et sur le rôle qui peut lui être confié.
Différencier nettement deux procédures :
– Conformément à la loi, un premier document de directive anticipée pourrait être proposé par le médecin traitant à tout adulte qui le souhaite, sans aucune obligation, quel que soit son état de santé, et même s’il est en bonne santé, et régulièrement actualisé. La commission recommande que le ministère de la santé formalise dès 2013 un modèle de document s’inspirant des exemples étrangers.
– En cas de maladie grave diagnostiquée, ou en cas d’intervention chirurgicale pouvant comporter un risque majeur, un autre document de volontés concernant spécifiquement les traitements de fin de vie, devrait être proposé en sus du premier, notamment dans le cadre d’un dialogue avec l’équipe médicale et soignante.
Ø Ce document est signé par le malade qui le souhaite (le malade a le droit en effet de vouloir rester dans l’ignorance de sa maladie ou de ne pas vouloir exprimer ses choix) et aussi par son médecin traitant.
Ø Ce document, engageant, et aisément identifiable par une couleur spécifique, doit être inséré dans le dossier du malade.
Ø À cette fin, la commission recommande qu’un décret soit édicté en 2013 et que le ministère de la santé là encore formalise un tel document en s’inspirant notamment du modèle des Etats-Unis.
– Créer un fichier national informatisé de ces deux documents, notamment facilement utilisable en situation d’urgence.
b) La formation
Demander à la conférence des doyens dès 2013 de :
– Créer dans chaque université une filière universitaire spécifiquement destinée aux soins palliatifs.
– Repenser en profondeur l’enseignement des études médicales afin que les attitudes curatives ne confisquent pas la totalité de l’enseignement :
Ø Rendre obligatoire un enseignement de soins palliatifs qui aborde en profondeur les différentes situations cliniques.
Ø Développer la formation au bon usage des opiacés et des médicaments sédatifs.
Ø Susciter un enseignement universitaire et en formation continue sur ce que l’on entend par « obstination déraisonnable ».
Ø Apporter tout au long de leur cursus une formation aux étudiants en médecine à l’exigence de la relation humaine dans les situations de fin de vie, grâce au concours des sciences humaines et sociales, et les amener à une réflexion sur les excès de la médicalisation.
Ø Rendre obligatoire pour les étudiants, généralistes et spécialistes principalement concernés par les maladies graves, un stage en soins palliatifs durant leur internat.
Pour les instituts de formation du personnel soignant, une démarche analogue doit être conduite.
– Pour la formation continue des médecins (Développement Professionnel Continu), exiger qu’un des programmes de formation annuelle suivi par un médecin en activité, au moins une fois tous les trois ans, porte sur les soins palliatifs et sur les attitudes à adopter face à une personne malade en fin de vie.
Pour la formation continue des soignants, une démarche analogue doit être conduite.
c) L’exercice professionnel
L’objectif des soins palliatifs est de prévenir et soulager la souffrance, de préserver le plus possible la qualité de la vie des malades et de leur entourage, indépendamment du stade de la maladie et des besoins thérapeutiques. De ce fait, les soins palliatifs s’érigent au moins autant en soins de support qu’en soins de fin de vie :
– Dès lors, introduire les soins palliatifs dès le premier jour de l’annonce ou de la découverte d’une maladie grave.
– Dès lors, introduire dès le début de la prise en charge du malade, dans les commissions interdisciplinaires de la cancérologie en particulier, la présence d’un spécialiste de soins palliatifs.
– Dès lors, inscrire dans les recommandations de bonnes pratiques élaborées par la haute autorité de santé (HAS), la prise en compte des soins de support et des soins palliatifs, avec le même degré d’exigence que pour les soins curatifs.
Dans le même esprit, demander à la HAS d’élaborer, pour les maladies chroniques les plus graves, des recommandations de parcours de soin et de santé prenant en compte les souhaits des personnes malades y compris en fin de vie et l’articulation des différentes compétences sanitaires, médico-sociales et sociales (en particulier les travailleurs sociaux) coordonnées par le médecin généraliste, assisté si nécessaire par un professionnel formé à cette fonction de coordination.
d) Les hôpitaux et les établissements médico-sociaux
– Demander à la HAS dès 2013 d’engager un travail avec les urgentistes sur leurs pratiques de réanimation afin d’éviter le plus possible de créer des situations de prolongation déraisonnable de la vie.
– Faire de la qualité de la prise en charge des personnes en fin de vie dans les établissements de santé et les établissements médico-sociaux, conformément aux recommandations de ce rapport, un élément obligatoire dans leur certification.
– Revoir avec les autorités compétentes le principe inadapté de la tarification à l’activité dont les conséquences sont en particulier désastreuses pour la culture palliative.
– Demander aux agences régionales de santé (ARS) dès 2013 de s’assurer que chaque établissement de santé ou médico-social puisse avoir accès directement ou indirectement à une équipe mobile de soins palliatifs. La commission recommande qu’un rapport du ministère de la santé puisse retracer ces éléments à la fin de l’année 2013.
– Développer l’épidémiologie de la fin de la vie par l’INSERM et l’Observatoire National de la Fin de Vie.
– Rendre obligatoire pour chaque établissement de santé ou médico-social la transmission de ces données épidémiologiques dans son rapport annuel d’activité.
e) Le domicile
– Demander à chaque ARS d’organiser une information sur leur site Internet permettant d’identifier et de donner une visibilité des différentes structures et compétences disponibles, auxquelles le malade et son entourage peuvent s’adresser, pour assurer la continuité des soins curatifs et de support 24h sur 24h jusqu’à la fin de vie à domicile.
– Demander aux ARS de s’assurer de la couverture du territoire en soins palliatifs à domicile 24h/24 et 7j/7, en application des recommandations de parcours de soins et de santé de la HAS citées plus haut.
– Permettre aux généralistes un accès libre à tous les médicaments sédatifs, sans lesquels il est illusoire d’envisager une prise en charge de la fin de vie à domicile.
– Inscrire dans les premières priorités des ARS le renforcement de la coordination entre l’hospitalisation à domicile (HAD), les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et soins palliatifs ; et demander aux pouvoirs publics d’engager une réflexion sur une fusion entre HAD et SSIAD, pour assurer une parfaite continuité dans toutes les phases de la prise en charge.
– Déconcentrer vers les ARS les aides nationales dans le secteur médico-social, afin qu’elles puissent contractualiser avec les collectivités territoriales concernées des programmes d’amélioration de la prise en charge des soins de support à domicile et dans les EPHAD.
f) L’accompagnement
Demander aux pouvoirs publics de :
– Renforcer les possibilités de congé de solidarité familiale adaptées aux situations.
– Soutenir les associations de bénévoles d’accompagnement de fin de vie, à l’intérieur des hôpitaux et à domicile, par exemple en facilitant les exonérations fiscales de leur donateur, et l’accès au service civique.
– Engager un travail visant à développer les « formules de répit » les mieux adaptées au maintien à domicile.
g) La néonatologie
La culture palliative pédiatrique, qui s’est installée plus tardivement que dans les structures d’adulte, a toujours bénéficié a contrario, en particulier chez les néonatologistes, d’une réflexion beaucoup plus attentive aux questions de fin de vie que chez l’adulte. Elle doit continuer de se développer au même titre que celle concernant l’adulte avec le renforcement des programmes de formation à cette fin et la mise en œuvre de réflexions sur l’obstination déraisonnable. Obstination qui n’est pas toujours le fait de la seule médecine.
Toute décision d’arrêt de traitement, voire d’arrêt des soins de supports vitaux, doit toujours être prise avec les parents et dans le cadre d’un échange collégial pluridisciplinaire. Le travail en équipe est toujours protecteur pour l’enfant, sa famille et le personnel soignant.
h) La décision d’un geste létal dans les phases ultimes de l’accompagnement en fin de vie
Lorsque la personne en situation de fin de vie, ou en fonction de ses directives anticipées figurant dans le dossier médical, demande expressément à interrompre tout traitement susceptible de prolonger sa vie, voire toute alimentation et hydratation, il serait cruel de la « laisser mourir » ou de la « laisser vivre », sans lui apporter la possibilité d’un geste accompli par un médecin, accélérant la survenue de la mort.
Il en va de même :
– Lorsqu’une telle demande est exprimée par les proches alors que la personne est inconsciente, et en l’absence de directives anticipées figurant dans le dossier médical, dont la commission continue de souligner l’importance. Cette demande doit nécessairement être soumise à une discussion collégiale afin de s’assurer qu’elle est en accord avec les souhaits réels de la personne.
– Lorsque le traitement en lui-même est jugé, après discussion collégiale avec le malade ou ses proches, comme une obstination déraisonnable, et que des soins de support n’auraient désormais pour objet qu’une survie artificielle.
Cette grave décision prise par un médecin engagé en conscience, toujours éclairée par une discussion collégiale, et présente dans le dossier médical, peut correspondre, aux yeux de la commission, aux circonstances réelles d’une sédation profonde telle qu’elle est inscrite dans la loi Leonetti.
Pour la commission, les critères qu’une loi voudrait imposer dans ce type de décision, ne pourront jamais contenir toute la complexité et la diversité du réel. Mais il paraît évident à la commission que dans l’esprit de la loi Leonetti, ce serait une sorte d’acharnement de « laisser mourir » ou de « laisser vivre » une personne, après arrêt de tout traitement et des soins de support.
Aux yeux de la commission, cette grave décision relève d’édictions de recommandations de bonnes pratiques d’une médecine responsable, plutôt que d’une nouvelle disposition législative.
******
La commission considère que ces propositions doivent mobiliser les pouvoirs publics et l’ensemble de la société de manière prioritaire.
Pour cette raison elle ne recommande pas de prendre de nouvelles dispositions législatives en urgence sur les situations de fin de vie.
Elle présente ici quelques réflexions sur des conduites non prévues par les lois actuelles.
3. Réflexions concernant des conduites non prévues par les lois relatives aux droits des malades en fin de vie
a) L’assistance au suicide
Pour la commission, l’assistance au suicide ne peut en aucun cas être une solution proposée comme une alternative à l’absence constatée de soins palliatifs ou d’un réel accompagnement.
Mais pour certaines personnes atteintes d’une maladie évolutive et incurable au stade terminal, la perspective d’être obligé de vivre, jusqu’au terme ultime, leur fin de vie dans un environnement médicalisé, où la perte d’autonomie, la douleur et la souffrance ne peuvent être soulagés que par des soins palliatifs, peut apparaître insupportable. D’où leur souhait d’interrompre leur existence avant son terme. Leur demande est celle d’une assistance au suicide, sous la forme de médicaments prescrits par un médecin.
Ces demandes, qui sont très rares quand existe réellement une possibilité d’accompagnement sous forme de soins palliatifs, peuvent correspondre davantage à une volonté de pouvoir disposer d’un recours ultime qu’à une réelle décision d’interrompre sa vie avant terme. En effet, dans l’Etat d’Oregon, aux Etats-Unis, où le suicide assisté concerne deux décès pour mille, la moitié des personnes en fin de vie qui demandent – et obtiennent – les médicaments leur permettant de se suicider, ne les utilisent pas.
Si le législateur prend la responsabilité de légiférer sur l’assistance au suicide, les éléments suivants devraient être pris en compte :
– S’assurer que la personne demande de manière explicite et répétée sa volonté de finir sa vie par une telle assistance.
– Reconnaître par une collégialité médicale l’existence de la situation en fin de vie de la personne malade.
– S’assurer que la décision de la personne en fin de vie, sera prise :
Ø dans la mesure où celle-ci est en capacité d’un geste autonome.
Ø dans la mesure où celle-ci est informée, libre dans son choix.
Ø dans la mesure où celle-ci a un réel accès à toutes les solutions alternatives d’accompagnement et de soulagement de la douleur physique et psychique.
Ø dans la mesure où celle-ci est informée des conditions concrètes du suicide assisté.
Ø dans le cadre d’un échange collégial pluridisciplinaire associant le malade, ses proches, le médecin traitant, un médecin non engagé dans les traitements en cours, et un soignant accompagnant le malade.
– Requérir la présence du médecin traitant, ou en cas d’objection de conscience de ce dernier, du médecin prescripteur, lors du geste et de l’agonie.
– Garantir l’objection de conscience des pharmaciens.
– S’assurer que les médicaments utilisés satisfont aux exigences de la réglementation et de la sécurité sanitaires et pharmacologiques.
– S’assurer de l’absence d’un calendrier préétabli de l’accomplissement du geste.
– S’assurer d’une remontée d’informations (nature de la maladie, motifs de la décision, déroulement du geste) transmis par le médecin à une structure nationale chargée de faire un rapport annuel retraçant l’ensemble des remontées d’information.
En aucun cas, l’administration par un tiers d’une substance létale à une personne ne peut être considérée comme une assistance au suicide, quelles que soient les directives anticipées et même si une personne de confiance a été désignée. Elle serait alors une euthanasie active.
Et lorsque la demande émane d’une personne consciente mais incapable d’accomplir elle-même de quelque manière que ce soit le geste de suicide assisté, la loi ne pourrait pas, par définition, être mise en oeuvre. Mais la médecine ne peut se considérer comme quitte et doit envisager à la demande de la personne un arrêt des soins de supports vitaux accompagné d’une sédation.
b) L’euthanasie
Le geste euthanasique à la demande des personnes malades, tel qu’il est à ce jour autorisé dans le seul Benelux, est un acte médical qui, par sa radicalité dans son accomplissement, et par sa programmation précise dans le temps, interrompt soudainement et prématurément la vie.
Il diffère totalement de la décision évoquée au point précédent.
Il diffère également totalement d’une assistance au suicide où l’acte létal est accompli par la personne malade elle-même.
L’euthanasie engage profondément l’idée qu’une société se fait des missions de la médecine, faisant basculer celle-ci du devoir universel d’humanité de soins et d’accompagnement à une action si contestée d’un point de vue universel. La commission ne voit pas comment une disposition législative claire en faveur de l’euthanasie, prise au nom de l’individualisme, pourrait éviter ce basculement.
Elle rappelle au demeurant que tout déplacement d’un interdit crée d’autres situations limites, toujours imprévues initialement et susceptibles de demandes réitérées de nouvelles lois. À titre d’exemple, en Belgique, 25 projets d’extension des cas de figure prévus par la loi ont été proposés depuis 2002.
*
Ø Pr Didier Sicard, ancien président du Comité consultatif national d’éthique, chargé par le président de la République d’une mission de réflexion sur la fin de vie
Ø Observatoire national de la fin de vie – Pr Régis Aubry, président
Ø Conseil national de l’Ordre des médecins – Dr Michel Legmann, président, Dr Walter Vorhauer, secrétaire général, et Dr Pierrick Cressard, conseiller national, président de la section Éthique et Déontologie